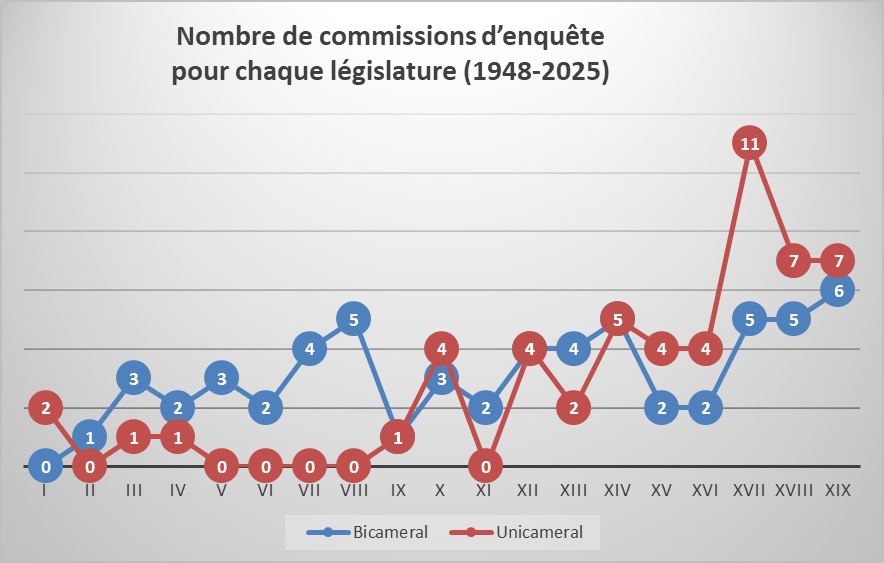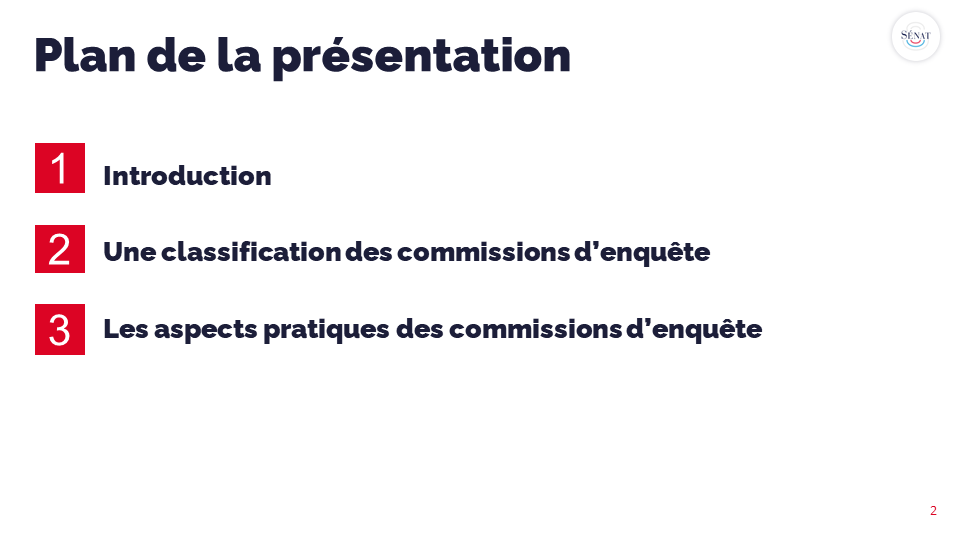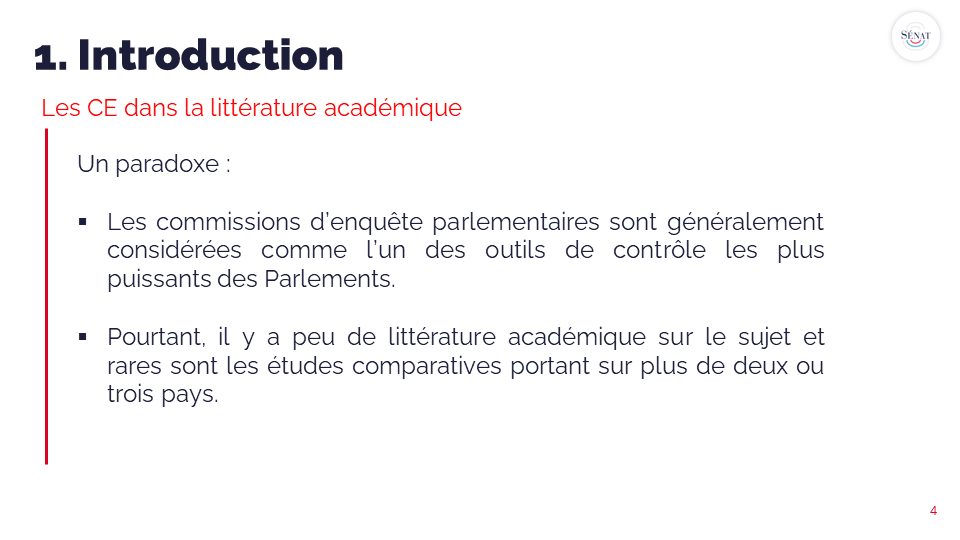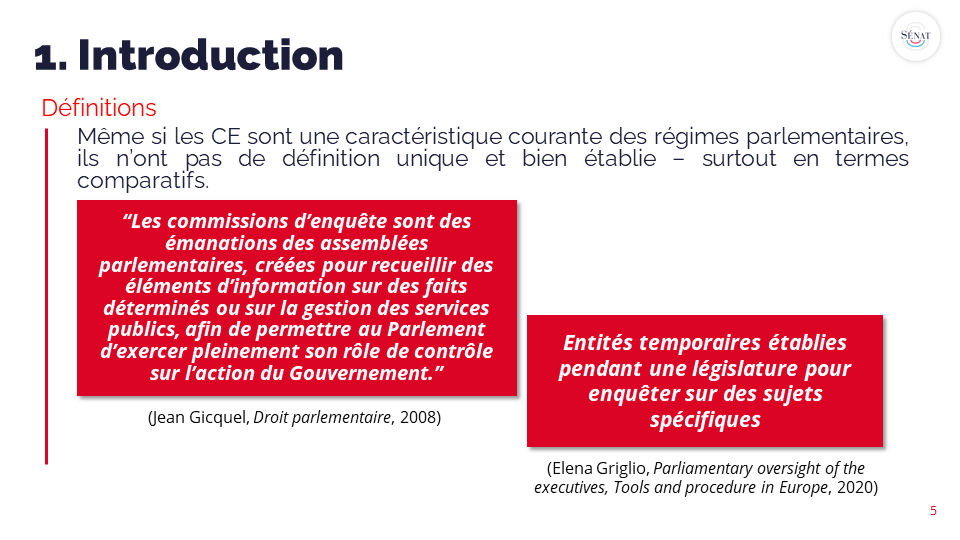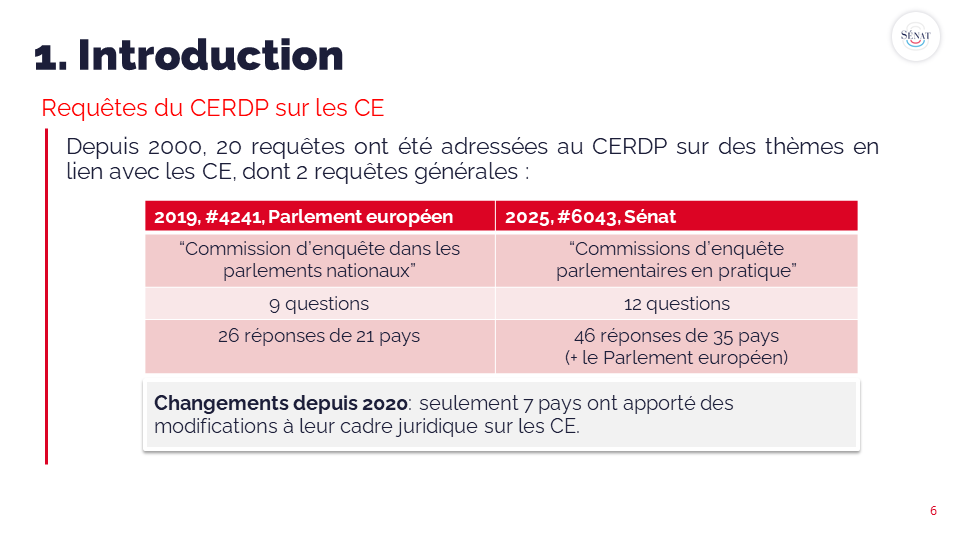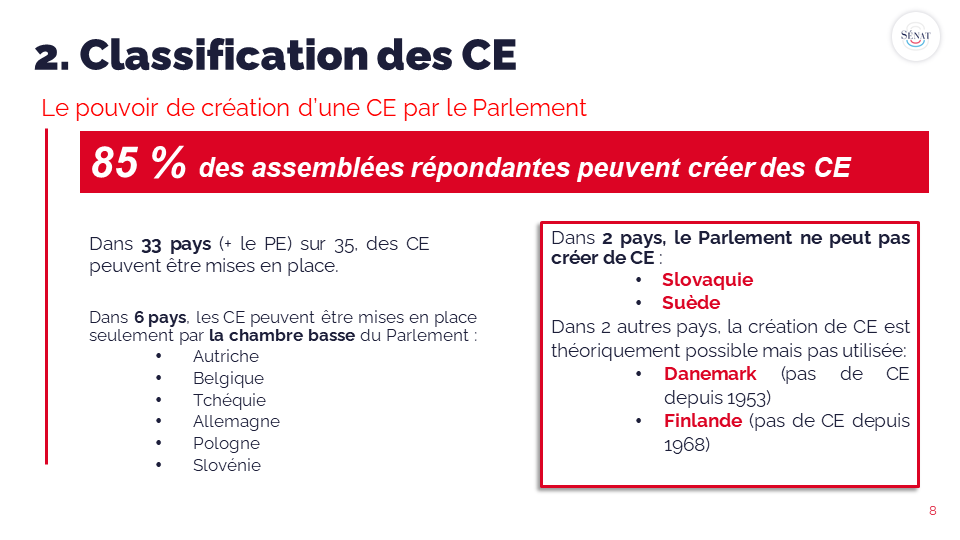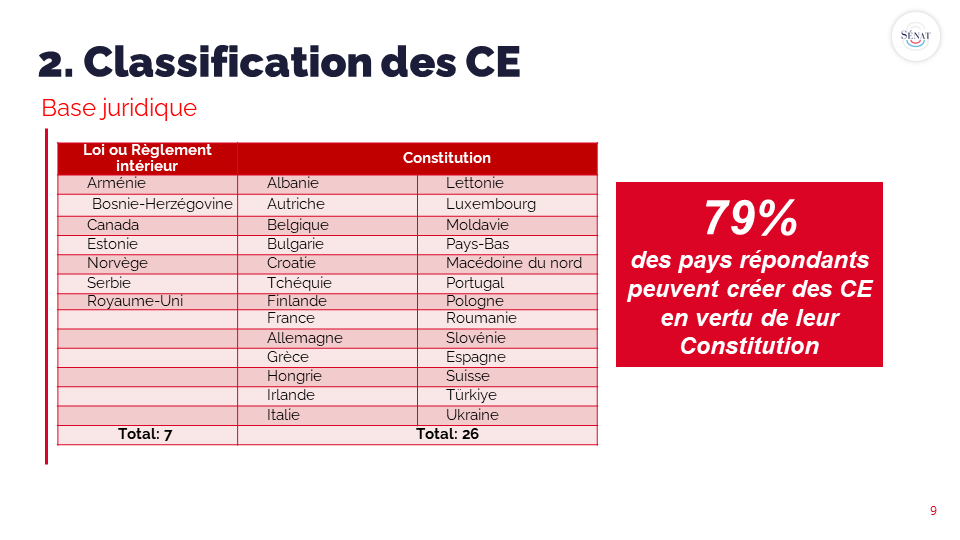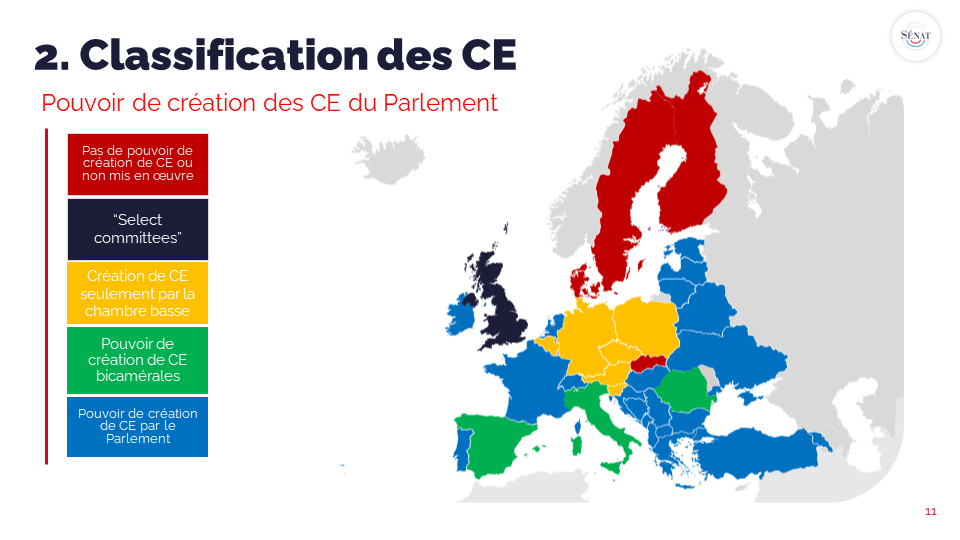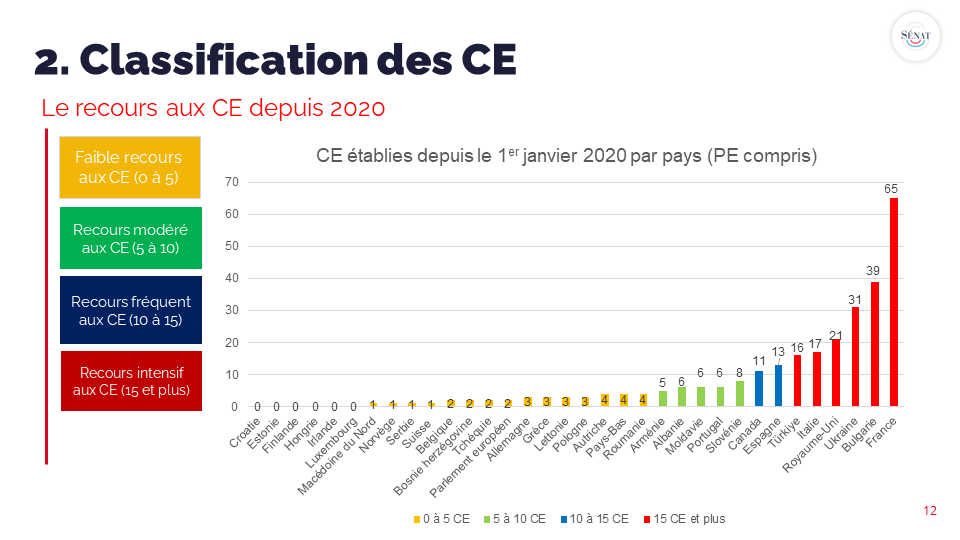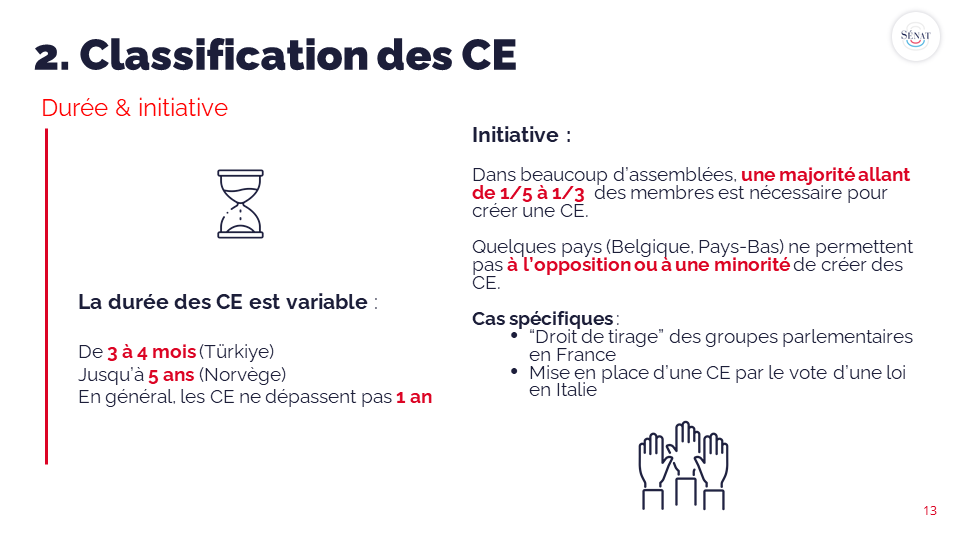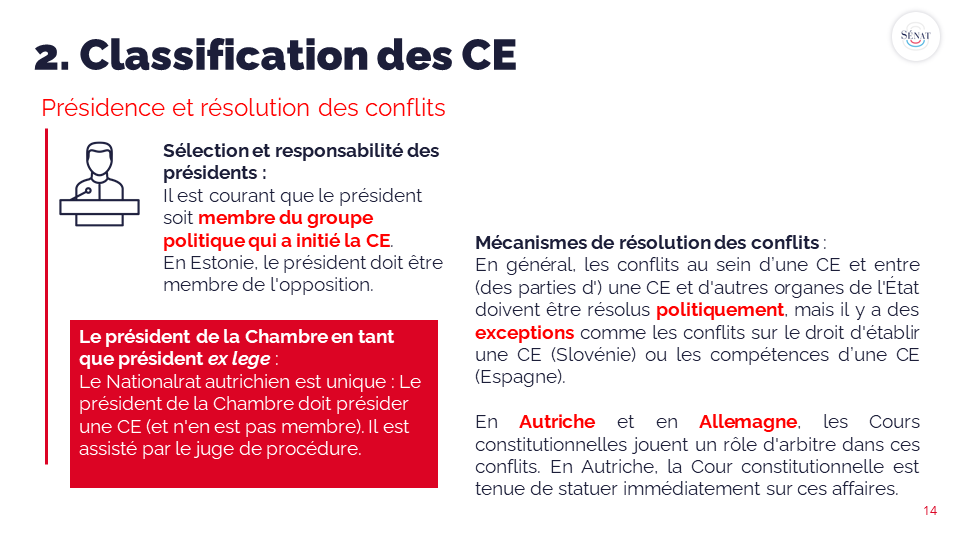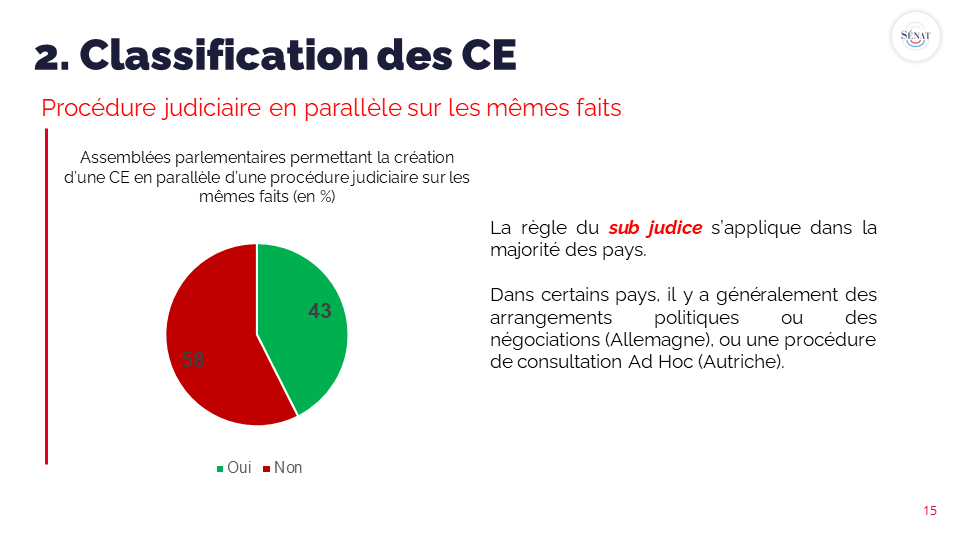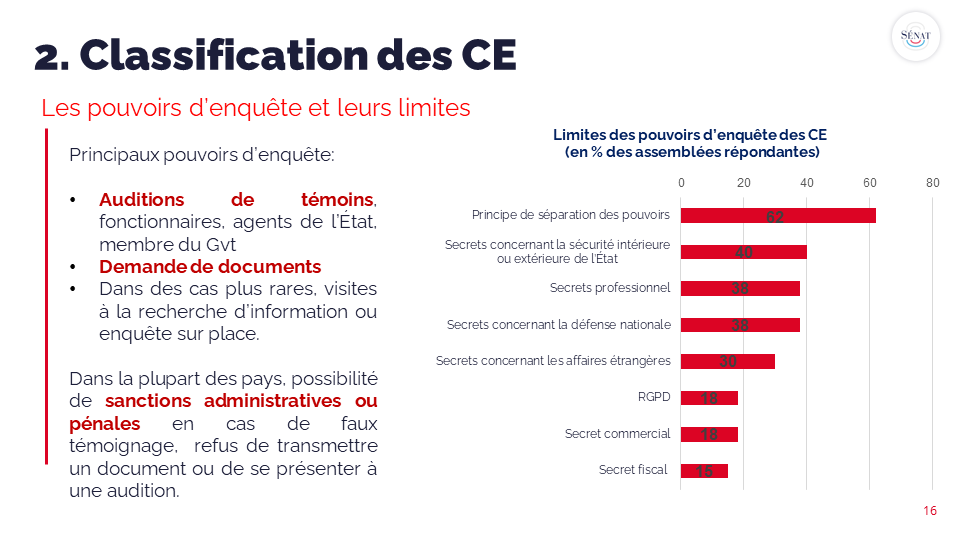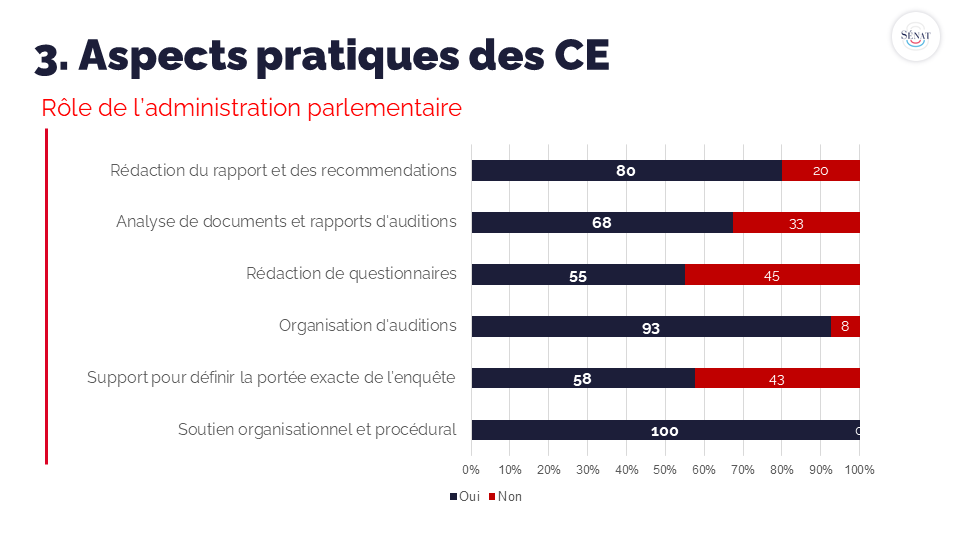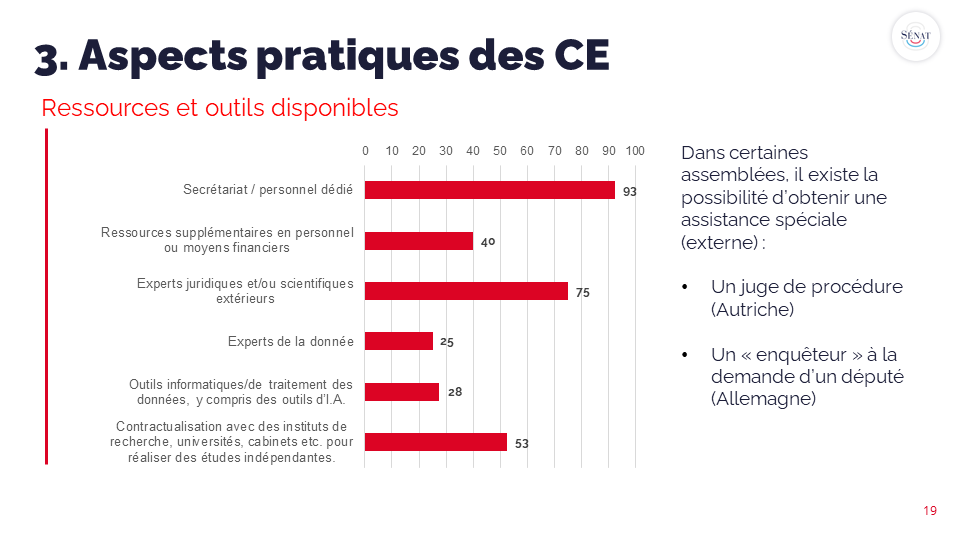- A. AVANT-PROPOS
- B. PROPOS INTRODUCTIF
- C. SESSION D'OUVERTURE : VUE D'ENSEMBLE DES
COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES DANS LES PARLEMENTS MEMBRES DU CERDP
- D. SESSION 1 - LES COMMISSIONS
D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES COMME OUTIL DE CONTRÔLE DE
L'EXÉCUTIF
- 1. Les obstacles juridiques à la conduite
d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN
(Houses of the Oireachtas - Irlande)
- 2. Les commissions d'enquête
bicamérales et le rôle du Sénat italien, M. Luigi
GIANNITI (Senato della Repubblica - Italie)
- 3. Les commissions d'enquête parlementaires
et le droit de tirage au Sénat français, M. Jean-Pascal
PICY, conseiller hors classe à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées
(Sénat - France)
- 4. Séance de
Questions - Réponses
- 1. Les obstacles juridiques à la conduite
d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN
(Houses of the Oireachtas - Irlande)
- E. SESSION 2 - POUVOIRS,
MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVESTIGATION
- 1. Les ressources des commissions d'enquête
parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des
informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)
- 2. Les limites juridiques et pratiques aux pouvoirs
d'enquête, Mme Rita NOBRE (Assembleia da
Republica - Portugal)
- 3. La pratique des commissions d'enquête
parlementaires à la Chambre des représentants des Pays-Bas, MM.
Rob DE BAKKER et Martijn VAN HAEFTEN (Tweede Kamer - Pays-Bas)
- 4. Séance de
Questions - Réponses
- 1. Les ressources des commissions d'enquête
parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des
informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)
- F. SESSION 3 - COLLABORATION ET
CONFLITS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS, Y COMPRIS LE POUVOIR JUDICIAIRE
- 1. La procédure de consultation au Conseil
national autrichien - Un mécanisme visant à garantir la
prise en considération des activités des autorités
chargées des poursuites, M. Alexander FIEBER
(Nationalrat - Autriche)
- 2. Le rôle des commissions d'enquête
parlementaires dans les poursuites engagées contre les membres du
gouvernement, Mme Konstantina - Styliani GAVATHA
(Voulí ton Ellínon - Grèce)
- 3. L'immunité parlementaire des
témoins, Mme Rhiannon WILLIAMS (House of
Lords - Royaume-Uni)
- 4. Séance de
Questions - Réponses
- 1. La procédure de consultation au Conseil
national autrichien - Un mécanisme visant à garantir la
prise en considération des activités des autorités
chargées des poursuites, M. Alexander FIEBER
(Nationalrat - Autriche)
- G. CONCLUSIONS
- H. PANORAMA DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE
PARLEMENTAIRES
A. AVANT-PROPOS
Créé en 1977, le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP)1(*) réunit 63 assemblées parlementaires de 50 États, ainsi que le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Le Sénat participe activement à ses travaux par l'intermédiaire de la division de la Législation comparée2(*) qui fait partie de la direction de l'Initiative parlementaire et des Délégations, dont deux fonctionnaires sont les correspondants du Sénat pour le CERDP.
L'organisation du CERDP s'articule autour de cinq pôles : « Pratiques et procédures parlementaires », « Bibliothèques, recherche et archives parlementaires », « Technologies de l'information et de la communication dans les parlements », « Affaires économiques et budgétaires » et « Échanges relatifs au règlement général sur la protection des données ».
Chaque automne, le CERDP réunit l'ensemble des correspondants de ses assemblées membres. Les pôles organisent en outre régulièrement des séminaires thématiques réunissant les spécialistes identifiés au sein des services parlementaires.
Le thème des commissions d'enquête parlementaires suscite depuis plusieurs années un intérêt institutionnel soutenu. Dans ce cadre, et sous l'égide du pôle « Pratiques et procédures parlementaires », le Sénat a accueilli les 12 et 13 juin 2025 un séminaire consacré à ce sujet.
Le présent document en rassemble les actes.
B. PROPOS INTRODUCTIF
1. Mme Sylvie VERMEILLET, Vice-présidente du Sénat en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur
Monsieur le Secrétaire général du Sénat,
Mesdames, messieurs,
Chers membres du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP),
En ma qualité de vice-présidente du Sénat, présidente de la délégation du Bureau en charge du travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat de sénateur, je vous souhaite la bienvenue au Sénat français. Vous êtes aujourd'hui près de 60 fonctionnaires et employés de 30 parlements, provenant de 29 pays ainsi que du Parlement européen - venus participer à ce séminaire thématique sur les commissions d'enquête parlementaires.
Je me réjouis à plusieurs titres d'accueillir cet événement au sein de notre institution :
- premièrement, il s'inscrit pleinement dans l'action du Sénat en faveur de la coopération interparlementaire. Bien qu'il ne soit pas encore suffisamment connu, le réseau du CERDP apporte une contribution essentielle à la coopération des différents parlements en matière de recherche et de documentation. Il nous permet d'échanger plus efficacement des informations, mais aussi des idées et des expériences sur des sujets d'intérêt commun. À titre d'exemple, on peut citer le rôle essentiel qu'a joué le réseau pour faciliter l'échange rapide d'informations sur les mesures mises en place par les parlements durant la pandémie de Covid-19 ou, plus récemment, le partage d'informations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les assemblées parlementaires.
Le Sénat n'avait pas accueilli d'événement du CERDP depuis la conférence annuelle de 2016, qui avait été coorganisée avec l'Assemblée nationale. Avec ce séminaire, nous venons confirmer notre pleine implication dans ce réseau, ce dont je me réjouis ;
- deuxièmement, ce séminaire manifeste l'attention que porte notre institution au droit comparé. Le Sénat dispose en effet depuis 1995 d'une division de la législation comparée, placée au sein d'une direction ad hoc, qui exerce également les fonctions de « correspondant » du CERDP. Ce service produit de nombreuses études de droit comparé, en particulier dans le cadre des travaux de contrôle parlementaire et à la demande des commissions d'enquête. Une fois adoptées, ces études, je le souligne, sont toutes publiques et largement accessibles sur le site internet institutionnel du Sénat. Le fait de disposer de cette expertise en interne est précieux pour éclairer nos travaux. Parfois, les solutions juridiques développées à l'étranger peuvent aussi être une inspiration pour de futures propositions de réforme, voire des initiatives législatives ;
- troisièmement, le thème de ce séminaire - les commissions d'enquête - revêt une importance particulière pour le Sénat. Notre Haute Assemblée joue un rôle essentiel de contre-pouvoir et l'exercice de cette fonction de contrôle passe souvent par le vecteur des commissions d'enquête. Depuis l'inscription des commissions d'enquête dans la Constitution en 2008, puis la consécration par le règlement du Sénat du « droit de tirage » annuel des groupes politiques, le Sénat a créé plus de 40 commissions d'enquête, chiffre historiquement élevé et probablement sans équivalent dans la plupart de vos parlements. Cela sans compter les cas où des prérogatives de commission d'enquête ont été accordées à des commissions permanentes. En ce moment même, cinq commissions d'enquête sont en cours au Sénat et vont très prochainement achever leurs travaux.
Les commissions d'enquête occupent ainsi une part non négligeable de l'activité des sénateurs et de l'administration qui nous épaule dans nos travaux.
Pour ma part, sans préjudice de mes différentes responsabilités au sein du Bureau, de mon groupe parlementaire, de la commission des finances ou de la délégation à la prospective, je suis actuellement membre du Bureau de la commission d'enquête sur la délinquance financière, créée à l'initiative du groupe Union centriste, auquel j'appartiens. L'objectif de cette commission d'enquête est d'approfondir les travaux préexistants du Sénat sur ce sujet. Ceci nous est apparu nécessaire au regard de l'emprise de la criminalité organisée aujourd'hui en France et de l'ampleur des masses financières liées aux activités criminelles.
En 2020, j'ai aussi été co-rapporteure de la commission d'enquête sur la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire du Covid-19. Cette commission d'enquête avait été créée à la demande du président du Sénat, M. Gérard Larcher. En l'espace de quelques mois et dans les conditions sanitaires difficiles que nous nous rappelons tous, nous avons mené 47 auditions, entendu plus de 130 personnes, demandé communication de centaines de documents et consulté de nombreuses archives. Ces travaux ont donné lieu à l'adoption en décembre 2020 d'un rapport de 500 pages qui analyse minutieusement l'état de préparation de la France à la veille du déclenchement de l'épidémie et la gestion de la crise sanitaire par les responsables politiques et administratifs.
Nos conclusions étaient sans appel : à l'instar de beaucoup de pays européens, la France n'était pas prête face à une telle pandémie. Cependant, la triste saga de la pénurie de masques restera le symbole d'une impréparation lourde de conséquences dans la lutte initiale contre le virus, qui a alimenté le désarroi, voire la colère des soignants et de beaucoup de nos concitoyens. Sur ce point en particulier, les travaux de la commission d'enquête ont montré que la disparition du stock stratégique de masques de protection, dans les années 2010, résultait d'un choix délibéré de l'administration de ne pas renouveler ce stock. De plus, cette pénurie avait été sciemment dissimulée au début de l'épidémie.
S'appuyant sur un ensemble de preuves et des arguments étayés, notre commission d'enquête a ainsi permis d'apporter une information fiable à nos concitoyens et a eu un impact important dans l'opinion publique car ses conclusions très largement partagées par tous les groupes politiques ont connu un remarquable écho médiatique.
Elle a également ouvert des perspectives pour l'avenir en formulant toute une série de préconisations sur la gestion des stocks stratégiques et la gouvernance sanitaire, pour une meilleure coordination entre l'État et les territoires. Près de cinq ans après ces conclusions, qu'en est-il ? Une partie des recommandations formulées a été prise en compte mais force est de constater que le suivi de la mise en oeuvre de ces recommandations - qui peut s'inscrire dans un temps très long - demeure un défi. Je sais combien vous êtes attachés au suivi dans le temps de ces recommandations et espère donc que, de vos échanges, surgiront des propositions en ce sens.
L'épidémie de coronavirus est fort heureusement passée mais les commissions d'enquête parlementaires demeurent au coeur de l'actualité. En particulier en France, plusieurs commissions d'enquête ont fait l'objet d'une intense couverture médiatique ces derniers mois, comme la commission sénatoriale sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille ou encore, à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, qui a entendu le Premier ministre, M. François Bayrou. L'époque où, selon les propos attribués à Georges Clemenceau, on considérait « qu'en politique, la meilleure façon d'enterrer une affaire, c'est de créer une commission d'enquête » est donc révolue. Il faut s'en féliciter.
Cependant, des critiques, voire des polémiques émergent : pour certains commentateurs ou responsables politiques, les commissions d'enquête seraient devenues trop nombreuses ; d'autres feignent de s'offusquer par voie de presse - avec d'inévitables arrière-pensées - du « piège » que seraient devenues les commissions d'enquête parlementaires pour les dirigeants d'entreprises. Par ailleurs, certaines personnalités ont récemment refusé de se présenter en audition devant des commissions d'enquête alors même qu'elles sont tenues par la loi organique de déférer à la convocation qui leur est délivrée.
Cette situation est regrettable car la commission d'enquête parlementaire est l'un des principaux moyens de contrôle de l'action du Gouvernement. Cet instrument doit être mis au service du contrôle démocratique. Je pense que le meilleur moyen de couper court à ces polémiques est de continuer à faire preuve, plus que jamais, de sérieux et de rigueur dans nos travaux, et ce dans un esprit transpartisan, dépassant les clivages politiques. Pour citer à nouveau mon expérience au sein de la commission d'enquête sur la pandémie de Covid-19, j'y exerçais les fonctions de rapporteur avec deux autres collègues issus d'autres groupes politiques. Ceci nous a permis d'établir des constats partagés et de dégager des conclusions consensuelles. Je crois que cela fait partie de notre « marque de fabrique » au Sénat.
À la lumière de cette actualité, je souhaite donc souligner en conclusion l'utilité de vos échanges à venir sur les cadres juridiques et les pratiques des commissions d'enquête parlementaires dans vos pays respectifs. Il est vrai que nos institutions évoluent dans des cadres constitutionnels très différents mais les commissions d'enquête sont un instrument de contrôle largement répandu. Vos discussions contribueront sans doute à éclairer nos propres manières de faire et d'identifier de bonnes pratiques utiles à tous qui, j'en forme le voeu, pourront éclairer la prochaine « fournée » des commissions d'enquête issues des droits de tirage de l'automne prochain.
Avant de laisser la parole à M. le Secrétaire général du Sénat, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre participation et vous souhaite à toutes et tous un excellent séminaire.
2. M. Éric TAVERNIER, Secrétaire général du Sénat
Madame la Présidente,
Mesdames, messieurs,
Chers et Chères collègues,
Je vous remercie d'être si nombreux à avoir répondu positivement à notre invitation. Je tiens notamment à saluer la présence de deux collègues de la Rada d'Ukraine, avec laquelle le Sénat entretient une coopération active. Je remercie également le secrétariat du CERDP, ainsi que le coordonnateur du domaine « procédure et pratiques parlementaires », M. Christoph Konrath, pour le soutien qu'ils ont apportés à l'organisation de ce séminaire.
Madame la présidente, vous avez souligné à juste titre l'utilité du réseau du CERDP pour la coopération interparlementaire et le partage d'informations. J'ajouterai que ceci est tout particulièrement le cas en matière de droit et de procédure parlementaires car c'est un domaine où il existe peu de littérature académique et d'informations publiques avec une dimension comparatiste. L'échange direct d'informations entre praticiens est donc essentiel et je souhaite qu'il permette aussi de nourrir nos échanges avec les milieux universitaires auxquels je suis personnellement et fonctionnellement très attentif et que je m'attache à développer. C'est la raison d'être de la réunion de ce jour.
Vous avez aussi évoqué, Madame la présidente, l'actualité des commissions d'enquête parlementaires et leur importance pour le Sénat. À cet égard, permettez-moi un bref retour historique, alors même que nous fêtons cette année le 150e anniversaire du Sénat républicain. Le Sénat a en effet contribué très substantiellement au développement des commissions d'enquête en France, a fortiori durant la Ve République.
On retrouve les traces des premières commissions d'enquête en France dès le début de l'installation d'un régime parlementaire. Après la grande Révolution française, puis un épisode napoléonien n'ayant pas brillé par son libéralisme et, enfin, après le retour des Bourbons, c'est en 1832, sous la monarchie de Juillet, que la Chambre des députés s'est arrogée, sans fondement textuel, un « droit d'enquête » explicite et, par là même, a créé une commission d'enquête sur le déficit du caissier central Kessner. Certains historiens voient aussi dans les procès de la Chambre des Pairs - l'ancêtre du Sénat - lorsqu'elle était constituée en Haute Cour, une forme d'enquête parlementaire émerger, notamment lors du procès des anciens ministres de Charles X en 1832. Sur la base de cette création coutumière, les commissions d'enquête se sont ensuite multipliées sous la Troisième République : de 1876 à 1878, le Sénat crée notamment une commission d'enquête sur les « chemins de fer et les souffrances du commerce » ou encore, en 1886, une autre sur la consommation d'alcool.
Il faudra néanmoins attendre la veille de la Première Guerre Mondiale pour que la loi dite « loi Rochette » [loi du 25 mars 1914] - consécutive au scandale financier du même nom - donne un fondement législatif aux pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête de la Chambre des Députés et du Sénat.
La IVe République poursuit les règles et usages du régime précédent en matière de commissions d'enquête. Le Conseil de la République - nom donné à l'époque à la Chambre haute - introduit le droit d'enquête dans son règlement en 1947 et crée notamment des commissions d'enquête sur la situation économique des territoires d'Outre-mer (1952) ou encore sur le scandale du vin (1949) afin de « vérifier » les conclusions du rapport de l'Assemblée nationale sur le sujet.
Cependant, la Constitution de 1958, dans la droite continuité des conceptions institutionnelles du Général de Gaulle, marque la volonté de rompre avec les « excès » des commissions d'enquête parlementaires des régimes précédents. Dans les premiers temps de la Ve République, les commissions d'enquête parlementaires ont des pouvoirs strictement encadrés : les personnes convoquées n'ont pas l'obligation juridique de se présenter devant une commission d'enquête, les auditions sont secrètes et le rapport n'est pas publié (sauf si l'assemblée l'autorise par un vote). Le Sénat, où le parti gaulliste n'est alors pas majoritaire, lance cependant des commissions d'enquête sur des sujets brûlants : en 1961, sur les événements d'Algérie, puis sur les « événements de mai 1968 ».
Mais en l'absence de pouvoirs d'enquête contraignants, leurs résultats sont maigres. Ainsi, en 1967, la commission d'enquête du Sénat sur l'Office de radio-télévision française (ORTF) se voit refuser l'audition de toute une série de directeurs. Les agents de l'ORTF sont même menacés de sanctions par leur directeur général s'ils répondent à des questions posées par les membres de la commission.
C'est à l'initiative du Sénat qu'une proposition de loi est adoptée en 1977 pour étendre les prérogatives des commissions d'enquête parlementaires : leur durée maximale est portée de quatre à six mois, un droit d'enquête sur pièces et sur place des rapporteurs est créé et le principe de la publicité du rapport affirmé. Cette même loi crée également une obligation de déférer devant les commissions d'enquête, sous serment, à peine de poursuites pénales. Puis, en 1991, la publicité des auditions est autorisée.
La réforme constitutionnelle de 2008 marque enfin la consécration des commissions d'enquête : afin de revaloriser le rôle du Parlement, elle inscrit dans la Constitution la possibilité de « créer au sein de chaque assemblée, des commissions d'enquête pour recueillir des éléments d'information, dans les conditions fixées par la loi ». Le Sénat fait depuis pleinement usage de ce « droit de tirage » comme l'ont illustré notamment, en 2018, la commission d'enquête sur l'affaire dite « Benalla » - portant sur les agissements d'un chargé de mission à la présidence de la République - et la commission d'enquête sur le recours aux cabinets de conseil, en 2022. Faut-il y voir, comme le souligne le professeur Jean-Éric Gicquel dans sa note parue au Dictionnaire encyclopédique du Parlement, la conséquence du « désalignement possible » du Sénat par rapport au bloc majoritaire ?
Le Sénat n'hésite donc pas à défendre ce droit d'enquête lorsqu'il est fragilisé : à plusieurs reprises, et dernièrement en mai 2025 concernant un responsable de Nestlé Waters, le Bureau du Sénat a saisi le Parquet pour faux témoignage. Bien que ces signalements soient souvent classés sans suite, une condamnation à 20 000 euros d'amende pour faux témoignage a été prononcée en appel par la justice en 2018, à l'encontre d'un médecin qui avait caché ses liens avec l'entreprise Total lorsqu'il avait été entendu par la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Il était en conflit d'intérêt avéré.
Il est ainsi frappant de constater que plus de 200 ans après les premières commissions d'enquête, les pouvoirs d'investigation demeurent essentiellement les mêmes. Dans son Traité de droit politique, électoral et parlementaire édité pour la première fois en 1878, Eugène Pierre cite parmi les pouvoirs des « enquêtes parlementaires » le droit de convoquer des témoins, de requérir des documents et de procéder à des auditions. Les méthodes et les techniques d'enquête se sont toutefois perfectionnées. De plus, avec le développement des technologies numériques, des réseaux sociaux et désormais de l'intelligence artificielle, l'usage de ces pouvoirs d'enquête ne sera-t-il pas amené à évoluer ?
L'un des objectifs de ce séminaire est justement de nourrir les réflexions sur l'évolution en cours et future de nos techniques et moyens d'enquête. Il s'agit aussi de confronter nos cadres juridiques respectifs à l'expérience concrète des commissions d'enquête et de nous réinterroger sur nos procédures. D'où le choix que nous avons fait d'orienter résolument ce séminaire sur la « pratique des commissions d'enquête parlementaires », en espérant vivement pouvoir les améliorer davantage encore, dès l'automne 2025, comme l'évoquait la présidente Vermeillet à l'instant.
Après la session introductive de ce jour qui vous donnera un aperçu des différents modèles de commission d'enquête, la journée de demain sera organisée autour de quatre thèmes :
- la première session traitera des commissions d'enquête en tant qu'outil de contrôle du pouvoir exécutif, en intégrant une réflexion sur les équilibres entre majorité et opposition et sur le rôle des Chambres hautes ;
- la deuxième session sera consacrée aux pouvoirs, méthodes et techniques d'enquête ;
- la troisième session portera sur la collaboration et les conflits entre les commissions d'enquête et les autres institutions, notamment le pouvoir judiciaire ;
- enfin, la question des résultats et des suites données aux commissions d'enquête fera l'objet de groupes de discussions, lors desquels vous pourrez échanger sur les bonnes pratiques en matière de suivi des recommandations et de communication.
Des intervenants de neuf assemblées parlementaires différentes se succéderont pour partager leur expérience et leur expertise sur ces différents sujets. Je les en remercie chaleureusement. Je ne doute pas que ces exposés nourriront des discussions passionnantes et j'en lirai avec grand intérêt les comptes rendus.
Très bon séminaire ; je vous souhaite des échanges aussi riches que stimulants.
C. SESSION D'OUVERTURE : VUE D'ENSEMBLE DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES DANS LES PARLEMENTS MEMBRES DU CERDP
Lors de la session d'ouverture, Mme Anne-Céline DIDIER, responsable de la division de la Législation comparée et correspondante CERDP (Sénat - France) et M. Christoph KONRATH, coordonnateur du domaine d'intérêt Procédure et pratique parlementaire du CERDP (Nationalrat - Autriche) ont présenté les différents modèles et cadres juridiques des commissions d'enquête parlementaires parmi les Parlements membres du CERDP.
Introduction
À titre préliminaire, un paradoxe mérite d'être souligné : bien que les commissions d'enquête parlementaires soient largement répandues et reconnues comme l'un des instruments les plus puissants du contrôle parlementaire sur l'exécutif, la littérature qui leur est consacrée demeure relativement limitée, en particulier dans une perspective comparatiste. Lorsqu'elle existe, cette littérature porte le plus souvent sur deux ou trois parlements seulement, sans proposer de vision plus générale. Ce constat appelle une tentative de définition du concept de commission d'enquête parlementaire. Or, il n'existe pas de définition unique qui s'impose de manière transversale à l'ensemble des parlements.
Dans son ouvrage de droit parlementaire, le constitutionnaliste Jean-Éric Gicquel définit les commissions d'enquête parlementaires comme des émanations des assemblées, instituées en vue de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics, afin de permettre au Parlement d'exercer pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale.
A contrario, dans une perspective comparatiste, Elena Griglio, fonctionnaire du Sénat italien, propose dans son ouvrage sur le contrôle parlementaire une définition plus large des commissions d'enquête, qu'elle qualifie d'organes temporaires institués au sein d'une législature afin d'enquêter sur des faits spécifiques.
En règle générale, le champ couvert par les commissions d'enquête apparaît très étendu. Dans les sources analysées, la notion la plus fréquemment mentionnée est celle d'un « sujet d'intérêt public ». La commission doit en principe porter sur un sujet d'intérêt général, mais cette exigence est rarement définie de manière précise, ce qui contribue à élargir sensiblement le périmètre des enquêtes possibles.
Pour préparer cette introduction conceptuelle, nous nous sommes principalement appuyés sur les réponses aux questionnaires diffusés par le CERDP. Depuis les années 2000, une vingtaine de requêtes adressées à ce réseau ont porté, directement ou indirectement, sur les commissions d'enquête, le plus souvent à propos de questions procédurales spécifiques, telles que l'audition des témoins. Parmi elles, seule une requête d'envergure - émise par le Parlement européen - a permis de dresser un panorama général, qui a ensuite donné lieu à une étude. Celle-ci comportait neuf questions et a recueilli 26 réponses provenant de 21 pays. Sur cette base, nous avons adressé à notre tour aux membres du CERDP, une requête comportant douze questions, en partie destinées à actualiser les données existantes. Nous avons reçu 46 réponses émanant de 35 pays, plus le Parlement européen. Les réponses issues de l'étude précédente ont été intégrées à notre analyse. Sur le plan juridique, il convient de noter que seuls sept pays ont modifié leur cadre juridique relatif aux commissions d'enquête depuis 2020.
Panorama général et tentative de classification
Le pouvoir de création d'une commission d'enquête est, dans une large majorité des cas, reconnu aux assemblées parlementaires. Ainsi, dans le cadre de notre étude, 85 % des assemblées ayant répondu au questionnaire ont indiqué disposer de cette prérogative, soit 33 pays, auxquels s'ajoute le Parlement européen. Dans certains systèmes parlementaires, une distinction est toutefois opérée entre les deux chambres. Dans six pays - notamment l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la Pologne et la Slovénie - seule la chambre basse est habilitée à instituer une commission d'enquête.
À cela s'ajoutent deux cas particuliers : la Slovaquie et la Suède, où les parlements ne disposent pas de la faculté de créer de telles commissions d'enquête. On observe également des situations intermédiaires dans certains pays où, bien que la création de commissions d'enquête soit juridiquement possible, elle n'est pas mise en oeuvre en pratique. Le Danemark et la Finlande en offrent deux exemples. Dans les réponses fournies tant à la requête du Parlement européen qu'à celle du Sénat français, le Danemark a indiqué que cette possibilité existe sur le plan constitutionnel, mais qu'aucune commission d'enquête parlementaire n'a été créée depuis 1953. En Finlande, aucun usage n'en a été fait depuis 1968.
Quant à la Suède, si elle ne prévoit pas formellement la création de commissions d'enquête parlementaires et réserve ce pouvoir au gouvernement, la commission constitutionnelle du parlement suédois dispose de prérogatives d'investigation étendues, notamment en matière d'accès à l'information. Ce cas peut donc faire l'objet d'une certaine nuance dans la classification.
Dans près de 80 % des pays ayant répondu au questionnaire, le pouvoir de création des commissions d'enquête repose sur un fondement constitutionnel. Dans un nombre plus restreint d'États, cette compétence est encadrée par la loi. Un seul pays, l'Estonie, la fonde exclusivement sur le règlement de son assemblée.
Les cas spécifiques
Certains cas particuliers rendent difficile l'établissement d'une typologie stricte, tant les configurations institutionnelles peuvent varier.
Le Royaume-Uni se distingue par le recours aux select committees, commissions permanentes investies d'une mission de contrôle, dont les pouvoirs peuvent être aussi étendus que ceux des commissions d'enquête. À cela s'ajoute, à la Chambre des Lords, la possibilité de créer des special investigative committees, de nature temporaire, qui s'apparentent davantage aux commissions d'enquête telles qu'on les connaît dans d'autres pays.
Une autre configuration intéressante est celle de certains régimes bicaméraux - notamment l'Italie, l'Espagne et la Roumanie - où il est possible de créer non seulement des commissions d'enquête propres à chaque chambre, mais aussi des commissions communes aux deux assemblées.
En Grèce, deux types de commissions d'enquête coexistent : d'une part, les examination committees, et d'autre part, des commissions ad hoc principalement chargées de mener des enquêtes préliminaires à l'encontre de responsables politiques.
Dans certains parlements, enfin, il est possible d'investir des commissions permanentes des mêmes prérogatives que les commissions d'enquête. Cette pratique tend à se développer en France.
Ces différentes configurations nous ont conduits à élaborer une carte typologique distinguant les situations observées (voir présentation en annexe). Y figurent en rouge les pays dans lesquels le Parlement ne dispose pas du pouvoir de créer des commissions d'enquête ou ne l'exerce pas en pratique ; en jaune, les États où cette prérogative est réservée à la chambre basse ; en vert, les systèmes bicaméraux permettant la création de commissions d'enquête communes aux deux chambres ; en bleu clair, les pays où chaque chambre - dans les régimes monocaméraux comme bicaméraux - peut instituer une commission d'enquête et, en bleu foncé, le cas britannique.
Fréquence et durée des commissions d'enquête parlementaires
Pour fournir un aperçu quantitatif, nous avons retenu comme point de référence la date du 1er janvier 2020, afin d'éviter les biais liés à la diversité des législatures. Il en ressort que la France se situe nettement en tête, avec 65 commissions d'enquête créées depuis cette date : 25 au Sénat et 40 à l'Assemblée nationale. Viennent ensuite la Bulgarie et l'Ukraine.
À l'inverse, plus de la moitié des pays ont instauré moins de quinze commissions d'enquête sur la même période, et six d'entre eux n'en ont créé aucune depuis 2020. Ces données confirment la grande diversité des usages selon les pays.
Au Royaume-Uni, il est difficile de produire des statistiques comparables, dans la mesure où de nombreuses enquêtes sont menées dans le cadre des select committees. Le chiffre que nous présentons ici correspond uniquement à une partie de l'activité d'enquête de la Chambre des Lords et ne reflète donc pas l'ensemble du travail de contrôle parlementaire.
Comparer la fréquence des commissions d'enquête parlementaires entre les pays est une tâche complexe, compte tenu de la grande variation dans leur durée. Dans certains cas, les enquêtes sont menées à bien en quelques mois - trois à quatre mois en Turquie, par exemple - tandis que dans d'autres, comme en Norvège, leurs travaux peuvent durer jusqu'à cinq ans. En moyenne, cependant, la plupart des commissions fonctionnent pendant une période d'un à deux ans.
La création des commissions d'enquête
La création d'une commission d'enquête présuppose une initiative formelle. Dans la plupart des pays, les minorités parlementaires ont désormais la possibilité de créer une commission d'enquête, une prérogative souvent décrite comme une forme de « droit des minorités ». L'extension de ce droit est relativement récente, mais de plus en plus répandue. De nombreux parlements autorisent un cinquième, un quart ou jusqu'à un tiers de leurs membres à demander la création d'une commission d'enquête le seuil le plus courant étant un quart.
À l'inverse, en Belgique et aux Pays-Bas, les minorités ou les partis d'opposition n'ont pas le droit d'initier une commission d'enquête. En Autriche, ce droit minoritaire n'a été introduit qu'en 2015. Plusieurs cas spécifiques existent également : en France, par exemple, les groupes politiques ont un « droit de tirage » pour demander une commission d'enquête ; en Italie, une loi formelle doit être adoptée pour en créer une. L'utilisation effective de ce droit minoritaire varie considérablement d'un pays à l'autre : il est très utilisé dans certains pays et rarement invoqué dans d'autres.
La présidence des commissions d'enquête
La question de savoir qui préside une commission d'enquête fait l'objet d'un débat considérable. Le président doit-il rester neutre ? Doit-il jouer un rôle actif dans l'orientation de la commission vers des conclusions ? Ou peut-il utiliser cette fonction pour faire avancer sa propre carrière politique ?
Dans la plupart des pays, la règle en vigueur est que le président est élu parmi les membres du groupe politique qui a initié la commission d'enquête. L'Estonie fait exception : le président doit être membre de l'opposition. En Allemagne, la question fait depuis longtemps l'objet de débats, ce qui reflète sa sensibilité institutionnelle.
L'Autriche propose un arrangement unique : le président de la chambre préside de plein droit toute commission d'enquête parlementaire. Il n'est pas membre de la commission et agit en tant qu'autorité neutre. Il est à noter que le président n'agit pas seul ; il est assisté par un juge de procédure dont le rôle est de protéger les droits des témoins et des tiers susceptibles d'être affectés par les travaux de la commission. Cette configuration semble être unique en Europe.
La gestion des conflits au sein ou autour d'une commission d'enquête
Des différends peuvent surgir tant au sein des commissions d'enquête parlementaires qu'entre une commission et d'autres institutions étatiques. En général, ces conflits sont résolus par la voie politique. Cependant, des interventions judiciaires ont parfois lieu. En Slovénie et en Espagne, par exemple, les tribunaux ont statué sur des questions liées au droit de créer une commission d'enquête ou à l'étendue de ses compétences. En Allemagne et en Autriche, de nombreuses affaires ont été portées devant les cours constitutionnelles pour régler des litiges internes à la commission ou entre la commission et d'autres organes de l'État. Ces litiges concernent généralement l'obligation de transmettre des documents ou la classification des informations. En Autriche, les personnes concernées par les travaux d'une commission d'enquête peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle. Certaines de ces affaires seront examinées plus en détail demain.
Les commissions d'enquête et les procédures judiciaires
Les commissions d'enquête sont souvent comparées aux procédures judiciaires, une comparaison parfois renforcée par la manière dont elles sont présentées dans les médias - même la disposition physique des sièges peut évoquer une salle d'audience. Néanmoins, la plupart des parlements maintiennent une séparation stricte entre les procédures parlementaires et judiciaires, affirmant que les deux ne doivent pas se dérouler simultanément.
Il y a près de dix ans, cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH)3(*) a rendu une décision historique dans une affaire polonaise, estimant que les procédures judiciaires et parlementaires suivent des logiques distinctes et peuvent donc se dérouler en parallèle. Cette décision invite à réfléchir davantage à la manière dont ces chevauchements peuvent être gérés dans la pratique.
Le Bundestag allemand a mis en place des mécanismes informels de négociation pour gérer les conflits potentiels. En Autriche, il existe une procédure de consultation formelle, à laquelle participent à la fois le ministre fédéral de la Justice et la commission d'enquête parlementaire. Au Royaume-Uni, la règle du sub judice sert de garantie, conçue pour empêcher le déroulement simultané de procédures parlementaires et judiciaires sur la même affaire.
Les pouvoirs des commissions d'enquête
Les pouvoirs fondamentaux conférés aux commissions d'enquête sont relativement similaires d'un pays à l'autre : ils comprennent la possibilité de convoquer et d'entendre des témoins (souvent des fonctionnaires et des agents publics), de demander des documents et de mener des missions d'enquête.
Il existe néanmoins certaines divergences, notamment en ce qui concerne l'application effective de l'obligation de coopérer . Par exemple, les procédures et les sanctions relatives aux témoins qui refusent de témoigner ou qui refusent de communiquer des documents diffèrent d'un État à l'autre. Un autre domaine clé de divergence concerne le traitement des informations sensibles ou classifiées, et la mesure dans laquelle les membres des commissions peuvent s'appuyer sur ces informations dans leurs rapports ou dans leurs actions politiques ultérieures.
Au cours des dernières années, de nouvelles préoccupations ont émergé concernant la protection des données et l'applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD). Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'Autriche a établi que les commissions d'enquête sont soumises à l'obligation de protéger les données à caractère personnel. Cela a des implications importantes non seulement pour les auditions elles-mêmes, mais aussi pour la rédaction des rapports et l'utilisation politique plus large de leurs conclusions. Ces questions méritent d'être examinées avec soin.
Le rôle de l'administration parlementaire
Il ressort de notre enquête que, dans la très grande majorité des cas, l'administration parlementaire est étroitement associée au fonctionnement des commissions d'enquête au sein des assemblées. Dans l'ensemble des parlements interrogés, elle intervient au minimum pour assurer le soutien logistique et organisationnel des commissions.
Dans plus de la moitié des cas, les services administratifs participent également à la définition précise du champ de l'enquête. Dans deux tiers des assemblées, ils prennent part à l'analyse de la documentation collectée, voire en assurent la conduite. Leur implication peut aller jusqu'à la rédaction du rapport final, voire des recommandations elles-mêmes.
En revanche, les réponses faisant état d'une contribution de l'administration à la rédaction des questionnaires sont moins nombreuses. Cela peut surprendre, notamment au regard de la pratique française, où la rédaction de questionnaires est fréquente.
Enfin, dans tous les parlements, l'administration joue un rôle de soutien sur les questions de procédure. Elle veille au respect du cadre juridique applicable aux commissions d'enquête, et constitueun point de référence pour l'interprétation des règles constitutionnelles ou réglementaires encadrant leurs travaux.
Les ressources et outils mis à disposition des commissions d'enquête
Dans la plupart des assemblées, les commissions d'enquête disposent d'un secrétariat propre, composé de fonctionnaires ou d'agents du parlement. Dans 93 % des cas, une structure administrative dédiée est mise en place.
De nombreux parlements prévoient également des moyens humains supplémentaires, notamment via les groupes politiques. Le recours à des experts extérieurs, juridiques ou scientifiques, est fréquent. Ces experts peuvent intervenir à titre individuel ou dans le cadre de contrats passés avec des instituts de recherche ou des centres universitaires.
En revanche, seuls un quart des parlements déclarent avoir recours à des experts de la donnée, chargés de traiter des volumes importants d'informations, notamment numériques - données chiffrées, courriels en masse, etc. L'utilisation d'outils informatiques de gestion des données, dont des outils, d'intelligence artificielle demeure encore marginale : seuls 28 % des parlements interrogés ont indiqué y avoir recours.
Enfin, certaines configurations nationales présentent des spécificités notables. Dans les systèmes austro-germaniques, on observe un recours formalisé à des expertises extérieures : en Autriche, par exemple, un juge de procédure assiste les travaux de la commission ; en Allemagne, il est possible de recourir à un enquêteur externe.
D. SESSION 1 - LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES COMME OUTIL DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTIF
1. Les obstacles juridiques à la conduite d'enquêtes parlementaires dans le contexte irlandais, Mme Cathy EGAN (Houses of the Oireachtas - Irlande)
Le thème majeur des discussions d'aujourd'hui est de savoir si les commissions d'enquête parlementaires sont des outils efficaces pour contrôler l'exécutif.
Dans cette contribution, je présenterai le contexte historique et juridique qui a façonné le cadre actuel, l'expérience de la commission d'enquête sur la crise bancaire, les défis juridiques et opérationnels rencontrés et, enfin, les enseignements tirés de cette expérience.
Depuis la fondation de l'État irlandais, les enquêtes parlementaires ont été rares. Seules quelques-unes ont été menées avant les années 2000. L'affaire Abbeylara4(*) a marqué un tournant important. Elle a conduit à la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée, entre autres, d'examiner la conduite de la Gardaí et d'évaluer si la situation aurait pu être gérée différemment.
Cette commission d'enquête a été contestée juridiquement par la police, qui a fait valoir que toute décision relative à une faute de sa part devait être prise par un tribunal et non par un organe parlementaire. Dans sa décision Abbeylara rendu en 2002, la Cour suprême irlandaise a statué que les Chambres de l'Oireachtas - le Parlement irlandais - ne disposaient pas d'un pouvoir constitutionnel inhérent leur permettant de rendre des décisions qui portent atteinte à la réputation d'individus. Selon la Cour, ces décisions relèvent exclusivement de la compétence du pouvoir judiciaire. La décision Abbeylara a effectivement entraîné l'arrêt des commissions d'enquête parlementaires en Irlande pendant plus d'une décennie.
En réponse, le gouvernement a cherché à modifier la Constitution afin de permettre le rétablissement de commissions d'enquêtes parlementaires. Cependant, la proposition d'amendement constitutionnel a été rejetée par référendum en 2011, à la suite d'une campagne marquée par une opposition forte et virulente. Des personnalités éminentes du monde juridique ont mis en garde contre les risques d'un pouvoir parlementaire excessif et le référendum a échoué.
En conséquence, le gouvernement a été contraint de travailler dans le cadre constitutionnel existant. Ces efforts ont abouti à la promulgation de la loi de 2013 sur les Chambres de l'Oireachtas (enquêtes, privilèges et procédures) », ci-après dénommée « loi sur les commissions d'enquête ». Cette législation a établi un cadre réglementaire autorisant cinq types distincts d'enquêtes parlementaires :
1. les enquêtes sur des questions législatives - visant à déterminer si une nouvelle loi est nécessaire dans un domaine particulier ;
2. les enquêtes visant à révoquer des titulaires de fonctions officielles - par exemple, pour évaluer si un juge doit être révoqué ;
3. les enquêtes sur la conduite de titulaires de fonctions officielles - telles que l'évaluation des performances du secrétaire général d'un ministère ;
4. les enquêtes sur la conduite des membres de l'Oireachtas - traitant des questions disciplinaires ou éthiques impliquant des parlementaires ;
5. et en fin les enquêtes générales en vertu de l'article 7 - la catégorie la plus large et la plus flexible, permettant d'enquêter sur n'importe quelle question. Elles sont communément appelées commissions d'enquête de l'article 7 « Enquêter, enregistrer, rendre compte ».
Parmi ces cinq types, le premier - les enquêtes législatives - présente un intérêt pratique limité et est rarement utilisé. Les autres sont plus substantiels, mais se concentrent sur des personnes ou des circonstances étroitement définies. La cinquième catégorie, prévue à l'article 7 de la loi, est la seule qui autorise les enquêtes sur des questions d'intérêt public général. Elle offre le champ d'application le plus large, mais reste soumise aux limites strictes du cadre constitutionnel défini par la décision Abbeylara.
La fonction la plus importante d'une enquête parlementaire menée en vertu de l'article 7 de la loi sur les enquêtes est la possibilité de conclure qu'une question particulière - relative aux systèmes, aux pratiques, aux procédures, aux politiques ou à la mise en oeuvre des politiques - aurait dû être traitée différemment. Par exemple, une conclusion pourrait indiquer qu'un organisme de réglementation qui avait le pouvoir légal d'imposer des limites aux dépenses aurait dû exercer ce pouvoir.
La seule enquête menée à ce jour en vertu de la loi sur les enquêtes a été celle de la commission d'enquête sur la crise bancaire, qui a servi de test grandeur nature aux dispositions de la loi. Elle a opéré entre fin 2014 et début 2016, avec pour mandat d'enquêter sur les causes de l'effondrement systémique du système bancaire irlandais. Je faisais partie de l'équipe administrative dédiée, composée de 57 membres à temps plein, chargée de soutenir les travaux de la commission pendant cette période.
La commission d'enquête a représenté un effort institutionnel considérable : elle a coûté plus de 6,5 millions d'euros, a donné lieu à des auditions publiques avec 131 témoins et a nécessité l'examen de plus de 500 000 pages de documentation.
En tant qu'enquête relevant de l'article 7 « Enquêter, enregistrer, rendre compte », cette commission était principalement chargée d'enregistrer les preuves et de rendre compte de ses conclusions. Cependant, elle ne disposait que d'une autorité limitée pour tirer des conclusions factuelles. En vertu de la loi, la commission n'était pas autorisée à établir des conclusions factuelles si les preuves à l'appui étaient contredites par d'autres témoignages.
Il est peu probable qu'une enquête menée en vertu de l'article 7 aboutisse à une conclusion officielle à l'encontre d'une personne. Néanmoins, la loi exige que toutes les enquêtes, quel que soit leur type ou leur portée juridique, respectent les mêmes garanties procédurales strictes. Cela inclut notamment les obligations énoncées à l'article 24 de la loi de 2013 concernant les procédures équitables.
Des règles strictes s'appliquaient également à toute perception potentielle de partialité. Toute suggestion de partialité pouvait entraîner la destitution d'un membre de la commission. Cela nous a obligés à former les membres à adopter une approche neutre et prudente pendant les auditions, en évitant les questions contradictoires ou les pièges. Les apparitions publiques des membres ont également été restreintes pendant toute la durée de l'enquête, ce qui constitue une contrainte inhabituelle dans un contexte politique.
Cette faille structurelle, inhérente à la législation elle-même, a imposé dès le départ des contraintes opérationnelles importantes à l'enquête. Outre ces contraintes systémiques, l'enquête sur le système bancaire a été confrontée à un certain nombre de défis uniques qui ne se poseront peut-être pas lors d'enquêtes futures, notamment la question de la pression du temps et du risque politique.
Dans le cadre de la première enquête menée en vertu de la loi, nous avons été chargés de concevoir l'architecture globale du processus. Cependant, aucune période préparatoire n'a été prévue avant le début de l'enquête. L'urgence politique a imposé un lancement rapide, et nous avons été contraints d'élaborer des cadres procéduraux au cas par cas alors que l'enquête était déjà en cours.
La commission a officiellement commencé ses travaux en décembre 2014. En vertu des règles régissant notre système parlementaire, la Dáil (chambre basse) ne pouvait rester en session au-delà du début du mois de mars 2016. Cependant, la décision de dissoudre le Parlement appartient au Taoiseach et peut être prise à tout moment, généralement à un moment jugé politiquement avantageux, et pas nécessairement à la fin du mandat complet.
Dans notre rapport final, nous avons inclus une proposition de modèle pour la conduite des futures enquêtes parlementaires en Irlande. La recommandation clé était d'établir un processus séquentiel et clairement défini, chaque phase (préparation, enquête, auditions et rapport) se voyant attribuer suffisamment de temps et de ressources. Nous avons préconisé un délai minimum de deux ans pour permettre la bonne exécution de ces étapes, plutôt que de superposer tous les éléments simultanément comme nous avions été contraints de le faire.
Si une autre enquête devait avoir lieu à l'avenir, elle bénéficierait au moins du cadre, de la documentation et des modèles que nous avons élaborés. Bien qu'ils datent maintenant de plus de dix ans, ils restent une référence précieuse.
Un deuxième défi majeur rencontré lors de la commission d'enquête sur le système bancaire concernait le chevauchement avec les procédures pénales en cours. Plusieurs personnes clés faisaient à l'époque l'objet de poursuites pénales liées à la crise bancaire. La Gardaí et le directeur des poursuites publiques (DPP) ont averti que les activités de l'enquête, en particulier la collecte de certains éléments de preuve, pourraient compromettre ces procès pénaux.
Une autre difficulté importante est venue de la découverte tardive de l'article 33AK de la loi sur la banque centrale, qui interdit la divulgation d'informations détenues par la banque centrale. Cette disposition légale n'a été mise en lumière qu'après le début de l'enquête, malgré le caractère décisif des documents de la Banque centrale pour l'objet de l'enquête. Une législation d'urgence a été nécessaire pour modifier cette disposition. Même après la modification, tout document obtenu en vertu de la disposition révisée était soumis à des obligations de confidentialité strictes. L'enquête a été contrainte de mettre au point des protocoles complexes de séparation des données, imprévus au départ, afin de garantir le respect de ces obligations.
L'une des principales recommandations pour les enquêtes futures est l'identification et la résolution précoces de tout obstacle juridique à la production de preuves, une étape qui a malheureusement été négligée dans le cas présenté ici.
Les limites juridictionnelles ont constitué des obstacles supplémentaires. Si les citoyens et résidents irlandais peuvent être contraints de témoigner, bon nombre des principaux acteurs de la crise bancaire, notamment les conseillers et les décideurs, étaient des ressortissants étrangers. À ce titre, la commission n'avait pas le pouvoir légal de les contraindre à coopérer.
Malgré toutes ces difficultés, la commission d'enquête a réussi à publier son rapport final. Le volume I présente les conclusions de la commission et les preuves qui les étayent ; le volume II comprend 28 recommandations procédurales pour les futures commissions d'enquête. La principale d'entre elles est un appel à modifier la loi sur les enquêtes afin de permettre une procédure simplifiée d'enquête, d'enregistrement et de rapport, sans pouvoir de rendre des conclusions à l'encontre de personnes physiques et, par conséquent, avec des obligations procédurales proportionnées. Parmi les autres recommandations figuraient un délai minimum de deux ans pour les enquêtes, un audit réglementaire complet au stade préalable à l'enquête afin d'éviter les obstacles inconnus (tels que l'article 33AK) et un protocole clair régissant les relations entre le directeur des poursuites publiques et les chambres de l'Oireachtas.
En conclusion, les commissions d'enquête parlementaires peuvent-elles constituer un instrument de contrôle efficace en Irlande ? En théorie, oui. Mais dans la pratique, le cadre constitutionnel et législatif actuel les rend rares, lourdes sur le plan procédural et limitées sur le plan juridique, en particulier par rapport aux commissions ordinaires dotées de pouvoirs contraignants. La recommandation en faveur d'une forme d'enquête simplifiée et moins contraignante revient en fait à recommander le retour aux commissions parlementaires permanentes existantes.
2. Les commissions d'enquête bicamérales et le rôle du Sénat italien, M. Luigi GIANNITI (Senato della Repubblica - Italie)
Le pouvoir d'enquête des Chambres est expressément prévu par la Constitution italienne : selon l'article 82, « Chaque chambre du Parlement peut mener des enquêtes sur des questions d'intérêt public ». Le deuxième paragraphe précise en outre les modalités d'exercice de ce pouvoir : « Une commission d'enquête peut mener des investigations et des examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que le pouvoir judiciaire ».
Le cadre constitutionnel fait référence aux commissions d'enquête que « chaque chambre » peut créer, ce qui implique que les commissions peuvent appartenir soit à la Chambre des députés, soit au Sénat. Et pourtant, le Parlement italien mène fréquemment ses enquêtes par le biais de commissions bicamérales. La raison tient à une caractéristique du bicaméralisme italien : le Parlement est composé de deux chambres élues au suffrage direct, avec des lois électorales sensiblement similaires, qui accordent toutes deux leur confiance au gouvernement et participent à parts égales à la fonction législative.
Les commissions d'enquête, un choix de la majorité
Les commissions bicamérales sont généralement établies par la loi, ce qui permet de mieux clarifier leurs pouvoirs. La décision de créer une commission d'enquête est adoptée à la majorité. Lors de la rédaction de la Constitution par l'Assemblée constituante, la possibilité de créer des commissions d'enquête minoritaires (selon le modèle allemand) a été envisagée. Finalement, ce choix n'a pas été retenu.
Tout au long de la première phase de l'histoire républicaine, la décision de procéder à des enquêtes parlementaires était le résultat d'un accord largement partagé entre les partis politiques. Les premières commissions d'enquête des années 1950 ont traité des questions majeures de la société italienne : la pauvreté, le chômage, la condition des travailleurs ou encore les obstacles à la concurrence dans l'économie.
Cet instrument a donc été initialement utilisé par le Parlement pour tenter d'apporter des réponses politiques et législatives à ces problèmes, sur la base de la devise du président Luigi Einaudi « savoir pour décider ».
À partir des années 1960, les enquêtes lancées à des fins législatives ont été accompagnées d'enquêtes politiques sur des événements spécifiques. Dès lors, la question de la relation entre l'exercice du pouvoir d'enquête parlementaire et le pouvoir judiciaire a commencé à se poser.
Commissions bicamérales versus commissions monocamérales
Si l'on retrace l'histoire de la République italienne de 1968 à 1983, toutes les enquêtes ont été menées par des commissions bicamérales : c'étaient les années de la « centralité du Parlement ». Le recours à des commissions bicamérales établies par la loi pour mener des enquêtes était également un signe de la cohésion du système des partis et de sa représentation parlementaire.
En 1971, de nouvelles règles parlementaires ont été approuvées, introduisant les missions d'information. Celles-ci sont devenues l'outil standard utilisé par les commissions (permanentes et temporaires) pour acquérir des connaissances sur les questions relevant de leur compétence, de manière coordonnée et systématique.
Au cours de la Xe législature (caractérisée par une grande mobilité politique et couvrant toute la durée du mandat constitutionnel de cinq ans, de 1987 à 1992), sept commissions d'enquête ont été créées, soit le nombre le plus élevé à ce jour. Quatre d'entre elles étaient des commissions monocamérales : trois au Sénat et une à la Chambre.
La crise de la « République des partis » (« Repubblica dei partiti ») a atteint son paroxysme au cours de ces années. Il est significatif que, pendant cette législature, le président de la République de l'époque, Francesco Cossiga, ait mis en garde contre le risque d'« activités discordantes et donc improductives, voire carrément nuisibles », en particulier pour les enquêtes concernant « des affaires pour lesquelles des procédures judiciaires sont encore en cours, dans lesquelles il serait gravement inapproprié d'intervenir, même de facto, par des empiétements ou des suggestions inappropriées5(*) ».
Plus récemment, à partir de 1992, les commissions monocamérales ont refait leur apparition. De 1994 à 1996, il y a eu neuf commissions d'enquête : quatre bicamérales et cinq monocamérales, dont trois au Sénat. Depuis lors, les commissions monocamérales sont plus nombreuses que les commissions bicamérales. Le Sénat compte souvent plus de commissions monocamérales que la Chambre des députés.
Au cours de la XVIIe législature (2013-2018), il y a eu quinze commissions d'enquête, et au cours de la XVIIIe législature (2018-2022), il y en a eu douze (cinq bicamérales, trois au Sénat et quatre à la Chambre des députés). L'impression générale est que la fragmentation politique se traduit par un plus grand nombre d'enquêtes (menées pour la plupart par une seule chambre).
Les commissions bicamérales actuellement actives au Parlement italien
Au cours de la législature actuelle, depuis 2022, quatorze commissions ont été créées : six bicamérales, deux monocamérales au Sénat et six monocamérales à la Chambre des députés. Et ce, malgré une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires6(*). Il y avait auparavant 630 députés et il y en a aujourd'hui 400, tandis que le nombre de sénateurs élus est passé de 315 à 200, auxquels s'ajoutent cinq sénateurs à vie.
Parmi les commissions bicamérales actuellement en activité, trois poursuivent les travaux des commissions créées dans le passé et traitent de questions générales : la lutte contre la mafia, la gestion des déchets et la question du féminicide (sur ce dernier point, la loi a établi une infraction spécifique). En ce qui les concerne, on peut affirmer qu'il s'agit d'organes parlementaires permanents qui sont constamment renouvelés au début de chaque législature. Cet élément peut être considéré comme controversé en termes d'efficacité et d'opportunité, car il amplifie les risques liés aux commissions d'enquête permanentes « dotées des mêmes pouvoirs et limitations que le pouvoir judiciaire » (voir ci-dessous).
Trois nouvelles commissions ont été créées : deux d'entre elles concernent des questions spécifiques faisant l'objet d'une enquête judiciaire qui ont eu un impact majeur sur l'opinion publique (la disparition de deux jeunes filles dans des circonstances exceptionnelles et une communauté de réinsertion pour mineurs et personnes handicapées), et la dernière concerne la gestion de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de Covid. Toutes ont été créées par la loi.
Durée et évolution des responsabilités des commissions d'enquête
Certaines commissions d'enquête se sont limitées à une seule législature. Dans d'autres cas, les commissions chargées de tâches extrêmement ardues ont continué à fonctionner pendant plusieurs législatures. Dans ces cas, l'instrument de la commission bicamérale est toujours utilisé.
L'une de ces commissions est celle chargée d'enquêter sur les activités liées à la mafia (commission antimafia), créée pour la première fois en 1962 (lors de la IIIe législature) et régulièrement confirmée depuis lors, avec des responsabilités qui se sont consolidées au fil du temps.
L'activité d'enquête proprement dite s'accompagne actuellement d'une activité cognitive parallèle, assumant même des fonctions d'élaboration de politiques et de contrôle. Par exemple, la loi n° 22/2023, qui a créé la commission antimafia dans la législature actuelle, lui a confié la tâche d'enquêter sur les relations entre la mafia et les partis politiques, notamment en ce qui concerne la formation des listes électorales. La commission peut également demander des informations au procureur national antimafia et antiterroriste et surveille les tentatives d'influence et d'infiltration de la mafia dans les autorités locales. Cela témoigne clairement de l'importance croissante des tâches confiées aux commissions d'enquête ces derniers temps. En outre, ce type de pouvoirs et de prérogatives particuliers tend à renforcer la tendance à l'autonomie par rapport aux chambres elles-mêmes.
Limites de nature politique : enquêtes parlementaires et pouvoir judiciaire
Un aspect problématique concerne les limites des pouvoirs des commissions d'enquête. En vertu de l'article 82 de la Constitution, comme mentionné ci-dessus, la commission « peut mener des enquêtes et des examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que le pouvoir judiciaire ». Les outils mis à la disposition de cet organe parlementaire sont donc essentiellement ceux de l'enquête pénale. En outre, des outils plus informels, tels que les auditions, peuvent être utilisés. Depuis la Xe législature, c'est-à-dire depuis la fin des années 1980, le problème des relations entre les enquêtes parlementaires et les procédures judiciaires s'est posé à plusieurs reprises. Des commissions d'enquête ont été mises en place et menées simultanément à des procédures judiciaires en cours. L'un de ces cas a donné lieu à un conflit de compétences et à une décision de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 26 de 2008). À titre dissuasif, de nombreuses lois instituant des commissions d'enquête ont exclu l'adoption de « mesures concernant la liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication, ainsi que la liberté individuelle »7(*).
Une autre question problématique a été la tentative de la majorité actuelle de condamner les actions des responsables gouvernementaux des législatures précédentes par le biais des commissions d'enquête. À plusieurs reprises, l'opposition a non seulement voté contre le projet de loi instituant la commission d'enquête, mais a même tenté de ralentir ses activités.
Tout comme les autorités judiciaires, les commissions d'enquête parlementaires peuvent ordonner des perquisitions et des saisies. Ces mesures, qui constituent une atteinte à la vie privée, doivent être justifiées par des besoins spécifiques liés à l'enquête. En outre, elles doivent être menées dans le respect des règles du code de procédure pénale régissant la collecte de preuves et des garanties protégeant le suspect, y compris au niveau constitutionnel. D'autres limites à l'utilisation de ces instruments semblent découler de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dans la mesure où aucun moyen ou recours ne semble exister pour contester la légitimité des saisies et des perquisitions ordonnées par les commissions d'enquête devant une autorité indépendante et impartiale8(*).
3. Les commissions d'enquête parlementaires et le droit de tirage au Sénat français, M. Jean-Pascal PICY, conseiller hors classe à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (Sénat - France)
L'année dernière, j'ai occupé le poste de chef du secrétariat de la commission d'enquête parlementaire sur TotalEnergies, une grande entreprise française d'électricité et de gaz. Cette mission était d'autant plus intéressante que la commission avait été créée à l'initiative de l'opposition. Cela met en évidence une caractéristique distinctive du système parlementaire français, qui diffère significativement du modèle italien. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, chaque groupe politique appartenant à l'opposition a le droit de créer et de diriger une commission d'enquête par an, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, je voudrais vous donner un aperçu du fonctionnement pratique des commissions d'enquête au sein du Parlement français. Ceci comprend une présentation de leur cadre juridique, des conditions pratiques dans lesquelles elles opèrent, des méthodes et techniques qu'elles utilisent, ainsi que les résultats et les mécanismes de suivi associés à leur travail.
Avant la réforme de 2008, seule la loi organique de 1958 réglementait la création et le fonctionnement des commissions d'enquête. Dans ce cadre, chaque chambre du Parlement peut créer sa propre commission d'enquête. Contrairement à l'Italie, les commissions d'enquête bicamérales ne sont pas autorisées en France. L'objectif d'une commission d'enquête est de recueillir des informations soit sur des faits clairement définis, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises publiques. Tous les sujets proposés par un parlementaire ne constituent pas une base légitime pour une enquête ; le champ d'application est strictement limité par la loi. En outre, les commissions d'enquête ne peuvent être créées pour des faits qui font ou ont fait l'objet d'une procédure judiciaire, conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
La composition de chaque commission d'enquête reflète l'équilibre politique de la chambre à laquelle elle appartient. Les commissions d'enquête sont des organes temporaires, dont la durée légale est limitée à six mois. Cependant, la procédure de création prend à elle seule souvent au moins un mois, ce qui réduit encore le temps effectif disponible pour l'enquête elle-même. Dans ce délai limité, la commission procède à des auditions obligatoires. Les personnes convoquées pour témoigner sont légalement tenues de se présenter. Dans la pratique, cependant, elles résistent souvent dans un premier temps à ces convocations, invoquant des conflits d'horaires, des obstacles techniques ou des inconvénients généraux. C'est généralement à ce moment-là qu'on leur rappelle la possibilité d'une intervention policière pour les contraindre à se présenter, ce qui constitue un moyen de dissuasion très efficace. En conséquence, les personnes convoquées se conforment presque toujours à la convocation.
Les personnes entendues sont tenues de témoigner sous serment et sont explicitement informées que le parjure et tout acte portant atteinte au caractère solennel de la procédure constituent des infractions pénales. Cette obligation contribue au sérieux avec lequel les témoins abordent les auditions.
Depuis 1991, le principe des auditions publiques est devenu la norme, ce qui permet aux médias de couvrir et de rendre compte des travaux des commissions d'enquête. Certaines auditions peuvent toutefois se tenir à huis clos lorsque des informations classifiées ou confidentielles sont discutées. Une autre prérogative essentielle des commissions d'enquête est le pouvoir d'enquête conféré au rapporteur, qui comprend le pouvoir d'effectuer des inspections sur place et d'accéder à des documents. La perspective d'une visite surprise de sénateurs - souvent accompagnés de membres de la presse - pour saisir des documents exerce une pression considérable sur les entités visées. En conséquence, la menace seule suffit généralement à obtenir la coopération des personnes convoquées ou faisant l'objet d'une enquête.
Il existe deux procédures distinctes permettant la création d'une commission d'enquête parlementaire en France. La première est la procédure standard, en vigueur depuis 1958. Dans le cadre de cette procédure, les sénateurs rédigent d'abord une résolution proposant la création d'une commission d'enquête. Cette résolution est soumise à la commission permanente compétente sur le sujet en question. Après cet examen initial, la commission des lois doit vérifier qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours ou n'a eu lieu concernant les mêmes faits. Enfin, la résolution doit être adoptée en séance plénière par le Sénat. Une fois adoptée, la commission est officiellement créée et ses membres sont nommés. Chaque commission d'enquête parlementaire peut compter jusqu'à 23 membres.
Le deuxième mécanisme, introduit par la réforme constitutionnelle de 2008, est le « droit de tirage ». Cette procédure fonctionne comme une sorte de procédure accélérée, permettant à chaque groupe politique de créer une commission d'enquête parlementaire par an. Dans ce cas, la résolution n'est pas soumise à la commission permanente compétente, mais elle est tout de même soumise à l'examen de la commission des lois, qui doit confirmer l'absence de procédures judiciaires passées ou en cours. Contrairement à la procédure standard, il n'y a pas de vote en séance plénière ; le Président du Sénat se contente de prendre acte de la création de la commission. Ce processus accéléré confère à l'opposition un instrument de contrôle important, car la majorité ne peut bloquer la création d'une commission d'enquête exercée en vertu du droit de tirage.
Depuis 2009, les commissions d'enquête créées dans le cadre du droit de tirage se sont souvent concentrées sur des questions sensibles ou controversées. En général, ces commissions sont présidées par un membre de la majorité, tandis que le rapporteur est nommé parmi les membres de l'opposition, c'est-à-dire le groupe politique qui a initié la commission. Cette configuration donne souvent lieu à des débats houleux et attire davantage l'attention des médias. Si ces commissions d'enquête permettent de sensibiliser le public au contrôle parlementaire, elles peuvent également susciter des inquiétudes quant à la politisation des enquêtes. Un exemple notable s'est produit le mois dernier, lorsque le Premier ministre, M. François Bayrou, a été entendu pendant plus de cinq heures par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire sur la violence à l'égard des jeunes dans les écoles, y compris l'affaire dite « Bétharram », largement médiatisée. Certains observateurs ont critiqué cette audition, la qualifiant de procès politique plutôt que d'enquête neutre.
La composition d'une commission d'enquête parlementaire suit le principe de la représentation proportionnelle. Les membres désignent collectivement le président et le rapporteur, qui exercent chacun une autorité considérable. Le président est chargé de convoquer les réunions de la commission et de son bureau, de signer les convocations aux auditions et, si nécessaire, de recourir à des mesures coercitives pour garantir la présence des personnes concernées. Le président préside également les auditions et peut engager des poursuites en cas de faux témoignage. Le rapporteur a la priorité pour interroger les témoins et est chargé de rédiger le rapport final. Compte tenu de la nature complémentaire mais distincte de leurs rôles, la relation entre le président et le rapporteur est essentielle au bon fonctionnement de la commission. Lorsque le président appartient à la majorité et le rapporteur à l'opposition, comme c'est souvent le cas dans les commissions créées en vertu du droit de tirage, la collaboration peut s'avérer complexe.
Le bureau de la commission d'enquête comprend le président, le ou les rapporteurs, les vice-présidents et les secrétaires, tous sénateurs, et fait office d'instance de délibération confidentielle. Il définit l'orientation stratégique de l'enquête, règle les différends internes et coordonne la logistique. Lorsqu'une commission d'enquête est lancée en vertu du droit de tirage, le bureau sert également d'organe de conciliation afin de faciliter la coopération entre la majorité et l'opposition, en particulier pendant la phase de rédaction du rapport. En effet, même si l'opposition lance la commission d'enquête, elle ne peut imposer le rapport final, qui doit être adopté à la majorité des voix. Cela oblige souvent le rapporteur à faire des concessions.
Le chef du secrétariat de la commission, qui opère sous l'autorité conjointe du président et du rapporteur et appartient à l'administration parlementaire, joue un rôle central dans l'organisation et l'exécution des activités de la commission. Cela comprend la programmation des réunions, la rédaction des questionnaires et des rapports, l'organisation des visites sur le terrain et la gestion de la communication. Le chef du secrétariat, en particulier, peut aussi servir d'intermédiaire entre le président et le rapporteur afin de maintenir le bon fonctionnement de la commission.
En ce qui concerne les méthodes et techniques utilisées dans le cadre des travaux des commissions d'enquête parlementaires, les auditions sont naturellement l'instrument le plus visible et le plus largement utilisé. La plupart des auditions des commissions d'enquête sont publiques et diffusées en direct. Toutefois, des séances à huis-clos peuvent être organisées lorsque des informations sensibles ou confidentielles sont en jeu, par exemple lorsque des ambassadeurs, des juges ou des responsables d'autorités indépendantes sont appelés à témoigner. La décision de tenir une audition en public ou à huis-clos est prise conjointement par le président et le bureau.
Les questionnaires écrits constituent un autre outil d'enquête essentiel. Ils sont préparés et envoyés par le rapporteur aux personnes convoquées par la commission et aux services ministériels concernés afin d'obtenir des faits et des données précis. Une attention particulière doit être accordée à la confidentialité de certaines informations, qui ne peuvent être rendues publiques. Les réponses à ces questionnaires sont juridiquement et politiquement contraignantes et doivent donc être rédigées avec le plus grand soin.
En outre, le rapporteur a le pouvoir de procéder à des inspections sur place et de demander tout document jugé utile à l'enquête. La simple possibilité de telles visites constitue une puissante incitation à la coopération, garantissant l'exactitude des réponses écrites et la contribution constructive des personnes interrogées aux auditions.
Les membres des commissions d'enquête peuvent également effectuer des visites sur le terrain en France et, dans certains cas, à l'étranger. Celles-ci sont particulièrement utiles dans le cadre d'enquêtes portant sur des événements localisés, tels que des catastrophes naturelles, des accidents industriels ou des dysfonctionnements dans le fonctionnement des services publics. Néanmoins, les pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés au-delà des frontières nationales.
En ce qui concerne les résultats et le suivi des commissions d'enquête, le processus aboutit à l'adoption d'un rapport final. Quelques jours avant la séance de clôture, les membres de la commission ont accès au projet de rapport. Lors de la réunion finale, la commission discute des modifications éventuelles et ensuite un vote a lieu. Comme c'est souvent le cas dans les procédures parlementaires, la majorité détermine le résultat. Lorsque la majorité est à l'origine de la création de la commission d'enquête, elle peut adopter le rapport de manière unilatérale ; toutefois, même dans ce cas, des efforts sont généralement déployés pour obtenir un consensus plus large afin de renforcer la crédibilité du rapport et son impact médiatique.
Une conférence de presse est ensuite organisée pour présenter les conclusions du rapport, mettre en évidence les manquements identifiés et annoncer les recommandations de la commission d'enquête. En règle générale, le rapport final comprend entre dix et vingt recommandations spécifiques visant notamment à modifier la législation ou la réglementation. Dans certains cas, le rapport peut conduire au dépôt d'une proposition de loi ou à la modification d'un projet de loi déjà en discussion. Lorsque des infractions pénales potentielles sont découvertes, la commission d'enquête peut renvoyer l'affaire au ministère de la Justice ou directement au procureur général, déclenchant ainsi une procédure judiciaire.
4. Séance de Questions - Réponses
Lors de la séance de questions-réponses, les participants ont interrogé les orateurs sur les pouvoirs des commissions d'enquête, leurs interactions et leurs différences avec les procédures judiciaires, y compris les règles relatives à la confidentialité et à la publicité, le recours éventuel à des procédures judiciaires pour empêcher une enquête parlementaire de poursuivre ses travaux, les droits individuels des personnes entendues, en particulier lorsque les auditions sont publiques et diffusées en direct, et la possibilité de faire appel lorsque ces droits sont violés, et enfin sur les ressources humaines consacrées aux commissions d'enquête au sein des administrations parlementaires.
E. SESSION 2 - POUVOIRS, MÉTHODES ET TECHNIQUES D'INVESTIGATION
1. Les ressources des commissions d'enquête parlementaires et la méthodologie utilisée pour recueillir des informations, M. Frank RAUE (Bundestag - Allemagne)
En m'appuyant sur mon expérience au sein de quatre commissions d'enquête parlementaires, je voudrais donner un bref aperçu des ressources dont disposent ces commissions et de la méthodologie qu'elles utilisent pour recueillir des preuves.
Les commissions d'enquête parlementaires disposent de trois sources principales de preuves : les documents, les témoins et les experts. Les commissions ont également le pouvoir d'effectuer des inspections sur place, par exemple dans des installations utilisées pour stocker des déchets nucléaires, bien que ces visites ne soient pas courantes. Dans la pratique, le travail d'enquête consiste principalement à collecter et à examiner des documents, à interroger des témoins et à consulter des experts en la matière.
Les auditions de témoins sont généralement basées sur des documents que la personne entendue a rédigés, signés ou reçus. Par conséquent, l'une des toutes premières mesures prises par une commission nouvellement créée consiste à adopter une série de résolutions demandant la présentation de documents par les organes gouvernementaux concernés. Ces résolutions se fondent sur des motions présentées par un ou plusieurs groupes parlementaires. Il convient de noter que si une telle motion est soutenue par au moins un quart des membres de la commission, celle-ci est tenue de l'adopter.
Les motions visant à recueillir des preuves sont généralement rédigées par le personnel des groupes parlementaires à l'origine de la demande. Le secrétariat de la commission participe rarement à ce processus de rédaction. À ce stade, ses principales responsabilités sont plutôt d'ordre logistique : transmettre les résolutions adoptées aux services gouvernementaux concernés, clarifier les méthodes privilégiées pour la remise des documents, recevoir et organiser les soumissions, et mettre les documents à la disposition des membres de la commission.
Chaque ministère concerné par l'enquête désigne un agent de liaison auprès de la commission. Cette personne assiste aux réunions de la commission et sert de point de contact principal pour le secrétariat. Lorsque les documents sont soumis sous forme papier, le secrétariat les numérise et les télécharge sur le serveur de la commission, accessible à tous les membres et au personnel des groupes parlementaires. Ces dernières années, cependant, la plupart des documents soumis par le gouvernement ont été transmis par voie électronique, généralement via des clés USB. Le secrétariat transfère ces fichiers vers le serveur de la commission. Dans le cas de documents classifiés, des procédures spéciales s'appliquent. Ces documents sont remis dans des locaux sécurisés au sein du Bundestag, où ils sont copiés sur des ordinateurs portables désignés à cet effet. L'accès à ces ordinateurs portables est strictement limité à des salles sécurisées, bien qu'ils puissent être temporairement apportés dans la salle de réunion de la commission lorsque cela est nécessaire pour des auditions couvertes par le secret.
Une fois les documents mis à disposition, ils sont examinés et analysés principalement par le personnel des groupes parlementaires. Ces documents permettent souvent d'identifier de nouveaux témoins potentiels ou de déterminer la nécessité de demander des documents supplémentaires. Lorsqu'un groupe parlementaire identifie un témoin pertinent grâce à son analyse, il peut demander une résolution visant à accorder à cette personne le statut officiel de témoin. Si le groupe détient au moins un quart des sièges de la commission, la résolution doit être adoptée. Dans le cas contraire, le groupe doit obtenir le soutien d'autres groupes parlementaires. Il arrive fréquemment que plusieurs groupes identifient les mêmes personnes clés à entendre, ce qui donne lieu à des motions ou propositions conjointes soumises par le président au nom de tous les groupes parlementaires.
Grâce à ce processus itératif, la commission établit progressivement une liste complète des témoins à convoquer au cours de son enquête.
Cependant, l'inscription d'un nom sur la liste des témoins potentiels ne signifie pas automatiquement que la personne sera convoquée. Les hauts responsables des groupes parlementaires se réunissent régulièrement pour délibérer sur les témoins à entendre et l'ordre dans lequel ils le seront. Le résultat de ces discussions est soumis aux porte-paroles des groupes parlementaires, qui approuvent généralement la proposition. Celle-ci est ensuite officiellement adoptée lors de la réunion suivante de la commission. C'est ainsi que le calendrier des auditions de témoins prend progressivement forme.
Au début de l'enquête, le calendrier est généralement défini à court terme et ne couvre que la ou les deux prochaines sessions d'auditions. Cependant, à mesure que l'enquête avance, le calendrier devient plus complet et plus prospectif. Une approche courante consiste à structurer les auditions par ministère : les témoins d'un ministère sont interrogés à tour de rôle avant de passer à un autre. Au sein de chaque ministère, les auditions commencent souvent par les fonctionnaires des échelons inférieurs de la hiérarchie, suivis de leurs supérieurs directs, puis des fonctionnaires de rang supérieur, pour aboutir aux témoignages des directeurs ministériels ou des membres du gouvernement. Ces dernières auditions sont largement considérées comme le point culminant de l'enquête.
Le secrétariat n'est généralement pas impliqué dans la planification stratégique de l'ordre des témoignages, qui reste du ressort exclusif des groupes parlementaires. Une fois qu'un consensus a été atteint, généralement communiqué par le chef de cabinet du plus grand parti au pouvoir, le secrétariat est chargé de mettre en oeuvre les décisions. Cela comprend la préparation des réunions, l'organisation logistique et la mise en oeuvre des résolutions de la commission, par exemple en envoyant des invitations officielles aux témoins et en s'assurant que les autorisations appropriées pour leur témoignage sont obtenues.
Le rythme hebdomadaire des commissions d'enquête suit un schéma bien établi, qui est souvent le suivant : le mardi, les hauts responsables des groupes parlementaires se réunissent ; le mercredi, les porte-paroles se réunissent ; et le jeudi, la commission elle-même se réunit. Les réunions de la commission sont généralement divisées en deux parties. Tout d'abord, une séance à huis clos est organisée pour délibérer sur des questions de procédure, telles que le calendrier des auditions des témoins ou l'adoption de nouvelles résolutions visant à recueillir des preuves. Vient ensuite la réunion publique (mais non retransmise), au cours de laquelle les témoins sont officiellement interrogés.
Une réunion type comprend l'audition de trois à quatre témoins, interrogés individuellement. Le processus commence par l'invitation faite au témoin de présenter un compte rendu ininterrompu de son propre point de vue. Viennent ensuite les questions des membres de la commission, à commencer par celles du président. Ce dernier peut s'appuyer sur un questionnaire préparé à l'avance par le secrétariat. Ces questionnaires commencent généralement par des questions de base sur les antécédents professionnels du témoin, la mission de son ministère ou de son unité et ses responsabilités spécifiques. D'autres questions portent sur la manière dont le témoin s'est préparé à l'audition.
Il est important de noter que ces questionnaires ne sont pas communiqués aux témoins à l'avance ; il s'agit d'outils strictement internes destinés à aider le président et les membres de la commission à structurer leurs questions. La seconde partie du questionnaire aborde généralement des questions de fond, confrontant le témoin à des documents qu'il a rédigés, signés ou reçus, ou à des témoignages fournis précédemment par d'autres témoins.
Une fois que le président a terminé sa série de questions - qui peut ou non suivre le questionnaire préparé -, la parole est donnée aux autres membres de la commission, qui sont libres de poser leurs propres questions. Le président conserve toute latitude quant au nombre de sujets abordés et au déroulement de l'audition.
Les auditions des témoins sont structurées en plusieurs séries de questions, chacune durant généralement environ une heure. Au sein de chaque série, le temps est réparti entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur taille. Si le président appartient à un groupe de la coalition au pouvoir, le premier créneau après la première série de questions du président est attribué au plus grand groupe d'opposition, suivi du groupe partenaire de la coalition au pouvoir, puis du deuxième plus grand groupe d'opposition, et ainsi de suite. Cette alternance entre les partis majoritaires et les partis d'opposition garantit une dynamique équilibrée tout au long de l'interrogatoire.
Une fois la première série terminée, le président invite les membres à indiquer s'ils ont d'autres questions à poser. Dans la plupart des cas, cela donne lieu à des séries de questions supplémentaires - une deuxième, une troisième et parfois même une quatrième ou une cinquième - jusqu'à ce que toutes les questions aient été épuisées. Les questions posées par les membres sont généralement préparées à l'avance par le personnel de leurs groupes parlementaires respectifs. Il n'y a généralement pas de coordination entre les groupes concernant le contenu ou l'ordre de leurs questions, et certainement pas de stratégie d'interrogatoire coordonnée de manière centralisée par le président ou le secrétariat de la commission.
Cette approche décentralisée et non coordonnée entraîne inévitablement certains doublons, les témoins se voyant poser plusieurs fois les mêmes questions ou des questions similaires. À l'inverse, des sujets importants peuvent parfois être laissés de côté. D'un point de vue procédural, les auditions menées de cette manière peuvent sembler moins structurées et moins efficaces que celles qui se tiennent devant un tribunal. Néanmoins, ce manque apparent de coordination peut parfois donner lieu à des observations surprenantes et précieuses, issues de l'interaction spontanée entre différentes personnes.
En règle générale, plusieurs semaines s'écoulent entre la création officielle d'une commission et le début des auditions des témoins. Cela s'explique principalement par le fait que la sélection des témoins dépend de l'analyse des documents pertinents, qui doivent d'abord être demandés, soumis, examinés et interprétés. Pendant cette période intermédiaire, les commissions organisent souvent une ou deux auditions d'experts. Celles-ci se déroulent de manière similaire aux consultations d'experts organisées par les commissions législatives.
Les groupes parlementaires désignent plusieurs experts qui seront nommés par la commission. La commission convient ensuite d'une série de questions, et les experts sont invités à fournir des réponses écrites, qui serviront de base à une audition publique ultérieure. Les experts ne sont généralement pas tenus d'analyser les éléments de preuve recueillis par la commission. Ils fournissent plutôt des conseils d'interprétation sur des questions juridiques, procédurales ou scientifiques et contribuent à éclaircir les débats conceptuels ou académiques plus larges liés à l'enquête. Leurs déclarations, présentées lors de l'audition, servent à valider le rapport final de la commission en tant qu'avis « d'experts sur l'état de la question» et sont souvent citées comme des références faisant autorité.
Dans certains cas, cependant, les commissions d'enquête parlementaires peuvent nommer des enquêteurs plutôt que des experts. Un exemple notable concerne l'enquête menée en 2020 sur l'effondrement de la société Wirecard. La commission a obtenu une documentation complète relative aux audits financiers de la société. Afin d'analyser de manière approfondie ces documents techniques, la commission a engagé quatre experts-comptables agréés. Ces personnes n'ont pas été nommées en tant qu'experts au sens traditionnel du terme, mais plutôt en tant qu'enquêteurs, chargés spécifiquement d'examiner et d'interpréter des données financières et des dossiers d'audit complexes. Mais qu'est-ce qu'un enquêteur exactement ? Dans le contexte allemand, un enquêteur - ou Ermittlungsbeauftragter, que l'on pourrait également traduire par « commissaire d'enquête » - est une personne nommée par une commission d'enquête parlementaire pour soutenir et préparer le travail d'enquête de la commission. Cette fonction a été introduite par la loi de 2001 sur les commissions d'enquête, plus précisément à l'article 10 de cette loi.
Depuis l'adoption de cette disposition légale, 19 commissions d'enquête parlementaires ont été créées. Parmi celles-ci, huit ont eu recours à ce mécanisme, nommant collectivement 14 enquêteurs. Parmi les personnes sélectionnées figuraient d'anciens membres du Parlement, des juges ou procureurs à la retraite, d'autres hauts fonctionnaires et, comme mentionné précédemment, des experts-comptables agréés.
Le mandat de l'enquêteur consiste généralement à examiner des documents, à identifier les preuves pertinentes et à interroger les personnes susceptibles d'être appelées à témoigner. Il est important de noter que les enquêteurs ne se limitent pas aux preuves déjà soumises à la commission ; ils ont le pouvoir de demander des documents supplémentaires et de mener des entretiens préliminaires avec des personnes qui ne sont pas encore officiellement reconnues comme témoins. Cependant, la coopération avec un enquêteur est entièrement volontaire : les personnes interrogées ne sont soumises à aucune obligation légale de se conformer à cette coopération.
Les enquêteurs rendent compte de leurs conclusions à la commission, tant oralement que par écrit. Ils peuvent recommander à la commission de poursuivre certaines pistes d'enquête ou d'interroger des personnes spécifiques. Néanmoins, ces recommandations ne sont pas contraignantes. La commission reste pleinement autonome et peut agir indépendamment des conclusions de l'enquêteur, en choisissant de suivre ou non les conseils reçus.
Les raisons de nommer des enquêteurs sont multiples et se recoupent souvent. Ils peuvent être particulièrement utiles lorsque les commissions sont confrontées à des contraintes de temps, lorsqu'il y a un volume important de preuves à analyser ou lorsque le nombre de témoins potentiels est particulièrement élevé. Dans de tels cas, les enquêteurs peuvent proposer des évaluations préliminaires des preuves, aider à hiérarchiser les pistes d'enquête ou proposer des listes de témoins adaptées au délai disponible.
En outre, l'analyse de documents complexes ou techniques, tels que des audits financiers ou des rapports spécialisés, peut nécessiter des compétences que ni les membres de la commission ni leur personnel ne possèdent. Dans le cadre de l'enquête sur Wirecard, par exemple, ce manque d'expertise a été comblé par la nomination d'enquêteurs ayant une formation professionnelle en comptabilité.
Une question connexe concerne l'accès à des documents sensibles, souvent classifiés, en particulier ceux détenus par les services de renseignement ou les autorités policières. Compte tenu du caractère sensible de ces documents, le pouvoir exécutif peut être tenté d'interpréter de manière très restrictive le champ d'application du mandat de la commission afin d'éviter une divulgation trop large. Dans ces cas, la nomination d'un enquêteur de confiance - en particulier un ancien juge ou un haut fonctionnaire du ministère de la Justice - peut constituer une solution de compromis. Les autorités peuvent être plus disposées à accorder l'accès à des documents sensibles si elles savent qu'ils seront d'abord examinés uniquement par l'enquêteur désigné qui, fort de son expérience et de son expertise, évaluera leur pertinence et leur importance pour la commission. Cet arrangement permet d'éviter, ou du moins de réduire, le risque de longues batailles juridiques entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Sur le plan procédural, un enquêteur doit être nommé si au moins un quart des membres de la commission en font la demande. Une résolution distincte est alors nécessaire pour désigner la personne qui exercera cette fonction. Cette résolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers, ce qui garantit qu'aucun enquêteur ne sera nommé sans un large soutien de tous les partis. Une fois nommés, les enquêteurs agissent en toute indépendance dans le cadre de leur mandat et ont droit à être assisté par un membre du personnel. Dans la pratique, l'administration du Bundestag affecte généralement deux ou trois fonctionnaires pour les assister.
2. Les limites juridiques et pratiques aux pouvoirs d'enquête, Mme Rita NOBRE (Assembleia da Republica - Portugal)
Je travaille à la Division du soutien aux commissions du Parlement portugais et j'ai été invitée à parler des limites juridiques et pratiques des pouvoirs des commissions d'enquête parlementaires . Je commencerai par donner un aperçu de ces pouvoirs tels qu'ils sont reconnus par la législation portugaise, avant de présenter les principales restrictions qui s'appliquent à leur exercice.
Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi les pouvoirs des commissions d'enquête peuvent poser des défis et pourquoi ils doivent nécessairement être circonscrits : les enquêtes parlementaires ne peuvent pas prévaloir sur les droits constitutionnels ou les garanties juridiques.
Les commissions d'enquête constituent un mécanisme essentiel au sein de l'Assembleia da República, notamment pour l'exercice du contrôle politique. Leur fondement juridique se trouve dans la loi régissant les enquêtes parlementaires, au sein de laquelle l'article 13 joue un rôle central. Cette disposition précise que les commissions d'enquête bénéficient des mêmes pouvoirs d'enquête que les autorités judiciaires, du moins dans la mesure où ces pouvoirs ne sont pas constitutionnellement réservés à ces autorités. Ces pouvoirs comprennent notamment la capacité d'obtenir la coopération des organismes publics, ce qui implique le droit d'être assisté par les autorités judiciaires et administratives, ainsi que par les forces de police criminelle, dans les mêmes conditions qu'un tribunal. Les commissions d'enquête peuvent également demander des informations et des documents aux ministères, à l'administration publique, aux autorités de régulation indépendantes et aux entités privées. De plus, elles sont habilitées à convoquer tout citoyen à témoigner, y compris les membres du gouvernement ou les représentants d'institutions publiques ou privées.
Témoigner devant une commission d'enquête implique une stricte obligation légale de dire la vérité. Les témoins peuvent être pénalement responsables de faux témoignage de la même manière que s'ils témoignaient devant un tribunal.
Où commencent les difficultés entourant ces pouvoirs ? La réponse se trouve une fois de plus à l'article 13 de la loi sur les commissions d'enquête. Le fait que les commissions d'enquête au Portugal bénéficient de prérogatives d'enquête comparables à celles des autorités judiciaires signifie que leurs procédures partagent inévitablement certaines caractéristiques avec les procédures judiciaires. Cependant, il existe une différence fondamentale dans la nature et le but de ces organes. Les tribunaux sont chargés de déterminer la responsabilité juridique, qu'elle soit civile, pénale ou administrative. En revanche, les commissions d'enquête se concentrent uniquement sur la responsabilité politique et la fourniture d'informations au Parlement. Elles ne sont autorisées, en aucune circonstance, à rendre des jugements contraignants. C'est cette distinction qui permet de mener des enquêtes parlementaires et des enquêtes judiciaires sur les mêmes faits en parallèle.
En pratique, lorsqu'une commission d'enquête est établie au Portugal, celle-ci demande d'abord des informations à la Cour suprême pour savoir si des procédures judiciaires sont déjà en cours concernant l'affaire en question. Si de telles procédures existent, la commission peut décider de poursuivre ou de suspendre son enquête. Dans la plupart des cas, les deux procédures se déroulent en parallèle.
Cependant, un problème majeur se pose avec la rédaction de l'article 13 lui-même. Sa formulation délibérément large comporte à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, elle offre une flexibilité précieuse, permettant aux commissions de s'adapter à la nature très diverse des sujets qu'elles étudient. D'autre part, cela crée une incertitude interprétative et des frictions juridiques potentielles. La raison d'être de cette rédaction large repose sur trois considérations principales :
- tout d'abord, il s'agit d'offrir à la commission une flexibilité opérationnelle compte tenu de la nature hétérogène de ses mandats ;
- deuxièmement, elle permet d'établir un certain degré d'équivalence entre les commissions d'enquête et les instances judiciaires en termes de légitimité et d'autorité ;
- troisièmement, elle empêche l'obstruction institutionnelle en décourageant les acteurs publics ou privés d'exploiter les ambiguïtés juridiques pour éviter de coopérer avec les commissions d'enquête.
Cependant, le caractère très large de l'article 13 soulève plusieurs préoccupations importantes. Le manque de clarté peut conduire à des interprétations divergentes, en particulier lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, tels que le droit à la vie privée, la protection des données ou la présomption d'innocence. Les frontières institutionnelles ne sont pas toujours clairement définies, notamment entre les compétences des commissions d'enquête et le ministère public. Dans certains cas, les tribunaux ont été appelés à revenir sur des décisions de commissions d'enquête, par exemple lorsque la demande de documents a été contestée.
Il est donc essentiel de reconnaître que les pouvoirs des commissions d'enquête ne sont pas illimités. Malgré la latitude accordée par l'article 13, il existe des limites bien connues qui peuvent être invoquées pour refuser de coopérer ou de soumettre des documents à une commission. La principale limite est le respect des droits et libertés constitutionnels. Les commissions d'enquête doivent respecter le droit à la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, le droit à une bonne réputation, le droit de ne pas témoigner contre soi-même et le droit à un avocat. Les décisions des commissions d'enquête peuvent également faire l'objet d'un contrôle judiciaire.
Une autre limite importante concerne la confidentialité protégée par la loi. Certaines questions sont soumises à un secret juridique strict, qui ne peut être levé que dans des circonstances étroitement définies. Cela inclut les secrets d'État, le secret judiciaire (en particulier lorsqu'il s'agit de procédures pénales en cours), le secret professionnel pour les journalistes, les avocats et les professionnels de la santé, ainsi que le secret bancaire et fiscal.
La restriction peut-être la plus fondamentale découle du principe de séparation des pouvoirs. En vertu de ce principe, il est interdit aux commissions d'enquête d'intervenir dans les procédures judiciaires ou de compromettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, même si le système juridique portugais permet que des enquêtes parlementaires soient menées parallèlement à des enquêtes judiciaires. Bien que les commissions puissent enquêter sur les mêmes faits, elles ne peuvent pas rendre de décisions ayant force de loi ou se substituer aux tribunaux.
Ces dernières années, plusieurs controverses notables ont émergé concernant les limites des pouvoirs d'enquête parlementaires. Un cas particulièrement illustratif était la dernière commission d'enquête au Portugal, qui a fonctionné entre avril 2024 et avril 2025. Cette commission a examiné les circonstances entourant l'administration de Zolgensma - un traitement très coûteux pour un trouble génétique rare - à deux jumeaux luso-brésiliens. L'enquête a rencontré de multiples contraintes juridiques, ce qui a incité à adopter diverses stratégies pour préserver son rôle tout en restant dans les limites de la loi.
La première limite rencontrée concernait les obligations de secret professionnel et de protection des données. Pour remédier à cela, la commission a accepté la soumission de documents expurgés ou anonymisés, en particulier lorsqu'il s'agissait de renseignements médicaux ou personnels sensibles. Cette approche visait à trouver un équilibre entre le besoin de la commission d'accéder aux documents pertinents et le respect strict de la législation sur la protection des données.
Parallèlement, la commission a constamment réaffirmé que son mandat n'était pas d'établir une responsabilité juridique mais plutôt d'évaluer la responsabilité politique et de promouvoir la transparence institutionnelle. Cette précision s'est avérée essentielle pour justifier la réception de certaines informations dans le cadre du contrôle parlementaire.
Une deuxième contrainte découle du droit à la vie privée et de la protection de son image. En règle générale, les auditions des commissions d'enquête au Portugal sont publiques. Cependant, la loi permet des exceptions, sous réserve de l'approbation de la commission. Dans cette affaire, une audition à huis clos a été autorisée pour un témoin afin de respecter ses droits constitutionnels.
La troisième limite concernait le refus de transmettre des documents pour des raisons de protection des données personnelles, notamment médicales. En réponse, la commission a consulté les services juridiques de l'Assembleia da República pour obtenir des conseils sur la façon de procéder. Encore une fois, elle a souligné la nature politique- non judiciaire - de son travail pour appuyer sa demande.
Une autre question importante concernait le droit de garder le silence. La commission a convoqué deux personnes qui étaient des défendeurs dans une procédure pénale en cours. Tous deux ont comparu devant la commission mais ont choisi d'invoquer leur droit de garder le silence. La commission était obligée de respecter cette décision. Cependant, les membres de la commission souhaitaient néanmoins les interroger. Dans de tels cas, la portée des interrogatoires a été soigneusement limitée à des questions d'intérêt politique ou administratif, excluant explicitement tout sujet susceptible d'interférer avec les processus judiciaires en cours.
Un autre épisode illustratif concernait le nom de la commission elle-même. Étant donné que l'enquête portait sur deux jeunes enfants, on a commencé à utiliser informellement le nom « commission des jumeaux ». Cependant, la mère des enfants, qui publiait par ailleurs régulièrement des images des enfants sur les réseaux sociaux, a saisi la Cour suprême, affirmant que cette désignation portait atteinte au droit des enfants à la vie privée et à leur bonne réputation. Bien que la décision du tribunal ait été ambiguë, elle a généralement été perçue comme favorable au requérant. En réponse, la commission a officiellement adopté son nom officiel complet et a cessé d'utiliser la désignation informelle-suivant les instructions du président de l'Assembleia da República. Bien que de nombreux membres de la commission aient estimé que ces questions relevaient exclusivement des prérogatives constitutionnelles du Parlement, ils ont accepté le changement comme un geste de bonne volonté institutionnelle.
En conclusion, les commissions d'enquête parlementaires au Portugal disposent de pouvoirs d'enquête solides, mais ces pouvoirs ne sont pas illimités, notamment dans les affaires impliquant des procédures judiciaires parallèles. L'article 13 du régime juridique régissant les commissions d'enquête parlementaires, qui constitue la base juridique de ces pouvoirs, est délibérément large. Bien que cela permette une flexibilité et une adaptabilité, cela favorise également l'incertitude et la confusion interprétative concernant le champ de l'action autorisée.
La récente commission d'enquête concernant l'affaire Zolgensma illustre à quel point les limites des enquêtes parlementaires peuvent être testées. En pratique, chaque nouvelle commission cherche souvent à innover sur le plan procédural, mais dans certains cas cela s'est avéré peu judicieux. À mon avis, il est essentiel d'élaborer un cadre juridique plus clair capable de concilier les fonctions d'enquête des commissions d'enquête parlementaires avec leurs limites constitutionnelles. Un tel cadre devrait s'appuyer sur la jurisprudence, l'expérience institutionnelle et les précédents établis par des commissions d'enquête antérieures. Sans une telle clarification, nous continuerons d'entendre dire, comme on le dit souvent au Portugal, que les « commissions d'enquête parlementaires ne sont pas des tribunaux - et qu'elles ne peuvent pas agir comme si elles l'étaient ».
3. La pratique des commissions d'enquête parlementaires à la Chambre des représentants des Pays-Bas, MM. Rob DE BAKKER et Martijn VAN HAEFTEN (Tweede Kamer - Pays-Bas)
M. Rob de BAKKER
Je vous remercie de nous donner l'occasion de partager notre expérience en matière d'enquêtes parlementaires aux Pays-Bas. Je m'appelle Rob de Bakker et je suis accompagné de mon collègue Martijn van Haeften. Nous travaillons tous deux au sein de la direction d'analyse et de recherche de la Chambre des représentants néerlandaise, c'est-à-dire la chambre basse du Parlement, et non le Sénat. Au fil des années, nous avons participé à plusieurs enquêtes parlementaires et investigations à plus petite échelle, souvent en tant que coordinateurs ou coordinateurs adjoints de recherche.
D'après ce que nous avons entendu de la part de nos collègues d'autres pays, il existe de nombreux points de convergence dans nos pratiques respectives, mais aussi des différences notables. Dans cette présentation, nous aimerions mettre en évidence les deux aspects. Pour commencer, nous avons cherché des documents sur notre propre participation à des enquêtes, et nous avons trouvé une photo de l'enquête sur la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Amsterdam et Bruxelles. Elle nous montre en train d'assister le président de la commission lors d'un débat en plénière.
Nous examinerons plusieurs aspects clés de notre système, tels qu'ils sont décrits dans les réponses au questionnaire que nous avons soumises au CERDP. Nous reviendrons également sur les difficultés rencontrées récemment dans le cadre de nos dernières commissions d'enquêtes.
Commençons par la base juridique. Le droit d'enquête parlementaire existe dans la Constitution néerlandaise depuis 1848. Il est accordé aux deux chambres, mais dans la pratique, seule la Chambre des représentants l'a exercé. Le Sénat n'a jamais mené d'enquête parlementaire. Cela peut s'expliquer par des différences d'échelle, le Sénat néerlandais étant nettement plus petit.
Parmi les pouvoirs spécifiques accordés aux commissions d'enquête, deux se distinguent. Premièrement, la possibilité de convoquer des personnes pour qu'elles témoignent sous serment lors d'auditions publiques, une obligation légale qu'ils ne peuvent refuser. Deuxièmement, le droit d'exiger la production de documents et d'informations, un pouvoir qui dépasse celui dont dispose habituellement le Parlement dans le cadre de ses travaux ordinaires. En outre, comme cela a été mentionné aujourd'hui, les commissions peuvent également effectuer des visites sur place. Nous avons entendu précédemment que ces visites peuvent avoir un impact majeur, nous pensons donc qu'il pourrait être utile d'étudier les moyens d'utiliser cet outil plus efficacement dans la pratique.
Les objectifs officiels de nos enquêtes sont la recherche de la vérité et la compréhension de faits. Cependant, elles poursuivent souvent des objectifs supplémentaires, moins explicites. Ceux-ci peuvent inclure la responsabilité publique et, de manière plus ambitieuse, le rétablissement de la confiance du public dans le gouvernement. Comme l'ont fait remarquer certains membres d'une commission d'enquête pour laquelle nous avons travaillé, « nous pouvons contribuer à rétablir la confiance, mais nous ne pouvons pas le faire seuls ». D'autres vont encore plus loin et parlent d'une « fonction de purification publique » des enquêtes, c'est-à-dire d'un effort pour affronter les échecs passés et tourner la page.
En raison de ces attentes élevées, les commissions d'enquêtes aux Pays-Bas sont considérées comme des exercices importants et solennels, parfois comme « l'enquête qui mettra fin à toutes les enquêtes ». Cela explique pourquoi elles ont tendance à être plus longues et plus complexes que les enquêtes plus rapides menées par d'autres organes parlementaires dans d'autres pays.
Dans la salle dédiée aux commissions d'enquête, les membres siègent face à la personne entendue. Toutes les auditions sont diffusées en direct à la télévision nationale. Mark Rutte, notre ancien Premier ministre est sans doute le témoin le plus expérimenté de l'histoire parlementaire néerlandaise. Ayant occupé le poste de Premier ministre pendant quatorze ans, il a été entendu à de nombreuses reprises devant des commissions d'enquête. En tant que chef du gouvernement, il assume en dernier ressort la responsabilité politique de nombreuses questions faisant l'objet d'un examen.
Cette audition particulière s'est tenue dans le cadre de l'enquête sur la ligne ferroviaire à grande vitesse. Comme vous pouvez le constater, les enquêtes parlementaires aux Pays-Bas sont traitées avec le plus grand sérieux.
En termes de quantité, nous avons mené moins d'enquêtes que certains de nos collègues dans d'autres pays, notamment la France. Cependant, celles qui ont été lancées concernent généralement des défaillances ou des crises à grande échelle ayant un impact significatif sur le public ou le gouvernement. Parmi les commissions d'enquêtes auxquelles j'ai personnellement participé, citons celles sur le projet de train à grande vitesse, le programme de lutte contre la fraude et, plus récemment, la pandémie de COVID-19, que nous avons commencé à traiter un peu plus tard que d'autres pays.
Les enquêtes parlementaires néerlandaises sont généralement des entreprises de longue haleine, qui durent souvent entre 18 et 24 mois. En fait, elles s'allongent avec le temps. L'un des facteurs qui contribue à cette situation est la fragmentation croissante de notre Parlement. Avec de nombreux partis politiques représentés, les commissions d'enquête nécessitent des majorités larges et stables pour fonctionner efficacement. Les délais que je viens de mentionner reflètent la durée nette de la phase d'enquête. Si l'on inclut les travaux préparatoires effectués par une commission préliminaire dédiée, qui durent généralement environ cinq mois, la durée totale dépasse souvent deux ans.
Les cycles électoraux constituent un défi supplémentaire. Aux Pays-Bas, les élections sont fréquentes et peuvent avoir lieu à intervalles rapprochés. Malgré cela, les commissions d'enquête se sont jusqu'à présent toujours poursuivies au-delà des cycles électoraux, avec le soutien suffisant d'une large majorité. Cela dit, la continuité future n'est jamais garantie.
Je me souviens d'une anecdote tirée de l'enquête sur le train à grande vitesse qui illustre les exigences logistiques de ces enquêtes : nous avons dû demander une évaluation structurelle des sols de notre bâtiment en raison de la quantité importante de documents physiques. Cela remonte à plus de dix ans et a marqué le début de notre transition vers la collecte de documents numérisés, une transition qui est désormais achevée et qui est aujourd'hui essentielle, compte tenu du volume toujours croissant d'informations que nous collectons.
La structure des enquêtes néerlandaises suit globalement toujours le même modèle. Toutes les phases de l'enquête sont fondées sur des décisions formelles prises à la majorité. Une caractéristique distinctive de notre procédure réside dans les auditions préparatoires confidentielles qui suivent la phase intensive d'examen des documents. Nous organisons généralement entre 80 et 130 de ces auditions à huis clos, sur une base volontaire. La participation n'est pas une obligation légale, mais la plupart des témoins acceptent d'y participer. Ces auditions préparatoires impliquent généralement également des fonctionnaires subalternes et du personnel ministériel. En revanche, les auditions publiques se concentrent sur les hauts responsables : ministres, hauts fonctionnaires et autres décideurs. Le nombre d'auditions publiques est beaucoup plus restreint, généralement entre 40 et 80.
Dans notre modèle, les auditions publiques marquent la première véritable apparition publique de la commission. Jusqu'alors, celle-ci fonctionne en toute discrétion, « sous le radar ». Les auditions publiques ont généralement lieu après un an ou plus de travail confidentiel et servent à tester les éléments clés de l'enquête sous serment, comblant ainsi les lacunes restantes dans le récit. Elles attirent également une attention considérable de la part des médias et, dans certains cas, deviennent le véritable point culminant du processus d'enquête, ce qui ajoute une pression supplémentaire à la phase finale de rapport.
L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés consiste à obtenir le soutien de la majorité. Comme je l'ai mentionné, notre paysage politique est très fragmenté : à l'heure actuelle, 15 partis sont représentés au Parlement. Cela rend la recherche d'un consensus complexe. Ainsi, la semaine dernière, notre gouvernement de coalition a éclaté entraînant la démission de ses membres. Cela entraînera inévitablement des changements dans la composition de la commission d'enquête en cours. Celle-ci se poursuivra probablement, mais peut-être avec de nouveaux membres.
Martijn van HAEFTEN
Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements envers tous les autres intervenants. Je travaille dans ce domaine depuis plus de dix ans, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion d'échanger directement avec des collègues d'autres pays qui exercent des fonctions similaires. Cette expérience a été à la fois stimulante et enrichissante.
Comme mon collègue l'a mentionné précédemment, les enquêtes parlementaires néerlandaises ont tendance à être longues, ce qui peut parfois être une source de frustration pour les politiciens qui privilégient des processus plus rapides. En réponse à ces préoccupations, la Chambre des représentants a adopté en 2015 une motion demandant de tester des enquêtes plus courtes. Cela a conduit à l'élaboration d'un protocole spécial pour ce qu'on a appelé les « interrogatoires parlementaires ». L'idée derrière ce nouveau format était de mener des enquêtes condensées axées presque exclusivement sur des auditions publiques. Ceci consistait ainsi à contourner l'analyse fastidieuse des documents et les entretiens préparatoires confidentiels, pour passer rapidement à des auditions en direct menées par des parlementaires déjà familiarisés avec le sujet faisant l'objet de l'enquête
Cette approche contrastait avec celle des commissions d'enquête traditionnelles, qui sont généralement menées par des parlementaires n'ayant aucune implication préalable dans le sujet, une caractéristique visant à garantir la neutralité et une perspective d'ouverture d'esprit. Les interrogatoires ne devaient pas durer plus de quelques semaines ou quelques mois. Au cours de la phase expérimentale, trois interrogatoires de ce type ont été menés. Rob et moi avons participé à l'un d'entre eux, concernant le scandale des allocations familiales, une affaire très médiatisée qui a généré une pression politique et publique intense. L'enquête devait être menée à bien rapidement en raison des élections imminentes, et le rapport final a été publié juste à temps. Elle a finalement contribué à la démission du gouvernement, même si la proximité des élections a limité l'impact politique de cette conséquence.
À la suite du troisième « interrogatoire », une évaluation officielle de l'expérience a été menée. La conclusion était que la réglementation et le protocole distincts régissant ces interrogatoires raccourcis n'étaient plus nécessaires. Si une commission d'enquête parlementaire ordinaire souhaitait adopter un calendrier plus rapide, elle était libre de le faire sans cadre particulier. Dans la pratique, cependant, l'expérience a été effectivement arrêtée et aucun nouvel interrogatoire parlementaire n'a été lancé. L'une des raisons à cela est le nombre croissant de groupes politiques au Parlement. Chaque parti apporte ses propres questions et priorités, ce qui conduit à un élargissement progressif de la portée de l'enquête et rend difficile le maintien d'un processus court et ciblé.
De plus, l'expérience a démontré que même les auditions publiques nécessitent une base probatoire solide, comprenant notamment l'analyse de documents et une préparation préalable. Le fait de négliger ces étapes essentielles réduit considérablement la qualité et la crédibilité des auditions. En bref, la promesse d'une procédure rapide s'est avérée difficile à tenir sans compromettre l'intégrité de l'enquête.
Revenons maintenant à nos commissions d'enquête standard : la loi néerlandaise accorde aux commissions d'enquête un mandat étendu. Il n'y a pratiquement aucune restriction formelle quant aux sujets pouvant faire l'objet d'une enquête. Cependant, les pouvoirs de la commission sont soumis à certaines contraintes, notamment le principe de proportionnalité. Lorsque la Chambre adopte une motion visant à créer une commission d'enquête, elle vote également un mandat de recherche détaillé. Toutes les mesures d'enquête ultérieures doivent être proportionnées aux termes de ce mandat.
Les entités privées conservent le droit de contester les actions de la commission devant les tribunaux si elles estiment, par exemple, que la demande de documents dépasse ce qui est justifié par les objectifs de l'enquête. Bien que rares, de telles contestations judiciaires sont possibles, et les commissions doivent en tenir compte lorsqu'elles planifient leurs travaux. Les conflits avec les ministères ne peuvent toutefois pas être réglés par des moyens juridiques ; ils doivent être résolus sur le plan politique.
Il existe également des exceptions reconnues à l'obligation de fournir des documents. Il s'agit notamment des raisons liées à la sécurité nationale, au secret commercial, à la vie privée, au secret professionnel et au secret judiciaire. Dans de tels cas, les commissions peuvent négocier des solutions telles que la suppression des contenus sensibles ou l'organisation d'un accès contrôlé aux documents confidentiels. Ces dispositions sont courantes et reflètent une approche pragmatique visant à trouver un équilibre entre les besoins de l'enquête et les préoccupations légitimes.
Comme nous l'avons vu lors des sessions précédentes, il n'existe aucune restriction légale aux commissions d'enquête menées parallèlement à des procédures judiciaires. La loi néerlandaise dispose explicitement que l'objectif d'une enquête est de rechercher la vérité et que cet objectif peut, dans certains cas, primer sur les intérêts des poursuites pénales. Afin de préserver cet équilibre, la loi prévoit également que les déclarations des témoins devant une commission d'enquête ne peuvent être utilisées comme preuves dans des procès pénaux. Ce pare-feu juridique renforce l'autonomie de l'enquête parlementaire et lui permet de se concentrer sur l'établissement des faits dans l'intérêt public.
Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques observations pratiques concernant le fonctionnement de nos commissions d'enquête et de leur personnel. En règle générale, une commission d'enquête se compose d'environ cinq parlementaires - parfois plus - issus de différents partis politiques. Malgré leurs affiliations différentes, les membres doivent collaborer étroitement et s'efforcer généralement de produire un rapport consensuel
Le secrétariat organisant les travaux est composé de fonctionnaires de la Chambre des représentants, sans aucune implication du personnel des groupes politiques. Leurs responsabilités couvrent à la fois des tâches procédurales et des tâches de recherche. Dans le cadre d'enquêtes plus importantes, nous faisons souvent appel ponctuellement à des chercheurs extérieurs et à des experts en la matière pour renforcer l'équipe. Le personnel de recherche est chargé d'effectuer l'analyse des documents, de rédiger des notes d'information à l'intention de la commission et de préparer les questionnaires pour les auditions. La plupart de ces travaux préparatoires sont effectués par le secrétariat, puis examinés, discutés et éventuellement modifiés par la commission. La rédaction du rapport final incombe également au secrétariat. Si les membres de la commission ont le dernier mot, en particulier sur les conclusions et les passages politiquement sensibles, la plupart des premières ébauches sont rédigées par l'équipe de recherche.
Une règle claire établit que toutes les communications externes pendant l'enquête sont exclusivement gérées par le président. Les autres membres de la commission ne sont pas autorisés à s'adresser à la presse pendant l'enquête. Toutefois, lors des auditions publiques, tous les membres peuvent poser des questions. Celles-ci sont généralement tirées d'un questionnaire convenu à l'avance. Si les auditions s'articulent autour de ces questions, les membres s'en écartent souvent si nécessaire en fonction des réponses des témoins. Une coordination préalable permet à chacun de connaître les domaines sensibles et les axes de questionnement envisagés par les autres.
En ce qui concerne le suivi des rapports d'enquête, une fois que le rapport final est soumis au Parlement, il est suivi d'une série de questions et réponses écrites. Cela aboutit à un débat en plénière entre la commission et l'ensemble de la chambre. Au cours de cette session, les parlementaires peuvent interroger la commission sur ses travaux, ses conclusions et ses recommandations. Le débat se termine généralement par le dépôt d'une motion, souvent par le groupe politique le plus important. Le ton de cette motion peut varier : elle peut aller d'un soutien total aux conclusions du rapport et d'une invitation pressante du gouvernement à agir, à des appréciations plus modestes ou à une simple demande de réponse du gouvernement sans soutien clair.
Ensuite, le gouvernement publie une réponse écrite au rapport, qui est à son tour débattue au Parlement. À ce stade, les membres de la commission d'enquête ne jouent plus un rôle de premier plan ; la responsabilité du débat est transférée aux porte-paroles parlementaires habituels. Il n'existe pas de mécanisme standardisé pour suivre la mise en oeuvre des recommandations. Il appartient à chaque parlementaire de veiller à ce que les conclusions de la commission continuent de faire l'objet d'une attention particulière.
Vous pouvez voir ici une photo d'un débat en plénière impliquant une commission d'enquête. Au premier rang se trouvent les membres de la commission ; juste derrière eux sont assis les membres du secrétariat, ce qui est un privilège rare, car cette section est généralement réservée aux ministres. Pour nous, fonctionnaires, participer à ces débats de manière aussi visible est une expérience unique réservée aux commissions d'enquête
Nous sommes également confrontés à certains défis contemporains. L'utilisation généralisée des applications de messagerie instantanée a suscité des inquiétudes concernant la confidentialité et l'accès aux communications pertinentes. Nous dépendons de plus en plus des outils de recherche électronique9(*) pour traiter de grands volumes de données numériques. Par exemple, lors de l'enquête sur la COVID-19, nous avons reçu plus de trois millions de documents, un volume immense qui pose de sérieuses difficultés de traitement et d'analyse.
Enfin, notre système repose traditionnellement sur le consensus. Les commissions d'enquête ont souvent été composées principalement de partis politiques centristes, ce qui facilitait la recherche d'un terrain d'entente. Cependant, avec la fragmentation politique croissante, ce modèle est mis à rude épreuve. Il devient de plus en plus difficile de former des commissions d'enquête et de parvenir à un consensus.
4. Séance de Questions - Réponses
Au cours de la séance de questions-réponses, les participants ont posé des questions sur divers sujets, notamment le suivi des recommandations des commissions d'enquête, leurs éventuelles conséquences politiques, les défis liés au grand nombre de documents et aux archives numériques et les outils utilisés pour y faire face. Les discussions ont également porté sur la publicité des auditions, les cadres juridiques et procéduraux des commissions d'enquête, la vérification de la bonne transmission des informations demandées par le gouvernement et, enfin, l'utilisation de déclarations écrites en lieu et place des auditions.
F. SESSION 3 - COLLABORATION ET CONFLITS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS, Y COMPRIS LE POUVOIR JUDICIAIRE
1. La procédure de consultation au Conseil national autrichien - Un mécanisme visant à garantir la prise en considération des activités des autorités chargées des poursuites, M. Alexander FIEBER (Nationalrat - Autriche)
Pour maintenir l'élan de ce séminaire, je serai bref et concis. Au Conseil national, la chambre basse du Parlement autrichien, nous disposons d'un mécanisme unique appelé « procédure de consultation ». Il est spécialement conçu pour garantir que les commissions d'enquête parlementaires puissent remplir leur mandat de contrôle sans interférer avec les enquêtes pénales en cours.
Commençons par une question simple : que se passe-t-il lorsqu'une commission d'enquête a l'intention de convoquer une personne qui fait également l'objet d'une enquête pénale ? Qui décide si cela est autorisé, et comment ? La procédure de consultation apporte une réponse structurée à cette question précise.
Quelques mots de contexte pour commencer. L'Autriche dispose d'un Parlement bicaméral, mais seul le Conseil national peut créer des commissions d'enquête parlementaires. Jusqu'en 2015, ces commissions ne pouvaient être créées qu'à la majorité des voix. Cependant, depuis une réforme constitutionnelle en 2015, un quart des membres du Conseil national (46 membres) peuvent créer une telle commission. Parallèlement à cette extension des droits des minorités, un ensemble complet de règles de procédure a été introduit pour régir les commissions d'enquête. L'objectif était de rendre les procédures plus prévisibles, de mettre en place des mécanismes de résolution des conflits et d'améliorer la coordination avec les autorités policières et judiciaires. Cette réforme a coïncidé avec une affaire portée devant la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant la Pologne, qui soulevait des questions similaires concernant l'équilibre des pouvoirs entre les institutions judiciaires et parlementaires. Cette affaire a également inspiré le cadre réglementaire autrichien.
La procédure de consultation est désormais inscrite au paragraphe 58 du règlement intérieur des commissions d'enquête parlementaires. Elle prévoit que les commissions doivent respecter le travail en cours des autorités judiciaires. À cette fin, la procédure instaure un dialogue entre la commission d'enquête et le ministère fédéral de la Justice. Il incombe au président de la commission d'informer le ministre de la Justice de toute décision générale relative à l'administration de la preuve, aux demandes de preuves supplémentaires ou aux déclarations des témoins.
Une figure institutionnelle importante dans ce système est le juge de procédure, un rôle unique au Parlement autrichien. Le juge assiste le président dans toutes les questions de procédure. Il travaille avec sa propre équipe, tandis que nous, c'est-à-dire le secrétariat, soutenons le déroulement global des travaux.
L'ouverture d'une procédure de consultation n'est pas automatique. Elle n'est engagée que si le ministère de la Justice estime que l'action prévue par la commission, par exemple une demande de documents, de preuves ou la convocation d'un témoin, est susceptible d'entraver une enquête en cours. Le ministère n'est pas tenu de justifier cette conviction. Une fois la demande formulée, le président de la commission est tenu d'entamer sans délai la procédure de consultation. La réunion est présidée par le président de la commission et fait toujours l'objet d'un procès-verbal écrit. La réunion doit aboutir à un accord de consultation formulé sur la base du procès-verbal.
En ce qui concerne les participants, la réunion est, en théorie, présidée par le président du Conseil national, qui peut être représenté par le deuxième ou le troisième président en cas d'indisponibilité. Dans la pratique, c'est presque toujours le premier président qui participe. Les autres participants comprennent le ministre fédéral de la Justice, le juge chargé de la procédure, le président de la commission d'enquête et les représentants des groupes parlementaires participant à la commission.
Cela dit, la pratique parlementaire s'écarte souvent quelque peu des règles officielles. Les réunions sont fréquemment présidées par une personne du cabinet du président de la commission. Outre le juge des procédures et les représentants du ministère, les réunions sont également suivies par des représentants des forces de l'ordre, le personnel des groupes parlementaires et le secrétariat commun. Cela illustre la manière dont la pratique évolue souvent au-delà de la lettre stricte du paragraphe 58.
L'accord de consultation est rédigé par le ministère de la Justice sur la base du procès-verbal de la réunion. Il doit préciser par écrit comment les activités des autorités chargées de l'application de la loi et certaines mesures d'enquête seront prises en compte par l'adoption d'ajustements procéduraux spécifiques. Le président de la commission ne contribue pas au contenu de l'accord, mais assure, par l'intermédiaire de son cabinet, la coordination formelle et la conclusion du processus. Le contenu est coordonné conjointement entre le ministère et les groupes parlementaires concernés.
Un équilibre attentif doit être trouvé entre les intérêts des autorités de poursuite et ceux du contrôle parlementaire. Les situations sensibles incluent, par exemple, les premières étapes d'une enquête pénale ou des mesures d'investigation non divulguées qui doivent rester inconnues des personnes concernées.
L'accord définit les mesures procédurales appropriées, qui peuvent inclure des ajustements du programme de travail de la commission, du calendrier de remise des documents, de l'organisation des auditions de témoins et de la publication des conclusions de la commission. En pratique, ces accords ont également servi à atténuer les contraintes de ressources de la justice en établissant des priorités pour les demandes de documents ou en clarifiant des aspects techniques.
Jusqu'à une décision de 2022 de la Cour constitutionnelle autrichienne, la conclusion de tels accords nécessitait le consentement unanime de tous les groupes parlementaires représentés au sein de la commission. Depuis cette décision, une décision à la majorité simple de la commission suffit. Si aucun accord ne peut être trouvé entre la commission et le ministère concernant la nécessité ou le contenu d'un accord de consultation, la commission peut demander officiellement au ministère de présenter sa position dans un délai de deux semaines. La Cour constitutionnelle doit alors rendre une décision dans un délai de quatre semaines.
L'arrêt de 2022 a marqué un tournant dans la formalisation de la procédure de consultation. Dans l'affaire qui a déclenché cette décision, une commission parlementaire avait cherché à convoquer un témoin qui n'avait pas encore rempli son questionnaire pour le Parquet central pour la répression des infractions économiques et de la corruption. La commission a émis une convocation formelle, ce qui a conduit le ministère à déclencher la procédure de consultation en raison du risque d'interférence avec une enquête en cours. Plusieurs réunions n'ont pas permis d'aboutir à un consensus entre les groupes parlementaires et les représentants des autorités. Le ministère a finalement saisi la Cour constitutionnelle, qui n'a pas statué sur le fond de l'accord, mais sur les exigences procédurales nécessaires pour conclure de tels accords en vertu de la Constitution.
Pour conclure, je souhaiterais résumer brièvement le fonctionnement de cette procédure dans la pratique. La commission d'enquête sur la corruption de l'ÖVP (Österreichische Volkspartei10(*)) a nécessité sept réunions de consultation pour finaliser trois accords. La commission d'enquête COFAG (COVID-19-Finanzierungsagentur11(*)) a tenu une réunion qui a abouti à un accord. La commission d'enquête « Red-Blue Abuse of Power » 12(*) a tenu quatre réunions et conclu trois accords.
J'espère que cet aperçu vous aura été utile, et je vous remercie de votre attention.
2. Le rôle des commissions d'enquête parlementaires dans les poursuites engagées contre les membres du gouvernement, Mme Konstantina - Styliani GAVATHA (Voulí ton Ellínon - Grèce)
Ce séminaire a été très instructif, et j'espère que la Grèce pourra y contribuer de manière utile en partageant son expérience des commissions d'enquête spécialisées, notamment celles habilitées à proposer la mise en accusation des membres du gouvernement.
En Grèce, les commissions d'enquête parlementaires sont strictement encadrées par la Constitution, le règlement intérieur du Parlement et des lois d'application spécifiques. Ce cadre réglementaire rigoureux est né du traumatisme historique de la dictature militaire qui a précédé l'adoption de notre Constitution actuelle en 1975. L'absence de contrôle parlementaire effectif durant la période antérieure à la dictature a conduit à une conception constitutionnelle particulièrement stricte des mécanismes de contrôle parlementaire, y compris ceux régissant les commissions d'enquête.
Il existe deux types distincts de commissions d'enquête. Le premier, sur lequel je me concentrerai ici, est le plus puissant et le plus significatif sur le plan constitutionnel : la commission ad hoc d'enquête préliminaire, qui détient la compétence exclusive pour examiner les allégations criminelles visant des membres du gouvernement. L'article 86 de la Constitution hellénique dispose que « seul le Parlement a le pouvoir de poursuivre les membres en exercice ou anciens membres du gouvernement ou les vice-ministres pour des infractions pénales commises dans l'exercice de leurs fonctions ». De plus, si au cours d'une autre enquête une autorité judiciaire ou un procureur découvre des éléments impliquant de telles personnalités politiques, ils ont l'obligation constitutionnelle de suspendre leur procédure et de transmettre sans délai le dossier pertinent au Parlement.
Une fois le dossier transmis, le Parlement doit décider en séance plénière s'il convient d'ouvrir une enquête préliminaire. Dans l'affirmative, une commission ad hoc d'enquête préliminaire est constituée pour traiter l'affaire. La formation et le fonctionnement de ces commissions sont régis par le chapitre constitutionnel définissant les compétences respectives du législatif et de l'exécutif, et non par celui relatif au fonctionnement interne du Parlement. Leur mandat est strictement judiciaire : elles enquêtent sur des comportements criminels présumés de ministres, vice-ministres ou secrétaires d'État. Leurs travaux se concluent par un rapport motivé contenant une recommandation explicite sur l'opportunité d'engager ou non des poursuites pénales. Ce rapport est ensuite soumis à la plénière, où il est voté au scrutin secret.
Ces commissions doivent être nettement distinguées d'une seconde catégorie, appelée commissions parlementaires d'examen. Celles-ci ne concernent pas les enquêtes criminelles mais se penchent sur des questions d'intérêt général ou de préoccupation publique. Leur fondement constitutionnel se situe dans un autre chapitre, consacré aux fonctions parlementaires. Bien qu'elles partagent certaines caractéristiques avec les commissions ad hoc - notamment des pouvoirs d'investigation équivalents à ceux des autorités judiciaires durant la phase d'enquête- leur objectif n'est pas de poursuivre, mais de renforcer la capacité de contrôle du Parlement. Leurs rapports ne font pas l'objet d'un vote.
La procédure de création des commissions parlementaires d'examen est beaucoup plus simple : moins exigeante sur le plan formel, plus ouverte et plus accessible. En 2019, la Constitution a été révisée afin de renforcer le rôle de l'opposition parlementaire en lui accordant le droit de constituer jusqu'à deux commissions de ce type par législature, indépendamment de l'approbation de la majorité. Cette modification visait à garantir que l'opposition puisse mettre en lumière des sujets d'intérêt public même sans l'aval de la majorité - ce qui demeure impossible pour les commissions ad hoc d'enquête préliminaire, qui ne peuvent être créées qu'avec l'approbation de la plénière.
Revenons maintenant aux commissions ad hoc d'enquête préliminaire et à leur processus de création. Il commence par le dépôt d'une motion au Parlement, signée par au moins 30 députés. La motion doit préciser clairement les infractions pénales alléguées, en citant les dispositions pertinentes du code pénal, les textes applicables et les éléments de preuve justifiant l'ouverture d'une enquête. Il n'est pas nécessaire de fournir une preuve complète de l'infraction, mais les éléments doivent être suffisamment substantiels pour justifier un examen.
Une fois déposée, la motion doit être inscrite à l'ordre du jour et débattue en séance plénière. Les délais pour programmer cette discussion sont stricts. Lorsqu'elle est examinée, un débat public a lieu, suivi d'un vote au scrutin secret. Pour être adoptée, la motion doit recueillir la majorité absolue des députés. Si elle est adoptée, la commission est constituée.
En 2011, une étape préliminaire facultative a été ajoutée : avant de former la commission, le Parlement peut - sur initiative d'au moins 30 députés et sous réserve d'une majorité absolue - renvoyer l'affaire à un conseil judiciaire de trois membres, chargé d'examiner les preuves et d'en apprécier la fiabilité. Cette réforme, introduite pour répondre à une vive inquiétude publique, visait à réduire les biais politiques et à garantir une procédure plus juridiquement fondée. Paradoxalement, malgré un large soutien à l'époque, cette option n'a jamais été utilisée.
Une fois la commission créée, ses membres sont nommés. Le nombre minimum est de 12, mais en pratique il est plus élevé pour assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. La commission assume alors les pouvoirs du ministère public. Elle peut donner des instructions aux autorités judiciaires et solliciter leur assistance pour mener son enquête. Pour les besoins de cette enquête spécifique, la commission et son président agissent comme autorités de poursuite exclusives.
En raison de la nature pénale de la procédure, la confidentialité est stricte et les principes du procès équitable ainsi que les droits de la défense sont pleinement respectés pour toutes les personnes mises en cause ou entendues en audition. À l'issue de ses travaux, la commission rédige un rapport exposant ses conclusions et présentant les éléments de preuve. Le rapport doit comporter une analyse juridique et une proposition motivée sur l'opportunité d'engager des poursuites. En cas de désaccord - situation systématique - l'opinion minoritaire doit être pleinement développée dans un chapitre séparé. Le rapport final et la documentation annexe sont transmis au président du Parlement, qui notifie formellement la plénière. Celle-ci doit entamer ses délibérations dans les 15 jours. Le débat est général et porte sur l'opportunité d'engager des poursuites. À ce stade, la personne mise en cause - en fonction ou non - peut, sans y être contrainte, se présenter devant le Parlement pour être entendue publiquement.
Immédiatement après le débat, un scrutin secret a lieu non seulement sur les recommandations générales de la commission, mais aussi sur chacune des infractions alléguées. Chaque accusation est soumise à un vote distinct. Si le Parlement est dissous ou si la législature expire avant la fin de la procédure, le débat doit reprendre dans la nouvelle assemblée. Cette continuité est garantie par la nature judiciaire de la procédure, qui ne doit pas être interrompue par les cycles électoraux.
Si la recommandation de poursuite est rejetée, aucune nouvelle motion ne peut être déposée contre la même personne pour les mêmes faits. En cas d'autorisation, le Parlement est chargé de composer la Cour spéciale et le conseil judiciaire associé. Cela se fait par tirage au sort en séance plénière et en présence du président du Parlement. Des membres des hautes juridictions grecques et du ministère public sont désignés par tirage au sort pour siéger à la Cour spéciale. Une fois désignés, le président transmet formellement le dossier, la résolution parlementaire et la liste des juges titulaires et suppléants à la Cour spéciale, qui est ainsi constituée.
En pratique, les commissions ad hoc d'enquête préliminaire débouchent rarement sur des poursuites. La Cour spéciale grecque ne s'est réunie que trois ou quatre fois au total. La procédure a été largement critiquée pour son caractère politisé. Les députés - qui ne sont pas formés à l'analyse juridique - doivent évaluer des preuves complexes et assumer le rôle de procureurs. Les exigences procédurales - séances à huis clos, normes strictes de preuve, vocabulaire juridique et rédaction de rapports structurés - sont difficiles à maîtriser pour eux.
C'est précisément pour répondre à ces difficultés que la réforme de 2011 a introduit le renvoi facultatif à un conseil judiciaire avant la création d'une commission. Cette étape devait alléger la charge du Parlement en confiant à des magistrats l'examen préalable de la crédibilité des preuves. Bien qu'accueilli favorablement, ce mécanisme n'a jamais été utilisé.
Une autre question de longue date concernait le délai de prescription qui régissait auparavant la responsabilité des ministres. Prévu à l'article 86 de la Constitution de 1975, il limitait les poursuites à la fin de la deuxième session ordinaire du Parlement suivant l'infraction alléguée. Une fois ce délai écoulé, ni la justice ni le Parlement ne pouvaient engager de poursuites, le pouvoir étant constitutionnellement éteint. Ce mécanisme a été très critiqué car il favorisait l'impunité. Une révision constitutionnelle adoptée en 2019 a supprimé ce délai, permettant ainsi la poursuite sans limite de temps. Cette réforme visait à renforcer la responsabilité, améliorer la transparence et répondre au sentiment d'impunité des responsables politiques.
Plusieurs affaires récentes illustrent le fonctionnement concret des commissions ad hoc. La plus récente concerne un ancien vice-ministre auprès du Premier ministre lors de l'accident ferroviaire mortel de Tempi en 2023. Une commission d'examen parlementaire standard avait déjà enquêté et rendu un rapport critique - sans conséquence juridique. Compte tenu de la gravité des faits, le Parlement avait constitué une commission ad hoc d'enquête préliminaire. La personne mise en cause avait demandé à ne pas être auditionnée et proposé un renvoi direct devant la Cour spéciale. Bien que la Constitution ne prévît pas un tel raccourci, la commission avait finalement recommandé le renvoi immédiat devant la Cour spéciale. La procédure est toujours en cours.
Une autre affaire importante a eu lieu en 2021 et impliquait un ancien ministre du Numérique, accusé de corruption et d'abus de pouvoir lors de l'appel d'offres pour les licences de télévision en 2016. Après enquête et vote parlementaire, l'affaire a été renvoyée à la Cour spéciale. Le ministre a été poursuivi, reconnu coupable d'abus de pouvoir et condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
L'affaire la plus marquante reste celle de 2011 concernant des accusations de corruption et de blanchiment liées à l'achat de sous-marins de type 214. Une commission ad hoc a été constituée pour enquêter sur le ministre de la Défense de l'époque. À l'issue de la procédure judiciaire, l'ancien ministre a été reconnu coupable de toutes les charges en 2013 et condamné à 20 ans de prison, avant d'être libéré pour raisons de santé.
En conclusion, malgré les efforts visant à renforcer le cadre institutionnel des commissions d'enquête, des difficultés subsistent dans la mise en accusation des membres du gouvernement. Les députés doivent assumer des responsabilités quasi judiciaires qui dépassent leur mandat habituel. De plus, le conseil judiciaire créé en 2011 pour garantir un examen objectif préalable n'a jamais été activé.
Bien que les commissions ad hoc continuent de produire des rapports détaillés, la confiance du public dans leur efficacité demeure limitée. La révision constitutionnelle de 2019, qui a supprimé le délai de prescription, visait à renforcer la responsabilité et la transparence. Néanmoins, une partie importante de l'opinion publique reste sceptique quant à la capacité du Parlement à mener des enquêtes impartiales et crédibles sur ses propres membres.
3. L'immunité parlementaire des témoins, Mme Rhiannon WILLIAMS (House of Lords - Royaume-Uni)
Au Royaume-Uni, le privilège parlementaire constitue une caractéristique distincte du système constitutionnel britannique. Il désigne un ensemble de droits et d'immunités accordés au Parlement, à ses membres et à son personnel afin de permettre à chaque chambre d'exercer ses fonctions sans interférence extérieure. Un élément central de ce privilège, particulièrement pertinent pour le travail des commissions spécialisées, est la liberté d'expression, telle qu'elle est consacrée à l'article IX de la Déclaration des droits de 1689, qui dispose : « La liberté d'expression et les débats ou délibérations au Parlement ne doivent être ni contestés ni remis en cause devant aucun tribunal ou lieu en dehors du Parlement. » Ce principe sous-tend ce que l'on appelle communément la compétence exclusive, ce qui signifie que les délibérations parlementaires relèvent uniquement du contrôle du Parlement lui-même et ne sont pas soumises à un contrôle judiciaire. La liberté d'expression s'étend à toutes les délibérations parlementaires officielles, y compris les séances des commissions, les débats en séance plénière et les questions orales, mais elle ne protège pas les parlementaires ou le personnel contre les actions se produisant en dehors de ces délibérations. En d'autres termes, le privilège s'applique aux délibérations elles-mêmes, et non aux individus en tant que tels.
Le privilège parlementaire reste un domaine complexe et sensible. Les témoignages fournis devant une commission spéciale, qu'ils soient oraux ou écrits, sont protégés : ils ne peuvent servir de base à une action en justice, ni être utilisés dans le cadre de poursuites pénales. Un cas notable s'est produit il y a une vingtaine d'années, lorsqu'un fonctionnaire a été licencié après avoir témoigné devant une commission ; cet incident a finalement conduit le ministère concerné à revenir sur sa décision, embarrassé.
Toutefois, le privilège ne s'étend pas à toutes les conséquences possibles. Par exemple, si un témoignage devant une commission déclenche une enquête pénale distincte, le privilège parlementaire n'offre aucune protection. Il ne s'applique pas non plus si un témoin répète en public une déclaration faite initialement au Parlement : une fois faite en dehors du Parlement, une telle déclaration perd son statut protégé. Les preuves publiées, y compris celles mises à disposition en ligne, bénéficient d'une immunité légale absolue en vertu de la loi de 1840 sur les documents parlementaires (Parliamentary Papers Act 1840).
Les preuves soumises à une commission spéciale sont également couvertes par le droit d'auteur parlementaire. Les témoignages écrits ne peuvent être publiés de manière indépendante par les témoins ; ils doivent d'abord être examinés et autorisés à la publication par la commission. Dans certains cas, par exemple pour ceux impliquant des allégations ou des informations sensibles, les commissions peuvent choisir de retarder la publication, de censurer le contenu ou de rejeter complètement les preuves. Dans ce dernier cas, les documents en question ne seraient pas couverts par le privilège. Les commissions acceptent également les soumissions anonymes dans les cas où la sécurité personnelle pourrait être menacée.
Les témoins peuvent republier leurs propres preuves, à condition de consulter au préalable la commission et d'indiquer clairement que les documents ont été initialement soumis à une commission spéciale. Ce faisant, ils peuvent bénéficier d'un privilège qualifié, mais cette protection peut être perdue si la publication est jugée malveillante. La publication de témoignages avant leur divulgation officielle par la commission, ou la divulgation de témoignages qui ont été rejetés ou expurgés, pourrait constituer un outrage au Parlement. Tout comportement visant à dissuader les témoins de témoigner, tel que les menaces, l'intimidation ou les représailles, peut également être considéré comme un outrage et doit être porté à l'attention de la commission.
Le personnel des commissions est fréquemment interrogé par des témoins potentiels sur les protections dont ils bénéficient, en particulier dans les cas de divulgations sensibles - par exemple les lanceurs d'alerte, les allégations de mauvaise conduite, de corruption ou d'incompétence. Il n'existe pas de réponse définitive quant à ce qui sera protégé et dans quelle mesure, car beaucoup dépend des circonstances et du contenu précis de la preuve.
En pratique, la jurisprudence récente clarifiant l'étendue du privilège parlementaire est rare, surtout concernant les commissions spécialisées. L'essentiel des décisions provient des débats en chambre. Parmi les exemples notables figurent les affaires de superinjunctions13(*) et celle impliquant Lord Hain, qui avait cité le nom d'un homme d'affaires devant le Parlement, en lien avec des accusations relayées par la presse. On peut également citer une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme par Lord Ahmed, ancien député, dans laquelle la Chambre des Lords a eu gain de cause. La CEDH a invoqué la doctrine de la marge d'appréciation, mais a précisé qu'elle n'était pas liée par les règles internes sur le privilège parlementaire, contrairement aux juridictions britanniques.
Les pouvoirs disciplinaires et de sanction font partie de la capacité de chaque chambre à réguler ses propres affaires. Faire obstacle au bon fonctionnement d'une chambre ou interférer dans les fonctions du personnel parlementaire peut être jugé comme un outrage au Parlement. Chaque chambre peut diligenter des enquêtes, convoquer des témoins et exiger la production de documents. Le refus de comparaître, de répondre aux questions ou de produire des documents peut être considéré de la même façon. Cela met en évidence une autre facette essentielle du privilège : le pouvoir de convoquer des personnes, des documents et des archives (persons, papers and records). Cependant, dans la pratique contemporaine, l'exécution repose davantage sur la responsabilité publique que sur la contrainte légale. Un exemple bien connu est celui de Dominic Cummings, déclaré coupable d'outrage par la Chambre des Communes après avoir refusé de comparaître devant une commission spécialisée.
Les deux chambres du Parlement suivent des procédures globalement similaires lorsqu'elles traitent des violations de privilèges ou des cas d'outrage, bien que ces mécanismes soient moins formalisés et moins fréquemment invoqués à la Chambre des Lords. En règle générale, lorsqu'un cas d'outrage potentiel survient en rapport avec une commission spéciale, la commission concernée rédige un rapport afin de porter l'affaire à l'attention de la Chambre. Les violations présumées sont traitées au cas par cas. Si un parlementaire souhaite soulever une question de privilège, il doit le faire par écrit auprès du Président de la Chambre. L'affaire peut alors être renvoyée soit à la commission des normes (Committee on Standards), soit à la commission des privilèges (Committee of Privileges), une commission spéciale multipartite chargée d'enquêter et de faire rapport sur l'outrage présumé.
Les sanctions sont aujourd'hui relativement limitées. Bien que le Parlement ait autrefois exercé des pouvoirs judiciaires, notamment celui d'imposer des amendes ou des peines d'emprisonnement, ces pouvoirs sont tombés en désuétude. La dernière amende enregistrée a été infligée en 1666 et la dernière peine d'emprisonnement a eu lieu en 1880, lorsque le contrevenant a été détenu dans la tour de l'horloge, une option clairement considérée comme inappropriée aujourd'hui. Bien qu'il y ait eu des appels répétés en faveur de la création d'un pouvoir statutaire, aucune mesure législative n'a été prise à ce jour. Dans la pratique actuelle, les non-membres qui commettent un outrage peuvent être convoqués devant la Chambre pour recevoir une réprimande officielle.
S'agissant des documents officiels, les rapports des commissions spécialisées et autres publications sont considérés comme des débats parlementaires et bénéficient donc du privilège parlementaire. En vertu du principe énoncé à l'article IX de la Déclaration des droits, ces débats « ne peuvent être contestés ou remis en cause devant aucun tribunal ». Cela signifie que les tribunaux peuvent reconnaître l'existence des débats parlementaires en tant que faits historiques, mais ne peuvent en contester ou en examiner le contenu. Toutefois, toutes les activités menées par une commission ne relèvent pas de la définition des travaux parlementaires. Les réunions informelles, les événements de sensibilisation ou les communications via les réseaux sociaux sont généralement exclus de ce champ de protection.
En ce qui concerne la règle sub judice, il convient d'être particulièrement vigilant lors de la collecte de preuves orales ou écrites afin d'éviter tout commentaire sur le fond des procédures judiciaires en cours. Cette règle s'applique à la fois aux affaires pénales et civiles et interdit toute discussion sur le fond des affaires en cours lors des auditions des commissions ou dans les documents publiés. Des exceptions peuvent être accordées, et le président de la chambre (Lord Speaker) a le pouvoir discrétionnaire de déroger à la règle lorsque cela est approprié. Cette restriction ne s'applique pas aux projets de loi, aux textes législatifs délégués ou aux questions déjà examinées dans le cadre d'enquêtes ministérielles. En général, le Parlement doit s'abstenir d'intervenir dans les domaines pour lesquels il a délégué ses responsabilités. La décision du président de la chambre d'accorder ou de refuser une dérogation est définitive et ne peut être contestée en séance.
Pour plus de détails, le Joint Committee on Parliamentary Privilege a produit un rapport exhaustif en 2013, qui explore de manière approfondie de nombreuses questions. Un domaine particulièrement sensible concerne les risques réputationnels auxquels les commissions s'exposent en lien avec les preuves qu'elles reçoivent et publient. Une enquête récente sur l'accord de partenariat centenaire entre le Royaume-Uni et l'Ukraine a mis en lumière ces difficultés. La commission saisie avait reçu un grand nombre de contributions écrites - dont beaucoup présentaient une similitude frappante, soulevant des soupçons quant à une éventuelle automatisation ou coordination.
Une fois publiées, ces déclarations bénéficient du privilège parlementaire et ne peuvent être retirées ni contestées devant un tribunal. Malgré ces inquiétudes, la commission a choisi de publier les preuves, désormais disponibles sur le site du Parlement. Cet épisode souligne la nécessité de traiter avec prudence les preuves controversées. Les commissions doivent rester vigilantes afin de protéger non seulement les droits des témoins et des contributeurs, mais aussi leur propre intégrité institutionnelle.
4. Séance de Questions - Réponses
Au cours de la séance de questions-réponses, les discussions ont porté sur divers sujets, notamment les rôles du « bureau du président » et du « juge de procédure » au Parlement autrichien, les concepts de « règle sub judice » et d'« outrage au Parlement » au Royaume-Uni, le déclenchement de poursuites contre des membres du gouvernement par le Parlement hellénique et la coopération entre les commissions d'enquête parlementaires et le pouvoir judiciaire.
G. CONCLUSIONS
1. Groupes de discussion - Résultats et suivi des commissions d'enquête parlementaires
Les participants ont été invités à se répartir en trois groupes de discussion afin de partager leurs expériences sur les résultats et le suivi des commissions d'enquête, ainsi que pour discuter des questions liées aux stratégies de communication et à l'impact des commissions d'enquête sur l'opinion publique. L'objectif était d'identifier les trois meilleures pratiques permettant de maximiser les résultats d'une commission d'enquête et de faciliter la mise en oeuvre de ses recommandations, le cas échéant.
Après les ateliers, un représentant de chaque groupe a présenté à l'assemblée plénière les meilleures pratiques choisies par son groupe et les participants ont voté pour celles qui leur semblaient les plus convaincantes. Les trois meilleures pratiques qui ont recueilli le plus de votes étaient les suivantes :
- réaliser une évaluation ex post de l'impact de l'enquête de satisfaction et/ou de ses recommandations ;
- organiser la prise en charge du suivi de l'enquête de satisfaction, par exemple par le biais de commissions permanentes ;
- proposer un nombre limité de recommandations et les classer par ordre de priorité.
2. Mot de conclusion par M. Charles WALINE, directeur de l'Initiative parlementaire et des Délégations (Sénat - France)
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Alors que nous arrivons au terme de ce séminaire, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence, votre engagement et les précieuses contributions que vous avez apportées tout au long du séminaire.
Je tiens tout d'abord à remercier tout particulièrement les intervenants qui ont accepté de venir présenter les travaux des commissions d'enquête dans leurs assemblées respectives. Les connaissances et l'expertise dont ils ont fait preuve ont été vraiment remarquables. Je tiens également à remercier tout spécialement notre collègue autrichien et coordinateur du domaine d'intérêt « pratiques et procédures parlementaires », Christoph Konrath, pour ses conseils et son soutien au cours des derniers mois.
Je n'oublierai bien sûr pas l'équipe du CERDP, Christine Detourbet, qui vient de partir, et Barbara Pinto Leite, qui prendra la relève dans quelques jours, pour leur soutien organisationnel et leur grande efficacité. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe organisatrice de la division de la Législation comparée du Sénat, Anne-Céline Didier, Franck Tissot et Marie-Cécile Cozic.
Au cours de ces deux derniers jours, nous avons eu l'occasion d'entendre des présentations inspirantes, d'échanger des idées et de réfléchir ensemble aux défis juridiques et pratiques liés au fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires. Comme mentionné dans l'introduction hier, à ce jour il existe peu d'études ou de publications universitaires qui abordent les commissions d'enquête sous l'angle du droit comparé. Il serait dommage, à mon avis, de ne pas tirer parti de ce séminaire pour faire progresser ce domaine de connaissance. Je souhaite donc que le Sénat publie les actes de ce séminaire à l'automne prochain.
Je vous remercie encore une fois de votre participation et vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos différents travaux et dans vos différentes activités.
H. PANORAMA DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES
* 1 « Le CERDP a pour objectif de promouvoir les échanges d'informations, d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations des parlements d'Europe sur des sujets d'intérêt commun, de renforcer l'étroite coopération entre les services parlementaires dans tous les domaines de l'administration, de la législation, de l'information, des études et de la documentation parlementaires ; et de recueillir, échanger et diffuser les études réalisées par les services parlementaires. » (article 1er des statuts du CERDP).
* 2 https://www.senat.fr/europe-et-international/etudes-de-legislation-comparee.html
* 3 AffaireRywin v. Pologne (Requêtes nos 6091/06, 4047/07 et 4070/07)
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161037%22]}
* 4 Cette affaire fait référence à la fusillade d'un citoyen irlandais par la police irlandaise (Gardaí) dans des circonstances controversées à son domicile à Abbeylara en avril 2000.
* 5 Le président Cossiga a exprimé ces préoccupations dans une lettre adressée aux présidents des deux chambres, transmise à l'occasion de la promulgation de la loi n° 397 de 1991, qui prolongeait le délai fixé pour l'achèvement des travaux de la commission sur les massacres.
* 6 Il y avait autrefois 630 députés et il y en a aujourd'hui 400, tandis que le nombre de sénateurs élus est passé de 315 à 200, auxquels s'ajoutent cinq sénateurs nommés à vie.
* 7 Les présidents de la République italienne se sont exprimés à plusieurs reprises sur les dangers découlant d'une éventuelle ingérence entre les activités des commissions d'enquête et celles des autorités judiciaires. Récemment, lors de la traditionnelle rencontre avec la presse parlementaire, le président de la République Sergio Mattarella a invité les présidents des deux chambres à suivre « avec attention les travaux de la commission afin de garantir le respect des limites fixées par la Constitution et le droit de l'Union européenne, ainsi que le respect des différences de rôles et de responsabilités ». D'une part, il s'agit d'éviter que l'enquête ne se transforme en « contrôle du crédit », qui « constitue un exercice de la liberté d'initiative économique reconnue et garantie par l'article 41 de la Constitution » ; d'autre part, il s'agit de garantir que les relations entre les enquêtes parlementaires et les autorités judiciaires se déroulent conformément aux « principes de non-ingérence et de coopération loyale ». À cette occasion, le président Mattarella, se référant expressément à la jurisprudence constitutionnelle, a fait remarquer que « les enquêtes parlementaires ne sont pas empêchées d'examiner des faits qui font l'objet d'enquêtes judiciaires, sans préjudice des objectifs différents poursuivis par chaque institution, exprimés par la formule `'parallélisme à des fins différentes''. Toutefois, l'enquête ne doit pas influencer le cours normal de la justice, et l'organe parlementaire n'est pas habilité à vérifier la manière dont la fonction judiciaire est exercée et les responsabilités qui y sont liées.
* 8 Corte EDU, prima sezione, sentenza 19 dicembre 2024 - Ricorso n. 29550/17 - Grande Oriente d'Italia c. Italia
* 9 Les solutions de recherche électronique (eDiscovery) sont des logiciels utilisés pour identifier, collecter, préserver, traiter, examiner, analyser et produire des informations stockées électroniquement.
* 10 Parti populaire autrichien.
* 11 La COFAG est l'Agence de financement de la COVID-19.
* 12 Cette commission d'enquête a été mises en place pour déterminer si des fonds publics avaient été détournés à des fins inappropriées par différents ministres.
* 13 Une superinjunction est une ordonnance judiciaire du droit anglais qui interdit non seulement de publier certaines informations, mais aussi de révéler l'existence même de l'ordonnance.