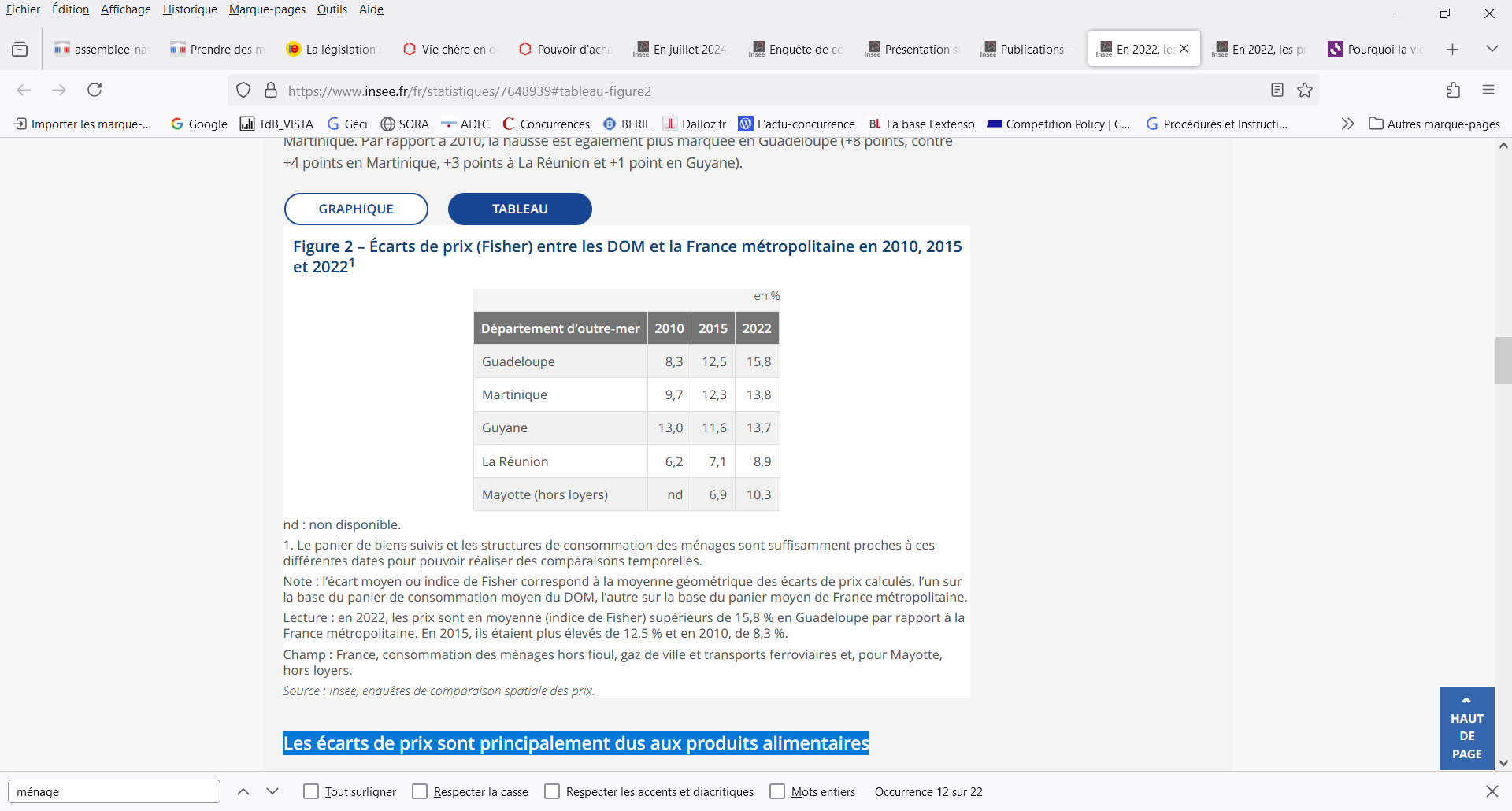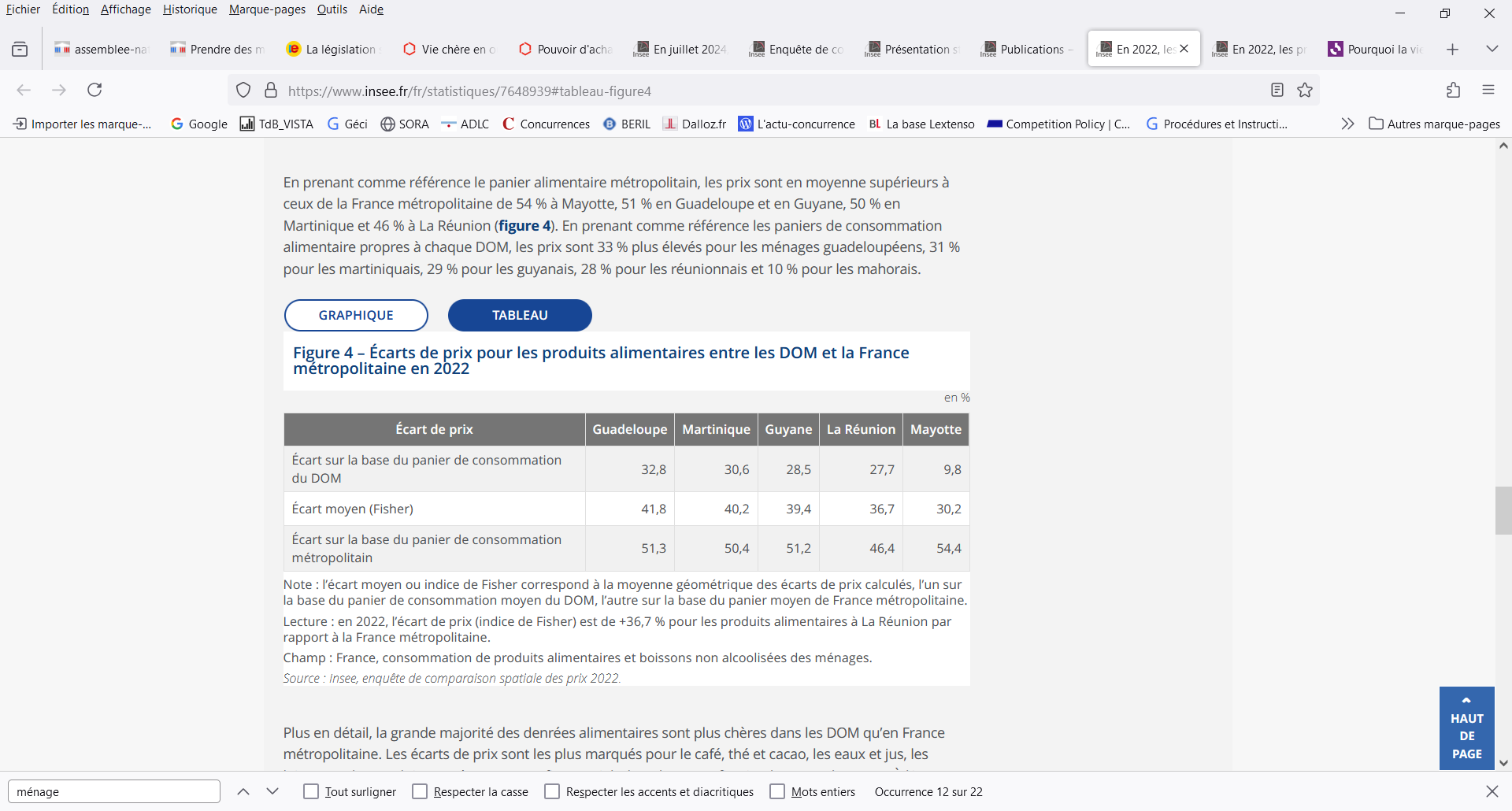ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
de lutte contre la vie chère dans les outre-mer
NOR : MOMO2517046L/Bleue-1
29 juillet 2025
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 13
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 19
TITRE IER - AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT 25
CHAPITRE IER - BAISSER LES PRIX PAR UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA CHÈRE 25
Article 1er - Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer 25
Article 2 - Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services 35
Article 3 - Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité et ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence 45
Article 4 - Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin 56
Article 5 - Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche 68
Article 6 - Créer une obligation de transmission de données économiques des distributeurs à l'autorité administrative chargée de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes 75
Article 7 - Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs 89
Article 8 - Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus 98
Article 9 - Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer 110
Article 10 - Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer 120
Article 11 - Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 159
Article 12 - Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence 164
Article 13 - Préserver la production locale 173
Articles 14 et 15 - Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros 181
Article 16 - Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables 192
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Depuis de trop nombreuses années, nos compatriotes ultramarins subissent de plein fouet le fléau de la vie chère. Le constat est connu et documenté. En 2022, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les écarts de prix vis-à-vis de l'hexagone atteignent jusqu'à 16 % sur les prix à la consommation en général et parfois plus de 40 % sur les denrées alimentaires. C'est insoutenable pour tous nos compatriotes ultramarins. C'est une véritable fracture sociale.
Le présent projet de loi contribue à lutter plus efficacement contre la vie chère dans les outre-mer, à améliorer le pouvoir d'achat des ultramarins et, partant, la cohésion sociale de notre nation.
Structuré autour de quatre titres, il contribue au renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère par une action de baisse de prix et d'amélioration de la transparence et la concurrence dans les outre-mer. Il vise à soutenir le tissu économique ultramarin, en particulier en matière de souveraineté alimentaire.
Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un plan gouvernemental plus vaste de lutte contre la vie chère. D'abord, l'État a d'ores et déjà agi, par exemple récemment dans le cadre du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024, et qui a permis d'ores et déjà de réelles baisses de prix. C'est le résultat d'efforts partagés, et notamment, du côté de l'État, d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à taux zéro sur les produits de première nécessité en Guadeloupe et en Martinique.
Le Gouvernement porte également d'autres dispositifs qui seront mis en oeuvre par la voie de mesures réglementaires.
Lutter contre la vie chère nécessite également d'engager un plan plus structurel et plus largement de transformation économique des territoires. Le Gouvernement mobilisera les préfets en ce sens.
L'article 1er ouvre la faculté d'exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte (SRP). Le différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche » (activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage, etc.).
Le prix du transport représente entre 50 et 75 % de ces frais d'approche.
Actuellement, seule cette composante des frais d'approche est prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.
Les modalités de calcul du seuil de revente à perte prévues par l'article L. 442-5 du code de commerce s'appliquent sur l'ensemble du territoire, sans distinction pour les territoires ultramarins précités.
L'article 1er vise donc à abaisser le seuil de revente à perte applicable dans les outre-mer en déduisant les coûts de transport. Cela permettrait ainsi aux distributeurs ultramarins de faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité dont le coût du transport représente une part plus élevée proportionnellement à leur valeur. Les distributeurs seraient libres d'absorber les coûts de transports déduits ou de les répercuter sur d'autres produits, notamment des produits à forte valeur ajoutée.
Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10 % du SRP sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire métropolitain du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.
L'article 2 porte sur l'amélioration du dispositif relatif aux négociations des accords annuels de modération des prix de produits de grande consommation, dits accords « bouclier qualité-prix ». Le bouclier qualité-prix (BQP) favorise la modération des prix des produits de grande consommation dans les territoires ultramarins.
Il est proposé d'en renforcer la portée et l'efficacité sous plusieurs angles :
- en tenant compte des impératifs de santé publique lors des négociations ;
- en associant systématiquement à la négociation le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou à Wallis-et-Futuna le président de l'Assemblée territoriale, et en permettant au représentant de l'Etat d'inviter les associations de défense des consommateurs à assister aux négociations ;
- en permettant au représentant de l'Etat d'étendre les négociations aux services, en particulier les services essentiels comme l'entretien automobile, les forfaits d'abonnement téléphonique ou internet ;
- en explicitant l'objectif de réduction de l'écart de prix entre l'hexagone et l'outre-mer, et en prévoyant des modalités particulières selon la surface des magasins concernés par le BQP (l'accord pouvant prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface, et pouvant autoriser les magasins d'une surface inférieure à un seuil à dépasser le prix global de 5 %) ;
- en mentionnant explicitement qu'en cas de réussite des négociations, l'accord est signé par les parties qui l'ont négocié et est homologué par arrêté du représentant de l'Etat ;
- en introduisant à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises n'ayant pas signé l'accord ou n'y ayant pas adhéré une publicité de cette information ;
- en introduisant une sanction administrative en cas de défaut d'affichage de l'absence de signature ou d'adhésion d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise à l'accord de BQP ;
- en introduisant une sanction administrative en cas de non-respect par une entreprise signataire de l'accord de BQP. Cela comble une lacune du dispositif actuel qui ne prévoit aucune sanction dissuasive en cas de non-respect de l'accord ;
L'article procède enfin à des corrections matérielles (actualisation de références) et à une mise en cohérence de la numérotation.
Il donne également aux agents chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes, la possibilité de prononcer une injonction aux parties à l'accord de se conformer aux obligations prévues au présent article.
L'article 3 limite la réglementation des prix des produits de première nécessité prévue au premier alinéa de l'article L. 410-4 du code de commerce en cas de circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs et donne, au second alinéa du même article, la faculté aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix, spécifique aux territoires dont il a la compétence, aux fins de fournir en réponse une analyse de la situation au regard de la réglementation prévue au premier alinéa, dans des conditions qui seront précisées par décret.
L'article 4 vise la création d'un service public de gestion logistique en Martinique répondant à un objectif d'intérêt général et d'amélioration de l'attractivité économique de ce territoire.
Le présent projet de loi prévoit que l'État confiera par voie contractuelle (contrat de concession), pour une durée de cinq ans, à un opérateur économique sélectionné, les missions suivantes :
- la gestion d'un service public de logistique, incluant des fonctions de stockage et de distribution, destiné aux entreprises préalablement sélectionnées selon des critères définis par voie réglementaire ;
- la sélection l'aménagement et la maintenance du site logistique, ainsi que la conception, la construction et l'exploitation du bâtiment dédié à cette mission.
La gestion de ce service public implique pour l'opérateur désigné, de récolter les fruits de l'exploitation et d'en assumer les risques. En l'espèce, la Martinique présente des contraintes logistiques structurelles, combinées à une carence avérée de l'initiative privée en matière de mutualisation des flux logistiques liés au commerce, notamment électronique. En parallèle, il convient de répondre aux objectifs du zéro artificialisation nette en réhabilitant une friche bâtie pour accueillir le site logistique susmentionné.
Ces éléments justifient l'implantation du dispositif sur ce territoire, sans qu'il soit nécessairement généralisé à d'autres régions d'outre-mer ou de l'hexagone.
L'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure législative, en application de l'article 38 de la Constitution permettant dans un délai de douze mois de proposer un mécanisme visant à réduire les frais d'approche sur les produits de première nécessité importés en outre-mer.
Cette mesure s'inscrit dans un objectif de pérennisation du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 2024 par l'Etat, la collectivité territoriale de Martinique et les principaux acteurs économiques de l'île.
En effet la mise en place d'un mécanisme de péréquation permettant de réduire les frais d'approche sur les produits dits de première nécessité (PPN) et pallier les conséquences structurelles sur les prix, liées à l'éloignement géographique ainsi qu'à la dépendance aux importations des territoires ultramarins. L'élaboration de ce mécanisme nécessite une concertation avec les acteurs concernés et doit se faire en cohérence avec le cadre institutionnel existant (droit des aides d'Etat, droit de la concurrence, etc.).
L'article 6 oblige les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins, pour leurs magasins de plus de 400 m² à transmettre à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce et relatives aux prix et aux quantités vendues des produits de grande consommation.
Ces informations concernent les prix et les quantités vendues par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire de produits de grande consommation. Les conditions de transmission de ces informations seront précisées par décret en Conseil d'Etat. En effet, la transparence économique des acteurs ultra-marins nécessite d'être renforcée, afin d'améliorer la connaissance des marchés et en particulier du secteur de la grande distribution.
Ces informations permettront d'enrichir la connaissance des marchés et des prix de détail pratiqués par les grandes enseignes de la distribution sur les territoires ultramarins.
Cette mesure permettra à l'autorité en charge de la concurrence et de la consommation de recueillir les informations nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la réglementation des prix.
Ces informations permettront en particulier aux services de l'Etat de préparer les négociations du bouclier qualité-prix dans chaque territoire, mais également d'assurer le suivi et le respect du résultat des négociations, et d'en assurer un bilan annuel qui pourra être présenté aux OPMR et rendu public.
Le respect de cette obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une amende administrative.
L'article 7 a pour objet de répondre au manque de transparence des distributeurs implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et- Futuna au sujet des « marges arrière » dont ils bénéficient de la part de leurs fournisseurs et qui sont considérées comme contribuant à la cherté de la vie en outre-mer.
Pour répondre à cette demande légitime de transparence, l'article 7 prévoit la transmission d'informations par les distributeurs exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 400 m² à l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces informations visent à faire la lumière sur les montants effectivement perçus par les distributeurs, qu'il s'agisse des réductions de prix figurant sur les factures d'achat des marchandises ou des avantages facturés au fournisseur par le distributeur, y compris les ristournes conditionnelles.
Cet article permettra d'objectiver la situation et les difficultés que pourraient rencontrer les producteurs locaux au regard de la pratique des marges dites « arrière ». L'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourra vérifier la fiabilité des informations transmises. Enfin, afin que les distributeurs respectent cette nouvelle obligation de communication, cette dernière est assortie d'une sanction administrative en cas de manquement à cette obligation de la part des distributeurs.
L'article 8 crée une nouvelle pratique restrictive de concurrence passible de sanctions civiles qui vise les situations dans lesquelles des conditions commerciales différenciées sont prévues sur le seul fondement du fait que les produits sont destinés aux territoires ultramarins. Elle nécessitait un complément au code de commerce qui dispose déjà, au 4° du I du L. 442-1, qu'il est interdit de « pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». En effet, dès lors qu'un distributeur ultramarin n'est pas en concurrence avec un distributeur métropolitain, la condition d'un avantage ou d'un désavantage dans la concurrence n'a pas été reprise dans la disposition proposée.
L'objectif de cette disposition est de ne permettre l'application, à un acheteur de produits destinés aux territoires ultramarins de conditions commerciales différenciées par rapport à un acheteur métropolitain (pour des produits totalement identiques) que sous réserve de l'existence de raisons objectives, telles que l'éloignement géographique lorsque le fournisseur se charge de l'acheminement des marchandises jusqu'au territoire ultramarin.
En complément de cette mesure et afin, notamment, de veiller à sa bonne application, l'article 8 crée une nouvelle obligation, pour tout fournisseur de produits de grande consommation qu'il sait destiné à une commercialisation dans les outre-mer, consistant en la communication, à sa demande, à l'autorité administrative chargée de la de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des conditions générales de vente soumises à la négociation avec ses acheteurs pour chacun des circuits de distribution auxquels il a recours ainsi que les conventions conclues avec chacun des acheteurs concernés.
L'article 9 prévoit, afin de s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, en cas de défaut de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, que les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code consommation qui justifient d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ou le représentant de l'Etat, puissent saisir le juge des référés qui pourra ordonner le dépôt de ces documents sous astreinte, dont le montant pourra aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Enfin, l'article prévoit d'instaurer une communication permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.
Ce nouveau régime devrait ainsi renforcer les obligations de transparence pesant sur les entreprises ultramarines, ces dernières respectant en effet beaucoup moins leurs obligations de dépôt et de publication des comptes que leurs homologues de l'hexagone. Pour exemple, à la Martinique, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national.
L'article 10 renforce les moyens de l'Autorité de la concurrence, lui permettant de renforcer sa capacité à répondre aux enjeux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
L'article élargit le collège de l'Autorité de la concurrence à deux nouveaux membres, choisis parmi des personnalités ayant une expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre-mer.
L'article prévoit également la création d'un service spécialisé pour traiter les sujets concernant les outre-mer au sein des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en modifiant le premier alinéa de l'article L. 461-4 du code de commerce.
L'article 10 permet par ailleurs l'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions. Cette ouverture permet d'harmoniser, simplifier et sécuriser les procédures d'enquête et les voies de recours en matière de droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie.
Le président de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a alerté le Gouvernement sur la nécessité de modifier l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, qui est en retard par rapport à l'ordonnance équivalente en Polynésie française sur deux points :
- l'unification devant la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions du rapporteur général relatives au secret des affaires (suites de la décision CE 2014 FILMM) ;
- la coopération étroite de l'autorité de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en matière d'enquêtes.
Enfin, l'article revoit le seuil de notification des opérations de concentration en abaissant le seuil en chiffre d'affaires réalisé par au moins deux entreprises dans au moins l'un des outre-mer concerné, de 5 à 3 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail. Ainsi, davantage d'entreprises actives dans ce secteur sensible pour les outre-mer sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle par l'Autorité.
L'article 11 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de niveau législatif pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions par lesquelles l'Etat exerce les compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques statutaires. L'objectif est une meilleure accessibilité du droit.
L'article 12 renforce la possibilité pour les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) de saisir l'Autorité de la concurrence quand la part de marché - calculée en surface de vente - d'une entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un projet d'aménagement commercial est susceptible pour l'entreprise de dépasser 25 % de part de marché de ses implantations sur l'ensemble du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, et à Saint-Martin, et de dépasser 50 % de part de marché dans la zone de chalandise concernée dans ces mêmes territoires, après l'opération.
L'article 13 vise à renforcer la possibilité de réglementer les prix ou importations de produits dont le prix de vente dans les outre-mer est manifestement inférieur à celui pratiqué dans l'hexagone, en ajoutant la notion de produits locaux « substituables » aux produits importés concernés qui pourraient bénéficier de l'accord entre producteurs locaux et importateurs conclu sous l'égide du préfet, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce. Ainsi, par l'ajout du terme « substituable », seront considérés l'ensemble des produits locaux en concurrence avec les produits importés vendus à un prix manifestement inférieur, dans l'un ou plusieurs des territoires ultramarins, à celui constaté dans l'hexagone.
Les article 14 et article 15 instaurent dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros. Cette expérimentation s'inspire de l'expérimentation prévue à l'article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer dite EROM) en y apportant les modifications nécessaires pour lever les obstacles rencontrés par les acheteurs dans la mise en oeuvre concrète de la loi du 28 février 2017. Ainsi, n'a pas été reprise la limite au dispositif de réservation prévue par la loi EROM, de 15% du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné, difficile à mettre en oeuvre et qui a pu freiner les acheteurs. En contrepartie, la réservation des marchés ne s'applique qu'aux marchés d'un montant inférieur aux seuils européens. Cette rédaction est donc plus simple d'application et juridiquement plus sûre.
L'article 16 met à jour les compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna, l'ensemble des articles qui leurs sont applicables.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
|
Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
|
1er |
Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départementale de la Réunion Conseil départementale de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
2 |
Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
3 |
Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité et ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
4 |
Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin |
Assemblée de Martinique |
Conseil départemental de Guadeloupe Conseil régional de Guadeloupe Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
5 |
Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
6 |
Créer une obligation de transmission de données économiques des distributeurs à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
7 |
Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
8 |
Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer, et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
9 |
Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de la Nouvelle Calédonie |
|
10 |
Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Congrès de Nouvelle Calédonie |
Assemblée de la Polynésie française Autorité de la concurrence |
|
11 |
Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
12 |
Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée Territoriale des îles Wallis et Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de Polynésie française Congrès de Nouvelle-Calédonie |
|
13 |
Préserver la production locale |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de la Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |
Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |
|
14 |
Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |
Sans objet. |
|
15 |
Rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros |
Assemblée de Guyane Assemblée de Martinique Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna Conseil départemental de Guadeloupe Conseil départemental de La Réunion Conseil départemental de Mayotte Conseil régional de Guadeloupe Conseil régional de La Réunion Conseil territorial de Saint-Barthélemy Conseil territorial de Saint-Martin Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon Assemblée de la Polynésie française Congrès de Nouvelle Calédonie |
Sans objet. |
|
16 |
Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables. |
Sans objet. |
Sans objet. |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer |
Néant. |
Sans objet. |
|
2 |
Renforcer le Bouclier Qualité-Prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services |
Décret simple Arrêtés préfectoraux |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |
|
3 |
Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité Ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence |
Décret simple |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |
|
4 |
Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin |
Néant. |
Sans objet. |
|
5 |
Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche |
Ordonnance |
Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale des entreprises (DGE) |
|
6 |
Créer une obligation de transmission de données économiques par les distributeurs à l'autorité administrative chargée de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) |
|
7 |
Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |
|
8 |
Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer, et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |
|
9 |
Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la Justice Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) Direction des services judiciaires (DSJ) Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) |
|
10 |
Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM). |
|
11 |
Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle- Calédonie et en Polynésie française |
Ordonnance |
Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) Ministère des outre-mer Direction générale des outre-mer (DGOM) Ministère de la justice Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) |
|
12 |
Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence |
Néant. |
Sans objet. |
|
13 |
Préserver la production locale |
Néant. |
Sans objet. |
|
14 |
Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales |
Néant |
Sans objet. |
|
15 |
Rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros |
Néant. |
Sans objet. |
|
16 |
Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables. |
Néant. |
Sans objet. |
TABLEAU D'INDICATEURS
|
Indicateur |
Objectif et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Nombre d'entreprises référencées en tant qu'utilisatrices |
Nombre d'entreprises référencées en tant qu'utilisatrices |
Augmentation du nombre d'entreprises et de produits référencés |
Relevé et bilan annuel |
Article 4 Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin Cibler les biens bénéficiant du dispositif. |
|
Pourcentage des acteurs soumis à l'obligation et ayant répondu |
Mesurer le respect de leur obligation d'information par les distributeurs |
100 % |
Echéance de l'obligation : 30 avril Echéance de la mesure de l'indicateur : 30 juin |
Article 7 Assurer la transparence auprès des pouvoirs publics sur les modalités de construction des prix des produits de grande consommation dans les outre-mer |
|
Nombre de référés déposés et nombre de référés recevables |
Mesurer le nombre de référés par rapport au nombre de compte sociaux par entreprises |
Indicateur quantitatif |
Evaluation annuelle |
Article 9 L'objectif est d'évaluer l'efficacité de la mesure |
|
Part des projets représentant plus de 25 % des parts de marché soumis à avis de l'autorité de la concurrence |
Cet indicateur vise à identifier si l'autorité de la concurrence est bien saisie d'un nombre suffisant de dossiers susceptibles de nuire à la concurrence dans les territoires ultramarins |
Objectif : tendance à la hausse de l'indicateur |
Annuel |
Article 12 Renforcer l'analyse concurrentielle des projets d'aménagements commerciaux en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy Entre 2013 et 2025, l'autorité de la concurrence n'a été saisie que d'un unique projet en application de l'article L.752-6-1 du code de commerce. Par ailleurs sur la période 2020 à mai 2025 ce sont 55 projets examinés par les CDAC des territoires couverts par le présent projet de loi sans qu'il ne soit possible d'identifier lesquels ont conduit à dépasser les 25% de parts de marché de la zone de chalandise, ce point n'étant pas examiné au stade de l'instruction. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'il s'agisse d'une possibilité offerte aux CDAC et non d'une obligation, l'objectif visé mesuré en tendance est le plus adapté. L'objectif visé par cet indicateur est donc une hausse de la part des dossiers d'équipements commerciaux représentant une part de marché de plus de 25 % soumis à l'avis de l'autorité de la concurrence. Comme cette saisine est une faculté donnée à la CDAC, une telle hausse indiquera que la disposition est utilisée et donc utile au regard de l'objectif de favoriser la concurrence dans ces territoires. La référence temporelle initiale sera la valeur de cet indicateur à la fin de l'année suivant l'adoption de la présente loi. |
TITRE IER - AGIR POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L'ÉLOIGNEMENT
CHAPITRE IER - BAISSER LES PRIX PAR UN RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA CHÈRE
Article 1er - Réviser le calcul du seuil de revente à perte dans les outre-mer
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le marché de la distribution est relativement plus concentré dans les outre-mer que dans l'hexagone. En effet, l'Autorité de la concurrence indique dans son avis 19-A-121(*) qu'« aujourd'hui, la structure de la concurrence appréhendée à l'échelle de chaque DROM (sans préjudice d'une analyse par zone de chalandise) apparait globalement plus concentrée qu'en métropole, bien que des nuances soient à observer selon les territoires » (p.5). Une autre spécificité du marché de la distribution dans les outre-mer est sa forte dépendance aux importations, en particulier depuis l'Hexagone, ce qui se traduit par des surcoûts liés notamment au transport des marchandises. L'Autorité de la concurrence relève ainsi dans l'avis précité que « les acteurs des produits de grande consommation (PGC) dans les département et régions d'outre-mer (DROM) soulignent en premier lieu l'impact de l'éloignement sur le coût des achats de marchandises importées. Cet impact se traduit par des coûts supplémentaires et inévitables, constitués de frais d'approche comme le transport maritime, l'octroi de mer, des taxes diverses, ou encore le coût d'intermédiation lié au recours à différents prestataires pour l'import. Selon certains des répondants, ces coûts s'élèvent à plus de 30 % du coût d'achat des marchandises importées. Le détail de ces coûts, parfois communiqué à l'Autorité, fait apparaître jusqu'à 40 postes comptables, comme l'empotage, le fret, la surcharge carburant, les assurances, l'acconage, l'embarquement, l'octroi de mer, les taxes de douanes, d'autres taxes, les coûts de palettes et d'emballages, les frais de pesage, ou encore le transport local. » (§452). Ainsi, le prix du transport est, dans les DROM, une composante plus importante du prix de détail des marchandises que dans l'hexagone.
Actuellement, l'article L. 442-5 du code de commerce interdit à tout commerçant de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Le seuil de revente à perte correspond donc au prix d'achat effectif du produit. Ce dernier se définit comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport »2(*).
Le prix du transport est donc compris dans le seuil de revente à perte. Or pour les marchandises acheminées par exemple depuis l'Hexagone, ce prix peut être élevé et augmenter significativement le seuil de revente à perte. Ainsi, dans l'avis précité, l'Autorité de la concurrence prend comme exemple l'impact du prix du transport sur les bouteilles d'eau et de champagne pour illustrer l'impact important que le prix du transport peut avoir sur le prix de détail des produits à faibles valeur ajoutée alors qu'il peut être beaucoup plus faible sur des produits à plus forte valeur ajoutée : « une bouteille d'eau minérale importée coûte 1,03 € (base 100 prix champagne). Elle est donc près de 100 fois moins chère qu'une bouteille de champagne à l'achat. L'importation de ces produits génère des frais supplémentaires, notamment d'approche comme le fret, l'octroi de mer ou encore le transport local. Ces frais sont certes comparables en valeur nominale entre les deux produits (les volumes étant comparables), ainsi qu'en base 100 « prix champagne », mais ils ont un impact nettement plus significatif sur le prix de revient de l'eau minérale. En effet, ce dernier fait plus que doubler avec la simple prise en compte du fret. En définitive, le prix de la bouteille d'eau minérale est multiplié par plus de 4, contre 1,36 pour la bouteille de champagne » (tableau 13, p. 103).
En effet, si l'Autorité de la concurrence (avis n°19-A-12) indique que les coûts de transport représentent en moyenne une part limitée des coûts d'achat des produits importés, elle souligne que cette part est plus importante pour les produits à faible valeur ajoutée que pour les produits plus onéreux.
Elle indique ainsi que « de manière générale, les coûts de transport maritime représentent une part limitée du coût d'achat des produits importés (moins de 5 % en moyenne en ne considérant que la partie « fret » et en excluant les coûts de carburant et de manutention que les compagnies maritimes subissent et répercutent sur leurs clients). » (p.7), en précisant que « les coûts de transport maritime (fret, carburant, manutention, etc.) représentent en moyenne moins de 10 % du coût d'achat des produits importés. Les coûts de fret représentent quant à eux environ 50 % des coûts de transport. Le reste des coûts est notamment constitué par la surcharge carburant (25 %) et la manutention (15 à 20 % selon les territoires) » (§306, p.72). Elle souligne alors que « le coût du fret ne dépend cependant pas de la valeur de la marchandise transportée. En effet, le prix d'un conteneur vingt pieds ou quarante pieds est identique, qu'il soit rempli, par exemple, d'écrans plasma ou de paquets de biscuits. Ainsi, il apparaît que les produits à faible valeur ajoutée sont, d'une manière générale, susceptibles d'être plus impactés par le prix du fret maritime que les produits à forte valeur ajoutée » (§308, p.72).
Les distributeurs continueront à devoir s'acquitter du prix du transport des marchandises, mais la mesure proposée leur permettra, s'ils le souhaitent, de mettre en oeuvre des mécanismes de péréquation visant à ne plus imputer de prix du transport au seuil de revente à perte de certains produits, en particulier ceux pour lesquels il est le plus significatif relativement au prix de détail, pour le reporter sur d'autres à plus forte valeur ajoutée, et donc pour lesquels l'impact sur le prix de détail sera marginal.
Le fait de prévoir un cadre dérogatoire pour les DROM en matière de seuil de revente à perte a déjà connu un précédent à l'occasion de la mise en place, dans le cadre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite EGAlim 1, de l'expérimentation relative à la majoration de 10% du seuil de revente à perte des produits alimentaires (expérimentation prolongée par plusieurs lois depuis, et en vigueur jusqu'en avril 2028). Habilité par ladite loi à légiférer par ordonnance, le gouvernement avait alors estimé que, en raison du contexte de vie chère déjà prégnant dans les DROM, il n'était pas opportun d'y appliquer cette mesure de majoration, par nature inflationniste pour les produits revendus proches du seuil.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Si l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 et l'article 1er de la Constitution prévoient un principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées.
L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités3(*). Le même principe existe pour les Collectivités ultramarines (COM) à l'article 74-1 de la Constitution.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (voir la décision Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-2854(*) QPC ; voir aussi la décision Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC5(*)). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (voir la décision Cons. const., 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC6(*), Syndicat français de l'industrie cimentière sur l'absence de motif d'intérêt général) et énoncées de façon claire et précise (voir par exemple la décision Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC7(*) sur l'incompétence négative). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique8(*).
Ainsi, la présente disposition respecte le principe d'adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. L'éloignement géographique de ces territoires implique en effet des frais de transport significatifs qui ne sont pas aussi prégnants en hexagone et qui expliquent en partie le différentiel de prix entre les outre-mer et l'Hexagone. La mesure dérogatoire mise en place est justifiée par cette situation spécifique. Elle vise à réduire l'impact du prix du transport sur les produits dont le prix de détail est le plus sensible à cette charge, pour le reporter sur d'autres. Cette mesure préserve en outre la liberté d'entreprendre puisqu'elle laisse toute liberté aux distributeurs de ventiler la charge globale que représente le transport entre les différents produits qu'ils revendent.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ).
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le mode de calcul du seuil de revente à perte est prévu par une disposition législative, l'article L. 442-5 du code de commerce. Sa modification ne peut donc être réalisée que par une mesure législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le différentiel de prix au détail entre la France hexagonale et les DROM s'explique en grande partie par l'éloignement géographique. En effet, les produits sont acheminés moyennant le paiement d'un certain nombre de frais dénommés « frais d'approche », tels que les activités d'empotage, de manutention portuaire, de transports routier et maritime et de dépotage9(*).
Le prix du transport représente entre 50 et 75% de ces frais d'approche.
Actuellement, seule cette composante des frais d'approche doit être obligatoirement prise en compte dans la détermination du seuil de revente à perte. Les autres composantes, logistiques pour l'essentiel, sont donc déjà exclues du calcul puisqu'elles ne sont pas comprises dans le prix du transport.
Le prix du transport entre donc dans le calcul du prix d'achat effectif et du seuil de revente à perte au sens de l'article L. 442-5 du code de commerce, sans distinction spécifique relative aux situations ultramarines.
Le présent article vise donc à abaisser le seuil de revente à perte en outre-mer en tenant compte du fait que le prix du transport affecte fortement le prix d'achat effectif des produits qui y sont vendus aux consommateurs. Ainsi, la totalité des frais d'approche serait désormais exclue du calcul du seuil de revente à perte.
Pour les seuls départements et régions d'outre-mer, le fait de supprimer le prix du transport des éléments à intégrer dans le calcul du seuil de revente à perte permettrait ainsi de l'abaisser. Cela autoriserait les distributeurs à faire diminuer les prix en rayon, en particulier pour les produits de première nécessité, qui supportent actuellement généralement un prix du transport plus élevé proportionnellement à leur valeur que des produits plus chers. Cela les autoriserait à allouer de façon beaucoup plus flexible les prix de transport sur les prix finaux.
Cette spécificité s'ajouterait à l'absence de majoration de 10% du seuil de revente à perte sur les produits alimentaires, majoration qui ne s'applique que sur le territoire hexagonal du fait des particularités des outre-mer, qui justifient un régime dérogatoire en matière d'interdiction de la revente à perte.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée. Cette mesure est cependant complémentaire de celle prévue à l'article 5 du présent projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toute disposition relative à la mise en place d'un mécanisme permettant de réduire les frais d'approche sur les produits de première nécessité. Cette dernière mesure aurait donc un champ d'application plus restreint, limité aux produits de première nécessité.
Le fait d'exclure le prix du transport du calcul du seuil de revente à perte n'empêche en effet pas que ce prix soit pris en charge par les distributeurs ultra-marins. Une mesure visant à faire baisser les frais d'approche reste donc utile pour contribuer à la lutte contre la vie chère dans les outre-mer.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La présente disposition consiste dans l'exclusion du prix du transport pour le calcul du seuil de revente à perte.
La mesure retenue consiste dans l'exclusion du prix du transport pour le calcul du seuil de revente à perte dans les collectivités visées par l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition entrainera la modification de l'article L. 442-5 du code de commerce en insérant un nouvel alinéa après le deuxième alinéa du I.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition est conforme aux textes internationaux mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure est susceptible d'avoir un effet positif sur les prix des produits de première nécessité.
L'impact réel de la mesure reste difficile à évaluer précisément. En effet, par définition, la baisse du seuil de revente à perte a pour seule conséquence certaine de permettre aux distributeurs ultra-marins de réduire leurs prix de revente au détail tout en restant au-dessus du seuil de revente à perte.
En revanche, dès lors que le prix du transport reste pris en charge par ces derniers, ils doivent nécessairement le répercuter sur leurs prix de revente au détail. En complément de la mesure prévue par l'article 5 du présent projet de loi sur la réduction des frais d'approche sur les produits de première nécessité, il peut être raisonnablement envisagé que les distributeurs réaliseront des péréquations, en n'intégrant pas le prix du transport dans leurs prix de détail pour les produits de première nécessité, en particulier ceux pour lesquels le prix du transport est une composante importante du prix de détail. En revanche, ils pourraient logiquement répercuter ce prix du transport sur les prix de revente au détail de produits plus hauts de gamme, sur lesquels la demande des consommateurs est moins sensible aux variations de prix qui, en outre, seront comparativement plus faibles que sur les produits à moindre valeur ajoutée.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure est sans impact direct global pour les entreprises. Dans une certaine mesure, cette disposition simplifiera les obligations des entreprises en matière de calcul du seuil de revente à perte, ainsi que les contrôles en la matière par les services de l'Etat, puisque le prix du transport ne sera plus une de ses composantes.
En cas de mise en oeuvre, cette mesure serait sans incidence sur le niveau moyen de marge mais elle permettrait de réduire cette dernière sur les produits de première nécessité, généralement à faible valeur ajoutée, et, dès lors, très impactés par le coût du transport, en compensant cette perte par une hausse des niveaux de marge appliqués sur des produits à haute valeur ajoutée. Elle n'est assortie d'aucune obligation déclarative et est donc sans incidence en termes de coûts induits par le respect d'une telle obligation.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure n'a pas d'impact direct sur les services administratifs. En effet, cette mesure, n'implique pas d'accompagnement particulier par l'Etat, et ne créé pas de nouvelle interdiction susceptible d'engager la nécessité de contrôles complémentaires. Par ailleurs, le nombre d'amendes infligées en cas de revente à perte ne devrait en effet pas être impacté.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure pourra générer des baisses de prix sur certains produits, qui seront compensées par des hausses de prix proportionnellement plus faibles sur d'autres produits. Les particuliers ne seront donc pas impactés dans leur ensemble. Pour autant, les consommateurs ayant une forte propension à acheter des produits de première nécessité, qui se verront exemptés du prix du transport par les distributeurs, bénéficieront de cette mesure tandis que ceux ayant une forte propension à acheter des produits à forte valeur ajoutée en subiront une hausse des prix des produits qu'ils achètent.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de texte d'application.
Article 2 - Renforcer le bouclier qualité-prix (BQP) dédiés aux produits de grande consommation et créer un BQP dédiés aux services
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La cherté de la vie dans les outre-mer est une préoccupation constante du gouvernement. Afin de modérer les prix de certains produits, en 2012, a été institué un bouclier qualité prix (BQP) négocié sous l'égide du représentant de l'Etat dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, et, à compter de 2018, de Saint-Martin.
Issu de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (dite loi Lurel), l' article L. 410-5 du code de commerce prévoit en effet que, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi qu'avec les entreprises de fret maritime et les transitaires un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante.
Ce dispositif connaît certaines limites qui obèrent son efficacité.
En particulier, il ne couvre aujourd'hui que les produits et non les services. Ensuite, le choix des opérateurs économiques de participer ou pas au BQP n'est pas systématiquement connu des consommateurs, ce qui est un frein à la participation des opérateurs économiques. Par ailleurs, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du BQP ou en cas de non affichage auprès des consommateurs de ces engagements. Enfin, le texte actuel ne prévoit pas d'associer à la négociation du BQP des représentants de la collectivité ou des consommateurs.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées10(*).
L'article 73 de la Constitution prévoit, quant à lui, le principe d'adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités11(*). Le même principe existe pour les collectivités d'outre-mer (COM) à l'article 74-1 de la Constitution. Le renchérissement des prix de biens et services en outre-mer du fait de l'insularité et du coût de la logistique constitue bien une contrainte particulière des territoires ultramarins qui justifie une telle dérogation.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (CC, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. ; CC, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1er de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (CC, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre) et énoncées de façon claire et précise (CC, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (CC, décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre).
Conformément au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC aux termes duquel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » les éléments constitutifs de l'infraction doivent être définis de façon précise et complète et la sanction doit être prévue par un texte.
Par ailleurs, cet article énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87- 237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos d'amendes fiscales, le principe de proportionnalité implique que la sanction infligée soit adaptée, au vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement. En outre, le Conseil constitutionnel affirme que l'article 8 de la DDHC ne se restreint pas aux peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent « à toute sanction ayant le caractère d'une punition » (voir par exemple Cons. Const., n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, M. Laurent D.).
Ainsi, d'une part, en adossant le déroulement de la procédure de sanction au bon respect des conditions déjà prévues par la loi, la mesure ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et d'autre part, en prévoyant un montant de sanction comparable à celui déjà légalement établi pour des fautes de même nature, par exemple à l'article L. 441-6 du code de commerce, la mesure ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des délits et des peines.
Il ressort, enfin, que la nécessité de sanctionner le non-respect d'un engagement économique se justifie pleinement, notamment afin de préserver l'espérance légitime des consommateurs.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (articles 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne. De même, les articles 101 à 109 du TFUE encadrent la politique de concurrence au sein de l'UE. A ce titre, est particulièrement visée par une incompatibilité avec le marché intérieur la fixation de prix d'achat ou de vente qui fausse le libre jeu de la concurrence.
L'article 349 du TFUE donne néanmoins la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a admis plus généralement la validité de mesures nationales de contrôle des prix dès lors que des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient dans son arrêt Deutsche Parkinson Vereinigung ( C-148/15) du 19 octobre 2016.
Au cas d'espèce, l'accès de l'ensemble de la population à un panier de produits de grande consommation12(*) et la lutte contre l'inflation sont au nombre des objectifs d'intérêt général de nature à justifier la mesure. Cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, compte tenu notamment de son champ d'application géographique limité et de ce qu'elle ne vise qu'à plafonner le prix global d'un panier de produits, en laissant chaque distributeur libre des moyens à mettre en oeuvre pour respecter cette limite.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article L. 410-5 du code de commerce ayant été introduit par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, sa modification doit donc nécessairement passer par la loi.
En tout état de cause, le renforcement de la portée du dispositif BQP par voie réglementaire n'aurait pas permis d'inclure les services dans le dispositif, le texte actuel ne visant que les produits de consommation courante, ni de prévoir des sanctions administratives.
Par ailleurs, l'introduction d'une publicité de la liste des organisations professionnelles et des entreprises qui participent et qui ne participent pas aux négociations nécessite de compléter le texte existant.
Enfin, en l'état actuel du droit, le non-respect par un signataire de l'accord de BQP ou l'absence d'affichage ne peuvent pas être sanctionnés en tant que tels, ce qui est une limite importante du dispositif qui ne peut être levée par la voie réglementaire.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le bouclier qualité-prix (BQP) est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les outre-mer. Le présent article vise à renforcer son efficacité en le rendant plus contraignant sans dénaturer ses composantes principales. Le BQP est, en effet, un dispositif volontaire dans lequel les acteurs économiques acceptent de négocier un accord de modération tarifaire sous l'égide du représentant de l'Etat. Si le caractère volontaire du dispositif est conservé, la présente disposition étend le périmètre des négociations aux services, qui en étaient jusqu'alors exclus. Sont ainsi envisagés, les services de la téléphonie ou encore des prestations automobiles mais il appartiendra au représentant de l'Etat territorialement compétent de déterminer la liste des services pouvant faire l'objet d'un accord de modération global des prix. De plus, la mesure a vocation à associer davantage les acteurs aux négociations, et tend à renforcer l'effectivité du dispositif en l'assortissant de sanctions administratives jusqu'alors absentes.
Ce même article explicite que la réussite des négociations est formalisée par la signature de l'accord par les parties. Celui-ci doit également permettre de renforcer les incitations des acteurs à participer au dispositif en introduisant à l'égard des organisations professionnelles ou des entreprises n'ayant pas signé l'accord ou n'y ayant pas adhéré, une publicité de cette information, selon des modalités précisées par décret.
Il s'agit donc d'améliorer le dispositif existant, sans imposer à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises leur participation auxdits accords de modération global des prix.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée y compris le statu quo qui ne permet pas d'atteindre les objectifs décrits supra.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu est une modification de l'article L. 410-5 du code de commerce par voie législative.
Le présent article renforce la portée et l'efficacité du dispositif du bouclier qualité-prix en agissant sur plusieurs leviers :
- En visant expressément les produits de grande consommation au lieu de produits de consommation courante, les premiers étant définis juridiquement à la différence des seconds ;
- En tenant compte des impératifs de santé publique lors de la négociation ;
- En associant systématiquement à la négociation, le président de la collectivité exerçant les compétences de la région, ou à Wallis-et-Futuna, le président de l'Assemblée territoriale ;
- En permettant au représentant de l'Etat d'inviter les associations de défense des consommateurs à assister aux négociations ;
- En explicitant l'objectif de réduction de l'écart de prix entre l'hexagone et l'outre-mer, et en prévoyant des modalités particulières selon la surface des magasins concernés par le BQP (l'accord pouvant prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface, et pouvant autoriser les magasins d'une surface inférieure à une seuil à dépasser le prix global de 5 %) ;
- En permettant au représentant de l'Etat d'étendre les négociations aux services, ce qui n'est pas aujourd'hui possible ;
- En mentionnant explicitement qu'en cas de réussite des négociations, l'accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l'Etat ;
- En introduisant à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises n'ayant pas signé l'accord BQP ou n'y ayant pas adhéré, une publicité de cette information ;
- En introduisant une sanction administrative en cas de défaut d'affichage de l'absence de signature ou d'adhésion d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise à l'accord de BQP ;
- En introduisant une sanction administrative en cas de non-respect par une entreprise signataire de l'accord de BQP. Cela comble une lacune du dispositif actuel dans lequel aucune sanction spécifique n'est prévue.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Au sein du code de commerce, les articles L. 410-5 et L. 470-1 sont modifiés.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition est conforme aux textes internationaux mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans imposer aux acteurs d'entrer en négociation, et donc de modérer les prix, la mesure devrait favoriser la négociation des accords de modération de prix et in fine favoriser la baisse des prix aux consommateurs des produits de grande consommation visés. La mesure permettra également de négocier un accord de modération global des prix d'une liste de services.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La présente disposition maintient le principe de négociation propre au BQP et n'introduit donc pas de mesure économiquement contraignante pour les entreprises en dehors de la mesure de publicité à l'égard des organisations professionnelles et de entreprises n'ayant pas signé l'accord ou n'y ayant pas adhéré.
Cette obligation de publicité devrait inciter les opérateurs économiques à participer au dispositif BQP à défaut de quoi leur image auprès des consommateurs pourrait se trouver altérée, ce qui n'est actuellement pas le cas puisque seuls les participants au dispositif sont connus. Cette participation au dispositif, qui reste néanmoins au choix de l'opérateur, conduit à une modération tarifaire dont la portée et l'importance dépendent des négociations qui ont lieu chaque année.
En conservant le caractère volontaire du BQP, et en laissant aux acteurs économiques la liberté de participer aux négociations, le dispositif n'aura pas d'effets contraignants sur eux. Ceux-ci pourront en outre adapter leur négociation à leur propre structure de coûts et à leur politique commerciale. Les entreprises ne participant pas au dispositif seront aisément identifiées comme ne participant pas aux efforts collectifs de lutte contre la vie chère.
En introduisant des sanctions administratives en cas de manquement en matière d'information et de non-respect de l'accord, la disposition aura un impact financier sur les entreprises contrevenantes.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure est sans impact direct sur les collectivités territoriales. Les négociations auxquelles le président de la collectivité compétente peut être associé n'impliquent pas une charge de travail significative.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure n'a pas d'impact direct sur les services administratifs. En effet, cette mesure, n'implique pas d'accompagnement particulier par l'Etat, et ne crée pas de nouvelle interdiction susceptible d'engager des contrôles complémentaires.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Un décret sera nécessaire afin de préciser les modalités d'affichage à l'égard des organisations professionnelles et des entreprises concernées, de leur non-signature ou non-adhésion à l'accord.
De plus, un arrêté précisera les conditions de mise en oeuvre de l'affichage du prix global de la liste des produits de grande consommation arrêtée dans chaque territoire.
Enfin, la présente mesure nécessitera également, dans un second temps, la mise à jour du décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce.
Article 3 - Limiter la réglementation des prix des produits de première nécessité et ouvrir la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Plusieurs handicaps structurels dont l'éloignement géographique, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat difficiles brident le développement des économies ultramarines et creusent les écarts de prix avec l'Hexagone. Ces écarts de prix sont encore plus sensibles en particulier sur les produits alimentaires qui, selon l'INSEE, seraient 30 à 42 % plus chers dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), qu'en moyenne, sur l'ensemble du territoire national. Entre 2015 et 2022, cet écart aurait même augmenté dans les cinq DROM selon l'INSEE13(*).
Afin de renforcer la transparence sur ces écarts de prix en outre-mer, les observatoires des prix et des revenus (OPR) ont été créés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007. En 2012, le Parlement a souhaité donner une base législative à ces observatoires, dans un premier temps par la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, puis par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (LREOM). Cette dernière leur consacre un titre entier au livre IX du code de commerce, crée un observatoire à Wallis-et-Futuna, les intègre au dispositif du bouclier qualité-prix (saisine obligatoire des OPMR pour avis, avant l'ouverture des négociations annuelles) et étend leurs compétences à l'étude des marges. Les OPR deviennent alors Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR). L'année 2013 a été une année de transition qui a vu la création effective des OPMR après la parution du décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des OPMR en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna, codifié à l' article D. 910-1 C du code de commerce.
Les OPMR de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont par la suite été créés par le décret n° 2016-1394 du 17 octobre 2016, puis les deux territoires ont été intégrés au champ d'application du livre IX du code de commerce par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.
Les observatoires n'ont pas le statut de personne morale. Ce sont des instances collégiales pouvant notamment réunir des élus locaux, des représentants des chambres consulaires et des organisations syndicales, des personnalités qualifiées à raison de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus, des associations de consommateurs, en coopération avec les représentants de l'Etat et de ses établissements publics locaux, dont l'INSEE et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)14(*) ou l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM)15(*).
Les missions et le champ d'intervention des observatoires sont définis par le code de commerce et le code de la consommation16(*). Conformément à la réglementation en vigueur, les observatoires ont notamment pour fonction :
- L'analyse du niveau et de la structure des prix, des marges et des revenus17(*). De leur création en 2007 jusqu'à la rénovation de leur composition et de leur fonctionnement, l'essentiel des travaux des observatoires des prix et des revenus a porté sur l'évolution et l'analyse des prix des carburants, des rapports ayant été régulièrement publiés sur ce sujet. Les évolutions de 2011 ont entraîné un élargissement de leur champ d'investigation. Chaque observatoire a ainsi défini en 2011 un programme de travail et procédé à la création de commissions spécialisées (carburants, marchés de gros, etc.) ;
- La formulation d'avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi18(*) ;
- La formulation d'un avis public dans le cadre du dispositif « bouclier qualité-prix » (BQP) précédant l'ouverture des négociations19(*). Les observatoires sont partie prenante dans le nouveau dispositif BQP. Ils se réunissent en fin d'année et remettent un avis public aux préfets avant l'ouverture des négociations annuelles. Ils sont également destinataires des listes mensuelles transmises par les distributeurs aux préfets, et doivent aussi se prononcer sur les éventuelles demandes de révision du prix global en application de l'article 7 du décret du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation20(*). Aussi, les OPMR publient des avis relatifs aux négociations des accords BQP, aux produits inclus dans ces accords et à leur exécution. Les observatoires suivent également l'application du BQP, dans le cadre de commissions ad hoc, ou à travers les bilans des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) lors des réunions plénières ;
- Le président des OPMR dispose également du pouvoir de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence (ADLC) sur toute question de concurrence relevant des intérêts dont ils ont la charge21(*).
Pour mener leurs missions, les neuf OPMR disposent d'un budget annuel consolidé s'élevant depuis 2019 à 600 000 euros. Les dotations budgétaires allouées aux activités des OPMR avaient en effet sensiblement augmenté, passant de 279 350 euros en 2018 à 600 000 euros en 2019, afin d'amplifier leur activité en matière d'études.
L' article L. 410-4 du code de commerce permet de réglementer après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'Etat, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité, notamment des produits alimentaires et d'hygiène couvrant les besoins essentiels de la population, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Il est proposé de renforcer ce dispositif d'un deuxième alinéa de l'article L. 410-4 du code de commerce en permettant aux présidents d'OPMR d'alerter le préfet sur des variations excessives des prix des produits de première nécessité qu'ils auraient constatées, ou identifiées sur la base des contrôles de prix opérés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et qui sont évaluées par les Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence, en vue de la mise en oeuvre du premier alinéa du même article par le Gouvernement.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées22(*).
L'article 73 de la Constitution prévoit, quant à lui, le principe d'adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités23(*). Le même principe existe pour les collectivités d'outre-mer (COM) à l'article 74-1 de la Constitution. Le renchérissement des prix de biens et services en Outre-mer du fait de l'insularité et du coût de la logistique constitue bien une contrainte particulière des territoires ultramarins qui justifie une telle dérogation.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (CC, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. ; CC, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1er de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique. Les restrictions à la liberté du commerce garantie par l'article 4 de la DDHC de 1789 par la réglementation des prix sont justifiées dans les cas limitativement énumérés par les articles L. 410-2 à 410-4 du code de commerce. Elles restent également proportionnées par rapport à l'objectif de lutte contre la vie chère dans des territoires marqués par leur éloignement, l'étroitesse de leurs marchés et leurs niveaux de pauvreté.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (CC, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre) et énoncées de façon claire et précise (CC, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (CC, décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 34 TFUE interdit les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) à l'importation. Une fixation des prix peut être jugée comme telle si elle décourage les importations. Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en interdisant entre États membres les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, est visé toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (CJCE, 13 mars 1979, SA des grandes distilleries Peureux v. Directeur des services fiscaux de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, aff. 119/78).
La CJUE a également considéré qu'un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importés de sucre ne constitue pas en lui-même une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, mais il peut cependant sortir un tel effet lorsqu'il est fixé à un niveau tel que l'écoulement des produits importés devient, soit impossible, soit plus difficile que celui des produits nationaux. Un prix maximal, pour autant, en tout cas, qu'il s'applique à des produits importés, constitue donc une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, notamment lorsqu'il est fixé à un niveau tellement bas que - compte tenu de la situation générale des produits importés comparée à celle des produits nationaux - les opérateurs désirant importer le produit dont il s'agit dans l'État membre concerné ne pourraient le faire qu'à perte (CJCE, 26 février 1976, Ricardo Tasca, aff. 65-75 ; CJCE, 26 février 1976, Società SADAM and others v. Comitato Interministeriale dei Prezzi and others, aff. 88 à 90-75).
Par ailleurs, l'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques (RUP), compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état, l'article L. 410-4 du code de commerce ne prévoit pas d'intégrer dans les modalités de réglementation des prix la possibilité pour le président des OPMR de saisir le représentant de l'Etat dans le territoire ultramarin en question dès lors que celui-ci constate une variation excessive des prix de première nécessité. Or, le contexte de crise de la vie chère dans les outre-mer appelle à un renforcement des dispositifs en vigueur et à une implication globale des acteurs locaux dont le suivi et l'analyse du niveau des prix font partie de leur mission, à l'image des OPMR.
Par ailleurs, l'article L. 410-4 précité n'a jamais été mise en oeuvre en raison du caractère général de la réglementation des produits de première nécessité qu'il prévoit.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article permet de donner effet au dispositif de réglementation des prix des produits de première nécessité, en limitant cette possibilité à des circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs.
Il permet également aux présidents des OPMR, d'alerter et de saisir le préfet en cas de variations excessives des prix, spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence, afin que ce dernier fournisse en réponse une analyse de la situation conduisant à l'opportunité de réglementer les prix des produits de première nécessité pour lesquelles des variations excessives sont constatées dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les conditions du premier alinéa de l'article L. 410-4 du code de commerce.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Deux options ont été envisagées afin de répondre à la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte contre la vie chère des acteurs locaux.
La première option consistait à associer directement les présidents des OPMR au pouvoir de réglementation des prix du Gouvernement en prévoyant une saisine préalable de l'OPMR pour avis facultatif dans des délais encadrés.
Toutefois, cette option est peu adaptée pour le représentant de l'Etat qui devra attendre le délai de saisine préalable des OPMR alors que la réglementation des prix de certains produits est le plus souvent caractérisée par l'urgence.
La seconde option consistait à ouvrir la possibilité aux présidents des OPMR d'alerter et de saisir le représentant de l'Etat territorialement compétent en cas de variations excessives des prix, spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence, afin de déclencher, si cela est justifié, la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux du Gouvernement en matière de réglementation des marchés et des prix en outre-mer.
Ainsi, cette option présente l'avantage de renforcer le suivi du niveau des prix en impliquant les acteurs locaux au plus proche des territoires sans revenir sur les prérogatives du Gouvernement en matière de réglementation des prix en outre-mer. Elle a donc été retenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La présente disposition consiste donc à permettre au président de l'OPMR du territoire sur lequel il a compétence de saisir le représentant de l'Etat sur ce territoire afin de l'alerter en cas de constat de variations excessives des prix sur le territoire. Le cas échéant, si le représentant de l'Etat l'estime opportun, celui-ci peut décider de réglementer les prix de vente des produits de première nécessité, dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article L. 410-4 précité.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article modifie l'article L. 410-4 du code de commerce en donnant un effet utile à l'alinéa 1 et en le complétant par un second alinéa renforçant les missions des OPMR.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La réglementation des prix peut, dans certains cas, être incompatible avec l'article 34 du TFUE lorsqu'elle est susceptible d'affecter le commerce au sein du marché intérieur24(*). Cependant, la limitation de la réglementation des prix à des produits de première nécessité et dans des cas limitativement énumérés (circonstances exceptionnelles ou prix excessifs) constatés localement) rend les dispositions prévues à l'alinéa 1 de l'article L. 410-4 du code de commerce justifiées, nécessaires et proportionnées au regard de l'objectif poursuivi, et partant, conformes au droit de l'UE.
L'alinéa 2 de l'article L. 410-4 précité est sans incidence. Il n'entre pas en contrariété avec le droit de l'UE.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les alertes des présidents des OPMR renforceront la vigilance sur les prix des produits de première nécessité, ce qui pourra conduire à permettre la mise en oeuvre de la réglementation des prix de ces produits par le Gouvernement quand cela est justifié pour pallier les handicaps structurels qui creusent les écarts de prix avec l'Hexagone.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure n'a pas d'impact direct sur les entreprises. Elle conduit cependant à donner un effet utile au premier alinéa de l'article L. 410-4 du code de commerce et à renforcer le dispositif en donnant la possibilité aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus d'alerter le représentant de l'Etat territorialement compétent de variations excessives de prix de produits de première nécessité, spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence, en vue de leur réglementation par le Gouvernement.
La réglementation des prix, selon le droit en vigueur, limite les marges des entreprises exploitant des commerces de détail. Cette réglementation est encadrée aux articles L. 410-2 à L. 410-4 du code de commerce dans des situations limitativement énumérées, qui ne concerne que certains produits ou catégories de produit et n'est possible que dans certaines situations limitativement énumérées. Par ailleurs, elle peut être limitée dans le temps, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 410-2 dudit code.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services des préfectures ultramarines pourront être saisis et mobilisés par les présidents des OPMR s'agissant de la constatation de variations excessives de prix spécifiques aux territoires dont ils ont la compétence.
Toutefois, cette mesure reste budgétairement neutre et, si elle donne la possibilité au président de l'OPMR de saisir le représentant de l'Etat dans le territoire ultramarin en question à la condition de constater une variation excessive des prix des produits première nécessité, celle-ci n'impose pas pour autant une obligation de saisine aux OPMR. Ainsi, cette mesure n'appelle pas à une augmentation des effectifs des services administratifs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La saisine du représentant de l'Etat sur le territoire duquel est constaté, par le président de l'OPMR, une variation excessive des prix de vente sur certains produits de première nécessité contribuera à préserver le pouvoir d'achat de la population locale.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure vise à renforcer la réglementation des prix en cas de variations excessives constatées, au bénéfice des populations ultramarines du ou des territoires concernés.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Un décret précisera les conditions de mise en oeuvre de la procédure prévue au premier alinéa par le représentant de l'Etat.
CHAPITRE II - RÉDUCTION DES COÛTS D'ACHEMINEMENT ET LOGISTIQUES
Article 4 - Développer le e-commerce, soutenir les territoires : l'expérimentation du E-Hub ultramarin
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La Martinique souffre d'un handicap géographique majeur : son insularité et son éloignement entraînent des coûts logistiques et fiscaux élevés. De manière générale, les consommateurs ultramarins sont confrontés à un renchérissement du prix des produits : en plus du prix hexagonal, chaque envoi à l'étranger supporte des droits de douane forfaitaires (2,5 %) et des taxes locales (octroi de mer pouvant atteindre 30 %).
S'agissant du commerce en ligne (dit e-commerce), son développement reste marginal en 2024. En effet, moins de 5 %25(*) des flux de marchandises sont issus des achats en ligne, malgré un taux d'utilisation d'internet quotidien élevé (76,2 % des antillais utilisent Internet chaque jour).
Parallèlement, la Martinique26(*) fait donc face à une carence de l'initiative privée en la matière, s'expliquant notamment par le coût des loyers des locaux professionnels27(*), la dépendance logistique à quelques opérateurs en situation monopolistique28(*) et au manque de filières de services portuaires ultramarines29(*). En effet, les commerces physiques indépendants soulignent les difficultés structurelles liées à la logistique d'approvisionnement des produits destinés au marché ultramarin. Leur dépendance à des groupes de distributeurs en situation monopolistique, entraînent une importante hausse des prix finaux.
Les élus et les acteurs économiques en outre-mer soulignent que structurer la logistique pour notamment développer le commerce en ligne, est un levier essentiel pour réduire le coût de la vie et dynamiser l'économie locale.
Le contexte général associe une volonté politique (plans de convergence, stratégies numériques) à un besoin économique fort : améliorer les prix et l'offre pour les 350 000 Martiniquais, tout en tirant parti des nouvelles infrastructures logistiques en cours de déploiement, à l'instar du Hub Antilles. Ce dispositif régional vise à faire des ports de Guadeloupe et de Martinique des plateformes logistiques majeures dans la Caraïbe et vers l'Europe. Il se matérialise notamment par le développement des infrastructures portuaires : modernisation des quais, augmentation des capacités de traitement et accueil de navires plus grands.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le projet d'E-Hub s'inscrit, d'une part, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution autorisant les adaptations territoriales dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) justifiées par leur situation et caractéristiques particulières. D'autre part, en vertu de l'article 37-1 de la Constitution, la loi peut comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Ainsi, en raison de son insularité et de son éloignement, un régime temporaire spécifique pour la Martinique peut être légitimé tant qu'il ne crée pas d'inégalités abusives entre personnes dans le même territoire. En pratique, ce dispositif expérimental, limité dans le temps à 5 ans est circonscrit à la Martinique.
Les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marché que dans la limite de leurs compétences et pour satisfaire un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. La Martinique bénéficiera d'un traitement différencié par rapport aux autres collectivités entraînant une rupture d'égalité. Or, la jurisprudence constitutionnelle reconnaît la possibilité de procéder à des adaptations sur un territoire déterminé, à condition que cette différence de traitement soit justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi et proportionnée au but poursuivi ( décision n° 2025-881 DC du 7 mai 2025). Ainsi, l'expérimentation du E-Hub s'inscrit en tant que véritable levier d'autonomie économique pour lutter contre la vie chère. Ce dispositif vise à structurer un écosystème logistique de proximité en valorisant les savoir-faire ultramarins, à faciliter l'approvisionnement des commerçants martiniquais et à permettre aux consommateurs locaux d'accéder à une offre de produits plus diversifiée.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Martinique est une région ultrapériphérique (RUP) de l'Union européenne (UE).
L' article 349 du TFUE reconnaît explicitement « l'insularité, l'éloignement, la petite superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance d'un petit nombre de produits » comme contraintes permanentes propres aux RUP. Sur cette base, l'UE autorise la France à appliquer des mesures spécifiques aux DROM (par exemple, le maintien d'un octroi de mer dérogatoire soumis aux décisions de la Commission).
En revanche, l'Union douanière ( règlement n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) et les règles concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le commerce électronique de l'UE s'appliquent, sous réserve des modalités particulières pour les DROM. Par exemple, la « refonte du paquet e-commerce » de juillet 2021 rend imposables tous les achats à distance inférieurs à 22 € dans l'UE, sauf dans les DROM, ces derniers bénéficiant de dérogations temporaires sur ces seuils.
En pratique, la Martinique reste liée par les obligations européennes en matière d'ouverture des marchés et d'aide d'État, comme le respect des règles de la concurrence européenne, mais les aides à la convergence (Fonds européen de développement régional -FEDER) et le cadre spécifique des RUP (statut prévu par le Protocole annexé) permettent d'adapter la mise en oeuvre du droit de l'UE.
Au plan international, la France et l'UE sont parties à divers accords commerciaux. Le projet de E-Hub devra veiller à rester compatible avec les principes de libre circulation (entre la Martinique et l'Hexagone, les droits de douane intra-européens sont censés être nuls, mais l'octroi de mer fait office de mesure dérogatoire spécifiquement autorisée) et de non-discrimination. En somme, aucune convention internationale ne semble s'opposer à cette expérimentation : au contraire, elle s'appuie sur les marges de manoeuvre qu'offrent l'article 349 du TFUE et les décisions de l'UE en faveur des régions périphériques.
Ainsi, les contrats de concession sont encadrés par la directive 2014/23/UE relative à l'attribution des contrats de concession. Cette directive s'applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à un seuil en vertu de ses articles 8 et 9. Ce seuil est fixé à 5,35 millions d'euros HT (valeur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Par conséquent, l'application de cette directive dépend de la valeur estimée du contrat : si celle-ci est égale ou supérieure à ce seuil, les règles de procédure prévues par la directive s'imposent, notamment en matière de transparence, de publicité et de mise en concurrence.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Au sein de l'UE, d'autres RUP (îles Canaries, Açores, ...) mettent en place des mesures fiscales et logistiques spécifiques (ex. taxes locales réduites comme l'Impuesto General Indirecto Canario aux Canaries) pour compenser l'enclavement. Dans le Pacifique, de petites nations insulaires (Etats de la Polynésie, îles Fidji, etc.) ont étudié des plateformes de consolidation pour groupage de fret aéroporté/océanique, avec le soutien de programmes internationaux.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le projet de création de service public envisagé présente un caractère original en ce qu'il ne s'inscrit pas pleinement dans la distinction traditionnelle entre services publics nationaux et services publics locaux. En effet, bien que son périmètre géographique soit restreint au territoire de la Martinique, la collectivité martiniquaise ne sera pas investie de la responsabilité de sa mise en oeuvre. Ce service ne peut donc être qualifié ni de service public local, en l'absence de compétence locale, ni de service public national, son action étant limitée à une seule collectivité territoriale.
Cette spécificité ne remet toutefois pas en cause la légalité du dispositif. En droit administratif, la notion de service public national n'a de portée impérative que dans l'interprétation du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui encadre la privatisation des services publics nationaux ou des monopoles de fait ( Conseil constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006). En dehors de ce cadre, le législateur conserve la faculté de créer un service public à compétence territoriale ciblée, même si la gestion de ce service n'est pas confiée à la collectivité concernée.
Toutefois, une telle création législative doit respecter le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Ce principe implique que les différences de traitement entre territoires doivent être justifiées par un motif d'intérêt général en lien avec l'objet de la loi, et proportionnées au but poursuivi. La jurisprudence du Conseil constitutionnel admet, dans ce cadre, des adaptations territoriales législatives fondées sur des spécificités locales, comme le rappelle la décision n° 2025-881 DC du 7 mai 2025.
En l'espèce, la situation particulière de la Martinique - caractérisée par une carence avérée de l'initiative privée30(*) dans le secteur logistique - justifie l'intervention ciblée de l'État. Cette spécificité locale constitue un fondement légitime à la mise en place d'un service public expérimental limité à ce territoire. Certes, la création d'un service public n'est pas mentionnée à l'article 34 de la Constitution, cependant le législateur est compétent pour la création de tout service public à caractère économique étant donné qu'il porte atteint à des matières ou des principes lui étant réservés ( Conseil d'Etat, 17 décembre 1997, n°181611). En effet, le projet de service public de logistique porte atteinte à des libertés publiques au sens de l'article 34 de la Constitution, telles que la liberté d'entreprendre et la liberté de commerce et d'industrie.
Dès lors, aucun principe constitutionnel ne s'oppose à la création par la loi d'un service public limité à une collectivité territoriale, même en l'absence de compétence locale de gestion. La conformité constitutionnelle du dispositif suppose toutefois que son implantation exclusive sur le territoire martiniquais repose sur l'existence de particularités locales, objectives et substantielles, justifiant l'absence de généralisation à d'autres territoires en situation comparable.
Le projet envisagé consiste pour l'Etat à confier à un opérateur économique désigné ou sélectionné et pour une durée cinq ans la gestion d'un service public de logistique au sein d'une friche bâtie réhabilitée à cet effet et implantée sur le territoire de la Martinique. Ce service est ouvert à toutes les entreprises.
A ce stade, il n'est pas possible de chiffrer le potentiel des risques liés à l'exploitation du E-Hub. En revanche, il est d'ores et déjà prévu que l'opérateur assumera l'intégralité des risques liés à l'exploitation en raison du régime contractuel prévu, par contrat de concession.
Le recours à la loi pour instituer une délégation de service public (DSP) en matière de logistique mutualisée en Martinique s'impose avec d'autant plus de nécessité que cette action se situe dans le champ du développement économique, une compétence désormais transférée à la Collectivité territoriale de Martinique (CTM). Créée par la loi organique n° 2011-884 du 27 juillet 2011, la CTM dispose d'un statut particulier au sens de l'article 73 de la Constitution. Elle exerce de plein droit les compétences dévolues aux régions et aux départements, y compris celle, stratégique, du développement économique, désormais exclusive en vertu de l'article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
En intervenant directement dans l'organisation d'un service public local de logistique, sans base législative expresse et en dehors de tout mécanisme de coordination ou de convention avec la CTM, l'État empiète sur une compétence qu'il ne détient plus, au risque de commettre une ingérence manifeste dans les prérogatives locales, au mépris du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution). Une telle situation a déjà été jugée attentatoire à l'autonomie locale par le Conseil d'État, notamment dans sa décision Commune de Venelles (CE, 18 janvier 2001, n° 229247), laquelle pose le principe selon lequel une collectivité territoriale est fondée à contester toute mesure de l'État portant une atteinte grave à sa capacité d'exercer ses compétences. Cette analyse est confortée par la jurisprudence constitutionnelle : dans sa décision du 9 décembre 2010 (n° 2010-618 DC), le Conseil constitutionnel a indiqué que la loi fixe les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Il est toujours possible pour le législateur, dans le cadre de ses compétences, d'adopter de nouvelles règles qu'il juge opportunes, de modifier les lois existantes ou de les abroger pour en adopter d'autres. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne doit pas supprimer les garanties légales qui protègent des exigences ayant une valeur constitutionnelle.
Ainsi, l'État ne saurait donc se prévaloir d'un intérêt commercial ou d'une cohérence d'action nationale pour empiéter sur une compétence locale, sauf à justifier son action dans un cadre légal clair et sécurisé. Par conséquent, la mise en place d'une délégation de service public par l'Etat, sans compétence pour la CTM car confiée à un opérateur privé, suppose dès lors une habilitation législative explicite afin de prévenir tout risque de contentieux constitutionnel et garantir l'équilibre institutionnel voulu par la loi NOTRe. La création de ce dispositif nécessite donc une disposition législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article poursuit plusieurs objectifs complémentaires. D'une part, il vise à renforcer la concurrence pour maitriser le coût de la vie. En effet, en facilitant l'accès à une offre de produits diversifiée, notamment via le développement du e-commerce, l'E-Hub devrait permettre aux consommateurs martiniquais de bénéficier de prix plus bas. Cet objectif répond aux préoccupations relevées par la délégation sénatoriale outre-mer qui a souligné que le développement du e-commerce pourrait contribuer à réduire le coût de la vie. La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique visait déjà à promouvoir l'accès des DROM au commerce électronique, et l'E-Hub est une déclinaison concrète de cet engagement.
D'autre part, le dispositif entend également accélérer les transformations locales par l'innovation. En structurant un écosystème logistique et en développant le potentiel du e-commerce à l'échelle territoriale, la mesure doit soutenir l'émergence d'emplois et d'innovations dans la logistique ultramarine. La mutualisation des moyens (entrepôt, transport, informatique) permet aux entreprises bénéficiaires de tirer parti d'économies d'échelle. Par ailleurs, le projet s'inscrit dans la stratégie « Hub Antilles » en contribuant ainsi à l'attractivité du territoire via la réhabilitation d'une friche.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Diverses options ont été envisagées.
Option n° 1 : Maintien du régime actuel. Aucune disposition nouvelle n'est créée. Dans ce scénario, les difficultés structurelles demeurent : formalités répétitives aux douanes, absence d'un regroupement efficace des expéditions, délais de livraison encore longs, ainsi que la présence dominante d'acteurs chinois du e-commerce freinent le développement d'une offre diversifiée, européenne et compétitive aggravant ainsi les inégalités d'accès pour les consommateurs. Cette option, insatisfaisante, a donc été écartée.
Option n° 2 : Mesures réglementaires limitées. Il pourrait être envisagé d'adapter par voie réglementaire certains aspects fiscaux ou douaniers. Par exemple, créer un régime simplifié pour les « colis e-commerce groupés ». Toutefois, en l'absence d'habilitation législative claire, ces modifications seraient juridiquement fragiles. Le Code des douanes et le Code du commerce ne prévoient pas aujourd'hui de traitement allégé pour les flux e-commerce consolidés dans un entrepôt outre-mer. De plus, un simple décret ne pourrait pas instaurer un programme expérimental sur cinq ans comme exigé par la stratégie prévue. Cette option s'apparente donc à une solution incomplète qui ne couvrirait pas toutes les dimensions. Elle a donc également été écartée.
Option n° 3 : Mesure d'expérimentation d'un E-Hub territorial. Cette option consiste à inscrire dans la loi les conditions d'une expérimentation d'un E-Hub en Martinique sur une durée limitée à cinq ans. Cette approche législative permet d'assurer la sécurité juridique du projet, de prévoir son évaluation, et de l'adapter précisément aux objectifs. Elle a été retenue car elle permet de répondre aux objectifs structurels susmentionnés et de respecter le cadre juridique général.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu est l'option n° 3, qui crée une expérimentation d'un « E-Hub » territorial en Martinique, pour une durée limitée à 5 ans. Concrètement, les clients qui feront appel à cet opérateur bénéficieront d'un service logistique complet.
L'objectif est que l'opérateur, titulaire de cette concession de service public, devienne l'interlocuteur unique chargé de gérer l'ensemble des opérations logistiques de distribution au profit des entreprises qui souhaitent bénéficier des services proposés par celui-ci.
L'opérateur proposera notamment la gestion du stockage sous toutes ses formes (stock d'urgence, stocke tampon ou de régulation, stock de long terme), la préparation des commandes, la gestion des retours, la livraison finale, aussi bien aux consommateurs qu'aux professionnels et l''expédition vers l'Hexagone ou vers d'autres territoires.
Les clients pourront ainsi commander des volumes importants de manière individuelle. À ce stade, aucun mécanisme de groupement de commandes entre entreprises n'est prévu.
Le présent article précise le statut et la forme du E-hub : il s'agit d'un entrepôt de logistique, où les marchandises importées destinées à la Martinique peuvent être stockées puis expédiées sur le territoire à destination des consommateurs ou commerçants locaux. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif, en particulier l'exploitation de ce service public déléguée par l'Etat et encadrée par un contrat de concession à un opérateur privé. Ce dispositif a pour effet de transférer l'ensemble des charges, coûts et risques liés à l'exploitation du service public au concessionnaire. Ainsi, les charges liées au service public31(*) seront assumées par le concessionnaire, qui reçoit en contrepartie les recettes tirées de cette exploitation.
De plus, l'expérimentation sera subordonnée au respect de certaines obligations mentionnées dans le contrat de concession (par exemple : un e-commerçant utilisant l'E-Hub devra s'engager à garantir un service après-vente pour les consommateurs désirant exercer leur droit de rétractation).
Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan intermédiaire et final portant sur ses effets économiques, sociaux et budgétaires. Le présent article fixe le cadre temporel et la possibilité pour le Parlement d'en décider la fin ou l'extension aux autres territoires ultramarins.
Enfin, le contrat de concession permettra de fixer la sélection de l'opérateur gestionnaire et ses modalités de fonctionnement.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le présent article vise à créer, sous forme de concession, un service public de gestion logistique en Martinique. Celui-ci ayant un caractère expérimental, il ne sera pas codifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition est conforme aux dispositions du droit de l'Union européenne mentionnés supra.
La valeur du contrat de concession32(*), une fois estimée, déterminera si les règles spécifiques découlant de la directive 2014/23/UE sont applicables pleinement, à savoir :
- Publier l'avis de concession au niveau européen (Journal Officiel de l'Union européenne) ;
- Respecter des procédures plus rigoureuses de publicité et mise en concurrence ;
- Justifier plus strictement les critères d'attribution et la sélection.
La question de la compatibilité avec le régime des aides d'État a été soulevée. Néanmoins, la configuration retenue (concession de service public) dans laquelle l'opérateur est rémunéré par les recettes issues de l'exploitation et assume le risque économique associé, semble écarter le risque de qualification d'aide d'état33(*).
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Du point de vue commercial, l'amélioration de l'offre en e-commerce devrait bénéficier à moyen terme à la demande locale (hausse de la consommation) et potentiellement renforcer l'activité du port en augmentant les volumes de fret maritime vers le E-Hub. L'émergence d'une nouvelle alternative d'approvisionnement permettra de renforcer la concurrence et de mettre fin à des situations monopolistiques opérées par les grands groupes de la distribution. Enfin, la réhabilitation d'une friche contribuera à l'attractivité du territoire martiniquais et la montée en gamme de ses infrastructures logistiques. Si l'expérimentation porte ses fruits, elle sera potentiellement réplicable dans les autres territoires ultramarins.
|
Effets pour les acteurs locaux |
Effets pour les consommateurs |
Effets pour les territoires |
|
Augmentation du chiffre d'affaires des e-commerçants |
Baisse des prix finaux |
Création d'emplois locaux |
|
Réduction des coûts logistiques et amélioration de la chaîne opérationnelle |
Amélioration de la qualité de service et de l'exercice des certains droits (service après-vente, droit de rétractation) |
Attractivité territoriale |
|
Accès facilité à une logistique moderne |
Accès à une offre diversifiée |
Digitalisation des acteurs locaux |
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les entreprises locales (transporteurs, logisticiens, start-ups numériques, e-commerçants, ...) bénéficieront d'un nouveau débouché et d'une modernisation des procédés contribuant à la croissance de leurs chiffres d'affaires.
L'intensification de la concurrence liée au E-Hub pourrait, à court terme, fragiliser les acteurs dominants du commerce en outre-mer. Toutefois, cette intensification permettra aux entreprises locales d'améliorer leur compétitivité grâce à une logistique structurée.
Le E-Hub devrait donc permettre de réduire le coût logistique unitaire, constituant actuellement un frein au développement du e-commerce et des commerçants traditionnels locaux. In fine, le consommateur bénéficiera d'une baisse des frais de livraison.
Enfin, les gains potentiels identifiés pour l'opérateur découleront de la récolte des fruits de cette exploitation notamment liés à l'accès tarifé aux services de logistique (préparation des commandes, location des espaces de stockage, etc.). A ce stade, il n'est pas possible de chiffrer le potentiel des risques liés à l'exploitation du E-Hub. En revanche, il est d'ores et déjà prévu que l'opérateur assumera l'intégralité des risques liés à l'exploitation en raison du régime contractuel prévu (contrat de concession).
4.2.3. Impacts budgétaires
Les gains potentiels identifiés pour l'Etat sont l'augmentation des recettes liées à la TVA et aux droits de douanes.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La Collectivité Territoriale de Martinique est directement impliquée puisqu'elle accueillera sur son territoire le futur entrepôt. Ainsi, les gains potentiels identifiés sont l'obtention des recettes liées aux octrois de mer, ainsi qu'aux taxes locales prélevées sur l'entrepôt.
Le dispositif ne comporte pas de disposition d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative de la collectivité.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le présent article prévoit un suivi de l'expérimentation, notamment par la collectivité territoriale de Martinique et le Gouvernement. Toutefois, l'expérimentation ne devrait pas imposer de surcharge administrative aux administrations concernées (DGE, DGOM, ...).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le présent article aura une incidence sur l'emploi et le marché du travail local car la réhabilitation de la friche et le développement de l'activité attendue favoriseront la création d'emplois. Le dispositif vise notamment à améliorer l'inclusion numérique et sociale en outre-mer.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Pour les jeunes créateurs d'entreprise, notamment les TPE/PME locales, il crée une opportunité d'intégrer l'économie numérique (places de marché, logistique etc...) et de bénéficier d'un nouveau débouché et d'une modernisation des procédés contribuant à la croissance de leurs chiffres d'affaires.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Pour les usagers particuliers l'impact immédiat est l'augmentation possible de l'offre produits disponibles34(*). A moyen terme, grâce à la hausse de la concurrence, les prix observés en Martinique pourraient baisser.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure n'a pas d'incidence environnementale directe majeure.
L'entrepôt lui-même, selon son aménagement (type de bâtiment, équipements énergétiques), devra répondre aux normes environnementales locales et s'inscrit dans les objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN) en recyclant un foncier utilisé.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
L'assemblée de Martinique a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 02 juillet 2025.
Le conseil départemental et le conseil régional de Guadeloupe ont été saisis le 16 juin 2025, à titre facultatif, compte tenu du marché unique antillais (fiscalité et droits de douanes).
Enfin, le projet a été préparé en concertation avec la majorité des acteurs concernés : entreprises du e-commerce opérant en outre-mer, entreprises du commerce, les élus locaux, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), la direction générale des outre-mer (DGOM) et la direction générale des entreprises (DGE).
Par ailleurs, conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été saisi pour avis, en procédure d'urgence, le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 03 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci a été saisi le 18 juin 2025 en procédure d'urgence.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. L'expérimentation de 5 ans démarrera à compter de la date d'effet du contrat de concession prévu par le présent article.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article ne concerne que la Martinique.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de texte d'application. Toutefois, le contrat de concession prévu définira les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Un rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois avant son achèvement.
Article 5 - Habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance en vue de la mise en oeuvre d'un mécanisme de réduction des frais d'approche
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'éloignement géographique des outre-mer vis-à-vis de l'Hexagone pèse sur les économies ultramarines et constitue un surcoût structurel creusant les écarts de prix avec la France hexagonale. Ces écarts de prix sont encore plus sensibles dans le secteur alimentaire - où les produits sont, à titre d'exemple, 40% plus chers en Martinique - et surtout plus dynamiques, cet écart ayant selon l'INSEE, augmenté dans les cinq départements et régions d'outre-mer (DROM) entre 2015 et 202235(*). Ces chiffres sont calculés en prenant en référence un panier moyen dans un département d'outre-mer et un panier moyen de France hexagonale. Certains produits sont plus marqués, à titre d'exemple : le café, le thé, le cacao, les eaux et jus, les laitages et les produits sucrés plus généralement.
En raison de cet éloignement et de la dépendance des territoires ultramarins aux importations, chaque produit de consommation importé en outre-mer subit ainsi des « frais d'approche », à travers une chaîne de valeur du transport comprenant jusqu'à 15 étapes. Ces surcoûts, incluant notamment les coûts du transport (routier comme maritime), de stockage, de logistique, de conditionnement et de distribution des marchandises, jouent un rôle significatif dans le différentiel de prix entre les outre-mer et l'Hexagone en venant renchérir les prix d'achat des marchandises et pourraient expliquer, à eux seuls, environ deux tiers des écarts de prix avec l'Hexagone36(*).
Une mission demandée par le ministre d'Etat, ministre des outre-mer et le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, est par ailleurs en cours afin d'éclairer les administrations compétentes à l'identification du mécanisme de péréquation des frais d'approche des produits de première nécessité le plus adapté. La présente habilitation devra permettre de traduire par ordonnance les mesures proposées dans le cadre de ladite mission.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées37(*).
L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Le même principe existe pour les COM à l'article 74-1 de la constitution.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité. Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique. La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées et énoncées de façon claire et précise. Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique38(*).
La mesure proposée prévoit la mise en place d'un mécanisme de péréquation ou de réduction des frais d'approche, et notamment de transport des produits de première nécessité en outre-mer qui sera opérée par une ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Il dispose que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin).
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
Le mécanisme de péréquation ou de réduction des frais d'approche, et notamment de transport, des produits de première nécessité devra veiller au respect de l'interdiction des aides d'état définie par l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi qu'à l'interdiction des droits de douane et toute taxe d'effet équivalent prévue aux articles 28 et 30 du TFUE.
Tout mécanisme susceptible d'avoir un impact sur le respect de ces règles communautaires fera le cas échéant l'objet d'une notification à la Commission européenne impliquant un délai supplémentaire.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le contexte de crise de la vie chère dans les outre-mer, alimenté en grande partie par l'éloignement géographique, appelle à trouver des solutions pérennes et communes à ces territoires par la création d'un dispositif permettant de réduire les frais d'approche, entendus comme l'ensemble des frais de logistique et d'acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs, sur les produits de première nécessité en contrepartie d'une majoration de ces frais sur d'autres produits.
L'autorisation de procéder par ordonnance pour définir et concevoir ce dispositif relève du niveau législatif car elle est conférée au Gouvernement par le Parlement, afin de lui permettre de proposer la création du dispositif le plus adapté et compatible aux droits de l'Union européenne et national. Le dispositif envisagé n'étant parfaitement identifié, l'habilitation par ordonnance permettra au Gouvernement d'agir pleinement au niveau législatif pour les futures mesures qui le nécessiteront.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'article permet d'habiliter le Gouvernement à mettre en place par ordonnance un mécanisme de péréquation ou de réduction des frais d'approche, visant à faire baisser le prix des produits de première nécessité importés en outre-mer conformément au cadre réglementaire national et européen et sans porter atteinte à la liberté d'entreprendre.
Cette mesure traduit la volonté du Gouvernement d'agir sur réduction des coûts supportés par les ultramarins, du fait des handicaps structurels et conjoncturels de ces territoires. Les frais d'approche sont prépondérants dans la constitution des prix des produits, supportés par le consommateur ultramarin selon l'étude de l'INSEE précitée. En conséquence, pour agir sur l'écart avec l'Hexagone pour les prix des produits de première nécessité, un mécanisme de péréquation devra être défini et élaborer en vue de traduire cette volonté.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Trois options ont été envisagées afin de répondre à la nécessité de neutraliser l'éloignement géographique des territoires et le surcoût structurel qui en découle :
Option n°1 : Négocier avec les acteurs de la logistique et notamment les transporteurs, la mise en place d'un mécanisme de péréquation ou de réduction des frais d'approche des produits de première nécessité importés en outre-mer. Cette option présente l'avantage d'agir dans des délais moindres avec toutefois le risque d'aboutir à un mécanisme non conforme à la réglementation européenne sur les droits de douane ou toute taxe d'effet équivalent, ainsi que sur les aides d'Etat, ayant le cas échéant pour conséquence le remboursement de ces aides par les bénéficiaires.
Option n°2 : Légiférer directement la mise en place d'un mécanisme de péréquation des frais d'approche des produits de première nécessité importés en outre-mer. Cette option présente l'avantage d'agir dans des délais moindres avec toutefois le risque d'aboutir à un mécanisme non conforme à la réglementation européenne sur les droits de douane ou toute taxe d'effet équivalent, ainsi que sur les aides d'Etat ayant le cas échéant pour conséquence le remboursement de ces aides par les bénéficiaires.
Option n°3 : Faire adopter une mesure d'habilitation permettant au Gouvernement d'opérer par ordonnance la mise en place d'un mécanisme de péréquation des frais d'approche des produits de première nécessité importés en outre-mer. Cette option permet le temps nécessaire pour atteindre l'objectif de conception d'un mécanisme pérenne et d'en vérifier la compatibilité aux règlements, notamment en cas de notification de la Commission européenne. Elle nécessite toutefois un temps plus long. L'option n°3 a ainsi été privilégiée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La présente disposition habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi permettant la mise en place d'un mécanisme de péréquation des frais d'approche, entendus comme l'ensemble des frais de logistique et d'acheminement facturés aux importateurs établis dans les collectivités concernées, des produits de première nécessité importés en outre-mer, en veillant à moduler ces frais d'approche de manière à assurer une redistribution équilibrée des coûts.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :
- Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne : Le mécanisme de péréquation ou de réduction des frais d'approche, et notamment de transport, des produits de première nécessité devra veiller au respect du droit de l'UE, s'agissant notamment de l'interdiction des aides d'état, des droits de douane et toute taxe d'effet équivalent, ainsi que des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent respectivement prévues aux articles 107, 28 et 30, ainsi qu'à l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
- Impacts macroéconomiques : La mise en place d'un mécanisme de péréquation des frais d'approche entraînerait une baisse des prix des produits de première nécessité importés en outre-mer. L'impact sur les prix de ces produits serait en effet d'autant plus notable que les frais d'approche représenteraient à eux seuls environ deux tiers des écarts de prix avec l'Hexagone. En ciblant les frais d'approche, dont notamment les coûts du transport, l'impact de ce mécanisme sur les produits de première nécessité issus de la production locale serait toutefois limité.
- Impacts sur les entreprises : La mise en place d'un mécanisme de réduction des frais d'approche des produits de première nécessité en outre-mer a vocation à être neutre pour les transporteurs : les baisses du coût du transport sur les produits de première nécessité seraient compensées par une hausse sur les produits à plus forte valeur ajoutée.
- Impacts budgétaires : La mise en place d'un mécanisme de péréquation des frais d'approche des produits de première nécessité en outre-mer serait neutre pour les finances publiques.
- Impacts sur les collectivités territoriales : Le mécanisme mis en place devra tenir compte de la recette d'octroi de mer des collectivités d'outre-mer concernées.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Une ordonnance sera prise dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française
6. JUSTIFICATION DU DÉLAI D'HABILITATION
La création du dispositif le plus adapté, notamment du fait des impacts évoqués supra, nécessite un temps de conception (mission d'expertise et d'analyse en particulier), et devra faire l'objet d'échanges avec la Commission européenne qui peuvent s'étaler sur une durée assez longue, afin de vérifier la conformité du dispositif au droit européen. Toutefois, afin de réduire les frais d'approche dans un délai raisonnable pour que la population des territoires concernés puisse bénéficier d'une baisse des prix, en particulier des produits de première nécessité, l'ordonnance sera prise dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
TITRE II - RENFORCER LA TRANSPARENCE SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX CONSENTIS AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS
Article 6 - Créer une obligation de transmission de données économiques des distributeurs à l'autorité administrative chargée de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La cherté de la vie dans les outre-mer est particulièrement prégnante dans l'alimentaire, où la majorité des dépenses sont réalisées dans les enseignes de la grande distribution à prédominance alimentaire. Ainsi, selon l'INSEE39(*), « les écarts de prix entre les départements d'outre-mer et la métropole sont en grande partie imputables aux produits alimentaires. Il s'agit en effet d'un des premiers postes de consommation des ménages (15 %) et de celui pour lequel les écarts de prix sont les plus marqués entre les territoires ». Pour autant, les niveaux et les évolutions des prix et des quantités des produits de grande consommation vendus par la grande distribution à prédominance alimentaire restent mal connus dans les outre-mer alors que ce secteur y est relativement concentré et fait régulièrement l'objet de la défiance des consommateurs. L'Autorité de la concurrence indique ainsi dans son avis 19-A-12 que « la structure de la concurrence appréhendée à l'échelle de chaque DROM (sans préjudice d'une analyse par zone de chalandise) apparait globalement plus concentrée qu'en métropole, bien que des nuances soient à observer selon les territoires ».
Plus globalement, les outre-mer présentent la double caractéristique de prix élevés, en particulier dans l'alimentaire, et d'un faible niveau de transparence qui concerne tant les prix de détail que les marges des opérateurs économiques. Si, sur ce dernier point, la DGCCRF et l'Autorité de la concurrence mobilisent régulièrement leurs pouvoirs d'enquête pour identifier d'éventuelles situations de rente ou de marges excessives au niveau des opérateurs économiques, ces mêmes pouvoirs apparaissent plus difficilement mobilisables lorsqu'il s'agit de suivre au long cours les évolutions de prix de détail des produits de grande consommation.
Actuellement, les principales données économiques du secteur de la grande distribution en outre-mer sont connues des services de l'INSEE, qui réalisent des enquêtes statistiques régulières. Ces données ont toutefois une finalité exclusivement statistique et ne peuvent être communiquées aux autres administrations à des fins de contrôle ou à des fins directes de régulation40(*). Le secret statistique41(*) interdit en effet strictement la communication de données individuelles ou susceptibles d'identifier les personnes, issues de traitements à finalités statistiques, que ces traitements proviennent d'enquêtes ou de bases de données. Le secret statistique est opposable à toute réquisition judiciaire ou émanant d'autorités administratives.
En outre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés dans les services d'enquête situés dans les outre-mer (DEETS, DGCOPOP et DCSTEP) disposent, dans le cadre de leur habilitation à constater et relever des infractions pénales et des manquements administratifs, du pouvoir d'exiger des entreprises contrôlées la communication de leurs informations économiques et comptables ( article L.450-3 du code de commerce). Cependant, ce droit de communication ne peut s'exercer que dans la perspective de la recherche d'un manquement ou d'une infraction. Cela exclut de facto la transmission de données exhaustives, transmises dans la durée, permettant le suivi général des prix de détail et des quantités vendues dans le but d'éclairer le régulateur et le cas échéant de mettre en oeuvre une régulation des prix.
Aucune transmission systématique de ces données n'est donc actuellement organisée (excepté sur une base volontaire dans le cadre du suivi du protocole d'objectifs et de moyens signé en Martinique le 16 octobre 202442(*) afin que la DGCCRF puisse réaliser les bilans43(*) des effets de ce protocole), alors même que ces données sont essentielles pour élaborer et mettre en oeuvre les politiques publiques, en particulier de lutte contre la vie chère en outre-mer.
Or l'accès aux données économiques par produit, principalement issues des sorties de caisse44(*), portant sur les prix mais aussi les quantités vendues au niveau de chaque magasin, est indispensable pour détecter ou objectiver d'éventuelles situations anormales de marché (e.g. pénuries ou variations anormales des prix), de caractériser les comportements de consommation (e.g. poids des marques de distributeurs ou des marques premier-prix dans les paniers relativement à celui des marques nationales, sensiblement plus chères) et agir efficacement sur la régulation, en particulier tarifaire, sur les marchés ultramarins. En effet, le suivi précis et régulier des prix de détail et des quantités des produits de grande consommation vendus en grandes surfaces à dominante alimentaire permettrait, d'une part, de mieux comprendre les comportements de consommation dans les DROM45(*) et, d'autre part, d'établir des diagnostics précis et fiables en matière d'écarts de prix vis-à-vis de l'hexagone ou de variations importantes de prix. Ces données permettraient donc une régulation tarifaire plus efficace pour l'application des articles L410-2 à L.410-4 du code de commerce, lorsque celle-ci s'avère nécessaire de manière ponctuelle ou pérenne.
En outre, le suivi au long cours des données de prix permettrait une meilleure efficacité des négociations du bouclier qualité-prix prévues par l'article L.410-5 du code de commerce, pour viser les produits les plus vendus et négocier des prix réellement avantageux, ainsi que des contrôles plus exhaustifs du respect des engagements en limitant les contrôles in situ qui sont une charge pour les entreprises et l'administration.
Afin de garantir l'effectivité du dispositif et s'assurer que l'ensemble des grandes enseignes de la distribution (e.g. d'une surface de vente supérieure à 400 m²) transmettent les données utiles, il est nécessaire de prévoir un dispositif de sanction administrative en cas de non-respect de cette obligation (amende de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale).
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées.
L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Le même principe existe pour les COM à l'article 74-1 de la constitution.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité. Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique. La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées et énoncées de façon claire et précise. Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique.
Conformément au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC aux termes duquel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » les éléments constitutifs de l'infraction doivent être définis de façon précise et complète et la sanction doit être prévue par un texte.
Par ailleurs, cet article énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87- 237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos d'amendes fiscales, le principe de proportionnalité implique que la sanction infligée soit adaptée, au vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement.
La mesure prévoit une transmission à l'administration, à sa demande, de données économiques (prix et quantités vendues pour les produits de grande consommation) par certaines entreprises exploitant des enseignes de la grande distribution en outre-mer (d'une surface supérieure à 400 m²).
En premier lieu, cette transmission se justifie par la spécificité des territoires ultramarins, lesquels se caractérisent par un différentiel de prix de détail significatif avec l'Hexagone, et par des dispositifs spécifiques de régulation tarifaire (articles L.410-4 et L410-5 du code de commerce). Au surplus, contrairement au territoire hexagonal sur lequel des analyses statistiques sont menées par l'INSEE de manière rapprochée, la connaissance des prix et des volumes de ventes ne font pas l'objet d'un suivi fin et régulier en outre-mer. Conformément à l'article 73 de la Constitution, cette nouvelle obligation s'explique par les caractéristiques et les contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer.
A l'instar d'autres dispositifs obligeant les professionnels à transmettre de manière des données économiques à l'administration, la mesure crée une obligation pour certaines entreprises, d'une certaine taille (magasins d'une superficie supérieure à 400m²) et uniquement dans le secteur de la grande distribution de détail, sans pour autant porter atteinte à leur liberté d'entreprendre. La mesure n'instaure aucun nouveau dispositif de régulation des prix mais a simplement pour finalité de permettre une mise en oeuvre effective et adaptées des dispositions de régulation des prix existantes.
En second lieu, il convient de souligner que l'administration sera l'unique destinataire de ces données, qui n'ont pas vocation à être rendues publiques et, d'autre part, qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif, de veiller à ce que l'ampleur et la périodicité des demandes de communication n'excèdent pas les besoins liés à la politique de réglementation des prix dans les territoires concernés.
A cet égard, le présent article précise que les informations susceptibles de faire l'objet de ces demandes de communication de la part de l'administration sont celles nécessaires à la mise en oeuvre des articles L. 410-2 à L. 410-5 du code de commerce.
Dans ces conditions, l'obligation de communication instituée par ces dispositions ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-774 QPC du 12 avril 2019, paragraphe 25).
Des mesures de même nature ont par exemple été introduites dans le code de commerce par la loi n°2015-990 du 6 août 2015. L'article L444-5 du code de commerce prévoit ainsi la communication d'informations statistiques et de toute donnée utile auprès des professionnels du droit aux fins d'arrêter les tarifs réglementés de certaines professions. En application de cet article, l' arrêté du 11 septembre 2018 relatif au recueil de données et d'informations auprès de certains professionnels du droit prévoit une transmission systématique de certaines données économiques.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin).
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
Le présent article n'instaure aucun nouveau régime de régulation tarifaire mais se limite à créer une obligation de transmission de données économiques pour toutes les personnes qui exploitent un commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface supérieure à 400 m² sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, ou dans les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna. Cette disposition ne saurait être considérée comme de nature à restreindre les échanges au sein du marché intérieur.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état actuel du droit, seule l'INSEE est en mesure d'obtenir régulièrement les données, par opérateur, portant sur les prix et les quantités vendues des produits de grande consommation mentionnés à l'article L.441-4. Or les données collectées par l'INSEE, ou l'intermédiaire qu'elle a désigné, sont couvertes par le secret statistique et ne peuvent par conséquent par être transmises à un tiers.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés dans les services d'enquête situés dans les collectivités ultramarines (DEETS, DGCOPOP et DCSTEP)peuvent également exiger, en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés par l'article L. 450-3 du code de commerce, « la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ». Cette prérogative ne peut toutefois s'exercer que dans la perspective de la recherche et de la constatation d'un manquement ou d'une infraction.
Cela exclut donc tous travaux à caractère général visant à améliorer la connaissance des marchés et l'accès à l'ensemble des données pertinentes pour que le Gouvernement puisse mettre en oeuvre les mesures de régulation tarifaire qui pourraient le cas échéant s'avérer nécessaires. Or une bonne connaissance des comportements de consommation et des marchés de la distribution alimentaire dans les outre-mer est le prérequis d'une régulation efficace, qu'il s'agisse des négociations annuelles du bouclier qualité-prix (BQP) et du contrôle des engagements pris ou des problématiques de régulation tarifaire. Plus globalement, le suivi exhaustif et au long cours des données économiques portant sur les prix et les quantités vendues par les distributeurs à prédominance alimentaire en outre-mer apparait nécessaire et proportionné à l'atteinte de l'objectif de transparence qui actuellement fait défaut dans les régions ultramarines.
L'obligation faite par la loi de transmettre, à sa demande, à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 vendus par ces établissements comblerait cette lacune. Cette mesure, qui ne concerne que les outre-mer, apparait nécessaire pour adapter la régulation aux spécificités de ces régions qui se traduisent notamment par la cherté de la vie et l'opacité des facteurs qui l'expliquent.
A l'instar de l'obligation législative susmentionnée et instaurée par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, cette réforme doit être conduite au niveau législatif.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La transparence économique des acteurs ultramarins nécessite d'être renforcée, afin d'améliorer la connaissance des marchés et, en particulier, du secteur de la grande distribution à prédominance alimentaire, dont les écarts de prix avec l'Hexagone figurent parmi les plus significatifs. Cette transparence permettra d'objectiver les éventuelles anomalies dans le fonctionnement des marchés et les écarts de prix, afin de mettre en oeuvre le cas échéant les dispositifs de régulation tarifaire prévus par les articles L.410-2 à L.410-4 du code de commerce et de renforcer l'efficacité des négociations du bouclier qualité-prix prévues à l'article L.410-5 du code de commerce.
L'administration chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne dispose pas, actuellement, d'un accès à l'ensemble des données économiques pertinentes relatives aux prix et aux quantités vendues par les acteurs de la grande distribution, malgré l'affichage d'une partie de celles-ci en magasin et la possibilité qu'elle a de mobiliser les pouvoirs d'enquête qu'elle tient de l'article L. 450-3 du code de commerce en cas de suspicion de manquement aux dispositions des titres II et III du livre IV du code de commerce. Pour atteindre cet objectif de transparence, et permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de disposer des données pertinentes, l'article 6 oblige les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements ayant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface supérieure à 400 m² dans une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, , à transmettre à cette autorité administrative, à sa demande, les informations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 vendus par ces établissements
Ces informations, dont le destinataire ne sera que l'administration et qui ne seront pas rendues publiques, permettront d'enrichir la connaissance des marchés et des prix de détail pratiqués par les grandes enseignes de la distribution sur les territoires ultramarins. Elles contribueront à la meilleure compréhension des comportements de consommation sur ces territoires.
Elles permettront ainsi à la DGCCRF de recueillir, à sa demande, les informations utiles pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la régulation tarifaire prévue par les articles L.410-2 à L.410-4 du code de commerce.
Les informations récoltées permettront en particulier aux services de l'Etat de préparer les négociations du bouclier qualité-prix dans chaque territoire ultra-marin, mais également d'assurer le suivi et le respect du résultat des négociations, et d'en assurer un bilan annuel qui pourra être présenté aux OPMR et rendu public. Pour assurer l'effectivité de cette disposition, le respect de cette obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes, et son non-respect sera sanctionné par une amende administrative.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Deux options alternatives auraient pu être envisagées mais sans qu'elles répondent totalement à l'objectif exposé supra d'une plus grande transparence.
La première option consisterait pour l'administration à négocier, sur chacun des territoires ultramarins concernés, avec chaque personne exploitant un établissement à prédominance alimentaire de plus de 400 m², sur une base strictement volontaire, la transmission de ses données de sortie de caisse.
Une telle option, non seulement aurait un coût administratif significatif (temps de négociation, formalisation d'un accord contractuel ...), mais se heurterait au risque qu'un ou plusieurs distributeurs refusent la transmission des données, réduisant alors la représentativité des données collectées et privant de toute utilité les données effectivement collectées pour toute régulation tarifaire.
Dans ces conditions, cette option a été écartée.
La seconde option consisterait à ce que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mobilisent, aux fins de recueillir les données économiques pertinentes, les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent de l'article L. 450-3 du code de commerce en cas de suspicion de manquement aux dispositions des titres II et III du livre IV du code de commerce.
Une telle option se heurterait toutefois à une contrainte juridique qui impose que de tels pouvoirs soient mobilisés exclusivement pour la recherche de manquements ou d'infractions, lesquels ne sont pas nécessairement en cause dans les écarts de prix entre l'hexagone et les outre-mer. En outre, de tels pouvoirs ne permettent pas de recueil systématique et sur le long terme des données nécessaires pour atteindre l'objectif de transparence.
Dans ces conditions, cette option a été écartée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure retenue oblige les acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins (collectivités de l'article 73 de la Constitution, ainsi que collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna), pour leurs magasins de plus de 400 m², à transmettre, à sa demande, à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation toutes les informations relatives aux prix et aux quantités vendus des produits de grande consommation.
L'obligation pèse sur les personnes exploitant des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de plus de 400 m².
Ces informations concernent les prix et les quantités vendues par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire de produits de grande consommation. Les conditions de leur transmission seront définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette mesure permettra à l'autorité en charge de la concurrence et de la consommation de recueillir de manière les informations utiles pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la réglementation des prix prévues par les articles L.410-2 à L.410-5 du code de commerce.
- Cette obligation est nécessaire pour permettre la bonne mise en oeuvre des articles précités et n'excède pas les besoins liés à la politique de régulation tarifaire :
- Les données concernées ne concernent que les prix et les quantités des produits vendus dans les magasins d'une surface supérieure à 400 m² : les commerces de détail d'une surface inférieure, qui auraient pu avoir des difficultés à agréger ces données, ne sont pas soumis à cette obligation ; les commerces de plus grande taille disposent déjà quant à eux de systèmes d'information permettant cette agrégation de données.
- Les modalités de transmission de ces données et leur périodicité seront définies par décret en Conseil d'Etat, en veillant à ne pas excéder les besoins de l'administration et à ne pas créer une charge excessive pour les acteurs de la grande distribution concernés.
- Les données concernées ne seront pas rendues publiques mais seront exclusivement analysées pour les besoins de la mise en oeuvre des articles L.410-2 à L.410-5 du code de commerce.
Le respect de cette obligation de transmission sera assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes et sera sanctionné par une nouvelle amende administrative (75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale). Le régime (publicité, recouvrement, contradictoire, etc.) applicable aux sanctions administratives pour les manquements en matière de concurrence et de consommation, prévu à l'article L.470-2 du code de commerce, est applicable à ce nouveau manquement.
La mesure est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition sera insérée à l'article L. 410-6 du code de commerce dont elle remplacera la disposition actuelle, laquelle n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le présent article est conforme aux textes internationaux mentionnés supra, en particulier l'article 349 du TFUE.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure aura un impact positif sur la connaissance de la formation des prix, et facilitera la bonne mise en oeuvre des outils de régulation tarifaire prévus aux articles L.410-2 à L.410-5 du code de commerce.
La mesure contribuera à la une plus grande efficacité des politiques de réglementation des prix en facilitant la connaissance des variations et des écarts de prix pour les produits de grande consommation, afin de mettre en place le cas échéant des mesures de réglementation. Elle facilitera également un paramétrage adapté des prix réglementés si une telle mesure devait être mise en place.
L'impact réel de la mesure reste cependant difficile à évaluer a priori.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Si la transmission systématique des données concernées créé une charge administrative pour les entreprises, cette obligation existe en réalité déjà au bénéfice des services de l'INSEE, de sorte qu'aucune charge supplémentaire n'est formellement créée.
L'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique prévoit en effet notamment que « les personnes morales dont un des établissements a une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire de plus de 400 m² transmettent par voie électronique à l'Institut national de la statistique et études économiques les données nécessaires à la réalisation de l'enquête statistique pour l'indice des prix à la consommation et l'enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces alimentaires dans les conditions décrites dans les articles suivants ».
Cette disposition, qui prévoit que les personnes morales dont un des établissements a, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire de plus de 400 m2 transmettent, à sa demande, à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les informations concernant les prix et les quantités vendues des produits de grande consommation ne crée donc pas de charge supplémentaire pour les établissements susvisés qui doivent déjà être en mesure de le faire auprès de l'INSEE, éventuellement via un intermédiaire désigné.
En pratique, les personnes exploitant des magasins d'une surface supérieure à 400 m² utilisent déjà des systèmes d'information permettant de collecter et d'agréger les données concernées par la mesure.
Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités de transmission de ces données en veillant à ce que leur ampleur et la périodicité des transmissions n'excèdent pas les besoins de l'administration et ne créent pas une charge excessive sur les entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure pourrait avoir impact budgétaire marginal positif du fait du recouvrement des amendes prévues par la présente disposition en cas de non-transmission des données par les distributeurs.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure est susceptible d'impacter les services de l'État au niveau central du fait de la nécessité de traiter statistiquement les données pour en extraire l'information utile à l'atteinte des objectifs poursuivis. Les données seront traitées par les services centraux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure devrait participer d'une meilleure compréhension du fonctionnement des marchés de la distribution à dominante alimentaire dans les outre-mer et de la formation des prix. Elle contribuera à une meilleure régulation de ces marchés, en particulier au niveau tarifaire, et à des négociations plus efficaces du bouclier qualité-prix.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour préciser les modalités de transmission des données économiques et notamment la liste des informations utiles.
Article 7 - Instaurer une obligation d'information à la charge des distributeurs sur les marges arrière et autres avantages obtenus auprès de leurs fournisseurs
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Actuellement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés dans les Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) peuvent exiger, en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés par l' article L. 450-3 du code de commerce « la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ».
Les données, dont la mesure proposée par le présent article vise à rendre la transmission par les distributeurs obligatoire, sont donc déjà accessibles pour les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) au moyen des pouvoirs d'enquête qui leur sont conférés puisqu'elles résultent des contrats conclus par les distributeurs et les fournisseurs et des factures émises en exécution de ces contrats. Elles sont cependant très difficiles à agréger en pratique du fait de la complexité des circuits d'approvisionnement dans les outre-mer, avec notamment des intermédiaires entre le fournisseur et le magasin de détail bien plus nombreux qu'en métropole.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées (CC, décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion).
L'article 73 de la Constitution prévoit, quant à lui, le principe d'adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (CC, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). Le même principe existe pour les collectivités d'outre-mer (COM) à l'article 74-1 de la Constitution. Le renchérissement des prix de biens et services en Outre-mer du fait de l'insularité et du coût de la logistique constitue bien une contrainte particulière des territoires ultramarins qui justifie une telle dérogation.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (CC, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. ; CC, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1er de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (CC, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre) et énoncées de façon claire et précise (CC, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (CC, décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre).
Conformément au principe de légalité des délits et des peines qui découle de l'article 8 de la DDHC aux termes duquel « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » les éléments constitutifs de l'infraction doivent être définis de façon précise et complète et la sanction doit être prévue par un texte.
Par ailleurs, cet article énonce que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87- 237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos d'amendes fiscales, le principe de proportionnalité implique que la sanction infligée soit adaptée, au vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement. En outre, le Conseil constitutionnel affirme que l'article 8 de la DDHC ne se restreint pas aux peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent « à toute sanction ayant le caractère d'une punition » (CC, décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, M. Laurent D.).
Ainsi, d'une part, en adossant le déroulement de la procédure de sanction au bon respect des conditions déjà prévues par la loi, la mesure ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et d'autre part, en prévoyant un montant de sanction comparable à celui déjà légalement établi pour des fautes de même nature, par exemple à l'article L. 441-6 du code de commerce, la mesure ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des délits et des peines.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna).
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état actuel du droit, les pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF ne permettent pas de disposer aisément d'une vision claire et complète de l'ensemble des avantages que les distributeurs ultra-marins obtiennent globalement auprès de leurs fournisseurs de produits de grande consommation (PGC). En effet, d'une part, les investigations portent davantage sur le respect des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce (formalisation des négociations et des contrats, réalité de certaines contreparties consenties par les enseignes aux avantages financiers octroyés par leurs fournisseurs etc.).
D'autre part, les effectifs de la DGCCRF établis dans les DROM étant limités, les contrôles des conventions sont réalisés par sondage et ne portent pas nécessairement sur les enveloppes globales consenties au titre des marges dites arrière (avantages financiers octroyés aux distributeurs par les fournisseurs mais ne figurant pas sur les factures de produits : rémunération de services de coopération commerciale, de services distincts, ristourne conditionnelles). Ces avantages font l'objet de factures établies par les distributeurs, et ne constituent pas des réductions de prix au sens propre, même si leurs montants sont généralement contractualisés sous la forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires prévisionnel.
Enfin, concernant les fournisseurs de produits à marque nationale, ils sont majoritairement établis dans l'Hexagone et entendus au sujet de leurs relations commerciales avec les distributeurs métropolitains. Cette situation crée donc un sentiment d'opacité qui altère la confiance des opérateurs, confiance qui reste une condition essentielle du bon fonctionnement de l'économie et d'une saine concurrence.
L'obligation faite par la loi de transmettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations relatives à l'ensemble des avantages obtenus par les distributeurs auprès de leurs fournisseurs de PGC permettrait aux pouvoirs publics de disposer d'une vision claire et complète de la situation en la matière. Or, une telle obligation de communication ne peut être prévue que par une disposition législative, car envisager une communication de ces informations par les distributeurs sur une base volontaire ne constituerait pas une option réaliste vis-à-vis d'opérateurs donc certains ne déposent même pas leurs comptes sociaux malgré l'obligation que la loi leur impose déjà en ce sens.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La transparence des pratiques et des niveaux de marge des acteurs ultra-marins nécessite d'être renforcée, afin d'améliorer la connaissance des marchés et en particulier celle du secteur de la grande distribution à dominante alimentaire, dans lequel les écarts de prix avec l'Hexagone figurent parmi les plus significatifs.
La présente disposition a pour objet de répondre au manque de transparence des distributeurs implantés dans les DROM au sujet des « marges arrière », rémunérations ou remises différées dont ils bénéficient de la part de leurs fournisseurs et qui sont considérées comme étant à l'origine de la cherté de la vie en outre-mer.
La mesure prévue au présent article s'ajouterait à celle de l'article 8 qui prévoit de rendre obligatoire la transmission par les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire des informations relatives aux prix et aux quantités vendues de produits de grande consommation.
Ces informations permettront d'améliorer la connaissance par les pouvoirs publics de la réalité de la situation en matière de marges arrière, celles-ci étant en effet parfois difficiles à rattacher à des produits précis. Les pouvoirs publics ne sont en effet pas réellement capables, en l'état actuel des choses, de mesurer la capacité éventuelle des distributeurs ultra-marins à diminuer leurs prix au détail en utilisant les marges arrière qu'ils perçoivent.
Cette mesure permettra à la DGCCRF de recueillir de manière systématique les informations utiles notamment pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la réglementation des prix ou à la régulation des marchés.
Le respect de cette obligation de transmission doit être assuré par les agents chargés de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraudes. Son non-respect doit être sanctionné par une amende administrative afin d'assurer l'efficacité de la disposition.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Une autre option envisagée aurait pu consister à rétablir la pratique des prix dits « prix export ». Or, celle-ci n'est pas envisageable car la fin des « prix export » est un effet de bord de l'interdiction, en 2012, des accords d'exclusivité entre importateurs-grossistes et industriels.
En effet, dans le cadre de tels accords, ces grossistes bénéficiaient, de la part de leurs fournisseurs nationaux, de prix facturés plus bas, permettant ainsi de réduire l'assiette de l'octroi de mer, et assuraient en contrepartie à leurs frais les services de coopération commerciale par exemple, sans les facturer ensuite aux fournisseurs comme cela est normalement le cas. Désormais, les produits d'une même marque peuvent être acquis par une enseigne par plusieurs circuits et les fournisseurs n'ont plus de raison de pratiquer de prix export dans ces conditions.
La restauration des prix export n'est pas un objectif réaliste, les circuits d'approvisionnement ayant évolué depuis 2012. En effet, les accords d'exclusivité entre fournisseurs et grossistes-importateurs ayant disparu, les industriels sont désormais en mesure de négocier avec les centrales locales des enseignes, qui se sont par ailleurs concentrées au fil des années, ou de négocier uniquement avec les centrales hexagonales. Ils ne trouvent ainsi plus d'intérêt à appliquer ces tarifs export aux seuls grossistes importateurs.
En outre, toute ingérence de l'Etat par l'intermédiaire de tels dispositifs serait de nature à fausser le jeu de la concurrence, à rebours de l'objectif affiché.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure proposée consiste donc à rendre obligatoire, pour tout distributeur exploitant un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 400 m², la communication des montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou tout autre avantage financier obtenus auprès de ses fournisseurs dans le cadre de l'exécution de la convention conclue l'année précédente, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces avantages financiers sont négociés et stipulés dans les conventions annuelles comme cela est prévu à l' article L. 441-3 du code de commerce. Ces montants seraient exprimés en valeur absolue, mais aussi en pourcentage du tarif de chaque fournisseur soumis à la négociation. Enfin, afin que les distributeurs respectent cette nouvelle obligation de communication, cette dernière est assortie d'une sanction administrative en cas de manquement à cette obligation de la part des distributeurs.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition crée un nouvel article L. 441-4-1 dans le code du commerce, à la suite de l'article L. 441-4 du même code.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente disposition est conforme au cadre conventionnel mentionné supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure proposée constituerait une alternative à la restauration des « prix export ».
Elle permettrait de documenter les différences de tarifs et de niveaux de prix convenus entre les DROM et l'Hexagone et d'éclairer le Parlement sur l'impact des marges arrière sur les prix convenus. Couplée à la transmission des données de sortie de caisse, ces informations permettraient également d'observer la façon dont ces marges arrière, qui viennent minorer le tarif des fournisseurs, sont répercutées dans les prix de vente, et d'évaluer les phénomènes de péréquation de marge à l'oeuvre dans la détermination de ces derniers.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Cette mesure créant une nouvelle obligation déclarative, représente une nouvelle charge, administrative et financière, pour les distributeurs ultra-marins. Elle pourrait donc être perçue négativement, toutefois, elle participe aux besoins de transparence sur les prix, sujet particulièrement prégnant en outre-mer.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Cette nouvelle obligation déclarative pesant sur les distributeurs impactera les services de l'État, en particulier la DGCCRF qui sera en charge du traitement, de l'agrégation et de l'analyse de ces données.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication.
Par ailleurs, le présent article est applicable aux remises, rabais, ristournes et aux rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur. Les conventions entre fournisseurs et distributeurs de produits de grande consommation devant être conclues au plus tard le 1er mars de chaque année, l'objectif est de permettre une entrée en vigueur rapide de la mesure et de ne pas obliger l'administration à attendre la fin de l'exécution de la convention qui serait conclue après la promulgation de loi pour disposer d'informations sur les marges arrière perçues par les distributeurs ultra-marins.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat sera nécessaire pour préciser les modalités de transmission des données économiques et notamment la liste des informations utiles.
Article 8 - Interdire les conditions générales de vente et conditions commerciales discriminatoires des fournisseurs au seul motif que les produits auraient pour destination finale les outre-mer et instaurer une obligation d'information sur les prix convenus
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
A l'heure actuelle, les enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire dans les DROM s'approvisionnent, pour les marques nationales, à hauteur de 35% auprès d'une centrale d'achat régionale ou nationale implantée dans l'Hexagone. Pour le reste des achats, elles s'approvisionnent localement auprès de trois catégories de fournisseurs : grossistes-importateurs, industriels d'envergure nationale ou internationale disposant d'entités implantées dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) ou négociant en direct les conditions commerciales avec ces enseignes, producteurs locaux.
Concernant les produits acquis par le biais des centrales nationales ou régionales de l'Hexagone, les fournisseurs ne connaissent pas la destination des produits, et les conditions commerciales sont ainsi négociées indistinctement pour l'ensemble des volumes (Hexagone et DROM).
Dans les autres cas, les fournisseurs connaissent la destination des produits, et les marques nationales, hors production locale, peuvent prévoir des conditions générales de vente (CGV) dédiées aux marchés des DROM, et des grilles tarifaires distinctes. Ces conditions différenciées peuvent se fonder sur des raisons objectives (prix départ entrepôt, l'acheteur prenant à sa charge les frais de transport, recettes différentes, conditionnements différents, etc.), mais peuvent également n'être justifiées par aucun élément de prix objectivable et constituer une pratique commerciale discriminatoire en créant un différentiel de prix du simple fait que les produits distribués se destinent aux DROM
Les conditions générales de vente étant le socle de la négociation commerciale, les prix convenus à l'issue de cette dernière correspondent au tarif prévu par les CGV, diminué des sommes liées à d'autres éléments concourant à la détermination du prix qui sont également prévus par les CGV (remises) ou négociés par les parties (rémunération de services rendus par le distributeur, ristournes conditionnelles liées à l'atteinte de volumes d'affaires par exemple). Le prix convenu s'élève alors généralement à un niveau compris entre 60% et 100% du tarif, selon la nature du produit et la taille du fournisseur (les plus petites entreprises ne rémunèrent généralement pas de services et ne prévoient pas de ristournes).
Dans les DROM, la négociation des prix, et notamment la négociation des « marges arrière » (rémunération de services et ristournes conditionnelles), est perçue comme opaque, ne permettant pas de comprendre les éléments de justification des prix, et, in fine, comme un facteur de renchérissement des prix au consommateur.
Dans ce contexte, il semble donc utile de restaurer la confiance entre les divers acteurs des chaînes d'approvisionnement des DROM. A cette fin, le présent article vise d'une part à interdire aux fournisseurs, qu'ils soient grossistes ou non, de différencier leurs conditions sans raison objective lorsque les produits sont destinés aux outre-mer et à les sanctionner le cas échéant, et d'autre part à permettre d'examiner plus rigoureusement la façon dont se forment les prix convenus pour ces produits. En l'état actuel du droit, cela est impossible ou techniquement malaisé.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoit un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées.
L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (e.g. décision Cons. const., du 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). Le même principe existe pour les COM à l'article 74-1 de la Constitution.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (e.g. décision Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC ; voir aussi la décision Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (e.g. décision Cons. const., 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC, Synd. français de l'industrie cimentière sur l'absence de motif d'intérêt général) et énoncées de façon claire et précise (e.g. décision Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC sur l'incompétence négative). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC).
L'article 72 prévoit un principe de libre administration des collectivités territoriales (communes, départements, régions, etc.), ce qui signifie qu'elles disposent d'une autonomie pour gérer leurs affaires locales, dans le respect de la loi. Le Conseil constitutionnel considère que si le principe de libre administration des collectivités a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique dépendent de décisions des collectivités et puissent ainsi ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire (voir par exemple la décision Cons. const., 17 janv. 2002, n° 2001-454 DC).
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les nouveaux critères d'impact économique et territorial pour l'autorisation d'exploitation commerciale prévus aux I, III et IV de l'article L. 752-6 du code de commerce. Le Conseil a considéré que ces exigences sont proportionnées : elles servent un objectif d'intérêt général liée à la revitalisation des centres-villes et n'entravent pas de manière excessive la liberté d'entreprendre, sous le contrôle des juridictions administratives (cf. Saisine le 13 décembre 2019 par le Conseil d'État à la suite d'une QPC déposée par le Conseil national des centres commerciaux, le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans la décision du 12 mars 2020 (QPC n° 2019-830, Conseil national des centres commerciaux) sur la conformité à la Constitution de certains alinéas de l'article L. 752-6 du code de commerce concernant les autorisations d'exploitation commerciale).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin).
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Actuellement, concernant les conditions générales de vente (CGV), l'article L. 441-1 du code de commerce prévoit que les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Lorsqu'un fournisseur les établit, ces CGV doivent obligatoirement être communiquées à l'acheteur qui en fait la demande, comme le prévoit le premier alinéa du II du même article ; toutefois, cette obligation de communication porte uniquement sur les CGV applicables à la catégorie d'acheteurs à laquelle appartient le demandeur. L'article L. 441-1-2 du même code prévoit par ailleurs une disposition analogue pour les grossistes, catégorie d'opérateurs dont il donne en outre une définition.
En outre, concernant les pratiques commerciales déloyales, bien que le 4° de l'article L. 442-1 du code de commerce interdise le fait « de pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence », ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer de manière évidente dans le contexte des outre-mer. En effet, les distributeurs exerçant en métropole ne sont pas plus en concurrence avec les distributeurs ultramarins sur leurs marchés amont (intermédiation des grossistes importateurs ou négociations locales avec les industriels) que sur le marché aval (consommateurs). Ainsi, des conditions commerciales qui seraient différenciées par un fournisseur sur le seul fondement de la destination des produits vendus au distributeur ne tomberaient pas sous le coup de ce texte, quand bien même elles ne seraient pas justifiées par des facteurs objectifs, le critère du désavantage dans la concurrence n'étant pas rempli.
Il est donc possible, à ce jour, pour un fournisseur, de distinguer ses CGV selon que son acheteur destine, ou non, les produits qu'il lui vend à une distribution dans les territoires ultramarins, et sans que cet acheteur puisse documenter cette différence de traitement et déterminer si elle découle d'un simple opportunisme ou de raisons et contreparties objectives (telles que l'éloignement, les conditionnements différents, etc.), puisqu'il n'a accès qu'aux CGV de sa propre catégorie.
De plus, en l'état actuel du droit, les pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne permettent pas de disposer aisément d'une vision claire et complète de l'ensemble des tarifs et des prix convenus par les fournisseurs avec les premiers acheteurs de produits de grande consommation destinés à une consommation finale dans les outre-mer.
Il est donc nécessaire de légiférer pour :
- modifier les dispositions des articles L. 441-1, L.441-1-2 et L. 442-1 du code de commerce afin de de sanctionner les conditions commerciales différenciées sans contrepartie pratiquées par les fournisseurs, qu'ils soient grossistes ou non, envers les distributeurs ultramarins - laquelle modification ne peut intervenir qu'au niveau législatif ;
- permettre à la DGCCRF de disposer d'informations claires et complètes relatives à l'ensemble des tarifs et des prix convenus par les fournisseurs avec les premiers acheteurs de PGC destinés à une consommation finale dans les outre-mer afin de prévenir les situations non justifiées par des raisons objectives de différenciation des conditions commerciales - laquelle obligation ne peut être créée que par une disposition législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de cette disposition est de ne permettre aux fournisseurs, qu'ils soient grossistes ou non, de pratiquer, pour des produits parfaitement identiques, des conditions commerciales différenciées entre les acheteurs de produits destinés aux territoires ultramarins et les acheteurs de produits destinés à l'Hexagone qu'à la condition de contreparties objectives, liées par exemple à l'éloignement géographique lorsque le fournisseur se charge de l'acheminement des marchandises jusqu'au territoire ultramarin.
Il est prévu, en parallèle, une obligation déclarative, incombant aux fournisseurs et portant sur deux éléments : (i) leurs tarifs selon la destination des produits et (ii) sur les prix convenus en Hexagone et dans les DROM, et l'explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant. Cela permettra à la DGCCRF de s'assurer du respect de l'interdiction de discrimination et de mieux documenter les spécificités des circuits d'approvisionnement dans les DROM et leur impact sur la construction des tarifs et des prix convenus à l'issue des négociations commerciales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
(i) Au sujet de l'application des CGV dans les outre-mer : la présente disposition vise à répondre à la mesure figurant dans la proposition de loi de Victorin Lurel visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer. L'objet de cette proposition de loi était de prévoir l'application des conditions générales de vente de plein droit et de manière transparente et non-discriminatoire dans les DROM. Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat, est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
L'article 3 bis de la proposition de loi susvisée, tel qu'adopté par le Sénat le 5 mars 2025, dispose ainsi : « Art. L. 441-2-1. - Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les conditions générales de vente établies au niveau national entre un fournisseur, un distributeur ou un prestataire de services et définies dans la présente section s'appliquent de plein droit, de façon transparente et non discriminatoire. »
Or il ne semble pas économiquement pertinent ni équitable, du fait des contraintes inhérentes à l'approvisionnement des territoires ultramarins liées à leur éloignement géographique du territoire métropolitain, d'imposer aux fournisseurs l'application de conditions générales de vente rigoureusement identiques, que l'acheteur soit situé en métropole ou sur un territoire ultramarin : en effet, les circuits logistiques sont différents, les volumes d'affaires moins importants, et, dans certains cas, les recettes, conditionnements et dates de durabilité minimale, par exemple, sont adaptés aux marchés des DROM.
La notion d'application de plein droit des conditions générales de vente n'a donc pas été reprise dans la disposition proposée. En effet, les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale, conformément au III de l'article L. 441-1 et au IV de l'article L.441-1-2 (pour les grossistes) du code de commerce. Elles ne sauraient donc s'appliquer obligatoirement de plein droit mais elles sont le point de départ de la négociation ; elles peuvent toutefois déjà s'appliquer de plein droit, mais seulement lorsque l'acheteur ne souhaite par les négocier.
(ii) Au sujet des pratiques commerciales en outre-mer : certains acteurs appellent de leurs voeux la restauration des « prix export ». Or une telle restauration n'est pas envisageable : la pratique avait cours dans le contexte révolu des exclusivités d'importation pour les grossistes-importateurs. Ces derniers bénéficiaient, de la part de leurs fournisseurs implantés dans l'Hexagone, de prix facturés préférentiellement bas, permettant ainsi de réduire l'assiette de l'octroi de mer, et assuraient en contrepartie à leurs frais les services de coopération commerciale par exemple, sans les facturer ensuite aux fournisseurs comme cela est normalement le cas. Désormais, les produits d'une même marque peuvent être acquis par une enseigne via plusieurs circuits et les fournisseurs n'ont plus de raison de pratiquer de prix export dans ces conditions.
(iii) Sur l'obligation de communication des informations commerciales par les fournisseurs : la communication de ces informations par les fournisseurs sur une base volontaire ne constituait pas une option réaliste.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La disposition proposée prévoit donc trois modifications du code de commerce, applicables aux territoires ultramarins.
(i) La première modification introduit une interdiction, à la fois pour les fournisseurs et les grossistes, de pratiquer des CGV différenciées au seul motif que les produits sont destinés aux territoires ultramarins. Cette modification, respectivement de l'article L. 441-1 et l'article L.441-1-2 du code de commerce permet d'assurer la sanction de l'interdiction nouvellement introduite : les manquements à la nouvelle interdiction seraient passibles des sanctions administratives prévues au IV de l'article L. 441-1 et au VI de l'article L.441-1-2 du code de commerce (amende administrative de 75.000 euros par manquements pour les personnes morales).
(ii) La deuxième modification introduit une nouvelle pratique restrictive de concurrence (pratique commerciale déloyale au sens du code de commerce) passible de sanctions civiles et qui consiste en l'application de conditions commerciales différenciées au seul motif que les produits sont destinés aux territoires ultramarins. Cette modification nécessite de compléter texte actuel du 4° du I de l'article L. 442-1 qui dispose déjà qu'il est interdit de « pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ». En effet, un distributeur ultramarin n'est pas en concurrence avec un distributeur métropolitain c'est pourquoi la condition d'un avantage ou d'un désavantage dans la concurrence n'a pas été reprise dans la disposition proposée. Cette disposition s'applique indistinctement à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et donc également aux grossistes sans qu'une précision en ce sens soit nécessaire.
En tant que telle, la disposition relative à l'interdiction de pratiques discriminatoires ne créerait pas d'obligation particulièrement nouvelle pour les fournisseurs, le principe de non-discrimination existant déjà dans l'article L. 442-1 ainsi qu'en droit civil. Il s'agit seulement d'adapter ce principe à la réalité ultramarine en précisant la législation actuelle et en actant que les distributeurs implantés dans les DROM ne sont pas en concurrence avec les distributeurs hexagonaux. A ce jour, les fournisseurs peuvent en effet appliquer des conditions commerciales différenciées et non justifiées par des contreparties réelles envers les distributeurs ultramarins sans être passibles d'une sanction au titre du 4° du I de l'article L. 442-1 du code de commerce. C'est pour prévenir ce type de pratiques que la présente mesure est proposée dans le cadre du projet de loi et que des sanctions sont prévues pour les opérateurs qui ne la respecteraient pas.
(iii) La troisième modification introduit un nouvel article L. 441-4-2, qui prévoit une obligation, pour les fournisseurs de produits de grande consommation destinés aux DROM, de transmettre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur simple demande, les éléments relatifs à leurs différents tarifs selon la destination des produits, aux prix convenus en Hexagone et dans les DROM, et à l'explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant. Elle vise aussi à identifier, via les déclarations des fournisseurs, ces raisons objectives.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Au sein du code de commerce, les articles L. 441-1, L.441-1-2 et L. 442-1 sont modifiés, et l'article L. 441-4-2 est créé.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La mesure n'a pas d'impact sur le droit international, ni sur le droit de l'Union européenne.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
L'impact attendu de cette mesure consiste en un effet potentiellement positif sur les prix des produits lors de leur première cession entre l'industriel et le distributeur ultramarin, l'interdiction de conditions discriminatoires étant susceptible d'amener certains industriels à pratiquer des prix plus bas ou à octroyer aux distributeurs ultramarins des avantages financiers à des niveaux plus proches de ceux consentis à leurs distributeurs établis en France hexagonale. En effet, les conditions commerciales différenciées pratiquées aujourd'hui par les fournisseurs envers les distributeurs ultramarins contribuent à augmenter le coût d'achat des produits par les distributeurs et à aggraver le phénomène de cherté de la vie dans les territoires ultramarins, contre lequel les pouvoirs publics cherchent justement à lutter.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
(i) L'impact attendu de cette mesure consiste en ce que les fournisseurs ne pratiquent plus, envers leurs acheteurs de produits de grande consommation destinés aux territoires ultramarins, des conditions commerciales différenciées qui ne seraient pas justifiées par des raisons objectives. Cette baisse des prix de vente aux distributeurs ultramarins est possible mais toutefois incertaine.
(ii) En outre, l'obligation déclarative dont est assortie la nouvelle interdiction de pratiques commerciales déloyales entre l'Hexagone et les outre-mer représenterait nécessairement une nouvelle charge, administrative et financière, pour les fournisseurs concernés. Elle pourrait donc être perçue négativement, et en tout état de cause, être regardée comme étant contraire aux objectifs de simplification poursuivis par le Gouvernement.
Toutefois, cette obligation porterait sur un nombre relativement restreint d'opérateurs, c'est-à-dire ceux dont les produits sont distribués dans les DROM, et avec lesquels une négociation dédiée est menée. Les négociations menées avec les centrales d'achat hexagonales seraient par nature exclues du champ de la déclaration, les conditions étant négociées sans distinction particulière entre destination hexagonale ou ultra-marine des produits, et le fournisseur n'ayant pas connaissance de cette dernière.
Enfin, parmi les opérateurs concernés, tous ne seraient pas sollicités chaque année, la déclaration n'étant obligatoire que sur demande de l'autorité administrative en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle pourra donc déterminer un panel limité mais représentatif, susceptible d'évoluer chaque année, de façon à ce que l'impact sur les entreprises soit limité et proportionné à l'objectif poursuivi d'une plus grande transparence sur les mécanismes de formation des prix dans les DROM.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La première partie de la mesure n'a pas d'impact direct sur les services administratifs, s'agissant d'une simple déclinaison du principe général d'interdiction des pratiques discriminatoires, elle ne crée pas une nouvelle charge de contrôle et n'implique pas la mise en oeuvre de méthodologies d'investigation inhabituelles.
Les obligations déclaratives dont elle est assortie sont en revanche susceptibles d'impacter les services de l'État au niveau central. L'autorité administrative en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, c'est-à-dire la DGCCRF, serait en effet chargée d'agréger les contributions reçues de la part des fournisseurs.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Bien que non quantifiable à ce stade (en l'absence de données précises sur les pratiques des fournisseurs), un impact déflationniste est attendu de cette disposition.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Bien que non quantifiable à ce stade (en l'absence de données précises sur les pratiques des fournisseurs), un impact d'amélioration du pouvoir d'achat des particuliers est attendu de cette disposition.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Par ailleurs, il est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu'ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur. En effet, dès lors que le présent article crée de nouvelles interdictions, dont le non-respect est passible de sanctions administratives et dont l'élément matériel trouve sa source dans les CGV et les conventions, il ne peut s'appliquer qu'aux documents établis et signés après sa promulgation.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Le IV du présent article nécessite un décret en Conseil d'Etat pour préciser en tant que de besoin les modalités d'application de cette obligation, notamment les modalités de communication et les documents devant l'accompagner.
Article 9 - Accentuer le pouvoir d'injonction du juge pour assurer une meilleure transparence comptable des entreprises en outre-mer
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
En l'état actuel du droit, toute société commerciale doit obligatoirement déposer ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de la clôture de chaque exercice annuel (articles L 232-21 à L 232-26 du code de commerce). Ces documents comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable. Le dépôt des comptes assure une certaine transparence financière et garantit l'information des tiers.
En outre-mer, la transmission des pièces et actes au RCS, prévue par des dispositions réglementaires ou législatives, par un grand nombre d'entreprises, fait défaut. A titre d'exemple, dans les Antilles-Guyane, entre 20 et 24 % des sociétés déposent leurs comptes sociaux. Ces chiffres descendent même à 14 % au greffe du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui comprend également les sociétés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, alors qu'au niveau national ce taux atteint 85 %. Il apparait nécessaire de renforcer l'arsenal juridique, en particulier les sanctions aujourd'hui peu dissuasives, et de l'adapter aux besoins des territoires ultramarins, afin d'améliorer la transparence comptable des entreprises.
Le défaut d'exécution de l'obligation de publicité des comptes sociaux est sanctionné d'une amende de cinquième classe ( R. 247-3 du code de commerce), dont le montant est modeste pour les entreprises d'une certaine taille. Cependant, le dispositif punitif est relayé par le dispositif des injonctions sous astreinte, qui vise, selon le droit commun, la société elle-même (par application des articles L. 232-23 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, Com. 3 mars 2021, n° 19-10.086), et en application de l'articles L. 123-5-1, les dirigeants sociaux.
Par ailleurs, l'article R. 210-18 du code de commerce prévoit un mécanisme de mise en oeuvre forcée, via la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc. L'efficacité de mise en oeuvre de ces mécanismes repose ainsi davantage sur l'initiative des personnes intéressées, plutôt que sur la diligence du ministère public, confronté à des choix de priorité d'action publique en matière d'infractions économiques.
L'article L. 123-5-1 du code de commerce, issu de l'article 123 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, prévoit la possibilité pour le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. - Par exemple, il peut enjoindre le dépôt par toute société commerciale des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable), comme le prévoient les articles L. 232-21 et suivants du code de commerce.
En pratique, ces dispositions ont été peu appliquées, les entreprises ultramarines étant moins diligentes quant à cette obligation de transparence que dans l'hexagone. La présente disposition vise donc à accentuer le pouvoir d'injonction du juge, en majorant la sanction encourue par l'entreprise en cas de non-transmission de ses comptes et en prévoyant la possibilité d'une publicité de la décision judiciaire. En outre, les associations de consommateurs sont expressément visées par ce nouvel article L. 123-5-1-1 pour plus de transparence afin de ne pas laisser planer de doute sur l'intérêt et la qualité à agir de ces associations.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le montant de l'astreinte pouvant être prononcée par le juge sera plafonné (5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société). Il s'agit donc d'un maximum légal, le juge pouvant toujours aller en-deçà en fonction des circonstances de l'espèce. Ce mécanisme, qui se retrouve également à l'article L. 123-5-2 du code de commerce instauré par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi dite « Egalim »),a été déclaré conforme par le Conseil constitutionnel ( Cons. const. 25 oct. 2018, n° 2018-771 DC, consid. n°5 et s.).
L'affichage ou la diffusion d'une décision judiciaire se retrouve fréquemment en matière pénale ou « para pénale ». Il s'agit d'une peine complémentaire applicable pour les personnes morales ( art. 131-39 19° CP). S'agissant des dispositions prévoyant une peine complémentaire d'affichage d'une décision, le Conseil constitutionnel a pu décider de la constitutionnalité de la peine complémentaire obligatoire de publicité de la condamnation pour pratiques commerciales trompeuses, dans la mesure où le juge peut tout de même individualiser les modalités d'exécution de cette peine, en faisant varier l'importance et la durée de la publication ( Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-41 QPC, consid. n° 4). En revanche, il a déclaré contraire à la Constitution une disposition qui prévoyait un affichage automatique de la décision sans laisser au juge de marge suffisante pour fixer les modalités de cette peine ( Cons. const. 10 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC, consid. n°5). Même si elles concernent la matière pénale, ces décisions peuvent être transposées mutatis mutandis à la disposition envisagée. En effet, la mesure de publication d'une décision qui constate un manquement et ordonne sous astreinte à la société d'y mettre un terme pourrait être analysée comme une forme de sanction par le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle il est proposé de retenir une rédaction qui permet au juge : (i) de décider de l'opportunité d'ordonner la publication de la décision lorsqu'une telle demande sera faite par le représentant de l'Etat, (ii) de fixer les modalités de cette publicité (durée, support).
Enfin, s'agissant de la possibilité de prévoir un mécanisme qui ne serait applicable que dans certains territoires (ici les collectivités ultramarines), le Conseil constitutionnel admet que le législateur peut prévoir des règles différenciées entre l'hexagone et les collectivités ultramarines sans contrevenir au principe d'indivisibilité de la République ( Cons. const. 6 sept. 2018, n°2018-770 DC, consd. ,°40 et s.). En particulier, le Conseil constitutionnel a validé le mécanisme de l'injonction prévu à l'article L123-5-2 du code de commerce qui ne s'appliquait qu'aux sociétés opérant dans le secteur agroalimentaire, alors pourtant que les obligations de publicité des comptes incombent à toutes les sociétés commerciales. Il a écarté le grief tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi en estimant que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ( Cons. const. 25 oct. 2018, n° 2018-771 DC, consid. n°5 et s.). Dès lors, il semble possible de prévoir un mécanisme d'injonction applicable uniquement dans certains territoires dans la mesure où cette disposition poursuit une raison d'intérêt général (augmenter la transparence économique des acteurs ultra-marins) et est en rapport direct avec l'objet de la présente loi (lutte contre la vie chère en outre-mer).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'obligation de publicité des comptes résulte également du droit communautaire, aux termes de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'option législative est nécessaire puis qu'il s'agit de renforcer le montant de l'amende dissuasive en cas de non dépôt de ses comptes au RCS par une entreprise ultramarine, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
Par rapport aux injonctions existantes, la présente disposition propose une injonction spécifique, applicable uniquement dans les collectivités d'outre-mer et pour les sociétés qui ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes. Elle permet au préfet et aux associations, qui sont les interlocuteurs privilégiés des consommateurs ultramarins dans la lutte contre la vie chère, de saisir le président du tribunal de commerce pour qu'il enjoigne les entreprises négligentes, à déposer leurs comptes.
Ces dispositions visant à créer une nouvelle source de responsabilité civile pour les entreprises dans les outre-mer et modifiant pour ce faire le code de commerce, elles appartiennent bien au champ de l'article 34 de la Constitution.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure doit permettre de renforcer la transparence des activités économiques et de s'assurer qu'en cas de non-transmission des données, les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code consommation qui justifient d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ou le représentant de l'Etat saisiront le juge des référés qui pourra appliquer une astreinte dissuasive.
Elle doit également permettre au juge, sur demande de la partie demanderesse, d'instaurer une mesure de publicité rendant publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.
Cette disposition, qui vise à dissuader les comportements « frauduleux », contribue à faire évoluer les normes en matière économique, et, à ce titre, elle constitue un aspect important d'une stratégie en faveur de la transparence des entreprises en outre-mer, nécessaire à l'identification des déterminants de la vie chère dans les territoires ultramarins.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Plusieurs options ont été envisagées afin de répondre à la nécessité de renforcer la transparence de la vie économique dans les outre-mer.
Option n°1 : Prévoir la possibilité pour le président du tribunal d'enjoindre le dirigeant de l'entreprise qui ne se conforme pas aux obligations de transmission des pièces et actes au RCS prévues par des obligations réglementaires ou législatives, à une amende en valeur absolue plafonnée à 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
Cette option ne semble pas parfaitement adaptée ni juste, les manquements aux obligations de transmission au RCS étant davantage rattachables à la société en tant que personne morale et qu'à son dirigeant. Par ailleurs, la sanction prononcée contre la personne morale est plus incitative car permettant d'appliquer un montant d'astreinte plus élevé.
Option n°2 : Prévoir la possibilité pour le président du tribunal d'enjoindre la personne morale qui ne se conforme pas aux obligations de transmission des pièces et actes au RCS prévues par des obligations réglementaires ou législatives, à une amende dont le montant ne peut dépasser ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société qui fait l'objet de l'injonction, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Ce dispositif a été retenu.
Option complémentaire : Prévoir également la possibilité pour le président du tribunal d'ordonner la publication de la décision d'injonction. Ce dispositif a été retenu.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option n°2 et l'option complémentaire ont ainsi été privilégiées car plus incitatives.
La présente disposition propose de renforcer la transparence de la vie économique dans les outre-mer en complétant le droit en vigueur par un dispositif similaire à celui prévu à l'article L. 123-5-1 précité. La nouvelle saisine du juge, ainsi introduite, pourra résulter de la demande des associations de consommateurs (mentionnées à l' article L. 621-1 du code consommation) qui justifient d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l'Etat, et visera la personne morale ayant manqué à ses obligations afin de rattacher la sanction à la personne à laquelle incombe l'obligation.
L'obligation de dépôt des comptes sociaux annuels et de leurs documents annexes au greffe du tribunal de commerce concernant les sociétés commerciales, donc la personne morale, celle-ci est titulaire de droits et de devoirs. A ce titre, il est tout à fait justifié qu'elle puisse engager sa responsabilité civile, en cas de faute ou de non-respect de ses obligations, et pénale propre, comme c'est déjà le cas en vertu de l'article 121-2 du code pénal en cas d'infractions commises pour son compte ou par ses représentants.
Par ailleurs, la personne morale disposant d'un patrimoine autonome, il permet à la présente disposition de prévoir un montant d'astreinte plus important, et donc plus dissuasif, que celui de l'article L.123-5-1 susvisé.
Pour davantage de transparence et de prévisibilité de la sanction à l'égard des entreprises, il est également prévu un montant maximal de l'astreinte pouvant être prononcée par le président du tribunal de commerce par jour de retard à compter de la date fixée dans l'injonction. Ce montant maximal de l'astreinte est fixé à 5% du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes afin de tenir compte de la taille de l'entreprise concernée.
Concernant la liquidation de l'astreinte, il est fait le choix de ne pas faire un renvoi aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), car ces dispositions ont en tout état de cause vocation à s'appliquer et le renvoi à ces dispositions spécifiques peut générer un doute quant à l'applicabilité des autres dispositions du droit commun. Il est donc proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour le régime de liquidation de l'astreinte, qui seront inspirées des dispositions de l'article R. 611-16 du code de commerce, dans la mesure où la loi ne peut renvoyer à un article réglementaire.
Il en résulte que seul le juge qui a prononcé l'astreinte sera compétent pour la liquider, à l'exclusion du juge de l'exécution. Par ailleurs, le montant de l'astreinte sera versé au Trésor public et non pas au demandeur. Enfin, les voies de recours ouvertes contre cette décision pourront être exercées par le procureur de la République et l'appel sera instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure sans représentation obligatoire.
Ce dispositif de sanction serait en outre assorti d'une mesure de type « name and shame » permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise et donc de dissuader le contournement de la loi. Du fait du cadre constitutionnel mentionné supra, il est proposé de retenir une rédaction qui permet au juge : (i) de décider de l'opportunité d'ordonner la publication de la décision lorsqu'une telle demande sera faite par le représentant de l'Etat, (ii) de fixer les modalités de cette publicité (durée, support).
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Est inséré, après l'article L.123-5-1 du code de commerce, un article L. 123-5-1-1.
La présente mesure mentionne le « président du tribunal » ; celle-ci a un impact juridique neutre sur la répartition des compétences classiques entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures proposées visent à participer d'un impact déflationniste pour le consommateur en outre-mer.
Un certain niveau de transparence est nécessaire dans un marché. Notamment parce que l'asymétrie d'information donne à ceux qui ont accès aux données les plus précises un pouvoir disproportionné. Mais aussi parce qu'une transparence accrue permet aux différents acteurs de faire des choix plus éclairés, de mieux comprendre les mécanismes de formation des prix et l'évolution des tendances dans l'ensemble de la chaîne alimentaire.
La transparence est, pour le consommateur, également une question d'équité : l'égalité d'accès à des informations sur les prix lui fait mieux appréhender la chaîne d'approvisionnement et l'autorise à avoir plus de liberté dans le choix de ses achats. Or, en période d'inflation, l'impact des hausses qui en résultent ont des conséquences sur le pouvoir d'achat des consommateurs.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La présente disposition vise désormais les personnes morales, donc les entreprises et non plus son dirigeant, en cas de non-transmission des actes et pièces au RCS, prévue par des dispositions réglementaires ou législatives :
- Elle aura un impact administratif sur les entreprises, en accroissant les incitations à ce qu'elles déposent leurs comptes au RCS.
- Elle pourrait également avoir un impact financier sur les entreprises, dans le cas où celles-ci devraient s'acquitter de l'astreinte proposée.
- Elle pourrait enfin avoir un impact sur la réputation des entreprises, dans le cas où celles-ci se verraient enjoindre d'afficher la décision judiciaire dont elles auront fait l'objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
La mesure pourrait avoir impact budgétaire marginal positif du fait du recouvrement des astreintes prévues par la présente disposition en cas de non-transmission des comptes par les entreprises.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure est susceptible d'avoir un impact sur l'activité des tribunaux de commerce en outre-mer.
Le recouvrement des astreintes devrait impacter l'activité des services de recouvrement selon les modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet
4.5.6. Impacts sur les particuliers
La transparence de l'information a pour objectif de faire baisser le coût des marchandises de grande consommation, et ainsi d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs.
4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
La mesure nécessite un décret en Conseil d'Etat afin de fixer les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive.
TITRE III - RENFORCER LA CONCURRENCE
Article 10 - Augmenter les moyens de l'Autorité de la concurrence pour agir en outre-mer
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
L'Autorité de la concurrence (ADLC) est une autorité administrative indépendante (AAI) instituée par l'article 95-I 2° de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite « LME »). L'organisation de son collège est fixée à l'article L. 461-1 II du code de commerce.
Il se compose de dix-sept membres au mandat irrévocable. Le président et les quatre vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics (article L. 461-2 du code de commerce), tandis que les 12 autres membres sont non permanents. Les membres du collège sont nommés pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Les membres sont issus de la sphère publique mais également de la sphère privée : ainsi magistrats, professeurs d'université, responsables économiques, représentants d'organisations professionnelles ou d'associations de consommateurs croisent leurs points de vue lors des délibérations.
Cette diversité de profils favorise la richesse des échanges et est un gage d'impartialité. La composition actuelle du collège est la suivante :
- un président nommé par décret du Président de la République (article L. 461-1 du code de commerce) ;
- un 1er groupe de personnalités comprenant six membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
- un 2ème groupe de personnalités comprenant cinq membres choisis en raison de leurs compétences en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
- un 3ème groupe de personnalités comprenant cinq membres exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
Parmi les membres du collège, quatre sont désignées dans les fonctions de vice-présidents ou vice-présidentes, dont au moins deux au titre des 2èmeet 3ème groupes de personnalités :
- Choisies en raison de leurs compétences en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;
- Exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
L'article 4 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes a introduit des règles de parité au sein des différents groupes de personnalités composant le collège. Le premier groupe de personnalités comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Les deuxième et troisième groupes comprennent, ensemble, un nombre égal de femmes et d'hommes (article L. 461-1 II du Code de commerce).
L'article 28 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes a précisé les modalités de renouvellement des membres du collège, codifiées aux II et III de l'article L. 461-1 du code de commerce :
- le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois ;
- le mandat des membres du collège n'est renouvelable qu'une seule fois.
L'article 7 de ladite loi a précisé les modalités de remplacement d'un membre du collège avant la fin de son mandat : un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.
L'article 2-I du décret n° 2019-169 du 6 mars 2019 a précisé que pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité de la concurrence, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prenait fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin (article R. 461-10 du Code de commerce).
Depuis 2017, les membres du collège sont soumis aux règles sur les conflits d'intérêt des membres d'une autorité administrative indépendante, définies à l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
Ces règles de composition, de nomination et de renouvellement des membres du collège de l'ADLC ne prévoient pas de critère d'expertise de l'économie ou de concurrence spécifique aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. C'est ce point que le I. du présent article modifie en prévoyant que deux nouvelles personnalités sont choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les économies d'outre-mer.
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
Le rôle et l'organisation des services d'instruction de l'ADLC sont fixés à l'article L. 461-4 du code de commerce et aux articles R. 461-3 à R. 461-8 du même code.
Les services d'instruction sont dirigés par un rapporteur général.
Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A (article R. 461-3 du code de commerce du code de commerce).
Les rapporteurs permanents sont nommés parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A (article R. 461-4 du code de commerce).
Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite (article R. 461-5 du code de commerce).
L'article 9 de la décision de l'Autorité du 17 juin 2024 portant organisation de l'Autorité de la concurrence précise que le nombre et la composition des services d'instruction sont fixés par le rapporteur général de l'Autorité.
Selon le rapport annuel 2023 de l'Autorité, les services d'instruction représentaient, au 31 décembre 2023, 123,62 équivalents temps plein travaillés (ETPT) soit 62,02% de ses effectifs.
Ils sont organisés en six services « concurrence » dédiés aux pratiques anticoncurrentielles (activité dite « antitrust ») et à l'activité consultative, un service des investigations, un service en charge du contrôle des concentrations, un service économique et un service de l'économie numérique. Le II de l'article 11 du projet de loi vise à créer, au sein des services d'instructions de l'Autorité de la concurrence, un service dédié aux outre-mer pour renforcer la régulation concurrentielle en outre-mer, en modifiant l'article L. 461-4 du code de commerce.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
La réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de procédures d'enquête et de contentieux relatifs à la politique de concurrence souffre de lacunes par rapport au droit applicable en Polynésie française. Ce retard et cette asymétrie freinent l'efficacité de la lutte contre la vie chère en Nouvelle-Calédonie.
La présente mesure permet d'y remédier en mettant en harmonie le droit applicable en Nouvelle-Calédonie par des modifications de l'ordonnance de 2014 ratifiée par l'article 56 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014. Ainsi, le contentieux des sanctions des pratiques anticoncurrentielles et celui des décisions connexes relatives au secret des affaires dans le cadre de ces mêmes procédures seraient unifié sur l'ensemble du territoire national (Hexagone et outre-mer, y compris la Polynésie-Française et la Nouvelle-Calédonie) et confié au premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
En effet, si les collectivités de Polynésie-Française et de Nouvelle-Calédonie disposent chacune d'une compétence exclusive en matière de droit de la concurrence, l'Etat conserve une compétence en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours et de sanctions, ce qui justifie l'unification des contentieux relatifs à la concurrence dans le même ordre de juridiction.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
L'Autorité de la concurrence est l'autorité administrative indépendante en charge du contrôle des concentrations en France. À ce titre, l'Autorité de la concurrence est tenue d'examiner toute opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, dès lors qu'elle franchit certains seuils exprimés en chiffres d'affaires définis à l'article L. 430-2 du code de commerce. Les concentrations couvrent les opérations entrainant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Elles peuvent prendre différentes formes : fusion d'entreprises antérieurement indépendantes, prise de contrôle d'une entreprise par une autre entreprise, création par deux sociétés persistantes d'une entreprise commune. Ces opérations font l'objet d'une notification obligatoire à l'Autorité de la concurrence, qui doit intervenir avant la réalisation de l'opération de concentration, conformément à l'article L. 430-3 du code de commerce. L'Autorité de la concurrence a l'obligation de se prononcer dans un délai contraint fixé par la loi (Articles L430-5 à L430-7 du code de commerce), afin de ne pas ralentir plus que nécessaire les activités économiques des entreprises. Pour les cas ne présentant pas difficultés d'analyse particulières, l'Autorité effectue un examen rapide sous 25 jours ouvrés (phase 1).
Si, au terme de ce premier examen, des doutes subsistent quant au risque d'atteinte à la concurrence, l'Autorité ouvre une procédure d'examen approfondi (phase 2) et dispose de 65 jours ouvrés supplémentaires46(*).
L'article L. 430-8 du code de commerce prévoit plusieurs sanctions à l'égard des entreprises ayant réalisé des opérations de concentration sans avoir procédé à la notification préalable obligatoire. Elle peut obliger les sociétés à procéder à la notification, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. En outre, elle peut leur infliger une sanction pécuniaire : jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France pour les personnes morales et 1,5 millions d'euros pour les personnes physiques.
Les seuils applicables au contrôle national des concentrations ont varié à plusieurs reprises dans la législation française depuis l'instauration d'un tel contrôle.
La loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante mettait pour la première fois en oeuvre un contrôle des opérations de concentration fondé sur un mécanisme de notification volontaire des parties à l'opération, qui réalisaient plus de 25 % des ventes ou des achats sur le(s) marché(s) concerné(s) par l'opération. Un contrôle plus spécifique des concentrations a été instauré, toujours sur une base volontaire, par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, avec deux seuils alternatifs : une opération de concentration était contrôlable (i) si le chiffre d'affaires total des parties à l'opération était supérieur à sept milliards de francs et le chiffre d'affaires d'au moins deux des parties était supérieur à deux milliards de francs, ou (ii) si les parties réalisaient plus de 25 % des ventes ou des achats sur le(s) marché(s) concerné(s).
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite « NRE ») a modifié le système en instaurant une procédure de notification obligatoire des concentrations auprès du ministre chargé de l'économie et des finances, à la condition que deux seuils exprimés en chiffre d'affaires soient cumulativement atteints : (i) le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des parties à la concentration doit être supérieur à 150 millions d'euros et (ii) le chiffre d'affaires en France d'au moins deux des parties à l'opération doit être supérieur à 15 millions d'euros. Le seuil alternatif en parts de marché a ainsi été abandonné. Ces seuils sont applicables à tous les secteurs économiques et pour l'ensemble du territoire national.
L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 a porté de 15 à 50 millions d'euros le second seuil en chiffre d'affaires. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite « LME ») a transféré la compétence du contrôle des concentrations du ministre chargé de l'économie à l'Autorité de la concurrence. La LME a également introduit, outre les seuils généraux, des seuils spécifiques pour les opérations portant sur le commerce de détail et pour les opérations impliquant une entreprise active dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer. En 201047(*), un seuil local spécifique au commerce de détail en outre-mer a été mis en place, à la suite des recommandations de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de son avis de 2009 concernant le fonctionnement de la concurrence en outre-mer48(*), et initialement fixé à 7,5 millions d'euros. La loi relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel » du 20 novembre 201249(*), a abaissé ce seuil à 5 millions d'euros, pour tenir compte du fait que les chiffres d'affaires réalisés en outre-mer par le commerce de détail sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole, et s'assurer ainsi que ces opérations n'échappent pas au contrôle de l'Autorité.
À ce jour, le contrôle des concentrations s'inscrit dans le cadre légal défini par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du code de commerce. Sa mise en oeuvre est précisée par les articles R. 430-2 à R. 430-10 de la partie réglementaire du code de commerce.
· Les seuils applicables à tous les secteurs économiques et pour l'ensemble du territoire national (seuils dits « généraux »)
Le paragraphe I de l'article L. 430-2 du code de commerce définit le niveau des seuils généraux, applicables à tous les secteurs économiques et pour l'ensemble du territoire national depuis 2004. En vertu de cet article, une concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; et
- l'opération n'entre pas dans le champ de compétence de la Commission définie par le règlement 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Depuis la LME de 2008, le commerce de détail fait l'objet de dispositions spécifiques.
Selon le paragraphe II de l'article L. 430-2 du code de commerce, lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004.
Comme précisé dans les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations50(*), la notion de commerce de détail est définie par référence aux règles applicables en matière d'équipement commercial. Un magasin de commerce de détail s'entend comme un magasin qui effectue, pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Sont traditionnellement assimilés à du commerce de détail, bien que ne constituant pas de la vente de marchandises, un certain nombre de prestations de service à caractère artisanal : pressing, coiffure et esthétique, cordonnerie, photographie, entretien de véhicules et montage de pneus. Sont exclues de la notion de commerce de détail les prestations de service à caractère immatériel ou intellectuel (comme les banques, l'assurance, ou les agences de voyage), ainsi que les établissements de service ou de location de matériel (comme les laveries automatiques, les vidéothèques ou les salles de sport), et les restaurants. Sont également exclues de la notion de commerce de détail les entreprises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne ou par correspondance, ou encore via des livraisons directes aux consommateurs, le II de l'article L. 430-2 précisant que ne sont concernées que les entreprises qui exploitent au moins un magasin.
Il n'existe pas de définition légale du commerce de détail en France. L'INSSE définit le commerce de détail comme la vente « des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Outre la vente, cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l'installation chez le client (de meubles ou d'électroménager par exemple). La commercialisation d'un bien comprend généralement successivement une activité de commerce de gros suivie d'une activité de commerce de détail mais certains biens (biens d'équipement) ne font pas l'objet de commerce de détail. »51(*).
La notion de « commerce de détail » au sens de l'article L. 430-2, III du code de commerce recouvre un champ matériel très large. L'Autorité a pu sur ce fondement examiner des opérations dans des domaines variés, tels que :
- La distribution à dominante alimentaire (voir par exemple la décision n° 14-DCC-34 du 18 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs de la société GD Sainte Rose et de la SARL du Sud par la société Soco Sainte Rose) ;
- Les concessions et la location automobile (voir par exemple la décision n° 19-DCC-11 du 23 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Mayotte Motor Corporation Distribution et Hamaha Rent par la société Citadelle) ;
- La vente au détail de carburant et de combustibles (voir par exemple la décision n° 12-DCC-53 du 24 avril 2012 relative à l'acquisition du fonds de commerce de la société West Indies Petroleum Company par la société Compagnie Antillaise des Pétroles) ;
- La boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (voir par exemple la décision n° 20-DCC-28 du 03 mars 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Financière Pain Frotté par les groupes Kin Siong, Lam Tow et Yong Wai Man) ;
- La vente au détail de produits électrodomestiques (voir par exemple la décision n° 18-DCC-79 du 23 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dimeco par la société Cafom).
Les seuils spécifiques au commerce de détail permettent à l'Autorité de la concurrence de contrôler des concentrations non soumises au contrôle des concentrations en vertu des seuils du I de l'article L. 430-2 qui pourraient affaiblir substantiellement la concurrence dans certaines zones de chalandise locales.
· Les seuils applicables aux entreprises actives dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer (seuils dits « outre-mer »)
Depuis la LME, le paragraphe III de l'article L. 430-2 prévoit des seuils de notification spécifiques pour les opérations de concentrations impliquant des entreprises actives dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer.
Selon les termes de cette disposition, lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004.
Cette disposition permet à l'Autorité de la concurrence de contrôler des concentrations - non soumises au contrôle des concentrations en vertu des seuils du I et II de l'article L. 430-2 - qui pourraient affaiblir substantiellement la concurrence dans certains départements et collectivités d'outre-mer.
Le seuil spécifiquement applicable au commerce de détail en outre-mer a pour objet de soumettre au contrôle préalable de l'Autorité les opérations ne dépassant le seuil général mais qui sont susceptibles de soulever des problèmes de concurrence dans des zones de chalandise locales.
A l'image de l'article L. 430-2, II, la notion de
« commerce de détail » au sens de l'article
L.
430-2, III recouvre un champ matériel étendu. L'Autorité
de la concurrence a pu, sur ce fondement, examiner des opérations dans
des domaines variés, tels que :
- La distribution à dominante alimentaire52(*) ;
- Les concessions et la location automobile53(*) ;
- La vente au détail de carburant et de combustibles54(*) ;
- La boulangerie, viennoiserie, pâtisserie55(*) ;
- La vente au détail de produits électrodomestiques56(*).
La mesure proposée abaisse le seuil local spécifique au commerce de détail (actuellement 5 millions d'euros à 3 millions d'euros) de notification de l'article L. 430-2 paragraphe III du code de commerce, applicable à certains départements et collectivités d'outre-mer, à 3 millions d'euros.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
Les mesures proposées aux I. et II. du présent article s'inscrivent dans le cadre de l'article 73 de la Constitution qui prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM afin de permettre l'adaptation des lois et règlements aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (Voir par exemple la décision Cons. const., du 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). Le même principe existe pour les COM à l'article 74-1 de la Constitution.
L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante (AAI). Conformément à la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, sa composition et ses attributions sont fixées par la loi qui l'institue, soit l'article 95-I 2° de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME).
L'organisation de l'Autorité de la concurrence permet à cette dernière d'assurer une distinction entre d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements aux règles de concurrence, assumées par les services d'instruction, et d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, dont son collège a la charge. Cette séparation permet à l'Autorité de se conformer au principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC), qui fait partie du bloc de constitutionalité, lequel dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » (Cons. const., 2013-331 QPC, 5 juill. 2013, Sté Numéricable SAS).
La diversité des membres du collège de l'Autorité de la concurrence, actuellement au nombre de dix-sept, permet d'associer le maximum de parties prenantes, en termes de capacités d'expertise et de représentation des intérêts concernés par les questions de régulation concurrentielle des marchés. L'ajout de deux personnalités au sein du collège, choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les collectivités d'outre-mer, ne remet pas en cause le principe de séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et celles de jugement décrit ci-avant. Le projet de disposition est donc conforme au principe d'impartialité.
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
La loi organique n° 2017-54 et la loi ordinaire n° 2017-55 du 20 janvier 2017 prévoient différentes garanties de l'indépendance des autorités administratives indépendantes (AAI), qui doivent s'apprécier globalement. L'habilitation donnée à une AAI d'établir par un règlement intérieur ses règles d'organisation et de fonctionnement, si elle constitue une des différentes dimensions de son autonomie fonctionnelle, ne semble pas être un des éléments essentiels de son indépendance au même titre que d'autres exigences, comme les conditions d'exercice des mandats de ses membres. L'inscription dans la loi d'une mesure organisationnelle concernant l'ADLC ne semble donc pas porter une atteinte substantielle à son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Si les autorités administratives indépendantes disposant d'un pouvoir de sanction sont soumises à une exigence renforcée d'indépendance dans l'exercice de leurs attributions57(*), la création d'un service d'instruction dédié à l'Outre-mer est sans impact sur l'organisation et la séparation des fonctions d'instruction de celles de jugement et sur les modes de saisine de l'ADLC. Elle n'a pour effet que d'orienter l'activité d'un des services d'instruction prévu à l' article L. 461-4 du code de commerce et ne porterait donc pas atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'ALDC dans l'exercice de sa mission de sanction.
L'inscription dans la loi de la création d'un service d'instruction dédié à l'Outre-Mer ne semble donc pas porter atteinte à l'indépendance de l'ADLC, que ce soit vis-à-vis du pouvoir exécutif ou dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Le IV et le V du présent article donnent la possibilité au Gouvernement, d'étendre en Nouvelle-Calédonie les dispositions de nature législative en vigueur en Hexagone, ou d'adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de cette collectivité.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La liberté d'entreprendre est un principe général à valeur constitutionnelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ( 81-132 DC, 16 janvier 1982, cons. 16, Journal officiel du 17 janvier 1982, page 299).
Par la décision QPC du 30 novembre 2012, le Conseil constitutionnel consacre la double portée de la liberté d'entreprendre, qui comprend « non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité » (Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012).
Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. ( 2010-55 QPC, 18 octobre 2010, cons. 4, Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n° 82)
Le statut des territoires ultra-marins et l'application des lois sur leur territoire sont régis par la Constitution du 4 octobre 1958. A cet égard l'article 73 dispose :
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement [...] ».
L'article 74 dispose également : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ».
Ces principes constitutionnels sont respectés par les dispositions du projet de loi qui vise spécifiquement l'abaissement du seuil local de contrôle par l'Autorité de la concurrence des opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail dans les territoires ultramarins. La limitation de la liberté d'entreprendre qui découle de ce contrôle est proportionnée au but d'intérêt général à atteindre, à savoir le renforcement des moyens de l'Autorité de la concurrence aux fins de préserver le pouvoir d'achat des citoyens des territoires d'outre-mer.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
Le traité de Rome signé en 1957 qui institue la communauté économique européenne (CEE) fixe les règles d'une concurrence loyale entre États membres.
Le droit européen de la concurrence interdit les accords restreignant la concurrence entre les entreprises (article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), anciennement 81 du Traité CEE, les abus de position dominante (article 102 TFUE, anciennement 82 du Traité CEE), certaines concentrations et acquisitions, ainsi que certaines aides d'Etat.
Depuis 2004, les autorités de concurrence des Etats membres de l'Union européenne sont tenues d'appliquer directement le droit européen en matière de pratiques anticoncurrentielles (articles 101 et 102 du TFUE. Le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité fixe le cadre procédural permettant une application uniforme du droit de la concurrence dans les Etats membres de l'Union européenne.
Transposée en droit national par l'Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, prise pour application de l'article 37 de la loi du 3 décembre 2020 relative à l'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, la directive 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « ECN + », a introduit des mécanismes pour que les autorités nationales de concurrence (ANC) disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des articles 101 et 102 du TFUE susmentionnés.
L'ajout de deux membres choisis en raison de leur expertise sur des sujets ultramarins, mais également compétents pour siéger sur tout type d'affaires, est compatible avec les exigences d'indépendance des autorités chargées de la régulation concurrentielle au sein de l'UE prescrites par la directive 2019/1 « ECN + », notamment son article 4.5, lequel dispose que « Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter des tâches nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [...]. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d'examiner les plaintes formelles, ces autorités ont le pouvoir de rejeter de telles plaintes au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité ».
L'élargissement du collège de l'Autorité de la concurrence à deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les territoires d'outre-mer ne remet pas en cause le principe de liberté de fixation des priorités ni le pouvoir de rejeter celles des plaintes que l'Autorité de la concurrence ne considérerait pas comme une priorité.
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
Le considérant 23 de la Directive ECN + susmentionnée prévoit que : « Le pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en oeuvre n'affecte pas le droit d'un gouvernement d'un État membre d'adresser à ces autorités des règles de politique générale ou des orientations prioritaires qui ne portent pas sur des enquêtes sectorielles ou sur une procédure particulière relative à la mise en oeuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
La disposition visant à créer un service dédié à l'Outre-mer au sein de l'Autorité de la concurrence est compatible avec la Directive ECN + susmentionnée dès lors que l'Autorité de la concurrence préserve son pouvoir de rejeter des plaintes, alors même que celles-ci concernent l'outre-mer, au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité. L'Autorité de la concurrence conserve en effet le pouvoir d'orienter son activité et de fixer librement ses priorités.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Le règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 du Conseil, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (« le règlement 139/2004 ») régit le contrôle des concentrations de dimension européenne.
Certaines de ses dispositions sont directement applicables, notamment :
- L'article premier, qui fixe la limite des compétences respectives de la Commission européenne et des autorités de concurrence nationales en fonction des chiffres d'affaires des entreprises concernées par la concentration. Une concentration est de dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et que le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre ;
- L'article 5, qui précise le mode de calcul des chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du code de commerce ;
- Les articles 4 (paragraphes 4 et 5), 9 et 22, qui prévoient les mécanismes de renvoi d'une concentration entre la Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres. D'une part, les renvois d'affaires de dimension européenne vers les autorités nationales de concurrence peuvent être effectués soit à la demande des entreprises (article 4§4), soit à la demande des États membres (article 9), éventuellement sur invitation de la Commission (article 9). D'autre part, des concentrations de dimension nationale peuvent être renvoyées devant la Commission à la demande des entreprises (article 4§5) ou à la demande des États membres (article 22).
Les autres dispositions du règlement 139/2004 ne sont pas directement applicables au contrôle des concentrations par l'Autorité. Toutefois, dans un souci de cohérence et d'harmonisation avec la pratique européenne, l'Autorité se réfère, pour déterminer la portée des différentes notions relatives au contrôle des concentrations utilisées dans le code de commerce, aux notions mentionnées par le règlement 139/2004.
En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne établie depuis son arrêt du 21 février 1973 « Continental Can » (aff. C-6/72)58(*)- et récemment rappelée dans son arrêt du 16 mars 2023 « Towercast » (aff. C-449/21)59(*) - affirme qu'une opération de concentration non soumise à un contrôle des concentrations, notamment parce que le chiffre d'affaires des entreprises concernées est inférieur aux seuils applicables, peut faire l'objet d'un examen contentieux au titre de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux abus de position dominante.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
L'article 5 du Règlement 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CEE (devenus 101 et 102 du TFUE) stipule que les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels.
Le 2e considérant de la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, dite directive « Dommages », rappelle que la mise en oeuvre des règles par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence, qui peuvent adopter les décisions énumérées à l'article 5 du règlement n°1/2003 susdit. Conformément à ce règlement, les États membres sont en mesure de désigner des autorités aussi bien administratives que judiciaires chargées d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public et d'assurer les différentes fonctions conférées par ledit règlement aux autorités de concurrence.
La France a fait le choix de désigner comme ANC une autorité administrative indépendante.
Dans certains Etats membres, l'ANC est également chargée des questions relatives à la protection des consommateurs (Bulgarie, Danemark, Irlande, Malte, Pologne notamment).
|
Bundeskartellamt |
|
|
Bundeswettbewerbsbehörde
(de) |
|
|
Commission for Protection of Competition (Commission pour la protection de la concurrence |
|
|
Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen
(da) |
|
|
Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia |
|
|
Estonie |
Konkurentsiamet |
|
ÅðéôñïðÞ
Áíôáãùíéóìïý
(el)
(Epitropi Antagonismou) |
|
|
Gazdasági
Versenyhivatal
(hu)
(GVH) |
|
|
Islande |
Samkeppniseftirlitið |
|
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autorité de la concurrence et du marché) |
|
|
Lettonie |
Konkurences padome |
|
Konkurencijos
taryba
(lt) |
|
|
Malte |
Malta Competition and Consumer Affairs Authority |
|
Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(pl)
(UOKiK) |
|
|
Autoriteit
Consument & Markt
(en)
(ACM) |
|
|
République tchèque |
Úøad pro ochranu
hospodáøské soutìúe |
|
Protimonopolný
úrad Slovenskej republiky
(sk) |
|
|
Slovénie |
Javna agencija Republike Slovenije za varstvo
konkurence |
|
Konkurrensverket (KKV) |
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
La Directive ECN + susvisée vise à garantir l'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence, mais elle ne contient pas de dispositions spécifiques sur les modalités de l'organisation interne de ces autorités. Les informations relatives à l'organisation interne des autorités nationales de concurrence ne sont pas documentées en-dehors des éléments indiqués ci-avant.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
|
Pays |
Seuils de contrôle exprimés en chiffres d'affaires (CA) |
|
Allemagne |
- Le CA mondial agrégé des parties excède 500 millions d'euros et - le CA domestique d'une entreprise est de plus de 50 millions d'euros et le CA domestique d'une autre entreprise concernée est de plus de 17,5 millions d'euros. |
|
Autriche |
- Chiffre d'affaires cumulé mondial de plus de 300 millions d'euros. - Chiffre d'affaires cumulé domestique de plus de 30 millions d'euros - Au moins deux entreprises ont plus de 5 millions d'euros de CA mondial. Sont exclus les cas où : - Seulement une partie a plus de 5 millions d'euros de CA domestique - Les autres parties à l'accord ont un chiffre d'affaires mondial de moins de 30 millions d'euros. |
|
Danemark |
- Le CA agrégé de toutes les entreprises est supérieur à 900 millions DKK et le CA agrégé au Danemark d'au moins deux entreprises est supérieur à 100 millions DKK. - Le CA agrégé au Danemark d'au moins une entreprise est supérieur à 3,8 milliards DKK et le CA agrégé mondial d'au moins une des autres entreprises est supérieur à 3,8 milliards DKK. |
|
France |
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physi²ques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ; - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; et - l'opération ne rentre pas dans le champ de compétence de la Commission (elle n'est pas de « dimension européenne »). |
|
Italie |
- Le chiffre d'affaires agrégé en Italie des parties excède 567 millions d'euros ou - Le chiffre d'affaires agrégé en Italie d'au moins deux entreprises dépasse 35 millions d'euros. |
|
Norvège |
- Le chiffre d'affaires combiné annuel des entreprises concernées excède 1 milliard NOK sauf si seulement une entreprise concernée par l'opération a un chiffre d'affaires annuel qui excède 100 millions NOK. |
|
Suède |
- Chiffre d'affaires agrégé des entreprises en Suède est de plus d'1 milliard de SEK ET - Au moins deux entreprises ont un chiffre d'affaires en Suède supérieur à 200 millions de SEK. |
|
Slovénie |
-Le chiffre d'affaires annuel cumulé de toutes les entreprises concernées (y compris celles appartenant au même groupe) dépasse 35 millions d'euros sur le marché slovène et -le chiffre d'affaires annuel de la société cible (y compris celles appartenant au même groupe) dépasse 1 million d'euros sur le marché slovène. |
|
Lituanie |
-Le chiffre d'affaires global cumulé des entreprises concernées dépasse 220 millions d'euros et -le chiffre d'affaires global individuel d'au moins deux entreprises concernées dépasse 2 millions d'euros. |
|
Lettonie |
-le chiffre d'affaires total en Lettonie des participants à la dépasse 30 millions d'euros et -le chiffre d'affaires individuel en Lettonie d'au moins deux participants à la fusion dépasse 1,5 million d'euros. |
|
Irlande |
-Les parties ont un chiffre d'affaires cumulé irlandais qui dépasse 60 millions d'euros et - au moins deux des parties ont un chiffre d'affaires irlandais individuel qui dépasse 10 millions d'euros. |
|
Hongrie |
-Le chiffre d'affaires national combiné de tous les groupes d'entreprises participantes dépasse 20 milliards HUF - environ 49 millions d'euros (contre 15 milliards HUF - environ 37 millions d'euros auparavant) et ; -Le chiffre d'affaires national d'au moins deux groupes d'entreprises participantes dépasse 1,5 milliard HUF - environ 3.7 millions d'euros (contre 1 milliard HUF - environ 2.5 millions d'euros auparavant). |
|
Portugal |
- Le chiffre d'affaires agrégé des parties à l'opération excède 100 millions d'euros et - Le chiffre d'affaires au Portugal d'au moins deux des entreprises excède 5 millions d'euros. |
|
Espagne |
- Le chiffre d'affaires agrégé des parties en Espagne dépasse 240 millions d'euros ET au moins deux parties ont un chiffre d'affaires en Espagne d'au moins 60 millions d'euros. |
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
La composition du collège de l'Autorité de la concurrence relève du domaine de la loi (article L. 461-1 du Code de commerce).
Alors que l'économie des territoires ultramarins se caractérise par une plus grande sensibilité aux pratiques anticoncurrentielles et par la dominance de certains opérateurs économiques dans de nombreux secteurs, le collège de l'Autorité de la concurrence n'intègre pas la spécificité ultramarine dans la composition de son collège. En effet, la composition actuelle ne laisse pas de place à une représentation permettant de prendre en compte les spécificités des économies ultramarines.
Depuis sa création en 2008, l'Autorité de la concurrence a rendu 46 décisions contentieuses concernant les territoires ultramarins, pour un montant total de sanctions 232 millions d'euros. Parmi ces 45 décisions contentieuses, 10 concernaient l'interdiction des exclusivités d'importation, qui est une disposition propre aux outre-mer introduite par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer dite « loi LROEM ».
En 2023, sur un total de 24 décisions de sanction, 6 ont concerné les territoires ultramarins, soit 25 %.
L'Autorité de la concurrence a formulé 17 avis portant sur des enjeux tant généraux que spécifique, dans une variété de secteurs, notamment la consommation, la viande fraîche, le poisson, la téléphonie, l'aérien ou encore le contrôle technique des poids lourds. Ella a rendu deux avis concernant plus généralement l'analyse de la concurrence en Outre-mer :
- l'avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 centrée sur les mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'Outre-mer ;
- l'avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-mer.
L'Autorité de la concurrence a récemment initié un avis sur l'organisation des marchés d'importation, de gros et de distribution sur ce territoire afin d'analyser finement les intégrations verticales susceptibles d'être non optimales, voire artificielles.
Actuellement, une vingtaine d'enquêtes sont en cours dans les outre-mer, dont plusieurs ont franchi le stade de l'instruction. La lutte contre la vie chère dans les territoires ultramarins est inscrite parmi les trois axes stratégiques de la feuille de route de l'Autorité.
Le présent article vise à adapter la composition du collège de l'Autorité de la concurrence aux enjeux ultramarins afin qu'elle soit en capacité de faire usage de ses prérogatives spéciales outre-mer et de mieux prendre en compte les spécificités des économies ultramarines dans son analyse concurrentielle.
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
L'article L. 461-4 du code de commerce prévoit que l'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général et nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité de la concurrence a récemment initié un avis sur l'organisation des marchés d'importation, de gros et de distribution sur ce territoire afin d'analyser la formation des prix et des marges et leur possible accumulation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la grande distribution alimentaire en Martinique.
Cependant, en dépit de l'engagement constant de l'Autorité, les problématiques de vie chère persistent et se sont même aggravées depuis 2019, comme en atteste l'enquête de comparaison spatiale des prix 2022 de l'INSEE (Insee Première, n° 1958, Juillet 202360(*)) qui révèle qu'entre 2015 et 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) par rapport à la France hexagonale se sont accrus dans tous les départements d'outre-mer.
De même, alors que le législateur a introduit dans le code de commerce des mécanismes dédiés aux économies ultramarines, l'Autorité ne s'en est pas pleinement saisie, à l'instar des injonctions structurelles, introduites dans le droit national à l'article L. 752-27 du code de commerce par l'article 10 de la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (dite « LREOM ») et modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et par l'article 37 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Ce mécanisme permet à l'Autorité de la concurrence, à l'issue d'une procédure contradictoire, d'enjoindre à tout opérateur exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de gros ou de détail et dont la position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés de modifier, compléter ou résilier tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée sa puissance économique, voire de céder certains de ses actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective.
Le pouvoir d'injonction structurelle n'a jamais été mis en oeuvre par l'Autorité de la concurrence. En effet, aucune affaire de ce type n'a été présentée devant son Collège à ce jour. La mobilisation de cette faculté passe en effet par l'ouverture d'une enquête par le rapporteur général et qu'une instruction soit menée sous sa direction par les services d'instruction. Or, le standard de preuve très élevé nécessaire à mettre en oeuvre une injonction structurelle, corollaire de l'atteinte au droit de propriété inscrit à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC), à valeur constitutionnelle, exige d'être en capacité de mobiliser des moyens dans la durée pour consolider un dossier permettant in fine de prouver l'existence de prix (au détail) ou de marges « anormalement élevés par rapport aux moyennes habituellement constatées dans le secteur ».
Dans ce contexte, la création d'un service d'instruction spécialisé pour les outre-mer, sous réserve qu'elle s'accompagne de moyens supplémentaires pour l'Autorité, permettrait à celle-ci de renforcer ses capacités de détection et de sanction des pratiques anticoncurrentielles en outre-mer et d'améliorer son suivi dans la durée de l'évolution des prix et des marges, au bénéfice des consommateurs et des entreprises ultramarines.
L'extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Le haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie, relayant une demande du président de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, a alerté les services de l'Etat sur la nécessité de modifier l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
Pour des raisons de bonne administration de la justice, le législateur doit pallier à cette asymétrie par la modification de l'ordonnance applicable à la Nouvelle-Calédonie.
La présente mesure permet d'y remédier en mettant en harmonie le droit applicable en Nouvelle-Calédonie par des modifications de l'ordonnance de 2014 ratifiée par l'article 56 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014. Ainsi, le contentieux des sanctions des pratiques anticoncurrentielles et celui des décisions connexes relatives au secret des affaires dans le cadre de ces mêmes procédures seraient unifié sur l'ensemble du territoire national (Hexagone et outre-mer, y compris la Polynésie-Française et la Nouvelle-Calédonie) et confié au premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Le contrôle des concentrations en France relève du domaine de la loi (article L. 430-1 et suivants du code de commerce). La révision des seuils applicables à ce contrôle spécifiquement en outre-mer implique dès lors une modification de la disposition législative prévue au III de l'article L. 430-2 du code de commerce.
Les seuils prévus au III de l'article L. 430-2 du code de commerce, et en particulier le seuil spécifique au commerce de détail en outre-mer, n'ont pas été révisés depuis le 20 novembre 2012. La situation économique en outre-mer a pourtant fortement évolué depuis cette date.
L'enquête de comparaison spatiale des prix menée en 2022 par l'INSEE (Insee Première, n° 1958, Juillet 202361(*)) révèle qu'entre 2015 et 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) par rapport à la France hexagonale se sont accrus dans tous les départements d'outre-mer. L'augmentation est plus marquée à Mayotte et en Guadeloupe : +3 points, contre +2 points en Guyane, à La Réunion et en Martinique. Par rapport à 2010, la hausse est également plus marquée en Guadeloupe (+8 points, contre +4 points en Martinique, +3 points à La Réunion et +1 point en Guyane).
Enquête de l'INSEE 2022 :
Écarts de prix (Fisher) entre les DOM et la France métropolitaine en 2010, 2015 et 2022
https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939#tableau-figure2
Selon l'enquête de comparaison spatiale des prix 2022 de l'INSEE, les écarts de prix entre les départements d'outre-mer et la France hexagonale sont en grande partie imputables aux biens (plutôt qu'aux services), et en particulier aux produits alimentaires. En 2022, les écarts de prix (indices de Fisher) pour les produits alimentaires sont de +42 % entre la Guadeloupe et la France métropolitaine, +40 % pour la Martinique, +39 % pour la Guyane, +37 % pour La Réunion et +30 % pour Mayotte Les produits alimentaires représentent l'un des premiers postes de consommation des ménages (15 % en France hexagonale et dans la plupart des DOM, davantage à Mayotte) et celui pour lequel les écarts de prix sont les plus marqués avec la France hexagonale. L'INSEE signale que ces écarts ont augmenté en 2022 dans les cinq DOM (+11 points à Mayotte, +9 points en Guadeloupe et à La Réunion, +6 points en Guyane et +2 points en Martinique).
En prenant comme référence le panier alimentaire métropolitain, les prix sont en moyenne supérieurs à ceux de la France hexagonale de 54 % à Mayotte, 51 % en Guadeloupe et en Guyane, 50 % en Martinique et 46 % à La Réunion.
En conclusion, l'étude de comparaison spatiale de l'INSEE met en lumière des écarts de prix significatifs entre la France hexagonale et l'outre-mer dans le secteur des biens de consommation et tout particulièrement des produits alimentaires. C'est également dans ce domaine que les écarts de prix se sont le plus aggravés entre 2015 et 2022.
Cette problématique de la « vie chère » commune aux départements et collectivités d'outre-mer s'inscrit dans des environnements économiques locaux caractérisés par un degré de concentration souvent élevé et un niveau d'animation concurrentielle en moyenne inférieur à la France hexagonale. Les acteurs économiques et politiques locaux, malgré les actions des autorités compétentes (DGCCRF et Autorité de la concurrence), continuent à exprimer des attentes en matière de renforcement de la régulation concurrentielle dans les outre-mer.
Ce déficit structurel de concurrence souligne l'importance du contrôle des concentrations dans ces territoires, dans lesquels le développement des acteurs existants passe le plus souvent par des opérations de croissance externe, notamment dans le secteur du commerce de détail. Dans son avis n° 19-A-12 relatif au fonctionnement de la concurrence en outre-mer62(*), l'Autorité souligne que l'étroitesse des marchés, inhérente aux caractéristiques géographiques de ces territoires, est de nature à décourager l'entrée de nouveaux arrivants et que l'entrée de nouveaux acteurs se fait le plus souvent via des changements d'enseignes existantes plutôt que par des créations de points de vente.
Dans ce contexte, le contrôle des concentrations joue un rôle essentiel pour préserver la structure concurrentielle des marchés en outre-mer, comme l'illustre l'action de l'Autorité de la concurrence en la matière.
Depuis sa création en 2008, celle-ci a rendu 83 décisions relatives à des opérations impliquant des entreprises actives dans les départements et collectivités d'outre-mer, dont 22 ont été assorties de conditions visant à remédier à des risques de concurrence. La grande majorité des opérations ayant soulevé des problèmes de concurrence impliquait des entreprises actives dans le commerce de détail (pour davantage de détails sur ce point, voir ci-dessous 2.2 Objectifs poursuivis).
Dès lors, un abaissement ciblé des seuils de contrôle des concentrations en outre-mer permettrait de renforcer la régulation concurrentielle dans le secteur particulièrement sensible du commerce de détail, sans engendrer de charge administrative excessive pour les entreprises et les services de l'Autorité de la concurrence.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le développement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur les spécificités des outre-mer
La disposition vise à renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en ajoutant à son collège deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique, en matière de concurrence ou de consommation dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy et Wallis et Futuna.
L'intégration de ces nouveaux membres, choisis en raison de leur compétence et de leur connaissance des spécificités de l'outre-mer, a pour objectif d'assurer à l'Autorité les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission de régulation de l'économie et d'améliorer la prise en compte des enjeux ultramarins. Elle fait suite à la recommandation n° 13 du rapport d'information du Sénat n° 514 (2024-2025), déposé le 3 avril 2025, fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer et relatif à la lutte contre la vie chère outre-mer63(*).
L'élargissement du collège de l'Autorité à deux personnalités permettrait de construire une doctrine ad hoc et une grille d'analyse prenant en compte les particularités des marchés ultramarins et des règles de la concurrence qui y sont applicables. Les critères d'évaluation de l'intensité concurrentielle doivent en effet être adaptés aux réalités économiques ultramarines, où l'effet de taille joue un rôle amplifié.
Le renforcement de l'expertise des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sur les questions liées à l'Outre-mer
La disposition vise par ailleurs à créer un service d'instruction dédié aux outre-mer au sein de l'Autorité de la concurrence pour y renforcer la régulation concurrentielle.
Cette spécialisation permettrait d'une part de construire une grille d'analyse prenant en compte les particularités des marchés ultramarins et des règles de la concurrence qui y sont applicables et d'autre part de disposer des données économiques précises, qui sont aujourd'hui insuffisantes, afin de disposer d'éléments factuels suffisamment solides pouvant permettre de proposer, le cas échéant, au Collège de l'Autorité de mettre en oeuvre une injonction structurelle. Ce mécanisme exige en effet d'être en mesure de démontrer que l'atteinte qui est portée au droit de propriété par l'injonction structurelle est adaptée, nécessaire et proportionnée au but d'intérêt général à atteindre.
Une telle spécialisation des services d'instruction vise à dote l'Autorité de la capacité d'adapter les critères d'évaluation de l'intensité concurrentielle aux réalités économiques ultramarines et d'actionner plus facilement les outils régulateurs prévus par la loi qui requièrent un suivi continu des marchés.
Ce service d'instruction pourrait également créer des relations plus étroites et directes avec les services déconcentrés de la DGCCRF sur le terrain. Cette collaboration est d'autant plus nécessaire que les affaires traitées par l'Autorité dans les territoires ultramarins proviennent principalement de la DGCCRF, y compris des directions locales, qui collaborent étroitement avec les Observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et les collectivités territoriales, comme l'a souligné le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence alors en fonction lors de son audition par le Sénat le 28 novembre 202464(*).
L'extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
L'ordonnance n°2014-471 du 7 mai 2014 applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie doit être unifiée sur le modèle de l'ordonnance n°2017 du 9 février 2017 s'appliquant à la Polynésie française. Cela concerne deux points :
- l'unification devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions du rapporteur général, relatives au secret des affaires ;
- la coopération étroite de l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en matière d'enquêtes.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
L'abaissement des seuils de contrôle des opérations de concentration spécifiques au commerce de détail en outre-mer vise à renforcer la capacité de contrôle de l'Autorité de la concurrence dans un secteur particulièrement sujet aux difficultés de concurrence et qui constitue l'un des premiers postes de dépenses pour les ménages ultramarins.
L'expérience pratique de l'Autorité depuis 2008 montre en effet que la grande majorité des opérations de concentration problématiques en outre-mer concernent le commerce de détail.
Tableau n° 1 recensant les opérations de concentrations notifiées en outre-mer
|
Total |
Sur le fondement des seuils généraux (L. 430-2, I et II) |
Sur le fondement des seuils outre-mer (L. 430-2, III) |
|
|
Décisions de contrôle des concentrations rendues par l'Adlc depuis 2008 concernant l'outre-mer |
83 |
27 |
56 |
|
Décisions assorties d'engagements |
22 |
11 (dont 8 affectant le secteur du commerce de détail) |
11 (dont 9 affectant le secteur du commerce de détail) |
Comme il ressort de ce tableau, l'Autorité a rendu à ce jour 83 décisions relatives à des opérations de concentration impliquant des parties présentes en outre-mer. Sur ces 83 opérations, 27 ont été notifiées sur le fondement des seuils généraux applicables à la France dans son ensemble (article L. 430-2, I et II du code de commerce). Ces opérations concernent en général des acteurs de dimension nationale, voire internationale, présents à la fois en métropole et dans les DROM (tels que Canal Plus, Tereos, SFR, Orange).
En outre, 56 opérations ont été notifiées sur le fondement des seuils spécifiques à l'outre-mer (article L. 430-2, III). Ces 56 opérations recouvrent celles notifiées sur le fondement des seuils généraux outre-mer (chiffre d'affaires local supérieur à 15 millions d'euros) et celles au titre des seuils outre-mer spécifiques au commerce de détail (chiffre d'affaires local supérieur à 5 millions d'euros).
Sur les 83 décisions rendues, 22 ont été assorties d'engagements pour remédier à des problèmes de concurrence. Sur ces 22 décisions, 17 se rapportent à des opérations impliquant des parties actives dans le secteur du commerce de détail en outre-mer. Autrement dit, 77, 2 % des opérations notifiées ayant suscité des préoccupations de concurrence en outre-mer ont concerné en tout ou partie le secteur du commerce détail. Il convient de relever que cette analyse s'intéresse aux secteurs économiques effectivement concernés par les opérations et non au fondement juridique des notifications, qui dépend des chiffres d'affaires globaux des parties. Sur les 17 décisions, 8 ont été notifiées sur le fondement des seuils généraux nationaux (article L. 430-2, I et II) et 9 à raison du franchissement des seuils spécifiques à l'outre-mer (article L. 430-2, III). Si l'on s'en tient aux seules opérations notifiées sur le fondement des seuils spécifiques à l'outre-mer, 81, 8% des décisions assorties d'engagements ont concerné en tout ou partie le secteur du commerce de détail.
En outre, des préoccupations de concurrence peuvent apparaitre dans les territoires ultramarins à l'occasion d'une opération de concentration dans le secteur du commerce de détail alors même que le seuil de 5 millions d'euros n'est pas atteint65(*).
Les risques de concurrence identifiés dans ce cadre par l'Autorité s'apprécient souvent au niveau local dans les zones de chalandise du ou des points de vente concernés. Le rachat d'un seul supermarché est ainsi susceptible, selon le degré de concurrence de la zone affectée, de créer ou de renforcer une position dominante au détriment des consommateurs. Cette particularité de la distribution au détail justifie l'existence de seuils spécifiques.
Une réduction ciblée des seuils prévus au III de l'article L. 430-2 du code de commerce permettrait de renforcer la capacité de contrôle de l'Autorité s'agissant d'opérations de concentration portant sur des entreprises de taille modestes mais néanmoins susceptibles de diminuer significativement la concurrence dans des zones de chalandise locales.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
L'élargissement du collège de l'Autorité et la création d'un service d'instruction dédié aux outre-mer nécessitent une modification des articles L. 461-1 II et L. 461-4 du code de commerce.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Aucune autre option n'a été envisagée. Cette mesure procède à la réunion du contentieux qui a été faite en métropole et en Polynésie française.
Elle fait, d'une part, suite à une décision du 10 octobre 2014 Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées n°367807, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que, en l'absence de disposition législative expresse en attribuant la contestation à la juridiction judiciaire, les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, lesquelles sont détachables de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, relèvent, conformément au droit commun, de la juridiction administrative et, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, sont de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
Elle étend et adapte, d'autre part, à la Nouvelle-Calédonie, certaines dispositions du code de commerce s'agissant de la coopération entre l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) et l'Autorité de la concurrence (ADLC) en matière d'enquête.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La révision du niveau des seuils proposée ne nécessite pas la création d'une nouvelle règle de droit. Elle implique une actualisation de l'article L. 430-2 III, du code de commerce. Aucune autre option n'a donc été envisagée en-dehors de la loi.
Dans le cadre de la modification de l'article L. 430-2 III du code de commerce, différentes options ont été envisagées pour adapter le seuil de contrôle des opérations des concentrations en outre-mer :
- Option 1 : Pas de modification du seuil de chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des parties à l'opération de 75 millions d'euros, mais abaissement à 5 millions d'euros du seuil de chiffre d'affaires local réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des parties à l'opération tous secteurs confondus (suppression du seuil spécifique au commerce de détail) ;
- Option 2 : Pas de modification du seuil de chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des parties à l'opération de 75 millions d'euros, mais abaissement à 5 millions d'euros du seuil de chiffre d'affaires local réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des parties à l'opération tous secteurs confondus, et abaissement à 3 millions d'euros du seuil spécifique au commerce de détail ;
- Option 3 : Pas de modification du seuil de chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des parties à l'opération qui est de 75 millions d'euros ni du seuil de chiffre d'affaires local tous secteurs confondus, mais abaissement à 3 millions d'euros du seuil local applicable au commerce de détail.
L'option 3 a été privilégiée afin de conserver un niveau de contrôle compatible avec la liberté d'entreprendre. Les options 1 et 2 auraient pu avoir comme effet de limiter les investissements en soumettant les opérateurs économiques à un niveau de contrôle qui aurait induit une charge administrative et financière plus importante au regard du formalisme de la notification des opérations de concentration à l'Autorité de la concurrence. Le ciblage du seuil local dans le commerce de détail permet de cibler celles des opérations de concentrations susceptibles d'avoir le plus fort impact sur les produits de grande consommation dans les territoires ultramarins.
En effet, une révision des seuils outre-mer généraux n'apparaît pas opportune dans la mesure où le niveau actuel de ces seuils (fixés à des niveaux très inférieurs aux seuils nationaux) permet déjà à l'Autorité d'exercer un contrôle étroit sur les secteurs économiques n'impliquant pas de vente au détail, où les rachats de petites entreprises sont par nature moins susceptibles de créer des problèmes de concurrence sur des marchés locaux.
L'abaissement des seuils ultramarins dans tous les secteurs de l'économie risquerait en outre d'augmenter de manière sensible le nombre d'opérations soumises à obligation de notification, créant une charge administrative supplémentaire pour les entreprises (qui, au vu du niveau des seuils, peuvent être des petites et moyennes entreprises) et sans nécessairement permettre aux services de l'Autorité de la concurrence d'examiner davantage d'opérations problématiques pour la concurrence.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
L'hypothèse retenue consiste à élargir la composition du collège de l'Autorité de la concurrence fixée à l'article L. 461-1 paragraphe II du code de commerce à deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique, en matière de concurrence ou de consommation dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Martin, Saint Barthélemy et Wallis et Futuna.
Elle consiste également à créer un service spécialisé au sein des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en modifiant le 1er alinéa de l'article L. 461-4 du code de commerce.
L'Extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
La mesure consiste en un rééquilibrage des mesures applicables en métropole, Polynésie française et Nouvelle Calédonie en matière d'unification devant la cour d'appel de Paris du contentieux relatif aux décisions du rapporteur général de l'ACNC relatives au secret des affaires et en matière de coopération entre les services d'instruction de l'ADLC et de l'ACNC.
Elle prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Pour l'ensemble des motifs exposés ci-avant, l'hypothèse retenue (option 3) consiste à abaisser uniquement le seuil local spécifique au commerce de détail (actuellement 5 millions d'euros) de notification, de l'article L. 430-2 paragraphe III du code de commerce, applicable à certains départements et collectivités d'outre-mer, à 3 millions d'euros.
La présente disposition abaisse les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence, exprimés en chiffre d'affaires, par la modification de la disposition législative prévue à l'article L. 430-2 paragraphe III du code de commerce (seuils applicables au commerce de détail en outre-mer).
Tableau n°2 - Seuils révisés
|
Seuils en vigueur (en euros) dans le commerce de détail en outre-mer |
Seuils révisés (en euros) |
|
|
Mondial |
75 000 000 |
Pas de modification |
|
Local |
5 000 000 |
3 000 000 |
L'abaissement des seuils applicables au commerce de détail permet de cibler les opérations les plus susceptibles de soulever des risques de concurrence, dans un secteur particulièrement concentré et qui constitue l'un des premiers postes de dépenses pour les ménages. La mesure envisagée est justifiée et proportionnée au regard des objectifs de lutte contre la vie chère et de protection du pouvoir d'achat des consommateurs ultramarins.
Le calibrage de la mesure sur le commerce de détail permet ainsi de proposer une limite à la liberté d'entreprendre proportionnée aux objectifs poursuivis et maintenir une distinction entre le commerce de détail et les autres secteurs, à l'image des seuils nationaux.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
Les II et III de l'article L. 461-1 et l'article L. 461-4 du code de commerce sont modifiés.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
L'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions est modifié par la création de l'articles 6-1. Par ailleurs, l'article L. 462-9-1-1 du code de commerce est créé.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Le III de l'article L. 430-2 du code de commerce est modifié.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
Le droit de la concurrence européen s'articule avec le droit de la concurrence national dans le cadre du Règlement 1/2003 et des directives « Dommages » et « ECN + » précités.
En conséquence, l'articulation entre le droit de la concurrence français et le droit de la concurrence européen resterait inchangée avec la réforme proposée.
Le fonctionnement administratif de l'Autorité de la concurrence est fixé dans son règlement intérieur, conformément à l'article R. 461-8 du code de commerce.
La création d'un service dédié aux outre-mer ne semble pas faire pas obstacle à l'article 4.5 de la directive 2019/1 dite « ECN + », lequel dispose que « Les autorités nationales de concurrence administratives ont le pouvoir de fixer leurs priorités afin de s'acquitter des tâches nécessaires à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive. Dans la mesure où les autorités nationales de concurrence administratives sont tenues d'examiner les plaintes formelles, ces autorités ont le pouvoir de rejeter de telles plaintes au motif qu'elles ne les considèrent pas comme une priorité ».
En conséquence, l'articulation entre le droit de la concurrence français et le droit de la concurrence européen resterait inchangée avec la réforme proposée.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
La présente mesure n'a aucun impact sur le droit international et le droit de l'Union européenne.
Abaisser les seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Le droit des concentrations français s'articule avec le droit des concentrations européen et plus particulièrement avec le règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises précité.
Le relèvement des seuils de notification en France n'aurait pas d'impact sur le contrôle des concentrations exercé par la Commission européenne, dans la mesure où les seuils de notification en France resteraient inférieurs aux seuils de notification européens, et que l'article L. 430-2 continuerait à prévoir qu'une opération de concentration ne peut être notifiée à l'Autorité de la concurrence lorsqu'elle rentre dans le champ de compétence de la Commission tel que défini par le règlement 139/2004 précité.
Enfin, aucune disposition du règlement n° 139/2004 ne fait référence au niveau des seuils de contrôle des concentrations défini par chaque État membre, qui restent libres de déterminer le niveau qu'ils estiment pertinent.
En conséquence, l'articulation entre le droit des concentrations français et le droit des concentrations européen resterait inchangée avec la révision des seuils proposée.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
Une meilleure prise en compte des spécificités des économies ultramarines dans les décisions du collège de l'Autorité de la concurrence est attendue.
La création d'un service d'instruction dédié aux outre-mer au sein de l'Autorité de la concurrence permettra de renforcer la régulation concurrentielle dans les outre-mer. Ainsi, l'amélioration de l'intensité concurrentielle pourrait favoriser l'entrée de nouveaux acteurs et induire une baisse des prix dans certains secteurs au bénéfice des ménages et des entreprises ultramarines.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La révision envisagée vise à renforcer la régulation concurrentielle en outre-mer en permettant à l'Autorité de la concurrence d'exercer un contrôle plus étroit des opérations de concentration impliquant des entreprises actives dans la vente au détail en outre-mer, dans l'intérêt des consommateurs ultramarins.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
La meilleure prise en compte en compte les spécificités des économies ultramarines, notamment dans le commerce de gros et de détail, vise à faciliter l'entrée de nouveaux opérateurs et à améliorer la compétitivité des entreprises déjà installées sur les zones de chalandise concernées.
Sur un marché plus concurrentiel, les entreprises seraient incitées à utiliser leurs ressources de manière plus productive et à améliorer leurs services et produits.
Le renforcement de la régulation concurrentielle dans les outre-mer est profitable aux entreprises qui peuvent être victimes de pratiques anticoncurrentielles et bénéficient d'un environnement concurrentiel plus dynamique et ouvert.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La révision des seuils de contrôle des concentrations est également de nature à augmenter la charge administrative relative à l'obligation de notification qui incombe aux entreprises et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises.
4.2.3. Impacts budgétaires
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
La rémunération des membres non permanents du collège de l'Autorité de la concurrence est fixée dans son règlement intérieur qui prévoit, conformément à l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendante :
- une indemnité de sujétion par dossier : 250 euros ;
- indemnité complémentaire de préparation du dossier avant une séance : 250 euros ;
- indemnité de participation aux séances du collège : 350 euros par jour ;
- indemnité au titre de la délibération : 250 euros par délibération ;
- indemnité de participation à la rédaction d'une décision : 250 euros.
Le nombre maximal de vacations s'élève à 50 par type d'indemnité et par an.
Dans une hypothèse minimaliste (une seule séance par an pour un seul des deux nouveaux membres du collège), l'impact budgétaire de la disposition est estimé à 1350 euros par an. Dans l'hypothèse maximaliste, soit 50 vacations par type d'indemnité par an pour les deux nouveaux membres, l'impact budgétaire est estimé à 135 000 euros par an, ce scénario apparaissant toutefois peu probable au regard du nombre de décisions rendues ces dernières années.
Pour retenir une hypothèse crédible, en prenant en compte le nombre de décisions qui ont concerné les territoires ultramarins rendues en 2023, soit 6 décisions, si les deux nouveaux membres délibèrent et réalisent toutes les vacations prévues au titre d'une décision, l'impact budgétaire est estimé à 16 200 euros.
Pour atteindre les objectifs poursuivis, la création d'un service d'instruction dédié devra s'accompagner de moyens supplémentaires pour permettre à l'Autorité de recruter plusieurs ETP. L'hypothèse basse est estimée à un ETP supplémentaire, l'hypothèse haute est estimée à 10 ETP environ, en prenant en compte la taille approximative actuelle des unités qui composent les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.
L'Extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
La mesure n'a pas d'impact direct sur les services administratifs à l'exception des services de l'Autorité de la concurrence (voir la rubrique 4.2.3).
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La mesure envisagée se traduirait par une augmentation du nombre de notifications d'opérations de concentration et par conséquent par une charge de travail supplémentaire pour les services de l'Autorité de la concurrence. La nature ciblée de la mesure permettrait toutefois de garantir sa proportionnalité au regard de l'objectif poursuivi.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
Une meilleure régulation du jeu concurrentiel pourrait, en réduisant la concentration économique, favoriser l'entrée de nouvelles entreprises sur certains marchés ce qui pourrait favoriser la création d'emplois.
La création d'un nouveau service vise à accroitre l'intensité concurrentielle pour limiter la hausse des prix et augmenter la variété de produits, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs dans ces territoires.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
La mesure est sans impact direct sur l'emploi et le marché du travail.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
La mesure n'a pas d'incidence directe sur l'emploi et le marché du travail.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
La mesure visant à élargir le collège de l'Autorité de la concurrence à deux membres non permanents dédiés aux outre-mer respecte les règles en matière de parité établies par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Les autres mesures n'ont pas d'impact direct en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Le renforcement de l'expertise de l'Autorité de la concurrence et de ses services d'instruction sur les spécificités des outre-mer
La meilleure prise en compte des spécificités ultramarines par le collège de l'Autorité de la concurrence vise à permettre d'assurer le fonctionnement régulier des marchés et d'accroître l'intensité concurrentielle pour limiter la hausse des prix et augmenter la variété de produits, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs dans ces territoires.
L'extension et l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions
Sans objet.
L'abaissement des seuils de notification des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté, à titre obligatoire, sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Ce dernier a été consulté le 18 juin 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
L'autorité de la concurrence a été saisie à titre facultatif en application de l'article L. 462-1 et suivants du code de commerce.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna pour les I, III et IV où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du IV.
S'agissant du II, le mandat des membres nommés pour la première fois au titre du 4° du II de l'article L. 461-1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues au IV et au plus tard le 1er janvier 2026.
5.2.2. Application dans l'espace
Les I, II, III et VI du présent article sont applicables aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Le IV et le V sont applicables à la Nouvelle Calédonie.
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les délais de recours et de pourvoi et fixera la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 11 - Habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de codifier dans le code de commerce les dispositions connexes au droit de la concurrence relevant de la compétence l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Si la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie disposent de compétences propres en matière de droit de la concurrence conférées par les lois organiques statutaires qui les régissent, l'Etat demeure compétent en matière de garantie des libertés publiques, de justice et organisation judiciaire, de droit pénal, procédure pénale et procédure administrative contentieuse, en vertu d'une part, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les règles relevant de la compétence de l'Etat et nécessaire au bon fonctionnement des réglementations locales en matière de droit et politique de la concurrence sont rassemblées dans les deux ordonnances suivantes :
- l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ;
- l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
Ces dispositions relevant de la compétence de l'Etat s'articulent avec les dispositions adoptées par les collectivités dans le cadre de l`exercice de leurs compétences propres.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance répond aux exigences de l'article 38 de la Constitution, qui prévoit que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
S'agissant de la Polynésie française, l'article 74 de la Constitution dispose que « les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique [...]; »
En vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'Etat est compétent dans cette collectivité en matière de « garantie des libertés publiques », « justice : organisation judiciaire », « droit pénal, procédure pénale », « procédure administrative contentieuse » (2° de l'article 14).
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l'article 77 de la Constitution dispose que : « Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
-les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; [...] »
Ainsi, en vertu de la loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'Etat est compétent dans cette collectivité en matière de « garantie des libertés publiques » (1° du I. de l'article 21) « Justice, organisation judiciaire », « procédure pénale et procédure administrative contentieuse » (2° de l'article 20), « droit pénal » (5° du II de l'article 21), procédure pénale » et « procédure administrative contentieuse » (2° de l'article 14).
Le Conseil constitutionnel a consacré un objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 178966(*).
Le Conseil constitutionnel a également dans plusieurs décisions réitéré la nécessité de codifier les normes67(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les deux ordonnance précitées n° 2017-157 du 9 février 2017 et n° 2014-471 du 7 mai 2014 ne sont pas codifiée.
En outre, il est possible que d'autres dispositions applicables non contenues dans l'ordonnance restent à identifier.
Le code de commerce comporte un livre IX consacré à l'outre-mer, il apparaît donc opportun de codifier ces dispositions au sein de ce livre pour des raisons d'accessibilité de la norme, afin de regrouper l'ensemble des dispositions relatives au droit et à la politique de concurrence au sein d'un même texte.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Comme le rappelle le guide de légistique (fiche 1.4.2) la codification a notamment pour objet de « rassembler des normes dispersées, législatives ou réglementaires, qu'elle coordonne pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan logique ». Ainsi, elle contribue à rendre le droit plus lisible, limite les inconvénients inhérents à la dispersion des textes et apparait comme un moyen de favoriser la sécurité juridique, tout en améliorant la qualité des textes.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La Polynésie-Française et la Nouvelle-Calédonie sont les seules collectivités d'outre-mer à disposer d'une compétence propre en droit de la concurrence. C'est donc uniquement dans ces collectivités que se pose la question de l'articulation entre les règles de compétences dévolues à l'Etat et les règles locales dans ce domaine.
Ainsi, l'entreprise de codification de ces dispositions législatives éparses nécessite un important travail de fond et de coordination avec les dispositions de droit relevant des compétences propres de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas été possible de procéder à ce travail d'ampleur à l'occasion du présent projet de loi. Il a donc semblé préférable de profiter de ce vecteur législatif pour habiliter le Gouvernement à procéder à ce travail de clarification par ordonnance, afin de permettre d'engager ce travail de fond minutieux.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure consiste à habiliter le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions par lesquelles l'Etat exerce les compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie-Française en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
L'analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation.
Néanmoins, il peut d'ores et déjà être fait état des impacts suivants :
L'ordonnance à vocation à codifier dans le code de commerce les dispositions par lesquelles l'Etat exerce les compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle-Calédonie et de les coordonner et harmoniser. Elle entrainera notamment l'abrogation des deux ordonnances suivantes :
- l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ;
- l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
L'ordonnance à intervenir aura également un impact sur l'accessibilité et l'intelligibilité du droit applicable en Polynésie français et en Nouvelle-Calédonie nécessaire pour l'exercice des compétences locales en matière de droit et politique de concurrence.
5. JUSTIFICATION DU DELAI D'HABILITATION
Le travail de recensement des dispositions à codifier mobilisant plusieurs services ministériels d'une part, et la nécessité de bien coordonner ce projet d'ordonnance avec les réglementations locales en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie d'autre part, justifient un délai de dix-huit mois afin de pouvoir aboutir à une codification coordonnée et sécurisée.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication l'ordonnance.
Article 12 - Etendre les pouvoirs des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) pour favoriser la concurrence
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Depuis sa création par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'Autorité de la Concurrence (ADLC) veille au respect des règles de la concurrence, notamment dans les outre-mer. Ses missions sont de nature :
- Consultative par ses avis à l'occasion desquels elle formule des recommandations en vue d'améliorer la concurrence dans le secteur concerné ;
- Contentieuse, par ses décisions de sanctions ;
- Préventive, par ses décisions portant sur des opérations de concentration.
Elle est particulièrement active dans les outre-mer du fait, notamment, de l'étroitesse des marchés ultramarins.
Les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), prévues à l' article R. 751-1 du code du commerce, ont, quant à elle, connaissance des projets d'aménagement commerciaux, tels que des extensions ou créations de nouvelle surface commerciale de plus de 1 000 m². De tels projets sont susceptibles d'avoir un impact sensible sur la concurrence dans les territoires ultramarins, en particulier dans le secteur du commerce de détail alimentaire où les écarts de prix avec l'Hexagone sont, selon l'INSEE, de l'ordre de +30 à +42 % dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM).
Ainsi, il est proposé de renforcer la possibilité pour les CDAC de saisir l'Autorité de la concurrence lorsqu'un projet d'aménagement commercial est susceptible de faire dépasser les 25 % de parts de marchés sur le territoire concerné, par l'entreprise à l'origine du projet.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées (CC, décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion).
L'article 73 de la Constitution prévoit, quant à lui, le principe d'adaptation des lois et règlements dans les DROM afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (CC, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse). Le même principe existe pour les collectivités d'outre-mer (COM) à l'article 74-1 de la Constitution. Le renchérissement des prix de biens et services en Outre-mer du fait de l'insularité et du coût de la logistique constitue bien une contrainte particulière des territoires ultramarins qui justifie une telle dérogation.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la DDHC de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (CC, décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. ; CC, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1er de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique.
La liberté du commerce découle par ailleurs de la liberté d'entreprendre. Ces libertés supposent que toute personne puisse entreprendre et commercer sans privilège, ni discrimination.
La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (CC, décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre) et énoncées de façon claire et précise (CC, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (CC, décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre).
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les nouveaux critères d'impact économique et territorial pour l'autorisation d'exploitation commerciale prévus au I, III et IV de l' article L. 752-6 du code de commerce. Le Conseil a effectivement considéré que ces exigences sont proportionnées : elles servent une cause d'intérêt général liée à la revitalisation des centres-villes et n'entravent pas de manière excessive la liberté d'entreprendre, sous le contrôle des juridictions administratives (CC, décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) garantit la liberté d'établissement (articles 49 à 55) et la libre prestation de services (aux articles 56 à 62).
La directive services 2006/123/CE encadre les services dans le marché intérieur, y compris les services de distribution commerciale. L'article 10 de cette directive prévoit notamment que les régimes d'autorisation soient justifiés par un motif d'intérêt général, qu'ils soient non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères clairs, objectifs, transparents et préalables.
Par ailleurs, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) considère que des procédures d'autorisation commerciale peuvent constituer une entrave à la liberté d'établissement si elles ne sont pas justifiées, proportionnées, et non discriminatoires.
A titre d'exemple, dans la décision de la CJUE du 24 mars 2011, la Catalogne, avait mis en place une législation régionale soumettant l'implantation de grandes surfaces commerciales à une autorisation spéciale, en plus des règles d'urbanisme classiques, comme préalable à l'ouverture de grandes surfaces commerciales et fondée sur des critères d'aménagement du territoire, de préservation du tissu commercial existant, de développement durable, et de protection de l'environnement urbain68(*). La CJUE a considéré que le régime d'autorisation en Catalogne reposait sur des critères permettant une marge d'appréciation excessive par les autorités locales. Elle a par ailleurs considéré que la double procédure d'autorisation était disproportionnée, sans qu'elle ne soit justifiée par l'intérêt général. Elle a ainsi jugé que le régime espagnol créait des obstacles à l'implantation de distributeurs étrangers, qui pouvaient être dissuadés d'entrer sur le marché espagnol par la lourdeur des procédures et le risque d'arbitraire.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Les CDAC ne peuvent saisir l'Autorité de la concurrence que pour les projets susceptibles de faire dépasser, pour l'entreprise qui sollicite l'autorisation d'exploitation commerciale, 50 % de parts de marchés dans la zone de chalandise concernée. Or, cette faculté n'a été utilisée qu'une seule fois69(*). Par ailleurs, des projets ne dépassant pas ce seuil sont pourtant susceptibles de générer des préoccupations de concurrence dans les outre-mer au regard de la faible concurrence entre entreprises actives dans le secteur du commerce de détail physique dans les outre-mer, non compensée par le e-commerce encore peu développé dans les territoires ultramarins.
Le renforcement en parts de marchés d'une entreprise exploitant des commerces de détail peut ainsi se faire rapidement dans les outre-mer, compte tenu de l'étroitesse de leurs marchés, au détriment des consommateurs ultramarins.
Ces spécificités ultramarines expliquent pourquoi les autorités de concurrence de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie-Française mènent une analyse des opérations d'aménagement commercial avant leur réalisation, à l'instar du contrôle a priori des opérations de concentration mené dans l'Hexagone et les outre-mer.
A titre d'exemple, l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC) avait identifié des préoccupations de concurrence ayant donné lieu à des engagements structurels de l'entreprise (nouvel entrant dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire) à l'occasion de l'installation d'hypermarchés entrainant une part de marché pour l'entreprise concernée située autour de 30 % après l'opération, soit bien inférieure à 50 %70(*). D'autres décisions de l'ACNC avaient également donné lieu à des engagements alors que les entreprises ne dépassaient pas les 50 % de parts de marchés dans la zone de chalandises concernées après la mise en oeuvre de leur projet d'aménagement commercial71(*).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure vise à renforcer l'analyse concurrentielle des projets d'aménagement commercial dans les outre-mer en renforçant la possibilité de saisine de l'ADLC par les CDAC.
Elle permet aux commissions départementales d'aménagement commercial de saisir l'Autorité de la concurrence quand la part de marché - calculée en surface de vente conformément à l' article L. 752-6-1 du code de commerce - d'une entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre d'un projet d'aménagement commercial est susceptible à son issue de dépasser 25 % de parts de marché dans la zone de chalandise concernée, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Option n° 1 : Permettre aux CDAC de saisir l'ADLC lorsque l'entreprise qui sollicite une autorisation d'exploitation commerciale est susceptible de dépasser, après l'opération, 25 % de parts de marché sur l'ensemble du territoire concerné en plus des 50 % de parts de marché dans la zone de chalandise concerné déjà prévus par le droit en vigueur.
Option n° 2 : Permettre aux CDAC de saisir l'ADLC lorsque l'entreprise à l'origine d'un projet d'aménagement commercial est susceptible de dépasser les 25 % de parts de marché dans la zone de chalandise concernée après l'opération (contre 50 % actuellement).
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option 1 conduit à ajouter un second seuil en parts de marchés sur l'ensemble du territoire concerné par le projet d'aménagement commercial. Cependant, l'ensemble du territoire ne correspond pas à un marché géographique pertinent où s'exerce la concurrence. L'ajout de ce seuil supplémentaire conduirait également à rendre plus difficile la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 752-6-1 du code de commerce.
Par ailleurs, un seuil alternatif plutôt que cumulatif ne serait pas davantage pertinent dans la mesure où l'ensemble du territoire et la zone de chalandise concernés pourraient parfois se confondre (ex : à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy).
L'option 2 abaisse le seuil existant de 50 à 25 % de parts de marché dans la zone de chalandises concernée, ce qui correspond au marché géographique pertinent en matière de commerce de détail.
Cette option 2 devrait conduire à des saisines de l'ADLC plus fréquentes, renforçant ainsi l'analyse concurrentielle des projets d'aménagement commercial. Elle reste toutefois proportionnée dans la mesure où il s'agit d'une faculté laissée aux CDAC pour leur permettre de saisir l'ADLC lorsqu'un projet d'aménagement commercial est susceptible de soulever des préoccupations de concurrence.
L'option 2 est donc privilégiée pour intensifier la concurrence sur des bases communes quel que soit le territoire concerné. Elle permettra de baser l'analyse de l'Autorité de la concurrence sur des données plus certaines et objectives. Cette option est à privilégier.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
L'article L. 752-6-1 du code de commerce est modifié. Les modifications apportées ne contreviennent pas au bloc de constitutionnalité. Elles sont proportionnées puisque la mesure prévoit une faculté de saisine de l'ADLC par les CDAC sans obligation.
Une analyse concurrentielle des projets d'aménagement commercial est par ailleurs nécessaire dans les outre-mer, au regard de l'étroitesse des marchés ultramarins et de la concentration des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La mesure proposée reste proportionnée :
· Elle est limitée aux projets les plus importants d'une surface commerciale supérieure à 1 000 m² après l'opération ;
· Elle laisse une possibilité pour les CDAC de saisir l'ADLC, ce qui n'est qu'une faculté, non une obligation ;
· Une fois saisie, l'ADLC doit répondre dans un délai de 25 jours ouvrés.
Elle n'est donc pas susceptible, en soi, de dissuader de nouveaux entrants sur le marché.
Elle est par ailleurs justifiée pour les outre-mer au regard de l'étroitesse de leurs marchés et de la forte concentration des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure vise à prévenir le renforcement du pouvoir de marché des entreprises exploitant des commerces de détail à dominante alimentaire, susceptibles d'engendrer des problématiques de concurrence au détriment des entreprises ultramarines concurrentes et in fine des consommateurs.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure engendre un délai supplémentaire avant autorisation du projet d'aménagement commercial par la CDAC afin d'obtenir l'avis de l'Autorité de la concurrence, lequel doit intervenir dans les vingt-cinq jours ouvrés à compter de la saisine.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les services administratifs, la saisine de l'ADLC restant une faculté pour les CDAC visant à être utilisée pour les projets d'aménagement commercial les plus sensibles.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
En renforçant l'analyse concurrentielle des projets d'aménagement commercial dans les outre-mer, la mesure vise à prévenir des problématiques de concurrence qui seraient la conséquence d'un renforcement du pouvoir de marché des entreprises exploitant des commerces de détail, au bénéfice in fine des consommateurs ultramarins.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire le 17 juin 2025, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a émis un avis défavorable le 2 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025 et le conseil régional a émis un avis le 4 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a été consulté le 19 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 3 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Cette dernière a été consulté le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne nécessite pas de texte d'application.
TITRE IV - SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN
Article 13 - Préserver la production locale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Au sein des territoires ultramarins, les perspectives de développement de la production locale sont bridées par l'étroitesse des marchés et in fine la difficulté de bénéficier d'économies d'échelle. Selon l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), le taux de couverture de la consommation locale par la production locale varie entre 1 % et 10 % en outre-mer contre environ 80 % en Hexagone.
Pour pallier ces handicaps structurels, l'alinéa 2 de l'article L. 420-5 du code de commerce permet au préfet de rendre obligatoire la conclusion d'un accord entre importateurs et producteurs locaux de produits identiques ou similaires dont le prix de vente aux consommateurs des produits importés serait manifestement inférieur dans les outre-mer à celui pratiqué dans l'Hexagone. Cela renvoie particulièrement aux produits dits de « dégagement », soit des produits en majorité alimentaires parfois peu consommés dans l'Hexagone et dès lors vendus à bas coût vers les outre-mer où ces produits trouvent de meilleurs débouchés. Un exemple type de produit de dégagement est le poulet congelé, importé de l'Hexagone et vendu dans les outre-mer en caisses à moins de 2 euros le kilo en moyenne.
Certains produits locaux peuvent ne pas être parfaitement identiques ou similaires mais demeurer substituables, et dès lors se trouver en concurrence avec les produits importés dont les prix de vente aux consommateurs sont manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone. Deux produits sont dits substituables lorsque la consommation de l'un procure la même satisfaction au consommateur que la consommation de l'autre et ce, pour un même besoin. Ainsi, pour un prix et une qualité proche, certaines références de riz et de pâtes pourraient par exemple être considérées comme des produits substituables qui répondant au même besoin de consommation de féculents. En pratique, les produits substituables sont déterminés à l'issue d'études de marché réalisées par les offreurs (les distributeurs) auprès des consommateurs, afin d'évaluer comment ces derniers arbitrent entre les différents produits mis en vente et ainsi permettre aux distributeurs d'adapter leur offre de produits le cas échéant.
Il est donc proposé d'étendre le dispositif susmentionné de l'article L. 420-5 du code de commerce, sur les accords entre importateurs et producteurs à l'initiative du préfet, aux produits substituables pour le consommateur, c'est-à-dire en concurrence avec les produits importés précités.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 1er de la Constitution et la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) prévoient un principe d'égalité devant la loi mais le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse instaurer des différences de traitement entre territoires, à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation et qu'elles soient proportionnées72(*).
L'article 73 de la Constitution prévoit le principe d'adaptation des lois dans les DROM aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Le même principe existe pour les COM à l'article 74-1 de la constitution.
La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Elle comprend deux volets, à savoir la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité (e.g. décision Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC ; voir aussi la décision Cons. const., 16 janv. 1982, n° 81-132 DC). Par extension, cette liberté est aussi rattachée à l'article 1 de la DDHC, car elle repose sur l'égalité d'accès à l'activité économique. La liberté d'entreprise peut être limitée par des considérations d'intérêt général qui doivent être à la fois avérées (e.g. décision Cons. const., 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC, Synd. français de l'industrie cimentière sur l'absence de motif d'intérêt général) et énoncées de façon claire et précise (e.g. décision Cons. const., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC sur l'incompétence négative). Cet intérêt général est largement compris. Ainsi, des restrictions à la liberté d'entreprise peuvent notamment être justifiées par la préservation de l'ordre public économique (Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC).
L'adoption d'un accord entre importateurs et producteurs locaux, sous l'égide du préfet, peut contraindre la liberté du commerce et la liberté d'entreprendre. La mesure reste toutefois proportionnée dans la mesure où le préfet jugera de la nécessité d'intervenir pour la production locale, ce qu'il fera dans des cas exceptionnels et indispensables pour atteindre cet objectif.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit, sans justification, les droits de douane ou taxe d'effet équivalent (article 28 et 30) ainsi que les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (article 34) au sein du marché intérieur de l'Union européenne incluant les régions ultrapériphériques françaises (collectivités visées à l'article 73 de la Constitution et Saint-Martin).
Par ailleurs, l'article 101 paragraphe 1 du TFUE prévoit que tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises et toute pratique concertée, susceptible d'affecter le commerce entre des États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, est incompatible avec ce dernier.
Ces ententes anticoncurrentielles peuvent toutefois être justifiées sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 101 si elles contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans : (i) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ; (ii) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
L'article 349 du TFUE donne la possibilité au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'adopter des mesures spécifiques visant à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Il semble exister des limitations aux importations dans les trois régions ultrapériphériques (RUP) portugaises et espagnole :
- Elles prennent la forme de quotas, autorisations ou plafonds dans les régimes d'approvisionnement (POSEI) ;
- Elles sont souvent indirectes, via des incitations fiscales ou des aides locales ;
- Les Canaries ont plus de souplesse que Madère et les Açores, en raison de leur statut douanier spécifique. Ainsi, l'importation de bananes d'Amérique du Sud est encadrée afin de ne pas déstabiliser la production locale.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état, l'article L. 420-5 du code de commerce permet au préfet de rendre obligatoire la conclusion d'un accord entre importateurs et producteurs locaux portant uniquement sur des produits identiques ou similaires entre les deux parties, et dont le prix de vente aux consommateurs des produits importés serait manifestement inférieur dans les outre-mer à celui pratiqué dans l'Hexagone.
Cette limitation de l'article aux seuls produits identiques ou similaires entre les importateurs et producteurs locaux ne permet pas de suffisamment préserver la production locale ultramarine concurrencée par des produits importés substituables. En effet, un marché de produits est constitué de l'ensemble des biens considérés comme substituables entre eux du point de vue du consommateur, en raison de leurs caractéristiques, de leur usage, et des conditions de concurrence. Les produits locaux qui ne seraient pas parfaitement identiques ou similaires aux produits importés vendus à un prix manifestement inférieur à celui pratiqué dans l'Hexagone mais en concurrence directe avec ces produits importés (car substituables) seraient ainsi impactés par ces importations sans pouvoir bénéficier de la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 420-5 du code de commerce. Il apparait donc nécessaire de modifier ce dernier afin d'inclure les produits substituables.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il est proposé d'étendre le dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 420-5 du code de commerce aux produits locaux substituables pour le consommateur, c'est-à-dire à l'ensemble des produits en concurrence avec les produits importés dont les prix seraient manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone, indépendamment de leur caractère identique ou similaire à ces produits importés. Cette mesure vise à protéger davantage la production locale des produits importés qui seraient en concurrence avec elle et dont les prix constatés dans les outre-mer seraient manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure proposée conduit à considérer l'ensemble des produits substituables pour les consommateurs, c'est-à-dire l'ensemble des produits en concurrence entre eux. Ceux-ci seront désormais inclus au dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 420-5 du code de commerce.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
La présente disposition modifie le deuxième alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
La présente mesure est conforme aux textes internationaux, en particulier européens, mentionnés supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
La mesure pourrait avoir un effet bénéfique sur le développement et la valorisation de la production locale dans les outre-mer. Elle participe à l'objectif de souveraineté alimentaire des territoires.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
La mesure pourrait soutenir l'activité des entreprises locales puisque les accords qui seront conclus entre les importateurs et producteurs locaux viseront à ce que les entreprises de production locale. L'accord reflétera les engagements pris par les distributeurs, importateurs et producteurs locaux qui pourraient notamment se traduire par une meilleure valorisation de la production locale par la grande distribution et une augmentation de la production locale pour répondre à la demande des consommateurs.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Sans objet.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les services préfectoraux dans les outre-mer, en particulier les Directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), pourraient être davantage mobilisés en raison de l'élargissement du dispositif aux produits substituables, ce qui nécessitera des études de marché. Cette hausse de l'activité devrait néanmoins rester raisonnable, le préfet étant libre de ne pas solliciter les parties prenantes à la conclusion d'un accord, lorsqu'il estime que la lutte contre la vie chère prime sur la protection de la production locale pour un ensemble de produits substituables donnés.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
En préservant la production locale, la mesure pourrait favoriser l'emploi et le marché du travail dans les outre-mer.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
En préservant la production locale, cette mesure pourrait ainsi favoriser le développement économique endogène des territoires ultramarins et de leurs habitants.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La promotion de la production locale devrait également favoriser des productions moins carbonées (auxquelles les consommateurs peuvent être sensibles).
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil départemental de Mayotte a été consulté à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025.
L'assemblée de Martinique a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales le 17 juin 2025 et a rendu un avis défavorable le 02 juillet 2025.
Le conseil régional et le conseil départemental de La Réunion ont été saisis à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales le 24 juin 2025. Le Conseil régional a rendu un avis le 04 juillet 2025.
L'assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales le 16 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Le conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a rendu un avis défavorable le 03 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Ce dernier a rendu été saisi le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.
5.2.3. Textes d'application
La présente mesure ne nécessite pas de texte d'application.
Articles 14 et 15 - Instaurer dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La sous-traitance est définie à l' article L. 2193-2 du code de la commande publique comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du marché public ou de l'accord-cadre qui lui a été attribué ».Cette définition est issue de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui a instauré pour la première fois dans le droit interne un régime organisant les relations entre donneurs d'ordre, entrepreneurs principaux et sous-traitants. Dans le code de la commande publique elle est désormais codifiée aux articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.
Les règles issues de cette loi de 1975 précitée et ses décrets d'application s'appliquent à la fois aux contrats de droit privé et de droit public, avec des aménagements pour ces derniers.
Le régime juridique actuel de la sous-traitance trouve sa source dans l' article 71 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, transposée en droit français. Il vise notamment à favoriser l'accès des PME à la commande publique.
Prise sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics transpose en droit français le volet législatif de la directive 2014/24/UE. Cette ordonnance vise à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics et promouvoir l'utilisation stratégique des marchés publics comme levier de politique en matière d'emploi, d'innovation et de développement durable, tout en optimisant les politiques d'achat.
Le tissu économique ultramarin est composé majoritairement d'entreprises de petite taille (TPE)73(*). Le rapport de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) consacré à La Réunion en 2022 indique que, sur les 62 963 entreprises présentes à La Réunion en 2022, seules 2 654 comptent 10 salariés ou plus. 96 % des entreprises réunionnaises comptent donc moins de 10 salariés.
Le bâtiment et les travaux publics sont l'un des plus importants secteurs économiques dans les outre-mer : il est, lui aussi, majoritairement composé d'artisans et de TPE. Le rapport de 2022 de l'IEDOM consacré à la Guyane note que pas moins de 17,5 % des établissements actifs du territoire exercent une activité dans le bâtiment. Au sein des entreprises guyanaises de ce secteur, 83,3 % n'ont aucun salarié et 13,9 % ont entre 1 et 9 salariés. Le rapport de 2022 de l'IEDOM consacré à la Guadeloupe note également que le secteur « de la construction représente 14,4 % des entreprises du département. Ce sont essentiellement des structures de petite taille (70,9 % des entreprises ne déclarent pas de salariés) ».
La commande publique représente une part très importante de l'activité économique du bâtiment et des travaux publics. Elle représentait ainsi 83 % du chiffre d'affaires du secteur selon le rapport publié en 2022 de l'IEDOM consacré à La Réunion. De même, le rapport consacré à la Martinique en 2022 indique que « l'activité des entreprises du BTP est dépendante des grands projets lancés par les organismes publics de l'île. »
Les marchés publics, qui représentent 120 milliards d'euros par an au niveau national, sont un puissant levier d'orientation de l'économie, puisque les PME sont titulaires de près de 60 % de ces marchés, à hauteur de 30 % de leur montant global74(*). Favoriser l'activité de ces TPE ultramarines est dès lors essentiel pour soutenir le dynamisme économique et l'insertion sociale dans les outre-mer. Vu l'importance de la commande publique, il est par ailleurs capital de décloisonner deux mondes : celui des entreprises et celui des collectivités territoriales.
Si l'expérimentation initiée par l'article 73 de la loi « égalité réelle outre-mer » dite « loi EROM » était extrêmement intéressante, le Gouvernement regrette qu'elle n'ait pas rencontré le succès espéré. En effet, « seuls 4 % des acheteurs s'en sont saisis - en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés ». À ce titre, le rapport du Haut conseil de la commande publique de La Réunion publié en octobre 2022 apporte plusieurs propositions d'amélioration.
Celle-ci a en effet pâti potentiellement d'un manque de communication les deux premières années et surtout de l'intervention de la crise du Covid-19 en 2020, suivi d'un enchainement de crises géopolitiques et économiques (conflit en Ukraine, inflation, etc.), ne permettant pas de mener à bien l'expérimentation et de pouvoir procéder à son évaluation.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En droit interne, les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes fondamentaux, rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique, ont été élevés au rang d'exigences de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel75(*). Toutefois, le juge constitutionnel a également admis que le législateur pouvait, pour des motifs d'intérêt général, déroger à ces principes dès lors que la dérogation était nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi76(*).
Si la préférence locale est interdite, il existe néanmoins des moyens pour l'acheteur public de faciliter l'accès des entreprises locales aux marchés publics, sans méconnaître les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement. Par exemple, l'article R. 2171-23 du code de la commande publique, pris en application de l'article L. 2171-8 du même code, prévoit que la part minimale confiée directement ou indirectement à des PME ou à des artisans, est fixée à 20% du montant du marché. D'autres mesures permettent de privilégier les entreprises locales sans pour autant faire de la préférence locale. Tout d'abord, pour les marchés dont le montant se situe en dessous des seuils de publicité imposés, le pouvoir adjudicateur est libre de favoriser les supports de publicité locaux pour la publicité de la consultation. Outre ce dispositif, il est possible de prendre en compte l'implantation géographique des candidats, si elle est justifiée par l'objet du contrat ou par ses conditions d'exécution. C'est par exemple le cas pour les marchés de maintenance pour lesquels il est nécessaire d'assurer une rapidité d'intervention77(*).
Par ailleurs, dans sa décision précitée de 2003, le Conseil constitutionnel a jugé qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, l'aménagement, la maintenance et l'entretien d'un ouvrage public.
La disposition permettant de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales sera applicable aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire applicable à ces collectivités est celui de la France hexagonale. Toutefois, ce régime peut faire l'objet d'adaptation au regard d'une situation particulière. Aussi le législateur peut donc, sans méconnaitre l'article 1er de la Constitution, ni le principe d'égalité devant la loi, adapter les règles relatives au droit de la commande publique afin de favoriser le tissu économique local qui se traduit spécifiquement dans ces collectivités marquées par l'étroitesse des marchés, l'ultra périphéricité et l'éloignement. Cette disposition sera également applicable à certaines collectivités régies par l'article 74 de la Constitution à savoir à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. S'agissant de ces dernières, l'expérimentation est justifiée pour favoriser l'activité des PME et TPE présentes sur ces territoires pour les mêmes raisons.
En outre la disposition permettant de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros sera applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont régies par l'article 74 de la Constitution.
Les présentes dispositions feront l'objet d'une expérimentation conformément à l'article 37-1 de la Constitution qui prévoit que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Il permet de déroger au principe d'égalité en adoptant, pour un objet et une durée limités, des dispositions applicables seulement à l'échantillon retenu pour l'expérimentation. Par ailleurs, lorsque l'expérimentation a pour objet de déroger à des dispositions déjà existantes, elle relève de la loi s'il s'agit de déroger à des dispositions législatives ce qui est le cas en l'espèce. Aucune matière ne semble a priori exclue du régime de l'expérimentation et les territoires concernés peuvent être exclusivement situés outre-mer. En outre, en ce que le dispositif envisagé définit de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de ces deux expérimentations et ne méconnaît par les autres exigences de valeur constitutionnelle, il semble conforme à la Constitution (CC, no 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 9).
En sus, même si le Conseil constitutionnel juge qu'« aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de déterminer les modalités de l'évaluation consécutive à une expérimentation »78(*), les dispositions prévoient, dans un souci de bonne administration et d'efficacité, un dispositif d'évaluation de l'expérimentation. La logique du régime fixé par l'article 37-1 de la Constitution est en effet que l'expérimentation fasse l'objet d'une évaluation, destinée à éclairer l'autorité sur l'opportunité de proroger ou non le dispositif.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les directives 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics et 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux encadrent les procédures de passation des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices répondant à un besoin dont le montant estimé est égal ou supérieur à certains seuils. Pour les marchés de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs centraux ce seuil est actuellement fixé à 143 000 euros HT. Il est fixé à 221 000 euros HT pour les autres pouvoirs adjudicateurs (collectivités) et à 443 000 euros HT pour les entités adjudicatrices. Pour les marchés de travaux, ce seuil est actuellement fixé à 5 382 000 euros hors taxes, en application du règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission européenne.
En dessous ce seuil, les Etats membres sont libres de fixer les règles de passation des marchés publics, sous réserve de respecter les règles générales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98), les contrats exclus du champ d'application des directives sont néanmoins soumis aux règles fondamentales du traité et notamment au principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel implique une obligation de transparence, dès lors qu'ils présentent un intérêt transfrontalier certain.
Enfin, les outre-mer bénéficient en droit européen et en droit français de larges possibilités d'adaptation, consacrées par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'expérimentation nécessite de légiférer dès lors qu'elle déroge à l'interdiction d'attribuer des marchés sur la base d'une préférence locale ou nationale, et qu'il n'existe aucune disposition la permettant.
Les dispositions relatives à la commande publique sont spécifiques. Des mesures adaptées doivent être prévues par le projet de loi, sans compromettre l'égalité des territoires ni le respect du droit européen.
Le dispositif expérimental prévu par la loi adoptée en février 2017, qui offrait aux acheteurs la possibilité de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales et obligeait les entreprises répondant aux marchés supérieurs à 500 000 euros à présenter un plan de sous-traitance locale, n'a pas été prorogé en l'état, étant donné qu'il était peu utilisé sur le terrain.
La mesure proposée souhaite approfondir cette expérimentation. Les présentes dispositions relèvent du domaine de la loi conformément à l'article 34 de la Constitution.
Une expérimentation de nature législative en la matière parait proportionnée en vertu du domaine auquel elle s'applique.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre la mise en place d'un dispositif expérimental d'adaptation des règles de la commande publique dans les outre-mer afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros. La réservation de marchés aux PME, TPE et artisans vise à permettre l'émergence ou la consolidation de l'activité d'acteurs économiques locaux. Les présentes dispositions viseront donc à protéger l'activité économique ultramarine
Favoriser l'activité de ces TPE ultramarines est dès lors essentiel pour soutenir le dynamisme économique et l'insertion sociale dans les outre-mer. Vu l'importance de la commande publique, il est par ailleurs capital de décloisonner deux mondes : celui des entreprises et celui des collectivités territoriales.
Si l'expérimentation initiée par la loi « égalité réelle outre-mer » était extrêmement intéressante, le Gouvernement regrette qu'elle n'ait pas rencontré le succès espéré. En effet, « seuls 4 % des acheteurs s'en sont saisis - en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés ». À ce titre, le rapport du Haut conseil de la commande publique de La Réunion publié en octobre 2022 apporte plusieurs propositions d'amélioration. Le risque de dépasser la limite des 15 % qui était prévue à l'alinéa 2 de l'article 73 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a pu freiner les acheteurs.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Option 1 : Statu quo, les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Option 2 : instaurent dans les outre-mer des règles adaptées de la commande publique afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option 2 est donc privilégiée. Le statu quo ne permet pas une adaptation aux particularités ultramarines, et notamment l'étroitesse des marchés et de plus grandes difficultés de préfinancement pour petites et moyennes entreprises locales.
Aussi, il est prévu une expérimentation pour une durée de 5 ans permettant une adaptation des règles de la commande publique dans les outre-mer afin de réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales et de rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Une expérimentation ayant une durée limitée, les dispositions l'instituant ne font, en principe, pas l'objet d'une codification. En outre, les mesures envisagées concernant de plein droit et à titre expérimental les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, et strictement encadrées, ne s'appliqueront qu'à certaines prestations sur une partie déterminée du territoire national, et n'ont pas ainsi vocation à modifier les règles de droit commun prévues dans le code de la commande publique.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Les procédures d'attribution dérogatoires prévues ne concernent que des marchés publics d'un montant inférieur aux seuils européens. La mesure s'inscrit donc en dehors du champ d'application des directives européennes sur les marchés publics.
En effet, il est juridiquement sécurisant de prévoir que le dispositif ne vaut que pour les marchés en dessous des seuils européens, le droit européen ne prévoyant pas de réservation de marchés autres que ceux prévus au profit (i) des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés et (ii) des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Les mesures proposées sont susceptibles d'avoir une incidence sur la croissance, la compétitivité des entreprises et la concurrence au sein des territoires ultramarins, ainsi qu'un impact positif en faveur de la lutte contre la vie chère en outre-mer.
En favorisant les entreprise locales, la mesure aura un impact positif sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat des habitants ultramarins.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Les mesures envisagées auront un effet positif sur l'accès à la commande publique des PME, des microentreprises et des artisans. En effet, celles-ci seront soit attributaires de marchés soit chargées de l'exécution d'une partie d'un marché, en tant qu'entreprise sous-traitante, selon le plan de sous-traitance prévu par l'entreprise attributaire du marché. Dans les deux cas, une part de la commande publique devrait dans les territoires concernés bénéficier aux TPE, PME et artisans établis sur ces territoires.
4.2.3. Impacts budgétaires
Pour certains marchés, la contractualisation avec des entreprises locales pourrait peut-être permettre de bénéficier de prix moins élevés, car n'incluant pas le coût d'un transport par avion.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La mesure n'a pas d'impact direct identifié pour les acheteurs locaux concernés. Les collectivités passent leurs marchés selon les mêmes procédures mais pourront réservés une part de ces marchés aux entreprises locales.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure pourra nécessiter la sensibilisation des services administratifs, notamment en matière de formation en particulier pour les agents chargés de vérifier les candidatures aux appels d'offres.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
La mesure a une incidence sociale directe au regard des emplois qui devraient être réservés aux entreprises ultramarines, et le cas échéant les foyers défavorisés.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
La mesure peut avoir un impact sur l'emploi des jeunes ultramarins, et notamment les jeunes des foyers défavorisés.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La mesure n'a pas d'incidence environnementale directe.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Ces expérimentations ne sont pas prévues en droit commun. Il en résulte que ces dispositions constituent des adaptations, de nature à requérir la consultation des collectivités ultramarines concernées et ce, y compris lorsque la portée est restreinte aux seuls marchés de l'Etat et de ses établissements publics (collectivités du Pacifique).
Les régions et départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités uniques de Guyane et Martinique et le département de Mayotte sont consultés sur les projets de loi comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative :
Le Conseil départemental de Mayotte a été consulté pour avis le 17 juin 2025, à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil régional et le Conseil départemental de Guadeloupe ont été saisis pour avis le 16 juin 202, à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
L'assemblée de Martinique a été saisie, à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis défavorable le 02 juillet 2025.
Le Conseil régional et le Conseil départemental de La Réunion ont été saisis le 24 juin 2025 à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application des articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil régional a rendu un avis le 04 juillet 2025.
L'Assemblée de Guyane a été saisie à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L. 7152-2 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
De plus, le Conseil territorial de Saint-Barthélemy a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6213-3 du code général des collectivités territoriales le 19 juin 2025.
Le Conseil territorial de Saint-Martin a été saisi à titre obligatoire, en procédure d'urgence, en application de l'article L.O.6313-3 du code général des collectivités territoriales le 20 juin 2025.
Le Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisir à titre obligatoire en application de l'article L.O.6413-3 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable le 30 juin 2025.
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été saisie pour avis le 17 juin 2025 et a émis un avis favorable le 3 juillet 2025.
Conformément au 1° de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est consultée, à titre obligatoire, sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Cette dernière a rendu un avis défavorable le 03 juillet 2025.
En vertu des dispositions de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès est consulté, à titre obligatoire, sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci a été saisi pour avis le 18 juin 2025.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Ø Réserver une part des marchés publics aux petites et moyennes entreprises locales
Cette expérimentation sera conduite dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon régies par l'article 74 de la Constitution et pourra être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.
Ø Rendre obligatoire un plan de sous-traitance pour les marchés supérieurs à 500 000 euros
Cette expérimentation sera conduite dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon régies par l'article 74 de la Constitution et pourra être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions n'appellent pas de mesures d'application. Un rapport d'évaluation de cette expérimentation afin de déterminer l'opportunité de son éventuelle pérennisation sera remis au Parlement au plus tard trois mois avec son terme.
Article 16 - Mise à jour des compteurs Lifou permettant d'étendre aux îles de Wallis et Futuna l'ensemble des articles qui leur sont applicables
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Sans objet.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna est une collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution régie par le principe de spécialité.
À la lecture combinée des dispositions de l'article 7 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, l'État détient une compétence de droit commun en matière de droit commercial.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
La nécessité d'une mention expresse d'application à Wallis-et-Futuna des modifications apportées à des textes qui y ont déjà été déclarés applicables, découle des textes constitutionnel et organiques et de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat Ass., 9 février 1990, Élections municipales de Lifou, n° 107400, Rec. p. 28)
Dans son avis d'assemblée générale du 7 janvier 2016 (Section du rapport et des études - Recommandation n° 391040), le Conseil d'Etat préconise pour les codes la technique des tableaux Lifou pour les collectivités sous spécialité législative : « une présentation sous forme de tableau indiquant, en deux colonnes, pour chaque collectivité concernée, les dispositions étendues et la rédaction dans laquelle elles sont applicables. »
À cet effet, l'article L. 950-1 du code de commerce prévoit des tableaux « Lifou » indiquant les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Etendre à Wallis-et-Futuna les modifications du code de commerce auxquelles procède le projet de loi.
3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Aucune autre option n'a été envisagée.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Le présent article vise à mettre à jour des tableaux Lifou de la partie législative du code de commerce.
Ainsi, il a pour objet de rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications des articles du code de commerce auxquelles procède le projet de loi ainsi que ceux qui sont cités par ces dispositions et qui n'avaient pas été étendus jusqu'à présent sans que cet oubli ne soit justifié.
Ainsi, cet article rend applicable à Wallis-et-Futuna, par une mise à jour des tableaux « Lifou » au L. 950-1 du code de commerce :
- les modifications de l'article L. 410-4 apportées par l'article 3 ;
- les modifications de l'article L.410-5 apportées par le I de l'article 2 ;
- les modifications de l'article L. 410-6 apportées par l'article 6 ;
- les modifications de l'article L. 441-1 apportées par le I de l'article 8 ;
- l'article L. 411-1-1 dans sa dernière modification ;
- les modifications de l'article L. 441-1-2 apportées par le II de l'article 8 ;
- l'article L. 441-3-1 qui est cité dans les modifications par les I et II de l'article 8 ;
- l'article L. 442-1 cité au III et au IV de l'article 8 ;
- les modifications de l'article L. 442-5 apportées par l'article 1er ;
- l'article L. 443-8 mentionné au I de l'article 7, par le I et le III de l'article 8 ;
- les modifications de l'article L. 461-1 apportées par l'article 10 ;
- les modifications de L. 470-1 apportées par le II de l'article 2 ;
- l'article L. 470-2 cité au IV et au VI de l'article 2, à l'article 6, au I de l'article 7 et au IV de l'article 8.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne
Les tableaux « Lifou » de L. 950-1 du code de commerce sont actualisés de sorte que les habitants de Wallis-et-Futuna sont en mesure de connaître précisément les articles du code de commerce qui sont applicables dans cette collectivité et la version applicable.
4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts budgétaires
Sans objet.
4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Application à Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sans objet.
4.5. IMPACTS SOCIAUX
4.5.1. Impacts sur la société
Sans objet.
4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.5.4. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.5.5. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
Sans objet.
4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Sans objet.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, à l'exception des îles de Wallis et Futuna où il entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication, en application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux iles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
5.2.2. Application dans l'espace
Le présent article est applicable dans la collectivité de Wallis-et-Futuna.
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne nécessite pas de texte d'application.
* 1 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer.
* 2 Article L. 442-5 du code de commerce
* 3 Voir par exemple Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
* 4 Conseil constitutionnel, 30 novembre 2012, n° 2012-285 QPC
* 5 Conseil constitutionnel, 16 janvier 1982, n° 81-132 DC
* 6 Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n° 2013-317 QPC
* 7 Conseil constitutionnel, 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC
* 8 Conseil constitutionnel, 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC.
* 9 L'empotage est l'opération de chargement des marchandises à l'intérieur d'un conteneur. Le dépotage représente l'opération inverse.
* 10 Conseil constitutionnel, 25 juillet 1984, n° 84-174 DC, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
* 11 Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
* 12 Au sens de l'article D.441-1 du Code de commerce.
* 13 INSEE « Enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation entre territoires français 2022 » publiée dans la collection INSEE Première, n°1958 de juillet 2023.
* 14 L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) est chargé d'assurer la continuité territoriale des missions de banque centrale par délégation de la Banque de France dans les départements et collectivités d'outre-mer dont la monnaie est l'euro.
* 15 L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) est la banque centrale des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc Pacifique.
* 16 Voir les articles L. 910-1 A et suivants du code de commerce, L. 410-5 et L. 462-1 du même code et l'article L. 113-3 du code de la consommation.
* 17 Article L. 910-1 A du code de commerce.
* 18 Article L. 910-E du code de commerce.
* 19 Article L. 410-5 du code de commerce.
* 20 Article L. 410-5 du code de commerce.
* 21 Conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce.
* 22 Voir par exemple Conseil constitutionnel, 25 juillet 1984, n° 84-174 DC, Loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
* 23 Conseil constitutionnel, 9 mai 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
* 24 Voir les éléments du 1.3.
* 25 Rapport sénatorial n°514 sur la vie chère en outre-mer (2025).
* 26 En 2023, le déficit commercial de la Martinique atteignait 3 milliards d'euros.
* 27 Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, compte-rendu de réunion n° 20.
* 28 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 de l'Autorité de la concurrence concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-mer.
* 29 Rapport du CESE « Mieux connecter les Outre-mer » d'octobre 2024.
* 30 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 de l'Autorité de la concurrence
* 31 Les charges sont l'obligation de continuité du service public (entretenir et renouveler les équipements ; assumer le risque économique, etc.).
* 32 En 2024-2025, pour les concessions le seuil d'application de la directive 2014/23/UE est fixé à 5 382 000 € HT (il est révisé tous les deux ans par la Commission européenne).
* 33 Au regard de l'article 107 du TFUE, le dispositif ne répond pas aux critères cumulatifs définissant une aide d'État au sens du droit européen : (i) aucun avantage économique n'est accordé (pas de subvention, d'avantage fiscal ou de mise à disposition gratuite d'actifs), (ii) pas de financement public, (iii) le dispositif n'est pas sélectif dans la mesure où celui-ci est ouvert à l'ensemble des entreprises. Enfin, (iv) aucun effet de distorsion avéré sur la concurrence ou les échanges n'est identifié.
* 34 Pour rappel, les grands acteurs nationaux expédient 10 % de leurs marchandises vers les DROM, ce qui représente 0,5 % à 1 % de leur chiffre d'affaires.
* 35 INSEE « Enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix à la consommation entre territoires français 2022 » publiée dans la collection INSEE Première, n°1958 de juillet 2023.
* 36 Etude CCI - DME relative à Formation des prix en Martinique d'avril 2023.
* 37 Conseil constitutionnel, 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC et n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.
* 38 Conseil constitutionnel, 12 octobre 2012, n° 2012-280 QPC
* 39 Insee Première N°1589, paru le 14/04/2016
* 40 Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique
* 41 Le secret statistique découle des obligations définies, d'une part en droit national, par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et d'autre part en droit européen, par le règlement général sur la protection des données ( RGPD) et par le règlement 223 relatif aux statistiques européennes.
* 42 https://www.martinique.gouv.fr/Actualites/Signature-du-protocole-d-objectifs-et-de-moyens-de-lutte-contre-la-vie-chere
* 43 https://www.martinique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Consommation-et-commerce/Lutte-contre-la-vie-chere/1er-bilan-du-protocole-du-16-octobre-2024-d-objectifs-et-de-moyens-pour-lutter-contre-la-vie-chere
* 44 Les sorties de caisse désignent les données que les points de ventes collectent lorsque les consommateurs passent à la caisse en faisant leurs achats (essentiellement le prix des produits achetés et les quantités vendues, les données peuvent également comprendre les promotions pratiquées).
* 45 Si les comportements de consommation sont relativement bien documentés sur l'Hexagone, notamment par les panélistes exploitant les données de sortie de caisse des distributeurs, tel n'est pas le cas dans les outre-mer où aucun panéliste ne collecte ni n'exploite de manière exhaustive ce type de données.
* 46 Une seule décision concernant les outre-mer a été rendue par l'Autorité de la concurrence en phase 2 : voir la décision n° 11-DCC-187 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation.
* 47 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
* 48 Avis n° 09-A-45 du 08 septembre 2009relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer
* 49 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
* 50 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, 2020, §103 à 105.
* 51 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1647
* 52 Voir par exemple la décision n° 14-DCC-34 du 18 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs de la société GD Sainte Rose et de la SARL du Sud par la société Soco Sainte Rose
* 53 Voir par exemple la décision n° 19-DCC-11 du 23 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Mayotte Motor Corporation Distribution et Hamaha Rent par la société Citadelle
* 54 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-53 du 24 avril 2012 relative à l'acquisition du fonds de commerce de la société West Indies Petroleum Company par la société Compagnie Antillaise des Pétroles
* 55 Voir par exemple la décision n° 20-DCC-28 du 03 mars 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Financière Pain Frotté par les groupes Kin Siong, Lam Tow et Yong Wai Man
* 56 Voir par exemple la décision n° 18-DCC-79 du 23 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dimeco par la société Cafom
* 57 Conseil constitutionnel, 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, n° 2012-280 QPC.
* 58 CJCE, n° C-6/72, Arrêt de la Cour, Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. contre Commission des Communautés européennes, 21 février 1973.
* 59 CJUE, n° C-449/21, Arrêt de la Cour, Towercast SASU contre Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l'économie, 16 mars 2023.
* 60 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939
* 61 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939
* 62 Avis 19-A-12 concernant le fonctionnement de la concurrence Outre-mer
* 63 https://www.senat.fr/rap/r24-514/r24-5141.pdf
* 64Ibid.
* 65 Voir en ce sens la décision la décision de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n° 2024-DCC-04 du 29 avril 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de la SARL Sodexma par la SARL Nord Holding (opération dans le secteur du commerce de détail de produits de bazar et décoration).
* 66 Voir par exemple, les décisions du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, considérant 13 ; n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, considérant 16 ; n° 2014-694 DC du 28 mai 2014, considérant 7.
* 67 Voir par exemple les décisions du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ; n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit.
* 68 Voir par exemples la décision de la CJUE du 24 mars 2011, Commission c. Espagne, aff. C-400/08 : L'Espagne imposait une autorisation pour ouvrir de grandes surfaces commerciales, fondée sur des critères d'aménagement du territoire de préservation du tissu commercial existant, de développement durable, et de protection de l'environnement urbain.
* 69 Voir l' avis de l'Autorité de la concurrence n° 13-A-20 du 7 novembre 2013 relatif au projet d'agrandissement du principal magasin de distribution alimentaire de Saint-Barthélemy, après saisine sur le fondement de l'article L. 752-6-1 du code de commerce.
* 70 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n° 2020-DEC-08 du 11 septembre 2020 et 2020-DEC-09 du 22 septembre 2020.
* 71 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n° 2021-DEC-13 du 29 décembre 2021 ; n° 2022-DEC-05 du 24 août 2022 ; n° 2022-DEC-07 du 7 octobre 2022 ; n° 2022-DEC-09 du 21 décembre 2022 ; n° 2023-DEC-05 du 1er mars 2023 ; n° 2023-DEC-13 du 4 octobre 2023 .
* 72 Voir par exemple, les décisions du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 ou encore, n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.
* 73 Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précise les critères permettant de déterminer l'appartenance à une catégorie d'entreprises :
- Une microentreprise est une entreprise dont l'effectif est inférieur à dix personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros ;
- Une PME est une entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Il fait référence dans ses visas à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, à laquelle renvoie l'article R.2351-12 du code de la commande publique.
* 74 Question au Gouvernement 433, publiée le 11 janvier 2023.
* 75 Conseil constitutionnel, n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
* 76 Conseil constitutionnel, n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
* 77 Question écrite n° 03931 [Sénat] - Réponse publiée le 14 février 2013
* 78 Conseil constitutionnel, n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, cons. 19.