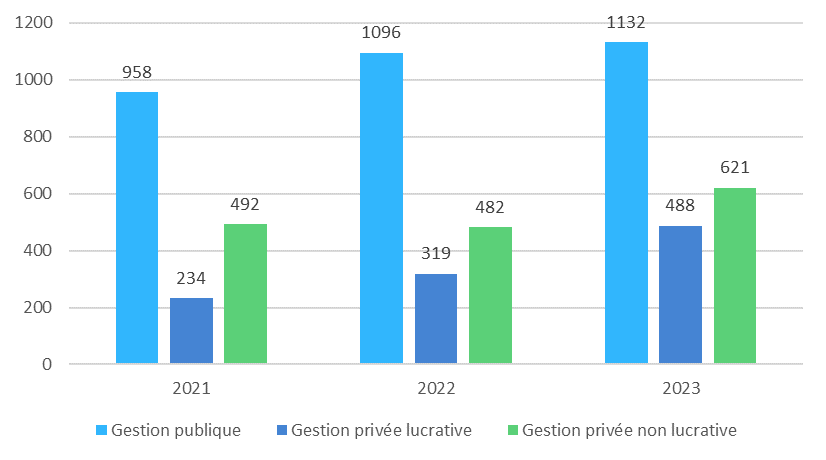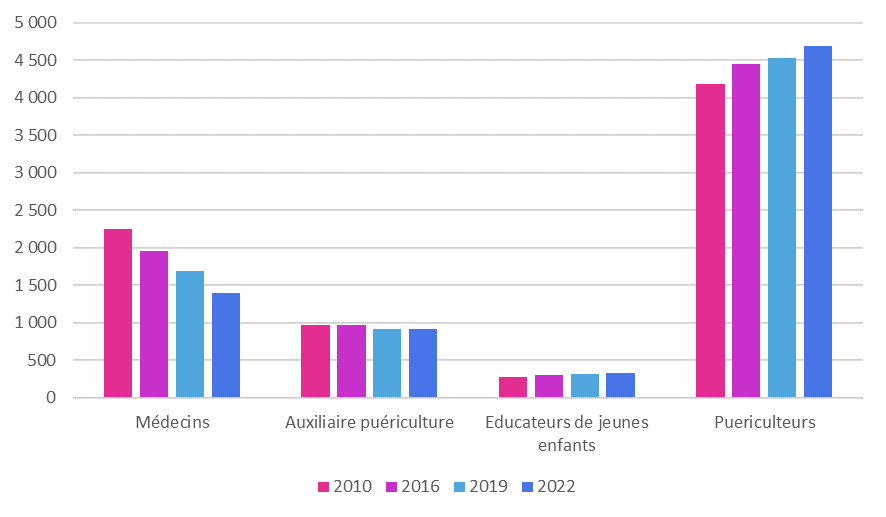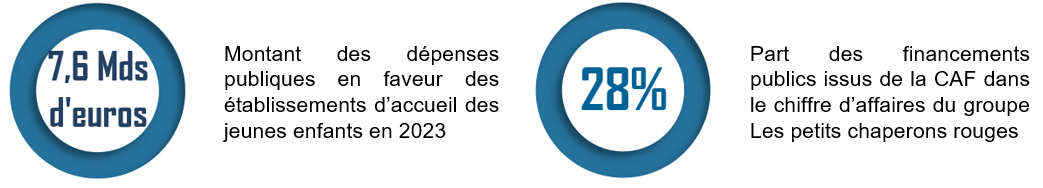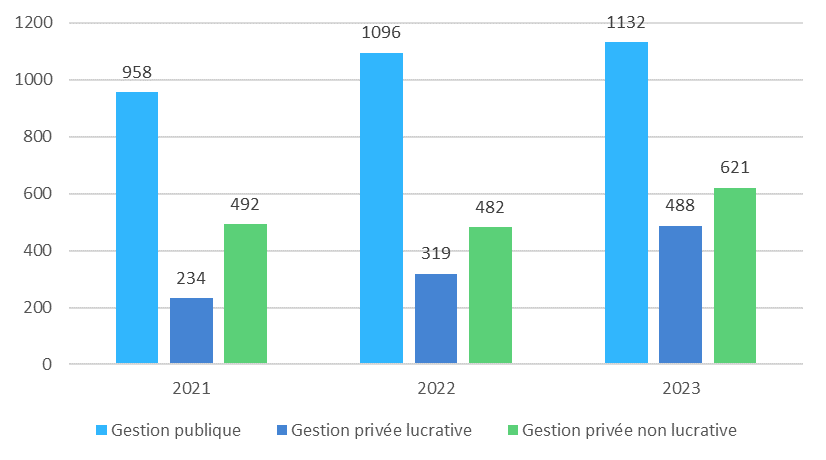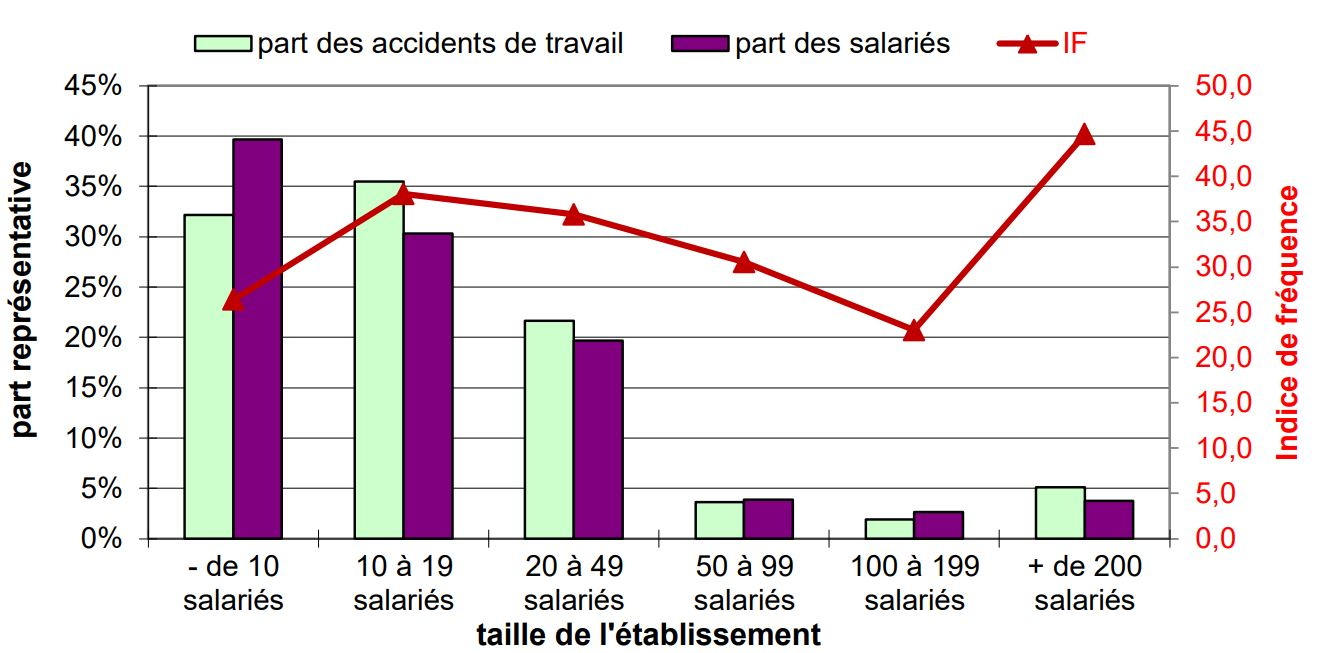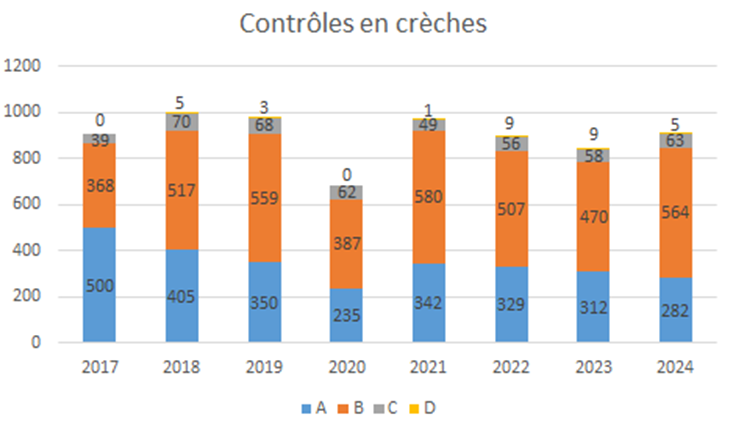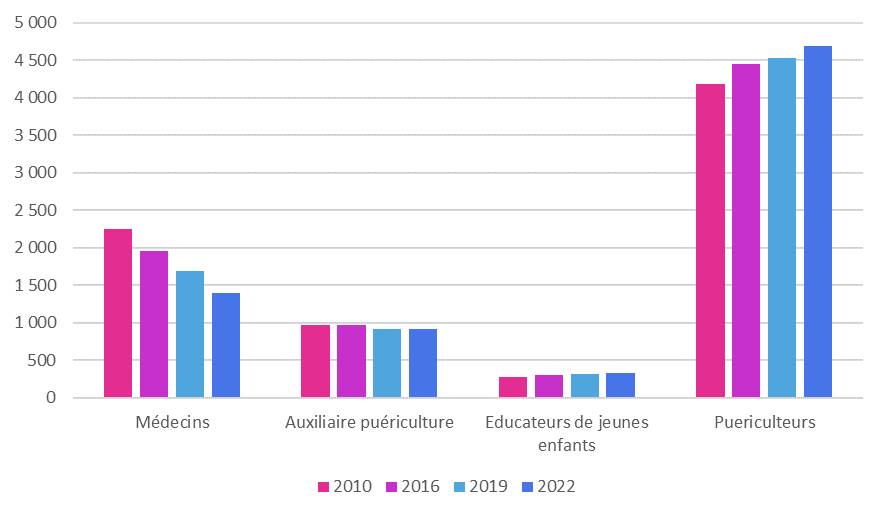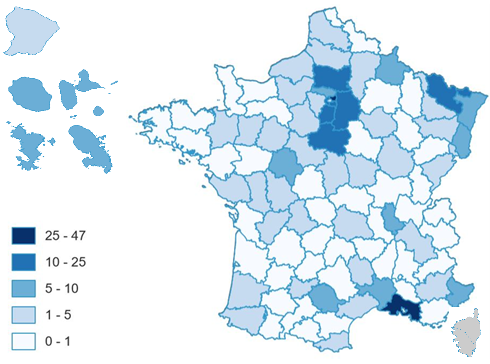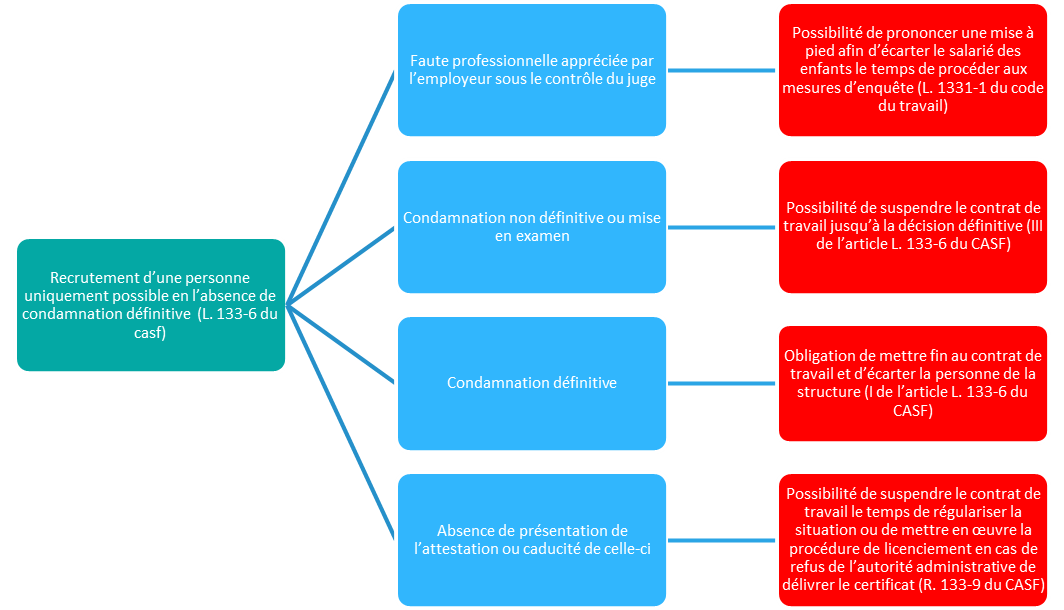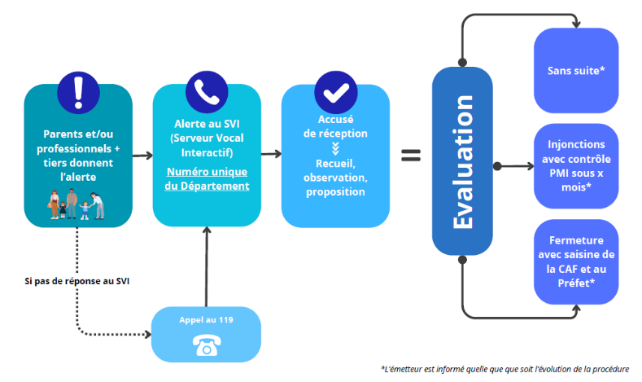- L'ESSENTIEL
- I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES
EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE
PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS
CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES
DISPARITÉS TERRITORIALES
- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune
enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet
- 2. Le contrôle du respect des normes par les
services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes
disparités entre les départements
- 3. Malgré leur expertise et la
nécessité de leur action, les services de l'État, faute de
moyens, ne participent que faiblement au contrôle des
établissements d'accueil du jeune enfant.
- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune
enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet
- B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION
AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER
- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS
CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES
DISPARITÉS TERRITORIALES
- II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI
NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
L'ACCUEIL DES ENFANTS
- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR
L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT
ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
- 1. Fixer des règles claires et opposables
pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique
et sur tout le territoire
- 2. Permettre aux services départementaux de
la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des
équipes
- 3. Renforcer les outils à disposition des
autorités publiques pour améliorer l'effectivité du
contrôle tant des établissements que des groupes
- 1. Fixer des règles claires et opposables
pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique
et sur tout le territoire
- B. RENFORCER LE CONTRÔLE ET LA FORMATION DES
PROFESSIONNELS AU CONTACT DES ENFANTS POUR MIEUX REPÉRER LES SITUATIONS
DYSFONCTIONNELLES
- 1. Face à un roulement de personnel
très important et à des difficultés de recrutement
majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit
être renforcé
- 2. L'amélioration du repérage des
situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des
formations des professionnels de la petite enfance
- 1. Face à un roulement de personnel
très important et à des difficultés de recrutement
majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit
être renforcé
- C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE
L'ÉVALUATION AUPRÈS DE TOUS LES ACTEURS
- 1. Renforcer la transparence des
établissements et des résultats des contrôles
- 2. Renforcer le dispositif de signalement dans le
secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes
- 3. Faire des familles des acteurs de
l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des
professionnels de la petite enfance
- 1. Renforcer la transparence des
établissements et des résultats des contrôles
- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR
L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT
ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
- I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES
EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE
PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- AVANT-PROPOS
- I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE
D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS
CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES
DISPARITÉS TERRITORIALES
- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune
enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui
peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit
leur mode de financement
- 2. Le contrôle du respect des normes par les
services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes
disparités entre les départements
- 3. Des dispositifs de contrôle interne trop
dépendants de la seule volonté et capacité des
acteurs
- 1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune
enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui
peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit
leur mode de financement
- B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE
COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER
- A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS
CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES
DISPARITÉS TERRITORIALES
- II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI
NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
L'ACCUEIL DES ENFANTS
- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR
L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN RENFORCEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
- 1. Fixer des règles claires et opposables
pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique
et sur tout le territoire
- 2. Permettre aux services départementaux de
la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des
équipes
- a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers
pour effectuer le contrôle du respect du référentiel
bâtimentaire
- b) Renforcer l'effectivité de la
procédure d'évaluation des crèches en permettant à
des organismes extérieurs certifiés de participer à
l'obligation d'évaluation quinquennale des établissements
- c) Mieux former les agents chargés du
contrôle afin de renforcer la qualité de l'action de la PMI
- d) Encourager la distinction entre les actions de
contrôle et de conseil dans l'organisation des services
départementaux
- a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers
pour effectuer le contrôle du respect du référentiel
bâtimentaire
- 3. Renforcer les outils à disposition des
autorités publiques pour améliorer l'effectivité du
contrôle tant des établissements que des groupes
- 1. Fixer des règles claires et opposables
pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique
et sur tout le territoire
- B. RENFORCER LE CONTRÔLE DES PROFESSIONNELS
AU CONTACT DES ENFANTS ET AMÉLIORER LEUR FORMATION AFIN D'ASSURER
LE REPÉRAGE DES SITUATIONS DYSFONCTIONNELLES
- 1. Face à un roulement de personnel
très important et des difficultés de recrutement majeures, le
contrôle des professionnels au contact des enfants doit être
renforcé
- a) Des difficultés de recrutement et un
roulement de personnel important qui entraînent une dégradation
des exigences de recrutement
- b) Une récente amélioration des
conditions de vérification des antécédents judiciaires qui
doit être rapidement généralisée
- c) L'établissement d'un socle commun de
compétences des professionnels de la petite enfance et la reconnaissance
des qualifications afin d'assurer la qualité des personnels
recrutés
- a) Des difficultés de recrutement et un
roulement de personnel important qui entraînent une dégradation
des exigences de recrutement
- 2. L'amélioration du repérage des
situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des
formations des professionnels de la petite enfance
- 1. Face à un roulement de personnel
très important et des difficultés de recrutement majeures, le
contrôle des professionnels au contact des enfants doit être
renforcé
- C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE
L'ÉVALUATION AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS
- 1. Renforcer la transparence des
établissements et des résultats des contrôles
- 2. Renforcer le dispositif de signalement dans le
secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes
- 3. Faire des familles des acteurs de
l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des
professionnels de la petite enfance
- 1. Renforcer la transparence des
établissements et des résultats des contrôles
- A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR
L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN RENFORCEMENT DE
L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
- I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE
D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- DÉPLACEMENT
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
- ANNEXE
N° 460
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mars 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur l'efficacité du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant et sur ses éventuelles défaillances,
Par Mmes Laurence MULLER-BRONN, Émilienne
POUMIROL
et M. Olivier HENNO,
Sénatrices et Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.
L'ESSENTIEL
Face à l'onde de choc provoquée par les récents ouvrages sur la situation dans les crèches, la commission a souhaité enquêter sur l'efficacité du contrôle des établissements. À l'issue de ses travaux, elle pointe des faiblesses dans l'exercice de ces contrôles et estime nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle et une évaluation au service de l'amélioration de la qualité de l'accueil sur l'ensemble du territoire.
Elle formule pour cela 15 propositions.
Depuis plusieurs années, la multiplication des scandales au sein des structures d'accueil collectif des jeunes enfants oblige les pouvoirs publics à agir. Il n'est pas acceptable que des dysfonctionnements puissent perdurer avant que des sanctions ne soient prises et que de l'argent public soit utilisé pour l'enrichissement d'investisseurs au détriment du bien-être des enfants.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales a souhaité enquêter sur les différents modes de contrôle, les moyens mis à disposition des pouvoirs publics et sur l'efficacité de ce contrôle.
Si, dans le cadre de leur mission, les rapporteurs se sont limités à l'effectivité du contrôle des crèches, ils soulignent toutefois que l'amélioration de l'accueil ne pourra pas faire l'économie d'une amélioration concrète des conditions de travail des professionnels de la petite enfance et d'actions en vue du renforcement des taux d'encadrement des enfants, ainsi que d'une révision du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants.
I. UN CONTRÔLE DES CRÈCHES EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES DISPARITÉS TERRITORIALES
|
Les Caisses d'allocations familiales (CAF) ï Contrôle financier et comptable relatif au respect des règles de financement de la branche famille ï Contrôle des aides à l'investissement des établissements |
La Protection maternelle et infantile (PMI) ï Autorisation des ouvertures des structures ï Contrôle du respect des normes bâtimentaires, de sécurité et des règles d'encadrement ï Accompagnement et conseil des équipes |
Les services de l'État ï Contrôles complémentaires à ceux du département ï Autorité subsidiaire du Préfet en cas de défaillance des contrôles du département ï Contrôles effectués au sein des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités |
1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet
Si les contrôles opérés par les CAF s'inscrivent dans une procédure nationale de contrôle répondant aux priorités fixées au niveau national, ceux-ci restent majoritairement perçus comme techniques et administratifs, ne prenant pas en compte les critères d'amélioration de la qualité de l'accueil.
Ainsi, des éléments pouvant permettre d'identifier des signaux faibles de risque sur la qualité comme l'analyse des postes de dépenses tels que l'achat de nourriture ou de couches ont récemment été intégrés aux procédures de contrôle.
En 2023, les CAF ont contrôlé 2 241 établissements sur les 13 028 financés par la prestation de service unique (PSU), soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, 167 équivalents temps plein (ETP) moyen annuel sont mobilisés par les CAF pour réaliser les contrôles des 13 000 établissements d'accueil collectif financés par la PSU sur le territoire.
Nombre de contrôles d'établissements
d'accueil du jeune enfant (EAJE) bénéficiaires de la PSU au titre
du fonctionnement
selon la nature du gestionnaire de 2021 à
2023
Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnaf
þ Revoir à la hausse, d'ici à la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG), les effectifs dédiés au contrôle au sein des CAF afin que les nouvelles compétences concernant les établissements financés indirectement par la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) ne se traduisent pas par une baisse de la fréquence et de la qualité des contrôles.
2. Le contrôle du respect des normes par les services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes disparités entre les départements
L'absence de données au niveau national est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI en matière de contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.
Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance ont pu exprimer leur souhait de voir la fréquence des contrôles de PMI renforcée. En effet, ces contrôles seraient « trop rares, voire inexistants »1(*).
Dans la continuité du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, les rapporteurs pointent l'absence au sein de nombreuses PMI de personnel dédié au suivi et au contrôle des EAJE2(*).
Évolution des ETP en PMI entre 2010 et 2022
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les chiffres de l'enquête « Aide sociale » de la Drees - chiffres hors Mayotte
3. Malgré leur expertise et la nécessité de leur action, les services de l'État, faute de moyens, ne participent que faiblement au contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.
Malgré tout l'engagement des agents dans les services déconcentrés, force est de constater que les agents de l'État ne disposent pas des moyens nécessaires à l'établissement de leurs missions de contrôle.
B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER
1. Une gouvernance complexe et une coordination entre les acteurs déficiente malgré de récentes améliorations
En l'absence de stratégie nationale globale ou d'outils de supervision, il est presque impossible d'établir un contrôle efficace et homogène sur l'ensemble du territoire.
a) Au niveau national, une politique sans chef de file ni priorités clairement identifiées
ý Une politique de la petite enfance qui souffre d'un défaut de pilotage, d'une gouvernance trop complexe et de la succession de ministres depuis plusieurs années ;
ý Les pouvoirs publics ne disposent pas d'une vision exhaustive des contrôles réalisés par chaque administration compétente et par les départements, en l'absence de système de remontée d'information dédié.
b) Au niveau départemental, de récentes améliorations permettent un meilleur dialogue entre les instances de contrôle
þ Mise en place par la loi plein emploi d'un plan annuel d'inspection et de contrôle au niveau départemental, qui rassemble autour de la table l'ensemble des acteurs pour coordonner des objectifs annuels d'inspection et de contrôle ;
þ Renforcer la coordination des actions et la mobilisation des moyens via les comités départementaux des services aux familles, afin de devenir une véritable instance de coordination de l'action des pouvoirs publics.
2. L'indispensable renforcement du pilotage national et des échanges entre autorités de contrôle
Constats
ý Il n'existe aucun système de coordination et d'échanges d'informations formalisé entre les services de différents départements sur la mission des contrôles des crèches, ce qui constitue une faiblesse majeure du système de contrôle des acteurs supra-départementaux ;
ý Absence de protocoles de communication et d'échanges d'informations entre les administrations compétentes et les CAF dans le cadre des contrôles d'acteurs supra-départementaux.
Recommandations
þ Mettre en place une plateforme nationale sécurisée d'échanges d'informations entre les différents services de PMI, afin d'identifier plus facilement ce qui relève d'un dysfonctionnement local de ce qui constitue une vraie volonté de réduire la qualité d'accueil ;
þ Renforcer les contrôles coordonnés entre les CAF en direction des acteurs supra-départementaux et mobiliser les administrations compétentes (DGFiP, Urssaf...) via des protocoles d'échange d'informations.
II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL DES ENFANTS
A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
1. Fixer des règles claires et opposables pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique et sur tout le territoire
Constats
ý Un excès de normes et une complexité préjudiciable aux relations entre les contrôleurs et les professionnels au sein des structures ;
ý Une interprétation des règles très variables entre les départements, voire en fonction des contrôleurs, qui entraîne parfois des impacts opérationnels importants pour les gestionnaires.
Recommandations
þ Fixer une grille nationale de contrôle composée d'éléments objectivables applicables sur l'ensemble du territoire ;
þ Créer des fiches d'auto-évaluation précises et homogènes pour les professionnels permettant d'assurer de façon continue le respect de la réglementation et de préparer les contrôles.
2. Permettre aux services départementaux de la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des équipes
a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers pour effectuer le contrôle du respect du référentiel bâtimentaire et participer à la nouvelle obligation d'évaluation quinquennale des établissements
Constats
ý Des services départementaux de PMI débordés face à la multiplication de leurs missions et la baisse de leurs effectifs ;
ý Une expertise des professionnels de PMI bien plus utile pour aider les équipes à améliorer leurs pratiques que pour mesurer la hauteur des poignées de porte.
Recommandations
þ Favoriser toutes les mesures permettant de recentrer les services de PMI sur l'accompagnement et l'évaluation de la qualité de l'accueil ;
þ Mettre en en place le cadre juridique permettant au président du conseil départemental de déléguer à des organismes tiers certifiés le contrôle de la conformité, notamment au référentiel bâtimentaire, d'un établissement.
Ces dispositions ne visent pas à attribuer un quelconque pouvoir de sanction ou d'autorisation à ces organismes tiers.
b) Mieux former les agents chargés du contrôle afin de renforcer la qualité de l'action de la PMI
Constats
ý Une évolution constante de la réglementation et des connaissances dans le domaine de l'accueil du jeune enfant, qui appelle une actualisation continue des compétences des agents chargés du contrôle et de l'évaluation ;
ý Des contrôles réalisés par des professionnels aux profils très différents en fonction de l'organisation propre à chaque département.
Recommandations
þ Élaborer une base commune de formation au contrôle et à l'évaluation de la qualité ;
þ Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle des établissements d'accueil, afin d'améliorer la qualité du contrôle effectué et de sécuriser l'action des agents.
Il faut encourager une distinction claire entre les agents chargés des contrôles, notamment des contrôles inopinés ou à la suite de signalements, et les agents en charge de l'accompagnement des équipes et de l'évaluation de la qualité de l'accueil.
3. Renforcer les outils à disposition des autorités publiques pour améliorer l'effectivité du contrôle tant des établissements que des groupes
a) Poursuivre le contrôle des grands groupes privés et, le cas échéant, en tirer les conséquences en matière d'encadrement
Constat
ý Éviter les dérives liées à la maximisation des profits et à la recherche de réduction des charges de fonctionnement par les groupes privés de crèches.
Recommandations
þ Poursuivre le contrôle des grands groupes à la suite du premier contrôle du groupe La Maison bleue par l'Igas et soutenir la mise en place par la Cnaf d'une procédure de contrôle des groupes avec des sanctions qui pourront s'appliquer à l'ensemble de leurs établissements ;
þ Déterminer, en fonction des conclusions de ces travaux, s'il apparaît pertinent d'encadrer plus fortement les prises de participation de certains fonds d'investissement et fonds de dette au capital des entreprises de crèches.
b) Perfectionner l'arsenal juridique à disposition des autorités publiques pour effectuer le contrôle des établissements et des groupes
Constats
ý Au regard de l'ampleur des financements publics dans le secteur, la réponse des pouvoirs publics n'est pas encore à la hauteur.
ý Impossibilité pour les juridictions financières de s'assurer que les financements publics servent exclusivement à l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les établissements.
Recommandations
þ Donner à la Cour des comptes, dans le code des juridictions financières, les moyens de contrôler les groupes privés de crèche afin de renforcer l'efficience de la dépense publique ;
þ Habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations contractuelles afin de protéger davantage les familles ;
þ Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de pouvoir qualifier directement de frauduleux les comportements constatés, afin de renforcer le caractère dissuasif des contrôles et d'apporter un levier supplémentaire d'action pour les contrôleurs.
B. RENFORCER LE CONTRÔLE ET LA FORMATION DES PROFESSIONNELS AU CONTACT DES ENFANTS POUR MIEUX REPÉRER LES SITUATIONS DYSFONCTIONNELLES
1. Face à un roulement de personnel très important et à des difficultés de recrutement majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit être renforcé
Constats
ý La baisse des exigences de recrutement au détriment de la qualité de l'encadrement des enfants ne saurait être une réponse aux difficultés du secteur ;
ý Une fréquence de renouvellement des effectifs, particulièrement forte dans les grandes agglomérations, conjuguées à difficultés de recrutements qui peut permettre à des professionnels défaillants de passer de structure en structure.
Recommandations
þ Généraliser, sans attendre l'échéance du 1er janvier 2026, la vérification des antécédents judiciaires via la plateforme honorabilite.social.gouv.fr ;
þ Assurer une qualité de recrutement et participer à la reconnaissance de l'expertise des professionnels de la petite enfance via la mise en place d'une carte professionnelle à titre expérimental.
2. L'amélioration du repérage des situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des formations des professionnels de la petite enfance
Constat
ý Améliorer les modalités de réaction des institutions ne suffit pas et il est nécessaire d'apporter aussi des solutions préventives.
Recommandations
þ Former davantage aux repérages des situations de maltraitance, aux procédures de signalement et à la notion de bientraitance l'ensemble des professionnels exerçant au contact des jeunes enfants ;
þ Prévoir une formation spécifique pour les responsables de structure à la fois au repérage des situations dysfonctionnelles et à la gestion et à l'accompagnement des équipes.
C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE L'ÉVALUATION AUPRÈS DE TOUS LES ACTEURS
1. Renforcer la transparence des établissements et des résultats des contrôles
Constats
ý La pénurie de places en crèche et la complexité du système d'accueil collectif issu d'une juxtaposition de dispositifs ne permettent pas aux parents de décider en pleine connaissance de cause de l'endroit où leur enfant va être accueilli ;
ý Un besoin de transparence et d'une relation de confiance entre les parents et les professionnels chargés d'accueillir leurs enfants.
Recommandations
þ Publier les résultats des contrôles des établissements sur le modèle de ceux disponibles sur le site Alim'Confiance pour les contrôles vétérinaires.
Les rapporteurs rappellent que plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne ou le Québec, publient déjà l'intégralité des résultats et des rapports de l'autorité de contrôle.
2. Renforcer le dispositif de signalement dans le secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes
Constats
ý D'importantes disparités entre les départements concernant les modalités de suivi des suites données aux signalements ;
ý Une absence de données aux niveaux départemental et national concernant les événements indésirables graves dans les structures, qui limite fortement le pilotage de l'action publique et le repérage des dysfonctionnements.
Recommandations
þ Mettre en place un système obligatoire de remontée et de suivi des signalements et des événements indésirables graves (EIG) sur le modèle de celui prévu pour les établissements médico sociaux ;
þ Accompagner l'obligation de signalement d'une obligation d'information des suites données aux alertes par les autorités de contrôles ;
þ Renforcer le temps d'analyse des pratiques et des EIG par les équipes via l'augmentation du nombre de journées pédagogiques pris en charge par les CAF.
3. Faire des familles des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des professionnels de la petite enfance
Constats
ý Des parents trop souvent peu au fait des règles de fonctionnement des crèches et des conditions de travail des professionnels de la petite enfance ;
ý Un besoin pour les parents de disposer d'informations concernant la réalité de la vie de leur enfant au sein de la crèche ;
ý Une prise en compte parfois limitée de la part des pouvoirs publics des inquiétudes et des attentes spécifiques des familles.
Recommandations
þ Associer les parents à la vie quotidienne des structures via des événements formels (réunion de rentrée...) et informels (café, moments de convivialité...) ;
þ Sensibiliser davantage les parents à la détection des signaux de maltraitance et améliorer l'accompagnement dans la parentalité ;
þ Inclure dans les financements publics des établissements une composante relative à la participation des parents au projet éducatif de la structure.
Liste des principales recommandations
Proposition n° 2 : Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques.
Proposition n° 4 : Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes.
Proposition n° 5 : Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés.
Proposition n° 6 : Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique.
Proposition n° 8 : Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS.
Proposition n° 9 : Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.
Proposition n° 10 : Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles.
Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.
Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG), à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.
Réunie le mercredi 19 mars 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté à l'unanimité le rapport et les recommandations présentés par Mme Laurence Muller-Bronn, M. Olivier Henno et Mme Émilienne Poumirol, rapporteurs, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Proposition n° 1 : Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements.
Proposition n° 2 : Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques.
Proposition n° 3 : Renforcer les contrôles coordonnés entre CAF ciblant des gestionnaires de structures implantés à une échelle supra-départementale.
Proposition n° 4 : Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes.
Proposition n° 5 : Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés.
Proposition n° 6 : Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique.
Proposition n° 7 : Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle au sein des PMI par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de renforcer les compétences et la formation continue des professionnels.
Proposition n° 8 : Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS.
Proposition n° 9 : Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.
Proposition n° 10 : Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles.
Proposition n° 11 : Créer une carte de qualification professionnelle permettant de certifier les qualifications des employés sur le modèle de la carte prévue à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
Proposition n° 12 : Revoir le contenu des formations des professionnels de la petite enfance via la mise en place de certifications obligatoires visant à améliorer l'identification de toutes les situations de maltraitance, la connaissance des procédures de signalement et les connaissances relatives au développement et au bien-être de l'enfant.
Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.
Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG) à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.
Proposition n° 15 : Soutenir les actions visant à renforcer la participation des parents au fonctionnement des établissements en incluant dans les financements publics une composante relative à la participation des parents au projet pédagogique de la structure.
AVANT-PROPOS
Face à l'onde de choc provoquée par les récents ouvrages sur la situation dans les crèches, la commission a souhaité enquêter sur l'efficacité du contrôle des établissements. À l'issue de ses travaux, elle pointe des faiblesses dans l'exercice effectif de ces contrôles et estime nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle réellement au service de l'amélioration de la qualité de l'accueil sur l'ensemble du territoire.
Elle formule pour cela 15 propositions.
*
* *
Depuis plusieurs années, la multiplication des scandales au sein des structures d'accueil collectif des jeunes enfants oblige les pouvoirs publics à agir. Il n'est pas acceptable que des dysfonctionnements puissent perdurer avant que des sanctions ne soient prises et que de l'argent public soit utilisé pour l'enrichissement d'investisseurs au détriment du bien-être des enfants.
C'est pourquoi, sans céder aux sirènes du sensationnel, la commission des affaires sociales a souhaité enquêter sur les différents modes de contrôle, les moyens mis à disposition des pouvoirs publics et sur l'efficacité de ce contrôle.
Après trois mois de travaux, plus d'une trentaine d'auditions et un déplacement sur le terrain, les rapporteurs font le constat d'un sous-dimensionnement chronique des moyens humains et financiers alloués au contrôle des crèches et appellent à la mise en place d'un contrôle au service de la qualité de l'accueil, d'un renforcement de l'évaluation et de l'accompagnement des professionnels et à une prise de conscience collective et à tous les échelons de l'impératif du respect du bien-être de l'enfant.
Les rapporteurs souhaitent souligner que le dysfonctionnement d'un acteur peut jeter l'opprobre sur la grande majorité des établissements dans lesquels les enfants sont accueillis avec bienveillance et dans un environnement de qualité.
Si dans le cadre de leur mission, les rapporteurs ont étudié l'effectivité du contrôle des crèches, ils soulignent toutefois que l'amélioration de l'accueil de nos enfants passe également par l'amélioration concrète de la qualité de vie au travail des professionnels et par des actions en vue du renforcement des taux d'encadrement des enfants.
L'amélioration de la qualité de l'accueil ne pourra pas non plus faire l'économie d'une refonte globale du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants et de la prestation de service unique qui entraîne une surcharge administrative excessive pour les professionnels.
I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS
A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES DISPARITÉS TERRITORIALES
Les contrôles effectués sur les établissements d'accueil du jeune enfant relèvent principalement de trois acteurs qui exercent tous leurs contrôles selon des fréquences, des champs d'action et des pouvoirs divers :
- les caisses d'allocation familiales (CAF) assurent avant tout un contrôle financier relatif au respect des règles de financement de la prestation de service unique ;
- les services de la protection maternelle et infantile (PMI) au sein des départements ont pour mission d'assurer le contrôle du respect des normes bâtimentaires, de sécurité ou encore des règles d'encadrement ;
- les services de l'État essentiellement au sein des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit leur mode de financement
a) Le champ du contrôle effectué par les CAF
Les contrôles effectués par les CAF s'organisent autour de trois axes principaux :
- le respect des règles relatives aux conditions de versement de la prestation de service unique (PSU) : règles de facturation, traitement équitable des familles, enregistrement des heures de présence ;
- l'analyse des charges des établissements, notamment celles déclarées dans les comptes de résultats, incluant les frais de siège, de gestion intragroupe et d'impôt sur les sociétés ;
- le respect des engagements contractuels liés à la PSU comme le traitement des avoirs et des remboursements.
Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont pu constater que les contrôles des CAF sont très majoritairement perçus comme extrêmement techniques et administratifs par les professionnels. Ainsi, l'association des collectifs enfants parents professionnels (Acepp) entendue en audition a regretté des contrôles qui ne sont jamais vécus par les professionnels comme « en lien avec la qualité de l'accueil » et avec des exigences administratives au-delà de ce qu'un gestionnaire associatif peut mobiliser, ce qui engendre une charge « technique et mentale » sur des personnels de direction « débordés »3(*).
Pour remédier à cela, les contrôles effectués par les CAF ont été étendus à des éléments pouvant permettre d'analyser un niveau de qualité du service au sein de l'établissement comme l'analyse des postes de dépenses tels que l'achat de nourriture, de couches ou le niveau de recours à l'intérim. Lors de leur déplacement dans le Maine-et-Loire, les rapporteurs ont pu bénéficier d'une présentation du contrôle des CAF structuré en trois étapes. En raison du grand nombre de documents administratifs et comptables demandés par les contrôleurs en vue de la réalisation de leur contrôle, les CAF ne peuvent procéder à des contrôles inopinés. Ainsi, le contrôle sur place est systématiquement précédé d'une phase d'échange d'informations. La phase de contrôle sur place permet à la fois de dialoguer avec les équipes, d'étudier les « dossiers familles » comprenant les données d'activités de chaque enfant (heures réalisées, facturées...), ainsi que de pouvoir opérer une appréciation visuelle globale de la structure. Les éléments identifiés comme devant être corrigés ou améliorés lors des contrôles sur place font l'objet ensuite d'un accompagnement par les équipes de la CAF auprès du gestionnaire pour l'aider à améliorer ses pratiques et son organisation. Le cas échéant, le contrôleur peut transmettre à la PMI des points de vigilance concernant certains éléments relevés lors de la visite.
De fait, comme a pu le noter un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la petite enfance, les contrôles opérés par les CAF sont reconnus comme étant structurés et s'inscrivent dans une procédure nationale de contrôle répondant aux priorités fixées au niveau national4(*).
En 2023, les CAF ont contrôlé 2 241 établissements sur les 13 028 financés par la PSU, soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, à la suite de ces contrôles, 28 millions d'euros de sommes indues ont été récupérées. Interrogée par les rapporteurs sur la fréquence de contrôle, la Caisse nationale des allocations familiale a indiqué qu'en moyenne, chaque établissement fait l'objet d'un contrôle sur place tous les cinq ans. Ces contrôles étant établis conformément à un plan de contrôle construit sur la base d'une analyse de risques, certains établissements sont plus régulièrement contrôlés que d'autres.
Ainsi, selon des éléments transmis par la Cnaf, en 2023, 136 contrôles concernaient le groupe People&Baby et 101 contrôles le groupe La Maison bleue (soit respectivement 28 % et 20 % des contrôles des établissements d'accueil du jeune enfant - EAJE - lucratifs), alors que ces groupes représentent respectivement 12,2 % et 12 % des EAJE lucratifs. Ces éléments illustrent le ciblage renforcé de certains acteurs qui, ces dernières années, ont eu « entre 2 et 3 fois plus de probabilité d'être contrôlés par les CAF »5(*).
Évolution du secteur
Les dépenses publiques pour l'accueil des 0-3 ans se sont élevées à 16,7 milliards d'euros en 2023 : 7,6 milliards d'euros pour les EAJE, 5,5 milliards pour les accueils individuels, 2 milliards de dépenses fiscales, 1,1 milliard de financement des congés parentaux et 500 millions pour la scolarisation des enfants de 2 ans6(*).
L'accueil collectif représentait 18 % des modes d'accueil en 2021, une part qui a doublé depuis 2002 et désormais similaire à celle des assistantes maternelles (20 % en 2021).
La hausse du nombre de places en EAJE en 2022 (+ 15 900 places en « création nette », soit + 3,2 %) est quasi intégralement portée par les micro-crèches dites « Paje »7(*). En effet, de 2010 à 2020, la part des micro-crèches dans la création de places nettes en EAJE est de près de 50 %. Sur la période 2015-2020, les micro-crèches sont même à l'origine de 70 % de la création de places nettes en EAJE.
Concernant les établissements financés indirectement par le versement aux familles du complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (micro-crèches « Paje »), ils sont quasi intégralement gérés par des entreprises privées à but lucratif (92 % des 6 145 établissements). Les autres établissements sont gérés par le secteur associatif.
Concernant les établissements financés directement par la prestation de service unique, les 12 815 crèches offraient 420 400 places en 2023, soit 9 000 de plus qu'en 2018. Ces établissements restent principalement gérés par les collectivités territoriales (55 %), puis par des associations (environ 26 %) et des entreprises privées (16 %).
Ces évolutions masquent des différences selon les catégories : une diminution des places offertes en crèche familiale, un développement concernant les micro-crèches PSU (+ 10,4 %) et une stabilité en EAJE multi-accueil.
Si le nombre de crèches gérées par des associations est stable (3 410 en 2023), le secteur privé connaît une hausse importante (de 1 510 en 2019 à 1 943 en 2023, soit + 30 %) notamment due à l'augmentation du nombre de délégations de service public. En effet, lorsqu'une collectivité territoriale délègue la gestion de ses équipements, c'est le statut du délégataire qui est pris en compte et non celui de la personne morale commanditaire, et ce, même si les places afférentes continuent probablement de dépendre des commissions d'attribution des collectivités ayant opté pour cette organisation.
Nombre de
contrôles d'EAJE bénéficiaires de la PSU au titre du
fonctionnement
selon la nature du gestionnaire de 2021 à
2023
Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnaf
Au total, 167 équivalents temps plein moyen annuel sont mobilisés par les CAF pour réaliser les contrôles des 13 000 établissements8(*) d'accueil collectif financés par la PSU sur le territoire.
Par ailleurs, les rapporteurs ont interrogé la Cnaf sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer le contrôle des aides à l'investissement particulièrement pointées du doigt dans l'ouvrage de Victor Castanet intitulé Les Ogres. La Cnaf a ainsi précisé que le « solde de la subvention n'est versé qu'après une visite de conformité de la structure effectuée par les services ». Ce contrôle apparaît encore trop faible selon plusieurs acteurs entendus et les rapporteurs estiment nécessaire que la branche famille les renforce davantage en collaboration avec les PMI pour déterminer la réalité et la qualité des travaux ainsi subventionnés au regard du référentiel bâtimentaire notamment.
b) Un contrôle désormais étendu aux établissements non financés par la prestation de service unique, ainsi qu'aux groupes dans leur ensemble
Jusqu'au 1er janvier 2025, le contrôle des CAF ne pouvait porter que sur les établissements qui bénéficiaient directement de leurs financements via la prestation de service unique. Les services de contrôle étaient dans l'incapacité de contrôler les établissements qui étaient financés indirectement par le CMG dit « structure ». Cette impossibilité de procéder à des contrôles financiers sur ces établissements, hors subvention à l'installation, était particulièrement dommageable au regard de l'augmentation de ces établissements depuis une dizaine d'années et alors même que l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ou la Cour des comptes dans leurs récents rapports ont relevé de nombreuses pratiques anormales comme la facturation d'heures au-delà de celles effectuées ou l'obligation de souscrire des contrats horaires supérieurs aux besoins réels des familles. Ainsi, en 2023, 6 145 établissements micro-crèche « Paje » échappaient aux contrôles des agents des CAF. Selon le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale 2023, la branche famille consacrait, en 2021, 534 millions d'euros au soutien au fonctionnement des micro-crèches, directement (via la prestation de service unique) ou indirectement (via la prestation d'accueil du jeune enfant).
L'article L. 2324-2-3 du code de la santé publique, créé par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, étend les compétences des CAF aux établissements accueillant des enfants dont les parents bénéficient du complément libre choix de mode de garde dit « structure » au sein de la Paje. Cette évolution du champ du contrôle permet ainsi d'apporter notamment une réponse au risque « sur les versements d'indus du CMG structure » relevé par l'Igas9(*). Sur ce dernier point, la procédure de recouvrement a été récemment renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 202510(*).
Dans cette perspective, les CAF de Gironde et du Nord ont mis en place une expérimentation de procédures de contrôle ad hoc de ces établissements en 2024. Selon le directeur général de la Cnaf entendu en audition, ces procédures ont vocation à être généralisées dès lors que les différents points d'application de la réglementation seront stabilisés. Les rapporteurs soulignent toutefois le fait que ces nouvelles compétences vont entraîner une charge de travail supplémentaire importante pour les CAF. Ainsi, dans le Maine-et-Loire, 119 micro-crèches « Paje » devront désormais également être contrôlées. Dans les départements d'outre-mer où la structuration de l'offre d'accueil est très favorable au micro-crèches, notamment « Paje » (jusqu'à 50,5 % de l'offre de crèche à La Réunion contre 20,8 % sur le territoire hexagonal)11(*), cet élargissement du champ du contrôle constituera un défi majeur. Au regard de ces nouvelles compétences, les rapporteurs appellent la Cnaf à revoir à la hausse, d'ici à la prochaine COG, les effectifs dédiés afin que ces nouvelles attributions soient pleinement effectives et ne se traduisent pas par une baisse de la fréquence et de la qualité des contrôles.
2. Le contrôle du respect des normes par les services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes disparités entre les départements
En application de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, le président du conseil départemental détient en premier lieu la compétence du contrôle des conditions d'accueil. Il contrôle l'application des dispositions du code de la santé publique applicables aux EAJE et notamment le fait que ces établissements « ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ». Il dispose pour cela du personnel des services de la PMI pour diligenter les contrôles.
Ces contrôles sont répartis en deux grandes catégories :
- les contrôles réguliers qui s'intègrent dans un plan de suivi départemental. Il peut s'agir de contrôles programmés pour lesquels la structure est informée en amont, ou de contrôles inopinés ;
- les contrôle à la suite de la réception d'informations ou de signalements relatifs à un risque de nature à compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants accueillis.
S'ajoute à ces contrôles, la mission d'agrément lors de l'ouverture ou de la transformation d'un établissement, ainsi qu'au moment du renouvellement de l'autorisation désormais prévue pour une durée de 15 ans.
La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 renforce les pouvoirs du président du conseil département qui peut désormais prononcer la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités d'accueil12(*) et, le cas échéant, désigner un administrateur provisoire chargé de mettre en oeuvre de manière urgente les actions demandées. Des astreintes financières d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et des sanctions plafonnées à 5 % du chiffre d'affaires peuvent désormais également être prononcées. Ces sanctions rapprochent davantage le régime de contrôle de celui applicable aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS). Toutefois, ce régime de sanction n'est pleinement applicable que depuis le 6 décembre 2024 à la suite de la parution du décret d'application13(*). Il est donc encore trop tôt pour établir un premier bilan de ces nouvelles dispositions et compétences.
a) L'absence de données au niveau national est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI en matière de contrôle des EAJE
Alors même que les services de la protection maternelle et infantile constituent le premier acteur du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant, les rapporteurs n'ont pu que constater l'impossibilité de pouvoir disposer, au niveau national, du nombre d'agents mobilisés pour les contrôles au sein des départements, ainsi que du nombre de contrôles effectués par ces agents.
Toutefois, l'enquête Aide sociale menée par la Drees permet de tirer des premiers enseignements concernant les effectifs des PMI dans leur globalité. Alors que les PMI voient leurs missions s'accroître, les rapporteurs s'inquiètent de la chute continue de leurs effectifs depuis plus de dix ans. Pour assurer l'ensemble des missions dévolues aux PMI sur l'ensemble du territoire, la Drees recensait 10 600 emplois en équivalent temps plein (ETP) en 2022 soit 390 de moins qu'en 2010.
Surtout cette évolution cache de nombreuses disparités. Ainsi si la Seine-Saint-Denis a perdu 367 ETP sur la période, le Bas-Rhin ou le Nord en ont gagné respectivement 53 et 38. Ces différences au niveau des effectifs se traduit nécessairement par une grande hétérogénéité au niveau des contrôles effectués dans les départements. Ces disparités sont particulièrement ressenties par les acteurs présents sur plusieurs départements qu'ils soient associatifs14(*), publics ou privés lucratifs.
b) De manière générale, des contrôles ressentis comme trop peu nombreux
Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance ont pu exprimer en audition leur souhait de voir la fréquence des contrôles de PMI augmentée. Ainsi, selon certains, ces contrôles seraient « trop rares, voire inexistants15(*) ». Selon une enquête menée auprès de plus de 5000 directeurs d'établissements, 48 % d'entre eux indiquent souhaiter des contrôles plus réguliers16(*). Lors de son audition par les rapporteurs, l'union nationale des associations familiales (Unaf) a également pu regretter le trop faible nombre de contrôles des structures et, lorsque ces contrôles étaient effectués, leur absence de prise en compte de la qualité de l'accueil. Ces remontés du terrain confirment le constat établi par l'Igas qui indiquait que « le nombre de contrôle PMI reste très insuffisant, avec en moyenne un contrôle tous les deux ans pour les micro-crèches et un tous les cinq ans pour les autres ». Surtout, le rapport de l'Igas alertait sur l'absence au sein de nombreuses PMI de personnel dédié au suivi et au contrôle des EAJE17(*) et sur les disparités territoriales qui en découlaient.
Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, il existe 720 établissements d'accueil du jeune enfant. A minima, chaque établissement est vu au moins une fois par an et 12 professionnels sont mobilisés pour effectuer ces contrôles, soit environ 60 établissements par agent. En Alsace, 6 agents se consacrent au contrôle des 540 structures recensées sur le territoire. Avec 130 structures par agent, il est extrêmement difficile de réaliser un suivi exhaustif des structures et les agents sont quasiment exclusivement mobilisés par les autorisations d'ouverture des établissements et les contrôles en réaction à des alertes reçues. Enfin, en Meurthe-et-Moselle, les 165 établissements du département sont contrôlés tous les 15 mois environ. Les professionnels mobilisés pour ces contrôles réunissent 7 puéricultrices cadres de santé et 12 professionnels administratifs non affectés à temps plein sur la mission modes d'accueil.
3. Malgré la nécessité de leur action, les services de l'État, faute de moyens, ne participent que faiblement au contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant
L'article L. 2324-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi pour le plein emploi, précise que le représentant de l'État dans le département dispose des mêmes pouvoirs de contrôle que le président du conseil départemental et peut, à tout moment, diligenter des contrôles. Il précise expressément que le préfet peut disposer, en plus des personnels sous son autorité, du personnel des agences régionales de santé (ARS) pour effectuer ces missions. En effet, une incertitude perdurait auparavant sur les compétences des agents des ARS dans le contrôle des EAJE. Toutefois, cette disposition semble encore trop peu mise en oeuvre et la mission n'a pas eu connaissance de contrôles effectués par les agences régionales de santé dans ce cadre.
Les agents de plusieurs administrations de l'État, en application de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, exercent également des contrôles sur les établissements d'accueil du jeune enfant. Force est de constater pourtant que les services de l'État ne sont que peu ou pas identifiés comme tels par les professionnels de la petite enfance. Ce contrôle est principalement exercé par les agents de l'État au sein des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions de la protection des populations (DPP).
Les rapporteurs regrettent le manque de moyens et la quasi-absence des services de l'État sur le terrain. Ils ont pu constater que malgré toute la volonté des agents dans les services déconcentrés, ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires à l'établissement de leurs missions. Comme le relevait l'Igas, « les moyens humains consacrés à la fonction d'inspection contrôle dans les services déconcentrés pour l'ensemble des Dreets et DDETS s'élevaient à un total de 55,6 ETPT sur l'ensemble du territoire au 31/12/2021, en diminution de 45,5 % en trois ans »18(*).
Sollicitées par les rapporteurs, les différentes administrations centrales en charge du contrôle, au premier rang desquelles la direction générale du travail, la direction générale de l'alimentation ou encore la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont fourni des éléments quant à la réalité de leur contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.
L'inspection du travail
Chargés du contrôle de l'application du code du travail dans sa globalité (santé, sécurité, application des conventions collectives, protection des droits des salariés...), les inspecteurs de la direction général du travail ne sont compétents que pour contrôler les établissements privés.
La direction générale du travail (DGT) a confirmé qu'au regard du nombre d'emplois et des caractéristiques du secteur, ce dernier ne constitue pas un champ d'action ou une priorité spécifique de l'action de contrôle des inspecteurs. Toutefois, les établissements privés peuvent être contrôlés au même titre que n'importe quelle entreprise. La DGT a ainsi pu transmettre à la mission le nombre d'actions réalisées par les inspecteurs sur les quatre dernières années. Les chiffres mettent en lumière une relative stabilité de ces contrôles autour de 420 établissements privés par an19(*).
Interrogée par les rapporteurs, la direction générale du travail n'a pas pu préciser les principaux cas de non-respect de la réglementation identifiés dans le cadre de ses inspections. Les rapporteurs insistent toutefois sur les conditions de travail dégradées des professionnels de la petite enfance. La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) indique ainsi que « ces métiers se caractérisent par de nombreuses situations à risques (postures contraignantes, port des enfants, chutes et glissades, stress, risques infectieux...), qui se traduisent par des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la fréquence ne cesse d'augmenter »20(*). La qualité de l'accueil dans les crèches passe également par un renforcement de la protection des professionnels.
Répartition des accidents de travail et des
effectifs salariés
par taille d'établissement d'accueil du
jeune enfant - 2021
Source : Caisse nationale d'assurance maladie, Synthèse risque professionnels et sinistralité des accidents du travail des entreprises relevant de la catégorie « Accueil du jeune enfant » (code NAF 8891A), 2021
La direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
La DGCCRF ne dispose d'aucune habilitation pour contrôler les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique, mais elle intervient dans le contrôle des établissements à plusieurs titres, notamment au regard du respect des règles du code de la consommation et du droit des contrats. Toutefois, ses agents ne sont pas compétents pour effectuer le contrôle des modalités de fixation des tarifs payés par les parents, qui reste du ressort des CAF.
Face à l'expansion rapide du secteur des micro-crèches « Paje » et de leur grande liberté tarifaire vis-à-vis des familles, la DGCCRF avait lancé une vaste enquête en 2021 au cours de laquelle 364 opérateurs avaient été contrôlés. Si cette enquête avait révélé un taux de non-conformité important (32 % des établissements contrôlés), aucune alerte majeure n'avait été relevée, ni d'anomalie susceptible d'entraîner des suites répressives. Dans la majorité des cas, il a semblé que les défauts d'information n'étaient pas intentionnels et relevaient « plutôt d'une méconnaissance de la part de opérateurs de leurs obligations en matière de protection économique du consommateur »21(*). Néanmoins, une vigilance particulière doit être portée sur les grands groupes qui bénéficient de services juridiques de qualité et pour lesquels l'excuse de « méconnaissance » des règles applicables ne peut objectivement pas être retenue.
Les rapporteurs seront particulièrement attentifs aux conclusions de la nouvelle enquête inscrite dans le programme national de la DGCCRF pour 2025 et portant sur l'ensemble des crèches. Ils notent avec intérêt que la DGCCRF est la seule administration à avoir mis en place un plan d'action spécifique concernant le contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.
Au regard de l'expertise des agents de la DGCRRF et de l'importance de l'impératif de protection des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les établissements d'accueil, les rapporteurs estiment nécessaire de renforcer leurs moyens d'action en vue d'étendre leur habilitation aux dispositions du code de la santé publique. Comme a pu le signaler la DGCCRF dans sa réponse au questionnaire, l'absence d'habilitation sur les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'information précontractuelles et contractuelles peut limiter les suites apportées aux contrôles, alors même que des manquements sont identifiés (cf. infra).
La direction générale de l'alimentation (DGAL)
Au sein des DDPP, les agents de la DGAL veillent à la qualité et la sécurité de l'alimentation et au respect de la réglementation sanitaire dans les établissements. Selon les chiffres transmis à la mission, seuls 125,83 ETP ont été mobilisés en 2024 pour les contrôles officiels sur l'ensemble de la restauration collective. Au sein des établissements de restauration collective, les crèches ne font pas l'objet d'une classification spécifique mais relèvent de la catégorie des « publics sensibles » au même titre que les Ehpad ou les établissements hospitaliers et font à ce titre l'objet d'une activité prioritaire22(*).
Le programme de contrôle établi sur la base d'une programmation nationale ne fait pas la distinction entre les crèches privées lucratives, publiques ou associatives mais seulement en fonction du type de cuisine (élaboration des repas sur place ou simple réchauffage). Les premiers font l'objet d'un suivi particulier en raison des risques plus élevés liés à la préparation des repas sur place. Les rapporteurs notent que ces contrôles, qui portent aussi bien sur les salariés (respect des règles d'hygiène) que sur les gestionnaires (conditions de fabrication, de conservation des aliments et notamment des biberons), sont réalisés suivant une grille nationale harmonisée d'utilisation obligatoire. Par ailleurs, les attendus des inspecteurs sont détaillés et rendus publics sur internet.
En 2023, 849 contrôles de crèche ont ainsi été diligentés par les services vétérinaires. Les résultats transmis par les services du ministère font état de 36,7 % des établissements en A, 55,4 % en B, 6,8 % en C, 1 % en D. Chacune de ces notes fait référence à un niveau de risque spécifique allant de « Très satisfaisant » à « À corriger de manière urgente ». Les établissements relevant des catégories C et D font l'objet de suites administratives, voire pénales, et d'une inspection de suivi de contrôle visant à s'assurer que les mesures adéquates ont été mises en place.
Les résultats des contrôles sanitaires ainsi menés sont disponibles sur le site Alim'Confiance comme c'est le cas pour l'ensemble des établissements contrôlés par les services vétérinaires23(*). Les rapporteurs soulignent tout l'intérêt de cette démarche au bénéfice de l'information des usagers et de l'amélioration de la qualité de l'accueil (cf. infra).
Source : Réponse de la DGAL au questionnaire transmis par les rapporteurs
La direction générale des finances publiques (DGFiP)
Comme ont pu le confirmer les services de la DGFiP, les entreprises du secteur de l'accueil du jeune enfant ne font pas l'objet d'une action spécifique de leur part et sont contrôlées au même titre que n'importe quelle entreprise. Toutefois, au regard de l'importance des financements publics dans les comptes de ces entreprises, la lutte contre la fraude fiscale doit être d'autant plus prioritaire. Sollicitée sur ces éléments par la mission, la DGFiP a indiqué aux rapporteurs que la part des sanctions dans les résultats financiers du contrôle des établissements du secteur s'établissait à 8 % sur la période 2021-2023, alors qu'elle s'élevait à 24 % pour l'ensemble des contrôles des entreprises.
Par ailleurs, 16 % des contrôles effectués sur le secteur ont abouti à des actions répressives, contre 30 % au niveau national. L'administration fiscale a également pu confirmer que sur la période 2021-2023, parmi les principaux rappels effectués lors des contrôles des entreprises du secteur aucun n'était « spécifiquement imputable à l'activité d'accueil du jeune enfant »24(*).
Le contrôle du crédit d'impôt famille (Cifam) à destination des entreprises
Le Cifam, prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI), vise à encourager les entreprises, imposées sur leur bénéfice réel, à engager des dépenses en faveur de la garde des enfants de moins de trois ans de leurs salariés pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Les dépenses ainsi engagées sont éligibles au crédit d'impôt au taux de 50 % dans la limite de 500 000 euros.
Les rapporteurs n'ont pas souhaité étudier dans le cadre de cette mission la pertinence de cette dépense fiscale mais se sont interrogés sur les moyens mis en oeuvre pour contrôler le recours au Cifam.
En réponse aux questions des rapporteurs, l'administration fiscale a indiqué assurer le contrôle des montants déclarés au titre du Cifam par les entreprises bénéficiaires « à travers l'analyse des dépenses éligibles ou de la nature de l'activité du déclarant à l'instar des autres crédits d'impôts accordés aux entreprises à l'occasion des contrôles sur pièces et sur place ». Ainsi, pour une dépense fiscale estimée en 2022 à 170 millions d'euros, les contrôles effectués par l'administration ont abouti à une trentaine de rectifications, chiffre stable sur les dernières années, pour un montant total de rectification estimé à un million d'euros en droit.
Toutefois, une attention particulière doit être portée sur les plateformes d'intermédiation de réservation de berceaux détenues majoritairement par les grands groupes de crèches. En effet, cette pratique peut contribuer, du fait de la rémunération de l'acte d'intermédiation, à augmenter de manière non raisonnable le prix des places des berceaux tout en faisant supporter ce surcoût par la collectivité publique via l'éligibilité de ces dépenses au Cifam25(*).
Dans le cadre des nouvelles compétences attribuées aux CAF et à la Cnaf pour contrôler l'ensemble des groupes de crèches, les rapporteurs regrettent qu'à ce jour aucune procédure normalisée de communication ne soit mise en place entre la Cnaf et les services fiscaux. Ils appellent à la mise en place de circuits d'échanges d'information formalisés entre les administrations concernées (cf. infra).
Au regard de la multiplicité des acteurs intervenant dans le contrôle des établissements, les rapporteurs estiment indispensable de renforcer la coordination des actions et la mobilisation des moyens. Les comités départementaux de service aux familles doivent dans ce cadre être renforcés au-delà des réunions annuelles prévues par la loi afin de devenir, le cas échéant dans un format restreint, une véritable instance de coordination de l'action des pouvoirs publics en matière de contrôle.
Proposition n° 1 : Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements.
3. Des dispositifs de contrôle interne trop dépendants de la seule volonté et capacité des acteurs
Depuis de nombreuses années déjà, l'ensemble des acteurs de la petite enfance s'engagent dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'accueil. Ces dernières années, concomitamment à la multiplication des scandales dans les établissements de santé, comme dans les Ehpad et les crèches, ces démarches se sont faites de plus en plus soutenues. Cette multiplication des labels et des certifications répond aussi bien au besoin d'afficher des signes de qualité adaptés aux attentes et aux inquiétudes des parents mais également à la nécessité de s'adapter à une évolution rapide des exigences réglementaires, ainsi qu'environnementales et sociétales.
La Cour des comptes précise dans son rapport d'évaluation sur la politique d'accueil du jeune enfant que les entreprises du secteur privé ont « davantage recours à la certification et à la labellisation ou à des enquêtes de satisfaction auprès des usagers, visant à promouvoir une qualité standardisée de l'accueil dans leurs établissements »26(*). Dans sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, la fédération française des entreprises de crèches (FFEC) a ainsi pu indiquer qu'il était obligatoire pour ses adhérents de disposer d'une procédure de contrôle permettant d'améliorer les pratiques professionnelles et la qualité de l'accueil.
En effet, toujours selon la Cour des comptes, les « démarches de contrôle conduites en interne sont moins formalisées dans le secteur public, qui s'appuie davantage sur le contrôle hiérarchique, la coordination territoriale et une culture de la transparence dans la remontée d'éventuels dysfonctionnements ».
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont pu constater que les procédures de contrôle interne comme le recours à la certification et l'audit étaient plus difficiles à mettre en place dans les structures associatives, les structures publiques ainsi que les plus petites entreprises, faute de moyens mais aussi de compétence dédiée. Les grands groupes de leur côté mobilisent de plus en plus de moyens pour mettre en oeuvre des processus poussés de supervision de leurs établissements. Ces éléments peuvent créer une sorte de « rupture » entre des gestionnaires pouvant afficher des certifications et des labels et les plus petites structures qui, sans que cela ne soit par principe synonyme d'une moindre qualité, ne peuvent mettre en place ces outils.
Ainsi, dès 2013, les représentants des Petits Chaperons rouges (LPCR) ont indiqué en audition que « 100 % de leurs crèches devaient démontrer 138 points de contrôles » de manière régulière allant souvent « au-delà des exigences réglementaires »27(*). L'entreprise a précisé avoir également développé un outil de supervision de ses établissements et de suivi de l'ensemble des audits des crèches du groupe.
Interrogés sur les procédures mises en place par People&Baby, notamment depuis le drame ayant entraîné la mort d'un enfant en 2022 et les scandales révélés par les récents ouvrages, les représentants du groupe ont indiqué tout mettre en oeuvre pour mettre fin au « système Durieux » du nom du fondateur et ancien président du groupe. Ainsi, le groupe a annoncé revoir l'ensemble de ses contrats auprès de ses fournisseurs et se doter de nouvelles procédures de contrôle interne avec pour objectif de disposer d'un véritable département d'audit interne au cours de l'année 2025.
Si les entreprises privées ont mis en place davantage de processus normalisés de certification et de supervision de leurs établissements, il est faux de penser que les gestionnaires publics ou associatifs ne participent pas à ce mouvement de démarche d'amélioration continue de la qualité. Figurent ainsi parmi les tout premiers processus de certification, deux référentiels Quali'Enfance (2010) puis Certi'Crèches (2011) créés en collaboration avec le groupe Afnor Certification à la demande respectivement de la Mutualité française et de la ville de Bordeaux. Ces deux référentiels étaient à l'origine spécifiquement mis en place pour les associations et les collectivités publiques.
Ces processus de certification imposent généralement la mise en place de contrôles internes qui doivent être conduits régulièrement pour conserver le label. Les entreprises sollicitées par la mission ont toutes indiqué avoir travaillé avec les autorités de contrôle, et en premier lieu les PMI et CAF, lors de l'élaboration de leurs référentiels. La certification joue ainsi un rôle structurant dans l'amélioration continue de la qualité. Elle apparaît comme complémentaire du rôle de contrôle des autorités auquel elle n'entend et ne doit pas se substituer.
La multiplication des labels et des certifications28(*) traduit donc une volonté d'afficher un niveau de qualité élevé. Toutefois, elle contribue également à rendre encore plus complexe et parfois illisible pour les parents la garantie de qualité du système au risque de provoquer « une perte de confiance généralisée qui fait douter de tout »29(*).
Ainsi les rapporteurs estiment nécessaire de prévoir l'intégration du référentiel de qualité de l'accueil des jeunes enfants réalisé sous la coordination de l'Igas dans les procédures de certification externe des établissements afin de poser l'indispensable cadre commun à l'ensemble des processus.
B. LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SOUFFRE TOUJOURS D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE ET D'UN MANQUE DE COORDINATION AUXQUELS IL CONVIENT DE REMÉDIER
Les autorités de contrôle agissent trop souvent encore en silos. Ainsi, la DGCS a identifié en 2023 seulement 13 contrôles conjoints entre les services de l'État et les conseils départementaux à la suite de 55 signalements.
La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 permet la mise en place de nouveaux outils en faveur de la coordination des actions. Elle clarifie la répartition des compétences en faisant du président du département l'autorité principale du contrôle et d'agrément et en attribuant au préfet un rôle d'autorité subsidiaire en cas, notamment, de non-intervention du département.
1. Une gouvernance complexe et une coordination entre les acteurs déficiente malgré de récentes améliorations
a) Au niveau national, une politique sans chef de file ni priorités clairement identifiées
La politique de la petite enfance souffre d'un défaut de pilotage et d'une gouvernance trop complexe. Les rapporteurs font leurs les conclusions de la Cour des comptes qui relevait « une douzaine d'organismes » intervenant dans la mise en oeuvre de la petite enfance avec « une multiplicité d'objectifs » ne faisant pas « l'objet d'arbitrages coordonnés au plan national alors même qu'ils peuvent être contradictoires ».
Les rapporteurs regrettent la succession de ministres depuis quelques années qui met à mal toute mise en place sur le long terme d'une véritable politique globale de la petite enfance et en particulier d'amélioration de la qualité de l'accueil dans les crèches.
Dans ce cadre, les rapporteurs s'interrogent sur la création d'un Haut-commissariat à l'enfance, qui semble avoir vocation à pallier l'absence d'un ministre de plein exercice chargé de l'enfance.
En particulier, ils s'inquiètent de l'adéquation entre l'ampleur des compétences qui lui sont attribuées30(*) et son rattachement au seul ministre en charge de l'enfance et non au Premier ministre. Ils estiment que la création d'une telle structure doit s'accompagner d'une réelle capacité d'agir et de disposer de moyens spécifiques au risque de ne constituer qu'une nouvelle instance venant complexifier davantage la gouvernance du secteur.
b) Au niveau départemental, de récentes améliorations qui permettent un meilleur dialogue entre les instances de contrôle
Lors de son enquête menée en 2022 auprès des conseils départementaux, la DGCS avait identifié que près de la moitié des 56 départements ayant répondu n'avaient pas de plan de contrôle annuel. L'actualisation de cette enquête au début de l'année 2024 auprès de 70 départements montre une forte augmentation avec 57 départements désormais dotés d'un plan de contrôle31(*).
Il faut dès lors se féliciter de la mise en place par la loi pour le plein emploi d'un plan annuel d'inspection et de contrôle au niveau départemental32(*) qui rassemble autour de la table l'ensemble des acteurs, afin de permettre aux autorités compétentes de se concerter et de se coordonner pour déterminer des objectifs annuels d'inspection et de contrôle. Le bilan de la mise en oeuvre du plan annuel d'inspection et de contrôle devra être présenté au comité départemental des services aux familles (CDSF).
Les évolutions apportées par la loi
pour le plein emploi
dans le champ du contrôle des
établissements d'accueil du jeune enfant
Le législateur a profondément fait évoluer le régime de l'inspection et du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre de l'article 18 de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, afin de le rapprocher de celui applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux :
• l'article L. 2324-1 du code de la santé publique met en place un avis favorable préalable de l'autorité organisatrice pour tout projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé et soumet l'ouverture d'un établissement public à l'autorisation du président du conseil départemental ;
• l'article L. 2324-1-1 prévoit que l'autorisation du président du conseil départemental est donnée pour 15 ans et précise la procédure en cas de changement de gestionnaire ;
• l'article L. 2324-2 clarifie la répartition des compétences entre le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département. Le président du conseil départemental contrôle les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement, et s'assurent que celles-ci ne présentent pas de « risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ». Il prévoit également la possibilité pour l'Igas et l'inspection générale des finances (IGF) d'étendre leur contrôle au fonctionnement des groupes dans leur ensemble et aux flux financiers entre les établissements et leur siège, et permet aux CAF de contrôler les micro-crèche « Paje » ;
• l'article L. 2324-2-2 prévoit l'élaboration d'un plan départemental de contrôle des modes d'accueil conjoint entre les différentes autorités de contrôle. Il prévoit également que les différents organes de contrôle pourront désormais se communiquer tous les documents ou informations obtenus dans le cadre de leurs missions ;
• l'article L. 2324-2-3 oblige les établissements et le groupe auquel ils appartiennent à transmettre chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales les documents de nature comptable et financière dont la liste doit être définie par décret ;
• l'article L. 2324-2-4 met en place une évaluation quinquennale des établissements sur le fondement des référentiels nationaux relatifs à la qualité d'accueil. L'application concrète de cette disposition pose question au regard des effectifs des PMI, sur les modalités de publication des résultats et sur l'impact sur l'autorisation en cas de bilan insuffisant de l'évaluation ;
• l'article L. 2324-3 révise l'échelle des sanctions applicables aux établissements en cas de mise en danger de la santé physique et mentale des enfants, qui peuvent aller jusqu'à la décision de suspension ou de fermeture de l'établissement en question par le président du conseil départemental ou le préfet. Auparavant seul le préfet pouvait prononcer la fermeture en urgence d'un établissement. Il prévoit également explicitement la réalisation d'un contrôle de suivi de la mise en oeuvre des injonctions. Enfin, il faut noter qu'à la différence du régime applicable dans le champ du médico-social33(*), aucun mécanisme automatique de transfert de l'autorisation à un autre gestionnaire en cas de sanction de fermeture n'est explicitement prévu. Cette absence de précision quant aux modalités du transfert de l'autorisation peut entraîner la fermeture de places sans solution de remplacement.
La plupart de ces dispositions sont entrées récemment en vigueur ou ne sont pas encore appliquées en raison de l'absence de publication des décrets nécessaires à leur application. Dès lors, il convient de ne pas bouleverser de nouveau le régime d'inspection et de contrôle des établissements d'accueil afin de permettre aux acteurs de s'approprier pleinement ces nouvelles dispositions.
En effet, jusqu'alors cette coordination ne relevait que de la volonté des acteurs sur le terrain. Ainsi, la Meurthe-et-Moselle avait mis en place en 2023, une cellule de coordination des contrôles des EAJE en présence de représentants de la CAF et de la DDETS, et des réunions de concertation en cas de dysfonctionnements importants. L'organisation mise en oeuvre dans le Maine-et-Loire constitue un modèle d'échange et de communication entre toutes les autorités de contrôle travaillant dans une logique partenariale. Ainsi, les pouvoirs publics (services de l'État, PMI et CAF) ont mis en place une plateforme commune recensant toutes les alertes, les comptes rendus, les plans de contrôle et les textes de référence de chacune des instances. Par ailleurs, sous l'égide du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, une réunion quadrimestrielle du CDSF restreint afin de partager les informations et d'échanger sur l'avancée des plans de contrôle de chacun. Les rapporteurs soulignent tout l'intérêt de ces démarches qui doivent avoir vocation à se diffuser sur l'ensemble du territoire au service de l'amélioration de la cohérence et de l'effectivité de l'action publique.
À ce titre, les rapporteurs souhaitent que les comités départementaux de service aux familles puissent être accompagnés dans la mise en place d'outils d'analyse de risque34(*) permettant d'établir un plan de contrôle objectif et non uniquement fondé sur le statut du gestionnaire ou une quelconque présomption de qualité certains établissements au détriment d'autres.
La loi pour le plein emploi a également autorisé le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l'État dans le département à se communiquer entre eux les informations ou documents en leur possession sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle. Il est également prévu que l'autorité organisatrice sur le territoire de laquelle se situe l'établissement contrôlé soit obligatoirement informée des décisions et des résultats des contrôles.
Ces dispositions instaurant le cadre de la coopération et de la coordination de l'action des autorités de contrôles, il s'agit désormais aux acteurs de s'en saisir afin de rendre ces nouveaux outils pleinement effectifs. S'il est encore trop tôt pour pouvoir tirer un bilan de ces nouvelles dispositions, certains points ont alerté les rapporteurs. Ainsi, les services de la direction générale de l'alimentation ont indiqué à la mission ne pas avoir eu de remontées d'une mobilisation de leurs agents au sein des départements pour l'élaboration de ces plans d'inspection et de contrôle.
L'organisation du contrôle et de la
supervision des crèches
Comparaisons internationales
Canada (Québec)
Au sein de la fédération du Canada, les provinces et territoires disposent de la compétence exclusive en matière de garde des jeunes enfants. La surveillance des établissements d'accueil est donc réglementée à l'échelon des provinces et des territoires au moyen d'inspections pour la délivrance des permis et à intervalles réguliers (de façon annuelle ou semestrielle le plus souvent).
Au Québec, les inspections sont menées par un corps d'inspecteurs du ministère de la famille. Des fiches d'auto-inspection contenant l'ensemble des éléments faisant l'objet du contrôle sont mises à disposition des établissements afin d'évaluer le niveau de conformité de l'établissement de façon continue et/ou en amont de la visite des inspecteurs.
Lorsque des éléments doivent être corrigés, une visite de contrôle est programmée afin d'assurer la bonne prise en compte des corrections demandées. Surtout, l'ensemble des résultats d'inspection des services ainsi que les sanctions et amendes infligées aux gestionnaires au cours des cinq dernières années sont accessibles en ligne sur une plateforme dédiée.
Autriche35(*)
La compétence en matière d'accueil du jeune enfant relève des Länder. En règle générale, les autorités locales s'assurent, par l'intermédiaire des autorités de contrôle spécifiques à chaque Land, du contrôle de tous les établissements à intervalles réguliers (au minimum 1 fois par an). Les inspections des crèches dans le cadre de la surveillance annuelle ou en cas de plaintes se font prioritairement sans préavis.
Finlande36(*)
La surveillance des établissements d'accueil du jeune enfant est organisée au niveau national par la loi sur l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. Les municipalités sont l'autorité organisatrice pour l'installation et le développement des modes d'accueils sur leur territoire.
Les établissements gérés par les municipalités sont supervisés par l'agence administrative régionale de l'État et par l'agence d'autorisation et de contrôle des affaires sociales et sanitaires (Valvira).
Pour les établissements privés, en plus des agences précédemment mentionnées, la municipalité concernée dispose également d'un droit de contrôle étendu. Si la municipalité n'exerce pas son droit de contrôle, les agences d'État peuvent l'enjoindre de procéder à un contrôle.
Les autorités de contrôle mentionnées ci-dessus doivent exercer leur surveillance en fournissant les orientations et les conseils nécessaires aux organisateurs de l'EAJE en vue de l'amélioration de la qualité de l'accueil.
Grande-Bretagne
Le contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant est effectué sur l'ensemble du territoire par l'Office for Standards in Education, Chidren's Services and Skills (OFSTED). Les résultats des contrôles sont rendus publics sur le site de l'agence et font l'objet d'un rapport public annuel remis au Parlement. Ce rapport s'inscrit dans un objectif de valorisation des bonnes pratiques et d'amélioration de la qualité de l'accueil sur le territoire.
Tous les établissements doivent s'enregistrer auprès de l'OFSTED qui attribue les autorisations d'ouverture. Des visites d'inspection sont réalisées dans les trois premiers mois suivant l'enregistrement, puis tous les quatre ans.
2. L'indispensable renforcement du pilotage national et des échanges entre les autorités de contrôle
a) Le nécessaire renforcement des échanges d'information entre les départements et du pilotage national de l'action des PMI
Malgré ces récentes améliorations, les rapporteurs ne peuvent que constater que la dispersion des compétences et des responsabilités est source de dysfonctionnements. Il est difficile, voire impossible, d'établir un contrôle efficace et homogène sur l'ensemble du territoire sans orientation nationale ni outils de supervision.
Ainsi, la DGCS ne dispose pas d'une vision exhaustive des contrôles réalisés par chaque administration compétente, en l'absence notamment de système de remontée d'information dédié. Preuve en est également l'impossibilité pour les services de l'État de pouvoir transmettre à la mission le nombre de contrôles effectués par les services des PMI lors des trois dernières années.
Il a ainsi fallu attendre la publication de l'arrêté du 4 juillet 2024 pour que l'État se dote enfin d'un outil, rudimentaire qui plus est, de suivi statistique des contrôles effectués sur l'ensemble du territoire37(*). A minima les indicateurs prévus dans cet arrêté doivent être enrichis et laisser apparaître la qualité juridique du gestionnaire de l'établissement contrôlé, ainsi que le cadre dans lequel le contrôle a été réalisé (ouverture de structure, signalement, caractère inopiné ou non, coordination entre plusieurs autorités de contrôle...).
Enfin, comme l'indique la Cour des comptes dans son récent rapport sur la politique de l'accueil du jeune enfant, il serait souhaitable d'augmenter la fréquence des enquêtes Modes de garde de la Drees, qui permettent de recueillir des données réelles sur l'activité des services des PMI38(*).
Par ailleurs, alors que les CAF ont pu mettre en place des contrôles coordonnés supra-départementaux (cf. infra), il n'existe à ce jour aucun système de coordination et d'échange d'informations formalisé entre les services de différents départements sur la mission des contrôles des crèches.
Cette absence d'outil de communication et de coordination de l'action de contrôle entre les PMI constitue une faiblesse majeure du système de contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant. La mise en place d'une plateforme nationale sécurisée d'échanges d'informations entre les différents services de PMI pourrait ainsi permettre de pouvoir identifier plus facilement ce qui relève d'un dysfonctionnement local de ce qui relève d'une véritable volonté de réduire la qualité de l'accueil. Elle pourrait également faciliter la mise en place de contrôles coordonnés de gestionnaires disposant de structures sur plusieurs départements. Enfin, elle assurerait le rôle de pôle ressources pour les professionnels dans une perspective de partage des bonnes pratiques et d'amélioration des compétences.
Dans ce cadre, l'instance nationale d'animation des PMI annoncée par la DGCS pour début 2025 et dont les contours d'action paraissent encore flous pourrait assurer le suivi et l'animation de cette plateforme.
Proposition n° 2 : Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques.
b) La généralisation des contrôles coordonnés entre CAF à l'échelle supra-départementale
L'action de contrôle des structures d'accueil collectif des CAF est pilotée par la Cnaf au travers d'un plan de contrôle en action sociale. Chaque année, un bilan est ainsi établi avec le réseau afin de partager et de recenser les pratiques non conformes observées chez les gestionnaires d'établissements.
Par ailleurs, des contrôles coordonnés entre CAF ciblant des gestionnaires de structures implantés à une échelle supra-départementale sont mis en oeuvre dans certaines régions depuis plusieurs années. Si la Cnaf a pu préciser que des contrôles coordonnés entre plusieurs CAF, dans les régions Hauts-de-France et Île-de-France, ciblés en particulier sur People&Baby avaient été mis en place, aucun bilan chiffré de ces dispositifs n'a été fourni. Le bilan des opérations devrait toutefois être présenté au printemps 2025 au Conseil d'administration de la Cnaf.
Les rapporteurs appellent la Cnaf dans le cadre des nouvelles compétences de contrôle qui lui sont dévolues à généraliser ce type de contrôle. Le contrôle des acteurs supra-départementaux suppose la mobilisation de compétences extérieures à celles des CAF et des collaborations avec d'autres services publics (Urssaf, DGFiP, etc.) concernant le droit des sociétés ou la réglementation fiscale. Ici encore, la création de protocoles de communication et d'échange entre les administrations compétentes constitue un prérequis indispensable à l'effectivité de ces nouveaux outils de contrôle. Pour mener ce chantier, la branche famille a mis en place une équipe nationale de contrôle au sein d'un service mutualisé dit « Mission SPPE » (cf. infra).
Proposition n° 3 : Renforcer les contrôles coordonnés entre CAF ciblant des gestionnaires de structures implantés à une échelle supra-départementale.
II. UN CONTRÔLE ENCORE TROP PARCELLAIRE QUI NE PARTICIPE PAS ASSEZ À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL DES ENFANTS
A. PASSER D'UN CONTRÔLE CENTRÉ SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ À UN RENFORCEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL
1. Fixer des règles claires et opposables pour l'ensemble des établissements quel que soit leur statut juridique et sur tout le territoire
La libre administration des collectivités territoriales ne saurait justifier la persistance de disparités territoriales qui in fine sont préjudiciables aux enfants et aux professionnels de la petite enfance. Sans remettre en cause la nécessaire adaptation aux spécificités locales que seuls les acteurs sur le terrain peuvent identifier, il convient d'établir des règles précises et applicables sur l'ensemble du territoire par tous les acteurs.
Par ailleurs, la DGCS a confirmé que les 26 décisions de fermeture administratives prises en 2023 concernaient quasiment exclusivement des micro-crèches du secteur privé lucratif. Ainsi, 24 des 26 établissements fermés étaient des micro-crèches (93 % lucratif et 7 % associatif)39(*). Si une attention particulière doit être apportée localement sur certains établissements, les rapporteurs regrettent la posture de « méfiance » qui semble prédominer vis-à-vis des établissements privés et estiment qu'il faut que l'ensemble des établissements puissent être contrôlés de la même manière par des agents s'appuyant sur le même référentiel. En effet, la mission a pu constater que les micro-crèches « Paje » pouvaient être des établissements de grande qualité autant qu'elles pouvaient donner lieu à des dérives insupportables.
Il existe chez les gestionnaires d'établissement un véritable besoin de stabilité dans l'édiction des normes et de clarté dans leur interprétation. Il s'agit d'éviter au maximum toute imprévisibilité pour les professionnels de terrain.
Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont pu constater qu'en fonction du département, voire en fonction du contrôleur au sein du département, l'interprétation des normes pouvait être différente, entraînant parfois des impacts opérationnels importants pour le gestionnaire. À ce titre, les rapporteurs ont pu consulter des exemples de documents d'évaluation fournis par différentes PMI sur le territoire et constater la diversité des attentes et des demandes qui peuvent être faites aux structures. Ainsi, certains gestionnaires ont pu indiquer à la mission avoir dû modifier toute leur organisation en ressources humaines en raison de l'évolution de la demande d'une PMI sur la surveillance des siestes à la minute près ou encore avoir dû changer l'ensemble des matelas de la structure après que ceux-ci ont été qualifiés de « pas assez fermes ». On peut également citer le fait que certaines PMI imposent que chaque boîte de lait maternel soit contenue dans une seconde boîte pour des raisons d'hygiène, quand d'autres ne le font pas ou encore des divergences sur les règles de conservation des médicaments. L'excès de normes et leur interprétabilité est préjudiciable aux relations entre les contrôleurs et les professionnels au sein des structures.
Les maisons d'assistantes maternelles (MAM)
L'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les assistantes maternelles peuvent « accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels », c'est-à-dire dans un lieu autre que leur domicile.
Issue d'une expérimentation dans le département de la Mayenne, cette modalité d'exercice pérennisée par la loi en 201040(*) rencontre depuis plusieurs années un succès grandissant sur l'ensemble du territoire. Le modèle hybride entre accueil individuel et accueil collectif répond à un besoin de la part des familles et permet aux assistantes maternelles de rompre l'isolement ou de pouvoir exercer alors que leur logement ne répond pas aux critères d'agrément. L'agrément des assistantes maternelles exerçant au sein des MAM doit explicitement en autoriser cet exercice. Il est délivré par le président du conseil départemental.
Selon la Cour des comptes, leur nombre est passé de 1 600 en 2015 à 4 029 en 2022. Elles proposeraient aujourd'hui 46 000 places d'accueil.
Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer simultanément dans une même MAM ne peut être supérieur à quatre. Ainsi, alors que jusqu'à 20 enfants peuvent être accueillis simultanément, ces établissements ne sont pas considérés aujourd'hui comme des établissements d'accueil collectif du jeune enfant au titre de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique. D'autres règles relatives à l'accueil collectif ne sont également pas applicables ; les règles portant sur la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration collective ne s'appliquent pas aux MAM. La préparation de repas au sein de ces structures est en effet considérée comme une restauration domestique privée d'un point de vue réglementaire.
Alors que dans le cadre d'une crèche familiale, les assistantes maternelles sont employées par la structure, les assistantes maternelles exerçant au sein des MAM restent directement employées par les parents. Chaque assistante maternelle reste responsable uniquement des enfants dont elle a la charge conformément au contrat conclu avec les parents. Toutefois, un dispositif de délégation de l'accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant au sein de la même maison est prévu. Ce système de délégation rapproche encore plus ces établissements du fonctionnement des établissements d'accueil collectif.
Au vu de leur développement rapide, les rapporteurs estiment nécessaire de remettre à plat les normes applicables aux maisons d'assistantes maternelles afin d'assurer une garantie de sécurité et de qualité équivalente aux autres établissements d'accueil collectif tout en prenant en compte les spécificités de ce type de structure.
Les rapporteurs notent également que se développent sur le territoire des « Maisons d'éducatrices de jeunes enfants » (MEJE) qui, sans remettre en cause par principe leur existence, doivent également pouvoir faire l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire adéquats.
Face à la diversité de ces demandes et des interprétations des textes, il apparaît indispensable de fixer une grille d'évaluation nationale des contrôles. Il s'agit aussi de permettre aux professionnels de disposer de fiches d'auto-évaluation précises et homogènes permettant d'assurer de façon continue le respect de la réglementation et de préparer les visites de contrôle. La mission appelle en ce sens à aller plus loin que la seule création du guide d'inspection et contrôle confiée à l'Igas. Le contenu de cette grille nationale d'évaluation et de contrôle opposable doit être déterminé en collaboration avec l'ensemble des acteurs et faire l'objet d'une large concertation.
La création de cette grille composée d'éléments objectivables permettra également la réalisation de véritables comptes rendus précis et constructifs à l'issue des visites. En affichant les points atteints ou à améliorer, elle s'inscrira dans une démarche d'amélioration continue entre les autorités de tutelle et les gestionnaires des structures.
Proposition n° 4 : Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes.
Mettre en place les outils d'un contrôle structuré et homogène sur l'ensemble du territoire oblige l'ensemble des acteurs et en premier lieu l'État à prendre toutes ses responsabilités.
L'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoit que les « seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services (...) sont fixées par décret ». Dès lors, il apparaît indispensable de publier l'ensemble des textes attendus par les professionnels dans les meilleurs délais afin de sécuriser l'action tant des contrôleurs que des professionnels au sein des structures.
Les rapporteurs ont pu constater des retards trop importants dans la publication de nombreux décrets ou arrêtés indispensables à l'efficacité du contrôle. Ainsi, ils ont vivement regretté que des arrêtés aussi essentiels que ceux relatifs aux quantités minimales des repas servis en crèche (article D. 230-28 du code rural et de la pêche maritime) ou encore fixant les modalités de calcul de l'effectif mensuel de référence permettant de vérifier la répartition entre personnels diplômés et personnels qualifiés au sein de la structure, prévu par l'article R. 2324-43 du code de la santé publique, n'avaient toujours pas été pris.
Par ailleurs, les rapporteurs s'interrogent sur la suppression programmée de l'obligation de transmission du rapport annuel à fournir aux services départementaux41(*). Si la volonté de soulager la charge administrative pesant sur les structures peut être soulignée, celle-ci ne doit pas se faire au détriment du suivi des établissements et de la suppression d'un outil pertinent de supervision. La réalisation d'un rapport annuel d'activité dont le contenu est clairement fixé dans la réglementation peut en effet constituer un outil précieux d'alerte pour les PMI dans le cadre de leur suivi.
2. Permettre aux services départementaux de la PMI de se recentrer sur le conseil et l'accompagnement des équipes
Les services départementaux des PMI sont aujourd'hui débordés face à la multiplication de leurs missions (protection de l'enfance, accompagnement des parents avant la naissance, santé maternelle et infantile...). De plus, ils ont perdu près de 400 emplois en équivalents temps plein (ETP) entre fin 2010 et fin 202242(*). Les professionnels de PMI ne peuvent que constater chaque jour la dégradation de leurs conditions de travail. Cette réalité oblige les PMI à fonctionner à flux tendu, rendant très difficile la réalisation d'un contrôle de qualité et presque impossible la mission d'accompagnement et d'évaluation. Les représentants du collectif « Assurer l'avenir de la PMI » ont ainsi regretté les insuffisances dans l'accompagnement des structures liées à un manque de personnel et une multiplication des missions.
Cette crise de la PMI se répercute évidemment sur le terrain. Ainsi, pour une grande majorité des personnes entendues par la mission, les contrôles effectués par les PMI restent trop « réglementaires et administratifs » mettant de côté l'analyse « des pratiques pédagogiques et le bien-être des enfants ». Trop souvent perçus comme « autoritaires », ils ne donnent que trop rarement lieu à des « échanges sur les différentes activités mises en place, les partenariats ou encore les actions menées auprès des familles »43(*).
Évolution des ETP PMI entre 2010 et 2022
Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les chiffres de l'enquête « Aide sociale » de la Drees - chiffres hors Mayotte
Le principe de réalité oblige les rapporteurs à reconnaître qu'aujourd'hui un renforcement de la mission de contrôle des établissements d'accueil des enfants reviendrait à affaiblir les autres missions de la PMI. Cela est particulièrement vrai dans les départements et régions d'outre-mer (Drom) où l'accueil collectif occupe une place très importante (plus de 50 % de l'offre d'accueil formel en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, contre 39 % sur l'ensemble du territoire44(*)), mais au sein desquels les indicateurs dégradés en termes de précarité et de santé périnatale nécessitent également une action forte et soutenue des PMI. Renforcer la fréquence des contrôles et augmenter le temps d'accompagnement sur le terrain reposent d'abord sur la reconstitution des moyens humains des services de PMI. Dès lors, se pose la question des moyens accordés aux départements pour exercer leurs missions mais aussi de la possibilité, comme c'est le cas pour les établissements sociaux et médico-sociaux, d'externaliser une partie de ces missions de contrôle et d'évaluation.
a) Pouvoir solliciter l'appui d'organismes tiers pour effectuer le contrôle du respect du référentiel bâtimentaire45(*)
Le constat est partagé par tout le monde : l'expertise d'un médecin de PMI ou d'un éducateur de jeune enfant serait bien plus utile pour aider les équipes à améliorer leurs pratiques que pour mesurer la hauteur d'une poignée de porte ou la largeur entre deux barreaux de lit.
Si ces contrôles bâtimentaires et sécuritaires, qui, sur de nombreux points, sont encore largement imprégnés de la culture hospitalière des premiers établissements d'accueil, constituent un aspect essentiel du contrôle des établissements, il est impératif de pouvoir recentrer l'expertise des PMI sur le « contrôle-amélioration » au lieu du « contrôle-sanction ». Il importe également de sortir d'une conception « hygiéniste » du contrôle.
Les rapporteurs entendent soutenir et favoriser toutes les mesures permettant de recentrer les services de PMI sur l'accompagnement et l'évaluation de la qualité de l'accueil.
L'expérimentation de la
délégation des missions de la PMI à la CAF
en
Haute-Savoie
Lancée en avril 2021, cette expérimentation concernait l'agrément des nouveaux établissements d'accueil ; le contrôle des établissements existants restant géré selon leurs prérogatives par la PMI et la CAF.
La délégation de compétences du conseil départemental vers la CAF portait plus précisément sur :
- l'instruction des demandes de création et de modification des structures avec l'appui d'un bureau d'étude qui incluait le contrôle des dispositions du référentiel bâtimentaire ;
- les visites de conformité et de post-ouverture en lien et/ou en relais le cas échéant avec le service de PMI.
D'après les premiers éléments de bilan dont la mission a eu connaissance, cette expérimentation a permis de recentrer les services de PMI sur l'accompagnement et le suivi. Elle a également apporté une meilleure efficacité dans l'étude des dossiers d'agrément sous forme de guichet unique entre la CAF et la PMI avec un contrôle globale ne dissociant pas agrément et subvention.
Toutefois, il a été mis fin à cette expérimentation après deux ans et demi en raison de l'importance des effectifs mobilisés par la CAF dans le cadre de cette expérimentation (4 ETP à temps plein supplémentaires) qui ne pouvaient être maintenus dans la durée.
Un bilan complet de cette expérimentation devrait être réalisé au début de l'année 2025.
Dès lors ils souhaitent qu'au-delà des expérimentations autorisées46(*), le cadre juridique permanent permettant au président du conseil départemental de déléguer à des organismes tiers certifiés le contrôle de la conformité réglementaire notamment au référentiel bâtimentaire d'un établissement puisse être mis en place.
Afin d'offrir une véritable possibilité aux départements de déléguer cette compétence et ainsi de permettre aux équipes des PMI d'assurer une véritable mission de conseil et d'accompagnement, les contrats de délégation pourraient être en partie financés par la Cnaf dans le cadre d'une contractualisation avec les départements.
Par ailleurs, les rapporteurs soulignent que cette disposition ne vise pas à remettre en cause le pouvoir de contrôle des services départementaux qui resteront les seuls à même de pouvoir contrôler les structures de manière inopinée ou encore à la suite de signalements. Il ne s'agit pas plus d'attribuer un quelconque pouvoir de sanction ou d'autorisation à ces organismes tiers mais bien de permettre aux autorités de contrôle de pouvoir décider sur la base de rapports réalisés par des tiers. Elle permettra également de décharger les services de PMI d'une partie des tâches liées aux agréments d'ouverture. En effet, de nombreux services départementaux sont aujourd'hui embolisés par la seule gestion du flux des ouvertures de structure et rencontrent d'importantes difficultés à superviser le stock des établissements sur leur territoire.
Sur le modèle applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux47(*), les organismes habilités à réaliser ces contrôles seraient certifiés par le Comité français d'accréditation (Cofrac) et réaliseraient leurs contrôles sur la base de la grille nationale d'évaluation et de contrôle souhaitée par les rapporteurs (cf. supra). La liste de ces organismes, dont il est nécessaire d'assurer la neutralité au regard de leurs liens potentiels avec les gestionnaires de crèche, devra être rendue publique et accessible en ligne.
Proposition n° 5 : Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés.
b) Renforcer l'effectivité de la procédure d'évaluation des crèches en permettant à des organismes extérieurs certifiés de participer à l'obligation d'évaluation quinquennale des établissements
Sur le modèle de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles applicable aux ESSMS, l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique prévoit que les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans « font l'objet, tous les cinq ans, d'une évaluation ». Toutefois, à la différence du cadre prévu pour les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, le législateur n'a pas prévu que cette évaluation puisse être réalisée par des organismes extérieurs ni le cadre précis dans lequel cette évaluation doit être effectuée. Or, l'évaluation quinquennale de l'ensemble des établissements d'accueil, si elle devait être uniquement supportée par les services de PMI, représenterait une charge de travail extrêmement lourde qui viendrait s'ajouter au programme annuel de contrôle ou encore à la mission de conseil et d'accompagnement régulier qui constitue la véritable plus-value de ces professionnels.
Ainsi, afin de renforcer ce dispositif et d'en assurer son effectivité, il est nécessaire de modifier le cadre législatif pour permettre à des organismes tiers accrédités de réaliser ou de participer à ces évaluations. Les organismes de certifications interviennent déjà depuis plusieurs années dans le secteur de la petite enfance et leur expertise est reconnue tant par les gestionnaires privés que publics (cf. supra).
Le référentiel d'évaluation prévu par l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles doit pouvoir servir de référentiel commun à l'ensemble des établissements sur la base duquel les organismes extérieurs accrédités devront réaliser leurs évaluations. L'action des organismes extérieurs chargés de cette évaluation s'inscrirait alors en complément de celle des autorités publiques. Par ailleurs, les modalités de prise en compte de ces évaluations dans le retrait ou le maintien de l'agrément par le président du conseil départemental gagneraient à être précisées par la loi.
Comme pour la délégation du contrôle bâtimentaire à des organismes certifiés, la liste des organismes extérieurs pouvant réaliser cette évaluation quinquennale sera rendue publique. Ces organismes devront, eux aussi, être certifiés par le Cofrac sur la base du respect d'un cahier des charges établi par la puissance publique.
Les rapporteurs regrettent que, comme dans de nombreux autres domaines, les autorités n'entretiennent pas de relations plus régulières avec ces sociétés qui disposent eux aussi d'une véritable expertise. Les rapporteurs estiment que l'échange et la connaissance mutuelle des pratiques ne peuvent être que bénéfiques à l'ensemble du secteur. Les entreprises de certification et de conseil pourraient ainsi utilement présenter à une fréquence régulière le bilan de leurs travaux au comité départemental de service aux familles ou dans le cadre de l'élaboration du plan annuel départemental d'inspection et de contrôle.
Proposition n° 6 : Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique.
c) Mieux former les agents chargés du contrôle afin de renforcer la qualité de l'action de la PMI
Plusieurs gestionnaires et professionnels ont pu regretter lors des auditions avoir parfois rencontré des agents des services de PMI chargés du contrôle de leur établissement qui n'étaient pas au fait des dernières évolutions de la réglementation. L'évolution constante de la réglementation et des connaissances dans le domaine de l'accueil du jeune enfant appelle une actualisation continue des compétences des agents chargés du contrôle et de l'évaluation.
La question de la formation continue des agents chargés du contrôle à la fois sur l'évolution de la réglementation mais aussi et surtout sur la question de la prévention de la maltraitance, l'accueil des enfants en situation de handicap, ou encore la prise en compte de la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, constitue un aspect essentiel de l'effectivité du contrôle et de son objectif d'amélioration de la qualité de l'accueil.
De nombreux départements ont mis en place des plans de formation pour leurs agents. Par exemple, en Mayenne, les formations sont régulièrement actualisées via des webinaires à la suite des évolutions réglementaires, pour actualiser les connaissances. Dans le Maine-et-Loire, des formations sont proposées à chaque changement du cadre réglementaire, ainsi que des formations centrées sur le développement de l'enfant (aménagement de l'espace, santé environnementale...).
Actuellement, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) propose une formation appelée « La PMI : mission d'inspection et de contrôle des structures d'accueil de la petite enfance ». L'association Départements de France a relevé que de nombreux départements appellent à la mise en place par la CNFPT d'un nombre plus important de formations, notamment sur des points spécifiques comme sur le service public de la petite enfance ou la prise en charge d'enfants à besoins spécifiques.
Par ailleurs, du fait de l'organisation propre à chaque service de PMI, les contrôles peuvent être réalisés par des professionnels avec des profils totalement différents. Par exemple, dans les Deux-Sèvres, c'est le médecin départemental qui assure l'intégralité des contrôles alors qu'en Mayenne, ce contrôle est exercé par des infirmières puéricultrices. Si les profils les plus fréquents sont aujourd'hui encore les infirmières, les puéricultrices et les médecins, Départements de France a indiqué aux rapporteurs qu'il y avait actuellement une montée en puissance des éducateurs de jeunes enfants dont les compétences en termes d'accompagnement au développement de l'enfant constituent une réelle plus-value. Toutefois, leur nombre au sein des services de PMI reste encore trop faible dans beaucoup de départements.
Effectifs d'éducateurs de jeunes enfants en
équivalent temps plein
par départements - 2022
Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de l'enquête Aide sociale 2022 - Drees (chiffres non disponibles pour la Corse)
En raison même de cette grande diversité des profils exerçant au sein des PMI (infirmiers, éducateurs de jeunes enfants, médecins, puéricultrices...) et des diversités des dispositifs de formation proposés par chaque département, il apparaît pertinent, sans remettre les spécificités et expertises propres à chacune de ces professions, d'élaborer une base commune de formation au contrôle et à l'évaluation de la qualité déclinant le référentiel de la qualité de l'accueil actuellement en cours d'élaboration sous la coordination de l'Igas. Les rapporteurs souhaitent dans ce cadre que puisse être mise en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle des établissements d'accueil afin de renforcer et d'améliorer la qualité du contrôle effectué mais également de sécuriser l'action des agents des PMI.
Proposition n° 7 : Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle au sein des PMI par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de renforcer les compétences et la formation continue des professionnels.
d) Encourager la distinction entre les actions de contrôle et de conseil dans l'organisation des services départementaux
Au cours des auditions, il est apparu nécessaire de mieux différencier la fonction de contrôle, qui doit s'appuyer sur des normes précises et opposables, de celle d'évaluation de la qualité qui doit s'inscrire dans une logique d'accompagnement des équipes. La qualité de l'accueil s'évalue et s'améliore, et ne peut pas se limiter à des grilles trop strictes qui contraignent la créativité et la capacité d'adaptation des professionnels. Dans ce cadre, si le référentiel sur la qualité de l'accueil coordonné par l'Igas doit pouvoir comporter des éléments opposables liés au contrôle, il ne doit pas être un outil qui « dépossède [les professionnels] de leur savoir-faire »48(*). Comme les rapporteurs ont pu l'entendre plusieurs fois en audition : « S'occuper d'un enfant ne peut être standardisé comme peut l'être la fabrication d'une pièce de moteur ». Tous les acteurs, qu'ils soient chargés du contrôle ou auprès des enfants, ont appelé de leurs voeux un renforcement des temps d'échange et d'évaluation.
Les mesures présentées précédemment permettront de libérer du temps pour les services de la protection maternelle et infantile afin de se recentrer sur le coeur de leur métier et leur véritable plus-value. En effet, un des atouts majeurs des équipes au sein des PMI pour assurer un accompagnement et un contrôle de qualité repose sur leur pluridisciplinarité : puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, médecins, psychologues. Tous peuvent participer à l'amélioration des conditions d'accueil des enfants et des conditions de travail des professionnels. Mais le conseil et l'évaluation doivent s'inscrire dans le temps long. Les agents doivent pouvoir s'immerger au sein des structures, pendant une demi-journée par exemple, afin de pouvoir identifier les pratiques à corriger et à améliorer. Ils doivent pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels et non pas seulement avec les personnels de direction des établissements.
Afin de permettre à cette mission d'accompagnement et de conseil de pouvoir être réalisée en toute confiance avec les équipes au sein des crèches, il faut encourager, autant que possible au sein des départements, une distinction claire entre les agents chargés des contrôles, notamment les contrôles inopinés ou à la suite de signalements, et les agents en charge de l'accompagnement et de l'évaluation de la qualité de l'accueil.
La collectivité européenne d'Alsace a par exemple organisé ses services en ce sens en disposant d'une équipe de PMI en central, qui réalise les contrôles dans les établissements et des équipes positionnées dans les territoires qui assurent l'accompagnement et qui sont identifiées comme telles par les acteurs. De même, le département des Bouches-du-Rhône a, dès 2006, créé un service dédié au sein de la PMI pour l'accompagnement des modes d'accueil.
Par ailleurs, les rapporteurs appellent les autorités départementales à favoriser les contrôles inopinés des structures, seuls à même de pouvoir réellement se rendre compte des dérives ou dysfonctionnements dans les établissements. Toutefois, ce renforcement des contrôles inopinés doit être accompagné d'un temps d'évaluation, de conseil et d'accompagnement plus important permettant une véritable immersion dans la structure et avec les équipes.
3. Renforcer les outils à disposition des autorités publiques pour améliorer l'effectivité du contrôle tant des établissements que des groupes
a) Poursuivre le contrôle des grands groupes privés et, le cas échéant, en tirer les conséquences
Dans son rapport référence de mars 2023, l'Igas indiquait que « la situation du secteur privé (lucratif ou non) dans les établissements d'accueil du jeune enfant a suivi le même type d'évolution que dans le secteur des personnes âgées. À la faveur de dynamiques de mutualisation, de fusions et de rachats, cinq grands groupes ont acquis une domination sur le secteur » et qu'il était impératif que l'État se garde de « reproduire les erreurs faites par manque de régulation dans le secteur des personnes âgées ». En adoptant l'article 18 de la loi pour le plein emploi, le législateur a souhaité donner aux pouvoirs publics les moyens de contrôler efficacement les stratégies financières et le modèle économique de ces groupes afin d'éviter les dérives liées à la maximisation des profits et à la recherche de réduction des charges de fonctionnement. Il s'agit de mieux encadrer l'activité des groupes, sans être limité à un contrôle des seuls établissements pris individuellement, afin de permettre le développement de leurs activités dans un cadre sécurisé et avec des possibilités de contrôle fréquentes.
Sur ce fondement l'Igas a lancé, au cours de l'année 2024, un premier contrôle du groupe La Maison bleue. Les autres principaux acteurs du secteur seront par la suite également contrôlés. Il est dès lors préférable d'attendre les premières conclusions des inspections qui devraient être connues au printemps 2025 avant de formuler des propositions d'évolution de ces nouvelles compétences. Les rapporteurs regrettent cependant de ne pas avoir pu bénéficier au cours de leur travaux des premiers éléments de bilan établis par les inspecteurs.
Il peut toutefois être souligné que, dans le cadre des nouvelles compétences de contrôle attribuées aux inspections générales, les services centraux de la DGFiP et le service gestionnaire (DGE) ainsi que la Cnaf ont été sollicités par l'Igas, de mai à décembre 2024, afin de lui transmettre des éclairages sur la structuration du groupe, des données de gestion ou encore pour apporter des réponses à des questions relatives à la législation fiscale (notamment en matière d'impôts sur les sociétés et de TVA). Il apparaît essentiel pour les rapporteurs qu'un travail de coordination avec les services de Bercy puisse se mettre en place ; cette coordination devant être également instituée dans le cadre des nouvelles compétences de contrôle de la Cnaf.
De son côté, la Cnaf a pu préciser à la mission avoir d'ores et déjà mis en place une mission spécifique dite « SPPE » en charge du contrôle des groupes et notamment des frais de sièges49(*), notamment pour vérifier si les activités du siège réalisées pour le compte d'établissements situés à l'étranger ne sont pas intégrées dans les comptes des établissements français. Elle peut bénéficier à ce titre de l'expertise de la DGFiP pour la détermination de la réalité de certains frais. En disposant ainsi d'une connaissance plus fine des coûts de fonctionnement, les organismes débiteurs de prestations familiales pourront mieux identifier les éventuelles anomalies dans les comptes des établissements. La Cnaf a ainsi déjà lancé des travaux de recensement des documents financiers et sociaux des principaux groupes. Ce premier travail a pour but « de préparer les contrôles des groupes qui auront lieu par la suite et menés par les contrôleurs experts de la mission 50(*)» et de mettre en place une procédure nationale spécifiquement applicable à ce type de contrôle. Par ailleurs, la Cnaf sécurise ses procédures en la matière afin que ces contrôles effectués au niveau des groupes puissent donner lieu, le cas échéant, à des décisions applicables à l'ensemble des structures du gestionnaire.
Ces nouvelles compétences ayant pour objectif de poser un diagnostic sur les stratégies globales des grandes entreprises, le législateur devra, si nécessaire, se saisir des premiers bilans de ces contrôles afin de mettre en place les outils permettant de s'assurer que les financements publics servent exclusivement à la mise en oeuvre d'un accueil de qualité.
La rémunération des fonds d'investissement ou de dette51(*) au capital de ces groupe ne se fait pas sous la forme de dividendes et affiche des objectifs à plus long terme que les investisseurs boursiers. Toutefois, la stratégie de croissance reste basée sur le développement du groupe qui semble amener malgré tout à maximiser la création de places au détriment de la qualité de l'accueil.
Dans ce cadre, les résultats de ces contrôles pourront déterminer s'il apparaît pertinent d'encadrer plus fortement les prises de participation de certains fonds d'investissement et fonds de dette au capital des entreprises de crèches.
Le recours à des capitaux privés pour concourir au financement de l'accueil de la petite enfance doit s'inscrire dans un cadre qui présente des garanties solides. Sur ce point, il convient de rappeler, comme l'écrit Victor Castanet dans son ouvrage Les Ogres, que, concernant les dérives rencontrées chez People&Baby, ces dernières ont précisément eu lieu « parce qu'il n'y avait pas d'actionnaires » et que le groupe « ne réalisait pas d'hyperprofits ; il était en déficit permanent ».
Dès lors, il apparaît nécessaire de ne pas décourager les investisseurs, notamment dans un contexte de désengagement des établissements bancaires et de difficultés liées à la conjoncture économique et au déficit d'image des établissements d'accueil52(*), mais de mettre en place une régulation garantissant la durabilité des investissements et le réinvestissement dans la qualité de l'accueil des enfants.
Il convient donc de renforcer la transparence quant à la gestion de ces groupes. Les rapporteurs notent que le décret prévoyant la liste des documents de nature comptable et financière que les groupes de crèches doivent transmettre annuellement aux CAF, en application de l'article L. 2324-2-3 du code de la santé publique, n'a toujours pas été publié, alors même que l'entrée en vigueur de cette disposition était fixée au 1er janvier 2025. Ce retard remet en cause l'effectivité des dispositions pourtant votées par le Parlement à la fin de l'année 2023.
b) Perfectionner l'arsenal juridique à disposition des autorités publiques pour effectuer le contrôle des établissements et des groupes
Les rapporteurs considèrent que le récent renforcement des outils de contrôles prévu par la loi pour le plein emploi constitue une réelle avancée et amélioration du cadre du contrôle. Ils estiment toutefois nécessaire de perfectionner davantage les moyens à disposition des agents chargés du contrôle.
Premièrement, au regard de l'ampleur des financements publics dans le secteur de la petite enfance53(*), les rapporteurs considèrent que la réponse des pouvoirs publics n'est pas encore à la hauteur. Dans son rapport précité, l'Igas indiquait que « les administrations publiques ne disposent pas d'une visibilité suffisante sur le modèle économique et le fonctionnement financier d'activités pourtant très largement financées par le biais de l'argent public, et n'ont pas les moyens de s'assurer que ces financements servent exclusivement à délivrer un service d'accueil de qualité. Une telle absence de maîtrise est incompatible avec la notion de service public de la petite enfance [...] ». Il est apparu que les juridictions financières, contrairement à la réglementation applicable aux ESSMS54(*), ne disposent pas de la compétence pour contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle les établissements d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
En effet, la Cour des comptes peut aujourd'hui contrôler les crèches directement financées par les CAF au moyen de la PSU. Par ailleurs, quel que soit leur statut juridique, les chambres régionales des comptes peuvent, chacune dans sur le territoire de sa juridiction, contrôler les établissements en régie ou percevant une subvention au moins égale à 1 500 euros55(*) ou encore faisant l'objet d'une délégation de service public56(*). À ce titre, les CRC exercent des contrôles réguliers sur les établissements d'accueil gérés directement par des gestionnaires placés sous son contrôle (commune, hôpitaux...)57(*).
Toutefois, ni la Cour ni les chambres régionales des comptes ne peuvent contrôler les établissements ne recevant pas de financement direct de la CAF ou de la commune au premier rang desquels les micro-crèches « Paje ».
Surtout, la Cour des comptes ne dispose pas des compétences pour contrôler l'utilisation des financements publics par les têtes de groupes privés de crèches, faute de fonds publics directement versés aux personnes morales sous le contrôle desquelles les crèches sont placées.
Interrogée par les rapporteurs sur cette faiblesse de sa capacité de contrôle, la Cour des comptes a estimé « qu'une modification du code des juridictions financières [...] permettrait de remédier à cet angle mort »58(*). Dans ce cadre, les rapporteurs estiment qu'il est nécessaire d'attribuer à la Cour un pouvoir de contrôle des groupes privés de crèches afin de permettre un contrôle efficace de l'ensemble des établissements59(*).
Proposition n° 8 : Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS.
Deuxièmement, alors que les agents de la répression des fraudes ont mis en place de nombreuses procédures de contrôle des établissements d'accueil, notamment des micro-crèches « Paje » (cf. supra), ils sont souvent limités dans les suites qui peuvent être données à ces contrôles. En effet, les agents de la DGCCRF ne bénéficient pas d'une habilitation à contrôler les dispositions du code de la santé publique et leurs contrôles se limitent donc aux dispositions du code de la consommation. Dans certains cas, l'absence d'habilitation spécifique en cas de manquement à la réglementation issue du code de la santé publique peut être problématique. Les agents se retrouvent dans l'impossibilité d'adopter une mesure faisant grief comme des mesures de police administratives ou procès-verbal pénal concernant des clauses illicites.
Par ailleurs les contrats mis en oeuvre, en particulier dans les micro-crèches « Paje » peuvent être particulièrement complexes pour les familles, au regard des frais facturés par exemple. Pour ces raisons, il apparaît nécessaire de protéger davantage les familles dans la conclusion de ces contrats d'accueil de leurs enfants. Dès lors, il convient d'envisager la création d'un article d'habilitation générale des agents sur les dispositions du code de la santé publique relatives à l'obligation d'information précontractuelle et contractuelle.
Proposition n° 9 : Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles.
Troisièmement, il semble nécessaire de donner aux contrôleurs des CAF la possibilité de sanctionner plus facilement la fraude en action sociale afin de pouvoir imposer, en parallèle de la récupération des indus, des sanctions financières aux établissements en cas de fraude constatée.
Actuellement, à la différence des contrôles des situations individuelles, les contrôleurs en action sociale, chargés du contrôle des établissements financés par la branche famille, qui constatent des comportements et des faits pouvant conduire à la suspicion de manoeuvres frauduleuses ne peuvent pas les qualifier directement comme telles. Les CAF doivent alors procéder à un dépôt de plainte afin qu'un juge instruise le dossier. La procédure est complexe et lourde et peut limiter les moyens d'action et la réactivité des caisses. Selon la réponse apportée par la Cnaf aux demandes de précisions des rapporteurs, l'obtention d'une base légale pour qualifier la fraude de manière plus systématique qu'en recourant aux décisions des juges permettrait de « structurer un plan de lutte contre la fraude aux aides financières collectives, à l'instar de ce qui existe pour les prestations légales, comme le réclame chaque année la Cour des Comptes ».
Les financements des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans relevant d'un régime de prestations extra-légales, il conviendra d'étudier les différentes modalités de mise en oeuvre de cette base légale et d'en vérifier la pertinence60(*).
Parallèlement à l'obtention de cette base légale pour la qualification des comportements frauduleux, une possibilité d'assermentation des contrôleurs en action sociale, sur le modèle de celle existante pour les contrôleurs des situations individuelles61(*), leur permettrait notamment de pouvoir établir des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Si certaines CAF assermentent déjà leurs contrôleurs des aides collectives, il semble préférable de sécuriser juridiquement les possibilités d'assermentation de ces contrôleurs afin de renforcer leurs moyens d'action.
Ainsi, permettre au réseau des CAF de qualifier, dans le cadre des contrôles aux aides collectives, les comportements constatés de frauduleux, renforcerait le caractère dissuasif de ces contrôles et apporterait un levier supplémentaire d'action pour les contrôleurs.
Proposition n° 10 : Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles.
Enfin, il n'est pas acceptable que des agents chargés du contrôle puissent être empêchés ou se heurtent à des obstacles dans l'exercice de leur mission. C'est pourquoi, il apparaît également nécessaire de prévoir dans le code de la santé publique une sanction pénale en cas d'obstacle aux inspections prévues par les articles L. 2324-1 et L. 2324-2 du code de la santé publique. Cette disposition existe déjà dans le code de l'action sociale et des familles pour les ESSMS62(*) et dans le code de la santé publique63(*), et pourrait utilement être étendue aux inspections des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans.
B. RENFORCER LE CONTRÔLE DES PROFESSIONNELS AU CONTACT DES ENFANTS ET AMÉLIORER LEUR FORMATION AFIN D'ASSURER LE REPÉRAGE DES SITUATIONS DYSFONCTIONNELLES
1. Face à un roulement de personnel très important et des difficultés de recrutement majeures, le contrôle des professionnels au contact des enfants doit être renforcé
a) Des difficultés de recrutement et un roulement de personnel important qui entraînent une dégradation des exigences de recrutement
Le nombre de professionnels travaillant au sein des établissements d'accueil collectif est difficile à estimer précisément. En effet, les financements de la Cnaf n'intègrent pas dans leur calcul le nombre exact de professionnels ou leurs caractéristiques. Par ailleurs, les professionnels exerçant dans les micro-crèches financées indirectement par la Cnaf sont encore plus difficilement dénombrables. Ici encore, le manque d'éléments statistiques quant au nombre d'emplois concernés est particulièrement préjudiciable à la mise en place d'un pilotage national de la politique de la petite enfance et sa déclinaison territoriale à travers le service public de la petite enfance.
Toutefois les difficultés de recrutement sont bien identifiées depuis plusieurs années. Selon une enquête conduite en 2022 par le Comité de filière petite enfance, près de la moitié des crèches déclarait un manque de personnel. La Cnaf estimait la même année à 10 000 le nombre de postes vacants. Ces difficultés de recrutement, auxquelles il convient d'amener des réponses, a poussé les gouvernements successifs à diminuer les exigences au sein des crèches, permettant par exemple, sous conditions, le recrutement de personnels sans qualification64(*). Si plusieurs gestionnaires, comme la mairie de Paris, ont indiqué ne pas appliquer ces dérogations afin de maintenir une qualité d'accueil, les rapporteurs considèrent que la baisse des exigences de recrutement au détriment de la qualité de l'encadrement des enfants ne saurait être une réponse pertinente aux difficultés que rencontre le secteur.
À ces difficultés de recrutement s'ajoutent une fréquence de renouvellement des effectifs importante relevée par l'ensemble des personnes entendues par les rapporteurs. Ce « turnover », particulièrement fort dans les grandes agglomérations, s'explique en partie par des conditions de travail dégradées du fait du manque de personnel. L'effet conjugué de ces deux phénomènes amène les gestionnaires65(*) à ne pas toujours réaliser « convenablement » le contrôle de l'honorabilité66(*) et des compétences « par manque de temps, de moyens et dans l'urgence de devoir embaucher quelqu'un ». Ainsi, certaines structures ne déclarent pas les modifications au sein de leur équipe et certaines PMI ne peuvent plus suivre les changements en raison d'une rotation de personnel trop importante, permettant ainsi à des professionnels défaillants de pouvoir passer de structure en structure.
b) Une récente amélioration des conditions de vérification des antécédents judiciaires qui doit être rapidement généralisée
Dans ce cadre, la loi sur la protection de l'enfance du 7 février 2022 a inscrit l'obligation du contrôle des antécédents judiciaires en amont de tout recrutement et périodiquement après le recrutement. Ainsi, toute personne définitivement condamnée, quel que soit son statut juridique ou sa fonction, doit être écartée de la structure concernée dès que l'employeur a connaissance de ladite condamnation. C'est désormais le professionnel qui doit attester auprès de son employeur de son honorabilité. Dans ce cadre, le déploiement en cours du dispositif en ligne de contrôle d'honorabilité67(*) permet la présentation fiable et rapide des extraits de casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) par les professionnels, et diminuera d'autant la charge de travail des gestionnaires tout en sécurisant le processus de vérification.
Après une phase d'expérimentation au sein de six départements, le dispositif doit être étendu au premier semestre 2025 à 23 autres départements puis au niveau national avant le 1er janvier 2026. Au regard des premiers enseignements positifs de l'expérimentation, les rapporteurs appellent le Gouvernement à généraliser l'expérimentation le plus rapidement possible sans attendre l'échéance du 1er janvier 2026.
Ce système de vérification périodique des antécédents est indépendant du contrôle de l'employeur qui s'exerce dans le cadre disciplinaire. Dans le premier cas, l'employeur tire les conséquences d'une obligation qui lui est faite par la loi de ne pas employer un salarié condamné pour des faits qui peuvent être sans lien avec l'exécution de son contrat de travail. Dans l'autre cas, il use de son pouvoir disciplinaire pour des faits commis dans son champ de compétence. En cas de faute, il revient à l'employeur de se saisir des outils de sanction à sa disposition. La proportionnalité de la sanction à la faute s'établit sous le contrôle du juge. Lorsque les faits le justifient, les employeurs doivent utiliser leur pouvoir de sanction pour mettre à pied le salarié fautif et ainsi l'écarter des enfants de manière plus automatique.
Régime de sanctions applicables en cas de
condamnation
ou de faute professionnelle
Source : Commission des affaires sociales du Sénat - Mission d'information sur l'efficacité du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant et sur ses éventuelles défaillances
Rejoignant l'analyse de la direction générale du travail, les rapporteurs estiment toutefois qu'il n'est pas pertinent ni applicable au regard du droit constitutionnel de prévoir que la réalisation d'une infraction hors du cadre professionnel ouvrirait automatiquement la voie à une sanction disciplinaire. Si les évolutions récentes dans le contrôle de l'honorabilité des employés du secteur de la petite enfance vont toutes dans le bon sens, la mission, à l'instar de l'Association des maires de France, regrette qu'elles n'aient pas été davantage travaillées en lien avec le ministère de la fonction publique ainsi qu'avec les instances de dialogue social. Elle appelle à une actualisation rapide du code de la fonction publique à la suite de la publication du décret68(*).
c) L'établissement d'un socle commun de compétences des professionnels de la petite enfance et la reconnaissance des qualifications afin d'assurer la qualité des personnels recrutés
En parallèle de l'indispensable contrôle des antécédents judiciaires, il apparaît essentiel de renforcer le contrôle des compétences des professionnels amenés à exercer dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Ce contrôle des compétences doit permettre à la fois d'assurer une qualité de recrutement mais également de participer de la reconnaissance de l'expertise et de la valorisation des professionnels de la petite enfance. Dans ce cadre, la constitution d'un socle commun des professionnels de la petite enfance portée par le comité de filière petite enfance doit être soutenue et poursuivie afin d'aboutir dans les meilleurs délais et élaborer un véritable référentiel des compétences et des connaissances.
Le dispositif de contrôle des diplômes permettant de délivrer des attestations numériques certifiées des diplômes et, pour les employeurs, d'en vérifier l'authenticité69(*) constitue une avancée majeure dans le processus de recrutement des professionnels. Toutefois, comme l'a souligné la Fédération française des entreprises de crèches dans sa réponse au questionnaire des rapporteurs, il souffre de deux écueils : il ne couvre pas les diplômes d'État de la petite enfance tel que le diplôme d'éducateur du jeune enfant, et, d'autre part, il ne comporte pas tous les diplômes de l'Éducation nationale. De ce fait, il ne s'agit pas encore d'un outil réellement opérationnel pour les employeurs du secteur. Dès lors, les rapporteurs appellent de leur voeux une généralisation rapide de ce dispositif à l'ensemble des diplômes de la petite enfance.
Les rapporteurs souhaitent que l'ensemble de ces formations et de ces compétences puissent être valorisées. Le renforcement de l'attractivité des métiers ne passe pas uniquement par la question de la rémunération mais aussi par la mise en place d'outils, parfois symboliques, permettant de reconnaître la qualité d'une expertise et le savoir-faire professionnel. Dès lors, les rapporteurs soutiennent la mise en place d'une carte de qualification professionnelle des personnes pouvant exercer au sein des établissements d'accueil du jeune enfant sur le modèle de la carte instituée par la loi de 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie pour les personnes intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. La mise en place de cette carte pourrait prendre dans un premier temps la forme d'une expérimentation pour une durée et sur des territoires qui seraient définis par décret.
Proposition n° 11 : Créer une carte de qualification professionnelle permettant de certifier les qualifications des employés sur le modèle de la carte prévue à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
2. L'amélioration du repérage des situations dysfonctionnelles doit passer par une révision du contenu des formations des professionnels de la petite enfance
Les acteurs entendus par la mission ont tous évoqué la nécessité de revoir le contenu des formations des professionnels de la petite enfance. En effet, il ne suffit pas uniquement d'améliorer les modalités de réaction des institutions une fois les problèmes survenus mais il est nécessaire d'apporter aussi des solutions préventives.
Les professionnels, quels qu'ils soient, doivent être davantage sensibilisés aux différentes notions de la maltraitance ainsi qu'aux repérages des situations de maltraitance et aux procédures de signalement. Si le repérage des signes de maltraitance est déjà présent dans le programme des formations70(*), celui-ci doit être amélioré, par exemple via des modules de formation obligatoires dans les certifications, afin de prendre en compte à la fois les situations de maltraitance intrafamiliales mais aussi et surtout les risques de maltraitances institutionnelles. Par ailleurs, en termes de contenu, il importe également d'améliorer, notamment pour le personnel encadrant, les connaissances et les compétences de management et d'apprentissage du travail en équipe.
Il importe en effet que dans le cadre d'une véritable diffusion d'une culture du signalement à des fins d'amélioration de la qualité, ces éléments soient maîtrisés par l'ensemble de la chaîne et non pas uniquement par les acteurs chargés du contrôle et de l'évaluation.
Plus généralement, tous les professionnels doivent pouvoir bénéficier d'une formation continue régulière et la régularité des séances d'analyse des pratiques professionnelles doit être révisée à la hausse. Depuis 2024, ce temps de retour et d'analyse fait l'objet d'une prise en charge par les CAF dans la limite de trois journées pédagogiques par an et par établissement. Toutefois, ces temps d'analyse sont encore, pour beaucoup de professionnels entendus, trop limités. Les rapporteurs estiment que cette mesure récente doit davantage être accompagnée sur le terrain par une prise en charge renforcée afin de faciliter son appropriation par les équipes et faire, dès que possible, l'objet d'un bilan.
Dans le cadre d'un objectif d'amélioration du repérage des situations dysfonctionnelles dans les établissements et d'une meilleure connaissance sur le développement de l'enfant et de la parentalité, le rôle du « Référent santé accueil inclusif » est essentiel. Leur action doit être soutenue par les pouvoirs publics pour guider et soutenir les équipes dans la prévention des risques mais aussi dans l'analyse a posteriori des événements indésirables qui ont pu avoir lieu.
Il apparaît également nécessaire de mieux former les responsables de structure à la fois au repérage des situations dysfonctionnelles et surtout à la gestion et à l'accompagnement des équipes. La question d'une formation continue obligatoire spécifique pour les responsables et porteurs de projet intégrant des éléments de connaissance de la réglementation et des procédures de contrôle, de développement de l'enfant et de management du personnel doit être étudiée.
Enfin, les périodes de stage au sein des structures au cours des formations doivent également être renforcées, notamment au regard de la montée en puissance des formations à distance71(*). Toutefois, la pénurie de professionnels rend de plus en plus difficile la prise en charge des stagiaires par les professionnels qui ne peuvent les accompagner dans de bonnes conditions, entraînant ainsi un cercle vicieux auquel il convient de mettre fin.
Les solutions concernant les conditions d'amélioration d'attractivité des métiers de la petite enfance sortent du champ de la mission et appellent des réponses en termes d'offre de formation72(*), de revalorisation financière et de taux d'encadrement des enfants. Les rapporteurs souhaitent souligner la mise en place dans les territoires de dispositifs innovants pour améliorer l'attrait et la connaissance des métiers de la petite enfance. Ainsi à Avrillé dans le Maine-et-Loire, la Mutualité française a pu ouvrir une micro-crèche dite « d'application » permettant aux élèves se formant aux métiers de la petite enfance de mettre en pratique les techniques et connaissances professionnelles apprises en formation.
Proposition n° 12 : Revoir le contenu des formations des professionnels de la petite enfance via la mise en place de certifications obligatoires visant à améliorer l'identification de toutes les situations de maltraitance, la connaissance des procédures de signalement et les connaissances relatives au développement et au bien-être de l'enfant.
C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE L'ÉVALUATION AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS
1. Renforcer la transparence des établissements et des résultats des contrôles
Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté le fossé qui a pu parfois se creuser entre les professionnels de crèche et les parents. Les professionnels souhaitent que leur engagement et leur expertise puissent être reconnus à leur juste valeur. Quant aux parents, ils souhaitent plus de transparence. En effet, la pénurie de places en crèche et la complexité du système d'accueil collectif issu d'une juxtaposition de dispositifs ne permettent pas aux parents de décider en pleine connaissance de cause de l'endroit où leur enfant va être accueilli. S'ajoute à cela la médiatisation de trop nombreux cas de maltraitance qui accentue la méfiance a priori sur certains établissements. Il y a besoin de transparence et d'une relation de confiance avec les professionnels chargés d'accueillir leurs enfants.
La publication d'informations claires sur les résultats des contrôles effectués et d'indicateurs objectifs relatifs à la qualité de l'accueil - comme le taux moyen d'accueil en surnombre, et le taux d'encadrement - participerait de ce nécessaire renforcement de la transparence73(*).
Plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne74(*) ou le Québec75(*), publient déjà l'intégralité des résultats et des rapports de l'autorité de contrôle. En France également, comme évoqué plus haut, les résultats des contrôles vétérinaires sont déjà accessibles en ligne à tous.
La publication des résultats, selon des modalités qui devront être définies avec l'ensemble des acteurs, permettra d'engager un cercle vertueux d'amélioration de la qualité de l'accueil, et ce sans tomber dans les travers d'un classement entre les établissements.
Ainsi, ces résultats pourraient, dans un premier temps et sur le modèle de ceux disponibles sur le site Alim'Confiance, ne concerner que les critères de sécurité et de respect des aspects réglementaires. Le fait, pour les parents, de pouvoir savoir si le lieu d'accueil de leur enfant respecte les critères exigibles s'inscrit dans une saine démarche de transparence et d'amélioration de la qualité et de la sécurité.
Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.
2. Renforcer le dispositif de signalement dans le secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes
Comme évoqué précédemment les gestionnaires ont mis en place des procédures de contrôle et de signalement internes afin de leur permettre d'apporter les réponses nécessaires en cas de comportement dysfonctionnel et de maltraitance notamment. Le groupe La Maison bleue a ainsi créé une ligne d'alerte destinée à son personnel en mai 2023 leur permettant d'alerter un « référent éthique » en dehors de la chaîne hiérarchique76(*). Le groupe People&Baby a quant à lui pu préciser aux rapporteurs le fonctionnement de sa plateforme de signalement mise en place en octobre 2024 et appelée « Integrity Line » permettant à tous les collaborateurs de signaler anonymement tout comportement inapproprié ou situation préoccupante auprès d'un organisme extérieur au groupe77(*). Le groupe a également précisé avoir enregistré sur la seule année 2024, 1962 « situations préoccupantes » dans ses établissements dont 3 ont été considérées comme « graves ». Enfin, on peut également citer la politique menée par la Mutualité française ou encore l'ADMR concernant la sensibilisation de ses personnels à la culture de la déclaration et à l'identification des événements indésirables.
Toutefois, ces procédures ne peuvent être un palliatif aux manquements de l'action publique. Des circuits de signalement et de remontée des alertes doivent être mis en place par les pouvoirs publics. Comme le préconise Mme Florence Dabin, présidente du département du Maine-et-Loire, ce système doit être réactif et harmonisé pour traiter efficacement les signalements dans les structures78(*).
En effet, les rapporteurs n'ont pu que constater les disparités entre les départements au regard, d'une part, des circuits de remontée des alertes et, d'autre part, du suivi et des actions entreprises à la suite de celles-ci. Ils font également le constat d'une véritable faiblesse concernant le suivi des suites données aux alertes.
La mise en place d'un système de remontée des signalements d'actes ou d'événements susceptibles d'entraîner un risque pour les enfants ou des cas de maltraitance sur le modèle de celui prévu à l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements médico-sociaux participerait inévitablement d'une amélioration du contrôle des établissements et de la qualité de l'accueil79(*).
Ces signalements pourraient être effectués auprès d'une instance pilotée par les services du département et ceux de la préfecture, afin d'assurer l'information et le traitement des situations de manière coordonnée.
Cette obligation de signalement pour les professionnels doit être accompagnée d'une obligation d'information des suites données au signalement. En effet, l'Association des maires de France a pu souligner lors de son audition que les maires ne sont pas toujours informés des suites données aux signalements qu'ils peuvent être amenés à réaliser. Cette absence de retour sur les actions entreprises auprès de l'auteur de l'alerte participe du manque d'effectivité des procédures de signalement et peut entraîner une sorte de « découragement » de la part des acteurs.
Par ailleurs, les rapporteurs ont été alertés au cours de leurs auditions que même les alertes émises par les services de PMI à la suite de leurs contrôles peuvent parfois ne pas être suivies d'action. En effet, si le médecin responsable de la PMI est destinataire de l'ensemble des rapports qu'il lui revient de valider, c'est en dernière instance le président du conseil départemental qui est décisionnaire quant aux observations ou injonctions qui doivent être transmises au gestionnaire. Face à l'impératif de protection des enfants, les rapporteurs regrettent que puissent encore parfois subsister la politique du « pas de vague » au motif notamment du manque de place d'accueil sur le territoire. Le dispositif de signalement et de recueil des événements indésirables graves que les rapporteurs appellent de leurs voeux devra également permettre le suivi des alertes émises par les services de contrôle et les actions entreprises à leur suite.
La déclaration d'un événement indésirable grave ne doit pas être assimilé par les professionnels comme une action préalable à une sanction de la part de l'autorité de contrôle mais comme une étape indispensable de la diminution des risques et de l'amélioration de la qualité. Conscients du phénomène de sous-déclaration de ces événements dans les secteurs où ces dispositifs existent, les rapports soulignent que le mauvais usage d'un outil ne doit pas conduire, lorsque celui-ci est pertinent, à son abandon mais au renforcement de son appropriation par les acteurs.
Une base commune d'événements devant faire l'objet d'une telle déclaration ainsi que le contenu de celle-ci doit parallèlement être mise en place afin d'harmoniser les pratiques80(*). Un temps d'analyse par les équipes des événements déclarés au sein de chaque établissement doit également être formalisé. Par ailleurs, la réglementation devra prévoir que les événements indésirables graves ne peuvent comporter de données nominatives.
L'instance mise en place au sein de chaque département aura aussi pour mission de recueillir les signalements de faits constitutifs de maltraitance au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle sera chargée, le cas échéant, de transmettre le signalement à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip) du département81(*). Elle devra aussi s'inscrire en pleine complémentarité avec le circuit existant de signalement d'urgence « Enfant en danger » aujourd'hui largement identifié par les acteurs, et en premier lieu les parents, via le numéro 119. La mise en place d'une telle organisation au sein des départements devra nécessairement être accompagnée par l'État et, le cas échéant, par les financements de la branche famille.
Circuit de signalement unifié en
établissement d'accueil du jeune enfant
proposé dans le
rapport de Mme Florence Dabin remis à la ministre de la famille
Source : Extrait du rapport de Mme Florence Dabin, Proposition d'un circuit sur le recueil des alertes dans les lieux d'accueil du jeune enfant, 3 octobre 2024
Ce système permettra de pouvoir disposer de statistiques régulières, au niveau départemental et agrégées au niveau national via la Drees, permettant d'améliorer le pilotage de l'action publique et le repérage des dysfonctionnements. Cela nécessite de disposer de logiciels de recueil des données complets assurant le partage des informations et allant au-delà de simples tableurs bureautiques en permettant une réelle supervision.
Enfin, le renouvellement de l'architecture du dispositif de signalement doit prévoir la mise en place, le cas échéant, d'un statut de « lanceur d'alerte » pour les auteurs de signalement. Cette protection supplémentaire, notamment pour les professionnels qui peuvent avoir peur de perdre leur emploi en cas de signalement, permettra d'assurer l'effectivité de ce dispositif.
Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG) à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.
3. Faire des familles des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des professionnels de la petite enfance
Les rapporteurs estiment que l'association des parents à la vie quotidienne des structures est un élément majeur de garantie de la qualité de l'accueil. Il ressort de la table ronde des associations familiales organisée par la mission que les familles ne sont tout simplement pas au courant des règles de fonctionnement des crèches, des réalités en termes de modalités de fonctionnement et de financement, ainsi que des contraintes quotidiennes et concrètes des métiers de la petite enfance. Ce qui est source d'incompréhensions et parfois même de tensions.
Si les parents ne peuvent et ne doivent pas être des agents chargés du contrôle ni se substituer aux professionnels, il semble important de renforcer leur implication dans le repérage des pratiques dysfonctionnelles. Ce renforcement implique de sensibiliser davantage les parents à la détection des signaux de maltraitance mais aussi à renforcer l'accompagnement dans la parentalité. À ce titre, il convient de faire du site Monenfant.fr la plateforme unique de diffusion des informations relatives à l'identification des signes de maltraitance. Concernant les relations contractuelles avec les gestionnaires d'établissements, il convient également de redonner à la plateforme SignalConso une place de premier plan et de mieux la faire connaître auprès des parents pour s'informer sur leurs droits et pour signaler des difficultés avec les gestionnaires82(*).
Les rapporteurs soutiennent les initiatives mises en place par plusieurs gestionnaires, notamment lucratifs, visant à offrir aux parents l'accès à une application permettant de signaler tout dysfonctionnement au sein des structures83(*). Il faut toutefois éviter que ces applications ne constituent qu'un outil de communication sans suivi des alertes. Surtout, comme ont pu le souligner les représentants de l'association Familles rurales lors de leur audition, il s'agit de ne pas renvoyer systématiquement vers internet au détriment du contact humain. Il apparaît essentiel de soutenir le rôle et la place des relais petite enfance sur le territoire pour que les familles puissent trouver des réponses à leurs questions ainsi que dialoguer et alerter le cas échéant sur des pratiques ou des situations suscitant leurs inquiétudes.
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont pu mesurer les difficultés rencontrées par les parents pour disposer d'une solution d'accueil, notamment en accueil collectif. L'enquête menée par l'Association des familles catholiques de France et l'ensemble des associations familiales entendues par la mission ont insisté sur la priorité donnée par les parents à la nécessité de trouver « un mode d'accueil abordable financièrement et proche géographiquement ». Face à la pénurie de places en accueil collectif et au reste à charge que ce type d'accueil peut entraîner en fonction de la structure ou du contrat, les familles priorisent ce besoin. Mais cela ne signifie pas que le contrôle et la qualité de l'accueil ne sont pas au coeur des préoccupations des parents. L'Union nationale des associations familiales de France a ainsi pu rappeler les attentes des parents concernant le retour des professionnels sur la manière dont s'est déroulée la journée de leur enfant et les progrès qu'il fait dans son développement. Ainsi, les « transmissions » en fin de journée ne peuvent être limitées à un échange s'apparentant à un compte rendu post-opératoire ; elles doivent répondre aux attentes des parents qui souhaitent des « détails très concrets et précis »84(*), leur permettant de se représenter « la vie de leur enfant dans la crèche »85(*).
La réglementation actuelle oblige les structures à proposer un projet éducatif et social intégrant les parents, en laissant toutefois aux établissements la liberté concernant la forme que peut prendre cette implication des parents sur le quotidien des établissements et leur gouvernance. Cette place accordée aux parents s'inscrit dans les principes énoncés par la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant qui appelle à impliquer « les parents dans la déclinaison des valeurs éducatives et en soutenant les relations parents-professionnels ». Au regard de la disponibilité que nécessite un conseil d'établissement, les rapporteurs estiment qu'il n'est pas pertinent, à ce stade, de le rendre obligatoire au risque d'apporter une charge administrative supplémentaire et de faire face à des difficultés de mobilisation des parents. Les difficultés rencontrées par les crèches parentales, au sein desquelles l'intégration des parents à la gouvernance constitue le coeur du modèle, en est le révélateur. Toutefois, lorsqu'ils existent, les conseils de crèche pourraient utilement transmettre les comptes rendus de leurs réunions aux partenaires chargés du contrôle, ce qui constituerait un facteur d'amélioration de l'information sur le territoire et de la connaissance de la vie et des problématiques des établissements.
Il importe de trouver les moyens d'assurer un climat de confiance et de respect entre les professionnels et les parents au service du bien-être des enfants. Ce climat de confiance passe par la mise en place de moments de convivialité renforcés (café, ateliers, outils de communication...) et par l'ouverture de la crèche aux parents. Ces temps d'échanges et la participation des parents au projet éducatif doivent pouvoir être soutenus et, le cas échéant, valorisés financièrement.
Reprenant une proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, les rapporteurs estiment nécessaire d'inclure dans les financements publics de la Cnaf une composante relative à la participation des parents au projet éducatif de la structure86(*).
Proposition n° 15 : Soutenir les actions visant à renforcer la participation des parents au fonctionnement des établissements en incluant dans les financements publics une composante relative à la participation des parents au projet pédagogique de la structure.
Enfin, dans le cadre de la mise en place du service public de la petite enfance qui fait des communes et intercommunalités les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, il convient de favoriser au niveau local la consultation et la participation des parents aux diagnostics locaux de recensement des besoins et de l'offre d'accueil et de soutien de la qualité des modes d'accueil (via des représentants des conseils de crèche lorsque ces derniers existent sur le territoire).
Le nécessaire accompagnement des
élus locaux dans leur nouveau rôle
d'autorité
organisatrice de l'accueil du jeune enfant
Les maires disposent de capacités de contrôle des établissements qui ont été récemment renforcées.
Dans le cadre d'un établissement géré en régie, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services dotés de l'autonomie financière doivent présenter annuellement un bilan d'activité à la commission consultative des services publics locaux.
Dans le cadre d'une délégation de service public, le gestionnaire doit a minima transmettre annuellement un rapport d'activité. Par ailleurs, le cahier des charges de la délégation peut déterminer d'autres modalités de contrôle (visites périodiques, objectifs, obligation de réaliser des audits externes à intervalles réguliers...).
Enfin, les communes ne sont pas totalement démunies non plus dans le cadre d'une gestion d'un établissement par convention avec une association. La subordination du versement de la subvention au respect des critères et objectifs dans le respect de la jurisprudence doit être généralisée.
L'article 18 de la loi pour le plein emploi fait de la commune l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Dans ce cadre, les élus doivent donner un avis avant toute création ou transformation d'un établissement de droit privé. Cette compétence est nécessaire au développement maîtrisé d'une offre d'accueil dans les territoires87(*). Toutefois, elle nécessite un indispensable accompagnement. Elle ne doit pas non plus constituer une simple couche supplémentaire complexifiant davantage le système pour les usagers au lieu de le rendre plus opérationnel. La qualité du dialogue entre l'autorité départementale d'autorisation et de contrôle et l'autorité organisatrice qui se prononcera sur la pertinence d'une implantation sera indispensable afin d'assurer la cohérence de l'action publique.
Relayant les inquiétudes exprimées en audition par l'Association des maires de France et Intercommunalités de France, les rapporteurs soulignent que cette responsabilité entrainera la mobilisation des moyens humains et des compétences nécessaires à l'établissement de référentiels permettant de qualifier sur une base solide les décisions des autorités organisatrices. Il s'agit d'éviter que des avis puissent par exemple être prononcés sur la base d'une position de principe de refus du privé lucratif.
Les élus doivent en effet pouvoir faire le choix de la qualité en toute connaissance de cause car ce sont eux qui, au final, devront justifier auprès des familles la création ou pas d'une crèche sur le territoire de la commune. Ce sont eux aussi qui feront face aux risques de recours de la part d'opérateurs ayant vu leur demande d'implantation refusée.
De manière générale, et notamment lorsque l'autorité organisatrice fait le choix d'une délégation de service public, les rapporteurs constatent que les élus sont trop souvent seuls face à des acteurs privés parfois agressifs dans leur approche commerciale et leur réponse au marché public.
Dès lors, il faut saluer le déploiement au sein des CAF, depuis septembre 2024, de 40 ETP, répartis au sein de 5 pôles régionaux, permettant un appui renforcé auprès des collectivités territoriales dans le déploiement du service public de la petite enfance et les aider à élaborer une offre d'accueil de qualité correspondant aux besoins spécifiques de leur territoire.
Les rapporteurs appellent la Cnaf à renforcer ce soutien aux collectivités notamment dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges lors des délégations de services publics (détermination du prix de revient88(*), connaissance des acteurs...). Ils saluent également l'émergence d'une offre de conseil dédiée à l'accompagnement des acteurs publics dans le secteur de la petite enfance.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 19 mars 2025, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport d'information de Mmes Laurence Muller-Bronn, Émilienne Poumirol et M. Olivier Henno, rapporteurs de la mission d'information sur l'efficacité du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant et sur ses éventuelles défaillances.
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, nous allons entendre la communication de Laurence Muller-Bronn, Émilienne Poumirol et Olivier Henno, à l'issue des travaux qu'ils ont conduits dans le cadre de la mission d'information sur l'efficacité du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) et sur ses éventuelles défaillances.
Cette mission d'information a été lancée le 9 octobre dernier, à la suite de l'audition de Victor Castanet, auteur du livre Les Ogres, afin de faire le point sur les outils de contrôle et leur coordination à l'échelon national. Le fait de cibler nos travaux devait nous permettre d'avancer relativement vite, compte tenu des contraintes de la période budgétaire, et d'éviter les redondances avec les missions conduites par d'autres instances.
Le livre de Victor Castanet a fait beaucoup réagir. Il est clair qu'il existe de grandes difficultés liées au contrôle des crèches, d'où les recommandations qui ont été formulées par nos collègues. J'espère que le Gouvernement s'en saisira.
Mme Laurence Muller-Bronn, rapporteure. - Le 2 octobre dernier, notre commission entendait Victor Castanet, à la suite de la parution de son livre d'enquête Les Ogres. Cet ouvrage-choc relate principalement les dysfonctionnements du groupe People&Baby et fait écho non seulement au rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, mais aussi à la commission d'enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements.
Ces travaux mettent tous en lumière les difficultés rencontrées par le secteur de l'accueil du jeune enfant. En outre, ils dénoncent des faits de maltraitance envers les enfants et la souffrance au travail des employés.
Dans un esprit de continuité, notre commission a souhaité se pencher sur la question de l'efficacité des contrôles des crèches, qu'elles soient publiques, privées non lucratives ou privées lucratives. Nos travaux n'étaient pas voués à dresser un énième bilan de la situation dans les crèches ou à analyser la pertinence de leur mode de financement. Nous n'avions pas non plus pour mandat de vérifier si tel ou tel grand groupe de crèches respecte bien les règles.
Notre mission a consisté à analyser l'efficacité du contrôle, son organisation et la pertinence des outils à disposition des autorités et à proposer, en réponse, des recommandations opérationnelles permettant d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants au sein des établissements.
Quel est le résultat de la présente mission d'information ? Après trois mois de travaux, une trentaine d'auditions et un déplacement en Maine-et-Loire, notre rapport fait état de fortes disparités territoriales dans le contrôle des établissements, d'un défaut de pilotage et de supervision à plusieurs niveaux et d'un contrôle encore trop hygiéniste et administratif, ne laissant que peu de place à l'accompagnement et au conseil des équipes.
Nous formulons ainsi quinze propositions destinées à améliorer l'efficacité des contrôles, au profit de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants.
Tout d'abord, les contrôles effectués sur les EAJE relèvent principalement de trois acteurs qui exercent tous leurs missions selon des fréquences, des champs d'action et des pouvoirs divers. Tout d'abord, les caisses d'allocations familiales (CAF) assurent un contrôle financier. Ainsi, elles veillent notamment au respect des règles de financement de la prestation de service unique (PSU).
Ensuite, les services de protection maternelle et infantile (PMI) ont pour mission, au sein des départements, de contrôler le respect des normes bâtimentaires et de sécurité et des règles d'encadrement. En outre, ils délivrent les autorisations d'ouverture des établissements.
Enfin, les services de l'État - essentiellement, les directions départementales de la protection des populations (DDPP) et les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - exercent un contrôle complémentaire via l'inspection du travail, la répression des fraudes et les services vétérinaires.
Nous avons fait le constat d'un sous-dimensionnement chronique des effectifs de ces acteurs. Ainsi, en 2023, le contrôle opéré par les CAF a concerné 2 241 établissements financés par la PSU, soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, 167 équivalents temps plein (ETP) moyens sont mobilisés annuellement par les CAF pour réaliser le contrôle de 13 000 établissements d'accueil collectif sur le territoire.
Le contrôle effectué par les CAF s'inscrit dans une procédure nationale répondant à des priorités fixées à l'échelle nationale. En conséquence, il est relativement homogène sur l'ensemble du territoire. Toutefois, ce contrôle reste majoritairement perçu par les acteurs de terrain comme étant extrêmement technique et excédant les moyens que certains gestionnaires, en particulier associatifs, peuvent mobiliser. Surtout, il n'a quasiment jamais de lien avec l'amélioration de la qualité de l'accueil.
C'est pourquoi, depuis l'an dernier, les CAF ont intégré dans leurs procédures de contrôle des éléments permettant d'identifier des signaux faibles de risque sur la qualité du service, comme l'analyse de postes de dépenses : achat de nourriture ou de couches, niveau de recours à l'intérim, etc. Si des points d'alerte sont relevés dans ce cadre, les CAF peuvent alerter les services de PMI.
Le contrôle exercé par les PMI souffre d'une absence de données à l'échelon national. En effet, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) n'a pas été capable de nous fournir les chiffres relatifs au nombre de contrôles réalisés sur l'ensemble du territoire. Ce manque de données est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI et au pilotage de l'action de contrôle.
De fait, le contrôle du respect des normes par les services de PMI souffre de trop grandes disparités entre les départements. Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance souhaitent un renforcement de la fréquence des contrôles effectués par les PMI, car ils demeurent trop rares, voire inexistants.
En 2024, la Mutualité française a recensé des territoires dans lesquels plus de 60 % de ses établissements avaient été contrôlés, tandis que d'autres territoires n'avaient connu aucun contrôle.
Par ailleurs, dans la continuité du rapport de l'Igas sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, nous ne pouvons que regretter l'absence, au sein des services de PMI, de personnel attaché au suivi et au contrôle des EAJE. Cela complique l'identification des acteurs par les professionnels, le suivi des dossiers et la cohérence de l'action de contrôle.
Enfin, nous n'avons pu que constater la quasi-invisibilité des services de l'État sur le terrain. Malgré leur engagement et l'expertise des services déconcentrés, les agents de l'État ne disposent tout simplement pas des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions. Pourtant, celles-ci sont indispensables pour réaliser un contrôle à 360 degrés des établissements.
Quelques chiffres : en 2021, 364 opérateurs de micro-crèches ont été contrôlés par les services de la répression des fraudes dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) ; en 2023, 408 actions de contrôle ont été réalisées par l'inspection du travail sur des établissements d'accueil gérés par une personne de droit privé et 849 établissements ont été contrôlés par les services vétérinaires ; la même année, 12 815 établissements financés par la PSU et 6 145 micro-crèches étaient recensés en France.
Nous avons été frappés par l'absence de pilotage de la politique de contrôle des établissements et par le manque de coordination entre les acteurs, malgré les améliorations apportées par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
En Maine-et-Loire, nous avons pu identifier des modèles de coordination entre les acteurs, grâce à la mise en place d'une plateforme de partage des données et des bonnes pratiques entre le département, la CAF et les services de l'État.
Force est de constater que ce genre de dispositif n'existe pas partout. Or nous sommes convaincus que l'absence de stratégie globale ou d'outils de supervision à l'échelle nationale rend presque impossible la mise en place d'un contrôle efficace et homogène sur l'ensemble du territoire.
Surtout, il n'existe aucun système de coordination et d'échange d'informations formalisé entre les services de différents départements sur la mission de contrôle des crèches. C'est là une faiblesse majeure du système de contrôle des gestionnaires d'établissements supra-départementaux.
Ainsi, nous appelons à la mise en place d'une plateforme nationale sécurisée d'échanges d'informations entre les différents services de PMI. Cela permettra d'identifier plus facilement ce qui relève d'un dysfonctionnement local et ce qui traduit une volonté d'abaisser la qualité d'accueil. Nous invitons également à renforcer les contrôles coordonnés entre les CAF, en direction des acteurs supra-départementaux, et à mobiliser, via des protocoles d'échanges d'informations, les administrations compétentes. Je pense en particulier à la direction générale des finances publiques (DGFiP) et aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité (Urssaf).
M. Olivier Henno, rapporteur. - La gouvernance du contrôle des établissements doit être encore largement améliorée, tout comme le contenu du contrôle. Il est temps de passer d'un contrôle centré sur l'hygiène et la sécurité à un accompagnement des équipes et à une évaluation de la qualité de l'accueil. En d'autres termes, nous devons passer d'un contrôle-sanction à un contrôle-amélioration.
Il est essentiel que le contrôle puisse être efficace, car le dysfonctionnement d'un acteur peut conduire à jeter l'opprobre sur l'ensemble des établissements, alors que la majorité d'entre eux accueillent les enfants avec bienveillance, dans un environnement de qualité.
Pour cela, il importe de fixer des règles claires et opposables à l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut juridique, sur tout le territoire. Un excès de normes et une interprétation des règles trop dépendantes du département ou du contrôleur sont préjudiciables aux relations entre les contrôleurs et les professionnels. De plus, cela entraîne parfois des conséquences opérationnelles importantes pour les gestionnaires.
Certains d'entre eux ont été contraints de modifier toute l'organisation de leurs ressources humaines, en raison de l'évolution de la demande d'une PMI sur la surveillance des siestes, ou de changer l'ensemble des matelas d'une structure au motif que ces derniers manquaient de fermeté.
Nous préconisons donc de fixer une grille nationale de contrôle, composée d'éléments objectivables, ainsi que des fiches d'auto-évaluation précises et homogènes à destination des professionnels.
Par ailleurs, nous appelons à la publication, dans les meilleurs délais, de l'ensemble des textes réglementaires attendus par les professionnels, en vue de sécuriser l'action des contrôleurs et des professionnels au sein des structures. Le décret établissant la liste des documents comptables et financiers devant être transmis par les groupes de crèches aux CAF chaque année n'est toujours pas paru, alors que l'entrée en vigueur de cette disposition était fixée au 1er janvier 2025. Il en est de même de l'arrêté relatif aux quantités minimales des repas servis en crèche, prévues depuis 2013.
Nous faisons tous le même constat dans nos départements : les services de PMI sont débordés en raison de la multiplication de leurs missions - prévention, agrément, suivi de la femme enceinte, santé infantile, accompagnement à la parentalité - et de la baisse de leurs effectifs, à hauteur de 400 ETP en dix ans sur l'ensemble du territoire.
Cette réalité oblige les PMI à fonctionner en flux tendu, ce qui rend très difficile la réalisation d'un contrôle de qualité, et presque impossible la mission d'accompagnement et d'évaluation. Par ailleurs, de nombreuses PMI sont asphyxiées par la seule gestion du flux des ouvertures de structures et rencontrent d'importantes difficultés à superviser le stock sur leur territoire.
Dans un tel contexte, préconiser l'augmentation de la fréquence des contrôles est un voeu pieux, d'autant que cette fréquence doit aussi dépendre d'une analyse de risques objective conduisant à contrôler certains établissements plus que d'autres.
Par ailleurs, nous pouvons tous convenir que l'expertise d'un médecin ou d'un éducateur est bien plus utile pour aider les équipes à améliorer leurs pratiques que pour mesurer la hauteur d'une poignée de porte ou la largeur de l'espace qui sépare deux barreaux de lit !
Dès lors, nous avons souhaité la mise en place d'un cadre juridique permanent qui permet au président du conseil départemental de déléguer à des organismes tiers certifiés le contrôle de la conformité au référentiel bâtimentaire d'un établissement. Le contrôle de ce référentiel lors de l'agrément d'un établissement pourrait être réalisé par un bureau d'étude externe. La branche famille pourra, le cas échéant, mobiliser les financements nécessaires à la mise en place de cette contractualisation.
Que les choses soient claires, il s'agit non pas de remettre en cause le pouvoir de contrôle des services départementaux ou d'attribuer un quelconque pouvoir de sanction à des organismes tiers, mais bien de laisser la décision aux autorités de contrôle, sur la base de rapports réalisés par des tiers.
Par ailleurs, la loi prévoit désormais que les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans font l'objet, tous les cinq ans, d'une évaluation.
Toutefois, à la différence du cadre prévu pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le législateur n'a pas prévu que cette évaluation quinquennale puisse être réalisée par des organismes extérieurs.
Or il nous semble que cela doit pouvoir être le cas. En effet, l'évaluation quinquennale de l'ensemble des établissements d'accueil représenterait une charge de travail supplémentaire trop lourde si elle devait être uniquement supportée par les services de PMI.
De plus, l'expertise de certains organismes de certification, comme l'Agence française de normalisation (Afnor) ou Bureau Veritas, est bien présente dans le secteur de la petite enfance depuis près d'une quinzaine d'années, via des certifications qui vont souvent au-delà des seules exigences réglementaires.
L'action des organismes extérieurs chargés de cette évaluation compléterait alors celle des autorités publiques. Les services de la PMI auraient ainsi plus de temps pour se recentrer sur leur coeur de métier, pour conseiller et accompagner les professionnels.
Enfin, il ne suffit pas d'améliorer les modalités de réaction des institutions, une fois les problèmes survenus : il convient, en plus, d'apporter des solutions préventives. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux la mise en place d'une certification professionnelle pour les agents chargés du contrôle des structures, afin d'améliorer la qualité du contrôle effectué et de sécuriser leur action.
Par ailleurs, la baisse des exigences de recrutement, au détriment de la qualité de l'encadrement des enfants, ne saurait être une réponse pertinente aux difficultés rencontrées par le secteur. Nous appelons à un renforcement de la formation des professionnels via des certifications visant à améliorer l'identification de la maltraitance et la connaissance des conditions du bien-être de l'enfant.
Nous souhaitons également la généralisation rapide du dispositif dématérialisé de contrôle des antécédents sur le site honorabilite.social.gouv.fr et l'expérimentation d'une carte professionnelle qui permette de reconnaître la qualité d'une expertise et le savoir-faire professionnel.
Du reste, j'évoquerai rapidement la place des familles. Il ne s'agit ni de faire des parents des agents du contrôle ni de créer une suspicion permanente. Toutefois, nous devons être conscients du fait que les parents, bien qu'extérieurs aux établissements, s'y déplacent régulièrement, parfois tous les jours. Or ils sont trop souvent mal informés de leurs règles de fonctionnement et de la réalité des conditions de travail des professionnels de la petite enfance.
En nous inscrivant dans une logique de confiance au service de la qualité de l'accueil, il nous semble important d'associer davantage les parents à la vie quotidienne des structures à l'occasion d'événements formels, tels que les réunions de rentrée ou les journées « crèche ouverte », et des moments de convivialité plus informels. À ce titre, les financements publics pourraient inclure une composante relative à la participation des parents au projet éducatif de la structure.
Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - Il me semble important de bien différencier les deux échelles de contrôle : le contrôle des établissements et celui des personnes morales qui contrôlent ces établissements.
Concernant les groupes de crèches privés, au sein desquels les scandales ont éclaté, il nous semble essentiel, compte tenu de l'ampleur des financements publics dans le secteur, de renforcer les outils à disposition des autorités publiques. Par exemple, le groupe Les Petits Chaperons rouges a indiqué que les financements publics de la CAF représentaient 28 % de son chiffre d'affaires.
L'Igas a réalisé un premier contrôle du groupe La Maison bleue, sur le fondement de l'article 18 de la loi pour le plein emploi. Les autres principaux acteurs du secteur seront par la suite contrôlés.
La caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a, de son côté, mis en place des procédures de contrôle des sièges qui s'accompagnent de sanctions pouvant s'appliquer à l'ensemble des établissements d'un groupe.
Nous devons attendre les résultats et, le cas échéant, agir en fonction des conclusions et des difficultés rencontrées. Nous pourrons ainsi déterminer s'il y a lieu d'encadrer plus fortement les prises de participation de fonds d'investissement et de fonds de dette au capital des entreprises de crèches.
Toutefois, nous préconisons, sans attendre, d'attribuer à la Cour des comptes les moyens de contrôler les groupes de crèches privés, sur le modèle des prérogatives dont elle dispose vis-à-vis des gestionnaires d'Ehpad. Cela permettra de vérifier que les financements publics servent exclusivement à l'amélioration de la qualité de l'accueil dans les établissements.
Par ailleurs, nous suggérons d'attribuer aux contrôleurs en action sociale des CAF le pouvoir de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés, afin de renforcer le caractère dissuasif du contrôle qu'ils exercent sur les établissements.
En cas de suspicion de manoeuvres frauduleuses, les CAF doivent aujourd'hui procéder à un dépôt de plainte. La procédure est complexe et lourde, en plus de limiter les moyens d'action et la réactivité des CAF.
Enfin, il est indispensable d'instaurer une véritable culture de l'évaluation auprès des acteurs. La complexité du système d'accueil du jeune enfant dans notre pays et la multiplication des scandales ont profondément abîmé la relation de confiance entre les professionnels et les parents. Pourtant, dans la très grande majorité des cas, que ce soit dans les micro-crèches ou dans les crèches classiques, privées ou publiques, les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions, par du personnel bienveillant et engagé.
Il nous semble opportun de publier le résultat des contrôles des établissements via une plateforme en ligne, comme le site monenfant.fr, sur le modèle du Nutri-Score. Des indicateurs objectifs de qualité pourraient également être publiés, comme le taux moyen d'encadrement ou d'accueil en surnombre. Pour rappel, le Royaume-Uni et le Québec publient déjà l'intégralité des résultats et des rapports des autorités de contrôle. En France, les résultats de l'ensemble des contrôles vétérinaires sont déjà disponibles sur la plateforme Alim'confiance.
Le fait pour les parents de savoir que le lieu d'accueil de leur enfant respecte les critères exigibles s'inscrit dans une saine démarche de transparence et d'amélioration à la fois de la qualité et de la sécurité.
Pour conclure, je dirai un mot des procédures de signalement lorsque des événements indésirables graves surviennent au sein des structures. Les procédures instituées en interne par les gestionnaires ne peuvent être un palliatif aux manquements de l'action publique. À cet égard, nous partageons les conclusions du rapport de Florence Dabin, présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire.
Compte tenu de la disparité des circuits de remontée des alertes, mais aussi du suivi et des actions entreprises, nous devons mettre en place un système de remontée des signalements d'actes de maltraitance, ou d'actes susceptibles d'entraîner un risque pour les enfants, sur le modèle des établissements médico-sociaux.
Cette obligation de signalement doit s'accompagner d'une obligation d'information quant aux suites données. Cela permettra de disposer de statistiques régulières dans le département, agrégées à l'échelon national, et d'améliorer le repérage des dysfonctionnements.
En conclusion, j'insiste une nouvelle fois sur la ligne de conduite que nous avons suivie. Notre objectif consistait non pas à pointer du doigt le vilain petit canard et à vouer aux gémonies les acteurs du contrôle, mais à apporter des solutions pragmatiques. Celles-ci doivent pouvoir autant profiter aux professionnels de la petite enfance qu'aux autorités de contrôle, en vue d'améliorer le bien-être des enfants.
Une grande partie de nos recommandations pourront faire l'objet, dans un second temps, d'une proposition de loi relative à l'amélioration de l'efficacité du contrôle des crèches.
Le présent rapport ne vise ni à dresser le bilan de la qualité de l'accueil dans les crèches ni à analyser les déterminants de son amélioration. Toutefois, il nous paraît important de souligner que l'amélioration de l'accueil des enfants dans notre pays passe par l'amélioration concrète de la qualité de vie au travail des professionnels et le renforcement des taux d'encadrement des enfants.
L'amélioration de la qualité de l'accueil ne pourra pas non plus faire l'économie d'une refonte globale du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants, qui entraîne une surcharge administrative excessive pour les professionnels, une course effrénée au remplissage des structures et, in fine, une perte de sens des métiers de la petite enfance.
Mme Corinne Bourcier. - Je remercie nos collègues d'avoir formulé des propositions détaillées et pragmatiques ; j'étais ravie de les accompagner lorsqu'ils sont venus dans mon département, le Maine-et-Loire.
Je suis tout à fait d'accord avec la cinquième recommandation : les services de PMI doivent pouvoir être libérés du contrôle bâtimentaire. Ainsi, ils pourront se recentrer sur leurs missions de soutien et d'accompagnement des EAJE. Par ailleurs, il convient d'accentuer les visites au sein des établissements, afin d'éviter les dysfonctionnements, comme les professionnels le demandent.
Il est impératif que les responsables des micro-crèches soient titulaires d'un diplôme spécialisé dans la petite enfance - éducateur spécialisé ou puériculteur -, afin d'assurer la sécurité des enfants. Ils doivent avoir une parfaite connaissance du jeune enfant, soutenir les équipes, assurer la formation pour garantir la qualité de l'accueil et conseiller les parents au quotidien.
En Maine-et-Loire, une plateforme a été mise en place en octobre 2023 pour partager les comptes rendus des contrôles avec le département, la Dreets et la CAF. En outre, un renforcement du rappel aux obligations est effectué lorsque les dysfonctionnements perdurent. Nous souhaitons également augmenter la prévention via une approche pédagogique lors des visites, pour garantir la qualité et la sécurité de l'accueil.
Compte tenu de ces éléments, quels moyens doit-on mettre en oeuvre pour aider les services de PMI à se recentrer sur leurs missions ? Quelles aides pourraient assurer la formation continue des professionnels ?
Mme Marion Canalès. - Ce travail était attendu et arrive à point nommé, en cette semaine nationale de la petite enfance et journée mondiale du travail social (JMTS). Le contrôle est le reflet de la compétence de l'entité qui l'exerce. Ainsi, les services de PMI vérifient la qualité de l'accueil, tandis que la CAF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la DGFiP contrôlent le financement public des établissements.
Il faudra se pencher sur la question du suivi, car les contrôles effectués restent parfois sans effet. Par ailleurs, il conviendrait de penser le contrôle du projet éducatif, afin d'améliorer la qualité du service rendu. Pour cela, il faut absolument dégager du temps pour les personnels, qui sont déjà en tension. Les travailleurs sociaux en mesure de réaliser les contrôles sont trop peu nombreux. En effet, on ne compte que 55 ETP à la Dreets et 167 ETP à la Cnaf.
Dans ces conditions, il convient d'utiliser les divers leviers de l'État, notamment les ARS, mais aussi l'inspection du travail, qui ne s'occupent que des établissements privés, et la DGFiP, qui contrôle les entreprises.
Le contrôle des financements publics se heurte à de nombreuses difficultés. C'est la raison pour laquelle vous préconisez de l'attribuer à la Cour des comptes. Comme vous, je regrette que le décret relatif aux documents comptables et financiers des crèches privées à but lucratif n'ait toujours pas été publié. Pourtant, l'obligation de communiquer ces documents a été débattue et votée en 2023, pour une entrée en vigueur en janvier 2025. Nous devrons sans doute interpeller le Gouvernement sur ce sujet.
Mme Florence Lassarade. - La baisse de la natalité qu'on observe actuellement ne va-t-elle pas modifier le fonctionnement des crèches et conduire à diminuer le nombre de personnels, comme à l'Éducation nationale ?
Cela fait vingt ans qu'on certifie les services hospitaliers. À l'origine, ce système était regardé d'un mauvais oeil, mais, aujourd'hui, il est perçu comme une aide. Serait-il possible de l'étendre aux crèches ? Une telle évolution serait bénéfique, d'autant que les certifications sont peu coûteuses puisqu'elles sont effectuées par des volontaires. Du reste, pensez-vous que les missions de certification pourraient inclure les pédiatres ?
Mme Élisabeth Doineau. - Le groupe Union Centriste se félicite de ce rapport, qui balaye des questions essentielles, à savoir le contrôle des établissements et la qualité de l'accueil. Il répond ainsi à l'attente des familles et à celle de l'ensemble des Français.
Le manque de coopération entre les différentes autorités de tutelle est un problème que j'ai vécu dans ma circonscription. En effet, ce n'est pas facile de mettre en commun les moyens de la CAF et ceux du département. Pourtant, ils se complètent.
Le principal objectif est d'apporter une réponse aux familles, ce qui suppose un travail commun. À cet égard, les comités départementaux des services aux familles fonctionnent plus ou moins bien selon les territoires.
Dans ma circonscription, le département et la CAF avaient, chacun de leur côté, créé une plateforme en ligne indiquant le nombre d'assistants maternels disponibles pour l'accueil des enfants : c'est absurde ! Le temps est venu de mutualiser les moyens, surtout que les effectifs des instances sociales n'augmenteront pas dans les années à venir.
Au demeurant, je souscris pleinement à vos propositions en matière de qualité et de transparence. Reste que le décret relatif aux règles d'encadrement et sur lequel nombre d'entre nous ont été alertés, qui aura un impact sur les micro-crèches, fait peur à tous les gestionnaires concernés. En effet, ces derniers ont déjà du mal à faire tenir leur modèle économique. Beaucoup de ces structures font faillite, même dans une grande ville comme Montrouge. La semaine dernière, la gestionnaire de l'un de ces établissements m'a indiqué qu'elle se versait un salaire de 500 euros par mois, tant les difficultés économiques sont fortes.
Il est bon de vérifier si les normes sont respectées, mais nous devons aussi veiller à accompagner les micro-crèches, qui demeurent fragiles à l'heure actuelle.
Mme Frédérique Puissat. - Les missions d'information transpartisanes, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, ne peuvent qu'éclairer les élus des territoires.
Vous dressez un constat clair qui ne surprend personne : peu de contrôles sont menés et les quelques contrôles existants sont très disparates d'un territoire à l'autre. Je vous remercie d'avoir proposé des solutions réalistes, à l'heure où l'État et les départements ont peu de marges de manoeuvre, compte tenu du budget qui a été voté cet hiver.
Le décret évoqué par Élisabeth Doineau ne me choque pas, étant donné les recommandations qui ont été formulées par les rapporteurs en matière de contrôle.
Par ailleurs, les parents jouent un rôle important dans les crèches, quoique délicat, car ils sont parfois amenés à critiquer les conditions d'accueil. Avez-vous creusé cet aspect-là ? Peut-on protéger les enfants en cas d'alerte, en les transférant, par exemple, dans d'autres structures ? Notons que les parents gèrent souvent des structures associatives, qui se révèlent précieuses pour les territoires.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Vos propositions ne sont pas déconnectées puisqu'elles répondent précisément à diverses demandes ; elles font d'ailleurs écho aux suggestions formulées par l'Igas.
Au sein de notre commission, l'enfance ne constitue pas un sujet clivant. En effet, nous souhaitons tous que nos enfants grandissent bien et soient accueillis dans les meilleures conditions au sein de divers lieux de garde. Cela n'empêche pas notre groupe de plaider, depuis plusieurs années, pour la mise en place d'un véritable service public de la petite enfance.
La ministre Catherine Vautrin nous a alertés sur une baisse de la natalité significative dans notre pays. De nombreux jeunes nés en 1989 et 1990 ne souhaitent pas avoir d'enfants.
Parmi les facteurs qui contribuent à la baisse de la natalité, on peut citer les modes de garde. En région parisienne, notamment, il est difficile de trouver une place en crèche, sans parler de l'accès au logement.
La qualité de l'accueil des enfants au sein des établissements est un sujet essentiel. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup plus de contrôles. Toutefois, on manque de personnels pour les effectuer.
Les contrôles devraient être davantage regardés comme une aide, plutôt que comme un outil servant à dénoncer les conditions d'hygiène. Certes, dans certaines crèches privées, les bénéfices comptent plus que les enfants, mais, dans la grande majorité des cas, les professionnels de la petite effectuent leurs missions avec beaucoup de bienveillance.
Quant aux cartes professionnelles, elles sont indispensables. Il faudrait cependant évoquer la question des salaires, qui, à mes yeux, ne sont pas à la hauteur des missions réalisées par les travailleurs sociaux.
Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue Frédérique Puissat : ce genre de rapport d'information transpartisan, qui repose sur un travail conjoint et approfondi, nous sera particulièrement utile.
Mme Chantal Deseyne. - Avez-vous mesuré, en marge de cette mission d'information, si le besoin en personnel qualifié était couvert ? Le manque d'effectifs est souvent cause de dysfonctionnements et provoque parfois la dégradation de la qualité d'accueil.
En effet, lorsqu'un professionnel est absent et n'est pas remplacé, la crèche, qu'elle soit privée ou publique, invite souvent les parents qui le peuvent à garder leur enfant.
Mme Laurence Muller-Bronn, rapporteure. - Deux contrôles apparaissent prioritaires : d'une part, le contrôle financier, qui est justifié par l'existence de nombreuses dérives et l'enrichissement de certains opérateurs privés avec de l'argent public ; d'autre part, le contrôle de la qualité du travail et de l'accueil des enfants.
Nous vivons un moment particulier, où beaucoup de choses se croisent dans le secteur de la petite enfance : le décret relatif règles d'encadrement des micro-crèches sera effectif en septembre 2026 et, par ailleurs, les communes sont désignées comme autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant.
J'en viens à la formation. Nous savons que les micro-crèches de moins de douze berceaux n'ont pas les mêmes obligations de recrutement de personnels diplômés que les crèches classiques. Si ce mode de garde s'est développé dans les territoires, c'est parce qu'il répond à un besoin particulier. En outre, nous constatons qu'il satisfait souvent les élus locaux.
Souvent, les micro-crèches font partie d'un groupe d'établissements franchisés. On peut estimer que le modèle économique des micro-crèches est réellement équilibré à partir de six structures en gestion. Cette « taille critique » permet de recruter plus facilement le personnel diplômé nécessaire. Ainsi, le fait de morceler la garde d'enfants en plusieurs petites structures peut aussi être une manière de disperser le personnel et d'amortir les coûts de revient.
Les services de PMI du Bas-Rhin m'ont fait part d'un certain nombre de difficultés. Notamment, les CAF sont poussées, à l'échelle nationale, à soutenir massivement l'ouverture d'un grand nombre de structures d'accueil, quitte, selon les professionnels avec lesquels j'ai pu échanger, à faire tomber certaines barrières de prudence. En conséquence, les PMI leur courent après. Elles ne peuvent plus se déplacer qu'en cas d'alerte, si bien que les contrôles ne sont pas réalisés de manière récurrente.
Il est impératif de trouver davantage de moyens et de former des professionnels, car les crèches assurent un accompagnement humain. Un enfant n'est peut-être pas innovant, à l'instar de l'intelligence artificielle, qui capte tous les investissements, mais il constitue la subsistance de la civilisation. Trouver ces moyens serait aussi une façon de reconnaître comme essentiels les professionnels de l'enfance.
Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'expérience d'une plateforme commune entre l'État, la CAF et les services de PMI que nous avons pu observer dans le Maine-et-Loire devrait être reproduite dans tous les départements, car les alertes sont lancées très rapidement et seulement à partir de signaux faibles.
Les PMI sont dépassées depuis plusieurs années par un manque de personnel chronique, la création de nouvelles structures d'accueil et les contrôles bâtimentaires, lesquels sont parfaitement ridicules : un médecin de PMI ne devrait pas avoir à vérifier la largeur entre les barreaux d'un berceau !
Encore une fois, il faut laisser ces sujets à des experts et libérer du temps pour les PMI, afin qu'elles se concentrent sur l'accompagnement et le contrôle de la qualité de l'accueil, ce qui constitue leur réelle plus-value. La formation du personnel est très importante, de même que le renforcement de l'attractivité du métier, au travers du salaire et surtout des conditions de travail.
Pour répondre à notre collègue Marion Canalès, le rôle des ARS n'a été clarifié que depuis la mise en oeuvre de la loi pour le plein emploi. Il existait en effet avant une incertitude sur la possibilité pour le préfet de mobiliser, sur ce type de contrôle, les agents des ARS, par ailleurs déjà sollicités sur de nombreuses autres missions. Cela reste donc relativement récent et nous n'avons pas eu écho, à ce stade, de la mise en oeuvre d'une telle coopération. Du reste, nous sommes favorables à ce que les services de PMI, s'ils ont suffisamment de temps, discutent du projet éducatif avec les équipes concernées.
La Cnaf est très mobilisée sur le plan national pour assurer le contrôle du financement public des grands groupes de crèches. Elle a recruté un certain nombre d'experts à cette fin et procède déjà à des contrôles au niveau des sièges des groupes et notamment de People&Baby.
La complexité même de la PSU entame le temps des responsables des crèches, qui feraient mieux d'être auprès des enfants et de leur équipe. Or qui dit complexité, dit contournement du modèle.
Concernant le contrôle des grands opérateurs privés, nous devrons aller plus loin, car ils parviennent encore à réaliser d'importants bénéfices financés en grande partie par de l'argent public.
Madame Lassarade, ce n'est pas parce que nous constatons une baisse de la natalité que nous devons anticiper une réduction des effectifs, d'autant que l'accueil en structures n'est pas majoritaire parmi les modes de garde et que la demande continue de s'accroitre.
Les PMI verront le processus de certification comme un soulagement, puisqu'elles pourront se concentrer sur le contrôle de la qualité d'accueil.
Il est normal que l'enfant, quel que soit l'endroit où il est accueilli, ait le droit d'être suivi par le même type de personnel qualifié. N'ayons donc pas peur du décret qui affectera les micro-crèches.
Au demeurant, l'âge d'or de People&Baby, des Petits Chaperons rouges, de Babilou et de La Maison bleue est révolu. Ces groupes rencontrent des difficultés à ouvrir de nouvelles places. Par ailleurs, compte tenu du nombre et du champ des contrôles effectués aujourd'hui, ces groupes auront plus de difficultés à réaliser des bénéfices au détriment de la qualité de l'accueil des enfants.
La création de conseils de crèches est intéressante, car ces derniers permettent aux parents de participer à la vie de l'établissement et d'assurer un suivi régulier. Toutefois, la question de la disponibilité des parents se pose.
J'entends les propos de notre collègue Apourceau-Poly sur le service public de la petite enfance. On déplore aujourd'hui un manque d'objectifs généraux et de règles communes, d'où la nécessité de réfléchir à un pilotage national.
Enfin, a-t-on suffisamment de personnels qualifiés ? Il y a en effet beaucoup de postes vacants, en raison des difficultés de recrutement. Cela doit nous amener à réfléchir à la question de l'attractivité des métiers.
M. Olivier Henno, rapporteur. - Je précise, à l'intention de Corinne Bourcier, que nous misons beaucoup sur la grille nationale de contrôle et les fiches d'auto-évaluation : elles permettront d'atténuer les disparités dans le mode de fonctionnement et la qualité même des contrôles.
Deux modèles coexistent : celui de la PSU et celui de la Paje, qui inclut les familles, la CAF et les groupes privés. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce second modèle, car cela entraînerait la fermeture de nombreuses structures. Néanmoins, nous devons accentuer les contrôles, comme pour les Ehpad. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un engagement fort de la part de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Surtout, il faut inverser la logique du contrôle pour l'orienter vers l'accompagnement et la qualité. Finissons-en avec les contrôles à l'ancienne, où l'on tremble quand les évaluateurs arrivent et on souffle quand ils repartent : ce n'est absolument pas productif !
Le modèle mis en place en Maine-et-Loire est intéressant pour assurer la coopération des différents acteurs concernés, d'autant que l'on constate une disparité entre les moyens significatifs dont disposent les CAF et les faibles moyens des PMI, qui varient d'un endroit à un autre et s'ajoutent au manque de personnels.
La place des parents au sein des crèches est un atout. Il s'agit non pas de permettre aux parents d'être intrusifs à l'excès, mais d'accompagner et d'encadrer la volonté de participation. Force est de constater qu'il y a moins de dérives au sein de ces établissements que dans les Ehpad, car les parents s'y rendent tous les jours.
Malgré notre souhait d'augmenter les contrôles, les personnels manquent pour les effectuer. D'ailleurs, beaucoup de départs en retraite ne seront pas remplacés, ce qui n'arrangera pas les choses.
Concernant le décret précité et la situation des micro-crèches, il faut se méfier des injonctions contradictoires. On ne peut pas vouloir améliorer la qualité de l'accueil et, en même temps, ne pas être exigeant sur la formation et les diplômes. Il y va de la valorisation du métier.
Si les contrôles sont moins disparates, plus qualitatifs, cohérents et mieux centrés sur l'accompagnement, notre mission d'information aura été utile.
M. Philippe Mouiller, président. - Nous avons déclenché une série d'échanges avec la Cour des comptes et nous pousserons l'initiative parlementaire pour réaliser des contrôles dans les groupes de crèches privés, la loi ne permettant toujours pas d'aller au bout de la démarche.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Auditions
· Comité de filière « Petite enfance »
Élisabeth Laithier, présidente
Jean-Baptiste Frossard, secrétaire général
Élisa Bazin, secrétaire générale adjointe
· Fédération française des entreprises de crèches (FFEC)
Jérôme Obry, président
Elsa Hervy, déléguée générale
· Association des maires de France (AMF)
Clotilde Robin, co-présidente du groupe de travail petite enfance de l'AMF et 1ère adjointe au maire de Roanne (42)
Nelly Jacquemot, responsable du département action sociale, éducation, culture et santé
Sarah Reilly, conseillère chargée de la petite enfance
Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
· Intercommunalités de France
Anne Terlez, vice-présidente
· La Maison bleue
Claire Laot, directrice générale
· Les Petits Chaperons rouges
Sacha Tikhomiroff, directeur général France
· Babilou
Vincent Bulan, directeur général
· People&Baby
Cédric Dugardin, directeur général
Marie Morchin, responsable du pôle pédagogie
Stéphanie De Haldat, consultante chargée de la transformation du groupe
· Collectif Assurer l'avenir de la PMI
Pierre Suesser, co-président
Peggy Alonso, puéricultrice et présidente de l'association nationale des puéricultrices et des étudiantes (ANPDE)
Géraldine Goure, psychologue et représentante de l'association nationale des psychologues pour la petite enfance (ANAPSYpe)
Élisabeth Jude-Lafitte, médecin de PMI et membre du bureau du SNMPMI
· Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP)
Philippe Dupuy, directeur
· Syndicat national des professionnel.le.s de la petite enfance (SNPPE)
Véronique Escames, co-secrétaire générale
· Collectif Pas de bébés à la consigne
Émilie Philippe, porte-parole du collectif
· Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE)
Julie Marty Pichon, coprésidente
· Inspection générale des affaires sociales (Igas)
Dr Nicole Bohic
· Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
Nicolas Grivel, directeur général
Vincent Nicolle, sous-directeur chargé de l'action sociale familiales et sociales
Klara Le Corre, chargée des relations institutionnelles
· Union des associations familiales (Unaf)
Véronique Demaizières, administratrice de l'Unaf chargée de la petite enfance
Patricia Humann, coordonnatrice du pôle École-Petite enfance-Jeunesse
Claire Ménard, chargée des relations parlementaires
· Familles de France
Jacqueline Delannoy, administratrice et responsable du pôle vie associative et vie fédérale
Gabrielle Parisot, chargée de mission pôle vie associative, vie fédérale et responsable des services
· Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC)
Dr Pascale Morinière, présidente
Jérôme Husson, délégué général
· Union des familles laïques (UFAL)
Nicolas Gavrilenko, président
Jean-Louis Haurie, délégué national aux politiques familiales
· Familles rurales
Rita Ciccarella-Vanderbeke, membre du conseil d'administration
Mickaël Philippe, conseiller technique solidarité et cohésion sociale
· Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Jean-Benoît Dujol, directeur général
Pauline Domingo, sous-directrice du service enfance et famille
· Direction de la sécurité sociale (DSS)
Jean-Baptiste Frossard, directeur du projet service public de la petite enfance
Élisa Bazin, adjointe au directeur du projet SPPE
· Mairie de Paris
Johanne Kouassi, conseillère déléguée chargée de la petite enfance, des services publics de proximité et des relations avec les arrondissements auprès de Patrick Bloche, premier adjoint à la Maire de Paris
Emmanuelle Leroch, collaboratrice auprès de Patrick Bloche
· Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)
Sylviane Giampino, présidente
· Départements de France (ADF)
Marie-Paule Chesneau, vice-présidente enfance de Maine-et-Loire
Julie Ducoin, vice- présidente enfance de la Mayenne
· Mutualité française (FNMF)
Agnès Blondeau, responsable petite enfance
Anaïs Rodrigues, chargée d'affaires publiques
Contributions écrites
· Cour des Comptes (M. Bernard Lejeune, président de la 6ème chambre)
· Mme Florence Dabin, présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire, auteure du rapport sur les circuits de signalement de la maltraitance dans les lieux d'accueil du jeune enfant, présidente du GIP France enfance protégée
· Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
· Direction générale du travail (DGT)
· Direction générale de l'alimentation (DGAL)
· Direction générale des finances publiques (DGFiP)
· Regroupement des entreprises de micro-crèches (R.E.Mi)
· Union nationale ADMR (aide à domicile en milieu rural)
· Collectif national des assistants maternels en crèche familiale (CNAMCF)
· Horizon Crèche
· Bureau Veritas
· SGS-ICS France
· Afnor Certification
DÉPLACEMENT
Déplacement à
Angers
(jeudi 6 mars 2025)
À Angers (Préfecture du Maine-et-Loire)
Accueil par Philippe Chopin, préfet.
Table ronde avec les autorités de contrôle sur la coordination de leurs actions : Wilfrid Pélissier, directeur de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Éric David, directeur de la direction départementale de la protection des populations, Cécile Bonamy, directrice de la CAF49, Nathalie Gilles, directrice de l'action sociale, Carine Boumard, contrôleure, Marie-Paule Chesneau, vice-présidente du département, Anne-Sophie Abgrall, directrice générale adjointe, Priscille Sage, directrice santé, Sylvie Cottenceau, responsable unité mode d'accueil périnatalité et planification familiale.
À Avrillé
Visite de la micro-crèche d'application Les Buissonnets et entretien avec :
- Anaïs Perelman, directrice adjointe de la direction de la prévention et de l'accompagnement mutualiste, Anaïs Rodrigues, chargée d'affaires publiques de la Mutualité française ;
- Guy Piétin, vice-président, Sandrine Boyer, directrice adjointe, Étienne Le Mière, directeur de la petite enfance de VYV3 Pays-de-La-Loire ;
- Anne Méchine, responsable de la structure.
À Angers
Déjeuner de travail à l'hôtel de ville avec Pascale Mitonneau, adjointe à la petite enfance, Augustine Yecke, conseillère déléguée à la petite enfance, Pierre-Antoine Ragueneau, directeur général adjoint, et Sylvain Cherre, directeur de la petite enfance.
Visite de la crèche multi-accueil de La Roseraie et entretien avec les équipes et des représentants de la ville : Pascale Mitonneau, adjointe à la petite enfance, Augustine Yecke, conseillère déléguée à la petite enfance, Sylvain Cherre, directeur de la petite enfance, Arnaud Guillou, responsable du service ressources, Aurélie Phung, directrice de la crèche, Marie-Claude Plot, éducatrice de jeunes enfants, et Nadine Lequeux, directrice de crèche.
Échanges avec Florence Dabin, présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire.
TABLEAU DE MISE
EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Support |
|
1 |
Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements |
Gouvernement / département / CAF |
Circulaires |
|
2 |
Créer une plateforme nationale d'échanges d'informations entre les services de PMI afin d'améliorer le partage des compétences, l'harmonisation des pratiques et l'identification des situations ou des structures à risques |
Parlement / Gouvernement / départements |
Textes législatif et réglementaire |
|
3 |
Renforcer les contrôles coordonnés entre CAF ciblant des gestionnaires de structures implantés à une échelle supra-départementale |
Cnaf / CAF / Gouvernement |
Convention d'objectifs et de gestion |
|
4 |
Établir une véritable grille opposable d'évaluation nationale afin de garantir un niveau de contrôle comparable partout sur le territoire et éviter les « surtranspositions » de normes |
Gouvernement |
Textes réglementaires |
|
5 |
Permettre aux départements de déléguer, dans le cadre d'une contractualisation avec les organismes débiteurs de prestations familiales, le contrôle du respect des normes du référentiel bâtimentaire à des organismes tiers certifiés |
Parlement |
Texte législatif |
|
6 |
Permettre à des organismes tiers certifiés de procéder aux évaluations quinquennales prévues par l'article L. 2324-2-4 du code de la santé publique |
Parlement |
Texte législatif |
|
7 |
Mettre en place une certification professionnelle des agents chargés du contrôle au sein des PMI par le Centre national de la fonction publique territoriale afin de renforcer les compétences et la formation continue des professionnels |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
8 |
Donner à la Cour des comptes le pouvoir de contrôler les groupes privés de crèche sur le modèle des prérogatives dont elle dispose concernant les ESSMS |
Parlement |
Texte législatif |
|
9 |
Habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'informations précontractuelles et contractuelles |
Parlement |
Texte législatif |
|
10 |
Permettre aux contrôleurs en action sociale des CAF de qualifier directement de frauduleux les comportements constatés et de bénéficier d'une assermentation dans le cadre de leurs contrôles |
Parlement |
Texte législatif |
|
11 |
Créer une carte de qualification professionnelle permettant de certifier les qualifications des employés sur le modèle de la carte prévue à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées |
Parlement |
Texte législatif |
|
12 |
Revoir le contenu des formations des professionnels de la petite enfance via la mise en place de certifications obligatoires visant à améliorer l'identification de toutes les situations de maltraitance, la connaissance des procédures de signalement et les connaissances relatives au développement et au bien-être de l'enfant |
Gouvernement |
Textes réglementaires |
|
13 |
Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne |
Parlement |
Texte législatif |
|
14 |
Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG) à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux |
Parlement |
Texte législatif |
|
15 |
Soutenir les actions visant à renforcer la participation des parents au fonctionnement des établissements en incluant dans les financements publics une composante relative à la participation des parents au projet pédagogique de la structure |
Gouvernement / Cnaf / CAF |
Convention d'objectifs et de gestion |
ANNEXE
Audition de
M. Victor Castanet, auteur de l'ouvrage Les Ogres,
devant la
commission des affaires sociales
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, nous allons entendre à présent le journaliste Victor Castanet.
Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo, retransmise en direct sur le site du Sénat. Elle sera disponible en vidéo à la demande et est ouverte à la presse.
Monsieur Castanet, nous avons souhaité vous entendre quelques jours après la parution, le 18 septembre dernier, de votre livre intitulé Les Ogres. Cet ouvrage, consacré principalement à un des leaders français du secteur des crèches privées People&Baby, a mis en lumière les conséquences d'un système d'optimisation des coûts, parfois au détriment de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants : ce que vous appelez le « syndrome Ryanair ». À ce titre, les récits de maltraitance sur les enfants, mais également de souffrance au travail des employés décrits dans votre livre sont glaçants.
Votre ouvrage s'intéresse également à la question des contrôles effectués par les centres de protection maternelle et infantile (PMI) et les caisses d'allocations familiales (CAF), ainsi qu'à l'absence de pilotage national dans ce domaine. Enfin, il pointe du doigt un système de financement extrêmement complexe, « indétricotable » selon vous, qui interroge les parlementaires que nous sommes sur le bon emploi de l'argent public.
Monsieur Castanet, après votre propos liminaire, les membres de la commission vous interrogeront, en premier lieu Olivier Henno, rapporteur pour la branche « famille ».
M. Victor Castanet, auteur de l'ouvrage Les Ogres - Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir organisé cette audition et de porter par là même ce sujet majeur de la petite enfance.
Ce n'est pas dans mon habitude, mais je commencerai par un propos qui pourrait être perçu comme politique. Dans cette enquête, des centaines de témoins mettent au jour un vaste système de maltraitance, qui se déploie au détriment des contribuables, des salariés des crèches et surtout de nos enfants, avec des séquelles qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, voire pendant une vie entière, qu'il s'agisse de problèmes de sociabilisation, des rapports aux autres et notamment à l'adulte, de syndromes post-traumatiques ou encore de retards, notamment au niveau du langage et de la propreté.
Nous ne rappellerons jamais à quel point les 1 000 premiers jours de nos enfants sont déterminants pour leur vie future. Au-delà des irrégularités dont je dresse une liste non exhaustive - politique de suroccupation, non-respect des ratios d'encadrement, pratiques commerciales trompeuses, clauses contractuelles abusives, montages immobiliers, non-paiement des fournisseurs, dynamique du low cost -, j'ai été amené à rencontrer dans toute la France des familles dont les enfants avaient été affectés par des dysfonctionnements graves et/ou des faits de maltraitance. Le drame de Lyon, qui a entraîné la mort d'un nourrisson de onze mois en juin 2022, est le cas le plus tragique ; mais je pense également aux neuf enfants de la crèche de Villeneuve d'Ascq concernés par des faits de maltraitance et de privation de nourriture ; je pense au petit Elias à Metz, que ses parents ont retrouvé l'oeil ensanglanté ; je pense à Ismaël, à Paris, que sa mère a découvert avec des traces de coups et de griffures. À Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Dijon, à Dreux et dans tant d'autres villes, des parents et des professionnels de la petite enfance m'ont rapporté des défaillances graves.
La régularité de ces incidents doit nous alerter. Au-delà des dérives d'un groupe, la dynamique du low cost impulsée par trois grands acteurs - People&Baby, Les Petits Chaperons rouges et La Maison bleue - a entraîné une dégradation continue des conditions de travail et de la qualité d'accueil, avec la complicité de nombreuses villes, collectivités territoriales et ministères. Partout, on a fait le choix du moins cher et donc du moins-disant. Le mode de financement pensé par l'administration, la fameuse prestation de service unique (PSU), a participé de cette dégradation en se focalisant uniquement sur des critères financiers et d'occupation, négligeant ainsi les questions de qualité.
Depuis la publication de mon enquête, des adjoints à la petite enfance de six grandes villes - Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Lille et Bordeaux - ont organisé une conférence de presse pour dénoncer cette dynamique du low cost et demander la remise à plat du mode de financement. Des syndicats tels que la CGT ont lancé un appel à la grève, des organisations du secteur tels que le syndicat national des professionnels de la petite enfance se sont mobilisés, des parlementaires socialistes, écologistes et insoumis se sont positionnés sur le sujet en procédant à des auditions ou en créant des groupes de travail dédiés aux problématiques des crèches.
En revanche, du côté de l'exécutif et plus globalement de la majorité présidentielle, rien, aucun signe, pas un mot. La ministre en place, Agnès Canayer, nommée depuis une dizaine de jours, n'a pas eu une expression publique sur le sujet ; aucune enquête de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ou de l'inspection générale des finances (IGF) n'a été diligentée ; la direction de People & Baby n'a pas été convoquée, ni aucun autre acteur du secteur ; les autorités de contrôle, les PMI (protection maternelle et infantile) et les CAF (caisses d'allocations familiales ) n'ont pas été questionnées : pourquoi ? De plus en plus de professionnels et de familles s'étonnent de ce silence assourdissant. Ce sujet ne peut pas faire l'objet de querelles politiciennes ou d'intérêts partisans : que l'on soit de droite, de gauche ou du centre, il nous concerne tous. Il y va de la sécurité et du bien-être de nos enfants.
M. Philippe Mouiller, président. - Merci pour ces propos liminaires qui dressent le tableau de la situation. Je sais que la ministre Agnès Canayer suit nos travaux et je pense que vous aurez très rapidement de ses nouvelles.
M. Olivier Henno, rapporteur pour la branche « famille ». - Le point commun des Fossoyeurs et des Ogres est qu'ils concernent les personnes les plus fragiles de notre société, vers lesquelles l'action publique doit être dirigée en priorité. D'autres livres, tels que celui d'Aziliz Le Corre - L'Enfant est l'avenir de l'homme : la réponse d'une mère au mouvement « No kids » - traitent de la question du désir d'enfants, lié à des problématiques concrètes comme la garde d'enfants, qui est centrale et qui doit rassurer les parents.
Je tiens à saluer l'organisation de cette audition, qui pourrait se prolonger sous la forme d'une mission d'information ou d'une commission d'enquête.
La première de mes interrogations a trait au financement. En termes quantitatifs, la branche famille de la sécurité sociale a consacré, en 2023, 5,3 milliards d'euros aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), auxquels s'ajoutent une augmentation de 1,5 milliard d'euros des financements du Fonds national d'action sociale (Fnas) d'ici à 2027, ainsi que les crédits d'impôt - comme le crédit d'impôt famille (Cifam) - et les financements du bloc communal, à hauteur de 4 milliards d'euros environ. Il n'est donc pas possible d'affirmer que nous ne consacrons pas d'argent public à la petite enfance. Quel regard portez-vous sur ce mode de financement ? Faut-il le revoir en profondeur ?
S'agissant du personnel et de la réglementation applicable, il manque déjà au moins 10 000 professionnels et les départs à la retraite ne faciliteront pas une situation assez grave. Parallèlement, les métiers de la petite enfance sont moins attractifs que par le passé : dans ma génération, les collégiens, lycéens et étudiants étaient davantage attirés par la puériculture. Comment redonner de l'attractivité à ce secteur, au-delà de la question du low cost ?
J'en viens à la problématique de la financiarisation, sujet sur lequel Bernard Jomier, Corinne Imbert et moi-même avons rédigé un rapport d'information concernant celle de la santé. Disposez-vous d'exemples précis dans lesquels des fonds d'investissement auraient pesé dans les décisions stratégiques de ces grands groupes, au détriment de l'accueil de nos enfants ?
En outre, le rôle des CAF et des PMI pose question, le contrôle qualitatif s'étant révélé insuffisant. Y voyez-vous une absence de pilotage ou une réelle volonté de ne pas aborder le sujet ?
Enfin, et même s'il est toujours délicat d'évoquer les travaux de l'autre chambre, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée aux crèches n'a pas fait, selon vous, de révélation majeure, les sujets ayant été, je cite, « survolés ». Quel regard portez-vous sur ses travaux ?
M. Victor Castanet. - Plus technique que les situations de maltraitance que j'ai pu évoquer dans les médias, le mode de financement est une question centrale. Tous les opérateurs du secteur, qu'ils soient associatifs, municipaux ou privés, se plaignent de la PSU, créée en 2002 et dont les effets négatifs ont été amplifiés par la réforme de 2014. Ce système de financement a été pensé sous l'impulsion de Bercy et de la Cour des comptes, dont certains membres m'ont confié avoir fait une erreur dans ce domaine.
Concrètement, la PSU a été conçue dans une seule visée, à savoir l'optimisation de l'utilisation de l'argent public dans le cadre d'un financement à l'heure, à l'image de la tarification à l'acte (T2A) à l'hôpital, avec comme idée directrice de pouvoir vérifier que chaque euro dépensé correspond bien à une heure de présence effective auprès de l'enfant.
À partir de 2014, le taux d'occupation et le taux de facturation ont été introduits : le premier permet de suivre l'occupation d'une crèche en fonction des heures facturées aux familles, le second d'apprécier la différence entre le nombre d'heures facturées et le nombre d'heures de présence effective, puisque des parents peuvent retirer leur enfant plus tôt que prévu certains jours. Ce sont des systèmes d'une complexité inouïe dans lesquels les dotations horaires sont plus ou moins élevées en fonction du taux de facturation et qui ont poussé les opérateurs à maximiser l'occupation effective. Il en a résulté la mise en place d'une incroyable usine à gaz, puisque les parents ont dû commencer à badger systématiquement à l'arrivée et au départ de la crèche, parfois au quart d'heure près, tandis que les opérateurs ont été incités à se focaliser sur les taux d'occupation et de facturation.
Plusieurs opérateurs m'ont confié que ce système est dénué de sens : si un enfant part plus tôt que prévu ou ne vient pas un après-midi, ils ne vont pas retirer une auxiliaire de puériculture, mais seront pénalisés financièrement. Dans ce dispositif, tous les opérateurs - le secteur privé se montrant peut-être encore plus efficient sur ce point - ne pensent qu'à remplacer chaque absence et positionnent donc des enfants comme des « bouche-trous », sur telle tranche de deux heures ou tel après-midi.
Cette manière de gérer une crèche, néfaste pour les enfants, a notamment conduit les fondateurs de Babilou à quasiment doubler le nombre d'enfants présents dans nombre de leurs crèches. D'un point de vue de la gestion de l'argent public, ce mode de fonctionnement pourrait paraître fondé dans la mesure où l'on accueille plus d'enfants sans créer de places de crèche supplémentaires. Cependant, du fait de ce doublement du nombre d'enfants, les professionnelles de la petite enfance doivent gérer en permanence des arrivées et des départs et n'ont plus la possibilité de suivre attentivement un groupe d'enfants stables de septembre à juin, ce qui les empêche de définir un projet éducatif. Cette évolution a dégradé le sens même de leur travail, certaines expliquant avoir l'impression que les crèches se sont transformées en halls de gare et les enfants en codes-barres. De plus, cette dégradation des conditions de travail des personnels et du sens de leur mission va totalement à l'encontre du bien-être des enfants, qui ont avant tout besoin de stabilité et non pas d'avoir de nouveaux compagnons en fonction des créneaux.
Il s'agit d'ailleurs d'un des rares points sur lesquels les opérateurs s'accordent, qu'il s'agisse de groupes associatifs, de groupes privés ou de l'ensemble de ces maires adjoints qui ont organisé la conférence de presse mentionnée précédemment. Ils racontent tous la même histoire et tous se sont plaints auprès de leurs CAF et de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), depuis la création de ce système. Une ancienne directrice adjointe de la Cnaf, Frédérique Leprince, témoigne d'ailleurs dans mon livre : après avoir mis en place cette PSU - avant la réforme de 2014 -, elle raconte avoir reçu des alertes dès 2004, deux ans après la mise en place de ce mécanisme. Elle a demandé à la Cnaf d'améliorer le dispositif en mettant en place un système de forfait et non plus à l'heure, mais aucune remise en cause n'est intervenue du côté de la Cnaf ou de l'administration, malgré ces alertes du terrain. Certaines villes ont tenté, sans succès, de résister en refusant d'appliquer cette PSU, mais ont été finalement obligées de céder.
Le fait que ce mouvement de résistance ne soit pas parvenu à faire obstacle à ce mécanisme est d'ailleurs très difficile à comprendre, peut-être est-ce en raison de l'insistance de Bercy sur l'optimisation de la dépense publique. Néanmoins, les choses vont peut-être changer : des maires se sont positionnés publiquement et des rapporteurs de la Cour des comptes doivent, dans les jours qui viennent, publier un nouveau rapport actant les dysfonctionnements majeurs de ce mode de financement, qui n'est pas pensé en fonction des besoins des professionnels et des enfants.
J'en viens à votre question portant sur la gestion du personnel. Dans les métiers de la santé et du care, dans les maisons de retraite comme dans les crèches, il s'agit d'un point crucial. Je précise que je n'affirme jamais dans mon livre que tous les groupes privés dysfonctionnent et que tout va pour le mieux dans le secteur public. En effet, des différences d'approche existent dans le privé en termes de gestion des ressources humaines et de stratégies de développement, avec des écarts parfois colossaux. Ayant pu me procurer des audits du cabinet KPMG, j'ai ainsi pu constater qu'il existait un écart de 15 % à 20 % sur la masse salariale entre Babilou et La Maison bleue, avec 11 500 euros de masse salariale par berceau pour la première et 9 500 euros pour la seconde.
Concrètement, il manquait environ 400 équivalents temps plein (ETP) au sein de La Maison bleue, soit un poste par structure. Dans mon enquête précédente, j'avais pu constater que la marge d'Orpea reposait certes sur du détournement d'argent public, mais avant tout sur des économies de masse salariale puisque le groupe enlevait entre 1 et 4 postes d'auxiliaires de vie dans ses résidences, malgré le fait que ces derniers avaient été budgétés et financés par l'argent public, les autorités de contrôle ne parvenant pas à repérer ces excédents de dotations qui repartaient ensuite vers le siège et qui pouvaient représenter jusqu'à 20 millions d'euros par an.
J'ai pu identifier un système similaire au sein du secteur de la petite enfance et notamment dans un groupe tel que La Maison bleue, qui a sciemment retiré 10 % de la masse salariale pour faire de la marge. Cette pratique a été confirmée par quatre directeurs régionaux qui ont quitté leur poste après avoir découvert le pot aux roses. Bien loin d'incidents isolés, il s'agissait bien d'une politique pensée au siège, et, lorsqu'un contrôle de la PMI intervenait et constatait un non-respect des ratios d'encadrement, il suffisait à La Maison bleue d'invoquer le déficit d'attractivité du secteur et les pénuries de personnels, argumentation qui pouvait être recevable pour un poste manquant. J'ai pu avoir accès à un certain nombre de rapports de PMI dans lesquels les inspecteurs ont écrit noir sur blanc que la capacité réglementaire des établissements n'était pas respectée, tout comme les ratios d'encadrement. Pourtant, il ne me semble pas qu'ils aient donné lieu à des fermetures administratives.
Pour donner un autre exemple de cette gestion du personnel, j'ai recueilli le témoignage d'une jeune directrice qui, venant de la psychiatrie, rêvait de travailler dans le secteur de la petite enfance : âgée de 25 ans, elle décide de suivre un master en management pour devenir directrice et répond à une annonce publiée par People & Baby. Immédiatement rappelée, elle explique qu'elle ne dispose d'aucune expérience et indique qu'elle devra être accompagnée, point sur lequel on lui affirme qu'il n'y aura aucun problème.
Embauchée, elle déménage, part à Paris et se retrouve à ouvrir une crèche seule, sans aucun accompagnement, avec pour seule aide une auxiliaire de puériculture, débutante elle aussi, qui n'a jamais changé une couche de sa vie. La directrice censée l'accompagner est en effet elle-même débordée, et cette jeune directrice doit alors accueillir les enfants, assumer la gestion administrative et faire fonctionner les réfrigérateurs et les fours, sans disposer d'aucune compétence. Alors qu'elle prend peur, on lui propose de gérer une deuxième structure, ce qu'elle refuse avant de décider de démissionner au bout d'une semaine. Si elle était restée, peut-être que des incidents graves auraient pu se produire ; toujours est-il qu'on a laissé une jeune femme dépourvue d'expérience s'occuper de la gestion d'une crèche sans aucun soutien. Après cette démission, elle a quitté le secteur de la petite enfance, alors même qu'elle rêvait d'y travailler.
Cela en dit long sur la pénurie de personnel et la perte d'attractivité du secteur. Les groupes qui ont dégradé les conditions de travail dans des logiques d'optimisation des coûts et de la masse salariale en sont aussi responsables. Améliorer le fonctionnement des structures en mettant fin à la dynamique du low cost permettra sans doute de faire revenir des professionnels.
Les personnes qui s'occupent de nos enfants sont à 90 % des femmes. Leurs métiers sont peu valorisés par la société et extrêmement mal payés. Les logiques d'industrialisation ont des conséquences sur les conditions de travail. Je compare souvent ces femmes aux ouvriers de l'ère industrielle dans le secteur automobile, à la différence que ces derniers étaient extrêmement syndiqués ; leur force de mobilisation et de résistance face aux patrons leur permettait d'obtenir des revalorisations salariales et des accords collectifs satisfaisants. Et il y avait un dialogue social, ce qui n'est pas le cas dans le secteur de la petite enfance. De même, il y a très peu de syndicats. Des groupes profitent de cet état de fait, qu'ils ont amplifié. Ainsi, La Maison bleue maintient 400 structures juridiques distinctes, afin d'avoir moins de charges patronales à payer en restant sous le seuil de cinquante salariés et de ne pas avoir de représentation du personnel à l'échelon national. Le groupe se vante de faire de la « déflation salariale », les augmentations de salaire ne dépassant pas 1 %. D'ailleurs, depuis la publication de mon livre, il n'y a pas eu de grève ou d'arrêt de travail dans le secteur ; comme il s'agit de femmes très jeunes, précarisées et dissociées les unes des autres, aucun mouvement ne peut se mettre en place. La question de la représentation du personnel et du dialogue social est évidemment essentielle pour faire revenir les professionnels.
J'en viens à la financiarisation. On critique souvent, parfois à raison, le rôle de l'actionnariat : visiblement, personne à Orpea n'imaginait qu'avoir des taux de marge aussi importants dans un secteur traitant d'êtres humains entraînerait une dégradation de la qualité d'accueil... Mais, chez People&Baby, s'il y a eu des dérives pendant vingt ans, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas d'actionnaires. Le groupe ne réalisait pas d'hyperprofits ; il était en déficit permanent. J'ai mis des mois à comprendre : en réalité, les fondateurs se sont enrichis non pas grâce aux dividendes, mais grâce à un système de sociétés civiles immobilières (SCI) qui fonctionnait en parallèle, voire au détriment de People&Baby. Des SCI appartenant en propre à ces derniers - cela représente aujourd'hui 7 millions d'euros de loyers annuels et une valorisation comprise entre 120 millions d'euros et 150 millions d'euros - louaient leurs locaux au groupe en fixant les prix, avec des risques de surfacturation. En l'espèce, les dérives ont été rendues possibles par l'absence d'actionnaires. Quand il n'y a pas d'actionnaires, il y a également beaucoup moins de contrôles : le comité de direction d'un fonds d'investissement peut contrôler qu'il n'y a pas de surfacturation des loyers ou de pratiques irrégulières. Si certains actionnaires peuvent parfois être trop voraces, quand il n'y en a pas du tout, les risques sont plus importants.
Derrière le développement de People&Baby, il n'y a pas de fonds d'investissement. Il y a un fonds de dette, Alcentra, qui a été absorbé voilà peu par Franklin Templeton, un des plus grands fonds au monde. Le fonds de dette a prêté 450 millions d'euros à People&Baby entre 2018 et 2022, non pas pour améliorer la qualité de ses structures, mais pour en acheter d'autres, à Dubaï, à Singapour, en Chine, aux États-Unis. Mais l'argent n'est jamais gratuit : quand un fonds de dette prête 450 millions d'euros, c'est avec des taux d'intérêt très importants, en l'occurrence autour de 10 %. La dette s'est ainsi amplifiée à une vitesse folle, immaîtrisable, pour atteindre 600 millions d'euros : en 2023, People&Baby devait rembourser 37 millions d'euros d'intérêts annuels. Le groupe a été dépassé et n'a pas pu rembourser. Alcentra et Franklin Templeton ont alors sorti le fondateur de la gestion opérationnelle. Aujourd'hui, People&Baby, qui s'occupe tout de même de milliers d'enfants dans toute la France, est piloté par un fonds de dette anglo-saxon n'ayant absolument aucune compétence en matière de petite enfance et dont la visée première est de récupérer les 600 millions d'euros que le groupe lui doit. Des processes ont été mis en place avec les conseils d'un banquier d'affaires pour démembrer People&Baby. Bercy aura-t-il un regard sur les modalités de vente de tout ou partie d'un des plus grands opérateurs de crèches de France ?
Mme Christine Bonfanti-Dossat. - Si je vous rejoins sur de nombreux points, deux éléments me heurtent. D'abord, même si je connais votre impatience, il faut laisser à la ministre le temps de pouvoir agir. Ensuite, lorsque vous pointez la responsabilité des pouvoirs publics, notamment de certains élus qui se vantent de faire des économies, vous pensez surtout - je l'ai bien compris - aux grandes villes. Mais nous sommes nombreux ici à avoir été maires de petites communes et à avoir créé ou géré des crèches avec pour seule boussole le bien-être des enfants. Ne pensez-vous pas avoir été un peu désobligeant envers ces maires qui se dévouent sans compter pour protéger notre bien le plus précieux : nos enfants ?
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Vous avez été alerté sur la situation des crèches en 2022. Mais le problème existait depuis des années. Comment se fait-il que l'État ne s'en soit pas rendu compte ?
Dans votre livre, vous décrivez les cas de maltraitance - cela ne concerne évidemment pas, tant s'en faut, la majorité des salariés -, ainsi que la dégradation des conditions de travail. Ce que vous remettez en cause, c'est un système. Il y a d'ailleurs des similitudes avec ce que l'on observe dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés.
Les établissements privés concernés surfacturent et font payer à la CAF des prestations qui ne sont pas honorées. Pour moi, c'est du vol. Derrière tout cela, il y a - vous le démontrez - l'ouverture à la concurrence et la financiarisation du secteur. Une entreprise qui réserve un berceau à 10 000 euros par an ne débourse que 2 500 euros ; ce sont donc les finances publiques, via les déductions fiscales, qui prennent en charge la plus grande partie de la dépense.
Si les contrats en délégation de service public (DSP) sont pour vous le symbole et le symptôme d'un système à la dérive, j'ai surtout été interpellée par ce que vous avez indiqué sur les pratiques d'enrichissement par le biais de SCI mises en place par les fondateurs de People&Baby. Mais comment se fait-il que l'État ne s'en soit pas rendu compte ? Comment se fait-il que les CAF n'aient pas vu ce système mafieux ? Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de contrôles.
Mme Brigitte Devésa. - Vous le soulignez, les différents opérateurs se plaignent du financement actuel. N'est-on pas en mesure de proposer une grande réforme sur la PSU ?
Certes, les 1 000 premiers jours de la vie d'un enfant sont essentiels, et il faut évidemment parer à toute maltraitance. Mais qu'entendez-vous par « maltraitance administrative » ? Je m'étonne de ce que vous dénoncez. Pourquoi les différents acteurs du secteur n'ont-ils pas alerté les autorités de tutelle ? Pourquoi l'État et la Cnaf n'ont-ils rien fait ?
À entendre la collègue qui vient de s'exprimer, la DSP est quelque chose de répréhensible et tous ceux qui y ont recours sont des voyous.
Mme Céline Brulin. - Elle n'a pas dit cela !
Mme Brigitte Devésa. - Quasiment...
Connaissant tout de même un peu les DSP, je suis très surprise de ce que j'entends. Je le rappelle, il y a beaucoup de garde-fous, de la part de la ville concernée, qui effectue des contrôles importants, de la part de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), de la part du préfet, etc. Comment pouvez-vous affirmer qu'il y aurait une espèce de mafia dans les DSP ?
Je trouve également très curieux que vous n'évoquiez pas les secteurs public et associatif, alors que vous stigmatisez largement le secteur privé.
Mme Marion Canalès. - Il est un peu frustrant de devoir attendre la sortie d'un ouvrage comme le vôtre pour que la presse se fasse l'écho d'un problème sur lequel existent déjà des rapports parlementaires ou de l'Igas. Néanmoins, je me réjouis que vous mettiez en lumière un certain nombre de dérives.
La maltraitance est-elle aujourd'hui un impensé de l'accompagnement des plus vulnérables dans un système marchand ? Initialement, l'ouverture de l'accueil du jeune enfant au secteur marchand a pu aider des collectivités à ouvrir des places. Puis, le rapport de l'Igas a pointé une dégradation progressive de la qualité de l'accueil. Aujourd'hui, il y a trois tensions : sur les collectivités territoriales, sur les familles et autour des professionnels.
Comment se fait-il que l'on n'ait pas tiré plus de conséquences de l'exclusion, en 2011, de la fédération française des entreprises de crèches (FFEC) pour pratiques frauduleuses du directeur général du groupe dont vous parlez beaucoup ?
La garantie de réservation anticipée, que vous évoquez, n'est ni tout à fait légale ni tout à fait illégale. Avez-vous constaté ce type de pratique dans d'autres groupes privés ? Il y a là une sorte de vide juridique sur lequel il faudrait travailler.
Indépendamment de la réforme de la PSU, faudrait-il un prix plancher par berceau ? Le rapport de l'Igas montre que le privé a affiché une progression anormalement faible, par rapport au public et au secteur associatif, des ressources humaines dans les crèches gérées en DSP.
Mme Florence Lassarade. - Ce qui me frappe - je suis pédiatre -, c'est que l'on parle de tout sauf de l'enfant. Comment une jeune femme de 25 ans peut-elle envisager de devenir directrice de crèche en n'ayant jamais changé une couche ? Il y a de quoi s'interroger sur la réalité de l'appétence pour les métiers concernés.
Actuellement, il y a 2 500 pédiatres en France. À mes débuts, en 1987, à Bordeaux, il y avait quasiment un pédiatre par crèche ; celui-ci assurait même des consultations sur place. Depuis, j'avais été alertée par l'adjointe d'Alain Juppé, elle-même pédiatre : les crèches Babilou venaient directement en concurrence avec les crèches municipales, qui étaient moitié vides. Les parents préféraient s'orienter vers des crèches privées, pour différentes raisons.
Par rapport à d'autres pays européens, où l'enfant est scolarisé ou mis en collectivité plus tard, n'est-ce pas le modèle français qui pèche ?
Vous êtes-vous penché sur d'autres types de garde d'enfants ? Je pense aux nounous, aux maisons d'assistants maternels (MAM), voire aux emplois à domicile, dont certains ont malheureusement été supprimés à cause de la fiscalité brutale imposée aux familles.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Vous êtes un journaliste d'investigation et, d'une certaine façon, un lanceur d'alerte. Vous avez mentionné « trois opérateurs » ; en réalité, il y en a quatre.
Votre présentation, c'est un peu Le Bon, la Brute et le Truand. La « brute », c'est People&Baby, auquel vous consacrez, me semble-t-il, trop de place : à trop se concentrer sur un voyou, on finit par occulter les mécanismes. Les deux « truands », ce sont les deux autres groupes que vous avez cités : pour rester dans le lucratif, le secteur privé gonfle les taux d'occupation et utilise les failles de la PSU et, surtout, de la tarification à l'heure, souvent à la limite de la légalité. Le « bon », c'est Babilou, mais vous oubliez de préciser qu'il s'est désinvesti : dans certaines crèches d'entreprise, compte tenu des dispositifs fiscaux, l'État ou la Cnaf payent 75 % du berceau ; il est alors plus facile dans ces conditions de combiner qualité et grande lucrativité...
Si ces groupes arrivent à croître, c'est parce qu'ils deviennent des opérateurs immobiliers et qu'ils n'ont plus vraiment besoin de marchés.
La PSU et la tarification à l'heure ont cassé le service public et aggravé les effets délétères du privé lucratif. Mais, en tant que législateurs, nous avons une responsabilité. Comment pouvons-nous accepter qu'un texte législatif sur le plein emploi comporte tout un chapitre cavalier sur les crèches ? Ces dernières devraient faire l'objet d'un projet de loi dédié ; elles relèvent de la politique éducative, pas de la politique de l'emploi. C'est avec des représentations comme celle de l'enfant que l'on peut mettre à la consigne que l'on en vient à concevoir des dispositifs de financement comme la PSU ou la tarification à l'heure.
Mon voisin lyonnais le pédagogue Philippe Meirieu a coutume de dire que plus on est bas dans l'enfance, plus le personnel doit être qualifié. Les plus qualifiés devraient être affectés aux crèches ou aux écoles maternelles.
Encore une fois, je trouve que vous vous focalisez trop sur les « truands » alors que l'enjeu est de décortiquer les mécanismes. Quand on passe d'une régie municipale à la DSP parce que le privé réduit les coûts au prix d'une dégradation de la qualité, en tant qu'élus, nous avons aussi notre part de responsabilité.
Selon vous, la différence entre les crèches municipales et les premiers prix du privé, c'est l'absentéisme. En réalité, le privé a aussi de l'absentéisme ; simplement, il ne le remplace pas... En revanche, je connais des crèches municipales qui ferment des berceaux ou refusent des enfants quand il leur manque du personnel.
M. Philippe Mouiller, président. - Mes chers collègues, je vous rappelle que cette audition est publique et que, quelles que soient vos convictions, vous avez une responsabilité dans les propos que vous pouvez tenir.
Mme Corinne Bourcier. - La protection de l'enfance est un sujet extrêmement important. Cela a été rappelé, les 1 000 premiers jours sont déterminants. Dans nos fonctions, nous rencontrons heureusement beaucoup de professionnels engagés. Comment expliquez-vous le manque de réactivité et de sanctions des organismes de contrôle face aux alertes ?
M. Vincent Castanet. - Madame Bonfanti-Dossat, malheureusement, ce sont les faits qui sont « désobligeants » à l'égard des maires.
À partir de 2004, le secteur des crèches s'est ouvert au privé, parce qu'il y avait une lacune des pouvoirs publics. Il s'est agi, grâce à un certain nombre de dispositifs fiscaux, d'inciter le privé à venir sur ce marché et à créer des places de crèches. Aujourd'hui, 90 % des nouvelles places de crèche sont le fait du privé, ce qui illustre un effacement du public.
Au même moment, un certain nombre de maires, par exemple à Courbevoie, ont choisi de confier la gestion des crèches municipales à des opérateurs extérieurs. Une telle formule leur semblait présenter trois avantages.
D'abord, les crèches sont gérées par des personnes dont c'est le métier. Ensuite, la création d'une crèche est plus rapide. Enfin, cela permet de réaliser des économies sur le budget municipal. Selon mes informations, une place de crèche en gestion directe coûte environ 12 000 euros par an ; d'après l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, ce serait plutôt 16 000 euros par an, et l'on parle de 24 000 euros par an à Marseille. Pour les municipalités, les crèches sont l'un des premiers postes budgétaires. Or, en faisant appel à des opérateurs extérieurs, notamment privés, le coût est plutôt de 8 000 euros par an. Tout le monde y gagne : la municipalité fait des économies budgétaires, et l'opérateur privé, même si cela lui rapporte un peu moins que la vente de places de crèches d'entreprise, n'a pas besoin de réaliser d'investissements immobiliers, puisqu'il peut le plus souvent s'installer dans des locaux municipaux.
À partir des premiers renouvellements en 2010, il y a eu une guerre entre les principaux opérateurs, qui voulaient conquérir des parts de marché. Et le meilleur moyen d'être plus compétitifs, c'est de jouer sur les prix. La Maison bleue, Les Petits Chaperons rouges et People&Baby sont arrivés sur le marché en cassant les prix. Les maires, à qui l'on proposait des prix inférieurs de moitié, ont très souvent, soit par choix économique, soit sous la pression de leur opposition, opté pour l'offre la moins chère, donc la moins-disante. Le patron des Petits Chaperons rouges m'expliquait que, compte tenu de la diversité des situations, il n'y a pas « un prix » en France. En réalité, il y en a bien un. Et aujourd'hui, il y a une évolution à la baisse des prix.
Prenons l'exemple de la ville de Nogent-sur-Marne, qui a choisi l'offre la moins chère pour sa crèche. L'année suivante, la masse salariale a baissé de 10 % à 15 %, ce qui représente deux à quatre ETP en moins. Simplement, pour un maire, réaliser 1,9 million d'euros d'économies est toujours une perspective intéressante. Et quand des élus demandent si cela ne risque pas d'avoir des conséquences sur les effectifs ou la qualité, on leur promet qu'il n'y aura aucune répercussion. Mais il y en a toujours. À Nogent-sur-Marne, la baisse de la masse salariale a été comprise entre 120 000 euros et 150 000 euros.
Et c'est partout pareil en France. Certes, tous les maires n'ont pas fait les mêmes choix. Certains ont refusé de mettre en place des DSP. De mon point de vue, faire des économies sur la petite enfance est toujours une mauvaise idée. Il n'y a que deux effets possibles : soit le groupe qui a fait une offre deux fois moins chère baisse sa marge au point de mettre en péril son fonctionnement, soit il diminue sa masse salariale.
Mme Brigitte Devésa. - Il y a des exigences, un cahier des charges, dans les DSP.
M. Vincent Castanet. - Vous savez, dans le cadre de mon enquête sur Orpea, quand j'ai indiqué que le groupe détournait de l'argent public, on m'a rétorqué qu'il y avait des contrôles, de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), des agences régionales de santé (ARS), des inspecteurs du travail, des départements, etc. L'Igas et l'IGF, qui n'y croyaient pas, ont mené leurs investigations et sont revenues me dire que j'avais raison.
Il y a, me répondez-vous, des règles dans les DSP. Certes, mais malheureusement, il est factuel que les prix ont diminué. Ce n'est pas moi qui le dis. Je me fais simplement le porte-voix de maires de grandes villes, d'opérateurs associatifs et même d'opérateurs privés. Car, non, je ne stigmatise pas les opérateurs privés. Dans le cadre de mon enquête, j'ai rencontré des familles, mais aussi des salariés de tous les groupes, et pas seulement des auxiliaires de puériculture : il y avait des directrices de terrain, mais également des cadres du siège, par exemple des directeurs financiers, des responsables des ressources humaines, des contrôleurs de gestion. Tous ont insisté sur la nécessité de mettre un terme non pas à l'activité privée, mais à certaines dérives.
Mon propos n'est pas de dire du bien ou du mal de Babilou, qui a décidé de s'opposer au low cost et d'opter pour une autre stratégie de développement. Simplement, selon les fondateurs du groupe, qui est l'un des leaders européens, le low cost est en train de détruire le secteur de la petite enfance. Et ils ne sont pas les seuls à le penser. Dans les prochaines semaines, vous entendrez sûrement d'autres opérateurs privés le souligner à leur tour.
Les entreprises du CAC 40, mais également des entreprises de taille moyenne, voire des petites entreprises investissent en moyenne autour de 15 000 euros par berceau, en plus de la PSU. Dans les DSP, c'est 3 000 euros, et même parfois moins, par berceau. Comment peut-on admettre un écart d'un à cinq entre les crèches gérées en DSP et les crèches d'entreprise ? Voilà qui devrait tous nous interroger sur l'injustice à laquelle sont confrontés les parents et, plus encore, les enfants s'agissant des montants alloués pour les places de crèche.
Mme Jocelyne Guidez. - Ce qui a été dit sur les maires me choque un peu. Quelles réflexions vous inspire la montée de l'agressivité à laquelle nous assistons d'une manière générale, qu'il s'agisse des écoles, des institutions accueillant des personnes ou des enfants handicapés ou d'autres structures ? Avec mon collègue Jean Sol, nous avons formulé un certain nombre de propositions contre la maltraitance.
Mme Guylène Pantel. - Dans le cadre de vos travaux, avez-vous perçu des défaillances dans les structures d'accueil privées, low cost ou pas, sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap ou à demande particulière ou besoin spécifique ? Si oui, s'agit-il, selon vous, d'un défaut de formation professionnelle ou d'un manque de moyens humains dédiés à l'inclusion ?
Mme Patricia Demas. - À votre avis, quelles actions immédiates pourraient être engagées pour prévenir de nouveaux cas de maltraitance et de négligence dans les crèches ? Quels exemples concrets de bonnes pratiques qui pourraient être généralisées avez-vous pu observer dans certaines crèches ? Pensez-vous qu'il faudrait explorer la piste d'une remise en régie des établissements en DSP ?
M. Daniel Chasseing. - Les rémunérations indirectes, par l'immobilier, que vous décrivez sont absolument anormales. Je pense qu'il est temps - certes, la ministre vient seulement d'arriver - d'agir. Il y a une responsabilité des pouvoirs publics.
Lorsqu'il y a une diminution du personnel, cela signifie que la DSP n'a pas été appliquée. Cette « erreur » volontaire est le fait des signataires, et non du maire.
Les critères qui nous sont imposés dans nos communes pour recruter une directrice de crèche municipale ou des auxiliaires puéricultrices sont fixés en fonction du nombre d'enfants accueillis.
S'il y a eu des dérives, il faut que les CAF et la PMI fassent des contrôles et que la ministre mette les pieds dans le plat pour y remédier.
Mme Émilienne Poumirol. - On ne répétera jamais assez combien il est dangereux de vouloir faire des économies sur le dos des plus vulnérables, en l'occurrence des enfants.
Le changement de la PSU a été une catastrophe ; je l'ai vécu en tant que responsable d'une crèche intercommunale. Cela a créé de multiples difficultés dans la gestion du personnel. Nous avons dû investir dans un système de badges. À quand des puces à insérer dans la paume du bébé pour qu'il puisse badger à l'entrée de la crèche ? Plus sérieusement, le dispositif est à revoir. Lorsque nous faisions des contrats à temps plein, à mi-temps ou à 80 %, tout était plus simple, et les résultats étaient bien meilleurs.
Le personnel, c'est 90 % des frais de fonctionnement d'une crèche. Il est donc logique que ceux qui veulent faire des économies les fassent sur le personnel. Se pose également la question des mini-crèches dans lesquelles les règles d'encadrement sont moins importantes. Nous devons, me semble-t-il, améliorer le contrôle de la PMI. Tous les départements n'ont pas les mêmes ressources ni les mêmes services. En tout cas, il faut mettre un terme à cette « industrialisation » : quel mot terrible quand on parle de bébés !
Comment peut-on empêcher ce système mafieux des fonds de pension ? Pour éviter les investissements dans des SCI, il faudra peut-être modifier la loi. Nous interpellerons évidemment la ministre sur le sujet.
Mme Solanges Nadille. - Votre livre met en lumière les dérives de l'utilisation des finances publiques dans des secteurs dits « vulnérables ». Pensez-vous vraiment que les pouvoirs publics ne sont pas au courant ? Cet état de fait dure depuis des années, et tout le monde le sait, y compris au sein des collectivités communales. Je vous suggère d'ailleurs de venir enquêter sur la vie chère dans les territoires ultramarins ; vous verrez si les pouvoirs publics ne sont pas au courant.
M. Victor Castanet. - Je complète ma réponse quant à la possibilité de mettre en place des DSP à un tel prix. L'audit du cabinet KPMG consacré à la stratégie de La Maison bleue mentionne clairement le fait qu'une baisse des prix a été actée et que la direction générale préconise la diminution de 10 % de la masse salariale à la suite de la reprise d'une DSP. Il s'agit donc d'une politique réfléchie et assumée par le siège de La Maison bleue, alors qu'il est interdit de baisser les effectifs en cas de reprise d'une crèche municipale : une défaillance des autorités de contrôle semble donc en cause.
Celles-ci ont-elles fait leur travail ? J'ai pu rencontrer des inspecteurs et un formateur juridique de la PMI, qui ont avancé plusieurs explications. Premièrement, ces organismes fonctionnent en silo et se cantonnent à leur département, d'où l'incapacité à établir un lien avec des phénomènes observés ailleurs : une autre organisation aurait pu permettre de constater qu'un effet de système était à l'oeuvre, et non pas des dérives isolées. Il y a une question concernant le pilotage du contrôle. Deuxièmement, une diminution des compétences des inspecteurs a été constatée ces dernières années, à la fois au niveau juridique et au niveau économique. Or, décrypter des pratiques d'optimisation des coûts ou des montages immobiliers nécessite des compétences financières et comptables. Troisièmement, un certain nombre d'inspecteurs qui ont voulu mettre en place des sanctions allant jusqu'à la fermeture administrative se sont heurtés à l'absence de décision, en bout de chaîne, de l'élu local, soit pour ne pas mécontenter les familles et devoir retrouver d'autres places, soit en raison d'une dépendance au privé. Une fois les structures privées introduites, il n'est pas en effet évident de les critiquer ou de remettre en cause leur fonctionnement.
Les pouvoirs publics ont fait preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de structures privées, qui sont nécessaires et qui - une fois encore - ne dysfonctionnent pas toutes, malgré les dérives que je rapporte. Cependant, si ces pratiques ont perduré pendant vingt ans, c'est bien parce que les autorités de contrôle n'ont pas joué leur rôle face aux suroccupations, au non-respect des rations d'encadrement, aux montages immobiliers ou encore aux clauses abusives.
Au-delà du manque de compétences et de moyens, un élément doit nous conduire à nous interroger : au sein des CAF et de la Cnaf, de nombreux acteurs étaient au courant de certaines des pratiques incriminées. Tel est le cas d'un directeur de la CAF du Nord qui, alerté par les pratiques irrégulières identifiées à l'occasion de plusieurs contrôles dans des crèches People&Baby, a envoyé un rapport à la Cnaf à Paris. Malgré plusieurs relances, le sujet n'a pas été traité. Pour avoir échangé avec des figures importantes de la Cnaf, avec plusieurs collaborateurs ministériels et avec d'anciens ministres, je peux confirmer que la pratique des fausses déclarations d'heures de présence était connue.
Pour conclure, je rappelle qu'il vous revient plus qu'à moi de trouver des solutions, mon travail se limitant à rapporter des faits. Pour autant, je citerai trois considérations ou suggestions qui remontent du terrain.
Tout d'abord, contrecarrer la stratégie du low cost pourrait s'appuyer sur la mise en place d'un prix plancher par berceau, à l'image de ce qui a été décidé pour le secteur de l'édition avec le prix du livre. Ensuite, une réflexion devrait être menée sur le mode de financement, aucun autre pays européen n'ayant déployé un système aussi complexe que la PSU. L'Allemagne utilise ainsi un système de forfait à la journée, bien plus simple pour les personnels. Enfin, imposer une exigence de transparence pourrait être envisagé : il est en effet très difficile de comparer les établissements lorsque vous recherchez en urgence une place dans une maison de retraite, le problème étant exactement le même en matière de crèches. Peut-être que des indicateurs de qualité et des critères objectifs tels que le turn-over, le nombre d'effectifs ou encore le coût journalier du repas permettraient aux familles de comparer et de faire leur choix, ce serait sain pour le secteur et permettrait de tirer l'ensemble des opérateurs vers le haut, à l'inverse de la situation actuelle, dans laquelle ils n'ont pas de réel intérêt commercial à mettre l'accent sur la qualité.
Cette transparence est essentielle et présenterait l'avantage de ne rien coûter aux finances publiques, ce qui est précieux dans le contexte de recherche d'économies que nous connaissons.
M. Philippe Mouiller, président. - Merci pour tous ces éléments. S'il paraît difficile de refonder la politique familiale pour la petite enfance en pleine période d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), nous nous emparerons du sujet et nous pencherons notamment sur les outils de contrôle, ceux-ci devant s'adapter à la complexité et à l'étendue des problématiques soulevées.
* 1 Réponse de l'ADMR au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 2 Selon une enquête menée en 2022 par la DGCS à laquelle 56 conseils départementaux représentant 75 % des structures d'accueil sur l'ensemble du territoire, 22 % des PMI n'avaient pas d'agents dédiés à ces missions.
* 3 Réponse de l'Acepp au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 4 Réponse du cabinet Horizon crèche au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 5 Caisse nationale d'allocations familiales, extrait d'un courrier au rapporteur de la branche famille de l'Assemblée nationale, décembre 2024.
* 6 Onape, Rapport public annuel sur l'accueil des jeunes enfants, 2024.
* 7 Prestation d'accueil du jeune enfant.
* 8 Réponse de la Cnaf au questionnaire transmis par les rapporteurs. Chiffres au 31 août 2024.
* 9 Igas, Qualité de l'accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, mars 2023.
* 10 Article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 11 Rapport d'information de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles des outre-mer, n ° 870 (2022-2023)
* 12 Article L. 2324-3 du code de la santé publique.
* 13 Décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services mentionnés aux articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
* 14 La Mutualité française a pu recenser en 2024 certains territoires où aucune de ses structures n'avait eu de contrôle quand, sur d'autres territoires, plus de 60 % de ses établissements avaient été contrôlés.
* 15 Réponse de l'ADMR au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 16 Audition du Dr Nicole Bohic, inspectrice générale de l'action sociale.
* 17 Selon une enquête menée en 2022 par la DGCS à laquelle 56 conseils départementaux représentant 75 % des structures d'accueil sur l'ensemble du territoire, 22 % des PMI n'avaient pas d'agents dédiés à ces missions.
* 18 Igas, Qualité de l'accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, mars 2023.
* 19 Toutes actions de contrôle confondues (contrôle sur place, contrôle sur pièces, enquête ou intervention en entreprise).
* 20 Site internet ameli.fr.
* 21 Réponse de la DGCCRF au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 22 Il s'agit des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes immunodéprimées, des personnes hospitalisées ou séjournant dans des établissements médico-sociaux, des enfants et des jeunes enfants.
* 23 Le site ma-cantine.agriculture.gouv.fr publie aussi des informations sur le respect par les structures des obligations liées à la loi « EGalim » et des outils d'auto-évaluation pour les gestionnaires
* 24 Réponse de la DGFiP au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 25 Selon le cabinet Horizon crèche, pour un montant facturé par place aux entreprises réservataires entre 10 000 et 15 000 €, seuls 5 000 à 7 500 € seraient réellement directement reversés aux crèches.
* 26 Cour des comptes, Rapport d'évaluation de la politique d'accueil du jeune enfant, décembre 2024.
* 27 Le groupe LPCR a élaboré avec l'entreprise SGS certification le label « Crèch'Expert » afin de certifier l'ensemble de ses établissements.
* 28 La certification est encadrée par la loi, en particulier les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et atteste d'une qualité de service adossée à un référentiel contrôlé par un organisme tiers accrédité. Le label quant à lui est plus libre et ne répond pas à une définition juridique précise. Il valorise une prestation ou une entreprise sans forcément avoir recours à une certification par un organisme accrédité. Toutefois, certains labels sont associés à des certifications.
* 29 Réponse de Bureau Veritas Certification au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 30 L'article 2 du décret n° 2025-118 du 10 février 2025 instituant un Haut-Commissaire à l'enfance prévoit que « le Haut-Commissaire à l'enfance apportera son concours à la définition, la coordination, la promotion, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques conduites en matière d'enfance, en particulier en matière de protection de l'enfance, de santé de l'enfant, de soutien à la parentalité, d'adoption, de petite enfance et d'accueil du jeune enfant. »
* 31 DGCS, Synthèse des retours de l'instruction adressée aux préfets par la ministre des solidarité et des familles relative à la sécurité au sein des établissements et services d'accueil du jeune enfant (EAJE), février 2024.
* 32 Article L. 2324-2-2 du code de la santé publique.
* 33 L. 313-18 et L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles.
* 34 À titre d'exemple, le plan de contrôle des CAF intègre des cibles obligatoires, notifiées par la caisse nationale, pour lesquelles les résultats du contrôle permettent de calculer un indicateur national de risque financier résiduel. Les données relatives au suivi du plan de contrôle annuel ainsi qu'à leurs résultats sont renseignées dans le système d'information. Elles permettent un suivi et un pilotage du plan à l'échelle départementale et nationale.
* 35 Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERPD).
* 36 Ibid.
* 37 Arrêté du 4 juillet 2024 fixant la liste des indicateurs communs aux schémas départementaux de services aux familles et les modalités de transmission des indicateurs.
* 38 Cour des comptes, Évaluation de la politique de l'accueil du jeune enfant, décembre 2023.
* 39 Réponse de la DGCS et de la DSS au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 40 Loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels.
* 41 Article R. 2324-25 du code de la santé publique.
* 42 - 38 % d'effectifs de médecins, - 25 % d'effectifs de psychologues, peu de nouvelles embauches d'éducateurs de jeunes enfants, alors qu'il s'agit d'un profil essentiel dans le secteur de la petite enfance.
* 43 Réponse de la Mutualité française au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 44 Onape, Rapport public annuel sur l'accueil des jeunes enfants, 2024.
* 45 Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage.
* 46 Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l'expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles.
* 47 Article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
* 48 Réponse du collectif Pas de bébé à la consigne au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 49 Les « frais de sièges » correspondent aux coûts que la société mère d'un groupe refacture à ses filiales en fonction d'une clé de répartition (chiffre d'affaires, total de bilan, effectifs...) et qui sont destinés à rémunérer les services apportés par la société mère à ses filiales (frais généraux d'administration et de direction générale). Dans la mesure où la prestation de service unique correspond à la prise en charge d'un pourcentage du prix de revient horaire dans la limite du prix plafond, les modalités de calcul des frais de sièges intégrés dans le coût de revient doit effectivement faire l'objet d'un contrôle.
* 50 Réponse de la Cnaf au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 51 Un fonds de dette permet aux entreprises de se financer via un emprunt non bancaire. Il s'agit d'une dette accordée par des prêteurs institutionnels et privés à des entreprises. Cette solution de financement peut notamment permettre une plus grande souplesse dans les modalités de remboursement mais implique généralement des taux d'intérêt très supérieurs à ceux proposés par les établissements de crédit traditionnels.
* 52 Ainsi les représentants du groupe Babilou entendus par la mission ont indiqué avoir stoppé le développement du groupe et ne pas avoir lancé de création de nouvelles places depuis 18 mois mais simplement réorganiser leur parc d'établissements au regard des besoins dans les différents territoires. Le groupe LPCR a quant à lui précisé n'avoir procédé à quasiment aucune création nette de place depuis 2 ans et se concentrer sur « l'ajustement du réseau » à la demande.
* 53 En réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, le groupe LPCR a ainsi indiqué que les financements publics de la CAF représentaient 28 % de son chiffre d'affaires. En 2023, les groupes People&Baby, La Maison bleue et Babilou ont respectivement reçu 61,4, 68,9 et 79,5 millions d'euros de financement via la PSU.
* 54 Article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 55 Article L. 211-8 du code des juridictions financières.
* 56 Article L. 211-10 du code des juridictions financières.
* 57 Ainsi sept contrôles ont été réalisés fin 2023 dans le cadre du rapport d'évaluation de la Cour des comptes sur la politique d'accueil du jeune enfant.
* 58 Réponse de la Cour des comptes au courrier du président de la commission des affaires sociales, 3 mars 2025.
* 59 Article 34 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
* 60 L'article L. 263-2 du code de la sécurité sociale prévoit seulement aujourd'hui que des sanctions financières en cas de manquement aux règles peuvent être prévues dans le cadre des « conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale ».
* 61 Article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
* 62 Article L. 313-22-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 63 Article L. 2326-3 du code de la santé publique.
* 64 Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant.
* 65 Réponse du syndicat national des professionnel.le.s de la petite enfance au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 66 L'attestation d'honorabilité est un document officiel qui certifie qu'une personne ne fait l'objet d'aucune condamnation définitive l'empêchant d'exercer ou d'intervenir auprès des mineurs.
* 67 Honorabilite.social.gouv.fr.
* 68 Ibid.
* 69 Diplôme.gouv.fr.
* 70 À titre d'exemple, le référentiel du CAP Accompagnant éducatif petite enfance prévoit dans les compétences communes de réalisation de « Repérer des signes d'altération de la santé et du comportement : maladie, malaise, maltraitance » (RC4).
* 71 Le nombre de candidats diplômés suivant un enseignement à distance a augmenté de 150 % entre 2019 et 2023 (1 500 diplômés en 2023).
* 72 Par exemple, en 2021, la première année du CAP « Accompagnement éducatif petite enfance » proposée en formation initiale scolaire en établissement public local d'enseignement (EPLE) et qui affichait 1 438 places, a été demandée en premier voeu par 3 093 élèves, et globalement par un total de 9 459 élèves. Le nombre de candidats diplômés au CAP AEPE entre 2019 et 2023 est en forte augmentation passant de 13 700 à 22 000 candidats soit une hausse de 60 %.
* 73 Dans le cadre de sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, la Confédération nationale des associations de familles catholiques a réalisé une enquête auprès de ses adhérents. Cette enquête révèle que plus de 70 % d'entre eux estiment que la publication d'indicateurs constituerait un outil précieux dans le choix du lieu d'accueil de leurs enfants.
* 74 https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted.
* 75 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx.
* 76 Selon le groupe, 24 cas avaient été remontés au 20 novembre 2024 dont 6 seulement avaient fait l'objet d'une procédure de sanctions pour maltraitance.
* 77 Selon le groupe, 11 signalements avaient été reçus sur cette plateforme au 15 décembre 2024.
* 78 Rapport de Mme Florence Dabin, Proposition d'un circuit sur le recueil des alertes dans les lieux d'accueil du jeune enfant, 3 octobre 2024.
* 79 Actuellement, l'article R. 2324-25 prévoit simplement une obligation pour le gestionnaire d'informer le président du conseil départemental de tout accident ayant entraîné l'hospitalisation ou la prise en charge par des équipes de secours extérieures d'un enfant ainsi que de « tout décès d'un enfant ».
* 80 Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.
* 81 Article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 82 Depuis le 1er janvier 2022, le secteur des crèches a donné lieu à moins de 200 plaintes sur SignalConso (DGCCRF, réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 83 Par exemple, l'application Chaperons&vous mise en place par le groupe Les Petits Chaperons rouges permet aux parents de signaler un dysfonctionnement directement au responsable de secteur et au siège.
* 84 Unaf, Place des parents au sein des modes d'accueil du jeune enfant - État des lieux et recommandations, décembre 2023.
* 85 Ibid.
* 86 HCFEA, Réponse à la saisine de madame la ministre des solidarités et des familles au sujet de la place des parents dans les EAJE, décembre 2023.
* 87 L'action des CAF s'inscrit en cohérence avec cette volonté de maîtrise du développement de l'offre d'accueil en réduisant la part de ses financements dans le montant total des projets de création de micro-crèches « Paje » de 80 à 50 %, en portant l'exigence de maintien de la destination sociale associée aux financements à 15 ans et en renforçant les critères territoriaux d'implantation.
* 88 Le prix de revient peut en effet connaître d'importantes variations en fonction du territoire d'implantation, des charges salariales ou encore du modèle d'établissement. En réponse au questionnaire des rapporteurs, la Cnaf a précisé qu'entre 2010 et 2022, le prix de revient moyen d'une place d'accueil en EAJE PSU est passé de 12 881 euros à 17 536 euros (soit + 36 %).