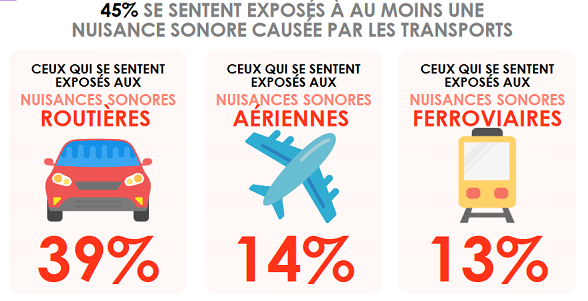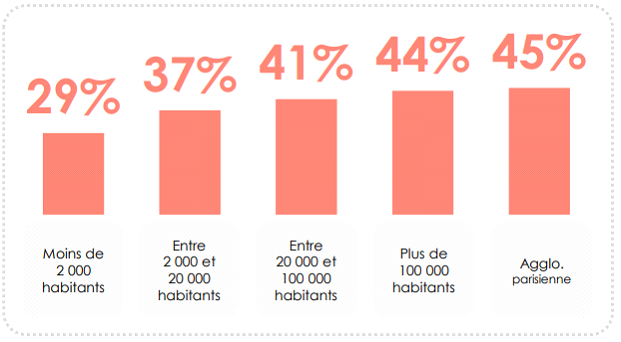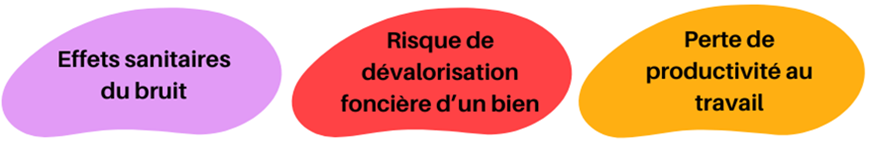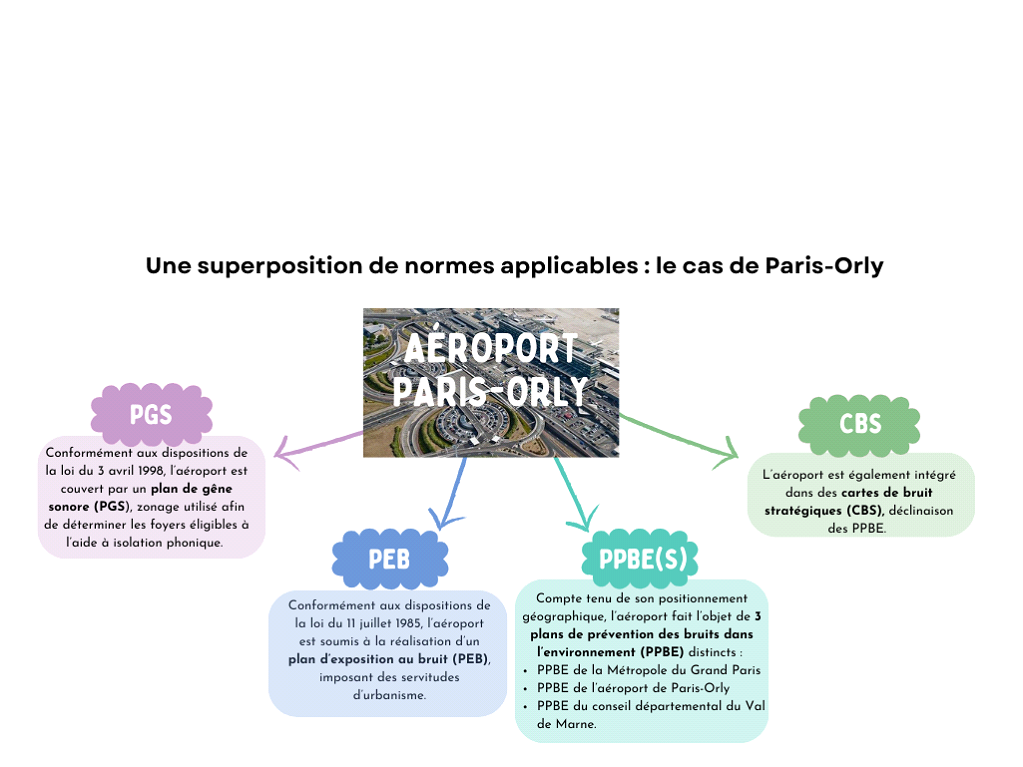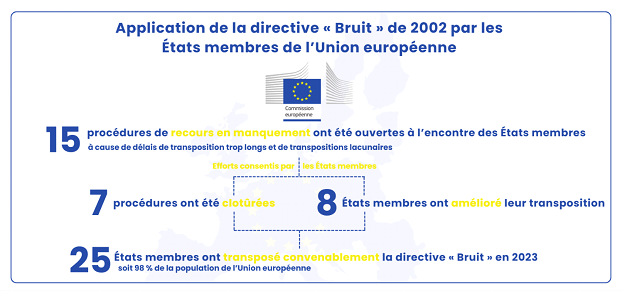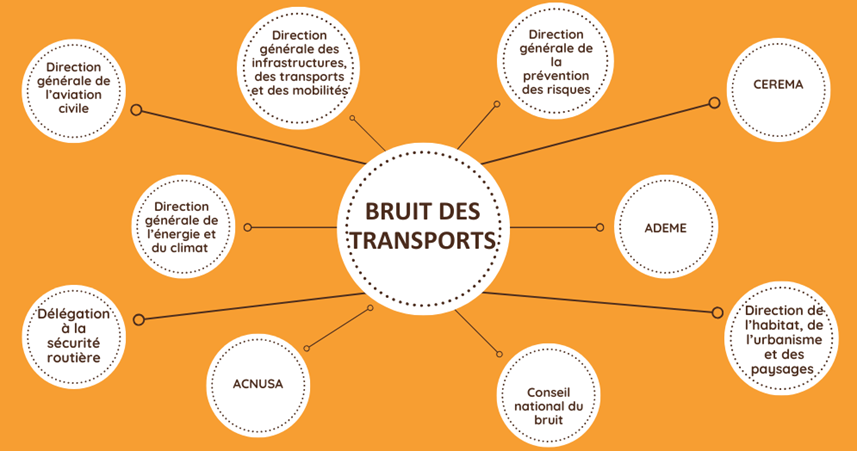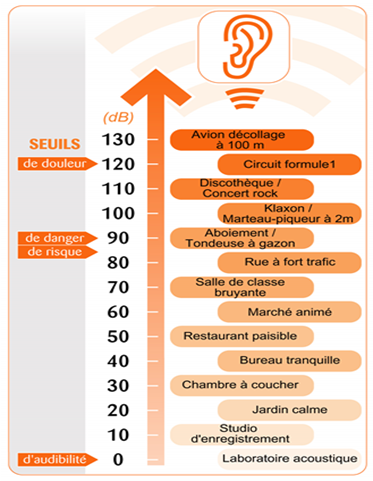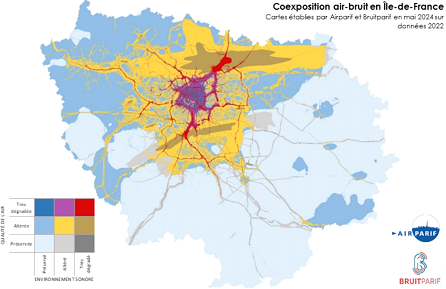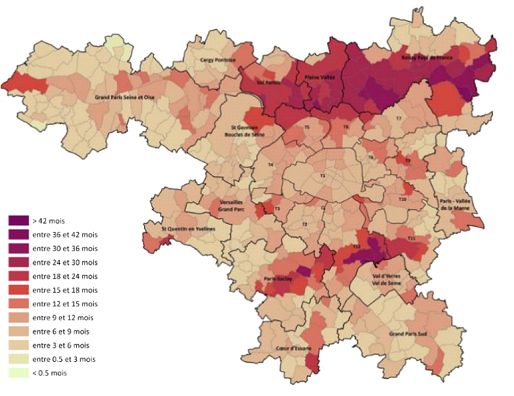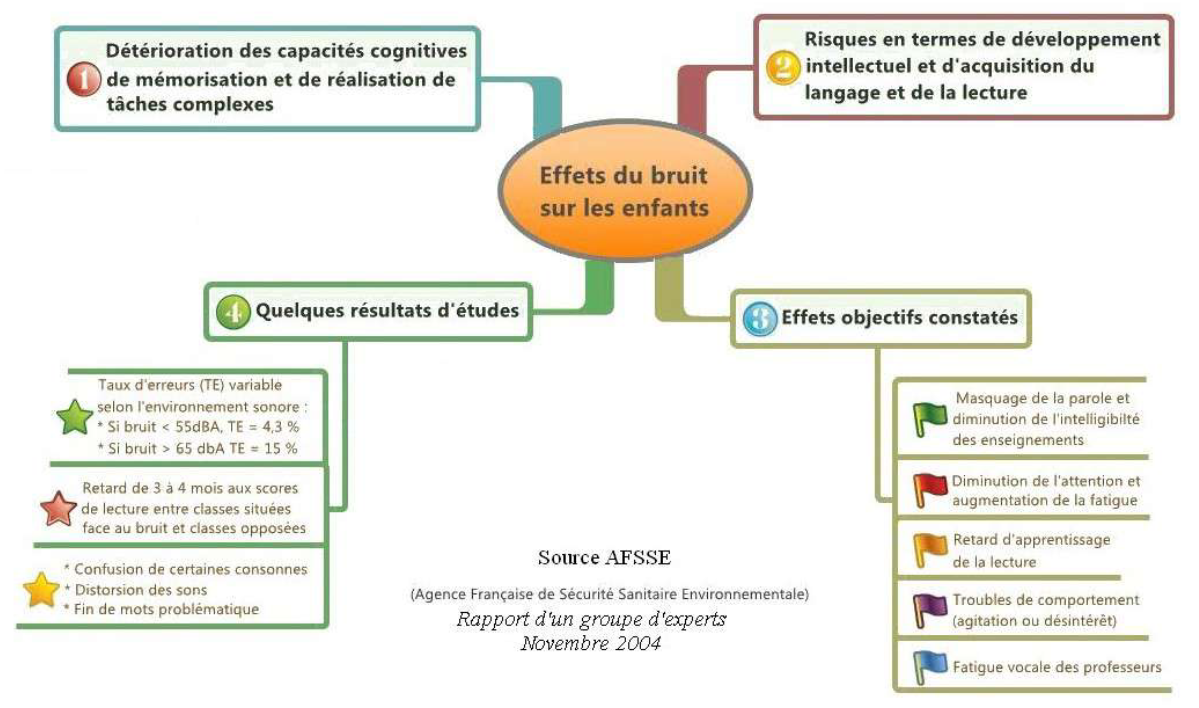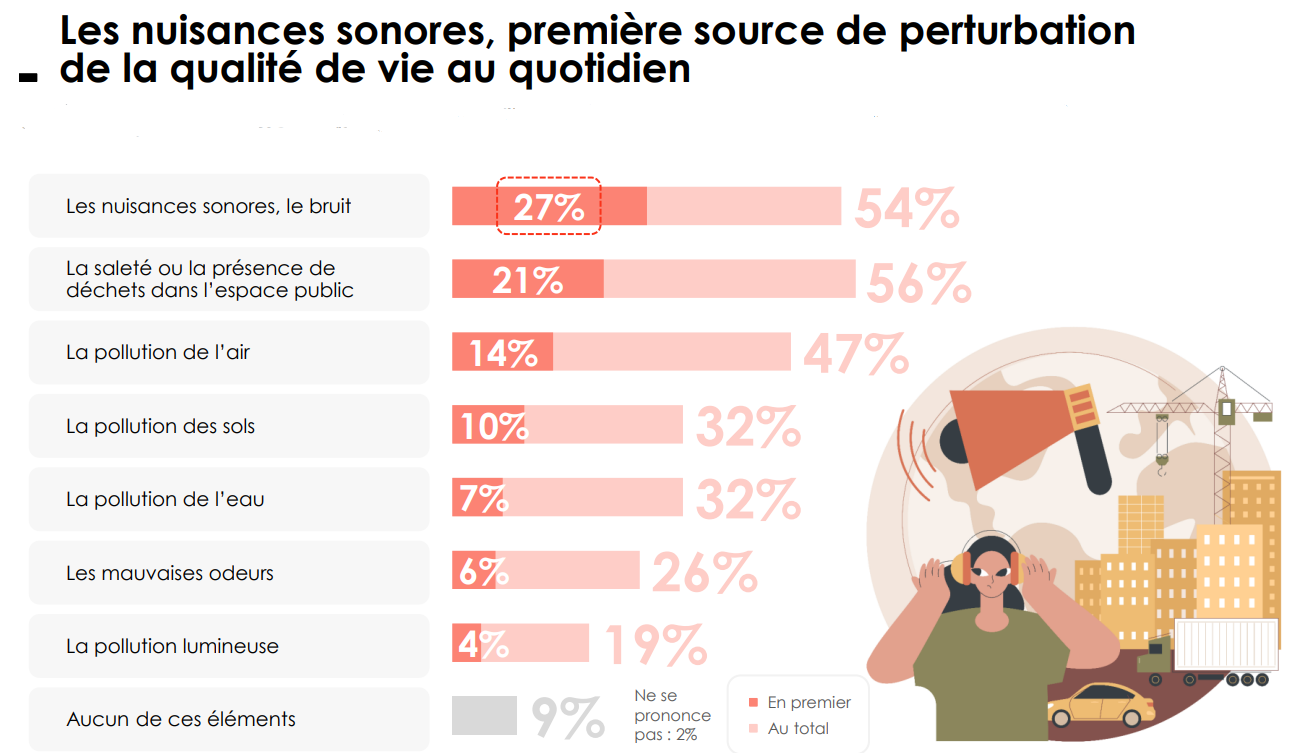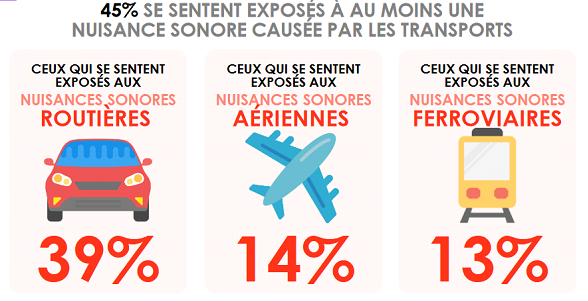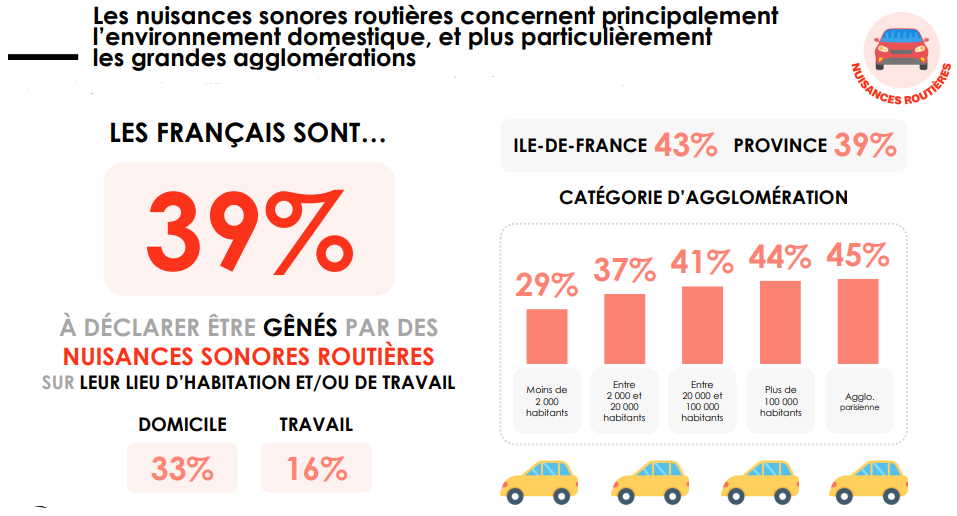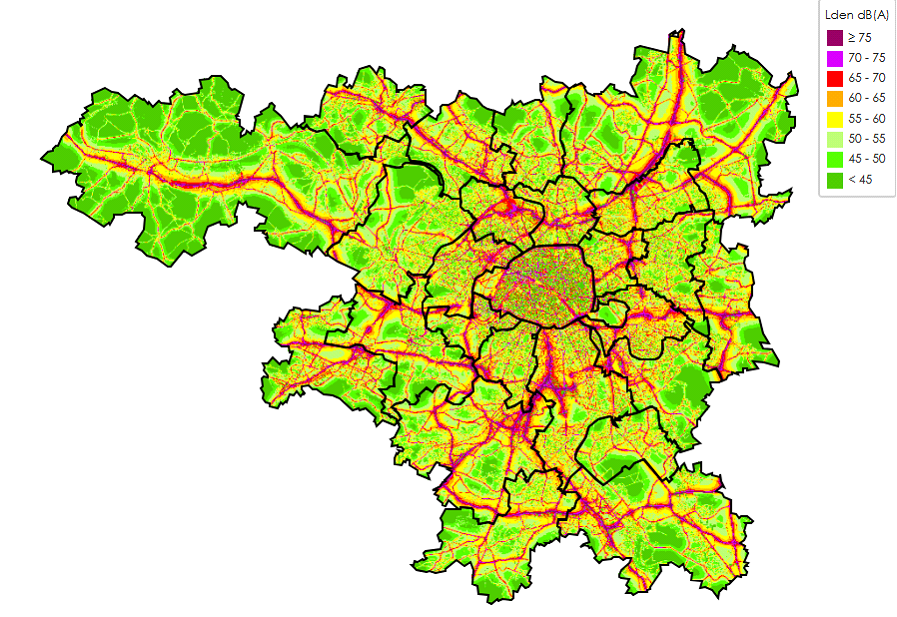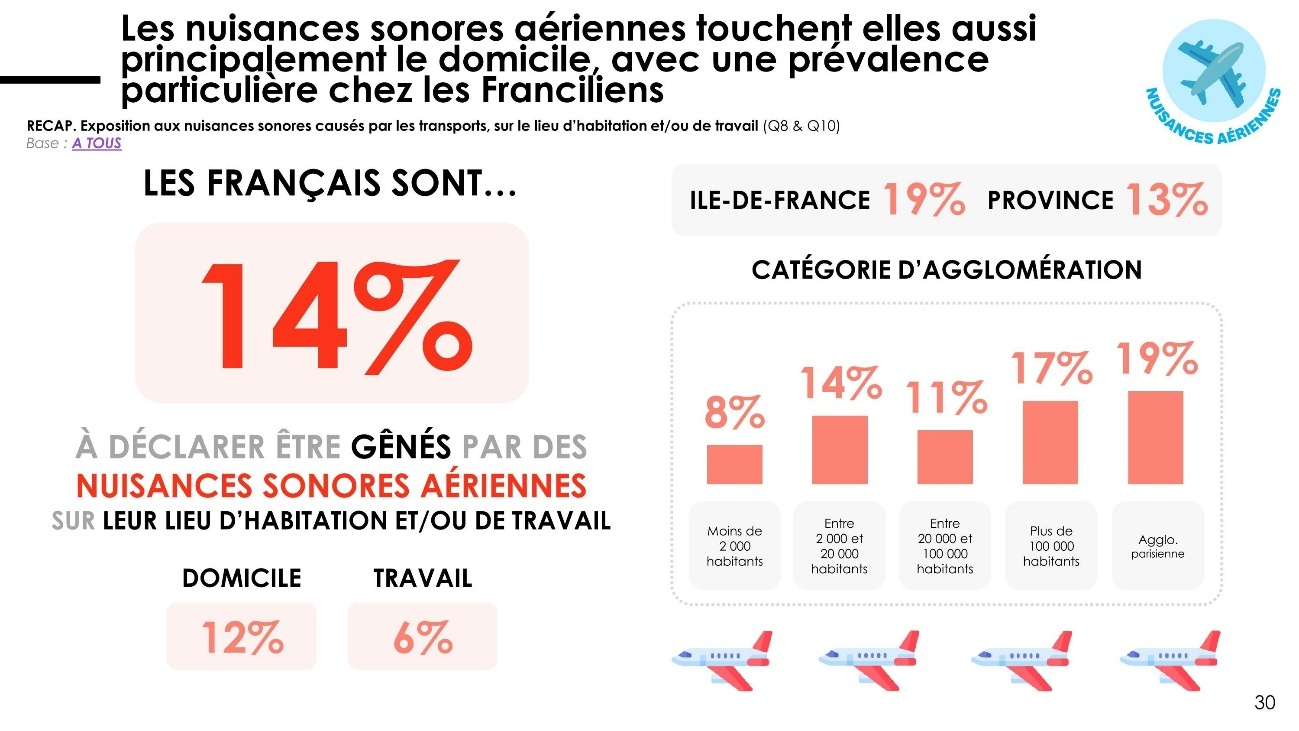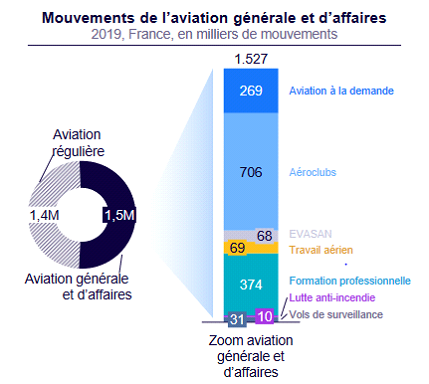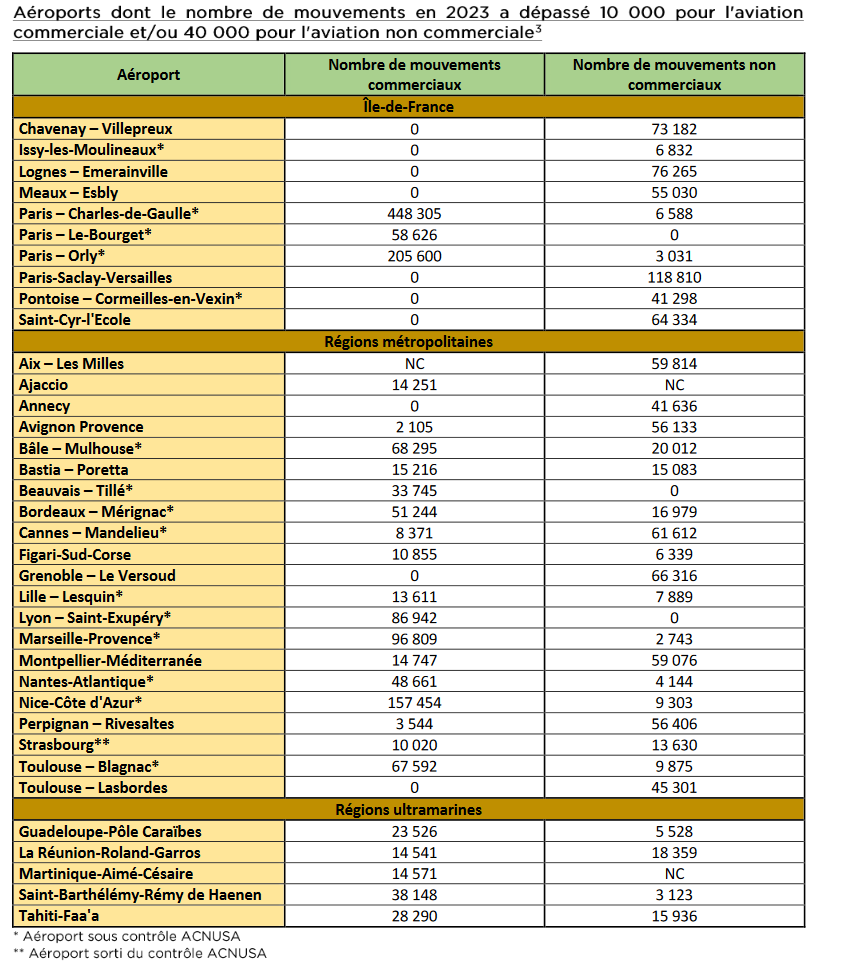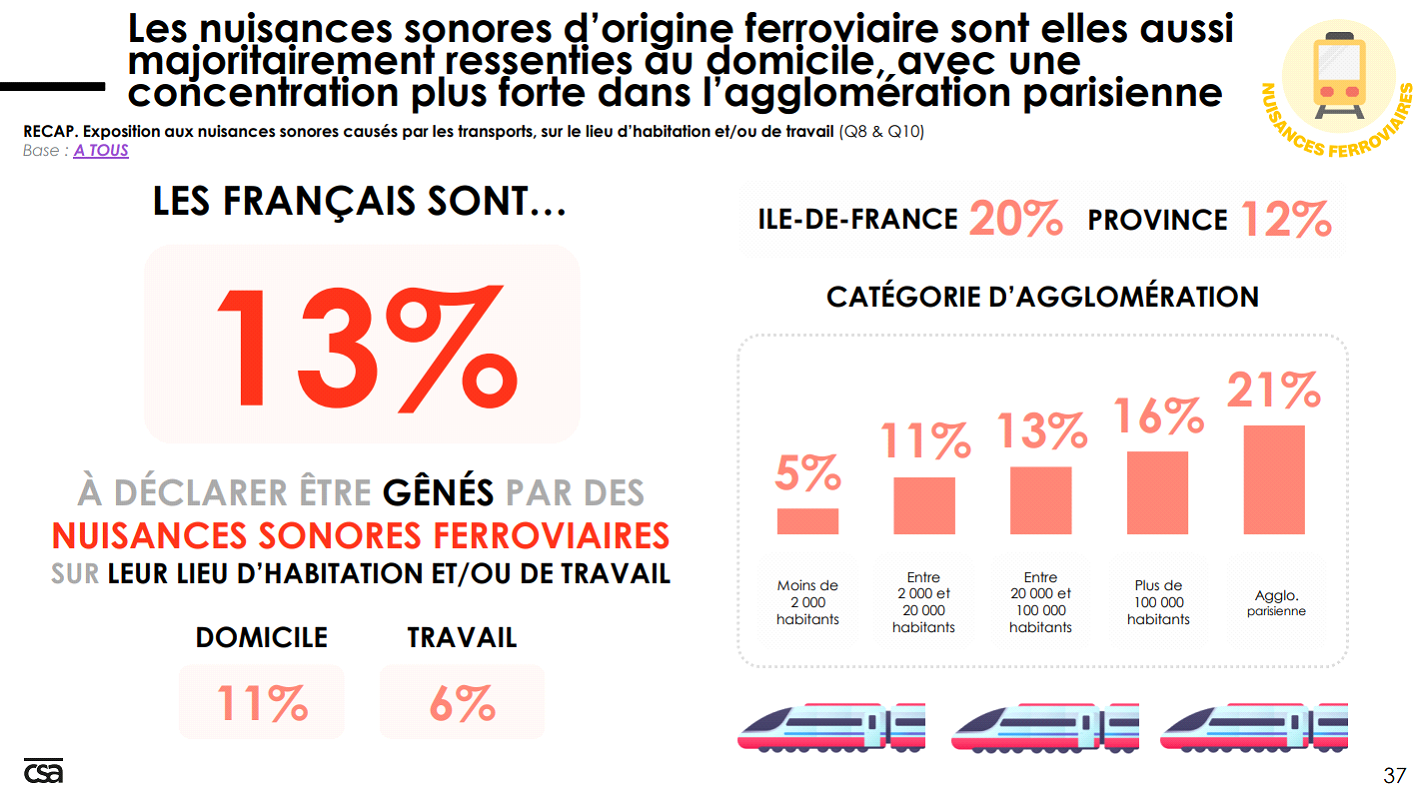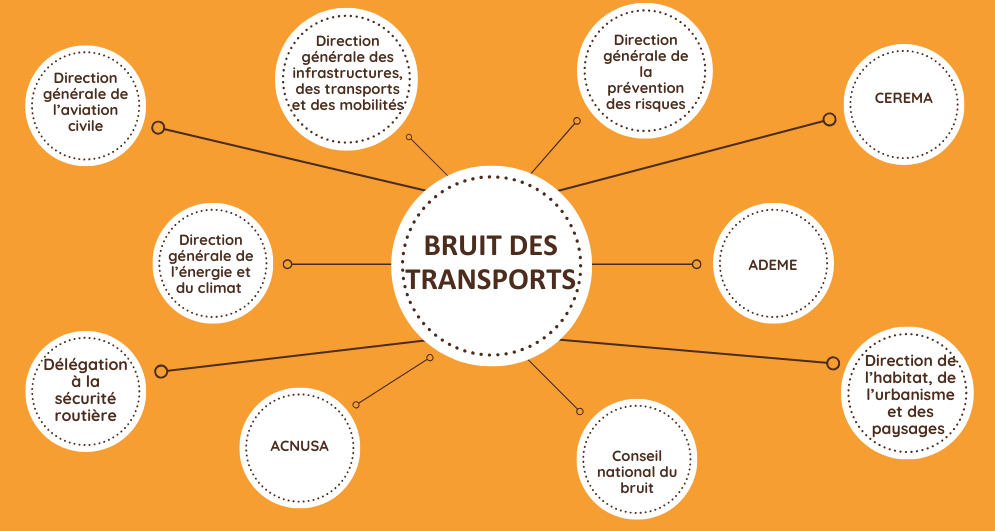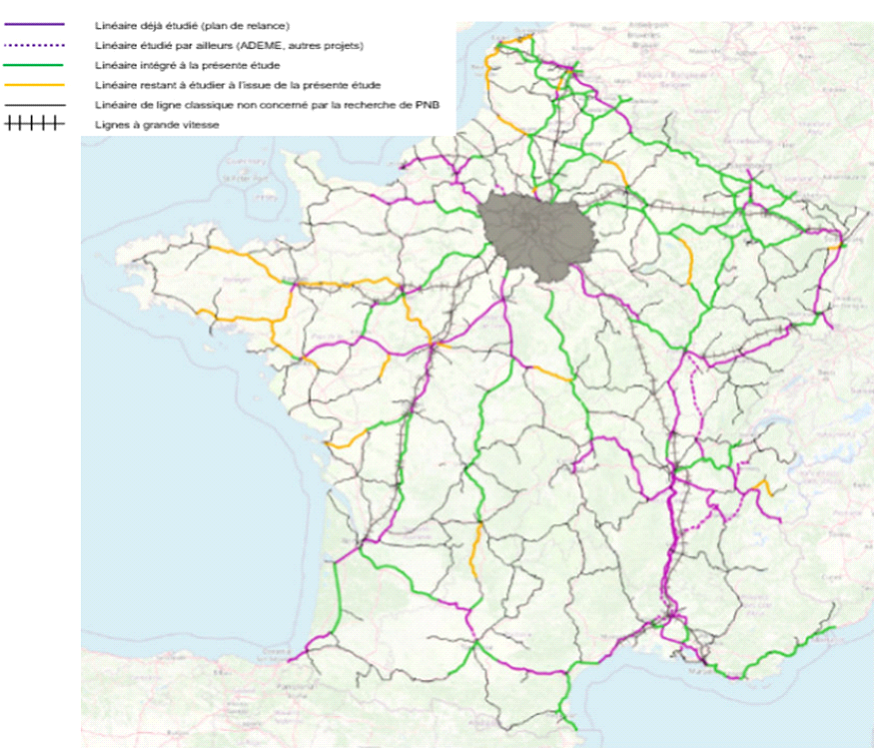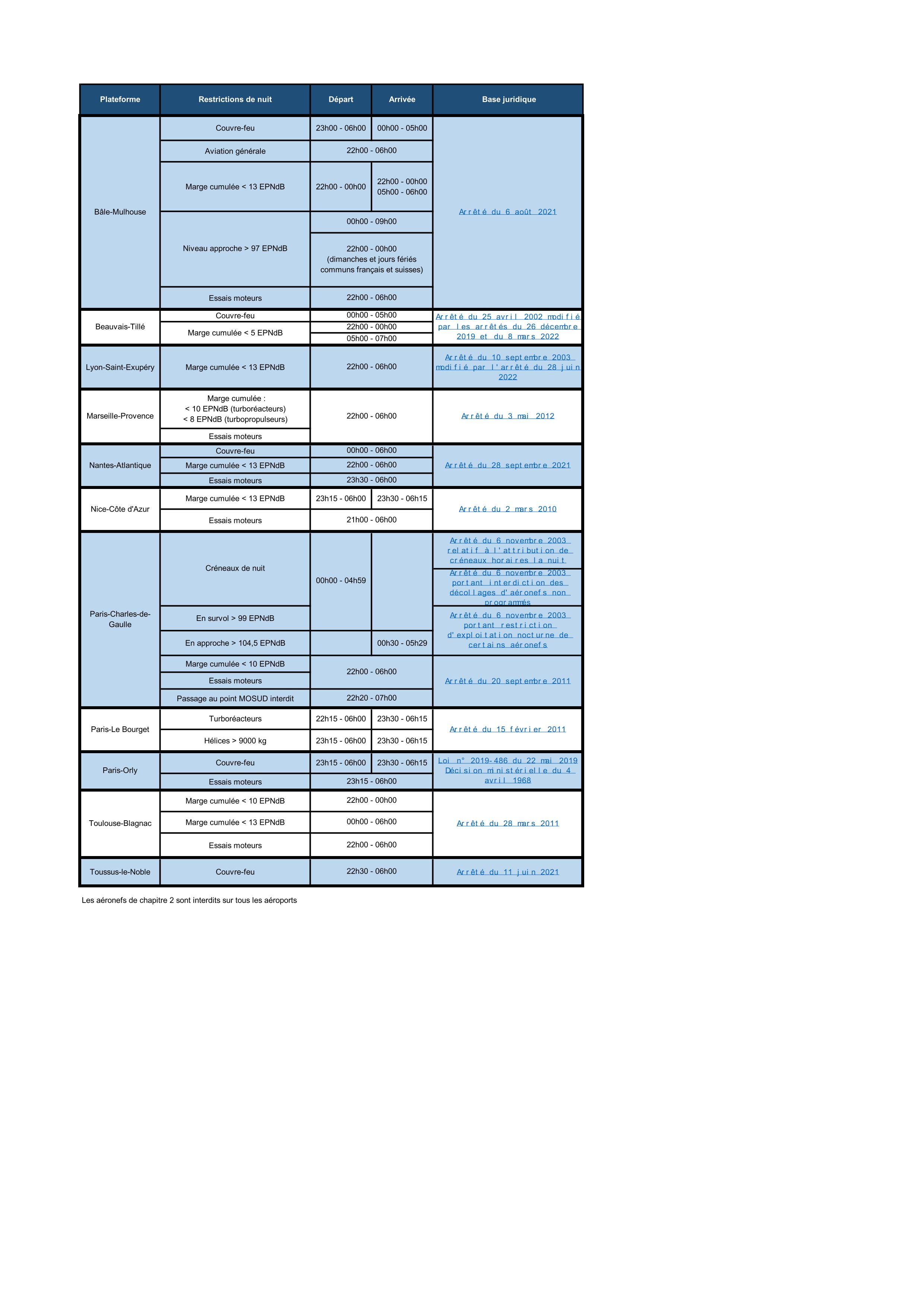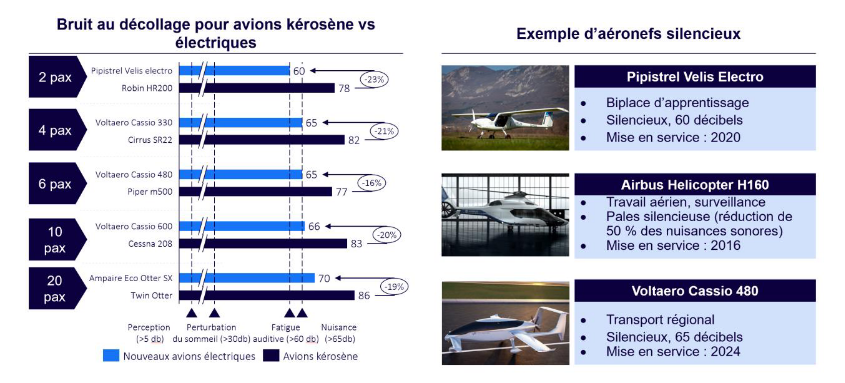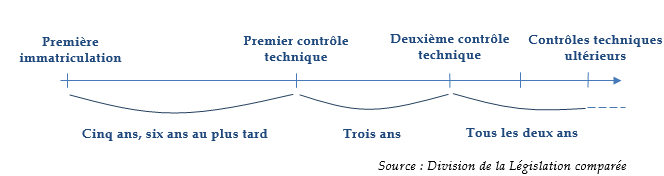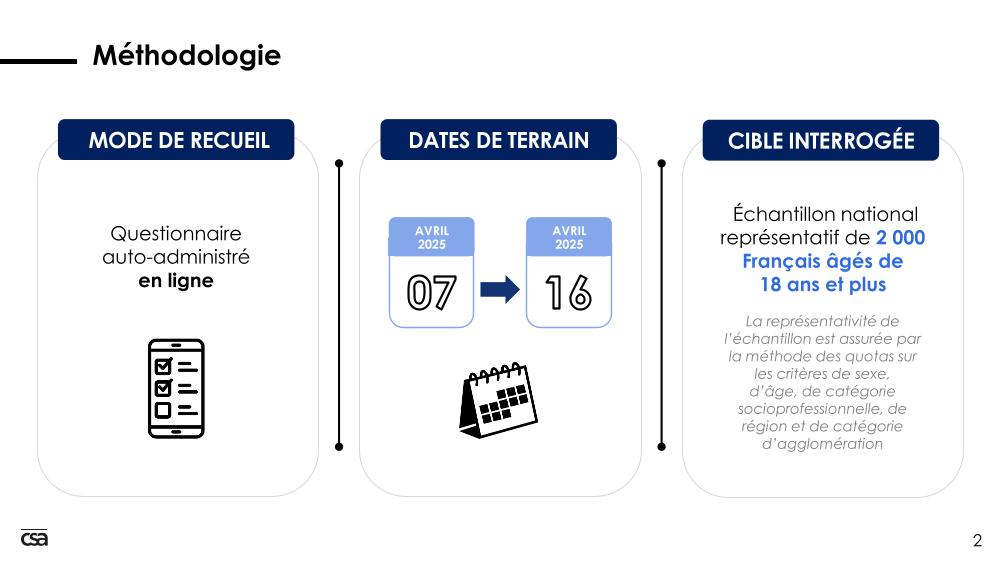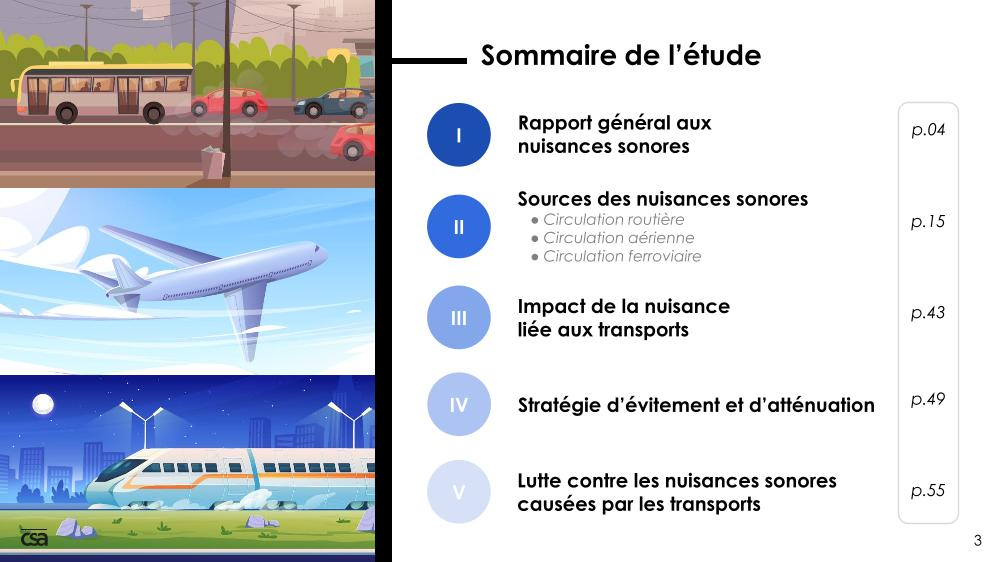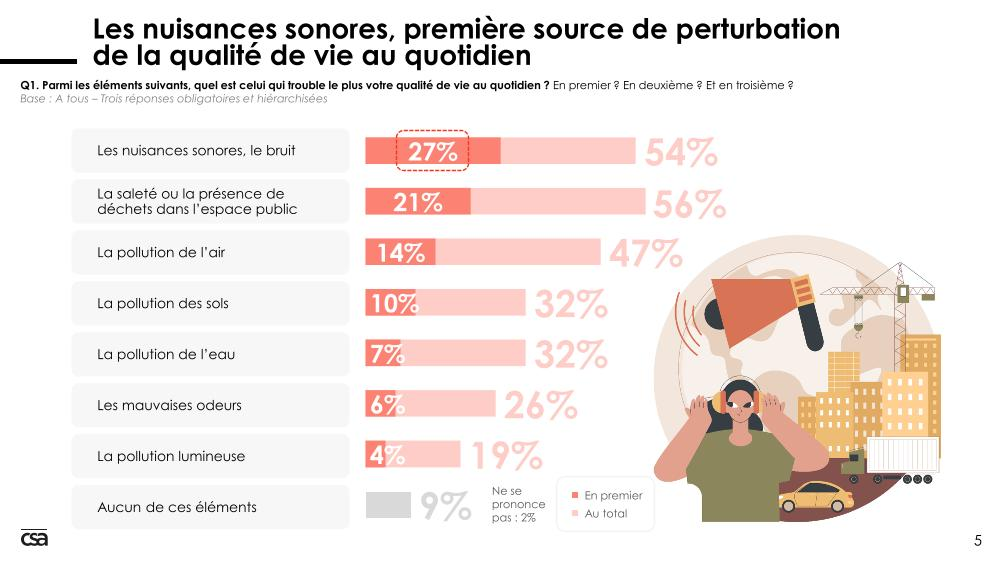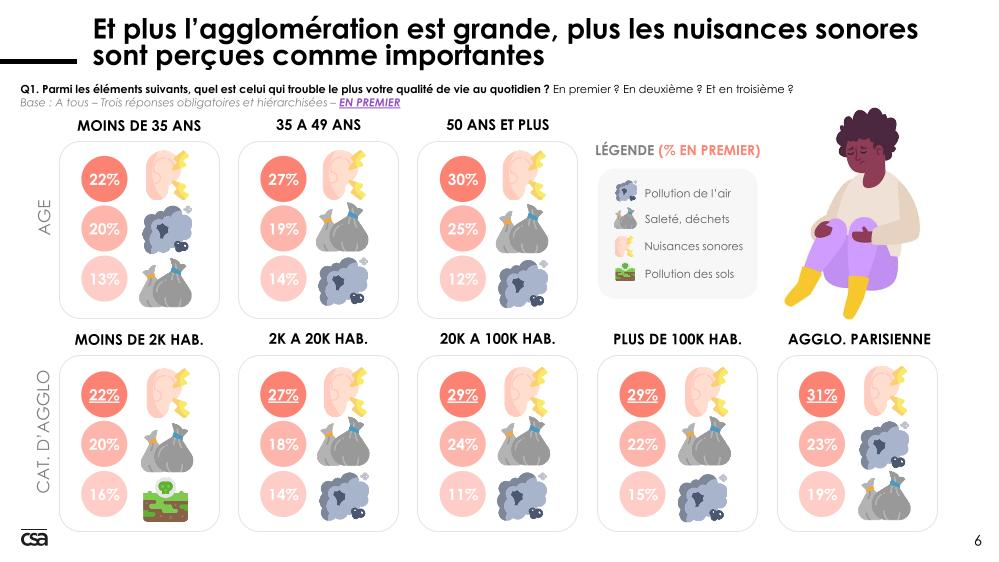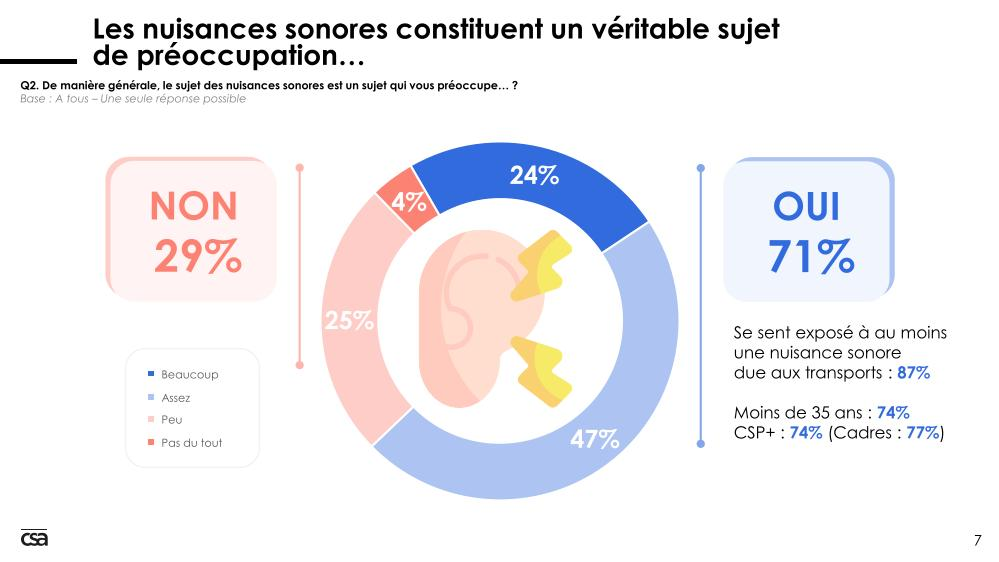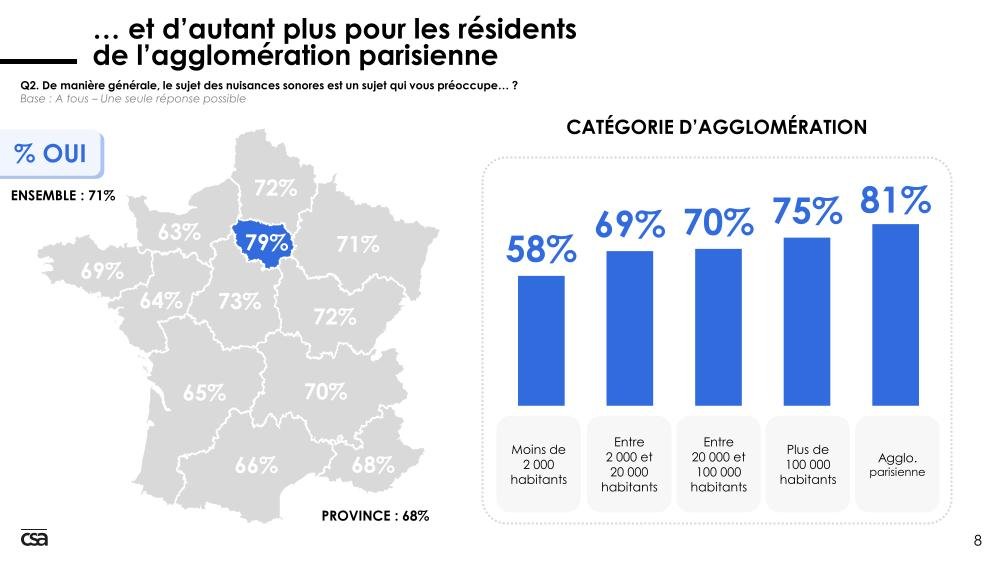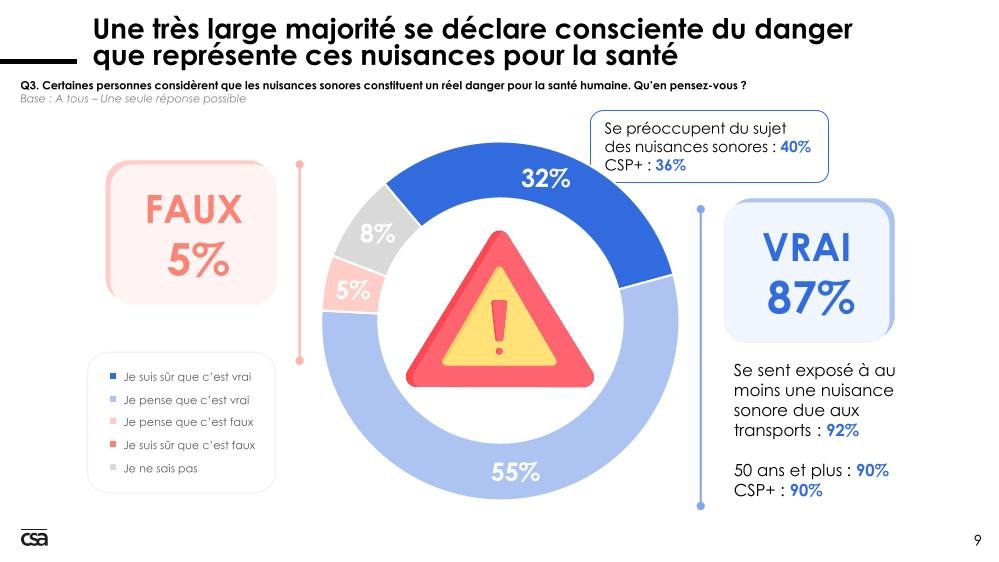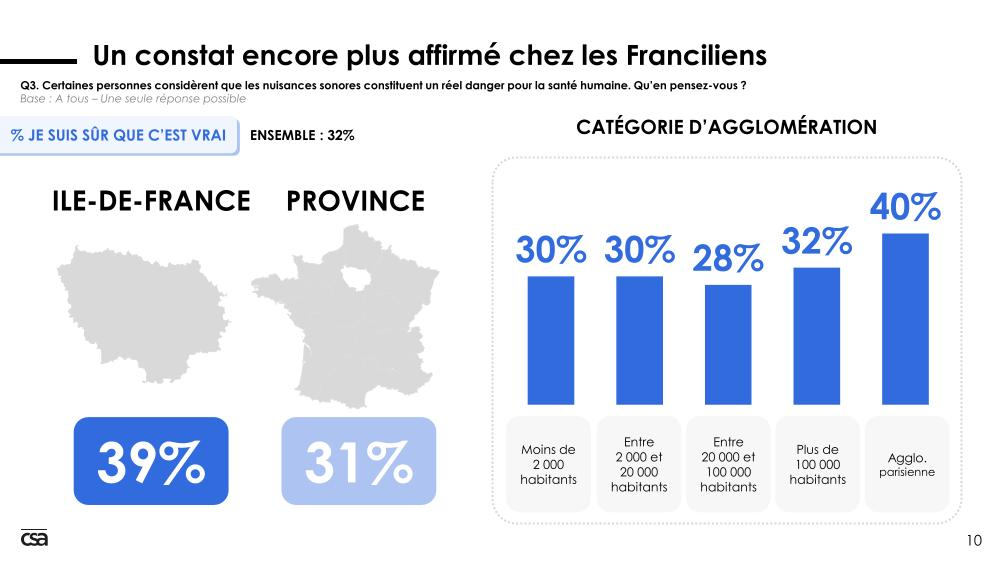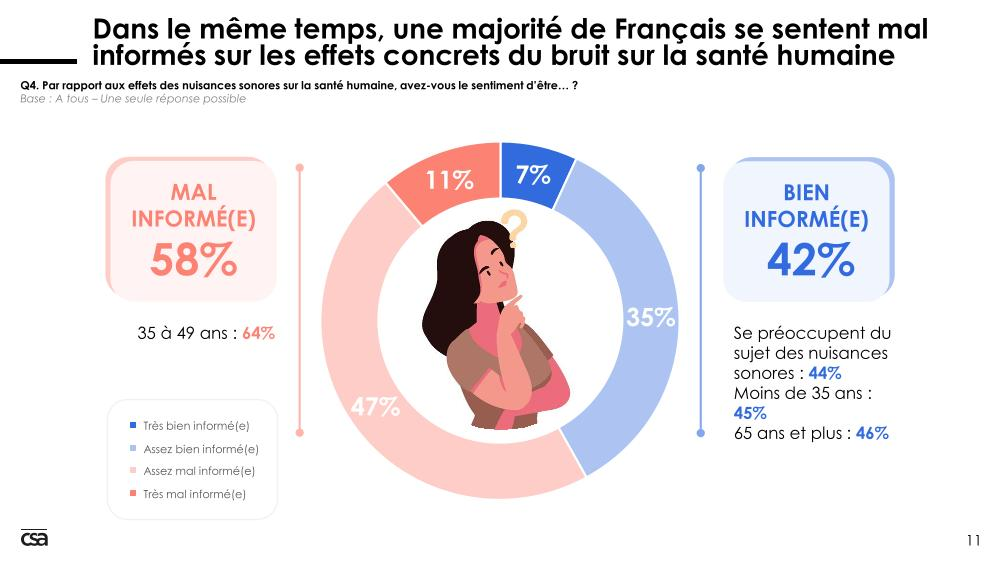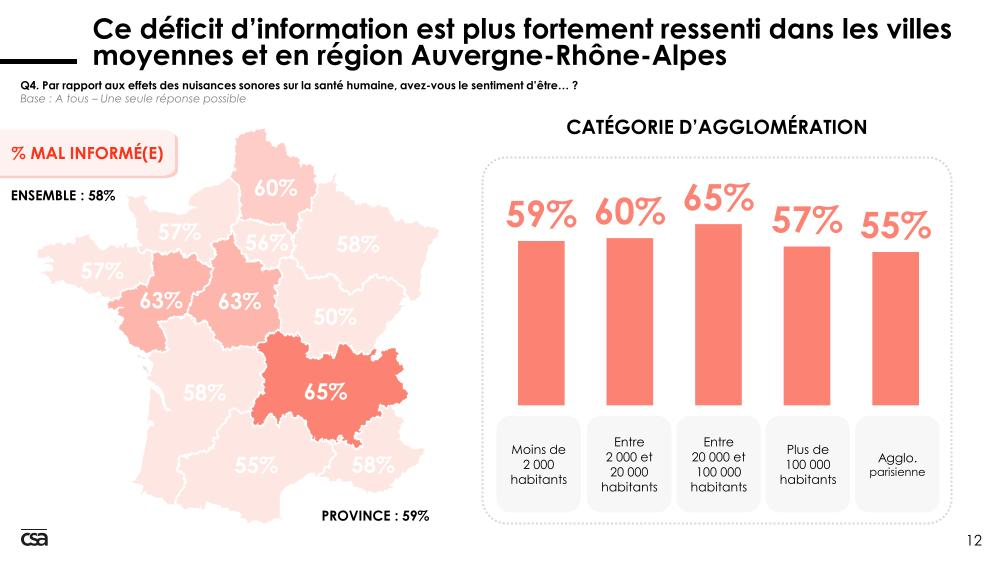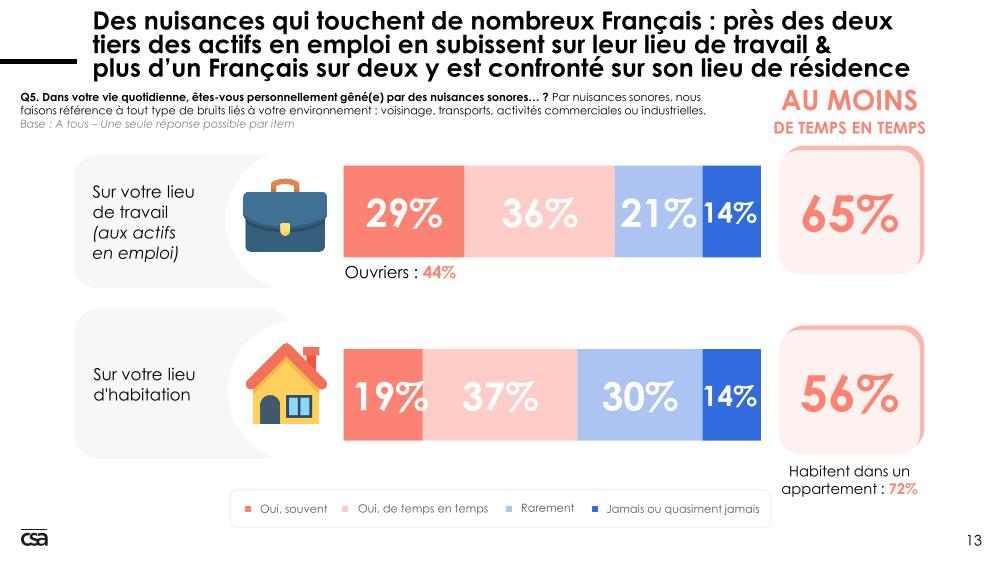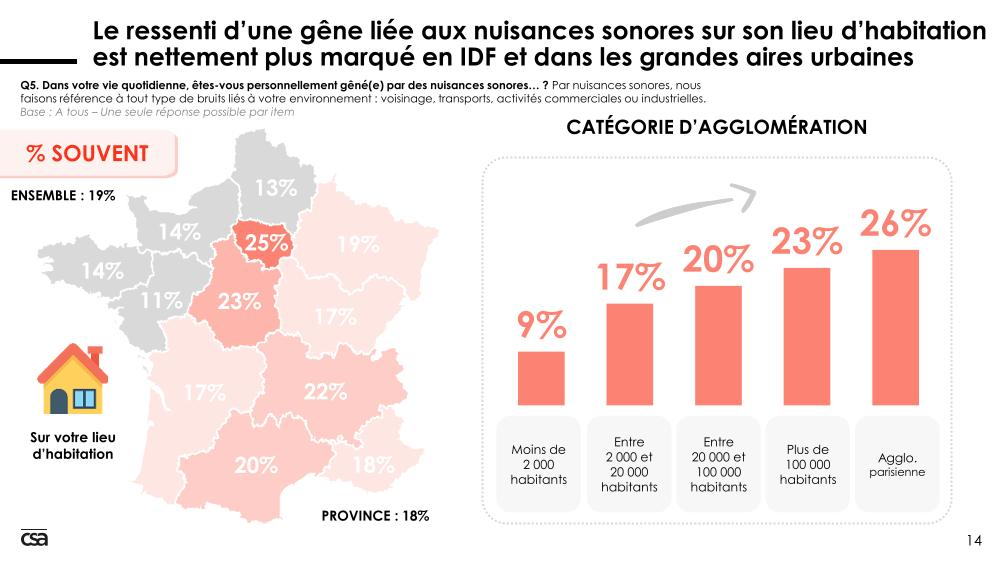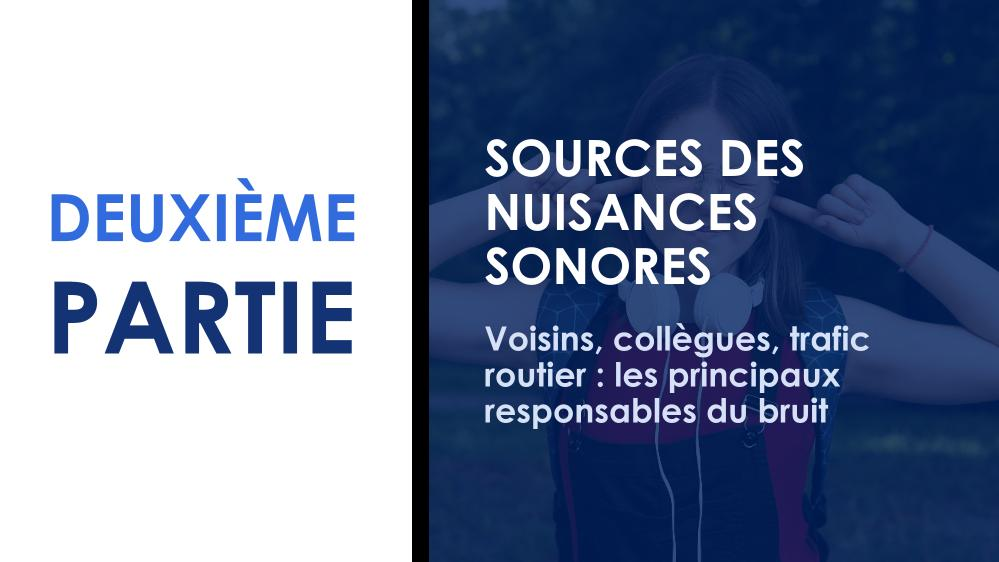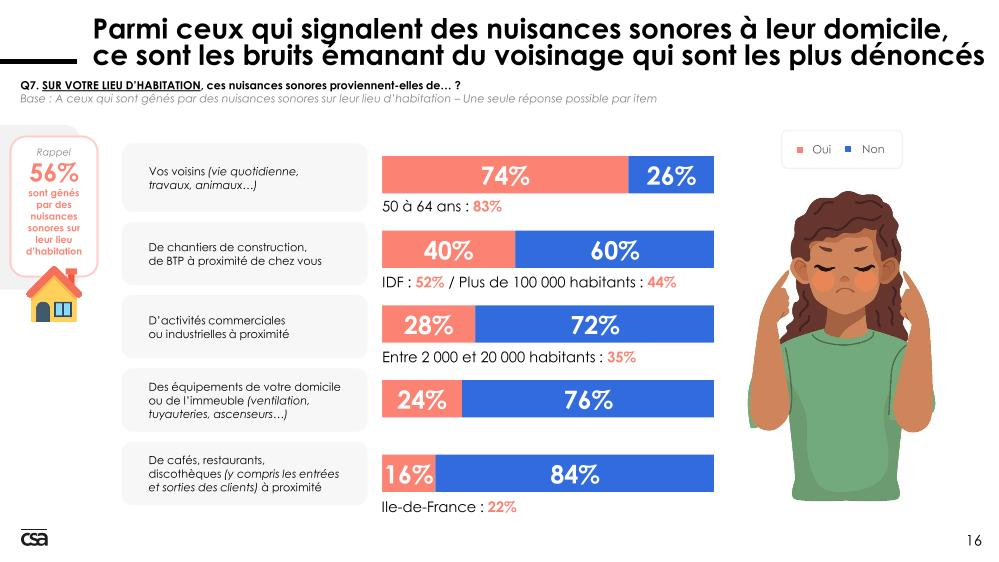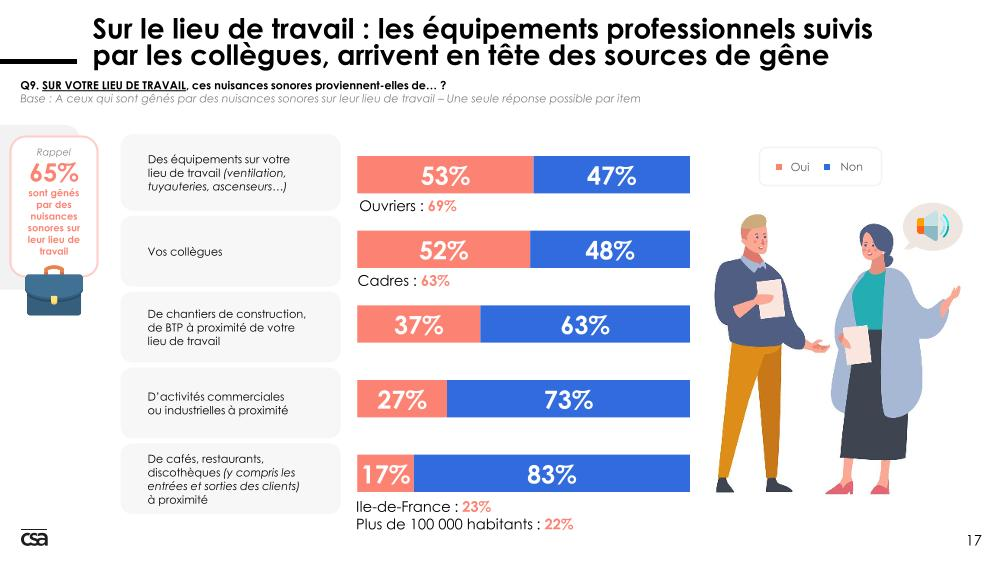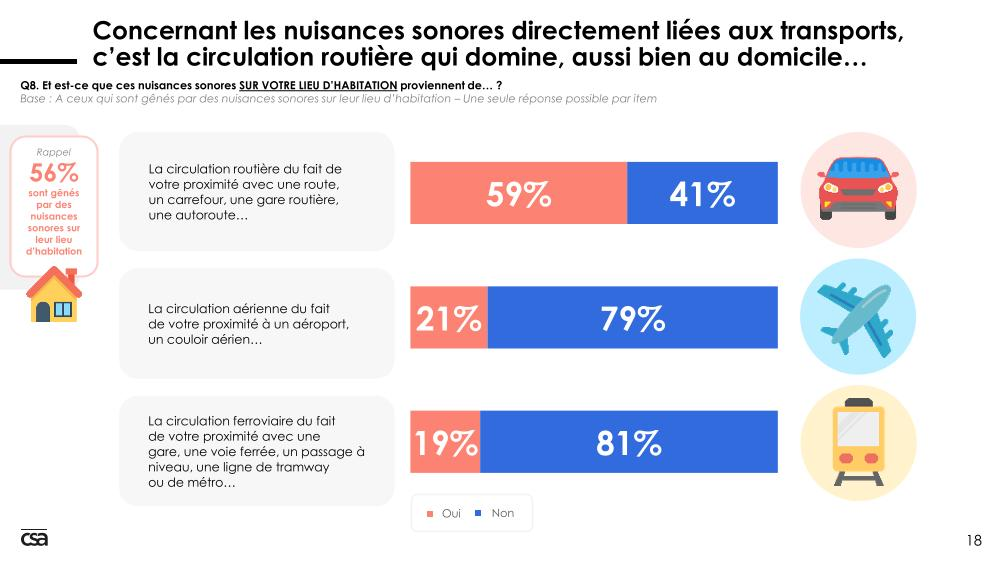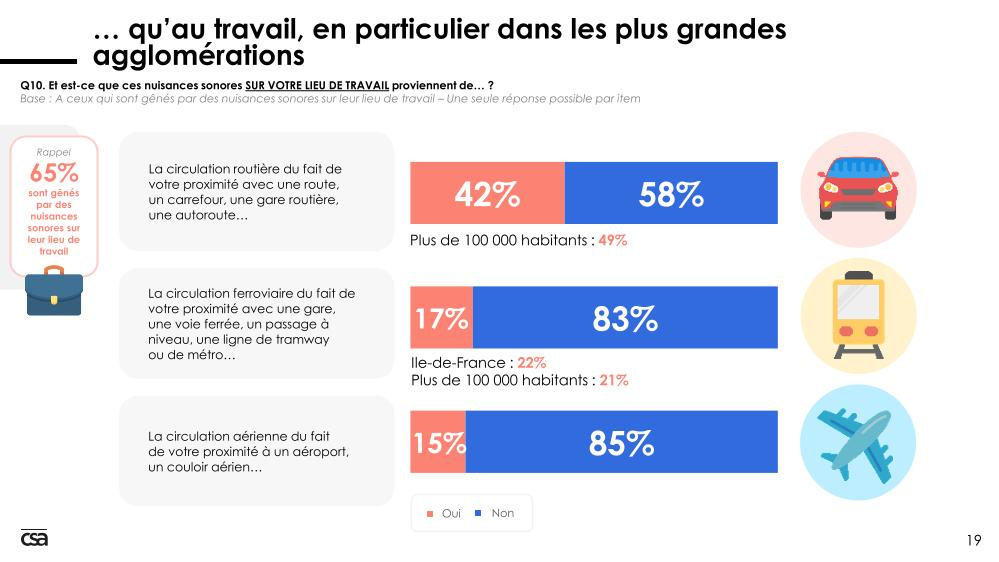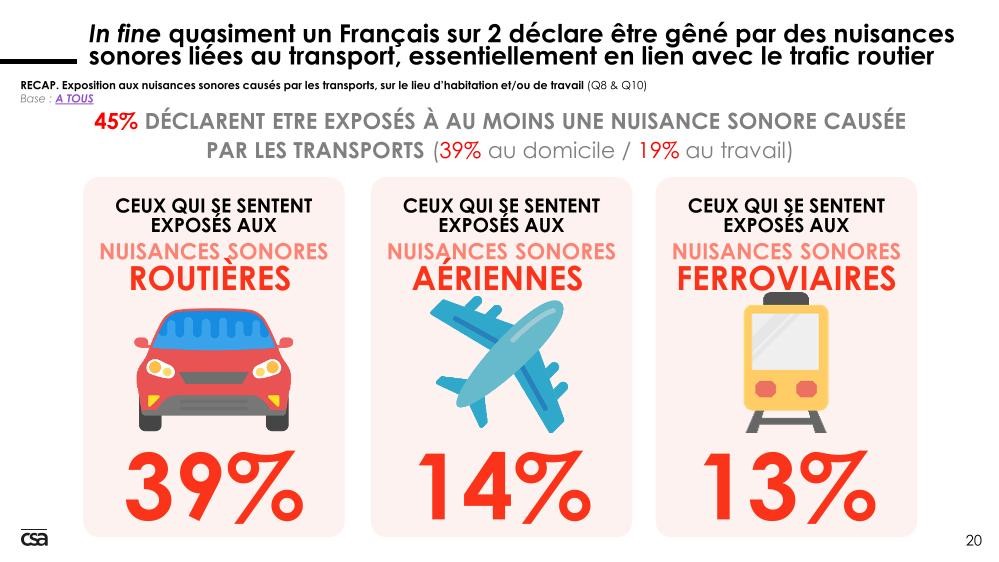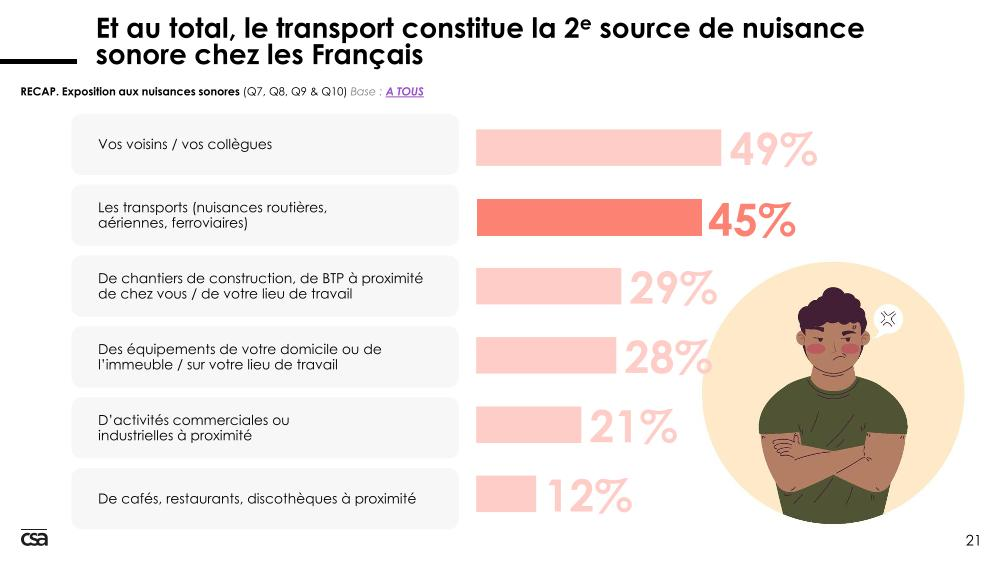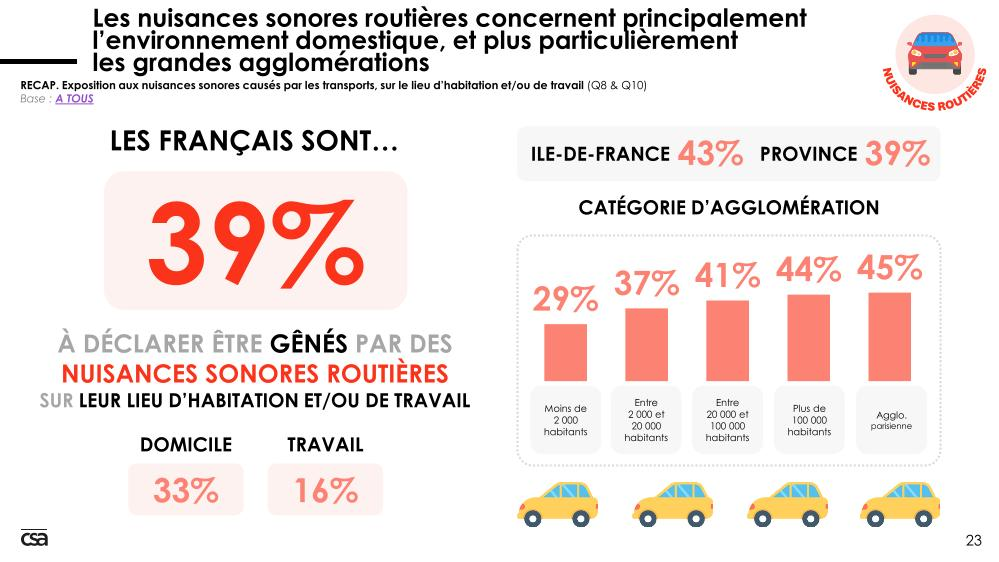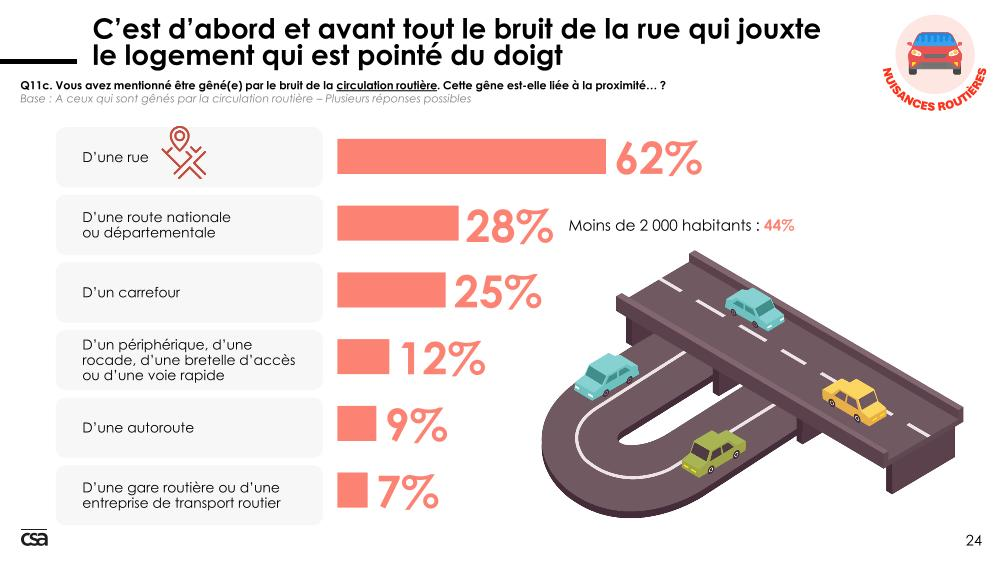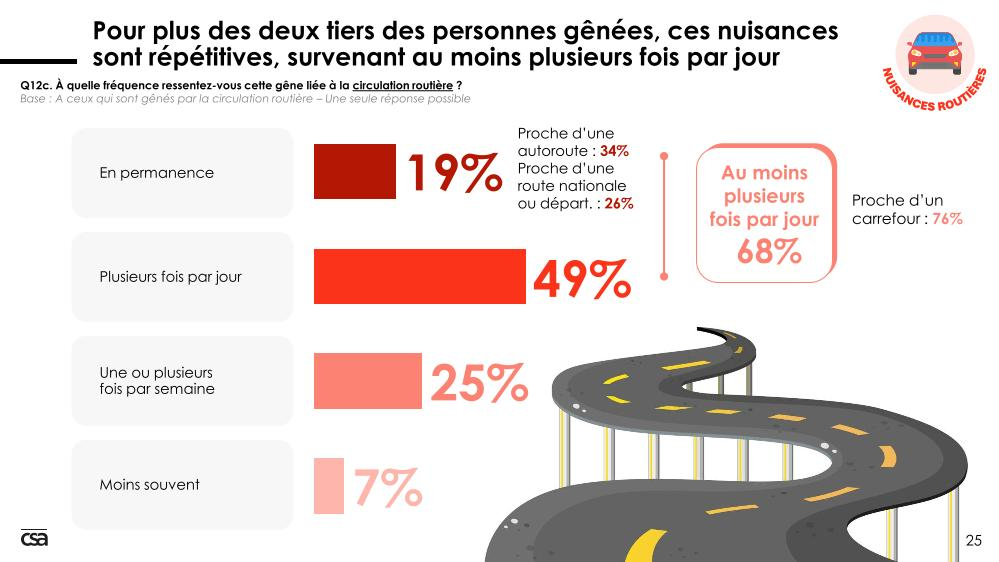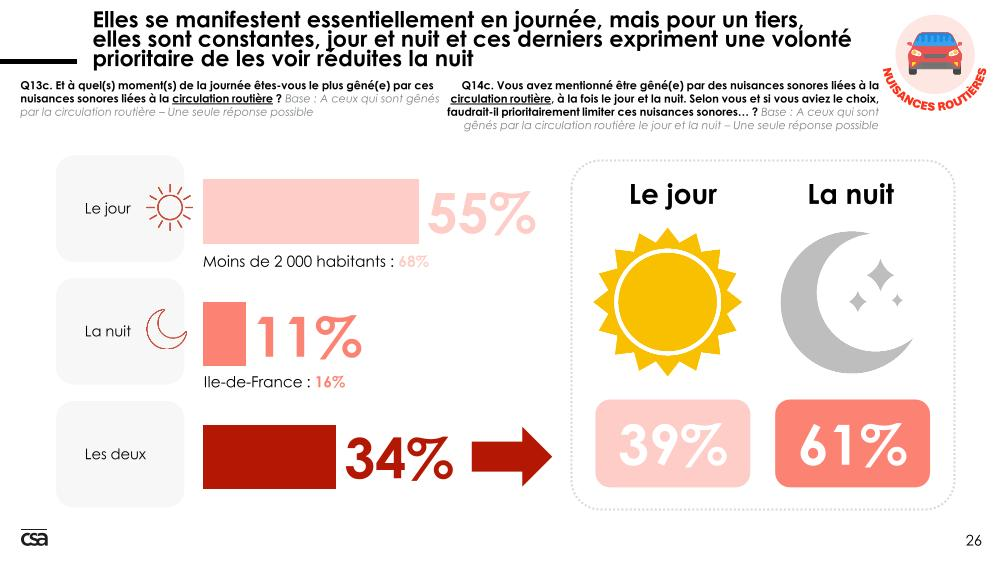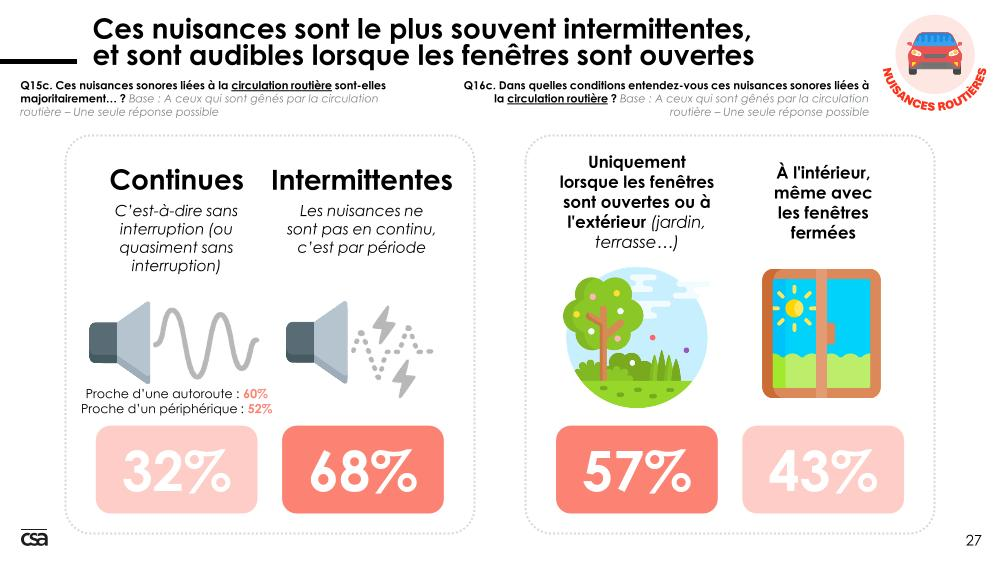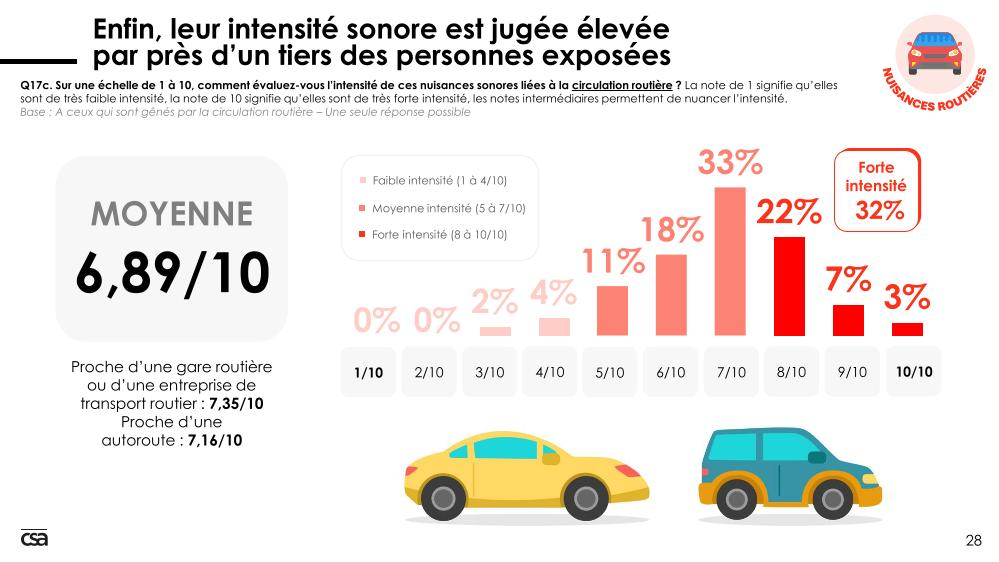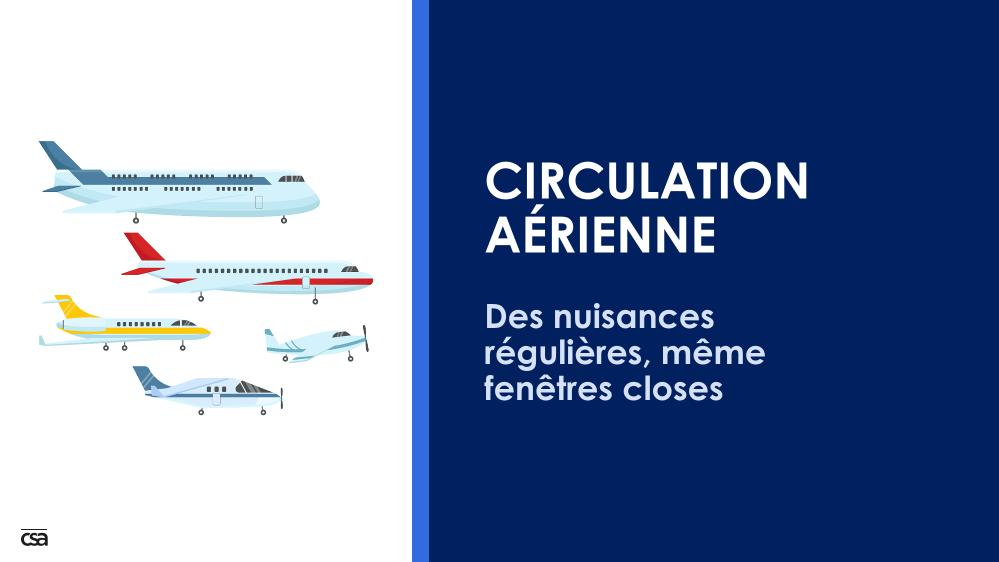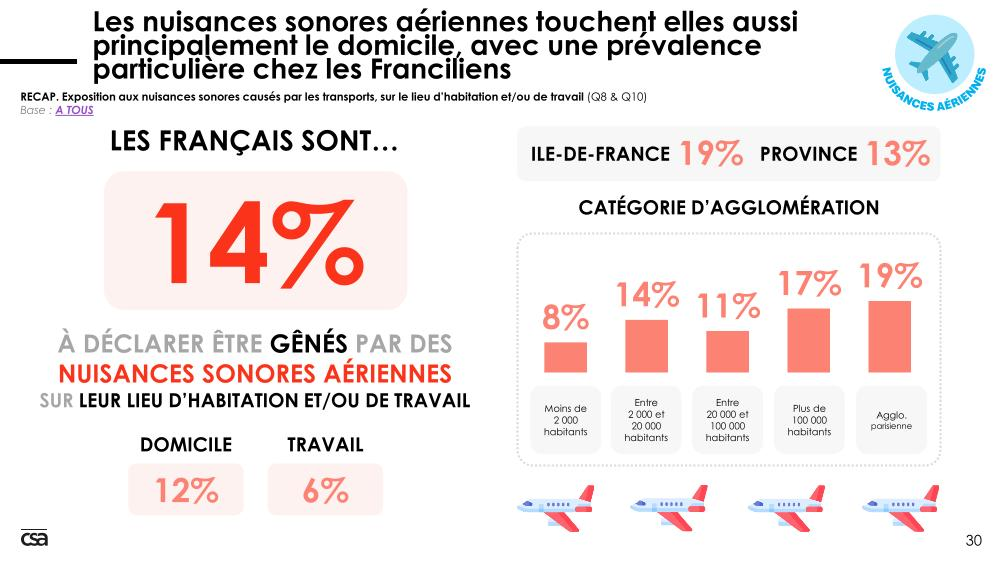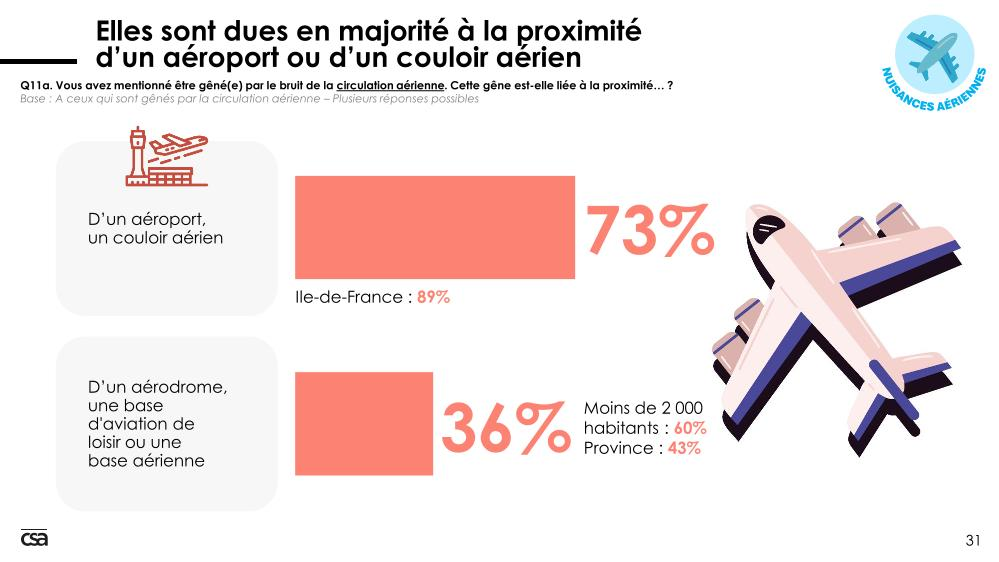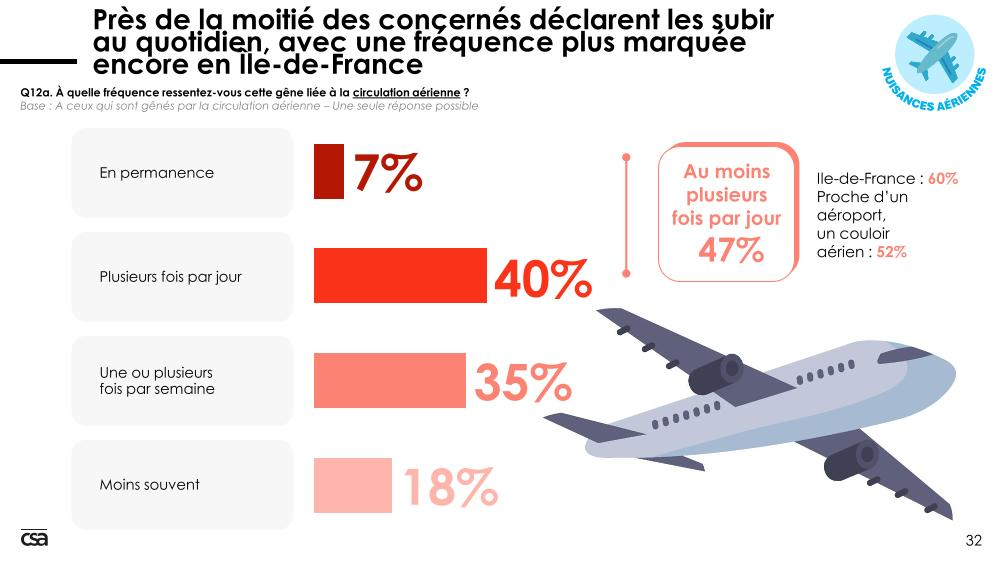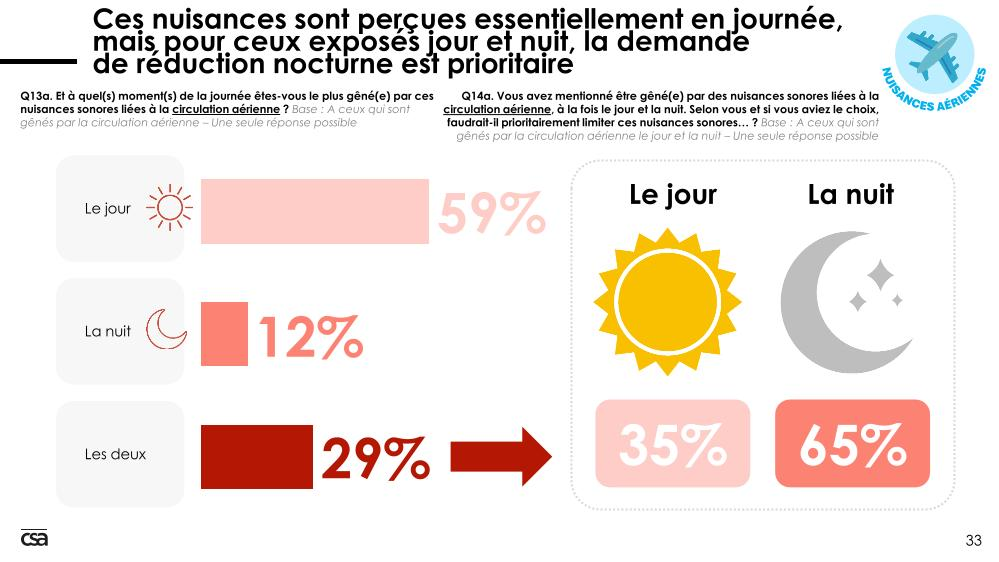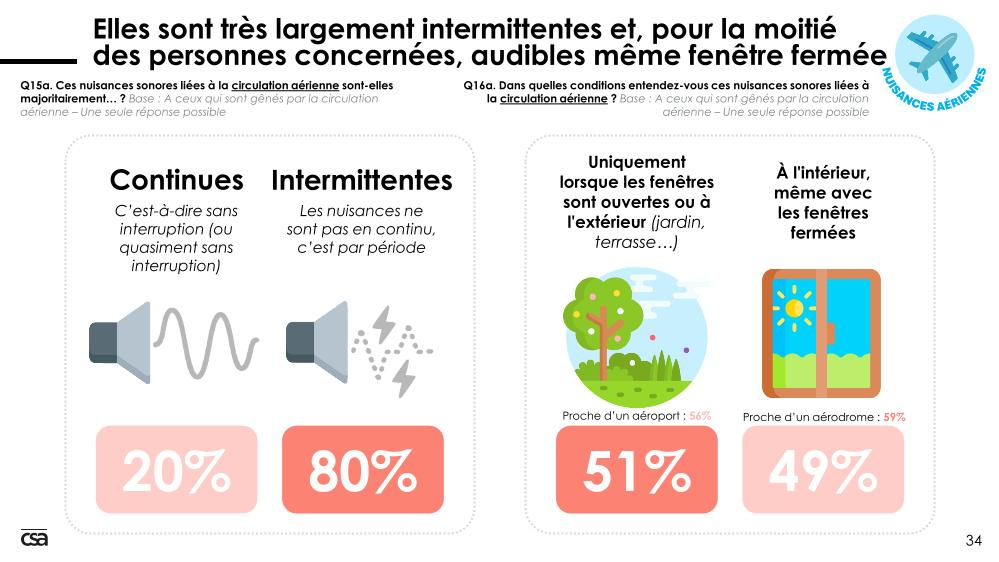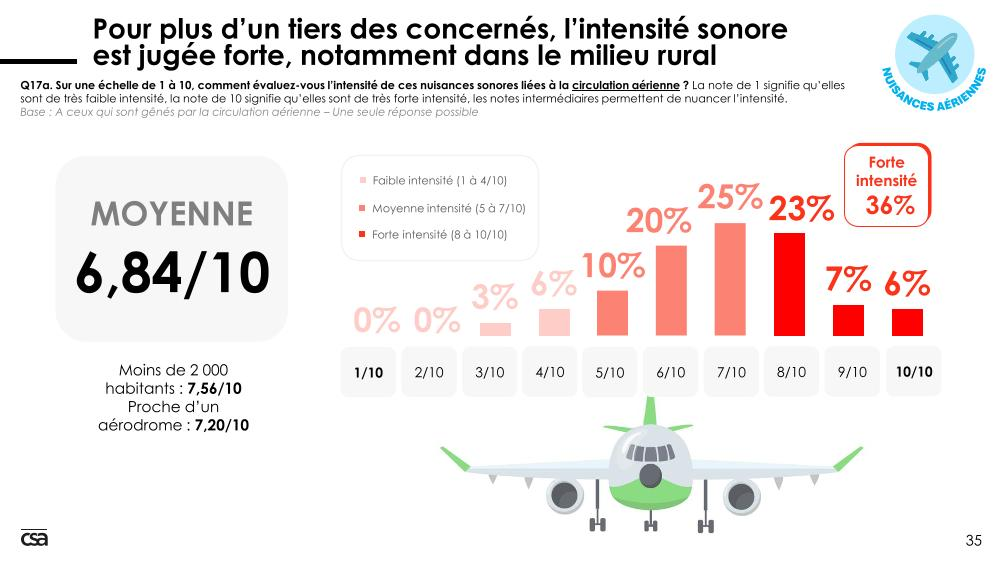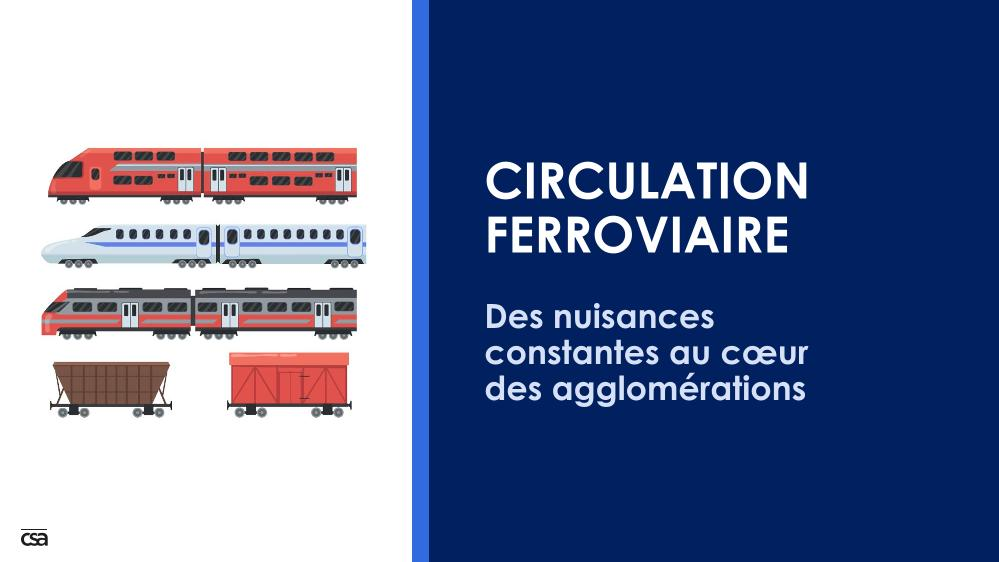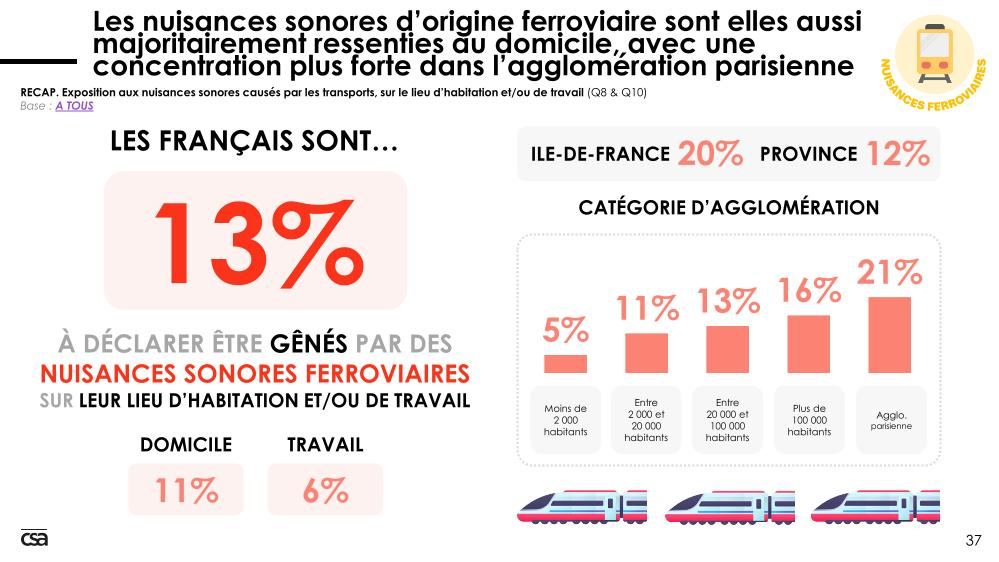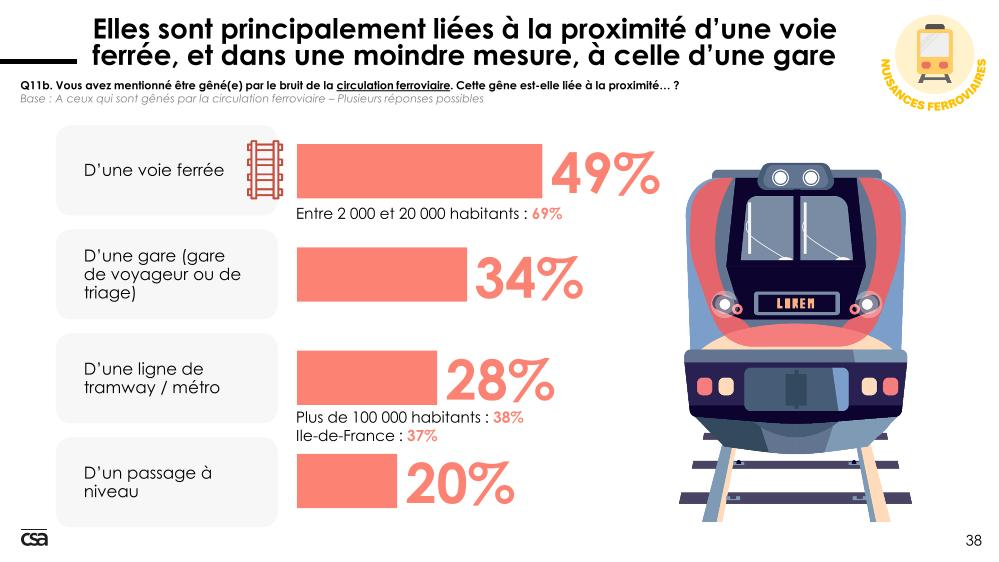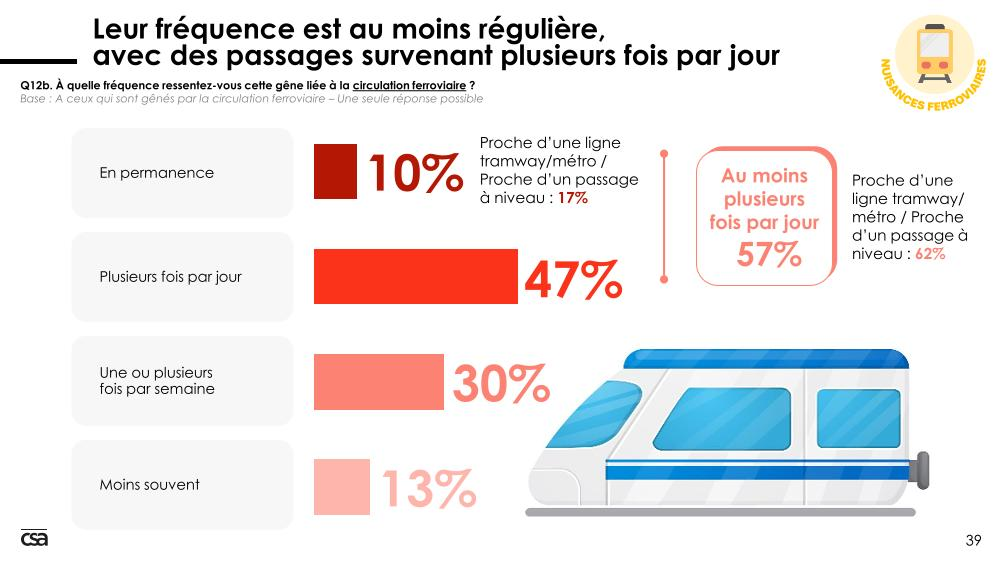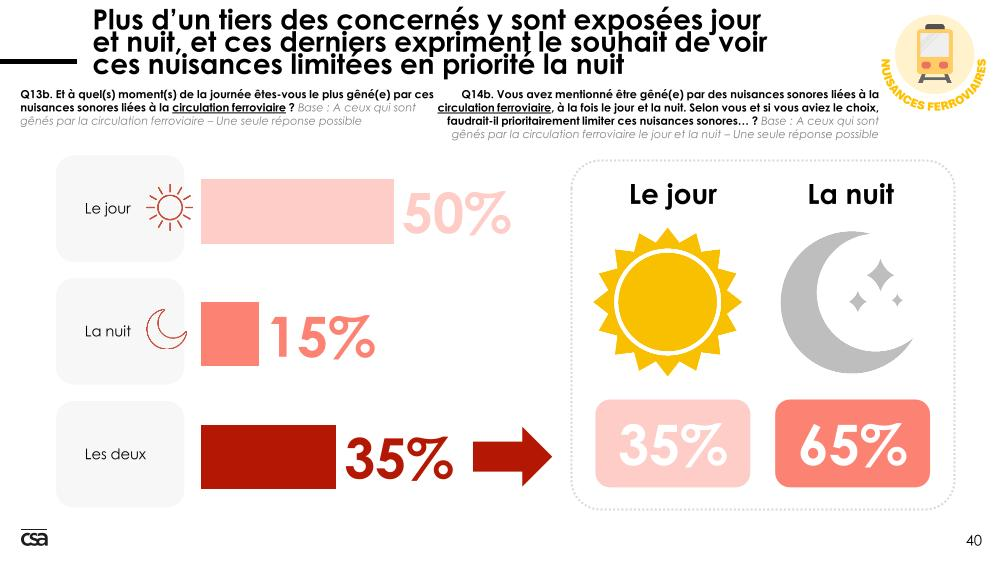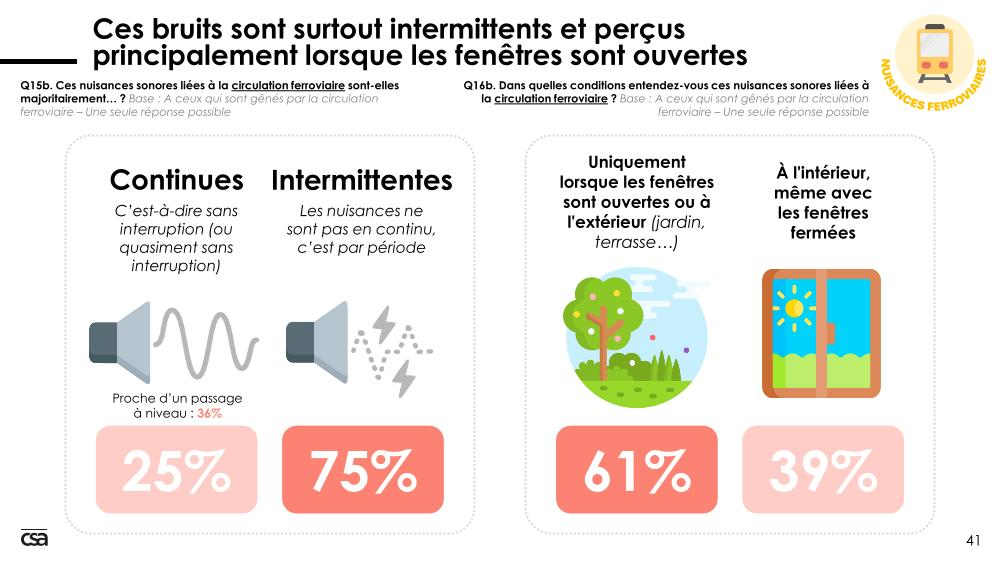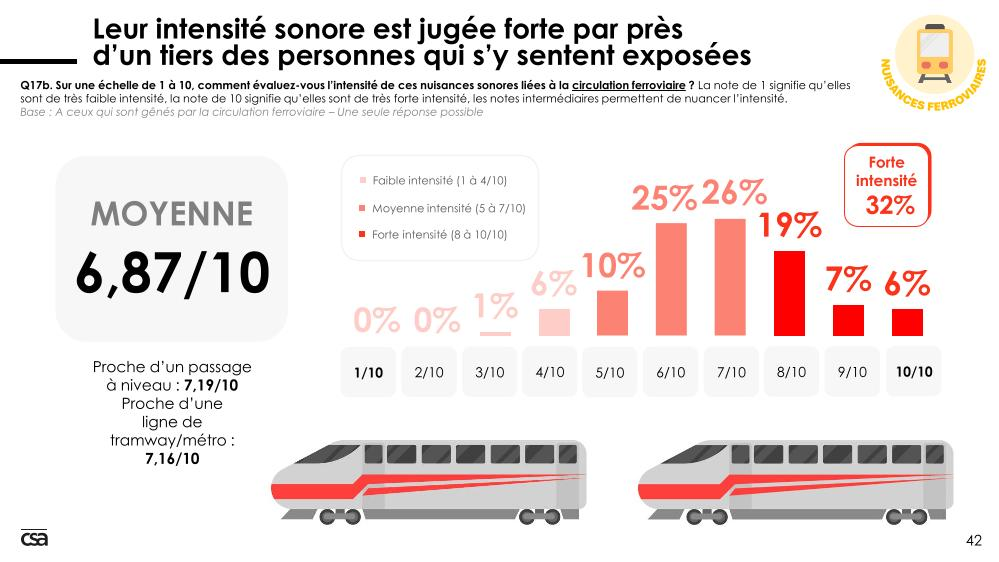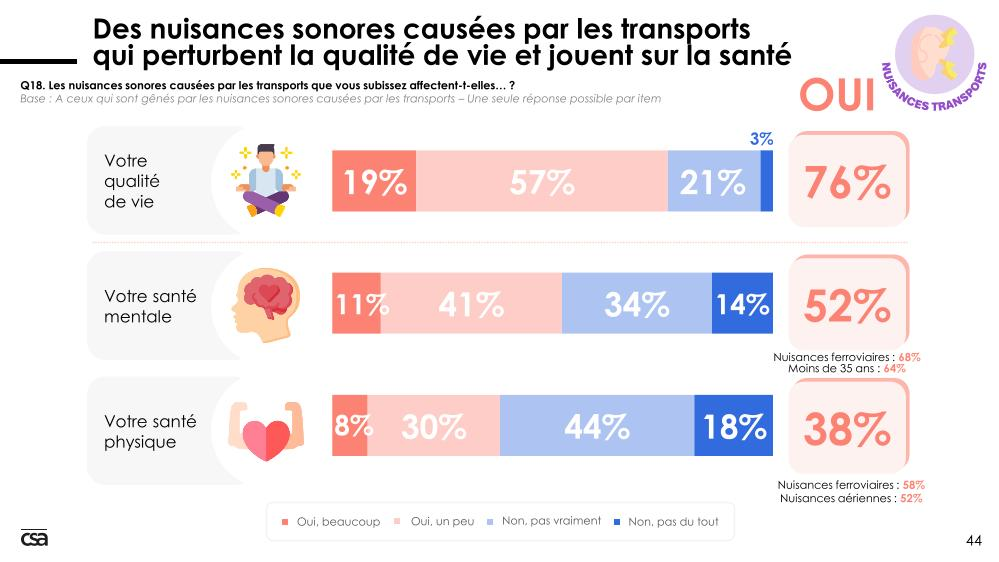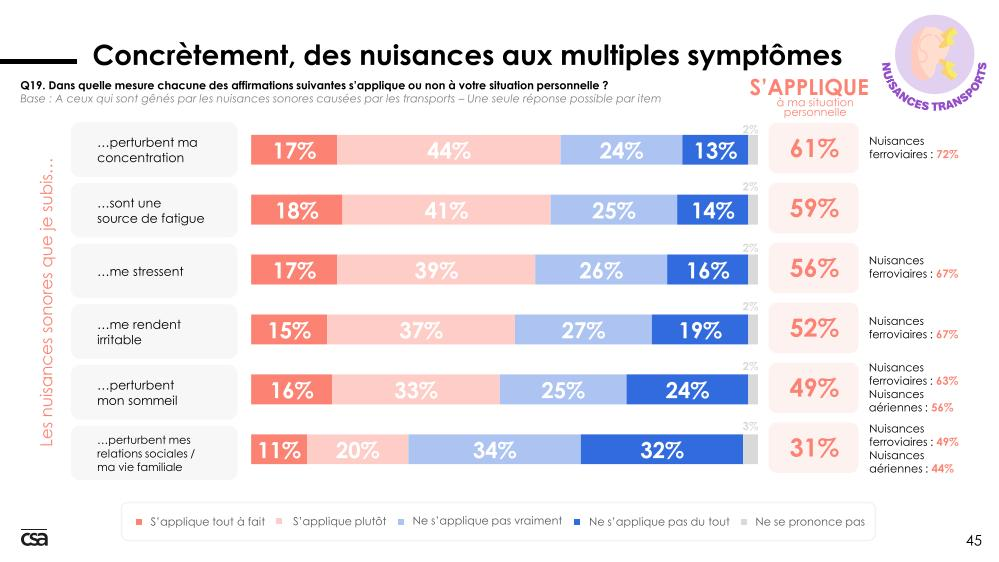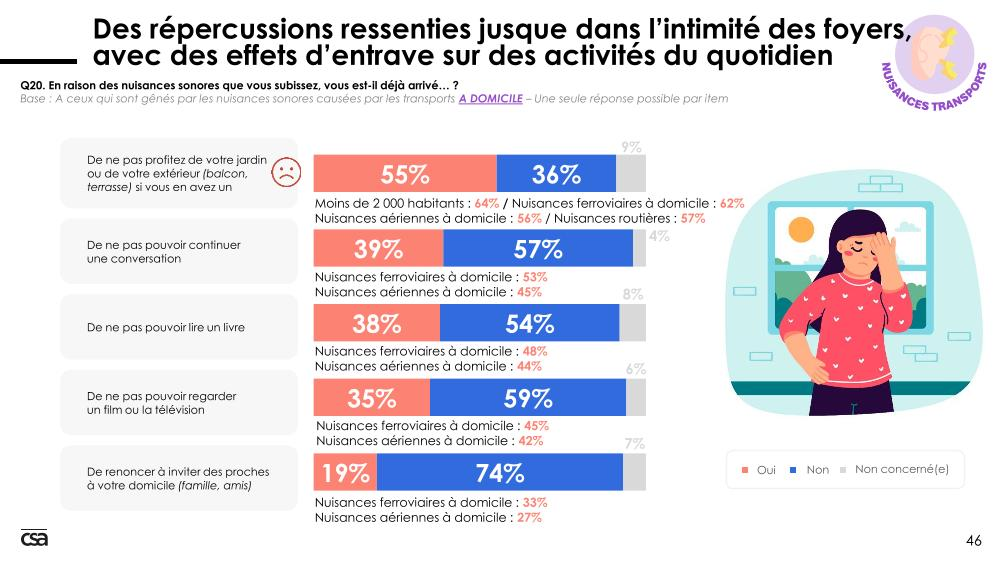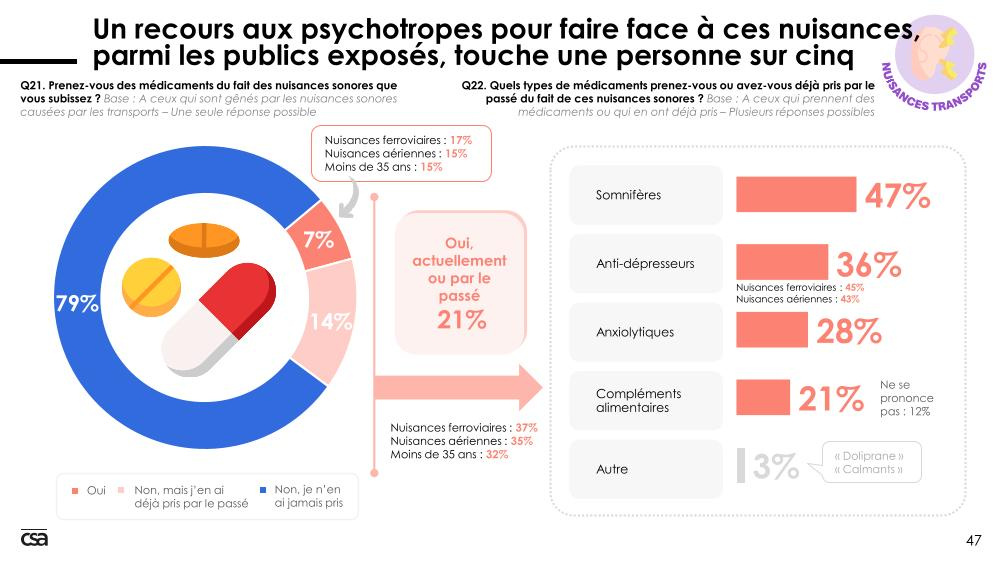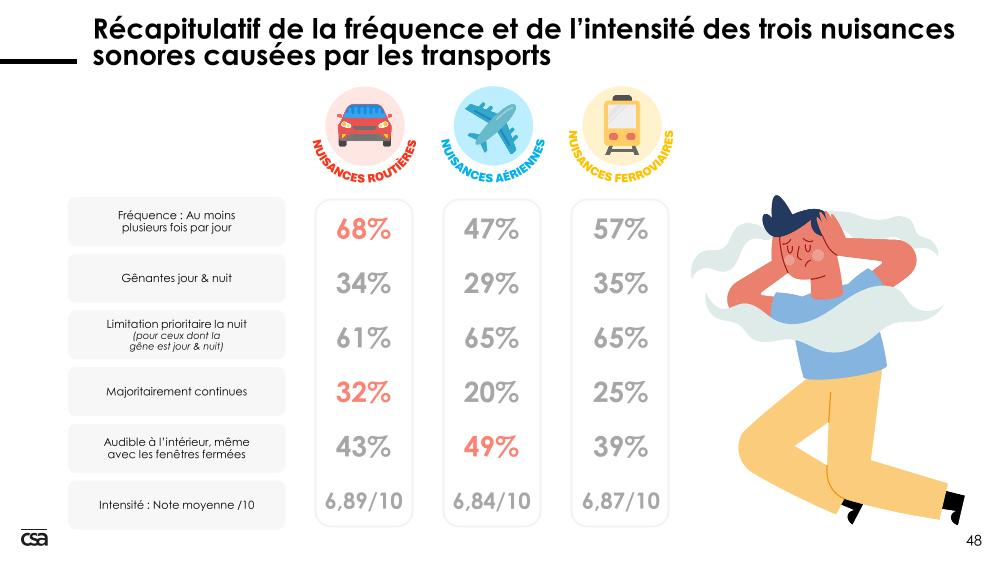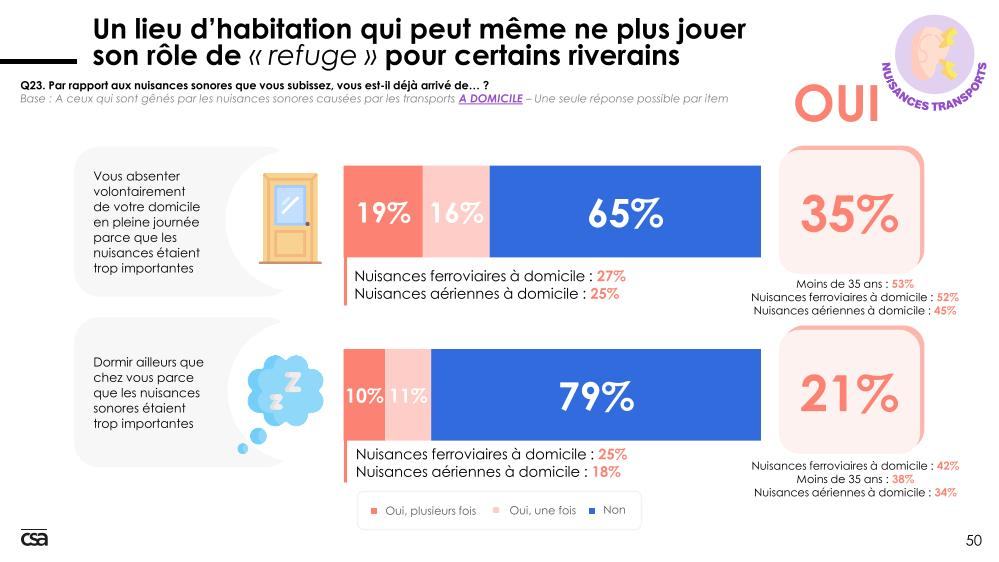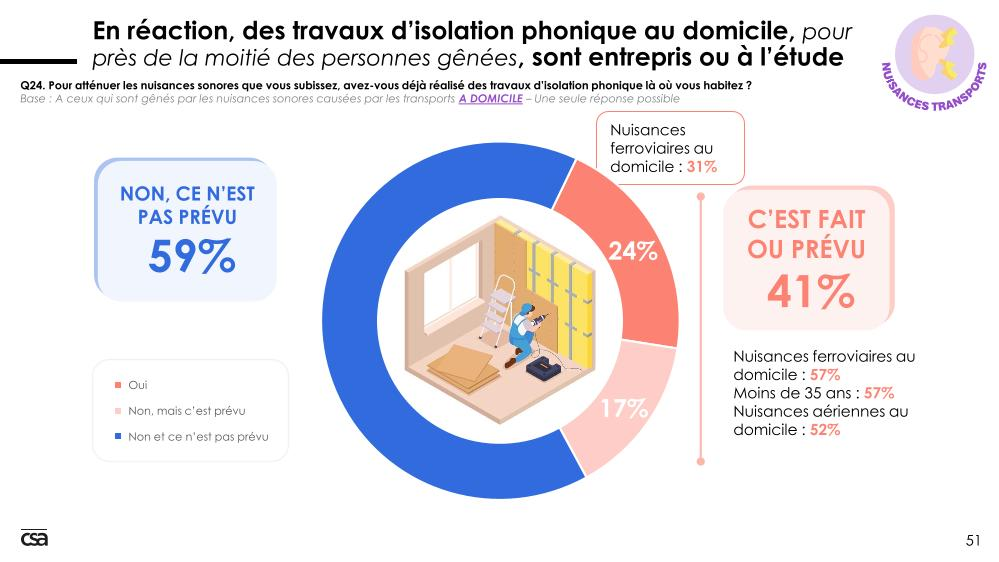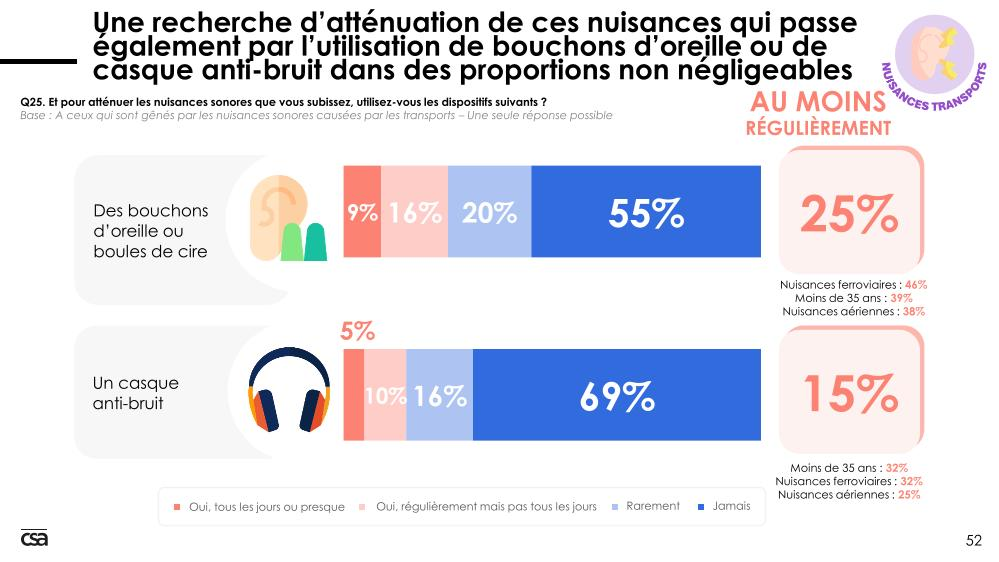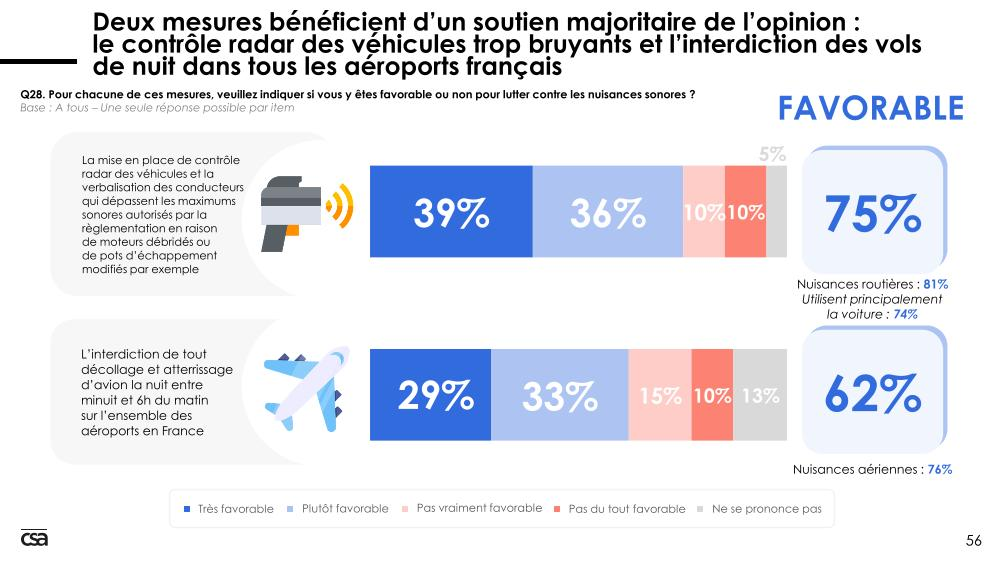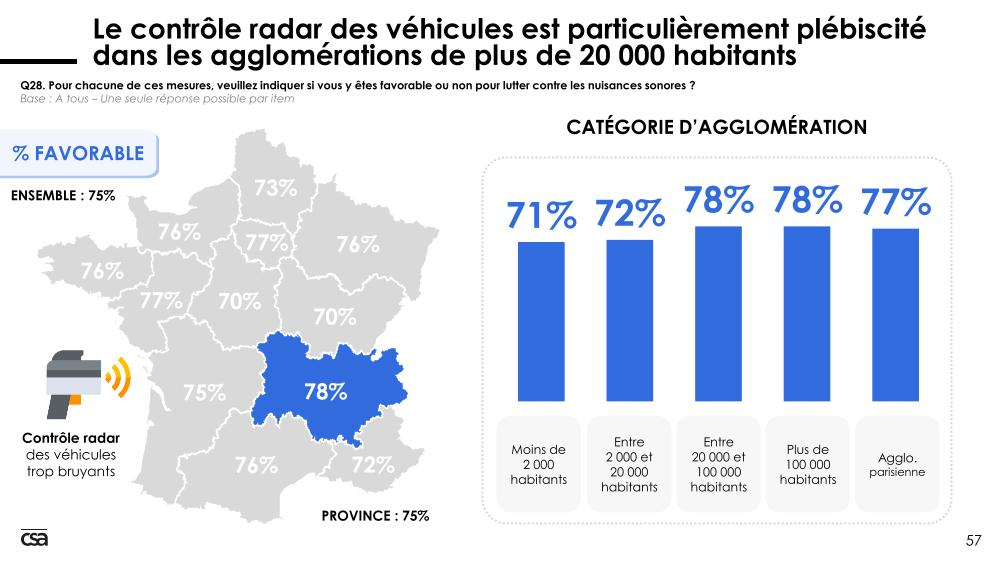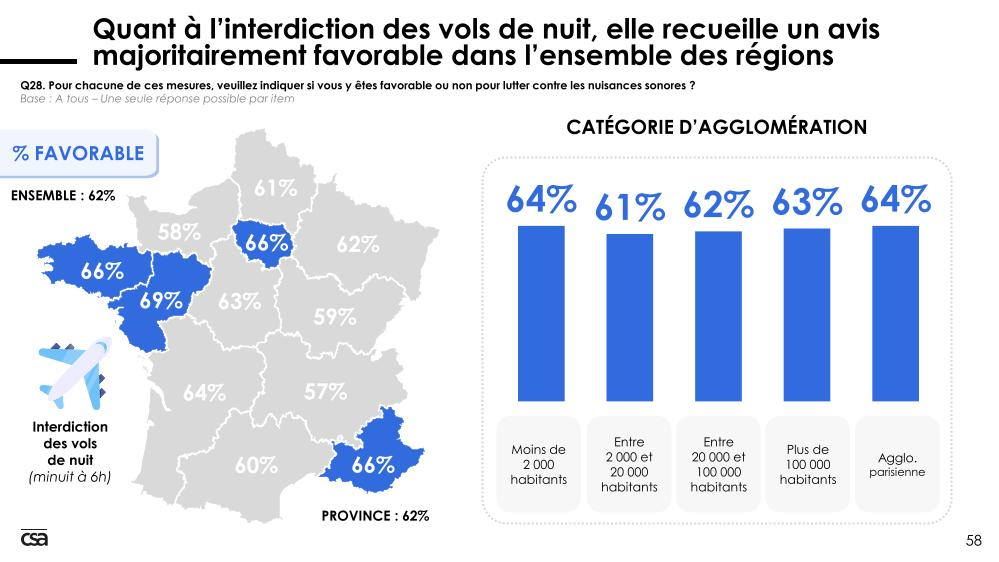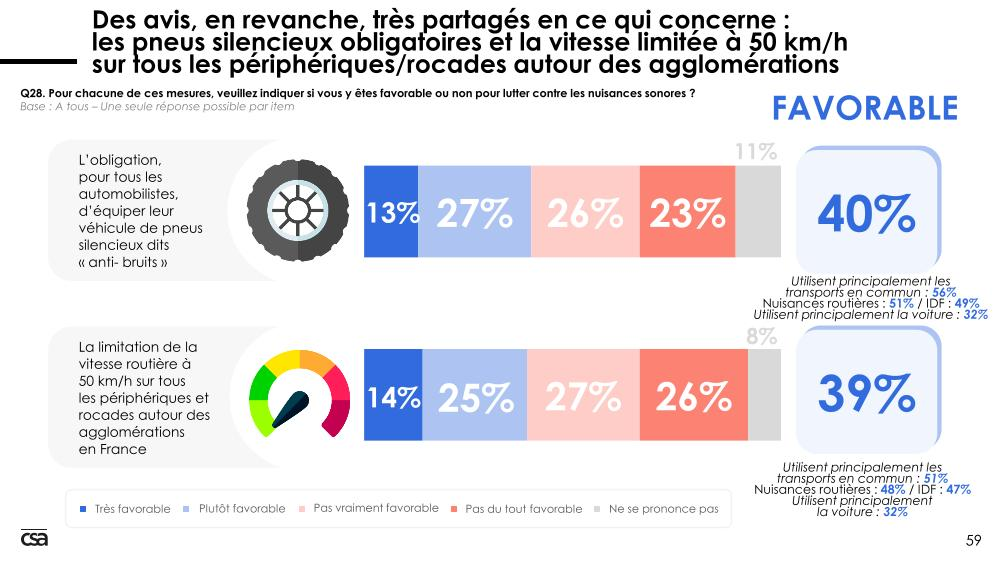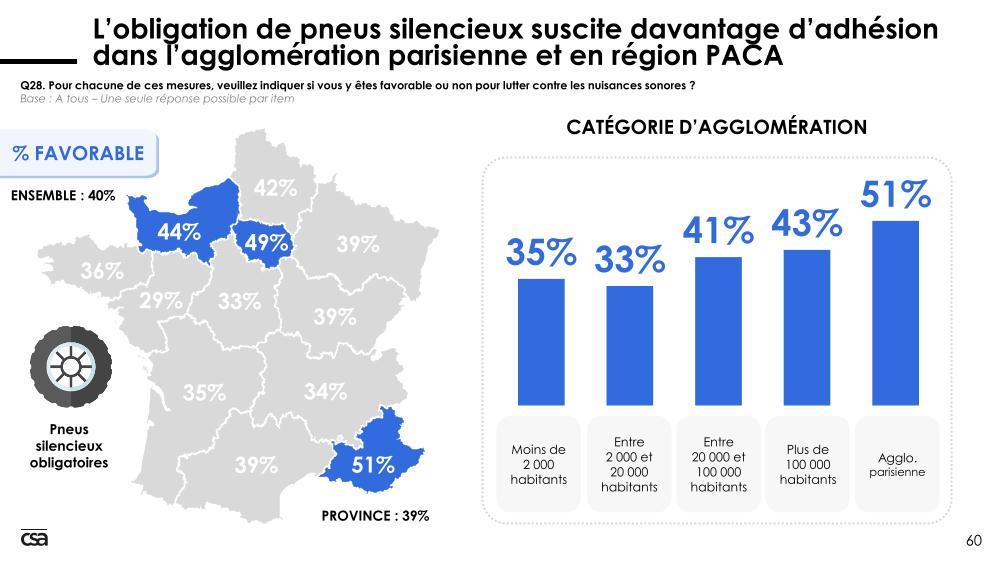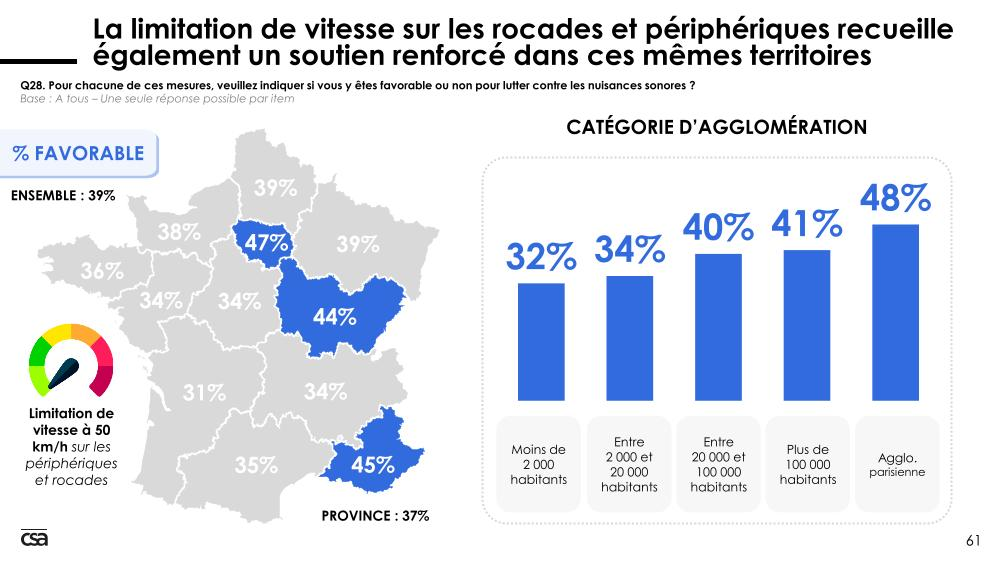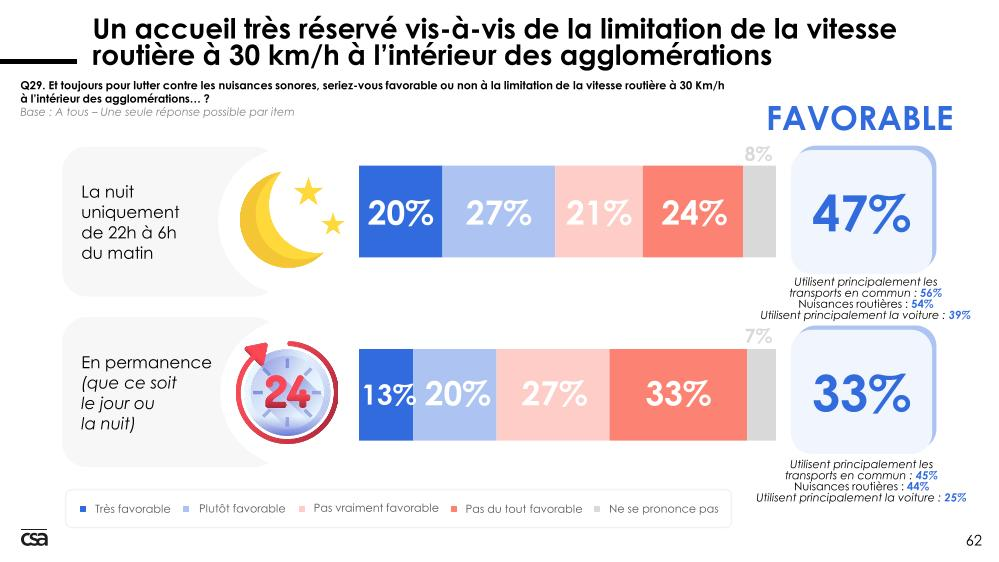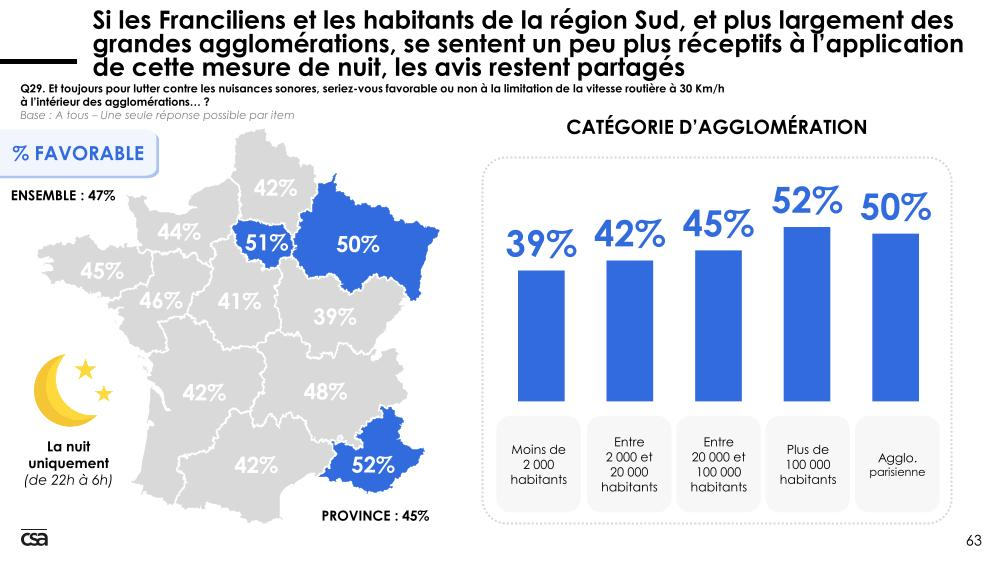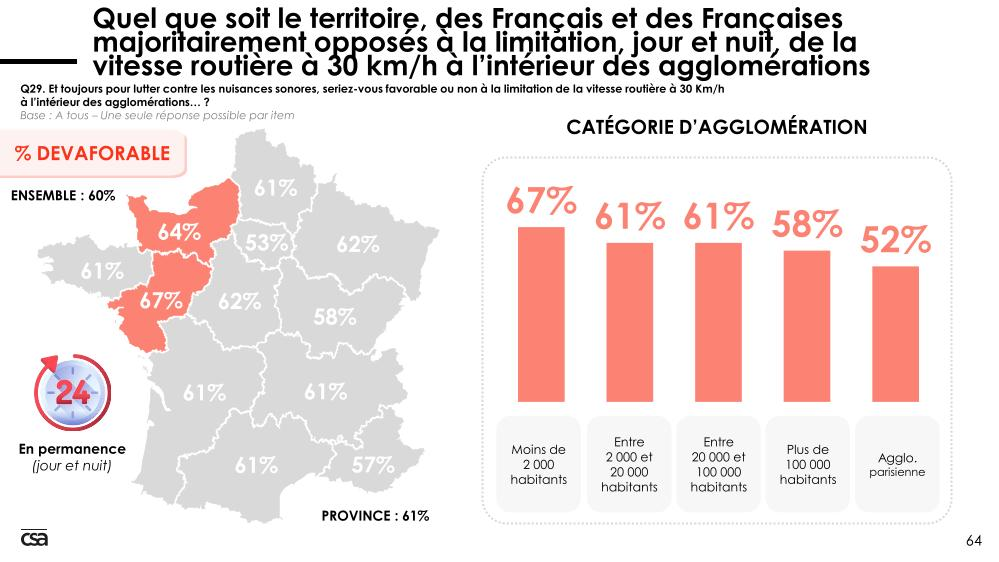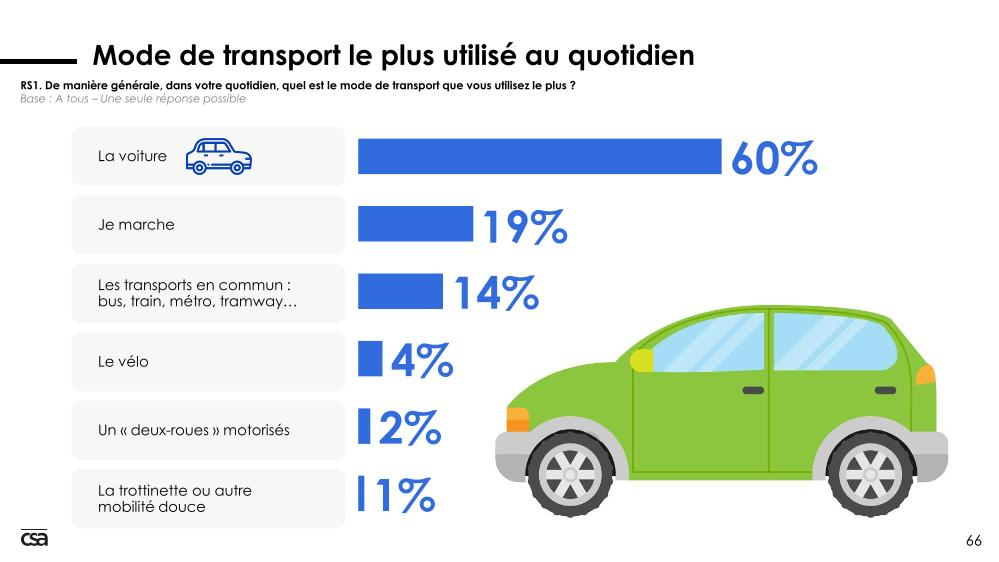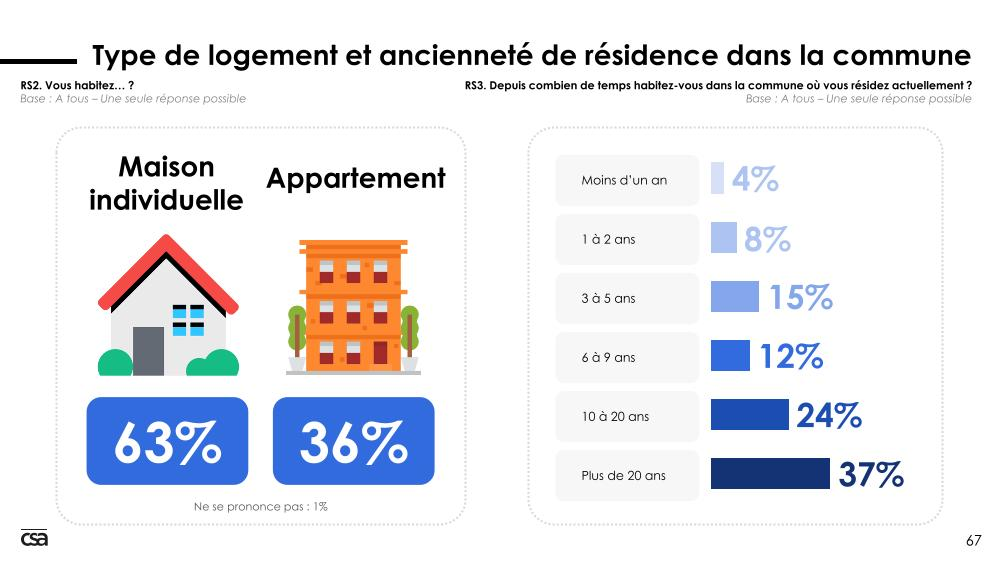- INDEX DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS
LE RAPPORT D'INFORMATION
- L'ESSENTIEL
- I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN
SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES
FRANÇAIS
- A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE
CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
- B. NUISANCES SONORES CAUSÉES PAR LES
TRANSPORTS : QUEL EST L'IMPACT DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT ?
- 1. Le transport routier : la principale
source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes
agglomérations
- 2. Le transport aérien : une exposition
de faible ampleur, mais de forte intensité
- 3. Le bruit ferroviaire : une cause
d'exposition spécifique des populations au bruit et aux
vibrations
- 1. Le transport routier : la principale
source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes
agglomérations
- A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE
CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
- II. UN FOISONNEMENT COMPLEXE ET PEU LISIBLE
D'OUTILS RÉGLEMENTAIRES
- A. UNE SUPERPOSITION ILLISIBLE D'OUTILS DE
CARTOGRAPHIE DU BRUIT ET DE PLANIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES
- 1. La cartographie du bruit : une utilisation
de référentiels divers, source de complexité
- 2. Classement sonore des voies et PPBE : une
cacophonie des outils de planification
- 3. Les plans de gêne sonore (PGS) : un
dispositif perfectible
- 4. Une prise en compte insuffisante du bruit dans
les documents d'urbanisme
- 1. La cartographie du bruit : une utilisation
de référentiels divers, source de complexité
- B. LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES : UNE
MESURE IMPARFAITE DE LA GÊNE LIÉE AU BRUIT
- C. UN ÉCART ENTRE LA RÈGLEMENTATION
ET LES SEUILS DE RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE DÉFINIS PAR
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
- A. UNE SUPERPOSITION ILLISIBLE D'OUTILS DE
CARTOGRAPHIE DU BRUIT ET DE PLANIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES
- III. LES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION
DES RISQUES NE S'APPUIENT PAS SUR DES LEVIERS EFFICACES POUR LUTTER CONTRE LE
BRUIT
- A. LES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE
L'EXPOSITION À LA POLLUTION SONORE SOUFFRENT D'UN MANQUE DE
PILOTAGE
- B. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU
BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS LIMITÉS ET MAL
MESURÉS
- 1. L'échec de la lutte contre les points
noirs de bruit
- 2. De nécessaires actions transverses de
lutte contre le bruit
- 3. Accentuer la lutte contre le bruit routier,
première source d'exposition aux nuisances sonores
- 4. Réduire les nuisances sonores
liées au transport ferroviaire
- 5. Une indispensable meilleure protection des
riverains contre le bruit aérien
- 1. L'échec de la lutte contre les points
noirs de bruit
- A. LES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE
L'EXPOSITION À LA POLLUTION SONORE SOUFFRENT D'UN MANQUE DE
PILOTAGE
- I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN
SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES
FRANÇAIS
- LISTE DES PROPOSITIONS
- TRAVAUX EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- DÉPLACEMENT
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES
PRINCIPALES PROPOSITIONS
- ANNEXE - LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
- ANNEXE - ÉTUDE D'OPINION
RÉALISÉE À LA DEMANDE DE LA MISSION D'INFORMATION
N° 783
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur les nuisances sonores causées par les transports,
Par MM. Guillaume CHEVROLLIER et Gilbert-Luc DEVINAZ,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.
INDEX DES SIGLES ET ACRONYMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT D'INFORMATION
AABV : Association antibruit de voisinage
AASQA : Association Agréée Surveillance Qualité de l'Air
Acnusa : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
ADVOCNAR : Association de défense contre les nuisances aériennes
ADP : Aéroports de Paris
AE : Autorité environnementale
AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France
AFRA : Association française du rail
Afsse : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
AOM : Autorité organisatrice des mobilités
ARS : Agence régionale de Santé
ASFA : Association des sociétés françaises d'autoroutes
AVC : Accident vasculaire cérébral
BPL : Bretagne-Pays de la Loire
CBS : Carte de bruit stratégique
CDC : Caisse des dépôts et consignations
Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CGEDD : Commissariat général de l'environnement et du développement durable
CIDB : Centre d'information et de documentation sur le bruit
Cinov Giac : Groupement de l'ingénierie acoustique
CJUE : Cour de justice de l'Union européenne
CNB : Conseil national du bruit
CNDP : Commission nationale du débat public
CPER : Contrat de plan État-Région
CSTB : Centre scientifique et technique des bâtiments
dB : Décibel
DDT : Direction départementale des territoires
DGAC : Direction générale de l'aviation civile
DGEC : Direction générale de l'énergie et du climat
DGITM : Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
DGPR : Direction générale de la prévention des risques
DGS : Direction générale de la santé
DHUP : Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DSR : Délégation à la sécurité routière
EIAE : Étude d'impact selon l'approche équilibrée
ETP : Équivalent temps plein
ETPT : Équivalent temps plein travaillé
FFB : Fédération française du bâtiment
FIF : Fédération des industries ferroviaires
FNAM : Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers
FNE : France Nature Environnement
GIFAS : Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
IDFM : Île-de-France Mobilités
LAeq : niveau équivalent de pression acoustique pondéré à une période de temps T
LAmax : niveau « instantané » le plus élevé mesuré par le sonomètre pendant la durée d'observation
Lden : Level Day-Evening-Night
LGV : ligne à grande vitesse
LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais
Lnight : Level night
LOM : Loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONR : Observatoire national de la route
PCAET : Plan climat-air-énergie territoriaux
PDM : Plan de mobilité
PEB : Plan d'exposition au bruit
PGS : Plan de gêne sonore
PLU : Plan local d'urbanisme
PPBE : Plan de prévention des bruits dans l'environnement
SCoT : Schémas de cohérence territoriale
SEA : Sud Europe Atlantique
SFA : Société française d'acoustique
SGP : Société des Grands Projets
SRADDET : Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
STI : Spécifications techniques d'interopérabilité
TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TNSA : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
UAF : Union des aéroports français
UFCNA : Union française contre les nuisances des aéronefs
L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité le rapport d'information de Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz sur la pollution sonore liée aux transports. Pour les rapporteurs, le constat est sans appel : la lutte contre le bruit, sujet au coeur du quotidien des Français, est loin d'être une priorité des pouvoirs publics.
Pourtant, un sondage réalisé à l'initiative de la commission1(*) révèle que le bruit est en tête des préoccupations de 27 % des Français sondés, devant d'autres perturbations quotidiennes comme les déchets dans l'espace public ou les pollutions de l'air, des sols et des eaux.
Près de la moitié de nos concitoyens se considèrent en effet exposés au bruit des transports à leur domicile ou sur leur lieu de travail, notamment en milieu urbain. Pour autant, le bilan des politiques publiques de lutte contre le bruit des transports fait apparaître que les moyens juridiques et humains déployés pour répondre à cette problématique de santé publique ne sont pas à la mesure des enjeux. Les outils réglementaires nationaux, largement perfectibles et faiblement opérationnels, s'écartent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les référentiels utilisés sont inadaptés, et les publics les plus exposés ne bénéficient pas d'un accompagnement suffisant pour mieux s'isoler du bruit.
Face à ce constat réaliste, la commission a adopté à l'unanimité 22 recommandations, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le bruit causé par les transports et, ainsi, mieux protéger la santé de nos concitoyens. Elle juge indispensable l'élaboration d'un plan national pour protéger les populations vivant dans les lieux les plus exposés au bruit, les « points noirs de bruit ». Elle appelle également de ses voeux :
- une adaptation de notre réglementation pour mieux protéger les riverains des infrastructures de transports routiers, ferroviaires et aériens ;
- une vigilance particulière par rapport au secteur du transport routier, principale source d'exposition au bruit causé par les transports.
I. LE BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS : UNE POLLUTION AUX EFFETS SANITAIRES MAJEURS
A. UN FRANÇAIS SUR DEUX EST EXPOSÉ AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS
Le sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que l'exposition aux bruits engendrés par les transports affecte environ 45 % des Français. La gêne ressentie liée les pollutions sonores varie d'une génération à une autre, ainsi pour la tranche d'âge des 35-49 ans, elle est particulièrement aiguë.
La perception des pollutions sonores et de la gêne en résultant dépend en effet largement de l'âge et du lieu de vie.
Part de la population se déclarant exposée aux nuisances sonores routières selon la taille de l'agglomération
Le transport routier - deux-roues, voitures, poids-lourds - est identifié par le sondage comme la principale source de pollutions sonores. Les causes sont évidentes : c'est en effet le premier mode de transport des Français, le bruit généré par ce mode de transport est donc massif : le réseau routier dessert l'ensemble du territoire, à la différence du trafic aérien et ferroviaire, concentré à proximité des aéroports et des voies de chemin de fer.
L'exposition aux pollutions sonores est particulièrement forte en milieu urbain et progresse avec la taille de l'agglomération, pour tous les modes de transport.
Source : Sondage réalisé à la demande de la mission d'information
B. LE BRUIT CAUSÉ PAR LES TRANSPORTS AFFECTE LA SANTÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES
Les effets sanitaires du bruit causé par les transports justifient de l'appréhender non comme une nuisance, mais comme une véritable « pollution ».
Ses impacts négatifs multiples sur la santé touchent toute la population ainsi que l'a mis en avant l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) : perturbations du sommeil, troubles de l'apprentissage chez l'enfant, risque accru d'infarctus du myocarde, hypertension artérielle ou encore aggravation de risques de désordres psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Les coûts induits par les pollutions sonores sont difficilement quantifiables, mais certaines conséquences sont objectivées.
II. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE ET PEU LISIBLE, EN MAL D'EFFICACITÉ
A. CARTES ET PLANS DE LUTTE CONTRE LE BRUIT : UN MAQUIS PEU OPÉRATIONNEL
Éparse et complexe, la réglementation de la lutte contre les pollutions sonores s'est forgée par strates successives, sans approche globale.
Le législateur s'est dans un premier temps, en 1985, borné à encadrer les émissions acoustiques du transport aérien, en créant :
- les plans d'exposition au bruit (PEB)2(*), qui délimitent des zones à proximité des aéroports soumises à des règles d'urbanisme limitant la construction de logements ;
- les plans de gêne sonore (PGS), qui ouvrent aux riverains résidant dans les zones exposées au bruit des aéroports le bénéfice d'une aide financière à l'isolation phonique de leur logement3(*).
Puis, une étape plus ambitieuse a été franchie avec la loi « bruit » du 31 décembre 1992 afin de prendre en compte l'ensemble du spectre des nuisances sonores. Ce texte est, d'ailleurs, toujours le cadre de référence en la matière. Cette loi définit un « classement sonore des voies » de transports terrestres les plus bruyantes et des obligations de protection des riverains situés à leur proximité.
Enfin, la directive européenne « bruit » du 25 juin 20024(*) a invité les États membres à mettre en place une cartographie du bruit dans un périmètre déterminé (grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport) par le biais de cartes de bruit stratégiques (CBS). Des « plans de prévention des bruits dans l'environnement » (PPBE) visant la réduction du bruit ont également été définis pour mettre en oeuvre cette exigence européenne dans notre droit.
Force est de constater que ces outils se superposent sans qu'une remise à plat rationnelle et une réflexion d'ensemble aient été menées : un seul et même émetteur de bruit doit appliquer une multitude de normes.
Ainsi, les grandes infrastructures de transports terrestres sont répertoriées dans des CBS et dans le classement sonore des voies de transport terrestre. Cet enchevêtrement est source d'illisibilité et de complexité, car les indicateurs de bruit utilisés dans ces documents, applicables aux mêmes infrastructures, ne sont pas identiques.
Le cas des PPBE est révélateur de cette complexité. Les périmètres de plusieurs PPBE peuvent se chevaucher, notamment dans les grandes agglomérations. En outre, les mesures qui y figurent n'ont pas de valeur normative et leur non-respect ne fait l'objet d'aucune sanction. Il en résulte un manque d'appropriation de cet outil, perçu comme une contrainte administrative par les acteurs concernés. Un autre symptôme de ce faible intérêt pour les PPBE est que certains d'entre eux, obligatoires au regard du droit de l'Union européenne (UE), n'ont toujours pas été réalisés, si bien que la Commission européenne a ouvert une procédure de recours en manquement à l'encontre de la France.
Proposition : Rationaliser l'élaboration des PPBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen.
B. METTRE À JOUR NOS NORMES : UN IMPÉRATIF POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
Actuellement, les réglementations française et européenne utilisent des indicateurs énergétiques qui mesurent un niveau moyen annualisé de bruit.
Cette méthode, adaptée pour mesurer la gêne liée au bruit routier, se fonde sur une logique linéaire. Moins opérationnelle pour le transport ferroviaire et aérien, elle présente l'inconvénient de lisser les pics de forte intensité entrecoupés de silences. Pourtant, ces bruits sont gênants la nuit : ils perturbent la qualité du sommeil et méritent donc d'être pris en compte. Cette approche est en décalage manifeste avec la gêne ressentie par les riverains. À titre d'exemple, une voie ferroviaire comptant moins de 50 trains par jour n'est pas considérée comme une installation bruyante.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 20195(*) a prévu, pour mesurer le bruit ferroviaire, le recours à des indicateurs dits événementiels, qui prennent en compte l'intensité et le nombre d'événements sonores : ils permettent d'éviter d'appréhender de la même façon un bruit moyen et durable et des pics de bruit répétés. Cet instrument est expérimenté depuis 2022 pour le transport ferroviaire. Le transport aérien fait l'objet d'une démarche analogue depuis 2023. Pour l'heure, ces expérimentations n'ont pas encore permis la définition d'indicateurs fiables en raison des difficultés techniques rencontrées.
Proposition : Appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique.
En outre, l'OMS a défini en 2018 des seuils au-delà desquels l'exposition au bruit des transports est nocive pour la santé. Les plafonds définis dans la réglementation française sont moins disant par rapport aux indicateurs internationaux. Cet écart entre notre droit et les recommandations de l'OMS est peu satisfaisant. Cependant, l'application stricte de ces exigences aux nouveaux projets d'infrastructures de transport semble difficile à envisager dans l'immédiat, au risque d'empêcher le développement de projets indispensables au report modal et au respect de nos engagements climatiques.
Pour les rapporteurs, ce principe de réalité ne doit pas, pour autant, justifier l'inaction réglementaire. Si la définition de nouveaux seuils réglementaires à brève échéance alignés sur ceux établis par l'OMS n'est pas encore possible, des études d'impact pourraient amorcer des évolutions souhaitables de la réglementation. Dans un souci de pragmatisme, cette mise à jour pourrait s'appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications significatives des infrastructures existantes.
Proposition : Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité.
En complément :
- introduire des zones d'ambiance sonore très modérée avec des seuils de bruit plus exigeants à respecter pour les nouvelles infrastructures de transport ;
- introduire un seuil de bruit pour la soirée, intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit pour les nouvelles infrastructures de transport.
III. UN PILOTAGE À VUE QUI NUIT À L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU BRUIT
La prévention de l'exposition des populations au bruit des transports mobilise une dizaine d'administrations et opérateurs de l'État.
La mission du bruit et agents physiques, entité de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) assure le pilotage et la coordination de tous ces acteurs. Les moyens humains qui lui sont alloués sont modestes, trois agents en équivalent temps plein. Eu égard à la diversité des actions et à la technicité des enjeux ainsi qu'au nombre d'acteurs en présence, ce service est sous-dimensionné pour s'acquitter de sa mission stratégique de pilotage dans de bonnes conditions.
Proposition : Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit.
À l'échelle des territoires, la gouvernance de la prévention du bruit est également inadaptée : elle implique de nombreux acteurs locaux dans les collectivités territoriales (conseils régionaux et départementaux, communes et EPCI) et les administrations déconcentrées (préfectures départementales et régionales, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, directions départementales des territoires). Un observatoire régional du bruit fédérant ces acteurs n'existe que dans deux régions : en Île-de-France, avec BruitParif, et en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Acoucité, l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon.
Le bruit est un sujet éminemment technique, à forts enjeux scientifiques et juridiques au demeurant complexes. La dispersion des compétences engendrée par une gouvernance éclatée limite les capacités d'action des acteurs publics.
Un regroupement des moyens humains des services déconcentrés de l'État à l'échelle régionale et un renforcement de leur coordination avec les collectivités territoriales serait souhaitable. Cette mise en commun des compétences permettrait d'en éviter l'émiettement, source d'une perte d'efficience de l'action.
Proposition : Regrouper à l'échelle régionale les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit afin de renforcer et mutualiser les compétences territoriales.
IV. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS INSUFFISANTS
A. L'ÉCHEC DE LA LUTTE CONTRE LES POINTS NOIRS DE BRUIT
Source : Le Parisien
Les zones les plus exposées au bruit des transports terrestres sont appelées points noirs de bruit (PNB).
Depuis 1984, puis au début des années 2000 et en 2009, des plans visant à les résorber en isolant les logements ou en modernisant les infrastructures de transports ont été déployés. Les moyens budgétaires n'ont pas été suffisamment mobilisés, ainsi qu'en atteste la diminution progressive des crédits consacrés à la résorption des PNB, principale cause de l'échec des politiques en la matière6(*).
Ainsi, en 2017, sur 53 000 PNB ferroviaires, SNCF Réseau en a traité seulement 2 200. Quant aux axes routiers, on estimait alors à 850 000 les logements situés sur un PNB routier à protéger. Or, le plan bruit de l'Ademe mené entre 2009 et 2015 n'a permis de protéger que 3 324 logements sur le même stock. On dénombrerait donc près de 900 000 PNB liés aux transports terrestres selon le Cerema, mais le rythme atone du traitement de ce stock ne permet pas, à ce stade, d'envisager une amélioration substantielle de la situation.
De surcroît, les pouvoirs publics ne disposent malheureusement pas d'une base de données identifiant finement l'ensemble des PNB. Un recensement est donc urgent car il constitue un préalable à la définition d'un plan national de traitement en vue de financer presque intégralement les travaux pour les riverains. Un tel plan répondrait à un impératif de santé environnementale, en application du principe « pollueur-payeur ».
Proposition : Lancer un plan de résorption des PNB, à partir d'une cartographie préalable des zones concernées, par redéploiement de financements budgétaires, et d'une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation.
B. LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER : INTENSIFIER LA RIPOSTE
Deux modes de transports routiers sont particulièrement émetteurs de bruits : les deux-roues motorisés (2RM) et les poids lourds. Des radars sonores ont été déployés depuis la LOM de 2019 dans plusieurs territoires, notamment à Paris, dans le cadre d'une expérimentation pilotée par la DGPR. Le constat est sévère : rue d'Avron, dans le XXe arrondissement de Paris, 166 véhicules en moyenne par jour dépassent les 83 dB. Or, à partir de 80 dB, la durée d'exposition à la source de bruit devient un facteur important de risque.
« Les nuisances sont dues à des deux-roues aux pots d'échappement non conformes ainsi qu'à leur vitesse inadaptée. Et surtout à l'absence de contrôle des forces de l'ordre. »
Un répondant au sondage CSA réalisé pour le compte de la commission
Les rapporteurs ont eu l'opportunité en avril dernier d'expérimenter in situ7(*) la mise en oeuvre de ce dispositif prometteur, qui aurait un effet dissuasif sur les comportements de conduite excessivement sportive et agressive dans les agglomérations, responsables d'intenses pics de bruits.
Proposition : Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée.
Appréhender le bruit causé par un véhicule en circulation est un impératif. Dans ces conditions, la commission estime nécessaire de remédier au décalage entre les seuils sonores réglementaires d'homologation des véhicules (obtenu à partir d'un test en mouvement) et les valeurs renseignées sur les papiers d'immatriculation des véhicules (mesurées lors d'un test à l'arrêt), utilisées pour verbaliser les véhicules trop bruyants.
Proposition : Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule.
C. BRUIT AÉRIEN : AGIR POUR PROTÉGER LES RIVERAINS LA NUIT ET RÉPONDRE AUX PERTURBATIONS LOCALES
Les évolutions récentes du trafic aérien, marquées par un accroissement du trafic en soirée et tôt dans la matinée en raison de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts, méritent d'être prises en compte dans la politique de lutte contre le bruit.
Une actualisation de la réglementation applicable au trafic aérien pour appréhender la permanence de l'exposition des riverains au bruit aérien, en particulier nocturne, est souhaitable.
Certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées à l'instar de Toulouse-Blagnac, Nantes Atlantique et Paris-Orly exigent une attention particulière à l'égard de la population qui réside aux alentours. L'extension au trafic aérien de mesures de couvre-feu serait la solution la plus efficace. Il faut cependant veiller à ce que la mise en place d'un tel encadrement n'ait pas de conséquences économiques et sociales disproportionnées.
Proposition : Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées.
Enfin, réglementer les activités des aérodromes de loisir ou d'entraînement ne doit plus être un tabou.
Seuls quatre aérodromes sont soumis à des restrictions d'exploitation. Or, 5 % des Français sont gênés sur leur lieu de vie ou au travail par les nuisances sonores qu'ils émettent. Les communes de petite taille comptent parmi les plus pénalisées par ces nuisances.
Proposition : Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes.
I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS
Le monde moderne a radicalement changé notre appréhension et notre perception du bruit. Alors que le silence était une vertu solidement ancrée dans nos sociétés comme un moment d'élévation spirituelle propice à la réflexion - ce qui poussait les moines anachorètes à se murer dans le silence ou les prêtres orthodoxes à pratiquer l'hésychasme - ce temps suspendu est devenu un produit de luxe.
Il convient toutefois de distinguer entre le bruit recherché ou voulu et le bruit subi, qui devient alors une nuisance sonore. Le tumulte des scènes de liesse et des grands rassemblements - culturels et sportifs notamment - peut être directement recherché pour la vitalité et l'effervescence qui en découlent. A contrario, le bruit, lorsqu'il est subi, revêt rapidement les caractéristiques d'une nuisance, dont l'intensité varie en fonction de nombreux facteurs.
À l'occasion de la pandémie de covid-19, en 2020, les populations confinées, l'arrêt de la circulation de masse des véhicules légers, le recul des vols commerciaux et la réduction drastique de circulation des trains ont remis au goût du jour les bienfaits du silence. Désormais, cette recherche du silence perdu se manifeste dans des objets du quotidien : écouteurs et casques à réduction de bruit active ou encore bouchons d'oreilles. Ces outils tentent alors d'atténuer les effets de nuisances sonores devenues omniprésentes et parfois insupportables aux populations.
Ces sons du quotidien, le bruit de la voiture, du passage du train sur les voies de chemin de fer qui jouxtent les habitations, des réacteurs de l'avion qui effectue sa descente dans son couloir aérien, des infrastructures de transports collectifs, ne sont pas anodins.
Les rapporteurs de la mission d'information ont souhaité s'intéresser aux désagréments liés aux transports avec trois priorités :
- ne pas s'en tenir à dresser un état des lieux du bruit causé par ces mobilités, mais aussi faire état des effets des nuisances sonores sur la santé de la population - sujet de préoccupation vive chez les Français ;
- ne pas contribuer à l'inflation normative mais plutôt proposer des pistes de simplification du droit existant et veiller à la bonne application des normes applicables ;
- enfin, ils ont voulu esquisser des pistes d'amélioration pour que ce sujet soit davantage pris en compte dans nos politiques publiques.
A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs de la mission d'information ont été exposés à une difficulté sémantique. Certains acteurs regardent le bruit causé par les transports comme une simple « nuisance » tandis que d'autres retenaient une approche plus maximaliste en estimant que ce bruit peut être considéré comme une véritable « pollution ».
C'est cette dernière approche que vos rapporteurs ont finalement retenue, les incidences du bruit sur la santé humaine et sur l'environnement de manière générale, ont plaidé en faveur d'une telle définition. En conséquence, il convient d'appréhender le bruit causé par les transports comme une « pollution sonore ».
1. Les pollutions sonores : un fardeau pour la santé physique, mentale et le bien-être
a) Une incidence majeure sur la santé des populations exposées
Le bruit peut représenter un double risque pour la santé humaine. D'une part, à partir d'environ 90 décibels, il peut entraîner des lésions auditives. D'autre part, il peut également entraîner des lésions dites « extra-auditives », sur la santé humaine de manière générale, qui sont plus difficiles à mesurer et évaluer. La mission d'information a principalement orienté sa réflexion sur ces lésions extra-auditives.
|
Le bruit causé par les transports se situe en effet généralement dans cette seconde catégorie de lésions. Il atteint rarement des seuils susceptibles de mettre en péril la qualité auditive d'un individu. Les effets sur la santé des bruits environnementaux - parmi lesquels figurent les bruits liés aux transports - sont aujourd'hui largement documentés. |
Source : Bruitparif
Dans un rapport de 2009 intitulé Burden of disease from environnemental noise, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mettait en évidence plusieurs risques :
- des incidences immédiates telles que des perturbations du sommeil et des gênes quotidiennes ;
- des effets à moyen et long termes comme des troubles de l'attention et même des pathologies comme l'infarctus du myocarde, avec des effets spécifiques sur les enfants, en particulier des troubles de l'apprentissage scolaire.
Les nombreux travaux scientifiques sur ce sujet donnent une vision claire des risques associés aux nuisances sonores sur la santé humaine. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de décembre 2012 distingue les effets physiologiques extra-auditifs des effets psychosociologiques et comportementaux liés au bruit.
Les effets physiologiques sont nombreux :
- une dégradation subjective et objective de la qualité du sommeil. Un répondant au sondage réalisé à la demande de la commission a ainsi déclaré à propos du bruit lié aux transports : « Cela m'empêche de dormir correctement, même les fenêtres fermées. Lors d'une conversation, on ne s'entend plus parler. » ;
- un risque d'hypertension artérielle pouvant favoriser un accident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus du myocarde ou encore la maladie d'Alzheimer ;
- sur-sécrétion d'hormones du stress (cortisol) et un niveau élevé de glucocorticoïdes pouvant nuire au fonctionnement optimal de la mémoire ;
- aggravation de désordres mentaux tels que la dépression ou l'anxiété.
L'OMS a publié en 2018 des Lignes directrices relatives au bruit dans l'environnement dans la Région européenne, qui apportent des recommandations en vue de protéger la santé humaine de l'exposition au bruit, compte tenu des preuves scientifiques des effets du bruit sur la santé et le bien-être des individus. Les recommandations concernant le bruit des transports sont qualifiées par l'OMS de « fortes », ce qui traduit le haut degré de robustesse de la preuve scientifique des effets néfastes du bruit.
Le bruit emporte des effets sanitaires préoccupants sur la santé physique. Ils se conjuguent par ailleurs avec d'autres risques environnementaux, tels que le risque lié à la pollution de l'air, dont l'origine est étroitement liée aux transports.
|
Nuisances sonores et pollutions de l'air : les deux faces d'une même pièce ? La conjugaison des facteurs de risques liés à une coexposition air-bruit constitue un cocktail particulièrement nocif pour la santé humaine. Les victimes des nuisances sonores sont aussi généralement parmi les plus concernées par la pollution de l'air. Si toute la population est susceptible d'être concernée par cette dernière, force est de constater que les zones où le bruit causé par les transports est le plus fort sont aussi les espaces dans lesquels la pollution de l'air est la plus élevée. Ces deux pollutions constituent pour les personnes exposées une véritable double peine. En plus des risques physiologiques associés aux nuisances sonores précédemment évoqués, la pollution de l'air concourt au développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires, au cancer du poumon et à une perte globale d'espérance de vie. Elle est responsable de 7 900 décès prématurés par an en Île-de-France, et près de 40 000 décès prématurés environ sur l'ensemble du territoire hexagonal. |
Des cartes produites par Bruitparif et Airparif en mai 2024 sur la région Île-de-France font état d'une nette superposition entre ces deux risques.
Source : BruitParif
Le bruit causé par les transports sur la santé humaine a également des effets psychologiques liés à la gêne qu'il induit, susceptible d'engendrer une dégradation de la capacité d'apprentissage ou encore des comportements agressifs. Pour l'un des répondants au sondage commandé par la commission, « les nuisances sonores impactent la santé mentale et par extension, la santé au global ».
Les rapporteurs soulignent que les effets psychologiques sont variables d'un individu à un autre et qu'ils sont multifactoriels. Il est donc plus délicat d'agir sur ces paramètres de santé mentale et de les quantifier.
Les effets sur la santé des nuisances sonores peuvent mener à une diminution de l'espérance de vie en bonne santé des populations exposées. Selon une étude de Bruitparif, intitulée Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l'agglomération parisienne, parue en 2019 « rapportées à l'individu, les évaluations réalisées donnent une valeur statistique moyenne de 10,7 mois de vie en bonne santé perdue du fait du bruit cumulé des transports »8(*).
Les risques associés aux bruits causés par les transports sont inégalement répartis sur le territoire à toutes les échelles. Ainsi que l'illustre le graphique ci-après, les disparités intrarégionales et même locales sont fortes et dépendent de la proximité avec de grandes infrastructures de transport.
Carte représentant le cumul du bruit causé par les transports en année d'espérance de vie perdue
Source : Bruitparif
Lecture : Répartition par commune de mois de vie en bonne santé perdus par un individu sur une vie entière en raison du bruit cumulé des transports
Les associations et collectifs entendus par la mission d'information ont fait état des difficultés au quotidien, face à l'omniprésence du bruit causé par les transports. Ainsi, l'association septèmoise pour la réduction des nuisances de l'autoroute (Chutt) a décrit le calvaire quotidien vécu par les riverains de la route et le désarroi des habitants face à l'incapacité de l'État à proposer des solutions structurées, concertées et pertinentes.
Le risque lié au bruit sur le développement de l'enfant est un enjeu de santé publique à part entière, d'autant plus que le développement cognitif d'un individu a lieu essentiellement durant la période de l'enfance.
Effets du bruit causé par les transports sur les enfants
Source : Agence française de sécurité sanitaire environnementale (ex-Anses)
Au regard des effets sanitaires du bruit sur la santé, la mission d'information estime que le bruit causé par les transports doit faire l'objet d'une attention renforcée des pouvoirs publics.
Or, les impacts sanitaires de la pollution sonore sont insuffisamment suivis. L'évolution des effets auditifs et extra-auditifs du bruit à l'échelle de la population est en effet mal connue faute de marqueurs sanitaires suivis par un dispositif de surveillance des impacts sanitaires du bruit. En effet, comme l'a mis en avant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse) dès 2004, « l'évaluation des résultats d'une politique de lutte contre les nuisances sonores passe obligatoirement par la définition et le suivi d'indicateurs. Ces derniers doivent au préalable être définis comme étant représentatifs des objectifs poursuivis en matière de prévention des impacts sanitaires du bruit. Le dispositif de surveillance doit permettre le suivi de ces indicateurs ».
Saisie par la DGPR et la Direction générale de la santé (DGS), l'Anses a réalisé en février 2013 une étude visant à élaborer des indicateurs et des valeurs de référence dans le domaine des risques liés au bruit des transports.
Cependant, l'agence a conclu qu'elle n'était pas en mesure de proposer de tels indicateurs en raison des lacunes dans les connaissances et du caractère multifactoriel des impacts sanitaires du bruit, les études étant encore insuffisantes pour obtenir des courbes dose-effet robustes entre un descripteur de bruit et un impact sanitaire.
L'Agence a, en effet, mis en avant des « lacunes dans les connaissances actuelles » et « la complexité des interactions entre les divers paramètres physiques, physiologiques, humains et cognitifs impliqués dans les relations bruit-santé ».
Une décennie plus tard, les connaissances scientifiques des impacts de bruit sur la santé ont progressé.
Dans ce contexte, il pourrait donc être pertinent de confier à Santé publique France la mission de définir des indicateurs pour suivre à l'échelle de la population les impacts sanitaires du bruit. Une telle mesure permettrait d'ailleurs d'appréhender plus précisément le coût social du bruit et les effets des politiques de lutte contre le bruit.
Proposition n° 1 : Confier à Santé publique France la définition des indicateurs de mesure des impacts sanitaires du bruit et la surveillance de leur évolution.
b) Un enjeu pour les finances sociales et la productivité des individus
Les effets sur la santé des nuisances sonores liés aux transports sont nombreux et largement documentés. En plus de dégrader la santé des individus exposés, les nuisances sonores induisent également des coûts exogènes - économiques et sociaux qui pèsent sur les finances publiques et la productivité des travailleurs.
Une étude de l'Ademe de 2021, sur le « coût social du bruit en France », fait état du coût sanitaire marchand et non marchand du bruit et des coûts non sanitaires du bruit d'une ampleur loin d'être marginale.
Le bruit causé par les transports a d'abord un coût sanitaire marchand dont la charge est essentiellement endossée par la sécurité sociale. L'étude de l'Ademe propose une estimation de ces coûts - dont la certitude doit être relativisée, la relation directe de cause à effet entre le développement d'une pathologie, par exemple cardiovasculaire, ne pouvant être totalement imputée au bruit causé par les transports. Le bruit des transports peut en effet favoriser la survenue de pathologies, sans en être la cause unique.
Ainsi, environ 116 000 personnes souffrent d'une pathologie cardiovasculaire liée au bruit des transports, ce qui représente un coût d'hospitalisation annuel de près de 78 millions d'euros9(*).
Les coûts de médication sont également élevés : la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques représenterait un coût total estimé à 3,5 millions d'euros pour environ 287 000 personnes s'administrant ces traitements en raison d'une exposition au bruit routier (en supposant un coût moyen de 12 € pour un traitement de huit semaines).
Par ailleurs, le bruit causé par les transports a également un coût sanitaire non marchand dont la quantification est néanmoins plus approximative.
En appliquant une valeur d'une année de vie en bonne santé de 132 000 €, définie pour l'année 2020 par la commission Quinet (Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013), le coût sanitaire des morbidités liées aux transports - comprenant la gêne, l'obésité, les troubles mentaux, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le coût des difficultés d'apprentissage - est estimé à environ 82,2 milliards d'euros. S'ajoutent les coûts de la mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires liées aux bruits des transports, représentant environ 9,8 milliards d'euros.
Le Cerema a indiqué à la mission d'information que la révision par l'OMS en 2024 des coefficients d'invalidité liée aux impacts sanitaires du bruit, utilisée par l'étude de l'Ademe en 2021, conduit désormais à réduire l'estimation du coût social établie par l'étude d'environ 35 milliards d'euros par rapport à l'estimation initiale.
Enfin, le bruit causé par les transports emporte des coûts non sanitaires, qui ne sont toutefois pas à sous-estimer.
Le bruit causé par les transports est un facteur de perte de productivité au travail. Un individu qui subit des perturbations de son sommeil risque d'avoir un niveau de fatigue plus élevé et ainsi d'être moins productif dans son activité professionnelle.
Les nuisances causées par les transports peuvent enfin avoir une incidence sur la valorisation patrimoniale d'un bien immobilier.
2. Les pollutions sonores nocturnes : une gêne amplifiée
La gêne ressentie et la gêne réellement occasionnée par le bruit causé par les transports varient, d'une personne à une autre, et selon la durée de la nuisance.
Le bruit soudain, par exemple l'atterrissage d'un avion, le passage du train sur la voie de chemin de fer ou encore l'accélération du véhicule motorisé dépassant les seuils sonores réglementaires, peut ainsi favoriser une perturbation momentanée et particulièrement brève de l'attention la journée, et entraîner un réveil pendant la nuit.
Le bruit de fond, continu, provoqué notamment par le transport routier, peut perturber la qualité de vie tout au long de la journée, par exemple en empêchant l'ouverture de fenêtre, ou en nuisant à la qualité de l'attention et de la concentration.
Le bruit nocturne est davantage nocif, et ce dès des niveaux d'exposition relativement plus faibles que le bruit diurne10(*). Une étude de Santé publique France publiée en décembre 202411(*), effectuée sur la métropole de Lille estime que si les préconisations de l'OMS en matière d'exposition au bruit étaient suivies, le niveau de bruit généré conduirait à diminuer le nombre de personnes effectivement exposées aux pollutions sonores nocturnes de 7 %.
Selon cette étude, si toutes les communes de la métropole de Lille respectaient les recommandations de l'OMS sur le bruit routier la nuit (45 dB Lnight), cela permettrait à plus de 11 600 habitants d'avoir moins de fortes perturbations du sommeil. Si les niveaux de bruit routier sur 24 heures respectaient la valeur recommandée par l'OMS sur tout le territoire de la métropole de Lille (53 dB Lden), 85 nouvelles hospitalisations pour cardiopathies ischémiques seraient évitées chaque année, ce qui représente 6 % des nouvelles hospitalisations pour ce motif de la métropole de Lille. De même, près de 8 décès dus à cette pathologie seraient évités chaque année dans cette seule zone géographique.
L'OMS préconise de limiter les bruits causés par les transports sur une plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, permettant au mieux 8 heures de sommeil de qualité.
Un sondage réalisé auprès de 2 000 Français par la mission d'information montre que parmi ceux qui estiment subir des nuisances sonores liées au transport routier, 61 % estiment que la priorité des mesures visant à lutter contre le bruit devrait se concentrer sur la période nocturne.
L'ensemble des acteurs entendus par la mission d'information ont en effet insisté sur les nuisances sonores nocturnes, estimant que la réglementation et les mesures mises en oeuvre pour lutter contre le bruit causé par les transports devaient tenir compte des horaires du coucher, période durant laquelle la gêne ressentie est démultipliée.
3. Les pollutions sonores : une préoccupation majeure des Français
La mission d'information a souhaité mesurer le pouls de la population sur cette pollution générée par les nuisances sonores liées aux transports. Elle a mandaté l'institut CSA pour réaliser une enquête, conduite du 7 au 16 avril 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus. Aucun sondage en la matière de cette envergure n'avait été mené depuis plus de 10 ans12(*), si bien que le rapport des Français à cette problématique était jusqu'alors mal connu.
Les résultats de l'enquête ont été présentés à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 30 avril 2025. Ils révèlent que le bruit causé par les transports constitue un enjeu majeur pour les Français.
Ainsi, pour 71 % des sondés les nuisances sonores sont un sujet de préoccupation. Pour 27 % des sondés, le bruit est le premier élément qui perturbe leur quotidien, devant la saleté et les déchets dans l'espace public, mais aussi les pollutions de l'air, des sols et de l'eau. Cette approche doit toutefois être nuancée en fonction de deux facteurs : l'âge et le lieu de vie.
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
Pour les moins de 35 ans, les nuisances sonores arrivent derrière la présence de déchets et la pollution de l'air. En revanche, pour la tranche d'âge des 35 à 49 ans, les nuisances sonores sont les premières préoccupations quotidiennes des Français. La gêne ressentie par les populations dépend ainsi d'un facteur générationnel.
Le lieu de vie est également un facteur important de l'appréhension du bruit. Dans les petites communes de moins de 2 000 habitants, les habitants sondés évoquent en priorité la nuisance causée par la présence de déchets dans l'espace public. En revanche, plus les concernés vivent dans des espaces urbanisés - dans des villes de plus de 100 000 habitants - et a fortiori dans de grandes agglomérations comme Paris, plus les nuisances sonores se situent en haut du classement des nuisances.
Loin d'être anodines, les nuisances causées par les transports concernent près d'un français sur deux. Le bruit causé par le transport routier est le premier pourvoyeur de nuisances.
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
B. NUISANCES SONORES CAUSÉES PAR LES TRANSPORTS : QUEL EST L'IMPACT DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT ?
1. Le transport routier : la principale source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes agglomérations
La route irrigue la totalité du territoire français. Le dernier rapport public annuel de l'Observatoire national de la route (ONR) recense 11 786 km de voirie nationale non concédée, 381 964 km de voies départementales et enfin 701 322 km de voies communales et intercommunales13(*), auxquels s'ajoutent les quelque 12 379 km d'autoroutes. L'ampleur de ce réseau explique que les Français soient fortement exposés aux nuisances routières.
La voiture est le premier mode de déplacement des Français, même dans les zones les plus urbanisées et dans les grands centres-villes.
Selon les données de l'enquête « mobilité des personnes 2018-2019 » de l'Insee, 80 % des ménages disposent d'au moins un véhicule et 65 % de la population réalise entre 0 et 12 500 km par an, parmi eux, la moitié parcourant entre 7 500 et 12 500 km par année.
Le bruit routier a deux sources, le bruit de propulsion, lié au moteur, et le bruit de roulement, dont l'ampleur respective varie en fonction de la vitesse du véhicule :
- jusqu'à 30 km/h, le bruit de la propulsion est prédominant ;
- au-delà de 30 km/h, le bruit de roulement prend le dessus.
Le bruit de roulement dépend de trois facteurs : la qualité du revêtement routier, la vitesse du véhicule et la conception du pneumatique.
La qualité du revêtement est identifiée comme le facteur prépondérant dans la constitution du bruit routier.
Le passage de la voiture sur la route engendre à la fois des vibrations, dont le bruit émis peut varier de 6 décibels (dB) en fonction de la qualité du revêtement, et un bruit lié à la compression de l'air.
Selon une étude, produite à l'occasion de la conférence « internoise » à Nantes en août 2024, intitulée « traffic road noise and transportation energy efficiency », la conception du revêtement routier est susceptible de faire varier le bruit mesuré jusqu'à 15 décibels.
Le bruit de roulement augmente avec la vitesse selon une relation en logarithme. À 80 km/h, le bruit de roulement est 6 à 7 dB plus élevé qu'à 50 km/h, selon Michelin, entendu par la mission d'information.
À ces bruits causés par l'interaction entre le passage du véhicule et la route se conjuguent les bruits causés par le moteur, particulièrement élevé pour certains véhicules.
Si la réglementation, et notamment l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles, fixe certaines valeurs limites de décibels à ne pas dépasser pour la mise sur le marché d'un véhicule - celles-ci variant en fonction de la nature du véhicule (deux-roues, voiture, transports de marchandises) - on constate à l'intérieur de ces sous-catégories de grandes disparités.
Certaines voitures sportives atteignent des records en matière de décibels. Ainsi, une Ferrari 458, disposant d'un moteur V8, émet jusqu'à 155 dB, soit près du double de ce qui est fixé par la réglementation européenne (la valeur limite sonore pour les automobiles est passée de 82 dB [A] à 74 dB [A] entre 1972 et aujourd'hui). À l'inverse, un véhicule comme le Honda CR-V, en version hybride, émet environ 55 dB.
Les véhicules sportifs et les « supercars » disposent d'une puissance motrice élevée et de lignes d'échappement potentiellement bruyantes, fortement dépendantes du style de conduite. Un style de conduite « sportif » ou « agressif » favorise des rugissements abrupts du véhicule, ce qui entraîne des pics de bruits nuisibles pour les riverains.
|
Les pollutions sonores causées par les
deux-roues motorisés (2RM) : D'après une étude réalisée par le Crédoc pour Bruitparif en 2016, le bruit des véhicules deux-roues motorisés représente, pour 35 % des Franciliens, le bruit le plus gênant parmi les différents modes de transport14(*). Le plan de prévention des bruits dans l'environnement (PPBE) de la ville de Paris pour la période 2015-2020 indique qu'en 2010, sur 2 371 verbalisations tous véhicules confondus dans Paris, 2 110 verbalisations concernaient des motos et cyclomoteurs, soit 89 %. Le conseiller de Paris, Pierre-Yves Bournazel souhaitait que soit expérimentée l'interdiction des deux-roues motorisés thermiques de 22 heures à 7 heures dans la capitale. Une association comme « Ras-le-scooter » va jusqu'à demander l'interdiction pure et simple des deux-roues motorisés (2RM) dans le centre-ville. |
Les nuisances sonores engendrées par les 2RM sont d'autant plus fortes que ces véhicules ont longtemps été exempts de tout contrôle technique, ce qui permettait de débrider certains moteurs, entraînant une augmentation de l'intensité acoustique. Cette dernière était parfois amplifiée par une pratique de tuning (i. e pratique consistant à modifier un véhicule automobile afin de le personnaliser), permettant aux propriétaires de changer une ligne ou un pot d'échappement pour un dispositif plus bruyant. Une moto équipée d'un système d'échappement illégal couplé à une conduite de manière agressive peut émettre jusqu'à 30 dB supplémentaires, soit en termes de ressenti, être huit fois plus bruyante qu'une moto équipée d'un système réglementaire et d'une conduite responsable15(*). Cette pratique, bien que prohibée par l'article R. 318-3 du code de la route selon lequel « toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite », est largement répandue.
Le transport de marchandises et les poids lourds, dont les seuils réglementaires d'émission sonore sont plus élevés que les véhicules légers comme la voiture, sont également source d'importantes nuisances. Selon BruitParif, « en milieu urbain, un poids lourd représente acoustiquement 10 véhicules légers ».
De nombreux élus locaux et riverains se plaignent de l'omniprésence des camions et poids lourds dans leurs communes. Les rapporteurs ont en particulier été alertés sur la hausse massive de trafic routier sur des routes communales et départementales liée à l'usage des applications de guidage routier, qui permettent de contourner les itinéraires les plus fréquentés. Dans le Loiret par exemple, le maire de Chevilly, déplore depuis près de dix ans les nuisances sonores engendrées par le passage de ces véhicules dans sa commune16(*). Le député Emmanuel Duplessy a d'ailleurs interpellé le Gouvernement à ce sujet à l'occasion d'une question écrite publiée le 20 mai 2025 : « cette situation, devenue intenable, provoque des nuisances sonores, met en danger la sécurité des riverains et pousse certains habitants à quitter leur logement »17(*).
L'ensemble des pollutions sonores causées par les transports se conjugue par ailleurs avec l'utilisation du klaxon, source de bruit majeure dans les centres-villes. À Paris, selon l'étude du Crédoc susmentionnée, cette nuisance arrive en seconde place, comme deuxième sujet de préoccupation des Franciliens.
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
Le résultat du sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que parmi les nuisances causées par le transport routier, 62 % des sondés déclarent que le désagrément émane en priorité d'une proximité avec la rue, le fait que le logement jouxte un périphérique ou une rocade est évoqué que dans 12 % des cas et seulement 9 % pour la proximité avec une autoroute.
Parmi les personnes ayant indiqué subir des nuisances sonores routières, 43 % d'entre eux évoquent être victimes de ces bruits même en intérieur avec les fenêtres fermées. 55 % des sondés considèrent que l'intensité du bruit est élevée, estimée à 7-8/10 sur une échelle d'intensité ressentie.
Les bruits causés par le transport routier sont une problématique qui concerne une partie importante des Français. Il existe néanmoins de profondes disparités entre eux, selon qu'ils résident à proximité ou non d'une zone intense de trafic routier.
L'agglomération et la diversité de véhicules dans un même espace (deux-roues motorisés, véhicules légers, poids lourds, etc.), ont une incidence notable sur l'intensité acoustique. L'addition de plusieurs véhicules n'entraîne pas une multiplication proportionnelle du bruit globalement émis, mais peut conduire à dépasser les seuils auditifs à partir desquels les nuisances sonores ont des incidences sur la santé : 85 décibels étant un seuil de danger pour l'oreille et 120 décibels le seuil de douleurs.
Si deux véhicules identiques (voiture par exemple) émettent chacun 60 décibels, l'addition des deux sources de bruits revient à augmenter l'intensité acoustique de 3 décibels, soit un total de 63 décibels - une telle variation est à peine perceptible par l'oreille humaine. Néanmoins, si dix voitures émettent du bruit, alors l'intensité sonore augmente de 10 décibels, ce qui correspond au doublement de la sensation auditive. Il faudrait en conséquence diviser le trafic par 10 pour réduire de 10 dB le niveau sonore. Le niveau de bruit dépend par ailleurs des véhicules considérés. Ainsi, lorsqu'il y a 10 dB d'écart entre deux sources sonores, par exemple entre une voiture et un camion, on ne perçoit que la source qui émet le plus de sons, on parle alors d'« effet masque »18(*).
Les zones intenses en matière de trafic routier, responsables de nuisances sonores, font l'objet d'un recensement par l'intermédiaire des cartes de bruit stratégiques (CBS) prévues aux articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement.
Carte du bruit stratégique (CBS) du
transport routier
au sein de l'agglomération
parisienne
Source : BruitParif
Ces cartes permettent d'identifier les zones où se concentre l'essentiel du bruit, au sein desquelles le quotidien des habitants peut être particulièrement affecté.
2. Le transport aérien : une exposition de faible ampleur, mais de forte intensité
a) L'aviation commerciale : un bruit à fort impact pour les populations exposées, particulièrement la nuit
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
Le bruit émis par l'aviation a plusieurs caractéristiques spécifiques. Il est marqué par des pics particulièrement élevés pour certaines populations. Son impact est ainsi de forte intensité, mais concentré sur les personnes vivant à proximité des aéroports, particulièrement en Île-de-France.
Selon les données transmises par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) aux rapporteurs, environ 550 000 personnes seraient exposées durant la journée à plus de 55 dB (A) en Lden19(*), et près de 220 000 à plus de 50 dB (A) en Lnight en moyenne la nuit. Les plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont responsables de la majeure partie de cette pollution sonore : 81 % de la population exposée à une gêne diurne et 88 % de celle qui est exposée à une gêne nocturne le sont du fait de leur activité.
Il convient toutefois de nuancer ce caractère limité de l'impact du transport aérien. 10 % des répondants du sondage réalisé du 7 au 16 avril 2025 pour la mission d'information ont ainsi indiqué être gênés par la proximité d'un aéroport ou d'un couloir aérien. Cette proportion est même de 17 % en Île-de-France. En outre, environ 41 % des personnes concernées par des nuisances sonores liées à la circulation aérienne le sont la nuit.
La prise en compte des valeurs limites recommandées par l'OMS, à savoir 45 dB (A) Lden le jour et 40 dB (A) Ln la nuit, amène à des résultats plus cohérents avec ce ressenti des populations. Selon BruitParif, 2,2 millions de personnes sont affectées en Île-de-France par un bruit lié au transport aérien à un niveau supérieur aux recommandations de l'OMS, dont 736 000 autour de Paris-Orly (274 000 la nuit) et 1 373 000 autour de Paris-CDG (805 000 la nuit). En Île-de-France, 1 habitant sur 5 est ainsi exposé à une pollution sonore liée au trafic aérien des aéroports de Paris-Orly et de CDG.
Le bruit émis par les aéronefs est plus circonscrit que le bruit routier, du fait de sa concentration à proximité des aéroports, qui sont inégalement répartis sur le territoire et dont le volume de trafic est hétérogène. Toutefois, comme le relève la Cour des comptes, « comparée à ses voisins, la France dispose du plus grand nombre d'aéroports par habitant (1,09 par million d'habitants contre 0,29 en Allemagne) et par kilomètre carré ». Le bruit émis par les aéronefs en France est donc plus diffus que dans les autres pays européens.
Il est difficile d'évaluer l'évolution de la pollution sonore liée au trafic aérien des grands aéroports français. Sur le long terme, plusieurs effets jouent : les variations du trafic d'une part, et la diminution du bruit unitaire émis par les aéronefs, qui a été réduit de 75 % depuis 1960 selon le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), d'autre part. Ainsi, à Paris-CDG, l'énergie sonore totale mesurée durant une année pour les décollages et pour les atterrissages a diminué d'un tiers entre le début des années 2000 et 201920(*). En revanche, pour Paris-Orly, BruitParif a constaté une augmentation de la pollution sonore, notamment la nuit, entre 2012 et 2018, avant que le trafic ne chute avec la crise sanitaire.
À niveau de bruit équivalent, mesuré par un indicateur énergétique de type Lden (Level Day-Evening-Night)21(*), le bruit aérien est moins bien toléré par les populations que le bruit routier et le bruit ferroviaire (hors LGV). Cette situation s'explique par le caractère intermittent, soudain, et de forte intensité du bruit aérien. Un seul événement suffit en effet pour avoir un impact marqué sur la santé et la qualité de vie, et notamment du sommeil, des populations.
|
L'effet de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts sur le bruit émis par le transport aérien L'augmentation du trafic opéré par des compagnies à bas coûts, dont la part est passée de 35,1 % en 2019 à 44,1 % en 2024, a des impacts contrastés sur le bruit émis par les aéronefs. D'une part, le modèle économique de ces compagnies repose sur une maximisation des capacités des aéronefs, ce qui amène une hausse de l'emport moyen de ces dernières : pour un nombre de passagers équivalent, le nombre de mouvements est inférieur. On observe ainsi, en France, une décorrélation entre le nombre de mouvements et la hausse du nombre de passagers. Source : Union des aéroports français (UAF) Toutefois, cet effet est pondéré par un effet volume : les prix attractifs pratiqués par ces compagnies favorisent une hausse du trafic, notamment sur certaines plateformes régionales. Ainsi, l'aéroport de Beauvais-Tillé a accueilli 64 % de passagers en plus en 2024 qu'en 2019 alors que le trafic est en légère diminution sur la même période à l'échelle nationale. Enfin, le modèle économique de ces compagnies exige de maximiser le nombre de rotations journalières des aéronefs, ce qui implique en particulier d'effectuer le premier vol tôt le matin et le dernier tard le soir. Ce trafic est donc source de bruit au moment où son impact sur la santé des populations est maximal. |
L'évolution future du bruit engendré par les plateformes aéroportuaires difficile à estimer devrait varier en fonction des dynamiques de trafic locales. À l'échelle nationale, l'augmentation du trafic anticipée par les principaux acteurs du secteur devrait accentuer la pollution sonore. En Île-de-France, cette hausse des circulations pourrait ainsi être de 40 % d'ici 205022(*). Toutefois, le renouvellement des flottes et les progrès dans les procédures de contrôle aérien pourraient contrebalancer cette tendance.
b) L'aviation générale : une source d'exposition au bruit, notamment dans les territoires peu denses et le week-end
L'aviation générale désigne l'ensemble des activités aériennes hors aviation commerciale régulière. Il s'agit donc de l'aviation d'affaires, de l'aviation de loisir et de vols sanitaires, de police et militaires, ainsi que des vols de formation. Ces différentes activités sont fréquemment pratiquées sur des plateformes autres que celles de l'aviation commerciale, en particulier l'aviation de loisir et l'aviation militaire. Environ 5 % des Français sont ainsi gênés par des nuisances sonores aériennes sur leur lieu d'habitation ou de travail à cause de la proximité d'un aérodrome, d'une base d'aviation de loisir ou une base aérienne. Les nuisances liées au transport aérien dans les communes de moins de 2 000 habitants sont même majoritairement associées à ce type d'infrastructures. Les représentants de France Nature Environnement entendus par les rapporteurs ont indiqué observer une augmentation du nombre de plaintes transmises à leur structure concernant les aérodromes.
Selon la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM), il y aurait en France « une flotte de près de 11 700 aéronefs [d'aviation générale et d'affaires], qui réalise 1,5 million de mouvements et environ 1 million d'heures de vol par an. L'aviation générale et d'affaires représente ainsi autant de mouvements que l'aviation régulière en France (...), mais seulement moins de 20 % du nombre d'heures de vol totales effectuées en France (en considérant que l'aviation régulière effectue environ 5 millions d'heures de vol par an) ».
Source : FNAM
Aérodromes et pollution sonore : de quoi parle-t-on ?
La France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer comptent environ 550 aérodromes. Ces derniers, eu égard à la définition retenue à l'article L. 6300-1 du code des transports, incluent également ce que l'on nomme communément « les aéroports ». Néanmoins, seuls 340 sont ouverts à la circulation aérienne publique et parmi eux 180 accueillent du trafic commercial.
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (article L. 6312-2 du code des transports) comprennent : les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État ; les aérodromes à usage restreint ; les aérodromes à usage privé. Ces derniers permettent notamment l'utilisation d'un matériel dit « d'aviation légère » : planeurs, ULM, hélicoptères légers, avions légers parmi lesquels figurent les appareils d'école de pilotage, de voltige aérienne et de tourisme.
Les nuisances causées par ces avions à usage de loisir ne sont pas marginales. Selon une enquête d'Acoucité portant sur les aérodromes de Corbas et de Lyon-Bron, l'intensité de la gêne occasionnée est estimée à 6/10. Certaines personnes interrogées signalent même être « extrêmement gênées »23(*).
Source : Acnusa
Certains territoires subissent également une forte pollution sonore du fait d'une activité intense liée à l'aviation non commerciale. La mairie de Ramatuelle a ainsi souligné auprès des rapporteurs que les populations du Golfe de Saint-Tropez subissaient la pollution sonore consécutive à une circulation d'hélicoptères, notamment estivale, particulièrement dense.
À l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avait été envisagée la possibilité d'expérimenter l'usage d'hélicoptères électriques et de réaliser une plateforme d'accueil flottante temporaire (dite vertiport) sur la Seine, quai d'Austerlitz. Ce projet avait fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis défavorable du commissaire enquêteur. Il a été abandonné à la suite de l'annulation de l'arrêté portant création du vertiport par le Conseil d'État au motif que l'Acnusa aurait dû être consultée en amont de la publication dudit arrêté.
3. Le bruit ferroviaire : une cause d'exposition spécifique des populations au bruit et aux vibrations
a) Le transport ferroviaire : un facteur de pics de bruit élevés pour les populations, notamment urbaines
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
Comme le transport aérien, le transport ferroviaire engendre un bruit intermittent, avec des événements sonores de forte intensité entrecoupés de silence. Il se manifeste en majorité en journée, avec des pics le matin et le soir liés à une fréquence accrue des trains sur ces plages horaires, notamment pour les LGV. Toutefois, les trains de fret circulent fréquemment la nuit, et sont donc source de pics de bruit nocturnes. Ils sont de surcroît plus bruyants et plus lents que les trains de voyageurs, ce qui renforce leur impact sur les populations résidant à proximité des voies. La commission nationale du débat public (CNDP) a souligné auprès des rapporteurs que les préoccupations des riverains concernant le bruit portaient plus fortement sur les LGV et le fret.
On distingue plusieurs sources de bruit ferroviaire :
- le bruit des équipements, prépondérant à l'arrêt, est lié aux moteurs, ventilateurs ou à la climatisation ainsi qu'à l'ouverture et la fermeture des portes ;
- le bruit lié à l'effort de traction, prépondérant à moins de 60 km/h, provient des moteurs et des ventilateurs du matériel roulant ;
- le bruit de roulement, prédominant entre 60 km/h et 320 km/h, est lié au contact entre le rail et les roues du matériel roulant. Il dépend notamment de la rugosité des roues, liée pour partie elle-même au système de freinage utilisé et de la rugosité du rail ;
- le bruit aérodynamique, qui apparaît à partir de 250 km/h, et ne devient prépondérant qu'au-delà de 320 km/h.
L'état actuel du réseau français et l'obsolescence de certaines infrastructures engendrent une hausse des nuisances, en augmentant le bruit de roulement. Comme l'a souligné la Fédération des industries ferroviaires (FIF), « Les rails usés ou détériorés, par exemple, entraînent une usure irrégulière des roues, ce qui génère des vibrations et des bruits plus importants. Une voie en mauvais état peut émettre jusqu'à 10 dB (A) de plus qu'une voie neuve ».
On peut y ajouter des bruits de crissement liés au freinage ou dans les courbes, qui concernent essentiellement les tramways. De même, le bruit lié à la présence d'une gare participe à la pollution sonore engendrée par le trafic ferroviaire. Ainsi, pour SNCF Réseau, « l'origine du bruit est dite systémique. C'est-à-dire qu'elle provient à la fois des caractéristiques de l'infrastructure, du type de matériel roulant, et des conditions d'exploitation, dont la vitesse ».
Selon le sondage réalisé pour la mission d'information, 13 % des Français s'estiment gênés par le bruit lié au trafic ferroviaire, dont la moitié la nuit. Cette proportion atteint 21 % dans l'agglomération parisienne. D'après l'Ademe, 11,5 millions d'individus subissent des niveaux sonores qui excèdent 45 dB (A) en façade de leur logement selon l'indicateur Lden. 4,4 millions de personnes sont affectées par un bruit supérieur à 55 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 54 dB (A). La nuit, 6,6 millions d'individus sont exposés de nuit à des niveaux dépassant 45 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 44 dB (A). Pour les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel entendus par les rapporteurs, « le bruit ferroviaire est la deuxième source de bruit la plus importante après le bruit routier et représente un problème environnemental majeur en Europe ». L'un des répondants au sondage précité a ainsi déclaré que « Le plus gênant [sont les] rails SNCF à proximité, avec des bruits stridents la nuit et [les] passages de trains de fret ».
Ces données doivent toutefois être nuancées. En effet, selon SNCF Réseau, « les cartes ferroviaires sont majorantes car réalisées sur la base de la vitesse maximale de la ligne alors que la vitesse réelle des circulations peut être inférieure ».
SNCF Réseau a indiqué aux rapporteurs que l'on observe « une baisse générale objective du niveau sonore ces dernières années » liée à l'amélioration des infrastructures et du matériel roulant. Concernant l'Île-de-France, BruitParif constate ainsi « une nette diminution du nombre de personnes exposées au bruit du trafic ferroviaire » dans les cartes de bruit stratégiques en vigueur par rapport aux cartes réalisées cinq ans auparavant : « les parts de personnes exposées au-delà des valeurs recommandées par l'OMS passant de 15,8 % à 9,6 % pour l'indicateur Lden et de 22,6 % à 11,6 % pour l'indicateur Ln [la nuit] ». Il faut toutefois rester prudent dans l'interprétation de cette évolution qui s'explique pour partie par des changements méthodologiques dans l'élaboration des cartes.
Cette diminution du bruit émis par le trafic ferroviaire pourrait ralentir dans les prochaines années compte tenu de la hausse attendue du trafic. Selon les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel, « l'augmentation du trafic ferroviaire va accroître inévitablement l'exposition au bruit, les gains apportés par les évolutions technologiques ayant tendance à stagner ces dernières années ».
Concernant les transports publics urbains et interurbains ferroviaires (TER, Transilien, RER, tramway), on observe également une diminution de l'exposition au bruit des populations ces dernières années. La RATP a ainsi fait état aux rapporteurs d'une diminution du nombre de personnes exposées à des niveaux sonores élevés à proximité de son réseau ces dernières années. Cependant, une hausse pour le tramway entre 2012 et 2017 liée à la création de nombreuses lignes nouvelles en Île-de-France est tangible.
Cette diminution du niveau de bruit lié au trafic ferroviaire a été rendue possible grâce à des actions sur les voies et le matériel roulant. SNCF Réseau a ainsi indiqué aux rapporteurs que les travaux de régénération des voies conduisent à une diminution de l'intensité acoustique de l'ordre de 6 dB (A), du fait de la généralisation du remplacement des rails courts par de longs rails soudés qui réduisent le nombre de joints de rails et du remplacement des traverses bois par des traverses en béton. Comme l'a signalé Île-de-France Mobilités (IDFM) aux rapporteurs, « Les trains de nouvelles générations intègrent les exigences normatives récentes et sont également moins bruyants grâce aux améliorations technologiques, en particulier concernant le freinage. ».
Évolution de l'exposition sonore de la population francilienne habitant le long du réseau RATP de 2007 à 2022 en fonction de l'indicateur Lden.
Source : RATP
b) Lignes à grande vitesse : des pics de bruit soudains qui perturbent des territoires souvent peu exposés au bruit
Les lignes à grande vitesse (LGV) génèrent un bruit aux caractéristiques différentes de celui des autres lignes. Comme le souligne SNCF Réseau : « S'agissant des TGV, leur irruption sonore soudaine liée à leur rapidité est perçue négativement. Le bruit des TGV se caractérise par un contenu spectral riche en basses fréquences ».
L'exposition des populations au bruit émis par la circulation des TGV est cependant essentiellement diurne. Selon SNCF Réseau, « les LGV ne sont que très faiblement circulées de nuit, en tout début et toute fin de période ».
La mise en service récente des nouvelles lignes de LGV Sud Europe Atlantique (SEA - Tours-Bordeaux) et Bretagne-Pays de la Loire (BPL - Le Mans-Rennes) en 2017 a entraîné une augmentation du niveau sonore, qui a été perçue négativement par les populations. Une mission de médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique a donc été confiée au commissariat général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) par la ministre chargée des transports en 201924(*). Cette mission a mis en évidence des enjeux propres au bruit émis par les nouvelles LGV. S'il n'y a pas d'exposition nocturne au bruit, « le soir les trains sont plus fréquents, ainsi que les vendredis et dimanche soir et cela correspond aux périodes de repos souhaitées » par les habitants. En outre, « les passages de train les gênent pour s'endormir le soir et les réveillent tôt le matin ». Les TGV traversent des zones auparavant calmes, si bien que les pics de bruit sont perçus comme une dégradation majeure de l'environnement, d'autant plus qu'ils perturbent l'usage des jardins, plus largement répandus dans les zones peu denses. Cette perception négative est exacerbée par des facteurs extra-auditifs : la gêne ressentie est considérée comme moins acceptable par les riverains qui estiment que l'infrastructure n'est pas utile pour leur territoire, ce qui est le cas dans des zones traversées par des rames qui ne s'arrêtent pas aux gares intermédiaires.
c) Les circulations ferroviaires : une source de vibrations et de bruit solidien
Le transport ferroviaire est source de vibrations concomitantes au bruit. Selon le Cerema, « les vibrations sont une extension des gênes acoustiques, certains bruits pouvant engendrer des vibrations, et inversement, certaines vibrations pouvant engendrer du bruit intérieur par rayonnement par les structures bâties ». Le bruit découlant des vibrations est le bruit solidien. L'impact des vibrations est particulièrement fort pour les lignes à grande vitesse et les réseaux urbains, notamment le réseau historique du métro parisien. Des progrès sont toutefois à attendre à l'avenir, la Société des Grands Projets (SGP) a indiqué, à propos du Grand Paris Express, que « s'agissant des vibrations, l'objectif de performance est de se situer sous le seuil de perception humaine ».
En zone urbaine dense, la propagation des vibrations et du bruit solidien, et donc l'exposition des populations, dépend non seulement des caractéristiques de l'infrastructure, mais également de celles du bâti autour de celle-ci. Comme l'a indiqué la RATP aux rapporteurs, « Dans les expertises techniques de nombreuses causes exogènes au “système transport” sont souvent identifiées ». En effet, « toute modification des hauteurs, des volumes, de la nature des matériaux ou agencements des bâtiments en champ proche des infrastructures de transport ou des sites industriels ainsi que toute création de ponts vibratoires, de réflexions de l'énergie vibratoire sur les fondations, de modifications structurelles ou de charge ou d'aménagements intérieurs sont susceptibles d'amplifier les vibrations chez les riverains existants ainsi qu'au sein même des bâtiments rénovés, réhabilités sans que les ouvrages RATP n'aient subi de modifications significatives ».
II. UN FOISONNEMENT COMPLEXE ET PEU LISIBLE D'OUTILS RÉGLEMENTAIRES
Les outils réglementaires relatifs au bruit des transports ont pour objectif de limiter les risques sanitaires liés à une exposition acoustique trop forte.
Néanmoins, les référentiels applicables divergent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Une pluralité d'indicateurs est utilisée pour qualifier une même nuisance dans les normes européennes et nationales. Cette situation est source de complexité pour les acteurs et les destinataires de la norme, parfois incapables de se repérer dans ce véritable « maquis » normatif que constitue la politique publique de lutte contre les nuisances sonores.
A. UNE SUPERPOSITION ILLISIBLE D'OUTILS DE CARTOGRAPHIE DU BRUIT ET DE PLANIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES
1. La cartographie du bruit : une utilisation de référentiels divers, source de complexité
Comme le met en avant la juriste Véronique Jaworski, la lutte contre le bruit est par essence complexe puisque le « travail normatif se heurte à l'extrême complexité des problèmes du bruit, qui occupent une position particulière, à la frontière des sciences humaines et des sciences physiques et mathématiques. En effet, les individus ne souffrent pas du bruit, mais des bruits. Aucun pays ni même aucune personne n'a la même perception du phénomène que son voisin »25(*).
Les auditions des rapporteurs ont unanimement souligné cette difficulté à établir une réglementation lisible. La direction générale de la prévention des risques (DGPR) indique ainsi que « la réglementation sur le bruit reste complexe, avec une approche par source de bruit et avec des indicateurs variés (niveau sur une durée, émergence, nombre d'événements) ». Ce constat est partagé par BruitParif qui estime que « la réglementation est complexe pour les riverains, d'autant que les notions d'acoustiques et d'indicateurs de bruit sont compliquées pour des non-spécialistes. Il n'est pas rare de voir des erreurs faites même par des bureaux d'étude lors de la réalisation d'études "bruit" ».
Deux dispositifs majeurs de cartographie du bruit en France coexistent : les cartes de bruit stratégiques (CBS) et le classement sonore des voies de transport terrestre.
Les cartes de bruit stratégiques (CBS) sont un outil de cartographie du bruit répondant à une obligation fixée par la directive européenne du 25 juin 200226(*). En application de l'article 7 de ce texte, il est obligatoire de réaliser une CBS pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour tous les grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicule par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 60 000 passages de train par an et tous les grands aéroports situés sur leur territoire.
Le classement sonore des voies les plus bruyantes est un outil de cartographie des voies de transport terrestre. En application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les CBS et le classement sonore des voies ont des champs d'application qui se superposent partiellement : les grandes voies de transports terrestres sont répertoriées dans ces deux outils de cartographie du bruit.
Cette superposition est source d'illisibilité, car les indicateurs de bruit utilisés ne sont pas identiques.
La mesure du bruit dans les CBS s'effectue à l'aide de l'indicateur Lden tandis que le classement sonore des voies s'appuie sur la combinaison des indicateurs LAeq diurne et LAeq nocturne, en application de la circulaire du 25 juillet 1996 relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, qui fixe la méthodologie applicable.
Le Lden (Level Day-Evening-Night) et le LAeq (niveau équivalent de pression acoustique pondéré à une période de temps T) sont en effet deux indicateurs utilisés pour mesurer les nuisances sonores.
Le LAeq représente le niveau sonore moyen sur une période donnée, en intégrant toutes les fluctuations sonores pendant cette période. Il a pour incidence de lisser les pics de bruit et donc la gêne occasionnée. La distinction d'un LAeq diurne et d'un LAeq nocturne permet de prendre en compte la gêne supérieure causée par le bruit la nuit.
Le Lden correspond au niveau sonore moyen pondéré sur une journée entière, en donnant un poids plus fort au bruit produit en soirée (18 h-22 h) (+5 dB(A)) et durant la nuit (22 h-6 h) (+10 dB(A)) pour tenir compte de la sensibilité accrue des individus aux nuisances sonores durant ces deux périodes.
Ainsi, utiliser une combinaison de LAeq diurne et nocturne ou le Lden répond à un objectif similaire : obtenir un niveau moyen de bruit en tenant compte des spécificités du bruit nocturne. Cependant, il n'est pas possible de comparer les données exprimées en LAeq et en Lden. L'absence de référentiels communs et partagés rend les comparaisons difficiles, voire impossibles, dans certains cas. Ainsi, pour une même infrastructure ferroviaire ou routière, coexistent plusieurs instruments de mesure du bruit, utilisant des référentiels distincts.
Un alignement des indicateurs permettrait non seulement une meilleure cohérence des outils, mais aussi une mutualisation des données : le préfet pourrait, par exemple, fonder le classement des voies bruyantes sur les cartes stratégiques de bruit, et inversement. La convergence des référentiels améliorerait tant la clarté du cadre juridique que la pertinence des réponses apportées aux enjeux de santé publique liés aux nuisances sonores.
2. Classement sonore des voies et PPBE : une cacophonie des outils de planification
Les outils de cartographie du bruit servent de base à des outils de planification visant à limiter l'exposition de la pollution aux nuisances sonores.
a) Le classement sonore des voies : fondement de la lutte contre le bruit des transports terrestres
La cartographie du bruit issue du classement sonore des voies, créée par la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « loi bruit », et codifiée aux articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement est le fondement de l'action publique de lutte contre le bruit des transports terrestres.
En application de l'article L. 571-9 du code de l'environnement, la construction et la modification des infrastructures terrestres bruyantes doivent prendre en compte le bruit. Si des riverains sont exposés à un bruit supérieur à un certain niveau mesuré en LAeq, le porteur de projet est tenu de prendre des mesures limitant le bruit émis par l'infrastructure ou limitant sa propagation (notamment en isolant phoniquement les logements à proximité)27(*).
L'article L. 571-10 du code de l'environnement dispose que sur la base du classement sonore des voies, le préfet de département détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. L'article R. 151-53 du code de l'urbanisme prévoit par conséquent que figurent en annexe du plan local d'urbanisme (PLU) le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
L'article R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation précise que l'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par cet arrêté préfectoral. L'article R. 462-4-3 du code de l'urbanisme indique que la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique.
b) Les plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) : des dispositifs non-normatifs
La directive européenne du 25 juin 200228(*) prévoit que, sur la base des CBS, sont réalisés de plans d'action, devenus en droit français les « plans de prévention des bruits dans l'environnement » (PPBE) visant la réduction du bruit (article 8).
Les PPBE sont établis par le préfet, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétente. Ils s'appliquent à l'ensemble des transports : routier, ferroviaire et aérien. Les mesures mentionnées dans les PPBE n'ont cependant pas de valeur normative et leur non-respect n'emporte donc aucune conséquence juridique. BruitParif regrette à cet égard que « les PPBE manquent d'une obligation de résultats et d'objectifs clairs à atteindre » et pointe l'insuffisance de l'évaluation des actions menées. Certaines associations de défense de l'environnement et de représentation des riverains ont exprimé leur déception sur la mise en oeuvre de ces dispositifs.
Ainsi, pour France Nature Environnement (FNE), « 25 ans après la directive de 2002, on commence seulement, lors de la quatrième échéance, à les considérer sérieusement. Les trois échéances précédentes n'ont quasiment pas produit de résultat concret en matière de baisse des nuisances. Pour les grands aéroports, sujet sur lequel les associations se sont le plus mobilisées, on constate plutôt à chaque échéance une augmentation du bruit ! ».
Plusieurs acteurs entendus ont souligné que la France ne respectait d'ailleurs qu'imparfaitement ses obligations en la matière, découlant de l'article 8 de la directive « bruit » du 25 juin 2002.
Par conséquent, elle a reçu une première mise en demeure le 31 mai 2013, suivie d'une mise en demeure complémentaire le 7 décembre 2017, avant un avis motivé de septembre 2023 de la Commission européenne pour ne pas avoir adopté de plans d'action contre le bruit.
Dans son avis motivé, la Commission européenne mettait en avant un retard dans l'adoption des plans d'action contre le bruit en France (les PPBE).
Comme l'a indiqué la DGPR aux rapporteurs, elle relevait ainsi que 19 plans d'actions faisaient toujours défaut pour les agglomérations et 65 plans d'action pour les grands axes routiers alors que ces plans auraient dû être adoptés avant le 18 juillet 2013. Toujours selon la DGPR, « dans la plupart des cas, les plans existaient, mais avaient été mal rapportés », de sorte que, « à date, sur les 84 plans initialement attendus par la Commission dans son avis motivé, 2 PPBE d'agglomérations et 12 PPBE de collectivités gestionnaires de grandes infrastructures routières restent encore à fournir ». Le 24 juillet 2024, la Commission a annoncé son intention de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement contre la France pour défaut d'adoption de plans d'action contre le bruit conformément à la directive de 2002 sur le bruit.
Cette décision autorise les services à saisir la Cour, mais n'implique pas une saisine automatique de la CJUE. La Commission n'a toujours pas saisi la CJUE. Cette saisine pourrait devenir sans objet dans la mesure où la DGPR a indiqué aux rapporteurs que « sous réserve de la tenue des calendriers affichés par les collectivités concernées, les PPBE devraient pouvoir être fournis d'ici l'été 2025 ».
Cette application incomplète et tardive de l'obligation de réaliser des PPBE est le signe d'une appropriation limitée de cet outil par les acteurs publics, qui y voient un outil de reporting contraignant plutôt qu'un outil stratégique pour les politiques publiques de réduction du bruit. À cet égard, certains acteurs entendus par les rapporteurs, comme l'association CAN Environnement, ont souligné que la concertation était « difficile » et les demandes du public souvent insuffisamment prises en compte.
En dépit de leurs imperfections et du respect seulement partiel par la France de ces obligations, les PPBE restent un outil précieux.
Comme l'a mis en avant le Cerema, « les PPBE sont aujourd'hui les seuls documents réglementaires liés au bruit que les collectivités doivent porter sur leur territoire. Cela a permis une prise de conscience sur la problématique bruit et pousse les gestionnaires de voiries à proposer des actions pour limiter les nuisances. L'ajout de l'obligation d'évaluer les impacts sanitaires lors de la dernière échéance des CBS contribue à une meilleure prise de conscience des collectivités des réels impacts sur la santé (les enjeux sont souvent plus aisément compréhensibles quand ils sont exprimés sous la forme de réduction d'espérance de vie en bonne santé ou de populations exposées à des effets nuisibles (fortes gênes, fortes perturbations du sommeil, etc.), que sous la forme de populations exposées à des niveaux en dB (A)). Cela contribue de plus à la possibilité de monétariser les coûts économiques du bruit, et de communiquer alors en termes de pertes économiques ».
Pour les rapporteurs, il pourrait donc être pertinent de rationaliser la production de PPBE et d'éviter leur juxtaposition sur un même territoire en prévoyant des PPBE communs aux grandes infrastructures et aux grandes agglomérations quand c'est possible. Cette rationalisation pourrait favoriser l'implication des collectivités territoriales, la lisibilité de ces documents et la participation du public. Elle pourrait ainsi permettre d'en faire des outils stratégiques plus efficaces de réduction de la pollution sonore.
Proposition n° 2 : Rationaliser l'élaboration des PPBE pour éviter leur juxtaposition sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen.
L'application de la directive « bruit
» de 2002 par les États membres :
des situations
hétérogènes
En 2023, 25 États membres sont considérés par la Commission européenne comme ayant transposé convenablement la directive, ce qui représente 98 % de la population de l'Union européenne (UE)29(*). Toutefois, en raison de délais de transposition trop longs et de transpositions lacunaires, la Commission avait initié des procédures de recours en manquement à l'encontre de 15 États membres30(*) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Grâce à l'effort de certains États membres, la directive a ensuite été transposée avec une meilleure conformité, ce qui a permis la clôture de sept procédures de recours en manquement31(*) et des améliorations dans les transpositions en droit interne des huit autres États membres.
L'exemple de la Grèce est à cet égard significatif. Elle fait l'objet de deux procédures d'infraction concomitantes liées à des manquements aux obligations résultant de la directive sur le bruit.
D'une part, la Commission européenne reproche à la Grèce d'avoir manqué aux obligations d'adoption et de révision de plusieurs cartes de bruit (article 7 de la directive) et plans d'action (article 8 de la directive) pour diverses agglomérations et routes. En outre, certains plans et cartes adoptés ne répondent pas aux exigences minimales fixées par la directive (annexes IV et V de la directive) et ont été adoptés sans consultation du public en bonne et due forme. La Commission européenne a donc envoyé à la Grèce une mise en demeure en 2017, puis une mise en demeure complémentaire en 2020. Depuis, les seules évolutions positives concernent l'aéroport international d'Athènes ; pour le reste, les griefs sont toujours d'actualité, d'où l'avis motivé du 19 avril 202332(*). La Grèce disposait alors d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission européenne pourrait décider de saisir la CJUE.
D'autre part, la Grèce fait l'objet d'une seconde procédure d'infraction pour non-communication à la Commission européenne de toutes les informations pertinentes sur les cartes de bruit stratégiques (article 10 al. 2 de la directive), notamment l'exposition au bruit de la population puisque la réglementation grecque retient des seuils de niveau sonore de 70 Lden (Level Day Evening Night)33(*) et 60 Lnight (Level night)34(*), ce qui ne correspond pas aux standards minimaux de la directive dont la méthodologie est définie à l'annexe I. En conséquence, la Commission européenne lui a transmis une lettre de mise en demeure en octobre 202435(*) : la Grèce disposait d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements que la Commission a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
Source : Sénat, direction de la législation comparée, note sur les nuisances sonores causées par les transports
3. Les plans de gêne sonore (PGS) : un dispositif perfectible
Les plans de gêne sonore (PGS) ouvrent aux riverains se trouvant à l'intérieur de zones exposées au bruit des aéroports le droit de bénéficier d'une aide financière à l'isolation phonique de leur logement. Ce plan est réalisé par le préfet de département.
Ces instruments ont fait preuve de leur efficacité. Selon le DGAC, entre 2004 et 2023, 78 246 locaux de natures diverses (logements, établissements d'enseignement et locaux à caractère sanitaire et social) situés dans un des PGS des 11 plus grands aéroports français ont bénéficié d'une aide à l'insonorisation pour un montant de plus de 777 millions d'euros. Parmi ces locaux, 58 000 se situent en région parisienne.
Logements restant à insonoriser dans les PGS en vigueur
|
Aérodromes |
Nombre théorique de locaux restant à insonoriser |
|
Beauvais-Tillé |
73 |
|
Bordeaux-Mérignac |
1 234 |
|
Marseille-Provence |
791 |
|
Nantes-Atlantique |
2 591 |
|
Nice-Côte d'Azur |
1 719 |
|
Paris-Charles de Gaulle |
16 866 |
|
Paris-Le Bourget |
9 194 |
|
Paris-Orly |
8 773 |
|
Toulouse-Blagnac |
2 370 |
|
Total |
43 618 |
Source : DGAC
Il resterait encore environ 45 000 locaux potentiellement éligibles à l'insonorisation pour un montant d'aide approchant 675 M€, dont 27 500 logements en région parisienne. Cependant, paradoxalement, les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) versées par les compagnies aériennes pour financer l'insonorisation sont supérieures au coût actuel des travaux d'insonorisation à cause d'une demande durablement faible de prise en charge des travaux. Il en résulte un excédent de trésorerie de TNSA estimé à 110,5 millions d'euros.
Excédent de trésorerie de TNSA des aéroports
|
Montant de trésorerie déduction faite des engagements déjà réalisés au 1er janvier 2025 |
M€ |
|
Beauvais-Tillé |
0,8 |
|
Bordeaux-Mérignac |
1,5 |
|
Marseille-Provence |
5,5 |
|
Nice-Côte d'Azur |
4,3 |
|
Paris-Charles de Gaulle* |
65,8 |
|
Paris-Le Bourget* |
-13,0 |
|
Paris-Orly |
39,3 |
|
Toulouse-Blagnac |
6,3 |
|
Total |
110,5 |
*Trésorerie commune CDG/LBG
Source : DGAC
Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, les montants maximums de prise en charge des travaux ont longtemps constitué un frein, car ils n'avaient pas été revus entre 2011 et 2023 en dépit de l'évolution du coût des travaux. Ils ont été augmentés de 25 % le 26 décembre 2023. Dans le rapport d'information sur la modernisation de Nantes Atlantique, le rapporteur Didier Mandelli avait recommandé une hausse de 33 %, plus proche de l'augmentation réelle des coûts. La DGAC a d'ailleurs confirmé aux rapporteurs que les effets de cette augmentation de 25 % « ne se font pas encore sentir, le flux des nouveaux dossiers de demande d'aide est pour le moment sensiblement égal ». Une nouvelle augmentation des plafonds des aides pour les rendre cohérents avec les coûts réels des travaux pourrait être bienvenue. Des augmentations plus ciblées des plafonds de prise en charge seraient par ailleurs souhaitables, notamment pour certains logements atypiques (avec des surfaces vitrées importantes) ou situés dans un périmètre protégé soumis à l'avis des architectes des bâtiments de France.
En outre, l'article R. 571-87 du code de l'environnement prévoit un plafonnement de la prise en charge des travaux à 80 % de leur coût, le reste étant financé par les propriétaires des logements eux-mêmes. En cas de très faibles revenus (12 455 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire), l'aide est portée à 90 % du montant des travaux. Les travaux sont pris en charge à 100 % uniquement pour les propriétaires bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de certaines aides sociales. Entre 2012 et 2014, avait été mis en place un taux de prise en charge des travaux de 100 %. Selon la DGAC, « le retour d'expérience de la mise en oeuvre d'une telle mesure a montré qu'en l'absence de ressources de financement calibrées au bon niveau, l'afflux de nouvelles demandes dans les services des exploitants pouvait engorger durablement le dispositif et créer une file d'attente de plusieurs années en contradiction totale avec l'objet même de cette politique publique ».
Pour les rapporteurs, la situation actuelle d'atonie des travaux d'insonorisation est en contradiction avec l'objet même de cette politique publique. La DGAC reconnaît d'ailleurs que « le niveau élevé de trésorerie actuellement disponible permettrait cependant, sans doute, d'absorber un regain d'activité ». C'est la raison pour laquelle la FNAM est favorable à un relèvement à 100 % du taux de prise en charge des travaux pour 2 ans. Les rapporteurs estiment qu'il serait cependant plus équitable de définir un nouveau taux de prise en charge pérenne plutôt que temporaire. Un relèvement à 95 % de la prise en charge de droit commun des travaux d'insonorisation serait donc opportun, car elle lèverait le principal frein à la demande d'insonorisation des logements.
Enfin, plusieurs acteurs entendus ont évoqué la possibilité de rouvrir le droit à insonorisation pour des logements insonorisés à une période où les techniques d'insonorisation étaient plus limitées et moins durables. La DGAC a fait part aux rapporteurs de ces réserves sur cette possibilité : « La DGAC et la DGPR s'accordent sur le fait que la seule dégradation, au cours du temps, des qualités d'isolation phonique des installations ne constitue pas un cas pouvant mettre en jeu le dispositif d'aide, et le maintien en l'état relève de l'unique responsabilité du propriétaire au titre de l'entretien de son bien. L'octroi d'aides à des logements ayant bénéficié (pour les mêmes pièces) d'une première aide à l'insonorisation pose en outre des questions d'égalité de traitement. » Pour les rapporteurs, cette analyse est en contradiction avec le principe de pollueur-payeur. En effet, s'il revient à un propriétaire d'entretenir son bien afin d'éviter une dégradation de la qualité de son insonorisation, la détérioration structurelle du dispositif d'insonorisation dans le temps ne s'explique pas par un défaut d'entretien. La pollution sonore aéroportuaire étant durable tandis que l'efficacité des dispositifs d'insonorisation décroît dans le temps, il pourrait être pertinent d'envisager la possibilité de prévoir de façon pérenne une réouverture du droit à insonorisation pour les mêmes logements. Le financement de l'atténuation de l'impact de la pollution doit en effet être strictement corrélé avec sa durée.
En outre, un élargissement de l'éligibilité aux aides à l'insonorisation pourrait être opportun. Ainsi que l'indique BruitParif, « il est fréquent que des secteurs autour des territoires soient concernés par des dépassements de la valeur limite réglementaire de 55 dB (A) selon l'indicateur Lden dans une configuration mais pas dans l'autre et qu'en moyenne sur l'année il n'y ait pas de dépassement et que par conséquent ils ne soient pas éligibles à l'aide à l'insonorisation ». Pour les rapporteurs, le périmètre des PGS pourrait être étendu aux locaux concernés par un dépassement des valeurs réglementaires sur une partie significative de l'année, par exemple plusieurs mois.
Le bruit aérien ayant un impact particulièrement délétère sur la santé des populations exposées la nuit, il pourrait être envisageable d'étudier la possibilité d'intégrer un seuil d'exposition nocturne dans les PGS, plus bas que le seuil actuel estimé en Lden de 55 dB (A).
Certaines situations particulières appellent également des évolutions paramétriques. BruitParif a ainsi mis en avant le cas de riverains exposés au bruit des aéroports de Paris-CDG et du Bourget, qui subissent un bruit cumulé des deux plateformes supérieures aux valeurs réglementaires, mais qui ne l'atteignent pas lorsque l'on comptabilise séparément les vols. Un PGS global de ces deux infrastructures, exploitées par le même gestionnaire aéroportuaire, permettrait de mettre un terme à une situation jugée injuste et incompréhensible par les riverains.
Les différentes zones des PGS sont définies en fonction du bruit mesuré à proximité des plateformes. Cette mission est assurée par les gestionnaires des aéroports. Or, selon BruitParif, « le fait que la surveillance du bruit aérien (réseau de mesure permanent du bruit) soit confiée aux gestionnaires d'aéroports n'est pas de nature à favoriser un dialogue serein entre l'ensemble des acteurs, malgré le cahier des charges à respecter établi par l'Acnusa ». Étudier la possibilité, pour les différentes plateformes, de confier cette tâche à des acteurs indépendants du monde aérien à l'instar des observatoires régionaux de bruit serait opportun. Une telle mesure permettrait de renforcer la qualité du dialogue entre les exploitants aéroportuaires et les riverains.
Proposition n° 3 : Améliorer les politiques d'aide à l'insonorisation en réduisant le reste à charge pour les riverains, en rouvrant ce droit pour les locaux dont le dispositif d'insonorisation s'est dégradé dans le temps et en élargissant le nombre de locaux éligibles.
4. Une prise en compte insuffisante du bruit dans les documents d'urbanisme
Actuellement, le droit de l'urbanisme prend peu en compte le bruit émis par les transports.
Les seules restrictions de l'urbanisme actuellement en vigueur concernent les aéroports via les plans d'exposition au bruit (PEB) réalisés autour des plateformes. Ces outils délimitent des zones à proximité des aéroports soumises à des règles d'urbanisme limitant la construction de logements et d'établissements sensibles (écoles, hôpitaux...).
En revanche, pour les infrastructures de transport terrestre, les règles d'urbanisme sont particulièrement limitées.
À proximité d'une infrastructure de transport terrestre, il est possible de construire n'importe quel type de bâtiment dès lors qu'il est correctement insonorisé. Comme le souligne SNCF Réseau, « le classement sonore n'est pas une règle d'urbanisme mais une règle de construction visant à faire en sorte que les nouvelles constructions situées en secteurs affectés par le bruit soient suffisamment insonorisées pour éviter l'apparition de nouveaux points noirs du bruit ». Ainsi, il n'existe aucune servitude d'urbanisme empêchant la construction de certains types de locaux, BruitParif regrette ainsi que « rien n'empêche de construire au droit de l'A6, du périphérique ou d'une voie ferrée ». Le CGEDD dresse un constat similaire : « Il n'existe paradoxalement aucune restriction de droit à l'occupation de l'espace riverain des voies bruyantes par des immeubles d'habitation ou d'accueil de publics sensibles tels que les enfants. Il est donc possible de construire au voisinage des voies ferrées et des routes à trafic intense, dès lors que les immeubles respectent les normes d'isolation acoustique aux bruits extérieurs. (...) Le silence du code de l'urbanisme sur le bruit des transports terrestres, comparé aux dispositions très complètes qu'il édicte au voisinage des aérodromes, surprend. Il paraît étrange qu'on puisse implanter une crèche ou une nouvelle école le long d'une voie rapide urbaine, sous la seule condition que le bruit à l'intérieur, fenêtres fermées, respecte les valeurs limites édictées par la réglementation ».
Interdire la construction de nouveaux logements et de bâtiments sensibles (crèches, écoles, établissements de santé...) à proximité immédiate des infrastructures de transport terrestre bruyantes, comme c'est le cas actuellement pour le transport aérien, pourrait être opportun.
Une telle interdiction de construction de logements à proximité des infrastructures de transports terrestres les plus bruyantes pourrait inciter les porteurs de projets d'aménagement urbain à développer une approche globale de la question du bruit et à construire des bâtiments moins sensibles vis-à-vis du bruit dans ces zones. La prise en compte des enjeux de bruit dès la conception des projets éviterait d'avoir à mettre en place des mesures d'isolation curatives. L'isolation des bâtiments se dégrade avec le temps et peut de surcroît devenir insuffisante en cas de hausse du bruit émis par l'infrastructure de transport voisine (notamment en cas d'augmentation du trafic). Elle entraîne en outre une exposition au bruit à l'extérieur et fenêtres ouvertes. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes entendues aux rapporteurs, en matière de bruit, il vaut mieux prévenir que guérir.
Le CGEDD note dans son rapport précité de 2017 qu'il « a été signalé à la mission des exemples paradoxaux de crèches implantées en ZAC le long d'une voie rapide urbaine, alors que les terrains à l'arrière, jugés commercialement plus intéressants, étaient réservés aux bureaux et aux entreprises. A contrario, les urbanistes et les architectes savent aujourd'hui construire le long des voies bruyantes des immeubles tolérants au bruit (bureaux, hôtels, salles de sport...), dont la façade côté voie est occupée par les espaces les moins nobles (couloirs, cuisines et sanitaires...) et qui jouent vis-à-vis des immeubles à l'arrière le rôle bienvenu d'écrans acoustiques ». Des règles d'urbanisme plus strictes impliqueraient que les logements soient construits « en deuxième rideau » ou en coeur d'îlots.
L'AE souligne ainsi « l'intérêt, voire la nécessité d'approches globales, inscrites conjointement dans les politiques d'aménagement et urbanisme et de transport et mobilités ». La conception de certains projets d'aménagement prenant en compte ex ante la question du bruit « peut permettre de créer des situations qui intrinsèquement exposent moins les populations au bruit ». L'AE a mis en avant auprès des rapporteurs l'aménagement du projet de la ZAC Lyon Confluence pour lequel ces questions ont été prises en compte.
Proposition n° 4 : Prendre en compte le bruit émis par les transports terrestres dans les documents d'urbanisme au même titre que le bruit aérien.
Les documents d'urbanisme et de planification réalisés par les collectivités territoriales peuvent également inclure des dispositions relatives au bruit. C'est par exemple le cas des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), dont l'articulation avec les PPBE a fait l'objet d'une étude du Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB)36(*) en mars 2019. Ce travail a mis en évidence que la périodicité des documents est assez similaire (réalisé tous les 5 ans pour les PPBE et 6 ans pour les PCAET) et qu'ils comportent tous les deux des phases d'études et de diagnostics sur l'incidence des modes de transports. En outre, compte tenu de la forte imbrication entre pollution sonore et pollution de l'air, l'articulation des dispositifs semble tout à fait opportune.
Outre les PCAET, les collectivités territoriales réalisent de nombreux documents de planification qui ont une incidence sur les transports. À cet égard, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) à l'échelle du bassin de vie via les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) à l'échelle de la Région, les plans locaux d'urbanisme (PLU) à l'échelle communale ou encore les plans de mobilité (PDM) élaborés par les autorités organisatrices des mobilités (AOM). Ce dernier présente un intérêt singulier dans la lutte contre les pollutions sonores dans la mesure où il s'articule autour du double objectif de proposer une offre satisfaisante de mobilité et de protéger la santé et l'environnement (lutte contre les gaz à effet de serre, qualité de l'air, bruit, biodiversité, etc).
Malheureusement, les rapporteurs ont constaté, la quasi-absence d'articulation entre les dispositifs nationaux et les mesures locales. Des concertations, à la maille départementale ou intercommunale, devraient être menées afin de favoriser la cohérence entre les différents documents de planification et les outils de cartographie existants.
Un exemple de superposition des outils : le transport aérien
Pour le seul secteur aérien, trois documents de cartographie et d'actions en faveur de la lutte contre les pollutions sonores peuvent être recensés : plan de gênes sonores (PGS), plan d'exposition au bruit (PEB) et plan de prévention des bruits dans l'environnement (PPBE). Une telle pluralité d'outils pose déjà des difficultés en soi, notamment en matière de lisibilité, mais elles sont exacerbées dès lors qu'un même espace géographique se situe au confluent de plusieurs dispositifs.
Ainsi, selon l'Union des aéroports français (UAF), « La gouvernance des politiques locales de prévention du bruit aérien est complexifiée par la superposition des instances et des outils. À Toulouse, par exemple, le manque de cohérence entre le PPBE de l'aéroport et celui de la métropole, notamment sur le périmètre des populations exposées, remet en question l'efficacité du plan ».
Le cas de l'aéroport Paris-Orly est particulièrement significatif. Situé à 10 kilomètres au sud de Paris, à proximité immédiate de près de sept communes : Orly, Villeneuve-le-Roi, Paray-Vielle-Poste, Wissous, Athis-Mons, Chilly-Mazarin et Morangis. Il est par ailleurs à cheval sur deux départements : Essonne et Val-de-Marne. Enfin, il se situe dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris.
Il est ainsi concerné par trois PPBE :
- PPBE de la Métropole du Grand Paris ;
- PPBE de l'aéroport de Paris-Orly ;
- PPBE du conseil départemental du Val-de-Marne.
Or, les orientations arrêtées dans chaque PPBE ne sont pas nécessairement harmonisées entre elles. À titre d'exemple, le PPBE de la Métropole du Grand Paris fixe des objectifs ambitieux en matière d'extension du couvre-feu nocturne, tandis que le PPBE propre à l'aéroport concerné ne prévoit, pour sa part, aucune extension de la période de restriction. Cette divergence révèle un manque de coordination entre les différents niveaux de planification, susceptible de nuire à l'efficacité globale des mesures de lutte contre les nuisances sonores.
B. LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES : UNE MESURE IMPARFAITE DE LA GÊNE LIÉE AU BRUIT
1. Les pics de bruit sont insuffisamment pris en compte
Les indicateurs énergétiques utilisés dans les réglementations françaises et européennes mesurent un niveau moyen de bruit, sur une période annuelle. Cette méthode est considérée comme adaptée pour mesurer la gêne ressentie du fait du bruit routier, qui compte assez peu de pics. Or, le bruit ferroviaire et le bruit aérien se caractérisent par des pics de forte intensité. Comme le met en avant la DGPR, cette méthode « a le défaut de “lisser” les pics de bruit, qui sont pourtant l'une des sources principales de nuisances dans le cas d'infrastructures avec un trafic intermittent, comme le trafic ferroviaire ».
Selon l'Université Gustave Eiffel, « un même niveau de bruit en Lden peut aussi bien correspondre à de nombreux événements peu bruyants que peu d'événements très bruyants, alors que le ressenti des riverains n'est pas le même dans les deux situations ».
Ces pics de bruit sont pourtant considérés par les riverains comme particulièrement gênants. Selon l'association France Nature Environnement (FNE), « le riverain subit une succession de “pics de bruit” vécus comme une répétition d'agressions sonores qui déclenchent autant de réactions de défense de leur organisme. » Ce constat est partagé par les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel, qui soulignent que « le choix du Lden, indice moyen, est questionné concernant sa capacité à prédire la gêne due au bruit par exemple pour des sources de bruit intermittentes, comme les trains ou les avions, caractérisées par des pics de bruit ».
Dès février 2013, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) soulignait que « les indices acoustiques ne sont pas suffisants » car « seule l'utilisation de certains d'entre eux pourrait permettre d'intégrer les effets des pics de bruit sur la santé dans la construction d'indicateurs d'impact sanitaire : il s'agit des indices acoustiques événementiels qui disposent d'éléments descriptifs de l'émergence de l'exposition sonore. Les indices acoustiques intégrés, qui décrivent une exposition sonore moyenne, ne permettent pas de distinguer deux situations d'exposition de niveau sonore moyen identique pour lesquelles une différence d'impact sanitaire serait uniquement attribuable à la présence de pics de bruit dans l'un des cas. De par leur nature, ces indices acoustiques intégrés, descripteurs de l'exposition sonore, ne traduisent pas la gêne ressentie (seul le Lden tente de la prendre en compte, mais de façon incomplète) et a fortiori, ils ne permettent pas de caractériser les autres effets extra-auditifs du bruit (problèmes d'apprentissage scolaire, stress, perturbations du sommeil, etc.) »37(*).
En outre, les voies de chemin de fer n'entrent dans le classement sonore des voies que si elles ont un trafic supérieur à 50 trains par jour (en moyenne annualisée). Les deux LGV mises en service en 2017, qui génèrent des pics de bruit élevés, sont insuffisamment circulées pour entrer dans le champ de la réglementation. Les riverains de ces lignes ont donc contesté la pertinence des indicateurs énergétiques pour évaluer les effets du bruit émis par ces lignes. Selon le rapport de médiation du CGEDD sur cette question, les riverains « souhaitent que soient pris en compte les pics de bruit, à la fois dans la médiation conduite par la mission et dans la réglementation sur le bruit ferroviaire ».
Les pics de bruit nocturnes sont notamment source de perturbation du sommeil. Or, selon le Cerema, « après les conséquences liées à la gêne, la perturbation du sommeil constitue le second impact, le plus significatif sur la santé, engendré par les pics de bruit ». SNCF Réseau a d'ailleurs indiqué aux rapporteurs que l'indicateur LAmax, qui mesure le niveau sonore maximal lié au passage d'un train « est adapté pour décrire les perturbations du sommeil (réveil nocturne) ».
Ce décalage entre la réglementation actuelle et les effets sanitaires du bruit est source d'insécurité juridique pour les porteurs de projets. Le respect des normes en vigueur par ces derniers ne les protège pas de décisions de justice défavorables liées à la gêne subie par les riverains du fait du bruit émis par les voies. SNCF Réseau a ainsi indiqué aux rapporteurs avoir reçu depuis la mise en service des lignes de LGV BPL et SEA et du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) en 2017 environ 250 requêtes avec une réclamation totale estimée à près de 40 millions d'euros.
Selon le gestionnaire d'infrastructure, « si l'argument premier de ces réclamations a pour origine le bruit, les requérants, dont les habitations sont soumises à des niveaux sonores conformes à la réglementation, étayent généralement leur demande à partir d'une atteinte à leur santé et une prétendue baisse de la valeur vénale de leur bien. Le nombre de contentieux augmente de façon évidente et les juges tendent à reconnaître beaucoup plus facilement l'existence d'un dommage permanent de travaux publics avec probablement une augmentation du montant des indemnisations retenues ». Comme l'a précisé la DGITM aux rapporteurs, « dans ces différents dossiers, le juge administratif a considéré que la circonstance que les seuils prévus par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus ne suffit pas à exclure l'existence d'un préjudice grave lié à des nuisances sonores, dès lors qu'il y a lieu de prendre également en compte, pour l'appréciation d'un tel préjudice, la gravité des émergences sonores résidant dans les pics de bruit généré par le passage des trains ».
Ces condamnations des gestionnaires d'infrastructures concernés (LISEA et Eiffage Rail Express) conduisent à faire du contentieux administratif un moyen de traitement des nuisances sonores. Une telle situation est triplement problématique : elle fait peser une incertitude juridique et financière sur les projets de lignes ferroviaires ; elle aboutit à une forme de rupture d'égalité entre les riverains, certains ayant les moyens financiers et l'expertise de mener une procédure contentieuse souvent longue ; et engendre une gestion individuelle par le juge d'une question devant être réglée collectivement par l'État.
Une meilleure prise en compte de ces pics de bruit par la réglementation est souhaitable. Cet objectif est affirmé à l'article L. 571-10-2 du code de l'environnement, créé par l'article 90 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Il prévoit que « les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit ». Un indicateur événementiel mesure l'intensité d'un événement sonore et le nombre d'événements : il permet ainsi d'éviter de considérer de la même façon un bruit moyen et durable et des pics de bruit répétés.
Il a fallu attendre trois ans après la parution de la LOM, pour qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et du logement du 29 septembre 2022 pris en application du même article L. 571-10-2, fixe à titre expérimental les modalités de détermination et d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire38(*). Cet arrêté, réalisé avec l'appui technique du Cerema, identifie plusieurs indicateurs événementiels à tester sur différentes voies ferrées. Ces tests visent notamment à vérifier la fiabilité technique de la mesure des indicateurs.
Un premier bilan des campagnes de test menées par les opérateurs ferroviaires devrait être réalisé dans les prochains mois. SNCF Réseau a indiqué aux rapporteurs que la mesure de ces indicateurs événementiels est particulièrement complexe.
Premièrement, selon SNCF Réseau, les situations de multiexposition peuvent rendent difficile l'identification du bruit émis par les circulations ferroviaires. Pour le gestionnaire d'infrastructure, « dans de nombreux cas, les conditions de mesure ne permettent pas la caractérisation de ces indicateurs (passages des trains partiellement ou totalement masqués par le bruit environnant, impossibilité d'affecter un pic à un évènement ferroviaire, impossibilité de garantir que le pic le plus élevé lors d'un passage ferroviaire identifié n'est pas dû à une autre source perturbatrice simultanée) ».
En outre, même dans les cas où la caractérisation du bruit émis par les trains est possible, la variabilité des valeurs mesurées n'atteindrait pas la fiabilité souhaitée. SNCF Réseau a en particulier mis en avant « la très forte variabilité de ces indicateurs par rapport à la forte stabilité de l'indicateur LAeq ». Par exemple, pour le LAmax, « deux matériels roulants de caractéristiques identiques ne produiront pas nécessairement la même signature acoustique au même endroit. Le LAmax mesuré ne sera donc pas nécessairement le même ». Ce manque de régularité de la mesure pour le même type de circulations rend difficile la définition d'un indicateur uniforme.
Ainsi, pour SNCF Réseau, « il s'agit de difficultés techniques rédhibitoires pour répondre à ce stade à la demande de l'arrêté de fournir à titre d'information pour les projets de création ou de modification significative d'infrastructures les niveaux des indicateurs » événementiels. C'est pourquoi, « SNCF Réseau défend la position pragmatique de maintenir les indicateurs actuels avec un seuil à abaisser en fonction des types de trafic et des niveaux sonores préexistants ». Compte tenu de ces limites, le gestionnaire d'infrastructure estime que « l'introduction d'un indicateur événementiel de type LAmax ne pourrait s'envisager qu'à titre informatif pour les riverains, mais sans intervenir dans le dimensionnement des protections ».
La DGPR a indiqué aux rapporteurs qu'une deuxième phase de l'expérimentation serait lancée à la suite de l'analyse détaillée des résultats de la phase initiale.
Ces expérimentations souffrent d'une autre limite : aucune évaluation de la corrélation des indicateurs événementiels testés avec les effets du bruit sur la santé n'a été menée. Comme l'a rappelé le Conseil national du bruit, « il n'existe pas d'indicateur défini et validé scientifiquement qui permettrait à lui seul de tenir compte des principaux paramètres acoustiques d'influence de la gêne de long terme ressentie par les riverains des infrastructures ferroviaires »39(*). Selon les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel entendus par les rapporteurs, les premiers résultats de l'expérimentation « en aucun cas ne prouvent qu'ils permettent de mieux expliquer la gêne ou de mieux prédire les effets sur la santé. En effet, l'arrêté ne mentionne malheureusement pas la réalisation conjointe d'études évaluant la gêne des personnes exposées au bruit ou des effets sanitaires. Or des résultats en ce sens sont indispensables pour choisir les bons indicateurs et fixer les seuils ».
Toute évolution de la réglementation doit donc intégrer les limites des expérimentations menées jusqu'à présent. De surcroît, comme l'a rappelé IDFM aux rapporteurs, les infrastructures de transports en commun ferroviaires « viennent souvent en lieu et place d'une voie routière avec un effet souvent positif concernant le bruit, et d'autre part, le contexte urbain empêche la mise en oeuvre de protections à la source comme des écrans acoustiques ». Il est donc nécessaire de ne pas perdre de vue cet impact positif et vertueux sur le bruit total subi par les habitants : il serait paradoxal d'empêcher la réalisation d'un projet entraînant une baisse du bruit émis par les transports à cause du bruit qu'il émet.
Pour les rapporteurs, il est indispensable d'appliquer l'article 90 de la LOM, qui répond aux attentes légitimes des riverains, qui considèrent que les indicateurs actuellement utilisés ne reflètent qu'imparfaitement l'impact du bruit émis par les circulations ferroviaires. Compte tenu des obstacles techniques rencontrés lors des expérimentations menées, lancer au plus vite la phase 2 de l'expérimentation est nécessaire. Six ans après la promulgation de la LOM, la DGPR devrait fixer un calendrier ambitieux, pour mener les études scientifiques attendues le plus rapidement possible. Lancer sans plus tarder concomitamment des études épidémiologiques afin de déterminer les indicateurs les plus pertinents vis-à-vis des effets du bruit sur la santé est également essentiel.
Proposition n° 5 : Appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique.
L'Acnusa a par ailleurs indiqué aux rapporteurs avoir engagé en 2023 un partenariat avec le Conseil national du bruit pour définir un ou plusieurs indicateurs réglementaires événementiels, qui compléteraient les indicateurs existants applicables au transport aérien. Le Cerema a ainsi lancé la même année pour le compte de cette Autorité une étude technique sur ce sujet. L'Acnusa a précisé que « la commission mixte CNB/ACNUSA sera en mesure d'apporter en 2025, un avis conclusif relatif à la définition d'indicateur(s) événementiel(s) ». La DGAC a également déclaré aux rapporteurs que « ces nouveaux outils pourraient ainsi utilement compléter le panel des indicateurs réglementaires et permettre une prise en compte plus précise de ces facteurs lorsque cela s'avère justifié. Le cas échéant, cela devra se traduire par l'intégration dans le corpus réglementaire de cet indicateur ». Pour les rapporteurs, cette initiative bienvenue de l'Acnusa est de nature à répondre aux interrogations des riverains sur la pertinence des indicateurs actuellement utilisés.
2. Les sons de basses fréquences, les vibrations et le bruit solidien : un angle mort réglementaire
Le transport ferroviaire est également source d'émissions sonores spécifiques, liées aux émissions de sons de basse fréquence et de vibrations.
Les basses fréquences sonores sont moins bien perçues par l'oreille humaine, mais peuvent être sources d'une gêne spécifique, insuffisamment prise en compte par les indicateurs actuels. Selon SNCF Réseau, « Le bruit des TGV se caractérise par un contenu spectral riche en basses fréquences. Les indicateurs acoustiques employés dans la réglementation actuelle ne permettent pas une bonne représentation de ces caractéristiques. L'influence de ces paramètres sur la gêne sonore reste à étudier. » Le Cerema a jugé opportun d'approfondir les études sur ce sujet, avec pour objectif de créer un nouvel indicateur qui prenne en compte les basses fréquences sonores.
Le transport ferroviaire est aussi source de vibrations et de bruit solidien. Toutefois, il n'existe pas actuellement d'indicateur de référence de mesure des vibrations ni, a fortiori, de réglementation reposant sur des seuils à ne pas dépasser.
De telles réglementations sont en vigueur pour le transport ferroviaire dans certains pays européens, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Suisse et le Royaume-Uni40(*). En France, pour certains projets de transports publics notamment le Grand Paris Express et la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors, des objectifs à respecter ont été définis par les porteurs de projets. La RATP mène également des actions spécifiques pour diminuer les vibrations liées à l'exploitation du réseau de métro historique parisien, à travers le déploiement de solutions techniques ad hoc (meulage préventif, pose d'un tapis antivibratile lors du remplacement du ballast, pose de semelles en caoutchouc entre la traverse et le rail...). Selon le gestionnaire d'infrastructure, « ces traitements conduisent à une réduction des niveaux vibratoires de l'ordre de 5 à 10 dB au niveau du piédroit du tunnel ».
Ces spécificités ont été prises en compte par le législateur. L'article L. 571-10-3 du code de l'environnement, créé par l'article 91 de la LOM, prévoit que « les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure spécifique ». Il précise que « l'État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d'ici au 31 décembre 2020, les méthodes d'évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes ». Le Cerema pilote actuellement un groupe de travail afin de prendre en compte les vibrations lors des passages des trains.
Ces travaux ont notamment pour finalité de définir des indicateurs harmonisés. Or, comme le souligne la RATP, « la communauté scientifique a du mal à définir une norme de mesurage des vibrations et du bruit solidien dans les bâtiments aux abords des infrastructures de transport ferroviaire tant au niveau national, européen qu'international ».
Pour les rapporteurs, une meilleure prise en compte de l'ensemble des impacts sonores et vibratoires des infrastructures de transport est nécessaire afin de mieux protéger la santé de nos concitoyens. Ils regrettent que les travaux menés en application de l'article 91 de la LOM n'aient pas encore débouché sur la définition d'indicateurs, alors qu'ils sont déjà appliqués et mis en oeuvre chez certains de nos partenaires européens.
Proposition n° 6 : Mener au plus vite des études préalables à la définition d'indicateurs qui prennent en compte les vibrations, le bruit solidien et les basses fréquences sonores
C. UN ÉCART ENTRE LA RÈGLEMENTATION ET LES SEUILS DE RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE DÉFINIS PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
L'OMS a défini des seuils au-delà desquels l'exposition au bruit est nocive pour la santé. Elle utilise, pour réaliser les courbes dose-effet, les indicateurs énergétiques Lden et Lnight.
Pour le trafic routier, l'OMS, dans ses lignes directrices de 2018 relatives au bruit dans l'environnement pour la région Europe, recommande de réduire les niveaux sonores produits par le trafic routier à moins de 53 dB Lden, car un niveau sonore supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur la santé, et même à moins de 45 dB Lnight la nuit, car un niveau sonore nocturne supérieur à cette valeur est associé à des perturbations du sommeil. Pour le trafic ferroviaire, ces valeurs sont de 54 dB Lden, et de 44 dB Lnight. Pour le trafic aérien, les niveaux à ne pas dépasser sont de 45 dB Lden, et 40 dB Lnight.
Dans son rapport annuel 2023, l'AE s'est inquiétée d'un « écart préoccupant entre la réglementation nationale et le consensus scientifique ». Pour l'AE, en effet, « les niveaux de bruit constatés et les plafonds réglementaires sont très supérieurs aux valeurs au-delà desquelles des effets néfastes pour la santé humaine sont désormais amplement documentés dans le cadre d'un consensus scientifique international ». L'AE considère donc que « ces plafonds devraient être ramenés, selon des modalités et calendriers engageants, aux niveaux recommandés par l'OMS. Ces niveaux devraient être pris en compte (et non simplement identifiés) comme des objectifs à ne pas dépasser en matière d'incidences sur la santé humaine dans les évaluations environnementales ».
Cette préconisation est partagée par la Société française d'acoustique (SFA), qui a fait valoir auprès des rapporteurs la nécessité d'une mise à jour des recommandations de l'OMS qui « montrent que les valeurs réglementaires d'exposition en France doivent être révisées. Il faut mener les efforts pour tendre vers les valeurs d'exposition aux bruits des transports recommandés par l'OMS ».
Les rapporteurs partagent les inquiétudes de l'AE sur l'insuffisante prise en compte du bruit et de ses impacts sur la santé dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de transport.
Toutefois, l'application stricte des normes de l'OMS aux nouveaux projets d'infrastructures de transport est, pour le moment, difficilement envisageable. Elle pourrait paralyser la réalisation des projets indispensables pour assurer le report modal et le respect de nos engagements climatiques. En effet, comme le rappelle le Cerema, « ces seuils portent sur l'environnement sonore (et non pas sur le niveau sonore à l'intérieur d'une habitation). L'exposition au bruit est donc évaluée différemment. Cela engendre de très grandes variations dans les seuils, qui ne sont finalement pas comparables : le seuil de la réglementation française s'entend en complément de niveaux d'isolement phonique, notamment des logements, contrôlés fenêtres fermées, tandis que le seuil de l'OMS concerne le bruit perçu dans les espaces extérieurs ou intérieurs fenêtres ouvertes ».
Actuellement, le respect de la réglementation française peut en effet être atteint par des actions complémentaires de réduction du bruit à la source, de limitation de sa propagation et d'isolation des bâtiments. L'application des seuils de l'OMS, qui mesurent le bruit fenêtres ouvertes, exigerait donc de ne pas pouvoir utiliser l'isolation des bâtiments pour respecter la réglementation et de n'avoir recours qu'à des mesures de réduction du bruit à la source. Ainsi, selon le Cerema, « pour passer par exemple de 60 dB (A) pour le LAeq (22 h 00-6 h 00) en façade extérieure d'un logement avec fenêtre fermée, issu de la réglementation française, à 45 dB (A) qui est la valeur limite recommandée par l'OMS en extérieur, il faudrait diviser par 16 le trafic. On peut préciser que la perception auditive de l'oreille humaine n'évolue pas de manière linéaire, et que, pour que l'oreille humaine ait la sensation qu'il y a deux fois moins de bruit, il faut une baisse de 10 dB (A), ce qui revient à diviser le trafic par 10 ».
L'exemple du transport ferroviaire en Île-de-France est éclairant. Selon IDFM, en effet, « la part de la population concernée par un dépassement des seuils au sein de la zone dense francilienne passerait d'environ 0,4 % à environ 10 % ».
En outre, une évolution éventuelle de la réglementation ne peut être décidée sans intégrer les contraintes d'adaptation qui en résulteraient pour les gestionnaires d'infrastructures et leurs partenaires industriels. Ainsi, pour le transport ferroviaire, la FIF a mis en avant que « le cycle d'évolution actuel des réglementations pose des défis majeurs pour la filière industrielle. Le rythme soutenu des modifications réglementaires, notamment au travers de l'évolution rapide et continue des STI, rend la stabilité et la prévisibilité réglementaire difficiles. Cette situation engendre des coûts de conformité très élevés, qui pèsent sur les entreprises du secteur et limitent leur capacité à innover et à rester compétitives face à d'autres industries ». Pour les acteurs industriels, il est donc indispensable de trouver « un équilibre entre exigence sanitaire, acceptabilité sociale et soutenabilité économique, afin de garantir une évolution maîtrisée des normes tout en préservant la dynamique industrielle et le développement du transport ferroviaire ». Alstom a en outre indiqué aux rapporteurs que des limites techniques ont été atteintes pour le bruit émis par les trains à grande vitesse, et que les progrès à réaliser sont donc limités.
À la lumière de cet écart peu satisfaisant entre la réglementation française et les recommandations de l'OMS, la DGITM a chargé le Cerema d'une étude d'impact sur la prise en compte des seuils OMS dans les projets d'infrastructures de transport. Cette étude analyse notamment l'impact financier d'une telle évolution de la réglementation et les enjeux de faisabilité opérationnelle de son éventuelle application.
Les premiers résultats de ces travaux, menés sur quatre projets routiers, montrent qu'il n'est pas encore réaliste de transformer les recommandations de l'OMS en indicateurs réglementaires. Le Cerema a en effet indiqué aux rapporteurs que « les recommandations OMS impliqueraient une augmentation de la surface impactée d'un facteur entre 2 et 4 ». Par conséquent, « l'application des seuils OMS imposerait donc l'utilisation massive d'écrans acoustiques, dont la taille et le coût augmenteraient considérablement, sans toutefois garantir la protection de l'ensemble des bâtiments sensibles, la hauteur des murs n'étant pas infinie. Cette approche poserait donc des problèmes d'intégration paysagère et engendrerait des contraintes techniques et financières importantes ». Pour le Cerema, « compte tenu du surcoût engendré par la prise en compte systématique des seuils OMS, une réponse graduée pourrait être d'envisager ponctuellement le respect d'un seuil intermédiaire en priorité dans les zones où un nombre important de populations impactées ».
Pour les rapporteurs, ces résultats ne doivent pas pour autant justifier une inaction réglementaire. Si la définition immédiate de nouveaux seuils réglementaires au niveau des seuils OMS n'est pas techniquement envisageable à ce stade, cette étude d'impact pourrait mettre en lumière les évolutions possibles de la réglementation, selon deux orientations. D'une part, une diminution des seuils en vigueur pourrait être envisagée pour les nouveaux projets d'infrastructures si les conditions opérationnelles et financières sont réunies. D'autre part, une meilleure prise en compte du bruit de façade, fenêtres ouvertes, pourrait être étudiée. Comme l'a en effet indiqué BruitParif aux rapporteurs, le réchauffement climatique, de plus en plus source d'une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des épisodes caniculaires, devrait inciter la population à ouvrir les fenêtres de leurs habitations la nuit dans les grandes agglomérations.
L'une des possibilités envisageables pour abaisser au cas par cas les indicateurs applicables pourrait être de mieux distinguer les zones en fonction de l'ambiance sonore préexistante lors de la création d'une infrastructure nouvelle. À titre d'exemple, pour le transport ferroviaire, SNCF Réseau a indiqué aux rapporteurs que « les principales difficultés vis-à-vis de l'impact sur le cadre de vie des riverains concernent l'implantation d'une ligne nouvelle dans des secteurs particulièrement calmes ». Pour le gestionnaire d'infrastructure, il serait donc intéressant de définir une zone d'ambiance sonore préexistante très modérée, avec des objectifs de maîtrise du bruit plus stricts. Une expérimentation est d'ailleurs menée en ce sens depuis 202241(*). Sa généralisation pourrait ainsi être étudiée à court terme. Il pourrait également être envisagé d'introduire un seuil réglementaire applicable en soirée (18 h - 22 h), qui serait intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit, comme l'a suggéré Acoucité. Une expérimentation est aussi menée sur ce sujet depuis 2022.
Pour les rapporteurs, guidés par le légitime souci de garantir la sécurité juridique des projets en cours, ces nouvelles exigences ne pourraient s'appliquer qu'aux nouvelles infrastructures et aux modifications significatives des infrastructures existantes.
Proposition n° 7 : Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité
En complément :
- introduire des zones d'ambiance sonore très modérée avec des seuils de bruit plus exigeants à respecter pour les nouvelles infrastructures de transport ;
- introduire un seuil de bruit pour la soirée, intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit pour les nouvelles infrastructures de transport.
III. LES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION DES RISQUES NE S'APPUIENT PAS SUR DES LEVIERS EFFICACES POUR LUTTER CONTRE LE BRUIT
A. LES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE L'EXPOSITION À LA POLLUTION SONORE SOUFFRENT D'UN MANQUE DE PILOTAGE
1. Le bruit : une pollution traitée par plusieurs administrations insuffisamment coordonnées
L'exposition des populations au bruit émis par les transports est un enjeu qui fait intervenir une dizaine d'administrations centrales et opérateurs de l'État ainsi qu'une autorité administrative indépendante.
La direction générale de la prévention des risques (DGPR), responsable de la politique de lutte contre le bruit, définit les actions de prévention et de limitation de la pollution sonore. Au sein de cette direction, cette fonction est assurée par la mission du bruit et des agents physiques.
Plusieurs autres administrations sont concernées.
· La DGAC est compétente sur les enjeux de bruit aérien, notamment pour la mise en oeuvre des PEB et des PGS, ainsi que des PPBE aéroportuaires. Elle vient en appui aux préfets compétents pour réaliser les études d'impact selon l'approche équilibrée (EIAE). L'Acnusa, autorité administrative indépendante, est chargée de sanctionner le non-respect des restrictions d'exploitation sur les plus grands aéroports français.
· La DGITM a pour mission de veiller à ce que les infrastructures de transport terrestre majeures aient la capacité de supporter des services de transport dans des conditions optimales de fluidité, de sécurité et d'efficacité. Au-delà des missions de supervision, elle intervient dans la lutte contre le bruit généré sur le réseau routier national non concédé. Comme elle l'a indiqué aux rapporteurs, s'agissant des opérations d'aménagement (construction de nouvelles routes, élargissements, etc.), elle apporte un appui aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), maîtres d'ouvrage déconcentrés, dans la prise en compte des enjeux environnementaux, dont le bruit, pour les projets les plus structurants ou les plus complexes. Elle participe également au traitement des points noirs de bruit sur le réseau national concédé en partenariat avec les concessionnaires et non concédé en partenariat avec les régions dans le cadre des CPER. La DGITM intervient également dans la lutte contre les PNB ferroviaires sur le réseau existant.
· La direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) est compétente en matière de réglementation technique véhicules.
· La délégation à la sécurité routière (DSR) du ministère de l'intérieur est compétente en matière de sécurité routière.
· La direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) est compétente en matière de respect des règles d'insonorisation des logements.
Si la direction générale de la santé (DGS) a un rôle en matière de bruit de voisinage, elle n'est pas impliquée dans les politiques de lutte contre la pollution sonore liée aux transports. Le ministère de la santé a ainsi déclaré aux rapporteurs que « les projets concernant les transports ne sont pas soumis au ministère chargé de la santé par les ministères qui portent les projets d'infrastructures ».
Parmi les opérateurs de l'État, deux ont des compétences en matière de bruit :
- En application de l'article L. 131-3 du code de l'environnement, l'Ademe exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans le domaine de la lutte contre les nuisances sonores. Toutefois, elle a indiqué aux rapporteurs qu'elle « ne travaille plus sur les sujets de nuisances sonores liées aux transports ».
- Le Cerema est le relais technique de l'action publique de l'État en matière de pollution sonore liée aux transports. Il accompagne les directions de l'administration centrale dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Il calcule les cartes de bruit stratégique pour les grandes infrastructures de transport terrestre (53 000 km de voies routières et 6 000 km de voies ferroviaires), et réalise le rapportage des cartes produites par l'ensemble des acteurs concernés par la directive européenne de 2002 sur le bruit (43 agglomérations, sociétés concessionnaires d'autoroutes). Il effectue également ce travail pour le compte de différentes métropoles françaises. Il établit des classements sonores des infrastructures de transports terrestres sur sollicitation des directions départementales des territoires (DDT) et des collectivités. Il pilote les groupes de travail portant sur les expérimentations de construction d'indicateurs prenant en compte les pics sonores et des problématiques vibratoires lors des passages de train.
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) est une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir de sanction relatif au respect de la réglementation sonore par les aéronefs effectuant un mouvement sur l'un des 11 principaux aéroports français ou l'un des 4 aérodromes dont l'exploitation est restreinte pour des raisons environnementales par arrêtés ministériels.
Elle a aussi un rôle consultatif : elle rend des avis sur les plans et programmes d'actions traitant des nuisances aéroportuaires sur et autour des principaux aéroports français, les projets de modification de la circulation aérienne et les projets de textes réglementaires visant à assurer la protection de l'environnement des aérodromes.
Pour les rapporteurs, le pouvoir de sanction reconnu à l'Acnusa afin d'assurer le respect de la réglementation sonore aux abords des aéroports est stratégique pour lutter contre le bruit. Il pourrait donc être opportun d'étudier la possibilité d'envisager son renforcement pour permettre à cette autorité de s'imposer comme un véritable « gendarme du bruit des transports ».
Le Conseil national du bruit (CNB) :
une
instance consultative sans rôle stratégique
Créé en 1982, Conseil national du bruit est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de l'environnement dont le secrétariat est assuré par la DGPR. Il comprend quarante-huit membres, dont des représentants des différentes administrations centrales et déconcentrées concernées, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des partenaires sociaux, des organisations professionnelles, des entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes, des représentants d'associations oeuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore, ainsi qu'un représentant des observatoires du bruit en agglomération, et dix personnalités qualifiées.
Le CNB est saisi pour avis des textes réglementaires relatifs au bruit. Il peut également être saisi pour avis par le ministre chargé de l'environnement de toute question concernant la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
À l'échelle nationale, les moyens humains qui sont alloués à la mission bruit et agents physiques de la DGPR sont modestes, trois agents en équivalent temps plein. Eu égard à la diversité des missions, à la technicité des enjeux, et au nombre d'acteurs en présence, cet organe ne semble pas suffisamment étoffé pour s'acquitter de sa mission stratégique de pilotage dans de bonnes conditions. Redéployer des moyens humains au profit de cette mission afin qu'elle puisse jouer son rôle de pilotage serait judicieux. Elle pourrait ainsi définir les orientations stratégiques de l'action des autres administrations concernées, valider les plans d'actions qu'elles définiraient et assurer un suivi des résultats de cette politique publique. Dans la mesure où l'Ademe a indiqué aux rapporteurs ne plus assurer de missions au titre de sa compétence de lutte contre les nuisances sonores, un gisement potentiel de moyens existe donc. Le rôle trop limité de la DGS à l'échelle nationale et des Agences régionales de santé (ARS) dans les territoires est également à revoir, la pollution sonore étant un enjeu de santé publique majeur.
Proposition n° 8 : Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit.
Lutte contre le bruit : les ménages, principaux contributeurs financiers
Selon le ministère de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, en 2021, les dépenses allouées à la lutte contre le bruit représentent 2,4 milliards d'euros. L'isolation acoustique des bâtiments représente l'essentiel des dépenses dédiées à la gestion du bruit. Les ménages contribuent de manière prépondérante au financement de ces dépenses (76 %) suivies par les entreprises (17 %), et les administrations publiques (7 %).
2,3 Md€ ont été alloués à la construction de dispositifs de protection, notamment dans le secteur du bâtiment (achat de fenêtres à isolation acoustique renforcée dans les logements neufs et existants). Ces actions visent à protéger principalement les logements contre le bruit extérieur, y compris celui provoqué par les transports.
Les dépenses allouées à la mise en oeuvre de dispositifs de prévention visant à réduire le bruit à la source représentent 68 M€ en 2021. Elles concernent notamment le remplacement des silencieux des véhicules légers et des deux-roues ou la mise en place de revêtements silencieux sur les voies urbaines et périurbaines.
Les opérations de surveillance, de mesure et de contrôle du bruit, comme les réseaux de mesure du bruit des aéroports, représentent une part marginale des dépenses (1 %).
À long terme, les dépenses allouées à la lutte contre le bruit augmentent en moyenne de 2,9 % chaque année, et de 1,5 % par an hors inflation. Cependant, après une période de forte augmentation entre 2004 et 2008 (+ 15,6 % par an en moyenne), imputable notamment aux mesures engagées pour réduire les points noirs du bruit (PNB) et à la mise en oeuvre des plans de prévention du bruit, le montant de ces dépenses s'est stabilisé autour de 2 Md€ jusqu'en 2018. La crise sanitaire a entraîné un recul des dépenses en 2020 avant qu'elles ne repartent à la hausse en 2021.
Source : Ministère de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, données et études statistiques Pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports « La dépense de lutte contre le bruit en 2021 ».
2. La région : un échelon adapté pour mener les politiques de bruit dans les territoires
À l'échelle des territoires, la gouvernance des enjeux liés au bruit est également complexe.
Dans le cadre du bruit routier et ferroviaire, l'organisation territoriale des services de l'État est fixée par la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'Observatoire du bruit des transports terrestres - Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres qui prévoit la mise en place d'un observatoire du bruit des transports terrestres aux niveaux départemental, régional et national et la résorption des points noirs du bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux.
Cette circulaire prévoit un comité de pilotage départemental fédérant l'ensemble des acteurs concernés par la lutte contre le bruit des transports terrestres ayant notamment vocation à inciter l'ensemble des gestionnaires à agir, y compris les collectivités. Elle précise en particulier que le préfet de département propose au préfet de région, chaque année, une liste hiérarchisée des opérations des points noirs du bruit des réseaux routiers et ferroviaires qui lui paraissent devoir être engagées rapidement.
Selon la DGPR, de nombreux départements ont conservé de tels observatoires, animés par les services des DDT. Il s'agit d'instances de concertation et de coordination des acteurs disposant de compétences en matière de bruit à l'échelle locale. En outre, on compte deux grands observatoires régionaux Bruitparif (l'observatoire du bruit en Île-de-France) et Acoucité (l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon, qui accompagne de nombreuses agglomérations sur l'ensemble du territoire français).
La lutte contre le bruit mobilise des connaissances scientifiques et juridiques de haut niveau d'expertise. À cet égard, la DGPR a souligné que « La dispersion des compétences (au sein de l'État mais aussi des collectivités) pose également la question du maintien des compétences au sens métier du terme : la compétence bruit ne représente parfois que quelques dixièmes d'ETP au sein d'une structure, avec des enjeux forts en matière de formation et de maintien des compétences métiers critiques ».
Les collectivités territoriales ont également des obligations relatives à la lutte contre le bruit, notamment dans le cadre des infrastructures de transport qu'elles réalisent ainsi que dans la rédaction des PPBE. Le Cerema a d'ailleurs souligné aux rapporteurs que « en collectivités, les pilotes d'opérations et instructeurs d'autorisations d'urbanisme manquent de ressources pour la prise en compte du bruit dans leurs projets, à la fois par un manque de temps de leurs équipes, et par un manque de données simples d'utilisation et actionnables ». Elles ont donc fréquemment recours à une expertise extériorisée coûteuse pour remplir leurs obligations.
Pour les rapporteurs, regrouper les moyens humains de l'État dans les services déconcentrés à l'échelle régionale est donc pertinent, afin d'éviter un émiettement des compétences, source de perte d'efficacité de son action. Comme l'a d'ailleurs souligné BruitParif, « l'échelon régional apparaît bien adapté pour permettre la mutualisation de moyens techniques et faire des économies d'échelle ». Cette nouvelle organisation pourrait aussi faciliter les échanges avec les agences régionales de santé (ARS) sur la question des enjeux sanitaires posés par le bruit.
En particulier, les observatoires du bruit pourraient être organisés à l'échelle régionale, plutôt que départementale. Les rapporteurs jugent opportun de généraliser les observatoires comme BruitParif et Acoucité. Ce modèle, qui implique l'État, les collectivités territoriales, les acteurs des activités bruyantes et des associations de riverains permettrait de mettre en commun les compétences entre les départements, mais également entre l'État et les collectivités territoriales. Une collaboration entre observatoires régionaux pour mutualiser les coûts serait également pertinente. Dans certains cas, afin d'assurer une maîtrise efficace des coûts, ces observatoires pourraient être créés au sein des Associations Agréées Surveillance Qualité de l'Air (AASQA). Ces observatoires régionaux fourniraient un appui technique aux collectivités qui auraient ainsi moins besoin d'avoir recours à une expertise externe.
Ces observatoires sont également un moyen pertinent d'impliquer de façon participative les habitants, représentés au sein de leur gouvernance, dans les politiques relatives au bruit. Or, comme l'ont souligné les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel entendus « des recherches participatives sur le bruit montrent l'intérêt d'une meilleure implication des habitants dans les processus décisionnels. ».
Ils pourraient ainsi devenir les points de contact de référence sur le bruit avec le Cerema, qui pourrait apporter également un appui technique et scientifique aux collectivités territoriales. Ce dernier a ainsi créé l'outil Diagbruit afin de « développer et diffuser une expertise acoustique vulgarisée auprès des instructeurs d'autorisations d'urbanisme, leur permettant de guider efficacement les porteurs de projets dans l'intégration de critères acoustiques dès la conception de leurs projets ».
Proposition n° 9 : Regrouper les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit à l'échelle régionale et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit afin de renforcer et mutualiser les compétences territoriales.
B. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS LIMITÉS ET MAL MESURÉS
1. L'échec de la lutte contre les points noirs de bruit
Les points noirs de bruit (PNB) ont fait l'objet depuis une quarantaine d'années d'une série de plans successifs devant assurer leur résorption, qui sont in fine, un échec.
Le premier plan de résorption des points noirs de bruit a été lancé en 1984. Le rapport La résorption des Points Noirs du bruit routier et ferroviaire, rédigé en 1998 par Claude Lamure, réalisé sur la demande de la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement d'alors, Dominique Voynet, dresse un bilan contrasté des progrès réalisés depuis cette date. Il souligne en particulier le manque de fiabilité des bases de données relatives aux points noirs de bruit et la nécessité d'augmenter les investissements pour les résorber. Ce constat a fait réagir le Gouvernement qui s'est fixé, en 1999, l'objectif de résoudre les situations critiques en dix ans.
La circulaire du 12 juin 2001 relative à l'Observatoire du bruit des transports terrestres - Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres assure la déclinaison territoriale de cette ambition. Ce texte, encore d'actualité, définit l'organisation locale de l'action de l'État pour résorber les PNB.
La circulaire confie aux observatoires du bruit, placés sous l'égide du préfet, la mission de recenser les zones de bruit critique de toutes les infrastructures des réseaux de transports terrestres. En revanche, la détermination exacte des points noirs devant faire l'objet d'actions de résorption ne concerne que les réseaux routier et ferroviaire nationaux. Ce programme de résorption devait porter sur 200 000 logements et s'échelonner sur une durée d'au moins dix ans. Des financements à hauteur d'environ 350 millions de francs par an étaient alors prévus.
Ensuite, un nouveau plan bruit de l'ADEME a été lancé en 2009, après le Grenelle de l'Environnement, qui visait une résorption des points les plus préoccupants dans un délai maximal de sept ans. Ainsi, sur la période 2009-2015, 28,45 M€ ont été rattachés au Programme 181 (Prévention des risques) piloté par la DGPR pour la résorption des PNB. Ces crédits ont permis de financer plus de 700 opérations sur la période (soit un montant moyen d'environ 40 000 € par opération).
Les sociétés concessionnaires d'autoroute ont également mené des actions sur le réseau concédé. Selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) « les PNB le long des réseaux concédés sont ainsi globalement résorbés ou en voie de l'être ».
Actuellement, la résorption des PNB ne fait plus l'objet d'une enveloppe budgétaire spécifique. Elle est englobée dans les crédits consacrés à la modernisation du réseau routier, ce qui conduit à amoindrir les actions de lutte contre les points noirs.
D'après les informations communiquées par la DGITM aux rapporteurs, pour ce qui concerne le réseau national concédé antérieur à la loi bruit de 1992, la DGITM s'est appuyée depuis le début des années 2000 sur les concessionnaires autoroutiers pour l'ensemble des points noirs bruit. Fin 2025, la quasi-totalité des points noirs du bruit aura été résorbée. S'agissant du réseau non concédé, les CPER 2015-2020 ont déployé un financement total de 104 M€ (dont 78 M€ de part État), dédié au traitement des nuisances sonores le long des routes existantes essentiellement par écrans phoniques. Des financements à hauteur de 7,2 M€ ont été mis en place sur la période 2023-2024, dont une participation de l'État de 6,5 M€, pour traiter la résorption des PNB par écrans phoniques et par isolations de façades sur le réseau national non concédé.
S'agissant du réseau national non concédé, il y a donc une diminution des moyens consacrés à la résorption des PNB ces dernières années. Cette baisse progressive des crédits consacrés à la résorption des PNB explique l'échec des politiques en la matière. Dès 2017, le CGEDD soulignait que cette politique était dans une impasse. Il estimait à 53 000 le nombre de bâtiments (et à 62 000 le nombre de logements) pouvant être considérés comme des points noirs de bruit ferroviaires, SNCF Réseau n'en ayant traité alors que 2 200. Quant au bruit routier, le CGEDD mettait en avant que « le Cerema estime à 850 000 le nombre de logements situés dans des points noirs de bruit routier. Sur la base d'un coût de traitement unitaire par logement de 7 000 €, le coût de résorption des points noirs de bruit serait de l'ordre de 6 Md€, soit 6 fois plus que l'estimation produite en 2008. La différence provient clairement de la prise en compte toute récente des points noirs des réseaux “historiques” des collectivités territoriales ». Par comparaison, « le plan bruit de l'Ademe mené entre 2009 et 2015 a mobilisé environ 90 M€ pour le traitement des points noirs de bruit routiers et a permis de protéger 3 324 logements (par mur anti-bruit ou par isolation de façade) ». Ainsi, le nombre de points noirs de bruit liés aux transports terrestres serait d'environ 900 000. Le rythme de traitement de ces derniers est sans commune mesure avec leur nombre.
Cette évaluation d'ensemble ne correspond cependant pas à une identification individuelle de la totalité des PNB. Comme l'a indiqué le Cerema aux rapporteurs, « il n'existe pas de base de données ou de cartographies à jour identifiant l'ensemble des points noirs de bruit à l'échelle nationale ». Une telle persistance du caractère lacunaire des bases de données, qui était déjà pointée par le rapport Lamure de 1998, rend difficile la mise en oeuvre d'une politique de résorption des points noirs. Elle a d'ailleurs mené à une large sous-estimation du nombre de PNB routiers, liée à la non-prise en compte de certains réseaux des collectivités territoriales, pointée par le CGEDD dans son rapport de 2017.
Les PNB ferroviaires ont également bénéficié d'un plan de 172 millions d'euros lancé en 2020, dont 120 millions d'euros de crédits du plan de relance issus de la cession d'actifs du groupe SNCF, mais également des crédits de l'AFITF et des collectivités territoriales.
Pour les rapporteurs, réaliser une cartographie nationale des points noirs de bruit est impératif. Ce travail pourrait être piloté par les observatoires de bruit régionaux avec l'appui technique du Cerema.
Carte du recensement des PNB ferroviaires
Source : SNCF Réseau
Le recensement des PNB ne peut cependant pas être décorrélé de leur traitement. Pour les rapporteurs, lancer ensuite un plan de résorption des PNB piloté par l'État, bénéficiant de crédits ad hoc identifiés dans les annexes du projet de loi de finances est nécessaire. Ce plan reposerait sur le traitement prioritaire des points de bruit les plus exposés, notamment ceux qui ont l'impact sanitaire le plus fort et qui sont touchés par un cumul de pollution sonore provenant de différents modes de transports.
Ce plan doit en particulier garantir une meilleure prise en charge des travaux par les riverains.
En application de l'article D. 571-56 du code de l'environnement, pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
En revanche, pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant de la subvention est fixé à 80 % du montant des travaux. Un taux dérogatoire de 90 % est applicable pour les personnes à faible revenu42(*). L'aide représente 100 % du montant des travaux pour les personnes bénéficiaires de certains minimas sociaux.
Les plafonds des aides d'insonorisation peuvent également engendrer une augmentation du reste à charge. Ils n'avaient d'ailleurs pas été revus entre 2002 et 2024, en dépit de l'inflation constatée sur cette période43(*).
Ce reste à charge peut amener certains riverains à renoncer à des travaux qu'ils ne peuvent financer. Il constitue en outre une entorse au principe « pollueur-payeur » en vertu duquel il revient à l'émetteur d'une pollution d'assumer le coût de son traitement.
Par conséquent, les rapporteurs recommandent de porter à 95 % le niveau de prise en charge par l'État des travaux d'insonorisation de leur résidence en cas de résorption d'un PNB.
Proposition n° 10 : Lancer un plan de résorption des PNB, reposant sur une cartographie préalable des points noirs de bruit, des financements budgétaires ad hoc et une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation.
2. De nécessaires actions transverses de lutte contre le bruit
Au-delà de la réponse urgente à apporter aux points noirs de bruit, déployer des mesures transverses permettant de diminuer la pollution sonore liée aux transports est indispensable.
a) Développer la recherche française en acoustique
Afin de mener des politiques efficaces, une connaissance technique et scientifique fine des enjeux rencontrés est nécessaire. C'est particulièrement le cas pour l'exposition au bruit des populations, dont l'ensemble des acteurs entendus ont souligné la complexité. La nécessité de mener des projets de recherche sur le bruit est notamment apparue concernant la fiabilité technique des indicateurs événementiels et leur degré de corrélation avec les effets du bruit sur la santé. Selon la Société française d'acoustique (SFA), « la recherche dans le domaine des nuisances sonores est moins développée en France que dans d'autres pays européens, avec trop peu d'appels à projets spécifiques sur le bruit, comme l'illustrent, par exemple, les rapports de l'OMS, avec un faible nombre d'études françaises, par rapport aux contributions d'autres pays européens. Le groupe de travail sur le Bruit, du Grenelle de l'environnement, avait pointé les domaines de recherche pour lesquels des connaissances devaient être générées. Ce rapport datant de 2007 reste d'actualité car il faut en effet poursuivre les efforts et moyens associés sur ces questions ». La SFA a également indiqué aux rapporteurs que l'absence d'enquêtes socio-acoustiques régulières en France rendait impossible un suivi de l'évolution de l'exposition des populations à la pollution sonore et de l'impact sur la santé du bruit.
Proposition n° 11 : Augmenter le nombre d'appels à projets scientifiques sur la pollution sonore afin de porter la recherche française au niveau de ses principaux voisins européens.
b) Mieux lier isolation thermique et acoustique des bâtiments
Les études scientifiques peuvent notamment permettre des gains d'efficience des politiques publiques. C'est en particulier le cas des enjeux de rénovation thermique et acoustique des bâtiments.
Dans un avis du 5 octobre 2020, le Conseil national du bruit (CNB) a souligné la pertinence de la prise en compte du volet acoustique dans les opérations de rénovation énergétique des bâtiments et de rénovation urbaine. Selon le CNB, « au niveau du bâti, ces aspects sont étroitement liés : les actions visant économies d'énergie, isolement acoustique et ventilation peuvent être convergentes, ou au contraire se contrarier l'une l'autre ». Une meilleure prise en compte de ces deux aspects peut favoriser le choix de techniques d'isolation possédant des co-bénéfices thermiques et acoustiques.
Des travaux sont actuellement menés pour étudier les synergies entre rénovation thermique et acoustique. La DGPR a mis en avant avoir financé l'élaboration d'un guide par le Centre scientifique et technique des bâtiments (CSTB), qui recense notamment les solutions de rénovation thermique et acoustique permettant d'obtenir les meilleurs bénéfices couplés ainsi que les surcoûts de rénovations thermique et acoustique réalisées de façon concomitante. Selon la DGPR, ils peuvent représenter 30 % à 50 % du coût initial d'une rénovation thermique simple, mais ils peuvent être partiellement compensés, notamment par une valorisation accrue du bien44(*). En outre, ils sont moins élevés que le coût cumulé de deux rénovations thermique et acoustique distinctes : une démarche globale permet une optimisation des coûts. Pour la DGPR, « ces surcoûts interrogent dans la mesure où, pour les dispositifs de rénovation (acoustique ou thermique) existants, les restes à charge sont déjà un frein conséquent pour les propriétaires qui souhaitent s'engager dans une démarche de rénovation ».
En application de l'article R. 154-4 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale ou de travaux de rénovation importants et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport sont tenus à certaines obligations de performance acoustique45(*). En effet, si les travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur, la réfection d'une toiture, ou l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ces différents équipements doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
Les rapporteurs s'interrogent sur la bonne application de ce texte compte tenu de l'absence d'identification de très nombreux PNB sur le territoire. Comme l'a souligné la fédération française du bâtiment (FFB), « concernant le couplage rénovation thermique/acoustique, il existe déjà un arrêté de 2017 visant les rénovations dans les points noirs de bruit : l'arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants. Toutefois, nous n'avons pas de retours d'expérience sur l'application de ce texte, sachant que les zones de points noirs de bruits considérées sont difficiles à identifier, notamment les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l'appellation cartes “c” ».
La DHUP a indiqué aux rapporteurs que des contrôles relatifs au respect de la réglementation acoustique sont organisés, y compris pour ce qui concerne l'isolement acoustique nécessaire par rapport aux infrastructures de transport terrestre et ferroviaire, ainsi que les aérodromes. L'administration vérifie notamment l'obligation de production par les maîtres d'ouvrage d'une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. Les équipes chargées du contrôle du respect des règles de construction (CRC) dans les DDT-M mènent des contrôles ponctuels réalisés dans les 6 ans suivant le dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, pour les constructions de bâtiments neufs. Selon la DHUP, ce contrôle devrait s'étendre à terme à la rénovation des bâtiments existants. Ainsi, « à ce stade, les contrôles du respect de la réglementation acoustique après rénovation sont très limités (uniquement à travers les attestations de respect de la réglementation dans le cas où les bâtiments d'habitation font l'objet de travaux de mise en accessibilité), sauf dans le cas où le projet bénéficie d'une aide de l'État (exemple du bonus de prêt prévu dans le cadre de l'éco-prêt logement social avec la CDC) ». Ces missions exigent toutefois des moyens humains non négligeables. Or, la DHUP, ne compte actuellement environ que 70 ETPT au niveau national, pour l'ensemble des missions de contrôle.
La réglementation des travaux d'isolation complexe gagnerait à être simplifiée et harmonisée. La FFB a ainsi mis en avant l'existence de « divergences entre réglementation thermique et réglementation acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs. Dans la réglementation acoustique, au-delà d'une distance de 300 mètres, on considère qu'une voie de catégorie 1 (catégorie la plus bruyante) n'a plus d'impact. Dans la réglementation thermique, le classement au bruit des baies est fait de façon à identifier les bâtiments nécessitant la mise en place d'une climatisation, considérant que celle-ci est nécessaire dès lors que le bruit est trop important pour ouvrir les fenêtres. Ici, la réglementation considère que, au-delà d'une distance de 700 mètres, les voies de catégorie 1 n'ont plus d'impact ».
De surcroît, cette réglementation est jugée insuffisamment incitative par certains acteurs interrogés par les rapporteurs, comme la SFA qui regrette qu'il n'y ait pas d'« obligation d'améliorer l'acoustique lors de travaux de rénovation thermique dans les bâtiments anciens que ce soit vis-à-vis de l'isolation phonique ou l'isolation au bruit d'impact ».
Le CNB a proposé dans son avis précité d'accroître les exigences en la matière en définissant « des exigences acoustiques pour toute opération de rénovation, qu'elle soit en zone bruyante ou pas, avec des seuils variables en fonction de l'importance des travaux de rénovation ». Le Cinov Giac partage cette recommandation, et a indiqué aux rapporteurs qu'il « serait financièrement et socialement très intéressant de lier à tout chantier d'isolation thermique une amélioration ou a minima une non-dégradation de la situation acoustique ». Les rapporteurs partagent ce constat et considèrent que les synergies éventuelles entre les travaux d'isolation thermique et acoustique doivent être mieux exploitées. Il serait donc pertinent d'introduire un principe de « non-régression » de la performance acoustique des bâtiments en cas de rénovation thermique. Une obligation d'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments pourrait en revanche être disproportionnée et contraindre à réaliser des travaux non nécessaires compte tenu de l'ambiance sonore de la zone du bâtiment.
Concernant spécifiquement les travaux de rénovation thermique bénéficiant d'aides publiques, comme « Ma Prime Revov' », il pourrait être opportun de prévoir un volet thermique intégré afin d'obtenir des effets bénéfiques simultanés. Une augmentation du plafond de l'aide, éventuellement majorée si le logement se trouve à proximité d'une infrastructure bruyante, pourrait être envisagée.
Les travaux de rénovation urbaine pourraient aussi être un vecteur de diminution de l'exposition des populations à la pollution sonore. Les quartiers les plus défavorisés sont en effet fréquemment ceux qui sont les plus sujets à une exposition excessive au bruit. Le rapport Lamure de 1998 mettait déjà en avant une corrélation positive entre faible niveau de vie et exposition au bruit. L'ANRU, au titre de ses missions de rénovation urbaine, notamment en matière de quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), pourrait prévoir un volet acoustique systématique dans les opérations de rénovation urbaine qu'elle contribue à financer.
Proposition n° 12 : Mieux articuler rénovation thermique et acoustique des bâtiments en :
- prévoyant un principe de « non-régression acoustique » des bâtiments en cas de rénovation d'ampleur ;
- majorant le plafond des aides publiques de rénovation thermique en cas de rénovation acoustique simultanée.
c) Améliorer l'information des acheteurs d'un bien immobilier sur l'environnement sonore de leur bien
Mieux informer les acheteurs ou les locataires d'un bien immobilier de l'environnement sonore de leur bien est également nécessaire. Aujourd'hui, seule la situation du bien au regard des PGS des aéroports est mentionnée dans les documents notariés. Ce déficit d'information pour le bruit ferroviaire et routier par rapport au bruit aérien pourrait être comblé en mentionnant la présence de routes et de lignes de chemin de fer entrant dans les classements sonores des voies à proximité du logement. Le travail d'identification des points noirs de bruit pourrait également être utilisé afin d'indiquer systématiquement, le cas échéant, si le bien est situé dans un PNB. Des travaux de rénovation étant le plus fréquemment menés au moment d'un achat immobilier, cette meilleure information des acheteurs leur permettrait de mieux prendre en compte cet enjeu dans leur projet immobilier.
Prévoir cette information est, pour les rapporteurs, préférable à l'institution d'un diagnostic bruit obligatoire, sur le modèle de diagnostic de performance énergétique, compte tenu des coûts supplémentaires que ce diagnostic engendrerait. En revanche, il pourrait être pertinent que la DGPR définisse un cadre réglementaire identifiant une méthode certifiée d'établissement des diagnostics bruit, afin que les acheteurs ou vendeurs qui le souhaitent puissent avoir accès à une information standardisée et fiable.
Proposition n° 13 : Promouvoir l'information sur les niveaux sonores auxquels est exposé un bien immobilier à l'occasion de sa location ou sa cession.
3. Accentuer la lutte contre le bruit routier, première source d'exposition aux nuisances sonores
Force est de constater que le transport routier est aujourd'hui le principal émetteur de bruits : le bruit routier est omniprésent, sur la quasi-totalité du territoire et se caractérise à certains endroits par des pics de bruits particulièrement élevés.
Les rapporteurs ont également souligné que l'intensité acoustique des poids lourds, des deux roues motorisées et des supercars, sont un point de vigilance renforcé, dans la mesure où ils sont responsables de fortes nuisances. Un répondant au sondage CSA réalisé pour le compte de la commission a ainsi déclaré que « Les nuisances sont dues à des deux-roues aux pots d'échappement non conformes ainsi qu'à leur vitesse inadaptée. Et surtout à l'absence de contrôle des forces de l'ordre ».
Dans le cadre de leurs travaux, ils se sont déplacés au laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) en avril 2025, afin de découvrir une innovation porteuse d'espérances en matière de lutte contre les nuisances sonores : les radars sonores, qui permettent, outre la caractérisation des niveaux sonores en temps réel, de déterminer avec précision l'origine du bruit routier et d'apporter ainsi la preuve de la source de la pollution.
Ce dispositif a été expérimenté en 2022 sur huit sites au sein de sept collectivités sélectionnées46(*). Les résultats de cette phase expérimentale sont concluants :
- En plein coeur de la ville, dans le 20e arrondissement de Paris, près de 166 véhicules par jour dépassent le seuil de 83 dB, bien au-delà de la réglementation établie avec des pics à plus de 90 dB pour 8 véhicules en moyenne par jour. Les deux roues motorisées et les véhicules lourds sont les plus représentés parmi les véhicules identifiés par le radar sonore.
- Au sein de la vallée de Chevreuse, dans une zone plus résidentielle et calme, c'est près de 34 véhicules qui dépassent les seuils sonores de 83 dB chaque jour. Les véhicules deux-roues motorisés sont à nouveau surreprésentés.
|
Le radar sonore « Hydre » conçu par BruitParif |
|
|
Source : Bruitparif |
|
Pour la DGPR, Bruitparif, Acoucité et les principales associations concernées par la politique publique de lutte contre les nuisances sonores, l'extension de ce dispositif à l'ensemble du territoire serait une piste intéressante de lutte contre le bruit lié au transport routier.
Les rapporteurs ont toutefois conscience que la généralisation de ce dispositif pourrait faire l'objet d'une contestation de la part des automobilistes, notamment des usagers des deux-roues motorisés - qui seront plus directement affectés par le déploiement des radars sonores. Ils appellent donc les pouvoirs publics à faire preuve, dans un premier temps, de pédagogie avec les conducteurs concernés. Les seuils sonores utilisés par ces radars sonores devront être définis afin de cibler les véhicules excessivement bruyants conduits de manière sportive, responsables de pics de bruit. La fin de l'expérimentation permettra de dresser un bilan utile à l'élargissement des radars sonores.
Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles a fixé l'expérimentation a deux ans. Elle arrive donc à son terme. Le seuil sonore retenu au-delà duquel le conducteur pourra être verbalisé a été fixé à 85dB en dynamique.
Si les résultats se révèlent concluants, les rapporteurs appellent à déployer cet outil sur l'ensemble du territoire. La DGPR a néanmoins appelé l'attention des rapporteurs sur une difficulté de déploiement rapide des radars sonores. Saisi pour avis sur le décret précisant les contours de l'expérimentation de l'utilisation des radars sonores, le Conseil d'État a considéré qu'il était nécessaire d'adapter l'article L. 130-9 du code de la route prévoyant l'expérimentation du dispositif.
Proposition n° 14 : Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée.
L'article R. 318-3 du code de la route prévoit que « les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains », sous peine de verbalisation forfaitaire de 68 €. Les niveaux sonores des véhicules circulant dans une agglomération doivent demeurer inférieurs à ceux fixés par le ministre chargé de l'environnement, reportés sur la carte grise.
Les valeurs inscrites sur la carte grise permettent aux autorités de police chargées du contrôle routier de verbaliser l'automobiliste responsable d'une nuisance sonore engendrée par un véhicule excessivement bruyant47(*). À cet égard, elles se fondent sur les références seuils inscrites sur ce document, qui tiennent compte à la fois de la nature du véhicule, notamment du cylindrage, et de la valeur limite sonore à ne pas dépasser fixée par un arrêté ministériel.
Force est toutefois de constater que la verbalisation des conducteurs ne tient qu'imparfaitement compte des moteurs gros cylindres48(*) en raison de la méthode de quantification du bruit utilisée lors de l'immatriculation du véhicule. Ainsi que l'indiquait Bruitparif aux rapporteurs, les valeurs à l'arrêt servant à l'immatriculation des véhicules peuvent permettre à des engins de dépasser « allègrement les 80-85 dB (A) voire même les 100 dB (A) pour certains modèles de motos de grosses cylindrées et de voitures sportives ».
En outre, la marge de tolérance appliquée par les autorités de contrôle est supérieure de 5 décibels. En conséquence, certains véhicules, notamment ceux qui roulent à un régime moteur élevé, peuvent en toute légalité dépasser les seuils réglementaires.
Les rapporteurs considèrent que cette situation n'est pas satisfaisante et qu'il serait opportun de rapprocher les valeurs inscrites sur la carte grise, sur la base desquelles sont dressées pour les contraventions, des référentiels, plus contraignants, utilisés pour l'homologation de mise sur le marché d'un véhicule. En effet, les seuils d'homologation du véhicule obtenu à partir d'un test dit « dynamique », en mouvement, sur une piste par exemple, permettant de vérifier que les véhicules mis sur le marché respectent les valeurs seuils fixées par l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles différent des mesures effectuées à l'arrêt du véhicule reportées sur la carte grise. Ces valeurs sont pourtant celles utilisées pour caractériser la valeur reportée sur les certificats d'immatriculation.
À cet égard, il propose que les seuils d'homologation fixés pour la mise en circulation des véhicules sur le marché et ceux définis pour l'immatriculation du véhicule convergent, et notamment que les données renseignées en case U2 tiennent davantage compte des particularités du véhicule.
Proposition n° 15 : Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule.
Pour les rapporteurs, l'électrification des deux-roues est également un moyen opportun d'assurer une diminution du bruit émis par ces véhicules. En effet, le bruit émis par les deux-roues est principalement un bruit lié au moteur. Or, celui-ci est nettement plus silencieux s'il est électrique, notamment en phase d'accélération.
Dans un objectif de lutte contre les véhicules les plus pourvoyeurs de bruits, les rapporteurs considèrent que les pratiques dites de « tunning » doivent être davantage encadrées, notamment pour les deux roues motorisées.
Les véhicules deux-roues motorisés (2RM) sont en effet facilement modifiables par leur propriétaire. Il est aisé de changer une ligne d'échappement, un pot d'échappement, où simplement d'enlever la chicane d'un échappement afin d'amplifier le bruit produit par le véhicule. Or, la modification d'un de ces éléments conduit à une aggravation sensible de l'intensité acoustique et contourne la réglementation et l'homologation effective du véhicule.
Afin de lutter contre ce phénomène, les rapporteurs proposent de limiter la vente des pots et lignes d'échappement non homologués à leur utilisation dans le cadre d'une pratique sportive et en compétition, par exemple sur circuit.
Proposition n° 16 : Mieux encadrer la vente de pots d'échappement et lignes d'échappement non homologués afin qu'ils ne puissent être vendus que pour une utilisation dans le cadre de pratiques sportives.
Enfin, concernant le bruit routier, les rapporteurs estiment nécessaire une réflexion autour de la vitesse de circulation - spécialement nocturne - des véhicules motorisés.
Un abaissement généralisé des vitesses de circulation nocturne (22 h - 6 h) sur l'ensemble du territoire ne serait pas opportun, il apparaît cependant utile d'adapter la réglementation à la lutte contre le bruit routier nocturne.
Les rapporteurs proposent ainsi que soit ouverte aux maires ou, le cas échéant, aux présidents d'EPCI, la faculté d'abaisser les vitesses de circulation nocturne pour mieux protéger le sommeil et la santé des habitants de leurs agglomérations en fonction des spécificités de leurs territoires.
Pour les voies de circulation qui s'étendent à plusieurs territoires, telles des rocades ou des périphériques ou pour les voies départementales, la décision d'abaisser la vitesse de circulation doit être décidée soit par le préfet de département, soit par l'intercommunalité compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de mobilité.
Proposition n° 17 : Permettre aux autorités en charge de la voirie d'abaisser les vitesses de circulation la nuit pour protéger le sommeil et la santé des populations.
4. Réduire les nuisances sonores liées au transport ferroviaire
Le gestionnaire du réseau ferré national et les opérateurs de transport de voyageurs et de fret ferroviaire ont mené des efforts marqués de diminution du bruit ferroviaire.
SNCF réseau a ainsi engagé des actions favorables à la diminution du bruit ferroviaire en renforçant la performance acoustique de l'infrastructure ferroviaire. Les opérateurs ferroviaires ont également conduit des actions sur le matériel roulant avec, en particulier, le remplacement d'une grande partie des équipements de freinage.
Le fret ferroviaire, essentiel pour décarboner le transport de marchandises, en particulier, engendre une pollution sonore qui fragilise son acceptabilité sociale. Les trains de fret circulent en effet majoritairement de nuit et certains étaient encore récemment équipés de semelles en fonte, qui fonctionnent avec des niveaux sonores particulièrement élevés en cas de freinage. Le droit européen a défini en 2019 des « itinéraires moins bruyants » dont le matériel roulant équipé de freins en fonte est exclu. SCNF réseau a ainsi indiqué aux rapporteurs que « Les entreprises ferroviaires ne savent généralement pas affecter un wagon à un itinéraire précis et ont donc entrepris la modernisation de leur parc pour se conformer aux exigences de la STI bruit dont l'application est effective depuis le 8 décembre 2024 (changement de service annuel). La quasi-totalité des wagons de marchandises est désormais équipée de semelles de freins en composite ».
L'évolution du droit européen a favorisé le rétrofit des wagons fret et a permis de diviser par deux le bruit produit par ces matériels. Selon SNCF réseau la réglementation européenne « ayant conduit au rétrofit des wagons fret a pratiquement divisé par deux le bruit produit par ces matériels. ».
Il pourrait être opportun d'accentuer cet effort. Pour ce faire, le rétrofit des locomotives diesel, remplacées par des locomotives électriques, envisagé initialement pour décarboner le transport ferroviaire, permettrait également d'améliorer significativement la prévention de la lutte contre le bruit généré par le fret. Néanmoins, sa mise en oeuvre reste lourde et coûteuse. En effet, les itinéraires de fret ne sont pas toujours complètement électrifiés et il est donc nécessaire de prévoir qu'une partie du trajet s'effectue en recourant à des batteries électriques. L'usage de locomotives « bi-modes », utilisant du diesel et de l'électricité lorsque l'infrastructure le permet pourrait également être envisagé. Un appui financier aux opérateurs de fret pour l'achat de ces locomotives, notamment à travers une éligibilité aux certificats d'économie d'énergie (C2E) serait opportun.
Ces mesures sont de nature à renforcer, à cet égard, l'acceptabilité sociale du fret ferroviaire. Le report modal de la route vers le rail favorise de façon générale une baisse de la pollution sonore nocturne. En effet, comme l'a mis en avant l'Association française du rail (AFRA) auprès des rapporteurs, « un train de fret [est] équivalent à environ 40 à 44 semi-remorques, les nuisances sonores ponctuelles sont à comparer à celles générées par la circulation d'une noria de camions comparable en volume et masse transportés ».
Proposition n° 18 : Favoriser le rétrofit des locomotives de fret.
La réduction de l'exposition des populations au bruit ferroviaire implique donc de cibler prioritairement des actions à la source, sur le réseau et le matériel roulant. Ensuite, il est également possible d'agir sur la propagation du bruit à travers l'installation de murs antibruit, écrans de faible hauteur, remplissage des plateformes avec des matériaux absorbants. Enfin, des actions curatives peuvent être menées au niveau des récepteurs au travers de l'isolation des façades.
Les gestionnaires d'infrastructure, comme SNCF Réseau et la RATP, prennent donc des mesures tendant à éviter que des logements soient exposés à un niveau de bruit supérieur à la réglementation49(*) et à résorber les points noirs de bruit50(*). Toutefois, il peut arriver que des évolutions du bâti avoisinant exogènes à l'infrastructure elle-même accentuent l'intensité du bruit subi par les riverains. Selon la RATP, les dispositions constructives des bâtiments, leur orientation, leur positionnement face aux infrastructures, ainsi que les choix d'aménagement, et la nature des matériaux retenus par les riverains peuvent amplifier ou réduire certaines fréquences sonores.
Or, l'opérateur de transport a indiqué aux rapporteurs constater fréquemment dans le cadre des avis qu'il rend51(*) sur les projets de constructions à proximité des voies, une insuffisante prise en compte de ces enjeux : « À ce jour, 90 % des dossiers instruits par la RATP reçoivent un avis défavorable pour non prise en compte des enjeux acoustiques et vibratoires ou prise en compte de façon très générique, nécessitant la réalisation d'une étude acoustique et vibratoire en bonne et due forme pour assurer le respect du confort des futurs occupants au regard des sources de bruit et de vibrations spécifiques liées à l'exploitation d'une infrastructure de transport terrestre (équipements/ouvrages annexes associés) qui, bien que conforme, produit, de fait, du bruit et des vibrations ». Pour les projets de construction à proximité des infrastructures majeures de transport terrestre, une étude acoustique et, pour le transport ferroviaire, vibratoire, pourrait être systématiquement réalisée.
Proposition n° 19 : Prendre en compte dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de la construction d'un bâtiment à proximité immédiate d'une infrastructure de transport majeure le bruit qui en résulterait.
5. Une indispensable meilleure protection des riverains contre le bruit aérien
a) Des restrictions d'exploitation supplémentaires sur certaines plateformes
L'aviation est le secteur pour lequel une réglementation relative au bruit a été mise en place le plus précocement et largement compte tenu de l'intensité de la pollution sonore engendrée par le trafic aérien à proximité des aéroports. Cependant, la réglementation mériterait une actualisation afin de mieux prendre en compte les évolutions récentes de cette activité, notamment l'accroissement du trafic en soirée et tôt le matin, en lien avec l'essor des compagnies aériennes à bas coûts.
Actuellement six études d'impact selon l'approche équilibrée (EIAE) sont menées sur des aéroports français pour évaluer la pertinence de mesures de diminution du bruit émis par le trafic aérien. Le droit européen52(*) impose en effet de procéder à une telle étude sur chaque plateforme afin de définir les mesures les plus adéquates pour lutter contre le bruit.
La diminution de la pollution sonore liée au trafic aérien repose sur quatre piliers :
- la réduction du bruit à la source via, par exemple, l'usage d'aéronefs moins bruyants ;
- la gestion de l'utilisation des terrains proches de l'aéroport, comme les restrictions de l'urbanisation prévues par les PEB et le droit à l'insonorisation des logements inclus dans les PGS ;
- les procédures de navigation aérienne à moindre bruit, dites procédures de « descente continue » ;
- les restrictions d'exploitation des aéronefs, notamment le plafonnement du nombre de vols et couvre-feu nocturne.
Une EIAE peut être lancée lorsque les mesures pouvant être prises au titre des trois premiers leviers sont insuffisantes pour résoudre le problème de bruit identifié. Comme l'a indiqué la direction générale de l'aviation civile (DGAC) aux rapporteurs, « L'EIAE vise précisément à déterminer le scénario de restrictions permettant d'atteindre les objectifs de réduction du bruit définis (sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre) et ayant le meilleur rapport coût-efficacité ». Les restrictions d'exploitation n'ont donc vocation à n'être utilisées qu'en dernier recours.
Pour les rapporteurs, la persistance de l'exposition de populations53(*) au bruit aérien, en particulier nocturne, nécessite d'envisager une extension des mesures de lutte contre la pollution sonore autour de certaines plateformes. BruitParif rappelle d'ailleurs que « afin de diminuer le bruit sur la période nocturne, et sans tenir compte des conséquences économiques pour les compagnies aériennes, la solution la plus radicale et la plus protectrice du sommeil des riverains consiste naturellement en l'instauration d'un couvre-feu ou en l'élargissement de la période de couvre-feu existant ». La mise en oeuvre de couvre-feux est donc régulièrement demandée par les riverains des aéroports au regard de l'efficacité inégalée de cette mesure pour protéger leur santé.
L'union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) met ainsi en avant que « Seul un couvre-feu respectant les recommandations de l'OMS (8 h consécutives de sommeil) permet à un adulte d'avoir une nuit récupératrice et d'éviter les problèmes de santé liés au bruit aérien. Pour les enfants et les adolescents, le temps de sommeil est encore plus important. Il suffit d'un seul évènement sonore pour perturber le sommeil. Le repos est nécessaire pour être efficient dans le travail de la journée mais est absolument indispensable au développement cognitif des enfants et adolescents. Les cerveaux se structurent pendant les phases de sommeil qui favorisent l'enregistrement des données acquises au cours de la journée. Un couvre-feu est nécessaire pour tous les aéroports urbains ou impactant des zones urbanisées ».
Restrictions nocturnes en vigueur dans les aéroports français
Source : Acnusa
Toutefois, aucune restriction de trafic généralisée ne peut être envisagée à l'échelle nationale, une telle mesure serait incompatible avec le droit de l'Union européenne, qui prévoit que de telles restrictions ne peuvent avoir lieu qu'après une EIAE spécifique à une plateforme donnée.
Toute restriction d'exploitation supplémentaire doit également prendre en compte les conséquences économiques et sociales que son application engendrerait.
En particulier, une extension trop large de couvre-feux pourrait porter atteinte à l'activité des compagnies aériennes « basées » dans les aéroports concernés. Pour l'UAF, en effet, « une remise en cause du modèle économique des bases en France aurait des conséquences majeures, notamment sur l'emploi ». Ainsi, selon le groupe ADP, « toute restriction opérationnelle supplémentaire [à l'aéroport de Paris-Orly] entraînerait des conséquences importantes sur les acteurs et sur ce bassin économique, qui génère 30 000 emplois directs. Sans compter les effets négatifs en termes de connectivité et d'attractivité ».
À l'aéroport de Paris-CDG, le groupe ADP a souligné le rôle spécifique du fret et son impact majeur sur l'emploi local : « plus de 93 % des mouvements de nuit sont des vols de fret ou d'expressistes, qui ont un très fort impact sur l'emploi dans les territoires riverains de CDG. C'est par exemple le cas de FEDEX et ses 6000 emplois, DHL ou encore La Poste ». La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) a également mis en avant que « les politiques publiques doivent intégrer le fait que la disponibilité d'avions tout cargo répondant aux normes acoustiques les plus exigeantes est extrêmement limitée. En conséquence, compte tenu du caractère incontournable de l'activité nocturne pour les acteurs du fret express, d'autres solutions que les normes acoustiques des appareils doivent être privilégiées ». Cette analyse est partagée par l'Acnusa qui souligne que « notre industrie aéronautique a un besoin vital que les compagnies aériennes restent bénéficiaires pour pouvoir acheter de nouveaux avions moins bruyants ».
Certains aéroports, se trouvent à proximité immédiate de zones densément urbanisées, notamment Toulouse-Blagnac, Nantes Atlantique et Paris-Orly, et exigent une attention particulière. Pour BruitParif, ces aéroports devraient même être systématiquement concernés par des mesures de restriction de trafic la nuit : « Pour les aéroports fortement imbriqués dans le tissu urbain (Orly, Toulouse...) et/ou pour lesquels le nombre de riverains exposés au-dessus de la valeur limite de 50 dB (A) selon l'indicateur Ln est important (Paris-CDG...), les EIAE devraient systématiquement intégrer des hypothèses de restriction du trafic (de type couvre-feu partiel ou plafonnement du nombre de mouvements nocturnes) en plus ou en parallèle des hypothèses d'évolution technologique des aéronefs, qui risquent de ne pas suffire à améliorer significativement la situation dans les 10 à 20 prochaines années ».
La commission a déjà souligné que des mesures supplémentaires, incluant un renforcement du couvre-feu en vigueur, sont nécessaires concernant l'aéroport de Nantes Atlantique.
Le bruit et la fureur : la difficile mise en oeuvre du couvre-feu à Nantes Atlantique
L' arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes Atlantique, entré en vigueur le 8 avril 2022, a mis en place un couvre-feu sur l'aéroport. Il prévoyait qu'aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre minuit et 6 heures en vue d'un décollage. Toutefois, une exception était prévue pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs effectuant des vols programmés entre 21 heures et 23 h 30 et qui ont été retardés et des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés, pour des « raisons indépendantes de la volonté du transporteur ».
Entendues par le rapporteur de la mission d'information sur la modernisation de Nantes Atlantique, les compagnies aériennes avaient souligné les progrès réels permis par le couvre-feu. Pourtant, au regard des données collectées par la commission, le bilan du couvre-feu était mitigé lors de ses premières années de mise en oeuvre.
Selon la DGAC, 220 procès-verbaux ont été dressés en 2022 constatant le non-respect du couvre-feu par les compagnies. Avec 43 procès-verbaux dressés pour 10 000 mouvements en moyenne - la quasi-totalité étant liée au non-respect du couvre-feu -, la plateforme de Nantes Atlantique est celle où est constaté le taux d'infraction à la réglementation environnementale le plus élevé, selon les données transmises par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa). L'Acnusa considère que de tels manquements ont eu lieu « dans des proportions dépassant celles qui auraient pu être admissibles pour la riveraineté pour une première année, malgré le délai de prévenance entre la publication de ces règles et leur entrée en vigueur », qui a été d'environ six mois.
Il semble que ce nombre élevé d'infractions puisse, pour partie, s'expliquer par un « flou juridique » dans la rédaction de l'arrêté, spécifiquement dans l'interprétation des « raisons indépendantes de la volonté du transporteur » permettant de déroger au couvre-feu.
Tant l'Acnusa que les compagnies aériennes ont souligné les difficultés d'interprétation posées par cette rédaction. Les représentants du Coceta, une association de riverains rencontrés par le rapporteur de la mission d'information, avaient d'ailleurs fait part de leur lassitude concernant le respect insuffisant du couvre-feu. L'Association contre le survol de l'agglomération nantaise (Acsan) juge quant à elle ce dispositif « insuffisant » et note que « la rédaction de cet arrêté laisse beaucoup trop de possibilités de déroger à l'interdiction ».
Source : mission d'information relative à la modernisation de l'aéroport de Nantes Atlantique
Depuis 2023, des améliorations sont notables. Selon la DGAC, le nombre de vols entre minuit et 6 heures a été divisé par 12 entre 2019 et 2024. En outre, un arrêté publié le 23 mai 2024 et entré en vigueur le 1er juin 2024 a prévu plusieurs améliorations du cadre juridique :
- en précisant le périmètre de la notion de « raisons indépendantes de la volonté du transporteur » ;
- en permettant aux services locaux de l'aviation civile de s'opposer en temps réel à un mouvement d'avion lorsque la réglementation n'est manifestement pas respectée ;
- en accélérant et en facilitant l'instruction des manquements et la procédure de sanction qui s'y rapporte, en imposant aux compagnies de transmettre aux services de l'administration les éléments relatifs aux raisons du retard ou de l'anticipation des vols opérés entre minuit et 6 heures, dans un délai de deux jours ouvrés.
Pour les rapporteurs, cependant, ces mesures restent insuffisantes. Ils rappellent que la commission avait recommandé l'interdiction des atterrissages avant 7 heures du matin et des décollages après 21 heures, ce qui permettait de diminuer la pollution sonore sans porter atteinte à l'activité des compagnies aériennes basées sur la plateforme.
Concernant l'aéroport de Paris-Orly, un couvre-feu en vigueur depuis plus de 50 ans s'applique entre 23 h 30 et 6 heures du matin. Selon le groupe ADP, « l'aéroport a déjà une des réglementations les plus strictes et protectrices des populations au monde, avec non seulement un couvre-feu, mais également un plafonnement - inscrit dans la loi - du nombre de ses mouvements, qui prennent en considération le caractère très urbain de l'aéroport ». Toutefois, le maire de Villeneuve-le-Roi entendu par les rapporteurs a mis en avant qu'en dépit de ces règles, le bruit émis par sur la plateforme touche 750 000 personnes à cause de son enclavement dans le tissu urbain francilien.
Une EIAE a été conduite par la préfète du Val-de-Marne. Plusieurs scénarios ont été étudiés. Le premier, dit « scénario A » renforce les exigences des aéronefs en matière de performance acoustique. Les scénarios B et C prévoient une extension du couvre-feu, respectivement pour les seuls départs et pour les départs et les arrivées.
Selon la DGAC, « le scénario A présente le meilleur rapport coût-efficacité - critère décisif prévu par la réglementation européenne - au regard de ses impacts acoustiques et socio-économiques. Il acte des réductions significatives du bruit sans risquer d'effet contre-productif sur l'évolution des flottes. Le scénario B et plus encore le scénario C contraindraient de manière irréversible l'exploitation de l'aéroport alors que d'autres pistes liées aux trajectoires de vol sont actuellement étudiées (déploiement des descentes continues au premier chef) ».
Elle note en outre que les scénarios B et C « auraient de surcroît un impact économique majeur sur les compagnies aériennes, tel qu'il apparaît de nature à limiter les capacités de renouvellement de flotte d'ici 2029 ».
Une telle affirmation peut être nuancée. Une extension du couvre-feu n'interdit pas de mettre conjointement en place des mesures relatives aux marges sonores des aéronefs utilisés. Comme l'a souligné l'ARS d'Île-de-France, « le scénario C, le plus performant à l'horizon 2027 du point de vue acoustique et sanitaire, est présenté comme le moins favorable au renouvellement de la flotte sur le long terme. Il aurait été intéressant de tester un scénario alternatif qui aurait combiné l'interdiction progressive des appareils à marge acoustique cumulée <17 EPNdB à partir de 22 heures et couvre-feu intégral à partir de 23 heures ». Ce scénario est aussi défendu par les acteurs du secteur aérien.
Pour BruitParif cependant, il n'y a pas une équivalence stricte des résultats des scénarios envisagés du point de vue de leur impact sur la santé des riverains : « Les études réalisées par Bruitparif dans le cadre de l'analyse des différents scénarios proposés dans l'EIAE de Paris-Orly ont ainsi montré que l'élargissement d'une demi-heure du couvre-feu à Orly (scénario C) permettrait d'obtenir à l'horizon 2029 une diminution de bruit nocturne selon l'indicateur Ln plus importante (-3,4 dB (A)) que ne le permet le scénario A (-2,8 dB(A)) fondé sur une conversion à 100 % des flottes d'aéronefs avec des marges cumulées >= 17 EPNdB ».
En outre, les mesures de restriction d'utilisation des aéronefs dont les marges acoustiques sont les plus basses rencontrent plusieurs limites. D'une part, « la marge cumulée d'un avion est calculée en fonction de la masse de l'avion, du nombre de moteurs et des niveaux acoustiques de certification mesurés au sol selon une procédure standardisée. Ce mode de calcul tend à “bénéficier” aux avions gros porteurs. Ainsi un gros porteur peut présenter une marge acoustique cumulée meilleure qu'un avion moyen porteur plus léger et moins bruyant ». Par conséquent, pour BruitParif, il serait également nécessaire d'introduire des « restrictions sur les niveaux de bruit certifiés à l'approche et au survol, notamment en période nocturne, surtout dans le contexte international d'augmentation de l'emport moyen favorisant le développement des vols gros porteurs ».
Plus généralement, les effets du renouvellement des flottes peuvent être difficiles à évaluer avec précision et sont parfois limités. Ainsi, selon BruitParif, « en atterrissages notamment, les réductions de bruit sur les moyens porteurs type A320 et B737 qui représentent une part importante des vols, sont peu significatives, de moins de 1 dB (A) ».
De surcroît, les impacts sanitaires et sociaux du bruit émis par la plateforme sont structurellement sous-estimés selon l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France : « L'évaluation des impacts acoustiques et sanitaires des mesures de restriction se base sur la valeur limite réglementaire pour le niveau de bruit aérien nocturne (Ln), soit 50 dB (A). L'Organisation mondiale de la Santé porte quant à elle des valeurs-guides sensiblement inférieures : 40 dB (A) pour le Ln. Les impacts sanitaires apparaissent donc globalement sous-évalués par l'EIAE. Malgré le couvre-feu actuel entre 23 h 30 et 6 h 00, plus de 274 000 personnes sont encore exposées à des niveaux qui dépassent la recommandation de l'OMS (40 dBA Ln), contre 57 000 en dépassement de la valeur limite réglementaire (50 dB(A)) et 45 000 souffriraient de fortes perturbations de sommeil (source : Bruitparif, 2023) là où l'AIEA en dénombre moins de 14 000. Par ailleurs, la recommandation de 8 heures de sommeil en continu peut être considérée comme un objectif de santé publique, qui ne peut être atteint pour les riverains des aéroports sans la perspective d'une extension à terme du couvre-feu ».
Pour ces raisons, les rapporteurs estiment qu'il n'est pas opportun de conserver un couvre-feu uniquement entre 23 heures 30 et 6 heures, et plaident pour avancer d'une demi-heure le début du couvre-feu, comme le Président du Sénat, Gérard Larcher, l'a lui-même recommandé en mai 202454(*).
Proposition n° 20 : Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées.
En 2023, l'Acnusa a réalisé près de 223 contrôles et recouvré 11 491 000 € au titre des amendes qu'elle a infligées. Cette recette est toutefois à mettre en regard de la faiblesse du montant moyen des amendes infligées aux acteurs, établi à environ à 18 359 €55(*).
Afin de garantir le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions, il serait également pertinent de doubler le montant du plafond des amendes infligées par l'Acnusa, qui est actuellement de 20 000 € (40 000 € en cas de récidive). Comme l'avait mis en avant la commission dans son rapport d'information sur la modernisation de Nantes Atlantique, ce doublement éviterait que les compagnies aériennes envisagent ces sanctions comme de simples données intégrées dans leur modèle économique.
Proposition n° 21 : Doubler le plafond des amendes infligées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
b) Un meilleur encadrement de l'aviation générale
En dépit de niveaux de bruit parfois particulièrement élevés auxquels sont soumis les riverains d'aérodromes de loisir ou d'entraînement, les activités de l'aviation générale sont faiblement encadrées. Comme l'a mis en avant l'association antibruit de voisinage (AABV), « L'aviation légère de loisir se caractérise par un nombre important d'aérodromes (plus de 400) et d'aéro-clubs (plus de 600) en France et un nombre d'adhérents aux clubs en augmentation. Au total, plusieurs millions de personnes subissent des nuisances sonores dues à l'aviation légère. »
L'acceptabilité sociale des bruits émis par ces avions est particulièrement faible, liée à la sociologie parfois différente des usagers et des riverains. L'AABV a ainsi dénoncé une pollution sonore qui « est généralement le fait de quelques privilégiés alors qu'elle préjudicie à de nombreuses personnes qui n'ont pas toujours le choix de leur lieu d'habitation ».
Ce constat est partagé par FNE qui considère le cadre juridique actuel insuffisamment protecteur des riverains : « les avions peuvent décoller comme ils veulent, quand ils veulent, faire des tours de piste s'ils le souhaitent tout un dimanche après-midi alors qu'on a des horaires à respecter pour utiliser sa tondeuse le week-end ». Ainsi, comme le met en avant l'UFCNA, « il n'existe jusqu'à présent aucun contre-pouvoir politique, technique, ni administratif » dans le secteur de l'aviation générale, contrairement à l'aviation commerciale qui est strictement encadrée de longue date. Pour l'UFCNA, ce cadre juridique constituerait un « privilège archaïque et exorbitant ». Le contrôle de l'aviation générale par la DGAC concentre d'ailleurs les critiques des associations ; l'UFNA dénonce ainsi « la toute-puissance de la DGAC favorise cette situation en servant exclusivement les intérêts du monde de l'aviation ».
Pour les rapporteurs, plus que le rôle de l'administration, les relations conflictuelles entre la riveraineté et les associations d'une part, et les usagers et la DGAC, d'autre part, résultent d'un encadrement insuffisant des activités de l'aviation générale. Comme l'a rappelé l'Acnusa dans un rapport sur l'aviation légère56(*), celle-ci n'est encadrée que par une circulaire interministérielle de 200557(*). Cette circulaire indique aux préfets que la lutte contre le bruit généré par l'aviation légère nécessite de :
- maîtriser l'urbanisation au voisinage des aérodromes en révisant les plans d'exposition au bruit (PEB) ;
- concilier les intérêts de l'ensemble des partenaires concernés en renforçant la concertation et en signant des chartes de l'environnement relatives à l'exploitation des aérodromes ;
- réduire le bruit à la source en incitant les aéro-clubs et les propriétaires privés à équiper leurs avions de systèmes réducteurs de bruit et en poursuivant l'attribution de subventions pour le financement de silencieux et d'hélices multipales.
En sus de ces actions locales dont la conduite relève de la compétence des préfets, la circulaire mentionne également des actions déployées au niveau national. Il s'agit :
- d'un programme de recherches sur les nouveaux dispositifs réducteurs de bruit financé par la direction générale de l'aviation civile ;
- d'une sensibilisation des personnels susceptibles de mettre en oeuvre des actions de prévention des nuisances sonores, en particulier les contrôleurs aériens (stages de maintien de compétence) ainsi que leur encadrement (stages de prise de poste).
De surcroît, les bénéfices économiques et sociaux des clubs d'aviation de loisir sont perçus par les populations comme inférieurs à ceux de l'aviation commerciale, ce qui rend le bruit qu'elle émet moins acceptable.
Par conséquent, mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en définissant des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et en prévoyant des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes serait pertinent. Cette faculté de définir des restrictions d'exploitation pourrait être confiée au maire. Cette compétence pourrait ainsi être exercée au plus près des aérodromes et des riverains et prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire. Une telle décentralisation de la compétence est nécessaire compte tenu du nombre de plateformes concernées : il serait difficilement envisageable de publier plusieurs centaines d'arrêtés ministériels sur cette question. Actuellement, en effet, selon l'Acnusa, seuls deux héliports et trois aérodromes disposent d'arrêtés ministériels portant restriction d'exploitation et les plaçant sous le contrôle de l'Acnusa.
Comme l'a mis en avant un rapport commandé en 2023 par la FNAM, l'électrification de la flotte des aéronefs d'aviation légère pourrait avoir des effets bénéfiques sur les nuisances sonores. Pour les rapporteurs, il serait donc opportun que la réglementation incite les aéro-clubs à utiliser ce type d'aéronefs en prévoyant des restrictions d'exploitation plus strictes pour les aéronefs à moteur classique.
Source : FNAM, 2023
Proposition n° 22 : Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes.
LISTE DES PROPOSITIONS
Proposition n° 1 : Confier à Santé publique France la définition des indicateurs de mesure des impacts sanitaires du bruit et la surveillance de leur évolution.
Proposition n° 2 : Rationaliser l'élaboration des PPBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen.
Proposition n° 3 : Améliorer les politiques d'aide à l'insonorisation en réduisant le reste à charge pour les riverains, en rouvrant ce droit pour les locaux dont le dispositif d'insonorisation s'est dégradé dans le temps et en élargissant le nombre de locaux éligibles
Proposition n° 4 : Prendre en compte le bruit émis par les transports terrestres dans les documents d'urbanisme au même titre que le bruit aérien.
Proposition n° 5 : Appliquer pleinement, six ans après, la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique.
Proposition n° 6 : Mener au plus vite des études préalables à la définition d'indicateurs qui prennent en compte les vibrations, le bruit solidien et les basses fréquences sonores.
Proposition n° 7 : Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité.
En complément :
- introduire des zones d'ambiance sonore très modérée avec des seuils de bruit plus exigeants à respecter pour les nouvelles infrastructures de transport ;
- introduire un seuil de bruit pour la soirée, intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit pour les nouvelles infrastructures de transport.
Proposition n° 8 : Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit.
Proposition n° 9 : Regrouper à l'échelle régionale les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit afin de renforcer et mutualiser les compétences territoriales.
Proposition n° 10 : Lancer un plan de résorption des PNB, à partir d'une cartographie préalable des zones concernées, par redéploiement de financements budgétaires, et d'une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation.
Proposition n° 11 : Augmenter le nombre d'appels à projets scientifiques sur la pollution sonore afin de porter la recherche française au niveau de ses principaux voisins européens.
Proposition n° 12 : Mieux articuler rénovation thermique et rénovation acoustique des bâtiments en :
- définissant un principe de « non-régression acoustique » des bâtiments en cas de rénovation d'ampleur ;
- majorant le plafond des aides publiques de rénovation thermique en cas de rénovation acoustique simultanée.
Proposition n° 13 : Promouvoir l'information sur les niveaux sonores auxquels est exposé un bien immobilier à l'occasion de sa location ou sa cession.
Proposition n° 14 : Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée.
Proposition n° 15 : Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule.
Proposition n° 16 : Mieux encadrer la vente de pots d'échappement et de lignes d'échappement non homologués afin de la limiter à une utilisation dans le cadre de pratiques sportives.
Proposition n° 17 : Permettre aux autorités en charge de la voirie d'abaisser les vitesses de circulation la nuit pour protéger le sommeil et la santé des populations.
Proposition n° 18 : Favoriser le rétrofit des locomotives de fret.
Proposition n° 19 : Prendre en compte dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de la construction d'un bâtiment à proximité immédiate d'une infrastructure de transport majeure le bruit qui en résulterait.
Proposition n° 20 : Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées.
Proposition n° 21 : Doubler le plafond des amendes infligées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Proposition n° 22 : Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes.
TRAVAUX EN COMMISSION
Désignation du rapporteur
(Mercredi 18 décembre 2024)
M. Jean-François Longeot, président. - Le mercredi 30 octobre dernier, le bureau de la commission a acté le principe de la création d'une mission d'information relative aux nuisances sonores liées aux transports.
Le bruit causé par les transports est la première cause d'exposition aux nuisances sonores en France. Cependant, celles-ci sont encore insuffisamment prises en compte dans les projets d'infrastructures. Les normes sur ce sujet sont d'ailleurs complexes, difficilement lisibles et parfois source d'interprétations divergentes. L'Autorité environnementale (AE) a en outre souligné dans son dernier rapport annuel qu'il existe « un écart préoccupant entre la réglementation nationale et le consensus scientifique » sur le bruit.
Cette mission d'information permettra donc de dresser un bilan du cadre de prévention et de lutte contre les nuisances sonores causées par les infrastructures de transport.
Les nuisances sonores causées par les transports sont au coeur des préoccupations des Français et fragilisent l'acceptabilité sociale des projets d'infrastructures. Or, dans un contexte de décarbonation des mobilités, qui devrait conduire à moyen terme à un renforcement de l'offre ferroviaire, notamment dans le cadre des services express régionaux métropolitains (Serm), il est opportun de veiller à ce que les nuisances engendrées par les projets ne fragilisent pas le consensus autour de leur réalisation.
Le report modal du transport routier vers le transport ferroviaire, le transport fluvial et les mobilités actives peut également constituer une opportunité de diminution des nuisances sonores, les nuisances causées par le transport routier étant nettement plus élevées que celles qui sont engendrées par les autres modes de transport.
La commission a régulièrement l'occasion de travailler sur les nuisances sonores aériennes, comme le montre l'audition portant nomination du président de l'ACNUSA que nous venons de mener. Pourtant, le transport aérien alimente une part assez faible des nuisances sonores liées aux transports. Il est donc opportun que nous élargissions notre spectre de travail à l'ensemble des modes de transport.
Vous l'avez compris, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable doit prendre toute sa place dans le débat public sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une mission interne d'information sur les nuisances sonores causées par les transports. Afin d'associer le plus largement possible les commissaires à ces travaux, il a été décidé qu'un co-rapporteur issu d'un groupe minoritaire serait désigné.
J'ai reçu les candidatures de Guillaume Chevrollier et de Gilbert-Luc Devinaz.
Je vous propose donc de les désigner conjointement rapporteurs..
M. Guillaume Chevrollier. - Merci de votre confiance. Nous serons à votre disposition.
M. Gilbert-Luc Devinaz. - Je travaillerai avec plaisir avec Guillaume Chevrollier sur ce sujet.
M. Jean-François Longeot, président. - Je félicite les rapporteurs et leur souhaite bon courage pour engager ce travail, qui fera l'objet d'une attention particulière.
Communication
relative aux résultats du sondage sur le bruit lié aux transports
réalisé pour le compte de la commission
(Mercredi 30 avril
2025)
M. Jean-François Longeot, président. - La commission a confié à Guillaume Chevrollier et à Gilbert-Luc Devinaz le soin de mener une mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports. Nous nous sommes déjà saisis de cette question.
Pour le cas spécifique du transport aérien, Didier Mandelli a été le rapporteur d'une mission d'information portant sur l'aéroport Nantes-Atlantique à l'automne 2023. Stéphane Demilly, en tant que rapporteur pour avis au projet de loi de finances sur le transport aérien, a également proposé des amendements sur ce sujet.
Nous avons également entendu Pierre Monzoni, le 16 décembre dernier, dans le cadre d'une audition au titre de l'article 13 de la Constitution, pour nous prononcer sur sa nomination à la tête de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Je salue le travail du rapporteur pour cette audition, notre collègue Paul Vidal.
Toutefois, et sans dévoiler encore les résultats de l'enquête d'opinion, le transport aérien n'est pas la première source d'exposition au bruit. Une étude d'ensemble sur cette question est donc opportune, d'autant plus qu'aucune des deux assemblées n'a encore mené des travaux sur le sujet.
Dans le cadre des travaux, les rapporteurs ont décidé de recourir à l'accord-cadre conclu par le Sénat pour bénéficier de l'appui d'un institut de sondage. Il revient donc à Monsieur Quentin Llewellyn de l'Institut CSA qui a piloté cette enquête d'opinion de nous en présenter les grandes lignes.
Avant de lui céder la parole, je laisse le soin aux rapporteurs de faire un point d'étape sur l'avancée de leurs travaux.
M. Gilbert-Luc Devinaz. - Je devais être retenu du fait d'un engagement dans un groupe d'amitié, j'ai néanmoins pu me libérer et vais en définitive pouvoir suivre la présentation du sondage en réunion plénière. Je laisserais donc la parole à Guillaume Chevrollier pour introduire la présentation de l'étude d'opinion.
M. Guillaume Chevrollier. - Nous avons mené avec mon collègue Gilbert-Luc Devinaz une trentaine d'heures d'auditions afin d'entendre 90 interlocuteurs sur la question des nuisances sonores causées par les transports.
Nous avons en particulier entendu des associations de riverains, qui nous ont expliqué souffrir non de simples nuisances, mais bien d'une véritable pollution sonore qui dégrade leur santé à cause de la proximité d'infrastructures de transports. Nous recevrons cet après-midi des élus locaux qui souhaitent nous faire part du même constat pour leur commune. L'Autorité environnementale, la Commission et la Cour des comptes européennes se sont aussi emparées de cette question : comme l'a rappelé le président Longeot, le Parlement ne pouvait donc pas se soustraire à l'examen de cet enjeu qui n'a, pour l'heure, pas fait l'objet d'un travail de contrôle.
Nous avons également reçu des représentants des gestionnaires de routes et d'autoroutes, d'infrastructures ferroviaires, d'aéroports, ainsi les administrations concernées et de nombreux experts en matière d'acoustique et d'isolation phonique.
Nous nous sommes aussi rendus à Trappes au Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) le 3 avril dernier afin d'assister à la phase de certification des radars sonores routiers qui permettront bientôt de verbaliser les conducteurs de véhicules trop bruyants - notamment des deux-roues débridés ou au pot d'échappement trafiqué.
L'ensemble des auditions ainsi menées et ce déplacement nous ont bien montré que ce sujet du bruit émis par les transports est très technique et complexe, mais concerne directement la vie quotidienne de nos concitoyens.
Le bruit est de plus un véritable angle mort des politiques publiques - notamment si on le compare à la pollution de l'air, qui fait l'objet de politiques bien plus volontaristes. À titre d'exemple, nous ne savons même pas combien de logements sont aujourd'hui exposés à des niveaux de bruit dépassant largement les seuils réglementaires, que l'on appelle des points noirs de bruit, alors même que l'État s'était fixé en 2000 l'objectif de tous les résorber.
Devant ces constats, nous n'avons pas encore arrêté l'orientation de nos recommandations que nous formulerons. Toutefois, une chose est sûre : nous serons sur une ligne de crête entre, d'une part, la nécessité de simplifier le lancement de projets d'infrastructures essentielles pour permettre à nos concitoyens de se déplacer et massifier le recours aux transports décarbonés, et, d'autre part, l'impératif de mieux protéger la santé et la qualité de vie de nos concitoyens.
Afin de mieux cerner la situation, nous avons jugé qu'il serait pertinent de bénéficier de résultats statistiquement robustes sur l'opinion de nos concitoyens sur le bruit émis par les transports auquel ils sont exposés : combien se considèrent exposés ? dans quels territoires ? Quelles sont les conséquences de cette exposition sur leur vie et leur santé ? Jugent-ils la réponse publique à la hauteur du problème ?
L'étude d'opinion est dans ce contexte destinée à mieux comprendre ce qu'attendent nos concitoyens du législateur en la matière. À cet égard, cette démarche se révèle complémentaire du travail « classique » d'auditions pour recueillir l'opinion de la majorité - quelque peu silencieuse - de nos concitoyens.
La dernière étude d'opinion d'ampleur sur le bruit, réalisée pour le compte du Conseil national du bruit, datait en effet de plus de 10 ans. Une enquête actualisée portant spécifiquement sur les transports nous est donc apparue d'autant plus opportune et permettait d'utilement éclairer les travaux de notre mission d'information.
Les premiers résultats de ce sondage montrent l'ampleur massive incontestable de l'exposition au bruit causé par les transports, qui touche près de la moitié de nos concitoyens. Le Parlement ne pouvait donc plus rester sans voix sur cette question.
M. Quentin Llewellyn, directeur conseil de l'institut CSA. - Je vais à présent vous présenter les principaux enseignements de cette enquête sur les opinions des Françaises et des Français à l'égard des nuisances sonores, plus précisément causées par les transports routiers, aérien et ferroviaire.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions de méthodologie : ce sondage en ligne a été réalisé entre le 7 et le 16 avril dernier auprès d'un échantillon de 2 000 individus, représentatif de la population française métropolitaine âgée de 18 ans et plus.
Cet échantillon assure une représentativité par la méthode des quotas appliqués aux variables sociodémographiques structurantes, ainsi qu'une dispersion géographique optimale.
Il est important de noter que nous sommes dans le cadre d'une enquête d'opinion, avec des données déclaratives traduisant des sentiments et des perceptions.
L'objectif était de faire le point sur la perception de cette problématique, d'identifier la part des Français gênés par ces nuisances, d'observer les répercussions sur leur santé et leur vie au quotidien, et de leur soumettre des propositions pour atténuer ces nuisances.
Je commencerais par quelques données de cadrage qui permettent de recontextualiser la problématique de l'étude en s'intéressant au ressenti des Français vis-à-vis des nuisances sonores. C'est un sujet qui est loin d'être anecdotique et qui constitue très clairement un enjeu majeur de qualité de vie pour les Français aujourd'hui. Lorsqu'on leur demande ce qui trouble le plus leur qualité de vie au quotidien, les nuisances sonores ressortent très nettement, avec 27 % de citations. La saleté ou la présence de déchets dans l'espace public se situent juste derrière. Viennent ensuite, de manière moins marquée, différents types de nuisances et notamment différents types de pollution. Les nuisances sonores arrivent en tête, quel que soit l'âge des individus. Même si, dans le détail, on constate que les aînés le soulignent avec d'autant plus de vigueur. En outre, on note une sensibilité à ces nuisances d'autant plus marquée que l'on habite dans les territoires urbains et notamment dans les plus grandes agglomérations. Même les habitants des territoires ruraux placent ces nuisances au premier rang. C'est donc une perception qui est partagée par l'ensemble de la population dans toute sa diversité. Ce sujet qui laisse d'ailleurs peu de Français indifférents, puisqu'ils sont très nombreux à nous identifier cette préoccupation, 71 % dont près d'un quart vont même jusqu'à dire que les nuisances sonores les préoccupent beaucoup.
Nous sommes face à une population qui considère, à 87 %, que les nuisances sonores constituent un réel danger pour la santé humaine. Cette opinion s'exprime avec un niveau de conviction nuancé : 55 % des Français pensent que cela leur semble vrai, tandis qu'un tiers, 32 %, estiment que c'est une vérité scientifique incontestable.
Cette perception du danger est d'autant plus soulignée chez les habitants d'Île-de-France, les catégories socioprofessionnelles supérieures, et ceux qui se disent préoccupés par ce sujet.
Pourtant, près de 6 Français sur 10, 58 %, reconnaissent qu'ils sont mal informés sur les effets concrets du bruit sur la santé humaine. Ce ressenti est partagé par une majorité de ceux qui déclarent que ce sujet les préoccupe.
L'enquête révèle également que les Français considèrent le bruit comme un élément perturbateur de leur qualité de vie au quotidien. Près des deux tiers des actifs en emploi en France en subissent sur leur lieu de travail, et plus d'un Français sur deux, 56 %, se disent touchés sur son lieu d'habitation, avec une fréquence de la gêne nettement plus ressentie en Île-de-France qu'en territoires ruraux.
Après avoir dressé le constat, l'enjeu est de déterminer la nature, la provenance et l'origine de ces nuisances, et de mesurer la place des nuisances sonores causées par les transports dans l'univers plus large des nuisances sonores. Si l'on se focalise sur les personnes qui se déclarent touchées par des nuisances à leur domicile, c'est d'abord et avant tout une histoire de voisinage. C'est lié à nos chers voisins. Les nuisances sonores au travail proviennent principalement des collègues et des équipements techniques. Il y a des différences en fonction du métier et de la catégorie socioprofessionnelle, mais c'est ce qui ressort en tête des problématiques en matière de nuisances sonores. En ce qui concerne les nuisances directement causées par les transports, 59 % des Français qui se disent gênés par des nuisances sonores à leur domicile pointent du doigt le trafic routier. Les circulations ferroviaires et aériennes sont également relevées, mais dans une moindre mesure. Une personne sur cinq se dit en effet gênée par des nuisances sonores. Chez les actifs en emploi, c'est le même constat, avec des scores légèrement différents. Enfin, près d'un Français sur deux, 45 %, nous dit être exposé à au moins une nuisance sonore causée par les transports, que ce soit à son domicile ou sur son lieu de travail.
Dans le détail, 39 % des personnes déclarent être exposées à des nuisances sonores liées à la circulation routière, 14 % à des nuisances aériennes et 13 % à des nuisances ferroviaires. Le routier est logiquement en tête, tandis que le ferroviaire et l'aérien sont à égalité, touchant une part quasi égale de Français. Les nuisances liées au transport arrivent en deuxième position, à 45 % de citations, faisant presque jeu égal avec les problématiques de voisinage ou de collègues de travail. Les autres sources de nuisances sonores sont reléguées au second plan. Les Français font un lien entre nuisances sonores et santé. Nous avons donc ciblé les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui subissent des nuisances sonores directement causées par les transports. Ces personnes confirment que ces nuisances affectent leur qualité de vie, à 76 %, et 52 % disent que ces nuisances affectent leur santé mentale. Ce score grimpe à 64 % pour les moins de 35 ans, et 38 % évoquent des répercussions sur leur santé physique. Ces personnes décrivent leur ressenti physique en mettant en exergue des symptômes tels que des problèmes de concentration, de fatigue, de stress, d'irritabilité ou de sommeil perturbé. On nous a également fait part de répercussions directes jusque dans l'intimité des foyers, avec des effets d'entrave sur certaines activités du quotidien.
Une part non négligeable de Français, notamment ceux exposés à des nuisances sonores à leur domicile, nous ont fait part de leurs difficultés. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un espace extérieur, il leur est déjà arrivé de ne pas pouvoir en profiter, et pour 55 % d'entre eux, ces nuisances en sont la cause. Ces nuisances perturbent également la possibilité de regarder un film, la télévision, de lire ou de poursuivre des conversations. On note que ces entraves sont d'autant plus ressenties parmi ceux qui sont touchés par des nuisances aériennes ou des nuisances sonores ferroviaires. Pour pallier ces difficultés, une personne sur cinq concernée par ces nuisances sonores prend ou a déjà pris des médicaments pour se soulager, principalement des somnifères, mais aussi des antidépresseurs et des anxiolytiques. Certaines vont même jusqu'à prendre des décisions radicales, notamment quand leur domicile ne joue plus son rôle de refuge. 35 % des personnes gênées par des nuisances sonores causées par les transports se sont déjà absentées au moins une fois de leur domicile en pleine journée, car cela devenait insupportable. 21 % ont déjà dormi ailleurs que chez elles pour les mêmes raisons. Ces scores sont nettement plus élevés dans le cas de nuisances sonores aériennes et ferroviaires. Un quart des personnes qui se déclarent gênées par ces nuisances sonores liées aux transports ont déjà réalisé des travaux d'isolation phonique à leur domicile. 17 % l'envisagent à l'avenir. En définitive, le total cumulé des gens qui ont entrepris ou vont entreprendre des travaux en ce sens est de 41 %.
Ce score atteint 52 % pour les personnes touchées par des nuisances aériennes et 57 % pour celles concernées par des nuisances ferroviaires. La recherche d'atténuation du bruit passe également par le recours à des outils spécifiques et individuels, comme les bouchons d'oreille, utilisés régulièrement par un quart des personnes gênées par les nuisances sonores causées par les transports. Le casque anti-bruit, quant à lui, est porté de manière régulière par 15 % des personnes gênées. Près d'un quart et un peu plus d'un tiers des personnes gênées songent à changer de vie, ou à changer d'air tout simplement. 23 % envisagent ou souhaitent changer d'emploi à cause de cela et 37 % envisagent ou souhaitent déménager, que les nuisances soient subies au domicile ou sur le lieu de travail. Seule une minorité est en mesure de concrétiser cette envie d'ailleurs ou cette recherche de mise à distance sociale des nuisances sonores que l'on subit à son domicile. Enfin, nous nous intéressons à la perception de différentes mesures qui cherchent à atténuer ces différentes nuisances sonores causées par les transports. Deux mesures bénéficient d'un réel soutien de l'opinion : la mise en place de contrôle radar des véhicules et la verbalisation des conducteurs qui dépassent les maximums sonores autorisés par la réglementation en vigueur.
75 % des Français, quel que soit leur profil, sont favorables à cette mesure, dont 39 % qui la revendiquent avec force. Ce soutien majoritaire se retrouve également parmi les usagers de la voiture au quotidien, qui sont 74 % à y être favorables. L'interdiction de tout décollage et d'atterrissage d'avion la nuit, entre minuit et 6 heures du matin, recueille 62 % d'avis favorables, dont 29 % très favorables. Ce score atteint 42 % pour ceux qui subissent directement des nuisances aériennes. La limitation de la vitesse routière à 30 km/h à l'intérieur des agglomérations suscite des réactions contrastées, surtout auprès des usagers quotidiens de la voiture. Cependant, une limitation de vitesse nocturne, entre 22 heures et 6 heures du matin, est un peu mieux acceptée. Enfin, 40 % des Français sont favorables à l'obligation d'équiper les véhicules de pneus silencieux. Le pourcentage d'approbation n'est pas très élevé, avec une majorité défavorable et les avis sont partagés sur cette mesure. Mais ce score chute fortement, lorsqu'on s'intéresse aux automobilistes. Le taux d'approbation chute à 32 %. La limitation de la vitesse à 50 km/h sur les rocades et les périphériques obtient des résultats quasi identiques, avec environ 4 Français sur 10 favorables. Cependant, 26 % sont très défavorables et les automobilistes sont également majoritairement défavorables. Les franciliens, qui utilisent majoritairement les transports en commun, sont ceux qui accueillent le plus positivement cette mesure, mais leur taux d'approbation ne dépasse que de quelques points les 50 %. Le soutien est donc en demi-teinte, même auprès de cette population. Voilà les principaux enseignements. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos remarques ou questions.
M. Jean-François Longeot, président. - Je vous remercie pour cette présentation éclairante, qui montre la pertinence de notre mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports. Les nombreux éléments enrichiront notre travail et pourront faciliter le choix des orientations qui correspondent aux attentes de nos concitoyens.
Mme Nicole Bonnefoy. - Il y a des pollutions qui se cumulent avec les nuisances sonores, comme la pollution de l'air. Je pense aux personnes riveraines d'axes routiers majeurs, qui subissent une double peine, voire une triple peine : le bruit et les oxydes d'azote, les particules, etc. Et pourtant, malgré nos mises en garde répétées, rien ne change, malheureusement.
M. Stéphane Demilly. - Comme ma collègue Nicole Bonnefoy vient de le souligner, ce sujet est un serpent de mer. Le bruit est l'une des premières préoccupations des Français. J'ai siégé au Conseil national du bruit, où nous menions des études et des sondages. En dépit de ces travaux, aux conclusions identiques, la situation ne s'améliore pas.
Dans ma ville, ce sont surtout certains véhicules particulièrement bruyants qui posent problème. Je pense notamment aux conducteurs qui roulent avec la radio à plein volume, confondant leur voiture avec une boîte de nuit mobile, ou aux deux roues avec des pots trafiqués. C'est infernal, surtout la nuit.
Plus largement, il y a un problème d'incivilité, comme on le voit avec les gens qui téléphonent dans les trains sans se soucier de leurs voisins, alors qu'ils devraient se rendre sur les plateformes réservées.
Je pense qu'il faut lancer un grand chantier national, pédagogique, sur cette question du bruit. Il faut sanctionner les comportements défaillants, mais les radars antibruit coûtent cher aux communes. Pour moi, c'est une grande cause nationale qui mériterait un « grenelle du bien vivre ensemble ».
M. Jean-François Longeot, président. - Le cas de l'usage du téléphone portable dans les trains est à cet égard topique des incivilités que vous mentionnez. Certaines personnes se soustraient aux règles communes avec des conversations téléphoniques hors des zones dédiées à cet effet. Il m'arrive parfois d'interpeller directement les personnes concernées pour leur faire remarquer ce manque de civisme. Je pense qu'un vrai travail de pédagogie et une sensibilisation à cet égard sont à conduire.
M. Jacques Fernique. - J'ai trois remarques, puis des questions. J'ai travaillé sur ce sujet il y a une vingtaine d'années, car dans mon secteur, nous étions confrontés à une nuisance ferroviaire en zone urbaine dense. Les habitants disaient s'y habituer, mais les spécialistes nous ont fait remarquer l'existence d'un décalage entre le ressenti et les effets physiologiques. En effet, même si les gens s'habituent, il y a des effets sur la santé.
Il est intéressant de voir que beaucoup de gens reconnaissent qu'il y a un réel danger pour la santé, mais en même temps, qu'ils se sentent mal informés sur les effets sur la santé. C'est un enjeu important, notamment concernant les points noirs de bruit mentionnés par Guillaume Chevrollier, sur lesquels l'État s'était engagé à agir. Cependant, nous n'avons pas de dispositifs et d'obligations analogues à ceux pratiqués en Europe du Nord, où les densités urbaines et l'imbrication avec les réseaux de transport sont telles qu'ils ont une longueur d'avance sur nous.
Une diapositive de la présentation de l'étude d'opinion montre que 45 % des gens disent être exposés à au moins une nuisance sonore causée par les transports. La méthodologie de l'étude distingue entre le domicile et le travail. On constate que 45 % disent être exposés à une nuisance sonore, dont 39 % au domicile et 19 % au travail.
Enfin, j'ai remarqué qu'une des mesures évaluées par l'étude d'opinion est similaire à ce qui a été fait sur le périphérique parisien, avec une réduction de la vitesse à 50 km/h. Cependant, dans mon secteur, l'enjeu a été de ramener les vitesses à 70 km/h pour les voies rapides traversant les zones urbaines. Il y aurait peut-être des résultats différents si l'on avait proposé cette mesure-ci.
Mme Nicole Bonnefoy. - S'agissant des limitations de vitesse, j'ai l'exemple de l'agglomération d'Angoulême, où il est question de réduire la vitesse des véhicules légers sur environ 11 km de route nationale pour diminuer le bruit pour les riverains. Cependant, la présence de véhicules lourds pose problème, car un seul camion peut couvrir le bruit de plusieurs voitures. Ainsi, même si l'on réduit la vitesse des véhicules légers, cela n'aura aucun impact sur le bruit généré par les véhicules lourds.
M. Quentin Llewellyn. - Lorsqu'on aborde la mesure de limitation de vitesse, les Français perçoivent davantage les inconvénients et l'impact direct sur leur vie quotidienne, mais moins les gains potentiels sur la question des nuisances sonores.
La mesure sur les pneus antibruit exige une démarche proactive de l'individu, ce qui implique un coût, dont le montant est inconnu, mais supposé élevé. Un effort financier est demandé, alors que certains sondés se demandent pourquoi les constructeurs ne généraliseraient pas cela.
Les mesures d'interdiction des vols de nuit, qui ont un impact moins direct sur la pratique quotidienne, ou l'idée générale d'une lutte contre les nuisances sonores sont appréhendées comme plus efficaces.
M. Olivier Jacquin. - Je remercie les rapporteurs pour leur travail et cette enquête très intéressante. J'ignorais l'existence du dispositif des pneus antibruit. Existe-t-il également pour les poids lourds, et non seulement pour les véhicules légers ? Y a-t-il un surcoût important à cette technologie qui empêcherait leur généralisation ?
M. Gilbert-Luc Devinaz. - Nous avons entendu la société Michelin, qui travaille sur ce sujet. Le dispositif antibruit a un impact sur la qualité du pneu, son coût, la vitesse de son usure et les conditions de freinage. La vitesse est un facteur clé : au-dessus de 50 km/h, c'est le roulement qui est audible. En dessous de 50 km/h, c'est le bruit du moteur qui prédomine.
Michelin travaille sur ce sujet, mais a souligné que cela pose d'autres problèmes. Les dessins sur les pneus antibruit servent à évacuer l'eau et à assurer la sécurité et le freinage. Des pneus antibruit auraient par ailleurs un coût plus élevé.
M. Jean-François Longeot, président. - Je remercie notre invité et les rapporteurs pour cette présentation.
Examen du rapport
d'information
(Mercredi 25 juin 2025)
M. Jean-François Longeot, président. - Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour entendre les conclusions et les recommandations de la mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports, conduite par Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz.
Le bruit causé par les transports est la première cause d'exposition aux nuisances sonores en France. Ce constat a été confirmé et précisé par le sondage réalisé par l'Institut CSA à la demande de la commission sur ce sujet et dont les résultats nous ont été présentés le 30 avril dernier. Le recours à cet outil d'investigation nous a confrmé que le bruit émis par les transports est bien au coeur des préoccupations des Français. Notre commission était donc parfaitement fondée à se pencher sur ce sujet qui a des répercussions directes sur le quotidien de nos concitoyens.
Nous avions déjà travaillé à plusieurs reprises sur ces enjeux. Je pense en particulier à la mission d'information sur la modernisation de l'aéroport de Nantes-Atlantique conduite par Didier Mandelli à l'automne 2023. Notre rapporteur pour avis sur les crédits « Transport aérien » du projet de loi de finances, Stéphane Demilly, a aussi travaillé sur ces enjeux. Nous avons enfin entendu en audition, conformément à l'article 13 de la Constitution, Pierre Monzani avant sa nomination à la tête de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa).
Toutefois, le transport aérien n'a pas le monopole du bruit causé par les transports. Il était donc particulièrement pertinent d'élargir l'objet de notre travail pour avoir une vue d'ensemble sur le secteur des transports.
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - Je suis heureux de partager avec vous le fruit des investigations conduites avec mon collègue rapporteur Gilbert-Luc Devinaz, que nous allons vous présenter au travers des conclusions de notre rapport d'information sur la pollution sonore causée par les transports.
Vous avez bien entendu : nous parlons de « pollution sonore », et non de « nuisances sonores ». Si notre mission d'information avait pour objet initial les « nuisances sonores », nos travaux nous ont amenés à une prise de conscience plus large : le bruit, plus qu'une nuisance du quotidien affectant notre qualité de vie, est une véritable pollution, qui dégrade la santé des populations et représente un enjeu sanitaire majeur.
La trentaine d'auditions que nous avons conduites nous ont permis d'échanger avec les acteurs concernés de près ou de loin par cette problématique, certes techniquement complexe, mais dont l'impact est direct et concret sur le quotidien de nos concitoyens.
Un déplacement au laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), en avril dernier, qui teste actuellement des radars sonores routiers pour sanctionner les véhicules trop bruyants - notamment les deux-roues à pot d'échappement modifié -, a également été très instructif sur les instruments de lutte contre le bruit qui sont susceptibles d'être généralisés.
Enfin, nous avions souhaité, comme vous le savez, prendre le pouls des Français sur leur rapport au bruit. C'est la raison pour laquelle nous avons confié à un institut de sondage, l'Institut CSA, le soin de réaliser une enquête dont les résultats vous ont été présentés le 30 avril dernier.
Les principaux enseignements de cette étude sont sans ambiguïté : le bruit est un sujet de préoccupation majeure des Français. Ainsi, 71 % d'entre eux considèrent les nuisances sonores comme un sujet de préoccupation, et 45 % se déclarent personnellement affectés par le bruit lié aux transports.
Le Parlement n'avait encore jamais mené des travaux de contrôle sur ce sujet essentiel. Il est donc très positif que notre commission se soit emparée de cette problématique.
Le transport routier est identifié comme le premier émetteur de pollutions sonores. Ce constat est logique : la voiture demeure le premier mode de transport des Français et la densité du réseau routier est forte sur le territoire. Cette conjonction de facteurs entraîne mécaniquement la sensation d'une omniprésence des nuisances routières.
Cette exposition aux pollutions sonores est particulièrement intense en milieu urbain et progresse avec la taille de l'agglomération, pour tous les modes de transport. Ainsi, un Francilien sur cinq déclare subir des nuisances sonores aériennes et ferroviaires.
M. Gilbert-Luc Devinaz, rapporteur. - J'aimerais compléter le propos de mon collègue rapporteur en revenant sur les enjeux sanitaires causés par les pollutions sonores.
À court terme, les effets du bruit sur la santé peuvent se résumer à des perturbations de l'attention la journée et à des troubles du sommeil la nuit. Lorsque ces événements sont passagers et ponctuels, ils n'ont qu'une incidence faible sur notre santé. En revanche, l'exposition régulière à cette pollution conduit à dégrader significativement la qualité de vie d'un individu, ce qui peut avoir des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle : une irritabilité par exemple, ou encore une perte de productivité au travail.
C'est surtout à moyen et long terme que les effets du bruit sur la santé sont les plus notables. Des études scientifiques ont mis en avant une relation de cause à effet entre exposition au bruit et développement de pathologies lourdes telles qu'un risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde, voire de développement de la maladie d'Alzheimer, notamment en raison d'une sursécrétion d'hormones du stress, le cortisol. Enfin, des scientifiques ont souligné des risques élevés pour les enfants, notamment concernant leur développement intellectuel et l'acquisition du langage et de la lecture.
J'évoquerai ensuite l'un des constats phares de notre rapport d'information : la complexité, l'illisibilité, voire parfois la cacophonie des instruments de lutte contre le bruit causé par les transports.
Éparse et complexe, la réglementation de la lutte contre les pollutions sonores s'est forgée par strates successives, sans approche globale.
D'abord, en 1985, le législateur s'est concentré sur le transport aérien, en imposant des servitudes d'urbanisme aux espaces urbains situés à proximité des aéroports et en instaurant des plans d'exposition au bruit (PEB).
Puis, une étape plus ambitieuse a été franchie avec la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « Bruit », afin de prendre en compte l'ensemble du spectre des nuisances sonores émis par les transports. Ce texte est, d'ailleurs, toujours le cadre de référence en la matière. Cette loi définit un « classement sonore des voies » de transports terrestres les plus bruyantes et des obligations de protection des riverains situés à leur proximité.
Enfin, la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, dite « Bruit », a invité les États membres à mettre en place une cartographie du bruit dans un périmètre déterminé - grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport - par le biais de cartes de bruit stratégiques (CBS). Des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) visant la réduction du bruit ont également été définis pour mettre en oeuvre cette exigence européenne dans notre droit.
Force est de constater que ces outils se superposent sans qu'une remise à plat rationnelle et une réflexion d'ensemble aient été menées : un seul et même émetteur de bruit doit appliquer une multitude de normes.
Ainsi, les grandes infrastructures de transports terrestres sont répertoriées dans des CBS et dans le classement sonore des voies de transport terrestre. Cet enchevêtrement est source d'illisibilité et de complexité, car les indicateurs de bruit utilisés dans ces documents, applicables aux mêmes infrastructures, ne sont pas identiques.
Le cas des PPBE est révélateur de ce labyrinthe normatif. Les périmètres de plusieurs PPBE peuvent se chevaucher, notamment dans les grandes agglomérations. En outre, les mesures qui y figurent n'ont pas de valeur normative et leur non-respect ne fait l'objet d'aucune sanction. Il en résulte un manque d'appropriation de cet outil par les pouvoirs publics, perçu comme une contrainte administrative. Un autre symptôme de ce faible intérêt pour les PPBE est que certains d'entre eux, obligatoires au regard du droit de l'Union européenne (UE), n'ont toujours pas été réalisés, si bien que la Commission européenne a ouvert devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) un recours en manquement à l'encontre de la France sur ce motif.
Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple topique : l'aéroport de Paris-Orly. Ce dernier est soumis à 4 instruments de cartographies différents : plan d'exposition au bruit (PEB), plan de gênes sonores (PGS), CBS et PPBE. La complexité ne se réduit pas à cette démultiplication des outils ; elle tient aussi à la pluralité des acteurs chargés de les utiliser. À cet égard, l'aéroport d'Orly est à lui seul soumis à 3 PPBE : celui de la Métropole du Grand Paris, celui du conseil départemental du Val-de-Marne, et enfin, celui qui est réalisé par l'aéroport lui-même. Or, comme vous pouvez vous en douter, les objectifs et orientations de ces PPBE diffèrent les uns des autres. Cet exemple illustre l'inefficacité de notre système de lutte contre les pollutions sonores.
Rationaliser l'élaboration des PPBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit, plutôt qu'un simple outil de reporting européen, constitue donc un impératif.
J'en viens désormais à la question des indicateurs, très technique, mais centrale pour promouvoir une politique publique de lutte contre le bruit efficace.
Actuellement, les réglementations française et européenne utilisent des indicateurs énergétiques qui mesurent un niveau moyen de bruit annualisé.
Cette méthode, adaptée pour mesurer la gêne liée au transport routier, se fonde sur une logique linéaire. Moins opérationnelle pour le transport ferroviaire et aérien, elle présente l'inconvénient de lisser les pics de forte intensité entrecoupés de silences. Pourtant, ces bruits sont gênants la nuit : ils perturbent la qualité du sommeil et méritent donc d'être pris en compte. Cette approche est en décalage manifeste avec la gêne ressentie par les riverains. À titre d'exemple, une voie ferroviaire comptant moins de 50 trains par jour n'est pas considérée comme une installation bruyante. Les voisins d'une ligne à grande vitesse (LGV) ont du mal à l'accepter !
La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite « LOM », a prévu, pour mesurer le bruit ferroviaire, le recours à des indicateurs dits « événementiels », qui prennent en compte l'intensité et le nombre d'événements sonores : ils permettent d'éviter d'appréhender de la même façon un bruit moyen et durable et des pics de bruit répétés. Cet instrument est testé depuis 2022 pour le transport ferroviaire. Le transport aérien fait l'objet d'une démarche analogue depuis 2023. Pour l'heure, ces tests n'ont pas encore permis la définition d'indicateurs fiables en raison de difficultés techniques rencontrées. Il nous paraît indispensable que la volonté du législateur soit respectée : il faut appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités, six ans après son entrée en vigueur, avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels.
En outre, d'un point de vue sanitaire, un indicateur est considéré comme performant s'il est bien corrélé avec les effets du bruit sur la santé. Toutefois, aucune étude n'a, à ce stade, été menée pour démontrer la supériorité des indicateurs événementiels sur les indicateurs énergétiques pour quantifier les effets du bruit sur la santé. Réaliser des études de santé publique afin d'évaluer leur rôle dans l'explication des effets du bruit sur la santé nous paraît donc indispensable.
En outre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini en 2018 des seuils au-delà desquels l'exposition au bruit des transports est nocive pour la santé. Les plafonds définis dans la réglementation française sont moins disant par rapport aux indicateurs internationaux. Cet écart entre notre droit et les recommandations de l'OMS est peu satisfaisant.
Cependant, l'application stricte de ces exigences aux nouveaux projets d'infrastructures de transport semble difficile à envisager dans l'immédiat, au risque d'empêcher l'achèvement de projets indispensables au report modal et au respect de nos engagements climatiques.
Ce principe de réalité ne doit pas, pour autant, justifier l'inaction réglementaire. Si la définition de nouveaux seuils réglementaires à brève échéance alignés sur ceux qui ont été établis par l'OMS n'est pas encore possible, des études d'impact pourraient amorcer des évolutions souhaitables de la réglementation. Dans un souci de pragmatisme, ces modifications pourraient s'appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications significatives des infrastructures existantes.
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - J'en viens maintenant aux politiques publiques de lutte contre la pollution sonore liée aux transports.
Notre constat est sévère : le bruit demeure un angle mort des politiques publiques de prévention des risques et souffre en particulier d'un manque de pilotage.
La prévention de l'exposition des populations au bruit des transports implique une dizaine d'administrations et opérateurs de l'État. La mission du bruit et agents physiques, rattachée à la direction générale de la prévention des risques (DGPR), assure le pilotage et la coordination de tous ces acteurs. Les moyens humains qui lui sont alloués sont modestes : trois agents en équivalent temps plein (ETP). Eu égard à la diversité des actions de lutte contre le bruit, à la technicité des enjeux, et au nombre d'acteurs en présence, cette cellule ne semble pas suffisamment calibrée et donc armée pour s'acquitter de sa mission stratégique de pilotage dans de bonnes conditions.
En outre, le ministère de la santé, que nous avons entendu dans le cadre de nos travaux préparatoires, dispose de peu de compétences en matière de lutte contre la pollution sonore. L'évolution des effets sanitaires, tant auditifs qu'extra-auditifs, du bruit à l'échelle de la population est mal connue, faute de marqueurs sanitaires suivis par un dispositif de surveillance des effets sanitaires du bruit. Alors que nous connaissons avec précision les effets de la pollution de l'air, nous agissons à l'aveuglette pour lutter contre la pollution sonore. Dans ce contexte, il pourrait être pertinent de confier à Santé publique France la mission de définir des indicateurs permettant de suivre, à l'échelle de la population, les conséquences sanitaires du bruit. Cet acteur pourrait ainsi mesurer plus précisément le coût social du bruit, estimé à environ 150 milliards d'euros par an, ainsi que les effets des politiques de lutte contre le bruit, dont le coût pour les mobilités est estimé à 100 milliards d'euros.
À l'échelle des territoires, la gouvernance de la prévention du bruit est également complexe : elle implique de nombreux acteurs locaux dans les collectivités territoriales (conseils régionaux et départementaux, communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)) et les administrations déconcentrées - préfectures départementales et régionales, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), directions départementales des territoires. Un observatoire régional du bruit fédérant ces acteurs n'existe que dans deux régions : en Île-de-France, avec Bruitparif, et en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Acoucité, l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon.
Le bruit est un sujet éminemment technique - nous avons pu le mesurer au fil des auditions -, à forts enjeux scientifiques et juridiques. La dispersion des compétences engendrée par une gouvernance aussi éclatée limite les capacités d'action des acteurs publics.
Un regroupement des moyens humains des services déconcentrés de l'État à l'échelle régionale et un renforcement de leur coordination avec les collectivités territoriales serait souhaitable. Cette mise en commun des compétences permettrait d'en éviter l'émiettement, source d'une perte d'efficience de l'action.
Par-delà ces questions de gouvernance, la politique de protection des Français les plus exposés au bruit est insuffisante.
Les zones les plus exposées au bruit des transports terrestres sont appelées points noirs de bruit (PNB).
Depuis 1984, puis au début des années 2000 et en 2009, des plans visant à les résorber en isolant les logements ou en modernisant les infrastructures de transports ont été déployés. Les moyens budgétaires n'ont pas été suffisamment mobilisés, ainsi qu'en atteste la diminution progressive des crédits consacrés à la résorption des PNB, principale cause de l'échec des politiques en la matière.
Ainsi, en 2017, sur 53 000 PNB ferroviaires, SNCF Réseau en a traité seulement 2 200. Quant aux axes routiers, on estimait alors à 850 000 les logements situés sur un PNB routier à protéger. Par comparaison, le plan Bruit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) mené entre 2009 et 2015 a permis de protéger 3 324 logements. On dénombrerait aujourd'hui près de 900 000 PNB liés aux transports terrestres selon le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), mais le rythme atone du traitement de ce stock ne permet pas, à ce stade, d'envisager une amélioration substantielle de la situation.
De surcroît, les pouvoirs publics ne disposent pas d'une base de données identifiant finement l'ensemble des PNB - les demandes que j'ai adressées au préfet de mon département sont restées lettre morte. Un recensement est donc urgent, car il constitue un préalable à la définition d'un plan national de traitement en vue de financer presque intégralement les travaux pour les riverains. Un tel plan répondrait à un impératif de santé environnementale, en application du principe « pollueur-payeur ».
M. Gilbert-Luc Devinaz, rapporteur. -Le transport routier est le premier pourvoyeur de bruit causé par les transports. Deux modes de transports routiers sont particulièrement émetteurs de bruits : les deux-roues motorisés (2RM) et les poids lourds. Des radars sonores ont été déployés depuis la LOM de 2019 dans plusieurs territoires, notamment à Paris, dans le cadre d'une expérimentation pilotée par la DGPR. Le constat est sévère : rue d'Avron, dans le XXe arrondissement de Paris, 166 véhicules en moyenne par jour dépassent les 83 décibels. Or, à partir de 80 décibels, la durée d'exposition à la source de bruit devient un facteur important de risque.
Par ailleurs, il nous paraît fondamental d'agir pour réduire les pollutions sonores nocturnes, dont les effets sur la santé sont les plus importants. Il semble pertinent de faire confiance à l'intelligence des territoires et de placer les maires au coeur de la décision. Les autorités chargées de la voirie pourraient être autorisées à agir pour abaisser les vitesses de circulation la nuit en vue de protéger le sommeil et la santé des populations.
J'en viens maintenant au transport aérien.
La persistance de l'exposition de populations au bruit aérien, en particulier nocturne, nécessite d'envisager une extension des mesures de lutte contre la pollution sonore aérienne, notamment au travers de mesures de restriction d'exploitation comme des couvre-feux.
Ces mesures doivent toutefois être proportionnées : il est indispensable de prendre en compte leurs conséquences économiques et sociales éventuelles. Certains aéroports se trouvent à proximité immédiate de zones densément urbanisées, notamment Toulouse-Blagnac, Nantes Atlantique et Paris-Orly, et exigent une attention particulière. Didier Mandelli a déjà proposé des évolutions du couvre-feu pour l'aéroport Nantes Atlantique. Le président Gérard Larcher a également mis en avant la nécessité d'avancer d'une demi-heure le couvre-feu instauré à l'aéroport de Paris-Orly. Nous partageons tous deux ces propositions.
Enfin, en dépit de niveaux de bruit parfois particulièrement élevés auxquels sont soumis les riverains d'aérodromes de loisir ou d'entraînement, leurs activités sont faiblement encadrées - voire pas du tout. Nous vous proposons donc de mieux les encadrer en confiant au maire la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes. Là encore, faisons confiance aux élus locaux, qui connaissent leur territoire !
M. Stéphane Demilly. - Merci pour cette présentation. J'aurai trois questions à vous poser.
La première porte sur le Conseil national du bruit (CNB), créé en 1982 et placé sous la responsabilité du ministère de l'environnement. Je m'interroge sur son utilité concrète, car il ne fait pas beaucoup de bruit... L'avez-vous contacté ?
La deuxième question concerne la sensibilité aux bruits du quotidien dans les transports. J'y suis moi-même très sensible, notamment aux nuisances nocturnes : klaxons intempestifs, véhicules aux fenêtres ouvertes, ou encore boosters pétaradants qui gênent les riverains. J'ai le sentiment que nous accumulons les rapports, mais que nos politiques publiques ne sont pas très courageuses. Avez-vous échangé avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) sur le développement des radars sonores, ces outils déjà installés dans certaines villes ? Au-delà de la sensibilisation, la répression est nécessaire. Pour ce faire, des contraventions ciblées pourraient avoir un réel effet dissuasif. Avez-vous exploré cet aspect ?
La troisième et dernière question a trait au transport aérien, qui suscite une forte attention dans les zones aéroportuaires. Ce secteur, je l'ai déjà dit ici, a entrepris depuis plusieurs années d'importants efforts : recherche sur des moteurs plus silencieux ; renouvellement progressif des flottes par les compagnies aériennes et respect des normes acoustiques internationales.
En tant que rapporteur budgétaire sur les crédits alloués au transport aérien, je souligne le rôle fondamental de l'Acnusa, acteur clé de la médiation entre autorités, opérateurs et usagers, notamment pour veiller au respect des normes de sécurité. D'ailleurs, avec Vincent Capo-Canellas, nous recevrons tout à l'heure cette autorité dans le cadre du groupe d'études Aviation civile. Comme chaque année, il conviendra d'être particulièrement attentif aux moyens qui lui sont alloués, tant elle est essentielle pour répondre aux défis croissants du transport aérien. Partagez-vous mon sentiment quant à l'importance de son rôle ?
Mme Nicole Bonnefoy. - À mon tour, je tiens à remercier nos rapporteurs, en saluant la qualité de leur travail et les recommandations qu'ils formulent.
Vous qualifiez le bruit de véritable pollution, et ce à juste titre. J'espère que notre réglementation et notre législation progresseront en conséquence. Le bruit a, en particulier, de graves effets sur la santé humaine.
Notre ancienne collègue Nelly Tocqueville avait beaucoup travaillé sur une question connexe, celle de la pollution de l'air. Louis-Jean de Nicolaÿ et moi-même avons, pour notre part, traité du bruit provoqué par la LGV Sud-Europe-Atlantique (SEA) : nous avons obtenu, par voie d'amendement, la modification du référentiel de mesures, notamment afin que l'on adapte la vitesse des trains.
Pour limiter les différentes pollutions provoquées par les poids lourds, parmi lesquelles la pollution sonore, il faut, selon vous, faire confiance aux élus locaux.
Ce problème est particulièrement préoccupant dans mon département. En certains points de l'agglomération d'Angoulême, traversée par la route nationale 10 (RN10), le bruit est absolument insupportable.
J'insiste, à cet égard, sur le trafic de transit. Certains poids lourds traversant mon département quittent l'autoroute pour prendre une route nationale, voire départementale, afin d'économiser quelques euros de péage, ce qui nuit gravement à la qualité de vie des riverains et endommage la chaussée aux frais des contribuables.
L'interdiction de traverser les agglomérations la nuit aurait déjà des effets considérables. Une telle mesure, qui ne coûte pas d'argent et relève tout simplement du bon sens, permettrait de réduire de 40 % le trafic de poids lourds en transit sur les axes considérés. J'ai défendu cette solution auprès du ministre chargé des transports.
Ces poids lourds n'ont pas leur place sur les routes nationales et départementales. Il faut faire en sorte qu'ils circulent sur des voies qui leur sont destinées. La situation actuelle est absolument insupportable, qu'il s'agisse du bruit ou de la pollution atmosphérique.
M. Pierre Jean Rochette. - En matière de transport routier, nous devons tenir compte des évolutions technologiques. À l'évidence, il faut aller vers le poids lourd électrique, d'autant que le poids lourd thermique est la source principale d'émission de bruit. Telle doit être, à mon sens, notre ligne nationale.
Vous suggérez de donner aux maires le pouvoir de fixer le niveau de bruit toléré sur les aérodromes. De manière générale, il faut bien sûr renforcer les prérogatives des maires, notamment en matière de police. Néanmoins, je me méfie de la tendance de notre pays à réglementer à outrance : il ne faudrait pas aboutir à une surenchère de propositions coercitives à l'occasion des élections municipales.
Je pense à l'aérodrome de Villefranche-Tarare : des restrictions excessives y seraient d'autant plus dommageables que ce lieu est en partie dédié à la formation des pilotes.
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. - Monsieur Demilly, le CNB est sans président depuis le dernier renouvellement de l'Assemblée nationale. Il s'agit, du reste, d'une instance essentiellement consultative et non décisionnaire. Nous n'avons donc pas entendu de représentant du CNB.
Vous évoquiez la réduction du bruit provoqué par les différents moyens de transport. Pour assurer des verbalisations, nous proposons la généralisation des radars sonores. De même, nous suggérons de mieux encadrer la vente des pots d'échappement non homologués.
Quant aux pics de bruit constatés sur les LGV, ils suscitent de fortes attentes. Il faut faire évoluer la législation.
Madame Bonnefoy, nous insistons dans notre rapport sur la nécessité de traiter les points noirs de bruit, en mettant en oeuvre le principe du pollueur-payeur. Les transporteurs provoquant des nuisances doivent apporter des réponses aux riverains.
M. Gilbert-Luc Devinaz, rapporteur. - Monsieur Demilly, soyons clairs : à l'heure actuelle, le CNB demeure une coquille vide. Il s'agit à l'évidence d'une lacune du dispositif, d'autant qu'à ce jour nombre de ministères sont chargés de la question du bruit. On peine à s'orienter dans cette forêt de pouvoirs publics.
Outre le voisinage et les transports, les terrasses peuvent être une grande source de nuisances sonores. Ces différents bruits du quotidien mériteraient sans doute une mission à part entière, en tout cas pour ce qui concerne les zones urbaines. Des radars mesurant le bruit sont en train d'être expérimentés ; ils finiront tôt ou tard par être mis au point. Il faudra alors les faire accepter, mais ils peuvent offrir une solution en ville.
L'aérien constitue un sujet à part entière. La commission devrait, à mon sens, prolonger ses réflexions sur le rôle et les prérogatives dévolues à l'Acnusa. En particulier, il semblerait légitime d'envisager l'extension de son champ de compétence aux aérodromes voire à d'autres modes de transport. Je précise que les aérodromes ne font l'objet, à ce jour, d'aucune réglementation en la matière. Le but est de traiter le problème du bruit dans sa globalité, donc d'assurer la cohérence de nos politiques publiques.
Madame Bonnefoy, le problème que vous mentionnez tient pour partie aux dispositifs de téléguidage et aux itinéraires bis qu'ils proposent. Au-delà des restrictions de circulation, il faut trouver des solutions dans le respect du principe de libre circulation des personnes et des marchandises.
Monsieur Rochette, en deçà de 50 kilomètres à l'heure, on entend le bruit du moteur : au-delà, c'est le bruit du roulement que l'on entend. Le passage au moteur électrique ne résoudra donc pas tous les problèmes de bruit.
Il faut faire en sorte que le pneumatique émette moins de bruit au contact. En parallèle, on peut adopter un revêtement moins bruyant sur les routes ; mais ce dernier coûte un peu plus cher et est davantage adapté aux routes en milieu urbain.
M. Jacques Fernique. - Merci de votre travail et de la pertinence de vos recommandations. Vous proposez, à juste titre, d'aligner nos seuils réglementaires sur ceux de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Vous voulez, en outre, remettre de la cohérence dans la « forêt des pouvoirs publics » chargés de lutter contre le bruit, ce qui est bel et bien nécessaire. Vous voulez assurer, via les documents d'urbanisme, la prise en compte des bruits provoqués par les transports terrestres. Vous insistez, de surcroît, sur l'effort de rénovation thermique et acoustique en proposant un diagnostic bruit en cas de cession ou de location d'un bien immobilier.
De même, j'approuve le renforcement du pouvoir de police des maires et le regroupement, à l'échelle régionale, des moyens humains et techniques de lutte contre le bruit.
Cela étant, je m'interroge sur la proposition relative au bruit solidien et aux basses fréquences sonores. Pouvez-vous nous apporter des précisions à cet égard ?
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. - Étant a priori chargé de représenter le Sénat au CNB, à la suite de Marta de Cidrac, je ne manquerai pas de tenir notre commission informée des travaux de cette instance. Jusqu'à présent, le CNB a des airs de belle endormie, mais elle semble se réveiller tranquillement - sans bruit !
Je reviens sur les indicateurs de trajet. Ne faut-il pas mener un travail avec les entreprises proposant ces outils afin qu'ils précisent les itinéraires que les poids lourds doivent privilégier ?
Enfin, compte tenu des restrictions de circulation appliquées en région parisienne le dimanche jusqu'à minuit, voire jusqu'au lundi matin, les poids lourds s'accumulent sur les routes nationales, ce qui complique la circulation dans la région du Mans. Je pense en particulier à l'ex-route nationale 23.
M. Jean-François Longeot, président. - Le report de trafic vers les axes secondaires s'observe également dans nombre de villages du Doubs, traversés par la route nationale 83 (RN83). Mon collègue député Laurent Croizier s'est saisi du sujet ; à cet égard, il faut bel et bien se pencher sur les indicateurs de trajet.
M. Olivier Jacquin. - Lors d'un voyage au Japon, il y a quelques années de cela, j'ai été frappé du calme qui règne à Tokyo. À l'évidence, la réduction du bruit relève en bonne partie du civisme. La dimension culturelle du sujet ne doit pas être négligée.
Je salue l'important travail accompli par nos collègues. En particulier, j'approuve la volonté de traiter le bruit des transports routiers aussi rigoureusement que les nuisances sonores imputables aux transports aériens. En ce sens, la proposition n° 16 m'étonne quelque peu : pour moi, les pots d'échappement hurlants sont un irritant considérable. Puisque ces équipements émettent trop de décibels, au point de ne pouvoir être homologués, pourquoi ne pas les interdire purement et simplement ?
M. Pierre Jean Rochette. - Si tant de poids lourds circulent sur les routes nationales, c'est pour ne pas payer de péage : dès lors, la solution n'est-elle pas l'écotaxe ? Il me semble que nous sommes en train de rouvrir le débat.
Je tiens à revenir sur les transports par hélicoptère. Un certain nombre d'activités hôtelières et touristiques ont besoin d'hélisurfaces. Je l'observe dans les Alpes comme dans le Beaujolais. Or, aujourd'hui, la création d'une hélisurface est autorisée par le préfet sans consultation du maire. À mon sens, il faut revoir la procédure en vigueur pour donner davantage de poids à celui-ci.
Mme Nicole Bonnefoy. - En cas d'accident sur une route nationale, on dévie aussitôt le trafic vers l'autoroute. Il faut pouvoir, dans d'autres cas, orienter le trafic vers les axes autoroutiers.
M. Gilbert-Luc Devinaz, rapporteur. - Monsieur Fernique, le bruit solidien est le bruit causé par les vibrations - on peut penser aux vibrations provoquées, à Paris, par le passage du métro. Les LGV émettent quant à elle des bruits à basses fréquences.
Monsieur de Nicolaÿ, vous soulevez le problème des assistants de navigation utilisés par les automobilistes. Lorsque ces services sont apparus, je travaillais pour Bison Futé et mes collègues techniciens et ingénieurs avaient tout de suite anticipé les problèmes qu'ils entraîneraient. Certaines plateformes ne tiennent pas du tout compte des interdictions de passage en fonction, par exemple, du tonnage.
Vous avez raison, un travail doit être mené pour mettre en place une réglementation spécifique.
Monsieur Jacquin, il me semble que l'usage de pots d'échappement non homologués n'est autorisé que sur circuit et en compétition. À part cette exception, l'usage de ce type de pots d'échappement est déjà interdit sur la voie publique. Il s'agit simplement de faire respecter la règle.
Selon des estimations mentionnées dans le rapport d'information qui sera publié prochainement, les coûts sanitaires non marchands liés aux bruits s'élèveraient à 82 milliards d'euros et le coût de la mortalité prématurée lié aux maladies cardiovasculaires serait de près de 10 milliards d'euros. Le Cerema estime pour sa part à 57 milliards d'euros le coût sanitaire des nuisances sonores. En tout état de cause, le bruit coûterait donc entre 57 milliards et 92 milliards d'euros par an.
Compte tenu de ce chiffre, les moyens consacrés à la lutte contre le bruit sont non pas une dépense, mais un investissement pour la santé de l'ensemble de nos concitoyens.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information à l'unanimité et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 5 mars 2025
- Table ronde Association de défense contre les nuisances aériennes (ADVOCNAR) et Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) : Mmes Dominique LAZARSKI, vice-présidente de l'ADVOCNAR, Françoise BROCHOT, présidente de l'ADVOCNAR et administratrice de UFCNA, MM. François WOLF, vice-président de l'UFCNA et Luc OFFENSTEIN, administrateur de UFCNA et président de OYE 349.
- Table ronde Chutt.org et Collectif anti nuisances environnement (CAN) : MM. Pierre GALLOUIN, président de l'association septèmoise pour la réduction des nuisances de l'autoroute, Eric PARIS, délégué médiatisation, porte-parole de Chutt et Stéphane COPPEY, délégué juridique FNE 13, aux transports et à la mobilité.
- Association Anti-bruit de Voisinage (Aabv) : Mme Anne LAHAYE, présidente et M. Michel RICARD, membre du Conseil d'Administration.
Mercredi 12 mars 2025
- Acoucité : M. Bruno VINCENT, directeur honoraire, conseiller scientifique stratégique du Conseil national du bruit, membre collège ACNUSA et Mme Valérie JANILLON, directrice.
Mercredi 19 mars 2025
- Autorité environnementale : M. Laurent MICHEL, directeur général et Mme Caroll GARDET, rapporteure.
- France Nature Environnement : Mme Geneviève LAFERRERE, pilote du réseau « Territoires-Mobilités Durables » et M. Claude CARSAC, membre du réseau santé-environnement.
Mercredi 26 mars 2025
- Table ronde 40 millions d'automobilistes, Fédération nationale des transports routiers (FNTR) et Automobile Club de France (ACF)
. 40 millions d'automobilistes : M. Pierre CHASSERAY, délégué général
. FNTR : M. Erwan CELERIER, délégué aux affaires techniques environnement et innovation et Mme Pauline MARTIN, secrétaire générale FNTR Ile-de-France
. ACF : MM. Yann DE PONTBRIAND, président, Nicolas DUBAN, vice-président et président de la commission de l'automobile et Emmanuel PIAT, directeur patrimoine historique et automobile
- Assemblée des départements de France (Adf) : Mme Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental de l'Oise.
- Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) : MM. Christophe BOUTIN, délégué général, Cédric HEURTEBISE, responsable de l'expertise environnementale et Nicolas MORONVAL, chef de département transition écologique, innovation et développement.
Jeudi 27 mars 2025
- Michelin : Mme Armelle BALVAY, chargée des affaires publiques France, MM. Jérôme BARRAND, chef des normes et règlement et Romain BENTZ, Directeur déléguée Affaires publiques France.
- Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Sébastien BERCOT, mandataire technique en acoustique, Mmes Nadège LARRIGAUDIERE, ingénieur qualité construction prévention des risques et Léa LIGNÈRES, chargée d'études.
- Ministère de la transition écologique et solidaire - Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités : Mme Nirina DELAGUILLAUME, adjointe au chef du bureau du développement du réseau ferroviaire et des actions transverses, MM. Jérôme AUDHUI, sous-directeur de la stratégie d'aménagement et de modernisation du réseau routier national et Nicolas BINA, conseiller élus et communication.
- Table ronde SNCF Réseau et Société des grands projets (SGP)
. SNCF Réseau : MM. Benoit CHEVALIER, directeur délégué à la stratégie du réseau, Jean-Philippe REGAIRAZ, responsable pôle acoustique et vibrations et Mme Laurence NION, conseillère parlementaire du Groupe SNCF, direction des affaires publiques, direction des relations extérieures de la SNCF
. SGP : MM. Frédéric WILLEMIN, directeur adjoint de la stratégie de l'environnement et de l'innovation et Etienne PIOUHEE, directeur adjoint de la stratégie de l'environnement et de l'innovation
- Table ronde SNCF Voyageurs et Association française du rail (AFRA)
. SNCF Voyageurs : MM. Xavier OUIN, directeur industriel, directeur du matériel, Franck POISSON, responsable du pôle NEO, expert scientifique et technique en acoustique, ingénierie du matériel et Mme Laurence NION, conseillère parlementaire du Groupe SNCF, direction des affaires publiques, direction des relations extérieures de la SNCF
. AFRA : M. Alexandre GALLO, vice-président (PDG Euro Cargo Rail), Mme Solène GARCIN-BERSON, déléguée générale et M. Claude STEINMETZ, vice-président AFRA et président Transdev Rail
Mardi 1er avril 2025
- Fédération des industries ferroviaires (FIF) : MM. Patrick JEANTET, président et Jean-Jacques MOGORO, directeur du pôle industrie.
Mercredi 2 avril 2025
- Ministère de la santé et de l'accès aux soins : MM. Yannick NEUDER, ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins et Dinh Phong NGUYEN, conseiller.
- Table ronde Groupe des autorités responsables de transport (GART), Ile-de-France Mobilités (IDFM) et Régions de France
. GART : MM. Alexandre MAGNY, directeur général et Benoît CHAUVIN, directeur innovation et transitions
. IDFM : M. Grégoire DE LASTEYRIE, président et vice-président de la région IDF chargé des transports et vice-président IDFM, Mmes Ludivine DANIEL-DIT-ANDRIEU, chef du département management de projet et expertises au sein de la direction infrastructures, Zélia HAMPIKIAN, chargée de projet mise en oeuvre du plan des déplacements urbains d'Ile-de-France (PDUIF) au sein de la direction prospective et études et M. Martin GABRIEL, conseiller spécial à la direction de la stratégie, du Grand Paris, relations avec les territoires et les voyageurs
- RATP : M. Thomas HARTOG, directeur des affaires publiques et Mme Corinne FILLOL, responsable du pôle d'ingénierie et de recherche en acoustique et vibrations.
Mardi 8 avril 2025
- Alstom : MM. Pierre FLEURY, directeur Technique Groupe Alstom, Nezam SANEI, expert senior Vibroacoustic et Damien CABARRUS, responsable des affaires publiques.
Mercredi 9 avril 2025
- Direction générale de l'aviation civile (DGAC) : M. Kévin GUITTET, sous-directeur des études, des statistiques et de la prospective à la direction du transport aérien.
- Table ronde Union des aéroports français (UAF), Fédération de l'aviation et de ses métiers (FNAM), Aéroports de Paris (ADP) et Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas)
. UAF : MM. Nicolas PAULISSEN, délégué général et Rafael COSTA, responsable développement durable
. FNAM : MM. Laurent TIMSIT, délégué général et Cyril BEUCHET, responsable pôle technique et développement durable
. ADP : MM. Mathieu CUIP, directeur des affaires publiques et Paul BEYOU, responsable des affaires publiques nationales
. GIFAS : MM. Baptiste VOILLEQUIN, directeur recherche et développement-Espace et Environnement et Jérôme JEAN, directeur des affaires publiques
- Commission nationale du débat public : M. Marc PAPINUTTI, président.
Jeudi 10 avril 2025
- BruitParif : M. Olivier BLOND, président et délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air à la Région Île-de-France et Mme Fanny MIETLICKI, directrice.
- Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) : MM. Pierre MONZANI, président et Romain BARBEAU, expert acoustique.
- Table ronde Centre d'information sur le bruit (CIBD) et Société française d'acoustique (SFA)
. CIBD : M. Gaëtan FOUILHOUX, président
. SFA : Mme Catherine MARQUIS FAVRE, chercheuse au Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes de Lyon
- Table ronde Cerema, Université Gustave Eiffel, Groupement de ingénierie acoustique (Cinov Giac)
. Cerema : M. David ZAMBON, directeur infrastructures de transport et matériaux et Mme Sophie CAROU, directrice adjointe du département gestion intégrée de patrimoine d'infrastructure et responsable d'activité réduction des nuisances
. Université Gustave Eiffel : Mme Chrystèle PHILIPPS-BERTIN, chargée de recherche
. Cinov Giac : MM. Eric GAUCHER, vice-président et Nicolas LOUNIS, acousticien
- Direction générale de la prévention des risques (DGPR) : MM. Philippe BODENEZ, chef de service santé environnement économie circulaire et Christophe LAGORCE, chef de la mission bruit et agents physiques.
- Cour des comptes européenne : M. Emmanuel RAUCH, manager principal à la Chambre 1 - Utilisation durable des ressources naturelles.
Mercredi 30 avril 2025
- Table ronde Mairie de Ramatuelle et Mairie de Villeneuve-le-Roi : MM. Didier GONZALES, Maire de Villeneuve-le-Roi, Michel FRANCO, maire-adjoint et membre au sein du conseil municipal du groupe « Transition écologique » et Guy MARTIN, directeur de cabinet, à la mairie de Ramatuelle.
DÉPLACEMENT
Déplacement au Laboratoire national de
métrologie et d'essais (LNE)
à Trappes pour assister à
la phase de test des radars sonores routiers
Jeudi 3 avril 2025
Échanges avec les équipes du LNE à propos des enjeux techniques rencontrés dans le cadre du processus de certification des radars sonores routiers, qui a pour rôle de vérifier leur fiabilité en toutes circonstances.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES PRINCIPALES PROPOSITIONS
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
2 |
Rationaliser l'élaboration des PBBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen |
Infrastructures de transports et acteurs locaux |
Bonnes pratiques |
|
|
4 |
Prendre en compte le bruit émis par les transports terrestres dans les documents d'urbanisme au même titre que le bruit aérien |
Ministère de la transition écologique et DGPR |
Projet de loi de finances pour 2026 et circulaires |
|
|
5 |
Appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique |
État et collectivités territoriales |
Règlement et circulaire |
|
|
7 |
Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité |
Collectivités territoriales et infrastructures du transport |
Bonnes pratiques et réunion entre acteurs concernés |
|
|
8 |
Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit |
État, DGPR et Cerema |
Projet de loi de finances pour 2026, règlements et circulaires |
|
|
9 |
Regrouper à l'échelle régionale les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit |
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Agence nationale de la recherche (ANR) |
Instructions et appels à projets |
|
|
10 |
Lancer un plan de résorption des PNB, à partir d'une cartographie préalable des zones concernées, par redéploiement de financements budgétaires, et d'une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation |
État, DGPR et Cerema |
Loi et règlement |
|
|
14 |
Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée |
État |
Loi, règlement et circulaire |
|
|
15 |
Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule |
État |
Règlement et circulaire |
|
|
20 |
Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées |
État et Acnusa |
Loi et règlement |
|
|
22 |
Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes |
Collectivités territoriales et DGAC |
Arrêté et circulaire |
ANNEXE - LÉGISLATION COMPARÉE - NOTE
LES NUISANCES
SONORES
CAUSÉES PAR LES TRANSPORTS
À la demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la division de la Législation comparée a effectué des recherches sur la thématique des nuisances sonores causées par les transports et le respect de la législation européenne en la matière.
La présente note aborde successivement les procédures d'infraction en cours à la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit (directive 2002/49/CE), les réglementations nationales contre le bruit causé par les transports (Allemagne, Espagne, Grèce et Suisse) ainsi que la réglementation du contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues (Allemagne, Espagne, Italie et Suisse)58(*).
1. État des lieux des procédures d'infraction en cours à la directive européenne sur le bruit (directive 2002/49/CE)
Afin de mettre en oeuvre l'objectif de pollution zéro, le législateur européen a introduit plusieurs mesures dans la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement59(*). Aussi les États membres doivent-ils notamment établir des « cartes de bruit stratégiques »60(*) déterminant l'exposition au bruit dans l'environnement, les réexaminer et, le cas échéant, les réviser tous les cinq ans (article 7). Ces cartes doivent présenter des données précises visées au point 1 de l'annexe IV, notamment le dépassement d'une valeur limite d'émission sonore. En se fondant sur ces cartes, les États membres doivent ensuite adopter des plans d'action afin de prévenir ou réduire la pollution sonore lorsqu'elle atteint des niveaux pouvant entraîner des effets nuisibles sur la santé et l'environnement (article 8). Ces cartes de bruit stratégiques et plans d'action concernent les bruits résultant de l'activité dans les agglomérations, des axes routiers et ferroviaires et des aéroports.
En 2023, 25 États membres sont considérés par la Commission européenne comme ayant transposé convenablement la directive, ce qui représente 98 % de la population de l'Union européenne (UE)61(*). Toutefois, en raison de délais de transposition trop longs et de transpositions lacunaires, la Commission avait initié des procédures de recours en manquement à l'encontre de 15 États membres62(*) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Grâce à l'effort de certains États membres, la directive a ensuite été transposée avec une meilleure conformité, ce qui a permis la clôture de sept procédures de recours en manquement63(*) et des améliorations dans les transpositions en droit interne des huit autres États membres.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu trois arrêts64(*) en 2022 et en 2023 à l'encontre de la Slovaquie, du Portugal et de la Pologne, après avoir été saisie par la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive 2002/49/CE.
La présente note dresse un état des lieux plus détaillé de la situation concernant cinq États membres : l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, la Pologne et le Portugal.
État des lieux des procédures d'infraction dans cinq États membres
|
Procédures d'infraction |
Manquements à la directive 2002/49/CE reprochés |
En cours |
|
|
Allemagne |
29/09/2016 : Mise en demeure |
En 2016, défaut d'établissement de plans d'action pour les grands axes routiers. Depuis 2017, les plans d'action nécessaires ont été élaborés pour les agglomérations, les chemins de fer et les aéroports. Toutefois, 16 000 plans d'action pour les grands axes routiers font toujours défaut, d'où la mise en demeure complémentaire. |
Oui |
|
04/10/2017 : Avis motivé |
|||
|
13/03/2024 : Mise en demeure complémentaire |
|||
|
Espagne |
29/09/2016 : Mise en demeure |
La Commission a notifié une mise en demeure à l'Espagne en 2016 afin qu'elle établisse des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action pour des agglomérations et de grands axes routiers et ferroviaires. De plus, l'Espagne n'a ni réexaminé ni révisé les plans d'action existants pour les grands aéroports. Aussi, la Commission a émis un avis motivé en 2018. |
Oui |
|
19/07/2018 : Avis motivé |
|||
|
Grèce |
07/12/2017 : Mise en demeure |
La Grèce n'a pas adopté les cartes de bruit stratégiques et les plans d'actions nécessaires dans certaines agglomérations et pour certains grands axes routiers, d'où la mise en demeure de 2017 puis la mise en demeure complémentaire de 2020. Depuis, les seules évolutions positives concernent l'aéroport international d'Athènes ; pour le reste, les griefs sont toujours d'actualité, d'où l'avis motivé de 2023. Une mise en demeure complémentaire a été notifiée à la Grèce par la Commission en 2024 pour défaut de communication des certains éléments liés aux cartes de bruit stratégiques et plans d'action. |
Oui |
|
30/10/2020 : Mise en demeure complémentaire |
|||
|
19/04/2023 : Avis motivé |
|||
|
03/10/2024 : Mise en demeure |
|||
|
Pologne |
18/05/2017 : Mise en demeure |
Art. 8 § 1, 2 : plans d'action relatifs à 290 grands axes routiers et 20 grands axes ferroviaires non établis Annexe V, point 1, neuvième tiret : plans d'action incomplets Art. 10 § 2 : non-adoption de plans d'action et non-communication de leurs résumés à la Commission |
Non |
|
25/01/2019 : Avis motivé |
|||
|
28/09/2021 : Saisine de la CJUE |
|||
|
20/04/2023 : Arrêt de la CJUE |
|||
|
Portugal |
18/05/2017 : Mise en demeure |
Art. 7 § 2 al. 1 : cartes de bruit stratégiques non établies pour 5 grands axes routiers Art. 8 § 2 : plans d'action relatifs à deux agglomérations, 236 grands axes routiers et 55 grands axes ferroviaires non établis Art. 10 § 2 : non-communication des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d'action relatifs aux infrastructures mentionnées dans les deux points ci-dessus. |
Non |
|
20/07/2018 : Avis motivé |
|||
|
02/07/2020 : Saisine de la CJUE |
|||
|
31/03/2022 : Arrêt de la CJUE |
a) Allemagne
Depuis l'avis motivé d'octobre 2017, l'Allemagne a élaboré les plans d'action nécessaires pour les agglomérations, les chemins de fer et les aéroports. Toutefois, environ 16 000 plans d'action pour les grands axes routiers en dehors des agglomérations faisaient toujours défaut. Ainsi, la procédure d'infraction de l'article 258 TFUE est toujours ouverte et la Commission européenne est susceptible de notifier à l'Allemagne un nouvel avis motivé à l'issue de la mise en demeure complémentaire du 13 mars 2024.
La lettre de mise en demeure complémentaire adressée à l'Allemagne en mars 2024 ouvrait un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés.
Au 1er juin 2025, plusieurs Länder avaient adopté un plan d'action à l'échelle régionale concernant spécifiquement les grands axes routiers - comme par exemple, le Bade-Wurtemberg65(*), la Bavière66(*) et la Rhénanie du Nord-Palatinat67(*). Néanmoins, les recherches n'ont pas fait état d'un état des lieux consolidé au niveau fédéral des plans d'action à jour.
En ce qui concerne les grands axes ferroviaires, l'autorité fédérale des transports ferroviaires (Eisenbahn-Bundesamt) - autorité administrative indépendante relevant du ministère fédéral des transports - a publié en juillet 2024 un rapport à l'occasion du quatrième cycle quinquennal de réexamen et de révision des plans d'action, faisant état de l'élaboration de nouveaux plans d'action pour 16 000 kilomètres de voies ferroviaires supplémentaires alors même que ceux-ci étaient facultatifs du fait du faible impact sonore sur l'environnement des axes concernés68(*).
b) Espagne
En raison de manquements généraux aux principales exigences de la directive sur le bruit, la Commission européenne a mis en demeure en 2016 l'Espagne afin qu'elle établisse des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action pour un grand nombre d'agglomérations et de grands axes routiers et ferroviaires sur son territoire. La Commission reprochait également à l'Espagne de ne pas avoir réexaminé ni révisé les plans d'action existants pour les grands aéroports. La Commission européenne a également émis un avis motivé le 19 juillet 2018.
Les recherches n'ont pas permis d'établir si cette procédure d'infraction avait été formellement classée mais aucune suite n'a été donnée par la Commission européenne à ce jour69(*).
c) Grèce
La Grèce fait l'objet de deux procédures d'infraction concomitantes liées à des manquements aux obligations résultant de la directive sur le bruit.
D'une part, la Commission européenne reproche à la Grèce d'avoir manqué aux obligations d'adoption et de révision de plusieurs cartes de bruit (article 7 de la directive) et plans d'action (article 8 de la directive) pour diverses agglomérations et routes. En outre, certains plans et cartes adoptés ne répondent pas aux exigences minimales fixées par la directive (annexes IV et V de la directive) et ont été adoptés sans consultation du public en bonne et due forme. La Commission européenne a donc envoyé à la Grèce une mise en demeure en 2017, puis une mise en demeure complémentaire en 2020. Depuis, les seules évolutions positives concernent l'aéroport international d'Athènes ; pour le reste, les griefs sont toujours d'actualité, d'où l'avis motivé du 19 avril 202370(*). La Grèce disposait alors d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission européenne pourrait décider de saisir la CJUE.
D'autre part, la Grèce fait l'objet d'une seconde procédure d'infraction pour non-communication à la Commission européenne de toutes les informations pertinentes sur les cartes de bruit stratégiques (article 10 al. 2 de la directive), notamment l'exposition au bruit de la population puisque la réglementation grecque retient des seuils de niveau sonore de 70 Lden (Level Day Evening Night)71(*) et 60 Lnight (Level night)72(*), ce qui ne correspond pas aux standards minimaux de la directive dont la méthodologie est définie à l'annexe I. En conséquence, la Commission européenne lui a transmis une lettre de mise en demeure en octobre 202473(*) : la Grèce disposait d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements que la Commission a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.
d) Pologne
Les échanges entre la Commission européenne et la Pologne à propos d'une éventuelle infraction quant à la transposition de la directive 2002/49/CE en droit interne ont abouti en 2023, au terme d'une procédure précontentieuse puis contentieuse ayant duré six ans, à un arrêt rendu par la CJUE le 23 avril 2023 (affaire C- 602/21), par lequel la Cour a constaté que la Pologne avait manqué aux obligations lui incombant ; tous les griefs présentés par la Commission européenne ont ainsi été retenus74(*).
La Commission européenne reprochait à la Pologne de ne pas se soumettre aux exigences minimales contenues dans la directive et formulait à son égard trois griefs :
- une transposition incorrecte de l'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive en ne prévoyant pas l'adoption de plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites de bruit n'étaient pas dépassées ;
- une méconnaissance de l'annexe V, point 1, neuvième tiret en ne prévoyant pas que les plans d'action devaient inclure la description des mesures à prendre pour les cinq années à venir en vue de préserver les zones calmes ;
- un manquement à ses obligations faute d'avoir établi des plans d'action et communiqué des résumés de plans d'action concernant plusieurs grands axes ferroviaires et routiers du pays.
En ce qui concerne le premier grief, la Commission reprochait à la République de Pologne d'avoir transposé l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/49/CE de manière incomplète en prévoyant l'obligation d'adopter des plans d'action uniquement dans les zones dans lesquelles les valeurs limites de bruit dépassent les seuils minimaux. Dans son état antérieur à la loi du 30 août 2019, le droit polonais ne prévoyait en effet aucune obligation d'adopter des plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites n'étaient pas dépassées, alors que cette obligation s'applique quel que soit le niveau de bruit dans l'environnement. Aussi, le grief tiré de ce que la Pologne a manqué à ses obligations en estimant qu'elle n'était pas tenue d'adopter de plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites n'étaient pas dépassées dans les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2002/49/CE était fondé à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, et ce nonobstant le fait que le droit polonais se soit ultérieurement conformé aux dispositions litigieuses (par la loi du 30 août 2019) puisque la Cour juge les faits à la date d'expiration du délai qu'elle a fixé (c'est-à-dire le 25 mars 2019).
En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission européenne soutenait que la République de Pologne avait méconnu l'annexe V, point 1, neuvième tiret, de la directive 2002/49/CE, en ne prévoyant pas que les plans d'action devaient inclure la description des mesures à prendre pour les cinq années à venir en vue de préserver les zones calmes. Si la Pologne a finalement adopté des dispositions nationales prévoyant que les plans d'action incluent des mesures à mettre en oeuvre dans un délai de cinq ans et des mesures pluriannuelles en matière de lutte contre le bruit, ces dispositions sont issues de la loi du 30 août 2019. Elles sont ainsi postérieures au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission. Elles ne sauraient donc, en tout état de cause, être prises en compte par la Cour dans le cadre du recours. Il en va de même du règlement du ministre polonais chargé du climat et de l'environnement, du 26 juillet 2021, relatif au programme de protection de l'environnement contre le bruit précisant le contenu de ces programmes. Par conséquent, la Cour a accueilli le deuxième grief de la Commission et constaté que la Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe V, point 1, neuvième tiret, de la directive 2002/49/CE.
Enfin, dans son dernier grief, la Commission européenne reprochait à la Pologne de n'avoir pas adopté de plans d'action pour 13 grands axes ferroviaires et 247 grands axes routiers ainsi que de ne pas avoir adopté de présentation de résumés de plans d'action pour 13 grands axes ferroviaires et 263 grands axes routiers. À la défense de la Pologne, qui faisait valoir que ces grands axes ferroviaires et routiers concernés par le grief avaient été traités au sein de plans d'action relatifs à des agglomérations, la Cour a répondu que les plans d'action établis pour les grandes agglomérations ne peuvent tenir lieu de plans d'action pour les grands axes ferroviaires et routiers situés sur le territoire de ces dernières.
e) Portugal
Dans le cadre de l'évaluation de la transposition de la directive 2002/49/CE par le Portugal, la Commission européenne a relevé des manquements et a décidé d'entamer une procédure d'infraction : après une mise en demeure le 18 mai 2017, puis un avis motivé fixant une date limite de mise en conformité au 20 octobre 2018, la Commission, constatant une persévérance des manquements aux obligations, a saisi la CJUE en vertu de l'article 258 TFUE.
La Cour a rendu un arrêt Commission européenne contre République portugaise (affaire C- 687/20) le 31 mars 2022 concluant au fait que le Portugal avait manqué aux obligations lui incombant. Tous les griefs de la Commission ont ainsi été retenus, à savoir :
- une méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 1 en n'établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers ;
- les plans d'action relatifs à deux agglomérations, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires ;
- une méconnaissance de l'article 10, paragraphe 2 en ne communiquant pas à la Commission européenne les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les plans d'action mentionnés dans les deux points précédents.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'établir des plans d'action, la majorité des grands axes routiers et ferroviaires a fait l'objet d'un tel plan, mais ultérieurement à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé de la Commission (le 20 octobre 2018), de sorte que la Cour ne pouvait pas établir de non-lieu, conformément à sa jurisprudence constante.
Concernant certains axes routiers, le Portugal défendait l'absence d'établissement de plan d'action en raison du fait qu'il n'y avait pas de présence humaine aux abords de ces axes. La Cour a jugé que l'article 8, paragraphe 2, ne prévoit aucune exception à l'obligation d'établir de tels plans pour les grands axes routiers, ces axes étant définis, à l'article 3 n) de cette directive, comme visant les routes régionales, nationales ou internationales sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an. Ainsi l'absence de plans d'action pour les grands axes routiers en cause ne saurait-elle être justifiée par l'absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l'État membre concerné. En effet, si l'absence d'une population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l'État membre concerné peut conduire cet État membre à décider, dans le cadre de la marge d'appréciation que l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive lui confère, d'indiquer, dans le plan d'action concerné, qu'il n'y a pas d'actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir pour l'axe en cause, cela n'exclut pas le caractère nécessaire de l'élaboration d'un tel plan.
2. Les réglementations nationales contre le bruit causé par les transports
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conduit une étude scientifique à propos des effets de la nuisance sonore sur la santé75(*) et en a déduit, en conséquence, une série de recommandations afin de réduire le bruit en dessous de certains seuils. Le tableau ci-après présente les seuils définis par l'OMS pour l'Europe.
Seuils de bruit environnemental définis par l'OMS
|
Bruit durant la journée, |
Bruit durant la nuit (Lnight) |
|
|
Axes routiers |
53 |
45 |
|
Axes ferroviaires |
54 |
44 |
|
Axes aériens |
45 |
40 |
Source : OMS, Lignes directrices concernant le bruit environnemental pour la région européenne, 2018.
Les dispositions de la directive 2002/49/CE relative à la gestion du bruit dans l'environnement s'inspirent de cette étude mais envisagent des seuils plus hauts : ainsi l'obligation de l'article 10 selon laquelle les États membres doivent rapporter à la Commission les données relatives à l'exposition des personnes aux nuisances sonores ne vaut qu'à partir de 55 Lden et 50 Lnight76(*).
a) Allemagne
En Allemagne, c'est principalement la loi sur la lutte contre les pollutions atmosphériques, sonores et liées aux vibrations77(*) (Bundes-Immissionsschutzgesetz) qui transpose les obligations prévues par la directive 2002/49/CE, notamment dans sa partie 6 relative à la planification sur la réduction du bruit. On y retrouve notamment l'obligation pour les Länder, en collaboration avec les communes (Gemeinde), d'établir des cartes de bruit stratégiques78(*). À cet égard, la loi dispose que ces cartes doivent respecter les exigences minimales prévues à l'annexe IV de la directive et transmettre à la Commission européenne les données visées à l'annexe VI de la directive - ces deux annexes renvoient aux seuils d'exposition des personnes aux pollutions sonores.
Le décret d'application de cette loi79(*) précise en son article 4 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques que celles-ci doivent reproduire graphiquement la situation sonore à l'aide de bandes isophones à partir de 55 Lden et 50 Lnight. Le droit allemand reprend donc à l'identique les standards prévus par le droit de l'UE et non ceux issus des recommandations de l'OMS.
b) Espagne
En Espagne, la législation contre la pollution sonore résulte principalement d'une loi de 200380(*), transposant la directive 2002/49/CE en droit interne. On y retrouve notamment les dispositions relatives aux cartes de bruit stratégiques (mapas de ruido estratégicos) dans la section 3 du chapitre 2, et les plans d'action (planes de acción) dans la section 3 du chapitre 2. L'article 15 de la loi, relatif au contenu des cartes de bruit stratégique, renvoie au pouvoir réglementaire la définition du fond et de la forme des cartes, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs limites de pollution sonore.
Aussi, le décret royal n° 1513/200581(*) appliquant la loi espagnole sur le bruit prévoit, en son article 9 al. b, que celles-ci doivent indiquer qu'une zone est soumise à une pollution sonore dès lors que les valeurs 55 Lden et 50 Lnight sont atteintes. Le droit espagnol reprend donc à l'identique les standards prévus par le droit de l'UE et non ceux issus des recommandations de l'OMS.
c) Grèce
En Grèce, le champ d'application et le contenu des obligations découlant de la directive 2002/49/CE sont fixés dans le décret interministériel n° 211773 du 27 avril 201282(*) relatif au bruit dans l'environnement.
L'article 4 du décret, déterminant les limites des indicateurs d'évaluation du bruit lié aux transports (routiers, ferroviaires et aériens) dans l'environnement, prévoit que les cartes de bruit stratégiques doivent reproduire graphiquement les zones géographiques soumises à une pollution sonore dès lors que les sonométries révèlent des niveaux sonores supérieurs ou égaux à 70 Lden et 60 Lnight. Ainsi, la réglementation grecque fixe des standards moins stricts que ceux du droit de l'UE, ce que la Commission européenne lui reproche dans la lettre de mise en demeure transmise en octobre 2024.
d) Suisse
En Suisse, le cadre juridique de la lutte contre la pollution sonore résulte essentiellement de la loi fédérale RS 814.01 sur la protection de l'environnement de 198383(*), et plus particulièrement de son titre 2, chapitre 1, consacré aux pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons.
L'article 13 de la loi fédérale renvoie au gouvernement suisse, le Conseil fédéral, le rôle d'établir par voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions84(*) applicables à l'évaluation des pollutions, notamment sonores. Concernant plus particulièrement le bruit, l'article 15 de cette même loi dispose que : « les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. » En outre, l'article 19 de la loi fédérale précise que, outre les valeurs limites classiques, le Conseil fédéral peut fixer des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'urgence des assainissements à mettre en oeuvre. Enfin, l'article 23 de la loi fédérale prévoit un troisième type de valeurs limites : les valeurs de planification. Celles-ci sont également fixées par le Conseil fédéral et permettent d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir.
Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance RS 814.41 sur la protection sur le bruit de 198685(*) qui met en oeuvre les dispositions de la loi fédérale correspondante, notamment eu égard à la fixation des valeurs limites. Par ailleurs, le Conseil fédéral a entendu déterminer différentes valeurs en fonction du degré de sensibilité de la zone concernée. Aussi l'article 43 de l'ordonnance prévoit-il quatre degrés de sensibilité différents : le degré de sensibilité I représente les zones les plus sensibles - où le bruit doit être le moins polluant possible - et le degré de sensibilité IV représente les zones où sont admises les pollutions sonores les plus gênantes (type « zone industrielle »). Les différentes valeurs limites en fonction des différents degrés de sensibilité sont précisées à l'annexe 3 de l'ordonnance et reproduites dans le tableau ci-après.
Valeurs limites de bruit environnemental en Suisse
|
Degré de sensibilité |
Valeurs de planification (Lden et Lnight en dB) |
Valeurs limites d'immission |
Valeurs d'alarme |
|||
|
Jour |
Nuit |
Jour |
Nuit |
Jour |
Nuit |
|
|
I |
50 |
40 |
55 |
45 |
65 |
60 |
|
II |
55 |
45 |
60 |
50 |
70 |
65 |
|
III |
60 |
50 |
65 |
55 |
||
|
IV |
65 |
55 |
70 |
60 |
75 |
70 |
3. La réglementation du contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues
La directive 2014/45/UE86(*) relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur établit des exigences minimales harmonisées au niveau de l'UE. En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues87(*), la directive laisse aux États membres une marge de manoeuvre afin de définir la date et la fréquence du contrôle technique : « Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique » (article 5 al. 2). En ce qui concerne le contenu et les méthodes de ce contrôle, la directive laisse également aux États membres la liberté de leurs définitions : « Pour les catégories de véhicules L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3, les États membres définissent les domaines, points et méthodes de contrôle adaptés » (article 6 al. 3).
a) Allemagne
En Allemagne, le contrôle technique des véhicules est régi essentiellement par le règlement relatif à l'admission à la circulation routière (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO)88(*) qui prévoit les conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler sur la voie publique, eu égard à des considérations environnementales et sécuritaires.
L'article 29, qui pose le principe selon lequel les véhicules destinés à rouler sur la voie publique doivent se soumettre à un contrôle technique, renvoie respectivement vers l'annexe VIII et l'annexe VIIIa du même règlement pour la fréquence du contrôle puis pour son contenu, pour chaque type de véhicule.
S'agissant des motocycles89(*), les pouvoirs publics allemands ont ainsi opté pour une fréquence de contrôle technique de 24 mois (annexe VIII point 2.1.1). L'annexe suivante, relative au contenu du contrôle technique, prévoit plusieurs types de vérifications à effectuer successivement : outre les vérifications de sécurité (systèmes de freinage, de direction, rétroviseurs, phares, etc.), le décret prévoit également des vérifications liées au respect de l'environnement avec notamment un volet relatif à la pollution sonore (point 6.8.1). Ce contrôle du niveau sonore implique, s'agissant des motocycles, de vérifier l'état et la conformité du système de réduction du bruit du pot d'échappement. Il convient également de vérifier l'éventuel niveau sonore lié au moteur et à la carrosserie.
b) Espagne
En Espagne, le contrôle technique des véhicules est encadré par le décret royal sur le contrôle technique des véhicules (Real Decreto por el que se regula la inspección técnica de vehículos)90(*) transposant divers textes du droit de l'UE, notamment la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, afin de garantir une sécurité routière optimale.
L'article 4 al. 1 pose le principe selon lequel les véhicules immatriculés en Espagne doivent, afin de pouvoir circuler librement sur la voie publique, se soumettre à un contrôle technique dans les conditions telles que fixées par le présent décret royal.
En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues, l'article 6 relatif à la fréquence des contrôles techniques dispose que ceux-ci doivent se soumettre à un contrôle technique tous les deux ans à partir de leur quatrième année ; avant cela, ils en sont exonérés.
L'annexe 1 du décret, relative au contenu du contrôle technique, prévoit plusieurs types de vérifications à effectuer successivement : outre les vérifications de sécurité classiques, le décret prévoit également des vérifications liées au respect de l'environnement avec notamment un volet relatif à la pollution sonore (point 8.1.1). Ce contrôle du niveau sonore implique de vérifier l'état et la conformité du système de réduction du bruit (sistema de supresión de ruido) du véhicule. Ce contrôle consiste à vérifier à l'aide d'un sonomètre que le bruit engendré par le véhicule n'atteint pas un niveau supérieur à ceux autorisés dans les prescriptions. Le point 8.1.1 liste en outre quelques faits pouvant témoigner d'un dépassement des valeurs limites d'émissions sonores : « Tout composant du système de suppression du bruit est desserré, endommagé, mal installé, manquant ou manifestement modifié d'une manière qui affecte négativement les niveaux de bruit. Risque très sérieux de détachement. »
c) Italie
En Italie, la réglementation encadrant les contrôles techniques périodiques des véhicules est définie par le décret du 19 mai 2017 du ministère des transports91(*), transposant la directive européenne 2014/45/UE et dans sa version révisée en 2022. Le décret précise dans son article 2 relatif au champ d'application qu'il s'applique notamment aux cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles (c'est-à-dire les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e).
Depuis le 20 mai 2018, les contrôles techniques des véhicules de la catégorie L sont soumis à la fréquence suivante : quatre ans après la date de la première immatriculation et tous les deux ans par la suite (article 5 al. 1 point d).
En ce qui concerne le contenu du contrôle technique des véhicules motorisés à deux roues, un tableau en annexe du décret précise que la pollution sonore en fait bien partie (point 8.1.). Le contrôle technique analyse le système de protection contre le bruit (sistema di protezione dal rumore), notamment sa fixation, d'éventuels endommagements ou tout autre élément susceptible d'altérer son fonctionnement. Le tableau précise en outre que cette analyse se fait de façon « subjective » par l'autorité de contrôle, qui peut toutefois, si elle estime que la limite réglementaire d'émission sonore risque d'être dépassée, procéder à un contrôle formalisé de mesure du bruit à l'aide d'un phonomètre placé proche du véhicule en position de stationnement.
d) Suisse
La réglementation suisse encadrant le contrôle technique des véhicules est consacrée dans l'ordonnance 741.41 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers de 199592(*). Son article 29 pose le principe général : les véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s'ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l'équipement. Pour les véhicules neufs, la preuve du respect des prescriptions est apportée au moyen d'un rapport d'expertise préalable à la première immatriculation (article 30). En ce qui concerne les contrôles subséquents, l'article 33 al. b prévoit que les motocycles et tricycles à moteur s'y soumettent pour la première fois cinq ans - ou au plus tard six ans - après la première mise en circulation, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans.
Fréquence des contrôles techniques
des motocycles et tricycles à moteur
en Suisse
Le contrôle technique des véhicules suisses comprend un volet relatif à la pollution sonore. L'article 53 de l'ordonnance, qui s'applique à l'ensemble des véhicules soumis à une obligation de contrôle technique, y compris les motocycles, prévoit un contrôle du niveau sonore et des dispositifs de silencieux : « Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. ». Les valeurs limites des émissions sonores sont régies par l'annexe 6 de l'ordonnance. En vertu du point 37 de cette annexe, les motocycles dont le moteur a une puissance inférieure ou égale à 4 kW doivent respecter une valeur limite de 71 dB ; ceux dont le moteur a une puissance supérieure à 4 kW sont soumis à une valeur limite de 75 dB93(*).
ANNEXE - ÉTUDE D'OPINION RÉALISÉE À LA DEMANDE DE LA MISSION D'INFORMATION
La mission d'information a confié à l'institut CSA le soin de réaliser une étude d'opinion dont l'objectif était de mesurer l'ampleur et l'intensité des nuisances sonores causées par les transports en zones urbaines, périurbaines et rurales, et mieux appréhender leurs effets sur la qualité de vie et la santé des riverains d'infrastructures de transport.
L'institut CSA, mandaté à cet effet, a conduit l'étude du 7 au 16 avril 2025 en interrogeant un échantillon de 2 000 individus représentatif de l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus sur la base d'un questionnaire auto-administré en ligne.
La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge (en 5 classes), catégorie socioprofessionnelle de l'individu. Une stratification géographique de l'échantillon en croisant la région avec la catégorie d'agglomération afin de représenter tous les territoires a été réalisée.
Cette étude a fait l'objet d'une présentation en commission et a donné lieu à un débat en réunion plénière le 30 avril 2025.
* 1 Sondage réalisé par l'institut de sondage CSA.
* 2 Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes
* 3 Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
* 4 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
* 5 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
* 6 Sur le réseau routier national non-concédé, l'État a apporté 6,5 M€ de financements en 2023-2024, à comparer avec une enveloppe de 78 M€ débloquée entre 2015 et 2022 dans le cadre de la part État des CPER, auxquels s'ajoutaient des financements de l'Ademe (30 M€ entre 2009 et 2021).
* 7 Au laboratoire national de métrologie et d'essais
* 8 Étude Bruitparif, février 2019, « Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Île-de-France ».
* 9 En prenant pour base le coût moyen d'une hospitalisation en de cardiologie d'environ 4 209 € en 2018
* 10 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que des effets sanitaires extra-auditifs indésirables apparaissent dès une exposition à un bruit de 40 décibels la nuit, contre 50-55 décibels en journée.
* 11 Santé Publique France, décembre 2024, « Agir sur les espaces verts, les mobilités actives, la chaleur, la pollution de l'air et le bruit : quels bénéfices pour la santé ? ».
* 12 IFOP, 2014, Les Français et les nuisances sonores
* 13 Rapport d'activité 2024 de l'Observatoire national du bruit.
* 14 Centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie, 2016, « Qualité de vie et nuisances sonores : opinion et comportements des franciliens ».
* 15 BruitParif, fiche thématique, « Maîtriser le trafic, quels enjeux ? », p. 4
* 16 France Bleu, 5 mai 2025, Chevilly « ces habitants de Chevilly n'en peuvent plus des camions qui traversent la commune ».
* 17 Question écrite n° 6929 (AN), 17e législature, publiée le 20 mai 2025, Emmanuel Duplessy (député)
* 18 BruitParif, fiche thématique, « Maîtriser le trafic, quels enjeux ? ».
* 19 Sur les indicateurs utilisés et leur signification, voir le A du II « Un maquis de réglementations applicables : une superposition illisible et des référentiels distincts ».
* 20 Selon le groupe ADP, cette évolution « met en lumière dans la durée, la profonde modernisation des flottes engagée par les compagnies depuis 2003 ».
* 21 Voir à cet égard le développement consacré au sein du II. A - 1.
* 22 À supposer que la hausse annuelle du trafic soit comprise entre 1 % et 1,5 %, comme l'anticipe ADP.
* 23 Acoucité, Champelovier P., Lambert J., Vincent B., 2009, « La gêne due au bruit de l'aviation légère ».
* 24 CGEDD, Emmanuelle BAUDOIN, Sylvain LEBLANC et Catherine MIR, avril 2019, Médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique
* 25 Jaworski Véronique, « Le bruit et le droit ». Communications, 2012/1 n° 90, 2012, p. 83-94
* 26 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
* 27 Pour les infrastructures routières : arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et pour les infrastructures ferroviaires : arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
* 28 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
* 29 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, COM(2023) 139 final.
* 30 Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.
* 31 Belgique, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.
* 32 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'avril 2023, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, cartes de bruit stratégiques et plans d'action en Grèce : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_23_1808 (consulté le 13 mai 2025).
* 33 La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB (A)), représente le niveau d'exposition totale au bruit au cours d'une journée entière.
* 34 La valeur de l'indice de bruit Lnight correspond au bruit moyen pondéré durant la nuit (22h-6h).
* 35 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'octobre 2024, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, déclarations incombant à la Grèce en vertu de la directive bruit : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_24_4561 (consulté le 13 mai 2025).
* 36 CIDB, 2019 « convergences des actions Bruit, Climat, Air, Énergie pour une planification plus performante ».
* 37 Anses, février 2013, Évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit environnemental
* 38 Arrêté du 29 septembre 2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire.
* 39 Avis du Conseil national du bruit du 7 juin 2021 sur les pics de bruit des infrastructures ferroviaires
* 40 Voir le rapport de la mission de médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique, p. 31.
* 41 Arrêté du 29 septembre 2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire.
* 42 12 455 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire.
* 43 Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'État concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
* 44 La DGPR mentionne également une valorisation indirecte par les économies réalisées en termes de coût social, qui est surtout non-marchand (bien-être et meilleure santé), même s'il est aussi marchand pour certaines de ces composantes (économies réalisées par le système de santé).
* 45 Les obligations portent sur les équipements donnant sur les pièces principales des bâtiments d'habitation, les pièces de vie d'établissements d'enseignement, les locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et les chambres d'hôtel.
* 46 Paris (2 sites : rue Cardinet dans le 17e et rue d'Avron dans le 20e), Rueil-Malmaison, Villeneuve-le-Roi, Communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, Bron, Nice, Toulouse.
* 47 La valeur reportée sur la carte grise, qui est issue d'une prise de mesure statique - à la différence de la mesure réalisée pour la mise sur le marché d'un véhicule -, prend en compte, d'une part, la valeur limite que le véhicule ne doit pas dépasser à l'arrêt, par exemple 75 dB (indiquée dans la case U1 sur la carte grise) et, d'autre part, le régime du moteur en tour par minute (tr/min) à la moitié de son régime de puissance maximal, ce qui permet d'obtenir la valeur U2 sur la carte grise, par exemple 4400 tr/min.
* 48 Un véhicule sportif, à l'instar d'une moto grosse cylindrée ou d'une supercar peut atteindre des puissances motrices très importantes, allant jusqu'à 8 000 tr/min, ce qui peut entraîner une hausse notable de l'intensité acoustique estimée jusqu'à +6 % par rapport à un véhicule plus commun.
* 49 Voir, sur cette réglementation, la partie II.
* 50 Voir le 1) du présent B.
* 51 En application de l'article L. 2231-7 du code des transports, les projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, envisagés à une distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, font l'objet d'une information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière.
* 52 Règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union
* 53 Voir la partie 2) du B du I « 2. Le transport aérien expose une faible part de la population au bruit, mais avec une forte intensité ».
* 54 Dans une lettre datée du 24 mai 2024 adressée au ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergriete.
* 55 Rapport d'activité annuel de l'Acnusa, 2024.
* 56 Acnusa, 11 avril 2024, Réduire les nuisances de l'aviation légère autour des aérodromes.
* 57 Circulaire n° 2005-88 du 6 décembre 2005 relative à la maîtrise des nuisances sonores au voisinage des aérodromes d'aviation légère.
* 58 L'échantillon des pays étudiés varie selon la pertinence des situations nationales ainsi que pour des motifs linguistiques.
* 59 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant.
* 60 L'Agence européenne pour l'environnement établit une carte globale et interactive reprenant les données de tous les pays européens participant, disponible en ligne : https://noise.eea.europa.eu/ (consulté le 9 juin 2025).
* 61 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, COM(2023) 139 final.
* 62 Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.
* 63 Belgique, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.
* 64 CJUE, 13 janvier 2022, Commission c. République slovaque, affaire C-683/20 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0683&qid=1746024633748 ; CJUE, 31 mars 2022, Commission c. République portugaise, affaire C-687/20 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0687&qid=1746024529748 ; CJUE, 20 avril 2023, Commission c. République de Pologne, affaire C-602/21 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62021CA0602&qid=1746024615998
* 65 https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/240308_Laermaktionsplan_BW.pdf
(consulté le 17 juin 2025).
* 66 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2129_0_U_11133
(consulté le 17 juin 2025).
* 67 https://lfu.rlp.de/service/aktuelles/detail/mehr-schutz-vor-verkehrslaerm-1
(consulté le 17 juin 2025), en cours d'adoption définitive.
* 68 Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung an Schienenwegen, 17.07.2024 : https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html (consulté le 13 mai 2025).
* 69 Pour plus d'informations voir : les cartes de bruit stratégiques (mapas estratégicos de ruido - MER), https://sicaweb.cedex.es/los-mapas-de-ruido/), les plans d'action (planes de acción - PAR) : https://sicaweb.cedex.es/planes-de-accion/ et l'historique des communications à la Commission : https://sicaweb.cedex.es/comunicaciones-a-la-comision-europea/ (consulté le 17 juin 2025).
* 70 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'avril 2023, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, cartes de bruit stratégiques et plans d'action en Grèce : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_23_1808 (consulté le 13 mai 2025).
* 71 La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB (A)), représente le niveau d'exposition totale au bruit au cours d'une journée entière.
* 72 La valeur de l'indice de bruit Lnight correspond au bruit moyen pondéré durant la nuit (22h-6h).
* 73 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'octobre 2024, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, déclarations incombant à la Grèce en vertu de la directive bruit : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_24_4561 (consulté le 13 mai 2025).
* 74 Pour une analyse détaillée voir : Allard, A., Canali, L., Bereni, A., Boucherifi, T., Delcroix, V., Fenner, A., sous la responsabilité d' Truilhé, E. (2023). Bruit - Directive 2002/49/CE - Prévention - Manquement. Revue juridique de l'environnement, 48 (3), 723-725. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-3-page-723?lang=fr (consulté le 9 juin 2025).
* 75 World Health Organisation, 2018, Environmental noise guidelines for the European Region : https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563 (consulté le 30 avril 2025)
* 76 Directive 2002/49/CE, annexe VI, points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7.
* 77 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG).
* 78 Bundes-Immissionsschutzgesetz, art. 47c - Lärmkarten.
* 79 Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung).
* 80 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 08/12/2003.
* 81 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
* 82 Décret conjoint des ministères grecs de l'environnement, énergie et changement climatique et des infrastructures, transports et réseaux - Õ.Á. ïéê. 211773/2012, ÖÅÊ 1367/Â - du 27 avril 2012 : https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-2117732012-fek-1367b-2742012
(consulté le 14 mai 2025)
* 83 Loi fédérale sur la protection de l'environnement, RS 814.01, 1983.
* 84 Les émissions sont des substances émises par une source telle que par exemple un moteur d'avion. Ces substances sont fortement mélangées dans l'air. Les immissions représentent par contre la concentration de substances dans l'air ambiant mesurée en un point spécifique.
* 85 Ordonnance sur la protection contre le bruit, RS 814.41, 1986 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1987/338_338_338/fr
* 86 Directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur du 3 avril 2014.
* 87 La directive 2014/45/UE précise la définition des véhicules à deux ou trois roues auxquels elle s'applique : il s'agit des véhicules à deux ou trois roues des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125cm 3 et dont la vitesse est supérieure à 25km/h (art. 2 al. 1 tiret 6).
* 88 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).
* 89 Le terme motocycle (Kraftrad) concerne les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3. Le droit allemand exclut explicitement les motocyclettes de l'obligation biannuelle de contrôle technique. V. décret sur l'admission des véhicules (Fahrzeug-Zumassungsverordnung), § 3 : https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__3.html
* 90 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12841 (consulté le mai 2025)
* 91 Decreto Ministero dei Trasporti - 19/05/2017 - n. 214 - Controlli tecnici periodici dei veicoli e rimorchi.
* 92 Ordonnance 741.41 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/fr
* 93 Le point 43 de l'annexe 6 précise les conditions dans lesquelles la mesure du niveau sonore, dans le cadre du contrôle technique, doit être effectuée. S'agissant des motocycles, le niveau sonore est mesuré à l'arrêt et à proximité de l'échappement.