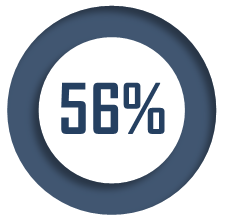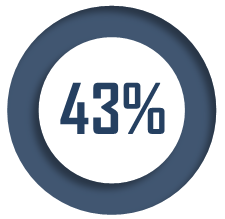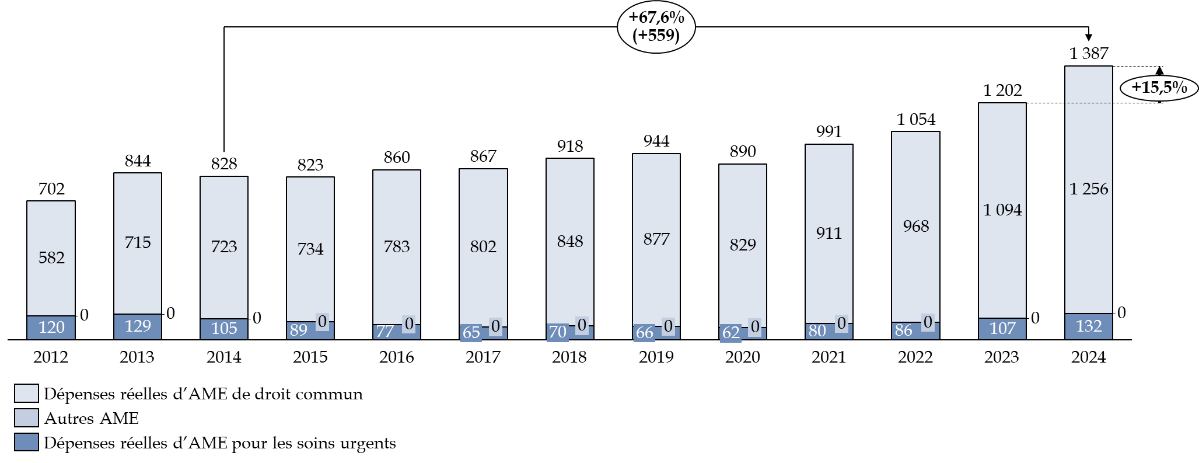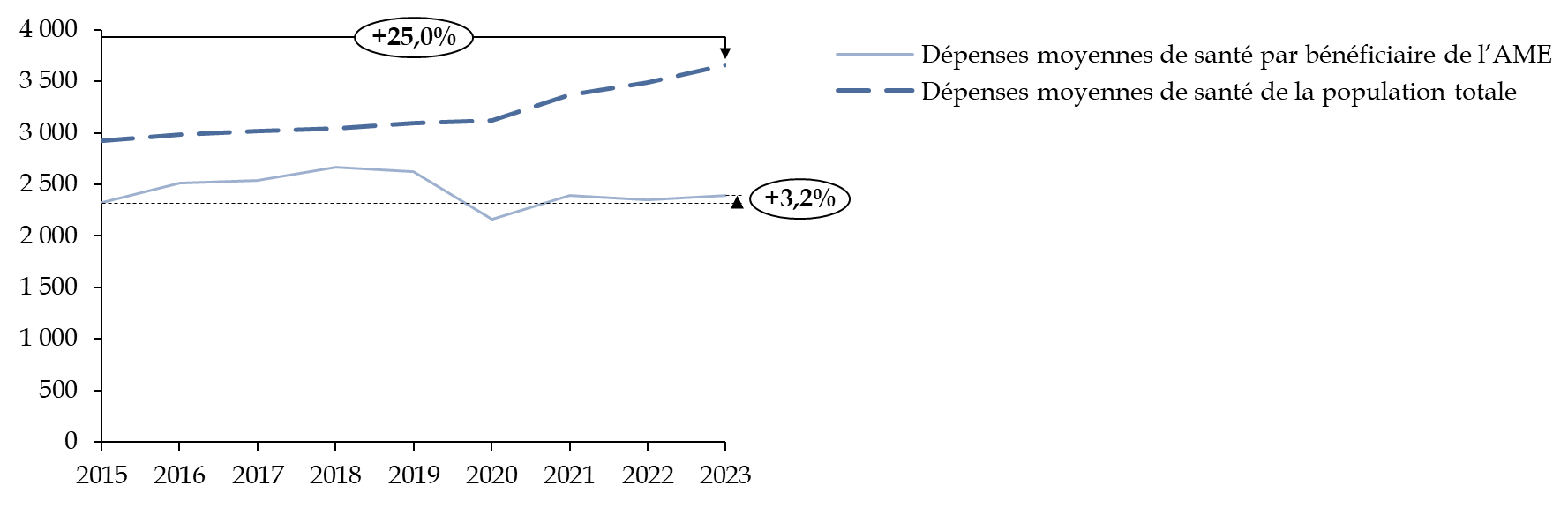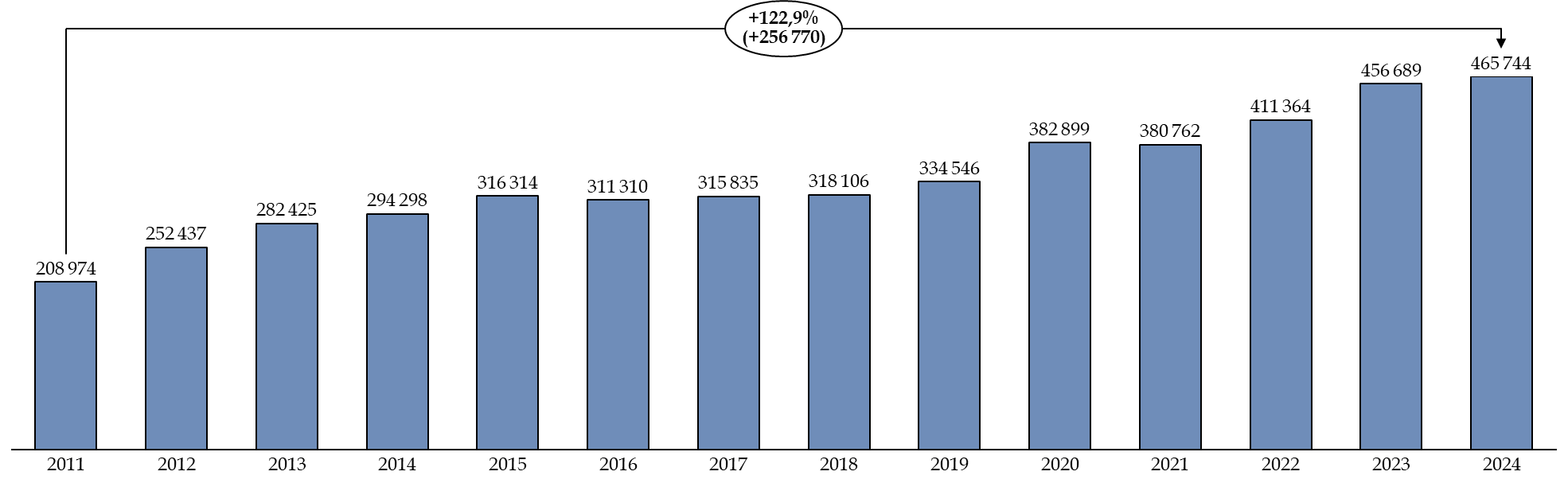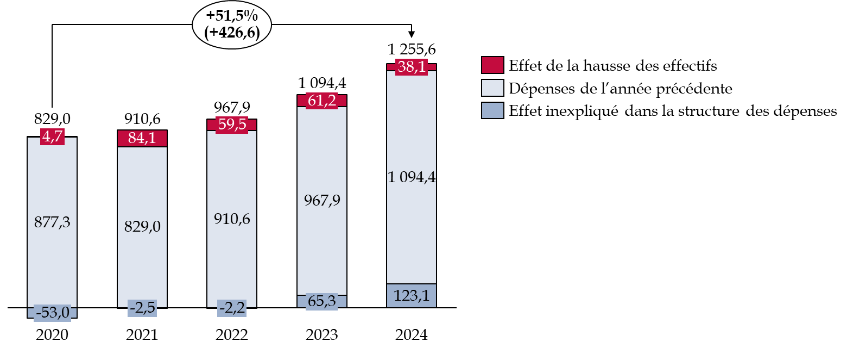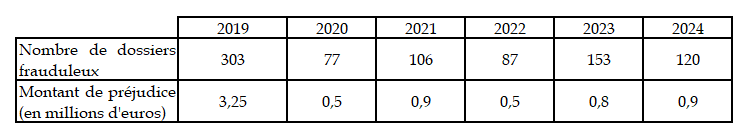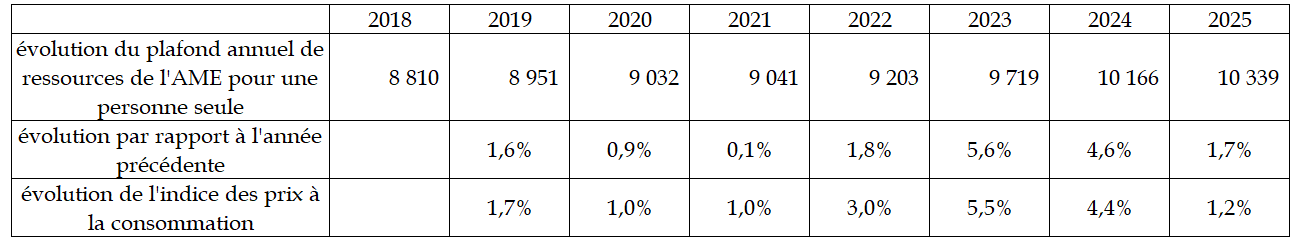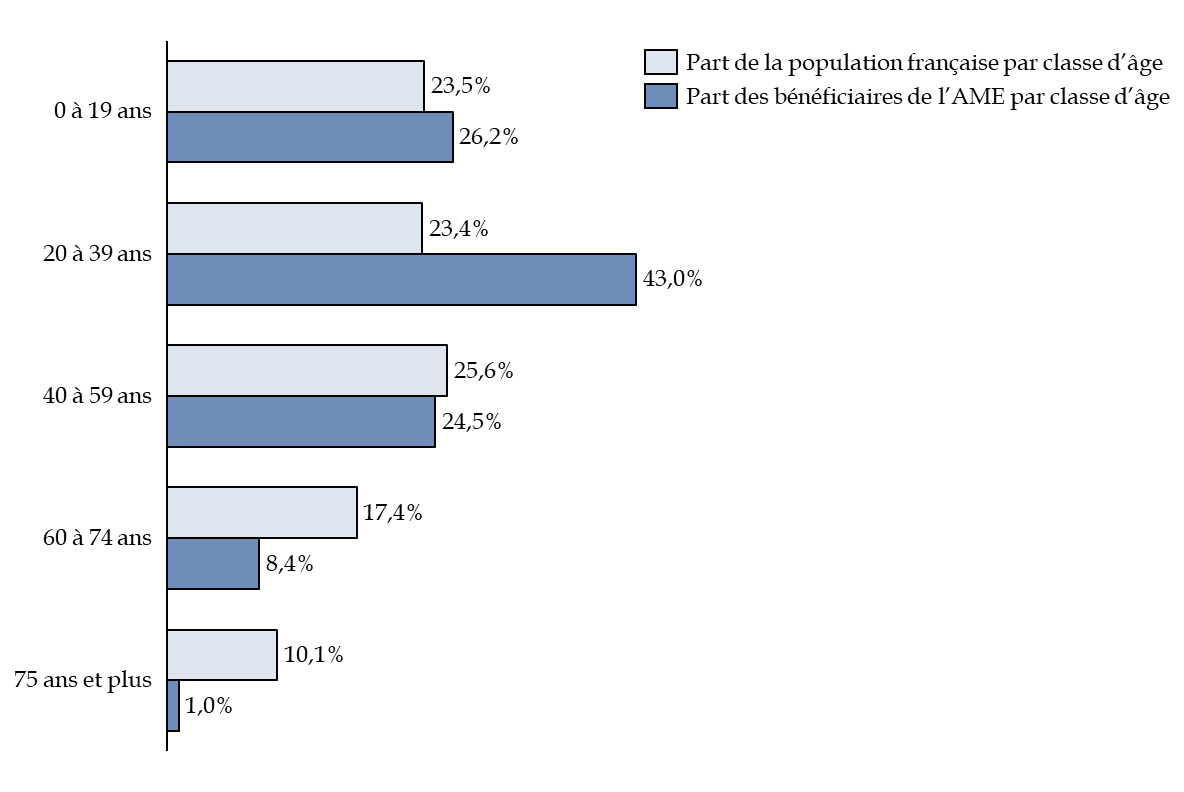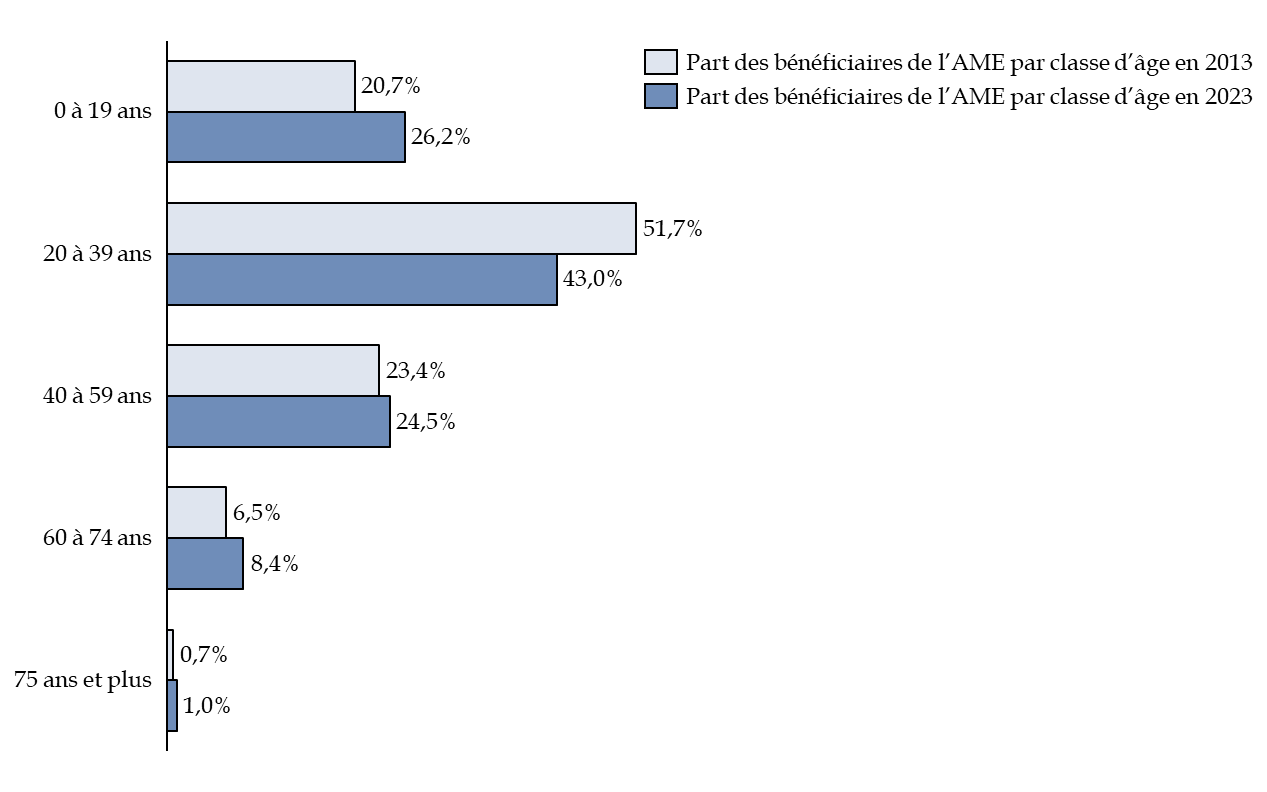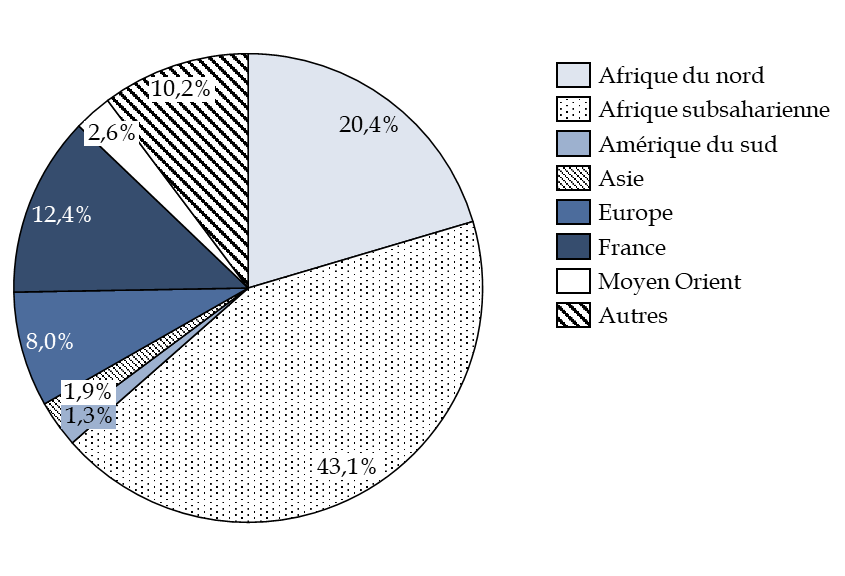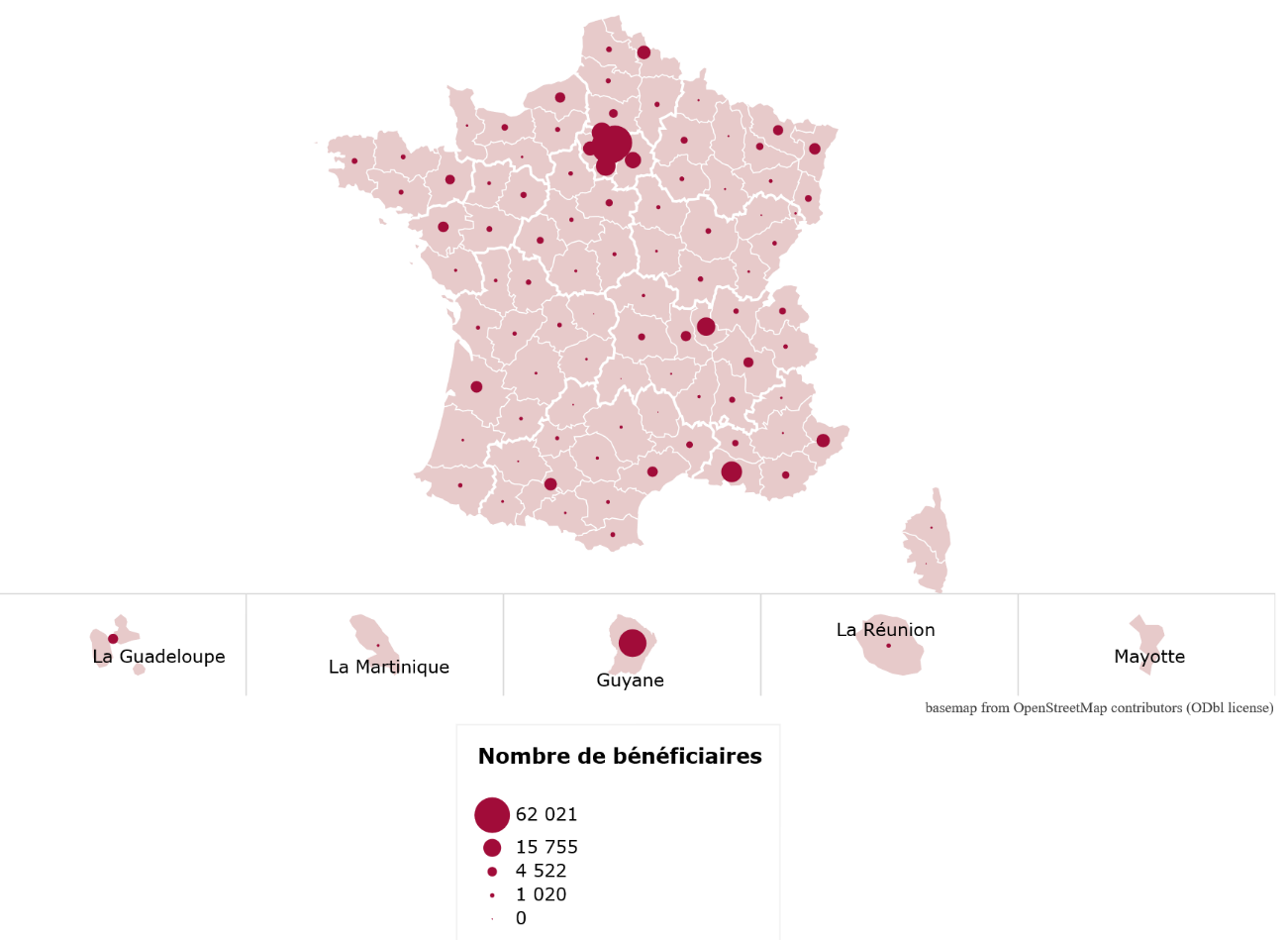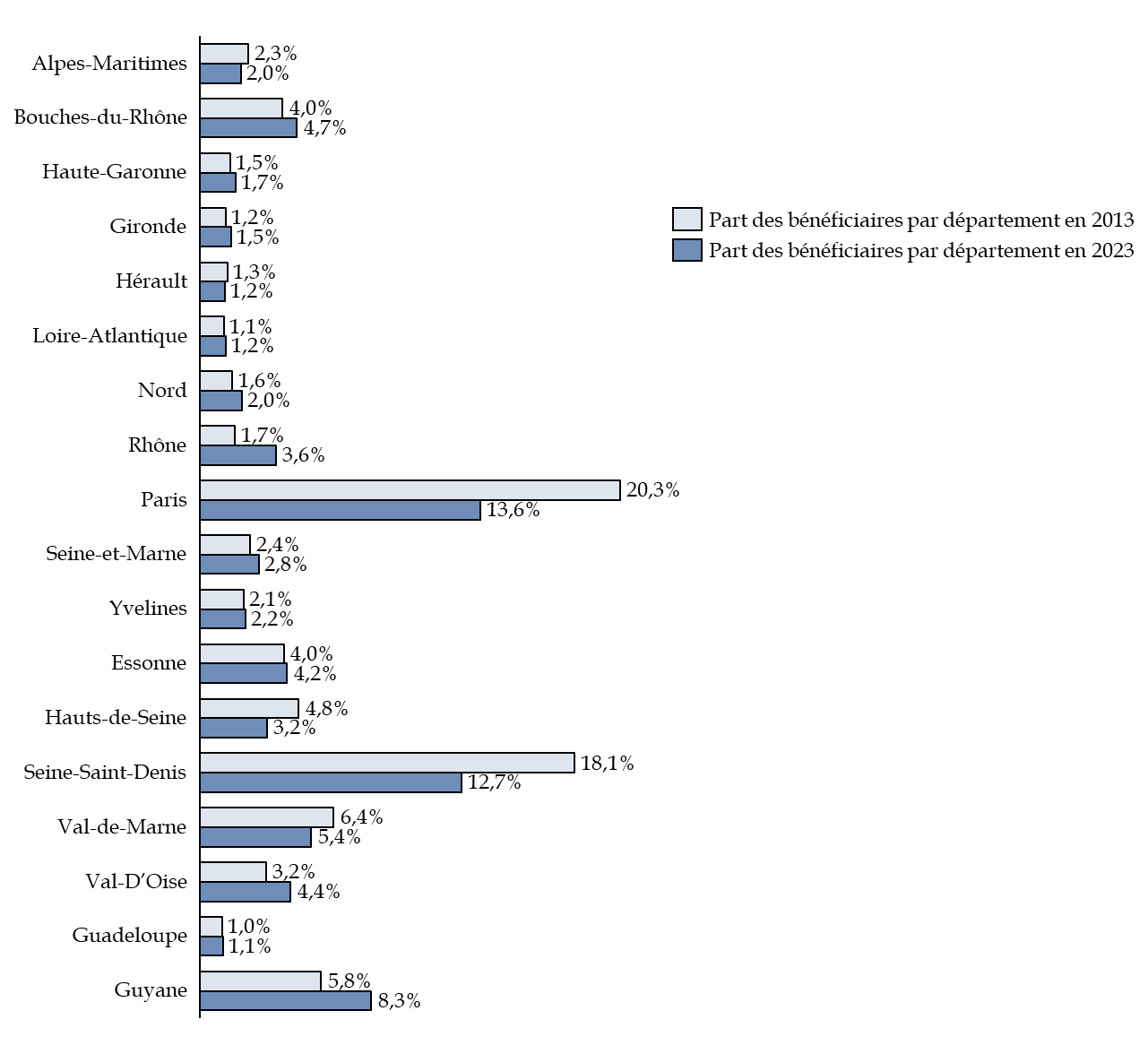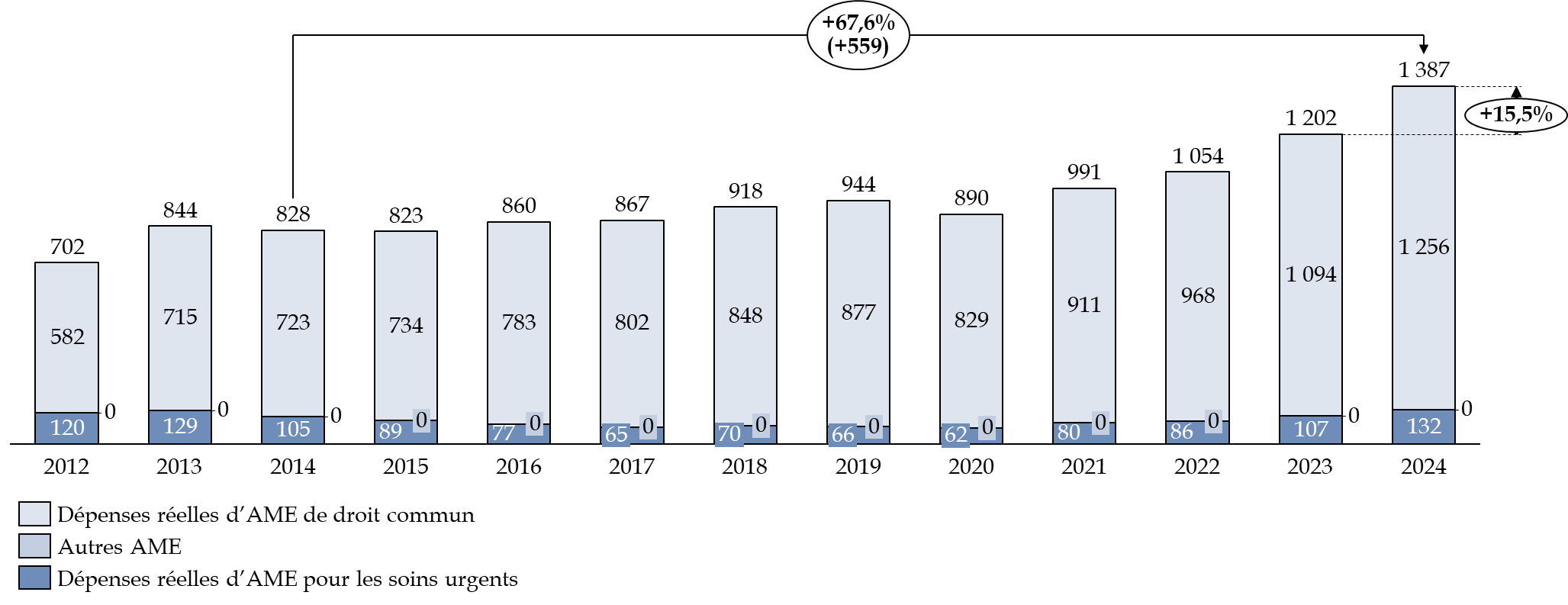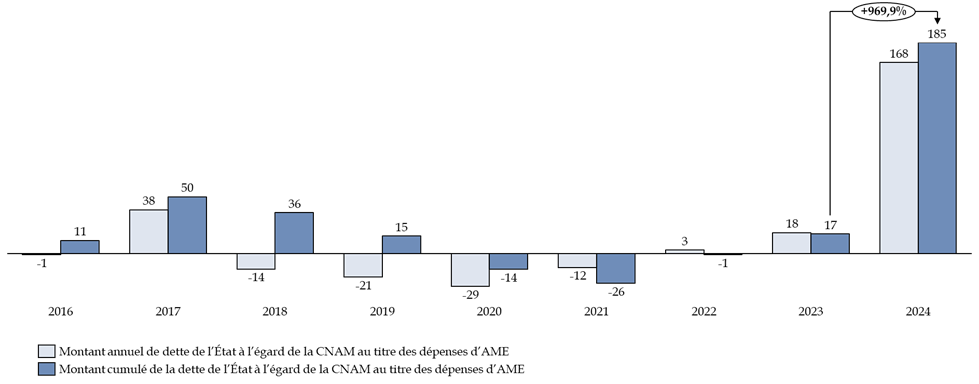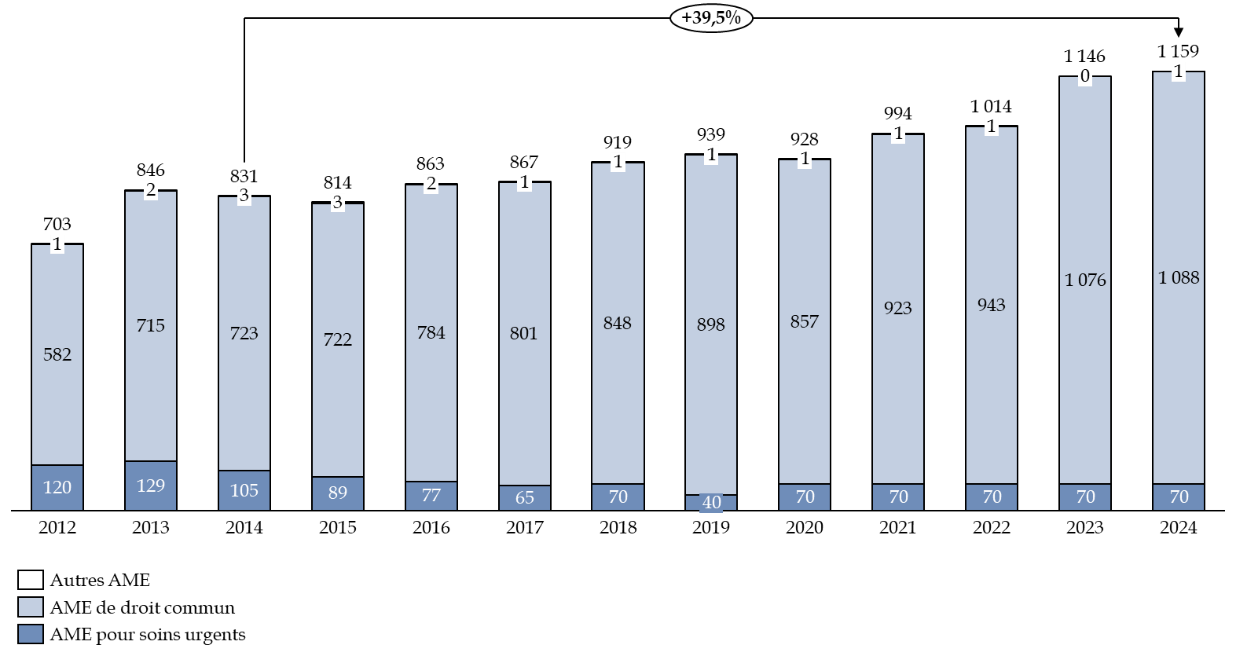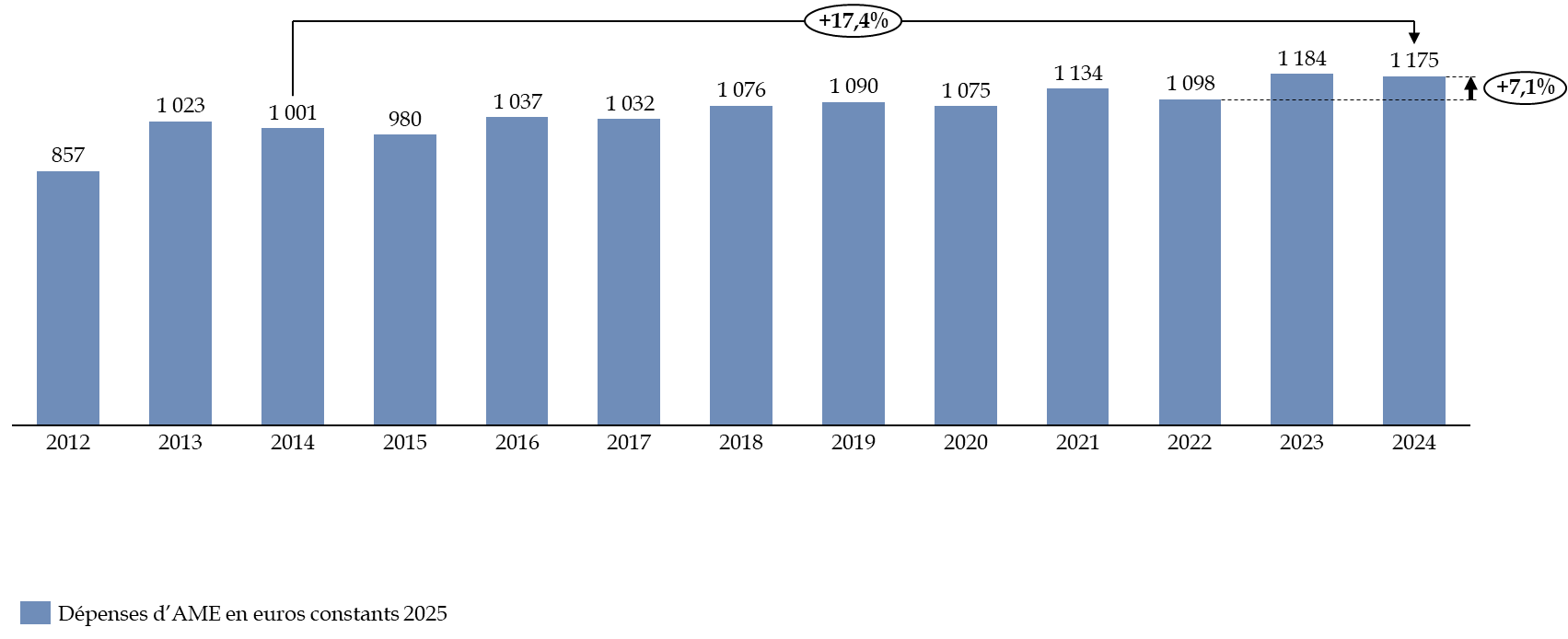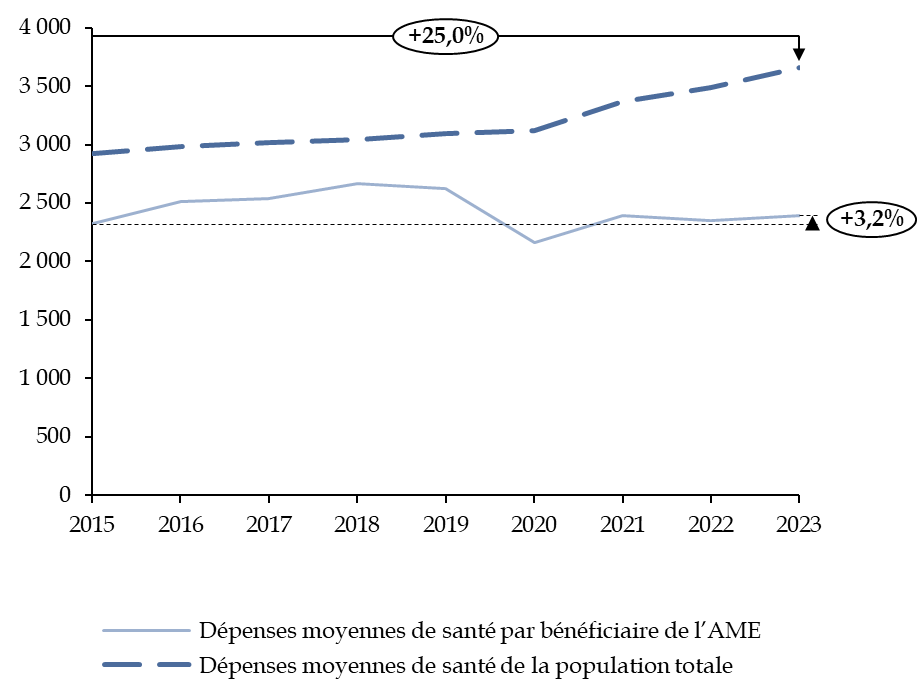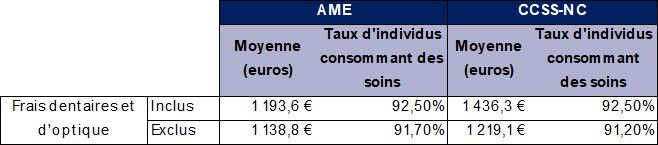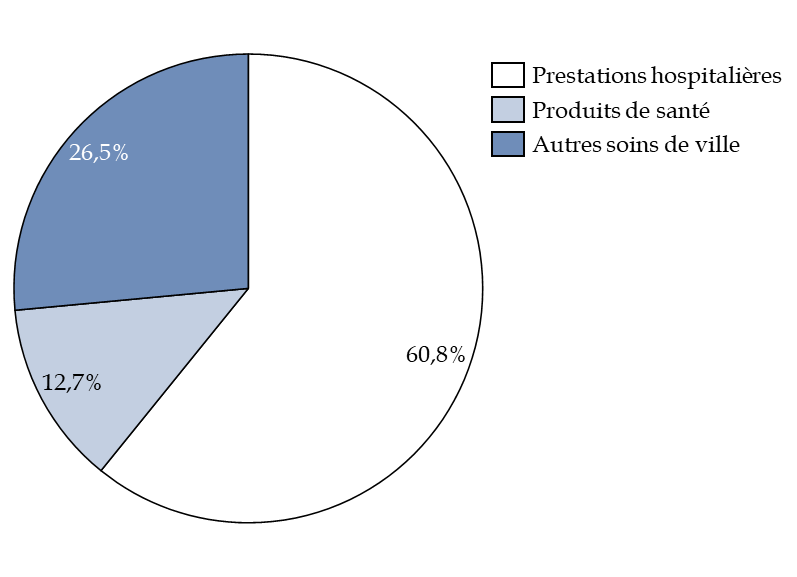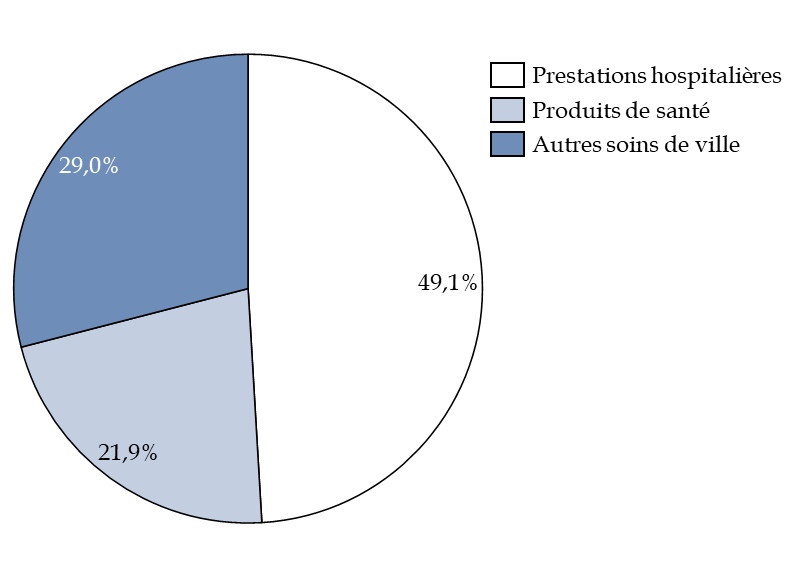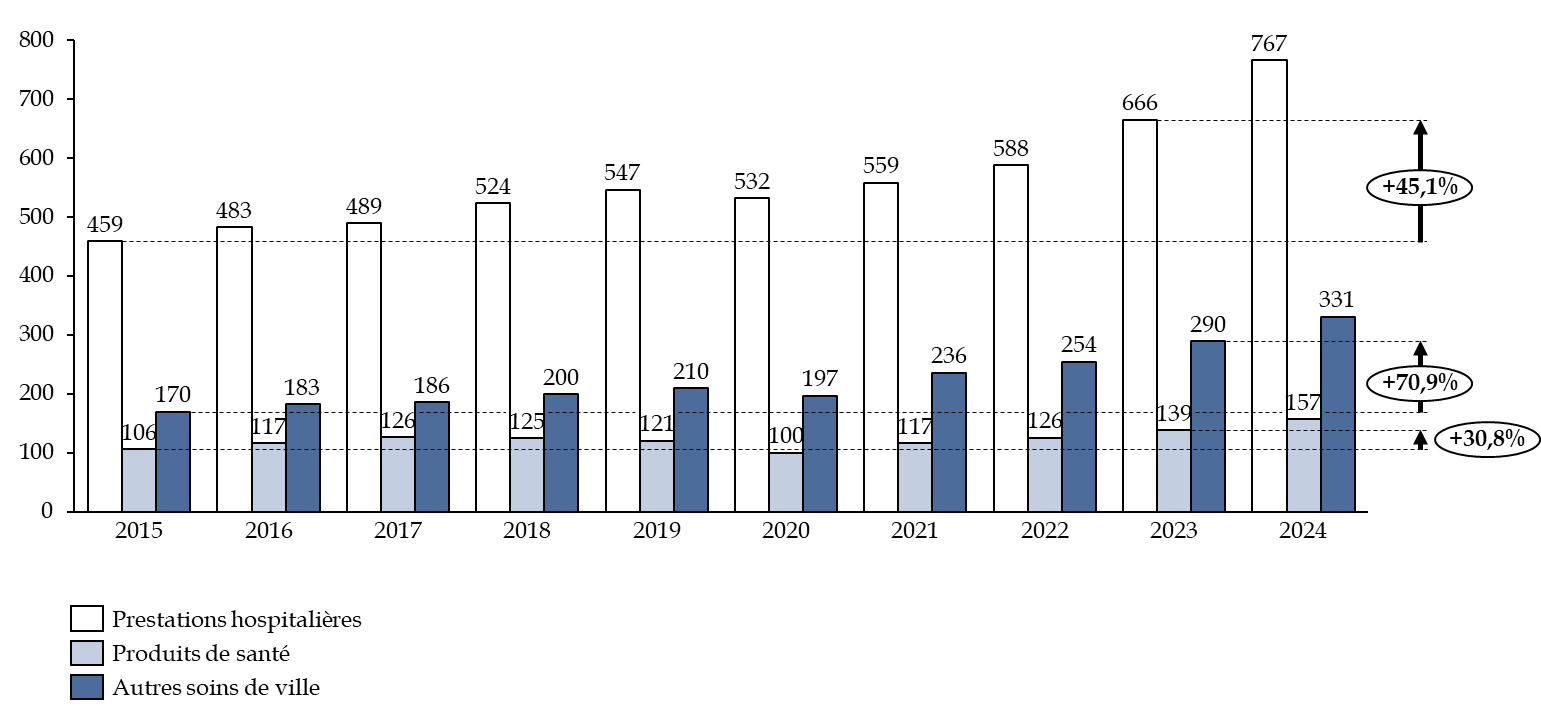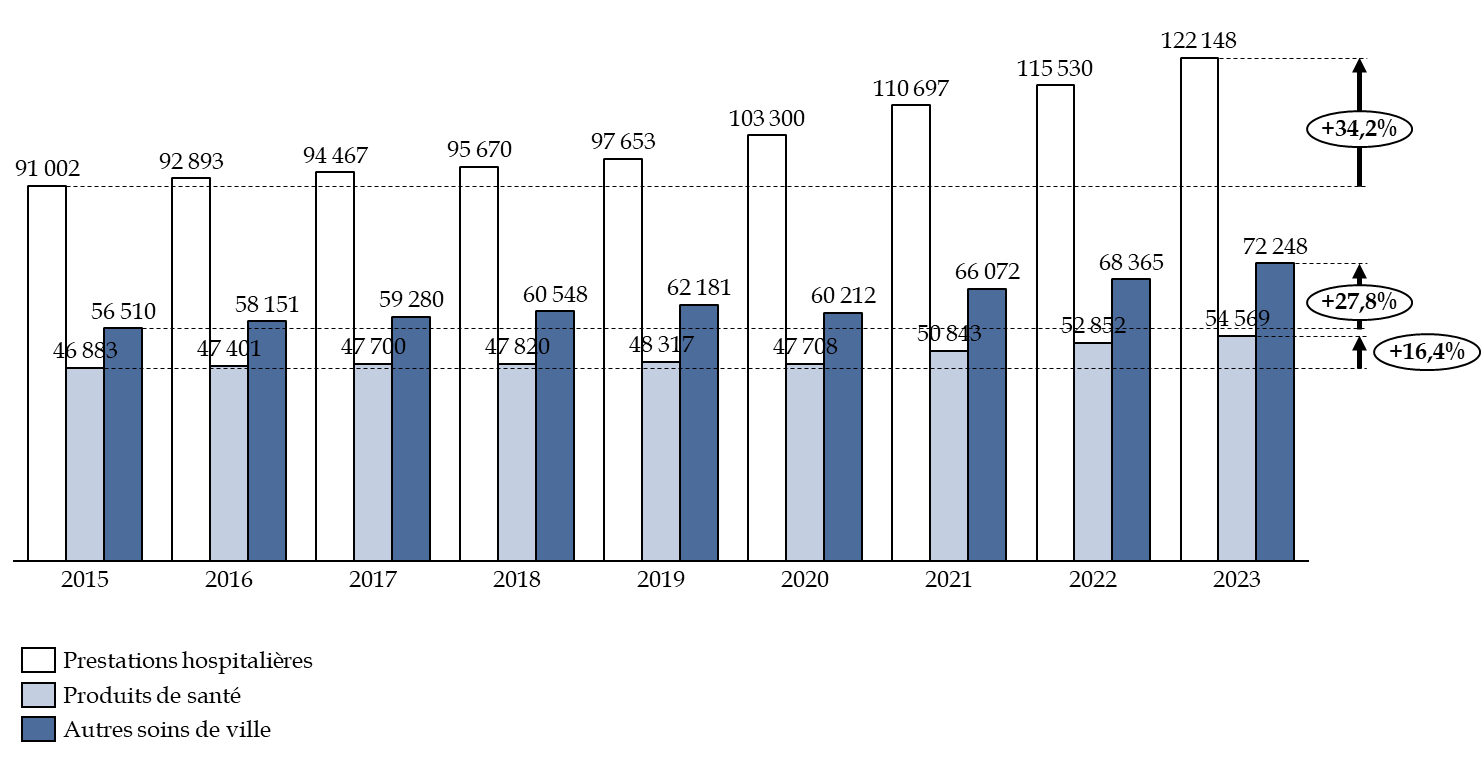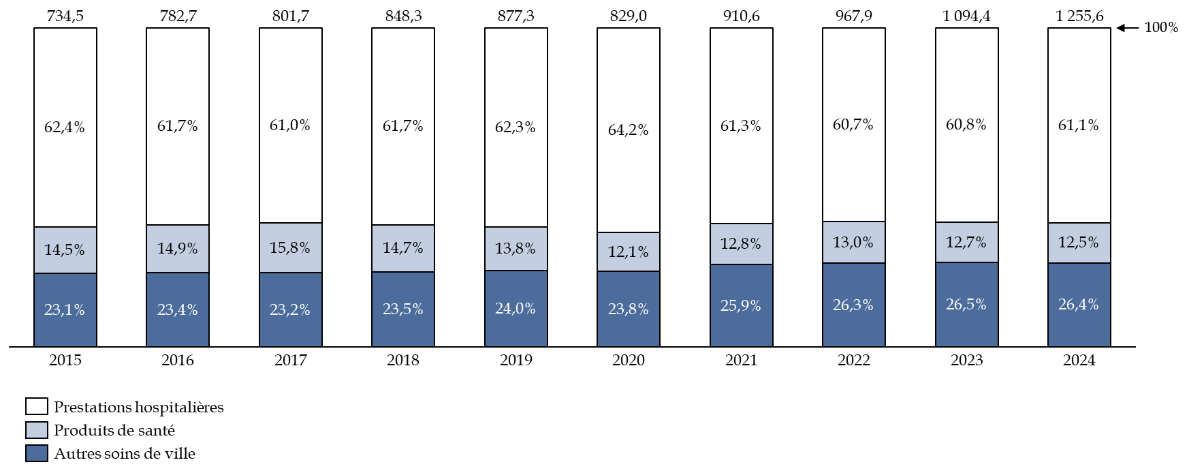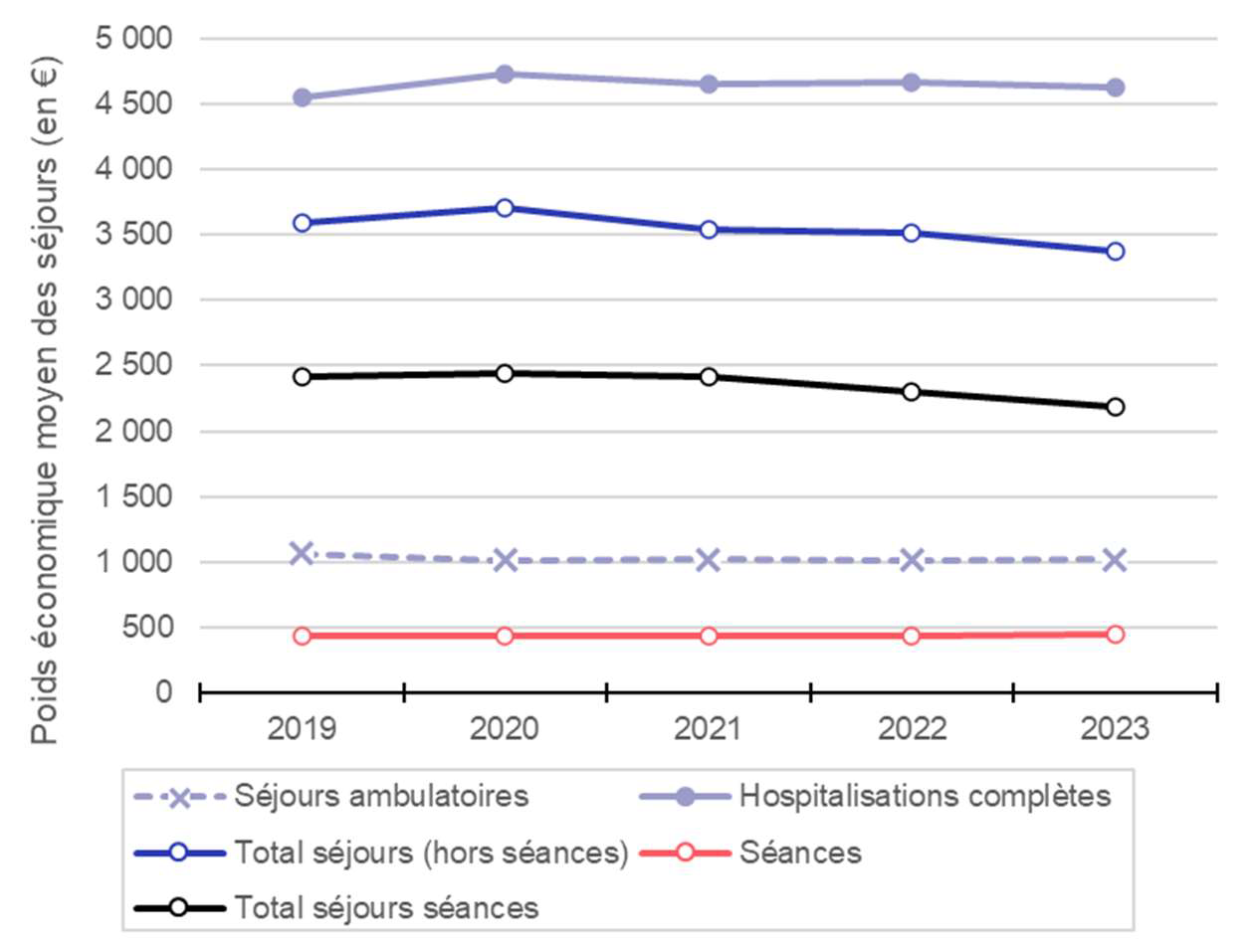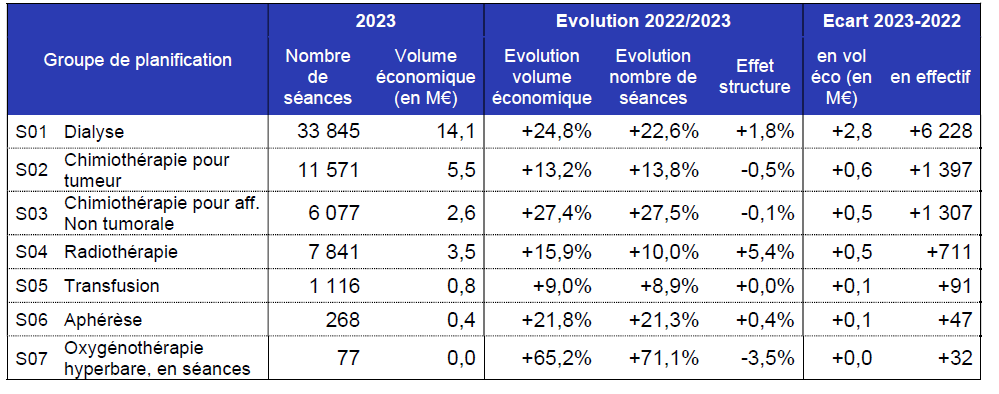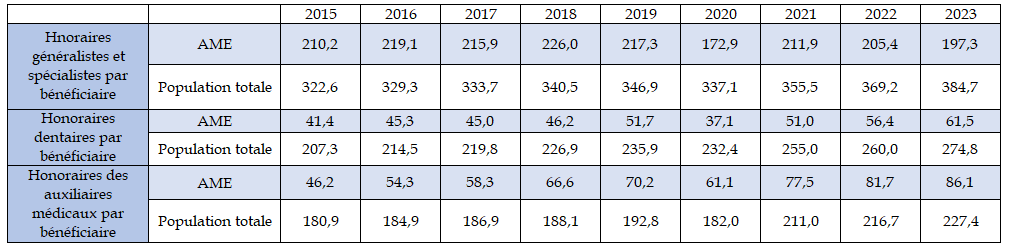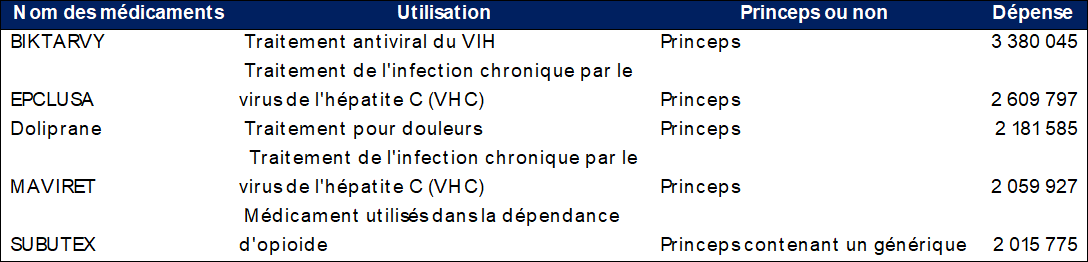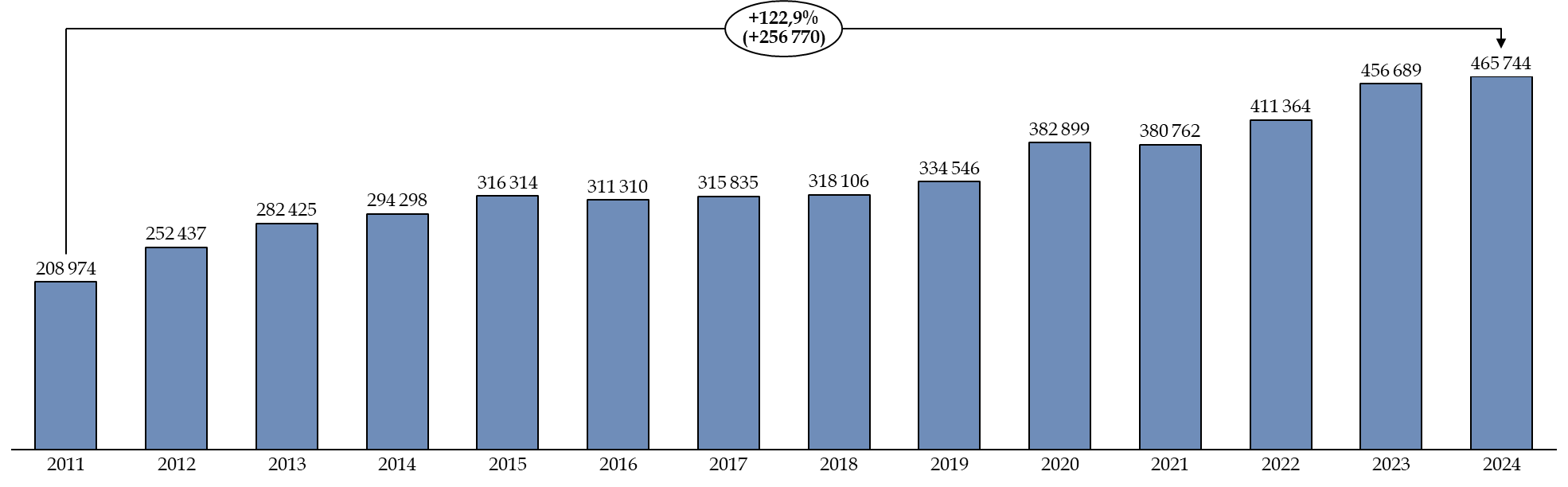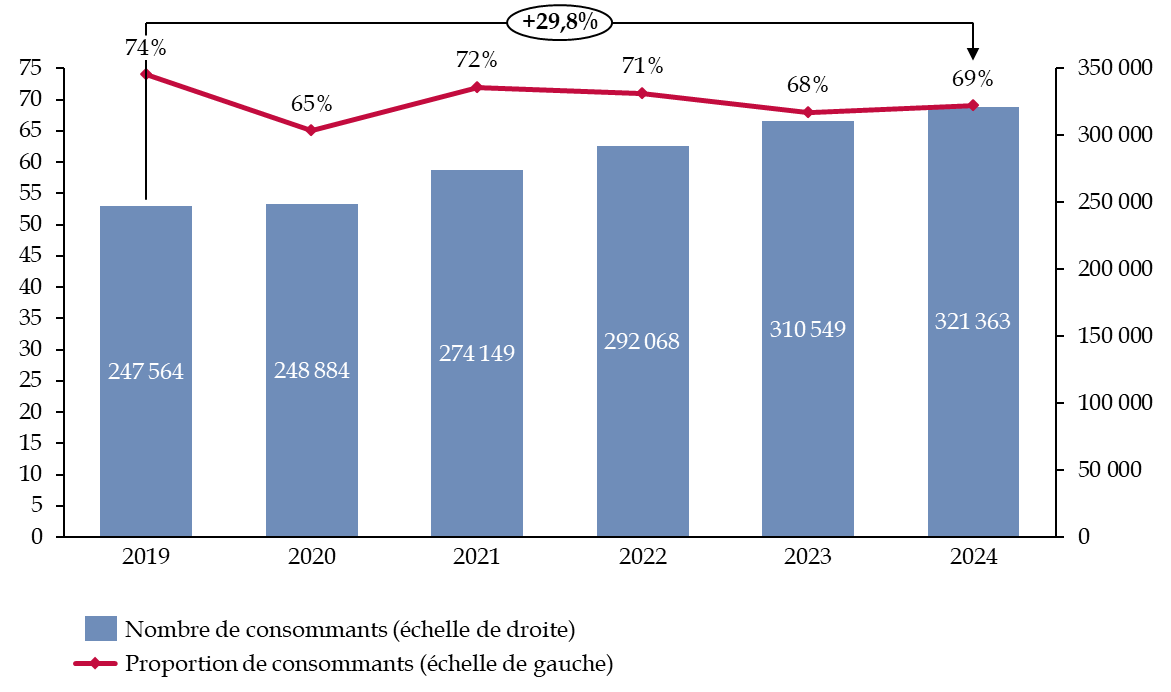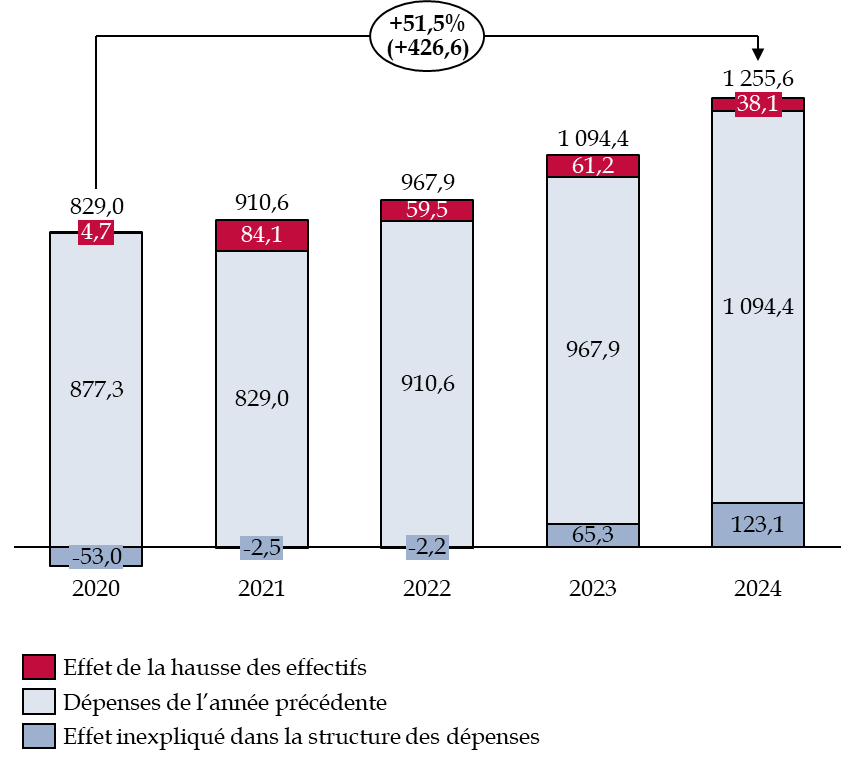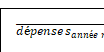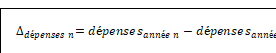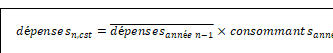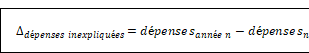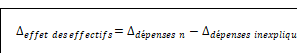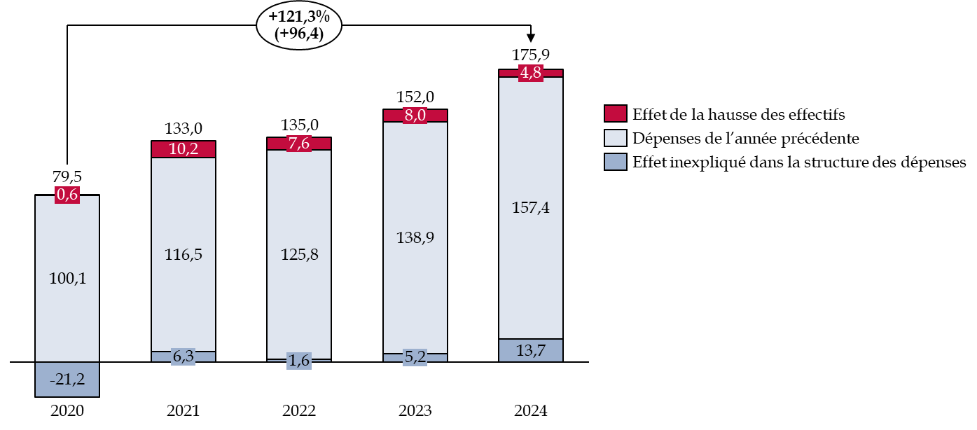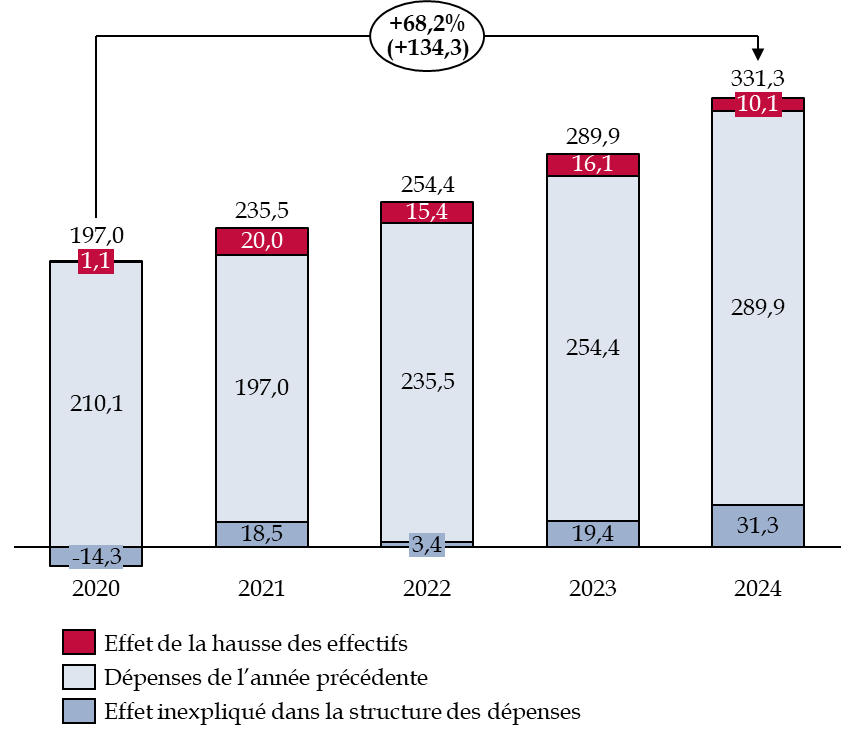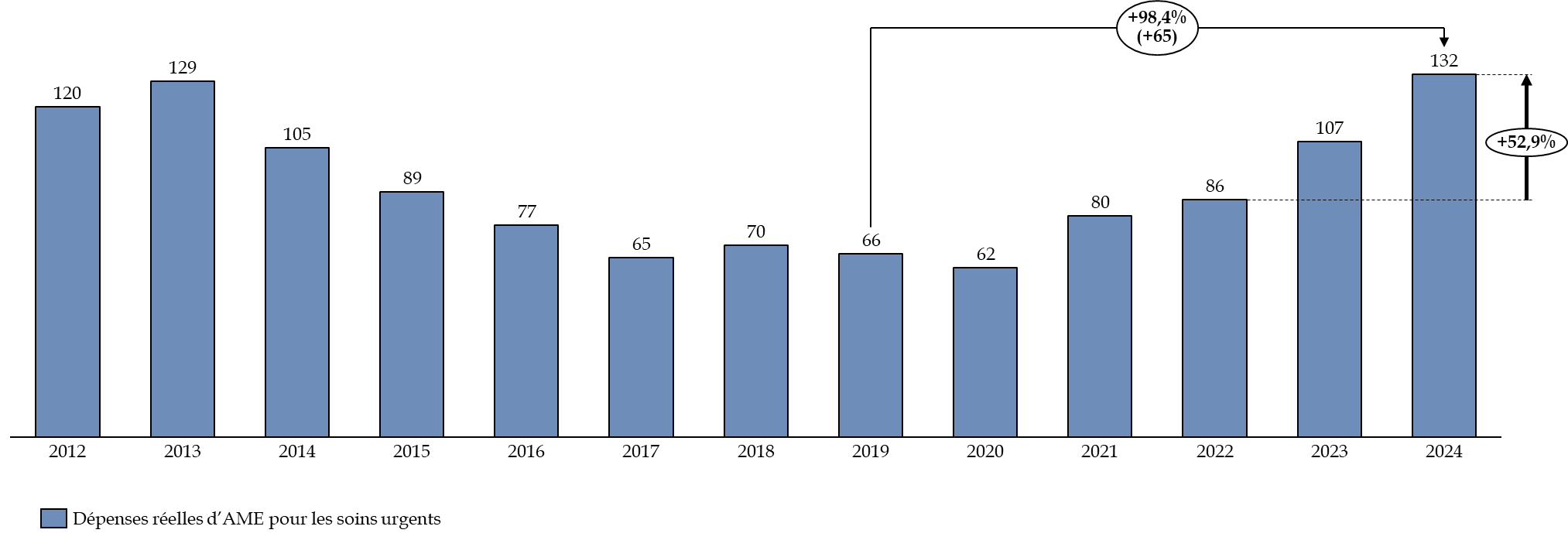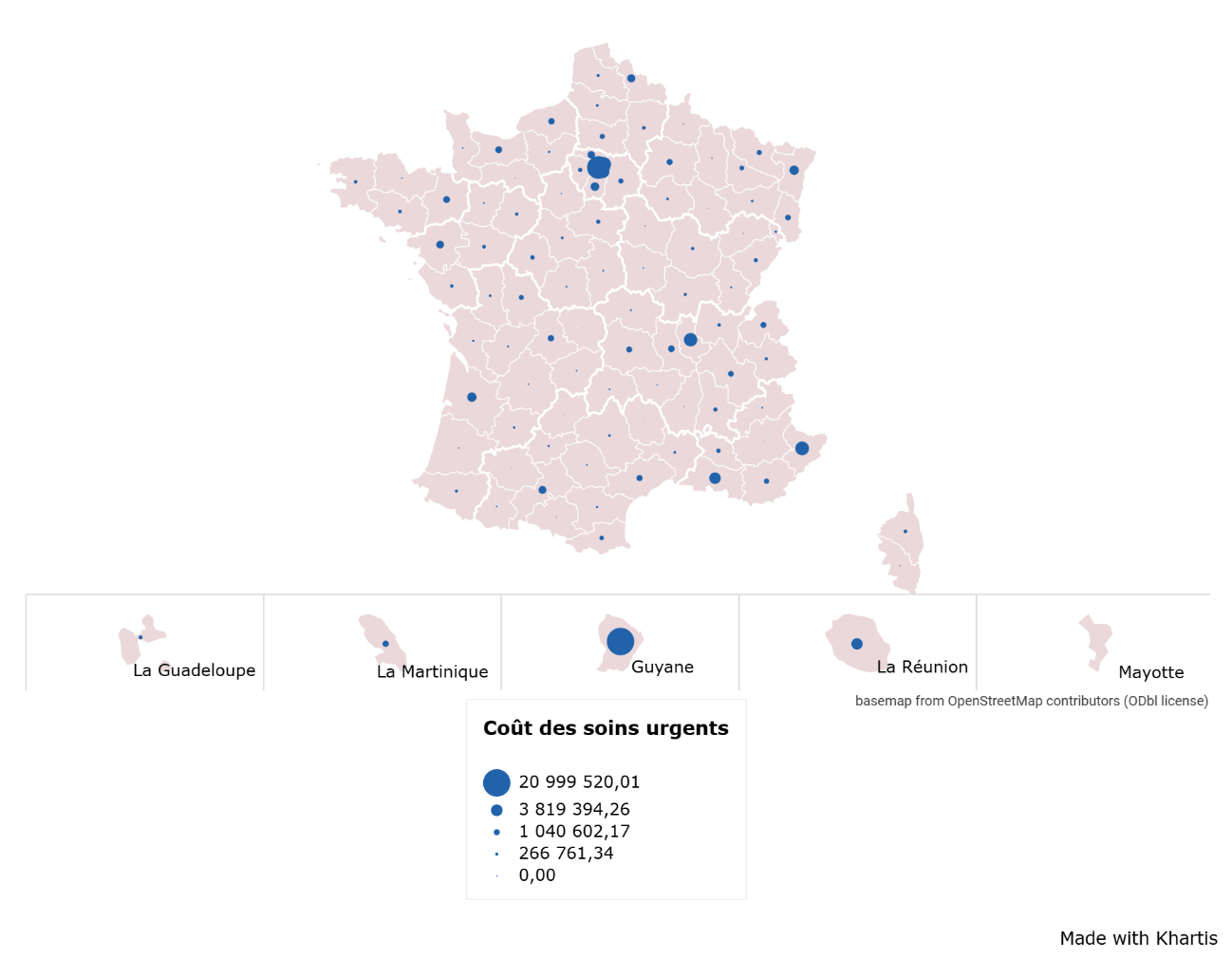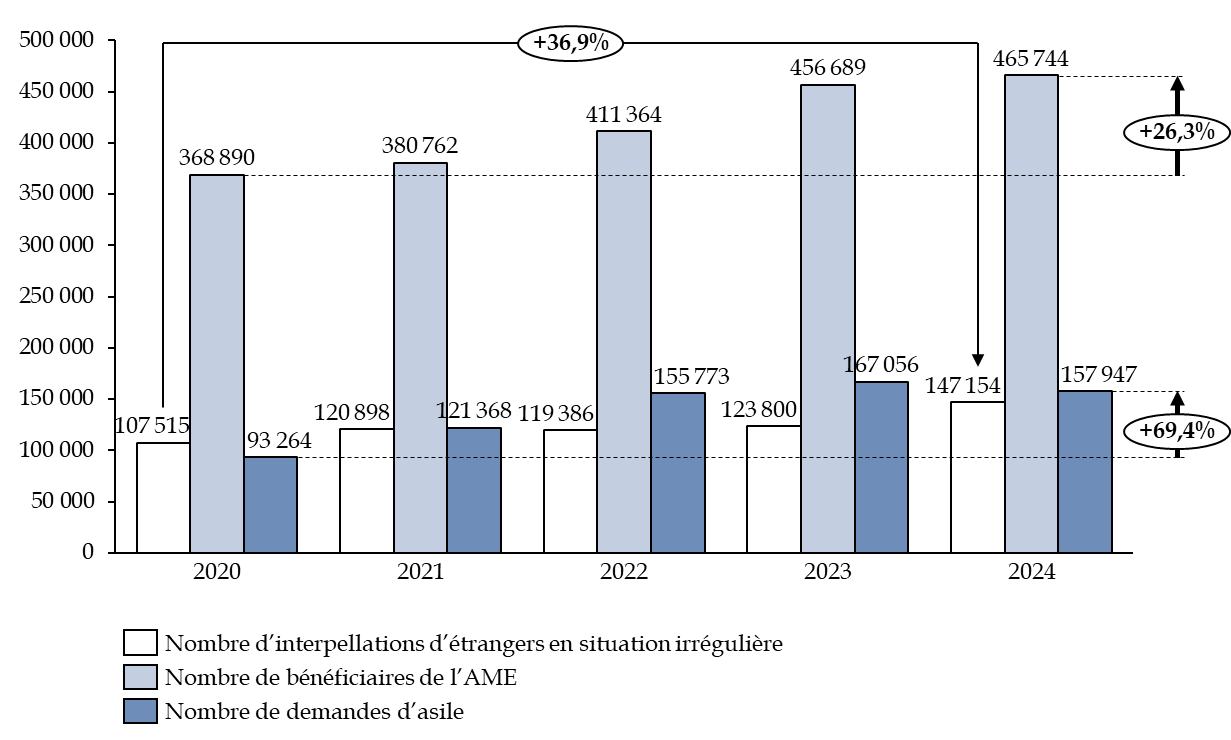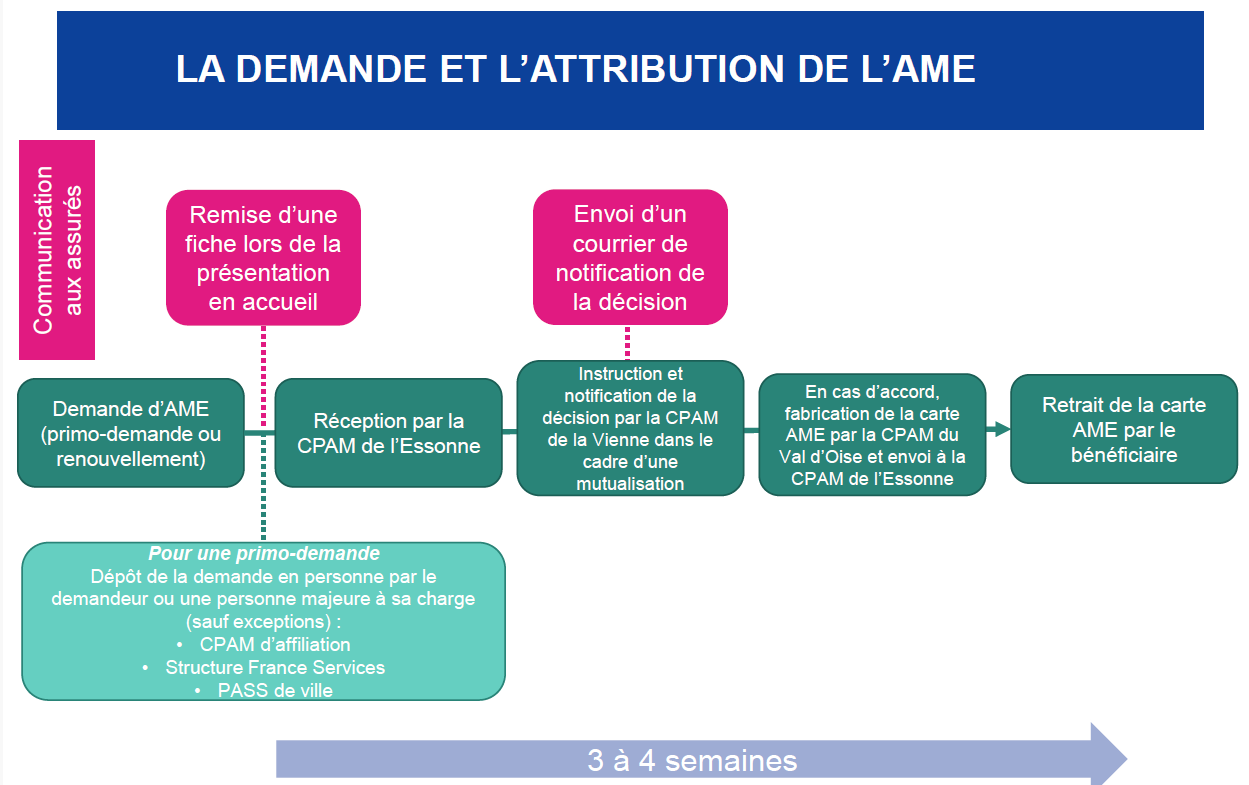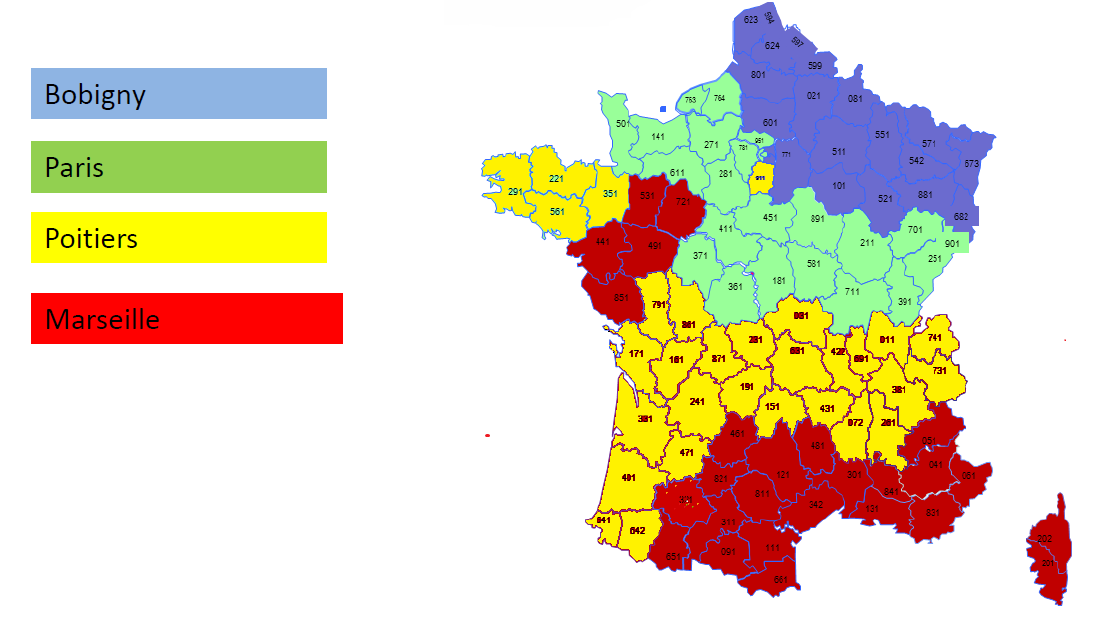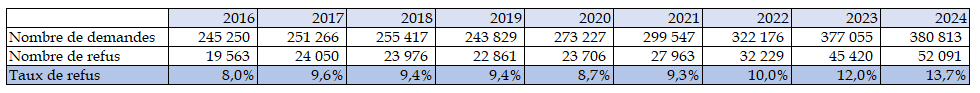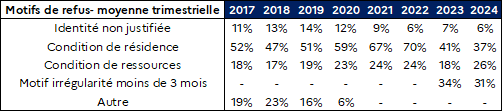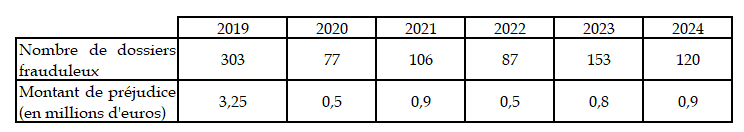- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET
INCHANGÉ DEPUIS 2020
- A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT,
PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN
FRANCE
- B. DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME MAL
CONNUS
- C. UN SYSTÈME FRANÇAIS
GÉNÉREUX PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS
- 1. Une prise en charge limitée aux soins
hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse
- 2. Certains pays (Allemagne, Royaume-Uni,
Suède, Italie) permettent l'accès à un panier de soins
élargi notamment aux actions de prévention, et à la prise
en charge de la grossesse mais plus limité que celui des assurés
sociaux
- 3. Certains pays (Espagne, Belgique) ont fait le
choix d'un large panier de soins
- 1. Une prise en charge limitée aux soins
hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse
- A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT,
PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN
FRANCE
- II. UN COÛT TRÈS ÉLEVÉ
POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES
- A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE
DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT
- B. DES DÉPENSES DES
BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLE DES
ASSURÉS SOCIAUX
- 1. Une dépense moyenne par
bénéficiaire modérée
- 2. Des dépenses centrées sur les
soins hospitaliers
- 3. Des dépenses de santé
spécifiques aux bénéficiaires de l'AME
- a) Des dépenses de soins hospitaliers
centrées sur les accouchements, les problèmes digestifs et
cardiovasculaires
- b) Des dépenses de médecine de ville
par bénéficiaire inférieure à la moyenne par
habitant pour les soins dentaires et d'optique
- c) Des dépenses de médicaments
centrées sur la lutte contre les maladies infectieuses (VIH,
hépatite C)
- a) Des dépenses de soins hospitaliers
centrées sur les accouchements, les problèmes digestifs et
cardiovasculaires
- 1. Une dépense moyenne par
bénéficiaire modérée
- C. UNE HAUSSE DES DÉPENSES D'AME
LIÉE EN PARTIE À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES
- A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE
DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT
- III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER
LES DÉPENSES D'AME
- A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION
IRRÉGULIÈRE
- B. REDÉFINIR LES DROITS OUVERTS AU TITRE DE
L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT
- C. UNE GESTION DE L'AME RELATIVEMENT
SATISFAISANTE
- A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION
IRRÉGULIÈRE
- I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET
INCHANGÉ DEPUIS 2020
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 841
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur l'aide médicale d'État,
Par M. Vincent DELAHAYE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
I. UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET INCHANGÉ DEPUIS 2020
A. UN DISPOSITIF INCHANGÉ DEPUIS 5 ANS MALGRÉ LES PROMESSES GOUVERNEMENTALES
1. L'AME recoupe 4 dispositifs
Le dispositif principal est l'AME de droit commun, créée par la loi du 27 juillet 19991(*). Elle permet la protection de la santé des personnes étrangères vivant en France depuis au moins trois mois consécutifs en situation irrégulière et dont les ressources ne dépassent pas un plafond de 862 euros mensuels en 2025.
L'AME de droit commun s'applique également aux « ayant-droits » du bénéficiaire (conjoint, enfants mineurs et majeurs à charge, ainsi qu'une personne unique à charge, vivant depuis 12 mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide).
Pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'AME de droit commun, une prise en charge au titre de « soins urgents » est prévue, sans condition de résidence, dès lors que le pronostic vital est engagé.
Deux autres dispositifs s'y ajoutent : l'AME humanitaire, accordée au cas par cas par le ministère chargé de l'action sociale, et l'aide médicale pour les personnes gardées à vue.
Le cas spécifique des demandeurs d'asile
Les demandeurs d'asile bénéficient après trois mois de résidence en France de la protection universelle maladie (PUMa). Toutefois, lorsque la demande est déboutée, c'est-à-dire dans 54,3 % des cas en 2024, ils n'ont plus droit à la PUMa et ne peuvent demander que l'aide médicale de l'État. Ainsi, 14 % des bénéficiaires de l'AME seraient des demandeurs d'asile déboutés.
Il serait plus cohérent de faire bénéficier les demandeurs d'asile de l'aide médicale de l'État, donnant une vision plus transparente de la dépense en termes de santé. Un tel système est par exemple utilisé en Allemagne.
2. Une absence de réforme pourtant promise par deux gouvernements successifs
Une réforme de l'aide médicale de l'État avait été annoncée par le Gouvernement en 2023, à l'occasion du vote par le Sénat de la transformation de l'AME en Aide médicale d'urgence au cours de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration2(*). Dans ce cadre, le gouvernement avait chargé MM. Evin et Stefanini de réaliser une mission concernant l'AME, en moins de trois mois. Depuis la remise du rapport en décembre 2023, aucune réforme n'a été mise en oeuvre, ce qui est très regrettable.
B. DES BÉNÉFICIAIRES MAL CONNUS
|
Les bénéficiaires de l'AME sont à |
Près de |
et |
|
des hommes. |
ont entre 20 et 39 ans |
ne bénéficieraient de l'AME que depuis un an. |
Les bénéficiaires de l'AME sont particulièrement concentrés dans certains départements très urbains : à Paris (13,6 % des bénéficiaires), en Seine-Saint-Denis (12,7 %), dans l'Essonne (4,2 %), dans les Bouches-du-Rhône (4,7 %) et le Rhône (3,6 %), ainsi qu'en Guyane (8,3 %).
C. UN SYSTÈME FRANÇAIS GÉNÉREUX PAR RAPPORT À SES VOISINS EUROPÉENS
Le Danemark et la Suisse ne prennent en charge gratuitement que les soins urgents et demandent une participation financière pour le traitement des maladies infectieuses, la prévention et les frais liés à la grossesse.
La plupart des pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) limitent davantage qu'en France le panier de soins remboursé pour les étrangers en situation irrégulière par rapport à celui des assurés sociaux mais sont plus généreux que le Danemark et la Suisse.
Certains pays (Espagne, Belgique), prennent en charge pratiquement l'ensemble des soins dont bénéficient les assurés sociaux pour les étrangers en situation irrégulière.
II. UN COÛT ÉLEVÉ D'1,3 MILLIARD D'EUROS POUR L'ÉTAT
A. UNE HAUSSE DE 68 % DES DÉPENSES EN 10 ANS
Pour l'année 2024, le coût total réel de l'AME, toutes AME incluses, est de 1 386,8 millions d'euros, soit une hausse de 15,5 % par rapport à 2023, et de 67,6 % en 10 ans, représentant 543 millions d'euros.
Évolution des dépenses réelles d'AME entre 2012 et 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Les dépenses d'AME sont toutefois plus élevées que celles qu'affiche le budget de l'État. En effet, d'une part, l'État ne prend en charge qu'une partie de l'AME pour soins urgents, à hauteur d'une dotation forfaitaire, le reste du coût étant pris en charge par l'Assurance maladie.
Par ailleurs, malgré la formulation très explicite de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses de l'aide médicale de l'État de droit commun n'ont pas été prises en charge intégralement par l'État. L'AME étant une dépense de guichet, si l'État ne programme pas suffisamment de crédits budgétaires pour financer l'intégralité des dépenses d'AME de droit commun, il crée une dette à l'égard de la Sécurité sociale.
Or, en particulier en 2024, le décret d'annulation du 21 février 20243(*) a supprimé près de 50 millions d'euros de crédits au titre de l'aide médicale de l'État (AME). En conséquence, l'État a contracté une dette inédite à l'égard de la CNAM, de 185,1 millions d'euros.
Une telle situation n'est pas acceptable : une budgétisation des dépenses réelles d'aide médicale de l'État est indispensable.
Au total, les dépenses de l'ensemble des AME dans le budget de l'État se sont élevées à 1,16 milliard d'euros en 2024, et ont augmenté de 40 % en 10 ans. Les dépenses d'aide médicale de droit commun se sont élevées à 1,088 milliards d'euros en 2024.
B. DES DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLES DES ASSURÉS SOCIAUX
La dépense moyenne de l'AME s'élève en 2023 à 2 396,4 euros par bénéficiaire, un montant en hausse de 3,2 % par rapport à 2015, mais inférieur à celui de l'ensemble de la population française.
Près de 60,8 % des dépenses sont constituées de prestations hospitalières, tandis que les produits de santé ne représentent que 12,7 % des dépenses et les soins de ville 26,5 %.
Évolution de la consommation annuelle
moyenne dans la population totale
et par bénéficiaire de
l'AME
(en euros)
Source : commission des finances d'après la DREES
C. UNE HAUSSE DES DÉPENSES ESSENTIELLEMENT MAIS PAS UNIQUEMENT LIÉE À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
La hausse des dépenses de l'AME est notamment liée à la progression du nombre de bénéficiaires ces dernières années. Ils étaient 465 744 bénéficiaires au 30 septembre 2024, soit une multiplication par 2 entre 2011 et 2024.
Évolution du nombre de
bénéficiaires de l'AME de droit commun
entre 2011 et
2024
(en nombre de bénéficiaires)
Source : commission des finances d'après la DSS
Au total, depuis 2020, il est possible d'estimer que l'augmentation du nombre de bénéficiaires a entrainé une hausse de 243 millions d'euros de dépenses d'AME de droit commun, sur un total de 426,6 millions d'euros.
Effet de l'augmentation des
bénéficiaires d'AME de droit commun
sur la hausse des
dépenses entre 2020 et 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DSS
La hausse du nombre de bénéficiaires explique pour partie seulement l'augmentation tendancielle des dépenses d'AME.
III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER LES DÉPENSES D'AME
A. AXE 1 : LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION ILLÉGALE
Il apparait relativement avéré que le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français est en hausse depuis au moins 4 ans. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 26,3 % entre 2020 et 2024, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière de 37 % et le nombre de demandes d'asile de 69,4 % à la même période. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière pourrait être de 900 000 personnes, dont la moitié aurait recours à l'AME. Lutter contre les flux de l'immigration illégale constitue la condition essentielle de maitrise des dépenses d'AME.
B. AXE 2 : REDÉFINIR LES DROITS OUVERTS AU TITRE DE L'AME
1. Revoir les conditions d'accès à l'AME
Le bénéfice de l'AME est accordé quel que soit le motif de l'irrégularité du séjour de la personne concernée, y compris aux personnes se trouvant en situation irrégulière à la suite d'un retrait de titre de séjour pour motif d'ordre public. 5 852 personnes en 2024 sont éligibles à l'aide médicale de l'État en 2024, alors qu'elles sont jugées comme constituant une menace pour l'ordre public. Une telle situation n'est pas acceptable : il serait important que les personnes concernées par un refus ou un retrait de titre de séjour pour motif d'ordre public ne puissent être éligibles à l'AME de droit commun.
2. Revoir la définition des soins pris en charge
Actuellement, sont explicitement exclus de la prise en charge au titre de l'AME : les cures thermales, l'assistance médicale à la procréation (PMA), les médicaments dont le service médical rendu est faible ou encore les frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire.
Il serait pertinent de se rapprocher du système mis en oeuvre en Allemagne, qui représente une solution « médiane » entre les systèmes danois et suisse et le système espagnol.
En Allemagne, par rapport à la France, sont notamment exclus totalement du panier de soins pris en charge les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, sauf si leur non réalisation entrainerait une aggravation critique de l'état de santé de la personne. Sont soumis à autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie notamment les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie.
Il est assez difficile d'évaluer l'ampleur des économies représentées Toutefois, les soins de suite et de réadaptation, les hospitalisations à domicile, la psychiatrie et les dépenses des cliniques privées, représentent 338 millions d'euros.
Contrairement au dispositif allemand, il serait préférable de conserver les dépenses de prévention dans le panier de soins pris en charge par l'AME.
Enfin, les personnes bénéficiant de l'aide médicale de l'État depuis moins de neuf mois ne peuvent recevoir certains soins qu'après un accord préalable de la caisse d'assurance maladie. De 2021 à 2024, seulement 32 demandes d'accord préalable ont été émises.
Il est étonnant que cette obligation ne concerne que les personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois. Ce dispositif devrait être étendu pour ces mêmes soins à tous les bénéficiaires d'AME, conformément à l'amendement adopté au Sénat lors du vote du projet de loi de finances pour 2025.
C. AXE 3 : UNE GESTION DE L'AME ENCORE PERFECTIBLE POUR ÉVITER LA FRAUDE
Les contrôles a priori conduits par les CPAM sont efficients, et conduisent à un taux de refus de dossier d'AME en augmentation, passant de 8 % des dossiers en 2016 à 13,7 % en 2024.
Évolution du nombre de dossiers frauduleux et du montant du préjudice subi entre 2019 et 2024
Source : commission des finances d'après la CNAM
Un programme national de contrôle est mis en oeuvre depuis juin 2019 afin de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés et bénéficiaires de l'AME, sur la base de requêtes dans les bases de données détectant les multi-hébergeurs, de l'exploitation des signalements d'organismes et d'échanges avec les consulats.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire, dans le pays d'origine, grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).
Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).
Recommandation n° 3 : actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État afin d'améliorer la prévision (DSS, CNAM).
Recommandation n° 4 : enregistrer le statut administratif des personnes sollicitant ou bénéficiant d'une greffe (agence de biomédecine).
Recommandation n° 5 : limiter le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux enfants mineurs à charge du bénéficiaire et prendre en compte les revenus du conjoint lors de la définition du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'aide (DSS).
Recommandation n° 6 : exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public (DSS).
Recommandation n° 7 : étendre le recours à l'accord préalable avant de bénéficier de soins « non urgents » à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME (DSS, CNAM).
Recommandation n° 8 : limiter le panier de soins pris en charge, sur le modèle de la recommandation cadre de l'Allemagne, en excluant notamment les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, et en soumettant à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie (DSS, CNAM).
Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre des campagnes de prévention spécifiques à destination des bénéficiaires de l'AME dans les CPAM, en particulier lors de la délivrance de la carte de bénéficiaire de l'aide (DSS, CNAM).
Recommandation n° 10 : exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État (DSS, CNAM).
I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET INCHANGÉ DEPUIS 2020
A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT, PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN FRANCE
1. Des dispositifs réservés aux étrangers en situation irrégulière
L'aide médicale de l'État (AME) recouvre en réalité plusieurs dispositifs distincts, relevant de la mission « Santé » du budget de l'État.
a) L'aide médicale de l'État de droit commun
Le dispositif le plus massif en termes de dépenses et de nombre de bénéficiaires est l'AME de droit commun. Elle a été créée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle4(*). En effet, jusqu'en 1993, l'aide médicale départementale permettait de couvrir les soins des personnes les plus précaires, y compris les étrangers en situation irrégulière. Or la loi du 24 août 1993 relative à la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entrée5(*), d'accueil et séjour des étrangers en France (dite loi « Pasqua-Debré ») a imposé une condition de régularité du séjour pour bénéficier de l'assurance maladie. L'aide médicale départementale a donc été remplacée par la couverture maladie universelle, pour les résidents en situation régulière, ainsi que par l'aide médicale de l'État, pour les étrangers présents en situation irrégulière, à partir de 2000. Plusieurs objectifs sous-tendaient la création de l'aide médicale de l'État :
- un objectif de santé publique, visant à améliorer la prise en charge notamment des maladies contagieuses ;
- un objectif éthique et humanitaire, visant à reconnaitre le droit à la santé de toutes les personnes présentes en France ;
- un objectif de rationalisation de la dépense publique, aux fins d'éviter une prise en charge plus importante de soins qui auraient pu être évités avec une détection plus précoce.
L'AME de droit commun, définie aux articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, permet donc la protection de la santé des personnes étrangères vivant en France depuis au moins trois mois consécutifs en situation irrégulière et, de ce fait, non éligibles à la protection universelle maladie (PUMa)6(*).
Ces personnes ne doivent pas disposer de ressources dépassant un plafond annuel défini au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ce plafond, qui s'élève à 10 339 euros par an pour une personne seule en métropole à partir du 1er avril 20257(*), est révisé chaque année « pour tenir compte de l'évolution des prix ». Il correspond à un revenu maximal de 862 euros mensuels.
Évolution du plafond annuel de ressources
du bénéfice de l'AME
entre 2018 et 2025
(en euros et en pourcentage)
Source : commission des finances
Au total, le plafond de ressources pour bénéficier de l'AME de droit commun a augmenté de 17,3 % entre 2018 et 2025, alors que l'inflation cumulée a été de 17,5 %. L'évolution du plafond est donc globalement conforme à la hausse de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, il est à noter qu'il s'agit du même plafond que celui qui est utilisé pour définir le droit d'un assuré social, en situation régulière, à la protection complémentaire en matière de santé. Les conditions d'évolution du plafond ne dépendent donc pas uniquement de considérations liées à l'aide médicale de l'État.
Le plafond de ressources est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
L'AME de droit commun s'applique également aux « ayant-droits » du bénéficiaire, à savoir :
- le conjoint ou le concubin, les enfants mineurs à charge et les enfants majeurs qui poursuivent leurs études ou sont dans l'impossibilité d'exercer un travail salarié en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique, conformément à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
- une personne unique, vivant depuis 12 mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide et se trouvant à sa « charge effective, totale et permanente ». Le demandeur effectue une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, à cette fin.
L'aide médicale de l'État s'applique enfin dans l'ensemble des départements français et ultramarins, à l'exception de Mayotte, conformément à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des familles. À Mayotte, sauf pour les soins dont le défaut « peut entrainer une altération grave et durable de l'état de santé » ou de ceux relevant du « cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves », la prise en charge relève directement des patients, conformément à l'article L. 614-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, conformément à l'article 74 de la Constitution, la compétence en matière de santé relève du Pays en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'AME ne s'y applique donc pas.
Enfin, tous les frais de santé ne relèvent pas de l'aide médicale de l'État de droit commun. Sont compris, comme pour les assurés sociaux, des frais de médecine générale et spéciale, pour :
- les soins et de prothèses dentaires ;
- les frais pharmaceutiques et d'appareils ;
- les frais d'examens de biologie médicale,
- les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle,
- les frais des séances d'accompagnement psychologique ;
- les frais d'interventions chirurgicales ;
- la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs ;
- les frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir des examens ;
- les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
- les actes et traitements à visée préventive, y compris les rendez-vous de prévention organisés à certains âges ;
- l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens liés à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ;
- le forfait journalier acquitté par les assurés sociaux lors d'un séjour dans un établissement de santé, institué à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, est pris en charge intégralement pour les mineurs.
Pour les bénéficiaires majeurs, l'AME couvre 100 % du tarif de la sécurité sociale. Ainsi, aucun dépassement d'honoraires ou du tarif de la Sécurité sociale n'est pris en charge au titre de l'aide médicale de l'État.
Peuvent toutefois être exclus de la prise en charge, sauf pour les mineurs, les actes, produits et prestations dont le service médical rendu n'est ni moyen ni important, ou « lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ».
Conformément à l'article R. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont explicitement exclus de la prise en charge au titre de l'aide médicale de l'État :
- les cures thermales ;
- l'assistance médicale à la procréation (PMA) ;
- les médicaments dont le service médical rendu est faible.
Ne sont pas non plus inclus dans le bénéfice de l'AME de droit commun par exemple les frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire ou encore de repérage des troubles du neurodéveloppement.
Les bénéficiaires de l'AME sont également supposés recevoir systématiquement des médicaments génériques en pharmacie, à moins que le prix du générique ne soit supérieur ou égal à celui du princeps ou si ce générique est soumis au tarif forfaitaire de responsabilité. Pour les assurés sociaux, la substitution en pharmacie d'un princeps par un générique est conditionnée à l'accord du patient.
Enfin, les personnes bénéficiant de l'aide médicale de l'État depuis moins de neuf mois ne peuvent recevoir certains soins qu'après un accord préalable de la caisse d'assurance maladie, et uniquement si l'absence de réalisation de ces prestations peut avoir des conséquences « vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne », comme indiqué à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces soins sont définis à l'article R. 251-3 du même code, et comprennent :
- certaines prestations réalisées en établissement de santé, lorsqu'elles ne concernent pas des « traumas, fractures, brûlures, infections, hémorrhagies, tumeurs suspectées ou avérées » : libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, libérations du médian au canal carpien, interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, allogreffes de cornée, interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, rhinoplasties, pose d'implants cochléaires, interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, interventions pour oreilles décollées, prothèses de genou, prothèses d'épaule, prothèses de hanche, interventions sur la hanche et le fémur, sur le sein, gastroplasties et autres interventions pour obésité ;
- certains actes réalisés en ville : les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières précitées, les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières précitées.
b) L'AME pour soins urgents
Par ailleurs, pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'AME de droit commun, une prise en charge au titre de « soins urgents » est prévue aux articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette prise en charge est également possible pour les demandeurs d'asile majeurs ne relevant pas du régime général d'assurance maladie, c'est-à-dire les demandeurs d'asile présents depuis moins de trois mois sur le territoire national, conformément à l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale.
L'AME pour soins urgents concerne les étrangers en situation irrégulière, sans condition de résidence, dès lors que leur pronostic vital est engagé ou qu'ils sont victimes d'une altération grave et durable de leur état de santé ou de celui de leur enfant à naitre.
c) L'AME humanitaire et l'AME médicale pour les personnes gardées à vue
Enfin, conformément aux 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, il existe deux autres dispositifs d'aide médicale de l'État :
- L'AME humanitaire, qui vise les prises en charge ponctuelles de soins hospitaliers de personnes françaises ou étrangères ne résidant pas sur le territoire. Cette couverture est accordée au cas par cas par le ministère chargé de l'action sociale et doit permettre, chaque année, à une centaine de personnes disposant de faibles revenus de régler une dette hospitalière ;
- l'aide médicale accordée aux personnes gardées à vue qui se limite à la prise en charge des médicaments - si l'intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires à leur acquisition - et aux actes infirmiers prescrits, ainsi que l'aide médicale fournie aux personnes placées en rétention administrative pour les soins prodigués à l'extérieur des lieux de rétention.
2. Une réforme promise de l'AME mais jamais mise en oeuvre
Depuis sa création en 1999, le dispositif de l'AME a été modifié à plusieurs reprises.
La loi de finances du 30 décembre 2002 rectificative pour 20028(*) instaure ainsi le principe d'une participation financière des bénéficiaires de l'AME, conditionnée à un décret d'application qui ne sera jamais appliqué.
La loi de finances pour 2003 instaure une condition de résidence ininterrompue de trois mois pour accéder à l'AME et crée, en réaction, la prise en charge au titre des soins urgents codifiée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
Un droit de timbre pour bénéficier de l'AME, d'un montant de 30 euros, est institué au 1er mars 2011 par la loi de finances initiale pour 20119(*), mais est supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 pour 201210(*).
À l'initiative du Gouvernement, une réforme limitée de l'aide médicale de l'État a été adoptée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2021 afin de mieux prévenir les risques de fraudes et de détournements abusifs du dispositif de l'AME :
- une condition de durée minimale de séjour irrégulier de trois mois est nécessaire pour obtenir le bénéfice de l'AME11(*), afin d'éviter un accès immédiat au dispositif dès l'expiration d'un visa touristique ;
- une obligation de dépôt physique de la première demande d'AME12(*) est instituée.
Les caisses primaires d'Assurance maladie ont commencé, par l'interrogation de la base Visabio, à vérifier que les demandeurs ne disposaient pas d'un visa en cours de validité, situation devant les exclure du bénéfice de l'AME.
- enfin, le bénéfice de certaines prestations programmées et non urgentes est subordonné à un délai d'ancienneté de neuf mois de bénéfice de l'AME13(*). Pour les cas les plus urgents ne pouvant attendre le délai d'ancienneté, la prise en charge par l'AME est également possible après accord préalable du service du contrôle médical de la caisse primaire d'Assurance maladie.
Une nouvelle réforme de l'aide médicale de l'État avait été annoncée par le Gouvernement en 2023, à l'occasion du vote par le Sénat de la transformation de l'AME en Aide médicale d'urgence le 14 novembre 2023 au cours de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration14(*). Dans ce cadre, le gouvernement avait chargé MM. Evin et Stefanini de réaliser une mission concernant l'AME.
Le rapport Evin-Stefanini, publié le 4 décembre 2023, estime qu'il s'agit d'un dispositif « utile, maîtrisé pour l'essentiel mais exposé à l'augmentation récente du nombre de ses bénéficiaires ». Cette mission a eu lieu en un temps record (moins de trois mois), ce qui a complexifié son travail. Les co-auteurs ont toutefois pu recommander notamment :
- l'émancipation des majeurs ayants-droits pour le bénéfice de l'AME ;
- le resserrement de la vérification des conditions d'accès (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers) ;
- l'exclusion du bénéfice de l'AME des personnes frappées d'une mesure d'éloignement du territoire pour motif d'ordre public ;
- l'extension du recours à l'accord préalable (application au-delà de 9 mois, extension à d'autres actes ou affections).
Or ces réformes, dont une partie est d'ordre réglementaire, n'ont jamais été conduites par le Gouvernement, malgré les promesses en ce sens des Premiers ministres Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Il n'est pas acceptable que le Gouvernement ne tienne pas des engagements pris devant les Parlementaires. Il est indispensable et urgent de procéder à une amélioration substantielle du régime de l'aide médicale de l'État.
3. Une prise en charge sanitaire des étrangers en France dépassant le cadre de la seule AME
Par ailleurs, la prise en charge sanitaire des étrangers présents sur le sol national dépasse le seul cadre de l'aide médicale de l'État.
a) Le cas des étrangers entrés avec un visa sur le sol français
Certains étrangers en situation irrégulière sont en réalité entrés sur le territoire français de manière régulière et leur visa a expiré. La question de la prise en charge des frais de santé de ces personnes, parfois venues en France pour bénéficier des soins, constitue un enjeu financier certain pour le système sanitaire.
Ainsi, pour les ressortissants non membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un justificatif « de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ». Cet article concerne tant les visas de court séjour que ceux de long séjour (d'une durée supérieure à 90 jours). Pour les citoyens de l'Union européenne, un séjour de plus de trois mois est conditionné également à la souscription à une assurance maladie, conformément à l'article L. 233-1 du code précité.
Des dispenses à cette obligation sont prévues dans le cas des visas de long séjour :
- les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs (art. L.312-5) ;
- l'étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France (art. L. 312-6) ;
- les enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France (art. L.312-6) ;
- les personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées (art. L.312-6) : on trouve dans cette catégorie les volontaires internationaux et les « talents ».
Les étudiants sont également exemptés de produire une attestation d'assurance lors du dépôt de leur demande de visa, attendu qu'ils peuvent demander leur affiliation à l'assurance maladie15(*).
En pratique, s'agissant des visas de long séjour, sont concernés par l'obligation de produire une attestation de prise en charge des soins médicaux et du rapatriement, pour la totalité de la durée du séjour, les demandeurs de visa ayant vocation à recevoir :
- un visa de long séjour temporaire (VLS-T) délivré aux étrangers « visiteurs » (art. L. 426-20), aux enfants « mineurs scolarisés », aux étrangers participant à un programme « visa vacances-travail » si l'accord bilatéral concerné le prévoit ;
- un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) délivré à l'étranger en recherche d'emploi ou créateur d'entreprise au titre de l'article L.422-14.
Dans le cas des visas de court séjour, sont dispensés de produire une telle assurance dans le cas des visas de court séjour : les titulaires d'un passeport diplomatique, les ressortissants de pays tiers membres de famille d'un ressortissant de l'Union ou relevant de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union et qui souhaitent rejoindre le ressortissant de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord sur le retrait dans l'État d'accueil où il se trouve. La dérogation à l'obligation de présenter une preuve d'assurance maladie en voyage peut également concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.
L'absence d'assurance, lorsqu'exigée, constitue un motif de refus du visa. L'assurance doit être valable sur tout le territoire des États membres et couvrir l'intégralité du séjour envisagé par le demandeur pendant la période de validité du visa. La couverture minimale est de 30 000 euros, conformément à l'article R. 313-3 du CESEDA.
L'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a une mission médicale double :
- dans le cadre de l'entrée d'étrangers sur le territoire français avec un titre de séjour, une visite de prévention avec une radiographie pulmonaire est conduite par l'un des médecins agréés de l'OFII. Près de 60 000 personnes par an reçoivent une telle visite médicale, qui conditionne la pérennité de leur titre de séjour. L'objectif de cette visite est le contrôle des maladies transmissibles, l'appréciation de la santé mentale des individus arrivant et la compatibilité entre le travail pressenti en France et l'état de santé de la personne. Une partie des visites médicales est conduite à l'étranger.
- dans le cas des demandeurs d'asile, une visite médicale est également prévue et effectuée par l'OFII.
Lors des auditions, des cas de filières d'étrangers entrés souvent légalement sur le territoire français ont été mentionnés, notamment en provenance d'Algérie, de Géorgie ou encore du Kosovo. Or dans le cas de ces pays, aucun visa n'est demandé en cas de séjour en France d'une durée inférieure à 90 jours. L'assurance médicale demeure obligatoire, mais son existence est difficile à contrôler en amont en l'absence de procédure de visa en consulat précédant la venue en France.
Par ailleurs, il n'existe pas de lien entre une pathologie et le refus d'un titre de séjour en France, alors que c'est le cas aux Etats-Unis. En effet, pour ce faire, il faudrait systématiser la visite médicale avant l'arrivée en France dans le pays d'origine, comme le font déjà les Etats-Unis qui disposent de conventions en ce sens avec des médecins locaux. Un tel système pourrait être avantageusement mis en oeuvre en France. Il permettrait de limiter le nombre de personnes venant en France se faire soigner pour une maladie chronique, en demandant un visa qui peut arriver à expiration avant la fin des soins. L'objectif est d'éviter le « tourisme médical ».
Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire dans le pays d'origine grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).
Dans leur rapport de 2019 sur l'aide médicale de l'État16(*), les inspections préconisaient également, afin de détecter les suspicions de migration pour soins, de permettre aux consulats et à la police aux frontières de connaître les bénéficiaires de l'AME et les redevables d'une créance hospitalière, grâce à la constitution d'un fichier centralisé des impayés hospitaliers. Quant au signalement des impayés hospitaliers, il suppose que les établissements de santé concernés renseignent la nationalité des patients, ce qui n'est le plus souvent pas le cas. Une telle initiative doit être mise en oeuvre.
De plus, même dans le cas où les personnes bénéficient d'une assurance médicale privée, il est parfois difficile pour les hôpitaux d'obtenir le recouvrement de leurs créances. Notamment lors d'un passage aux urgences la nuit, la facture n'est pas produite immédiatement et aucun acompte n'est demandé aux patients. Par ailleurs, dans le cas de pathologies anciennes, il est parfois difficile d'obtenir le remboursement par les assurances.
b) Le cas des étrangers titulaires d'un titre de séjour
Les étrangers présents régulièrement sur le sol français pour une durée trop importante pour bénéficier d'un visa sont titulaires d'un titre de séjour. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier de l'affiliation à la protection universelle maladie (PUMa) qu'au bout de six mois de résidence en France, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale. Dans l'intervalle, ils peuvent alors bénéficier de l'aide médicale de l'État de droit commun au bout de trois mois de résidence, et surtout des soins urgents si leur état de santé le justifie.
Le titre de séjour pour soins
Il existe également un titre de séjour accordé spécifiquement pour les étrangers qui auraient besoin d'une prise en charge sanitaire. L'article L. 425-9 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », s'il remplit les conditions suivantes :
- son état de santé nécessite une « prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ;
- il ne pourrait bénéficier d'un « traitement approprié » dans son pays d'origine, « eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé » ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- il réside habituellement en France.
En 2024, 3 054 premiers titres de séjour pour soins (dits « étranger malade ») ont été accordés, en baisse de 4,1 % par rapport à 2023. Il est très difficile d'évaluer combien de titres de séjour pour soins sont en circulation en France, étant donné que le motif des renouvellements de titre « de plein droit » n'est pas enregistré. En tout état de cause, selon l'OFII, le stock est composé de 20 600 titres de séjour pour soin fin 2022, contre 30 400 en 2018.
Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers en France
À noter, qu'en cas de mesure d'éloignement définitive, les droits à la PUMa éventuellement ouverts sont fermés au bout de deux mois (article R. 111-4 du code de la sécurité sociale), afin d'éviter des procédures administratives trop lourdes en cas de retard dans le renouvellement d'un titre de séjour. Cela signifie toutefois que des étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de la PUMa pendant deux mois, avant de devoir demander l'AME.
c) Le cas spécifique des demandeurs d'asile
Les demandeurs d'asile, soit la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger menacé dans son pays d'origine qui ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays, bénéficient après trois mois de résidence en France de la protection universelle maladie (PUMa). Avant ces trois mois, ils n'ont une prise en charge sanitaire qu'au titre de l'aide médicale de l'État pour les soins urgents.
Si la demande d'asile est acceptée, les demandeurs d'asile continuent à bénéficier de la PUMa. Toutefois, lorsque la demande est déboutée, c'est-à-dire dans 54,3 % des cas en 202417(*), ils ne peuvent demander que l'aide médicale de l'État, à condition de satisfaire les critères d'accès de résidence stable et de ressources. Or dans ce cas, le droit d'accès à la PUMa n'est résilié qu'au bout de 6 mois, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, 14 % des bénéficiaires de l'AME seraient des demandeurs d'asile déboutés.
Une telle organisation parait très étonnante. Il serait plus cohérent de faire bénéficier les demandeurs d'asile de l'aide médicale de l'État, donnant une vision plus transparente de la dépense véritable en termes de santé de l'État en faveur des étrangers présents sur le territoire français sans titre de séjour. Le parcours administratif de prise en charge des soins de ces personnes s'en trouverait moins heurté. De plus, le régime de l'AME de droit commun étant moins étendu que celui de la PUMa, une telle mesure serait une source d'économies pour la puissance publique. Un tel système est par exemple utilisé en Allemagne.
L'un des intérêts de faire bénéficier les demandeurs d'asile de la PUMa est qu'ils peuvent demander également la complémentaire santé solidaire, sous conditions de ressources, limitant de fait la prise en charge sanitaire par la sécurité sociale. Toutefois, la complémentaire santé solidaire est financée par l'État : le coût des soins des demandeurs d'asile relève ainsi de la puissance publique dans tous les cas.
Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).
Toutefois, deux points doivent être pris en compte :
- d'une part, un tel dispositif revient à augmenter le coût pour l'État de la mission « Santé » via un transfert depuis la sécurité sociale. Entre 2021 et 2024, l'OFPRA a enregistré entre 103 164 et 153 715 demandes chaque année, en hausse de 50 % en quatre ans ;
- d'autre part, certains demandeurs d'asile ne demandent en fait pas l'AME une fois qu'ils sont déboutés.
B. DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME MAL CONNUS
1. Une population particulièrement jeune et masculine
Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État de droit commun sont à 56 % des hommes, une proportion n'ayant quasiment pas varié depuis 2011 (54,7 % des bénéficiaires de l'AME étaient alors des hommes).
La population des bénéficiaires de l'AME est également beaucoup plus jeune que l'ensemble de la population résidant en France. Ainsi, près de 43 % des bénéficiaires de l'AME ont entre 20 et 39 ans, alors que cette proportion n'est que de 23,4 % dans la population française. Près de 13,7 % des bénéficiaires de l'AME ont entre 30 et 34 ans.
Répartition par classe d'âge de la
population résidant en France
et des bénéficiaires de
l'AME
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale
La population d'ayant-droits en particulier est très jeune : 80,5 % d'entre eux sont mineurs.
La pyramide des âges des bénéficiaires de l'AME a peu varié en dix ans, même si le nombre de mineurs a augmenté. Ainsi, en 2013, 51,7 % des bénéficiaires de l'AME avaient entre 20 et 39 ans, alors que seuls 20,7 % d'entre eux étaient mineurs, contre 26,2 % en 2023.
Répartition par classe d'âge des
bénéficiaires de l'AME
en 2013 et en 2023
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale
Aucune information relative à la nationalité et au lieu de naissance ne sont disponibles dans les données sur les bénéficiaires de l'AME transmises par la direction de la sécurité sociale, étant donné qu'il ne s'agit pas de conditions à l'accès de l'aide médicale de l'État.
Il est toutefois très regrettable que de telles informations ne soient pas remontées, alors qu'elles figurent sur les documents d'identité fournies par le demandeur, au même titre que son âge. Il serait souhaitable que les caractéristiques des bénéficiaires de l'AME soient mieux connues, d'autant qu'il s'agit de l'une des rares sources d'informations sur les étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français (voir infra). Des remontées de données plus détaillées sur les bénéficiaires de l'AME sont nécessaires et justifiées.
Toutefois, les établissements de santé, en particulier, disposent parfois de ces informations. Ainsi par exemple, le Centre hospitalier sud francilien, qui a traité 3 355 patients en 2024, a pu fournir un échantillonnage des lieux de naissance des patients bénéficiant de l'AME. Près de 43,1 % d'entre eux seraient nés en Afrique subsaharienne.
Lieu de naissance des patients
bénéficiaires de l'aide médicale de l'État
traités au centre hospitalier sud francilien
Source : commission des finances d'après le centre hospitalier sud francilien
Selon la caisse générale de sécurité sociale, les bénéficiaires de l'AME en Guyane, qui constituent une population assez spécifique, proviennent essentiellement du Brésil et du Suriname, mais également d'Haïti.
2. Une forte concentration géographique
Les bénéficiaires de l'AME sont particulièrement concentrés dans certains départements très urbains. En Île-de-France, Paris concentre 13,6 % des bénéficiaires de l'AME, la Seine-Saint-Denis 12,7 %, l'Essonne 4,2 % et le Val-de-Marne 5,4 %. Les Bouches-du-Rhône (4,7 %) et le Rhône (3,6 %) attirent également un grand nombre de bénéficiaires de l'AME.
La Guyane compte 8,3 % des bénéficiaires de l'AME, soit 37 784 en tout en 2024, représentant 13 % de la population totale du département. 98,8 % des bénéficiaires de l'AME sont localisés dans 13 communes du département, qui regroupent pourtant 10 % de la population des bénéficiaires couvertes par la Sécurité sociale (notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Cayenne ou encore Kourou).
À l'inverse, dans certains départements très ruraux (le Cantal, les Ardennes, le Jura, le Lot ou encore la Nièvre) se trouvent moins de 0,1 % des bénéficiaires de l'AME.
Répartition des bénéficiaires de l'AME par département
Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale
La répartition des bénéficiaires de l'AME sur le territoire a toutefois évolué dans le temps, au profit d'une moins forte concentration en région parisienne. Ainsi, en 2013, Paris comptait 20,3 % des bénéficiaires de l'AME, alors que ceux vivant dans le Rhône ne représentaient que 1,7 % d'entre eux. Toutefois, en raison de la hausse globale du nombre de bénéficiaires (voir infra), la population présente en Ile-de-France a fortement augmenté en 10 ans.
Part des bénéficiaires de l'AME par
département
concentrant plus de 1 % des
bénéficiaires
(en pourcentage)
Note : le nombre global des bénéficiaires de l'AME ayant augmenté, une diminution de la proportion des bénéficiaires d'AME dans certains départements (Paris, Seine-Saint-Denis) n'empêche pas que le nombre global de bénéficiaires de l'AME ait augmenté.
Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale
Certains hôpitaux concentrent une part importante des dépenses de l'AME : l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), le centre hospitalier de Cayenne, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), le centre hospitalier Franck Joly à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, les hospices civils de Lyon, le centre hospitalier de Saint-Denis ou encore le centre hospitalier sud-francilien.
Au centre hospitalier de Saint-Denis, par exemple, les hospitalisations des patients sous aide médicale de l'État et soins urgents représentent 10 % des hospitalisations en 2024 (8,4 % des séjours pour les patients bénéficiant de l'AME), contre 9,2 % en 2022. Les bénéficiaires de l'AME représentent 8 % des patients de l'hôpital, contre 0,5 % en moyenne nationale.
3. Les demandes d'AME augmentent avec la durée de séjour
La durée moyenne de la couverture des bénéficiaires de l'AME n'est pas suivie par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), qui n'accorde le droit à l'AME que pour une durée d'un an.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a évalué la durée moyenne du bénéfice de l'AME à 3,6 années, sur un échantillon de 44 028 dossiers en avril 2023. Une étude conduite en novembre 2023 auprès de 9 caisses regroupant près de 190 000 dossiers (ce qui représente environ 42 % des bénéficiaires) montre toutefois que près de 41 % des bénéficiaires de l'AME n'y auraient accès que depuis moins d'un an.
Répartition des bénéficiaires
de l'AME selon l'ancienneté
de l'ouverture des droits
(en pourcentage)
|
Ancienneté d'ouverture des droits à l'AME |
Répartition des bénéficiaires |
|
Inférieure 1 an |
41% |
|
Entre 1 an et 2 ans |
20% |
|
Entre 2 ans et 3 ans |
11% |
|
Entre 3 ans et 4 ans |
10% |
|
Entre 4 ans et 5 ans |
6% |
|
Entre 5 ans et 7 ans |
6% |
|
7 ans et plus |
6% |
Source : commission des finances d'après la CNAM
La durée de présence sur le territoire français avant l'obtention de l'AME n'est pas suivie en tant que telle, ce qui est dommage, car une telle donnée serait utile et pertinente pour évaluer le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France.
Toutefois, dans le cadre de la gestion des demandes d'AME, la durée effective de résidence en France est enregistrée, que ce soit pour une primo-demande ou un renouvellement et que le demandeur obtienne ou non l'AME. Ainsi pour les dossiers d'AME déposé au dernier trimestre 2024, 20 % des demandeurs résident en France depuis moins d'un an, 15 % entre un an et deux ans, 13 % entre deux ans et trois ans et 52 % depuis plus de trois ans.
Enfin, dans le cadre de l'enquête Premiers Pas18(*), conduite par l'institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) à partir d'un échantillon de plus de 1200 personnes en situation irrégulière à Paris et dans l'agglomération de Bordeaux, il est observé que l'accès à l'AME est fortement corrélé avec la durée de séjour. Ainsi, d'après l'IRDES, « le taux de personnes couvertes passe de 24 % parmi les personnes vivant en France depuis plus de trois mois mais moins d'un an, à 65 % parmi celles résidant en France depuis plus de cinq ans. »19(*)
Part des personnes bénéficiant de
l'AME
selon leur durée de séjour en France
|
Ancienneté en France |
Part (%) |
|
3 mois à 1 an |
24 |
|
1 à 3 ans |
54 |
|
3 à 5 ans |
70 |
|
Plus de 5 ans |
65 |
|
Source : commission des finances d'après l'IRDES - Enquête Premiers pas |
|
Il convient de préciser que depuis l'enquête, les conditions d'accès à l'AME ont été durcies, rendant plus difficile encore l'accès à l'aide pour les personnes résidant depuis peu de temps en France.
C. UN SYSTÈME FRANÇAIS GÉNÉREUX PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS EUROPÉENS
La totalité des pays européens étudiés prend en charge les soins urgents, c'est-à-dire indispensables à la survie du patient, dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière.
Seuls le Danemark et la Suède ne prennent pas en charge intégralement le traitement des maladies infectieuses, la prévention et les frais liés à la grossesse. La plupart des pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) limitent toutefois davantage le panier de soins remboursé pour les étrangers en situation irrégulière que pour les assurés sociaux.
Certains pays, comme l'Espagne ou encore la Belgique, font bénéficier les étrangers en situation irrégulière de pratiquement l'ensemble des soins dont bénéficient les assurés sociaux.
1. Une prise en charge limitée aux soins hospitaliers urgents au Danemark et en Suisse
Au Danemark, si l'État fédéral définit des orientations en matière de santé, ce sont les régions qui ont la compétence de réguler les hôpitaux et la médecine de ville. Les soins urgents (accident, maladie subite, aggravation d'une maladie chronique) sont pris en charge gratuitement au Danemark y compris pour les étrangers en situation irrégulière.
Les soins hospitaliers non urgents sont également pris en charge lorsqu'il n'est pas jugé raisonnable de diriger la personne vers un traitement dans son pays d'origine. Les cas pris en charge dépendent des établissements de santé et des autorités sanitaires locales (régions). Une participation financière peut également être demandée au cas par cas.
En particulier, les soins liés aux grossesses sont susceptibles de faire l'objet de participations financières, tout comme les vaccinations. Le Danemark constitue en ce sens une exception : dans la plupart des pays européens étudiés, les soins liés à la grossesse ou à la vaccination sont pris en charge intégralement.
L'urgence des situations est appréciée au cas par cas par les hôpitaux.
En Suisse, conformément à l'article 12 de la Confédération fédérale, toute personne en situation de détresse peut obtenir de l'aide sur les soins médicaux indispensables à sa survie. Chaque canton définit la liste des soins couverts dans ce cadre.
2. Certains pays (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Italie) permettent l'accès à un panier de soins élargi notamment aux actions de prévention, et à la prise en charge de la grossesse mais plus limité que celui des assurés sociaux
En Allemagne, une loi fédérale établit un plancher de soins qui doivent être pris en charge. Ensuite, chaque Länd définit soit une règlementation s'appliquant à l'ensemble des communes, soit une règlementation cadre mise en oeuvre par les communes le souhaitant.
Selon la loi, le panier de soins inclut :
- Les urgences ;
- Les soins médicaux et dentaires nécessaires pour le traitement des maladies et douleurs aigues. L'appréciation des douleurs aigues est toutefois variable selon les Länder et peut être laissée à l'appréciation du soignant, ce qui pose des difficultés ;
- Le suivi des grossesses et l'accompagnement post-grossesse ;
- Un schéma vaccinal complet.
La recommandation-cadre de l'union fédérale des caisses d'assurance maladie et des congrès allemands des villes, qui est appliquée dans un grand nombre de Lander, limite pour le traitement des maladies chroniques la couverture aux soins indispensables pour prévenir une aggravation de la maladie. Elle exclut :
- la prévention ;
- les aides ménagères ;
- l'insémination artificielle ;
- la stérilisation ;
- les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques ;
- les soins à l'étranger ;
- les prestations monétaires.
Sont soumis à autorisation préalable :
- les traitements hospitaliers non urgents ;
- la rééducation physique ;
- la psychothérapie ;
- les soins à domicile ;
- certains dispositifs médicaux (chaises roulantes) ;
- certains traitements dentaires (orthodontie).
Ce régime s'applique aux demandeurs d'asile et aux étrangers sans titre de séjour régulier, les 18 premiers mois de résidence sur le territoire. À noter, concernant la prise en charge sanitaire des demandeurs d'asile (relevant de la PUMA en France), la prise en charge des soins supérieurs à 250 euros peut impliquer une autorisation écrite.
Le panier de soins pris en charge par l'Allemagne pour les étrangers en situation irrégulière est donc moins large que celui appliqué en France.
Au Royaume-Uni, les pouvoirs publics ont introduit des dispositifs pour limiter le recours aux soins de santé. En particulier, les hôpitaux ont l'obligation de déterminer si un patient doit être facturé des soins qu'il reçoit : certains établissements sont dotés d'agents dédiés aux patients étrangers à ce titre.
Les soins délivrés par la médecine de ville sont gratuits. Concernant l'hôpital, certains actes sont de toute façon gratuits :
- le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses mentionnées dans une liste ;
- le traitement des maladies sexuellement transmissibles ;
- les actes relevant du planning familial (sauf l'IVG) ;
- les soins requis pour une pathologie physique et mentale résultant d'un acte de torture, de mutilations sexuelles féminines ou de violences conjugales et sexuelles ;
- les actes urgents pour la survie du patient - mais dans ce cas les soins délivrés ultérieurement sont facturés.
Ces soins deviennent d'ailleurs onéreux s'il est établi que la personne est venue au Royaume-Uni pour les recevoir.
Pour les autres soins, les étrangers en situation irrégulière doivent s'acquitter par avance du coût de leur prise en charge, cadre qui s'applique également aux étrangers présents régulièrement sur le sol britannique. S'ils ne peuvent pas payer, ils doivent avoir un garant. Toutefois, le recouvrement des créances dues par les étrangers est notoirement difficile (y compris pour les créances dues par des étrangers présents régulièrement sur le sol) - surtout quand les personnes n'ont pas de papier d'identité.
En Suède, une loi fixe le cadre de prise en charge des soins de santé pour les étrangers en situation irrégulière. Certains soins sont pris en charge gratuitement :
- les soins « urgents » ;
- les soins généraux et dentaires « qui ne peuvent attendre » - mais cette notion n'a aucune définition claire ;
- les soins de suivi de grossesse, de maternité, de contraception et d'avortement ;
- le traitement des maladies infectieuses ou sexuellement transmissibles (VIH, hépatite A, B et C etc.) ;
- les soins dentaires ;
- les médicaments (sauf le reste à charge, identique à celui des citoyens résidants).
Les mineurs en situation irrégulière ont accès à l'ensemble des soins de manière gratuite. Les régions disposent par ailleurs d'une certaine autonomie : ainsi les trois-quarts d'entre elles considèrent par exemple que les étrangers ressortissants de l'UE ne relèvent pas de cette loi et doivent bénéficier des soins dans les mêmes conditions que les Suédois.
En Italie, le cadre réglementaire est défini par l'État, même si les régions disposent d'une certaine autonomie, et ont tendance à restreindre l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière.
Les soins pris en charge pour les étrangers en situation irrégulière sont en principe limités aux « soins ambulatoires et hospitaliers urgents et, en tout cas, indispensables, même s'ils sont continus, en cas de maladie ou d'accident, et aux programmes de médecine préventive étendus pour sauvegarder la santé individuelle et collective ». Toutefois, la définition des soins dits « urgents » serait en général l'objet d'une interprétation « large » des professionnels de santé.
En pratique, une circulaire définit les soins urgents comme ceux « ne pouvant être reportés sans mettre en danger la vie de la personne ou nuire à sa santé ». Les soins « essentiels » sont ceux qui pourraient « entrainer des dommages plus importants pour la santé ou un risque pour la vie ». Les soins de santé suivants sont garantis :
- les soins liés à la grossesse et à la maternité ;
- la protection de la santé des mineurs ;
- les vaccinations ;
- la prophylaxie, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses.
3. Certains pays (Espagne, Belgique) ont fait le choix d'un large panier de soins
En 2012, l'Espagne avait drastiquement réduit la prise en charge des soins aux personnes en situation irrégulière aux soins urgents, à la maternité et aux mineurs de moins de 18 ans. Toutefois, ce cadre a été revu en 2018, pour décharger les urgences hospitalières. Les étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier des soins gratuits dans les mêmes conditions que les citoyens espagnols. Ils doivent toutefois s'acquitter de 40 % du prix des médicaments, ne bénéficiant pas d'une réduction de ce ticket modérateur.
En Belgique, l'aide médicale d'urgence est définie au niveau fédéral en Belgique et est mise en oeuvre et gérée localement par les centres publics d'action sociale (CPAS). Les CPAS disposent de l'autonomie de décision pour définir l'étendue de la prise en charge. Sont pris en charge tous les soins jugés « nécessaires » par un médecin établissant un certificat médical. Il n'existe pas de définition préalable des soins nécessaires, qui peuvent donc recouvrir en théorie tous les soins concernés.
II. UN COÛT TRÈS ÉLEVÉ POUR LES DÉPENSES PUBLIQUES
A. PLUS DE 1,3 MILLIARD D'EUROS DE DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT
1. Un coût en hausse de près de 68 % en 10 ans
Pour l'année 2024, en incluant l'ensemble des dépenses d'AME, le coût total réel de l'AME est de 1 386,8 millions d'euros, soit une hausse de 15,5 % des dépenses par rapport à 2023, et de 64,3 % des dépenses par rapport à 2014, représentant une augmentation de 543 millions d'euros en 10 ans. Les dépenses d'AME de droit commun s'élèvent à 1,255 milliard d'euros. Une telle hausse des dépenses n'est pas acceptable et appelle à des mesures de maitrise des coûts.
Évolution des dépenses réelles d'AME entre 2012 et 2024
(en millions d'euros constants 2025)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
2. Une budgétisation insincère ces dernières années
Les dépenses d'AME sont toutefois plus élevées que celles qu'affiche le budget de l'État. D'une part, l'État ne prend en charge qu'une partie de l'AME pour soins urgents, à hauteur d'une dotation de 70 millions d'euros en 2024 par exemple, le reste du coût de l'AME pour soins urgents (61,8 millions d'euros en 2024) étant pris en charge par l'Assurance maladie.
Par ailleurs, malgré la formulation très explicite de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses de l'aide médicale de l'État de droit commun n'ont pas toujours été prises en charge intégralement par l'État. Or l'AME est une dépense de guichet. Les remboursements versés aux bénéficiaires de l'AME sont ainsi effectués quel que soit le niveau de crédits budgétaires provisionnés par le gouvernement, qui doit rembourser la Sécurité sociale des frais qu'elle a avancés aux professionnels médicaux. Si l'État ne programme pas suffisamment de crédits budgétaires pour financer l'intégralité des dépenses d'AME de droit commun, alors une dette à l'égard de la Sécurité sociale est créée.
Or, en particulier en 2024, comme le relève également la Cour des comptes20(*), le décret d'annulation du 21 février 202421(*) a supprimé près de 50 millions d'euros de crédits au titre de l'aide médicale de l'État (AME), alors que la direction de la sécurité sociale avait déjà indiqué qu'elle prévoyait une dépense d'AME supérieure à celle qui a été budgétée en loi de finances initiale pour 2024.
En conséquence, les crédits ouverts en 2024 au titre de l'AME sont largement inférieurs aux dépenses effectives à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'État a ainsi contracté une dette à l'égard de la CNAM, d'un montant total de 185,1 millions d'euros en 2024. L'ampleur de la dette de l'État à l'égard de la CNAM au titre des dépenses d'AME est inédite en 2024 : le montant maximal de dette était auparavant de 50 millions d'euros.
Montant annuel et cumulé de dette de
l'État vis-à-vis de la CNAM
au titre de l'aide médicale
de l'État
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Une telle situation n'est pas acceptable : une budgétisation sincère et fiable des dépenses réelles d'aide médicale de l'État est absolument indispensable.
Le rapporteur spécial considère qu'il est particulièrement dommageable de prévoir des baisses de crédits, comme cela a été fait en 2024 via le décret d'annulation précité, sans y associer de réforme structurelle de l'AME, nécessaire pour maitriser le niveau réel des dépenses.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que sur les 167,8 millions d'euros non financés par l'État de dépenses d'aide médicale de l'État en 2024, seuls 50 millions d'euros sont liés à une annulation par voie décrétale. Ainsi, près de 117,8 millions d'euros ont été dépensés sans avoir été budgétés, en raison d'une erreur de prévision. Il serait souhaitable qu'une amélioration de la méthodologie de prévision soit mise en oeuvre, afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir. La Cour des comptes22(*) recommande ainsi de « revoir la méthode de prévision des dépenses d'AME dans un but de transparence budgétaire et afin de faciliter le pilotage des crédits », recommandation à laquelle le rapporteur spécial s'associe. En effet, les dépenses d'AME semblent mal suivies : seul un relevé trimestriel des dépenses et du nombre de bénéficiaires est disponible à ce stade, et ce avec plus de 4 mois de retard, au mieux. Un suivi plus régulier parait absolument nécessaire, en vue de fiabiliser la programmation budgétaire, alors que la direction de la sécurité sociale rencontre des difficultés dans ses prévisions.
La direction de la sécurité sociale a d'ailleurs mis en oeuvre une nouvelle méthode de calcul fondée sur une périodicité mensuelle des dépenses d'AME. Il sera intéressant de vérifier si cette méthode fait ses preuves et permet d'éviter de trop grandes erreurs de prévisions. Il serait souhaitable que les données mensuelles soient remontées et puissent être produites à la demande du Parlement.
Recommandation n° 3 : actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État afin d'améliorer la prévision (DSS, CNAM).
Ainsi, au total, les dépenses d'AME dans le budget de l'État s'élèvent à 1,159 milliard d'euros en 2024 et ont augmenté de 40 % en 10 ans. Les dépenses d'AME de droit commun en particulier se sont élevées à 1,088 milliard d'euros en 2024, contre 723 millions d'euros en 2014, dix ans plus tôt, soit une hausse de 50,1 % en 10 ans. En 2025, la loi de finances initiale a maintenu le niveau des crédits au niveau de 2024 en commission mixte paritaire.
La dotation versée par l'État à la CNAM au titre des soins urgents s'élève à 70 millions d'euros depuis 2020.
Enfin, le coût de l'AME pour les personnes en garde à vue et de l'AME humanitaire s'élève à 1 million d'euros chaque année, et est pris en charge intégralement par l'État.
Évolution des dépenses d'AME entre 2012 et 2024 dans le budget de l'État
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Même en tenant compte de l'inflation, la hausse des dépenses d'AME a été de 17,4 % entre 2014 et 2024, et de 7,1 % entre 2022 et 2024.
Évolution des dépenses d'AME entre 2012 et 2024 dans le budget de l'État, retraitées de l'inflation
(en millions d'euros constants 2025)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
3. Un coût des dépenses de santé des étrangers sous-estimé
Les dépenses de santé liées aux étrangers présents sur le sol français ne se réduisent de plus pas à l'aide médicale de l'État, comme évoqué infra.
Ainsi, les demandeurs d'asile sont pris en charge par la PUMa. Au total, 153 715 demandes d'asile ont été enregistrées en 2024, représentant un tiers du nombre de bénéficiaires de l'AME en 2024. Le rapport IGAS-IGF de 2019 précité avait estimé le coût de la protection maladie des demandeurs d'asile à 200 millions d'euros en 2018, sachant que 109 783 demandes d'asile avaient été déposées. La mission précisait elle-même que le calcul était très rudimentaire. En rapportant cette dépense au nombre de demandes d'asile déposées en 2024 et en multipliant le résultat obtenu par l'inflation cumulée entre 2018 et 2025, il est possible d'évaluer le coût de la protection maladie des demandeurs d'asile à 327,6 millions d'euros. Ce résultat est toutefois à considérer avec une grande précaution.
Par ailleurs, près de 20 600 personnes sont présentes régulièrement en France en 2022 grâce à un titre de séjour pour soins. Il est très difficile de chiffrer ce coût, puisqu'il est inclus dans les dépenses de la PUMa. Le montant moyen des dépenses d'un bénéficiaire de l'AME est de 2 396 euros en 2023. Ainsi, il est possible d'estimer le coût des titres de séjour pour soins pour la sécurité sociale à 50 millions d'euros, sachant qu'il est probable que le coût soit en réalité plus élevé, puisque les personnes concernées ont en général des pathologies lourdes. Ainsi, en 2023, 25,9 % des personnes ont émis une demande en raison d'une maladie infectieuse ou parasitaire (VIH etc.).
Enfin, le système de santé français n'est pas toujours indemnisé des soins comme il le devrait pour certains étrangers présents régulièrement sur le sol français. En excluant les prestations fournies au titre de l'AME ou des soins urgents qui par nature sont recouvrées par les établissements, les soins effectués en France pour des personnes étrangères non-résidentes et non-assurées auprès d'un régime français de sécurité sociale peuvent être classés en dettes publiques ou en dettes privées.
Les dettes publiques concernent les assurés de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse qui sont couverts par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et qui peuvent recevoir des soins inopinés ou programmés, avec autorisation préalable, en France. Le même mécanisme s'applique pour les personnes couvertes par une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant que cette dernière prévoie la prise en charge des soins contre remboursement par le régime d'origine. Ces créances sont - au même titre que les dettes françaises d'assurance maladie - traitées par la CNAM via le Centre national des Soins à l'Étrangers (CNSE). Environ 800 millions d'euros sont remboursés annuellement à la France à ce titre. Les dettes dites « publiques » sont donc solvabilisées.
Les dettes privées ou créances hospitalières, correspondent quant à elles aux dettes laissées, en dehors de tout cadre conventionnel, dans les établissements de santé français par les personnes qui ne résident pas en France et ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française ou à un régime coordonné. Ces personnes, si elles sont entrées régulièrement en France, bénéficient normalement d'une assurance santé.
Les comptes financiers des établissements renseignent les dettes laissées par des patients non-résidents. Toutefois, ces montants ne sont pas disponibles automatiquement et de façon détaillée par pays d'origine. Il est néanmoins possible d'évaluer le montant annuel moyen de ces créances à 159 millions d'euros entre 2016 et 2021. En 2023, un montant de créances de 141 millions d'euros a été constaté dans les comptes financiers de 560 établissements de santé. Or 24 établissements concentrent 91 % de ces créances impayées : l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (90,1 millions d'euros), le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bordeaux (6,5 millions d'euros), le centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (4,2 M€), le CHU de Nantes (4,1 millions d'euros) et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (3,9 millions d'euros).
Ainsi, le coût de prise en charge sanitaire des étrangers présents sur le sol français dépasse largement le cadre de la seule AME. Il serait souhaitable de disposer d'une information centralisée et fiable quant à l'ampleur véritable des dépenses, afin d'améliorer significativement l'information tant du Parlement que des citoyens à ce sujet.
B. DES DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE L'AME INFÉRIEURES À CELLE DES ASSURÉS SOCIAUX
1. Une dépense moyenne par bénéficiaire modérée
La dépense moyenne par bénéficiaire de l'AME s'élève en 2023 à 2 396,4 euros par bénéficiaire, un montant en hausse de 3,2 % par rapport à 2015, soit une hausse largement inférieure à celle de l'inflation. La dépense annuelle moyenne par bénéficiaire de l'AME est donc modérée. Elle est d'ailleurs inférieure à celle de l'ensemble de la population française. En 2023, la consommation de soins et de biens médicaux annuelle moyenne d'un résidant français sur le territoire métropolitain est de 3 658,9 euros23(*). Elle a augmenté de 25 % entre 2015 et 2023. Il est à noter toutefois que 7,5 % des dépenses est financée par les ménages dans le cadre du reste à charge, alors que pour les bénéficiaires de l'AME le reste à charge est nul, et 12,4 % des dépenses relèvent des organismes complémentaires. Seuls 80 % de la consommation de soins et de biens médicaux est financée par les administrations publiques, représentant 2 927 euros par bénéficiaire. Même dans ce cas, la dépense de soins par bénéficiaire de l'aide médicale de l'État demeure modérée.
Évolution de la consommation annuelle
moyenne dans la population totale
et par bénéficiaire de
l'AME
(en euros)
Source : commission des finances d'après la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
En restreignant le champ d'étude à la dépense remboursable moyenne par assuré social consommant de l'assurance-maladie obligatoire, la DREES24(*) estime, en effet, que la dépense par assuré de la Sécurité sociale, s'établit à 2 685 euros en 2017. Pour la même année, la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire de l'AME s'établit à 2 563 euros.
L'institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) a publié en décembre 202325(*) une étude comparant la consommation de soins de ville des personnes couvertes par l'AME à celle des personnes couvertes par la complémentaire santé solidaire non contributive (CSS-NC). Ces deux populations, relativement comparables, présentent des revenus faibles et un état de santé plus fragile que le reste de la population française.
Ainsi, les dépenses ambulatoires des consommants bénéficiant de l'AME s'élevaient en moyenne à 1 194 euros contre 1 436 euros pour ceux de la CSS-NC. L'écart est expliqué par les niveaux de couvertures très différents pour les soins dentaires et optiques. En effet, contrairement aux bénéficiaires de la CSS-NC, la prise en charge des frais dentaires et optiques n'est pas assurée à 100 % pour les bénéficiaires de l'AME.
En dehors de ces postes, les dépenses moyennes s'élèvent à 1 139 euros pour les bénéficiaires de l'AME contre 1 219 euros pour ceux de la CSS-NC, soit des montants relativement similaires.
Dépenses de soins de ville des
assurés consommant des soins
et couverts par l'AME ou la CSS-NC en
2017 en Gironde
Source : IRDES, étude précitée, 2023
À noter toutefois, cette étude a été construite en comparant les bénéficiaires de l'AME et de la CSSNC de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde : il n'est donc pas certain que ces résultats soient généralisables à l'ensemble de la population. Il serait souhaitable de conduire ce type d'étude de manière plus systématique, afin d'améliorer la connaissance des dépenses effectuées au titre de l'AME.
2. Des dépenses centrées sur les soins hospitaliers
Les dépenses des bénéficiaires de l'AME sont toutefois assez spécifiques en termes de structure de la dépense de soins. Près de 60,8 % des dépenses sont constituées de prestations hospitalières, tandis que les produits de santé ne représentent que 12,7 % des dépenses et les soins de ville 26,5 % des dépenses.
Répartition par postes de dépenses d'AME en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la direction de la sécurité sociale
Les prestations hospitalières représentent pourtant seulement 49,1 % des dépenses de soins et de biens médicaux pour l'ensemble de la population, alors que les soins de ville comptent pour 29 % des dépenses et les produits de santé 21,9 %.
Répartition par postes de dépenses
globale de biens
et de soins médicaux en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la DREES
Une telle répartition des dépenses de santé semble cohérente, au sens où les bénéficiaires de l'AME constituent une population relativement défavorisée, bien que jeune, et plus éloignée que les assurés sociaux des parcours de soin habituels. Il est donc probable qu'une partie de leurs affections ne soit traitée que lorsqu'elles deviennent graves et relèvent d'une prise en charge hospitalière. Par ailleurs, il leur est peut-être plus facile de simplement se rendre aux urgences que de prendre un rendez-vous médical en ville.
Évolution des dépenses de
santé d'aide médicale de l'État
par poste de
dépense
(en millions d'euros)
Note : le poste soins de ville comprend ici les actes et consultations externes (ACE) réalisés à l'hôpital.
Source : commission des finances d'après la DSS
Entre 2015 et 2023, les dépenses hospitalières des bénéficiaires de l'AME ont augmenté de 45,1 %, soit une hausse supérieure à celle des dépenses hospitalières de la population française (de 34,2 %). Par ailleurs, les dépenses de soins de ville ont augmenté de 70,9 % pour les bénéficiaires de l'AME, contre 27,8 % pour l'ensemble de la population, et de 30,8 % pour les produits de santé, contre 16,4 % pour l'ensemble de la population.
Cette forte évolution des dépenses d'AME s'explique dans une large mesure par l'augmentation du nombre de bénéficiaires, comme expliqué infra. Par ailleurs, il faut noter que les actes et consultations externes réalisées à l'hôpital mais n'impliquant pas d'actes hospitaliers sont comptabilisés dans les dépenses « soins de ville » de l'AME, alors qu'elles sont prises en compte dans le poste « prestations hospitalières » pour l'ensemble de la population, ce qui peut expliquer également l'augmentation plus forte des dépenses de soins de ville des bénéficiaires de l'AME par rapport à celles de la population globale.
Évolution des dépenses de
santé dans l'ensemble de la population
par poste de
dépense
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DREES
Enfin, un léger rééquilibrage entre les dépenses de prestations hospitalières et surtout de produits de santé a été opéré entre 2015 et 2024 au profit des dépenses de soins de ville, celles-ci représentant 26,4 % des dépenses d'AME en 2024, contre 23,1 % en 2015.
Évolution de la répartition des dépenses d'AME par poste de dépenses
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la DSS
3. Des dépenses de santé spécifiques aux bénéficiaires de l'AME
a) Des dépenses de soins hospitaliers centrées sur les accouchements, les problèmes digestifs et cardiovasculaires
En 2023, les hôpitaux publics ou privés à but non lucratif avec une activité en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) ont réalisé 89 103 séjours hospitaliers et 60 795 séances26(*) pour plus de 58 700 bénéficiaires de l'AME, représentant 12,9 % de l'ensemble des bénéficiaires. Le volume économique des séjours hospitaliers associés à l'AME s'élève à 328 millions d'euros et a augmenté de 9 % entre 2022 et 2023. Les hospitalisations complètes représentent plus de 92 % des dépenses.
Il est à noter toutefois que grâce au développement des prises en charge ambulatoires et à la baisse de la lourdeur économique moyenne des hospitalisations complètes, le coût moyen d'un séjour ou d'une séance à l'hôpital est passé de 2 409 euros en 2019 à 2 186 euros en 2023, soit une baisse de 9,3 % du coût d'un passage à l'hôpital.
Évolution du coût économique
de chaque séjour ou séance à l'hôpital
pour les
bénéficiaires de l'AME entre 2019 et 2023
(en euros)
Source : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH)
La durée moyenne d'un séjour à l'hôpital est de 5,3 jours, soit une durée relativement longue, contre 4,6 jours en moyenne par patient non bénéficiaire de l'AME. En effet, les bénéficiaires de l'AME ne sont pas toujours logés dans de bonnes conditions, expliquant peut-être la réticence des hôpitaux à limiter la durée des hospitalisations.
Selon le Samu social, les profils rencontrés parmi les bénéficiaires de l'AME à la rue sont souvent polypathologiques, complexes, porteurs de maladies chroniques (diabète, HTA, asthme, épilepsie...), de maladies liées au parcours migratoire ou à la vie à la rue (problèmes respiratoires dont tuberculose, dermatologiques dont gales, ostéoarticulaires, psychiatriques etc.) et d'un retard vaccinal.
Les dépenses à l'hôpital sont portées par les actes suivants :
- un quart des dépenses d'hospitalisations complètes (hors séance) est lié aux soins associés à l'accouchement (grossesse, post-partum, périnatalité), représentant un volume économique de 78 millions d'euros. Dans la population totale, seules 8 % des hospitalisations sont liées à l'accouchement ;
- les chirurgies représentent 25,8% des dépenses d'hospitalisation, soit 84,6 millions d'euros. Les chirurgies les plus coûteuses sont les chirurgies de l'appareil locomoteur et les amputations (10,6 millions d'euros) ainsi que les neurochirurgies (8,1 millions d'euros) ;
- le traitement de la pneumologie (21 millions d'euros), de l'hépato-gastro-entérologie (14,4 millions d'euros), du diabète (8,1 millions d'euros) et des maladies immunitaires (11 millions d'euros) représentent les principales dépenses de médecine prise en charge à l'hôpital.
- enfin, les séances, donc le traitement des maladies chroniques, représentent un coût important pour l'hôpital. En particulier, le volume économique des dialyses (14,1 millions d'euros) a augmenté de 25 %. Dans la population globale, les séances de dialyse ont augmenté de 1,5 % seulement entre 2022 et 2023.
Coût des séances réalisées à l'hôpital en 2023
(en millions d'euros, en pourcentage et en nombre de séances)
Source : Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH)
Les prestations hospitalières restantes, représentant 338 millions d'euros, sont liées aux soins de suite et de réadaptation, aux hospitalisations à domicile, à la psychiatrie et aux dépenses des cliniques privées.
À noter, la transplantation d'organes représente un coût de 2 millions d'euros, pour 38 greffes réalisées en 2023. Au total, près de 5 634 greffes d'organes ont été réalisées en France en 2023. Les bénéficiaires de l'AME auraient donc bénéficié de 0,7 % des greffes réalisées.
Seuls un critère de résidence et des critères médicaux sont en effet appliqués dans l'attribution des greffes, ce qui signifie que l'agence de biomédecine ne connait pas le nombre de greffes données à des résidents en situation irrégulière. Il pourrait être utile, comme l'avait recommandé Mme Louwagie, de permettre à l'agence de biomédecine de connaitre le statut administratif des patients sollicitant et bénéficiant d'une greffe.
Recommandation n° 4 : enregistrer le statut administratif des personnes sollicitant ou bénéficiant d'une greffe (agence de biomédecine).
b) Des dépenses de médecine de ville par bénéficiaire inférieure à la moyenne par habitant pour les soins dentaires et d'optique
Les données concernant la répartition des dépenses de médecine de ville ne sont pas disponibles au niveau national. Seule une distinction entre les honoraires généralistes et spécialistes, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux est établie. Il est regrettable qu'une information plus fine concernant la consommation des soins de ville des bénéficiaires de l'AME ne soit pas disponible.
En moyenne, les dépenses en honoraires au titre de la médecine de ville sont moins élevées par bénéficiaire de l'AME qu'au sein de la population totale. Un bénéficiaire de l'AME dépense 197,3 euros par an au titre de remboursements de consultations de médecins généralistes et spécialistes, contre 384,7 euros pour l'ensemble de la population.
Les honoraires dentaires moyens d'un bénéficiaire de l'AME sont particulièrement bas : ils ne sont que de 61,5 euros par personne, contre 274,8 euros dans la population française globale.
Dépenses en honoraires médicaux au
titre de la médecine de ville,
pour l'aide médicale de
l'État et la population globale
(en euros par personne)
Note : les auxiliaires médicaux groupent les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.
Source : commission des finances d'après la DSS et la DREES
Une telle observation est cohérente avec les résultats de l'étude de l'IRDES précitée, qui effectue une comparaison de la consommation des bénéficiaires de l'AME sur les dépenses de ville avec celle des bénéficiaires de la CSS non contributive en 2018 dans la CPAM de la Gironde. Les résultats montrent que la consommation de soins est globalement similaire entre les deux populations, à l'exception des soins dentaires et d'optique, qui sont beaucoup moins bien pris en charge pour les bénéficiaires de l'AME.
c) Des dépenses de médicaments centrées sur la lutte contre les maladies infectieuses (VIH, hépatite C)
En 2023, les cinq médicaments délivrés par les pharmacies de ville les plus consommés représentaient 12 % de la dépense totale en médicaments des bénéficiaires de l'AME. Les principaux traitements concernent la lutte contre le VIH et l'hépatite C.
Médicaments représentant les dépenses les plus élevées en 2023
(en euros)
Source : direction de la sécurité sociale
Il convient de noter qu'il n'est pas possible d'identifier précisément l'ensemble des médicaments non génériques dans la dépense totale. La prise en charge par l'AME étant de façon générale réservée aux médicaments génériques, les médicaments princeps27(*) ne sont pris en charge que dans des situations bien précises :
- le médicament princeps appartient à un groupe générique soumis au tarif forfaitaire de responsabilité, avec une prise en charge fondée sur ce tarif ;
- le médicament princeps présente un prix inférieur ou égal à celui du médicament générique ;
- le prescripteur exclut la possibilité de substituer le médicament par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance.
C. UNE HAUSSE DES DÉPENSES D'AME LIÉE EN PARTIE À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
1. L'évolution du nombre de bénéficiaires de l'AME, principal facteur de l'augmentation des dépenses
La hausse des dépenses de l'AME est notamment liée à la progression du nombre de bénéficiaires ces dernières années. Ils étaient 465 744 bénéficiaires au 30 septembre 2024 (dernière donnée transmise), soit une hausse de 2 % par rapport à 2023 et de 13,2 % par rapport à 2022. Le nombre de bénéficiaires a en effet été multiplié par plus de 2 entre 2011 et 2024.
Évolution du nombre de
bénéficiaires de l'AME de droit commun
entre 2011 et
2024
(en nombre de bénéficiaires)
Source : commission des finances d'après la DSS
La hausse du nombre de bénéficiaires de l'AME est accompagnée d'une augmentation du taux de personnes consommant des soins d'un point de pourcentage entre 2023 et 2024. La proportion de bénéficiaires de l'AME consommant des soins, de 69 % en 2024, reste toutefois inférieure à celle de 2019, où elle atteignait 74 % des bénéficiaires.
Évolution du nombre et de la proportion de consommants parmi les bénéficiaires de l'AME de droit commun entre 2019 et 2024
(en nombre de bénéficiaires et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la DSS
2. Le coût des soins, un facteur d'explication de la hausse des dépenses moins important que l'augmentation des bénéficiaires
La hausse des dépenses d'AME est partiellement, mais pas entièrement, liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Ainsi, entre 2023 et 2024, près de 38,1 millions d'euros de hausse des dépenses d'aide médicale de l'État serait liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, en considérant ceux qui consomment des soins. Près de 123,1 millions d'euros de dépenses supplémentaires ne serait pas expliquée par les bénéficiaires supplémentaires d'AME, mais par d'autres facteurs, tels que l'évolution du coût des soins ou l'inflation. Entre 2022 et 2023, c'était 61,2 millions d'euros sur 126,5 millions d'euros supplémentaires pour l'AME qui étaient liés à l'augmentation des bénéficiaires de l'AME.
Au total, depuis 2020, il est possible d'estimer que l'augmentation du nombre de bénéficiaires a entrainé une hausse de 243 millions d'euros de dépenses d'AME de droit commun, sur un total de 426,6 millions d'euros de hausse.
Effet de l'augmentation des
bénéficiaires d'AME de droit commun
sur la hausse des
dépenses entre 2020 et 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DSS
Calcul de l'effet de la hausse des effectifs de bénéficiaires de l'AME consommant des soins sur la hausse globale des dépenses
Les dépenses d'AME d'une année « n » évoluent chaque année sous l'effet tant de la hausse des effectifs que de la structure des dépenses. En conséquence, il est possible de décomposer l'évolution de la dépense entre l'effet lié à la hausse des effectifs de bénéficiaires consommant des soins et celui qui dépend d'autres facteurs.
En multipliant les dépenses moyennes par consommant de l'année « n-1 » (
) par le nombre de bénéficiaires consommant des soins de l'année « n », la statistique obtenue (
) décrit quel aurait été le niveau de dépenses à l'année « n » si le seul facteur déterminant la hausse des dépenses d'AME avait été la hausse des bénéficiaires. La différence avec la dépense réelle d'AME constitue la part de l'augmentation des coûts qui n'est pas liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
Source : commission des finances
Afin de neutraliser les effets liés à l'évolution de la structure des soins, le même calcul a été effectué en distinguant par poste de dépenses d'AME (prestations hospitalières, soins de ville, produits de santé). Il permet de conclure que sont liés à l'augmentation du nombre de bénéficiaires de l'AME :
- près de 151,8 millions d'euros de hausse des dépenses de prestations hospitalières, sur 235 millions d'euros dépensés en plus entre 2020 et 2024 ;
- près de 25 millions d'euros de hausse des dépenses de produits de santé, sur 96,4 millions d'euros dépensés en plus entre 2020 et 2024 ;
- près de 71,6 millions d'euros de hausse des dépenses de soins de ville, sur 134,3 millions d'euros dépensés en plus entre 2020 et 2024.
Effet de l'augmentation des
bénéficiaires d'AME de droit commun sur la hausse des
dépenses de prestations hospitalières (à gauche), de
produits de santé
(à droite) et de soins de ville (en bas)
entre 2020 et 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DSS
Les éléments d'explication liés à la hausse du nombre de bénéficiaires paraissent ainsi pertinents mais insuffisants pour expliciter totalement la hausse tendancielle des dépenses d'AME.
Les effets de rattrapage liés à la sortie de la crise sanitaire ne permettent pas non plus de justifier à eux seuls la hausse des dépenses liées à l'AME, qui ont largement dépassé en 2023 les niveaux atteints avant la crise sanitaire. Une amélioration de la connaissance des déterminants de l'augmentation des dépenses d'AME de droit commun est absolument indispensable.
3. Une augmentation mal documentée du coût des soins urgents
Comme montré infra, l'un des déterminants de la hausse des dépenses d'aide médicale de l'État est le coût de l'AME pour soins urgents, couvert partiellement par une dotation forfaitaire de l'État, le restant étant pris en charge par la CNAM. Il a été pratiquement multiplié par deux entre 2019 et 2024.
Évolution des dépenses d'aide
médicale de l'État au titre des soins urgents
entre
2012 et 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DSS
La direction de la sécurité sociale (DSS) a indiqué ne disposer d'aucune information sur le nombre de bénéficiaires et de consommants de l'AME pour soins urgents. En effet, la prise en charge de ces soins correspond au remboursement de frais de séjour et de séances hospitalières, qui ne sont pas rattachés à des individus, les patients n'étant pas, par définition, affiliés à un dispositif de prise en charge des frais de santé. Il est toutefois étonnant et regrettable de ne pas disposer de données plus précises concernant les soins urgents.
La caisse générale de sécurité sociale de Guyane a toutefois été en mesure d'indiquer la présence de 4 074 bénéficiaires des soins urgents sur son territoire en 2024, en baisse de 28 % entre 2022 et 2024, malgré une hausse des dépenses engagées au titre des soins urgents de 11 % pour atteindre 6,695 millions d'euros en 2024.
Comme pour l'AME de droit commun, l'essentiel des dépenses d'AME pour soins urgents est concentré en Île-de-France, en Guyane, dans les Alpes-Maritimes, dans le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Si cette répartition géographique des dépenses ne parait pas surprenante au vu des flux de l'immigration, il serait tout de même souhaitable d'améliorer significativement la connaissance des déterminants de la dépense d'AME pour les soins urgents.
Répartition géographique des
dépenses d'aide médicale de l'État
au titre des soins
urgents en 2023
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DSS
III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER LES DÉPENSES D'AME
A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
1. Une hausse probable du nombre d'étrangers en situation irrégulière
L'aide médicale de l'État représente un coût important pour les finances publiques, qu'il importe de maitriser dans un objectif de diminution du déficit. À cette fin, la première priorité est de maitriser le flux des bénéficiaires de l'AME, ce qui implique de lutter contre l'immigration illégale sur le territoire français.
Il est par définition très difficile d'estimer le nombre d'étrangers présents sur le sol français en situation irrégulière. La direction générale des étrangers de France (DGEF) au ministère de l'intérieur dispose toutefois de moyens d'évaluation et d'appréciation du nombre d'étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national.
D'une part, le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État constitue un premier indicateur du nombre d'étrangers présents sur le sol français de façon irrégulière. Toutefois, il ne suffit pas à lui seul, tous les étrangers en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l'AME. D'une part, un critère de durée de résidence (trois mois) et de plafond de ressources limite l'accès à l'AME. D'autre part, l'ensemble des étrangers en situation irrégulière ne font pas la demande d'AME, même s'ils pourraient y avoir droit.
D'autre part, le nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière constitue un deuxième indicateur. Il est en forte hausse en 2024 : 147 154 interpellations ont eu lieu, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à l'année précédente, contre une progression de 3,7 % entre 2022 et 2023.
Enfin, la troisième source d'informations concernant la présence d'étrangers sur le sol national en situation irrégulière est le nombre de demandes d'asile. Celui-ci est globalement en augmentation, puisque 157 947 demandes d'asile ont été déposées en 2024 contre 93 264 en 2020. Or le taux d'accord de demandes d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) oscille en fonction des années entre 29 % et 38,8 % des demandes.
L'éloignement de ces déboutés du droit d'asile est de plus en plus difficile en raison de leur nationalité d'origine : 10 % des demandeurs viennent d'Afghanistan, 8 % d'Ukraine et 17 % de Guinée, de République démocratique du Congo et du Soudan. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le sol français s'en trouve mécaniquement augmenté.
Au total, quel que soit l'indicateur retenu, il apparait relativement clair que le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français est en hausse depuis au moins 4 ans. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 26,3 % entre 2020 et 2024, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière de 37 % et le nombre de demandes d'asile de 69,4 % à la même période. Il s'agit d'une raison majeure de la hausse des dépenses d'AME.
Évolution du nombre de
bénéficiaires de l'AME, de demandes d'asile
et
d'interpellations d'étrangers en situation
irrégulière
(en nombre de personnes)
Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers de France (DGEF)
La provenance des étrangers en situation irrégulière est difficile à établir. Ils peuvent entrer irrégulièrement en France, ou avoir pénétré régulièrement dans l'espace Schengen, avec un titre de séjour expiré. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière peut augmenter en raison des dynamiques internationales : conflits, crises humanitaires, politiques ou économiques. Le rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances d'octobre 201928(*) avait relevé, dans la dépense de soins des bénéficiaires de l'AME et son évolution, des atypies qui « renforcent de façon convaincante l'hypothèse d'une migration pour soins », même si une telle définition est difficile à établir de manière certaine.
Par ailleurs, si, par définition, les caractéristiques de l'ensemble de la population en situation irrégulière ne sont pas disponibles, il est possible d'en faire une évaluation, certains étrangers étant régularisés de manière exceptionnelle grâce à l'article L. 435-1 du CESEDA. Ainsi, parmi les personnes ayant bénéficié de la régularisation, la majorité sont des hommes ; 40 % d'entre eux ont entre 30 et 39 ans. Les cinq nationalités les plus fréquentes des étrangers régularisés sont de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, malienne et sénégalaise.
L'absence d'articulation entre politique de l'immigration et prise en charge des soins délivrés aux étrangers en situation irrégulière met en cause la capacité de l'État à maitriser ses dépenses d'AME. Les liens entre ces deux politiques doivent être renforcés.
2. Seule la moitié des étrangers en situation irrégulière demanderait l'AME
L'ensemble des personnes satisfaisant les critères d'accès à l'AME n'en font pas la demande, que ce soit par ignorance de l'existence de l'AME ou par difficulté à produire les documents demandés pour en bénéficier. Ainsi, le Samu social de Paris a indiqué que l'étude de l'IRDES29(*), concordante avec leurs observations, montre que près de 50% des personnes éligibles à l'AME n'y ont pas recours. La proportion de non-recours serait la même parmi les personnes porteuses de maladies chroniques, notamment dans le cas du diabète. L'Observatoire de l'accès aux droits de Médecin du Monde30(*) a évalué en 2023 que dans leurs 14 centres d'accueil et d'orientation, 8 personnes éligibles à l'AME sur 10 n'en avaient pas fait la demande.
Le précédent ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait ainsi estimé le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français à 800 000 personnes, ce qui est cohérent avec un taux de recours à l'AME de 50 % estimé par les associations.
Le non-recours à l'AME représente une difficulté notamment pour les hôpitaux publics. Les patients se présentant sans droit ouvert ne peuvent être orientées vers la maison médicale de garde ou vers le privé, et sont donc nécessairement traitées à l'hôpital, en général aux urgences.
Par ailleurs, il faut noter que l'accès aux soins des personnes éligibles à l'AME est également associé à des discriminations relevées notamment par le Défenseur des droits. En 2018, il avait ainsi constaté un encadrement légal insuffisant du fonctionnement des plateformes de rendez-vous médical en ligne qui pouvaient comporter des mentions discriminatoires indiquant que les bénéficiaires de l'AME n'étaient pas acceptés.
En 2022, une équipe de recherche de l'Institut des politiques publiques (IPP) a mené une étude sur les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l'AME31(*). Cette étude s'appuie sur un testing téléphonique pour lequel 34 000 appels ont été passés entre mars et septembre 2022 auprès de plus de 3 000 praticiens. Si les chances d'obtenir un rendez-vous médical pour les bénéficiaires de la C2S sont proches de celles des patients de référence, en revanche les bénéficiaires de l'AME doivent passer en moyenne 1,3 appel de plus que les patients de référence pour obtenir un rendez-vous médical. Par rapport aux patients de référence, les bénéficiaires de l'AME ont entre 14 % et 36 % de chances en moins d'avoir un rendez-vous chez un généraliste, entre 19 % et 37 % de chances en moins chez un ophtalmologue et entre 5 % et 27 % chez un pédiatre.
Une procédure applicable aux refus de soins discriminatoires a été définie par le décret du 2 octobre 202032(*). En 2023, 281 plaintes pour refus de soins discriminatoires ont été déposées auprès d'une caisse d'assurance maladie ou du conseil départemental d'un ordre. Dans près de deux tiers des cas, les plaintes sont déposées par des patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (152 plaintes) ou de l'aide médicale de l'Etat (26 plaintes).
La discrimination à l'égard des bénéficiaires de l'AME en médecine de ville implique un report des soins vers l'hôpital, qui reviennent alors à un coût supérieur pour l'État.
B. REDÉFINIR LES DROITS OUVERTS AU TITRE DE L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT
1. Revoir les conditions d'accès à l'aide médicale de l'État
Comme mentionné supra, pour bénéficier de l'AME, conformément à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, seules les ressources du bénéficiaire de l'AME sont prises en compte dans les critères d'accès. Pourtant, il paraitrait plus pertinent de comprendre également les ressources du conjoint ou de la personne cohabitant, d'autant que celle-ci bénéficie automatiquement de la protection de santé comme ayant-droit. En conséquence, tout comme MM. Evin et Stefanini dans le rapport précité, le rapporteur spécial souhaite recommander la prise en compte des ressources de tous les membres du foyer fiscal du bénéficiaire pour déterminer l'éligibilité à l'AME de droit commun.
Dans ce cas, il pourrait être envisagé de rehausser le plafond de ressources pour accéder à l'AME, qui s'élève à 862 euros mensuels. À noter toutefois, qu'il s'agit du même plafond que celui utilisé pour déterminer l'accès à la complémentaire santé solidaire.
Par ailleurs, le rapporteur spécial estime qu'il n'est pas justifié d'intégrer dans les ayant-droits les enfants majeurs à charge du couple. Ces derniers peuvent demander l'accès à un système de protection sociale de leur côté, notamment l'AME s'ils sont en situation irrégulière. Il parait plus légitime et cohérent de limiter les ayant-droits des bénéficiaires de l'AME aux enfants mineurs, au conjoint et à une personne résidant dans leur domicile.
Recommandation n° 5 : limiter le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux enfants mineurs à charge du bénéficiaire et prendre en compte les revenus du conjoint lors de la définition du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'aide (DSS).
Par ailleurs, il est à noter que le bénéfice de l'AME est accordé quel que soit le motif de l'irrégularité du séjour de la personne concernée. Or certaines personnes se trouvent en situation irrégulière à la suite d'un retrait de titre de séjour, d'un non renouvellement ou d'un refus du titre parce qu'ils représentent une menace à l'ordre public. Dans les cas les plus extrêmes, une décision d'expulsion peut être prise.
En 2024, 1 562 décisions de retrait de titres, 1 904 refus de délivrer un premier titre de séjour, 2 386 décisions de non renouvellement de titre de séjour ont été pris pour un motif d'ordre public. Ce sont donc potentiellement 5 852 personnes en 2024, qui sont éligibles à l'aide médicale de l'État, alors qu'elles sont jugées constituer une menace pour l'ordre public. Une telle situation ne parait pas acceptable : il serait important que les personnes concernées par un refus de titre de séjour pour motif d'ordre public ne puissent être éligibles à l'AME de droit commun.
De plus, l'identité des personnes concernées est documentée par le ministère de l'Intérieur. Il serait donc possible pour les CPAM d'avoir accès à un fichier recensant l'identité des personnes concernées par un refus de titre de séjour pour ordre public.
Nombre de décisions de refus de titre de
séjour pour motif d'ordre public
entre 2022 et 2024
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
Décisions de retraits de titres pour un motif d'ordre public |
1515 |
1061 |
1562 |
|
Décisions de refus de délivrer un premier titre de séjour pour un motif d'ordre public |
1677 |
1666 |
1904 |
|
Décisions de refus de renouveler le droit au séjour pour un motif d'ordre public |
1822 |
1822 |
2386 |
|
Décisions d'expulsions |
100 |
87 |
692 |
|
Total |
5114 |
4636 |
6544 |
Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers de France (DGEF)
Recommandation n° 6 : exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public (DSS).
À noter, toutefois, que ces personnes demeureraient éligibles à la prise en charge au titre de l'AME pour soins urgents.
2. Revoir les soins pris en charge au titre de l'aide médicale de l'État
Comme mentionné supra, conformément à l'article L 251-2 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge des frais correspondant à des prestations dites « non urgentes », définies à l'article R. 251-3 du code précité, est subordonnée à un délai d'ancienneté de neuf mois d'admission à l'AME, sauf lorsque l'absence de réalisation de ces prestations est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne. Hors ce dernier cas, les frais peuvent être pris en charge avant le délai d'ancienneté de neuf mois uniquement sur accord préalable des caisses primaires d'assurance maladie. Cette disposition a été introduite par l'article 264 de la loi33(*) de finances initiale pour 2020.
De 2021 à 2024, seulement 32 demandes d'accord préalable ont été émises. Sur ce total, 23 demandes ont été considérées comme infondées en raison d'une ancienneté à l'AME supérieure à neuf mois ou parce qu'il s'agissait d'une prestation dont la prise en charge n'est pas soumise à cette procédure. Parmi les 9 demandes d'accord préalable qui ont in fine été instruites par le service médical, seule une demande a fait l'objet d'un accord de prise en charge.
La demande de prise en charge dérogatoire est réalisée sur un formulaire spécifique rempli par le prescripteur qui l'envoie par voie dématérialisée au service médical, via une messagerie sécurisée.
L'avis du service médical est transmis au professionnel de santé par le même canal de messagerie sécurisée, qui le tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service médical dans les 15 jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge. L'avis défavorable du service médical vaut refus de prise en charge.
Le rapporteur spécial estime étonnant que cette obligation ne concerne que les personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois et n'y voit aucune justification médicale. Il propose d'appliquer ce dispositif à tous les bénéficiaires d'AME, quelle que soit leur ancienneté. Une telle réforme impliquerait la modification de l'article L 251-2 du code précité.
Le rapport34(*) remis par Claude Evin et Patrick Stefanini à la Première Ministre Élisabeth Borne en décembre 2023 recommandait également d'étendre ce régime de l'accord préalable à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME. Cette réforme a d'ailleurs été adoptée par amendement au Sénat lors du vote du projet de loi de finances pour 2025. Elle n'a toutefois pas été conservée lors du vote de la commission mixte paritaire, ce qui est fortement regrettable.
Recommandation n° 7 : étendre le recours à l'accord préalable avant de bénéficier de soins « non urgents » à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME (DSS, CNAM).
Une redéfinition du panier de soins pris en charge de droit, de celui qui relève d'un accord des caisses primaires d'assurance maladie et des soins non pris en charge est également nécessaire en vue d'une maitrise des dépenses d'AME. Comme démontré supra, le système français est significativement plus généreux que les dispositifs danois et suisses, les plus austères des pays étudiés. Même par comparaison avec l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie, le système de prise en charge des frais de santé des étrangers en situation irrégulière parait encore relativement large en France.
Le Sénat a ainsi constamment recommandé ces dernières années une révision du panier de soins pris en charge par l'AME, qui se limiterait au traitement des maladies graves et des soins urgents, aux soins liés à la grossesse et ses suites, aux vaccinations réglementaires et aux examens de médecine préventive, notamment lors du vote du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration35(*).
De telles propositions rejoignent les recommandations du rapport Evin-Stefanini d'examiner l'élargissement de la liste d'actes donnant lieu à une demande d'accord préalable de l'Assurance maladie, en faisant référence aux actes de masso-kinésithérapie, à l'appareillage auditif et optique, à la pose de prothèses dentaires, à l'hospitalisation à domicile ou aux soins médicaux et de réadaptation.
Le rapporteur spécial recommande ainsi de se rapprocher du système mis en oeuvre en Allemagne, qui parait représenter une forme de voie « médiane » entre les systèmes danois et suisse et le système espagnol, relativement étendu.
En Allemagne, par rapport à la France, sont notamment exclus totalement du panier de soins pris en charge les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, sauf si leur non réalisation entrainerait une aggravation critique de l'état de santé de la personne.
Sont soumis à autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie :
- les traitements hospitaliers non urgents ;
- la rééducation physique ;
- la psychothérapie ;
- les soins à domicile ;
- certains dispositifs médicaux (chaises roulantes) ;
- certains traitements dentaires (orthodontie).
Il est assez difficile d'évaluer l'ampleur des économies représentées. Actuellement, l'ensemble des prestations définies à l'article R. 251-3 du code précité soumises à accord préalable de la CPAM pour les bénéficiaires de l'AME depuis moins de 9 mois représente un coût très limité de 6,7 millions d'euros en 2024.
Toutefois, les traitements hospitaliers non urgents et surtout les programmes de soins programmés constituent des gisements d'économies sans doute relativement importants, puisqu'il peut s'agir de traitements répétés au coût élevé. Ainsi, pour rappel, le coût des séances36(*) des bénéficiaires de l'AME à l'hôpital public représentent en 2023 un coût de 27 millions d'euros. Les soins de suite et de réadaptation, les hospitalisations à domicile, la psychiatrie et les dépenses des cliniques privées, représentent 338 millions d'euros, alors qu'une large partie de ces prestations pourraient faire partie des soins « non urgents » nécessitant un accord préalable de l'assurance maladie.
La réforme du panier de soins constitue une source majeure d'économies pour les dépenses d'AME. Elle doit être réalisée par voie réglementaire, le panier de soins pris en charge étant défini aux articles R. 251-1 et R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles. Il est urgent et important que ces mesures soient prises par le gouvernement, en vue d'une meilleure maitrise de la dépense publique.
Recommandation n° 8 : limiter le panier de soins pris en charge, sur le modèle de la recommandation cadre de l'Allemagne, en excluant notamment les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, et en soumettant à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie (DSS, CNAM).
Toutefois, contrairement au dispositif allemand, il serait préférable de conserver dans le panier de soins pris en charge par l'AME les dépenses de prévention, qui permettent à la fois de préserver la santé des bénéficiaires de l'AME et de l'ensemble de la population, et qui de plus sont sources de moindres dépenses en évitant une prise en charge trop tardive de l'état de santé d'un patient.
Il peut s'agir de dépister des pathologies de tout type à un stade précoce, de suivre une grossesse, de stabiliser une pathologie chronique, de fournir un traitement pharmaceutique primaire, ou encore d'assurer un rattrapage vaccinal ; tous ces modes de prévention étant moins onéreux que des prises en charges médicales ou chirurgicales techniques à un stade avancé. L'accès à la prévention permis par l'AME pourrait néanmoins être renforcé.
Dans certains cas, les bénéficiaires de l'AME sont exclus de la rédaction des articles législatifs et règlementaires ayant trait à la prévention qui ne mentionnent que les assurés sociaux, dont ils ne font pas partie. L'article L 1411-6-2 du code la santé publique prévoit ainsi l'organisation de bilans de prévention gratuits à certains âges pour les « assurés sociaux ». L'arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux dépistages organisés des cancers37(*) mentionne de la même façon les « assurés sociaux ».
Il est souhaitable que les bénéficiaires de l'AME soient plus fréquemment la cible de campagnes de prévention qui pourraient leur être dédiées. Ils sont par exemple susceptibles d'être porteurs de maladies infectieuses, comme le VIH ou l'hépatite C.
Dans la mesure où les bénéficiaires de l'AME doivent se présenter pour obtenir et récupérer leur carte AME, ce pourrait être un moment adapté pour mettre en oeuvre des actes de prévention ou pour proposer des vaccinations par le médecin de la CPAM, par exemple.
Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre des campagnes de prévention spécifiques à destination des bénéficiaires de l'AME dans les CPAM, en particulier lors de la délivrance de la carte de bénéficiaire de l'aide (DSS, CNAM).
C. UNE GESTION DE L'AME RELATIVEMENT SATISFAISANTE
1. Une organisation de l'affiliation à l'AME efficace dans les CPAM
Conformément à l'article L. 2521 du code de l'action sociale et des familles, « la première demande d'aide médicale de l'État est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'État. » La carte est accordée pour une durée d'un an, sur décision du directeur de l'organisme d'assurance maladie, ici la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
De plus, « toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'État peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'État, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département. Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie. »
Les CPAM sont donc chargées de l'instruction des primo-demandes et des demandes de renouvellement de l'aide médicale de l'État. Lors du dépôt d'un dossier, elles s'assurent que chacune des pièces constitutives du dossier sont valides (pièce d'identité, attestation de résidence stable depuis trois mois et preuve de ressources inférieures au plafond défini par la loi). Le dépôt d'un dossier d'AME se fait par le demandeur venu sur place, très souvent sur rendez-vous. Un formulaire est rempli par le personnel de la CPAM à cette fin.
Procédure de gestion des cartes AME dans les CPAM
Source : CPAM de l'Essonne
Le dossier est ensuite envoyé à l'une des quatre CPAM chargées de l'instruction des dossiers pour l'ensemble de la France : Bobigny, Paris, Marseille et Poitiers. Celles-ci instruisent les dossiers, en se servant des outils de lutte contre les fraudes (voir infra) et communiquent la décision aux CPAM d'origine.
En cas d'accord, une carte AME est fabriquée puis adressée à la CPAM d'origine. Un courrier est envoyé au bénéficiaire pour lui demander de prendre un rendez-vous afin de venir récupérer sa carte, et ce en se présentant physiquement à la CPAM.
Une telle organisation présente plusieurs avantages. Ainsi, elle permet de renforcer l'expertise des agents des CPAM chargés de l'instruction des dossiers, et de réaliser des économies d'échelle entre CPAM. Les dossiers de demande d'AME sont en effet très spécifiques et seraient difficiles à traiter pour des agents ne recevant pas quotidiennement de telles demandes.
Zone géographique pour lesquelles les CPAM
mentionnées
sont chargées d'instruire les
dossiers
Source : CPAM de l'Essonne
Le dépôt, la remise des cartes AME et l'instruction des dossiers représentent en effet une charge certaine pour les CPAM : ainsi, par exemple, dans la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, qui centralise 8,3 % des dossiers d'AME, 12 agents se consacrent au traitement des dossiers. Un tiers des passages à l'accueil de la CGSS concernent des dossiers d'AME.
Certaines CPAM, notamment dans l'Essonne, ont par ailleurs décidé de centraliser l'ensemble des dépôts de demande d'AME dans un site unique du département. L'avantage est que cela permet de limiter les flux de personnes, et de spécialiser les agents dans l'accueil des demandeurs d'AME. Le retrait de carte AME n'est en revanche pas centralisé dans une CPAM. Les associations critiquent toutefois ce système, dans les départements étendus notamment, et insistent sur la complexité des procédures de prise de rendez-vous pour certaines personnes.
Un équilibre peut sans doute être trouvé, afin d'aider les personnes éloignées du numérique à prendre un rendez-vous. Le dépôt du dossier d'AME peut être fait dans les permanences d'accueil des soins de santé (PASS) à l'hôpital, dans certains centres communaux d'action sociale ou même dans les maisons France services, lorsqu'une convention en ce sens a été passée. Une aide peut être accordée dans ces structures aux demandeurs peu familiarisés avec les outils informatiques.
Le système de délivrance des cartes AME géré par les CPAM parait assez satisfaisant, d'autant qu'il permet une lutte contre la fraude relativement efficace (voir infra). Les principales difficultés rencontrées par les CPAM sont l'incomplétude des dossiers, l'absence de retour des pièces réclamées par les demandeurs, le dépôt tardif de dossiers suite à une hospitalisation, la rétroactivité du droit étant impossible passé un délai de 90 jours, et enfin la difficulté de contacter les demandeurs.
2. Des contrôles de lutte contre la fraude relativement développés
De mesures de lutte contre la fraude ont été mises en oeuvre. Les dossiers contrôlés font l'objet d'une double instruction vérifiant notamment l'exactitude des ressources déclarées, le respect des critères de résidence ou encore la conformité des pièces justificatives.
La Caisse nationale d'Assurance maladie conduit également des contrôles ciblés sur les consommations de médicaments présentant des montants élevés ou des anomalies. Un programme national de contrôle mis en oeuvre depuis 2019 permet de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés de l'AME, en exploitant les signalements d'organismes ou via des échanges avec les consulats.
a) Les contrôles effectués lors du dépôt des demandes d'AME
Les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) contrôlent la présence physique des primo-demandeurs de l'AME. Elles réalisent des contrôles au moment de l'instruction du dossier pour vérifier que les conditions d'attribution sont remplies, notamment le séjour irrégulier en France depuis plus de trois mois et le montant des ressources.
Dans ce cadre, le contrôle du caractère irrégulier du séjour a été renforcé en 2020 avec l'accès des caisses à la base Visabio, permettant ainsi de contrôler l'absence de visa. En 2024, les caisses ont interrogé Visabio 276 525 fois et trouvé un visa dans 1 932 dossiers, soit 0,7 % des cas. Le visa détecté pouvant être en cours ou échu, le contrôle a conduit à un rejet effectif de 64 dossiers d'AME.
Un second niveau de contrôle intervient dès l'acceptation de la demande, par le biais des services de l'agent comptable. Un échantillon de dossiers fait ainsi l'objet d'une double instruction afin de s'assurer :
- de la présence et de la conformité des pièces justificatives ;
- de l'exactitude des ressources déclarées et prises en compte par l'ordonnateur ;
- du respect des critères de résidence (stabilité et irrégularité) ;
- de la qualité de l'enregistrement du droit dans le système d'information.
Centralisés au sein des caisses d'assurance maladie de Paris, Bobigny, Marseille et Poitiers, ces contrôles sont menés a priori afin de limiter le risque d'indus. En 2023, le taux de dossiers contrôlés s'établit à 15,5 %. Ainsi, 49 693 dossiers donnant lieu à un accord d'AME ont fait l'objet d'un contrôle a priori et, parmi eux, 1 142 ont présenté une anomalie menant à un rejet du dossier, soit 2,3 % des dossiers contrôlés. Le montant des préjudices évités est estimé à 2,83 millions d'euros.
Une fois le droit accordé, le bénéficiaire doit se rendre à sa caisse d'assurance maladie pour retirer son titre d'admission à l'AME. Celui-ci est remis en mains propres, permettant de confronter le titulaire du titre à la photo transmise.
Ces contrôles a priori paraissent relativement efficients, et conduisent à un taux de refus de dossier d'AME en augmentation, passant de 8 % des demandes en 2016 à 13,7 % en 2024.
Évolution du nombre de demandes, de refus et du taux de refus d'AME
Source : commission des finances d'après la DSS
La principale raison du refus d'un dossier d'AME est la non satisfaction du critère de résidence depuis 3 mois sur le sol français.
Évolution des motifs de refus d'AME
(en pourcentage)
Source : CNAM, traitement DSS
La procédure de gestion des demandes d'AME peut toutefois être améliorée. D'une part, le contrôle de la régularité des documents d'identité présentés est difficile dans certains cas. En effet, les extraits d'acte de naissance, dont la présentation est autorisée pour bénéficier de l'AME, ne comprennent pas de photo, et sont sans doute plus faciles à falsifier. Il est difficile pour un agent de CPAM de vérifier qu'il s'agit bien de l'extrait d'acte de naissance de la personne se présentant. Or en Guyane par exemple, lors d'une enquête conduite pendant deux semaines sur 68 dossiers, près de 41 % des demandeurs ont présenté un extrait d'acte de naissance. En conséquence, il ne parait pas justifié d'autoriser l'extrait d'acte de naissance comme document d'identité valable.
Recommandation n° 10 : exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État (DSS, CNAM).
Par ailleurs, les outils informatiques utilisés par les CPAM pourraient être améliorés. L'accès à la base VISABIO via un web service dédié, COVISA, pour permettre la vérification de la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant l'AME ne permet cependant à l'heure actuelle que de vérifier l'existence de visas nationaux, long séjour ou pour l'Outre-mer. Serait souhaitable que les CPAM puissent avoir accès à la base VIS, c'est-à-dire à la base européenne qui regroupe l'ensemble des visas court séjour délivrés pour l'espace Schengen.
Parallèlement, le ministère de l'intérieur a indiqué qu'un système analogue est en cours d'élaboration au bénéfice des postes consulaires afin de leur permettre, à l'occasion des demandes de visas, de détecter si, par le passé, le demandeur a sollicité ou obtenu l'AME. Il est donc prévu que les postes consulaires puissent avoir accès à la base AME de l'assurance maladie. Le consulat serait en mesure de déterminer si le demandeur de visa était en séjour régulier au moment où il a sollicité l'AME, de manière indue, s'il a obtenu l'AME sur la base de fausses déclarations sur ses ressources propres, afin d'apprécier un éventuel risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales.
Des risques de fraude pourront ainsi être signalés aux CPAM compétentes. Les informations contenues dans les demandes de visa, notamment dès lors qu'elles portent sur les ressources, les conditions de résidence ou encore l'historique de la stabilité socio-professionnelle du demandeur, pourront en effet être comparées à celles figurant dans la base AME.
Un tel système parait éminemment souhaitable et doit être développé dans les délais les plus courts possibles.
Actuellement, les échanges entre les services consulaires et les CPAM ont lieu essentiellement par courriel (environ 350 signalements sont recensés chaque année). La consultation de la base AME par les postes représentera un gain de temps et de fiabilité significatif.
b) Les contrôles ciblés a posteriori, au travers des programmes nationaux de contrôle visant tant les assurés que les bénéficiaires de l'AME
Les bénéficiaires de l'AME sont inclus dans les programmes nationaux de contrôle de la CNAM, qui concernent tous les assurés. La CNAM met en oeuvre des contrôles ciblés sur les consommations de médicaments ou produits de la liste des produits et prestations (LPP) des assurés et bénéficiaires de l'AME présentant des montants élevés, des anomalies ou atypies, afin de détecter des recours aux soins abusifs ou des utilisations frauduleuses de la carte Vitale ou AME. Ce sont des contrôles dits de « méga consommants ». Des contrôles sont effectués en parallèle auprès des professionnels de santé pour déceler les fraudes lors des prescriptions ou facturations, notamment pour des traitements de substitution aux opiacés.
Enfin, un programme national de contrôle est mis en oeuvre depuis juin 2019 afin de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés et bénéficiaires de l'AME, sur la base de requêtes dans les bases de données détectant les multi-hébergeurs, de l'exploitation des signalements d'organismes et d'échanges avec les consulats. Ces contrôles permettent de vérifier que les bénéficiaires et assurés résident en France depuis au moins 3 mois à l'ouverture des droits, puis au moins 6 mois pendant l'année de versement des prestations. S'agissant des échanges avec les consulats, les signalements sont opérés à l'occasion d'une demande de visa ou d'une naturalisation par mariage. Dès réception d'un signalement, la CNAM le transmet à la CPAM concernée pour investigation.
Ainsi, 120 dossiers relatifs à l'AME ont fait l'objet d'investigations en 2024 contre 153 dossiers en 2023. Le montant de préjudice s'élève à 0,91 million d'euros (0,33 million d'euros de préjudice subi et 0,58 million d'euros de préjudice évité) contre 0,84 million d'euros de préjudice en 2023. En 2023, ces dossiers représentent 1,05 % des dossiers de fraude ou activités fautives des assurés, pour lesquels la CNAM a mené des actions et 0,93 % du montant total des préjudices enregistrés pour l'ensemble des assurés.
Évolution du nombre de dossiers frauduleux et du montant du préjudice subi entre 2019 et 2024
Source : commission des finances d'après la CNAM
En complément, des mesures de lutte contre la fraude à la PUMa sont développées, pour mettre fin au versement de prestations qui seraient indues dès lors que l'étranger ne satisfait plus à la condition de régularité du séjour. À noter, que les fraudes à la PuMA sont en réalité plus faciles que les fraudes à l'AME : les cartes d'identité sont systématiquement demandées aux bénéficiaires de l'AME. À l'inverse, les fraudes à la carte vitale (seul document exigé pour les assurés sociaux) seraient plus fréquentes et faciles à mettre en oeuvre, d'après certains acteurs.
Un dispositif interministériel de lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires et aux prestations sociales est confié à la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). Cette dernière coordonne l'activité des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) présidés par les préfets et les procureurs de la République. Elle anime les 10 groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF), créés en 2021.
C'est ainsi dans ce cadre du GONAF qu'un protocole a été conclu, entre administrations relevant du ministère de l'intérieur et administrations relevant du ministère chargé de la sécurité sociale, pour systématiser les échanges d'information concernant les décisions préfectorales prises en matière de droits des étrangers, notamment de retrait de titre de séjour.
De tels dispositifs gagneraient à être encore renforcés. Il pourrait être avantageux d'impliquer davantage les professionnels de santé en ville, en systématisant la consultation de la base ADRI (attestation des droits des résidents), qui permet de s'assurer de l'affiliation d'un patient à la Sécurité sociale. Cette vérification est opérée beaucoup plus souvent à l'hôpital.
c) Une sécurisation de la carte à puce nécessaire mais coûteuse
La sécurisation de la carte AME est renforcée depuis janvier 2020, en contenant un hologramme. Par ailleurs, la production de la carte est centralisée et donc mieux contrôlée.
L'introduction d'une carte à puce pour l'AME serait un moyen à la fois de faciliter les remboursements obtenus par les professionnels de santé et de mieux suivre les dépenses des bénéficiaires de l'AME. En effet, l'utilisation d'une telle carte permettrait la télétransmission des feuilles de soins. Elle pourrait également contribuer à limiter les refus de soins de professionnels de santé, freinés par les démarches administratives nécessaires pour récupérer auprès de l'Assurance maladie le remboursement de la consultation réalisée. Elle sécuriserait par ailleurs le dispositif en présentant encore plus de garanties contre la duplication frauduleuse que la carte actuelle. Elle permettrait enfin de vérifier en temps réel que les droits sont toujours ouverts au moment où le bénéficiaire utilise la carte.
Néanmoins, la CNAM avait déjà étudié les contraintes techniques d'un tel projet en 2019. La carte en elle-même représenterait un coût de 5 euros par bénéficiaire, soit un total de 2,33 millions d'euros. La mise en oeuvre de la délivrance d'une carte à puce spécifique impliquerait plusieurs chantiers d'ampleur, au coût difficile à évaluer mais important :
- la création d'une chaîne de délivrance des cartes AME à puce couvrant notamment la création d'un dossier de demande de carte, la récupération dématérialisée de la photo avec une collecte en face à face, la création d'une chaîne pour produire des cartes AME à puce et la création d'outils de gestion du parc et de la mise à jour des cartes, etc. ;
- l'évolution des équipements des professionnels de santé et des établissements pour lire et mettre à jour cette carte, ainsi que l'évolution des logiciels de facturation, etc.
Un vecteur juridique de niveau législatif serait nécessaire pour encadrer l'usage de cette nouvelle carte afin de la rendre opposable en usage chez tous les professionnels de santé et les établissements, ainsi qu'une déclinaison en conventions de la garantie de paiement pour chaque profession concernée.
Une évaluation plus précise des coûts de l'introduction d'une carte à puce serait nécessaire, afin d'évaluer de manière complète la pertinence de l'introduction d'une telle carte, qui présenterait des avantages bien identifiés.
3. Des difficultés de recouvrement pour les hôpitaux
Conformément à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, « par exception, la demande [d'AME] peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie. »
Ainsi, dans les hôpitaux, les permanences d'accès aux soins (PASS) permettent d'ouvrir les droits à l'AME des patients éligibles se présentant. Il s'agit d'une charge de gestion administrative assez lourde. Selon certains hôpitaux, remplir un dossier d'AME représenterait 4 à 6 heures de travail pour une assistante sociale. Des plans de formation des assistantes sociales sont mis en oeuvre pour faciliter le traitement des dossiers.
L'enjeu financier représenté par le traitement des dossiers AME peut être conséquent pour les hôpitaux. Lorsque la demande d'AME a été déposée après le début d'une hospitalisation ou de soins, la décision d'admission à l'AME peut prendre effet au jour d'entrée dans l'établissement ou de la date de soins, sous réserve que le patient remplisse les conditions d'attribution de l'AME au moment des soins et surtout qu'il transmette sa demande dans un délai maximal de 90 jours à compter du jour de sortie de l'établissement ou de la date des soins. Ce délai de prise en charge rétroactive est entré en vigueur de façon pérenne le 1er janvier 202138(*), alors qu'il était de 30 jours auparavant, ce qui alourdissait les difficultés des hôpitaux à obtenir un remboursement de soins effectués. Surtout pour les hôpitaux recevant de nombreux patients éligibles à l'AME, la gestion des dossiers n'est pas neutre. Elle est de plus difficile à organiser : en général, les PASS ne sont pas ouvertes la nuit ou le week-end par exemple. Il peut donc arriver que des patients sans couverture se présentent aux urgences, reçoivent des soins et repartent sans avoir été pris en charge administrativement par une assistante sociale. Le coût des soins vient alors grossir le déficit des hôpitaux.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles, « les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance ». En revanche, pour les établissements de santé, le délai de paiement des prestations est d'une année seulement, conformément à la loi de finances initiale pour 2015 du 29 décembre 201439(*), alors qu'il était auparavant de deux ans. Ce délai est très compliqué à tenir, en particulier quand un patient a quitté l'hôpital sans présenter de justificatif de prise en charge. S'il est retrouvé par les huissiers quelques mois plus tard, et qu'il présente alors une demande d'AME, le délai d'un an peut être passer, empêchant l'hôpital de se faire rembourser.
Enfin, la prise en charge des soins urgents est également lourde administrativement parlant : pour en bénéficier, les hôpitaux sont obligés de faire une demande d'AME, qui doit être refusée, avant de pouvoir faire valoir le droit à l'AME pour soins urgents. Cette procédure peut inciter les hôpitaux à prolonger la durée d'hospitalisation des patients concernés, afin de disposer facilement des documents nécessaires.
En tout état de cause, une réflexion sur les procédures de facturation administrative des soins à l'hôpital doit être menée, afin de limiter autant que possible d'alourdir le déficit déjà élevé des établissements de santé, évalué à 3 milliards d'euros en 2024 par l'Assurance maladie.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 9 juillet 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial, sur l'aide médicale de l'État.
M. Claude Raynal, président. - Nous entendons la communication de notre collègue Vincent Delahaye, rapporteur spécial de la mission « Santé », sur l'aide médicale de l'État (AME).
M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial. - En tant que rapporteur spécial de la mission « Santé », je n'avais pas tellement le choix du sujet, cette mission n'étant composée que de l'aide médicale de l'État, ou presque.
En premier lieu, je souhaiterais préciser que l'appellation d'aide médicale de l'État recoupe en réalité quatre dispositifs différents.
L'aide médicale de l'État de droit commun, créée en 1999, constitue le principal système existant en termes budgétaires. Il est destiné aux étrangers présents irrégulièrement sur le sol français depuis plus de trois mois d'affilée, et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini annuellement, qui s'élève en 2025 à 862 euros mensuels. Les enfants mineurs et majeurs à charge, les conjoints, ainsi qu'une personne à charge pendant un an du bénéficiaire de l'AME sont également pris en charge au titre de cette protection santé. L'AME s'applique dans l'ensemble de la France hexagonale et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'exception de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le dispositif d'aide médicale de l'État est complété par l'AME dite pour « soins urgents », qui permet la prise en charge sanitaire des étrangers en situation irrégulière, sans condition de résidence, dès lors que leur pronostic vital est engagé ou qu'ils sont victimes d'une altération grave et durable de leur état de santé. À l'inverse de l'AME de droit commun, financée intégralement par le budget de l'État, seule une dotation forfaitaire, d'un montant de 70 millions d'euros en 2025, est versée par l'État à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) au titre des soins urgents, le reliquat étant financé par la sécurité sociale.
Enfin, une AME humanitaire permet la prise en charge sanitaire ponctuelle de soins hospitaliers de personnes françaises ou étrangères ne résidant pas sur le territoire national, sur décision du ministère chargé de l'action sociale. Une aide médicale est également accordée aux personnes qui sont en garde à vue. Ces deux derniers dispositifs représentent un montant de 1 million d'euros.
Je voudrais évoquer ici le cas particulier des demandeurs d'asile. Ceux-ci sont affiliés à la protection universelle maladie (PUMa), lorsqu'ils font une demande d'asile à laquelle ils n'ont plus le droit si leur demande est déboutée. En cas de refus de demande d'asile, les anciens demandeurs relèvent alors de l'aide médicale de l'État. Or, en 2024, ce sont 54 % des demandes qui ont été déboutées. Il me paraîtrait donc plus logique et cohérent d'affilier les demandeurs d'asile à l'aide médicale de l'État, comme c'est le cas en Allemagne. Cela représenterait une hausse d'un tiers des bénéficiaires de l'AME. Il ne s'agirait que d'un transfert de dépenses entre l'État et la sécurité sociale et cela permettrait une plus grande transparence.
Des réformes de l'AME ont été évoquées à de multiples reprises. En 2023, lors de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, le Sénat avait adopté un amendement visant à transformer l'aide médicale de l'État en aide médicale d'urgence (AMU), en réduisant le panier de soins pris en charge pour les bénéficiaires de l'AME. Dans le même temps, le Gouvernement avait confié à MM. Évin et Stefanini une mission, réalisée en un temps record de moins de trois mois, sur l'AME, à la suite de quoi Mme Borne, puis M. Attal avaient successivement promis une réforme de l'AME. Cette réforme n'a jamais été mise en oeuvre, ce qui n'est pas acceptable, d'autant qu'une partie des mesures qu'il faudrait prendre passe par la voie réglementaire. J'espère que le Gouvernement reprendra en main ce sujet.
Afin de vous éclairer sur les dépenses de l'AME, je voudrais évoquer les systèmes en vigueur dans les pays voisins. Au Danemark par exemple, comme en Suisse, seuls les soins urgents, engageant le pronostic vital, sont pris en charge pour les étrangers en situation irrégulière. Les soins liés aux grossesses ou à la vaccination, par exemple, ne peuvent être administrés sans demander une compensation financière. Il s'agit des systèmes de prise en charge des soins des étrangers en situation irrégulière les plus restreints, parmi ceux que j'ai étudiés.
En Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et en Italie, la prise en charge des soins des étrangers en situation irrégulière est plus large qu'au Danemark et en Suède, mais plus restreinte qu'en France. En Allemagne, notamment, les soins liés à l'accouchement, par exemple, sont pris en charge intégralement. En revanche, les programmes de soins programmés des maladies chroniques ne peuvent être pris en charge par la collectivité, sauf lorsque leur défaut engagerait le pronostic vital du patient. Les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie ne peuvent être effectués que sur autorisation préalable de la sécurité sociale.
Enfin, certains pays, comme l'Espagne et la Belgique, ne font pratiquement pas de distinction dans la prise en charge des soins entre les étrangers en situation irrégulière et les assurés sociaux. Il faut toutefois noter que, en Espagne, les étrangers en situation irrégulière doivent s'acquitter de 40 % du prix des médicaments qui leur sont prescrits.
J'en viens maintenant aux dépenses d'aide médicale de l'État. Celles-ci représentaient un total de 1,387 milliard d'euros en 2024, en hausse de 15,5 % par rapport à 2023.
Ce total de dépenses est toutefois sous-estimé dans le budget de l'État, où il représentait seulement 1,16 milliard d'euros en 2024, dont 1,088 milliard d'euros pour l'AME de droit commun, en hausse de 40 % en dix ans.
D'une part, l'État ne prend pas en charge l'intégralité de la dépense d'AME pour soins urgents, puisqu'il ne verse que 70 millions d'euros à la sécurité sociale sur un coût total de 132 millions d'euros, le reste étant pris en charge par la Cnam.
D'autre part, le montant budgétisé de dépenses d'AME de droit commun dans les dépenses de l'État a été bien inférieur aux dépenses réelles en 2024. En effet, le Gouvernement avait sous-estimé la dépense d'AME dans son budget initial. De plus, le décret d'annulation du 21 février 2024 a entraîné la suppression de 50 millions d'euros de dépenses d'AME, sans aucune réforme du dispositif qui aurait permis de justifier cette économie. En conséquence, les dépenses d'AME étant des dépenses de guichet forcément décaissées, une dette de l'État à l'encontre de la Cnam a été générée, d'un montant de 185 millions d'euros. Une telle situation n'est pas acceptable : il est indispensable que le Gouvernement budgète un montant d'AME conforme aux dépenses exécutées et prévoie de combler sa dette à l'égard de la sécurité sociale.
Je relève par ailleurs, globalement, le manque de connaissances sur le dispositif d'AME, particulièrement regrettable, que ce soit sur l'origine des bénéficiaires ou même, plus simplement, sur leur nombre en temps réel. Je recommanderai d'ailleurs d'actualiser tous les mois les remontées de dépenses et de nombre de bénéficiaires de l'AME, au lieu de tous les trois mois.
Au-delà de la problématique de la prévision des dépenses d'AME, la hausse massive des dépenses est claire et avérée.
Pour la comprendre, je veux évoquer les bénéficiaires de l'AME. Ceux-ci sont en majorité des hommes, âgés de 20 à 39 ans, dont l'origine n'est pas connue. Ils sont présents majoritairement dans les départements très urbains d'Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Rhône, ainsi qu'en Guyane pour 8 % d'entre eux.
Or la progression des dépenses d'AME s'explique principalement par la hausse du nombre de ces bénéficiaires, qui a été multiplié par deux entre 2011 et 2024. En 2024, 465 744 personnes ont bénéficié de l'AME. Même si l'estimation n'est pas exacte, environ 900 000 personnes sont en situation irrégulière sur le territoire français.
Ainsi, il est possible d'estimer qu'entre 2020 et 2024, sur une progression des dépenses de 426 millions d'euros, près de 243 millions d'euros de hausse sont liés à l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Le reliquat de l'augmentation est lié à l'inflation et aux coûts des soins.
Au vu de ces constats assez frappants, je souhaite d'abord insister sur la nécessité de lutter contre les flux d'immigration illégale en France. Plusieurs indicateurs, qu'il s'agisse du nombre de bénéficiaires de l'AME, d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière ou de demandes d'asile, indiquent qu'un nombre croissant d'étrangers parviennent irrégulièrement à entrer sur le sol français. Ces flux doivent être maîtrisés, c'est là la première condition pour maîtriser les dépenses d'AME. À cette occasion, je souhaiterais rappeler que les étrangers à qui un titre de séjour a été refusé ou retiré pour un motif d'ordre public demeurent éligibles à l'AME, s'ils remplissent les conditions de résidence et de ressources. Une telle situation ne me paraît pas acceptable : il est souhaitable que les personnes à qui un titre de séjour a été refusé parce qu'ils étaient jugés constituer un trouble à l'ordre public soient retirées de la liste des bénéficiaires de l'AME.
D'autres sources d'économies sont possibles.
En premier lieu, je pense qu'il est indispensable de redéfinir les droits ouverts au titre de l'AME. En effet, comme l'avaient déjà relevé MM. Évin et Stefanini, il est très étonnant de constater que les enfants majeurs à charge d'un bénéficiaire de l'AME font partie de ses ayants droit. Par ailleurs, les revenus du conjoint d'un bénéficiaire de l'AME ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources, ce qui n'est pas pertinent.
Ensuite, il faudrait revoir la définition du panier de soins, en s'inspirant du modèle allemand. Il s'agit d'une voie médiane entre les systèmes danois et suisse, très restreints, et le système français actuel. Ainsi, aujourd'hui, dans le système français, ce sont seulement les cures thermales, l'assistance médicale à la procréation (PMA), les médicaments dont le service médical rendu est faible ou encore les frais relatifs aux examens de prévention buccodentaire qui sont exclus du panier de soins pris en charge au titre de l'AME. Il serait pertinent d'y ajouter notamment les programmes de soins programmés pour maladies chroniques, comme c'est le cas en Allemagne.
Par ailleurs, il existe actuellement un panier de soins dits « non urgents », qui doivent être autorisés par la Cnam pour pouvoir être administrés. Ce panier de soins est très restreint : il n'a représenté que 6 millions d'euros de coûts en 2024. En s'inspirant du modèle allemand, ce panier de soins « non urgents » pourrait être élargi, par voie réglementaire, notamment à la rééducation, à la psychiatrie et aux traitements hospitaliers non urgents.
Ce système d'accord préalable des soins hospitaliers n'est de plus réservé qu'aux personnes bénéficiant de l'AME depuis moins de neuf mois, ce qui n'est pas justifié. Il serait souhaitable d'étendre le régime de l'accord préalable à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME, conformément à l'amendement adopté par le Sénat lors du vote du projet de loi de finances 2025, sur l'initiative de notre commission et de celle des affaires sociales. Je regrette qu'un tel ajout n'ait pu être conservé dans le texte final.
Au total, le montant des économies est difficile à estimer, mais le coût des hospitalisations à domicile, des soins de suite et de réadaptation, et de la psychiatrie, activités qui seraient concernées par le dispositif d'accord préalable, était de 338 millions d'euros en 2024.
Enfin, quelques améliorations du système de gestion de l'AME sont possibles en vue de lutter contre la fraude : il s'agirait notamment d'exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte AME, puisqu'il n'y a pas de photo. Une puce pourrait aussi être introduite dans les cartes AME afin de faciliter les remboursements des professionnels de santé et de mieux suivre les dépenses des bénéficiaires de l'AME.
Si nous voulons pouvoir maîtriser l'évolution des dépenses de l'AME et, le cas échéant, faire des économies, il est indispensable de réformer certains éléments du dispositif. Sans supprimer l'AME, car elle est nécessaire, des efforts de rigueur doivent être poursuivis. Le montant budgété pour 2025, qui a été décidé en commission mixte paritaire, risque d'être dépassé. C'est la raison pour laquelle je souhaite que l'assurance maladie nous fournisse des données mensuelles plutôt que trimestrielles. Je n'ai d'ailleurs toujours pas reçu le relevé du premier trimestre 2025. Il faudrait que les informations soient transmises de façon plus régulière.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - À défaut de pouvoir travailler de manière précise sur des données qui devraient être fournies par la Cnam, nous naviguons dans l'incertitude, ce qui permet une latitude d'interprétations de la part des uns et des autres. Il n'y a là rien de satisfaisant et nous devons obtenir de l'État un suivi de bien meilleure qualité.
La recommandation n° 11 vise à introduire une carte à puce pour les bénéficiaires de l'AME. À quel coût est estimée cette mesure ?
Le panier de soins non urgents avait fait débat lors de la commission mixte paritaire, certains considérant que la dérive des dépenses est inévitable. Comment garantir un suivi précis dans le temps ? Est-ce un manque de volonté politique qui l'empêche, ou bien des difficultés pratiques ? Pour dépassionner le débat, il faudrait objectiver le sujet en renforçant la précision des données.
M. Jean-Raymond Hugonet. - Dans ces temps budgétaires incertains, ce rapport est très utile. Il révèle ce que notre commission est capable de produire sur un sujet qu'il faudrait dépassionner.
Je connais bien mon collègue Vincent Delahaye, sénateur de l'Essonne - tout comme moi -, et longtemps maire d'une ville de taille conséquente, mais aussi son humanisme. Je ne déplacerai pas une virgule dans son discours. Il a su faire preuve tout autant d'humanisme que de responsabilité. Je suis curieux de voir ce que donnera le débat qui va suivre et j'espère que nous parviendrons à des conclusions justes, humaines et équilibrées.
M. Bruno Belin. - Le rapporteur spécial a eu des mots justes. Je me retrouve également dans les propos du rapporteur général, au sujet des crispations qui existent.
J'aimerais vous partager mon expérience de trente-cinq ans d'exercice officinal. Je pratique toujours mes gardes, dans une ville, chef-lieu de canton, qui compte un certain nombre de foyers de migrants. Lorsque nous délivrons un formulaire Cerfa, nous le faisons à l'aveugle sans pouvoir vérifier l'identité de la personne concernée. Nous ne savons même pas si le document a été envoyé ou pas, car nous sommes payés un ou deux ans après, ce qui rend le suivi difficile.
De plus, quand le sujet est évoqué dans les communautés professionnelles des territoires de santé (CPTS) ou bien auprès des médecins concernés, la conclusion est toujours la même : on ne refusera jamais de soigner. La recommandation n° 6 qui vise à exclure du bénéfice de l'AME les personnes qui n'ont pas de titre de séjour est donc limitée dans son application.
Quant à la recommandation n° 11 sur les cartes à puce, elle est inapplicable, car nous n'avons aucun moyen de vérifier l'état civil de ces personnes.
Ma pratique de terrain m'incite à vous rappeler que, en face du dispositif, il y a des êtres humains et qu'un professionnel de santé ne refusera jamais de les soigner.
Mme Ghislaine Senée. - Sans refaire le débat sur l'AME, le rapport Évin-Stefanini a rappelé que le dispositif ne créait pas d'appel d'air. Il faut bien dissocier le sujet de l'AME et celui de l'immigration illégale. Les ministres de la santé successifs ont souligné que l'AME permettait de faire face à un danger triple : pour la santé publique, pour l'organisation des soins et pour le budget de l'État, car si l'on ne traite pas suffisamment tôt certaines maladies, les conséquences risquent d'être très graves, alors que nos hôpitaux sont déjà mis à mal.
Nous ne voterons pas en faveur de ce rapport, mais je voudrais poser deux questions. Tout d'abord, pourriez-vous détailler le chiffre de 60,8 % de prestations hospitalières ? Ensuite, vous avez mentionné la progression des dépenses réelles d'AME de 60,6 % en dix ans : il serait intéressant d'avoir un comparatif avec l'évolution des dépenses de la branche maladie de la sécurité sociale.
M. Michel Canévet. - Je tiens à remercier le rapporteur spécial de la qualité de son travail et du bon sens des recommandations formulées.
Comment expliquer l'accélération des dépenses qui semble être à l'oeuvre depuis deux ans ? Par ailleurs, le recours à l'AME est-il significatif dans les territoires ultramarins, qui sont confrontés à une certaine pression migratoire ?
M. Thomas Dossus. - Cette hausse des dépenses n'est-elle pas liée à une politique migratoire de plus en plus restrictive ? La multiplication des obligations de quitter le territoire français (OQTF), en empêchant un certain nombre de personnes de travailler, les conduit vers le régime de l'AME plutôt que vers le régime général. Ladite politique est à l'origine d'absurdités administratives puisque nous recevons dans nos permanences des personnes privées de leur titre de séjour pour un simple rendez-vous raté, ce qui nourrit le bataillon des demandeurs de l'AME.
J'ajoute que ces dépenses doivent être mises en perspective avec les dépenses globales de santé, puisqu'elles ne représentent guère que 0,5 % du total, soit une proportion extrêmement faible.
Enfin, la recommandation n° 6 justifie à elle seule un vote défavorable sur ce rapport tant elle va à l'encontre des valeurs de notre République.
M. Thierry Cozic. - Nous voterons également contre ce rapport, même si je remercie le rapporteur spécial pour son travail. Nous retrouvons là un débat que porte, assez classiquement, la majorité sénatoriale.
Le rapport remis en 2023 par Claude Évin et Patrick Stefanini au sujet de l'AME évoquait « un dispositif sanitaire utile », « globalement maîtrisé », « correctement cadré sur le plan réglementaire et largement opérationnel », ce qui résume bien la situation.
Nous parlons bien d'un budget qui ne représente que 0,44 % des dépenses globales, et ce débat n'a donc pas lieu d'être, car réduire ces dépenses entraînerait davantage de coûts indirects à l'avenir. D'autres thèmes budgétaires me semblent bien plus importants.
M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial. - Je n'ai pas dit que le dispositif était inutile et ne contredis donc pas le rapport de MM. Évin et Stefanini, qui n'ont d'ailleurs eu que peu de temps pour mener ce travail, comme ils me l'ont indiqué au cours de leur audition.
S'ils ont indiqué que l'AME était utile, son caractère « globalement maîtrisé » est discutable ; surtout, je réfute l'affirmation selon laquelle le sujet ne mérite pas d'être débattu, car nous devons aborder l'ensemble des sujets, qu'ils soient majeurs ou non, de la façon la plus dépassionnée possible.
M. Dossus a critiqué la recommandation n° 6, qui prévoit d'exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public. Je précise que les intéressés pourront toujours recevoir des soins urgents, et j'estime qu'il ne serait guère pertinent de ne prévoir aucune conséquence en cas de retrait du titre de séjour.
Sur un autre point, j'ai hésité à introduire la recommandation n° 11 - relative à l'introduction d'une carte à puce pour les bénéficiaires de l'AME - en raison de son coût, la fabrication de ce nouveau support représentant une dépense de 2 millions d'euros à 3 millions d'euros, à laquelle s'ajouteraient des modifications des systèmes de facturation des professionnels de santé.
Il ne s'agit donc pas de la recommandation à laquelle je suis le plus attaché. Rappelons que les cartes d'AME sont renouvelées chaque année, ce qui donne lieu à un contrôle déjà strict de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), comme j'ai pu le constater au cours de visites dans l'Essonne et en Seine-Saint-Denis. J'émets une réserve, cependant, concernant l'acceptation d'extraits d'acte de naissance comme pièce d'identité valable pour délivrer une carte d'AME.
J'en profite pour faire le lien avec votre interrogation relative aux territoires ultramarins, monsieur Canévet : outre la Martinique et la Guadeloupe, seule la Guyane est réellement concernée par l'AME, et pas Mayotte, la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. En Guyane, 40 % des demandeurs présentent des extraits d'acte de naissance comme pièce d'identité, ce qui semble élevé. De manière générale, les titulaires de la carte d'AME sont censés disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité.
M. Bruno Belin. - Les confrères des Antilles sont submergés par les demandes en provenance d'Haïti.
M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial. - J'en prends note. Par ailleurs, les délais de règlement sont sans doute liés aux difficultés de trésorerie que nous rencontrons, les dépenses excédant souvent les budgets alloués.
Je remercie également M. Hugonet pour ses propos, qui m'ont touché ; une fois encore, ce sujet mérite un débat dépassionné, et je rappelle que nous ne pourrons pas proposer d'évolution des crédits de la mission AME sans apporter des modifications au dispositif. Tout en rappelant l'utilité de ce dernier, le rapport Évin-Stefanini contenait une série de propositions qui n'ont pas été mises en oeuvre pour l'instant.
Madame Senée, les soins de ville englobent les consultations hospitalières externes, même si cela peut sembler surprenant. Dans le détail, les coûts des séjours hospitaliers, des accouchements et des actes de chirurgie s'élèvent respectivement à 328 millions d'euros, 78 millions d'euros et 85 millions d'euros. Il reste très difficile d'obtenir les données, qui sont parfois inexistantes, ou qui ne sont tout simplement pas exploitées, alors que l'intelligence artificielle (IA) pourrait être utilisée pour interroger les bases de données de l'assurance maladie.
Enfin, M. Canévet a soulevé la question de l'augmentation des dépenses. Depuis 2020, la hausse du nombre de bénéficiaires a été assez forte, mais, alors qu'elle a ralenti entre 2023 et 2024, les dépenses ont pourtant augmenté de 15 %. Cela pourrait signifier que les dépenses moyennes d'un bénéficiaire de l'AME, inférieures à celles d'un assuré social « classique », ont progressé en 2024, mais nous aurions besoin d'une analyse plus fine pour comprendre ce phénomène.
M. Claude Raynal, président. - Vous proposez donc de retirer la recommandation n° 11 ?
M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial. - Tout à fait.
La recommandation n° 11 est retirée.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Ministère de l'intérieur - Direction générale des étrangers en France
- Mme Sylvie DUBOIS, conseillère santé du directeur général ;
- M. Ludovic GUINAMANT, sous-directeur du séjour et du travail.
Ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction de la sécurité sociale : sous-direction du financement de la sécurité sociale et sous-direction des études et prévisions financières
- M. Thomas RAMILIJAONA, sous-directeur ;
- M. Harry PARTOUCHE, sous-directeur ;
- Mme Eva DE ALMEIDA, chargée d'études statistiques sur l'AME ;
- Mme Sara DONATI, chargée de mission à la DSS ;
- Mme Maroussia PEHERINEC, adjointe à la sous-directrice de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail ;
- Mme Sophia BOUZID, cheffe de bureau à la sous-direction de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail.
Auteurs d'un rapport sur l'aide médicale de l'État en décembre 2023, dans le cadre d'une mission d'évaluation confiée par le gouvernement
- M. Claude EVIN, ancien ministre ;
- M. Patrick STEFANINI, conseiller d'État honoraire.
Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane
- M. Jean-Xavier BELLO, directeur général ;
- Mme Adeline FARNABE, attachée de direction à la direction générale ;
- Mme Yolaine ELFORT, responsable des droits à l'assurance maladie.
Office français de l'immigration et de l'intégration
- M. Didier LESCHI, directeur général ;
- Docteur Bénédicte BEAUPÈRE, directrice adjointe du service médical.
Samu social de Paris
- Mme Vanessa BENOIT, directrice générale.
Fédération hospitalière de France (FHF)
- Mme Cécile CHEVANCE, responsable du pôle Offres ;
- M. Vincent OLLIVIER, responsable adjoint du pôle Offres.
Caisse nationale d'assurance maladie
- M. Thomas FATÔME, directeur général ;
- Mme Manon CHONAVEL, directrice de cabinet ;
- Mme Véronika LEVENDOF, chargée des relations avec le Parlement ;
- Mme Fanny RICHARD, directrice de l'intervention sociale et de l'accès aux soins.
France Assos santé
- Mme Féreuze AZIZA, chargée de mission assurance maladie au sein de France Assos Santé ;
- Mme Catherine SIMONIN-BÉNAZET, membre du bureau de France Assos santé et présidente de la commission société et politiques de santé de la ligue contre le cancer.
Haut conseil de la santé publique
- M. Didier LEPELLETIER, président ;
- Mme Ann PARIENTE-KHAYAT, secrétaire générale ;
- M. Renaud VERDON, membre de la commission spécialisée maladies infectieuses et maladies émergentes ;
- M. Nicolas VIGNIER, membre de la commission spécialisée maladies infectieuses et maladies émergentes ;
- M. François EISINGER, président de la commission spécialisée déterminants de santé et maladies non-transmissibles ;
- M. Pascal FORCIOLI, membre de la commission spécialisée système de santé et sécurité des patients et copilote du groupe de travail inégalités sociales et territoriales de santé.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Déplacement dans l'Essonne
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne
- M. Albert LAUTMAN, directeur général de la CPAM de l'Essonne ;
- M. Philippe GILLES, président de la CPAM de l'Essonne ;
- M. Frédéric BAYSSELANCE, directeur général adjoint ;
- Mme Sandrine CUNHA, chargée d'étude gestion des bénéficiaires ;
- Mme Pauline GARÉ, responsable de département accueil et solidarité ;
- Mme Angela MINEAS, conseillère service de l'assurance maladie.
Centre hospitalier sud francilien
- M. François BERARD, directeur général du centre hospitalier sud-francilien ;
- Mme Bénédicte DRAGNE-EBRARDT, directrice générale adjointe ;
- Mme Marie-Paule SAULI, Coordonnatrice Générale des Soins ;
- M. Marc TOCHON, Directeur des Finances ;
- Mme Corinne ROUILLAT, Responsable du Service Social ;
- Mme Nathalie LAURENDEAU, Responsable du bureau des entrées ;
- Mme Nathalie DELAGE, Cadre Supérieur de santé pôle SARMU ;
- Dr Yohann ALTERVAIN, chef du service des urgences adultes ;
- Mme Nathalie DELAGE, cadre de pôle au service des urgences adultes.
Déplacement en Seine-Saint-Denis
Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
- M. Stephan DI IORIO, directeur général ;
- M. Stéphane HÉLIÈRE, chef de cabinet ;
- M. Thomas VACHEON, Directeur des Prestations ;
- M. Denis ELIOT, Responsable du Département AME ;
- M. Emmanuel DELAHAYE, Responsable du service AME 93 ;
- M. Medhi RACHID, référent technique dans le service AME 93 ;
- Mme Karine VEIGNANT, responsable du Département Accueil Physique ;
- Mme Béatrice ONESTAS, responsable de l'agence de la Courneuve.
Centre hospitalier de Saint-Denis
- M. Yohann MOURIER, directeur général adjoint ;
- Mme LEGUAY PORTADA, directrice déléguée ;
- Mme Natty TRAN, directrice du parcours patient et de la performance ;
- Dr BOLOT, président de la commission médicale d'établissement ;
- Mme Elisa PASQUALONI, praticienne hospitalière en médecine interne responsable de l'unité d'aval des Urgences et de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS) ;
- Mme BARBEREAU, responsable du service social et référente administrative des PASS ;
- Mme Patricia BRIENNE, responsable de la facturation.
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Imposer une visite médicale obligatoire dans le pays d'origine grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France |
DGEF, Consulats |
Rentrée 2026 |
Circulaire ministérielle |
|
2 |
Intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME. |
DSS, CNAM |
Loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances pour 2026 |
Loi, règlement (code de l'action sociale et des familles) |
|
3 |
Actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État pour améliorer la prévision. |
DSS, CNAM |
Rentrée 2025 |
Instruction aux services |
|
4 |
Enregistrer le statut administratif des personnes sollicitant ou bénéficiant d'une greffe. |
Agence de biomédecine |
Rentrée 2025 |
Instruction aux services |
|
5 |
Limiter le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux enfants mineurs à charge du bénéficiaire et prendre en compte les revenus du conjoint lors de la définition du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'aide. |
DSS |
Loi de finances pour 2026 |
Loi, règlement (code de l'action sociale et des familles) |
|
6 |
Exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public. |
DSS |
Loi de finances pour 2026 |
Loi, règlement (code de l'action sociale et des familles) |
|
7 |
Étendre le recours à l'accord préalable avant de bénéficier de soins « non urgents » à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME. |
DSS |
Loi de finances pour 2026 |
Loi, règlement (code de l'action sociale et des familles) |
|
8 |
Limiter le panier de soins pris en charge, sur le modèle de la recommandation cadre de l'Allemagne, en excluant notamment les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, et en soumettant à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie. |
DSS, CNAM |
Janvier 2026 |
Règlement (code de l'action sociale et des familles) |
|
9 |
Mettre en oeuvre des campagnes de prévention spécifiques à destination des bénéficiaires de l'AME dans les CPAM, en particulier lors de la délivrance de la carte de bénéficiaire de l'aide. |
DSS, CNAM |
Janvier 2026 |
Campagnes de prévention |
|
10 |
Exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État. |
DSS, CNAM |
Janvier 2026 |
Circulaire ministérielle |
* 1Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
* 2 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 3 Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
* 4 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
* 5 Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
* 6 La PUMa a remplacé la couverture maladie universelle (CMU) au 1er janvier 2016.
* 7Arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé.
* 8 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.
* 9 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
* 10 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
* 11 Article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
* 12 Article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles.
* 13 Articles L. 251-1 et R. 251-4 du code de l'action sociale et des familles.
* 14 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 15 En vertu de l'instruction ministérielle DSS n° D18-018498 du 15 janvier 2019.
* 16 L'aide médicale de l'État : diagnostic et propositions, mission Inspection générale des finances - inspection générale des affaires sociales, 11 octobre 2019.
* 17 D'après le ministère de l'Intérieur, 70 284 asiles ont été attribués, contre 153 715 demandes.
* 18 Le recours à l'Aide médicale de l'État des personnes en situation irrégulière en France : premiers enseignements de l'enquête Premiers pas , IRDES, Questions d'économie de la santé n° 245, novembre 2019.
* 19 Questions d'économie de la santé n° 245
« Le recours à l'Aide médicale de l'État des personnes en situation irrégulière en France : premiers enseignements de l'enquête Premiers pas », Irdes, novembre 2019.
* 20 Note d'exécution budgétaire, mission « Santé » du budget général de l'État, avril 2024.
* 21 Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
* 22 Note d'exécution budgétaire, mission « Santé » du budget général de l'État, avril 2024.
* 23 Ce calcul est effectué à partir de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) totale et du nombre de résidants sur le territoire français en 2023.
* 24 DREES, Plus les dépenses de santé sont importantes, plus la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire est élevée, n° 1251, décembre 2022.
* 25Des assurés comme les autres : une analyse des consommations de soins de ville des personnes couvertes par l'aide médicale de l'État, Questions d'économie de la santé n° 284, décembre 2023, IRDES.
* 26 Une séance est une venue dans un établissement de santé réalisée au cours d'une journée, pour un motif thérapeutique impliquant une venue fréquente (dialyse, chimiothérapie, transfusion sanguine, oxygénothérapie hyperbare, aphérèse sanguine).
* 27 Médicaments à partir desquels sont conçus les médicaments génériques.
* 28 L'aide médicale de l'État : diagnostic et propositions.
* 29 Le recours à l'Aide médicale de l'État des personnes en situation irrégulière en France : premiers enseignements de l'enquête Premiers pas, Questions d'économie de la santé n° 245, novembre 2019, IRDES.
* 30 Rapport 2023 de l'observatoire de l'accès aux droits et aux soins, 18 octobre 2023, Médecins du monde.
* 31 Les refus de soins opposés aux bénéficiaires opposés aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'État, Institut des études politiques, mai 2023.
* 32 Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux. Depuis 2021, en cas de refus de soins discriminatoire, le patient peut saisir sa caisse d'assurance maladie ou le conseil local de l'ordre, dont dépend le professionnel de santé mis en cause, ce qui conduit à l'organisation d'une conciliation devant une commission associant des représentants de l'ordre et des représentants de la caisse d'assurance maladie. En cas d'échec de la conciliation ou en cas de récidive, le litige est susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire à l'encontre du professionnel de santé concerné, voire à une sanction financière par l'assurance maladie obligatoire en cas de carence de l'ordre.
* 33 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
* 34 Rapport sur l'aide médicale de l'État, Claude Evin et Patrick Stefanini, décembre 2023.
* 35 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 36 Une séance est une venue dans un établissement de santé réalisée au cours d'une journée, pour un motif thérapeutique impliquant une venue fréquente (dialyse, chimiothérapie, transfusion sanguine, oxygénothérapie hyperbare, aphérèse sanguine).
* 37 Arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistages organisés des cancers.
* 38 Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'État et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France.
* 39 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.