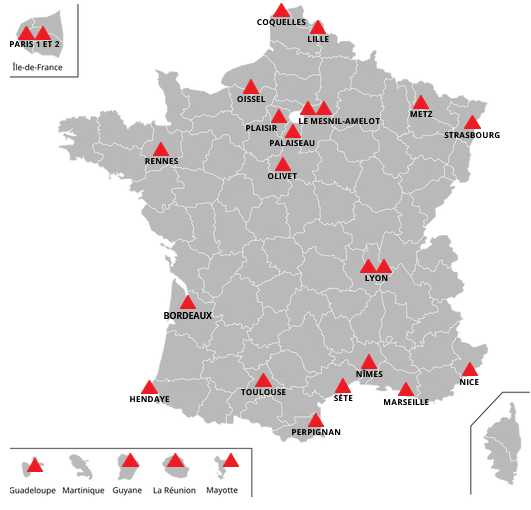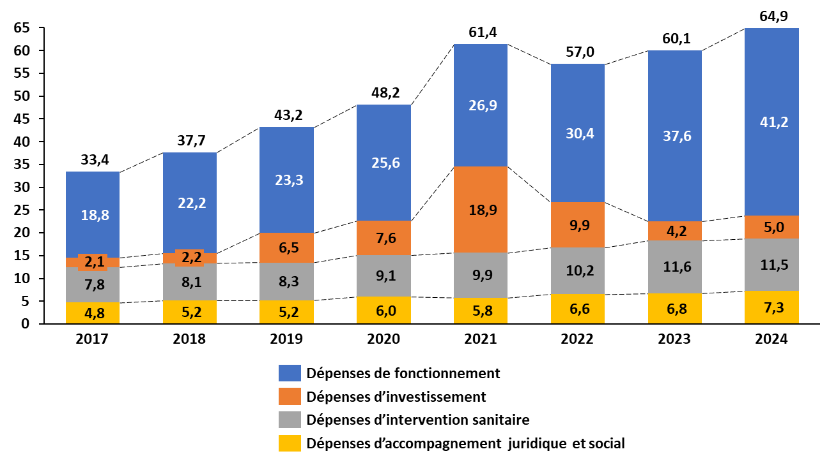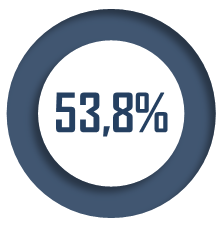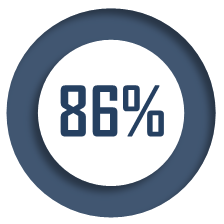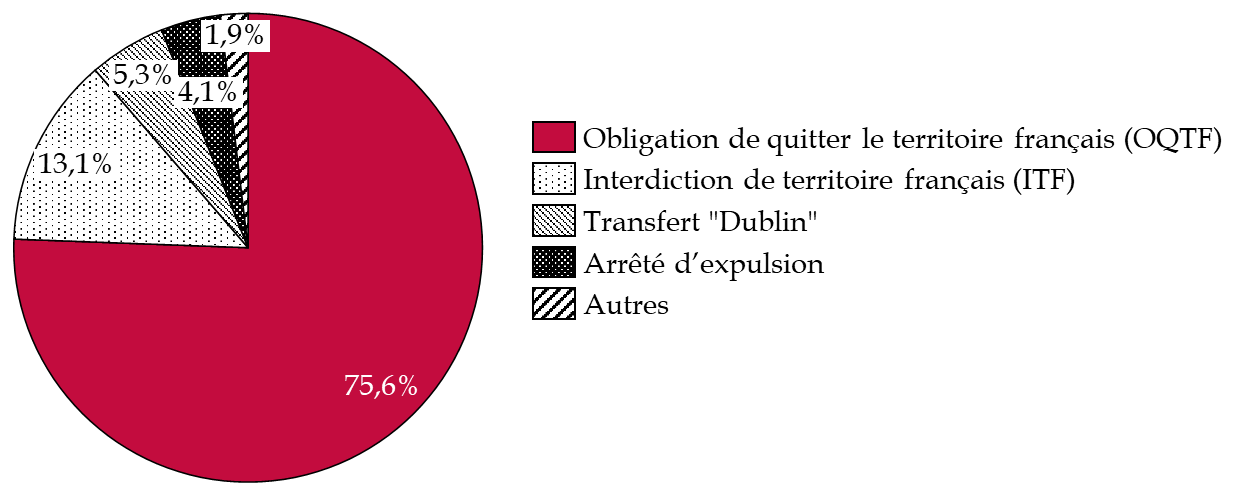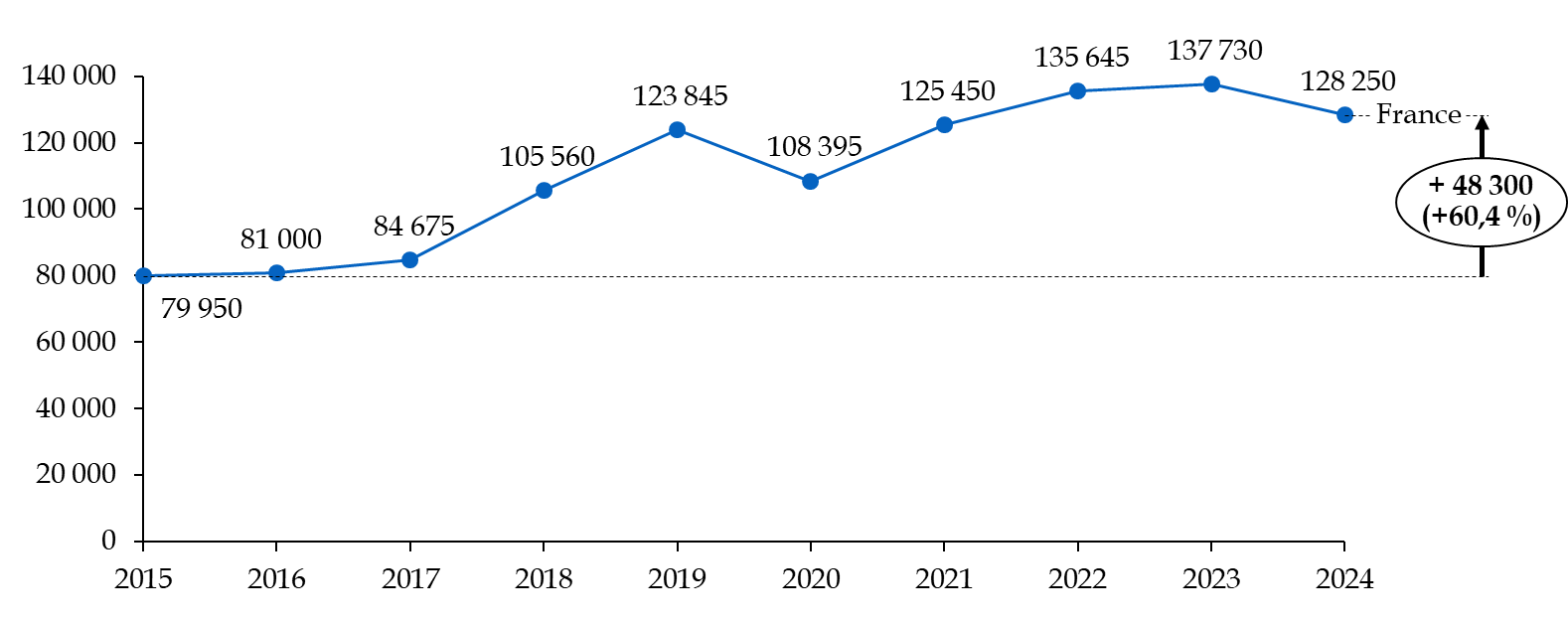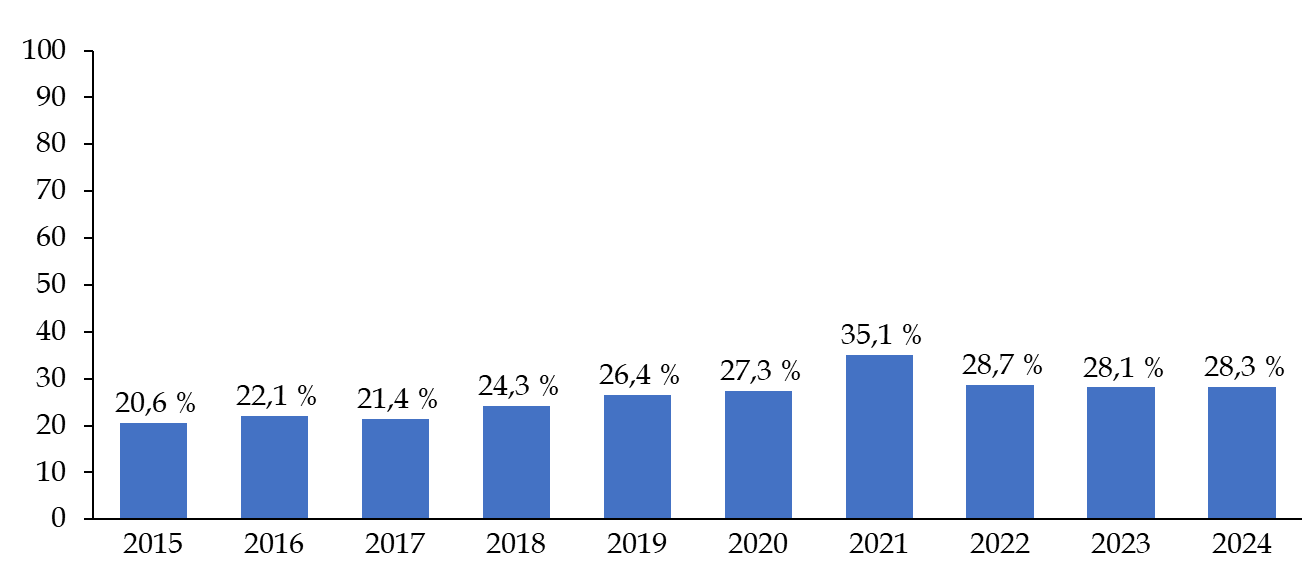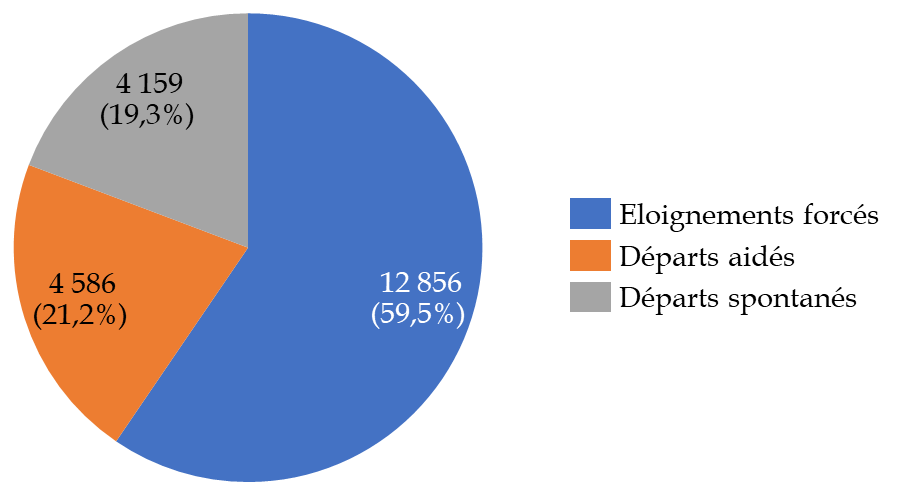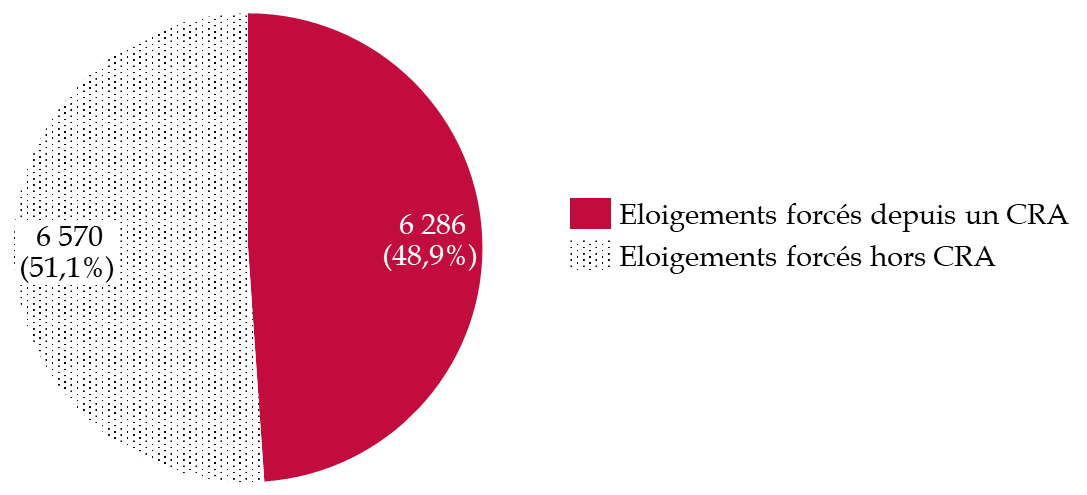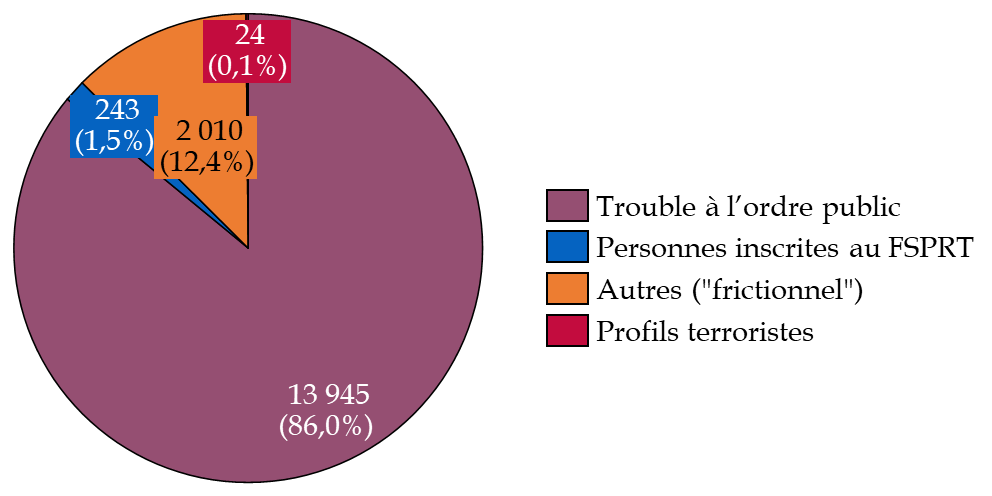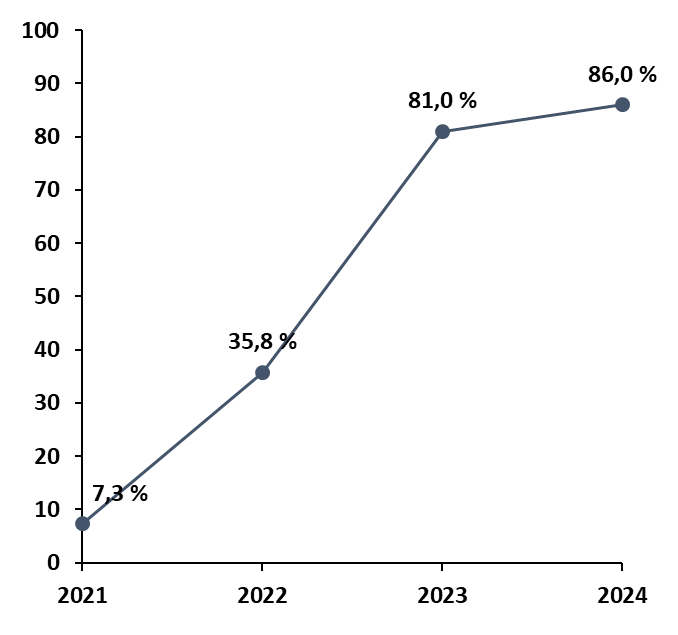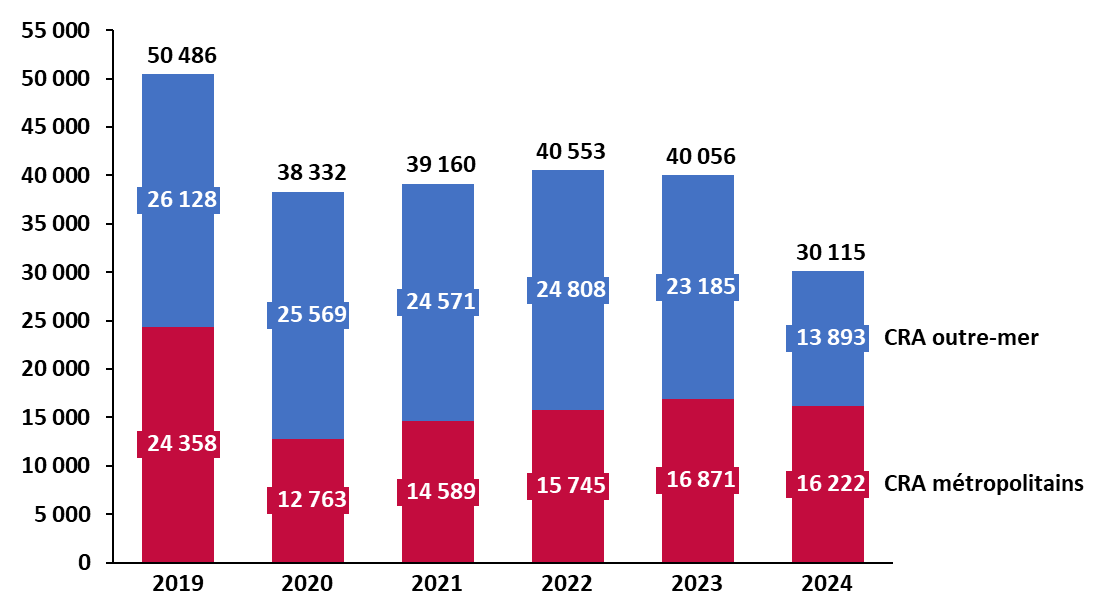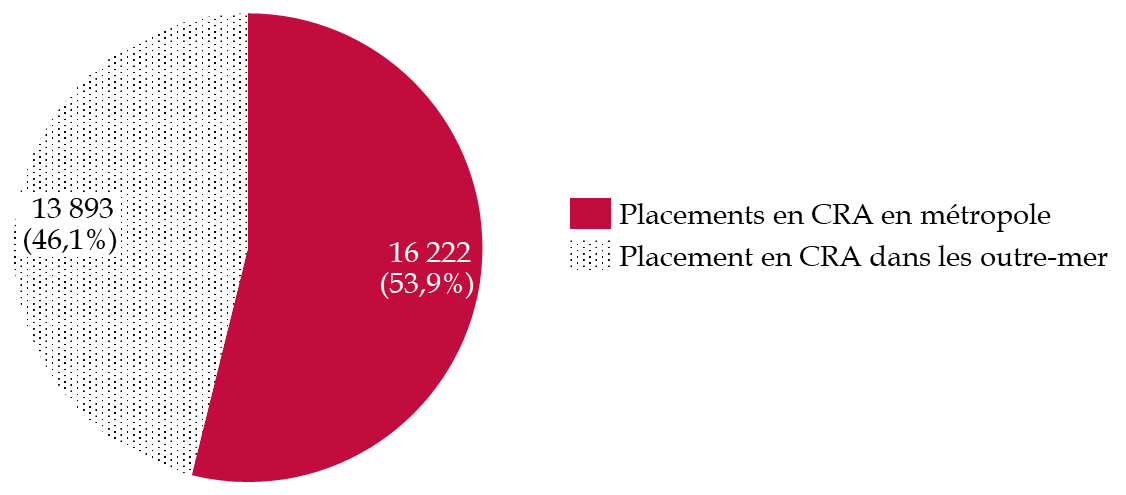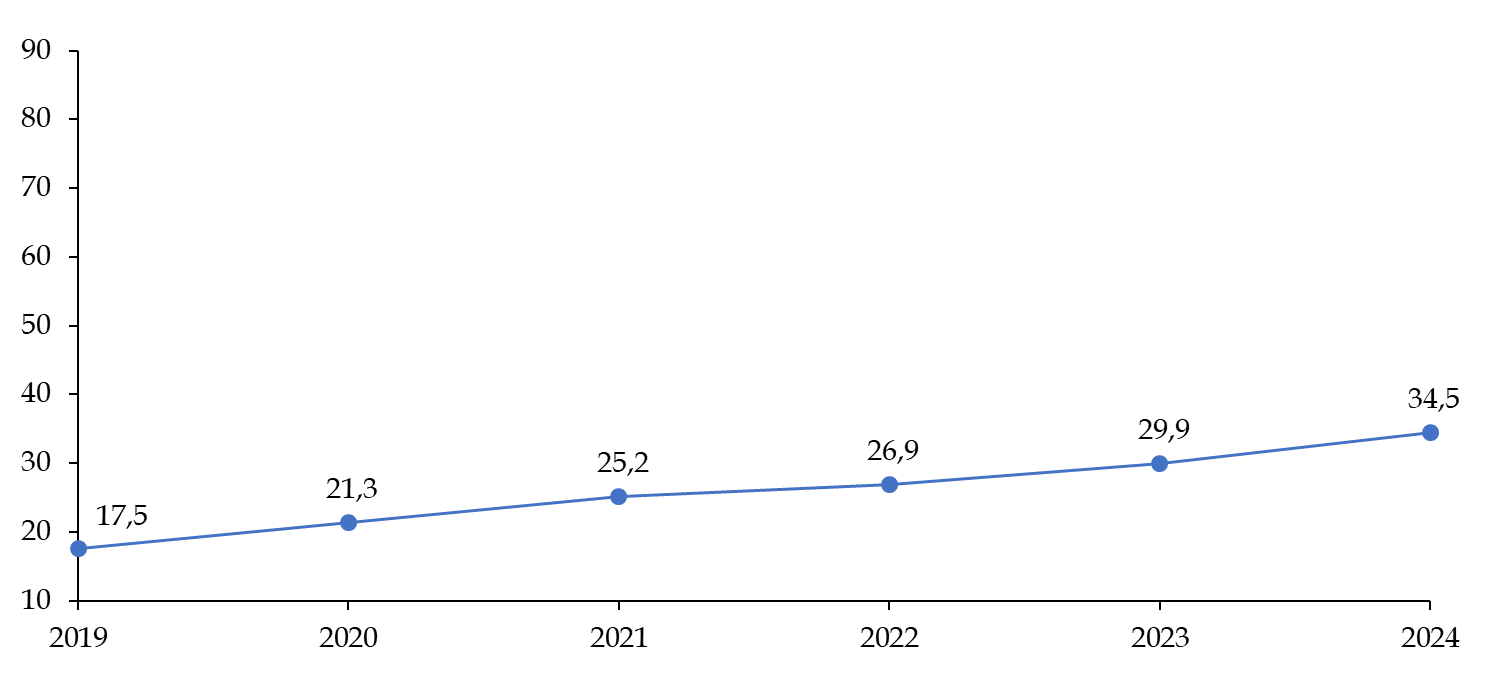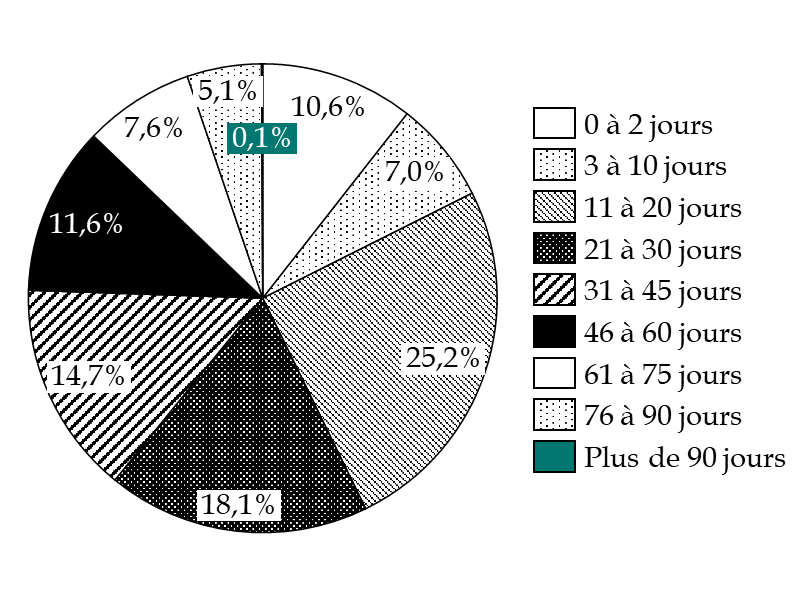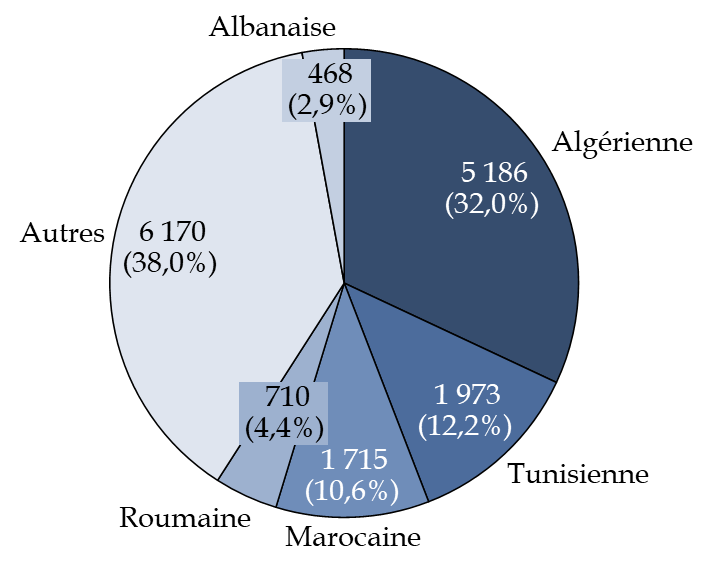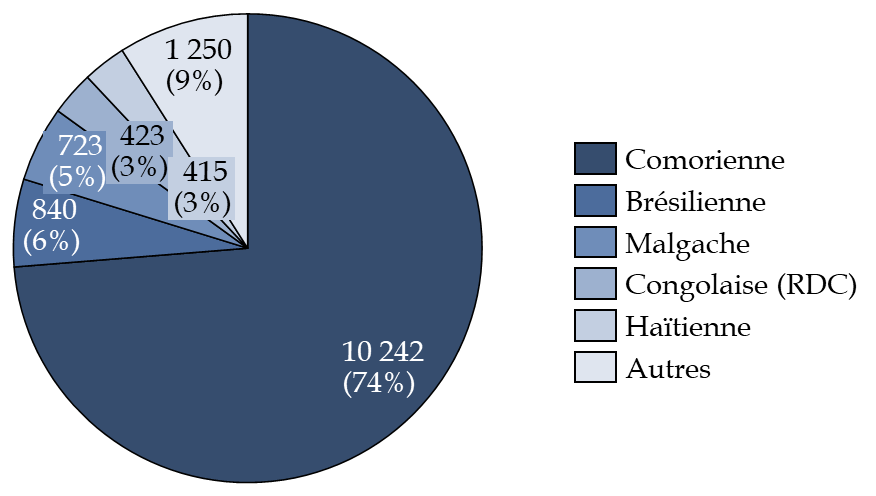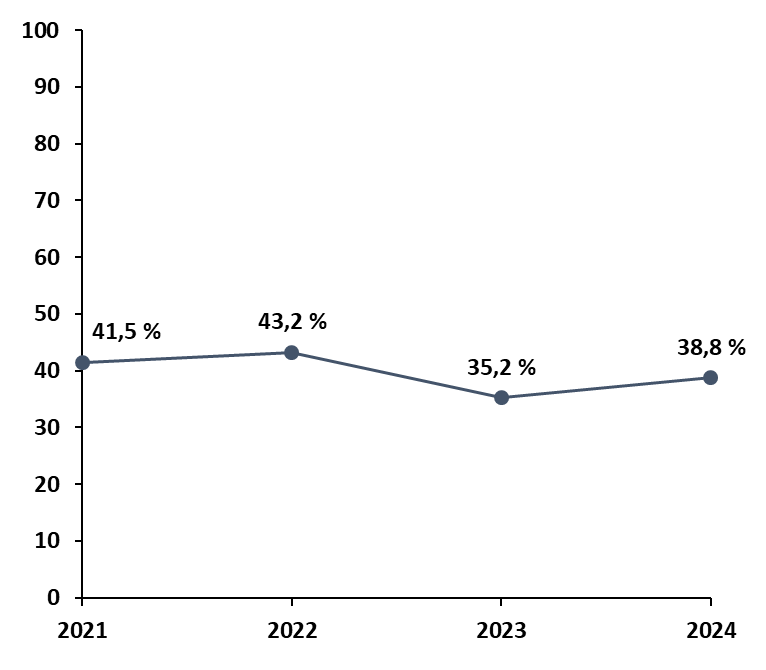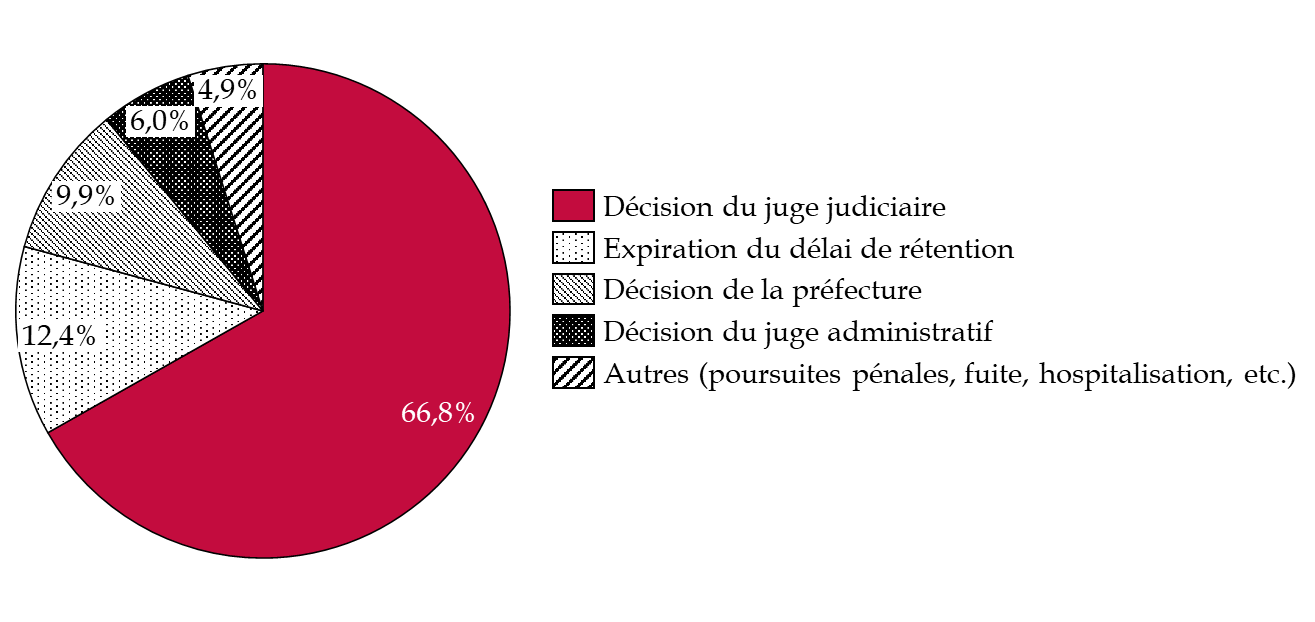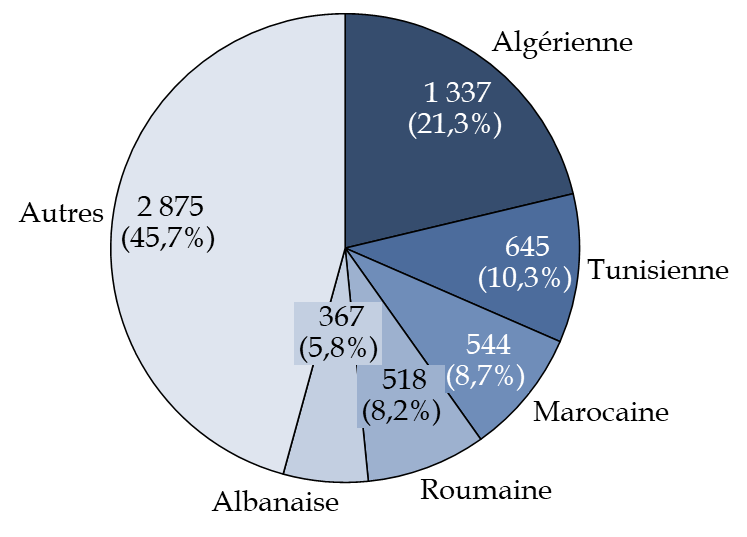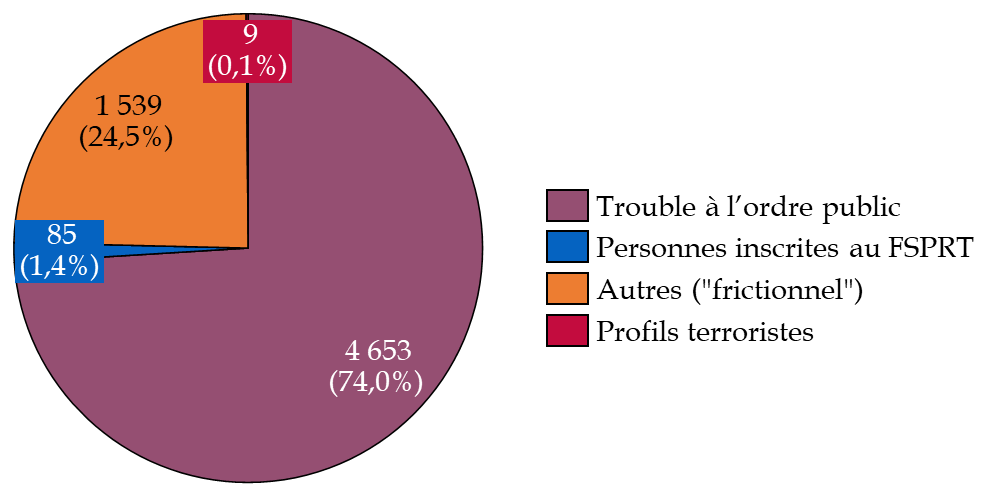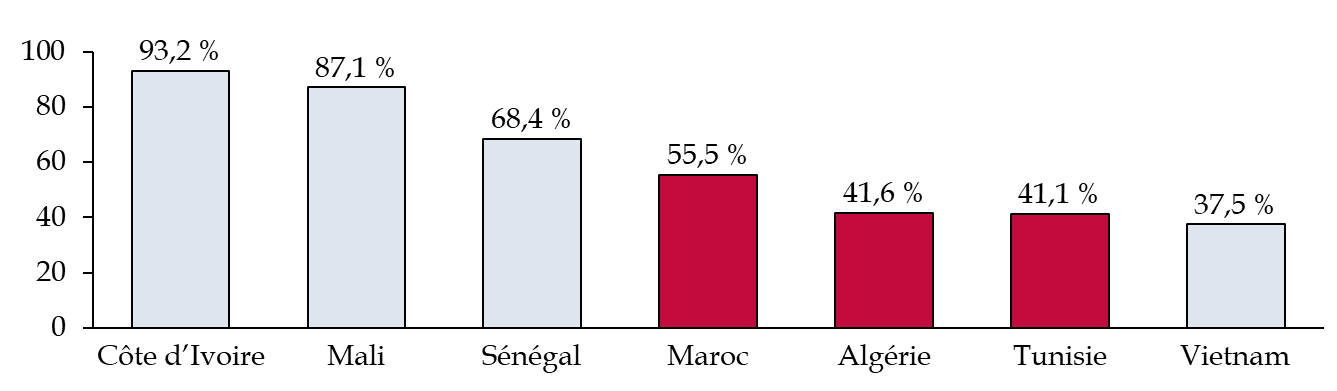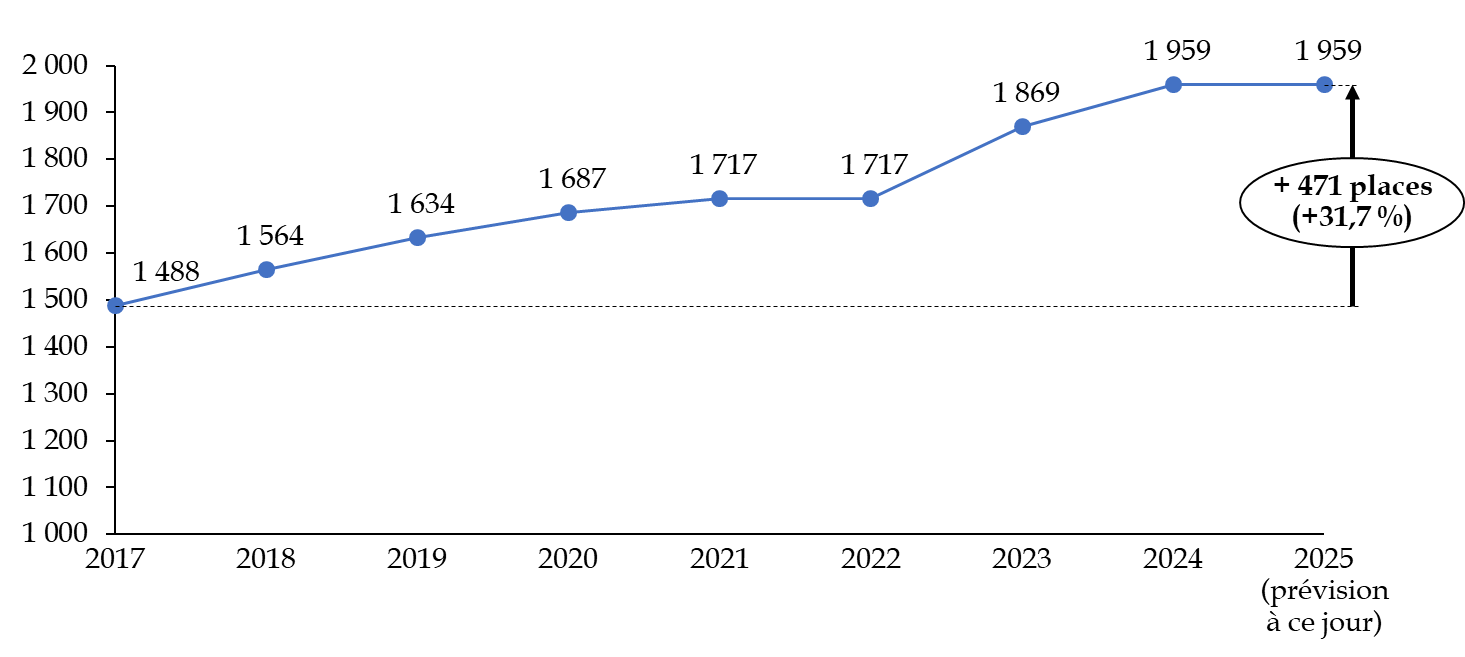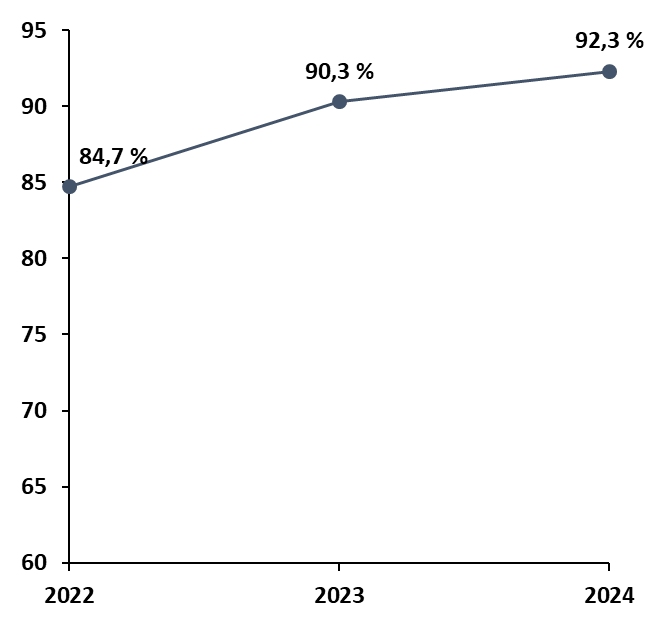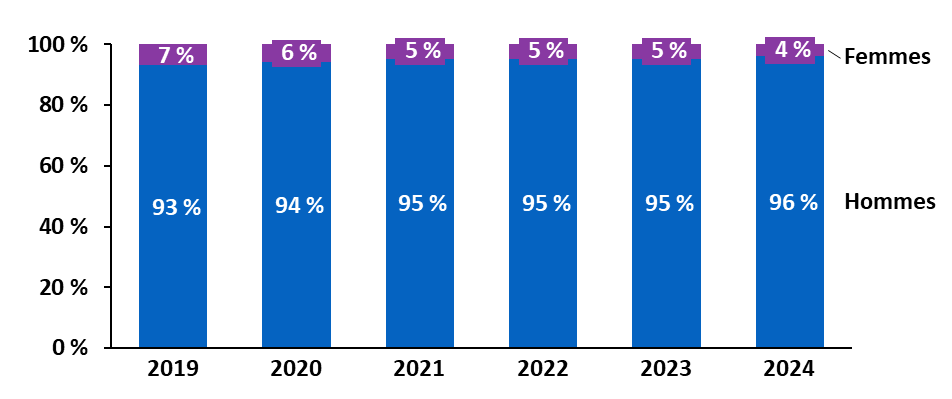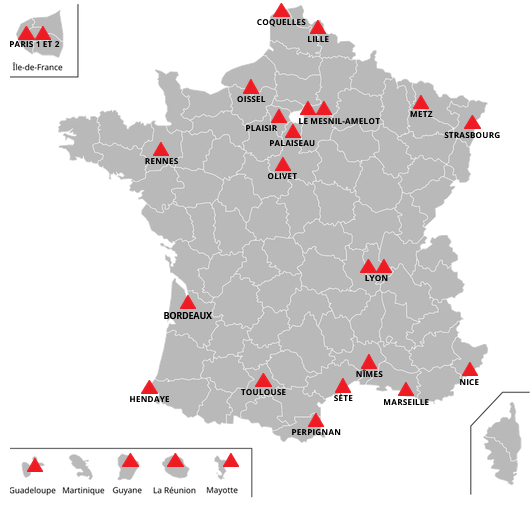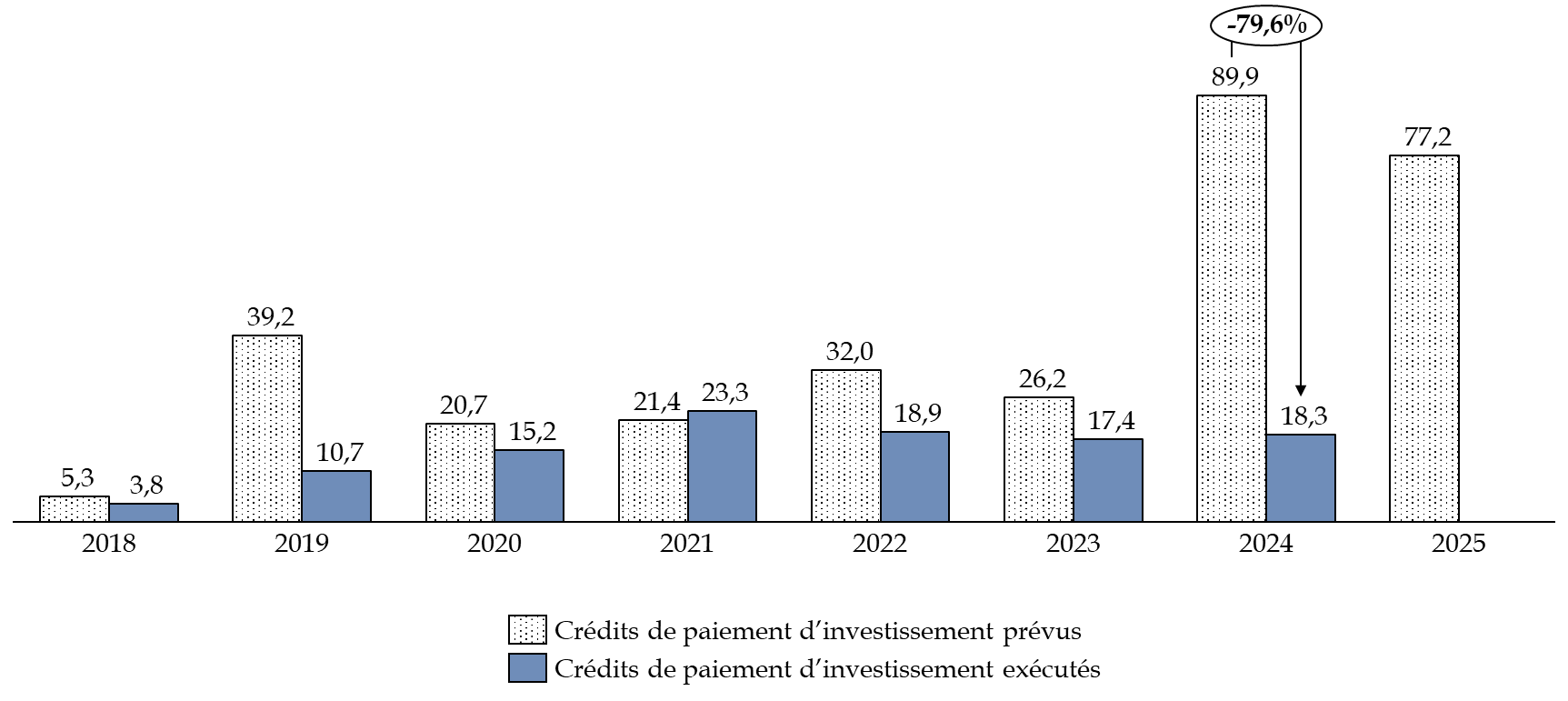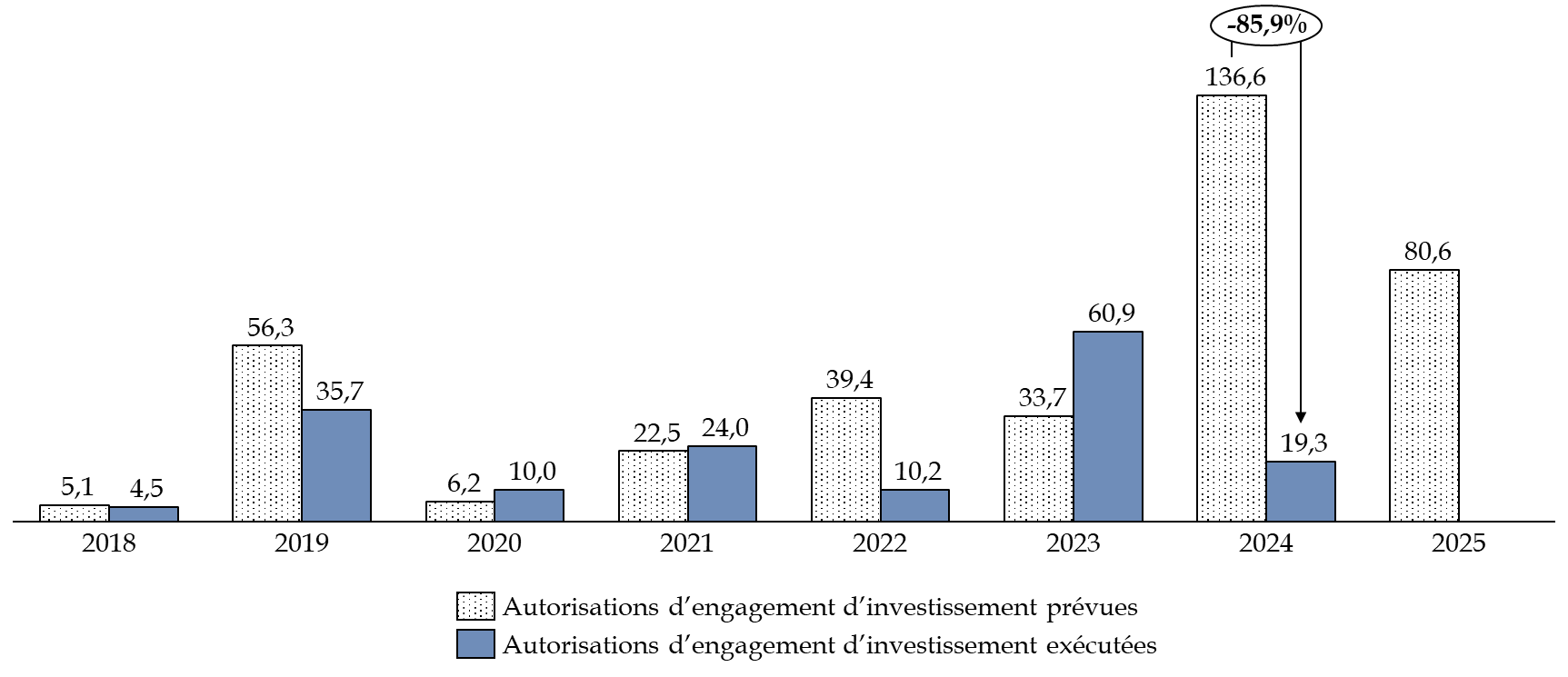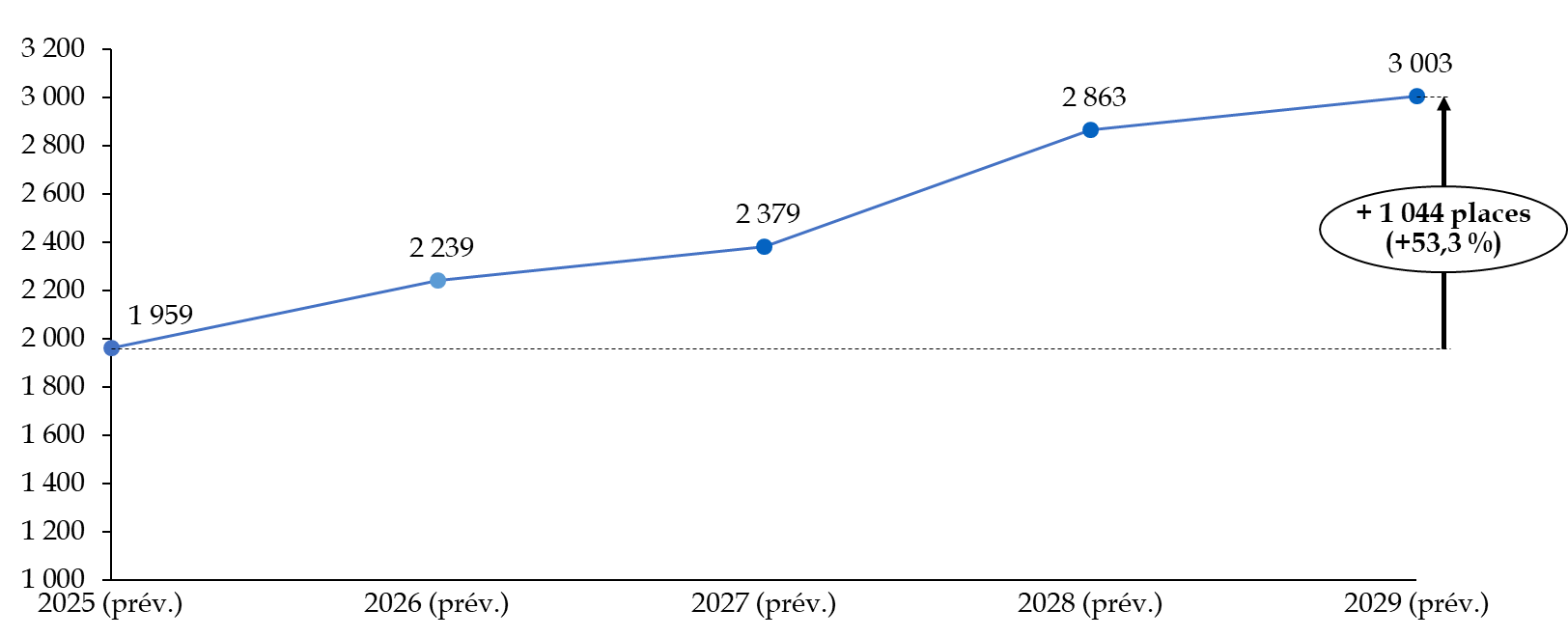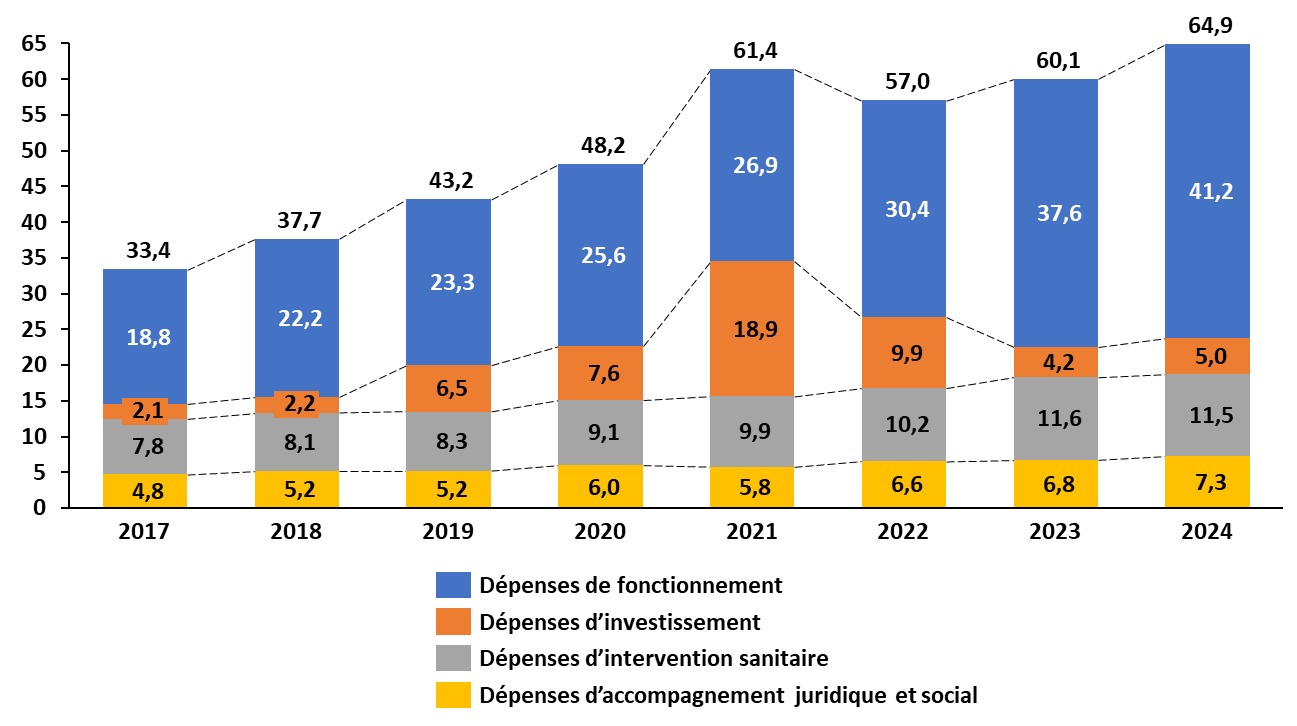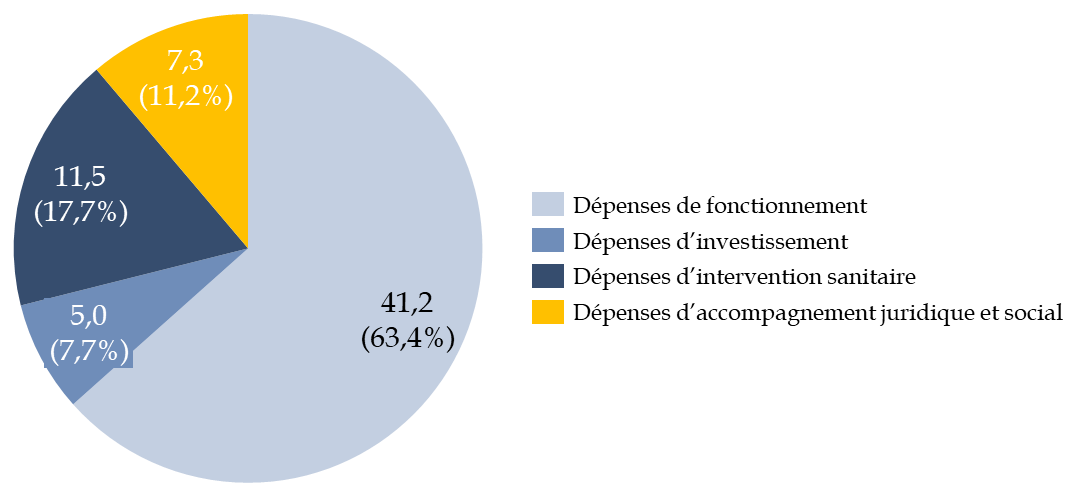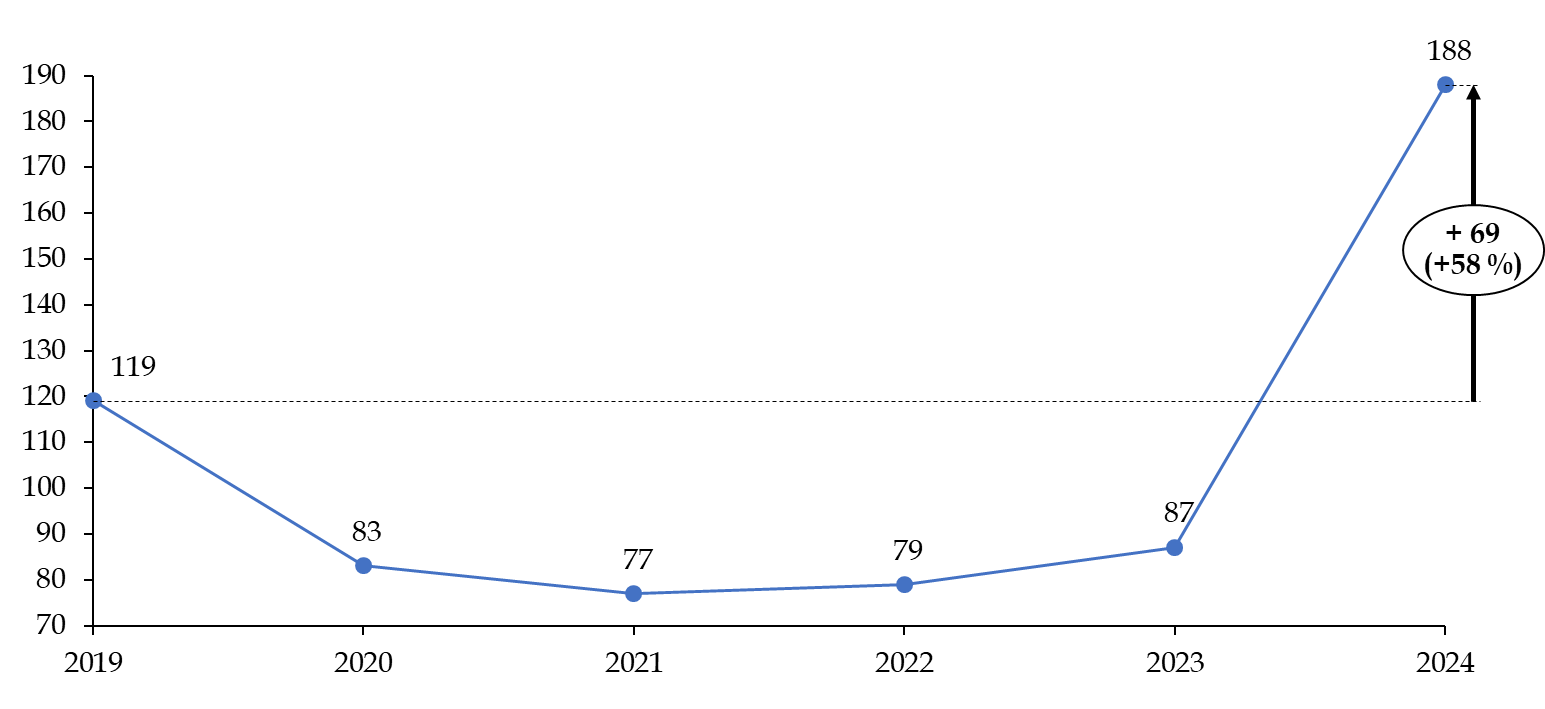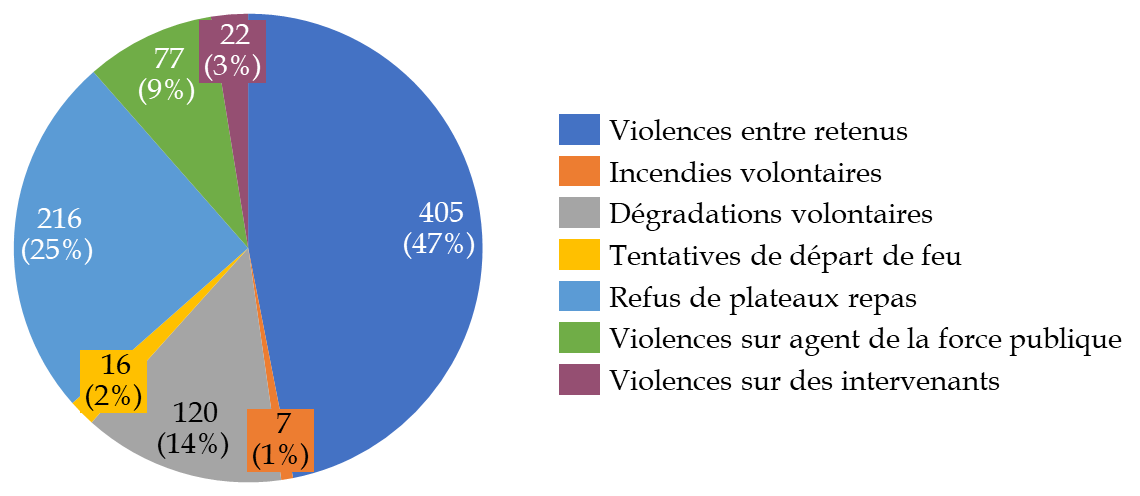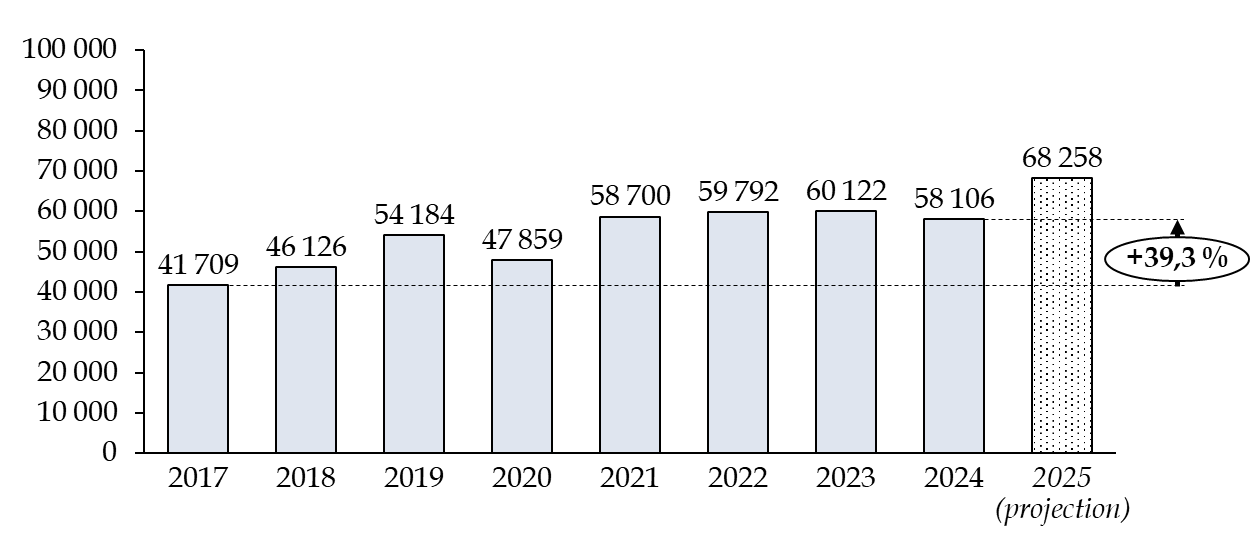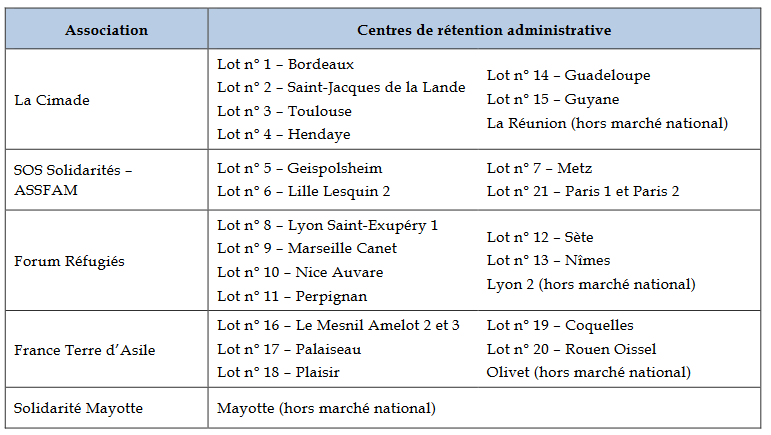- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL
- PREMIÈRE PARTIE
LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE MAIS ENCORE SOUS-DIMENSIONNÉ
- I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL
STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES
DÉDIÉS
- A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ENCADRÉE PAR LE DROIT
- 1. Le cadre fixé par la directive
européenne dite « retour » de 2008
- 2. Le cadre fixé par le droit national au
placement et au maintien en rétention administrative
- a) La décision d'éloignement
sous-tendant le placement en rétention administrative
- b) Le placement en rétention
administrative
- (1) Les conditions du placement en rétention
administrative
- (2) Les modalités juridiques du placement en
rétention administrative
- (3) Un maintien en rétention administrative
relevant du juge judiciaire et soumis à un encadrement strict
- a) La décision d'éloignement
sous-tendant le placement en rétention administrative
- 1. Le cadre fixé par la directive
européenne dite « retour » de 2008
- B. DES LOCAUX DÉDIÉS À LA
RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ENCADRÉE PAR LE DROIT
- II. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL AU
CoeUR DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT
- III. UNE POLITIQUE DE RÉTENTION
CONFRONTÉE À DES FREINS STRUCTURELS À
L'ÉLOIGNEMENT
- IV. UNE CAPACITÉ DE RÉTENTION
RENFORCÉE MAIS TOUJOURS INSUFFISANTE
- I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL
STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES
DÉDIÉS
- DEUXIÈME PARTIE
ASSOCIER L'EXTENSION DE LA CAPACITÉ DE RÉTENTION À UNE AMÉLIORATION DE L'EFFECTIVITÉ DE L'ÉLOIGNEMENT DES PERSONNES RETENUES
- I. ACCÉLÉRER L'EXTENSION DU PARC DE
RÉTENTION TOUT EN MAÎTRISANT SON COÛT
- A. UNE MONTÉE EN CHARGE DU PLAN D'EXTENSION
À ACCÉLÉRER...
- B. ...TOUT EN ASSURANT LA MAÎTRISE DES
COÛTS ASSOCIÉS
- A. UNE MONTÉE EN CHARGE DU PLAN D'EXTENSION
À ACCÉLÉRER...
- II. RATIONALISER LE RECOURS À LA
RÉTENTION ADMINISTRATIVE AU SERVICE D'UNE POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT
EFFICIENTE
- A. FAVORISER LES ÉLOIGNEMENTS À
L'ISSUE D'UNE DÉTENTION ET MOBILISER LE LEVIER DE L'AIDE AU
RETOUR
- B. AMÉLIORER LA MISE EN oeUVRE DE LA
RÉTENTION ADMINISTRATIVE POUR EN RENFORCER L'EFFICACITÉ
- A. FAVORISER LES ÉLOIGNEMENTS À
L'ISSUE D'UNE DÉTENTION ET MOBILISER LE LEVIER DE L'AIDE AU
RETOUR
- I. ACCÉLÉRER L'EXTENSION DU PARC DE
RÉTENTION TOUT EN MAÎTRISANT SON COÛT
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1)
sur
l'extension de la
capacité d'accueil
des
centres de
rétention
administrative,
Par Mme Marie-Carole CIUNTU,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À la différence de la détention, elle ne vise pas à sanctionner un crime ou un délit mais à tenir à disposition un étranger dépourvu de droit au séjour, soumis à une décision d'éloignement (le plus souvent, une obligation de quitter le territoire français) et présentant un risque de fuite, dans le but de l'éloigner.
Le rapporteur spécial de la mission « Asile, immigration et intégration », Marie-Carole Ciuntu, a présenté le 1er octobre 2025 les conclusions de son rapport d'information sur l'extension de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative.
I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL CENTRAL DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT, MAIS ENCORE SOUS-DIMENSIONNÉ
A. UN OUTIL INDISPENSABLE, DÉSORMAIS RECENTRÉ SUR LES PROFILS PRIORITAIRES
Instituée en 1981, la rétention administrative est régie par le droit européen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle n'intervient, sur décision administrative (le plus souvent du préfet), qu'en cas de nécessité pour exécuter une mesure d'éloignement. La durée initiale est limitée à 96 heures, prolongeable par le juge judiciaire jusqu'à 90 jours (et 180 jours pour les profils terroristes).
Par une décision du 7 août 20251(*), le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi du 11 août 20252(*) dont l'objet était de permettre, dans certains cas précisément définis et liés à la dangerosité des individus concernés et au risque de fuite, de prolonger la durée de rétention jusqu'à 180 jours ou 210 jours. Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif à l'égard de profils dangereux et était conforme au droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, appliquée dans de nombreux pays, dont l'Allemagne3(*).
1. Un dispositif efficient
La rétention ne concerne qu'une fraction des étrangers visés par une mesure d'éloignement, mais demeure le moyen le plus sûr de les exécuter. En 2024, 12 856 éloignements forcés ont été réalisés en métropole, dont 6 286 à la suite d'une rétention, soit environ la moitié (48,9 %). La France est le pays de l'Union européenne qui procède au plus grand nombre d'éloignements forcés de ressortissants de pays tiers ces dernières années selon les données d'Eurostat, y compris en 2025 (7 375 au 1er semestre 2025, devant l'Allemagne).
2. Un ciblage renforcé sur la menace à l'ordre public des personnes
Depuis 2022, les différentes instructions ministérielles ont conduit à placer prioritairement en rétention les étrangers en situation irrégulière présentant une menace à l'ordre public. La part des retenus du profil « trouble à l'ordre public » est ainsi passée de 7,3 % en 2021 à 86 % en 2024 dans les CRA métropolitains. Malgré ce ciblage, le taux global d'éloignement n'a que légèrement reculé4(*), manifestant un équilibre entre sécurité publique et efficacité de l'éloignement.
B. UNE RÉTENTION PROLONGÉE ET MARQUÉE PAR UNE STABILITÉ DES PROFILS NATIONAUX CONCERNÉS
Le nombre de placements en CRA s'est établi à 30 115 en 2024, en réduction par rapport à la fin de la décennie 2010, sous l'effet principalement de la variabilité du nombre de placements dans les outre-mer. En 2024, 16 222 personnes ont été placées en CRA en métropole et 13 893 en outre-mer.
Parallèlement, la durée moyenne de rétention a augmenté en métropole, passant de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024, reflétant le durcissement des profils et les difficultés à obtenir l'exécution rapide de l'éloignement par les États tiers. Dans les outre-mer, elle reste très courte (5,9 jours en 2024).
Les profils nationaux des retenus demeurent stables. En 2024, plus de la moitié des retenus en métropole étaient originaires du Maghreb (55 %), dont 32 % d'Algérie, 12 % de Tunisie et 11 % du Maroc.
C. DES CAPACITÉS DE RÉTENTION ENCORE INSUFFISANTES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
La France dispose de 27 CRA (23 en métropole, 4 en outre-mer), représentant 2 187 places théoriques (en moyenne 80 par centre). Elle dispose fin 2024 de l'une des plus grandes capacités de rétention en Europe.
Depuis 2017, la capacité théorique du parc des CRA en métropole a progressé de 31,7 %, passant de 1 488 à 1 959 places, tandis que la sécurisation des sites a été nettement renforcée depuis 2022. La disponibilité réelle des places a par ailleurs augmenté (89,4 % en 2025). Sur 2 187 places théoriques, 1 956 étaient effectivement disponibles à la mi-mai 2025 (1 761 en métropole et 195 en outre-mer). Le taux d'occupation a quant à lui atteint 92,3 % en 2024 (70,8 % en 2017).
Malgré ces progrès, le parc reste saturé : 3 624 demandes d'admission en CRA ont été refusées en 2024 faute de place, limitant l'usage de la rétention, alors même qu'elle demeure l'outil le plus sûr pour exécuter les éloignements. Cette grave difficulté doit être résolue.
Carte d'implantation des CRA en 2025
Source : commission des finances du Sénat
II. ÉTENDRE LES CAPACITÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS, TOUT EN MAÎTRISANT LES COÛTS
A. UNE MONTÉE EN PUISSANCE À GARANTIR...
La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI) 2023-20275(*) fixait l'objectif de parvenir à une capacité de 3 000 places en CRA, à une échéance longtemps fixée pour 2027, mais qui ne pourra pas être tenue. En effet, la création de nouveaux CRA se heurte à des difficultés foncières et immobilières, notamment l'identification de terrains adaptés, les contraintes urbanistiques et les contentieux.
Le calendrier prévoit désormais l'ouverture de huit CRA d'ici 2029 (Bordeaux et Dunkerque en 2026, Dijon en 2027, Nantes, Béziers, Oissel et Périchet en 2028, puis Aix-en-Provence en 2029), pour porter la capacité à 3 003 places.
B. ...POUR UN COÛT QUI DOIT DEMEURER MAÎTRISÉ
En 2024, le coût direct annuel de la rétention administrative (dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention sanitaire, juridique et sociale dans les centres et dépenses de personnel des forces de l'ordre) est estimé à 265 millions d'euros6(*). Le coût annuel des CRA imputé à la mission « Immigration, asile et intégration » est quant à lui passé de 33,4 millions d'euros en 2017 à 64,9 millions d'euros en 2024.
Évolution des dépenses
exécutées dans les CRA entre 2017 et 2024,
hors
dépenses de personnel
(en CP, en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Porter la capacité de 1 959 à 3 000 places d'ici 2029 nécessitera un effort financier. L'extension des capacités représentera un investissement global pluriannuel qui peut être estimé à 300 millions d'euros (environ 40 millions pour un CRA de 140 places). Les dépenses de fonctionnement augmenteraient quant à elles d'environ 35 millions d'euros par an, hors coûts de personnel, une charge soutenable mais qui doit être anticipée dans les prochains budgets de la mission.
Pour contenir ces coûts, plusieurs leviers existent, en particulier recourir à des installations modulaires plus rapides et moins coûteuses à déployer, et substituer partiellement les effectifs de policiers par des agents administratifs, contractuels ou réservistes pour certaines missions. En outre, il est nécessaire d'approfondir la démarche d'externalisation de tâches non régaliennes initiée en 2018, la phase d'expérimentation ayant produit des résultats convaincants en matière d'économies de personnels. Elle suppose de doter la mission « Immigration, asile et intégration » des crédits correspondants, qui viendront réduire ceux nécessaires à la mission « Sécurités » (policiers).
III. MIEUX UTILISER LA RÉTENTION POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES ÉLOIGNEMENTS
A. UN TAUX D'ÉLOIGNEMENT EN PROGRÈS EN 2024 MAIS ENCORE INSUFFISANT
En 2024, 30 115 placements en CRA ont conduit à 16 206 éloignements (53,8 % d'éloignement), avec un contraste entre outre-mer (71,4 %) et métropole (38,8 %, contre 35,2 % en 2023 et 43,2 % en 2022).
|
Taux d'éloignement depuis les CRA français en 2024 |
Part des profils « trouble à l'ordre public » dans les CRA métropolitains en 2024 |
Nombre de places visé en CRA métropolitains en 2029 |
En métropole, 61 % des retenus n'ont pas été éloignés l'année dernière. Dans 67 % des cas, la libération a résulté d'une décision du juge judiciaire sanctionnant une irrégularité. Dans d'autres cas, l'échec de l'éloignement soit a fait suite à l'expiration du délai légal de rétention (12,5 %), à une libération par la préfecture (10 %) ou à une décision du juge administratif (6 %), soit s'explique par des situations particulières comme l'ouverture de poursuites pénales, une hospitalisation ou une fuite.
Enfin, les éloignements demeurent difficiles vers certaines zones géographiques en raison notamment de conflits en cours, d'absence de desserte aérienne ou de difficultés diplomatiques. En 2024, environ 40 % des personnes éloignées étaient originaires du Maghreb, une proportion inférieure à leur poids dans les placements en rétention (55 %), témoignant d'obstacles consulaires pour cette région.
B. RÉDUIRE LES ÉCHECS LIÉS À L'IDENTIFICATION DES PERSONNES RETENUES
La connaissance de l'identité et de la nationalité des personnes placées en rétention reste un enjeu majeur, mobilisant de nombreux acteurs (préfectures, police aux frontières, consulats). L'absence de documents d'identité, leur destruction volontaire ou l'usage d'alias compliquent les démarches et expliquent une partie des échecs de l'éloignement à réaliser dans les délais de la rétention.
La loi du 11 août 20257(*) a marqué une avancée en autorisant, sous conditions, le relevé d'empreintes et la prise de photographies sans consentement lorsqu'ils sont l'unique moyen de confirmer l'identité. Pour aller plus loin, il conviendrait d'élargir l'arsenal d'investigation (via notamment l'exploitation encadrée des données de téléphonie) et d'améliorer l'interopérabilité des systèmes d'information des services de l'État.
C. ACCÉLÉRER L'OBTENTION DES LAISSEZ-PASSER CONSULAIRES
Pour les étrangers dépourvus de documents de voyage valides, l'éloignement dépend de la délivrance d'un laissez-passer consulaire (LPC) par leur pays d'origine. Cette étape, demeure un point de blocage majeur. Les difficultés sont particulièrement marquées avec certains pays.
Pour lever ces obstacles, l'obtention des LPC doit constituer un objectif assumé de la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays étrangers, y compris dans la politique d'attribution de visas, de titres de séjour et d'aide au développement.
Sur le plan opérationnel, les circuits de demande auprès des consulats demeurent trop fragmentés entre les préfectures, la police aux frontières et la direction générale des étrangers en France (DGEF). La centralisation des demandes au sein de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, déjà mise en oeuvre avec succès pour certains pays, devrait être élargie à d'autres États, tout en renforçant les effectifs de cette unité.
D. FLUIDIFER LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET CONFIER À L'ÉTAT L'INFORMATION JURIDIQUE
Les procédures juridictionnelles prévues en matière de rétention administrative, qui mobilisent à la fois le juge administratif et le juge judiciaire, restent complexes et génèrent un enchevêtrement de délais et de recours difficile à appréhender. Cette complexité alourdit le travail des juridictions et celui des préfectures et des forces de l'ordre, nuisant à la lisibilité et à l'efficacité de la politique d'éloignement.
La loi du 11 août 20258(*) a réduit de quatre à trois le nombre d'ordonnances judiciaires nécessaires pour porter la rétention à 90 jours. Le rapporteur spécial recommande, d'une part, de ramener ce nombre à deux pour permettre au juge, qui souffre d'une embolie du nombre de dossiers en matière de droit des étrangers, d'étendre en une seule fois la rétention de 30 à 90 jours, et de prévoir, d'autre part, des prolongations de la rétention au-delà du délai maximal de 90 jours pour certains profils.
Le recours à la visioconférence, prévu par la loi CIAI9(*) du 26 janvier 2024, mériterait d'être amplifié afin de réduire les déplacements chronophages des magistrats, avocats et escortes.
Enfin, les modalités d'assistance juridique doivent impérativement être clarifiées. Actuellement confiée à des associations dans le cadre de marchés publics, cette mission présente de graves limites (pratiques hétérogènes, coût redondant avec l'aide juridictionnelle, positions parfois militantes). En cohérence avec la proposition de loi déposée par le rapporteur spécial et récemment adoptée par le Sénat en première lecture, il est proposé que, dès le 1er janvier 2026, l'information sur les droits soit assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), déjà présent en CRA.
E. DONNER AUX POLICIERS LES MOYENS D'ASSURER LEURS MISSIONS
L'extension du parc et le profil plus sensible des retenus nécessitent des effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité des centres. 1 685 ETP supplémentaires seraient ainsi prévus pour la PAF d'ici 2027, un renfort qui devra être garanti par les lois de finances.
La substitution partielle de policiers actifs10(*) par des personnels administratifs, réservistes ou contractuels, et l'externalisation de certaines tâches, permettront de limiter la hausse des besoins en effectifs. Enfin, la formation doit être adaptée pour préparer les agents à la gestion de profils difficiles, tandis qu'il convient de rendre les affectations en CRA plus attractives en matière de déroulé de carrière.
F. ANTICIPER LES ÉLOIGNEMENTS ET DIVERSIFIER LES OUTILS
1. Favoriser les éloignements à l'issue d'une détention
En 2024, 27,2 % des placements en CRA concernaient des sortants de prison. Or, les travaux du rapporteur spécial ont mis en évidence des progrès mais aussi des lacunes dans l'articulation de la détention et de la rétention et dans le partage d'informations entre les services préfectoraux, la police, l'administration pénitentiaire et les magistrats. Trop souvent, la période de détention n'est pas pleinement utilisée pour engager les démarches nécessaires (identification, obtention du LPC), ce qui réduit les chances d'éloignement dans les délais légaux de la rétention.
Pour y remédier, il est nécessaire de systématiser l'identification des étrangers détenus dépourvus de droit au séjour, de lancer les démarches d'éloignement dès la détention, et de renforcer le partage d'informations « en temps réel » entre les acteurs concernés. Dans ces conditions, davantage d'éloignements pourront être réalisés dès la sortie de prison, ou après une rétention courte.
2. Mobiliser le levier de l'aide au retour
L'aide au retour volontaire constitue une alternative moins coûteuse que l'éloignement forcé. Elle peut en outre permettre d'éviter les blocages des pays tiers constatées en matière de réadmissions forcées. Depuis 2019, elle est ouverte aux personnes placées en rétention pour favoriser leur départ et libérer des places, mais reste sous-utilisée (188 bénéficiaires en 2024 pour un objectif de 300).
Pour accroître son efficacité, il est nécessaire de s'assurer qu'elle soit proposée plus largement en rétention et en détention et de lever les blocages techniques.
LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
Recommandation n° 1 : Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents (ministère de l'Intérieur).
Recommandation n° 2 : Centraliser, pour un plus grand nombre de pays, les demandes de laissez-passer consulaires auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de simplifier et d'accélérer la procédure (ministère de l'Intérieur).
Recommandation n° 3 : Garantir, d'ici 2029, l'atteinte de l'objectif de 3 000 places en centres de rétention administrative en métropole (ministère de l'Intérieur).
Recommandation n° 4 : Recourir, en complément de la construction de nouveaux centres, à des bâtiments modulaires adaptés à la rétention administrative, afin d'accélérer les déploiements et d'en limiter le coût (ministère de l'Intérieur).
Recommandation n° 5 : Approfondir la politique de substitution des effectifs actifs de police affectés à la rétention administrative par des personnels administratifs, contractuels ou relevant du secteur privé, pour certaines missions précisément définies (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale).
Recommandation n° 6 : Favoriser l'éloignement rapide des étrangers détenus en situation irrégulière, si possible sans avoir à les placer en rétention, en anticipant les démarches nécessaires en amont de la fin de peine et en assurant une meilleure coordination entre services compétents (ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice).
Recommandation n° 7 : Mobiliser davantage le levier de l'aide au retour volontaire pour les personnes détenues et retenues, afin de renforcer l'efficacité et de réduire le coût des éloignements (ministère de l'Intérieur).
Recommandation n° 8 : Adapter la formation des policiers à la gestion de la rétention et valoriser les affectations en CRA dans les parcours de carrière, afin de mieux accompagner la place croissante de cette mission au sein de la police nationale (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale).
Recommandation n° 9 : Ramener de trois à deux le nombre de décisions du juge judiciaire nécessaires pour porter la durée de rétention administrative à 90 jours (pouvoir législatif).
Recommandation n° 10 : Accélérer la généralisation du recours à la vidéo-audience pour les contentieux de la rétention administrative, dans des conditions garantissant la qualité des échanges (ministère de la Justice, juridictions administratives, ministère de l'Intérieur).
PREMIÈRE PARTIE
LA
RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'ÉLOIGNEMENT
DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE MAIS ENCORE
SOUS-DIMENSIONNÉ
La rétention administrative constitue, du fait de son efficacité en matière d'éloignement et malgré des obstacles persistants, un instrument central de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière.
Elle fait l'objet, en tant que mesure privative de liberté, d'un encadrement juridique rigoureux. Par ailleurs, elle a été, depuis 2022, recentrée sur les personnes représentant une menace pour l'ordre public.
Bien que la capacité d'accueil des centres de rétention administrative (CRA) ait connu une hausse ces dernières années, elle demeure à ce jour insuffisante au regard des besoins constatés.
I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES DÉDIÉS
A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENCADRÉE PAR LE DROIT
La rétention administrative s'applique en France depuis 198111(*). Elle constitue, d'un point de vue juridique, une modalité d'exécution dite « d'office » d'une décision d'éloignement d'un étranger dépourvu d'un titre de séjour valide, à l'image de l'assignation à résidence. Concrètement, la rétention permet de conserver à disposition les personnes présentant un risque de fuite12(*) dans le but d'exécuter effectivement, après avoir réalisé les formalités nécessaires, l'éloignement.
La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À ce titre, elle est strictement encadrée par le droit français ainsi qu'à l'échelle du droit européen, qui en fait un outil de dernier recours.
1. Le cadre fixé par la directive européenne dite « retour » de 2008
La directive dite « retour » du 16 décembre 200813(*) fixe, à l'échelle européenne, un certain nombre de règles s'imposant aux conditions de recours à la rétention administrative. Son chapitre IV14(*) couvre ainsi les principes, modalités et conditions de recours à la rétention administrative, y compris dans des cas spécifiques (mineurs, familles, situations d'urgence).
La directive fixe plusieurs principes généraux :
- le placement en rétention administrative constitue un outil de dernier recours qui doit être mobilisé lorsque d'autres mesures moins coercitives ne sont pas suffisantes pour préparer le retour et procéder à l'éloignement. La directive précise ainsi que « lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire » ;
- ce placement n'est possible qu'à condition que la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial, la France soutient à l'occasion de la négociation en cours du prochain règlement européen « Retour » qui se substituera à la directive, que tous les départs devraient être exécutés immédiatement et qu'à défaut, les personnes concernées seraient mises sous contraintes sauf si elles démontrent leur coopération à l'éloignement ;
- la rétention doit être aussi brève que possible et ne peut perdurer qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
- un contrôle juridictionnel doit s'exercer sur le placement en rétention par l'autorité administrative, tandis que le maintien en rétention doit faire l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office ;
- la durée de rétention ne peut excéder six mois. Néanmoins, cette période peut, pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, être portée à dix-huit mois soit lorsque la personne ne coopère pas, soit dans le cas où le pays de renvoi connaît des retards pour fournir les documents de voyage15(*) ;
- la rétention s'effectue par principe dans des centres de rétention spécialisés, dans lesquels les personnes retenues disposent de droits spécifiques, notamment d'entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ;
- les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.
Le placement en rétention administrative, qui fait suite à une décision administrative, doit être distingué de la détention, qui résulte d'une décision judiciaire ayant vocation à condamner un délit ou un crime. Il doit également être distingué du placement en zones d'attente, situées sur des points d'entrée du territoire (à l'image de celle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle), les personnes concernées faisant l'objet d'une non-admission sur le territoire16(*), sur lequel elles ne sont juridiquement pas entrées.
2. Le cadre fixé par le droit national au placement et au maintien en rétention administrative
a) La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative
La décision d'éloignement constitue, sous la réserve de certaines interdictions du territoire français17(*), la première condition à l'éventuel placement en rétention administrative d'une personne en situation irrégulière, bien que la grande majorité des personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement ne soient jamais placés en rétention.
La décision d'éloignement peut prendre différentes formes et être prise par différentes autorités (le préfet, le ministre de l'Intérieur et le juge)18(*). Elle prend quatre expressions principales.
En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) constitue une décision administrative individuelle prise par le préfet et prononcée avec ou sans délai de départ volontaire ; elle doit préciser le pays de destination. Elle résulte de la constatation que l'étranger soit ne justifie plus d'aucun droit au séjour, soit constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, soit encore est coupable d'un abus de droit au séjour. L'autorité administrative compétente doit tenir compte, dans sa décision, de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'étranger et notamment sa durée de séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique et son intégration sociale et culturelle. L'OQTF peut être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) dont le non-respect est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, à la différence de l'OQTF.
En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion constitue une décision administrative plus contraignante pour la personne, interdisant en principe tout retour ; cet arrêté peut être pris par le préfet (APE) ou le ministre (AME19(*)).
En troisième lieu, l'interdiction de territoire français (ITF) constitue une peine pouvant être prononcée par le juge judiciaire dans le cadre d'un délit ou d'un crime, pour une durée variable, voire définitive. Lorsqu'elle est prononcée à titre principal et assortie de l'exécution provisoire, l'ITF entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger20(*).
En dernier lieu, le transfert « Dublin » consiste à renvoyer une personne dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen21(*).
La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative prend toutefois dans trois quarts des cas (75,6 % en 2024 pour les centres de rétention administrative métropolitains) la forme d'une OQTF émise par le préfet de département. Elle fait le plus souvent suite au rejet d'une demande de titre de séjour ou à un contrôle d'identité et du droit au séjour. Le droit européen22(*) impose, en effet, qu'en l'absence de droit au séjour, toute personne doit se voir soumise à une décision de retour, afin d'éviter toute « zone grise » juridique23(*).
Ventilation du type de décisions
d'éloignement sous-tendant le placement
en centre de rétention
administrative en 2024 en métropole
(en pourcentage)
Source : commission des finances, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Le nombre d'OQTF a connu, dans la période récente, une très forte hausse. Alors qu'il était annuellement d'environ 80 000 en 2015, il a été supérieur de plus de 60 % en 2024, s'établissant à 128 250 OQTF délivrés.
Évolution du nombre d'OQTF émises entre 2015 et 2024
Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat
En 2024, la France a émis 28,3 % des OQTF prises dans l'ensemble de l'Union européenne, contre 20,6 % en 2015.
Part des OQTF émises en France dans
l'ensemble de celles émises
au sein de l'Union européenne
(hors Royaume-Uni) entre 2015 et 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat
Sans une plus grande maîtrise des flux migratoires réguliers (notamment les visas et les titres de séjour) et irréguliers entrants sur le territoire, le nombre d'OQTF pourrait à l'avenir poursuivre sa progression.
Cette dynamique induit une charge de travail très conséquente pour les services préfectoraux, y compris dans l'identification des personnes sous OQTF à placer en rétention. Si ces effectifs ont connu une hausse de 111 ETPT entre 2021 et 202524(*), ils restent relativement modestes au regard de la charge de travail impliquée. Ils s'établissent aujourd'hui à 575,2 ETPT pour l'ensemble du territoire, hors préfecture de police, soit moins de 6 ETPT par département en moyenne25(*). À titre d'illustration, les effectifs du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne sont au nombre de 12 pour assurer le bon traitement d'un nombre élevé de dossiers, dans l'ensemble de leurs aspects (procédures d'éloignement, d'assignation à résidence, de rétention, relations avec l'administration pénitentiaire pour les étrangers écroués, obtention des laissez-passer consulaires, contentieux, etc.).
Cet effet ciseaux n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur la qualité et l'argumentation des décisions d'éloignement produites et leur défense effective devant les juridictions, ainsi que le bon suivi de leur exécution.
b) Le placement en rétention administrative
(1) Les conditions du placement en rétention administrative
L'étranger s'étant vu infliger une peine d'interdiction du territoire français (ITF)26(*) prononcée à titre de peine principale par le juge judiciaire et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention pour une durée de quatre jours.
Hormis ce cas spécifique, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) conditionne la possibilité pour l'autorité administrative de procéder à une rétention administrative à la réalisation de conditions cumulatives.
Si l'autorité administrative peut dans certains cas être incarnée par le ministre de l'Intérieur27(*), c'est dans la quasi-totalité des cas le préfet de département (et, à Paris, le préfet de police) qui est compétent. Afin d'assurer l'accès effectif de tous les préfets aux moyens de rétention et réaliser des arbitrages pertinents en fonction des profils dont il est proposé la rétention, les préfets de zone assurent, par ailleurs, une mission de régulation en matière de rétention.
Pour être réalisé légalement, le placement en rétention administrative doit concerner une personne dépourvue de titre de séjour valide et répondant à un certain nombre de conditions, dont les principales sont les suivantes :
- être dépourvue de la nationalité française ;
- faire l'objet d'une décision d'éloignement28(*), à exécuter sans délai de départ volontaire ou dont le délai de départ volontaire imparti a expiré ;
- être majeure, en application de la loi CIAI du 26 janvier 202429(*), cette disposition ne s'appliquant qu'ultérieurement pour ce qui concerne Mayotte30(*) ;
- ne pas présenter de garanties de représentation effectives (document de voyage, adresse fiable en France, etc.) propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; ce risque est apprécié selon différents critères31(*) « ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;
- ne pas être susceptible de faire l'objet d'une autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'éloignement, notamment l'assignation à résidence ; en effet, cette assignation32(*) peut se révéler difficilement réalisable pour des populations soit précaires et ne disposant pas nécessairement d'adresse fiable soit pouvant se montrer non-coopératives.
(2) Les modalités juridiques du placement en rétention administrative
S'agissant des modalités du placement en rétention, le CESEDA dispose, conformément au droit européen, que la personne ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En outre, il est notamment prévu un encadrement des modalités de ce placement, dont certaines ont fait l'objet d'une modification très récente, par la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, issue d'une proposition de loi présentée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio33(*) :
- l'autorité administrative ne peut placer l'étranger en rétention que pour une durée de quatre-vingt-seize heures34(*) ;
- la décision de placement en rétention est prise, alternativement, après l'interpellation de l'étranger, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou, enfin, à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée ;
- cette décision doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ;
- elle ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement, ou de quarante-huit heures en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit.
(3) Un maintien en rétention administrative relevant du juge judiciaire et soumis à un encadrement strict
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, à la demande de l'autorité administrative, doit être autorisé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire35(*),36(*).
L'autorisation judiciaire est toutefois limitée dans le temps et son renouvellement successif doit être sollicité par l'autorité administrative, à savoir les préfectures. À tout moment, l'autorité administrative peut par ailleurs décider de mettre fin à la rétention.
Une première ordonnance du juge judiciaire peut porter la rétention à 30 jours, sans condition supplémentaire à satisfaire par rapport à celles applicables au placement en rétention37(*).
Une deuxième ordonnance du juge peut prolonger cette durée à 60 jours dans les cas alternatifs suivants :
- en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
- lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
- lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans les délais nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement ou en cas d'absence de moyens de transport.
Enfin, alors que jusqu'ici, une troisième puis une quatrième ordonnance pouvaient, dans des conditions plus restrictives, prolonger la durée de la rétention à respectivement 75 jours puis 90 jours, il est désormais prévu38(*) que le juge peut prolonger par une troisième ordonnance la durée de rétention de 60 à 90 jours selon les mêmes conditions que pour la deuxième ordonnance. Cette durée de 3 mois ne peut être prolongée et continue de constituer ainsi la durée maximale de rétention de droit commun.
Cette simplification, qui ramène de quatre à trois le nombre d'ordonnances nécessaires pour atteindre la durée maximale de rétention de droit commun, constitue une avancée opportune. Elle allège la charge pesant notamment sur les juridictions et les services de police - qui accompagnent les personnes retenues à l'audience -, déjà fortement mobilisés, tout en préservant le contrôle du juge judiciaire. Il serait néanmoins souhaitable d'aller plus loin39(*).
Certaines personnes peuvent se voir appliquer une durée maximale de rétention dérogatoire de 180 jours. Il s'agit des étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Ces derniers peuvent voir la durée de leur rétention être prolongée par période de 30 jours jusqu'à une durée maximale de 180 jours, soit 6 mois. Celle-ci pouvait, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel précitée du 7 août 2025, être portée à 210 jours, soit 7 mois40(*).
Sur la base de la proposition de loi précitée41(*), le Parlement a récemment opportunément adopté un texte de loi qui prévoyait l'extension des cas d'application de cette durée maximale dérogatoire aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Néanmoins, les dispositions concernées ont fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel42(*). Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif français à l'égard de profils dangereux, tout en s'inscrivant en cohérence avec le droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, et de nombreux exemples étrangers, dont l'Allemagne. Le rapporteur spécial souligne en outre que le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.
À l'issue du délai maximal applicable (de droit commun ou dérogatoire), l'étranger peut être libéré ou être assigné à résidence. Au-delà d'un certain délai43(*), il peut de nouveau être placé en rétention si sa situation en réunit les critères.
Les apports de la loi du 11 août 2025 visant
à faciliter le maintien en rétention
des personnes
condamnées pour des faits d'une particulière gravité
et
présentant de forts risques de récidive
La loi du 11 août 2025 apporte un certain nombre d'améliorations au cadre applicable à la rétention administrative, dont les principales sont les suivantes :
- modification des modalités de décompte de la durée maximale de placement initial en rétention de 4 jours en décomptant en 96 heures, pour un tirer le profit maximal lorsque le placement débute par exemple en fin de journée ;
- instauration de la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude ;
- réduction de quatre à trois du nombre d'ordonnances nécessaires pour porter la rétention de 60 jours à 90 jours, tout en en simplifiant les conditions ;
- introduction de la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile soit dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, soit qui n'a pas appliqué les règles applicables aux demandes d'asile.
Certains apports du texte de loi adopté par le Parlement ont en revanche été censurés par le Conseil constitutionnel44(*) :
- extension du champ d'application de la durée maximale dérogatoire de 180 jours, voire 210 jours, de rétention, qui aurait désormais été applicable aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement est de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public45(*) ;
- élargissement du périmètre matériel des appels à caractère suspensif de l'Etat contre les décisions judiciaires mettant fin à la rétention administrative.
Source : commission des finances
B. DES LOCAUX DÉDIÉS À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Ainsi que le prévoit la directive dite « retour », la rétention administrative est organisée dans des centres dédiés, le CESEDA précisant que « l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ». Concrètement, il s'agit des centres et des locaux de rétention administrative, respectivement les CRA et les LRA. Le placement en rétention s'effectue en principe en CRA. Néanmoins, un placement en LRA peut être effectué lorsqu'en raison de circonstances particulières, l'étranger ne peut être placé immédiatement dans un CRA.
1. Les centres de rétention administrative
Par principe, la rétention se déroule dans les CRA, lesquels ont une vocation nationale. Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération juridique de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut en outre, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre.
Les CRA sont créés par arrêté interministériel46(*) et sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent (à Paris, du préfet de police), qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
En application de dispositions réglementaires du CESEDA, chacun des CRA ne peut pas dépasser une capacité de 140 places et doit répondre à un certain nombre de normes matérielles.
Les normes immobilières applicables aux CRA
Les CRA doivent respecter, en matière immobilière, un ensemble de règles précises, fixées par l'article R. 744-6 du CESEDA, afin d'assurer des conditions de vie décentes aux personnes retenues.
Chaque retenu doit disposer d'un minimum de 10 m² d'espace, comprenant la chambre et les lieux de vie accessibles en journée. L'hébergement s'effectue en chambres collectives non mixtes, limitées à six personnes maximum. Des sanitaires - lavabos, douches, toilettes - doivent être accessibles à tout moment, avec un bloc pour dix personnes.
Les CRA doivent également garantir la possibilité de communiquer avec l'extérieur, un téléphone devant être mis à disposition pour cinquante retenus. Des installations adaptées à la restauration sont également obligatoires. À partir de quarante retenus, une salle de détente, distincte du réfectoire, doit être aménagée.
En outre, d'autres espaces doivent être prévus pour répondre aux besoins essentiels : une infirmerie pour les soins médicaux ; un espace pour recevoir la famille ou les représentants consulaires ; un bureau réservé aux avocats ; un local pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; un bureau équipé pour l'association chargée d'informer et d'aider les retenus dans l'exercice de leurs droits ; un espace extérieur pour la promenade et un local pour le stockage des bagages.
Enfin, lorsqu'un centre est susceptible d'accueillir des familles, il doit prévoir des chambres spécifiques et du matériel adapté, notamment pour les jeunes enfants.
Source : commission des finances
Différents types d'acteurs sont amenés à intervenir au sein des CRA, le plus souvent quotidiennement. Les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que les relations entre eux apparaissent globalement fluides et satisfaisantes.
Les principaux intervenants au sein des CRA
En tant que lieux de privation de liberté, les CRA voient intervenir un certain nombre d'acteurs aux missions distinctes, dont les principaux sont les suivants :
- les personnels de garde, qui assurent la sécurité, mais également le bon ordre général du centre ;
- le greffe du CRA, qui assure le suivi de l'ensemble des procédures (identité des retenus, conditions de maintien en rétention, avancée de la préparation de l'éloignement, etc.) ;
- les personnels médicaux présents de manière régulière (comme les infirmiers) ou plus ponctuelle (psychologues, psychiatres, médecins, etc.) ;
- les personnels de l'OFII, qui jouent un rôle central. Ils sont notamment chargés de l'entretien de premier accueil et de l'évaluation de la situation de la personne, en termes d'aide à la préparation au départ, et de l'instruction de son éventuelle demande d'aide au retour. Ils réalisent en outre des démarches en faveur du retenu : achats, récupération des effets personnels auprès des structures d'hébergement (foyer, hôpital, hôtel, etc.) ou des maisons d'arrêt et des proches, retrait d'espèces et clôture des comptes auprès des établissements bancaires, récupération de salaires auprès d'employeurs, etc. Ces missions, exercées dans la plupart des CRA six jours par semaine, représentent 37 ETP pour l'OFII en 2025, dans un contexte d'exercice professionnel (milieu fermé et public exigeant) qui peut réduire l'attractivité des postes ;
- les associations, en charge de l'assistance juridique aux personnes retenues47(*) ;
- les avocats et interprètes, chargés respectivement de la défense de leurs droits et de leur bonne compréhension de leurs droits et devoirs, dans leur langue ;
- des prestataires de services extérieurs, mobilisés pour la gestion quotidienne de certaines prestations, comme la restauration ou l'entretien.
Source : commission des finances
2. Les locaux de rétention administrative
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un CRA, le préfet peut les placer dans des LRA48(*), qui ont un rôle subsidiaire.
L'étranger ne peut toutefois être maintenu en LRA après la première ordonnance de prolongation de la rétention49(*) : il peut ainsi y demeurer en principe au maximum quatre-vingt-seize heures.
Les LRA sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral, qui précise si le local est susceptible d'accueillir des familles. À la différence des CRA, les LRA ont une vocation départementale, et non nationale.
Les locaux de rétention administrative doivent disposer d'un certain nombre d'équipements, plus basiques que dans les CRA et n'incluant notamment pas de local au bénéfice des associations en charge de l'assistance juridique.
II. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL AU CoeUR DE LA POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT
A. UN OUTIL CENTRAL POUR L'EFFECTIVITÉ DES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
La rétention administrative ne concerne, au regard du nombre de places disponibles, qu'une faible part des étrangers concernés par une mesure d'éloignement. Pour autant, elle apporte une contribution déterminante au nombre d'éloignements effectivement réalisés.
Les différents types de départs du territoire des étrangers en situation irrégulière
En 2024, il est estimé que 27 791 personnes étrangères majeures en situation irrégulière ont quitté le territoire métropolitain50(*). Ces départs peuvent être ventilés en cinq catégories.
Premièrement, les éloignements forcés, aidés et spontanés ont pour point commun de concerner des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Les éloignements forcés (12 856 en 2024) sont mis en oeuvre par la contrainte, à la différence des éloignements aidés (4 586 en 2024), qui font l'objet d'une aide au retour, et des éloignements spontanés (4 159 en 2024), qui sont réalisés sans contrainte et sans aide.
Deuxièmement, d'autres départs d'étrangers dépourvus de titre de séjour valide peuvent intervenir, sans mesure d'éloignement préalable ; ils se répartissent en deux catégories. D'une part, les départs volontaires aidés (89 en 202451(*)) qui désignent les cas de départs s'appuyant sur une aide et, d'autre part, les départs spontanés (6 101 en 2024), qui sont réalisés sans aide. Les départs de ce dernier type ne sont, par nature, pas tous connus.
Les éloignements faisant suite à une rétention administrative relèvent de la catégorie des éloignements forcés52(*).
La France est le pays de l'Union européenne qui procède au plus grand nombre d'éloignements forcés de ressortissants de pays tiers ces dernières années selon les données d'Eurostat, y compris en 2025 (7 375 au 1er semestre 2025, devant l'Allemagne)53(*).
Source : commission des finances, d'après les chiffres de la direction générale des étrangers en France (DGEF)
Ventilation des
départs du territoire métropolitain à la suite
d'une
mesure d'éloignement selon leurs modalités, en 2024
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les données du ministère de l'Intérieur
En 2024, 12 856 départs du territoire métropolitain ont résulté d'un éloignement forcé (dont 6 507 hors UE), soit 9,7 % de plus qu'en 2023. Parmi eux, 6 286 départs ont fait suite à une rétention en CRA en France métropolitaine, ce qui représente environ la moitié (48,9 %). Ce résultat s'explique par le fait que les personnes concernées sont physiquement disponibles pour préparer et exécuter l'éloignement. En comparaison, 1 198 personnes ont été éloignées à la suite d'une assignation à résidence la même année54(*).
Ventilation des départs forcés du territoire métropolitain, en 2024
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les données du ministère de l'Intérieur
À l'échelle de l'ensemble du territoire, en 2024, 16 206 personnes ont été éloignées depuis un CRA (dont 9 920 depuis un CRA d'outre-mer et 6 286 depuis un CRA métropolitain).
Ces chiffres attestent d'une très forte contribution de la rétention administrative à l'éloignement forcé. De facto, comme le rappelait la Cour des comptes55(*), « la probabilité de mettre en oeuvre un éloignement forcé est nettement supérieure lorsqu'il est précédé d'une mesure de détention ou de rétention. »
B. DES PLACEMENTS EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE CIBLANT DÉSORMAIS LES PROFILS MENAÇANT L'ORDRE PUBLIC
La rétention administrative ayant pour finalité première de garantir l'exécution effective des mesures d'éloignement, elle s'applique donc en principe prioritairement aux personnes en situation irrégulière pour lesquelles un départ forcé apparaît nécessaire en raison du risque de fuite. Toutefois, l'évolution de la politique migratoire a progressivement fait émerger un second objectif, à savoir permettre l'éloignement prioritaire des personnes dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
Ce second objectif a été affirmé clairement à compter de la circulaire du 3 août 2022 du ministre de l'Intérieur d'alors, Gérald Darmanin56(*). Cette dernière indiquait que la rétention devait désormais être prioritairement utilisée à l'encontre des étrangers représentant une menace pour l'ordre public, « y compris lorsque l'éloignabilité ne paraît pas acquise au jour de la levée d'écrou ou de l'interpellation ». Ces instructions sont régulièrement rappelées dans les différentes circulaires ministérielles.
À titre d'illustration, cette doctrine s'est traduite concrètement en Île-de-France, à compter de septembre 2022, par une priorisation des placements visant les personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), condamnées pour des faits de terrorisme, fichées « S », sortant de détention, ou encore visées par des mesures d'expulsion ou d'interdiction du territoire ou ayant des antécédents judiciaires.
La loi CIAI du 26 janvier 2024 a formalisé au niveau législatif la priorité accordée à la menace sur l'ordre public en en faisant un critère de placement et de maintien en rétention57(*), dont la mobilisation est encouragée par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2024 portant renforcement du pilotage de la politique migratoire.
Les deux objectifs fixés à la rétention administrative ne présentent pas, par nature, un caractère concurrent. Il apparaît au demeurant logique, dans un contexte de nombre de places de rétention limité, de placer en rétention celles qui sont le plus menaçantes pour la société et ce afin d'augmenter les chances d'éloignement effectif, à titre principal, et d'empêcher la commission d'un trouble à l'ordre public dans l'intervalle, à titre accessoire. D'autres pays ont également fait ce choix, à l'image de l'Allemagne.
Néanmoins, une tension entre les deux objectifs peut se révéler lorsqu'un choix doit être réalisé entre le placement ou le maintien en rétention d'une personne menaçant l'ordre public mais dont la probabilité d'éloignement est relativement faible, par exemple du fait de sa nationalité, et celui d'une personne ne présentant pas un tel profil mais facilement éloignable. Les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que c'est globalement la menace à l'ordre public qui prime aujourd'hui, la circulaire ministérielle précitée du 3 août 2022 précisant par ailleurs qu'« en cas de manque de places disponibles, il convient de libérer systématiquement les places occupées par les étrangers en situation irrégulière sans antécédents judiciaires non éloignables et de les assigner à résidence ».
Concrètement, le nombre de personnes répondant parmi les retenus à un profil dit « trouble à l'ordre public » (ou « TOP ») - un groupe hétérogène dont le point commun est le risque qu'ils emportent pour l'ordre public - a très fortement augmenté.
Ventilation des placements dans les CRA
métropolitains
par catégories de personnes retenues, en
2024
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Note : FSPRT : Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
En 2024, 86 % des retenus correspondent à ce profil, contre 7,3 % en 2021 ; 12,4 % correspondent à des profils plus classiques, désormais qualifiés de « frictionnels ».
Évolution de la proportion de personnes retenues dans les CRA métropolitains répondant au profil « trouble à l'ordre public »
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Ces équilibres ne se retrouvent pas, en revanche, dans les outre-mer où les profils « frictionnels » ont continué en 2024 d'être largement majoritaires (95,4 %), les profils « troubles à l'ordre public » en représentant 4,5 %, tandis que les personnes inscrites au FSPRT étaient au nombre de trois, et les profils terroristes non-représentés.
L'observation du taux d'éloignement constaté depuis 2022 témoigne de l'équilibre trouvé dans la conciliation des deux objectifs de la rétention. En effet, malgré une orientation renforcée vers les profils les plus problématiques sur le plan sécuritaire, le taux global d'éloignement n'a connu qu'un recul modéré58(*).
Cette stabilité s'explique par deux facteurs principaux. D'une part, le ciblage des personnes placées en rétention a montré une certaine efficacité. D'autre part, la catégorie des profils « troubles à l'ordre public » recouvre une large diversité de situations, allant d'infractions de gravité modérée à des faits relevant de crimes, ce qui permet, dans de nombreux cas, de concilier le caractère réalisable de l'éloignement avec celui de protection de l'ordre public.
C. UNE RÉTENTION RECENTRÉE, PROLONGÉE, ET MARQUÉE PAR UNE STABILITÉ DES PRINCIPAUX PROFILS NATIONAUX
1. Une rétention recentrée
Depuis 2019, le nombre de personnes retenues en CRA sur l'ensemble du territoire national a eu tendance à se réduire. Il atteignait 50 486 en 2019, avant de reculer à partir de 2022, d'abord sous l'effet de la pandémie de COVID-19, puis en raison d'autres facteurs, parmi lesquels un ciblage plus sélectif des placements - qui a contribué à un allongement de la durée moyenne de rétention et donc à une moindre rotation des places -, une diminution du nombre de personnes relevant de la procédure « Dublin », qui généraient un turn-over important et, enfin et surtout, une forte variabilité du nombre de placements dans les outre-mer.
Évolution du nombre de personnes placées dans les centres de rétention administrative sur le territoire national entre 2019 et 2024
(en nombre de personnes)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
En 2024, 30 115 personnes ont été placées en CRA, dont 16 222 en métropole et 13 893 dans les outre-mer. Ce faible niveau global résulte principalement de la forte baisse des placements dans les outre-mer en un an, illustrant la variabilité importante observée chaque année dans ces territoires. En 2024, le CRA de Mayotte a ainsi connu une forte baisse des placements par rapport à l'année précédente, notamment dans un contexte de blocages sociaux en début d'année sur l'île, et de l'impact du cyclone Chido en fin d'année. En métropole, en revanche, les volumes sont restés globalement stables par rapport à 2023.
Ventilation des placements en CRA sur le territoire national, en 2024
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
Dans le même temps, 24 916 personnes ont fait l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement d'une mesure d'éloignement. Ce chiffre demeure quasi identique à celui de 2023 (24 767)59(*).
2. Une rétention prolongée
En métropole, la durée moyenne de rétention a nettement augmenté au cours des dernières années, passant de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024. Dans les outre-mer, en revanche, elle demeure beaucoup plus courte, s'établissant à 5,9 jours en 2024.
Évolution de la durée moyenne de
rétention dans les CRA métropolitains
entre 2019 et
2024
(en nombre de jours)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
L'allongement de la durée moyenne de rétention en métropole s'explique à la fois par des évolutions juridiques et des contraintes concrètes liées à l'éloignement et à l'évolution du profil des personnes retenues.
Sur le plan légal, la durée maximale de rétention a été progressivement étendue.
Une extension progressive de la durée
maximale légale de rétention
demeurant modeste en comparaison
européenne
La limite maximale de droit commun60(*) de la durée de rétention administrative a fait l'objet d'allongements successifs. Initialement fixée à 7 jours61(*), elle a été portée à 10 jours en 1993, à 12 jours en 1998, à 32 jours en 2003, à 45 jours en 2011 puis, enfin, à 90 jours en 2019. La loi CIAI de 2024 n'a, quant à elle, pas modifié ce plafond.
Une telle durée demeure modeste au regard de l'encadrement prévu par le droit européen, qui prévoit une durée maximale de 6 mois, pouvant être portée à 18 mois62(*). Cette durée maximale de rétention a été adoptée dans plusieurs pays européens, à l'image de l'Allemagne.
Le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit en outre de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.
Source : commission des finances
Sur le plan pratique, les difficultés liées à l'éloignement effectif63(*) sont restées fortes, tandis que le profil des personnes retenues s'est durci. Ces dernières, qui présentent le plus souvent une menace à l'ordre public, tendent à être moins coopératives, alors que certains pays tiers rechignent à délivrer les documents de voyage nécessaires ou à accepter le retour de ce type de profils, allongeant ainsi les délais requis pour finaliser la procédure d'éloignement.
En 2024, environ 61 % des éloignements depuis les CRA métropolitains ont eu lieu à l'issue d'une rétention d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ; 39 % ont eu lieu après.
Ventilation des éloignements en fonction de
la durée de rétention effective
dans les CRA
métropolitains en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
3. Une rétention marquée par une stabilité des principales nationalités représentées
En 2024, la répartition des nationalités parmi les personnes placées en CRA illustre des dynamiques différenciées entre le territoire métropolitain et les outre-mer, tout en confirmant une stabilité dans les grandes tendances observées ces dernières années.
a) Dans l'hexagone
Parmi les 16 222 personnes placées en CRA dans l'hexagone en 2024, plus de la moitié (55 %) étaient originaires des pays du Maghreb, l'Algérie représentant à elle seule près d'un tiers du total (32 %), suivie par la Tunisie (12,2 %) et le Maroc (10,6 %), reflétant la structure migratoire de la France. Cette prédominance des ressortissants des pays du Maghreb s'inscrit dans une continuité observée sur plusieurs années. S'y ajoute la présence - plus marginale mais notable - de ressortissants roumains (4,4 %) et albanais (2,9 %), la totalité des autres nationalités représentant 38 % des placements.
Nationalités des personnes placées en CRA en 2024 en France métropolitaine
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
Le profil des personnes retenues dans les CRA métropolitains est aujourd'hui très largement masculin, les hommes représentant 96 %64(*) des personnes placées en 2024.
Dans plus d'un quart des cas (27,2 %), la rétention est intervenue à la suite d'une sortie de détention. Elle peut également faire suite à un contrôle de police, qu'il soit ou non lié à une infraction suspectée, ainsi qu'à d'autres situations, tels qu'un contrôle routier, une interpellation à la frontière, un contrôle en gare ou encore une arrestation au domicile de l'intéressé.
b) Dans les outre-mer
La situation observée dans les territoires ultramarins se distingue nettement de celle de la métropole. Sur les 13 893 placements en CRA recensés dans les outre-mer en 2024, les ressortissants comoriens représentaient à eux seuls trois quarts (74 %) des personnes retenues, soit 10 242 individus. Cette forte concentration traduit le caractère structurel de la pression migratoire aux abords de Mayotte, dans un contexte de proximité géographique avec l'archipel des Comores. Les autres principales nationalités sont les Brésiliens, les Malgaches, les Congolais, et les Haïtiens, les autres nationalités représentant 9 % du total.
Nationalités des personnes placées en CRA en 2024 dans les outre-mer
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
Enfin, le nombre de personnes retenues sortant d'un établissement pénitentiaire est beaucoup plus faible dans les outre-mer qu'en hexagone, s'établissant à 4,2 %.
III. UNE POLITIQUE DE RÉTENTION CONFRONTÉE À DES FREINS STRUCTURELS À L'ÉLOIGNEMENT
A. UN TAUX D'ÉLOIGNEMENT ENCORE TROP MODESTE MALGRÉ UNE AMÉLIORATION EN 2024
Le taux d'éloignement des personnes placées en rétention administrative en France métropolitaine demeure, depuis de nombreuses années, inférieur à 50 %. Dans les années récentes, exception faite de la période marquée par l'épidémie de COVID-19, les modifications tenant au ciblage beaucoup plus fort, à compter de 2022, des personnes présentant une menace à l'ordre public, et dont une part est plus difficilement éloignable, y ont sans doute contribué, bien que de manière modérée. Ainsi, le taux d'éloignement est passé de 43,2 % en 2022 à 35 % en 2023. Il a toutefois connu un redressement en 2024.
Évolution du taux d'éloignement des
personnes retenues en CRA
en France métropolitaine
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Sur l'ensemble du territoire national, 30 115 personnes ont été placées en CRA en 202465(*). Parmi elles, 16 206 ont effectivement été éloignées, dont 6 286 en métropole et 9 920 dans les territoires ultramarins. Le taux d'éloignement global s'est ainsi établi à 53,8 %, avec un net contraste entre la métropole (38,8 %) et les outre-mer (71,4 %). Cette situation s'explique notamment par les différences de nationalités, de profils des retenus et des dynamiques géographiques dans les différents territoires. À titre d'illustration, même sur le seul territoire métropolitain, les taux d'éloignement varient considérablement selon les CRA, s'étalant de 21 % à Nice à 73,7 % à Mayotte.
a) Dans l'hexagone
En 2024, 61 % des personnes placées en CRA en métropole n'ont finalement pas été éloignées. Dans les deux tiers des cas (66,8 %), la remise en liberté a été ordonnée par le juge judiciaire en raison d'irrégularités de droit, de procédure ou de forme affectant la décision de placement. Dans une proportion plus réduite, la libération est intervenue à l'issue du délai maximal de rétention sans exécution de l'éloignement (12,4 %), à l'initiative de l'administration (9,9 %), à la suite d'une décision du juge administratif (6 %) ou pour d'autres motifs, tels que l'ouverture de poursuites pénales, une hospitalisation ou une fuite du centre.
Ventilation des
voies de libération des personnes retenues
dans les CRA
métropolitains en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Parmi les 6 286 personnes éloignées depuis un CRA situé en métropole en 2024, environ 40 % étaient originaires des pays du Maghreb. Ce chiffre, sensiblement inférieur à leur part dans les placements en rétention (55 %), met en lumière les difficultés persistantes rencontrées dans l'exécution des éloignements vers cette zone géographique.
Nationalités des personnes éloignées en 2024 depuis un CRA métropolitain
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
Parmi les mêmes personnes, si les profils « troubles à l'ordre public » ont été les plus nombreux (74 %), ceux dits « frictionnels » ont continué à représenter une part notable (24,5 %), témoignant, au regard de leur part beaucoup plus réduite au sein de l'ensemble des retenus, de la plus grande facilité de leur éloignement.
Ventilation des éloignements depuis un CRA
métropolitain
par catégories de personnes en 2024
(en nombre de personnes et en pourcentage)
Note : FSPRT : Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction nationale de la police aux frontières au questionnaire du rapporteur spécial
b) Dans les outre-mer
Les éloignements réalisés depuis les CRA des outre-mer ont concerné, en 2024, majoritairement des ressortissants comoriens, qui représentaient 81,3 % des personnes éloignées, loin devant les ressortissants brésiliens (8,3 %) et malgaches (4,3 %). Cette répartition reflète relativement fidèlement le profil des personnes retenues dans ces territoires. La quasi-totalité des éloignés (96 %) relevaient de profils dits « frictionnels », c'est-à-dire ne présentant pas de menace particulière pour l'ordre public. Seuls 4 % étaient classés comme de profils « troubles à l'ordre public »66(*).
Le CRA de Mayotte a comptabilisé 8 648 éloignements, soit plus de la moitié des éloignements réalisés à l'échelle nationale (53,3 %) et 87 % de ceux effectués depuis l'ensemble des territoires ultramarins. Ce niveau élevé s'explique principalement par la relative facilité des éloignements vers les Comores. La coopération avec ce pays est en effet globalement efficace de ce point de vue, ce qui permet une exécution rapide des mesures et favorise une forte rotation des places disponibles en rétention.
B. DES OBSTACLES PERSISTANTS À L'ÉLOIGNEMENT EFFECTIF
Si certaines difficultés liées à l'éloignement sont propres aux personnes placées en centre de rétention administrative et appellent des réponses spécifiques, les obstacles plus généraux rencontrés dans la mise en oeuvre des mesures d'éloignement de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière - qu'ils soient retenus ou non - affectent également la politique de rétention.
Ces obstacles tiennent notamment à la détermination de l'identité et de la nationalité des personnes, à l'obtention des laissez-passer consulaires et aux conditions matérielles d'éloignement.
a) La détermination formelle de l'identité et de la nationalité de certaines personnes retenues
L'identification formelle de l'identité et de la nationalité des personnes à éloigner, à laquelle concourent de nombreux services67(*), demeure une difficulté notable.
En application du CESEDA, l'éloignement ne peut être mis en oeuvre - sauf exceptions - que vers le pays d'origine ou un pays de transit, ce qui impose de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé.
En outre, l'identité de la personne doit être connue pour obtenir un laissez-passer consulaire. Or, pour 20 à 30 % des personnes retenues, l'identité n'est pas connue68(*).
Cette situation résulte du fait qu'une partie des étrangers dépourvus de titre de séjour valide ne dispose pas de papiers d'identité ou, dans certains cas, en assure la destruction aux fins de rendre l'éloignement plus difficile. Elle oblige les différents services relevant du ministère de l'Intérieur, et parfois les consulats compétents pour délivrer les laissez-passer consulaires, à identifier leur nationalité en fonction d'un faisceau de critères (langues maîtrisées, connaissance du pays, etc.), avec des risques d'erreurs. Dans d'autres cas, certains étrangers utilisent un ou plusieurs alias.
Or, les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que le cadre d'investigation limite, à ce jour, les actions possibles en la matière. Néanmoins, la très récente loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a opportunément instauré la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude.
D'autres mesures pourraient être envisagées, parmi lesquelles l'exploitation des données du téléphone portable, sous les mêmes conditions. Cette mesure pourrait être intégrée notamment dans le cadre de la négociation en cours du projet de nouveau règlement « retour » à l'échelle de l'Union européenne. En outre, l'éclatement et le manque d'interopérabilité des systèmes d'information entre services doivent être résolus.
Recommandation n° 1 : Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents (ministère de l'Intérieur).
b) L'obtention d'un laissez-passer consulaire pour les personnes ne disposant pas de titres d'identité valables délivrés par leur pays d'origine
Pour tout étranger dépourvu de document de voyage valide (en particulier un passeport ou une carte d'identité), l'éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'après l'obtention d'un laissez-passer consulaire (LPC) délivré par le pays d'origine. Or, la délivrance de ce document repose sur la souveraineté de chaque État, qui reste seul juge pour reconnaître ou non l'un de ses ressortissants. En pratique, la France se heurte à des difficultés importantes avec un certain nombre de pays, alors que les profils des personnes retenues, qui s'est durci, rendent les autorités étrangères parfois encore moins enclines à coopérer.
Des avancées sont constatées avec certains États, notamment grâce à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de réadmission, qui ont permis de fluidifier les procédures dans plusieurs cas. Toutefois, des blocages persistants continuent de freiner les retours, notamment s'agissant des ressortissants des pays du Maghreb, qui représentent plus de la moitié des personnes placées en CRA69(*). Le niveau de délivrance des LPC par ces pays reste globalement insuffisant, même s'il varie fortement selon les périodes. Cette situation se reflète dans le taux de coopération calculé au niveau ministériel, qui prend en compte non seulement le nombre de LPC délivrés, mais aussi leur obtention dans des délais utiles et le taux d'exécution des retours.
Comparaison du taux de coopération de
plusieurs pays dans la délivrance
des LPC à l'ensemble des
personnes faisant l'objet d'un éloignement, en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au questionnaire du rapporteur spécial
En outre, la forte détérioration des relations diplomatiques avec l'Algérie ces derniers mois complique beaucoup la mise en oeuvre des éloignements vers ce pays, alors même que les ressortissants algériens constituent, de loin, la première nationalité représentée en centre de rétention administrative70(*). Depuis le début de l'année 2025, la situation s'est nettement aggravée, les autorités algériennes délivrant un nombre extrêmement limité de LPC. De surcroît, elles tendent à refuser désormais la réadmission de leurs ressortissants lorsqu'ils voyagent munis d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, exigeant, en complément, un LPC qu'elles ne délivrent que très rarement. Cette exigence va à l'encontre des accords bilatéraux conclus avec la France et d'autres engagements internationaux.
Dans ce contexte, l'administration peine en outre encore à pleinement coordonner ses efforts pour optimiser les demandes de LPC, comme l'avait déjà souligné la Cour des comptes71(*). La responsabilité de ces démarches repose principalement sur les préfectures de département, qui, ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des appuis nécessaires pour assurer un suivi efficace et homogène sur l'ensemble du territoire. Pour 26 pays72(*), c'est néanmoins l'unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières qui est en charge de l'obtention des LPC auprès des consulats des pays concernés73(*). Enfin, une « task force » de la DGEF est quant à elle chargée de la centralisation des demandes de laissez-passer mise en place avec le Maroc (seul pays du Maghreb pour lequel l'obtention des LPC ne relève pas directement des préfectures), de la coopération consulaire, ou encore de la gestion et la promotion de la coopération technique en matière de lutte contre l'immigration illégale. En revanche, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) n'intervient en définitive, en complément, que très ponctuellement sur les dossiers d'éloignement, sur des cas très particuliers.
Au regard du caractère efficace de la centralisation des demandes de LPC au niveau de l'UCI pour les pays concernés, de l'expérience et de l'expertise de cette cellule, il apparaîtrait pertinent d'élargir cette solution à davantage de pays, en l'accompagnant d'un renforcement des effectifs concernés.
Recommandation n° 2 : Centraliser, pour un plus grand nombre de pays, les demandes de laissez-passer consulaires auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de simplifier et d'accélérer la procédure (ministère de l'Intérieur).
Au-delà des enjeux de procédure, et bien que des efforts soient faits en la matière par le MEAE, il importe d'intégrer encore plus fortement le volet de l'obtention des LPC dans la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays peu coopératifs en matière de réadmission. Seule une approche globale, tant à l'échelle française qu'européenne, intégrant notamment les politiques de délivrance de visas, d'aide publique au développement et de réadmission des personnes en situation irrégulière en France est susceptible de produire des résultats significatifs et de long terme. Or, celle-ci est in fine davantage dans les mains du MEAE que du ministère de l'Intérieur, bien que les conseillers diplomatiques placés auprès des préfets de région doivent également sans doute être davantage mobilisés sur ces sujets.
c) Les difficultés matérielles de l'éloignement
Sur le principe, lorsqu'une personne est en possession de documents d'identité valides, ou qu'un laissez-passer consulaire a pu être obtenu, l'administration est en mesure de procéder à l'organisation matérielle de son éloignement. Toutefois, dans les faits, cette étape reste inégalement exécutée. Entre 2019 et 2022, toutes situations confondues - y compris celles concernant des personnes placées en rétention - moins de la moitié des demandes d'éloignement forcé adressées par les préfectures à la police aux frontières ont pu effectivement aboutir, hors outre-mer74(*).
Selon la Cour des comptes75(*), plus de 90 % des éloignements forcés depuis la métropole sont réalisés par voie aérienne. Dans environ trois quarts des cas, ils s'effectuent sur des vols commerciaux, la personne éloignée étant escortée et installée parmi les passagers. Afin de garantir le départ des profils les plus sensibles, en particulier ceux présentant une menace à l'ordre public, une priorisation est opérée dans l'organisation de ces éloignements par ordre décroissant de priorité : profils terroristes, personnes inscrites au FSPRT76(*), sortants de prison, personnes placées en CRA, assignés à résidence de profil « troubles à l'ordre public », assignés à résidence « simples », etc.
Toutefois, plusieurs contraintes freinent la mise en oeuvre effective de l'éloignement par voie de vol commercial. Certaines destinations sont, tout d'abord, desservies par un nombre limité de vols commerciaux, ce qui complique la programmation rapide des départs. Par ailleurs, les compagnies aériennes se montrent globalement réticentes à accepter des passagers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour des raisons à la fois commerciales et de tranquillité à bord. Enfin, la plupart imposent des plafonds annuels de reconduites, réduisant de fait la marge de manoeuvre de l'administration.
S'y ajoutent de nombreuses annulations de dernière minute ; en moyenne, 36 % des tentatives d'éloignement forcé échouent du fait de l'obstruction de la personne concernée. Ces blocages peuvent prendre diverses formes, tels que le refus d'embarquement, les absences à la convocation, l'agitation à bord de l'avion, voire des automutilations.
Face à ces limites, l'organisation de vols affrétés par la police aux frontières permet un encadrement plus strict. Leur taux de réussite est nettement supérieur, à savoir 66 % pour les vols affrétés par la France seule, et jusqu'à 89 % pour les vols groupés organisés sous l'égide de Frontex. Cette efficacité s'explique par un encadrement renforcé, une meilleure anticipation et une capacité de coercition accrue de la part des forces de l'ordre, comme le rappelle la Cour des comptes77(*).
Pour autant, le recours à ce mode d'éloignement reste ponctuel. Il suppose d'obtenir l'accord préalable du pays de destination, et de pouvoir regrouper, dans un même laps de temps, un nombre suffisant de personnes à éloigner vers le même État. Ces conditions sont loin d'être toujours réunies. Pour l'Algérie, la coopération en la matière est totalement suspendue depuis 2024.
Une utilisation plus fréquente des vols affrétés, y compris par Frontex, pourrait néanmoins être utilement envisagée, en particulier pour les profils menaçant le plus gravement l'ordre public.
IV. UNE CAPACITÉ DE RÉTENTION RENFORCÉE MAIS TOUJOURS INSUFFISANTE
A. SI LA CAPACITÉ DE RÉTENTION A AUGMENTÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES...
1. Des places plus nombreuses et davantage occupées
Dans la dernière décennie, le nombre de places de rétention administrative a progressé de manière continue sur le territoire métropolitain. Ainsi, le nombre de places théoriques en CRA est passé de 1 488 en 2017 à 1 959 en 2024, soit une hausse de près d'un tiers (31,7 %) en sept ans. S'y ajoutent 141 places dans les 28 LRA permanents. La France disposait ainsi, fin 2024, de l'une des plus grandes capacités de rétention en Europe.
Évolution de la capacité théorique du parc de CRA en métropole
(en nombre de places)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Dans les outre-mer, le nombre de places théoriques s'établit en 2025 à 228 en CRA et 35 dans les 4 LRA permanents. Au total, la France dispose ainsi aujourd'hui de 2 187 places théoriques en CRA et de 176 en LRA permanents, soit un total de 2 363 places de rétention administrative.
Au-delà de l'augmentation du nombre de places, un effort a également été engagé pour améliorer la disponibilité réelle et l'occupation effective des capacités théoriques. Une instruction du ministre de l'Intérieur du 10 janvier 2023 a ainsi demandé aux préfets de mobiliser tous les leviers organisationnels à leur disposition (ressources humaines, planification des travaux, et amélioration du niveau de sécurisation des bâtiments) en ce sens.
La disponibilité effective des places peut néanmoins être limitée par des difficultés d'ordre matériel (insalubrité, problèmes de sécurité, travaux) ou par le manque d'effectifs policiers. Sur les 2 187 places théoriques en CRA, 1 956 étaient effectivement disponibles à la mi-mai 2025, dont 1 761 en métropole et 195 dans les outre-mer, soit un taux de disponibilité de 89,4 %, en nette progression dans les dernières années. D'après les éléments transmis au rapporteur spécial, environ 80 % des places temporairement indisponibles le sont en raison de travaux en cours ou à venir, les 20 % restants étant liés à un déficit de personnels policiers.
Parallèlement, des progrès notables ont été enregistrés en matière de taux d'occupation. Celui-ci est passé de 70,8 % en 2017 à 92,3 % en 2024.
Évolution du taux d'occupation des places en CRA entre 2022 et 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Cette amélioration s'explique en partie par la réaffectation de certaines places initialement réservées aux femmes et aux familles (moins occupées) en places pour hommes, dans le cadre d'une politique de rétention recentrée sur les profils considérés comme menaçant l'ordre public.
Évolution de la part des hommes et des femmes au sein des personnes retenues dans les CRA métropolitains entre 2019 et 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
2. Un parc de rétention diversifié et faisant l'objet d'une sécurisation accrue
a) Un parc de rétention hétérogène couvrant une grande partie du territoire
À ce jour, la France dispose de 27 CRA en fonctionnement, dont 23 situés en métropole et 4 implantés dans les outre-mer (en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe et à La Réunion). À ces structures s'ajoutent 32 LRA permanents, répartis selon un équilibre similaire (28 en métropole et 4 dans les territoires ultramarins).
Carte des implantations des CRA en 2025
Source : commission des finances du Sénat
Le parc de rétention administrative se caractérise ainsi par sa relative dispersion et l'absence de volonté de mettre en place un ou plusieurs grands CRA en substitution du maillage actuel.
Ce choix repose sur deux considérations principales. D'un côté, le maillage territorial permet d'assurer des placements en rétention plus rapides et limite la distance à parcourir pour accomplir les différentes démarches nécessaires à l'éloignement et à la rétention : présentation devant le juge compétent, rendez-vous consulaires, examens médicaux, etc. Il permet également de mieux répartir la charge de travail entre les différents services de l'État concernés (forces de l'ordre, préfectures, structures de soins) sur le territoire. D'un autre côté, limiter la taille des centres tend à faciliter les interactions entre les personnes retenues elles-mêmes et les agents intervenants, de nature à limiter les tensions, les atteintes aux biens ou les incidents à caractère violent.
Les LRA, dont la création comme la pérennisation éventuelle relèvent de la compétence des préfets de département78(*), constituent un complément important au maillage territorial des CRA. Leur souplesse d'implantation permet d'adapter rapidement le parc de rétention aux évolutions locales, notamment en cas de tensions migratoires ponctuelles. Ces structures présentent en outre l'avantage de pouvoir être ouvertes (et, le cas échéant, fermées) dans des délais relativement courts.
Au-delà de sa répartition géographique, le parc de rétention administrative se distingue en outre par sa grande diversité. Fruit d'une histoire de plus de quarante ans, il s'est constitué en fonction des opportunités immobilières locales (disponibilité du foncier, réhabilitation de bâtiments existant, etc.), expliquant son absence d'uniformité.
Les centres varient ainsi considérablement en taille : leur capacité théorique s'échelonne d'une vingtaine79(*) à 140 places80(*), cette dernière constituant le plafond réglementaire81(*). En moyenne, un CRA offre environ 80 places. Les LRA sont, quant à eux, de taille plus modeste, celui du Val-de-Marne82(*) comptant par exemple seulement huit places.
L'ancienneté et le type des structures diffère également d'un site à l'autre. Le CRA d'Olivet a été construit récemment et a ouvert ses portes en 2024, tandis que celui de Nice est installé dans une ancienne caserne83(*), édifiée en 1870.
b) Un parc de rétention engagé dans un processus de modernisation sécuritaire
En tant que lieux de privation de liberté, les CRA sont exposés à un certain nombre de risques. Ceux-ci tiennent notamment au comportement des personnes retenues (dans leurs interactions entre elles ou avec les personnels), ainsi qu'au risque de fuite. D'autres menaces proviennent de l'extérieur, notamment des tentatives d'aide à la fuite ou d'introduction d'objets prohibés (armes, stupéfiants, etc.), y compris par l'usage de drones.
Longtemps restés à un niveau contenu, ces risques ont nettement augmenté depuis 2022, en lien avec le durcissement des profils des personnes placées en rétention84(*).
Dans ce contexte, une démarche de sécurisation progressive des CRA a été engagée. Elle s'est traduite, selon les sites, par l'installation de systèmes de vidéo-surveillance et de dispositifs anti-drones, un renforcement des systèmes de verrouillage, ainsi que par une organisation plus stricte des déplacements au sein des centres. Un plan d'action global articulé autour de 24 mesures a ainsi été lancé à la fin de l'année 202285(*).
Le rapporteur spécial souligne que ces adaptations sont nécessaires face au durcissement des profils retenus, et peuvent être réalisées dans des conditions préservant les droits des personnes concernées. Lors des visites effectuées, il a pu constater que, malgré le cadre sécuritaire renforcé, les personnes retenues conservent en journée une liberté de circulation entre les différents espaces du centre (chambres, locaux des associations et de l'OFII, unité médicale, cour extérieure, etc.) et bénéficient, dans des conditions encadrées, d'un accès à leur puce téléphonique86(*), ainsi que, a minima dans certains centres, d'activités sportives ou culturelles.
B. ... ELLE DEMEURE AUJOURD'HUI INSUFFISANTE
Si les capacités de rétention administrative ont été renforcées dans les années récentes, les besoins demeurent aujourd'hui importants, pour deux séries de raisons. D'une part, le parc actuel ne répond tout simplement pas à l'ensemble des besoins de placement en rétention administrative formulés par les préfectures et à la pression migratoire croissante. D'autre part, une extension du parc est nécessaire pour tirer davantage profit de l'efficacité de l'outil de la rétention en matière d'éloignement, en cohérence avec un renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière.
En premier lieu, si le nombre de personnes placées en rétention a diminué récemment, la pression sur les capacités d'accueil s'est en réalité accentuée. Cette évolution paradoxale tient à l'allongement progressif de la durée moyenne de rétention, qui ralentit la rotation des places et réduit mécaniquement le volume annuel de retenus. Dès lors, le renforcement quantitatif récent du parc ne suffit pas à répondre aux besoins exprimés, notamment dans les territoires fortement exposés à l'immigration irrégulière, à l'instar de l'Île-de-France. Le rapporteur spécial a ainsi pu constater que, faute de places disponibles, les préfets de zone sont régulièrement contraints d'opérer des arbitrages entre plusieurs demandes de placement émanant de différents préfets de département. Alors qu'en 2023, 2 967 demandes d'admission en CRA avaient ainsi été refusées pour cause de saturation du parc, ce nombre s'est établi à 3 624 en 2024. À la différence du système pénitentiaire, la rétention ne prévoit en effet pas de dépassement de capacité.
En second lieu, l'extension du parc apparaît comme un levier indispensable pour renforcer l'efficacité globale de la politique d'éloignement. Elle répondra à plusieurs enjeux :
- elle permettra de mieux garantir l'exécution des décisions d'éloignement, dont le nombre et le caractère exécutable devrait augmenter grâce aux dispositions prévues dans la loi CIAI, nettement enrichies par le Sénat ;
- elle est cohérente avec l'évolution du profil des retenus, souvent moins coopératifs, pour lesquels une rétention prolongée est nécessaire afin de mener à bien les démarches préalables à l'éloignement, telles que l'identification ou l'obtention d'un laissez-passer consulaire ;
- elle permettra de limiter le besoin d'arbitrer entre l'éloignabilité rapide et la dangerosité des personnes, en assurant la rétention à la fois des personnes rapidement éloignables et de celles qui le sont moins rapidement mais qui constituent une menace à l'ordre public ;
- elle répond à la pression migratoire croissante, tendance désormais structurelle à l'échelle européenne pour les années à venir, dans un contexte où le nombre de places apparaît très limité au regard des 128 250 OQTF délivrées en 2024 ;
- elle pourrait être organisée dans des conditions permettant une couverture renforcée de l'ensemble du territoire.
DEUXIÈME PARTIE
ASSOCIER L'EXTENSION DE LA
CAPACITÉ DE RÉTENTION À UNE AMÉLIORATION DE
L'EFFECTIVITÉ DE L'ÉLOIGNEMENT DES PERSONNES RETENUES
S'il est indispensable de mettre en oeuvre rapidement l'extension du parc de rétention administrative, son coût doit être maîtrisé. En outre, sa pleine effectivité en matière d'éloignement suppose de rationaliser les conditions du recours à la rétention administrative.
I. ACCÉLÉRER L'EXTENSION DU PARC DE RÉTENTION TOUT EN MAÎTRISANT SON COÛT
A. UNE MONTÉE EN CHARGE DU PLAN D'EXTENSION À ACCÉLÉRER...
1. Un objectif de 3 000 places initialement fixé pour 2027 qui ne devrait pas pouvoir être atteint, comme le traduit le rythme d'exécution des dépenses d'investissement
Si la dynamique d'augmentation de la capacité d'accueil des CRA lui est antérieure87(*), la LOPMI88(*) a marqué une évolution importante en la matière, son rapport annexé prévoyant que « le nombre de places en centres de rétention administrative sera progressivement porté à 3 000 » en métropole. Du point de vue budgétaire, la trajectoire budgétaire de la LOPMI avait d'ailleurs été complétée d'un montant de 60 millions d'euros annuellement sur la période de programmation, à savoir de 2023 à 2027, pour atteindre cet objectif89(*).
Une instruction ministérielle en date du 10 janvier 2023 avait enjoint aux préfets de zone de défense et de sécurité d'identifier des sites permettant l'implantation de CRA d'une capacité maximale de 140 places. En complément, une politique d'extension du parc des LRA est également déployée90(*).
Les travaux menés par le rapporteur spécial ont néanmoins été l'occasion de confirmer que l'objectif de 3 000 places de places en CRA ne devrait pas pouvoir être atteint dès 202791(*), principalement pour des raisons immobilières.
a) Des obstacles immobiliers qui se reflètent dans le rythme d'exécution des dépenses d'investissement
En premier lieu, sur le plan immobilier, la création de nouveaux CRA se heurte à un ensemble d'obstacles qui ralentissent leur mise en oeuvre. Outre la prise en compte des contraintes urbanistiques et environnementales, la principale difficulté réside dans l'identification d'un foncier adapté. Le terrain recherché doit répondre à plusieurs critères cumulatifs, notamment une superficie suffisante (environ 20 000 m²) et une proximité avec un aéroport international, les juridictions administratives et judiciaires, ainsi que, le cas échéant, les consulats les plus fréquemment sollicités. Il doit également bénéficier d'un accès facile par voie autoroutière, tout en étant éloigné des zones résidentielles. S'ajoutent la nécessité d'assurer une concertation avec les élus locaux, et souvent, celle d'une modification du plan local d'urbanisme. En outre, comme pour tout projet immobilier d'envergure, des études préalables doivent être conduites, un permis de construire sollicité, tandis que des contentieux peuvent survenir à plusieurs étapes du projet.
Ces difficultés se reflètent dans le rythme d'exécution des dépenses d'investissement dans les CRA (et LRA et zones d'attente92(*)) constaté ces dernières années, qui se révèle incompatible avec l'atteinte de l'objectif d'une capacité de 3 000 places en CRA fixé pour 2027. Si les crédits de paiement (CP) effectivement consommés ont connu une nette progression entre 2018 (3,8 millions d'euros) et 2021 (23,3 millions d'euros), leur niveau s'est depuis stabilisé dans une fourchette comprise entre 17 et 19 millions d'euros par an, sans tendance haussière et en-deçà des prévisions annuelles.
Évolution des crédits de paiement
d'investissement prévus et exécutés
dans les CRA, LRA
et zones d'attente entre 2018 et 2025
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
En matière d'autorisations d'engagement (AE), doit en outre être soulignée une baisse marquée de l'exécution entre 2023 et 2024. Les documents budgétaires93(*) imputent ce recul au report de la signature des marchés relatifs aux projets de construction des CRA de Dijon et de Dunkerque à l'année 2025, pour un montant total de 80 millions d'euros.
Évolution des autorisations d'engagement
d'investissement prévus et exécutés
dans les CRA, LRA
et zones d'attente entre 2018 et 2025
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Par ailleurs, les crédits effectivement exécutés (tant en CP qu'en AE) sont demeurés sur la période, la plupart du temps, inférieurs à ceux prévus annuellement.
Les travaux du rapporteur spécial ont mis en évidence que ce niveau de sous-consommation ne découle pas de restrictions budgétaires imposées en cours d'exécution annuelle, mais bien de difficultés concrètes à engager et à mener à terme les projets dans les délais ambitieux initialement annoncés, en dépit des efforts déployés.
b) Des enjeux d'effectifs
En second lieu, l'augmentation du nombre de places en CRA s'accompagne de besoins renforcés en effectifs, en particulier pour assurer la garde des établissements.
La gestion de 24 des 27 CRA qui incombait, en mai 2025, à la police nationale - et plus spécifiquement à la police aux frontières (PAF) - mobilisait 2 383 agents, dont 200 dans les CRA d'outre-mer. À ces effectifs s'ajoutaient ceux de la gendarmerie nationale, temporairement affectés94(*) à l'un des deux CRA de Lyon (pour 134 effectifs à la même date), ainsi que ceux de la préfecture de police pour les deux CRA situés à Paris, à savoir 33795(*). Au total, environ 2 850 personnels des forces de sécurité intérieure sont ainsi dédiés à la gestion des centres de rétention administrative.
Ces effectifs restent globalement insuffisants, avec des disparités notables selon les centres. Parmi les CRA métropolitains gérés par la PAF, quatre présentent un taux d'encadrement inférieur à 1,15 agent par place. Huit autres disposent d'un taux compris entre 1,25 et 1,45, tandis que les huit restants dépassent le seuil de 1,45 (certains allant au-delà de 2). Ces écarts s'expliquent par plusieurs facteurs : l'implantation géographique des centres (proximité des juridictions, aéroports ou consulats), la configuration des bâtiments (taille, niveau de sécurisation, circulation interne) ou encore leur capacité d'accueil, influant directement sur les économies d'échelle possibles. Un rééquilibrage apparaît néanmoins ponctuellement nécessaire, en particulier pour certains centres tels que Coquelles (taux d'encadrement de 1,09) ou Toulouse (1,04), qui fonctionnent aujourd'hui avec des marges très réduites.
En moyenne, le taux d'encadrement observé dans les CRA gérés par la PAF s'établit à 1,25, soit un niveau inférieur à la cible fixée nationalement, comprise entre 1,3 et 1,6 selon les sites. Sur cette base, il manquait environ 410 agents supplémentaires à l'échelle nationale pour atteindre les standards d'encadrement souhaités au 1er mai 202596(*).
Cette tension sur les effectifs n'a, comme le rapporteur spécial l'a constaté, que peu d'effet sur le nombre de places effectivement ouvertes à la rétention. Néanmoins, elle pèse fortement sur les conditions de travail des agents et limite les capacités d'escorte indispensables au bon déroulement de la rétention et de la procédure d'éloignement (présentations devant les consulats pour l'obtention de laissez-passer consulaires, escortes vers les juridictions et l'aéroport, ainsi que certaines escortes médicales non vitales97(*), etc.).
Dans ce contexte, l'extension à venir des capacités de rétention pose un défi certain en termes de ressources humaines, étant précisé que la reprise par la PAF de la garde du CRA n° 1 de Lyon à compter du 1er septembre 2025 nécessite à elle seule l'affectation de 140 policiers. Le plan d'extension des CRA à l'horizon 2027 prend en compte cette contrainte. Selon les données communiquées au rapporteur spécial, la PAF estime que 1 685 ETP supplémentaires seront nécessaires sur la période 2026-202798(*), répartis en 400 ETP en 2026 et 1 285 ETP en 2027, sous réserve que les travaux avancent selon le calendrier prévu d'ouverture des nouveaux CRA99(*).
Enfin, l'augmentation des capacités de rétention implique également un renforcement des effectifs de l'OFII. À ce titre, un besoin de 29 ETP supplémentaires a été identifié entre 2026 et 2028 (7 en 2026, 8 en 2027 et 14 en 2028).
2. ... mais qui doit l'être au plus tôt
Concrètement, deux phases du « plan CRA », selon la terminologie du ministère, sont mises en oeuvre concomitamment.
La première phase a ainsi consisté à partir de 2017 à étendre le parc de 1 488 places en 2017 à 1 959 places en métropole en 2024, l'année 2025 ne connaissant pas l'ouverture de nouvelles places. Cette première phase du plan est toujours en cours de mise en oeuvre pour ce qui concerne la création des CRA du Périchet et de Bordeaux et la reconstruction de l'un des deux CRA de Paris100(*).
La seconde phase du plan « CRA » vise quant à elle à porter la capacité du parc à 3 000 places en métropole. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial, il est désormais prévu d'atteindre ce niveau de capacités à l'horizon 2029, via l'ouverture de 8 nouveaux CRA, selon le séquençage suivant :
- en 2026 : ouverture des CRA de Bordeaux et Dunkerque (140 places chacun), portant la capacité à 2 239 places ;
- en 2027 : ouverture du CRA de Dijon (140 places), portant la capacité à 2 379 places ;
- en 2028 : ouverture des CRA de Nantes (140 places), Béziers (140 places), Oissel (140 places), et Périchet (64 places), portant la capacité à 2 863 places ;
- en 2029 : ouverture du CRA à Aix-en-Provence101(*) (140 places), portant la capacité à 3 003 places.
En outre, une réflexion est actuellement en cours pour répondre aux besoins en termes de capacité de rétention à Mayotte102(*). En parallèle, les capacités des LRA font l'objet d'une progression (la capacité a été portée à 176 places), bien que dans des proportions plus modestes, le temps de séjour ne pouvant dépasser quatre jours.
Prévision
de la chronique annuelle d'extension de la capacité du parc de CRA
en
métropole de 2025 à 2029
(en nombre de places)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses aux questionnaires du rapporteur spécial
Il convient néanmoins d'être prudent quant à l'atteinte des objectifs annuels fixés au regard des obstacles potentiels susmentionnés. Il est d'ailleurs attendu, en 2025, une sous-consommation des crédits initialement ouverts, en raison notamment d'un décalage temporel dans la notification des marchés du futur CRA de Dunkerque et de retards dans le planning de travaux du projet de CRA de Dijon, du fait de la découverte d'aléas103(*).
Dans ce contexte, le rapporteur spécial souligne qu'il est impératif, en cohérence avec les orientations portées par le ministère de l'Intérieur, que l'ensemble des leviers soient mobilisés pour garantir l'atteinte de l'objectif de 3 000 places en CRA à l'horizon 2029, un objectif déjà repoussé de deux ans par rapport à l'échéance initialement prévue.
Recommandation n° 3 : Garantir, d'ici 2029, l'atteinte de l'objectif de 3 000 places en centres de rétention administrative en métropole (ministère de l'Intérieur).
B. ...TOUT EN ASSURANT LA MAÎTRISE DES COÛTS ASSOCIÉS
L'augmentation des capacités de rétention administrative - et leur sécurisation - engendre, par nature, un coût financier. Ainsi, elle a conduit, dans les dernières années, à une progression des dépenses de fonctionnement et d'investissement afférentes. L'extension du nombre de places prévue pour l'avenir conduira aux mêmes effets, selon une intensité qu'il est nécessaire de maîtriser.
1. Un coût de la rétention administrative en hausse sur les dernières années
Bien qu'il soit complexe d'établir le coût complet de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, la Cour des comptes104(*) l'a récemment évalué à environ 1,8 milliard d'euros par an, en prenant en compte l'ensemble des moyens mobilisés par les différentes administrations concernées.
Au sein de cette enveloppe globale, la rétention administrative (hors coûts directement liés aux opérations d'éloignement) représente une part modeste. Elle recouvre un ensemble de dépenses hétérogènes réparties entre plusieurs missions budgétaires, et notamment les rémunérations des forces de l'ordre, relevant de la mission budgétaire « Sécurités », les dépenses juridictionnelles, portées par la mission « Justice », les crédits d'intervention (assistance sociale, juridique et sanitaire), de fonctionnement courant et d'investissement (rénovation, sécurisation ou construction de centres), imputés à la mission « Immigration, asile et intégration », et, enfin, les effectifs préfectoraux affectés à la gestion de l'éloignement, couverts par la mission « Administration générale et territoriale de l'État ».
En 2024, le coût direct annuel des centres de rétention administrative, incluant les dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention dans les centres (sanitaire, juridique, social), ainsi que les dépenses de personnel des forces de l'ordre, peut être estimé à environ 265 millions d'euros105(*). Cette somme n'inclut notamment pas le coût des personnels des préfectures ainsi que les dépenses liées à la Justice.
La charge budgétaire portée par la mission « Immigration, asile et intégration » est en progression depuis plusieurs années. Ainsi, les dépenses exécutées s'agissant des CRA sont passées de 33,4 millions d'euros en 2017 à 64,9 millions d'euros en 2024.
Évolution
des dépenses exécutées dans les CRA entre 2017 et
2024,
hors dépenses de personnel
(en CP, en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
Ce montant, s'est réparti en 2024 selon la décomposition suivante :
- 41,2 millions d'euros de dépenses de fonctionnement courant, principalement au titre des dépenses de fonctionnement hôtelier des CRA et de celles liées à l'entretien immobilier courant et à l'interprétariat106(*) ;
- 5 millions d'euros de dépenses d'investissement immobilier107(*) ;
- 11,5 millions d'euros au titre de l'accompagnement sanitaire, y compris psychologique, dans les CRA ;
- 7,3 millions d'euros au titre des dépenses d'accompagnement juridique et social, principalement l'assistance juridique dans les CRA effectuée par les associations.
Dépenses
liées aux CRA et assumées par la mission
« Immigration, asile et intégration » en
2024
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial
2. Une augmentation des capacités de rétention qui doit intégrer les préoccupations budgétaires
L'augmentation prévue de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative métropolitains de 1 959 places aujourd'hui à 3 000 places à l'horizon 2029 est de nature à rehausser tant les dépenses d'investissement que de fonctionnement, y compris de personnel.
En premier lieu, un effort doit être réalisé en matière d'investissement immobilier, qu'il s'agisse de construire de nouveaux CRA ou d'agrandir des structures existantes. Selon les éléments recueillis par le rapporteur spécial, la construction d'un CRA de référence de 140 places représente un coût d'environ 40 millions d'euros. À ce titre, le coût d'investissement global pluriannuel de l'extension du parc pourrait être estimé à environ 300 millions d'euros.
En deuxième lieu, l'augmentation du nombre de places engendrera une hausse annuelle des dépenses de fonctionnement. Sur la base des coûts actuels, un parc porté à 3 000 places représenterait environ 35 millions d'euros supplémentaires par an, hors dépenses de personnel.
Des solutions peuvent toutefois être envisagées pour limiter cette charge financière tout en favorisant l'accélération de la mise en oeuvre de l'extension du parc.
Tout d'abord, comme l'a récemment évoqué le ministre de l'Intérieur108(*), il serait pertinent de compléter la construction de nouveaux centres « en dur » par la mise en place d'installations modulaires, pérennes ou non, plus rapides à déployer et moins coûteuses. Ces modules pourraient être intégrés à certains CRA existants dont la capacité est inférieure à 140 places, lorsque la configuration le permet, ou implantés de manière autonome. Ils seraient notamment adaptés à l'accueil de personnes ne présentant pas de menace pour l'ordre public et dont l'éloignement est prévu à court terme. Ce format permettrait à la fois d'élargir rapidement les capacités de rétention et de maîtriser les dépenses d'investissement.
Recommandation n° 4 : Recourir, en complément de la construction de nouveaux centres, à des bâtiments modulaires adaptés à la rétention administrative, afin d'accélérer les déploiements et d'en limiter le coût (ministère de l'Intérieur).
Ensuite, afin de contenir l'ampleur de l'augmentation des effectifs de policiers actifs nécessaire à la gestion des futurs centres de rétention, une politique de substitution partielle pourrait être déployée. Davantage de missions pourraient ainsi être confiées à d'autres types de personnels, tels que des agents administratifs, des policiers adjoints, des réservistes, ou encore des agents contractuels.
Parallèlement, l'externalisation de tâches non régaliennes109(*), expérimentée dans le CRA de Palaiseau à compter de 2018 puis progressivement étendue (Lyon, Marseille, Nîmes, Toulouse, Lille, Coquelles et Paris), pourrait être approfondie. Le bilan de l'expérimentation fait en effet état d'un gain de 26 ETP pour les dix CRA concernés, dont 14 ETP pour les transports de retenus. Cette réforme implique de doter la mission « Immigration, asile et intégration » des crédits correspondants, qui viendront réduire ceux nécessaires à la mission « Sécurités » (policiers).
Recommandation n° 5 : Approfondir la politique de substitution des effectifs actifs de police affectés à la rétention administrative par des personnels administratifs, contractuels ou relevant du secteur privé, pour certaines missions précisément définies (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale).
Enfin, le rapporteur spécial estime, à la lumière de ses travaux, que le maintien d'un plafond de capacité par centre reste globalement pertinent. Il répond à plusieurs objectifs, en particulier favoriser une gestion apaisée des centres, garantir une mobilisation équilibrée des effectifs sur le territoire, mailler ce dernier, et respecter des délais de construction réalistes. Il considère, en revanche, qu'au regard du besoin d'augmentation des capacités de rétention, il convient de porter la capacité de centres plus nombreux à des niveaux proches de 140 places, a fortiori pour les centres en projet, selon un schéma architectural qui devra être standardisé afin de générer des économies d'échelle, notamment s'agissant des études. C'est la direction qui semble être prise pour les projets en cours.
II. RATIONALISER LE RECOURS À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE AU SERVICE D'UNE POLITIQUE D'ÉLOIGNEMENT EFFICIENTE
L'objectif final de la rétention administrative consiste à renforcer l'effectivité des mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière.
Toutefois, au regard des capacités d'accueil nécessairement limitées des CRA, de leur coût pour la collectivité et de leur caractère privatif de liberté pour les personnes concernées, il apparaît aujourd'hui que certaines opportunités ou procédures susceptibles de faciliter l'éloignement sans recourir à la rétention, ou en en limitant la durée, restent insuffisamment exploitées. C'est notamment le cas des personnes étrangères détenues, dont l'éloignement pourrait être mis en oeuvre plus systématiquement dès la sortie de prison, ou après une brève rétention. De même, le recours à la procédure d'aide au retour, qu'il s'agisse des détenus ou des retenus, demeure peu mobilisée alors qu'elle constitue un outil potentiellement efficace et économique.
Par ailleurs, le fonctionnement juridique et opérationnel de la rétention administrative pourrait être simplifié, afin d'en renforcer l'efficacité.
A. FAVORISER LES ÉLOIGNEMENTS À L'ISSUE D'UNE DÉTENTION ET MOBILISER LE LEVIER DE L'AIDE AU RETOUR
1. Accélérer l'éloignement des étrangers en situation irrégulière à l'issue de leur détention
Comme cela a été précisé110(*), la rétention administrative est un outil de privation de liberté dont l'objectif est de maintenir à disposition un étranger dépourvu de titre de séjour valide dans le but de préparer et d'exécuter son éloignement du territoire. Elle se distingue nettement de la détention pénale, qui constitue une sanction judiciaire prononcée à la suite d'un délit ou d'un crime.
Ces deux régimes, bien que juridiquement distincts, peuvent néanmoins se succéder. Un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation peut, à l'issue de sa peine, être placé en rétention administrative s'il ne dispose pas ou plus d'un droit au séjour. Néanmoins, dans l'idéal, l'éloignement devrait avoir lieu dès la fin de leur peine, ou après une brève rétention.
a) Les détenus en situation irrégulière, un public nombreux dont l'éloignement est prioritaire
La population carcérale de nationalité étrangère constitue un vivier significatif de personnes susceptibles d'être éloignées. Au 1er mai 2025, les personnes de nationalité étrangère représentaient 24,4 % de la population carcérale, dont 20,6 % hors Union européenne et Royaume-Uni. En outre, selon l'administration pénitentiaire, au 15 juin 2025, 36 % a minima des étrangers détenus étaient visés par une mesure d'éloignement, le plus souvent une interdiction judiciaire du territoire français (ITF)111(*).
En 2024, 27,2 % des personnes placées en rétention en métropole sortaient directement d'un établissement pénitentiaire112(*). Ces profils, souvent considérés comme représentant une menace à l'ordre public, justifient une attention particulière.
b) Des dysfonctionnements persistants dans l'articulation de la détention et de la rétention
Les travaux du rapporteur spécial ont mis en évidence, en dépit d'efforts réels, des difficultés persistantes dans la coordination et le partage d'informations (y compris parfois sur le signalement des détenus concernés par une mesure d'éloignement) entre les différents acteurs intervenant dans l'éloignement des étrangers sortants de prison et dépourvus d'un droit au séjour (services préfectoraux, police, administration pénitentiaire, magistrats).
D'une part, trop souvent, la période d'incarcération n'est pas pleinement utilisée pour préparer l'éloignement. Les démarches administratives essentielles (confirmation de l'identité113(*) et de la nationalité, obtention du laissez-passer consulaire) ne sont ainsi régulièrement, pour tout ou partie, engagées qu'à la sortie de prison, une fois le placement en rétention effectué. Cette situation réduit la probabilité d'un éloignement effectif dans les délais légaux applicables à la rétention.
D'autre part, lorsqu'un éloignement immédiat n'est pas possible, la personne devrait être placée sans délai en rétention. Or, dans certains cas, des défaillances entraînent une libération sans placement en rétention, obligeant ensuite les forces de police à retrouver la personne concernée, parfois sans succès. Ces défaillances sont liées à un manque de partage d'information sur la date de fin de peine (notamment en cas de réduction de peine décidée par le juge d'application des peines) et, parfois, à une réactivité insuffisante ou un manque de personnels des différents services lors des libérations imprévues ou tardives, notamment en soirée.
c) Des efforts engagés à renforcer
Face à cette situation, d'importants efforts de coordination ont été engagés, notamment dans le cadre de la circulaire du ministre de la Justice du 21 mars 2025 relative à la prise en charge des personnes détenues de nationalité étrangère définitivement condamnées et de l'instruction du ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2024 portant renforcement du pilotage de la politique migratoire114(*).
Ces initiatives, qui vont dans le bon sens, nécessitent une mise en oeuvre approfondie qui devra permettre de répondre à plusieurs nécessités :
- identifier systématiquement les personnes étrangères détenues dépourvues de titre de séjour valable, afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont ils font l'objet ou, à défaut, de pouvoir en prendre une ;
- réaliser les formalités nécessaires à l'éloignement de ces personnes immédiatement ou rapidement après la période de détention ;
- renforcer le partage d'information si possible « en temps réel » entre les services pénitentiaires, préfectoraux, judiciaires et de police, notamment via une meilleure interopérabilité des systèmes d'information ;
- prévoir une organisation des services de l'Etat permettant une réactivité opérationnelle renforcée, y compris en horaires décalés, afin d'assurer la prise en charge immédiate des personnes détenues dont la libération n'avait pas été anticipée et dont le placement en rétention est prioritaire.
Recommandation n° 6 : Favoriser l'éloignement rapide des étrangers détenus en situation irrégulière, si possible sans avoir à les placer en rétention, en anticipant les démarches nécessaires en amont de la fin de peine et en assurant une meilleure coordination entre services compétents (ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice).
2. Mobiliser le levier de l'aide au retour pour les étrangers retenus ou détenus
L'aide au retour volontaire s'adresse notamment aux étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
Elle constitue une alternative à l'éloignement contraint, en permettant aux personnes éligibles115(*) de retourner volontairement dans leur pays d'origine, avec un accompagnement logistique (organisation du trajet) et financier (versement d'un pécule). La gestion de ce dispositif est confiée à l'OFII, qui instruit les demandes, organise les retours et en assure le financement.
Ce mécanisme présente de nombreux atouts. Bien moins coûteux pour l'État qu'un éloignement forcé, il s'accompagne en général d'une meilleure coopération de la personne concernée, et permet parfois d'éviter un passage en rétention administrative. En outre, il permet de contourner les freins posés par certains pays quant à la réadmission de personnes faisant l'objet d'un éloignement forcé, puisque le retour est ici volontaire. Pourtant, si la France met effectivement en oeuvre un nombre conséquent de retours forcés, elle fait encore un usage relativement limité des retours aidés, même si leur nombre a nettement augmenté en 2024.
Depuis 2019, l'aide au retour volontaire est accessible aux personnes placées en rétention administrative. L'objectif visé est de favoriser un éloignement effectif et rapide, tout en raccourcissant la durée de rétention et en allégeant la pression sur les places disponibles. En 2024, 188 personnes retenues ont bénéficié de ce dispositif, un chiffre en hausse, mais encore nettement inférieur à l'objectif annuel fixé à 300 bénéficiaires.
Évolution du nombre de bénéficiaires en CRA de l'aide au retour
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de l'OFII au questionnaire du rapporteur spécial
Plusieurs pistes mériteraient d'être explorées pour renforcer l'impact du dispositif. Tout d'abord, une solution devra être trouvée pour contourner les blocages spécifiques à certains États. Ainsi, depuis 2021, l'Algérie n'autorise plus le système de virement via Western Union, ce qui rend inopérante la remise du pécule aux ressortissants algériens, pourtant les plus nombreux en CRA. Il apparaît nécessaire de trouver rapidement une solution pratique à cette difficulté.
Ensuite, selon les informations recueillies par le rapporteur spécial, l'OFII prévoit désormais de proposer de façon plus volontariste l'aide au retour aux personnes détenues116(*), en prévision de leur libération. Cette évolution pourrait représenter une avancée importante en permettant d'anticiper l'éloignement, d'éviter un passage par la rétention administrative, et de réduire les coûts associés, tout en contournant les éventuels freins posés par les pays de réadmission. Elle suppose néanmoins de donner les moyens humains à l'OFII d'y parvenir. En tout état de cause, l'aide au retour devra être déployée dans des conditions de nature à permettre un retour effectivement pérenne dans le pays d'origine.
Recommandation n° 7 : Mobiliser davantage le levier de l'aide au retour volontaire pour les personnes détenues et retenues, afin de renforcer l'efficacité et de réduire le coût des éloignements (ministère de l'Intérieur).
B. AMÉLIORER LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE POUR EN RENFORCER L'EFFICACITÉ
Les conditions juridiques et matérielles de mise en oeuvre de la rétention administrative sont aujourd'hui, pour partie, sources de difficultés pratiques, d'une tension sur les services de l'Etat et leurs effectifs, ainsi que d'une moindre effectivité des éloignements. Plusieurs mesures permettraient pourtant de juguler ces problèmes, dans le respect plein et entier des droits des personnes retenues.
1. Donner aux forces de police les moyens pour assurer leurs missions en matière de rétention administrative
La mise en oeuvre concrète de la rétention administrative repose, en pratique, sur les forces de sécurité intérieure, principalement les effectifs de la police aux frontières (PAF). L'exercice de leurs missions, y compris en matière d'éloignement, se heurte aujourd'hui à plusieurs difficultés qui en limitent l'efficacité.
a) Répondre aux enjeux de ressources humaines et de formation
La garde des personnes retenues dans les CRA ne constitue pas une mission traditionnelle de la police nationale. Elle s'apparente davantage, dans ses modalités quotidiennes, à celle des surveillants pénitentiaires, bien que le cadre juridique de la rétention administrative diffère fortement de celui de la détention117(*). En outre, elle présente, en particulier depuis le ciblage de la rétention sur les personnes menaçant l'ordre public à compter de 2022, un caractère potentiellement difficile et parfois conflictuel.
Dans ce contexte, le faible attrait des postes en CRA conduit à des affectations de policiers en sortie d'école, souvent jeunes et peu expérimentés, ce qui complique leur prise de fonction. Le rapporteur spécial observe, en outre, que le cursus de formation initiale des gardiens de la paix n'intègre à ce jour une formation à la rétention administrative que pour les élèves affectés dans des postes de la filière « police aux frontières », et sur une durée réduite.
Compte tenu de l'augmentation continue des capacités d'accueil et du nombre de centres, il apparaît nécessaire d'adapter la formation initiale et continue de la police nationale à ces enjeux, d'optimiser les conditions d'affectation, et de mieux intégrer cette mission dans les parcours professionnels.
Recommandation n° 8 : Adapter la formation des policiers à la gestion de la rétention et valoriser les affectations en CRA dans les parcours de carrière, afin de mieux accompagner la place croissante de cette mission au sein de la police nationale (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale)
b) Mettre à disposition des services de police des outils favorables à la bonne gestion des centres de rétention
La bonne gestion des centres de rétention administrative par les forces de sécurité intérieure suppose que ces dernières disposent des moyens matériels et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans un triple objectif d'effectivité de l'éloignement, de sécurité et d'apaisement.
D'une part, le renforcement des conditions de sécurité dans les CRA constitue un levier essentiel de facilitation du travail des policiers. Les travaux de sécurisation des locaux engagés ces dernières années (vidéosurveillance, grillages anti-drones, sécurisation des accès, etc.) ont permis de réduire certains risques opérationnels. Parallèlement, l'armement individuel des policiers affectés en CRA a été progressivement adapté à l'évolution du profil des retenus, de plus en plus souvent identifiés comme représentant une menace pour l'ordre public.
Le rapporteur spécial souligne également les avancées législatives récentes118(*), permettant aux agents de procéder à la prise d'empreintes digitales sans le consentement des personnes retenues. Cette évolution est de nature à renforcer l'efficacité des procédures d'éloignement, en facilitant l'identification formelle des intéressés et, partant, à donner un sens à la mission de rétention confiée aux forces de police. D'autres ajustements de cette nature mériteraient d'être envisagés119(*).
D'autre part, les efforts déployés par les forces de police en matière d'apaisement au sein des centres doivent être soulignés, et ce dans un contexte difficile. En effet, les tensions constatées sont en hausse. Entre 2023 et 2024, le nombre d'incidents signalés en métropole a augmenté de 8 %, principalement en raison de violences entre retenus. Ces faits demeurent une source constante de préoccupation pour les personnels.
Ventilation des incidents constatés en 2024 dans les CRA métropolitains
(en nombre et en pourcentage)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial
Les visites réalisées par le rapporteur spécial ont permis d'identifier plusieurs initiatives favorables à une gestion apaisée des centres. Il en va notamment ainsi de la mise en place d'activités occupationnelles encadrées (séances de sport, accès collectif aux téléphones portables, mise à disposition de livres), de la désignation d'agents dits « CAEL120(*) » (policiers en civil121(*) chargés notamment d'informer les retenus et de désamorcer les tensions), ou encore de la présence ponctuelle de professionnels de santé mentale, psychologues ou psychiatres. Ces dispositifs, bien qu'hétérogènes selon les centres, participent à une meilleure qualité de la vie collective au sein des CRA et mériteraient d'être déployés de manière plus systématique à l'échelle nationale. Pour les personnes retenues provenant de la détention, une meilleure transmission, entre services compétents, des informations disponibles doit en outre être assurée, y compris du point de vue comportemental et en matière de suivi médical.
Enfin, si le rapporteur spécial n'a constaté, au cours de ses visites, aucune situation de dégradation notable ou de traitement indigne dans les CRA observés, il souligne l'importance de maintenir ce niveau d'exigence en matière de conditions matérielles, tant pour le respect des droits fondamentaux des personnes retenues que pour l'efficacité et la sérénité du travail des agents.
2. Simplifier les procédures juridiques et juridictionnelles applicables à la rétention administrative
Les procédures juridiques et juridictionnelles prévues en matière de rétention administrative apparaissent, aux yeux de l'ensemble des acteurs impliqués, nombreuses et complexes. Elles font intervenir à la fois le juge administratif et le juge judiciaire.
Le juge administratif est compétent, d'une part, pour examiner les recours portant sur la mesure administrative d'éloignement (par exemple, l'OQTF122(*)), qui fonde la décision de placement en rétention123(*) et dont l'annulation a pour effet d'y mettre fin, et d'autre part, pour statuer dans le cas spécifique du maintien en rétention d'une personne ayant formulé une demande d'asile durant sa période de rétention et dont l'autorité administrative estime qu'elle n'est formulée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Pour sa part, le juge judiciaire, acteur juridictionnel central de la rétention en tant que gardien de la liberté individuelle124(*), est compétent pour apprécier, en cas de recours, la légalité de la décision de placement en rétention et, le cas échéant, pour décider du maintien en rétention à la demande de l'administration, si les conditions prévues sont réunies125(*). Il est, en outre, compétent pour statuer sur les recours des personnes retenues concernant la légalité de leur maintien en rétention. Il peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, le cas échéant en l'assignant à résidence.
Cette dualité de compétences, qui ne se retrouve pas dans certains pays voisins, se double d'un enchevêtrement procédural complexe, notamment en termes de délais et d'articulation entre les différentes voies de recours. Ce cadre juridique et institutionnel se révèle en pratique difficilement soutenable, à mesure que le volume des contentieux augmente. Les juridictions judiciaires et administratives sont ainsi aujourd'hui confrontées à une surcharge structurelle, que leurs effectifs ne permettent pas d'absorber pleinement.
Évolution du nombre de recours
présentés devant les tribunaux administratifs
en
matière d'éloignements entre 2017 et 2025126(*)
Note : la projection 2025 est calculée par la commission des finances sur la base du nombre de recours présentés sur les cinq premiers mois de l'année 2025, à savoir 28 441.
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Conseil d'Etat au questionnaire du rapporteur spécial
Cette situation génère une forte tension pour l'ensemble des services concernés (juridictions, services préfectoraux chargés d'assurer la défense des décisions, services de police en charge des escortes, etc.). Elle nuit par ailleurs à la lisibilité et à l'efficacité de la politique d'éloignement.
Pour y remédier, plusieurs pistes de simplification peuvent être envisagées, dans le respect des droits des personnes retenues.
Premièrement, une simplification des modalités légales du prolongement de la rétention administrative au-delà de quatre jours par le juge judiciaire apparaissait nécessaires. Elle a été très récemment engagée par la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, qui a réduit de quatre à trois le nombre d'ordonnances nécessaires pour porter la rétention à 90 jours, tout en simplifiant les conditions.
Afin d'améliorer encore l'efficacité du dispositif, le rapporteur spécial recommande de fusionner les deuxième et troisième prolongations, permettant au juge d'étendre directement la durée de rétention de 30 à 90 jours lorsque les conditions légales sont réunies.
Recommandation n° 9 : Ramener de trois à deux le nombre de décisions du juge judiciaire nécessaires pour porter la durée de rétention administrative à 90 jours (pouvoir législatif).
Deuxièmement, le développement du recours à la visioconférence, prévu par la loi CIAI127(*), doit être accéléré, dans des conditions garantissant la qualité des échanges et le respect des droits de la défense. Cette modalité permettrait d'éviter des déplacements chronophages et coûteux des magistrats, des avocats, des retenus et des escortes de policiers. À ce jour, seules quelques salles d'audience adaptées existent au sein ou à proximité immédiate de certains CRA (notamment Le Mesnil-Amelot, Coquelles, Marseille et Olivet), tandis que quelques autres centres expérimentent la visioconférence sans salle dédiée. Le rapporteur spécial recommande, partout où cela est possible, la création rapide de salles dédiées à la vidéo-audience, en veillant à la qualité technique du dispositif (son, image, confidentialité) plutôt qu'à l'aménagement d'espaces pouvant accueillir un public nombreux, ce dernier étant rarement présent.
Recommandation n° 10 : Accélérer la généralisation du recours à la vidéo-audience pour les contentieux de la rétention administrative, dans des conditions garantissant la qualité des échanges (ministère de la Justice, juridictions administratives, ministère de l'Intérieur).
Troisièmement, la question de l'assistance juridique apportée aux personnes retenues appelle une clarification. Conformément au droit applicable, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ128(*). Plus précisément, l'article R. 744-20 du CESEDA dispose que « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »
Si cette mission a pendant longtemps été assurée par la seule CIMADE, plusieurs associations interviennent depuis 2008, dans le cadre de marchés conclus avec l'Etat129(*). Les prestations réalisées, qui vont bien au-delà de la simple information, incluent un accompagnement juridique complet (aide à la constitution de dossiers, rédaction de recours, orientation vers des avocats, etc.). En 2025, cinq associations exercent leurs missions dans les 27 CRA, une seule association étant présente dans chacun des CRA.
Associations titulaires des marchés d'assistance juridique
Source : commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat130(*)
Tout en soulignant l'engagement avec lequel les associations remplissent leurs fonctions, le rapporteur spécial identifie plusieurs limites inhérentes au dispositif actuel, mis en place par l'État :
- un positionnement parfois très critique des associations vis-à-vis de la politique d'éloignement, qui sous-tend pourtant le marché public qui leur est confié ;
- une participation, dans certains cas, à une forte intensité contentieuse, en lien avec le caractère très fréquent des recours engagés ;
- une hétérogénéité des pratiques constatées dans les différents centres, reflétant la diversité des approches portées par les différentes structures ;
- un coût budgétaire redondant, l'État finançant à la fois l'assistance juridique assurée par les associations et l'aide juridictionnelle délivrée pour le recours à un avocat pour défendre les mêmes recours.
En cohérence avec la proposition de loi qu'il a déposée et qui a été récemment adoptée par le Sénat en première lecture, le rapporteur spécial propose une évolution du dispositif. S'il aurait été possible de confier la mission d'assistance juridique à l'OFII, le texte adopté en première lecture prévoit qu'à compter du 1er janvier 2026131(*), l'information des personnes retenues sur l'accès au droit et les voies de recours serait effectuée par cet organisme132(*), déjà présent dans les CRA, tandis que la défense des personnes retenues (conseil sur l'opportunité d'un recours, présentation de recours, présence à l'audience) serait confiée aux avocats133(*). Le texte rappelle par ailleurs que les personnes retenues bénéficient du droit d'être assisté par un avocat, éventuellement commis d'office, et de l'aide juridictionnelle.
Cette réforme n'aurait pas pour conséquence de priver les associations de l'accès aux CRA. En effet, les représentants des associations humanitaires peuvent bénéficier d'un droit de visite, en application de l'article L. 744-14 du CESEDA, de même que le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), les parlementaires, les représentants du haut-commissariat aux réfugiés et les journalistes.
Les droits des personnes retenues
Conformément au CESEDA, les personnes placées en rétention administrative bénéficient d'un ensemble de droits destinés à garantir leur information, leur dignité et l'exercice effectif des voies de recours.
À leur arrivée dans le centre, elles sont informées, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'elles comprennent, de leurs droits. Un document d'information, rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, leur est remis. Il expose les modalités de la procédure d'éloignement, les droits qui leur sont reconnus durant la rétention, ainsi que les modalités concrètes de leur exercice.
Les étrangers retenus peuvent notamment solliciter l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin. Ils peuvent également entrer en contact avec leur consulat et communiquer avec toute personne de leur choix.
Ils sont par ailleurs informés, à leur arrivée, des conditions d'exercice du droit d'asile. À ce titre, ils peuvent recevoir une assistance juridique et linguistique.
Les entretiens avec les avocats se déroulent de manière confidentielle, dans des locaux aménagés à cet effet.
Durant leur séjour en centre de rétention, les personnes retenues sont hébergées et nourries à titre gratuit. Elles peuvent accéder, si elles en font la demande, aux soins médicaux, fournis gratuitement.
Enfin, le responsable du centre informe chaque retenu des prévisions de déplacement le concernant (audiences, présentations consulaires, modalités de départ, etc.), sauf si cette information est de nature à compromettre l'ordre public ou si l'état psychologique de la personne ne le permet pas.
Source : commission des finances
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence de M. Stéphane Sautarel, vice-président, la commission a entendu une communication de Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial, sur l'exentsion de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative.
M. Stéphane Sautarel, président. - Nous allons entendre maintenant une communication de Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial de la mission « Immigration, asile et intégration », sur l'extension de la capacité d'accueil des centres de rétention administrative (CRA).
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial. - Lorsque j'ai choisi, il y a quelques mois, de consacrer mon contrôle budgétaire à la rétention administrative, j'avais pleinement conscience de la sensibilité du sujet. La rétention touche en effet à la fois aux libertés individuelles, à la politique migratoire et à la sécurité publique.
Tout au long de ce travail, j'ai donc veillé à adopter une approche rigoureuse, tant dans l'analyse des données disponibles, que lors des auditions et des déplacements sur le terrain.
C'est sur cette base que j'ai déposé, il y a quelques mois, la proposition de loi relative à l'information et l'assistance juridiques en rétention administrative et en zone d'attente, et que je vous présente aujourd'hui les conclusions de mon rapport.
Je commencerai par rappeler ce qu'est la rétention administrative. Il s'agit d'un lieu fermé, gardé par des policiers, où l'autorité administrative - en pratique, le préfet - peut placer, pour une durée maximale de 90 jours, et 180 jours pour les profils terroristes, des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. La rétention administrative ne vise pas à punir. Elle a pour seule finalité de maintenir l'étranger à disposition afin de permettre son éloignement, sur la base le plus souvent d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Comme vous le savez, la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, dans sa version adoptée par le Parlement, prévoyait de porter la durée maximale de rétention de 90 à 180 jours pour un certain nombre de profils dangereux, mais le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Je le regrette, d'autant que je rappelle que le droit européen prévoit une durée maximale de rétention de droit commun de 6 mois, pouvant même être portée à 18 mois dans certains cas. L'effectivité des éloignements en pâtira.
En 2024, un peu plus de 30 000 personnes ont été placées dans un centre de rétention, dont plus de 16 000 en métropole. Quelque 96 % de ces personnes étaient des hommes, et plus de la moitié provenaient du Maghreb - 32 % d'Algérie, 12 % de Tunisie et 11 % du Maroc. Dans les outre-mer, les ressortissants comoriens représentent une part prépondérante, du fait de l'activité soutenue du centre de Mayotte.
J'en viens à mes principaux constats.
Le premier est le plus central. Il est factuel : la rétention administrative est l'outil le plus efficace pour exécuter les décisions d'éloignement.
Certes, le taux d'éloignement à l'issue d'une rétention reste encore insuffisant. En 2024, environ 54 % des personnes placées en rétention ont effectivement été éloignées ; pour la seule métropole, le taux est de 39 %. Ce chiffre s'améliore par rapport à 2023, mais il demeure trop faible.
La moitié de l'ensemble des éloignements forcés exécutés en 2024 ont toutefois eu lieu après une rétention et ce, alors même que seule une très faible proportion des étrangers en situation irrégulière et visés par une mesure d'éloignement sont placés en rétention.
La rétention administrative s'impose donc comme l'outil le plus efficace de la politique d'éloignement, même si des marges de progrès subsistent pour en renforcer l'efficacité.
Mon deuxième constat porte sur l'évolution profonde du profil des personnes retenues. Depuis 2022, la rétention n'est plus décidée seulement en fonction du risque de fuite et de la probabilité d'un éloignement rapide : elle tient désormais compte de la menace que représente l'étranger retenu pour l'ordre public.
Cette évolution a profondément modifié la rétention administrative. En métropole, les profils relevant de la catégorie des « troubles à l'ordre public » représentaient 86 % des personnes retenues en CRA en 2024, contre seulement 7,3 % en 2021.
Ce changement a eu des effets structurels. D'une part, il a contribué, parallèlement à d'autres facteurs, à l'allongement de la durée moyenne de rétention, passée de 17,5 jours en 2019 à 34,5 jours en 2024. Cela s'explique par le fait que cibler les profils les plus problématiques peut conduire à placer en rétention des personnes plus difficilement éloignables, notamment du fait de leur nationalité ou de leur parcours criminel. D'autre part, ce ciblage a nécessité une sécurisation accrue des centres et a augmenté la pression sur les policiers chargés de la surveillance.
Pour autant, je crois que ce choix est le bon. Dans un contexte où les capacités de rétention sont limitées, il est sage de placer en priorité les personnes les plus problématiques, afin qu'elles quittent effectivement le territoire et qu'elles ne puissent pas, entre-temps, troubler gravement l'ordre public. En outre, ce recentrage ne s'est pas traduit par une chute du taux d'éloignement. Ce dernier est resté proche de celui constaté avant 2022 et repart même à la hausse depuis 2024.
Mon troisième constat a trait à la saturation persistante des capacités d'accueil.
La France dispose aujourd'hui de 27 centres de rétention, représentant un total de 2 187 places théoriques, soit environ 80 places par centre en moyenne. La capacité en métropole a progressé d'environ un tiers depuis 2017, et le taux d'occupation est aujourd'hui de 92,3 %, un niveau très élevé.
En dépit de ces améliorations, le parc demeure insuffisant. Plus de 3 600 demandes de placement en rétention formulées par les préfets ont ainsi été refusées en 2024, faute de place, sans compter celles qui n'ont même pas été déposées pour cette même raison. L'État se voit donc contraint de réserver la rétention aux situations les plus problématiques, alors même qu'elle est l'outil le plus sûr pour exécuter les éloignements.
Sur la base de ces constats et dans le cadre actuel applicable à la politique migratoire, je propose plusieurs axes d'amélioration.
Il faut d'abord étendre les capacités. La loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur avait fixé l'objectif de 3 000 places en CRA, initialement pour 2027. Compte tenu des obstacles fonciers et immobiliers, cet objectif a été décalé à 2029, avec l'ouverture échelonnée de 8 nouveaux centres. C'est un investissement non négligeable mais nécessaire, de l'ordre d'environ 300 millions d'euros d'ici à 2029, selon mes calculs, auxquels s'ajouteront 35 millions d'euros par an pour le fonctionnement une fois les 3 000 places disponibles, hors effectifs de police.
Pour contenir ce coût et accélérer la montée en charge, je préconise un recours accru aux installations modulaires, moins chères et plus rapides à déployer, à la substitution de certaines missions de policiers actifs par des personnels administratifs ou réservistes, et à une externalisation plus large des tâches non régaliennes, afin de concentrer les policiers sur la surveillance et les escortes.
Mais augmenter les capacités ne suffit pas, il faut aussi améliorer l'efficacité de chaque placement. Cela passe d'abord par une identification plus rapide et plus fiable des personnes retenues. L'absence de documents d'identité, leur destruction par les personnes ou l'usage d'alias freinent en effet les procédures. La très récente loi du 11 août 2025 a permis, sous conditions, le relevé d'empreintes et la prise de photographies sans consentement. C'est un progrès, mais nous devons aller plus loin en donnant aux services les moyens d'investigation nécessaires - y compris, sous contrôle du juge, l'exploitation des données téléphoniques - et en améliorant l'interopérabilité de leurs systèmes d'information.
Il est également nécessaire de lever les blocages liés à la délivrance des laissez-passer consulaires (LPC), notamment avec certains pays du Maghreb. L'obtention des LPC doit à ce titre constituer un objectif assumé de la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays étrangers, y compris dans la politique d'attribution de visas, de titres de séjour et d'aide au développement.
Sur le plan opérationnel, les demandes de laissez-passer auprès des consulats doivent être davantage centralisées auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, dont l'efficacité a été démontrée pour les pays déjà concernés.
Il est par ailleurs nécessaire de simplifier les procédures juridictionnelles. Aujourd'hui, le juge judiciaire doit intervenir trois fois pour porter la rétention à 90 jours - c'était quatre avant la loi du 11 août 2025. Je propose de réduire ce nombre à deux, pour autoriser, quand les conditions sont réunies, une prolongation directe de 30 à 90 jours. Le recours à la visioconférence doit également être généralisé pour limiter les déplacements coûteux et chronophages des retenus, des magistrats et des escortes de police.
Il est également temps de réformer les modalités de l'assistance juridique des retenus, aujourd'hui confiée par l'État à des associations dans le cadre de marchés publics. Ce système présente de graves limites, parmi lesquelles une tendance à des recours systématiques de nature à emboliser encore davantage la justice, l'hétérogénéité des pratiques entre associations et entre centres, un coût redondant avec l'aide juridictionnelle, et parfois même des positions militantes. Je recommande, conformément à la proposition de loi que j'ai déposée et que le Sénat a adoptée il y a quelques mois, de confier l'information juridique à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), déjà présent en CRA, tout en maintenant bien sûr le droit au recours à un avocat et le droit de visite des associations humanitaires.
Il convient en outre de donner aux policiers les moyens d'assurer leurs missions en centre de rétention. Cela passera par une hausse des effectifs pour accompagner l'augmentation des capacités des centres, mais également par une meilleure formation et une plus grande valorisation des affectations en CRA dans leur carrière.
Un enjeu majeur réside enfin dans notre capacité à anticiper les éloignements pour éviter des rétentions longues et coûteuses.
En 2024, 27 % des placements concernaient des sortants de prison. Or trop souvent, les démarches de fiabilisation de l'identification des personnes et de demande de LPC ne sont engagées qu'à la libération de prison, réduisant les chances d'éloignement dans les délais légaux de la rétention. Ces démarches doivent impérativement être engagées dès la période de détention, tandis que doit être organisé un partage d'informations fluide entre préfecture, police aux frontières, administration pénitentiaire et magistrats, afin que l'éloignement puisse intervenir immédiatement après la détention ou après une rétention courte.
Par ailleurs, l'aide au retour volontaire doit être davantage proposée et utilisée en rétention administrative et en détention. Elle coûte moins cher qu'un éloignement forcé et peut éviter certains blocages consulaires, ce qui renforcerait l'efficacité des éloignements.
En conclusion, la rétention administrative n'est pas parfaite, mais elle demeure de loin le moyen le plus efficace de faire appliquer les décisions d'éloignement dans un contexte où un certain nombre de personnes refusent de s'y conformer spontanément. Mes recommandations sont donc d'augmenter les capacités, de simplifier les procédures et de rendre le dispositif plus performant pour concilier effectivité des décisions d'éloignement de l'État, protection de l'ordre public et respect des droits des personnes retenues.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les recommandations formulées par notre collègue visent notamment à rationaliser les procédures, à éviter d'emboliser la justice et à maîtriser les coûts, ce qui doit être un objectif pour de nombreuses politiques publiques. Je la remercie de l'objectivité et de la sérénité avec lesquelles elle a présenté ses conclusions. Celles-ci rendent possible une discussion apaisée sur ce sujet qui fait souvent l'objet de polémiques.
Mme Nathalie Goulet. - Je remercie notre rapporteur spécial pour le choix courageux de ce sujet de contrôle et pour la sérénité avec laquelle elle a mené ses travaux. Sans doute faudra-t-il que les rapporteurs spéciaux des différents contrôles budgétaires travaillent ensemble à la traduction budgétaire des actions de renforcement de la coordination entre les différents services, car certaines actions pâtissent de la structuration du budget en missions budgétaires.
Mme Christine Lavarde. - Je remercie à mon tour le rapporteur. Dans quelle mesure les coûts qu'emportera l'augmentation des capacités d'accueil des CRA, et de manière générale, les coûts afférents à l'immigration irrégulière, pourraient-ils être réduits par une politique plus affirmée d'aide au départ volontaire ?
M. Pascal Savoldelli. - S'il est utile, ce contrôle m'interroge sur son champ, qui me semble aller bien au-delà des simples questions budgétaires - comme le précédent contrôle que l'on a examiné ce matin - et correspond à un sujet qui me paraît toutefois limité par les positions politiques, notamment de notre rapporteur, qui n'a du reste pas caché que ce travail s'inscrivait dans la continuité de sa proposition de loi. Bien que le présent rapport n'aborde pas cette question, vous êtes par exemple nombreux à souhaiter que le délai de rétention soit porté de 90 à 180 jours, mes chers collègues.
Je tiens par ailleurs à pointer la contradiction entre les recommandations nos 5 et 8, et sur le fond, j'estime que la gestion de la rétention doit relever exclusivement des forces de police, car l'entrée de personnels privés dans de tels lieux me paraît impensable.
De même qu'il avait voté contre la proposition de loi du rapporteur spécial, mon groupe votera contre ce rapport.
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial. - Le coût de la rétention étant notable, il nous faudra voir ce qui est effectivement proposé dans les prochains projets de loi de finances. Je tiens par ailleurs à signaler qu'au-delà des sujets budgétaires et des freins immobiliers, l'augmentation du nombre de places présente des implications en termes de ressources humaines. Des effectifs manquent d'ores et déjà au sein des CRA, et nous aurons besoin d'environ 1 700 agents supplémentaires d'ici à 2027, selon mes informations.
Par ailleurs, des expérimentations sont actuellement menées au sein de plusieurs CRA afin d'évaluer les conditions dans lesquelles des missions non régaliennes peuvent être confiées à des agents qui ne sont pas des policiers. Les résultats sont concluants. Cela permettra de limiter le besoin en effectifs, tout en laissant aux policiers les missions principales dans les CRA.
Les missions qu'emporte la rétention étant par ailleurs très différentes de celles qui leur sont traditionnellement confiées sur la voie publique, les forces de police doivent être davantage accompagnées en termes de formation, tandis que leur passage en CRA doit être mieux valorisé dans leur carrière. Il n'y a donc pas de contradiction entre les recommandations nos 5 et 8, mon cher collègue.
En outre, il faut effectivement encourager les départs aidés, aussi bien en détention qu'en rétention. Une telle politique présente des avantages notamment du point de vue du coût - la rétention coûte beaucoup plus cher que l'éloignement aidé - et de celui de l'éloignement lui-même. En effet, lorsque le départ est volontaire, la coopération du pays dont l'étranger est ressortissant pour l'attribution d'un LPC n'est pas nécessaire. En outre, les départs aidés peuvent permettre à des étrangers de retrouver une vie normale dans leur pays d'origine, même si le risque existe que certains d'entre eux utilisent une partie de l'aide financière qui leur est versée pour revenir illégalement sur notre territoire. Il faut trouver un bon équilibre, notamment dans le montant versé.
Il faudra par ailleurs en effet intégrer le budget de la police aux frontières dans la prise en compte du budget global des CRA lors de l'examen des projets de loi de finances. Je salue au passage le travail que vous avez réalisé avec Rémi Féraud sur la délivrance des visas, ma chère collègue Nathalie Goulet.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - J'estime qu'il convient sans doute de préciser la rédaction de la recommandation n° 5, en précisant qu'il s'agit plutôt « d'appuyer » les effectifs actifs de police pour certaines missions « non régaliennes », plutôt qu'en assurer la substitution. Nous nous prémunirions ainsi contre toute erreur d'interprétation.
M. Jean-Raymond Hugonet. - Je souhaitais intervenir dans le même sens.
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial. - Je suggère d'ajouter « précisément définies » après « certaines missions ». En revanche, l'autre correction que vous proposez ne me paraît pas opportune, car elle irait dans le sens d'une inflation des effectifs.
Il en est ainsi décidé.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial ainsi modifiées et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ministère de l'Intérieur - Direction générale des étrangers en France (DGEF)
- M. Frédéric JORAM, directeur de l'immigration ;
- M. Cyriaque BAYLE, sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière ;
- M. Richard MIR, chef du bureau de la rétention et de l'éloignement.
Ministère de l'Intérieur - Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)
- M. Guillaume GALLOUIN, directeur national adjoint de la police aux frontières.
Ministère de l'Intérieur - Secrétariat général
- M. Pierre CHAVY, directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier.
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
- M. Cyrille BAUMGARTNER, ambassadeur thématique chargé des migrations.
Ministère de la Justice - Direction de l'administration pénitentiaire (DAP)
- M. Emmanuel RAZOUS, directeur adjoint de l'administration pénitentiaire ;
- M. Alan PIERRE, chef de projet « Quali'Greffes ».
Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII)
- M. Didier LESCHI, directeur général.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
- M. André FERRAGNE, secrétaire général ;
- Mme Yanne POULIQUEN, contrôleure déléguée à la communication.
Cour des comptes
- M. Emmanuel GLIMET, président de section à la 4e chambre, conseiller-maître ;
- M. Luca VERGALLO, co-rapporteur, conseiller référendaire à la 4e chambre ;
- Mme Rébecca ASSOULINE-BÉRA, co-rapporteure, auditrice à la 4e chambre.
Conseil national des barreaux
- Mme Anne-Sophie LEPINARD, présidente de la commission « Accès au droit et à la Justice » et membre de la commission « Libertés et droit de l'Homme » ;
- Mme Laurence ROQUES, référente de la commission « Libertés et droits de l'Homme » sur les sujets de droit des étrangers.
Table-ronde d'associations
La Cimade
- Mme Fanélie CARREY-CONTE, secrétaire générale ;
- Mme Justine GIRARD, responsable nationale rétention.
Sos Solidarités
- Mme Chantal MIR, directrice générale ;
- Mme Céline GUYOT, directrice juridique - droit des étrangers.
Forum Réfugiés
- M. Sylvestre WOZNIAK, directeur général ;
- M. Laurent DELBOS, adjoint de direction de l'asile et du plaidoyer.
France Terre d'Asile
- M. Vincent BEAUGRAND, directeur général ;
- M. Guillaume LANDRY, directeur de l'appui juridique.
Table-ronde des syndicats de magistrats
Union syndicale des magistrats (USM)
- M. Aurélien MARTINI, secrétaire général adjoint.
Union syndicale des magistrats administratifs (USMA)
- M. Hervé COZIC, secrétaire général adjoint.
Syndicat de la juridiction administrative (SJA)
- M. Virgile NEHRING, secrétaire général ;
- Mme Tiphaine RENVOISE, secrétaire générale adjointe.
*
* *
- Contributions écrites -
Ministère de la Justice
Conseil d'État
Direction générale de la gendarmerie nationale
Préfecture de police de Paris
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot (7 avril 2025)
- M. Stéphane COSSIAUX, chef du service interdépartemental de la police aux frontières ;
- Mme Françoise NORMAND, commandant divisionnaire, cheffe du CRA n° 2 ;
- Mme Nathalie TINARD, cheffe du bureau de l'OFII ;
- M. Adrien CHIMM, responsable du service rétention, France Terre d'Asile.
Centre de rétention administrative de Coquelles (9 mai 2025)
- M. Laurent SIMONIN, directeur interdépartemental de la police nationale ;
- M. Fabrice MOLLET, chef du service interdépartemental de la police aux frontières ;
- M. Gérald LEFEBVRE, commandant, chef du CRA ;
- M. Adrien CHIMM, responsable du service rétention, France Terre d'Asile.
Centres de rétention administrative de Paris (20 juin 2025)
- M. Nicolas RALLIERES, sous-directeur adjoint de la lutte contre l'immigration irrégulière (SDLII) de la préfecture de police de Paris ;
- M. Bertrand BORDUS, commandant divisionnaire fonctionnel, chef des CRA ;
- M. André GENTEUIL, directeur territorial de l'OFII.
Préfecture du Val-de-Marne (20 juin 2025)
- M. Étienne STOSKOPF, préfet ;
- M. Emmanuel DUPUIS, directeur de cabinet ;
- M. Ludovic GUILLAUME, secrétaire général.
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (15 septembre 2025)
- M. Christophe DEBARBIEUX, chef d'établissement ;
- M. Yvan BARON, adjoint au chef d'établissement.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents |
Ministère de l'Intérieur |
Le plus rapidement possible |
Toutes modalités, dont les processus administratifs |
|
2 |
Centraliser, pour un plus grand nombre de pays, les demandes de laissez-passer consulaires auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de simplifier et d'accélérer la procédure |
Ministère de l'Intérieur |
Dès 2025 |
Organisation administrative |
|
3 |
Garantir, d'ici 2029, l'atteinte de l'objectif de 3 000 places en centres de rétention administrative en métropole |
Ministère de l'Intérieur |
Mise en oeuvre immédiate |
Projets de loi de finances et pilotage immobilier |
|
4 |
Recourir, en complément de la construction de nouveaux centres, à des bâtiments modulaires adaptés à la rétention administrative, afin d'accélérer les déploiements et d'en limiter le coût |
Ministère de l'Intérieur |
Dès que possible |
Projets immobiliers et cadre réglementaire |
|
5 |
Approfondir la politique de substitution des effectifs actifs de police affectés à la rétention administrative par des personnels administratifs, contractuels ou relevant du secteur privé, pour certaines missions précisément définies |
Ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale |
Dès que possible |
Politique de ressources humaines |
|
6 |
Favoriser l'éloignement rapide des étrangers détenus en situation irrégulière, si possible sans avoir à les placer en rétention, en anticipant les démarches nécessaires en amont de la fin de peine et en assurant une meilleure coordination entre services compétents |
Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice |
Dès aujourd'hui |
Procédures et protocoles administratifs |
|
7 |
Mobiliser davantage le levier de l'aide au retour volontaire pour les personnes détenues et retenues, afin de renforcer l'efficacité et de réduire le coût des éloignements |
Ministère de l'Intérieur |
Dès 2025 |
Procédure administrative |
|
8 |
Adapter la formation des policiers à la gestion de la rétention et valoriser les affectations en CRA dans les parcours de carrière, afin de mieux accompagner la place croissante de cette mission au sein de la police nationale |
Ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale |
Dès que possible |
Politique de ressources humaines |
|
9 |
Ramener de trois à deux le nombre de décisions du juge judiciaire nécessaires pour porter la durée de rétention administrative à 90 jours |
Pouvoir législatif |
Dès que possible |
Texte de loi |
|
10 |
Accélérer la généralisation du recours à la vidéo-audience pour les contentieux de la rétention administrative, dans des conditions garantissant la qualité des échanges |
Ministère de la Justice, juridictions administratives, ministère de l'Intérieur |
Dès que possible |
Modalité d'organisation du travail juridictionnel |
* 1 Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
* 2 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
* 3 Le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit en outre de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.
* 4 Voir infra.
* 5 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
* 6 Sans compter les dépenses des préfectures et celles de la Justice.
* 7 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
* 8 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
* 9 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 10 Voir supra.
* 11 Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
* 12 Article L. 751-10 du CESEDA.
* 13 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
* 14 Articles 15 à 18.
* 15 À savoir, essentiellement le laissez-passer consulaire, voir infra.
* 16 Les zones d'attente n'ont ainsi pas vocation à être traitées par le présent rapport.
* 17 Voir infra.
* 18 Les citoyens européens et les membres de leur famille sont soumis à des dispositions spécifiques, qui autorisent leur placement en rétention dans le seul cas où ils font l'objet d'une OQTF ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français (article L. 23-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).
* 19 Respectivement arrêté préfectoral d'expulsion et arrêté ministériel d'expulsion.
* 20 Voir supra.
* 21 En application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
* 22 En vertu de l'article 6 de la directive 2008/115 susmentionnée.
* 23 Ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-546/19 « BZ / Westerwaldkreis » du 3 juin 2021, « lorsqu'un État membre est confronté à un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur son territoire et ne dispose pas ou ne dispose plus de titre de séjour valide, cet État membre doit déterminer, en application des dispositions pertinentes, s'il y a lieu de délivrer à ce ressortissant un nouveau titre de séjour. Si tel n'est pas le cas, l'État membre concerné est tenu d'adopter à l'égard dudit ressortissant une décision de retour (...) ».
* 24 Source : réponses du secrétariat général du ministère de l'Intérieur au questionnaire du rapporteur spécial.
* 25 Les départements prononçant le plus de mesures d'éloignement en 2024 sont la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, les Hauts-de-Seine, le Nord, le Val-d'Oise, la Guyane et le Val-de-Marne.
* 26 Dont le prononcé est lui-même soumis à un certain nombre de conditions, notamment de nationalité et d'âge.
* 27 En particulier pour les arrêtés ministériels d'expulsion, voir infra.
* 28 Sauf, dans certains cas, pour le demandeur d'asile. Voir infra.
* 29 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Auparavant, un mineur pouvait, dans des conditions limitatives, être placé en rétention lorsqu'il y accompagnait un étranger majeur.
* 30 La loi CIAI prévoyait une entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2027, date repoussée au 1er juillet 2028 par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
* 31 Notamment, alternativement : l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou de son titre de séjour ; l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document, etc.
* 32 Consistant à limiter les déplacements dans un périmètre géographique fixé par le préfet, et à contraindre à des obligations de pointage et, le cas échéant, de présence à domicile.
* 33 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Voir infra pour une présentation des principaux apports de cette loi issue de la proposition de loi n° 298 de Jacqueline Eustache-Brinio, déposée au Sénat le 3 février 2025.
* 34 La loi CIAI avait prolongé ce délai de 48 heures à quatre jours. La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 précitée a transformé ce délai de quatre jours en un délai de quatre-vingt-seize-heures.
* 35 Qui statue dans un délai de quarante-huit heures.
* 36 Lorsque la personne est retenue au sein d'un local de rétention administrative (LRA), elle doit être transférée dans un centre de rétention administrative (CRA) au plus tard dans ce même délai.
* 37 Voir supra.
* 38 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
* 39 Voir infra.
* 40 Ce recul constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu'il faudra rapidement corriger.
* 41 Proposition de loi n° 298 de Jacqueline Eustache-Brinio, déposée au Sénat le 3 février 2025.
* 42 Au motif que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre l'exigence constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, en particulier la liberté individuelle. Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
* 43 Voir supra.
* 44 Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
* 45 La décision conduit en outre indirectement à empêcher le maintien en rétention des profils terroristes au-delà de 180 jours, jusqu'à 210 jours, voir supra.
* 46 Arrêté conjoint des ministre chargés des affaires sociales, de l'immigration, de l'intérieur et de la justice.
* 47 Voire infra.
* 48 Notamment en l'absence de CRA à proximité ou par manque de places.
* 49 Sauf durant le temps d'appel contre cette décision.
* 50 S'y ajoutent les personnes qui ont quitté le territoire sans que l'administration n'en ait connaissance, parfois après y être entré dans les mêmes conditions, notamment en se rendant dans un autre pays de l'espace Schengen.
* 51 Ce niveau très faible s'explique par le fait qu'un demandeur de l'aide au retour doit faire l'objet a minima, depuis l'arrêté du 9 octobre 2023 réformant l'aide au retour, d'une OQTF afin de bénéficier de l'aide de l'OFII.
* 52 Sauf, éventuellement, dans le cas où la personne retenue recourt à l'aide au retour, désormais proposée en rétention administrative, voir infra.
* 53 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_eirtn1/default/table?lang=en
* 54 Source : réponses de la DGEF au questionnaires du rapporteur spécial.
* 55 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 56 Instruction du 3 août 2022 du ministre de l'Intérieur relative aux mesures nécessaires pour améliorer la chaîne de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l'ordre public, complétée par celle du 17 novembre 2022 sur l'exécution des OQTF et le renforcement des capacités de rétention.
* 57 Voir supra.
* 58 Voir infra.
* 59 Source : documents budgétaires de la mission « Immigration, asile et intégration ».
* 60 Hors profils terroristes, voir supra.
* 61 Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
* 62 En vertu de l'article 15 de la directive 2008/115 dite « directive retour », voir supra.
* 63 Voir infra.
* 64 Source : réponse de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial.
* 65 Dont 16 222 en métropole et 13 893 dans les outre-mer, voir supra.
* 66 Une seule personne éloignée était inscrite au FSPRT et aucun individu au profil terroriste n'a été éloigné.
* 67 Notamment l'unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières (PAF) à l'échelle nationale mais également les services généraux de la PAF ou de la police nationale, la gendarmerie ou tout agent de l'Etat spécialement habilité à cet effet par la préfecture.
* 68 Selon la Cour des comptes : La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, janvier 2024.
* 69 Voir supra.
* 70 Voir supra.
* 71 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 72 26 pays et un territoire situé en Chine : Albanie, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Cap-Vert, République populaire de Chine et Hong-Kong, Union des Comores, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Géorgie, Guinée-Conakry, Haïti, Inde, Mali, Mauritanie, Moldavie, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Côte d'Ivoire, Kosovo, Sénégal et Soudan.
* 73 Information du 9 janvier 2019 de la direction générale des étrangers en France (DGEF) relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.
* 74 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 75 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 76 Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
* 77 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 78 Voir supra.
* 79 Pour le CRA actuel de Bordeaux.
* 80 Pour les CRA de Lyon.
* 81 Voir supra.
* 82 À Choisy-le-Roi.
* 83 La caserne Auvare.
* 84 Voir supra.
* 85 Incluant notamment la mise en place d'un outil d'évaluation des CRA et le déplacement d'une équipe d'évaluation dans tous les centres de métropole, la rédaction d'un « RAIDBOOK » en partenariat avec les antennes locales du RAID pour tous les centres métropolitains, l'acquisition de gants de palpation à détection magnétique, la révision de la doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique (PIE) pour adapter son port en zone de rétention, le floutage des images aériennes par les sites web de géolocalisation relevant du droit national, la généralisation des cellules d'appui à l'éloignement (CAEL), et l'expérimentation de la vidéo augmentée.
* 86 Qui ne peut être utilisée avec un smartphone.
* 87 Voir supra.
* 88 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
* 89 Via l'adoption d'un amendement des députés Éric Ciotti et Philippe Gosselin en faveur de l'extension des capacités de rétention administrative.
* 90 Dans le cadre de la circulaire du 3 août 2022 visant la poursuite de l'exécution du plan de renforcement des capacités de rétention administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé à l'ensemble des préfets de zone de diversifier les lieux de placement en développant les capacités de LRA d'au moins un tiers de celles existantes. À ce titre, 66 places supplémentaires en LRA ont été programmées en 2024.
* 91 Hors hypothèse d'une très forte mobilisation de l'outil - dont la mise en place est envisagée pour l'avenir - des bâtiments modulaires, cf. infra. Un développement de cette ampleur d'infrastructures modulaires ne semble néanmoins pas prévu à ce jour, selon les informations recueillies par le rapporteur spécial.
* 92 La granularité budgétaire ne permet pas d'isoler les dépenses d'investissement prévues et exécutées en faveur des seuls CRA. Cependant, ces derniers représentent la majorité des dépenses d'investissement dans les CRA, LRA et zones d'attente.
* 93 Rapport annuel de performances de la mission « Immigration, asile et intégration », annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024.
* 94 Jusqu'au 1er septembre 2025. Voir infra.
* 95 Au 1er juillet 2025, selon la réponse de la préfecture de police au questionnaire du rapporteur spécial.
* 96 Source : réponses de la direction nationale de la police aux frontières au questionnaire du rapporteur spécial.
* 97 Du type d'une visite nécessaire chez le dentiste.
* 98 Ce nombre n'inclut pas les 410 agents manquants au 1er mai 2025 pour atteindre le taux d'encadrement cible, voir supra.
* 99 Voir infra.
* 100 Le foncier nécessaire n'ayant pas été identifié pour ce qui concerne le projet prévu à Nice.
* 101 Dans le quartier de Luynes.
* 102 Le rapport annexé à la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte prévoit la création d'un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026.
* 103 Pollution du terrain.
* 104 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.
* 105 Dont environ 200 millions d'euros au titre des dépenses de personnel, contributions aux pensions comprises (environ 169 millions d'euros pour la police aux frontières, 22,5 millions d'euros pour la préfecture de police et environ 9 millions d'euros pour la gendarmerie nationale).
* 106 Dans le cadre notamment de marchés d'interprétariat physique ou téléphonique et de la délivrance des laissez-passer consulaires.
* 107 Couvrant l'investissement immobilier des CRA, LRA et zones d'attente (travaux d'extension du parc et de sécurisation en raison des nouveaux profils des retenus).
* 108 « Créer des CRA modulaires, moins chers, permettrait de développer notre capacité d'accueil » : Déclaration de M. Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les résultats de la politique d'éloignement des personnes sous obligation de quitter le territoire français, à l'Assemblée nationale le 11 juin 2025.
* 109 Notamment pour la conduite des véhicules de transfert, l'accueil des visiteurs, la gestion de la bagagerie, la sécurité incendie ou encore l'assistance aux personnes.
* 110 Voir supra.
* 111 Source : réponses de la direction de l'administration pénitentiaire au questionnaire du rapporteur spécial.
* 112 Source : réponses de la direction nationale de la police aux frontières au questionnaire du rapporteur spécial.
* 113 La condamnation pénale ne nécessite pas de déterminer l'identité exacte de la personne, seule la certitude de sanctionner la bonne personne étant nécessaire. En revanche, l'éloignement nécessite cette identification exacte.
* 114 Ou encore de l'instruction interministérielle du 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, et de la circulaire de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 115 L'aide est octroyée à la condition principale que son bénéficiaire, résidant en France depuis au moins 3 mois, retourne dans son pays d'origine de manière volontaire. D'autres conditions s'y ajoutent, notamment s'agissant des pays éligibles.
* 116 Le droit applicable le permettant.
* 117 Voir supra.
* 118 Loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.
* 119 Voir supra.
* 120 À savoir, « cellule d'appui à l'éloignement ».
* 121 Mais portant un insigne de police.
* 122 Et les décisions qui lui sont accessoires : pays de destination, délai de départ volontaire éventuel, décision d'interdiction de retour, etc.
* 123 La personne placée en rétention administrative peut formuler un recours contre la décision d'éloignement la justifiant dans un délai de 48 heures.
* 124 Article 66 de la Constitution.
* 125 Voir supra.
* 126 Le contentieux de l'éloignement est plus large que celui de la rétention administrative. Plus globalement, en 2024, 43 % des affaires présentées devant les tribunaux administratifs concernaient le contentieux des étrangers, contre 25 % en 2009.
* 127 Tel que l'article L. 922-3 du CESEDA le prévoit aujourd'hui.
* 128 Article L. 744-9 du CESEDA.
* 129 Actuellement, un marché national regroupant 21 lots géographiques, trois marchés nationaux distincts concernant trois CRA et un marché local pour le CRA de Mayotte.
* 130 Rapport n° 593 (2024-2025), déposé le 7 mai 2025, de David Margueritte sur la proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues.
* 131 1er avril 2027 à Mayotte.
* 132 Schématiquement, les agents de l'OFII auraient pour mission d'assister les retenus pour leur expliquer le sens et la portée des décisions dont ils font l'objet, leur rappeler leurs droits et la manière de les exercer et les aider à obtenir l'aide d'un avocat s'ils le souhaitent.
* 133 L'assistance juridique applicable dans la cadre d'une demande d'asile formée en rétention serait en revanche confiée à l'OFII.