La Cinquième République au Parlement
Sénat, 15 mai 2008 - Palais du Luxembourg
Disponible au format Acrobat (477 Koctets)
-
SÉANCE DU MATIN
-
L'ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS
-
M. Adrien GOUTEYRON, Sénateur de la Haute-Loire.-
-
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président.-
-
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
-
INTERVENANTS
-
M. Pierre MAZEAUD, ancien Président du Conseil constitutionnel
-
M. Bastien FRANÇOIS, Professeur à l'Université de Paris I - La place de l'Assemblée nationale dans l'évolution de la Ve République
-
M. Alain DELCAMP, Secrétaire général du Sénat, vice-Président de l'Association Française des Constitutionnalistes - La place du Sénat dans l'évolution de la Ve République
-
M. Claude ESTIER, ancien Président du groupe socialiste du Sénat
-
M. Nicolas ROUSSELLIER, Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris
-
M. Mathias BERNARD, Professeur à l'Université de Clermont II - Les forces politiques au Parlement
-
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président.-
-
M. Jean GARRIGUES, Président du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique.-
-
M. Pierre MAZEAUD, ancien Président du Conseil constitutionnel
-
M. Adrien GOUTEYRON, Sénateur de la Haute-Loire.-
-
SÉANCE DE L'APRES-MIDI
-
LE PARLEMENT DANS LA Ve RÉPUBLIQUE
-
PREMIÈRE TABLE RONDE :
LE PARLEMENT, MIROIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
-
DEUXIÈME TABLE RONDE :
QUELLE PLACE POUR LE PARLEMENT DANS LA VIE POLITIQUE ?
-
M. Edouard BALLADUR, Président.-
-
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
-
M. Roger KAROUTCHI, Secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement.-
-
M. Jean-François KAHN, journaliste.-
-
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, Sénatrice de Paris.-
-
M. Jean GICQUEL, Professeur émérite à l'Université de Paris I.-
-
M. Guy CARCASSONNE, Professeur à l'Université de Paris X et à l'Institut d'études politiques de Paris.-
-
M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur de la Seine-et-Marne, Président de la Commission des lois du Sénat.-
-
M. Edouard BALLADUR, Président.-
-
PREMIÈRE TABLE RONDE :
LES COLLOQUES DU SÉNAT
Sous le Haut patronage de Christian Poncelet,
Président du Sénat
« LA V e RÉPUBLIQUE AU PARLEMENT »
Jeudi 15 mai 2008
PALAIS DU LUXEMBOURG
Journée d'études organisée au Sénat en partenariat avec
le Comité d'Histoire Parlementaire et Politique
SÉANCE DU MATIN
La séance est ouverte à 9 heures 30.
Présidence de M. Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, Sénateur de la Vienne.
L'ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS
M. Adrien GOUTEYRON, Sénateur de la Haute-Loire.-
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous accueillir au nom du Président du Sénat, qui m'a demandé de lire en son nom un texte et de vous tenir quelques propos d'accueil, ce que je fais avec beaucoup de plaisir.
Je salue toutes les personnes qui sont à la tribune : M. le Président Mazeaud, MM. les Professeurs, M. le Président du Comité d'histoire parlementaire et politique, M. le Secrétaire général du Sénat et vous tous qui êtes ici présents.
Ce colloque est donc consacré à la V e République au Parlement et il est organisé en partenariat avec le Comité d'histoire parlementaire et politique. En cette année du cinquantième anniversaire de notre Constitution, j'aimerais rappeler ce qu'a représenté la naissance, en 1958, d'un nouveau Sénat, celui de la V e République. Ce fut le renouveau d'un bicamérisme d'équilibre. En effet, s'inscrivant dans le droit fil de la tradition bicamérale française, le Sénat de la V e République représente un élément de sagesse et de réflexion dans un édifice constitutionnel solide, certes, mais que les évolutions rapides d'opinion à l'Assemblée nationale ne mettent pas totalement à l'abri de l'instabilité.
Le général de Gaulle lui-même l'avait souligné dans son discours de Bayeux en écrivant : « Le premier mouvement d'une assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entières. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée, élue et composée d'une autre manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets. »
Le Sénat, depuis 1958, assume d'autant mieux cette fonction stabilisatrice qu'il est issu d'un corps électoral lui-même stable et confronté chaque jour aux réalités du terrain. Les Sénateurs, renouvelés par tiers jusqu'en 2003, puis par moitié, disposent d'un mandat dont la durée, un peu plus longue que celle des Députés, leur assure à la fois le recul face aux contingences de l'instant et le temps de la réflexion pour l'avenir.
Cette singularité peut naturellement conduire le Sénat à se distinguer de la majorité de l'Assemblée nationale, quitte à assumer peu ou prou une fonction d'opposition. Cependant, loin des modèles binaires, cette singularité se manifeste texte par texte, contrôle après contrôle, sans jamais se réduire à une opposition systématique et en se plaçant en maintes occasions sur un terrain constructif. Cette attitude expose la seconde chambre à des critiques cela a toujours été le cas et cela le reste et maints gouvernements, depuis 1958, ont tenté de l'infléchir, y compris par une dilution.
Pour autant, stabilité ne doit pas signifier stagnation, et équilibre n'est pas synonyme d'immobilisme. Non seulement le Sénat a évolué dans son statut électoral, son recrutement sociologique et sa composition politique depuis 1958, mais il a aussi su s'adapter aux évolutions sociales, administratives et technologiques considérables de la société depuis cinquante ans : l'urbanisation croissante de la population, la décentralisation administrative, la prise de responsabilité des acteurs locaux, l'irruption de questions et de solutions nouvelles dans des pans entiers des rapports individuels et collectifs (informatique, bioéthique ou organismes génétiquement modifiés, comme nous l'avons vu hier encore).
Du coup, le Sénat de 2008 est aujourd'hui bien différent de celui de 1958. Sans rien renier des principes fondateurs qui en justifient l'existence, la deuxième chambre s'est graduellement adaptée aux réalités de son temps. Elle s'est féminisée, a accru la part de scrutin proportionnel dans son mode d'élection, a abaissé son âge d'éligibilité, a réduit la durée de son mandat et a valorisé des formes plus modernes de l'action parlementaire, en particulier la fonction de contrôle qui, selon le Président Poncelet, est devenue une seconde nature.
Pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs, d'avoir centré cette intervention, à la demande du Président du Sénat, sur l'évolution sénatoriale au cours des cinquante dernières années, mais on ne parle bien que de ce que l'on connaît !
Je vais maintenant céder la parole à des universitaires et des personnalités politiques diverses et éminentes qui pourront vous faire partager, avec leur esprit critique, leurs analyses et leur expérience.
Pour terminer, je salue M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui vient de nous rejoindre.
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président.-
Merci, M. le Président Gouteyron.
Mesdames et Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir m'excuser de mon retard. Je suis rentré cette nuit d'Israël, où je représentais le Président Sarkozy aux commémorations du 60 e anniversaire de la création de cet état, ce qui m'a valu ces quelques minutes de retard.
Je tiens à vous dire combien les propos du Président Gouteyron sont importants pour nous, ici, au Sénat, puisque nous sommes très heureux que vous ayez choisi la Haute assemblée pour tenir ce colloque sur la V e République au Parlement.
Je salue toutes les personnalités qui participent à cette réflexion si importante en ce moment, puisque nous préparons une réforme institutionnelle. Il est essentiel d'avoir un éclairage né d'une réflexion partagée.
Pour que nous poursuivions cette réflexion, je laisse la parole à M. Jean-Marie Mayeur, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne, que je remercie de bien vouloir être le modérateur de cette table ronde ce matin.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Je vous remercie, M. le Président et tiens à adresser un double remerciement. Au Sénat tout d'abord, qui nous accueille pour ce colloque. Combien de fois certains d'entre nous ont-ils participé à des colloques au Sénat qui a toujours manifesté une très grande ouverture vis-à-vis des historiens ?
Mon deuxième remerciement va au Comité d'histoire politique et parlementaire (CHPP), institution qui a été fondée il y a cinq ou six ans par de jeunes collègues qui ont su marquer rapidement leur autorité. Le nombre de participants, jeunes en particulier, à ce colloque me paraît significatif. Le souci de M. Garrigues et de ses collègues et amis a été double : donner une place nouvelle non seulement à l'histoire politique, mais aussi à l'histoire parlementaire, plutôt négligée par les historiens pendant un certain nombre d'années, et, d'autre part, comme le montrent les intervenants de cette matinée, associer dans des réflexions convergentes des hommes politiques, des politistes, des juristes, des fonctionnaires des assemblées et, évidemment, des historiens.
Mon rôle sera celui de modérateur, un terme qui peut susciter quelques interrogations. Je serai fondamentalement un modérateur du temps, parce que nous aurons de nombreuses et riches interventions et qu'elles ne devront pas, si possible, dépasser une vingtaine de minutes. Vous m'excuserez de le dire avec un peu de sévérité. D'autre part, je me permettrai à l'occasion quelques réflexions en allant d'un orateur à l'autre tout au long de cette matinée.
Je donne tout de suite la parole à M. Pierre Mazeaud, l'ancien Président du Conseil constitutionnel, en le remerciant de sa présence à cette table ronde.
INTERVENANTS
M. Pierre MAZEAUD, ancien Président du Conseil constitutionnel
Je vous remercie, M. le Modérateur, en commençant par vous dire tout de suite que je ne dépasserai pas les vingt minutes que vous venez de nous impartir. Vous me permettrez cependant, sans allonger mon propos, de remercier le Sénat et les organisateurs de cette réunion. Je suis particulièrement touché d'être ici, encore qu'entouré de tels éminents juristes, j'espère que la jeunesse ici présente sera suffisamment indulgente en entendant mes propos. Je tiens effectivement à saluer les personnalités présentes, les Sénateurs eux-mêmes ainsi que mon ami Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, de même que tous les universitaires que je connais de longue date et avec lesquels je me suis souvent entretenu sur les questions dont on m'a chargé de vous dire quelques mots.
On m'a demandé effectivement de parler des conditions qui ont amené à la Constitution de 1958 et également de dire quelles ont été les modifications profondes qui y ont été apportées depuis son origine. Ces modifications n'ont pas toutes la même signification. Certes, il y en a de profondes et de lourdes sur lesquelles je m'arrêterai. En revanche, un certain nombre de modifications secondaires ne justifient pas une longue discussion.
Je commencerai par un point qui n'est pas toujours très connu. En réalité, la Constitution de 1958 remonte à une réflexion de Michel Debré pendant la guerre, pendant sa période de Résistance. En 1943, il écrivit un livre sous le nom de Jacquier-Bruère, son nom de Résistance, dans lequel, critiquant la III e République, il donnait les axes de ce qu'il considérait comme devant être une future Constitution. Tout en étant attaché au régime parlementaire, il voulait déjà, en 1943, un régime de parlementarisme rationalisé, en montrant bien les distinctions entre l'exécutif et le législatif, chacun devant, au travers des institutions futures, avoir ses propres prérogatives.
Michel Debré a joué un rôle tout à fait exceptionnel dans l'élaboration de cette Constitution de 1958, mais je tiens à souligner que ce sont d'abord ces réflexions de 1943, le livre n'étant sorti qu'en 1944, reprises par le Conseil national de la Résistance, qui vont former l'ossature de ce que sera la Constitution de 1958.
C'est d'autant plus vrai qu'au lendemain de la IV e République, c'est-à-dire de la Constitution de 1946, contre laquelle le général de Gaulle s'était effectivement élevé sans que les Français le suivent, celui-ci, dans deux grands discours qui sont toujours cités, celui de Bayeux suivi de celui d'Epinal, avait repris presque mot à mot les dispositions écrites par Michel Debré dans ce petit livre que j'ai rappelé tout à l'heure. En réalité, il s'agit là des éléments essentiels de nos futures institutions : celles de la Constitution de 1958.
Pourquoi modifier nos institutions ? Pourquoi Michel Debré et, par la suite, le général de Gaulle ont-ils insisté sur cette nécessité ? Parce que le souvenir de la III e République et la période que l'on vivait au cours de la IV e montraient qu'il était nécessaire de clarifier les choses. Le nombre de gouvernements et l'impossibilité à trouver une majorité solide du fait du mode de scrutin étaient autant d'éléments justifiant que la Constitution de 1946 soit changée.
C'est ce qui se fera, vous le savez, avec la chute de la IV e République, l'affaire algérienne, l'arrivée du général et son désir premier manifesté de modifier les institutions. Il avait d'ailleurs demandé au Parlement, devant lequel il s'était présenté, les moyens nécessaires pour modifier en tout premier lieu les institutions, c'est-à-dire revenir à ce qu'il avait toujours pensé, de même que l'équipe qui l'entourait, en particulier Michel Debré, dont il fera le garde des Sceaux et qu'il chargera de la nouvelle Constitution de 1958.
Michel Debré a mené cela rondement, si vous me permettez cette expression. Il a réuni un comité d'experts, un comité consultatif, et, en quelques mois, fin août 1958, la question sera pratiquement réglée au travers de discussions très sérieuses dont nous avons naturellement tous les éléments et dans lesquelles s'entremêlaient les positions des gens de gauche comme de droite, puisque, dans ce comité consultatif, il y avait des personnes éminentes de gauche, comme Guy Mollet, et des gens éminents de droite, tous entourés d'un très grand nombre de collaborateurs, notamment de jeunes du Conseil d'Etat, M. Janot, du Conseil d'Etat, étant lui-même le secrétaire général de ce comité consultatif.
Comme vous le savez, la Constitution de 1958 sera proclamée par le peuple à la suite d'un vote, le 4 octobre 1958. Nous allons bientôt fêter son cinquantenaire : il y aura des manifestations dans notre pays, aussi bien au Parlement français qu'à l'Institut, voire à la Fondation de Gaulle que j'ai l'honneur de présider.
Cette Constitution est donc votée très largement par les électrices et les électeurs français. Je vous rappelle que les femmes c'était évidemment le souhait du général de Gaulle depuis 1945 ont pu voter cette Constitution de 1958. Il y a eu alors une très large majorité et cela a permis à la France, même si on la critique beaucoup aujourd'hui et si l'on veut encore la changer, d'avoir une Constitution qui a su résister à des moments particulièrement difficiles. Je pense à l'affaire algérienne, dont je dirai un mot tout à l'heure, et, bien sûr, aux troubles de 1968.
Cette Constitution, encore une fois, a fait ses preuves. Bien sûr, j'en suis un ardent défenseur et, ayant fait partie du Comité Balladur en tant que vice-Président, je me suis opposé à un certain nombre de modifications. Nous verrons ce qu'il en est à la suite du débat parlementaire actuel.
Dans cette Constitution, nous retrouvons les grandes idées, partagées par le général, du Colbert français, c'est-à-dire de Michel Debré. Nourri de la réflexion anglo-saxonne et du modèle parlementaire, lui qui a condamné les dérives des III e et IV e Républiques, il a quand même maintenu un système parlementaire, mais, comme il le dira, un « système parlementaire rationalisé ».
A cet égard vous me permettrez cette incursion, Messieurs les Sénateurs, même si vous allez avoir à en débattre d'ici peu j'ai bien peur qu'on nous propose la suppression de cette rationalisation, à laquelle Michel Debré tenait tout particulièrement, et en particulier la restriction de l'article 49.3 de la Constitution, alors que, comme nous venons de le voir à l'occasion du vote de la loi sur les OGM, le 49.3 aurait réglé un certain nombre de problèmes.
De même, quand on revient sur les articles 34 et 37, qui sont l'essentiel de la Constitution de 1958 pour Michel Debré, je réponds que chacun doit avoir son métier : au pouvoir exécutif le règlement, au pouvoir législatif la loi. Lorsqu'on veut revenir sur ce point, on touche profondément à l'analyse fondamentale de la Constitution de 1958, du général et de Michel Debré. Par là-même, on enlèverait à la Constitution sa véritable souplesse, Michel Debré ayant toujours parlé de deux lectures possibles de la Constitution, ce qui revenait à montrer qu'elle avait une certaine souplesse qui a toujours été sa marque notamment lors des périodes de cohabitation, marquées par une différence politique entre le Président de la République, élu du peuple avec la plus forte légitimité, et le gouvernement, dans la mesure où il répond à l'élection je ne dirai pas secondaire du Parlement et, plus particulièrement, de l'Assemblée nationale. Or la Constitution a été faite pour répondre à deux situations qui paraissent totalement antagonistes. Pourtant, je suis de ceux qui considèrent que, malgré la cohabitation et avec celle-ci, la Constitution de 1958 a bien fonctionné.
Cette Constitution n'en a pas moins été modifiée, et je me permettrai de dire qu'à mon sens, elle l'a été trop souvent. Je prie M. le Premier ministre de m'excuser de revenir tout à l'heure sur les modifications de la décentralisation, les articles 72 et suivants. Certes, je ne m'arrêterai pas sur des modifications secondaires. Je souhaite simplement vous signaler des modifications lourdes qui ont été apportées à la Constitution de 1958.
Je ne suis pas, par nature, tellement favorable aux modifications constitutionnelles, comme j'ai eu l'occasion de le dire souvent. Cela ne veut pas dire que je sois conservateur au point de dire que l'on ne doit jamais la modifier. Même si elle est inscrite dans le marbre et même si c'est la loi suprême, il n'en demeure pas moins vrai que les circonstances et certaines évolutions dans le pays doivent conduire les responsables politiques à proposer et faire voter un certain nombre de modifications. La société évolue, elle change et il est nécessaire, même dans nos institutions, d'en tenir compte et de traduire ces mêmes évolutions.
La première grande modification, la plus lourde, est celle de novembre 1962 : l'élection du Président de la République au suffrage universel. Désormais, cette élection est inscrite dans nos moeurs et il est bien évident que l'on ne la remettra jamais en cause. J'allais presque dire que les Français y prennent goût. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre de suffrages exprimés lors de cette élection. Cela ne m'empêche pas de dire, même dans cette enceinte, que j'ai toujours été sceptique sur ce point et qu'envoyé par Michel Debré auprès du général de Gaulle pour lui dire ce que pouvait penser la jeunesse, j'avais fait part de certaines observations au général, qui m'avait tout simplement répondu : « Mon cher petit Mazeaud, c'est décidé ! »... (Sourires.)
Je n'y ai jamais été tout à fait favorable, je dois le reconnaître, car je n'hésite pas à dire que l'on est un peu à l'origine d'une ambiguïté. Le Président de la République a la plus forte légitimité en France puisqu'il est élu par l'ensemble du pays. Il correspond un peu au chef de l'exécutif. Or il ne l'est pas, puisque l'article 20 précise qu'il y a un Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation.
Le Président de la République c'est d'ailleurs ce qu'a compris le général de Gaulle doit donner les grandes orientations, mais, par là même, dans la mesure où il est élu et où ce suffrage universel lui confère cette si forte légitimité, on crée une ambiguïté à laquelle les Français sont aujourd'hui habitués puisqu'ils tiennent à cette élection et que l'on ne reviendra jamais, naturellement, là-dessus. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette élection présidentielle a bien résisté aux périodes de cohabitation. C'est donc une chose inscrite sur laquelle on ne reviendra pas.
On me permettra de signaler une autre ambiguïté. Le général de Gaulle a toujours été contre le régime des partis. Or il ne peut se concevoir aujourd'hui une élection présidentielle sans le soutien d'une formation politique. Les partis ont leur candidat, et ils en ont même plusieurs parfois, ce qui est un autre problème... Je veux dire qu'il est étonnant que l'homme qui a dénoncé avec une telle vigueur le régime des partis, qui a pris ses distances en 1946 parce qu'il le sentait revenir après la période de la Libération, n'ait pas senti que, par l'élection présidentielle, on revenait au régime des partis. En tant que gaulliste, je le dis parce que je l'ai toujours pensé, et je m'étais permis de le dire à quelques éminents gaullistes responsables politiques. Mais, encore une fois, cette grande réforme de 1962 est rentrée dans nos moeurs.
Elle a été, hélas, suivie de ce qu'on appelle l'inversion du calendrier qui pose un véritable problème parce que nous aurons toujours, sauf exception, des majorités très fortes derrière le Président de la République qui vient d'être élu. Le Président de la République élu s'adressant aux Françaises et aux Français en disant : « Merci de m'avoir élu. Maintenant, donnez-moi dans un mois les moyens politiques d'exercer la politique pour laquelle vous venez de m'élire, c'est-à-dire donnez-moi une majorité forte ». Or, dans une démocratie, une majorité trop forte je n'hésite pas à le dire même si mes propres amis sont quelque peu choqués n'est pas bonne pour la démocratie. Il est bon d'avoir des équilibres. J'irai presque jusqu'à dire qu'une majorité de 30 ou 40 est préférable. A ce moment-là, on voit les rangs de l'Assemblée nationale remplis, c'est-à-dire que les Députés répondent à l'article 34 leur donnant obligation de voter la loi. C'est l'exécution de leur propre mandat.
La deuxième grande réforme, qui me touche peut-être plus particulièrement, est celle de 1974 sur le Conseil constitutionnel. Dans l'esprit des constituants de 1958, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par le Président de la République, les Présidents des assemblées et le Premier ministre. En réalité, dans l'esprit de Michel Debré et des constituants eux-mêmes, c'était le Parlement qui était souverain en ce qui concerne la loi, et on avait envisagé un Conseil constitutionnel uniquement pour garantir la grande séparation des articles 34 et 37, c'est-à-dire pour ne pas permettre au Parlement, notamment aux Députés, de légiférer alors qu'il s'agissait de domaines réglementaires. De même, il est vrai que le gouvernement ne peut pas légiférer sous sa seule autorité dans la mesure où il n'a que la possibilité d'agir sur le règlement.
Comme Michel Debré a considéré que, dans le parlementarisme rationalisé, les articles 34 et 37 étaient essentiels, les constituants ont tenu à ce Conseil constitutionnel de 1958 pour que le Parlement n'aille pas au-delà de ses prérogatives et ne dise pas, comme il l'a fait souvent et comme j'ai eu l'occasion de le condamner à de nombreuses reprises, comme mon ami Estier le sait bien : « Qui peut le plus peut le moins ; puisque nous pouvons voter la loi, nous pouvons voter un règlement. » Non ! A chacun son métier.
La loi de 1974 a cependant apporté une profonde modification, que j'ai approuvée, en donnant la possibilité à soixante Députés ou soixante Sénateurs, souvent les uns et les autres en même temps, de saisir le Conseil constitutionnel. Cela revenait déjà à changer profondément la nature même du Conseil constitutionnel, dans la mesure où celui-ci est désormais considéré comme un dernier recours : les saisines de cette institution émanent naturellement de la minorité puisque les lois déférées, votées par la majorité, semblent toucher, pour la minorité qui se protège, à des éléments de nature constitutionnelle. La loi n'est pas conforme à la Constitution et l'on demande au Conseil constitutionnel de le dire.
C'était donc une modification profonde, approuvée et reconnue par tous dans les milieux universitaires et juridiques et, bien sûr, par les parlementaires, puisqu'ils sont désormais les auteurs éventuels de saisines.
Peut-être y a-t-il eu quelques débordements, dans la mesure où, ce recours étant considéré comme le dernier, le plus grand nombre des lois je n'irai pas jusqu'à dire leur totalité fait l'objet d'une saisine devant le Conseil constitutionnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles mais je n'y reviendrai pas parce qu'étant le seul dans ce cas, ma parole n'a pas beaucoup d'effet , je me suis toujours élevé, notamment ces derniers temps, contre le développement proposé sur l'exception d'inconstitutionnalité : ne changeons pas ce qui va bien. Mais je ne poursuivrai pas dans cette voie.
En 1992, une autre modification a touché la construction européenne et l'arrivée de l'Union européenne. Je n'en dirai qu'un mot parce que, en réalité, il y a eu un grand débat sur l'article 88.4, débat qui a été repris depuis par le Parlement en plusieurs occasions. Je le dis d'autant plus volontiers, même si cela paraîtra peut-être un peu présomptueux de ma part, que j'ai été l'auteur du premier article 88.4 à l'Assemblée nationale. Je trouvais en effet inadmissible que Bruxelles puisse « pondre » des règlements sans même que le Parlement français ait eu la connaissance de ces projets de directives. Par là même, je voulais aider tous les gouvernements, de droite comme de gauche, qui, voyant la réaction du Parlement français sur un projet de directive, permettaient aux représentants français à Bruxelles de dire : « Cette directive est bien, mais regardez la réaction qu'a sur ce projet le Parlement français ; faites attention, modifiez-la ». C'était donc un service à rendre au gouvernement dans le cadre de la construction européenne. On ne saurait nous imposer n'importe quel règlement.
Je m'aperçois qu'hélas, il a fallu modifier l'article 88.4 à plusieurs reprises et qu'une grande partie de notre législation vient de Bruxelles, d'où la nécessité de transcription des directives par le Parlement, ce qui pose un véritable problème, y compris au Conseil constitutionnel, dans la mesure où les grandes décisions sur cette question s'appuient sur le 88.4. Il en va quand même de la souveraineté de notre pays.
Je parlerai également de la réforme de 1993 sur le droit d'asile, pour une petite parenthèse qui m'avait profondément touché puisque, bien qu'en en étant rapporteur, je m'y étais opposé, y compris au Congrès, quand j'avais pris la parole devant le Premier ministre de l'époque, qui était Edouard Balladur et qui avait paru quelque peu étonné.
Le Conseil constitutionnel avait rendu une décision contre une disposition législative relative au droit d'asile en considérant que la disposition législative était contraire à la Constitution et le Premier ministre avait alors modifié la Constitution. Je m'y suis donc opposé, en ces termes : « Si, à chaque décision du Conseil constitutionnel, vous changez la Constitution, de deux choses l'une : soit vous supprimez le Conseil constitutionnel et on n'en parle plus, soit on en arrive à une Constitution de 500 pages et de 2 000 articles ! Vous avez créé un Conseil constitutionnel pour dire si la loi est conforme ou non à la Constitution, aux principes fondamentaux et au bloc de constitutionnalité, mais si, à chaque fois que le Conseil rend une décision, il faut aller à Versailles pour modifier la Constitution, il faut être sérieux ! » Je m'y étais donc opposé et le Premier ministre de l'époque, de même qu'Alain Juppé, n'étaient pas contents du tout.
En 1995, nous avons connu deux grandes modifications.
La première a été l'extension du champ du référendum dans l'article 11. Les articles 11 et 89 vous vous en souvenez avaient soulevé un grave problème. Lorsque le général de Gaulle avait voulu l'élection du Président de la République au suffrage universel, il s'était servi de l'article 11 et de nombreux juristes s'étaient élevés pour dire qu'il fallait appliquer seulement l'article 89, les procédures n'étant pas les mêmes. Je dois dire que, si j'avais eu à me prononcer j'étais encore assez jeune à l'époque sur cet aspect du suffrage universel, j'aurais sans doute dit qu'il fallait effectivement employer non pas l'article 11 mais l'article 89. Cependant, comme l'a très bien dit Georges Vedel, le peuple avait tranché et l'article 89 n'a donc pas été utilisé.
Cela étant, on a étendu le champ d'application de l'article 11, ce qui a été une réforme essentielle, dans la mesure où, au-delà de l'organisation des pouvoirs publics, on avait prévu des modifications concernant les réformes politiques, sociales et économiques, ce qui est très important.
La deuxième modification constitutionnelle de 1995 j'en ai été le rapporteur, mais, aujourd'hui, je suis mal à l'aise pour en parler au Sénat comme à l'Assemblée est la réforme de Philippe Seguin sur la session unique. Je maintiens que c'est une erreur. Pourtant, je l'ai rapportée. Excusez-moi ; on peut parfois se tromper. Je l'avais fait pour rendre un peu service j'en ai un peu honte parce que ce n'est pas tout à fait dans ma nature , mais c'était une erreur. Je l'avais fait quand même aussi pour des raisons profondes, pensant qu'il y aurait moins de textes et que le Parlement aurait plus de temps pour les étudier.
Aujourd'hui, les Sénateurs et les Députés n'ont pas le temps d'étudier des textes, d'autant plus que, depuis quelques années, on leur supprime la deuxième lecture par la procédure d'urgence puisque, sur tous les textes, c'est la procédure d'urgence qui est appliquée et qui se termine par une commission mixte paritaire. Si on a prévu la procédure d'urgence, c'est à titre tout à fait exceptionnel ! Or, aujourd'hui, le gouvernement la demande à chaque fois, ce qui veut dire que les parlementaires ont droit à la première lecture et non pas à la deuxième, alors qu'il s'avère que le rôle du Sénat, comme celui de l'Assemblée d'ailleurs, est d'améliorer les textes des projets de loi qu'on lui soumet et que les deux lectures sont nécessaires.
Aujourd'hui, nous avons une inflation législative du fait de cette session unique alors que j'aurais pu penser le contraire dans la mesure où les ministres se disent : « Nous avons plus de temps et nous votons donc plus de lois ». Je sais bien, mon cher Jean-Pierre, que tous les Premiers ministres se sont opposés à cette inflation, mais tels et tels ministres veulent leur texte, souvent pour des raisons médiatiques vous m'excuserez de le dire devant d'anciens ministres parce que, pour passer à la télévision et se faire connaître, le mieux, pour un jeune ministre, est d'avoir un texte qui porte son nom : c'est la loi "Dupont" ou la loi "Durand" et en avant la musique ! La presse continue dans ce sens : on parle de la loi de tel ou tel ministre et non pas de la loi de la République alors que cela devrait être le cas !
Cette session unique est à mon sens une mauvaise réforme, mais l'on ne reviendra naturellement pas dessus.
J'ajoute qu'il est bon que les parlementaires, qui sont élus au scrutin majoritaire, consacrent un temps, les trois mois libres quand il y avait les deux sessions, à leur circonscription. Aujourd'hui, ils ont pris l'habitude d'y aller chaque semaine et, souvent, d'y rester, c'est-à-dire de ne pas respecter les obligations du mandat imposées par l'article 34, et d'être absents. Jamais l'absentéisme à l'Assemblée nationale n'a été aussi élevé qu'en ces derniers temps.
Cela s'explique aussi par le cumul des mandats. Je me suis toujours opposé à tout cumul, comme Jean-Pierre le sait, parce qu'il est contraire à l'esprit même de la Constitution. Quand je présidais la Commission des lois, je me souviens qu'alors qu'il devait y avoir une discussion importante, des Députés faisaient valoir des réunions de leur Conseil municipal, de leur région ou de leur département.
Le cumul est contraire à l'esprit de la Constitution, comme j'ai eu l'occasion de le manifester à l'Assemblée nationale en face d'un dénommé Puech, un homme que j'estime beaucoup et qui est très sympathique, Président du Conseil général de l'Aveyron et également président de l'Association des Présidents des conseils généraux. Nous avions alors la majorité (il était ministre de l'agriculture ou de la fonction publique), et nous votons son budget le vendredi. Le dimanche, il réunit l'Association des Présidents des conseils généraux à Toulon et dit : « C'est scandaleux, l'Etat ne donne pas assez d'argent aux collectivités locales ! » Il me semble quand même qu'un ministre est solidaire du gouvernement. Evidemment, le mardi suivant ou le mercredi, aux questions orales, j'ai été quelque peu violent, ce qui est un peu mon habitude, et j'ai dit alors, en m'adressant à M. Balladur : « M. le Premier ministre, ce n'est pas au ministre de la fonction publique que je m'adresse, parce que je vais demander sa démission, mais à vous parce qu'il faut que vous acceptiez cette démission ! », et je lui en ai donné les raisons.
Il est vrai que, dans le cumul des mandats, qui est une exception française, il y a quelque chose qui ne va pas, mais, là aussi, je sais qu'il faudra peut-être attendre trente ou quarante ans pour changer les choses, encore que trente ou quarante ans, dans l'histoire d'une République, ce ne soit pas grand-chose.
Nous avons eu encore une réforme normale en 1996, qui était d'ailleurs souhaitée par tous les groupes politiques, celle de l'article 47.1 de la Constitution, concernant le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, aux côtés de la loi de finances.
En 1998, nous avons eu une modification qui s'est imposée à la suite des grands accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie : une disposition concernant ce territoire d'outre-mer.
En 1999, nous avons eu la modification de l'article 53 sur la Cour pénale internationale. C'était la reconnaissance du traité que nous avions signé et ratifié en 1998.
Nous avons eu également une modification plus importante, qui fait couler encore beaucoup d'encre aujourd'hui mais que je crois nécessaire, même si elle amène à certains excès dans d'autres domaines qui ne sont pas constitutionnels : celle qui a concerné les articles 3 et 4 de la Constitution sur l'égal accès des femmes aux mandats et fonctions électives, ce qui, en réalité, ne peut pas se réaliser, ou seulement très difficilement, dans le scrutin majoritaire mais uniquement à la proportionnelle. Cela pose donc un problème en ce qui concerne l'application de la Constitution elle-même. Aujourd'hui, cela entraîne un débat qui pourrait paraître un peu communautariste c'est pour la défense des femmes que je le dis parce que, une fois que l'on aura mis le doigt dans l'engrenage, on le mettra nécessairement dans d'autres domaines, ce qui pose incontestablement une question lourde.
J'en arrive à la réforme de 2000 sur le mandat de cinq ans, qui a changé profondément les choses. A la suite des élections perdues de 1997 sous la présidence de Jacques Chirac, Président de la République, j'avais que Dieu me pardonne écrit un article dans Le Monde intitulé « Pourquoi pas cinq ans ? » Les professeurs de droit s'en souviennent. J'avais fait cela par pur esprit politique, alors que je ne suis pas politicien, comme tout le monde le sait, parce que je m'étais opposé très durement à la dissolution de 1997. Comme la presse l'avait dit elle le savait et cela venait d'ailleurs plus de l'Elysée que de moi , j'en étais presque venu aux mains avec le Président de la République. C'est un fait connu.
J'avais en effet dit qu'il n'avait pas le droit de faire une dissolution en 1997 puisqu'il s'agissait d'une dissolution de convenance. Or le Président de la République, dans la Constitution, est un arbitre, c'est-à-dire celui qui règle un conflit. Le général de Gaulle, en 1968, alors que les gens étaient dans la rue, a réglé le problème par une dissolution. Quand François Mitterrand a été élu alors qu'il avait au Parlement une majorité contraire à sa propre élection, il était logique de dissoudre. Mais en 1997, alors que nous avions la majorité à l'Assemblée, au Sénat, dans les régions, dans les départements et dans les plus grandes municipalités, où pouvait être l'arbitrage ?
On a dissous. J'ai alors voulu être bon prince pour mon ami Jacques Chirac et j'avais fait ce papier dans Le Monde en disant : « Pourquoi pas cinq ans ? », afin de lui donner un élément pour se relancer. Finalement, il ne m'a pas suivi, mais on l'a contraint, notamment Lionel Jospin et Valéry Giscard d'Estaing, à modifier la Constitution.
Je n'hésite pas à dire que la corrélation de la durée des mandats législatifs et présidentiels est une erreur sur laquelle, hélas, on ne reviendra pas non plus. La rapidité des choses, le désir des Françaises et des Français de retourner aux urnes pour l'élection essentielle, l'intérêt que cela peut représenter pour la presse, qui, à peine une élection terminée, parle déjà de la suivante sont autant d'éléments qui font que l'on n'y reviendra pas, mais c'est quand même une modification très lourde de conséquences.
J'en viens, mon cher Jean-Pierre, à 2003 et à l'organisation décentralisée, à laquelle je sais combien tu tenais et que tu as obtenue c'est l'un de tes grands succès par une modification de la Constitution. Je dois dire qu'à l'époque, j'étais un peu jacobin et que je le suis toujours. Certes, la décentralisation telle que l'a voulue et obtenue Jean-Pierre Raffarin à Versailles ne touchait pas les pouvoirs régaliens du Président de la République, de l'exécutif et donc de l'Etat et j'ai bien voulu y souscrire, mais dans la mesure et si je sors vivant d'ici, je serai heureux où on réfléchissait enfin sur le nombre de collectivités locales dans notre pays. A chaque fois qu'il y a une difficulté, on en crée une nouvelle et certaines collectivités n'ont même pas de nom : elles ont été créées du temps de Charles Pasqua et on les appelle les Pays. On en attend toujours les décrets d'application et la notion juridique.
Nous avons d'abord les communes, auxquelles on ne touchera jamais. La preuve, c'est que, lorsqu'on décède, on veut retourner dans sa commune d'origine, à laquelle on est attaché. C'est la structure de droit public de base.
Ensuite, on a les cantons, les départements et les régions. Cela fait vingt-cinq ans qu'à l'Assemblée, j'ai dit que j'étais pour la région mais qu'il fallait supprimer le département. Je suis content de voir que l'on y revient un peu et que l'on y réfléchit. En effet, au-delà de la région, il y a l'Etat et, au-dessus, il y a Bruxelles et l'Europe. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de la mondialisation, non pas encore sur le plan juridique ou institutionnel, mais cela viendra.
Pourquoi supprimer l'une de ces collectivités, et en particulier le département ? Parce qu'il y a des conflits de compétences. Il est vrai que, lorsque le département n'a pas assez d'argent pour terminer son collège, la région fait un effort, et presque réciproquement dans certaines régions. On a des conflits de compétences sur un grand nombre de sujets et c'est la complexité même. Pour la maman qui a trois enfants, le tout petit à la maternelle, un plus grand à l'école et le troisième au lycée, qui est compétent ? Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est une idée que je défends.
Je reste donc décentralisateur, et je le serai d'autant plus que Jean-Pierre m'entende bien si, un jour, une réflexion est menée sur la nécessité d'étudier le nombre de collectivités, qui complique les choses du fait des conflits de compétences.
Certes, lorsque les départements ont été créés, pendant la Révolution, il fallait aller en charrette ou à cheval du lieu le plus éloigné jusqu'au chef-lieu d'arrondissement, mais aujourd'hui, on peut aller en voiture du lieu le plus éloigné au chef-lieu de la région et les moyens de transport se sont quelque peu modifiés par rapport à 1793 !
Bien que jacobin, je ne suis donc pas contre la décentralisation, d'autant plus que l'article 72 était accompagné de l'article 74 qui touchait les territoires d'outre-mer et que cela s'imposait pour d'autres raisons.
Enfin, la dernière modification, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est celle de 2005, relative au référendum sur les adhésions des pays qui souhaitent entrer dans l'Union européenne. Naturellement, la réforme voulue par Jacques Chirac concerne une question qui soulève aujourd'hui des interrogations : l'adhésion de la Turquie.
Voilà ce que je voulais dire rapidement. Je suis de ceux qui regrettent un certain nombre de modifications, comme vous l'avez sans doute senti, et qui estiment que la Constitution étant inscrite dans le marbre, il ne faut la changer qu'après beaucoup de réflexions, comme le disait Portalis, mais il est vrai qu'il parlait, lui, de la loi civile. Veillons donc à ne pas faire un peu tout et n'importe quoi.
Je ne me permettrai pas de m'immiscer dans les discussions parlementaires en ce qui concerne les modifications proposées, mais, dans la mesure où j'étais vice-Président du comité Balladur, j'appelle le Parlement à faire attention, y compris face aux textes proposés par le gouvernement qui retient quelques-unes des propositions Balladur, aux modifications qui doivent être apportées et qui pourraient changer profondément les choses.
J'appellerai pour terminer l'attention des Sénateurs présents sur une chose qui me consterne : j'ai appris hier soir le vote de l'amendement à l'Assemblée nationale qui tend plus ou moins à supprimer la juridiction administrative dans notre pays alors que nous avons deux systèmes : l'organisation judiciaire et l'organisation administrative. Messieurs les Sénateurs, prêtons attention à cela : je ne veux pas, demain vous m'excuserez de le dire, et comme je ferai un communiqué dans la presse, je peux me permettre de l'exprimer publiquement voir les préfets poursuivis par des juges d'instruction de l'ordre judiciaire.
Voilà, M. le Modérateur, et mon cher Jean-Pierre, ce que je veux dire. Je m'exprime toujours avec mon indépendance ; on voudra bien me le pardonner. Vous aurez des gens beaucoup plus compétents que moi pour entrer dans le fond des textes.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Merci beaucoup, M. le Président, de cet exposé si riche qui nous a énormément appris et qui est aussi un témoignage personnel. Nous y sommes très sensibles et votre ton indépendant a été très bien compris par les uns et les autres.
Je donne tout de suite la parole au professeur Bastien François, professeur à l'université de Paris I, qui va nous parler de la place de l'Assemblée nationale dans l'évolution de la V e République. J'indique au passage que M. François a donné une importante contribution à L'histoire du Parlement de 1789 à nos jours publiée, sous l'autorité de Jean Garrigues, par le Comité d'histoire politique et parlementaire.
M. Bastien FRANÇOIS, Professeur à l'Université de Paris I - La place de l'Assemblée nationale dans l'évolution de la Ve République
Merci, M. le Modérateur. Je suis né pendant l'article 16 de la Constitution, ce qui vous donne une idée de mon âge, mais cela fait que je ne pourrai pas parler d'expérience, comme l'a fait le Président Mazeaud, et je serais donc, pour cette raison, sans doute moins intéressant.
Je vais être aussi mal élevé, parce que nous sommes au Sénat et que je vais parler exclusivement de l'Assemblée nationale, même si certains de mes propos pourraient concerner le Sénat, mais il est vrai que le secrétaire général du Sénat parlera juste après moi et rétablira donc cet équilibre.
Je commencerai par un fait extrêmement connu mais qu'il est bon de rappeler : pour les auteurs de la Constitution de 1958 l'Assemblée nationale est le maillon faible du système politique, le lieu générateur de l'instabilité gouvernementale, le lieu du désordre et de la division partisane. C'est aussi l'épicentre d'un certain archaïsme politique et d'une certaine culture politique dépassée. Par conséquent, dans l'esprit des constituants de 1958, le Parlement ne doit plus être le lieu d'impulsion des politiques publiques, le poumon de la vie politique, si on rétablit pour partie le rôle du Sénat par rapport à la Constitution de 1946, pour contrer éventuellement l'Assemblée nationale.
Le contraste, à cinquante ans de distance, est saisissant. En effet, force est de constater qu'aujourd'hui, non seulement l'Assemblée nationale est au coeur de toutes les grandes évolutions de la V e République, comme cela vient d'être rappelé par le Président Mazeaud, mais l'Assemblée nationale a retrouvé une place centrale dans la vie politique, à défaut d'avoir retrouvé son pouvoir d'antan. A tel point qu'aujourd'hui, à gauche comme à droite, tous s'accordent, dans une mesure variable, comme on peut le voir dans la discussion du projet de révision constitutionnelle, sur le fait que la modernisation de la vie démocratique dans notre pays passe nécessairement par un accroissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale, par un accroissement des pouvoirs des Députés, qui doivent être plus présents, mieux outillés pour contrôler le pouvoir exécutif et moins corsetés par la rationalisation du parlementarisme.
Pour prendre la mesure de ce contraste, je vais revenir d'abord très brièvement sur les intentions des constituants pour montrer ensuite comment l'Assemblée nationale est au coeur de toutes les grandes transformations de la V e République, même si je ne vais pas pouvoir, dans le temps qui m'est imparti, traiter de l'ensemble de ces transformations, et en particulier des plus difficiles à saisir sur le plan institutionnel, notamment la professionnalisation de la vie politique, le cumul des mandats ou l'emprise des partis politiques sur la vie politique, à tel point que c'est la V e République qui a inventé le régime des partis, ce qui peut paraître paradoxal. Je ne vais traiter que de trois grands thèmes :
- la question de la stabilité gouvernementale et de l'alternance,
- la question de la répartition des pouvoirs au sein du pouvoir exécutif,
- la question des transformations du contrôle de constitutionnalité,
le tout dans les vingt minutes qui me sont imparties.
Je commencerai donc par l'intention des constituants. Les Constitutions servent toujours à régler des problèmes. Quel était le problème des constituants de 1958 ? Un problème ancien, simple à exposer mais assez difficile à régler : le problème de l'instabilité gouvernementale. Pour le dire dans un langage moderne, c'est l'absence de majorités stables, cohérentes et disciplinées sur la durée d'une législature. Dans la vie politique française, avant 1962, on n'a jamais connu de majorité stable, cohérente et disciplinée sur la durée d'une législature. Le problème des constituants est donc d'essayer de gouverner sans majorité stable, cohérente et disciplinée.
Vous en avez une explication lumineuse dans un texte extraordinaire, pour moi le plus grand texte en langue française d'un constituant : le discours de Michel Debré devant le Conseil d'Etat, en 1958, qui est très beau et d'une très grande clarté. Michel Debré dit très clairement : « Parce que, en France, la stabilité gouvernementale ne pourra pas résulter de la loi électorale (il se trompait un peu sur ce point, mais peu importe), il faut que l'on règle le problème dans l'architecture constitutionnelle. »
Toute la Constitution de 1958 est donc orientée dans ce but. On le voit dans la définition des compétences des chambres et dans les relations entre le gouvernement et le Parlement, avec une très forte emprise du gouvernement sur le Parlement, dans la conception du rôle présidentiel et, en particulier, dans cette bizarrerie, du point de vue de la théorie du parlementarisme : le fait que le Président de la République a des pouvoirs propres. On a besoin d'un Président de la République qui, en cas de nécessité, en dépit du dispositif de rationalisation du parlementarisme, pourrait sauver la mise si cela n'allait plus du tout. On crée donc un Président de la République un peu bizarre, qui est un arbitre, mais avec des pouvoirs propres.
Comme vous le savez, deux miracles structurants se sont produits : celui du fait majoritaire je n'ai pas le temps d'en faire la chronologie, qui est plus chaotique qu'on le raconte , puis, un peu plus tard, le temps que les choses se mettent en place, celui de la bipolarisation de la vie politique française, qui empêche de passer d'un camp à l'autre comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire l'étanchéité de deux grands pans, gauche et droite, avec des rapports assez compliqués au sein de chacun d'eux, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation.
Cette nouvelle donne du fait majoritaire, qui va se pérenniser, se consolider et pénétrer les esprits et qui est la seconde nature de la V e République, va conduire à un déséquilibre structurel de nos institutions du fait d'un surdimensionnement des instruments de disciplinarisation des parlementaires à la disposition du gouvernement, puisque le problème qui était celui des constituants de 1958 n'existe plus. Ils ont fait une Constitution remarquablement cohérente et intelligente pour régler un problème et ils se retrouvent assez rapidement sans ce problème. De ce fait, les relations entre le Premier ministre, le Président de la République et le Parlement ou, de façon générale, les relations entre l'exécutif et le législatif, sont déséquilibrées plus qu'à l'origine.
Il est surtout important de signaler que cette nouvelle donne majoritaire, qui va produire une chose tout à fait inédite dans la vie politique française : le fait de transformer l'Assemblée nationale en pôle de stabilité, va avoir des effets en chaîne sur la définition des rôles politiques, sur les relations entre les pouvoirs et donc sur les principales caractéristiques de notre régime.
Pour examiner cela, je partirai d'un constat auquel nous sommes tellement habitués que nous n'y faisons plus attention, surtout pour ceux qui sont nés, comme moi, après 1958 : l'Assemblée nationale de la V e République est directement liée à une double révolution dans la vie politique française et à l'une des caractéristiques majeures de la V e République : la stabilité gouvernementale et l'alternance.
Je commencerai par la stabilité gouvernementale. A partir de 1962, tous les gouvernements ont disposé d'une majorité stable, cohérente et plus ou moins disciplinée. Il y a toujours eu une majorité, à tel point que, depuis 1962, aucun gouvernement n'a jamais été renversé par l'Assemblée nationale. C'est une chose tout à fait inédite dans l'histoire de la vie politique française et personne ne pouvait imaginer, en 1958, que l'Assemblée nationale serait ce pôle de responsabilité, ce point d'acte essentiel de la stabilité gouvernante.
De même, personne ne pouvait imaginer en 1958 que, depuis le précédent du 14 avril 1962, c'est-à-dire le jour où le général de Gaulle remplace souverainement Michel Debré par Georges Pompidou à Matignon, le principal facteur d'instabilité en France est le Président de la République. Ce n'est pas très grave, mais il s'est arrogé alors le droit de changer quand il veut de Premier ministre et de gouvernement, du moins lorsqu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, et je reviendrai sur ce point.
L'Assemblée nationale devient donc le pôle de responsabilité du pouvoir gouvernant en France. Le complément de cette révolution est ponctué à intervalles relativement réguliers, ou en tout cas prévisibles, par des alternances et, là aussi, c'est une nouveauté. A strictement parler, il n'y a pas d'alternance avant la V e République : il n'y en a ni sous la III e , ni sous la IV e . Il y a des élections et des camps qui les perdent, mais les véritables changements se font par des formes de déplacement et de glissement. Il n'y a pas d'alternances franches, ou très peu, ou elles ne durent pas longtemps. Ce sont des glissements d'alliances qui se font au sein du Parlement et en raison de l'existence de forces politiques charnières centristes, si je puis dire pour aller vite. Avant 1962, les configurations politiques sont donc marquées par l'incertitude et le perpétuel déplacement des clivages politiques.
C'est cette situation qui change, mais très lentement. En effet, pour qu'il y ait une alternance, il faut non seulement qu'il y ait une majorité, mais aussi une opposition susceptible de devenir la majorité. Nous avons eu très vite une majorité, mais nous avons mis plus longtemps à avoir une opposition susceptible d'être une majorité. Il a fallu attendre les années 70 et le rassemblement des forces de gauche pour que nous passions d'une majorité sans alternance à une alternance des majorités.
Cette première alternance, celle de 1981, est consécutive à une élection présidentielle, mais elle est uniquement permise par les élections législatives qui suivent. Ce sont les élections législatives qui permettent l'alternance et c'est ce qu'avait théorisé M. Giscard d'Estaing dans son fameux discours de 1978 à Verdun-sur-le-Doubs, dans lequel il expliquait : « Si je perds les élections législatives, je ne pourrai pas résister ; ce sera le programme de gauche qui s'appliquera. »
Evidemment, la situation est plus compliquée en France, où nous avons un double circuit de dévolution du pouvoir exécutif, ce qui veut dire que l'alternance peut être enclenchée soit par des élections présidentielles, soit par des élections législatives, mais, en réalité, les conséquences ne sont pas les mêmes selon les deux cas. En effet, lorsqu'elle est enclenchée par l'élection présidentielle, l'alternance ne peut être complète, c'est-à-dire que l'on ne peut attribuer la plénitude du pouvoir à un camp que si le Président de la République qui a gagné l'élection présidentielle gagne les législatives qui sont consécutives à une dissolution ou bien, naturellement, dans le schéma du quinquennat, qui suivent son élection. Dans tous les cas, le Président de la République ne peut gouverner que s'il y a une élection législative alors qu'en revanche, lorsqu'un camp gagne les législatives, il a pratiquement la plénitude du pouvoir gouvernant parce que, contrairement à ce que l'on pourrait penser (je pourrais en donner des preuves, mais je manque de temps), un Premier ministre de cohabitation a parfaitement les moyens de gouverner la France en dépit de quelques difficultés. Gouverner la France, cela peut se faire parfaitement en période de cohabitation.
J'en ai une preuve excellente que je vous cite en passant. Le directeur de cabinet de Lionel Jospin a publié un livre qui s'appelle Matignon, rive gauche. Dans les deux premières pages, il dit que la cohabitation est horrible et que c'est la fin des haricots, et dans les 250 pages qui suivent, il dit : « Nous sommes les meilleurs du monde ; nous avons très bien gouverné ». Cela veut dire que l'on peut très bien gouverner en période de cohabitation et que la victoire d'un camp aux élections législatives peut, à elle seule, conférer l'essentiel du pouvoir de gouvernement.
C'est ce que je propose d'appeler la double découverte des années 80 au point de vue institutionnel et politique : d'une part, les élections déterminantes pour l'attribution du pouvoir gouvernant sont les élections législatives ; d'autre part, le droit de dissolution ne sert plus à régler un conflit entre l'exécutif et le législatif mais à lier l'assemblée nationale et le Président de la République.
Cette dernière considération m'amène à aborder un deuxième point, tellement connu que je serai plus bref : celui des rapports au sein de l'exécutif. On peut le dire d'une façon très simple : le Président de la République, en France, est puissant lorsqu'il est lié politiquement à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que, contrairement à ce qu'on dit très souvent, il est faux de dire que la prééminence présidentielle et le rôle de gouvernant que s'attribue le Président de la République sont directement issus de son élection au suffrage universel direct. De tous les autres Présidents des pays de l'Union européenne élus au suffrage universel direct, y compris ceux qui ont des pouvoirs assez proches du Président de la République français en termes de pouvoir propre, aucun n'a le pouvoir du Président de la République français. Par conséquent, contrairement à ce qu'on dit, la prééminence du Président de la République et, surtout, son rôle de gouvernant sont liés à l'existence d'une majorité à l'Assemblée nationale sur laquelle il peut s'appuyer et, idéalement, de son point de vue, sur laquelle il a été élu.
Si je devais résumer cela par une formule, je dirais que c'est à l'Assemblée nationale que le Président de la République trouve son pouvoir de gouvernement, qui n'est pas inscrit dans la Constitution, ce qui est une très grande surprise. Si on avait raconté cela aux constituants de 1958, ils n'y auraient pas cru. Cela se mesure parfaitement dans ce type d'alternance particulier qui est créé par les élections législatives et qui débouche sur ce que l'on a appelé la cohabitation, dans laquelle on voit que la configuration du pouvoir exécutif dépend de l'Assemblée nationale.
Dans ce cas, soit le Président de la République est le chef réel du gouvernement, avec un Premier ministre qui fait le go-between entre le Président de la République et le Parlement (ce n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, et j'ouvre une parenthèse pour le dire au Premier ministre qui est ici et qui pourra le confirmer : contrairement à ce que dit la presse, le Premier ministre a l'ensemble des instruments de pilotage et de coordination du travail intergouvernemental ; quand j'entends que M. François Fillon n'est qu'un collaborateur, cela me fait rire, parce qu'il a des instruments sans lesquels le Président de la République ne peut rien faire à l'Elysée), soit le Président de la République est réduit à un rôle de tribunicien, avec un Premier ministre qui est le chef réel du gouvernement et qui aspire à devenir calife à la place du calife.
Cela veut dire que l'Assemblée nationale est, elle aussi, le vecteur de cette particularité française, que personne ne nous envie en réalité, et qui fait que le chef de gouvernement est tantôt Président de la République, tantôt Premier ministre.
J'en viens à ma troisième et dernière observation : l'Assemblée nationale est l'acteur indirect, comme le disait aussi Pierre Mazeaud, d'un approfondissement de l'Etat de droit en France. Le Conseil constitutionnel d'aujourd'hui ne ressemble vraiment pas à ce qu'il était en 1958, où il était chargé exclusivement de protéger le pouvoir exécutif contre les parlementaires.
Ce Conseil constitutionnel avait été pendant très longtemps accusé d'être aux ordres du pouvoir gaulliste. Je pense à cet égard à des phrases exceptionnelles de François Mitterrand dans Le coup d'Etat permanent. François Mitterrand, comme Michel Debré mais dans un autre genre, avait une sacrée plume et, quand il disait les choses, elles avaient une force et une clarté que l'on retrouve malheureusement assez peu aujourd'hui. Ce Conseil constitutionnel, qui a donc été dénoncé par toute la gauche et aussi par une partie de la droite, est devenu aujourd'hui une juridiction chargée de la protection des libertés et des droits des citoyens qui est tout à fait admise. Si on avait dit en 1958 que l'on qualifierait les membres du Conseil constitutionnel de « sages », je pense que cela aurait fait rire. Cet organe, qui était chargé de cette mission technicienne de réguler l'activité normative des pouvoirs publics, comme on le disait dans les années 60, est donc devenu le garant suprême de l'Etat de droit.
Cela s'explique tout d'abord par le fait majoritaire. Avec le fait majoritaire, sa mission de protection du pouvoir exécutif passe nécessairement au second plan, comme l'avait parfaitement compris M. Giscard d'Estaing en 1974 lorsqu'il a voulu faire de la saisine, qui est désormais ouverte aux parlementaires, un élément du statut de l'opposition.
Cela s'explique aussi c'est encore plus important par le fait que la saisine du Conseil constitutionnel a été utilisée par les Députés de l'opposition, et aussi par les Sénateurs, comme un élément de prolongation du débat législatif, ce qui permet au Conseil constitutionnel d'injecter à jets continus des nouveaux principes Constitutionnels dans le bloc de constitutionnalité et, de ce fait, le Conseil constitutionnel abreuve à jets continus l'opposition, qui trouve des arguments supplémentaires pour attaquer le gouvernement. L'Assemblée nationale a créé, avec le Conseil constitutionnel, une sorte de surgénérateur d'arguments constitutionnels, c'est-à-dire que, plus on en met, plus il en ressort.
Je terminerai par ce paradoxe qui me fait sourire : qui aurait pu croire en 1958 que les parlementaires, notamment les Députés, allaient devenir les meilleurs alliés objectifs du développement du contrôle de Constitutionalité en France ?
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Je vous remercie, d'abord pour avoir tenu dans le temps imparti et, surtout, pour avoir dit tant de choses. Vous montrez en effet très bien tout ce qui a changé depuis 1958 par rapport aux motivations mêmes de la Constitution.
Vous apportez beaucoup de nuances, voire de corrections, à des idées reçues indéfiniment répétées sur le régime, la Constitution et la place de l'Assemblée nationale.
Je donne tout de suite la parole à M. Delcamp, secrétaire général du Sénat, que je remercie d'autant plus qu'il est à la fois un homme de réflexion et un témoin. Après M. Delcamp, viendra, ce qui me paraît tout à fait opportun, le témoignage de M. Claude Estier, ancien Président du groupe socialiste du Sénat.
M. Alain DELCAMP, Secrétaire général du Sénat, vice-Président de l'Association Française des Constitutionnalistes - La place du Sénat dans l'évolution de la Ve République
Merci beaucoup, Monsieur le modérateur.
Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les universitaires,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d'abord remercier M. Bastien François, qui a parfaitement tenu la ligne qu'il s'était fixée. Il n'y avait effectivement peut-être pas lieu de parler du Sénat dans son développement, puisqu'il nous a parlé de la logique profonde et institutionnelle de la V e République (Président, Premier ministre, majorité à l'Assemblée nationale) et que, personnellement, j'ai toujours pensé que le Sénat se situait un peu en dehors de cette logique dominante. C'est ce qui fait son originalité et aussi la difficulté, quand on n'en est pas l'un des acteurs ou que l'on n'y travaille pas, de comprendre son rôle et la subtilité qui peut être la sienne.
M. Bastien François m'a également fait prendre conscience brusquement qu'en ce qui me concerne, j'étais né avec la IV e République et que j'étais rentré au Sénat l'année où le Président du Sénat a donné l'impulsion décisive au contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire en 1971 !
Ces cinquante années vues du Sénat ont été particulièrement riches. Elles l'ont confronté à des situations variables et elles n'ont pas levé l'incertitude qui pèse quasiment depuis l'origine sur le destin de la seconde chambre en France. En revanche, le paradoxe est que, malgré ces débats, cette longue période de temps n'a pas affaibli le Sénat, bien au contraire, puisque la nécessité du bicamérisme est aujourd'hui quasiment unanimement reconnue, même si l'on peut encore discuter la composition et le rôle de la seconde chambre.
Je vais vous proposer deux chemins pour visiter ces cinquante années du Sénat dans la République :
- une approche chronologique : la République vue du Sénat ;
- une approche thématique : le Sénat vu de la République.
Ma première partie concerne donc les mutations de la « République sénatoriale ».
Les plus anciens savent que l'expression est une citation du doyen Prélot, qui fut vice-Président de la commission des lois du Sénat, et les moins anciens s'étonneront sans doute que l'on puisse parler ainsi. Or c'était bien l'analyse qui était faite en 1958 : la Constitution restaurait la seconde chambre en lui redonnant le nom de Sénat, en lui donnant la garde conjointe de la Constitution avec l'Assemblée, en lui donnant un pouvoir législatif restauré s'appuyant sur une parenté profonde entre son collège électoral et celui du Président de la République.
Elle s'inspirait ainsi de son attachement au bicamérisme proclamé par le général de Gaulle, comme l'a rappelé Pierre Mazeaud, et, surtout, à la théorie développée par Michel Debré pendant la guerre (je vous cite à mon tour un passage de ce livre publié sous le pseudonyme de Jacquier-Bruère) :
« Deux chambres à effectif raisonnable et à mandat d'une certaine durée, telle est la première mesure de sagesse. La dualité évite l'imprévoyance et les excès d'une assemblée unique. La première chambre est l'expression directe de la nation. Elle transmet au gouvernement l'impulsion de la majorité. A côté d'elle, le Sénat est doté des mêmes attributions, mais il en use dans un autre esprit : il tempère les volontés trop neuves et trop vives, il relie la politique du présent à celle du passé et à celle de l'avenir. »
J'ai tendance à considérer que cette phrase est la plus belle qui puisse être appliquée au le Sénat de la V e République.
La plupart des commentateurs de 1958 approuvent cette interprétation sénatoriale. Pour les uns, l'insertion de la Constitution dans le terreau des notables confirme cette impression, et le mode de scrutin du Président de la République est jugé «révélateur» du goût des constituants pour le suffrage indirect inégalitaire, par M. Maurice Duverger.
« Cette identité d'origine entre le Sénat et le Président de la République confère au Sénat, tant par son Président, éventuel Président intérimaire de la République, que par lui-même, assemblée indissoluble, la mission d'assurer la continuité de la République. » C'est une dernière citation du doyen Prélot.
J'ai voulu marquer ce départ pour bien faire sentir combien, aujourd'hui, nous sommes loin de ces interprétations. Cela veut dire que le Sénat, lui aussi, a bénéficié ou a contribué à démontrer la flexibilité de la Constitution de la V e République. Il l'a fait à travers cinq moments que je vais rapidement caractériser.
Le premier, c'est la première législature, qui dissipe les illusions du doyen Prélot. Jusqu'à la crise du référendum de 1962, le Sénat devient le premier opposant du nouveau régime et, après les élections législatives de 1962 et leur majorité introuvable, il devient le seul refuge pour l'opposition. Alors qu'il devait être le soutien potentiel du régime, il devient le principal obstacle aux deux majorités, présidentielle et parlementaire, confondues.
Il ne s'agit pas pour autant d'affrontements idéologiques. On pourrait dire que la majorité d'alors du Sénat est une sorte de prolongement de la troisième force de la IV e République. Ce qui unit cette majorité et l'oppose à la « République gaullienne », c'est une autre conception que je qualifierai de « République parlementaire ». Le Sénat est attaché à un parlementarisme classique à la française dans lequel les assemblées affirmeraient leur autonomie face à l'exécutif. Symbole de cette différence : la résistance aux premières décisions du Conseil constitutionnel et son refus quasi systématique des procédures du parlementarisme rationalisé pendant longtemps et, à certains égards, encore aujourd'hui.
Le deuxième moment est l'élection de M. Giscard d'Estaing à la présidence de la République qui fait que, pour la première fois, la majorité du Sénat coïncide avec la majorité présidentielle. Dans cette conjoncture, il est alors en passe de jouer le rôle de contrepoids, avec la complicité de l'exécutif, qui avait été envisagée par les pères de la Constitution face à une majorité, que je qualifierai de rétive, à l'Assemblée nationale.
Le troisième moment est celui de l'alternance de 1981, qui ouvre une troisième période institutionnellement fort redoutable pour l'avenir de l'institution et également très ambiguë. La majorité sénatoriale, ainsi qu'elle se qualifie désormais, doit affronter la tentation de faire du Sénat une contre-Assemblée nationale et de confondre le bicamérisme avec l'affrontement de deux assemblées idéologiquement opposées. En fait, par son attachement à la qualité du travail législatif et par le maintien d'une préférence marquée pour la modération, le Sénat trouve un équilibre nouveau bâti sur le refus du tout ou rien, une forme de modus vivendi débouchant sur un nombre de désaccords très vigoureux mais quantitativement limités, parfois temporaires, comme sur la décentralisation, compensés par des accords plus inattendus : l'amnistie, l'abolition de la peine de mort, la loi Quillot sur les rapports bailleurs-locataires et, deux législatures plus tard, la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht.
C'est en cette période que s'inscrit aussi plus clairement un rôle d'équilibre institutionnel, s'appuyant tantôt sur le Conseil constitutionnel, où le Sénat et son Président peuvent apparaître comme des recours face à l'alliance majorité parlementaire/majorité présidentielle, tantôt sur l'opinion publique, avec la fameuse affaire de la question scolaire.
La caractéristique de cette période, c'est que la stabilité de l'institution, qui ne peut être dissoute, et la durée du mandat de ses membres lui permettent d'ajuster son comportement à l'égard du gouvernement en place en fonction des fluctuations de l'esprit public.
Quatrième moment : les cohabitations. C'est une période intéressante, mais qui n'est guère homogène. L'identité majoritaire entre 1986 et 1988 amène l'assemblée du Luxembourg à privilégier le soutien au gouvernement sur le recul auquel la destinait son mode d'élection indirect. Le Sénat découvre alors la nécessité de lutter en son sein contre l'obstruction et de faire une lecture moins souple de son règlement, voire de recourir à des procédés discutables - la question préalable dite «positive» - afin d'abréger les débats en réponse, par exemple, au refus du Président de la République de signer les ordonnances. Ce raidissement est tempéré par une plus grande prise de responsabilité dans l'élaboration des textes, responsabilité jusqu'alors contestée au Parlement par l'exécutif, au point que, sur certains aspects, le Sénat peut apparaître, dans ces époques, comme un laboratoire de l'alternance. Ce sont des propositions sénatoriales qui nourrissent le futur programme de la majorité à l'Assemblée nationale.
Une particularité : les périodes de 1988 et de 1993, seuls moments où la Constitution rencontre la conjoncture pour laquelle elle a été faite, à savoir l'absence de majorité à l'assemblée. Les gouvernements minoritaires découvrent l'avantage de traiter avec une assemblée fondamentalement plus encline au compromis et à la recherche de solutions concrètes qu'au recours à l'abus de majorité.
J'en viens au cinquième moment. En 1997 et 2002, est expérimentée la dernière configuration possible : une divergence idéologique de majorité avec l'Assemblée nationale compliquée d'une identité avec la majorité présidentielle. Le Sénat fait alors non seulement contrepoids à la majorité de l'Assemblée nationale, mais devient aussi l'allié objectif du Président de la République, compliquant singulièrement la tâche du gouvernement, ce qui lui vaut l'épithète d'«anomalie dans les démocraties».
Comme l'Assemblée nationale, le Sénat a dû se prononcer sur la question du quinquennat, mais il fut amené plus rapidement que l'Assemblée nationale à en tirer lui-même les conséquences à travers l'abrègement de son mandat et l'accélération du rythme de son renouvellement. Nul ne peut mesurer aujourd'hui les conséquences de cette mesure, non pas tant en termes de conséquences politiques que d'effets sur le comportement sénatorial et sa singularité par rapport à l'autre assemblée.
Le débat sur l'inversion des élections lui fournit en 2001 l'occasion de marquer, plus de quarante ans après les débuts de la V e République, la continuité organique de son attachement à une lecture parlementariste des institutions. L'esquisse de quinquennat absolu, sur laquelle ont débouché les élections de 2007, constitue sans doute un nouveau test de la capacité du Sénat à incarner la continuité de la République. La question est de savoir si le maintien en sa faveur du plus long mandat de la République et son caractère permanent suffiront à compenser une accélération assez probable du renouvellement des élites qui le composent. C'est l'une des interrogations majeures des années à venir.
Cinquante ans après, force est de constater que la réalité sénatoriale et son rôle exact dans le fonctionnement global du système politique n'ont pas bénéficié d'une attention considérable, au point que l'ensemble de ces fluctuations et nuances, fort éloignées des visions simplistes qui prévalent encore, demeure assez largement ignoré.
Il en va de même de la place réelle du Parlement depuis 1958, qui dépasse de beaucoup les apparences textuelles auxquelles on le réduit trop souvent. C'est sans doute un des apports du Sénat d'avoir contribué à esquisser par ses pratiques les voies du renouveau attendu aujourd'hui.
J'en viens à ma deuxième partie, dans laquelle je me propose d'examiner le Sénat du point de vue de la République et de voir dans quelle mesure il a contribué ou non à l'affirmation du Parlement.
Dans son ouvrage très célèbre sur la Constitution britannique, Walter Bagehot attribuait cinq fonctions à la Chambre des Communes : fonction électorale, fonction d'expression, fonction pédagogique, fonction d'information et, enfin, fonction de législation. Force est de constater que la Constitution de 1958 n'en mentionne explicitement qu'une seule, celle de législation, et encore celle-ci est-elle généralement contestée au motif que c'est l'exécutif qui occupe la place la plus importante dans l'élaboration des lois. Voyons rapidement ces cinq fonctions.
Je commence par la fonction électorale ou d'investiture. Celle-ci ne fait pas partie des fonctions du Sénat et il n'a jamais cherché à l'exercer sous la V e République, ce qui le différencie de façon essentielle du Sénat de la III e République, auquel on l'assimile trop souvent et à tort. J'observe que le fait de ne pas avoir de fonction d'investiture n'est pas forcément un désavantage. C'est peut-être même un avantage et l'une des raisons de la spécificité et de l'autonomie du Sénat. Les notions de majorité et d'opposition sont moins centrales dans son fonctionnement, d'autant que, sauf pendant la très brève période de 2002 à 2004, aucun groupe politique n'a détenu à lui seul la majorité en son sein.
En contrepartie, le gouvernement dispose à son égard de moins de pouvoirs de contrainte que vis-à-vis de l'Assemblée nationale : il n'y a pas d'équivalent de l'article 49.3 au Sénat. Cela a permis à l'assemblée du Luxembourg d'exercer à de multiples reprises son influence sur la fixation de l'ordre du jour et, surtout, sur les délais d'examen des textes. C'est précisément sur cette absence de fonction d'investiture qu'il peut appuyer ses réticences traditionnelles à l'application des procédures du parlementarisme rationalisé.
Il a fallu attendre 2007 pour que la conférence des Présidents du Sénat accepte, non sans réticence, que la commission des finances applique a priori la procédure d'irrecevabilité de l'article 40. Il en est de même concernant toutes les décisions du Conseil relevant de la jurisprudence dite «de l'entonnoir». Ce caractère rétif aux disciplines imposées de l'extérieur s'insère dans un état d'esprit marqué en général par une interprétation libérale des règles régissant le fonctionnement de la séance publique et qui est la marque d'une assemblée attachée essentiellement à son autonomie.
J'en viens à la deuxième fonction, celle d'expression, qui renvoie à la fonction de représentation du Parlement, qui est rarement considérée en tant que telle dans les études, celles-ci la réduisant la plupart du temps à la question du mode de scrutin. En fait, pour le Sénat, cette fonction de représentation est au coeur de la problématique, et on peut regretter qu'elle ne soit pas examinée par rapport au rôle que l'on voudrait voir jouer par le Sénat dans les institutions. Comment trouver le moyen de dégager une représentation différente et, mieux encore, complémentaire de la première, s'appuyant si possible sur une légitimité différente ?
De ce point de vue, la V e République a fait progresser les choses, puisque le résultat du référendum de 1969 a montré que cette légitimité ne pouvait être recherchée en dehors du suffrage universel, qui seul fonde le rôle du Sénat dans la révision de la Constitution et assoit sa capacité autonome de contestation.
La première question qui se pose quarante ans après n'est donc pas, à mon sens, de savoir si le Sénat actuel est représentatif c'est une question qu'on ne se pose pas pour l'Assemblée nationale et pourtant..., mais bien plutôt s'il convient de conserver une deuxième assemblée parlementaire à part entière, comme le dit familièrement le Président Christian Poncelet, et quelles sont les conditions que devrait alors remplir son mode de scrutin pour assurer un comportement différent de celui de l'Assemblée nationale.
Le débat est ouvert, on le sait, mais un consensus assez large se dégage, et c'est sans doute l'une des nouveautés de ces dernières années, pour que la base de la représentation sénatoriale demeure les collectivités territoriales. Tel est le sens de la récente proposition de loi constitutionnelle déposée par M. Jean-Pierre Bel, Président du groupe socialiste, et ses collègues.
Le débat se concentre donc surtout sur le point de savoir jusqu'où le fait de représenter les collectivités locales peut justifier un écart par rapport à une représentation proportionnelle de la population.
Au-delà du débat de principe, force est aussi de constater que ce mode de scrutin, qui a été revu et actualisé ne l'oublions pas à cinq reprises souvent à l'initiative des Sénateurs eux-mêmes depuis 1958, a déjà assuré une fonction appréciable de différenciation par rapport à la première chambre :
- une relative stabilité du personnel politique, ce qui n'est pas sans importance dans la vie quotidienne du Parlement,
- une plus grande diversité dans la composition politique, marquée par l'importance traditionnelle des formations centristes ou modérées,
- une certaine correction par rapport aux effets d'amplification du scrutin majoritaire des Députés, permettant le plus souvent, en cas d'alternance forte à l'Assemblée nationale, une meilleure représentation relative des forces d'opposition, un souci assez naturel d'associer l'opposition ou, plus exactement, d'essayer de trouver les évolutions sinon consensuelles, du moins acceptées par l'ensemble des groupes politiques ; n'oublions pas que, jusqu'en 1983, l'opposition possédait deux présidences de commission permanente.
Ces caractéristiques ont permis au Sénat de mieux jouer son rôle pédagogique, la troisième fonction de Bagehot. Il a ainsi affirmé une culture du débat préalable et mis en place une politique d'ouverture vers le citoyen plus développée que l'Assemblée nationale, sans doute parce qu'il en avait plus besoin.
Cette culture du débat, qui rejoint la spécificité de son rôle législatif, est marquée de façon assez constante par l'importance du travail en commission, le recours systématique aux auditions, l'ouverture de ces auditions, leur relais non seulement par la presse mais aussi par la télévision parlementaire, l'attachement à la procédure des questions orales avec débat, que l'Assemblée nationale a abandonnée pendant plusieurs années, et l'accroissement régulier des initiatives en amont des débats législatifs sous des formes diverses.
Ce travail constitutionnel s'est trouvé relayé par une politique délibérée de communication avec le public qui, à mon sens, fait partie intégrante des missions de l'institution. N'oubliez pas que c'est le référendum de 1969 qui a convaincu le Sénat de cette nécessité et que les trois Présidents qui se sont succédé depuis ont vu dans ce développement des relations avec le public l'une des réponses possibles à l'éloignement des citoyens des institutions en général.
Je passe sur l'investissement précoce et massif dans les nouvelles technologies. Le développement des moyens de communication classiques, mais aussi la communication indirecte à travers une politique globale de communication événementielle font du Palais du Luxembourg l'un des lieux les plus fréquentés de France. Quelques manifestations événementielles ont permis de mieux faire comprendre la logique de représentation et le rôle du Sénat dans les institutions de la République :
- les états généraux des élus locaux dans les grandes villes de province,
- les états généraux de la parité réunissant l'ensemble des femmes élus locaux,
- la Fête de la Fédération du 14 juillet 2000 rassemblant les maires de France, en présence du Président de la République et du Premier ministre, pour ne citer que les plus emblématiques.
J'en arrive à la quatrième mission : le pouvoir d'information.
C'est dans ce pouvoir d'information, que nous appelons aujourd'hui plus volontiers «pouvoir de contrôle» que les avancées institutionnelles sont les plus grandes. Par sa pratique, le Sénat a contribué à donner un contenu rénové à la notion de contrôle, qui ne figurait pas parmi les missions majeures du Parlement en 1958. On se souvient que les pouvoirs d'enquête étaient très réduits et qu'ils n'avaient été que faiblement octroyés par une simple ordonnance. Le Sénat s'est donc employé à être le premier à utiliser ces moyens, à la fois les commissions de contrôle, puis les commissions d'enquête, après quoi il a veillé à développer les pouvoirs de ces commissions (la loi du 19 juillet 1977 est d'origine sénatoriale).
Il a veillé aussi à ce que toutes les commissions permanentes puissent avoir, si le Sénat le veut, les mêmes pouvoirs que les commissions d'enquête, et il a inventé des solutions de substitution à ces commissions d'enquête pour aller au-delà de la période de six mois, par exemple sous la forme de missions communes d'information non prévues par son Règlement. Trois ont fonctionné encore tout récemment en 2007.
Le Sénat a été aussi le premier à se pencher sur le contrôle de l'application des lois, depuis 1972, sans interruption. Il est aujourd'hui possible de consulter les données de ce contrôle en permanence sur Internet. Le contrôle s'est enrichi ces dernières années par le souci d'un plus grand suivi ponctuel. Enfin, la nouvelle loi organique sur les lois de finances a permis de multiplier les initiatives, notamment en liaison avec la Cour des comptes.
Pour finir, je noterai sur ce point que la suspension des travaux de séance publique en 2007, qui est liée aux élections législatives et présidentielles, a été précisément utilisée par le Bureau du Sénat, la conférence des Présidents et ses commissions pour marquer sa permanence et lancer un nombre considérable de travaux de contrôle qui ont abouti à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre.
C'est aussi cette permanence qui lui a permis de bien exercer la fonction de législation, en accueillant par exemple sur son bureau cinq des sept projets déposés par la nouvelle majorité, lors de la session extraordinaire, en priorité par rapport à l'Assemblée nationale.
Cette activité législative est aujourd'hui l'un des indicateurs du progrès du développement du Parlement dans le fonctionnement des institutions. On dit souvent que l'importance législative d'une assemblée se mesure au pourcentage de lois d'origine parlementaire. On sait en fait que ce critère n'est pas adapté puisque, dans aucun pays, sauf dans ceux à véritable régime présidentiel, cette initiative est majoritaire, mais que le Sénat a essayé de grignoter une partie de cette initiative, notamment grâce à la journée réservée, que l'on critique aujourd'hui mais dont je crois pouvoir dire qu'elle est bien utilisée par le Sénat et qu'il y attache de l'importance. Par exemple, sur la période 1995-2007, 13,5 % des lois sont issues de propositions de loi du Sénat contre 3 % entre 1959 et 1988.
La grande novation de la pratique institutionnelle est cependant l'essor du droit d'amendement parlementaire, qui contrebalance, et au-delà, la faiblesse relative de l'initiative. Il est rare que les projets de loi ne soient pas profondément transformés et complétés par le débat parlementaire. Dans cet exercice, le Sénat contribue à marquer les textes de son empreinte, y compris lorsque le gouvernement donne le dernier mot à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, selon les périodes, le pourcentage d'amendements adoptés par le Sénat qui figurent dans le texte final oscille entre 44 % en 1983 (troisième période) et 93 %, à trente ans d'intervalle, en 1974 comme en 2004 (deuxième et cinquième période).
L'un des apports capitaux de ces cinquante premières années de la V e République est en effet l'essor de la navette et la confirmation du rôle essentiel de cette novation que constituait l'institution de la commission mixte paritaire. Celle-ci est avant tout un dernier recours : deux tiers des textes sont adoptés sans navette, ou plus exactement par la navette sans réunion de la CMP, et sa réunion est une condition pour que le gouvernement puisse donner, s'il le souhaite, le dernier mot à l'Assemblée nationale. Depuis 1959, 66 % des CMP ont réussi et leur taux de succès demeure significatif, même dans les périodes du plus fort affrontement entre les majorités des deux assemblées : 38 % en 1981, près d'une fois sur deux entre 1988 et 1989.
Au total, l'activité et la place du Sénat, au cours de ces cinquante dernières années, est fort loin de mériter la caricature que l'on en fait parfois. Multiforme, elle illustre l'intérêt du double examen législatif mais - c'est un point auquel je tiens personnellement beaucoup - elle ne s'y résume pas. Le caractère permanent et le suffrage indirect permettent au Sénat d'assurer ce rôle si particulier de stabilisation et de pondération, voire de gardien des équilibres des principes fondamentaux qu'appelle une tradition politique d'instabilité et d'embrasements successifs, renforcée aujourd'hui par les engouements des médias, voire la recherche ambiguë de leur consécration.
Plus ouverte sur la société qu'on l'imagine, traditionnellement intéressée par les dimensions européenne ou internationale des problèmes, l'assemblée du Luxembourg n'apparaît pas la plus mal préparée face aux demandes de revalorisation du rôle du Parlement.
Son mode de désignation lui-même, s'il peut nourrir quelques procès d'intention, appelle sans doute à être replacé dans une problématique plus large : celle de l'équilibre global du système politique, celle aussi de la nécessité d'une organisation du législateur adaptée à la complexité nouvelle d'un Etat qui ne se réduit plus à une administration centralisée et toute-puissante.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Je vous remercie de cette communication précise et sûre qui corrige une caricature trop fréquente. Je me permets d'ajouter que j'ai été touché de voir que vous avez évoqué Marcel Prélot, que j'ai un peu connu. Je me souviens de cette formule qui lui était chère, en 1958, d'une République sénatoriale .
A travers votre exposé, on prend la mesure de la dimension prise par le Sénat, qui n'est peut-être pas toujours suffisamment apparente, mais qui est réelle et de plus en plus marquée. On le voit par votre analyse des diverses configurations de la vie politique française.
Je donne la parole à M. Claude Estier, ancien Président du groupe socialiste du Sénat.
M. Claude ESTIER, ancien Président du groupe socialiste du Sénat
Merci, M. le Modérateur.
Mesdames et Messieurs,
Je remercie beaucoup les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à présenter mon témoignage. En effet, contrairement, à ce que vous avez entendu depuis le début de ce colloque, mon exposé ne sera pas historique ou juridique mais beaucoup plus personnel.
Je commencerai par dire que je m'inscris très volontiers, même si j'ai quelques nuances à exprimer, dans la défense et illustration du Sénat et de son rôle que M. Delcamp vient de présenter. J'aurai évidemment quelques nuances à apporter, notamment sur la définition qu'il a donnée des grands moments du Sénat, mais ce n'est pas le but que je souhaite donner à mon intervention.
Je tiens donc à apporter un témoignage personnel en tant que praticien, comme mon voisin, M. le Premier ministre, et parce que j'ai vécu pendant longtemps quotidiennement dans cette maison.
Je suis entré au Sénat en 1986, en venant de l'Assemblée nationale, où j'occupais les fonctions de Président de la commission des affaires étrangères et où j'avais assisté pendant toute une législature à des débats tendus, souvent violents, notamment au moment des questions au gouvernement du mardi et du mercredi. Quand je suis arrivé au Sénat, une maison que je ne connaissais pas du tout, j'avais le sentiment d'entrer dans un palais d'abord beaucoup plus solennel que celui de l'Assemblée nationale et à l'ambiance beaucoup plus feutrée. Quelques-uns de mes amis m'ont mis en garde tout de suite en me disant : « Il y a aussi, au Sénat, des peaux de banane, mais on les voit moins parce qu'elles sont sous les tapis »...
Pendant deux ans, de 1986 à 1988, j'ai fait l'apprentissage de mon rôle de Sénateur de base, j'ai appris ce qu'était cette maison, comment on y travaillait et ce qu'on y faisait. Puis je suis devenu, en 1988, le Président du groupe socialiste, fonction que j'ai occupée jusqu'en 2004, au moment où j'ai décidé de ne pas me représenter et où j'ai donc pris ma retraite.
Pendant toutes ces années, j'étais un élu parisien, je n'avais pas, comme le disait tout à l'heure M. Pierre Mazeaud, à retourner dans ma circonscription le mardi, le mercredi, le vendredi ou le dimanche et y rester parfois toute la semaine, et je ne cumulais donc pas les mandats, ce qui fera plaisir à M. Mazeaud, puisque je n'avais que mon mandat de parlementaire et un mandat de conseiller de Paris qui n'en était pas vraiment un puisque nous étions dans l'opposition à l'époque. Cela m'a permis d'être présent dans cette maison du lundi matin au vendredi soir, maison que j'ai donc bien connue et dont j'ai découvert petit à petit tous les secrets qui me sont restés tout à fait chers. Je pense que ma longue présence au Sénat a été l'un des grands moments de ma carrière politique.
J'ai participé naturellement, en tant que Président du groupe, à toutes les conférences des Présidents, qui se réunissaient régulièrement sous la présidence d'Alain Poher, René Monory et Christian Poncelet, et j'ai eu l'occasion de présenter, au cours de cette longue carrière au Sénat, tout en étant dans un groupe minoritaire, les positions de mon parti politique et d'essayer de les faire connaître souvent en vain, mais j'y reviendrai tout à l'heure , comprendre et adopter par mes collègues du Sénat.
Je dois dire que le travail que j'ai effectué dans cette maison a été pour moi très enrichissant. C'est une maison à laquelle je reste attaché. Je suis aujourd'hui parlementaire honoraire, mais je suis resté attaché au Sénat et j'y fréquente encore très souvent les amis, les institutions et personne n'en a encore parlé la bibliothèque du Sénat, qui est tout à fait exceptionnelle. Ceux qui y travaillent savent de quoi je veux parler.
En tant que Président du groupe et en tant que membre de la commission des affaires étrangères du Sénat (où j'avais eu à mon arrivée des rapports très cordiaux avec le Président Lecanuet), nous avons engagé un certain nombre de missions de cette commission dans différentes parties du monde, et cela a été pour moi aussi un élément extrêmement instructif et pédagogique, si j'ose dire, de ma présence au Sénat.
En tant qu'européen convaincu, j'étais naturellement membre de la délégation de l'Union européenne et j'ai participé à toutes sortes de réunions de ce que l'on appelle la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC), la réunion périodique des représentants parlementaires des différents pays de l'Union européenne.
J'ai donc travaillé dans tous ces secteurs, à la fois sur le plan de la politique intérieure et de la défense du gouvernement quand il était de gauche, bien entendu, notamment pendant le gouvernement de Lionel Jospin, de 1997 à 2002, et, naturellement, sur la difficulté d'un représentant du groupe socialiste de se faire entendre et de faire adopter ses idées dans cette maison qui est restée, en dépit des différents moments qu'a évoqués M. Delcamp, profondément marquée par une majorité de droite.
En ce qui concerne la pédagogie, il est vrai que la deuxième chambre, le Sénat français, a une fonction pédagogique incontestable, et cela doit être souligné, même par un représentant de l'opposition que je suis, parce que c'est à mon avis un élément tout à fait important dans la vie parlementaire et la vie politique française. Cet élément pédagogique s'est développé au fil des années sous les différentes présidences, notamment celle du Président Poncelet.
Je pense aussi qu'un élément important a été introduit dans cette pédagogie et cette connaissance du travail parlementaire à destination de l'opinion publique par la création de la chaîne Public Sénat, qui a eu d'abord une audience limitée, mais qui se développe aujourd'hui de façon tout à fait positive ce dont je me félicite personnellement parce qu'on y retrouve un certain nombre d'éléments qui permettent à l'opinion publique et aux téléspectateurs de comprendre mieux ce que sont les débats et les différentes positions qui peuvent s'exprimer à travers ces débats.
Autrement dit, j'ai tiré de ces dix-huit ans passés au Sénat des sentiments extrêmement positifs sur l'atmosphère de cette maison et les conditions dans lesquelles on pouvait y travailler, même si j'y viens maintenant , sur le plan politique, les choses sont quand même un peu différentes.
Après ce que je viens de dire, je ne peux m'empêcher de m'engager dans la partie critique. Je crois en effet qu'il y a, au sujet du Sénat, une incompréhension, qui s'est manifestée lorsque Lionel Jospin a parlé d'anomalie du Sénat dans une société démocratique comme celle que nous connaissons en France. Cela ne voulait pas dire, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, que l'on mettait en cause l'existence du Sénat, pas du tout. Le parti auquel j'appartiens est tout à fait attaché au bicamérisme, qui est un progrès et une chance de meilleurs débats et d'amélioration du travail législatif. L'anomalie, qui est aujourd'hui encore plus criante, réside dans le mode de scrutin des Sénateurs.
Certes, il y a eu quelques modifications, auxquelles M. Delcamp a fait allusion, mais elles n'ont pas changé grand-chose. La principale modification, qui est intervenue au cours des dernières années, est le fait d'avoir abrégé la durée du mandat du Sénat. C'est une bonne chose parce que le mandat de neuf ans était un anachronisme par rapport à la réduction des autres mandats, notamment du mandat présidentiel, mais en ce qui concerne le mode de scrutin, les choses n'ont pas beaucoup changé.
Le Sénat j'en prends à témoin M. le Premier ministre, qui est attaché à tout ce qui concerne les collectivités territoriales est censé représenter les collectivités territoriales. C'est sa fonction. Or, aujourd'hui, surtout après les dernières élections de mars 2008, les collectivités territoriales sont en très grande majorité orientées à gauche : vingt régions sur vingt-deux, la majorité des départements et la plus grande partie des grandes villes françaises sont aujourd'hui dirigés par la gauche et le Sénat, qui est censé représenter les collectivités territoriales, n'a aucune chance, même après le prochain renouvellement de septembre prochain, de s'orienter vers cette majorité de gauche car son mode de scrutin l'interdit.
Pourquoi en est-il ainsi ? Tout simplement parce que, dans le corps électoral du Sénat, domine la présence des élus et des maires des toutes petites communes françaises. Cela veut dire que, grosso modo et je grossis le trait , le corps électoral du Sénat correspond à ce qu'était la France il y a cinquante ans, un pays essentiellement rural alors qu'aujourd'hui, plus de 80 % des Français vivent dans les grandes villes. Le corps électoral du Sénat n'a pas évolué en fonction de cette évolution de la société française et c'est ce qui fait qu'éternellement, il y a un déséquilibre, même si, à chaque renouvellement, la gauche grignote quelques sièges supplémentaires. Quand je suis devenu Président du groupe socialiste, en 1988, nous étions soixante alors que mes amis sont aujourd'hui un peu plus de quatre-vingt-quinze. Nous avons à chaque fois gagné des sièges, mais la majorité reste la même, une majorité de droite, même quand un ensemble de collectivités territoriales, comme je viens de le rappeler, se situe à gauche.
Dans toute démocratie, la deuxième chambre, lorsqu'elle existe, doit être soumise à l'alternance, comme la première. Je prends l'exemple de l'Italie, qui vient de changer de majorité : le Sénat était à gauche et il est passé à droite à la suite des élections qui viennent de se dérouler. C'est tout à fait normal en démocratie. En France, le Sénat ne change jamais de majorité à cause de ce mode de scrutin.
Cela pose un vrai problème. C'est pourquoi, dans le débat qui s'instaure aujourd'hui sur la réforme des institutions, mon parti et mon groupe ont décidé de poser, non pas comme question préalable, mais comme condition au fait d'aller plus loin dans cette réforme des institutions la prise en considération sérieuse, enfin, du problème de la réforme du mode de scrutin du Sénat.
M. Delcamp, vous avez dit tout à l'heure que le débat est ouvert. Tant mieux, mais je voudrais qu'il ne soit pas refermé sans que l'on ait changé les choses. C'est un vrai problème, et je ne suis pas sûr que l'on y arrive.
Pour ma part, je déplore cette situation parce que, encore une fois, et c'était la première partie de mon témoignage, j'ai beaucoup de choses positives à dire sur le Sénat. J'ai apprécié considérablement tout ce que j'ai pu y faire et y vivre pendant ces dix-huit années, mais je souhaite qu'un jour prochain, le plus rapidement possible, cette réforme du mode de scrutin du Sénat permette que, dans cette assemblée, comme dans l'Assemblée nationale, l'alternance soit possible. C'est une condition fondamentale dans une société démocratique.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Je vous remercie de votre réflexion et du bilan de votre long passage au Sénat. J'ai été très frappé de vous entendre dire que la gauche, aujourd'hui, est désormais, depuis un certain nombre d'années, pour le bicamérisme, car ce n'était pas la tradition républicaine.
M. Claude ESTIER.-
Elle l'est depuis longtemps.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
C'est en 1875 que Gambetta a pesé pour que ses amis dits de l'extrême-gauche, socialistes ou radicaux, l'acceptent. Cela n'a pas été sans problème dans les années suivantes.
M. Claude ESTIER.-
C'est vrai, mais cela fait quand même depuis 1875 !
M. Jean-Marie MAYEUR.-
Cela fait un certain temps, en effet.
Je vais donner la parole à Nicolas Rousselier qui va parler des Premiers ministres au Parlement. Nicolas Rousselier a publié un ouvrage tout à fait dans l'axe de nos préoccupations. Ce livre, intitulé « Le parlement de l'éloquence », est fondamentalement une réflexion tout à fait neuve et dont les analyses sont maintenant largement reprises, sur l'importance des délibérations parlementaires et du compromis parlementaire dans la III e République, en s'intéressant à la législature de 1919.
M. Nicolas ROUSSELLIER, Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris
Les Premiers ministres au Parlement
Entre autres changements radicaux, la V e République a été le théâtre d'un bouleversement de la place et du rôle des Premiers ministres au Parlement. De « président du Conseil » avant 1958 à « Premier ministre », le changement de nom n'était pas seulement symbolique de cette évolution ; il indiquait la réalité d'une mutation.
Sous les III e et IV e Républiques, les présidents du Conseil étaient constamment présents dans les hémicycles des deux assemblées. Ils devaient non seulement être là, physiquement, sur le banc des ministres, mais aussi multiplier les interventions à la tribune. Le simple fait de se montrer ne suffisait pas à assurer la discipline de la majorité ; il fallait pouvoir constamment réassurer le pacte majoritaire par les discours et les interventions dont certaines devaient être improvisées afin de mieux contrer les attaques des opposants.
Cette servitude parlementaire des présidents du Conseil s'inscrivait dans le principe même du régime ultra délibératif que connaissaient ces deux Républiques. La confection des lois ne pouvait pas être assurée par la discipline de vote. Il fallait donc se battre au sein même de l'hémicycle ; parler aux groupes politiques, intervenir auprès des parlementaires influents, faire les couloirs ou les faire faire par ses lieutenants et ses informateurs, être là en signe de soutien des ministres et, surtout, monter soi-même à la tribune autant de fois que nécessaire pendant toute la durée des sessions parlementaires. La majorité n'était jamais certaine d'avance. Autrement dit, le métier de président du Conseil s'identifiait pour l'essentiel à celui de tribun parlementaire. La vie et la mort politique d'un président du Conseil relevaient presque entièrement de l'arène parlementaire.
Face à cette longue tradition venue du 19ème siècle, la Constitution de 1958 eut pour principal objectif d'assurer une autorité nouvelle au pouvoir exécutif tout en lui conservant son caractère dual partagé entre « président de la République » et « président du Conseil » rebaptisé « Premier ministre ». Dans le cas du président de la République, la voie du renforcement passa par la définition d'un certain nombre de pouvoirs propres (dont celui de nommer le Premier ministre) et par la légitimité tirée de l'élection. Dans le cas du Premier ministre, l'affaire était plus compliquée ; il fallait à la fois maintenir sa raison d'être parlementaire en tant que chef d'un gouvernement responsable devant les assemblées mais aussi le protéger des aléas politiques liés aux incertitudes majoritaires et donc du risque d'instabilité gouvernementale.
L'originalité de Michel Debré
La protection qui devait entourer le Premier ministre pour le prémunir contre les risques d'un renversement parlementaire ne fut pas conçue au départ comme un cordon sanitaire ou une cloison étanche qui aurait eu pour conséquence d'éloigner le Premier ministre des hémicycles parlementaires. Au contraire, dans l'esprit de Michel Debré qui fut le premier à exercer ce rôle inédit, le « Premier ministre », tout en bénéficiant de l'arsenal du parlementarisme rationalisé que lui offrait la Constitution, devait pleinement assumer le rôle de chef des débats parlementaires sur le mode anglais. Cette préférence parlementaire du sénateur gaulliste s'était d'ailleurs signalée lors de la phase d'élaboration du texte constitutionnel, au mois de juin et au début du mois de juillet 1958. Michel Debré, contre l'avis des juristes qui composaient le « groupe des experts », avait par exemple voulu inscrire dans la Constitution l'obligation pour le Premier ministre de faire une déclaration de politique générale chaque année, en début de session, avec débat et mise en jeu de la responsabilité du gouvernement 1 ( * ) . Proposition non retenue par le groupe, Michel Debré se retrouvant quelque peu isolé face à des experts issus non pas du monde parlementaire mais du Conseil d'Etat.
En ce sens, Michel Debré se situait encore dans ce que l'on pourrait appeler la tradition philosophique républicaine considérant le Parlement comme le lieu de la nation assemblée et le lieu d'où devait être puisée la légitimité politique du pouvoir exécutif. Certes, il avait bien compris qu'une part nouvelle de la légitimité du Premier ministre lui venait du choix opéré par le président de la République, lui-même issu d'un suffrage élargi (puis du suffrage universel). Mais, Michel Debré concevait encore qu'une part non négligeable de sa légitimité devait être associée à la confiance que lui exprimerait l'Assemblée nationale (voire le Sénat) et ceci de manière fréquente et régulière. La confiance exprimée par une majorité parlementaire tenait lieu de confiance de la nation ; l'Assemblée faisant encore figure, dans l'esprit de Debré, de métonymie de la nation politique.
L'idée première était donc de permettre au Premier ministre d'être le tuteur sévère et même redoutable des joutes parlementaires, notamment dans le but d'assurer l'efficacité et la rapidité de la confection des lois, tout en reconnaissant son appartenance ontologique au Parlement.
On ne s'étonnera pas de constater que Michel Debré fut le seul Premier ministre de la V e République à se situer, au moins en partie, dans la continuité des présidents du Conseil de la IV e République. Au cours de l'année 1959, il eut ainsi à son actif 28 interventions à l'Assemblée nationale puis 33 l'année suivante. A titre de comparaison, Guy Mollet en 1956 comptait 40 interventions et Antoine Pinay, 38 pour l'année 1952 2 ( * ) . Si on note une diminution entre l'avant et l'après 1958, l'ordre de grandeur restait cependant le même ; la pratique avait changé mais pas forcément la philosophie ou la « culture politique » que partageaient les principaux acteurs. Miche Debré intervenait encore à la manière d'un président du Conseil comme le démontrait son activisme au sein des importants débats de confection législative telles que la réforme agricole, la réforme judiciaire ou les nouveaux dispositifs militaires 3 ( * ) .
Comme sous la IV e ou la III e République, le Premier ministre était encore omniprésent lors de la discussion budgétaire : en novembre 1959, on le voit ainsi intervenir le 6 sur les enjeux généraux du débat budgétaire, le 18 sur les crédits militaires, le 21 sur l'aide au développement, le 22 sur les crédits de l'éducation nationale, les anciens combattants et les crédits des services du Premier ministre et le 24 sur les anciens combattants et sur l'engagement de l'article 49-3.
Au total, si l'on répartit les interventions de Michel Debré en tant que Premier ministre en trois catégories, les interventions liées aux déclarations générales (en y ajoutant les allocutions diverses), les interventions liées aux débats sur des motions de censure et, enfin, les interventions de confection législative, on obtient pour l'année 1960 : 8 et 6 interventions pour les deux premières catégories et 19 interventions pour la catégorie purement législative 4 ( * ) . On saisit bien ainsi la nature encore très parlementaire du travail primo-ministériel sous l'ère Michel Debré.
L'ère du déclin
La véritable rupture intervint donc après Michel Debré. Comme on peut le voir dans les graphiques placés en annexe, la présence et l'activité des Premiers ministres connurent une diminution rapide et spectaculaire à partir de la longue tenure de Georges Pompidou. Cet effondrement est encore plus marqué au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Après la crise de 1962, véritable fondation d'un nouveau régime à l'intérieur du régime né de la Constitution de 1958, on ne comptabilise que 7 interventions de Georges Pompidou à l'Assemblée nationale en 1964, puis 6 en 1966 et 11 en 1967. A partir de cette brutale rupture, on peut dire que le pli de la Constitution et de la place des Premiers ministres est pris ; le phénomène s'inscrit dans la durée et la place des Premiers ministres est désormais installée dans la rareté.
Certes, on note des variations individuelles. Certains Premiers ministres sont plus interventionnistes que d'autres, tel Raymond Barre, Pierre Mauroy en 1981 et 1982, Jacques Chirac en 1986 ou encore Alain Juppé en 1995 et 1996. Mais leur zèle parlementaire ne porte pas la signification d'un « revival » ou d'une attitude délibérément favorable à un retour au parlementarisme d'antan. Dans tous les cas, les raisons sont plus simples et plus terre à terre : le fait de cumuler le poste de Premier ministre et celui de ministre des Finances (pour Raymond Barre), le fait de mener tambour battant une impressionnante série de réformes à la suite d'élections de combat (pour Mauroy, Chirac, Juppé) ou encore le fait d'avoir à répondre à de nombreuses motions de censure (pour les quatre cités). Inversement, les Premiers ministres les moins interventionnistes, tel Michel Rocard (3 interventions seulement en 1988) ou Lionel Jospin (3 interventions en 1997-1998 et aucune au Sénat, 2 interventions en 1999-2000 et en 2001) ne sont pas forcément les hommes politiques réputés les plus hostiles au principe de la discussion et à l'idéal de démocratie délibérative.
En tout état de cause, le phénomène dans sa globalité, sur une période de quatre décennies apparaît très marqué. C'est celui d'une diminution forte et inexorable du rôle personnel du Premier ministre au Parlement sous la forme des interventions classiques 5 ( * ) . Cela s'explique par les conséquences quasi mécaniques des armes juridiques qui avaient été données au Premier ministre par la Constitution de 1958 : réduction du temps de session, accélération du temps de travail législatif, procédure d'urgence, rareté de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, suppression des interpellations sous leur forme classique, possibilité offerte de passer par la voie des ordonnances. Autant d'éléments qui réduisent les débats législatifs en séance et autant d'éléments qui réduisent les occasions d'intervention des premiers ministres 6 ( * ) .
De plus, avec l'avènement du fait majoritaire, les premiers ministres n'ont plus besoin de se montrer et de parler pour exercer leur force ; la majorité le fait à leur place. Et cette majorité est connue d'avance. La discipline de la majorité ne se gagne plus à la tribune mais dans les concertations préalables ; elle est dorénavant le fruit d'une construction politique placée entre les mains des états-majors des partis et sous la haute surveillance du président de la République (sauf en période de cohabitation). Le contraste est donc devenu spectaculaire entre les présidents du Conseil des deux républiques parlementaires et le Premier ministre de la République semi-présidentielle installée depuis 1962. Nous avons déjà cité les exemples de Pinay et Mollet mais, en remontant plus en arrière, on pourrait rappeler les chiffres qui démontrent l'ancienne absorption des présidents du Conseil dans le travail parlementaire : 54 interventions à la Chambre des députés pour Waldeck-Rousseau en 1900, 113 pour Poincaré en 1927, 83 pour Ramadier en 1947 (et seulement de fin janvier à fin novembre). En comparaison, on comprend pourquoi les premiers ministres de la V e République ont pu consacrer l'essentiel de leur temps et de leur énergie à la coordination du travail gouvernemental et au suivi des grandes politiques publiques, ce que les anciens présidents du Conseil ne pouvaient faire qu'avec d'extrêmes difficultés et seulement à la marge de leurs activités parlementaires.
La mutation est de nature quantitative mais elle comporte aussi des aspects qualitatifs. Le Premier ministre ne participe plus guère aux débats de confection législative. Il intervient lors des déclarations de gouvernement et lors des joutes verbales que ne manquent pas de soulever les débats sur les motions de censure. Mais il n'a plus à être le maître des débats et l'animateur de la vie législative comme Michel Debré l'avait envisagé et tenté d'en configurer la pratique. Si l'on veut employer une image facile, on peut dire que le Premier ministre de la V e République a été exfiltré de la zone dangereuse et tumultueuse que représentait autrefois l'arène parlementaire. Dorénavant, avec le fait majoritaire, ce n'est plus le Premier ministre qui est comptable de son action devant le Parlement mais plutôt la majorité parlementaire qui est comptable vis-à-vis du Premier ministre de la réalisation en bon ordre du programme gouvernemental 7 ( * ) , le Premier ministre étant lui-même comptable de cette réalisation devant le président de la République.
L'ère du rachat
Faut-il après tous ces chiffres en arriver à la conclusion d'un éloignement voire d'un divorce entre le Premier ministre de la V e République et la sphère parlementaire ? Si le changement et le déclin ne peuvent être niés, ils doivent cependant être nuancés du fait de nouvelles mutations intervenues à partir des années 1970. Une première distinction est utile ; entre la présence parlementaire du Premier ministre et sa fonction politique effective. La diminution des interventions orales ne signifie pas ipso facto la perte d'un rôle parlementaire. Tout au long de ces années, grâce aux services de Matignon, grâce au travail du cabinet du Premier ministre et au rôle d'un secrétaire d'Etat (ou ministre) chargé des relations avec le Parlement, le Premier ministre de la V e République a pu asseoir son rôle de chef de la majorité parlementaire et assurer ainsi l'efficacité de la discipline de vote. Intervenant peu à la tribune ou de son banc, le Premier ministre n'en est pas moins présent dans l'hémicycle. Par cette présence, il continue d'assurer, plus que jamais, son rôle de chef politique du Parlement ; tant d'un point de vue symbolique (sa présence surtout si elle est médiatisée) que d'un point de vue pratique (sa présence permet de tenir les troupes via les réunions du groupe politique et les multiples conciliabules).
Mais on peut aller plus loin dans la nuance qui doit être apportée à l'idée d'un déclin parlementaire des premiers ministres. Car, les hôtes de Matignon ont trouvé une sorte de second souffle parlementaire avec l'introduction des questions au Gouvernement, en 1975 pour l'Assemblée, en 1983 au Sénat. La nouvelle pratique a ouvert une fenêtre d'opportunité et d'intervention que les premiers ministres ont largement mise à profit. Comme on le voit dans les graphiques présentés en annexe, il y a multiplication des interventions des premiers ministres par l'entremise des réponses apportées lors de ces questions au Gouvernement. Ces réponses ont donc joué en quelque sorte le rôle de substitution par rapport au déclin des interventions classiques liées aux débats de confection législative. Jacques Chirac intervenait ainsi 25 fois pour des réponses aux questions au Gouvernement dès 1976 tandis que Pierre Mauroy intervenait 48 fois pour la seule année 1984 (si on ajoute les premiers mois de Laurent Fabius). Juppé atteignait pratiquement le même chiffre en 1995-1996 (47 réponses). Le champion de ce type de pratique a été Lionel Jospin que l'on classait tout à l'heure « mauvais élève » des interventions parlementaires classiques. Il donne 40 réponses en 1997-1998 puis 45, 33 et 42 dans les années suivantes.
Ce retour en force des premiers ministres au sein des assemblées peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord par le bon sens : les assemblées parlementaires conservent un intérêt politique évident pour la stratégie des gouvernants. Elles offrent un cadre chargé d'histoire, de symbole et de légitimité dans lequel l'expression d'un message politique de l'exécutif peut prendre toute sa force, surtout s'il est retransmis par la télévision et permet ainsi de toucher l'opinion publique. De manière plus stratégique, un débat parlementaire, notamment s'il soulève le folklore des passions et du chahut parlementaires, est le moyen pour le Premier ministre d'entretenir le statut d'un chef d'équipe gouvernementale capable de mener ses troupes à la bataille. Il est évident qu'un Premier ministre ne peut pas laisser ses ministres monter seuls au créneau ou en ordre dispersé. Il doit, à certains moments, assumer des discours de politique générale et prendre en charge la réponse aux attaques les plus vives faites par l'opposition, notamment dans les périodes de crise et de forte tension politique ou lorsque surgissent des « affaires ». Il se doit de galvaniser les troupes de la majorité à intervalles réguliers et de nourrir l'identité du parti majoritaire. En ce sens, les passes d'armes qu'offrent très souvent les questions au Gouvernement sont d'excellents moyens pour raviver le clivage droite/gauche et pour retrouver les fondamentaux sans lesquels il n'y a pas construction politique d'une majorité.
Ainsi, bien que le Premier ministre ait perdu sa place dans le travail de confection des lois, il a pu devenir un redoutable débatteur politique. Par ce rôle, il se plie à la fonction de contrôle qu'exercent les assemblées parlementaires sur l'exécutif, mais il y trouve surtout un moyen de stratégie politique aussi bien collective (diriger sa majorité) qu'individuelle (imposer sa marque personnelle auprès de l'opinion, y compris en concurrence avec le Président de la République). En fait c'est plus une ressource stratégique qui s'est offerte à lui qu'une contrainte démocratique qui l'aurait obligé à retrouver le chemin de l'hémicycle parlementaire.
On le devine, les questions au Gouvernement sont loin de marquer une véritable renaissance parlementaire des Premiers ministres. Difficile de les considérer comme de véritables substituts des anciens grands débats d'interpellation des III e et IV e Républiques ou comme des compensations au déclin des interventions classiques. Les réponses sont souvent regroupées sur une seule séance et ne sont donc pas une forme régulière susceptible de rythmer la vie parlementaire. Elles sont souvent rapides et peu approfondies, et sont donc à mille lieues des interpellations parlementaires d'antan (qui étaient parfois étalées sur plusieurs séances et débouchaient sur une véritable épreuve politique sous la forme du vote des ordres du jour).
Une conclusion, une proposition
En conclusion, et pour sortir de la tour d'ivoire que l'universitaire aime à se construire au nom de sa sacro-sainte « objectivité », nous ferions volontiers une proposition permettant de réinscrire le Premier ministre dans le cadre d'un contrôle parlementaire digne de ce nom. Il s'agirait de faire renaître sous une forme modernisée la vieille tradition des auditions du Premier ministre en commission. Cette tradition a quasiment disparu sous la V e République en parallèle avec la diminution du rôle des premiers ministres dans les débats de confection législative. Elle restait encore vivace sous Michel Debré mais n'apparaît plus que de manière sporadique ensuite 8 ( * ) . L'audition du Premier ministre pourrait être déclenchée soit à la suite d'une demande formulée par un certain nombre de députés ou de sénateurs soit, de manière obligatoire, pour tout sujet correspondant aux grands domaines qui intéressent la vie de la nation (réforme de l'Etat, modification apportée aux services publics de la nation, réforme de la protection sociale, défense nationale, politique extérieure). Le Premier ministre devrait passer audition devant la commission parlementaire correspondant au sujet et au débat mis en jeu. Une telle pratique remplacerait avantageusement le débat à l'emporte pièce des questions au Gouvernement par une audition fondée sur un interrogatoire serré et approfondi. Ce serait donc le moyen de renforcer la fonction de contrôle que le Parlement exerce sur l'exécutif.
Après plus de quatre décennies de déclin du rôle des premiers ministres dans les assemblées parlementaires, il serait vain de vouloir revenir à une fonction de débatteur législatif qui caractérisait autrefois la lourde tâche des présidents du Conseil. Rien n'interdit en revanche d'espérer la refondation de la relation entre le Parlement et le Premier ministre par l'introduction d'une obligation constitutionnelle imposant au Premier ministre de rendre des comptes aux élus de la nation. A condition d'être juridiquement et politiquement contraignant, exigeant dans sa forme et sa procédure, un tel débat serait bien autre chose que le contrôle indirect et incertain qui s'exerce dans notre « démocratie du public » soit par les médias soit par les sondages. Il doterait le Premier ministre d'une nouvelle raison d'être dans une période où sa fonction voire son existence sont de plus en plus remis en cause.
Annexes - Tableaux
Interventions des premiers ministres à l'Assemblée nationale
Les interventions sont définies ici comme nombre total des séances où les premiers ministres sont intervenus (plusieurs interventions lors de la même séance compte pour une seule occurrence), y compris si les interventions portent sur le même sujet lors de séances successives. N'ont pas été comptabilisées les interventions où le Premier ministre se contente d'engager la responsabilité du gouvernement sans faire de discours. Il s'agit des interventions « classiques » : les réponses aux questions au Gouvernement n'ont pas été comptabilisées.
De Michel Debré à Pierre Messmer
*1 intervention pour Debré, 9 pour Pompidou ; ** 6 pour Pompidou et 5 pour Couve ; *** les 5 interventions sont de Chaban, aucune intervention de Couve ; **** 4 pour Chaban, 3 pour Messmer
De Jacques Chirac à Michel Rocard
|
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
|
13* |
7 |
14** |
13 |
8 |
14 |
10 |
11*** |
11 |
6 |
10**** |
4 |
17 |
5 |
3 |
11 |
* 2 interventions pour Messmer, 11 pour Chirac ; ** 5 pour Chirac, 9 pour Barre ; *** aucune intervention de Barre ; **** 5 interventions pour Mauroy, 5 pour Fabius
De Michel Rocard à Jean-Pierre Raffarin
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
98/99 |
99/00 |
00/01 |
01/02 |
02/03 |
03/04 |
04/05 |
|
9 |
13* |
12** |
9 |
5 |
14 |
4 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3*** |
6 |
8 |
6 |
* 3 interventions pour Rocard, 10 pour Cresson ; ** 2 pour Cresson, 10 pour Bérégovoy ; *** 2 pour Jospin, 1 pour Raffarin
Réponses aux questions au Gouvernement depuis 1975 à l'Assemblée nationale
Les chiffres correspondent aux nombres de réponses faites par les premiers ministres (plusieurs réponses peuvent être faites lors de la même séance)
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
98/99 |
99/00 |
00/01 |
01/02 |
02/03 |
03/04 |
04/05 |
|
29 |
18 |
25 |
13 |
8 |
47 |
16 |
40 |
45 |
33 |
42 |
27 |
40 |
33 |
30 |
Interventions des premiers ministres au Sénat
* 1 pour Chaban, 1 pour Messmer
|
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
|
9* |
5 |
4** |
5 |
3 |
5 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
5 |
7 |
3*** |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
Ligne 2 : nombre de séances où le Premier ministre répond à une ou plusieurs questions au Gouvernement
* 1 pour Messmer, 8 pour Chirac ; ** 1 pour Chirac, 3 pour Barre ; *** 2 pour Mauroy, 1 pour Fabius
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
19997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
2 |
2* |
3 |
6 |
3 |
*** |
*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3**** |
1 |
|
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
*** |
*** |
2 |
2 |
4 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* 1 pour Rocard, 1 pour Cresson ; ** 1 pour Rocard, 2 pour Cresson ; *** données manquantes ; **** 1 pour Raffarin, 3 pour Villepin
Annexes-Graphiques
Interventions des Premiers ministres au Sénat
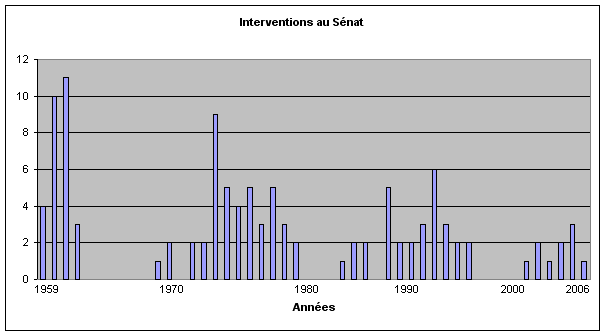
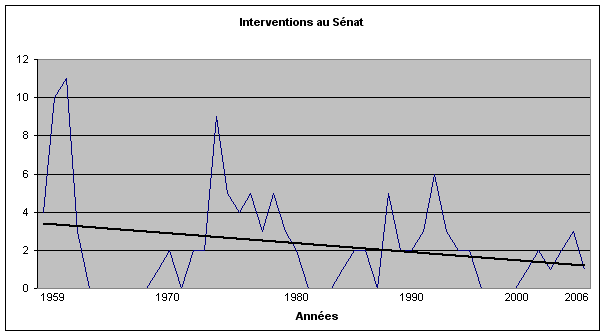
Interventions et réponses aux questions au gouvernement au Sénat
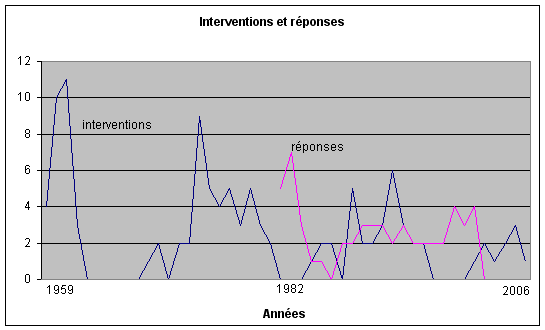
Interventions des Premiers ministres à l'Assemblée nationale
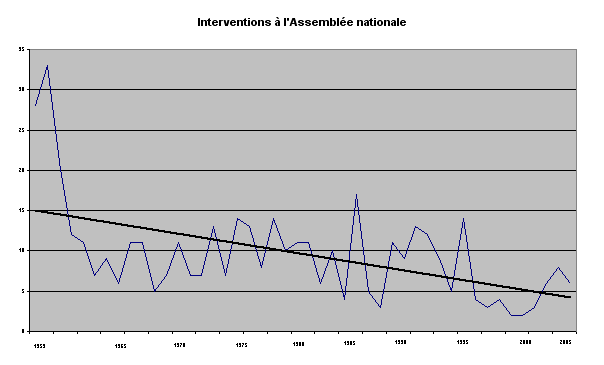
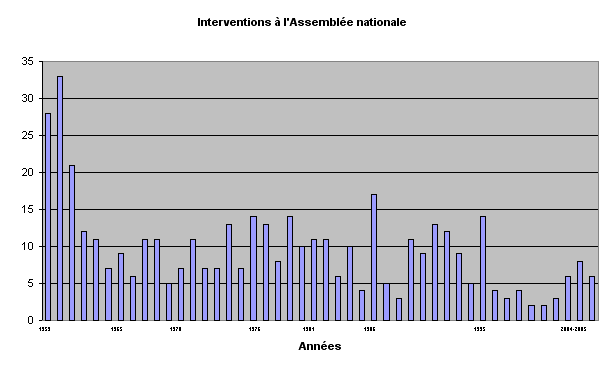
Interventions et réponses aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale
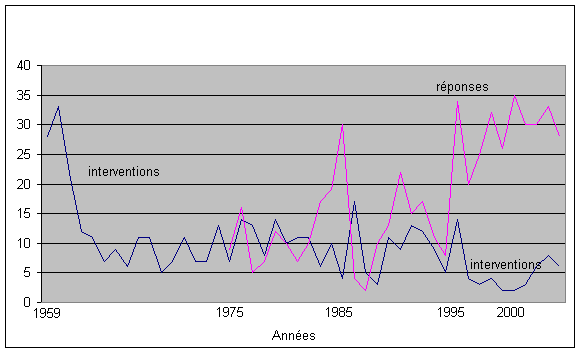
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Merci beaucoup de nous avoir dit tant de choses en peu de temps, avec beaucoup de rigueur et de précision. J'apprécie aussi que vous ayez donné vos sentiments personnels pour finir.
Je donne la parole à Mathias Bernard, l'un de mes anciens étudiants, qui a fait une thèse il y a quelques années sur la Fédération républicaine, puis une habilitation sur les relations entre nationaux et libéraux dans la France du XXe siècle. Professeur à l'Université de Clermont II, il va évoquer les forces politiques au Parlement. J'ajoute que Mathias Bernard a donné des synthèses très utiles sur la France politique très contemporaine.
M. Mathias BERNARD, Professeur à l'Université de Clermont II - Les forces politiques au Parlement
Merci, M. le modérateur. Je retiens tout d'abord deux choses qui ont été dites ce matin : le fait que la V e République n'a pas été incompatible, loin de là, avec l'affirmation du système des partis, qui ont été consolidés, contre toute attente, par ce système politique ; le fait que le parlementarisme rationalisé n'a pas affaibli l'importance politique du Parlement et des assemblées.
De fait, le Parlement reste, tout au long de la V e République, un enjeu important pour les forces politiques, même s'il existe d'autres lieux du débat politique qui se sont affirmés, notamment les médias audiovisuels. Du coup, ce qu'on a appelé la dépendance politique de la part des parlementaires s'est même renforcée au cours de ces années, à tel point qu'elle a pu faire l'objet de toute une bibliographie critique, dont on peut retenir l'ouvrage de Jean-Pierre Masclet, publié en 1982, un ouvrage scientifique ayant parfois une tonalité de réquisitoire intitulé « Un Député, pour quoi faire ? » dans lequel l'auteur associe la double dépendance : la dépendance du Député par rapport à sa circonscription et ses autres mandats et sa dépendance nationale.
Je vais faire le point sur ces différents liens entre les parlementaires et les partis en dégageant des évolutions observées entre 1958 et 2008.
Mon premier ensemble de réflexions concerne les liens entre partis et parlementaires. Je rappellerai quelques évidences qui expliquent la permanence, voire le renforcement, de la place des partis au Parlement.
Première évidence : ce sont bien les organisations politiques et les partis qui jouent un rôle central dans la sélection des candidats éligibles au Parlement et ce sont eux qui apportent un concours décisif à leur élection. Le changement de scrutin en 1958 n'a pas inversé une évolution sensible depuis l'entre-deux-guerres, une situation qui fait que le Député, même lorsqu'il est un élu de terrain et qu'il a des réseaux locaux, s'inscrit dans des réseaux politiques nationaux. Les non-inscrits restent à un niveau très bas tout au long de la période : ils étaient 24 en 1958 (et encore, ce chiffre est gonflé par le fait que les Députés communistes, étant réduits à une dizaine, n'avaient pas pu constituer de groupe à l'Assemblée nationale) et jamais plus d'une vingtaine par la suite, avec parfois des niveaux de sept à huit Députés non inscrits.
On voit aussi cette place des organisations politiques dans l'élection des Députés, notamment lorsqu'on constate que les candidats dissidents ont souvent des difficultés à se faire élire, même lorsqu'ils sont des Députés sortants. C'est peut-être moins vrai depuis une dizaine d'années, mais, dans les premières années, voire les premières décennies, nous avons quelques cas célèbres, notamment celui d'Edgar Pisani, en 1968, qui n'a pas pu se faire réélire dans le Maine-et-Loire, et qui était un gaulliste non orthodoxe.
Par conséquent, si le parlementaire libre de toute attache partisane n'existe presque pas, le type de relation entre l'élu et son parti c'est une deuxième évidence dépend du type d'organisation politique auquel il se rattache. C'est particulièrement vrai au cours de la première décennie du régime où il existe une différence sensible entre deux types d'élus :
- les élus des groupes communiste, socialiste et gaulliste qui ont une dépendance assez forte avec le parti (ce n'est pas une surprise de la part des Députés communistes, dont bon nombre sont souvent membres permanents de leur parti ; c'est le cas également des élus socialistes, qui doivent justifier, en vertu de leur statut, une adhésion suffisamment ancienne pour être investis par leur parti) ;
- les élus centristes, modérés et indépendants, qui sont moins massivement des membres actifs d'organisations politiques nationales.
Cette différence s'estompe au cours des décennies, mais elle reste quand même importante. Par exemple, plusieurs études qui ont été conduites sur les Députés de la législature 2002-2007 montrent que la moitié des Députés de l'Assemblée nationale ont exercé, avant leur élection ou au moment de celle-ci, en 2002, des responsabilités dans un parti, mais ce chiffre moyen de 50 % cache des disparités, puisque c'es le cas de 70 % des Députés socialistes et de "seulement" 43 % des Député UMP. Nous avons des cursus qui restent différents, même au début du XXIe siècle, entre Députés des différents groupes politiques.
J'en viens à ma troisième évidence : on peut dire qu'au-delà des différences individuelles d'engagement dans les partis politiques, le lien entre le parlementaire et son parti est le groupe parlementaire. C'est d'ailleurs sur ce point que je vais centrer mon intervention. De ce point de vue, l'évolution de la configuration des groupes parlementaires entre la IVe et la V e Républiques est spectaculaire, notamment à l'Assemblée nationale. Cette évolution tient à la simplification du paysage de l'Assemblée nationale, qui est lié à un dispositif assez mécanique : le relèvement du seuil permettant de constituer un groupe parlementaire. Le seuil est désormais fixé à quatorze Députés alors qu'il était de trente Députés en 1958.
Du coup, le nombre de groupes parlementaires s'est considérablement réduit. Il y en avait une quinzaine sous la IV e République alors que, sous la V e République, il y en a cinq à six pendant les vingt premières années et qu'il n'y en a même plus que quatre dans certaines législatures (c'est le cas en 1978, en 1981, en 2002 et en 2007) en dépit de l'abaissement du seuil.
De fait, le groupe parlementaire ne va plus recouvrir, comme c'était le cas auparavant, des réseaux d'élus semi-individuels selon des affinités qui ne sont pas seulement politiques, et nous aurons une meilleure coïncidence des groupes parlementaires avec les principales forces politiques du pays.
C'est vrai jusqu'en 1997, après quoi cette coïncidence est un peu perturbée par la Constitution de groupes techniques dans lesquels vont se rassembler des forces politiques assez différentes. Le premier de ces groupes apparaît en 1997, à l'Assemblée nationale ; c'est le groupe intitulé Radical, Citoyens et Verts, une force politique relativement hétérogène. Dix ans plus tard, en 2007, nous avons un autre groupe hétérogène : la Gauche démocrate et républicaine, intitulé dans lequel, pour la première fois, on ne fait plus référence au mot "communiste", alors que ce groupe rassemble en grande partie des Députés communistes.
La création de ces groupes techniques a donc tendance à diluer dans leur intitulé la référence à des forces ou des sensibilités politiques.
Dans un deuxième temps, je vais essayer de définir les principales fonctions des groupes parlementaires, puisque ce sont eux qui expriment les sensibilités politiques, en dégageant trois fonctions principales.
La première fonction d'un groupe parlementaire est une fonction de relais de l'action du parti politique. Cette fonction est ancienne, puisqu'elle date du début du XX e siècle, dans les partis de la gauche que je qualifierai de marxistes ou qui font référence au marxisme. On la retrouve de façon très nette au sein du groupe communiste dans les deux assemblées, ou même dans le groupe socialiste. Les statuts du PS, qui ont été définis en 1971, affirment que, même en cas de circonstances exceptionnelles, le groupe [socialiste] ne peut engager le parti sans son assentiment. On a donc un lien étroit entre le groupe et le parti avec des relations de dépendance.
Il est assez clair aussi que les hommes choisis pour présider ces groupes, communiste et socialiste, sont souvent des personnalités influentes dans le parti. Je pense par exemple à Gaston Defferre, qui a exercé pendant de longues années la présidence du groupe socialiste de l'Assemblée nationale avant 1981, ou à Waldeck Rocher, Président du groupe communiste avant d'être secrétaire général du parti. Ce sont donc des personnalités influentes dans le parti qui expriment assez fidèlement la position de l'appareil.
Ce modèle socialiste et communiste va imprégner, dès la première législature de la V e République, le groupe gaulliste, à l'intérieur duquel la discipline de vote va s'imposer dans les circonstances difficiles de la guerre d'Algérie, avec des tensions, des exclusions et des démissions, toute une série de péripéties. Ceux que l'on appelle les "godillots du général" sont dirigés par des personnalités qui assument, peut-être plus clairement que dans le groupe socialiste, par exemple, leur fonction de courroie de transmission.
On peut citer à cet égard, de façon symptomatique, l'accès à la fonction de Président du groupe gaulliste, en novembre 1962, de Roger Dussaulx, qui est un ancien secrétaire général de l'UNR et qui, juste avant d'entrer dans cette fonction, a exercé quelques mois la charge de ministre chargé des relations avec le gouvernement dans le premier gouvernement Pompidou. On constate donc qu'il existe un lien étroit entre la présidence du groupe, le parti et le gouvernement.
Je citerai aussi le fait qu'en 1978, le groupe UDF, qui vient de se constituer à l'Assemblée nationale, juste après la création de cette confédération, choisit comme Président de groupe l'ancien secrétaire général des Républicains indépendants, Roger Chinaud, dans un lien très fort entre partis et groupes parlementaires.
La deuxième fonction d'un groupe parlementaire est de situer l'ensemble de ses membres par rapport à la majorité et au gouvernement. Cela renvoie, là aussi, à la position du parti par rapport à ce gouvernement. Cette relation entre groupe parlementaire et gouvernement peut être de trois ordres. Cela peut être le soutien presque inconditionnel d'un parti et d'un groupe au gouvernement, lorsque ce groupe constitue le pilier de la majorité. C'est le cas du groupe gaulliste jusqu'en 1974 et du groupe socialiste lors des trois législatures au cours desquelles les socialistes assuraient cette fonction.
Il est intéressant de voir qu'à partir de 1981, la place du groupe parlementaire dans le dispositif de gouvernement a été renforcée, par exemple, par l'invitation quasi institutionnalisée du Président des groupes socialistes des assemblées à des réunions de travail avec le Président de la République, les membres du gouvernement, le chef du parti, etc. Il s'agit là d'une série de dispositifs qui assurent cette fonction de pivot pour ces groupes parlementaires.
Autre type de position : celle de l'opposition, sur laquelle je n'insiste pas.
Le cas le plus intéressant est celui de la force d'appoint. Le privilège du centre est d'être habitué, depuis de longues décennies ce n'est pas propre à la V e République à cette fonction. On la retrouve sous la V e République, entre 1962 et 1969, avec le groupe des Républicains indépendants, qui sont finalement moins unis par une communauté de sensibilité politique, puisqu'ils divergent sur bon nombre de points dans les années 60, que sur une appréciation convergente de la situation politique et de la nécessité de s'allier au régime dans ce système bipolaire qui se met en place. On retrouvera, quarante ans plus tard, en 2007, ce même type de restructuration avec la formation du groupe du Nouveau Centre, qui joue son rôle d'allié avec l'UMP.
Les hommes du centre ont rêvé à plusieurs reprises de cette fonction de groupe d'appoint, mais cela n'a pas été toujours couronné de succès. Songeons à la création, en 1988, du groupe parlementaire Union du centre, qui a été formé par des Députés du CDS et de quelques élus barristes et qui s'est détaché du groupe UDF, dans l'hypothèse d'une alliance majoritaire claire entre socialistes et centristes, en lieu et place de l'ouverture mitterrandienne assez floue.
J'en viens enfin à la troisième fonction d'un groupe parlementaire, qui est plus complexe et plus conjoncturelle mais aussi plus intéressante parce qu'on est là dans une relation inversée par rapport aux partis politiques. Il s'agit de la situation dans laquelle un groupe, plutôt que de relayer les positions d'un parti, va esquisser les contours d'une organisation politique à venir, en se plaçant en agent de restructuration du paysage politique, lorsqu'un groupe parlementaire va vouloir remédier aux dysfonctionnements du système partisan en s'en dégageant et en essayant de recomposer le système politique.
Cette fonction apparaît nettement au lendemain des élections de novembre 1962, qui ont véritablement dynamité le paysage politique et qui ont été l'occasion de redéfinir les contours des groupes. C'est à cette période que s'est constitué le groupe des Républicains indépendants qui va être à l'origine, trois ans plus tard, de la création d'une organisation politique. On n'a pas un groupe parlementaire qui est dans le prolongement d'un parti politique mais le contraire : un parti politique qui va prolonger et élargir l'action d'un groupe parlementaire avec la création, en 1965 seulement, de la Fédération nationale des Républicains indépendants.
C'est aussi au lendemain de l'élection de 1962 que se constitue le groupe du Centre démocratique, qui entend élargir l'assise du MRP, qui, autour d'un noyau d'élus MRP, va attirer une dizaine de Députés du centre droit et qui, à bien des égards, préfigure l'organisation du Centre démocrate, qui sera constitué, au moment de l'élection présidentielle de 1965, autour de Jean Lecanuet.
On constate donc que le groupe parlementaire peut être, notamment dans les groupes du centre et au cours des vingt premières années de la V e République, un élément de réorganisation et de recomposition du paysage politique.
Dans mon troisième point, je vais traiter les évolutions qui sont constatées entre 1958 et 2008 et qui sont assez différentes entre les deux chambres.
Je commencerai par l'Assemblée nationale. Jusqu'à la veille des présidentielles de 1965, on constate un contraste important entre, d'une part, une majorité assez disciplinée tout en se réduisant progressivement, elle a appris rapidement la discipline de vote et, d'autre part, une opposition atomisée, à l'Assemblée comme dans le pays. En effet, si les socialistes et les communistes votent de façon assez homogène au cours de la première législature, en 1965, il n'en est pas du tout de même pour les élus radicaux, les élus MRP, les élus centristes ou les élus indépendants.
Autrement dit, nous avons une grande dispersion des votes, notamment dans les moments politiques importants. Je pense notamment à la déclaration de politique générale de Georges Pompidou au moment de l'investiture de son gouvernement, en avril 1962, et à l'éclatement des votes de ces groupes à cette occasion. Je pense aussi aux votes des motions de censure, avec une sorte de déperdition ou de dispersion des élus de ces forces politiques. A l'exception des groupes communiste et socialiste, les autres groupes de l'opposition ne sont pas forcément homogènes en termes de stratégie et de comportement parlementaire ou même en termes idéologiques.
On peut donc dire que la crise de 1962 et les élections présidentielles de 1965 n'ont pas complètement produit leurs effets à l'Assemblée nationale. Le phénomène de cristallisation ne va apparaître qu'au lendemain des législatives de 1967, à partir desquelles seront constitués, à l'Assemblée nationale, des groupes parlementaires assez homogènes et plus disciplinés.
Du coup, à partir de 1967 et de 1969, l'Assemblée nationale va refléter assez fidèlement les grandes évolutions du paysage politique, qu'il s'agisse de l'ouverture pompidolienne au centre droit, des difficultés du libéralisme avancé de Valéry Giscard d'Estaing, des rivalités entre giscardiens et chiraquiens, tellement sensibles lors du vote du budget de 1981, de la contre-offensive de la droite après 1981 ou même, à la faveur des modifications éphémères de la loi électorale, de l'irruption du Front national sur la scène politique avec l'élection de Députés du FN en 1986.
Le retour au scrutin majoritaire à l'Assemblée nationale, en 1988, a permis à l'Assemblée nationale d'échapper à l'éclatement de la vie politique, qui est une caractéristique importante depuis les années 90, mais au prix d'une certaine distorsion entre l'Assemblée nationale et le paysage électoral de la France. C'est essentiellement par des systèmes d'alliance que des forces politiques significatives ont pu être représentées à l'Assemblée. Je vous donne un seul exemple : celui des Députés écologistes qui arrivent à l'Assemblée nationale en 1997 grâce à un jeu d'alliance avec le PS, alors même qu'ils représentent à ce moment deux fois moins d'électeurs qu'en 1993, époque à laquelle ils n'avaient eu aucun élu.
Ces éléments de distorsion font que certains phénomènes d'opinion importants, depuis une vingtaine d'années, ne trouvent pas forcément de reflet à l'Assemblée nationale. Je cite à cet égard deux exemples tirés d'une actualité relativement récente : d'une part, le fait que la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 et le score relativement important qu'il a fait au cours de cette élection n'ont eu aucun écho dans l'Assemblée nationale élue un mois plus tard ; d'autre part, en 2007, le score lui aussi relativement important de François Bayrou qui est presque contemporain de la disparition d'un groupe UDF à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a là des écarts, peut-être plus importants que dans les années 70, 80 et 90, entre une conjoncture politique électorale et le paysage parlementaire.
J'évoquerai enfin le rôle du Sénat, qui a été déjà très bien présenté et sur lequel je ne vais donc pas insister, en revenant sur trois phases principales.
Dans la première, le Sénat a joué un rôle de premier opposant de France. Cela a été le cas très nettement jusqu'en 1969 et, un peu moins, jusqu'en 1974.
La deuxième phase intermédiaire se situe entre 1974 et 1981.
Enfin, à partir de 1981, on assiste à un renforcement de la place politique dans la haute assemblée, liée notamment au fait que, depuis les années 80, les deux groupes qui ont le plus fortement progressé, à savoir le groupe socialiste et le groupe RPR, ou néo-gaulliste, ont eu tendance à peser davantage sur le fonctionnement et la nature même des débats parlementaires.
Pour conclure, je dirai simplement que le Sénat et l'Assemblée nationale représentent une image des forces et équilibres politiques qui n'est pas un reflet exact car elle est biaisée par différents éléments, que ce soit le mode de scrutin, les traditions propres à chacune des deux assemblées, les fonctions spécifiques des groupes parlementaires, l'ordre du jour de ces assemblées ou l'étroitesse ou non de la majorité dont dispose le gouvernement dans chacune de ces assemblées. On peut donc dire que le Parlement est un acteur important de la vie politique sous la V e République et qu'il est surtout le principal point de condensation de cette vie politique depuis 1958.
M. Jean-Marie MAYEUR, modérateur.-
Merci beaucoup. J'apprécie votre maîtrise et votre rigueur ainsi que le fait que vous ayez pris les groupes comme angle d'attaque. J'ai pensé aussi, en entendant les orateurs précédents, que ce sont à chaque fois des exposés qui portent sur une longue période de cinquante années, ce qui représente plusieurs régimes de l'histoire politique de la France avant 1870. J'ai d'ailleurs admiré la qualité de synthèse des uns et des autres sur cette difficulté qui fait que, parfois, lorsqu'on lit certains articles dans les journaux, on nous parle de la V e République en privilégiant tel ou tel aspect et en en faisant une sorte de synthèse globale quelque peu éloignée de la réalité.
M. le Premier ministre, je vous donne la parole.
M. Jean-Pierre RAFFARIN, Président.-
Merci, M. le Modérateur. Je tiens à féliciter les intervenants de la qualité et de la densité de leurs présentations et, surtout, féliciter les unes et les autres dans cette salle plus les unes que les autres, d'ailleurs , y compris les Sénatrices, puisque, parmi la population sénatoriale qui assiste à cette manifestation, deux Sénateurs sur trois sont des Sénatrices. Je tiens donc à vous remercier de votre attention parce que la matinée a été assez dense.
Ma position est assez paradoxale. Je vais en effet essayer de vous expliquer pourquoi il faut réformer la Constitution, comme le souhaite le Président de la République, mais je vais en même temps vous avouer une chose dont je me sens très coupable : j'ai été un Premier ministre institutionnellement heureux. En effet, pendant trois ans, à Matignon, je me suis trouvé dans une situation institutionnelle qui était plutôt une pratique heureuse, probablement parce que mon Président de la République, qui était aussi celui de tous les Français, avait d'abord été Premier ministre et qu'il avait donc déjà à la fois le souci d'imposer sa ligne, mais, en même temps, de respecter la fonction de Matignon qu'il connaissait. C'est l'un des atouts très importants de cette dialectique, et j'invite les chercheurs à travailler sur ces éléments.
L'entente que j'ai eue avec Jacques Chirac n'était pas une entente de soumission. C'était une entente profonde de vraie discussion, une entente que nous avons eue parce qu'il avait été désigné par les Français et qu'il avait la légitimité la plus forte, comme l'a dit Pierre Mazeaud, puisque le Premier ministre tire sa légitimité de celle du Président, mais aussi parce que le Président connaissait suffisamment la fonction de Matignon pour l'utiliser à plein et faire en sorte qu'elle soit assumée. De ce point de vue, je ferai quelques remarques après ce que j'ai entendu ce matin.
L'un des atouts formidables de la V e République est de permettre au Président de la République de choisir lui-même son implication sur tous les dossiers. C'est un élément très important, et j'invite le Président de la République actuel à bien y réfléchir. Le Président Jacques Chirac, avec lequel j'ai travaillé, choisissait, sur chacun des dossiers, son degré d'implication. Il pouvait être très intervenant, notamment dans des dossiers comme la lutte contre le cancer, sur lequel il intervenait jusqu'aux détails opérationnels, ou se contenter, sur d'autres sujets, de donner à son Premier ministre et à son gouvernement des rendez-vous pour lesquels nous devions délivrer une action.
Dans les études très intéressantes que vous faites, mes chers amis universitaires, il serait intéressant d'examiner la manière dont sont fabriqués les discours de politique générale. En effet, pour un Premier ministre, le discours de politique générale est vraiment le cadrage de son action. Chaque Premier ministre, à l'issue de son mandat, compare son action par rapport à son discours de politique générale, qui est donc un élément très important de l'action publique et dont l'élaboration est très importante. Cela peut être la déclinaison du projet présidentiel ou, dans mon cas, un discours très discuté, voire négocié, avec le Président de la République sur un certain nombre de sujets auxquels je tenais plus que lui ou auxquels il tenait plus que moi. Ce discours est donc le cadre même de l'action et, pour le Premier ministre, c'est la référence de ce qui va mener son action.
Dans les réflexions que vous avez évoquées tout à l'heure sur le rôle du Premier ministre, vous avez dit qu'il assumait un rôle de go-between, de management de la majorité parlementaire et de la liaison entre le Président et la majorité parlementaire. C'est en effet un élément très important.
Certes, tout cela n'est pas simple et, dans cette situation, certaines périodes sont difficiles, mais il y a un atout de base : le fait que le Premier ministre est souvent l'allié du Député parce qu'il a participé à son élection. Du fait de l'élection législative de 2002 et du nouveau dispositif institutionnel dont Pierre Mazeaud a parlé et que l'on peut qualifier de quinquennat inversé, le Premier ministre a précédé la majorité parlementaire. Il a été nommé en mai alors que la majorité parlementaire a été élue en juin et c'est son gouvernement qui a conduit la campagne législative. Il y a donc une sorte d'association entre le Premier ministre, la majorité parlementaire et l'Assemblée nationale, et c'est un élément très important de cette proximité que peut avoir le Premier ministre et sa majorité.
J'en viens, de manière sous-jacente, à l'accident sur les OGM à l'Assemblée nationale. On a évoqué plusieurs raisons, et Pierre Mazeaud a notamment évoqué celles du cumul. A mon avis, le cumul a une influence, mais il serait une erreur de penser que c'est le cumul qui génère l'absentéisme. Les plus présents au Parlement ne sont pas ceux qui ont le moins de mandats. Le point clé, c'est l'obstruction. Quand on dit à des parlementaires qu'il y aura 800 amendements sur un texte, cela veut dire qu'ils doivent venir à Paris pour entendre l'opposition déposer des amendements mais que, du fait d'un calendrier parlementaire serré, ils ne pourront pas répondre et devront se contenter d'écouter et de voter contre 800 fois. S'il y a dix orateurs par amendement, il faut écouter 8 000 interventions ! On peut comprendre qu'un certain nombre de Députés préfèrent rester sur le terrain.
Le problème de l'absentéisme est donc lié aussi au fonctionnement et à l'utilité de la présence du parlementaire de la majorité. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets majeurs. On peut discuter du cumul des mandats et c'est une question qui est posée, mais l'absentéisme relève avant tout du règlement du Parlement et de l'utilisation de la présence parlementaire.
Pierre Mazeaud disait ce matin que l'activité législative était excessive et que ce n'était pas le Premier ministre qui poussait à l'inflation législative mais les jeunes ministres, qui voulaient avoir une loi portant leur nom. L'argument, avec le respect que je dois et l'amitié que je porte à Pierre Mazeaud, est un peu facile. La vraie raison, c'est que la société française demande de la loi et que, lorsque les Députés sont dans leur permanence de parlementaire, les gens leur demandent des lois.
Qu'est-ce que demandait la FNSEA pour fêter son cinquantenaire au Président Chirac ? Une nouvelle loi d'orientation agricole. Qu'est-ce que demandait l'Union professionnelle des artisans pour fêter son cinquantenaire ? Une grande loi de l'artisanat.
Je me suis heurté moi-même, en tant que Sénateur de base, à une question importante. J'avais noté que, dans ma région, les statistiques n'étaient pas exactes en ce qui concerne les enfants qui décèdent dans les piscines privées et j'ai donc voulu alerter les pouvoirs publics sur la protection des enfants en bas âge dans ces piscines, mais je n'ai pu intéresser personne à ce sujet, ni le ministre de la santé, ni le ministre de l'intérieur en charge de la protection civile, ni le ministre de l'équipement en charge du permis de construire. Un jour, j'ai déposé une proposition de loi instaurant la pose de barrières à 80 centimètres et tout le monde a accouru, notamment les médias. C'est le projet de loi qui est devenu un objet politique.
Il conviendrait donc de mener une réflexion sur la place que prend le projet de loi comme produit politique face à ce constat inquiétant. Ce n'est pas tellement le jeune ministre qui veut avoir une loi qui porte son nom. Une fois que le projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres et a été présenté à l'Assemblée nationale, ce que devient le projet est parfois secondaire sur le plan politique car le produit a été médiatiquement présenté. L'une des raisons pour lesquelles on a aujourd'hui tant de difficultés à avoir des décrets d'application, c'est que le produit politique étant très faible une fois qu'il a été voté, il intéresse peu de gens dans son application. C'est un vrai sujet de notre démocratie : on s'intéresse plus au lancement du produit qu'est la loi plutôt qu'à sa réalisation à travers les décrets d'application.
J'ai donc eu une pratique heureuse des institutions, notamment sur un certain nombre de sujets c'est le paradoxe que je voulais citer tout à l'heure pour lesquels on propose une réforme.
Le premier point est le 49.3, dont je vous rappelle qu'il a deux missions. Il est d'abord conçu pour dompter la majorité. Lorsque celle-ci doute de son Premier ministre et de la politique gouvernementale, il s'agit de lui dire : « C'est ma politique ou l'élection ; soit tu me suis, sois je te renvoie devant les électeurs ». C'est un rapport de forces élémentaire, mais il fonctionne et, dans certaines circonstances, les Premiers ministres ont eu besoin, dans le passé, de dompter leur majorité qui était parfois rebelle. Si Raymond Barre était très présent à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il n'avait pas véritablement de majorité, ou plutôt qu'il existait un conflit dans sa majorité. Il a utilisé beaucoup le 49.3 parce qu'il avait besoin de maîtriser sa majorité.
J'ai été moi-même dans une autre situation. Nous avons utilisé le 49.3 parce que, du fait des moyens techniques, notamment numériques, on peut déposer des dizaines de milliers d'amendements en faisant varier quelques éléments des amendements précédents. On se trouve alors face à la nécessité d'arrêter le processus d'obstruction par le 49.3. Si, dans la réforme, on pouvait limiter le temps des débats à un moment ou un autre, on pourrait avoir une autre limitation, mais, aujourd'hui, le 49.3 sert à lutter contre l'obstruction. C'est pourquoi je veux bien que l'on revienne sur cet article, mais à condition que l'on puisse maîtriser les questions liées à l'obstruction.
L'ordre du jour prioritaire est très utile pour un Premier ministre, mais je dois dire que si on va, comme je le souhaite, vers un ordre du jour confié à 50 % au Parlement, cela imposera à celui-ci des réformes considérables. Au Sénat, nous aurons à nous structurer très différemment de la situation que nous connaissons aujourd'hui. En effet, il faudra non seulement des textes qualifiés sans passer systématiquement par le Conseil d'Etat (je ne souhaite pas que nous ayons des lois à trois étoiles qui seraient passées par le Conseil d'Etat et des lois à une seule étoile qui n'y seraient pas passées, auquel cas on ferait à nouveau du Conseil d'Etat ce qu'il rêve parfois : la deuxième chambre), en nous renforçant dans nos structures, mais aussi gagner des capacités de prospective. Avec cette journée dont parlait le secrétaire général brillamment tout à l'heure, il est clair que ce travail se fait dans le court terme alors que, lorsque vous aurez 50 % de l'ordre du jour sur une période quinquennale, cela voudra dire que vous aurez des forces de prospective qui prépareront en 2008 les textes de 2011 et de 2012.
J'y suis favorable, mais cela implique un certain nombre de modifications de notre organisation.
Je prendrai un exemple de mesure sur laquelle tout le monde est d'accord pour en décrire les subtilités et montrer qu'il est utile de donner au gouvernement la possibilité d'agir, parfois même dans l'ambiguïté. Il s'agit de l'amendement ADN sur le texte proposé par Brice Hortefeux. Brice Hortefeux défend son texte et, du fait d'un Député de sa majorité, un amendement sur les tests ADN est passé à l'Assemblée nationale. Brice Hortefeux le condamne un peu et il reste en distance avec le texte en disant que ce n'est pas un texte du gouvernement mais d'un Député de la majorité et le Premier ministre observe la situation. Dans la situation dans laquelle nous sommes institutionnellement, ce texte vient au Sénat avec l'amendement Mariani, il est examiné en séance plénière et, après instruction du dossier par sa commission des lois, la chambre haute rejette cet amendement.
Dans le cadre de la révision constitutionnelle qui nous est proposée, la commission des lois examinera d'abord l'amendement Mariani et il est clair que, dans ces conditions, elle fera sauter cet amendement. Ensuite, le texte viendra en plénière et si Brice Hortefeux veut cet amendement, il sera obligé de faire un amendement du gouvernement, c'est-à-dire de sortir de l'ambiguïté pour dire que c'est le gouvernement qui le demande. On se rend compte que ce type d'évolution, sans être très important, va concerner aussi l'organisation et le rôle de la commission. Or vous savez qu'au Sénat, la commission des lois est un lieu assez consensuel. Comme l'a dit tout à l'heure le Président Estier, il y règne aujourd'hui un climat de cohérence assez peu partisan, même si chacun assume son engagement. A partir du moment où le texte qui viendra en plénière sera celui de la commission, nous devrons être organisés entre majorité et opposition dans les commissions, ce qui changera un peu le climat général. Il faut en avoir conscience.
Pour faire encore référence à ce qui a été dit ce matin, j'ajouterai deux points à destination de mon ancien collègue et ami le Président Estier, qui a parlé tout à l'heure de la loi électorale. Il dit que le Sénat représente les collectivités territoriales. Il est vrai qu'il représente les collectivités territoriales d'aujourd'hui, mais également celles du mandat précédent. Comme les Sénateurs avaient précédemment un mandat de neuf ans et qu'ils ont maintenant un mandat de six ans, cela veut dire que nous représentons les collectivités territoriales et les élus des dernières élections municipales, mais aussi celles d'avant, tout simplement parce qu'on a donné au Sénat un rôle d'amortisseur, de lissage de l'opinion publique. L'Assemblée nationale est en direct avec le pouls, le coeur ou la passion des Français et, pour notre part, nous amortissons les évolutions. Le Sénat a une fonction de distance. Nous représentons donc les collectivités territoriales de ces élections, mais aussi celles de n 1.
C'est pourquoi je réponds à sa question qu'il pourra y avoir une alternance en 2014. En effet, il y a fort à parier que ceux qui gagneront les élections municipales de 2014 gagneront la majorité sénatoriale à cette même date. C'est la réalité d'aujourd'hui, avec un mandat à six ans qui assure un renouvellement par moitié plus rapide. Nous retrouverons donc peut-être l'alternance en fonction du résultat des municipales de 2014. Vous constatez quand même que le Sénat n'est pas seulement lié à la situation politique territoriale d'aujourd'hui, dans la mesure où, ayant un renouvellement partiel, il est responsable d'amortir les éléments politiques, l'Assemblée nationale ayant le souci de représenter la légitimité populaire à un instant donné.
Je comprends que le Président Estier en fasse un sujet majeur du débat constitutionnel. Notre position n'est pas de dire que ce débat ne peut pas avoir lieu, mais qu'il ne peut pas avoir lieu dans le cadre de la loi constitutionnelle. Or, pour avoir les 3/5e, la loi constitutionnelle doit trouver ses équilibres à l'intérieur de la loi et non pas en faisant la promesse d'autres lois qui ne sont pas d'ordre constitutionnel. C'est à l'intérieur de la loi constitutionnelle que l'on doit trouver des logiques permettant de trouver un équilibre. Il faudra bien arriver à cet équilibre pour réunir une majorité des 3/5ème au Congrès de Versailles. Il faudra en effet discuter avec l'opposition, sachant qu'il ne peut y avoir les 3/5ème sans une discussion trans-partis, mais il faut aussi savoir qu'il ne peut pas y avoir de majorité des 3/5ème sans que la majorité sénatoriale dise clairement ce qu'elle souhaite. Cela fait aussi partie des équilibres, et je suis obligé de le rappeler au cas où ce serait oublié.
Sur l'avenir, pour reprendre un certain nombre de propositions. Il y a toujours deux lectures sur les institutions. On peut reprendre celles de la V e République, les lire dans son histoire et reconnaître assez facilement que, depuis notre première Constitution, celle de 1791, la comparaison de la V e République avec toutes les autres est très flatteuse. Depuis 1791, nos régimes constitutionnels ont trouvé une forme d'aboutissement avec la Constitution de 1958, cette synthèse et ce rationalisme parlementaire dont nous avons parlé tout à l'heure et qui est un élément très important.
Cela dit, il ne faut pas considérer notre Constitution de 1958 comme immobile, même si c'est notre patrimoine, et nous devons envisager quelques adaptations à la situation de notre société, de notre pays et de son environnement. Je vois cinq mutations rapides à envisager.
Premièrement, il convient de bien veiller à l'affirmation d'un Etat de droit dans la société française. A cet égard, je pense aussi à la stabilité du droit. C'est l'un des éléments très importants auxquels nous devons être très attentifs parce que c'est là que se trouve, pour une très grande majorité d'entre nous, l'équilibre entre la politique et l'humanisme et que l'on doit veiller à garantir les droits individuels qui ne peuvent souffrir aucune exception. Cette logique de l'Etat de droit et de la stabilité du droit nous concerne directement et cette démocratie ne peut se concevoir dans cette perspective sans contre-pouvoir et sans une certaine division du pouvoir.
A ce point de vue, on pense à la place que peut avoir le Sénat. L'insoumission fait partie du code génétique des Sénateurs et c'est donc un élément très important du débat, comme le Sénat l'a prouvé à de nombreuses reprises. Vous qui êtes étudiants et chercheurs sur ce sujet, je vous rappellerai qu'en 1971, le Conseil constitutionnel a intégré le préambule de la Constitution dans le fameux bloc de constitutionnalité à la suite de sa saisine par le Président Poher sur la loi relative au contrat d'association. On a conforté les garanties apportées à ce que l'on pourrait qualifier de démocratie libérale.
Le Président Giscard d'Estaing a donné aussi toute la portée de cette évolution, en 1974, comme l'a dit Pierre Mazeaud, en élargissant les modalités de la saisine du Conseil.
Cela a été également fait en 1993, conformément à la proposition du doyen Vedel, et vous avez fait référence tout à l'heure à la proposition du comité Balladur d'étendre la saisine du Conseil à l'ensemble des justiciables par voie d'exception, comme Pierre Mazeaud y a fait allusion tout à l'heure. Je pense que c'est un progrès et, de ce point de vue, je trouve que M. Balladur et sa commission ont eu raison de faire cette proposition.
J'ajoute que la limitation des risques d'arbitraire, qui est un objectif de notre République, ne trouve pas sa seule raison d'être dans le contrôle des dispositions législatives. Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, au cours de la campagne présidentielle, a notamment pris position sur le pouvoir de nomination du chef de l'Etat. C'est un point qui n'est pas secondaire. En effet, n'oublions pas le fond et, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans laquelle il est dit que tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans aucune distinction que celle de leur vertu et de leur talent.
Pour avoir participé à un certain nombre de nominations, je peux vous dire qu'il y a des progrès à faire si on veut plus de diversité et si on souhaite que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 soit effective.
La proposition de Nicolas Sarkozy d'encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République au moyen d'un avis prononcé par une commission composée de Députés et de Sénateurs me paraît donc aller tout à fait dans le bon sens.
De même, je suis favorable à la création de la Constitutionnalisation du défenseur des droits des citoyens qui pourra ainsi disposer de moyens renforcés pour assurer le bon fonctionnement des services publics et le respect des droits des citoyens.
Sur la modernisation, qui est le deuxième objectif de notre vie politique, nous devons essayer d'avoir une certaine lucidité dans notre approche et reconnaître un certain nombre de vices, voire de travers d'un système politique. L'une des conséquences de l'élection du Président de la République au suffrage universel, c'est la part de la promesse dans la vie politique confrontée à la grande difficulté de la gestion quotidienne. Je crois que c'est Péguy qui disait qu'un parti vit de ses mythes et meurt de sa politique. La question majeure de la campagne électorale est bien cette inflation de la promesse, notre capacité à promettre.
Pour un praticien de la vie politique, il faut bien se dire que ce n'est pas un travers des hommes politiques. L'électeur demande souvent de la promesse, même s'il sait qu'elle est un peu incertaine, favorisant ainsi son inflation. De ce point de vue, nous avons, pour notre climat politique, à changer un peu les choses et à ne pas surdimensionner l'action politique en laissant penser qu'à chaque élection, on peut passer de l'ombre à la lumière, ou inversement. Sur la politique, il faut à mon avis avoir une certaine distance par rapport à cette idée très française, que l'on voit chez nous plus qu'ailleurs, selon laquelle le politique a tous les moyens pour résoudre tous les problèmes.
Dans notre organisation sociale actuelle, les moyens des uns et des autres dans la société ont souvent pour but d'empêcher l'autre de faire et non pas de faire soi-même. Dans une société complexe, chacun a donc la possibilité d'empêcher l'autre plutôt que de susciter sa propre action, c'est l'un des problèmes majeurs de notre démocratie et sera toujours un problème important.
L'une des façons de régler ce problème est de renforcer la concertation entre majorité et opposition et de civiliser notre démocratie. Je pense qu'on ne peut avancer dans cet apaisement du débat que par ce dialogue. Les choses sont progressivement devenues possibles parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, nous allons vers une organisation politique articulée autour de deux grandes formations politiques qui, avec leurs alliés, sont deux forces de gouvernement. Je pense que nous devons aller vers une certaine discussion entre ces deux forces de gouvernement.
Hier soir, j'étais à Jérusalem à l'occasion de la commémoration des 60 ans de l'Etat d'Israël, où M. Georges Bush était l'invité de Shimon Peres dans une conférence. Il y avait là M. Netanyahou, présent pour l'opposition, et quand j'ai vu la discussion qui a eu lieu entre l'opposition et la majorité sur les questions stratégiques importantes, je me suis dit que la démocratie avait des atouts, notamment le dialogue entre l'opposition et la majorité, qui est d'une fertilité réelle et sur lequel je pense que nous avons des progrès à faire, y compris dans le fonctionnement de nos institutions.
A cet égard, la proposition du doyen Gélard de nous comparer à d'autres parlements européens est utile pour associer l'opposition aux décisions prises par une majorité dans les différentes chambres. Je pense par exemple que les commissions d'enquête, les missions d'information ou un certain nombre de sujets de cette nature, y compris ceux dont nous avons parlé au Sénat avant 1983, pourraient être le champ de cette association.
Je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais de l'organisation de l'ordre du jour et une plus grande maîtrise de celui-ci. Je pense qu'un progrès majeur pour le Parlement réside dans l'ordre du jour. Cela obligera le gouvernement à faire des choix, à fixer des priorités et à ouvrir le dialogue avec sa majorité et la force d'opposition. Cela fera partie de cette vision que nous devons avoir et qui a été finalement marquée par un seul et très bel exemple : tout ce qui s'est passé avec la loi organique relative aux lois de finances, dont Alain Lambert était le rapporteur pour le Sénat, qui a été un texte important et structurant pour la vie démocratique et financière et qui a été bâti en cohérence avec la majorité et l'opposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'entre le législatif et l'exécutif.
C'est un sujet sur lequel nous devons avancer pour faire reconnaître, par notre capacité de contrôle, le rôle du Parlement aux yeux des citoyens.
Beaucoup de choses ont été faites pour valoriser le travail du Parlement. Je pense notamment à ce qu'a fait René Monory sur Internet ou Christian Poncelet avec Public Sénat. Nous avons là des champs très importants pour mieux faire connaître aux citoyens le travail parlementaire, qui fait partie aussi de la nécessité de modernisation que nous avons engagée. J'ai cité la présence féminine des Sénatrices ici, pour ce colloque, mais je dois dire que le renouvellement du Sénat a été très important à ce sujet. Je pense d'ailleurs que notre renouvellement par moitié va accélérer cette tendance.
Comme je l'ai dit tout à l'heure sur les élites, je pense que le renouvellement tous les trois ans par moitié va accélérer le renouvellement du Sénat, sa féminisation et sa diversification, et que, de ce point de vue, les orientations prises permettront d'arriver à quelques progrès.
Je dirai un mot sur la République décentralisée et le principe de subsidiarité qui est dans la Constitution. Par sympathie, Pierre Mazeaud ne l'a pas évoqué tout à l'heure parce que je ne suis pas sûr qu'il était d'accord avec son entrée dans la Constitution en 2003, mais ce principe de subsidiarité est entré dans la Constitution, et il serait donc très important que le Sénat, celui des collectivités territoriales, puisse être garant de l'exercice de la subsidiarité. Il y a là un grand champ de développement permettant à la Haute assemblée de définir ce qu'est aujourd'hui la pratique du principe de subsidiarité, l'obligation de compenser les transferts de charges et la possibilité de diversifier les institutions locales et, sans doute, d'ouvrir la discussion sur notre organisation territoriale, que Pierre Mazeaud a lancée ce matin.
Un certain nombre de pistes ont été ouvertes dans cette direction. Je pense notamment à la Commission nationale des exécutifs, qui a montré qu'il pouvait y avoir une perspective. Je sais que l'on parle beaucoup, dans cette assemblée, de la création de nouvelles commissions : une commission des affaires locales, une commission de la décentralisation et une commission de la subsidiarité. C'est à discuter. Cela peut être une commission ou un comité, sur le mode du Comité pour les élections européennes dans cette délégation. Il y a là une réflexion très utile pour que la Haute assemblée assume ce droit de suite au principe de subsidiarité et s'affirme comme la chambre de la République décentralisée.
J'ai vu que le Comité de décentralisation avait également travaillé hier sur ces questions. La reconnaissance de l'élu local dans la Constitution est l'un des éléments dont nous pouvons parler, et l'Observatoire de la décentralisation en discute en ce moment dans le cadre de la mise en place de l'acte II de la décentralisation. C'est donc un sujet très important.
Enfin, il est nécessaire d'instaurer une relation plus confiante entre le Parlement et l'exécutif. Le fait que le Président de la République puisse s'exprimer à la Knesset ou devant le Congrès américain alors qu'il ne peut pas venir devant le Parlement français est effectivement quelque peu choquant. Cela dit, je ne suis pas favorable au fait que le Président de la République remplace le Premier ministre dans son rôle de chef de la majorité parlementaire car les deux fonctions sont bien séparées. C'est pourquoi je propose que la présence du Président de la République au Parlement soit rare et solennelle, notamment à travers le Congrès. Autant l'idée d'interdire le contact entre le Parlement et le Président me paraît archaïque, autant l'idée de remplacer le Premier ministre dans son rôle de chef de la majorité parlementaire par le Président me semblerait revenir sur des principes de base de la synthèse qui a été celle de Michel Debré dans l'organisation des pouvoirs et des institutions de la V e République.
Ce qui me paraît aujourd'hui devoir nous guider dans notre réflexion, c'est le fait que la V e République a voulu que l'exécutif ait une capacité d'action réelle pour sortir d'un certain nombre de désordres et d'une relative impuissance. Très franchement, j'ai vu des réformes échouer, une attente de réformes et un certain nombre de choses qui n'allaient pas assez vite, et je comprends que la société française demande que la politique aille plus vite, mais quand la politique va lentement, ce n'est pas seulement de la responsabilité des institutions. Il y a d'autres responsabilités dans l'exercice des pouvoirs et dans les rapports de forces que celles des institutions. Ne modifions donc pas les institutions pour réformer davantage. L'exécutif est responsable des réformes et il ne faut pas aller chercher dans l'organisation institutionnelle la source des difficultés de la société française, de sa diversité et, quelquefois, de sa difficulté à être gouvernée.
Sur ce sujet, il faut donc vraiment préserver une capacité d'action. Je suis préoccupé quand je vois monter toutes les idées de réflexion sur ce que peut être une démocratie participative qui serait une démocratie permettant en permanence à des structures de s'impliquer davantage dans l'organisation des décisions. Autant je suis favorable à des référendums locaux, comme on l'a vu avec la loi de 2003, pour qu'un certain nombre de sujets fassent vraiment l'objet d'une expression populaire, autant il faut veiller à ne pas fragiliser la démocratie représentative. La société étant de plus en plus complexe, on a besoin de spécialistes et de concertation pour avancer sur ces textes. Plus on incitera la société et les partenaires sociaux, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, à discuter avant que la loi soit arrêtée, plus nous aurons besoin de lieux dans lesquels on pourra travailler ces questions avec l'exigence de la représentativité.
Il y a sans doute des moyens pour que le citoyen ne se sente pas éloigné de tout cela. C'est le cas du droit de pétition, qui existe au Parlement européen. Pour le Sénat, je ne vois pas pourquoi une mission des élus locaux, le corps électoral des Sénateurs, ne pourrait pas faire une proposition, qui serait soumise par exemple par mille maires de l'opposition et qu'examinerait la commission des lois pour montrer que nous sommes vraiment ouverts à ce qui se passe dans la société. Un certain nombre de règles pourraient sans doute être aménagées afin d'être davantage connectées avec les citoyens. Il est clair aussi que si, dans la société telle que la définit Edgar Morin dans son extrême complexité en souhaitant en permanence examiner le yin et le yang, nous nous passons de la démocratie représentative, nous risquons de nous passer de l'expertise et, surtout, de la confrontation.
C'est la polémique, la politique, le débat et la confrontation qui, de temps en temps, font apparaître un problème que personne n'avait pu relever auparavant. Quand il y a débat et affrontement, on voit apparaître parfois des difficultés, mais pour qu'il y ait débat et affrontement, il faut une organisation du débat et de l'affrontement. De ce point de vue, la capacité à agir du Parlement est un élément clé de notre réalité.
Je voudrais simplement m'adresser aux plus jeunes qui sont dans cette salle pour leur dire que la vie politique est passionnante, qu'elle donne le sentiment que l'on peut participer à quelque chose de plus grand que soi-même, mais, naturellement, dans le respect d'une histoire et d'un certain nombre de principes et de convictions. C'est ce qui me paraît le plus important dans le débat institutionnel. Ce n'est pas un débat d'experts ou réservé à des spécialistes. C'est de la belle politique ! C'est cela qu'il faut essayer de valoriser avec sa dimension historique, mais aussi sa modernité dans la société.
C'est le message le plus important de ce matin. La présence nombreuse, parmi vous, de jeunes qui sont intéressés par ces sujets m'amène à dire que c'est la modernité de notre débat politique que de nous intéresser à l'organisation de ce débat et, donc, à la pratique de nos institutions.
M. Jean GARRIGUES, Président du Comité d'Histoire Parlementaire et Politique.-
Je remercie très chaleureusement M. le Premier ministre. Au nom du Comité d'histoire parlementaire et politique, qui est l'organisateur de cette journée, je vous convie à déjeuner salle René Coty, où un buffet vous attend, et je vous rappelle que les débats reprendront à 14 h 30 sous la présidence de M. Edouard Balladur.
SÉANCE DE L'APRES-MIDI
Présidence de M. Edouard BALLADUR, ancien Premier ministre.
LE PARLEMENT DANS LA Ve RÉPUBLIQUE
Mesdames et Messieurs,
Nos travaux de cet après-midi sont consacrés au rôle du Parlement dans la V e République. Il est prévu deux tables rondes. La première, intitulée « Le Parlement, miroir de la société française », sera animée par M. Bastien François, et la seconde, intitulée « Quelle place pour le Parlement dans la vie politique ? », le sera par M. Jean Garrigues. A la fin de cette seconde table ronde, je ferai à votre intention quelques-unes de mes réflexions.
PREMIÈRE TABLE RONDE :
LE PARLEMENT, MIROIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Merci, M. le Président. C'est une question très large dont nous allons traiter cet après-midi. Ce matin, nous avons insisté sur la relation singulière qui s'était établie, sous la V e République, entre les gouvernements et le Parlement. Gérard Longuet, vous avez été un jeune ministre. J'aimerais que vous commenciez par nous parler de votre relation de jeune ministre face au Parlement et que vous nous disiez comment un gouvernant de la V e République affronte l'arène parlementaire.
M. Gérard LONGUET, ancien ministre, sénateur de la Meuse.-
Merci.
J'ai eu la chance d'appartenir à des gouvernements de qualité et je salue avec beaucoup de respect, de déférence et de sympathie mon second patron, Edouard Balladur, Premier ministre de 1993 à 1995, mais j'ai eu surtout la chance, très rare sous la V e République, d'être membre de gouvernements dont la légitimité était exclusivement parlementaire.
J'en viens donc à l'essentiel de mon propos pour répondre à votre question. Les périodes de cohabitation ont été, pour les ministres qui ont une culture parlementaire, des périodes de bonheur intégral. Pourquoi ? Parce que nous avions un interlocuteur et un seul : l'Assemblée nationale et le Sénat, principalement l'Assemblée nationale dont nous tirions notre légitimité. Je dois reconnaître que ma présence au gouvernement était moins la conséquence de mon talent particulier et personnel que celle d'un rapport de forces à l'intérieur d'une majorité qui faisait que, dans la coalition entre la famille gaulliste et la famille libérale, le Parti républicain, auquel j'avais le bonheur d'appartenir, représentait une part significative de cette majorité nouvelle.
J'étais donc un ministre de la V e République parfaitement atypique : je n'avais pas été choisi par le Président de la République, je dépendais du Parlement et je rendais compte à ma majorité parlementaire et, plus particulièrement, à l'intérieur de celle-ci, avec complicité, à la formation dont j'étais l'un des animateurs. Cela m'a simplifié considérablement l'existence puisque je n'avais pas d'autre contrainte que le respect de la Constitution, la seule tutelle étant celle du Premier ministre qui fédère la majorité et anime son gouvernement.
Cela s'est vérifié avec deux personnalités très différentes, et M. le Premier ministre Edouard Balladur va assurément rougir. La règle de Jacques Chirac était : « Vous faites ce que vous voulez dès lors qu'il n'y a pas d'ennuis », et la règle d'Edouard Balladur était de dire : « Faites bien ma politique », ce qui est plus intéressant. Il y avait une ligne politique, nous avions la nécessité de l'appliquer et, à partir du moment où nous l'appliquions convenablement, nous avions la liberté pour le faire.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Cela pouvait provoquer des ennuis.
M. Gérard LONGUET.-
C'est vrai, et cela nous est arrivé, d'ailleurs.
En revanche, sur les relations avec le Parlement, je tiens à exprimer deux certitudes de ministre. Premièrement, un ministre est un homme seul, dans son ministère. Il s'en rend compte lorsqu'il arrive aux commandes de ce ministère. Le premier que j'ai exercé était celui de la Poste et des Télécommunications. Ce n'est pas un ministère politiquement stratégique, mais quand on a près de 480 000 fonctionnaires sous son autorité, on est pris d'un sentiment de vertige en s'asseyant devant son bureau et en se demandant comment diable on va avoir de l'autorité sur ce quasi demi-million de professionnels qui connaissent leur métier alors qu'on ne le connaît pas. C'est une première difficulté.
La deuxième particularité, c'est qu'un ministre qui dépend du Parlement avec des parlementaires qui travaillent, est obligé de travailler lui-même et de diriger son administration par lui-même.
Je vous donne un exemple concret. J'ai exercé le rôle de ministre de l'Industrie en 1993 et il y avait un groupe de travail de l'Assemblée nationale, présidé à l'époque par M. Borotra, Député des Yvelines, qui s'intéressait à l'avenir de l'automobile, ce qui est logique puisque les industries automobiles sont nombreuses dans les Yvelines. Il avait constitué un groupe de travail extrêmement compétent et le ministre qui était entendu par ce groupe de travail y venait avec une réelle appréhension de compétence, de technicité et de maîtrise du sujet. La pression qu'exerçait ce groupe technique sur le ministre m'a conduit en tant que ministre à exercer ma propre pression sur mes directions générales afin d'être certain qu'elles ne me tiennent pas un langage d'eau tiède répétant les rapports précédents.
J'affirme donc avec force que les parlementaires qui veulent contrer des ministres ont la capacité de le faire et que, malgré le parlementarisme rationalisé de la V e République, les parlementaires qui veulent exercer leur mandat ont, sur les ministres, un réel pouvoir dès lors qu'ils exercent effectivement ce pouvoir de proposition et, surtout, de contrôle.
J'ajoute que j'ai la conviction personnelle que l'intérêt du ministre est d'avoir des relations musclées, directes et viriles comme on le dit dans le jeu de rugby avec les parlementaires pour se valoriser lui-même au sein du gouvernement. En effet, un ministre doit exister face à son administration et, face à l'opinion publique, il doit exister à l'intérieur du gouvernement. Or, exister à l'intérieur du gouvernement, c'est s'exprimer au sein de l'équipe gouvernementale à laquelle il participe dans le cadre d'une hiérarchie formelle et informelle. La hiérarchie formelle est naturellement le Président de la République quand on est hors cohabitation, le Premier ministre quand on est en cohabitation et le ministre de l'économie et des finances j'ai le souvenir du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances de 1986 à 1988 , une force qui s'impose aux autres ministres. Si on est un technicien qui tient ses interlocuteurs parlementaires sur les sujets de sa compétence, on existe dans le gouvernement et on peut exister face aux autres ministres en imposant un certain nombre de points de vue que l'on ne peut pas imposer si on ne dispose pas du relais de la demande parlementaire.
Il y a donc un jeu passionnant, sous la V e République, dans lequel, si chacun fait son métier, le système peut être extrêmement dialectique et conflictuel dans le bon sens du terme, puisque les problèmes ont plus de chances d'être réglés s'ils sont vraiment posés.
C'est pourquoi je répète que, dans un gouvernement de cohabitation qui, par définition, a une séquence courte et qui doit rapidement rendre des comptes dans une échéance électorale au calendrier très proche, nous avons un climat extrêmement intense d'échanges avec le Parlement et que celui-ci est en réalité l'allié du ministre. En effet, le ministre qui tient son sujet s'adosse sur le Parlement.
J'ai connu dans la salle des séances du Sénat des moments extrêmement cruels pour des ministres qui défendaient des projets de loi compliqués devant des parlementaires compétents et qui nageaient proprement dans les amendements. Il est certain que le monde politique est petit et cruel et que tout cela se sait et se répète rapidement.
A contrario, si vous maîtrisez, vous gagnez une sorte d'autorité qui vous permet d'assumer votre mission dans votre ministère avec une autorité que les relations avec le Parlement vous donnent plus sûrement que les relations avec l'opinion à travers les sondages. Le ministre peut s'adosser sur une bonne opinion et c'est favorable, mais c'est insaisissable et c'est parfois incompréhensible. Une bonne relation avec le Parlement est compréhensible, durable et, à mon avis, plus utilisable.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Merci, M. le Ministre. Nous pourrons ensuite ouvrir la discussion, mais je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Chevènement, qui a eu une ligne à peu près équivalente en étant ministre de l'alternance.
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ancien ministre.-
J'ai été chargé par François Mitterrand de cinq ministères : celui de la recherche et de la technologie, de 1981 à 1983, ministère auquel j'ai ajouté l'industrie de 1982 à 1983, celui de l'éducation nationale, de 1984 à 1986, celui de la défense, de 1988 à 1991, et, toujours dans une logique présidentielle. Par contre, c'est dans une logique parlementaire, comme vient de le rappeler avec justesse Gérard Longuet, que j'ai accepté la charge de ministre de l'intérieur, de 1997 à 2000. Dans tous les cas, il y a quand même le fait majoritaire qui s'impose (même s'il manquait quelques voix au gouvernement de Michel Rocard, qu'il allait chercher dans « l'ouverture », déjà !).
On m'a demandé d'exposer ce qu'avait été mon expérience des relations avec le Parlement comme ministre de la défense, en me faisant valoir que d'autres ministres exposeraient leur expérience comme ministre de la justice.
J'ai donc préparé un court exposé sur l'expérience de ministre de la défense qui fut la mienne de 1988 à janvier 1991, pendant un peu moins de trois ans, mais je suis également disponible pour toute question, soit sur l'expérience que j'ai eue dans d'autres ministères, soit sur l'idée que je me fais des institutions et de leur réforme, puisque c'est une question d'actualité, à la suite des travaux menés par la commission présidée par M. Balladur.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous avez parlé du fait majoritaire et c'est effectivement un point essentiel de notre réflexion. C'est en effet à cause du fait majoritaire qu'il faut donner sans doute plus de pouvoir au Parlement et qu'il y a moins besoin de corseter le Parlement avec des instruments de marginalisation du parlementarisme du fait d'une forme de stabilité qui s'est installée. C'est cette relation du ministre avec un Parlement dominé par le fait majoritaire qui est intéressante, notamment dans la perspective de la réforme des institutions. Il serait aussi intéressant que vous nous disiez comment vous voyez le rôle de l'opposition, le rôle du gouvernement et du Parlement ou le rôle particulier que l'opposition pourrait avoir au sein d'un Parlement rénové.
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ancien ministre.-
Les dispositions qui établissent le parlementarisme rationalisé pouvaient avoir un sens en 1958, mais elles n'en ont guère aujourd'hui parce que le fait majoritaire, à cause de l'élection du Président de la République au suffrage universel et du scrutin majoritaire aux élections législatives, a créé une sorte d'allégeance des parlementaires soit au Président de la République, qui est le chef de la majorité quand il a une majorité au Parlement, soit au Premier ministre, quand celui-ci est le chef de la majorité d'un gouvernement de cohabitation.
J'ajoute que la réforme du quinquennat et, plus encore, l'inversion du calendrier électoral fait, qu'aujourd'hui, les hypothèses de cohabitation sont beaucoup plus réduites. Par conséquent, on pourrait se passer de la plupart des dispositions relatives au parlementarisme rationalisé : la maîtrise de l'ordre du jour par le gouvernement ou l'article 49.3 de la Constitution. De ce point de vue et selon moi, les propositions du comité Balladur, largement reprises par la réforme institutionnelle, vont globalement dans le bon sens.
Certes, j'aurais des observations à présenter sur tel ou tel point, par exemple le fait que le CSM ne soit plus présidé par le garde des Sceaux (mais que celui-ci y assiste ne changera pas grand-chose à l'affaire) ; mais, globalement, je donne une appréciation plutôt positive à cette réforme qui revalorise le rôle du Parlement alors que toute l'évolution de la V e République par le fait majoritaire et les différentes réformes institutionnelles, intervenues depuis l'élection au suffrage universel de 1962 jusqu'au quinquennat et à l'inversion du calendrier électoral, a abouti à ce résultat : l'hyper présidentialisation du régime.
Il faut donc corriger cela, et je pense que les dispositions avancées vont plutôt dans le bon sens, même si, par ailleurs, on peut dire que la réforme du mode de scrutin aux élections sénatoriales mériterait d'être étudiée. On peut aussi être partisan d'un autre mode de scrutin à l'Assemblée nationale -la proportionnelle à l'allemande-, ce qui amènerait alors à revenir au parlementarisme rationalisé. Il faut donc avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est un système institutionnel en gardant à l'esprit que le pays doit être gouvernable. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Maintenant, soit je reprends l'exposé que j'avais prévu, soit nous continuons sur ce mode.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Je me disais simplement que votre expérience de ministre vous permettait de répondre à ces questions : que veut dire le fait d'être gouvernable et jusqu'où peut-on aller dans la liberté donnée au Parlement ? Gérard Longuet a dit qu'il avait profité de la critique ou de la pression du Parlement, mais jusqu'où peut-on augmenter cette capacité de critique et de pression et où faut-il s'arrêter pour éviter que cela devienne ingouvernable ?
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.-
Il y a un point d'équilibre, duquel nous sommes d'ailleurs très en deçà aujourd'hui. Je suis frappé par la surpuissance du gouvernement et des ministres par rapport aux assemblées. Le fait que le ministre arrive entouré d'un bataillon de commissaires du gouvernement avec, derrière lui, tous les services, le met en situation de domination intellectuelle et politique forte par rapport à des parlementaires qui sont généralement plutôt démunis, s'appuyant certes sur les services soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat, mais qui, quelle que soit la valeur des hommes, sont dans un rapport de forces très inégal avec les services dont dispose le gouvernement.
La réalité est celle-là : nous sommes face à un exécutif surpuissant. Il faut trouver un meilleur point d'équilibre.
Evidemment, on peut aller au-delà ou faire machine arrière. En 1958, il y avait un régime d'assemblée, dont je ne suis pas partisan, mais on est passé d'un extrême à un autre, on est tombé de Charybde en Scylla. Je pense donc que la réforme qui est proposée va plutôt dans le bon sens. Mais voulez-vous que je vous parle de mon expérience concrète ?
M. Bastien FRANÇOIS.-
Tout à fait, mais Gérard Longuet veut ajouter un point.
M. Gérard LONGUET.-
Je ferai une simple remarque. L'exécutif, sous la V e République, du fait de l'hyper médiatisation de la vie publique, est très exposé à la moindre nuance. Nous ne savons plus gérer les nuances et les différences, et on le voit dans l'actualité immédiate. Il est tellement évident, pour la presse politique qui observe la vie parlementaire, que l'attitude de l'opposition est de s'opposer et le rôle de la majorité de soutenir que, dès qu'apparaissent des nuances sur des sujets de société qui montrent la complexité des positions de chacun d'entre nous, cela entraîne de l'incompréhension.
Je prends l'exemple de Mme Morano, que je connais bien. Elle est secrétaire d'Etat à la famille, elle a été conseillère régionale de Lorraine pendant longtemps et elle a à la fois l'image d'une droite assez musclée et, sur des sujets de société, celle d'une personne très différente et très opposée au point de vue dominant de l'UMP. Les gens ne comprennent plus dès lors qu'il n'y a pas une homogénéité absolue et que l'on constate le début du commencement de l'esquisse d'une différence entre le point de vue ministériel et le point de vue de la majorité qui le soutient.
Il en est de même si un opposant a l'honnêteté de reconnaître que, sur tel sujet, le chemin parcouru va dans la bonne direction. Pour avoir voté des lois présentées par le gouvernement de Michel Rocard, je me souviens du jugement sévère dont j'avais fait l'objet dans mon camp. Nous avons perdu l'habitude d'une certaine liberté et donc d'un certain dialogue. Les vies parlementaires des pays européens, qui nous éclairent, montrent que ce dialogue, cette liberté et ces nuances vont de pair et que nous n'avons pas à attendre des relations entre le Parlement et le gouvernement cette architecture extraordinairement simpliste et totalement binaire. C'est en tout cas le voeu que je formule, dès lors que l'on a la sécurité que donne un exécutif stable pour cinq ans pour les raisons que Jean-Pierre Chevènement vient d'évoquer.
Enfin, j'ajouterai une remarque plutôt prospective. Vous parlez d'un exécutif stable, et l'expérience malheureuse de la dissolution de 1997 a tendance à montrer qu'il n'y a pas vraiment de dissuasion. Que se passe-t-il quand il y a des états d'âme ? Jean-Pierre Chevènement a traité le problème avec brio il y a quelques années en disant : « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne » et en le faisant. Ce n'est pas le tempérament naturel des hommes politiques qui veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le poste et la nuance jusqu'à la différence. C'est une nouvelle chose à gérer et je pense que nous allons découvrir, avec ce quinquennat qui va durer encore quatre ans, que la vie politique est plus compliquée pour l'exécutif qu'on ne le croit.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Dans les propos qui viennent d'être tenus, aussi bien par Gérard Longuet que par Jean-Pierre Chevènement, on pourrait penser que le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire la contrainte utilisée sur le Parlement, pour parler en termes simples, n'a plus lieu d'être dès lors qu'il y a un fait majoritaire durable et qu'il n'y a plus de cohabitation.
Je voudrais simplement répondre que le fait qu'il y ait une majorité et une opposition dépend aussi du mode de scrutin, comme Jean-Pierre Chevènement l'a d'ailleurs évoqué rapidement, et que, si on aboutissait à un système proportionnel, la notion de fait majoritaire n'aurait pas le même contenu. C'est mon premier point.
Deuxièmement, faut-il exclure à tout jamais la cohabitation ? Je ne le crois pas. Ce n'est pas parce que le Président de la République est élu et que l'Assemblée nationale l'est quelques semaines après lui qu'il n'y a pas de risque de cohabitation. Un Président peut démissionner (cela s'est déjà vu) et son successeur peut ne pas être de la même tendance que lui (cela ne s'est pas vu) ; un Président peut mourir (cela s'est déjà vu) et son successeur peut, sans être exactement de la même tendance que la sienne, s'accommoder de la majorité parlementaire qu'il lui laisse en héritage (cela s'est vu) ; enfin, un Président peut éprouver le besoin de dissoudre sans nécessité absolue (cela s'est déjà vu) et se trouver en période de cohabitation...
La conclusion, c'est qu'il ne faut pas considérer que, le fait majoritaire étant un fait acquis irréversible et la cohésion entre majorité et gouvernement étant également acquise à jamais, on peut s'accommoder de revenir au régime antérieur à la V e République. Il faut trouver un équilibre et c'est ce que nous avons essayé de faire, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Nous en venons donc à votre expérience, M. Chevènement.
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.-
Avant d'y venir, j'ajouterai que je suis d'accord avec Gérard Longuet, mais non pas tellement avec l'expression « Le Parlement, miroir de la société française ».
A mon avis, les parlementaires doivent, autant que possible, se déterminer à l'aune de l'intérêt général et ne pas être simplement le reflet des revendications ou des mouvements de l'opinion. On demande aux parlementaires, par le régime représentatif, de s'élever à une certaine considération de l'intérêt général, ce qu'ils ne feront pas forcément spontanément parce que le sectarisme, propre à la droite et à la gauche, est puissant et fait que l'on est contre simplement parce que les autres sont pour, ce qui est idiot. Il faut savoir être constructif. Quand on a confiance en ses idées, on peut dire oui. On peut dire non aussi, bien entendu. C'est la possibilité du non qui fait la valeur du oui.
Nous sommes donc d'accord sur ce point, mais j'observe que le fait majoritaire est une sorte d'entraînement à voter pour ou contre selon que l'on est dans la majorité ou dans l'opposition, ce qui réduit beaucoup l'intérêt de la fonction parlementaire, mais c'est ainsi.
Vous me demandez donc mon expérience de ministre de la défense. Je vais tenter de la résumer. Je vais vous faire un aveu : j'ai été ministre de la défense avant que le gouvernement de Michel Rocard soit constitué. En effet, le Président de la République m'ayant demandé mon avis sur le Premier ministre, Michel Rocard ou Pierre Bérégovoy, je lui ai indiqué ma préférence : celui avec lequel il avait les meilleures relations, bref celui en lequel il avait le plus confiance et il m'a dit ensuite : « Vous sortirez par le bureau de ma secrétaire parce que Michel Rocard attend dans l'antichambre »... (Rires.) Michel Rocard est devenu Premier ministre peu de temps après que François Mitterrand m'a demandé de devenir ministre de la défense. Voilà la manière dont se composent les gouvernements, mais c'est un autre sujet qu'on ne m'a pas demandé de traiter.
Je vous livre donc mon expérience, en traitant rapidement trois sujets.
Le premier est l'exécution de la loi de programmation votée sous le gouvernement de Jacques Chirac et le ministère d'André Giraud, que j'avais révisée de manière minimaliste en 1988-1989. Cette loi de programmation avait laissé les crédits du titre V à un niveau inégalé depuis lors : 103 milliards de francs en 1991, alors que nous en sommes à 85 aujourd'hui en francs constants. Cette loi a fait l'objet d'âpres discussions en interne au sein du gouvernement mais non pas avec le Parlement, qui l'a approuvée, et il a fallu attendre 1990 pour que le Président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, réclame à l'époque les « dividendes de la paix ». Il n'a pas eu le temps de les réclamer longtemps parce que la crise du Golfe a éclaté, ce qui fait que les économies ont été faites après que j'ai quitté le ministère de la défense, en 1991-1992, et sans doute dans les années suivantes, puisque la suspension du service national par Jacques Chirac en 1996 a entraîné un déport massif des crédits de la défense du titre V vers le titre III, c'est-à-dire de l'équipement vers le fonctionnement.
Il n'y a pas eu de débats sérieux sur ce que devait être notre posture de défense après la fin de la guerre froide, si ce n'est le débat sur le livre blanc de 1994, sous le gouvernement de M. Balladur. Tout s'est réalisé par petites touches. Par exemple, j'ai lancé en 1989-90 le plan "Armées 2000" qui réduisait de moitié les états-majors, et cela s'est fait contre l'état-major des armées et contre le Sénat. J'ai réuni de manière informelle un petit groupe de contrôleurs généraux et d'officiers généraux qui ont travaillé discrètement et j'ai annoncé ce plan au chef d'état-major des armées la veille du Conseil des ministres, qui a approuvé l'orientation en partie A de l'ordre du jour.
C'est dire que les rapports étaient très difficiles ils le sont toujours entre, d'une part, le ministre de la défense, qui a un cabinet civil et militaire dans lequel les militaires sont nommés par le chef d'état-major des armées, et, d'autre part, l'état-major des armées lui-même plus les chefs d'état-major des différentes armes qui, à l'époque, jouissaient d'une certaine autonomie.
Le débat sur le service national, longtemps après que j'ai quitté le ministère de la défense, en 1996, n'a pas vraiment eu lieu. Les socialistes, derrière Paul Quilès, qui avait été ministre de la défense, ont pris position pour la suspension du service national et les opposants étaient peu nombreux : le Parti communiste, Jean-Michel Boucheron, ancien Président de la commission de la défense, et moi-même. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu beaucoup d'opposants et cela s'est donc passé très facilement.
C'est curieux, parce que le service national avait fait l'objet d'une approbation massive dans les sondages (70 %) jusqu'à la fin, même si, naturellement, les jeunes étaient plutôt pour la suspension du service national. C'était donc une réforme qui allait dans le sens de ce qu'ils souhaitaient.
Je passe rapidement sur le redimensionnement des armées et le plan « Armée 2000 », ainsi que sur les interventions de basse intensité que j'ai eu à gérer au Tchad et aux Comores et les dernières péripéties de la guerre Iran-Irak. Tout cela n'a fait l'objet que de quelques questions d'actualité et de réponses assez laconiques et le Parlement a accepté je le dis parce que c'est la vérité sa marginalisation en matière de défense. La réélection de François Mitterrand à la présidence de la République, en mai 1988, lui assurait une légitimité écrasante et personne ne lui contestait d'être celui qui décidait en dernier ressort en matière de défense. Il a pu abandonner le missile terrestre mobile S4 sans qu'il y ait eu, du moins de mon temps, un débat à l'Assemblée nationale. Il a peut-être eu lieu précédemment, mais je n'en ai pas le souvenir.
L'affaire sur laquelle je me concentrerai est la crise et la guerre du Golfe, dont le Parlement a eu à connaître à trois reprises. Après l'invasion du Koweït, le 2 août 1990, le Parlement a été convoqué en session extraordinaire le 27 août. Il entend alors un message du Président qui est un appel à la mobilisation au service du droit. En fait, le Président avait déjà eu l'occasion de s'exprimer le 9 août 1990 et il avait envoyé des émissaires dans tout le monde arabo-musulman en y associant l'opposition : M. François-Poncet en Jordanie, M. Lecanuet en Inde et en Turquie et M. de Lipkovski en Indonésie, Malaisie et Thaïlande.
Le débat du 27 août ne fut suivi d'aucun vote. C'est M. Balladur, si mes souvenirs sont bons, qui est intervenu pour le compte du RPR, et M. Chirac n'a donné son avis que tardivement, le 23 août, expliquant que, ne disposant pas des éléments d'information nécessaires, il s'en remettait au gouvernement pour les dispositions à prendre. Je crois traduire fidèlement ce qui s'est passé.
Pour ma part, craignant d'emblée que les Etats-Unis ne veuillent pas laisser sa chance à une issue pacifique à ce conflit je rappelle que nous avions été aux côtés de l'Irak dans la guerre Iran-Irak , j'ai tenté d'influencer la politique de la France pour qu'elle favorise au contraire une telle issue. Or les interventions du Président de la République ont soufflé le chaud et le froid. Il a donné d'abord le sentiment d'une très grande fermeté, puis il a fait un certain nombre d'ouvertures devant les Nations Unies, le 24 septembre 1990, où il a déclaré que, si l'Irak exprimait l'intention d'évacuer le Koweït, tout redeviendrait possible. Même à la dernière minute, le 14 janvier 1991, une initiative de paix a été produite par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, portée par notre ambassadeur, M. Blanc, mais retirée le lendemain sous la pression américaine. Je vous rappelle que la guerre a éclaté le 17 janvier 1991.
Pour revenir un peu en arrière, je vais vous faire une confidence qui illustre le fait majoritaire, sachant que le délai de prescription est passé puisque dix-huit ans se sont écoulés. Le 22 août 1990, le Président de la République, sentant bien que j'étais plutôt favorable à une issue pacifique il m'a d'ailleurs dit plus tard qu'il ne lui déplaisait pas que le ministre de la défense soit plutôt « proche de la paix » , m'a demandé si je ne souhaitais pas devenir ministre de l'équipement, ce que j'ai refusé. Il m'a dit alors : « De toute façon, on ne peut pas être à la fois contre les Etats-Unis et contre la droite ». Cela m'a surpris. Je lui ai alors répondu que, si la droite faisait le même raisonnement (et il y avait lieu de penser que beaucoup de dirigeants de la droite faisaient un raisonnement qui n'était pas éloigné, mais en sens inverse), la défense de la France serait toujours à la remorque.
Cela s'est passé dans une ambiance relativement amicale. Le Président de la République a conclu : « Je m'attendais à ce que vous le refusiez ; cela ne me dérange pas. »
Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons été amenés à déployer des forces, celles de la mission Daguet, après le viol de l'ambassade de France au Koweït, le 15 septembre, et j'ai fait en sorte qu'elles prennent position à l'ouest, sur la frontière de l'Irak, pour une manoeuvre de contournement assez éloignée des frontières du Koweït. C'était le travail du ministre de la défense sous l'autorité bien sûr du Président. Celui-ci a approuvé mes propositions. Le Parlement n'est pas intervenu dans cette affaire.
Il s'est réuni une seconde fois, le 7 janvier 1991, à la veille du déclenchement de la guerre, pour entendre un message du Président de la République déclarant légitime le recours à la force un mois et demi après l'adoption par le Conseil de sécurité, le 29 novembre 1990, de la résolution 678 autorisant l'usage des « moyens nécessaires » pour assurer le retrait des troupes irakiennes du Koweït. Je rappelle que les résolutions 676 et 665, le 4 août, prévoyaient l'embargo, et que l'on est donc passé d'une stratégie d'embargo à une stratégie de force et de contrainte.
Alors qu'un Député de l'opposition, M. Jean-François Deniau avait eu l'occasion, le 12 décembre 1990, de s'étonner du passage d'une stratégie d'embargo à une stratégie de contrainte sans vote du Parlement sur la base de l'article 35 de la Constitution autorisant la déclaration de guerre, le Premier ministre lui a répondu beaucoup plus tard, le 16 janvier 1991, qu'il ne s'agissait pas d'une guerre mais d'une opération de sécurité collective sur la base du chapitre VII de la Charte de l'ONU. C'est sur cette interprétation et sur la base de l'article 49 de la Constitution que le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement, le 16 janvier 1991, devant les deux chambres, à partir d'une déclaration du gouvernement de Michel Rocard sur le Moyen-Orient.
Il y eut alors un vote à l'Assemblée nationale (523 votes pour et 43 votes contre) et au Sénat (290 votes pour et 25 votes contre). Le Parlement était réduit à un rôle de simple chambre d'enregistrement et M. Crépeau a dit que le Président avait fait merveille dans l'habillage démocratique de sa politique. Les moteurs des avions américains qui allaient bombarder Bagdad étaient déjà chauds sur l'aéroport de Dahran quand le vote est intervenu, quelques heures auparavant, et l'essentiel des décisions il faut le dire a été pris entre M. Bush, Mme Thatcher, M. Gorbatchev et François Mitterrand. Ce n'est pas le sujet et je ne l'aborde donc pas.
La gestion de la crise et la gradation de l'émotion ont été rythmées par les déclarations télévisées du Président de la République le 19 décembre 1990 et les 9 et 16 janvier 1991.
Le Parlement sera réuni une troisième fois en session extraordinaire le 19 mars 1991, et il entendra une déclaration du Premier ministre, M. Michel Rocard, qui « salue la victoire du droit, la résolution du Président de la République et la responsabilité des dirigeants politiques qui, majorité et opposition confondues, ont su mettre entre parenthèses des querelles intérieures pour n'avoir en tête que l'intérêt du droit et celui de la France ». Il a ajouté : « La défense du droit a fait se lever un espoir : celui, peut-être, de l'aube d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité, d'un monde vraiment régi par le droit ».
On sait ce qu'il en est advenu : la proclamation du règne du droit limité géographiquement au Koweït n'a été historiquement qu'une parenthèse ressentie comme tellement hypocrite, avec la prolongation de l'embargo sur l'Irak jusqu'en 2003, que les Etats-Unis eux-mêmes ont pris sur eux de la refermer, douze ans après la première guerre du Golfe, en en déclenchant une seconde et en envahissant l'Irak sans en avoir reçu le mandat des Nations Unies.
Quel aurait pu être le rôle de la France ? François Mitterrand a décidé seul et l'écrasante majorité du Parlement et de l'opinion publique, à partir du déclenchement de la guerre, a entériné ses choix. Ceux qui lui ont résisté n'étaient pas nombreux. Il faut se rappeler l'atmosphère de curée médiatique orchestrée à l'échelle mondiale et répercutée en France par tous les moyens de communication pour mesurer combien ce choix était difficile.
Voilà l'expérience que je peux vous livrer avec beaucoup de litotes.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Merci beaucoup, M. le Ministre. Vous venez d'illustrer la nécessité de la réforme proposée par M. Balladur d'une intervention du Parlement consécutive aux opérations extérieures de la France et, en même temps, d'illustrer les limites d'une telle intervention. Six mois après, comment peut-on intervenir une fois que les troupes sont engagées ? C'est toujours très délicat. Souhaitez-vous intervenir immédiatement, sur ce point, M. Balladur ?
M. Edouard BALLADUR, Président.-
J'en dirai un mot tout de suite, si vous le voulez bien. Je tirerai deux réflexions sur l'exposé très intéressant qu'a fait M. Chevènement. Premièrement, il n'y a pas de définition juridique de la guerre. On dit que le Parlement déclare la guerre dans la Constitution, mais qu'est-ce que la guerre ? C'est une opération de violence, bien entendu, mais d'autres opérations le sont aussi sans que ce soient des guerres et le Parlement ne les autorise pas.
D'où la nécessité de prévoir dans la Constitution c'est notre proposition et nous verrons bien si le Parlement est d'accord que les interventions militaires à l'extérieur soient autorisées, mais a posteriori seulement, par le Parlement.
Vous avez parlé de six mois, M. le Professeur, mais il s'agit là du texte du gouvernement. Qu'il me soit permis d'indiquer que le texte de mon comité prévoit trois mois. C'est peut-être trop long aussi, je vous en donne acte très volontiers, mais c'est mieux que la situation actuelle : nous avons depuis de nombreuses années des milliers de soldats français en Côte d'Ivoire sans que le Parlement français ait jamais été appelé à voter sur ce point et à l'approuver.
M. Bastien FRANCOIS.-
Un autre élément me semble très important dans le projet de réforme issu du Comité que vous avez présidé : le fait que le Parlement devait être obligatoirement informé des accords de défense signés par la France, ce qui permettait au Parlement d'intervenir à froid plutôt que d'être obligé de le faire à chaud, une fois les opérations engagées. Malheureusement, cette disposition n'est plus dans le projet du gouvernement.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Oui, mais il y a des amendements en cours sur ce point, si j'ai bien compris.
Ma deuxième remarque porte sur la résurrection du droit de résolution aux mains du Parlement, dont je considère que c'est un élément capital de la restauration des droits du Parlement. Certes, le vote d'une résolution n'est pas une décision qui a une force juridique ; cela revient à exprimer un voeu, mais, en l'espèce, si on souhaite que les forces françaises soient présentes dans tel ou tel endroit du monde, qu'il y ait ou non une résolution du Conseil de sécurité offrant une base internationale et légitime à cette présence, le droit de résolution rendu au Parlement le permettrait.
Enfin, je retire de l'exposé de M. Chevènement la conclusion que, s'agissant de la première guerre du Golfe, le Parlement a joué son rôle puisqu'il a été amené à voter plusieurs fois, et j'en ai d'ailleurs un souvenir précis puisque j'ai été une fois le porte-parole de mon groupe politique. Il a donc été appelé à voter, même si on ne savait pas très bien si c'était une guerre ou non. Pour ce qui est de la guerre du Golfe, on avait raison de dire que c'était une guerre, mais comme il n'y a pas de définition juridique et que la Constitution n'en donne pas, on était un peu dans l'embarras.
J'en conclus qu'il n'est pas normal, dans une démocratie, que les forces militaires d'un pays soient engagées sans que le Parlement soit amené à l'approuver. On peut discuter des délais et des formes, mais, sauf cas d'urgence extrême où il faut faire les choses tout de suite, il est normal, légitime et souhaitable que le Parlement soit amené à voter, et si la réforme que nous proposons conduisait à ce résultat nous verrons ce qu'il en sera je pense que nous aurions fait un progrès.
M. Gérard LONGUET.-
Je voudrais dire une chose assez désagréable sur la société française dont le Parlement est, au fond, le reflet : les Français donnent à l'exécutif une obligation de résultat et ils ne sont pas très regardants sur les moyens. Ils veulent « que ça marche », ils délèguent et ils ne font pas toujours l'effort de savoir à quelles conditions ils sont prêts à ce que les choses fonctionnent, qu'il s'agisse de décisions d'ordre social ou politique ou de décisions relatives à la construction européenne ou à l'aménagement du territoire.
Le sentiment que je retire de ma trop longue vie parlementaire, c'est qu'un grand nombre d'entre eux ont adopté exactement la même attitude : ils délèguent, dans le cadre du rapport entre majorité et opposition, leur mandat à l'exécutif s'ils sont dans la majorité et ils ont plus de responsabilité, d'autonomie et de liberté s'ils sont dans l'opposition, surtout si elle est désorganisée, ce qui lui arrive assez souvent, entre deux présidentielles. Cela dit, ils sont le miroir de la société française, c'est-à-dire qu'ils demandent au gouvernement une obligation de résultat à laquelle ils ne se sentent pas tenus nécessairement de participer et ils se réveillent lorsqu'on leur dit que les résultats ne sont pas au rendez-vous ou qu'ils les perçoivent par eux-mêmes avec une attitude de grogne. Je l'ai constaté entre 1981 et 1986 dans la majorité de gauche, mais je suis persuadé qu'on pourrait le constater à un moment ou à un autre dans une majorité de droite, sans y apporter une contribution nécessairement positive.
Il en est ainsi, malheureusement, du fait d'une tradition de dessaisissement de la responsabilité qui fait que les parlementaires s'occupent de leur circonscription jusqu'au moment où ils ont le sentiment que le projet collectif auquel ils sont associés prend largement de la bande et atteint une limite de naufrage.
Or le véritable travail parlementaire et politique consisterait à suivre au jour le jour les actions du gouvernement et à en être à la fois le soutien et le contrôle, ce qui permet d'en être solidaire en toutes circonstances, y compris quand les résultats c'est normal ne sont pas au rendez-vous et pour la majorité qui a participé de les assumer. Cette attitude de délégation est, malheureusement, assez représentative d'un certain comportement de nos compatriotes qui considèrent que, votant une fois tous les cinq ans, il appartient au Président élu de régler tous les problèmes.
J'ajoute qu'il reste heureusement une petite fenêtre d'espoir : depuis six à dix mois, les partenaires sociaux, en France, ont montré une responsabilité qui devrait éclairer l'attitude des partenaires politiques. Ils se sont engagés dans des accords et ils ont abouti à des résultats qui vont être, d'une façon ou d'une autre, transformés en loi par le Parlement. Nous avons donc des Français qui prennent leurs responsabilités. Il serait bon que les parlementaires le fassent tout au long du mandat pour lequel ils sont élus, sans remettre en rien en cause leur loyauté à l'égard des grands courants d'opinion qui les ont portés dans la majorité ou dans l'opposition au Parlement.
M. Bastien FRANCOIS.-
Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Claude Estier qui, ce matin, nous a fait part de son expérience de Président de groupe au Sénat, une expérience semble-t-il heureuse et, en même temps, une frustration à être dans une assemblée dans laquelle il était condamné à être un opposant à vie.
Je commencerai de façon un peu provocante, en partant de l'exposé de Jean-Pierre Chevènement. Vous qui êtes un grand parlementaire socialiste et qui connaissez la tradition du Parti socialiste de défendre les droits du Parlement, quand vous avez un ministre de la défense qui avoue aussi facilement une marginalisation du Parlement, j'aimerais connaître votre sentiment et la façon dont vous avez vécu, au Parlement, cette distance de la politique de la défense par rapport à votre responsabilité de parlementaire.
M. Claude ESTIER.-
M. le modérateur, je n'avais pas prévu d'engager un débat ou une polémique avec Jean-Pierre Chevènement sur son expérience. Mon intention, puisque vous me donnez la parole, est d'intervenir de façon assez différente des interventions que je viens d'entendre, et ce pour une raison très simple : n'ayant jamais été ministre, je ne vais naturellement pas vous faire part d'une expérience ministérielle comme l'ont fait Gérard Longuet et Jean-Pierre Chevènement. J'avais donc plutôt l'intention de m'en tenir à l'intitulé de notre table ronde : « Le Parlement, miroir de la société française », et j'aurais ajouté un point d'interrogation, parce que je pense que ce sujet entraîne davantage de questions que d'affirmations.
Le Parlement est-il un miroir de la société française ? Représente-t-il vraiment la société française telle qu'elle se définit et telle que l'on peut la constater tous les jours ? Je ferai trois grandes remarques à ce sujet.
Premièrement, les Députés sont élus à l'Assemblée nationale au suffrage universel et ils sont donc parfaitement légitimes. Pour autant, représentent-ils la société française dans toutes ses catégories sociales ? Certainement pas. Il est évident que, lorsqu'on se penche sur la statistique des professions représentées à l'Assemblée nationale, on ne voit guère d'ouvriers et d'employés et on voit beaucoup de fonctionnaires et de membres de professions libérales. On a donc une vision qui est totalement déformée par rapport à la réalité des catégories sociales qui existent en France.
Cela s'explique d'une certaine manière : il est naturellement plus facile d'être élu Député, avec le risque de ne plus l'être quelques années plus tard, si on a soit la sécurité de l'emploi, pour un fonctionnaire, soit la possibilité de retrouver son travail, quand on est avocat, médecin ou membre d'autres professions libérales alors que, lorsqu'on est salarié et que l'on perd son emploi, il est beaucoup plus difficile de le retrouver. Il y a donc beaucoup moins de salariés qui sont candidats à ce genre de fonction et cela explique, mais en partie seulement, la déformation qui existe entre la réalité sociale des 577 Députés de l'Assemblée nationale je parlerai ensuite du Sénat et la réalité de la société française.
C'est une première interrogation, ou plutôt un constat négatif. Je pense qu'il s'agit là d'un vrai problème qui fait qu'à l'Assemblée nationale, les Députés sont légitimes, puisqu'ils sont élus au suffrage universel, mais qu'en même temps, ils ne représentent pas la totalité des différentes catégories sociales en France.
Ma deuxième remarque rejoint la petite manifestation que nous avons eue tout à l'heure. Je pense que le problème des relations hommes/femmes, dans la vie parlementaire, est vraiment très loin d'être satisfaisant. La société française est mixte ; elle se compose d'hommes et de femmes, et elle comporte d'ailleurs une légère majorité de femmes. On ne retrouve évidemment pas cela au Parlement, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Je remarque d'ailleurs que, curieusement, des progrès sont faits davantage au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, mais il est vrai que ces progrès sont très lents.
Je vais vous donner un exemple qui concerne le groupe que j'ai eu l'honneur de présider pendant seize ans. Quand je suis devenu Président du groupe socialiste au Sénat, il y avait une femme sur soixante Sénateurs. Aujourd'hui, sur quatre-vingt-quinze Sénateurs dans ce groupe, il y a une vingtaine de femmes. Le progrès est considérable, mais il est largement au-dessous de la réalité de la société française.
C'est donc un vrai problème. Le progrès a été réalisé dans la mesure où on a introduit une modalité, dans les élections au scrutin de liste, qui oblige à avoir alternativement un homme, puis une femme sur la liste. Dans les départements où les élections se font à la proportionnelle, par scrutin de liste, c'est ce qui a permis de faire entrer au Sénat un certain nombre de femmes. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de circonscription, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, le progrès ne se fait qu'extrêmement lentement et la société parlementaire française reste essentiellement et majoritairement masculine.
C'est vraiment un problème qui, à mon avis, entre dans la constatation que le Parlement n'est pas véritablement un miroir de la société française.
Ma troisième grande remarque concerne plus particulièrement le Sénat, et je reprendrai ce que j'ai dit ce matin dans un autre cadre. Je pense que le Sénat est, encore moins que l'Assemblée nationale, le représentant de la société française parce que le mode d'élection des Sénateurs fait qu'il ne peut pas suivre aujourd'hui l'évolution de la société française depuis cinquante ans. Le mode de scrutin du Sénat est resté ce qu'il était au moment où la France était un pays rural alors qu'aujourd'hui, la France est un pays dont plus de 80 % des citoyens vivent dans les villes et les grandes villes. On a laissé au Sénat un poids considérable et totalement injustifié de représentants des maires des petites communes dans le poids du collège électoral sénatorial.
Lorsque, il y a quelques années vous vous en souvenez , Lionel Jospin avait parlé d'anomalie du Sénat dans une société démocratique, on a voulu expliquer ce mot en disant que nous étions hostiles à l'existence même du Sénat, ce qui n'est pas vrai. Le Parti socialiste, depuis très longtemps, a été et reste tout à fait favorable au bicaméralisme. Le fait d'avoir deux assemblées dans une démocratie est un progrès considérable pour le débat législatif, à condition, comme on le disait ce matin, que l'on ne recoure pas constamment à la procédure d'urgence. En tout cas, l'anomalie ne concernait pas l'existence du Sénat mais son mode d'élection.
Je souhaite donc interroger M. le Premier ministre, Edouard Balladur, sur cette affaire, parce que nous avons un vrai débat, qui va se prolonger dans les semaines qui viennent, sur la réforme des institutions. On dit que les socialistes sont hostiles à cette réforme, mais ce n'est pas exactement la façon dont il faut présenter les choses. Certes, il y a un débat sur un certain nombre de questions (notamment sur la façon dont le Président de la République pourrait s'exprimer devant le Parlement : dans un congrès ou dans chacune des assemblées), mais, bien que cela n'entre pas dans la réforme de la Constitution, même si cela va de pair, la question est de savoir si on souhaite mettre fin, à la faveur de cette réforme de la Constitution et des institutions, à cette anomalie que représente le mode de scrutin et d'élection des Sénateurs.
La question est ouverte. Je ne sais pas si la réponse sera favorable. Je dois dire que je suis plutôt pessimiste, d'après ce que j'entends à ce sujet de la part de ceux qui ont la responsabilité de cette réforme, mais nous nous battrons dans ce sens et je pense que c'est un élément important, qui s'ajoute aux deux autres questions que j'ai soulevées, pour que le Parlement devienne véritablement un bon miroir de la société française.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Je vous remercie de n'avoir pas répondu à la question que vous ai posée, car vous avez dit des choses beaucoup plus intéressantes que celles que je vous suggérais de dire. Je me permettrai d'ajouter un autre élément qui me semble important et qui est rarement noté dans le problème de la représentativité de nos élites : la question de la mauvaise représentativité des générations. Une série de travaux montre un vieillissement très important des élites parlementaires françaises, beaucoup plus rapide que le rythme normal du vieillissement des enfants du baby-boom, à tel point que nous sommes le Parlement le plus vieux d'Europe. C'est une question qui ne sera pas sans effet au moment où le Parlement doit traiter de questions très importantes.
M. Claude ESTIER.-
Cela s'ajoute tout à fait aux remarques que j'ai faites.
M. Bastien FRANCOIS.-
Cela s'ajoute aux questions évoquées, mais les solutions seront sans doute différentes, et je pense en particulier aux questions de cumul des mandats dans le temps.
Comme j'ai peur maintenant de faire de mauvaises introductions, je vais vous donner la parole librement, Mme Procaccia, ce qui vous permettra de vous en saisir et d'intervenir beaucoup mieux que selon la façon dont je pourrai vous l'offrir.
Mme Catherine PROCACCIA, Sénateur du Val-de-Marne.-
De toute façon, je suis une femme libre et, au Sénat, j'ai l'habitude et la chance de pouvoir dire ce que je veux. Quand j'ai accepté de participer à cette table ronde, on ne m'a pas demandé sur quoi je voulais intervenir. J'ai pris ce thème, comme M. Estier, « Le Parlement, miroir de la société française », et je n'ai pas essayé d'y réfléchir beaucoup parce que, pour moi, le miroir de la société française n'est pas de représenter les particularismes de la société. Or, à cette tribune, aujourd'hui, j'ai la particularité d'être le vilain petit canard : je suis une femme, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été Députée, je n'ai jamais été Présidente de groupe et je suis une salariée qui vient du privé. J'ai donc toutes les caractéristiques me permettant d'affirmer que le Parlement n'est pas le reflet de la société française.
Cela dit, je m'empresse de dire que je partage l'analyse de M. Claude Estier selon laquelle les femmes sont sous-représentées nous sommes environ 20 % dans les deux assemblées , mais aussi que nous sommes très peu de salariés pour la raison que M. Estier a évoquée : lorsqu'on a 35 ou 40 ans et que l'on est salarié du privé, on n'a pas forcément envie de se retrouver sans mission et sans travail alors que l'on a des enfants, un appartement à payer, etc.
Vous avez parlé du vieillissement du Parlement, mais cela vient du fait j'en ai parlé notamment avec le Medef qu'il n'y a absolument rien pour aider des salariés lambda qui, comme moi, n'étaient pas programmés pour être Sénateurs ou parlementaires. Cela fait vingt-cinq ans que l'on attend de parler du statut du parlementaire. Je pense que le parlementaire qui est salarié et qui ne retrouve pas son emploi devrait au moins avoir les protections qui existent pour les syndicalistes et les partenaires sociaux dans les entreprises. Cela faciliterait peut-être la présence de cette partie de la société que sont les salariés du privé.
Cela étant dit, je suis contente d'avoir choisi de parler des femmes au Parlement, en donnant mon sentiment sur deux points complémentaires : la façon dont je voyais les femmes aux Parlement avant de l'être je le suis moi-même depuis trois ans et demi et la façon dont je les vois maintenant.
Y a-t-il eu des progrès depuis l'époque où j'étais encore relativement jeune et étudiante ? Quand j'étais étudiante, je réfléchissais déjà à ce thème et j'avais deux explications sur la sous-représentation des femmes au Parlement.
La première, c'est une raison historique et personnelle, hypothèse que j'ai un peu honte d'avancer dans un colloque d'historiens : celle de la loi salique, qui fut exhumée à une période où l'on voulait sauver le royaume de France et que l'on a complètement déformée puisque, à l'époque carolingienne et auparavant, elle ne concernait que l'héritage des terres.
La loi salique appliquée en France s'est traduite par le fait que l'on a exclu les femmes du pouvoir. On en a fait des femmes d'influence et non pas des femmes de pouvoir. Seule la France a procédé ainsi. En Angleterre, en Espagne ou en Russie, à l'époque de la grande Catherine, il y a eu des femmes. Il n'y a qu'en France où les femmes ont été exclues du pouvoir, et je pense qu'au XX e comme au XXI e siècle, c'est l'une des raisons qui expliquent le peu de présence des femmes.
La deuxième raison est connue et partagée dans un certain nombre de pays. C'est le fait que la plupart des partis politiques, dans tous les pays, donnent la primauté aux sortants. Les femmes ont eu le droit de vote il y a relativement peu de temps. Comment donner la place à une femme quand le Député ou le Sénateur sortant a bien fait son travail ? Avec la primauté au sortant, nous n'arriverons jamais à quelque chose.
Pour moi, ce sont les deux raisons qui expliquent cet état de fait et ce tant que les partis politiques ne changeront pas. Bien que je sois UMP, je remercie la gauche d'avoir fait voter un certain nombre de dispositions en faveur des femmes, mais tant que l'on ne changera pas cela, on n'aura pas une représentation de la société française à la fois pour les femmes et pour les salariés, mais aussi pour d'autres formations.
Si vous regardez le décalage qui existe entre la première assemblée, celle de la Révolution, ou celles de la II e ou de la III e Républiques, et le droit de vote des femmes, vous constaterez qu'il s'est passé déjà un siècle et demi à deux siècles. Il y a donc un énorme décalage dans le temps entre, d'une part, la création d'un Parlement et le droit de vote universel accordé uniquement aux hommes, et, d'autre part, le droit de vote accordé aux femmes, puisqu'il a fallu attendre pour cela le XX e siècle.
La prochaine grande révolution mais elle n'est pas près d'arriver se produira quand ces femmes, qui sont maintenant un peu plus présentes au gouvernement et au Parlement, arriveront aux postes de responsabilité. Même si, en tant que salariée, je trouve que les femmes sont relativement peu représentées aux postes de direction dans les entreprises, c'est la catastrophe dans nos parlements. Je pense que nous aurons plus facilement une femme Président de la République qu'une femme Président du Sénat ou une femme Président de l'Assemblée nationale.
En même temps, comme je l'ai dit, il y a tout un passé à prendre en compte. Il y a quarante ans, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorité de leur mari, et je me demande comment elles faisaient quand elles divorçaient ou quand elles étaient célibataires. En tout cas, les fonctions de prestige ne sont pas aujourd'hui comme hier pour nous au Parlement.
Au Sénat, sur seize hautes fonctions, un Président, six vice-Présidents, trois questeurs et six Présidents de commission, nous n'avons qu'une seule femme. A l'Assemblée, où plus de postes sont concernés, il n'y a que deux femmes. Telle est la représentation des femmes.
J'ajoute un point que j'ai constaté lors de la préparation des élections municipales et cantonales. Quand j'allais voir une femme en lui demandant si elle ne voulait pas se présenter aux cantonales ou si elle voulait être éventuellement sur l'une des listes municipales, elle me disait : « Croyez-vous que j'en sois capable ? » Jamais un homme ne m'a demandé s'il était capable d'être élu. C'est un positionnement un peu différent.
Avant d'être parlementaire, j'avais une vision assez négative de la femme au Parlement, car on en voyait peu. Sous la IV e République, j'étais enfant et il n'y en a quasiment pas eu. Sous la V e République, la première femme qui m'a marquée, sans la connaître beaucoup, a été Marie-Madeleine Dienesch, qui fut la première femme Présidente d'une commission, mais, si je m'en souviens bien, c'est parce qu'un de mes maîtres de conférences, à Sciences Po, était son directeur ou son chef de cabinet et qu'il nous en avait parlé. J'ajoute qu'en préparant, hier, ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai vu qu'elle déclarait elle-même que sa réussite était d'être une femme sans histoire. C'est sans doute parce qu'elle a été une femme sans histoire qu'elle est restée aussi longtemps ministre.
Après avoir été étudiante, je suis devenue jeune cadre et j'ai vu trois femmes ministres qui m'ont donné l'espoir que les choses allaient changer, en France, en matière de politique.
La première, c'est Françoise Giroud, qui a été plutôt un symbole puisque c'est à ce moment-là que l'on a créé la notion de « condition féminine ». Alors que j'en étais restée à l'égalité hommes/femmes, je me disais qu'effectivement, les femmes ne vivaient pas comme les hommes et qu'il y avait quelque chose à faire.
La deuxième est évidemment Simone Veil, d'abord parce que les autres ont été secrétaires d'Etat et qu'elle a été la première femme ministre. Elle a été au ministère de la santé parce qu'il était normal, pour la société française, de mettre une femme à la santé, mais elle a été surtout un ministre à part entière, qui est intervenu pour les femmes contre les hommes. A cette époque, lorsque je regardais les débats à la télévision, pour moi, cette femme était un modèle de ténacité, de conviction, d'engagement et de compétences, et je pense qu'elle a donné à un certain nombre de femmes je n'étais pas du tout engagée dans la politique une image différente de celle de la mère au foyer que l'on donnait aux femmes à l'époque.
La troisième femme qui m'a frappée, c'est Edith Cresson. Cela s'est passé après 1981, alors que je m'étais engagée politiquement au RPR, mais elle m'a frappée d'abord parce qu'elle a été nommée à l'agriculture et que je travaillais dans un organisme agricole. Je me suis demandé à l'époque comment ces Messieurs, les conjointes d'exploitants n'existant pas encore vraiment à cette époque, allaient tolérer une femme à l'agriculture. Elle a eu à faire face à un certain nombre de difficultés. Ensuite, elle est devenue la première femme Premier ministre en France et elle le demeure : il n'y en a jamais eu d'autres.
Tout le monde se souvient d'un certain nombre d'écarts de langage, mais je demeure persuadée que ce que l'on n'a pas pardonné à Edith Cresson, c'est qu'elle était une femme et que ses collègues de gauche comme de droite ont été beaucoup moins tendre avec elle qu'avec un homme qui aurait été Premier ministre pour la première fois. C'est pourquoi, sans porter un jugement sur son action et bien que je sois une femme de droite, Edith Cresson fait partie des femmes politiques qui m'ont marquée et dont je me souviens.
J'ai un très mauvais souvenir, ensuite, de l'époque des « Juppettes ». Pour nous, les femmes j'étais alors dans le monde des entreprises et je ne faisais toujours pas de politique , cela a été une humiliation. J'ai fait attention, aujourd'hui, à ne pas porter de vêtements de couleur, parce que, souvent, les femmes qui sont à une tribune apportent un peu de couleur. En tout cas, ces femmes avaient été nommées pour faire beau sur la photo et, ensuite, on leur a demandé de partir très rapidement, comme si elles étaient plus incompétentes que d'autres.
En revanche, récemment, Michèle Alliot-Marie à la défense est une réussite parce que c'est une femme qui est nommée à un poste typiquement masculin, même si Mme Avice l'avait occupé auparavant. Elle s'est impliquée dans un monde qui n'est pas normalement le sien, puisque les femmes n'ont pas fait le service militaire, et, pour moi, elle est le symbole que des femmes peuvent réussir dans des domaines qui ne sont pas les leurs, que nous pouvons arriver, nous, les femmes, quand nous parvenons à être meilleures que les hommes et qu'il faut pouvoir travailler plus, être meilleure et s'affirmer pour réussir.
En octobre 2004, je suis devenue Sénateur. Je fais partie de ces femmes politiques qui n'ont pas eu à se battre : on est venu me chercher pour être conseiller municipal, puis pour être conseiller général, puis pour être premier adjoint et, enfin, pour être Sénateur. Je dois dire d'ailleurs que l'une des personnes qui est venue me chercher alors que j'étais déjà élue a été Antoine Pouillieute et, le jour où, alors qu'il était proche de M. le Premier ministre, il a dit qu'il s'associerait à Catherine Procaccia quand il serait Député, j'ai commencé à exister aux yeux de ceux avec lesquels je travaillais depuis douze ans. Ce sont quand même des hommes qui sont toujours venus me chercher et qui m'ont reconnue.
Je suis arrivée au Sénat à cause de la loi sur la parité et en tant que première adjointe d'une grande commune de France et que conseiller général, sachant que nous n'étions que deux femmes dans cette position et que j'avais donc de fortes chances d'être sur une liste, mais je n'aurais pas été en position éligible. Quand je suis arrivée dans cette assemblée qui avait la réputation d'être misogyne, la réalité du Sénat m'est apparue complètement différente par rapport aux femmes. Au début, nos collègues Sénateurs je salue Bernadette Dupont, qui a été élue en même temps que moi en 2004 sur un scrutin de liste nous ont regardées un peu bizarrement en se demandant en gros ce qu'allaient être ces femmes qu'on leur avait imposées, même si je pense qu'en tant qu'élues depuis longtemps (je l'ai été pendant un quart de siècle pour ma part), nous pensions avoir fait nos preuves.
Très rapidement, au Sénat, nous sommes devenues des Sénateurs à part entière. Nous sommes aussi bonnes et aussi mauvaises, aussi présentes et aussi absentes que les hommes. La seule différence, c'est qu'en tant que Sénatrices, nous n'avons pas un seul rêve, celui de devenir ministre, contrairement à la plupart de mes collègues.
Je dois dire que je ne ressens une différence dans les relations et le travail que lorsque je suis rapporteur d'un projet de loi. En trois ans et demi, j'ai été rapporteur de cinq textes de loi, dont plusieurs en première lecture et dont deux importants récemment : la loi sur le service minimum et la fusion Anpe-Unedic. Vous constatez que l'on ne confie pas aux femmes uniquement des textes sans importance, y compris en première lecture. Je me rends compte que je suis une femme à la fin de la présentation de ces textes parce que mes collègues me disent : « Tu t'es bien débrouillée, tu étais bonne », en sous-entendant « surtout pour une femme ».
Hormis dans cette situation, je n'ai rencontré aucune misogynie, je me trouve à égalité avec mes collègues du Sénat, y compris au sein du groupe UMP, où nous intervenons de la même façon que les hommes si nous avons envie de le faire.
Malheureusement, les Sénateurs comme les Députés ne veulent pas laisser leur place à des femmes. Permettre à d'autres femmes de rentrer dans l'institution, quelle qu'elle soit, c'est abandonner leur place, et ils ne nous reconnaissent donc pas globalement. On dit à toutes les femmes qu'il faut qu'une femme se présente, conformément à la fameuse loi sur la parité qui permet de présenter des femmes dans les endroits imprenables pour permettre aux partis politiques de ne pas être pénalisés, mais une fois que nous sommes intégrées au Sénat je ne parlerai pas de l'Assemblée nationale car je ne sais pas comment cela se passe , nous sommes des parlementaires à part entière. Par conséquent, à l'intérieur de cette maison, ma vision est un peu différente.
Pour revenir sur le thème de cette table ronde, je réponds que le Parlement ne devrait pas être le reflet de la société mais la devancer. Il devrait devancer les réflexions et faire avancer la société. Je constate que, dans le gouvernement actuel de Nicolas Sarkozy, les femmes sont présentes dans des ministères importants (économie, justice, intérieur et, auparavant, défense) alors qu'elles sont absentes dans nos deux assemblées parlementaires. La question qui se pose n'est pas d'être le reflet de la société mais de se demander si notre Parlement est vraiment démocratique puisqu'il refuse de reconnaître une place aux femmes dans ces assemblées. Les femmes n'ont quasiment aucune place : il y a ici une vice-Présidente et deux vice-Présidentes à l'assemblée alors que nous sommes plus de 20 %.
Je pense que la loi sur la parité a fait avancer les choses, mais elle ne les a pas fait avancer du fait des pénalités financières, auxquelles je m'oppose, comme je l'ai dit au Président de la République. De toute façon, plutôt que de décider de mettre une femme à la place d'un homme et de faire de la peine à un parlementaire qui n'a pas forcément démérité, les partis politiques préféreront payer des pénalités. La pénalité ne m'intéresse pas. Je préférerais que l'on verse un bonus plutôt qu'un malus aux partis politiques, même si je ne suis pas sûre que cela changera les choses. En tout cas, pour que les femmes et les salariés, hommes ou femmes, soient plus représentés, il faut continuer à faire évoluer les choses.
Je terminerai en disant que si, quand on est à l'intérieur, on constate que l'ambiance est moins misogyne, de l'extérieur et pour y accéder, je n'ai pas l'impression qu'en trente ans, les choses aient énormément changé.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Merci beaucoup, Mme la Sénatrice. Je pense que les jeunes femmes qui sont devant nous avec des barbes étaient déjà convaincues, mais après ces explications apportées aux gens comme moi, c'est-à-dire à nous, les hommes, nous sommes convaincus que c'est vraiment important.
Je vais donner tout de suite la parole à mon collègue Paul Smith qui va user d'un regard excentré, sachant qu'il est toujours bon d'avoir un point de vue comparatif. Je vous demanderai, cher collègue, d'être si possible assez bref, parce que nous avons ici l'inspirateur n° 1 de la réforme constitutionnelle dont on discute actuellement et qu'il serait donc utile pour la France et intéressant pour nous tous de l'écouter sur ce point.
M. Paul SMITH, Professeur à l'Université de Nottingham.-
Merci, M. le modérateur, et merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui à être parmi vous. Je vais reprendre une petite citation de mon compatriote Winston Churchill : « Je vous préviens, vous êtes en grand danger, je vais vous parler en français ! »
Venu d'Angleterre en ma qualité d'historien du Sénat, je vais aujourd'hui vous parler du Sénat dans le contexte de ce colloque et proposer quelques idées à propos de cette assemblée.
Quand Jean Garrigues m'a demandé de participer à la table ronde intitulée « Le Parlement, miroir de la société française », cela m'a fait tout de suite penser à une petite phrase d'Yves Weber que j'ai lue au début de mes études sur le bicamérisme, il y a treize ans, et qui avait été publiée en 1972 dans un article consacré à la crise du bicamérisme en Europe. A l'époque, on parlait en effet de la suppression de la Chambre des Lords, les Français venaient de dire non au général de Gaulle pour la réforme du Sénat, on posait la même question en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie, et les Suédois venaient de supprimer leur Haute assemblée. C'était donc une question d'actualité.
Weber a donc écrit dans son article : « Le bicamérisme informe et traduit tout ensemble la nature profonde du système politique. » Ce n'est pas un mauvais point de départ pour un débat que nous aurons peut-être tout à l'heure. En effet, que signifie le fait d'avoir une deuxième assemblée ? Weber a dit que la première chambre - l'Assemblée nationale en France - est élue au suffrage universel par un système ou un autre, mais que lorsqu'on discute sur la Haute assemblée, on trouve autre chose.
J'ai donc été frappé par cette réflexion de Weber, surtout dans le contexte de la Grande-Bretagne. En effet, vous savez que, chez nous, la Chambre des Lords est constituée des « copains à Tony Blair », comme on le dit en anglais, c'est-à-dire du fait des nominations des partis. C'est le reflet de la domination presque totale des partis politiques dans le système outre-manche. Je schématise énormément, mais c'est une réflexion sur laquelle nous pourrons peut-être revenir tout à l'heure.
J'ai aussi été frappé par certaines réflexions qui ont été faites ce matin. Alain Delcamp a parlé de l'évolution du Sénat et je suis toujours étonné par le fait que la Constitution de la V e République et le Sénat sont deux choses tout à fait protéiformes, qui sont plus qu'évolutives et qui sont toujours en train de changer. On parle de Parlement rationalisé, de régime semi-présidentiel ou du Sénat d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des choses qui changent. Autrement dit, vous avez un système qui n'est pas figé et qui est toujours en train d'évoluer, ce qui est assez frappant.
Lorsque je parle à mes étudiants, à Nottingham, pour les initier à l'histoire constitutionnelle de la France et que je leur demande de visiter le site Internet du Conseil constitutionnel, ils sont toujours surpris par le nombre de révisions de la Constitution de la V e République depuis 1958. Pour eux, c'est une révélation, parce qu'en tant que petits Anglais et Anglaises, ils imaginent qu'une Constitution, une fois écrite, perd sa vie. Ce n'est pas vrai.
Il en est de même du Sénat. A propos du Sénat, en tant qu'historien, j'utilise la phrase suivante, qui est liée à ce qu'Alain Delcamp a dit ce matin : aujourd'hui, le Sénat se trouve à un point crucial de son histoire, à un carrefour dans son évolution, peut-être plus que l'Assemblée nationale. En effet, le Sénat est au centre de la transformation requise par les réformes de 2003. Je ne parle pas de la réforme constitutionnelle mais de la loi Poncelet qui a institué la réduction du mandat à six ans et l'augmentation du nombre de sièges.
Mon premier constat est donc qu'il s'agit d'une institution qui est en évolution.
On a parlé de la présence des femmes au Sénat (18 % aujourd'hui) qui va se développer à l'avenir.
Jean Garrigues m'a également demandé si je pouvais choisir un moment clé des cinquante dernières années qui a été, pour moi, véritablement important dans la vie du Sénat. Au début, je pensais à 1969, bien sûr, c'est-à-dire au référendum, mais je me suis dit que c'était trop évident. J'ai pensé aussi à 1958, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la « République sénatoriale », mais ce n'était pas cela non plus. Le moment qui m'a frappé le plus, alors que j'étais en train de rédiger le deuxième tome de mon livre, a été la nomination à Matignon de M. Raffarin parce que, pour moi, cela marquait le moment où il n'était plus interdit d'être Sénateur et Premier ministre. C'était en effet la première fois depuis 1958 et la nomination de M. Michel Debré, que l'on osait aller à la Haute assemblée chercher son Premier ministre et non pas à l'Assemblée nationale, ou parmi des spécialistes en divers domaines, parce que je sais que tous les Premiers ministres n'ont pas été Députés.
Je me suis également fait la réflexion que, depuis 2002, nous avons eu trois Premiers ministres dont deux étaient Sénateurs au moment de leur nomination. Cependant, un Sénateur ne ressemble pas un autre : M. Raffarin n'est pas le même genre de Sénateur que M. Fillon. Je n'insiste pas là-dessus, mais, pour moi, cela a ressemblé au moment où, sous la III e République, il y a eu un rééquilibrage entre les deux institutions. Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison parce que la V e République n'est pas la III e , bien sûr ; mais c'est néanmoins la période où des hommes politiques malheureusement, il n'y avait que des hommes à cette époque comme Georges Clemenceau, Raymond Poincaré, Léon Bourgeois et d'autres ont cherché à gagner le Sénat depuis la Chambre des Députés, ou plutôt, dans le cas de Clemenceau, de revenir au Parlement à travers le Sénat.
C'est à partir de ce moment-là que le message suivant a été délivré aux autres hommes politiques : le Sénat n'est pas « l'Hôtel des Invalides des Députés surannés », pour reprendre la description de la Chambre des pairs sous la Monarchie de juillet.
En fait, j'ai constaté que M. Raffarin n'est pas un cas particulier parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui commencent leur carrière parlementaire non pas à l'Assemblée nationale mais au Sénat. Pour moi, il y a donc une sorte de rééquilibrage depuis 1992, date charnière. A mon avis, les choses ont commencé à changer après 1992, sous la présidence de M. Monory et, bien entendu, sous celle de M. Poncelet.
Je terminerai en citant une expression anglaise : Every cloud has a silver lining, ce qui signifie que, derrière chaque nuage, il y a le soleil. C'est peut-être le soleil d'Austerlitz...
La dissolution de 1997 a été un désastre pour la droite à l'Assemblée nationale, mais à la deuxième chambre, cela a été un petit miracle ou plutôt une divine surprise parce qu'elle a permis à la majorité du Sénat d'aller au secours du Président de la République, de lui apporter son soutien. Cela n'a pas été sans inconvénient puisqu'il a été confronté à la loi sur la parité ou sur le cumul des mandats. Mais la récompense, pour la majorité sénatoriale a été la nomination de M. Raffarin. Il avait beaucoup de qualités, bien sûr, et il n'a pas été nommé uniquement pour remercier les Sénateurs de droite, cependant sa nomination a été une récompense pour la majorité au Sénat, et il en a été de même avec l'introduction de la subsidiarité dans la Constitution et l'insertion dans l'Article 39 de la primauté du Sénat en ce qui concerne tout projet ou proposition de loi touchant aux collectivités territoriales. C'était, aussi, le moment de triomphe des «rénovateurs», ce groupe insaisissable, nébuleux, mais très influent au coeur de la Haute assemblée depuis plus de vingt ans. Pour eux, 2002-2003, c'est en quelque sorte l'apothéose.
Voilà les quelques réflexions que je tenais à apporter.
M. Bastien FRANCOIS, modérateur.-
Merci beaucoup, mon cher collègue. Je donne la parole à M. le Premier ministre Balladur pour conclure ou tirer quelques leçons de ce qui a été dit au sujet du projet de réforme.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je vais m'exprimer dans un moment un peu particulier, puisque la discussion sur le projet de réforme constitutionnelle a commencé, en tout cas devant la commission des lois de l'Assemblée, qui va continuer à amender sur un certain nombre de points le projet du gouvernement qui, lui-même, n'est pas exactement celui que nous avions proposé.
De crainte de pénétrer dans des débats qui sont politiquement complexes, et sauf si vous m'y invitez particulièrement, je me bornerai à parler de nos propositions car j'en suis sûr. Pour le reste, nous verrons comment va se dérouler la discussion.
Je commencerai par quelques réflexions sur le rôle du Parlement sous la V e République, puisque c'est l'objet de notre discussion.
Il y a un lien c'est une banalité de le dire extrêmement étroit entre le Parlement et la démocratie et on l'oublie parfois. Dans les luttes pour le pouvoir, les peuples essaient d'asseoir un contrôle sur le détenteur du pouvoir et, lorsque ce détenteur est unique, ce qui arrive dans les régimes que j'oserai appeler traditionnels, tout l'effort de l'histoire consiste à faire en sorte qu'il y ait une représentation du peuple sous des formes directes, indirectes, aristocratiques ou plus ou moins démocratiques qui encadrent l'action du titulaire du pouvoir.
A partir de là, le problème de toujours est de définir un équilibre entre le Parlement et le gouvernement. Il faut que le Parlement joue vraiment le rôle pour lequel il est fait, c'est-à-dire voter les lois et contrôler le gouvernement, et il faut que, pour autant, le gouvernement demeure efficace et ne soit pas empêtré dans sa tâche par une intervention excessive du Parlement. Nous, Français, depuis deux siècles nous tâtonnons et il nous est arrivé de ne pas trouver longtemps la bonne solution. Nous avons essayé tous les régimes : la monarchie, la dictature, la monarchie constitutionnelle, la République plus ou moins autoritaire ou plus ou moins parlementaire. Le régime qui a duré le plus longtemps, est celui de la III e République, qui a duré un peu moins de soixante-dix ans, et il est possible que, sans la défaite de 1940, il durerait encore.
A partir de cette époque, après la dictature de Vichy, on a rétabli une notion traditionnelle de la République et je voudrais insister sur cette notion parce que les choses ont changé.
Dans le conformisme de l'époque, le fait d'être républicain voulait dire tout d'abord que l'on était hostile au référendum, qualifié de plébiscite quasi automatiquement. Il faut reconnaître que l'expérience des deux époques napoléoniennes allait dans ce sens.
C'était également être hostile au contrôle de la constitutionnalité des lois, parce que le principe jacobin, principe républicain de base, était la souveraineté de la loi, et donc du Parlement, et l'hostilité au Parlement d'Ancien Régime, qui se prétendait supérieur au pouvoir politique alors qu'il était composé tout simplement de nantis qui achetaient leur charge avant de la transmettre à leurs héritiers. C'était le deuxième principe.
Le troisième était la supériorité du Parlement sur le gouvernement : le gouvernement était vraiment sous un contrôle très étroit et sa vie dépendait très étroitement du Parlement.
Autour des années 1930, il est probable que c'était l'opinion la plus répandue dans les milieux politiques : hostilité au référendum, hostilité au contrôle de la constitutionnalité des lois et hostilité envers un gouvernement trop fort face au Parlement.
C'est une conception qui a plus ou moins été validée, quand elle n'a pas été exagérée, par la Constitution de la IV e République. Finalement, du fait de l'instabilité des gouvernements et de leur faiblesse, comme toujours dans notre histoire politique et constitutionnelle, il y a eu une réaction en sens inverse et, comme toujours je me permets de le dire bien qu'appartenant à un mouvement politique qui s'est longtemps réclamé du général de Gaulle , on a réagi en allant trop loin dans l'autre sens.
On a encadré très étroitement les pouvoirs du Parlement, posant le principe que celui-ci n'avait pas besoin d'investir le gouvernement et que le gouvernement existait dès que le Président de la République l'avait nommé.
On a institué, avec d'infinies prudences, car ce n'était pas la tendance du général de Gaulle, le contrôle de la constitutionnalité des lois, et il a fallu que, de Gaulle disparu, le Conseil constitutionnel élabore une jurisprudence qui a accru son rôle alors qu'à l'origine, ce rôle était beaucoup moins important.
Enfin, on a validé le recours au référendum comme étant la procédure la plus démocratique, si bien qu'aujourd'hui, selon les alternances et les circonstances politiques, c'est tantôt la droite ou tantôt la gauche qui réclame des référendums. Je me permets de dire et j'espère ne pas être suspect de partialité politique que la réclamation du référendum était une tradition davantage de droite que de gauche dans notre histoire, mais c'est devenu une tradition de quiconque a envie de mettre le pouvoir politique en difficulté. On pourrait donner cette définition du recours au référendum ; elle ne serait pas plus fausse qu'une autre.
A partir de là, comment les choses ont-elles évolué ? J'attirerai tout d'abord votre attention sur le fait que la IV e République s'était déjà rendu compte des excès d'une suprématie parlementaire qui conduisait au régime d'assemblée et que, déjà, avec des hommes tels que Pierre Mendès-France ou Félix Gaillard, on avait commencé à réfléchir à ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire dans lequel le gouvernement a des moyens de contrainte sur le Parlement qu'il n'avait pas jusque là.
L'originalité de la V e République, au départ, c'est que l'on a cumulé deux systèmes. Le premier est une forte tendance présidentielle, le Président de la République étant doté de pouvoirs qu'il exerce. En effet, dans les Républiques précédentes, en tout cas le régime de la III e République, il avait des pouvoirs dans les textes mais il ne les exerçait pas. Il en avait été privé par une dissolution aventureuse, ce qui ne s'est pas produit sous la V e République en cas de dissolution aventureuse... (Sourires.)
Il exerce donc des pouvoirs très importants mais, en même temps, le principe de base du régime parlementaire est respecté du fait que le gouvernement dépend dans sa vie du Parlement qui peut le renverser ; il ne peut pas l'investir puisqu'on a supprimé l'investiture, mais il peut le renverser.
Ce qui définit la V e République, au fond, c'est la concomitance de ces deux légitimités qui, à des degrés diverses, sont l'une et l'autre issues du peuple :
- le Président, qui tire sa légitimité et son autorité du fait qu'il est élu au suffrage universel (mais il est vrai qu'avant de l'être, de Gaulle avait une autorité sans égal et très supérieure à ce que les textes lui reconnaissaient) ;
- le gouvernement, qui dépend du Parlement qui le contrôle et qui peut le renverser, ce qu'il a fait une fois ce n'est pas beaucoup en cinquante ans , et qui dépend donc lui aussi du suffrage populaire.
Il est normal qu'il y ait une concurrence entre le législatif et l'exécutif et elle se voit dans les régimes présidentiels ou autres, mais ce qui fait l'originalité de la V e République, c'est la concurrence de deux légitimités au sein de l'exécutif : la légitimité présidentielle et la légitimité gouvernementale, l'une et l'autre issues plus ou moins directement du suffrage populaire.
Il en est résulté je ne suis pas le seul à être de cet avis une hypertrophie du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif car on a multiplié les contraintes s'exerçant sur le gouvernement. On l'a fait de bon droit à l'époque, soyons honnêtes. Tout le monde était ravi de voir le général de Gaulle porter quasi seul la responsabilité de régler le difficile problème algérien et, finalement, tout le monde s'est accommodé de ces trois à quatre premières années de la V e République dans lesquelles il a exercé une sorte de pouvoir consulaire. En tout cas, le pays s'en est remis à lui et a voté à 80 % les référendums qu'il lui proposait.
Une fois l'affaire algérienne réglée, cela a changé, et ceux qui avaient fait appel à lui se sont dit que le moment était peut-être venu qu'il cède la place puisqu'il avait rempli sa tâche. Il ne l'a pas entendu ainsi je pense d'ailleurs qu'il ne l'avait jamais entendu ainsi , et l'épreuve de force ayant eu lieu fin 1962, loin de céder la place, il a renforcé son pouvoir en décidant que le Président de la République serait élu au suffrage universel par le peuple directement. A partir de là, nous avons eu un système qui a cumulé contre le législatif les conséquences d'une certaine prépotence présidentielle, d'un côté, et les instruments d'un parlementarisme rationalisé, de l'autre, qui conduit à encadrer l'ordre du jour, le contrôle du gouvernement, la possibilité de décider des commissions d'enquête, etc. Je ne vais pas décliner dans le détail tout ce qui est bien connu et ce qui figure dans les propositions que nous avons faites.
Ces propositions résultent très directement de la situation que je viens de décrire. Je considère depuis un certain nombre d'années, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, que notre système politique a pour double caractéristique d'être instable, puisqu'il permet la cohabitation (je sais bien qu'avec le quinquennat, celle-ci sera peut-être moins fréquente, mais elle n'est pas non plus totalement à exclure), et d'introduire une certaine confusion des pouvoirs puisqu'on se pose toujours la question de savoir quel est le pouvoir de chacun, entre le Président et le gouvernement.
Quand la majorité est du côté du Président de la République, personne ne s'interroge, ou très peu : il faut vraiment avoir très mauvais l'esprit pour le faire. En revanche, quand il y a cohabitation, le pouvoir repasse entre les mains du Premier ministre. C'est une Constitution qui n'a pas beaucoup d'exemple dans les pays étrangers. D'où une certaine confusion et une certaine instabilité de la répartition des pouvoirs, mais une grande stabilité du gouvernement quand on a réussi à le constituer.
A partir de là, ce régime étant déséquilibré, pour qu'il dure et je souhaite qu'il dure parce que je considère que, fondamentalement, il a de très grands avantages , il faut lui redonner l'équilibre qu'il a perdu ou qu'il n'a jamais eu, ou remédier à un déséquilibre qui s'est aggravé. Cela passe par le fait de donner ou redonner des droits nouveaux au Parlement.
Je ne vais pas décliner tout ce dont il s'agit.
La réglementation du recours au 49.3 est une sorte de moyen de contrainte exercé sur le Parlement pour faire en sorte qu'une loi existe même si elle n'est pas votée, faute de quoi le Parlement risque sa vie, si j'ose dire, car s'il renverse le gouvernement, il risque la dissolution. C'est l'esprit du 49.3.
Je ne parlerai pas non plus longuement du travail législatif ni du fait que le Parlement devrait avoir au moins la maîtrise de la moitié de son ordre du jour. C'est ce que nous avons prévu et proposé.
Par ailleurs, je pense qu'il faut également redonner au Parlement le droit de voter des résolutions, c'est-à-dire d'exprimer des voeux. Je sais bien que l'on a interdit les résolutions sous la Constitution de la V e République parce que les Républiques antérieures, notamment la IV e , en faisaient un usage immodéré. C'était une façon de mettre en cause la responsabilité du gouvernement sans recourir aux moyens constitutionnels de la motion de censure. On votait une résolution et le Président du Conseil, alarmé aux petites heures du matin par ce vote, allait voir le Président de la République et lui disait : « Dans ces conditions, je crois plus sage de remettre la démission de mon gouvernement ». Voilà, grosso modo, la manière dont cela s'est passé plusieurs fois. D'où le fait de proscrire les résolutions.
Je pense qu'il faut rendre au Parlement le droit de voter des résolutions, notamment en matière européenne. Il faut en effet tirer les conclusions du fait que plus de la moitié de la règle de droit qui s'impose désormais en France est d'origine européenne et que, lorsque le Parlement exerce son contrôle, ce qui n'est pas toujours le cas, il a le choix entre refuser la règle européenne ou l'adapter quasiment sans l'examiner ni la discuter. Il serait donc à mon avis préférable que le Parlement, avant les négociations européennes, soit amené à voter des résolutions dans lesquelles il donnerait son sentiment sur tel ou tel rapport, acte ou projet de directive émanant de Bruxelles afin d'éviter d'être mis ensuite devant le fait accompli.
Voilà une série de dispositions que je souhaitais citer. Je vais très vite parce que je ne veux pas entrer dans des détails trop techniques.
M. Bastien FRANÇOIS, modérateur.-
Si je puis me le permettre, M. le Premier ministre, nous sommes en train d'anticiper sur l'objet de la deuxième table ronde pour laquelle les invités sont déjà arrivés et je vous propose donc de réserver quelques éléments de votre exposé pour nourrir le débat qui va suivre. Nous avons en effet glissé d'un premier à un second débat, emportés par l'intérêt de ces questions d'actualité.
La séance, suspendue à 16 h 30, est reprise à 16 h 40.
DEUXIÈME TABLE RONDE :
QUELLE PLACE POUR LE PARLEMENT DANS LA VIE POLITIQUE ?
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Nous reprenons notre séance, qui va être animée par un nouveau modérateur : M. Garrigues, Président du Comité d'histoire politique et parlementaire.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Cette deuxième table ronde est prospective et s'intéresse à l'actualité la plus brûlante de la réforme des institutions, notamment de ce qui a été l'un des milliers des travaux de la commission Balladur : la question du renforcement du parlementarisme, qui est l'un des axes forts repris ensuite par le projet du gouvernement et dont va nous parler le ministre chargé des relations avec le Parlement, Roger Karoutchi.
M. Roger KAROUTCHI, Secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement.-
Merci, M. le Président. Comme M. le Premier ministre vous a dit probablement l'essentiel, je vais aller directement à l'accessoire.
Ayant été moi-même élu dans cette noble maison pendant quelques années avant d'entrer au gouvernement et ayant été au préalable élu Député européen, j'étais de ceux qui, incontestablement, affirmaient le vrai déséquilibre entre l'exécutif et le législatif depuis des décennies. Gaulliste impénitent, je suis naturellement favorable au maintien, voire au renforcement de la V e République. Pour autant, on ne peut que regarder l'évolution avec un peu d'inquiétude.
En 1963, à peine cinq ans après la mise en place de la V e République, le général de Gaulle demande à s'exprimer devant le Parlement. Jacques Chaban-Delmas, alors Président de l'Assemblée, lui fait savoir que l'on vient d'avoir une révision constitutionnelle, en 1962, pour mettre en place l'élection du Président de la République au suffrage universel et qu'il est compliqué d'avoir une autre réforme. Dans la Revue de droit parlementaire, l'inestimable Président de l'Assemblée dit : « J'ai dit au chef de l'Etat qu'il ne pourrait pas s'exprimer devant l'Assemblée nationale et le résultat, c'est que le général de Gaulle fait plusieurs réunions à l'Elysée avec des Députés ». Cela s'est passé il y a 45 ans. L'expression du Président devant le Parlement est donc un problème ancien.
En 1971, les six Présidents des commissions de l'Assemblée nationale, tous gaullistes, font une motion publiée dans la presse dans laquelle ils disent qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler de la même façon, que le gouvernement leur impose régulièrement l'urgence, qu'ils travaillent mal, qu'ils sont constamment sous la pression de l'exécutif, qu'ils n'ont ni assez de temps, ni assez de pouvoirs de contrôle, ni assez de pouvoir d'interpellation et que, de fait, le Parlement est de plus en plus réduit. Cela s'est passé il y a 37 ans et cela a continué dans les décennies qui ont suivi.
Finalement, pourquoi faire cette réforme si tard si, dès 1963, le général de Gaulle se demande pourquoi il ne peut pas s'exprimer et si, dès 1971, les six Présidents de commission sur six de l'Assemblée nationale disent que cela ne peut pas continuer ainsi ? Parce que, très probablement, au fur et à mesure du temps, l'exécutif, de gauche comme de droite, a considéré que c'était bien pratique.
François Mitterrand, avant 1981 c'était dans son programme présidentiel , dit : « Il faut absolument rééquilibrer et revaloriser le Parlement », mais une fois qu'il est élu Président, il trouve qu'il n'est pas mal du tout d'avoir les pleins pouvoirs de l'exécutif et, finalement, assez peu de pouvoirs pour le Parlement.
Nous sommes donc restés dans cette situation qui a conduit à la situation de ces dernières années, et ce quel que soit le gouvernement : je ne fais pas de politique politicienne. Qu'il s'agisse du gouvernement d'Edouard Balladur, de celui de Lionel Jospin ou des gouvernements qui ont suivi, les parlementaires se sont progressivement sentis, sinon dessaisis, du moins sans influence majeure sur le cours des événements.
Pour être très franc, lorsque j'étais Sénateur, ici, il y a encore un an, je me disais très souvent que ma présence au Sénat n'avait qu'un intérêt assez limité et que, finalement j'avais plus d'influence, plus de poids et plus de responsabilité quand j'étais dans mon bureau de Président de groupe d'opposition au Conseil régional d'Ile-de-France qu'en étant au Sénat, parce que, au moins, le conseiller régional que j'étais pouvait influencer la décision et avoir un impact sur des affaires concrètes alors qu'ici ou à l'Assemblée, quand on est dans la majorité, on a le sentiment qu'il faut lever la main pour voter les textes du gouvernement et, quand on est dans l'opposition, c'est « cause toujours, tu m'intéresses, il y a peu de chances que tu aies une influence sur ce que nous disons ! »
Dans le projet présidentiel du candidat Nicolas Sarkozy, il y avait, après plusieurs conventions sur les institutions, un projet de rééquilibrage des pouvoirs et de revalorisation du Parlement. Je dois dire d'ailleurs que, non pas tout à fait dans les mêmes conditions mais dans la même orientation, dans le projet de campagne présidentielle de Ségolène Royal, nous avions également des éléments sur la manière de rééquilibrer les pouvoirs.
Le Président de la République, une fois élu, a confié au Premier ministre Edouard Balladur le soin de préparer cette réflexion avec un comité et les conclusions ont été proposées à l'automne dernier. Le gouvernement a alors travaillé et, sans entrer dans les détails, j'estime que 80 % des propositions du comité présidé par Edouard Balladur ont été reprises dans le projet.
Quel est ce projet ? Comme le thème est aujourd'hui celui du Parlement, je ne vais pas évoquer les points qui concernent le Conseil supérieur de la magistrature ou la défense des citoyens, préférant rester sur le Parlement. Il s'agit de dire que le gouvernement a les armes nécessaires pour imposer finalement sa vision des choses au Parlement. Il dispose d'une batterie d'articles. L'article 40, par exemple, empêche le Parlement d'imposer au gouvernement des dépenses supplémentaires ; il en est de même pour la procédure sur le vote bloqué : le gouvernement, après avoir constaté le dépôt de 32 000 amendements pour un texte de loi sur la Poste, peut décider le vote bloqué. Nous avons également l'article 49.3, qui permet à un moment ou à un autre au gouvernement d'arrêter le débat et de dire que, sauf si l'opposition dépose une motion de censure, le texte est réputé adopté sans vote.
Le gouvernement a donc des armes. Il en a une autre non négligeable : si vous travaillez en commission sur un texte, c'est quand même le texte du gouvernement qui arrive dans l'hémicycle.
Il a enfin une arme majeure que je connais bien : la maîtrise de l'ordre du jour. J'arrive le mardi matin à la conférence des Présidents de l'Assemblée, Bernard Accoyer ou Christian Poncelet me dit : « Bonjour, M. le Ministre, le Parlement souhaiterait ceci ou cela » et je réponds : « Vous avez parfaitement raison. Maintenant, je vous donne votre ordre du jour : demain, vous ferez ceci, mercredi, vous ferez cela, lundi prochain, vous ferez ceci et cela. J'ai bien entendu que vous souhaitez que j'inscrive telle ou telle proposition, mais je n'ai ni le temps, ni le calendrier, on verra plus tard ! »
En réalité, le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour et a les moyens d'imposer sa vision. Cependant, il n'a pas la possibilité de tout imposer. Il y a, bien sûr, un travail parlementaire d'amendements sur chacun des textes de loi et le gouvernement peut parfaitement être battu, quelle que soit sa majorité, parce que, contrairement à ce qu'on dit parfois on l'a vu encore récemment , la majorité n'est pas en rangs serrés, « soldats, avançons ! ». Cela peut être aussi des débats internes ou des choses plus compliquées.
Finalement, ce texte de révision constitutionnelle a plusieurs conséquences pour le Parlement.
La première, c'est le partage de l'ordre du jour. Si la révision est votée, le ministre en relation avec le Parlement ne disposera plus que de la moitié de l'ordre du jour, sauf pendant la phase budgétaire, car on est obligé de faire le budget pendant l'automne. Cela veut dire que le Parlement en récupère la moitié. Ce sera à lui de voir s'il fait du contrôle de l'action du gouvernement pendant un moment ou s'il prend des initiatives législatives le reste du temps. C'est sa partie et il s'agit d'un vrai partage. Cela veut dire que l'on va forcer le gouvernement, ce qui n'est pas plus mal, à négocier réellement avec les groupes politique et le Parlement pour savoir ce que l'on inscrit ou non à l'ordre du jour.
Le deuxième élément non négligeable, c'est que le texte qui arrivera en débat dans l'hémicycle sera celui qui sortira de la commission. La commission thématique concernée débattra d'un texte de loi en l'amendant autant qu'elle le veut, et le texte qui sera débattu sera le texte amendé par la commission et non pas, comme aujourd'hui, celui du gouvernement, avec une commission tenue de convaincre la majorité de voter ses amendements. Cela signifie que les ministres concernés par des projets de loi devront venir en commission défendre leur texte, y compris par rapport aux amendements et, ensuite, dans la séance plénière, revenir sur le texte, s'il a été amendé, pour convaincre la majorité de remodifier un texte qui aurait été amendé.
Je prédis du bonheur au ministre qui va le faire parce que, si la commission a voté des amendements qu'elle a intégrés au texte, comme, en commission, la majorité est normalement majoritaire, cela veut dire que, pour y revenir dans l'hémicycle, il faudra que le ministre arrive à convaincre sa majorité de déjuger les commissaires majoritaires qui, en commission, auraient accepté des amendements. Là-dessus, le rééquilibrage va être sérieux et c'est vraiment un élément extrêmement important.
D'autres points qui font partie de la révision constitutionnelle vont permettre l'expression du Parlement. C'est le cas du pouvoir de résolution. L'Assemblée nationale et le Sénat pourront voter des résolutions sur un certain nombre de sujets qui ne seront ni des projets de lois, ni des propositions de loi mais qui concerneront les sujets décidés par les Députés ou les Sénateurs.
De la même manière, la révision renforce considérablement les pouvoirs de l'Assemblée et du Sénat en matière de défense et de politique étrangère. Jusqu'ici, dans ces deux domaines, les pouvoirs du Parlement étaient extrêmement faibles, pour ne pas dire inexistants, à part sur la transposition des directives européennes avec les deux délégations à l'Union européenne. Nous allons donc retrouver un vrai contrôle parlementaire avec la possibilité de contrôler et de voter, le cas échéant, le maintien de troupes à l'étranger plus de six mois.
De même, il est prévu l'encadrement de l'article 16 et une réduction de la possibilité d'utiliser le 49.3 : il serait maintenu sur le budget, mais, pour le reste, il ne pourrait être appliqué qu'une seule fois par session. Là encore, ce système va nous permettre d'avoir un vrai équilibre et de réduire les armes du gouvernement.
On va également ouvrir un certain nombre de possibilités d'interpellation. Le contrôle du Parlement va être essentiel, premièrement parce que la Constitution, pour la première fois, ne va pas parler que du pouvoir législatif mais du pouvoir de contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement ; deuxièmement parce que, en lien avec la Cour des comptes et avec la capacité de faire appel à des moyens extérieurs, on va donner au Parlement beaucoup de moyens de contrôle et d'interpellation par rapport à l'action du gouvernement.
Enfin, naturellement, le fait que, dans l'ordre du jour, le Parlement puisse décider de réserver telle ou telle séance au contrôle de l'activité du gouvernement ou de telle ou telle action ministérielle va mettre l'ensemble du gouvernement dans la ligne de mire du contrôle parlementaire.
Voilà un certain nombre de mesures, parmi d'autres, qui vont renforcer considérablement les pouvoirs du Parlement. Je sais bien que, dans le débat sur les futures lois organiques ou ordinaires, un certain nombre de groupes disent qu'ils veulent parler de la dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale et d'un mode de scrutin différent pour le Sénat. Par exemple, le groupe socialiste de l'Assemblée dépose deux propositions de loi la semaine prochaine sur un certain nombre de thèmes de ce genre. Dans l'immédiat, ce n'est pas dans la Constitution. Il est prévu une petite modification sur le Sénat, mais, naturellement, le type de scrutin n'a jamais été dans la Constitution depuis 1958. Il s'agit donc plus d'un débat sur les lois qui suivent que sur la Constitution.
En tout cas, sur le renforcement des pouvoirs du Parlement, c'est incontestablement une nouvelle page qui s'écrit, quel que soit le sort de la révision, parce que, à mon avis, nous sommes arrivés au bout non pas d'un système politique -la V e République étant loin d'être terminée- mais d'un système de relations entre le gouvernement et le Parlement.
Chacun comprend bien que les parlementaires représentants de la nation ne peuvent plus aujourd'hui, ni individuellement, ni collectivement, accepter le système qui consiste à réduire à la fois leur rapport, leur influence et leur impact. On nous demande sans arrêt pourquoi il y a tant d'absentéisme, pourquoi les parlementaires ne sont pas plus présents ou pourquoi la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a voté un texte par 4 voix contre 3 alors que, normalement, elle comprend 74 Députés. Il est évident que le public se demande ce qu'ils font.
Au-delà du fait que, malheureusement, la surcharge de travail fait qu'ils sont plus présents en commission que dans l'hémicycle, on peut répondre qu'il y a incontestablement une utilité politique et une unité publique et que les parlementaires veulent être plus respectés. Je pense que cette révision va dans ce sens.
Voilà, M. le Président, ce que je souhaitais vous dire.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Merci, M. le Ministre, de nous avoir éclairés, d'avoir repéré les enjeux de la révision en cours et d'avoir également replacé cette révision dans une perspective historique.
Avant de donner la parole aux Constitutionnalistes, j'aimerais que Jean-François Kahn, qui est à la fois historien, journaliste et philosophe de l'histoire, nous dise comment il voit cet effort d'adaptation de la V e République à l'évolution de la société française d'aujourd'hui et, singulièrement, le rôle du parlementarisme dans cet effort d'adaptation.
M. Jean-François KAHN, journaliste.-
Je ne rentrerai pas dans le débat sur la réforme parce que, comme l'a dit très bien le Premier ministre, on ne sait pas encore aujourd'hui ce qui sera retenu ou non, sachant que tout ce qui va dans le sens du renforcement des pouvoirs du Parlement va évidemment dans le bon sens. Je ne sais pas qui a dit qu'une idée n'est intéressante que si l'idée contraire peut être soutenue. En l'occurrence, c'est une idée intéressante, mais l'idée contraire peut difficilement être soutenue.
D'un point de vue historique, je voudrais faire entendre une musique qui correspond à mon opinion mais que l'on entend rarement : je suis parlementariste. Je sais bien que je suis très minoritaire et que je n'ai aucune chance de convaincre ni d'avoir la moindre influence sur l'évolution des choses, mais je suis partisan d'un régime parlementaire et je souhaite simplement faire quelques remarques de bon sens dont j'espère qu'elle finiront par bousculer un jour le conformisme ambiant dont vous avez parlé, M. le Premier ministre. En effet, dans ce domaine, on constate qu'en France, il règne un grand conformisme depuis quelques décennies. Il faut vraiment le vouloir pour défendre le système parlementaire.
-- Ma première remarque, c'est que la France a un système institutionnel qui est, en Europe, une exception absolue. Hier, il s'est passé un événement considérable en Ukraine : le Premier ministre a empêché le Président de la République de parler à la tribune de l'Assemblée, ce qui est une chose extraordinaire pour nous. Nous avons donc un système unique en Europe.
Seules y ressemblent la Constitution et les institutions de la Russie de Poutine, ce qui n'est plus tout à fait le cas d'ailleurs puisque, Poutine devenant Premier ministre, il y a de fortes chances que le Premier ministre prenne l'ascendant. Cette exception, d'autant plus que la Russie n'est pas en Europe, risque donc de sauter.
-- Autre paradoxe : alors qu'on nous explique qu'il faut absolument appliquer les résolutions européennes concernant le fromage au lait cru ou que l'on ne peut pas baisser le taux de TVA en fonction d'un certain nombre de réglementations européennes, l'idée que nous pourrions peut-être essayer de rapprocher nos institutions, qui sont uniques, de ce qui se passe partout en Europe n'est même pas évoquée. Il est possible que, si nos institutions se rapprochaient des institutions européennes, cela favoriserait l'intégration communautaire. Il est en effet très difficile de défendre un progrès d'intégration tout en s'accrochant à une absolue unicité ou exception.
Par ailleurs, si, en termes darwiniens vous savez que ce qui est retenu par la sélection est ce qui présente un avantage en fonction de l'environnement , nos institutions présentaient un avantage compte tenu de l'environnement, la sélection l'aurait retenu peu à peu et les pays européens auraient donc adopté le système. Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi aucun pays européen n'a adopté nos institutions : même lorsque de nouveaux pays européens ont obtenu l'autonomie et l'indépendance, par exemple en sortant du bloc soviétique, leur tendance a été d'adopter un régime parlementaire premier ministrable. C'est une question que l'on a le droit de se poser.
J'en viens à ma deuxième remarque. On nous explique depuis des décennies que les institutions de la V e République ont permis notre renouveau et nous ont donné une force considérable compte tenu de l'instabilité ministérielle, que, grâce à notre système, nous avons la stabilité, la force gouvernementale et la force de l'action et que nous pouvons bien sûr faire des réformes mais que nous ne pouvons pas renoncer à ce qui est au coeur du système parce que cela nous a donné une telle supériorité que ce serait absurde, surtout par rapport aux autres pays qui ont, eux, gardé un régime parlementaire dont on nous dit qu'il est effroyable et qu'il débouche sur l'instabilité totale, l'inaction et le reste.
Je constate que ceux qui tiennent ce propos, lui-même totalement honorable et respectable, sont souvent ce qu'on a appelé des « déclinistes » je pense à Nicolas Baverez et à d'autres qui nous expliquent en plus que la France va de mal en pis, qu'elle a pris du retard sur tous les autres pays et que les autres ont fait des réformes et non pas nous. Ils nous expliquent que nous avons des institutions qui nous rendent meilleurs, plus actifs, plus performants et plus stables et, après l'avoir dit, ils ajoutent que les autres font mieux que nous et que nous avons pris du retard. Je ne comprends pas.
Peut-être n'est-ce pas si simple et peut-être en effet un certain nombre de pays ont-ils pu aller très loin dans les réformes, la modernisation et l'adaptation avec un système parlementaire tout en assurant la stabilité de leur pays. Je précise entre parenthèses que l'Angleterre a un système totalement parlementaire et que le même parti a gouverné pendant trois législatures. Nous avons beaucoup d'exemples de partis ou de Premiers ministres qui restent au pourvoir très longtemps avec un système parlementaire.
-- Troisième remarque : j'ai travaillé personnellement, et j'ai même publié un livre, sur les grands débats de la République et sur ceux de la période de Louis-Philippe, qui sont extraordinaires d'un point de vue littéraire parce que la beauté et la force de certaines interventions sont absolument fascinantes.
Je pense par exemple au débat sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il faut se remettre dans la situation de l'époque : c'est une chose qui touche à l'essentiel, qui choque des convictions profondes, religieuses et morales. Ce débat est formidable : il est long, on va jusqu'au bout, tout le monde peut intervenir, il est d'une profondeur et d'une intelligence inouïe, mais il est en même temps très violent. Or, finalement, il y a peu d'agitation dans la rue. Il y en aura lorsque l'on voudra confisquer les biens de certains couvents, mais au départ, il y a très peu de manifestations et de violence. Je me demande donc si cette violence organisée et talentueuse n'a pas épongé quelque part la violence de la rue, si elle ne servait pas de buvard, en la symbolisant, à la violence intrinsèque qui aurait pu éclater sans cela dans la société.
Il est vrai que cela s'est passé lentement et que l'on n'en est plus conscient, mais, à l'époque, le Parlement était vraiment pluraliste. M. le Premier ministre a eu cette phrase qui a l'air banale mais qui est profonde et réelle : « La démocratie, c'est d'abord l'existence d'un Parlement élu et pluraliste ». Autrement dit, le Parlement pluraliste et élu doit être au coeur de la démocratie. Quand il bat, c'est que la démocratie est vivante. S'il ne bat plus, la démocratie est en état de semi-coma.
Il faut voir ce qu'était le Parlement sous la IV e République je suis à un âge qui me permet de l'avoir connu. Son coeur battait en même temps que la passion des gens et des lecteurs des journaux, qui prenaient des places pour aller voir les débats parlementaires, qui s'y reconnaissaient et qui lisaient les interventions de leur camp parce que c'était une façon pour eux-mêmes d'intervenir. Aujourd'hui, où sont les débats parlementaires dans les journaux ? Ils n'existent pas ! Il n'y en a plus ! On ne trouve que quelques lignes. Certes, on a des chaînes spéciales le fait qu'elles soient spéciales est déjà un problème pour retransmettre les débats parlementaires, mais si, dans les journaux de 20 heures, vous avez une heure trente sur un grand débat, c'est le maximum.
Sur l'intervention en Afghanistan, qui était un problème de fond, il y a eu trois heures de débat sans vote. Je vous renvoie au débat sur la réforme constitutionnelle de 1851 (qui débouche d'ailleurs, parce qu'il va rater, au coup d'Etat de Napoléon III) au cours duquel, dans un discours très célèbre, Victor Hugo évoque pour la première fois les Etats-Unis d'Europe et dans lequel il oppose Napoléon le petit à Napoléon le grand. Tout d'abord, le discours de Victor Hugo dure six heures de suite, même s'il est haché et interrompu ; ensuite, quand on lit les journaux de l'époque, on constate que cela a provoqué dans le pays autant d'émotion et de passion que les feuilletons d'Eugène Sue, dont on disait qu'il ne fallait pas arrêter leur auteur parce que, si le feuilleton s'arrêtait, il y aurait une émeute. Du même coup, il n'y a pas eu de bagarres de rue ni de troubles autour de ce problème fondamental parce que le débat avait lieu au Parlement.
Aujourd'hui, qui s'investit dans les débats du Parlement ? On a suffisamment dit qu'en Mai 68, les manifestants sont passés devant le Parlement sans avoir même l'idée d'y jeter une pierre. C'est la troisième remarque que je voulais faire.
Ma dernière remarque ira dans le même sens. Finalement, on s'obnubile de façon exclusive, ce qui est toujours un tort, sur le fait que la République parlementaire a débouché sur la défaite de 1940, et on juge tout en fonction de cet exemple qu'on nous donne et qu'on nous répète à l'envi. Tout d'abord, l'Angleterre a gagné la guerre de 1940 avec un régime parlementaire qui n'a absolument pas été remis en cause. Il y avait des débats : on interpellait le gouvernement, il pouvait y avoir une motion de censure, il y avait une liberté totale de débat et c'est dans ce climat que les Anglais ont gagné la guerre de 1940.
Ensuite, c'est le premier régime bonapartisme, celui de Napoléon Ier, qui a laissé la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée, et c'est surtout le deuxième régime bonapartiste, celui de Napoléon III, qui s'est fracassé sur le désastre de Sedan alors que l'une des rares grandes guerres que nous ayons gagnée, celle de 1914, est due à un régime totalement parlementaire. Il est extraordinaire de voir à quel point le Parlement est intervenu, en dehors des séances à huis clos parce qu'il ne fallait pas que l'ennemi soit au courant des renseignements que l'on pouvait donner. Personne ne dit d'ailleurs aujourd'hui que, pendant la Première guerre mondiale, le régime était faible et caractérisé par son instabilité, bien qu'il y ait eu beaucoup de changements de gouvernement, de crises, de motions de censure et de chutes de Présidents du Conseil. C'est ce qui a permis à Clemenceau d'arriver au pouvoir à la fin.
J'ajoute que nous avons eu un jour en France un régime tellement fort et tellement efficace, même s'il l'a fait avec des moyens que je réprouve, qu'il est parvenu à repousser cinq interventions étrangères : le régime de la Convention nationale, qui est le plus parlementaire que nous ayons jamais eu en France.
Il faut évidemment se pencher sur les raisons de la chute de la République en 1940, mais il ne faut pas s'obnubiler là-dessus. Nous avons suffisamment d'exemples, à la fois dans notre histoire et autour de nous, de régimes parlementaires équilibrés, évidemment avec des scrutins permettant de garantir le pluralisme et d'avoir une majorité et des garde-fous, ce qui n'est pas contradictoire, dont le bilan et l'efficacité dans l'épreuve se sont avérés aussi importants et aussi évidents, sinon plus, que nos institutions actuelles.
Pour conclure, j'affirme que, dans la mesure où notre Parlement, lors de débats nationaux, est effacé au profit de la rue et où nous avons beaucoup de rues et un chouia de gouvernement, il ne me dérangerait pas que nous ayons aujourd'hui beaucoup de Parlement et un chouia de rue !
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je me permettrai d'apporter quelques réflexions rapides sur l'exposé que vient de faire M. Jean-François Kahn.
Nous nous sommes posé la question du parlementarisme au sein du comité. Un certain nombre d'entre nous étaient plutôt portés vers ce que l'on appelle maintenant je l'ai appris à cette occasion un régime primo ministériel alors que d'autres, dont moi-même, étaient pour un régime présidentiel. Je vais vous dire pourquoi, de mon point de vue, le retour au régime parlementaire est très difficile en France, même s'il aurait l'avantage de rejoindre une sorte de droit commun européen puisque c'est pratiquement le régime de tous les pays européens.
Tout d'abord, l'élection du Président de la République au suffrage universel le rend quasiment impossible. Certes, d'autres pays d'Europe connaissent un régime parlementaire et en même temps l'élection du Président au suffrage universel (c'est le cas de la Pologne, du Portugal, de la Finlande et de l'Irlande), mais imaginez que nous ayons eu l'an dernier le débat sur l'élection présidentielle et les programmes affichés au deuxième tour par les deux candidats qui restaient en lisse et que l'un ou l'autre de ces candidats une fois élu l'une ou l'autre dise : « ce n'est plus mon affaire, adressez-vous au gouvernement ou au Parlement pour déterminer la politique qu'il faut mener ». Ce serait proprement inconcevable compte tenu de ce qu'est devenu en France l'élection présidentielle.
Sinon, il faut supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel, mais je n'ai encore entendu personne le proposer, sauf Michel Rocard dans un débat que j'ai eu avec lui récemment au Figaro. J'ai d'ailleurs salué son courage.
Ensuite, Jean-François Kahn dit que, si nous adoptions le régime parlementaire, cela rendrait peut-être plus facile l'intégration européenne et communautaire car nous aurions tous des régimes parlementaires. J'observe que l'exemple le plus parfait de régime parlementaire est le Royaume-Uni et que ce n'est pas un modèle d'adhésion spontanée et facile aux dispositions communautaires. Il me semble donc que l'argument n'est pas très frappant.
Maintenant, pourquoi aucun pays européen n'a-t-il adopté nos institutions si elles sont tellement bonnes ? Parce que chacun a son expérience historique. En tant que Français, nous sommes marqués par l'instabilité que nous avons connue depuis deux siècles, nous avons le sentiment d'avoir enfin trouvé un minimum de stabilité et nous nous disons c'est, au fond, la réaction de tous ceux qui s'opposent à la réforme proposée en ce moment que nous devons préserver cet acquis extrêmement précieux et qu'il faut y rester fidèle sans le modifier pratiquement en rien.
C'est notre expérience historique. D'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont fait l'expérience de régimes autoritaires contre lesquels ils ont réagi et ils ne veulent surtout pas donner une forme trop contraignante à l'autorité exécutive. D'autres, comme la Grande-Bretagne, n'ont pas ce complexe historique et considèrent que leur régime a été bâti dans une évolution finalement assez heureuse et assez continue.
Donc, ne négligeons pas les spécificités nationales. C'est l'observation que je souhaite faire. Nous avons une histoire française qui est ce qu'elle est, avec ses bons côtés et ses côtés plus difficiles, et la V e République, d'une certaine manière, en inventant ce mix, comme le diraient les économistes, entre parlementarisme et présidentialisme a inventé une chose qu'à tort ou à raison, beaucoup considèrent comme étant mieux adaptée à nos besoins.
En revanche, je suis tout à fait de l'avis de Jean-François Kahn : il n'y a rien de plus étrange que de dire que, si nous avons perdu la guerre en 1940, c'est parce qu'il y avait un régime parlementaire. Il a raison de relever que nous avons gagné pas tout seuls, quand même celle de 1914-1918 avec un régime parlementaire et que nous avons perdu un certain nombre d'autres guerres avec des régimes autoritaires.
Cela étant, je n'aurai pas la tentation de qualifier la Convention de régime parlementaire. C'était le propre même d'une tyrannie exercée par un petit groupe, la commune de Paris, sur le Parlement qui tremblait dès que les sectionnaires envahissaient la salle du Jeu de Paume pour faire pression sur la Convention, mais c'est un problème historique que nous pouvons laisser de côté.
Maintenant, l'objection qu'avance Jean-François Kahn et à laquelle il faut réfléchir est la suivante : si c'est un régime tellement efficace, d'où vient que nous soyons en retard sur les autres pays européens dans nos réformes ? C'est une question importante et une vraie objection. Je ne voudrais pas vous paraître iconoclaste, mais on peut se demander si l'élection du Président de la République au suffrage universel est le système qui favorise le mieux la réforme. On peut s'interroger et se demander si, dans un système dont le pouvoir dépendrait plus directement du Parlement, les choses ne seraient pas plus simples.
De toute façon, ce n'est pas le mode de sélection du pouvoir qui est une garantie d'efficacité mais la personne que l'on sélectionne. Le suffrage universel peut sélectionner des hommes ou des femmes courageux et capables ou non, de même que le système parlementaire. Par conséquent, n'accordons pas trop d'importance au lien entre l'efficacité gouvernementale et réformatrice, d'une part, et le monde de sélection des gouvernants, d'autre part.
Ma réflexion globale est la suivante : la France est la France, elle a eu une expérience, elle en demeure marquée et elle cherche la réforme en tâtonnant parfois nous en sommes actuellement à une phase de tâtonnement , mais, si la réforme que nous proposons est l'objet de critiques au nom de l'intangibilité de principes vieux maintenant d'un demi-siècle, je ne propose pas du tout que l'on fasse litière de ces principes ; je dis simplement qu'ils doivent être adaptés.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Merci, M. le Premier ministre, de cet échange d'arguments avec un ardent parlementariste, ce qui va droit au coeur des membres du Comité d'histoire parlementaire et politique que je dirige et des historiens du Parlement que nous sommes.
Puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous Mme la Sénatrice Nicole Borvo Cohen-Seat, qui représente le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, je me permettrai de revenir sur une petite polémique qui a été lancée en lui disant que nous avons demandé à plusieurs représentants du Parti communiste de participer à ce colloque et que, malheureusement, ils n'ont pas pu en faire partie. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir et d'avoir son opinion sur les réformes annoncées ces derniers jours.
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, Sénatrice de Paris.-
Je vais revenir moi-même sur la polémique. Je suis effectivement sénatrice communiste et Présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, et je tiens à dire que je suis la seule femme Présidente d'un groupe parlementaire à ce jour, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat et même au Parlement européen (pour les Français).
En fait, la polémique est double. En effet, je ne savais pas que des collègues de mon groupe ou du groupe de l'Assemblée nationale avaient été invités à ce colloque et qu'ils n'avaient pas pu y participer. En même temps, en tant que membre de l'Observatoire de la parité, je me suis associée à la critique faite par la Présidente de cet Observatoire, Mme Marie-Jo Zimmermann -qui n'est pas de ma sensibilité politique- qui a constaté que, pour parler du Parlement et des institutions, il y avait dix-neuf hommes sur dix-neuf intervenants. Etant moi-même à la fois membre d'un groupe minoritaire, le groupe communiste, et une femme Présidente de groupe, j'ai décidé de m'inviter. Je me suis donc invitée, et je sais gré aux organisateurs de m'avoir dit qu'ils avaient sollicité des communistes...
M. Jean GARRIGUES.-
...et beaucoup de femmes.
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT.-
Peut-être, mais vous ne m'avez pas sollicitée. Puisqu'il s'agissait du Parlement, il aurait pu apparaître à quelqu'un qu'un groupe, même s'il est petit puisqu'il ne comprend que vingt-trois membres, était présidé par une femme et qu'il était intéressant de se demander pourquoi il n'y en avait qu'une. J'en suis très heureuse, mais je ne m'en glorifie pas et je regrette qu'il n'y en ait pas d'autres.
Cela dit, il y a quand même des femmes élues, des femmes qui ont été ou qui sont parlementaires ou ministres, même s'il n'y en a pas assez.
Cela m'amène à une réflexion plus intéressante que cette petite polémique qui est néanmoins significative : puisque le thème de cette table ronde est le Parlement et la politique, quels sont les problèmes ? J'en citerai un qui est pour moi très important : la représentativité du Parlement. Quand je constate que, pour nos concitoyens, les personnes politiques dont ils ne voient pas bien l'utilité sont en premier lieu les parlementaires et quand je constate qu'ils se sentent aux deux tiers mal représentés, je commence par m'interroger sur la représentativité du Parlement avant de le faire sur l'organisation des pouvoirs.
Comme vous le savez sans doute, mais comme il vaut toujours la peine de le rappeler, les parlementaires, Sénateurs comme Députés, ont une moyenne d'âge de 60 ans, ils comptent moins de 18 % de femmes (malgré l'acquis d'une longue bataille pour la parité qui est beaucoup trop partielle même si elle est inscrite dans nos textes fondamentaux), et 1 % d'ouvriers et il n'y a pas de représentation de la diversité des origines. On constate donc une surreprésentation des hommes, des cadres supérieurs, des professions libérales et des personnes « mûres », pour le dire ainsi, ce qui n'est pas très représentatif des citoyens.
Ce problème est à mon avis absolument fondamental. En effet, je suis moi-même parlementariste et ce n'est pas un gros mot, parce que je considère, à condition bien entendu que le peuple soit bien représenté, que c'est le peuple qui est au coeur de la démocratie. Il est donc mieux représenté, dans sa pluralité et sa diversité, puisque personne ne parle d'en revenir à l'agora, par une pluralité de personnes que par un seul ou un petit nombre. Mon penchant pour le parlementarisme vient surtout de là.
Cela implique beaucoup de changements nécessaires et, franchement, je ne crois pas que la petite dose de droits supplémentaires du Parlement que le projet constitutionnel actuel serait supposé nous donner va changer fondamentalement les choses, loin s'en faut.
Quand on parle de représentativité, cela implique évidemment les modes de scrutin c'est indiscutable et personne ne me contredira là-dessus et donc le passage à la proportionnelle, qui est la seule garantie de la parité, comme l'expérience l'a montré, et d'une meilleure représentation du peuple lui-même. Le mode de scrutin me paraît une question de première importance et, même s'il ne relève pas de la Constitution, il est clair que, dans le débat sur des changements qui pourraient rééquilibrer le pouvoir, cette question est absolument centrale.
Il en est de même pour les pouvoirs réels accordés au Parlement. Aujourd'hui, il en a très peu, et la question de l'utilité des parlementaires, pour la population et les citoyens qui les élisent, est donc légitimement posée. Le Parlement a perdu tout pouvoir budgétaire, il a perdu le pouvoir concernant la défense et il a perdu le pouvoir sur le plan européen.
La question est donc de donner plus de pouvoirs aux citoyens. J'avais trouvé intéressant que, dans les 77 propositions du comité de M. Balladur, on évoquât quelques possibilités d'initiative citoyenne à l'égard du Parlement, mais elles ont curieusement disparu du projet.
Globalement, il nous est simplement proposé dans le projet actuel que le Parlement donne des avis et qu'il y ait un partage de l'ordre du jour. A ce sujet, j'ai fait un calcul qui montre que nous aurions neuf jours d'initiative parlementaire, alors que c'est à peu près ce qui se passe dans la pratique à l'heure actuelle avec les niches parlementaires. Vous voyez donc que le changement est minime.
Quant aux avis, nous savons bien qu'ils ne donnent pas de pouvoir, puisque nous en donnons assez régulièrement et qu'ils n'ont pas d'effet impératif. Sur la politique européenne, les affaires étrangères ou la défense, nous ne donnons que des avis.
Pour moi, la question est donc de redonner réellement la primauté au Parlement comme représentant des citoyens. Bien sûr, cela pose le problème de l'élection du Président de la République au suffrage universel. Je vous rappelle que, de façon constante, nous nous sommes opposés à la Constitution de 1958 et aux modifications qui ont eu lieu depuis et qui ont toutes été dans le sens d'un présidentialisme de plus en plus affirmé et d'un Parlement de plus en plus diminué. Il y a une certaine logique à notre position.
J'en viens à cette fameuse originalité française. On a en effet tendance à dire que, dans d'autres pays, il peut y avoir des Présidents de la République élus au suffrage universel qui n'ont que peu de pouvoirs et qu'en France, notre penchant bonapartiste nous empêche de considérer qu'un Président de la République élu au suffrage universel ne puisse avoir de pouvoir. Ce penchant bonapartiste me paraît justement tout à fait dommageable et regrettable. Peut-être cela demande-t-il du courage, mais le fait de poser la question de l'élection du Président de la République au suffrage universel ne me paraît pas totalement incongru.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Je vous remercie, Mme la Sénatrice, d'avoir mis l'accent sur un enjeu crucial de la réflexion sur toute réforme et tout renforcement du Parlement : celui de la représentativité. Cette question est revenue plusieurs fois dans les débats ce matin et cet après-midi et elle est sans aucun doute majeure.
Je voudrais donc demander aux juristes, Jean Gicquel et Guy Carcassonne, si, à travers les réflexions et les propositions du comité Balladur et ce qui semble en ressortir dans les projets gouvernementaux, il leur paraît que cette question centrale de la représentation est suffisamment évoquée. Je leur demande aussi de nous donner leur sentiment plus général sur l'ensemble de ces réformes. Nous commencerons par Jean Gicquel, si vous le voulez bien.
M. Jean GICQUEL, Professeur émérite à l'Université de Paris I.-
Merci, M. le modérateur. Evoquer le Parlement et la vie politique m'amène tout naturellement, puisque nous sommes en fin de parcours, à me livrer à une mise en perspective avant d'émettre un jugement de valeur sur le projet de révision actuellement soumis au Parlement.
« Le Parlement, c'est le destin de la démocratie ». Comment ne pas saluer ici l'affirmation de Kelsen tant l'identification est parfaite entre Parlement et démocratie ? Cela me fait songer à cette péroraison célèbre de Paul Reynaud, le 4 octobre 1962, au moment où l'Assemblée nationale débat sur le futur référendum tendant à faire élire le Président de la République au suffrage universel. Paul Reynaud, le parlementaire type, s'adressant au Premier ministre, lui a alors déclaré : « Pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs. Aussi, M. le Premier ministre, allez dire à l'Elysée que cette assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République ! »
Ces propos ont été tenus en 1962 et ils montrent bien que, dans l'esprit commun, le Parlement exprime la liberté politique, qui, lorsqu'on y réfléchit, est la première des libertés car c'est celle par laquelle les gouvernés choisissent leurs gouvernants.
Dans cet ordre d'idées, le Parlement occupe une place particulière et singulière dans notre pays en ce sens qu'il est indispensable et irremplaçable parce qu'il est, comme on le dit, la nation assemblée, mais également à la croisée de la politique et du droit. Dire que le Parlement est la nation assemblée ce thème a été longuement abordé aujourd'hui , c'est rappeler qu'il a pour mission de représenter la nation. Les différents préopinants ont montré que, de ce point de vue, il existait un certain nombre de manques que je n'ai pas besoin de rappeler.
Il convient aussi d'indiquer que le Parlement a pour mission de mettre en place le gouvernement de la nation. Quelle est en effet sa fonction première ? Comme mon vieil ami Pierre Avril le rappelait récemment dans sa préface à la thèse d'Armel Le Divellec, historiquement et politiquement, le rôle du Parlement est de former le gouvernement. Bien entendu, c'est simpliste lorsqu'on est dans un régime parlementaire strict sur le modèle anglais ou allemand, mais cette évidence s'impose également à la France, en régime présidentialiste.
M. le Premier ministre, vous avez écrit que l'élection présidentielle était l'élection reine et je partage tout à fait votre analyse. Cependant, être élu Président de la République, c'est bien, mais c'est insuffisant. Que faut-il donc au Président pour être le gouvernant suprême ? Disposer à l'Assemblée nationale d'une majorité qui lui soit acquise et qui n'ait d'autre ambition que de concrétiser son projet.
C'est pourquoi, en France, les élections législatives sont toujours dramatisées, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'il s'agit à chaque fois de se demander si la majorité des Députés va oeuvrer avec le Président ou s'opposer à lui.
De ce point de vue, la place du Parlement est indispensable ; de même que, par la suite, on ne peut pas imaginer un gouvernement qui ne soit pas représentatif de la majorité existant à l'Assemblée nationale. Effectivement, le Président de la République peut nommer qui bon lui semble ; mais, bien entendu, les Députés pourraient parfaitement refuser de collaborer avec un gouvernement ne représentant pas la majorité en déposant une motion de censure. De ce point de vue, il n'y a aucune difficulté.
Le Parlement est également à la croisée de la politique et du droit. C'est le lieu privilégié. Qu'est-ce que la politique ? Qu'est-ce que le droit ? Une union, car le droit est une politique qui a réussi. De ce point de vue, il faut souligner la qualité supérieure avec laquelle le Parlement fabrique le droit. Son mode opératoire, à savoir la délibération, est intrinsèquement supérieur à tout autre mode d'élaboration. En effet, la procédure législative est une procédure publique, contradictoire et répétitive c'est le sens du bicamérisme , alors que l'on sait que la procédure suivie par le pouvoir exécutif est secrète.
Je prendrai, à cet égard, un exemple qui me paraît tout à fait représentatif. Lorsque, en 1995, le Premier ministre, Alain Juppé, a utilisé l'article 49.3 devant l'Assemblée nationale, il l'a fait à la surprise des Députés de l'opposition : « Nous ne savions pas qu'à la dernière délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre était autorisé à utiliser l'article 49.3 ». Il a fallu notamment que le rapporteur du Conseil constitutionnel use de son pouvoir inquisitoire pour obtenir communication du délibéré du Conseil des ministres et ainsi que le 49.3 avait bien été discuté et que le Premier ministre était autorisé.
J'en viens maintenant au projet de révision. Il s'agit d'un très beau projet, du point de vue du droit constitutionnel et du droit parlementaire, et on peut dire qu'il s'inscrit dans une perspective pérenne et consensuelle qui est celle de la réévaluation de la place du Parlement par rapport à l'exécutif, ou à la reparlementarisation de la V e République. En effet, le rôle dirigeant de l'exécutif découlant de la révolution copernicienne de 1958 est accompli. Mais, il faut maintenant gommer, limer les aspects les plus abrupts du parlementarisme rationalisé afin que le Parlement n'ait pas le sentiment d'être évacué de la scène politique et qu'il s'estime partie prenante au processus normatif.
De ce point de vue, la procédure va tout à fait dans le bon sens. Comme on l'a dit, le Parlement est de retour. C'est vrai avec la réforme de 1974 relative à l'élargissement de la saisine à soixante Députés ou soixante Sénateurs pour introduire un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est vrai avec la révision de 1995 qui crée la session unique. On en termine ainsi avec l'époque d'une démocratie à mi-temps ; le Parlement peut contrôler et légiférer pendant neuf mois.
J'ajouterai qu'un esprit parlementaire se dégage de ce projet, ne serait-ce qu'à travers la reconnaissance de l'opposition. L'article 4 de la Constitution devrait, demain, faire état de la place de l'opposition, de la reconnaissance des groupes parlementaires, à l'article 51.1 du projet et d'autres dispositions. En effet, que sont les groupes parlementaires, sinon la traduction institutionnelle des partis politiques ?
De même que l'on fait confiance au Parlement en lui permettant de voter des résolutions qui n'ont pas un caractère contraignant, c'est-à-dire qui ne sont pas une façon de contraindre le gouvernement à agir, comme c'était le cas avant 1958. De la même façon, le projet du comité Balladur (vous me pardonnerez cette simplification de langage) fait appel plusieurs fois au règlement des assemblées, à toutes fins utiles.
Les deux fonctions du Parlement, la fonction législative et la fonction de contrôle, se trouvent revalorisées et rehaussées à travers le projet de révision constitutionnelle qui reprend pour l'essentiel les propositions du comité Balladur.
En ce qui concerne la fonction législative, on peut rappeler qu'il s'agit peut-être de légiférer moins pour contrôler plus ; de légiférer moins mais dans une meilleure qualité. Là encore, quand on évoque les résolutions, cela signifie que l'on se détourne des lois mémorielles. Si la France reconnaît le génocide arménien, pourquoi ne pas reconnaître, dans ce cas, que Louis XIV est mort le 1er septembre 1715 ? On évitera des lois honoris causa, selon le doyen Vedel, qui n'ont aucun contenu normatif, d'autant plus que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est extrêmement stricte. Finis les neutrons législatifs (J. Foyer), une loi doit être un commandement (Portalis) et doit contenir des dispositions contraignantes !
Pour ce qui est de la fonction législative, il est prévu des dispositions très importantes, en particulier sur l'ordre du jour. Il est proposé un ordre du jour partagé, mais le projet de révision constitutionnelle fait que ce partage n'est pas aussi strict qu'on veut bien le dire. Quand on lit l'article 48 revu et corrigé, on s'aperçoit en effet que la répartition est beaucoup plus favorable au gouvernement qu'au Parlement. Il existera désormais un ordre du jour prioritaire au profit de l'opposition et on sait ce qu'il en est des niches parlementaires.
Une autre disposition importante est prévue s'agissant du texte qui servira de support législatif devant la première assemblée saisie : ce sera le texte qui sortira des travaux de la commission. Les parlementaires s'en réjouissent à juste titre. Mais, là encore, même si je ne voudrais pas ici jouer les Cassandre, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas des matières pour lesquelles le gouvernement a le monopole de l'initiative : la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale, voire la révision de la Constitution, la ratification des engagements internationaux ou la transposition des directives communautaires. Là encore, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi simples que l'on veut bien le dire et que le gouvernement se situe en retrait par rapport aux propositions du Comité Balladur.
J'ajouterai une disposition phare : le droit d'amendement. C'est ce qui correspond le mieux à la psychologie parlementaire. Faut-il rappeler que c'est par un amendement que la III e République fut votée, certes à une voix de majorité, le 30 janvier 1875 ?
Le droit d'amendement c'est une avancée pourra s'exercer en commission, ce qui nous rapproche un peu du système italien, ou en séance publique. Cela dit, le texte du gouvernement tel qu'il est soumis au Parlement me paraît extrêmement critiquable, dans la mesure où ce droit s'exercera selon une loi organique qui devra être ensuite suivie par une modification du règlement des assemblées. Trop, c'est trop. Il suffit de faire confiance à celles-ci pour traduire correctement la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
J'émets le souhait que, dans leur sagesse, les Sénateurs je me tourne vers le Président de la Commission des lois se demanderont pourquoi il faudrait changer le règlement. Une modification de la Constitution ne coûte rien et, surtout, permet d'éviter un contrôle du Conseil constitutionnel. On sait comment le Sénat appliquerait à sa façon l'article 40, en ne modifiant surtout pas son règlement.
Mais ces avancées ne sont pas pour autant synonymes de changement, parce que gouverner, c'est légiférer. Cela m'amène à rappeler que le fait majoritaire, qui est l'une des conquêtes majeures de la V e République, aboutit à ce que la majorité n'a d'autre ambition que de servir le gouvernement et de mettre à sa disposition ses pouvoirs législatifs. Qu'il s'agisse de François Mitterrand ou de Nicolas Sarkozy, c'est la même logique : une majorité est la marge de manoeuvre, toute révérence gardée, pour la représentation nationale. Au total, ce qui était au départ un oxymore, le gouvernement législateur est devenu une banalité. Certes, les parlementaires pourront intervenir à la marge, mais il me semble que, fondamentalement, il n'y aura pas de changement.
Il reste la fonction de contrôle. Je sais que, pour le Président Poncelet, c'est la seconde nature du Parlement. Il a certainement raison, mais, là encore, avec beaucoup de nuances. Cette fonction a été largement ouverte et renouvelée avec ce que l'on appelle la Constitution financière de la France : la fameuse LOLF du 1er août 2001. C'est également un préalable très important car, là encore, on sait que gouverner, c'est dépenser.
Sous cet aspect, il est très bien qu'au cours de sessions extraordinaires, le gouvernement réponde désormais à des questions d'actualité.
Quant au fait que le gouvernement puisse limiter l'usage du 49.3 devant l'Assemblée nationale, cela me paraît une disposition quelque peu inutile pour deux raisons.
La première, c'est qu'il est indiqué dans le texte cela figurait déjà dans le rapport du comité Balladur que le 49.3 pourrait être utilisé pour le vote de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Or, à ma connaissance et avec tout le respect que je dois aux membres dudit comité, c'est une disposition superfétatoire puisqu'il s'agit de lois obligatoires. Si, le 1er janvier, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale n'ont pas été adoptées, le gouvernement, en vertu de la Constitution, est habilité à les mettre en vigueur par ordonnance.
M. Guy CARCASSONNE, Professeur à l'Université de Paris X et à l'Institut d'études politiques de Paris.-
Seulement si le Parlement ne s'est pas prononcé et non pas s'il a voté contre.
M. Jean GICQUEL.-
Tout à fait. Ce n'est prévu qu'en cas de carence de vote et pour éviter d'aboutir au spectacle affligeant de la IV e République qui voulait que, le 31 décembre, à minuit, l'on arrêta symboliquement les pendules du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg.
La deuxième raison, c'est qu'à mon avis, l'article 49.3 est essentiel au régime. Le regretté doyen Vedel disait et Guy ne me démentira pas , que la V e République, c'était l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel et le 49.3. Le seul moyen de permettre un retour déguisé à la IV e République serait de dénaturer le 49.3. Car, avec cet article, chacun prend ses responsabilités : si l'Assemblée ne veut pas accorder au gouvernement ce dont il a besoin, c'est son droit le plus strict. Mais il faut alors que les Députés sachent qu'ils seront renvoyés prématurément devant leurs électeurs. Un Député qui perd son siège est un Député qui perd son âme.
Je préférerais personnellement que l'on réglemente le 49.3 en faisant en sorte que le gouvernement ne soit pas autorisé à l'utiliser en première lecture et que l'on interdise un montage avec un vote bloqué ou une habilitation législative de l'article 38.
Quant au fait de contraindre le gouvernement à ne recourir au 49.3 qu'une fois par an, je réponds qu'il ne faut pas mécaniser la vie institutionnelle. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-on imaginer qu'un gouvernement soit pris à la gorge et décide que, parce qu'il a utilisé son droit de tirage, il doive laisser les choses en l'état ? On peut dire le mal que l'on veut du 49.3, mais il faut se souvenir qu'il est très utile en cas de majorité rétive, comme cela s'est vérifié pour Raymond Barre entre 1976 et 1981. Pourquoi le RPR n'a-t-il jamais franchi le Rubicon ? Parce qu'il savait que le 49.3 impliquait un retour prématuré devant les électeurs.
Pendant une législature, de 1988 à 1993, c'est grâce au 49.3 que les gouvernements Rocard, Bérégovoy et Cresson, en dépit d'une majorité relative en vue de laquelle le parlementarisme rationalisé avait été conçu, ont pu gouverner. Michel Rocard Guy Carcassonne ne me démentira pas est le champion toutes catégories, avec 28 utilisations du 49.3 sur les 82 applications de cet article.
Personnellement, j'estime donc que le 49.3 doit être conservé, quitte peut-être à l'aménager, parce que c'est un instrument de gouvernement et que l'on ne sait jamais dans quelle situation politique notre pays pourrait se trouver à un certain moment.
La fonction de contrôle me paraît donc extrêmement importante pour revaloriser le rôle du Parlement. Cependant, une chose est, pour le Parlement, de disposer des moyens on le voit avec l'application de la LOLF , une autre est d'avoir la volonté de les exercer. Dans la situation actuelle, on s'aperçoit que le contrôle parlementaire se heurte au temps parlementaire : trois quarts de législation, un quart de contrôle. Il faudrait donc peut-être revenir à une conception plus raisonnable de la législation.
Surtout, le contrôle parlementaire se heurte à la logique majoritaire qui est une sorte de mur de verre. En effet, on sait bien qu'à certains moments, le gouvernement acceptera la critique de ses amis, mais pas au-delà. Bref, nous n'avons pas encore trouvé, en France, cette culture britannique, cette forme de contrôle de la solidarité qui amène les meilleurs amis du monde à se faire un procès pour un oui ou pour un non. Je sais bien que, dans la salle Colbert, à l'Assemblée nationale, lors du tête-à-tête entre le gouvernement et sa majorité, on se dit des choses parfois très dures. Cependant, la majorité sait le plus souvent à qui elle doit son pouvoir et les Députés à qui ils doivent leur investiture. Ils accepteront que le gouvernement finisse par l'emporter.
Je conclurai en disant que, dans mon esprit, ce projet est très avantageux, même s'il faut le limiter dans sa portée. En définitive, il est parvenu à une sorte d'équilibre, dans la mesure où le rôle dirigeant de l'exécutif, qui est l'une des conquêtes majeures de la V e République, n'est pas remis en cause, et qu'à côté de ce rôle dirigeant, le Parlement ne sera ni le Parlement souverain d'avant 1958, ni le Parlement soumis qu'il a été dans les premières années de la V e République. Le Parlement occupera ainsi une position médiane et obligera quand même le gouvernement à tenir compte de ce qu'il représente au premier chef : la nation.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je ferai deux réflexions sur ce que vient de dire M. Gicquel.
Premièrement, sur le 49.3, le texte que dépose le gouvernement prévoit trois recours au 49.3 par an : deux plus un. Si ce texte avait été en vigueur depuis 1958, pendant cinquante ans, cela aurait donné lieu à 150 recours au 49.3. Comme vous venez de le dire vous-même, M. le Professeur, il n'y en a eu que 82 depuis cinquante ans. Nous prévoyons donc deux fois plus que ce qui a été utilisé. C'est relativement généreux.
J'ajouterai que plusieurs lois ont donné lieu à plusieurs 49.3, c'est-à-dire que 45 ou 46 lois ont été votées grâce au 49.3 en cinquante ans, dont une quinzaine de lois de finances et de lois sur la sécurité sociale. Cela signifie qu'une trentaine de lois que je qualifierai de normales ont eu besoin du 49.3 en cinquante ans.
Je veux dire par là que la disposition qui est prévue n'étrangle pas les moyens et les instruments auxquels le gouvernement peut recourir. Il se peut que certains gouvernements les aient épuisés plus que d'autres, l'un parce qu'il avait une majorité rétive qui ne voulait pas le suivre en tout ou l'autre parce qu'il n'avait pas de majorité et je ne citerai personne. Dans ces cas-la, vaut-il mieux utiliser le 49.3 pour rester au pouvoir ou en tirer les conséquences ? C'est un problème politique que chacun résoudra comme il l'entend.
Deuxièmement, je vous suis infiniment reconnaissant, M. le Professeur, de tout ce que vous avez bien voulu dire sur la réforme qui est proposée et qui, grosso modo, est conforme au comité que nous avons constitué. Cela dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la conception que vous vous faites de la majorité parlementaire. Dans la plus grande partie de ma vie, j'ai été au sein de l'exécutif et non pas du législatif, mais je ne suis pas d'accord pour dire que la majorité est faite pour servir le gouvernement.
Vous nous dites que, finalement, gouverner, c'est légiférer et que la majorité est là pour faire ce que souhaite le gouvernement. Je réponds tout d'abord que, gouverner, ce n'est pas uniquement légiférer. Prendre des décisions de politique étrangère ou militaire, choisir un système d'arme, par exemple, n'est pas du tout du domaine législatif et constitue une chose très importante. On ne peut donc pas réduire la fonction gouvernementale à la fonction de législation.
J'ajoute qu'à mon avis, le fait que la Constitution reconnaisse au Parlement le droit de proposer des lois prouve bien qu'il n'est pas uniquement à la disposition du gouvernement, sans quoi on aurait dit qu'il a pour responsabilité non pas de proposer des lois mais de voter celles qu'on lui propose, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Je vous suis donc très reconnaissant de ce que vous dites sur les pouvoirs du Parlement qu'il faut élargir, mais permettez-moi de vous dire que, sur ce point, je ne vois pas tout à fait les choses comme vous.
M. Jean GICQUEL.-
Ma formule était peut-être un peu abrupte en ce qui concerne le rôle de la majorité, parce que personne n'ignore la négociation intra majoritaire et que, même aujourd'hui, l'ordre du jour prétendument prioritaire est négocié entre le gouvernement et la majorité.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Les négociations ne sont pas toujours heureuses. Ce sont des cas d'espèce.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Je vous remercie de cet échange stimulant. Je pense qu'il le sera encore plus avec l'intervention de Guy Carcassonne, l'autre grand sage, qui, lui, a déjà participé aux travaux du comité Balladur. Il est donc très intéressant pour nous d'avoir son point de vue.
M. Guy CARCASSONNE.-
Merci, M. le modérateur. J'ai eu en effet le plaisir de travailler pendant des semaines sous l'autorité, que j'ai beaucoup appréciée, d'Edouard Balladur. Je commencerai par revenir d'un mot sur quelques remarques qui ont été faites auparavant.
D'ordinaire, quand on dit à quelqu'un qu'il n'est pas tout seul, cela a plutôt tendance à le rassurer, mais, s'agissant de Jean-François Kahn, j'ai peur de le chagriner. Etre parlementariste n'a strictement rien d'original ni de non conformiste, en tout cas du côté de ceux qui s'intéressent aux Constitutions. Une très large majorité d'entre eux, quasi écrasante il y en a d'ailleurs un certain nombre dans la salle considère qu'à l'évidence, le meilleur système institutionnel est celui qui fonctionne en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et je pourrais continuer la liste un bon moment. Une très large majorité de Constitutionnalistes, à laquelle j'appartiens, rêverait d'avoir un régime comme celui-là en France.
Simplement dans cette très large majorité de Constitutionnalistes, une large majorité considère aussi qu'hélas, pour les raisons qui ont été dites, qui sont parfois identifiées et qu'a mentionnées à son tour Edouard Balladur, ce n'est pas possible en France en l'état parce qu'il n'apparaît pas que les Français soient désireux de renoncer à l'élection présidentielle. Or, aussi longtemps qu'on n'aura pas renoncé à l'élection présidentielle directe en France, on ne pourra pas instaurer un régime que l'on peut qualifier de primo ministériel ou de parlementariste.
M. Jean-François KAHN.-
C'est pourtant ce qui arrive quand il y a cohabitation.
M. Guy CARCASSONNE.-
Non, puisque cela n'arrive que le temps de la cohabitation et qu'ensuite, bizarrement, les Français ne reconduisent pas la cohabitation. Jusqu'à présent, ils ont toujours choisi d'y mettre fin et donc de revenir à un système qui fait l'objet de vos griefs.
Une chose me frappe à propos de la cohabitation qui, à mon sens, n'est jamais suffisamment dite : les Français auraient pu toujours et systématiquement choisir de la pérenniser. Or il semble qu'ils l'aient plutôt subie que voulue et que, dès que l'occasion s'est présentée d'y mettre fin, ils y ont recouru.
Par ailleurs, vous dites que si ce régime était bien, darwinisme aidant, il aurait fait des petits, ce qui, pour le coup, me semble matériellement inexact. Il a fait beaucoup de petits, Jean-François Kahn. Dans l'Europe, au sens de l'Union européenne, chacun a sa tradition institutionnelle et, effectivement, il n'y a pas eu de changements considérables, mais, en dehors de celle-ci, la totalité des pays de l'ex-Yougoslavie et la quasi-totalité des pays d'Europe centrale et orientale, à l'unique exception de l'Estonie, à mes yeux remarquable d'ailleurs, ont adopté des systèmes dans lesquels il y a un régime parlementaire avec un gouvernement responsable devant le Parlement et un Président élu au suffrage universel direct. Ensuite, ces pays se sont, pour les uns, plutôt orientés vers le modèle français, hélas majoritaire, et, pour quelques autres, heureusement, plutôt orientés vers le modèle austro-portugais, mais il est inexact de penser que ce régime n'a pas suscité des vocations.
Je ne dis pas cela spécialement pour le défendre, d'abord parce que je ne suis pas sûr qu'il soit indispensable de le défendre il le fait très bien tout seul et sans moi , mais surtout parce que, encore une fois, je rêverais d'un régime parlementaire. Rassurez-vous ou inquiétez-vous, Jean-François Kahn : à cet égard, vous n'êtes pas seul.
J'en viens aux autres aspects qui ont été évoqués et je vais donner une interprétation personnelle du travail que nous avons accompli ensemble et de la manière dont il a été repris par le gouvernement.
L'intitulé du comité qu'Edouard Balladur a présidé portait sur le rééquilibrage et la modernisation des institutions. Il me pardonnera de faire un aveu qui n'est pas extraordinairement coupable : dans ces deux termes, j'ai toujours été beaucoup plus sensible à l'idée de modernisation qu'à l'idée de rééquilibrage. Je vois bien ce que signifie, sous-tend et charrie l'idée de rééquilibrage, mais c'est une idée qui, selon moi, renvoie aux poids et mesures ou à une forme d'esthétique bien davantage qu'à ce qui était notre propos, c'est-à-dire un système qui fonctionne. Faut-il que, sur deux plateaux d'une même balance, l'exécutif et le législatif aient exactement le même poids ? Je n'en suis pas sûr. Je crois d'ailleurs que, dans les autres systèmes que l'on nous offre à juste titre en modèle, ils n'ont pas du tout le même poids. Ce serait une illusion que de le croire. Je pense surtout que le problème n'est pas pondéral, mais avant tout fonctionnel ou fonctionnaliste.
Cela signifie que la modernisation était un enjeu à mes yeux beaucoup plus important que le rééquilibrage, en ceci qu'il s'agit de faire en sorte que ceux auxquels les institutions démocratiques attribuent des compétences puissent les exercer le mieux possible. C'est aussi simple que cela. Le travail que nous avons contribué à faire ensemble au sein du comité a, de ce point de vue, quelques mérites, mais il se caractérise non pas par la remise en cause de la rationalisation du parlementarisme, mais, au contraire, par ce que j'appellerai une nouvelle rationalisation du parlementarisme.
En d'autres termes, les choix qui ont été faits pour rationaliser le parlementarisme en 1958 étaient pour beaucoup d'entre eux judicieux et pour tous compréhensibles, mais, cinquante ans plus tard, d'autres réalités se sont révélées et beaucoup d'éléments ont conduit à proposer d'autres choix qui nous paraissent plus judicieux et ne vont pas dans le sens d'une sortie du parlementarisme rationalisé. En effet, je rappelle que le contraire du parlementarisme rationalisé est le parlementarisme débridé et irrationnel, un parlementarisme qui ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas que la France qui aurait un parlementarisme rationalisé par opposition à d'autres régimes qui auraient un bon parlementarisme. Il n'y a pas plus rationalisé que le parlementarisme allemand ou britannique. Par conséquent, le parlementarisme rationalisé, loin d'être une insulte, est, à mes yeux, tout à fait essentiel.
Nous avons donc travaillé pour essayer d'adapter la rationalisation du parlementarisme aux changements que le temps avait éprouvés, comme le disait Montaigne, et nous l'avons fait en toute bonne foi, j'en suis certain, et avec un peu de réflexion.
Cela m'amène à faire quelques remarques très brèves. Il arrive assez fréquemment à mes étudiants, à des journalistes ou parfois même à des groupes parlementaires qui m'ont fait l'honneur de m'auditionner, de me demander quelle est la plus importante des 77 mesures que nous avons présentées, ce qu'il faut absolument adopter. La réponse que je fais est toujours la même, et je pense qu'Edouard Balladur ne me démentira pas : en ce qui concerne le Parlement, nous avons essayé de raisonner par bloc. Il fallait un bloc cohérent sur la législation et il fallait un bloc cohérent sur le contrôle et l'évaluation. Nous nous sommes attachés à essayer de fabriquer ces blocs dont, évidemment, chaque élément, chaque mesure peut être détachable, mais dont l'intérêt majeur est précisément qu'ils forment un tout.
Cela a été vrai en matière de législation. Comme cela a été dit tout à l'heure, nous savons très bien que l'on légifère beaucoup trop et, souvent, extrêmement mal. Le premier élément du bloc consiste donc à prévoir un délai minimum entre le dépôt et l'inscription à l'ordre du jour.
Le deuxième, c'est que l'on ne va pas légiférer dans n'importe quelles conditions sur n'importe quoi sans avoir réfléchi avant. C'est pourquoi nous avons proposé qu'une loi organique sur les projets de loi puisse imposer des études d'impact ou des études d'option.
Troisièmement, une fois que l'on discute, puisque la commission a travaillé et fait notamment un certain nombre d'améliorations rédactionnelles, on ne va pas embarrasser la séance publique avec une discussion vaine et une perte de temps sur ces améliorations rédactionnelles en faisant en sorte que tout cela soit intégré au texte. Toutes les propositions que nous avons formulées s'inséraient dans ce bloc.
De la même manière, il y avait un bloc sur l'évaluation et le contrôle et cela a commencé par l'ordre du jour : une semaine sur quatre devait, dans notre esprit, être obligatoirement consacrée à des tâches de contrôle. Ces tâches de contrôle ne se résument certainement pas à l'opposition qui essaie de montrer combien le gouvernement gère mal la nation et combien chaque ministre est incompétent dans son département. Certes, c'est une tâche nécessaire, mais cela n'aurait aucun intérêt s'il ne s'agissait que de cela. Le contrôle, c'est à la fois le contrôle conjoint entre majorité et opposition, c'est-à-dire le contrôle du politique sur l'administratif, et ce que j'appellerai l'autoévaluation : le fait que le Parlement se soucie de suivre et d'analyser le devenir de ses lois, constate les résultats qu'elles ont produits et les redresse éventuellement. Il vaut mieux réfléchir avant que réparer après, mais il vaut mieux réparer après que ne rien faire du tout.
Le Parlement a réussi le prodige de mettre en panne plusieurs dizaines de milliers d'ascenseurs en France. Il faut au moins qu'il médite sur cette mésaventure qui est parvenue à rendre la vie impossible à des centaines de milliers de personnes. Je sais cependant qu'au Sénat, il s'était trouvé un Sénateur pour prévoir ce qui allait se produire, le dire publiquement et voir son propos balayé avec superbe par le ministre, de sorte qu'il n'a pas été entendu.
C'est donc bien de deux blocs qu'il s'agit : l'un plutôt sur la législation et l'autre plutôt sur le contrôle, même si les deux sont coordonnés. Donc je crois que l'essentiel est la cohérence. Si ces blocs, non pas nécessairement tels quels mais dans leur esprit, pouvaient faire leur entrée dans la Constitution, il y aurait une amélioration substantielle.
Cela appelle de ma part deux remarques conclusives, la première étant un regret et la seconde une inquiétude.
Le regret, c'est que, sur le travail que nous avons fait, le gouvernement a fait ses choix qui sont parfaitement légitimes : nul ne doute que c'était destiné à l'exécutif, puis au législatif, et que c'est à eux de prendre les décisions. Je regrette néanmoins qu'un certain nombre de nos propositions aient paru rognées. Alors que nous proposions par exemple un délai de deux mois entre le dépôt et l'inscription à l'ordre du jour, il a été ramené à un mois ; alors que nous proposions dix commissions permanentes, elles ont été ramenées à huit ; alors que nous proposions une intervention du Parlement pour autoriser la poursuite d'une opération extérieure au bout de trois mois, cela a été renvoyé à six mois ; alors que nous proposions l'exception d'inconstitutionnalité, on prétend la limiter aux lois postérieures à 1958. J'ai l'impression que certains, au gouvernement, n'ont pas pu s'empêcher de ne lire le rapport du comité présidé par Edouard Balladur qu'un rabot à la main, ce que, personnellement, je trouve un peu regrettable. Voilà pour mon regret.
En ce qui concerne l'inquiétude, elle est toujours la même. Je ne vois pas comment on peut revaloriser une institution vide, je ne vois pas comment on peut revaloriser un Parlement sans les parlementaires et je ne vois pas comment cette révision, venant après un certain nombre d'autres, pourra substantiellement modifier la situation et l'améliorer si les parlementaires ne font pas les efforts nécessaires sur eux-mêmes d'abord et sur leur emploi du temps.
Voilà des années que je répète que ce qui manque au Parlement, ce ne sont pas des pouvoirs mais des parlementaires pour les exercer et je n'ai pas changé d'avis. Je pense que, si de nouveaux pouvoirs leur sont donnés, ce sera très bien, mais que, s'il n'y a toujours pas de parlementaires pour les exercer, nous n'aurons pas beaucoup avancé.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Je retrouve un thème cher à Guy Carcassonne, mais Jean-François Kahn a demandé un droit de réponse et je ne peux pas décemment le lui refuser.
M. Jean-François KAHN.-
Ce n'est pas vraiment un droit de réponse. Je voudrais simplement insister sur une remarque de Mme Borvo Cohen-Seat qui a dit que tout ce que l'on propose d'intelligent ou de judicieux risque d'être vide si on exclut du débat le problème du mode du scrutin, mais aussi celui du cumul : vous aurez beau réhabiliter le Parlement, si des parlementaires ne sont pas là, cela ne servira à rien puisque ce sera une boîte vide.
Pour ce qui est du mode de scrutin, on a donné les raisons, mais j'ai lu récemment qu'au moins un ministre propose une réforme du scrutin électoral pour les régionales et pour les législatives en appliquant le système anglais. Comme vous avez beaucoup parlé de spécificité, je retourne l'argument : si on applique ce scrutin en France, cela voudrait dire qu'une majorité sortante qui obtiendrait 40 % des voix et l'opposition 60 % mais étant divisée (c'était le cas au premier tour, sachant qu'il n'y aurait plus qu'un tour, évidemment), ceux qui ont obtenu 40 % auraient une très forte majorité au Parlement.
Ensuite, vous pouvez raconter ce que vous voulez, notamment sur le 49.3 plus ou moins utilisé ou sur un accroissement des pouvoirs pour l'opposition, cela n'aura aucune importance puisque, de toute façon, c'est la minorité qui sera la majorité et donc qu'il y aura un rejet de l'opinion par rapport à cela. Vous ne pouvez pas l'exclure.
J'ai une deuxième remarque à faire, et il est dommage que M. Karoutchi ne soit plus là car cela lui ferait plaisir. Si on veut que le Parlement soit de retour, il ne faut plus voir la situation que j'ai constatée ces jours-ci : quand, au Parlement, des Députés ils sont en l'occurrence de la majorité de droite, mais cela pourrait être l'inverse votent selon leurs convictions, sans être aux ordres, sans être des "godillots", ce qui crée un petit problème en conséquence, il faut arrêter de dire que c'est un couac, un fiasco, une horreur et une crise gouvernementale ! Si on veut restaurer un Parlement, cela veut dire que l'on permet enfin aux Députés de voter selon leurs convictions, ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent et non pas selon les ordres du chef d'orchestre. Si on continue de considérer qu'il y a une crise quand les Députés ne votent pas selon les ordres du chef d'orchestre, ne parlons pas de réhabiliter le Parlement.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je crois effectivement que le problème du mode de scrutin se pose. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on peut, d'ici le mois de juillet, compte tenu du calendrier qui a été retenu, voter à la fois une réforme de la Constitution, une réforme de la loi électorale sénatoriale, une réforme de la loi électorale régionale et une réforme de la loi électorale de l'Assemblée nationale. Cependant, Jean-François Kahn a raison : le problème se pose.
J'ai une deuxième observation. Il y a un pays dans lequel c'est régulièrement la minorité qui a la majorité des sièges au Parlement : la Grande-Bretagne. Quand on additionne les voix obtenues par le parti qui a été battu plus le parti libéral, qui est tout le temps battu mais qui réunit 20 % du corps électoral, on constate que les battus sont toujours majoritaires. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais c'est une situation à prendre en compte.
M. Jean-François KAHN.-
J'aimerais que vous insistiez sur le fait que ce n'est pas un modèle pour vous... (Rires.)
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je n'ai pas dit du tout que c'est un modèle.
Enfin, vous regrettez l'absence de M. Karoutchi parce que vous auriez voulu lui demander de ne pas dire que, dès que quelques parlementaires ne sont pas d'accord avec le gouvernement, c'est une crise profonde. Vous avez mille fois raison, mais c'est aux journalistes qu'il faut donner ce conseil...
Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT.-
Je souhaite faire quelques remarques dans le cadre du débat.
Dans la réforme qui nous est proposée, il y a effectivement non pas une volonté de s'en prendre à un Parlement rationalisé, mais, au contraire, de le rationaliser davantage et d'avoir à la fois un présidentialisme à la française et un Parlement rationalisé à l'anglo-saxonne. Or il existe un pays dont la minorité est majoritaire compte tenu du mode de scrutin, la Grande-Bretagne, et un pays où le pouvoir est minoritaire, les Etats-Unis, où en général seulement 40 % de la population participe au vote.
Mon opinion vient sans doute du fait que j'appartiens à un courant qui est très minoritaire au Parlement, ce qui découle du rapport de forces dans le pays, mais je dois dire que le Parlement bipartiste rationalisé ne peut pas me satisfaire.
Je vois que dans les pays où il est en oeuvre, où les institutions contribuent à le figer et à l'aggraver, tout simplement parce qu'à un moment donné cela correspond à un rapport de forces, on aboutit petit à petit à ce qu'une partie de la population, ne se sentant pas représentée, se désintéresse de la politique. Je regrette infiniment de constater qu'à part quelques exceptions qui sont dues à de nombreuses raisons dont on pourrait discuter longtemps, l'abstention grandit dans notre pays et que le désintérêt de la politique est assez important, ne serait-ce que parce que les gens ne voient pas bien à quoi servent les politiques, sans parler de la tentation extrémiste.
Glorifier un parlementarisme bipartiste rationalisé me paraît donc complètement hors de propos, car je suis convaincue qu'au coeur de la démocratie se trouve, non pas le Parlement mais le peuple, ce qui nous renvoie à la représentativité et au mode de scrutin. M. le Premier ministre, vous nous dites que l'on n'a pas le temps de faire tout cela dans les délais qui nous sont impartis, mais, tout d'abord, les délais ont été fixés par le Président de la République et la majorité et, ensuite, pour moi, les institutions forment un bloc. Par conséquent, si on décide de faire un certain nombre de choses mais qu'on n'a pas le temps de faire le reste, cela veut surtout dire qu'on ne veut pas le faire. Tout cela me paraît donc assez spécieux.
Maintenant, je tiens à faire quelques remarques sur le projet de réforme. On a parlé du 49.3, mais, M. Balladur, vous avez fort bien dit que le 49.3 que vous proposez est plus important que le 49.3 utilisé depuis l'histoire de nos institutions, ce qui est au-delà de l'utilisation qui en est faite habituellement.
Ensuite, toujours dans une optique de rationalisation parlementaire, on organise un 49.3 de la majorité, c'est-à-dire que la majorité aura le pouvoir de limiter le débat public. Mais le Parlement sans débat public n'est pas le Parlement. Toujours dans l'optique qui est la mienne, à savoir le fait que le Parlement représente le peuple, tout ce qui ne ressort pas du débat public n'est pas en phase avec la réalité du peuple invisible.
Je constate que le droit d'amendement sera autolimité par la majorité, et donc diminué, mais il l'est déjà largement puisque le droit d'amendement n'existe pas dès lors qu'il y a des implications financières. Cela veut dire que le Parlement n'a pas de pouvoir sur les grandes décisions et qu'il ne fait qu'entériner les choses ou émettre des avis. De ce point de vue, on ne peut pas dire que ce projet va accroître les pouvoirs du Parlement. Même si le gouvernement l'a affirmé à plusieurs reprises, cette affirmation est petit à petit contredite.
En revanche, les pouvoirs du Président de la République ne sont en rien limités puisque, dans notre régime plutôt présidentialiste, le Président gardera le droit de dissolution, ce qui est extravagant et ce qui fait que notre pays a vraiment un régime exceptionnel de ce point de vue. Ce n'est pas remis en cause.
Il en est de même pour l'expression du Président de la République devant le Parlement. J'ai conscience que beaucoup a été dit là-dessus, peut-être même trop, mais c'est une chose contraire à la logique républicaine, puisque quelqu'un qui n'est pas responsable devant le Parlement ne devrait pas s'exprimer devant celui-ci. C'est peut-être un argument simpliste, mais cela me paraît une réalité institutionnelle. Je ne vois pas pourquoi on y dérogerait au détour de cette réforme.
Enfin, le gouvernement présente cette réforme comme importante. Je ne sais pas ce qu'il en sera au bout de la discussion et je ne sais même pas dans quelles conditions on arrivera au bout de cette discussion, mais il est quand même contraire à notre tradition républicaine qu'une révision de la Constitution, dont on dit qu'elle est importante, ne soit pas soumise à la consultation populaire. Normalement, cela se passe de cette façon. L'élection du Président de la République au suffrage universel a été soumise au vote populaire et, au fond, la loi fondamentale doit être soumise au peuple. Cela me paraît normal.
M. Jean GARRIGUES, modérateur.-
Je vais passer la parole à Jean-Jacques Hyest, Président de la Commission des lois du Sénat pour qu'il puisse donner quelques mots de conclusion, en le remerciant d'avoir attendu son tour aussi patiemment.
M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur de la Seine-et-Marne, Président de la Commission des lois du Sénat.-
Comme il reste quand même quelques parlementaires, plus nombreux que vous le pensez, qui assistent aux séances quand il y en a, ce qui ne m'a pas permis de participer à l'ensemble des travaux de la matinée ni de cet après-midi, je tiens à dire que le premier devoir d'un parlementaire est effectivement de s'organiser pour participer efficacement aux travaux de son assemblée.
Je peux témoigner que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est quand même pas en séance publique, comme Mme Borvo Cohen-Seat le sait bien, que se fait l'essentiel du travail au Parlement. La séance publique est indispensable et importante, mais je pense qu'une certaine rationalisation des travaux devrait être possible dans un certain nombre de cas.
Certes, rien n'est technique et tout est politique, mais la complexité des problèmes de technique juridique fait que, sur un certain nombre de sujets techniques, à partir du moment où on est d'accord sur un certain nombre d'amendements c'est ce qui a d'ailleurs été proposé par le comité présidé par Edouard Balladur , on doit pouvoir partir du texte de la commission pour éviter les répétitions d'amendements. Parfois, le rapporteur se lève, le gouvernement dit qu'il est d'accord et on se rassied. Il faut donc discerner les grands enjeux d'un texte et je pense que, pour l'opinion publique et les citoyens qui ne sont pas très habitués à nos techniques parlementaires, ce serait plus profitable et cela donnerait un meilleur éclairage au débat.
Comme certains se sont lancés dans l'appréciation de vos propositions, M. le Premier ministre, puisque tout le monde les a trouvées excellentes, moi y compris, je tiens à préciser que c'est le Parlement réuni en Congrès qui est constituant, ou bien le peuple si on fait appel à lui. Je me contente ici de rappeler ce qui est prévu dans l'article 89 de la Constitution et je ne porte pas d'appréciation sur le fait qu'il faille soumettre ou non à référendum une révision constitutionnelle.
Pour être parlementaire depuis quelques années et pour avoir été Député, puis Sénateur, ce qui me donne un double regard que n'ont pas toujours certains autres, je remarque que nous avions fait en 1995 une réforme, dont nous espérions beaucoup, sur la modernisation du travail parlementaire. M. le Professeur Gicquel, avec son enthousiasme, dit que la session unique est très bien, mais à condition que le rythme de travail permette aux parlementaires de la suivre. Même s'ils ne cumulent pas les mandats, ils ont des électeurs et des gens à voir et ils doivent se renseigner sur le terrain. Si on les fait travailler comme des forçats toute l'année, on n'aura amélioré ni la qualité du travail parlementaire, ni le fait que les parlementaires doivent être en phase avec leur territoire et l'opinion publique. Ce sont donc des équilibres à respecter.
En revanche, si la réforme de 1962 a été fondamentale avec l'élection du Président de la République au suffrage universel, le quinquennat et les élections législatives qui suivent, avec ce qu'on a appelé l'inversion du calendrier, ne pourront pas être facilement modifiés. Certes, il peut y avoir une dissolution et cet ordre peut être à nouveau modifié, mais tout Président de la République nouvellement élu dissoudra l'assemblée, comme l'a fait deux fois François Mitterrand parce qu'il était logique qu'une majorité parlementaire suive l'élection du Président.
Cette majorité parlementaire a été obtenue de justesse en 1988 : il manquait toujours des voix et on se demandait si le gouvernement allait avoir une majorité pour voter les textes, mais non pas pour l'engagement de responsabilité, parce que le fait de voter une motion de censure n'a rien à voir avec le fait de ne pas voter un texte.
A ce sujet, vous me permettrez de vous dire que l'on peut être parlementariste, mais que cela ne change strictement rien. Il ne faut pas se faire d'illusions : au Parlement britannique ou au Bundestag, la discipline de vote est extrêmement forte, souvent bien plus forte que chez nous.
M. Jean-François KAHN.-
A cinq ou six reprises, sur un vote fondamental dans le Parti travailliste de Tony Blair, soixante Députés ont voté contre le gouvernement. La discipline est donc beaucoup moins forte.
M. Jean-Jacques HYEST.-
Je suis désolé de vous dire que, sur le long terme et sur l'ensemble de la politique, la discipline de soutien au Premier ministre est extrêmement forte, celui-ci étant d'ailleurs le chef de la majorité parlementaire. Je ne dis pas qu'il est l'émanation de la majorité parlementaire, mais une fois qu'il est Premier ministre, c'est lui qui a l'autorité et, ensuite, la majorité suit. Il ne faut donc pas idéaliser un système ou un autre.
En tout cas, je pense que Guy Carcassonne a raison sur ce point : il faut sans doute un rééquilibrage et incontestablement une modernisation parce que notre mode de fonctionnement parlementaire n'est plus adapté.
Quant à la fonction législative, il est certain que nous légiférons trop. Je suis parlementaire depuis vingt-deux ans et j'ai vu une accélération du nombre de lois. Nous n'avons même plus le temps de vérifier qu'elles sont applicables et nous n'avons même pas les textes d'application que l'ont refait une loi sur une loi. Ces méthodes sont détestables et elles doivent être arrêtées.
Nous avons aussi bien souvent l'impression que les lois sont demandées par l'opinion publique. Si un journal excellent révèle un scandale, on va faire une nouvelle incrimination sans même se demander si l'incrimination n'existe pas déjà. Personne ne se pose la question. Si on ne fait pas de loi, on dira que le Parlement défend les méchants. On ne sait pas résister, même si nous le faisons un peu mieux au Sénat.
Par exemple, nous avons fait une loi parce que des enfants se noyaient dans les piscines alors qu'il suffisait de changer la norme NF ou de prendre un arrêté. Il en est de même pour les ascenseurs. Les réformes d'ensemble sont beaucoup plus difficiles à faire lorsque la législation se fait de cette façon.
Je pense quand même qu'il est bon de tenter de moins légiférer en prenant plus de temps pour le faire, car les parlementaires font d'énormes efforts pour s'informer en amont d'un avant-projet ou pour faire des missions d'information sur des sujets d'actualité qui vont un jour faire émerger une législation. Le Sénat a la caractéristique d'avoir beaucoup de missions d'information composées de la majorité et de l'opposition, ce qui est souvent extrêmement profitable. Nous l'avons expérimenté sur un certain nombre de sujets sans qu'il soit forcément nécessaire de modifier le règlement. On peut le faire si on est ouvert et si on pense que cela répond à l'intérêt supérieur du pays et à la nature des problèmes que l'on traite.
Le contrôle est indispensable, mais il ne s'agit pas du contrôle qui est fait parfaitement par les juridictions financières. Le contrôle de la Cour des comptes est une chose ; nous devons, pour notre part, assurer un contrôle des politiques publiques et, surtout, une évaluation de la législation. Dans la révision de 1995, il avait été créé deux offices : l'Office d'évaluation de la législation et l'Office d'évaluation des politiques publiques. Si j'ai bien compris certains propos, l'Assemblée voudrait ressusciter une chose qu'elle a tuée dans l'oeuf puisque c'était avec le Sénat et que cela ne pouvait donc pas fonctionner... L'Office d'évaluation de la législation, bon an mal an, a produit trois rapports, deux à l'initiative du Sénat et un à l'initiative de l'Assemblée nationale.
C'est sans doute l'évaluation préalable faite sur tout ce qui concernait les difficultés des entreprises qui a grandement contribué à une réforme importante qui a été votée en 2007 et qui a été un bouleversement des procédures. On a fait une procédure de sauvegarde en amont qui n'existait pas auparavant et qui donne des résultats. C'est parti d'une évaluation de la loi de 1985 sur les difficultés des entreprises. Il ne faut donc pas désespérer. Sur ces travaux de fond, il est vrai qu'en dehors des revues spécialisées et de quelques journaux économiques, cela ne fait pas une ligne ; cela n'intéresse pas les médias généralistes. Pourtant, il y a 300 000 règlements judiciaires ou liquidations judiciaires par an.
Nous faisons donc notre travail de législateur et je crois que tout ce qui pourra favoriser une meilleure pratique des gouvernements vis-à-vis du Parlement en l'obligeant à des délais sera bienvenu, car il n'y a rien de mieux que les délais pour réfléchir : on sait bien que, si on se précipite, on fait des bêtises. Il faut parfois réfléchir avant d'agir alors que certains agissent et réfléchissent après, ce qui est souvent redoutable. Tout ce qui va dans ce sens a été repris, certes avec des réductions et des éléments qui ont été rognés, mais nous ne sommes pas au bout de la procédure parlementaire et, si j'ai bien compris, la commission des lois de l'Assemblée nationale a déjà remis les délais qui ont été proposés par votre comité, M. le Premier ministre.
La procédure parlementaire va donc se développer et j'espère que cette réforme, qui est importante, qui est une bonne occasion à condition qu'elle ne soit pas polluée par de nombreuses autres considérations intéressantes et qui mérite un débat sur d'autres sujets, permettra au Parlement d'être mieux apprécié, de mieux faire son travail et de ne pas décourager les parlementaires, parfois, devant l'inutilité de leur tâche.
M. Edouard BALLADUR, Président.-
Je vous remercie, M. le Président, de votre exposé. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à ce débat intéressant et difficile, parce qu'il n'y a pas de solution totalement évidente, sauf si on veut bien se référer à quelques principes de base.
Nous avons un système qui a fait la preuve qu'il était efficace. Il lui reste à faire la preuve qu'il est plus équitable au sens où il donne plus de place à chacun des acteurs de la vie publique. Le problème, c'est effectivement la modernisation et le rééquilibrage, qui est à la fois un instrument de cette modernisation et un moyen de moderniser. On peut discuter sur tel ou tel point les propositions qui sont faites, mais il me semble que l'esprit général mériterait de faire l'objet d'un accord très large.
Le Parlement est souverain, bien entendu. La commission des lois de l'Assemblée a déjà commencé à discuter, l'Assemblée va continuer et la commission des lois du Sénat va prendre ensuite le relais, de même que le Sénat dans son ensemble. Je souhaite que les partis, les groupes et le gouvernement arrivent à trouver une solution qui permette de donner à nos concitoyens un sentiment d'attachement au Parlement. J'entends dire souvent que cela n'intéresse pas les Français, qu'ils sont intéressés uniquement par le pouvoir d'achat, la sécurité routière et la lutte contre telle ou telle pandémie. Il n'empêche que, lorsqu'on les interroge sur la façon dont la politique fonctionne dans leur pays, ils ne sont pas satisfaits. Il faut donc croire que les institutions ne les laissent pas indifférents.
Par conséquent, si nous arrivons à instaurer une réforme institutionnelle qui leur permette de penser que le fait d'élire des parlementaires est plus important qu'ils ne le croient, parce qu'ils jouent un rôle plus important qu'ils le jouent actuellement dans l'élaboration de la règle de droit qui gouverne leur vie et encadre leurs comportements, je pense que nous aurons oeuvré pour rendre la démocratie plus solide dans notre pays. C'est l'effort que nous avons fait.
Maintenant, il appartient au souverain tel qu'il est représenté par le Parlement de dire s'il a envie que l'on accroisse ses pouvoirs ou non.
Je vous remercie.
La séance est levée à 18 h 40.
* 1 « Compte rendu de la réunion du groupe de travail du 27 juin 1958 », Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958 , volume 1, Des origines de la loi Constitutionnelle du 3 juin 1958 à l'avant-projet du 29 juillet 1958 , p. 292-293.
* 2 Dans les deux cas, l'année était plus courte que les deux années complètes réalisées par Debré.
* 3 Par exemple, lors de la discussion du budget de l'armée, pour « répondre à quelques orateurs et, en particulier, au président de la commission de la défense nationale et des forces armées », Michel Debré intervient longuement en lieu et place du ministre de la Défense. Il promet d'ailleurs aux députés l'organisation prochaine d'un débat sur la loi programme. Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances , Deuxième séance du 18 novembre 1959, p. 2567-2570.
* 4 Pour l'année 1961, on obtient des proportions tout à fait comparables : 4 interventions liées aux déclarations générales du gouvernement et allocutions diverses ; 1 intervention liée aux débats sur les motions de censure ; 3 réponses à des questions orales et 13 interventions de confection législative.
* 5 La moyenne annuelle des interventions des premiers ministres était de 15 au cours de la première décennie du régime entre 1959 et 1968 ; elle est passée à 6 dans la dernière période 1996-2005.
* 6 Si l'on prend en compte le nombre de pages du Journal Officiel correspondant aux interventions des premiers ministres, on obtient les résultats suivants : 108 pages en 1959, 111 en 1960 et 66 en 1961 pour Michel Debré ; 45 pages en 1963, 32 en 1964, 38 en 1965, 32 en 1966 et 44 en 1967 pour Georges Pompidou. A titre d'exemples ; on peut compter 25 pages pour Chaban en 1970, 32 pour Messmer en 1973, 29 pour Chirac en 1975, 52 pour Barre en 1979, 60 pour Mauroy en 1981, 17 pour Fabius en 1985, 27 pour Rocard en 1989, 15 pour Balladur en 1994, 30 pour Jospin entre octobre 1998 et septembre 1999, 36 pour Raffarin d'octobre 2002 à septembre 2003.
* 7 D'où le rôle-clef joué par le secrétaire d'Etat ou le ministre des relations avec le Parlement.
* 8 On compte encore 14 auditions pour Michel Debré (4 en 1959, 8 en 1960 et 2 en 1961). Pompidou se présente 5 fois devant les commissions de 1962 à 1968 (1 fois en 1963 et 1964, 2 fois en 1965, 1 fois en 1967). Ensuite, on ne compte plus que 16 auditions entre 1968 et 1995 qui se répartissent de la manière suivante : Chaban (1 fois), Chirac (1 fois), Barre (4 fois), Mauroy (5 fois dont 4 pour la seule année 1981), Rocard (2 fois), Cresson (1 fois), Balladur (1 fois), Juppé (1 fois). On ne compte plus aucune audition depuis 1995.







