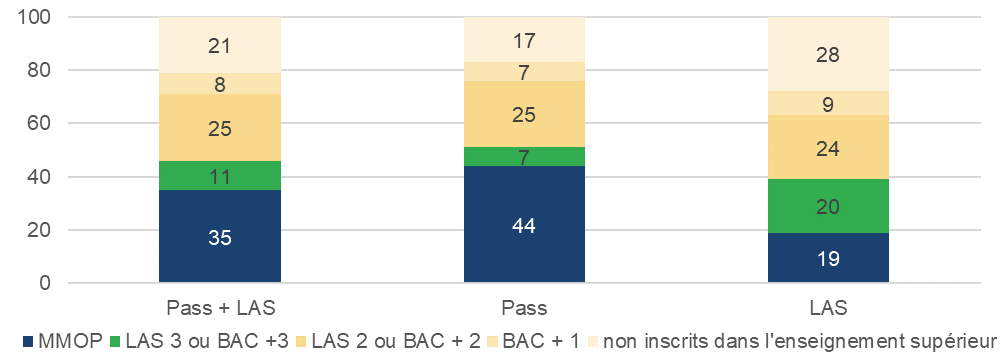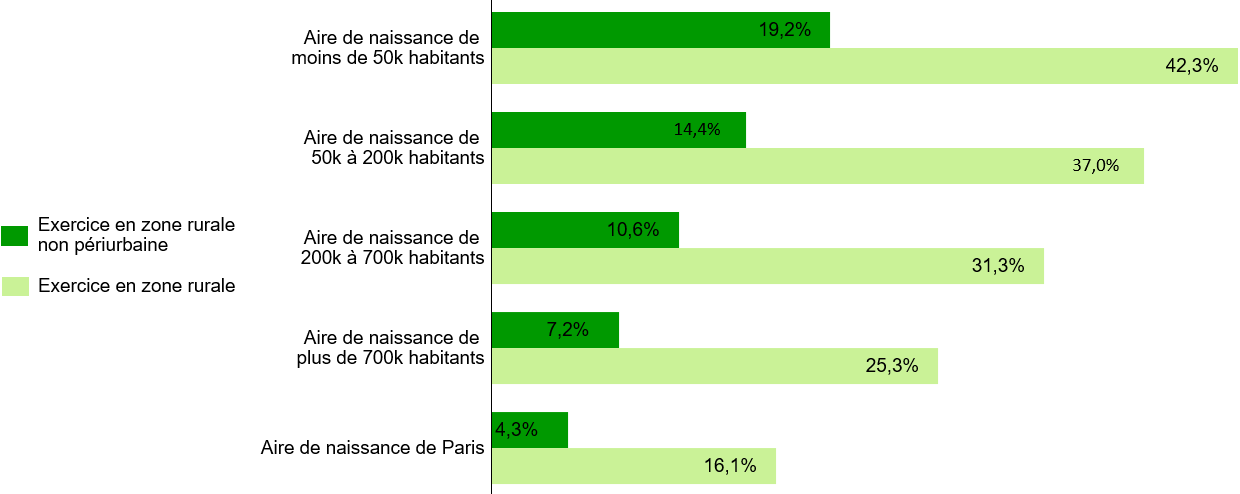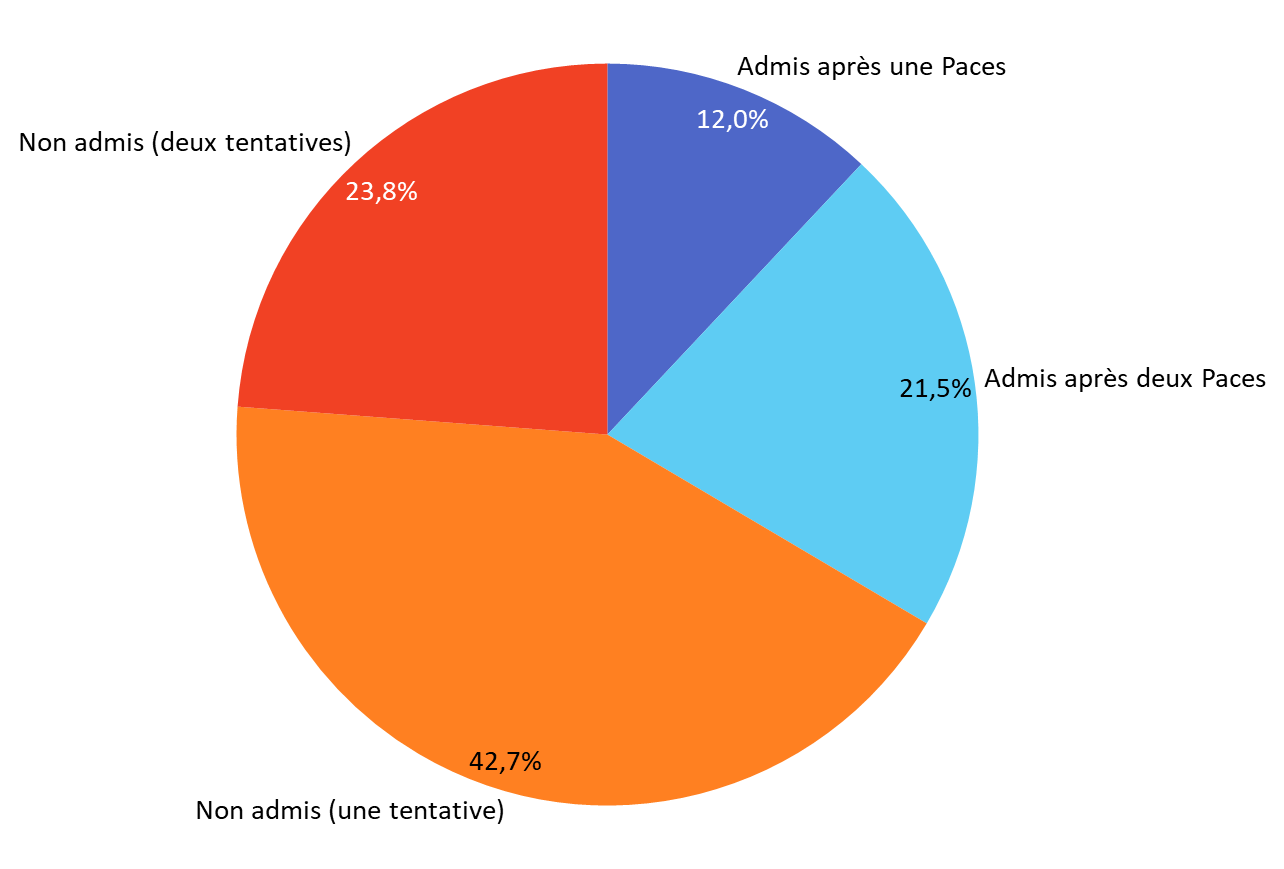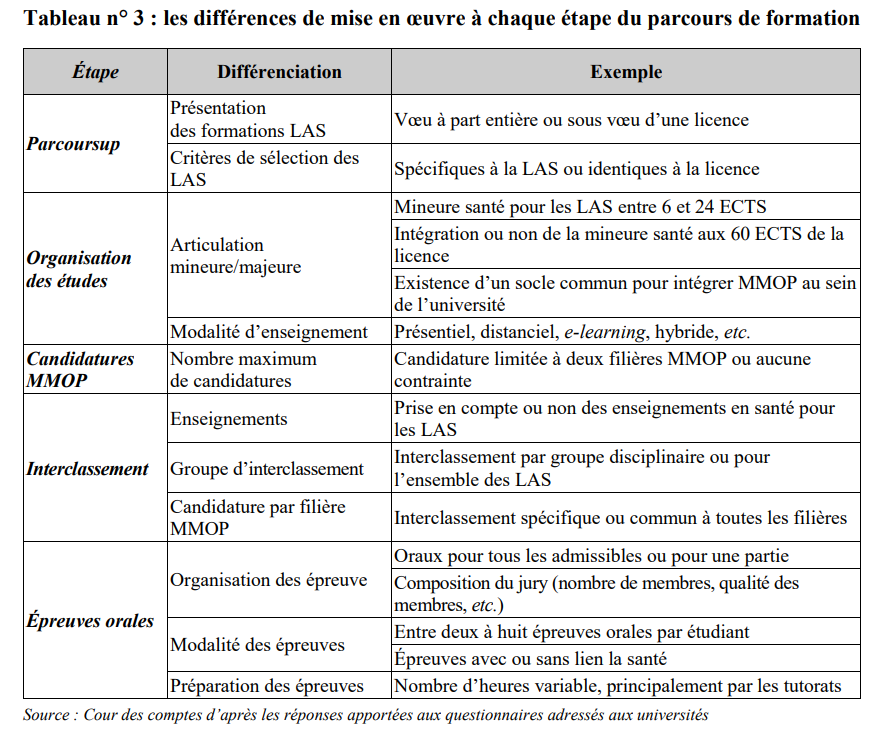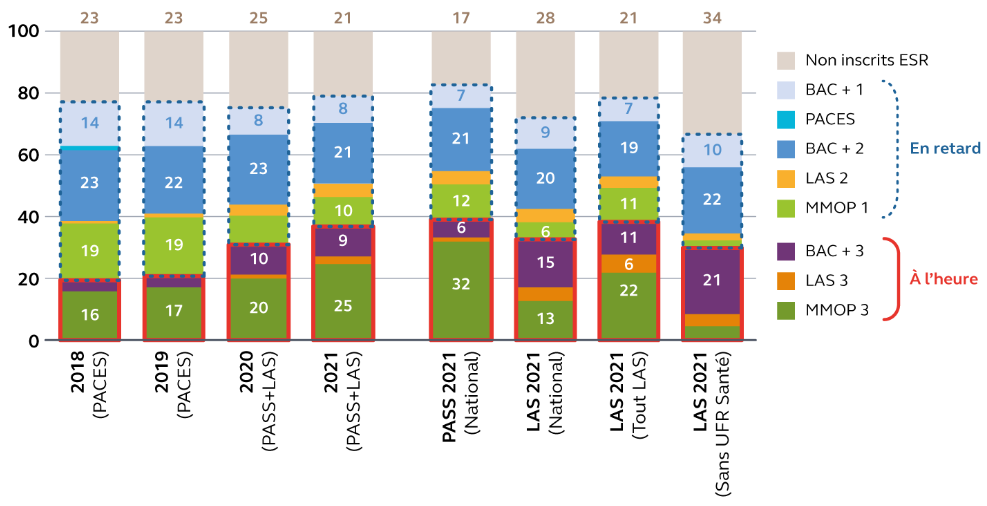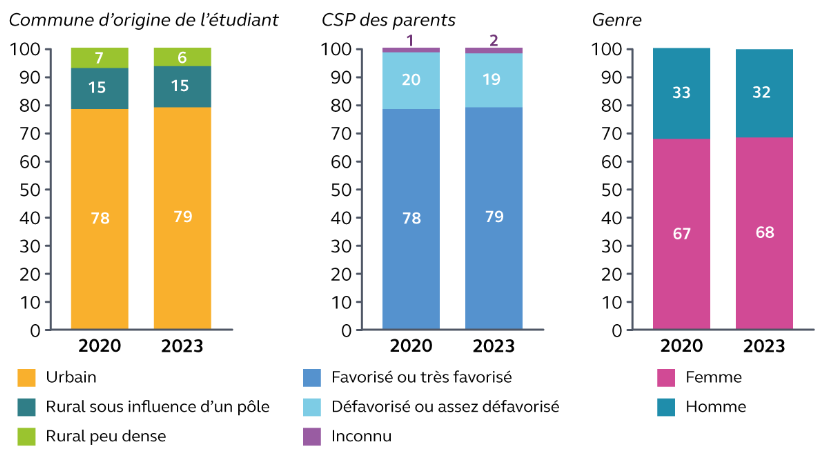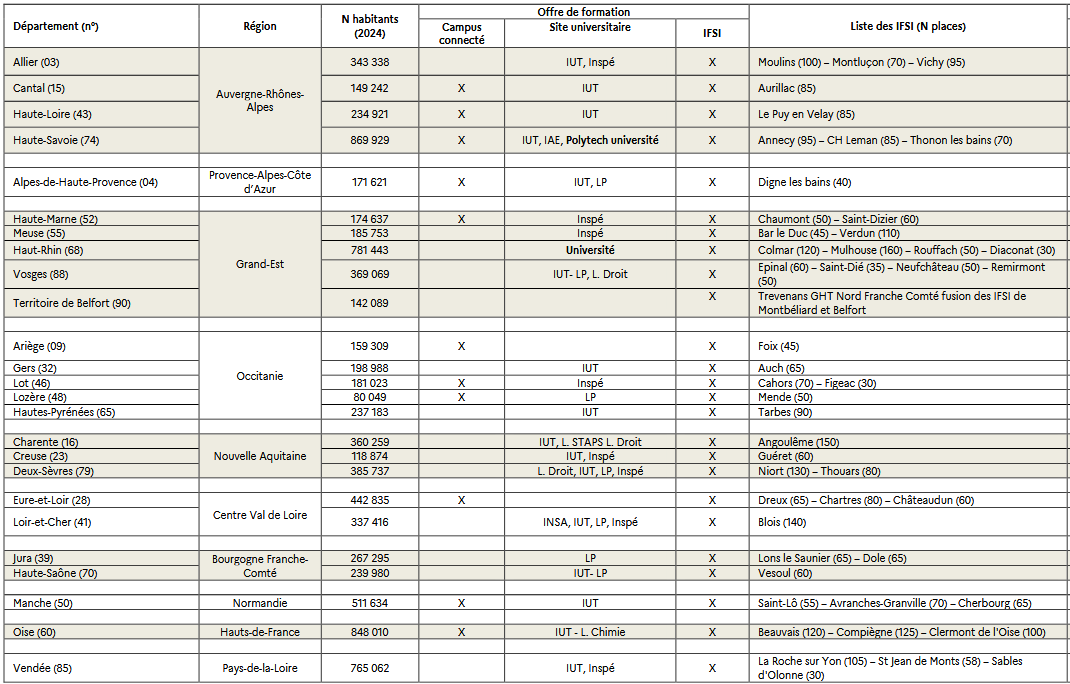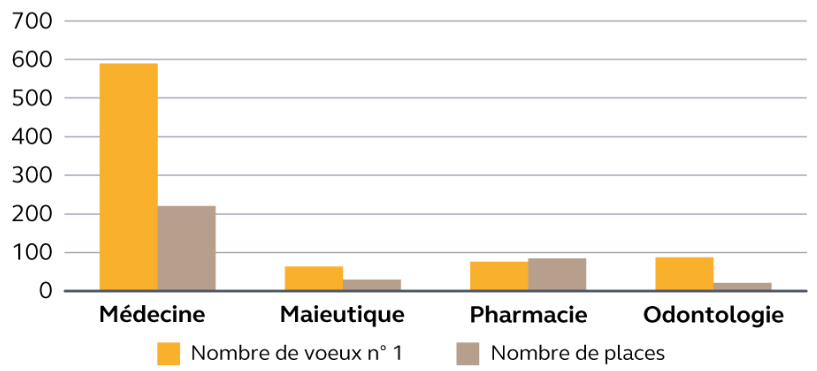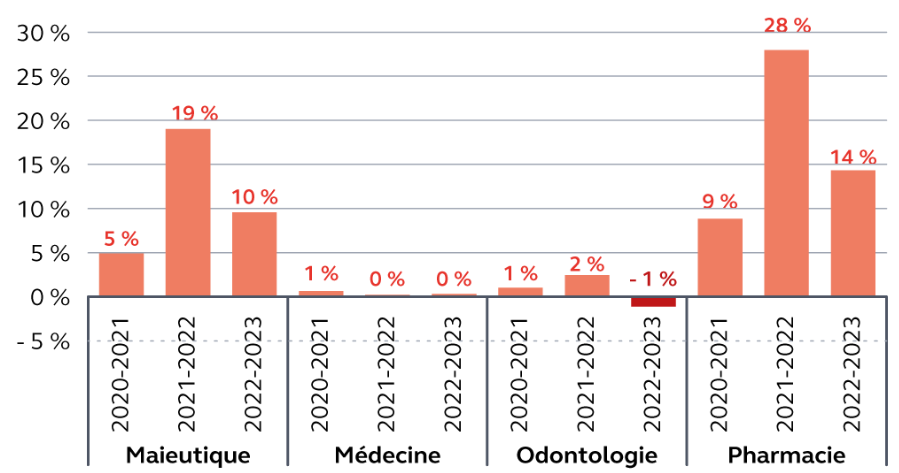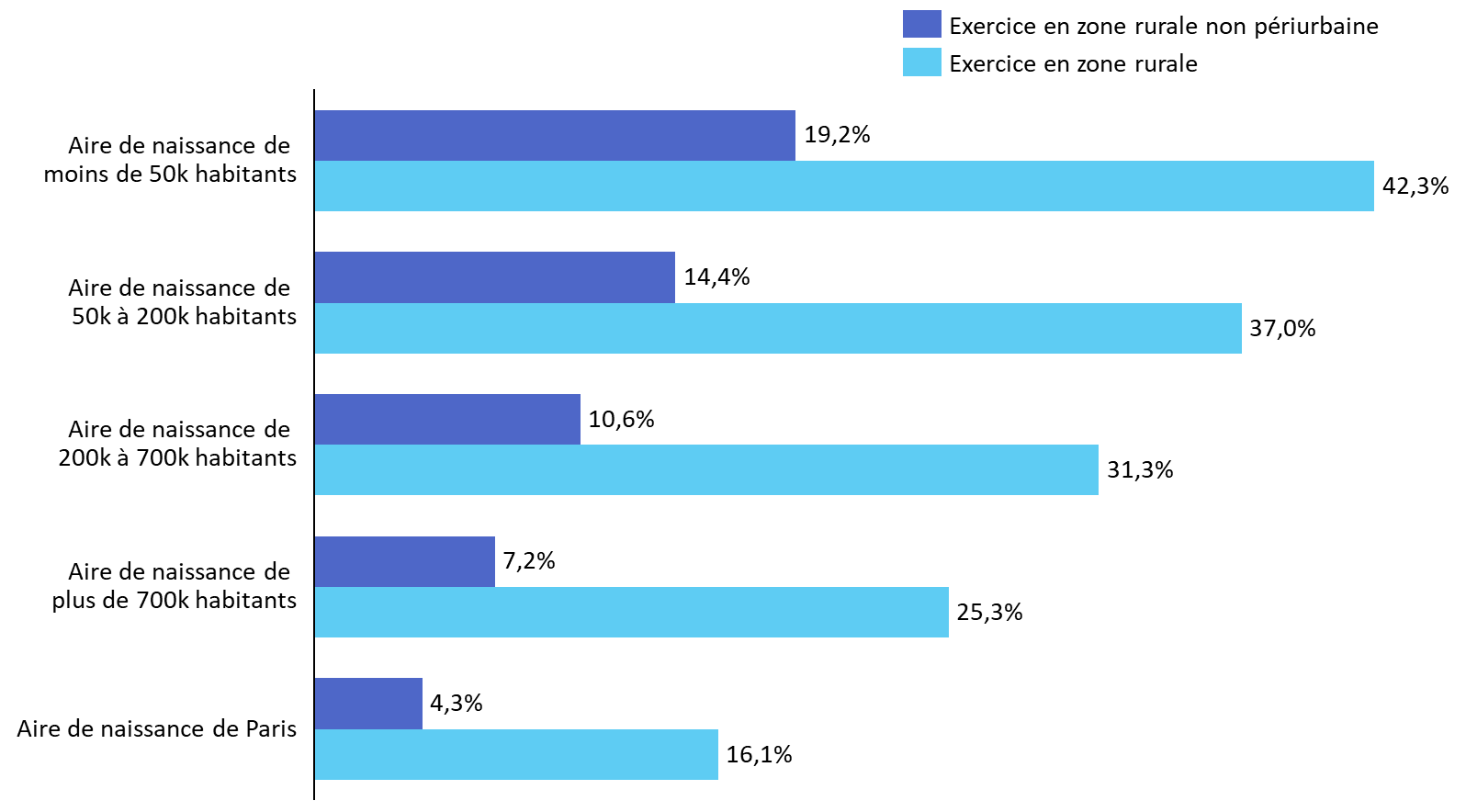- L'ESSENTIEL
- EXAMEN DES ARTICLES
- CHAPITRE IER
AMÉLIORER L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ
ET DIVERSIFIER LE RECRUTEMENT
- CHAPITRE II
TERRITORIALISER LE TROISIÈME CYCLE
DES ÉTUDES DE MÉDECINE
- CHAPITRE III
AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS EN STAGE
- GAGE FINANCIER
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITE
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 35
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
la proposition de loi
relative aux formations en
santé,
Par M. Khalifé KHALIFÉ et Mme Véronique GUILLOTIN,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
868 (2024-2025), 30 et 36 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
___________
Les modalités d'accès et d'organisation des études de santé revêtent une importance cruciale pour l'accès aux soins comme pour la réussite étudiante sur l'ensemble du territoire.
La présente proposition de loi entend apporter des réponses concrètes aux dysfonctionnements et difficultés du système actuel.
Elle a été largement soutenue par la commission.
I. AMÉLIORER L'ACCÈS AU PREMIER CYCLE DES ÉTUDES DE SANTÉ
A. REVOIR LES CONDITIONS D'ACCÈS
L'accès aux études de santé repose, depuis 2019, sur un dispositif Pass (parcours d'accès spécifique santé, structuré autour d'une majeure santé et d'une mineure disciplinaire) - LAS (licence accès santé, structuré autour d'une majeure disciplinaire et d'une mineure santé), largement critiqué pour l'hétérogénéité de son déploiement et pour l'illisibilité de l'offre existante. De nombreux paramètres varient d'une université à l'autre :
• voies d'accès offertes : 29 universités font coexister Pass et LAS, 7 ont un modèle « tout LAS », certaines universités sans unités de formation et de recherche (UFR) santé proposent des LAS avec des universités en disposant ;
• disciplines universitaires proposées : 230 Pass différents coexistent en France ;
• organisation des études : articulation majeure / mineure, nombre de crédits ECTS (european credits transfer system) associés, enseignements en présentiel, distanciel ou hybride ;
• nombre maximal de candidatures aux filières de médecine, maïeutique, odontologique et pharmacie (MMOP) : parfois une candidature limitée à deux filières, parfois pas de contraintes ;
• modalités d'interclassement des étudiants en LAS ;
• nombre et types d'épreuves orales.
Les objectifs assignés à la réforme sont très peu atteints. Deux tiers des étudiants échouent à intégrer les filières MMOP et les étudiants en LAS réussissent globalement moins bien. La progression dans les études n'a été que légèrement renforcée : deux ans après leur première année d'accès aux études de santé, 64 % des étudiants ont perdu une année d'études. Plus inquiétant, 79 % des étudiants ne poursuivant pas en MMOP se réorientent dans une discipline autre que celle suivie pendant leur Pass ou leur LAS.
Situation des bacheliers 2021 deux ans après leur première année d'accès santé
Source : commission des affaires sociales, d'après des données de la Cour des comptes
En conséquence, l'article 1er refond le dispositif Pass-LAS en une voie unique d'accès, mieux encadrée au niveau national, et intégrant explicitement la masso-kinésithérapie, dont deux tiers des étudiants sont d'ores et déjà issus de Pass ou de LAS. La formation, articulée autour d'une licence universitaire, comportera, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé.
Soucieuse d'apporter davantage de lisibilité aux lycéens et à leurs familles, de répondre à leur souhait d'accéder à des études cohérentes avec leur projet professionnel et de lutter contre les inégalités observées entre les étudiants, la commission a soutenu la mise en place de cette voie unique d'accès aux études de santé. Elle a, toutefois, souhaité laisser aux acteurs le temps nécessaire pour favoriser la réussite de cette réforme, en prévoyant qu'elle entrerait en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, à la rentrée universitaire 2027.
Par ailleurs, la commission est consciente de la mise en concurrence des filières mais aussi des phénomènes d'évitement que peut engendrer l'organisation d'une première année commune fortement sélective. Ainsi, les cursus de pharmacie souffrent de places laissées vacantes (environ 200 à la rentrée 2024), dans un contexte désormais bien documenté de diminution du nombre de pharmacies d'officine (moins 1 800 entre 2012 et 2022).
Elle a, en conséquence, favorablement accueilli l'article 2 qui permet l'expérimentation, souhaitée par les doyens et pharmaciens, d'un accès direct à la filière. Celui-ci permettra de recruter, directement via Parcoursup, des lycéens motivés par la discipline.
B. FAVORISER LA DIVERSIFICATION DU RECRUTEMENT
À rebours des objectifs de la réforme de 2019, les profils recrutés dans les filières MMOP demeurent très homogènes socialement et géographiquement : seuls 21 % des étudiants admis sont issus d'une commune rurale (6 % d'une commune rurale peu dense) et 19 % sont issus de milieux défavorisés ou assez défavorisés, des proportions inférieures d'un point à celles observées avant la réforme.
Les étudiants des départements ruraux sont moins susceptibles d'accéder aux filières MMOP alors que 25 départements demeurent dépourvus de première année d'accès aux études de santé et que le suivi d'études hors de leur département d'origine implique des coûts financiers et des contraintes logistiques significatifs.
Outre un enjeu d'égalité des chances, la diversification géographique du recrutement constitue un puissant outil de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins, l'influence de l'origine géographique sur les choix d'installation étant largement documentée. Ainsi, selon l'Insee, la moitié des médecins généralistes formés dans les années 2000 exerce à moins de 85 kilomètres de sa commune de naissance.
Proportion de médecins exerçant en
zone rurale en 2019,
selon le type d'aire où ils sont
nés
Source : commission des affaires sociales, d'après des données Insee (2024)
Au vu de ces éléments, l'article 1er prévoit l'organisation, dans chaque département d'une première année d'accès aux études de santé. La commission a soutenu cette mesure, de nature à permettre à des bacheliers éloignés des grandes villes universitaires d'accéder à des filières vers lesquelles ils ne s'orientent pas spontanément ou auxquelles ils renoncent pour des raisons matérielles, logistiques et financières.
Afin de favoriser la mise en place de formations délocalisées de qualité, la commission a adopté un amendement reportant la pleine application de cette obligation à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, à la rentrée 2030. Elle souhaite également que le Gouvernement accompagne activement le déploiement de ces formations et veille à la réussite des étudiants concernés. À cet effet, elle a amendé l'article 1er pour prévoir que les universités transmettent chaque année aux ministres concernés un bilan de la réussite des étudiants dans chaque département.
Enfin, dans la même logique de diversification du recrutement, l'article 3 étend l'expérimentation des options santé dans les lycéens à l'ensemble du territoire national et précise leurs objectifs. La commission soutient cette mesure, comme toutes celles de nature à mieux faire connaître les études de santé et à y favoriser l'orientation et la réussite de lycéens plus divers. Elle encourage également le développement des tutorats organisés par les étudiants et écarte toute promotion des structures de préparation privée.
II. SÉCURISER LES CONDITIONS D'ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE ET LES CONDITIONS DE STAGE
A. ADAPTER L'ORGANISATION DU TROISIÈME CYCLE DE MÉDECINE AUX BESOINS DE SANTÉ
Aujourd'hui, 50 % des étudiants de deuxième cycle de médecine quittent leur région, soit par choix, soit par défaut, faute de places disponibles ou d'un rang de classement suffisant pour obtenir la spécialité de leur choix dans leur région d'origine.
Or le lieu d'internat figure parmi les principaux déterminants du choix du lieu d'exercice : 72 % des médecins généralistes et 69 % des médecins des autres spécialités s'installent là où ils ont suivi leur troisième cycle de formation. Il constitue donc un outil efficace de réduction des inégalités territoriales d'accès aux soins.
De plus, la procédure actuelle de définition du nombre de postes d'internat et de leur répartition territoriale est critiquée par certains acteurs qui se jugent insuffisamment consultés et déplorent l'insuffisante prise en compte des besoins de santé du territoire.
Se fondant sur ces constats, l'article 4 hiérarchise les critères de répartition des postes d'internat dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins de santé et territorialise partiellement le troisième cycle de médecine. Il instaure, à cet effet, un objectif national de deux tiers d'étudiants accédant au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé leur deuxième cycle. La commission a soutenu ces dispositions, jugeant que celles-ci permettraient de mieux répondre aux besoins de santé des territoires tout en préservant la liberté d'installation des médecins. Elle a jugé que le dispositif permettrait au Gouvernement de définir, en concertation avec les principales parties prenantes, des modalités d'affectation des internes favorisant leur fidélisation à un territoire sans renoncer à l'excellence médicale ni interdire la mobilité étudiante. Elle a souhaité, enfin, laisser au Gouvernement le temps nécessaire pour conduire cette concertation en reportant à la rentrée 2027 l'entrée en vigueur de cette mesure.
Par ailleurs, pour faciliter l'entrée en vigueur de la réforme du troisième cycle de médecine générale, l'article 6 permet, à titre transitoire, l'accueil de docteurs juniors par des médecins généralistes accueillants non encore agréés. La commission est favorable à cette mesure qui facilitera l'accueil de docteurs juniors en stage, en ambulatoire, dans les zones sous-denses, qui ne disposent pas aujourd'hui de suffisamment de maître de stages agréés.
L'article 6 prévoyait également que les docteurs juniors en médecine générale suivent, lors de leur quatrième année d'internat, la formation nécessaire à l'agrément à la maîtrise de stage. Pour tenir compte du fait que tous les étudiants concernés n'entendent pas s'installer dès l'obtention de leur diplôme, ni accueillir immédiatement des stagiaires, la commission a amendé ces dispositions pour offrir aux étudiants cette possibilité, sans en faire une obligation.
B. AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL EN STAGE
Les statuts applicables aux maîtres de stages universitaires (MSU) sont aujourd'hui fortement hétérogènes d'une filière à l'autre. En médecine, le statut prévoit une formation préalable, un agrément et une rémunération. En odontologie et en pharmacie, aucune formation n'est explicitement prévue et le praticien agréé ne perçoit pas de rémunération. Enfin, en maïeutique, le décret nécessaire à l'application du statut n'a jamais été publié alors même que deux tiers des sages-femmes libérales accueillent des étudiants en stage.
Afin de remédier à ces inégalités que rien ne justifie, l'article 5 consacre, au niveau législatif, quatre statuts homogènes pour les MSU en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Afin de garantir des conditions d'accueil en stage de qualité aux étudiants des filières MMOP et de fournir aux professionnels les accueillant une juste reconnaissance, ces statuts s'articulent autour d'une formation obligatoire, d'un agrément et d'une rémunération.
La commission a favorablement accueilli cette harmonisation, et constaté que celle-ci bénéficiait d'un soutien unanime de la part des acteurs entendus.
Réunie le mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence de Pascale Gruny, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi modifiée par 9 amendements.
EXAMEN DES ARTICLES
___________
CHAPITRE
IER
AMÉLIORER L'ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ
ET
DIVERSIFIER LE RECRUTEMENT
Article 1er
Instauration d'une voie unique d'accès aux
études de santé
Cet article vise à refondre le dispositif « Pass-LAS » en une voie d'accès unique aux études de santé, consistant en une licence universitaire qui comprendrait, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Il renforce l'encadrement national applicable au dispositif d'accès en prévoyant, notamment, qu'un arrêté devra fixer une liste de disciplines universitaires pouvant être enseignées dans la licence. Il inclut également explicitement les formations en masso-kinésithérapie dans le périmètre de cette voie d'accès. Enfin, l'article prévoit l'organisation par les universités d'une première année de cette voie unique dans chaque département.
La commission a adopté cet article modifié par trois amendements.
I - Le dispositif proposé
A. La réforme de l'accès aux études de santé de 2019 n'a pas atteint les objectifs assignés
1. Le dispositif d'accès aux études de santé a été profondément réformé en 2019
a) Le contexte de la réforme de 2019
Portée par la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) de 20191(*) et par un décret de la même année2(*), la réforme de l'accès aux études de santé a profondément renouvelé les modalités d'accès aux filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie (MMOP).
La réforme était motivée par les limites de la première année commune aux études de santé (Paces), observées depuis son instauration en 2010 :
- un taux d'échec des étudiants important - plus de deux sur trois, deux ans après leur première inscription en Paces ;
- une absence de valorisation des connaissances acquises après, le plus souvent, deux années d'échec obligeant les étudiants à « reprendre depuis le début » ;
- un profil stéréotypé des candidats : celui d'un étudiant titulaire d'un bac « S » mention très bien, originaire d'une grande métropole et issu d'un milieu social favorisé.
Le Gouvernement relevait ainsi que, sur 1 000 étudiants nouvellement inscrits en Paces en 2015-2016, 12 % intégraient les filières MMOP dès la première tentative, 21 % les intégraient après une seconde année de Paces et 67 % échouaient3(*).
Devenir des étudiants en Paces deux ans
après
leur première inscription en 2015-2016
Source : commission des affaires sociales, d'après les données publiées par le ministère de l'enseignement supérieur
En conséquence, la réforme poursuivait trois grands objectifs, rappelés dans l'étude d'impact jointe par le Gouvernement au projet de loi4(*) :
- améliorer la réussite et le bien-être des étudiants en favorisant leur progression dans les parcours d'études ;
- diversifier le profil des étudiants recrutés d'un point de vue académique, géographique et social, par la diversification des voies d'accès ;
- favoriser les passerelles entre les filières de santé, jugées excessivement hermétiques.
b) Le dispositif d'accès mis en place
• La loi et le décret de 2019 ont substitué à la Paces trois modalités d'accès communes aux filières MMOP.
D'abord, un parcours d'accès spécifique santé (Pass), organisé par les unités de formation et de recherche (UFR) en santé dans les universités en disposant. Le Pass prend la forme d'une formation d'un an, accessible directement après le baccalauréat et structurée autour d'une majeure en santé et d'une mineure dans une autre discipline. Il permet de se présenter une fois à l'accès aux filières MMOP.
Ensuite, la licence accès santé (LAS), accessible directement après le baccalauréat (LAS 1) ou après une année de Pass (LAS 2). Pilotée par une composante hors santé, elle est structurée, à l'inverse, autour d'une majeure disciplinaire et d'une mineure en santé. Elle permet de se présenter aux épreuves de sélection des filières MMOP sur la base des notes et rangs obtenus dans chaque licence et d'un interclassement.
Enfin, les épreuves de sélection aux filières MMOP sont ouvertes aux étudiants des formations d'auxiliaire médical d'une durée minimale de trois ans.
Les universités dispensant des formations MMOP doivent proposer, pour chaque filière, un accès par au moins deux voies, dont au moins une LAS5(*).
Une admission en deuxième ou troisième année de premier cycle demeure, par ailleurs, possible, par voie de « passerelle », pour les titulaires de certains grades, titres ou diplômes listés par arrêté6(*). Permettent, notamment, une telle admission : les diplômes conférant le grade de master, les diplômes d'État des filières MMOP ou de docteur vétérinaire, le titre d'ingénieur diplômé, la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ou l'appartenance aux corps des enseignants-chercheurs7(*).
• Les modalités d'organisation des Pass et des LAS sont encadrées par voie réglementaire.
Les étudiants ne validant pas leur Pass ou leur LAS 1 peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits en LAS 1, demander un redoublement au sein de la mention de licence correspondante, sans possibilité de suivre les enseignements du domaine de la santé ni de déposer une candidature pour l'accès aux filières MMOP. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d'études peut être effectuée en LAS 28(*).
Sauf dérogation exceptionnelle, tout candidat ne peut présenter que deux fois sa candidature pour une admission dans les formations MMOP. L'inscription en Pass épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait été ou non en mesure de la présenter9(*).
Enfin, le nombre de places offertes est réparti entre les parcours de formation de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée par les universités et encadrée par un arrêté, prévoyant notamment que :
- 30 % des places au moins sont réservées, d'une part, à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS et, d'autre part, à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS ;
- 50 % des places au plus peuvent être attribuées à des étudiants inscrits en Pass ou au sein d'une même formation de LAS ;
- au moins 5 % des places sont réservées aux passerelles10(*).
• Toutefois, l'encadrement national demeure relativement permissif et accorde aux universités une grande liberté dans la définition des modalités d'évaluation des candidats aux filières MMOP.
Bien que renforcé11(*) à la suite d'une décision du Conseil d'État, qui a jugé illégales, en 2023, des dispositions réglementaires qui laissaient entièrement aux universités le soin de déterminer les modalités selon lesquelles chaque épreuve était prise en compte dans les résultats d'admission12(*), le cadrage national prévoit seulement :
- l'existence de deux groupes d'épreuves, écrites pour le premier et orales pour le second, définis par les universités ;
- la possibilité d'admettre, dès l'issue du premier groupe d'épreuves, un contingent de candidats ne pouvant excéder un pourcentage du total des places proposées fixé par arrêté à 50 %13(*) ;
- que le second groupe comprend entre deux et quatre épreuves orales, correspondant à 30 % de la note globale, une variation de cette pondération pouvant être prévue par les universités dans la limite de 5 points ;
- que lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir l'ensemble des places disponibles, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus14(*).
2. Les principales critiques adressées au dispositif d'accès
a) L'hétérogénéité observée dans le déploiement du dispositif et l'illisibilité de l'offre existante
Dès le début du déploiement de la réforme, le Sénat avait identifié d'importants dysfonctionnements. Deux rapports de Sonia de la Provôté, au nom de la commission de la culture, en 2021 puis 202215(*), ont pointé de très grandes disparités selon les universités, ainsi qu'une communication et une transparence insuffisantes de la part de certaines d'entre elles.
Quatre ans après la réforme, dans une enquête réalisée à la demande de la commission des affaires sociales, la Cour des comptes relève toujours une très grande hétérogénéité, qui nuit à la lisibilité du dispositif. Il y aurait, selon elle, « autant de déclinaisons de la réforme que d'universités »16(*).
• Cette hétérogénéité se manifeste, d'abord, dans la diversité des modèles retenus localement.
Les voies d'accès offertes varient, d'abord, grandement d'une université à l'autre.
La loi permet l'organisation de LAS dans les universités ne disposant pas d'une UFR en santé, grâce à des partenariats avec les universités en disposant. Si cette organisation permet une meilleure répartition territoriale de l'offre de formation - dans 75 % des départements, au moins une voie d'accès est disponible -, des difficultés sont parfois constatées. L'intersyndicale nationale des internes (Isni) déplore, ainsi, les contraintes logistiques que cela génère parfois pour les étudiants concernés : décalage des dates de rentrée, organisation administrative complexe, etc.
Par ailleurs, parmi les 36 universités avec UFR santé, 29 ont fait le choix de faire coexister Pass et LAS et 7 ont choisi un modèle « tout LAS ». Certaines de ces universités ont, du reste, fait le choix d'ouvrir une LAS « science pour la santé », proposant des mineures hors santé en partenariat avec d'autres UFR.
Cette hétérogénéité est particulièrement prégnante pour l'accès aux études de masso-kinésithérapie. Chaque institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) peut être accessible à l'issue d'une année de Pass, d'une année de LAS, ou d'une année de licence relevant du domaine « biologie, sciences et techniques » ou de la mention « sciences et techniques des activités physiques ou sportives » (Staps). Les modalités de sélection sont susceptibles de varier d'une université à l'autre et d'un IFMK à l'autre. En conséquence, les universités ont l'obligation d'indiquer, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès aux études de masso-kinésithérapie17(*) et le ministère recommande aux étudiants de vérifier systématiquement cette possibilité avant toute inscription.
• La réforme laisse, par ailleurs, de grandes marges d'adaptation aux universités dans l'organisation du parcours de formation et de la sélection à l'entrée des filières MMOP.
La Cour des comptes relève ainsi une dizaine d'éléments différenciants entre universités, parfois structurels dans le parcours ou la sélection18(*) :
- la mineure santé, pour les LAS, peut représenter entre 6 et 24 crédits ECTS (european credits transfer system) et peut être, ou non, intégrée aux 60 ECTS de la licence ;
- les enseignements peuvent avoir lieu en présentiel, en distanciel, ou être organisés de manière hybride ;
- le nombre de candidatures peut être limité à deux filières ou non ;
- les modalités d'interclassement des étudiants en LAS peuvent ou non prendre en compte les enseignements en santé, peuvent être spécifiques à une filière ou communs à l'ensemble des filières MMOP, peuvent consister à comparer des groupes disciplinaires ou l'ensemble des LAS organisées par l'université ;
- les oraux peuvent être imposés à l'ensemble des admissibles ou à une partie d'entre eux, les épreuves peuvent avoir ou non un lien avec la santé, leur nombre varier d'une université à l'autre, etc.
Les différences de mise en oeuvre du
dispositif d'accès à chaque étape
du parcours de
formation
Source : Cour des comptes (2024)
• Enfin, une très grande hétérogénéité est observée sur le territoire national dans le choix des disciplines universitaires proposées aux étudiants.
Selon la Cour des comptes, 103 possibilités de parcours Pass et LAS seraient, ainsi, disponibles en Île-de-France et 230 Pass différents coexisteraient en France19(*).
• La forte hétérogénéité des déclinaisons de la réforme selon les universités et les territoires apparaît très difficilement lisible pour les lycéens et leurs familles.
Elle conduit également à un phénomène de fuite vers des universités étrangères, réel bien que difficile à quantifier : 5 000 étudiants français suivraient un cursus en médecine dans d'autres pays de l'Union européenne - principalement Espagne, Roumanie et Belgique20(*) - et 3 600 étudiants feraient de même en masso-kinésithérapie21(*). La moitié des chirurgiens-dentistes s'inscrivant à l'ordre ont un diplôme étranger, sans précision sur la proportion de diplômés de nationalité française22(*). Les filières de maïeutique et de pharmacie semblent aussi concernées, sans chiffres officiels cependant.
b) Les principaux objectifs assignés à la réforme n'ont pas été atteints
Les objectifs assignés à la réforme - amélioration de la réussite étudiante, diversification des profils recrutés, renforcement des passerelles - apparaissent, cinq ans après l'entrée en vigueur de la réforme, très peu atteints.
• La réussite des candidats et leur progression dans leur parcours d'études n'ont que très peu été améliorées.
Les étudiants en LAS semblent, globalement, moins bien réussir. Parmi les étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat, ceux inscrits en LAS 1 ont un taux d'accès en MMOP de 31 % contre 60 % pour ceux inscrits en Pass. Par ailleurs, les LAS 1 redoublent plus souvent la deuxième année que les Pass : en 2021, dans les universités proposant les deux voies d'accès, le taux de redoublement des étudiants issus d'un Pass était de 3 % en médecine contre 18 % pour ceux issus d'une LAS 1.
La progression dans les études n'apparaît, en outre, que très légèrement renforcée. D'après la Cour des comptes, deux ans après leur première année d'accès aux études de santé, 63 % des étudiants ont perdu une année d'études contre 79 % avant la réforme. Parmi les étudiants ne poursuivant pas en MMOP, 79 % se réorientent dans une discipline autre que celle suivie pendant leur Pass ou leur LAS, à rebours des objectifs de la réforme23(*).
Situation des nouveaux bacheliers deux ans après leur première année d'accès santé, en fonction de l'année de leur baccalauréat
Source : Cour des comptes (2024)
Lecture : La part des étudiants qui n'a pas perdu une année (mention « à l'heure » sur le graphique) s'améliore en passant de 21 % en 2019 à 37 % pour les bacheliers de 2021. Les PASS permettent un meilleur accès à MMOP que les LAS puisque 44 % des étudiants sont en MMOP deux ans après leur baccalauréat contre 19 % des LAS.
• Aucune diversification n'est, par ailleurs, observée dans les profils recrutés dans les filières MMOP.
La réforme a, au contraire, fait apparaître de nouvelles inégalités de réussite entre étudiants, selon le parcours et la discipline choisis. Les étudiants en Pass ou ceux inscrits en LAS 2 ou LAS 3 mais ayant été précédemment inscrits dans un Pass réussissent mieux : ils représentent, d'après la Cour, 62 % des étudiants inscrits en MMOP. Après exclusion des universités ayant choisi un modèle « tout LAS », cette proportion s'élèverait même à 75 %24(*). D'importantes inégalités sont également observées au sein d'un même parcours, à l'échelle nationale : en 2022, seuls 5 % des étudiants inscrits en LAS 1 en droit ont été admis, contre 24 % de ceux inscrits en LAS 1 en psychologie25(*). Enfin, les taux de réussite varient sensiblement d'une université à l'autre, les LAS organisées par des universités sans UFR en santé présentant les taux les plus bas, y compris à niveau scolaire équivalent.
En conséquence, la réforme n'a pas permis de maîtriser le recours aux établissements privés de préparation. Ceux-ci recruteraient désormais, d'après la Cour des comptes, dès le secondaire pour aider les étudiants dans leur orientation. Plus de 60 % des étudiants admis en MMOP y auraient recours. Des systèmes de tutorat ont été mis en place pour accompagner les élèves, mais ceux-ci demeurent très inégaux selon les universités.
Les tutorats : un dispositif d'accompagnement et d'orientation des étudiants à visibiliser
Les dispositifs d'accompagnement des étudiants en première année d'accès aux études de santé jouent un rôle central dans leur accession aux filières MMOPK, qui se caractérisent par une forte sélectivité, générant une pression importante chez les étudiants.
Depuis 1998, un arrêté encadre le tutorat d'accompagnement méthodologique et pédagogique26(*), consacré en 2007 par l'article L. 811-2 du code de l'éducation27(*). Les conditions d'organisation des tutorats sont définies par chaque établissement d'enseignement supérieur et ceux-ci évaluent annuellement leur fonctionnement28(*).
Formés par des enseignants, des étudiants de deuxième ou troisième cycle bénévoles réalisent un accompagnement pédagogique qui consiste en une aide à l'apprentissage et la dispensation de conseils méthodologiques, mais également en un suivi personnalisé pour le bien-être étudiant, notamment par le biais du parrainage. Ils se voient souvent déléguer la préparation des étudiants aux épreuves orales29(*). Ils participent aussi à l'information à l'orientation des lycéens en présentant les filières MMOPK aux journées portes ouvertes, aux salons d'orientation et dans les lycées.
Depuis 2017, le ministère chargé de l'enseignement supérieur soutient les tutorats des universités avec UFR en santé, en leur attribuant un agrément reconnaissant la qualité des services proposés. Son obtention incite les tutorats à mettre en place des innovations pédagogiques variées (reportages, podcasts, plateformes d'aide en ligne). Ce sont ainsi la totalité des 38 tutorats qui ont obtenu leur agrément en 202530(*).
Certaines associations étudiantes déplorent toutefois les contraintes logistiques et financières auxquelles les tutorats font face, ainsi que la réticence de certains rectorats et universités à faciliter leur fonctionnement et à les visibiliser31(*). En 2024, seuls 33 % des tutorats disposent d'un accès aux listes de diffusion rectorales, limitant de ce fait la portée de leur action32(*). Par ailleurs, si cet accompagnement concerne le Pass et la LAS, celui-ci est plus hétérogène dans le cadre des LAS, du fait de l'éloignement géographique entre certaines LAS et les campus des étudiants en filière MMOPK bénévoles33(*).
En dépit de ces perspectives d'amélioration, l'action des tutorats, à la fois efficace et peu onéreuse, contribue à renforcer l'égalité des chances dans l'accès aux études de santé et à diversifier les profils des étudiants, à rebours des organismes de préparation privés. Pour la rentrée 2024-2025, le tarif des tutorats était ainsi compris entre 14 € et 26 € (Pass et LAS confondus). Par comparaison, le tarif moyen d'inscription à un organisme de préparation privé est plus de 360 fois plus élevé34(*).
Contrairement aux objectifs affichés, la réforme n'aurait permis aucune amélioration de la diversité sociale ou géographique du recrutement. Selon la Cour des comptes, entre 2020 et 2023, la part des étudiants issus d'une commune rurale a légèrement diminué - de 22 % à 21 % - et celle des étudiants dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle assez défavorisée également - de 20 % à 19 %35(*).
Profil des étudiants admis en MMOP avant et après la réforme
Source : Cour des comptes (2024)
L'intersyndicale nationale des internes (ISNI) note également que « l'accès inégal aux différentes LAS sur le territoire a conduit certains étudiants à faire des choix stratégiques, plutôt que guidés par leurs réelles aspirations, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial de diversification des profils »36(*).
• Enfin, les passerelles demeurent une voie d'accès marginale aux études MMOP.
Le nombre d'étudiants des formations d'auxiliaire médical admis dans les filières MMOP demeure, d'abord, extrêmement faible. D'après la Cour des comptes, il variait, en 2022-2023, de 1 pour l'odontologie et la pharmacie à 12 pour la médecine. Dans cette dernière filière, il représentait environ 0,1 % des effectifs recrutés37(*). La Cour souligne ainsi que « la troisième voie apparaît comme la grande oubliée de la réforme » malgré l'importance d'un rapprochement des professionnels de soins, nécessaire à l'élan d'une pratique pluriprofessionnelle38(*).
Les passerelles dites « tardives », accessibles aux titulaires de certains grades, titres ou diplômes, représentaient une voie de recrutement plus importante, bien que fortement minoritaire. En médecine, 494 étudiants ont été recrutés par cette voie en 2022-2023, soit 5 % de la promotion39(*).
B. L'article 1er refond le dispositif d'accès aux études de santé en une voie unique, mieux encadrée au niveau national
L'article 1er vise à répondre aux principaux écueils de la réforme, en instaurant une voie unique d'accès aux études de santé, en améliorant la lisibilité du dispositif et en favorisant la diversification du recrutement.
1. L'instauration d'une voie unique d'accès
L'article 1er vise, d'abord, à refondre le dispositif Pass-LAS en une voie d'accès unique.
Pour ce faire, le d du 1° de l'article modifie l'article L. 631-1 du code de l'éducation, relatif aux formations en santé, pour prévoir que le parcours de formation antérieur auquel est subordonnée l'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations MMOP peut consister :
- soit en une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par une université et conduisant à un diplôme national de licence ;
- soit en une formation conduisant à un diplôme d'auxiliaire médical d'une durée minimale de trois ans.
L'article 1er vise, par ailleurs, à renforcer le cadrage national applicable au dispositif d'accès.
En ce sens, le g du 1° insère, dans le même article du code de l'éducation, des dispositions précisant que la formation du premier cycle devra comporter, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Les autres disciplines pouvant être enseignées devront, par ailleurs, être énumérées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le respect de critères favorisant la réussite des étudiants, fixés par décret en Conseil d'État.
Le b du 2° confie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les étudiants inscrits dans la licence permettant l'accès aux filières MMOP peuvent demander un redoublement.
2. L'inclusion de la masso-kinésithérapie
L'article 1er vise, en outre, à inclure explicitement la masso-kinésithérapie parmi les filières destinées à recruter des étudiants par la nouvelle voie d'accès unique aux études de santé.
Pour ce faire, il modifie l'article L. 631-1 du code de l'éducation pour préciser :
- que la formation en masso-kinésithérapie relève de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donne lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'État (a du 1°) ;
- que l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de masso-kinésithérapie est subordonnée à la validation des mêmes parcours de formation que ceux exigés pour intégrer les filières MMOP (c du 1° et a du 2°) ;
- que les passerelles tardives sont applicables aux formations de masso-kinésithérapie (e du 1°).
Comme pour les filières MMOP, l'article 1er confie à un décret en Conseil d'État le soin de définir :
- les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle (c du 2°) ;
- les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès au premier cycle (d du 2°).
En revanche, l'article 1er précise que les dispositions relatives au numerus apertus, qui définissent les modalités de fixation, par les universités, des capacités d'accueil en premier cycle, ne concernent que les filières MMOP, partiellement ou entièrement universitarisées (b du 1°).
3. Permettre un accès de proximité aux études de santé
Enfin, l'article 1er vise à permettre aux lycéens d'accéder aux études de santé par des formations organisées à proximité.
Pour cela, le f du 1° de l'article insère, à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des dispositions précisant que les modalités d'admission dans les filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de maso-kinésithérapie (MMOPK) doivent garantir un accès de proximité sur l'ensemble du territoire national.
Le g du 1° fait, par ailleurs, obligation aux universités d'organiser, dans chaque département, des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation de licence donnant accès aux filières MMOPK.
Le b du 2° confie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de cette obligation.
II - La position de la commission
· La commission est favorable à la mise en place d'une voie unique d'accès aux études de santé, commune aux filières de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de masso-kinésithérapie.
Les auditions conduites dans le cadre de la mission d'information sur l'accès aux études de santé ont démontré qu'une telle transformation du système Pass-LASS en une voie unique est largement attendue. Si elle bouleverse de nouveau, seulement cinq ans après la réforme, les modalités d'accès aux études de santé, elle correspond cependant à une demande de l'ensemble des acteurs concernés (étudiants, professionnels, universités...).
Une voie unique offrira davantage de lisibilité aux lycéens et à leurs familles, à rebours de la complexité et de l'hétérogénéité entre universités auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés. Elle permettra de lutter contre les inégalités observées entre les parcours des étudiants.
En comportant une majorité d'enseignements en santé, la première année de formation aux filières MMOPK répondra mieux au souhait des étudiants d'accéder à des études cohérentes avec leur projet professionnel. Les rapporteurs sont attachés à ce que les étudiants de première année bénéficient d'une majorité de disciplines relevant du champ de la santé ou directement utiles aux futurs professionnels de santé.
Dans le même temps, adosser cette formation à une licence, avec un bloc d'enseignement « hors santé », dont la part augmentera en deuxième puis troisième années, répond à l'objectif louable, poursuivi par la précédente réforme, d'intégration dans le système universitaire et de marche en avant pour les étudiants qui n'intégreront pas les filières MMOPK - qui représentent les deux tiers des promotions aujourd'hui.
La commission est favorable à la définition, au niveau national, d'un cadre plus strict, afin de resserrer le nombre de licences disciplinaires proposées par les universités et de s'assurer que celles-ci soient cohérentes avec les intérêts et projets professionnels des étudiants et avec la nécessité de leur fournir des enseignements de base utiles pour la suite de leurs études médicales et de leur carrière. Elle souhaite également que ces licences permettent une réorientation réussie des étudiants n'accédant pas aux filières MMOPK, avec des débouchés professionnels.
Plusieurs maquettes pourront être envisagées. Une mission a été confiée aux inspections générales placées auprès des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur afin d'accompagner la concertation des acteurs et d'établir des propositions de cadrage d'un nouveau modèle de voie unique.
À ce stade, les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé40(*) comme France Universités41(*) envisagent une répartition en deux blocs « santé » et « hors santé » de taille équivalente ou quasi équivalente, avec, le cas échéant, un troisième bloc, qui pourrait correspondre à l'acquisition de connaissances et de compétences transversales utiles à des futurs professionnels de santé.
Parmi les disciplines « hors santé » considérées comme pertinentes par les représentants des étudiants comme des universités et des professionnels de santé figurent notamment les sciences- y compris les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), la psychologie, le droit et l'anglais. Il reviendra aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'énumérer la liste des disciplines.
· S'agissant de l'inclusion explicite de la masso-kinésithérapie au sein de cette voie unique, la commission estime que cette disposition est en cohérence avec l'objectif de simplification et de lisibilité des modalités d'accès aux études de santé.
Les deux tiers des étudiants de la filière masso-kinésithérapie proviennent d'ores et déjà des dispositifs Pass-LAS42(*). Inclure la masso-kinésithérapie au sein de la voie unique reviendra à acter une situation de fait et à simplifier le dispositif existant. En outre, la diversification des profils étudiants sera toujours assurée par la variété des licences disciplinaires associées à la composante « santé ».
Les représentants de la profession et les principales associations étudiantes sont favorables à cette intégration. Ils appellent plus largement à universitarisation de la formation, avec la délivrance par les universités des diplômes de premier et deuxième cycle de masso-kinésithérapie et une harmonisation des frais de scolarité - qui atteignent en moyenne 6 800 euros par an et varient de 170 à 10 000 euros selon les instituts de formation43(*).
• La commission a souhaité favoriser la réussite de cette réforme en laissant aux acteurs le temps nécessaire pour la préparer.
Elle est en effet consciente des conséquences que l'organisation d'une voie unique et l'inclusion explicite de la masso-kinésithérapie auront pour les universités. Son attention a notamment été attirée, par les conférences des doyens, sur la façon dont les actuels partenaires universitaires de LAS seront affectés, soit en raison d'un flux supplémentaire d'étudiants pour les licences disciplinaires qui seront conservées, soit par une baisse du nombre d'heures de cours pour celles qui ne seront plus proposées au sein de la voie unique.
En conséquence, la commission a adopté, à l'initiative des rapporteurs et de la commission de la culture, des amendements identiques COM-14 et COM-23 prévoyant l'entrée en vigueur de ces dispositions à la rentrée universitaire 2027.
Les universités et les conférences des doyens, entendues par les rapporteurs, ont confirmé qu'il leur paraissait possible de mettre en oeuvre la réforme dans ce délai.
• Par ailleurs, la commission souscrit à l'objectif de diversification sociale et géographique du recrutement des étudiants poursuivi par l'organisation, dans chaque département d'une première année de la formation de licence donnant accès aux filières MMOPK. Elle estime que la création de telles formations délocalisées est de nature à permettre à des bacheliers éloignés des grandes villes universitaires d'accéder à des filières vers lesquelles ils ne s'orientent pas spontanément ou auxquelles ils renoncent pour des raisons matérielles, logistiques et financières. La présence d'antennes au plus près des territoires limite également, pour les étudiants concernés, les coûts liés à la vie étudiante ainsi que l'isolement familial.
En outre, le recrutement de futurs professionnels de santé issus de territoire ruraux répond à l'enjeu majeur de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins, l'origine géographique jouant un rôle déterminant dans le choix d'installation des professionnels de santé.
À la rentrée universitaire 2025, si les 38 universités permettant l'accès aux études de santé ont déployé près de 70 antennes dans des campus universitaires décentrés, 25 départements demeurent dépourvus de toute antenne universitaire permettant l'accès aux études de santé44(*).
Soucieuse de s'assurer de la réussite des étudiants accédant à ces formations délocalisées, la commission souhaite laisser aux universités un temps suffisant pour réunir les moyens humains, pédagogiques, immobiliers et matériels nécessaires à des enseignements de qualité et s'assurer que ces enseignements fournissent aux étudiants des conditions de vie et d'études satisfaisantes et leur permettent effectivement d'accéder aux filières MMOPK.
Des associations représentant les étudiants ont notamment mis en avant45(*) la nécessité de disposer de salles d'enseignement et d'espaces de travail et de révision, d'organiser, pour les étudiants bénéficiant de formations délocalisées dispensées à distance, un regroupement présentiel hebdomadaire et de valoriser, pour tous, les tutorats d'entrée dans les études de santé.
La commission a donc adopté un amendement COM-15 des rapporteurs prévoyant que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions devra être précisée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, fixée à la rentrée universitaire 2030. Cet amendement prévoit également que les universités devront transmettre annuellement aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un bilan de la réussite des étudiants formés dans chaque département.
La commission souhaite que le Gouvernement accompagne activement, en lien avec les collectivités territoriales volontaires, les universités dans la mise en oeuvre de ces formations délocalisées, qu'il préconisait lui-même dans le pacte de lutte contre les déserts médicaux présenté par le Premier ministre François Bayrou en avril 202546(*).
La conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers (CMECH) a également exprimé son souhait que ces formations délocalisées s'accompagnent de partenariats structurés avec les hôpitaux en proximité, estimant que « les centres hospitaliers doivent devenir des acteurs de formation à part entière, avec la création d'unités de formation délocalisées, permettant d'accueillir ensuite des étudiants de deuxième et troisième cycles » afin « d'implanter les étudiants plus tôt dans le territoires mais aussi de valoriser le rôle pédagogique des praticiens hospitaliers qui y exercent »47(*).
Enfin, la commission a noté avec intérêt la présence, dans l'intégralité des 25 départements ne disposant pas de première année d'accès aux études de santé, d'instituts de formation aux soins infirmiers (Ifsi) sur lesquels les universités pourraient s'appuyer.
Liste et description de l'offre de formation des
départements dépourvus
d'une première année
d'accès aux études de santé
Source : Circulaire « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » du 5 septembre 2025 adressée aux recteurs, aux directeurs d'ARS et aux préfets
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 2
Expérimentation d'un accès direct aux
études de pharmacie
Cet article vise à autoriser, sous la forme d'une expérimentation de cinq ans, l'admission directe d'étudiants en premier cycle de pharmacie par Parcoursup. La part des étudiants ainsi recrutés ne pourra excéder, dans chaque université, un tiers des capacités d'accueil.
La commission a adopté cet article modifié par trois amendements.
I - Le dispositif proposé
A. L'accès sélectif actuel aux études de pharmacie ne permet plus d'attribuer toutes les places disponibles
1. La pharmacie dispose de longue date d'un accès sélectif à l'issue d'une première année d'études
· Le modèle français d'accès aux études médicales et pharmaceutiques est fondé, de longue date, sur une procédure de sélection exigeante organisée après, au moins, une année de formation.
Ce modèle prévaut depuis l'instauration, à compter du début des années 1970, d'un numerus clausus largement inférieur au nombre d'étudiants inscrits en première année. Instauré dès 1971 pour les études de médecine et d'odontologie48(*), ce système a été progressivement étendu à la pharmacie et à la maïeutique. La loi de 1984 sur l'enseignement supérieur confie, ainsi, aux ministres de la santé et de l'Éducation nationale le soin d'arrêter « le nombre des étudiants admis, pendant le premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques »49(*).
La sélectivité à l'issue de la première année apparaît élevée. En 2008, un rapport coordonné par le professeur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, observait, déjà, qu'environ 11 500 étudiants étaient inscrits en première année de premier cycle des études de pharmacie (PCEP 1), pour un numerus clausus inférieur à 3 000, soit un taux d'admission d'environ 25 %. Les trois filières médicales - médecine, odontologie, maïeutique -, qui organisaient depuis plusieurs années une première année commune50(*), cumulaient alors 50 000 étudiants inscrits pour environ 9 000 places offertes51(*), soit un taux d'admission de 18 %. Une telle sélectivité a fréquemment amené les observateurs à regretter un « gâchis de temps et de motivation pour les étudiants de très bon niveau »52(*).
Ce modèle fondé sur une sélection un an après le baccalauréat est peu reproduit à l'international. Aux États-Unis, les études médicales sont accessibles après l'obtention d'un premier diplôme de l'enseignement supérieur. Dans de nombreux pays européens, les filières médicales et pharmaceutiques sont accessibles directement à l'issue des études secondaires - tel est le cas en Espagne, en Belgique ou en Roumanie53(*). Le rapport précité de 2008 indique, toutefois, avoir écarté cette solution « tant en raison de la difficulté de sa mise en oeuvre à très grande échelle que [du fait de] son inacceptabilité politique, même si une telle pratique - en usage dans la plupart des pays étrangers pour les études de santé - existe pour d'autres filières dans notre pays »54(*).
• Depuis le début des années 2010, l'accès aux études de pharmacie est subordonné à la validation d'une première année commune avec les trois filières médicales.
Instaurée par la loi en 200955(*), la première année commune aux études de santé (Paces) permettait, ainsi, d'accéder aux études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie. Le rapprochement de la pharmacie et des trois filières médicales visait alors, d'après le député Jacques Domergue, auteur de la proposition de loi et rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à « ouvrir aux étudiants un nombre élargi de débouchés, afin de réduire le taux d'échec en première année des études médicales et pharmaceutiques. » Elle devait également « permettre de forger une culture scientifique commune aux professions médicales et pharmaceutiques, ce qui est censé faciliter la coopération des professionnels de santé. »56(*)
Si les nombreux écueils observés ont conduit le législateur à réformer profondément le dispositif d'accès en 201957(*), cette réforme n'est pas revenue sur le principe d'un accès aux études de santé à bac +1, à l'issue d'une année de formation commune aux filières médicales et pharmaceutique. Les parcours d'accès spécifique santé (Pass) et licences accès santé (LAS) instaurés permettent, ainsi, aux étudiants de candidater à une ou plusieurs des quatre filières. L'instauration d'un numerus apertus, conduisant les universités à définir elles-mêmes leurs capacités d'accueil dans le respect d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'État58(*), n'a pas davantage supprimé le principe d'un concours permettant à un nombre limité de candidats d'accéder à ces études.
2. Les cursus de pharmacie souffrent d'un déficit d'attractivité et de places laissées vacantes
· L'organisation d'une première année commune présente le risque de mettre en concurrence les quatre filières concernées et, partant, de complexifier le recrutement dans certaines d'entre elles.
Dans son avis sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale relevait ainsi que la Paces n'avait « pas permis de remettre en cause la hiérarchie » entre les filières. L'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (Anepf) observait, dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche deux ans plus tôt, que la Paces n'avait « fait que renforcer le manque d'attractivité des études de pharmacie », le nombre d'étudiants inscrits en Paces et présentant le concours de pharmacie se révélant « en nette diminution »59(*).
La réforme de 2019 des dispositifs d'accès aux études de santé n'a pas permis de supprimer cet écueil. Au contraire, la Cour des comptes observait, en décembre 2024, que cette réforme, « qui augmente significativement le nombre de places offertes en médecine, conduit à un effet de siphonage des étudiants en pharmacie et en maïeutique aggravé localement par la mise en oeuvre différenciée des modalités de sélection. » Certaines universités, en effet, exigent des étudiants la priorisation de leurs voeux ou limitent le nombre de filières auxquelles ils peuvent postuler60(*).
Nombre de voeux de priorité n° 1 et de places par filière en 2022-2023
Source : Cour des comptes (2024)
• En conséquence, des places vacantes sont apparues dans les formations de pharmacie et de maïeutique depuis la mise en oeuvre de la réforme de 2019.
En pharmacie, le nombre de places vacantes s'est révélé particulièrement élevé lors des premières années de mise en oeuvre de la réforme, et décroît depuis. D'après la Cour des comptes, les places vacantes auraient atteint 28 % des capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle en 2021-2022 et 14 % en 2022-202361(*). Le ministère de la santé a recensé62(*) 990 places vacantes à la rentrée 2022, 434 en 2023 et 198 en 2024, dans uncontexte d'augmentation du nombre de places de 8,3 % entre 2020 et 202463(*).
Part des places vacantes par rapport aux capacités d'accueil
Source : Cour des comptes (2024)
La diminution du nombre de places vacantes est principalement expliquée par les mesures correctives mises en place par les universités et l'effort de communication déployé par la profession. Certaines universités ont, ainsi, choisi d'appeler un plus grand nombre de candidats de ces filières à l'oral, de renforcer les admissions par passerelles ou de permettre aux étudiants de candidater aux quatre filières proposées64(*). Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop), de son côté, a renforcé sa communication auprès des élèves de l'enseignement secondaire et des étudiants, et déployé une large campagne d'information nommée « Pharmacien : le moins connu des métiers connus »65(*).
· Malgré cette progression, de nombreux acteurs jugent que le nombre de places restant vacantes traduit des difficultés structurelles de la filière, et proposent de faire évoluer en conséquence les modalités d'accès.
La Cour des comptes juge, ainsi, que les mesures correctrices prises « ne suffiront pas à faire cesser le problème des places vacantes qui risque au contraire de s'installer dans la durée. » Elle relève, notamment, un manque de motivation et une plus faible réussite des étudiants, « avec un nombre important de demandes de passerelles vers la médecine et l'odontologie et des abandons d'études. » En conséquence, la Cour des comptes recommande l'expérimentation d'un accès direct en pharmacie « pour un contingent d'élèves sélectionnés sur Parcoursup, en complément d'un accès classique via la première année d'études de santé pour le contingent restant »66(*).
L'Académie nationale de pharmacie a, dans une communication de juillet 2025, également dénoncé « le manque de visibilité des études et métiers de la pharmacie au moment d'exprimer ses voeux dans Parcoursup ainsi que l'accès aux études de pharmacie par une première année commune (...) quasiment exclusivement orientée vers la médecine ». Elle souligne que ce dispositif est également responsable « d'une iniquité et d'une perte de chance pour les étudiants voulant s'engager dans les études de pharmacie et voyant leur place prise par des étudiants non classés en rang utile pour intégrer médecine et choisissant pharmacie par défaut ». Elle demande la mise en place « d'une voie d'accès direct aux études de pharmacie dès la première année universitaire, avec un choix dédié dans Parcoursup. »67(*)
B. L'article 2 permet l'expérimentation d'un accès direct aux études de pharmacie
L'article 2 de la présente proposition de loi vise à favoriser l'admission en pharmacie d'étudiants motivés par cette filière, en autorisant l'expérimentation d'une admission directe par Parcoursup.
Pour ce faire, le I autorise, par dérogation aux modalités d'accès de droit commun et sous la forme d'une expérimentation de cinq ans, l'admission directe d'étudiants en premier cycle des formations de pharmacie par la procédure nationale de préinscription portée par la plateforme Parcoursup. La part des étudiants ainsi admis directement ne pourra excéder, dans chaque université participant à l'expérimentation, un tiers des capacités d'accueil en deuxième et troisième années de premier cycle déterminées annuellement.
Le II confie à un décret le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.
Enfin, le III précise qu'un an, au moins, avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation, afin de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de la pérennisation de cette mesure. Le rapport remis devra apprécier l'effet de l'expérimentation sur le nombre d'étudiants choisissant de poursuivre leurs études dans un pays étranger, ainsi que la réussite des étudiants admis directement dans la suite de leurs études.
II - La position de la commission
La commission s'inquiète de la baisse du nombre de pharmaciens observée depuis plusieurs années. Entre 2012 et 2022, la France a perdu plus de 1 800 pharmacies d'officine68(*) quand elle gagnait 3,7 % d'habitants69(*).
Elle soutient donc la mise en place d'un accès direct aux études de pharmacie, en complément de la première année d'accès aux études de santé, qui lui semble de nature à améliorer la visibilité et l'attractivité de la filière pharmacie.
La filière pharmacie sera ainsi alimentée par deux sources de bacheliers : ceux sélectionnés directement par le biais de Parcoursup, qui manifestent d'ores et déjà un intérêt pour les métiers de la pharmacie, et ceux qui, dans le cadre de la voie d'accès commune aux études MMOPK, feront le choix de se diriger vers cette filière. La nouvelle voie d'accès, avec une sélection avancée dès la sortie du lycée, devrait permettre d'attirer davantage d'étudiants.
Elle pourrait également permettre d'éviter que des étudiants motivés par des études de pharmacie mais effrayés par la complexité des voies d'accès ne partent directement étudier à l'étranger sans tenter leur chance en France.
L'Académie nationale de pharmacie et la conférence des doyens des facultés de pharmacie appellent de leurs voeux une telle expérimentation. La conférence des doyens estime en effet que le système d'accès unique « dessert la filière pharmacie, choisie souvent par défaut » alors même que, dans le même temps, « les enseignants-chercheurs en pharmacie assurent une grande majorité de la formation des futurs étudiants en médecine ». Elle souhaite sortir d'« un modèle qui maintient la hiérarchisation des études de santé », « nuisant gravement à la visibilité de la filière pharmacie ». 70(*)
Le ministère de la santé a également indiqué aux rapporteurs être favorable à un projet d'expérimentation, décliné au niveau national, qui permettra d'analyser la pertinence de cette réponse pour pallier les difficultés de recrutement de la filière pharmacie71(*).
La commission a souhaité préciser le dispositif introduit par le présent article en prévoyant une admission directe en première année du premier cycle des formations de pharmacie (amendement COM-16 des rapporteurs), créant ainsi une première année d'études de pharmacie au sein des unités de formation et de recherche (UFR) concernées.
Lors de son audition par les rapporteurs, la conférence des doyens des facultés de pharmacie a estimé être en mesure de mettre en place rapidement de tels enseignements.
Dans sa contribution adressée aux rapporteurs, elle souhaite structurer la première année autour d'enseignements majoritairement similaires à ceux que suivront les étudiants de la voie unique, tout en envisageant de remplacer les enseignements disciplinaires par des enseignements de pharmacie. Elle estime que, de cette manière, une telle première année de premier cycle peut être mise en place sans surcoût pour les universités concernées.
La commission a également adopté un amendement de Mme Patricia Demas (COM-3) visant à préciser que les critères d'admission directe, via Parcoursup, devront garantir l'équité d'accès à la formation en pharmacie et la transparence de la sélection.
Par ailleurs, afin de pleinement produire ses effets, la création d'une voie d'accès direct devra s'accompagner d'une meilleure communication, dès le lycée, autour des métiers de la pharmacie et de l'élargissement de compétences dont ils ont bénéficié ces dernières années. Les rapporteurs appellent à veiller, dans les prochaines années, à l'attractivité de la filière pharmaceutique et au maintien du maillage officinal, indispensable à l'accès aux soins dans de nombreux territoires.
Enfin, la commission a adopté un amendement rédactionnel COM-17 des rapporteurs précisant une référence à l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 3
Extension et renforcement des options santé
Cet article vise à étendre l'expérimentation des options santé, portée par la loi dite « Valletoux » de 2023, à l'ensemble du territoire national. Il renforce l'expérimentation en précisant que ces options doivent permettre la découverte des formations médicales, pharmaceutique et paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Enfin, il prévoit la conclusion de conventions entre les lycées concernés, les universités et les organismes de formation.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Face aux inégalités géographiques et sociales persistantes d'accès aux études de santé, la loi a autorisé l'expérimentation d'options santé
1. Les inégalités géographiques et sociales d'accès aux études de santé
• L'homogénéité sociale et géographique des profils recrutés dans les études médicales et pharmaceutique est observée de longue date et apparaît stable dans le temps.
De nombreuses études ont objectivé l'origine sociale élevée des professionnels médicaux et des pharmaciens. Dans une publication de 2006, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux relevait ainsi que « sans surprise, les médecins, pharmaciens et dentistes se recrutent largement (à 40 % ou plus) dans les familles de cadres et professions intellectuelles supérieures. » Ces proportions se révélaient particulièrement élevées chez les médecins, dont 45 % provenaient de telles familles, et, parmi eux, chez les spécialistes libéraux72(*).
La concentration du recrutement dans les études de santé parmi les catégories socio-économiques favorisées apparaît stable dans le temps. La Drees observait ainsi, neuf ans après son étude précitée, que « la réforme de la Paces n'a pas modifié les caractéristiques sociodémographiques des étudiants de première année, dont l'origine est marquée par une surreprésentation des classes favorisées ». Relevant que quatre étudiants sur dix inscrits en Paces avaient des parents cadres supérieurs ou exerçant une profession libérale, et que ces étudiants avaient 2,5 fois plus de chance qu'un enfant d'ouvrier d'intégrer la deuxième année de médecine, la Drees concluait : « l'accès aux études de médecine donne donc lieu à une sélection sociale qui opère de façon stable dans le temps. »73(*)
• Alors que la diversification des profils recrutés figurait parmi les objectifs affichés par le Gouvernement et le législateur, la réforme de 2019 de l'accès aux études de santé74(*) n'a entraîné aucune modification significative de ces équilibres.
La Cour des comptes relève, au contraire, que depuis l'entrée en vigueur de la réforme, « la part d'étudiants issus d'une commune rurale baisse légèrement, tout comme la part d'étudiants dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle assez défavorisée ou défavorisée ». En particulier, la part des étudiants admis dont les parents appartiennent à une catégorie socioprofessionnelle défavorisée ou assez défavorisée demeurerait fortement minoritaire, de l'ordre de 20 %. La part des étudiants issus d'un milieu rural peu dense aurait, quant à elle, diminué de 7 % à 6 % entre 2020 et 202375(*).
• La diversification géographique du recrutement constitue, pourtant, un puissant outil de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins.
L'influence de l'origine géographique sur les choix d'installation apparaît, en effet, largement documentée. Dans une méta-analyse de 2021 relative aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques, la Drees souligne ainsi que « les résultats des études menées montrent partout l'importance du milieu d'origine du médecin dans son choix de localisation. » Elle relève que « sur la base de ce constat, des initiatives ont été développées dans plusieurs pays pour accroître, au sein des promotions d'étudiants en médecine, la proportion de ceux qui sont issus de zones moins bien desservies, et dès lors plus enclins à y exercer. »76(*)
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a, par ailleurs, récemment mesuré que, pour la moitié des médecins généralistes libéraux ayant débuté l'internat entre 2004 et 2007, la distance à vol d'oiseau entre la commune de naissance et la commune d'exercice est inférieure à 85 kilomètres. Par ailleurs, la taille de l'aire dans laquelle le médecin est né constitue également l'un des principaux déterminants de l'exercice dans une commune rurale. Ainsi, 42,3 % des médecins nés dans une aire de moins de 50 000 habitants exercent dans une commune rurale, contre 16,1 % des médecins nés dans l'aire de Paris77(*).
Proportion de médecins exerçant en
zone rurale
selon le type d'aire où ils sont nés,
en 2019
Source : commission des affaires sociales, d'après des données Insee (2024)
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, pour les mêmes raisons, « d'appliquer des politiques d'admission ciblant les étudiants d'origine rurale aux programmes de formation » des professionnels de santé78(*).
La Cour des comptes ajoute que si le levier consistant à diversifier l'origine géographique des étudiants recrutés dans les études de santé « ne peut être envisagé seul et doit être accompagné d'une exposition aux milieux ruraux durant les stages et d'incitation organisationnelles et financières, il constitue toutefois l'un des leviers non coercitifs les plus efficaces pour lutter contre les déserts médicaux. »79(*)
2. L'expérimentation d'options santé dans les lycées
• Afin de favoriser la diversification du recrutement dans les études de santé, la loi dite « Valletoux » de 2023 a autorisé l'expérimentation, pour une durée de cinq ans, d'options santé dans trois académies volontaires.
En application de la loi, ces options ont vocation à être proposées aux élèves de première et de terminale de la voie générale des lycées situés dans des zones sous-denses, afin d'encourager l'orientation des lycéens vers les études de santé80(*).
• Le champ de cette expérimentation apparaît toutefois limité et le délai de déploiement significatif.
Selon le Gouvernement, une enquête diligentée au printemps 2024 a permis d'obtenir un panorama des actions menées à l'initiative d'établissements volontaires dans les territoires pour favoriser l'orientation des élèves vers les études de santé. Trois académies - Bordeaux, Nancy-Metz et Toulouse-Montpellier - s'étaient déjà inscrites dans cette démarche, avant que cette loi ne soit promulguée, respectivement en 2023, 2022 et 2020, et devraient être désignées comme académies référentes.
Le pacte contre les déserts médicaux, présenté par le Premier ministre François Bayrou en avril 2025, prévoyait d'accélérer ce déploiement. Il visait à « inciter les jeunes des territoires sous-denses à faire des études de santé en déployant, dans les régions, les options santé dans les lycées et en intensifiant l'effort pour faire connaître l'intérêt des études et métiers de la santé. »81(*)
Selon les informations de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP)82(*), à la rentrée 2025, six académies - et vingt-trois départements - proposaient des options santé, au sein de 36 lycées. Ces options sont composées à 75 % d'enseignements scientifiques complémentaires (biologie, physique-chimie, mathématiques) et à 25 % d'interventions de professionnels de santé (forums, conférences, visites).
La Cour des comptes suggère, dans son rapport récent relatif à l'accès aux études de santé, d'accélérer la mise en place de tels dispositifs. Elle observe qu'« afin de généraliser ces expérimentations, les mesures pourraient utilement s'appuyer sur des dispositifs existants comme les cordées de la réussite », visant à lutter contre l'autocensure et développer l'ambition scolaire par un partenariat établi entre un établissement d'enseignement supérieur et des établissements d'enseignement secondaires83(*).
B. L'article 3 vise à étendre et renforcer l'expérimentation des options santé
L'article 3 de la présente proposition de loi vise à étendre l'expérimentation des options santé et à en préciser les objectifs. Pour ce faire, il modifie l'article 24 de la loi « Valletoux » de 2023, pour apporter au dispositif trois modifications.
D'abord, les a et b du 1°améliorent la rédaction des dispositions légales prévoyant cette expérimentation et étendent cette dernière, aujourd'hui limitée à trois académies volontaires, à l'ensemble du territoire national.
Le c du 1° précise les objectifs des options santé en prévoyant, d'une part, que celles-ci doivent permettre la découverte des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique (MMOP) et des formations paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Il prévoit également que les lycées concernés pourront, pour l'organisation des options santé, conclure des conventions avec les universités comportant une unité de formation et de recherche (UFR) en santé et les organismes délivrant des titres de formation requis pour l'exercice des professions de santé.
Le 2° précise qu'un décret devra déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.
II - La position de la commission
La commission est favorable à l'extension de l'expérimentation d'options santé dans les lycées situées dans les zones sous-denses, dont elle avait soutenu la mise en place. Ayant pris connaissance de la mise en oeuvre de plusieurs expérimentations qui semblent positives, notamment en Centre-Val-de-Loire, elle déplore la lenteur actuelle du déploiement.
L'objectif de ce dispositif est de mieux faire connaître les études de santé aux lycéens et donc de favoriser leur orientation vers celles-ci. En cohérence avec l'article 2 de la présente proposition de loi, il doit notamment permettre la découverte des filières moins connues des lycéens et souffrant de places vacantes, telles que la pharmacie et la maïeutique. Il importe également de faire connaître l'ensemble des métiers dans toute leur diversité, y compris des métiers moins bien identifiés comme, par exemple, celui de manipulateur en électro-radiologie.
La commission voit également dans ce dispositif une réponse aux inégalités sociales et territoriales d'accès aux études de santé et une piste pour recruter davantage de professionnels de santé, médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, issus des territoires ruraux ou sous-dotés.
La généralisation de l'expérimentation permettra d'accélérer sa mise en oeuvre et de disposer de données plus robustes pour évaluer ses effets et pour comparer - et au besoin harmoniser - les pratiques.
Les principales associations représentant les étudiants des filières MMOPK ont exprimé84(*) leur soutien à cette généralisation, sous réserve que les options santé soient accessibles sans condition, qu'elles ne se transforment pas en une classe préparatoire générant un stress supplémentaire pour les lycéens et qu'elles ne constituent pas un critère de sélection sur Parcoursup. Elles souhaitent également que les présentations des différentes professions de santé soient effectuées par des étudiants et professionnels concernés et que les tutorats d'étudiants d'entrée en étude de santé soient impliqués, en écartant tout partenariat ou promotion de structures de préparation privée.
Les représentants des professionnels de santé, en particulier le conseil national de l'ordre des médecins, ont émis le souhait que la découverte des métiers de santé s'accompagne de stages d'observation.
La conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers (CMECH) appelle quant à elle de ses voeux la mise en place de stages d'observation en milieu hospitalier, y compris dans les centres hospitaliers non universitaires.
Au regard de ces éléments, la commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE
II
TERRITORIALISER LE TROISIÈME CYCLE
DES ÉTUDES DE
MÉDECINE
Article 4
Territorialisation des procédures de
répartition des postes d'internat
et d'affectation des internes
Cet article vise à améliorer la procédure de fixation du nombre de postes d'internat, par spécialité et par subdivision territoriale, en hiérarchisant les critères applicables et en prévoyant l'existence d'une procédure de concertation préalable destinée à évaluer, notamment, les besoins de santé des territoires et les besoins prévisionnels du système de santé. Il vise également à territorialiser l'internat en prévoyant que la procédure d'affectation des étudiants doit permettre aux deux tiers d'entre eux d'accéder au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé le deuxième cycle.
La commission a adopté cet article modifié par deux amendements.
I - Le dispositif proposé
A. Les procédures d'affectation des internes et de fixation du nombre de postes à pouvoir
1. Les procédures de fixation du nombre de postes et d'affectation des internes
· Le caractère national de la procédure d'affectation en troisième cycle de médecine est ancien.
La loi de 2002 de modernisation sociale85(*) et un décret de 200486(*) ont substitué à l'ancien concours de l'internat de spécialité, qui coexistait avec le résidanat de médecine générale, des épreuves classantes nationales (ECN) applicables à l'ensemble des étudiants.
L'affectation de ces derniers en qualité d'interne, dans chacune des disciplines et dans chacun des centres hospitaliers universitaires (CHU), dépendait de leur choix et de leur rang de classement à ces épreuves nationales.
· Ce dispositif a, depuis, été profondément réformé sans, toutefois, remettre en cause le principe d'une affectation des internes à l'échelle nationale.
La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) de 201987(*) et un décret de 202188(*) ont, ainsi, substitué aux ECN une procédure nationale d'appariement dématérialisée, fondée sur trois éléments dont la pondération peut varier en fonction des spécialités choisies89(*) :
- des épreuves nationales, anonymes et dématérialisées d'évaluation des connaissances90(*) ;
- des examens cliniques objectifs structurés (ECOS), ayant vocation à vérifier que l'étudiant a acquis un niveau clinique suffisant91(*) ;
- le parcours de formation et le projet professionnel des intéressés.
· La procédure de fixation du nombre de postes d'internes à pourvoir a, dans le même temps, été progressivement renforcée. Le nombre d'étudiants de troisième cycle susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision est, désormais, fixé annuellement par arrêté en fonction de la situation de la démographie médicale, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation92(*). La liste des 28 subdivisions territoriales, qui peuvent comprendre un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU)93(*), est fixée par un arrêté de septembre 201794(*).
Un arrêté de juillet 202595(*) a, ainsi, réparti pour l'année universitaire 2025-2026 les 8 607 postes d'internat ouverts - hors contrat d'engagement de service public - entre les 44 spécialités médicales et 28 subdivisions territoriales.
Ce nombre est fixé sur la base des propositions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), établies à l'issue de concertations régionales96(*). D'après le ministère, « Le nombre de postes d'internes tient ainsi compte des besoins exprimés par les ARS, des caractéristiques démographiques nationales et régionales et du nombre de candidats ayant validé le 2e cycle des études de médecine et étant classés à l'issue des ECN »97(*).
2. La question de la « territorialisation » de l'internat et de l'adaptation du nombre de postes aux besoins de santé
· Intervenant à la fin des études de médecine, à un âge où les étudiants construisent les bases de leur vie future, le lieu d'internat figure parmi les principaux déterminants du choix du lieu d'exercice.
La Cour des comptes relève ainsi que 72 % des médecins généralistes et 69 % des médecins des autres spécialités décideraient de s'installer là où ils ont suivi leur troisième cycle de formation98(*).
L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a mesuré, de son côté, que la moitié des médecins généralistes libéraux ayant débuté leur internat entre 2004 et 2007 exercent en 2019 à moins de 43 kilomètres à vol d'oiseau de l'université dans laquelle ils ont effectué leur internat99(*).
L'Insee a également étudié les effets respectifs du lieu de naissance et du lieu d'internat sur le lieu d'exercice. Il relève que, dans la mesure où le choix de l'université d'internat et de la spécialité se font par ordre de classement aux épreuves nationales, cela « contraint certains médecins à une mobilité géographique vers une région dans laquelle ils ne souhaitent pas initialement s'installer. » Toutefois, l'Insee observe que « la période de l'internat est structurante dans la vie d'un médecin » : « âgé entre 25 et 30 ans, l'interne tisse son premier réseau professionnel, reçoit ses premiers salaires et est susceptible de nouer des liens affectifs dans sa région de l'internat. »
En conséquence, selon l'Insee, l'expérience de l'internat est « susceptible de modifier [les] préférences initiales et de mener l'étudiant à choisir de finalement exercer dans sa région d'affectation. » Autrement dit, un étudiant désirant initialement exercer dans sa région d'origine peut être amené à changer d'avis lorsque, contraint de changer de région au stade du troisième cycle, il a construit ailleurs le début de sa vie professionnelle et personnelle.
Il a, ainsi, été mesuré qu'une augmentation d'un point de pourcentage de la part des internes en médecine générale affectés à une université serait associée, en moyenne, à une augmentation de 0,4 point de pourcentage de la part de généralistes libéraux issus de ces promotions installés douze ans plus tard dans la zone de l'université100(*).
· En conséquence, la question d'une déconcentration, ou d'une « territorialisation » de la procédure d'affectation des internes de médecine, pour fidéliser les étudiants à leur territoire de formation, apparaît de manière récurrente dans le débat public.
Dès 2010, le rapport dit « Hubert » sur la médecine de proximité, remis au Président de la République, propose d'instituer un examen classant interrégional pour favoriser l'enracinement des étudiants dans leur région et lutter ainsi contre les déserts médicaux. Élisabeth Hubert observe qu'il « est aisé de constater l'attachement des étudiants à leur région dès lors que leur famille y est installée, et qu'ils y ont effectué toutes leurs études secondaires et universitaires. »101(*)
En 2013, afin de tenir compte de la « propension des médecins à s'installer dans la région où ils ont fait leurs études », le Sénat a adopté, lors de la première lecture du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, un amendement d'Hervé Maurey transformant les ECN en épreuves classantes interrégionales102(*). Cette initiative a suscité, toutefois, une vive opposition des organisations étudiantes. L'Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf) a notamment déclaré craindre « l'inefficacité de ce mode de répartition des internes », ainsi qu'une « perte d'égalité des chances »103(*).
Si cette réticence est affirmée avec constance par les associations étudiantes, plusieurs organisations médicales se sont, ces dernières années, prononcées en faveur d'une territorialisation du troisième cycle. Dans sa contribution à la Grande conférence de santé de 2016, la Conférence des doyens de faculté de médecine plaidait ainsi « pour une régionalisation de tout ou partie des ECN dont le programme comme les modalités d'évaluation seraient définis au plan national »104(*).
Dans un rapport récent sur la formation médicale initiale, l'Académie nationale de médecine se prononce pour une « proportion de régionalisation de l'internat ». Elle observe que, dans le système actuel, les étudiants choisissent en priorité la spécialité qui a leur préférence, acceptant de se former « dans une subdivision par défaut avec généralement l'intention de la quitter dès le terme de leur formation ». En conséquence, l'Académie souligne que « Pour contribuer à résoudre la question des déserts médicaux, il apparaît souhaitable de favoriser la possibilité pour un interne de se former à la spécialité de son choix, dans sa région de coeur, celle au sein de laquelle il a grandi (...) et a débuté ses études de médecine », sans « supprimer la prime au mérite qui conditionne en grande partie le maintien d'une élite médicale qui contribue au progrès ». Elle propose de faire bénéficier aux étudiants d'un « coefficient de pondération » destiné à favoriser leur affectation locale105(*).
B. L'article 4 vise à améliorer les procédures de fixation du nombre de postes et de répartition des internes pour mieux répondre aux besoins de santé
L'article 4 apporte plusieurs modifications aux procédures de fixation du nombre de postes d'internat et d'affectation des internes, afin de mieux répondre aux besoins de santé et de favoriser la fidélisation des étudiants à leur territoire.
1. Sur la procédure de fixation du nombre de postes d'internat
L'article 4 vise, d'abord, à préciser et renforcer la procédure de fixation du nombre de postes d'internat. Il modifie, pour ce faire, l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatif au troisième cycle des études de médecine.
Le 1° complète, d'abord, l'article L. 632-2 du code de l'éducation en élevant au niveau législatif des dispositions aujourd'hui portées par le code de l'éducation au niveau réglementaire106(*), prévoyant que le nombre de postes d'internat, par spécialité et par subdivision territoriale, est arrêté en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires, des besoins prévisionnels du système de santé et des capacités de formation en stage et hors stage. Les critères de fixation des capacités d'accueil en deuxième et troisième année de premier cycle sont, en comparaison, définis par la loi107(*).
En cohérence avec la solution retenue par le législateur pour le numerus apertus, le 1° de l'article 4 hiérarchise ces critères en précisant que les trois premiers doivent être pris en compte prioritairement.
Enfin, le a du 2° de l'article précise que la fixation du nombre de postes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, doit intervenir au terme d'une procédure de concertation destinée à évaluer, notamment, les besoins de santé des territoires et les besoins prévisionnels du système de santé.
2. Sur la procédure d'affectation des internes
Le 1° de l'article 4 complète également l'article L. 632-2 du code de l'éducation pour prévoir que la procédure d'affectation des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves nationales doit permettre aux deux tiers d'entre eux d'accéder au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé le deuxième cycle des études de médecine.
Le 1° de l'article et le b du 2° apportent, par ailleurs, diverses améliorations rédactionnelles aux dispositions de l'article L. 632-2 relatives à cette procédure d'affectation.
II - La position de la commission
· La commission soutient la volonté de la proposition de loi de préciser et renforcer la procédure de fixation du nombre de postes d'internat.
Affirmer la priorité de la prise en compte de la démographie médicale et des besoins territoriaux répond à la nécessité de lutter contre les inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins et de mieux anticiper les besoins du système de santé.
Comme le relève le conseil national de l'ordre des médecins, qui salue cette hiérarchisation, cela implique de renforcer les capacités de formation et d'accueil en stage des étudiants, afin de préserver la qualité de formation et d'encadrement des internes.
La commission se félicite que l'existence d'une procédure de concertation soit confirmée au niveau législatif. Plusieurs acteurs demandent à être mieux associés à cette concertation.
Ainsi, la Fédération hospitalière française (FHF) appelle à « associer davantage les hôpitaux, les ARS et les territoires, afin que le nombre de postes répondent davantage aux enjeux de santé publique dans les territoires »108(*).
De même, la conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers (CMECH) souhaite être intégrée de façon systématique au processus, estimant que « les CME de centres hospitaliers sont insuffisamment associés aux décisions, alors qu'elles connaissent les besoins réels des territoires »109(*).
La commission juge indispensable la mise en place d'une procédure de concertation solide, permettant d'établir une estimation partagée des besoins dans les territoires.
· La commission est également favorable à une territorialisation partielle de l'internat à travers l'instauration d'un objectif national de deux tiers d'étudiants accédant au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé leur deuxième cycle.
Aujourd'hui, environ la moitié des étudiants choisit d'effectuer son internat dans la même région que son deuxième cycle, tandis que l'autre moitié l'effectue dans une autre région, soit par choix, soit par défaut, faute de places disponibles dans sa région d'origine. L'ONDPS indique ainsi qu'en 2023, 44 % des étudiants de deuxième cycle sont restés dans leur subdivision territoriale, 6 % sont partis de leur subdivision mais restés dans leur région, et 50 % ont changé de région110(*). La conférence des doyens de facultés de médecine précise que la majeure partie des changements de régions entre le deuxième et le troisième cycle est la conséquence d'un rang de classement insuffisant pour que l'étudiant obtienne la spécialité de son choix dans sa ville d'origine111(*).
Instaurer un objectif visant à augmenter aux deux tiers la proportion d'étudiants restant dans leur région d'origine favorisera la fidélisation des étudiants à leur territoire et permettra à un plus grand nombre d'étudiants souhaitant se maintenir dans leur région d'origine de le faire.
Compte tenu des études soulignant le lien entre la zone d'installation et le lieu de formation en deuxième et troisième cycles, cette disposition participera à la lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins tout en préservant la liberté d'installation des médecins.
Cette mesure est notamment soutenue par les agences régionales de santé (ARS) interrogées par les rapporteurs et par France Université.
L'objectif national proposé par la proposition de loi laisse une grande marge de manoeuvre dans la définition des modalités de classement et d'affectation des étudiants. Celles-ci devront être définies par voie réglementaire, en tenant compte du fait que, pour certaines spécialités, des postes ne sont pas offerts annuellement dans l'ensemble des subdivisions territoriales. L'Académie nationale de médecine a, par exemple, récemment proposé de faire bénéficier les étudiants d'un « coefficient de pondération » destiné à favoriser leur affectation locale112(*). Si cette solution était retenue, l'existence et l'importance d'un tel coefficient dans le classement des étudiants pourrait dépendre de la spécialité ou du groupe de spécialités visés.
Afin de donner sa pleine portée à cette mesure, il importera de réduire le taux d'inadéquation entre le nombre d'internes et le nombre de postes mis à leur disposition mais aussi de territorialiser davantage les stages de second cycle, notamment au sein de centres hospitaliers périphériques, afin de faire découvrir aux étudiants l'ensemble des territoires et des modalités d'exercice.
En parallèle, la commission soutient également la valorisation du contrat d'engagement de service public (CESP) qui permet, au travers d'une allocation mensuelle, d'un accompagnement au cours de la formation et d'un soutien au moment de l'installation ou de la prise de fonctions, d'encourager de jeunes médecins à s'installer dans des lieux qui souffrent d'une offre de soins insuffisante ou de difficultés d'accès aux soins.
· Afin de laisser au Gouvernement et aux universités le temps de définir de nouvelles modalités d'affectation des internes par spécialité et par subdivision territoriale, la commission a adopté, à l'initiative des rapporteurs, un amendement COM-19 reportant à une date prévue par décret en Conseil d'État et, au plus tard, au 1er septembre 2027 l'entrée en vigueur des dispositions du présent article.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-18 des rapporteurs procédant à des coordinations juridiques.
La commission a adopté cet article ainsi modifié
CHAPITRE
III
AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS EN
STAGE
Article
5
Statuts applicables aux maîtres de stage universitaires en
médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie
Cet article vise à créer quatre statuts législatifs homogènes pour les maîtres de stage universitaires en médecine, en maïeutique, en odontologie et en pharmacie (MMOP). L'accession à la maîtrise de stage serait subordonnée à une formation préalable obligatoire et à un agrément. Les maîtres de stage bénéficieraient d'une rémunération en contrepartie de l'accueil des stagiaires.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
A. Les statuts applicables aux maîtres de stage universitaires restent fortement hétérogènes d'une filière à l'autre
1. La maîtrise de stage en médecine
· La maîtrise de stage universitaire permet d'encadrer et de favoriser l'accueil des étudiants en santé par des professionnels, principalement libéraux, en ambulatoire.
En médecine, l'existence de praticiens agréés maîtres de stage des universités (Pamsu) est consacrée par la loi. Celle-ci prévoit que les étudiants de deuxième et de troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de Pamsu. Elle subordonne également l'agrément des Pamsu à une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité113(*) par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC)114(*).
Le statut des Pamsu est précisé par voie réglementaire. Ceux-ci peuvent exercer en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service des armées115(*). Ils perçoivent des honoraires pédagogiques, d'environ 300 € par externe reçu et 600 € par interne reçu.
La procédure d'agrément est destinée à attester de la compétence de formateur du Pamsu116(*). L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) en médecine qui assure la formation médiale dont relève l'étudiant117(*). Il ne peut être délivré que si le praticien :
- atteste avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
- propose des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation ;
- justifie d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en oeuvre pour assurer la qualité de la formation118(*) ;
- exerce son activité en tant que médecin installé depuis au moins un an119(*).
· Le développement de la maîtrise de stage universitaire est particulièrement prégnant en médecine générale.
Les internes en médecine générale réalisent, en effet, plusieurs stages en ambulatoire auprès de Pamsu. La maquette de formation du diplôme d'études spécialisées (DES) prévoit ainsi :
- un stage de niveau 1 en médecine générale auprès d'un Pamsu, au cours de la première année d'internat ;
- un stage couplé en santé de la femme et de l'enfant et un stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée, pouvant être intégralement réalisés auprès de Pamsu120(*).
En outre, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023121(*), reprenant une mesure précédemment adoptée par le Sénat122(*), a allongé le troisième cycle de médecine générale à quatre ans, et affecté la dernière année à la réalisation de stages en autonomie supervisée par un ou plusieurs Pamsu, en ambulatoire et, en priorité, dans les zones sous-denses123(*).
Le nombre de Pamsu en médecine générale est important et est amené, pour permettre l'application de cette réforme, à croître encore dans les prochaines années. Selon le Collège national des généralistes enseignants et le Syndicat national des enseignants de médecine générale, 13 908 Pamsu de médecine générale ont accueilli des étudiants de 2e et de 3e cycle en 2024, soit une progression nette de 1 118 Pamsu par rapport à l'année précédente124(*).
Pour contribuer à répondre à ces besoins, un arrêté de 2024 a révisé le référentiel de formation des Pamsu en médecine pour améliorer l'attractivité de la maîtrise de stage en favorisant, notamment les formations en distanciel permettant la participation des médecins installés à distance des grands centres universitaires.
2. La maîtrise de stage universitaire dans les autres filières MMOP
La maîtrise de stage universitaire a, de la même manière, progressivement été encadrée dans les autres filières MMOP. Toutefois, les statuts applicables aux professionnels concernés apparaissent moins complets que celui applicable aux médecins.
· En odontologie, le code de l'éducation dispose seulement que les étudiants du troisième cycle long peuvent accomplir une partie de leur formation auprès d'un praticien agréé maître de stage125(*).
Un arrêté de 2013 prévoit, par ailleurs, que les étudiants de troisième cycle court réalisent un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste maître de stage agréé. Il encadre la réalisation de ce stage en précisant notamment que :
- que le maître de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire à la fois et ne perçoit pas de rémunération ;
- qu'il doit justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel ;
- qu'il est agréé par le directeur de l'UFR d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes126(*).
· En maïeutique, la loi de 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme127(*) a consacré un statut de sage-femme agréée maître de stage des universités, en autorisant les étudiants de deuxième et de troisième cycles à réaliser auprès d'elles une partie de leurs stages dans des conditions fixées par décret. Elle précise que les conditions de l'agrément doivent comprendre une formation obligatoire auprès de l'université ou de tout autre organisme habilité128(*).
Toutefois, plus de deux ans après leur entrée en vigueur, le décret nécessaire à l'application de ces dispositions n'a toujours pas été publié. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes (CNOSF), interrogé par les rapporteurs, indique même que le groupe de travail prévu « n'a jamais vu le jour »129(*).
Pourtant, les stages en ambulatoire apparaissent fréquents dans la formation. Selon une enquête de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique (Cnema), citée par l'Association nationale des sages-femmes libérales (ANSFL), deux tiers des sages-femmes libérales accueilleraient des étudiants sages-femmes en stage, en particulier au cours du deuxième cycle des études130(*).
· Enfin, en pharmacie, un arrêté de 2013 encadre l'accueil des étudiants par des pharmaciens d'officine, sans toutefois offrir les garanties attendues par la profession.
Pour pouvoir recevoir des stagiaires, les pharmaciens titulaires d'une officine doivent, ainsi, avoir la qualité de maîtres de stage, agréés en cette qualité par décision du directeur de l'UFR dispensant des formations pharmaceutiques, après avis du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. Ils doivent justifier de cinq années d'exercice officinal, dont deux années au moins en tant que titulaires. Enfin, pour être agréé, le pharmacien doit signer une charte d'engagement conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux131(*). Aucune rémunération du pharmacien maître de stage n'est prévue.
B. L'article 5 vise à créer quatre statuts de maître de stage homogènes pour les filières MMOP
L'article 5 porte quatre statuts homogènes pour les maîtres de stage universitaire des filières MMOP.
Le I de l'article insère, ainsi, dans le code de l'éducation quatre nouveaux articles dans les chapitres relatifs aux études médicales, aux études pharmaceutiques, aux études odontologiques et aux études de maïeutique. Ces quatre articles prévoient que :
- les étudiants de deuxième et troisième cycles de médecine, les étudiants en pharmacie, les étudiants en odontologie et les étudiants de deuxième et troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès, respectivement, de Pamsu, de pharmaciens agréés maîtres de stage des universités, de chirurgiens-dentistes agréés maîtres de stage des universités et de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret ;
- le même décret devra définir les modalités de rémunération des professionnels qui accueillent ainsi des étudiants ;
- les conditions de l'agrément de ces professionnels devront comprendre une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou auprès d'un organisme habilité, et seront fixées par décret en Conseil d'État.
Le II de l'article abroge les articles L. 4131-6 et L. 4151-9-1 du code de la santé publique, relatifs respectivement aux Pamsu et aux sages-femmes agréées maîtres de stage des universités. Ces articles deviendront, en effet, obsolètes en cas d'entrée en vigueur des dispositions du I.
II - La position de la commission
Soucieuse à la fois de garantir des conditions d'accueil en stage de qualité aux étudiants des filières MMOP et de fournir aux professionnels de santé maîtres de stage des universités (MSU) les accueillant une rémunération reconnaissant leur rôle essentiel, la commission accueille favorablement la proposition de créer quatre statuts homogènes pour ces maîtres de stage, articulés autour d'une formation obligatoire, d'un agrément et d'une rémunération.
Cette harmonisation recueille un soutien général de tous les acteurs concernés. Ces derniers soulignent cependant la nécessité d'adapter la formation à chaque filière et d'accompagner l'extension des obligations de formation et de rémunération - sous forme d'honoraires pédagogiques - de crédits budgétaires dédiés lors du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils expriment également le souhait d'une forme de reconnaissance institutionnelle du statut de MSU, s'accompagnant de garanties de temps libéré de la part de leur structure de rattachement.
L'Association nationale des étudiants sages-femmes (Anesf) souhaite également que le statut de MSU soit, à plus long terme, ouvert aux sages-femmes hospitalières et non plus aux seules sages-femmes libérales.
L'ordre des pharmaciens a précisé, pour sa part, que le statut de maître de stage universitaire lui semblait spécifiquement nécessaire pour les pharmaciens titulaires d'officines, mais non pour les autres filières, notamment industrielles. Dans le cadre de la réforme en cours du troisième cycle officinal, des représentants de pharmaciens ont, de la même manière, réitéré leurs demandes tendant à la création d'un statut complet de maître de stage, prévoyant notamment la rémunération des pharmaciens impliqués.
La commission juge nécessaire un tel encadrement. Elle appelle également le Gouvernement à travailler à la définition de nouveaux statuts permettant de cumuler pratique clinique et enseignements universitaires, sur le modèle de celui dont bénéficient les enseignants-chercheurs médecins généralistes. Les conférences des doyens d'odontologie et de pharmacie, auditionnés, ont rappelé ce souhait et précisé, s'agissant de la pharmacie, qu'un tel statut contribuerait à l'amélioration de l'accueil des étudiants en stage et au renforcement des compétences professionnelles enseignées au sein des facultés, alors qu'aujourd'hui seuls 46 % des enseignants chercheurs des facultés de pharmacie sont pharmaciens.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
Faciliter la mise en oeuvre de la réforme du
troisième cycle de médecine générale
Cet article vise à favoriser la réussite de la réforme ayant conduit à l'allongement du troisième cycle de médecine générale, en permettant l'accueil, jusqu'à la rentrée universitaire 2031, des docteurs juniors de médecine générale dans des lieux de stage dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes enseignants, préalablement déclarés à l'agence régionale de santé, qui ne sont pas encore praticiens agréés maîtres de stage des universités. Pour favoriser le développement de la maîtrise de stage, l'article prévoit également que les étudiants suivront, lors de la dernière année du troisième cycle, la formation nécessaire à leur agrément.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement.
I - Le dispositif proposé
A. Le troisième cycle de médecine générale a récemment été réformé
1. L'allongement du troisième cycle de médecine générale
• Depuis sa réforme en 2016 et 2017, le troisième cycle des études de médecine comprend 44 diplômes d'études spécialisées (DES) permettant la qualification et l'exercice des étudiants dans chacune des spécialités médicales132(*).
La durée du troisième cycle est comprise entre trois et six ans et fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formations définies par arrêté ministériel133(*). La plupart des spécialités médicales sont accessibles à l'issue d'un troisième cycle de quatre ans, et la plupart des spécialités chirurgicales à l'issue d'un troisième cycle de six ans134(*).
Depuis la réforme, le troisième cycle est organisé en trois phases et offre deux statuts successifs aux étudiants :
- une phase « socle » puis une phase « d'approfondissement », durant lesquelles les étudiants bénéficient du statut d'interne135(*) ;
- une phase « de consolidation »136(*), enfin, durant laquelle les étudiants bénéficient d'un nouveau statut de docteur junior, leur permettant d'accéder ainsi à un degré d'autonomie renforcé et à une rémunération revalorisée137(*).
• Alors que la médecine générale était, depuis 2017, la seule des 44 spécialités pour laquelle la durée minimale de trois ans avait été retenue, son DES a récemment été allongé. Jusque-là, le DES de médecine générale était également le seul à ne pas comprendre de phase de consolidation ni de statut de docteur junior, réservés aux spécialités dont le troisième cycle dure au moins quatre ans138(*).
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a, en effet, allongé à quatre ans la durée du troisième cycle de médecine générale139(*), reprenant une mesure précédemment portée par une proposition de loi du président Bruno Retailleau adoptée en octobre 2022 par le Sénat140(*).
La réforme prévoit que les étudiants intégrant le troisième cycle de médecine générale à compter de la rentrée de l'année universitaire 2023 s'inscrivent dans un DES d'une durée de quatre ans, dont la dernière année, voulue professionnalisante, est effectuée en stage.
Les stages de quatrième année sont, en principe, réalisés sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens agréés maîtres de stage des universités (Pamsu), en pratique ambulatoire et, en priorité, dans les zones sous-denses. À titre exceptionnel et dérogatoire, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier au cours de cette année141(*).
2. Les besoins induits en recrutement de Pamsu
• La réforme du DES de médecine générale induit d'importants besoins de recrutement de Pamsu.
D'abord, parce que ceux-ci devront accueillir une nouvelle cohorte nombreuse de docteurs juniors, en sus des internes qu'ils accueillent déjà. À titre d'illustration, selon l'ONDPS, 3 848 postes d'internat en médecine générale ont été pourvus en 2023 et 3 385 en 2024142(*). Ce nombre a vocation à augmenter significativement dans les prochaines années, du fait de la forte croissance du recrutement dans les études de médecine permise ces dernières années par l'augmentation du numerus clausus puis du numerus apertus.
La priorité donnée, par la loi, aux stages de quatrième année réalisés en zone sous-dense induit également des besoins de recrutement spécifiques dans les territoires les moins bien dotés en médecins généralistes. D'après un rapport d'octobre 2024 de la commission des affaires sociales, les modalités d'appariement envisagées par le Gouvernement devraient conduire les étudiants à choisir d'abord des lieux de stage situés dans des territoires peu pourvus en médecins, les autres ne devenant « accessibles que lorsque les terrains de stage en zone sous-dense seraient tous occupés » 143(*). En conséquence, un nombre insuffisant de lieux de stage disponibles en zone sous-dense pourrait réduire sensiblement la portée de la réforme et son efficacité pour lutter contre les inégalités territoriales d'accès aux soins.
• Malgré une augmentation sensible du nombre de Pamsu observée ces dernières années, la capacité de l'université à mettre en oeuvre la réforme dès la rentrée 2026, pour plus de 3 000 docteurs juniors en médecine générale, demeure incertaine.
Le nombre de Pamsu agréés en médecine générale a, en effet, significativement augmenté ces dernières années. Avant même l'adoption de la réforme, le nombre de Pamsu serait ainsi passé de 11 805 en 2019 à 12 941 en 2021 d'après une instruction interministérielle de 2022144(*). Cette croissance s'est poursuivie depuis : d'après le collège national des généralistes enseignants (CNGE) et le syndicat national des enseignants de médecine générale (SNEMG), 13 908 Pamsu de médecine générale ont accueilli des étudiants en 2024, soit une progression nette de plus de 1 000 Pamsu par rapport à l'année précédente145(*).
Toutefois, cette augmentation pourrait ne pas suffire à accueillir, dans de bonnes conditions et dans les territoires en ayant prioritairement besoin, les nouveaux docteurs juniors en médecine générale à compter de 2026. Dans son rapport d'octobre 2024 précité, la commission des affaires sociales soulignait ainsi que « La capacité de l'université à proposer suffisamment de terrains de stage en zone sous-dense apparaît, à ce stade, incertaine. » Elle relevait que, selon le CNGE, « le retard majeur de publication des textes statutaires relatifs à la phase de consolidation constitue un frein majeur au recrutement anticipé de maîtres de stage » pour accueillir des étudiants de quatrième année du DES de médecine générale146(*).
B. L'article 6 vise à faciliter l'accueil, en ville, des étudiants de la quatrième année du troisième cycle de médecine générale
• Pour augmenter le nombre de lieux de stage disponibles dans le cadre de la phase de consolidation du DES de médecine générale, notamment en zone sous-dense, l'article 6 permet, d'abord, l'accueil des docteurs juniors par des médecins généralistes accueillants non encore agréés.
Pour ce faire, le 2° du I insère, dans le code de l'éducation, un nouvel article L. 632-2-1 permettant d'autoriser les étudiants de dernière année du DES de médecine générale à effectuer leurs stages pratiques dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes accueillants. Il précise que ces stages demeureront supervisés par un Pamsu exerçant à proximité du lieu de stage.
L'accueil d'un stagiaire par un médecin généraliste accueillant ferait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente. Le médecin généraliste accueillant devrait, en outre, s'engager à s'inscrire à la formation obligatoire dans le cadre de l'agrément à la maîtrise de stage, dans un délai de deux ans compter de la première déclaration.
Enfin, le nouvel article L. 632-2-1 du code de l'éducation confierait à un décret le soin de préciser les conditions d'application de ces dispositions.
Destinée à faciliter la réforme du DES de médecine générale dans les premières années de sa mise en oeuvre, cette mesure demeurerait transitoire : le II de l'article 6 prévoit, ainsi, l'abrogation du nouvel article L. 632-2-1 du code de l'éducation le 1er novembre 2031.
• Dans l'objectif de favoriser la croissance du nombre de Pamsu et de permettre, à terme, la bonne mise en oeuvre de la réforme prévue, le b du 1° du I modifie l'article L. 632-2 du code de l'éducation, relatif au troisième cycle de médecine, pour prévoir que les étudiants de dernière année du DES de médecine générale devront suivre, au cours de l'année, la formation nécessaire à l'agrément à la maîtrise de stage.
• Enfin, le a du 1° du I apporte au même article L. 632-2 du code de l'éducation une amélioration rédactionnelle.
II - La position de la commission
La commission avait oeuvré en faveur de l'instauration d'une quatrième année d'internat de médecine générale, axée sur des stages ambulatoires supervisés par des maîtres de stages universitaires agréés.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de ce troisième cycle et de disposer de suffisamment de lieux de stage pour les docteurs juniors, la commission est favorable à la possibilité pour des médecins généralistes accueillants non encore agréés d'accueillir des docteurs juniors en stage, de manière transitoire.
La direction générale de l'offre de soins (DGOS) soutient cette mesure, de nature à augmenter les capacités d'accueil, et estime pertinent le délai fixé à 2031, propre à laisser le temps nécessaire pour former davantage de Pamsu, afin d'accueillir les étudiants dont le nombre augmentera dans les prochaines années.
Le conseil national de l'ordre de médecins insiste sur la nécessité de garantir le caractère provisoire du statut de médecin accueillant, et de l'assortir, comme prévu par la proposition de loi, d'une obligation de formation en tant que Pamsu, afin de ne pas dissocier trop longtemps l'accueil du suivi pédagogique au détriment des étudiants.
La commission, soucieuse de la qualité des conditions d'accueil des stagiaires, souligne que les docteurs juniors qui effectueront un stage auprès d'un médecin généraliste accueillant demeureront supervisés par un Pamsu exerçant à proximité du lieu de stage. Les conditions d'application de cette garantie devront être précisées par décret.
Tout en souscrivant à l'objectif de former davantage de Pamsu, la commission a adopté un amendement COM-20 des rapporteurs rendant facultatif le suivi, par les docteurs juniors de quatrième année de médecine générale, de la formation obligatoire dans le cadre de l'agrément à la maîtrise de stage universitaire. En effet, tous les diplômés ne souhaitent pas s'installer rapidement ni recevoir, dans ce cadre, des stagiaires dès le début de leur carrière - une possibilité qui leur est ouverte un an après leur installation147(*). En accord avec les préconisations du conseil national de l'ordre des médecins, l'objectif est de laisser la possibilité de suivre la formation de Pamsu aux docteurs juniors qui le souhaitent, dans une logique de volontariat et d'engagement personnel. Il a été souligné le fait qu'une telle formation serait également pertinente pour les docteurs juniors s'orientant vers un post-internat (assistant, chef de clinique) puisqu'ils seront amenés à accueillir, dans ce cadre, des étudiants.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
GAGE FINANCIER
Article 7
Gage
financier de la proposition de loi
Cet article gage les conséquences financières sur l'État et sur les organismes de sécurité sociale de l'adoption de la présente proposition de loi.
La commission a adopté cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé
L'article 7 gage l'incidence de la proposition de loi sur les finances de l'État et des organismes de sécurité sociale, par majoration à due concurrence de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II - La position de la commission
Limitée par les conditions de recevabilité financière, la commission n'est pas en mesure de lever d'elle-même ce gage. Elle appelle toutefois le Gouvernement à procéder de lui-même à la suppression du gage financier.
La commission a adopté cet article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
___________
Réunie le mercredi 15 octobre 2025, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport de M. Khalifé Khalifé et Véronique Guillotin, rapporteurs, sur la proposition de loi (n° 868, 2024-2025) relative aux formations en santé.
Mme Pascale Gruny, présidente. - Notre ordre du jour appelle l'examen du rapport de Khalifé Khalifé et Véronique Guillotin et l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de loi relative aux formations en santé, déposée par notre collègue Corinne Imbert. Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat lundi 20 octobre. Je vous indique que 23 amendements ont été déposés sur ce texte. L'un d'entre eux ayant été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, 22 restent soumis à notre examen.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Les études de santé constituent un enjeu de premier ordre pour l'accès aux soins de nos concitoyens comme pour la réussite des étudiants. Principal moyen de recrutement des professionnels de santé, elles sont chargées par la loi de contribuer à la répartition équilibrée de ces derniers sur le territoire au regard des besoins de santé constatés. Elles constituent également une voie plébiscitée par les lycéens : en 2024, un bachelier sur cinq a fait un voeu sur Parcoursup pour intégrer les voies communes d'accès aux études de médecine, de maïeutique, d'odontologie ou de pharmacie (MMOP).
Cette proposition de loi a pour objet d'agir là où tout commence - au moment des études - afin de construire un système de santé plus juste, plus efficace et mieux adapté aux besoins des territoires. Elle est le fruit d'une réflexion menée depuis plusieurs mois à la suite de l'enquête sur l'accès aux études de santé que notre commission avait commandée à la Cour des comptes, ainsi que des nombreuses auditions que nous avons conduites.
La proposition de loi mobilise trois principaux leviers d'action : améliorer le dispositif d'accès aux études de santé, fortement décrié aujourd'hui, et diversifier le recrutement ; territorialiser le troisième cycle des études de médecine ; améliorer, enfin, les conditions d'accueil des étudiants en stage. J'évoquerai pour ma part le premier chapitre de la proposition de loi, et ses articles 1 à 3 visant à améliorer l'accès aux études de santé et diversifier le recrutement.
Depuis la réforme de 2019, les lycéens qui souhaitent accéder à des études de santé se débattent dans une véritable jungle : parcours accès spécifique santé (Pass) avec une majeure santé et une mineure disciplinaire, licence accès santé (LAS) avec une majeure disciplinaire et une mineure santé, diversité des voies d'accès, des disciplines universitaires proposées, des modalités retenues d'organisation des études, d'interclassement, de nature ou de nombre des épreuves orales proposées en fonction des universités... Les lycéens et leurs familles peinent à se repérer face à l'hétérogénéité et l'illisibilité de l'offre, ce qui accentue des inégalités sociales et territoriales déjà bien documentées.
En outre, la réforme n'a pas réellement atteint ses objectifs. In fine, deux tiers des étudiants échouent à intégrer les filières MMOP. Parmi ceux qui échouent, près de huit sur dix abandonnent même la discipline dans laquelle ils s'étaient engagés. C'est un immense gâchis humain et universitaire.
L'article 1er de ce texte vise donc à refondre le dispositif Pass-LAS en une voie unique d'accès, articulée autour d'une licence universitaire qui comportera, en première année, une majorité d'enseignements relevant du domaine de la santé. Il intègre explicitement la masso-kinésithérapie dans ce parcours : alors que deux tiers des étudiants de cette filière sont d'ores et déjà issus de Pass ou de LAS, cette mesure répond à une revendication importante de la part des étudiants comme des professionnels en kinésithérapie.
Nous soutenons cette réforme, que les étudiants appellent de leurs voeux : elle apportera davantage de lisibilité aux jeunes et à leurs familles, répondra à leur souhait d'accéder à des études cohérentes avec leur projet professionnel et permettra de lutter contre les inégalités observées entre les étudiants, les universités et les territoires. En refondant les voies d'accès, nous ne fermons pas les portes, nous ouvrons enfin des chemins plus clairs et cohérents. Nous jugeons toutefois nécessaire de donner aux acteurs le temps suffisant pour préparer cette réforme et s'assurer de sa réussite. C'est pourquoi nous vous soumettrons un amendement visant à permettre une entrée en vigueur pour la rentrée universitaire 2027.
L'article 1er contient également une disposition visant à organiser une première année d'accès aux études de santé dans chaque département. Les profils recrutés dans les filières MMOP demeurent en effet très homogènes socialement et géographiquement : 21 % seulement des étudiants admis sont issus d'une commune rurale, 6 % d'une commune rurale peu dense et 19 % de milieux défavorisés ou assez défavorisés, soit des proportions inférieures d'un point à celles observées avant la réforme. Les étudiants des départements ruraux sont moins susceptibles d'accéder aux filières MMOP alors que 25 départements demeurent dépourvus de première année d'accès aux études de santé et que le suivi d'études hors de leur département d'origine implique souvent des coûts financiers et des contraintes logistiques significatifs. La création de formations délocalisées est, dans ce contexte, une mesure de justice territoriale pour les jeunes de nos territoires ruraux. C'est aussi un enjeu de lutte contre les inégalités territoriales d'accès aux soins. Une récente étude de l'Insee a montré que la moitié des médecins généralistes s'installaient à moins de 85 kilomètres de leur commune de naissance.
Nous comprenons, toutefois, que l'organisation d'une première année délocalisée puisse soulever des difficultés dans certains départements. Il conviendra donc de s'assurer de la qualité des formations mises en place, sans quoi nous ne saurions parler de justice territoriale. C'est pourquoi nous vous proposerons un amendement reportant la pleine application de cette mesure à une date fixée par décret en Conseil d'État - au plus tard, à la rentrée 2030 - et prévoyant la transmission annuelle d'un bilan de la réussite des étudiants dans chaque département.
Si nous sommes favorables, comme l'ensemble des associations étudiantes auditionnées, à l'organisation d'une voie d'accès unique aux filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie rééducation (MMOPK), nous avons néanmoins conscience des effets de bord d'une telle organisation. Celle-ci peut alimenter une concurrence entre filières et conduire à des phénomènes d'évitement de la part de lycéens qui partent étudier à l'étranger.
La filière pharmacie semble particulièrement exposée. Elle souffre aujourd'hui d'un déficit d'attractivité et de places laissées vacantes, dans un contexte de diminution de nombre de pharmacies d'officine - 1 800 pharmacies en moins entre 2012 et 2022 - qui inquiète notre commission depuis plusieurs années. Dans ce contexte, l'article 2 permet l'expérimentation d'un accès direct à la filière pharmacie dès l'obtention du baccalauréat. Cette expérimentation est souhaitée tant par les doyens que par les pharmaciens. Nous espérons qu'elle permettra de recruter directement via Parcoursup des lycéens motivés par la discipline.
Enfin, l'article 3 étend l'expérimentation des options santé dans les lycées à l'ensemble du territoire national et précise leurs objectifs. L'extension des options santé permettra de mieux faire connaître les études de santé aux jeunes de nos territoires ruraux ou sous-dotés et, nous l'espérons, de faire naître des vocations. Pour lutter contre les inégalités territoriales d'accès aux soins, il est essentiel d'avoir des professionnels de santé issus des territoires ruraux : ils sont les plus susceptibles d'y revenir pour y exercer une fois diplômés.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - Les deux autres chapitres de la proposition de loi visent respectivement à territorialiser le troisième cycle des études de médecine et à améliorer les conditions d'accueil des étudiants en stage.
Près de 50 % des étudiants de deuxième cycle de médecine quittent leur région. Certains le font par choix, mais beaucoup y sont contraints, faute de places disponibles ou d'un rang de classement suffisant pour obtenir la spécialité de leur choix dans leur région d'origine. Or le lieu d'internat figure parmi les principaux déterminants du choix du lieu d'exercice : 72 % des médecins généralistes et 69 % des médecins des autres spécialités s'installent là où ils ont suivi leur troisième cycle de formation. Agir sur le lieu d'internat pourrait donc permettre de réduire efficacement les inégalités territoriales d'accès aux soins. Par ailleurs, la procédure actuelle de définition du nombre de postes d'internat et de leur répartition territoriale est critiquée par divers acteurs - notamment les centres hospitaliers - qui se jugent insuffisamment consultés et déplorent l'insuffisante prise en compte des besoins de santé du territoire.
Se fondant sur ces constats, l'article 4 hiérarchise les critères de répartition des postes d'internat dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins de santé et territorialise partiellement le troisième cycle de médecine. Il instaure à cet effet un objectif national de deux tiers d'étudiants accédant au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé leur deuxième cycle. Il s'agit de fidéliser les étudiants sur un territoire et de leur permettre de rester dans leur région d'origine, sans renoncer à l'excellence médicale ni interdire la mobilité étudiante. Ces dispositions devraient permettre de mieux répondre aux besoins de santé des territoires, tout en préservant la liberté d'installation des médecins. Le dispositif précis sera défini par le Gouvernement, en concertation avec les principales parties prenantes. Nous vous proposerons de lui laisser le temps de le faire, en reportant l'entrée en vigueur de ces dispositions à la rentrée universitaire 2027.
La proposition de loi contient également plusieurs dispositions relatives aux conditions d'accueil des étudiants en stage. Nous demandons beaucoup à celles et ceux qui forment et accueillent nos futurs professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. Or leurs statuts sont aujourd'hui d'une grande hétérogénéité : formation obligatoire ici, inexistante là, rémunération prévue pour les uns, absente pour les autres, texte d'application manquant en maïeutique...
L'article 5 crée enfin quatre statuts homogènes de maîtres de stage universitaires pour toutes les filières MMOP, inspirés de celui qui est actuellement applicable aux médecins, lequel offre les meilleures garanties. Chaque maître de stage bénéficiera ainsi d'une formation préalable, d'un agrément et d'une rémunération. C'est une mesure de justice, mais aussi de qualité : mieux former les formateurs et les rémunérer pour le travail qu'ils fournissent, c'est garantir aux futurs soignants de meilleures conditions de formation. Cette harmonisation bénéficie d'un soutien unanime de la part des acteurs que nous avons entendus. Nous vous invitons donc à l'adopter.
Cependant, inciter les professionnels à s'investir dans l'accueil des étudiants et former des maîtres de stage universitaires prend plusieurs années. C'est pourquoi, afin de faciliter l'entrée en vigueur de la réforme du troisième cycle de médecine générale, l'article 6 permet, à titre transitoire, l'accueil de docteurs juniors par des médecins généralistes accueillants non encore agréés. Cette mesure facilitera l'accueil de docteurs juniors en stage dans les zones sous denses, qui disposent aujourd'hui d'un nombre insuffisant de maîtres de stages agréés. Il s'agit pourtant là d'un des principaux objectifs de la réforme voulue par le législateur. Les médecins accueillants devront se former à la maîtrise de stage et auront vocation, à terme, à être agréés. Les étudiants, eux, demeureront suivis par un maître de stage universitaire exerçant à proximité du lieu de stage.
Ayant seulement vocation à permettre la pleine application de la réforme dès ses premières années de mise en oeuvre, ces dispositions cesseront de s'appliquer à la rentrée universitaire 2031. Cette mesure a été largement soutenue lors des auditions que nous avons conduites. Nous vous proposerons, en conséquence, de l'adopter. En revanche, nous vous soumettrons un amendement visant à laisser le choix aux docteurs juniors en médecine générale de suivre eux-mêmes la formation nécessaire à l'agrément à la maîtrise de stage, sans en faire une obligation.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, la présente proposition de loi constitue, selon nous, un texte équilibré, largement attendu par le secteur. Sans résoudre l'ensemble des problèmes constatés, elle permettra d'apporter des réponses opérationnelles aux principales difficultés remontées par les étudiants en santé, les professeurs et les maîtres de stage. Elle contribuera, en diversifiant le recrutement et en territorialisant l'organisation du troisième cycle, à freiner la progression inacceptable des inégalités territoriales d'accès aux soins.
Enfin, en tant que rapporteurs, il nous revient de vous proposer un périmètre au titre de l'article 45 de la Constitution.
Nous considérons que ce périmètre inclut des dispositions relatives, premièrement, à l'accès aux études de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de masso-kinésithérapie ; deuxièmement, aux dispositifs visant à favoriser l'orientation des lycéens dans les études de santé ; troisièmement, à l'organisation du troisième cycle des études de médecine ; et enfin, quatrièmement, aux conditions d'accueil des étudiants en santé en stage.
En revanche, nous considérons que ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte, des amendements relatifs à l'organisation des établissements de santé et aux compétences des professionnels de santé.
Mme Corinne Imbert, auteure de la proposition de loi. - Je remercie les deux rapporteurs pour le travail que nous avons conduit ensemble au sein de la mission, pour l'élaboration de ce rapport et, évidemment, pour leur écoute. Je remercie également Sonia de La Provôté pour ses deux rapports éclairants sur ce sujet, ainsi que pour nos échanges.
Vous le savez, mes chers collègues, la Cour des comptes, que notre commission avait sollicitée pour avis, avait proposé de revenir de manière urgente sur la réforme Pass-LAS, dont nous avions constaté ici les lacunes et surtout l'illisibilité. La réforme avait notamment comme objectif initial de favoriser l'accès aux études de santé d'étudiants issus de l'ensemble du territoire national.
Les études de santé sont donc à la croisée d'enjeux universitaires et sanitaires. Il y va de l'orientation et de la réussite des étudiants comme de l'accès aux soins de demain. Si ces enjeux semblent majeurs pour une modeste proposition de loi, il s'agit de faire un pas supplémentaire vers l'amélioration du système et, en tout cas, de revenir sur une réforme qui a été mise en oeuvre de façon très hétérogène. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque, en discutant avec un doyen, j'ai découvert le « Tout-LAS »... !
Je reconnais qu'une application des dispositions de cette proposition de loi à la rentrée 2026 serait trop ambitieuse et n'aurait que peu de chances d'aboutir. Je souscris donc à l'idée de fixer une date d'application à la rentrée 2027. Mais ne perdons pas de temps. Il nous faut former plus de médecins et diversifier leur profil.
Mme Sonia de La Provôté, rapporteure pour avis de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport. - Compétente en matière d'enseignement supérieur, la commission de la culture s'est saisie pour avis de cette proposition de loi afin de se prononcer sur ses dispositions concernant l'accès aux études de santé. Comme cela a été rappelé, nous avons une certaine antériorité sur ce sujet. Je suis en effet l'auteure de deux rapports rédigés à la suite de missions flash en 2021 et en 2022, dans lesquels je tirais déjà la sonnette d'alarme sur la mise en oeuvre de la réforme de l'accès aux études de santé. Le premier avait pour titre Un départ chaotique au détriment de la réussite des étudiants et le second, deux ans après, Des progrès, mais peut mieux faire. Nous en arrivons enfin à une proposition de loi qui devrait permettre de mettre définitivement de l'ordre dans cette réforme.
Notre commission estime que la voie unique d'accès aux études de santé telle que proposée dans le texte répond aux exigences de simplification et de clarification du système actuel, qui reste confus pour bon nombre d'étudiants et de lycéens. Sa complexité, son caractère illisible et inéquitable, mais aussi la charge anxiogène qu'il entraîne font l'unanimité contre lui.
La commission appelle néanmoins à la vigilance sur cinq points.
Premièrement, les universités, qui ont déjà subi le choc organisationnel de la réforme Pass-LAS, doivent pouvoir se préparer dans de bonnes conditions à la mise en place de la voie d'accès unique. Une entrée en vigueur du nouveau dispositif pour la rentrée universitaire 2026, comme cela était proposé, était déraisonnable et à mon sens impossible. C'est pourquoi la commission a adopté un amendement fixant cette date au plus tard au 1er septembre 2027. Nous sommes donc complètement en phase, d'autant que cette réforme nécessite de nouveau un dialogue entre les composantes santé et université, afin de mettre en place les méthodes et les contenus.
Deuxièmement, dans la continuité de ses prises de position précédentes, la commission insiste sur la nécessité d'un cadrage réglementaire plus serré de la part du ministère de l'Enseignement supérieur pour remédier à la trop grande hétérogénéité des situations. Le texte prévoit déjà un meilleur cadrage national des disciplines hors santé enseignées, ce qui me semble essentiel. La commission estime que d'autres aspects auraient besoin d'être harmonisés à l'échelle nationale, comme le bloc d'enseignement santé. Il serait souhaitable qu'un socle commun de connaissances minimales soit précisé. Il en va de même pour les modalités d'évaluation pour l'accès en MMOPK, ainsi que pour les règles d'interclassement, peu transparentes et pas toujours très bien comprises. Dans certaines universités, les conditions de l'oral, par exemple, restent un sujet de polémique et de contestation.
Troisièmement, la commission considère que la refonte du dispositif Pass-LAS offre aussi l'occasion de renforcer les passerelles existantes entre certaines formations paramédicales et les filières de santé, dans un objectif de diversification académique des profils. Ces passerelles sont régies au niveau réglementaire, mais il ressort nettement des auditions qu'elles méritent d'être élargies.
Quatrièmement, la réforme doit également permettre de rappeler l'importance du tutorat étudiant, dont l'amélioration et la mise en place effective constituent probablement des conséquences positives de la réforme de l'accès aux études de santé. Il y a eu un avant et un après. Par la force des choses, il a fallu des tuteurs pour faire comprendre, expliquer et accompagner. Cet accompagnement pédagogique par les pairs se voit concurrencé par une offre de préparation privée toujours bien présente et qui, contre toute attente, n'a pas disparu avec la disparition de la première année commune aux études de santé (Paces). Les universités doivent être incitées par le ministère à mener une politique active en faveur du tutorat, via le renforcement de sa visibilité et sa meilleure reconnaissance dans le parcours académique. Être tuteur est en effet un engagement. J'ajoute que la multiplication des antennes nécessitera de toute façon un renforcement du tutorat. Ce dernier sera l'émanation de l'accompagnement de l'université-centre dans les antennes auprès des étudiants.
Cinquièmement enfin, la commission réitère son appel à un travail conjoint du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale. L'articulation entre la réforme de l'accès aux études de santé et la réforme du lycée interroge et nous voyons bien que des hiatus se font jour. En effet, la mise en place d'une voie d'accès unique ne sera pas sans conséquence sur les choix disciplinaires. Elle l'est déjà, puisque la triplette sciences de la vie et de la terre (SVT), physique-chimie et mathématiques est plébiscitée pour devenir médecin. Elle est même présentée comme indispensable et incontournable, ce qui ne va probablement pas dans le sens d'une meilleure atteinte des objectifs de diversité des profils. Il faudra donc redoubler d'efforts en matière d'information et d'orientation auprès des lycéens. À l'occasion de la réforme du baccalauréat et de l'enseignement supérieur, ce sujet principal avait été soulevé par un certain nombre de commissions : on ne peut faire un choix éclairé que si l'on a été bien orienté et bien conseillé. Je vous félicite et vous remercie pour tout ce travail.
Mme Raymonde Poncet Monge. - Au cours des deux auditions auxquelles j'ai pu participer, il a été souligné que les options santé en première et en terminale prévues à l'article 3 ne devaient pas être trop centrées sur les filières MMOPK. Si la mise en place de ces options ne vise nullement à répondre à un quelconque problème d'attractivité - les candidats sont nombreux -, elle pourrait contribuer à susciter des vocations sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les territoires ruraux peu denses. Cependant, ces options doivent s'ouvrir aux disciplines de santé au sens large, celui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles devraient sensibiliser au secteur médico-social qui, lui, souffre d'un manque criant d'attractivité, y compris pour les métiers d'encadrement. C'est la raison pour laquelle ces options doivent dépasser le pur médical pour être inclure le paramédical et le médico-social.
Le deuxième enseignement que j'ai tiré des auditions est que l'enjeu principal n'est pas tant le premier cycle que les deuxième et troisième cycles. C'est l'objet de l'article 4 de la proposition de loi, qu'il faudra discuter plus avant. J'étais, comme vous, favorable à la présence d'un premier cycle dans chaque département, mais peut-être n'est-il pas utile de viser 100 % des territoires. En revanche, il faut absolument consolider la territorialisation des deuxième et troisième cycles.
Par ailleurs, on en revient toujours, à un moment ou à un autre, à la régulation de la financiarisation de la santé. Dans la mesure où le secteur public ne suit pas en matière de développement du tutorat, le fait d'imposer des premières années d'accès aux études de santé sur tout le territoire facilite l'implantation des organismes privés. Rappelons que le coût de ces organismes atteint 5 000 à 6 000 euros et qu'il a encore augmenté récemment. Un développement massif du tutorat par les universités est donc nécessaire.
Les auditions ont par ailleurs mis en évidence l'échec total de la diversification sociale. Malgré l'existence d'un quota qui, à compétence égale, favorise les boursiers, la situation est catastrophique. Aussi, bien que s'éloignant du sujet de la proposition de loi, la question du niveau des bourses des boursiers qui ont été admis mérite d'être posée. Ces derniers ne devraient pas avoir à travailler en plus de leurs études.
Enfin, l'accès direct aux études de pharmacie après le bac est une bonne chose, mais vous avez entendu comme moi que les dentistes font d'ores et déjà la même demande. Les pharmaciens et les dentistes considèrent en effet que la première année n'est utile que pour ceux qui se destinent à la médecine, d'où cette demande d'accès direct. Penchons-nous donc sur cette question du contenu de la première année avant que toutes les professions hors médecine ne demandent à leur tour un accès direct.
Mme Émilienne Poumirol. - Tout le monde s'accorde à dire que la réforme Pass-LAS, trop complexe, est un échec. Le système actuel provoque du stress chez les étudiants, et même chez les parents. Je comprends donc que l'on ait voulu travailler sur ce sujet. Il y a par ailleurs une certaine urgence : cette réforme a été mise en place il y a cinq ans, trop rapidement et à un très mauvais moment, pendant la crise de la covid. De fait, on dénombre aujourd'hui en France près de 500 LAS différentes.
Cela étant dit, si je salue l'initiative, une réforme des études de santé aurait nécessité, me semble-t-il, un projet de loi émanant d'une concertation entre les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Vous vous attaquez aux deux extrêmes, la première année et l'internat, mais c'est en réalité l'ensemble de la maquette des études de médecine qui devrait être revu. L'Académie de médecine fait d'ailleurs des propositions extrêmement intéressantes en ce sens, qui consistent en une révision globale du corpus, du premier cycle jusqu'à l'internat.
Votre proposition de loi arrive en outre dans un contexte politique très particulier. La date à laquelle ce texte sera soumis à l'Assemblée nationale est un mystère et nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour y travailler sur le fond.
J'ai donc de nombreuses questions, qui portent en particulier sur l'article 1er. Est-il question d'instaurer une licence en santé ou simplement de modifier la première année ? Même si les doyens d'université rappellent leur autonomie, l'ensemble des personnes que nous avons auditionnées s'accordent sur la nécessité de proposer un socle commun santé et moins de LAS. Les étudiants qui ont réussi le concours se dirigent en médecine, en maïeutique ou vers la filière de leur choix. Mais que deviennent les autres ? Passent-ils en L2 de la mineure qu'ils ont choisie, avec un « rattrapage santé » ? S'il est souhaitable de maintenir le principe d'une deuxième chance, y aura-t-il pour autant une véritable formation de licence en santé en trois ans ? Sera-t-elle dotée d'un corpus commun suffisamment important ?
Nous devons aussi préparer nos étudiants au fait qu'ils devront travailler différemment. La complexité des connaissances à acquérir n'est pas tant un problème, car les moyens techniques évoluent très vite ; en revanche, les étudiants devront apprendre à travailler ensemble et à se coordonner, ce qui relève, à mon sens d'une licence en santé globale. L'Académie de médecine prône ainsi une licence santé en trois ans. Or l'article 1er se prête à des interprétations divergentes. J'aimerais donc obtenir des éclaircissements sur le devenir des étudiants en fin de première année qui ne réussissent pas le concours.
Concernant l'article 2, je connais bien le problème de la pharmacie et suis consciente du retard qui a été pris, mais il me semble quelque peu paradoxal, sur le principe, de rédiger une proposition de loi visant à créer une voie unique d'accès aux études de santé tout en prévoyant d'emblée une exception.
Les options santé visées à l'article 3 fonctionnent dans beaucoup de régions. En Occitanie par exemple, elles sont proposées dans dix-sept lycées situés en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones peu denses. Le texte mentionne cependant une « convention avec l'université ». Je ne comprends pas très bien : les enseignements dont il est question - biologie, chimie, etc. - sont actuellement dispensés par des professeurs de l'éducation nationale. Ces heures supplémentaires sont payées par l'éducation nationale. Quel serait le lien avec l'université ? En Occitanie en tout cas, ces options ne se limitent pas à une préparation aux métiers médicaux. Elles visent aussi les métiers paramédicaux, aides-soignants et infirmiers en particulier.
Par ailleurs, la régionalisation du troisième cycle des études de médecine est certes un moyen de lutter contre les déserts médicaux. Toutefois, le dispositif proposé à l'article 4 me paraît complexe. Qui décidera de la répartition ? Pourriez-vous nous apporter des précisions à ce sujet ?
Je suis bien sûr favorable aux dispositions de l'article 5 sur les maîtres de stage des universités en pharmacie notamment. La période tampon envisagée à l'article 6 jusqu'en 2031 me paraît souhaitable. Nous comptons certes plus de 14 000 maîtres de stage en médecine, mais il en faudrait certainement un peu plus.
Enfin, je reviens sur l'importance du tutorat. La présence de tuteurs est indispensable, en particulier si l'on déploie des antennes dans tous les départements. Développer le tutorat permettra d'éviter la multiplication des boîtes privées, dont les tarifs atteignent non pas 5 000 euros, mais 10 000 euros !
M. Daniel Chasseing. - Je félicite l'auteure de la proposition ainsi que les rapporteurs pour ce travail.
Les modalités d'accès aux études de santé revêtent une grande importance pour les soins de demain. Le système Pass-LAS ayant montré ses dysfonctionnements, je suis naturellement favorable à son remplacement par une voie unique d'accès aux formations de santé incluant, en première année, les masseurs-kinésithérapeutes. La création d'une option santé dans les lycées est une bonne chose également. Pour les familles, il est sûrement très appréciable, lorsque cela est possible, que les jeunes puissent accéder à une première année d'études de santé dans tous les départements.
La mesure proposée à l'article 4, qui organise l'affectation des étudiants du troisième cycle dans la région de leurs études, ainsi que la répartition des postes d'internat, devrait fidéliser les étudiants et maintenir leur présence sur place. Bien que suscitant l'opposition de ces derniers, elle doit néanmoins être conservée : nous avons besoin de médecins dans tous les territoires.
La création d'un statut de maître de stage des universités et d'une formation nécessaire à leur agrément, proposée à l'article 5, me semble par ailleurs souhaitable. Les stages de quatrième année auprès des médecins généralistes feront découvrir la médecine aux étudiants, tout comme le territoire. C'est tout à fait bénéfique.
Je suis en revanche assez réservé sur l'article 2 et sur la possibilité d'accéder directement, via Parcoursup, à la filière pharmacie après le baccalauréat, dans la limite du tiers des capacités. Certes, le nombre de pharmacies d'officine a diminué de 200 unités par an ces dernières années. Je m'interroge sur le fait de proposer deux voies d'accès pour entrer en première année de pharmacie, l'une par concours, l'autre directement. Il faut que nous incitions les lycéens à s'orienter dans cette voie, mais si nous devions instaurer un accès direct, il faudrait que cela se fasse uniquement en année N+1 lorsque le nombre de candidats reçus en année N n'est pas suffisant. Tel sera le sens d'un amendement que je soutiendrai.
Mme Céline Brulin. - Je me réjouis que nous examinions une proposition de loi relative aux formations en santé. Comme vous le savez, le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky y est particulièrement attaché : il avait organisé un débat sur ce thème auquel vous aviez activement participé. Nous avions alors senti qu'il existait entre nous des points de convergence pour avancer et améliorer les choses. Cependant, nous sommes là confrontés - le contexte y est sûrement pour beaucoup - à une succession de propositions de loi parcellaires et qui manquent de cohérence.
Je rejoins bien évidemment les critiques qui ont été émises sur la réforme Pass-LAS, tant sur le fond que sur la manière chaotique avec laquelle elle a été mise en oeuvre. De toute évidence, les objectifs affichés n'ont pas du tout été atteints, en particulier celui visant à diversifier les profils. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, il y a une corrélation directe entre les profils qui accèdent aux études de médecine et, ensuite, les lieux d'installation. Les inégalités territoriales existent et il faut y répondre, mais il y a aussi, et il faut s'en emparer de la même manière, des inégalités sociales. Nous n'inscrirons pas cela dans la loi, mais il faudra veiller, par exemple, à ce que les options santé soient proposées dans les territoires où sont présents des jeunes issus de milieux populaires. C'est aussi de cette manière que nous corrigerons les choses. À cet égard, j'émets une petite inquiétude, peut-être à mauvais escient : on constate que les enseignements de spécialité ne sont pas les mêmes - peut-être suis-je légèrement caricaturale - dans les lycées cotés du coeur des grandes métropoles et dans ceux des villes moyennes, en ruralité ou dans les quartiers populaires. Il ne faudrait donc pas que les nouvelles options santé suivent le même chemin.
Nous souscrivons totalement, évidemment, à l'idée d'intégrer les masseurs-kinésithérapeutes dans la première année de tronc commun. Il y a toutefois une forme de contradiction dans le fait, d'un côté, de vanter ce tronc commun et, de l'autre, d'en écarter une partie des futurs pharmaciens. Les rapporteurs nous ont expliqué que les pharmaciens et les doyens étaient favorables à cette mesure. Je n'ai pas participé à beaucoup d'auditions, mais il me semble que les syndicats étudiants s'y étaient opposés. Ils avançaient notamment, me semble-t-il, l'argument que je formulerai de façon quelque peu caricaturale selon lequel les pharmaciens ne sont pas seulement des « vendeurs de boîtes de médicaments ». Au contraire, ils jouent un rôle de plus en plus important dans notre système de santé. Je ne méconnais pas les difficultés de recrutement et je comprends la nécessité de travailler sur le sujet, mais la réponse ne me paraît pas être la bonne.
De même, je suis assez sceptique sur l'assouplissement de la qualité de maître de stage pour les étudiants en quatrième année d'internat de médecine générale. Cela peut conduire à ce que ces derniers soient moins bien encadrés.
Les conditions d'études me semblent être l'angle mort de cette proposition de loi. Nombreux sont les étudiants en santé qui interrompent leurs études. L'une des priorités est peut-être de faire en sorte que ceux qui s'inscrivent puissent aller au bout de leur cursus.
J'aimerais aussi avoir des précisions sur le statut, le traitement, la rémunération et l'indemnisation actuels des maîtres de stage, car j'ai reçu des avis contradictoires : certains disent qu'ils ne sont pas du tout attractifs, d'autres sont plus nuancés.
Dans la mesure où tout cela devrait déboucher sur une augmentation des capacités d'accueil dans les universités, les rapporteurs ont-ils par ailleurs évalué les moyens budgétaires qu'il faudrait dégager pour y faire face ?
Enfin, il reste un sujet sur lequel nous avions constaté des convergences : quid de sortir l'accès aux instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) de Parcoursup ? Lors d'un débat en séance, nous étions convenus que notre commission y travaillerait. Cela doit rester, me semble-t-il, un objectif.
Mme Nadia Sollogoub. - Il ne m'appartient pas de répondre à Raymonde Poncet Monge, mais pour être élue d'un territoire dans lequel le caractère complexe et illisible du système Pass-LAS est manifeste, je confirme que ce dernier ne nous a pas aidés à attirer des professionnels de santé, bien au contraire. Les améliorations doivent porter sur les deux piliers que sont l'accès au premier cycle et la territorialisation du troisième cycle.
Dans notre territoire, l'accès aux études en santé se fait par un campus connecté qui obtient d'excellents résultats. Nous voyons arriver les premiers externes et les taux de réussite au concours ont atteint les 70 %. Parfois, les déserts médicaux étaient tout simplement des déserts de formation. Certains jeunes tout à fait brillants s'interdisaient totalement, pour des raisons financières ou logistiques, ne serait-ce que d'essayer les études en santé. Je soutiens donc absolument ce texte : il faut rouvrir cette porte et nous avons les outils pour le faire.
Je formulerai en revanche une remarque sur le troisième cycle. Nous nous sommes battus et nous avons légiféré sur ce sujet. Nous attendons énormément de l'arrivée des docteurs juniors, annoncée comme imminente. Pardonnez-moi d'enfoncer le clou, mais la mise en oeuvre de la loi semble coincer sur le terrain, faute notamment de décrets d'application. Dans mon territoire, nous attendions quarante docteurs juniors ; a priori, nous en aurons cinq. J'aimerais que nous fassions le point sur les négociations en cours, qui, manifestement, ne se déroulent pas aussi bien qu'on le dit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer dans la mise en oeuvre concrète du déploiement des docteurs juniors. Ce problème dépasse le strict cadre législatif.
M. Martin Lévrier. - Nous traitons ici du système de santé et du système universitaire, qui sont en théorie ouverts à tous. Aussi, le coût financier ne devrait-il pas entrer en ligne de compte. Au risque d'être hors sujet, je m'étonne que nous n'abordions absolument pas le problème des classes préparatoires, ces fameuses « prépas médecine » dont le coût est très élevé et sans lesquelles il est impossible de réussir la première année. J'en vois naître régulièrement dans mon département. Cette proposition de loi ne pourrait-elle pas être un véhicule, sinon pour interdire, du moins pour réguler ce type de prépas qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec le système universitaire ? À défaut, pourquoi ne pas acter qu'elles se situent en dehors du système universitaire ? Des éclaircissements seraient bienvenus sur ce sujet.
Mme Chantal Deseyne. - Je salue l'auteure de cette proposition de loi qui vise à simplifier l'accès aux études de médecine. Vous l'avez rappelé, le système Pass-LAS est une jungle. Personne ne s'y retrouve, en premier lieu les étudiants.
L'objet de l'article 4 - faire en sorte que les deux tiers des étudiants effectuent leur troisième cycle dans la région où ils ont obtenu leur deuxième cycle - me semble louable, mais peu réaliste. Dans la région Centre-Val de Loire, par exemple, les étudiants qui choisissent de faire des études de santé, et de médecine en particulier, étudient à Tours. Cette ville étant particulièrement attractive, ils sont naturellement tentés d'y poursuivre leur troisième cycle. Par conséquent, je serais favorable à un dispositif légèrement plus contraignant, qui renverrait ces étudiants vers leur département d'origine.
Mme Anne-Sophie Romagny. - Je remercie à mon tour l'auteure de cette proposition de loi, ainsi que nos rapporteurs pour le travail effectué. Les mesures proposées sont pertinentes et pragmatiques. Nous pouvons certes déplorer la situation politique actuelle et l'absence d'une grande loi. Pour ma part, je vous remercie d'essayer d'avancer, pas à pas, dans le contexte que nous connaissons et qui n'est pas simple. Au moins, nous pouvons apporter quelques modestes solutions qui, je l'espère, seront efficaces.
Je salue bien évidemment la mesure visant à sensibiliser les lycéens aux études de santé, que certains méconnaissent totalement. J'espère qu'elle suscitera des vocations médicales, mais aussi paramédicales.
Rendre les études de santé plus accessibles sur le territoire devrait par ailleurs favoriser un meilleur maillage des installations, et donc un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens. Tout comme l'équité sociale, c'est une finalité de cette réforme.
Il est aussi souhaitable de continuer à diversifier les licences d'adossement, en ouvrant l'accès à d'autres parcours, licences de mathématiques ou licences sciences de l'ingénieur par exemple. Les universités doivent être incitées à porter une attention particulière, en licence, aux étudiants en santé qui intègrent ce parcours. En effet, les étudiants en santé sont souvent laissés pour compte dans les licences disciplinaires, d'où un manque d'équité entre les étudiants en LAS, dans l'organisation des cours comme dans celle des examens.
Il faudra par ailleurs être très vigilants quant aux moyens supplémentaires que cette réforme implique, notamment en matière de personnel administratif et d'enseignants. Nous aurons beau faire des réformes ; si les moyens ne suivent pas, elles seront vaines.
Mme Marie-Do Aeschlimann. - Je salue la qualité du travail accompli : il est de nature à répondre à plusieurs interrogations et difficultés que nous avons soulignées à de nombreuses reprises au sein de notre commission.
Si le présent texte ne devait pas être le véhicule législatif adéquat pour répondre à la remarque très pertinente qu'a formulée notre collègue Martin Lévrier sur les organismes de préparation privée, cela pourrait être le cas de la proposition de loi de notre collègue Stéphane Piednoir visant à réguler l'accès à l'enseignement supérieur, qui devrait être discutée prochainement. Il y a effectivement beaucoup d'abus.
M. Alain Milon. - Je salue le travail important qui a été réalisé par Corinne Imbert et par les rapporteurs sur la question du Pass-LAS.
Cette proposition de loi est nécessaire, même indispensable, mais je veux tempérer l'optimisme des uns et des autres : celle-ci ne s'appliquera qu'à partir de 2027, pour des étudiants qui suivront dix années d'études. Autrement dit, ils n'arriveront sur le terrain qu'en 2037. Il ne faut pas donner de faux espoirs à nos concitoyens.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - Je me réjouis de la qualité de la collaboration que nous avons eue lors des auditions, puisque de nombreux collègues des différents groupes parlementaires y ont assisté. Je salue également la présence de notre collègue Sonia de La Provôté, au nom de la commission de la culture.
Avec cette proposition de loi, nous tentons de surmonter certaines difficultés et dysfonctionnements du système actuel. Certes elle ne pourra pas tout et mettre du temps à produire ses effets, comme le relevait Alain Milon. Cependant, elle contient des dispositions relatives au troisième cycle, qui permettront d'avoir des effets concrets avant dix ans. En outre, pour répondre à Chantal Deseyne, nous allons demander à la Cour des comptes de travailler sur l'organisation du troisième cycle de médecine.
Il est vrai que nous avons été confrontés dans l'instruction de cette proposition de loi, à de nombreuses difficultés, relatives notamment à l'autonomie des universités et aux questions de programmes pédagogiques et de maquettes. Nous avons eu la sagesse de ne pas déborder, de rester dans le rôle du législateur.
Les acteurs que nous avons entendus ont parfois émis des opinions divergentes.
Émilienne Poumirol a ainsi évoqué le sujet de la voie directe d'accès à la pharmacie : elle est souhaitée par les doyens et les pharmaciens, même si les étudiants émettent quant à eux des réserves. Alors que la moitié des dentistes ont obtenu leur diplôme à l'étranger, notamment en Roumanie, ces professionnels pourraient également demander un accès direct, mais ce ne fut pas le cas lors des auditions.
Les étudiants, pour leur part, se sont montrés hostiles à la régionalisation de l'internat. Cependant, aujourd'hui 50 % des internes exercent dans la région dans laquelle ils ont suivi leur deuxième cycle et cette part pourrait atteindre les deux tiers sans trop de difficulté. L'excellence ne concerne qu'environ 10 % des spécialités et nous maintenons, quant à nous, un tiers de postes exclus de la régionalisation.
Pour répondre à Martin Lévrier : nous avons naturellement dénoncé les organismes de préparation privée. Sachez que le tutorat est désormais généralisé partout, comme nous l'ont certifié étudiants, doyens et présidents d'université. Cela n'empêche pas des acteurs privés, motivés par des intérêts financiers, d'aller jusque dans les lycées, inquiétant les élèves et leurs parents, avec des tarifs d'environ 6 000 à 8 000 euros, et près de 10 000 euros à Toulouse.
Nous pourrions également aborder le deuxième cycle, mais procédons par étapes, attendons d'abord le rapport de la Cour des comptes sur le troisième cycle, et concentrons-nous sur ce qui nous unit et sur les mesures urgentes à mettre en oeuvre dès aujourd'hui.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Je commencerai par évoquer la question de l'accès direct en pharmacie. Plusieurs d'entre vous ont évoqué ce sujet. Il s'agissait d'une demande spécifique de la filière pharmacie, notamment pour pallier le manque de places et répondre à la fermeture de certaines officines en milieu rural. L'objectif est de rendre le métier plus attractif.
Cette mesure a été globalement consensuelle, sauf auprès des étudiants, qui préfèrent être tous ensemble en première année. Toutefois, les doyens nous ont indiqué que cette première année en accès direct reprendra le bloc santé de la voie d'accès unique, garantissant un niveau équivalent, avec en sus des modules transverses ou spécifiques à la pharmacie.
Les étudiants soulignent qu'ils doivent travailler ensemble. Sincèrement, le travail collectif ne se construit pas uniquement en première année, surtout dans un cursus de huit à dix ans. Apprendre à travailler de manière collaborative s'apprend tout au long des études, y compris dans les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
L'objectif de cette demande est de rattraper le retard, ce qui explique que la mesure soit expérimentale, avec un bilan prévu à l'issue de l'expérimentation.
Concernant les options santé, il s'agissait non pas d'une prépa pour les lycéens de terminale, mais bien d'une initiative pour sensibiliser et faire connaître les métiers de la santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, à l'ensemble des lycéens visés. Émilienne Poumirol a évoqué sa région, qui semble bien réussir dans la mise en place des lycées options santé, tandis qu'ailleurs, comme dans ma région, cela fonctionne moins bien. Il était donc nécessaire que l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et les universités soient pleinement impliqués.
Initialement, le choix des lycées avec options santé a pu concerner des établissements proches des facultés, ce qui n'était absolument pas l'objectif. Le texte précise que ces dispositifs doivent viser des lycées en zones sous-dotées ou rurales, afin de sensibiliser davantage les lycéens de ces territoires, de faire connaître les métiers de la santé et d'éviter l'autocensure territoriale, qui ne se limite pas toujours aux seuls facteurs financiers et sociaux.
S'agissant du Pass et de la LAS, la réforme instaure une voie unique, sous la forme d'une licence commune, remplaçant les anciennes distinctions entre Pass, LAS et Pass-LAS. Désormais, le futur socle Pass-LAS sera mieux encadré, avec éventuellement des mineures adaptées : par exemple du droit, pour répondre aux besoins juridiques, mais pas d'options décalées par rapport à la santé. Ce n'est pas à nous de réaliser la maquette. Après la première année de voie unique, avec une majorité d'enseignements en santé, les étudiants qui n'intègrent pas les filières MMOPK mais qui ont validé leur année poursuivent leur licence, en deuxième puis troisième année. Ils ont une deuxième chance d'accéder aux filières MMOPK.
Tout le monde est conscient de la nécessité d'un sursaut des universités face aux organismes de préparation privés. Les étudiants ayant suivi des tutorats au sein de leur université les jugent d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité que ceux des organismes privés. Il faut en convaincre les étudiants et les parents.
La mise en oeuvre d'une première année de voie unique dans tous les départements a été décalée pour en garantir la qualité, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des étudiants. Il ne faut pas laisser les étudiants de première année isolés dans un département, car cela pourrait entraîner des effets de bord. Une évaluation de leur réussite est nécessaire afin d'assurer l'encadrement, les ressources humaines et la viabilité du projet, tout en évitant une fracture sociale et territoriale dès la première année.
La diversification des profils des étudiants passe par la première année territorialisée et par la régionalisation en troisième cycle.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Les amendements identiques COM-14 et COM-23 visent à reporter l'entrée en vigueur de la voie unique à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.
Les amendements identiques COM-14 et COM-23 sont adoptés.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-9 vise à inclure, au sein de la première année de voie unique d'accès aux études de santé, des enseignements relatifs à la santé environnementale et à la transition écologique.
Nous ne contestons naturellement pas l'importance de la santé environnementale, mais notre rôle n'est pas de détailler les maquettes pédagogiques des universités. Celles-ci ont d'ailleurs déjà la possibilité d'intégrer ces enjeux dans leurs enseignements et nombre d'entre elles l'ont déjà fait. Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement COM-9 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-15 tend à reporter au 1er septembre 2030 l'entrée en vigueur de l'obligation d'organiser une première année de voie unique dans chaque département.
L'amendement COM-8 vise à mettre en oeuvre l'obligation d'organiser des premières années de voie unique dans chaque département par l'université dont le siège est implanté sur le territoire du département chef-lieu de la région. Nous sommes défavorables à cet amendement, qui rigidifie à l'excès le dispositif prévu par la proposition de loi.
L'amendement COM-15 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-8 devient sans objet.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-10 vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport relatif à la mise en place d'écoles normales des métiers de la santé.
Conformément à la position habituelle de la commission sur les demandes de rapport, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement COM-10 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-7 tend à supprimer l'article 2, qui prévoit l'expérimentation d'un accès direct à la filière pharmacie.
Nous soutenons cette expérimentation pour l'ensemble des raisons que nous avons évoquées. En conséquence, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement COM-7 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-16 précise le dispositif de l'article 2 en prévoyant un recrutement par admission directe en première année du premier cycle.
L'amendement COM-16 est adopté.
L'amendement rédactionnel COM-17 est adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-3 tend à préciser le fait que l'accès direct aux études de pharmacie doit s'effectuer selon des critères garantissant l'équité d'accès à la formation et la transparence de la sélection. Nous y sommes favorables.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-4 vise à préciser l'organisation des options santé dans les lycées en prévoyant leur encadrement par des enseignants en lien avec les unités de formation et de recherche de santé.
Une telle disposition porte atteinte à la souplesse du dispositif et pourrait en ralentir le déploiement. En conséquence, nous y sommes défavorables.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Nous sommes défavorables à l'amendement COM-11, qui prévoit la remise d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation d'options santé.
L'amendement COM-11 n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté sans modification.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-12 prévoit que les objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former doivent être établis par arrêté pour une période de quatre ans, au moins trois mois avant la fin de la période précédente.
Nous regrettons également que les objectifs soient régulièrement fixés avec retard. Toutefois, nous craignons que de telles précisions ne rigidifient excessivement le dispositif. La Cour des comptes suggère, par exemple, de mettre à jour ces objectifs plus fréquemment.
En conséquence, à ce stade, nous sommes défavorables à cet amendement.
L'amendement COM-12 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Nous sommes également défavorables à l'amendement COM-13, qui concerne une demande de rapport sur la santé mentale des étudiants en santé, même s'il s'agit évidemment d'un enjeu essentiel, aujourd'hui largement documenté.
L'amendement COM-13 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - Nous sommes aussi défavorables à l'amendement COM-21, qui vise à la remise d'un rapport relatif aux violences sexistes et sexuelles dans les formations en santé, même si nous sommes tous sensibles ici à la gravité de ce sujet.
L'amendement COM-21 n'est pas adopté.
Mme Véronique Guillotin, rapporteure. - L'amendement COM-22 prévoit pour sa part la remise d'un rapport sur les conditions de travail et la rémunération des externes et internes en médecine. Avis défavorable.
L'amendement COM-22 n'est pas adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-5 vise à préciser que, parmi les critères de définition du nombre et de la répartition des postes d'internat, la démographie médicale dans les différentes spécialités doit être prise en compte en distinguant les besoins en médecine hospitalière et en médecine de ville. Cette disposition nous semble déjà satisfaite par la proposition de loi. Avis défavorable.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-18 est un amendement de coordination juridique.
L'amendement COM-18 est adopté.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-19 vise à reporter l'entrée en vigueur de l'article 4 à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027.
L'amendement COM-19 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-6 vise à préciser les conditions d'octroi de l'agrément à la maîtrise de stage en médecine, en prévoyant que celui-ci soit délivré par le doyen de la faculté de médecine après avis du coordonnateur de la spécialité concernée. Nous sommes défavorables à cet amendement qui rigidifie le dispositif et n'a pas fait l'objet d'une demande de la part des acteurs auditionnés.
L'amendement COM-6 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté sans modification.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-20 vise à permettre aux docteurs juniors de quatrième année de médecine générale de suivre la formation obligatoire dans le cadre de l'agrément à la maîtrise de stage universitaire, sans les y contraindre.
L'amendement COM-20 est adopté.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Khalifé Khalifé, rapporteur. - L'amendement COM-1 tend à obliger les internes en médecine, de toutes les spécialités, à effectuer au moins un stage au sein d'un cabinet libéral ou d'un établissement de santé privé. Nous y sommes défavorables.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
Article 7
L'article 7 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
TABLEAU DES SORTS
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Chapitre Ier : Améliorer l'accès aux études de santé et diversifier le recrutement |
|||
|
Article 1er : Instauration d'une voie unique d'accès aux études de santé |
|||
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
14 |
Report de l'entrée en vigueur de la voie unique à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027 |
Adopté |
|
Mme de LA PROVÔTÉ |
23 |
Report de l'entrée en vigueur de la voie unique à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027 |
Adopté |
|
Mme SOUYRIS |
9 |
Inclusion d'enseignements relatifs à la santé environnementale et à la transition écologique en première année de voie unique |
Rejeté |
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
15 |
Report de l'entrée en vigueur de l'obligation d'organiser une première année de voie unique dans chaque département à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2030 |
Adopté |
|
Mme SOUYRIS |
8 |
Mise en oeuvre de l'obligation d'organiser des premières années de voie unique dans chaque département par l'université dont le siège est implanté sur le territoire du département chef-lieu de la région |
Rejeté |
|
Article additionnel après l'article 1er |
|||
|
Mme SOUYRIS |
10 |
Demande de rapport relatif à la mise en place d'écoles normales des métiers de la santé |
Rejeté |
|
Article 2 : Expérimentation d'un accès direct aux études de pharmacie |
|||
|
Mme BOURCIER |
7 |
Suppression de l'article |
Rejeté |
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
16 |
Recrutement par admission directe en première année du premier cycle |
Adopté |
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
17 |
Amendement rédactionnel |
Adopté |
|
Mme DEMAS |
3 |
Admission directe des étudiants en pharmacie selon des critères garantissant l'équité d'accès et la transparence de la sélection |
Adopté |
|
Article 3 : Extension et renforcement des options santé |
|||
|
Mme DEMAS |
4 |
Encadrement des options santé par des enseignants en lien avec les UFR de santé |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
11 |
Demande de rapport d'évaluation de l'expérimentation d'options santé |
Rejeté |
|
Articles additionnels après l'article 3 |
|||
|
Mme SOUYRIS |
12 |
Établissement des objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former au moins trois mois avant la fin de la période précédente |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
13 |
Demande de rapport sur la santé mentale des étudiants en santé |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
21 |
Demande de rapport relatif aux violences sexistes et sexuelles dans les formations en santé |
Rejeté |
|
Mme SOUYRIS |
22 |
Demande de rapport sur les conditions de travail et la rémunération des externes et internes en médecine |
Rejeté |
|
Chapitre II : Territorialiser le troisième cycle des études de médecine |
|||
|
Article 4 : Territorialisation des procédures de répartition des postes d'internat et d'affectation des internes |
|||
|
Mme DEMAS |
5 |
Distinction, parmi les critères de définition du nombre de postes d'internat, de la démographie médicale en ville et à l'hôpital |
Rejeté |
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
18 |
Amendement de coordination juridique |
Adopté |
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
19 |
Report de l'entrée en vigueur de l'article à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 1er septembre 2027 |
Adopté |
|
Chapitre III : Améliorer les conditions d'accueil des étudiants en stage |
|||
|
Article 5 : Statuts applicables aux maîtres de stage universitaires en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie |
|||
|
Mme DEMAS |
6 |
Délivrance des agréments à la maîtrise de stage par le doyen de la faculté de médecine après avis du coordonnateur de la spécialité concernée |
Rejeté |
|
Article 6 : Faciliter la mise en oeuvre de la réforme du troisième cycle de médecine générale |
|||
|
Mme GUILLOTIN et M. KHALIFÉ rapporteurs |
20 |
Faculté de suivre en quatrième année de troisième cycle de médecine générale la formation nécessaire à l'agrément à la maîtrise de stage |
Adopté |
|
Article additionnel après l'article 6 |
|||
|
M. MILON |
1 |
Obligation pour les internes en médecine d'effectuer au moins un stage au sein d'un cabinet libéral ou d'un établissement de santé privé |
Rejeté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS,
ALINÉA 3,
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
(« CAVALIERS »)
___________
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »148(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie149(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte150(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial151(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires sociales a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 15 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 868 (2024-2025) relative aux formations en santé.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- à l'accès aux études de médecine, de maïeutique, d'odontologie, de pharmacie et de masso-kinésithérapie ;
- aux dispositifs visant à favoriser l'orientation des lycéens dans les études de santé ;
- à l'organisation du troisième cycle des études de médecine ;
- aux conditions d'accueil des étudiants en santé en stage.
En revanche, la commission a estimé que ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte déposé, des amendements relatifs :
- à l'organisation des établissements de santé ;
- aux compétences des professions de santé.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITE
___________
Auditions
· Conférence nationale des commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers (CNCMECH)
Dr Thierry Godeau, président
Dr David Piney, vice-président
· France Universités
Yvon Berland, conseiller santé et politique
Christine Clerici, conseillère santé
Marie-Amélie Cuny, conseillère santé
Antoine Guery, chargé des relations parlementaires et institutionnelles
· Fédération hospitalière de France (FHF)
Hélène Gendreau, responsable adjointe du pôle RHH
· Conférence nationale des commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires (CNCMECHU)
Pr Rémi Salomon, président
· Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires (CNDCHU)
Michael Battesti, vice président de la commission des affaires médicales
Armelle Drexler, coordonatrice de la commission des affaires médicales
· Intersyndicale nationale des internes (ISNI)
Marie-Bérénice Roux, vice-présidente en charge des Politiques de Santé, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
· Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG)
Saga Bourgeois-Fratta, porte-parole
· Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM)
Estelle Gras, juriste de la section Formation et compétences médicales
· Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes (ONCD)
Dr Jean-François Josso, président de la commission de l'enseignement
· Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP)
Jean-Marc Glemot, membre
Anne Berthelot, directrice adjointe de la direction de l'Exercice professionnel et du Cespharm
Louise Bouché Bazerolle, chargée de mission au sein de la Direction de l'exercice professionnelle et du Cespharm
· Conseil national de l'Ordre des sages-femmes (CNOSF)
Isabelle Derrendinger, présidente
David Meyer, chef de cabinet
· Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK)
Nicolas Pinsault, vice-président
· Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF)
Marion Da Ros Poli, présidente
Anita Gelfi, vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur
· Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF)
Noémie Chantrel-Richard, présidente
Nina Didon, vice-présidente chargée de l'Enseignement Supérieur
Lucas Maurel, vice-président chargé des Tutorats
· Association nationale des étudiant.e.s sages-femmes (ANESF)
Chloë Grunenwald, présidente
Leïla Jamin, porte-parole
· Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK)
Lucas Chauvel, président
Raphaël Rault, vice-président chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
· Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD)
Margot Chiêu, première vice-présidente
· Conférence des doyens des facultés de médecine
Isabelle Laffont, présidente de la conférence et doyenne de la faculté de médecine de Montpellier - Nîmes
Pr Benoit Veber, doyen de l'UFR Santé de l'université de Rouen et past-président de la conférence
Pr Marie Essig, doyenne de l'UFR Médecine de Versailles - Saint Quentin
· Conférence des Doyens des facultés d'Odontologie
Vianney Descroix, président
Matthieu Resche-Rigon, doyen de la faculté de santé de l'université Paris Cité
· Conférence des doyens des facultés de pharmacie
Vincent Lisowski, président
Raphael Duval, doyen de la faculté de Pharmacie de Nancy
· Conférence nationale des enseignants en maïeutique (CNEMa)
Fabienne Darcet, présidente
Gina Gratier de Saint-Louis, vice-présidente aux Affaires Financières
· Syndicat national des instituts de formation en masso-kinésithérapie (SIFMK)
Pascal Gouilly, président du SIFMK, directeur de l'IFMK de Nancy et directeur du Département Universitaire Lorrain des professions de Santé de l'Université de Lorraine (DULPS)
Isabelle Aboustait-Arnould, secrétaire générale du SIFMK, directrice de l'École Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE) et directrice adjointe du Département Universitaire de Formation en Kinésithérapie/Physiothérapie (DUFKP) de l'Université Paris Saclay
· Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS)
Pierre Clavelou, président
Agnès Bocognano, secrétaire générale
· ARS Grand-Est
Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale
· ARS Nouvelle-Aquitaine
Benoît Elleboode, directeur général
Stéphane Laffon, directeur délégué aux professionnels de santé et à la prospective
Patrick Dehail, conseiller médical et scientifique
· ARS Centre-Val de Loire
Clara de Bort, directrice générale
· Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
Romain Bégué, sous-directeur des ressources humaines du système de santé
Marc Reynier, adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé
Florie Weber, cheffe du bureau de la démographie et de la formation initiale
· Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP)
Muriel Pochard, sous-directrice de la stratégie et de la qualité des formations
Laurent Régnier, adjoint à la sous-directrice de la stratégie et de la qualité des formations
Katia Siri, cheffe du département des études de santé
Olga Criez, adjointe à la cheffe du département des études de santé
Orianne Wagner-Ballon, conseillère scientifique et pédagogique en Santé aux participants
Contribution écrite
· Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers (CNDCH)
LA LOI EN CONSTRUCTION
___________
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-868.html
* 1 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
* 2 Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
* 3 Étude d'impact jointe au projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, déposé le 13 février 2019 à l'Assemblée nationale, pp. 17 et 18.
* 4 Ibid., pp. 19 et 20.
* 5 I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
* 6 II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
* 7 Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme modifié par l'arrêté du 18 février 2025.
* 8 III de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
* 9 I de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation.
* 10 Article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
* 11 Décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 relatif aux conditions et modalités d'admission des étudiants aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
* 12 Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, décision du 29 décembre 2023, n° 469479, considérant 19.
* 13 Article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
* 14 Article R. 631-1-2 du code de l'éducation.
* 15 Voir les rapports d'information de Mme Sonia de la Provôté, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la mise en oeuvre de la réforme de l'accès aux études de santé : un départ chaotique au détriment de la réussite des étudiants, 12 mai 2021, et sur la mise en oeuvre de la réforme de l'accès aux études de santé, bilan après deux ans : des progrès, mais peut mieux faire, 29 mars 2022.
* 16 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, p. 9.
* 17 Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute.
* 18 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 30.
* 19 Ibid., p. 46.
* 20 Le Quotidien du médecin, « Plus de 5 000 carabins français à l'étranger : on fait quoi ? », 17 mai 2024.
* 21 Selon le Syndicat national des instituts de formation en masso-kinésithérapie.
* 22 Selon la conférence des doyens de facultés d'odontologie.
* 23 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat., p. 10-11.
* 24 Ibid., p. 74.
* 25 Ibid., p. 79.
* 26 Arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle.
* 27 Article 22 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
* 28 Article 1er de l'arrêté du 18 mars 1998 relatif à l'organisation et à la validation du tutorat en premier cycle.
* 29 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 44.
* 30 Communication du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 27 juillet 2025.
* 31 Contribution écrite de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France.
* 32 Rapport « Réforme d'entrée dans les études de santé », Fédération des Associations Générales Étudiantes, février 2024, p. 10.
* 33 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 47.
* 34 Indice du coût de la rentrée MMPOK 2024, ANEMF, septembre 2024, p.9 et 12.
* 35 Ibid., p. 88-90.
* 36 Réponses écrites de l'ISNI au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 37 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, p. 122.
* 38 Ibid., p. 28.
* 39 Ibid., p. 123.
* 40 Lettre de mission du 18 juin 2025 du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, à l'attention de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et de l'Inspection générale des affaires sociales et réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.
* 41 Réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.
* 42 Selon l'enquête Écoles 2023 de la DREES, 65 % des étudiants inscrits en première année de la filière masso-kinésithérapie ont été admis via le dispositif Pass-LAS, soit 916 étudiants issus de Pass et 1 226 issus des LAS.
* 43 Réponses écrites du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et de la Fédération nationale de étudiants en kinésithérapie (FNAK) au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 44 Réponses écrites de la DGESIP au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 45 Réponses écrites de l'ISNI, de l'ISNAR-IMG et de l'ANEPF au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 46 Dossier de presse « Pacte de lutte contre les déserts médicaux. Présentation par le Premier ministre du plan d'action pour renforcer l'accès aux soins des Français », 25 avril 2025, p. 18.
* 47 Réponses écrites de la CMECH au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 48 Article 14 de la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 aménageant certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
* 49 Article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
* 50 Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales.
* 51 Pr Jean-François Bach, Réflexions et propositions sur la première année des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie et de sage-femme, 21 février 2008, p. 2.
* 52 Ibid., p. 7.
* 53 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, p. 15.
* 54 Ibid., p. 7.
* 55 Article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
* 56 M. Jacques Domergue, rapport n° 1318 (2008-2009) relatif à la proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, 10 décembre 2008, p. 27.
* 57 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
* 58 Article L. 631-1 du code de l'éducation.
* 59 M. Olivier Véran, avis n° 983 (2012-2013) sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, fait au nom de la commission des affaires sociales, 23 avril 2023, p. 9.
* 60 Voir, à ce sujet, le commentaire de l'article 1er de la présente proposition de loi.
* 61 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., p. 65.
* 62 Réponses écrites de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) aux questionnaires transmis par les rapporteurs.
* 63 Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de finance de la sécurité sociale, mai 2025, p. 355.
* 64 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., p. 65.
* 65 Conseil national de l'ordre des pharmaciens, « Faire connaître ma profession », 21 juillet 2022.
* 66 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op. cit., pp. 66 et 68.
* 67 Académie nationale de pharmacie, « Réforme d'accès aux études de santé : pour une filière pharmacie plus visible, la création expérimentale d'un accès spécifique aux études de pharmacie est nécessaire », 10 juillet 2025.
* 68 Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Démographie des pharmaciens : panorama 2022, p. 47.
* 69 Institut national de la statistique et des études économiques, Bilan démographique 2023.
* 70 Réponses écrites aux questionnaires transmis par les rapporteurs.
* 71 Réponses écrites de la DGOS au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 72 Drees, « L'origine sociale des professionnels de santé », Études et résultats, n° 496, juin 2006.
* 73 Drees, « Profil et parcours des étudiants en première année commune aux études de santé », Études et résultats, n° 927, juillet 2015.
* 74 Article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
* 75 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, pp. 86 et 87.
* 76 Drees, Remédier aux pénuries de médecins dans certaines zones géographiques. Les leçons de la littérature internationale, décembre 2021, p. 22.
* 77 Insee, « Les médecins généralistes libéraux s'installent souvent à proximité de leurs lieux de naissance ou d'internat », Insee Première, n° 2024, 12 novembre 2024.
* 78 OMS, Lignes directrices pour la production, l'attraction, le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les zones rurales et reculées, 2021, p. 30.
* 79 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op.cit., pp. 85.
* 80 Article 24 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels.
* 81 Dossier de presse « Pacte de lutte contre les déserts médicaux. Présentation par le Premier ministre du plan d'action pour renforcer l'accès aux soins des Français », 25 avril 2025, p. 18.
* 82 Réponses écrites de la DGESIP au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 83 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, op.cit., p. 104.
* 84 Réponses écrites de l'ISNI, de l'anemf, de l'anesf et de la FNEK au questionnaire transmis par les rapporteurs
* 85 Article 60 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
* 86 Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.
* 87 Article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
* 88 Décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine.
* 89 Article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
* 90 Article R. 632-2-1 du code de l'éducation.
* 91 Article R. 632-2-2 du code de l'éducation.
* 92 Article R. 632-2-6 du code de l'éducation.
* 93 Article R. 632-12 du code de l'éducation.
* 94 Arrêté du 18 septembre 2017 portant détermination des régions et subdivisions du troisième cycle des études de médecine et du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.
* 95 Arrêté du 30 juillet 2025 fixant le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés, par spécialité et par subdivision territoriale, au titre de l'année universitaire 2025-2026.
* 96 Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.
* 97 Réponse du ministère de la santé et de la prévention à la question écrite n° 4672 de M. Fabrice Brun, publiée au Journal officiel du 26 septembre 2023.
* 98 Cour des comptes, L'accès aux études de santé : quatre ans après la réforme, une simplification indispensable. Communication à la commission des affaires sociales du Sénat, décembre 2024, p. 53.
* 99 Insee, « Les médecins généralistes libéraux s'installent souvent à proximité de leurs lieux de naissance ou d'internat », Insee Première, n° 2024, 12 novembre 2024.
* 100 Julien Silhol, « La répartition géographique des internes en médecine générale : un outil de régulation des lieux d'installation ? »
* 101 Élisabeth Hubert, mission de concertation sur la médecine de proximité, rapport remis au Président de la République le 26 novembre 2010, pp. 39 et 40.
* 102 Amendement n° 265 rect. bis de M. Hervé Maurey sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, adopté par le Sénat en première lecture le 19 juin 2013.
* 103 « L'Anemf ne veut pas d'un internat interrégional », Le Quotidien du médecin, 24 juin 2013.
* 104 Propositions de la Conférence des doyens de faculté de médecine pour la Grande conférence de santé de 2016.
* 105 Académie nationale de médecine, La formation médicale initiale, 25 février 2025, p. 12.
* 106 Article R. 632-2-6 du code de l'éducation.
* 107 Article L. 631-1 du code de l'éducation.
* 108 Réponses écrites de la FHF au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 109 Réponses écrites de la CMECH au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 110 Réponses écrites de l'ONDPS au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 111 Réponses écrites de la conférence des doyens de facultés de médecine au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 112 Académie nationale de médecine, La formation médicale initiale, rapport adopté le mardi 25 février 2025, p. 12.
* 113 Article L. 4131-6 du code de la santé publique.
* 114 Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 portant organisation de la formation à la maîtrise de stage universitaire.
* 115 Article R. 632-27 du code de l'éducation.
* 116 Article R. 632-1 du code de l'éducation.
* 117 Article R. 632-1-2 du code de l'éducation.
* 118 Article R. 632-1 du code de l'éducation.
* 119 Article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine.
* 120 Maquette du DES de médecine générale annexée à l'arrêté du 21 avril 2017.
* 121 Article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 122 Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale de M. Bruno Retailleau adoptée par le Sénat le 18 octobre 2022.
* 123 Article L. 632-2 du code de l'éducation.
* 124 Communiqué de presse du Collège national des généralistes enseignants et du Syndicat national des enseignants de médecine générale « Une progression indite du nombre des Pamsu en 2024 », 26 septembre 2024.
* 125 Article R. 634-14 du code de l'éducation.
* 126 Article 20 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
* 127 Article 2 de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme.
* 128 Article L. 4151-9-1 du code de la santé publique.
* 129 Réponses écrites du CNOSF au questionnaire transmis par les rapporteurs.
* 130 Communiqué de presse de l'ANSFL « Statut MSU : toujours en chantier », 5 octobre 2024.
* 131 Article 21 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie.
* 132 Articles L. 632-4 et R. 632-24 du code de l'éducation.
* 133 Article R. 632-20 du code de l'éducation.
* 134 Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.
* 135 Articles R. 6153-1 à R. 6153-1-23 du code de la santé publique.
* 136 Article R. 632-20 du code de l'éducation.
* 137 Articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique.
* 138 Article R. 632-20 du code de l'éducation.
* 139 Article 37 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
* 140 Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale de M. Bruno Retailleau adoptée par le Sénat le 18 octobre 2022.
* 141 Article L. 632-2 du code de l'éducation.
* 142 Données relatives au nombre de postes ouverts à l'internat de médecine et au nombre de postes auxquels les étudiants sont affectés pour leur internat, par subdivision et par spécialité, publiées par l'ONDPS.
* 143 Contribution de Mme Corinne Imbert relative à la réforme du DES de médecine générale dans le rapport de Mme Doineau n° 44 (2024-2025) sur le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023, fait au nom de la commission des affaires sociales, 16 octobre 2024, p. 86.
* 144 Instruction interministérielle n° DGOS/RH1/DGESIP/2022/51 du 24 février 2022 relative au développement des stages en ambulatoire pour les étudiants en deuxième et troisième cycles des études de médecine.
* 145 Communiqué de presse du Collège national des généralistes enseignants et du Syndicat national des enseignants de médecine générale « Une progression indite du nombre des Pamsu en 2024 », 26 septembre 2024.
* 146 Contribution de Mme Corinne Imbert relative à la réforme du DES de médecine générale dans le rapport de Mme Doineau n° 44 (2024-2025) précité, p. 86.
* 147 Article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine.
* 148 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 149 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 150 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 151 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.