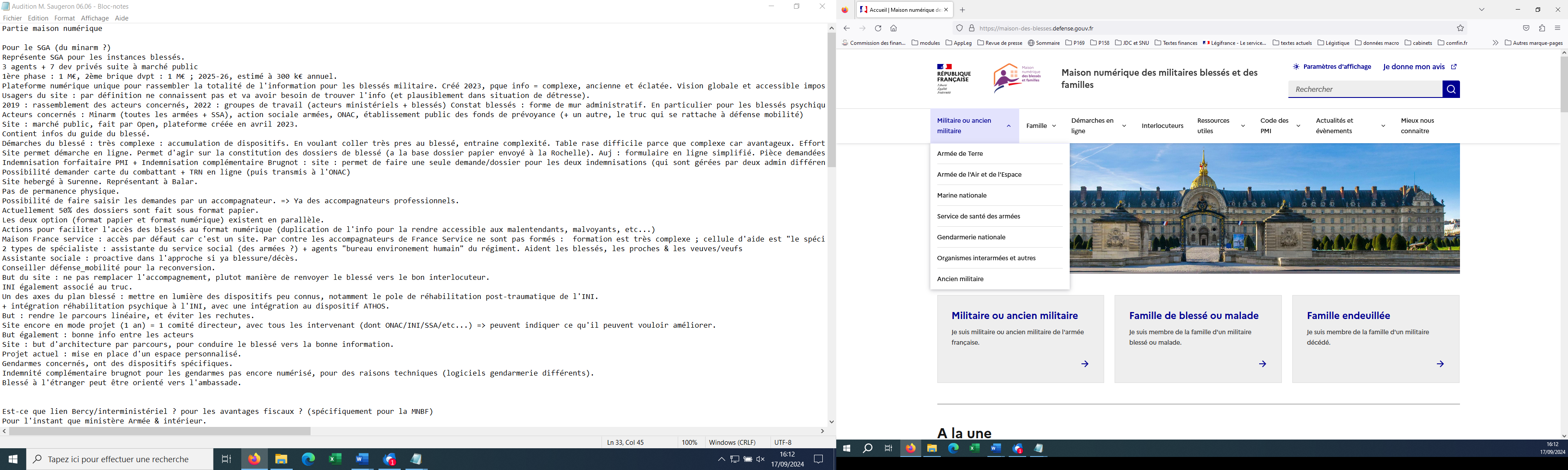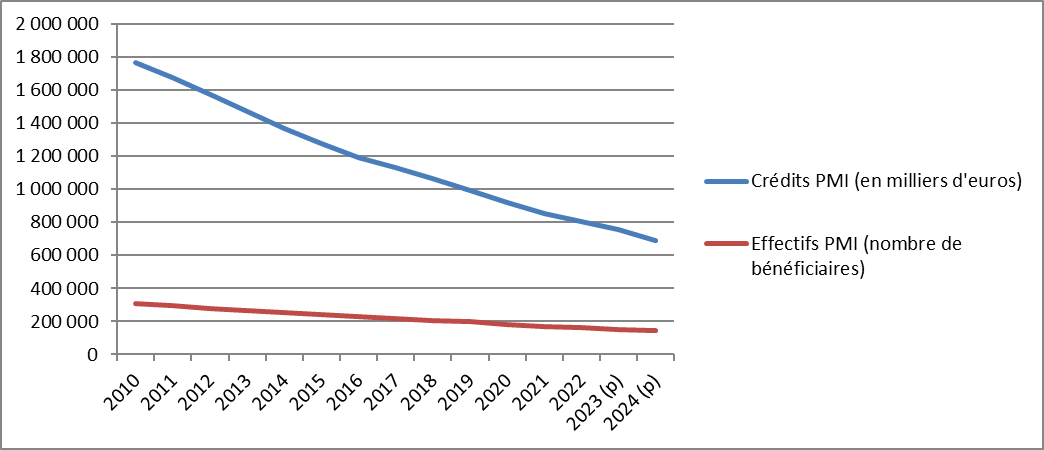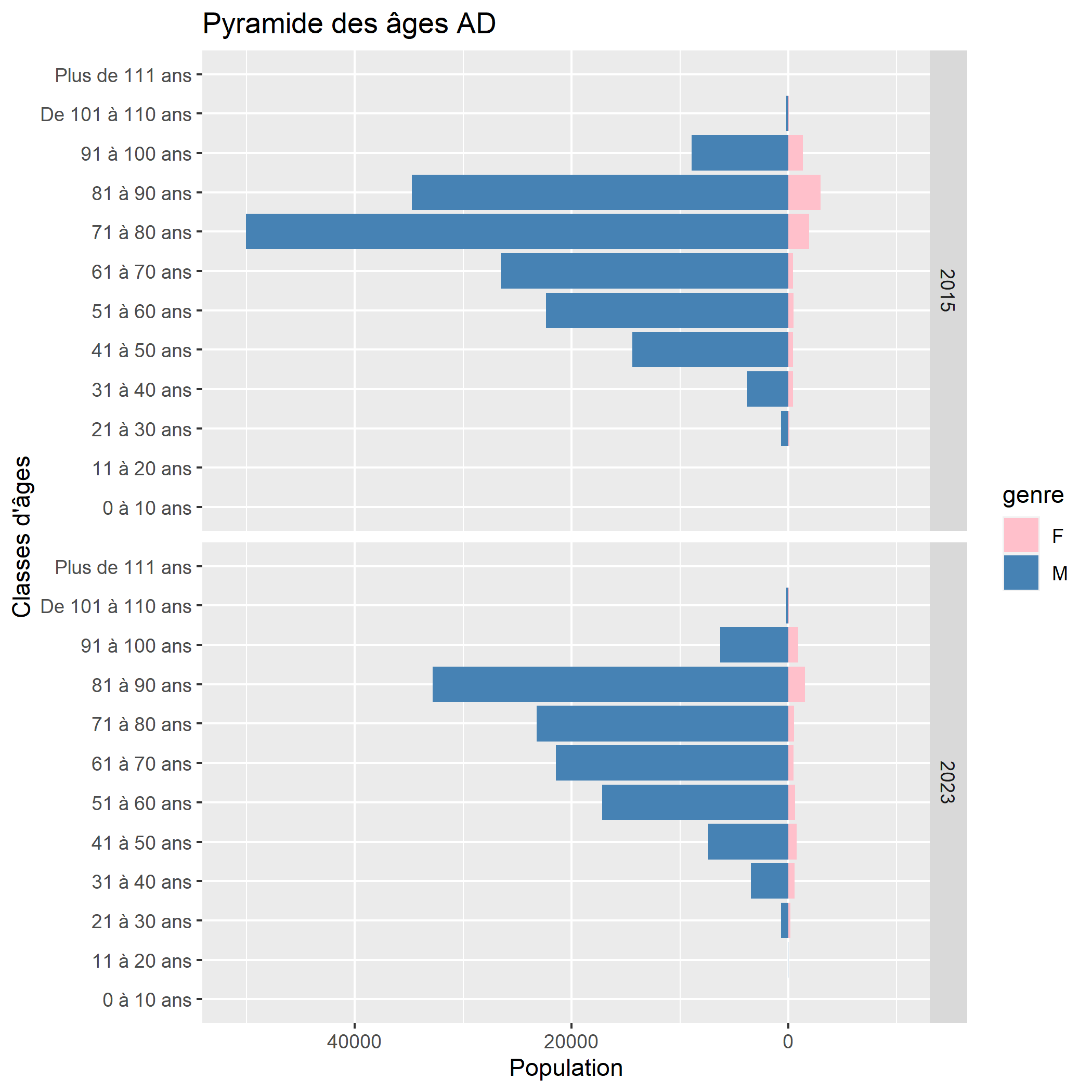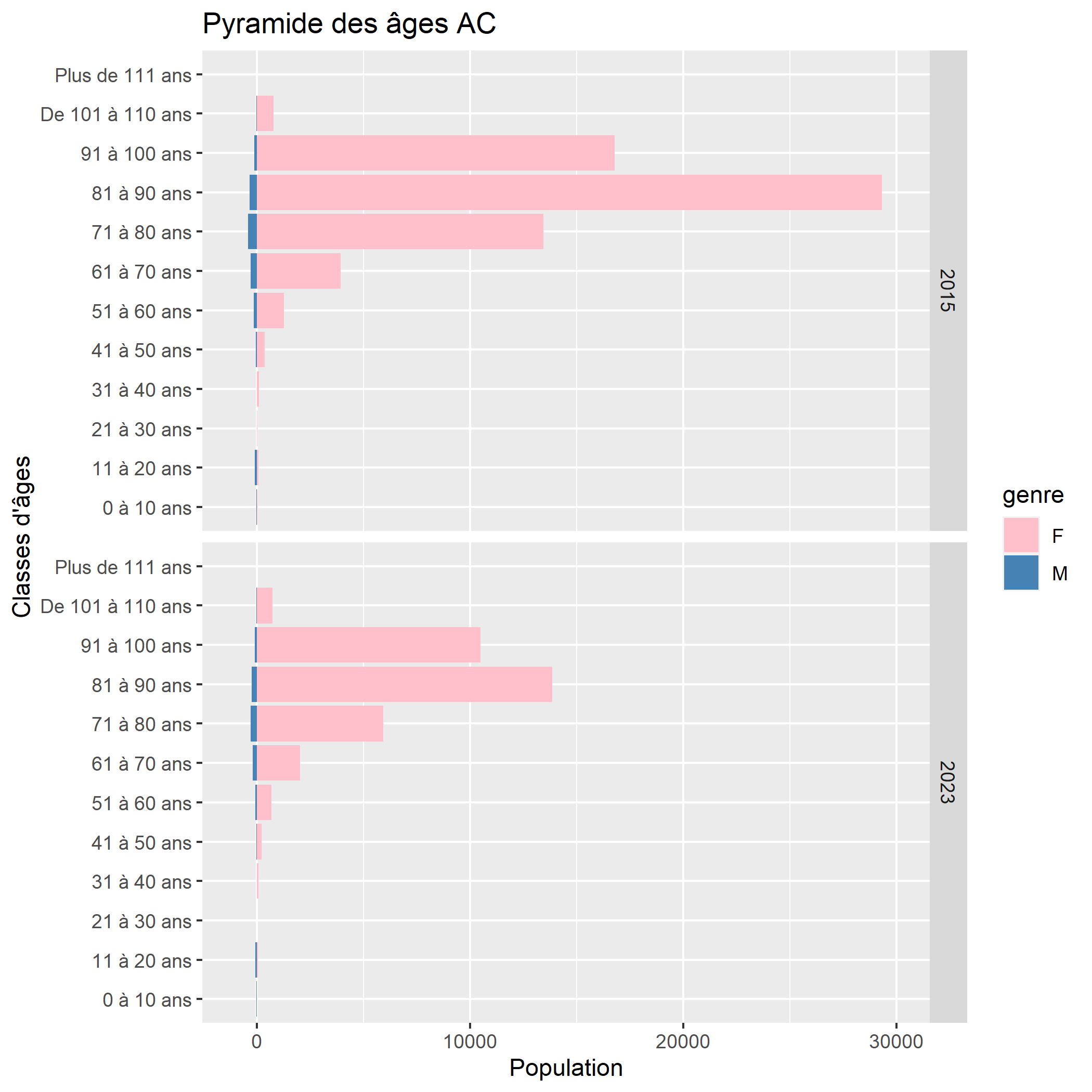- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION
SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE
SITUATIONS ADMINISTRATIVES
- A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE
BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS
COMBATTANTS »
- B. LE MILITAIRE BLESSÉ, UNE NOTION LARGE
RECOUVRANT TOUS LES MILITAIRES BLESSÉS OU MALADES À L'OCCASION DE
LEUR SERVICE
- C. UN COÛT GLOBAL DE LA PRISE EN CHARGE DES
BLESSÉS DE GUERRE DIFFICILE À ÉVALUER
- 1. Un coût budgétaire de
865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169
- a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits
rattachés en 2024
- b) Un financement de l'INI à hauteur de
14 millions d'euros
- c) Les dépenses indirectes en faveur des
militaires blessés d'environ 40 millions d'euros
- d) Des avantages fiscaux importants
renchérissant l'effort en faveur des blessés militaires
- a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits
rattachés en 2024
- 2. Une majorité des crédits de la
politique d'accompagnement des blessés non évaluée et
portée par la mission « Défense »
- 1. Un coût budgétaire de
865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169
- D. DES PARCOURS DE SOINS ET ADMINISTRATIFS LONGS ET
ENTRAINANT L'INTERVENTION DE NOMBREUX ACTEURS
- 1. Le parcours de soins du blessé
militaire
- 2. Un parcours administratif nécessitant
l'intervention de nombreux acteurs
- a) Plusieurs référents administratifs
pouvant intervenir selon la situation du blessé
- b) Un blessé pouvant relever de nombreuses
situations administratives
- (1) La situation administrative du militaire
blessé avant la radiation
- (2) La situation administrative du militaire
blessé après la radiation
- (3) Un statut ouvrant des droits
particuliers
- c) Les démarches administratives
liées à la blessure militaire
- (1) Les démarches liées à la
documentation de la blessure
- (2) Les démarches liées à
l'indemnisation de la blessure
- (3) Les démarches liées à la
réhabilitation et la réinsertion du blessé
- (4) Les démarches liées à la
reconnaissance envers les blessés
- a) Plusieurs référents administratifs
pouvant intervenir selon la situation du blessé
- 1. Le parcours de soins du blessé
militaire
- E. LE BLESSÉ MILITAIRE : D'IMPORTANTES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUXQUELLES LE MNISTÈRE DES
ARMÉES CHERCHE À RÉPONDRE
- 1. Une absence de correspondance entre parcours de
soins et parcours administratif, source de complexité
- 2. Des démarches administratives
d'accès aux dispositifs de réhabilitation et réparation
restant complexes
- 3. Une stigmatisation de certaines formes de
blessures et dépendances
- 4. Une blessure psychique dont la prise en compte
reste très récente et encore insuffisante
- 5. Le plan d'action blessé 2023-2027 :
une volonté de réponse forte face aux difficultés
identifiées
- a) Le 5ème plan blessé
- b) Un plan contenant d'importantes mesures
touchant aux différentes difficultés auxquelles font face les
blessés militaires : simplification administrative, meilleure prise
en compte de la blessure psychique, etc.
- c) La création d'une plateforme
informatique pour améliorer l'information des blessés et
permettre une dématérialisation des démarches
- d) Un plan utile mais encore récent, dont
la mise en oeuvre n'est dès lors pas finalisée et
nécessite des efforts de communication
- (1) Des mesures allant dans le bon sens
- (2) Une mise en oeuvre pour l'instant
partielle
- (3) Un besoin de communication autour de certaines
mesures
- (4) L'absence de prise en compte de la valeur des
PMI
- a) Le 5ème plan blessé
- 1. Une absence de correspondance entre parcours de
soins et parcours administratif, source de complexité
- A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE
BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS
COMBATTANTS »
- II. LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DU
MILITAIRE BLESSÉ
- A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
DES MILITAIRES BLESSÉS
- 1. L'Institution nationale des Invalides, acteur
historique de la réhabilitation des militaires blessés
- a) Un établissement disposant de
trois pôles pour une prise en charge globale du militaire
blessé
- (1) Un centre de pensionnaires permettant
d'accueillir et d'héberger les blessés les plus graves
- (2) Un centre de réhabilitation
spécialisé dans la prise en charge des invalidités
graves
- (3) Le Centre d'Études et de Recherche sur
l'Appareillage des Handicapés
- b) Un établissement disposant du soutien
d'acteurs associatifs et bénévoles
- c) Les principales évolutions
récentes de l'INI : un renouvellement immobilier rendu
nécessaire par l'ancienneté des bâtiments et une meilleure
prise en compte de la blessure psychique
- d) Un établissement faisant face à
des difficultés financières
- (1) Un financement protéiforme et
partiellement assis sur des revenus propres
- (2) Des difficultés financières
récentes pour l'institution
- (a) Des charges renforcées par le
renouvellement immobilier de l'établissement et l'inflation
- (b) Des recettes propres contraintes
- (c) Un manque d'attractivité de l'INI pour
le recrutement de personnels médicaux et paramédicaux entrainant
des fermetures de lits
- (d) Les conséquences de ces
difficultés : un gel des dépenses d'investissement
- a) Un établissement disposant de
trois pôles pour une prise en charge globale du militaire
blessé
- 2. ATHOS, un dispositif récent et bienvenu
de réhabilitation psychique des militaires blessés
- a) Un dispositif expérimental de
l'armée de terre qui a été pérennisé et dont
la gestion a été confiée à l'ONaCVG
- b) Un dispositif de réinsertion psychique
réservé aux militaires blessés et basé sur le
volontariat
- c) Une réhabilitation
non-médicalisée pertinente et complémentaire du traitement
médicalisé
- (1) Le parti pris d'une réhabilitation
non-médicalisée basée sur la progressivité et le
volontariat
- (2) Le programme de réhabilitation
ATHOS : des activités de la vie courante dans un environnement
bienveillant et contrôlé
- (3) Un programme de réhabilitation
permettant également de lutter contre l'isolement et les
difficultés de vie familiale des membres
- d) Le coût budgétaire d'une maison
ATHOS : 1 million d'euros par maison
- (1) Une durée moyenne de
réhabilitation de vingt mois
- (2) Un coût annuel d'environ 1 million
d'euros par maison
- (3) Une absence d'évaluation des
coûts sociaux évités
- e) Un dispositif encore récent auquel il
peut être complexe d'accéder
- a) Un dispositif expérimental de
l'armée de terre qui a été pérennisé et dont
la gestion a été confiée à l'ONaCVG
- 1. L'Institution nationale des Invalides, acteur
historique de la réhabilitation des militaires blessés
- B. POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION
DES BLESSÉS, DES DISPOSITIFS NOMBREUX MAIS ÉCLATÉS
- C. LA RÉPARATION ET LA
RECONNAISSANCE : UN ÉLÉMENT HISTORIQUE ET CENTRAL DE LA
PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS
- 1. Des dispositifs de reconnaissance
réservés aux blessés de guerre
- 2. Les pensions militaires d'invalidité,
pièce centrale de la politique d'indemnisation des militaires
blessés
- 3. Les dispositifs d'indemnisation
complémentaires à la PMI permettant une meilleure prise en compte
des situations spécifiques
- 1. Des dispositifs de reconnaissance
réservés aux blessés de guerre
- D. UN SOUTIEN ASSOCIATIF AUX BLESSÉS DE
GUERRE HISTORIQUE ET DYNAMIQUE : L'EXEMPLE DES « GUEULES
CASSÉES »
- A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
DES MILITAIRES BLESSÉS
- III. DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES DANS LA
PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS
- A. DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SIMPLIFIÉES MAIS RESTANT INADAPTÉES À CERTAINES BLESSURES
PSYCHIQUES
- 1. Une procédure de demande de PMI lourde
pour laquelle une simplification forte a été
engagée
- 2. Pensée pour la blessure physique, la
procédure est mal adaptée à la blessure psychique
- a) Un type de blessure dont la déclaration
est tardive, plus difficilement détectable et entravant la
capacité à réaliser des démarches
administratives
- b) Une procédure pensée pour un
blessé faisant partie de l'institution
- c) Un risque d'isolement lié à la
durée du congé de longue durée maladie
- d) La nécessité d'une adaptation des
procédures à la blessure psychologique
- a) Un type de blessure dont la déclaration
est tardive, plus difficilement détectable et entravant la
capacité à réaliser des démarches
administratives
- 1. Une procédure de demande de PMI lourde
pour laquelle une simplification forte a été
engagée
- B. LA PERTE DE VALEUR DES PMI FACE À
L'INFLATION
- A. DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SIMPLIFIÉES MAIS RESTANT INADAPTÉES À CERTAINES BLESSURES
PSYCHIQUES
- I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION
SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE
SITUATIONS ADMINISTRATIVES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
- ANNEXE
N° 77
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 octobre 2024
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1)
sur la
prise en charge des
militaires blessés,
Par M. Marc LAMÉNIE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de :
M. Claude Raynal, président ;
M. Jean-François Husson, rapporteur général
; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel
Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de
Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli,
vice-présidents ; M. Michel Canévet,
Mme Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie,
secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc,
Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet,
Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole
Ciuntu, MM. Raphaël Daubet,
Vincent Delahaye, Vincent
Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin,
Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet,
Éric
Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine
Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel,
Hervé Maurey,
Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud,
Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François
Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher
Szczurek,
Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre
Vogel.
L'ESSENTIEL
La prise en charge des blessés1(*) militaires se décompose en deux phases. Il y a d'abord la phase aiguë de la blessure, où la prise en charge est essentiellement assurée par le service de santé des armées (SSA)2(*). Elle ne relève pas de la mission « Anciens Combattants ».
Ensuite, la prise en charge fait intervenir des acteurs relevant de la mission « Défense » et de la mission « Anciens Combattants ». Elle apparaît très complète et des efforts importants sont encore fournis pour l'améliorer, ce qui mérite d'être salué. Pour autant, le parcours administratif des blessés reste long et lourd, et des adaptations aux situations personnelles sont encore possibles.
I. UN FINANCEMENT À HAUTEUR DE 865 MILLIONS D'EUROS POUR LA MISSION « ANCIENS COMBATTANTS » MAIS UNE MAJORITÉ DE CRÉDITS PROVENANT DE LA MISSION « DÉFENSE »
La mission « Anciens combattants » compte 144 980 bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité (PMI). Le dispositif ATHOS, qui s'adresse à des militaires victime de syndrome post-traumatique, compte au 1er juillet 2024 430 membres. Ce nombre est cependant en augmentation rapide et une capacité d'accueil de 1500 places est considérée comme nécessaire.
Pour couvrir ces besoins, 865 millions d'euros ont été programmés par la mission « Anciens combattant » en 2024. Il s'agit des crédits dédiés aux pensions militaires d'invalidité (PMI) et droits rattachés, au financement de l'Institution Nationale des Invalides (INI), à une partie des crédits de l'action sociale et de la subvention pour charge de services publics de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) ainsi qu'à une partie des crédits de l'allocation de reconnaissance du combattant, dont bénéficient environ 27 % des ayants droit d'une PMI.
L'essentiel de cette enveloppe budgétaire - 690 millions d'euros - est consacré aux seules PMI.
La majorité de l'effort budgétaire lié à la prise en charge des militaires blessés relève cependant de la mission « Défense ». Interrogé, le ministère des Armées indique qu'il n'existe pas d'estimation du coût agrégé de la prise en charge du soin et de la réhabilitation des militaires blessés. Le rapporteur relèvera néanmoins que, sans prise en compte de l'administration chargé d'accompagner le blessé dans la durée, le SSA bénéficie à lui seul d'un financement à hauteur de 1,6 milliard d'euros.
II. UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DU BLESSÉ DE GUERRE
A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
Le blessé peut bénéficier de séjours dans des organisme spécialisés dans la réhabilitation physique et psychique des invalides.
La prise en charge de la réhabilitation physique des invalides est historique et réalisée par différents établissements médico-sociaux. L'Institution Nationale des Invalides, établissement fondé en 1674, est un acteur historique de la réhabilitation, spécialisé dans la prise en charge de l'invalidité lourde, en coopération avec le SSA. Elle héberge les militaires dont l'invalidité et trop lourde pour permettre une réhabilitation dans un centre de pensionnaires.
La prise en charge institutionnelle de la blessure psychique est bien plus récente et connait un développement actif aujourd'hui, à travers notamment le contrat d'objectif et de performance de l'INI qui le prévoit expressément. En outre, le déploiement du dispositif ATHOS, confié à l'ONaCVG, doit permettre aux blessés psychiques d'être accueillis dans des centres de réhabilitation non-médicalisés destinés à les aider à se réinsérer dans la société. Ce dispositif - en développement - est encore très récent et ne dispose que d'une capacité d'accueil limité.
B. L'ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION DES BLESSÉS
Outre les dispositifs de réhabilitation, le militaire blessé - et dans certains cas sa famille - peut bénéficier d'un nombre important de dispositifs d'accompagnement et de réinsertion.
Le militaire blessé peut bénéficier d'un accompagnement social de la part de l'action sociale des armées, avec notamment des congés spécifiques et un suivi psychologique du blessé et de sa famille.
Le blessé bénéficie également d'un suivi particulier de la part de Défense Mobilité, l'opérateur de l'accompagnement professionnel des armées. Il peut y peut faire appel même après son départ des armées, sans limite de temps, et demander à bénéficier d'une formation, d'un programme de reconversion ou encore d'une aide au lancement d'une entreprise.
La grande majorité des blessés sont également des ressortissants de l'ONaCVG et peuvent à ce titre prétendre à l'accompagnement et à l'action sociale que l'Office met en oeuvre pour tous ses bénéficiaires.
C. LA RECONNAISSANCE ET LA RÉPARATION PAR L'INDEMNISATION
Le militaire blessé en service, si sa blessure provoque une invalidité d'une certaine gravité et s'il peut démontrer que sa blessure est imputable au service, peut demander une pension militaire d'invalidité (PMI). Il peut également demander une indemnisation des préjudices complémentaires dite « Brugnot ».
La PMI et l'indemnisation Brugnot visent à indemniser monétairement le militaire des conséquences de sa blessure. La PMI prend notamment la forme d'une rente d'une durée de 3 ans et, si au bout de cette durée, l'invalidité persiste, le bénéfice de la PMI devient viager. Le montant de la PMI est déterminé selon le grade et le degré d'invalidité du blessé.
Selon les circonstances de la blessure, le blessé peut également prétendre à des titres de reconnaissance, comme la Médaille du Blessé ou le titre de reconnaissance de la Nation. Certains de ces titres - la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation - donnent la qualité de ressortissant de l'ONaCVG.
III. UN PARCOURS DU BLESSÉ QUI RESTE COMPLEXE MALGRÉ DES EFFORTS DE SIMPLIFICATION
A. UN PARCOURS ADMINISTRATIF LOURD AUX INTERVENANTS NOMBREUX
Lors de son parcours administratif, le blessé pourra avoir jusqu'à trois référents administratifs différents selon qu'il soit en position d'activité ou de non activité au sein des armées, ou qu'il ait quitté l'institution. Il sera également amené à interagir avec de très nombreux intervenants (soignants, défense mobilité, action sociale des armées, ONaCVG, etc.) et à réaliser des demandes pour bénéficier des différents dispositifs auxquels il peut prétendre (PMI, maison ATHOS, accompagnement professionnel, etc.).
Ce parcours peut également être très long : le délai de traitement moyen des PMI est de 7 mois. Selon le type de blessure, le congé en position de non-activité peut durer jusqu'à 8 ans, et une infirmité permanente suivra malheureusement le blessé tout au long de sa vie et pourra entrainer de nouvelles démarches en cas d'aggravation ou de rechute.
De plus, le parcours administratif ne dépend pas du parcours de soins du blessé. En effet, chacun des trois référents administratifs (unité de rattachement, organisme administratif en charge du suivi des militaires en position de non-activité ou ONaCVG) peut potentiellement intervenir à toutes les étapes du parcours de soins et de réhabilitation.
Deux types de difficultés se posent alors. D'une part le militaire peut avoir du mal à identifier les bons interlocuteurs et doit être accompagné par un assistant social professionnel pour faire valoir ses droits. D'autre part l'administration peut rencontrer des difficultés de coordination et de partage de l'information, la transmission d'un dossier d'un acteur à l'autre ou le traitement d'un dossier par deux entités différentes étant toujours facteur de risque.
Les blessés de guerre sont parfois confrontés à une absence de correspondance entre parcours administratif et parcours de soins.
B. D'IMPORTANTS EFFORTS DE SIMPLIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS
Conscient des difficultés liées au parcours du blessé, le ministère des Armées a mis en place un plan blessé 2023-2027. Bien que très récent et non entièrement mis en place, ce dernier contient un nombre important de mesures particulièrement opportunes : fusion et simplification des demandes de PMI et d'indemnisation Brugnot, automatisation des demandes de renouvellement et de mise au niveau du grade des PMI, meilleure prise en compte de la blessure psychique et ouverture de 10 maisons ATHOS, mise en place d'une plateforme numérique de centralisation de l'information et des démarches pour les militaires blessés et leurs familles, etc. Cette initiative doit être saluée.
Néanmoins, l'absence de recul sur la mise en oeuvre de ces mesures empêche actuellement d'en tirer des conclusions.
Par ailleurs ces avancées étant récentes, elles sont encore mal connues de leur public cible et, de ce fait, ont encore du mal à l'atteindre. En particulier, une plus grande communication apparaît nécessaire pour les dispositifs de réhabilitation psychique, dont l'une des difficultés est actuellement de parvenir à capter la population des bénéficiaires potentiels.
À titre d'illustration, la plateforme numérique mise en place par le ministère des Armées était jusqu'à peu ignorée des associations qui pourtant accompagnent des blessés dans leurs démarches administratives.
Enfin, certaines situations personnelles restent encore mal prises en compte.
IV. LES LIMITES DE LA POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS : APPRÉHENDER LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES BLESSÉS PSYCHIQUES ET LA PERTE DE VALEUR DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ
A. LE CAS DES BLESSÉS PSYCHIQUES HORS ARMÉES
Le cas le plus problématique actuellement est celui du blessé psychique dont la blessure se déclenche après son départ des armées, en particulier s'il n'est pas ressortissant de l'ONaCVG. En effet, la blessure psychique est souvent incompatible avec la réalisation de toute démarche administrative et l'accès à un accompagnement est dans ce cas bien plus compliqué pour le blessé, qui ne pourra pas non plus bénéficier des congés auxquels il aurait pu prétendre s'il avait encore fait partie de l'armée.
Or, le blessé psychique est particulièrement vulnérable, susceptible de tomber dans des comportements addictifs et de s'isoler socialement. Il a besoin d'un accompagnement fort et proactif pour permettre sa réinsertion. Hors de l'armée, si l'ONaCVG n'est pas en mesure de l'aider le temps de la réalisation de ses démarches et du traitement de sa demande de PMI - qui est, au regard de la situation du blessé, très long -, le blessé ne pourra véritablement se retourner que vers la solidarité des associations de blessés. Si ces dernières sont des acteurs importants de l'aide aux blessés et des partenaires particulièrement précieux de l'État pour la prise en charge de ces derniers, il n'apparait pas satisfaisant qu'elles soient la seule entité en mesure d'intervenir pour certaines catégories de blessés.
B. CERTAINS BLESSÉS NE SONT PAS RESSORTISSANTS DE L'ONACVG
Dans certains cas, parfois simplement parce qu'ils n'ont pas fait la démarche, certains blessés quittant les armées ne deviennent pas ressortissants de l'Office. Cela aura deux conséquences : ils ne peuvent pas avoir recours à l'ONaCVG pour un accompagnement dans leurs éventuelles démarches futures et ils ne peuvent pas avoir recours à l'action sociale de l'ONaCVG.
C. LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES BLESSÉS EST UNE VICTIME COLLATÉRALE DU GEL DES RÉMUNÉRATIONS PUBLIQUES
La principale mesure de reconnaissance et de réparation en faveur des blessés, la PMI est calculée en fonction d'un point d'indice lui-même indexé sur la progression des rémunérations publiques. De ce fait, le gel des rémunérations publiques a indirectement entrainé une perte de valeur des pensions militaires d'invalidité face à l'inflation.
Or, ces pensions constituent une mesure de reconnaissance et d'indemnisation concédée à des militaires blessés à l'occasion de leur service au sein des armées, devant indemniser la gêne fonctionnelle et le manque à gagner causés par leur sacrifice.
Parallèlement, il convient de noter que la charge financière que représentent les PMI baisse d'année en année, au gré de la diminution de la population des bénéficiaires qui est particulièrement âgé.
Sans remettre en cause la trajectoire structurellement baissière des crédits qui sont consacrés aux pensions militaires d'invalidité, une réflexion mériterait d'être menée sur quant à leur adaptation et leur évolution, notamment en période de forte inflation.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé. (Ministère des Armées)
Recommandation n° 2 : Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes. (Ministère des Armées, ONaCVG)
Recommandation n° 3 : Adapter les procédures de demande de pensions militaires d'invalidité à la situation particulière des blessés psychiques, notamment dans le cas où ceux-ci ont déjà quitté les armées. (Ministère des Armées)
Recommandation n° 4 : Réfléchir à l'adaptation des modalités d'indexation des pensions militaires d'invalidité, notamment en période de forte inflation. (Ministère des Armées)
I. LE BLESSÉ MILITAIRE : UNE NOTION SPÉCIFIQUE POUVANT ENTRAINER UNE DIVERSITÉ DE DROITS ET DE SITUATIONS ADMINISTRATIVES
A. UN CONTRÔLE QUI DÉPASSE BUDGÉTAIREMENT LE CADRE DE LA MISSION « ANCIENS COMBATTANTS »
La prise en charge de militaires blessés est un sujet vaste qui ne correspond pas aux divisions effectuées en loi de finances entre les missions « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » et « Défense ». En effet, un militaire relève le temps de son engagement de la mission « Défense » puis, s'il remplit les conditions pour devenir ressortissant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), de la mission « Anciens combattants ».
Si un parcours « classique » est celui d'un militaire blessé lors de son engagement puis qui devient ressortissant de l'ONaCVG, il est possible aussi qu'une blessure se déclare et entraine un parcours de soins après que le militaire ait quitté l'institution.
Les intervenants du parcours du blessé relèvent des deux missions, avec, d'un côté, les acteurs du soin - qui prennent en charge le blessé au moment de sa blessure lors de sa phase aiguë - relevant des crédits de la mission « Défense » et, de l'autre, les acteurs de la réhabilitation - prenant en charge le blessé après que la blessure et son état soient stabilisés - relevant en grande partie de la mission « Anciens combattants ».
Les divisions administratives du parcours du blessé ne correspondent quant à elles pas nécessairement à ces deux missions : certains acteurs ne sont accessibles que par des militaires (par exemple le service de santé des armées), ou à l'inverse, par des non militaires (l'ONaCVG), d'autres comme l'Institution nationale des invalides (INI) peuvent s'adresser à la fois à des militaires et à des non militaires qui ont une blessure en lien avec un engagement militaire.
Le présent contrôle étant réalisé par le rapporteur de la mission « Anciens combattants », il se concentrera sur les mesures de réparation, reconnaissance et réhabilitation envers les blessés militaires après leur départ de l'institution. Néanmoins, il est impossible d'aborder ce sujet sans prendre en compte la partie du parcours du blessé se passant - ou susceptible de se passer - lorsque le blessé est encore membre de l'institution et pris en charge par la mission « Défense », puisque cette première partie du parcours est déterminante pour sa suite.
Ainsi, en accord avec son collègue rapporteur de la mission « Défense », le rapporteur exposera autant que nécessaire les dispositifs et acteurs relevant de la mission « Défense » pour la bonne compréhension des dispositifs de prise en charge des blessés. Il s'abstiendra néanmoins de toute recommandation ne portant pas sur les acteurs, actions ou crédits relevant de la mission « Anciens combattants ».
B. LE MILITAIRE BLESSÉ, UNE NOTION LARGE RECOUVRANT TOUS LES MILITAIRES BLESSÉS OU MALADES À L'OCCASION DE LEUR SERVICE
Le terme de militaire blessé peut recouvrir différentes situations. Dans son sens le plus strict, il s'agit du « blessé de guerre », soit un militaire blessé lors d'un affrontement direct et du fait d'une action délibérée de l'ennemi. Ce type de blessure ouvre le droit à la Médaille du blessé et certains droits d'office, comme la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation.
Dans un sens plus large, le blessé est un « militaire blessé en service », ce qui correspond à un militaire ayant subi une blessure ou contracté une maladie du fait ou à l'occasion de son service (par exemple lors d'un entrainement). Ce militaire pourra, selon la gravité de la blessure ou de la maladie, prétendre à divers dispositifs de soins et de réhabilitation. Par ailleurs, des droits différents peuvent s'attacher à une même blessure ou maladie en lien avec le service, selon que cette blessure soit intervenue ou non dans le cadre d'une OPEX.
S'agissant des blessures psychiques, la blessure peut se déclarer après que le militaire ait quitté l'institution sans que soit remis en cause ni le statut de militaire blessé, ni les droits qui s'y rattachent, à équivalence d'une blessure physique de la même gravité.
Dans le cadre de ce rapport, le terme de militaire blessé sera entendu au sens large en incluant donc, sauf mention contraire, les blessures stricto sensu et les maladies.
C. UN COÛT GLOBAL DE LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS DE GUERRE DIFFICILE À ÉVALUER
Le coût budgétaire global de la prise en charge des militaires blessés correspond à l'agrégation de différents dispositifs de soins, de réhabilitation, d'indemnisation et aux coûts de fonctionnement des opérateurs et administrations supportant ces dispositifs.
1. Un coût budgétaire de 865 millions d'euros en 2024 pour le programme 169
Les crédits de la mission « Anciens combattants » destinés à la prise en charge des militaires blessés sont contenus dans le programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »
Ces crédits s'élevaient à environ 865 millions d'euros en 2024 et s'inscrivent dans une trajectoire baissière forte, la principale dépense - les pensions militaires d'invalidité - diminuant d'année en année.
a) 812 millions d'euros pour les PMI et droits rattachés en 2024
La dépense liée aux pensions militaires d'invalidité (PMI) a été exécutée à hauteur de 755 millions d'euros en 2023. La programmation budgétaire pour 2024 prévoyait 690 millions d'euros pour une hypothèse de 144 980 bénéficiaires de PMI.
S'agissant de dépenses dites « de guichet », la programmation budgétaire est directement facteur des prévisions relatives à la démographie des bénéficiaires des PMI. Or, ceux-ci sont en moyenne très âgés et leur nombre diminue chaque année.
Ce mouvement dure depuis plus de 10 ans et les projections actuelles continuent de placer ces crédits sur une trajectoire baissière.
Par ailleurs, il existe des droits annexes liés à la qualité d'invalide :
- gratuité des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales, pharmaceutiques et de cures thermales nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension ou appareillage ;
- remboursement des réductions de transport accordées aux invalides ;
- remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides.
Le cout total de ces droits en 2023 s'élevait à 120 millions d'euros, dont 84,2 millions d'euros pour le remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides ; 33,7 millions d'euros pour la gratuité des soins ; et 2,1 millions d'euros pour le remboursement des réductions de transport accordées aux invalides.
La programmation budgétaire pour 2024 prévoyait 121,3 millions d'euros pour ces droits, dont 80,8 millions d'euros pour le remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides ; 38,8 millions d'euros pour la gratuité des soins ; et 1,7 million d'euros pour le remboursement des réductions de transport accordées aux invalides.
b) Un financement de l'INI à hauteur de 14 millions d'euros
L'Institution nationale des Invalides est un établissement médico-social référent en matière de réhabilitation post-traumatique. Elle est un opérateur de l'État bénéficiant d'une subvention pour charges de service public portée par le programme 169.
Cette subvention s'élevait à 13,7 millions d'euros en 2023 et 14,4 millions d'euros en 20243(*).
Elle représente environ 1/3 des ressources de l'INI, qui bénéficie également d'une dotation annuelle de financement de 14,4 millions d'euros, allouée par le ministère de la santé et de la prévention pour financer la part des dépenses prises en charge par le régime d'assurance maladie, et d'une dizaine de millions d'euros de revenus propres.
Si ces crédits sont nécessaires au fonctionnement de l'INI, ils n'apparaissent pour autant pas dans la mission « Anciens combattants ».
c) Les dépenses indirectes en faveur des militaires blessés d'environ 40 millions d'euros
Certains droits portés par la mission « Anciens combattants » et visant principalement les anciens combattants bénéficient également aux militaires blessés.
Il en va ainsi de l'allocation de reconnaissance du combattant, une pension viagère versée à tout titulaire de la carte du combattant de plus de 65 ans. Tout militaire blessé n'est pas nécessairement titulaire de la carte du combattant de la même manière que tout titulaire de la carte du combattant n'est pas nécessairement un militaire blessé. Néanmoins, une proportion importante de blessés de guerre est titulaire de la carte du combattant, qui est notamment attribuée aux militaires ayant totalisé 112 jours de service en OPEX, aux blessés de guerre (au sens strict du terme) et aux militaires ayant dû être évacués pour une blessure reçue ou une maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante en OPEX.
Selon les données du ministère des Armées, 27 % des bénéficiaires ayants-droits militaires d'une PMI (soit 41 100 pensionnés) bénéficiaient également de l'allocation de reconnaissance du combattant. Cette proportion s'élevait à 38 % en 2015, la baisse s'expliquant par le rajeunissement global de la population des pensionnés militaires d'invalidité du fait de la disparition des pensionnés les plus âgés.
L'allocation de reconnaissance du combattant s'élevant à 812,76 euros en 2023, le budget total consacré en faveur des pensionnaires militaires d'invalidité s'élevait ainsi à environ 33,3 millions d'euros.
Selon la même logique, l'aide sociale de l'ONaCVG bénéficie en partie a des blessés. Elle s'élève à 15 millions d'euros annuels et est versée à tous les ressortissants de l'Office, dont notamment les titulaires de la carte du combattant, les victimes civiles de guerre et d'acte de terrorisme et les pupilles de la Nation et de la République. Le financement des mesures liées au « plan blessé » mises en oeuvre par l'Office s'élève à 5,4 millions d'euros en 2024.
d) Des avantages fiscaux importants renchérissant l'effort en faveur des blessés militaires
Le programme 169 porte 3 exonérations fiscales qui représentent un volume budgétaire particulièrement important au regard des crédits portés par la mission. Ces exonérations bénéficient à la fois aux anciens combattants et aux blessés de guerre. Il s'agit :
- d'une demi-part fiscale pour les titulaires de la carte du combattant de plus 74 ans ou pour leur conjoint survivant de 74 ans ou plus, dont peuvent bénéficier les militaires blessés titulaires de la carte du combattant (ou leur conjoint survivant). Cette exonération était estimée à 489 millions d'euros en 2023 ;
- de l'exonération de toute imposition des pensions versées au titre code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (dont notamment les PMI et l'allocation de reconnaissance du combattant). Le coût de cette exonération était de 105 millions d'euros en 2023 ;
- de la déduction des versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant, estimée à 27 millions d'euros en 2023.
2. Une majorité des crédits de la politique d'accompagnement des blessés non évaluée et portée par la mission « Défense »
Interrogé sur le coût budgétaire agrégé de la politique d'accompagnement des militaires blessés supporté par la mission « Défense », le ministère des Armées a indiqué qu'une telle évaluation n'existe pas.
Néanmoins le seul service de santé des armées (SSA) bénéficie d'un financement s'élevant à 1,6 milliard d'euros, sans prise en compte du coût que représente les différentes administrations mobilisées dans le parcours d'accompagnement des blessés (action sociale des armées, cellules d'accompagnement des blessés, défense mobilité, etc.). Aussi, la majorité du coût de la prise en charge des blessés est supporté par la mission « Défense ».
D. DES PARCOURS DE SOINS ET ADMINISTRATIFS LONGS ET ENTRAINANT L'INTERVENTION DE NOMBREUX ACTEURS
Le blessé a deux parcours, un parcours de soin et un parcours administratif. Les acteurs des deux parcours sont différents et leurs temporalités respectives peuvent se chevaucher.
1. Le parcours de soins du blessé militaire
Suite à la survenue d'une blessure, le traitement de cette dernière passe par plusieurs phases principales durant lesquelles différents acteurs sont compétents. La phase aiguë correspond à la phase de la blessure en tant que telle et, que cette dernière soit physique ou psychique, elle nécessite une prise en charge médicale immédiate. Une fois que les soins ont été administrés et que le blessé a été stabilisé, vient le temps de la réhabilitation, qui peut prendre différentes formes : programmes de réhabilitation physique ou psychique, programme d'accompagnement social, accompagnement et éventuelle réorientation professionnelle, etc.
a) La phase aiguë
Premièrement, la blessure est dans une phase aiguë, durant laquelle l'intégrité physique ou psychique voire le pronostic vital du blessé est en jeu. Elle appelle un traitement médical immédiat, qui, lorsque le militaire est encore dans l'institution, est en principe pris en charge par le service de santé des armées (ci-après SSA), soit directement sur le théâtre d'opérations du militaire, soit dans un hôpital d'instruction des armées (ci-après HIA).
S'agissant des capacités du SSA, le rapporteur spécial renvoie au rapport « Le service de santé des armées, une pièce maitresse de notre outil de défense » de son collègue Dominique de Legge, rapporteur spécial de la mission « Défense »4(*).
b) La phase de réhabilitation
La phase de réhabilitation intervient après la phase aiguë lorsque la blessure est stabilisée. La réhabilitation médicale (kinésithérapie, ergothérapie, etc.) peut intervenir, selon l'état et les souhaits du blessé, directement dans un HIA, dans un établissement civil ou à l'institution nationale des invalides (ci-après INI).
L'INI est un acteur de référence historique de la réhabilitation des blessés militaire, notamment pour des niveaux d'invalidité lourds, et sert également de pensionnat pour les grands invalides militaires pour lesquels une réhabilitation et un regain d'autonomie ne sont pas possibles.
Enfin, depuis 2021 existent les maison ATHOS qui sont des établissements de réhabilitation non-médicalisés spécialisés dans la prise en charge de victimes militaires d'un syndrome post-traumatique.
Plusieurs acteurs interviennent en soutien de ces organismes de réhabilitation. Il s'agit notamment d'acteurs offrant un soutien pour la réinsertion sociale ou professionnelle du blessé, notamment les cellules d'aide au blessé, l'action sociale des armées, Défense Mobilité et l'ONaCVG.
Enfin, en dernier lieu intervient la consolidation, 3 ans après la première demande de PMI (ou 9 ans dans le cas d'une maladie), moment à partir duquel la gêne fonctionnelle encore constatée est considérée comme permanente et ouvre droit à une pension viagère.
Une commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades a été créée afin d'aider à orienter les blessés dans leur parcours de soins.
2. Un parcours administratif nécessitant l'intervention de nombreux acteurs
a) Plusieurs référents administratifs pouvant intervenir selon la situation du blessé
L'entité chargée du suivi administratif, référent dans le traitement du dossier du blessé, est chargé de coordonner l'action des différents acteurs intervenant sur ce parcours.
Lorsqu'un militaire est blessé, et tant qu'il reste en service dans les armées, son suivi administratif relève de son unité militaire d'affectation. L'entité de gestion des personnels isolés de son armée d'appartenance prend ensuite le relai lorsqu'il passe en position de non-activité. Les armées de terre et de l'air, la marine, le service de santé des armées, la gendarmerie, la Légion étrangère et les sapeurs-pompiers militaires ont chacun une entité spécifique. Le blessé peut demander à bénéficier, lors de cette période, d'un accompagnement par sa cellule d'aide au blessé de référence5(*).
À sa radiation des cadres, la charge du suivi du blessé est transférée à l'ONaCVG et sera exercée par le service local de l'Office du lieu de résidence du blessé. Cette responsabilité devra être exercée jusqu'à la mort du blessé.
L'Office a créé en avril 2023 un département de l'accompagnement des blessés afin de renforcer ses capacités de suivi des ressortissants blessés. Il n'existe cependant pas de traitement spécifique des ressortissants blessés de l'ONaCVG par rapport aux autres catégories de ressortissants s'agissant des aides offertes par l'Office lui-même.
Le plan blessé 2023-2027 du ministère des Armées a prévu l'établissement d'un « passeport du blessé », réalisé par la première administration en charge du suivi administratif du blessé et devant être transmis aux autres administrations qui seront à leur tour amenées à suivre ce blessé. Il contient toutes les informations relatives à l'identification du blessé, à sa situation militaire et familiale, les coordonnées du médecin et/ou psychiatre traitant, de l'assistante sociale de l'action sociale des armées ou du référent de reconversion ainsi que les informations administratives et juridiques spécifiques sur les pensions, droits ouverts et couvertures assurantielles. Y figurent également des données sur les divers parcours suivis ou envisagés (reconstruction par le sport, réhabilitation psychosociale, réinsertion et reconversion).
b) Un blessé pouvant relever de nombreuses situations administratives
La situation administrative du blessé change selon qu'il soit encore membre de l'institution militaire ou qu'il ait été radié. Si tous les militaires quittent l'institution à terme, selon les circonstances de la blessure, une partie importante du parcours du militaire blessé peut néanmoins être réalisé au sein de l'armée.
(1) La situation administrative du militaire blessé avant la radiation
Le militaire blessé peut bénéficier de quatre types de congé, deux d'activité et deux de non-activité.
Les deux congés d'activité sont le congé de maladie, de 6 mois au maximum, et le congé du blessé, dont le bénéfice est réservé aux militaires dont la blessure est intervenue en OPEX, de 18 mois maximum.
Les deux congés en non-activité sont le congé de longue maladie, d'une durée de 3 ans maximum, et le congé de longue durée pour maladie6(*), pouvant durer jusqu'à 8 ans.
Le congé est pensé comme un statut temporaire visant à permettre la réhabilitation du militaire et sa réintégration à son poste d'origine. Il reçoit tous les 6 mois un avis médical qui peut amener à une reprise de service, à un maintien en congé ou à une réforme.
Le congé du blessé est ainsi attribué au militaire « s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la Défense »7(*).
Les congés de longue maladie et de longue durée pour maladie sont attribués aux militaires blessés et malades après épuisement des droits au congé de maladie ou de congé du blessé, sauf en cas d'inaptitude définitive.
Le congé de longue durée pour maladie est attribué en cas d'affections cancéreuses, de déficit immunitaire grave et acquis, ou de troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service8(*). Dans les autres cas, le militaire pourra bénéficier du congé pour longue maladie si « l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée »9(*).
Les militaires en congé de non-activité peuvent demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la Défense ou par le ministère de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères, notamment des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi ou d'une période de création ou reprise d'entreprises10(*).
À la fin du congé en non-activité, le militaire peut demander à être placé en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois. Sinon, où à l'expiration du congé pour convenances personnelles, le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive11(*).
Le militaire peut également demander sa radiation à tout moment de son congé en non-activité12(*).
(2) La situation administrative du militaire blessé après la radiation
Après sa radiation, le suivi du militaire est en principe assuré par l'ONaCVG, s'il peut prétendre à la qualité de ressortissant de l'Office. La qualité de ressortissant est viagère et donne accès aux services de l'ONaCVG, parmi lesquels une aide sociale et un accompagnement professionnel. Lorsque le blessé peut prétendre à la qualité de ressortissant, la transition vers l'ONaCVG se réalise en principe par la transmission de son passeport du blessé au service départemental de l'Office compétent.
Cependant, tous les blessés ne sont pas automatiquement ressortissants de l'Office. Seuls les titulaires d'une PMI ayant été concédée au titre d'une blessure ou d'une maladie contractée lors d'une opération de guerre ou d'une opération extérieure sont ressortissants de droit. Dans les autres cas, il faudra que l'ancien militaire soit titulaire de la carte du combattant (attribuée dans la plus grande majorité des cas au bout de 4 mois d'OPEX).
Les titulaires d'une PMI hors situation de guerre et non titulaires de la carte du combattant ne sont pas ressortissants.
Il n'est pas non plus impossible qu'un ancien militaire puisse remplir les conditions pour être ressortissant de l'Office mais n'ait pas fait les démarches nécessaires pour le devenir. Cette hypothèse est toutefois moins fréquente depuis que l'armée de terre initie elle-même les dossiers de carte du combattant pour les militaires en retour d'opération pouvant y prétendre.
(3) Un statut ouvrant des droits particuliers
Les militaires blessés ont droit, outre à la prise en charge intégrale de leurs soins, au bénéfice de programmes de réhabilitation et de reconnaissance particuliers et uniques.
Premièrement, le blessé militaire bénéficie d'établissements médico-sociaux qui, s'ils ne lui sont pas entièrement dédiés13(*), lui sont principalement réservés : les HIA et l'INI.
Le blessé militaire et ses proches se voient également octroyer un certain nombre d'avantages mis en place par les armées, comme des séjours de repos, des billets de train et des nuits d'hôtel remboursés pour se rendre au chevet du blessé.
Des acteurs spécifiques participant à la réinsertion des blessés militaires existent, tel que l'opérateur Défense mobilité qui prévoit des dispositifs spécifiques aux blessés militaires pour leur permettre de réintégrer le monde professionnel.
Les militaires blessés bénéficient enfin de mesures de reconnaissance, pécuniaires ou symboliques. La première d'entre elles est la pension militaire d'invalidité, mais il convient de citer aussi l'attribution de médailles, les participations à des cérémonies commémoratives, la possibilité de témoigner dans des programmes mémoriels, etc.
c) Les démarches administratives liées à la blessure militaire
Les démarches administratives du blessé sont diverses et un certain nombre d'entre elles doit être réalisé auprès d'entités tierces. Elles varient selon les circonstances de la blessure.
(1) Les démarches liées à la documentation de la blessure
Lorsqu'une blessure survient, le commandement doit rédiger un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure et l'inscrire au registre des constatations. Il doit ainsi permettre d'établir la liaison de la blessure au service nécessaire au bénéfice des dispositifs d'indemnisation.
Le médecin militaire constatant la blessure peut réaliser une déclaration d'affection présumée imputable au service (DAPIAS) afin de permettre le remboursement à 100 % de soins réalisés dans le civil.
(2) Les démarches liées à l'indemnisation de la blessure
Deux indemnisations principales existent : la pension militaire d'invalidité et la jurisprudence Brugnot14(*).
Depuis la mise en oeuvre du plan blessé 2023-202715(*), ces deux demandes font l'objet d'une demande unique de la part du militaire blessé, dont le formulaire est joint en annexe du présent rapport.
L'indemnisation au titre de la pension militaire d'invalidité (PMI) débute à compter de la date du dépôt de la demande, ce qui encourage un dépôt précoce. Cependant, l'expertise médicale visant à établir le préjudice fonctionnel du militaire et son degré d'infirmité n'intervient qu'après la stabilisation de la blessure.
Ces démarches, spécifiques à la blessure militaire, se réalisent en sus de toutes les démarches administratives de droit commun liées à l'invalidité, le chômage ou la radiation des cadres du militaire (allocation de retraite ou de chômage, allocation du fonds de prévoyance, etc.).
Par ailleurs, les militaires doivent adhérer à une mutuelle complémentaire santé16(*), qui intervient en complément de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont blessés, ils déclarent leur blessure à leur mutuelle pour bénéficier du remboursement des soins.
Cette déclaration doit contenir :
- le rapport circonstancié et l'extrait du registre des constatations ;
- un certificat médical initial ;
- un bulletin de situation de l'hôpital mentionnant les dates d'entrée et de sortie.
Le rapporteur spécial a été informé que des recours juridiques sont parfois nécessaires pour que les militaires blessés bénéficient de l'intégralité des remboursements dus par ces mutuelles.
(3) Les démarches liées à la réhabilitation et la réinsertion du blessé
Si la réhabilitation physique s'inscrit dans le parcours de soins de base du blessé, ainsi que le traitement médical de la blessure psychique, l'accès à un certain nombre de dispositifs ne se fait qu'à la demande du blessé.
Il en va ainsi notamment de l'accès aux dispositifs de formation, d'accompagnement ou de réinsertion professionnelle. Le code de la défense précise par ailleurs que ces demandes sont soumises à l'agrément du ministre de la Défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'Intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation de la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades, lorsque le militaire est encore en position de non-activité au sein de l'institution.
De la même manière, l'accès au dispositif ATHOS17(*) doit faire l'objet d'une demande du militaire18(*), après avis de la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.
(4) Les démarches liées à la reconnaissance envers les blessés
Le militaire blessé peut, selon les circonstances de sa blessure, demander :
- la médaille du blessé de guerre ;
- la carte du combattant ;
- le titre de reconnaissance de la Nation.
La médaille du blessé de guerre est une décoration pouvant être obtenue par le militaire ayant subi une « blessure de guerre » au sens strict du terme (militaire blessé lors d'un affrontement direct et du fait d'une action délibérée de l'ennemi), lors d'une guerre, d'une OPEX ou d'une mission ou opération intérieure de protection militaire du territoire national dont la liste est déterminée par arrêté.
La carte du combattant peut être demandée si le militaire est blessé du fait d'une « blessure de guerre » au sens strict du terme ou s'il a dû être évacué d'une OPEX à cause d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante19(*).
Le titre de reconnaissance de la Nation peut être demandé en cas de blessure ou maladie contractée en OPEX20(*).
Un certain nombre de droits s'attachent au titre de reconnaissance de la Nation et à la carte du combattant, notamment la qualité de ressortissant de l'ONaCVG et le bénéfice de l'allocation de reconnaissance du combattant (carte du combattant uniquement).
E. LE BLESSÉ MILITAIRE : D'IMPORTANTES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUXQUELLES LE MNISTÈRE DES ARMÉES CHERCHE À RÉPONDRE
Plusieurs difficultés « classiques » liées à la condition de blessé militaire sont bien identifiées, et l'actuel plan blessé 2023-2027 a vocation à y apporter des solutions. Néanmoins, la plus grande importance prise par la blessure psychique tend à amplifier ces difficultés voire à en faire apparaitre de nouvelles et justifiant des mesures plus spécifiques.
1. Une absence de correspondance entre parcours de soins et parcours administratif, source de complexité
Comme indiqué précédemment, une des difficultés de la situation des militaires blessés est qu'il n'y a pas nécessairement de correspondance entre la situation administrative du militaire et son parcours de soins. L'intégralité du parcours de soin peut se passer en position d'activité comme il est possible, dans le cas d'une blessure psychique se déclarant tardivement, qu'il se déroule après la radiation des cadres.
De ce fait, les différents acteurs du soin et de la réhabilitation des militaires blessés ont une multitude d'interlocuteurs de référence chargé du suivi des différents blessés qu'ils traitent, en fonction du statut administratif de ces derniers. Ainsi, chaque unité militaire d'affiliation doit accompagner ses blessés lorsqu'ils sont en position d'activité, chaque armée à son entité de gestion des personnels isolés et sa cellule d'aide aux blessés. De même, si l'ONaCVG est l'acteur unique du suivi des blessés après leur radiation, tous ne sont pas nécessairement suivis par l'ONaCVG et le suivi des blessés est réalisé au niveau départemental. Le nombre des référents susceptible d'assurer un suivi administratif d'un blessé militaire varie ainsi, selon la manière de compter, de plus d'une dizaine à plus d'une centaine.
Or, l'acteur de référence est encore une fois détaché de l'état d'avancement du parcours du blessé et chacun d'entre eux est supposé pouvoir accompagner le blessé à tout moment de leur parcours et sur la totalité de ce dernier.
2. Des démarches administratives d'accès aux dispositifs de réhabilitation et réparation restant complexes
Le nombre très important de ces référents entraine des difficultés de deux ordres : d'une part, le parcours administratif du blessé apparaît opaque pour ce dernier et, d'autre part, au sein même de l'administration, la coordination et la communication entre les acteurs sont rendues complexes.
a) Un parcours administratif opaque et complexe
La séparation entre parcours de soins et parcours administratif n'est pas évidente. La multiplicité des acteurs auxquels le militaire peut ou doit s'adresser est source de complexité pour ce dernier de même que les nombreuses demandes qu'il peut ou doit réaliser pour bénéficier de certains dispositifs.
À titre d'exemple, il était jusqu'à récemment nécessaire de faire deux demandes et deux dossiers pour l'indemnisation du préjudice du militaire blessé, au titre respectivement de la PMI et de la jurisprudence Brugnot, ce qui nécessitait deux traitements administratifs distincts et deux expertises médicales par ailleurs réalisées par des médecins différents.
Outre leur multiplicité, ces dispositifs ne sont pas bien connus des militaires d'actives et ces derniers ne pourront donc en avoir connaissance qu'en passant par des accompagnants professionnels.
Enfin, plusieurs de ces dispositifs ont des délais de traitement long. La PMI, par exemple, nécessite d'attendre que l'état du militaire se soit stabilisé avant que l'expertise médicale puisse être conduite. L'union des blessés de la face et de la tête estime ainsi qu'il faut 2 ans entre le lancement d'une procédure pour une PMI et son premier versement au bénéficiaire dans le cas d'une blessure psychique qui se serait déclarée après que le militaire ait quitté l'institution.
La réalisation de ce parcours serait en soit un défi pour une personne bien portante et est imposée à des militaires par hypothèse vulnérables. De plus, toute erreur dans ce parcours ou manquement dans l'accompagnement se traduit assez directement en un non-recours à des droits pourtant prévus pour ces militaires. Il peut enfin exister une forme de stigmatisation au sein des armées quant au recours à des dispositifs sociaux par les militaires.
b) Des délais et des situations temporaires dont la concomitance ou la longueur peuvent entrainer des effets pervers
Comme indiqué plus haut, la blessure peut justifier des périodes de congés parfois très longues, pouvant aller jusqu'à huit ans.
Si le but poursuivi par ce congé - permettre au militaire de bénéficier d'une période de réhabilitation suffisante - est louable, il a également comme effet pervers qu'un militaire blessé et partiellement invalide, qui ne travaille pas pendant les huit années de son congé de longue durée pour maladie, peut avoir énormément de mal à se réinsérer au sein de la vie active à l'issue de ce congé.
Par ailleurs, le demande de PMI et la stabilisation de la blessure et la réhabilitation du militaire, concomitantes, peuvent apparaitre contradictoires puisque le niveau d'indemnisation perçu du fait de la PMI est directement lié au degré d'invalidité du militaire que la réhabilitation cherche à réduire. Cependant, la PMI, si elle est concédée, est due à compter du moment du dépôt de la demande. De ce fait, le militaire est fortement incité à réaliser une demande rapide.
c) Des difficultés de coordination
Le parcours administratif du blessé peut impliquer jusqu'à deux passations de dossier : d'abord de l'unité militaire d'affiliation au suivi administratif de l'armée considérée, enfin de cet organisme à l'ONaCVG. Ces acteurs doivent coordonner et orienter le parcours du blessé entre les différents acteurs intervenant directement pour soigner ou réhabiliter le blessé. Ces organismes sont aidés dans ce rôle par la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.
Or, une difficulté classique pour un tel parcours administratif est le risque de déperdition d'informations ou de perte de temps.
L'ONaCVG indique qu'à ce titre, le passeport du blessé constitue une avancée importante pour le suivi des blessés après leur départ de l'institution, car il permet une information systématique des services départementaux lors de l'installation de blessés ressortissants, alors qu'auparavant, ces derniers n'avaient aucune information lorsqu'un ressortissant blessé s'installait dans leur département et que le blessé en question ignorait bien souvent qu'il pouvait avoir recours à l'Office.
3. Une stigmatisation de certaines formes de blessures et dépendances
Il ressort des témoignages recueillis au cours des auditions que contrairement aux blessures physiques, certaines blessures, notamment psychiques, font souvent l'objet d'une sorte d'omerta.
De la même manière, le fait pour un militaire d'avoir recours aux différents dispositifs d'aide et de soutien qui existent peut-être mal vu et pourrait entrainer des remarques voir des brimades. Par exemple, ainsi en est-il d'un militaire ayant recours à l'assistante sociale selon ce qui a été dit au rapporteur spécial.
De tels comportements, au-delà de leurs conséquences directes pour les blessés qui en sont victimes, encouragent également un déni de la blessure, notamment psychologique, et un non-recours aux dispositifs et aux droits dont ils devraient pourtant bénéficier. Les personnes auditionnées lors d'une visite de maison ATHOS indiquent ainsi que les militaires peuvent repousser ou ne pas réaliser des démarches liées à la blessure psychique ou à l'accompagnement social de crainte d'être vu comme quelqu'un de fragile ou à qui il ne serait plus possible de confier de responsabilité.
4. Une blessure psychique dont la prise en compte reste très récente et encore insuffisante
La blessure psychique est une problématique qui prend de plus en plus d'importance, premièrement parce que les cas sont plus fréquents depuis 2010, mais également parce que ces derniers sont mieux pris en compte et donc plus régulièrement identifiés21(*).
Or, la blessure psychologique présente des particularités par rapport à la blessure physique. Premièrement, cette dernière n'intervient pas immédiatement après l'événement traumatique mais à un moment qui se situe en moyenne 3 à 12 mois après l'évènement, voir dans certains cas plusieurs années plus tard. Or, le modèle de l'indemnisation du blessé militaire avec une demande de PMI et un suivi engagé à partir de la survenance de la blessure a été pensé sur l'hypothèse d'une blessure physique.
Deuxièmement, la blessure psychologique, contrairement à la blessure physique, n'est pas immédiatement visible. Elle est moins facile à détecter et donc plus difficile à évaluer. Les modalités de réhabilitation suite à une blessure psychique sont différentes de celles d'une blessure physique.
Elles mettent enfin le blessé dans un état de vulnérabilité particulier dans lequel il risque rapidement de s'isoler socialement ou de tomber dans des conduites addictives. Un accompagnement social actif du blessé psychique est particulièrement nécessaire, car son état est incompatible avec le principe de démarches administratives.
5. Le plan d'action blessé 2023-2027 : une volonté de réponse forte face aux difficultés identifiées
Face aux difficultés constatées dans le parcours du blessé, le ministère des Armées a mis en oeuvre un plan blessé 2023-2027 visant à fortement simplifier les démarches administratives devant être réalisées par les blessés et à mieux prendre en compte la blessure psychique.
a) Le 5ème plan blessé
Le 5ème plan blessé mis en place par le ministère des Armées se distingue de ses prédécesseurs par une amplitude plus large en prenant notamment en compte les difficultés administratives. Il s'intéresse à tous les types de blessures et à tous les militaires, et fait suite à des travaux menés par dix groupes thématiques entre juillet 2022 et avril 2023.
Comprenant initialement 116 mesures22(*), ce nombre peut évoluer à la hausse ou à la baisse au cours de la mise en oeuvre du plan. La priorité est de renforcer et faciliter l'accès au droit à réparation.
Trois axes principaux ont ainsi été définis :
- améliorer la prise en charge, en renforçant la détection, en simplifiant la phase d'instruction, en consolidant le suivi épidémiologique et en renforçant la coordination des différents acteurs ;
- simplifier l'accès aux droits et renforcer la réparation des préjudices, en modernisant et automatisant autant que possible les démarches administratives et l'accès aux droits, en améliorant la formation du personnel encadrant et l'information des familles et aidants, en renforçant la réparation des blessures liées au service ;
- renforcer l'accompagnement et les parcours dans la durée, en développant les dispositifs de réparation et de reconnaissance ainsi que la reconstruction par le sport et en améliorant l'employabilité des blessés, conjoints et familles éprouvées.
b) Un plan contenant d'importantes mesures touchant aux différentes difficultés auxquelles font face les blessés militaires : simplification administrative, meilleure prise en compte de la blessure psychique, etc.
Le plan blessé prévoit en particulier une demande unique pour la PMI et l'indemnisation complémentaire Brugnot, qui prévoit la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, nés de l'accident ou de la maladie reconnue imputables au service et non réparés par la PMI.
Saluée par les associations accompagnant les blessés dans leur démarche, cette fusion réduit la quantité de dossiers que le militaire doit remplir. Il existe cependant une limite liée aux différences de procédures que ces deux demandes avaient avant leur fusion : la demande de PMI peut être déposée avant la consolidation alors que la demande Brugnot nécessite une consolidation. Ainsi, si une demande commune est réalisée avant la consolidation de la blessure, le demandeur devra tout de même, dans un deuxième temps, envoyer le certificat de consolidation lorsqu'il l'aura reçu pour pouvoir toucher l'indemnisation Brugnot.
Le nombre de pièces demandées pour un dossier de PMI a également été réduit.
Le plan blessé prévoit par ailleurs l'automatisation de certaines procédures.
Auparavant, la demande de renouvellement ou de pérennisation d'une PMI après sa période initiale de 3 ans devait faire l'objet d'une demande expresse de la part du blessé. L'administration instruit désormais d'elle-même le renouvellement des PMI. De la même manière, la revalorisation de la PMI au niveau du grade du militaire à son départ de l'institution a été automatisée.
Le plan prévoit aussi une meilleure formation du personnel d'encadrement des unités militaires
Ces derniers sont responsables de la rédaction d'un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure servant de base à l'imputabilité de la blessure au service. Une formation spécifique des officiers à la détection de la blessure psychique est également prévue.
Le plan prévoit également le renforcement de la prise en charge des blessures psychiques, avec notamment « la mise en oeuvre du pôle de réhabilitation post-traumatique » au sein de l'INI. Il s'agit d'une innovation prévue par le COP 2016-2021 de l'INI dont la mise en oeuvre, restée peu satisfaisante, est reprise par le COP 2022-2027 de l'établissement qui prévoit entre autres la mise en oeuvre de soins pour les blessés psychiques.
Il prévoit également la pérennisation du dispositif ATHOS et l'ouverture de dix maisons. Les maisons ATHOS sont un dispositif de réhabilitation non médicalisée des blessés psychiques lancé de manière expérimentale en 2021.
Le renforcement des dispositifs de réinsertion sociale et professionnelle figure également parmi les mesures, dans le cadre des dispositifs d'intervention et d'accompagnement du militaire blessé vers la reprise d'une activité professionnelle. Il prévoit également un meilleur accompagnement des militaires et de leurs familles dans des activités d'ordre social ou sportives.
Enfin, le plan prévoit la mise en place de la maison numérique des militaires blessés et des familles, une plateforme numérique centralisant les différentes démarches que peuvent réaliser les militaires blessés.
c) La création d'une plateforme informatique pour améliorer l'information des blessés et permettre une dématérialisation des démarches
La maison numérique des militaires blessés et des familles fait partie des mesures de simplification de l'accès au droit à réparation portées par le plan blessés. Elle a été créée en 2023 et a deux objectifs.
Premièrement, elle doit permettre de créer une base de données centralisant les différentes - et nombreuses - informations et démarches qui intéresse le militaire blessé. Ces informations sont en effet très diverses, difficilement accessibles et éclatées entre de nombreux acteurs. La méconnaissance de leurs droits par les blessés - souvent en situation de détresse - est un obstacle majeur à leur accès aux dispositifs de réparation et de reconstruction auxquels ils pourraient prétendre.
Deuxièmement, la maison numérique participe de la numérisation des procédures du militaire blessé. Il est désormais possible de déposer des demandes sous format numérique pour la totalité des démarches. Les dossiers numériques et papiers coexistent actuellement et le ministère indiquait qu'en 2024, les nouvelles demandes déposées l'étaient pour moitié sous format numérique et pour moitié sous la forme de dossiers papier.
Les blessés ont la possibilité de se faire assister par un accompagnateur pour réaliser des demandes sous format numérique. Il s'agit dans ce cas d'accompagnateurs spécialisés liés au service social des armées, aux différentes cellules d'aide aux blessés ou à l'ONaCVG. Les accompagnateurs « de droit commun » (comme les accompagnateurs France Service) ne sont pas formés pour aider un militaire blessé à réaliser des demandes qui lui sont spécifiques. Les accompagnateurs spécialisés sont formés pour être proactifs lorsqu'ils accompagnent un militaire blessé.
Le rapporteur souligne néanmoins que si l'usage de la plateforme visant à simplifier les démarches de militaires blessés et de leurs familles nécessite pour un nombre important d'usagers un soutien professionnel, il y a lieu de s'interroger sur leur degré de complexité, malgré les efforts de simplification engagés.
La mise en place de la maison numérique aura coûté 2 millions d'euros, et son coût de fonctionnement annuel pour 2025 et 2026 est estimé à 300 000 euros.
Source : Capture d'écran du site de la maison numérique
Le rapporteur spécial a été surpris d'apprendre que l'Union des Blessés de la Face et de la Tête n'avait pas connaissance de l'existence de la maison numérique des militaires blessés et des familles plus d'un an après sa création, alors même que cette association est un partenaire du ministère des Armées dans la prise en charge des blessés de guerre et assiste directement et régulièrement ses adhérents à réaliser les démarches que ce site se propose de simplifier.
Un effort de communication à destination des utilisateurs non institutionnels de ce site, qui sont en principe la population cible, semble donc nécessaire.
d) Un plan utile mais encore récent, dont la mise en oeuvre n'est dès lors pas finalisée et nécessite des efforts de communication
Le caractère particulièrement récent de la mise en oeuvre du plan blessé empêche d'apprécier pleinement les effets des mesures qu'il prévoit.
(1) Des mesures allant dans le bon sens
Les mesures de simplification de procédures administratives largement décrites comme longues et complexes ne peuvent qu'être particulièrement bienvenues, surtout la réduction du nombre de pièces demandées, la fusion des demandes de PMI et d'indemnisation complémentaire ainsi que l'instruction automatique des dossiers arrivant à une échéance administrative.
De la même manière, au regard du rajeunissement des nouveaux demandeurs, la dématérialisation des procédures paraît opportune.
La meilleure prise en compte de la blessure psychique est également une nécessité.
Recommandation n° 1 : Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé.
(2) Une mise en oeuvre pour l'instant partielle
Le plan blessé est récent et sa mise en oeuvre est inachevée. De plus, même si certaines mesures ont déjà été mises en place, les différents interlocuteurs intéressés n'ont pas nécessairement intégré le changement dans leurs propres procédures et pratiques. À ce titre, outre la mise en oeuvre des dernières mesures encore en attente, des efforts de communication apparaissent nécessaires.
(3) Un besoin de communication autour de certaines mesures
Les acteurs de la réhabilitation psychiques rencontrés par le rapporteur spécial ont indiqué que des efforts de communication étaient actuellement nécessaires afin de capter la population de bénéficiaires potentiels et de guider les futurs blessés directement vers les dispositifs sans interruption du parcours de soins.
Une communication institutionnelle relative aux modifications des démarches administratives, aux outils d'accessibilité développés - comme la maison numérique - et aux nouveaux droits relatifs à la réhabilitation psychique à destination des différents acteurs de l'accompagnement des blessés (ASA, CAB, ONaCVG, Associations, etc.) apparait nécessaire pour permettre à ces mesures de produire leur plein effet et de se pérenniser.
Recommandation n° 2 : Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes.
(4) L'absence de prise en compte de la valeur des PMI
Si l'objectif d'« améliorer la retraite du combattant » (désormais appelée « allocation de reconnaissance du combattant ») apparait dans les mesures portées par le plan blessé, tel n'est pas le cas de la revalorisation des PMI. Les deux pensions sont cependant liées puisqu'elles sont assises sur un même point d'indice (le point de pension militaire d'invalidité) et les motifs qui poussent à poser la question de la revalorisation de l'allocation de reconnaissance du combattant, à savoir un point d'indice très peu dynamique dont les revalorisations sont inférieures à l'inflation depuis plus de dix ans, s'appliquent en des termes identiques aux PMI.
Aussi, s'il estime louable de souhaiter renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant, le rapporteur appelle à ne pas oublier que les deux pensions sont liées et subissent la même érosion de leur valeur face à l'inflation car le recours à des augmentations de points d'indice pour renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant est une mesure au bénéfice exclusif de l'une de ces deux pensions, alors même que les invalides sont plus dépendant de leur pension pour vivre que les anciens combattants de leur allocation. En effet, si les masses budgétaires des deux pensions sont comparables (690 millions d'euros pour les PMI contre 536 millions d'euros pour les allocations de reconnaissance du combattant en 2024), le montant individuel des allocations de reconnaissance du combattant est bien plus faible que celui des PMI mais l'allocation est versée à bien plus de bénéficiaires (622 000 allocations de reconnaissance du combattant contre 143 000 PMI en 2024).
II. LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DU MILITAIRE BLESSÉ
La présente partie se concentrera sur la présentation des dispositifs de réhabilitation, réinsertion et reconnaissance relevant des crédits de la mission « Anciens combattants » ou sur les dispositifs dont peuvent bénéficier les blessés militaires ressortissants de l'ONaCVG.
Ces dispositifs - nombreux - permettent une prise en charge globale et complète du blessé, tant que ce dernier est capable d'en bénéficier.
A. LA RÉHABILITATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES MILITAIRES BLESSÉS
La mission « Anciens combattants » porte les crédits de deux acteurs de la réhabilitation physique et psychique des militaires blessés : l'Institution nationale des Invalides (INI) et les maisons ATHOS.
1. L'Institution nationale des Invalides, acteur historique de la réhabilitation des militaires blessés
L'INI est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. L'Institution a été fondée en 1674 par un édit royal et érigée en établissement public administratif en 1991. Elle est dirigée par un conseil d'administration au sein duquel sont représentés l'autorité de tutelle, les associations d'anciens combattants et de blessés de guerre, les personnels de l'INI et les usagers23(*).
Son statut est défini dans le code des pensions militaires d'invalidité (articles L. 621-1 et suivants). Elle est « la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie » et a pour mission :
- d'accueillir, dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides les plus lourds ;
- de dispenser, dans un centre médico-chirurgical, des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ;
- de participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
L'institution doit également mettre en oeuvre les missions communes aux établissements de santé publique.
a) Un établissement disposant de trois pôles pour une prise en charge globale du militaire blessé
Au regard de ses missions, l'INI est composé de trois pôles :
- un centre de pensionnaires ;
- un centre de réhabilitation ;
- le Centre d'Études et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés (CERAH).
(1) Un centre de pensionnaires permettant d'accueillir et d'héberger les blessés les plus graves
Le centre de pensionnaire sert à accueillir les invalides les plus lourds pour lesquels un retour à l'autonomie n'est pas possible. Deux types de pensionnaires se côtoient dans ce centre : les pensionnaires rentrant dans les critères définis à l'article R. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), qui bénéficient d'un accueil gratuit et représentent 85 % des pensionnaires du centre, et le reste des pensionnaires correspondent à des personnes en perte d'autonomie du fait de leur âge pour lesquels l'INI sert d'EHPAD. Bien que ces derniers ne rentrent pas dans les critères de l'article R. 621-1 précité, ils présentent généralement un lien avec l'armée. Hubert Germain, dernier des Compagnons de la Libération, faisait ainsi partie des pensionnaires hors article R. 621-1.
Le centre comptait, en septembre 2024, 62 pensionnaires.
L'entrée peut avoir lieu à différents moments de la vie du blessé.
Les pensionnaires de droit, en application de l'article R. 621-1 du CPMIVG sont les grands invalides bénéficiant à titre définitif :
- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 % et bénéficiant de la majoration pour tierce personne24(*), sans condition d'âge ;
- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 %, bénéficiaire d'une allocation spéciale aux grands mutilés et âgés de plus de quarante ans ;
- d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 % et âgés de plus de cinquante ans.
Les pensionnaires qui n'entrent pas dans une de ces catégories doivent payer 5 800 euros par mois pour être accueillis aux invalides. Les pensionnaires entrant dans les critères de l'article R. 621-1 du CPMIVG paient leur séjour, dans la limite maximale de 5 800 euros par mois, à hauteur de 30 % de leurs revenus, pension d'invalidité et allocations complémentaires comprises.
(2) Un centre de réhabilitation spécialisé dans la prise en charge des invalidités graves
Le centre de réhabilitation de l'INI est un centre spécialisé dans la réhabilitation post-traumatique lourde. Il dispose de plusieurs plateaux techniques - plateau de réhabilitation psychomoteur, piscine de réhabilitation, etc. - ainsi qu'une capacité d'accueil de 40 lits en plus d'un traitement en hôpital de jour.
Il ne dispose cependant pas de certains matériels, par exemple d'une IRM, et est obligé d'organiser le déplacement de ses patients - lourdement invalides - vers un établissement équipé lorsqu'une telle procédure est nécessaire.
L'INI ne réalise pas de soin en phase aiguë.
Le centre de réhabilitation de l'INI soigne, habituellement, environ 2/3 de patients civils et 1/3 de patients issus du monde militaire. Cette proportion se situe actuellement (septembre 2024) à 50 % de patients civils et 50 % de patients militaires, du fait d'un nombre de lits disponibles réduit.
Le centre de réhabilitation a récemment commencé à fournir des soins post phase aiguë psychiques. Ces soins sont - contrairement à ceux proposés par les maisons ATHOS - médicalisés et peuvent être fournis en hôpital de jour.
Outre le caractère récent des soins psychiques, qui ne sont pas forcément connus et donc demandés, des questions d'accessibilité au dispositif se posent : l'accès à des soins en hôpital de jour au coeur de Paris nécessite régulièrement de longs déplacements voire la réservation de nuitées qui ne sont pas toujours remboursées aux patients. Ces derniers étant par hypothèse des blessés psychiques, de tels obstacles peuvent s'avérer problématiques.
(3) Le Centre d'Études et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés
Au sein de l'INI, le CERAH a deux rôles principaux : l'appareillage des patients et pensionnaires de l'INI et la réalisation d'évaluation technique portant sur « les dispositifs médicaux, les produits d'assistance (aides techniques) ou tout matériel destiné à la suppléance d'un handicap moteur »25(*).
Il offre un service d'appareillage aux patients du centre de réhabilitation et aux pensionnaires de l'INI et est en mesure de réaliser des prothèses personnalisées sur place.
Il dispose d'une expertise spécifique aux exigences particulières de sa patientèle largement composée de militaires jeunes qui, compte tenu de leurs pratiques passés souhaitent à la fois retrouver leur autonomie et être capable de faire du sport avec leurs prothèses.
Le CERAH développe actuellement une compétence sur la réalisation de prothèses de sport.
Le centre de test des appareillages médicaux à Woippy. Il est responsable de l'homologation de ces dispositifs médicaux. Dans ce cadre, il réalise l'évaluation technique de dispositifs médicaux en vue de leur marquage CE ou de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Le CERAH peut aussi intervenir comme expert dans des processus de développement de prothèse.
b) Un établissement disposant du soutien d'acteurs associatifs et bénévoles
L'INI bénéficie du concours de plusieurs acteurs associatifs, dont notamment le Cercle Sportif de l'INI (CSINI) et les OEuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte.
Le CSINI est une association loi 1901 ayant pour but de permettre à des personnes handicapées présentant une déficience motrice, visuelle ou auditive, de pratiquer des activités sportives adaptées à leur handicap.
Cette association organise des séances d'activités physiques avec un matériel et un environnement adaptés aux pensionnaires et patients de l'INI. Elle organise également des stages de reconstruction par le sport, notamment au profit des militaires blessés.
Ces activités permettent d'optimiser le travail de rééducation réalisé par l'INI et participe à la re-sociabilisation du blessé.
L'Ordre de Malte est une association catholique hospitalière reconnue d'utilité publique, dont les membres interviennent quotidiennement aux côtés des personnels de l'INI et peuvent participer à des missions relevant du coeur de métier de l'INI comme le transport de patients. Ces interventions sont suffisamment régulières pour que les membres de l'Ordre de Malte intervenant à l'INI soient formés par l'Institution.
L'INI reçoit également des concours d'autres associations, notamment l'Union des blessés de la face et de la tête, qui finance certains projets, comme la rénovation du foyer de l'INI, et des associations, dont le CSINI.
Le rapporteur salue l'engagement des associations et de leurs bénévoles aux côtés de l'INI pour l'accomplissement des missions de cette dernière.
Le rapporteur souligne néanmoins la nécessité que l'INI reste en mesure d'accomplir par elle-même l'intégralité des missions dont la responsabilité lui est confiée et que ses financements demeurent calculés sur cette base.
c) Les principales évolutions récentes de l'INI : un renouvellement immobilier rendu nécessaire par l'ancienneté des bâtiments et une meilleure prise en compte de la blessure psychique
L'INI connait un certain nombre d'adaptations pour continuer à exercer au mieux ses missions. Ces dernières sont précisées dans le contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'établissement, établi pour la période 2022-2026. Il prévoit deux axes d'évolutions principaux :
- le premier est la concrétisation de la transformation de l'ancien centre médico-chirurgical de l'INI en centre de réhabilitation post-traumatique, qui prévoit notamment la mise en place d'une unité de soins psychiques et une coopération renforcée avec les hôpitaux d'instruction militaire de Begin et de Percy ;
- le second est la mise en oeuvre d'un programme lourd de rénovation et de réhabilitation immobilière, prévoyant des travaux sur la totalité des bâtiments occupés par l'INI après la décision de rénover le bâtiment Robert de Cotte en plus de ceux du centre de réhabilitation post-traumatique ;
Ces travaux avaient été rendus nécessaires à la suite d'avis défavorables à la poursuite de l'exploitation émis par la commission de sécurité de la préfecture de police de Paris sur les différents bâtiments de l'INI. Ces rénovations doivent également permettre à l'INI de disposer d'une unité dédiée à la prise en charge des blessés psychiques, alors que seuls quelques lits sont actuellement disponibles.
Le rapatriement du pôle appareillage-recherche du CERAH dans les locaux parisiens de l'INI a été rendu nécessaire par l'obligation de libérer le site de Créteil dès 202326(*), pour répondre aux besoins du projet du Grand Paris.
d) Un établissement faisant face à des difficultés financières
L'INI dispose d'un budget d'environ 40 millions d'euros, dont une partie provient de revenus propres. Du fait de difficultés circonstancielles, ces revenus propres se sont révélés inférieurs aux prédictions en 2023, entrainant des difficultés financières pour l'établissement.
(1) Un financement protéiforme et partiellement assis sur des revenus propres
L'INI dispose de trois sources de financement pour assurer son fonctionnement courant :
- une subvention pour charges de service public, d'un montant de 14,4 millions d'euros en 202427(*), portée par le ministère des Armées et des anciens combattants ;
- une dotation annuelle de financement, également à hauteur de 14,4 millions d'euros en 202428(*), allouée par le ministère de la santé et de la prévention ;
- des revenus propres, d'un montant généralement d'environ 10 millions d'euros. Les recettes propres s'élevaient à 8,6 millions d'euros dans le compte financier de l'INI de 2023.
Cette diversité de financement s'explique par le fait que l'INI est un établissement public administratif réalisant des actes de soins, un statut administratif unique. La dotation annuelle de financement correspond au financement des soins de suite et de réadaptation.
Le montant de la subvention pour charges de service public est déterminé en loi de finances et celui de la dotation annuelle de financement par arrêté29(*).
Les revenus propres de l'INI correspondent aux revenus tirés de l'activité de ses trois centres et comprennent notamment la redevance journalière des pensionnaires, les recettes provenant du forfait soins facturé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, les recettes des journées d'hospitalisation facturées au titre de l'activité hors dotation annuelle de financement et les recettes des activités d'appareillage. Ils sont donc directement dépendants du volume d'activité de l'INI.
Le budget de l'INI hors recette fléchée en 2023 s'élevait, dans son compte financier, à 36,7 millions d'euros, pour une prévision budgétaire de 40,3 millions d'euros. La différence entre prévision et compte financier s'explique par une sous-réalisation des recettes propres : le PLF les estimait à 12,4 millions et elles ne s'élevaient qu'à 8,6 millions d'euros lors de l'établissement du compte financier.
Il convient de noter que l'INI bénéficie d'un financement fléché pouvant atteindre 10 millions d'euros sur un exercice (9,6 millions d'euros dans le compte financier 2023) pour la mise en oeuvre de son schéma directeur immobilier. Ces crédits, dont le versement correspond à la mise en oeuvre de travaux sur plusieurs années, sont dédiés à la restauration de certains bâtiments de l'INI et ne couvre par ailleurs pas l'intégralité du coût de ces travaux. Ils correspondent essentiellement à des financements de l'État prenant la forme de subventions pour charges d'investissement.
(2) Des difficultés financières récentes pour l'institution
L'INI rencontre plusieurs difficultés dans l'exercice de sa mission, principalement financières. Elles se répercutent sur le fonctionnement de l'Institution et sont renforcées par ses difficultés à recruter des personnels soignants.
(a) Des charges renforcées par le renouvellement immobilier de l'établissement et l'inflation
L'INI met en oeuvre un schéma directeur immobilier (SDI) prévoyant la rénovation d'une grande partie des bâtiments que comportent les Invalides, auquel doit s'ajouter la réhabilitation du bâtiment Robert de Cotte. Le coût total du SDI est actuellement évalué à 70,96 millions d'euros, l'évaluation initiale étant de 51 millions d'euros. 12,7 millions d'euros sont financés sur des ressources propres de l'INI. Les coûts supplémentaires liés aux travaux du bâtiment Robert de Cotte sont eux évalués à 21,7 millions d'euros.
Aux surcoûts du SDI s'ajoute des surcoûts liés à l'inflation, notamment pour l'énergie et les prestations informatiques (+ 450 000 euros par an) et à la revalorisation des rémunérations publiques, dont celles des soignants, seulement partiellement couverte par les financements publics de l'INI et entrainant un reste à charge de 640 000 euros.
Ainsi, le budget de fonctionnement de l'INI en 2023 (y compris les charges de personnel) s'élevait à 39,2 millions d'euros30(*), montant supérieur de 11,1 millions d'euros aux financements issus de la subvention pour charges de service public et de la dotation annuelle de financement, ce qui nécessite un certain niveau de réalisation de ressources propres pour permettre de financer l'intégralité des dépenses courantes de l'INI. Or, le niveau de réalisation des ressources propres varie d'une année sur l'autre et, comme le montre l'exécution 2023, il n'est pas garanti qu'il atteigne le niveau attendu.
(b) Des recettes propres contraintes
Le centre de pensionnaire est confronté à une démographie défavorable au regard des titulaires de PMI remplissant les critères de l'article R. 621-1 du CPMIVG. De ce fait, la réserve de pensionnaires potentiels diminue et entraine une réduction d'activité et donc des ressources propres. Des réflexions sur l'extension du bénéfice de l'accès au centre des pensionnaires sont en cours.
Par ailleurs, le centre de réhabilitation post-traumatique a vu son nombre de lits ouverts réduit du fait d'un départ non remplacé d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, réduisant ainsi mécaniquement le volume d'activité de ce centre.
Enfin, le centre d'appareillage du CERAH a été déménagé de Créteil aux Invalides à la mi-2023, entrainant une réduction de l'activité sur l'année puis une baisse de fréquentation du fait d'un accès plus difficile. De plus, des évolutions réglementaires sur les fauteuils roulants sont actuellement attendues et cela entraine une forme d'attentisme des industriels et prestataires de service concernés, entrainant par extension une baisse de l'activité d'homologation du CERAH.
(c) Un manque d'attractivité de l'INI pour le recrutement de personnels médicaux et paramédicaux entrainant des fermetures de lits
L'INI rencontre également des difficultés pour le recrutement de ses personnels, qui ont des conséquences directes sur son niveau d'activité.
Le plafond des ETPT de l'INI a été réduit de 430 à 420 sur la période 2019-2024. Le nombre d'ETPT dont dispose effectivement l'INI est lui structurellement inférieur à son plafond. Depuis 2021, l'INI compte moins de 400 ETPT31(*).
Cette sous-réalisation d'ETPT est liée à des difficultés de recrutement de personnels médicaux et paramédicaux du fait de manque d'attractivité des conditions de rémunération par rapport au secteur privé.
Ce sous-effectif contraint l'INI à réduire le nombre de lits du centre de réhabilitation post-traumatique à 41 lits (pour une capacité maximale théorique de 55 lits). Les conséquences du non-recrutement de personnels paramédicaux sont actuellement limitées, l'activité du centre étant réduite du fait du non-remplacement d'un médecin.
Par ailleurs, le rapporteur spécial souligne que les financements publics et les revenus propres de l'INI ont été inférieurs en 2023 à ses coûts de fonctionnement courant dans un contexte pourtant de sous-exécution de son plafond d'emploi.
L'INI indique cependant qu'elle fidélise bien ses personnels, la durée de service médiane de ses soignants étant de vingt ans.
(d) Les conséquences de ces difficultés : un gel des dépenses d'investissement
Conséquence de ces financements contraints, les investissements de l'INI, hors travaux de réhabilitation prévus par le SDI, ont été gelés avec un dégel au cas par cas selon le niveau de nécessité et d'urgence de l'investissement.
Le rapporteur regrette cette situation. Il note cependant que l'INI conserve un niveau de trésorerie non fléchée à hauteur de 9 millions d'euros en fin d'exécution 2023.
Une baisse du nombre de personnels soignants parait cependant peu opportune, car leur réduction entrainerait une réduction des revenus propres de l'INI sans pour autant avoir d'impact sur les coûts fixes de l'Institution (électricité, chauffage, blanchisserie, etc.)
2. ATHOS, un dispositif récent et bienvenu de réhabilitation psychique des militaires blessés
Les Maisons ATHOS sont un dispositif récent de réhabilitation psychosociale mis en place par le ministère des Armées. Il s'agit d'un dispositif non médicalisé - soit un dispositif dans lequel il n'y a pas de personnel médical en blouse - venant s'inscrire dans la suite et en complément du parcours médicalisé suivi par les blessés psychologiques dont le but est de permettre la reconstruction et la réinsertion des blessés.
a) Un dispositif expérimental de l'armée de terre qui a été pérennisé et dont la gestion a été confiée à l'ONaCVG
Le dispositif ATHOS est né en 2018 d'une initiative de l'État-major de l'armée de terre qui fait suite au constat d'une augmentation du nombre de blessés psychologiques parmi les militaires engagés en OPEX à partir de 2010. Le ministère des Armées attribue cette augmentation à un changement de la nature des affrontements auxquels les soldats en OPEX font face depuis l'opération d'Afghanistan. Les opérations deviennent plus intenses et les engagements et combats avec l'ennemi plus durs et fréquents. La conséquence directe de cette plus grande intensité des OPEX est une augmentation du nombre de blessures psychiques.
L'initiative du ministère des Armées a entrainé la création du dispositif ATHOS sous une forme expérimentale à partir de 2021 avec l'ouverture de 2 maisons. À la vue des résultats de l'expérimentation, le dispositif ATHOS a été pérennisé en 2023 et sa gestion, jusqu'alors prise en charge par l'armée de terre, a été transférée au niveau ministériel. Les crédits des maisons ATHOS ont également été transférés à la mission « Anciens combattants » et les crédits qui leurs sont dédiés ont été intégrés au programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».
Si cette organisation est cohérente au regard du public cible et du mode de fonctionnement des maisons ATHOS, il en résulte une organisation administrative assez complexe.
Le dispositif ATHOS repose sur une gouvernance haute exercée par un comité directeur et son fonctionnement est sous la responsabilité de deux administrations : l'ONaCVG et l'institution de gestion sociale des armées (IGESA), dont les relations sont définies par un mandat de gouvernance et une convention.
Le comité directeur est coprésidé par le chef d'état-major de l'armée de terre (par délégation du chef d'état-major des armées) et par le secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées. Le comité fixe les orientations stratégiques du dispositif et apprécie ses résultats.
L'ONaCVG, entité ayant à sa charge le suivi et l'aide aux anciens combattants et blessés de guerre ainsi qu'aux victimes civiles de guerre et d'actes de terrorisme32(*), s'est vu transférer la gouvernance des maisons ATHOS le 1er juillet 2023. Les crédits des maisons ATHOS sont depuis intégrés à la subvention pour charges de service public (SCSP) de l'Office.
L'Office a la charge d'assurer la programmation du budget des maisons ATHOS et de suivre sa gestion afin de s'assurer qu'il rentre bien dans l'enveloppe de la SCSP. Dans ce cadre, l'Office doit notamment planifier et gérer l'ouverture de nouvelles maisons ATHOS. Il est également désigné comme responsable de la définition de la doctrine du programme et de la prospective scientifique.
L'IGESA est un établissement public industriel et commercial en charge de la mise en oeuvre de la politique sociale du ministère des Armées. Elle gère notamment les crèches et centres de vacances des armées.
Dans le cadre du dispositif ATHOS, l'IGESA assure le fonctionnement courant des maisons et s'occupe de tous les aspects « métiers » : définition des programmes de réhabilitation, recrutement du personnel, gestion courante, etc.
Si l'ONaCVG et l'IGESA sont copilotes du programme, l'IGESA agit généralement comme un prestataire de service et refacture ses différentes charges à l'Office, qui reste responsable de la soutenabilité d'ATHOS.
Au regard des besoins actuels d'accueil de militaires blessés psychiques, l'ouverture de dix maisons ATHOS est prévue à l'horizon 2030, dont une en Outre-Mer. 4 maisons ATHOS étaient déjà ouvertes au printemps 2024 et 6 nouvelles maisons doivent donc ouvrir leurs portes, soit un rythme d'une maison par an. L'une d'entre elles doit être ouverte par l'Union des Blessés de la Face et de la Tête dite « les gueules cassées », qui construit à titre gracieux une maison sur un terrain lui appartenant à Toulon.
En fonctionnement courant, le premier poste de dépense d'une maison est de loin la rémunération des personnels. Le loyer est le deuxième poste de dépense, les maisons actuellement ouvertes se situant dans des gites loués par le ministère des Armées. Le coût des activités est le troisième poste de dépense.
Répartition des crédits (hors
soutien) de la maison ATHOS d'Auray
en fonction des postes de
dépense
(en euros)
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les données de la maison ATHOS d'Auray
Le budget accordé au dispositif, de 5 millions d'euros en 2024, devrait ainsi connaitre une hausse significative du fait de l'augmentation du nombre de maisons ATHOS et des membres bénéficiaires du dispositif. Le besoin en accompagnateurs d'ATHOS est actuellement estimé à un accompagnateur pour 30 membres.
Ces ouvertures n'ont pas pour but de couvrir l'intégralité du territoire national mais doivent avoir lieu en fonction de la carte de la population des anciens militaires. Aussi, il n'est pas prévu d'ouverture de maison ATHOS dans les régions n'ayant pas de population militaire.
b) Un dispositif de réinsertion psychique réservé aux militaires blessés et basé sur le volontariat
ATHOS est un dispositif non médicalisé qui n'a pas pour vocation de traiter les cas de syndrome de stress post-traumatique en phase aigüe, qui nécessite une hospitalisation. Les maisons interviennent dans un deuxième temps et forment une sorte de sas entre la phase médicale et la réinsertion sociale du blessé psychique.
Ces dernières prennent la forme de grands gites en zone périurbaine capables d'accueillir en même temps entre 10 et 15 blessés et d'héberger 5 à 10 blessés. Elles sont dirigées par un directeur, ancien militaire, assisté d'un directeur adjoint, également ancien militaire, et de 4 accompagnateurs ayant des profils plus sociaux. Chaque maison dispose d'un psychologue référent. Des personnes tierces peuvent intervenir dans les maisons ATHOS, comme des personnels de l'ONaCVG ou de l'Aide sociale des armées.
Pour intégrer une maison, plusieurs étapes sont nécessaires : il faut qu'un diagnostic médical du service de santé des armées reconnaisse que le militaire est blessé psychique. Une fois la reconnaissance établie, une commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades doit rendre un avis favorable au suivi par le militaire blessé du programme de réhabilitation ATHOS.
Une fois l'avis favorable obtenu, le militaire va réaliser une journée découverte et à la suite de celle-ci doit donner son consentement formel au fait de devenir membre d'une maison ATHOS. Il intègre ensuite le dispositif et devient membre à vie de la maison.
Les membres n'ont pas d'obligations au regard du dispositif ATHOS. Ils réalisent des séjours selon leur convenance et sur la base du volontariat. La durée et l'éventuel hébergement sur place dépendent également de leur volonté. Un membre peut réaliser autant de séjours qu'il souhaite, y compris en cas de rechute. Par ailleurs, la qualité de membre est viagère et ne se perd pas même après une réinsertion réussie. Dans ce cas les membres peuvent revenir à la maison ATHOS en tant que membre aidant et assister les personnels de la maison dans leur mission de réhabilitation de nouveaux membres. Le dispositif ATHOS, dans sa globalité, comptait environ 400 membres au printemps 2024 dont 120 sont en cours de réhabilitation.
De plus, lorsqu'une maison ATHOS ouvre, le service psychiatrique en charge du suivi des blessés psychiques vivant aux alentours du lieu d'implantation de la maison va pouvoir de lui-même proposer les noms des militaires blessés psychiques suivis à la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.
Lorsque la procédure d'intégration au dispositif ATHOS est réalisée à l'initiative des services de suivi, environ 60 % des blessés deviennent membres de la maison ATHOS. Les 40 % restant refusent généralement au moment du contact téléphonique. La quasi-totalité des blessés réalisant la journée de découverte devient membre ATHOS. Pour la maison d'Auray par exemple, sur 65 blessés ayant réalisé la journée de présentation, 63 sont devenus membres.
c) Une réhabilitation non-médicalisée pertinente et complémentaire du traitement médicalisé
Lors des séjours en maison ATHOS, les membres peuvent bénéficier d'un programme de réhabilitation non médicalisé.
(1) Le parti pris d'une réhabilitation non-médicalisée basée sur la progressivité et le volontariat
Le programme ATHOS sert à traiter les symptômes liés à l'état de stress post-traumatique de moyenne ou basse intensité : désocialisation, isolement, conflits familiaux, sentiment d'abandon ou d'inutilité, dévalorisation, vulnérabilité, hypervigilance, insomnie, addictions diverses, etc.
Bien que la phase aiguë du syndrome post-traumatique soit passée, le blessé psychique reste très vulnérable. Nombreux sont les membres ATHOS qui ne peuvent pas, par exemple, prendre le train, le bus ou tout autre transport en commun pour se rendre à leur maison d'affiliation. De la même manière, certaines taches de la vie quotidienne comme le simple fait de faire ses courses, sont pour eux une épreuve.
À ce titre, la localisation des maisons ATHOS dans un environnement périurbain présente un double intérêt : ces maisons sont situées dans un environnement plus calme et moins dense et sont plus facilement accessibles en voiture qu'une maison située dans un centre-ville.
Pour ces mêmes raisons, les maisons ATHOS évitent tout ce qui pourrait rappeler au blessé son passé militaire, généralement associé à son traumatisme : il n'y a ni uniforme, ni levée du drapeau, ni aucun autre rite de la vie militaire. Les autorités militaires visitant une maison ATHOS sont invitées à le faire habillées en civil.
Une maison ATHOS avait initialement été ouverte dans un bâtiment installé sur la base Vie Saint-Anne à Toulon, mais il est vite apparu que la trop grande proximité avec le monde militaire et son positionnement dans un environnement urbain étaient deux facteurs qui limitaient la capacité de la maison ATOS à réinsérer ses membres. Suite à sa relocalisation dans un gite en zone périurbaine en septembre 2023, le nombre de membres de cette maison ATHOS a augmenté de 40 % en six mois.
La maison ATHOS cherche ainsi à permettre au membre de reprendre confiance en lui, à le remobiliser et à le réinsérer. Le parcours du blessé s'articule autour de quatre axes :
- le volontariat du blessé (exprimé par son consentement formel à devenir membre d'une maison ATHOS) ;
- la cogestion de la maison ;
- la progressivité du programme ;
- la personnalisation de l'accueil et de l'accompagnement.
(2) Le programme de réhabilitation ATHOS : des activités de la vie courante dans un environnement bienveillant et contrôlé
Le programme de réhabilitation consiste essentiellement à permettre aux blessés psychiques de réaliser des activités de la vie courante et de loisir entre pairs, dans un cadre bienveillant en étant accompagné par des personnels à l'écoute.
Dans une maison ATHOS, les activités de la semaine ainsi que les repas sont programmés par les membres eux-mêmes en début de semaine. Les taches de la vie courante - courses, cuisine, vaisselle, ménage, etc. - sont autant d'activités servant à la réhabilitation des membres.
Tout le programme ATHOS est basé sur le volontariat. Le blessé doit expressément accepter de devenir membre et le membre vient dans une maison de sa propre initiative et participe aux activités qu'il souhaite. Quand bien même un membre est présent dans la maison ATHOS lors d'une activité, il peut à tout moment décider de se reposer seul ou de rentrer. Il peut également à tout moment parler à l'un des personnels de la maison.
Un membre ne peut cependant pas passer plus de deux semaines par mois dans une maison ATHOS et aucun hébergement n'est proposé le week-end, afin d'éviter que le programme ATHOS ne détruise la sociabilité du membre en dehors de celui-ci.
Les maisons ATHOS interdisent strictement toute consommation d'alcool - ou de toute autre substance addictive - dans la maison. Cette règle est essentielle car les membres de la maison ATHOS sont particulièrement vulnérables aux comportements addictifs et suivent un traitement médicalisé généralement incompatible avec la consommation d'alcool. Les maisons ATHOS peuvent ainsi servir de « refuges » dans lesquels le membre sait qu'il n'aura pas de tentation sociale à la consommation d'alcool ni d'alcool à consommer à sa portée.
Les activités de loisirs proposées aux membres sont des activités participant directement à leur réhabilitation et facilitant la reprise de confiance. Il s'agit par exemple de médiation équine, d'activité de théâtre, de sport, d'atelier peinture, etc.
Les maisons ATHOS font également régulièrement venir sur place les différents intervenants du parcours du blessé : assistants sociaux des différentes cellules d'aide au blessé33(*), de l'ONaCVG, agents de défense mobilité, etc. Ces venues ont deux effets : premièrement elles permettent aux membres de réaliser leurs démarches administratives au sein de la maison ATHOS avec tous les intervenants pertinents représentés. Le second est de permettre à ces différents services de se rencontrer régulièrement et d'échanger sur le cas de certains membres.
(3) Un programme de réhabilitation permettant également de lutter contre l'isolement et les difficultés de vie familiale des membres
Les maisons ATHOS sont non médicalisées et toute action au sein d'une maison est basée sur le volontariat. Aussi, les blessés psychiques rencontrés par le rapporteur spécial indiquaient qu'un séjour en maison ATHOS est bien plus reposant qu'un séjour dans un établissement médico-social, dans lequel ils sont astreints à des horaires fixes pour le réveil, les rencontres avec les médecins ou les tests et activités qu'ils doivent réaliser. De la même manière, le rapport avec les personnels ATHOS est également basé sur l'écoute et le volontariat, ce qui est une relation très différente de celle avec un médecin cherchant à soigner son patient. Certains membres passent à la maison ATHOS après avoir rencontré leur psychiatre pour récupérer.
Également, les militaires blessés psychiques ont tendance à s'isoler socialement et beaucoup n'ont de relations qu'avec leur cercle familial proche (conjoint, enfants et éventuellement ascendants), qui se trouve de fait dans un rôle d'accompagnant auprès de personnes difficiles à vivre. Un blessé rencontré témoignait ainsi qu'il ne pouvait plus supporter les cris, quels qu'ils soient, alors qu'il avait deux enfants en bas âge chez lui. Beaucoup se retrouvent également dans l'incapacité de travailler sur de longues périodes. Le congé de longue durée pour maladie permet de toucher une demi-solde pendant huit ans.
La maison ATHOS permet de briser ce cercle vicieux, tout d'abord en permettant la réhabilitation du blessé, mais également en permettant aussi bien au blessé qu'à ses proches de « respirer » le temps de ses séjours en maison ATHOS, qui agissent comme un sas de décompression alternatif à son cercle familial proche, sans pour autant entrainer de sentiment de culpabilité de la part des accompagnants.
d) Le coût budgétaire d'une maison ATHOS : 1 million d'euros par maison
Le dispositif ATHOS est encore très récent, et il reste difficile de tirer des conclusions. Cependant, plusieurs éléments peuvent d'ores et déjà être soulignés :
(1) Une durée moyenne de réhabilitation de vingt mois
Premièrement, les maisons ATHOS les plus anciennes estiment avoir réussi à réhabiliter des membres et estiment la durée moyenne d'une réhabilitation à vingt mois. Il n'existe pas encore d'information sur le risque de rechute des membres réhabilités.
La totalité des acteurs rencontrés (membres, associations de blessés, personnels et administrations) se sont montrés très satisfaits des résultats obtenus par le dispositif ATHOS.
Le dispositif ATHOS permet de remobiliser les blessés psychiques bien avant l'expiration des congés pour longue maladie. Cet élément est particulièrement important, car la durée des congés pour longue maladie est de nature à totalement isoler un blessé psychique qui ne serait pas pris en charge.
(2) Un coût annuel d'environ 1 million d'euros par maison
Le coût complet annuel d'une maison à 120 membres est évalué entre 800 000 euros et 1,1 million d'euros et une maison ATHOS est capable d'assurer le suivi d'environ 120 membres. Ce nombre ne peut pas véritablement être augmenté - même s'il était accompagné d'une augmentation à proportion du nombre d'accompagnants - pour deux raisons : premièrement, cela remettrait en cause l'approche très qualitative de l'accompagnement des blessés psychique et le caractère « familiale » de la maison ATHOS, qui sont deux éléments essentiels pour le bon fonctionnement du dispositif ; deuxièmement, la capacité d'accueil des maisons est matériellement limitée par la capacité d'accueil du gite dans lequel elle se situe et ces gites sont choisis sur le critère de permettre d'accueillir 10 à 15 personnes en même temps et d'héberger 5 à 10 personnes la nuit. Ces capacités d'accueil sont adaptées à une population d'environ 120 membres par maison.
Le dispositif revient ainsi à environ 8 300 euros par membre et par an34(*). Le coût de fonctionnement actuel du dispositif varie légèrement, car l'ouverture de nouvelles maisons entraine nécessairement des surcouts. La première année de fonctionnement connait en revanche généralement un coût de fonctionnement moindre du fait d'un nombre de membres et d'accompagnants moins importants. Le fonctionnement en année pleine avec dix maisons devrait cependant avoisiner 10 millions d'euros, montant restant relativement faible par rapport aux crédits de la mission « Anciens combattants ».
La très large majorité de ce cout correspond à des charges de personnel, qui représentent un peu plus de 50 % du coût total du dispositif. Le personnel d'une maison ATHOS étant standardisé et non réductible pour un fonctionnement à 120 membres (un directeur, un directeur-adjoint, quatre accompagnants et un psychiatre référent). A contrario, le coût des activités est globalement négligeable par rapport au fonctionnement total35(*). La seule véritable économie réalisable consiste en l'acquisition en propre des maisons pour ne plus payer de loyer, mais cela nécessite soit de disposer d'un bien immobilier convenable pour réaliser une maison ATHOS, soit d'acheter le bien en question et cela suppose alors un investissement très important au regard des économies attendues.
En 2023, le dispositif mobilisait 32 personnels salariés de l'IGESA, dont 24 en maison ATHOS (directeurs, adjoints au directeur et accompagnateurs au sein des maisons), six ETPT de soutien (coordination nationale et assistants techniques de gestion) et deux employés de collectivités.
(3) Une absence d'évaluation des coûts sociaux évités
Le ministère avait présenté au rapporteur spécial une étude sur les coûts sociaux évités par le service militaire volontaire (SMV) lors de son contrôle sur ce dispositif36(*). Le SMV est également un dispositif d'intégration, cette fois dans le monde du travail, à destination de jeunes dans une situation sociale très difficile.
Malgré un coût par bénéficiaire beaucoup plus important pour le SMV, l'étude en question était arrivée à la conclusion que le dispositif revenait moins cher à l'État sur le long terme que le fait de ne pas aider les bénéficiaires37(*).
Sans vouloir préjuger des résultats d'une telle étude sur les maisons ATHOS, elle permettrait d'éclairer utilement le Parlement sur l'efficacité de la dépense publique engagée.
e) Un dispositif encore récent auquel il peut être complexe d'accéder
Le dispositif ATHOS connait toutefois certaines difficultés.
Premièrement, et de la même manière que les autres dispositifs du plan blessés visant à la prise en charge de la blessure psychique, est très récent et de ce fait encore mal connu. Le coordinateur national du dispositif ATHOS a indiqué en audition que le bouche à oreilles commençait à faire effet et que certains blessés réalisent désormais d'eux-mêmes la démarche de se rapprocher d'une maison. Néanmoins, la très grande majorité des membres actuels ont été identifiés par leurs organes de suivi pour intégrer une maison ATHOS, avec un succès mitigé puisque seuls 60 % des bénéficiaires potentiels ainsi contactés ont accepté de se rendre à la journée de découverte.
Si les difficultés liées à la notoriété du dispositif devraient s'amenuiser avec le temps, un effort de communication paraitrait pertinent à court terme.
Une deuxième difficulté concerne l'accessibilité du dispositif ATHOS. Il n'est pas toujours aisé de se rendre dans les maisons ATHOS, notamment pour les membres qui ne peuvent plus prendre les transports en commun. Or, les différentes armées ont des modalités de remboursement des trajets vers et en retour des maisons ATHOS différentes. En conséquence, un membre n'aura pas le droit aux même type ou niveau de remboursement selon son armée d'appartenance.
Ces différences de pratiques sont dommageables à deux égards : premièrement, elles font naitre un sentiment d'iniquité fort pour les membres moins bien traités lorsque ceux-ci se rendent compte que de telles différences de traitement existent. Deuxièmement, un moins bon niveau de remboursement des trajets peut constituer un obstacle à la réhabilitation d'un membre.
Le rapporteur souhaite vivement qu'une harmonisation des pratiques de remboursement des trajets des membres ATHOS ait lieu.
B. POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA RÉINSERTION DES BLESSÉS, DES DISPOSITIFS NOMBREUX MAIS ÉCLATÉS
De nombreux dispositifs d'accompagnement des blessés et de leur famille existent. Ces derniers relèvent, mis à part ceux directement mis en oeuvre par l'ONaCVG, de l'action du ministère des Armées et du budget de la mission « Défense ». Aussi, le rapporteur spécial se limitera à une approche descriptive de ces dispositifs.
1. L'ONaCVG, un acteur central à la fois référent administratif du parcours du blessé et pourvoyeur d'aides aux blessés
L'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) est un établissement public sous tutelle du ministère des Armées. Il a pour mission de servir au mieux les intérêts de ses ressortissants. Ces derniers recouvrent des situations très différentes, pouvant appartenir à 19 catégories différentes. Celles-ci comprennent notamment les anciens combattants, les invalides pensionnés de guerre, les prisonniers de guerre, les victimes civiles et leurs ayants cause. Il est présent dans chaque département, en outre-mer, en Algérie et au Maroc grâce à un réseau de 104 services locaux.
Il a un rôle double dans le parcours des blessés de guerre. L'Office est le référent administratif des militaires blessés ressortissants, chargé de la coordination et du suivi de leur parcours. Il est également un acteur capable de fournir une aide directe aux blessés, intervenant pour eux comme il le fait pour tous ses ressortissants.
Un département de l'accompagnement des blessés a été créé par l'ONaCVG en 2023 afin de faciliter sa montée en puissance sur l'accompagnement des blessés. En effet, si ces derniers sont des ressortissants de l'ONaCVG et à ce titre n'ont pas un statut différent des autres ressortissants, leur qualité de blessé leur ouvre des droits spécifiques et entraine des besoins de coordination entre l'ONaCVG et les autres acteurs du parcours du blessé.
a) L'Office, référent administratif de principe des militaire blessés après leur départ des armées
L'ONaCVG est chargé du suivi administratif des blessés qui sont ses ressortissants. À ce titre, il est chargé d'orienter le blessé vers les dispositifs dont il peut bénéficier. Ce suivi est réalisé par le service départemental de l'Office du lieu de résidence du blessé. Chaque service est informé de l'existence des blessés relevant de sa compétence et de leur situation par le biais du passeport du blessé, qu'ils devront alors tenir à jour.
Néanmoins, tous les blessés ne sont pas nécessairement ressortissants de l'Office, et les blessés non ressortissants ne pourront pas bénéficier du suivi administratif de l'Office, situation pouvant entrainer des non-recours à leurs droits.
Bien que cela ne soit pas spécifique aux blessés, les assistantes sociales de l'ONaCVG aident les ressortissants à réaliser les dossiers de demande pour tous les dispositifs.
b) L'Office est également un pourvoyeur d'aide directe à ses ressortissants
L'aide directe de l'ONaCVG prend plusieurs formes.
L'Office met en oeuvre une aide sociale à destination de ses ressortissants. Cette politique de solidarité est financée à hauteur de 26 millions d'euros.
Selon sa circulaire d'application, la politique de solidarité a pour objet « de venir en aide aux plus démunis et aux plus isolés de nos ressortissants. C'est pourquoi les services de l'ONaCVG étudient toutes les demandes des ressortissants et proposent, au vu de la situation particulière de chacun, d'attribuer l'aide qui leur paraît la plus adaptée ». Ces aides sont mises en oeuvre individuellement et sur des critères financiers, de logement et sociaux. Elles sont subsidiaires en intervenant après et en plus des aides de droit commun dans deux cas principaux : aide face à une difficulté financière et aide au maintien à domicile. Elles recouvrent ainsi de nombreuses hypothèses, dont des frais médicaux, des frais d'obsèques, des aides ménagères, etc.
Le rapporteur renvoie pour plus d'information sur l'action de l'ONaCVG à son rapport d'information sur l'Office38(*).
L'Office indique qu'il n'y a pas de différence de principe entre les blessés et les autres ressortissants pour la mise en oeuvre de son aide sociale. Seul le temps d'écoute peut varier. Il peut être plus long, notamment pour les blessés psychiques du fait de la complexité de leurs situations.
Il met en oeuvre un accompagnement vers la reconversion professionnelle de ses ressortissants distinct de celui offert par le ministère des Armées à travers le dispositif Défense mobilité39(*).
2. Les dispositifs d'accompagnement des militaires blessés et de leurs familles
Des dispositifs d'accompagnement, complémentaires au parcours de soins du blessé, existent au profit du blessé et de sa famille.
Le blessé et sa famille peuvent aussi bénéficier de séances de soutien psychologique.
Les séances collectives de soutien psychologique concernent toutes les familles de militaires, indépendamment de toute blessure, et consistent en des séances de sensibilisation au moment du départ du militaire en OPEX et, pour les cas intéressant le présent contrôle, à son retour.
De plus, jusqu'à six séances individuelles de soutien psychologique peuvent être remboursées dans le cadre d'une convention tripartite entre le service de santé des armées, la direction des ressources humaines du ministère de la Défense et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Le dispositif de soutien individuel est conduit par le SSA et mis en oeuvre par l'aide sociale des armées. La prise en charge individuelle peut être renouvelée à la demande du SSA.
Une aide aux transports existe pour les familles de blessés de guerre, afin de leur permettre de se rendre au chevet du blessé. Les frais de transport, de restauration et d'hébergement de six personnes désignées par le militaire blessé sont couverts pour une période de 56 jours non consécutifs.
Des séjours sont également organisés pour les blessés - OPEX, mais également faits de guerre, opération de maintien de l'ordre, de sécurité publique ou de sécurité civile - et leur famille ou les familles de militaires tués en opération. Ces séjours ont lieu dans un des centres de l'Institution de gestion sociale des armées. Des séjours de répit, à l'attention spécifiquement des familles aidante de blessés et ayant lieu sans le blessé, ont été expérimentées par l'armée de l'aire début 2024. Les résultats ayant été concluants, ces séjours doivent faire l'objet d'une généralisation.
D'autres types d'action de soutien non médical à destination des militaires et de leurs familles existent : réunions d'épouses sous forme de café social, de groupes de paroles, d'organisations de forums des aidants, de participations aux journées des aidants organisées par le SSA (hôpitaux d'Instruction des Armées) ou l'armée de Terre, ou encore, de participations aux journées des familles au sein des maisons ATHOS.
Des secours et prêts sont prévus pour les militaires blessés afin de répondre aux difficultés financières qui peuvent surgir au sein du foyer. L'aide financière, sous forme de secours ou de prêt, peut être effectuée par l'assistant de service social des armées, après analyse et évaluation, dès lors que la situation budgétaire le nécessite. Ils peuvent être versés sous une forme urgente. L'ONaCVG offre également une aide sociale dans deux cas principaux : aide face à une difficulté financière et aide au maintien à domicile. Ces aides recouvrent de nombreuses hypothèses, dont des frais médicaux, des frais d'obsèques, des aides ménagères, etc.
3. L'aide à l'emploi et à la réinsertion des militaires blessés
Le ministère des Armées dispose d'un opérateur nommé « Défense mobilité » spécialisé dans l'accompagnement des militaires pour définir un projet professionnel.
Si l'aide à la réorientation professionnelle n'est pas réservée aux militaires blessés - tous les militaires ont accès à défense mobilité et tous les ressortissants de l'ONaCVG peuvent bénéficier de son accompagnement - certaines aides leur sont spécifiquement dédiées.
Il n'y a pas de condition d'ancienneté ou de limite temporelle au recours à Défense mobilité dans le cas des militaires blessés en service.
Les blessés bénéficient ainsi auprès de défense mobilité d'une individualisation plus poussée de leur accompagnement ainsi que d'un dispositif de « découverte métier », permettant de réaliser un stage de découverte au sein d'une entreprise ou d'un organisme public. Le ministère des Armées intègre une clause sociale à ses marchés publics associant les entreprises prestataires au dispositif de « découverte métier ».
Défense mobilité anime également un centre militaire de formation pour les publics « fragiles » à Fontenay le Comte, proposant des formations certifiantes et qualifiantes. Il accueille annuellement environ 1 600 stagiaires, dont 98 % obtiennent un titre professionnel à l'issue de leur formation. Environ 10 % des stagiaires du centre sont des blessés.
L'accompagnement du projet professionnel des militaires et ex-militaire peut aussi prendre la forme d'une aide à la création d'entreprise.
Enfin, certaines catégories de blessés bénéficient du dispositif des emplois réservés.
Ce dernier a été rénové au 1er janvier 2020. Issu de l'article L. 4139-3 du code de la défense il était initialement ouvert à la fois aux militaires en reconversion et aux militaires blessés. Depuis cette révision, il s'est recentré sur les seuls bénéficiaires prioritaires tels que décrits dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
- les militaires blessés en OPEX titulaire d'une PMI ;
- les militaires blessés en service et radiés du fait de cette blessure ;
- les membres de leurs familles (enfants ou conjoints) ;
- les victimes d'attentat ;
- les enfants de harkis.
Après avoir complété un passeport professionnel, le militaire blessé est inscrit sur les listes d'aptitude pour une durée de 5 ans et intègre le vivier des bénéficiaires dits « prioritaires ». Le militaire devra ensuite postuler dans un emploi correspondant à ses compétences, et pourra être contacté pour un entretien par un employeur public en fonction de son profil. Au 31 décembre 2022, sur les 1 186 inscrits au titre des emplois réservés, 364 étaient des militaires ou gendarmes blessés.
C. LA RÉPARATION ET LA RECONNAISSANCE : UN ÉLÉMENT HISTORIQUE ET CENTRAL DE LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS
La réparation et la reconnaissance sont deux pendants essentiels de la prise en charge des blessés de guerre, tendant à démontrer la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont été blessés pour elle.
1. Des dispositifs de reconnaissance réservés aux blessés de guerre
Des mesures de reconnaissance concernent les militaires ayant reçu une blessure de guerre, soit une blessure reçue lors d'un affrontement direct et du fait d'une action délibérée de l'ennemi.
Le militaire ayant une blessure de guerre peut recevoir la médaille des blessés de guerre en témoignage de reconnaissance de la Nation. Cette médaille est attribuée aux militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre des Armées.
La carte du combattant, la croix du combattant et le titre de reconnaissance de la nation sont attribués à tout militaire ayant reçu une blessure de guerre.
Les enfants de militaires, blessés du fait d'un évènement de guerre et qui sont dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations, peuvent se voir reconnaitre la qualité de pupille de la Nation.
2. Les pensions militaires d'invalidité, pièce centrale de la politique d'indemnisation des militaires blessés
Comme indiqué supra, les deux dispositifs de réparation, la pension militaire d'invalidité (PMI) et la jurisprudence Brugnot, visent à indemniser monétairement le préjudice subi par les militaires blessés.
Représentant 690 millions d'euros en 2024, les pensions militaires d'invalidité sont de très loin le premier poste de dépense du budget « Anciens combattants » à destination des militaires blessés.
La PMI est due aux militaires souffrant d'une infirmité imputable au service.
Afin de pouvoir bénéficier d'une PMI, le militaire blessé doit en faire la demande. L'indemnisation débute à compter de la date du dépôt de la demande. Pour autant, il n'y a pas de délai formel pour le dépôt. La demande peut être réalisée sous format papier ou électronique.
Le militaire ayant fait une demande de PMI doit prouver que l'infirmité dont il demande l'indemnisation est imputable au service. Dans certains cas l'imputabilité peut être présumée.
À la réception de la demande, le Service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des Armées désigne un médecin expert afin de faire examiner les lésions que présente le demandeur et dont ce dernier demande l'indemnisation.
Après avoir examiné le militaire, le médecin expert élabore un diagnostic clinique et étiologique complet et détaillé des infirmités, donne son avis sur le caractère incurable ou non des infirmités, évalue et propose le taux d'invalidité au regard du guide barème des invalidités annexé au CPMIVG.
Le délai moyen de traitement des PMI était de 217 jours en 2023, soit plus de sept mois. S'agissant d'un délai moyen, certains délais de traitement peuvent être beaucoup plus longs. Par ailleurs, la réalisation d'une expertise médicale réalisée après un certain niveau de stabilisation de la blessure est de nature à créer des délais incompressibles dans le traitement de ces demandes.
Un taux minimal d'infirmité est exigé pour le versement d'une PMI, selon le tableau suivant :
Règles de minimum indemnisable en fonction de la nature de l'infirmité
|
Nature de l'infirmité |
Minimum indemnisable |
|
Infirmités résultant de blessures |
10 % |
|
Infirmité(s) résultant de maladie(s) associée(s) à des infirmités résultant de blessures |
30 % |
|
Infirmité unique résultant exclusivement de maladie |
30 % |
|
Infirmités multiples résultant exclusivement de maladie |
40 % |
|
Par dérogation, infirmités résultant de maladies imputables au service accompli en temps de guerre ou au cours d'une OPEX |
10 % |
Source : ministère des Armées
Si une PMI est concédée à l'issue de la procédure, celle-ci l'est pour trois ans et devient viagère si l'infirmité persiste à l'issue de cette période. S'il s'agit d'une maladie, la PMI est concédée pour une période de 3 ans renouvelable 2 fois et devient viagère si la maladie persiste ensuite. Le renouvellement et la pérennisation des PMI ont été automatisés par le plan blessé et se réalisent désormais automatiquement à l'expiration des périodes de 3 ans (une démarche de la part du blessé était auparavant exigée).
La PMI a pour objet d'indemniser la gêne fonctionnelle et la perte économique causée par la blessure. À ce titre, le nombre de points concédés pour une même blessure varie en fonction du rang du militaire blessé. Dans le cas où une PMI est concédée alors que le militaire blessé est encore en service, cette dernière l'est au grade de soldat, quel que soit le grade du militaire bénéficiant de la PMI. Lorsque le militaire quitte l'institution, le montant de sa pension est revu au niveau de son grade effectif. Cette revalorisation a également été automatisée par le plan blessé lorsque le militaire quitte l'armée. Selon le grade du blessé, l'augmentation de sa PMI peut être substantielle.
Tableau relatif aux revalorisations automatiques,
au taux du grade au 1er janvier 2024, des pensions
militaires d'invalidité (PMI) concédées au taux du soldat,
au titre d'une invalidité de 10 %,
à des militaires
avant leur radiation des cadres ou des contrôles
|
Grade du pensionné |
Taux du soldat correspondant à un taux d'invalidité de 10 % |
Valeur du point d'indice des PMI
|
Montant mensuel de la PMI au taux du soldat |
Taux du grade (nombre de points de PMI) |
Montant mensuel de la PMI au taux du grade |
Pourcentage d'augmentation entre le taux du grade et le taux du soldat |
|
Caporal |
48 points de PMI |
15,90 € |
63,60 € |
48,2 |
63,87 € |
0,42 % |
|
Sergent |
49,5 |
65,59 € |
3,13 % |
|||
|
Major |
56,4 |
74,73 € |
17,50 % |
|||
|
Lieutenant |
57,1 |
75,66 € |
18,96 % |
|||
|
Capitaine |
62,6 |
82,95 € |
30,42 % |
|||
|
Commandant |
72,4 |
95,93 € |
50,83 % |
|||
|
Lieutenant-colonel |
78,3 |
103,75 € |
63,13 % |
|||
|
Colonel |
85,9 |
113,82 € |
78,96 % |
|||
|
Général de division |
113,6 |
150,52 € |
136,67 % |
Source : ministère des Armées
Depuis 2010, les trois armées sont alignées sur la même échelle, avec des équivalences de grade. Ainsi, un quartier-maître de 2ème classe est, pour l'attribution d'une PMI, équivalent à un caporal et un vice-amiral de 1er échelon est équivalent à un général de division.
Cas des pensions de marine avant 2010
Il existait, avant 2010, une différence du nombre de points d'indice concédés aux militaires selon leur armée d'appartenance : les militaires non-officiers de la marine bénéficiaient de PMI plus importantes à blessure et grade équivalents par rapport aux autres armées.
Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires des pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a mis un terme à cette situation en alignant les PMI des autres armées sur celles de la marine.
Ce décret est cependant, comme tout acte réglementaire, soumis au principe de non-rétroactivité et cette harmonisation ne vaut que pour les pensions concédées après son entrée en vigueur. Les pensions des militaires des armées de terre et de l'air ainsi que de la gendarmerie antérieures à ce décret restent indexées sur des indices moins favorables.
Une application rétroactive aux pensions antérieures à 2010 nécessiterait ainsi une loi dont le coût annuel est estimé à 13 millions d'euros.
Source : ministère des Armées
Il est possible pour un militaire de demander une révision à la hausse de sa PMI sans condition de délai (notamment en cas d'apparition de symptômes d'une blessure psychique plusieurs années après sa radiation). A contrario, une PMI devenue définitive ne peut jamais être revue à la baisse.
Depuis le 1er novembre 2019, la contestation d'une décision de PMI (soit du refus de concession, soit du montant de la concession), prend la forme d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité (CRI).
Ces nouvelles modalités ont permis de faire passer un délai d'instruction qui durait 20 mois en moyenne avant 2019 à 7 mois en moyenne. Il s'agit ainsi d'une amélioration significative même si le délai reste très long.
Depuis sa création, la CRI a transmis 2 650 recours au service des pensions et des risques professionnels dont 531 en 2023, soit, rapporté au nombre de décisions PMI émises par le service depuis le 1er novembre 2019, un taux de recours moyen de 7,4 %.
Sur cette période, le taux de décisions SPRP confirmées par la CRI s'élève en moyenne à 78 %. Le taux de contestation des décisions de la CRI devant les juridictions administratives s'élève à 27 %.
3. Les dispositifs d'indemnisation complémentaires à la PMI permettant une meilleure prise en compte des situations spécifiques
Les dispositifs d'indemnisation complémentaires prennent deux formes. La première est une indemnisation des préjudices non couverts par la PMI, la seconde est une majoration des PMI et retraites des blessés pour prendre en compte la gravité ou les circonstances particulières de la blessure.
a) Une indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux au titre de la responsabilité sans faute de l'État : la jurisprudence « Brugnot »
L'indemnisation dite « Brugnot » est une indemnisation complémentaire de la blessure issue de la décision Brugnot du Conseil d'État du 1er juillet 2005.
Cette dernière prévoit la réparation, même en l'absence de faute de l'État, des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux certains, nés de l'accident ou de la maladie reconnue imputables au service et non réparés par la PMI (souffrances physiques et psychiques endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, etc.). Cette indemnité ne peut être versée qu'après consolidation de la blessure et expertise médicale. Elle est instruite pour le ministère des Armées par la Direction des affaires juridiques et le service du commissariat des armées.
Depuis la mise en oeuvre du plan blessé, cette dernière fait l'objet d'une demande unique commune avec la PMI. Cette demande unique doit être saluée à deux égards. Premièrement, elle allège la charge administrative pesant sur le blessé. Deuxièmement elle limite le non-recours à cette indemnité, certains militaires blessés pouvant ne pas connaitre l'existence de cette indemnité complémentaire ou la confondre avec la PMI.
b) Les majorations de retraite et de PMI pour les plus grands blessés
En cas de blessure particulièrement grave, le blessé pourra bénéficier de majorations prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).
Ainsi, la pension de retraite attribuée aux militaires mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base et à 80 % pour un blessé de guerre.
Les grands invalides40(*) et les grands mutilés41(*) bénéficient d'allocations spéciales venant majorer leurs PMI, en fonction de la gravité des blessures concernées. Les critères d'attributions et montants de ces allocations spéciales sont définis aux articles R. 131-1 et suivant du code.
Ces dernières peuvent concerner des montants significatifs dans les cas les plus graves. À titre d'exemple, la paraplégie entraine une majoration de 1 464 points de PMI pour les invalides bénéficiaires de la majoration pour tierce personne.
Une majoration pour tierce personne, visant à indemniser la dépendance des blessés, et une majoration pour enfants existent également.
D. UN SOUTIEN ASSOCIATIF AUX BLESSÉS DE GUERRE HISTORIQUE ET DYNAMIQUE : L'EXEMPLE DES « GUEULES CASSÉES »
Les blessés de guerre bénéficient aujourd'hui d'un soutien associatif fort, unique et bienvenu trouvant son origine dans la première Guerre Mondiale.
En effet, les associations de blessés de guerre, et notamment l'Union des Blessés de la Face et de la Tête, dite « les Gueules Cassées », sont à l'origine du loto. De ce fait, elles possèdent 15 % du capital social de la Française des jeux (FDJ) depuis sa privatisation. Les Gueules Cassées disposent à elles seules de 10 % du capital social de la FDJ, ce qui lui permet de bénéficier d'un budget de près de 20 millions d'euros par an grâce aux dividendes et faisant d'elle la principale association contributrice à l'action en faveur des militaires blessés.
Le loto et la Française des jeux, des entreprises historiquement dédiées au financement des associations de blessés de guerre.
La loterie nationale (puis le loto) avait été créée en 1933 par les associations de blessés de guerre à l'initiative de l'UBFT avec le concours de l'État. Les bénéfices de la loterie nationale étaient reversés aux associations de blessés de guerre. La loterie nationale est transformée en Loto face à la concurrence du PMU. Suite au succès du Loto, l'État créer la Société de la Loterie Nationale et du Loto National dont il est actionnaire majoritaire à 51 %, le reste du capital revenant aux associations d'Anciens combattants.
Cette société deviendra la Française des Jeux en 1991, qui sera introduite en bourse en 2019. Les Gueules cassées et la Fédération nationale André Maginot possèdent 15 % de son capital social. Une partie du dividende perçu par les Gueules Cassées est reversé à d'autres associations du fait d'accords de cessions de parts de marché intervenus lors de l'exploitation de la loterie nationale ou du Loto.
Source : commission des finances du Sénat
1. Une association actuellement en croissance et disposant de moyens considérables
Entendue par le rapporteur spécial, l'association les Gueules Cassées est originellement une association spécialisée dans l'accompagnement de militaires victimes d'une blessure maxillo-faciale. Elle considère néanmoins que la blessure psychique rentre dans son champ d'action et, de ce fait, enregistre depuis quelques années une augmentation significative du nombre de ses membres : l'association compte 3 000 membres au total (plus 2 000 conjoints survivants) et comptabilise 300 nouvelles inscriptions annuelles sur les trois dernières années, dont 80 à 90 % de blessés psychiques.
Cette augmentation du nombre de membres l'a contrainte à renforcer ses services, notamment son service juridique chargé d'accompagner les adhérents pour leurs démarches liées à la reconnaissance et la réparation.
Cette situation est assez différente de celle des associations d'anciens combattants, qui, bien que comptant plus d'adhérents, voit leur nombre se réduire.
De plus, l'association est spécifique à la blessure, pas à la catégorie du blessé, et n'est pas limitée aux militaires. Certains membres sont par exemple des personnels pénitentiaires ou des douaniers.
Enfin, si le nombre d'adhérents des « Gueules Cassées » est en augmentation, il reste relativement faible, en particulier lorsqu'il est rapporté aux moyens considérables dont dispose l'association grâce au dividende de la FDJ. Cela permet à l'association de bénéficier d'une « force de frappe » dans son action en faveur des blessés de guerre.
2. L'association offre des aides de plusieurs natures à ses membres, complémentaires des aides publiques
L'association peut offrir un soutien financier direct, avec des aides pouvant aller jusqu'à 1500 euros par mois, à ses adhérents dans le besoin. Elle indique que ces aides sont notamment versées dans deux cas.
Le premier correspond au cas des blessés psychiques dont la blessure se déclare après leur départ des armées. Ces derniers pouvant devenir adhérents le temps que leur demande de PMI soit traitée et que la pension commence à être versée. L'association pourra leur verser une aide le temps du traitement de leur demande de PMI qui est long : plus de sept mois en moyenne, les « Gueules Cassées » estimant qu'il faut 2 ans environ pour que les demandes de PMI pour blessure psychique réalisée après un départ des armées qu'elle accompagne aboutissent.
Le deuxième est celui des veuves dont la pension de réversion est d'un montant trop faible.
L'association finance également des travaux d'aménagement pour faciliter le maintien à domicile des membres les plus âgés.
Elle offre un soutien aux démarches administratives, similaire à celui que peut offrir l'ASA ou l'ONaCVG, et va aider ses adhérents à monter des dossiers pour bénéficier des différents dispositifs de réhabilitation et de reconnaissance auxquels ils ont droit.
L'association est détentrice d'une maison de repos et d'un EHPAD, labellisé « Bleuet de France ».
L'association insiste sur la difficulté qu'il y a à aider des blessés psychiques, qui sont démunis face aux démarches qui sont attendues d'eux et qui laissent également les aidants, dont les épouses, également démunis.
Enfin, en plus du soutien direct aux blessés, les Gueules Cassées subventionnent ou aident un nombre important d'actions menées par les acteurs étatiques en faveur des blessés.
Les Gueules Cassées ont ainsi subventionné une partie des travaux immobiliers de l'institution nationale des invalides ou des matériels médicaux offerts au SSA.
Elles sont également en train de construire à titre gracieux une maison ATHOS sur un domaine leur appartenant à Toulon afin de le remettre à l'ONaCVG.
Elles font encore partie des financeurs initiaux du fonds de dotation du Bleuet de France.
Les Gueules Cassées sont représentées au sein des conseils d'administration de l'INI et de l'ONaCVG.
III. DES DIFFICULTÉS PERSISTANTES DANS LA PRISE EN CHARGE DES BLESSÉS
Le rapporteur identifie des difficultés de deux ordres insuffisamment pris en compte ou non prises en compte par le plan blessé.
Les premières sont liées à une inadaptation des démarches et de l'accompagnement actuels au cas de la blessure psychique s'étant déclarée après le départ des armées.
La seconde difficulté est liée aux modalités de revalorisation des PMI, entrainant une perte de valeur réelle de ces dernières face à l'inflation.
A. DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SIMPLIFIÉES MAIS RESTANT INADAPTÉES À CERTAINES BLESSURES PSYCHIQUES
1. Une procédure de demande de PMI lourde pour laquelle une simplification forte a été engagée
Les dispositifs d'aide aux militaires blessés, dont les PMI, se caractérisent par leur complexité. Cette dernière s'explique par deux éléments principaux : premièrement, l'ancienneté de cette aide a entrainé une agrégation de dispositifs et procédures ayant comme résultat des aides complexes à comprendre et à demander ; deuxièmement, elle résulte aussi de la volonté de coller au plus près à la situation de ce dernier, ce qui est louable.
Pour autant, cela rend leur accès complexe pour les blessés, notamment les blessés psychiques, qui se trouvent généralement dans une situation de détresse peu compatible avec des démarches administratives, même simples.
S'agissant des militaires dont la blessure est subie lors de leur service, l'administration des armées fait preuve d'une certaine proactivité : le SSA va prendre en charge le blessé et le commandement rédige un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure. Les demandeurs disposent par ailleurs d'un portail spécifique pour les demandes de PMI. La demande initiale a été simplifiée par le plan blessé.
Les militaires sont généralement encouragés à réaliser une demande de PMI lorsqu'ils sont blessés, afin de permettre un traitement plus rapide de la demande et parce que la PMI, si elle est concédée, est versée à compter de la date de la demande. Avec la fusion de la demande de PMI et de la demande d'indemnisation complémentaire Brugnot, ces deux demandes sont ainsi déposées très tôt.
Cependant, les PMI sont attribuées au moment de la stabilisation de la blessure, après expertise par un médecin.
De plus, l'attente de la stabilisation de la blessure entraine nécessairement un temps de traitement important de la demande et donc des démarches, notamment en ce qui concerne l'expertise médicale, étalées dans le temps. Le militaire bénéficiera néanmoins d'un congé en position d'activité ou de non-activité le temps de cette stabilisation.
Il faut également souligner que cette demande met le blessé dans une situation contradictoire : meilleure sera sa situation lors de la stabilisation, moins importante sera son indemnisation.
Le plan blessé a heureusement automatisé les demandes de renouvellement de PMI et de remontée au taux du grade lors du départ du militaire de l'institution, évitant la multiplication des démarches administratives.
Aussi, si les démarches administratives des blessés restent relativement lourdes, dans le cas d'un blessé physique assisté par l'ASA, le plan blessé semble avoir significativement simplifié les procédures de demande d'indemnisation, ce qu'il faut saluer. Si sa mise en oeuvre est encore récente, ces mesures devraient avoir un impact concret sur les démarches que doivent réaliser les blessés.
2. Pensée pour la blessure physique, la procédure est mal adaptée à la blessure psychique
Si le parcours de la PMI pour le cas d'une blessure physique - se basant sur l'hypothèse d'une déclaration au sein des armées - apparait largement simplifié, tel n'est pas le cas pour le blessé psychique, notamment si sa blessure ne se déclare qu'après la radiation des cadres.
a) Un type de blessure dont la déclaration est tardive, plus difficilement détectable et entravant la capacité à réaliser des démarches administratives
La blessure psychique présente des particularités qui rendent sa prise en compte difficile.
Premièrement, cette dernière peut se déclarer de manière très différée dans le temps, parfois plusieurs années après l'évènement traumatique qui l'aura causée. De plus, ce n'est parfois pas toujours un évènement traumatique particulier qui cause la blessure mais une suite d'évènements et de situations qui, cumulés, entraineront la blessure. Aussi, le lien avec le service peut parfois être difficile à caractériser.
Il s'agit d'une blessure invisible. Sa détection est plus complexe quand bien même elle se serait déclarée. Or, la non détection entraine une absence de prise en charge et d'orientation du blessé vers les entités en mesure de l'aider.
Enfin, la blessure psychique peut être incompatible avec le fait de remplir un CERFA ou de réaliser un dossier administratif. Or, le versement d'une indemnité ou le bénéfice d'un dispositif restent conditionnés à la réalisation d'une démarche administrative qui passera nécessairement par des demandes de pièce et de remplissage de formulaires, ce qu'un blessé psychique seul peut être matériellement incapable de faire.
Un témoignage de blessé psychique recueilli indiquait qu'il avait eu besoin de deux mois pour réaliser son dossier de demande de PMI et que cela avait nécessité que son conseiller de l'ONaCVG vienne le voir chaque semaine à son domicile. Le blessé a également témoigné que la réalisation de ce dossier avait été très violente pour lui car elle l'avait obligé à refaire face à l'évènement traumatique qui avait causé sa blessure en le forçant à le décrire à de multiples occasions.
b) Une procédure pensée pour un blessé faisant partie de l'institution
La demande de PMI est longue, ne serait-ce que parce qu'il faut que la blessure soit stabilisée. Or, des congés existent pour le militaire blessé lorsqu'il fait encore partie de l'institution, pendant lesquels il garde le bénéfice de tout ou partie de sa solde et durant en principe le temps de sa réhabilitation. De plus, si la blessure stabilisée rend le militaire inapte et entraine sa réformation, par extension ce dernier pourra bénéficier d'une PMI, éventuellement majorée d'une allocation spéciale aux grands invalides.
La situation est très différente dans le cas où la blessure se déclare après que le blessé ait quitté l'armée.
La procédure de demande ne sera pas réduite dans le temps. Au contraire, l'association « Gueules cassées » estime qu'il faut en moyenne deux ans pour que les demandes des blessés psychiques qu'elle accompagne aboutissent.
Durant ce temps, le blessé ne bénéficie pas des congés du militaire lui permettant de conserver des revenus dans l'attente de la stabilisation de sa situation. S'il n'est pas ressortissant de l'ONaCVG au titre d'une des autres catégories de ressortissant (par exemple, titulaire de la carte du combattant), il ne peut pas non plus prétendre à l'aide sociale de l'Office.
De plus, l'imputabilité au service sera plus difficile à établir pour une blessure qui se sera déclarée plusieurs mois ou années après le fait générateur.
c) Un risque d'isolement lié à la durée du congé de longue durée maladie
La blessure psychique, lorsqu'elle se déclare avant le départ de l'institution du blessé, ouvre le droit au congé de longue durée pour maladie, d'une durée maximum de 8 ans.
Si ce congé est indéniablement nécessaire, il peut conduire le blessé psychique à s'isoler socialement.
C'est pourquoi un accompagnement des blessés psychique sur cette période et leur intégration à des dispositifs de réhabilitation comme ATHOS est essentiel afin d'éviter cet isolement.
d) La nécessité d'une adaptation des procédures à la blessure psychologique
Tous ces facteurs conjugués montrent une inadaptation de la procédure aux particularités de la blessure psychique.
Il apparait nécessaire au rapporteur que ces particularités soient prises en compte et que des adaptations soient apportées aux aides ou procédures.
En tout état de cause, un accompagnement systématique et volontariste de ces blessés dans leurs démarches et leur réhabilitation apparait nécessaire pour leur permettre d'obtenir une PMI à laquelle ils ont légitimement droit et éviter qu'ils ne sombrent dans un isolement social complet.
Recommandation n° 3 : Adapter les procédures de demande de pensions militaires d'invalidité à la situation particulière des blessés psychiques, notamment dans le cas où ceux-ci ont déjà quitté les armées.
B. LA PERTE DE VALEUR DES PMI FACE À L'INFLATION
Représentant une masse budgétaire importante - 690 millions d'euros en 2024 - le coût lié aux PMI baisse néanmoins d'année en année du fait d'une diminution de la démographie des pensionnaires. Cette diminution est amplifiée par un niveau de revalorisation très peu dynamique, qui entraine une perte de valeur des PMI face à l'inflation.
1. Les crédits liés aux PMI sont sur une trajectoire baissière forte et durable, liée à la démographie des pensionnaires
Le montant consacré aux PMI baisse d'année en année. Cette baisse est directement causée par la baisse du nombre de bénéficiaires, dont la population en moyenne très âgée connait une érosion forte.
Évolution des effectifs et des crédits des PMI entre 2010 et 2024
Source : commission des finances du Sénat, d'après la documentation budgétaire
Le nombre de bénéficiaires de PMI est ainsi passé de 309 000 en 2010 à 143 000 en 2024 (prévision du projet annuel de performance pour 2024 de la mission « Anciens combattants ») et les crédits dédiés à la PMI sont passés de 1,766 milliard d'euro à 690 millions d'euros sur la même période.
L'actuelle pyramide des âges des bénéficiaires de PMI, s'agissant des ayants droit aussi bien que des ayants cause - indique que ce mouvement devrait continuer au cours des années à venir :
Pyramide des âges des ayants droit de la PMI en 2015 et 2023
Source : ministère des Armées
Pyramide des âges des ayants cause de la PMI en 2015 et 2023
Source : ministère des Armées
Ainsi, si les crédits liés aux PMI restent importants en termes de volume, à 690 millions d'euros, ce montant est en baisse et devrait continuer de se réduire de manière significative.
2. Une concentration des montants versés au bénéfice des blessés les plus graves et des ayants causes
La répartition des pensions est très inégale. La très grande majorité des pensionnaires ayant droits à un taux d'invalidité relativement faible : plus de la moitié des pensions sont servies à un taux de 10 à 20 % d'invalidité. Pour autant, elles ne représentent que 17 % du montant total des pensions versées aux ayants droit.
A contrario, les pensions concédées à un taux d'invalidité de 100 % ou plus représentent 3,3 % des pensionnés et 31 % du montant total des pensions versées aux ayants droit.
Répartition par taux d'invalidité des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en crédits de paiement au 01/01/202442(*).
|
Taux |
Nombre de degré (Art. L. 125-10) |
Nombre de bénéficiaires |
Montant annuel en euros |
|
10 |
0 |
33 860 |
26 817 120 |
|
15 |
0 |
13 058 |
15 512 904 |
|
20 |
0 |
15 907 |
25 387 572 |
|
25 |
0 |
5 519 |
11 126 304 |
|
30 |
0 |
12 149 |
29 011 812 |
|
35 |
0 |
4 028 |
11 552 304 |
|
40 |
0 |
6 252 |
19 956 384 |
|
45 |
0 |
2 752 |
10 171 392 |
|
50 |
0 |
4 522 |
18 232 704 |
|
55 |
0 |
2 144 |
9 699 456 |
|
60 |
0 |
2 752 |
13 440 768 |
|
65 |
0 |
2 679 |
14 145 120 |
|
70 |
0 |
1 681 |
9 642 216 |
|
75 |
0 |
1 899 |
11 394 000 |
|
80 |
0 |
1 503 |
9 955 872 |
|
85 |
0 |
1 418 |
12 149 424 |
|
90 |
0 |
1 197 |
11 749 752 |
|
95 |
0 |
993 |
11 451 276 |
|
100 |
0 |
1 603 |
23 044 728 |
|
100 |
De 1 à 9 degrés |
1 015 |
23 629 200 |
|
100 |
10 à 19 |
509 |
18 207 948 |
|
100 |
20 à 29 |
255 |
12 481 740 |
|
100 |
30 à 39 |
175 |
11 056 500 |
|
100 |
40 à 49 |
138 |
10 265 544 |
|
100 |
50 à 59 |
85 |
8 013 120 |
|
100 |
60 à 69 |
55 |
5 351 280 |
|
100 |
70 à 79 |
29 |
2 987 232 |
|
100 |
80 à 89 |
18 |
1 888 488 |
|
100 |
90 à 99 |
23 |
2 896 896 |
|
100 |
100 degrés et plus |
36 |
5 353 344 |
|
Total |
N/A |
118 254 |
396 572 400 |
Source : ministère des Armées, d'après les données de la DGFIP et du service des retraites de l'État
En conséquence, les montants moyens et médians des pensions varient du simple au double, le montant moyen s'élevant à 3 352 euros annuels et le montant médian à 1 554 euros annuels.
Enfin, les PMI sont réversibles. En 2024, on décompte 35 000 bénéficiaires ayants cause, correspondant, dans 90 % des cas, à un conjoint. Ces derniers représentent ainsi 22,8 % des bénéficiaires et 44 % du montant total des PMI versées. Les ayants causes bénéficient de pensions en moyenne plus importantes car les pensions les plus faibles ne sont pas reversées.
3. Une pension indexée sur un point PMI moins dynamique que l'inflation
Une demande forte et récurrente des associations d'anciens combattants et des associations de blessés de guerre est d'obtenir une meilleure revalorisation du point de pension militaire d'invalidité (ci-après PMI) par une indexation de ce point sur l'inflation.
Le point PMI est un point d'indice sur lequel sont indexées les deux principales rentes viagères dont bénéficient les anciens combattants : l'allocation de retraite du combattant et la pension militaire d'invalidité. Sa valeur au 1er janvier 2024 est de 15,90 euros.
L'allocation de reconnaissance est versée à tout ancien militaire en possession de la carte du combattant, dont font partie les bénéficiaires d'une PMI, selon un nombre de points fixé par la loi. Son montant en 2024 était de 826,80 € par an, montant correspondant à 52 points PMI.
Les pensions militaires d'invalidité sont attribuées en nombre de points PMI, selon le degré d'invalidité constaté par un expert médical au moment de la stabilisation de la blessure et du grade du blessé.
La valeur du point PMI est indexée sur l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État. Cette valeur est calculée en fonction des mesures générales et catégorielles de revalorisation de la fonction publique, au prorata de leur incidence sur l'échelle indiciaire des fonctionnaires. En d'autres termes, la valeur des PMI est indexée sur l'évolution des rémunérations publiques.
Depuis 2022, la valeur du point PMI est révisée annuellement au premier janvier de l'année. La révision tient compte des évolutions des rémunérations publiques intervenues entre le 1er juillet de l'année n - 2 et le 30 juin de l'année n - 1. La révision du 1er janvier 2024 prenait ainsi en compte les évolutions intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
Du fait de cette modalité d'indexation, très peu dynamique, le pouvoir d'achat des pensionnés, à nombre de points constant, tend à se dégrader à cause de l'inflation. Si une mesure de revalorisation exceptionnelle du point PMI a été consentie en loi de finance pour 2022, cette dernière n'a, au final, pas été suffisante pour couvrir l'inflation exceptionnellement élevée constatée cette année-là. De la même manière, le pouvoir réglementaire a fait preuve de souplesse en acceptant de prendre en compte des revalorisations du point d'indice de la fonction publique intervenues en juillet de l'année n - 1 (soit une prise en compte un an plus tôt que ce à quoi aurait abouti une application stricte des modalités de revalorisation du point PMI), mais cette souplesse, même s'il faut la saluer, n'aura eu pour effet que de rendre moins forte la perte de pouvoir d'achat face à l'inflation.
Ainsi, entre 2011 et 2023, la valeur du point PMI est passée de 13,85 euros à 15,63 euros. Si le point PMI avait été indexé sur l'inflation, sa valeur au 1er janvier 2023 se serait élevée à 16,38 euros. Les bénéficiaires d'une PMI ont ainsi vu la valeur de leur pension baisser de 4,5 % sur cette période.
Si l'augmentation du nombre de points PMI de l'allocation de reconnaissance du combattant a permis de compenser les effets de l'inflation - bien que ces augmentations de points étaient présentées comme des mesures de plus grande reconnaissance envers les anciens combattants lors de leur adoption - cela n'est pas le cas pour les PMI, puisque le nombre de points d'une PMI dépend du degré d'invalidité et du grade du bénéficiaire.
Au regard des dynamiques respectives de l'évolution des rémunérations publiques et de l'inflation sur les dernières années, il n'y a pas lieu de penser que cette tendance - la perte de pouvoir d'achat des PMI face à l'inflation - s'inverse à court terme.
Cette situation est particulièrement problématique au regard des pensions les plus importantes, qui correspondent aux invalidités les plus graves, et qui sont donc des sources de revenus essentielles pour ces blessés, dont le pouvoir d'achat est directement touché par le manque de dynamisme des revalorisations.
De manière plus générale, même si la contrainte budgétaire pesant sur les finances publiques ne peut être niée, il faut regretter que la réparation légitime due aux militaires blessés pour le service de la France soit la victime collatérale d'une évolution atone des rémunérations publiques.
Recommandation n° 4 : Réfléchir à l'adaptation des modalités d'indexation des pensions militaires d'invalidité, notamment en période de forte inflation.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le jeudi 24 octobre 2024 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de M. Marc Laménie, rapporteur spécial, sur la prise en charge des militaires blessés.
M. Claude Raynal, président. - Nous allons maintenant entendre une communication de Marc Laménie sur son contrôle budgétaire sur la prise en charge des militaires blessés.
M. Marc Laménie, rapporteur spécial. - J'ai réalisé cette année un contrôle sur la prise en charge des militaires blessés. Je précise qu'il s'agit de la prise en charge après la phase aiguë de la blessure, car auparavant, ce ne sont pas les crédits de la mission « Anciens combattants » qui sont concernés.
Les blessures des militaires ne se limitent pas à la blessure de guerre : toute blessure imputable au service entraînant une infirmité ou une invalidité ouvre le droit à une pension militaire d'invalidité (PMI). En 2024, on compte 39 420 blessés recevant une PMI. Évidemment, la prise en charge des blessés ne se limite pas aux PMI, elle comprend le parcours de soins du blessé, y compris les phases de réhabilitation physique et psychique.
L'Institution nationale des invalides (INI) joue un rôle très important à ce titre : cet établissement est spécialisé dans la réhabilitation des militaires devenus invalides après avoir été blessés lourdement. Elle comprend également un centre de pensionnaires au sein duquel sont accueillis les blessés dont le degré d'invalidité empêche de recouvrer leur autonomie, ainsi qu'un centre d'appareillage pour les invalides ayant besoin de prothèses.
La prise en charge comprend aussi un accompagnement social et professionnel des blessés et de leurs familles. Outre des congés spécifiques, un suivi psychologique et une aide aux démarches, le militaire peut demander un accompagnement dans un projet professionnel - formation, réorientation, création d'entreprise - adapté à son invalidité. Après que le militaire a quitté l'armée, cet accompagnement est réalisé par l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG).
Enfin, le blessé militaire bénéficie de dispositifs de reconnaissance et de réparation au premier rang desquels les PMI. Ces différents dispositifs représentent 880 millions d'euros sur les crédits de la mission « Anciens combattants », dont 690 millions pour les seules PMI.
Au total, la majorité du coût de la prise en charge des blessés est supportée par la mission « Défense ». S'il n'existe pas d'estimation du coût global de cette politique, le service de santé des armées bénéficie à lui seul d'un financement à hauteur de 1,6 milliard d'euros.
Toutefois, malgré un parcours complet, certaines difficultés persistent : le parcours administratif du blessé pour qu'il bénéficie des dispositifs décrits est long et complexe. De même, la prise en compte de la blessure psychique n'est que très récente.
Le ministère des Armées a déployé un Plan Blessés 2023-2027, qui se distingue de ses prédécesseurs par son ampleur et son ambition, puisqu'il porte non seulement sur le parcours de soins, mais également sur les démarches et les acteurs qui l'entourent. Il prévoit notamment de réduire et de simplifier les démarches administratives qui incombent au blessé, de tenir compte de la blessure psychique dans le parcours de soins et de centraliser les informations et démarches du blessé sur une plateforme numérique.
Même s'il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, ces mesures vont dans le bon sens. Elles montrent une véritable volonté de s'attaquer au mur administratif que constituent les démarches du blessé. Ces initiatives doivent être soutenues et pérennisées ; c'est l'objet de ma première recommandation.
La meilleure prise en compte de la blessure psychique passe par l'ouverture de dix « maisons ATHOS » d'ici à 2030. Les maisons ATHOS sont des centres non médicalisés - celui que nous avons visité à Auray dans le Morbihan s'apparente à un gîte - de réhabilitation des blessés psychiques, qui permettent à ces derniers de se réintégrer à la suite du traitement médical qu'ils ont suivi. Le traitement médicalisé de la blessure psychique doit également être développé, notamment par l'Institution nationale des invalides.
Le développement récent de ces dispositifs ATHOS s'explique par l'accroissement du nombre d'anciens militaires en retour d'opérations extérieures (Opex) qui souffrent d'un syndrome post-traumatique depuis 2010. La capacité d'accueil de ces derniers doit être portée à 1 500 blessés grâce à l'ouverture de dix maisons ATHOS.
Par ailleurs, nous avons identifié quelques angles morts.
Tout d'abord, l'accès au traitement en cas de blessure psychique est une source de grandes difficultés. En effet, les blessés psychiques ne sont souvent pas capables de réaliser eux-mêmes les démarches administratives pour bénéficier de ce traitement.
Ensuite, si la blessure psychique ne se déclare qu'après le départ des armées, le blessé ne bénéficie pas des aménagements normalement prévus en cas de blessure - positions de congé de moyenne ou longue durée, accompagnement administratif, etc. Cette question de l'accès aux soins pour les blessés psychiques est l'objet de mes recommandations nos 2 et 3.
Enfin, les pensions militaires d'invalidité sont calculées à partir de points PMI, qui sont accordés selon le grade et le degré d'invalidité du blessé. Or la valeur du point PMI est fixée sur l'évolution des rémunérations publiques, qui est traditionnellement moins dynamique que l'inflation. Ainsi, au fil des années, la valeur des PMI est grignotée par l'inflation, ce qui est particulièrement problématique dans les périodes où celle-ci est élevée. C'est d'autant plus problématique que les plus grands invalides bénéficient des pensions les plus élevées et sont ainsi les plus dépendants de leur pension pour vivre. Ma recommandation n° 4 porte sur cette question.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorise la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG)
- M. le Général Éric MAURY, Directeur adjoint de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ;
- M. le Général Charles ORLIANGES, chef du département de l'accompagnement des blessés ;
- M. Frantz-Éric LELOUP, chef du département des finances et de l'évaluation.
Ministère des Armées
- M. Pierre-Damien SAUGERON, directeur de la maison numérique des blessés et des familles et chargé de mission auprès du SGA pour les blessés, les familles endeuillées, le monde combattant et les victimes d'actes de terrorisme ;
- Mme Sophie NOTTE, directrice du service des pensions et des risques professionnels du ministère des Armées ;
- M. Pierre-Arnaud COURRÈGES, chef du bureau des pensions, de la couverture des risques professionnels et des droits des anciens combattants au sein de la direction des ressources humaines du ministère des Armées (DRHMD).
Institution nationale des invalides
- M. Sylvain AUSSET, directeur de l'Institution nationale des Invalides ;
- M. Vincent HONORÉ, directeur adjoint de l'Institution nationale des invalides.
Union des Blessés de la Face et de la Tête
- M. Lucien FLAMANT, président de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête ;
- M. Olivier ROUSSEL, directeur général de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
La maison ATHOS d'Auray
- M. Arnaud LE GUERN, directeur de la maison ATHOS d'Auray ;
- Mme Alice DESNOES, directrice adjointe ;
- Deux membres de la maison ATHOS.
Institution nationale des invalides
- M. Sylvain AUSSET, directeur de l'Institution nationale des Invalides ;
- M. Vincent HONORÉ, directeur adjoint de l'Institution nationale des invalides.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé |
Ministère des Armées |
Dès que possible |
Documents et services administratifs |
|
2 |
Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes |
Ministère des Armées, ONaCVG |
1 an |
Autre |
|
3 |
Adapter les procédures de demande de pensions militaires d'invalidité à la situation particulière des blessés psychiques, notamment dans le cas où ceux-ci ont déjà quitté les armées |
Ministère des Armées |
3 ans |
Règlement |
|
4 |
Réfléchir à l'adaptation des modalités d'indexation des pensions militaires d'invalidité, notamment en période de forte inflation |
Ministère des Armées |
1 an |
Décret |
ANNEXE
Consultable uniquement au format PDF
* 1 Si le terme blessé est systématiquement utilisé, celui-ci couvre également le cas des militaires ayant contracté une maladie imputable au service.
* 2 Voir le rapport d'information « Le service de santé des armées, une pièce maitresse de notre outil de défense », Dominique de Legge, rapporteur spécial de la mission « Défense », publié le 27 septembre 2023.
* 3 En AE (autorisation d'engagement), les crédits en CP (crédits de paiement) étaient plus élevés du fait de l'engagement d'important travaux de rénovation de l'INI qui entrainent le versement de 9 millions d'euros de subvention d'investissement.
* 4 Rapport d'information n° 936 (2022-2023), déposé le 27 septembre 2023
* 5 Là aussi, les armées de terre et de l'air, la marine, le service de santé des armées et la gendarmerie ont chacun une cellule d'aide aux blessés spécifique.
* 6 Malgré l'utilisation du terme maladie, ces congés bénéficient après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé.
* 7 Article L. 4138-3-1 du code de la défense.
* 8 Article R. 4138-47 du code de la défense.
* 9 Article L. 4138-13 du code de la défense.
* 10 Articles R. 4138-54 et R. 4138-58 du code de la défense.
* 11 Article R. 4138-56 du code de la défense.
* 12 Article R. 4138-57 du code de la défense.
* 13 Les HIA et l'INI traitent également des blessés et malades civiles pour les deux tiers de leur activité. Cette activité est nécessaire afin de pouvoir maintenir les capacités d'action et le savoir-faire de ces structures car il n'y a - heureusement - pas suffisamment de militaires blessés ou malade pour que les HIA ne traitent que ces derniers avec leurs capacités de soins actuelles.
* 14 La jurisprudence Brugnot est une indemnisation complémentaire de la blessure réparant les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux non réparés par la PMI, voir infra.
* 15 Il s'agit d'un plan du ministère des Armées visant à améliorer la prise en charge des militaires blessés, voir infra.
* 16 Quatre mutuelles sont référencées par le ministère des Armées à cette fin : Unéo, en groupement avec GMF, Harmonie Fonction Publique, Intériale et les mutuelles du groupement Fortego.
* 17 Il s'agit d'un dispositif de réinsertion des militaires blessés psychiques, cf. infra.
* 18 Lors de l'ouverture d'une nouvelle antenne, la commission se saisit d'elle-même des dossiers de militaires identifiés blessés psychiques habitant à proximité de la nouvelle maison.
* 19 La condition « par défaut » de l'obtention de la carte du combattant est de totaliser 112 jours en OPEX ou opération considérée comme équivalente.
* 20 Le titre de reconnaissance de la nation peut également être obtenu en totalisant 90 jours en OPEX.
* 21 De nombreux militaires ont pu avoir des blessures psychiques de type syndrome post-traumatique au cours du 20ème siècle sans que ces dernières n'aient été diagnostiquées ou prise en compte. L'ONAC indique qu'un militaire a été diagnostiqué pour un syndrome post-traumatique causé par la guerre d'Indochine alors qu'il avait 90 ans.
* 22https://www.defense.gouv.fr/actualites/plan-blesses-2023-2027-toutes-blessures-parcours-lentourage
* 23 Le rapporteur spécial avait réalisé un rapport d'information dédié à cette institution : rapport d'information « L'Institution nationale des Invalides », Marc Laménie, rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », publié le 25 octobre 2016.
* 24 La majoration pour tierce personne est une majoration de pension dont bénéficient les pensionnaires d'une PMI que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne.
* 25 Site du CERAH, https://mobile.cerahtec.fr/fr/tests-laboratoire
* 26 Les locaux du CERAH se situaient à Créteil avant leur rapatriement aux invalides en 2023.
* 27 13,7 millions d'euros en 2023.
* 28 Montant inchangé par rapport à 2023.
* 29 Article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
* 30 9,3 millions d'euros de charges de fonctionnement et 29,9 millions d'euros de charges de personnel.
* 31 399 en 2021, 395 en 2022 et 398 en 2023, exécution 2024 non encore connue.
* 32 La liste exhaustive des ressortissants de l'ONaCVG peut être consultée à l'annexe législative du titre Ier du livre VI du code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre.
* 33 Chaque armée, la gendarmerie et le service de santé des armées ont chacun une cellule d'aide aux blessés qui lui est spécifique.
* 34 Pour une hypothèse de fonctionnement annuel moyen à 1 million d'euros pour 120 membres.
* 35 Environ 50 000 euros par an.
* 36 Le service militaire volontaire : un dispositif militaire original d'insertion professionnelle de la jeunesse, Rapport d'information n° 34 (2023-2024), déposé le 17 octobre 2023, Marc Laménie.
* 37 Selon cette étude, l'État était ainsi « remboursé » par les impôts payés - IR, TVA, etc. - par les bénéficiaires, par le non ou moindre recours à des prestation sociales (chômage, RSA, etc.) et par une chance bien moindre de tomber dans la délinquance.
* 38 Rapport d'information « L'Office national des anciens combattants : se moderniser pour accompagner les ressortissants et transmettre leurs mémoires au 21ème siècle », Marc Laménie, rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », publié le 27 octobre 2022.
* 39 Pour rappel, les ressortissants de l'Office incluent notamment tous les anciens combattants, les victimes civiles de guerre et les pupilles. Si les militaires blessés en service peuvent avoir recours à défense mobilité sans limite de temps après leur départ de l'institution, les autres militaires ne peuvent avoir accès à défense mobilité que jusqu'à trois ans après leur radiation et les ressortissants de l'Office non-militaires ne peuvent pas avoir recours à défense mobilité. Aussi, si cette offre peut apparaître redondante s'agissant du militaire blessé en service et ressortissant, elle trouve son utilité pour les multiples catégories de ressortissants ne pouvant pas avoir recours à Défense mobilité.
* 40 Définis à l'article L. 131-1 du CPMIVG comme les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, les invalides bénéficiant de la majoration pour tierce personne, amputés d'un membre ou pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.
* 41 Définis à l'article L. 132-1 du CPMIVG les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou bien d'infirmités multiples atteignant au moins 85 à 100 %(selon le nombre d'infirmité) si l'une de ces infirmités détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
* 42 Pensions des ayants droit uniquement