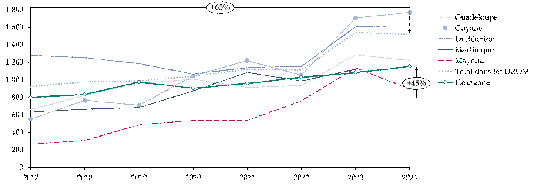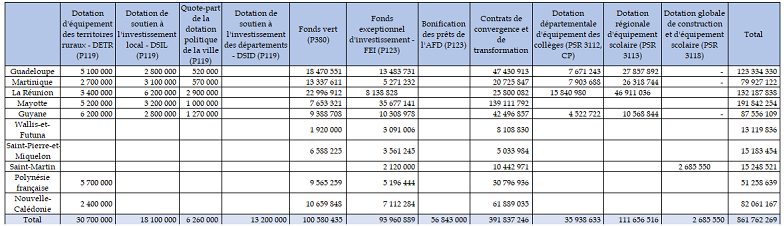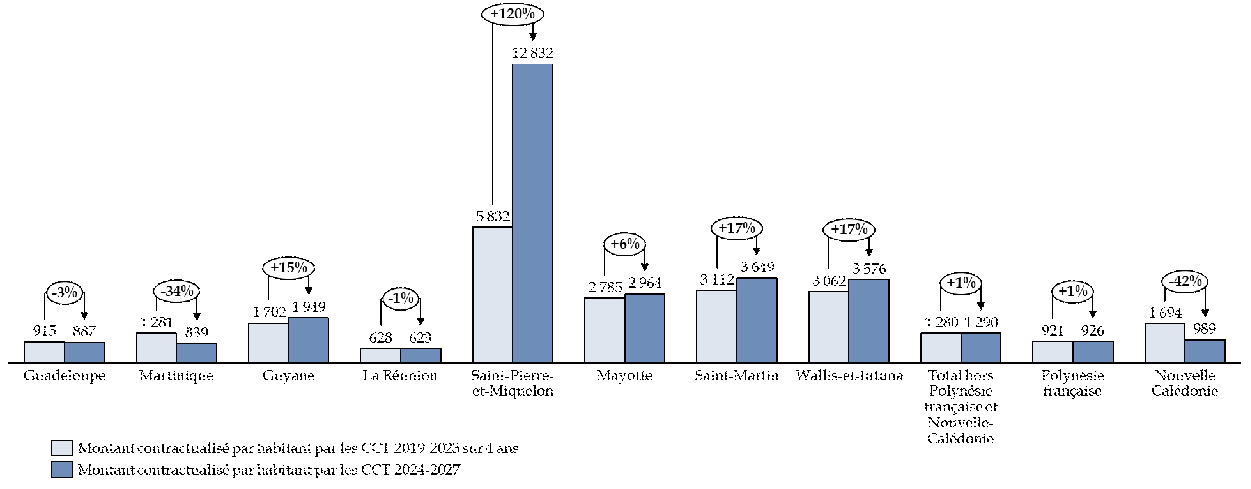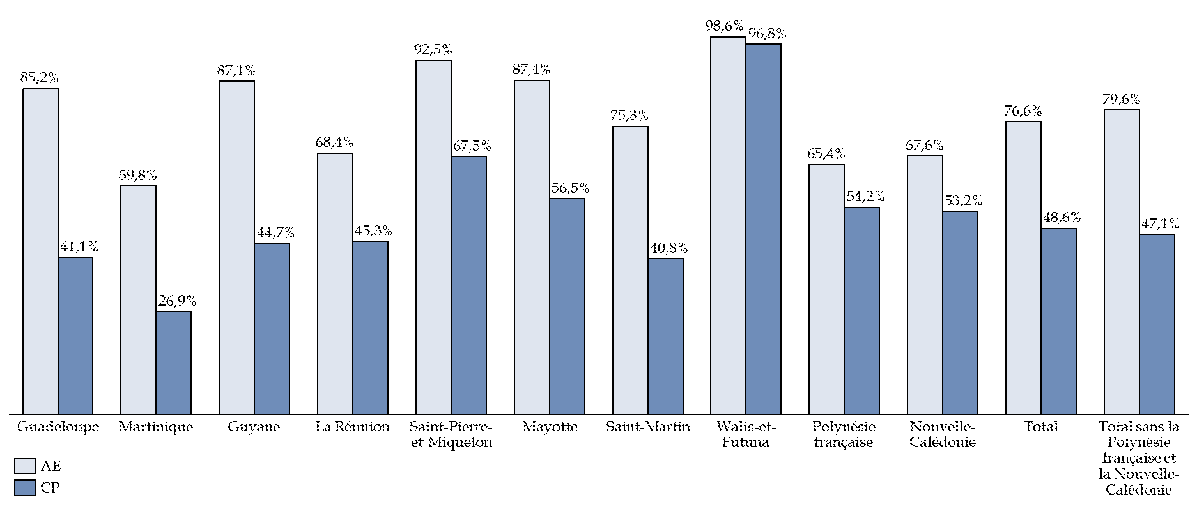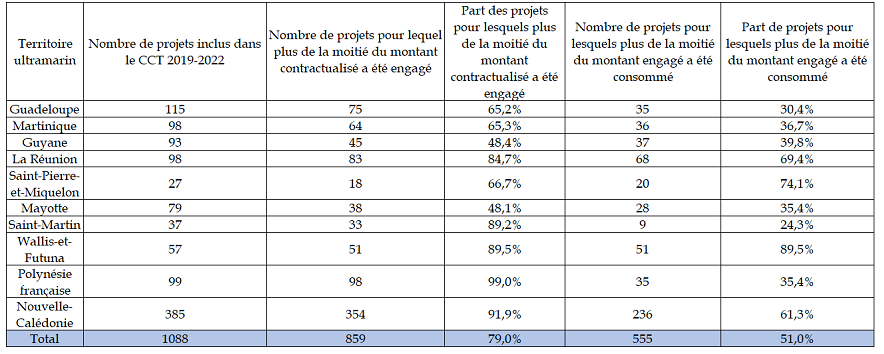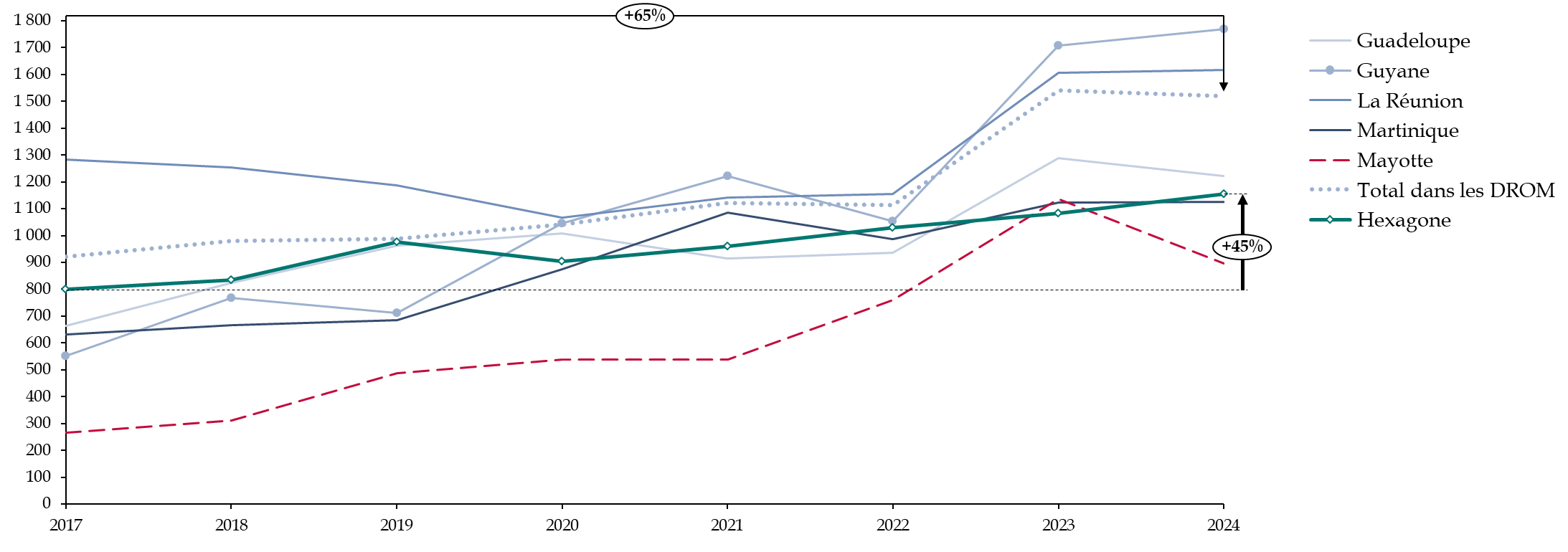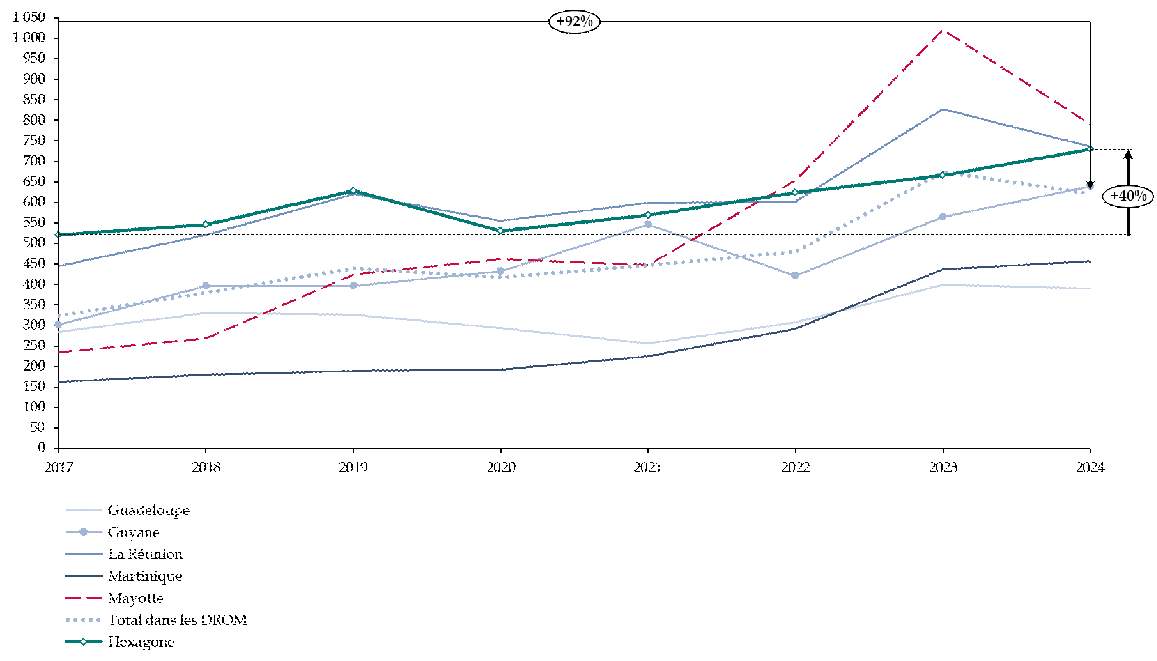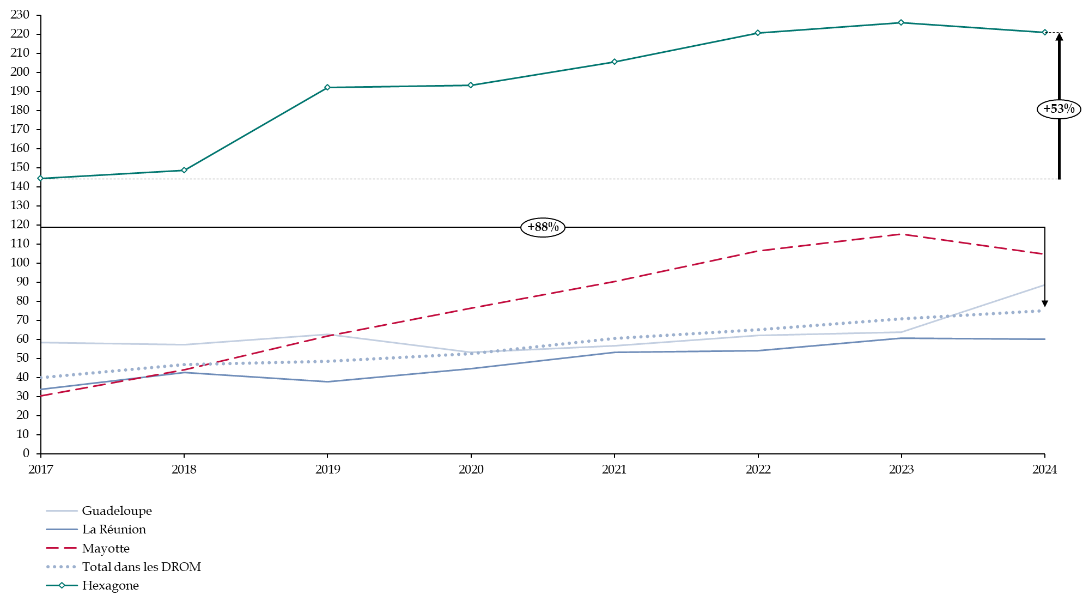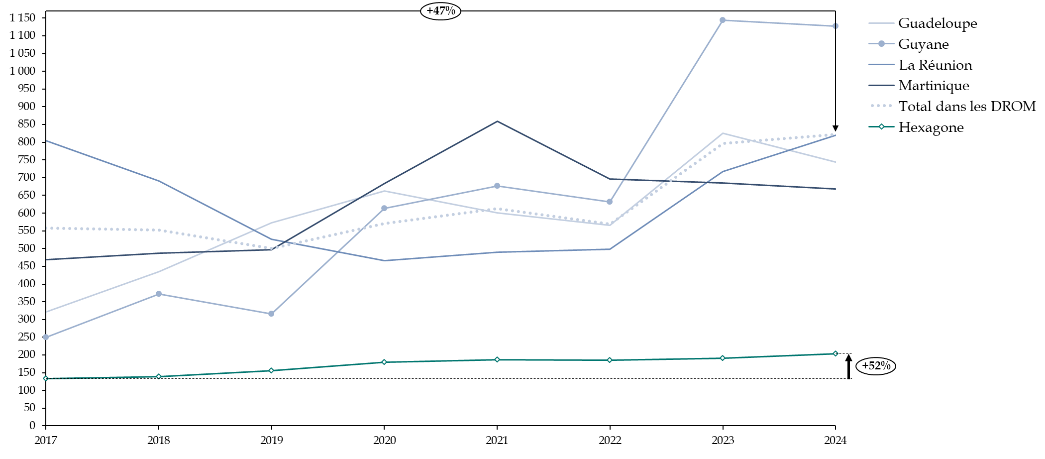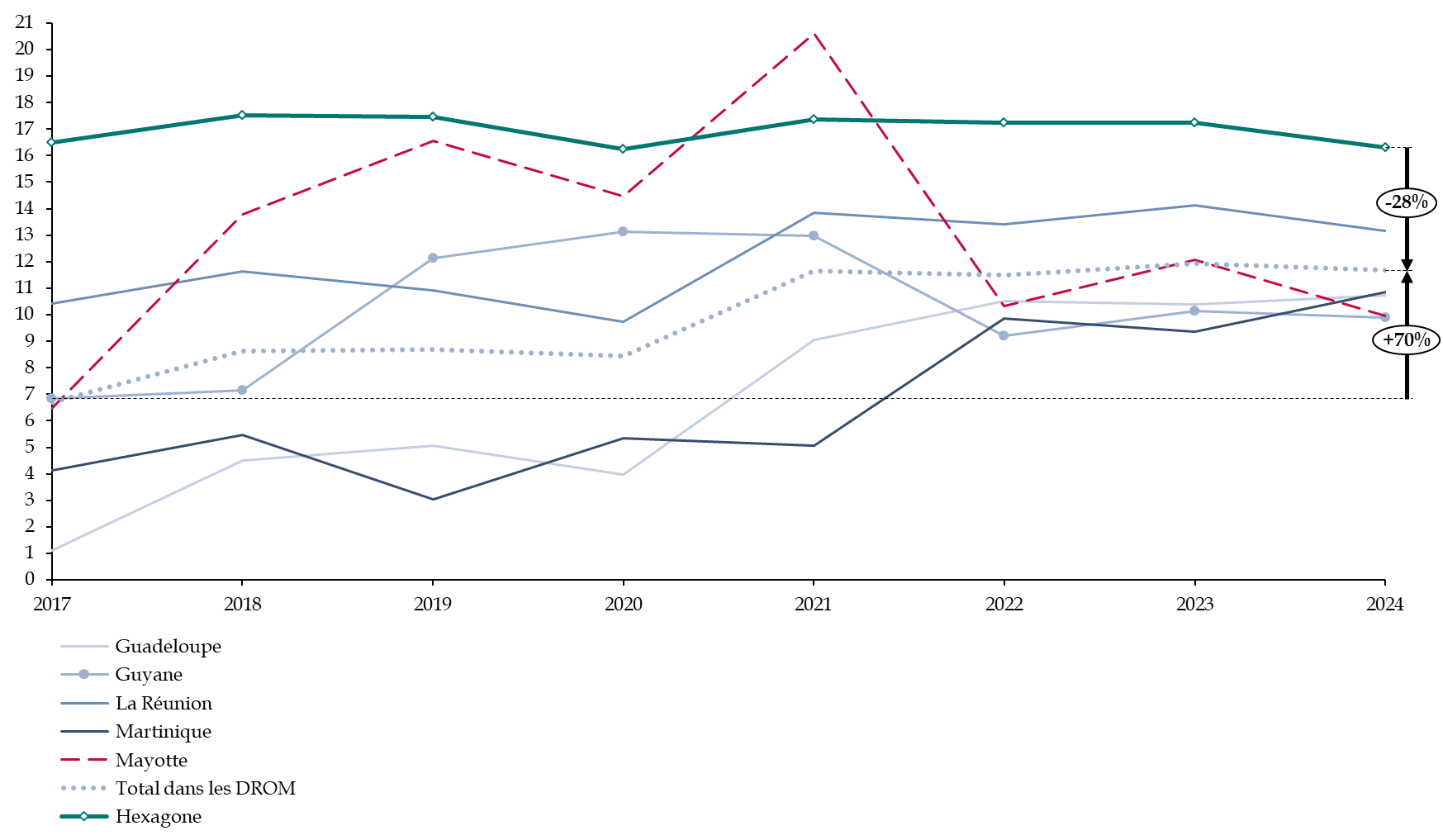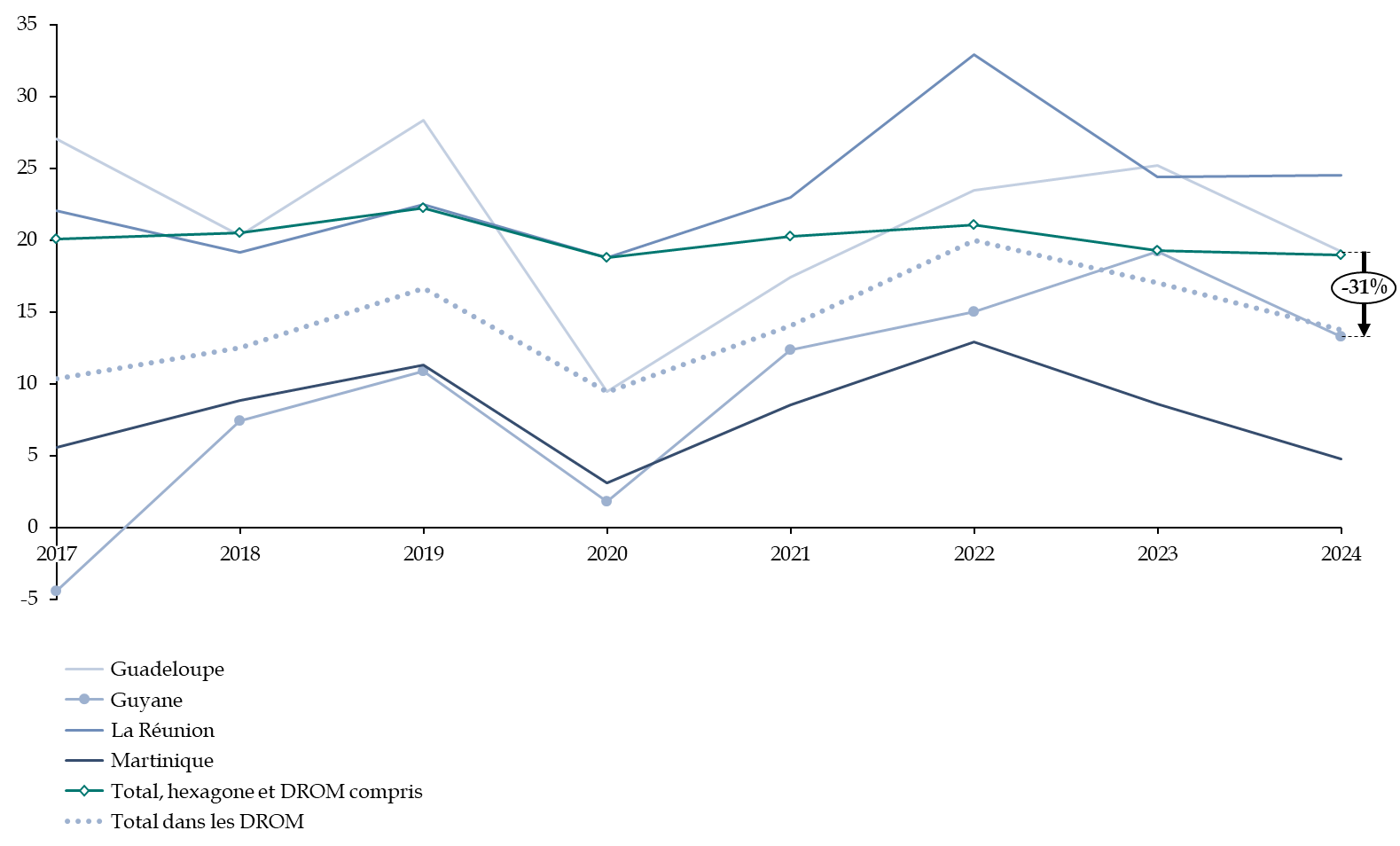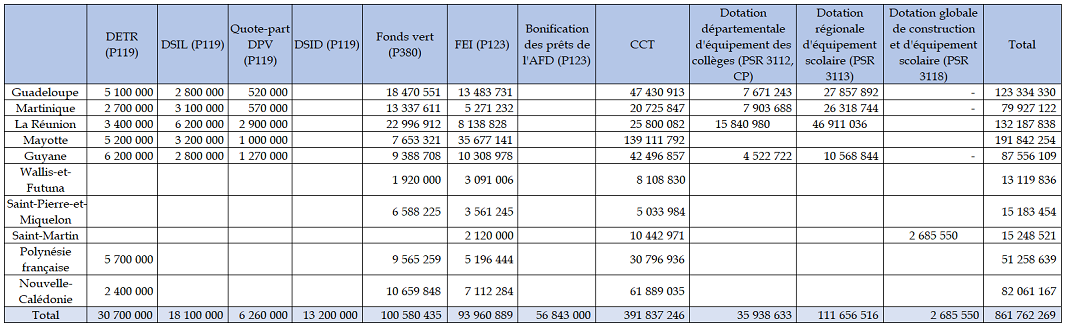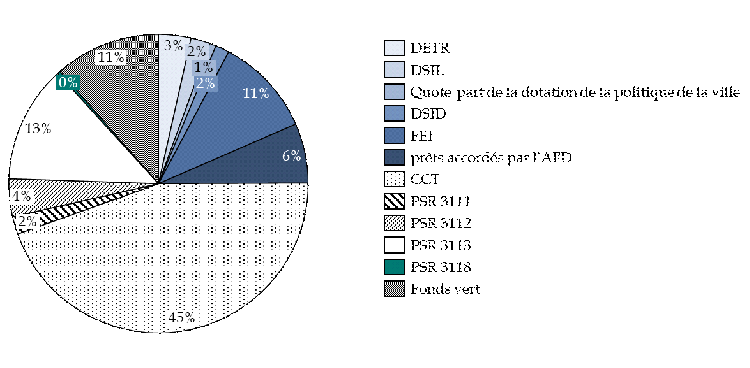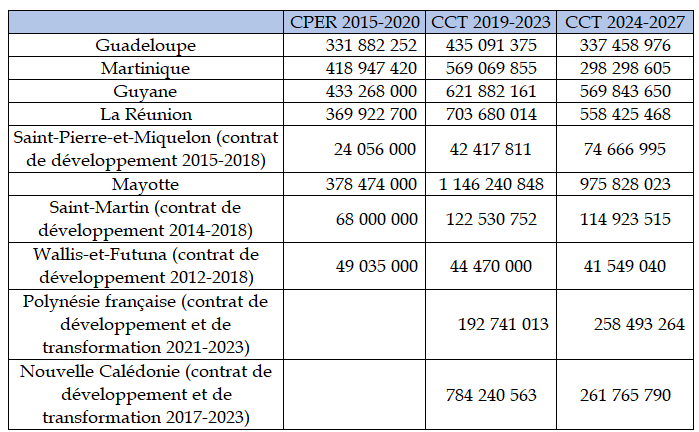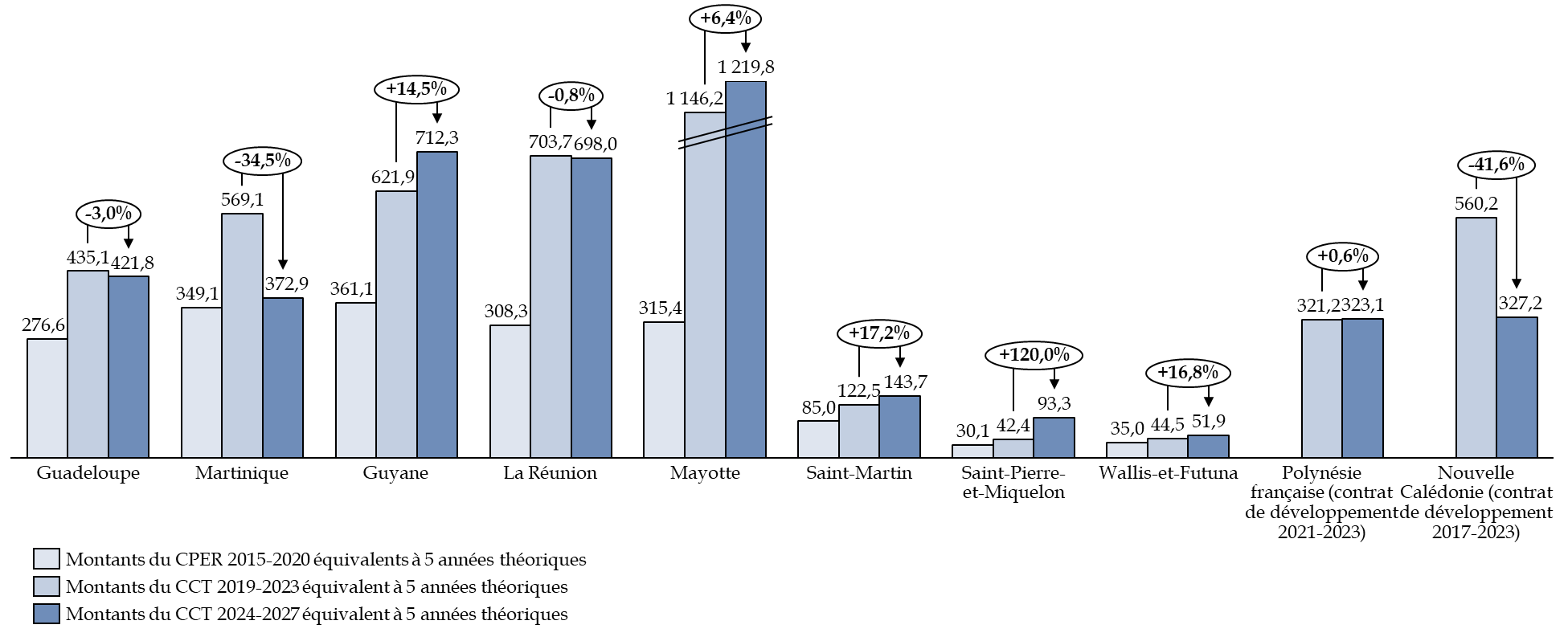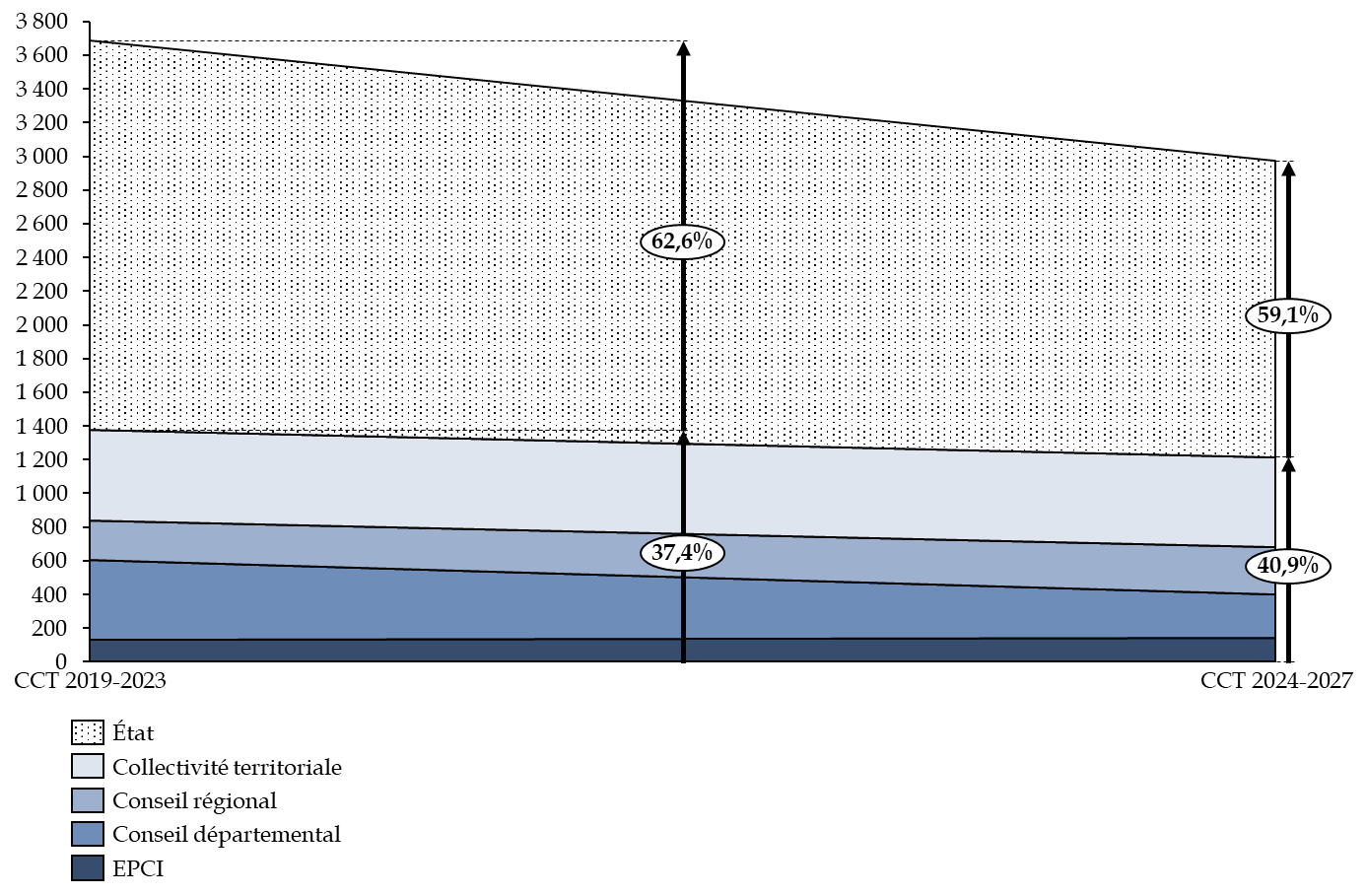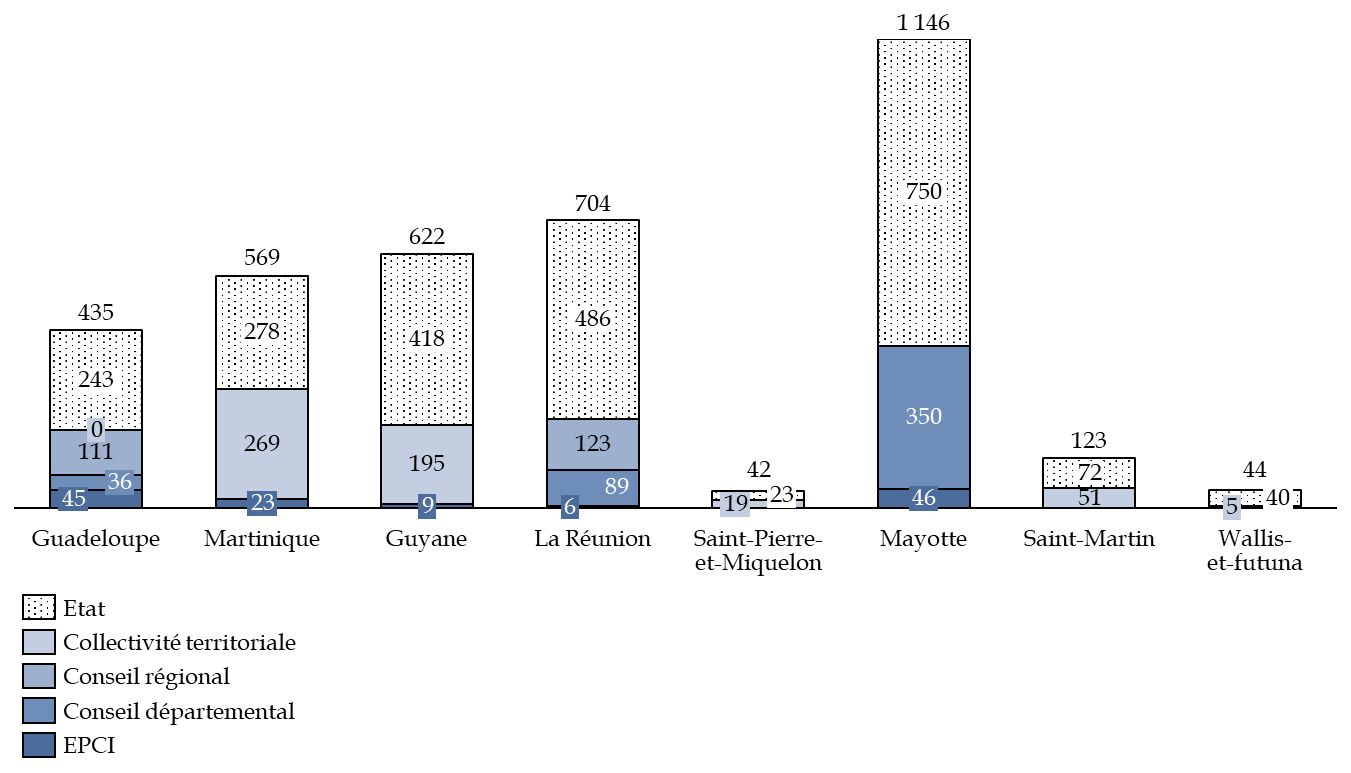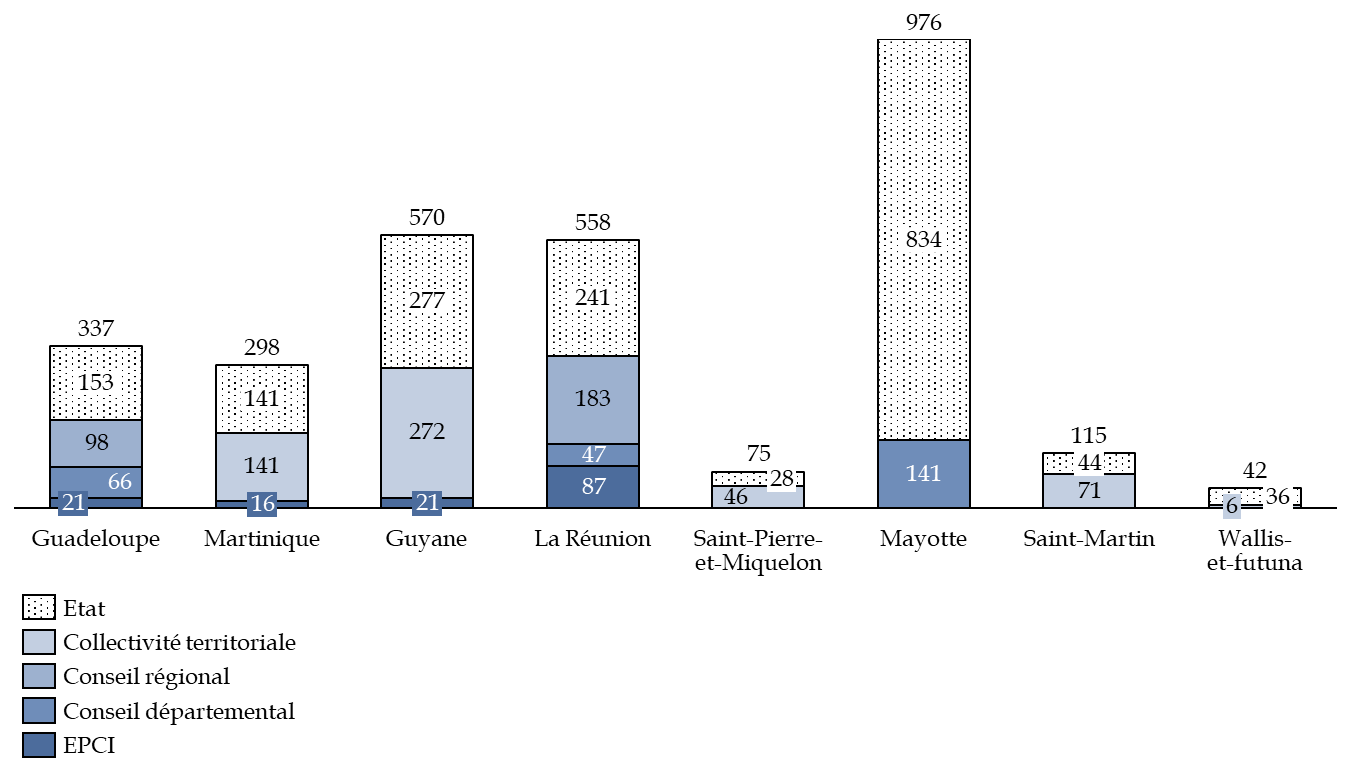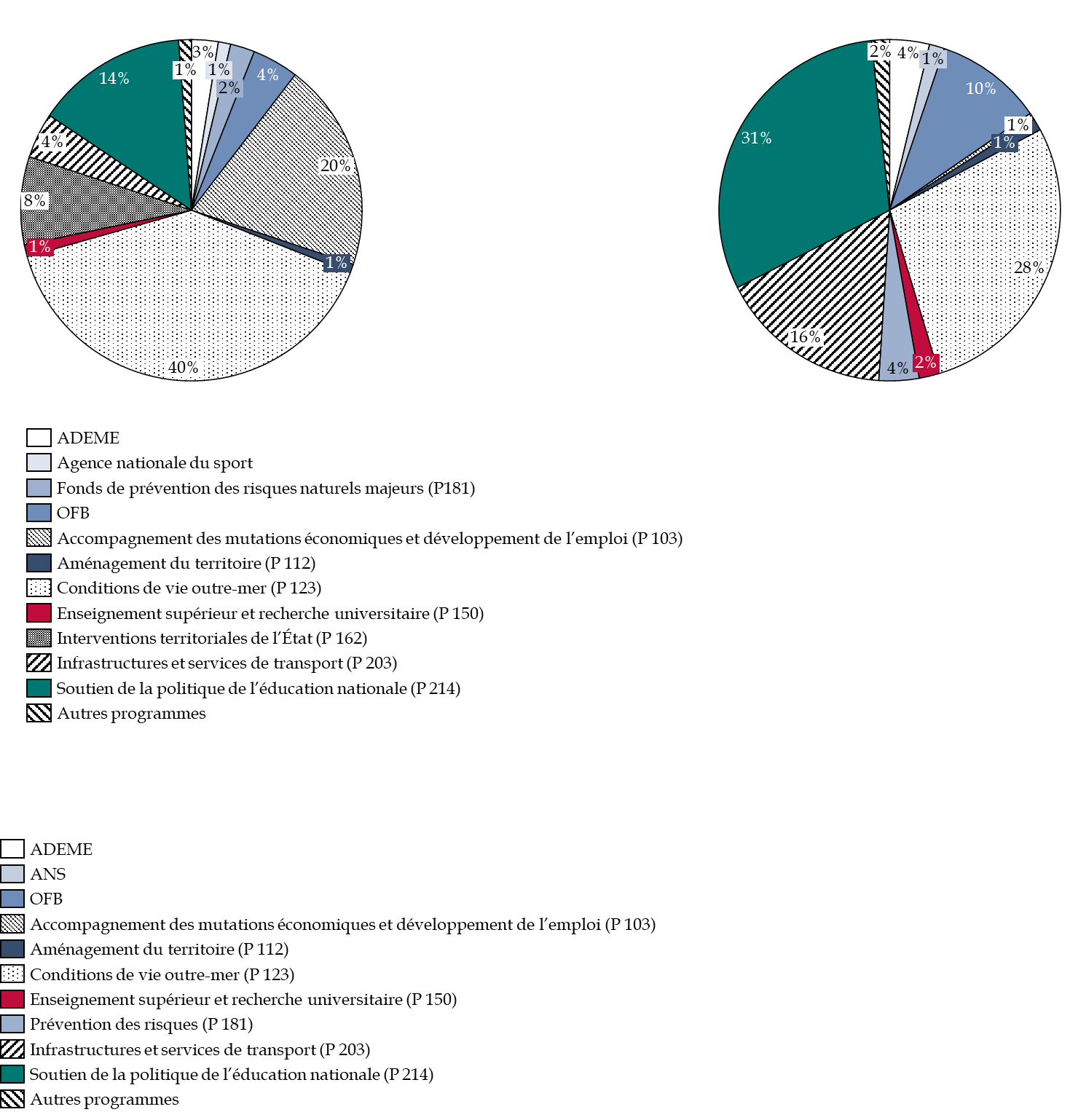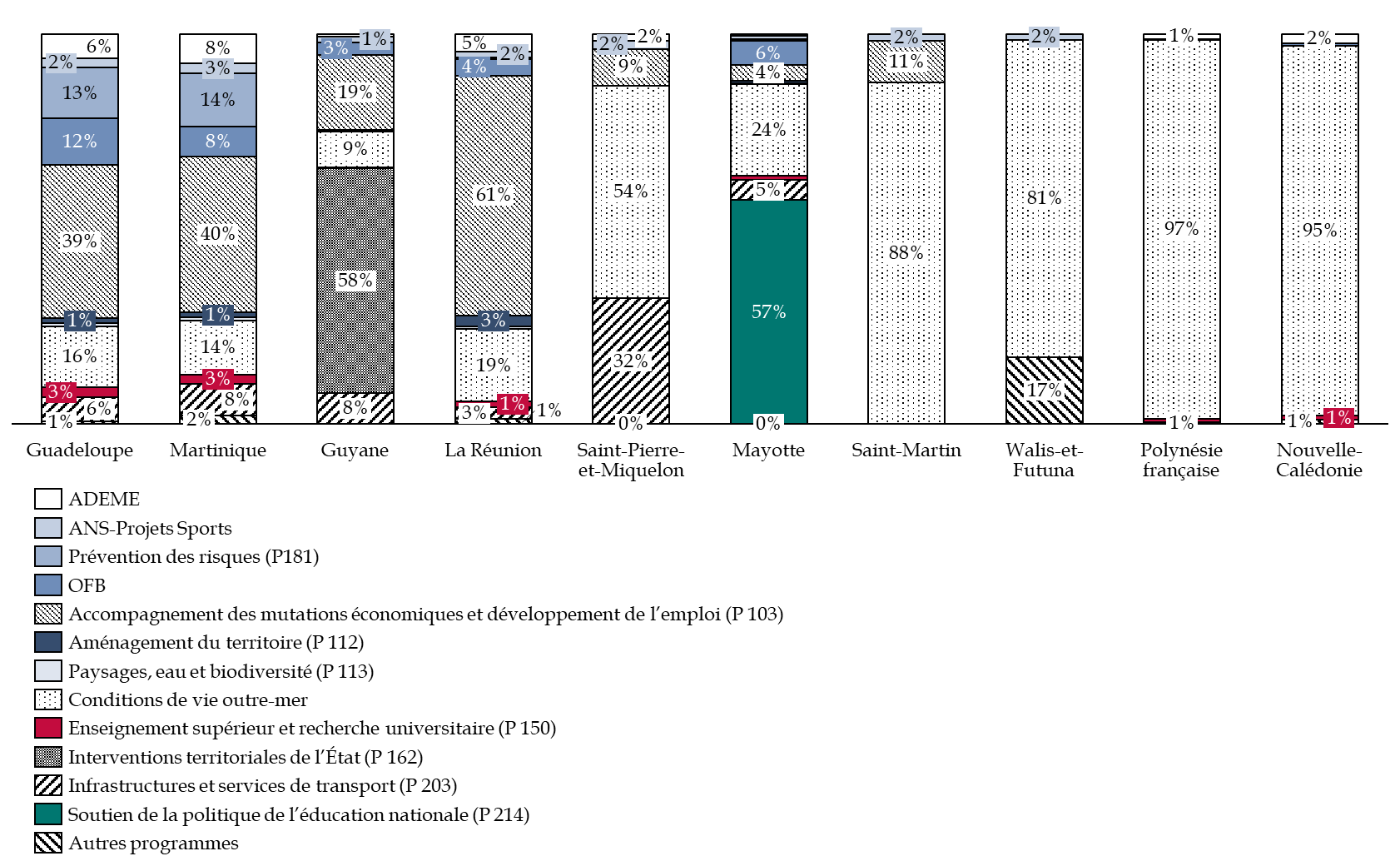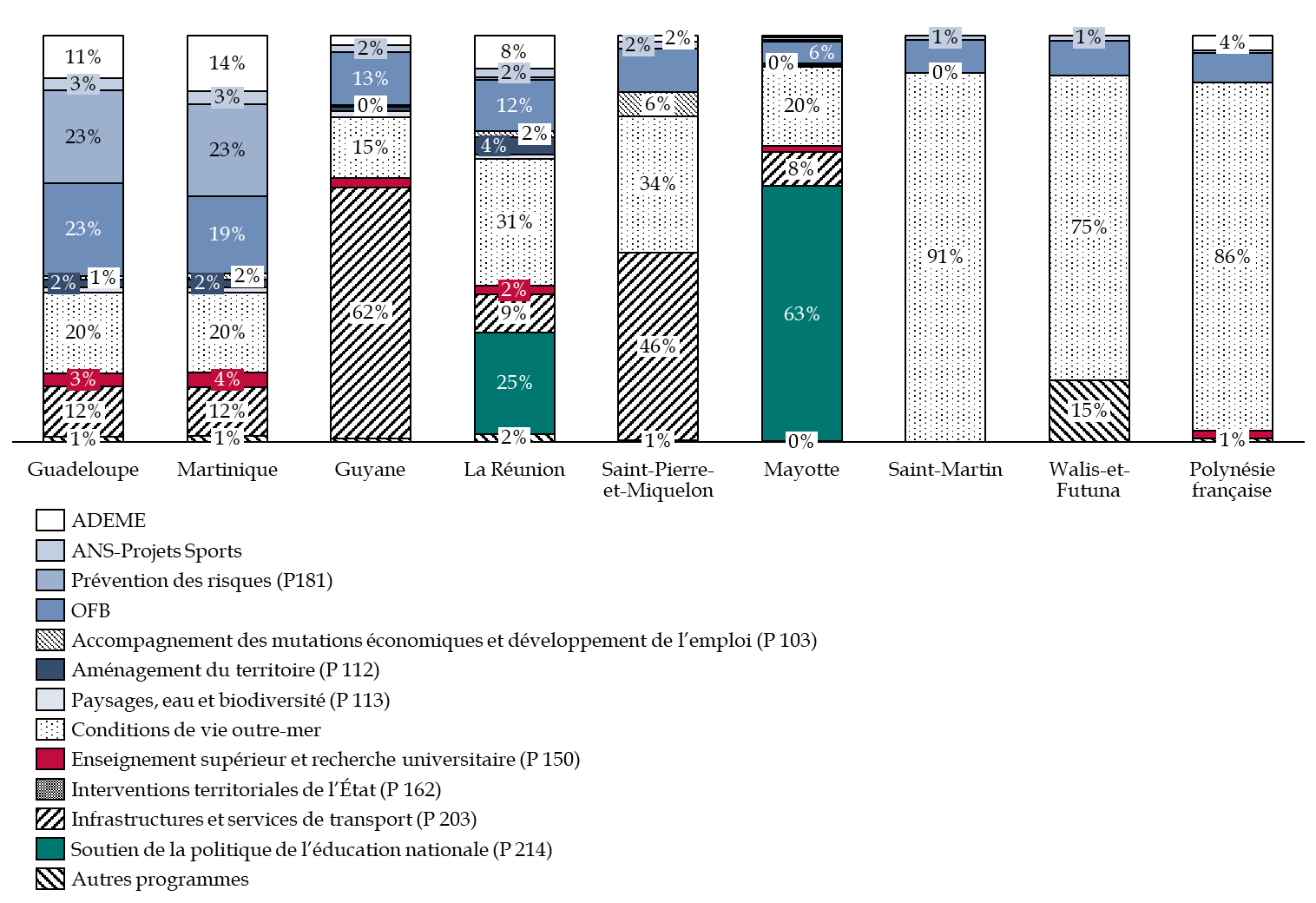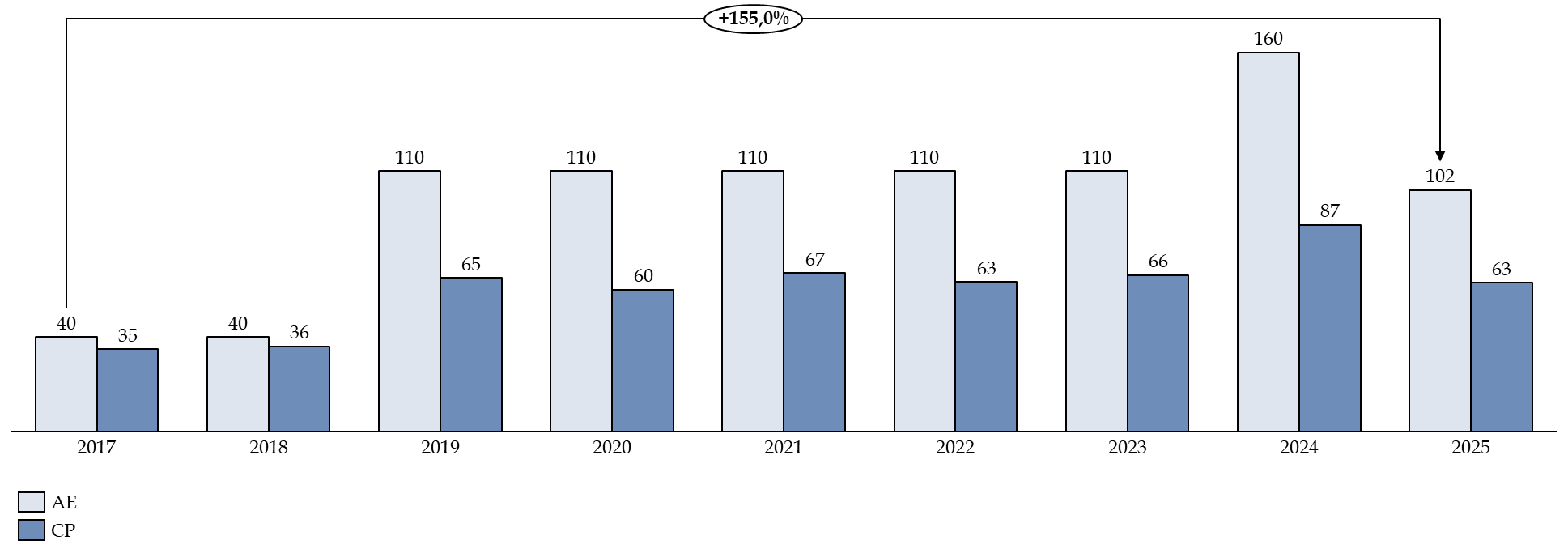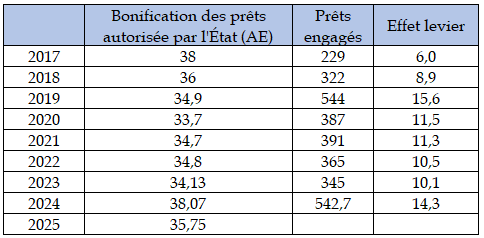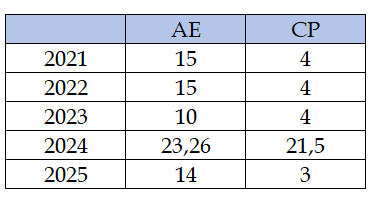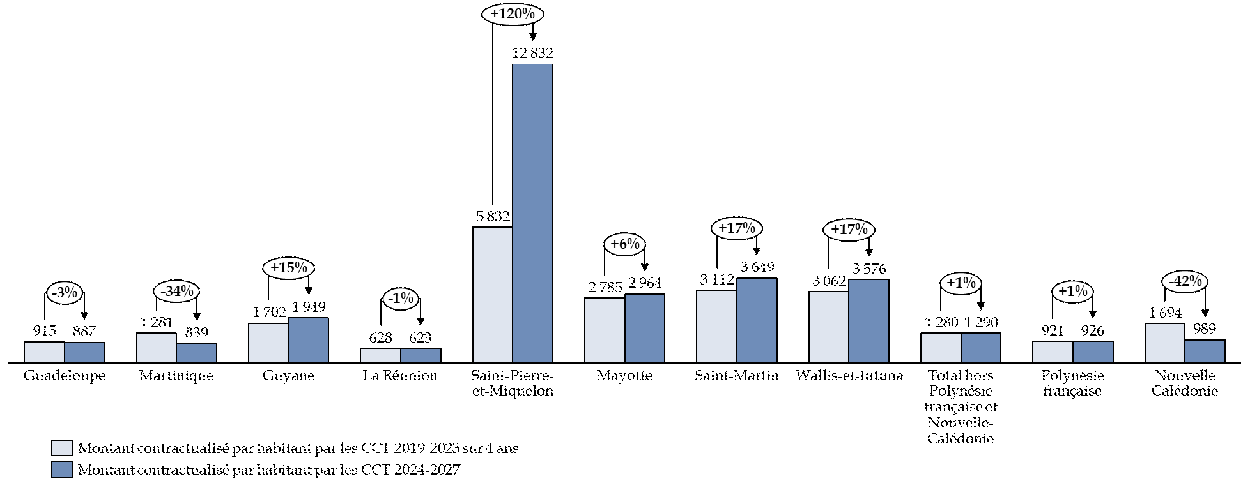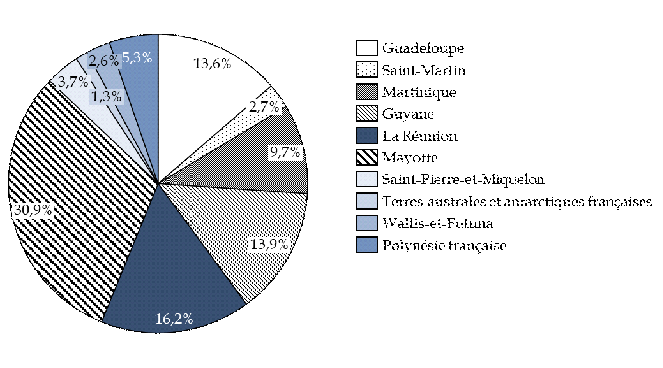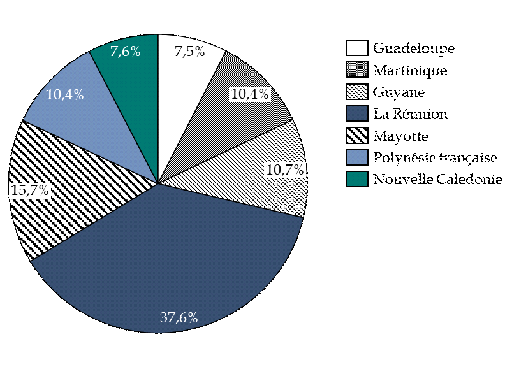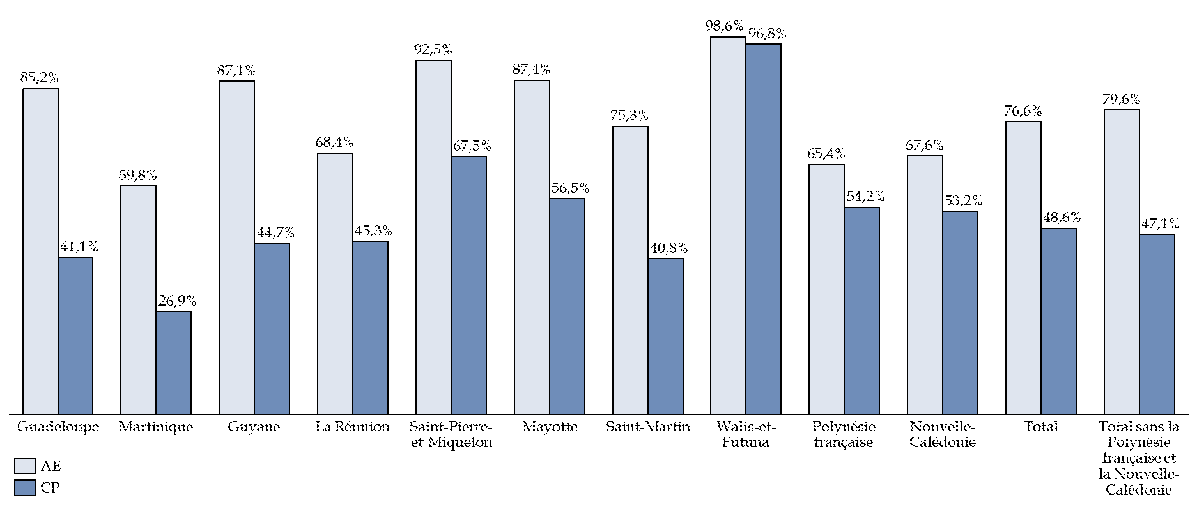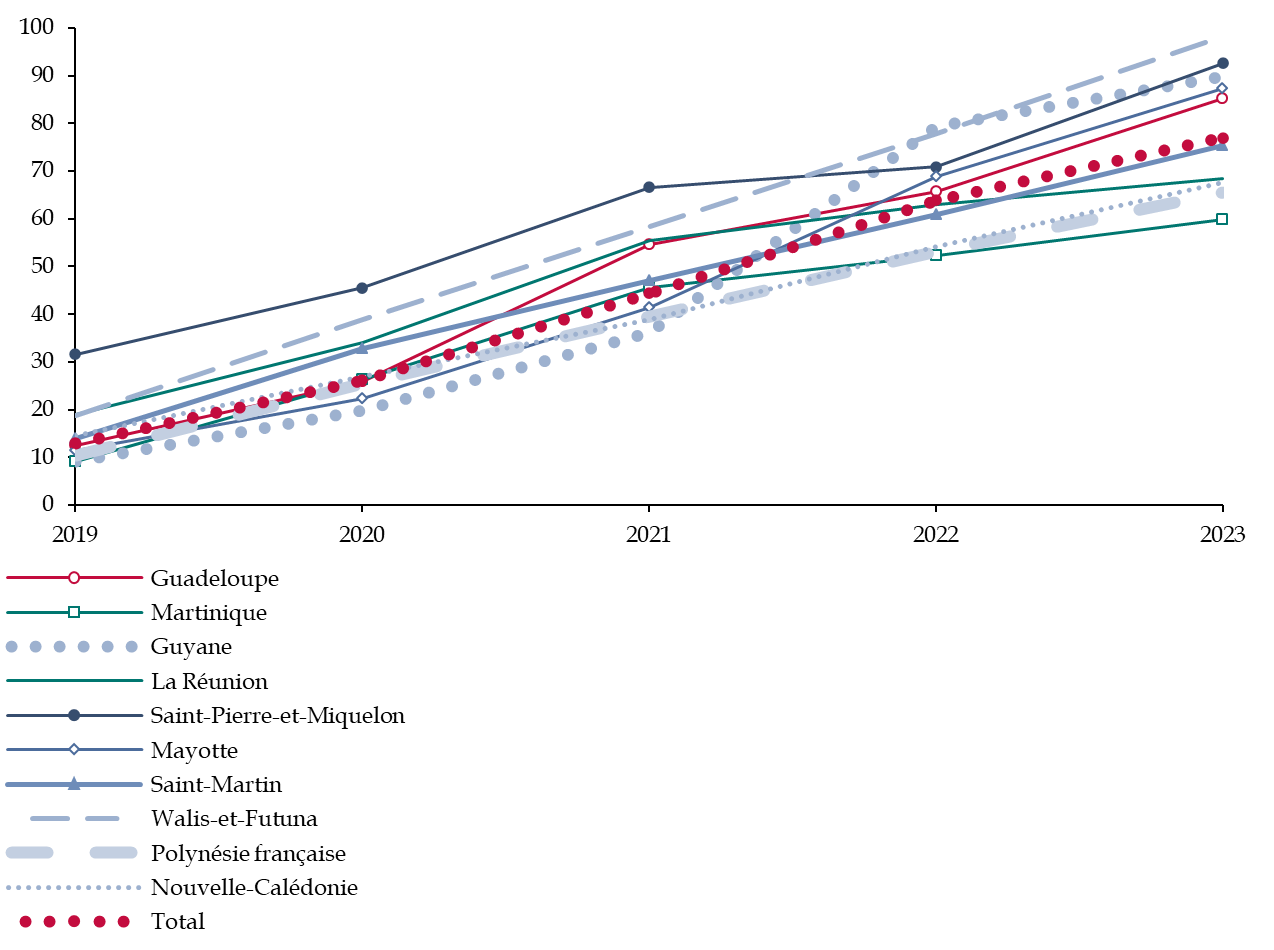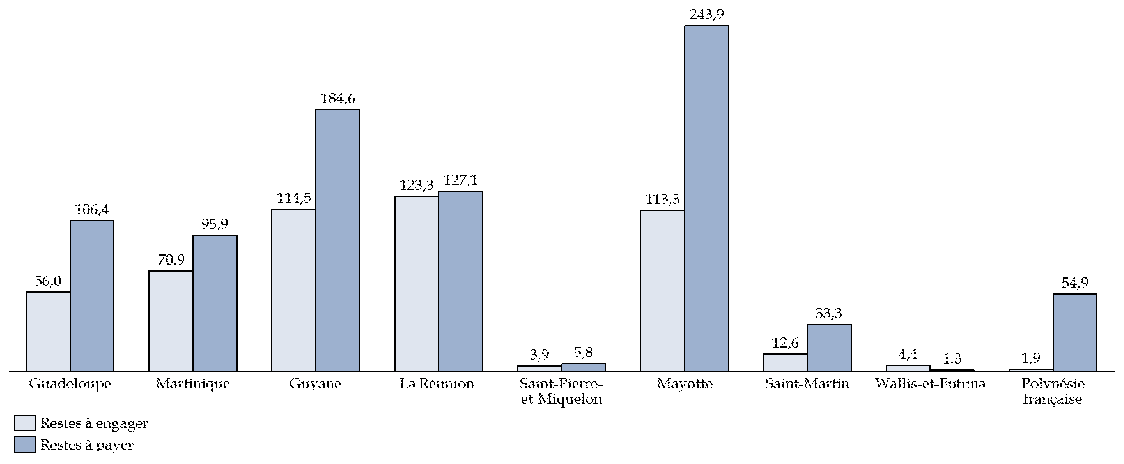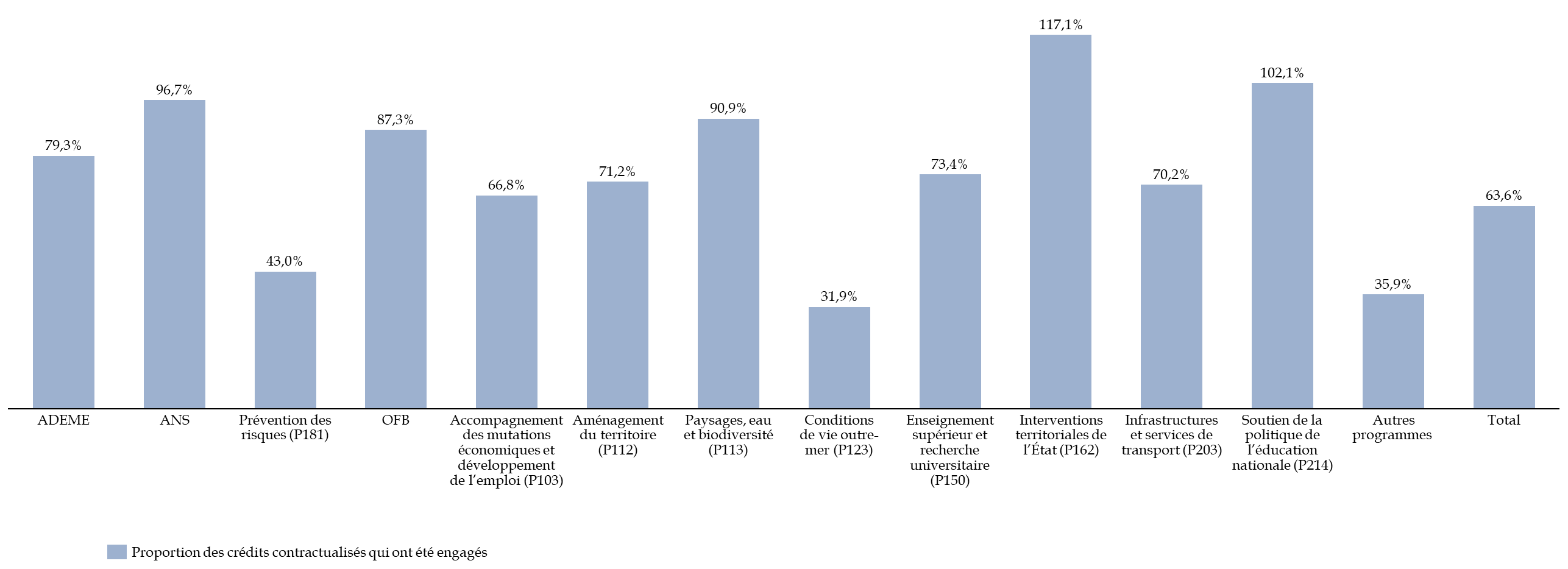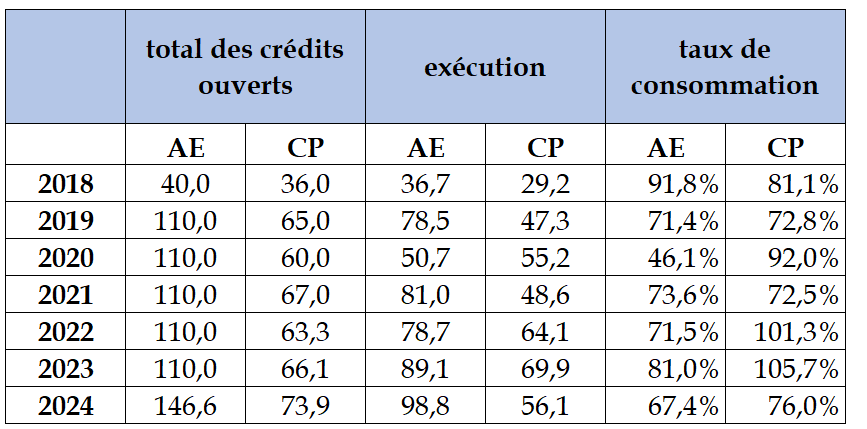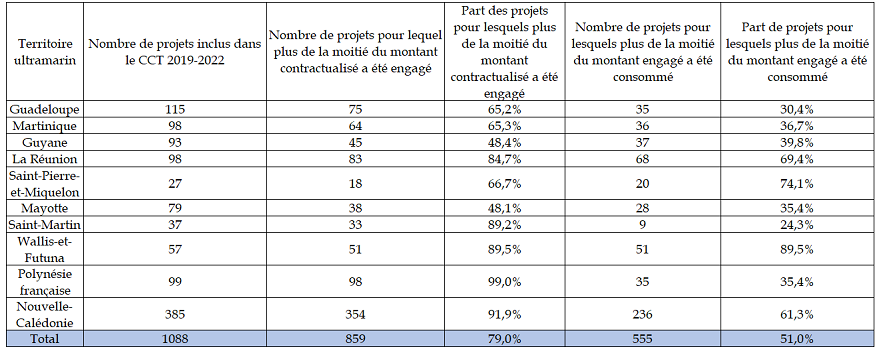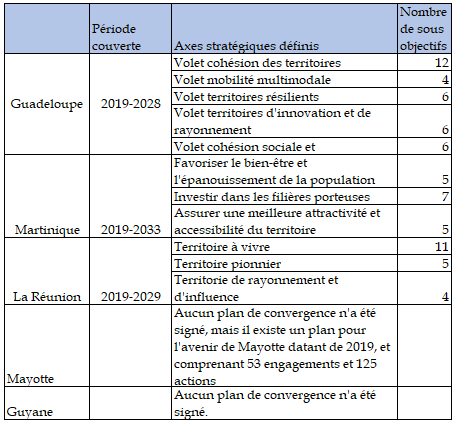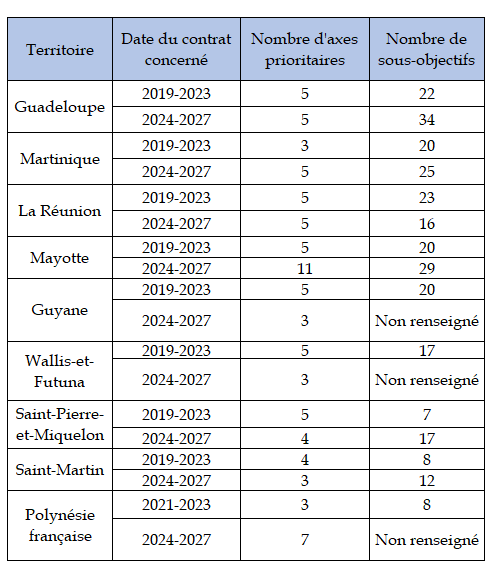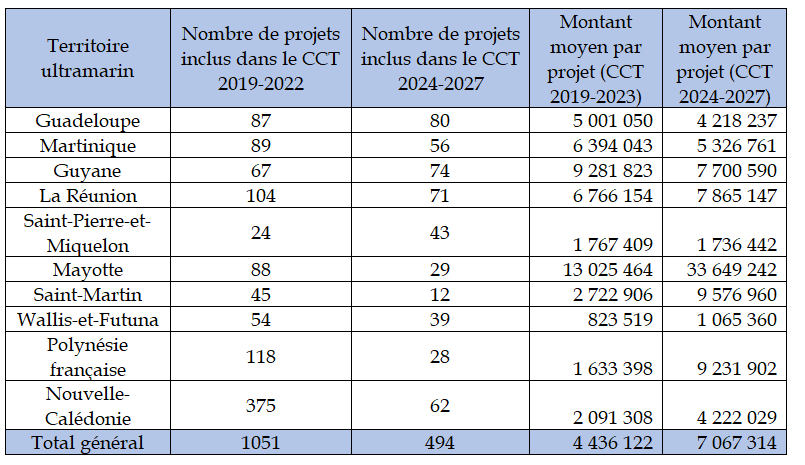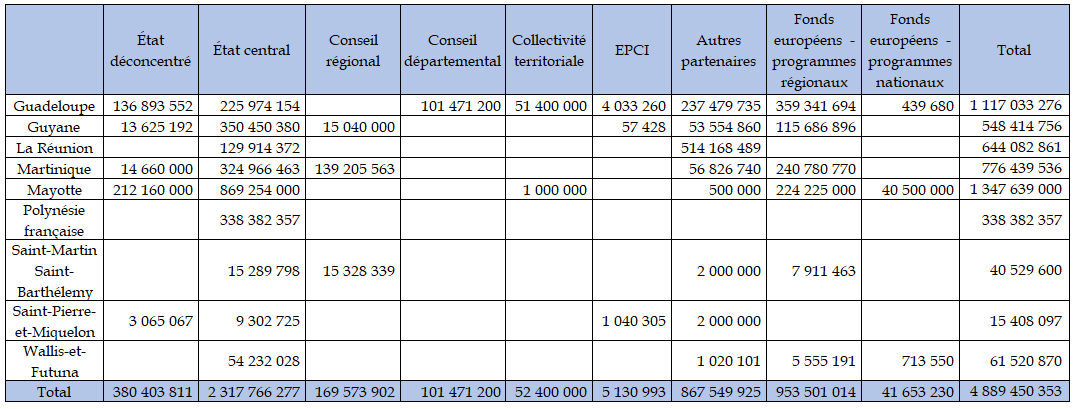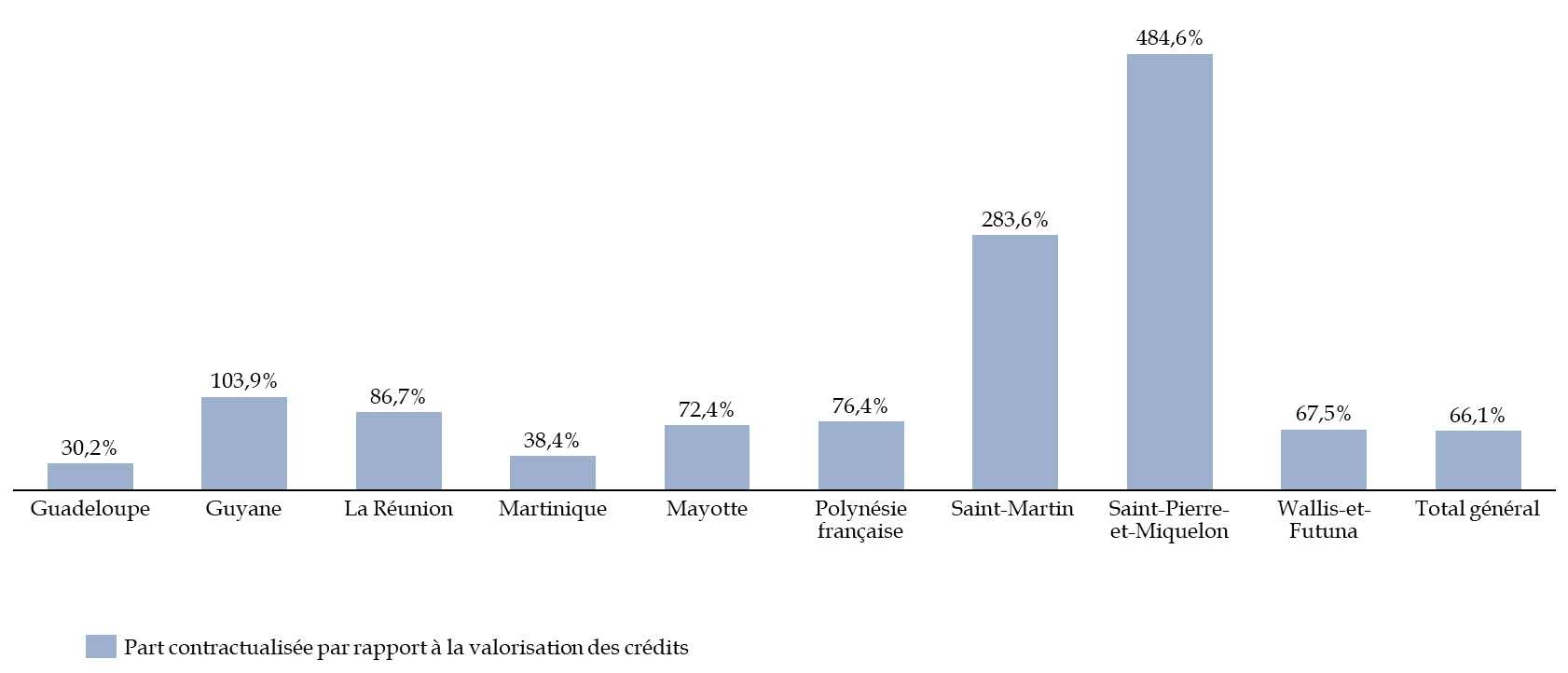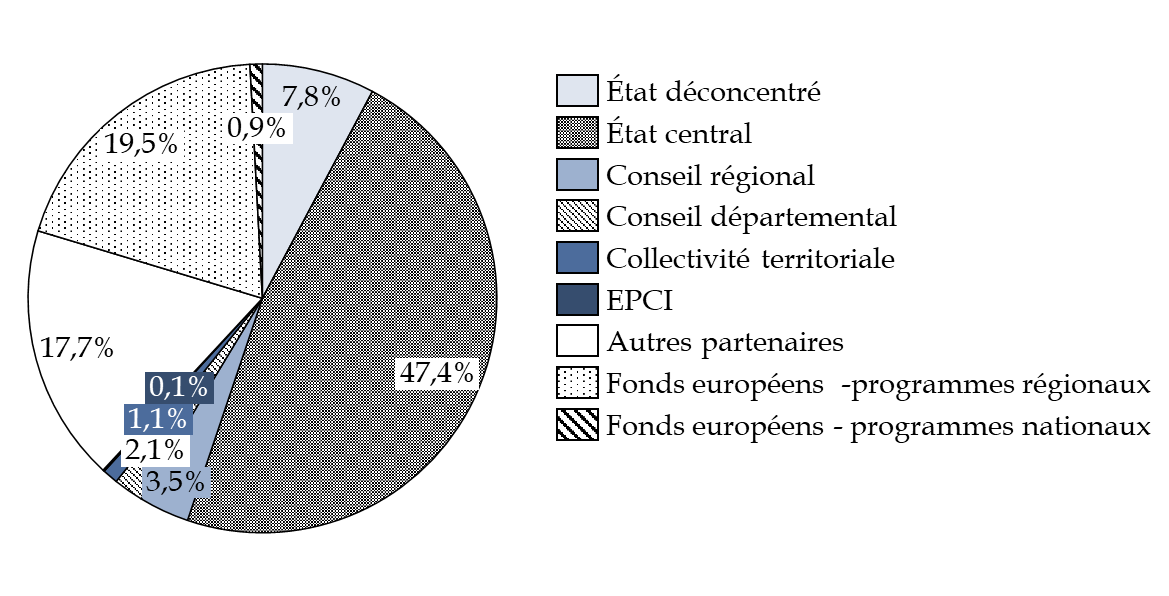- L'ESSENTIEL
- AVANT PROPOS
- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS
SPÉCIAUX
- I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
ULTRAMARINES EN PROGRESSION
- A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE
L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
ULTRAMARINES
- B. LES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE
TRANSFORMATION, UN OUTIL PERTINENT DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES
COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES
- C. DES DISPOSITIFS VARIÉS DE SOUTIEN
À L'INVESTISSEMENT LOCAL ULTRAMARIN
- A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE
L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
ULTRAMARINES
- II. DES INVESTISSEMENTS ENCORE INSUFFISANTS PAR
RAPPORT AUX ENJEUX ULTRAMARINS
- A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT
SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS
- 1. De nombreux projets entamés grâce
aux contrats de convergence et de transformation...
- 2. ... mais aussi des investissements
nécessaires qui restent non financés, en particulier en termes de
préservation de l'environnement
- 3. Une répartition géographique des
soutiens à l'investissement qui interroge
- 1. De nombreux projets entamés grâce
aux contrats de convergence et de transformation...
- B. DES DIFFICULTÉS À TENIR LES
ENGAGEMENTS D'INVESTISSEMENT
- C. UNE STRATÉGIE DE DÉFINITION DES
INVESTISSEMENTS À REVOIR
- A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT
SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS
- III. AMÉLIORER LA MOBILISATION DES
DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
ULTRAMARINES
- I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS
ULTRAMARINES EN PROGRESSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
N° 5
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le
soutien de l'État
à l'investissement des
collectivités
ultramarines,
Par MM. Stéphane FOUASSIN et Georges PATIENT,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
Les territoires ultramarins sont soumis à des besoins forts d'investissements, auxquels les collectivités ne peuvent répondre seules, sans un soutien spécifique de l'État, au vu des contraintes économiques et géographiques qui pèsent sur elles. Stéphane Fouassin et Georges Patient, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « outre-mer », ont présenté à la commission des finances le 1er octobre 2025 les conclusions de leur travail de contrôle sur cette problématique.
I. UN SOUTIEN RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN
A. DES BESOINS FORTS EN INVESTISSEMENTS
Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, ce qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins.
Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024
(en euros par habitant)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
Or les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement, notamment le coût élevé de la vie en outre-mer, ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins.
Le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.
B. UNE CONTRIBUTION ANNUELLE DE L'ÉTAT DE PLUS DE 860 MILLIONS D'EUROS À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN
L'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. Les dotations d'investissement (DSIL, DETR etc.) dont bénéficient l'ensemble des collectivités hexagonales également ne représentent toutefois que 8 % des financements pour l'investissement ultramarin. Les financements propres à l'investissement local ultramarin représentent près de 62 % des dépenses.
Ensemble des financements de l'État
destinés spécifiquement à l'investissement
des
collectivités locales ultramarines en 2023
(en euros, en AE)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
- En particulier, à hauteur de 11 % des dépenses, le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) apporte une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent des investissements sur des équipements publics collectifs. Le montant du FEI a été multiplié par 1,5 entre 2017 et 2025.
- Un système de bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) permet d'offrir des crédits à taux d'intérêts réduits pour financer les projets des collectivités ultramarines qui répondent à des critères d'impact social et environnemental.
- Enfin, les contrats de convergence de transformation (CCT) représentent 45 % du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales. Une première génération de contrats a été signée en 2019 et porte sur la période 2019-2023. Une deuxième génération de contrats a été signée pour la période 2024-2027.
|
Les financements des CCT de première génération (2019-2023) proviennent à |
et à |
|
de l'État |
des collectivités. |
Les financements apportés par l'État proviennent d'au moins 18 programmes budgétaires, dont le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (40 % des financements), le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi » et le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », en plus d'agences de l'État telles que l'office français de la biodiversité (OFB), l'agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'agence nationale du sport (ANS).
II. UN SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT LOCAL QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE MIEUX MOBILISÉ
A. UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FINANCEMENTS DÉSÉQUILIBRÉE
La répartition des fonds contractualisés dans le cadre des CCT dans chaque collectivité ultramarine est relativement déséquilibrée. Par exemple, les montants investis par habitant en Guyane, de 1 702 euros en moyenne entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027, sont étonnamment bas, au vu des enjeux importants en termes d'investissement de ce territoire soumis à des contraintes géographiques très fortes.
Montant total contractualisé par habitant
et par territoire
dans le cadre des CCT de première et de
deuxième génération
(en euros par habitant)
Note : pour la Polynésie française, c'est le contrat de développement pour 2021-2023 qui est pris en compte pour la première période, pour la Nouvelle-Calédonie, le contrat de développement de 2017-2023.
Source : commission des finances d'après les données de la DGOM
B. DES CRÉDITS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT ENCORE INSUFFISAMMENT CONSOMMÉS
Au total, le taux d'engagement des crédits des contrats de convergence et de transformation s'élève fin 2023 à 76,6 % sur l'ensemble des crédits contractualisés sur la période 2019 à 2023 (avenant compris), soit un niveau honorable. Le taux de consommation des crédits n'est en revanche que de 48,6 %, ce qui peut s'expliquer notamment par l'ampleur des travaux d'infrastructures engagés. Il s'agit souvent de constructions lourdes, de ponts ou de routes par exemple, dont la réalisation nécessite de nombreuses années.
Part consommée des crédits
contractualisés
dans le cadre des CCT de première
génération (2019-2023)
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de la DGOM
Au 31 décembre 2023, sur les 801 projets inscrits dans les CCT de 2019 à 2023, 63 ont été achevés, et 27 sont en phase de finalisation.
Nombre de projets inclus et réalisés
dans le cadre du CCT
de première génération par
territoire ultramarin
Source : commission des finances d'après les données de la DGOM
Des obstacles conjoncturels expliquent de plus les difficultés de consommation des crédits des contrats de convergence et de transformation, telles que la signature tardive des contrats, la période de crise sanitaire, l'engagement et le paiement des crédits du plan de relance en priorité par rapport aux crédits du CCT, ce qui a généré un effet d'éviction ou encore les mouvements sociaux de fin d'année 2021 aux Antilles et dans le Pacifique.
Toutefois, d'importantes difficultés structurelles ont également été relevées par les acteurs :
- la gestion d'un grand nombre d'opérations ;
- la pluralité des sources de financements, au sein de l'État même ;
- le manque de maturité de certains projets contractualisés au début de la période, rendant impossible l'engagement et le paiement des crédits pourtant disponibles ;
- le défaut de structuration et d'organisation de l'ingénierie publique pour la réalisation des opérations, en particulier dans les collectivités territoriales.
III. IMPLIQUER DAVANTAGE LES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES DÉCISIONS DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DE L'ÉTAT
A. DES INVESTISSEMENTS À DÉFINIR AVEC LES COLLECTIVITÉS
Si un plan de convergence a été défini en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, aucun n'a été signé à Mayotte et en Guyane, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. L'absence d'un tel plan de convergence et de transformation, faisant l'objet d'un compromis des collectivités locales présentes, est regrettable.
Chaque CCT définit des priorités répondant aux enjeux identifiés dans les plans de convergence et aux politiques prioritaires de chaque ministère financeur. Ces priorités sont validées en réunion interministérielle dans le cadre des mandats de négociation, donnés aux préfets et hauts-commissariats par le premier ministre en vue de négocier les CCT.
Une très faible marge de manoeuvre est laissée aux collectivités locales dans la négociation des priorités et des projets financés.
Les élus sont pourtant les mieux à même de définir les projets prioritaires dans leurs territoires. Il est de plus très difficile de faire aboutir un projet en l'absence de portage politique local.
Par ailleurs, le trop grand nombre de programmes financeurs limite la fongibilité des financements entre les différents projets et en complexifie la gestion. Ainsi, il serait pertinent de créer un programme budgétaire au sein de la mission « Outre-mer » qui centraliserait une partie des financements dédiés aux CCT pour l'ensemble des territoires.
B. UN PILOTAGE DES PROJETS À REVOIR POUR RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS
Des comités de pilotage ou de programmation entre le préfet et les collectivités selon les territoires sont organisés régulièrement et a minima une à deux fois par an. Des comités techniques sont organisés 3 à 4 fois par an. Pour autant, la réunion de ces instances parait encore insuffisante à nombre d'acteurs locaux. La concertation entre les acteurs doit être plus régulière, à tous les niveaux :
Comme le relèvent nombre d'acteurs, le dispositif de contractualisation est très lourd en termes de gestion administrative au niveau local.
C. UNE AMÉLIORATION DE L'INGÉNIERIE LOCALE NÉCESSAIRE POUR AUGMENTER L'INVESTISSEMENT LOCAL
Des dispositifs de soutien à l'ingénierie locale avaient été introduits dans le contexte du plan de relance. Ainsi, le « Fonds outre-mer » (FOM) permet de financer à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets planifiés par les collectivités locales, pour faciliter l'amorçage des projets d'investissement et renforcer les capacités des acteurs publics locaux, une assistance technique auprès des collectivités locales et un appui aux projets de coopération régionale. Il est opéré par l'AFD. En LFI 2025, le FOM serait financé à hauteur de 14 millions d'euros en AE et de 3 millions d'euros en CP.
D'autres dispositifs de soutien à l'ingénierie locale existent. Le CEREMA, l'AFD, la Banque des Territoires ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) fournissent un service d'ingénierie locale, allant parfois jusqu'à la mise à disposition de personnels avec des compétences techniques.
Devant la multiplicité des dispositifs existants, il est difficile pour les collectivités les plus en difficulté sur ce plan de faire appel à l'acteur le plus adapté par elle-même. En ce sens, la mise en place d'un guichet unique d'ingénierie, ou d'une « cellule ingénierie », comme c'est le cas par exemple au sein de la préfecture de Guadeloupe, peut s'avérer très utile. L'objectif est de centraliser à la préfecture toutes les demandes d'aide en ingénierie locale et de les transmettre aux acteurs compétents pour le compte des collectivités.
AVANT PROPOS
Les territoires ultramarins présentent des fragilités importantes en termes socio-économiques. Ils sont caractérisés, par exemple, par des taux de pauvreté de 77,3 % à Mayotte ou de 53 % en Guyane, d'après l'INSEE.
Ils sont soumis par ailleurs à des contraintes naturelles et géographiques fortes, en raison de leur insularité pour certains territoires, ainsi que de leur forte exposition à des risques naturels, tels que les séismes, les inondations ou encore les tempêtes. Le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte en décembre 2024, ou encore de la tempête Garance à la Réunion en janvier 2025, a illustré la nécessité de la construction d'infrastructures résistantes à ces aléas. Les besoins en investissements sont ainsi particulièrement forts en outre-mer.
En ce sens, l'État a développé une politique de soutien à l'investissement local spécifique à ces territoires, en plus des instruments utilisés dans l'hexagone, telles que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Il s'agit notamment des contrats de convergence et de transformation (CCT), du fonds exceptionnel d'investissement (FEI) ou encore de la bonification des prêts octroyés par l'Agence française de développement aux collectivités.
Une grande partie de ces dispositifs de soutien à l'investissement spécifiques à l'outre-mer transitent par la mission « Outre-mer ». C'est à l'étude de ces dispositifs que ce rapport de contrôle s'attache, et non à l'ensemble des outils permettant à l'État d'appuyer les outre-mer dans leur effort d'investissement.
Ce rapport n'étudie pas non plus les instruments de soutien à l'investissement des acteurs privés ultramarins, qui présentent des spécificités en regard des outils utilisés dépassant le champ du contrôle.
LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Recommandation n° 1 : définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation (direction générale des outre-mer (DGOM), collectivités, préfectures, hauts-commissariats)
Recommandation n° 2 : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts-commissariats, collectivités)
Recommandation n° 3 : limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants (collectivités locales, préfectures, DGOM)
Recommandation n° 4 : créer un programme budgétaire, au sein de la mission « Outre-mer », regroupant une partie des actions régionales et interrégionales comprises dans les contrats de convergence et de transformation, de nature interministérielle et territorialisée (DGOM, direction du budget)
Recommandation n° 5 : développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation (DGOM, préfectures, collectivités)
Recommandation n° 6 : organiser plus régulièrement un comité interministériel des outre-mer afin de favoriser la mise en oeuvre d'investissements impliquant plusieurs ministères (DGOM)
Recommandation n° 7 : définir un chef de file clair sur chacun des projets lorsqu'ils réunissent plusieurs financeurs, et ce dès l'intégration du projet dans un financement des CCT et organiser des réunions de suivi plus récurrentes (préfectures, ministères, collectivités)
Recommandation n° 8 : concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence (DGOM, préfectures, hauts-commissariats)
Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés (DGOM)
Recommandation n° 10 : renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation (Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM)
Recommandation n° 11 : créer un guichet unique de l'ingénierie publique pour centraliser les demandes des collectivités locales aux différents partenaires et intégrer des aspects de soutien à l'ingénierie locale dans les contrats de convergence et de transformation, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs (DGOM, préfecture, collectivités)
I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES EN PROGRESSION
A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES
1. Un investissement en hausse des collectivités ultramarines
Les collectivités territoriales, et ultramarines en particulier, constituent le premier investisseur public. Comme le rappelle en effet l'inspection générale des finances1(*), les administrations publiques locales représentent 58 % de l'investissement public en 2022.
Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Elles ont augmenté de 65 % par rapport à 2017, où elles représentaient 921,5 euros par habitant.
Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, soit un niveau inférieur à l'effort d'investissement en outre-mer, qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins. La hausse des dépenses d'investissements par habitant des collectivités hexagonales n'a été que de 45 % entre 2017 et 2024.
Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024
(en euros par habitant)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
L'effort d'investissement des communes et des intercommunalités dans les DROM, de 621,6 euros par habitant, est proche de celui des communes hexagonales, qui s'élève à 736 euros par habitant. Cet effort s'est accru, puisqu'il a augmenté de 92 % entre 2027 et 2024. En effet, en 2017, les communes d'outre-mer ne dépensaient que 323,4 euros par habitant, contre 521,5 euros pour les communes hexagonales. Un effort significatif de rattrapage des niveaux d'investissement hexagonaux a été réalisé par le bloc communal dans les DROM entre 2017 et 2024.
En particulier, les communes de La Réunion consacrent un budget par habitant élevé aux dépenses d'investissement, alors qu'il est nettement plus faible en Guadeloupe et en Guyane.
Évolution des dépenses
d'investissement par habitant dans le bloc communal
des départements
et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et
2024
(en euros par habitant)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
Concernant les départements, les niveaux d'investissement en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion demeurent significativement inférieurs à ceux de l'hexagone, puisqu'ils représentent en moyenne 75 euros par habitant, contre 221 euros dans l'hexagone. Toutefois, les dépenses d'investissement ont augmenté de 88 % entre 2017 et 2024, contre seulement 53 % pour l'hexagone, témoignant d'un effort de rattrapage réalisé par les départements ultramarins. Par ailleurs, au vu des difficultés structurelles notamment du bloc communal, comme développé supra, les départements consacrent une part significative à des subventions permettant de financer l'investissement du bloc communal.
Évolution des dépenses
d'investissement par habitant
dans les départements d'outre-mer et
dans l'hexagone, entre 2017 et 2024
(en euros par habitant)
Note : les comptes de la collectivité unique de Guyane et de Martinique sont intégrés aux comptes des régions.
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
À noter, le niveau élevé et en hausse de dépenses d'investissement par habitant du département de Mayotte, qui a été multiplié par 3,5 entre 2017 et 2024.
Évolution des dépenses
d'investissement par habitant
dans les régions d'outre-mer et dans
l'hexagone, entre 2017 et 2024
(en euros par habitant)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
Enfin, les régions d'outre-mer consacrent un budget à l'investissement par habitant de 822,5 euros en 2024, en hausse de 47 % par rapport à 2017. Cet effort est presque 4 fois plus élevé que le budget consacré par habitant par les régions hexagonales, illustrant l'importance de l'investissement pour les collectivités ultramarines. À noter, toutefois, que la structure des dépenses des collectivités uniques de Guyane et de la Martinique peuvent biaiser l'analyse.
Les dépenses d'investissement, élevées et en progression dans les collectivités ultramarines, ne peuvent être financées uniquement par les recettes d'investissements propres aux collectivités territoriales, au vu de l'importance des contraintes.
2. Des besoins en investissements non couverts par les seules recettes d'investissement
Malgré une forte subvention de l'investissement, les collectivités ultramarines ne disposent en effet pas des mêmes capacités d'autofinancement que les territoires hexagonaux.
Comme le relève la Cour des comptes2(*), les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement. En effet, le coût élevé de la vie en outre-mer3(*), ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins, contraignent fortement les dépenses de fonctionnement. Le niveau d'épargne brute, source majeure de financement de l'investissement, reste donc inférieur dans les collectivités ultramarines, par rapport à l'hexagone.
Les faibles taux d'épargne brute4(*) du bloc communal en particulier obèrent les capacités de financement de l'investissement. Ainsi, le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.
La capacité de financement de l'investissement du bloc communal ultramarin s'est toutefois améliorée de 70 % en 7 ans, le taux d'épargne brut s'élevant à seulement 6,7 % en 2017. Les communes réunionnaises, dont le taux d'épargne brute s'élève à 13,2 %, semblent les mieux à même de financer leur investissement parmi les collectivités ultramarines. Toutefois, même si les capacités d'autofinancement de l'investissement des communes guadeloupéennes et martiniquaises sont plus faibles que dans l'hexagone, il faut noter la nette amélioration de leur situation financière. En Guadeloupe en particulier, le taux d'épargne brute du bloc communal est passé de 1,1 % en 2017 à 10,7 % en 2024.
Évolution du taux d'épargne brute du
bloc communal d'outre-mer
et de l'hexagone entre 2017 et
2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
En conséquence, une part de l'investissement du bloc communal est financée par les collectivités régionales et départementales.
Évolution du taux d'épargne brute dans les régions d'outre-mer et de l'hexagone entre 2017 et 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales
Les régions et les collectivités uniques de DROM disposent de capacités d'autofinancement de l'investissement plus importantes que le bloc communal en moyenne, le taux d'épargne brute s'élevant à 13,3 % en 2024. Il est toutefois plus faible que le taux d'épargne brute des régions hexagonales, qui atteint 19,2 %.
Les faibles taux d'épargne brute des collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane expliquent largement cet écart ; toutefois, ces collectivités assumant les compétences du département, leur taux d'épargne brute n'est pas étonnant. En moyenne, dans l'hexagone, le taux d'épargne brute des départements n'est que de 6,8 %, alors que celui de la Réunion est de 7,9 % et celui de la Guadeloupe de 10 %, par exemple.
Ainsi, le bloc communal concentre la plus grande part des difficultés de financement de l'investissement en outre-mer. Les départements, régions ou collectivités uniques peuvent constituer des soutiens à l'investissement ; mais un appui propre de l'État aux outre-mer est nécessaire pour permettre de réaliser la convergence économique.
3. Un soutien spécifique complémentaire de l'État à l'investissement des collectivités ultramarines de 861 millions d'euros par an
Afin de soutenir l'investissement des collectivités ultramarines, l'État dispose d'une palette d'outils de financements. Les recettes de fonctionnement, versées notamment sous la forme de la dotation globale de fonctionnement, permettent d'ailleurs d'alimenter la section de fonctionnement et donc de dégager une épargne brute destinée à financer en partie l'investissement.
L'État verse de plus certains financements qui servent à soutenir spécifiquement les investissements des collectivités locales ultramarines. Ce soutien prend la forme de plusieurs dotations :
- comme le reste des collectivités locales, les communes ultramarines perçoivent la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), à hauteur de 30,7 millions d'euros en 2023, ainsi que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), pour un montant de 18,1 millions d'euros en 2023, et la quote-part de la dotation de politique de la ville, à hauteur de 6,3 millions d'euros. Les départements ultramarins perçoivent la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), pour un montant de 13,2 millions d'euros ;
- les collectivités ultramarines sont également destinataires de prélèvements sur recettes (PSR), notamment le PSR 3112 « Dotation départementale d'équipement des collèges » pour un montant de 35,9 millions d'euros, le PSR 3113 « Dotation régionale d'équipement scolaire », à hauteur de 111,7 millions d'euros, et le PSR 3118 « Dotation globale de construction et d'équipement scolaire » destiné exclusivement à Saint-Martin, à hauteur de 2,7 millions d'euros ;
- le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », porté par le programme 380 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », subventionne les projets locaux favorisant la décarbonation, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Près de 100,5 millions d'euros ont été consacrés aux outre-mer à ce titre en 2023 ;
- enfin, des outils spécifiques de soutien à l'investissement transitent essentiellement par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ». Il s'agit du fonds exceptionnel d'investissement (FEI), dont 94 millions d'euros en AE ont été consommés en 2023 ; des contrats de convergence et de transformation (CCT), au titre desquels 391,8 millions d'euros ont été engagés en 2023 ; et enfin de la bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) aux collectivités, pour un montant de 56,8 millions d'euros. Le présent contrôle a pour objectif d'évaluer en particulier la pertinence de ces outils, très spécifiques aux outre-mer.
Financements de l'État destinés à l'investissement des collectivités locales ultramarines
(en euros, en AE)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Ainsi, au total, l'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. La DETR, la DSIL, la quote-part de la DPV et la DSID ne représentent toutefois que 8 % de ces financements pour l'investissement local. Ce sont donc les financements propres à l'investissement local ultramarin qui priment pour les collectivités, à hauteur de près de 62 %. Ainsi, les CCT correspondent à près de 45 % du soutien de l'État à l'investissement local, le FEI 11 % et la bonification des prêts accordés par l'AFD près de 6 % du soutien.
Les principaux bénéficiaires du soutien de l'État à l'investissement sont, en 2023, Mayotte, à hauteur de 191,8 millions d'euros, La Réunion, pour un montant de 132,3 millions d'euros, et la Guadeloupe, à hauteur de 123,3 millions d'euros. Cette répartition n'est pas si étonnante, au sens où il s'agit soit de collectivités très peuplées (La Réunion) soit avec des difficultés structurelles fortes (Mayotte).
Répartition de l'ensemble des financements
de l'État destinés spécifiquement
à
l'investissement des collectivités locales ultramarines
(en euros, en AE)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Le rapport de l'IGF précité a évalué le soutien de l'État à l'investissement de l'ensemble de l'ensemble des collectivités locales à 3,37 milliards d'euros, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTA). Ainsi, en moyenne, le concours de l'État à l'investissement local est de 51 euros par habitant, alors qu'il s'élève à près de 374 euros par habitant en outre-mer. Si ces estimations sont à considérer avec précaution, elles illustrent tout de même l'effort particulier fourni par l'État en faveur de l'investissement des collectivités ultramarines.
B. LES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION, UN OUTIL PERTINENT DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES
1. La contractualisation permet une coopération efficiente entre l'État et les collectivités
Les contrats de convergence de transformation (CCT), régis par la loi5(*) du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, constituent l'un des principaux outils du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales.
Ils comprennent en effet normalement un plan de convergence, qui résume les priorités structurantes. Les priorités de chaque contrat correspondent aux enjeux définis dans le cadre des plans de convergence et des politiques prioritaires de chaque ministère co-financeur. Le détail de ces priorités a été validé par l'État dans le cadre des mandats de négociation fournis aux préfectures, qui sont chargées de piloter l'écriture des contrats avec les collectivités territoriales concernées.
Les CCT permettent de rassembler de multiples financeurs : ministères, collectivités territoriales, agences de l'État comme l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence française de développement (AFD) et l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME). Une maquette financière, résumant les financements prévus par chaque financeur, y compris les collectivités, est adjointe au CCT.
Enfin, des fiches « projets » résument les différents projets que les CCT permettront de financer dans chaque territoire, ainsi que le plan de financement envisagé. Près de 80 % des investissements sont décidés dès la signature du CCT, le reste faisant l'objet d'appels à projets au cours de la période.
Les CCT ont été conclus avec l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'avec la plupart des intercommunalités. Le dispositif de contractualisation n'a toutefois pas inclus les communes, considérées comme un échelon moins pertinent de contractualisation que les intercommunalités. À noter, que l'ingénierie locale nécessaire à la mobilisation des financements des CCT aurait rendu difficile l'intégration des communes à ce processus de contractualisation.
Une première génération de contrats a été signée le 8 juillet 2019 pour les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, ainsi que le 22 juin 2020 pour Saint-Martin. La première génération de contrats devait porter sur la période 2019-2022, et a été étendue à 2023 par un avenant. Une deuxième génération de CCT, portant sur la période 2024-2027, a été signée en 2024 par l'ensemble des collectivités ultramarines.
Les contrats de convergence et de transformation succèdent en outre-mer aux contrats de plan État-régions (CPER), instaurés par la loi6(*) du 29 juillet 1982, et dont la dernière génération en vigueur en outre-mer portait sur la période 2015-2020. À noter, les collectivités de Wallis-et-Futuna, pour la période 2012-2018, de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre 2015 et 2018, et de Saint-Martin, entre 2014 et 2018, avaient conclu un contrat de développement.
Par rapport aux CPER, les CCT prennent en compte les spécificités des outre-mer, permettant par exemple une forte concentration de moyens sur les enjeux d'assainissement et de production d'eau potable et le développement des enjeux scolaires et universitaires, moins prégnants dans l'hexagone. Ils couvrent un périmètre budgétaire plus large, en associant davantage de ministères (secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Agence nationale du sport) et donc de politiques publiques plus variées. Les CCT ont permis d'avoir une enveloppe financière plus conséquente que celle des CPER (voir infra).
En Polynésie française, en application de la loi7(*) organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de la loi8(*) du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, le contrat de développement et de transformation pour la période 2021-2023 a été signé en 2021. La Nouvelle-Calédonie est signataire d'un contrat de développement (CDEV) pour la période 2017-2023, qui repose sur les dispositions spécifiques de la loi9(*) organique du 19 mars 1999 et de la loi10(*) du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les contrats signés en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie diffèrent par rapport aux CCT de la première génération essentiellement par leur durée et leurs signataires. Pour ces deux territoires, des contrats spécifiques avec les collectivités locales autre que les pays ont été signés, par exemple avec les provinces et les intercommunalités de Nouvelle Calédonie. Concernant la durée, celle-ci a été adaptée afin que la fin du contrat soit concomitante avec la fin des CCT de première génération des autres territoires ultramarins. Dans le cadre des contrats de la deuxième génération, les durées sont identiques entre les contrats de développement et les CCT. En Nouvelle-Calédonie, seules les provinces et le Pays ont conclu un contrat de développement.
Autre spécificité propre à la Nouvelle-Calédonie, le CDEV de ce territoire dispose d'un volet fonctionnement, qui finance l'appui aux collectivités locales de Nouvelle Calédonie.
Enfin, le nombre de financeurs est réduit dans les CDEV du fait de la spécificité du partage de compétences entre les collectivités et l'État.
2. Des montants contractualisés élevés mais en baisse
Les contrats de plan État-Régions (CPER) ou les contrats de développement utilisés dans les collectivités d'outre-mer et en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie avant 2024, ainsi que les CCT, comprennent un volet de financement important. Ainsi, en Guadeloupe par exemple, près de 331,9 millions d'euros avaient été contractualisés entre 2015 et 2020 dans le cadre du CPER, puis ce sont 435 millions d'euros qui étaient prévus entre 2019 et 2023 et enfin 337,5 millions d'euros entre 2024 et 2027. Les montants contractualisés sont particulièrement élevés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion ou encore en Guyane.
Montants totaux contractualisés (comprenant
la part État et la part collectivité)
en outre-mer dans le
cadre des contrats de plan État-Régions
et des contrats de
convergence et de transformation
(en euros)
Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer
Les différentes générations de contrats ne portent toutefois pas sur la même durée, rendant la comparaison difficile. Ainsi, en faisant l'hypothèse que chaque contrat a duré cinq ans, soit la durée des contrats de convergence et de transformation de première génération (2019-2023), on constate que les montants mobilisés dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de la première génération (2019-2023) ont été largement supérieurs à ceux des contrats de plan État-Régions ou des contrats de développement de la période 2015-2020.
Évolution des montants
contractualisés (comprenant la part de l'État et la part
des
collectivités) en outre-mer dans le cadre des contrats de plan
État-Régions
et des contrats de convergence et de
transformation
(en euros)
Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer
Néanmoins, les montants mobilisés dans le cadre de la deuxième génération des CCT (2024-2027) n'ont significativement augmenté par rapport à la période 2019-2023 qu'en Guyane, et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna. En tenant compte de l'inflation, la hausse des crédits est par ailleurs pratiquement nulle à Mayotte et en Guyane.
Une telle diminution des financements contractualisés entre la première et la deuxième génération des CCT pour l'investissement local en outre-mer est regrettable, même si le contexte budgétaire peut l'expliquer en partie.
La diminution des financements est liée dans une large mesure à un moindre engagement de l'État, qui avait apporté 62,6 % du budget dans le cadre des CCT de première génération, alors qu'ils ne peuvent plus fournir que 59,1 % des financements pour les CCT de deuxième génération (2024-2027). L'engagement des collectivités territoriales représentent 40,9 % des financements dans les CCT de 2024-2027, alors qu'ils avaient apporté 37,4 % des financements lors de la première génération des contrats. Les financements de l'État ont ainsi baissé de 24 %, alors que ceux des collectivités territoriales n'ont diminué que de 11,6 %.
Évolution des montants contractualisés par financeur dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de première et deuxième génération
(en millions d'euros)
Note : les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ne sont pas inclus dans cette analyse (il ne s'agit pas de la même période). Ici, la « collectivité territoriale » désigne la collectivité territoriale unique de Martinique et de Guyane, ainsi que celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer
Au vu des grandes difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les territoires ultramarins, la diminution de l'engagement de l'État dans le soutien des investissements locaux est dommageable.
3. Des financeurs multiples de l'investissement dans les collectivités ultramarines
a) Une répartition des financements entre État et collectivités territoriales différenciée par territoire ultramarin
La répartition des financements des CCT de première génération entre l'État et les collectivités diffère selon le territoire ultramarin. Ainsi, l'État représente environ la moitié des financements en Martinique (48,8 %), en Guadeloupe (55,9 %) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (54,8 %). Les financements de l'État sont plus élevés à la Réunion (69 %), à Mayotte (65,4 %) et à Wallis-et-Futuna (89,2 %). Si l'importance des financements de l'État par rapport à ceux des collectivités parait cohérente à Mayotte, où ces dernières ont de grosses difficultés, en revanche à la Réunion, cet écart peut interroger.
Montants contractualisés par financeur et
par territoire
dans le cadre des CCT de première
génération (2019-2023)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer
Les collectivités ayant les compétences de niveau régional représentent la deuxième source de financements, à hauteur de 21 %, notamment en Martinique (47,2 % des financements) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (45,2 %). La participation des collectivités de niveau régional est toutefois moins élevée notamment à La Réunion (17,6 %) et à Wallis-et-Futuna (10,8 %). À noter, que les EPCI à Mayotte ne sont pas signataires du CCT, leurs ressources étant trop faibles pour permettre la contractualisation.
Montants contractualisés par financeur et
par territoire
dans le cadre des CCT de deuxième
génération (2024-2027)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer
Pour les CCT de la période 2024-2027, la participation de l'État est inférieure à 50 % dans la plupart des territoires ultramarins : à la Guadeloupe, où elle représente 45,5 % des financements, en Martinique (47,3 %), en Guyane (48,6 %) ou encore à la Réunion (43,2 %). Mayotte constitue une exception, les financements de l'État représentant 85,5 % des montants contractualisés, en raison des crises sévères ayant frappé le territoire mahorais. La participation des collectivités régionales a pris un poids plus important : elle représente presque 50 % des financements en Martinique ou en Guyane par exemple.
La participation constante des collectivités territoriales au dispositif des CCT est à saluer.
b) Des financements partagés entre les différents ministères
Les financements apportés par l'État proviennent d'une grande diversité de ministères. Au moins 18 programmes budgétaires, issus de missions différentes, sont recensés comme source de financements pour les CCT, en plus d'agences de l'État telles que l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'Agence nationale du sport (ANS).
Répartition des financements de
l'État par ministère et opérateur
dans le cadre des CCT
de première génération (2019-2023) à gauche
et
de deuxième génération (2024-2027) à
droite
(en pourcentage)
Note : les contributions des ministères en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le cadre des contrats de développement sont comptabilisées ici.
Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer
Lors de la signature de la première génération des CCT (2019-2023), le ministère des outre-mer, à travers le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », représentait 40 % des financements apportés par l'État, suivi par le ministère du Travail via le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi ». Le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » du ministère de l'Éducation nationale représente 14 % du budget, et permet de financer la construction des établissements scolaires du second degré à Mayotte, cette compétence n'ayant pas été transférée aux collectivités mahoraises.
Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la participation du ministère du travail a considérablement diminué, leurs financements provenant largement du plan de relance, qui a été mis en extinction. En revanche, les participations du ministère de l'Éducation nationale, en raison du contexte mahorais, et du ministère des transports via le programme 203 « Infrastructures et services de transport », ont été sensiblement augmentées.
La participation des ministères est décidée par ceux-ci en interne, après une sollicitation de la direction générale des outre-mer, et est formalisée à l'occasion d'un comité interministériel des outre-mer (CIOM), organisé dans le cadre de la signature à venir des CCT de deuxième génération (2024-2027) le 18 juillet 2023 par la Première ministre. Les projets retenus dépendent également des orientations internes de chaque ministère, la DGOM se bornant à collecter les participations décidées.
Le nombre élevé de ministères impliqués permet de traiter une grande diversité de problématiques, et de rassembler des financements relativement conséquents.
L'inconvénient en est toutefois un éclatement de la gestion des financements de l'État, qui relèvent des directions déconcentrées de chaque ministère, et non directement de la préfecture. Le préfet n'a véritablement la main dans le cadre des CCT que sur les financements du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » dont a la charge le ministère des outre-mer. Ce programme fait d'ailleurs très souvent office de « variable d'ajustement » pour compléter le financement de certains projets matures, mais ayant été insuffisamment budgétés. La gestion des financements de l'État est donc très morcelée dans le cadre des CCT, ce qui rend particulièrement difficile d'en assurer une cohérence d'ensemble.
La structure des financements de l'État diffère selon le territoire ultramarin concerné. Ainsi, Mayotte bénéficie de la totalité des financements en provenance du ministère de l'éducation nationale, pour ses établissements du second degré. Le programme 181, dit « Fonds Barnier », de prévention des risques naturels, finance essentiellement le confortement parasismique des établissements scolaires dans le cadre du plan Séismes Antilles, et bénéficie donc à la Guadeloupe et à la Martinique. L'Office français de la biodiversité (OFB) est très présent en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, dans le cadre du plan eau-DOM. Ces collectivités concentrent en effet un grand nombre de difficultés d'accès à l'eau.
Le programme 162 « Interventions territoriales de l'État » bénéficie essentiellement à la Guyane, puisqu'il porte le fonds interministériel pour la transformation de la Guyane dont l'objectif est de regrouper la majorité des financements en faveur de ce territoire dans un programme unique.
Enfin, le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » regroupe l'essentiel des financements destinés à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
Répartition des financements de l'État par ministère dans le cadre des CCT de première génération (2019-2023) dans chaque collectivité ultramarine
(en pourcentage)
Note : en Polynésie française, il s'agit ici des financements du contrat de développement de la période 2021-2023. Pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agit des financements des contrats de développement de la période 2017-2023.
Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer
Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la structure des financements a évolué. Le ministère des transports, via le programme 203 « Infrastructures et services de transport » finance davantage notamment les investissements en Guyane, où il a multiplié par 5 ses financements, et à Mayotte, où il a pratiquement multiplié par deux les fonds prévus par rapport à la première génération de CCT. À Mayotte, la loi11(*) de programmation pour la refondation de Mayotte a sanctuarisé le niveau important de crédits contractualisés dans le cadre du CCT de deuxième génération.
Le ministère de l'éducation nationale a également augmenté ses financements à Mayotte, à hauteur de 106 millions d'euros, en raison des crises, et à la Réunion pour un montant de 60 millions d'euros, afin de financer la construction de deux lycées.
Répartition des financements de
l'État par ministère dans le cadre des CCT
de deuxième
génération (2024-2027) dans chaque collectivité
ultramarine
(en pourcentage)
Note : la répartition des financements concernant la Nouvelle-Calédonie n'était pas disponible.
Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer
Les participations de l'OFB ont augmenté de 118,6 millions d'euros entre les deux générations de CCT, en excluant les crédits liés au plan de relance qui ont été décaissés lors de la première génération de CCT. La hausse des financements de l'OFB, au titre de la solidarité interbassins, qui permet de financer le plan eau-DOM, profite essentiellement à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
Si la pluralité des thématiques d'investissements couverte par les CCT est à saluer, le nombre de ministères impliqués dans les financements en complexifie la gestion locale, tant pour les collectivités que pour les directions déconcentrées de l'État.
C. DES DISPOSITIFS VARIÉS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL ULTRAMARIN
1. Le fonds exceptionnel à l'investissement (FEI), une aide non contractualisée aux collectivités
Le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) a été créé en 2009 par la loi12(*) dite « LODEOM ». L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent des investissements sur des équipements publics collectifs.
L'article 1 du décret13(*) du 30 décembre 2009 précise cet impératif en indiquant que « ces aides financent des opérations d'investissement individualisées portant sur la réalisation ou la modernisation d'infrastructures ou d'équipements publics à usage collectif participant de façon déterminante, de manière directe ou indirecte, au développement économique, social, environnemental et énergétique de ces collectivités ».
Ainsi, seuls des projets structurants réalisés par des personnes publiques et ayant un impact sur le niveau et les conditions de vie outre-mer peuvent être financés par le FEI.
Le FEI est administré par le ministre chargé de l'outre-mer qui détermine chaque année, dans le cadre d'une circulaire annuelle, la nature des opérations susceptibles de bénéficier, de manière prioritaire ou exclusive, d'une aide financière du fonds au titre de l'année suivante.
À partir de cette liste, les préfets et hauts-commissaires définissent, sur la base d'un diagnostic territorial, les thématiques prioritaires en matière d'équipements structurants, qui constituent le cadre de l'appel à projets lancé dans chacun des territoires conduisant, in fine, aux dépôts de candidature puis à la sélection des opérations qui bénéficieront d'une subvention du FEI.
À l'issu de ces appels à projets annuels, les représentants de l'État dans les collectivités proposent au ministre chargé de l'outre-mer une liste, par territoire, d'opérations susceptibles de bénéficier d'une aide du fonds exceptionnel d'investissement, classées par ordre de priorité au regard des besoins de chacun des territoires concernés et de l'impact attendu des projets en termes de développement économique et social, de préservation de l'environnement, de développement durable et de promotion des énergies renouvelables.
Ainsi, contrairement aux CCT, le FEI permet de déterminer annuellement les projets qui pourront bénéficier d'une subvention de l'État, sur la base d'un appel à projets. Il s'agit donc d'une procédure plus réactive de détermination des projets bénéficiant d'une subvention, par rapport aux CCT. Par ailleurs, l'État est le seul décisionnaire et aucune négociation avec les collectivités locales n'est menée pour en décider l'organisation.
Le montant du FEI a été multiplié par 1,5 entre 2017 et 2025, montrant l'effort de long terme réalisé par l'État en faveur des investissements collectivités ultramarines.
À noter, toutefois, que le FEI a été fortement diminué entre 2024 et 2025, pour revenir pratiquement au niveau prévu pour 2023. Le ministère des outre-mer a en effet argué qu'il rencontrait des difficultés pour sélectionner suffisamment de projets permettant de consommer l'intégralité du fonds.
Il s'agit toutefois d'un outil utile à l'investissement des collectivités territoriales, qui permet de compléter par des subventions à des projets qui n'ont pas nécessairement été prévus par les CCT. Une stabilisation des moyens du FEI est donc souhaitable.
Évolution du montant du FEI entre 2017 et 2025
(en millions d'euros)
Note : AE signifie autorisations d'engagement et CP crédits de paiement.
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
2. La bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement, une diversification bienvenue des sources de financement
Le ministère des outre-mer soutient également l'investissement des collectivités locales ultramarines via un système de bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD). Ce dispositif est financé sur l'action 9 « Appui à l'accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outremer ». Il permet d'offrir des crédits à taux d'intérêts réduits pour financer les projets des collectivités ultramarines qui répondent à des critères d'impact social et environnemental. Ce « prêt secteur public - Transition (PSP-T) », créé en 2022 (deux prêts préexistaient) a vocation à cibler les petites collectivités en difficulté financière (ayant signé un contrat de redressement outre-mer -COROM- notamment), et celles de la Guyane et de Mayotte.
La direction générale des outre-mer (DGOM) joue un rôle d'orientation stratégique et de pilotage budgétaire dans ce cadre :
- elle définit les modalités d'éligibilité à la bonification des prêts, en lien avec le ministère chargé des finances et l'AFD, en prenant en compte des critères généraux d'accès, comme la situation financière de la collectivité, la nature du projet, ou encore le respect des objectifs de développement durable.
- elle valide l'éligibilité des projets proposés à la bonification au-delà du seuil de 10 millions d'euros.
- elle veille à la cohérence des projets avec les priorités stratégiques de l'État, notamment dans le cadre des contrats de convergence et de transformation.
L'AFD choisit ensuite les projets conformément aux orientations stratégiques définies par la DGOM. Ce cadrage stratégique est actualisé chaque année en lien avec le groupe AFD pour renforcer l'impact de la politique publique. Les prêts bonifiés accordés par l'AFD financent des projets structurants d'investissements, comme par exemple en 2023 le prêt de 3 millions d'euros accordé à la commune du Moule en Guadeloupe pour financer la rénovation énergétique d'un bâtiment communal. Certains prêts peuvent également être accordés pour soutenir la trésorerie des collectivités, mais ils constituent une minorité.
Au premier trimestre de chaque année, l'AFD communique les listes de tous les prêts bonifiés octroyés l'année précédente, avec le montant de la bonification associée à chaque prêt. À noter que la part de prêt éligible à la bonification ne peut pas dépasser 21 millions d'euros par projet, avec une maturité de remboursement équivalente au maximum à 25 ans.
En 2024, l'AFD prévoyait des engagements de PSP-T à hauteur de 542,7 millions d'euros, soit un effet levier de 14,3 par rapport aux 38,06 millions d'euros d'AE de bonifications autorisées. L'effet de levier particulièrement élevé par rapport aux années précédentes, où il était compris entre 10,1 et 11,5. En effet, entre 2020 et 2023, le montant de prêts engagés par l'AFD s'élevait en moyenne à 372 millions d'euros. L'important effet de levier de l'année 2024 s'explique probablement par les conditions du marché financier.
Entre 2017 et 2024, la bonification accordée par l'État aux prêts consentis par l'AFD s'élevait en moyenne à 31,3 millions d'euros. L'effort consenti par l'État en 2025, le montant autorisé de bonification s'élevant à 35,74 millions d'euros, est à saluer particulièrement dans un contexte contraint budgétairement.
Évolution du montant de prêts engagés par l'AFD auprès des collectivités locales ultramarines et de la bonification autorisée par l'État en loi de finances initiale entre 2017 et 2024
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Cet outil de financement est particulièrement efficient d'un point de vue budgétaire. Ainsi, en 2023, les 345 millions d'euros de prêts accordés par l'État, générés grâce à la bonification de l'État de 34,13 millions d'euros, ont permis de réaliser des investissements d'un montant global de 1,4 milliard d'euros. Le mécanisme des prêts bonifiés par l'État constitue donc un levier important d'investissements pour les collectivités territoriales.
Toutefois, cet instrument présente également des limites. Ainsi, les collectivités territoriales en difficulté financière ne peuvent mobiliser facilement l'outil des prêts. Par ailleurs, même si leur situation financière le leur permet, elles n'ont pas forcément les ressources humaines ou les compétences techniques leur permettant de solliciter des prêts, conditionnés à l'établissement d'un projet mature avec un plan de financement solide, fondé souvent sur plusieurs sources de financement. Les prêts ne peuvent constituer la seule modalité de soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales. Des subventions budgétaires sont également indispensables.
Par ailleurs, d'autres dispositifs de prêts existent dans les outre-mer, financés notamment par Banque des territoires, à hauteur de 193,2 millions d'euros en 2024.
3. Un soutien nécessaire à l'ingénierie des collectivités locales
L'accès aux différents dispositifs de soutien à l'investissement est conditionné pour les collectivités locales ultramarines à leur capacité à mobiliser ces dispositifs. En effet, qu'il s'agisse de subventions budgétaires ou de prêts, les collectivités doivent généralement présenter des projets matures, avec un budget précis, nécessitant de faire appel à plusieurs sources de financements (État, autres collectivités, fonds européens etc.). Un certain nombre de collectivités, en particulier les petites communes, éprouvent des difficultés à répondre à l'ensemble des exigences, à la fois parce qu'elles ont des ressources humaines réduites et parce qu'elles ne disposent pas des compétences techniques.
Le contexte du plan de relance a renforcé la nécessité d'un appui à l'ingénierie au profit des collectivités territoriales, afin de leur permettre d'engager rapidement les nombreux projets qu'elles doivent réaliser. Ainsi, le Fonds 5.0, créé en 2019, a été reconduit sous l'appellation « Fonds outre-mer » (FOM). Il permet de financer à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets planifiés par les collectivités locales, pour faciliter l'amorçage des projets d'investissement et renforcer les capacités des acteurs publics locaux, une assistance technique auprès des collectivités locales et un appui aux projets de coopération régionale. Il est opéré par l'AFD.
Évolution du montant du fonds outre-mer en
loi de finances initiale
entre 2017 et 2024
(en millions d'euros et en AE)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Le FOM était initialement doté de crédits issus du plan de relance, à hauteur de 15 millions en AE pour 2021 et 2022.
La LFI 2024 prévoyait un financement de ce dispositif à hauteur de 23,26 millions d'euros en AE et 5 millions d'euros en CP, réduit à 16,32 millions d'euros en AE en raison du décret14(*) d'annulation du 21 février 2024. L'importante hausse du montant versé en CP en 2024 s'explique par la temporalité de mise en oeuvre des projets financés par le FOM. L'essentiel des CP relevait en effet des engagements des années antérieures.
En LFI 2025, le FOM serait financé à hauteur de 14 millions d'euros en AE et de 3 millions d'euros en CP. Le maintien du soutien à l'ingénierie territoriale des collectivités locales ultramarines doit être salué.
D'autres dispositifs de soutien à l'ingénierie locale existent. La loi15(*) de finances initiale pour 2021 a introduit par amendement les contrats de redressement outre-mer (COROM). Ce dispositif résulte des constats du rapport16(*) « Soutenir les communes des départements et régions d'outre-mer : pour un accompagnement en responsabilité » du député Jean-René Cazeneuve et du sénateur Georges Patient publié en décembre 2019 qui relevait que, sur les 129 communes des DROM, un tiers avait des délais de paiement supérieurs à 30 jours et plus de la moitié étaient inscrites dans le réseau d'alerte des finances publiques.
Les COROM visent à apporter un soutien spécifique de l'État aux communes ultramarines souhaitant assainir leur situation financière et réduire les délais de paiement de leurs fournisseurs locaux. Les communes qui signent un COROM s'engagent, en contrepartie d'un soutien financier de l'État, à redresser leur situation financière. Ce dispositif d'accompagnement est fondé sur :
- un effort de diagnostic et d'ingénierie préalable qui doit être mené au niveau local avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD) ;
- un accompagnement afin de mener certaines réformes structurelles indispensables concernant par exemple la fiscalité (meilleure identification des bases), la maitrise de certaines dépenses de fonctionnement, l'amélioration de la gestion de la chaîne de la dépense ou de la sincérité des comptes ;
- la restauration des marges de manoeuvre en section de fonctionnement, notamment sur la maitrise des frais de personnel ;
- une aide de l'État au processus de redressement, apportée en fonction des efforts de la collectivité ;
- une perspective pluriannuelle afin de redresser la situation financière de la collectivité contractante.
Les critères d'éligibilité, ainsi que les modalités de signature et de suivi des contrats sont définis dans une circulaire conjointe des ministères de l'économie, des finances et de la relance, des collectivités territoriales et de la ruralité et des outre-mer du 2 février 2021.
Les COROM ont été dotés de 30 millions d'euros en AE et de 5 millions d'euros en CP chaque année entre 2021 et 2024. Leur financement a été maintenu pour 2025, mais le montant exact n'est pas déterminé. Ce dispositif, particulièrement utile pour les collectivités territoriales, doit être conservé.
Par ailleurs, l'OFB, l'ADEME et la Banque des territoires disposent également de dispositifs de soutien à l'ingénierie des collectivités locales. Si ces dispositifs se révèlent particulièrement utiles, ils peuvent se révéler difficiles à mobiliser, en raison de la pluralité des acteurs concernés.
II. DES INVESTISSEMENTS ENCORE INSUFFISANTS PAR RAPPORT AUX ENJEUX ULTRAMARINS
A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS
1. De nombreux projets entamés grâce aux contrats de convergence et de transformation...
Les CCT de première génération (2019-2023) ont permis de réaliser un grand nombre d'investissements structurants dans les territoires ultramarins, qu'il parait utile d'évoquer pour montrer les conséquences concrètes de ce dispositif sur le quotidien des populations ultramarines.
En Guadeloupe, ont été réalisés notamment :
- la reconstruction de la maison de l'enfance, établissement médico-social départemental spécialisé dans l'accueil d'urgence (petite enfance, adolescence et jeunes mères en situation précaire) ;
- le projet de confortement parasismique des écoles de Gourbeyre et de Saint-Claude ;
- la pose du câble sous-marin « fibre optique » qui permet de relier les Iles du Sud à la Guadeloupe continentale et qui vise à réduire la double insularité de ces iles ;
- l'aménagement d'un pôle de production agroalimentaire local, appelé l'Agropark, dont la réalisation se poursuit dans le cadre du CCT 2024-2027, du fait d'un retard dans la mise en oeuvre de l'opération.
En Martinique, la réhabilitation du campus Schoelcher a pu être réalisée grâce au CCT de la période 2019-2023. L'intégralité des fonds contractualisés par l'État pour financer un pôle universitaire de santé a pu être engagée. Par ailleurs, de nombreux équipements sportifs ont été financés, alors que territoire a un taux d'équipement assez faible.
À la Réunion, des équipements sportifs, des actions de prévention contre le risque représenté par les requins, ou encore une éco-cité ont perçu l'intégralité des engagements prévus.
En Guyane, l'ensemble des fonds contractualisés pour financer l'échangeur des Maringouins, le pont sur la route nationale n° 1 (RN1) ou encore le pont du Larivot ont été engagés.
À Mayotte, 8,2 millions d'euros sont destinés à financer des routes, soit plus de 100 % du montant contractualisé. Autre exemple, le ministère de l'éducation nationale disposait à Mayotte de 417 millions d'euros. Grâce à ces moyens, quatre établissements scolaires ont été entièrement construits, comprenant deux collèges et deux lycées ou pôles spécialisés. En complément, 4 établissements (trois collèges et un lycée) ont fait l'objet d'extensions significatives. Ce sont 14 établissements, dont 8 collèges et 6 lycées, qui ont été réhabilités ou ont bénéficié de travaux de grande ampleur. Enfin, plusieurs équipements sportifs et de restauration ont été créés ou modernisés, contribuant à l'amélioration globale des conditions d'accueil et de vie scolaire.
Au-delà des constructions, des moyens significatifs ont été mobilisés pour la sécurisation, la maintenance et la rénovation des infrastructures annexes, comme les infirmeries, les blocs sanitaires ou les stations d'épuration, dans le but de rattraper le retard accumulé et de remplacer les locaux endommagés par les séismes. Le ministère a également financé des travaux de raccordement au réseau d'eau pour certains collèges, malgré la crise de l'eau qui n'a pas freiné l'avancement des chantiers.
La programmation des opérations de construction des établissements à Mayotte répond aux besoins d'infrastructures scolaires en lien avec la constante croissance des effectifs et à l'évolution de la carte des formations. Les effectifs ont plus que doublé ces 15 dernières années, provoquant une situation de saturation des établissements scolaires existants.
Pour le CCT 2024-2027, le ministère vise la construction de 14 000 places supplémentaires, en construisant 5 lycées et 5 collèges supplémentaires, 10 extensions d'établissements, 3 pôles métiers, 1 cuisine centrale et 24 cuisines satellites.
En Polynésie française, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2021-2023, des équipements sportifs, ainsi que les travaux de rénovation du réseau d'eau potable du secteur Outumaoro ont perçu l'intégralité des engagements prévus dans le contrat, notamment.
En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2017-2023, le projet de rénovation du collège de Koné, de réalisation de radas météorologiques ou encore de rénovation de la route secondaire reliant les villes de Pam et Tiari ont reçu tous les engagements qui avaient été contractualisés
Dernier exemple, l'OFB intervient en soutien des infrastructures de gestion de l'eau et de l'assainissement, dans le cadre du plan eau-DOM, via le fonds de solidarité interbassins. Un plan pluriannuel d'investissement (PPI) est défini dans chaque territoire ultramarin, dans un objectif d'amélioration du service rendu, que l'État s'engage à financer. Les projets sont présentés par une conférence des financeurs sous l'autorité du préfet, qui réunit les principaux financeurs, dont l'OFB. L'objectif est d'optimiser les financements pour permettre un financement à 100 % de chaque projet.
L'OFB priorise les projets dédiés à l'assainissement, à l'approvisionnement en eau des communes non desservies par le réseau d'eau, ainsi que ceux permettant la réutilisation des eaux usées traitées. L'OFB a par exemple engagé l'intégralité des fonds contractualisés en faveur de la construction de la station d'épuration Dumbéa 2 en Nouvelle-Calédonie
Le FEI permet enfin de réaliser des investissements dans des projets complémentaires.
En Guadeloupe, près de 1,2 million d'euros ont été versés en 2024 pour contribuer à la rénovation du collège de Cornet par exemple.
En Guyane, ce sont 1,2 million d'euros qui ont servi à la construction du grand ensemble culturel de Rémy-Montjoli.
À la Réunion notamment, le FEI a contribué à hauteur de 2,5 millions d'euros pour l'équipement et la mise en service du forage de Takamaka.
Ainsi, un très grand nombre de projets structurants dans les collectivités ultramarines ont pu être financés grâce aux contrats de convergence et de transformation, et au FEI dans une moindre mesure.
2. ... mais aussi des investissements nécessaires qui restent non financés, en particulier en termes de préservation de l'environnement
Certaines priorités d'investissement ne sont toutefois pas prises en compte dans les CCT, alors qu'elles constituent des enjeux structurants pour les territoires ultramarins.
Tout d'abord, les enjeux liés à la santé en sont exclus. En effet, le Ségur de la santé, lancé en juillet 2021 à la suite de la crise sanitaire, concentre déjà l'essentiel des financements et des projets associés à cette thématique. Par ailleurs, la DGOM estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment de fonds à cette fin.
Par ailleurs, les enjeux liés à l'adaptation à la transition écologique sont très peu pris en compte dans le cadre des CCT. En particulier, les actions de prévention face aux risques naturels sont pris en charge au titre du « Fonds Barnier ». Mais celui-ci finance les risques naturels listés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, soit « les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Ces risques ne se confondent pas avec l'ensemble des conséquences associées à l'adaptation au changement climatique, telle que les variations de chaleur ou la montée des eaux. Le « fonds Barnier » ne peut servir à financer les actions de préventions liées au recul du trait de côte, par exemple, alors qu'il s'agit d'un enjeu central dans la plupart des territoires insulaires ultramarins.
Le Fonds Barnier a ainsi bénéficié essentiellement au confortement parasismique des bâtiments en Guadeloupe, à hauteur de 31,7 millions d'euros entre 2019 et 2023, et en Martinique, pour un montant de 28,9 millions d'euros, dans le cadre du plan séismes-Antilles.
Montant contractualisé par CCT au titre du Fonds Barnier
(en euros)
|
Montant contractualisé lors de la première génération de CCT (2019-2023) |
Montant contractualisé lors de la seconde génération de CCT (2024-2027) |
|
|
Guadeloupe |
31 753 332 |
35 000 000 |
|
Guyane |
2 500 |
3 000 |
|
Martinique |
28 873 332 |
31 800 000 |
|
Mayotte |
783 332 |
3 500 000 |
|
La Réunion |
1 413 332 |
1 600 000 |
|
total |
62 825 828 |
71 903 000 |
Source : commission des finances d'après la direction générale de la prévention des risques
Ce sont essentiellement les bâtiments scolaires qui en ont bénéficié, comme par exemple le lycée Gerty Archimède en Guadeloupe. En Guyane, le Fonds Barnier contribue aux études de sécurisation du Mont-Baduel. À la Réunion, les travaux de protection du centre-ville de Saint-Joseph contre le phénomène d'inondation ont été intégrés dans le CCT.
Pour la période 2024-2027, les actions de prévention des risques naturels inscrites dans le CCT de la Martinique portent sur la mise en conformité parasismique des établissements scolaires et sur la refondation de la commune du Prêcheur. À Mayotte, des actions de prévention des inondations et de glissements de terrain sont financées par le Fonds Barnier dans le cadre du CCT.
Au total, près de 15 % du montant du fonds Barnier est délégué aux DROM. Pour autant, tous les risques naturels ne peuvent être couverts par le Fonds Barnier.
Ainsi par exemple à Mayotte, le passage du cyclone Chido a mis en évidence la fragilité du territoire en termes de gestion des eaux de ruissellement. Il pourrait être utile d'intégrer une dimension de lutte contre le ruissellement des eaux par l'aménagement des bassins versants dans le CCT de Mayotte, puisqu'il s'agit d'investissements lourds nécessitant l'engagement de plusieurs financeurs sur un grand nombre d'années.
L'intégration d'une dimension plus large de prévention des risques associés aux catastrophes naturelles ainsi que d'adaptation au changement climatique dans les CCT est ainsi nécessaire.
De plus, pratiquement aucun projet de préservation de l'environnement ne sont compris dans les CCT. L'ADEME finance pourtant certains projets liés à la transition écologique, à hauteur de 73,1 millions d'euros pour la première génération de CCT (2019-2023) et de 71,3 millions d'euros pour la deuxième génération de CCT (2024-2°27). Ces projets sont toutefois d'une ampleur réduite, et concernent essentiellement l'économie circulaire, pour un montant de 6,5 millions d'euros à la Martinique et de 4,9 millions d'euros à la Réunion.
Il pourrait donc être utile d'intégrer à la stratégie des CCT une dimension plus large liée à l'adaptation au changement climatique, à la préservation de l'environnement ainsi qu'à la prévention contre tous types de risques naturels.
D'autres financements que ceux issus du Fonds Barnier, qui n'a pas cette visée, devraient ainsi être envisagés en provenance notamment du ministère de la transition écologique.
La Cour des comptes17(*) avait ainsi estimé concernant les contrats de développement de Nouvelle-Calédonie qu'ils devaient « faire l'objet d'une redéfinition de leur périmètre et sélectionner des projets mieux préparés, intégrant les enjeux cruciaux du logement et des transitions énergétique et écologique. »
Concernant le logement, l'action 1 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », la ligne budgétaire unique, permet déjà de financer des investissements liés au logement, qui ne relèvent pas en général des collectivités locales. Il ne parait donc pas indiqué d'intégrer cette dimension aux CCT, contrairement aux enjeux écologiques.
Recommandation : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts commissariats, collectivités)
Les impacts du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte : réajustement budgétaire et allongement du calendrier
Le passage des cyclones Chido et Dikeledi a entraîné des dommages importants sur plusieurs infrastructures, notamment scolaires, nécessitant une reconstruction prioritaire. La gestion des chantiers et du financement des travaux a conduit à une révision de la trajectoire prévisionnelle du CCT 2024-2027, pour intégrer ces opérations nouvelles de reconstruction.
Certains chantiers ont donc été décalés d'un an, comme le lycée des métiers du bâtiment à Longoni, le collège de Bandraboua, ou encore l'extension des collèges de Koungou et de Dzaoudzi-Labattoir. La création d'une section agroalimentaire à Coconi a même été reportée de 3 ans.
Source : commission des finances
3. Une répartition géographique des soutiens à l'investissement qui interroge
Dans le cadre des CCT, les montants destinés à chaque territoire ultramarin ont été définis lors de réunions interministérielles successives qui se sont tenues en 2018 et 2019. Il n'y a cependant pas eu de définition préalable des montants à contractualiser par territoire, même s'il est possible de regrouper les différents territoires ultramarins en trois grandes catégories :
- les territoires peu peuplés mais qui nécessitent cependant des infrastructures et des équipements structurants minimaux (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna) ;
- les territoires en forte hausse démographique et qui accusent un retard en matière d'infrastructures (Mayotte, Guyane) ;
- les territoires qui présentent un taux d'équipement plutôt supérieur à d'autres collectivités d'outre-mer mais qui nécessitent cependant encore des investissements (La Réunion, Martinique, Guadeloupe).
L'État a par ailleurs veillé à ce qu'il y ait un équilibre entre les crédits apportés par les collectivités locales et ceux apportés par l'État, à l'exception de Mayotte et de Wallis-et-Futuna, en raison de leurs fortes difficultés financières.
La répartition des fonds contractualisés dans chaque collectivité ultramarine est relativement déséquilibrée. Ainsi, en Guadeloupe, à la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, le montant investi par habitant sur 4 ans est inférieur à 1 000 euros, alors qu'il est supérieur à 2 500 euros à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, ainsi, dans une moindre mesure, qu'à Mayotte, où il s'élève à 2 785 euros par personne et par an pour la période 2019-2023.
En particulier, les montants investis par habitant en Guyane, de 1 702 euros en moyenne entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027, sont étonnants, au vu des enjeux forts en termes d'investissement de ce territoire soumis à des contraintes géographiques très fortes.
Montant total
contractualisé par habitant dans le cadre des CCT
de première
et de deuxième génération
(en euros par habitant)
Note : pour la Polynésie française, c'est le contrat de développement pour 2021-2023 qui est pris en compte pour la première période, pour la Nouvelle-Calédonie, le contrat de développement de 2017-2023.
Source : commission des finances d'après la DGOM
Par ailleurs, les montants contractualisés par habitant baissent fortement en Nouvelle-Calédonie et en Martinique ainsi, dans une moindre mesure, qu'en Guadeloupe, entre les deux générations de contrats considérés. Une telle situation peut-être due à l'absence de maturité des projets en Nouvelle-Calédonie notamment, où la crise institutionnelle retarde les travaux des collectivités. De plus, même dans les territoires où l'augmentation des montants par habitant est sensible, comme par exemple en Guyane à hauteur de 15 %, est absorbée globalement par la hausse de l'inflation entre 2019 et 2024.
Il serait important que la contractualisation tienne compte dans la répartition des montants entre les territoires non seulement des projets présentés, mais également à la fois des évolutions démographiques et des difficultés particulières de certains territoires ultramarins.
Répartition territoriale du FEI en 2024
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Concernant le fonds exceptionnel d'investissement, pour 2024, Mayotte représente 31 % des montants engagés, la Réunion 16,2 % et la Guyane 13,9 %. Cette répartition est cohérente au vu à la fois de l'importance démographique de la Réunion, et des enjeux forts en termes d'investissement de Mayotte et de la Guyane.
Répartition territoriale des prêts de l'AFD, bonifiés par l'État, en 2023
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Près de 38 % des prêts accordés par l'AFD aux collectivités ultramarines est concentré à la Réunion en 2023, en raison tant du poids géographique de l'île, qui représente 31 % de la population ultramarine, que de la capacité de ses collectivités à y avoir recours. Cette répartition illustre toutefois les difficultés des collectivités des territoires les plus en difficulté financièrement à avoir recours aux prêts consentis par l'AFD, qui ne peuvent donc constituer l'instrument majeur de soutien aux investissements locaux.
B. DES DIFFICULTÉS À TENIR LES ENGAGEMENTS D'INVESTISSEMENT
1. Des crédits de soutien à l'investissement insuffisamment consommés
a) Un taux d'engagement de 77 % des crédits de l'État sur les CCT
Sur l'ensemble des contrats, la consommation globale des crédits contractualisés par l'État est relativement satisfaisante en termes d'engagement, mais reste en-deçà des espérances en termes de consommation des crédits de paiement.
La consommation globale des autorisations d'engagement contractualisées par l'État s'élève à 2,07 milliards d'euros en AE, soit 97 % de taux d'engagement sur les engagements contractualisés pour la période 2019-2022. Ce taux n'intègre toutefois pas les engagements supplémentaires qui ont été contractualisés fin 2022, lorsque les CCT ont vu leur durée augmenter d'un an.
Ainsi, au total, en tenant compte des contrats de développement signés pour la Polynésie française (2021-2023) et la Nouvelle-Calédonie (2017-2023), le taux d'engagement des crédits s'élève fin 2023 à 76,6 %. Le taux de consommation des crédits n'est que de 48,6 %. En excluant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le taux d'engagement des crédits est de 79,6 %. Ce sont 47,1 % des crédits qui ont été consommés.
Part consommée des crédits
contractualisés
dans le cadre des CCT de première
génération (2019-2023)
(en pourcentage)
Note : les deux dernières barres du graphique ne comprennent pas les contrats de développement de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Source : commission des finances d'après la DGOM
L'État éprouve des difficultés plus marquées d'engagement des crédits notamment en Martinique, où le taux d'engagement est de 59,8 %, à la Réunion, où 68,4 % des crédits ont été engagés, en Nouvelle-Calédonie, où le taux précité atteint 67,6 %, et en Polynésie française, où il s'élève à 65,4 %.
Toutefois, les territoires où la proportion de crédits de paiement consommée est la plus basse sont la Martinique, Saint-Martin et la Guadeloupe. Ainsi, un niveau plus faible d'engagement des crédits n'implique pas nécessairement une consommation plus faible que la moyenne des engagements, comme le montrent les exemples de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, où les taux de consommation des crédits de paiement s'élèvent à respectivement 54,2 % et 53,2 %.
La consommation annuelle des AE et des CP a par ailleurs fortement augmenté au fur et à mesure des années. En particulier, les années 2022 et 2023 ont été marquées par un fort engagement des crédits, alors que les niveaux initiaux étaient assez faibles. Ainsi, à fin 2021, alors que 3 ans sur les 5 années qu'ont duré le contrat s'étaient écoulées, seuls 44 % des crédits contractualisés avaient été engagés. La crise sanitaire, ainsi que les délais incompressibles de lancement et de montée en puissance des projets, expliquent que le niveau d'engagement des crédits ne soit pas linéaire au fur et à mesure des années.
Évolution de l'engagement des
crédits par territoire dans le cadre des CCT
de première
génération entre 2019 et 2023
(en pourcentage et en AE)
Source : commission des finances d'après la DGOM
Les restes à engager sur les CCT de première génération les plus élevés en valeur absolue sont de 123,3 millions d'euros à la Réunion et de 114,5 millions d'euros en Guyane. Les restes à payer s'élèvent à 184,6 millions d'euros en Guyane et à 243,9 millions d'euros à Mayotte.
S'il est difficile de dresser un suivi précis du devenir de ces restes à engager, puisque leur gestion relève d'un grand nombre de ministères différents, il semble qu'une proportion importante ait été transférée à la génération de contrats de la période 2024-2027, notamment à Mayotte concernant les restes à payer du ministère de l'éducation nationale, à hauteur de 124 millions d'euros.
Restes à payer et à engager sur les CCT de première génération (2019-2023) par territoire ultramarin
(en millions d'euros)
Source : commission des finances d'après la DGOM
L'engagement et la consommation des crédits contractualisés varient également selon le ministère financeur. Ainsi, la part des crédits contractualisés qui a été engagée est de seulement 31,9 % concernant le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » et de 43 % concernant le programme 181 « Prévention des risques ». La direction générale de la prévention des risques avait évoqué des difficultés de lancement des projets de confortement parasismique, en raison notamment du délai d'études des projets.
À l'inverse, le taux d'engagement des crédits est particulièrement satisfaisant concernant l'Agence nationale du sport (ANS), le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », le programme 214 « Soutien à la politique de l'éducation nationale » et le programme 162 « Interventions territoriales de l'État ». Concernant ce dernier, il est probable que la fongibilité des financements entre des actions très différentes d'un même programme, qui réunit une grande partie des financements destinés à la Guyane, ait facilité l'engagement des crédits.
Part des crédits contractualisés qui ont été engagés par programme
(en pourcentage et en AE)
Source : commission des finances d'après la DGOM
Un suivi budgétaire centralisé de l'exécution des crédits
La DGOM assure depuis 2019 le pilotage interministériel et national des contrats de convergence et de transformation (CCT) et des contrats de développement et assure donc un suivi des crédits contractualisés de chacun des territoires.
La DGOM demande aux préfectures ou hauts-commissariats de chaque territoire la transmission d'informations mensuelles sur l'état de consommation des AE et CP par projet et par financeur. Elle demande également à chaque responsable de programme, donc dans chaque ministère, un bilan annuel d'exécution de l'année N-1, établi en janvier. Il est attendu de compléter ces données budgétaires par des commentaires pour chaque projet précisant les principaux éléments tels que le calendrier de réalisation, l'état d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées.
Le suivi de la consommation des crédits de l'ensemble des projets inscrits dans les CCT ou les contrats de développement est assuré également par les préfectures ou hauts-commissariats lors des comités de pilotage ou de programmation.
La DGOM n'est toutefois pas en mesure de suivre le devenir des crédits non consommés en fin d'année sur les CCT.
Source : commission des finances d'après la DGOM
b) Un manque de visibilité sur l'engagement des crédits alloués par les collectivités
Par ailleurs, l'État et la DGOM en particulier n'ont qu'une visibilité très limitée sur les engagements des crédits des collectivités ultramarines sur les projets cofinancés par les CCT.
À titre d'exemple, la collectivité territoriale de Martinique a estimé le niveau d'engagement des crédits contractualisés à 65 % et le taux de consommation des crédits de paiement à 37 %, soit des niveaux d'engagement et de consommation supérieurs à ceux de l'État en Martinique. De plus, elle a fait état notamment des difficultés de gestion causées par une cyber-attaque de grande ampleur, qui a retardé les travaux relatifs à un grand nombre de projets.
Il est tout à fait justifié que l'État ne dispose pas du suivi de l'engagement et de la consommation des crédits contractualisés par les collectivités territoriales, qui disposent de l'autonomie financière. Toutefois, dans le cadre du bilan qui doit être dressé sur la première génération de CCT, il serait souhaitable que les préfectures disposent d'une telle estimation, afin de pouvoir dresser localement une évaluation de l'efficience du dispositif.
c) Une exécution satisfaisante des crédits du FEI et de bonification des prêts accordés par l'AFD
Le niveau d'engagement des crédits du FEI s'élève à 67,4 % en 2024. Près de 76 % des crédits de paiement ont été consommés. Les taux d'engagement et de consommation des crédits du FEI étaient particulièrement élevés entre 2021 et 2023, où ils ont été consommés à plus de 100 % concernant les CP.
Montant ouvert et exécuté au titre du FEI entre 2018 et 2025
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les documents budgétaires
Si le niveau d'engagement des crédits du FEI est relativement proche de celui des CCT, en revanche le niveau de consommation des crédits de paiement est sensiblement plus élevé. En effet, la procédure d'appel à projets du FEI permet de garantir que la subvention est accordée à un projet capable de consommer le montant demandé dans un délai temporel relativement faible. À l'inverse, les projets d'investissement sont décidés pour la majeure partie d'entre eux dès la signature du CCT. Il est relativement logique que des projets décidés sur une base pluriannuelle aient des taux de consommation des crédits plus faibles que des projets subventionnés sur une base annuelle.
Enfin, concernant la bonification des prêts accordés par l'AFD par l'État, presque toute la somme est consommée chaque année, à hauteur de 99 % en 2023, par exemple.
2. Seuls 12 % des projets achevés lors de la première génération de contrats de convergence et de transformation
Au 31 décembre 2023, sur les 801 projets inscrits dans les CCT de 2019 à 2023, hors Nouvelle-Calédonie, 63 étaient achevés, et 27 étaient en phase de finalisation.
Un bilan des CCT de la première génération est réalisé par la DGOM, en lien avec les préfectures, dans le courant de l'année 2025. Il est uniquement fondé sur une comparaison des crédits consommés par rapport aux crédits engagés jusqu'en fin 2024. Sous cette réserve, seules 12 % des opérations entamées ont été achevées, soit un taux relativement peu élevé.
Nombre de projets inclus et réalisés
dans le cadre du CCT
de première génération
(2019-2023) par territoire ultramarin
Source : commission des finances d'après la DGOM
Près de 80 % des opérations contractualisées ont néanmoins un taux d'engagement de crédits supérieur à 50 %, et donc véritablement avancé. Cette proportion est particulièrement élevée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
3. Des difficultés de consommation des crédits pas uniquement liées aux crises
Des difficultés conjoncturelles expliquent les difficultés d'engagement des crédits et surtout le faible niveau d'engagement des premières années dans le cadre des contrats de convergence et de transformation :
- la signature tardive des contrats ;
- la période de crise sanitaire ayant paralysé l'administration et les territoires concentrés sur la gestion de crise ;
- l'engagement et le paiement des crédits du plan de relance en priorité par rapport aux crédits du CCT, ce qui a généré un effet d'éviction ;
- les mouvements sociaux de fin d'année 2021 aux Antilles et dans le Pacifique qui ont entraîné le ralentissement de l'activité des territoires ;
- les difficultés de certaines filières, par exemple du secteur du BTP en Guadeloupe. Des contraintes liées au foncier ont également été relevées, notamment en Guyane. Des problématiques d'approvisionnement en matières premières ont également été évoquées.
Toutefois, d'importantes difficultés structurelles ont également été relevées par les acteurs.
Ainsi, la gestion d'un grand nombre d'opérations est très lourde. En Guadeloupe par exemple, la préfecture a dû prendre en charge près de 449 opérations, ce qui implique la mobilisation de ressources humaines importantes.
De plus, la pluralité des sources de financements, au sein de l'État même d'une part, et en lien avec les collectivités d'autre part, a encore complexifié la gestion. Chaque acteur pouvait fixer ses propres modalités d'engagement des crédits.
Par ailleurs, les décisions de financement ont pu évoluer au cours de la période par projet et par financeur, complexifiant encore la gestion.
Enfin, au-delà des difficultés de gestion liées à la nature des CCT, deux défauts principaux ont été relevés :
- le manque de maturité de certains projets contractualisés au début de la période, rendant impossible l'engagement et le paiement des crédits pourtant disponibles ;
- le défaut de structuration et d'organisation de l'ingénierie publique pour la réalisation des opérations, en particulier dans les collectivités territoriales, d'autant que la gestion des projets financés via les CCT est particulièrement complexe d'un point de vue administratif. Pour autant, un grand nombre de collectivités ont été capables de faire appel au financement des CCT, en recourant notamment à l'expertise de cabinets spécialisés dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
Pour la période 2024-2027, l'engagement et la consommation des crédits risquent d'être encore complexifiés par le délai de signature effective des CCT. Les signatures sont intervenues principalement entre mai et septembre 2024.
Par ailleurs, les enveloppes de financement disponibles en 2024 et 2025 sont inférieures à ce qui était initialement prévu sur la période pour certains programmes, ce qui limite de fait la possibilité d'engager les opérations. Ainsi, il risque d'être difficile d'améliorer à court terme le niveau d'engagement et de consommation des crédits, ce qui est regrettable. Il serait souhaitable que la contractualisation décidée en 2024 soit respectée en particulier par l'État.
C. UNE STRATÉGIE DE DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS À REVOIR
1. Des priorités définies localement, un cadre à renforcer
Le plan de convergence et de transformation est défini par l'article 7 de la loi18(*) du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer (EROM). Il a pour but de « réduire les écarts de développement » et est conclu entre l'État, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les EPCI. Conformément à l'article 7 de la loi précitée, il comprend notamment :
« 1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre 10 et 20 ans ;
2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;
3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;
4° Une stratégie de convergence de long terme (...). [Elle] prévoit des actions en matière d'infrastructures, d'environnement, de développement économique et d'implantation des entreprises, de développement social et culturel, d'égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d'accès aux soins, d'éducation, de lutte contre l'illettrisme, de formation professionnelle, d'emploi, de logement, d'accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d'accès aux services publics, à l'information, à la mobilité, à la culture et au sport. (...)
5° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa mise en oeuvre opérationnelle, précisant l'ensemble des actions en matière d'emploi, de santé, d'égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l'illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière. »
Axes stratégiques et nombre de
sous-objectifs dans le plan de convergence
et de transformation
défini par territoire
Source : commission des finances d'après la DGOM
Un plan de convergence a ainsi été établi en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. Toutefois, aucun plan de convergence n'a été signé à Mayotte, un plan pour l'avenir de Mayotte ayant été conclu en 2019, et en Guyane, en raison essentiellement de la crise sanitaire. L'absence d'un tel plan de convergence et de transformation, faisant l'objet d'un compromis des collectivités locales présentes, est regrettable, en plus d'être contraire à l'article 7 de la loi « EROM » précitée. Les collectivités définies à l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, ne sont quant à elles pas tenues de développer un plan de convergence et de transformation.
Chaque CCT définit ensuite des priorités répondant aux enjeux définis dans le cadre des plans de convergence et aux politiques prioritaires de chaque ministère financeur. Celles-ci sont validées dans le cadre des mandats de négociation, donnés aux préfets et aux hauts-commissariats par le premier ministre en vue de négocier les CCT dans chaque territoire.
Dans le cas des CCT de première génération (2019-2023), ils traduisent de façon opérationnelle la vision stratégique tracée dans les plans de convergence, suite aux Assises des outre-mer ayant eu lieu en 2018, mais aussi les engagements pris dans le cadre de plans spécifiques mis en oeuvre au profit de certains territoires.
Les CCT doivent reprendre également les engagements des CPER ainsi que des contrats de développement précédents.
Des listes de projets sont jointes en annexe des mandats de négociation. Elles ont été établies à partir d'un recensement de projets identifiés par les préfets et hauts-commissaires comme prioritaires dans le cadre des Assises et ont fait l'objet d'une première analyse par les ministères concernés. La forme reste à déterminer après concertation avec les collectivités cosignataires.
Le cas échéant, il est demandé aux préfets et aux hauts-commissaires de compléter ces orientations et projets par d'autres priorités résultant des consultations qu'ils engageraient localement.
Afin d'établir les mandats de négociation, la DGOM définit et négocie avec l'ensemble des ministères les crédits ayant vocation à être contractualisés au niveau des CCT. Une fois le mandat de négociation transmis, la préfecture de chaque territoire ultramarin entame les discussions avec les collectivités ultramarines concernées. La DGOM est chargée de veiller au respect du mandat et valide donc le projet de contrat une fois qu'il est établi. Elle organise des concertations interministérielles dématérialisées afin d'en obtenir la validation interministérielle.
Ce processus de négociation des priorités inscrites dans les CCT montre la très faible marge de manoeuvre qui a été laissée aux collectivités locales dans la négociation des priorités et des projets financés. Même si les Assises des outre-mer avaient été organisées en amont pour permettre un dialogue avec les ministères financeurs, le processus d'établissement des financements par les ministères et des projets retenus est fortement centralisé, au détriment des collectivités locales, alors qu'elles en assurent le cofinancement.
Un dispositif semblable a été mis en oeuvre dans la négociation des CCT de deuxième génération (2024-2027). Ainsi, le mandat de négociation du Premier ministre adressé aux préfets et hauts-commissaires imposait de :
- réaliser un bilan de la mise en oeuvre du CCT 2019-2022 ;
- reprendre, le cas échéant, les engagements figurant dans le précédent CCT qui n'auraient pas été mis en oeuvre ;
- privilégier les opérations et actions de nature à favoriser la création de valeur et les réponses pragmatiques aux attentes et besoins du territoire.
Les autres déterminants des priorités sont restés similaires à ceux des CCT de première génération :
- inscrire dans une démarche de développement durable, en déclinant territorialement les 90 actions du plan biodiversité, et en intégrant les objectifs du plan régional climat-air-énergie ;
- retenir des actions structurantes pour le territoire, d'une maturité suffisante pour garantir un début de mise en oeuvre opérationnelle durant la période 2024-2027.
Pour la deuxième génération de CCT, des échanges ont eu lieu en amont du comité interministériel des outre-mer (CIOM) organisé en juillet 2023. Les mandats de négociation ont toutefois été adressées aux préfets et aux hauts-commissaires en septembre 2023, ce qui laissait un délai extrêmement court pour finaliser la signature des contrats avant l'expiration des contrats de première génération prévue au 31 décembre 2023. Un tel processus décisionnel laisse une place trop peu importante à la négociation avec les collectivités locales.
Les élus sont pourtant les mieux à même de définir les projets prioritaires dans leurs territoires. De plus, comme l'ont relevé certains interlocuteurs, il est très difficile de faire aboutir un projet en l'absence de portage politique local. Il serait donc souhaitable de développer davantage la négociation entre les préfectures et les collectivités, en laissant des marges de manoeuvre beaucoup plus importantes aux préfectures dans la définition du mandat de négociation par les ministères.
Ce processus serait facilité par la généralisation de l'établissement d'un plan de convergence et de transformation à l'ensemble des collectivités ultramarines, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie qui relève d'un régime constitutionnel très spécifique. En effet, les priorités du CCT devraient en découler, au lieu d'être définies par les ministères dans un mandat de négociation.
Le dirigisme de l'État, au détriment des priorités portées par les collectivités locales, peut expliquer le manque d'ambitions structurantes portées par les contrats de convergence et de transformation qui a été relevé par de multiples interlocuteurs lors des auditions, ainsi que par la Cour19(*) des comptes. Ceux-ci sont pourtant supposés définir une ambition de rattrapage économique véritable, devant guider les investissements réalisés. La construction d'un projet de convergence dans l'ensemble des collectivités autour d'un nombre resserré de priorités, porté par les élus des collectivités locales, parait indispensable pour qu'une véritable vision stratégique soit mise en oeuvre à travers les CCT.
Recommandation : définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation (direction générale des outre-mer (DGOM), collectivités, préfectures, hauts-commissariats)
2. Des sous-objectifs trop nombreux pour servir d'orientations stratégiques
Le nombre d'axes prioritaires est en général resserré, que ce soit dans la première et la deuxième génération de CCT. Ainsi, la plupart des CCT de première génération, à l'exception de celui de Saint-Martin et de la Martinique et des contrats de développement de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, portaient sur les 5 axes suivants :
- un volet « cohésion des territoires » ;
- un volet « mobilité multimodale » ;
- un volet « territoires résilients » ;
- un volet « territoires d'innovation et de rayonnement » ;
- un volet « cohésion sociale ».
Toutefois, un très grand nombre de thématiques est en réalité couvert par ces axes. Ainsi, par exemple, en Guadeloupe, ce sont 22 sous-objectifs qui ont été définis pour la première génération de CCT et même 34 sous-objectifs pour la période 2024-2037. Les CCT des collectivités définies à l'article 73 de la Constitution comprennent tous plus de 20 sous-objectifs, tels que par exemple « la prévention des risques naturels » et « l'alimentation en eau potable » dans le CCT de première génération de la Guyane, ou encore « mettre des outils transversaux pour accompagner la diversification et la structuration de l'économie » dans le CCT de deuxième génération en Martinique. Le nombre de sous-objectifs définis dans chaque CCT est très important et en limite la portée stratégique.
Nombre de priorités et de sous-objectifs
définis dans les CCT
de première et deuxième
génération
Source : commission des finances d'après la DGOM
Pour la deuxième génération de CCT, les axes prioritaires diffèrent d'un territoire à l'autre, et vont de 3 axes, comme en Guadeloupe par exemple, à 11 axes à Mayotte. Les thématiques traitées sont d'ailleurs très vastes : l'insertion professionnelle, l'éducation nationale, l'environnement, l'eau et l'assainissement, les déchets, les transports, la culture, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement économique, le sport et la jeunesse. Il est logique et cohérent que chaque territoire définisse ses propres priorités. Ne pas définir des axes prioritaires communs à toutes les collectivités ultramarines est donc préférable.
Toutefois, pour que les objectifs et surtout les sous-objectifs puissent constituer le support d'une véritable stratégie de convergence cohérente pour les populations ultramarines, il serait souhaitable que les plans de convergence comprennent un nombre resserré de priorités et d'objectifs autour desquels prioriser les investissements structurants.
Par ailleurs, certaines thématiques n'entrent pas dans le champ d'action des CCT du fait de l'absence de réponse de certains ministères aux propositions de participation de la DGOM. C'est par exemple le cas de la thématique santé ou de l'agriculture dont les ministères concernés accompagnent les territoires ultramarins à travers d'autres dispositifs spécifiques comme le Ségur de la Santé qui finance de nombreux projets hospitaliers en outre-mer. Certains projets sont cependant mentionnés au titre des crédits valorisés dans les CCT (voir supra).
Concernant le FEI, celui-ci finance 8 thématiques, qui ne se recoupent pas avec celles des CCT :
- les constructions scolaires ;
- la culture ;
- le désenclavement du territoire ;
- le développement économique ;
- la gestion de l'eau potable et de l'assainissement ;
- le domaine sanitaire et social ;
- les établissements publics de proximité ;
- les infrastructures numériques ;
- les infrastructures d'accueil des entreprises :
- la prévention des risques majeurs ;
- le sport ;
- le tourisme ;
- le traitement et la gestion des déchets ;
- la transition énergétique ;
- le FEI scolaire (Mayotte).
Il s'agit de thématiques très nombreuses et peu précises, qui ne contribuent pas à définir un véritable portage stratégique du soutien de l'État à l'investissement local, et qui entraine une dilution des financements entre différents projets. Une mise en adéquation des thématiques du FEI avec la vision stratégique portée par les plans de convergence et de transformation est nécessaire (voir supra).
À noter, certains territoires fortement touchés par des crises ont pu positionner des opérations spécifiques permettant de répondre à ces crises. C'est le cas par exemple de Mayotte qui dispose dans son CCT d'opérations en matière de constructions scolaires mais aussi d'eau et d'assainissement à travers le financement du plan eau Mayotte. Les préfectures et les hauts-commissariats sont invités après une crise majeure à identifier les projets susceptibles de devoir évoluer et à proposer éventuellement un avenant au CCT en cours afin d'intégrer les conséquences de cette crise.
3. Une « liste à la Prévert » de projets souvent trop peu matures
La plupart des projets financés par les CCT fait l'objet d'une sélection en amont de la signature du contrat lors des échanges entre le territoire et les ministères. Ils sont, dans une large mesure, définis dès les mandats de négociation transmis aux préfets.
Les critères de sélection des projets des CCT sont :
- l'inscription dans le cadre du plan de convergence ;
- la cohérence et complétude du plan de financement ;
- la maturité du projet.
Par ailleurs, dans le champ des projets relatifs à la biodiversité, la cohérence avec les 90 actions du plan biodiversité de 2018 devait être recherchée en tenant compte des contraintes spécifiques inhérentes au territoire. De même, les projets relatifs à l'eau et à l'assainissement doivent s'inscrire dans un contrat de progrès décliné dans le cadre du plan eau-DOM.
Après des échanges entre les collectivités, la préfecture et les ministères financeurs, le choix final d'inscription d'un projet au financement du CCT par des crédits de l'État est acté dans le cadre d'une réunion interministérielle qui valide l'ensemble des fiches projets du contrat.
À noter, que les définitions des projets ne sont pas toujours très claires. Il s'agit parfois de formulations très vagues (« rénovations des infrastructures routières de Wallis ») par exemple, ce qui ne favorise pas le suivi du financement de l'investissement.
Or un très grand nombre de projets est financé par les CCT : au total, 1051 projets ont été inclus dans les CCT de première génération, et certains ont pu être ajoutés ensuite. Pour la période 2024-2027, le nombre de projets contractualisés a diminué, mais le suivi de l'ensemble des projets n'a pas forcément commencé auprès de la DGOM. Il est possible que le nombre de projets soit plus élevé. De nombreux interlocuteurs ont évoqué un problème de la « liste à la Prévert » des projets financés par les CCT, qui entraine un saupoudrage des aides.
En tout état de cause, un montant moyen de 4,4 millions d'euros d'investissement totaux (part État et collectivités comprises) est prévu par projet, ce qui au vu de l'importance de certains projets d'infrastructures parait insuffisant.
La DGOM estime que les dix projets principaux de chaque territoire représentent en général autour de 70 % de l'enveloppe des crédits. Toutefois, même des projets faiblement financés nécessitent des moyens administratifs de mise en oeuvre et de suivi, ce qui pèse notamment sur les capacités d'ingénierie locale des collectivités.
Nombre de projets inclus dans le CCT de première et de deuxième génération ou dans le contrat de développement et montant moyen par projet par territoire
(en euros)
Source : commission des finances d'après la DGOM
Par ailleurs, le grand nombre de projets limite l'impact stratégique des projets portés, lesquels pourraient être davantage priorisés et sélectionnés selon les enjeux locaux.
Recommandation : limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants (collectivités locales, préfectures, DGOM)
Par ailleurs, tous les projets financés ne sont pas contenus dans les CCT. Pour certaines thématiques, des appels à projets sont lancés annuellement par les services de l'État concernés. C'est le cas par exemple pour certains projets cofinancés par l'OFB, l'ADEME ou l'ANS. Un appel à projets comprend en particulier les modalités de cofinancement et le calendrier de versement des aides.
Développer davantage les appels à projets impliquerait une plus grande souplesse dans la définition des projets financés par les CCT, qui n'auraient pas à être définis nécessairement en amont. Ils permettent une instruction au fil de l'eau et le soutien à de nouveaux projets qui n'étaient pas matures au moment de la signature du CCT. Les EPCI ont parfois par exemple plus de facilités à répondre à un appel à projets ciblé qu'à inclure en amont dans le CCT une action spécifique.
Par ailleurs, une partie des difficultés d'engagement des crédits évoquées infra tient au manque de maturité de certains projets pourtant inscrits dans le CCT. Le dispositif d'appels à projets pourrait permettre de prioriser certains projets s'avérant in fine plus mature que ceux initialement envisagés dans le CCT.
En conséquence, il serait avantageux de diminuer le nombre de projets financés inclus dans le CCT initial, d'autant que des contretemps peuvent surgir sur certains projets, notamment lorsqu'ils concernent des infrastructures lourdes, au profit d'un plus grand nombre d'appels à projets. Les préfectures comme les collectivités disposeraient ainsi d'une plus grande souplesse dans l'attribution des financements.
Recommandation : développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation (DGOM, préfectures, collectivités)
III. AMÉLIORER LA MOBILISATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES
A. LAISSER UNE PLACE PLUS IMPORTANTE AUX COLLECTIVITÉS DANS LE PILOTAGE ET L'ORGANISATION DES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION
1. Simplifier la gestion des différentes sources de financement étatique
L'une des principales sources de complexité de la gestion des CCT tient à la multiplicité des acteurs concernés. Pour rappel, dans le cas du CCT 2019-2023, au moins 18 programmes budgétaires, provenant de missions différentes, sont recensés comme source de financements pour les CCT, en plus d'agences de l'État telles que l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'Agence nationale du sport (ANS).
D'une part, les coûts de coordination sont élevés entre les administrations financeuses. C'est la DGOM qui pilote les échanges interministériels sur les projets financés au sein de l'État central. Dans les administrations déconcentrées, de nombreuses directions sont impliquées dans le financement des CCT, ce qui rend difficile la gestion locale des fonds par le préfet, qui n'a pas la main sur l'ensemble des financements.
De plus, une telle organisation complexifie également la gestion des CCT pour les collectivités locales, en particulier pour les EPCI. Il est en effet plus difficile de suivre l'attribution de financements quand un grand nombre d'interlocuteurs est impliqué.
Enfin, une telle organisation empêche la fongibilité des financements entre les différents projets. Or certains d'entre eux s'avèrent finalement trop peu matures ou peuvent être bloqués en raison de contraintes extérieures, comme des difficultés d'acheminement de matières premières, par exemple. Pour autant, il est très difficile de transférer les fonds disponibles des CCT vers d'autres projets, sans rédiger un avenant signé par les ministères concernés et les collectivités. Un tel système est peu robuste à l'ensemble des imprévus pouvant se produire lors de la conduite des projets.
Le ministère chargé des outre-mer permet toutefois à travers la mobilisation des crédits du programme 123 d'avoir une certaine souplesse dans les projets retenus et d'accompagner ceux qui sont jugés prioritaires localement même si aucun programme spécifique n'est identifié ou si les crédits du programme initialement concernés sont insuffisants pour prendre en charge ce projet. Les crédits du programme 123 jouent dans une certaine mesure un rôle de réserve fongible pour compléter les financements de certains projets. Les montants sont toutefois largement insuffisants par rapport aux besoins.
Ainsi, il serait pertinent de créer un programme, dont le responsable serait la DGOM, sur le modèle de l'action 10 du programme 162 « Interventions territoriales de l'État », qui finance des actions interministérielles en faveur de la Guadeloupe. Un tel programme, placé au sein de la mission « Outre-mer », centraliserait une partie des financements dédiés aux CCT pour l'ensemble des territoires, ce qui permettrait une plus grande fongibilité des crédits et faciliterait la gestion administrative et financière des préfectures et des collectivités.
La nécessité d'une plus grande fongibilité entre les différents financements est également évoquée par la Cour des comptes dans le rapport20(*) précité.
Recommandation : créer un programme budgétaire, au sein de la mission « Outre-mer », regroupant une partie des actions régionales et interrégionales comprises dans les contrats de convergence et de transformation, de nature interministérielle et territorialisée (DGOM, direction du budget)
Toutefois, l'inconvénient de cette organisation est que les ministères financeurs auraient moins de contrôle sur les projets financés, alors qu'ils disposent de l'expertise technique. Afin d'éviter cet écueil, il est nécessaire de renforcer le dialogue et la coordination entre les ministères financeurs et le ministère des outre-mer
2. Renforcer la coordination entre les administrations centrales
La DGOM assure la coordination interministérielle des politiques publiques de l'État dans les territoires ultramarins, et plus spécifiquement des CCT. Dans ce cadre, les ministères financeurs rendent compte à la DGOM des objectifs poursuivis ainsi que des crédits engagés pour les opérations incluses dans les CCT.
En particulier, les responsables de programme budgétaire renseignent une maquette budgétaire spécifique aux CCT, qui est complétée par une contribution littéraire, évoquant l'avancée des projets financés sur le terrain. Toutefois, le suivi de la DGOM est encore trop souvent purement budgétaire et insuffisamment qualitatif.
Si les modalités de mise en oeuvre de la gouvernance entre la 1re et la 2e génération de CCT n'ont que peu évolué, le comité interministériel des outre-mer (CIOM) organisé en juillet 2023 a néanmoins permis de générer une dynamique positive autour de la 2e génération de CCT. En effet, les réunions interministérielles de préparation des arbitrages budgétaires ont été conduites dans le même cadre, ce qui a entrainé un engagement plus important de la part des ministères contributeurs. Une organisation plus récurrente de CIOM serait donc bienvenue.
De telles initiatives seraient particulièrement nécessaires s'il était créé un programme regroupant une grande partie des financements relatifs aux CCT, afin de mobiliser les ministères sur ces enjeux.
Recommandation : organiser plus régulièrement un comité interministériel des outre-mer afin de favoriser la mise en oeuvre d'investissements impliquant plusieurs ministères (DGOM)
Par ailleurs, afin de renforcer la coordination entre les ministères, un comité de pilotage a été mis en oeuvre. Ainsi, deux réunions de ce comité de pilotage, présidé par le directeur général des outre-mer et réunissant les administrations centrales mobilisant des cofinancements ainsi que les préfectures ou hauts commissariats ont été organisés en juin 2025, l'un pour les territoires de l'océan pacifique, l'autre pour les territoires des océans indien et atlantique. L'organisation plus fréquente de réunions entre les administrations centrales et déconcentrées est particulièrement bienvenue et doit être poursuivie.
La DGOM organise également des dialogues de gestion tous les trimestres avec les préfectures et les hauts-commissariats sur la mission « Outre-mer » et les CCT en particulier.
De nombreux interlocuteurs ministériels et locaux ont relevé l'importance de réunir l'ensemble des acteurs d'un écosystème lorsque des projets sont mis en oeuvre en outre-mer. L'exemple des financements du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » est à cet égard parlant. L'objectif du ministère du travail est en effet de structurer des filières dans les outre-mer à travers les CCT, pour financer des offres de formation qui permettront d'alimenter un bassin d'emplois spécifique. Tant les services locaux de l'État (France travail etc.) que les collectivités et les acteurs privés doivent donc être consultés pour créer des formations adaptées.
À cette fin, les CCT constituent un outil particulièrement pertinent, puisque les préfectures et surtout les élus locaux impliqués dans la signature des contrats sont les plus à mêmes de connaitre les besoins économiques d'un territoire. Il serait donc préférable que les financements du ministère du travail en faveur des outre-mer continuent de transiter par les CCT. Un niveau élevé de coordination au niveau central d'une part, et surtout local d'autre part, est donc indispensable.
3. Réorganiser la gouvernance locale de conduite d'un projet
Au niveau territorial, la gouvernance des CCT est portée par les préfets et les hauts-commissaires. La DGOM n'entretient d'ailleurs pas de lien direct avec les acteurs financés dont les interlocuteurs naturels sont les services de l'État déconcentrés et les collectivités locales. À noter, que concernant les financements des établissements scolaires du second degré à Mayotte, la coordination des financements est exercée par le rectorat, et non par la préfecture.
Les préfets sont chargés en particulier de :
- négocier le CCT avec l'ensemble des collectivités territoriales et les partenaires financiers ;
- faire remonter les projets susceptibles d'être inscrits dans les futurs CCT tant auprès de la DGOM que des ministères financeurs ;
- arbitrer quand ils en ont la possibilité entre les projets, notamment dans le cadre du programme 123, qui est le seul à être véritablement fongible ;
- rédiger le contrat et ses annexes ;
- organiser la communication autour de ces CCT et de leurs réalisations ;
- mettre en oeuvre avec les acteurs locaux les opérations retenues au titre du CCT et rendre compte de l'état d'avancement et d'achèvement des opérations.
Des instances de comitologie locales sont ainsi prévues par chaque CCT pour structurer le suivi et l'exécution budgétaire des projets et pour permettre d'identifier les avancées et difficultés éventuelles dans leur mise en oeuvre.
Des comités de pilotage ou de programmation selon les territoires sont organisés régulièrement et a minima une à deux fois par an. Le préfet ou le haut-commissaire réunit alors l'ensemble des cofinanceurs. C'est lors de ces réunions que peuvent être ajustés certains projets afin de prendre en compte les enjeux locaux comme l'ajustement du calendrier de réalisation.
Par ailleurs, dans certains territoires comme par exemple en Guadeloupe, des comités techniques sont organisés 3 à 4 fois par an sous l'égide du service général des affaires régionales (SGAR) de la préfecture, et réunissent les autres services de l'État, les opérateurs de l'État cofinanceurs et les directeurs généraux des services des collectivités concernées par les CCT.
Pour autant, la réunion de ces instances parait encore insuffisante à nombre d'acteurs locaux. La concertation entre les acteurs doit être plus régulière, à tous les niveaux :
- en Guyane par exemple, les réunions entre le préfet, la collectivité territoriale de Guyane et les EPCI ne sont organisées qu'une fois par an, au moins dans le cadre des CCT de première génération (2019-2023). Or les maquettes budgétaires prévues dans le cadre des CCT ne correspondent parfois plus aux évolutions des projets. Il serait utile de discuter plus fréquemment la répartition des financements entre les différents acteurs ainsi que le calendrier de décaissement des crédits. Par ailleurs, le processus de sélection des projets, dans le cadre de la négociation des CCT, n'est pas suffisamment transparent pour les collectivités, en particulier concernant les critères d'évaluation de la maturité d'un projet. Des réunions plus régulières à haut niveau entre les services déconcentrés et les élus doivent être organisées pour permettre un véritable portage politique des projets, indispensable à leur avancée.
- au niveau technique, la communication entre les porteurs des projets doit également devenir plus récurrente. En Guadeloupe par exemple, dans le cadre du suivi mis en oeuvre par la cellule ingénierie de la préfecture (voir supra), des réunions mensuelles sont organisées concernant la mobilisation des financements relatifs au fonds vert et aux CCT. Ces réunions permettent un regard croisé de l'ensemble des financeurs et se sont avérées très utiles en Guadeloupe. Une telle initiative gagnerait à être étendue à l'ensemble des territoires ultramarins. Elle permettrait également d'améliorer la capacité décisionnelle des instances du plus haut niveau hiérarchique, aujourd'hui parfois bloquées par le manque de communication au niveau technique.
Par ailleurs, afin de faciliter l'organisation de telles réunions notamment au niveau technique, il serait utile qu'un chef de file soit désigné sur chaque projet dès sa sélection au sein des CCT, alors qu'actuellement ce n'est pas systématiquement le cas. Il serait également pertinent qu'un acteur soit chargé spécifiquement du suivi du décaissement des financements du programme de l'État concerné, afin d'assurer une gestion fine de l'exécution des crédits. Les préfectures ne sont en effet pas véritablement en mesure d'assurer un suivi budgétaire précis pour les programmes relevant d'autres ministères.
Recommandation : définir un chef de file clair sur chacun des projets lorsqu'ils réunissent plusieurs financeurs, et ce dès l'intégration du projet dans un financement des CCT et organiser des réunions de suivi plus récurrentes (préfectures, ministères, collectivités)
Comme le relèvent nombre d'acteurs, le dispositif de contractualisation est très lourd en termes de gestion administrative au niveau local. Les collectivités locales mettent en exergue en particulier leurs difficultés à connaitre et comprendre l'évolution des projets, qui ont souvent de multiples co-financeurs (ministères, ADEME, OFB etc.).
La communication autour des CCT est assurée par le préfet, sauf pour la signature du contrat où elle relève des directions centrales. Dans le cadre des appels à projets, la communication se fait classiquement à travers l'information de tous les partenaires locaux par un avis d'appel à projet et via une information plus standard sur les sites d'information des services de l'État déconcentrés.
Une amélioration de la communication autour des projets portés par les CCT serait nécessaire afin notamment de mieux informer les porteurs de projets des exigences des CCT (processus de sélection des projets, dépenses éligibles etc.). Selon certains acteurs, la communication autour du plan de relance avait été efficace et pourrait servir de modèle pour améliorer la communication autour des CCT.
En particulier, une amélioration des outils informatiques parait indispensable. La mise en oeuvre des CCT n'a en effet pas entraîné de développements informatiques particuliers par le ministère des Outre-mer. Le suivi des CPER, précédant les CCT, était assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL). La DGOM a donc dû rapidement s'adapter et a développé des suivis financiers essentiellement via des tableurs « excel ». Or un tel outil présente des inconvénients majeurs. Le risque d'erreurs est en effet important. Par ailleurs, il serait beaucoup plus efficient de développer un outil commun de gestion à l'ensemble des financeurs, y compris les collectivités, permettant de suivre en temps réel l'évolution du projet et des décaissements de crédits.
La DGOM a pour ambition de développer un tel outil, dans le cadre de la seconde génération des CCT. Après avoir dans un premier temps souhaité s'associer au logiciel informatique développé par la DGCL, nommé « SIT Territorial », elle a finalement choisi de se positionner sur une autre solution intitulée « Grist », pour des raisons techniques. Il s'agit d'un tableau partagé entre les différents utilisateurs, y compris les collectivités, qui devrait permettre de faciliter la gestion du suivi des projets des CCT.
Il pourrait être envisagé d'aller plus loin dans la rationalisation des outils informatiques utilisés dans le cadre des CCT. En particulier, un logiciel permettant le dépôt d'un dossier unique par projet sur une plateforme dématérialisée, dans le cadre notamment de la négociation des CCT, pourrait être bienvenue, dans une logique de simplification des guichets.
Globalement, une plus grande implication des collectivités locales dans le processus de mise en oeuvre des CCT est indispensable. Certains acteurs locaux ont même mentionné le caractère « dirigiste » de l'État, alors que les CCT constituent une opération contractuelle. Les élus locaux sont pourtant les mieux placés, à la fois pour identifier les besoins du terrain et pour faire avancer les projets une fois sélectionnés.
B. MOBILISER DE FAÇON COHÉRENTE L'ENSEMBLE DES OUTILS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL
1. Renforcer la valorisation des crédits des CCT
Les projets financés par les CCT ne sont pas financés uniquement par cet outil contractuel. D'autres outils, tels que les fonds européens par exemple, peuvent être mobilisés par les administrations pour compléter le plan de financement. Les apports budgétaires extérieurs peuvent être inscrits dans les CCT comme des « crédits valorisés ». Ils ne font pas l'objet d'une contractualisation mais sont tout de même mentionnés, afin de démontrer la complétude des plans de financements des projets retenus dans le cadre des CCT.
Ainsi, au total, dans les CCT de deuxième génération (2024-2027), près de 4,9 milliards d'euros de crédits valorisés sont mentionnés.
Provenance des crédits valorisés
indiqués dans chaque CCT
de deuxième génération
(2024-2027)
(en euros)
Source : commission des finances d'après la DGOM
Les crédits contractualisés représentent ainsi les deux-tiers des crédits valorisés mentionnés dans les CCT. En particulier, ils représentent seulement 30,2 % des crédits valorisés en Guadeloupe et 38,4 % des crédits en Martinique. À l'inverse, la Guyane compte pratiquement autant de crédits contractualisés que de crédits valorisés dans le CCT. Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin indiquent entre 2,8 et 4,8 fois plus de crédits contractualisés que de crédits valorisés.
Toutefois, ces résultats sont à considérer avec précaution car il est très possible que certains CCT ne synthétisent pas l'intégralité des crédits supplémentaires pouvant servir à financer les projets mentionnés par les CCT et ne faisant pour autant pas l'objet d'une contractualisation.
Part des crédits contractualisés par rapport aux crédits valorisés pour chaque CCT de deuxième génération (2024-2027)
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la DGOM
Pratiquement la moitié (47,4 %) des crédits valorisés provient d'autres programmes de l'État central, en particulier de la mission « Justice » à hauteur de 430 millions d'euros, du Ségur de la santé pour un montant de 256 millions d'euros, et d'autres actions du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », telles que l'action 1 « Ligne budgétaire unique » qui finance le logement social en outre-mer, pour un montant total de 694 millions d'euros.
Les programmes régionaux des fonds européens représentent aussi 19,5 % des crédits valorisés. Ils sont essentiellement mobilisés par les régions ou collectivités territoriales uniques (en Guyane et en Martinique).
Provenance des crédits valorisés dans les CCT de deuxième génération (2024-2027)
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après la DGOM
L'ampleur des montants de crédits valorisés mentionnés dans les CCT illustre l'importance de mobiliser des sources variées de financement au vu des investissements à réaliser. Cet effort doit être poursuivi, dans une logique de priorisation des investissements les plus essentiels. Il serait dommageable de diluer les subventions disponibles entre un trop grand nombre de projets, au risque d'aboutir à une paralysie dans l'avancée de certains travaux.
Il serait dommageable que des projets identifiés comme prioritaires par les CCT ne bénéficient pas de l'intégralité des subventions disponibles. En effet, ils ont fait l'objet d'une négociation entre l'État et les acteurs locaux, et sont donc susceptibles de présenter le plus d'importance pour les populations. Le CCT est un cadre de convergence de moyens et son efficacité repose sur la capacité des acteurs locaux à activer de manière complémentaire l'ensemble des dispositifs disponibles. L'outil de la contractualisation doit permettre de mieux cibler les projets devant faire l'objet d'une subvention d'investissement.
Certains acteurs ont évoqué l'effet d'éviction sur les CCT qu'avait généré la mise en oeuvre du plan de relance. L'inscription comme crédits valorisés des autres sources de financement de l'investissement local permet d'éviter un tel écueil.
D'autres dispositifs de l'État, qui ne sont pas nécessairement mentionnés dans les CCT, complètent le soutien à l'investissement local ultramarin. Le ministère de l'éducation nationale subventionne par exemple les transports scolaires en outre-mer, à hauteur de 3,3 millions d'euros en 2025 en AE et en CP, notamment en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon (dans le cadre de cofinancements avec les collectivités).
En particulier, la mobilisation des fonds européens constitue un enjeu important, notamment pour les collectivités locales qui ont un budget d'investissement extrêmement contraint.
La question de l'alignement de la temporalité des CCT avec le calendrier des fonds européens peut d'ailleurs se poser. L'actuel cadre financier pluriannuel (CFP) européen a été conclu pour la période 2021-2027. La nouvelle génération de contrats de convergence et de transformation, prévue pour la période 2024-2027, est donc compatible avec ce calendrier. Un important travail a d'ailleurs été fourni par les ministères et les collectivités afin d'aligner la durée des contrats de développement de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie avec celle des CCT de deuxième génération, compatible avec le CFP européen à venir.
Le prochain cadre financier pluriannuel portera sur la période 2028-2034. L'avantage d'aligner la temporalité des futurs contrats de convergence et de transformation est, d'une part, de simplifier les schémas de financement des collectivités qui ont recours aux fonds européens, et d'autre part, d'étendre la durée prévisionnelle des investissements, ce qui au vu de l'importance de certains projets d'infrastructures (réseaux d'eau etc.), peut se justifier.
En effet, de nombreux projets financés par les CCT ne peuvent être achevés en 3 ou 4 ans, notamment les projets de construction d'infrastructures. Ainsi, par exemple, la reconstruction parasismique du lycée Gerty Archimède en Guadeloupe a-t-elle été réinscrite dans les CCT de deuxième génération, faute d'avoir été achevée entre 2019 et 2023. La crise sanitaire a par ailleurs retardé de nombreux projets immobiliers. La phase d'étude peut être très longue, en particulier dans le cas des régions à fort risque sismique.
Le cabinet du Premier ministre Bayrou aurait ainsi arbitré en faveur de la prolongation du CCT de Mayotte jusqu'en 2029, au moins pour le financement des établissements scolaires du second degré, en préservant l'enveloppe budgétaire. Cette décision vise à mieux lisser dans le temps la réalisation des objectifs stratégiques du programme, en tenant compte à la fois des capacités d'engagement et de paiement de l'État, et de la capacité effective à conduire les opérations de construction et de reconstruction.
Toutefois, un contrat de convergence et de transformation conclu sur 6 ans parait extrêmement long, surtout si l'essentiel des projets financés sont décidés en amont. En cas de crise ou de changement de priorité politique, le cadre défini serait particulièrement rigide. Il serait dans ce cas important de laisser une place plus importante aux appels à projets, comme recommandé infra, afin de permettre de la souplesse dans les investissements.
2. Le FEI, des recommandations du rapport de 2022 fait au nom de la commission des finances à mettre en oeuvre
Le FEI constitue un outil de soutien à l'investissement local ultramarin complémentaire aux CCT, qui doit être préservé. En effet, le fonctionnement par appel à projets permet justement une certaine souplesse dans la répartition des subventions, contrairement aux CCT. Certains projets non inclus dans les CCT peuvent ainsi être subventionnés.
La double particularité du FEI réside dans la possibilité pour l'État de soutenir des projets portés par l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines, quel que soit leur statut juridique, et d'être un outil complémentaire aux autres dispositifs de soutien à l'investissement (nationaux et européens).
La circulaire ministérielle adressée chaque année aux représentants de l'État dans les territoires ultramarins précise, à cet égard, aux préfets et aux hauts-commissaires que « doivent être privilégiées les opérations permettant un effet levier sur l'octroi d'autres financements (bancaires ou européens) ou qui ne pourraient être réalisées sans l'attribution de FEI ».
Ainsi, certains crédits du FEI sont valorisés au titre des projets des CCT. C'est le cas en particulier en Guadeloupe de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) accélérée en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement qui mobilise environ 7 millions d'euros de FEI, ainsi que des opérations du plan séisme Antilles. De même, à Mayotte, les opérations de construction scolaire du premier degré valorisent les crédits du FEI scolaire à hauteur de 20 millions d'euros par an.
Toutefois, comme l'indiquait le rapport21(*) fait au nom de la commission des finances sur le fonds exceptionnel d'investissement et publié en juin 2022, le dispositif du FEI peut être amélioré afin de garantir la pertinence de l'attribution des subventions.
Ainsi, comme mentionné infra, il est souhaitable que les priorités de financement du FEI recoupent celles définies dans les CCT, qui ont fait l'objet d'une négociation entre l'État et les collectivités et sont donc plus susceptibles de répondre aux enjeux locaux. L'objectif n'est pas de limiter les financements du FEI aux projets compris dans les CCT, l'objectif du FEI étant justement de pouvoir subventionner d'autres projets. Les co-financements avec d'autres crédits de l'État doivent être limités. Toutefois, les priorités financées par le FEI doivent impérativement reprendre celles du plan de convergence, puisqu'elles ont été établies par la négociation avec les collectivités.
Recommandation : concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence (DGOM, préfectures, hauts-commissariats)
Une telle recommandation reprend une préconisation déjà émise dans le rapport précité, qui prescrivait de « limiter strictement le champ des projets sélectionnés aux priorités retenues dans chaque territoire » (recommandation n° 3).
Actuellement, les priorités du FEI figurant dans les circulaires de programmation ne correspondent pas toutes aux axes d'importance présentés dans les plans de convergence. Pour 2025, la circulaire adressée aux préfectures fixe les quatre priorités d'investissement suivantes pour l'utilisation du FEI :
- les investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ;
- les opérations du plan séisme Antilles ;
- les investissements de lutte contre les sargasses ;
- les opérations s'intégrant dans le plan de rénovation des écoles primaires.
En particulier, la lutte contre les sargasses n'est pas l'axe le plus prioritaire identifié dans les CCT. Dans la première génération des CCT, seul un projet de contribution à la collecte et à la valorisation des Sargasses a été inscrit, pour un montant de 1,08 million d'euros.
Les rapporteurs se félicitent en revanche que la recommandation n° 2 du rapport précité, qui préconisait de « limiter à quatre le nombre des priorités retenues au niveau local afin d'éviter un phénomène de dispersion tout en s'adaptant au mieux aux besoins des territoires » soit appliquée.
Il est toutefois regrettable qu'une partie des crédits du FEI demeure fléchée sur les constructions scolaires de Mayotte, contrairement à la recommandation n° 1 du rapport précité. Dans ce domaine, les besoins sont considérables et le FEI « scolaire » est devenu une pratique depuis 2017. Il n'en demeure pas moins en contradiction avec le principe de limitation des cofinancements entre le FEI et les autres crédits du budget de l'État. Il est également révélateur des besoins importants dans ce domaine. Il serait préférable que les crédits alloués par le FEI aux constructions scolaires de Mayotte soient budgétés dans l'action 6 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».
D'autres recommandations du rapport précité n'ont pas été mises en oeuvre, telles la recommandation n° 8 préconisant « d'évaluer, ex-post, l'impact socio-économique des projets financés par le FEI » et la recommandation n° 9, visant à « déterminer une nouvelle trajectoire pluriannuelle pour la période 2023-2027 en adéquation avec les besoins d'investissement des territoires d'outre-mer. » Il serait ainsi pertinent d'évaluer l'impact concret qu'ont eu les financements du FEI sur les territoires, afin d'en dresser le bilan. Par ailleurs, dans le cadre d'investissements structurants, une programmation pluriannuelle, même indicative, permet de faciliter le lancement de projets nécessitant des montants de crédits élevés.
Il est ainsi souhaitable que l'ensemble des recommandations émises dans le cadre du rapport précité soient mises en oeuvre.
Recommandation : mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés (DGOM)
3. La bonification des prêts accordés par l'AFD, un dispositif pertinent à conserver pour compléter d'autres financements
La bonification des prêts de l'AFD, portée par l'action 9 « Appui à l'accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », s'articule comme un levier complémentaire pour financer les projets structurants identifiés dans les CCT.
À titre d'exemple, en Martinique, le projet de réhabilitation des réseaux d'eau potable porté par la Collectivité territoriale et inscrit dans le cadre du contrat de convergence 2019-2022 a été soutenu par un prêt bonifié de l'AFD.
L'objectif est de garantir la complémentarité et la coordination entre ces différents outils de développement des territoires.
Le dispositif de prêt bonifié permet en particulier :
- d'abaisser le coût du financement pour les collectivités, en particulier les plus fragiles financièrement, ce qui favorise le déclenchement du projet,
- d'offrir une souplesse d'intervention : les prêts peuvent couvrir une large gamme de secteurs (eau, routes, écoles, transition énergétique, numérique...), en lien avec les stratégies locales et les CCT ;
- de s'inscrire dans une logique d'ingénierie financière mixte, en complément d'autres dispositifs (FEI, dotations budgétaires, fonds européens...).
La collaboration étroite entre la DGOM et l'AFD permet un ciblage efficace des projets à forte utilité publique. La priorisation des projets financés via les CCT, définis par une procédure de négociation laissant une large place aux projets portés par les collectivités, permettrait de garantir l'efficience et la pertinence de l'attribution des prêts de l'AFD.
Recommandation : renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation (Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM)
Toutefois, l'accès au dispositif reste inégal selon les territoires, du fait de disparités dans les capacités techniques ou financières des collectivités à construire des projets viables. Certaines petites communes éprouvent des difficultés à recourir à l'emprunt, même bonifié, du fait de leur faible marge de manoeuvre budgétaire.
La bonification reste un soutien indirect à l'investissement, conditionné à un recours au crédit, ce qui n'est pas toujours adapté aux besoins urgents ou aux territoires en crise.
La préservation de cette enveloppe est essentielle pour conserver un volume conséquent de financement à tarif préférentiel pour les projets à impact des collectivités. Au-delà du financement, les collectivités bénéficient aussi de l'accompagnement de l'AFD qui constitue une réelle plus-value par rapport aux offres des banques commerciales.
En revanche, aucun nouvel abondement n'a été prévu depuis 2023 pour l'initiative Kiwa, qui a été lancée par l'AFD en mars 2020 pour les collectivités du Pacifique. Elle vise à faciliter l'accès aux financements de porteurs de projets (incluant les collectivités locales) en lien avec le développement de solutions fondées sur la nature (SFN), à travers des subventions ou de l'assistance technique, avec pour objectif de lutter contre les effets du changement climatique.
Cependant, au début de l'été 2022, l'intégralité des AE issues de la contribution initiale du ministère chargé des outre-mer avait été consommée, excluant de fait la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie des prochains appels à projets. Ainsi, la LFI pour 2023 a prévu un abondement complémentaire au bénéfice de l'Initiative Kiwa à hauteur de 4 millions d'euros en AE avec un décaissement de CP sur deux ans afin de compléter la contribution initiale intégralement consommée. Il est regrettable que l'État ne soutienne pas davantage cette initiative, qui s'est révélée utile.
C. RENFORCER L'INGÉNIERIE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Les difficultés de mobilisation des crédits de soutien à l'investissement liées partiellement aux faiblesses de l'ingénierie locale
Comme mentionné infra, une partie des freins à l'investissement local ultramarin est liée au manque d'ingénierie locale des collectivités.
D'une part, les difficultés de l'ingénierie locale empêchent de faire la demande de financements pour des investissements nécessaires. En effet, que ce soit dans le cadre du processus de contractualisation impliquant de présenter un plan de financement abouti pour obtenir l'inscription du projet dans le CCT, ou dans celui de l'appel à projets organisé pour bénéficier du FEI ou même de l'octroi des prêts bonifiés par l'AFD, des compétences très spécifiques en gestion administrative et financière sont nécessaires. Les petites communes en particulier auraient probablement de grandes difficultés à devenir cosignataires des CCT, surtout au vu des délais de négociation très resserrés des deux dernières générations de contrats.
D'autre part, la faiblesse de l'ingénierie locale constitue un frein important à la conduite et à l'achèvement des projets financés, en particulier lorsqu'il s'agit d'infrastructures lourdes. Des compétences en termes de droit de l'urbanisme par exemple sont indispensables, de même qu'une connaissance des processus permettant d'obtenir des études de faisabilité de bonne qualité.
2. Faciliter le recours aux dispositifs de soutien à l'ingénierie locale
Les aspects liés à l'ingénierie locale sont ainsi essentiels pour soutenir l'investissement local ultramarin. Ils ne sont par exemple pas mentionnés dans les CCT. Toutefois, ceux-ci n'ont pas forcément vocation à soutenir les collectivités de cette manière, alors qu'il existe déjà une multitude d'acteurs apportant un soutien à l'ingénierie locale.
Ainsi, comme mentionné infra, le CEREMA, l'AFD, la Banque des Territoires ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) fournissent un service d'ingénierie locale, allant parfois jusqu'à la mise à disposition de personnels avec des compétences techniques.
Devant la multiplicité des dispositifs existants, il est difficile pour les collectivités les plus en difficulté de faire appel à l'acteur le plus adapté. En ce sens, la mise en place d'un guichet unique d'ingénierie, ou d'une « cellule ingénierie », comme c'est le cas par exemple dans la préfecture de Guadeloupe, peut s'avérer très utile. L'objectif est de centraliser à la préfecture toutes les demandes d'aide en ingénierie locale et de les transmettre aux acteurs compétents pour le compte des collectivités.
Un tel dispositif permet à la fois de :
- renforcer la coordination entre les différents dispositifs de financement pour en renforcer la lisibilité auprès porteurs, notamment les EPCI ;
- soutenir les porteurs de projet pour qu'ils engagent effectivement les crédits prévus et les sensibiliser à la nécessité de remonter des éléments relatifs aux demandes d'engagement et de paiement.
Un tel dispositif s'est révélé très pertinent en Guadeloupe en particulier. En tout état de cause, sa mise en oeuvre dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer serait très bienvenue.
Recommandation : créer un guichet unique de l'ingénierie publique pour centraliser les demandes des collectivités locales aux différents partenaires et intégrer des aspects de soutien à l'ingénierie locale dans les contrats de convergence et de transformation, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs (DGOM, préfecture, collectivités)
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence de M. Stéphane Sautarel, vice-président, la commission a entendu une communication de MM. Stéphane Fouassin et Georges Patient, apporteurs spéciaux, sur le soutien de l'État à l'investissement des collectivités ultramarines.
M. Stéphane Sautarel, président. - Nous allons entendre maintenant une communication de MM. Stéphane Fouassin et Georges Patient, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Outre-mer », sur le soutien de l'État à l'investissement des collectivités ultramarines.
M. Stéphane Fouassin, rapporteur spécial. - Cette année, Georges Patient et moi-même avons souhaité conduire une mission de contrôle sur les dispositifs de soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales ultramarines, qui sont propres à ces territoires. Je précise d'emblée que notre mission ne portait pas sur l'ensemble des outils mobilisés par l'État pour venir en aide à ces collectivités, comme la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou le fonds vert - ils ne relèvent pas de notre mission -, mais bien sur les dispositifs transitant par la mission « Outre-mer ». À l'issue de ce contrôle, nous proposons onze recommandations contribuant à l'amélioration des dispositifs en vigueur.
En préambule, je tiens à rappeler que les collectivités locales ultramarines sont soumises à des besoins très importants en matière d'investissement, besoins auxquels elles ne peuvent répondre seules. Les dépenses d'investissement représentent ainsi, dans les départements et régions d'outre-mer, 1 519 euros par habitant, alors qu'elles ne s'élèvent qu'à 1 155 euros par habitant dans l'Hexagone. Plus précisément, les régions dépensent 822,5 euros par habitant, les départements et le bloc communal respectivement 75 euros et 622 euros par habitant. Cet effort significatif vise à concrétiser la convergence économique des territoires ultramarins, dont le niveau de richesse n'a pas encore rattrapé celui de l'Hexagone.
Pour autant, les recettes d'investissement des collectivités sont insuffisantes pour réaliser l'ensemble des infrastructures nécessaires. Les dépenses de fonctionnement sont en effet plus contraintes que dans l'Hexagone, en raison notamment du coût de la vie et des charges de personnel, ces dernières étant particulièrement élevées en vertu des suppléments de rémunération que perçoivent les fonctionnaires ultramarins. En conséquence, le taux d'épargne brut de ces collectivités est significativement plus faible que dans le reste de la France : celui du bloc communal s'élève ainsi à 11,7 %, contre 16,3 % dans l'Hexagone.
M. Georges Patient, rapporteur spécial. - L'État consacre une partie de ses ressources à soutenir l'investissement des collectivités locales ultramarines : selon nos calculs, il était question de 862 millions d'euros en 2023. Les dotations d'investissement, telles que la DSIL ou encore la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), qui ne sont pas spécifiques aux outre-mer, représentent 8 % de ces dépenses, soit une part minoritaire de l'effort. En réalité, 62 % du soutien de l'État à l'investissement local ultramarin transite par des outils propres à ces territoires périphériques.
Par ailleurs, l'État dispose du fonds exceptionnel d'investissement (FEI), qui lui permet de soutenir les personnes publiques effectuant des investissements dans des équipements publics collectifs, c'est-à-dire les collectivités locales pour l'essentiel. En 2025, la dotation du FEI atteint 102 millions d'euros, un montant en hausse par rapport à 2017, mais en nette baisse par rapport à l'an dernier - la dotation s'élevait alors à 160 millions d'euros.
L'action n° 09 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » permet de financer une bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) aux collectivités ultramarines pour des projets répondant à des critères précis en matière sociale et environnementale. Il s'agit d'un outil particulièrement efficace : à partir d'un budget de bonification des prêts de 38,1 millions d'euros en 2024, ce sont ainsi 542,7 millions d'euros qui ont été prêtés aux collectivités d'outre-mer. La limite de ce dispositif tient bien entendu à ce que certaines collectivités ne disposent pas d'une situation financière suffisamment favorable pour recourir à ce type d'instrument financier, lequel ne peut pas constituer l'unique soutien de l'État à l'investissement local ultramarin.
Enfin, les contrats de convergence et de transformation (CCT) représentent 45 % des dépenses de soutien de l'État aux collectivités ultramarines. Dans les territoires d'outre-mer, les CCT ont succédé aux contrats de plan État-région qui avaient été signés pour la période 2015-2020. Une première génération de CCT a été mise en oeuvre entre 2019 et 2023, pour un montant total de 4 milliards d'euros, hors contrat de développement de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième génération de ces contrats de convergence et de transformation, qui porte sur la période allant de 2024 à 2027, représente un budget global de 3,23 milliards d'euros, dont 1,89 milliard d'euros de l'État. Les collectivités ont financé les CCT à hauteur de 37,4 % entre 2019 et 2023, et le feront à hauteur de 40,9 % entre 2024 et 2027. Cette contribution soutenue des collectivités à l'effort de contractualisation est à saluer.
Les financements de l'État en faveur des CCT proviennent de dix-huit programmes budgétaires différents, dont le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » - celui-ci représente 40 % du total de ces financements -, ou encore le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » qui finance les établissements du second degré à Mayotte.
Les CCT reposent sur des priorités en matière d'investissement qui doivent donc correspondre à un plan de convergence établi en concertation entre État et collectivités, ainsi qu'à des projets d'infrastructures clairs et à une maquette financière bien précise.
M. Stéphane Fouassin, rapporteur spécial. - Si ce soutien de l'État à l'investissement local ultramarin est à saluer, il a tout de même des défauts qui doivent être corrigés.
Tout d'abord, la répartition géographique des investissements semble déséquilibrée. Ainsi, les Guyanais ne percevront, entre 2024 et 2027, que 1 949 euros par habitant via les contrats de convergence et de transformation, contre, par exemple, 12 832 euros à Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 3 649 euros par habitant à Saint-Martin. Une telle répartition pose question.
Par ailleurs, les taux d'engagement et de consommation des crédits consacrés à l'investissement local ultramarin pourraient être plus élevés. Ainsi, le taux d'engagement des crédits des CCT atteint 77 % fin 2023 : un tel effort est certes honorable, mais il pourrait être encore plus important. Le taux de consommation des crédits, quant à lui, est de 48,6 %. Plus particulièrement, la Martinique et la Polynésie française ont rencontré des difficultés pour engager et consommer l'ensemble des crédits dédiés à l'investissement dans ces contrats de convergence et de transformation. Aussi, l'ensemble des projets contractualisés dans le cadre des CCT n'ont pu être réalisés : sur 801 projets inscrits, seuls 63 ont été achevés.
Des obstacles conjoncturels - je pense notamment à la crise sanitaire - expliquent ces difficultés. De plus, le plan de relance a créé un effet d'éviction au détriment des crédits des CCT. Certaines filières, notamment le secteur du BTP, ont de ce fait rencontré des difficultés en matière d'approvisionnement.
Le dispositif de contractualisation en outre-mer est également confronté à des difficultés plus structurelles. Ainsi, le très grand nombre d'opérations engagées a engendré d'importants problèmes en matière de gestion administrative ; l'efficacité du dispositif pâtit en outre de l'existence d'une pluralité de sources de financement, partagées entre dix-huit programmes budgétaires, ainsi que de celle d'une multitude d'agences de l'État - je pense notamment à l'Office français de la biodiversité (OFB) ou à l'Agence nationale du sport (ANS). Le manque de maturité de certains projets a aussi pu faire obstacle au décaissement des fonds.
De nombreuses personnes que nous avons auditionnées ont par ailleurs relevé l'existence de problèmes liés au manque d'ingénierie locale.
M. Georges Patient, rapporteur spécial. - Un certain nombre d'améliorations peuvent être apportées aux dispositifs de soutien de l'État dédiés à l'investissement local ultramarin. Il est fondamental d'impliquer davantage les collectivités locales dans les décisions d'octroyer des subventions d'investissement.
Dans certaines collectivités comme la Guyane ou les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, aucun plan de convergence n'a été défini, alors même que ce sont des plans de cette nature qui doivent servir de base à l'élaboration des contrats de convergence et de transformation. En pratique, pour négocier chaque CCT, des mandats de négociation comportant déjà une liste très précise de projets, définie par les différents ministères lors d'une réunion interministérielle, sont transmis aux préfets peu avant la date butoir de signature des contrats.
Une très faible marge de manoeuvre est laissée aux collectivités pour s'écarter du mandat de négociation. Les élus locaux sont pourtant les mieux placés pour sélectionner les projets les plus importants pour le développement de leurs territoires. Il serait souhaitable de leur laisser une plus grande place dans la négociation des projets financés via les CCT.
Par ailleurs, le fonds exceptionnel d'investissement, tout comme les prêts de l'AFD bonifiés par l'État, devraient servir à financer prioritairement des projets répondant aux priorités d'investissement identifiées par les élus locaux lors de la rédaction des projets de convergence dans chaque territoire. Ainsi, les projets financés pourraient davantage répondre aux attentes locales.
Dans le cadre des CCT, la multiplicité des financements constitue une source de complication administrative supplémentaire. Elle limite la fongibilité entre les crédits afférents aux divers projets, ce qui diminue les marges de manoeuvre des préfectures. Ces dernières ont actuellement recours aux crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » pour compléter les financements manquants aux projets qui se révèlent être matures plus rapidement que prévu. Il pourrait donc être pertinent de réunir certains des financements des CCT en un programme budgétaire unique au sein de la mission « Outre-mer », lequel serait à la main des préfectures, et ce afin de permettre une plus grande fongibilité des crédits.
En outre, l'organisation de réunions plus fréquentes au niveau local entre préfectures et collectivités contribuerait à améliorer le suivi des projets.
Enfin, l'amélioration de la consommation des crédits en faveur de l'investissement local ultramarin implique de rationaliser davantage les aides à l'ingénierie locale. Actuellement, un grand nombre d'entités - je pense en particulier à la Banque des territoires, à l'Agence française de développement, ou encore au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) - disposent de dispositifs de soutien à ce type d'ingénierie. Il peut s'avérer complexe, en particulier pour les établissements publics de coopération intercommunale, de faire appel à l'un ou l'autre de ces dispositifs. Créer un guichet unique d'ingénierie, centralisé par la préfecture, permettrait aux collectivités de recourir plus facilement à l'un de ces outils. Un tel dispositif a déjà été déployé avec succès en Guadeloupe, pour ne citer que cet exemple.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nos collègues pointent du doigt la récurrence des problèmes rencontrés par les territoires ultramarins, la difficulté à y atteindre les objectifs fixés, en insistant sur le trop faible niveau de sollicitation de l'échelon local. C'est un constat que nous faisons, hélas, trop souvent et dans de trop nombreuses circonstances.
Nos collègues indiquent notamment que seuls 63 des 801 projets inscrits dans les CCT se sont concrétisés entre 2019 et 2023 : cela me rappelle les écarts que l'on a pu observer dans certains départements, en Meurthe-et-Moselle en particulier, entre crédits de paiement (CP) réellement consommés et autorisations d'engagement votées.
Ils réclament une simplification des outils utilisés par l'État pour soutenir les territoires : c'est un objectif qui rejoint les conclusions du rapport réalisé par notre collègue Christine Lavarde au nom de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, présidée par Pierre Barros. En outre-mer comme dans l'Hexagone, l'existence d'une multitude d'acteurs complique l'élaboration des projets et ralentit la mise en oeuvre des chantiers engagés. C'est la raison pour laquelle je suis, moi aussi, en faveur d'une rationalisation du soutien de l'État à l'investissement ultramarin.
Je salue l'approche des rapporteurs spéciaux : il me semble primordial aujourd'hui, dans le contexte de crise budgétaire que nous connaissons, de préconiser avant toute chose une meilleure consommation des crédits, et ce afin d'assurer une plus grande efficacité de la coopération entre État et collectivités et de rétablir la confiance à l'égard des décideurs publics.
M. Stéphane Sautarel, président. - Je ne peux à mon tour que souscrire à l'analyse de nos deux rapporteurs spéciaux.
M. Stéphane Fouassin, rapporteur spécial. - J'insiste sur le fait que l'une des raisons pour lesquelles le taux de concrétisation des projets est aussi faible réside dans la lourdeur des projets eux-mêmes, qu'il s'agisse de chantiers de rénovation de bâtiments ou de la réalisation d'infrastructures d'importance. J'espère sincèrement que la situation se sera sensiblement améliorée l'an prochain.
Mme Micheline Jacques, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. - S'agissant des territoires ultramarins, il importe moins de parler des dépenses que d'évoquer la façon dont les crédits sont consommés. Il faut faire évoluer la manière de dépenser dans nos territoires et mieux accompagner les collectivités ultramarines dans leurs projets d'investissement.
En outre-mer, les frais de fonctionnement sont souvent beaucoup trop élevés et, par suite, empêchent tout investissement significatif. Cela handicape les collectivités, qui ne peuvent pas engager seules des projets pourtant essentiels aux territoires et aux habitants.
Par ailleurs, nous constatons en outre-mer, à l'exception notable de La Réunion, un trop faible recours aux crédits européens. Il s'agit pourtant d'une option intéressante dans le contexte budgétaire actuel pour inscrire les territoires ultramarins dans une dynamique de développement et y favoriser l'emploi.
M. Jean-François Rapin. - Permettez-moi de rappeler que Georges Patient et moi-même avons commis un rapport, au nom de la commission des affaires européennes du Sénat, sur cette problématique consternante du manque de mobilisation des crédits européens en outre-mer.
Il manque à nos territoires ultramarins une véritable reconnaissance des institutions européennes, du moins dans les textes. L'inscription de la spécificité de ces territoires permettra, si elle est correctement anticipée, un meilleur accès aux fonds européens. Sauf exception, le recours à ces crédits est actuellement très insuffisant, probablement en raison à la fois d'un manque d'ingénierie et du manque d'implication de nos autorités nationales. Nous sommes, quoi qu'il en soit, très attentifs à cette question au sein de la commission des affaires européennes.
M. Pascal Savoldelli. - Je remercie les rapporteurs spéciaux pour la qualité de leur contrôle budgétaire. Si je salue leur expertise, je tiens à insister sur deux points : d'abord, il convient de trouver des solutions permettant de mobiliser plus facilement et plus largement l'ingénierie locale, et ce bien sûr dans respect du principe de libre administration des collectivités territoriales ; ensuite, il faut reconnaître que l'affaiblissement des services publics et la moindre place faite à l'État dans les territoires entravent la mise en oeuvre des projets d'investissement.
Cela étant, nous voterons en faveur des recommandations de nos rapporteurs spéciaux.
M. Laurent Somon. - Je suis pleinement d'accord avec Micheline Jacques et Jean-François Rapin sur la trop faible mobilisation des fonds européens en outre-mer. Je souhaiterais citer l'exemple du port de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie : celui-ci n'a pas pu bénéficier des programmes de financement de l'Union européenne, car le texte législatif qui devait instituer l'éligibilité de ce type d'infrastructure ne comportait pas de référence au port de Nouméa dans ses annexes... Il convient d'être attentif à ce genre de détail, en amont de l'élaboration des textes réglementaires et financiers, pour éviter des oublis terriblement nuisibles à nos territoires ultramarins.
La commission a adopté les recommandations des rapporteurs spéciaux et autorisé la publication de leur communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
Direction générale des outre-mer
- M. Étienne GUILLET, sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'État ;
- M. Colin PREVOTEAU du CLARY, chargé de mission ;
- M. François LE VERGER, directeur adjoint à la sous-direction des politiques économiques, de l'emploi et du développement durable (SDPEEDD) ;
- M. Pierre VILLA, chef du bureau de la vie économique, de l'emploi et de la formation (BVEEF).
Préfecture de Mayotte
- M. François-Xavier BIEUVILLE, préfet de Mayotte ;
- Mme Maxime AHRWEILLER, secrétaire générale pour les affaires régionales.
Préfecture de Guadeloupe
- M. Yves DAREAU, secrétaire général pour les affaires régionales.
Communauté de communes des Savanes en Guyane
- Mme Tatiana FALGAYRETTES, directrice générale des services.
Direction générale de la prévention des risques
- M. Jérémy DEBERT, chef du bureau de l'action territoriale/département de l'appui aux politiques de prévention/service des risques naturels ;
- M. Matthieu MENOU, chef de la mission d'appui aux politiques publiques relatives à la prévention des risques naturels majeurs outre-mer.
Cour des comptes
- M. Etienne Gradelet, rapporteur, conseiller référendaire en service extraordinaire à la 5ème Chambre,
- M. Christian Colin, responsable de secteur, conseiller-maître à la 5e chambre.
Secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale
- M. Patrice DURAND, sous-directeur de la performance et des politiques éducatives territoriales (DGESCO) ;
- Mme Frédérique CHARBONNIERAS, cheffe de la mission des politiques éducatives d'outre-mer (DGESCO) ;
- M. Thomas LEPAGE, sous-directeur du pilotage et du dialogue de gestion au SAAM ;
- Mme Isabelle OGER, cheffe du département des politiques et financements de l'immobilier des établissements (DGESIP).
Secrétariat général des affaires régionales de la préfecture de Martinique
- Mme Caroline MAURY, secrétaire générale adjointe aux affaires régionales ;
- M. Éric DIME, directeur de la coordination interministérielle.
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
- Mme Barbara CHAZELLE, cheffe du département d'animation territoriale ;
- Mme Catherine MOSMAN, adjointe du département d'animation territoriale ;
- Mme Camille DOJKA, adjointe à la mission anticipation et développement de l'emploi et des compétences.
Collectivité territoriale de Martinique
- M. Serge LETCHIMY, président de la collectivité territoriale de Martinique.
Banque des Territoires
- M. Loïc ROLLAND, directeur régional Antilles-Guyane ;
- M. Christophe CHARENTON, conseiller relations institutionnelles.
Agence française de développement (AFD) - Martinique
- M. Guillaume CHIRON, directeur ;
- M Jérôme NOTEBAERT, directeur adjoint.
Office français de la biodiversité
- M. Denis CHARISSOUX, directeur général délégué ;
- M. Jean-Michel ZAMMITE, directeur des Outre-mer.
*
* *
- Contributions écrites -
Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation |
DGOM, collectivités, préfectures, hauts commissariats |
Rentrée 2026 |
Contrat de convergence et de transformation |
|
2 |
Intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques |
Ministère de la transition écologique, préfectures, hauts-commissariats, collectivités |
Rentrée 2026 |
Contrat de convergence et de transformation |
|
3 |
Limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants |
Collectivités locales, préfectures, DGOM |
Rentrée 2026 |
Contrat de convergence et de transformation |
|
4 |
Créer un programme budgétaire, au sein de la mission « Outre-mer », regroupant une partie des actions régionales et interrégionales comprises dans les contrats de convergence et de transformation, de nature interministérielle et territorialisée |
DGOM, direction du budget |
Janvier 2027 |
Projet de loi de finances pour 2027 |
|
5 |
Développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation |
DGOM, préfectures, collectivités |
Janvier 2028 |
Contrat de convergence et de transformation |
|
6 |
Organiser plus régulièrement un comité interministériel des outre-mer afin de favoriser la mise en oeuvre d'investissements impliquant plusieurs ministères |
DGOM |
Été 2026 |
Communication ministérielle |
|
7 |
Définir un chef de file clair sur chacun des projets lorsqu'ils réunissent plusieurs financeurs, et ce dès l'intégration du projet dans un financement des CCT et organiser des réunions de suivi plus récurrentes |
Préfectures, ministères, collectivités |
Janvier 2026 |
Circulaire ministérielle |
|
8 |
Concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence |
DGOM, préfectures, hauts commissariats |
Janvier 2026 |
Circulaire ministérielle |
|
9 |
Mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement, concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés |
DGOM |
Janvier 2027 |
Loi de finances initiale pour 2027 et circulaire ministérielle |
|
10 |
Renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation |
Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM |
Janvier 2026 |
Circulaire ministérielle |
|
11 |
Créer un guichet unique de l'ingénierie publique pour centraliser les demandes des collectivités locales aux différents partenaires et intégrer des aspects de soutien à l'ingénierie locale dans les contrats de convergence et de transformation, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs. |
DGOM, préfecture, collectivités |
Janvier 2026 |
Circulaire ministérielle |
* 1 L'investissement des collectivités territoriales, octobre 2023, inspection générale des finances.
* 2 Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, Fascicule 1, Cour des comptes, juin 2025.
* 3 En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu'en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires, INSEE Première n° 1958, juillet 2023.
* 4 Le taux d'épargne brute mesure le rapport entre l'épargne dégagée par la section de fonctionnement des collectivités locales et les recettes de fonctionnement.
* 5 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant diverses dispositions en matière économique.
* 6 Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
* 7 Loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
* 8 Loi organique modifiée n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.
* 9 Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
* 10 Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
* 11 Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
* 12 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer.
* 13 Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 200-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer.
* 14 Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits.
* 15 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
* 16 Soutenir les communes des départements et régions d'outre-mer, pour un accompagnement en responsabilité, M. le député Jean-René Cazeneuve et M. le Sénateur Georges Patient, décembre 2019.
* 17 Les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie, Cour des comptes, 19 septembre 2023.
* 18 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
* 19 Les contrats de convergence et de transformation, Cour des comptes, juillet 2025.
* 20 Les contrats de convergence et de transformation, Cour des comptes, juillet 2025.
* 21 Rapport d'information n° 727 (2021-2022) du 22 juin 2022 - par MM. Georges PATIENT et Teva ROHFRITSCH, fait au nom de la commission des finances.