L'IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER AUX AJUSTEMENTS
L'absence d'ajustements tient, d'une part, à la difficulté d'admettre que les banques puissent faire faillite - c'est le dogme du " zéro faillite agreement " - et, d'autre part, à une législation particulièrement rigide qui ne facilite pas les adaptations, notamment en ce qui concerne la durée du travail ou la tarification des services.
L'immortalité des banques et le dogme du "zéro faillite agreement"
Comme on a pu le voir, le nombre réel des acteurs de la
compétition bancaire a eu tendance à augmenter en dépit de
l'accroissement sévère des conditions de concurrence. Les
"
barrières à l'entrée
" de la profession
(agrément, capital minimum, actionnaire de référence)
n'ont pas véritablement fonctionné. Elles n'ont
représenté qu'un filtre individuel, sans impact réel sur
l'équilibre économique du secteur.
Au demeurant, une telle limitation du nombre des entrants eût
été impossible compte tenu des engagements internationaux et
notamment européens en matière de libre établissement et
de libre prestation, sauf à ne faire porter le poids des restrictions
que sur les seuls candidats nationaux.
Mais cette "
libre entrée dans la branche
" aurait
supposé, en toute logique, une libre sortie. Or, le contraire s'est
produit puisque a été mis en place une "
administration de la
sortie
" qui constitue, comme le souligne le rapport du Commissariat
général du plan
23(
*
)
, une
"
incohérence"
.
Cette incohérence, qui est, de l'avis du groupe de travail, la cause
première des difficultés actuelles du secteur bancaire, trouve
son origine dans la conjugaison de deux phénomènes, l'un
financier, l'autre juridique, se traduisant par une forme d'immortalité
bancaire.
L'immortalité financière : le comportement de l'État actionnaire et le "colbertisme résiduel"
Chaque fois que des établissements de crédit
public ont connu des difficultés,
l'Etat
, actionnaire pendant les
années 84-93 d'une grande partie (sinon la majeure) du secteur bancaire,
a recapitalisé ces établissements
(ce qui était
normal)
sans exiger de façon systématique une réduction
des activités des établissements en mauvaise posture
(ce qui
non seulement constituait un encouragement à la mauvaise gestion, mais a
entraîné des surcapacités). C'est la litanie des
recapitalisations des années 90 : SDR, banque Hervet, SMC, Crédit
Lyonnais, annonciatrice des plans de redressement et de défaisance
(Comptoir des entrepreneurs, Crédit Lyonnais, Crédit Foncier).
Au total, et hors effet patrimonial, l'Etat a plus donné pour le
secteur bancaire, sous forme de dotations budgétaires, qu'il n'a
reçu de ses banques, sous forme de dividendes.
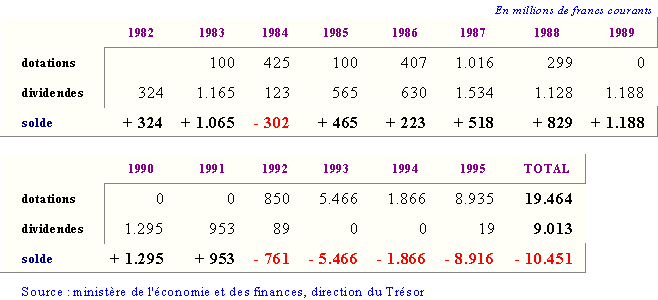
En contrepartie de cette immortalité
financière, l'Etat a continué à utiliser les banques comme
instrument de politique économique, leur assignant des objectifs
d'intérêt public (maintien de l'emploi
24(
*
)
, aménagement du territoire) ou
de politique industrielle.
Malheureusement, le colbertisme industriel, qui
a permis à la France de mener à bien de grands projets dans
l'aéronautique, le nucléaire ou les
télécommunications, n'a pas fait bon ménage avec le
libéralisme dominant dans les métiers de la banque et de la
finance
25(
*
)
.
C'est l'époque où les principales banques françaises,
"
grisées
" par les libertés nouvelles dont elles
bénéficiaient se sont lancés dans une course au bilan,
sans considération des règles élémentaires de
rentabilité et de contrôle des risques. C'est aussi
l'époque où le classement des banques se faisait avant tout en
fonction de leur "
total de bilan
".
Il faut bien admettre que l'Etat français n'est pas le seul à
être intervenu, par la voie de concours publics, au secours
d'établissements bancaires.
D'après les estimations dont on dispose,
26(
*
)
la Norvège a ainsi assuré
entre 1987 et 1992 le sauvetage par nationalisation totale ou partielle des
trois premières banques du pays pour un coût total pour l'Etat de
20 milliards de francs. La Suède a apporté entre 1991 et 1993, 50
milliards de fonds publics à 3 établissements sous forme de fonds
propres et de garantie ainsi que de nationalisation, en attendant la reprise
par des investisseurs privés. L'Etat finlandais, également entre
1991 et 1993, a dirigé des restructurations massives par le truchement
d'un fonds public d'assurance dont le coût final a été de
50 milliards de francs.
Dans la crise des caisses d'épargne américaines, le coût
supporté par le
Résolution Trust Corporation
, organisme
financé sur ressources budgétaires et emprunts garantis par le
Trésor a été de 700 milliards de francs (132 milliards de
dollars) étalé entre 1989 et 1992. Cet organisme a pris le
contrôle des caisses d'épargne en faillite et en a
cédé les actifs. Déjà, entre 1985 et 1992, le
coût supporté par le fonds de garantie des banques (FDIC) pour la
disparition d'environ 500 banques texanes avait été de 70
milliards de francs (13 milliards de dollars).
En Angleterre, le soutien de 40 petites banques sous forme de concours directs
et de garanties accordés par la Banque d'Angleterre peut être
estimé à 1 milliard de francs. Le coût de la faillite de la
BCCI a été de 2,6 milliards de francs. L'essentiel des pertes a
été supporté par les déposants, les
autorités publiques refusant de prendre en charge la partie non couverte
par le système de garantie des dépôts.
En Espagne, le règlement du sinistre de la Banesto en 1993, d'un
coût total estimé entre 35 et 48 milliards de francs, a
été assurée par le fonds de garantie des
dépôts et par la Banque centrale qui a joué un rôle
très important.
Au Japon, a été créée en janvier 1993, une
structure de
defeasance
(ou
bad bank
) dont les actifs proviennent
de 162 établissements de crédit pour un total estimé
à 360 milliards de francs. En février 1995, a été
créée une structure au capital de 2,1 milliards de francs,
détenu pour moitié par la Banque centrale et pour moitié
par les principaux établissements de la place. Cette structure est
censée racheter 2 établissements de crédit mutuel qui
totalisent 5,4 milliards de francs de créances compromises. C'est la
première fois qu'il a été dérogé au principe
de non-assistance financière de la puissance publique à des
établissements de crédit.
Mais comme on a déjà eu l'occasion de le voir, ces crises
bancaires ont été résolues dans un laps de temps
relativement court et dans la totalité de ces pays, à l'exception
il est vrai du Japon, les principales banques ont renoué avec les
bénéfices
. Qui parle encore de la banque Banesto, ou de la
Barings ? Par contraste, il ne se passe pas une semaine sans que l'on ne puisse
lire un article de presse sur le Crédit Lyonnais.
Indépendamment de la question de savoir si l'Etat a
été un bon actionnaire ou un bon gestionnaire, qui sera
évoquée plus loin, on remarquera qu'il n'a pas su traiter avec
efficacité les difficultés de ses propres banques.
Schématiquement, l'Etat dispose de quatre moyens pour venir à la
rescousse d'une banque défaillante.
1) La liquidation :
les banques insolvables sont mises en faillite, les
déposants assurés sont remboursés et tous les actifs
restant sont liquidés. Dans sa forme la plus pure, une liquidation
entraîne la perte des participations des détenteurs de la banque,
tandis que les détenteurs de la dette de deuxième rang perdent
également une partie, ou la totalité de leur argent. Dans la
pratique, seuls les Etats-Unis ont été en mesure d'adopter cette
politique : environ une banque sur cinq ayant fait faillite a été
liquidée. En revanche, aucune banque japonaise ne l'a été
depuis 1945.
2) La fermeture par fusion :
cela implique de fusionner une banque en
mauvaise santé financière avec une autre en bonne santé.
Dans certains cas, les autorités réglementaires offrent au
repreneur des incitations, peut être en gardant une partie des actifs non
garantis ou en remboursant les déposants assurés ou les
créanciers. Les autorités réglementaires
américaines emploient souvent cette méthode et nombre
d'autorités européennes l'ont mise en pratique. C'est le cas par
exemple des autorités espagnoles lorsque la banque Banesto a fait
faillite en 1994. Cette banque fut mise aux enchères et rachetée
par la banque Santander. C'est le cas également de la
Barings
en
Angleterre.
3) Les dotations budgétaires, ou les garanties gouvernementales
:
le plus souvent cela consiste à nettoyer les bilans des banques en
transférant leurs plus mauvais actifs à l'Etat ou à faire
en sorte qu'il s'en porte garant. C'est l'approche la plus souvent retenue. Une
étude de la
London School of economics
portant sur 120 cas de
faillites dans 24 pays différents au cours des années 80 a
montré en effet que deux banques sur trois étaient
renflouées. La forme d'intervention la plus simple implique la garantie
que l'Etat agira en tant que prêteur de dernier ressort au cas où
les prêts à risque viendraient à menacer la solidité
d'une banque. La forme la plus fréquente a été la
création d'une agence comme le
Securum suédois
, la
Résolution Trust Company
américaine ou la
Coopérative d'achat de crédit au Japon, qui garde les mauvais
actifs jusqu'à leur maturité ou à leur réalisation.
Le sauvetage du Crédit Lyonnais s'inspire également de cette
approche.
4) La nationalisation :
c'est la solution la plus radicale. Elle est
souvent adoptée lorsqu'un Gouvernement craint que les problèmes
d'une banque se répercutent sur l'ensemble du système. L'exemple
le plus éloquent a été la nationalisation d'une vaste
partie du système bancaire norvégien. Elle suppose, bien
évidemment, que les banques ne soient pas déjà entre les
mains d'actionnaires publics.
En écartant systématiquement l'option de la liquidation et
celle de la vente, les gouvernements successifs n'ont fait que rendre ces
options plus coûteuses, une fois l'inefficacité du renflouement
avérée. Le Crédit Lyonnais illustre malheureusement cette
vérité : le coût de la procrastination s'avère
élevé
27(
*
)
.
En outre, les instances gouvernementales ne possédaient pas de
compétence particulière en tant que gérants d'actifs
défaillants et il s'avère également difficile
d'évaluer le coût réel de ces arrangements pour les
contribuables. Là encore, le cas du Crédit Lyonnais se
révèle démonstratif.
En premier lieu, les autorité de tutelle ont, pendant longtemps,
donné l'impression de refuser de prendre la mesure exacte du
désastre.
Ensuite, le plan de sauvetage a mis à la charge de la banque en
difficulté une contribution qu'elle n'était pas en mesure
d'apporter.
Enfin, à la suite de modifications successives, le plan de sauvetage a
du finalement prendre acte du montant total des pertes (de l'ordre de 80
milliards de francs) et séparer définitivement la bonne banque de
la mauvaise (l'ensemble formé par l'Établissement public de
financement et de restructuration et le Consortium de réalisation).
D'après les informations rendues publiques par le Gouvernement, le
processus de privatisation est en passe d'être engagé.
Quand bien même l'Etat ne serait-il pas intervenu de façon aussi
massive et récurrente, on peut s'interroger sur les effets pervers de
notre système de droit commun concernant le traitement des banques en
difficulté.







