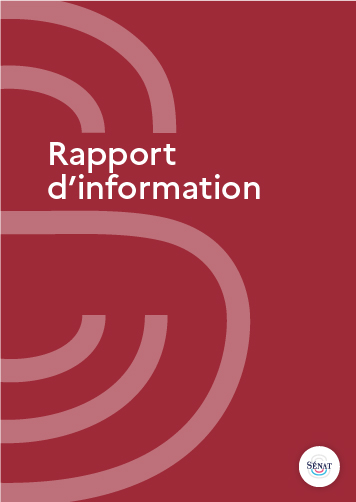Le résumé
Face à l'émiettement communal français et dans le but d'assurer une gestion plus efficace de certaines compétences, le législateur s'est, de longue date, employé à favoriser la coopération entre communes, en promouvant notamment la constitution, sur une base librement consentie, d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
À la mi-temps des années 2010, les résultats mitigés de cette politique, caractérisés par le maintien d'un grand nombre de communes isolées, ont poussé le gouvernement à franchir une nouvelle étape : les lois « Maptam » et « NOTRe » ont rendu obligatoire le rattachement des communes à une structure intercommunale, souvent qualifié d'achèvement « à marche forcée » de la carte intercommunale.
Ce sentiment a été renforcé à la fois par le transfert aux intercommunalités de compétences sans cesse plus nombreuses et par l'augmentation de leur taille, donnant l'impression d'une diminution de la proximité de l'action publique ainsi que d'une perte de l'esprit partenarial supposé être au coeur de la démarche intercommunale.
Si les nouvelles intercommunalités ont permis la mise en oeuvre de projets structurants, la loi NOTRe a, dix ans après son adoption, laissé des traces. C'est fort de ce constat que le Sénat a lancé, en avril 2025, une mission d'information afin de dresser un bilan objectif des réussites et des difficultés de l'intercommunalité.
Au vu du bilan en demi-teinte qu'elle en dresse, la mission appelle à ouvrir un nouveau chapitre de l'intercommunalité, fondé sur un pacte articulé autour de trois principes directeurs : la souplesse, la concertation et la confiance.
Pour ce faire, elle formule 20 propositions concrètes, de nature à remettre les élus au coeur de la définition du projet politique et du fonctionnement des intercommunalités, au service des citoyens.