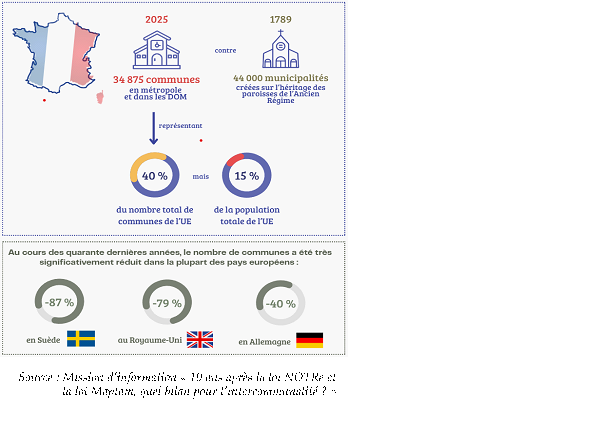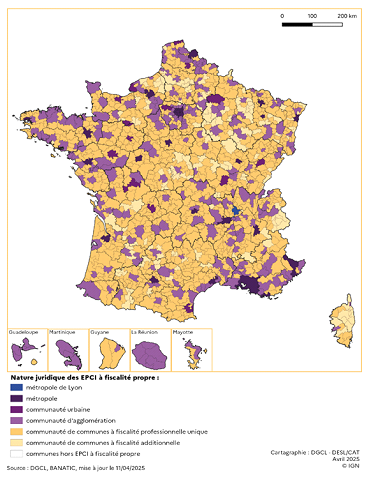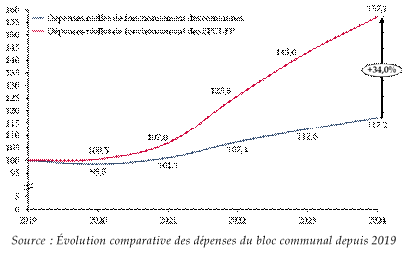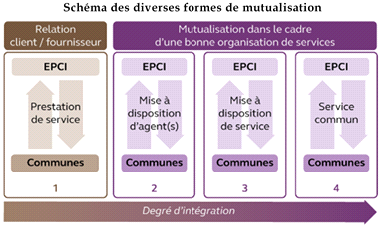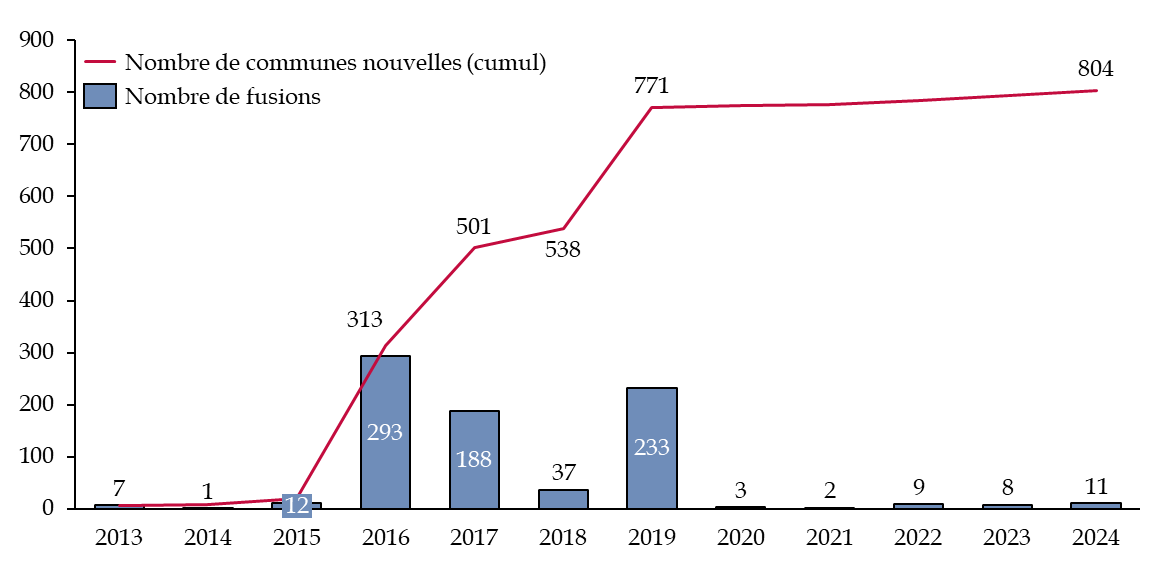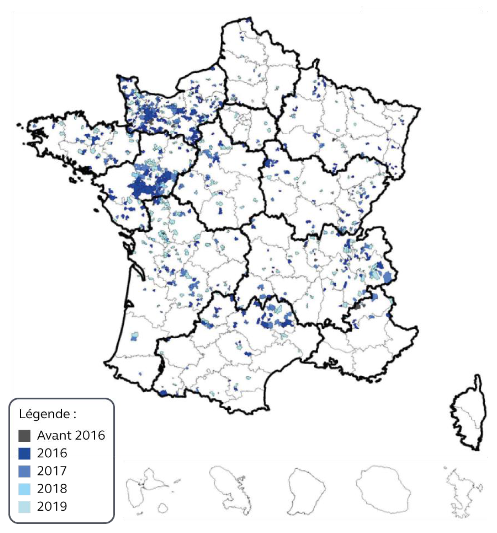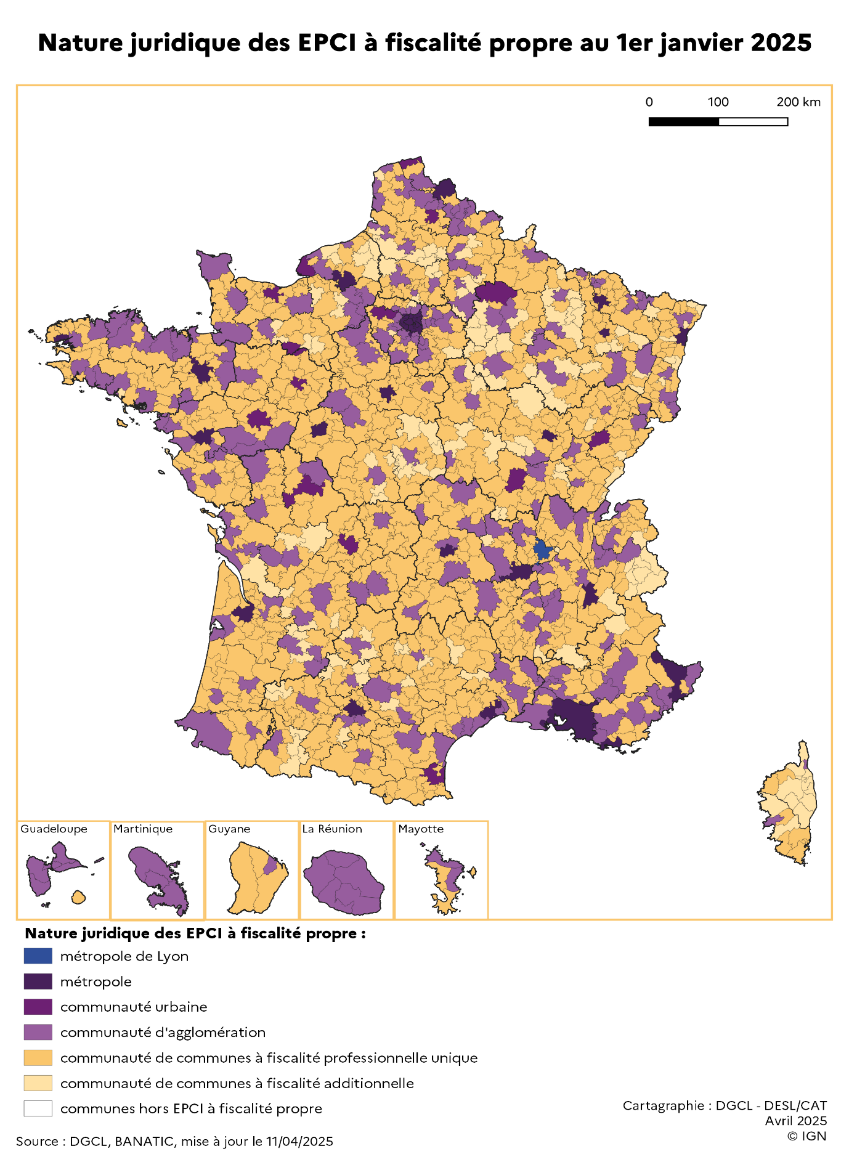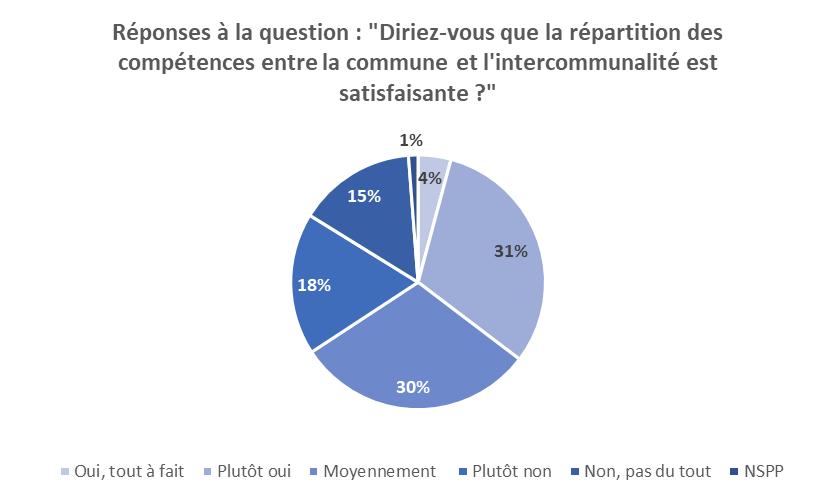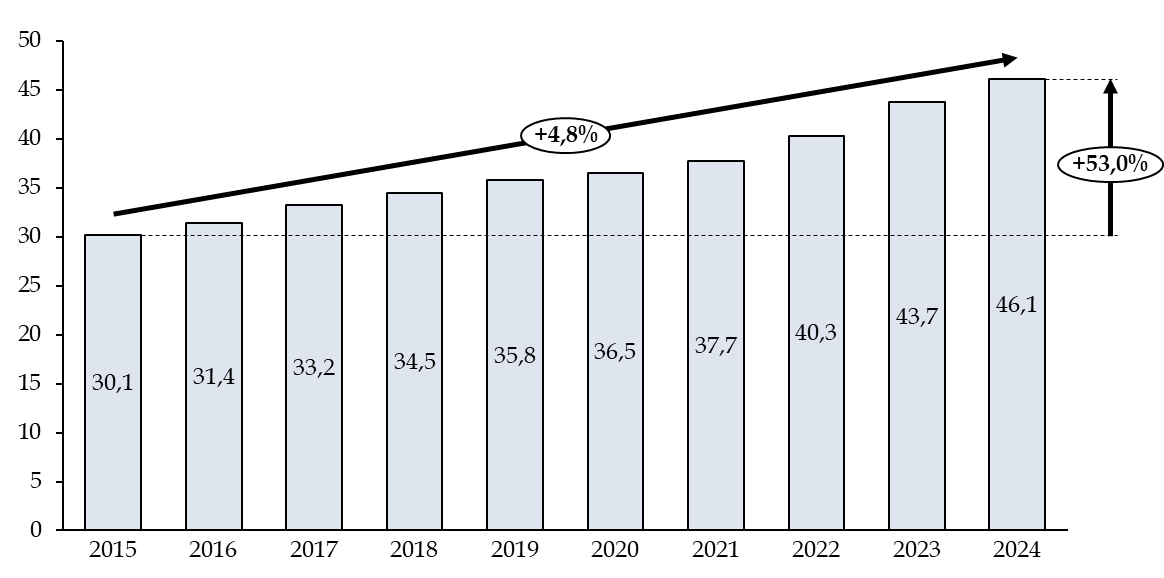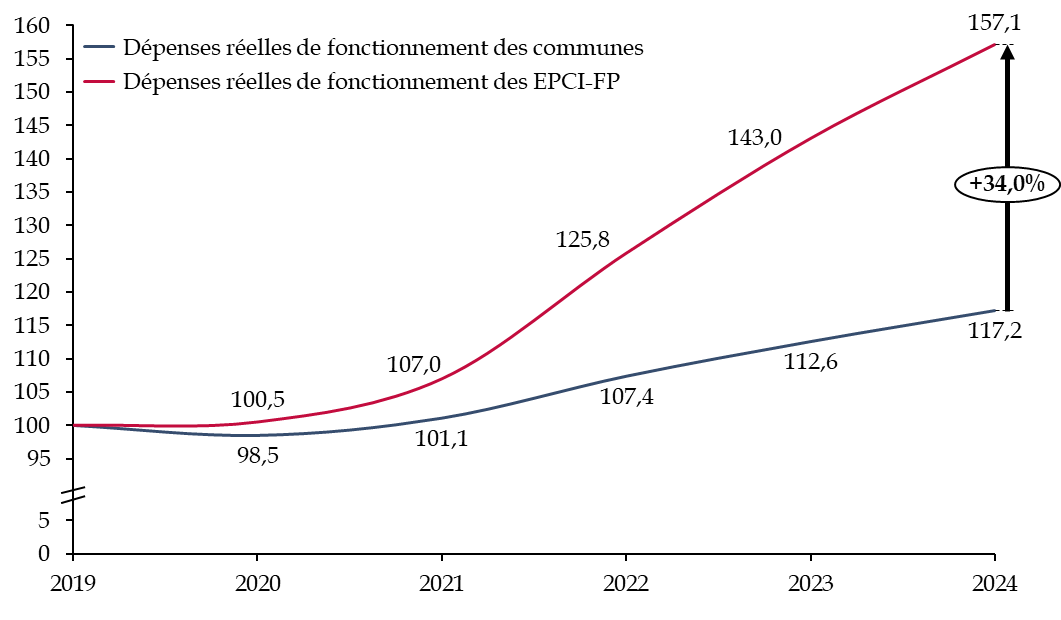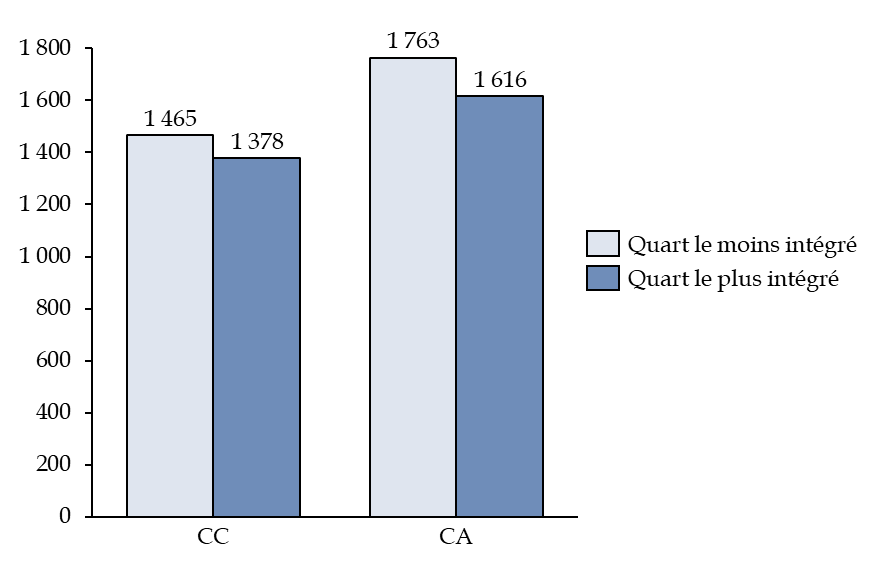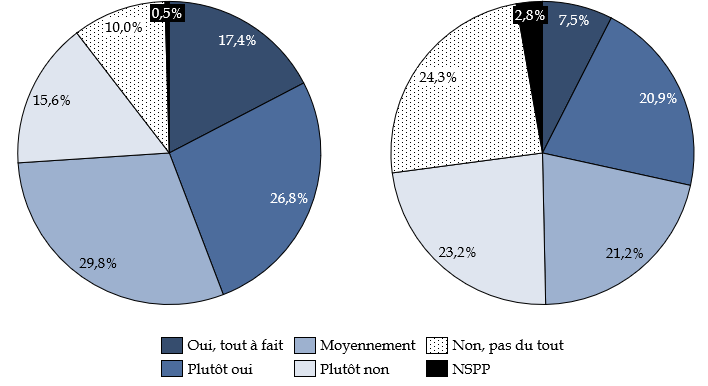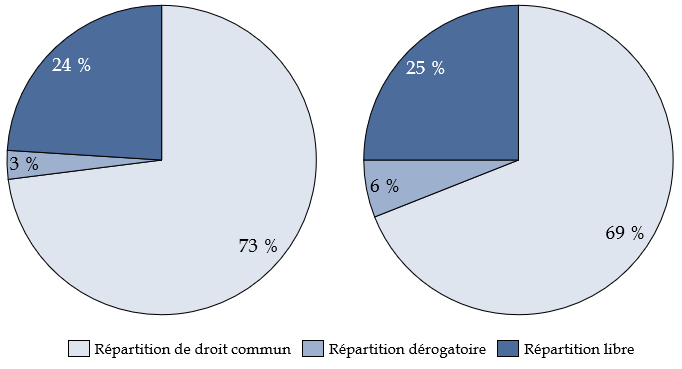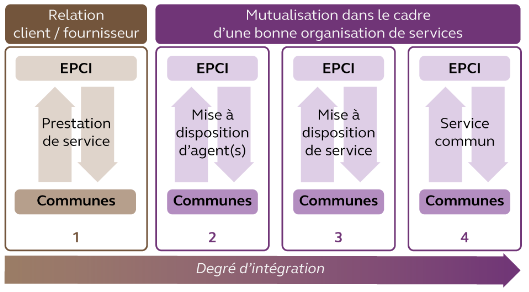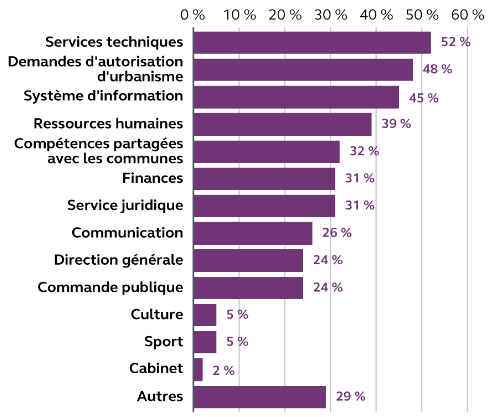- INTRODUCTION
- L'ESSENTIEL
- I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
- A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT
COMMUNAL
- 1. Le défi du morcellement communal :
une constante dans l'histoire institutionnelle française
- 2. Le renforcement de l'intercommunalité
sous la Ve République : un fil rouge des réformes
territoriales successives
- a) La création de nouvelles formes de
regroupement communal
- (1) La promotion des fusions de communes
- (2) Le développement de
l'intercommunalité, sur la base du principe de libre association des
communes
- (a) La création de plusieurs
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
- (b) Les incitations au développement de
l'intercommunalité
- b) L'intercommunalité
« fédérative » à fiscalité
propre : une originalité française pour éviter les
phénomènes de concurrence entre collectivités
- a) La création de nouvelles formes de
regroupement communal
- 1. Le défi du morcellement communal :
une constante dans l'histoire institutionnelle française
- B. AVEC LES LOIS « MAPTAM »
ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ
PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »
- 1. « Big is
beautiful » : de l'incitation à l'injonction
- a) Le bilan mitigé de la politique de
promotion des regroupements communaux
- (1) Le faible nombre de fusions de communes
- (2) Un nombre important de « communes
isolées », n'appartenant pas à
un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre
- b) Le passage à une logique d'injonction
à la coopération intercommunale
- a) Le bilan mitigé de la politique de
promotion des regroupements communaux
- 2. Une mise en oeuvre
hétérogène ayant conduit, dans de nombreux territoires,
à des regroupements au forceps
- a) Les préfets ont été
chargés d'achever la carte intercommunale
- b) Des préfets dotés de pouvoirs
dérogatoires pour arrêter les schémas départementaux
de coopération intercommunale
- c) Une couverture intégrale du territoire
par des structures intercommunales, parfois au prix de « mariages
forcés »
- (1) L'objectif de couverture intégrale du
territoire national par des établissements publics de
coopération intercommunale a été atteint
- (2) Un achèvement de la carte
intercommunale ayant entraîné des « mariages
forcés », en raison d'une consultation insuffisante
des élus locaux
- a) Les préfets ont été
chargés d'achever la carte intercommunale
- 3. La rationalisation de l'intercommunalité
sans fiscalité propre
- 1. « Big is
beautiful » : de l'incitation à l'injonction
- C. RÉALITÉ ET PERCEPTION DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
- 1.
L'hétérogénéité des situations
intercommunales, reflet de la diversité des territoires
- 2. Un sentiment de dépossession très
présent chez les maires et les élus municipaux,
révélateur d'un défaut de gouvernance
intercommunale
- 3. Une appréciation globalement positive de
l'intercommunalité de la part des exécutifs intercommunaux
- 4. Renouer avec une logique de partenariat de
territoire en conciliant stabilisation de la carte intercommunale et
évolution parfois nécessaire
- 1.
L'hétérogénéité des situations
intercommunales, reflet de la diversité des territoires
- A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT
COMMUNAL
- II. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES
INTERCOMMUNALITÉS : FAVORISER LES SOLUTIONS CONCERTÉES ENTRE
LES ÉLUS
- A. L'INTERCOMMUNALITÉ, UNE
SUPER-COMMUNE ?
- 1. Le couple
intercommunalité-communes : un équilibre délicat
entre logique intégrative et autonomie communale
- a) Les communes face au risque d'autonomisation de
l'intercommunalité
- b) Mieux associer les élus municipaux au
fonctionnement des intercommunalités
- (1) Pour une gouvernance intercommunale
véritablement démocratique
- (2) Maintenir le mode actuel d'élection des
conseillers communautaires
- c) Conforter le statut de l'élu
local
- d) La formation des élus municipaux et des
exécutifs communautaires : un levier d'amélioration de
la gouvernance
- e) Rapprocher l'action intercommunale des
citoyens
- a) Les communes face au risque d'autonomisation de
l'intercommunalité
- 2. Renforcer l'implication de l'ensemble des
parties prenantes dans une démarche de projet de territoire
- 3. Renforcer l'État territorial, partenaire
au service des communes
- 1. Le couple
intercommunalité-communes : un équilibre délicat
entre logique intégrative et autonomie communale
- B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
- A. L'INTERCOMMUNALITÉ, UNE
SUPER-COMMUNE ?
- III. L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS
INTERCOMMUNAUX EXISTANTS
- A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE
INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES
- 1. La hausse des dépenses du bloc communal
traduit une hausse du niveau de service
- a) Les dépenses du bloc communal ont
fortement augmenté ces dernières années,
particulièrement celles des intercommunalités
- b) Un « effet rebond » des
dépenses du bloc communal, moindre dans les intercommunalités les
plus intégrées
- (1) Un « effet rebond » des
dépenses permis par le redéploiement des marges
financières des communes et des EPCI
- (2) Un rebond des dépenses moins important
dans les intercommunalités les plus intégrées
- a) Les dépenses du bloc communal ont
fortement augmenté ces dernières années,
particulièrement celles des intercommunalités
- 2. La performance et l'efficacité des
services publics intercommunaux sont encore perfectibles
- 1. La hausse des dépenses du bloc communal
traduit une hausse du niveau de service
- B. CRÉER DES RELATIONS FINANCIÈRES
INTERCOMMUNALES PLUS PARTENARIALES ET STRATÉGIQUES
- 1. Des attributions de compensation (AC) parfois
inadaptées à la réalité des coûts d'exercice
des compétences
- a) Les transferts de compétence au sein du
bloc communal impliquent également des attributions de compensation
(AC)
- b) Un montant de plus en plus
décorrélé de la réalité des charges
transférées
- c) Assouplir le mode de révision des
attributions de compensation, mais entouré de garde-fous
- (1) Mieux documenter l'évaluation des
charges transférées
- (2) Un mode de révision
« libre » des attributions de compensation excessivement
strict
- (3) Assouplir les possibilités de
révision en cas de déséquilibre manifeste entre les
ressources et les besoins
- a) Les transferts de compétence au sein du
bloc communal impliquent également des attributions de compensation
(AC)
- 2. Favoriser le recours à des instruments
de solidarité intercommunale
- 3. Faire de l'intercommunalité un soutien
des initiatives communales : pour un bon usage des fonds de
concours
- 1. Des attributions de compensation (AC) parfois
inadaptées à la réalité des coûts d'exercice
des compétences
- C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE
RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
- A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE
INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES
- I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
- CONCLUSION
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- TRAVAUX DE LA MISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
- CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K
- GLOSSAIRE
N° 900
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission d'information (1) sur le
thème :
« Pour une
intercommunalité de la
confiance, au service des
territoires »,
Président
M. Jean-Marie MIZZON,
Rapporteure
Mme Maryse
CARRÈRE,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette mission est composée de : M. Jean-Marie Mizzon, président ; Mme Maryse Carrère, rapporteure ; Mmes Cécile Cukierman, Frédérique Espagnac, MM. Jean-Pierre Grand, Stéphane Le Rudulier, Clément Pernot, Didier Rambaud, Mme Ghislaine Senée, M. Lucien Stanzione, vice-présidents ; MM. Yves Bleunven, David Margueritte, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Martine Berthet, MM. Étienne Blanc, Hussein Bourgi, Mme Isabelle Briquet, MM. Jean-Marc Delia, Franck Dhersin, Daniel Gueret, Mme Évelyne Perrot, M. David Ros.
INTRODUCTION
Héritières des 44 000 paroisses d'avant 1789, les quelque 35 000 communes de France ont, de longue date, choisi de s'organiser pour conduire ensemble des projets qui répondent aux attentes des habitants. De cette organisation librement consentie par les élus des communes concernées, la coopération intercommunale a franchi une nouvelle étape, au tournant des années 2010. En quelques années, sa conception même a été bouleversée et elle est devenue imposée aux communes concernées. Au nom de la rationalisation et d'une meilleure intégration territoriale, la volonté du législateur les a placées de fait sous une toise unique. En 2015, le Sénat, chambre des collectivités territoriales, avait néanmoins pu oeuvrer à mieux tenir compte des réalités locales, en faisant passer le seuil de nombre d'habitants de 20 000 dans la version initiale du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) à 15 000 habitants, avec des adaptations (seuil de 5 000 habitants) pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires. Le Sénat n'avait toutefois pu s'opposer au principe même du regroupement général des communes au sein d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
La mise en oeuvre de cette loi a conduit à un regroupement parfois drastique, souvent autoritaire, des communes au sein d'EPCI élargis. Elle a également contribué à faire de la période 2010-2020 une « décennie terrible pour les territoires ruraux », pour reprendre les termes d'une des personnes auditionnées par la mission d'information.
La France compte désormais 1 254 EPCI à fiscalité propre et l'émergence de communautés de communes ou d'agglomération « XXL » a constitué l'aboutissement le plus emblématique de cette nouvelle politique des territoires.
Même si elle n'est pas le critère exclusif des difficultés de fonctionnement des intercommunalités issues de la loi NOTRe, cette grande taille entraîne mécaniquement des conséquences en termes de gouvernance : Comment faire en sorte que les représentants de toutes les communes membres de ces intercommunalités puissent trouver leur place au sein de conseils communautaires eux-mêmes XXL et soient à même d'exprimer un avis éclairé sur l'ensemble des sujets d'intérêt communautaire, qui plus est compte tenu de la très grande hétérogénéité de taille des communes membres ?
En 2020, pour la première fois, les élections municipales ont été organisées sous l'architecture territoriale des EPCI mis en place en application de la loi NOTRe. On connait les conditions dans lesquelles la pandémie de Covid-19 a imposé le déroulement exceptionnel du scrutin ainsi que le démarrage en mode dégradé des travaux des conseils municipaux et communautaires. S'en sont suivies des tensions entre communes membres, notamment en zone rurale ou de faible densité de population.
Le scrutin de mars 2026 marquera une nouvelle étape de l'application de la loi NOTRe. Il doit également être une occasion à ne pas manquer pour entamer un nouveau chapitre - fondé sur des bases saines - de l'intercommunalité.
Avec cette échéance en ligne de mire, le Sénat a décidé de mener un bilan de l'intercommunalité, de sorte de pouvoir formuler des recommandations qui permettent de faciliter le fonctionnement des structures intercommunales et d'accroitre la lisibilité de l'action publique.
Créée à l'initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, la mission d'information, forte de 23 membres appartenant à tous les groupes politiques, a entamé ses travaux début avril 2025. En 24 heures d'auditions, elle a entendu 34 élus, représentants d'associations et experts. Outre les représentants des grandes associations d'élus, « généralistes » comme « spécialisées », y compris d'outre-mer, elle a souhaité recueillir directement la parole des élus municipaux eux-mêmes.
C'est dans cet esprit d'être au plus près du terrain qu'elle a organisé un déplacement dans deux départements très différents : les Hautes-Pyrénées, département faiblement peuplé et touristique de montagne et la Moselle, plus peuplée, comprenant une métropole et traditionnellement doté d'une industrie forte. La mission d'information a également souhaité recueillir directement la parole de maires qui ne sont pas membres de l'exécutif de l'intercommunalité à laquelle appartient leur commune, lors d'une table ronde réunissant huit d'entre eux, librement choisis par les membres de la mission. Enfin, elle a mené une consultation en ligne des élus, à laquelle près de 2 000 d'entre eux ont bien voulu répondre.
Compte tenu du temps qui lui était imparti pour mener à bien ses travaux et pour ne pas répéter ceux engagés par ailleurs par différentes structures du Sénat, la mission d'information a fait le choix de ne pas se focaliser sur les questions financières en tant que telles, sauf lorsque cela s'est révélé indispensable à la bonne compréhension des difficultés des intercommunalités. Au nom du même principe d'efficacité, elle n'a pas étudié la situation particulière des métropoles, notamment celles à statut particulier que sont le Grand Paris, la Métropole de Lyon et la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Au terme de ses travaux, la mission d'information souligne qu'en matière d'organisation territoriale, nul, aujourd'hui, ne demande ni même n'évoque un retour à la situation antérieure aux lois Maptam et NOTRe. Elle est consciente de la difficulté que représenterait un retour en arrière.
Elle a également acquis la conviction que les intercommunalités issues de la loi NOTRe n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière et sont aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est pourquoi elle formule avec optimisme un ensemble de vingt recommandations de nature à remettre les élus au coeur de la définition du projet politique et du fonctionnement des intercommunalités. Elle espère contribuer ainsi à la bonne marche de cet outil que constitue l'intercommunalité pour porter des projets au service de toutes les Françaises et tous les Français.
L'ESSENTIEL
I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE L'INTERCOMMUNALITÉ
A. L'INTERCOMMUNALITÉ : UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT COMMUNAL
1. Le défi du morcellement communal
L'une des spécificités de l'organisation territoriale française, souvent qualifiée de « millefeuille », tient à son morcellement communal.
Cette singularité communale française repose sur un attachement très fort des Français à la commune en tant que creuset d'identité et échelon administratif de proximité. Elle a engendré une seconde particularité, le développement, depuis la fin du XIXe siècle, de différentes formes de coopération intercommunale. L'histoire institutionnelle française est en effet traversée par l'opposition entre deux aspirations : d'un côté, le souhait de préserver le socle communal, de l'autre, la reconnaissance de la nécessaire adaptation des périmètres communaux aux réalités socio-économiques des territoires.
De la IIIe à la Ve République, de nombreux dispositifs législatifs ont ainsi tenté de dépasser cette volonté contradictoire, en proposant des systèmes d'association susceptibles d'allier respect de l'intégrité communale et efficacité publique.
2. Le renforcement de l'intercommunalité sous la Ve République : un fil rouge des réformes territoriales successives
En réponse à l'émiettement communal, les réformes territoriales successives ont entrepris de promouvoir le développement de l'intercommunalité, sur la base du volontariat, afin de mutualiser l'exercice de certaines compétences, dont les enjeux dépassent le strict cadre communal.
Le législateur a ainsi créé plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre1(*) et mis en place une politique d'encouragement au regroupement de communes au sein de ces structures, avec la mise en place, par exemple, d'incitations financières.
B. AVEC LES LOIS « MAPTAM » ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »
1. Le développement de l'intercommunalité : de l'incitation à l'injonction
Le bilan de la politique de promotion des regroupements de communes au sein d'EPCI à fiscalité propre s'est révélé mitigé, en dépit des fortes incitations mises en place. Ainsi, au 1er janvier 2009, 6,9 % des communes demeuraient isolées - soit 2 516 communes.
Au vu de ces résultats en demi-teinte, le législateur a fait le choix de passer à une logique d'injonction à la coopération intercommunale, qui s'est traduite par :
· d'une part, la fixation d'un principe de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre2(*), duquel découle l'obligation, pour les communes, d'adhérer à une structure intercommunale ;
· d'autre part, l'augmentation du seuil minimal de population pour constituer des EPCI à fiscalité propre, afin qu'ils disposent d'une taille suffisante pour gérer des compétences stratégiques3(*) : le seuil du nombre d'habitants a été fixé par la loi NOTRe à 15 000 habitants, sous réserve de quelques adaptations aux spécificités des territoires, comme les zones de montagne où il s'établit à 5 000 habitants.
2. Une mise en oeuvre hétérogène ayant donné lieu à de multiples « mariages forcés »
Pour atteindre l'objectif de maillage intégral du territoire par des structures intercommunales, les préfets ont été chargés d'arrêter les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), fixant le périmètre des EPCI à fiscalité propre dans chaque département. Ils ont pour ce faire été dotés de pouvoirs dérogatoires leur permettant d'arrêter les SDCI, même en cas de désaccord avec les communes concernées.
L'octroi aux préfets de ces pouvoirs dérogatoires a permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre dès l'année 2021. Seules quatre communes demeurent isolées4(*), bénéficiant d'une dérogation liée à leur insularité.
Si l'objectif fixé par le législateur a donc été atteint, il est clair que l'achèvement de la carte intercommunale ne s'est pas toujours faite en concertation avec les élus locaux. Les auditions de la mission d'information ont ainsi montré que l'octroi de pouvoirs dérogatoires aux préfets avait parfois conduit à des regroupements forcés, ce qui a généré, chez les élus communaux concernés, un sentiment de défiance ainsi qu'une perte de confiance dans les exécutifs communautaires, encore visible aujourd'hui.
C. UN BILAN EN DEMI-TEINTE
1. Une réussite globale mais hétérogène, reflet de la diversité des territoires
L'analyse du fait intercommunal révèle une très grande hétérogénéité des situations, qui dépendent largement des contextes politiques et institutionnels locaux ainsi que des modes de gouvernance mis en place par les exécutifs des intercommunalités. Si les études de terrain montrent que, dans leur grande majorité, les intercommunalités fonctionnent bien, un trop grand nombre d'entre elles sont encore aujourd'hui perçues comme autoritaires.
Par ailleurs, beaucoup d'élus soulignent que les intercommunalités permettent de mener à bien des projets que la seule commune centre n'aurait pu assurer seule et qu'elles apportent de réels services aux habitants. Les représentants de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ont ainsi qualifié les intercommunalités « d'outil indispensable » de mutualisation.
Au regard de cette pluralité intercommunale, la mission souligne la difficulté à définir des règles uniques destinées à s'appliquer de manière indifférenciée à l'ensemble des structures intercommunales.
La mission plaide pour une adaptation du cadre
juridique
de l'intercommunalité à la diversité des
territoires.
2. Un sentiment de dépossession très présent chez les maires et les élus municipaux, révélateur d'un défaut de gouvernance intercommunale
La mission s'est attachée à analyser le « ressenti » des élus locaux, c'est-à-dire leur perception personnelle du fait intercommunal. Pour ce faire, au-delà de l'audition des grandes associations d'élus, elle a tenu à donner directement la parole aux élus de terrain pour croiser les constats, les points de vue et les retours d'expérience. Elle s'est également appuyée sur une consultation en ligne destinée aux élus municipaux.
Les informations qu'elle a ainsi recueillies lui ont permis de constater la récurrence d'un sentiment de dépossession chez certains maires et élus municipaux, tout particulièrement des petites communes. Nombreux sont les maires qui estiment que leurs marges de manoeuvre se sont réduites comme peau de chagrin et qu'ils ne sont plus en capacité à agir au plus près de leurs concitoyens, alimentant chez eux un sentiment d'impuissance et de perte de sens de leur mission.
Certains élus s'estiment également insuffisamment écoutés et pris en compte par les instances intercommunales. À leurs yeux, tout se passe comme s'ils étaient relégués au rang de simples observateurs de décisions prises ailleurs et avec des structures administratives qui les ignorent. Pour la mission, ces ressentis sont le signe d'un réel dysfonctionnement dans le couple intercommunalité-communes. Les témoignages recueillis par la mission ont néanmoins fait apparaître une profonde différence dans le ressenti des maires, selon qu'ils étaient déjà élus lors de la mise en place des intercommunalités issues de la loi NOTRe ou qu'ils ont été élus pour la première fois lors du dernier scrutin municipal et ont par conséquent toujours vécu sous ce régime : dans ce cas, leur appréciation est nettement moins négative que chez les élus de longue date.
La mission appelle à renouer le lien
entre l'intercommunalité
et les communes et à
réenclencher une démarche ambitieuse
de partenariat de
territoire, basée sur la confiance mutuelle.
D. RENOUER AVEC UNE LOGIQUE DE PARTENARIAT DE TERRITOIRE
Face au manque de confiance entre élus communaux et communautaires visible dans certains territoires, il apparaît indispensable de renouer avec l'esprit partenarial qui constitue en principe le socle de la construction intercommunale.
Reconstruire la confiance entre les communes et les intercommunalités implique en premier lieu de ne plus procéder à de nouveaux « mariages forcés », ni à un utopique retour en arrière. Compte tenu de la stabilité de la carte intercommunale depuis son achèvement, il importe donc d'éviter à l'avenir toute nouvelle modification autoritaire de celle-ci. En revanche, la loi ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'adaptation de la carte intercommunale lorsqu'elle émane d'une demande des élus ou permet de surmonter des blocages persistants.
II. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES INTERCOMMUNALITÉS : FAVORISER LES SOLUTIONS CONCERTÉES ENTRE ÉLUS
A. MIEUX ASSOCIER LES ÉLUS MUNICIPAUX AU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ
1. Inciter à une gouvernance intercommunale plus collaborative et plus intégrative
L'éloignement ressenti par les communes et leurs élus est un défi majeur pour les intercommunalités, particulièrement celles de grande taille, parfois qualifiées de « XXL ». Pour inverser cette tendance, la mission juge indispensable une meilleure implication des maires et des élus municipaux dans le fonctionnement intercommunal, ce qui passe par la mise en place de modes de gouvernance plus inclusifs et plus participatifs. Sur le terrain, de bonnes pratiques existent d'ores et déjà, témoignant d'une réelle prise de conscience de la part de certaines intercommunalités de l'enjeu de gouvernance et de leur capacité à mettre en place des solutions adaptées aux caractéristiques institutionnelles et politiques de leur territoire.
Faisant confiance à l'intelligence collective locale, la mission d'information ne souhaite pas imposer, suivant une logique verticale dont les territoires ne veulent plus, un modèle de fonctionnement intercommunal, ni même proposer la création de nouveaux outils. Certains sont déjà prévus par la loi et méritent d'être mieux exploités. Tel est le cas de la conférence des maires qui, quand elle n'est pas méconnue, fait l'objet d'une utilisation à géométrie variable. La mission incite les intercommunalités à mieux utiliser cet outil de gouvernance et à renforcer son rôle en lui permettant, par exemple, de voter une motion d'alerte.
2. Maintenir le mode d'élection actuel des conseillers communautaires
Certains interlocuteurs de la mission d'information ont exprimé leur volonté de voir les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, arguant d'une légitimité démocratique plus forte puisque découlant du vote des citoyens. La mission n'estime pour sa part pas souhaitable de retenir cette solution, ne serait-ce que compte tenu du scrutin municipal à venir en 2026. Qui plus est, le mode d'élection actuel des conseillers communautaires, par « fléchage » depuis la liste des candidats au conseil municipal - pour les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le fait que le conseil communautaire soit l'émanation des conseils municipaux. A contrario, leur élection au suffrage universel direct les doterait d'une légitimité propre et les placerait en concurrence directe avec les conseillers municipaux.
3. Améliorer la formation des élus municipaux et des exécutifs communautaires
La formation des élus locaux constitue un autre levier d'amélioration de la gouvernance des intercommunalités. Le manque de connaissance de la gouvernance propre aux EPCI à fiscalité propre et des outils existants parmi les élus locaux ne facilite en effet pas la communication avec l'exécutif communautaire. Pour y remédier et favoriser un dialogue plus fluide entre les communes et les intercommunalités, il pourrait être envisagé, en début de mandat, d'organiser une « journée des maires », pour leur présenter l'organisation de l'intercommunalité et les outils de gouvernance existants. En outre, des modules de formation à la gouvernance d'un EPCI à fiscalité propre pourraient être offerts aux exécutifs communautaires, toujours dans l'optique de favoriser le dialogue avec les communes membres.
B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
Rebâtir la confiance entre les communes et les intercommunalités passe également par un assouplissement de la répartition des compétences.
Les transferts obligatoires de compétences aux intercommunalités ont en effet généré un important sentiment de dépossession parmi les élus locaux, privés de leur capacité d'action alors qu'ils sont placés en première ligne par leurs administrés. Le cas du transfert des compétences « eau » et « assainissement » constitue à ce titre un exemple.
Il convient dès lors d'éviter tout nouveau transfert de compétences, et de privilégier un assouplissement des règles de répartition des compétences entre communes et intercommunalités, pour adapter cette répartition à la diversité des territoires. Cet assouplissement pourrait passer par exemple par une extension des possibilités de transfert de compétences « à la carte » ainsi que par une unification des régimes de délégations de compétences.
Parallèlement, le principe de subsidiarité doit être strictement appliqué, pour préserver les capacités d'action des communes, ce qui implique notamment la définition de l'intérêt communautaire sur la base de critères formalisés et objectifs.
III L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS INTERCOMMUNAUX EXISTANTS
A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES
À rebours des objectifs des lois Maptam et NOTRe, il semble que le renforcement de l'intercommunalité se soit accompagné non d'économies importantes, mais d'une hausse des dépenses du bloc communal.
Ce rebond des dépenses peut résulter, dans de nombreux territoires, des transferts de compétences et de charges décidés par l'État, ou encore d'une meilleure capacité des EPCI à répondre aux besoins de la population, et ne constitue donc pas nécessairement un effet négatif. L'augmentation des dépenses est d'ailleurs plus faible au sein des intercommunalités les plus intégrées.
B. CRÉER DES RELATIONS FINANCIÈRES INTERCOMMUNALES PLUS PARTENARIALES ET STRATÉGIQUES
La complexité des relations financières entre communes et EPCI s'est souvent invitée dans les auditions menées par la mission, de même que leur caractère injuste ou illisible. C'est particulièrement le cas des attributions de compensation (AC), qui sont trop souvent décorrélées de la réalité des charges transférées aux intercommunalités. De même, les instruments de solidarité intercommunale, comme la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les possibilités de répartition dérogatoires des prélèvements et des versements du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), semblent insuffisamment utilisés. La mission avance donc plusieurs pistes pour rendre les relations financières entre communes et EPCI plus partenariales et apaisées :
· assouplir les conditions de révision des attributions de compensation lorsque la commission d'évaluation des charges transférées fait apparaître que leur montant est manifestement inadapté ;
· recourir plus largement aux instruments de solidarité financière entre communes et EPCI, qu'il s'agisse du FPIC ou de la dotation de solidarité communautaire (DSC) ;
· faire des fonds de concours, là où les élus souhaitent les utiliser, un véritable levier au service d'investissements favorisant le projet de territoire.
C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Les outils de mutualisation sont nombreux et celle-ci peut prendre diverses formes. Une forme minimale de mise en commun consiste en la participation à des groupements de commandes, mais des formes plus intégrées existent, de la mise à disposition d'agent(s) à la création de services communs, en passant par la mise à disposition de services.
La mission considère que les services communs constituent un dispositif vertueux, particulièrement s'agissant des fonctions de secrétariat.
Enfin, la mission relève que les services communs permettent une mutualisation « à la carte », certaines communes pouvant décider d'avancer ensemble dans certains domaines (fonctions supports, par exemple), tandis que d'autres communes de la même intercommunalité peuvent préférer utiliser le levier des groupements de commandes si celui-ci leur paraît mieux adapté. Il s'agit donc d'un dispositif souple et adaptable selon les besoins des élus et des territoires.
Les services communs constituent un exemple concret d'efficacité intercommunale. Leur développement devrait donc constituer une priorité pour les intercommunalités, en fonction de leurs besoins spécifiques identifiés.
I. RENOUER AVEC LES RACINES PARTENARIALES DE L'INTERCOMMUNALITÉ
A. UNE RÉPONSE À L'ÉMIETTEMENT COMMUNAL
1. Le défi du morcellement communal : une constante dans l'histoire institutionnelle française
a) Un éparpillement qui pose d'emblée la question de la coopération entre communes
L'organisation territoriale française, constituée de quatre échelons de plein exercice - État, région, département, commune - auxquels se sont progressivement ajoutées de multiples structures de « coopération », est souvent qualifiée de « millefeuille » pour en souligner la complexité. L'une des spécificités bien connues de cette organisation tient à son morcellement communal.
Avec 34 875 communes en métropole et dans les départements d'Outre-mer (DOM) au 1er janvier 2025, la France compte à elle seule 40 % du nombre total de communes de l'Union européenne, alors qu'elle représente 15 % de sa population. Comparé aux 44 000 municipalités créées à la Révolution, sur l'héritage des paroisses de l'Ancien Régime, ce chiffre marque une modeste diminution. Par comparaison, au cours des quarante dernières années, le nombre de communes a été très significativement réduit dans la plupart des pays européens : de 87 % en Suède, de 79 % au Royaume-Uni et de 41 % en Allemagne.
Cette singularité communale française repose sur un attachement très fort à la commune en tant que creuset d'identité et échelon administratif de proximité5(*). Elle a engendré une seconde particularité, le développement, depuis la fin du XIXe siècle, de différentes formes de coopération intercommunale. L'histoire institutionnelle française est en effet traversée par l'opposition entre deux aspirations : d'un côté, le souhait de préserver le socle communal, de l'autre, la reconnaissance de la nécessaire adaptation des périmètres communaux aux réalités socio-économiques des territoires.
De la IIIe à la Ve République, de nombreux dispositifs législatifs ont tenté de dépasser cette volonté contradictoire, en proposant des systèmes d'association susceptibles d'allier respect de l'intégrité communale et efficacité publique.
Les limites opérationnelles inhérentes à cette fragmentation communale étaient d'ailleurs déjà bien présentes dans les esprits puisque l'instruction de l'Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives, en date du 12 août 1790, ouvre la voie à des regroupements entre communes, dans les termes suivants : « Il peut être à la convenance de plusieurs communes de se réunir en une seule municipalité ; il est dans l'esprit de l'Assemblée nationale de favoriser ces réunions, et les corps administratifs doivent tendre à les provoquer et à les multiplier par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. C'est par elles qu'un plus grand nombre de citoyens se trouvera lié sous un même régime, que l'administration municipale prendre un caractère plus important, et qu'on obtiendra deux grands avantages toujours essentiels à acquérir, la simplicité et l'économie. ». La recherche de ces deux avantages va dès lors constituer une ligne directrice pour la coopération intercommunale.
b) Les syndicats de communes, première forme d'intercommunalité de services
Si les premières coopérations entre communes prennent la forme d'ententes et de conférences, dont le régime juridique est défini par la loi du 5 avril 18846(*), le véritable point de départ de l'institutionnalisation de l'intercommunalité française est fixé par la loi du 22 mars 1890 qui crée les syndicats de communes7(*). Conçue sous la forme d'un complément à la loi du 5 avril 1884, la loi de 1890 propose, à destination des communes, une déclinaison de la liberté d'association que l'esprit libéral de la IIIe République s'est employé à garantir d'abord aux syndicats professionnels avec la loi du 21 mars 1884, puis à toute association avec la loi du 1er juillet 1901.
Le syndicat de communes (qui deviendra le syndicat intercommunal à vocation unique, ou SIVU) repose sur une logique de subsidiarité institutionnelle, articulée autour de la primauté de la volonté communale : l'initiative de l'association et la délimitation des missions du syndicat - institution secondaire - relèvent de la libre volonté des communes partenaires - institutions primaires -, l'action de l'État se limitant à un rôle procédural.
Au-delà de cette dimension politique, cette première forme d'intercommunalité revêt un caractère technique : elle doit permettre de répondre aux besoins d'équipement d'un territoire donné (assainissement, voirie, électrification, adduction d'eau...) que les capacités d'intervention individuelles des communes ne peuvent pas satisfaire.
Dans la pratique, cette possibilité offerte aux communes de se regrouper ne rencontre, à ses débuts, pas beaucoup de succès : en 1908, seuls 22 syndicats sont recensés. Il faut attendre les années 1920 et 1930 pour qu'une dynamique intercommunale s'enclenche sous l'effet d'un arsenal législatif incitant les élus locaux à investir les syndicats de communes8(*). En 1935, la France compte ainsi plus de 2 000 syndicats de communes.
Sous la IVe République, leur progression se poursuit, dans un contexte de relative stabilisation de l'organisation territoriale ; en 1953, plus de 3 800 syndicats sont dénombrés. Le « trio de tête » des compétences intercommunales est alors composé de l'électrification, de la gestion de l'eau et de la voirie.
Les EPCI sans fiscalité propre et les syndicats mixtes
Les EPCI sans fiscalité propre ou syndicats de communes associent des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal9(*) et dépendent, à la différence des EPCI à fiscalité propre, des contributions des communes membres.
Parmi les syndicats de communes, on distingue :
- les syndicats à vocation unique (Sivu), qui n'exercent qu'une unique compétence ;
- les syndicats à vocation multiple (Sivom), exerçant plusieurs compétences.
Les syndicats mixtes constituent quant à eux des établissements publics de coopération locale et peuvent associer des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités pour mettre des moyens en commun afin d'exercer ensemble une ou plusieurs activités d'intérêt général. Ces syndicats peuvent être fermés lorsqu'ils sont composés uniquement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI10(*) ; ou bien ouverts, lorsqu'ils intègrent, en plus des communes et des EPCI, d'autres personnes morales de droit public tels que des départements, des régions, d'autres établissements publics, des chambres de commerce et d'industrie, etc11(*).
2. Le renforcement de l'intercommunalité sous la Ve République : un fil rouge des réformes territoriales successives
Face à la persistance de l'émiettement communal, des réponses plus ambitieuses et plus intégrées voient le jour sous la Ve République, suivant d'abord une logique d'encouragement à la coopération volontaire jusqu'aux années 2000, puis une logique contraignante de regroupement, souvent qualifiée de « marche forcée », à partir des années 2010. Ainsi le décret n° 59-936 du 31 juillet 1959 prévoit que « les syndicats mixtes peuvent être autorisés à exécuter, avec les mêmes droits que les communes, les départements et leurs groupements [...] les travaux de défense contre les eaux, d'assainissement ou d'irrigation ».
À côté de la traditionnelle intercommunalité dite « de services », reposant sur la gestion partagée d'équipements et de services publics, se développe alors une intercommunalité dite « de projet », fondée sur la conduite collective de projets communs de développement local.
a) La création de nouvelles formes de regroupement communal
Parallèlement à la promotion de structures de coopération, une politique de promotion des regroupements de communes a été mise en place.
(1) La promotion des fusions de communes
Pour réduire le nombre total de communes et sur le modèle du dispositif de fusions de communes institué en Belgique12(*), la loi dite « Marcellin » de 197113(*) a d'abord entendu encourager les fusions de communes, à travers l'institution de deux régimes distincts :
- d'une part, la fusion simple, qui entraîne la disparition des communes ayant décidé de fusionner, mais qui peut donner lieu à la création d'annexes de la mairie sur le territoire des anciennes communes ;
- d'autre part, la fusion association, qui donne lieu à la création d'une ou plusieurs communes associées14(*) - chacune d'entre elle conservant sa dénomination antérieure. La création d'une commune associée entraîne également la mise en place d'une annexe de la mairie - notamment pour l'établissement des actes de l'état civil - ainsi que l'élection d'un maire délégué, chargé d'exercer les fonctions d'officier de l'état civil et d'officier de police judiciaire.
Le régime issu de la loi « Marcellin » a par la suite été remplacé, en 201015(*), par un nouveau dispositif de fusion de communes se voulant « plus simple, plus souple et plus incitatif16(*) », en ce qu'il n'exige plus automatiquement de consultation préalable des citoyens : il s'agit du dispositif des communes nouvelles, qui vise à promouvoir encore davantage la réduction du nombre de communes.
(2) Le développement de l'intercommunalité, sur la base du principe de libre association des communes
Parallèlement à l'encouragement aux fusions de communes, le législateur a souhaité promouvoir l'intercommunalité, dans l'objectif de mutualiser la gestion de certaines compétences, dont les enjeux dépassent le seul cadre communal.
(a) La création de plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Plusieurs catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dotés de compétences obligatoires et percevant des recettes fiscales, ont pour ce faire été instituées par le législateur, avec par exemple la création des districts urbains en 195917(*), des communautés urbaines en 196618(*) et des communautés de communes et des communautés de villes en 199219(*).
La loi dite « Chevènement » de 199920(*) est ensuite venue clarifier et rationaliser le cadre intercommunal en réduisant le nombre de catégories d'EPCI à fiscalité propre, pour conserver uniquement les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.
Le cadre issu de la loi « Chevènement » a enfin été complété par la création des métropoles en 201021(*).
Les catégories d'EPCI à fiscalité propre
En l'état du droit et au terme de ces nombreuses évolutions législatives, il existe désormais quatre catégories d'EPCI à fiscalité propre :
- les communautés de communes22(*) ;
- les communautés urbaines, qui réunissent plusieurs communes formant, à la date de la création de l'EPCI à fiscalité propre, un ensemble de plus de 250 000 habitants23(*) ;
- les communautés d'agglomération, qui regroupent plusieurs communes devant former, lors de la création, un ensemble de plus de 50 000 habitants, autour d'une ou plusieurs communes centres de 15 000 habitants24(*) ;
- et les métropoles, qui peuvent être créées dans les grandes aires urbaines, à partir d'EPCI à fiscalité propre existants et respectant certains critères de population25(*).
(b) Les incitations au développement de l'intercommunalité
Une politique d'incitation au regroupement de communes au sein d'EPCI à fiscalité propre a ensuite été mise en oeuvre.
Le principe était celui de la libre association des communes au sein de structures intercommunales, comme le prévoit l'article 66 de la loi dite « ATR26(*) », aujourd'hui codifié à l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».
Ce principe a été rappelé en 1999 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'intérieur, au moment de l'examen à l'Assemblée nationale de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, durant lequel il a indiqué que l'intercommunalité relevait de « l'initiative des élus27(*) ».
Toutefois, si le principe restait bien celui de la libre association des communes, des incitations à la constitution d'EPCI à fiscalité propre ont parallèlement été créées, pour encourager les élus communaux à rejoindre une de ces structures, avec par exemple :
- la création d'une dotation par habitant de 250 francs28(*) environ, au bénéfice des communautés d'agglomération créées ;
- ou encore la bonification de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes qui exerçaient davantage de compétences et qui adoptaient la taxe professionnelle unique29(*).
b) L'intercommunalité « fédérative » à fiscalité propre : une originalité française pour éviter les phénomènes de concurrence entre collectivités
Contrairement à d'autres pays européens dans lesquels la coopération locale prend largement une forme « associative », la France fait partie, avec l'Allemagne, des quelques pays dans lesquels la coopération locale prend plus volontiers une forme « fédérative », qui désigne une forme de coopération plus intégrée où un ensemble de compétences est transféré au niveau supra-communal et financé au moyen d'une fiscalité propre.
La fiscalité propre constitue une réponse française à un problème de concurrence économique et fiscale entre collectivités : si les contribuables locaux peuvent « voter avec leurs pieds » en changeant de collectivité de résidence, chaque collectivité sera incitée à fixer un taux au niveau le plus bas. Cette « course au moins-disant » engendrerait nécessairement une diminution des ressources des collectivités concernées, avec des conséquences négatives en termes de niveau de fourniture de services et d'équipements publics.
L'intercommunalité à fiscalité propre répond à cette problématique : en transférant les compétences et les ressources vers un échelon supérieur - en l'occurrence l'intercommunalité -, la concurrence entre les communes est atténuée.
Il existe toutefois plusieurs régimes fiscaux intercommunaux - et en particulier deux principaux :
- le premier, le moins intégré, est celui de la fiscalité additionnelle (FA)30(*), dans laquelle la commune continue de percevoir les quatre taxes locales - taxe d'habitation (sur les seules résidences secondaires depuis 2020, dite « THRS »), les deux taxes foncières sur le foncier bâti (TFPB) et non bâti (TFNB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) - tandis que l'EPCI fixe des taux additionnels sur ces quatre taxes et perçoit en outre des impositions professionnelles diverses (impositions sur les entreprises de réseaux - IFER - et taxe sur les surfaces commerciales - Tascom, notamment) ;
- le second, celui de la fiscalité professionnelle unique (FPU)31(*) qui correspond à la majorité des intercommunalités32(*), où la commune perçoit la fiscalité sur les ménages (THRS, TFPB, TFNB) tandis que l'EPCI perçoit la fiscalité professionnelle (CFE, Tascom, IFER, etc.).
Schéma de financement du bloc communal selon le régime fiscal
|
Communauté de communes |
Communauté d'agglomération |
Communauté urbaine |
Métropole |
||
|
Régime fiscal |
FA |
Peut opter pour la FPU |
FPU |
||
|
Impôts perçus par les communes |
THRS ; TFPB ; TFNB ; CFE |
Intégralité de la THRS ; TFPB ; TFNB |
|||
|
Impôts perçus par l'EPCI |
Taux additionnels sur les THRS ; TFPB ;
TFNB ; CFE |
Intégralité de la CFE ; Tascom ; IFER |
|||
Source : mission d'information
Ce régime permet « de mettre fin à une situation de concurrence entre communes pour les implantations économiques en mutualisant la fiscalité assise sur les entreprises »33(*).
En ce sens, l'intercommunalité à FPU instaure une véritable solidarité entre communes, puisque la mutualisation de la ressource fiscale limite les inégalités entre les communes membres. Elle favorise également la coopération puisque ces ressources mises en commun permettent de réaliser des équipements et de porter des compétences qu'une commune seule ne pourrait assumer.
B. AVEC LES LOIS « MAPTAM » ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »
1. « Big is beautiful » : de l'incitation à l'injonction
a) Le bilan mitigé de la politique de promotion des regroupements communaux
(1) Le faible nombre de fusions de communes
Le bilan de la loi « Marcellin » de 1971 apparaît plus que mitigé, puisqu'entre 1971 et 200934(*) :
- seules 943 fusions ont été prononcées, donnant lieu à la suppression de 1 343 communes ;
- parallèlement, 180 défusions ont été effectuées, ce qui a conduit à la création de 243 communes par défusion.
Au global, ce sont donc seulement 1 100 communes qui ont été supprimées grâce au dispositif de fusions de communes issu de la loi « Marcellin ».
Ce succès limité a conduit à la création d'un nouveau régime de fusions de communes, celui des communes nouvelles35(*).
En dépit des incitations financières mises en place, le bilan des communes nouvelles apparaît également en demi-teinte - bien que plus important que celui de la loi « Marcellin ». En effet, entre 2010 et 2022, seules 787 communes nouvelles avaient été créées36(*).
Si les communes nouvelles semblent globalement atteindre leurs objectifs, le nombre de fusions de communes est resté relativement faible depuis le début des années 2010. Elles ont été relativement nombreuses entre 2016 et 2019 : en 2015, la France comptait 20 communes nouvelles ; en 2019, ce nombre était porté à 771. Il n'a que peu évolué depuis, s'établissant à 804 en 2024.
Évolution du nombre de communes nouvelles et de fusion de communes
Source : mission d'information
Ce dynamisme est toutefois fortement concentré dans l'ouest du pays : les régions Normandie et Pays de la Loire sont particulièrement concernées, alors que d'autres n'ont vu la création que d'un très petit nombre de communes nouvelles.
Localisation des communes nouvelles
Source : Cour des comptes
Encore ces chiffres ne tiennent-ils pas compte du phénomène plus récent des scissions de communes, qui correspond à la « défusion » d'une commune nouvelle. Entendu par la mission d'information, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a d'ailleurs rappelé les enjeux de la création de tels regroupements : « pour fusionner deux communes, même quand les équipes s'entendent bien, il faut avoir la foi chevillée au corps, car parfois elles dé-fusionnent cinq ou six ans plus tard, au gré des changements d'équipes ».
(2) Un nombre important de « communes isolées », n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
De même, le bilan de la politique de promotion de l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre est apparu décevant.
Ainsi, au 1er janvier 2009, 6,9 % des communes (soit 2 516 communes) demeuraient isolées et 12,7 % de la population (soit 8,2 millions d'habitants) n'étaient pas intégrés au sein d'un EPCI à fiscalité propre37(*).
b) Le passage à une logique d'injonction à la coopération intercommunale
Face au bilan mitigé de la politique d'incitation à la création d'EPCI à fiscalité propre, le législateur a fait le choix de passer à une logique d'injonction à la coopération intercommunale.
La loi dite « RCT » de 201038(*) a ainsi posé le principe d'une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, rendant obligatoire, pour les communes, l'adhésion à une structure intercommunale.
Un seuil minimal de population pour chaque EPCI à fiscalité propre, fixé à 5 000 habitants, a par ailleurs été prévu par le législateur. Ce seuil a par la suite été rehaussé à 15 000 habitants par la loi dite « NOTRe39(*) » - sauf dérogation accordée par le préfet - donnant lieu à une nouvelle révision d'ampleur de la carte intercommunale.
La loi a toutefois prévu des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses, avec un seuil minimal à 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins récemment constituées pouvaient être maintenues.
Dans le cadre plus large d'une vaste réforme de l'organisation territoriale, l'objectif de la fixation de ces seuils était de permettre à chaque structure intercommunale d'atteindre une taille critique pour exercer des compétences stratégiques. Les intercommunalités rénovées avaient vocation, avec les « grandes régions » créées par la même loi, à constituer l'armature privilégiée du territoire national, la suppression des départements ayant même, un temps, été évoquée.
2. Une mise en oeuvre hétérogène ayant conduit, dans de nombreux territoires, à des regroupements au forceps
a) Les préfets ont été chargés d'achever la carte intercommunale
Les préfets ont été chargés, en application des lois « RCT » et « NOTRe », d'assurer la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, et ont à ce titre, élaboré les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui fixent les périmètres des intercommunalités dans le département.
En application de la loi « RCT », les préfets étaient ainsi tenus d'arrêter les SDCI avant le 31 décembre 2011. La révision des SDCI rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi « NOTRe » devait quant à elle être arrêtée par les préfets avant le 31 mars 2016 pour mise en oeuvre au 1er janvier 2017.
Les schémas départementaux de coopération intercommunale
Aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le SDCI est un document de programmation qui prévoit, pour chaque département :
- une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ;
- la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ;
- la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants.
Une fois élaboré par le préfet, le droit commun prévoit que le projet de SDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux et organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la carte intercommunale. Ces derniers peuvent se prononcer sur le projet de SDCI dans un délai de deux mois ; à défaut, leur avis est réputé favorable.
Le projet de SDCI est ensuite présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale40(*) (CDCI), composée d'élus locaux et consultée pour chaque projet de création, de modification ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre41(*) et qui dispose de trois mois pour se prononcer sur ce document et proposer d'éventuelles modifications, qui sont adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres et intégrées au projet de schéma, avant d'être arrêté définitivement par le préfet.
b) Des préfets dotés de pouvoirs dérogatoires pour arrêter les schémas départementaux de coopération intercommunale
Pour arrêter au plus vite les SDCI et garantir une couverture rapide du territoire par des EPCI à fiscalité propre, les préfets ont été dotés, à titre transitoire, de pouvoirs dérogatoires leur permettant d'arrêter les SDCI, même en cas de désaccord avec les communes concernées42(*).
Comme indiqué dans le rapport du Sénat consacré à l'avenir de la commune et du maire en France43(*) :
- d'une part, « le périmètre intercommunal pouvait être arrêté après accord non plus de l'ensemble des communes membres mais d'une majorité qualifiée de celles-ci ». Plus précisément, lorsque les projets de SDCI avaient fait l'objet d'un avis favorable d'au moins la moitié des communes concernées, représentant les deux tiers de la population du périmètre proposée (ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population), les préfets ont pu prendre directement des arrêtés de périmètre définitifs ;
- d'autre part, en l'absence d'atteinte des majorités qualifiées des conseils municipaux, « le préfet a été autorisé à passer outre les désaccords des communes pour toute création ou toute modification d'un périmètre d'EPCI à fiscalité propre », en saisissant directement la CDCI et « sous réserve des amendements votés à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI ».
c) Une couverture intégrale du territoire par des structures intercommunales, parfois au prix de « mariages forcés »
(1) L'objectif de couverture intégrale du territoire national par des établissements publics de coopération intercommunale a été atteint
Le principe d'adhésion obligatoire à un EPCI à fiscalité propre a permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire national par des EPCI à fiscalité propre - qui n'avait précédemment pas été atteint par la seule politique d'incitation mise en place.
Ainsi, dès l'année 2021, « l'ensemble du territoire était recouvert par le maillage des EPCI (...) regroupant ainsi 68,2 millions d'habitants ».
Seules quatre communes bénéficiant d'une dérogation législative demeurent isolées en raison de leur insularité, à savoir les îles de Bréhat, d'Ouessant, de Sein et d'Yeu.
Carte de l'intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2025
(2) Un achèvement de la carte intercommunale ayant entraîné des « mariages forcés », en raison d'une consultation insuffisante des élus locaux
La mise en place de pouvoirs dérogatoires pour le préfet, destinés à achever au plus vite la carte intercommunale, a conduit à des regroupements forcés dans plusieurs territoires.
Dès 2019, un rapport de l'Assemblée nationale indiquait que « plusieurs élus (...) ont souligné le caractère forcé de certaines démarches et la volonté de certains préfets de favoriser la création de très vastes EPCI, au-delà des critères fixés par la loi44(*) ».
Ce constat s'est retrouvé au cours des auditions conduites par la mission d'information. Interrogé à ce sujet, André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de France (AMF), a ainsi indiqué à la mission d'information que « durant la mise en place de cette intercommunalité, parfois à marche forcée, il y a eu des préfets zélés - j'utilise un terme aimable -, ce qui a conduit à une certaine brutalité. Là où cela s'est passé ainsi, le malaise reste encore présent et s'est même parfois amplifié ».
De même, selon Yannick Moreau, président de l'Association nationale des élus des littoraux (Anel), « les périmètres qui ont été établis en 2017 ont été fixés au forceps dans un calendrier très contraint et, selon les départements, ont été plus ou moins acceptés, plus ou moins subis ».
De même, pour Jean Deguerry, vice-président de l'Assemblée des départements de France, « il y a eu des mariages forcés, ce qui a laissé des traces », car, bien souvent, « la marche a été trop haute », comme l'a souligné un élu des Hautes-Pyrénées lors du déplacement de la mission.
Là encore, la fusion en de grandes entités a écrasé les identités rurales, ce qui a logiquement entraîné des dissensions, même si les élus s'y sont résignés. Un interlocuteur de la mission estimait même que cet « accouchement dans la douleur » avait rendu plus difficile le transfert de compétences aux intercommunalités.
S'en est par ailleurs suivi une perte de confiance dans les exécutifs des intercommunalités, dont les effets se font encore sentir dans bon nombre de celles dont les maires ont regretté le mauvais fonctionnement.
3. La rationalisation de l'intercommunalité sans fiscalité propre
Le développement des EPCI à fiscalité propre s'est accompagné d'une diminution du nombre d'EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes - objectif fixé par les SDCI, qui doivent « prévoir (...) les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants45(*) ».
L'objectif de cette rationalisation était de transférer « les compétences qui étaient jusqu'à présent exercées par des syndicats (...), chaque fois que cela est possible, à des intercommunalités à fiscalité propre46(*) ».
Plusieurs mesures en ce sens ont été prévues directement par le législateur. L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les syndicats de communes sont dissous de plein droit, par exemple lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date de transfert à un EPCI à fiscalité propre ou à un syndicat mixte des services en vue desquels il avait été institué.
Sous l'effet de ces mesures, le nombre de syndicats a donc été divisé par deux entre 1999 et 2021, passant de plus de 18 000 en 1999 à 9 000 en 202147(*).
C. RÉALITÉ ET PERCEPTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ
1. L'hétérogénéité des situations intercommunales, reflet de la diversité des territoires
L'intercommunalité s'est progressivement imposée comme un élément structurant du paysage institutionnel français, selon un double mouvement de renforcement de l'intégration communautaire, via un transfert croissant de compétences, et de généralisation des structures intercommunales sur l'ensemble du territoire.
À cette reconnaissance de l'intercommunalité comme modèle de coopération entre communes fait écho une réalité plus complexe au niveau de sa mise en oeuvre dans les territoires. L'analyse du fait intercommunal révèle en effet une très grande hétérogénéité des situations, lesquelles dépendent largement des contextes politiques et institutionnels locaux ainsi que des modes de gouvernance mis en place.
Nombreux sont les interlocuteurs auditionnés par la mission d'information qui ont insisté sur cette diversité intercommunale.
Ainsi, parmi les représentants des collectivités et les élus, Romain Colas, vice-président de l'Association des petites villes de France (APVF), a mis en évidence des différences en matière de « gouvernance, d'état d'esprit et [de] maturité communautaire ». Ayant également relevé « la diversité des réponses » en matière intercommunale, Éric Woerth, ancien ministre, entendu en qualité d'auteur, en 2024, du rapport au Président de la République sur la décentralisation48(*), y voit la conséquence logique de la diversité des territoires en France.
Du côté des représentants institutionnels, l'analyse est identique. Jean-Pierre Viola, président de section à la quatrième chambre de la Cour des comptes, a ainsi indiqué qu'« il y [avait] autant d'intercommunalités que de situations différentes, qu'il est difficile de caractériser et de faire entrer dans une catégorie commune », tandis que Cécile Raquin, directrice générale des collectivités locales (DGCL) au ministère de l'intérieur, a rappelé l'extrême diversité des formules intercommunales (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes).
L'intercommunalité se décline donc au pluriel, aussi bien en termes de périmètre, de mode de gouvernance que d'esprit communautaire. La mission d'information a pu pleinement le mesurer lors de ses déplacements sur le terrain, notamment dans le département des Hautes-Pyrénées. Les neuf intercommunalités qui le constituent, parmi lesquelles huit communautés de communes et une communauté d'agglomération49(*), bien que liées par une histoire commune, n'ont ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes pratiques. La table ronde réunissant à l'Hôtel du département l'ensemble des neuf présidents d'intercommunalité a ainsi mis en évidence d'importantes différences en matière d'exercice des compétences et de fonctionnement interne des structures intercommunales.
Un certain nombre de facteurs identifiés au cours des travaux de la mission d'information permettent d'expliquer pour partie la variété des situations intercommunales :
- l'histoire institutionnelle locale, qui conditionne l'existence ou non d'une culture de la coopération ;
- le rapport ville-centre/périphérie, qui est un facteur déterminant dans le transfert de compétences, la présence d'une ville-centre dominante d'un point de vue démographique pouvant susciter des réticences de la part des petites communes50(*) ;
- le degré de portage politique du projet communautaire, qui dépend beaucoup de la personnalité du président de l'intercommunalité ;
- le mode de gouvernance mis en place, qui associe plus ou moins les maires et les élus municipaux.
Au regard de la multiplicité des situations intercommunales, la mission d'information souligne la difficulté à définir des règles uniques destinées à s'appliquer de manière indifférenciée à l'ensemble des structures intercommunales et plaide, en conséquence, pour une adaptation du cadre juridique de l'intercommunalité à la diversité des territoires.
2. Un sentiment de dépossession très présent chez les maires et les élus municipaux, révélateur d'un défaut de gouvernance intercommunale
La mission d'information s'est attachée à analyser ce qu'il est possible de qualifier de « ressenti » des élus locaux, c'est-à-dire leur perception personnelle du fait intercommunal.
S'il n'est pas aisé d'objectiver un phénomène intrinsèquement subjectif, la mission d'information a souhaité donner le plus possible la parole aux élus de terrain pour croiser les constats, les points de vue et les retours d'expérience. Elle s'est également appuyée sur la propre expérience d'élus locaux de ses membres et sur une consultation en ligne qu'elle a élaborée à destination des élus municipaux.
Les informations qu'elle a ainsi recueillies lui ont permis de constater, sur un large spectre d'émotions allant de la résignation à l'enthousiasme, la récurrence d'un sentiment de dépossession chez les maires et les élus municipaux, tout particulièrement des petites communes.
Cette dépossession se fait ressentir au niveau des prérogatives communales : face à des intercommunalités parfois de taille XXL et aux compétences élargies à des domaines relevant auparavant du pré carré communal, nombreux sont les maires qui estiment que leurs marges de manoeuvre se sont réduites comme peau de chagrin et qu'ils ne sont plus en capacité à agir au plus près de leurs concitoyens. Ceci alimente chez eux un sentiment d'impuissance et de perte de sens de leur mission. Associée à d'autres facteurs (baisse des ressources financières, complexité croissante des affaires publiques locales), cette dépossession participe du « blues des maires », phénomène abondamment analysé ces dernières années.
Mais cette dépossession a également un impact fort sur le fonctionnement intercommunal : le fait que le centre de gravité décisionnel ait été déplacé au niveau de l'intercommunalité et la difficulté, si ce n'est parfois l'incapacité, de celle-ci à associer de manière pertinente ses communes membres et leurs représentants à la prise de décision donnent aux élus municipaux le sentiment qu'ils sont peu écoutés voire relégués au rang de simples observateurs. À ce problème de gouvernance s'ajoute une complexité de fonctionnement, parfois perçue comme technocratique, qui contribue au sentiment d'incompétence voire au « décrochage » de certains élus.
Extraits de propos tenus en audition évoquant le sentiment de dépossession des maires et des élus municipaux
? Jean Deguerry, vice-président de l'Assemblée des départements de France (ADF) : « Les intercommunalités sont parfois ressenties comme technocratiques par les maires, notamment ruraux, qui s'y sentent étrangers. J'observe de plus en plus de désaffection de la part de maires, qui ne trouvent plus leur place et qui, à mon avis, ne l'ont jamais vraiment trouvée. Beaucoup redoutent une dépossession du pouvoir communal et une négation de leur capacité à agir au plus près de leurs concitoyens. »
? Marie Annick Fournier, déléguée générale de l'Association nationale des élus de la montagne (Anem) : « Les élus de montagne ont souvent le sentiment d'être éloignés, incompris, notamment lorsqu'ils sont minoritaires. [...] S'agissant de la répartition des compétences entre communes et intercommunalités, on a le sentiment que le bloc de compétences obligatoires dépossède les élus d'une partie des prises de décision. La gouvernance n'est pas adaptée et ne permet pas aux petites communes d'être suffisamment prises en compte dans les débats, qui peuvent, en outre, parfois revêtir une certaine technicité. »
? Géraldine Leduc, directrice générale de l'Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett) : « L'une des principales difficultés est le sentiment de perte d'identité de nos petites communes touristiques, qui se retrouvent diluées dans de grandes intercommunalités. Certains maires n'ont plus les moyens de promouvoir leur tourisme communal. De nombreuses communes ont ainsi perdu en termes de lisibilité et de visibilité auprès des touristes. »
?Paul-Roland Vincent, maire de Bourgneuf : « Nous avons le sentiment de gérer le quotidien et que les grandes décisions nous échappent, ce qui est assez désagréable. »
Les résultats de la consultation en ligne conduite par la mission, même s'ils doivent être pris avec les précautions méthodologiques nécessaires puisqu'ils reposent sur une base déclarative, corroborent le sentiment de dépossession des élus municipaux : 46 % des répondants indiquent ainsi ne pas peser suffisamment sur les décisions de leur intercommunalité ; a contrario, ils ne sont que 18 % à considérer être en mesure de le faire.
La consultation révèle toutefois un rapport ambivalent des élus municipaux à l'intercommunalité. Alors qu'une majorité de répondants s'estime insuffisamment pris en compte dans le processus intercommunal, ils sont 75 % à considérer soit que l'intercommunalité fonctionne bien, soit qu'elle ne fonctionne ni bien ni mal. En outre, 44 % des répondants déclarent que l'intercommunalité bénéficie à leur commune. Cette ambivalence, qui avait déjà été relevée, il y a deux ans, par la mission d'information du Sénat sur l'avenir du maire et de la commune, montre que l'intercommunalité n'a pas les mêmes conséquences pour toutes les communes et qu'elle n'est donc pas vécue de la même manière par leurs élus : dans certains cas, elle est considérée comme un atout pour l'action publique locale, dans d'autres, comme une menace pour la capacité d'intervention communale, voire comme la source d'une perte de sens.
C'est ce qu'illustrent les propos de Yann Scotte, maire d'Hardricourt, lors de son audition : « Je ne me représenterai pas, car le mandat a beaucoup perdu de son sens. Pour moi, c'était le plus beau mandat, le plus proche aussi, mais aujourd'hui j'en doute, car beaucoup de choses nous échappent ».
D'une manière générale, la table ronde de maires non membres d'un exécutif communautaire organisée par la mission a montré que ceux-ci avaient une vision fort différente de leur intercommunalité selon qu'ils étaient déjà élus lors de la mise en place des intercommunalités issues de la loi NOTRe ou qu'ils avaient été élus pour la première fois en 2020 et, par conséquent, n'ont connu que ces intercommunalités : les premiers étaient nettement plus critiques que les seconds.
Par ailleurs, comme l'a expliqué Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, vice-président de l'Association des petites villes de France, devant la mission : « Je partage largement votre diagnostic sur le regard que l'on porte à l'exécutif des intercommunalités selon qu'on y appartienne ou non, mais j'ai tendance à porter un jugement très négatif sur la paralysie des institutions du fait de rancoeurs personnelles. Nous avons là une responsabilité collective et individuelle : l'intérêt général doit passer avant l'expression de nos inimitiés. [...] Au-delà des désaccords, nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Nous avons la fâcheuse tendance à critiquer la loi, mais ce sont parfois les personnes qui sont responsables. »
Compte tenu de la récurrence avec laquelle le sentiment de dépossession, principalement des maires des petites communes, a été évoqué lors de ses travaux, la mission d'information estime que ce ressenti est le signe d'un réel dysfonctionnement dans le couple intercommunalité-communes, qui nécessite de renouer avec une démarche ambitieuse de partenariat de territoire.
3. Une appréciation globalement positive de l'intercommunalité de la part des exécutifs intercommunaux
En 2024, le centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) a mené une enquête51(*) sur un échantillon de 3 566 présidents et vice-présidents intercommunaux pour tenter d'objectiver les rapports entre communes et intercommunalités.
Celle-ci révèle que, selon les répondants, 60 % des intercommunalités ne connaissent pas de franche opposition interne ; dans la plupart des cas, les votes au sein des conseils communautaires se déroulent de manière unanime.
Cet aspect consensuel se retrouve également dans l'avis porté sur le fonctionnement du conseil communautaire. Seuls 10 % des répondants estiment que leur conseil fonctionne mal, alors que le taux de satisfaction dépasse les 70 %. Le bon fonctionnement des conseils communautaires domine donc largement dans la perception que s'en font les exécutifs communautaires.
Cette appréciation positive se traduit aussi dans le jugement porté sur les résultats de l'intercommunalité : près des trois-quarts des répondants estiment que le bilan de leur intercommunalité depuis 2020 est positif.
L'étude souligne enfin l'aspiration des élus intercommunaux à la stabilité, 68 % d'entre eux déclarant souhaiter maintenir la taille actuelle de leur intercommunalité.
4. Renouer avec une logique de partenariat de territoire en conciliant stabilisation de la carte intercommunale et évolution parfois nécessaire
Les objectifs fixés par les lois « RCT » et « NOTRe » en matière de développement de l'intercommunalité ont été atteints. Comme indiqué supra, le territoire national est en effet intégralement couvert par des EPCI à fiscalité propre, à l'exception des quatre communes isolées, qui bénéficient d'une dérogation octroyée par le législateur.
Le nombre d'EPCI à fiscalité propre reste, en outre, relativement stable depuis l'achèvement de la carte intercommunale opéré par les lois « RCT » et Maptam et les personnes entendues par la mission d'information ont fait état de la stabilité des périmètres.
Nombre d'EPCI à fiscalité propre
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Métropole |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Communautés urbaines |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Communautés d'agglomération |
223 |
227 |
227 |
229 |
230 |
|
Communautés de communes |
996 |
992 |
992 |
990 |
989 |
|
Nombres d'EPCI à fiscalité propre |
1 253 |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
1 254 |
Source : Bulletin d'information
statistique,
Département des études et des statistiques
locales, DGCL, n° 195 - avril 2025
Interrogé à ce sujet, Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France a indiqué que « depuis 2020, parmi les 1 254 intercommunalités, il y a eu six fusions, trois scissions et quelques retraits d'adhésion de communes : neuf en 2023, cinq en 2024 et quatre identifiés pour 2025 », témoignant de la globale pertinence des périmètres des intercommunalités retenus dans les SDCI élaborés depuis l'entrée en vigueur des lois « RCT » et « NOTRe ». Certains observateurs estiment toutefois que les conditions mises pour quitter une intercommunalité au profit d'une autre sont à ce point difficiles à remplir que très peu de communes en expriment le souhait, sans compter la volonté de certains préfets de bloquer toute évolution à l'approche des élections municipales de mars 2026.
L'atteinte des objectifs que s'était assignés le législateur en matière de développement de l'intercommunalité à fiscalité propre ainsi que la stabilité de la carte intercommunale depuis lors plaide donc, à l'avenir, pour la stabilisation globale de la carte intercommunale issue des réformes « RCT » et « NOTRe ».
Une nouvelle modification de grande ampleur, avec l'octroi de pouvoirs dérogatoires aux préfets, permettant la modification autoritaire de la carte intercommunale, avec parfois trop peu de concertation avec les élus locaux doit impérativement être écartée à l'avenir.
Comme l'a résumé par Romain Colas, vice-président de l'Association des petites villes de France (APVF) : « nous sommes encore en train de digérer l'application de la loi NOTRe. À l'exception de quelques endroits marginaux où les choses se passent manifestement très mal et où des erreurs de périmètres ont été commises, des élus ayant la velléité de modifier la carte - cela ne marchera jamais -, nous sommes encore en train de digérer la création des intercommunalités. À l'échelle politico administrative, celles-ci sont encore très jeunes. Dans certains endroits, les projets de territoires ou les intérêts communautaires sont à peine définis. À moyen terme, personne n'appelle à un grand big bang de la carte intercommunale. »
Cette affirmation a par ailleurs été objectivée par une étude du Cevipof52(*) menée auprès d'environ 3 000 élus locaux et dont les résultats ont été publiés en 2024. Concernant le périmètre de leur intercommunalité, 61 % des élus interrogés indiquaient ainsi vouloir conserver le périmètre actuel de leur intercommunalité. Cette forte proportion d'élus en faveur de la stabilité du périmètre de leur EPCI à fiscalité propre plaide donc également pour le maintien de la carte intercommunale actuelle.
Recommandation n° 1 : Éviter à l'avenir un nouveau « big bang territorial », donnant lieu à une modification autoritaire de l'intégralité de la carte intercommunale.
S'il convient de stabiliser, de manière globale, la carte intercommunale issue des lois « RCT » et NOTRe », compte tenu des faibles demandes de modifications de celle-ci et de la nécessité de prendre le temps pour s'approprier les périmètres définis en 2017, des ajustements mineurs, conduits en concertation avec les élus locaux, ne doivent pas être écartés.
Les périmètres des EPCI à fiscalité propre demeurent en effet, dans certaines régions, peu adaptés aux réalités locales et ne correspondent pas aux bassins de vie et d'emploi existants.
Ainsi, lors de son audition, Annick Fournier, déléguée générale de l'Association nationale des élus de montagne (Anem) a indiqué à la mission d'information que « certains maires ne comprennent pas la carte intercommunale : ils se demandent pourquoi ils ont été rattachés à telle intercommunalité alors qu'elle ne compte que quatre communes de montagne et que l'intercommunalité voisine est intégralement composée de communes de montagne ».
De même, en Corse, la Chambre régionale des comptes notait que « le périmètre de la communauté de communes Pasquale Paoli coïncide avec le bassin de vie de Corte, mais duquel on aurait retranché sa zone la plus peuplée53(*) ».
Il y a deux ans, ce constat avait du reste déjà été établi dans le rapport de la mission d'information du Sénat consacrée à l'avenir de la commune et du maire54(*) : celui-ci soulignait que « les maires ont (...) fait part de leurs interrogations sur la pertinence du découpage intercommunal avec les réalités territoriales, en particulier s'agissant des communes du littoral. Elles sont actuellement réparties dans trois intercommunalités différentes, dont deux d'entre elles (...) possèdent à la fois une façade côtière importante et un arrière-pays conséquent mais très éloigné des communes côtières. Les communes côtières, notamment en raison de leur activité touristique, n'ont pas les mêmes problématiques que les autres communes de l'intercommunalité, et inversement. » Aux yeux d'Interco' outre-mer, il était clair que, dans le contexte territorial spécifique (très petit nombre de communes, peuplées et étendues le plus souvent), les intercommunautés d'outre-mer paraissent inadaptées et victimes d'une appropriation insuffisante.
Face à ce constat, il convient donc de permettre l'adaptation à la marge et à la demande des élus locaux des périmètres des intercommunalités, afin qu'ils correspondent bien aux bassins de vie et d'emploi. On notera toutefois que, comme l'a souligné un élu entendu par la mission, ce n'est pas tant le périmètre de la structure intercommunale qui importe que les services rendus aux habitants.
Quoi qu'il en soit, il pourrait être envisagé de faciliter les retraits et scissions d'intercommunalité, pour permettre une adaptation plus rapide des intercommunalités aux réalités locales.
Recommandation n° 2 : Faciliter les adaptations, à la marge et en concertation avec les élus locaux, des périmètres des intercommunalités, afin de les faire coïncider avec les bassins de vie et d'emploi.
À cet effet, assouplir les conditions de retrait et de scission des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. LE FONCTIONNEMENT INTERNE DES INTERCOMMUNALITÉS : FAVORISER LES SOLUTIONS CONCERTÉES ENTRE LES ÉLUS
A. L'INTERCOMMUNALITÉ, UNE SUPER-COMMUNE ?
1. Le couple intercommunalité-communes : un équilibre délicat entre logique intégrative et autonomie communale
a) Les communes face au risque d'autonomisation de l'intercommunalité
La montée en puissance de l'intercommunalité, sous l'effet des réformes adoptées depuis le début des années 2000, ébranle le pouvoir communal tel qu'il s'est affirmé historiquement, politiquement et institutionnellement.
Délicate à analyser sur le plan juridique55(*), cette recomposition du paysage institutionnel local entraîne bel et bien, en pratique, un déplacement du pouvoir des communes vers celui des structures intercommunales dont, rappelons-le, la légitimité émane de celle des communes elles-mêmes.
Poussée plus loin, cette tendance peut même aboutir, dans certaines situations, à ce qu'à l'intercommunalité classique, au sens d'espace de coopération garant des prérogatives communales, vienne se substituer une « supra-communalité », entité territoriale fonctionnant indépendamment des communes et décidant à leur place. On rappellera cependant que l'intercommunalité n'est pas une collectivité locale et qu'au sein du bloc communal, les communes sont les seules à détenir une clause générale de compétence.
Si une telle dérive est encore peu fréquente, les témoignages et remontées de terrain que la mission d'information a pu recueillir montrent que le lien entre l'intercommunalité et les communes s'est distendu au cours de la dernière décennie, sous l'effet de différents facteurs : regroupement forcé, multiplication des transferts de compétences, manque de dialogue avec les élus municipaux, excès d'autorité de la part de l'exécutif intercommunal...
La consultation des élus mise en oeuvre par la mission d'information du Sénat sur le thème « Faciliter l'accès aux services publics : restaurer le lien de confiance entre les administrations et les administrés », qui a mené ses travaux parallèlement à cette mission sur l'intercommunalité, souligne, elle-aussi, les critiques récurrentes sur la « dispersion des compétences » entre les différents échelons locaux, plus particulièrement entre communes et EPCI, à l'origine d'une certaine frustration des élus municipaux. L'un d'entre eux estime que « les mairies... perdent progressivement leurs compétences au profit des intercommunalités dont les services paraissent, parfois, bien loin des préoccupations des habitants », à tel point que « la mairie [...] devient un bureau de renseignement »56(*).
b) Mieux associer les élus municipaux au fonctionnement des intercommunalités
(1) Pour une gouvernance intercommunale véritablement démocratique
Pour faire vivre l'esprit communautaire et permettre à la démocratie intercommunale de fonctionner, les communes doivent se sentir écoutées et prises en compte ; trop nombreuses sont celles, notamment parmi les plus petites, qui se disent aujourd'hui « laissées au bord du chemin ».
À cet égard, les élus entendus par la mission ont souvent mis en cause le fonctionnement interne des intercommunalités, dont les services sont largement perçus comme exclusivement tournés vers la commune centre, au détriment des autres communes de l'intercommunalité, alors que leurs demandes sont tout aussi légitimes : à leurs yeux, tout se passe comme si la « technostructure » de l'intercommunalité continuait à avoir comme seul interlocuteur, ou tout du moins comme interlocuteur privilégié, le seul maire de la commune centre, ne reconnaissant pas la légitimité des autres maires à leur adresser des demandes.
Les propos tenus par Éric Krezel, vice-président national de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) devant la mission illustrent bien cette incompréhension : « Nous sommes souvent confrontés à des questionnements ou des retours d'agents territoriaux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement de l'intercommunalité. Il leur est difficile de comprendre qu'un jour ils travaillent pour la ville de Saint-Dizier, et, qu'à compter du lendemain - nous sommes alors en 2017 -, ils travaillent pour les 60 communes de la communauté d'agglomération. Ils ont exercé leur métier comme ils savaient le faire. En matière d'urbanisme, par exemple, je pense à une personne qui a instruit un dossier concernant ma commune au sein de la communauté d'agglomération. Je souhaitais voir les choses avancer rapidement, car il s'agissait d'un projet économique important. Mais je me suis vu répondre que le dossier devait d'abord passer entre les mains du chef de service, puis du maire de Saint-Dizier. J'ai dû faire comprendre que, dans ce cas, les fonctionnaires exerçaient leur métier pour les 60 communes de la communauté et que j'étais donc leur interlocuteur direct. Il existe une forme d'incompréhension du rôle et de la place des maires. Une intercommunalité, ce n'est pas une entité unique, avec un maire et une équipe, mais ce sont 60 entités. Et donc chacune doit être respectée, quelle que soit sa taille. »
Si, à force de pédagogie, les choses se sont améliorées, le constat de services trop tournés vers la seule commune centre semble encore d'actualité, à l'image des regrets exprimés à ce sujet par le maire d'une autre petite commune d'une communauté d'agglomération entendu par la mission. Selon Paul-Roland Vincent, maire de Bourgneuf, « l'agglomération dispose de cadres administratifs de catégorie A, auxquels les trois employés de Bourgneuf ont du mal à tenir tête. Ils nous envoient très vite dans les cordes, car nous ne sommes pas des "sachants". ».
L'éloignement ressenti par les communes est un défi majeur pour les intercommunalités, particulièrement pour celles de grande taille. Il est vrai que la constitution d'intercommunalités XXL a entraîné une dilution des petites communes dans des ensembles beaucoup plus vastes : avec 129 communes, la communauté de communes de la Haute-Saintonge est celle qui compte le plus de communes. La communauté d'agglomération du Pays Basque regroupe, pour sa part, 158 communes. Le conseil communautaire de ces intercommunalités XXL peut dépasser 100 voire 200 membres : il atteint par exemple, 233 membres pour la communauté d'agglomération du Pays Basque, ou 161 membres pour la communauté de communes de la Haute-Saintonge. Comment s'étonner dès lors que le maire d'une petite commune entendu par la mission, seul représentant de sa commune au conseil communautaire estime qu'il « faudrait passer la moitié de son temps à l'agglomération ; mais quand on est le seul représentant de sa commune, c'est impossible. Résultat : les décisions se prennent sans vous » ?
Inverser cette tendance passe nécessairement par une meilleure implication des maires et des élus municipaux dans la gouvernance intercommunale, tant au niveau de la conception des politiques publiques intercommunales que dans leur déploiement opérationnel. Il s'agit d'ailleurs là d'une revendication très largement exprimée par les intéressés.
Face au risque de déconnexion de l'intercommunalité de la vie communale, la mission d'information juge indispensable que les structures intercommunales se tournent vers des modes de gouvernance incluant toutes les communes membres, dans leur diversité démographique, géographique et économique, c'est-à-dire garantissant à l'ensemble de leurs élus d'être pleinement associés au fonctionnement intercommunal.
Elle observe que sur le terrain, de « bonnes pratiques » de nature à éviter la mise à l'écart de communes et à favoriser la participation des élus municipaux existent d'ores et déjà. Ceci témoigne d'une réelle prise de conscience de l'importance de l'enjeu par certaines intercommunalités et de leur capacité à mettre en place des solutions adaptées aux caractéristiques institutionnelles et politiques locales. L'une de ces bonnes pratiques a particulièrement retenu l'attention de la mission d'information : celle d'une organisation par pôles géographiques correspondant aux anciennes intercommunalités. Ce fonctionnement a notamment été mis en place dans le département de la Manche, ainsi que l'a expliqué en audition Christiane Tincelin, maire de Barfleur : « Les anciennes communautés de communes sont devenues des pôles de la communauté d'agglomération du Cotentin, qui couvre tout le nord du Cotentin, soit 129 communes. Les distances sont grandes et les problématiques très différentes entre la commune de La Hague à l'ouest et les petits villages de la côte est. On a donc conservé - et c'est une très bonne idée - des pôles, qui correspondent aux anciennes communautés de communes. Les quinze communes du pôle du Val-de-Saire travaillent dans la proximité et préparent, ensemble, les réunions du conseil communautaire. C'est une bonne unité intermédiaire entre le petit village et la grande agglomération. »
Faisant confiance à l'intelligence collective locale, la mission d'information ne souhaite pas imposer, suivant une logique verticale dont les territoires ne veulent plus, un modèle de fonctionnement intercommunal, ni même proposer la création de nouveaux outils. Certains sont déjà prévus par la loi et méritent d'être mieux exploités.
Tel est le cas de la conférence des maires qui, quand elle n'est pas méconnue, fait l'objet d'une utilisation à géométrie variable. Dans certaines intercommunalités, elle constitue parfois un passage obligé pour que le président de l'intercommunalité présente certains dossiers. Dans d'autres intercommunalités, elle représente un véritable espace de discussion et de dialogue. Il est vrai que, comme l'a souligné un élu lors de son audition : « les choses changent radicalement selon les personnalités ».
La conférence des maires, un outil de gouvernance à mieux exploiter
Prévue à l'article 1er de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, la conférence des maires est un outil de gouvernance complémentaire au conseil communautaire, destiné à renforcer le dialogue entre l'EPCI et les maires de ses communes membres.
Obligatoire (sauf dans les cas où le bureau de l'EPCI comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres), la conférence des maires est composée de l'ensemble des maires des communes membres, sous la présidence du président de l'EPCI. Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande de son président ou d'un tiers des maires dans la limite de quatre fois par an.
Extraits de propos tenus sur la conférence des maires lors des auditions
? Lyliane Piquion-Salomé, présidente d'Interco' Outre-mer : « C'est justement l'intérêt de la conférence des maires, qui permet aux maires de se mettre d'accord et d'assurer un partage équilibré et juste dans l'intérêt de chaque commune formant l'intercommunalité. Il s'agit de s'appuyer sur l'intelligence collective et la solidarité et de mettre en place des outils partagés. »
? Paul-Roland Vincent, maire de Bourgneuf : « La conférence des maires, qui n'a pas de pouvoir de décision, devrait avoir un rôle plus affirmé dans le fonctionnement de l'intercommunalité. »
? Cécile Raquin, directrice de la DGCL : « Le législateur, notamment le Sénat, a d'ailleurs instauré des outils comme la conférence des maires ou le pacte de gouvernance au moment de la constitution du conseil communautaire. L'essentiel relève de la pratique locale, de la volonté des élus de travailler en commun. Les choses fonctionnent plus ou moins bien selon les territoires. »
? Florence Cornier Picotin, secrétaire générale adjointe de l'ADGCF : « Nous fonctionnons efficacement grâce à la conférence des maires [...] qui est un lieu de fermentation et de dialogue, dans la recherche d'un service public efficace. »
Pour que la conférence des maires ne soit pas une « simple chambre d'enregistrement » pour reprendre l'expression employée par Yann Scotte, maire d'Hardricourt, à l'occasion de la table ronde réunissant des maires non membres du bureau du conseil communautaire, il convient évidemment que le président de l'intercommunalité soit avant tout un véritable chef d'orchestre.
Il est certain que le renforcement du rôle de la conférence des maires ne pourra pas se faire si celle-ci reste marquée par les « fâcheries politiciennes » de maires « pas convaincus par principe par l'intercommunalité », pour reprendre les termes d'un élu rencontré par la mission. Dans le respect de tous, le président de la structure intercommunale doit être animé d'une véritable volonté d'animation de son territoire. Cette condition nécessaire a conduit un interlocuteur de la mission à soulever la question de la suppression du « cumul horizontal » des fonctions de président du département et de président de l'intercommunalité, compte tenu du rôle essentiel de la présidence de l'intercommunalité et du fort engagement local qu'elle suppose.
Sans aller jusque-là, qui plus est à quelques mois des élections municipales, et sous la réserve tenant au respect et à la considération que tous les élus doivent pouvoir ressentir, la mission d'information incite les intercommunalités à renforcer le rôle de la conférence des maires. Il pourrait ainsi être envisagé que cette conférence puisse adopter une « motion d'alerte », qui permettrait l'inscription obligatoire à l'ordre du jour du conseil communautaire d'un débat sur le sujet ayant motivé le vote de ladite motion.
Recommandation n° 3 : Afin d'associer l'ensemble des communes, notamment les plus petites, à la gouvernance des intercommunalités, renforcer la place de la conférence des maires en lui permettant, par exemple, de voter une motion d'alerte.
La mission rappelle par ailleurs l'obligation faite à l'exécutif communautaire de communiquer chaque année aux maires des communes membres un rapport traçant l'activité de l'intercommunalité au cours de l'année écoulée.
Article L5211-39 du code général des collectivités territoriales :
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
Recommandation n° 4 : Garantir la mise en oeuvre effective de l'obligation de communication aux maires du rapport annuel d'activité de l'intercommunalité.
(2) Maintenir le mode actuel d'élection des conseillers communautaires
Outre les pratiques de gouvernance, un autre élément joue un rôle central dans la place accordée aux communes au sein de l'intercommunalité : les modalités d'élection au sein des organes délibérants.
À ce sujet, certaines personnes entendues par la mission d'information ont exprimé leur volonté de voir les conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, arguant d'une légitimité démocratique plus forte puisque découlant du vote des citoyens. A l'inverse, l'AMF est évidemment viscéralement opposée à une telle éventualité, y voyant le moyen de « tuer les communes » et estimant qu'il convient de ne pas éloigner les citoyens des lieux de responsabilité et de décision.
La mission d'information n'estime pas souhaitable de retenir cette solution, ne serait que compte tenu du calendrier électoral à venir en 2026. Le mode d'élection actuel des conseillers communautaires, par « fléchage » depuis la liste des candidats au conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus57(*), garantit en effet le fait que le conseil communautaire soit l'émanation des conseils municipaux. A contrario, leur élection au suffrage universel direct les doterait d'une légitimité propre et les placerait en concurrence directe avec les conseillers municipaux. Comme l'a résumé Romain Colas, vice-président de l'APVF lors de son audition, « une élection au suffrage universel direct [des conseillers communautaires] risquerait de politiser et de créer de la conflictualité ».
Qui plus est, la légitimité démocratique de l'intercommunalité doit rester attachée à l'élection municipale dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre ne sont pas des collectivités territoriales aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, mais bien des groupements créés à l'initiative des communes. C'est tout le sens de l'article L. 273-5 du code électoral qui précise que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement ».
Recommandation n° 5 : Maintenir le mode d'élection actuel des conseillers communautaires.
c) Conforter le statut de l'élu local
La mission d'information considère qu'une intercommunalité ne peut véritablement fonctionner si les élus ne sont pas présents et aptes à se prononcer en pleine connaissance de cause sur les nombreux dossiers relevant de leur intercommunalité.
D'un point de vue général, cette question renvoie à l'évidence à la question du statut de l'élu local, sujet d'intérêt majeur pour l'exercice démocratique sur les territoires et, en particulier pour le Sénat, à l'origine de la proposition de loi visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l'exercice du mandat d'élu local, qui reste, en septembre 2025, toujours en discussion. Les élus, souvent contraints, dans les petites communes tout du moins, de concilier vie professionnelles et exercice du mandat municipal et du mandat intercommunal, doivent disposer d'une juste rémunération.
C'est particulièrement vrai des élus qui sont par ailleurs travailleurs frontaliers, qui ne bénéficient d'aucun aménagement professionnel - crédit d'heures, autorisations d'absence et congés spécifiques.
d) La formation des élus municipaux et des exécutifs communautaires : un levier d'amélioration de la gouvernance
Une meilleure formation des conseillers municipaux et des exécutifs communautaires constitue également un levier d'amélioration de la gouvernance des intercommunalités.
Les travaux de la mission d'information ont en effet mis en lumière un déficit de formation des élus à la gouvernance propre aux intercommunalités et un manque de connaissance des outils existants. Lors de son audition, Éric Krezel, vice-président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF), a ainsi indiqué : « Il y a un manque important en matière de formation. Je dois souvent rappeler à mes collègues membres du bureau de l'intercommunalité pourquoi nous avons prévu le pacte de gouvernance, le pacte fiscal et financier ; j'ai parfois le sentiment qu'ils ne se sentent pas concernés. Il me paraît essentiel de former et d'associer davantage les élus. »
Or, la bonne compréhension des méthodes de fonctionnement et de travail de chacune des strates ainsi que des enjeux et contraintes spécifiques auxquels sont confrontés, respectivement, les élus municipaux et les conseillers communautaires, garantirait en effet un dialogue plus fluide et efficace et, in fine, une meilleure prise en compte des problématiques rencontrées par les communes - et notamment par les plus petites d'entre elles - ainsi que par les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, pour les exécutifs communautaires, des modules spécifiques de formation dédiés aux méthodes de gouvernance des intercommunalités, à la prise en compte des positions exprimées par chacune des communes ou encore à l'utilisation des outils de gouvernance propres aux EPCI à fiscalité propre (pacte de gouvernance, projet de territoire, pacte fiscal et financier, etc.) pourraient être proposés.
Ces modules pourraient être inclus dans le catalogue des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux (Dife).
La formation des élus locaux
Les élus locaux bénéficient d'un droit à la formation structuré autour de deux cadres distincts.
D'une part, les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions58(*), financée par les collectivités territoriales - la loi précise à cet égard que le montant du budget de la collectivité territoriale doit représenter entre 2 % et 20 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant59(*).
Les formations éligibles sont uniquement
des formations liées à l'exercice du mandat.
Elles doivent correspondre à un répertoire précis
fixé par arrêté
- le répertoire des
formations liées à l'exercice du mandat local60(*) - et ne peuvent être
dispensées que par des organismes agréés à ce
titre, après avis du Conseil national de la formation des élus
locaux (CNFEL). Les élus ont le libre choix des thématiques
suivies, à la condition qu'elles soient conformes au répertoire
précité.
D'autre part, les élus locaux bénéficient d'un droit individuel à la formation des élus (Dife), créé par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Ce dispositif permet à l'ensemble des élus locaux d'acquérir, chaque année, indépendamment du nombre ou de la nature des mandats exercés, des droits à formation, comptabilisés en euros, financés par des cotisations prélevées sur les indemnités de fonction des élus.
Ces droits leur permettent de financer des formations qu'ils sélectionnent sur une plateforme numérique appelée « Mon compte élu », rattachée à leur compte personnel de formation (CPF). Les formations éligibles dans le cadre du Dife recouvrent un champ plus large. Il peut s'agir de formations liées à l'exercice du mandat, ne pouvant être dispensées que par des organismes de formation agréés après avis du CNFEL, mais également de formations sans lien avec l'exercice du mandat, visant à permettre l'acquisition de compétences de nature à favoriser la réinsertion professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat. À ce titre, l'élu mobilisant son Dife a accès à toutes les formations proposées sur la plateforme du CPF.
La mise en place de ces modules de formation spécifiques aux intercommunalités répondrait à un véritable besoin, comme l'a souligné Éric Krezel devant les membres de la mission. En effet, à l'heure actuelle, « la formation des présidents d'intercommunalité est un problème, ils ne sont pas préparés à partager leurs connaissances. L'intercommunalité n'est pas une commune, c'est une entité à part, composée de 65, 60, 40 composantes, qui sont les communes. Il faudrait parvenir à faire projet ensemble, en additionnant les idées de chacun, mais c'est une démarche qui fait défaut aux élus. Et pourtant, des outils comme la conférence des maires existent, mais ils sont mal utilisés ».
Recommandation n° 6 : Compléter le catalogue des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus (Dife) par des formations spécifiques dédiées aux titulaires d'un mandat exécutif communautaire, et notamment à la gouvernance des intercommunalités.
Au-delà de ces formations, des formules souples et plus légères pourraient permettre de mieux faire partager les enjeux et les modalités de fonctionnement des intercommunalités auprès des élus : une « journée des maires et des conseillers municipaux » pourrait être organisée en début de mandat puis autant que nécessaire en cours de mandat, par chaque EPCI à fiscalité propre. Ce dispositif serait l'occasion de présenter aux maires l'organisation de l'intercommunalité, les outils de gouvernance (conférence des maires, projet de territoire, pacte de gouvernance, etc.) ainsi que les services pouvant être offerts par l'intercommunalité aux communes membres, en termes d'ingénierie locale ou encore de mutualisations (mise à disposition d'agents ou de services, services communs, etc.). A également été cité auprès de la mission, l'exemple d'une communauté d'agglomération ayant constitué en son sein une « assemblée informelle des petits maires », qui peuvent légitimement se sentir dépassés par la technicité des nombreuses délibérations sur lesquelles ils sont amenés à se prononcer.
Selon Cécile Raquin, directrice générale des collectivités locales, « l'instauration de relations de confiance entre les élus est l'un des grands enjeux des débuts de mandat. La formation des élus est primordiale : les intercommunalités devraient organiser des « journées des maires » afin de leur expliquer leur organisation administrative, les services qu'elles peuvent leur apporter ».
Recommandation n° 7 : Organiser, à chaque début de mandat puis autant que nécessaire, une « journée des maires et des conseillers municipaux », afin de leur présenter l'organisation de l'intercommunalité, les modalités de sa gouvernance et les services pouvant être offerts aux communes membres.
e) Rapprocher l'action intercommunale des citoyens
L'enjeu de la gouvernance intercommunale ne concerne pas seulement les relations entre l'intercommunalité et les communes, il porte aussi sur le rapport entre l'intercommunalité et les citoyens. Le bilan de l'intercommunalité doit aussi être dressé en termes de services rendus aux habitants, car c'est sa vocation première.
Si dans une récente étude de l'Ifop61(*), 85 % des Français affirment que l'intercommunalité est une bonne chose et que ses actions sont efficaces, ils ne sont pourtant que 68 % à connaître sa dénomination et seuls 43 % sont capables de donner le nom du président de l'intercommunalité à laquelle appartient leur commune de résidence. Ces résultats ambivalents illustrent d'un côté, un certain degré de reconnaissance de la légitimité des intercommunalités de la part des Français, de l'autre leur difficulté à bien identifier cette strate territoriale supplémentaire et ses acteurs décisionnaires, dont la notoriété est moindre que celle des maires.
La mission d'information a recueilli de nombreux témoignages soulignant ce manque de lisibilité de l'intercommunalité aux yeux des Français. André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalités de France (AMF) a ainsi déclaré : « La commune et les maires sont, de beaucoup, les structures et les élus préférés de nos concitoyens. Tous les sondages depuis dix ans vont dans le même sens. L'intercommunalité arrive très loin derrière les départements et les régions dans l'appréciation des élus eux-mêmes, sans parler de la population : les gens ont du mal à savoir ce qui relève de la commune ou de l'intercommunalité. » Un même constat a été dressé par Éric Krezel, vice-président national de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) : « Les citoyens ne comprennent pas les questions de compétence et d'organisation. Ils pensent que l'intercommunalité doit faire ce que la commune ne peut pas faire, avec des moyens supplémentaires. ». À propos de la répartition des compétences entre communes et intercommunalités, Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, s'est exclamé : « Mettons-nous à la place de nos concitoyens : ils ne comprennent rien ! ».
Quand l'intercommunalité est invisible : l'exemple de la voirie
L'exercice de la compétence voirie est l'une des actions publiques à laquelle les citoyens sont les plus attentifs. Qu'il soit obligatoire dès la création de l'intercommunalité (pour les communautés urbaines et les métropoles) ou optionnel (pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération), le transfert de cette compétence aux intercommunalités suscite des difficultés pratiques, qui nuisent à la perception de terrain des efforts mis en oeuvre par les collectivités et leurs groupements et, plus généralement, par les élus.
Les objectifs de ce transfert sont clairs : il s'agit de rationaliser la gestion et de réaliser des économies d'échelle, grâce à la mutualisation des moyens et au renforcement de l'ingénierie, notamment dans les EPCI les plus importants que sont les métropoles. Mais, en pratique, il se heurte à des difficultés, qui tiennent à la fois au manque de proximité, à une gouvernance insuffisante et à un bilan financier pas toujours conforme à ce qui était attendu à l'origine.
En 2022, une enquête menée par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) sur la mise en oeuvre de la compétence voirie au sein du bloc local avait montré que pour un quart des intercommunalités interrogées, la crainte d'une perte de proximité était explicitement citée comme un obstacle au transfert, juste après les enjeux financiers qui y sont liés. L'enquête soulignait également les limites du « modèle intercommunal » dans la gestion de la voirie : « L'impératif d'une égalité de traitement entre les communes peut avoir pour conséquence une prise en charge minimale des voies par la communauté. Ceci s'observe lorsque les communes compétentes n'ont pas procédé à des investissements sur leurs voies à des niveaux comparables, avant que ne se pose la question du transfert de compétence ».
Les maires soulignent légitimement les conséquences de la perte de compétence de la gestion quotidienne de la voirie, notamment en termes de rapidité d'intervention.
Mais ce sont les citoyens qui expriment le plus vivement leurs craintes quant aux conséquences de ce transfert sur le terrain : allongement du délai d'intervention, moindre prise en compte des spécificités locales et difficulté à identifier le bon interlocuteur. Comme le soulignaient les auteurs de la proposition de loi visant à revenir sur le transfert obligatoire de la compétence voirie des communes vers la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en 2019, « cette compétence est au coeur des enjeux du quotidien et de la proximité dont les élus communaux sont tenus de répondre auprès de leurs administrés ». Trop souvent, l'intercommunalité n'est pas identifiée comme l'échelon responsable de l'équipement et les habitants des communes concernées se tournent naturellement vers les élus municipaux, au risque d'aggraver la déconnexion avec une structure considérée comme lointaine.
En dépit de la meilleure image dont elle bénéficie au sein de l'opinion publique depuis quelques années, l'intercommunalité a encore d'importantes marges de progression pour améliorer sa visibilité auprès des citoyens et renforcer sa légitimité démocratique.
Pour ce faire, la mission d'information identifie deux principaux leviers d'action :
- renforcer la transparence et la pédagogie sur les enjeux intercommunaux, ce qui passe, par exemple, par l'amélioration des outils de communication sur les compétences exercées par l'intercommunalité ou par la mise à disposition de plateformes numériques de suivi des projets intercommunaux et de remontée des propositions citoyennes ;
- impliquer davantage les citoyens dans l'action publique intercommunale, s'agissant par exemple des grands projets d'aménagement, à travers la mise en place de dispositifs participatifs du type assemblée citoyenne consultative, budget participatif ou jury citoyen.
La réussite d'une telle démarche est toutefois conditionnée à plusieurs facteurs : la manifestation d'une volonté politique forte de la part de l'exécutif intercommunal, l'existence de ressources humaines et financières permettant de conduire ces actions de communication et de participation, l'articulation de ces dernières avec celles menées en propre par les communes membres pour éviter les redondances et les concurrences.
Si la mission d'information a conscience que la satisfaction de ces conditions nécessite des transformations profondes en termes de culture politique et d'ingénierie, elle la juge essentielle pour donner du sens à l'action publique intercommunale au service des citoyens. Quoi qu'il en soit, cette meilleure compréhension par tous les citoyens des enjeux de l'intercommunalité (« qui fait quoi ») répond à un impératif démocratique : outre qu'elle contribue à remplir l'objectif de clarté de la loi, elle est d'autant plus nécessaire que les attentes des Français à l'égard de l'action publique en général sont de plus en plus fortes.
2. Renforcer l'implication de l'ensemble des parties prenantes dans une démarche de projet de territoire
a) Le projet de territoire : un document-cadre reconnu par la loi, mais non obligatoire
La notion de projet de territoire a été introduite pour la première fois à propos des agglomérations par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite loi « Voynet ». Ce projet est alors destiné à déterminer « d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources [...] et, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations ». La loi prévoit également la consultation du conseil de développement sur l'élaboration du projet d'agglomération.
Malgré l'intention du législateur de poser le projet de territoire comme un objectif - ce « en vue de quoi » l'intercommunalité est constituée et met en oeuvre ses politiques, il n'en a pas donné une définition juridique précise ni n'en a fait une obligation légale. La terminologie « projet de territoire » stricto sensu n'apparaît d'ailleurs qu'à l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, encadrant le rôle du conseil de développement dans l'élaboration de ce projet.
Dans ce cadre juridique, le projet de territoire, tout à la fois document-cadre et démarche stratégique pour l'action publique intercommunale, n'a pas nécessairement à être formalisé. Son exercice est même facultatif, bien que fortement encouragé.
b) En pratique, un usage à géométrie variable d'un outil stratégique pourtant indispensable à une vision intercommunale partagée
La loi n'imposant aucune règle spécifique à son élaboration, le projet de territoire, quand il existe, semble faire l'objet d'une appropriation très diverse selon les intercommunalités, d'après les informations recueillies par la mission d'information.
Sur le fond, alors que certains projets se résument parfois à la somme des intentions des communes membres, d'autres constituent un véritable document programmatique pour l'action intercommunale. Sur la forme, quand certaines intercommunalités ont conçu un peu hâtivement leur projet, sans diagnostic préalable ni véritable concertation, d'autres ont pris le temps d'impliquer l'ensemble des acteurs pour mûrir leurs orientations stratégiques.
Cette mise en oeuvre à géométrie variable du projet de territoire tranche avec l'unanimité dont il fait l'objet en tant que principe. Nombre d'interlocuteurs de la mission d'information ont en effet insisté sur l'importance de cet outil pour donner un cap stratégique à l'intercommunalité et impliquer l'ensemble des acteurs territoriaux.
Ainsi, Éric Woerth, a dressé le constat suivant : « Il [le projet de territoire] est peu répandu et s'accompagne souvent d'une complexité technique chronophage. Il est cependant logique, au sein d'un EPCI, de savoir ce que l'on veut faire ensemble. Cela peut inclure des objectifs concrets, comme multiplier par deux le réseau de pistes cyclables ou changer les modes de recyclage des déchets. La notion d'habitat doit aussi y être intégrée. La définition de ce projet de territoire devait intervenir quelques mois après l'élection. ».
Pour sa part, Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, a déclaré : « Le fait intercommunal, c'est la promesse qu'en se regroupant, ce sera mieux demain. Parfois, ce n'est pas le cas, et cela engendre de la déception. Je constate souvent que la promesse est au rendez-vous lorsqu'un projet de territoire a été construit collectivement. [...] Certains maires éprouvent des difficultés au sein de leur intercommunalité, certains présidents d'intercommunalité ne sont sans doute pas bons. Je ne le conteste pas. Pour améliorer la situation, il convient selon moi de renforcer les outils d'ingénierie mis à disposition des intercommunalités et de développer la notion de projet de territoire, qui doit être au coeur du fait intercommunal. Si l'on se contente de gérer, sans vision, au bout d'un moment, cela n'intéresse plus les élus. »
Dans le même état d'esprit, Régis Petit, président de l'ADGCF, a indiqué : « La question fondamentale est la suivante : qu'avons-nous envie de faire ensemble et avec quelle stratégie ? Dans un projet de territoire, nous devons déterminer nos ambitions communes et nos projets de développement communs, qu'il s'agisse de développement économique adapté à nos réalités ou d'organisation de services comme les centres de loisirs. Ce travail de dialogue et de maturation de création d'un projet de territoire prend généralement un an, parfois 18 mois, en début de mandat. »
À propos du projet de territoire 2025-2035 élaboré par la Communauté d'agglomération Plaine-Vallée dont il est directeur général des services, Fabrice Belkacem, membre du conseil d'administration de l'ADGCF, a expliqué : « Nous venons de [le] finaliser en fin de mandat, les élus étaient initialement divisés, mais ils ont finalement été satisfaits de ce travail réalisé en commun. La clé a consisté à comprendre que ce projet n'était pas une simple addition des projets politiques de chaque commune, mais une vision territoriale partagée. ».
c) Améliorer la légitimité politique du projet de territoire
La mission d'information considère que le projet de territoire est un prérequis indispensable au bon fonctionnement d'une intercommunalité, dont il est en quelque sorte la colonne vertébrale.
Pour autant, elle ne souhaite pas le rendre obligatoire, afin de ne pas rigidifier un exercice qui relève d'une volonté proprement politique, une manière pour chaque intercommunalité de se construire et d'assumer, à un moment donné, ses dynamiques et ses ambitions. « Un projet de territoire ne se décrète pas », comme l'a très bien exprimé lors de son audition Jean-Pierre Viola, président de section à la quatrième chambre de la Cour des comptes.
Un élu auditionné estimait pour sa part qu'un projet de territoire devait s'appuyer sur un dialogue permanent entre élus, de sorte de parvenir à un consensus, la majorité ne devant pas pouvoir, selon lui, imposer le projet à la minorité.
En outre, concilier projet de territoire intercommunal et programme électoral municipal peut se révéler chose difficile. Si la campagne électorale pour les élections municipales est l'occasion, pour les candidats, de présenter leur programme, peu formulent ce que sera leur projet pour l'intercommunalité. Dans les cas extrêmes, sortir de l'intercommunalité peut tenir lieu de projet, à l'image de la Ferté-Macé, dont le maire, lors du scrutin municipal de 2020, avait clairement présenté comme projet la sortie de la communauté d'agglomération Flers Agglo pour rejoindre la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, sans que cet objectif ait été atteint à ce jour.
L'enjeu est plutôt de renforcer la légitimité politique de l'outil. C'est pourquoi la mission d'information invite les intercommunalités, au début de leur mandat, à inscrire à l'ordre du jour de leur organe délibérant un débat obligatoire sur l'élaboration d'un projet de territoire, dans le but d'impliquer l'ensemble des élus dans la démarche politique et stratégique de l'intercommunalité.
C'est d'une certaine manière ce qu'a proposé Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, vice-président de l'Association des petites villes de France, lors de son audition : « Personnellement, je considère que, si des exigences sont posées par la loi, notre responsabilité est de nous assurer qu'elles s'appliquent le mieux possible plutôt que de jouer aux irréductibles Gaulois qui en réalité ne résistent à rien, car la loi s'impose à tous, et qui en définitive n'assument pas leurs responsabilités. [...] Poser en début de mandat des temps obligatoires de discussion des principes de gouvernance et des priorités politiques nous semble être pertinent ».
Recommandation n° 8 : À chaque début de mandat, inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre un débat obligatoire sur l'élaboration d'un projet de territoire.
3. Renforcer l'État territorial, partenaire au service des communes
Parallèlement à l'évolution des relations entre les communes et leurs groupements qu'elle a induite, la dynamique intercommunale a aussi entraîné une modification des rapports du bloc communal avec l'État. Les auditions et les déplacements effectués par la mission d'information ont ainsi mis en lumière la tendance de l'État à considérer l'intercommunalité comme principal interlocuteur pour le bloc communal, au détriment des communes. Dans certains départements, des services de l'État - parfois les préfectures, parfois les directeurs académiques des services de l'éducation nationale (Dasen) - écrivaient directement au président de l'intercommunalité comme s'il appartenait à ce dernier d'en référer aux maires. Ces derniers sont très irrités par cette façon de procéder. Un élu signalait même que les services de l'État s'adressaient aux intercommunalités, y compris lorsque celles-ci ne détiennent pas la compétence, par exemple dans le domaine scolaire.
Le couple « maire-préfet », historiquement très pertinent pour assurer une réelle territorialisation des politiques publiques, se trouve ainsi concurrencé par le couple « président d'intercommunalité-préfet ».
Ce phénomène de substitution de la commune par l'intercommunalité comme partenaire privilégié se conjugue à l'affaiblissement tendanciel de l'État territorial. Abondamment documentée, cette évolution a fortement affecté les moyens humains des services préfectoraux et tout particulièrement des sous-préfectures. La Cour des comptes a ainsi rappelé, dans un rapport rendu en 2022, que « depuis 2010, les trajectoires d'effectifs des préfectures et des directions départementales interministérielles (DDI) se caractérisent par leur dynamique fortement descendante »62(*).
Limité dans ses moyens, l'État territorial est contraint au désengagement vis-à-vis des communes, en particulier peu peuplées, et compte sur les intercommunalités pour prendre son relais dans les territoires.
Un tel comportement se manifeste très nettement en matière d'appui d'ingénierie aux communes. Dans un autre rapport également publié en 202263(*), la Cour des comptes relevait ainsi qu'avec « la réduction des effectifs des services déconcentrés de l'État, l'appui aux communes en matière d'ingénierie a fortement diminué » et que « les EPCI, du moins les plus structurés d'entre eux, ont alors assuré ce rôle auprès de leurs communes membres », permettant ainsi à l'État de s'appuyer sur l'intercommunalité « pour assurer le rôle d'assistance aux communes qu'il ne remplit plus ». Un constat similaire a été dressé en audition par Régis Petit, président de l'ADGCF : « À présent, 70 % des compétences du bloc communal s'exercent en intercommunalité. L'intercommunalité offre la capacité de mobiliser une ingénierie que chaque commune individuellement ne pourrait pas financer. Sur des sujets techniques comme l'eau, l'assainissement ou les déchets, l'échelon intercommunal offre une réelle plus-value. Cette ingénierie, autrefois présente dans les services déconcentrés de l'État (direction départementale de l'équipement, direction départementale de l'agriculture), a progressivement glissé vers les intercommunalités, qui comptent souvent plus d'agents de catégorie A que les communes. ».
Or cette situation génère d'importantes inégalités territoriales, puisque toutes les intercommunalités ne fournissent pas de service d'ingénierie à mettre à disposition de leurs communes membres, et pénalise particulièrement les petites communes, qui n'ont pas suffisamment de ressources en interne.
Résoudre cette difficulté suppose un réarmement de l'État territorial, y compris sur le plan budgétaire. Un tel réinvestissement suppose aussi une rationalisation de son accès pour les maires, qui rencontrent actuellement trop souvent des difficultés face à la profusion d'interlocuteurs résultant de l'émiettement et l'agencification de ses services : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT)...
Une piste d'évolution, notamment suggérée par la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire64(*), pourrait consister à faire du préfet de département, doté d'une autorité fonctionnelle sur les services territoriaux, l'unique porte d'entrée des maires à l'État. C'est également le sens du « retour d'un État fort au niveau local » annoncé par le Premier ministre le 8 juillet dernier, permettant ainsi « de revenir à une organisation beaucoup plus lisible et mieux coordonnée au niveau local ».
En outre, comme l'a souligné la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État65(*), « Aujourd'hui, il est absurde que les préfets qui sont responsables des politiques prioritaires du gouvernement, chargés de la mise en oeuvre des politiques interministérielles perdent des compétences qui partent dans les agences, avec une tutelle faible ou qui n'existe pas ».
L'État ne peut continuer à parler de plusieurs voix et doit pleinement jouer son rôle de pilote stratégique. L'enjeu n'est pas de fragiliser l'ingénierie territoriale, notamment pour les petites communes, mais d'assurer la cohérence territoriale des décisions mises en oeuvre, au service d'une plus grande proximité et d'une meilleure prise en compte des réalités locales.
Elle simplifiera ainsi l'accompagnement que les maires sont en droit d'obtenir pour la conduite de projets.
Recommandation n° 9 : Simplifier, pour les maires, l'accès aux services d'ingénierie de l'État en centralisant toutes les formalités en un guichet unique.
B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
1. Les compétences obligatoires : en finir avec le sentiment de dépossession
a) Le choix d'approfondir l'intercommunalité par le transfert obligatoire de nombreuses compétences structurantes aux intercommunalités
En même temps que l'intercommunalité se généralisait, avec l'entrée en vigueur des lois « RCT » et « NOTRe » qui ont rendu obligatoire l'adhésion des communes à un EPCI à fiscalité propre, l'intercommunalité s'est approfondie par le transfert de compétences sans cesse plus nombreuses.
Le plus souvent, le législateur a opté pour le transfert obligatoire aux intercommunalités de compétences jugées structurantes et dépassant le seul cadre communal.
En particulier, la loi « NOTRe » a procédé au transfert obligatoire de larges compétences aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2017, avec par exemple le transfert obligatoire, au bénéfice des communautés de communes et des communautés d'agglomération, des compétences :
- « collecte et traitement des déchets ménagers » ;
- « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » ;
- « promotion du tourisme », incluant la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes ;
- « eau » et « assainissement »66(*).
Compétences obligatoires exercées
par chaque catégorie d'EPCI
à fiscalité
propre
|
Compétence |
Communautés de communes |
Communautés d'agglomération |
Communauté urbaine |
Métropole |
|
Aménagement de l'espace et urbanisme |
? |
? |
? |
? |
|
Développement économique |
? |
? |
? |
? |
|
Gemapi |
? |
? |
? |
? |
|
Aire d'accueil des gens du voyage |
? |
? |
? |
? |
|
Collecte et traitement des déchets ménagers |
? |
? |
? |
? |
|
Eau67(*) |
? |
? |
? |
? |
|
Assainissement68(*) |
? |
? |
? |
? |
|
Politique de l'habitat |
? |
? |
? |
? |
|
Politique de la ville |
? |
? |
? |
? |
|
Gestion des eaux pluviales |
? |
? |
? |
? |
|
Voirie d'intérêt communautaire |
? |
? |
? |
? |
|
Équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire |
? |
? |
? |
? |
|
Cimetières, sites cinéraires et abattoirs |
? |
? |
? |
? |
|
Services d'incendie et de secours |
? |
? |
? |
? |
|
Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores |
? |
? |
? |
? |
|
Réseaux et infrastructures de télécommunication |
? |
? |
? |
? |
|
Plan climat-air-énergie territorial |
? |
? |
? |
? |
b) Des transferts obligatoires de compétences générant un sentiment de dépossession chez les élus locaux
Le transfert obligatoire de compétences structurantes aux intercommunalités, exercées dès lors de plein droit et sans partage par celles à fiscalité propre en lieu et place des communes a généré un important sentiment de dépossession chez les élus locaux, qui ont vu leur capacité d'action se réduire drastiquement, alors même qu'ils demeurent placés en première ligne pour leurs administrés.
Le transfert obligatoire de certaines compétences n'a par ailleurs pas toujours été synonyme d'exercice plus efficace ni moins coûteux de ces compétences.
En conséquence, certains des transferts obligatoires de compétences opérés par la loi « NOTRe » ont, pour cette raison, provoqué d'importantes contestations de la part des élus municipaux.
Le cas le plus emblématique de cet état de fait est probablement celui du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».
Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement »
En dépit de l'opposition marquée du Sénat, la loi « NOTRe » a prévu une obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération.
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi « NOTRe », le Sénat a constamment réaffirmé son opposition à ce transfert obligatoire de compétences et a par exemple adopté à l'unanimité, dès le 23 février 2017, une proposition de loi visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes69(*).
Plusieurs aménagements ont au fil du temps été apportés à cette obligation, à l'initiative du Sénat.
Ainsi, la loi dite « Ferrand70(*) » de 2018 a créé une possibilité de report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement », en permettant aux communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas les compétences « eau » ou « assainissement » de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à l'intercommunalité si, avant fin 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens. À condition de réunir cette minorité de blocage, le transfert de compétence a ainsi été repoussé au 1er janvier 2026.
Par la suite, la loi dite « Engagement et proximité71(*) » a facilité les modalités de ce report, notamment en permettant aux communes membres d'une communauté de communes de s'opposer à la prise de compétence de leur intercommunalité lorsque celle-ci, alors qu'elle n'exerçait pas ou seulement partiellement ces compétences, se prononce sur leur exercice après le 1er janvier 2020.
Cette même loi a par ailleurs introduit un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » d'une communauté de communes vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infra-communautaire - de manière toutefois strictement encadrée, puisque le syndicat de communes devait exister avant le 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité - et autorisé le maintien de ces syndicats, même lorsque la compétence serait transférée de manière effective à l'intercommunalité, au plus tard au 1er janvier 2026.
Ces assouplissements successifs ont cependant démesurément complexifié le cadre juridique applicable à l'exercice de ces compétences et face aux difficultés rencontrées localement, le Gouvernement s'est alors engagé à aller vers « un assouplissement de l'obligation d'intercommunalisation fixée par la loi NOTRe72(*) ».
Dans ce contexte, le Sénat a adopté, le 16 mars 2023, la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », déposée par Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, dont la rapporteure de la mission. Le Sénat a une nouvelle fois réaffirmé son opposition à ce transfert obligatoire de compétences en adoptant, le 17 octobre 2024, la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », déposée par Jean-Michel Arnaud et plusieurs de ses collègues le 29 avril 2024. Celle-ci a finalement été adoptée définitivement par le Sénat le 1er avril 2025.
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », les communes ayant conservé l'exercice de ces deux compétences n'ont plus l'obligation de les transférer à la communauté de communes.
Le transfert de la compétence « promotion du tourisme » constitue un autre exemple des difficultés rencontrées dans l'application de la loi. Comme souligné dans le rapport des députés Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala consacré à la commune dans la nouvelle organisation territoriale73(*), « ce transfert a suscité de fortes réticences compte tenu de l'attachement des communes à la gestion de leur office de tourisme et à la promotion de leur image ». En dépit d'une dérogation introduite au bénéfice des communes classées « stations de tourisme », qui ont été autorisées à conserver la compétence « promotion du tourisme »74(*), « le transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme fait toujours l'objet de difficultés. (...) Les maires et présidents d'intercommunalité [se prononcent] en faveur du retour au caractère optionnel de cette compétence pour les intercommunalités ».
Ces difficultés ont été confirmées lors de l'audition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett), lors de laquelle la directrice générale, Géraldine Leduc, a indiqué à cet égard que « depuis la loi NOTRe, qui fait couler beaucoup d'encre, nous avons été entendus 24 fois par des commissions parlementaires sur le problème que pose le transfert obligatoire de la compétence de promotion du tourisme des communes vers les intercommunalités. Nous préconisions à l'époque le transfert optionnel de celle-ci. Notre président rappelle toujours le principe de subsidiarité, qui implique de mutualiser uniquement ce que les communes ne peuvent pas faire seules, ce qui pour nous est capital (...). Nous avons heureusement obtenu une exception pour les stations classées. Les maires de ces stations ont profité de cette exception et ont gardé la compétence de promotion du tourisme de manière isolée ».
Ce constat a également été confirmé par Annie Sagnes-Lagrange, maire de Luz-Saint-Sauveur et vice-présidente de la communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves, pour qui la conservation au niveau de la commune de la compétence « promotion du tourisme » et d'un office de tourisme est indispensable, en ce qu'elle permet, entre autres :
- une coopération étroite entre l'office de tourisme et les autres acteurs locaux (piscine, associations locales, maison de la culture, mairie, etc.) ;
- une grande réactivité pour résoudre rapidement les difficultés qui peuvent se poser en saison touristique, telles qu'une route coupée ou une fermeture de la piscine ;
- une offre touristique riche, car « les équipes [de l'office de tourisme] sont parfois issues du village et souvent y vivent. Les personnels sont donc imprégnés de la vie au village » ;
- une meilleure organisation des événements touristiques organisés, puisque les équipes sont directement sur place, pour organiser les événements et les animations.
Au total, au fil des auditions de la mission, la question des compétences obligatoires des intercommunalités a été l'une des plus discutées. Certains élus ont émis l'idée de supprimer les compétences obligatoires, là où d'autres proposaient d'aller plus loin en étendant le « bloc communal » aux compétences scolaire et santé.
À tout le moins, compte tenu des difficultés importantes provoquées par les transferts obligatoires de compétences, du sentiment d'impuissance et de dépossession qu'ils génèrent chez les élus municipaux et du peu de marges de manoeuvre qu'ils laissent pour adapter l'action publique aux réalités locales, il semble donc nécessaire, à l'avenir, d'éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences.
Comme explicité dans le rapport du groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation75(*), de nouveaux transferts obligatoires de compétences « doivent être proscrits à l'avenir. L'efficacité de l'action publique locale doit désormais être la seule boussole du législateur : les communes et l'EPCI à fiscalité propre doivent être libres de déterminer, en responsabilité, les compétences qui doivent être exercées au niveau intercommunal. D'une part, les transferts obligatoires de compétences des communes vers les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres n'ont pas tous fait la preuve de leur efficacité et exigent souvent de multiples interventions du législateur, prévoyant délais d'entrée en vigueur différée et dispositions dérogatoires - à l'exemple des compétences « eau » et « assainissement ». D'autre part, de manière plus générale, le fait intercommunal étant établi, les intercommunalités n'ont plus besoin que leur soient octroyées des compétences obligatoires, comme autant de béquilles de leur légitimité ».
Recommandation n° 10 : Éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences.
2. Assouplir les règles de répartition des compétences afin d'adapter l'intercommunalité à la diversité des territoires
Pour mieux adapter l'exercice des compétences aux spécificités du territoire et donner davantage de marges de manoeuvre aux élus locaux, il importe d'assouplir les règles de transfert et de délégations de compétences, pour s'adapter au mieux aux réalités locales.
Sous les réserves méthodologiques liées au caractère purement volontaire de la participation, la consultation des élus locaux organisée par la mission d'information laisse en effet penser que la répartition des compétences entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres est perfectible. Beaucoup de répondants ont en effet indiqué ne pas être satisfaits de la répartition actuelle des compétences, comme le montre le graphique ci-dessous.
Source : résultats de la consultation des élus locaux
Concernant les transferts de compétences, des progrès importants ont été obtenus à l'initiative du Sénat. Ainsi, la loi dite « 3DS76(*) » a introduit la faculté de transférer « à la carte » certaines compétences facultatives des communes vers les EPCI à fiscalité propre. Ce transfert de compétence à la carte peut être mis en oeuvre par une ou plusieurs des communes membres de l'intercommunalité et peut concerner tout ou partie de la compétence, garantissant un exercice des compétences au plus près des réalités locales et le respect du principe de subsidiarité.
Les régimes de transferts de compétences
Il existe plusieurs régimes de transferts de compétences entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres.
En premier lieu, l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales autorise les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre à transférer, à tout moment, tout ou partie de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, à l'EPCI à fiscalité propre. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population - et avec l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de l'intercommunalité.
En deuxième lieu, les compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre et dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent à tout moment être restituées aux communes membres, comme le prévoit l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. La restitution de compétences est décidée par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.
En troisième lieu, l'article L. 5211-17-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi « 3DS », prévoit un mécanisme de transfert de compétences « à la carte ». Ainsi, une ou plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre peuvent lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, selon les mêmes règles de majorité qualifiée.
Pour aller plus loin et conformément aux recommandations émises par le groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation déjà cité77(*), il convient d'approfondir les possibilités de transfert de compétences « à la carte ».
En effet, les mécanismes d'un tel transfert ne concernent pas l'ensemble des compétences.
Or, comme souligné dans le rapport précité, « l'exercice de certaines d'entre elles serait facilité par un transfert différencié à l'échelle du territoire. Il en va ainsi, en particulier, de la compétence « urbanisme » et de la possibilité de réaliser des PLUi « à la carte ». Sur certains pans du PLU, tels que l'urbanisme commercial, il pourrait ainsi être envisagé d'en transférer l'exercice à l'EPCI à fiscalité propre duquel la commune est membre, sans pour autant que celle-ci perde l'ensemble de sa compétence en matière d'urbanisme ».
Cette évolution constituerait une application concrète de la volonté de rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, objet d'une proposition de loi transpartisane issue des travaux de ce groupe de travail78(*). Il pourrait à ce titre être prévu :
- d'autoriser les EPCI à fiscalité propre à restituer certaines compétences obligatoires à leurs communes membres ;
- de permettre à une ou plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre de transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines compétences obligatoires qui leur auront été restituées par l'EPCI à fiscalité propre.
Recommandation n° 11 : Étendre les possibilités de transfert de compétences « à la carte » à certaines compétences obligatoires.
Ensuite, toujours dans l'optique d'adapter l'exercice des compétences aux spécificités des territoires, il apparaît nécessaire de permettre de modifier la répartition des compétences, y compris « à la carte », par accord local pris à l'unanimité des conseils municipaux et du conseil communautaire.
Cette possibilité pourrait par exemple concerner la compétence « mobilités » et permettrait aux conseils municipaux, en accord avec l'intercommunalité, de transférer une partie de la compétence, jugée d'importance communautaire, à l'EPCI à fiscalité propre, tout en continuant d'exercer le reste de la compétence au niveau communal, au plus près des besoins du territoire.
Comme rappelé dans le rapport précité, « il est courant qu'en fonction des territoires, l'échelon approprié d'exercice diffère. Et nul ne sait mieux à quel échelon une compétence doit être exercée que les élus locaux eux-mêmes. À l'inverse, il est vain pour le législateur de vouloir régler uniformément l'ensemble des situations pouvant se présenter ».
Recommandation n° 12 : Permettre, par accord local, de modifier la répartition des compétences.
En principe, un EPCI à fiscalité propre ne peut déléguer l'une de ses compétences79(*). Toutefois, plusieurs mécanismes permettant à un EPCI à fiscalité propre de déléguer ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres ou à un syndicat infra-communautaire ont été ponctuellement introduits par le législateur. Plusieurs régimes coexistent donc en l'état actuel du droit.
D'abord, les EPCI à fiscalité propre peuvent confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions à une ou plusieurs communes membres de l'intercommunalité, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public80(*).
Inversement, ces mêmes collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'EPCI à fiscalité propre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions, dans les mêmes conditions81(*).
Par ailleurs, les communautés de communes et communautés d'agglomération s'étant vu transférer les compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » peuvent déléguer, par convention, ces compétences à une commune membre ou à un syndicat infra-communautaire existant au 1er janvier 2019 et inclus dans la totalité du périmètre de l'intercommunalité82(*).
Ensuite, les communautés urbaines et les métropoles sont autorisées, depuis l'entrée en vigueur de la loi « 3DS », à déléguer, par convention, à leurs communes membres, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elles ont la charge83(*).
Dans un objectif de simplification et pour permettre aux acteurs de se saisir davantage de ces outils, et ainsi de mieux adapter l'exercice des compétences aux réalités du territoire, il serait opportun d'unifier par le haut le régime des délégations de compétences par voie de convention. L'ensemble des régimes de délégations de compétences d'un EPCI à fiscalité propre vers ses communes membres ou vers un syndicat infra-communautaire serait donc unifié au sein d'une unique procédure de délégation.
Recommandation n° 13 : Simplifier le régime des délégations de compétences.
3. Rationaliser la répartition des compétences : appliquer strictement le principe de subsidiarité
a) L'intérêt communautaire permet de donner corps au principe de subsidiarité
L'exercice de certaines compétences au niveau intercommunal est subordonné à la reconnaissance préalable d'un intérêt communautaire.
Traduction concrète du principe de subsidiarité, l'intérêt communautaire permet, pour une seule et même compétence, de délimiter la part de cette compétence qui doit rester gérée au niveau communal, au plus proche du terrain, et la part dont les enjeux dépassent le strict cadre communal et qui doit plutôt être exercée au niveau de l'intercommunalité.
L'identification d'un intérêt communautaire est exigée pour l'exercice, au niveau intercommunal, de l'ensemble des compétences facultatives ainsi que, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, pour l'exercice de certaines compétences obligatoires au niveau intercommunal.
À titre d'exemple, aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines exercent, de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence « construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs », lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire uniquement.
De même, pour les communautés d'agglomération, l'exercice de la compétence « politique du logement » au niveau intercommunal est subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire.
b) Un intérêt communautaire défini librement par les conseils communautaires
Depuis l'entrée en vigueur de la loi dite « Maptam84(*) », l'intérêt communautaire est défini par les conseils communautaires, à la majorité qualifiée des deux tiers, dans un délai de deux ans à compter du transfert de la compétence. À défaut de définition de l'intérêt communautaire, l'EPCI à fiscalité propre exerce l'intégralité de la compétence transférée.
Pour les communautés d'agglomération, le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi « Maptam », précise ainsi que « lorsque l'exercice des compétences (...) est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée ».
La définition de l'intérêt communautaire retenue par l'organe délibérant peut par la suite être modifiée à tout moment, de façon à adapter l'action publique aux circonstances locales.
L'intérêt communautaire rend donc concret le principe de subsidiarité, en évitant qu'une compétence soit exercée au niveau intercommunal, alors qu'elle serait mieux exercée par les communes, et en permettant d'adapter à tout moment la répartition des compétences pour ajuster au mieux le niveau d'exercice des compétences concernées.
Toutefois, le législateur n'a défini aucun critère objectif pour permettre aux conseils communautaires de définir l'intérêt communautaire.
Certes, certains critères indicatifs ont pu être donnés par voie de circulaire : c'est par exemple le cas pour la définition de l'intérêt communautaire en matière d'habitat. Une circulaire du ministère de l'intérieur du 13 juillet 200685(*) présente ainsi des critères pouvant guider à la définition de l'intérêt communautaire en matière d'habitat, tels que :
- les zones d'intervention - les EPCI à fiscalité propre ayant davantage vocation à exercer leur compétence, s'agissant d'opérations concernant plusieurs communes ;
- la spécificité de certaines opérations (logement des personnes âgées par exemple) ;
- le seuil financier du projet ;
- le nombre de logements créés, etc.
Ces démarches sont toutefois très rares et selon la Cour des comptes, « de nombreuses communautés ont fait le choix de le définir sous forme d'une liste d'équipements, de voiries ou encore de zones économiques. En l'absence de critères objectifs reflétant une stratégie globale, l'intérêt communautaire est bien souvent le fruit de compromis communaux ».
Cette absence de critères objectifs conduit parfois à maintenir au niveau communal l'exercice de certaines compétences dépassant en réalité le seul cadre de la commune, ou inversement.
Dans ce contexte et pour garantir l'efficacité de l'action publique locale, il pourrait être envisagé de définir des critères objectifs permettant, pour chaque compétence concernée, de définir l'intérêt communautaire.
Recommandation n° 14 : Dans le cas d'un transfert de compétence subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, prescrire que ce dernier soit défini par le groupement intercommunal sur la base de critères formalisés et objectifs.
III. L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS INTERCOMMUNAUX EXISTANTS
A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES
1. La hausse des dépenses du bloc communal traduit une hausse du niveau de service
a) Les dépenses du bloc communal ont fortement augmenté ces dernières années, particulièrement celles des intercommunalités
Pour leurs promoteurs, les lois Maptam et NOTRe, la réforme territoriale devait être génératrice d'importantes économies. Ainsi, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale d'alors avait évoqué en mai 2014 un montant d'économies possibles compris entre 12 et 25 milliards d'euros - en prenant également en compte, il est vrai, la refonte de la carte régionale.
Un mois plus tard, il avait revu ses ambitions à la baisse et avait avancé le chiffre d'une dizaine de milliards d'euros « à moyen terme, entre cinq et dix ans, en faisant des économies d'échelle, en supprimant les chevauchements de compétences »86(*).
En pratique, contrairement à ce qui a pu en être attendu, le renforcement des intercommunalités ne s'est pas accompagné d'une diminution ou d'un ralentissement de la dépense des intercommunalités et - plus généralement - du bloc communal.
Au contraire, les dépenses réelles de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre ont fortement augmenté depuis 2015 : de 30,1 milliards d'euros l'année du vote de la loi NOTRe87(*), elles se sont établies à 46,1 milliards d'euros en 2024 selon la Cour des comptes88(*), ce qui représente une hausse de plus de moitié (53 %).
Le rythme de cette progression est également impressionnant, puisqu'il représente une augmentation annuelle moyenne de + 4,8 %, avec des années de hausse plus modérée (2020 par exemple, avec + 3,3 %) mais également des années de très forte croissance - notamment dans les années récentes et particulièrement en 2023 (+ 8,4 %).
Évolution des dépenses des EPCI à fiscalité propre depuis la loi NOTRe
(en milliards d'euros)
Source : mission d'information, d'après la Cour des comptes
S'il s'agit là sans doute des effets des transferts de compétences (et donc des charges correspondantes) aux intercommunalités, cette explication n'est pas entièrement satisfaisante dans la mesure où les dépenses des communes ont également progressé sur la même période.
Évolution comparée des dépenses du bloc communal depuis 2019
(base 100 en 2019)
Source : mission d'information, d'après la Cour des comptes
Depuis 2019, les dépenses des communes ont en effet augmenté de 17,2 points de pourcentage. Il s'agit donc d'une progression moindre que pour les intercommunalités (57,1 points), mais tout de même d'une hausse significative.
Il semble donc que l'essor de l'intercommunalité ne se soit pas accompagné d'économies pour le bloc communal.
b) Un « effet rebond » des dépenses du bloc communal, moindre dans les intercommunalités les plus intégrées
(1) Un « effet rebond » des dépenses permis par le redéploiement des marges financières des communes et des EPCI
En 2007, Alain Guengant et Matthieu Leprince avaient conclu que « l'augmentation des dépenses intercommunales réduit faiblement les dépenses communales, voire dans certains cas favorise leur légère progression, entrainant ainsi une croissance du niveau cumulé des dépenses et des impôts locaux. »89(*)
Une première réponse réside dans les transferts verticaux de compétences et des charges financières non compensées qui en résultent. Dans ce cas, c'est parce que l'État confie de nouvelles compétences aux EPCI que la dépense intercommunale augmente - par exemple en matière d'urbanisme ou de gestion des Maisons France Services.
Une seconde raison tient dans ce que l'élargissement de la gamme des services publics offerts par les communautés entraine des dépenses supplémentaires : ainsi, les représentants de la Cour des comptes ont pu déclarer en audition constater « une forte dynamique des dépenses, notamment parce qu'une compétence portée au niveau intercommunal est techniquement plus aboutie ».
Cette même raison explique également la hausse de la part des investissements intercommunaux dans le total de l'investissement local : en 2021, les EPCI représentaient un cinquième (20,5 %) de l'investissement local, en particulier sur des projets de transport (23,7 %), ou d'aménagement du territoire (20,7 %), qui ne peuvent que difficilement être pris en charge par des communes seules.
Les auditions et déplacements menés par la mission ont confirmé cet apport des intercommunalités. Ainsi, lors du déplacement d'une délégation de la mission dans les Hautes Pyrénées, aux dires du maire de Tarbes lui-même, la seule ville de Tarbes n'aurait pu mener à bien le projet de l'Usine des sports, vaste centre sportif à vocation nationale construit dans le cadre de la reconversion de l'ancien arsenal. De même, Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, vice-président de l'Association des petites villes de France expliquait, lors de son audition, que « sur des sujets politiques et techniques aux incidences financières importantes, les petites communes restaient à la marge en raison de la faiblesse de leur ingénierie et de leur manque de moyens. Là où les intercommunalités fonctionnent, elles ont pu monter en compétence alors que les communes ne le pouvaient pas. À bien des égards, en matière d'aménagement, d'énergie ou de gestion des déchets, l'émergence du fait intercommunal a permis des avancées certaines ».
C'est donc parce que les intercommunalités répondent à des besoins et qu'elles ont davantage la capacité d'investir et d'offrir des services publics, que leur niveau de dépense s'accroit. En résumé, comme l'ont noté les représentants de l'association des gestionnaires des communautés de France (ADGCF) lors de leur audition, l'intercommunalité « ne génère pas forcément d'économies, mais elle permet une action plus efficace sur l'ensemble du territoire. »
Enfin, les dépenses des communes continuent à croitre car, en réaction aux transferts de compétences, elles procèdent à un « redéploiement des activités municipales »90(*).
(2) Un rebond des dépenses moins important dans les intercommunalités les plus intégrées
Un récent bulletin d'information statistique de la direction générale des collectivités locales (DGCL)91(*) tend néanmoins à montrer que les économies d'échelle existent, à condition que la mise en place des intercommunalités se traduise par une intégration suffisante.
En effet, « les dépenses de fonctionnement par habitant de l'ensemble du bloc communal [...] sont un peu plus faibles pour les [ensembles intercommunaux les] plus intégrés », hormis pour les communautés urbaines92(*).
Dépenses de fonctionnement des ensembles
intercommunaux
selon leur intégration fiscale
(en euros par habitant)
Source : mission d'information, d'après les données de la DGCL
Ainsi, parmi les blocs communaux des communautés d'agglomération, le quart des plus intégrés dépense 1 616 euros par habitant et par an, alors que le quart des moins intégrés dépense 1 763 euros par habitant, soit un niveau de dépense supérieur de 6,3 %. Le constat est similaire pour les ensembles constituant une communauté de communes : les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 378 euros par habitant pour le quart des plus intégrés et 1 465 euros par habitant pour le quart des moins intégrés, soit un niveau supérieur de 9,1 %.
Cette différence est encore plus marquée pour les blocs communaux des plus petites communautés de communes - celles de moins de 15 000 habitants. Parmi eux, le quart les moins intégrés dépense 25 % de plus par habitant que le quart des blocs communaux les plus intégrés.
Ces données confortent les propos tenus en audition par Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, qui se prévalait de ces chiffres pour avancer qu'« assumer (...) davantage de compétences permet donc, in fine, de réduire le niveau des dépenses de fonctionnement ».
2. La performance et l'efficacité des services publics intercommunaux sont encore perfectibles
a) Les bienfaits de l'intercommunalité pour l'accès aux services publics ne semblent guère perçus par les élus communaux
Si les élus semblent considérer, dans leur majorité, que l'intercommunalité bénéficie à leur commune, l'impact de l'intercommunalité sur l'accès et la qualité du service public semble plus difficilement perceptible.
C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats de la consultation d'élus menée par la mission d'information. En effet, bien que les réponses apportées par les élus locaux apparaissent contrastées, une majorité de répondants considère que l'intercommunalité bénéficie à leur commune. Ainsi, plus de 44 % des 1 751 répondants estiment que l'intercommunalité bénéficie à leur commune.
Diriez-vous que l'intercommunalité
bénéficie à votre commune ?
(gauche)
Y a-t-elle amélioré
l'accès et la qualité des services publics ?
(droite)
Source : mission d'information
Toutefois, ils ne sont que 28 % à juger que l'intercommunalité a permis d'améliorer l'accès et la qualité des services publics dans leur commune, ce qui suggère que les apports de l'intercommunalité peinent à se traduire concrètement pour de nombreux élus.
Cette perception est cohérente avec celle livrée par l'Assemblée des départements de France, qui juge qu'aujourd'hui, en France, « on dépend toujours des départements et des communes en matière de services publics de proximité. »
En revanche, les travaux des chambres régionales des comptes (CRC) tendent à la relativiser. Ainsi, la création de la communauté d'agglomération Grand lac se serait traduite par une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, notamment en matière de collecte des déchets ménagers et de transport scolaire93(*). De même, les maires de la communauté d'agglomération du Pays Basque considèrent que « la création de cette dernière a permis de développer l'offre de services aux communes en ingénierie, notamment dans les secteurs de l'urbanisme, de l'adressage, de l'eau et l'assainissement, de la fiscalité, de l'habitat et de l'accessibilité », même si les réponses sont plus nuancées s'agissant de la qualité du service rendu aux usagers.
Quant à la DGCL, elle a admis qu'« il est difficile de faire une estimation précise des économies réalisées, faute de données scientifiques comparatives ». Le sentiment de l'administration est toutefois « que l'intercommunalité a permis de maintenir un certain nombre de services publics grâce à la mutualisation, en particulier pour des équipements de grande envergure, ce qui était déjà, à l'origine, l'objet des Sivom. »
En tout état de cause, il semble que l'impact de l'intercommunalité sur les services publics soit difficile à établir avec précision.
b) Mieux évaluer l'efficacité des services intercommunaux
Le Cour des comptes, dans son rapport sur l'intercommunalité de 202294(*), notait également que le service public local, même lorsqu'il était plus accessible, n'en était « pas nécessairement plus performant ».
La Cour note par exemple que « les discussions entre l'EPCI et les communes visent en effet trop souvent à garantir une égalité de traitement entre ces dernières », ce qui peut aboutir à « des situations contre-performantes ». Les moyens des services publics doivent en effet être adaptés aux besoins, et non être dupliqués dans l'ensemble des communes indépendamment de leur taille, de leur situation géographique et de leurs moyens.
Plutôt que de faire en sorte que chaque commune, indépendamment de sa taille, dispose d'un niveau d'équipement équivalent, il est plus pertinent d'organiser les services communautaires selon un maillage du territoire en réseau, comme le suggère l'exemple de la politique de lecture publique dans la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne, fondée autour de médiathèques communautaires structurantes et de bibliothèques ou médiathèques de proximité, « dont la mise en réseau assure une qualité de service pour l'ensemble des habitants. »95(*)
Il reste qu'un meilleur suivi de l'efficacité des services publics intercommunaux est nécessaire, par exemple par une association plus étroite des chambres régionales des comptes avec les décideurs locaux. Éric Woerth n'a pas dit autre chose devant la mission d'information : il proposait pour ce faire d'« établir des normes de comparaison ».
B. CRÉER DES RELATIONS FINANCIÈRES INTERCOMMUNALES PLUS PARTENARIALES ET STRATÉGIQUES
La complexité des relations financières entre communes et EPCI s'est souvent invitée dans les auditions menées par la mission, de même que leur caractère injuste ou illisible. C'est particulièrement le cas des attributions de compensation (AC), qui sont trop souvent décorrélées de la réalité des charges transférées aux intercommunalités.
De même, les instruments de solidarité intercommunale, comme la dotation de solidarité communautaire (DSC) ou les possibilités de répartition dérogatoires des prélèvements et des versements du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) semblent insuffisamment utilisés. Enfin, l'usage des fonds de concours pourrait encore être développé, à condition d'être également mieux encadré pour s'inscrire dans une stratégie d'investissement de territoire.
1. Des attributions de compensation (AC) parfois inadaptées à la réalité des coûts d'exercice des compétences
a) Les transferts de compétence au sein du bloc communal impliquent également des attributions de compensation (AC)
Parmi les sujets financiers de crispation au sein des intercommunalités, les attributions de compensation (AC)96(*) tiennent une place de choix. Ce mécanisme a pour objet de garantir la neutralité budgétaire lors de chaque transfert de compétence entre un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres97(*).
Selon le Conseil d'État, « l'attribution de compensation versée par un EPCI à fiscalité professionnelle unique à chaque commune membre (...) est en principe égale au montant des impositions professionnelles perçu par la commune l'année précédant le transfert à l'EPCI du produit de ces impositions, diminué du coût net des charges transférées. Cette attribution ne peut être indexée. »98(*)
Afin de permettre aux organes délibérants de fixer le montant des attributions de compensation, les transferts de charges doivent au préalable faire l'objet d'une évaluation par la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect). Si l'évaluation par la Clect est obligatoire, il n'existe pas d'obligation à ce que le montant de l'attribution de compensation soit équivalent à celui de l'évaluation opérée par la Clect. En fonction des accords locaux concernant la répartition des richesses au sein du bloc communal, des différences peuvent être décidées.
Selon la Cour des comptes, les attributions de compensation représentent 11,7 milliards d'euros en 2024, pour des produits de fonctionnement des intercommunalités qui s'élèvent à 69,1 milliards d'euros avant déduction de ces mêmes attributions. Il ne s'agit donc pas de montants insignifiants, loin de là.
b) Un montant de plus en plus décorrélé de la réalité des charges transférées
Au cours de ses travaux, la mission d'information a eu connaissance de plusieurs dysfonctionnements portant sur les attributions de compensation.
D'une part, la Cour des comptes indique qu'il arrive que des transferts de compétences ne donnent lieu à « à aucune évaluation de la Clect et à aucune fixation de compensation »99(*), en méconnaissance de la loi. Ces situations ne sont malheureusement pas exceptionnelles, elles sont au contraire relativement fréquentes.
D'autre part, même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation, « des accords locaux semblent avoir pris le pas sur l'objectif de neutralité financière. »100(*) Or, les minorations des attributions de compensation aboutissent parfois à des résultats très déséquilibrés : la Cour souligne ainsi que « la communauté d'agglomération de Vesoul s'est vue transférer sans compensation deux piscines pour un coût évalué par la Clect à presque un million d'euros ».
A l'inverse, il peut arriver qu'un équipement coûteux jadis transféré n'existe plus. Dans la mesure où il a cessé d'être une charge pour l'intercommunalité, il serait logique que la commune se voit restituer le montant correspondant de son attribution de compensation.
Les chambres régionales des comptes entendues par la mission ont confirmé ce constat : Yves Roquelet, président de section à la CRC Nouvelle Aquitaine, a ainsi indiqué que « les attributions de compensation sont insuffisantes pour permettre aux intercommunalités, sans ressources supplémentaires, de maintenir les équipements transférés, puis d'approfondir et d'exercer les compétences qu'elles détiennent. Cela a évidemment un impact sur la qualité du service en exploitation et sur les projets. »
c) Assouplir le mode de révision des attributions de compensation, mais entouré de garde-fous
(1) Mieux documenter l'évaluation des charges transférées
Il n'est pas acceptable que la loi, qui impose une évaluation par la Clect avant tout transfert de compétences et de charges, ne soit pas respectée.
L'article 148 de la loi de finances pour 2017101(*) a prévu que les présidents des EPCI à FPU remettent tous les cinq ans un rapport d'information sur l'évolution des attributions de compensation eu égard aux compétences et charges transférées. Si ce rapport est obligatoire, aucune sanction n'est prévue en l'absence de remise.
Afin de donner une véritable portée à l'obligation de consultation de la Clect et de permettre un débat éclairé des élus communaux et intercommunaux sur l'évolution des AC et des charges transférées, il serait souhaitable de transformer ce rapport en une annexe obligatoire aux documents d'orientation budgétaire de l'intercommunalité.
Recommandation n° 15 : Transformer le rapport sur l'évolution des attributions de compensation en une annexe obligatoire aux documents d'orientation budgétaire de l'intercommunalité.
(2) Un mode de révision « libre » des attributions de compensation excessivement strict
Il semble également pertinent d'assouplir les modalités de révision du montant et de la répartition des attributions de compensation, afin de tenir compte des cas où le déséquilibre entre les ressources et les charges transférées à l'EPCI l'empêche d'exercer convenablement ses compétences.
Lorsqu'un transfert de charge a été sous-évalué ou surévalué, la procédure actuelle de révision « libre » des attributions de compensation est excessivement contraignante. Elle suppose en effet un accord de chaque commune concernée, ce qui la rend, dans les faits, peu utilisée.
Les personnes entendues par la mission d'information ont été nombreuses à se plaindre de cette rigidité. Mentionnée par l'association des maires ruraux de France (AMRF), elle a également été jugée « dissuasive » par le président de l'Association nationale des élus du littoral. Les représentants de l'ADGCF a en outre indiqué qu'« un point particulièrement crispant concerne les attributions de compensation, qui nécessitent l'unanimité pour être modifiées. Lorsqu'une commune conserve une attribution liée à une industrie qui n'existe plus, cette situation peut créer des tensions entre communes. Il faudrait davantage de souplesse et de dialogue dans ce domaine. »
Enfin, la Cour des comptes a indiqué lors de son audition que « les attributions de compensation mériteraient très certainement d'être revisitées au regard des coûts réels d'exercice des compétences, en supprimant la règle de l'unanimité pour accord qui, objectivement, est source de blocages. »
(3) Assouplir les possibilités de révision en cas de déséquilibre manifeste entre les ressources et les besoins
La Cour des comptes a ainsi proposé lors de son audition de « desserrer les contraintes institutionnelles en permettant au conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des deux tiers », en ne requérant donc pas systématiquement l'accord de chaque commune concernée.
Un tel assouplissement serait positif, à condition qu'il n'engendre de nouveaux déséquilibres. Il devrait donc être entouré de garde-fous. En outre, faute de cet encadrement, il n'est pas évident qu'un tel assouplissement serait conforme à la Constitution.
En effet, comme le rappelle le Conseil d'État, « tout dispositif pouvant conduire à la baisse d'un versement à une collectivité territoriale ou à la hausse d'un prélèvement sur ses ressources, dans le cadre de la construction ou de l'évolution d'une intercommunalité (...), doit être proportionné au motif d'intérêt général qui le justifie et comporter des conditions et des garanties suffisantes pour les collectivités concernées. »
La révision des attributions de
compensation
selon le Conseil d'État
II. - (...) Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou réduire leurs ressources, c'est à la condition que les mesures qu'il prend en ce sens répondent à des fins d'intérêt général, soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et leur portée et selon des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi, qu'elles soient proportionnées à la réalisation de cet objectif et qu'elles ne soient pas d'une ampleur telle que la libre administration des collectivités concernées s'en trouverait entravée ou dénaturée. (...)
III. - (...) Au regard des principes rappelés au II, le Conseil d'État (section des finances) estime que le régime de révision libre des attributions de compensation (1° bis du V de l'article 1609 nonies C), qui vise à corriger le caractère historique des attributions de compensation calculées conformément à la loi, ne peut être substantiellement assoupli. (...)
(...) Il pourrait être envisagé de s'inspirer de ce qui précède pour permettre, selon des modalités d'adoption et avec des limites similaires, une révision des attributions de compensation versées par un EPCI en cas d'inadaptation ou de déséquilibre manifeste de ces attributions au regard de l'évolution des charges assumées respectivement par cet établissement et ses différentes communes membres et de leurs ressources. Cette inadaptation ou ce déséquilibre devraient être objectivement constatés, le cas échéant par une commission telle que la commission d'évaluation des transferts de charges (...). Une telle révision ne devrait être permise que périodiquement, par exemple tous les cinq ou dix ans.
Source : Conseil d'État, avis n° 391 635, 12 juillet 2016
Si - comme le pense la mission d'information - un assouplissement des modalités de révision des attributions de compensation est nécessaire, il doit impérativement s'accompagner de garanties fortes pour éviter une instabilité de leurs montants et protéger les communes prises individuellement.
Suivant l'avis du Conseil d'État, il est possible de proposer qu'une telle nouvelle révision soit subordonnée à la constatation, par la Clect, d'un déséquilibre manifeste entre les attributions de compensation et les charges transférées, ainsi que par l'instauration d'une période minimale de six ans entre deux révisions, afin d'éviter les abus de cette procédure - qui ne pourrait être engagée qu'une fois au cours d'un même mandat.
Recommandation n° 16 : Permettre au conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des deux tiers lorsque l'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect) fait apparaître qu'elles sont manifestement inadaptées.
2. Favoriser le recours à des instruments de solidarité intercommunale
a) Mobiliser la dotation de solidarité communautaire (DSC)
Créée par la loi du 6 février 1992 dite « loi ATR », la dotation de solidarité communautaire (DSC)102(*) est une dotation de péréquation qui vise à mettre en oeuvre la solidarité au sein de l'intercommunalité103(*).
La dotation de solidarité communautaire (DSC)
Une dotation de solidarité communautaire (DSC) peut être versée par les EPCI en faveur de leurs communes membres et, le cas échéant, de certains EPCI limitrophes.
La loi NOTRe l'a rendue obligatoire pour les EPCI concernés par un contrat de ville et qui n'ont pas conclu de pacte financier et fiscal (PFF).
À compter de 2021, les critères de répartition de droit commun (potentiel financier ou fiscal par habitant et revenu par habitant) doivent représenter au moins 35 % de la répartition de l'enveloppe, ils doivent être pondérés par la population de chaque commune. Les critères librement choisis doivent viser à réduire les disparités de ressources et de charges entre communes. Cela exclut certains critères tels que l'indexation sur la dynamique des ressources fiscales.
Source : Cour des comptes, 2022
Obligatoire dans les métropoles et les communautés urbaines, elle n'est que facultative dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Ce caractère facultatif fait qu'elle devient de plus en plus « marginalement utilisée »104(*)
La Cour des comptes relève ainsi qu'en 2013, 440 EPCI à fiscalité professionnelle unique, soit le tiers d'entre eux, versaient une DSC. Cette part est descendue à moins du quart (23 %) en 2021 : seuls 285 EPCI versent encore une DSC.
La Cour des comptes a constaté un certain nombre de dévoiements de la DSC, qui a pu être utilisée, par exemple, pour prendre en charge la moitié des subventions versées par les communes au syndicat mixte en charge du déploiement de la fibre optique - à rebours de sa vocation péréquatrice.
Les chambres régionales des comptes entendues par la mission ont également relevé un « manque d'encadrement de l'utilisation des fonds de concours, qui sert parfois de prétexte pour diminuer très fortement l'emploi et la répartition de la DSC », ce qui « dissuade (...) les intercommunalités d'adopter un discours de solidarité à l'échelle du territoire ».
Recommandation n° 17 : À chaque début de mandat, prévoir, en plus de l'obligation d'établir un pacte fiscal et financier, un débat obligatoire sur la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire (DSC).
b) Faire des versements du FPIC un véritable levier de la solidarité intercommunale
Créé en 2012105(*), le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) redistribue, depuis 2016, un milliard d'euros chaque année entre les ensembles intercommunaux contributeurs « riches » et les ensembles intercommunaux bénéficiaires « pauvres ».
Le rapport remis en 2021 par les sénateurs Charles Guené et Claude Raynal106(*) indique qu'il s'agit d'un mécanisme de redistribution globalement efficace, puisqu'en 2020 il permettait de réduire de 12 % les inégalités de richesse entre territoires.
En 2020, 442 territoires étaient contributeurs et 757 étaient bénéficiaires du FPIC, sur un total de 1 259 ensembles intercommunaux.
Le fonctionnement du FPIC
Les prélèvements et reversements au titre du FPIC sont répartis entre les ensembles intercommunaux, c'est-à-dire les EPCI et leurs communes membres considérés comme un bloc, selon leur potentiel financier agrégé et leur revenu par habitant.
Au sein de l'ensemble intercommunal, reversements comme prélèvements sont à nouveau répartis en deux étapes.
La répartition de droit commun s'effectue entre l'EPCI et les communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF). Cet indicateur a pour objet de mesurer le degré d'intégration d'un territoire et est égal au rapport entre les produits fiscaux perçus par l'EPCI et la totalité des produits fiscaux perçus sur ce territoire. Ainsi, un EPCI peu intégré ne conservera qu'une très faible minorité des fonds redistribués. Plus généralement, l'EPCI ne conservera qu'une part du reversement proportionnel au rôle qu'il tient dans l'intercommunalité.
Dans un second temps, la somme restant à prélever ou à reverser est répartie entre les communes membres en fonction de leur potentiel financier et de leur population.
Source : Charles Guené et Claude Raynal, rapport précité, 2021
Il reste cependant loisible aux ensembles intercommunaux de décider de mettre en place des modalités de répartition alternatives, pour le prélèvement comme pour le reversement.
En premier lieu, une répartition dérogatoire peut être prévue par une délibération adoptée par l'EPCI à la majorité des deux tiers. La répartition entre l'EPCI et les communes membres peut alors s'écarter de la répartition de droit commun dans une limite de 30 %. La répartition entre communes membres peut ensuite être déterminée en fonction de critères de répartition supplémentaires107(*).
En outre, sur délibération adoptée à l'unanimité par l'EPCI, la répartition du prélèvement ou du reversement peut également être entièrement libre, aussi bien pour ce qui concerne la répartition entre l'EPCI et les communes membres que pour la répartition entre les communes membres.
Toutefois, ces facultés sont encore assez peu utilisées. En effet, en 2020, seuls 6 % des intercommunalités avaient opté pour une répartition dérogatoire et seul un quart avait opté pour une répartition libre.
Choix de répartition interne Choix de
répartition interne
du prélèvement en 2020
du reversement en 2020
Source : mission d'information, d'après la commission des finances du Sénat
Le FPIC n'est donc que trop rarement un instrument de répartition de la ressource s'inscrivant dans un réel projet de territoire.
Pour Charles Guené et Claude Raynal, « il revient avant tout aux ensembles intercommunaux de se donner les moyens d'assurer leur solidarité financière interne (...) Parmi la minorité d'entre eux ayant adopté des modalités de répartitions alternatives, trop peu se sont réellement emparés du dispositif comme d'un levier de solidarité financière s'inscrivant dans un réel projet de territoire. »108(*)
Il convient ainsi d'inscrire le FPIC dans une réflexion stratégique globale sur les objectifs ainsi que les voies et moyens de leur solidarité financière interne, en particulier dans les ensembles intercommunaux ayant institué une dotation de solidarité communautaire ou ayant conclu un pacte financier et fiscal.
Recommandation n° 18 : Faire de la répartition alternative du FPIC par les conseils communautaires, pour le prélèvement comme pour le reversement, un instrument de solidarité au sein des intercommunalités.
3. Faire de l'intercommunalité un soutien des initiatives communales : pour un bon usage des fonds de concours
a) Des fonds de concours pas toujours au service de projets stratégiques
Le fonds de concours109(*) est un mode de coopération financière et de solidarité territoriale. Il s'agit d'une participation versée par un EPCI à une ou plusieurs de ses communes membres pour aider à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement.
Cet instrument est très répandu : la directrice générale des collectivités locales a ainsi indiqué à la mission que « les fonds de concours sont beaucoup plus répandus pour répartir le financement d'investissements entre communes et intercommunalité », tandis que la Cour des comptes indiquait en 2022 qu'« il est rare qu'un EPCI ne verse aucun fonds de concours »110(*).
Ces fonds peuvent être un véritable levier de solidarité communautaire, afin de financer des projets municipaux d'investissement d'intérêt communautaire, ou pour financer des équipements communaux à rayonnement intercommunal.
Toutefois, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes ont montré que « le système de fonds de concours est fréquemment utilisé comme une enveloppe sur laquelle les communes ont droit de tirage. »111(*) Parfois, ces fonds sont mis à la disposition des communes selon des critères dont la pertinence est discutable (critère démographique seul), voire sans analyse de la situation spécifique des communes bénéficiaires. Selon un des magistrats financiers entendus par la mission, « les critères de répartition des fonds de concours n'étaient pas très satisfaisants quand ils existaient ».
Ces magistrats financiers ont également indiqué que les fonds de concours « peuvent être utilisés pour contourner ou atténuer les inconvénients ou la rigidité des mécanismes de reversement que nous avons évoqués précédemment [attributions de compensation, dotation de solidarité communautaire, etc.]. »
Cela s'explique par le fait que « les fonds de concours sont moins encadrés que les AC ou que la DSC », qui impliquent pour leur part d'effectuer un important travail de diagnostic en amont. À l'inverse, « le fonds de concours est un dispositif bien plus discrétionnaire ».
b) Mettre les fonds de concours au service du projet de territoire
Les auditions de la mission ont montré de très fortes disparités s'agissant de l'utilisation des fonds de concours : dans le même département, un président de communauté de communes les met en avant comme vecteur de partage des richesses, là où le vice-président d'une autre communauté de communes estime qu'ils ne sont pas une priorité car l'intercommunalité vise avant tout à aider les familles et non les communes membres en tant que telles.
La mission d'information n'est en rien par principe hostile aux fonds de concours. Mais les fonds de concours intercommunaux ne doivent pas constituer des enveloppes sur lesquelles les communes exerceraient une sorte de droit de tirage sans considération des projets à financer ou du fonctionnement d'équipements à assurer, qui plus est si les collectivités qui les octroient ont parallèlement recours à l'emprunt.
Certes, la souplesse de mobilisation des fonds de concours fait de cet instrument un atout dans la gestion locale. Pour autant, il conviendrait de mobiliser les fonds de concours selon une démarche plus stratégique, afin de favoriser une vision communautaire partagée, cohérente avec le projet de territoire.
Recommandation n° 19 : Mobiliser les fonds de concours pour soutenir les investissements communaux qui s'inscrivent dans le projet de territoire de l'intercommunalité.
C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
1. Des mutualisations encore insuffisamment mises en oeuvre
a) Une raison d'être de l'intercommunalité aux multiples formes
« Pour nous, l'intercommunalité sous toutes ses formes est un outil, et un outil indispensable, d'abord de mutualisation », avait déclaré M. André Laignel, vice-président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité chargé de l'intercommunalité.
Les outils de mutualisation sont nombreux et celle-ci peut prendre diverses formes.
Une forme minimale de mise en commun consiste en la participation à des groupements de commandes. Au-delà de cette mise en commun minimale, la mutualisation connait trois formes principales, qui correspondent à des degrés divers d'intégration.
Schéma des diverses formes de mutualisation
Source : Cour des comptes, 2022
La forme la moins intégrée de mise en commun de moyens est la simple prestation de service, qui se déroule selon la modalité de relation client/fournisseur. L'intercommunalité peut assurer des prestations pour une ou plusieurs de ses communes membres et les communes membres pour leur EPCI pour « la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions »112(*).
Une forme de mise en commun plus intégrée consiste en la mise à disposition d'agents ou de services ou de parties de services. Cette forme de mutualisation apporte de la souplesse, mais peut également entraîner des mises à disposition croisées dont l'efficacité est variable.
Enfin, la création d'un service commun est la forme de mutualisation la plus intégrée, dans la mesure où elle est pérenne, et peut donner lieu à ajustement des attributions de compensation. Cette forme de mutualisation permet de gérer une activité en dehors des compétences transférées, pour l'exercice de toute mission opérationnelle ou fonctionnelle, à l'exception de celles réservées aux centres de gestion.
b) Des mutualisations inégalement mises en oeuvre et dont la performance devrait être améliorée
Les mutualisations sont inégalement mises en oeuvre. Elles ne concernent d'ailleurs pas nécessairement les mêmes services et certains sont plus souvent mutualisés que d'autres : c'est ainsi le cas des divers services supports - technique, systèmes d'information, ressources humaines, services juridiques ou financiers.
Services concernés par les mutualisations en 2021
Source : Cour des comptes, 2022
La dynamique des dépenses de personnel du bloc communal tend également à démontrer que les effets des mutualisations en termes d'économies d'échelle en matière de personnel sont relativement décevants.
D'une part, les dépenses de personnel des intercommunalités ont fortement augmenté (+ 35,6 % entre 2015 et 2021), avec une hausse des effectifs de de 221 700 à 270 800 entre 2015 et 2019. Cela s'explique par les transferts de compétences, la création de services supplémentaires et les mutualisations avec les communes membres. En revanche, les dépenses de personnel des communes n'ont pas diminué (+ 5,4 % entre 2015 et 2021).
Ainsi, il semble que les mutualisations n'aient pas été suffisantes pour générer auprès des communes les économies d'échelle attendues.
2. Poursuivre le développement des mutualisations intercommunales
a) Favoriser l'adoption systématique d'un schéma de mutualisation
Plusieurs personnes entendues par la mission d'information ont souligné l'importance des schémas de mutualisation pour permettre aux élus d'avancer dans cette voie. Les schémas de mutualisation, dont l'élaboration avait été rendue obligatoire par la loi « RCT » de 2010, ont été rendus à nouveau facultatifs avec la loi « Engagement et proximité » de 2019.
En pratique, comme l'ont indiqué les représentants de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, lors de leur audition : « dès que la loi l'a permis, [les schémas de mutualisation] n'ont pas été renouvelés », ce qui a rendu « difficile la poursuite de l'intégration dans ces territoires ». De même, les représentants de la Cour des comptes ont estimé que la suppression du caractère obligatoire des schémas de mutualisation leur semblait « passablement dommageable » et ont proposé que cette obligation soit rétablie.
L'association des gestionnaires des communautés de France (ADGCF) considère également que rendre obligatoire le schéma de mutualisation « permettrait au minimum de mettre ces sujets à l'ordre du jour, ne serait-ce que pour envisager des groupements de commandes ou des services communs. »
Sans nécessairement aller jusqu'à réintroduire une véritable obligation d'élaborer un schéma de mutualisation, qui n'était déjà pas réellement respectée avant 2019 - comme la Cour le souligne elle-même - et qui pourrait de toute façon s'avérer un exercice uniquement formel en l'absence d'appropriation sur le terrain, il semble qu'il faille du moins encourager son élaboration en prévoyant un débat obligatoire sur le sujet en début de mandat, par exemple dans le cadre du débat sur le projet de territoire (cf. recommandation n° 8).
b) Développer les services communs, dispositif vertueux
S'il est un outil intercommunal qui a reçu un large soutien des personnes entendues par la mission, c'est bien le dispositif des services communs.
Ainsi, l'AMRF a relevé que cette pratique, qui « génère une solidarité entre communes », « fonctionne bien ». Quant aux représentants des fonctionnaires territoriaux, ils ont qualifié les services communs d'« essentiels » pour animer le collectif intercommunal.
Les services communs sont particulièrement intéressants s'agissant des fonctions de secrétariat. L'AMRF a ainsi indiqué que les services communs « permettent aux secrétaires de mairie de bénéficier d'une rotation, ce qui limite les absences ». Les représentants de l'ADGCF ont quant à eux souligné que « face aux départs massifs à la retraite » certaines intercommunalités ont « créé un secrétariat de mairie itinérant assurant les remplacements et animant un collectif ».
Enfin, le président d'Intercommunalité de France a relevé que les services communs permettaient une mutualisation « à la carte » : « certaines communes peuvent décider d'avancer ensemble sur les ressources humaines ou l'informatique, par exemple », tandis que d'autres communes de la même intercommunalité peuvent préférer « utiliser le levier des groupements de commandes » si celui-ci leur paraît mieux adapté. Il s'agit donc d'un dispositif souple et adaptable selon les besoins des élus et des territoires.
Les services communs constituent un exemple concret d'efficacité intercommunale. Leur développement devrait donc constituer une priorité pour les intercommunalités, en fonction de leurs besoins spécifiques identifiés.
Recommandation n° 20 : Encourager le recours aux mutualisations, et notamment aux services communs, par une meilleure information des élus locaux.
CONCLUSION
POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ DE LA CONFIANCE,
AU SERVICE DES TERRITOIRES
Animée initialement par un esprit partenarial, l'intercommunalité à la française s'est vue profondément transformée sous l'effet des réformes successives - notamment les lois Maptam et NOTRe - dont l'ambition était d'achever la carte intercommunale et d'approfondir l'intégration territoriale. Si ces objectifs ont été atteints, ces réformes ont contribué à distendre le lien entre les communes et les intercommunalités dont elles sont membres. Leur brutalité laisse des traces encore aujourd'hui.
L'écoute des élus, communaux comme intercommunaux, tout au long des travaux de la mission, a mis en lumière un sentiment persistant de dépossession, le regret d'une gouvernance souvent jugée trop descendante et une appropriation inégale des compétences transférées. Ce constat appelle à un réajustement stratégique du cadre intercommunal : il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de faire évoluer le système vers davantage de souplesse, de concertation et de confiance mutuelle.
Après une décennie de bouleversements, les intercommunalités nées de la mise en oeuvre des lois Maptam et NOTRe doivent encore s'ancrer dans la réalité territoriale, ce qui exclut tout nouveau big bang territorial. En revanche, des ajustements à la marge de la carte intercommunale doivent rester possibles, notamment pour répondre aux situations manifestement dysfonctionnelles. Ce rééquilibrage territorial doit être conçu dans une logique de dialogue et d'adaptation au terrain et non plus de mise sous contrainte voire de conflit ouvert.
Dans cette perspective, la différenciation territoriale, mise en avant avec les lois « engagement et proximité » et « 3DS », constitue un levier central. Face à la diversité des réalités locales, il est essentiel de permettre des configurations institutionnelles souples : développement des communes nouvelles, expérimentation des communes-communautés, renforcement des logiques de mutualisation volontaire. Loin d'affaiblir la République, cette adaptation aux réalités du terrain permettra de renforcer l'efficacité locale tout en respectant la liberté communale.
La qualité de la gouvernance intercommunale est un facteur déterminant pour faire vivre ce pacte de confiance. Les travaux de la mission ont montré que celle-ci n'était pas nécessairement corrélée au niveau de richesse de la structure intercommunale mais tenait davantage à la volonté des élus de définir de concert un véritable projet de territoire et à y impliquer l'ensemble des communes la composant. C'est pourquoi la mission appelle tous les élus à construire une communauté de projet, mobilisant l'ensemble des acteurs politiques, administratifs et citoyens.
Sur le plan financier, l'environnement actuel ne plaide pas en faveur d'une politique d'incitation plus déterminée, alors que les évolutions de la répartition des compétences ont mis en tension les équilibres financiers internes aux intercommunalités. Pour autant, la mission estime que des ajustements sont possibles : le système d'attribution de compensation, en particulier, requiert une révision plus souple et objective, fondée sur une évaluation transparente des charges transférées. Par ailleurs, les outils existants - DSC, FPIC, fonds de concours - pourraient être utilisés de manière plus stratégique, au service de la solidarité et du développement équilibré des territoires.
Au-delà des instruments de nature financière, la mutualisation demeure une raison d'être majeure de l'intercommunalité. Or, elle reste sous-exploitée. L'instauration systématique de schémas de mutualisation, la création de services communs à l'échelle communautaire, et l'accompagnement des petites communes sont autant de leviers pour réduire les fragilités administratives tout en augmentant la qualité des services publics locaux.
Au total, le rapport n'appelle pas à un grand soir institutionnel. Mais il propose une nouvelle étape, moins tournée vers des évolutions juridiques que de nature partenariale, pour faire de l'intercommunalité un cadre réellement choisi, adapté et utile aux communes qui la composent. L'intercommunalité ne peut être ni une « super commune » technocratique, ni une coquille vide. Tous les élus, qu'ils soient issus de la commune centre ou des plus petites d'entre elles, doivent pouvoir trouver leur place au sein d'une véritable instance de coordination, de mutualisation et d'impulsion territoriale, au service des habitants.
Pour cela, la mission appelle à fonder un nouveau pacte intercommunal, articulé autour de trois principes clairs : subsidiarité : (ne transférer que ce qui peut vraiment être mieux exercé à une autre échelle), respect de la liberté communale (garantir aux communes les marges de manoeuvre indispensables à leur identité et à leur responsabilité démocratique) et solidarité territoriale afin de faire de l'intercommunalité quelle qu'elle soit un instrument de développement de projets locaux au service des Français.
C'est à cette condition que l'intercommunalité - porteuse de services aux habitants - retrouvera sa légitimité fondatrice : être non pas subie, mais mise au service d'une action publique locale plus forte parce que partagée et concertée.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : Éviter à l'avenir un nouveau « big bang territorial », donnant lieu à une modification autoritaire de l'intégralité de la carte intercommunale.
Recommandation n° 2 : Faciliter les adaptations, à la marge et en concertation avec les élus locaux, des périmètres des intercommunalités, afin de les faire coïncider avec les bassins de vie et d'emploi.
À cet effet, assouplir les conditions de retrait et de scission des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Recommandation n° 3 : Afin d'associer l'ensemble des communes, notamment les plus petites, à la gouvernance des intercommunalités, renforcer la place de la conférence des maires en lui permettant, par exemple, de voter une motion d'alerte.
Recommandation n° 4 : Garantir la mise en oeuvre effective de l'obligation de communication aux maires du rapport annuel d'activité de l'intercommunalité.
Recommandation n° 5 : Maintenir le mode d'élection actuel des conseillers communautaires.
Recommandation n° 6 : Compléter le catalogue des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus (Dife) par des formations spécifiques dédiées aux titulaires d'un mandat exécutif communautaire, et notamment à la gouvernance des intercommunalités.
Recommandation n° 7 : Organiser, à chaque début de mandat puis autant que nécessaire, une « journée des maires et des conseillers municipaux », afin de leur présenter l'organisation de l'intercommunalité, les modalités de sa gouvernance et les services pouvant être offerts aux communes membres.
Recommandation n° 8 : À chaque début de mandat, inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre un débat obligatoire sur l'élaboration d'un projet de territoire.
Recommandation n° 9 : Simplifier, pour les maires, l'accès aux services d'ingénierie de l'État en centralisant toutes les formalités en un guichet unique.
Recommandation n° 10 : Éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences.
Recommandation n° 11 : Étendre les possibilités de transfert de compétences « à la carte » à certaines compétences obligatoires.
Recommandation n° 12 : Permettre, par accord local, de modifier la répartition des compétences.
Recommandation n° 13 : Simplifier le régime des délégations de compétences.
Recommandation n° 14 : Dans le cas d'un transfert de compétence subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, prescrire que ce dernier soit défini par le groupement intercommunal sur la base de critères formalisés et objectifs.
Recommandation n° 15 : Transformer le rapport sur l'évolution des attributions de compensation en une annexe obligatoire aux documents d'orientation budgétaire de l'intercommunalité.
Recommandation n° 16 : Permettre au conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des deux tiers lorsque l'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect) fait apparaître qu'elles sont manifestement inadaptées.
Recommandation n° 17 : À chaque début de mandat, prévoir, en plus de l'obligation d'établir un pacte fiscal et financier, un débat obligatoire sur la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire (DSC).
Recommandation n° 18 : Faire de la répartition alternative du FPIC par les conseils communautaires, pour le prélèvement comme pour le reversement, un instrument de solidarité au sein des intercommunalités.
Recommandation n° 19 : Mobiliser les fonds de concours pour soutenir les investissements communaux qui s'inscrivent dans le projet de territoire de l'intercommunalité.
Recommandation n° 20 : Encourager le recours aux mutualisations, et notamment aux services communs, par une meilleure information des élus locaux.
TRAVAUX DE LA MISSION
Examen du rapport
(Mardi 23 septembre 2025)
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme des travaux de notre mission d'information sur le bilan de l'intercommunalité. Je vous remercie tous de votre participation, et plus particulièrement Maryse Carrère, pour l'importance du travail qu'elle a accompli. Le rapport qu'elle nous présente aujourd'hui apporte un éclairage indispensable et équilibré sur la situation des intercommunalités. Compte tenu du temps qui nous était imparti et du fait que d'autres structures du Sénat avaient déjà mené des travaux sur ces sujets, nous avons, pour l'essentiel, écarté la situation des métropoles et des communautés urbaines, pour nous concentrer sur le fonctionnement des communautés de communes et des communautés d'agglomération.
Avant de céder la parole à Maryse Carrère, permettez-moi de présenter quelques enseignements généraux qui se dégagent de nos investigations.
Premièrement, le bilan de l'intercommunalité ne peut s'apprécier hors de tout contexte. Nos recommandations nous conduisent nécessairement à évoquer des sujets structurants pour la vie politique locale. Je pense plus particulièrement au statut de l'élu, dont on nous dit qu'il pourrait aboutir d'ici au congrès des maires, à la mi-novembre.
Deuxièmement, dix ans après le vote de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), nul ne demande le détricotage des intercommunalités qui se sont mises en place : tout retour en arrière serait impossible et illusoire.
Troisièmement, s'il est clair que certaines intercommunalités fonctionnent encore mal, la grande majorité d'entre elles a permis de mener à bien des projets structurants et d'offrir aux habitants des services nouveaux, par exemple dans le domaine scolaire. Lors de notre déplacement dans les Hautes-Pyrénées, le maire de Tarbes, par ailleurs président de la communauté d'agglomération, nous a ainsi expliqué que le très vaste projet de reconversion de l'ancien arsenal n'aurait pu être accompli par sa seule commune.
À l'inverse, certains élus ont très clairement exprimé un sentiment persistant de dépossession. Celui-ci relève parfois d'un paradoxe, les maires se sentant écartés de l'exercice d'une compétence au profit de l'intercommunalité alors que la commune ne l'exerçait pas avant sa mise en place. Mais, dans l'immense majorité des cas, il traduit une réalité, celle de l'effacement des petites communes au profit de l'intercommunalité, perçue comme l'expression de la seule ville-centre et de ses services.
Cela renvoie à une tendance de fond, qui s'impose à tous : le bon ou le mauvais fonctionnement des intercommunalités tient souvent à leur mode de gouvernance, à la personnalité de leur président et à la façon dont il exerce ses fonctions. S'il a un mode de fonctionnement très vertical, l'éloignement des élus n'appartenant pas à l'exécutif est particulièrement fort. La table ronde qui réunissait des maires non membres de l'exécutif communautaire a également montré que leur appréciation du bon fonctionnement de leur intercommunalité était très différente selon qu'ils occupaient déjà cette fonction lors de la création des intercommunalités issues de la loi NOTRe ou qu'ils avaient été élus pour la première fois en 2020. Les primo-élus portaient une appréciation beaucoup plus favorable sur le fonctionnement de leur intercommunalité, ce qui doit nous rendre optimistes pour l'avenir.
Enfin, nous ne pouvons ignorer un autre élément de contexte : la situation de nos finances publiques. Celle-ci doit nous inciter à la prudence, car nous savons bien que toute incitation financière supplémentaire en faveur de telle ou telle modalité d'exercice des compétences intercommunales se traduirait, en pratique, par une diminution des autres dispositifs, dans la mesure où l'État n'accorderait en aucun cas une majoration de ses dotations aux collectivités territoriales. C'est pourquoi je tiens à saluer l'équilibre des recommandations formulées par notre rapporteure, à laquelle je passe maintenant la parole.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Merci, monsieur le président, pour cette introduction et pour vos propos très élogieux sur le travail que nous avons mené en commun au cours de ces quelques mois.
Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon rapport consacré au bilan de l'intercommunalité, destiné à identifier les freins à son bon fonctionnement et à proposer des pistes d'évolution. Nous n'avons en aucun cas voulu instruire un procès : nous avons plutôt souhaité offrir « un couteau suisse », à charge pour les élus de s'en saisir s'ils le souhaitent.
Je suis pleinement consciente de l'apport des intercommunalités pour la conduite de projets de territoire au service des habitants, et c'est pourquoi je suis fondamentalement optimiste pour l'avenir. Mais il était normal que nous écoutions en priorité les élus qui ne se satisfont pas du fonctionnement actuel des intercommunalités, voire qui expriment des sentiments très négatifs à leur égard.
Vous le savez tous, la France fait figure d'exception en matière d'organisation du territoire, puisqu'elle ne compte pas moins de 35 000 communes, ces dernières étant elles-mêmes les héritières des 44 000 paroisses qui existaient avant 1789. Cette situation singulière, qui permet d'exercer l'action publique au plus proche des administrés et de l'adapter finement aux besoins des territoires, a néanmoins fait l'objet de critiques plus ou moins nombreuses, qui tiennent aux coûts que génère ce système ou encore à la difficulté d'exercer des compétences stratégiques au niveau communal, compte tenu, en particulier, des ressources limitées.
Face à l'émiettement communal observé en France, le législateur a d'abord mis en place une politique de promotion des fusions afin de réduire le nombre total de communes existantes, à travers le vote de la loi Marcellin, en 1971. Ce régime a depuis lors été remplacé par un dispositif plus incitatif, celui des communes nouvelles. Parallèlement, le législateur a entendu, dès le XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, promouvoir la coopération entre communes, en créant les syndicats de communes dès 1890, puis les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dès le milieu du XXe siècle - communautés urbaines en 1966, puis communautés de communes en 1992. Ce système de coopération entre communes reposait initialement sur le principe de la libre association des communes au sein de structures intercommunales.
Plusieurs mécanismes incitant les communes à se regrouper ont été créés, afin d'encourager les élus communaux à rejoindre des EPCI, mais le bilan de cette politique fondée sur le volontariat s'est révélé nuancé. Ainsi, entre 1971 et 2009, seules 943 fusions de communes ont été prononcées, et 787 communes nouvelles ont été créées entre 2010 et 2022. Pour ce qui concerne la coopération intercommunale, au 1er janvier 2009, près de 7 % des communes demeuraient isolées.
Ce bilan en demi-teinte a par conséquent poussé le législateur à passer d'une logique d'incitation à une logique d'injonction, abandonnant le principe de libre association des communes. En ce sens, la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) de 2010 a posé l'objectif de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, rendant par conséquent obligatoire, pour les communes, l'adhésion à une structure intercommunale. Pour disposer d'EPCI à même de gérer des compétences structurantes, le gouvernement a par la suite, à travers la loi NOTRe de 2015, entendu favoriser la constitution d'EPCI de plus grande taille, en rehaussant à 15 000 le seuil minimal de population pour chaque EPCI, sauf situations particulières, comme en zone de montagne. L'examen de ce projet de loi avait nourri des débats longs et difficiles, notamment au Sénat.
Pour construire la nouvelle carte intercommunale, les préfets ont été dotés de pouvoirs dérogatoires, leur permettant d'arrêter les schémas départementaux de coopération intercommunale même en cas de désaccord avec les communes concernées. Les pouvoirs octroyés aux préfets ont certes permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire national par des EPCI à fiscalité propre, mais ils ont également conduit à des « mariages forcés » de communes, donnant lieu à des tensions au sein des intercommunalités concernées. L'achèvement à marche forcée de la carte intercommunale a également provoqué, au sein de certaines intercommunalités, un fort sentiment d'éloignement, lié à la constitution d'intercommunalités « XXL », comptant un grand nombre de communes, au risque d'écraser les plus petites d'entre elles.
Au-delà de cette difficulté, nous avons senti, au cours des auditions, qu'en dépit du bilan globalement positif de l'action intercommunale, certaines intercommunalités connaissent des difficultés de gouvernance et peinent parfois à gérer efficacement les services publics locaux de manière à répondre au mieux aux besoins.
Au terme de nos travaux, je vous propose donc vingt recommandations qui visent à améliorer le fonctionnement des intercommunalités et qui s'articulent autour de trois principes directeurs : la souplesse, la concertation et la confiance. Je regrouperai les principales d'entre elles en trois grands axes.
Premier axe : renouer avec une logique de partenariat de territoire. Ce retour aux racines de la démarche intercommunale implique, en premier lieu, de ne plus procéder à des modifications autoritaires de l'ensemble de la carte intercommunale, comme cela a été fait précédemment, conduisant, dans certains cas, à des « mariages forcés ». Les adaptations à la marge de la carte intercommunale doivent être facilitées, pour mieux tenir compte des bassins de vie et d'emploi, mais elles doivent impérativement être décidées en étroite concertation avec les élus locaux.
Par ailleurs, il me semble que la création de communes nouvelles peut, lorsque les fusions résultent d'accords locaux, permettre aux communes de relever les défis que pose l'intercommunalité : les communes nouvelles réalisent, en effet, des économies d'échelle qui permettent à leurs élus de dégager des moyens supplémentaires pour mieux répondre aux besoins de leurs habitants, sans avoir besoin de demander de l'aide à l'intercommunalité. De même, les communes nouvelles pèsent généralement davantage au sein de leur EPCI, ce qui leur donne un avantage. En poussant cette logique à son terme, les « communes-communautés », chères à Françoise Gatel, qui consistent à fusionner toutes les communes d'un EPCI en une seule qui exerce les compétences de l'EPCI lui-même, permettraient de se passer entièrement de l'intercommunalité. C'est pourquoi nous proposons d'encourager la formation de communes nouvelles, notamment en lissant les effets de seuil, mais - je le répète - toujours à condition qu'il existe une volonté locale en ce sens.
Deuxième axe : promouvoir une gouvernance intercommunale plus collaborative et intégrative. Nous l'avons bien mesuré au cours de nos travaux, l'éloignement ressenti par les communes et leurs élus constitue l'un des principaux points de faiblesse du fonctionnement intercommunal. C'est particulièrement perceptible chez les intercommunalités de grande taille. Pour inverser cette tendance, une meilleure implication des maires et des élus municipaux est indispensable, ce qui passe par la mise en place de modes de gouvernance plus participatifs et plus respectueux de la diversité communale. Comme nous l'avons constaté, de bonnes pratiques existent d'ores et déjà sur le terrain. Je veux citer l'exemple de l'organisation par pôles géographiques correspondant aux anciennes intercommunalités, retenue notamment dans le département de la Manche, cher à notre collègue David Margueritte - elle semble porter ses fruits.
Il n'est évidemment pas question d'imposer, suivant une logique verticale dont les territoires ne veulent plus, un modèle de fonctionnement intercommunal, d'autant que les élus sont déjà submergés de normes. Faisons confiance à l'intelligence collective locale !
Il n'est pas question non plus de proposer la création de nouveaux outils de gouvernance. Certains sont déjà prévus par la loi et méritent d'être mieux exploités. Tel est le cas de la conférence des maires, qui, quand elle n'est pas méconnue, fait l'objet d'une utilisation à géométrie variable. Je pense qu'il faut inciter les intercommunalités à mieux utiliser cet organe de gouvernance et à renforcer son rôle en lui permettant, par exemple, d'adopter une « motion d'alerte », ce qui rendrait obligatoire l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire d'un débat sur le sujet ayant motivé le vote de cette motion.
Pour améliorer le fonctionnement intercommunal, certains de nos interlocuteurs ont par ailleurs défendu l'idée d'une élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, arguant d'une légitimité démocratique plus forte, puisque découlant du vote des citoyens. Je ne crois pas pertinent de retenir cette solution. Sur la forme, elle n'est guère réaliste compte tenu du calendrier électoral à venir en 2026. Sur le fond, le mode d'élection actuel garantit un conseil communautaire qui émane réellement des conseils municipaux. À l'inverse, l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct les doterait d'une légitimité propre qui les placerait en concurrence directe avec les conseillers municipaux, ce qui n'est, à mon avis, pas souhaitable.
L'amélioration du fonctionnement des intercommunalités passe également par une meilleure répartition des compétences. Il apparaît nécessaire, à cet égard, d'éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences : le cas emblématique des compétences « eau » et « assainissement » illustre les difficultés que soulève cette méthode. Comme l'a constamment défendu le Sénat, il importe, au contraire, d'assouplir les règles de répartition des compétences entre les communes et les intercommunalités, pour les adapter aux spécificités locales. Cela pourrait, par exemple, passer par une extension des possibilités de transférer des compétences « à la carte ». Il me semble également nécessaire d'appliquer strictement le principe de subsidiarité, pour préserver les capacités d'action des communes, ce qui implique notamment la mise en place de critères objectifs et formalisés pour la définition de l'intérêt communautaire.
J'en termine avec un troisième et dernier axe : mobiliser pleinement les instruments financiers existants pour promouvoir une intercommunalité plus solidaire.
L'intercommunalité produit, en elle-même, de la solidarité, puisqu'elle permet à plusieurs communes d'exercer en commun certaines compétences. Nous constatons que cette mise en commun, dont les promoteurs des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) et NOTRe prédisaient qu'elles généreraient des économies, s'est plutôt traduite par des hausses de dépenses, tant pour les communes que pour les intercommunalités.
Il est vrai que l'État ne s'est pas privé de transférer des charges aux collectivités locales sans assurer le transfert de ressources équivalentes. En outre, cette augmentation est aussi une illustration de leur réussite. Les intercommunalités ont pris en charge des compétences correspondant à de nouvelles attentes des habitants, par exemple en finançant la mise en place d'activités extrascolaires ou la création de maisons de santé intercommunales. Au total, il est difficile de savoir si les intercommunalités ont permis d'engendrer des économies. En tout état de cause, la question essentielle est de savoir si les relations financières entre les communes et les intercommunalités sont optimales.
Leur complexité a été mentionnée à de nombreuses reprises lors de nos auditions, de même que leur caractère obscur et parfois injuste. C'est notamment le cas des attributions de compensation, les fameuses AC, qui sont trop souvent décorrélées de la réalité des charges transférées aux intercommunalités. Je vous propose, à ce sujet, une recommandation visant à assouplir la révision des AC par un simple vote du conseil communautaire à la majorité des deux tiers. Consciente que cette proposition pourrait susciter des craintes face au risque, pour certaines collectivités, de perdre des sommes importantes, je propose que ce mode de révision soit subordonné à la stricte condition que la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect) constate objectivement et en toute neutralité que ces AC sont manifestement inadaptées à la réalité des charges.
Afin d'approfondir la solidarité au sein des intercommunalités, je propose aussi de prévoir qu'un débat sur la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire (DSC) se tienne obligatoirement à chaque début de mandat, afin de sensibiliser notamment les nouveaux élus à l'enjeu de solidarité et aux instruments qui permettraient de l'atteindre. Dans la même logique, nous avons tenu à mettre en avant une bonne pratique, qui consiste, pour les EPCI, à utiliser les reversements dont ils bénéficient au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) pour promouvoir la solidarité sur leur territoire.
Enfin, au cours des auditions et des tables rondes d'élus, la question des fonds de concours est apparue comme l'une des plus discutées. Parce que l'addition de pauvretés n'a jamais fait naître une richesse, certaines intercommunalités n'ont tout simplement pas les moyens d'en accorder. Et quand elles le peuvent, il me paraît contraire à l'esprit de solidarité qui doit guider l'action des intercommunalités que les fonds de concours constituent une sorte de « droit de tirage ». C'est pourquoi je pense qu'elles devraient en user le plus possible en cohérence avec leur projet de territoire.
Pour terminer, je souhaiterais aborder le sujet des mutualisations. Plusieurs personnes que nous avons auditionnées ont indiqué qu'elles constituaient la raison d'être de l'intercommunalité. Il me semble qu'il s'agit là d'un chantier qui doit être poursuivi, pour améliorer les relations entre élus et la qualité du service rendu à nos concitoyens. Le dispositif des services communs, qui représente l'aboutissement du processus de mutualisation, me semble particulièrement vertueux, en termes tant de solidarité que d'efficacité. Plusieurs de nos interlocuteurs ont, par exemple, mentionné des services communs pour les fonctions support - ressources humaines, informatique - ou de secrétariat.
Pour conclure, je vous propose un titre sans équivoque pour ce rapport : « Pour une intercommunalité de la confiance, au service des territoires. » J'espère que bon nombre de maires et de présidents d'intercommunalités le liront, se l'approprieront, et qu'ils y trouveront aussi un peu d'objectivité et d'humilité sur le fait intercommunal et ses avantages.
M. David Margueritte. - Je vous remercie pour la qualité de votre rapport, fruit d'auditions riches, variées et équilibrées.
Nombre de propositions que vous avancez me conviennent, qu'il s'agisse de la délibération sur un projet de début de mandat, de la motion d'alerte de la conférence des maires ou d'un certain nombre de mesures financières.
Cependant, je tiens, premièrement, à exprimer une forte réserve sur la recommandation visant à la création de communes nouvelles. Je ne partage pas le postulat selon lequel l'émiettement communal serait source de difficultés. Il me paraît paradoxal de considérer que les communes nouvelles renforcent le poids des communes au sein de la gouvernance intercommunale : au contraire, du fait de la décision Commune de Salbris, la représentation des communes fusionnées s'affaiblit fortement.
Ainsi, il y a sur mon territoire une commune nouvelle issue de la réunion de 19 communes : elle ne dispose plus que de sept délégués au sein du conseil communautaire contre 19 avant la fusion des communes. Comment le poids de la commune nouvelle pourrait-il être plus fort au sein de l'intercommunalité ? Comme cela est d'ailleurs indiqué dans le rapport, la bonne méthode est plutôt de maintenir la commune comme pôle de proximité.
Par ailleurs, je constate que les communes nouvelles, en particulier dans les communautés XXL, viennent renforcer mécaniquement le poids des grandes communes, donc écraser la représentation du milieu rural.
Ma réserve se fonde sur l'expérience du département de la Manche, l'un des trois départements à avoir créé le plus de communes nouvelles. Ces dernières ont été créées à marche forcée, sur le fondement d'incitations financières qui relevaient de l'injonction. À présent, nombre d'entre elles se rendent compte que le mariage financier n'était pas un mariage d'amour... Certaines opérations se sont bien passées, notamment dans les bassins disposant d'un vrai projet de territoire, mais on constate souvent une perte de proximité et de poids au sein de l'intercommunalité. La recommandation n° 3 me pose donc problème en l'absence d'un mécanisme constitutionnel qui permettrait de modifier la jurisprudence.
Deuxièmement, je tiens à exprimer mon soutien aux recommandations relatives aux attributions de compensation. Leur révision est un sujet de crispation majeur et permanent. Cette mission d'information a raison de lier cette question à celle de la DSC et au débat nécessaire sur les fonds de concours, lesquels ne peuvent être un simple droit de tirage en dehors de toute vision politique.
Troisièmement, je ne suis pas convaincu par l'idée que le transfert incomplet d'une compétence fluidifie le pilotage de l'intercommunalité - le rapport mentionne l'exemple de l'urbanisme. Il faut clarifier les conditions d'une telle répartition à la carte pour éviter un « multipilotage », c'est-à-dire une absence de pilotage de certaines compétences stratégiques ou de proximité. « Permettre, par accord local, de modifier la répartition des compétences » ne peut se faire qu'à la marge : en pratique, la jurisprudence bloque quasiment toute redistribution. J'approuve la recommandation tendant à simplifier le régime, extrêmement complexe, des délégations de compétences. J'en ai fait l'expérience en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. Ce sont de véritables usines à gaz ! Par ailleurs, l'État appréhende très mal de telles délégations. Cela peut créer des difficultés de fonctionnement au sein de l'intercommunalité, notamment en raison d'interprétations diverses que peuvent en faire les différents préfets.
Quatrièmement, je suis sceptique quant à l'inscription de l'« intérêt communautaire » dans le marbre de la loi. N'est-il pas paradoxal de vouloir le définir objectivement ? De fait, cet intérêt peut varier d'un territoire à l'autre : les accords locaux sont parfois la bonne méthode.
Enfin, je propose d'apporter une modification rédactionnelle au rapport pour éviter de donner le sentiment que le lien est distendu entre l'intercommunalité et les communes depuis plus de vingt ans, ce qui serait excessif.
Mme Ghislaine Senée. - D'abord, ce rapport présente une grande qualité : plutôt que de contenir des recommandations strictes, il met en lumière certaines difficultés que rencontrent les territoires, notamment liées au mode de scrutin indirect. Insister sur la mise en place de schémas de planification sur le modèle des projets de territoire me semble indispensable : il faudrait dès le départ définir des schémas de mutualisation, comme autant de points d'accroche pour qui a du mal à s'y retrouver. Je ne doute pas que ce rapport soit utile aux maires et à tous les élus.
Ce rapport met ensuite en exergue des points qui posent problème, notamment le manque de transparence. « Permettre au conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des deux tiers », une fois par mandat, « lorsque l'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges transférées » démontre des déséquilibres me paraît une excellente proposition.
Il est important d'insister sur la question de la solidarité, au travers, par exemple, de la DSC. Il faut redonner du sens à la péréquation, souvent critiquée.
Il n'est pas certain que l'échelle intercommunale permette de faire des économies. D'ailleurs, il faudrait préciser que certains élus et adjoints intégrés dans une intercommunalité touchent, à ce titre, une indemnité. Toute augmentation de cette dernière devra se faire sur l'enveloppe globale du bloc communal. En effet, si la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local devait être adoptée, il sera difficile, vu le contexte, de présenter à nos concitoyens une augmentation de ces indemnités.
La situation où le maire d'une grande commune a un cabinet qui travaille à la fois pour son territoire et pour l'intercommunalité fait du tort aux petites communes de l'ensemble. Je suis favorable à une définition claire de l'« intérêt communautaire ». Puisque chaque territoire l'entend à sa manière, nous devons disposer d'un état des lieux précis de la notion, pour l'ensemble du pays.
Enfin, la « journée des maires » proposée devrait être ouverte à l'ensemble des élus municipaux, étant donné le décrochage entre ces derniers et l'échelle intercommunale. Cela permettrait de présenter les compétences transférées. Une « journée des élus municipaux » est indispensable.
M. Clément Pernot. - Je m'interroge sur la pertinence du chapitre sur les communes nouvelles et les intercommunalités. Une petite commune qui s'unit à d'autres de même taille restera une petite commune, sans incidence sur la communauté de communes à laquelle elle participe ! Au travers de la loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, M. Pélissard souhaitait une agrégation autour des villes-bourgs : l'application du texte n'a pas eu cet effet.
Pour en venir à la question du statut de l'élu, il faut considérer chaque cas individuellement. Lorsque j'étais maire, j'ai pu mécaniquement doubler mon indemnité en devenant président de communauté de communes. En outre, les maires de ville-bourg bénéficient de cette hausse sans augmentation de la charge de travail : ils exercent au travers de la communauté de communes les compétences qu'ils exerçaient pour leur commune. Cette situation permet indirectement de corriger l'absence d'un statut de l'élu digne de ce nom.
Je ne pense pas qu'il faille aborder la question des économies liées aux intercommunalités. Ces dernières ont permis, comme nous l'avons entendu au cours des auditions, de réaliser des projets qui n'auraient pas été possibles autrement, donnant aux petits territoires les moyens d'avoir des infrastructures qu'ils n'auraient pas eues sans cet ensemble et assurant ainsi une meilleure égalité entre les citoyens des communes les plus peuplées et ceux des communes moins peuplées. S'il faut s'interroger de manière plus approfondie sur les économies permises par la constitution de grandes régions, celle des intercommunalités n'avait pas cet objectif.
Mme Isabelle Briquet. - Les communes nouvelles sont source d'une perte d'identité. De fait, la tendance est plutôt au retour aux communes anciennes. Je ne vois donc pas la plus-value de tels regroupements, sauf peut-être dans des cas où les communes avaient déjà mutualisé certaines compétences. L'accompagnement fiscal devrait ne survenir qu'à la fin du processus, et non constituer une incitation préalable.
Les compétences à la carte m'inquiètent. Il faut éviter l'ambiguïté : une intercommunalité n'est pas un syndicat. Je suis d'accord avec l'introduction de davantage de souplesse, mais n'allons pas trop loin ! L'intercommunalité doit demeurer inclusive.
M. Jean-Claude Anglars. - Je salue la grande qualité du travail réalisé. Je soutiens plusieurs des recommandations du rapport. Je souscris néanmoins à la remarque de David Margueritte sur les communes nouvelles.
Je voudrais insister sur un mot essentiel : celui de « confiance ». Il faut faire confiance aux élus pour s'organiser. Imposer des compétences a d'ailleurs été une erreur stratégique.
Par ailleurs, le rapport ne va peut-être pas assez loin concernant la gouvernance et la répartition des sièges. Lorsque j'étais président d'une communauté de communes, les intercommunalités avaient, à cet égard, une capacité de choix. Or la loi a fait dépendre ces éléments de la densité de population. J'estime que c'est une erreur.
La notion de « services communs » me semble en revanche particulièrement intéressante.
Le mot « confiance » est essentiel. Nous savons tous quel désamour peut séparer les citoyens des communautés de communes. Si les gens ont confiance en leurs maires, c'est parce qu'il existe avec eux un rapport de proximité ! Avant de créer une nouvelle structure, pensons à la valeur ajoutée qu'elle est susceptible d'apporter.
Mme Martine Berthet. - Tout un travail reste à réaliser sur les communes nouvelles, car de nombreux points doivent évoluer.
Pour ce qui concerne la recommandation n° 7 relative à la « journée des maires », nous avions, il y a quelque temps, adopté un texte dont l'une des dispositions consistait à rendre obligatoire la transmission des comptes rendus des conseils communautaires à l'ensemble des élus de l'intercommunalité, et non aux seuls élus communautaires. Or cette transmission ne se fait pas, et nombre d'élus se sentent exclus des intercommunalités. Cet élément figurait-il bien dans la loi telle qu'elle a été promulguée ? S'il n'y figure pas, ne faudrait-il pas l'y inclure ? Et, s'il y figure, ne faudrait-il pas recommander de bien le mettre en oeuvre ?
Pour ce qui est de la recommandation n° 10, « Éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences », il aurait été préférable d'aller plus loin, en recommandant de ne plus faire de transfert obligatoire.
Enfin, s'agissant de la recommandation n° 18, il faudrait préciser que toutes les intercommunalités sont concernées par le versement du Fpic, y compris les plus défavorisées. Il faudrait, là aussi, plus de souplesse, et dans les deux sens. Or la recommandation, dans sa rédaction actuelle, n'en fait pas état. À titre d'exemple, en Savoie, toutes les intercommunalités sont contributrices au Fpic, alors que certaines abritent des communes défavorisées.
Toutes mes félicitations pour ce travail intéressant !
Mme Frédérique Espagnac. - Je vous félicite à mon tour pour ce travail considérable. Il est intéressant de noter que le Premier ministre consulte en ce moment les élus. Il s'est ainsi adressé par courrier aux maires et aux présidents de conseil départemental et régional. Il est important, à cet égard, de dresser un bon état des lieux de la situation des intercommunalités et des souhaits des élus.
Une intercommunalité mûrit de différentes façons, selon les territoires. De même, elle gagne différemment en efficacité par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été constituée. Mon territoire, les Pyrénées-Atlantiques, abrite l'une des plus grandes intercommunalités de France, liée à l'identité spécifique du Pays basque et issue de la fusion de huit communautés de communes et de deux communautés d'agglomération, mais aussi l'une des plus petites, en Béarn. Ces intercommunalités ne présentent pas le même niveau de maturité. Une certaine adaptabilité est nécessaire. En effet, les intercommunalités doivent répondre aux besoins locaux, et à ce que les élus pensent être le mieux pour le bon fonctionnement de la représentativité dans leurs territoires.
Concernant le Fpic, de nombreuses communes de montagne membres d'intercommunalités sont en difficulté, comme cela a été souligné précédemment.
Par ailleurs, de très nombreux élus ont encore l'impression d'être laissés sur le bord du chemin. La communication est donc indispensable. Certes, tous ne se l'approprieront pas de la même façon, mais il faut qu'elle soit accessible, pour que tous aient le sentiment d'être traités à égalité et parties prenantes du projet, et pour que nous puissions passer d'une intercommunalité à l'ancienne, de guichet, à une intercommunalité de projet. Cette appropriation du projet communautaire doit se faire au long cours.
Je partage ce qui a été dit sur les communes nouvelles. Si, dans mon département, les communes nouvelles n'ont pas été très nombreuses, il en est allé autrement ailleurs, où l'on y a beaucoup cru. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Jacqueline Gourault et Françoise Gatel, ministres toutes deux issues du Sénat. Nous voyons à présent toutes les difficultés et les limites de ce modèle, dans lequel beaucoup voyaient pourtant une solution. Ainsi, je reçois aujourd'hui des demandes pour revenir sur les fusions réalisées, ce qui paralyse parfois toute l'intercommunalité.
Je vous alerte donc sur les conséquences de ce phénomène, qui peuvent être plus lourdes qu'on ne l'anticipe. La fusion à marche forcée ne fonctionne pas et peut même créer des incidents dans l'avenir, et l'incitation financière ne doit intervenir qu'en dernier recours.
Comme je l'ai souligné, l'exécutif semble s'interroger sur la décentralisation de demain. Les intercommunalités jouent un rôle majeur : il faut les conforter, et rien ne serait pire que revenir en arrière. En revanche, il faut les accompagner pour les aider à atteindre la maturité requise.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Je souhaite insister sur la communication. Une information est nécessaire, dès le début du mandat, destinée non pas aux seuls maires et élus communautaires, mais à l'ensemble des élus de l'intercommunalité.
Mme Frédérique Espagnac. - Tout à fait.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Peut-être faudrait-il également proposer une seconde communication à mi-mandat, comprenant toutes les informations nécessaires sur les réalisations du bureau communautaire.
Je reviens à mon tour sur la recommandation n° 10. Ce qu'il faut, ce n'est pas « éviter tout nouveau transfert obligatoire » : c'est ne pas imposer de transfert obligatoire tout court ! De manière générale, nous devons dire « stop » à l'obligation.
Se sentant mal intégrés dans les communautés de communes, les habitants s'approprient difficilement leur rôle. C'est pourquoi nous devons miser sur la communication, pour faire connaître leurs apports. À titre d'exemple, le sujet des ordures ménagères est important.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Je vous remercie pour vos prises de paroles respectives. S'il y a un sujet commun, c'est bien celui des communes nouvelles. Ce point a été souvent évoqué entre nous, pour avoir fait l'objet de nombreuses discussions après les auditions. En accord avec la rapporteure, je vous propose de supprimer l'ensemble des paragraphes dédiés aux communes nouvelles et aux communes-communautés. En effet, il semble difficile de trouver un accord sur ce sujet. Or nous souhaitons que le rapport soit le plus consensuel possible.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Je précise cependant que le rapport du groupe de travail sur la décentralisation, présidé par Gérard Larcher, préconisait de promouvoir unanimement les communes nouvelles.
Mme Ghislaine Senée. - De quand ce rapport date-t-il ?
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Il date de 2023.
Mme Ghislaine Senée. - C'était donc avant l'expérimentation !
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Il faut écouter les territoires.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - J'en viens aux compétences sécables. L'idée est d'appréhender les situations locales avec beaucoup de réalisme. Certes, chaque compétence forme un tout, mais ses parties n'en peuvent pas moins, parfois, être séparées. À titre d'exemple, si la compétence « entretien et construction des bâtiments scolaires » n'est pas sécable, cela signifie que l'intercommunalité doit intervenir chaque fois qu'il faut changer une ampoule, ce qui peut prendre jusqu'à quinze jours ! A contrario, si la commune s'en charge, le changement peut être effectué dans la soirée. Donnons de la souplesse. Laissons aux territoires la possibilité de s'organiser au mieux de leurs intérêts, à partir d'une boîte à outils pratiques et optionnels.
Il arrive que des communautés d'agglomération ayant le même nombre d'habitants fonctionnent de manière très différente. Ce qui fonctionne à un endroit ne fonctionne pas forcément à un autre. Une certaine souplesse est donc requise, pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est ce qu'attendent les élus. Même si cela complique la donne au niveau national, c'est un apport considérable pour ceux qui sont confrontés aux réalités du terrain.
M. David Margueritte. - Monsieur le président, votre exemple de l'ampoule à changer est très parlant. Ma réserve avait trait au risque de voir les uns et les autres se renvoyer la responsabilité des travaux à mener. Une telle mesure n'est-elle pas potentiellement source de conflits ? Il est en effet difficile de déterminer précisément, au sein de chaque compétence, ce qui relève de l'intercommunalité et ce qui relève de la commune.
M. Étienne Blanc. - Un mot important manque dans le rapport : celui de « liberté ». On parle de « souplesse », d'« adaptation », mais la liberté est essentielle. Et c'est elle que demandent les communautés de communes ! À titre d'exemple, dans ma communauté de communes, qui rassemble 27 communes, nous avons bien distingué l'investissement et le fonctionnement. Si le premier est mutualisé, le second est laissé à la liberté des communes. Si celles-ci le souhaitent, la communauté de communes peut intervenir pour de menus travaux, mais en ce cas, les communes sont averties des délais associés. Par ailleurs, si les maires décident d'effectuer les travaux, ils peuvent envoyer la facture à la communauté de communes.
Trop de contraintes pèsent sur les maires et les élus communaux. Il faut plus de liberté.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Nous nous rejoignons. Libre à chaque territoire de définir les choses comme il l'entend.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Exactement.
M. David Margueritte. - Cela suppose un assouplissement du code des marchés publics, que l'on nous oppose régulièrement. Cet assouplissement est nécessaire pour rendre possibles les réparations rapides que vous appelez de vos voeux.
Mme Ghislaine Senée. - D'où la nécessité de définir l'intérêt communautaire !
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Oui, tout se tient.
Concernant les indemnités des élus, monsieur Pernot, la présidence d'une intercommunalité ne revient pas de droit à la ville-centre.
M. Clément Pernot. - Mais elle peut lui revenir !
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Certes, mais vous examinez ce point à l'aune de votre propre expérience, ayant été maire avant d'être président d'intercommunalité. Les maires qui seront élus en 2026 n'auront pas forcément cette chance : ils seront soit l'un, soit l'autre.
Mme Ghislaine Senée. - Pourquoi ne pourraient-ils pas être à la fois maires et présidents d'intercommunalité ?
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Les missions du maire ne peuvent pas être les mêmes que celles du président d'intercommunalité. Il ne saurait y avoir de chevauchement.
Mme Martine Berthet. - Cela n'empêche pas d'être à la fois maire et président d'intercommunalité.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Oui, mais ce seront deux fonctions différentes. Il ne faut donc pas toucher aux indemnités.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Nous sommes d'accord.
Mme Ghislaine Senée. - Il faut prendre en considération le fait que, à compétences égales, il y a eu une hausse globale des indemnités. Il n'en est pas moins vrai que, dans les petites communes, il y a des élus qui ne sont pas suffisamment indemnisés. En revanche, d'autres s'en sortent bien en cumulant les indemnités communales et intercommunales.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Le statut de l'élu fait l'objet d'un autre texte...
M. Clément Pernot. - Mais il faut intégrer ces inégalités de fait à notre réflexion sur le statut de l'élu local.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - C'est le sujet du cumul « horizontal » de plusieurs fonctions locales, que les règles actuelles sur le cumul des mandats ne couvrent pas.
M. Clément Pernot. - C'est le cas d'un adjoint au maire qui se retrouve vice-président de la communauté de communes...
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Nous aurons très bientôt ce débat sur le statut de l'élu. Le cumul horizontal n'est pas soumis aux normes qui s'imposent aujourd'hui aux parlementaires, mais je connais des élus locaux de mon département qui, sans être parlementaires, voient leurs indemnités écrêtées, parce qu'ils perçoivent plus de 8 000 euros par mois.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - L'un de nos collègues, dont je tairai le nom, a proposé de mettre fin au cumul horizontal.
M. Clément Pernot. - C'est inepte !
M. Jean-Marie Mizzon, président. - L'intérêt communautaire est un enjeu central. Mais il y a un autre point crucial, que j'ai rappelé dans mon propos liminaire et que nous connaissons tous : ce qui fait qu'une intercommunalité fonctionne ou non, c'est très souvent son président, tout comme c'est le maire qui fait le succès de sa commune. C'est bien pourquoi il faut offrir une formation à ces présidents, parce que la gestion d'une intercommunalité est plus compliquée encore que celle d'une commune.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - J'ajouterai quelques éléments aux propos de notre président. Notre volonté a été d'inciter plutôt que de contraindre. Les élus ont besoin de liberté, ils en ont assez de se voir imposer des choses ; c'est ainsi que l'on fera en sorte qu'ils s'approprient davantage l'échelon intercommunal. Notre rapport a donc été construit autour de l'incitation et de la pédagogie.
Le Premier ministre a confié à la presse qu'il souhaitait mettre en oeuvre « un grand acte de décentralisation ». Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, tout en lui rappelant le besoin de stabilité exprimé par les élus, qui ne veulent pas voir tout bouleversé une nouvelle fois. Il m'a répondu que sa volonté s'adressait plus à l'État qu'aux collectivités territoriales.
Concernant les communes nouvelles, notre proposition visait en quelque sorte à assurer le service après-vente des travaux menés jusqu'à présent. Dans l'esprit du groupe de travail sur la décentralisation conduit par le président Larcher, les communes nouvelles sont un moyen de répondre à la crise des vocations qui risque de se faire jour à l'occasion des prochaines élections municipales. Bien que n'étant pas pleinement convaincue par cette approche, seul un petit nombre de communes nouvelles ont été créées dans mon département, je constate qu'il s'agit parfois de la seule solution. On peut en tout état de cause s'interroger sur la pertinence de conserver des communes de moins de dix habitants... Le sujet des communes nouvelles n'étant pas directement lié à celui de l'intercommunalité, il est préférable de ne pas en faire mention dans le rapport.
J'ai noté votre soutien à notre recommandation relative aux attributions de compensation. Le débat est très complexe, car il ne faudrait pas déstabiliser les financements de l'intercommunalité. Nous marchions sur des oeufs, mais je crois que, en sortant de la logique de l'unanimité, souvent impossible à atteindre, nous avons abouti à une proposition équilibrée.
L'intérêt communautaire est un autre sujet complexe. L'État a échoué à en formaliser certains éléments. Ainsi de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) : je vous mets au défi de comprendre qui, de la commune, de la communauté de communes ou du syndicat Gemapi, intervient sur une même rivière pour tel ou tel sujet ! Entre prévention et précaution, le flou est complet. Il faut donc mieux formaliser l'intérêt communautaire, tout en préservant la liberté de chaque territoire.
Frédérique Espagnac a parlé de maturité. Peut-être le renouvellement, en 2026, des conseils municipaux et des conseils communautaires sera-t-il l'occasion de repartir sur des bases nouvelles, plus confortables pour les intercommunalités. Le renouvellement de 2020, en plein covid, a été compliqué : les nouveaux élus se connaissaient mal, et il leur a été difficile d'apprendre à travailler ensemble. Le degré de maturité diffère selon les territoires. Les recommandations que nous formulons permettront peut-être d'aller un peu plus vite dans la maturation d'organisations encore jeunes.
Mme Frédérique Espagnac. - Tout à fait !
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Sur la question du bilan financier des intercommunalités, Clément Pernot a eu raison de dire que la comparaison n'avait pas de sens : de nouveaux investissements ont été consentis, des services nouveaux ont été créés. Il n'est pas possible de quantifier tout cela, même si l'inquiétude des élus locaux quant aux coûts croissants pour les collectivités et les citoyens est légitime. Qualitativement, la hausse des coûts s'accompagne tout de même d'une amélioration des services, répartis de manière plus équitable entre territoires.
M. Clément Pernot. - Absolument : si l'on rapportait le coût à la quantité de services offerts, je ne suis pas sûr que l'on constaterait une hausse.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - C'est bien ce que nous écrivons dans le rapport : « C'est parce que les intercommunalités répondent à des besoins et qu'elles ont davantage la capacité d'investir et d'offrir des services publics que leur niveau de dépense s'accroît. »
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Le problème, c'est qu'on a vendu les intercommunalités aux élus comme une source d'économies. Si les élus réagissent ainsi, c'est parce qu'on leur a dit que tout coûterait moins cher !
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Il faut faire confiance aux élus, comme le disait Jean-Claude Anglars, mais il faut aussi rebâtir de la confiance entre élus, ce qui est difficile quand il y a eu des contraintes, des « mariages forcés ».
Concernant le Fpic, nous intégrons bien les éléments pointés par Martine Berthet dans la rédaction du rapport et de la recommandation afférente.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Quid de la communication ? Il ne faudrait pas que la « journée des maires » préconisée pour le début de mandat se tienne une fois seulement. La tenir une seconde fois, à mi-mandat, permettrait d'évoluer dans l'intégration de l'intercommunalité.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Pour ne pas fermer la porte, on pourrait écrire « à chaque début de mandat puis autant que nécessaire ».
Cela étant dit, dans mon territoire, l'intercommunalité organise presque tous les ans une journée thématique ouverte à tous les conseillers municipaux, mais il n'y a jamais personne... La question de la disponibilité et de l'engagement se pose.
Mme Ghislaine Senée. - Les services de l'État devraient, eux aussi, organiser une telle présentation de leur activité en début de mandat.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Sur la communication des intercommunalités, madame Bellamy, comment pourrait-on traduire vos remarques dans une recommandation ?
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Je réfléchis à la formulation appropriée.
M. Clément Pernot. - Il faut responsabiliser les maires qui représentent leurs communes dans l'intercommunalité. Ils ont beau jeu d'accuser celle-ci, comme certains parlementaires accusent l'Europe... Selon moi, il revient à ces maires de diffuser les comptes rendus, plutôt que d'imposer une nouvelle obligation à la communauté de communes.
Mme Marie-Jeanne Bellamy. - Les rapports d'activité sont transmis.
Mme Ghislaine Senée. - C'est une question de forme. Quand l'exécutif intercommunal va vers les élus municipaux, cela leur offre une forme de reconnaissance.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Nous avons consacré tout un paragraphe du rapport au sujet de la gouvernance intercommunale. Nous y pointons le manque de lisibilité et le besoin de communication. Nous n'avons pas fait de recommandation en la matière, car cela relève plutôt de l'organisation interne de chaque intercommunalité et de son projet de territoire. J'entends toutefois les remarques de madame Bellamy.
M. Étienne Blanc. - À ma connaissance, le rapport d'activité de l'intercommunalité est communiqué à chaque conseiller municipal. S'agit-il d'une obligation réglementaire ou législative ?
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - C'est une obligation législative, figurant à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement (...). Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune (...) sont entendus. »
M. Lucien Stanzione. - Le conseil municipal donne acte de la communication. Il n'y a pas de vote.
M. Étienne Blanc. - En tout cas, puisqu'il s'agit d'une obligation légale, le rapport de l'intercommunalité doit être annexé à la convocation du conseil municipal.
Mme Maryse Carrère, rapporteure. - Le même article dispose : « Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. » Je ne suis pas sûre que beaucoup le fassent... C'est pourtant une obligation législative ! Si vous en êtes d'accord, nous pourrions introduire une recommandation rappelant la nécessité de rendre cette obligation effective.
M. Jean-Marc Delia. - Il me semble que toutes les délibérations du conseil communautaire font obligatoirement l'objet d'une communication à l'ensemble des conseillers municipaux.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Avez-vous encore des observations à formuler sur le rapport et ses recommandations, mes chers collègues ?
M. Clément Pernot. - En ce qui concerne les services communs, pour avoir été maire de Champagnole et président d'intercommunalité, j'ai tout fait pour ne pas trop mélanger - sinon, j'aurais été un despote absolu ! Dans le Jura, il y a une ville-bourg et une trentaine de petites agglomérations autour. Le sénateur du Jura que je suis ne conseille pas forcément au président de la communauté de communes de mutualiser ses services avec le maire de la ville... Les directions générales de services communs sont une catastrophe !
Mme Ghislaine Senée. - C'est vrai.
M. David Margueritte. - Il faut distinguer les services communs des services mutualisés. Vous faites référence aux relations entre la ville-centre et la communauté de communes, alors que nous débattons surtout des services mutualisés.
Mme Ghislaine Senée. - Je suis contre la mutualisation des services et des cabinets, mais un service technique commun entre communes peut être utile.
M. Jean-Marie Mizzon, président. - Je vais maintenant mettre aux voix les recommandations et le rapport.
Les recommandations, ainsi modifiées, sont adoptées.
La mission d'information adopte, à l'unanimité, le rapport d'information ainsi modifié et en autorise la publication.
M. Jean-Marie Mizzon, président - Si certains des groupes dont vous êtes membres souhaitent apporter une contribution complémentaire, ils pourront la faire parvenir au secrétariat de la mission d'ici à demain mercredi midi.
Comptes rendus des auditions
Les comptes rendus sont consultables ici.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Les réunions plénières
Mardi 8 avril 2025
- Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité : M. André LAIGNEL, premier vice-président.
Mercredi 9 avril 2025
- Association des maires ruraux de France (AMRF) : M. Éric KREZEL, membre du Bureau.
Mardi 29 avril 2025
- Mmes Marie-Annick FOURNIER, déléguée générale de l'ANEM, Géraldine LEDUC, directrice générale, MM. Philippe SUEUR, président et Alain BLANCHARD, délégué général
Mercredi 7 mai 2025
- Assemblée des départements de France : M. Jean DEGUERRY, président du conseil départemental de l'Ain.
Mercredi 14 mai 2025
- Assemblée des petites villes de France : M. Romain COLAS, vice-président.
Mardi 20 mai 2025
- M. Éric WOERTH, ancien ministre, auteur du rapport « Décentralisation : le temps de la confiance », mai 2024.
Mardi 3 juin 2025
- Interco' Outre-mer : Mmes Lyliane PIQUION SALOMÉ, présidente, Caroline CUNISSE, directrice générale et Christelle ÉTHÈVE VADIER, membre du bureau.
Mercredi 4 juin 2025
- Association des directeurs généraux des communautés de France : M. Éric PETIT, président, Mme Florence CORNIER PICOTIN, secrétaire nationale, MM. Fabrice BELKACEM, membre du conseil d'administration et David LE BRAS, délégué général.
Jeudi 26 juin 2025
- Direction générale des collectivités locales : Mme Cécile RAQUIN, directrice générale, MM. Lionel LAGARDE, adjoint à la sous-directrice des compétences et des institutions locales, Benoît CHAPUIS, adjoint au chef du bureau des structures territoriales et Mme Lucile TAMAGNAN, chargée de mission au bureau des structures territoriales.
- MM. Hubert LA MARLE, président de section, Yves ROQUELET, président de section, Jean-Pierre ROUSSELLE, président de section, Nicolas BILLEBAUD, premier conseiller, Jean-Pierre VIOLA, Conseiller maître, président de la section Synthèse financière et organisation de la protection sociale à la 4e chambre.
Mardi 1 juillet 2025
- M. François REBSAMEN, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
- MM. Yann SCOTTE, Vincent BOULNOIS, Mme Christiane TINCELIN, M. Werner KERVAREC, Mme Isabelle SURREAUX, MM. Xavier ODO, Laurent FOURCADE et Paul-Roland VINCENT, maires.
Réunions au format rapporteur
Mercredi 7 mai 2025
- France Urbaine : Mme Frédérique BONNARD LE FLOC'H, co-présidente de la commission « Alliance des territoires ».
Mardi 27 mai 2025
- M. Olivier JACOB, préfet, ancien directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur
Mardi 24 juin 2025
- Mme Armelle TREPPOZ, maître de conférences en droit public, responsable du master droit public, directrice du Centre d'Enseignement supérieur de Châteauroux et M. Éric KERROUCHE, sénateur des Landes.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Ville de la Ferté-Macé
- Ville de Lamballe-Armor
- Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP)
- Mme Annie SAGNES-LAGRANGE, vice-présidente de la communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves en charge de l'environnement et de la transition écologique, maire de Luz-Saint-Sauveur
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Jeudi 15 mai 2025 - Hautes Pyrénées
- Table ronde avec les présidents des intercommunalités du département : MM. Gérard TRÉMÈGE, président de la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et maire de Tarbes, Frédéric RÉ, président de la Communauté de Communes Adour Madiran et maire de Lahitte-Toupière, Philippe CARRÈRE, président de la Communauté de Communes Aure Louron et maire de Arreau, Jacques BRUNE, président de la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre, Cédric ABADIA, président de la Communauté de Communes des Côteaux du Val d'Arros et maire de Fréchou-Fréchet, Gérard BARTHE, président de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac et maire de Monléon Magnoac, Bernard PLANO, président de la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et maire de Lannemezan, Yoan RUMEAU, président de la Communauté de Communes Neste Barousse et maire de Aventignan, Noël PEREIRA DA CUNHA, président de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et maire de Pierrefitte-Nestalas.
- Déjeuner en préfecture en présence de MM. Jean-Louis CAZAUBON, vice-président de la région Occitanie, Michel PÉLIEU, président du Conseil départemental, Mme Viviane ARTIGALAS, sénatrice des Hautes-Pyrénées et M. Jean SALOMON, préfet des Hautes-Pyrénées.
- Visite de l'Usine des Sports, premier projet d'investissement porté par la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
- Table ronde autour des compétences optionnelles scolaire, petite enfance, périscolaire et extra-scolaire : MM. Pierre ABADIE, vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac en charge de la culture, sport, cinéma, petite enfance et enfance jeunesse et maire-Adjoint de Castelnau-Magnoac, Charles LEGRAND, vice-président de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves en charge des équipements communautaires, du sport et de la santé et maire d'Arras-en-Lavedan, Nicolas DATAS TAPIE, premier vice-président de la Communauté de Communes des Côteaux du Val d'Arros et maire de Tournay.
- Table ronde autour de la compétence optionnelle tourisme : Mme Annie SAGNES-LAGRANGE, vice-présidente de la Communauté de Communes en charge de l'environnement et de la transition écologique et maire de Luz-Saint-Sauveur, MM. André MIR, maire de Saint-Lary Soulan, Thierry LAVIT, vice-président de l'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées en charge de la promotion du tourisme et maire de Lourdes.
Jeudi 22 mai 2025 - Moselle
- Réunion avec des élus locaux de la Moselle : MM. Armel CHABANE, maire de Bouzonville, président de la communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières, Lionel FOURNIER, maire de Rombas, président de la communauté de communes Pays Orne Moselle, Arnaud SPET, président de la communauté de communes de l'Arc Mosellan, Patrick ABATE, maire de Talange, vice-président de la communauté de communes Rives de Moselle, Jean-Michel BRUN, maire de Coume, vice-président de la communauté de communes de la Houve Pays Boulageois, Roland KLEIN, président de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud, David SUCK, président de la communauté de communes du Pays de Bitche et Mme Brigitte TORLOTING, maire de Louvigny, présidente de la communauté de communes du Sud messin.
- Déjeuner à l'invitation de M. Patrick WEITEN, président du département de la Moselle
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Éviter à l'avenir un nouveau « big bang territorial », donnant lieu à une modification autoritaire de l'intégralité de la carte intercommunale. |
Gouvernement Parlement |
Sans objet |
- |
|
2 |
Faciliter les adaptations, à la marge et en concertation avec les élus locaux, des périmètres des intercommunalités, afin de les faire coïncider avec les bassins de vie et d'emploi. À cet effet, assouplir les conditions de retrait et de scission des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
Gouvernement Parlement Préfets Bloc communal |
Mesure législative Instruction aux préfets |
|
|
3 |
Afin d'associer l'ensemble des communes, notamment les plus petites, à la gouvernance des intercommunalités, renforcer la place de la conférence des maires en lui permettant, par exemple, de voter une motion d'alerte. |
Gouvernement Parlement |
Mesure législative |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
4 |
Garantir la mise en oeuvre effective de l'obligation de communication aux maires du rapport annuel d'activité de l'intercommunalité. |
Intercommunalités |
Sans objet |
- |
|
5 |
Maintenir le mode d'élection actuel des conseillers communautaires. |
Sans objet |
- |
|
|
6 |
Compléter le catalogue des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus (Dife) par des formations spécifiques dédiées aux titulaires d'un mandat exécutif communautaire, et notamment à la gouvernance des intercommunalités. |
Gouvernement DGCL |
Répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local |
|
|
7 |
Organiser, à chaque début de mandat puis autant que nécessaire, une « journée des maires et des conseillers municipaux », afin de leur présenter l'organisation de l'intercommunalité, les modalités de sa gouvernance et les services pouvant être offerts aux communes membres. |
Intercommunalités |
Bonnes pratiques |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
8 |
À chaque début de mandat, inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre un débat obligatoire sur l'élaboration d'un projet de territoire. |
Intercommunalités |
Bonnes pratiques |
|
|
9 |
Simplifier, pour les maires, l'accès aux services d'ingénierie de l'État en centralisant toutes les formalités en un guichet unique. |
Gouvernement, DGCL Préfets |
Instruction aux préfets Organisation administrative |
|
|
10 |
Éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences. |
Sans objet |
- |
|
|
11 |
Étendre les possibilités de transfert de compétences « à la carte » à certaines compétences obligatoires. |
Gouvernement Parlement |
Mesure législative |
|
|
12 |
Permettre, par accord local, de modifier la répartition des compétences. |
Gouvernement Parlement |
Mesure législative |
|
|
13 |
Simplifier le régime des délégations de compétences. |
Gouvernement Parlement |
Mesure législative |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
14 |
Dans le cas d'un transfert de compétence subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, prescrire que ce dernier soit défini par le groupement intercommunal sur la base de critères formalisés et objectifs. |
Gouvernement Parlement Intercommunalités |
Mesure législative Bonnes pratiques |
|
|
15 |
Transformer le rapport sur l'évolution des attributions de compensation en une annexe obligatoire aux documents d'orientation budgétaire de l'intercommunalité. |
Gouvernement, Parlement |
Loi de finances |
|
|
16 |
Permettre au conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des deux tiers lorsque l'évaluation de la commission locale d'évaluation des charges transférées (Clect) fait apparaître qu'elles sont manifestement inadaptées. |
Gouvernement, Parlement |
Mesure législative |
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
17 |
À chaque début de mandat, prévoir, en plus de l'obligation d'établir un pacte fiscal et financier, un débat obligatoire sur la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire (DSC). |
Gouvernement, Parlement |
Mesure législative |
|
|
18 |
Faire de la répartition alternative du FPIC par les conseils communautaires, pour le prélèvement comme pour le reversement, un instrument de solidarité au sein des intercommunalités. |
Intercommunalités |
Bonnes pratiques |
|
|
19 |
Mobiliser les fonds de concours pour soutenir les investissements communaux qui s'inscrivent dans le projet de territoire de l'intercommunalité. |
Intercommunalités |
Bonnes pratiques |
|
|
20 |
Encourager le recours aux mutualisations, et notamment aux services communs, par une meilleure information des élus locaux. |
DGCL Intercommunalités |
Bonnes pratiques |
CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K
Le groupe CRCE-K souhaite rappeler que s'il reste favorable à un approfondissement de la décentralisation, il refuse catégoriquement que celui-ci s'opère de manière autoritaire, dans un contexte d'austérité budgétaire ou de mise en concurrence généralisée entre les territoires, comme ce fut le cas pour les lois NOTRe et MAPTAM.
Ces deux lois ont laissé de profondes marques sur les collectivités locales. Elles ont eu pour effet de réduire leurs moyens et leurs marges de manoeuvre, tout en alourdissant leurs responsabilités. Les collectivités se retrouvent aujourd'hui confrontées à l'urgence de maintenir des services publics essentiels, dans un cadre budgétaire toujours plus contraint.
Notre groupe défend un monde rural dynamique, innovant et aux nombreuses potentialités de développement. Or, ces lois, avec d'autres, ont eu l'effet inverse en affaiblissant cette présence. La création de grandes régions, le redécoupage cantonal, le regroupement de services déconcentrés, et la suppression de la clause de compétence générale pour les départements et les régions, contribuent à éloigner les centres de décision des populations. Ce mouvement inverse au principe de proximité a aggravé la délégitimation de l'action publique locale.
En particulier, la logique de seuils imposés pour les intercommunalités ne correspond pas aux réalités des territoires ruraux. Elle a eu pour effet la formation d'intercommunalités trop vastes, dans lesquelles les décisions sont prises loin des habitants et de leurs besoins quotidiens. Or, pour que l'intercommunalité soit un véritable levier de développement, elle doit reposer sur des coopérations de projets adaptées aux contextes locaux, et non sur une simple logique démographique. Nous partageons la recommandation exprimée dans le rapport de faire coïncider les bassins de vie et d'emploi avec les périmètres des intercommunalités.
Au-delà de l'organisation institutionnelle, notre groupe regrette que le remplacement progressif de la notion de « service public » par celle de « services aux publics » qui témoigne d'un changement profond de paradigme. Ce glissement sémantique n'est pas anodin : il ouvre la voie à une approche plus contractuelle et privatisée, éloignée du principe d'universalité et de solidarité qui fonde le service public républicain.
Ces réformes territoriales ont eu pour conséquence le recul de l'État et des collectivités dans les territoires les plus fragiles. Notre groupe défend à l'inverse le renforcement de la pertinence et du rôle de l'échelon départemental en milieu rural, la garantie de l'accès effectif aux services publics, et de promouvoir une vision inclusive du développement, qui ne laisse aucun territoire de côté.
Enfin, le groupe CRCE-K souhaite rappeler que ce ne sont ni les logiques de marché, ni les grands opérateurs privés qui assureront, seuls, l'avenir des villages et des petites communes. Ce sont bien les collectivités locales, les élus de proximité, les associations, les habitants eux-mêmes, qui portent au quotidien les dynamiques locales. En affaiblissant, notre démocratie de proximité et l'équilibre territorial du pays ont été fragilisés.
Nous souhaitons ainsi ici rappeler notre attachement et notre gratitude envers les élus locaux qui se battent au quotidien pour se faire entendre et reconnaître par l'État. Ceux-ci ne sont pas de simples gestionnaires chargés d'administrer des compétences transférées : ils portent, auprès de leur population, une vision politique et une responsabilité démocratique issue des urnes.
Parallèlement, si la mission d'information a fait le choix de ne pas se focaliser sur les questions financières en tant que telles, elles restent toutefois très importantes pour notre groupe. Les collectivités territoriales, dans ce contexte tendu, ne peuvent exercer leurs responsabilités sans le soutien actif de l'État et de ses services déconcentrés.
Aussi, la conception de la décentralisation défendue par le groupe CRCE-K est indissociable d'un approfondissement parallèle de la déconcentration. Elle repose également sur la nécessité de stabiliser un cadre législatif national clair, garant de l'égalité devant la loi, ainsi que des principes d'unicité et d'indivisibilité de la République. C'est à travers une articulation intelligente entre les échelons local et national, fondée sur le principe de subsidiarité, qu'il est possible de construire des politiques publiques partant des réalités concrètes des territoires, tout en maintenant un haut niveau d'égalité républicaine.
Dans cette perspective, la commune, en tant que maillon de proximité essentiel, doit être pleinement revalorisée. Cette revalorisation passe notamment par un renforcement des finances locales, condition indispensable à une action publique efficace et à la pérennité des services rendus aux citoyens.
GLOSSAIRE
3DS : Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
AC : Attributions de compensation
AdCF : Assemblée des communautés de France
ADF : Assemblée des départements de France
ADGCF : Association des gestionnaires des communautés de France
AMF : Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité
AMRF : Association des maires ruraux de France
ANCT : Agence nationale de cohésion des territoires
Anel : Association nationale des élus des littoraux
Anem : Association nationale des élus de la montagne
Anett : Association nationale des élus des territoires touristiques
APVF : Association des petites villes de France
ATR : Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
CDCI : Commission départementale de la coopération intercommunale
Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Cevipof : Centre de recherches politiques de Sciences Po
CFE : Caisse des Français de l'étranger
CIF : Coefficient d'intégration fiscale
Clect : Commission locale d'évaluation des charges transférées
CNFEL : Conseil national de la formation des élus locaux
CPF : Compte personnel de formation
CRC : Chambre régionale des comptes
Dasen : Directeurs académiques des services de l'éducation nationale
DDI : Directions départementales interministérielles
DGCL : Direction générale des collectivités locales
Dife : Droit individuel à la formation des élus locaux
DOM : Départements d'outre-mer
DSC : Dotation de solidarité communautaire
DSR : Dotation de solidarité rurale
EPCI : Établissements publics de coopération intercommunale
FA : Fiscalité additionnelle
FPU : Fiscalité professionnelle unique
FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
Gemapi : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Ifer : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Maptam : Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
NOTRe : Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
PFF : Pacte financier et fiscal
PPI : Plan pluriannuel d'investissement
RCT : Loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
SDCI : Schémas départementaux de coopération intercommunale
Sivom : Syndicat intercommunal à vocation multiple
Sivu : Syndicat intercommunal à vocation unique
Tascom : Taxe sur les surfaces commerciales
TFNB : Taxes foncières sur le foncier non bâti
TFPB : Taxes foncières sur le foncier bâti
THRS : taxe d'habitation sur les résidences secondaires
* 1 Il existe aujourd'hui quatre catégories d'EPCI à fiscalité propre : les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
* 2 Loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 3 Loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 4 Il s'agit des îles de Bréhat, d'Ouessant, de Sein et d'Yeu.
* 5 Lors de l'Assemblée nationale constituante de 1789, la nouvelle organisation administrative qui doit être mise en place sur les ruines de l'Ancien Régime fait l'objet d'intenses débats. Finalement, le décret du 14 décembre 1789 dispose à son article 1er que : « Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en service, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés. ». À la place sont installées de nouvelles institutions uniformes et communes à toutes les localités, comme le précise dans sa première phrase l'instruction de l'Assemblée nationale sur la formation des nouvelles municipalités, en date du 14 décembre 1789 : « Il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ». Cette même instruction précise, en son paragraphe 2, que « toutes les municipalités du royaume, soit de ville, soit de campagne, étant de même nature et sur la même ligne dans l'ordre de la constitution, porteront le titre commun de municipalité, et le chef de chacune d'elles, celui de maire. ».
* 6 Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale
* 7 Loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes
* 8 La loi du 13 novembre 1917modifiant la loi municipale du 5 avril 1884 assouplit la procédure de création des intercommunalités désormais soumise à un simple arrêté préfectoral ; la loi du 26 juin 1925 modifiant l'article 169 de la loi du 5 avril 1884 facilite l'adhésion de nouvelles communes de départements limitrophes ; la loi du 5 avril 1927 réduit à une seule le nombre de session obligatoire ; la loi du 7 avril 1931 prolongeant la durée du mandat des membres des bureaux des comités des syndicats de communes conforte le rôle et la longévité de bureau syndical ; le décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'État sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État autorise la constitution de syndicats mixtes entre départements, communes, Chambres de commerce et établissements publics pour l'exploitation par voie de concession de services publics ; le décret du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux autorise les communes à créer un service intercommunal de lutte contre les incendies, etc.
* 9 Article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales.
* 10 Articles L. 5711-1 à L. 5711-6 du code général des collectivités territoriales.
* 11 Articles L. 5721-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
* 12 Une politique volontariste de fusions de communes a été mise en place en Belgique, à partir de 1977, ce qui a permis de faire passer le nombre de communes de 2 359 en 1977 à 565 en 2025.
* 13 Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.
* 14 Chaque commune ayant décidé de fusionner devient, dans le cadre du régime de la fusion association, une commune associée, à l'exception de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le chef-lieu de la commune issue de la fusion.
* 15 Article 21 de la loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 16 Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009 de Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des lois sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
* 17 Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts.
* 18 Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.
* 19 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
* 20 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
* 21 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 22 Articles L. 5214-1 à L. 5214-29 du code général des collectivités territoriales.
* 23 Articles L. 5215-1 à L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales.
* 24 Articles L. 5216-1 à L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales.
* 25 Articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.
* 26 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
* 27 Journal officiel de la République française, 5 février 1999, Comptes rendus de l'Assemblée nationale, p. 951.
* 28 Soit 38,11 euros.
* 29 Rapport d'information n° 193 (2005-2006) du 1er février 2006 de Philippe Dallier, au nom de l'Observatoire de la décentralisation, sur l'intercommunalité à fiscalité propre.
* 30 Article 1379-0 bis, II, du code général des impôts.
* 31 Article 1379-0 bis, I, du code général des impôts.
* 32 Selon la Cour des comptes, en 2023, 80 % des EPCI relevaient du régime de la fiscalité professionnelle unique.
* 33 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 34 Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009 de Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
* 35 Article 21 de la loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 36 Inspection générale de l'administration, « Les communes nouvelles : un bilan décevant, des perspectives incertaines », juillet 2022.
* 37 Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009 de Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des lois sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.
* 38 Loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
* 39 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 40 Articles L. 5211-42 à L. 5211-45-1 du code général des collectivités territoriales.
* 41 Les CDCI sont également chargées d'établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans leur département et peuvent également proposer une révision de la carte intercommunale au préfet.
* 42 Article 60 de la loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 43 Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France, Mme Maryse Carrère, présidente, M. Mathieu Darnaud, rapporteur, 5 juillet 2023.
* 44 Rapport n° 2191 du 24 juillet 2019 de Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale.
* 45 Article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
* 46 Journal officiel de la République, 13 octobre 2016, Réponse du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales à la question écrite n° 22 240 d'Élisabeth Lamure du 9 juin 2016.
* 47 Cour des comptes, « Les finances publiques locales en 2022 », Fascicule 2, octobre 2022.
* 48 « Décentralisation : le temps de la confiance », rapport d'Éric Woerth au Président de la République, mai 2024.
* 49 La Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la Communauté de communes Adour Madiran, la Communauté de communes Aure Louron, la Communauté de communes de la Haute-Bigorre, la Communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros, la Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac, la Communauté de communes du Plateau de Lannemezan, la Communauté de communes Neste Barousse, la Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves.
* 50A l'inverse, il peut également arriver que la ville-centre se retrouve de fait exclue de la prise de décision, comme l'a signalé à la mission le maire de Lamballe-Armor, ville-centre de la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer (mais représentant moins de 25 % de la population).
* 51 « Une intercommunalité bien loin des idées reçues », enquête 2024 sur les exécutifs intercommunaux, Martial Foucault et Éric Kerrouche, Cevipof, octobre 2024.
* 52 Cevipof, Enquête 2024 sur les exécutifs communautaires.
* 53 Chambre régionale des comptes de Corse, « Communauté de communes Pasquale Paoli (Haute-Corse) », 20 juillet 2023.
* 54 Rapport n° 851 (2022-2023) du 5 juillet 2023 de Maryse Carrère, présidente et Mathieu Darnaud, rapporteur, au nom de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France.
* 55 Le Conseil constitutionnel ne s'est pas explicitement prononcé sur l'adéquation de l'intercommunalité, dans ses développements récents, avec le principe de libre administration des collectivités territoriales, en particulier des communes.
* 56 https://www.senat.fr/notice-rapport/2024/r24-895-notice.html
* 57 Lorsque la commune compte moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux, suivant l'ordre du tableau : d'abord le maire, ses adjoints puis les conseillers municipaux, selon le nombre de sièges attribués à la commune.
* 58 L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales prévoit par exemple que « les membres [du] conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière ».
* 59 Voir par exemple l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales pour les communes.
* 60 L'arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat local précise par exemple que sont éligibles les formations liées aux fondamentaux du mandat (statut et rôle de l'élu, laïcité...), aux politiques publiques et aux actions locales (enfance et jeunesse, emploi et insertion...), à la communication ou encore au management et à la gestion des ressources humaines.
* 61 « Le rapport des Français à leur intercommunalité à 18 mois des élections municipales », étude réalisée par l'Ifop pour Intercommunalités de France, octobre 2024.
* 62 « Les effectifs de l'administration territoriale de l'État », rapport d'observations définitives, S2022-0494 de la quatrième chambre de la Cour des comptes.
* 63 Rapport public thématique sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements, Cour des comptes, octobre 2022.
* 64 Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France par Maryse Carrère, présidente et Mathieu Darnaud, rapporteur, 5 juillet 2023.
* 65 Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, par Pierre Barros, président et Christine Lavarde, rapporteur, 1er juillet 2025
* 66 Ce dernier transfert de compétences devait intervenir, initialement, à compter du 1er janvier 2020.
* 67 La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » a supprimé le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Seules les communautés de communes s'étant vues transférer ces compétences par toutes les communes membres, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'exercent à titre obligatoire.
* 68 Idem.
* 69 Proposition de loi n° 291 (2016-2017) visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues le 11 janvier 2017.
* 70 Article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.
* 71 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 72 Réponse de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à une question de Jean-Michel Arnaud (séance de questions d'actualité au Gouvernement du 10 avril 2024).
* 73 Rapport n° 2191 du 24 juillet 2019 de Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale.
* 74 Article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
* 75 Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir », 6 juillet 2023.
* 76 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 77 Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir », 6 juillet 2023.
* 78 Proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, présentée par MM. François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel et M. Jean-François Husson, 22 mars 2024.
* 79 Article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
* 80 Articles L. 5214-16-1, L. 5125-27 et L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales.
* 81 Ibid.
* 82 Articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
* 83 Articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
* 84 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 85 Circulaire du 13 juillet 2006 relative à l'aide à la définition de l'intérêt communautaire en matière « d'habitat » au profit des communes et de leurs groupements.
* 86 Avis n° 184 (2014-2015) fait par M. Charles Guené sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 11 décembre 2014.
* 87 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 88 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2024, Fascicule 1, juin 2025.
* 89 Guengant A. et Leprince M., « Évaluation des effets des régimes de coopération intercommunales sur les dépenses publiques locales », Économie et Prévision, n° 175-176, 2007/4-5.
* 90 Ibid.
* 91 DGCL, « L'intégration fiscale des intercommunalités », Bulletin d'information statistique, n° 191, décembre 2024.
* 92 Ibid.
* 93 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 94 Ibid.
* 95 Ibid.
* 96 Article 1609 nonies C du code général des impôts.
* 97 Il ne concerne pas les EPCI à fiscalité additionnelle, qui sont minoritaires (178 sur les 1 254 EPCI en 2022).
* 98 Conseil d'État, avis n° 391 635, 12 juillet 2016
* 99 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 100 Ibid.
* 101 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
* 102 Article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales.
* 103 Houser M., Droit de la péréquation financière, L'Harmattan, 2015.
* 104 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 105 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 106 « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales », rapport d'information n° 73 (2021-2022) fait par MM. Charles Guené et Claude Raynal au nom de la commission des finances du Sénat, sur le FPIC, déposé le 20 octobre 2021.
* 107 Définis à l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales : population ; écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'EPCI et potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'EPCI.
* 108 « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales », rapport d'information n° 73 (2021-2022) fait par MM. Charles Guené et Claude Raynal au nom de la commission des finances du Sénat, sur le FPIC, déposé le 20 octobre 2021.
* 109 Au sein du code général des collectivités territoriales, les fonds de concours sont définis à l'article L. 5214-16pour les communautés de communes, à l'article L. 5216-5 pour les communautés d'agglomération et à l'article L. 5215-26pour les communautés urbaines.
* 110 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.
* 111 Ibid.
* 112 Article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales.