B. UNE POLITIQUE DEVENUE TROP COMPLEXE ET INSUFFISAMMENT COORDONNÉE AVEC LES POLITIQUES DE DROIT COMMUN
1. Un enchevêtrement des différents zonages
Si elle cible également des individus, la politique de la ville a été conçue avant tout comme « territorialisée ». Elle s'applique à des périmètres clairement identifiés, au moyen d'une série de critères très précis, qui donnent ce qu'il est convenu d'appeler la « géographie prioritaire » de la politique menée.
C'est la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui a créé les trois types de zones enchâssées sur lesquelles la politique de la ville repose depuis maintenant dix-huit ans :
- les zones urbaines sensibles (ZUS), caractérisées par « la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi ». Il en existe aujourd'hui 751, incluant environ 4,4 millions d'habitants ;
- les zones de redynamisation urbaine (ZRU), sous-périmètre des ZUS, désignant des espaces confrontés « à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique ». On en dénombre 416, comprenant 2,9 millions d'habitants ;
- les zones franches urbaines (ZFU), sous-périmètre des ZRU, créées dans les quartiers de plus de 10 000 habitants « particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la délimitation des ZRU ». Leur délimitation est opérée « en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou de développement d'activités économiques ». Au nombre de 100, elles regroupent 1,3 million d'habitants.
À chacune de ces zones sont attachés des avantages particuliers au titre de la politique de la ville, fiscaux ou sociaux, pour la plupart, tels que des abattements d'impôts ou des réductions de charges. Ils visent en effet à alléger les contraintes pesant sur leurs opérateurs économiques afin de les inciter, en leur conférant un avantage par rapport au reste du territoire, à s'installer dans ces espaces urbains.
C'est donc sur ces zones qu'ont vocation à s'appliquer les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Depuis leur entrée en vigueur en 2007, ils ont en effet pour objet de regrouper et de coordonner l'ensemble des mesures de cohésion sociale - spécifiques à la politique de la ville -, mais aussi et même prioritairement, de droit commun, dont peuvent bénéficier ces territoires.
Cependant, le décalque entre CUCS et ZUS n'est pas parfait , puisque le nombre de CUCS (2 496) excède largement celui de ZUS (751). Ce sont donc pas moins de 70 % des quartiers ciblés par les CUCS qui ne sont pas classés en ZUS.
Si ce zonage en ZUS permet de déterminer l'éligibilité des dispositifs constituant le coeur de la politique de la ville, il sert également de support à d'autres volets connexes à cette politique. C'est le cas du périmètre d'application du dispositif de rénovation urbaine, le PNRU, qui a vocation à s'appliquer sur les ZUS, même s'il peut également traiter, sous certaines conditions, les zones situées sur le pourtour 3 ( * ) . Les mesures en faveur de la rénovation urbaine portées par le PNRU sont - comme celles liées à la cohésion sociale - rassemblées et ordonnées au sein des CUCS.
Il ressort de cette multiplicité de zonages et de mesures légales et contractuelles s'y appliquant un « enchevêtrement » de dispositifs se recoupant en grande partie, mais pas totalement, chacun ayant sa logique propre. La Cour des comptes, qui soulignait déjà de façon critique cette construction peu lisible dans son rapport de 2002, a réitéré ses remarques dans son dernier rapport sur la politique de la ville, en 2012 et regretté que l'absence d'harmonisation « affecte la lisibilité de la politique de la ville pour les acteurs de terrain ».
2. Un volet « rénovation urbaine » largement salué, mais restant à achever
Créé par la loi du 1 er août 2003 précitée, le programme national de rénovation urbaine (PNRU) avait pour objectif de restructurer profondément les quartiers urbains souffrant de dysfonctionnements majeurs. Fixant les principes et modes opératoires de ce programme essentiel pour la rénovation des banlieues, ce texte en a également délégué la mise en oeuvre à un organisme spécifique : l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
a) Une transformation des quartiers au bénéfice de ses habitants
Le volet « rénovation urbaine » de la politique de la ville, porté par l'ANRU, fait l'objet d'un bilan globalement favorable pour la décennie passée.
D'un point de vue quantitatif , environ 27 000 opérations ont ainsi été menées dans près de 600 quartiers sensibles, dans le cadre d'un programme doté de plus de 12 milliards d'euros de subventions publiques pour près de 45 milliards d'euros d'investissements.
Quatre types d'actions différentes peuvent être réalisées sur un financement ANRU, allant de la démolition des immeubles d'habitation les plus vétustes et de la reconstruction de nouveaux ensembles, à la modernisation de ceux existants. Ainsi, dans le cadre des conventions sous l'égide du PNRU, 144 692 logements ont été déconstruits, 140 842 ont été produits, 318 834 ont été réhabilités et 354 091 ont fait l'objet d'une « résidentialisation ».
La totalité de l'enveloppe allouée à l'ANRU au titre du PNRU était affectée aux conventions conclues avec les porteurs de projet locaux fin avril 2013. S'y sont rajoutés d'importants cofinancements provenant, pour les plus importants, des maîtres d'ouvrage (42,6 %), de villes et de leurs groupements (13,2 %), des régions (5,8 %) et des départements (4,1 %). Près de 60 % des livraisons programmées dans le cadre du programme ont à ce jour été livrées, tandis que plus des trois quarts des subventions sont désormais engagées et près de la moitié payée.
D'un point de vue plus qualitatif , le dernier rapport d'évaluation mené par l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus) 4 ( * ) détaille à la fois les succès et les limites du programme.
Au titre des premiers, il relève le « plébiscite » dont il a fait l'objet de la part des habitants des quartiers rénovés, et l'amélioration de leur image dans l'esprit des résidents. Les chantiers, très nombreux, ont remodelé le paysage urbain et le cadre de vie des usagers. Les conditions de logement se sont largement améliorées et ont été adaptées aux besoins des principaux intéressés, même si ces derniers ont préféré le neuf et se sont parfois montrés déçus de la réhabilitation.
Les quartiers ayant bénéficié du PNRU ont retrouvé de leur attrait. L'offre s'est étoffée et améliorée, tant sur les segments du neuf que de l'ancien, dans le logement intermédiaire comme dans le logement social, dans la location comme dans l'accession à la propriété. Si cette attractivité « n'est pas achevée », note l'Observatoire, le PNRU a toutefois eu pour effet de retourner une tendance que certains pensaient irréversible.
L'offre de services et d'équipements urbains s'est étoffée substantiellement, que ce soit à travers la réimplantation de commerces dans des espaces qui avaient été désertés, le maintien des services publics et l'appui aux établissements scolaires. Une véritable « trame urbaine », substrat indispensable à une vie de quartier digne de ce nom, s'est peu à peu reconstituée dans nombre d'endroits.
Le lien entre les quartiers et leur environnement urbain a été par ailleurs renforcé, en cherchant à désenclaver des zones autrefois isolées du reste de la ville. Les anciennes voiries internes des cités et, au-delà, les projets de transport en commun connectant les zones urbaines ont été soutenus, bien qu'ils ne relevaient pas du PNRU en tant que tels.
Le rapport ne fait pas l'impasse sur les échecs, ou tout au moins les limites du PNRU, que n'ont d'ailleurs pas manqué de relever les sociologues spécialisés dans les problématiques urbaines.
Au titre de ceux-ci, l'objectif de mixité sociale, introduit dans la politique de la ville par la loi du 1 er août 2003 précitée, a été contrarié par l'hostilité de certains résidents. Les démolitions et les relogements ont permis de répondre pour partie à cet objectif, mais sans dépasser le périmètre d'un immeuble ou d'une cité. Les ménages les plus en difficulté n'ont pas suffisamment été suivis dans la durée.
b) Un financement problématique du fait d'un désengagement de l'État
Le financement du PNRU, via l'ANRU, est marqué par un retrait progressif de l'État au profit d'autres co-financeurs, et notamment de l'Union d'économie sociale et du logement (UESL), qui gère la participation des employeurs à l'effort de construction (Peec). Cette dernière, créée en 1943 sous le nom de « 1 % logement », a pris le nom d'« Action logement » en 2009.
La loi du 1 er août 2003 précitée avait posé le principe d'un financement paritaire de l'ANRU par l'État et par le « 1% logement ». Cependant, l'État s'est depuis désengagé, notamment avec la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Le financement de l'ANRU est à présent quasi entièrement assuré par Action logement .
Ce retrait de l'État est particulièrement problématique car il survient à un moment où un « pic de paiement » est atteint, du fait d'une accélération des engagements contractés par l'Agence. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la « bosse de l'ANRU », dont rend compte le graphique ci-dessous.
PROGRAMMATION DES PAIEMENTS ANNUELS DE L'ANRU
SUR LA
PÉRIODE 2004-2020 (EN MILLIONS D'EUROS)
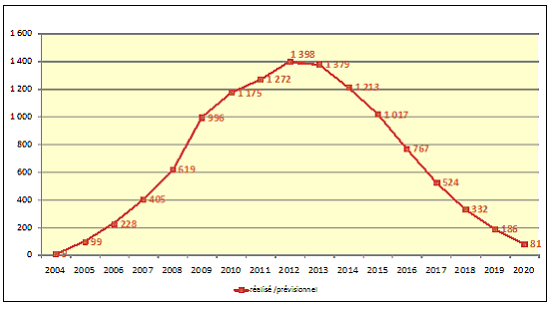
Source : Anru
Le recours à des « expédients » est désormais privilégié par l'État pour boucler les plans de financements. Le « plan de relance » du précédent gouvernement avait assuré un financement exceptionnel à hauteur de 350 millions d'euros pour les années 2009 et 2010, mais des difficultés de trésorerie sont réapparues dès 2011.
La loi de finances pour 2011 a cherché à y remédier en créant un fonds alimenté 5 ( * ) à hauteur de 340 millions d'euros chaque année, permettant à l'Agence de disposer de ressources suffisantes jusqu'en 2013. Mais, ainsi que le souligne un rapport sénatorial sur le projet de loi de finances pour 2012 6 ( * ) , « cette solution de financement n'est cependant que temporaire et de nouvelles difficultés devraient apparaître dès 2014, alors même que le Gouvernement prévoit le lancement d'un PNRU II ».
3. Une gouvernance insuffisante
L'absence de pilotage efficient de la politique de la ville constitue l'une des critiques les plus couramment émises à l'encontre de cette dernière. Les administrations nationales y ont conservé un rôle majeur, au détriment de leurs services déconcentrés. De la même façon, les communes ont conservé un rôle central alors que leurs groupements avaient été définis par la loi du 1 er août 2003 précitée comme l'échelon pertinent d'intervention au niveau local.
a) Un pilotage national altéré par des structures multiples et peu coordonnées
La gouvernance nationale de la politique de la ville a été marquée par une multiplication des acteurs, sans qu'une véritable coordination interministérielle permette d'en réguler l'action.
Jusqu'à 2003, elle était assurée par la Délégation interministérielle à la ville (DIV), sous l'autorité du Comité interministériel des villes (CIV) - constitué des ministres intéressés par la politique de la ville -, et en consultant le Conseil national des villes (CNV).
La loi du 1 er août 2003 précitée a modifié notablement cette architecture en créant l'ANRU et en lui confiant un rôle opérationnel essentiel. S'y est ajoutée, avec la loi du 31 mars 2006 précitée, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). La DIV s'est vu confier la tutelle de ces deux agences, avant d'être remplacée en 2009 par un secrétariat général du CIV.
La coordination de toutes ces structures, auxquelles viennent s'ajouter celles des services déconcentrés et des collectivités, exige un pilotage affirmé à l'échelle national. Or, selon les termes de la Cour des comptes, « celui-ci semble globalement insuffisant pour garantir la cohérence de l'effort engagé en faveur des quartiers ».
Au plus haut niveau, on compte en effet onze ministres ayant eu pour compétence la politique de la ville depuis 2002. Et ce n'est qu'en 2010 qu'a été créé un ministère de plein exercice pour ce portefeuille. Le CIV s'est réuni très épisodiquement, et sa capacité à s'imposer - ainsi que celle de son secrétariat général - s'est avérée assez faible. Quant aux deux agences, elles voient certaines de leurs interventions se recouper avec le SG-CIV, leurs attributions respectives n'ayant pas été suffisamment précisées.
Enfin, au niveau déconcentré, les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) sont restées des « acteurs mineurs », le relai de l'État n'y étant assuré que par les six préfets délégués à l'égalité des chances nommés en 2006 dans les départements les plus affectés par les problèmes urbains.
b) Une contractualisation insuffisante entre l'État et les collectivités territoriales
Le partenariat entre l'État et les collectivités dans la mise en oeuvre de la politique de la ville est au coeur de sa philosophie fondatrice . Les contrats signés entre ces deux catégories de personnes publiques visent à fédérer les acteurs autour d'approches communes. L'attachement profond de tous ces derniers à la démarche contractuelle est d'ailleurs ressorti clairement de la concertation nationale « Quartiers, engageons le changement ».
Le code général des collectivités territoriales, dans ses articles L. 5215-20 et L. 5216-5, pose le principe de la contractualisation, tandis que la loi du 1 er août 2003 précitée renvoie à des conventions pluriannuelles passées entre l'ANRU et les collectivités. L'instrument programmatique de rencontre de ces différentes institutions et de leurs interventions est le CUCS , élaboré à l'initiative des maires - ou des présidents de leurs groupements - et des préfets de département.
Sur le terrain, l' instrument contractuel n'a pas eu tous les effets escomptés . Créés pour coordonner les outils ressortant de la cohésion sociale et ceux portant sur la rénovation urbaine, ils n'ont pas réellement réussi à intégrer ces derniers, et se sont réduits à la gestion opérationnelle des crédits spécifiques de la politique de la ville.
En outre, et dans une approche plus institutionnelle, les CUCS n'auraient pas été en mesure de fédérer les acteurs locaux au même degré que les contrats de ville qu'ils avaient remplacés. Les conseils généraux et régionaux, notamment, n'en sont signataires que dans respectivement 34 % et 21 % des cas. Et ce bien qu'ils détiennent des compétences essentielles pour la mise en oeuvre de la politique de la ville, en matière sociale et économique.
c) L'intercommunalité, grande absente de la mise en oeuvre à l'échelon local
L'essence même de la politique de la ville la prédispose à s'appliquer à une échelle intercommunale : du fait tant de la transversalité des champs abordés que de leur extension géographique, elle ne peut être cloisonnée quartier par quartier, ni commune par commune. Aussi cette politique est-elle obligatoire pour deux des trois catégories d'EPCI : les communautés d'agglomérations et les communautés urbaines.
Pourtant, et alors qu'il avait été présenté comme le niveau le plus adapté de mise en oeuvre des CUCS, l' échelon intercommunal a été largement court-circuité . Selon la Cour des comptes, l'intercommunalité n'a « toujours pas trouvé sa place », ce qui in fine « entrave la coopération nécessaire entre collectivités d'un même bassin de vie ». Ainsi, seuls 40 % des CUCS associent des EPCI.
La première explication de cette absence remarquable tient, en négatif, à la sur-présence de l'échelon communal , qui n'a pas toujours « joué le jeu » de l'intercommunalité sur ces problématiques. « Il est difficile de dessaisir les villes centres de leurs moyens d'action en matière de politique de la ville en raison de leur poids, de leur rôle historique (...) et de la mise en place récente d'une intercommunalité intégrée », font valoir les hauts magistrats.
Dans la plupart des cas, l' intérêt communautaire se restreint à des domaines délimités . L'EPCI est certes signataire des projets de la politique de la ville l'intéressant, est associé aux structures de pilotage, mais ne reçoit pas délégation de la dotation de solidarité urbaine (DSU), que conserve la commune, et ne dispose pas des moyens humains suffisants. De sorte que malgré un intérêt souvent affiché pour ces dossiers, l'intercommunalité « gère fréquemment une coquille vide », souligne la Cour des comptes.
En outre, l'État n'a rien fait pour arranger ce déséquilibre, en privilégiant le dialogue avec les communes pour mettre en oeuvre la politique de rénovation urbaine. Bien que l'échelon intercommunal ait été mis en avant lors de la conception du PNRU, les dispositifs contractuels se sont positionnés sur le traitement de quartiers, sans aller jusqu'à prendre en compte les relations qu'ils entretenaient au-delà des frontières communales.
d) Une participation citoyenne encore largement anecdotique
La volonté d'instaurer une participation des habitants est une constante des discours et des lois portant sur la politique de la ville.
Force est pourtant de constater que les habitants ont souvent le sentiment de ne pas être réellement associés aux décisions qui concernent leur quartier et parfois leur habitat même. Le dernier rapport d'évaluation de l'Onzus sur le PNRU 7 ( * ) n'en fait pas mystère : « la participation des habitants est relevée comme un point faible ».
Pourtant, les structures de concertation, en théorie du moins, existent. Les maisons de quartier , gérées par des collectivités territoriales - municipalités, généralement - ou par des associations, peuvent mener des activités au profit des populations locales.
|
Créés par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, dite « loi Vaillant », les conseils de quartier , quant à eux, sont obligatoires dans les communes de plus de 80 000 habitants 8 ( * ) . Composés de personnalités représentatives des associations et des habitants, mais aussi d'élus municipaux, ils constituent des lieux d'information, de débats et de réflexions sur la vie de quartier et ses projets d'aménagement. À ce titre, ils peuvent être consultés par les municipalités pour les questions touchant à la politique de la ville, voire saisir ces dernières. |
Cependant, ces structures n'ont pas été pleinement sollicitées par les acteurs de la politique de la ville, tandis que les habitants des quartiers s'en sont souvent désintéressés.
L'Onzus commence ainsi par reconnaître la bonne volonté en la matière des collectivités et des bailleurs, avant de souligner son aspect très formel . La concertation a, le plus souvent, consisté pour les maitres d'ouvrage à présenter unilatéralement leurs projets une fois élaborés, et à recueillir les observations des habitants. Elle n'est pas allée jusqu'à réfléchir de façon approfondie et continue à leur définition, ni - encore moins - aux moyens d'atteindre les objectifs de cohésion les sous-tendant.
Pour la Cour des comptes, ce sont des « opérations de communication » qui ont pris le pas sur des démarches véritables de concertation. Les hauts magistrats citent la « crise de l'offre de participation » et le « manque de reconnaissance de l'expression citoyenne » également pointés par un rapport du Conseil national des villes sur la démocratie locale et la participation des habitants 9 ( * ) .
D'une façon plus globale, l' affaiblissement des corps intermédiaires , lieux d'apprentissage de la démocratie et du faire-ensemble, voire du vivre-ensemble, a pesé de façon négative dans l'investissement des populations. Ces relais naturels, et quasi quotidiens, de l'expression locale, n'ont plus joué le rôle central qui a longtemps été le leur dans les quartiers populaires. L'anonymat et l'individualisme y sont devenus la norme, cassant le lien qui reliait leurs habitants à l'ensemble des autres acteurs, publics et privés.
Il ne s'agit pas de remettre en cause la volonté, souvent sincère, des élus et des professionnels de laisser toute sa place à la parole des habitants, mais ils font face à des contraintes techniques et juridiques complexes. De plus, comme certains l'ont fait remarquer à votre rapporteur, ils constatent parfois que les procédures de concertation sont monopolisées par un petit nombre d'intervenants , au lieu d'amener à une véritable expression des besoins et des souhaits de la majorité des habitants.
|
Pour prendre l'exemple d'un projet de renouvellement urbain, il peut paraître difficile, en raison de la complexité des procédures de financement, d'impliquer la population dès le début : on peut craindre de faire naître des espoirs qui risqueront d'être déçus par la suite si les financements ne sont pas accordés. Mais si la concertation se limite à l'organisation de quelques réunions d'information une fois le projet approuvé par le comité national d'engagement de l'ANRU, les habitants peuvent avec quelques raisons anticiper que leur voix ne portera guère : les options laissées à leur appréciation devront s'inscrire dans des choix techniques et financiers déjà négociés et difficiles à infléchir. La concertation ne cherche alors, en pratique, qu'à rendre les projets le plus acceptables possible de sorte que, bien souvent, la participation dépasse rarement le stade de l'information ou de la consultation en France 10 ( * ) . |
Il existe pourtant d'autres moyens, connus notamment dans des pays anglo-saxons, pour parvenir à une participation plus active de la population. Ces pays réfléchissent à - et expérimentent - une « démocratie participative » ou « organisation communautaire » 11 ( * ) réunissant les personnes vivant dans un même quartier.
Ces procédures sont souvent vues en France, à tort, comme l'expression d'un « communautarisme » dérogeant à l'universalité des règles de la République. Il s'agit au contraire d'atteindre les individus eux-mêmes pour leur permettre d'exprimer leurs besoins avant la prise de décision.
Elles sont aussi perçues comme une source de délégitimation des élus locaux, que le suffrage universel a investis d'une mission de représentation des citoyens. Votre rapporteur souligne au contraire qu'une participation bien conçue, en rapprochant les autorités locales des préoccupations de la population, renforce la légitimité des décisions publiques prises par la suite.
Les habitants et les personnes qui travaillent quotidiennement dans les quartiers ont, par leur expérience, une connaissance des problèmes que ne peuvent avoir les experts extérieurs : la maîtrise technique de ces derniers doit pouvoir s'enrichir des solutions pratiques et concrètes qu'imaginent les habitants, de manière à renforcer l'efficacité des projets.
Cela n'est toutefois possible, selon votre rapporteur, que si la participation associe les habitants ou les autres acteurs implantés localement (associations, acteurs économiques) dès la phase de conception des projets.
4. Un volet économique négligé
La question du chômage est particulièrement prégnante dans les ZUS, où le taux d'inactivité est en moyenne le double de celui du reste du territoire. Or, la situation ne s'est pas améliorée ces dernières années, les jeunes étant particulièrement touchés. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport de 2012 précité sur la politique de la ville, les acteurs de la politique de l'emploi se sont « insuffisamment tournés vers les publics des quartiers prioritaires », et les publics y résidant n'ont pas été considérés comme prioritaires.
Les clauses d'insertion sont censées constituer un instrument privilégié de la dynamisation économique et du retour à l'emploi dans les quartiers concernés par la politique de la ville. La loi du 1 er août 2003 précitée précise en effet que les investissements réalisés dans le cadre du PNRU doivent concourir à l'insertion professionnelle des habitants des ZUS.
Une charte nationale d'insertion, venue intégrer cette exigence dans le programme, s'impose au porteur de projet et à l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Constituant une des contreparties aux apports financiers de l'ANRU, elle impose la signature d'un plan local d'application fixant un objectif minimum de 5 % du nombre total d'heures travaillées dans le cadre des investissements financés par l'ANRU et de 10 % des embauches effectuées. Pour parvenir à ces objectifs, peuvent être introduits dans les marchés publics des « clauses sociales » garantissant la prise en compte de l'impératif d'insertion.
Si le cadre posé par le législateur pour favoriser l'activité professionnelle dans les zones urbaines défavorisées est bien structuré, il n'a pas pour autant permis d'inscrire l'effort d'insertion dans la durée. Certes, selon le rapport d'évaluation précité de l'Onzus sur le PNRU, les clauses d'insertion ont été un moyen d'intéresser l'ensemble de la population des ZUS aux chantiers entrepris. Elles ont été respectées, et même dépassées, 16,6 millions d'heures d'insertion ayant été réalisées. Mais, relève l'Observatoire, ont manqué les relais nécessaires pour que cette remise en selle « permette une insertion durable ».
Le Comité interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé l'expérimentation pour une durée de trois ans d'un dispositif dit d'« emplois francs » censé pallier ces problèmes d'inactivité et de sous-emploi dans ces secteurs urbains. Il vise à faciliter l'embauche en CDI de jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient ou non qualifiés, dès lors qu'ils vivent dans un quartier situé en ZUS et font état d'une durée de recherche d'emploi d'au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois. Ainsi, une aide de 5 000 euros est versée aux employeurs embauchant ce type de salarié.
Le Gouvernement a entendu faire de ce dispositif un axe important de son action territorialisée pour l'emploi, en portant le nombre de sites éligibles de 10 à l'origine, à 43 dès le mois d'octobre dernier, tous figurant dans la future géographie prioritaire de la politique de la ville. Il a prévu de financer 5 000 de ces contrats en 2013 et 10 000 sur trois ans.
5. Une évaluation partielle et perfectible
Le principe général d'évaluation de la politique de la ville a constamment été affirmé comme essentiel à son succès. Des anciens contrats de ville aux CUCS actuels, l'approche contractuelle a toujours pris garde à définir des objectifs détaillées, et à y associer des indicateurs précisément définis.
Pourtant, dès le début des années 2000, les carences en ce domaine sont déjà soulignées par plusieurs travaux, et notamment par le rapport de la Cour des comptes de 2002 précité. Au-delà des principes généraux ayant présidé à leur élaboration, les CUCS n'ont pas intégré les objectifs et indicateurs qui en auraient permis un suivi fin et actualisé. L'évaluation de ces instruments centraux de la politique de la ville s'est rapidement restreinte à la vérification formelle de la publication des circulaires de mise en oeuvre.
L'État n'a pas su imposer de méthodes d'évaluation normées, qui auraient été reprises par les collectivités et auraient permis de consolider l'ensemble des études réalisées. Dès lors, une pluralité de démarches de suivi ont été menées en parallèle au niveau central, sans lien avec celles réalisées sur le terrain par les collectivités, les initiatives « se multipliant sans systématiquement se rejoindre », selon la Cour des comptes.
La création de l'Onzus , par la loi du 1 er août 2003 précitée, a constitué une inflexion appréciable dans l'évaluation de la politique de la ville. Selon la haute juridiction financière, elle a marqué « un progrès majeur, objectivant la situation des habitants des quartiers sensibles ». Le travail réalisé par cet observatoire a été unanimement salué pour sa qualité et sa précision, et a permis d'apprécier l'évolution de la situation des ZUS au regard des objectifs qui avaient été fixés dans la loi du 1 er août 2003.
Cependant, les analyses réalisées par l'Onzus ne sont pas encore de nature à satisfaire l'exigence de suivi que requiert une politique aussi complexe que celle de la ville. En effet, elles ne permettent de renseigner qu'une minorité - 32 sur 71 - des indicateurs généraux définis dans l'annexe de la loi du 1 er août 2003.
En outre, la mise en place d'une autre d'instance d'évaluation, le comité d'évaluation et de suivi (CES) de l'ANRU , en 2004, est venu compliquer le paysage de l'évaluation. Les deux institutions ont en effet travaillé de façon relativement isolée, selon des approches différentes mais sur des thématiques se recoupant largement.
Le fait d'avoir confié à l'Onzus, en 2011, un rôle de coordination de l'ensemble des travaux concernant la politique de la ville, a constitué un progrès notable. Il n'en reste pas moins que la rationalisation des structures réalisant ces travaux doit être poussée plus avant pour mettre à disposition des décideurs les tableaux de bord synthétiques indispensables au pilotage d'une telle politique.
* 3 En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 1 er août 2003 précitée.
* 4 Dix ans de Programme national de rénovation urbaine : bilan et perspectives, rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, mars 2013.
* 5 Par, d'une part, une fraction de la part variable de la cotisation additionnelle versée par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), ainsi que par une contribution sur le potentiel financier des bailleurs estimée à 175 millions, et d'autre part, une fraction du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, prévue pour financer le Grand Paris.
* 6 Ville et logement, rapport pour avis n° 109 (2011-2012) de M. Luc Carvounas, fait au nom de la commission des affaires sociales.
* 7 Voir supra .
* 8 Et facultatifs dans celles entre 20 000 et 80 000 habitants.
* 9 La démocratie locale et la participation des habitants , rapport du Conseil national des villes, janvier 2012.
* 10 Pour mémoire, la sociologue américaine Sherry R. Arnstein a identifié dans la pratique huit niveaux de participation, regroupés en trois catégories : « non-participation » (manipulation, « thérapie »), « participation symbolique » (information, consultation, décision tenant compte de l'avis des citoyens), « pouvoir citoyen » (partenariat, délégation de pouvoir, contrôle citoyen).
* 11 Le terme « démocratie participative » aurait été introduit par le philosophe américain Arnold Kaufman (Human Nature and Participatory Democracy, 1960), mais les pratiques de « community organizing » étaient expérimentées dès les années 1940 par Saul Alinsky à Chicago, où l'actuel président des États-Unis Barack Obama a lui-même été un « community organizer ».







