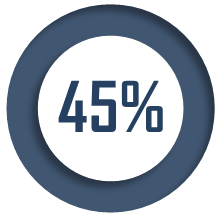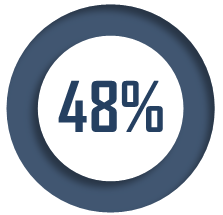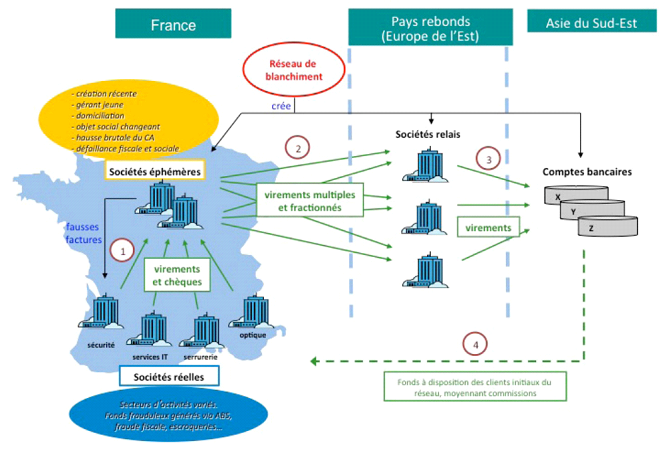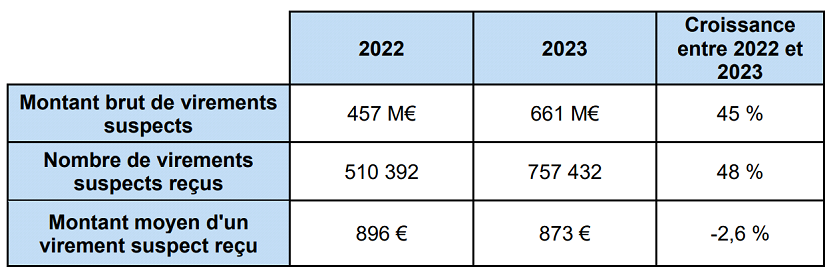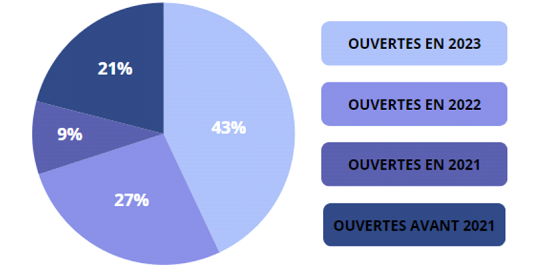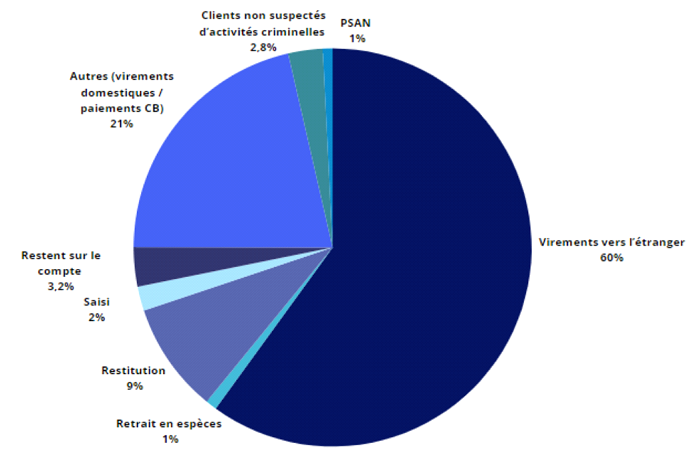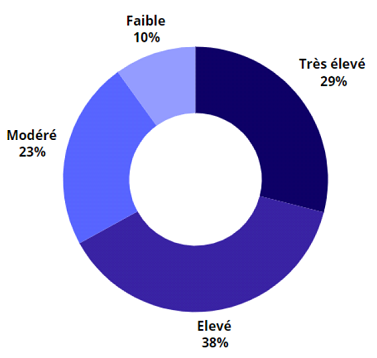- L'ESSENTIEL
- TITRE PREMIER
LUTTER CONTRE LES ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES
- TITRE II
RENDRE SYSTÉMATIQUE LA VÉRIFICATION
DE L'ORIGINE DES FONDS
AVANT LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE
- TITRE III
OBLIGATION POUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE DÉCLARER À L'ADMINISTRATION FISCALE
LEURS COMPTES BANCAIRES À L'ÉTRANGER
- TITRE IV
DISPOSITIF DE VIGILANCE RENFORCÉE
SUR LES COMPTES REBONDS
ET SUR LE CONTRÔLE DES NÉOBANQUES
- ARTICLE 5
Définition du compte rebond et obligation de mise en oeuvre de mesures de vigilance renforcées et de déclaration en cas de soupçon
- ARTICLE 6
Création d'un registre national des comptes rebonds
- ARTICLE 7
Définition législative du terme de néobanque et obligation pour ces dernières de faire l'objet d'un audit externe annuel
- ARTICLE 5
- TITRE V
RENFORCER LE RÔLE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 94
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur la
proposition de loi pour la
sécurisation
juridique des structures
économiques face aux
risques de
blanchiment,
Par M. Stéphane SAUTAREL,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
877 (2024-2025), 86 et 95 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Les travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales1(*), qui s'est achevée en juin 2025, ont permis de mettre en évidence la montée en puissance des réseaux de blanchiment en France. Le rapport estime que le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés dans le blanchiment atteint entre 12 et 20 milliards d'euros.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la proposition de loi n° 877 (2024-2025) pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, déposée précisément par Mme Nathalie Goulet et M. Raphaël Daubet le 19 août 2025, respectivement rapporteur et président de cette commission d'enquête.
La commission des finances, réunie le 29 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, a examiné le rapport de M. Stéphane Sautarel sur les articles 1er et 4 à 7 de la proposition de loi, l'examen des articles 2, 3, 8 et 9 ayant été délégué à la commission des lois.
Une double exigence a guidé la commission dans ses travaux. La première, s'assurer du caractère opérationnel des dispositifs proposés, notamment par la prise en compte des besoins des services d'enquête et de contrôle. La seconde, préserver un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de favoriser résolument l'action des services contre le blanchiment et, d'autre part, l'importance de ne pas alourdir de façon disproportionnée les obligations qui s'imposent aux acteurs économiques.
Les 5 amendements du rapporteur adoptés par la commission répondent à ces objectifs :
- l'amendement COM-8 du rapporteur à l'article 1er revient, à la demande des services auditionnés et engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), sur le projet de définition de société éphémère au niveau de la loi ;
- l'amendement COM-9 du rapporteur à l'article 2 procède à quelques ajustements et prévoit une entrée en vigueur différée pour l'obligation faite aux sociétés commerciales de déclarer leurs comptes bancaires à l'étranger ;
- l'amendement COM-10 du rapporteur à l'article 5, notamment pour faciliter la détection de comptes rebonds, oblige les organismes financiers à définir des opérations nécessitant le contrôle d'un agent qualifié et effectue une coordination ;
- l'amendement COM-11 du rapporteur supprime l'article 6 car il s'avère satisfait par l'article 1er de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire en cours d'adoption ;
- l'amendement COM-12 du rapporteur à l'article 7 renforce les pouvoirs de contrôle de l'ACPR en lui octroyant la possibilité d'imposer un audit externe à une entité défaillante, en vue notamment de mieux réguler les néobanques, et effectue une coordination.
I. LES RÉCENTS TRAVAUX DU SÉNAT PERMETTENT DE PRENDRE LA MESURE DE L'AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE DU BLANCHIMENT
La commission d'enquête précitée sur la délinquance financière2(*), mais aussi celle sur le narcotrafic3(*), ont mis en évidence la prégnance du phénomène du blanchiment dans la société française. Prenant diverses formes, les mécanismes de blanchiment tendent à briser les liens de confiance dans la sphère économique, en plus de permettre à des criminels de s'enrichir.
A. UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME ET DIFFICILE À APPRÉHENDER
Le Sénat a oeuvré à mettre en avant la diversité des phénomènes de blanchiment : consommation en argent liquide, rachat de tickets de loterie gagnants, travail dissimulé... L'interpénétration entre l'économie légale et l'économie du blanchiment constitue le mécanisme le plus néfaste à long terme.
Le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés dans le blanchiment atteint entre 12 et 20 milliards d'euros chaque année.
Cependant, la plus grande difficulté constitue à appréhender la réalité d'un phénomène qui cherche, par nature, à rester dissimulé. Ainsi, les entreprises n'ayant pas d'activité réelle mais servant uniquement à émettre de fausses factures ne peuvent souvent être découvertes qu'a posteriori. La fragmentation des flux de capitaux empêche, de même, de remonter la piste vers les criminels.
B. LA SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) VA DE PAIR AVEC LE RENFORCEMENT DE CES PHÉNOMÈNES
L'ensemble des services de contrôle et d'enquête, en France, tendent à être de plus en plus sensibilisés à la menace que représente le blanchiment et le financement du terrorisme. La création, en 20204(*), de la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF), en est un exemple : il est aujourd'hui nécessaire d'accroître la coordination entre les différents acteurs de la LCB-FT.
La coordination entre les services de contrôle et d'enquête et la création de synergies est aujourd'hui l'axe de progression prioritaire selon ces derniers.
L'accroissement du nombre de déclarations de soupçons auprès du service de renseignement financier Tracfin est frappant : la prise de conscience est aujourd'hui réelle et elle accompagne la montée en puissance des réseaux de blanchiment.
Nombre de déclarations de soupçons à Tracfin entre 2021 et 2024
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
160 952 |
162 708 |
175 031 |
211 165 |
|
+ 44 % |
+ 1 % |
+ 7 % |
+ 15 % |
Source : Rapports annuels de Tracfin 2021 à 2024
II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : DES OBJECTIFS PARTAGÉS QUI DOIVENT ÊTRE MIS AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
A. LA LUTTE CONTRE LES SOCIÉTÉS ÉPHÉMÈRES SE DÉPLOIE AVEC PLUS D'EFFICACITÉ DANS UN CADRE INFORMEL
L'article 1er de la proposition de loi propose une série de critères permettant de définir la notion de société éphémère et de permettre aux entités assujetties d'effectuer une déclaration à Tracfin lorsqu'il existe des soupçons d'existence d'une telle entreprise.
Les travaux du rapporteur l'ont mené à constater que le droit existant prévoit déjà la possibilité d'effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin lors de la détection ou de la présomption de détection d'une entreprise éphémère.
Par ailleurs, l'ensemble des services d'enquête et de contrôle auditionnés ont précisé que la définition des sociétés éphémères était aujourd'hui partagée, notamment dans un « Guide des sociétés éphémères » édité et diffusé par la MICAF. Ces structures sont aujourd'hui déjà ciblées et Tracfin a indiqué qu'il y avait lieu de parler de succès opérationnel. Cette pratique évolutive ne nécessite pas de définition légale, laquelle pourrait même s'avérer contreproductive car trop peu évolutive dans le temps.
|
Entre 2023 et 2025, Tracfin a détecté |
ces détections ont permis de geler |
|
sociétés éphémères |
qui ont été saisis par la justice |
Par conséquent, la commission a adopté l'amendement COM-8 du rapporteur qui revient, à la demande des services auditionnés et engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), sur le projet de définition de société éphémère.
B. LA DÉCLARATION DES COMPTES À L'ÉTRANGER POUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DOIT ÊTRE EXPERTISÉE
L'article 4 de la proposition de loi prévoit d'obliger les sociétés commerciales à déclarer les références des comptes ouverts, détenus ou clos à l'étranger à l'administration fiscale. En ce sens, il met au même niveau les obligations incombant aux sociétés commerciales avec celles qui incombent déjà aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France.
Cette disposition pourrait faciliter le travail des services du contrôle fiscal, mais doit aussi être expertisée plus avant, au regard notamment de son incidence potentielle sur l'attractivité de la France.
La commission a adopté l'amendement COM-9 du rapporteur à l'article 2. Il maintient, dans l'attente d'une expertise plus poussée, l'obligation pour les sociétés commerciales de déclarer leurs comptes bancaires à l'étranger, en procédant à quelques ajustements et en lui assortissant un délai d'entrée en vigueur.
C. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT PASSE PAR UN MEILLEUR CONTRÔLE DES VIREMENTS ET UNE MEILLEURE DÉTECTION DES COMPTES REBONDS
Les articles 5 et 6 de la proposition de loi visent à renforcer les moyens mis à la disposition des organismes financiers pour lutter contre l'utilisation de leurs produits et services comme « comptes rebonds », c'est-à-dire des comptes de transit rapide du produit de la fraude permettant d'en dissimuler l'origine ou les bénéficiaires.
Ainsi, l'article 5 donne une définition légale du compte rebond et impose aux organismes financiers de nouvelles obligations en cas de soupçon d'utilisation d'un compte bancaire ou de paiement comme compte rebond ; l'article 6, prévoit la création d'un registre national des comptes rebonds, géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Or, le droit en vigueur contraint déjà les organismes financiers à mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées. En outre, l'article 1er de la proposition de loi n° 496 (2024-2025) visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, dont l'adoption conforme est proposée par la commission des finances au Sénat ce 29 octobre, prévoit déjà la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude.
|
Le montant brut de virements suspects est en croissance de |
Le nombre de virements suspects reçus a augmenté de |
|
entre 2022 et 2023. |
entre 2022 et 2023. |
Par conséquent, la commission a adopté deux amendements : l'amendement COM-10 du rapporteur à l'article 5 oblige les organismes financiers à définir des opérations nécessitant le contrôle d'un agent qualifié, notamment pour identifier les comptes rebonds, et effectue une coordination ; l'amendement COM-11 du rapporteur à l'article 6 prend en compte l'adoption en cours de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire et supprime l'article car ce dernier devrait être satisfait.
D. RENFORCER LE CONTRÔLE SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES DÉFAILLANTS DANS LEURS OBLIGATIONS LCB-FT
L'article 7, enfin, prévoit la définition du terme de néobanque, entendu comme une banque dont l'activité est exercée exclusivement en ligne sans point de contact physique, et dont les procédures d'entrée en relation sont entièrement automatisées. Il propose d'astreindre ces néobanques ainsi définies à effectuer un audit externe annuel relatif à la conformité de leurs dispositifs LCB-FT.
Les travaux menés par le rapporteur indiquent que la typologie actuelle qui permet de définir les différents établissements bancaires apparaît cohérente. En revanche, les échanges entre le rapporteur et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) montrent qu'il pourrait être effectivement pertinent de donner la possibilité à l'ACPR d'exiger qu'un établissement sous sa supervision effectue un audit externe en cas de défaillance repérée.
Tel est l'objet de l'amendement COM-12 du rapporteur adopté par la commission à l'article 7. Il permettra notamment de renforcer le contrôle de l'ACPR sur les néobanques.
La commission a adopté la proposition de loi modifiée par les amendements.
TITRE PREMIER
LUTTER CONTRE LES ENTREPRISES
ÉPHÉMÈRES
ARTICLE
1er
Obligation d'effectuer une déclaration de soupçon
à Tracfin lorsqu'une société présente les
caractéristiques d'une société
éphémère
Le présent article prévoit de proposer une série de critères permettant de définir la notion de société éphémère et d'obliger les entités assujetties à effectuer une déclaration à Tracfin lorsqu'il existe des soupçons d'existence d'une telle entreprise.
D'une part, l'article impose aux personnes soumises aux obligations de déclaration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) d'effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin lors de la détection ou de la présomption de détection d'une entreprise éphémère.
D'autre part, il propose une liste d'indices qui permettent de définir les caractéristiques que pourraient avoir ces sociétés éphémères. Cette liste n'est pas exhaustive et ne constitue qu'une série de critères indicatifs.
Cet article soulève plusieurs difficultés de fond.
D'une part, il est largement satisfait par le droit existant, puisque les entités ciblées par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont déjà tenues, en l'état du droit, de déclarer à Tracfin les soupçons qu'elles ont lorsqu'elles repèrent une société éphémère.
D'autre part, la définition d'une telle société est d'ores et déjà partagée par l'ensemble des services mobilisés dans le cadre de la LCB-FT et s'avère évolutive pour s'adapter à la nature changeante des pratiques criminelles. L'inscription dans la loi de critères de définition, même non exhaustifs, ne semble pas opportun d'un point de vue opérationnel. Par ailleurs, dès lors que la série de critères retenus n'est qu'indicative, elle n'emporte pas de force normative et il est permis de s'interroger sur la portée normative de l'article.
Compte tenu de l'ensemble de ces limites, la commission a supprimé cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : LE LÉGISLATEUR N'A PAS ENTENDU DÉFINIR LA NOTION DE SOCIÉTÉ ÉPHÉMÈRE, CE QUI N'EMPÊCHE PAS DE LES CIBLER DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
A. LA LOI NE DÉFINIT PAS LES SOCIÉTÉS ÉPHÉMÈRES, CE QUI N'EMPÊCHE PAS L'ACTION DES SERVICES POUR LES VISER ET LES REPÉRER
1. Le ciblage des sociétés éphémères constitue une nécessité stratégique pour les services de lutte contre le blanchiment
Lors de son audition par la commission d'enquête sur la délinquance financière5(*) le 13 mars 2025, Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, définissait les sociétés éphémères comme « des entités juridiques qui, sous couvert d'un objet social licite et d'une activité économique réelle ou fictive, poursuivent des objectifs frauduleux dont la réalisation repose sur leur brève durée d'existence et sur des manoeuvres destinées à tromper la vigilance des administrations et des services publics ».
Ces entreprises ou structures juridiques sont utilisées de façon très courante dans les schémas de blanchiment, en ce qu'elles permettent d'émettre et de recevoir des factures qui donnent à de l'argent sale une crédibilité renouvelée.
Le service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) explique combien ces sociétés sont utilisées de façon récurrente et souvent en réseau. Selon ce service, les réseaux de sociétés éphémères sont habituellement constitués de plusieurs niveaux6(*) :
- au niveau 1, en amont de la chaîne, se trouvent les sociétés clientes disposant de capitaux à blanchir ;
- au niveau 2, plusieurs sociétés installées en France ayant ouvert des comptes bancaires sur le territoire national encaissent les capitaux ;
- au niveau 3, un second étage dit « relais » ou « rebond » est constitué de sociétés immatriculées dans des pays européens, le plus souvent en Europe de l'Est. Ces sociétés détiennent des comptes bancaires dans leur pays d'immatriculation et plusieurs pays voisins. Elles récupèrent les capitaux du niveau 2 afin de réduire la traçabilité des fonds ;
- enfin, au niveau 4, les capitaux blanchis peuvent enfin être dirigés vers les destinataires finaux ou des zones géographiques plus éloignées.
Ces sociétés, qui ont souvent une durée de vie courte, de six à dix-huit mois selon Tracfin7(*), sont identifiées par les services de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) grâce à des analyses multicritères.
En général, il s'agit de sociétés « sans activité économique réelle, avec des dirigeants de paille et disposant de comptes bancaires 8(*)». Ces entités sont en outre très souvent défaillantes dans le respect de leurs obligations fiscales et sociales.
Le ciblage de ces structures est donc, aujourd'hui, une priorité pour les services d'enquêtes.
2. L'existence d'une définition des sociétés éphémères à un niveau infra-législatif permet aux services de s'adapter aux évolutions des pratiques criminelles
La loi ne définit pas les sociétés éphémères, appelées aussi « lessiveuses » par les services de LCB-FT.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de définition partagée par l'ensemble des acteurs concernés par cette lutte. En effet, la Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF) oeuvre depuis sa création, le 15 juillet 20209(*), à animer et harmoniser la lutte contre la fraude aux finances publiques.
Ce service, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget par délégation du Premier ministre, coordonne des administrations et organismes publics et favorise le décloisonnement des approches par le partage d'informations et d'analyses, l'établissement de cartographies communes des risques, l'élaboration des stratégies d'action et d'enquête coordonnées.
Son rôle est ainsi de combattre les fraudes complexes et organisées en favorisant une meilleure articulation des actions administratives et judiciaires.
Les services auditionnés par le rapporteur ont ainsi indiqué que la MICAF a publié et diffusé, auprès des services partenaires, un guide des sociétés éphémères qui recense un certain nombre d'indices qui permettent de soupçonner l'existence de structures de ce type.
Ces indices sont notamment les suivants : durée de vie courte, le recours à une société de domiciliation, l'absence d'activité physique, une structure sociale incohérente, le recours au service de banques en ligne peu regardantes sur les obligations LCB-FT, entre autres.
La diffusion d'une culture de vigilance pour les sociétés éphémères est donc une priorité pour les services.
Le cadre légal actuel, enfin, permet à Tracfin, en lien avec les professions déclarantes, d'ajuster les capteurs en fonction de l'évolution du risque. En effet, en vertu de l'article L. 561-26 du code monétaire et financier, Tracfin peut désigner :
- les opérations qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées ;
- des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Dans ce cadre légal, la sensibilisation des professions déclarantes au repérage et à la déclaration des soupçons devant une potentielle entreprise éphémère est déjà effective.
B. L'OBLIGATION POUR LES ENTITÉS ASSUJETTIES D'EFFECTUER UNE DÉCLARATION DE SOUPÇON LORSQU'ELLES REPÈRENT UNE SOCIÉTÉ ÉPHÉMÈRE
De façon plus générale, comme l'indique la direction générale du Trésor dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, « le volet préventif du dispositif français de LBC-FT constitue une chaîne mobilisée pour détecter les indices et transmettre le cas échéant une déclaration de soupçon à Tracfin ».
Les professions assujetties, listées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont tenues, en vertu de l'article L. 561-15 du même code, de procéder à une déclaration de soupçon auprès de Tracfin lorsqu'elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une somme ou une opération sur des sommes dont elles ont connaissance pourrait provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou est liée au financement du terrorisme.
Pour les entreprises éphémères, plus spécifiquement, la chaîne d'analyse et de repérage est déjà robuste, comme l'indique la DGT dans ses réponses aux questionnaires :
- les greffiers des tribunaux de commerce10(*) procèdent à des contrôles au moment de l'immatriculation des sociétés et exercent leur vigilance tout au long de la vie des sociétés ;
- les entités assujetties comme, entre autres, les établissements bancaires, les sociétés de domiciliation, les notaires ou encore les avocats détectent certains signaux portant à soupçonner qu'une entreprise pourrait être éphémère11(*). Elles transmettent dans ce cas une déclaration de soupçon à Tracfin.
Si la détection des entreprises éphémères est perfectible, des efforts de sensibilisation notables sont déployés auprès des assujettis pour attirer leur vigilance sur ces schémas de blanchiment et faire connaître à chacun les indices qu'il est en capacité de détecter, selon la direction générale du Trésor.
La DG Trésor rappelle, enfin, que la récente loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic12(*) a permis des avancées notables dans la détection des sociétés éphémères. En effet, son article 4 permet aux greffiers des tribunaux de commerce d'avoir accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) pour vérifier l'existence d'un compte déclaré par une société. Or, les sociétés éphémères sont souvent créées sur la base de fausses attestations de dépôt de fonds : cette vérification permet d'accélérer l'identification des sociétés visées.
La même loi crée au même article 4 un mécanisme de radiation d'office des sociétés non conformes aux obligations de transparence des bénéficiaires effectifs, ce qui donne aux greffiers la possibilité de suspendre la personnalité morale de sociétés éphémères.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : PRÉVOIR DANS LA LOI UNE DÉFINITION DES ENTREPRISES ÉPHÉMÈRES ET UNE OBLIGATION DE DÉCLARATION DE SOUPÇON DANS LE CAS DU REPÉRAGE D'UNE TELLE SOCIÉTÉ
A. L'INSCRIPTION DANS LA LOI DE CERTAINS INDICES PERMETTANT D'IDENTIFIER UNE SOCIÉTÉ ÉPHÉMÈRE
Le texte proposé ajoute un article au code monétaire et financier, après l'article L. 561-15-1. Il propose ainsi d'inscrire dans la loi certains des indices qui permettent de définir et de repérer une société éphémère. Ainsi, selon le droit proposé, une entreprise éphémère serait définie comme répondant à « plusieurs des caractéristiques suivantes » :
- une durée de vie prévisible ou observée inférieure à douze mois ;
- une cessation d'activité ou une dissolution anticipée sans justificatif économique ;
- une domiciliation commerciale sans activité physique ;
- l'usage d'un établissement de paiement ou d'une banque en ligne ne disposant pas d'un agrément européen ;
- un siège social situé hors de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- une structure sociale atypique dès la constitution, caractérisée par la présence de plus de dix associés ou salariés dès le premier mois, ou de plus de vingt dès le deuxième mois ;
- un lien direct ou indirect avec une série de sociétés créées ou dissoutes par une même personne physique ou morale.
L'ensemble de ces indices sont, selon le texte, cumulatifs, pour repérer une entreprise éphémère, sans pour autant qu'il faille remplir un nombre précis de critères pour qu'une entreprise soit, selon la loi, déclarée comme entreprise éphémère.
B. L'OBLIGATION D'UNE DÉCLARATION DE SOUPÇON EN CAS DE DÉTECTION OU DE PRÉSOMPTION DE DÉTECTION D'UNE ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE
L'article L. 561-15-2 du code monétaire et financier que crée l'article 1er de la proposition de loi prévoit, en outre, que l'ensemble des personnes assujetties aux obligations déclaratives13(*) dans le cadre LCB-FT doivent effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin14(*) lorsqu'elles repèrent ou soupçonnent l'existence d'une société éphémère.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : SUPPRIMER L'ARTICLE DÉJÀ SATISFAIT PAR LE DROIT EXISTANT
A. S'IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER D'UNE DÉFINITION DE L'ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE, SON INSCRIPTION DANS LA LOI RISQUERAIT D'ÊTRE CONTRE-PRODUCTIVE
1. La fixation dans la loi de critères serait inefficace voire préjudiciable à la lutte contre le blanchiment
Les services du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique auditionnés par le rapporteur ont indiqué, unanimement, qu'il était nécessaire que les critères permettant de cibler les entreprises éphémères ne soient pas inscrits dans la loi.
En effet, comme l'indique la direction générale du Trésor, « l'approche prise dans cette proposition de loi consistant à ancrer dans la loi des pratiques criminelles observées aujourd'hui » risque « d'attirer l'attention des opérateurs privés ».
Toujours selon ce service, les pratiques décrites dans le texte proposé « évoluent de manière continue », ce qui fait courir le risque à la loi de « devenir obsolète très rapidement ».
La MICAF, dans la même veine, indique qu'il est préférable que les différents critères de vigilance pour les potentielles sociétés éphémères demeurent énoncés au niveau du guides des sociétés éphémères et non dans la loi. Ainsi, selon Éric Belfayol15(*), définir les sociétés éphémères dans la loi « n'apporte pas d'élément supérieur ».
La DG Trésor mentionne pour sa part qu'il est préférable de continuer d'utiliser les canaux existants pour alerter les acteurs privés quant aux risques : documents publics d'analyse des risques, appels à vigilance de Tracfin ou encore sessions de sensibilisation.
Les représentants de Tracfin eux-mêmes, au cours de leur audition, ont indiqué le « caractère contreproductif d'afficher dans la loi les critères de détection des pratiques criminelles », au risque de réduire l'efficacité opérationnelle du dispositif LCB-FT.
De l'ensemble des personnes entendues, seul le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) s'est montré favorable à l'inscription dans la loi de ces critères.
La réponse écrite au questionnaire du rapporteur, néanmoins, indique que le CNGTC partage les mêmes craintes que les services administratifs sur le risque d'immobilisme des critères si la définition était inscrite dans la loi : « afin de préserver la souplesse du dispositif, certaines de ces notions pourraient également être intégrées par décret. Cette approche permettrait d'en adapter le contenu à l'évolution rapide des pratiques économiques et technologiques, sans nécessiter une révision législative16(*) ».
Il ne paraît dès lors pas opportun d'inscrire dans la loi des critères de définition des entreprises éphémères.
2. Même en l'absence de définition législative, des résultats tangibles dans la détection et la neutralisation des sociétés éphémères
Selon Tracfin, de septembre 2023 à septembre 2025, 676 sociétés éphémères ont été ciblées avec le recours à 730 droits d'opposition sur les comptes de celles-ci17(*). Selon le même service, 646 notes d'information ont été adressées à 47 parquets différents.
Sur la même période, plus de 66,5 millions d'euros ont été saisis dans le cadre du ciblage des entreprises éphémères avec un taux de contestation marginal.
Ces données chiffrées montrent que la prise de conscience du ciblage des entreprises éphémères fonctionne : le service indique ainsi qu'il s'agit d'un véritable « succès opérationnel18(*) ».
La montée en charge et l'approfondissement de la stratégie qui vise les entreprises éphémères constituent des priorités d'action majeures à court et moyen-terme pour Tracfin.
3. Les critères proposés dans le texte semblent peu opérants
Enfin, les services entendus par le rapporteur ont fait part de leur questionnement quant à l'aspect opérationnel des critères indiqués dans le texte pour le ciblage de la lutte contre le blanchiment.
En effet, comme l'indique Tracfin19(*), « l'article 1er conduirait à signaler des sociétés certes éphémères mais qui n'ont pas vocation à permettre de commettre des infractions ou à permettre le blanchiment de leur produit ».
Les critères indiqués dans le texte sont en effet pour certains trop précis - par exemple le fait d'avoir plus de dix associés dès la création - et d'autres trop larges, comme le fait d'être situé hors de l'Union européenne.
Ainsi, une société créée par 11 associés aux États-Unis pourrait-elle faire automatiquement l'objet d'une déclaration de soupçon si le texte était adopté, alors que rien ne dit qu'une telle entreprise soit d'une quelconque façon condamnable.
De même, comme l'indique Tracfin, « toutes les créations d'entreprises individuelles, d'entreprises de production audiovisuelles ou les montages résultants de fusions acquisitions feraient systématiquement l'objet d'une déclaration de soupçons en application de ces nouvelles dispositions ».
B. L'OBLIGATION D'EFFECTUER DES DÉCLARATIONS DE SOUPÇON EN CAS DE DÉTECTION D'UNE SOCIÉTÉ ÉPHÉMÈRE EST SATISFAIT PAR LE DROIT EXISTANT
1. Les acteurs assujettis ont déjà pour obligation d'effectuer une déclaration dans le cas de soupçon d'une société éphémère
Comme indiqué précédemment, les dispositions actuelles qui régissent les déclarations de soupçon à Tracfin sont précisément définies dans la loi et couvrent déjà les cas de soupçon quant à l'existence de sociétés éphémères utilisées dans le blanchiment.
Ainsi, il n'apparaît pas nécessaire, pour le rapporteur, d'ajouter une disposition qui ciblerait précisément les déclarations de soupçon relatives aux entreprises éphémères.
En effet, les entités assujetties doivent, en vertu de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, effectuer une déclaration auprès de Tracfin des « sommes inscrites dans leurs livres ou [des] opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »
Or, lorsqu'un acteur repère une entreprise éphémère ou en soupçonne l'existence, il peut légitimement soupçonner qu'une telle structure soit utilisée pour blanchir des sommes.
En outre, le blanchiment, aux termes de l'article 324-1 du code pénal, est puni « de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ».
Par conséquent, les entreprises, éphémères ou non, qui pourraient être soupçonnées de participer au blanchiment de sommes frauduleuses, sont par défaut incluses dans les cas où une déclaration de soupçon est obligatoire.
La disposition relative à la déclaration de soupçon est donc satisfaite par le droit en vigueur.
2. En précisant certains cas de soupçon, le risque de fragiliser le dispositif de déclaration et de s'éloigner de la définition européenne commune
La réponse de la direction générale du Trésor au questionnaire du rapporteur indique que la direction est, « de manière générale, [...] réservée quant aux dispositions consistant à préciser des situations devant donner lieu à une déclaration de soupçon à Tracfin ».
En effet, le champ de l'obligation de déclaration de soupçon découle directement du droit européen et des normes internationales, et couvre l'ensemble des situations identifiées dans la loi puisque l'obligation porte sur toute « opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme20(*) ».
Le fait de préciser certaines situations spécifiques, comme celle du soupçon d'existence d'une société éphémère, pourrait mener à fragiliser le dispositif français vis-à-vis des situations qui ne seraient pas précisément identifiées dans la loi.
La DG Trésor explique enfin que le choix de préciser certaines situations spécifiques risque d'éloigner la France des normes européennes et internationales. Or, le renforcement actuel de la coopération européenne en matière de lutte contre le blanchiment appelle à une vigilance particulière pour éviter que cet effort de convergence ne soit mis en péril.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission a adopté l'amendement du rapporteur COM-8 de suppression de l'article.
Décision de la commission : la commission des finances a supprimé cet article.
ARTICLE
2
Création d'un fichier recensant les identités fictives
et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois21(*).
À l'initiative de son rapporteur Hervé Reynaud, la commission des lois a adopté un amendement ( COM-4) visant à étendre le périmètre des appels à la vigilance émis par Tracfin concernant les identités fictives.
Plutôt que de créer un fichier recensant les identités fictives et les prête-noms, l'article ainsi modifié par la commission des lois permet à Tracfin, non seulement de désigner explicitement aux personnes assujetties des personnes physiques particulièrement à risque mais également de leur signaler les identités fictives et les prête-noms qu'elles utilisent ou sont susceptibles d'utiliser.
La commission des finances salue cet enrichissement de l'information apportée aux personnes assujetties aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il permettra de cibler davantage les contrôles et de repérer au plus vite les cas de fraude documentaire.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE II
RENDRE
SYSTÉMATIQUE LA VÉRIFICATION
DE L'ORIGINE DES FONDS
AVANT
LA REPRISE D'UNE ENTREPRISE
ARTICLE
3
Justification de l'origine des fonds apportés pour
l'acquisition d'une entreprise par voie amiable
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois22(*).
À l'initiative de son rapporteur Hervé Reynaud, la commission des lois a adopté un amendement ( COM-5) qui crée une nouvelle mesure de vigilance applicables aux personnes assujetties aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Concrètement, au lieu d'une obligation systématique de déclaration de l'origine des fonds en cas de cession amiable d'une société commerciale comme le prévoyait l'article initial, les professionnels en charge de la rédaction de l'acte de cession, en particulier les notaires ou les greffiers des tribunaux de commerce selon les cas, auraient l'obligation de se renseigner auprès de l'acquéreur de l'origine des fonds lorsque le risque de blanchiment est élevé.
La commission des finances salue cette initiative qui consacre une approche par les risques et garantit en outre l'existence d'un contrôle effectif de l'origine des fonds.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
III
OBLIGATION POUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE
DÉCLARER À L'ADMINISTRATION FISCALE
LEURS COMPTES BANCAIRES
À L'ÉTRANGER
ARTICLE
4
Obligation pour les sociétés commerciales de
déclarer à l'administration fiscale leurs comptes bancaires
à l'étranger
Le présent article prévoit d'obliger les sociétés commerciales à déclarer les références des comptes ouverts, détenus ou clos à l'étranger à l'administration fiscale.
En ce sens, il met au même niveau les obligations incombant aux sociétés commerciales avec celles qui incombent aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France.
En outre, l'article prévoit d'inscrire dans la loi le fait que l'administration fiscale peut transmettre des déclarations de soupçon à Tracfin.
L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger détenus par les sociétés commerciales impliquerait un bouleversement important et demande à la direction générale des finances publiques de s'organiser pour stocker, gérer et exploiter ces nouvelles données. En conséquence, le rapporteur propose de décaler d'un an sa mise en oeuvre pour laisser aux services le temps de s'organiser.
En outre, l'adoption de cet article imposera, notamment aux entreprises multinationales, une nouvelle obligation déclarative lourde. D'ici à l'adoption définitive d'une telle mesure, une concertation avec les organisations professionnelles quant à l'application concrète du texte et son implication pour ces sociétés et l'attractivité de la France serait probablement indispensable.
Enfin, les dispositions qui offrent la possibilité à l'administration fiscale d'effectuer des déclarations de soupçon à Tracfin sont aujourd'hui satisfaites. Par conséquent, le rapporteur propose de les supprimer.
La commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : LE LÉGISLATEUR A ENTENDU EXONÉRER LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DE L'OBLIGATION DE DÉCLARER LEURS COMPTES BANCAIRES À L'ÉTRANGER
A. LE DROIT FRANÇAIS PRÉVOIT UN CERTAIN NOMBRE D'OBLIGATIONS DÉCLARATIVES RELATIVES À LA TENUE DES COMPTES BANCAIRES
1. L'obligation générale de déclarer l'ouverture, la modification et la clôture des comptes et des locations de coffres-forts au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)...
Afin de lutter plus efficacement contre la fraude et le blanchiment, la France s'est dotée en 198223(*) d'un fichier recensant l'ensemble des ouvertures, clôtures ou modifications de comptes bancaires.
Cette création du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) est la conséquence de l'adoption de la loi de finances pour 198024(*), dont l'article 75 a été codifié à l'article 1649 A du code général des impôts (CGI).
Le premier alinéa de cet article prévoit l'obligation pour toute personne recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes ainsi que la location de coffres-forts.
Les articles les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV du CGI précisent la mise en oeuvre de cet alinéa :
- les déclarations incombent aux établissements qui gèrent les comptes ou les coffres-forts25(*);
- les déclarations doivent avoir lieu dans les sept jours qui suivent l'ouverture, la modification, la clôture d'un compte ou la location d'un coffre-fort26(*);
- les déclarations comportent les informations suivantes : adresse de l'établissement, désignation du compte ou du coffre-fort, date et nature de l'opération déclarée, identité de la personne physique titulaire du compte et de ses mandataires ainsi que du numéro SIRET27(*) pour les entrepreneurs individuels28(*).
La direction générale des finances publiques (DGFiP) procède aux inscriptions à réception de la déclaration de l'établissement bancaire qui a procédé à l'ouverture du compte, sa modification ou sa clôture. Les éléments d'état civil des personnes sont certifiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), tandis que les agents de la DGFiP utilisent le SIRENE29(*) pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des organismes.
Outre les déclarations relatives aux comptes bancaires et aux coffres-forts, la DGFiP reçoit et compile des données provenant à la fois :
- des organismes qui permettent la souscription de contrats de capitalisation, comme les contrats d'assurance vie, en vertu de l'article 1649 AA du CGI ;
- des administrateurs de trusts en vertu de l'article 1649 AB du même code ;
- des teneurs de compte, organismes d'assurances et autres institutions financières en vertu de l'article 1649 AC du même code.
Le FICOBA constitue donc un fichier très complet et utile pour l'administration car il permet d'associer chaque compte bancaire, coffre-fort, et autres entités citées supra à son bénéficiaire effectif.
Les agents ayant accès aux informations contenues dans le FICOBA sont nombreux : il s'agit notamment de l'administration fiscale, des officiers de police judiciaire, de certains juges, des notaires en charge d'une succession, des commissaires de justice et de certains agents de la Caf30(*).
Les informations contenues dans le FICOBA sont conservées pendant toute la durée de vie du compte et durant les dix ans qui suivent sa clôture. En revanche, il ne retrace pas les opérations effectuées dans les comptes ni le solde de ces comptes.
2. ... est renforcée par une obligation pour certains acteurs de déclarer leurs comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France
La loi de finances pour 199031(*) a élargi les obligations déclaratives qui concernaient les comptes en France aux comptes à l'étranger détenus par des personnes domiciliées ou établies en France. Cette évolution est la conséquence logique de l'internationalisation du réseau bancaire et de la facilité croissante de mobilité des capitaux. Ainsi, le FICOBA se trouve également alimenté par les informations relatives aux titulaires de comptes à l'étranger.
Ces dispositions sont codifiées dans le deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI qui étend l'obligation déclarative aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales, domiciliées ou établies en France.
Aux termes de ces dispositions, l'obligation déclarative incombe aux acteurs suivants, lorsqu'ils sont domiciliés ou établis en France :
- les personnes physiques ;
- les associations ;
- les sociétés n'ayant pas la forme commerciale.
L'administration fiscale définit32(*) les sociétés qui n'ont pas la forme commerciale à partir de leur organisation juridique et de leur régime fiscal. Ainsi, la doctrine indique que les sociétés ayant la forme suivante ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger :
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;
- les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- les sociétés en commandite simple (SCS).
En revanche, le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) donne une liste indicative des structures devant se soumettre à une telle déclaration. Ainsi, entrent notamment dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts :
- des sociétés de fait et des indivisions ;
- des sociétés en participation ;
- des sociétés civiles quel que soit leur objet : sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés civiles immobilières de gestion ou de construction-vente, sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sociétés civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers ou encore exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;
- des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;
- des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.
La déclaration doit contenir les informations permettant l'identification des comptes, du déclarant, du titulaire du compte et du bénéficiaire de la procuration.
Les comptes visés par cette obligation déclarative sont ceux qui ont été ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant. La doctrine fiscale précise les termes de détention et d'utilisation d'un compte :
- un compte est réputé être détenu dès lors que le titulaire en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ;
- un compte est réputé avoir été utilisé par le déclarant dès lors que celui-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
La notion d'utilisation a, en outre, été précisée par le Conseil d'État33(*). Il a ainsi été jugé qu'un compte est réputé être utilisé seulement si le contribuable a effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte. Par conséquent, les opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte, ne constituent de telles opérations.
B. L'EXPLOITATION DU FICOBA EST CLÉ POUR L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF LCB-FT MAIS IL RESTE DÉPOURVU D'INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ÉTRANGERS DES SOCIETES COMMERCIALES
1. Les autorités impliquées dans la LCB-FT doivent bénéficier d'une habilitation législative afin d'obtenir communication des données issues du FIBOCA
Parmi les professions les plus exposées aux risques de délinquance financière, l'analyse nationale des risques (ANR) de 202334(*) du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) cible le secteur financier comme présentant l'essentiel des risques de blanchiment de capitaux. À cet égard, l'ANR souligne l'importance de l'ouverture de l'accès au FIBOCA aux différentes autorités impliquées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Il n'en demeure pas moins que l'accès au FICOBA est réglementé et trouve ses sources tant dans le droit européen que national.
D'une part, le titulaire d'un compte, mais aussi le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ainsi que l'un des héritiers du titulaire du compte peut avoir accès aux données du fichier en question. Cette disposition trouve sa source dans l'application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données35(*) qui consacre un droit d'accès aux données pour la personne concernée.
En outre, comme l'indique l'arrêté du 14 juin 1982 précité relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du FICOBA, en son article 2, les informations du fichier ne peuvent être communiquées « qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi ».
Néanmoins, ces personnes s'avèrent être nombreuses. En sus des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), on retrouve en effet, par exemple :
- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;
- les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;
- la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 ;
- et les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 mentionné supra détaille l'ensemble des entités autorisées à demander et recevoir des informations contenues dans le FICOBA.
L'application du secret professionnel, en vertu de l'article 103 du livre des procédures fiscales, peut limiter l'accès au FICOBA. Toutefois, il est possible, dans de nombreux cas prévus par la loi, d'y déroger.
2. L'exonération des sociétés commerciales de l'obligation de déclarer leurs comptes étrangers limite, de fait, le pouvoir d'enquête de ces autorités
Depuis la levée complète du contrôle des changes, intervenue le 1er juillet 1990, les personnes physiques résidant en France ont la possibilité de transférer librement des capitaux à l'étranger et d'y détenir des avoirs.
C'est cette évolution qui a conduit le législateur à instituer, en contrepartie, l'obligation de déclaration annuelle des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger par les personnes domiciliées ou établies en France.
Il ressort des débats parlementaires d'alors que cette initiative visait à éviter que la suppression des restrictions aux mouvements de capitaux ne favorise la fraude.
Le droit actuel n'impose pas aux sociétés commerciales les mêmes obligations déclaratives qu'aux autres types de sociétés, de sorte qu'il résulte du dispositif actuel une différence de traitement de nature à limiter la traçabilité des flux financiers internationaux, d'autant plus que les entités commerciales s'avèrent être davantage susceptibles de détenir des comptes à l'étranger dans le cadre de montage financiers complexes.
En outre, il convient de souligner que depuis le 1er janvier 2024, l'obligation de déclarer les portefeuilles d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, a été étendue à toutes les personnes ou entités juridiques domiciliées ou établies en France, y compris aux sociétés commerciales36(*).
Dès lors, force est de constater que le droit existant prévoit d'exonérer les sociétés commerciales domiciliées ou établies en France de l'obligation de déclarer leurs comptes bancaires à l'étranger, mais les assujettit à l'obligation de déclarer leurs comptes d'actifs numériques à l'étranger.
C. L'ADMINISTRATION FISCALE DISPOSE DU DROIT DE TRANSMETTRE À TRACFIN TOUTES LES INFORMATIONS UTILES À SA MISSION
Le droit existant prévoit, à l'article L. 561-27 du code monétaire et financier (CMF), que les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de protection sociale et toute personne chargée d'une mission de service public envoient à Tracfin les informations nécessaires à sa mission.
Le service de renseignement économique et financier peut, en outre et selon le même article du CMF, demander aux mêmes acteurs chargés d'une mission de service public de lui transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Par conséquent, les administrations de l'État, en particulier l'administration fiscale, sont habilitées à envoyer toute information à Tracfin qui permettrait au service d'accomplir sa mission.
Les administrations et les personnes chargées d'une mission de service public ne sont en revanche pas soumises au même type d'obligation de déclaration de soupçon que celles mentionnées à l'article L. 561-2 du CMF. En effet, ces dernières ne sont tenues d'effectuer une déclaration que si elles constatent que « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur [ces] sommes » proviennent ou pourraient probablement provenir « d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme37(*) ».
Le législateur, supposant une volonté d'entraide entre Tracfin et les personnes chargées d'une mission de service public, a permis que les échanges d'information entre ces entités servent, de façon très large, à l'accomplissement des missions du service.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : IMPOSER AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES DE DÉCLARER LEURS COMPTES À L'ÉTRANGER ET PERMETTRE À L'ADMINISTRATION FISCALE DE DÉCLARER LES ANOMALIES REPÉRÉES À TRACFIN
A. OBLIGER LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES À DÉCLARER LEURS COMPTES À L'ÉTRANGER
L'article 4 de la proposition de loi, en son 1°, supprime dans l'article 1649 A du code général des impôts la mention exonérant les sociétés commerciales, domiciliées ou établies en France, de la déclaration de l'ouverture, la détention, l'utilisation ou la clôture des comptes qu'elles détiennent à l'étranger.
Ainsi, l'adoption de l'article viendrait remettre au même niveau les obligations qui s'imposent aux sociétés n'ayant pas la forme commerciale et celles ayant forme commerciale.
Par conséquent, l'ensemble des structures juridiques listées ci-après devraient déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouvertes, détenus, utilisés ou clos à l'étranger :
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;
- les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- les sociétés en commandite simple (SCS).
B. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU MOTIF DE DÉCLARATION À TRACFIN POUR L'ADMINISTRATION FISCALE
Le 2° de l'article 4 ajoute un alinéa à l'article 1649 A du code général des impôts. Il prévoit que l'administration fiscale peut transmettre à Tracfin, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, les incohérences ou les éléments susceptibles de caractériser un risque de fraude, de blanchiment ou de financement du terrorisme repérés lors des déclarations de comptes à l'étranger.
Cette possibilité viendrait ainsi s'ajouter à celle, de portée plus générale, déjà prévue dans l'article L. 561-27 du code monétaire et financier. En effet, la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue l'une des missions constitutives de Tracfin : le 4° de l'article R. 562-3 du code monétaire et financier dispose que Tracfin participe « à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : À CE STADE, ADAPTER L'ENTRÉE EN VIGUEUR D'UN DISPOSITIF DONT LES EFFETS DEVRONT ÊTRE PLEINEMENT MESURÉS AVANT SON ÉVENTUELLE ADOPTION
A. L'UTILITÉ DE LA DÉCLARATION DES COMPTES À L'ÉTRANGER SE HEURTE NÉANMOINS À SON APPLICATION OPÉRATIONNELLE
1. L'obtention de ces nouvelles informations pourrait faciliter le contrôle de l'administration fiscale
Comme l'indique la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans ses réponses aux questions du rapporteur, « [la direction], par principe, souhaite obtenir toujours davantage d'informations pour permettre de réaliser ses contrôles, et donc l'information sur les comptes à l'étranger serait une donnée supplémentaire intéressante. »
La facilité qui existe, aujourd'hui, pour les personnes physiques comme les personnes morales, d'ouvrir des comptes à l'étranger et d'y faire transiter des capitaux, tend ainsi à faciliter le transfert de sommes frauduleuses ou blanchies avant que les autorités n'aient la capacité de les saisir.
Lors de l'audition de la DGFiP, le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) a fait part de l'émergence d'un schéma de fraude prenant de l'ampleur : la liaison directe de terminaux de paiement par carte bancaire vers des comptes à l'étranger. Certains commerçants peuvent ainsi ne déclarer qu'une partie de leurs revenus en France et dissimuler la part de chiffre d'affaires qu'ils souhaitent directement à l'étranger.
Ce schéma de fraude semble plutôt concerner les petits commerces et permettre le blanchiment de basse intensité dans certains cas.
Au niveau des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes, de même, l'existence de nombreux comptes à l'étranger facilite la mise en oeuvre de schémas financiers complexes. Ainsi, l'absence de connaissance par l'administration fiscale des comptes à l'étranger de ces sociétés commerciales réduit sa capacité d'action et de contrôle.
Cette nouvelle obligation pourrait ainsi grandement faciliter le travail de contrôle et d'enquête de l'administration fiscale.
2. La nécessité de prévoir une entrée en vigueur différée pour permettre aux services de traiter ces nouvelles informations
Les échanges avec le SJCF ont montré que la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif demanderait cependant une adaptation importante pour l'administration, qui prendrait un certain temps.
D'une part, il faudra renouveler et adapter les modalités déclaratives des sociétés commerciales, en adaptant les formulaires et les systèmes informatiques.
D'autre part, il conviendra de mettre sur pied une base de données sécurisée, fiable et ergonomique pour que l'ensemble de ces informations soient exploitables par l'administration.
Enfin, il faudra probablement recruter ou former des personnels en vue du stockage, du traitement et de l'exploitation des nouvelles données qui seraient massives : en France, en 2022, 8,9 millions d'unités légales sont enregistrées dans le répertoire SIRENE38(*) dans les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.
Après échanges avec le SJCF, le rapporteur estime qu'un délai d'un an à partir de la publication du dispositif serait nécessaire pour que sa mise en oeuvre opérationnelle soit fluide et maîtrisée.
Un tel délai serait également probablement utile pour que l'ensemble des sociétés commerciales puisse répondre à cette nouvelle exigence.
Tel est l'objet de l'amendement COM-9 du rapporteur.
3. La prudence doit guider la mise en oeuvre de ce dispositif, pour éviter tout effet potentiellement négatif sur l'attractivité économique de la France
Si les auditions et les travaux menés par le rapporteur n'ont, à ce stade, pas fait ressortir de réticences majeures à l'adoption de cette disposition, plusieurs alertes l'enjoignent néanmoins à la prudence.
D'une part, les organisations professionnelles, qui représentent les sociétés commerciales qui seraient soumises à cette obligation, n'ont pas eu la possibilité de présenter les incidences concrètes que cette nouvelle disposition aurait sur leur activité. Le rapporteur souhaite ainsi continuer ses travaux pour mesurer de façon plus précise la lourdeur qu'une telle obligation déclarative pourrait constituer sur les sociétés commerciales en France. Cette précaution a été soulevée par la DGFiP lors de ses réponses au rapporteur.
D'autre part, les risques de réduction de l'attractivité économique de la France en lien avec cette nouvelle obligation déclarative ne sont pas quantifiés à ce stade. Il conviendrait de s'assurer que la balance entre le bénéfice attendu et les effets économiques conjoints plaide bien pour l'adoption d'une telle disposition.
Lors de l'adoption, en loi de finances pour 1980, de la disposition obligeant l'ensemble des entités juridiques à l'exception des sociétés ayant la forme commerciale à déclarer leurs comptes à l'étranger, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, M. Roger Chinaud, avait porté un amendement qui la supprimait. Cet amendement avait d'ailleurs été adopté, contre l'avis du gouvernement. Le rapporteur général précisait alors que « la déclaration automatique des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, ferait peser une suspicion de fraude sur l'ensemble des personnes qui souhaitent utiliser les possibilités qui leur sont légalement offertes par la libération des mouvements de capitaux.39(*) »
Il apparaît ainsi que, dès l'origine, des réticences quant à la présomption de fraude qui pèserait sur les acteurs tenus à la déclaration avaient été exprimées. Il en est de même aujourd'hui : l'intégration des sociétés commerciales dans le champ du deuxième alinéa de l'article 1649 A risque de faire peser sur ces dernières une présomption de participation à des schémas de fraude et de blanchiment. Le risque d'une perte d'attractivité pour les sociétés commerciales d'une implantation en France doit ainsi être objectivé.
Cependant, comme indiqué précédemment, il existe déjà une obligation de déclaration des portefeuilles de crypto-actifs détenus à l'étranger40(*) pour l'ensemble des entités juridiques. Cette obligation ne semble pas avoir constitué un frein au développement de ces produits financiers pour les acteurs domiciliés en France depuis sa mise en oeuvre en janvier 2024.
Le rapporteur, dans l'attente d'une expertise plus approfondie, maintient ainsi la disposition modifiée par l'entrée en vigueur différée.
B. LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS PRÉVUE PAR L'ARTICLE EST DÉJÀ SATISFAITE PAR LE DROIT EXISTANT
Comme indiqué précédemment, l'article L. 561-27 du code monétaire et financier (CMF) prévoit déjà la transmission d'informations par l'administration fiscale à Tracfin.
En outre, comme le fait remarquer Tracfin dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, « le champ est plus large que celui prévu par la proposition de loi puisqu'elle porte41(*) sur les « sommes inscrites » ou les « opérations portant sur des sommes » et non uniquement sur des « fonds [qui] proviennent » d'une infraction42(*). »
Les modalités de transmission des informations de l'administration fiscale vers Tracfin sont donc satisfaites par le droit existant. Le service relève enfin, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, que « les modalités de cette transmission ne nécessitent pas d'être fixées par un décret en Conseil d'État » comme le prévoit le texte de la proposition de loi. En effet, l'article L. 561-27 du CMF ne prévoit de mesure réglementaire d'application.
Le rapporteur propose ainsi la suppression du 2° de l'article 4 de la proposition de loi, en ce qu'il est déjà satisfait.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
IV
DISPOSITIF DE VIGILANCE RENFORCÉE
SUR LES COMPTES REBONDS
ET SUR LE CONTRÔLE DES NÉOBANQUES
ARTICLE
5
Définition du compte rebond et obligation de mise en oeuvre de
mesures de vigilance renforcées et de déclaration en cas de
soupçon
Le présent article tend, d'une part, à définir dans la loi le compte rebond comme compte de transit rapide du produit de la fraude permettant d'en dissimuler l'origine ou les bénéficiaires.
Il vise, d'autre part, pour lutter contre l'utilisation de ce type d'outils de blanchiment, à imposer aux organismes financiers de nouvelles obligations en cas de suspicion d'utilisation de leurs produits ou services comme compte rebonds.
Il est ainsi proposé que ces organismes soient tenus de mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées lorsqu'ils identifient un risque en la matière au moment de l'entrée en relation et lorsqu'un compte rebond est détecté au cours de la relation d'affaires. Ils devraient dès lors déclarer le compte concerné auprès d'un registre national des comptes rebonds, dont la création est prévue par l'article 6 de la présente proposition de loi.
Néanmoins, le dispositif proposé présente plusieurs difficultés :
- il est d'abord largement satisfait, dans la mesure où le droit en vigueur contraint les organismes financiers à mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées et à adresser une déclaration de soupçon à Tracfin dans un certain nombre de situations, et notamment en cas de soupçon d'utilisation d'un compte comme compte rebond ;
- les acteurs de la lutte contre le blanchiment jugent délicat de fixer dans la loi une pratique en constante évolution, au risque de voir les fraudeurs s'adapter pour contourner le cadre légal ;
- il est difficile d'identifier un risque d'utilisation d'un compte comme compte rebond dès l'entrée en relation et, en tout état de cause, il serait alors plus judicieux de refuser l'ouverture du compte.
Pour autant, l'automatisation et la sous-traitance induisant, dans une logique de réduction des coûts, une aggravation du risque d'utilisation de comptes rebonds, cet article a été réécrit sur la proposition du rapporteur.
Il vise désormais à imposer aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d'interfaces automatisées de déterminer, pour chaque type de service de paiement, les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé.
La commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : FACE AU RISQUE DES « COMPTES REBONDS », LA RÉGLEMENTATION ATTRIBUE AUX ORGANISMES FINANCIERS PLUSIEURS LEVIERS DE PRÉVENTION ET D'ACTION QU'ILS DOIVENT DÉSORMAIS ASSOCIER À UNE VIGILANCE ACCRUE
A. LES « COMPTES REBONDS » : UN INSTRUMENT DE BLANCHIMENT DU PRODUIT DE LA FRAUDE DONT L'USAGE PROGRESSE FORTEMENT
Également appelés « comptes taxis » ou « comptes de transit », les « comptes rebonds » sont définis par l'ACPR comme des comptes bancaires ou de paiement utilisés pour recevoir les fonds d'une victime avant de les transférer rapidement vers d'autres comptes, et notamment vers des comptes ouverts à l'étranger, dans l'objectif de dissimuler la destination réelle des fonds et de compliquer la récupération des sommes.
Cas-type d'utilisation de comptes rebonds
Source : Tracfin, Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015
D'après une enquête menée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) et publiée en juillet 2025, 661 millions d'euros de virements reçus ont été identifiés « a minima comme suspects » par les organismes financiers interrogés en 2023, en progression de 45 % sur un an43(*). Le montant moyen des virements suspects reçus, lui, resterait stable, à un niveau légèrement inférieur à 900 €.
Volume des virements suspects en 2022 et 2023
Source : ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025
Concrètement, plusieurs éléments peuvent conduire à soupçonner le recours à des pratiques frauduleuses, à savoir :
- la réception d'une demande de rappel du virement par son émetteur ;
- une réquisition judiciaire ou une demande des autorités ;
- une détection par le dispositif interne de surveillance de l'organisme intéressé.
Au cours de l'année 2023, les données collectées par l'ACPR révèlent que 71 274 relations d'affaires ont fait l'objet d'une clôture de compte « suite à un évènement matérialisant le soupçon que leur compte aurait reçu des virements suspects », ce qui représente 1,06 % des nouvelles entrées en relation de 2023. 33 % de ces clôtures sont intervenues dans les trois mois ayant suivi l'ouverture du compte et 32 % d'entre elles plus d'un an après l'ouverture. Au total, en 2023, 982 millions d'euros ont transité sur les comptes ainsi clôturés sans avoir été ni immobilisés, ni saisis, ni restitués.
En outre, 43 % des relations d'affaires récipiendaires de virements suspects en 2023 avaient été ouvertes durant l'année 2023, contre seulement 21 % avant 2021.
Ancienneté des relations d'affaires
récipiendaires
de virements suspects en 2023
Source : ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025
En retenant les seules 650 relations d'affaires ayant reçu le montant cumulé de demandes de rappel de virements le plus important en 2023, qui représentent 138,7 millions d'euros de virements suspects reçus, l'ACPR constate que 60 % des flux transitant sur les comptes en question ont été virés à l'étranger, principalement au sein de l'Union européenne (Luxembourg, Lituanie, Allemagne, Irlande, Belgique et Espagne) et au Royaume-Uni.
Seuls 9 % de ces flux ont été restitués aux victimes dans le cadre d'un rappel et 2 % saisis par les autorités, tandis que 3,2 % d'entre eux sont restés sur les comptes concernés à la fermeture.
Destination des flux transitant sur les
comptes
apparaissant comme suspects
Source : ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025
70 % des comptes ayant reçu le montant cumulé de demandes de rappel de virement les plus importants avaient moins d'un an. In fine, 90 % d'entre eux ont été fermés par l'organisme financier concerné.
B. SI LA VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS DOIT ÊTRE RENFORCÉE, LA LOI LEUR PERMET D'ORES ET DÉJÀ DE PRÉVENIR, DE SIGNALER OU DE FAIRE CESSER L'UTILISATION DE LEURS PRODUITS ET SERVICES COMME COMPTES REBONDS
1. L'identité du client doit être vérifiée, que l'entrée en relation ait lieu en face à face ou à distance
La législation impose aux organismes financiers d'identifier leur client - et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif - avant d'entrer en relation d'affaires avec lui et de vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant44(*).
Du reste, ces organismes sont tenus d'identifier et de vérifier dans les mêmes conditions l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs lorsqu'ils soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant45(*).
Les moyens d'identification et de
vérification de l'identité du client
avant l'entrée en
relation d'affaires
Aux termes de la réglementation, les organismes financiers identifient leur client soit par le recueil de ses nom et prénoms ainsi que de ses date et lieu de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et celle du lieu de direction effective de l'activité46(*).
Pour vérifier l'identité de leurs clients, ces organismes peuvent notamment :
- recourir soit à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) soit à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un État membre de l'Union européenne, à la condition que le niveau de garantie du moyen utilisé corresponde au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur;
- recourir à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques;
- lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, demander la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et prendre une copie de ce document ;
- lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, demander la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger - la vérification de l'identité de la personne morale pouvant également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger47(*).
Lorsque ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre - notamment dans le cas d'une entrée en relation à distance -, les organismes financiers doivent vérifier l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
- obtenir une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ;
- mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
- exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) ;
- obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers ;
- recourir à un service certifié conforme par l'Anssi ou un organisme de certification autorisé par cette dernière au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité ;
- recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de caché et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale48(*).
En tout état de cause, les organismes financiers doivent identifier et vérifier l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités décrites ci-dessus et vérifier leurs pouvoirs49(*).
Source : Commission des finances du Sénat, d'après les dispositions du code monétaire et financier
L'ACPR relève à cet égard que, parmi les 650 cas ayant reçu le montant cumulé de demandes de rappels de virements le plus important, « certains organismes financiers se sont limités à recueillir la pièce d'identité de leurs clients sans appliquer une seconde mesure requise par l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier en cas d'entrée en relation à distance »50(*).
Par ailleurs, le code monétaire et financier dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires, les organismes financiers recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent et qu'ils actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires51(*). Au cours de celle-ci, ils doivent exercer, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'ils ont de la relation d'affaires52(*).
Lorsqu'un organisme financier n'est pas en mesure de satisfaire à ces obligations, il ne doit exécuter aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établir ni ne poursuivre aucune relation d'affaires et peut transmettre à Tracfin une déclaration de soupçon53(*) (voir infra).
2. En fonction du niveau de risque, des mesures de vigilance doivent être déployées par les organismes financiers
En sus des mesures de vigilance simplifiées rappelées ci-avant54(*), les organismes financiers appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client dans certaines situations :
- lorsque le client ou, le cas échéant, son bénéficiaire effectif est une personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'il exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relations d'affaires ;
- lorsque le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'il favorise l'anonymat - les produits et opérations visés sont les bons, titres et contrats au porteur, les jetons de monnaie électronique et les opérations portant sur ces produits55(*) ;
- lorsque l'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme56(*).
Au surplus, lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les organismes financiers sont tenus de mettre en oeuvre, sous la forme de mesures de vigilance renforcées57(*), les dispositions du code monétaire et financier portant sur l'identification et la vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs58(*), le recueil d'informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires59(*) et l'examen des opérations effectuées60(*).
De la même manière, ils sont tenus d'effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite61(*). Ils doivent alors se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Tracfin est par ailleurs autorisé, pour une durée maximale de six mois renouvelable, à désigner aux organismes financiers, pour la mise en oeuvre de leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, les opérations ou des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme62(*).
Comme le rappelle l'ACPR, ces organismes classent leurs clients au début de la relation d'affaires en leur attribuant un score de risque, lequel « va définir les procédures qui leur seront appliquées et plus particulièrement les éléments supplémentaires qui leurs seront demandés s'agissant de la connaissance client »63(*).
Or, seuls 29 % des 650 cas ayant reçu le montant cumulé de demandes de rappels de virements le plus important ont été classés à risque très élevé avant la première alerte en 2023, alors que 70 % de ces 650 relations d'affaires avaient moins d'un an lors du premier rappel de virement. L'ACPR y voit dès lors « une sous-estimation du risque lors de l'entrée en relation »64(*).
Niveau de risque du client avant la première alerte
Source : ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025
3. En cas de doute sur l'origine des sommes détenues ou virées, l'émission d'une déclaration de soupçon est obligatoire
Les organismes financiers sont tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ils proviennent :
- d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ;
- ou d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère65(*) défini par décret66(*).
De même, à l'issue de l'examen renforcé que le code monétaire et financier prescrit pour toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite67(*), les organismes financiers émettent, le cas échéant, une déclaration de soupçon68(*).
Au surplus, ils adressent à Tracfin les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations69(*).
La déclaration de soupçon est confidentielle70(*). Les organismes financiers doivent s'abstenir d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'ils aient procédé à cette déclaration71(*). Ils ne peuvent alors réaliser l'opération en question que si Tracfin n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris ne lui est parvenue.
De fait, suite à l'émission d'une déclaration de soupçon, Tracfin peut s'opposer à l'exécution d'une opération non encore exécutée, cette opposition pouvant également s'étendre, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle ayant fait l'objet de la déclaration ou de l'information et portant sur les sommes inscrites dans les livres de l'organisme financier chargé de ces opérations72(*).
Dans ces cas, les opérations sont reportées d'une durée de 10 jours ouvrables à compter du jour d'émission de la notification de cette opposition. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut, sur requête de Tracfin et après avis du procureur de la République de Paris, proroger ce délai ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Tracfin a ainsi exercé son droit d'opposition à 132 reprises en 2023, à 305 reprises en 2024 et à déjà plus de 350 reprises en 2025.
Selon l'ACPR, pour les 650 cas ayant reçu le montant cumulé de demandes de rappels de virements le plus important en 2023, le délai moyen entre la 1ère demande de rappel de virement sur le compte et l'émission d'une déclaration de soupçon s'est établi à 29 jours. Du reste, dans 80 % des cas ayant fait l'objet d'une telle déclaration, celle-ci a été émise après la réception de la demande de rappel de virement.
Dans le même temps, l'ACPR constate, entre la première demande de rappel de virement sur le compte et la clôture de ce dernier, un délai moyen de 65 jours. Parmi les comptes ainsi clôturés, 36 % n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration de soupçon.
4. Un certain nombre de recommandations ont été avancées par l'ACPR pour limiter le risque d'utilisation de comptes rebonds
Compte tenu des zones de fragilité identifiées, l'ACPR a formulé plusieurs préconisations tendant à permettre aux organismes financiers d'améliorer l'efficacité de leurs procédures et de limiter le risque d'utilisation de leurs produits et services comme « comptes rebonds ».
En premier lieu, l'Autorité invite les organismes financiers dont l'activité présente un risque élevé de blanchiment d'argent lié à l'utilisation de comptes pour le transit de fonds illicites à adapter leur dispositif de gestion des risques en assurant le suivi d'indicateurs de performance ou de risques et en mettant en oeuvre, lorsque des défaillances majeures exploitées par un réseau criminel sont identifiées, des actions rapides telles que la suspension des produits et processus en cause jusqu'à ce que les corrections utiles aient été apportées.
En parallèle, il est suggéré aux organismes financiers de combiner plusieurs mesures de vérification d'identité lors de l'ouverture de comptes au profit de nouveaux clients, d'utiliser, dans ce cadre, des pièces justificatives recueillies auprès de sources indépendantes fiables telles que les registres officiels lorsque le client est une personne morale et de vérifier avec soin l'identité et les pouvoirs des personnes agissant au nom du client.
L'ACPR préconise par ailleurs d'intégrer le risque d'utilisation de comptes pour le transit de fonds illicites dès la conception des produits et offres de services par les organismes financiers ainsi que d'adapter l'offre au profil du client dès le début de la relation d'affaires, par exemple en fixant des plafonds d'opérations en lien avec l'activité ou les revenus déclarés du client.
Il est également recommandé de faire figurer le risque de blanchiment du produit de fraudes et d'escroqueries dans la classification des risques et d'en tenir compte dans l'évaluation du profil de risque des clients et dans le dispositif de gestion des risques. Concrètement, il s'agit de déployer des mesures complémentaires pour évaluer précisément le profil des clients à risque élevé et les opérations attendues, par exemple, dans le cas d'une personne morale, les dépenses de personnel et de locaux ou les contributions sociales et fiscales.
D'autre part, une vigilance en temps réel devrait être assurée dans le cadre des dispositifs de surveillance des opérations atypiques, de façon à pouvoir suspendre les opérations dans l'attente de la réalisation des diligences nécessaires pour écarter tout soupçon de blanchiment par l'utilisation d'un compte rebond. Si le doute n'était pas levé au terme de l'examen, l'ACPR appelle à émettre immédiatement une déclaration de soupçon.
Enfin, l'Autorité incite les organismes financiers à analyser les opérations ayant fait l'objet de soupçons afin d'identifier et de corriger d'éventuelles défaillances dans les dispositifs de LBC-FT.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : FIXER UNE DÉFINITION LÉGALE DU COMPTE REBOND ET IMPOSER AUX ORGANISMES FINANCIERS LA MISE EN oeUVRE DE MESURES DE VIGILANCE RENFORCÉES ET DE SIGNALEMENT EN CAS DE SOUPÇON
Le présent article propose de modifier en deux points le code monétaire et financier dans le souci de mieux lutter contre les comptes rebonds.
Le 1° vise à compléter l'article L. 561-5, qui impose aux organismes financiers une obligation d'identification et de vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif, dans l'objectif :
- de contraindre ces organismes à mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées lorsque les informations disponibles au moment de l'entrée en relation laissent apparaître un risque d'utilisation du compte ouvert comme compte rebond ;
- de définir le compte rebond comme « tout compte bancaire ou de paiement utilisé de manière transitoire pour recevoir des fonds, avant leur transfert rapide vers un ou plusieurs autres comptes, sans justification économique apparente ni cohérence avec la relation d'affaires, notamment dans le cadre de schémas de blanchiment ou d'escroquerie visant à entraver la traçabilité des flux financiers ou à dissimuler l'origine et les bénéficiaires effectifs des fonds » ;
- d'obliger les organismes financiers, lorsqu'ils sont amenés à mettre en oeuvre, dans ce cadre, des mesures de vigilance renforcées, à procéder à la déclaration du compte concerné au registre national des comptes rebonds, dont l'article 6 de la présente proposition de loi prévoit la création.
Le 2° tend à réécrire l'article L. 561-6, qui impose aux organismes financiers une obligation de vigilance constante et d'examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d'affaires, et ce afin de :
- supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles ces organismes exercent leur vigilance ;
- procéder à une clarification rédactionnelle relative à la nature des organismes concernés - le droit en vigueur comportant une imprécision à cet égard découlant de la scission, en 2016, de l'ancien article L. 561-6 et de la création de l'article L. 561-5-1 et visant « ces personnes » plutôt que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 » ;
- supprimer la borne fixée dans ce cadre aux organismes financiers, qui exercent leur vigilance « dans la limite de leurs droits et obligations » ;
- imposer aux organismes financiers de mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées lorsqu'un compte présente les caractéristiques d'un compte rebond et, le cas échéant, de procéder à la déclaration du compte concerné au registre national des comptes rebonds.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : POUR RÉPONDRE À LA LÉGITIME INQUIÉTUDE FACE AU DÉVELOPPEMENT DES COMPTES REBONDS, PROPOSER D'INTERDIRE AUX ORGANISMES FINANCIERS D'EXÉCUTER CERTAINES OPÉRATIONS SANS EXAMEN PRÉALABLE DE LA PART D'UN PRÉPOSÉ
La commission relève en premier lieu que la fixation d'une définition légale du compte rebond peut s'avérer problématique.
Comme l'a noté l'ACPR, qui y est défavorable, « compte tenu de l'inventivité des réseaux criminels et de leur capacité élevée d'adaptation, se fixer sur des schémas trop spécifiques et en figer la définition dans la loi rendrait le nouveau dispositif inopérant assez probablement »73(*).
De même, M. Thibaut Herrero, chef du bureau en charge de la lutte contre la criminalité financière de la direction générale du Trésor, a rappelé qu'il était délicat de fixer dans la loi des pratiques en constante évolution : « La nécessité de s'adapter rapidement aux nouveaux risques et menaces est contradictoire avec la fixation de leur définition dans la loi »74(*).
Selon la direction générale du Trésor, la définition prévue par le texte recouvrirait des utilisations parfaitement légitimes de comptes bancaires ou de paiement, dans la mesure où les notions de « justification économique apparente » et de « cohérence avec la relation d'affaires » apparaissent particulièrement subjectives. Ainsi un particulier multi-bancarisé prévoyant des virements automatiques vers d'autres comptes bancaires lui appartenant dès réception de son salaire ou à date fixe ferait-il l'objet d'un signalement, de la même façon qu'une entreprise gérant sa trésorerie répartie entre plusieurs comptes bancaires dans différents pays ou qu'une société appartenant à un groupe et gérant les liquidités d'autres sociétés dudit groupe.
Pour finir, une telle définition engloberait des modèles d'activité tout à fait légitimes tels que ceux des acquéreurs - des prestataires de services de paiement chargés de traiter des opérations de paiement pour le compte de commerçants en leur reversant des paiements sur leur compte bancaire -, ce qui pénaliserait leur activité, pourtant fortement supervisée.
D'autre part, le dispositif proposé est d'ores et déjà largement satisfait par le droit en vigueur.
De fait, l'article L. 561-10-1 du code monétaire financier prévoit la mise en oeuvre par les organismes financiers de mesures de vigilance renforcées lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, ce qui recouvre manifestement les cas de soupçon d'utilisation d'un compte comme compte rebond.
En outre, doivent être déclarées à Tracfin par les organismes financiers les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, sont liées au financement du terrorisme ou proviennent de certains types de fraude fiscale75(*). Il en va de même, le cas échéant, à l'issue de l'examen renforcé prévu par la réglementation en cas d'opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite76(*).
Enfin, selon l'ACPR, il est difficile d'identifier un risque d'utilisation du compte comme compte rebond dès l'entrée en relation. Il serait plus judicieux de refuser l'entrée en relation, le cas échéant, que d'ouvrir le compte et de le déclarer à un registre national : « Si les doutes sur le client et la motivation économique de l'ouverture du compte est forte, l'établissement ne doit pas ouvrir de compte. Ce qu'il est important de développer, c'est la vigilance sur les opérations pour détecter le plus rapidement possible les opérations suspectes et être mesure de les bloquer »77(*).
En revanche, l'attention du rapporteur a été attirée sur les risques induits en la matière par la recherche, par certains organismes financiers, de réduction de leurs coûts de fonctionnement par l'automatisation ou la sous-traitance, qui leur permettent d'éviter de faire intervenir des personnels qualifiés.
Par conséquent, la commission a adopté un amendement COM-10 du rapporteur visant à traduire dans la loi la proposition formulée par l'ACPR en la matière. Celui-ci réécrit le présent article :
- en conservant la clarification rédactionnelle prévue par le dispositif initial à l'article L. 561-6 du code monétaire et financier ;
- et en complétant ce même article de façon à imposer aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d'interfaces automatisées de déterminer, pour chaque type de service de paiement, les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE
6
Création d'un registre national des comptes rebonds
Le présent article prévoit la création d'un registre national des comptes rebonds, géré par la DGFiP et accessible aux autorités judiciaires, aux services d'enquête et aux organismes financiers.
Les organismes financiers seraient tenus de déclarer auprès de ce registre les comptes identifiés comme comptes rebonds, dès l'entrée en relation et tout au long de la relation d'affaires.
Au surplus, il ne serait plus permis d'effectuer un virement à partir d'un nouveau compte bancaire ou de paiement avant l'expiration d'un délai d'activation de 72 heures et les organismes financiers seraient contraints d'exercer une surveillance renforcée à l'égard de tout nouveau compte, et ce pendant 30 jours à compter de son activation.
Les organismes qui ne respecteraient pas ces obligations seraient passibles de sanctions administratives et financières et engageraient leur responsabilité civile en cas de préjudice causé à une victime d'escroquerie.
Dans la mesure où l'article 1er de la proposition de loi n° 496 (2024-2025) visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, en passe d'être adoptée conforme par le Sénat, après l'avoir été par l'Assemblée nationale, prévoit déjà la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, la commission a adopté un amendement de suppression du présent article, qui se trouverait dès lors satisfait par un dispositif d'application plus générale.
La commission des finances a supprimé cet article.
I. LE DROIT EXISTANT : PLUSIEURS OBLIGATIONS LÉGALES PERMETTENT DE LIMITER LE RISQUE D'UTILISATION DE COMPTES REBONDS, MAIS IL N'EXISTE PAS DE REGISTRE NATIONAL EN LA MATIÈRE
Le droit en vigueur permet d'ores et déjà aux organismes financiers de limiter les risques d'utilisation de leurs produits ou services comme comptes rebonds :
- obligation d'identification et de vérification de l'identité des clients78(*) ;
- obligation de recueil et d'actualisation des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires79(*) ;
- obligation de vigilance constante et d'examen attentif des opérations effectuées80(*) ;
- obligation de mise en oeuvre de mesures de vigilance simplifiées81(*), complémentaires82(*) ou renforcées83(*) en fonction du niveau de risque ;
- obligation d'examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite84(*) ;
- obligation d'émission d'une déclaration de soupçon ou d'éléments d'information vers Tracfin dans certaines situations85(*) (voir le commentaire de l'article 5 de la présente proposition de loi).
En revanche, il n'existe à ce jour aucun registre spécifique centralisant les signalements de comptes rebonds.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CRÉER UN REGISTRE NATIONAL DES COMPTES REBONDS ET SANCTIONNER LES ORGANISMES FINANCIERS NE DÉCLARANT PAS LES COMPTES REBONDS DÉTECTÉS
Le présent article tend à insérer, dans le livre V du code monétaire et financier, un titre VI bis intitulé « Registres nationaux de traçabilité des comptes à risque », lequel serait composé d'un chapitre unique dénommé « Registre national des comptes rebonds » et incluant trois articles :
- un article L. 565-1 instituant un registre national des comptes rebonds, géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et reposant sur la définition du compte rebond proposée par l'article 5 de la présente proposition de loi. Ledit registre serait accessible aux autorités judiciaires, aux services d'enquête et aux établissements financiers dans le cadre de leurs obligations de vigilance. Les comptes identifiés comme comptes rebonds devraient y être enregistrés sans délai, avec une mise à jour en temps réel. Du reste, il est proposé qu'aucun virement ne puisse être effectué à partir d'un nouveau compte bancaire ou de paiement ouvert par une personne physique ou morale avant l'expiration d'un délai d'activation de 72 heures et que les organismes financiers soient tenus de mettre en oeuvre une surveillance renforcée pendant les 30 jours suivant l'activation d'un compte ;
- un article L. 565-2 obligeant les organismes financiers à mettre en oeuvre des dispositifs de détection des comptes présentant les caractéristiques d'un compte rebond et à procéder sans délai à la déclaration de tout compte identifié comme tel auprès du registre national des comptes rebonds. Cette obligation s'appliquerait dès l'entrée en relation et pendant toute la durée de la relation d'affaires ;
- un article L. 565-3 posant le principe, d'une part, de l'application de sanctions administratives et financières en cas de non-respect de ces obligations par les organismes financiers et, d'autre part, de l'engagement de la responsabilité civile de l'organisme concerné en cas de préjudice causé à une victime d'escroquerie du fait de l'absence de détection ou de signalement d'un compte rebond découlant d'un défaut de mise en oeuvre des mesures de vigilance et de transmission au registre national.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF SATISFAIT PAR UN TEXTE EN COURS DE NAVETTE ET SUR LE POINT D'ÊTRE DÉFINITIVEMENT ADOPTÉ
Adoptée par l'Assemblée nationale le 31 mars 2025, la proposition de loi (n° 496, 2024-2025) visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a été votée sans modification par la commission des finances du Sénat le 22 octobre dernier, selon la procédure de législation en commission. Son adoption définitive pourrait donc être confirmée dès la séance publique du 29 octobre 2025.
Son article 1er vise à permettre le partage entre les prestataires de services de paiement d'informations relatives aux comptes suspects par la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), dont la gestion serait confiée à la Banque de France.
Il prévoit ainsi que ces prestataires, ainsi que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), transmettent à la Banque de France, en vue de leur inscription au FNC-RF, les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt qu'ils estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude, de même que les éléments caractérisant la fraude ou suscitant la suspicion de fraude.
En tout état de cause, l'inscription au FNC-RF des informations relatives à un compte n'emporterait pas d'interdiction de réaliser des opérations de paiement sur ce compte et ne justifierait pas, à elle seule, la clôture de ce dernier. À la suite du signalement, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue du compte serait toutefois tenu d'effectuer sans délai l'ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux.
Ainsi, comme l'ont souligné tant l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) que la direction générale du Trésor, le champ de cette mesure serait très proche de celui du dispositif prévu par la présente proposition de loi, qui pourrait donc être satisfait par son adoption conforme par le Sénat.
Il convient par ailleurs de rappeler, comme l'a fait l'ACPR, qu'il n'est pas possible d'identifier à l'avance un compte qui servira de compte rebond. Dès lors, « si les doutes sur le client et la motivation économique de l'ouverture du compte est forte, l'établissement ne doit pas ouvrir de compte »86(*).
Enfin, selon M. Anselme Mialon, chef du bureau des services bancaires et des moyens de paiement à la direction générale du Trésor, le régime de responsabilité prévu par le présent article créerait un aléa moral et irait à l'encontre de la réglementation européenne en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement, qui doit être développée en 2026 dans le cadre de la nouvelle directive sur les services de paiement (DSP 3).
Du reste, il serait particulièrement lourd d'imposer aux organismes financiers la mise en oeuvre de mesures de vigilance renforcées pendant les 30 jours suivant l'activation de tout nouveau compte bancaire ou de paiement.
Sur la base de ces considérations, la commission se déclare de nouveau favorable à l'adoption sans modification de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire et a donc, par voie de conséquence et par coordination, adopté un amendement COM-11 du rapporteur supprimant le présent article, satisfait par le droit à venir.
Décision de la commission : la commission des finances a supprimé cet article.
ARTICLE
7
Définition législative du terme de
néobanque et obligation pour ces dernières de faire l'objet
d'un audit externe annuel
Le présent article prévoit l'ajout d'un article au code monétaire et financier, qui prévoit :
- d'une part, de définir le terme de néobanque, comme tout établissement de crédit ou prestataire de services de paiement agréé dont l'activité est exercée exclusivement en ligne sans point de contact physique, et dont les procédures d'entrée en relation sont entièrement automatisées ;
- d'autre part, d'astreindre les néobanques ainsi définies à effectuer un audit externe annuel relatif à la conformité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les travaux menés par le rapporteur indiquent que la typologie juridique actuelle qui permet, en droit bancaire, de définir les différents établissements selon leur agrément et les services qu'ils peuvent offrir, apparaît robuste et cohérente. Ainsi, le terme de néobanque ne trouverait pas à s'insérer efficacement dans le droit.
La commission a donc supprimé cette partie de l'article.
Par ailleurs, des échanges entre le rapporteur et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), il ressort que plutôt que d'astreindre certains établissements à effectuer un audit externe annuel, il pourrait être pertinent de donner la possibilité à l'ACPR d'exiger qu'un établissement sous sa supervision effectue un tel audit.
Tel est le sens de l'amendement, de réécriture globale de l'article, adopté par la commission.
La commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : LA TYPOLOGIE EXISTANTE POUR CARACTÉRISER LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES EST ROBUSTE ET LEUR SUPERVISION EST EXPRESSÉMENT PRÉVUE PAR LA LOI
A. LA TYPOLOGIE ACTUELLE NE DÉFINIT PAS LE CONCEPT DE NÉOBANQUE
1. Les définitions permettant de caractériser les différents établissements bancaires
Le code monétaire et financier (CMF) prévoit, en la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, un corpus de définitions directement inspiré du droit européen et qui permet de distinguer les différents prestataires de services bancaires selon des critères robustes.
L'article L. 511-1 du CMF indique ainsi qu'il existe deux types de prestataires de services bancaires :
- d'une part les établissements de crédit, tels que définis au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- d'autre part les sociétés de financement, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.
Les établissements de crédit reçoivent un agrément différent en fonction de leur statut et des services qu'ils sont en droit d'offrir. L'article L. 511-9 du CMF prévoit ainsi l'existence de plusieurs types d'agrément :
- les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
- les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
- les établissements de crédit et d'investissement peuvent effectuer toutes les opérations dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Sans obtention d'un agrément, aucun établissement ne peut exercer, en accord avec les dispositions de l'article L. 511-10 du CMF.
Le droit définit enfin, en sus des différents types de prestataires de services bancaires, des entités appelées prestataires de services de paiement.
Un prestataire de services de paiement (PSP) est une entreprise spécialisée dans le traitement des paiements électroniques, qui agit comme un intermédiaire entre le commerçant en ligne et les clients, facilitant ainsi le processus de transaction.
Le droit français, de même, définit ces PSP en établissant, à l'article L. 521-1 du CMF une typologie des structures existantes, en fonction de leur activité. Il existe ainsi :
- des établissements de paiement ;
- des établissements de monnaie électronique ;
- des établissements de crédit ;
- des prestataires de services d'information sur les comptes.
Les prestataires de services de paiement ne sont pas tous des établissements de crédit.
2. Le terme de néobanque n'existe pas actuellement dans la loi et est même combattu par le régulateur
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est en charge de l'agrément et de la surveillance des établissements bancaires. Définie à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, elle a pour mission, principalement :
- d'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
- d'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes qui relèvent de sa compétence ;
- de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle ;
- de veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du CMF.
À ce titre, l'ACPR veille notamment à ce que les différents vocables définissant les prestataires de services bancaires et les prestataires de services de paiement soient respectés. Ceci tend ainsi à protéger les clients de ces établissements contre toute tromperie et à maintenir la confiance dans le système bancaire.
Devant l'usage répété du terme de « néobanque » à des fins commerciales, l'ACPR a ainsi, en avril 2021, diffusé des règles87(*) rappelant les contraintes régissant l'usage d'un tel terme.
L'ACPR rappelle que le mot « banque » correspond à une notion définie par le Code monétaire et financier et que, pour maintenir la confiance des citoyens dans le système bancaire, il convient de ne pas utiliser ce terme à mauvais escient.
En ce sens, une « néobanque » doit d'abord être une « banque », c'est-à-dire entrer dans la définition posée à l'article L. 511 1 du CMF.
L'ACPR rappelle que l'emploi du mot de « banque » ou « d'établissement de crédit » pour qualifier une entreprise non bancaire, parmi lesquels les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et leurs distributeurs, est interdit par la législation.
L'article L. 511-8 du CMF précise en effet qu'« il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière ».
Il apparaît donc que, dans le droit existant, la notion de néobanque n'existe pas. Elle constitue un néologisme dont l'objet est avant tout commercial.
B. L'EXISTENCE D'UN CONTRÔLE EFFECTIF DE L'ACPR SUR LES ENTITÉS AGRÉÉES, QUEL QUE SOIT LEUR STATUT
1. L'ACPR exerce un contrôle général sur les entités auxquelles elle accorde un agrément, au sein du Mécanisme de surveillance unique européen
Depuis 2014, la Banque centrale européenne (BCE) assure la surveillance, directe ou indirecte, des établissements bancaires dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique (MSU).
L'ACPR coopère dans ce cadre avec la BCE, dans l'objectif de maintenir la stabilité financière de la Zone euro.
Ainsi, aux termes de l'article 6 du règlement MSU n° 1024/201388(*), la BCE exerce une surveillance directe sur les établissements bancaires dits « importants ». Cette supervision est effectuée par des équipes de surveillance conjointe composées d'agents de la BCE, de l'ACPR et des autres autorités nationales où les banques ont des activités. Les onze institutions dites « importantes » en France totalisent 86 % des actifs du secteur bancaire français.
Le contrôle de l'ACPR s'exerce en amont de l'entrée sur le marché des acteurs par la délivrance des agréments nécessaires à la proposition de services bancaires et de paiement. Par exemple, l'article L. 511-10 du CMF prévoit qu'en application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 la BCE agrée les établissements de crédit, sur proposition de l'ACPR.
Le contrôle de l'ACPR s'exerce ensuite pendant toute la durée d'activité des entités qui relèvent de sa compétence. Listées à l'article L. 612-2 du CMF, ces entités sont notamment :
- des établissements de paiement ;
- des établissements de monnaie électronique ;
- des établissements de crédit ;
- des prestataires de services d'information sur les comptes ;
- les sociétés de financement.
L'ensemble des entités définies dans le CMF et qui constituent la typologie des prestataires de services bancaires et des prestataires de services de paiement sont donc contrôlés par l'ACPR.
Comme l'indique l'Autorité dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, « les établissements intervenant en ligne sont soumis à la même réglementation que les autres établissements de paiement ou de crédit ».
Par conséquent, la summa divisio quant aux modalités de contrôle, au regard de l'ACPR, ne dépend pas du vecteur par lequel la relation d'affaire a lieu mais bien de l'agrément dont dispose l'établissement contrôlé, de sa taille et de l'opportunité du contrôle.
L'article L. 612-23 du CMF prévoit que les contrôles de l'ACPR ont lieu sur pièce et sur place. L'ACPR peut ainsi exiger, conformément à l'article L. 621-24 du CMF, que lui soient transmis périodiquement un certain nombre de documents. Quant aux contrôles sur place, ils donnent lieu à un rapport, conformément à l'article L. 612-27 du CMF, et peuvent être étendus aux filiales de la structure contrôlée ainsi qu'à de nombreuses autres entités qui lui sont liées, comme l'indique l'article L. 612-26 du CMF.
Par conséquent, les pouvoirs de contrôle de l'ACPR sont étendus et permettent une sécurisation efficace du secteur bancaire.
2. Ce contrôle s'exerce, en particulier, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
S'ils sont classiquement soumis à l'ensemble des règles de solvabilité et de respect de leur agrément, la plupart des entités sous la supervision de l'ACPR sont en outre assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Ainsi, comme l'indique l'ACPR dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, « l'article L. 561-2 du CMF liste les entités assujetties aux obligations de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, soumises au contrôle de l'ACPR en vertu des articles L.612-1, L.612-2, et L.561-36 » du même code.
On retrouve ainsi dans les entités soumises à ces obligations LCB-FT un grand nombre des établissements de la typologie décrite au 1 du A du I du présent commentaire :
- les établissements de paiement ;
- les établissements de monnaie électronique ;
- les établissements de crédit ;
- les prestataires de services de sur crypto-actifs ;
- les entreprises d'investissement.
Ces entités sont tenues de mettre en oeuvre l'ensemble des obligations de LCB-FT. Celles-ci comprennent notamment la compréhension des risques auquel l'établissement est exposé89(*), l'identification et la vérification de l'identité de la clientèle90(*), la connaissance suivie des relations d'affaires91(*) de l'établissement, les déclarations d'opérations suspectes à Tracfin après avoir procédé à leur examen renforcé92(*), la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs ainsi que l'élaboration de procédure et la mise en oeuvre d'un contrôle interne93(*) périodique et permanent.
L'ACPR peut donc sanctionner les établissements94(*) qui n'effectuent pas de déclaration de soupçon, ne mettent pas fin à une relation d'affaire ou n'adaptent pas leur niveau de vigilance en fonction de l'identification du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA DÉFINITION LÉGISLATIVE DU TERME DE NÉOBANQUE ET L'OBLIGATION D'UN AUDIT EXTERNE ANNUEL POUR CES DERNIÈRES
A. LE TEXTE PRÉVOIT DE CRÉER UN NOUVEAU TYPE D'ÉTABLISSSEMENT BANCAIRE DANS LE DROIT : LA NÉOBANQUE
L'article 7 de la proposition de loi prévoit d'insérer, après l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, un nouvel article L. 561-32-1 qui définit la notion de néobanque.
Selon les termes de l'article proposé, une néobanque serait :
- un établissement de crédit ou un prestataire de services de paiement agréé ;
- dont l'activité est exercée uniquement en ligne, sans point de contact physique et dont les procédures d'entrée en relation sont entièrement automatisées.
Il s'agit donc de cibler des établissements qui possèdent déjà un agrément et entrent donc dans le champ de contrôle de l'ACPR mais qui n'opèrent que par une relation virtuelle avec leurs clients.
B. L'IMPOSITION D'UN AUDIT EXTERNE ANNUEL AUX NÉOBANQUES
L'article 7 prévoit également, dans le nouvel article L. 561-32-1 du CMF qu'il propose d'introduire, d'obliger les néobanques à se soumettre à un audit externe annuel.
Aux termes de l'article, l'audit porterait sur la conformité de leurs dispositifs opérationnels, techniques et organisationnels aux obligations LCB-FT.
Un décret pris par le ministre de l'économie, après un avis de l'ACPR, permettrait de préciser les modalités de l'audit. En particulier, un tel décret pourrait probablement décrire le contenu possible de cet audit, les structures habilitées à le réaliser ainsi que la structure responsable d'assumer les coûts de cet audit.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : RENFORCER LE POUVOIR DE CONTRÔLE DE L'ACPR SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES SANS DÉFINIR UNE NOUVELLE CATÉGORIE DANS LA LOI
A. LA DÉFINITION LÉGISLATIVE DU TERME DE NÉOBANQUE NE SEMBLE PAS NÉCESSAIRE
1. La typologie actuelle pour désigner les différents établissements inclut les établissements agissant uniquement par voie dématérialisée
Les réponses obtenues par le rapporteur aux questionnaires qu'il a envoyé à la Fédération bancaire française et à l'ACPR tendent toutes à montrer que l'intégration dans la loi du terme de néobanque n'est pas nécessaire aujourd'hui pour cibler les établissements agissant par voie dématérialisée.
En effet, comme l'indique la Fédération bancaire française (FBF), « le terme « néobanque » est liée au caractère novateur de [leurs] activités, qui demain ne le seront plus. Les modalités d'exercice des « néobanques » sont d'ailleurs reprises dans des banques « traditionnelles ». Ce terme n'a donc pas vocation à être inscrit dans un texte de loi. »
Selon le représentant des principales banques françaises, il n'est pas significatif que l'activité soit opérée entièrement en ligne, dans la mesure où même les établissements qui opèrent de longue date sur la place tendent à automatiser de plus en plus certaines procédures, en rendant de plus en plus virtuelle la relation d'affaire.
L'ACPR indique de même qu'il « ne semble pas opportun de créer, pour les besoins d'un seul article, une nouvelle catégorie d'entité assujettie, alors que celles-ci sont listées et définies à l'article L.561-2 qui couvre d'ores et déjà les entités visées par ce terme ».
L'Autorité est d'autant plus défavorable à cette inscription dans la loi qu'elle vient contredire directement la mise au point sur l'utilisation du terme néobanque effectué en 202195(*). En effet, la définition proposée utilise le mot banque pour désigner des prestataires de service de paiement qui ne disposent pas tous d'agrément bancaire. Ceci risquerait même d'être source de confusion, comme l'estime l'ACPR.
Le rapporteur estime ainsi que le corpus de définitions actuel dans le droit bancaire est satisfaisant. La distinction faite entre les différents établissements correspond aux différents services qu'ils sont en droit de proposer à leurs clients, et non en fonction de l'existence ou non de points de vente physique.
2. La définition proposée par la proposition de loi ne vise pas les facteurs de risque les plus déterminants et il serait aisé de s'y soustraire
En outre, la définition proposée pour les néobanques ne semble pas, pour l'ACPR, « retenir les facteurs de risque les plus déterminants ». Le fait d'opérer uniquement en ligne, par des processus dématérialisés et au moyen d'interfaces numériques automatisées n'est en effet pas forcément un facteur d'aggravation du risque.
Lors de l'audition de Tracfin, le rapporteur a pu constater que le service de renseignement pouvait coopérer de façon très efficace avec des banques en ligne. Selon les auditionnés, le fonctionnement par interfaces numériques facilite la transmission rapide d'informations. Certains acteurs plus traditionnels, moins souples dans leur gestion et leur gouvernance, seraient ainsi moins réactifs et efficaces, en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, que les établissements qui seraient qualifiés de « néobanque » si la définition était maintenue.
La définition proposée, en outre, risque d'être rapidement contournée, comme l'indique l'ACPR dans ses réponses au questionnaire du rapporteur. En effet, les établissements visés pourraient se soustraire à l'obligation d'un audit annuel simplement par « la création d'un unique point de vente physique dont l'activité serait plus ou moins avérée ».
Il apparaît donc que les critères proposés s'insèrent avec difficulté dans le droit existant et reposent sur une analyse qui ne permet pas de cibler véritablement les acteurs défaillants.
3. Le risque d'une anomalie française dans le droit communautaire
En sus des difficultés tenant à la lettre de la définition proposée, une problématique d'insertion dans le droit bancaire communautaire a été soulevée par la direction générale du Trésor lors de son audition par le rapporteur.
Selon elle, la définition de « « néobanque » [...] para[ît] problématique » en ce qu'il s'agirait d'un principe défini « au niveau national, et non dans une réglementation européenne ».
Le droit bancaire étant de plus en plus d'application directe, la création de nouvelles notions uniquement au niveau national poserait inévitablement des difficultés en lien avec l'objectif d'une concurrence équitable96(*) dans le marché commun.
Les prestataires de services de paiement, opérant uniquement par voie dématérialisée mais établis dans d'autres États-membres de l'Union européenne, pourraient ainsi avoir une activité en France par le biais de la libre prestation de services sans être assujettis à l'obligation que crée l'article d'un audit externe annuel sous la supervision de l'ACPR.
B. PLUTÔT QU'UNE OBLIGATION ANNUELLE D'AUDIT, PERMETTRE À L'ACPR D'IMPOSER UN AUDIT EXTERNE AUX ÉTABLISSEMENTS ENTRANT DANS SON PÉRIMÈTRE DE SUPERVISION
1. Le contrôle de l'ACPR sur les entités visées par le présent article est déjà robuste
Comme l'indique la FBF dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, l'ACPR « exerce déjà une surveillance étroite sur les établissements de crédit et de paiement, y compris des établissements visés à cet article ».
Comme démontré précédemment, l'ACPR bénéficie en effet d'un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces et peut imposer des mesures correctrices en cas de défaillance repérée dans un établissement sous son contrôle. Ce pouvoir concerne aussi bien les établissements opérant exclusivement en ligne que les autres.
En plus de ses contrôles, l'ACPR agit par la publication de guides qui permettent aux établissements de prendre des mesures efficaces pour l'épauler dans son activité de supervision. Le Guide « contrôle interne » diffusé par l'ACPR et que cite la FBF dans ses réponses au questionnaire du rapporteur, promeut ainsi une organisation en trois lignes de défense :
- une première au niveau des opérations quotidienne, avec des contrôles de premier niveau au contact des clients ;
- une deuxième est constituée par les fonctions de support internes à l'entité, qui initient et conçoivent les contrôles que les employés en fonctions opérationnelles mettent en oeuvre.
- une troisième est constituée, enfin, de fonctions d'audit interne à l'entité.
En outre, certains établissements peuvent déjà faire l'objet d'un audit externe comme par exemple lors de la certification des comptes annuels qui permet d'interroger sur l'efficacité des dispositifs LCB-FT.
Par conséquent, le déploiement d'une nouvelle obligation d'audit externe pour les problématiques LCB-FT ne semble pas adapté. La FBF indique ainsi que « le dispositif législatif français appliqué aux établissements de crédit, complété par les publications des autorités, est suffisamment robuste pour permettre la couverture des risques visés par cette proposition de loi ».
2. Il pourrait toutefois être utilement complété par la possibilité pour l'ACPR d'exiger la tenue d'un audit externe pour les établissements qu'elle supervise, plutôt que de prévoir une obligation générale aux néobanques
Les échanges du rapporteur avec l'ACPR l'ont mené à comprendre que, s'il était superflu de soumettre l'ensemble des établissements opérant en ligne à un audit externe annuel, il pourrait être en revanche utile de confier à l'ACPR un pouvoir de diligenter des audits externes chez certaines entités défaillantes.
Comme l'indique l'Autorité, l'étendue de son champ de supervision ne se limite pas aux prestataires de service de paiement et aux prestataires de services d'investissement. Par conséquent, il serait cohérent de donner à l'ACPR la possibilité d'exiger la tenue d'un audit externe pour l'ensemble des entités relevant de son champ de contrôle. Ce pouvoir serait large et comprendrait ainsi le champ de la LCB-FT.
Une telle évolution des pouvoirs de l'ACPR est conforme à l'approche par les risques et permettrait de réagir rapidement en cas de risque élevé ou de défaillance connue dans un établissement sous contrôle. Le coût de l'audit serait mis à la charge de la structure tenue de l'effectuer et l'entité qui le réaliserait devrait obtenir l'accord de l'ACPR.
Ceci évite de faire supporter à l'ensemble de la communauté contrôlée par l'ACPR le coût de l'analyse des défaillances d'un des membres, tout en facilitant un suivi plus étroit de la correction rapide des défaillances identifiées.
Selon l'ACPR, un tel audit externe serait notamment très utile pour « établir la mesure exacte des infractions » d'une entité défaillante, comme par exemple le nombre de comptes concernés. Ceci permettrait à l'Autorité de décider de sanctions disciplinaires proportionnées et dissuasives.
Si les articles L. 561-36-3 et L. 612-39 du code monétaire et financier permettent déjà à l'ACPR d'imposer des sanctions fondées sur l'avantage financier qu'une entité défaillante a pu retirer de l'infraction, « la quantification de ces avantages nécessite des diligences coûteuses auxquelles un audit externe permettrait de remédier97(*) ».
Une mesure semblable est d'ailleurs en cours de discussion pour l'Autorité des marchés financiers98(*). Il serait ainsi cohérent d'assurer des pouvoirs de même nature à ces deux structures de contrôle.
Pour autant, les échanges du rapporteur avec la direction générale du Trésor ont montré que la question de la concurrence équitable se posait aussi devant la possibilité d'octroyer un pouvoir nouveau à l'ACPR.
En effet, il est compréhensible que l'octroi de pouvoirs supplémentaires à l'autorité de supervision, qui plus est lorsqu'il s'agit de mettre à la charge d'une entité défaillante la réalisation d'un audit externe, pourrait réduire l'attractivité de la France, notamment pour les activités bancaires et d'assurance.
Le rapporteur propose donc cette mesure, tout en restant attentif aux résultats que pourraient donner une expertise plus approfondie du dispositif, dans l'objectif de garantir un cadre plus sécurisé sans entraver la capacité de la France à attirer de nouveaux acteurs financiers.
Tel est l'objet de l'amendement COM-12 présenté par le rapporteur.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
TITRE
V
RENFORCER LE RÔLE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
ARTICLE
8
Renforcement des pouvoirs de contrôle des greffiers des
tribunaux de commerce
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois99(*).
À l'initiative de son rapporteur Hervé Reynaud, la commission des lois a adopté un amendement ( COM-6) qui précise les finalités des contrôles effectués par les greffiers des tribunaux de commerce.
L'article initial, qui visait à légitimer l'action des greffiers des tribunaux de commerce en indiquant que leurs contrôles des titres d'identité étrangers dans le cadre d'une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) visaient à prévenir les risques de fraude.
L'amendement prend en compte le fait que ces contrôles peuvent également revêtir d'autre objectifs, tels que la préservation de la qualité de l'information publiée : il précise donc que l'objectif de prévention des fraudes n'en est pas la finalité exclusive.
Il supprime par ailleurs le II de l'article initial, qui est satisfait par le droit existant.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE
9
Expérimentation permettant aux greffiers des tribunaux de
commerce d'accéder aux données cadastrales
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des lois100(*).
À l'initiative de son rapporteur Hervé Reynaud, la commission des lois a adopté un amendement ( COM-7) qui sécurise l'expérimentation prévue par l'article 9 d'un accès direct des greffiers des tribunaux de commerce aux données cadastrales.
L'amendement limite cet accès aux seules finalités de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il prévoit en outre que les modalités de mise en oeuvre de cet accès sont organisées de manière à garantir la traçabilité des consultations.
Il impose, de plus, la conclusion d'une convention entre l'administration fiscale et les trois greffes expérimentateurs définissant les conditions d'accès aux données.
Il instaure, enfin, une entrée en vigueur de l'article le 1er janvier 2027, la création d'un accès direct aux données cadastrales supposant d'importants travaux préparatoires.
Décision de la commission : la commission des finances a adopté cet article ainsi modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 29 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a examiné le rapport de M. Stéphane Sautarel, rapporteur, et élaboré le texte de la commission sur la proposition de loi n° 877 (2024-2025), pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment.
M. Claude Raynal, président. - Nous terminons par l'examen du rapport de M. Sautarel sur la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, présentée par Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis des articles délégués au fond à la commission des lois.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - Cette proposition de loi s'inscrit dans le sillage de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, qui a montré l'ampleur des enjeux de la lutte contre le blanchiment et la criminalité organisée. Elle entend ainsi renforcer notre arsenal législatif sur un certain nombre de thématiques : la lutte contre les entreprises éphémères, le renforcement des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce, ou encore l'obligation de déclaration des comptes bancaires à l'étranger pour les sociétés commerciales.
Dans sa version initiale, la proposition de loi comprend neuf articles. Quatre d'entre eux - les articles 2, 3, 8 et 9 - ont été délégués à la commission des lois. Ce texte s'ajoute à la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, qui commence à produire ses effets, ainsi qu'à la proposition de loi relative à la fraude bancaire et au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Cette accumulation conduit chaque texte à ne traiter qu'une partie du problème, créant parfois des redondances.
L'article 1er vise un double objectif : d'une part, il prévoit d'inscrire dans la loi un certain nombre de critères de définition d'une entreprise éphémère ; d'autre part, il impose aux professions soumises à la réglementation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) - notamment aux greffiers des tribunaux de commerce -l'obligation d'effectuer auprès de Tracfin un signalement, si des éléments laissent présumer l'existence d'une telle société.
Il ressort de nos auditions que les services de lutte contre le blanchiment sont très réticents face à l'inscription dans la loi d'une définition des entreprises éphémères. En effet, il existe déjà un guide relatif à ces sociétés qui est partagé entre les services d'enquête et diffusé largement par la Mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf) ; en outre, il est actualisé à mesure que les pratiques évoluent.
Par conséquent, l'article 1er se révélerait contre-productif, en permettant à la fois aux entreprises fraudeuses de mieux échapper aux radars des services de contrôle et en ralentissant la capacité d'adaptation de ces derniers aux évolutions des pratiques criminelles. Par ailleurs, l'obligation de déclaration de soupçon à Tracfin des professions soumises à la réglementation LCB-FT est d'ores et déjà satisfaite par le droit existant.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose, avec l'amendement COM-8, de supprimer l'article 1er.
La commission d'enquête sur la délinquance financière a montré que, en l'état actuel du droit, les sociétés commerciales ne sont nullement obligées de déclarer à l'administration fiscale les références des comptes ouverts, détenus ou clos à l'étranger. Pourtant, cette obligation incombe aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés non commerciales domiciliées ou établies en France. Dans ce contexte, l'article 4 supprime cette exception et étend l'obligation déclarative aux sociétés commerciales. En outre, il inscrit dans la loi la transmission par l'administration fiscale des déclarations de soupçon à Tracfin.
L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger détenus par les sociétés commerciales impliquerait un bouleversement important pour les entreprises et exigerait de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qu'elle adapte son organisation pour stocker, gérer et exploiter ces nouvelles données. En conséquence, je propose, au travers de l'amendement COM-9, de décaler d'un an la mise en oeuvre du dispositif et de supprimer l'obligation pour l'administration de saisir Tracfin de déclarations de soupçon, déjà satisfaite par l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
En outre, une expertise plus poussée sur les conséquences de l'article 4 en matière économique et d'attractivité doit être effectuée. D'ici à l'examen du texte en séance publique, les retours de la part des administrations et des organisations professionnelles permettront d'éclairer l'incidence d'une telle mesure sur l'activité des entreprises en France. Nous devrons sans doute adapter le texte en séance.
L'article 5, quant à lui, tend à définir la notion de compte rebond comme un compte de transit rapide du produit de la fraude permettant d'en dissimuler l'origine ou les bénéficiaires. Il vise en outre à imposer aux organismes financiers de nouvelles obligations en cas de détection ou de suspicion de détection d'un compte utilisé comme compte rebond. Il est ainsi proposé que ces organismes soient tenus de mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées lorsqu'ils identifient un risque en la matière, au moment de l'entrée en relation, et lorsqu'un compte rebond est détecté au cours de la relation d'affaires.
Ce dispositif présente plusieurs difficultés. D'abord, il est en partie satisfait, car le droit en vigueur contraint déjà les organismes financiers à mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées et à adresser une déclaration de soupçon à Tracfin dans un certain nombre de situations, notamment en cas de soupçon d'utilisation d'un compte comme compte rebond.
Ensuite, les acteurs de la lutte contre le blanchiment jugent inopportun de fixer dans la loi une pratique en constante évolution, au risque de voir les fraudeurs s'adapter pour contourner le cadre légal.
Enfin, il est difficile d'identifier un risque d'utilisation d'un compte comme compte rebond dès l'entrée en relation d'affaires. Il serait alors plus judicieux de refuser l'ouverture du compte.
Comme l'automatisation et la sous-traitance induisent une aggravation du risque d'utilisation de comptes rebonds, je vous propose d'adopter l'amendement COM-10, qui vise à remédier à ces vulnérabilités. Nous imposerions ainsi aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d'interfaces automatisées de déterminer les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un agent humain. En outre, nous procéderions à la coordination du dispositif en l'étendant à Wallis et Futuna.
Les services du ministère de l'économie et des finances se sont montrés sceptiques quant à la mise en oeuvre de cette disposition, qui va à rebours de l'évolution technologique du secteur bancaire. Nous devrons donc poursuivre, d'ici à l'examen du texte en séance, un échange constructif pour améliorer l'amendement précité.
L'article 6 crée un registre national des comptes rebonds, géré par la DGFiP et accessible aux autorités judiciaires, aux services d'enquête et aux organismes financiers. Ces derniers seraient ainsi tenus de déclarer les comptes identifiés comme comptes rebonds dès l'entrée en relation d'affaires et pendant toute sa durée.
En outre, il ne serait plus permis d'effectuer un virement à partir d'un nouveau compte bancaire ou de paiement avant l'expiration d'un délai d'activation de 72 heures. Les organismes financiers seraient contraints d'exercer une surveillance renforcée à l'égard de tout nouveau compte, et ce pendant 30 jours à compter de son activation. Les organismes ne respectant pas ces obligations seraient passibles de sanctions administratives et financières et engageraient leur responsabilité civile en cas de préjudice causé à une victime d'escroquerie.
L'objectif visé par cet article est, me semble-t-il, partagé par tous. La semaine dernière, la commission a adopté la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire. Ce texte, en passe d'être voté conforme par le Sénat, prévoit déjà en son article 1er la création d'un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude. Pour en prendre acte, je propose donc, à l'amendement COM-11, de supprimer l'article 6.
Enfin, l'article 7 prévoit l'ajout d'un article au code monétaire et financier qui définit le terme de « néobanque » comme tout établissement bancaire dont l'activité est exercée exclusivement en ligne sans point de contact physique et dont les procédures d'entrée en relation sont entièrement automatisées. Par ailleurs, il astreint les néobanques à effectuer un audit externe annuel relatif à la conformité des dispositifs de LCB-FT.
Les travaux de la commission ont montré que la typologie actuelle des différents établissements définis en droit bancaire permet déjà de les qualifier avec cohérence et efficacité, selon leur agrément et les services qu'ils peuvent offrir. Ainsi, le terme de « néobanque » ne trouverait pas à s'insérer efficacement dans le droit.
Il semble préférable de donner à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la possibilité d'exiger qu'un établissement sous sa supervision effectue un audit externe annuel. Tel est le sens de l'amendement COM-12.
M. Hervé Reynaud, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Pour rappel, nous avons procédé à l'audition en commun d'un certain nombre d'instances de contrôle, afin d'optimiser le temps qui nous était imparti et d'assurer la cohérence de notre démarche.
La commission des lois s'est réunie hier soir pour examiner les articles 2, 3, 8 et 9. Je ne reviendrai pas sur le contexte général dans lequel s'inscrit cette proposition de loi. Ayant participé à la commission d'enquête sur la délinquance financière, je veux m'associer à ses conclusions : la lutte contre les réseaux de blanchiment doit être une priorité d'action absolue pour les pouvoirs publics.
L'efficacité de cette lutte repose largement sur la capacité des autorités à frapper ces réseaux au portefeuille, dès le départ. À cet égard, les quatre amendements que j'avais présentés devant la commission des lois ont été adoptés hier, à l'unanimité. J'ai notamment proposé de sécuriser sur le plan juridique la rédaction de l'article 9 et de supprimer, à l'article 8, des dispositions redondantes avec le droit existant.
En outre, j'ai suggéré de remplacer certains mécanismes d'actions qui ne semblaient pas efficaces. Nous avons ainsi modifié l'article 2 concernant le périmètre des appels à vigilances émis par Tracfin pour permettre aux autorités de contrôle, sur le fondement de l'article L.561-26 du code monétaire et financier, de mieux cibler leurs opérations. Que les choses soient claires : ce qui importe aux autorités n'est pas le flux d'informations, mais la qualité de ces dernières.
À l'article 3, nous avons adopté une mesure de vigilance supplémentaire sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en cas de cession amiable d'une société commerciale. Il s'agit, après avoir entendu les remarques de la direction générale du Trésor et de Tracfin, de ne pas pénaliser la vie économique et d'éviter l'embolie aux diverses structures concernées.
À l'article 8, nous avons précisé que l'objectif de prévention des fraudes n'était pas la finalité exclusive des contrôles. En outre, nous avons supprimé le titre II, qui nous semble satisfait par le droit existant : en effet, l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) est déjà obligatoirement informé des radiations d'office.
Enfin, nous avons précisé, à l'article 9, un certain nombre de mesures et avons décalé leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Mme Nathalie Goulet, auteur de la proposition de loi. - À la suite de la commission d'enquête sur la délinquance financière, dont le rapport a été adopté à l'unanimité, Raphaël Daubet et moi-même avons rédigé un texte assez long pour compléter la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Le président Larcher a proposé de soumettre le texte au Conseil d'État, de façon à s'assurer de sa régularité juridique. Mais cela n'a pas été possible dans les délais, et nous n'avons pu l'inscrire dans le cadre d'un espace réservé.
À force de saucissonner les textes relatifs à la lutte contre la fraude et le blanchiment, les procédures sont tronquées et incomplètes. Par exemple, les dispositifs de lutte contre la fraude sociale ont été intégrés à la fois à la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, déposée par Thomas Cazenave, et au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Bref, les lois que nous votons deviennent illisibles pour les services administratifs, sans compter que le Conseil constitutionnel censure certains dispositifs considérés comme des cavaliers législatifs.
De ce fait, le rapporteur a raison : l'article 6 est redondant. Du reste, j'approuve les dispositions prises pour le renforcement du pouvoir des greffes.
Ma divergence d'appréciation porte sur l'inscription dans la loi d'une définition des entreprises éphémères. Pour rappel, j'ai présenté un amendement en ce sens à trois reprises : lors de l'examen de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, mais aussi dans le cadre de deux PLFSS différents. Si l'article 1er venait à être supprimé, je présenterais de nouveau cet amendement en séance.
Dans le cadre de notre commission d'enquête, les représentants de l'Urssaf et Carole Maudet, sous-directrice du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique à la DGFIP, nous avaient appelés à donner une définition aux entreprises éphémères. Je comprends qu'il puisse y avoir des réticences, comme l'a dit le rapporteur, mais, dans le même temps, beaucoup de personnes ne savent pas à quel point l'entreprise éphémère peut être un vecteur de fraude.
Je tiens à votre disposition le schéma de fonctionnement du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Colb). Alors que le blanchiment s'élève à 50 milliards d'euros, le taux de recouvrement n'est que de 2 %. Il nous faut continuer à progresser dans ce domaine.
Je suis favorable au maintien de l'article 1er, pourvu que l'on modifie sa rédaction, car plusieurs services nous ont demandé de définir les entreprises éphémères. Au passage, je remercie les rapporteurs d'avoir oeuvré au renforcement des dispositifs de sécurisation.
Je regrette infiniment que le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales soit aussi modeste - je pense notamment au volet consacré à la fraude fiscale. Je poserai d'ailleurs une question d'actualité au Gouvernement à ce sujet, tout à l'heure.
Je rappelle que les circuits de criminalité organisée utilisent les failles et les outils de l'évasion fiscale. La présente proposition de loi est peut-être modeste, mais elle a au moins le mérite de mettre en lumière les trous qui existent au sein des dispositifs franco-français.
M. Raphaël Daubet. - La lutte contre la délinquance financière nécessite un basculement culturel. Nous proposons en effet de passer du champ répressif judiciaire, qui a toujours plus de difficultés à rattraper les capacités d'innovation des trafiquants, au champ préventif administratif. Celui-ci a le défaut d'imposer des contrôles, mais il sera à même de limiter les flux financiers illicites.
Les trafiquants, même après avoir purgé leur peine de prison, peuvent continuer à jouir des profits de leur trafic. Voilà pourquoi nous devons nous attaquer à la dimension financière de la criminalité. Tel était l'objet de notre commission d'enquête.
La présente proposition de loi se concentre sur les entreprises. Je regrette, comme Nathalie Goulet, que nous ne parvenions pas à nous accorder au sujet des entreprises éphémères. Il est peut-être risqué d'inscrire leur définition dans la loi, mais nous devons pouvoir intercepter ces ovnis, si j'ose dire, qui sont aujourd'hui vecteurs de trafics et de flux financiers illicites. Les mesures relatives aux comptes rebonds sont également fondamentales pour alerter nos systèmes de contrôle.
L'article 4, qui concerne l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger pour les sociétés, est tout aussi essentiel. Le blanchiment d'argent a une dimension internationale évidente. Aussi, nous devons pouvoir connaître les comptes détenus par les entreprises à l'étranger. J'approuve la proposition du rapporteur de décaler d'un an la mise en oeuvre du dispositif, afin que les services puissent s'organiser.
L'argument consistant à dire qu'il existe un risque d'attractivité pour notre pays ne me paraît pas recevable. Le blanchiment est bel et bien un phénomène d'ampleur internationale profitant parfois à des individus qui résident dans des pays non coopératifs.
S'agissant de l'article 5, l'obligation de définir des critères sur les transactions ou opérations qui nécessiteraient une interface humaine est une bonne chose. Certains nous reprochent de légiférer à rebours de l'évolution technologique du monde bancaire. Au contraire, notre démarche est tout à fait pertinente dans la mesure où l'évolution très rapide de la technologie présente des risques. Grâce aux logiciels d'intelligence artificielle, il sera facile de rester en alerte sur certaines transactions.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les fraudes financière, fiscale et sociale inondent l'actualité et sont souvent fustigées. Dans ce contexte, il est du rôle de l'État de bâtir un arsenal. Or, on lui reproche souvent de fragmenter la législation en ce domaine. J'entends les frustrations des uns et des autres : on finit par se demander si l'envie de lutter contre la fraude est bien la même à tous les niveaux de notre société. Nous manquons à la fois de recul et de vision stratégique. L'État, malheureusement, participe à l'illisibilité des dispositifs.
Bercy avait appelé la commission des finances à faire preuve de prudence concernant l'inscription dans la loi d'une définition des entreprises éphémères. Les demandes en la matière sont contradictoires. Dans ce contexte, nous devons faire de notre mieux pour avancer sur cette question, en évitant de créer des dissensions.
M. Marc Laménie. - Nos services administratifs ont-ils des moyens suffisants pour lutter contre la délinquance financière ? Combien d'agents sont réellement affectés à la lutte contre le blanchiment, qui représente tout de même un manque à gagner compris entre 12 milliards et 20 milliards d'euros ? Quel est, dans ce contexte, le rôle de l'ACPR ?
M. Vincent Éblé. - Ce texte prévoit des outils concrets pour mieux prévenir le blanchiment : sécurisation des structures économiques, repérage d'entreprises éphémères, encadrement des comptes rebonds, transparence accrue des flux financiers, etc.
On l'a dit, nos dispositifs restent trop fragmentés et la criminalité économique exploite ces failles. Voilà pourquoi je me réjouis de cette proposition de loi, qui assure une cohérence d'ensemble en s'appuyant sur les acteurs de terrain - les greffiers, la DGFiP et Tracfin - et impose des obligations de transparence renforcées. L'enjeu est d'améliorer la clarté des dispositifs et la traçabilité. Ainsi, la détection précoce des entreprises éphémères et la création d'un fichier sur les identités frauduleuses constituent des avancées utiles.
Nous sommes pleinement favorables à la justification de l'origine des fonds et la déclaration des comptes étrangers dans la mesure où ces dispositions renforcent la transparence financière . En outre, la vigilance sur les comptes rebonds et les audits des néobanques modernisent notre arsenal face aux nouvelles pratiques numériques. Il faudra toutefois veiller à une mise en oeuvre proportionnée du texte.
La consolidation du rôle des greffes, pivots de la sécurité juridique, est bienvenue. L'expérimentation d'accès aux données cadastrales mérite d'être précisée, mais elle va dans le bon sens, en ce qu'elle permet de croiser les données et de mieux détecter les fraudes immobilières.
Notre groupe soutient ce texte, dans un esprit de responsabilité et d'efficacité, car il renforce la probité économique, traduit une volonté d'action concrète et s'appuie sur la coopération entre institutions plutôt que sur la surenchère normative. Lutter contre le blanchiment, c'est aussi restaurer la confiance dans l'économie légale et dans la République.
M. Grégory Blanc. - D'autres l'ont dit avant moi, il est insupportable de saucissonner les textes visant à lutter contre la fraude. Cela abaisse la qualité du travail législatif et réduit notre capacité à lutter contre la criminalité organisée. Le narcotrafic est un problème bien réel, mais il ne représente qu'une petite partie de l'activité des trafics organisés. C'est bien à l'ensemble des activités des réseaux criminels que nous devons nous attaquer, d'où la nécessité d'agir sur leur dimension financière.
Je suis favorable au maintien de l'article 1er. De nombreuses professions, hormis les notaires et les banques, ont parfois du mal à s'approprier l'obligation de déclaration de soupçons qui leur incombe ; c'est une réalité que nous constatons sur le terrain. Encore une fois, la commission d'enquête sur la délinquance financière a montré la nécessité de donner une définition aux entreprises éphémères. Elle a également mis en lumière l'interpénétration extrêmement puissante entre les réseaux illicites et les activités licites. Autrement dit, une entreprise qui a pignon sur rue peut être en lien avec des activités totalement criminelles.
En outre, si nous voulons mener un combat efficace contre les trafics, nous devons mieux identifier les comptes ouverts à l'étranger. L'ACPR se plaint d'un manque de moyens. Nous devons donc veiller à ce qu'elle puisse matériellement lutter contre le trafic organisé et les réseaux criminels.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - Je prends bonne note des remarques de Nathalie Goulet et Raphaël Daubet. L'article 1er est, de toute évidence, celui qui suscite le plus de controverses. En revanche, les propositions de modification qui portent sur les autres dispositions du texte semblent être approuvées par les membres de la commission.
M. Laménie a raison de poser la question des effectifs. Aujourd'hui, la mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf) dispose seulement d'une dizaine d'agents : c'est en effet bien peu pour impulser des synergies interservices qui constituent l'axe de progression prioritaire aujourd'hui. Cependant, des évolutions positives ont lieu : par exemple, Tracfin est doté de 230 agents, un nombre en hausse de 30 % en cinq ans. En revanche, je ne partage pas complètement les remarques de Grégory Blanc sur les moyens de l'ACPR.
J'en reviens à l'article 1er. Après avoir échangé avec les auteurs du texte et consulté les travaux de la commission d'enquête, j'étais plutôt acquis à l'idée d'inscrire dans la loi la définition des entreprises éphémères. Néanmoins, les travaux que j'ai menés m'ont dissuadé de le faire.
En reprenant l'historique des amendements adoptés par le Sénat sur ce sujet, on se rend compte en outre qu'il se dégage toujours plus un consensus sur le fait que ce n'est pas dans la loi qu'il faille définir les sociétés éphémères. Pour rappel, le premier amendement déposé en ce sens par Nathalie Goulet a été adopté dans le cadre du PLFSS pour 2023, contre l'avis du Gouvernement. Il a été adopté une seconde fois lors de l'examen du PLFSS pour 2025, malgré l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Enfin, il a été présenté lors de l'examen de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, en avril dernier. Je rappelle toutefois qu'il avait été retiré après avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Cette évolution du Sénat vers le rejet de cette mesure ne remet pas en cause l'objectif poursuivi : au contraire, il sera mieux atteint par le moyen d'une définition souple et adaptable.
Je comprends néanmoins que le débat demeure car il n'est pas simple de le trancher. Si nous ne souhaitons pas inscrire la définition des entreprises éphémères dans la loi, aujourd'hui, c'est justement pour rendre le texte plus opérationnel.
Les éléments transmis lors des auditions m'ont en effet convaincu de la nécessité de conserver la souplesse d'une telle définition. La direction générale du Trésor s'est ainsi montrée très réservée, car les phénomènes visés et les entreprises éphémères sont amenés à évoluer constamment. On risquerait aussi de cibler des acteurs ou des pratiques légitimes. De son côté, Tracfin estime que la définition des entreprises éphémères est difficile à mettre en oeuvre.
Les greffiers des tribunaux de commerce, pourtant favorables à une écriture législative en audition, ont indiqué dans leurs réponses écrites qu'il serait certainement judicieux de passer par voie réglementaire. Selon les greffiers, cela permettrait d'adapter le contenu de la définition face à l'évolution rapide des pratiques économiques et technologiques sans nécessiter une révision législative. Cette définition réglementaire pourrait aussi être le fruit d'une concertation technique préalable avec les autorités concernées - soit la direction générale du Trésor, Tracfin et l'ACPR -, ce qui garantirait une mise en oeuvre opérationnelle, cohérente et réactive.
Pour appréhender les sociétés éphémères, les services doivent nécessairement recourir à la technique du faisceau d'indices, notamment recensés par la Micaf dans son guide des sociétés éphémères. Tracfin met déjà en oeuvre ce dernier dans le cadre légal actuel, qui permet, en lien avec les professions déclarantes, d'ajuster les capteurs en fonction de l'évolution du risque.
Si je retiens une évolution législative remontée pendant les auditions, ce serait pour améliorer la supervision LCB-FT des professions autoréglementées, qui effectuent peu de déclarations de soupçons. Le présent texte n'en fait malheureusement pas état.
Vous l'aurez compris, je vous propose de nous en tenir à la suppression de l'article 1er, même si le débat sera probablement rouvert par notre collègue Nathalie Goulet lors de l'examen du texte en séance.
M. Claude Raynal, président. - En vertu du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 29 octobre 2025, le périmètre indicatif de la présente proposition de loi. Ce dernier comprend les dispositions relatives à la définition et la détection des sociétés éphémères ; aux acteurs habilités à effectuer des déclarations de soupçons à Tracfin et les cas dans lesquels de telles déclarations doivent être faites ; aux obligations de déclaration d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature, ainsi que la location de coffres-forts ; à la définition, à la détection et au signalement des comptes rebonds, ainsi qu'aux mesures de vigilance que les organismes financiers doivent mettre en oeuvre en cas de suspicion d'utilisation de leurs produits et services comme comptes rebonds ; à la supervision, dans un but de lutte contre la fraude et le blanchiment, des établissements de crédit et de paiement, ainsi que des prestataires de services de paiement ; aux leviers d'action contre l'usage d'identités fictives ou de prête-noms à des fins de blanchiment ; à la sécurisation du processus de cession amiable des sociétés commerciales face au risque de blanchiment ; au rôle des greffiers des tribunaux de commerce dans le dispositif de lutte contre le blanchiment.
M. Claude Raynal, président. - Je rappelle qu'il est de tradition que la commission saisie au fond prenne acte du résultat des travaux de la commission saisie pour avis sur les articles qui lui ont été délégués. Je vous propose donc d'adopter les amendements COM-4 et COM-5, qui rédigent respectivement les articles 2 et 3, ainsi que les articles 8 et 9 tels que modifiés par les amendements COM-6 et COM-7.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - L'amendement COM-8 tend à supprimer l'article 1er, pour les raisons qui ont été précédemment exposées.
L'amendement COM-8 est adopté.
L'article 1er est supprimé.
Article 2
L'amendement COM-4 est adopté.
L'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
L'amendement COM-5 est adopté.
L'article 3 est ainsi rédigé.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - L'amendement COM-9 vise à reporter l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration contenue dans le texte. Par ailleurs, il tend à supprimer un alinéa déjà satisfait par le droit existant et inclut Wallis et Futuna dans le périmètre d'application du dispositif.
L'amendement COM-9 est adopté.
L'article 4 est ainsi rédigé.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - L'amendement COM-10 a pour objet d'imposer aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d'interfaces automatisées de déterminer celles qui, en raison de leur nature et de leur montant, doivent être contrôlées par l'action d'un agent qualifié humain.
L'amendement COM-10 est adopté.
L'article 5 est ainsi rédigé.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - L'amendement COM-11 vise à supprimer l'article 6, qui est satisfait par la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, en voie d'être définitivement adoptée par le Parlement.
L'amendement COM-11 est adopté.
L'article 6 est supprimé.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - L'amendement COM-12 donne le droit à l'ACPR d'exiger la mise en oeuvre d'un audit externe pour certaines personnes qui relèvent de son champ de contrôle.
Mme Nathalie Goulet. - Je suis absolument favorable à cet amendement. Je précise que les dispositions relatives aux comptes rebonds sont issues du rapport alarmiste publié l'été dernier par l'ACPR, qui ne pensait pas que le législateur s'en saisirait aussi vite.
L'amendement COM-12 est adopté.
L'article 7 est ainsi rédigé.
Article 8
L'amendement COM-6 est adopté.
L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 9
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
L'amendement COM-7 est adopté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 9
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
TABLEAU DES SORTS
|
Article 1er |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. SAUTAREL, rapporteur |
8 |
Amendement de suppression |
Adopté |
|
Article 4 |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. SAUTAREL, rapporteur |
9 |
Obligation pour les sociétés commerciales de déclarer leurs comptes à l'étranger |
Adopté |
|
Article 5 |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. SAUTAREL, rapporteur |
10 |
Obligation pour les organismes financiers de désigner des opérations dans lesquelles un contrôle humain est nécessaire |
Adopté |
|
Article 6 |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. SAUTAREL, rapporteur |
11 |
Amendement de suppression |
Adopté |
|
Article 7 |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. SAUTAREL, rapporteur |
12 |
Octroi du droit à l'ACPR d'exiger des entités défaillantes qu'elles procèdent à un audit externe |
Adopté |
La réunion est close à 12 h 40.
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »101(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la
mention du texte « transmis » dans la Constitution, le
Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport
au contenu précis des dispositions du texte initial,
déposé sur le bureau de la première assemblée
saisie102(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien
matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de
l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la
présence de « cavaliers » dans le
texte103(*). Pour
les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un
« cavalier » toute disposition organique prise sur un
fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial104(*).
En application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 29 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 877 (2024-2025) pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment.
Ce périmètre comprend les dispositions relatives :
- à la définition et la détection des sociétés éphémères ;
- aux acteurs habilités à effectuer des déclarations de soupçons à Tracfin et les cas dans lesquels de telles déclarations doivent être faites ;
- aux obligations de déclaration d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts ;
- à la définition, à la détection et au signalement des comptes rebonds ainsi qu'aux mesures de vigilance que les organismes financiers doivent mettre en oeuvre en cas de suspicion d'utilisation de leurs produits et services comme comptes rebonds ;
- à la supervision, dans un but de lutte contre la fraude et le blanchiment, des établissements de crédit et de paiement ainsi que des prestataires de services de paiement ;
- aux leviers d'action contre l'usage d'identités fictives ou de prête-noms à des fins de blanchiment ;
- à la sécurisation du processus de cession amiable des sociétés commerciales face au risque de blanchiment ;
- au rôle des greffiers des tribunaux de commerce dans le dispositif de lutte contre le blanchiment.
LISTE DES PERSONNES
ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
M. Raphaël DAUBET et Mme Nathalie GOULET, sénateurs, président et rapporteur de la Commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, et auteurs et signataires de la proposition de loi.
Direction générale du Trésor (DGT)
- M. Thibaut HERRERO, chef du bureau Lutte contre la criminalité financière (SECFIN 1) au service des affaires multilatérales et du développement (SAMD) ;
- M. Anselme MIALON, chef du bureau « Services bancaires et moyens de paiement » (BANCFIN 4) au service du financement de l'économie (SFE) ;
- M. David SABBAN, adjoint au chef du bureau BANCFIN 4 au SFE ;
- M. Sofien ABDALLAH, conseiller parlementaire et relations institutionnelles.
Direction générale des finances publiques (DGFiP)
- M. Stéphane CRÉANGE, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB)
- M. Paul HEDON, adjoint au chef de bureau SECFIN 1 au SAMD.
Mission interministérielle de coordination antifraude (MICAF)
- M. Éric BELFAYOL, chef de la mission ;
- Mme Christine FOURNIER, cheffe de projet Enjeux numériques, responsable de l'analyse des données, de la performance, de la synthèse et de l'appui.
Tracfin
- M. Clément LARRAURI, adjoint au directeur ;
- Mme Eve MATHIEN, adjointe à la conseillère juridique.
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
- M. Victor GENESTE, président.
*
* *
- Contributions écrites -
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Direction des Affaires civiles et du sceau (DACS)
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-877.html
* 1 Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société, rapport n° 757 (2024-2025), déposé le 18 juin 2025, fait par Mme Nathalie Goulet et M. Raphaël Daubet.
* 2 Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société, op.cit.
* 3 Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic, rapport n° 588 (2023-2024), déposé le 7 mai 2024, fait par MM. Jérôme Durain et Étienne Blanc
* 4 Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude.
* 5 Ces dizaines de milliards qui gangrènent la société, rapport n° 757 (2024-2025) fait par Nathalie Goulet et Raphaël Daubet, déposé le 18 juin 2025.
* 6 Tracfin, Rapport annuel 2023.
* 7 Réponses écrites de Tracfin au questionnaire de la commission des finances.
* 8 Réponses écrites de Tracfin au questionnaire de la commission des finances.
* 9 Décret n° 2020-872 du 15 juillet 2020 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude et à la création d'une mission interministérielle de coordination anti-fraude.
* 10 Profession assujettie en vertu du 19° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
* 11 Par exemple, cela se manifeste par une croissance rapide de l'activité, une croissance contracyclique par rapport au secteur, une société domiciliée alors que son objet social ne permet pas a priori une domiciliation.
* 12 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
* 13 Article L. 561-2 du code monétaire et financier.
* 14 Selon les modalités prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 15 Chef de la Mission interministérielle de coordination antifraude.
* 16 Réponse du CNGTC au questionnaire de la commission des finances.
* 17 Réponses de Tracfin au questionnaire de la commission des finances.
* 18 Audition de Tracfin par le rapporteur.
* 19 Réponses de Tracfin au questionnaire de la commission des finances.
* 20 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 21 Se reporter à l'avis n° 86 (2025-2026) fait par M. Hervé Reynaud au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2025.
* 22 Se reporter à l'avis n° 86 (2025-2026) fait par M. Hervé Reynaud au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2025.
* 23 Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.
* 24 Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980.
* 25 Article 164 FB de l'annexe IV du CGI.
* 26 Article 164 FC de l'annexe IV du CGI.
* 27 Le numéro SIRET (système d'identification du Répertoire des établissements) est le numéro d'immatriculation de chaque établissement d'une entreprise. Il se compose de 14 chiffres attribués par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le SIRET permet l'identification de chaque établissement par les administrations et organismes publics.
* 28 Article 164 FD de l'annexe IV du CGI.
* 29 Le SIRENE, pour « Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements », identifie toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique ou leur secteur d'activité, implantés en France.
* 30 L'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 précité dresse la liste exhaustive des personnes autorisées à demander et recevoir communication des informations gérées par le FICOBA.
* 31 Article 98 alinéa 2. de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.
* 32 Bulletin officiel des finances publiques, BOI-CF-CPF-30-20.
* 33 Conseil d'État, décision du 4 mars 2019, n°410492.
* 34 COLB, Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France, janvier 2023.
* 35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
* 36 L'article 1649 bis C du code général des impôts indique que cette obligation s'impose à toutes les « personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France » à partir du 1er janvier 2024.
* 37 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 38 Le répertoire SIRENE compte, au total, 13,7 millions d'unités légales enregistrées, comprenant notamment des associations et des sociétés non commerciales, en sus des sociétés commerciales.
* 39 Compte rendu intégral, séance du 9 décembre 1989.
* 40 Article 1649 bis C du code général des impôts.
* 41 À l'article L. 561-27 du CMF.
* 42 Comme le prévoit la proposition de loi.
* 43 ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025.
* 44 Article L. 561-5 du code monétaire et financier.
* 45 Article L. 561-5 du code monétaire et financier.
* 46 Article R. 561-5 du code monétaire et financier.
* 47 Article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.
* 48 Article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
* 49 Article R. 561-5-4 du code monétaire et financier.
* 50 ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025.
* 51 Article L. 561-5-1 du code monétaire et financier.
* 52 Article L. 561-6 du code monétaire et financier.
* 53 Article L. 561-8 du code monétaire et financier.
* 54 Article L. 561-9 du code monétaire et financier.
* 55 Article R. 561-19 du code monétaire et financier.
* 56 Article L. 561-10 du code monétaire et financier.
* 57 Article L. 561-10-1 du code monétaire et financier.
* 58 Article L. 561-5 du code monétaire et financier.
* 59 Article L. 561-5-1 du code monétaire et financier.
* 60 Article L. 561-6 du code monétaire et financier.
* 61 Article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
* 62 Article L. 561-26 du code monétaire et financier.
* 63 ACPR, Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d'escroqueries et autres fraudes, zones de vulnérabilités appelant une attention particulière des organismes financiers les plus exposés à ce risque, juillet 2025.
* 64 Ibid.
* 65 La liste des critères est fixée par l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
* 66 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 67 Article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
* 68 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 69 Article L. 561-15-1 du code monétaire et financier.
* 70 Article L. 561-18 du code monétaire et financier.
* 71 Article L. 561-16 du code monétaire et financier.
* 72 Article L. 561-24 du code monétaire et financier.
* 73 Réponses de l'ACPR au questionnaire de la commission des finances.
* 74 Réponses écrites de la direction générale du Trésor au questionnaire de la commission des finances.
* 75 Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
* 76 Article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
* 77 Réponses de l'ACPR au questionnaire de la commission des finances.
* 78 Article L. 561-5 du code monétaire et financier.
* 79 Article L. 561-5-1 du code monétaire et financier.
* 80 Article L. 561-6 du code monétaire et financier.
* 81 Article L. 561-9 du code monétaire et financier.
* 82 Article L. 561-10 du code monétaire et financier.
* 83 Article L. 561-10-1 du code monétaire et financier.
* 84 Article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
* 85 Articles L. 561-8, L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.
* 86 Réponses écrites de l'ACPR au questionnaire de la commission des finances.
* 87 ACPR, Rappel des règles d'usage du terme « néobanque », avril 2021.
* 88 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
* 89 Article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
* 90 Article L. 561-5 du code monétaire et financier.
* 91 Article L. 561-6 du code monétaire et financier.
* 92 Article L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
* 93 Article L. 561-32 du code monétaire et financier.
* 94 Les pouvoirs de police administrative et les pouvoirs disciplinaires de l'ACPR sont détaillés aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
* 95 ACPR, Rappel des règles d'usage du terme « néobanque », avril 2021.
* 96 L'expression level playing field est couramment employée pour définir cet objectif d'harmonisation de la réglementation économique.
* 97 Réponse de l'ACPR au questionnaire de la commission des finances.
* 98 Article 12 de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière, n° 1818, déposée le mardi 16 septembre 2025 à l'Assemblée nationale.
* 99 Se reporter à l'avis n° 86 (2025-2026) fait par M. Hervé Reynaud au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2025.
* 100 Se reporter à l'avis n° 86 (2025-2026) fait par M. Hervé Reynaud au nom de la commission des lois, déposé le 28 octobre 2025.
* 101 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 102 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 103 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 104 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.