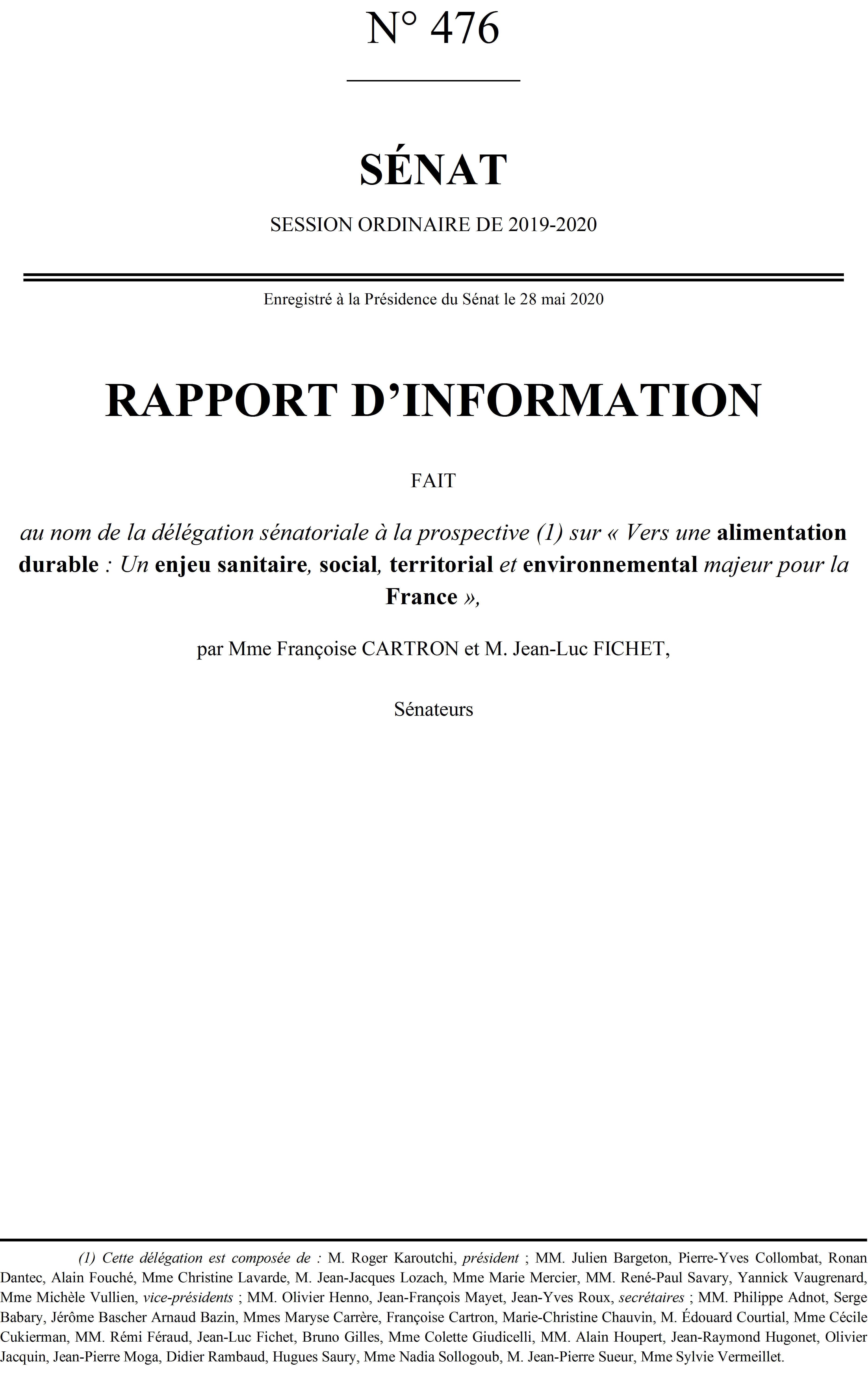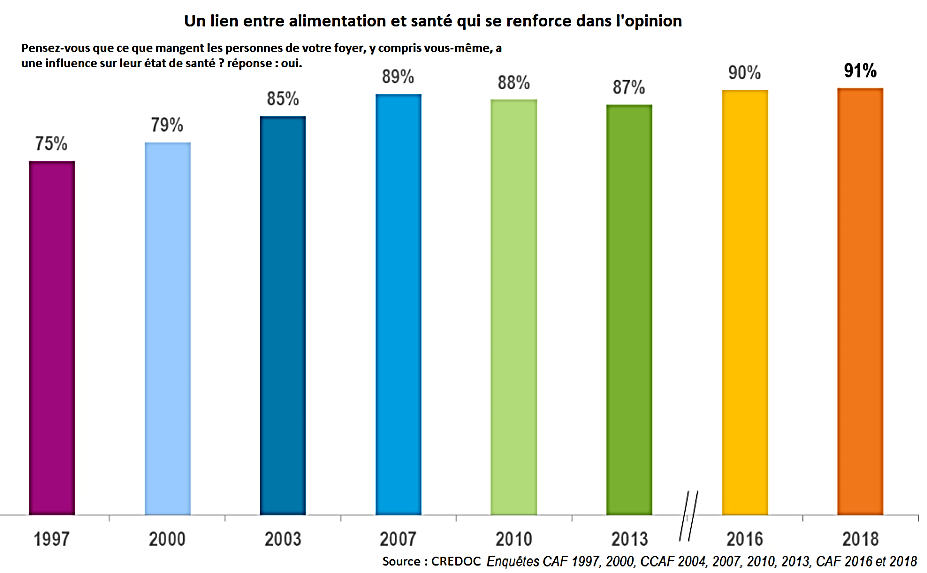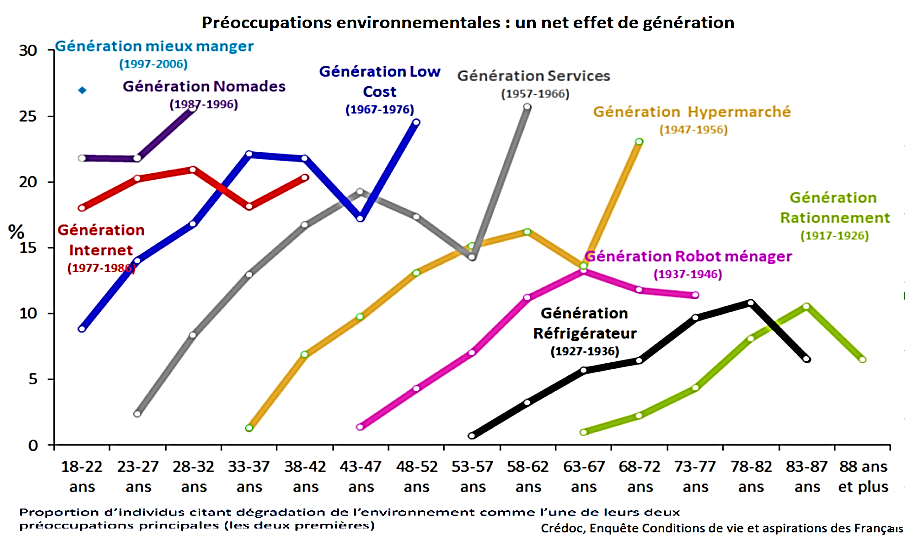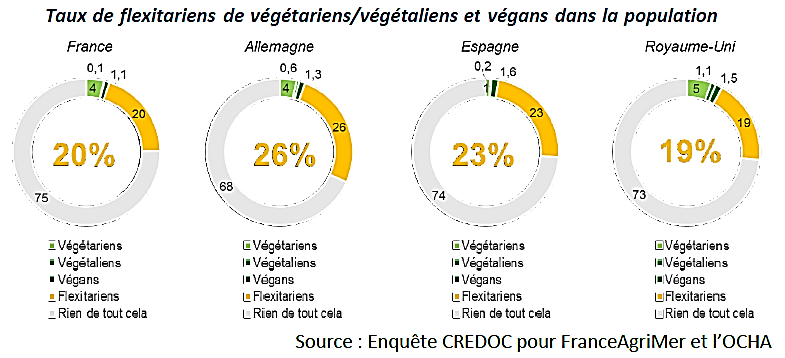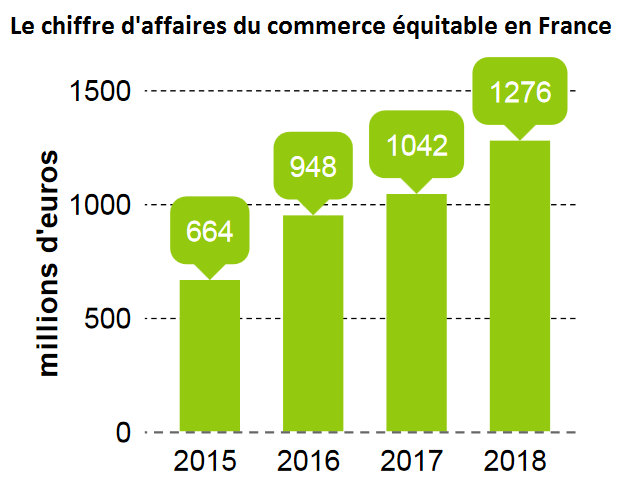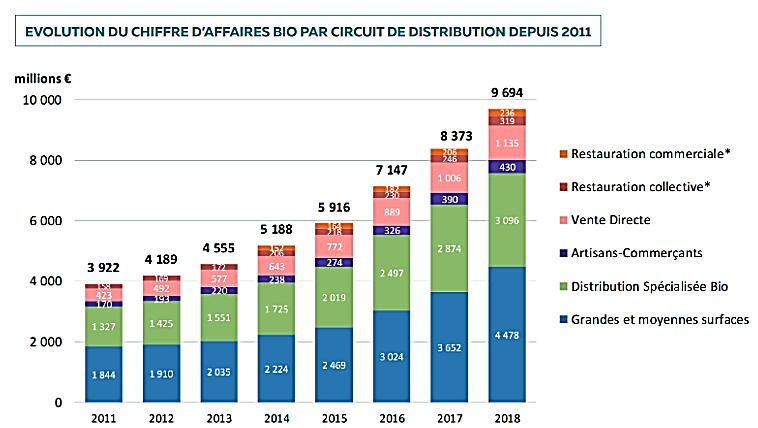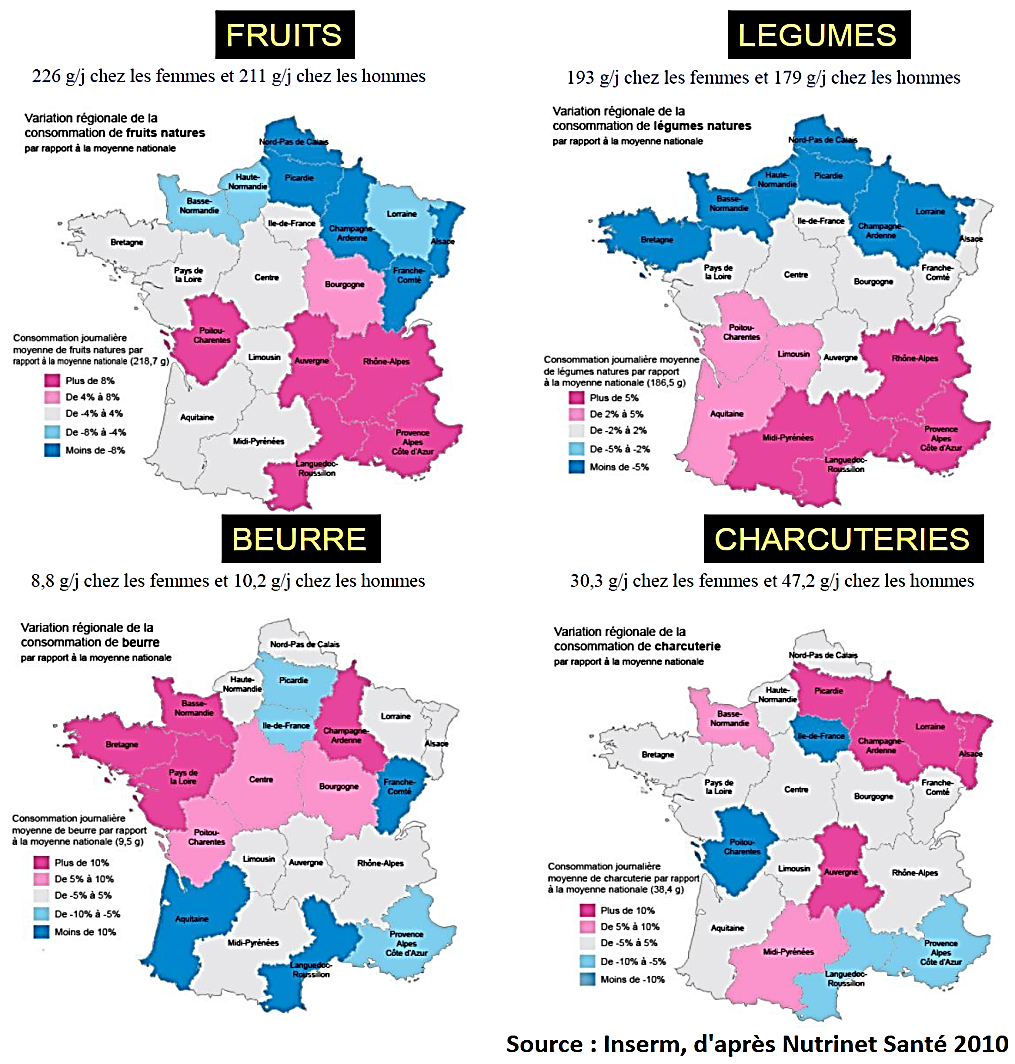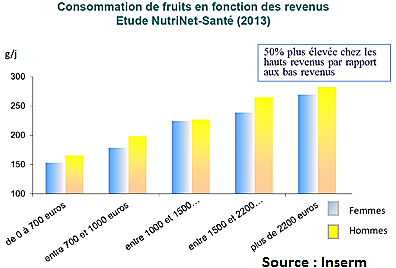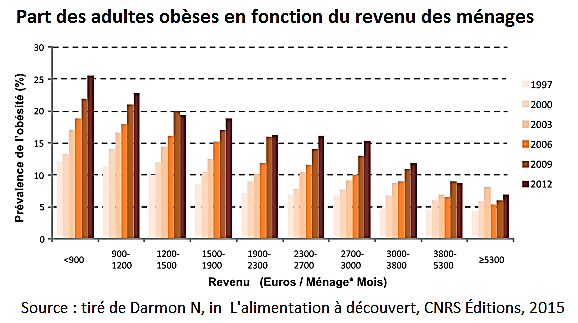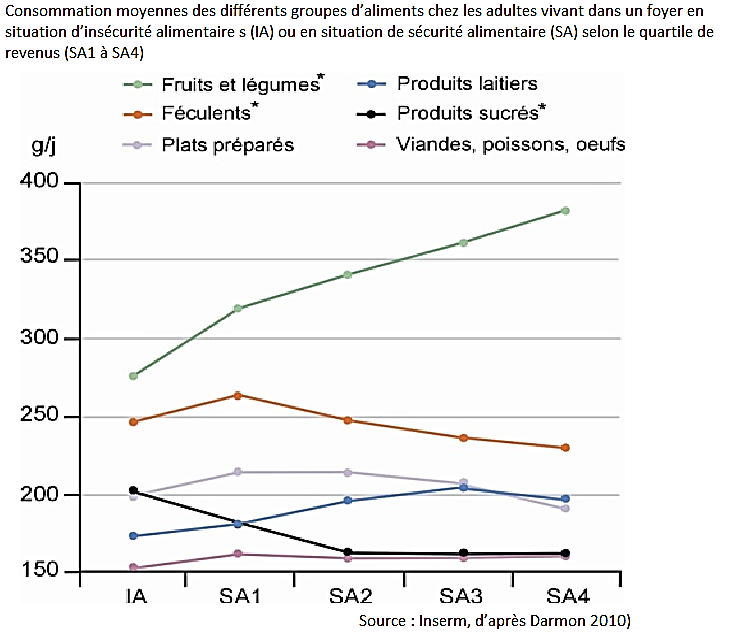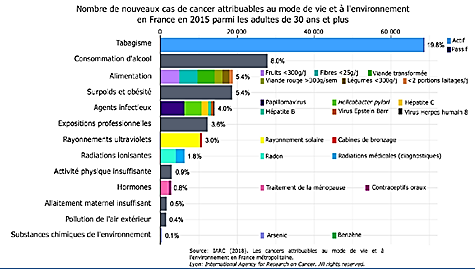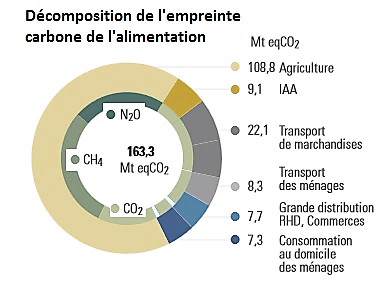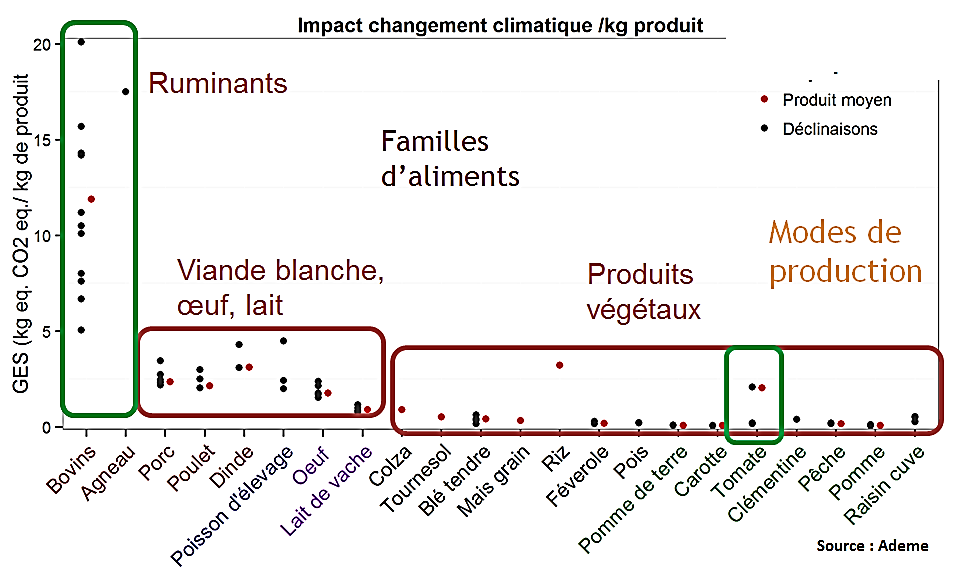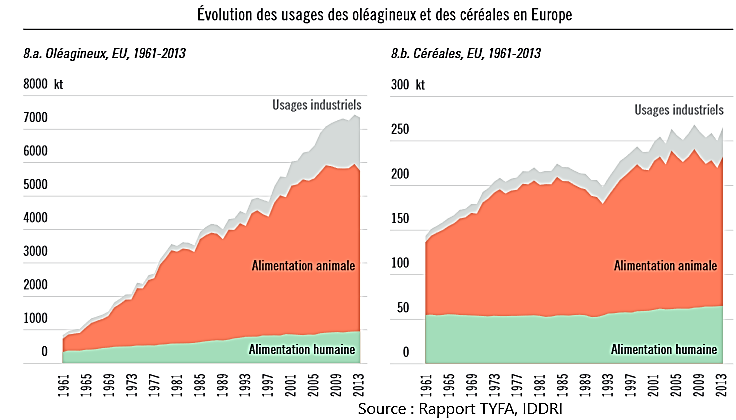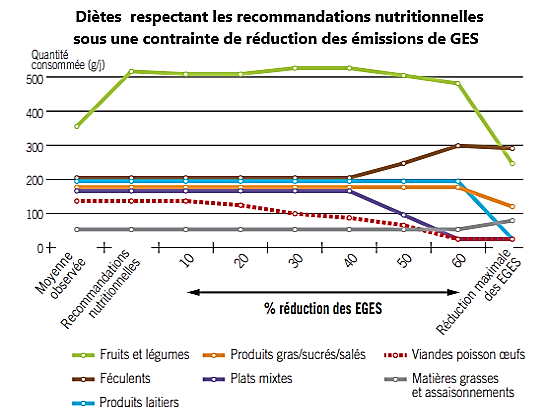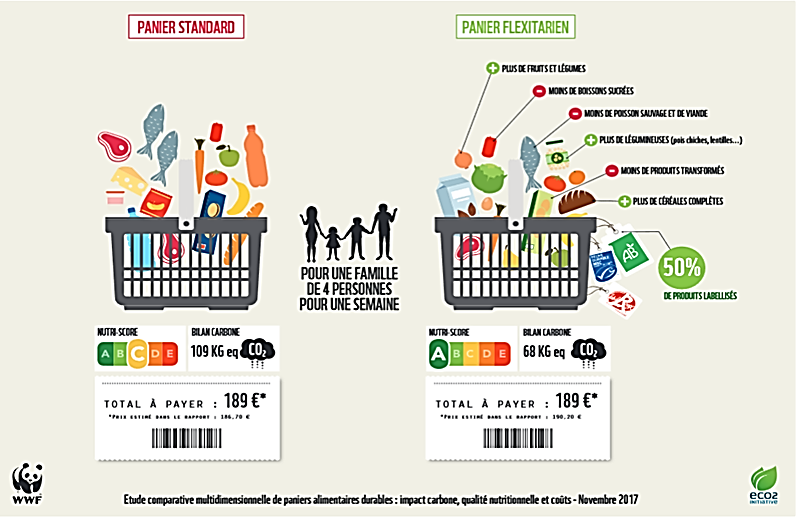Rapport d'information n° 476 (2019-2020) de Mme Françoise CARTRON et M. Jean-Luc FICHET , fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 28 mai 2020
Disponible au format PDF (4,3 Moctets)
Synthèse du rapport (180 Koctets)
-
SYNTHÈSE
-
LES 20 PROPOSITIONS DU RAPPORT
-
PREMIÈRE PARTIE :
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE FRANÇAIS : ÉTAT DES LIEUX, TENDANCES ET PHÉNOMÈNES ÉMERGENTS
-
I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA
TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE
-
A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES
ASSIETTES
-
B. UNE TRANSFORMATION DES LIENS SYMBOLIQUES
À L'ALIMENTATION
-
A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES
ASSIETTES
-
II. DES CHANGEMENTS ANNONCIATEURS D'UNE NOUVELLE
TRANSITION ALIMENTAIRE ?
-
A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ
ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS
-
1. Les redéfinitions contemporaines du bien
manger
-
a) La place croissante des préoccupations
relatives à la santé et au bien-être
-
b) Une montée des préoccupations
citoyennes et éthiques
-
(1) Concernant la prise en compte des enjeux
écologiques
-
(2) Concernant les critères éthiques
relatifs au statut des animaux
-
(3) Concernant les critères relatifs au
partage de la valeur
-
c) Une définition du bien manger plus
complexe
-
a) La place croissante des préoccupations
relatives à la santé et au bien-être
-
2. Un souci de réassurance et de
réappropriation de l'alimentation
-
3. Un recul des produits animaux
-
4. L'essor du bio et des modes de production
agricole durables
-
5. D'autres changements de comportements qui
restent à confirmer
-
1. Les redéfinitions contemporaines du bien
manger
-
B. DU CÔTÉ DE L'OFFRE, UN
FOISONNEMENT D'INNOVATIONS
-
A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ
ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS
-
III. DES INÉGALITÉS FACE À
L'ALIMENTATION
-
I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA
TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE
-
DEUXIÈME PARTIE :
RELEVER LE DÉFI D'UNE ALIMENTATION DURABLE
-
I. UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA
NON-SOUTENABILITÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
-
A. LE RETOUR DE LA QUESTION STRATÉGIQUE DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
-
B. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE
SANTÉ POSÉS PAR L'ALIMENTATION
-
C. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX
ÉCOLOGIQUES DE L'ALIMENTATION
-
A. LE RETOUR DE LA QUESTION STRATÉGIQUE DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
-
II. SOBRIÉTÉ ET
VÉGÉTALISATION : DEUX AXES POUR GUIDER LA TRANSITION
ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE
-
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION
PLUS SOBRE
-
B. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION
PLUS VÉGÉTALISÉE
-
1. La végétalisation de
l'alimentation bonne pour la santé
-
2. La végétalisation est bonne pour
l'environnement
-
a) Les bénéfices écologiques
attendus d'une moindre consommation de viande
-
(1) Inventaire des arguments environnementaux en
faveur de la baisse de produits animaux
-
(2) Une hypothèse centrale dans tous les
scénarios prospectifs sur l'alimentation
-
(3) Des effets mesurables de la
végétalisation de l'alimentation sur les émissions de
GES
-
b) Manger moins de viande, tout en maintenant un
élevage indispensable à la conversion agroécologique
-
(1) Élevage et environnement : des
liens à prendre en compte dans toute leur complexité
-
(2) L'élevage des ruminants permet
d'optimiser l'usage des surfaces agricoles
-
(3) L'élevage extensif contribue à
la biodiversité et fournit de nombreux services
agro-systémiques
-
(4) L'élevage ruminant est un levier
essentiel de l'optimisation du cycle de l'azote
-
a) Les bénéfices écologiques
attendus d'une moindre consommation de viande
-
1. La végétalisation de
l'alimentation bonne pour la santé
-
C. SOBRIÉTÉ ET
VÉGÉTALISATION SONT DES SOLUTIONS DURABLES, MAIS AUSSI
CULTURELLEMENT ACCEPTABLES
-
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION
PLUS SOBRE
-
III. QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE ?
-
A. LA TRANSITION ALIMENTAIRE SERA TIRÉE PAR
LA DEMANDE
-
B. LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
EST UNE DES CLÉS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE
-
C. UNE TRANSITION ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE SANS UN
FORT DÉVELOPPEMENT DES LÉGUMINEUSES
-
1. Les légumineuses : des vertus
uniques permettant de résoudre l'équation de l'alimentation
durable
-
a) Les légumineuses, des aliments sains,
énergétiques et bon marché
-
(1) Des qualités nutritionnelles propices
à une alimentation équilibrée
-
(2) Des aliments riches en énergie
-
b) Des vertus écologiques
-
(1) Les légumineuses et réduction
des quantités d'intrants azotés de synthèse
-
(2) Les légumineuses et la réduction
de l'usage des pesticides
-
(3) Variété et adaptabilité
des légumineuses
-
c) Des aliments capables de s'intégrer
aisément dans toutes les cultures culinaires
-
d) Un potentiel économique qui se
confirme
-
a) Les légumineuses, des aliments sains,
énergétiques et bon marché
-
2. Les légumineuses tiennent une place
centrale dans les prospectives sur le système alimentaire
-
3. Une filière dont le développement
doit être « déverrouillé »
-
a) Un problème de
compétitivité hérité de l'Histoire et
cumulativement renforcé au cours du temps
-
b) Identification des verrous à lever pour
développer les légumineuses
-
(1) Les verrous liés aux savoir-faire et
aux compétences
-
(2) Les retards liés au sous-investissement
dans la recherche variétale
-
(3) Les verrous techniques et logistiques
-
c) Quelle action des pouvoirs publics pour combler
le handicap de compétitivité des
légumineuses ?
-
(1) Rémunérer les
externalités positives générées par la production
de légumineuses
-
(2) Accompagner techniquement la conversion des
agriculteurs
-
(3) Donner un signal clair aux acteurs de la
filière pour orienter les investissements
-
(4) Mesures complémentaires
-
a) Un problème de
compétitivité hérité de l'Histoire et
cumulativement renforcé au cours du temps
-
1. Les légumineuses : des vertus
uniques permettant de résoudre l'équation de l'alimentation
durable
-
A. LA TRANSITION ALIMENTAIRE SERA TIRÉE PAR
LA DEMANDE
-
I. UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA
NON-SOUTENABILITÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
-
ANNEXES
SYNTHÈSE
L'alimentation et, plus largement, les systèmes alimentaires (c'est-à-dire l'ensemble des acteurs et des activités qui concourent à nourrir les êtres humains du « champ à l'assiette »), se situent aujourd'hui à la croisée d'enjeux sanitaires, écologiques et économiques majeurs et fortement interdépendants, qu'on doit aborder de manière systémique, à travers ce qu'il est désormais convenu d'appeler le « nexus alimentation - santé - environnement - agriculture ».
Alors qu'il faut nourrir une population qui devrait atteindre 9 à 10 milliards d'êtres humains vers 2050, il apparaît de plus en plus clairement que les systèmes alimentaires qui se sont développés dans les pays occidentaux au XX e siècle, avant de se diffuser dans de nombreuses parties du monde, ne sont pas durables en termes de consommation de ressources naturelles, d'impacts sur le climat et sur la biodiversité ou encore de santé. Leurs impacts négatifs soulèvent des oppositions croissantes sur le plan politique, social et éthique, mais ils suscitent aussi des doutes croissants quant à leur efficience économique réelle. Le haut niveau de productivité rendu possible par l'intensification de l'agriculture s'est en effet réalisé au prix d'atteintes à la biodiversité et à la qualité des sols, qui érodent lentement mais sûrement le capital productif agricole, compromettant par là-même notre capacité future à produire. Comme l'a indiqué M. Jean-François Soussana, vice-président de l'Inrae, lors de son audition par la délégation, à propos de l'état extrêmement détérioré des sols : « Nous vivons aux dépens d'une banque du sol qui est en train de perdre son capital . »
On peut également s'interroger sur la capacité de résilience des systèmes alimentaires dans un contexte de réchauffement climatique fort et rapide, désormais en grande partie irréversible, qui bouleverse les conditions de la production agricole.
Enfin, on peut se poser la question de la vulnérabilité des chaînes de valeur alimentaires, organisées à une échelle mondiale en fonction d'une logique économique d'avantages comparatifs. Alors que la crise du covid-19 a démontré que la rupture des circuits mondiaux d'approvisionnement pouvait avoir des effets désastreux pour les populations, peut-on accepter une situation de dépendance protéique comme celle que connaissent aujourd'hui la France et l'Europe ?
Le constat des impasses des systèmes alimentaires issus de la transition alimentaire et de la révolution agricole du XX e siècle conduit à rechercher quelles inflexions, voire quelles ruptures, pourraient faire émerger des systèmes alimentaires plus durables. C'est cette question que le présent rapport explore . Il le fait à partir des auditions réalisées, pendant quatre mois, avec plus d'une quarantaine d'experts de ces questions. Il s'appuie également sur de nombreuses études scientifiques, conduites notamment au sein des grands instituts français de recherche. Les travaux de l'Inrae, de l'Inserm, du Cirad ou encore du Cnrs ont apporté une aide précieuse. Alors qu'on peut craindre, au vu du contexte économique, que de nouvelles restrictions budgétaires soient imposées dans les années qui viennent au monde de la recherche, il est important de souligner le rôle majeur que jouent ces institutions non seulement pour faire progresser la science et les techniques, mais aussi pour éclairer le débat public et la décision politique.
* * *
Parce que, pour imaginer l'avenir, il faut connaître le passé et le présent, la première partie du rapport dresse un état des lieux du système alimentaire français. Cette approche n'est pas normative, mais descriptive et analytique. Elle cherche à caractériser notre système alimentaire, à en identifier les tendances structurelles et les transformations émergentes, les éléments de permanence comme les possibilités d'inflexion.
Premier constat : notre alimentation porte encore fortement la marque de la transition alimentaire du XX e siècle. Celle-ci a modifié le contenu de nos assiettes. Nos apports alimentaires sont devenus plus abondants et plus diversifiés. Notre alimentation est devenue plus riche en énergie et en produits animaux, davantage transformée et formulée, et même « ultra-transformée », par l'industrie. La consommation alimentaire hors domicile s'est aussi beaucoup développée, tandis que les temps de préparation des repas à domicile s'est fortement réduit. La part du budget des ménages consacrée à l'alimentation s'est réduite au fil du temps alors même que s'expriment des exigences croissantes en termes de qualité.
En même temps que nos assiettes, ce sont nos liens symboliques à l'alimentation qui ont changé. Le mangeur contemporain, de plus en plus réduit à un rôle de consommateur, ne participe plus guère à la production et à la transformation de ses aliments. Par ailleurs, le desserrement des contraintes économiques et culturelles traditionnelles, qui encadraient jusqu'alors les pratiques alimentaires, a élargi son espace de choix, faisant de l'alimentation l'un des domaines d'affirmation de l'individualisme contemporain tout en étant l'expression de nouvelles communautés. En même temps, et c'est un élément important pour imaginer l'avenir de l'alimentation, la déconnexion entre le mangeur et l'aliment brut, combinée à l'individualisation et à la différenciation croissante des pratiques alimentaires, ont contribué à installer une forme d'anxiété au coeur du rapport à l'alimentation : chacun est renvoyé à la responsabilité de faire les bons choix pour concilier les multiples dimensions du « bien manger », alors même qu'il ne dispose pas toujours des ressources pour faire ces choix.
Il est vraisemblable que nombre des traits actuels de notre alimentation perdureront, car ils sont liés à des tendances sociologiques et économiques lourdes, à une modification de nos modes de vie qui paraît irréversible. Rien n'annonce par exemple un mouvement significatif vers la désurbanisation, la baisse du temps consacré à la mobilité et aux loisirs ou encore un recul du niveau de l'emploi des femmes. Les consommateurs continueront donc à se tourner vers le prêt (ou le quasiment prêt) à manger. On assistera peut-être à un rejet des formes les plus extrêmes de transformation industrielle et à une pression accrue sur les industriels pour accroître la transparence des produits, mais les contraintes de temps ne permettront pas aux ménages de revenir significativement sur l'externalisation des tâches alimentaires. De même, malgré un essor vraisemblable des circuits courts, la concentration en ville d'une population nombreuse continuera sans doute à rendre nécessaire une forme de rationalisation des circuits logistiques alimentaires, avec des intermédiaires (industriels et grossistes) opérant sur des volumes massifs.
En dépit de ces facteurs de permanence, on peut pourtant identifier dans le présent des changements annonciateurs, peut-être, d'une nouvelle transition alimentaire au XXI e siècle. On assiste en effet, dans certains secteurs de la société, à des tentatives de redéfinition du bien manger. Elles se caractérisent par la place croissante donnée aux préoccupations relatives à la santé et au bien-être, par une montée des préoccupations citoyennes (manger écologique, manger éthique, respect des animaux, manger local...). Ces valeurs nouvelles se traduisent déjà par une évolution des pratiques alimentaires : la baisse de la consommation de viande, amorcée dans les années 1980, est une tendance désormais bien établie ; on assiste à l'essor rapide du Bio et des modes de production agricole durables. On voit aussi se développer un intérêt croissant pour les circuits de distribution à taille humaine, de gré à gré ou faiblement intermédiés, notamment les circuits courts. Si ces derniers sont encore, et resteront vraisemblablement, des marchés de taille limitée en volume, répondant à une part minoritaire de la demande, ils pourraient néanmoins jouer un rôle important pour soutenir la montée en qualité de l'offre alimentaire, la diversification de l'agriculture ou encore la lutte contre les inégalités face à l'alimentation. Du côté de l'offre enfin, on observe un foisonnement d'innovations portées notamment par le numérique et l'arrivée d'aliments nouveaux (viande de culture, algues, insectes...).
Comment ces facteurs de changement se combineront-ils avec les tendances à la permanence ? Apporter une réponse aujourd'hui est difficile. En revanche, identifier les évolutions en germe dans le présent est utile pour donner prise à l'action des pouvoirs publics. Comme nous le verrons dans la deuxième partie, ce sont ces derniers, en cherchant à promouvoir une alimentation durable conforme aux grands objectifs des politiques publiques, qui feront peut-être pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.
Un dernier point important souligné dans la première partie du rapport concerne la permanence de différences sociales très marquées dans le domaine de l'alimentation. Malgré la « moyennisation » de la société survenue pendant les Trente Glorieuses, ce qui est consommé, la façon de le consommer et plus largement le rapport culturel à l'alimentation continue à dépendre fortement de la position sociale. De nouveaux marqueurs sociaux de l'alimentation ont même commencé à apparaitre. En particulier, on constate que les régimes alimentaires sains et écodurables progressent, mais essentiellement dans les milieux aisés et diplômés urbains. Les ménages modestes quant à eux concentrent les problèmes de santé liés aux diètes alimentaires trop riches et déséquilibrées héritées du XX e siècle.
* * *
Alors que la première partie du rapport se voulait descriptive, la seconde adopte une perspective normative, en l'occurrence celle des pouvoirs publics qui, sans prétendre régenter l'alimentation de chacun, doivent néanmoins veiller à ce que les comportements alimentaires individuels, globalement et sur le long terme, soient compatibles avec les objectifs des politiques publiques. De fait, cette compatibilité n'existe pas aujourd'hui. Comme on l'a indiqué d'emblée, notre alimentation actuelle n'est pas durable. Son rôle dans les maladies dites de pléthore est aujourd'hui très bien documenté, de même que son implication dans le réchauffement climatique et dans le déclin de la biodiversité. En particulier, l'alimentation, du champ à l'assiette, représente le quart de l'empreinte carbone totale de la France. Réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 et de 75% d'ici 2050, objectif que s'est fixé notre pays, sera impossible sans une évolution profonde du système alimentaire.
Après avoir rappelé de façon détaillée ces constats sévères, qui nous placent dans l'obligation de réagir, la seconde partie du rapport cherche donc à identifier quels sont les axes de transformation à suivre pour aller vers une alimentation plus durable . Nous en identifions deux : la sobriété et la végétalisation . Aller vers plus de sobriété alimentaire, c'est à la fois moins manger et moins gaspiller. C'est le point essentiel, le levier majeur pour diminuer les impacts négatifs de notre alimentation. La végétalisation de nos assiettes, entendue comme un rééquilibrage des apports végétaux et animaux et non comme une exclusion de ces derniers, vient accompagner cette sobriété, pour lui donner son efficacité sanitaire et environnementale maximale.
Sobriété et végétalisation : cela peut sembler simple, voire évident, mais cela ne l'est pas. Le chemin d'une alimentation durable est en effet très étroit. Il doit concilier de multiples critères qui, dans les faits, ont tendance à s'exclure. Rien ne garantit en effet a priori qu'une alimentation bonne pour la santé soit également bonne pour l'environnement, accessible financièrement et acceptable culturellement.
Ainsi, quand on parle d'une alimentation bonne pour l'environnement, encore faut-il savoir à partir de quel critère écologique on établit ce diagnostic. Celui des émissions de GES ? De la consommation des ressources (qualité des sols, surfaces mobilisées, eau) ? De la biodiversité ? Ces différents aspects de la durabilité écologique ne sont pas toujours convergents. Par exemple, remplacer de la viande de boeuf par de la volaille peut avoir un effet positif en termes d'émissions de GES, mais négatif en termes de biodiversité, car, si l'élevage des ruminants est fortement émetteur de méthane, il est aussi propice à la biodiversité quand il est réalisé à l'herbe. Préconiser la végétalisation de l'alimentation ne peut donc se faire que sur le fondement d'une réflexion nuancée concernant la place qu'on entend donner à chaque type de viande et à la façon de produire chacune d'elle.
De même, concilier santé et environnement est possible, mais complexe. Le lieu commun selon lequel une alimentation bonne pour la santé est nécessairement bonne pour l'environnement ne se vérifie pas toujours. Plusieurs études ont pu mesurer que les régimes alimentaires les plus sains, riches en fruits et légumes, pouvaient avoir un impact carbone plus élevé que des régimes malsains. Ils peuvent aussi conduire à mobiliser davantage de ressources foncières du fait de la faible densité énergétique des aliments qu'ils contiennent. Pour renforcer la place des aliments sains dans les régimes alimentaires sans détériorer l'environnement, le choix précis des aliments s'avère donc crucial, ce qui nous renvoie notamment à la question des légumineuses, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Une alimentation durable doit par ailleurs être financièrement accessible à tous. Or, cet autre critère de durabilité introduit lui-aussi un risque de contradiction des objectifs. On a observé en effet que les régimes alimentaires les meilleurs pour la santé et l'environnement avaient tendance à inclure des aliments relativement chers (en termes de coût par Kcal), ce qui les rendait peu accessibles aux budgets modestes. Cette contradiction dessine peut-être l'obstacle majeur à la transition alimentaire : une dualisation des régimes alimentaires, avec des ménages aisés et diplômés pouvant accéder aux aliments les plus durables et des ménages modestes conservant les pratiques alimentaires les plus nuisibles du western diet .
Enfin, dans l'équation complexe d'une alimentation durable, il faut aussi prendre en compte l'acceptabilité culturelle. Si pour manger durable, il faut renoncer à ses traditions culinaires, à ses habitudes alimentaires, à ses goûts et au plaisir de se nourrir, il y a en effet peu de chances que les consommateurs adoptent ces régimes alimentaires.
C'est pourquoi le rapport ne se contente pas simplement d'affirmer qu'il faut aller vers une alimentation plus sobre et plus végétale. Il analyse aussi les conditions dans lesquelles une telle évolution peut effectivement permettre de concilier tous les critères d'une alimentation durable.
Ceci fait, le rapport se termine en examinant ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour favoriser la transition vers cette alimentation durable, plus sobre et plus végétale. Il n'est pas certain en effet que la transition puisse s'accomplir spontanément, sans intervention publique. Deux facteurs de blocage possibles doivent en particulier retenir l'attention.
L'un se situe du côté de la demande. Il concerne les inégalités sociales face à l'alimentation . Il est clair que la transition alimentaire échouera si les régimes durables en voie d'émergence restent l'apanage des milieux sociaux aisés et diplômés. Pour favoriser leur démocratisation, les pouvoirs publics doivent donc lever les barrières à leur diffusion. Barrières culturelles d'abord. Les recommandations nutritionnelles actuelles ayant fait la preuve de leur peu d'efficacité sur les ménages modestes, il est proposé de mettre en place un véritable accompagnement, et même une véritable éducation, alimentaire vers ces publics. Il est indispensable par ailleurs d'accompagner la « responsabilisation » des consommateurs par un réel effort d'assainissement de leur environnement alimentaire. Enfin, en même temps qu'ils lèvent les barrières culturelles, les pouvoirs publics devront aussi lever les barrières économiques, grâce à des incitations ou des aides financières pour accéder à des aliments plus sains, ou en soutenant les innovations sociales portées par les acteurs associatifs et locaux, notamment celles qui permettent de rapprocher consommateurs et producteurs sur un même territoire.
Si les consommateurs s'engagent massivement dans la transition alimentaire, l'offre alimentaire, dans l'ensemble, devrait suivre spontanément. Vos rapporteurs font à cet égard le pari d'une transformation du système alimentaire tirée par la demande. Dans un tel schéma, le rôle des pouvoirs publics devra être d'intervenir de manière ciblée pour débloquer les situations de verrouillage sociotechnique pouvant empêcher l'offre de répondre aux signaux de la demande. Le rapport identifie en particulier une situation de verrouillage de ce type au niveau de la filière « légumineuses » . Ces dernières possèdent des vertus (richesse en protéines de qualité, capacité de fixation symbiotique de l'azote, accessibilité financière, forte densité énergétique, acceptabilité culturelle potentiellement forte) qui en font une des clés de la transition alimentaire du XXI e siècle. Les études prospectives sur l'alimentation préconisent d'ailleurs toutes d'accroître leur place dans nos assiettes et dans les champs. Cette filière se heurte cependant à un problème de compétitivité structurelle, hérité de l'histoire et cumulativement renforcé au cours du temps. Son développement doit donc être « déverrouillé » par une action des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle le rapport se conclut en formulant plusieurs propositions en ce sens, notamment la réorientation des aides de la politique agricole commune (PAC) de manière à rémunérer les services agro-systémiques rendus par les légumineuses et, de façon plus générale, par l'agroécologie.
LES 20 PROPOSITIONS DU RAPPORT
Un enjeu d'indépendance : remettre la sécurité d'approvisionnement au coeur des objectifs des politiques alimentaires.
1. Définir une stratégie d'autonomie protéique des fermes « France » et « Europe » par la reterritorialisation de productions trop dépendantes des importations (cas notamment du soja destiné à l'alimentation animale).
2. Stimuler les investissements dans la recherche de semences plus performantes dans le secteur des protéagineux en donnant aux acteurs une visibilité de long terme sur son développement.
3. Soutenir et encourager les projets alimentaires et agricoles de territoire afin d'accroître la part des approvisionnements locaux dans la consommation régulière, en générant ainsi un développement territorial positif, une qualité optimale des produits et un renforcement de la confiance de tous les acteurs (exemple des AMAP).
4. Impulser une politique foncière permettant l'installation de producteurs locaux.
Un enjeu écologique et économique : encourager le développement de la filière des légumineuses, clé de voûte de la transformation des systèmes alimentaires, pour accélérer la transition agroécologique.
5. Revaloriser l'image des légumineuses en soulignant leur intérêt nutritionnel et écologique. Pour cela, remettre à l'honneur les recettes de légumineuses dans la cuisine du quotidien comme dans la cuisine d'exception grâce à un travail d'éducation du public et de formation des professionnels de la restauration. Renforcer également les recommandations nutritionnelles relatives aux légumineuses dans le PNNS.
6. Réorienter les aides de la PAC pour rémunérer les services agro-systémiques rendus par les légumineuses (réduction de l'usage de l'azote de synthèse et donc des pollutions agricoles diffuses, maintien du couvert des sols, maintien de la biodiversité). Les aides européennes pourraient ainsi favoriser la diversification des cultures, l'allongement des rotations, reconnecter géographiquement les productions animales et végétales et être allouées en fonction d'un travail agricole plus important et non des surfaces cultivées.
7. Encourager les dispositifs de contractualisation au sein de la filière « légumineuses » en conditionnant les aides publiques à l'adoption de contrats de filières sur plusieurs années. L'objectif est de sécuriser les investissements en engageant conjointement les opérateurs en amont et en aval.
8. Encourager les investissements de long terme nécessaires pour développer des variétés de légumineuses plus productives et moins sensibles aux aléas.
9. Renforcer l'adaptation et la résilience de l'agriculture face aux effets du réchauffement climatique grâce à la diversification agroécologique des espèces cultivées et à la recomposition progressive de la géographie des cultures en accompagnant techniquement les agriculteurs à cette conversion.
10. Promouvoir un discours équilibré et apaisé sur la consommation de produits animaux (« en manger moins pour en manger mieux »), en soulignant leur intérêt nutritionnel et en expliquant que des filières d'élevage durables sont un élément-clé de la conversion agroécologique, indispensable à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de la biodiversité.
Un enjeu social et culturel : diffuser les pratiques de consommation durable au-delà des milieux aisés ou diplômés grâce à un programme national Nutrition Santé et Environnement plaçant la lutte contre les inégalités au centre de ses objectifs.
11. Accompagner la promotion de l'alimentation durable pour tous avec le double objectif de sobriété (réduction des apports énergétiques, lutte contre le gaspillage) et de diversification en rééquilibrant les apports végétaux et animaux dans la consommation régulière.
12. Assainir l'offre alimentaire en incitant ou en obligeant à la reformulation des recettes des plats industriels (limitation de sel, de sucre ou de graisses saturées), en régulant l'offre de snacking des distributeurs automatiques, en généralisant l'étiquetage nutritionnel et environnemental, en interdisant les produits affichant un Nutriscore D ou E dans les couloirs promotionnels des grandes surfaces ou encore en régulant la publicité alimentaire télévisuelle ou au cinéma en direction des enfants.
13. Instaurer des dispositifs d'aide financière directe ou indirecte pour réduire le prix des produits alimentaires durables en taxant par exemple certains aliments en raison de leur mauvaise qualité nutritionnelle sur le modèle de la taxe Soda. Le produit de ces taxes pourrait financer des chèques « alimentation saine » sur le modèle du chèque énergie permettant d'acheter fruits ou légumes frais par exemple.
14. Intégrer la dimension d'acceptabilité culturelle et de plaisir dans la défense des régimes alimentaires durables, en soulignant que l'impact sanitaire et écologique de l'alimentation peut être fortement réduit sans bouleverser les habitudes alimentaires (inutile d'éliminer des catégories entières d'aliments ni d'introduire des aliments totalement atypiques).
Un enjeu de santé : faire évoluer les dispositifs de recommandations nutritionnelles et de surveillance de la sécurité sanitaire des aliments.
15. Définir un plan de lutte contre la dénutrition des personnes précaires et des personnes âgées, dont la part dans la population augmente fortement et qui sont très exposées à ce risque pour des raisons physiologiques, psychologiques ou sociologiques.
16. Mieux prendre en compte les risques de malnutrition liés à la diffusion de régimes alimentaires nouveaux (régime vegan, régimes amaigrissants de toutes sortes suivis sans contrôle médical) ou à des pratiques de consommation source d'obésité.
17. Soutenir les efforts de la recherche scientifique indépendante pour mesurer les effets sur la santé des résidus de pesticides de synthèse et des additifs alimentaires utilisés par l'industrie.
18. Faire évoluer les politiques de santé d'un accompagnement alimentaire ponctuel fondé sur le conseil nutritionnel à un accompagnement dans la durée et même à une véritable éducation à l'alimentation durable abordant toutes les dimensions du bien manger : dimension nutritionnelle mais aussi économique (acheter autrement) ou culinaire (préparer autrement).
19. Compléter les recommandations nutritionnelles par des recommandations de bonnes pratiques alimentaires du point de vue écologique.
20. Mettre en oeuvre un portage politique plus ambitieux de la transition alimentaire par les pouvoirs publics. Cette transition doit devenir une des priorités stratégiques affichée de l'État pour atteindre ses objectifs de santé publique et d'environnement.
PREMIÈRE PARTIE :
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE
FRANÇAIS : ÉTAT DES LIEUX, TENDANCES ET
PHÉNOMÈNES ÉMERGENTS
Construire une vision prospective de l'alimentation suppose d'analyser le système alimentaire actuel pour y rechercher les facteurs de permanence ou d'évolution. C'est l'objet de la première partie de ce rapport.
I. UNE ALIMENTATION QUI PORTE LA MARQUE DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXE SIÈCLE
Il s'est produit au cours du XX e siècle une transition alimentaire caractérisée, sur le plan nutritionnel, par une élévation forte de la disponibilité calorique individuelle moyenne et par une diversification du régime alimentaire (avec un recul des céréales et des légumes secs et une augmentation concomitante des apports d'origine animale) 1 ( * ) . Sur un plan économique, cette transition correspond à l'industrialisation du système alimentaire et à son intégration complète aux marchés. L'agriculture est ainsi devenue plus intensive du fait de la mécanisation, de l'utilisation massive d'intrants chimiques et d'une sélection variétale systématique. L'industrie est devenue son débouché principal, tandis qu'un système de distribution, organisé lui-même sur un mode industriel, s'est mis en place pour approvisionner une population de plus en plus urbanisée.
A. UNE MODIFICATION PROFONDE DU CONTENU DES ASSIETTES
1. Des apports alimentaires plus abondants et plus diversifiés
Le régime alimentaire a évolué en suivant les mêmes tendances dans l'ensemble des pays développés, même si la périodisation de ces évolutions varie légèrement en fonction des spécificités nationales. Dans le cas de la France, on observe, dans un premier temps, un fort accroissement de la ration calorique par tête pendant tout le XIX e siècle. Elle passe de 1700 Kcal par jour au début du XIX e siècle à plus de 3000 Kcal par jour avant la Première Guerre mondiale. Cette hausse des apports énergétiques est portée par l'ensemble des types d'aliments, mais ce sont les aliments traditionnels d'origine végétale (céréales et féculents) qui contribuent le plus à l'augmentation et qui restent donc à la base de l'alimentation. Ils représentent encore au début du XX e siècle les deux tiers des apports énergétiques.
À partir du début du XX e siècle, la ration calorique globale se stabilise à ce niveau élevé, tandis qu'un seconde tendance s'affirme : la diversification du régime alimentaire. La consommation de céréales, de féculents et de légumes secs est divisée par plus de deux pour atteindre son minimum dans les années 1980, alors que, dans le même temps, celle de produits animaux, de fruits et légumes, de corps gras et de sucre représente une part croissante des calories absorbées.
Cette diversification alimentaire s'accélère pendant les Trente Glorieuses. La consommation de viande et de poisson double entre 1950 et la fin des années 1980 pour s'approcher de 100 kg par personne et par an pour la première et atteindre 25 kg par personne et par an pour la seconde. La consommation de poisson se stabilise ensuite, tandis que la consommation de viande, après avoir atteint son point culminant à la fin des années 1990, entame ensuite un recul. La consommation de lait et de produits laitiers continue quant à elle à croître pendant quelques années, avant de reculer à son tour.
2. Une évolution du poids respectif de chaque famille de macronutriments
Sur un plan nutritionnel, les évolutions précédentes aboutissent à une baisse des apports glucidiques (leur part passe de 70 à 45 % de l'apport énergétique total entre le milieu du XIX e siècle et aujourd'hui) et à une hausse des apports lipidiques (dont la contribution passe de 16 % à 42 %). Dans les apports lipidiques, on observe en outre une hausse de la part des graisses saturées, souvent d'origine animale. Les apports protéiques restent pour leur part relativement stables (environ 13 % de l'apport calorique total), même si cette stabilité masque un effet de ciseau majeur : l'inversion de la part respective des protéines d'origine végétale et d'origine animale. Cette transition nutritionnelle s'achève dans les années 1980. On observe depuis lors une stabilisation de l'évolution des parts relatives des macronutriments dans l'apport énergétique.
3. Une alimentation de plus en plus fortement transformée
Depuis la première transition alimentaire, les aliments consommés par les êtres humains sont pour l'essentiel des aliments transformés. Dès lors en effet qu'on met en oeuvre un procédé de cuisson, de conservation ou d'extraction, on transforme l'apparence et les propriétés des aliments, notamment d'un point de vue chimique et bactériologique. L'alimentation issue de la quatrième transition alimentaire se caractérise cependant par le fait qu'une proportion très majoritaire des aliments est désormais transformée industriellement . De plus, parmi ces aliments industriels, les aliments ultra-transformés occupent une place croissante.
a) Les ménages ont externalisé la transformation des aliments à l'industrie
La consommation d'aliments transformés industriellement est liée à l'évolution générale des modes de vie : urbanisation, développement de l'emploi des femmes, allongement des trajets domicile-travail, etc. Elle répond au besoin des consommateurs de réduire le temps de préparation des repas. Ainsi, pour se limiter au cas de la France, le temps quotidien moyen consacré à faire la cuisine a été réduit de 18 mn entre 1986 et 2010, passant de 71 à 53 mn (soit un recul de 25 % en 15 ans 2 ( * ) ). Pour répondre à cette demande d'externalisation, l'industrie agroalimentaire a su innover et offrir des produits faciles d'emploi, consommables soit directement, soit moyennant un travail limité de transformation (réchauffage, assemblage). Dès 1960, on estime que 80 % des dépenses alimentaires des ménages étaient déjà issues de l'industrie agroalimentaire 3 ( * ) .
L'industrie agroalimentaire n'en a pas moins continué à se développer fortement dans les décennies suivantes en élargissant son offre grâce à un effort d'innovation incessant. L'Insee fait notamment le constat d'une diversification et d'une complexification des transformations opérées sur les aliments entre les années 1960 et 2000 4 ( * ) . Les surgelés apparaissent et se généralisent au fur et à mesure que les ménages s'équipent en réfrigérateurs et congélateurs. Les plats préparés, formulés de façon plus complexe, se développent considérablement. Ce phénomène concerne toutes les catégories d'aliments. Les légumes, qui sont d'abord vendus en conserves, gagnent le rayon des surgelés, puis intègrent des plats composés. Les produits laitiers sont également consommés sous une forme de plus en plus élaborée 5 ( * ) . Les plats préparés à base de poisson et de viande, inconnus dans les années 1950, se multiplient et font l'objet d'un véritable engouement. Les confiseries, les pâtisseries, les boissons sucrées deviennent des incontournables des rayonnages alimentaires 6 ( * ) . Dans le même temps, la consommation de produits bruts ou frais stagne ou recule.
7 ( * )
b) Une place croissante accordée aux produits ultra-transformés
Une des évolutions marquantes de l'alimentation contemporaine concerne le degré de transformation des aliments. Il s'est produit un passage de la transformation à l'ultra-transformation 8 ( * ) . Les procédés qui conduisent à classer certains aliments dans la catégorie « ultra-transformé » sont par exemple le chauffage à haute température, l'hydrogénation ou le prétraitement par friture. C'est également le recours à des additifs, tels que les colorants, les émulsifiants, les texturants ou les édulcorants 9 ( * ) . Les aliments ultra-transformés incluent par exemple les pains et brioches industriels pré-emballés, les soupes de légumes instantanées en poudre, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs, les sodas et boissons sucrées aromatisées, les nuggets de volaille et de poisson ou encore les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés. De même, les viandes salées, comme les saucisses et le jambon, sont considérées comme des aliments ultra-transformés quand ils incorporent aussi des nitrites et des conservateurs ajoutés.
Ces aliments ultra-transformés représentent désormais plus de la moitié des apports caloriques dans certains pays. En France, ce taux est de 30 à 35 %.
Cette croissance s'explique par le fait que l'ultra-transformation est prisée par les agro-industries pour ses effets sur le goût et l'apparence des produits, ainsi que pour son intérêt en matière de conservation ou de gains de temps pour le consommateur final. On peut souligner qu'elle est par ailleurs fréquemment associée à des formulations riches en sel, sucre et acides gras saturés et pauvres en fibres et vitamines, de sorte qu'en moyenne les aliments ultra-transformés sont d'une qualité nutritionnelle faible.
c) Un essor de la consommation hors domicile
L'essor de la consommation hors domicile est un autre aspect important de la transformation des modes de consommation alimentaire. En 2014, les ménages en France ont consacré à l'alimentation hors domicile 26 % de leur budget alimentaire, soit 59 milliards d'euros, contre seulement 14 % en 1960 10 ( * ) . Alors que les repas hors foyer ne représentaient qu'un repas sur vingt en 1958, ils représentent désormais plus d'un repas sur cinq. Comme le recours aux plats prêts à manger fournis par l'industrie, la prise des repas hors domicile correspond à une forme d'externalisation des tâches alimentaires pour les personnes soumises aux contraintes de temps caractéristiques des modes de vie contemporains. Néanmoins l'encouragement au télétravail suite à la crise sanitaire infléchira peut-être ce type de consommation.
4. Un mix paradoxal de diversité et d'homogénéité
Sur le plan du goût, la transition alimentaire du XX e siècle a débouché également sur un mix paradoxal de diversité et d'uniformité des aliments.
D'un côté, l'intégration aux marchés du système alimentaire et le passage à une organisation industrielle des activités de production, transformation et distribution ont conduit à concentrer l'alimentation sur un nombre très réduit de produits végétaux et animaux de base. Aujourd'hui, 75 % de l'alimentation de l'humanité provient de seulement 12 plantes et 5 espèces animales 11 ( * ) . Ces produits sont de surcroît cultivés ou élevés à partir d'un nombre lui-même très réduit de variétés ou d'espèces, sélectionnées pour leur productivité, leur robustesse ou leur apparence. La transition alimentaire du XX e siècle s'est ainsi accompagnée d'une (quasi) disparition des espèces et des variétés locales. Au cours des cent dernières années, on estime que 90 % des variétés de plantes cultivées ont disparu des champs des agriculteurs.
Cette extrême concentration du sourcing alimentaire sur quelques espèces et quelques variétés n'est cependant pas perçue comme un appauvrissement par les consommateurs et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, la mesure de la diversité alimentaire dépend fortement de l'échelle à laquelle on l'observe. Il y a un siècle, l'offre agricole mesurée à l'échelle nationale était sans doute beaucoup moins standardisée qu'aujourd'hui, puisqu'on comptait dans le pays davantage de variétés de chaque espèce végétale ou animale. Toutefois, comme les circuits d'approvisionnement étaient essentiellement locaux, les consommateurs n'avaient pour leur part accès qu'aux produits locaux. Ils mangeaient donc en réalité à peu près toujours la même chose. À l'échelle individuelle des consommateurs, l'accès à des marchés plus larges a donc permis d'accroître la diversité des approvisionnements.
De fait, un consommateur occidental moyen, dans les grands centres urbains, peut désormais accéder aux aliments de toutes les régions et même du monde entier, même si ces produits ne représentent en définitive qu'une faible part de son alimentation. Il peut également trouver à peu près tous les aliments à tous les moments de l'année en raison d'une désaisonnalisation poussée de l'offre alimentaire. Enfin, même si l'alimentation contemporaine repose très majoritairement sur un petit nombre d'ingrédients de base fortement standardisés, ces ingrédients sont accommodés et présentés sous une telle variété de formes et de styles par les industries de transformation et les professionnels de la restauration que c'est le sentiment de variété qui domine.
B. UNE TRANSFORMATION DES LIENS SYMBOLIQUES À L'ALIMENTATION
La description des pratiques alimentaires ne suffit pas à appréhender complètement la nature des changements opérés par la transition alimentaire du XX e siècle. Il est nécessaire de comprendre aussi ce qui a changé au plan symbolique. À cet égard, deux tendances méritent d'être soulignées : la déconnexion croissante entre le mangeur contemporain et l'aliment brut, ainsi que l'individualisation croissante des consommations alimentaires. Ces deux transformations sont à l'origine d'un troisième phénomène, qui peut sembler paradoxal, mais qui est cependant de plus en plus manifeste : l'installation d'un climat d'anxiété alimentaire.
1. Une déconnexion croissante entre le mangeur et l'aliment brut
Au cours du dernier siècle, le mangeur a été de plus en plus réduit à un strict rôle de consommateur sous l'effet de la transformation globale des modes de vie et de l'allongement considérable des circuits de transformation et de distribution des produits alimentaires. Il ne participe désormais plus à la production agricole, si ce n'est à travers le maintien de pratiques relativement marginales d'auto-consommation. Les circuits locaux d'approvisionnement ont fortement reculé au profit de circuits de transformation-distribution dominés par des entreprises industrielles et des chaînes de grandes surfaces, dont les approvisionnements et les débouchés sont organisés sur une vaste échelle, tant sur le plan géographique que sur le plan des volumes. Même les agriculteurs, du fait de la spécialisation des cultures sont obligés d'acheter dans le commerce une grande partie des produits de la terre, comme n'importe quel autre consommateur.
Non seulement le mangeur occidental du début du XXI e siècle ne participe plus à la production des aliments de base, mais, comme on l'a dit, il a aussi externalisé vers des acteurs spécialisés les tâches de transformation. L'industrie, la grande distribution et la restauration hors domicile lui fournissent du prêt ou du quasiment prêt à consommer, dont il ne connaît presque rien des conditions réelles de production, de transformation et de distribution, hormis les informations, certes utiles mais parcellaires, et parfois trompeuses, que lui fournissent les emballages.
Pour le mangeur réduit au rôle de consommateur, le système alimentaire ressemble donc de plus en plus à une boîte noire. En 2014, un sondage montrait ainsi qu'un Français sur deux dit qu'il a « très souvent » ou « souvent » le sentiment de ne plus vraiment savoir de quoi se composent les produits alimentaires qu'il consomme. 47 % des consommateurs ont aussi le sentiment qu'il est difficile de se procurer des produits alimentaires sur lesquels ils se sentent entièrement rassurés 12 ( * ) .
2. Des consommations alimentaires toujours plus individualisées
La seconde tendance qui modifie profondément le rapport symbolique du mangeur à ce qu'il mange est l'individualisation des consommations. Les contraintes économiques et culturelles qui, tout au long de l'Histoire humaine, ont encadré les pratiques alimentaires, se sont en effet desserrées au XX e siècle, élargissant d'autant l'espace du choix individuel 13 ( * ) :
- l'élévation générale du niveau de vie des ménages au cours du XX e siècle a desserré la contrainte budgétaire et permis de passer d'une culture alimentaire du manque à une culture de la (relative) abondance et de la variété ;
- l'essor de la publicité, de la presse culinaire et gastronomique, le développement du tourisme en régions et à l'étranger, le développement de la mobilité résidentielle et professionnelle ou encore les mouvements migratoires : tous ces phénomènes ont accompagné la hausse du niveau de vie et contribué à l'élargissement et au renouvellement des goûts des consommateurs et au brassage des cultures alimentaires ;
- le jeu de la concurrence a conduit les acteurs de la transformation, de la distribution et de la restauration à étendre considérablement la palette de leur offre pour capter la demande de variété des consommateurs ;
- enfin, l'accélération et la différenciation des temps sociaux ont participé à l'individualisation de l'alimentation à travers leurs effets sur le temps des repas et la commensalité 14 ( * ) .
Ainsi, au cours des dernières décennies, pour un nombre croissant de consommateurs, les pratiques alimentaires sont devenues un espace de liberté. On peut choisir ce qu'on mange, le lieu et le moment où l'on mange et les personnes avec qui on le fait. L'alimentation est devenue un espace d'affirmation de soi, ce qu'on mange servant autant à se nourrir qu'à exprimer un style, un standing, voire même des choix de nature éthique ou politique.
3. Une forme d'anxiété installée au coeur du rapport à l'alimentation
C'est l'un des paradoxes de notre système alimentaire actuel : une part croissante de consommateurs exprime une forme d'anxiété au sujet de leur alimentation, alors même que l'abondance, la diversité et la sûreté sanitaire des aliments n'ont objectivement jamais été aussi bien garanties que dans les sociétés contemporaines. Pour paradoxale qu'elle puisse paraître, cette montée de l'anxiété alimentaire n'est pourtant ni irrationnelle ni étonnante : elle est l'aboutissement de l'individualisation des pratiques alimentaires et de la déconnexion entre sphères de la production-transformation alimentaire, et de la consommation.
De fait, si l'individualisme alimentaire ouvre un espace très apprécié de liberté aux consommateurs, il a aussi pour conséquence de faire peser sur eux la responsabilité de bien ou mal s'alimenter. Dès lors que les régimes alimentaires sont moins structurés par des habitudes et des traditions alimentaires collectives, dictées par les conventions ou la nécessité, chacun est renvoyé à son propre jugement pour décider ce qu'est une bonne alimentation. Or, cette liberté peut aisément devenir anxiogène, car les critères susceptibles d'être pris en compte sont nombreux et complexes. Dois-je prendre en compte mon plaisir immédiat, ma santé, les impacts de ce que je mange sur mon environnement ou sur le niveau de vie des agriculteurs, par exemple ? Comment pondérer tous ces critères et concilier ces multiples objectifs ?
À supposer même qu'on dispose des ressources culturelles pour répondre à ces questions, une autre interrogation anxiogène surgit : comment savoir si ce que je mange correspond effectivement à ce que je souhaiterais manger ? Comment en effet manger sain si l'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les plats prêts à manger que l'on consomme ? Comment manger durable si on ne sait pas comment ont été produits les aliments et quels impacts ils exercent sur l'environnement ? Aujourd'hui cantonné à un strict rôle de consommateur, sans connaissance directe des aliments, de leurs caractéristiques réelles et de la façon dont ils ont été produits, le mangeur contemporain a besoin de nouveaux repères et de réassurance. C'est en ce sens qu'a été créé le Nutriscore, pour simplifier l'accès à l'information nutritionnel, dont nous reparlerons plus loin.
II. DES CHANGEMENTS ANNONCIATEURS D'UNE NOUVELLE TRANSITION ALIMENTAIRE ?
Si nos régimes alimentaires portent encore très nettement la marque de la transition alimentaire du XX e siècle, on observe néanmoins un certain nombre de phénomènes émergents, dont il faut se demander s'ils annoncent un nouveau changement de paradigme alimentaire. C'est l'objet des développements qui suivent.
A. VERS UNE DEMANDE DE QUALITÉ ÉLARGIE DES CONSOMMATEURS
Les changements que l'on peut observer touchent en premier lieu à la définition du bien manger, sans qu'il soit cependant évident, à ce stade, de faire la part entre ce qui relève de simples effets de conjoncture ou de changements sociaux plus profonds. Les discours et les pratiques en réaction contre certaines dérives ou contradictions du système alimentaire actuel se multiplient et expriment ce qu'on pourrait appeler une demande de qualité alimentaire élargie, le terme « élargi » renvoyant au fait que cette demande intègre de nombreux critères pour définir le bien manger. Sur le plan sociologique, ces critiques contre les formes dominantes d'alimentation et ces tentatives pour redéfinir ce qu'est une bonne alimentation sont principalement portées par les classes moyennes supérieures urbaines, plutôt fortement dotées en capital culturel.
1. Les redéfinitions contemporaines du bien manger
a) La place croissante des préoccupations relatives à la santé et au bien-être
La montée des préoccupations relatives à la santé et au bien-être est très nette depuis une trentaine d'années. Les vagues d'enquêtes successives du Crédoc 15 ( * ) montrent clairement le renforcement du lien que les mangeurs établissent entre alimentation et santé.
Cette progression est liée au fait que les consommateurs sont confrontés depuis les années 1980, non sans une certaine cacophonie, à une multiplication des conseils et des mises en garde à caractère nutritionnel portées par les autorités sanitaires ou par divers acteurs de la société civile (médecins, médias, associations de consommateurs...). On observe également une prolifération du marketing nutritionnel. Enfin, les scandales ou crises alimentaires depuis 2000 (vache folle, fraude à la viande de cheval, Lactalis...) et la montée du questionnement autour des maladies métaboliques possiblement liées à l'alimentation ont contribué à ancrer dans l'opinion l'idée que l'alimentation est un facteur de risque. Les trois quarts des Français le pensent aujourd'hui, contre seulement la moitié il y a vingt ans 16 ( * ) .
Si établir un lien entre alimentation et santé n'est pas en soi nouveau et relève même du lieu commun, la « diététisation », voire la médicalisation, des discours sur l'alimentation sont en revanche des éléments qui bousculent profondément la définition du bien manger. Chacun est en effet désormais incité à maîtriser une vulgate nutritionnelle, à être attentif à l'équilibre de son alimentation, à traquer le trop (trop abondant, trop gras, trop sucré, trop salé, trop souvent...) ou le trop peu (trop peu de fibres, d'oméga 3,...), à contrôler les apports en calories, en macro et en micronutriments et à se méfier des additifs et autres résidus aux effets encore mal cernés, sous peine de nuire à son capital-santé et de s'exposer à diverses maladies.
Si ce phénomène de diététisation de l'alimentation concerne tous les âges, il faut souligner la présence d'un effet de génération nouveau : les plus jeunes, qui, jusqu'à récemment, se préoccupaient assez peu du lien entre alimentation et santé, le font désormais autant que les autres catégories d'âges. C'est un phénomène important dans une approche prospective. Dans les nouvelles générations, le lien santé/alimentation est fortement associé aux recommandations nutritionnelles du Programme national nutrition santé, lancé en 2001, programme avec lequel elles ont en quelque sorte grandi. Même si ces représentations ne se traduisent pas (encore ?) dans une alimentation plus saine, elles témoignent de la diffusion d'un modèle fonctionnel de l'alimentation, qui était jusqu'alors plutôt l'apanage des pays du nord de l'Europe.
b) Une montée des préoccupations citoyennes et éthiques
La montée des préoccupations citoyennes et éthiques est un autre axe important des redéfinitions contemporaines du bien manger. De plus en plus de consommateurs affirment leur intérêt pour des produits qui prennent en compte les impacts écologiques, le bien-être animal 17 ( * ) , mais aussi l'impact socioéconomique (juste rémunération des agriculteurs, respect des règles sociales ou encore impact sur le développement des territoires).
(1) Concernant la prise en compte des enjeux écologiques
On dispose, là encore grâce aux travaux du Crédoc, d'un recul de plusieurs décennies qui montre l'essor très net de cette thématique 18 ( * ) . Alors qu'en 1995, la question de la dégradation de l'environnement était un sujet de préoccupation prioritaire pour seulement 7 % des personnes, il l'est désormais pour 25 % 19 ( * ) .
L'importance accordée au thème de l'environnement apparaît fortement liée à un effet de génération. Le taux de préoccupation pour l'environnement est en effet deux fois plus haut parmi les 18-24 ans que chez les plus de 65 ans. La préoccupation pour la dégradation de l'environnement est également extrêmement liée à la hiérarchie sociale. Elle est la plus haute chez les plus diplômés (>bac + 2), où elle s'élève à 40 %.
Les consommateurs qui se préoccupent de la dégradation de l'environnement intègrent assez logiquement des critères relatifs à l'impact écologique dans leur rapport à l'alimentation. C'est ce que confirment de nombreuses études d'opinion. À titre d'exemple, on peut citer un sondage de 2016 20 ( * ) selon lequel 47 % des personnes interrogées déclarent consommer davantage aujourd'hui que deux ans auparavant de produits ayant un faible impact sur l'environnement. Un autre sondage 21 ( * ) indique pour sa part que, parmi les sujets liés à l'alimentation sur lesquels il faudrait faire le plus d'effort, 47 % des personnes interrogées mettent en avant la limitation de l'impact sur l'environnement.
Il faut souligner que ces préoccupations émergentes autour des liens entre alimentation et environnement sont généralement en synergie avec les préoccupations relatives à la santé. Dans l'esprit des consommateurs, les aliments à faible impact écologique tendent à se confondre avec les aliments bons pour la santé. Cela est dû au fait que, dans l'opinion, les risques non nutritionnels de l'alimentation, ceux qui sont liés à la présence d'intrants agricoles (pesticides, herbicides et insecticides, antibiotiques) ou à la présence d'additifs, arrivent en tête dans la hiérarchie des risques alimentaires. Dans ces conditions, limiter les pollutions diffuses, notamment d'origine agricole, devient un facteur essentiel pour améliorer la qualité sanitaire de l'alimentation.
(2) Concernant les critères éthiques relatifs au statut des animaux
Selon une enquête réalisée auprès de plus de 26 000 personnes en Europe en 2016 22 ( * ) , 94 % des citoyens européens accordent de l'importance au bien-être des animaux d'élevage et 82 % pensent que ceux-ci devraient être mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. En France, ces taux sont supérieurs à la moyenne européenne.
Cette préoccupation pour le statut des animaux se retrouve logiquement dans les comportements et les représentations alimentaires. On observe en particulier que cette question est en voie de devenir un élément central dans la définition du bien manger. Désormais, les mangeurs eux-mêmes tendent à se définir et à se classer à travers ce critère. Ainsi, en France, 20 % des personnes se définissent aujourd'hui comme flexitariens, c'est-à-dire déclarent s'inscrire dans une démarche délibérée de réduction de leur consommation carnée 23 ( * ) . C'est un taux proche de ce qu'on constate en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni. Les personnes qui se disent végétariennes, végétaliennes ou véganes représentent quant à elles 5,6 % des personnes en moyenne, avec un taux maximum au Royaume-Uni (8 %) et minimal en Espagne (2,8 %), la France et l'Allemagne se situant respectivement à 5,2 % et 5,6 %.
Plus généralement, même pour les personnes qui ne définissent pas explicitement leur régime alimentaire à partir de la place qu'y occupent les produits animaux, la question du bien-être animal devient incontournable. Selon le Crédoc, environ deux tiers des adultes en France se disent incités à acheter un produit alimentaire parce qu'il tient compte du bien-être animal.
(3) Concernant les critères relatifs au partage de la valeur
L'idée selon laquelle le prix de l'alimentation doit permettre une juste rémunération des producteurs progresse dans l'opinion 24 ( * ) , même si évidemment ce souci de justice sociale n'est pas toujours aisé à concilier avec la contrainte budgétaire des consommateurs. L'objectif de partager plus justement la valeur ou de stimuler l'économie locale inspire par exemple le commerce équitable, dont le chiffre d'affaires, s'il reste encore modeste, a néanmoins fortement augmenté au cours de la dernière décennie. Il a atteint près de 1,3 milliard d'euros en 2018 (842 millions d'euros pour les filières internationales et 434 millions d'euros pour les filières nationales), soit une multiplication par plus de 4 entre 2008 et 2018 25 ( * ) .
Ce type de motivation fait également partie des éléments mis en avant par les promoteurs des circuits courts. 80 % des consommateurs disent acheter désormais des produits locaux et parmi eux, l'écrasante majorité (97 %) souligne que cette façon de consommer permet de faire marcher l'économie locale 26 ( * ) .
c) Une définition du bien manger plus complexe
L'intégration de toutes ces préoccupations nouvelles a profondément fait évoluer la conception du bien manger en France, et plus largement dans les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années.
Au début des années 2000, les Français définissaient un aliment de qualité comme un aliment « qui a du goût ». Désormais, la dimension du goût et du plaisir, sans avoir disparu, s'articule, non sans tension, avec d'autres critères. En 2018, les deux qualificatifs les plus cités pour définir la qualité d'un aliment étaient le « bio » et le « sans » (sans additifs, sans pesticide, sans huile de palme, sans sucre ajouté, etc.), tandis que la dimension du goût était reléguée en quatrième position, après les produits frais et presque au même niveau que le sain, le naturel et le local.
Un autre aspect important à souligner concernant la définition du bien manger est qu'elle n'est plus aussi bien partagée socialement qu'auparavant. Il y a encore une vingtaine d'années, les mots pour définir ce qu'est un bon aliment étaient les mêmes dans tous les milieux sociaux. Désormais, on relève des écarts importants entre les catégories sociales ou le genre. C'est dans les classes moyennes et supérieures que les critères relatifs au sain et au durable ont le plus progressé. Pour les employés ou les ouvriers en revanche, c'est-à-dire pour plus de la moitié des consommateurs, le plaisir et le goût surclassent toujours les préoccupations de santé. Ces catégories sociales ont donc conservé la définition du bien manger qui était celle de l'ensemble de la population il y a vingt ans.
2. Un souci de réassurance et de réappropriation de l'alimentation
Les transformations qui affectent la notion du bien manger et l'anxiété qui s'est installée au coeur des rapports à l'alimentation nourrissent une volonté de réappropriation de leur alimentation par une partie des consommateurs. Cette volonté se manifeste de multiples manières, en premier lieu par une demande de transparence concernant les produits alimentaires, leurs conditions de production et de transformation, leur origine et leurs propriétés nutritionnelles, ainsi que leurs impacts potentiels sur la santé, l'environnement ou les territoires.
En témoigne le succès des applications du type Open Food Facts ou Yuka, qui permettent de connaître le Nutriscore et la classification Nova des aliments. Cette attente forte constitue un défi à relever pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux transformateurs et aux distributeurs, ainsi que pour les pouvoirs publics : faire évoluer les mécanismes de définition et d'identification de la qualité des produits alimentaires, que ce soit au travers de l'évolution des règles d'étiquetage ou des outils publics ou privés de certification ou de labellisation de la qualité.
|
OpenFoodFacts est une base de données libre et collaborative. Elle répertorie des informations sur les ingrédients, les allergènes et la composition nutritionnelle des produits. Cest la seule aplication de ce type soutenue par les autorités sanitaires. |
La volonté de se réapproprier son alimentation inspire aussi les initiatives visant à la reterritorialisation des systèmes alimentaires et à la promotion des circuits courts : raccourcir la chaîne qui lie le mangeur au producteur, recréer des liens de proximité et d'interconnaissance, est vu comme un moyen de recréer de la confiance. Si ce phénomène doit être analysé avec le recul nécessaire, il apparaît qu'au cours de la période que nous traversons, le succès des AMAP est remarquable et participe de cette tendance. L'enquête CCAF 2016 souligne plus généralement la forte progression du critère de proximité dans les critères d'achat alimentaires depuis dix ans : le critère « fabriqué en France » est devenu le premier critère de choix de produit, cité devant le prix ; « favoriser la production régionale » est désormais cité en quatrième position.
Ces démarches de réappropriation, qui se développent en réaction contre certaines contradictions du système alimentaire actuel, pourraient être un des moteurs des transformations futures de l'alimentation et du système alimentaire.
3. Un recul des produits animaux
a) La baisse de la consommation de viande : une tendance désormais bien établie
Selon les données de FranceAgrimer, la consommation moyenne de viande par habitant en France a diminué de 10 % depuis 1998, année où elle avait atteint son maximum. Cette baisse s'accompagne d'un double effet de substitution :
- une subsitition entre types de viandes. La baisse de la consommation de boeuf et de veau a commencé dès le milieu des années 1980 et atteint près de 30 % en trente ans. Celle de porc a commencé à la fin des années 1990 et atteint 15 % en vingt ans, même si le porc reste la viande la plus consommée en France. Enfin, la consommation de volaille poursuit sa croissance ;
- une substitution entre viandes brutes et préparations à base de viande. Les produits élaborés à base de viandes de boucherie et de volailles voient leur part augmenter dans la consommation des ménages au détriment des viandes fraîches non transformées, dont la part n'est plus que de 42 %.
Au-delà de la consommation de viande, on observe plus largement un recul des produits d'origine animale et notamment de lait, sous toutes ses formes.
b) Une inversion sociologique
Le recul de la consommation de produits animaux est portée par les classes sociales supérieures, qui sont désormais moins consommatrices de viande que les autres - ce qui constitue un renversement sociologique historique. Les quantités ingérées par les ouvriers s'établissent aujourd'hui à 131 g/j, contre 95 g/j pour les cadres et professions intellectuelles supérieures (soit un écart de 38 %) 27 ( * ) .
Les changements de goûts et de valeurs alimentaires ont joué un rôle central dans ce recul 28 ( * ) . La baisse enregistrée dans les années 1980 et 1990 résulte en effet de la diffusion concomitante des arguments nutritionnels sur les effets nuisibles pour la santé d'une consommation excessive de viande. Le souci d'une alimentation plus saine, qui est désormais fortement ancré dans la partie la plus aisée et la plus diplômée de la population, constitue la principale motivation que mettent en avant les personnes qui souhaitant évincer ou réduire la consommation de viande. Cet argument est mobilisé par 50 % des Français (pour 25 %, c'est même l'argument principal). Viennent ensuite des arguments qui étaient inexistants dans le débat public à la fin du XX e siècle, comme le statut de l'animal (conditions d'élevage ou cruauté vis-à-vis des animaux) et, dans une moindre mesure, l'impact environnemental de la viande. La diffusion aujourd'hui très rapide de ces préoccupations donne à penser que la tendance à la baisse de la consommation de viande va s'amplifier, d'autant que c'est chez les moins de 30 ans que le flexitarisme et les différentes formes de végétarisme sont le plus présents.
4. L'essor du bio et des modes de production agricole durables
Depuis dix ans, quel que soit l'indicateur qu'on retienne, l'essor de l'alimentation bio en France est spectaculaire. Du côté de l'offre, les surfaces certifiées bio dépassent désormais 1,5 million ha (2 millions ha si on tient compte des surfaces en conversion, soit 7% de la SAU française) et ce sont plus de 40 000 exploitations qui sont engagées dans la démarche. Les taux de conversion des cultures « fruits » et, dans une moindre mesure, « vignes » et « surfaces fourragères », sont les plus élevés (respectivement 23, 12 et 10 % des surfaces), tandis que les grandes cultures restent en retrait (4 %).
Du côté des ventes, le chiffre d'affaires de l'alimentation bio a été multiplié par dix en vingt ans et approche désormais 10 milliards d'euros, avec une accélération depuis le début des années 2010. Les circuits de distribution se sont adaptés pour suivre cette demande très dynamique. Désormais, les grandes et moyennes surfaces enregistrent la moitié des achats d'aliments bio des ménages. Les filières de production-transformation françaises ont eu en revanche plus de mal à suivre le rythme, puisque le taux de couverture de la consommation par la production nationale est seulement de 69 % (il tombe même à 42 % pour les fruits).
L'étude des motivations des achats bio montre que leur essor correspond d'abord à la recherche d'une alimentation plus saine, ensuite à la recherche d'une alimentation plus écodurable. Le bio apparaît être un label qui inspire confiance et qui est parvenu à constituer un moyen de réduire l'anxiété alimentaire et de reprendre le contrôle de ce qu'on mange. Toutefois, nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin en détail, il existe de fortes inégalités dans l'accès au bio.
5. D'autres changements de comportements qui restent à confirmer
a) Le développement des circuits courts et du local
Le développement des circuits courts 29 ( * ) constitue une troisième tendance émergente de la consommation alimentaire française, qui reste toutefois moins affirmée que les deux précédemment évoquées. Dans un contexte d'anxiété alimentaire, le « consommer local » s'affirme d'abord comme un moyen de réassurance. Selon une enquête Ipsos déjà citée, les consommateurs attachent de plus en plus d'importance à l'origine et au lieu de fabrication des produits qu'ils consomment. Parmi les critères de confiance, ils citent d'abord le fait qu'un produit soit directement vendu par le producteur (23 %) avant l'existence de labels ou de signes officiels de qualités (16 %). Ils citent également la fabrication locale (9 %) et mettent quasi à égalité le label bio (8 %) et le « made in France » (7 %).
Le Crédoc indique lui-aussi que l'ancrage territorial est devenu un élément majeur dans la construction de la confiance dans l'alimentation 30 ( * ) . Dans l'édition 2016 de son enquête sur la consommation alimentaire des Français, le critère « fabriqué en France » est devenu pour la première fois le critère de choix de produit cité en tête. « Favoriser la production régionale » arrive en second, en forte croissance par rapport à 2010. Le Crédoc souligne que les significations liées à la fabrication nationale ou régionale sont multiples : c'est un moyen de manger durable 31 ( * ) et un acte engagé pour défendre l'emploi régional et national.
Si le critère de l'achat local progresse dans les préférences des consommateurs, il est cependant difficile, faute de suivi statistique du sujet, de mesurer si cela se traduit aussi par une progression des achats en circuits courts. 32 ( * ) Ces circuits représenteraient au total 6 à 7 % des achats alimentaires 33 ( * ) en France selon l'Ademe 34 ( * ) , ce qui, sans être négligeable, témoigne néanmoins d'un écart important entre la réalité des achats et la place que tient l'achat de proximité ou les circuits courts dans l'idéal contemporain du bien manger.
b) Un développement de l'alimentation fonctionnelle
La progression de la consommation de compléments alimentaires 35 ( * ) témoigne elle-aussi d'une évolution des modèles alimentaires. Entre l'enquête Inca 2 (2006-2007) et l'enquête Inca 3 (2014-2015), la part des consommateurs de compléments alimentaires a progressé nettement : de 12 % à 19 % chez les enfants de 3 à 17 ans et de 20 % à 29 % chez les adultes. Le marché annuel français des compléments alimentaires représente aujourd'hui environ 2 milliards d'euros.
B. DU CÔTÉ DE L'OFFRE, UN FOISONNEMENT D'INNOVATIONS
1. Le système alimentaire impacté par le numérique
Les outils numériques transforment le système alimentaire essentiellement à deux niveaux : ils rendent possible l'émergence de nouveaux modes de distribution et permettent la mise sur de marché d'applications au service de la transparence.
a) Vers l'émergence de nouveaux modes de distribution ?
On peut se demander dans quelle mesure les outils numériques pourraient demain remettre en question les chaînes de distribution alimentaire aujourd'hui dominées par les grandes et moyennes surfaces, sachant que celles-ci font preuve d'une grande souplesse pour suivre l'évolution des attentes des consommateurs. En particulier, elles ont déjà opéré un recentrage de leur activité sur les superettes de proximité et ont intégré dans leur modèle économique l'achat alimentaire à distance. Ce dernier s'est surtout développé en France à travers le système du Drive , dont le chiffre d'affaires est passé de 2,2 à 5,9 milliards d'euros entre 2012 et 2017, avec des effets en définitive limités sur l'organisation du système de distribution et sur la répartition de la valeur.
Le numérique pourrait cependant bousculer cette situation de plusieurs façons, soit par l'arrivée sur le marché alimentaire de pure players de grande taille, du type Amazon (ce qui ne changerait pas la structure fortement oligopolistique du commerce alimentaire et pourrait même aggraver le niveau de concentration), soit par le court-circuit des intermédiaires commerciaux actuels. Concernant ce dernier point, il est évident que le numérique facilite la mise en contact directe des consommateurs avec les producteurs agricoles ou industriels et peut donc stimuler le développement de la vente directe et des circuits courts. Ce schéma désintermédié profiterait vraisemblablement surtout à certains types de produits alimentaires (produits frais, vin, etc.).
Dans tous les cas cependant, il faut souligner que la concentration d'une population nombreuse dans les zones urbaines continuera à rendre nécessaire le maintien d'une forme de rationalisation des circuits logistiques alimentaires, avec des opérateurs (industriels et grossistes) capables de réaliser un approvisionnement en gros volumes sur une large gamme de produits et sur une échelle géographique très vaste. Le consommateur veut en effet pouvoir accéder à une offre alimentaire variée, à un coût maîtrisé sans avoir à supporter des coûts de prospection démesurés. Seule une organisation industrielle du commerce alimentaire permet de satisfaire ces trois objectifs. Un émiettement des chaînes logistiques aboutirait sans doute à une hausse des prix au détail, ainsi qu'à une hausse des émissions carbone liées au transport, ce qui rend une telle évolution peu vraisemblable.
Les circuits de distribution de gré à gré ou faiblement intermédiés, notamment les circuits courts, devraient donc croître grâce au numérique, tout en restant des marchés secondaires par leur volume et la variété des produits concernés. C'est vraisemblablement plutôt sur la logistique des derniers kilomètres que devraient se concentrer les changements liés au numérique, avec peut-être le développement d'une forme d'uberisation de la livraison. Ce phénomène affecte déjà le secteur de la restauration, avec par exemple des plateformes du type Uber Eats. Le développement de nouvelles formes de livraison (drones, robots de livraison autonome) permet d'imaginer que, demain, on assistera à une multiplication des microentreprises fournissant les consommateurs en plats prêts à consommer dans les centres urbains.
b) Des applications au service de l'aide à la décision pour le consommateur
Le numérique permet également de fournir aux consommateurs une aide à la décision dans plusieurs domaines. Nous avons déjà évoqué les applications au service de la transparence sur les produits, du type OpenFoodFacts, qui aident à mieux identifier la qualité des biens. On peut imaginer cependant de très nombreuses autres applications, par exemple des assistants permettant de gérer les stocks à domicile (que manque-t-il dans le réfrigérateur ou les placards), y compris de manière dynamique (notamment en analysant les stocks et les besoins d'achats en fonction des événements et des repas inscrits dans l'agenda), ou bien encore des assistants permettant d'identifier les revendeurs de tel ou tel produit ou marque, ou définissant des trajets optimisés pour s'approvisionner en fonction de la géolocalisation (notamment dans une perspective de circuits courts). On peut s'attendre à un foisonnement d'applications et de services nouveaux dans ce domaine dans les prochaines années.
2. Vers l'arrivée massive d'aliments nouveaux ?
Il se développe depuis plusieurs années un grand nombre de projets d'innovations visant à introduire sur le marché des aliments ou des ingrédients alimentaires nouveaux 36 ( * ) : viande de culture, algues ou encore insectes. De nombreuses start-up lèvent des fonds dans ce domaine, à l'image par exemple, d'Ynsect et Innovafeed en France 37 ( * ) . Ces initiatives plus ou moins disruptives représentent pour l'instant des volumes encore faibles d'aliments, mais se veulent une réponse à la forte hausse anticipée de la demande mondiale de protéines pour l'alimentation humaine et animale dans les prochaines décennies 38 ( * ) . Elles se présentent aussi comme un moyen de répondre aux changements des attentes des consommateurs, telles que la demande de protéines alternatives aux protéines d'origine animale pour des motifs liés à la santé, à l'environnement ou à la cause animale, ou bien encore la hausse de la demande d'« alicaments » liée à l'essor d'une conception fonctionnelle de l'alimentation. L'avenir de ces nouveaux aliments reste cependant incertain, car plusieurs questions restent en suspens concernant leur prix, leurs impacts environnementaux et sanitaires, ainsi que leur acceptabilité sociale. 39 ( * )
a) La viande de culture
Quelques start-up existent en France dans ce domaine, par exemple Gourmey, qui cherche à produire un foie gras issu de cellules d'oeuf de cane, ou Vital Meat. Aux États-Unis, on peut citer Memphis Meat, qui a levé plus de 161 millions de dollars. En Israël, Aleph Farms a aussi réalisé de grosses levées de fonds et projette de commercialiser un burger à 100 dollars. On dispose de très peu d'éléments pour évaluer les potentialités de ces technologies, qui en sont encore à un stade de développement amont. Les coûts sont pour l'heure rédhibitoires par rapport aux sources de protéines alternatives et les impacts écologiques restent incertains 40 ( * ) , ainsi que les effets sanitaires 41 ( * ) . Enfin, l'acceptabilité sociale de ces aliments de synthèse reste à vérifier. Cette viande sans élevage ni abattage repose en effet malgré tout sur l'utilisation de produits animaux 42 ( * ) . Par ailleurs, ce type de production alimentaire pousse à un niveau inédit le degré de tranformation des aliments, de sorte que les aliments ultra-transformés actuels, pourtant très décriés, font figure d'aliments peu transformés en comparaison ! Ces aliments nouveaux témoignent d'une vision très technologique du futur de notre alimentation et reposent sans doute sur la croyance de certains que la technologie résoudra tous nos problèmes.
b) Les algues ou micro algues
Elles représentent déjà un marché mondial important, estimé à 4 milliards d'euros en 2017, qui pourrait doubler encore d'ici 2024 43 ( * ) . Les acteurs dans ce domaine sont peu nombreux en France, le marché se développant surtout en Asie du Sud-est. Les macro-algues sont riches en sels minéraux, mais assez pauvres en protéines (protéines de surcroît relativement peu assimilables). Elles sont surtout utilisées comme texturants alimentaires. Les micro-algues, comme la spiruline ou la chlorelle, sont très riches en protéines (et contiennent en outre l'ensemble des acides aminés essentiels), ainsi qu'en nutriments 44 ( * ) , mais elles sont onéreuses, ce qui les destine avant tout à un usage de compléments alimentaires.
c) Les insectes
Ils sont une source de protéines de bonne qualité. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est d'ailleurs prononcée en 2013 en faveur du développement de l'élevage d'insectes à grande échelle pour répondre aux besoins de l'alimentation humaine et animale. Les perspectives commerciales sont réelles mais portent davantage sur l'alimentation animale que sur l'intégration d'insectes dans l'alimentation humaine, directement ou sous forme de farines, du fait de la faible acceptabilité sociale et culturelle de ce type d'aliments, au moins en Occident 45 ( * ) . Les marchés possibles sont :
- l'aquaculture. Depuis le 1er juillet 2017, l'Union européenne a autorisé la consommation par les poissons d'élevage de farines d'insectes en substitution à des farines de poisson, qui sont une ressource à la fois peu abondante et peu durable. La production de farine d'insectes pour les poissons est aujourd'hui compétitive et le marché en est au stade de l'industrialisation 46 ( * ) ;
- l'alimentation des animaux de compagnie ( petfood ). C'est un marché très dynamique, où de surcroît les prix de vente sont élevés, dont la farine d'insecte peut sans doute prendre une part ;
- l'alimentation des animaux d'élevage terrestres ( feed ). C'est un marché gigantesque 47 ( * ) , qui croît par ailleurs très vite en raison du dynamisme de la demande mondiale de viande, en particulier dans les pays émergents. Substituer une alimentation animale à base d'insectes aux aliments végétaux actuels (notamment soja) aurait le grand intérêt de réduire la déforestation mondiale. Pour l'heure toutefois, les farines d'insectes sont loin d'être compétitives par rapport au soja et autres protéagineux utilisés en alimentation animale. Par ailleurs, compte tenu de la taille même du marché de l'alimentation animale, un développement massif des farines d'insectes pourrait avoir des effets en cascade sur les marchés agricoles, qu'on ne mesure pas encore bien 48 ( * ) .
III. DES INÉGALITÉS FACE À L'ALIMENTATION
A. L'ALIMENTATION RESTE UN PUISSANT MARQUEUR SOCIAL
1. Les différences sociales d'alimentation restent fortes
Après la guerre et jusqu'aux années 1980, la « moyennisation » de la société française, qui a affecté les modes de vie de façon générale, a conduit en particulier à une certaine homogénéisation des pratiques alimentaires. L'élévation du niveau de revenu des classes moyennes et populaires et la baisse du prix relatif des produits agricoles du fait des gains de productivité agricoles ont permis la diffusion de certains des traits du modèle alimentaire des classes sociales supérieures, notamment un régime fortement carné, l'accès de tous à une plus grande diversité de produits alimentaires ou encore l'augmentation de la part des produits transformés par l'industrie dans le panier alimentaire.
Bien que réel et mesurable, ce rapprochement des régimes alimentaires n'a pas empêché la persistance de fortes différences et même d'inégalités dans les comportements alimentaires. On observe une persistance de différences régionales en ce qui concerne la consommation de fruits, de légumes, de beurre ou de charcuteries - aliments faisant l'objet de recommandations nutritionnelles.
On observe également que certains produits alimentaires sont restés des marqueurs sociaux. Les fruits et légumes, ainsi que le poisson sont surconsommés par les classes supérieures. Dans les ménages du dernier quintile, la consommation individuelle de ces aliments est supérieure de, respectivement, +50 %, +30 % et +100 % par rapport à celle observée dans les ménages du premier quintile de revenu. Inversement, la consommation de pommes de terre, de féculents et de charcuteries reste plus marquée dans les classes populaires.
2. L'apparition de nouveaux marqueurs sociaux de l'alimentation
Nous l'avons déjà signalé : depuis une trentaine d'années, les classes sociales les plus aisées et les plus diplômées sont engagées dans un processus de redéfinition du bien manger qui intègre des préoccupations liées à la santé, à l'environnement, au bien-être animal, etc. Cela les conduit à privilégier de plus en plus des pratiques alimentaires axées sur les valeurs de modération et de contrôle (ne pas trop manger de façon générale, ne pas trop consommer de certains aliments comme les graisses, le sucre, la viande...), ainsi que de naturalité et de qualité (ce qui conduit à privilégier les produits labellisés, le bio, le peu ou pas transformé). Ces catégories sociales ont désormais une consommation de viande plus faible que celle des ouvriers. On constate aussi une inversion sociale pour les boissons sucrées (sirops, sodas), qui sont aujourd'hui privilégiées par les personnes de faible niveau de revenu, ainsi que pour les produits transformés : c'est désormais dans les ménages les plus modestes que leur part est la plus forte, la consommation de produits frais étant devenue le marqueur d'une position sociale plus élevée 49 ( * ) .
3. Des différences de régimes alimentaires aux lourdes conséquences en matière de santé
Les différences sociales en matière d'alimentation pourraient n'être que des différences de styles ou de cultures. Toutefois, elles ne sont pas neutres sur le plan nutritionnel. Les habitudes de consommation des ménages du haut de l'échelle sociale correspondent mieux aux recommandations. Inversement, les aliments déconseillés pour la santé, comme les viandes grasses ou les boissons sucrées sont surconsommés dans les milieux modestes. Les personnes des classes élevées ont également une alimentation moins calorique.
Ces différences expliquent l'existence d'un véritable « gradient social de l'obésité ». Le taux d'obésité est en effet fortement décroissant en fonction du niveau social, comme l'illustre le graphique suivant. Il est à noter que ces inégalités sociales face à l'obésité s'installent dès l'enfance : le taux d'obésité est par exemple quatre fois plus haut parmi les enfants d'ouvriers que parmi les enfants de cadres, selon l'enquête Esteban 2015.
B. PRÉCARITÉ ET INSÉCURITÉ ALIMENTAIRES VOISINENT AVEC ABONDANCE ET GASPILLAGE
D'une manière qui peut sembler paradoxale à première vue, les maladies liées à l'excès et aux déséquilibres de consommations alimentaires voisinent avec les situations d'insécurité alimentaire. Cette dernière prend certes, en France, des formes moins sévères et plus complexes que dans les pays en développement 50 ( * ) , mais elle demeure un phénomène endémique, malheureusement trop souvent minoré. Au cours des années 2000, plusieurs enquêtes ont montré 51 ( * ) que plus de 10 % des personnes vivent parfois ou souvent des situations où elles disposent d'apports alimentaires en quantité insuffisante pour se nourrir normalement. Une proportion beaucoup plus importante d'individus (entre 16 et 20 % selon les études) mangent assez sur le plan quantitatif, mais n'ont pas toujours accès aux aliments qu'ils pensent souhaitables pour être bien nourris (par exemple, impossibilité d'acheter des fruits, des légumes ou du poisson). Enfin, 7 à 8 % des adultes disent vivre dans l'anxiété à l'idée de manquer d'aliments 52 ( * ) . Dans des zones défavorisées, le taux d'insécurité alimentaire peut même atteindre 40 à 50 %, preuve que le phénomène est socialement et géographiquement relativement concentré. Le champ de l'insécurité alimentaire ne se confond ni avec celui de la population en situation de pauvreté monétaire ni avec celui de la population qui recourt à l'aide alimentaire : il est bien plus vaste, car de nombreuses variables autres que le revenu monétaire y contribuent, par exemple, le fait de vivre dans un foyer monoparental ou de devoir faire face à des dépenses courantes de logement trop lourdes. Ces personnes vulnérables passent aujourd'hui sous les radars des politiques publiques d'accompagnement alimentaire et risquent d'être les oubliées de la sécurité alimentaire.
Pour terminer, on peut souligner que la qualité nutritionnelle de l'alimentation des personnes en insécurité alimentaire est généralement médiocre, ce qui s'explique par le fait qu'elles se tournent en priorité vers les aliments bon marché riches en énergie mais de faible qualité nutritionnelle.
DEUXIÈME PARTIE
:
RELEVER LE DÉFI D'UNE ALIMENTATION
DURABLE
Les régimes alimentaires nés dans les pays occidentaux au XX e siècle exercent des impacts négatifs forts et non soutenables à long terme pour la santé humaine et l'environnement. C'est un fait désormais parfaitement documenté par la science. Ce constat nourrit de nombreuses initiatives privées et publiques et de nombreux travaux scientifiques pour tenter de définir et de diffuser des modèles alimentaires plus durables. Un large accord existe aujourd'hui pour estimer que ces modèles doivent respecter deux grands principes : la sobriété et la végétalisation. Des signes montrent que la transition vers cette alimentation plus durable s'est déjà enclenchée spontanément au sein de la société. Toutefois, une intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour accompagner et amplifier ce mouvement, d'une part en réduisant les inégalités économiques et culturelles face à l'alimentation, car ces inégalités sont le principal frein à la diffusion des régimes sains ; d'autre part, en encourageant le développement de la filière des légumineuses, qui apparaissent comme une des clés de voûte de la transformation des systèmes alimentaires.
I. UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA NON-SOUTENABILITÉ DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
A. LE RETOUR DE LA QUESTION STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Du point de vue de l'État, la sécurité alimentaire est la capacité à garantir un approvisionnement pérenne répondant en quantité et en qualité aux besoins alimentaires de la population. Cet objectif a toujours été prioritaire pour les pouvoirs publics et il le restera dans les décennies à venir. La permanence de l'objectif général ne doit cependant pas masquer que des changements sont intervenus dans la façon de poser les enjeux de sécurité alimentaire.
1. Une question posée en des termes renouvelés
a) Le retour des discours d'inspiration malthusienne
Tout au long du XIX e et du XX e siècle, en raison des gains de productivité considérables réalisés par l'agriculture, la crainte que la croissance de la population puisse être limitée par les disponibilités alimentaires s'est progressivement estompée dans les consciences, au moins en Occident. Aujourd'hui, cette crainte resurgit. La question se pose en effet de savoir comment nourrir les 10 milliards d'êtres humains attendus en 2050, alors que les rendements agricoles semblent parvenus à un palier et que le changement climatique et le déclin de la biodiversité font peser des risques nouveaux sur la production. Coincée entre l'épuisement progressif du modèle d'agriculture intensif, l'intensification de la crise environnementale et le dynamisme démographique, l'Humanité se retrouverait aujourd'hui au pied d'un « mur » de calories et de protéines qui contraint sa croissance démographique.
Cette résurgence contemporaine de la crainte d'une divergence entre accroissement de la population et disponibilités alimentaires repose toutefois sur une hypothèse qui se trouvait déjà au coeur du modèle de Thomas Malthus, à savoir que la demande alimentaire est une donnée intangible, entièrement déterminée par les évolutions démographiques, de sorte que la seule variable d'ajustement pour répondre à une demande alimentaire en hausse se trouve du côté de l'offre alimentaire : l'agriculture doit produire davantage, avec une régularité suffisante. Ce postulat est faux.
b) Un paradigme malthusien inadapté à la situation contemporaine
La crainte malthusienne sur la sécurité alimentaire néglige plusieurs aspects essentiels du système alimentaire actuel. En premier lieu, contrairement à l'époque de Malthus, l'offre alimentaire dépasse aujourd'hui structurellement et très largement les besoins. On estime ainsi que 30 % de la production alimentaire mondiale est perdue à un stade ou un autre du fonctionnement du système alimentaire. Par ailleurs, sans même tenir compte de ces gaspillages, une partie conséquente de la population mondiale atteint aujourd'hui des niveaux de consommation alimentaire dépassant sensiblement les besoins physiologiques. En 2013, on comptait dans le monde 2,1 milliards de personnes en surpoids, dont 671 millions d'obèses. Sans qu'il soit besoin de produire davantage, agir sur ces deux facteurs de déséquilibre du système alimentaire que sont les gaspillages et la surconsommation permettrait déjà de nourrir convenablement les 9 à 10 milliards d'êtres humains attendus en 2050 !
Le problème n'est donc pas principalement dans la capacité de production, mais dans la demande et l'accès à l'alimentation. Il tient avant tout à la généralisation des manières de se nourrir les moins durables. Au fur et à mesure que son niveau de vie augmente en effet, une part croissante de la population mondiale adopte le régime hyper calorique et fortement carné des pays développés. Or, tenter de répondre à cette demande avec les ressources et les techniques disponibles ne peut que conduire à des conséquences négatives en cascade, que la prospective Agrimonde-Terra 53 ( * ) a explorées et chiffrées : explosion du surpoids, de l'obésité et des maladies chroniques liées à la suralimentation ; dégradation des ressources naturelles, déforestation et sensibilité accrue de l'agriculture au changement climatique ; pollutions aux carbones et aux nitrates ; perte d'accès à la terre et paupérisation des agriculteurs dans plusieurs parties du monde ; instabilité accrue sur les marchés mondiaux agricoles ; inégalités économiques et spatiales accrues et difficultés exacerbées d'accès à la nourriture pour une partie significative de la population mondiale. Cette voie est une impasse et génère d'importants coûts pour la société. Seule une évolution vers une consommation durable est en mesure de garantir demain une sécurité alimentaire mondiale compatible avec la résilience des écosystèmes et de l'homme.
2. La France face à la question de sa sécurité alimentaire
Pour la France, grande puissance agricole disposant d'un climat tempéré et d'une agriculture performante, la question de la sécurité alimentaire se pose de manière moins aiguë qu'au niveau mondial. Deux enjeux apparaissent cependant prioritaires pour notre pays : renforcer sa souveraineté protéique et adapter son agriculture au réchauffement climatique.
a) Renforcer la souveraineté protéique
Le système alimentaire et européen est aujourd'hui fortement dépendant en protéines en raison des importations de protéines végétales, essentiellement sous forme de tourteaux de soja, nécessaires pour nourrir les animaux d'élevage. Plus de 60 % du besoin en protéines végétales en Europe est couvert par des importations 54 ( * ) . L'Europe est, avec la Chine, la seule puissance dans une telle situation de vulnérabilité.
L'autonomie protéique de la France est certes mieux garantie que celle de l'Union européenne : le taux de couverture de nos besoins se situe autour de 55 % pour les matières riches en protéines. La France importe néanmoins plus de 3 millions de tonnes de tourteaux de soja en provenance des USA, du Brésil, de l'Argentine et de l'Inde, ainsi qu'1 million de tonnes de tourteaux de tournesol, essentiellement en provenance d'Ukraine 55 ( * ) .
À l'heure actuelle, cette dépendance protéique n'est pas perçue par tous les acteurs économiques ni par les pouvoirs publics comme un véritable problème. Les marchés mondiaux assurent en effet, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, un approvisionnement stable et important à la ferme Europe, ce qui crée l'illusion de la sécurité. Cette situation pourrait cependant radicalement changer. Même si elle ne rattrape pas le niveau observable actuellement dans les pays développés, on s'attend en effet à ce que la consommation de produits animaux au niveau mondial explose dans les prochaines années sous l'effet de la croissance démographique et de l'élévation des niveaux de vie. Cela va naturellement entraîner une forte hausse de la demande de protéines végétales nécessaires à l'élevage. Les importations européennes pourraient donc subir de fortes hausses de prix, voire même rencontrer des difficultés d'approvisionnement.
Par ailleurs, la hausse de la demande mondiale en protéines végétales ne peut qu'inciter, partout dans le monde, à mobiliser davantage de terres pour les produire. Cela ne pourra se faire qu'au prix d'une déforestation accrue et donc d'impacts fortement négatifs en termes de biodiversité et de gaz à effet de serre ou en détournant des terres arables produisant actuellement des aliments pour les humains (avec une concurrence feed/food qui aura des conséquences graves pour les populations rurales des pays en voie de développement, dont l'accès à la terre et à la nourriture sera menacé).
Que ce soit pour éviter de tomber dans une situation d'insécurité alimentaire ou pour éviter de contribuer à la déforestation et à la précarisation d'une partie de la population paysanne mondiale, la France et l'Europe ont donc intérêt à réduire leur dépendance protéique. Nous reviendrons plus loin sur l'analyse des freins et des leviers pour y parvenir, notamment en évoquant les enjeux du développement de la filière oléoprotéagineuse.
b) Adapter l'agriculture au réchauffement climatique
Maintenir un haut degré d'autonomie alimentaire en France et en Europe dans les prochaines décennies suppose aussi de renforcer la résilience de l'agriculture face aux effets du réchauffement climatique. Ce sujet a été traité dans un précédent rapport de la Délégation à la prospective du Sénat consacré à l'adaptation de la France au réchauffement climatique 56 ( * ) . On se contentera donc ici d'en reprendre les conclusions et les propositions qui concernent directement le présent rapport sur l'avenir de l'alimentation.
(1) La production agricole est sensible aux effets du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique, déjà nettement perceptible, va se poursuivre d'ici à 2050 en raison de l'inertie du système climatique mondial, avec pour conséquence :
- un impact négatif direct sur le rendement de cultures majeures, notamment le blé ;
- un impact négatif indirect sur les rendements, lié au développement des pathogènes ;
- une variabilité accrue de la production due à la multiplication et à l'intensification des aléas climatiques, tels que les épisodes de sécheresse, de grêle ou les inondations ;
- une modification de la phénologie des cultures pérennes, qui va entraîner une précocité accrue des floraisons et donc un risque augmenté d'exposition des cultures aux gels tardifs, entraînant là encore une variabilité accrue de la production ;
- une moindre régularité de la production sur le plan qualitatif, avec notamment des baisses de teneur en micronutriments ou en protéines de certaines cultures ;
- une perte d'aptitude de certaines cultures actuellement pluviales ou faiblement irriguées, entrainant des besoins nouveaux d'irrigation alors même qu'on attend une raréfaction de la ressource hydrique.
(2) La nécessité de développer une stratégie de diversification des risques agricoles
Pour faire face aux effets négatifs attendus du réchauffement climatique, la stratégie d'adaptation doit favoriser la diversification géographique et culturale du système agricole de sorte qu'il soit plus résilient.
Cela plaide pour une reterritorialisation au moins partielle de certaines productions excessivement dépendantes des importations (cas par exemple du soja, déjà évoqué), mais aussi pour une approche prudente vis-à-vis des politiques alimentaires locales se donnant pour objet l'autosuffisance alimentaire sur un territoire restreint. Un système alimentaire conçu sur un petit périmètre géographique est en effet très vulnérable aux aléas qui peuvent l'affecter, surtout s'il est peu diversifié.
Cela plaide également pour une recomposition progressive de la géographie des cultures 57 ( * ) .
Cela plaide enfin pour une diversification culturale plus poussée. La diversification agroécologique des espèces cultivées permettrait en effet de réduire fortement la vulnérabilité face aux bioagresseurs émergents ou rendus plus virulents du fait du réchauffement. Elle permettrait aussi de réduire l'exposition aux aléas climatiques, car toutes les cultures ne sont pas impactées simultanément et au même degré lorsque survient un tel aléa.
B. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX DE SANTÉ POSÉS PAR L'ALIMENTATION
1. L'émergence de la problématique des maladies de pléthore
On observe depuis un demi-siècle une nette évolution des pathologies liées à l'alimentation : les maladies causées par des carences tendent à céder la place à des pathologies liées à la surconsommation. Face à cette évolution, les objectifs de santé publique doivent être élargis pour intégrer la lutte contre ces maladies de pléthore, sans pour autant abandonner la lutte contre les problèmes de dénutrition qui peuvent encore toucher certaines populations.
a) Une mauvaise alimentation est à l'origine de l'essor de nombreuses pathologies
Les chiffres fournis à vos rapporteurs par l'Inserm montrent le caractère désormais central de l'alimentation dans les enjeux de santé publique. Le rôle d'une mauvaise alimentation est en effet prouvé pour de nombreuses pathologies : cancers, maladies cardiovasculaires, diabète (3,7 millions de diabétiques sont traités en France en 2015), surpoids et obésité (17 % des adultes en France sont obèses et un tiers sont en surpoids, chiffres qui, chez les enfants, sont respectivement de 4 % et 17 %) ou encore ostéoporose (celle-ci concerne 39 % des femmes de 65 ans et plus et est à l'origine de 400 000 fractures par an) 58 ( * ) .
Ces pathologies liées à l'alimentation sont devenues une cause majeure de décès. Elles représentent 80 % des causes de décès prématurés par maladies non transmissibles. Au-delà de leur impact sur la mortalité, ces pathologies représentent aussi une cause majeure de dégradation de la qualité de vie et de vieillissement en mauvaise santé, le tout avec des coûts considérables pour le système de santé.
b) L'alimentation est le premier facteur de risque évitable de mauvaise santé
L'alimentation a cette particularité d'être un facteur de risque pour de nombreuses maladies, mais un facteur de risque évitable , d'où évidemment sa place centrale dans les politiques de prévention. Des études de plus en plus nombreuses permettent de mesurer les effets bénéfiques qu'on peut attendre de changements de pratiques alimentaires. Par exemple, on estime qu'une baisse de la consommation de sel de 10 à 5 g par jour permettrait de réduire le taux global d'accident vasculaire cérébral de 23 % et les taux de maladies cardio-vasculaires de 17 %. De même, une étude récente du Centre international de recherche sur le cancer 59 ( * ) , qui a examiné 13 facteurs de risque pour cette maladie 60 ( * ) , conclut que 142 000 des 346 000 cas de cancer diagnostiqués chez les adultes en 2015 en France (soit 41 % du total) auraient pu être évités si l'ensemble de la population n'avait pas été exposée aux facteurs de risque étudiés, ou si son exposition avait été limitée.
En tête des facteurs de risque évitables pour la santé, on trouve, par ordre d'importance, le tabac, l'alcool, une alimentation déséquilibrée et l'excès de poids (surpoids et obésité). Une activité physique insuffisante et une durée d'allaitement de moins de six mois jouent aussi un rôle négatif mesurable. Au total, les facteurs de risques liés à l'alimentation (en incluant la consommation d'alcool et l'activité physique) sont le déterminant principal de 20 % des cancers évitables.
c) La persistance de comportements alimentaires mauvais pour la santé
Le Programme national nutrition santé (PNNS) a été lancé en janvier 2001. Il en est désormais à sa quatrième mouture (période 2019-2023). Malgré la continuité des efforts de prévention, les résultats du PNNS sont cependant assez contrastés. Depuis le milieu des années 2000, la prévalence du surpoids et de l'obésité s'est stabilisée en France, chez les adultes comme chez les enfants, à un niveau plus faible que dans de nombreux autres pays développés 61 ( * ) . Ce succès reste toutefois relatif, car le niveau auquel la France se situe demeure intrinsèquement trop élevé : on a réussi à stopper la dégradation enregistrée au cours des années 1980-1990, mais pas à l'inverser.
La prévalence du diabète de type 2 continue à augmenter, tandis que la pratique d'activité physique décroît dramatiquement, notamment chez les femmes et les enfants, du fait d'une explosion du temps passé devant des écrans. La consommation de sel, malgré une diminution au début des années 2000, demeure à un niveau excessif 62 ( * ) . Celle d'alcool reste trop importante, de même que celle de sucres. En particulier, la consommation de boissons sucrées chez les enfants constitue un problème important (plus d'un tiers des enfants dépassent la recommandation d'un demi-verre par jour). Inversement, la consommation de fruits et légumes et de fibres reste beaucoup trop faible 63 ( * ) , comme celle de poisson et de produits de la pêche. Enfin, la part des acides gras saturés dans les apports totaux en lipides reste trop élevée dans la ration alimentaire : pour à peine moins d'un Français sur cinq cette part est inférieure à 36 %, tandis que les profils en acides gras assimilés restent largement déficitaires en omega-3.
Globalement donc, l'alimentation des Français est trop riche et trop déséquilibrée.
2. Des risques de dénutrition qui n'ont pas disparu pour autant
La dénutrition se définit comme un état pathologique lié à la réduction des apports alimentaires, à une augmentation des besoins métaboliques ou à la combinaison de ces deux facteurs. De manière paradoxale, l'abondance alimentaire caractéristique des sociétés développées n'empêche pas certaines populations d'être exposées à des risques de dénutrition, dont la pauvreté n'est pas la cause principale.
a) Dénutrition et vieillissement de la population
Selon les prévisions démographiques, le nombre des plus de 75 ans va passer de 6,1 millions de personnes aujourd'hui à 10,6 millions en 2040. Or, on sait que le vieillissement s'accompagne d'un risque accru de dénutrition pour des raisons à la fois physiologiques, psychologiques et sociologiques :
- sur le plan physiologique, les personnes âgées présentent des particularités métaboliques qui favorisent la survenue de la dénutrition 64 ( * ) . En particulier, contrairement à une idée reçue, elles ont des besoins en protéines supérieurs de 20 % à ceux d'une personne de moins de 50 ans ;
- sur le plan psychologique et sociologique, le vieillissement s'accompagne plus fréquemment de conditions de vie défavorables à une alimentation en quantité et qualité suffisantes. Le fait de vivre seul chez soi, de voir sa sociabilité réduite ou de devoir vivre dans un établissement collectif est en effet propice à la dénutrition.
Cette dénutrition, qui peut s'installer insidieusement ou au contraire survenir très rapidement après un stress, est à l'origine de conséquences négatives en cascade pour la santé des personnes âgées : diminution de la rapidité de cicatrisation ; affaiblissement des défenses immunitaires et donc exposition accrue aux risques infectieux ; perte de masse musculaire à l'origine d'une dépendance accrue dans les gestes de la vie quotidienne, de risques de chutes augmentés, d'une altération générale de la qualité de vie et donc d'un état dépressif. Tout cela crée un cercle vicieux qui aggrave la tendance à la dénutrition.
b) Des risques liés à l'émergence de nouveaux comportements alimentaires
Comme indiqué dans la première partie de ce rapport, on assiste aujourd'hui à la diffusion de régimes alimentaires assez éloignés des habitudes alimentaires historiques du fait de l'individualisation de la consommation alimentaire et de la multiplication des modèles et des sources de prescription nutritionnelles (par exemple, le régime vegan ou les régimes amaigrissants de toutes sortes sans contrôle médical). Un des enjeux des politiques de lutte contre la dénutrition sera donc de suivre de façon plus précise les risques liés à ces nouveaux modes de consommation.
3. Une attention croissante portée aux risques diffus et de long terme
a) Des risques sanitaires émergents
La sécurité sanitaire des aliments est aujourd'hui garantie avec un degré de confiance élevé dans les pays développés grâce aux progrès des techniques de conservation et aux dispositifs de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments mis en place par les pouvoirs publics. Si des dysfonctionnements, à un stade ou un autre de la chaîne alimentaire, causent encore chaque année un nombre non négligeable de cas d'infections alimentaires, conduisant parfois à des décès, le nombre et la gravité de ces cas sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Dans les années 1950, en France, 15 000 personnes mouraient chaque année du fait d'infections alimentaires. Ce chiffre est tombé à 250 environ, alors même que la population a augmenté de 50 % dans l'intervalle 65 ( * ) .
Parce que les risques sanitaires liés à la qualité bactériologique des aliments sont de mieux en mieux maîtrisés, l'attention de la population, des chercheurs et des autorités sanitaires tend à se focaliser désormais vers des risques sanitaires nouveaux ou des risques jusqu'à présent s considérés comme secondaires, à savoir :
- les risques pour les consommateurs 66 ( * ) liés à l'utilisation de pesticides de synthèse. Les interrogations portent sur une possible perturbation du métabolisme résultant de la présence résiduelle de ces substances ;
- les risques liés à une alimentation ultra-transformée et donc à l'utilisation massive d'additifs. Environ 330 additifs sont autorisés sur le marché européen et les consommateurs en ingèrent quotidiennement des dizaines. Or, au cours des dernières années, plusieurs études expérimentales animales ou in vitro ont été publiées, suggérant des effets adverses de ces additifs (effets carcinogènes, effet de perturbateurs endocriniens et du microbiote, etc.). D'où une interrogation montante sur leurs effets à long terme chez l'homme, notamment en raison d'effets de cocktail.
b) La nécessité de faire évoluer les outils d'évaluation des risques sanitaires
Les outils traditionnels de mesure des risques sanitaires n'ont pas été conçus pour évaluer les effets d'une exposition diffuse sur le long terme, de surcroît quand sont impliqués des effets de cocktail. Une évolution des outils d'évaluation des risques sanitaires de l'alimentation est donc nécessaire. Elle est d'ailleurs déjà en cours dans le cadre de l'étude NutriNet-Santé lancée en 2009. Basée sur le suivi de l'alimentation de 165 000 personnes, cette étude récolte des données longitudinales massives sur l'exposition nutritionnelle et les comportements alimentaires émergents. Grâce à l'exploitation de cette base, le laboratoire Eren a déjà publié de nombreux articles dans les revues scientifiques et médicales de référence permettant de mieux mesurer les effets sanitaires des expositions environnementales alimentaires 67 ( * ) . Il est essentiel de poursuivre cet effort de recherche et, pour cela, de répondre au besoin de financement de la recherche publique et indépendante dans ce domaine, où l'on sait que les conflits d'intérêt potentiels existent. Ces travaux de recherche permettront, au cours des prochaines années, de renforcer des niveaux de preuves qui sont seulement suggérés à l'heure actuelle.
c) Ne pas se tromper sur la hiérarchisation des niveaux de risque
L'application du principe de précaution a conduit Santé publique France à formuler des recommandations générales relatives aux aliments ultra-transformés ou aux résidus de pesticides dans le PNNS 4, lorsqu'il existe des relations possibles entre certaines pathologies et certaines expositions environnementales alimentaires, documentées par des études animales ou in vitro, mais encore non démontrées en population humaine. Santé publique France conseille ainsi de limiter l'exposition aux colorants, conservateurs, antioxydants, agents de texture (émulsifiants, amidons modifiés), exhausteurs de goût et autres édulcorants, et donc de limiter la consommation d'aliments ultra-transformés pour privilégier plutôt celle d'aliments bruts ou peu transformés. De même, Santé publique France recommande de privilégier la consommation de produits bio pour limiter l'exposition aux résidus de pesticides.
De manière un peu paradoxale, ces risques possibles liés aux pesticides et aux additifs alimentaires, bien qu'ils ne soient pas encore démontrés en population générale, sont ceux qui suscitent le plus de crainte chez les consommateurs. Il est donc important de conserver vis-à-vis de la population des messages nutritionnels clairs et hiérarchisés pour éviter d'ancrer dans la population des représentations fausses sur les niveaux de risques :
- les facteurs nutritionnels de l'alimentation (excès de gras, de sucre, de sel, de calories ou insuffisance de fibres, etc.) sont associés de manière certaine à des pathologies graves extrêmement répandues. Si l'on veut améliorer fortement et rapidement l'état de santé de la population, c'est sur ces facteurs sanitaires que doit porter l'essentiel du travail de prévention via des recommandations spécifiques de santé publique ;
- les facteurs non nutritionnels (comme le degré de transformation de l'alimentation ou la présence de résidus de pesticides) sont pour leur part associés seulement de manière possible à des pathologies. C'est pourquoi ils doivent faire l'objet de recommandations générales en attendant leur éventuelle confirmation en population générale.
C. UNE PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DE L'ALIMENTATION
Depuis plusieurs années, le système alimentaire français est classé comme le plus vertueux des pays développés selon le Food Sustainability Index . Ce classement international 68 ( * ) montre que la France est en pointe en termes de durabilité de son alimentation comparativement aux autres pays . Il serait pourtant erroné d'en tirer un argument pour minorer l'ampleur des transformations à lui apporter, car, dans sa configuration actuelle, le système alimentaire français n'est pas plus soutenable que les autres sur le plan environnemental.
1. Les systèmes alimentaires sont fortement impliqués dans le réchauffement global
Au niveau mondial, le GIEC estime que les activités agricoles expliquent 13 % des émissions de CO 2 , 44 % des émissions de méthane (CH 4 ) et 81 % de celles de protoxyde d'azote (N 2 O) sur la période 2007-2016, ce qui représente 23 % du total des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine anthropique 69 ( * ) . Les émissions agricoles ne représentent cependant qu'une estimation basse des émissions du système alimentaire dans son ensemble, car ce dernier génère aussi des émissions en amont (notamment pour produire les engrais) et en aval (au niveau de la transformation, de la distribution et de la consommation). Au cours de la dernière décennie, des outils méthodologiques reposant sur l'analyse du cycle de vie ont été développés pour tenter de mesurer l'empreinte carbone cumulée tout au long de la chaîne de valeur de l'alimentation. Une récente étude de l' Institute for climate economics (I4CE) 70 ( * ) estime ainsi à 13,8 Gteq CO 2 , les émissions totales de la demande alimentaire mondiale en 2010, ce qui représente 28 % des émissions mondiales tous secteurs confondus, avec cependant, soulignent les auteurs, de fortes marges d'erreur. À elles seules, les émissions générées par la consommation de produits de l'élevage représenteraient 62 % des émissions de la consommation alimentaire mondiale.
Dans le cas de la France, l'Ademe s'est associée à divers partenaires dans le cadre du programme Agribalyse pour développer les outils nécessaires au chiffrage des émissions de GES de l'alimentation du « champ à l'assiette », en incluant aussi les émissions générées par les importations alimentaires. Il apparaît que l'empreinte carbone de l'alimentation française s'élève à 163 Mt d'eqCO2, soit 24 % de l'empreinte carbone des ménages en France 71 ( * ) . L'analyse détaillée de l'empreinte carbone du système alimentaire français 72 ( * ) montre que c'est l'amont du système alimentaire qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre (GES) : la production agricole représente en effet à elle seule les deux tiers de l'empreinte carbone totale du système alimentaire. Plus des trois quarts (77 %) des émissions agricoles de GES sont par ailleurs liées à deux causes :
- la production animale. Le méthane (CH 4 ) produit par la fermentation entérique des ruminants et les effluents d'élevages représentent 44 % des émissions agricoles ;
- la fabrication et l'usage d'engrais azotés de synthèse. Ces derniers produisent en effet du protoxyde d'azote (N 2 O). Cela représente plus du tiers (34 %) des émissions.
Il faut noter que ces émissions de N 2 O sont elles-mêmes très fortement liées à l'élevage, car plus de la moitié des céréales et des oléoprotéagineux produits en France servent à nourrir les animaux d'élevage 73 ( * ) . Au total, en agrégeant les émissions de méthane et celles de protoxyde d'azote associées à la production de nourriture pour l'élevage, les produits animaux sont à l'origine d'environ 60% des émissions de GES de l'agriculture.
L'analyse détaillée de l'empreinte carbone « produit par produit » conforte cette analyse globale : les aliments végétaux (légumes, fruits, céréales, légumineuses) ont, quasi systématiquement, un impact CO 2 par kilogramme de produit plus faible que les produits animaux (viande, lait). En outre, parmi ces derniers, l'impact carbone de la viande de ruminants apparaît significativement plus fort que celle du porc, de la volaille, des oeufs et du lait.
2. Les systèmes alimentaires sont fortement impliqués dans le déclin de la biodiversité
La question des impacts du système alimentaire sur la biodiversité est de mieux en mieux documentée. Parmi les travaux d'ampleur les plus récents, on peut citer celui sur des données de captures d'insectes réalisées en Allemagne depuis 1989 74 ( * ) : il révèle une baisse spectaculaire et inquiétante de 76 % du nombre des insectes volants. Une autre étude, consistant en une méta analyse de 73 études réalisées à l'échelle mondiale, parue en 2019 75 ( * ) , confirme à la fois l'ampleur des pertes de biodiversité enregistrées dans la période récente (40 % des espèces d'insectes ont disparu au cours des dernières décennies dans le monde) tout en soulignant le lien étroit entre ces pertes et les pratiques agricoles intensives. Les pertes d'habitat (liées à la conversion à l'agriculture intensive de zones naturelles, notamment forestières, ou de zones agricoles jusqu'alors exploitées de manière extensive) apparaissent comme étant la principale cause du déclin de la biodiversité, devant les pollutions liées à l'utilisation d'intrants chimiques ou le changement climatique.
Cette hiérarchisation des causes est utile pour éclairer la réflexion sur les liens entre alimentation et biodiversité. Il est en effet fréquent de pointer d'abord, sinon exclusivement, les effets négatifs de la pollution agricole sur la biodiversité (utilisation de pesticides, de fertilisants ou de méthodes de protection des semences) . Ces effets sont réels et massifs. Toutefois, avant l'utilisation intensive d'intrants, il semble que ce soit la destruction des habitats naturels qui exerce l'effet majeur. Sans même parler de la déforestation ou des destructions de zones humides, le simple fait de convertir de vastes parcelles à la monoculture suffit à éliminer toutes les espèces non adaptées à ce paysage simplifié à l'extrême.
Il est nécessaire enfin de souligner un autre aspect important des liens entre alimentation et biodiversité : il concerne plus spécifiquement la biodiversité des sols, qui est constituée à la fois de micro-organismes et d'insectes. M. Jean-François Soussana, vice-président de l'Inrae, lors de son audition par la délégation, a alerté sur l'état extrêmement détérioré des sols, indispensables à l'agriculture et à l'alimentation : « Nous vivons aux dépens d'une banque du sol qui est en train de perdre son capital. » 76 ( * ) Restaurer ce capital suppose l'abandon des pratiques agricoles nuisibles pour les sols et la vie qu'ils abritent et leur remplacement par des pratiques culturales moins agressives, basées sur la diversification des cultures et l'adoption de rotations plus longues, la gestion raisonnée des résidus de cultures et des bords de champs, l'implantation de couverts d'intercultures ou encore le raisonnement des interventions phytosanitaires.
II. SOBRIÉTÉ ET VÉGÉTALISATION : DEUX AXES POUR GUIDER LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE
Pour restaurer la soutenabilité de notre système alimentaire sur la plan de la santé, de l'environnement et de l'autonomie protéique, les transformations à lui apporter s'organisent selon deux axes principaux : sobriété et végétalisation.
A. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION PLUS SOBRE
Aller vers plus de sobriété dans l'alimentation, cela signifie deux choses : ingérer moins de nourriture, mais aussi réduire les gaspillages et les pertes alimentaires.
1. Manger moins
Ramener ses apports alimentaires, aujourd'hui excessifs, aux niveaux recommandés selon l'âge, le sexe ou l'activité physique aurait un effet bénéfique sur le taux d'obésité et de surpoids et, par suite, sur le niveau de santé moyen de la population. Une plus grande sobriété aurait aussi un effet positif sur l'environnement, notamment du fait de la réduction des émissions de GES. À cet égard, il est important de souligner que la sobriété est bien la condition première de toute amélioration de l'empreinte écologique du système alimentaire. La question de la composition des assiettes, c'est-à-dire de la part relative que devraient y occuper les différents aliments, est importante, nous y reviendrons, mais elle est secondaire par rapport à celle de la quantité de nourriture et de l'apport énergétique global de notre régime alimentaire. Les études qui ont évalué l'impact environnemental des changements d'alimentation 77 ( * ) , notamment pour ce qui concerne le niveau des émissions de GES, convergent sur la conclusion que l'empreinte carbone de l'alimentation ne baisse que faiblement (voire même augmente) si on se contente de modifier le poids relatif des différents aliments en conservant un apport énergétique total inchangé . Il n'est possible d'atteindre des réductions d'émissions significatives, de l'ordre de 20 ou 30 %, qu'à la condition première de moins manger 78 ( * ) . Les changements de composition des assiettes sont seulement un paramètre qui amplifie ou au contraire atténue les effets d'une plus grande sobriété. Cela s'explique assez simplement par le fait qu'il existe une forte corrélation positive entre quantités de nourriture ingérées, apports énergétiques totaux et émissions de GES.
L'évolution vers plus de sobriété alimentaire est une hypothèse-clé dans tous les scénarios prospectifs sur l'alimentation. Cette hypothèse se retrouve par exemple dans le scénario « Land use for food quality and healthy nutrition » de la prospective Agrimonde-Terra, déjà évoquée. Ce scénario « sain », qui repose sur l'hypothèse d'un rééquilibrage de tous les régimes alimentaires vers une cible de 2 750 à 3 000 kcal/jour par habitant, est le seul qui soit soutenable parmi les cinq explorés par la prospective. Concrètement, il implique, pour les pays développés et une partie des pays émergents, où la disponibilité calorique est excessive, de consommer moins de calories.
Cette hypothèse de sobriété est également centrale dans la prospective nationale AfTerres 79 ( * ) , dont le scénario fait l'hypothèse d'une réduction des quantités ingérées de 10 % entre 2010 et 2050, ainsi que dans la prospective européenne TYFA 80 ( * ) réalisée par l'Iddri, dont le scénario comporte l'hypothèse d'une baisse de la prise calorique de 2 606 à 2 445 kcal par jour (-6,2 %).
2. Moins gaspiller
C'est le second axe d'une alimentation plus sobre. Selon la FAO, au niveau mondial, les pertes alimentaires cumulées tout le long de la chaîne de valeur représentent en effet 25 à 30 % des quantités produites. Dans le cas particulier de la France, selon l'Ademe, ces pertes équivalent à 10 millions de tonnes de produits par an. Toutes les étapes de la chaîne alimentaire nationale y contribuent 81 ( * ) . Rien qu'au stade de la consommation, ces pertes représentent 30 kg d'aliments par personne et par an, dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés - ce qui, au prix des aliments à ce stade de la chaîne de valeur représente 108 € par an et par personne.
Les enjeux environnementaux de la maîtrise de ces pertes alimentaires sont significatifs. Au niveau mondial, on estime qu'elles contribuent par exemple pour 8 à 10 % des émissions anthropiques de GES 82 ( * ) . Pour la France, l'Ademe estime que les pertes sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 15,3 millions de tonnes équivalent CO 2 . Par ailleurs, outre cet effet sur l'atténuation des émissions de GES, moins gaspiller permettrait aussi de réduire la pression sur les terres agricoles.
B. LA NÉCESSITÉ D'UNE ALIMENTATION PLUS VÉGÉTALISÉE
La végétalisation de l'alimentation désigne le rééquilibrage 83 ( * ) des apports végétaux et animaux dans notre régime alimentaire. Comme la sobriété, cette végétalisation est souhaitable pour des raisons qui touchent à la santé, à l'indépendance protéique mais également à l'environnement.
1. La végétalisation de l'alimentation bonne pour la santé
En France, les produits animaux fournissent les deux tiers (soit 60 g/j) d'une consommation individuelle de protéines qui s'établit à 90 g/j. Or, l'OMS fixe les apports conseillés en protéines de 50 à 70 g/j pour une population adulte en bonne santé 84 ( * ) et elle recommande un apport de protéines végétales 85 ( * ) représentant la moitié de l'apport protéique total (soit un apport de 25 à 30 g/j de protéines animales). La consommation de protéines animales des Français pourrait être réduite de moitié sans tomber sous le niveau nutritionnellement recommandé. On peut certes argumenter qu'un excès modéré d'apport protéique animal ne constitue pas un risque majeur pour la santé 86 ( * ) . Toutefois, une partie des déséquilibres nutritionnels de notre alimentation découle indirectement d'une consommation excessive de produits animaux et, corollairement, d'une consommation insuffisante de certains produits végétaux. Comme on l'a vu, les apports de fibres, sont actuellement trop faibles en France, ainsi que dans tous les pays développés. Inversement, les apports de graisses, notamment de graisses saturées, dépassent les seuils recommandés. Accroître la consommation de certains produits végétaux tout en réduisant celle de produits animaux contribuerait à résorber simultanément ces deux déséquilibres.
|
Sain et végétal : éviter une assimilation simpliste Si réduire les risques de certaines pathologies suppose d'accroître significativement la part des produits végétaux dans l'alimentation, assimiler sans nuance végétal et sain est faux : - d'une part, tous les aliments d'origine végétale ne contribuent pas à une alimentation mieux équilibrée. À la base de l'alimentation la moins saine des pays occidentaux (ce que l'on appelle le western diet ), on trouve de nombreux ingrédients végétaux. C'est le cas notamment des boissons sucrées, des frites, de l'huile de palme ou des céréales raffinées. Ces aliments dotés d'une forte densité énergétique, généralement très bon marché, sont surreprésentés dans l'alimentation contemporaine, notamment dans les catégories socialement défavorisées, et contribuent clairement à l'épidémie d'obésité. L'enjeu nutritionnel de la végétalisation n'est donc pas d'accroître sans nuance la part du végétal, mais plutôt d'augmenter la part de bons végétaux insuffisamment consommés (fruits et légumes, légumes secs et céréales complètes). Cela suppose de résoudre le problème de l'accès économique aux bons végétaux, car ces derniers sont parfois significativement plus chers ; - d'autre part, il faut rappeler qu'une alimentation intégralement végétale est nutritionnellement risquée. En théorie, les besoins en acides aminés d'un adulte en bonne santé peuvent être couverts par un apport mixte de céréales et de légumineuses. Les nutritionnistes soulignent néanmoins qu'équilibrer un régime exclusivement végétal suppose une grande expertise nutritionnelle et présente des risques de carence en acides aminés essentiels, en vitamine B12 ou encore en fer. De plus, un tel régime est inadapté pour certains types de populations (personnes âgées, enfants, femmes enceintes, sportifs...). Les nutritionnistes déconseillent par conséquent d'éliminer complètement les produits animaux et préconisent plutôt une alimentation comprenant entre un tiers et la moitié d'apports protéiques d'origine animale. |
2. La végétalisation est bonne pour l'environnement
a) Les bénéfices écologiques attendus d'une moindre consommation de viande
(1) Inventaire des arguments environnementaux en faveur de la baisse de produits animaux
Il existe des arguments multiples pour soutenir que le niveau extrêmement élevé de la consommation de produits animaux observé en France et, plus largement dans les pays occidentaux et une partie des pays émergents, exerce une pression considérable sur l'environnement :
- comme on l'a vu, les produits carnés sont ceux qui émettent le plus de CO 2 par quantité de nourriture produite 87 ( * ) . Toutes choses égales par ailleurs, réduire leur consommation permet donc d'obtenir des baisses d'émissions de GES plus fortes que celles qu'on obtiendrait en réduisant la consommation des autres familles d'aliments. C'est la raison pour laquelle les efforts de sobriété alimentaire doivent porter en priorité sur les produits animaux : c'est le moyen de donner à cette sobriété son effet de levier maximum en matière d'atténuation des émissions ;
- des surfaces agricoles considérables sont aujourd'hui mobilisées pour produire la nourriture des animaux. Près de 60 % des céréales et 70 % des oléagineux disponibles en Europe y sont consacrés 88 ( * ) . La baisse de notre consommation de produits animaux permettrait par conséquent de libérer et de réallouer d'importantes surfaces de terres vers la production directe d'aliments pour les humains. Cela réduirait également la pression foncière sur les espaces naturels et forestiers mondiaux. L'intensification de l'élevage au cours des dernières décennies est en effet l'une des principales causes de la déforestation mondiale, et donc du déclin de la biodiversité et de la disparition des puits de carbone naturels. En 2010, on estime ainsi que 30 % des 30 millions de tonnes de tourteaux de soja importés par l'Union européenne en provenance du Brésil et de l'Argentine étaient issues de la déforestation ou de la dé savanisation 89 ( * ) ;
- l'utilisation massive d'engrais azotés et de pesticides pour produire en monoculture intensive des céréales et des protéagineux destinés aux animaux est une source majeure de pollution aux nitrates du milieu ambiant, aérien et aquatique ;
- enfin, l'élevage à grande échelle est une activité qui sollicite fortement les ressources en eau sur lesquelles des tensions croissantes s'exercent du fait du réchauffement climatique.
(2) Une hypothèse centrale dans tous les scénarios prospectifs sur l'alimentation
Ramener la consommation de produits animaux au niveau recommandé par l'OMS ou le PNNS n'aurait que des impacts écologiques positifs. C'est la raison pour laquelle cette baisse fait partie des hypothèses retenues dans tous les scénarios prospectifs sur l'alimentation. C'est le cas dans le rapport Agrimonde-Terra ou dans le rapport AfTerres. Ce dernier envisage en 2050 (cf. tableau suivant) une forte augmentation de la consommation de céréales (+20 %), de légumes (+22 %) et de légumineuses (+310 %) et, inversement, une diminution de la consommation de viande (-49 %), de produits de la mer (-74 %), mais aussi d'oeufs et de produits laitiers. C'est également le cas dans le scénario TYFA dont le modèle fait l'hypothèse d'une baisse des apports de protéines animales (-50 %).
L'assiette moyenne en 2050 dans le scénario AfTerres
(3) Des effets mesurables de la végétalisation de l'alimentation sur les émissions de GES
Les études disponibles confirment le rôle de la végétalisation dans la maîtrise des émissions du système alimentaire. Ainsi, des travaux de l'Inrae 90 ( * ) montrent qu'en ramenant la consommation moyenne de viande rouge à 50 g/j par personne et en supprimant les charcuteries, les émissions de GES diminueraient en moyenne de 12 %. L'effet est donc significatif. Toutefois, comme nous l'avons déjà souligné, la végétalisation n'exerce cet effet positif que si l'apport énergétique est également diminué. Si les calories « perdues » sont compensées par l'apport de calories provenant d'autres aliments, comme les produits laitiers ou les plat préparés (qui sont des plats à forte densité énergétique), la réduction des émissions de GES persiste mais avec une moindre ampleur. En revanche, si la viande et les charcuteries sont remplacées par des fruits et légumes de manière iso-calorique, les émissions de GES ne baissent pas, voire même augmentent 91 ( * ) .
|
Quand la végétalisation entraîne la hausse des émissions carbone Contrairement à l'idée reçue, un régime fortement végétalisé peut avoir un impact carbone relativement élevé, si l'on souhaite qu'il soit nutritionnellement équilibré et apporte l'ensemble des macro et des micronutriments nécessaires à une bonne santé . C'est ce qu'ont prouvé plusieurs études conduites dans les années 2000 et 2010. L'explication en est simple : un régime végétal, pour être nutritionnellement complet et équilibré, doit réduire la quantité de produits très énergétiques, riches en sucre ou en graisses, et accroître parallèlement la quantité des aliments, comme les fruits et légumes, qui, eux, ont une faible densité énergétique, mais apportent de nombreux micronutriments essentiels, ainsi que des fibres. Alors qu'avec une alimentation fondée sur des produits végétaux de forte densité énergétique, 750 g d'aliments suffisent à nourrir un homme, il faut en revanche en ingérer 1,85 kg pour obtenir le même apport énergétique dans un régime méditerranéen, recommandé par les nutritionnistes. Les émissions de GES étant croissantes avec les quantités d'aliments ingérés, un régime végétalisé équilibré peut en définitive présenter un impact carbone plus mauvais qu'un régime comportant une part de produits animaux. Les régimes les plus sains observés dans la population française ont d'ailleurs des niveaux d'émissions de GES sensiblement supérieurs aux régimes les moins sains (+9 % pour les régimes sains des hommes et +22 % pour ceux des femmes) 92 ( * ) . |
b) Manger moins de viande, tout en maintenant un élevage indispensable à la conversion agroécologique
Le message nutritionnel et écologique prônant une baisse de la consommation de viande est parfois interprété d'une façon radicale qui conduit à stigmatiser, voire à proscrire, la consommation de produits animaux. Ce discours négatif concerne tout particulièrement l'élevage des ruminants, accusé d'être une cause majeure du réchauffement climatique du fait des émissions entériques de méthane. Cette vision repose sur une prise en compte incomplète des impacts sur l'environnement.
(1) Élevage et environnement : des liens à prendre en compte dans toute leur complexité
Pour apprécier la réalité des impacts écologiques de l'élevage, il faut prendre en compte de nombreux paramètres :
- le premier est le niveau de départ de la consommation de produits carnés dans certains pays comme la France. C'est parce que ce niveau est extrêmement élevé qu'on peut préconiser sa réduction au nom de la défense de l'environnement sans risquer pour autant d'exposer la population à des risques de carence en nutriments essentiels ;
- il est important également de distinguer le type de critères pris en compte pour mesurer l'impact environnemental. Selon qu'on s'intéresse uniquement aux émissions de GES ou qu'on intègre aussi les effets sur la biodiversité ou les problématiques de pression foncière, on ne parvient pas nécessairement aux mêmes conclusions ;
- enfin, le type d'élevage et le mode de production doivent absolument être distingués, ce que ne permettent malheureusement pas toujours les données statistiques disponibles. L'élevage de ruminants n'a pas les mêmes impacts que celui des monogastriques. Un élevage extensif n'a pas le même effet qu'un élevage intensif.
Prendre en compte toute la complexité des liens entre élevage et environnement permet de montrer que l'élevage n'est pas en soi nuisible à l'environnement et, inversement, que la végétalisation de l'alimentation ne produit pas toujours que des effets positifs. Cela conduit à déplacer le débat, qui ne doit pas opposer schématiquement pro et anti viande, mais porter sur le positionnement précis du curseur : jusqu'où réduire la consommation de produits animaux ? Sur quels types d'élevages cette baisse doit-elle porter en priorité ? En particulier, alors que l'élevage de ruminants est souvent accusé d'exercer un effet négatif sur l'environnement, il apparaît qu'il est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition agroécologique de l'agriculture. Selon le scénario TYFA de conversion de l'agriculture européenne à l'agroécologie, il est même une hypothèse-clé de la réussite de cette conversion.
(2) L'élevage des ruminants permet d'optimiser l'usage des surfaces agricoles
L'élevage à l'herbe des ruminants permet en premier lieu de produire de la nourriture ingérable par l'homme à partir de surfaces en prairies impropres à la culture. Sans lui, les prairies seraient « stériles » pour le système alimentaire et il faudrait donc mobiliser d'avantage de terres cultivables hors des espaces prairiaux pour compenser la disparition des produits animaux de notre alimentation. De plus, l'élevage permet la valorisation de coproduits végétaux qui ne sont pas consommables directement par l'homme et qui seraient donc gaspillés si les animaux d'élevage ne les transformaient pas en produits ingérables par les humains. Là encore, pour compenser la non valorisation de ces coproduits végétaux par l'élevage il faudrait mobiliser plus de terres arables. Des simulations chiffrées ont permis de mesurer ce phénomène : pour nourrir une population en réduisant au minimum la surface des terres cultivées, il faut que le régime alimentaire comprenne de 15 à 30 % de protéines d'origine animales 93 ( * ) . En-deçà de ce seuil, compenser la non-utilisation des prairies et de certains coproduits végétaux conduit à augmenter la surface cultivée. Au-dessus, il faut aussi mobiliser plus de terres, mais cette fois-ci pour fournir des céréales et des protéagineux à un cheptel trop nombreux pour se nourrir uniquement d'herbe des prairies et des coproduits végétaux de l'alimentation humaine.
Source : Inrae, d'après Van Kernebeek et al. (2015) 94 ( * )
Cela constitue un résultat important, qui signifie que l'option la plus pertinente du point de vue de l'usage des terres n'est pas de faire disparaître l'élevage, mais de le recentrer sur les pâturages et sur les disponibilités en coproduits végétaux qui n'auraient pas d'usage en-dehors de l'alimentation animale.
(3) L'élevage extensif contribue à la biodiversité et fournit de nombreux services agro-systémiques
L'élevage à l'herbe contribue également à la préservation de la biodiversité. Plus du quart des espaces classés comme habitats d'importance communautaire en raison de leur contribution à la biodiversité sont des écosystèmes prairiaux. Les atteintes à la biodiversité mesurées au cours des dernières décennies s'expliquent en partie par le fort recul des prairies dans l'agriculture européenne. Leur part dans la surface agricole européenne a baissé de 14 % entre 1962 et 2010 à l'échelle de l'UE 28 95 ( * ) , entraînant la destruction de réservoirs de biodiversité précieux. Les prairies fournissent aussi des services agro-systémiques précieux, comme le stockage du carbone 96 ( * ) et la filtration de l'eau.
(4) L'élevage ruminant est un levier essentiel de l'optimisation du cycle de l'azote
On retrouve ici un fait connu depuis l'invention de l'agriculture : l'élevage fournit des effluents riches en matière azotée utilisables pour la fertilisation des sols. Avec le développement des engrais azotés de synthèse au XX e siècle, la fertilisation animale a cependant perdu une grande partie de son rôle historique dans ce domaine. L'industrie pouvant fournir les fertilisants nécessaires aux cultures, une spécialisation s'est opérée entre des territoires tournés vers les productions végétales et des territoires tournés vers les productions animales : « les productions animales et végétales ont été progressivement découplées, ce qui s'est traduit spatialement par la constitution de territoires spécialisés dans la production végétale d'une part, desquels les prairies permanentes ont progressivement disparu, dans la production animale d'autre part » 97 ( * ) .
Cette déconnexion a bouleversé les conditions du bouclage du cycle de l'azote. Quand ce cycle fonctionne correctement, les prairies, grâce à la part importante de légumineuses qu'elles comportent 98 ( * ) , fixent l'azote de l'air ; cet azote symbiotique est ensuite transféré vers le reste de la sole cultivée sous forme d'effluents des ruminants. En revanche, dans un système d'agriculture hyperspécialisée et intensive tel qu'il existe aujourd'hui dans les pays développés, le transfert d'azote des prairies vers la sole cultivée se réalise de manière beaucoup moins systématique puisque l'élevage a été exclu des zones de production végétale les plus intensives. On a ainsi une situation écologiquement absurde où l'azote synthétisé dans les prairies est perdu, tandis que l'azote nécessaire aux cultures est synthétisé par l'industrie 99 ( * ) .
Cette situation est responsable d'émissions agricoles massives de GES sous forme de protoxyde d'azote, ainsi que de pollutions importantes par les nitrates. C'est la raison pour laquelle, avec les apports d'azote permis par les légumineuses, sur lesquels le rapport reviendra plus loin, maintenir un élevage de ruminants est en réalité une composante centrale d'une stratégie systémique de limitation des émissions de GES.
C. SOBRIÉTÉ ET VÉGÉTALISATION SONT DES SOLUTIONS DURABLES, MAIS AUSSI CULTURELLEMENT ACCEPTABLES
Si la sobriété et la végétalisation de notre alimentation sont souhaitables pour des raisons sanitaires et écologiques, constituent-elles pour autant un programme appétissant ? Ne risquent-elles pas de heurter nos goûts et nos habitudes ? La réponse à ces questions n'est pas anecdotique, car un régime alimentaire a peu de chances de s'imposer s'il n'est pas également culturellement acceptable, autrement dit s'il ne permet pas de concilier les diverses dimensions du bienmanger : santé et environnement, mais aussi plaisir et cultures culinaires.
Pour répondre à cette question de l'acceptabilité culturelle de régimes sobres et végétalisés, plusieurs études scientifiques ont été réalisées au cours des dernières années. Les résultats obtenus sont remarquables et plutôt rassurants :
- une de ces études 100 ( * ) a analysé les consommations alimentaires des Français à partir de l'enquête Inca 2 101 ( * ) en cherchant à mesurer leur adéquation aux recommandations alimentaires officielles et en calculant leur empreinte carbone. Cette étude met en évidence qu'il existe dans la population un ensemble de mangeurs minoritaires mais exemplaires, qualifiés de « déviants positifs », qui représentent environ 20 % de la population totale : leur régime présente à la fois une plus haute valeur nutritionnelle et un plus faible impact carbone que les autres sous-populations. Il émet près de 20 % de GES de moins que celui de la moyenne de la population. Cela tient à la fois au fait qu'il se caractérise par une plus grande sobriété (ces mangeurs absorbent 200 kilocalories par jour de moins que la moyenne des mangeurs), par une moindre consommation de viande, de desserts et de snacks sucrés et salés et par une consommation plus importante de fruits et légumes, ainsi que de féculents. Ce régime alimentaire à la fois plus sobre et moins carné, plus sain et moins polluant, n'a rien d'ascétique ni de « bizarre », comme l'illustre le schéma suivant.
- une autre étude 102 ( * ) a procédé par modélisation des diètes alimentaires. Elle a cherché à identifier celles qui permettent à la fois de minimiser les émissions de GES et de minimiser l'écart par rapport à la diète moyenne actuelle, tout en respectant les apports nutritionnels. Il apparaît que les émissions de GES pourraient être réduites de 30 % sans qu'il soit nécessaire de modifier notre régime alimentaire au-delà de ce que prévoient déjà les recommandations des autorités publiques 103 ( * ) . En pratique, on peut en effet concilier santé, environnement et habitudes alimentaires en consommant un peu plus de fruits et de légumes 104 ( * ) et un peu moins de viande, de poisson et d'oeufs 105 ( * ) . C'est uniquement pour atteindre des baisses d'émissions plus importantes qu'il faudrait opérer des changements drastiques par rapport à notre régime alimentaire actuel.
Ces différents travaux apportent des éléments essentiels à la réflexion, puisqu'ils démontrent qu'on peut significativement améliorer l'impact sanitaire et écologique de l'alimentation sans bouleverser les habitudes alimentaires : inutile d'éliminer des catégories entières d'aliments ni d'introduire des aliments radicalement nouveaux dont l'acceptabilité culturelle est vraisemblablement faible (du type insectes ou viande de culture). La transition alimentaire du XXI e siècle n'implique pas une rupture avec notre culture et notre histoire culinaire et gastronomique, mais plutôt une inflexion de nos pratiques et de nos goûts.
III. QUELS LEVIERS ACTIONNER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ALIMENTAIRE DU XXIE SIÈCLE ?
Dès lors que l'on a identifié les contours d'une alimentation bonne pour la santé et l'environnement et en même temps susceptible de s'accorder avec notre culture alimentaire, la question se pose de savoir comment réaliser la transition vers cette nouvelle alimentation.
A. LA TRANSITION ALIMENTAIRE SERA TIRÉE PAR LA DEMANDE
Des signes montrent que ce processus est déjà engagé dans notre pays, comme en témoignent depuis plusieurs années la baisse de la consommation de produits animaux, l'essor rapide de secteur bio, la méfiance croissante à l'égard des pratiques d'ultra transformation industrielle ou encore l'existence d'une population de « déviants positifs », qui réconcilient santé et environnement dans une alimentation plus sobre et plus végétale.
Ces mutations de la demande alimentaire sont capables d'exercer un puissant effet d'entraînement sur l'ensemble du système alimentaire. Au fur et à mesure que se transforment les goûts, les exigences et les pratiques des consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire, des agriculteurs aux distributeurs en passant par les transformateurs, sont en effet elles-mêmes fortement incitées à adapter leur offre. Leur capacité d'innovation et d'adaptation n'est plus à prouver. Depuis une dizaine d'années, on observe ainsi de nombreuses innovations, comme l'arrivée en masse de produits végétaux dans les rayons ou le développement accéléré des produits bio.
Les pouvoirs publics, État et collectivités locales, n'ont donc pas à créer un mouvement. Ils doivent plutôt prendre appui sur la dynamique sociétale émergente en s'attachant à identifier et à lever les freins qui pourraient empêcher son plein déploiement 106 ( * ) .
En premier lieu, les pouvoirs publics doivent réaliser un portage politique plus ambitieux de la transition alimentaire. Cette dernière doit explicitement devenir l'une des priorités stratégiques de l'État, car elle est la condition de l'atteinte de ses objectifs de santé publique et du succès des politiques environnementales. En s'engageant à soutenir dans la durée les transformations du système alimentaire pour aller vers plus de sobriété et de végétal, vers moins d'impacts écologiques et sanitaires, l'État fixerait un cap propice à la réalisation des investissements nécessaires par les acteurs économiques. C'est vrai notamment pour le secteur agricole.
En deuxième lieu, dans le schéma d'une transition alimentaire tirée par la demande, la réussite de la transition dépend avant tout de la diffusion dans l'ensemble de la population des pratiques alimentaires les plus durables. Plus nombreux seront les consommateurs à se tourner vers des régimes alimentaires vertueux, plus puissant sera l'effet d'entrainement sur le secteur de l'offre. Or, les régimes sains sont aujourd'hui socialement très cloisonnés. Ils font leur chemin principalement parmi les classes sociales urbaines aisées et diplômées. Pour que la transition alimentaire ne reste pas enfermée dans un ghetto « bobo », l'État doit donc faire de la lutte contre les inégalités alimentaires le coeur de son action en faveur de la transition alimentaire.
La troisième priorité de l'État doit être de lever les verrous situés au niveau de l'offre alimentaire. Des situations de verrouillage de filières peuvent en effet exister. Le présent rapport se concentre sur l'un d'eux, encore trop méconnu : il concerne la filière des légumineuses.
B. LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS EST UNE DES CLÉS DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE
Dans un scénario de maintien du cloisonnement social des régimes alimentaires, les classes les plus modestes, qui sont aussi les plus nombreuses, conserveraient leur modèle alimentaire fortement impactant pour l'environnement et pour leur santé. Les indicateurs de santé publique liés à l'alimentation continueraient alors à se dégrader, tandis que les politiques environnementales, notamment sur le plan de la maîtrise des émissions de CO 2 , en seraient fortement handicapées. Le succès de la stratégie de transition alimentaire dépend donc crucialement de notre capacité à lever les barrières culturelles et économiques à la diffusion des régimes durables.
1. Diffuser les régimes durables en levant des barrières culturelles
a) Des barrières culturelles insuffisamment prises en compte dans les politiques nutritionnelles
De Maurice Halbwachs à Pierre Bourdieu, en passant par les époux Grignon, la sociologie a amplement fait la démonstration empirique de l'existence de cultures alimentaires différenciées en fonction de la situation sociale. Ces différences sociologiques de rapport à l'alimentation ont évidemment un impact fort sur la façon dont les individus s'approprient les recommandations nutritionnelles 107 ( * ) . Elles contribuent à expliquer pourquoi ces dernières ont peu d'effet sur les pratiques alimentaires des ménages modestes (ouvriers, employés). Les études sociologiques révèlent en effet un clivage très net entre ces derniers et les ménages plus aisés (cadres, professions intermédiaires) :
- pour les premiers, l'objectif d'équilibre nutritionnel (et le contrôle relativement soutenu des apports alimentaires qui va avec) est perçu comme une contrainte imposée de l'extérieur. Les messages nutritionnels officiels sont connus, mais restent lettre morte, car ils vont à l'encontre des goûts dominants, des habitudes de consommation et, en définitive, du plaisir de manger. En outre, leur respect imposerait d'inclure dans le régime des aliments plus chers que ceux habituellement consommés, ce qui, pour des ménages contraints financièrement, implique de limiter les dépenses dans d'autres postes de consommation et donc de renoncer à des plaisirs non seulement à table, mais aussi dans d'autres domaines. Ces « privations » au nom de la « santé » et de la « ligne » sont d'autant moins acceptées que le lien entre alimentation et santé n'est pas perçu comme évident dans ces milieux. Les individus y considèrent certes qu'il existe certains aliments bons pour la santé, parce qu'ils possèdent certaines vertus, mais ils n'appréhendent pas le lien entre alimentation et santé à l'échelle globale du régime alimentaire ni sur le long terme 108 ( * ) . De la même manière, le lien entre corpulence et santé n'est pas perçu comme évident : dans les milieux populaires, la recherche de la minceur se présente comme une question purement esthétique et non pas de santé. Au contraire même, la minceur ou la perte de poids sont fréquemment considérés comme des signes de santé fragile ;
- dans les milieux aisés en revanche, les recommandations nutritionnelles sont perçues de manière très différente. Elles ne sont pas un diktat dont le respect implique de renoncer au plaisir de manger, mais comme une hygiène de vie, un modèle intériorisé, où ce qui est « bon » du point de vue du goût tend à se confondre avec ce qui est bon pour la santé. De surcroît, les individus y sont convaincus que le bon au goût et le bon pour la santé favorisent également le beau selon leurs normes esthétiques, à savoir un corps mince. L'agréable et le nécessaire sont donc réconciliés dans leur rapport à l'alimentation.
Les recommandations nutritionnelles des politiques publiques, essentiellement élaborées par des médecins, sont délivrées sans véritablement prendre en compte les conditions socioculturelles de possibilité de leur bonne appropriation par le public. Dans le meilleur des cas, elles sont inaudibles ; au pire, elles sont perçues comme stigmatisantes. Cela contribue à expliquer pourquoi, malgré trois PNNS successifs et vingt ans de campagnes d'information, les recommandations nutritionnelles des pouvoirs publics n'ont finalement eu un impact significatif que sur les ménages les plus diplômés.
b) Passer d'une logique de recommandation à une véritable éducation alimentaire
Faire évoluer les pratiques alimentaires des personnes actuellement les plus éloignées des recommandations nutritionnelles suppose en premier lieu de passer d'une logique de conseils nutritionnels ponctuels à un véritable accompagnement nutritionnel dans la durée, voire à une véritable éducation à l'alimentation durable, à travers toutes ses dimensions : nutritionnelle, mais aussi économique (acheter autrement), et culinaire (préparer autrement).
De telles actions existent déjà, par exemple dans le cadre des structures d'aide alimentaire, à l'initiative de certaines collectivités dans le cadre de programmes territoriaux pour l'alimentation, ou dans le cadre de projets pédagogiques portés par des équipes enseignantes. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation, il est impératif de changer d'échelle d'intervention. Différents types de mesures peuvent y aider :
- au niveau du système de soins, mettre en place un forfait nutrition dans le cadre d'un parcours de soins coordonné pour les maladies de la nutrition ; développer les centres spécialisés de la nutrition chargés d'assurer la coordination des parcours des patients, le maillage du territoire et de coordonner l'action des différents experts et intervenants concernés ; développer un programme de dépistage et de prise en charge de la dénutrition en France ; faire évoluer la reconnaissance de la formation de diététicien (actuellement à Bac+2) et parallèlement créer les modalités de la prise en charge des consultations 109 ( * ) ;
- au niveau du système éducatif, développer les actions d'éducation nutritionnelle fédérant l'ensemble des compétences et des acteurs pertinents (Éducation nationale, ministères des sports et de l'agriculture, collectivités territoriales, monde associatif, représentants des professionnels de l'alimentation type chambres des métiers) ; utiliser le cadre scolaire et périscolaire pour favoriser l'exposition répétée à des aliments sains habituellement peu consommés ; développer l'éveil sensoriel en faisant découvrir la variété des goûts et des saveurs ; redonner du sens à l'alimentation et aux aliments (expliquer l'origine, les façons de produire, de transformer) ; encourager la création de jardins d'école pour cultiver légumes, fruits, herbes aromatiques ; initier à l'analyse critique des techniques de marketing et de promotion alimentaire.
c) Une responsabilisation inefficace sans un assainissement de l'environnement alimentaire
Faire évoluer les pratiques alimentaires des personnes actuellement les plus éloignées des recommandations nutritionnelles suppose de sortir d'une stricte logique de « responsabilisation » individuelle pour développer aussi une action plus large visant à assainir l'environnement nutritionnel. Cette action sur le contexte alimentaire peut passer par différentes actions :
- fixer un cadre normatif incitant ou obligeant à la reformulation des recettes des plats préparés par l'agro-industrie grâce à la définition de standards de référence fixant leur composition (limite maximale de certains nutriments, par exemple pour le sel ou les graisses saturées) ;
- réguler l'offre de snacking des distributeurs automatiques payants, en limitant par exemple les boissons sucrées ou édulcorées à 50 % de l'offre de boissons ou en définissant une part minimale réservée aux aliments solides de bonne qualité nutritionnelle (par exemple, au moins 50 % des produits classés A ou B en NutriScore) ;
- simplifier l'identification des aliments les plus durables par les consommateurs en généralisant l'étiquetage nutritionnel et environnemental simplifié ;
- dans le domaine du marketing, interdire les produits ayant un NutriScore D ou E dans les couloirs promotionnels des grandes et moyennes surfaces, en bout de rayon et en sortie de caisse ; réguler de façon plus sévère la publicité alimentaire en direction des enfants à la télévision ou au cinéma ; interdire les dispositifs d'incitation à l'achat (types bons offrant aux consommateurs une réduction de prix pour l'achat d'un produit donné) lorsque le produit concerné présente un Nutriscore D ou E ;
- rendre obligatoire l'emploi de diététiciens dans les sociétés de restauration collective ; rendre l'affichage du NutriScore obligatoire en restauration collective ; mettre en place des programmes de formation continue et initiale des cuisiniers pour que l'alimentation hors foyer intègre les pratiques compatibles avec une alimentation saine et durable ; faire évoluer les logiques d'approvisionnement dans le secteur de la restauration, notamment de la restauration collective, de manière à favoriser les aliments durables ; promouvoir un renforcement des exigences en matière de qualité nutritionnelle de l'offre dans le cahier des charges des appels d'offres publics.
2. Diffuser les régimes durables en levant les barrières économiques
a) L'enjeu de l'accessibilité financière des régimes durables
Une diffusion socialement plus large des régimes alimentaires sains et écodurables se heurte à l'obstacle de leur accessibilité financière, à la fois pour les ménages en situation de pauvreté, mais plus largement pour l'ensemble des ménages modestes 110 ( * ) . Les aliments qui composent les régimes vertueux sont en effet généralement plus chers que ceux qu'on retrouve dans les régimes malsains aujourd'hui dominants dans les régimes occidentaux. Ainsi, le poisson, les fruits et légumes frais, de faible densité énergétique, sont plus chers que les produits gras et sucrés qu'ils sont censés remplacer. Il en va de même des aliments recommandés pour leur faible impact environnemental et pour leur teneur plus faible en pesticides ou en additifs alimentaires. Il est incontestablement plus difficile d'avoir une alimentation saine et écodurable avec un petit budget.
Par ailleurs, demander aux ménages les plus modestes de consentir à payer davantage pour accéder à des aliments de meilleure qualité est irréaliste, car leur poste budgétaire « alimentation » (qui mesure l'effort financier consacré aux dépenses alimentaires) est déjà sensiblement plus élevé que celui des ménages plus favorisés.
b) La sobriété alimentaire est une des conditions de la démocratisation des régimes durables
Comment consommer des aliments plus chers sans accroître la pression sur le budget des ménages modestes ? C'est l'équation à résoudre pour réussir la transition alimentaire. La solution à ce problème passe sans doute, en partie, par la sobriété alimentaire. En diminuant la quantité d'aliments ingérés chaque jour jusqu'à un niveau nutritionnellement recommandé et en réduisant leurs gaspillages alimentaires, les consommateurs peuvent en effet réaliser des économies substantielles. Les marges de manoeuvre budgétaires ainsi dégagées rendraient possible une montée en gamme des aliments consommés à budget constant. Ces marges de manoeuvre sont d'autant plus significatives que la réduction des rations alimentaires et la lutte contre les gaspillages se portent en priorité sur des aliments relativement onéreux, comme la viande.
Des simulations chiffrées confirment l'intérêt de cette démarche consistant à consommer moins pour consommer mieux, sans dépenser plus. Une étude du WWF 111 ( * ) a chiffré par exemple le coût du panier alimentaire d'une famille de quatre personnes selon qu'elle adopte le régime alimentaire moyen de la population française aujourd'hui 112 ( * ) ou qu'elle se tourne vers un panier « flexitarien ». Pour un même coût (soit 189 euros par semaine), le panier flexitarien comporte moins de boissons sucrées, de produits transformés, de viande et de poisson sauvage, mais davantage de céréales, de légumineuses et de fruits et légumes 113 ( * ) . Son analyse d'impact montre qu'il est à la fois plus sain (NutriScore de A au lieu de C) et moins émetteur de CO 2 (68 kg équivalent CO 2 au lieu de 109) que le panier alimentaire moyen des Français. Par ailleurs, grâce aux économies réalisées sur certains aliments du panier standard, il peut intégrer des produits labélisés (Bio, label rouge,...) en proportion significative (50 %).
Concilier accessibilité financière, faible impact carbone, bonne qualité nutritionnelle et acceptabilité culturelle est donc parfaitement envisageable, mais suppose en pratique une véritable révolution dans le comportement d'achat. Les consommateurs doivent en effet passer de décisions d'achat à partir du prix de chaque aliment considéré isolément à des logiques d'optimisation, plus complexes, au niveau du coût du panier alimentaire. Consentir à payer plus chers certains aliments tout en comprenant que cela n'implique pas nécessairement un budget alimentation en hausse suppose un travail d'éducation et d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle les programmes d'accompagnement nutritionnel doivent absolument intégrer une dimension économique : il ne suffit pas d'expliquer aux personnes qui s'alimentent mal comment mieux se nourrir ; il faut aussi leur apprendre concrètement comment mieux acheter.
c) Créer des incitations ou des aides financières pour acheter des aliments plus durables
Une autre voie pour accroitre l'accessibilité sociale des produits les plus onéreux nécessaires à la transition alimentaire est de créer des dispositifs d'aides directes ou indirectes pour faire baisser le prix de ces produits. Cette intervention financière publique se justifie sur un plan doctrinal par le fait qu'une mauvaise alimentation produit des effets externes sanitaires et écologiques considérables, dont le coût final est supporté par la collectivité. On pourrait imaginer par exemple de taxer, sur le modèle de la taxe soda, certains aliments en raison de leur mauvaise qualité nutritionnelle (par exemple ceux classés D ou E dans le Nutriscore) et utiliser le produit de ces taxes pour financer des actions d'éducation nutritionnelle ou pour distribuer des chèques « alimentation saine », sur le modèle du chèque « énergie » permettant par exemple d'acheter des fruits ou des légumes frais 114 ( * ) . De tels chèques seraient distribués sous conditions de ressources ou attribués aux familles dont l'un des membres est identifié comme en surpoids ou obèse à l'occasion d'un programme de suivi médical. Compte tenu du coût des pathologies chroniques liées à une mauvaise alimentation, on peut aussi imaginer que l'assurance maladie participe, dans le cadre d'une politique de prévention, au financement de ces subventions.
C. UNE TRANSITION ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE SANS UN FORT DÉVELOPPEMENT DES LÉGUMINEUSES
Si la demande des consommateurs évolue vers plus de sobriété et que leurs assiettes, moins riches, sont par ailleurs mieux équilibrées grâce à des apports végétaux plus conséquents, cela va induire une restructuration profonde des filières de production alimentaire. Cela concerne d'abord, de manière évidente, les filières d'élevage. S'il se confirme, le recul de la consommation de produits animaux va en effet s'accompagner de celui de la production et, on peut l'espérer, d'une réorientation de cette dernière vers les modes de production les plus durables - avec notamment un recentrage de l'élevage des ruminants sur les pâturages et les coproduits végétaux non valorisables directement en alimentation humaine. Parce que la majorité de la sole cultivée sert aujourd'hui à produire des protéagineux et des oléagineux destinés aux animaux, le redimensionnement des filières d'élevage conduira aussi à un redéploiement des surfaces cultivées, aujourd'hui majoritairement consacrées aux céréales, vers d'autres productions végétales.
Parmi ces dernières, les pouvoirs publics ont deux motifs d'intérêt général à favoriser tout particulièrement les légumineuses :
- d'une part, le développement de la consommation de légumineuses semble incontournable pour résoudre la difficile équation d'une alimentation durable, à savoir concilier équilibre nutritionnel, réduction des impacts environnementaux, acceptabilité culturelle et accessibilité financière 115 ( * ) . Si l'on n'en introduit pas des quantités beaucoup plus importantes dans la composition de nos assiettes, l'un au moins de ces objectifs devient inatteignable;
- d'autre part, le développement de la filière des légumineuses constitue un levier essentiel pour entraîner le secteur agricole dans une conversion à grande échelle vers l'agroécologie. Pour le dire autrement, on a, avec l'essor de la filière « légumineuses », une opportunité de diffuser la transition alimentaire des assiettes jusqu'aux champs, de la fourchette jusqu'à la fourche 116 ( * ) . C'est un enjeu décisif, car on sait bien que, sans cette conversion agroécologique, il sera difficile, et vraisemblablement même impossible, de tenir les objectifs relatifs aux émissions de GES, à la lutte contre les pollutions aux nitrates et à la préservation de la biodiversité. Un changement d'échelle dans la production des légumineuses est ainsi l'un des leviers de la révolution agroécologique.
|
Qu'est-ce que l'agroécologie ? Les enjeux majeurs de la transition agroécologique sont la baisse de l'utilisation de l'énergie fossile en agriculture, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la réduction de l'usage des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) et la préservation des ressources naturelles. Pour ce faire, l'agroécologie vise à développer des pratiques agricoles valorisant la diversité biologique et les processus de régulation naturels (cycles des nutriments, dont l'azote, du carbone, de l'eau, équilibres biologiques entre bioagresseurs et organismes auxiliaires des cultures, etc...). |
1. Les légumineuses : des vertus uniques permettant de résoudre l'équation de l'alimentation durable
a) Les légumineuses, des aliments sains, énergétiques et bon marché
(1) Des qualités nutritionnelles propices à une alimentation équilibrée
Les légumineuses sont des plantes riches en protéines. Leur teneur en protéines varie de 20 à 40 % selon les espèces et peut même être sensiblement augmentée par certains procédés de transformation. Cela constitue un atout important alors que la demande mondiale de protéines est en forte croissance 117 ( * ) . Même dans les pays comme la France, déjà engagés dans la réduction de leur consommation de produits animaux, la baisse de la part des protéines animales implique de compenser cette baisse par une consommation plus équilibrée de différentes sources de protéines végétales. Dans ces équilibres, les légumineuses sont une source d'acides aminés essentiels complémentaire des céréales 118 ( * ) .
Outre leur richesse en protéines, les légumineuses constituent une excellente source de fibres et ont des effets positifs sur la santé de plus en plus documentés (elles semblent jouer en particulier un rôle dans la régulation du diabète et du cholestérol).
Les recommandations nutritionnelles des autorités sanitaires prennent d'ailleurs désormais mieux en compte ces diverses propriétés :
- les légumineuses sont devenues une catégorie spécifique d'aliments dans la nomenclature nutritionnelle officielle et leurs apports nutritionnels sont mieux mis en valeur (source de protéines et de fibres) 119 ( * ) ;
- elles font désormais l'objet de recommandations nutritionnelles spécifiques, mais encore timides, avec une fréquence de consommation-cible d'au moins deux fois par semaine, ce qui reste loin des niveaux recommandés dans différentes études prospectives, comme on le verra plus loin.
(2) Des aliments riches en énergie
Les légumineuses sont aussi des aliments à forte densité énergétique, ce qui est un atout décisif lorsqu'il s'agit de remplacer, dans nos régimes alimentaires, des aliments eux-mêmes très énergétiques (du type sucre, gras, viande). En effet, si la substitution devait se faire uniquement par des aliments à faible densité en énergie, du type fruits et légumes, cela aboutirait à une forte hausse des quantités d'aliments à ingérer et donc à une hausse des émissions de GES, ainsi qu'à une mobilisation accrue des terres arables. Par ailleurs, cette substitution se traduirait par une moindre accessibilité pour les petits budgets, car le prix des fruits et légumes rapporté au nombre de calories par kg est relativement élevé. Les légumineuses en revanche sont des aliments à la fois énergétiques et bon marché.
En définitive, pour remplacer les aliments aujourd'hui les plus consommés, dont la viande, sans dégrader le bilan environnemental du régime alimentaire ni sa qualité nutritionnelle, et sans accroître non plus son coût, les légumineuses sont d'excellentes candidates.
b) Des vertus écologiques
(1) Les légumineuses et réduction des quantités d'intrants azotés de synthèse
Les légumineuses sont une famille de plantes (les Fabacées) qui ont pour particularité de fixer l'azote atmosphérique grâce à des bactéries du sol qui vivent en symbiose avec leurs racines. Cette propriété leur confère un avantage agronomique et environnemental important, puisqu'on peut les cultiver sans apport d'azote sous forme d'engrais de synthèse, ou avec des apports fortement réduits.
Par ailleurs, elles contribuent à enrichir le sol en composés azotés qui peuvent être utilisés aussi par la culture suivante grâce aux reliquats (racines, tiges, feuilles selon les espèces) ou par une plante compagne dans le cas des cultures associées 120 ( * ) , comme une association luzerne-dactyle pour des légumineuses fourragères ou pois-blé pour des cultures de rente.
Les capacités de fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses en font un élément incontournable de toute stratégie de réduction des intrants azotés de synthèse en agriculture. Nous donnerons plus loin quelques éléments de chiffrages issus d'expérimentations agronomiques, concernant ce qu'on peut attendre du développement de la culture des légumineuses en termes de fertilisation des sols.
(2) Les légumineuses et la réduction de l'usage des pesticides
Les légumineuses ont la réputation d'être des plantes délicates à cultiver en culture pure dans des rotations courtes. Elles sont en effet particulièrement sensibles à des maladies fongiques et bactériennes 121 ( * ) , ainsi qu'à des insectes ravageurs 122 ( * ) et aux adventices 123 ( * ) . On peut citer en particulier le sclérotinia, maladie fongique des parties aériennes, commune à la plupart des oléagineux et protéagineux (colza, tournesol, soja, haricots...) : elle peut durer de nombreuses années dès lors qu'elle est installée dans une parcelle. Compte tenu de ces vulnérabilités, la tendance actuelle à la réduction des solutions de traitement chimique rend l'utilisation des légumineuses de plus en plus aléatoire en rotation courte.
Il est donc clair que la vocation des légumineuses est plutôt d'être utilisée en rotations longues dans le cadre d'une diversification des assolements, ce qui correspond à une approche agroécologique. Dans ce cadre, où la fréquence de retour de chaque espèce dans la rotation est fortement réduite (une fois tous les cinq ou sept ans), où par ailleurs les cultures se font plus fréquemment en associations, le jugement porté sur les performances des légumineuses dans la lutte contre les bioagresseurs change sensiblement. « La diversification des rotations avec des légumineuses permet [en effet] de rompre les cycles des bioagresseurs (maladies, insectes, mauvaises herbes) des cultures majoritaires (blé, colza) et donc de réduire l'usage des pesticides. En plus de diminuer la pression phytosanitaire (...), l'introduction de légumineuses dans les assolements améliore la qualité des sols, diversifie les paysages et, par la combinaison de tous ces facteurs, permet de maintenir la biodiversité. 124 ( * ) » Là encore, le rapport fournira plus loin quelques estimations chiffrées des gains permis par la culture des légumineuses en termes d'utilisation de pesticides.
(3) Variété et adaptabilité des légumineuses
Formant la troisième famille botanique en nombre d'espèces, les légumineuses offrent une palette très variée d'espèces, ce qui leur permet :
- de s'adapter à différents types de sols, notamment aux sols pauvres, ainsi qu'à différents climats 125 ( * ) ;
- de s'intégrer à une pluralité d'associations et de rotations 126 ( * ) .
Les agriculteurs, dès lors qu'ils sont accompagnés et conseillés, peuvent donc choisir les variétés et les rotations les mieux adaptées aux conditions pédoclimatiques locales et à l'organisation de leur exploitation.
c) Des aliments capables de s'intégrer aisément dans toutes les cultures culinaires
À l'heure où l'on recherche des sources de protéines complémentaires ou alternatives parfois « exotiques », comme la production d'insectes, de viande de culture ou encore d'algues, il n'est pas inutile de rappeler qu'on dispose avec les légumineuses d'une source de protéines produites et consommées depuis des millénaires et parfaitement intégrées aux répertoires alimentaires de toutes les cuisines du monde. Il est vrai que les légumineuses souffrent aujourd'hui d'une image socialement dévalorisée en France. Toutefois, c'est un point qui est en train de changer rapidement sous l'effet d'un triple mouvement :
- les légumineuses, qui ont quitté les assiettes des ménages les plus modestes dans la seconde moitié du XX e siècle 127 ( * ) , font leur retour aujourd'hui dans les assiettes des ménages urbains et diplômés. Les préjugés qui leur étaient attachés (en gros, aliments rustiques pour les pauvres) sont donc en train de disparaître ;
- les cuisiniers ont commencé à réinventer les usages des légumineuses, dans la cuisine du quotidien comme dans la cuisine d'exception. Par leur travail, ils sortent les légumineuses du piège d'un discours opposant végétal et animal qui risque de les cantoner à un usage principalement végétarien. Par ailleurs, ils exploitent de plus en plus leurs qualités de texturation, d'onctuosité et de fondant en les intégrant à des recettes du répertoire culinaire classique, recettes dans lesquelles les légumineuses viennent remplacer en tout ou partie des produits animaux, sucrés ou gras 128 ( * ) ;
- les industries agroalimentaires ont commencé à donner de nouveaux débouchés aux légumineuses. Le nombre de produits référencés à base de protéines végétales a été multiplié par 10 en 20 ans 129 ( * ) . Les légumineuses sont par exemple désormais utilisées dans des biscuits, des steaks végétaux, des pâtes à tartiner, etc. Elles sont également utilisées comme ingrédients fonctionnels dans des produits de consommation courante, tels que la farine ou les pâtes 130 ( * ) . C'est un point essentiel, car, nous l'avons vu, l'alimentation des pays développés est et restera très majoritairement une alimentation transformée industriellement. Il faut souligner que le développement des légumineuses n'est pas tributaire d'un scénario particulier concernant le degré futur de transformation de l'alimentation : elles peuvent trouver leur place aussi dans une alimentation naturelle ou modérément transformée qu'ultra-transformée. Quel que soit le cas de figure qui prévaudra, on a intérêt à les développer car elles ne peuvent que contribuer à réduire les impacts sanitaires et écologiques du système alimentaire.
d) Un potentiel économique qui se confirme
Les recherches agronomiques 131 ( * ) ont prouvé la pertinence économique des associations entre une céréale (blé tendre, blé dur ou orge) et une légumineuse (pois, féverole, pois chiche, lentille, lupin) pour l'alimentation animale ou humaine. Ces associations obtiennent de meilleures performances que les cultures pures en termes de rendement et de qualité, en raison des processus écologiques de complémentarité et de facilitation entre espèces qui permettent une meilleure utilisation des ressources abiotiques (notamment l'azote et la lumière) et des régulations biologiques (réduisant l'impact des ravageurs, maladies et adventices) par rapport aux cultures pures. I n fine , on peut obtenir grâce à des cultures associées comprenant des légumineuses :
- un rendement total en grains supérieur à la moyenne des cultures pures (+20 % en moyenne) ;
- une diminution des adventices par rapport aux légumineuses pures (-70 % en moyenne) ;
- une réduction des infestations de maladies aériennes, permettant une baisse potentielle de l'usage de fongicides, qui s'explique par le fait que chaque espèce joue un rôle de barrière vis-à-vis de l'autre, limitant ainsi la progression des maladies dans le couvert ;
- une teneur en protéines plus élevée dans les grains de céréales (+13 % en moyenne) ;
- une réduction de l'usage d'engrais en culture associée 132 ( * ) , ainsi qu'une réduction de l'énergie fossile consommée 133 ( * ) , avec en définitive une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 à 60 %, à production équivalente ;
- une réduction des fuites dans le cycle de l'azote. La quantité d'azote restant dans le sol après une culture associée est en effet moindre par rapport à celle restant après une légumineuse pure, réduisant ainsi les risques de pertes par lixiviation nitrique 134 ( * ) si une culture intermédiaire n'est pas implantée juste après.
Ces résultats confirment l'intérêt des associations légumineuses/céréales dans les systèmes à faible disponibilité en azote minéral et montrent qu'elles constituent un levier pour accroître et stabiliser les rendements en agriculture biologique et pour réduire l'utilisation des intrants pour la transition agroécologique.
2. Les légumineuses tiennent une place centrale dans les prospectives sur le système alimentaire
En raison de leurs propriétés agronomiques, nutritionnelles, gastronomiques et de leur faible coût relatif, les légumineuses apparaissent comme une composante clé des systèmes alimentaires durables du futur. Elles occupent une place centrale dans tous les exercices de prospective sur l'alimentation.
a) Vers une place croissante des légumineuses dans nos assiettes et dans les champs
D'ici à 2050, la prospective TYFA 135 ( * ) fait l'hypothèse d'une hausse de la consommation moyenne de légumes secs de 7 à 30 g par jour et par habitant, soit de 4 à 11 kg par habitant et par an 136 ( * ) . Pour satisfaire ce niveau de consommation au moyen d'une production nationale, il faudrait cultiver des légumineuses sur environ 500 000 ha 137 ( * ) en France, contre seulement 115 000 ha aujourd'hui 138 ( * ) , soit une multiplication de l'assolement par environ 4,5. Cet objectif peut sembler ambitieux, mais il doit être relativisé au regard de deux observations. D'une part, on constate d'ores-et-déjà un fort dynamisme de la production de légumes secs. Bien qu'encore très modestes, les surfaces plantées ont été multipliées par 6 en vingt ans. D'autre part, gagner 400 000 ha de terres au profit des légumineuses revient à « déplacer » seulement 4 % d'un assolement céréalier qui couvre actuellement 9 millions ha ! Il s'agit de changements de sole cultivée d'une ampleur relativement limitée, sachant qu'on raisonne sur un horizon de temps de trente ans.
b) Des besoins en légumineuses pas seulement pour la satisfaction directe des besoins alimentaires
Dans le système alimentaire, les légumineuses ne sont pas seulement des productions destinées à être ingérées par les humains. Elles servent à nourrir les animaux (cas notamment du soja ou des diverses variétés de légumineuses fourragères). Elles peuvent en outre servir en interculture comme « engrais vert », ce qui est fréquemment le cas en agroécologie où certaines cultures d'une rotation ne sont pas valorisées commercialement mais servent d'intrant recyclé directement dans l'exploitation. Évaluer la place qu'occuperont demain les légumineuses implique donc de prendre en compte tous ces usages.
Cet exercice est complexe. En particulier, mesurer la quantité de légumineuses utilisée demain en alimentation animale dépend d'hypothèses sur l'évolution de notre régime alimentaire (quelle part pour les protéines animales ? Quelle part pour les différents types de viandes ?), mais aussi d'hypothèses quant à la manière de nourrir les animaux (quel recours aux importations de protéines végétales sous forme de tourteaux, de soja notamment ? Quel usage des engrais de synthèse s'autorise-t-on ?). Par conséquent, s'il existe un consensus pour considérer que la satisfaction des besoins humains en légumineuses implique une sole cultivée d'environ 500 000 ha, les prévisions concernant le besoin global en légumineuses, tous usages confondus, varient en fonction des hypothèses retenues dans la construction des scénarios prospectifs. Il n'en demeure pas moins que, dans tous les cas, les cultures de légumineuses sont amenées à augmenter de manière importante.
C'est le cas dans la prospective du rapport TYFA. Il projette que les légumineuses à graines et fourragères pourraient représenter jusqu'à un quart des terres arables en 2050. Cette estimation repose, au plan de la consommation, sur l'hypothèse de la généralisation d'un régime alimentaire sain 139 ( * ) , à la fois sobre et fortement végétalisé, et, au plan de la production, sur l'hypothèse d'un arrêt des importations de protéines végétales pour nourrir les animaux et sur l'hypothèse de l'abandon complet des pesticides et des fertilisants de synthèse. Ce scénario agroécologique radical, qui est celui d'une agriculture entièrement biologique et souveraine, obligerait à développer au maximum la fonction de fixation symbiotique de l'azote et les mécanismes intégrés de lutte contre les bioagresseurs. Il n'est sans doute pas le plus vraisemblable, mais il a l'intérêt d'explorer une hypothèse limite et donc de fournir la borne supérieure des valeurs possibles pour la place des légumineuses dans l'agriculture future.
D'autres scénarios font l'hypothèse du maintien d'intrants azotés de synthèse, quoique dans des proportions moindres qu'aujourd'hui. Ainsi, dans le scénario Pulse Fiction du WWF, les surfaces de graines de protéagineux et de soja augmenteraient pour atteindre respectivement 500 000 et 1 million ha. Ce développement aurait essentiellement pour fonction de pallier l'arrêt des importations de soja destiné aux animaux d'élevage. Le total des surfaces de légumineuses à graines, y compris celles destinées directement à l'alimentation humaine, serait ainsi quadruplé par rapport à aujourd'hui pour atteindre 2 millions ha en 2050.
3. Une filière dont le développement doit être « déverrouillé »
a) Un problème de compétitivité hérité de l'Histoire et cumulativement renforcé au cours du temps
À partir du début des années 1960, l'Europe a donné la priorité au développement des cultures de céréales tout en acceptant de libéraliser les importations de soja depuis les États-Unis 140 ( * ) . Alors que la consommation européenne de légumes secs pour la consommation humaine avait déjà amorcé son déclin, ce choix stratégique a conduit à marginaliser aussi la culture des légumineuses pour l'alimentation animale. Malgré un rebond de la production entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, lié à la mise en place de mesures de soutien aux protéagineux, les grandes orientations de la PAC ont conduit à un recul prononcé des surfaces agricoles et de la production de légumineuses en Europe.
Cette marginalisation des légumineuses a créé une situation de verrouillage technologique de la filière. De fait, pendant cinquante ans, la plus grande partie des investissements (recherches variétales, équipements agricoles, outils industriels, investissements en capital humain, etc.) s'est orientée vers le secteur céréalier plutôt que vers les légumineuses. L'écart de compétitivité entre céréales et légumineuses est ainsi devenu considérable, d'autant plus que la capacité des légumineuses à fixer l'azote de l'air se traduit par des seuils de rendement moindre pour ces cultures comparativement aux céréales. Mais cet atout agroécologique de la légumineuse reste aujourd'hui une externalité non rémunérée par le marché. Aujourd'hui, les différences de rendements à l'hectare entre céréales et légumineuses sont d'un facteur 3 à 4 141 ( * ) , avec de surcroît des prix de vente plus faibles pour les légumineuses et une variabilité de la production plus forte.
Dans ces conditions, les légumineuses européennes risquent de ne pas pouvoir profiter de la tendance émergente à la revégétalisation de l'alimentation sans aide de l'État. « Si on laisse le développement des protéines végétales aux mains du marché, la logique industrielle privilégiera les protéines issues de céréales. On ne peut s'étonner que les acteurs économiques cherchent à rentabiliser leur investissement industriel. Les premières protéines utilisées, en France comme sur le marché mondial, pour les nouveaux segments de protéines végétales, sont d'ailleurs les protéines issues du blé et non celles qui sont issues des légumineuses. À l'échelle mondiale, ce seront les protéines issues du soja, qui représente des surfaces cultivées considérables . » 142 ( * )
On se trouve clairement ici devant une faille de marché qui justifie l'intervention des pouvoirs publics pour réorienter l'activité économique dans un sens plus conforme à l'intérêt général. La hausse de la production de légumineuses permettrait en effet de réduire fortement les externalités sanitaires et environnementales négatives du système alimentaire actuel. Il réduirait par ailleurs la dépendance de l'Europe dans le domaine des protéines végétales. À cet égard, la crise sanitaire du covid-19 souligne qu'il est peu avisé d'abandonner l'approvisionnement national dans des biens essentiels au bon fonctionnement du commerce international.
b) Identification des verrous à lever pour développer les légumineuses
(1) Les verrous liés aux savoir-faire et aux compétences
La culture des légumineuses dans un mode de culture agroécologique demande une compétence agronomique que nombre de professionnels ne possèdent pas ou plus. Dans une approche agroécologique, l'agriculteur doit en effet avoir une conception raisonnée des systèmes de culture (choix des espèces, choix des variétés au sein des espèces, et fréquences de retour) afin d'éviter des « disservices » écosystémiques (risque d'émergence de nouvelles problématiques sanitaires sur les légumineuses ou de développement de maladies ou ravageurs déjà connus pouvant notamment entraver le principe de la fixation symbiotique). De manière évidente, le développement de l'agroécologie exige une montée en compétences et donc un travail de formation et d'accompagnement des agriculteurs.
(2) Les retards liés au sous-investissement dans la recherche variétale
Depuis plus de cinquante ans, les recherches des semenciers se sont concentrées sur le marché porteur : celui des céréales. On estime que 80 % des programmes de recherche de sélection sur les protéagineux et les légumes secs ne sont pas rentables faute de surfaces suffisantes. On se trouve aujourd'hui devant un cercle vicieux : les faibles surfaces plantées en légumineuses offrent des marchés étroits pour les innovations de semence ; ces faibles perspectives commerciales expliquent la faiblesse des investissements des semenciers ; l'absence de progrès variétal entraîne la faible compétitivité des cultures et donc le peu d'intérêt des agriculteurs pour les légumineuses. Un exemple frappant est celui de la lentille verte du Puy, qui est majoritairement cultivée grâce à une variété datant de 1966 !
(3) Les verrous techniques et logistiques
La culture des légumineuses dans le cadre de rotations longues et diversifiées implique une adaptation des infrastructures de collecte et de stockage. L'orientation de monoculture intensive des cinquante dernières années a conduit les coopératives à investir dans des silos de grande taille avec peu de cellules. Installer des cellules de petite taille, adaptées à la diversification des cultures, implique donc pour les coopératives un effort d'investissement. On estime que 50 000 tonnes de stockages supplémentaires représentent 15 millions d'euros d'investissement.
Un autre enjeu essentiel est celui du tri. On sait que les légumineuses sont particulièrement performantes dans des cultures associées, et permettent une production céréalière plus agroécologique. Mais, si les associations permettent d'augmenter et de stabiliser le rendement à l'hectare, elles rendent aussi nécessaire l'acquisition d'outils de tri. En particulier, pour être valorisés en alimentation humaine (donc à un prix plus élevé 143 ( * ) ), les mélanges doivent respecter des cahiers des charges industriels rigoureux. Un tri performant, permettant aux industries agroalimentaires de bénéficier de lots aux qualités recherchées, séparant bien les graines, nécessite des trieurs optiques, relativement coûteux.
Enfin, les outils industriels de l'agroalimentaire ne sont pas aujourd'hui calibrés pour intégrer les légumineuses dans les processus de production. Par exemple, lorsqu'on souhaite fractionner et transformer les graines de légumineuses en farine, il faut recalibrer les chaînes industrielles existantes pour les graines de céréales, car la dureté des graines de légumineuses n'est pas la même que celle des graines de blé. Une farine de pois chiche réalisée avec des outils conçus pour la farine de blé ne permettra pas d'obtenir la même granulométrie. Son mélange, dans une recette, aura donc des effets différents sur les propriétés organoleptiques du produit et sur les processus de cuisson. Cette adaptation des procédés industriels implique, là encore, des investissements spécifiques.
c) Quelle action des pouvoirs publics pour combler le handicap de compétitivité des légumineuses ?
Le soutien public à la filière des légumineuses passe par des actions dans plusieurs domaines.
(1) Rémunérer les externalités positives générées par la production de légumineuses
Les légumineuses interviennent dans la réduction de l'usage de l'azote de synthèse et donc des pollutions agricoles diffuses (émissions de GES et pollutions aux nitrates). En intercultures, elles contribuent également à maintenir le couvert des sols. Elles participent enfin de paysages agricoles diversifiés propices au maintien de la biodiversité. Or, ces services agrosystémiques ne sont aujourd'hui pas valorisés. Sans nécessairement accroître le budget de la PAC, les aides que celle-ci redistribue doivent donc être réorientées et redéfinies pour rémunérer ces services utiles à la collectivité. Il n'est pas question ici de dire précisément comment ces nouveaux dispositifs devraient être paramétrés pour être efficaces, mais leurs objectifs apparaissent clairement : favoriser la diversification des cultures et l'allongement des rotations, reconnecter géographiquement les productions animales et végétales, encourager la présence de surfaces d'intérêt écologique ou encore passer d'aides attribuées en fonction des surfaces à des aides proportionnelles au travail agricole (pour tenir compte de l'augmentation de la charge de travail lors du passage de pratiques conventionnelles à des pratiques agroécologiques 144 ( * ) ).
(2) Accompagner techniquement la conversion des agriculteurs
Il entre dans les missions des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture de se saisir de ces enjeux de formation, de conseil et d'accompagnement des agriculteurs, notamment en favorisant les partages d'expérience et la mise en place de démonstrateurs territoriaux valorisant la diversité des légumineuses. Les parcours d'enseignement agricole doivent également donner dans les programmes une place accrue aux connaissances nécessaires à l'agroécologie et à la culture des légumineuses. Tout cela doit se faire en lien avec la recherche agronomique, dans laquelle, avec l'Inrae et le Cirad, la France possède des atouts de premier plan.
(3) Donner un signal clair aux acteurs de la filière pour orienter les investissements
Des investissements importants et de long terme sont nécessaires pour développer des variétés de légumineuses plus productives et moins sensibles aux aléas. Un programme de sélection variétale prend 10 à 15 ans avant d'aboutir. C'est également un effort financier important qui est nécessaire pour mettre en place des infrastructures de collecte et de stockage spécifiques, ainsi que des outils de ségrégation et de travail des graines. Les entreprises du secteur des semences et celles chargées de la collecte n'ont toutefois pas besoin d'un accompagnement financier de l'État pour réaliser ces investissements. Plus que de capitaux, elles ont avant tout besoin d'un signal clair que leurs investissements s'inscrivent dans une stratégie de long terme des pouvoirs publics au niveau national et encore plus européen.
Cette visibilité sur les perspectives de développement des légumineuses implique que l'Europe :
- réoriente ses aides agricoles vers l'agroécologie, comme indiqué précédemment ;
- mette en place un plan stratégique ambitieux de développement et de diversification des protéines végétales visant à renforcer la souveraineté protéique de la Ferme France et de l'Union européenne à long terme. Pour remplacer les protéines importées, il faudra en effet fortement développer les productions européennes de légumineuses ;
- émette des recommandations ambitieuses pour accroître la place des légumineuses dans l'alimentation du futur.
(4) Mesures complémentaires
Outre les leviers stratégiques précédemment évoqués, diverses autres pistes peuvent être envisagées :
- réfléchir aux évolutions souhaitables des systèmes d'assurance récolte pour tenir compte de la forte variabilité interannuelle des cultures de protéagineux ;
- encourager les systèmes de contractualisation au sein de la filière. Pour renverser les situations de verrouillage technologique, il faut en effet parvenir à engager conjointement les opérateurs en amont et en aval dans des filières très structurées pour sécuriser les investissements. On a donc intérêt à conditionner les aides publiques à l'adoption de contrats de filières engageant l'amont et l'aval durant plusieurs années. Cela incitera les agriculteurs à cultiver ces produits ; la coopération à investir dans des outils de stockage ; les industriels à investir également dans des outils industriels, en sachant qu'ils auront une production amont satisfaisante en qualité ;
- mettre en valeur l'origine « France » pour structurer des filières tracées de l'alimentation animale aux produits de grande consommation et mettre en valeur certains aspects de la qualité (en particulier l'absence d'OGM et de certaines substances chimiques couramment employées par les concurrents étrangers).
Réunie le 28 mai 2020, la délégation a autorisé à l'unanimité la publication du présent rapport d'information sous le titre "Vers une alimentation durable : un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France".
ANNEXES
I. LES ENQUÊTES SUR L'ALIMENTATION
Les enquêtes épidémiologiques ou sociologiques sur les pratiques alimentaires permettent de décrire précisément ce que mangent aujourd'hui les Français. On peut grâce à elles connaître le contenu de leur assiette, mesurer les apports nutritionnels et donc établir un régime alimentaire « moyen » de la population tout en montrant qu'autour de ces moyennes s'observent de fortes variations en fonction de la position socio-économique, de la géographie, de l'âge et du sexe.
Enquête Esteban (2014-2016)
Esteban étudie nos habitudes et consommations alimentaires et notre niveau d'activité physique, afin de compléter les informations déjà recueillies lors de l'Étude nationale nutrition santé (ENNS) conduite par Santé publique France en 2006 et 2007. Esteban mesure aussi l'exposition aux substances potentiellement nocives (pesticides, bisphénol A, phtalates, etc.), ainsi que leur origine, notamment dans l'alimentation. Enfin, Esteban mesure l'importance exacte de ces affections chroniques dans la population (asthme, allergies, diabète, broncho-pneumopathie chronique obstructive ou BPCO, hypertension artérielle, hypercholestérolémie). Plusieurs rapports ont déjà été publiés.
• Volet Nutrition. Chapitre Consommations alimentaires publié en septembre 2018
• Volet Nutrition - Surveillance épidémiologique, Adéquation aux nouvelles recommandations alimentaires des adultes âgés de 18 à 54 ans vivant en France
• Volet Nutrition. Chapitre Corpulence publié en janvier 2017
• Volet Nutrition. Chapitre Activité physique et sédentarité
Enquête INCA
L'étude individuelle nationale des consommations alimentaires dite INCA est réalisée par l'Anses. La troisième édition, INCA 3, a été réalisée en 2014-2015 auprès de 5 855 individus pour recueillir des données concernant :
• les consommations d'aliments, de boissons et de compléments alimentaires ;
• l'activité physique et la sédentarité ;
• les caractéristiques anthropométriques (poids, taille) ;
• les caractéristiques sociodémographiques et le niveau de vie ;
• les habitudes alimentaires : lieux et occasions de consommation, autoconsommation d'aliments produits par le ménage ou par un proche (potager, etc.), consommation d'aliments prélevés dans la nature (chasse, pêche, cueillette), mode de production des aliments (produits transformés, agriculture biologique...), etc. ;
• les pratiques potentiellement à risque au niveau sanitaire : préparation, conservation des aliments, température du réfrigérateur, consommation de denrées animales crues ;
• le traitement à domicile de l'eau destinée à l'alimentation humaine ;
• les connaissances et comportements en matière d'alimentation.
Enquête Crédoc
Ademe, Alléger l'empreinte environnementale de la consommation des Français
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-alleger-empreinte-environnement-2030_rapport_28112014.pdf
II. COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION
Audition de M. Jean-François Soussana , vice-président de L' INRA , sur les perspectives de l'alimentation en 2050 - Jeudi 17 octobre 2019
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191014/pro_2019_10_17.html
Audition de MM. Gilles de Margerie , commissaire général de France Stratégie , et Julien Fosse , chef de projet auprès du département « Développement durable et numérique » - Jeudi 12 décembre 2019
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191209/pro_2019_12_12.html
Tables rondes sur le thème : Qu'y aura-t-il dans nos assiettes en 2050 ? - Jeudi 6 février 2020
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200203/pro_2020_02_06.html
Examen du rapport - Jeudi 28 mai 2020
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200525/pro_2020_05_28.html
III. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Auditions devant la Délégation à la Prospective
• Jean-François Soussana, vice-président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA)
• Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, et Julien Fosse, chef de projet auprès du département « Développement durable et numérique » de France Stratégie
• Xavier Boidevezi, secrétaire national de la FoodTech
• Jean-Christophe Mano, membre du conseil d'administration de Synadiet, directeur général de Pharmanager Group
• Emmanuelle Maguin, directrice de recherches, Inrae
• Bruno Hérault, chef du Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
• Professeur Irène Margaritis, chef de l'unité « Évaluation des risques liés à la nutrition » (Anses)
• Thomas Uthayakumar, chargé de projets Alimentation Durable, WWF France
• Professeur Marie-Benoît Magrini, économiste, responsable du Groupe Filière Légumineuses, Inrae
• Gilles Daveau, consultant et formateur en cuisine alternative
Auditions devant les rapporteurs
• Jérôme Mousset, chef du service Forêt, Alimentation et Bioéconomie (Ademe)
• Sarah Martin, ingénieure (Ademe)
• Bénédicte Genthon, directrice adjointe Productions et énergies durables (Ademe)
• Arnold Puech d'Alissac, membre du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), en charge des questions internationales et président de la commission Chaîne alimentaire
• Guillaume Joyau, chargé de mission Innovation et Développement (FNSEA)
• Amaryllis Blin, chargée de mission Alimentation, Sanitaire et Élevage (FNSEA)
• Nadine Normand, attachée parlementaire (FNSEA)
• Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle (EREN), Inserm
• Anne-Sophie Etzol, chargée des relations institutionnelles (Inserm)
• Moez Sanaa, chef de l'unité « Évaluation des risques liés aux aliments » (Anses)
• Sophie Le Quellec, directrice de Cabinet, directrice de la communication et des relations institutionnelles (Anses)
• Jean-Jacques Mathieu, représentant de la Confédération paysanne au Conseil National de l'Alimentation
• Joris Gaudaré, animateur de la Commission alimentation de la Confédération paysanne
• Damien Houdebine, secrétaire national de la Confédération paysanne
• Élisabeth Claverie, en charge des relations institutionnelles, Cirad
• Nicolas Bricas, socio-économiste, directeur de recherches au Cirad et titulaire de la chaire Unesco Alimentations du Monde
• Christian Huyghe, directeur scientifique « Agriculture », Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement (Inrae)
• Marc Gauchée, conseiller relations parlementaires et institutionnelles, Inrae
• Professeur Agathe Raynaud-Simon, chef du Département de Gériatrie Bichat, Beaujon et Ambulatoire Bretonneau, APHP
• Professeur Jacques Delarue, vice-président de la Fédération française de nutrition (FFN)
• Loïc Sorin, responsable de la Cité du goût et des saveurs, Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA France) ;
• Samuel Deguara, directeur des relations institutionnelles de la CMA France
• Denis Couvet, professeur au département Homme et Environnement du Muséum national d'histoire naturelle, membre de l'Académie de l'Agriculture
• Isabelle de Guido, adjoint à la cheffe de bureau Alimentation et nutrition, Direction générale de la Santé (DGS), ministère de la Santé
• Michel Chauliac, chargé de mission, Programme National Nutrition Santé, Direction générale de la Santé (DGS), ministère de la Santé
• Guillaume Benoît, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
• Hervé Lejeune, inspecteur général de l'agriculture, membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
• Enzo Reulet, chargé de missions, affaires publiques, APCA
• Daniel Prieur, président de la Chambre interdépartementale Doubs-Territoire de Belfort et secrétaire adjoint de l'APCA
• Marc Nielsen, directeur de Terres en ville
• Eugénia Pommaret, directrice générale de l'Union des Industries de Protection des Plantes (UIPP)
• Emmanuelle Paboletta, directrice de la communication et des affaires publiques de l'UIPP
• Sébastien Abis, directeur, Club Demeter
• Pierre-Marie Décoret, responsable d'études économiques (Groupe Avril)
• Fabrice Moulard, agriculteur dans l'Eure, membre du Bureau de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux (FOP)
• Laurence Champier, directrice fédérale du réseau des banques alimentaires, Fédération des banques alimentaires
• Marie Castagné, directrice relations institutionnelles, Fédération des banques alimentaires
• Benoît Bordat, conseiller métropolitain, Dijon métropole
• Pascale Hébel, directrice du pôle Consommation et Entreprise, Crédoc
• Élisabeth Carbone, secrétaire générale du Miramap, mouvement Inter-Régional des AMAP
* 1 Cette transition est la quatrième à l'échelle de l'Histoire. Les trois premières correspondent, pour la première, au passage du cru au cuit, il y a environ 500 000 ans ; pour la deuxième, à l'invention de l'agriculture, il y a 10 à 12 000 ans, et, pour la troisième, à la constitution de Cités-État en Mésopotamie, il y a environ 5000 ans, qui s'accompagne d'une division du travail entre agriculteurs et nouveaux métiers de la transformation et du commerce alimentaires. Cf Académie d'Agriculture de France, « Transition alimentaire : pour une politique nationale et européenne de l'alimentation durable orientée vers les consommateurs, les filières et les territoires », 2 octobre 2019.
* 2 Thibaut de Saint Pol, Le temps de l'alimentation en France, Insee Première, No 1417, 2012
* 3 P. Etiévant, F. Bellisle, J. Dallongeville, F. Etilé, E. Guichard, M. Padilla, M. Romon-Rousseaux, Les comportements alimentaires. Quels en sont les déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Expertise scientifique collective, INRA, 2010
* 4 Christine Monceau, Élyane Blanche-Barbat, Jacqueline Échampe, La consommation alimentaire depuis quarante ans de plus en plus de produits élaborés, Insee Première, N° 846 ; 2002
* 5 La demande de yaourts et desserts lactés, marginale au début des années 1960, est multipliée par 15 entre 1960 et 2000 !
* 6 La consommation par habitant de limonades et de sodas augmente de 4, % par an en moyenne de 1960 à 2000. Celle de glaces et sorbets croît de plus de 10 % par an en moyenne dans les années 1970 et de près de 6 % dans les années 1980.
* 7 Dans ce graphique, les produits classés « santé forme » regroupent les aliments pour enfants et diététiques, soupes et potages, céréales pour petit déjeuner, eaux, jus de fruits et légumes. Les viandes préparées sont les charcuteries, plats préparés et conserves à base de viande. Les graisses brutes désignent beurre, huiles, margarines ; les produits bruts traditionnels, les pommes de terre, légumes secs, oeufs, farines, riz, pain, pâtes.
* 8 La classification NOVA, élaborée par des chercheurs de l'Université de São Paulo, est pionnière dans la définition de l'ultra-transformation et constitue aujourd'hui encore la référence dans ce domaine. Elle catégorise les aliments en quatre groupes : aliments peu ou pas transformés, ingrédients culinaires, aliments transformés et aliments ultra-transformés.
* 9 Par ailleurs, ces aliments contiennent souvent des substances provenant des emballages et sont susceptibles de véhiculer certains composés néoformés créés lors des processus de transformation.
* 10 Brigitte Larochette et Joan Sanchez-Gonzalez, Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements, Insee première, n° 1568, 2015
Céline Laisney, L'évolution de l'alimentation en France, Document de travail, n°56, Centre d'études et de prospective, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2012
* 11 Bioversity International, 2017. Mainstreaming Agrobiodiversity in Sustainable Food Systems: Scientific Foundations for an Agrobiodiversity Index. Bioversity International, Rome, Italy
* 12 Ipsos, « Consommer local » : ce que veulent les Français, février 2014.
* 13 Ce mouvement de desserrement est très inégal d'une catégorie sociale à l'autre, nous y reviendrons, mais il n'en est pas moins général à la population si on considère les choses avec un recul historique suffisant.
* 14 Pour plus de détails, cf. Le temps de l'alimentation en France. Insee Première, No 1417, 2012.
* 15 Il s'agit de l'enquête CAF, cf annexe 1 du présent rapport.
* 16 Crédoc pour France Agrimer, Enquête « Comportements et consommations alimentaires en France 2016 », novembre 2017
* 17 Pour des précisions sur cette notion, cf Pierre Mormede, Lucille Boisseau-Sowinski, Julie Chiron, Claire Diederich, John Eddison, Jean-Luc Guichet, Pierre Le Neindre, Marie-Christine Meunier-Salaün, (2018). Bien-être animal : contexte, définition, évaluation. Inrae Productions Animales, 31(2), 145-162.
* 18 La dégradation de l'environnement fait en effet partie, aux côtés par exemple du chômage, de la violence ou encore de la pauvreté, d'une liste de onze thèmes de société sur lesquels les Français sont interrogés à intervalle régulier par le Crédoc.
* 19 Cette hausse n'est pas linéaire car affectée par la conjoncture économique. Les préoccupations environnementales ont tendance à reculer quand la situation économique se dégrade.
* 20 Ipsos, novembre 2016, « le manger durable », sondage réalisé à l'occasion des premières Rencontres de l'alimentation durable.
* 21 BVA, Les Français et l'alimentation, juillet 2018
* 22 Eurobaromètre spécial 442 commandé par la Commission européenne sur ce sujet.
* 23 Les chiffres varient d'une étude à l'autre. Une étude Kantar Worldpanel de décembre 2017 évaluait à 34 % le nombre de flexitariens en France, contre 25 % en 2015. Le mot « flexitarisme » se diffusant de plus en plus largement, il est vraisemblable que des personnes soucieuses de réduire leur consommation de viande qui ne se définissaient pas jusqu'à présent comme flexitariennes se définissent à présent comme telles. La progression du taux traduit sans doute un double phénomène : un changement de dénomination d'un comportement préexistant pour une part ; une diffusion plus large de l'idéal flexitarien du bien manger d'autre part.
* 24 Fabienne Gomant, « Image des agriculteurs auprès du grand public, Persistance d'une réelle bienveillance, mais porosité au traitement médiatique de l'actualité de la profession par Madame », Demeter 2017. Page 15 : « les deux tiers des Francais se disaient, en fe'vrier 2016, pre^ts a` payer plus chers leurs produits dans le but d'assurer un revenu correct aux agriculteurs »
* 25 Plateforme du commerce équitable : https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/le-commerce-equitable/infographie_chiffres2018.pdf
* 26 IPSOS, Consommer local : ce que veulent les Français, février 2014.
* 27 Crédoc pour France Agrimer, Enquête comportements et consommations alimentaires en France 2016, Volet « Consommations », novembre 2017
* 28 Ce recul s'explique aussi en partie par des raisons économiques. 13 % des personnes qui ont réduit leur consommation de viande le justifient d'abord par son coût trop élevé. Pour 12 % des personnes, le prix, sans être le premier déterminant, est avancé comme un facteur explicatif d'une moindre consommation. La question du prix intervient donc dans un cas sur quatre dans l'explication du recul de la consommation de viande. Cf graphique suivant.
* 29 La définition des circuits courts admise par l'administration correspond à une vente présentant un intermédiaire au plus (vente directe, points de vente collectifs-magasins de producteurs, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne ou AMAP).
* 30 Crédoc, Enquête CCAF 2016 - Volet « Consommations » - Volet « Comportements » - Note de synthèse
* 31 La diminution des distances de transport dans un achat local est perçue comme un facteur de réduction des émissions de carbone, ce qui est sujet à discussion.
* 32 Selon le recensement agricole réalisé en 2010 par le ministère de l'agriculture, 21 % des exploitations françaises en 2010, soit 107 000 exploitations, commercialisaient au moins une partie de leur production en circuits courts. Les productions le plus souvent concernées sont le miel et les légumes (50 % des exploitations de ces filières), les fruits et le vin (25 % des exploitations), puis les produits animaux (10 %). La commercialisation en circuit court est également plus fréquente en agriculture biologique : plus de 90 % des maraîchers bio ont recours à ce mode de commercialisation, contre moins de la moitié des maraîchers en mode conventionnel ; dans 80 % des cas, plus de la moitié du chiffre d'affaires est même réalisé via ce mode de commercialisation (Insee, Les acteurs économiques et l'environnement, Édition 2017).
* 33 Cela concerne essentiellement les produits non transformés, fruits et légumes notamment.
* 34 Ademe, Alimentation - Les circuits courts de proximité, juin 2017
* 35 Les compléments alimentaires sont règlementairement définis comme les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, telles que les gélules, les pastilles ou les comprimés, par exemple. (Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires)
* 36 Un récent rapport du CGAAER fait le point sur les perspectives de diversification protéiques : « Diversification de la ressource protéique en alimentation humaine et animale - État des lieux et perspectives », septembre 2019.
* 37 Elles ont levé, à elles deux, plus de 230 millions d'euros. Au plan mondial, on peut citer par exemple AgriProtein en Afrique du Sud, qui a levé 122 millions d'euros, EnviroFlight aux États-Unis (120 millions d'euros) ou encore Protix aux Pays-Bas (qui a levé 45 millions d'euros)
* 38 Cette hausse sera forte si l'ensemble des pays du monde adoptent les régimes occidentaux caractérisés par une surconsommation de protéines. Différentes prospectives montrent en revanche que si la population mondiale respecte les recommandations nutritionnelles en termes d'apports protéiques, on pourrait se satisfaire de la production actuelle mondiale de protéines.
* 39 Données chiffrées fournies par Xavier Boidevezi, secrétaire national de la FoodTech, lors d'une table ronde au Sénat le 6 février 2020 sur le thème « Les aliments nouveaux ».
* 40 Pour produire de la viande de culture, il faut un apport d'énergie et de nutriments, qui doivent eux-mêmes être produits et générent donc des impacts écologiques.
* 41 En particulier, l'effet des doses massives d'anabolisants nécessaires à une croissance accélérée des cellules de viande est un sujet d'interrogations.
* 42 Notamment des cellules souches animales.
* 43 Données chiffrées fournies par Xavier Boidevezi, secrétaire national de la FoodTech, lors d'une table ronde au Sénat le 6 février 2020 sur le thème « Les aliments nouveaux ».
* 44 Vitamines, minéraux, oligoéléments, antioxydants, fer et bêta-carotènes.
* 45 Il faut par ailleurs veiller à la maîtrise d'un certain nombre de risques, notamment allergiques, même si rien ne dit que la consommation d'insectes présente sur ce plan des risques d'une ampleur supérieure à celle de nombreux aliments qui sont actuellement présents dans notre alimentation. L'Anses a rendu un avis en février 2015 relatif à la « valorisation des insectes dans l'alimentation et l'état des lieux des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires en lien avec la consommation des insectes ».
* 46 En 2018, la Fédération européenne des entreprises d'insectes (Ipiff) prévoyait une hausse de la production européenne de 2 000 tonnes par an à 200 000 tonnes en 2020, 1,2 million de tonnes en 2025 et 3 millions de tonnes en 2030, soit un tonnage comparable à celui des farines de poissons actuellement. Les entreprises (Ynsect, Innovafeed et Nextalim en France) se sont toutes attelées à la construction, en 2020, de sites de production de plus de 10 000 tonnes
* 47 Plus d'un milliard de tonnes par an dans le monde.
* 48 Les insectes eux-mêmes sont en effet nourris en utilisant des coproduits agricoles, comme la pulpe de betterave par exemple. Un développement massif de ces farines bouleverserait donc les conditions de valorisation de ces coproduits végétaux.
* 49 Les différences sociales en matière d'alimentation, Centre d'étude prospective, n° 64, octobre 2013
* 50 L'insécurité alimentaire reste un phénomène massif au niveau mondial : bien qu'elle ait beaucoup reculé, la sous-nutrition touche encore 820 millions de personnes en 2019 ; les carences nutritionnelles, notamment en vitamine A, en fer et en iode, concernent quant à elles 2 milliards de personnes ; enfin, si on prend en compte l'accès à une eau potable, qui est un aspect de l'alimentation, on note que 30 % de la population mondiale n'a pas accès à des services d'eau potable gérés en toute sécurité.
* 51 Etude nationale nutrition santé et Inca 2 en 2006-2007.
* 52 Il est vraisemblable que la crise sanitaire actuelle aura contribué à renforcer ces situations d'insécurité alimentaires.
* 53 Cirad, Inrae, Agrimonde-Terra : Land Use and Food Security in 2050, 2016
* 54 Report from The Commission on the development of plant proteins in the European Union, nov 2018. Les statistiques sur le marché des protéines reposent sur les plantes riches en protéines (taux >15 %). La demande européenne de protéines végétales est de 27 millions de tonnes par an, dont 17 millions de tonnes importées.
* 55 CGAAER, « Diversification de la ressource protéique en alimentation humaine et animale - État des lieux et perspectives », septembre 2019. NB : Selon les chiffres fournis par l'INRA, si on calcule l'autonomie protéique en incluant les protéines végétales venant de plantes non classées par les matières riches en protéines, c'est-à-dire les céréales et les prairies notamment, cette autonomie se situe autour de 80 à 90 %.
* 56 Délégation à la prospective du Sénat, Adapter la France aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 : urgence déclarée Rapport d'information de MM. Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, avril 2019.
* 57 Certaines cultures viables dans un territoire donné avec le climat des années 1980 seront plus fragiles ou moins productives avec le climat des années 2040-2050.
* 58 La nutrition joue également un rôle dans de nombreuses autres maladies, dont les origines alimentaires ne sont pas toujours bien identifiées par le grand public : pathologies digestives, ostéo-articulaires, thyroïdiennes, dermatologiques, neurologiques (déclin cognitif), respiratoires.
* 59 IARC (2018). Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine. Lyon: International Agency for Research on Cancer.
* 60 Les facteurs de risque pris en compte dans cette étude sont le tabagisme, l'alcool, l'alimentation (par exemple, faible consommation de fruits, légumes et fibres, et consommation importante de viande transformée), le surpoids et l'obésité, une activité physique insuffisante, l'utilisation d'hormones exogènes, les infections, les radiations ionisantes, la pollution atmosphérique, le rayonnement solaire (UV), les expositions professionnelles, une durée d'allaitement de moins de 6 mois et l'exposition aux substances chimiques de la population générale (arsenic dans l'eau de boisson et benzène dans l'air intérieur).
* 61 Il y avait en France, en 2015, 17 % d'adultes obèses et plus de 50 % d'adultes en surpoids ou obèses, selon Santé Publique France (étude nationale Esteban). Selon les données du Center of Disease Control and Prevention, les États-Unis comptent un taux très voisin de personnes en surpoids et non obèses (35 %), mais 30,9 % d'obèses.
* 62 Seulement 22 % des adultes et 40 % des enfants en consommaient moins de 6 g par jour.
* 63 Seuls 13 % des adultes et 2 % des enfants en consomment au moins 25 g par jour. C'est le résultat d'une consommation insuffisante de fruits et légumes (seuls 28 % des adultes et 13 % des enfants en consommaient au moins 5 par jour), de produits céréaliers complets et de légumes secs (60 % des adultes et 71 % des enfants n'en ont pas consommés sur les trois jours d'enquête alimentaire).
* 64 Avec l'âge, le renouvellement des protéines des muscles est en effet contrarié par un phénomène de résistance anabolique, qui se traduit par le fait que, pour un apport identique d'acides aminés, un sujet âgé dispose d'une capacité de renouvellement musculaire réduite par rapport à un sujet jeune. Par ailleurs, avec le vieillissement, l'âge, le foie et l'intestin capturent davantage d'acides aminés, réduisant d'autant la quantité d'acides aminés disponibles pour la synthèse musculaire. Enfin, en vieillissant, l'organisme présente une inflammation chronique de faible intensité, qui accélère le phénomène de résistance anabolique.
* 65 Rapport de l'OPECST n° 267 de M. Claude SAUNIER, Les nouveaux apports de la science et de la technologie à la qualité et à la sûreté des aliments ; avril 2004
* 66 Les risques pour les agriculteurs, potentiellement exposés de manière directe à des doses importantes de pesticide, ne relèvent pas de la conjecture : ils constituent un danger avéré.
* 67 Équipe de Recherche en Épidémiologie Nutritionnelle (Inserm 1153/Inra 1125/Cnam/Université de Paris - Paris 13). À la date de l'audition de ce laboratoire, huit articles font ainsi état d'un risque accru de cancers, maladies cardiovasculaires, mortalité, troubles fonctionnels digestifs, symptômes dépressifs et diabète en lien avec la consommation d'aliments ultra-transformés. Vingt-trois articles font à l'inverse état d'un risque plus faible de cancers, d'obésité et de syndrome métabolique en lien avec la consommation régulière d'aliments bio
* 68 Il croise trois séries d'indicateurs : les performances nationales en matière de réduction des gaspillages alimentaires et des déchets, la durabilité des pratiques agricoles et les performances nutritionnelles.
* 69 GIEC, Special Report: Special Report on Climate Change and Land, 2019
* 70 Lucile Rogissart, Claudine Foucherot, Valentin Bellassen, Estimer les émissions de gaz à effet de serre de la consommation alimentaire : méthodes et résultats, I4CE, Février 2019
* 71 Barbier C., Couturier C., Pourouchottamin P., Cayla J-M, Sylvestre M., Pharabod I, L'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation en France, Club Ingénierie Prospective Énergie et Environnement, Paris, Iddri, Janvier 2019. Ce résultat est sensiblement supérieur aux seules émissions agricoles. D'après le dernier rapport neutralité carbone de 2019 du Haut conseil pour le climat, le secteur de l'agriculture comptait pour 19 % des émissions en 2018 (86 MtCO2e).
* 72 Barbier C. et alii, op. cit.
* 73 Afterres 2050, version 2016, p.30.
* 74 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10)
* 75 Francisco Sánchez-Bayoa, Kris A.G. Wyckhuys, Worldwide decline of the entomofauna: a review of its drivers, Biological Conservation, Volume 232, April 2019
* 76 Délégation à la prospective du Sénat, 17 octobre 2019.
* 77 Pour une synthèse très accessible de ces travaux scientifiques cf. : Nicole Darmon, « Quelle compatibilité entre qualités nutritionnelle et environnementale de l'alimentation en France ? Apports du profilage nutritionnel des aliments, de l'épidémiologie nutritionnelle et de la modélisation de rations », Cholé-Doc, numéro 154, janv.-fév. 2017
* 78 Vieux F, Darmon N, Touazi D, Soler LG. Greenhouse gas emissions of self-selected individual diets in France: Changing the diet structure or consuming less ? Ecol Econ, 2012; 75, 91-101.
* 79 Solagro, Le scénario Afterres 2050, 2016. Les quantités consommées passeraient de 1598 g par adulte et par jour en moyenne à 1439 g/adulte/j.
* 80 TYFA : Ten Years For Agroecology . Cf : Xavier Poux, Pierre-Marie Aubert, Une Europe agroécologique en 2050: une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine, Iddri, N°09/18 Septembre 2018
* 81 32 % des pertes ont lieu en phase de production ; 21 % en phase de transformation ; 14 % en phase de distribution et 33 % en phase de consommation.
* 82 Audition de M. Jean-François Soussana, vice-président de l'Inrae, sur les perspectives de l'alimentation en 2050, Délégation à la prospective du Sénat, 17 octobre 2019.
* 83 Rééquilibrage ne signifie pas éviction.
* 84 Les apports conseillés en protéines sont calculés pour équilibrer le bilan azoté de l'organisme (synthèse versus dégradation des protéines).
* 85 Certains produits végétaux (céréales et légumineuses) sont d'excellentes sources de protéines et sont susceptibles de fournir, utilisées en association, l'ensemble des acides aminés essentiels. Historiquement, jusqu'au début du XX e siècle, les apports protéiques de la population française étaient majoritairement d'origine végétale.
* 86 Un excès de consommation de viande est associé à la survenue de surpoids et de maladies telles qu'hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2. Une forte consommation de viande rouge et de viandes transformées (charcuterie, salaison, conserves, produits à base de viande) est également associée à un risque accru de cancer colorectal.
* 87 Les produits animaux, et singulièrement la viande bovine, sont la catégorie d'aliments la plus émettrice de GES du fait du phénomène de fermentation entérique, mais aussi des engrais azotés utilisés pour produire les végétaux qui nourrissent les animaux.
* 88 Rapport TYFA, p. 41.
* 89 D'après rapport TYFA, p. 62 citant Weiss F. & Leip A., (2012). Greenhouse gas emissions from the EU livestock sector: a life cycle assessment carried out with the CAPRI model. Agriculture, ecosystems & environment, 149, 124-134.
* 90 Vieux F, Darmon N, Touazi D, Soler LG. Greenhouse gas emissions of self-selected individual diets in France: Changing the diet structure or consuming less ? Ecol Econ, 2012; 75, 91-101.
* 91 Pour compenser la perte énergétique d'une moindre quantité de viande, il faut manger en effet des quantités élevées de fruits et légumes. En l'occurrence, l'étude de l'Inrae citée ici estime qu'il faut 426 g de fruits et légumes supplémentaires pour compenser la baisse de la quantité de viande. Compte tenu de la corrélation positive entre quantités ingérées et émissions de GES, cette augmentation de la consommation de fruits et légumes conduit in fine à une hausse des émissions carbone (+2,7 %).
* 92 Attention à ne pas renverser complètement la conclusion. Dire qu'un régime sain fortement végétalisé peut être plus émetteur de carbone qu'un régime moins sain fortement carné ne veut pas dire qu'il l'est systématiquement. Tout dépend de l'analyse précise du contenu des assiettes. On peut en effet identifier dans les pratiques alimentaires ou concevoir par modélisation des régimes fortement végétalisés qui sont à la fois bons pour la santé et bons pour l'environnement. La conciliation de ces deux critères est donc possible. Toutefois, elle n'est pas automatique, de sorte qu'il faut se méfier des discours simplificateurs qui assimilent végétalisation et haute qualité environnementale.
* 93 Il est intéressant de souligner que la part de protéines animales dans le régime alimentaire qui est optimale du point de vue de l'utilisation des ressources agraires est très proche du seuil recommandé par ailleurs pour des motifs nutritionnels. Il y a donc, de ce point de vue, une convergence entre objectifs environnementaux et nutritionnels.
* 94 Van Kernebeek, H.R.J., Oosting, S.J., Van Ittersum, M.K. et al. Saving land to feed a growing population: consequences for consumption of crop and livestock products. Int J Life Cycle Assess 21, 677-687 (2016). https://doi.org/10.1007/s11367-015-0923-6
* 95 Xavier Poux, Pierre-Marie Aubert, Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine, Iddri, septembre 2018
* 96 De l'ordre de 0,7 t de carbone par hectare et par an (Soussana J.-F. et Lemaire G., Coupling carbon and nitrogen cycles for environmentally sustainable intensification of grasslands and crop-livestock systems. 2014. Agriculture, Ecosystems & Environment). Même si l'élevage à l'herbe des ruminants est générateur de GES via la fermentation entérique, cette pollution au carbone est donc au moins partiellement compensée par le stockage du carbone dans le sol.
* 97 Rapport TYFA, p. 25
* 98 « Dans une prairie permanente menée de manière extensive, la part des légumineuses se stabilise entre 25 et 40 %, permettant de fixer l'azote atmosphérique qui peut varier de 150 à 250 kg/ha/an » (Iddri, sept 2018, p.39).
* 99 Rapport Tyfa p.29. Globalement, à l'échelle européenne, malgré les efforts indéniables pour minimiser les fuites, on estime que la moitié de l'azote qui entre dans les cycles de production agricoles est perdu. Aussi loin qu'on aille dans l'agriculture de précision, ces pertes resteront massives du fait du découplage des zones de production animales et végétales.
* 100 Masset G, Vieux F, Verger E, Soler L, Touazi D, Darmon N, Reducing energy intake and energy density for a sustainable diet: a study based on self-selected diets in French adults; Am J Clin Nutr. 2014 Jun; 99(6).
* 101 Voir annexe 1 pour une présentation sommaire des études Inca.
* 102 Perignon Marlene, Masset Gabriel, Ferrari Gaël, Barré Tangui, Vieux Florent, Maillot Matthieu, Amio, Marie Josèphe, Darmon Nicole, « How low can dietary greenhouse gas emissions be reduced without impairing nutritional adequacy, affordability and acceptability of the diet? A modelling study to guide sustainable food choices », Public Health Nutrition -1-14 April 2016
* 103 Les diètes sont caractérisées à partir de sept grandes familles d'aliments.
* 104 En passant de 350 g par jour à 500 g par jour.
* 105 En passant de 140 g par jour à 90 g par jour.
* 106 Comme l'a souligné Christophe de Margerie lors de son audition par la délégation : « il faut garder à l'esprit que la société court souvent plus vite que le législateur ».
* 107 Cf. en particulier : F. Régnier, A. Masullo, Le régime entre santé et esthétique ? Significations, parcours et mise en oeuvre du régime alimentaire, Revue d'Études en Agriculture et Environnement, 91(2), 185-208
* 108 Dans les milieux modestes, la notion de régime, c'est-à-dire de contrôle au long cours de son alimentation a un sens seulement quand on est malade, autrement dit dans une visée curative, mais pas dans une perspective préventive de long terme.
* 109 La barrière financière pèse sur les milieux modestes qui sont aussi les plus concernés par les pratiques alimentaires mauvaises pour la santé.
* 110 Il est important de ne pas cibler l'accompagnement vers une alimentation saine uniquement sur les ménages les plus en difficultés. Comme on l'a vu, l'insécurité alimentaire en France ne concerne pas que les ménages en situation de pauvreté ni ceux qui ont recours aux banques alimentaires. C'est un phénomène beaucoup plus vaste.
* 111 WWF et Eco2 Initiative, Vers une alimentation bas carbone saine et abordable, 2017. Dans cette étude, l'assiette flexitarienne se compose de 2/3 de protéines végétales et 1/3 de protéines animales.
* 112 Tel qu'il ressort de l'enquête Inca 3.
* 113 Cette assiette a été composée à partir de 163 aliments les plus consommés par les Français. Elle se caractérise par une diminution de la viande (-31 % au total avec -66 % de boeuf et de veau), des poissons sauvages (-40 %), une diminution des produits transformés industriels, gras, salés et sucrés (-69 %), une diminution des produits à base de farines raffinées (-46 %) au profit de farines complètes et une augmentation de la part des légumes, céréales et légumineuses (95 %).
* 114 On peut par exemple imaginer des aides financières sous forme de bons de réduction avec codes-barres scannables lors du passage en caisse, qui imputent la réduction si le panier contient les aliments adéquats.
* 115 Comme on l'a vu, il est difficile de faire baisser les émissions de GES de l'alimentation sans consommer plus de surfaces agricoles et sans menacer l'équilibre nutritionnel. Il est également difficile de maintenir l'équilibre nutritionnel sans réduire l'accessibilité financière. Enfin, il est difficile de tenir les objectifs écologiques, nutritionnels et d'accessibilité en restant dans un cadre proche des habitudes alimentaires actuelles.
* 116 L'expression est empruntée au rapport Pulse Fiction réalisé par Thomas Uthayakumar et Hélène Loustau pour le WWF en octobre 2019. Nous avons inversé l'ordre des termes, « de la fourchette à la fourche », plutôt que l'inverse, pour souligner que ce sont les changements de pratiques de consommation (la fourchette) qui induiront les changements de production (la fourche).
* 117 Il faut en effet des protéines végétales pour nourrir les animaux et produire des protéines animales.
* 118 La viande, les produits laitiers, les oeufs ou le poisson sont des sources de protéines qui contiennent les neuf acides aminés indispensables. Les protéines de céréales, consommées seules, sont déficientes en lysine, un acide aminé limitant. Les légumineuses (lentilles, fèves, haricots, petits pois...) sont en revanche largement pourvues en lysine. Associer des céréales (2/3) et des légumineuses (1/3) permet donc d'obtenir tous les acides aminés indispensables (rapport Afterres, p.10).
* 119 Précédemment, elles étaient noyées dans la catégorie « féculents », dénomination qui convient mieux à des aliments riches en sucres lents.
* 120 Les cultures associées sont définies comme la culture simultanée d'au moins deux espèces dans un même champ et pendant une partie significative de leur cycle de vie. Elles peuvent être vues comme une pratique agroécologique visant à s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels au service de l'agriculture.
* 121 Oïdium, anthracnose, mildiou, septoriose.
* 122 Notamment papillons (les noctuelles, chenilles nocturnes), coléoptères (ex. la Bruche), des mouches, des pucerons, des punaises, des cicadelles, les thrips, etc. Les insectes ravageurs s'attaquent aux racines, aux tiges, aux feuilles, aux fleurs et aux graines. La Bruche du haricot s'attaque notamment aux fèves/fèveroles, et fore des trous dans les graines, les rendant impropres à la consommation humaine.
* 123 Les légumineuses sont d'autant plus concurrencées par les adventices que ces dernières profitent de l'enrichissement de la terre autour de leurs racines.
* 124 WWF, Pulse Fiction, p. 22
* 125 Dans la perspective de l'adaptation de l'agriculture au réchauffement climatique, les légumineuses peuvent permettre de définir des stratégies pertinentes d'évolution des systèmes de culture si les associations traditionnelles deviennent inadaptées au nouveau contexte climatique.
* 126 Il existe des légumineuses à graines (pois, fèves, féveroles, haricots-grains, lentilles, pois chiche, lupins, récoltés en sec à la différence des légumineuses récoltées en frais comme les haricots verts ou encore petits pois) et des légumineuses fourragères (luzernes, trèfles ou encore sainfoin).
* 127 La place des légumineuses dans l'alimentation humaine a beaucoup reculé en France et en Europe après la Seconde Guerre mondiale, au profit d'une hausse de la consommation de céréales et de produits animaux. La consommation des Français, qui était de 7,2 kg de légumineuses par personne et par an en moyenne en 1920, est ainsi tombée à 1,4 kg au milieu des années 1980.
* 128 Pour une illustration de ces propos, se rapporter à l'intervention de M. Gilles Daveau, consultant et formateur en cuisine alternative, lors de la table ronde de la Délégation à la prospective du Sénat, le 6 février 2020 (le texte figure en annexe du présent rapport).
* 129 Pulse Fiction, p. 21
* 130 La farine de lupin est par exemple utilisée en pâtisserie. Le lupin et la féverole peuvent aussi être utilisés en tant que liants dans les plats cuisinés, ce qui permet de réduire l'emploi des matières grasses. Le jus de cuisson de pois chiches peut remplacer le blanc d'oeuf dans certaines recettes. A noter que beaucoup de ces innovations alimentaires issues des légumineuses viennent du marché de l'alimentation biologique.
* 131 Notamment en France dans l'UMR AGIR (Inrae Toulouse), au LEVA (ESA d'Angers) et dans l'UMR Agronomie (Inrae Grignon). Les développements qui suivent exploitent directement les éléments fournis par l'Inrae et, notamment par Laurent Bedoussac et Marie-Benoît Magrini.
* 132 Utilisation de doses modérées de l'ordre de 30-80 unités d'azote/ha, alors que la céréale pure reçoit, dans les mêmes conditions, entre 150 et 200 unités d'azote/ha.
* 133 L'énergie fossile pour produire une tonne de produits récoltés en association est largement inférieure à celle pour une céréale pure (de 50 % à 75 % de réduction selon le niveau de fertilisation de l'association).
* 134 La lixiviation d'azote nitrique, couramment et improprement appelée lessivage de nitrates, est la principale forme de pertes d'azote en agriculture. Elle se produit par dissolution dans l'eau des nitrates.
* 135 Ten years for Agroecology.
* 136 Cette moyenne de 30 g/jour à l'horizon 2050 correspond au niveau actuel des recommandations au Canada ou aux États-Unis.
* 137 On fait ici l'hypothèse d'une population de 75 millions d'habitants en 2050 et d'un rendement de 2t/ha.
* 138 D'après les données fournies par l'Inrae, la surface plantée en légumes secs est de 65 000 ha, auxquels il faut ajouter la fraction de la surface de soja, de pois protéagineux, de féverole dont la production va à l'alimentation humaine (de l'ordre de 50 000 ha). À l'échelle européenne, en 2050, pour répondre à une demande de 11 kg de légumes secs par personne et par an, ce serait 5 millions ha de légumineuses à graines qu'il faudrait cultiver pour l'alimentation humaine, soit 9 % de l'assolement actuel de céréales.
* 139 Les repères nutritionnels pris en compte dans le scénario TYFA comportent notamment l'hypothèse d'un apport calorique moyen réduit de 11 % en 2050 par rapport à 2010 (soit 2300 kcal au lieu de 2600) et une consommation de protéines animales de 50 g par jour.
* 140 La PAC ayant posé un objectif d'autosuffisance européenne en céréales garanti par une protection du marché européen fondé sur la préférence communautaire, l'Europe a concédé aux États-Unis, en contrepartie de la protection des céréales européennes, le libre accès à son marché des oléagineux (dont le soja) par l'accord du Dillon round (1960-1962).
* 141 7 à 8 t/ha contre 2 t/ha.
* 142 Marie-Benoît Magrini, Les légumineuses, clé de la transition alimentaire, table ronde de la Délégation à la prospective du Sénat, 6 février 2020.
* 143 En faisant l'hypothèse que les cultures associées peuvent être triées correctement, comme dans le cas de lentille associée au blé, les travaux menés par l'Inrae concluent que la marge brute de l'exploitant est supérieure à celle de la moyenne des deux cultures pures dans 80 % des situations. Les cultures associées sont donc un moyen de sécuriser la marge pour les agriculteurs, en particulier dans le cas des années présentant de faibles rendements pour l'une ou l'autre des cultures pures (notamment de la légumineuse à graines), ou lorsque la teneur en protéines des céréales pures est faible en situation normale de production.
* 144 Pour approfondir la réflexion sur ce point, cf. France Stratégie, Faire de la PAC un levier de la transition agroécologique, octobre 2019.