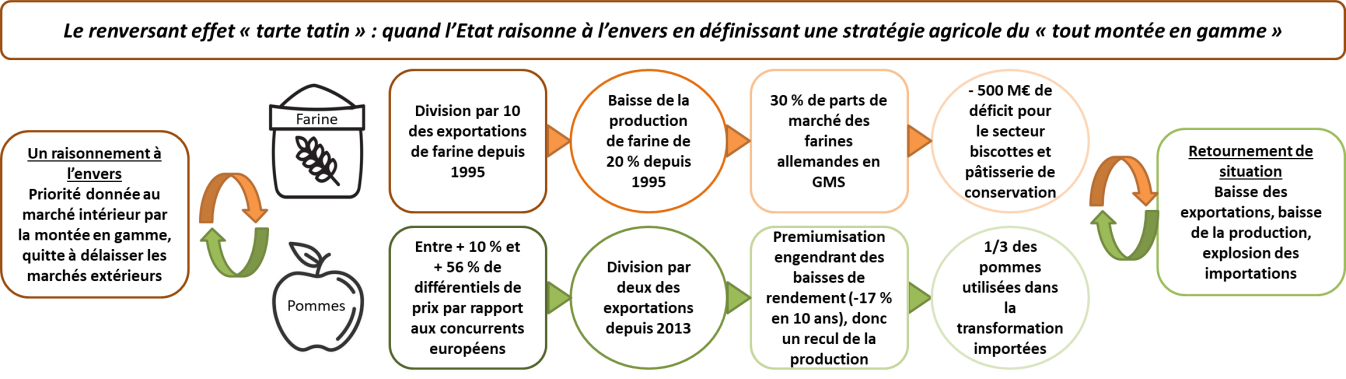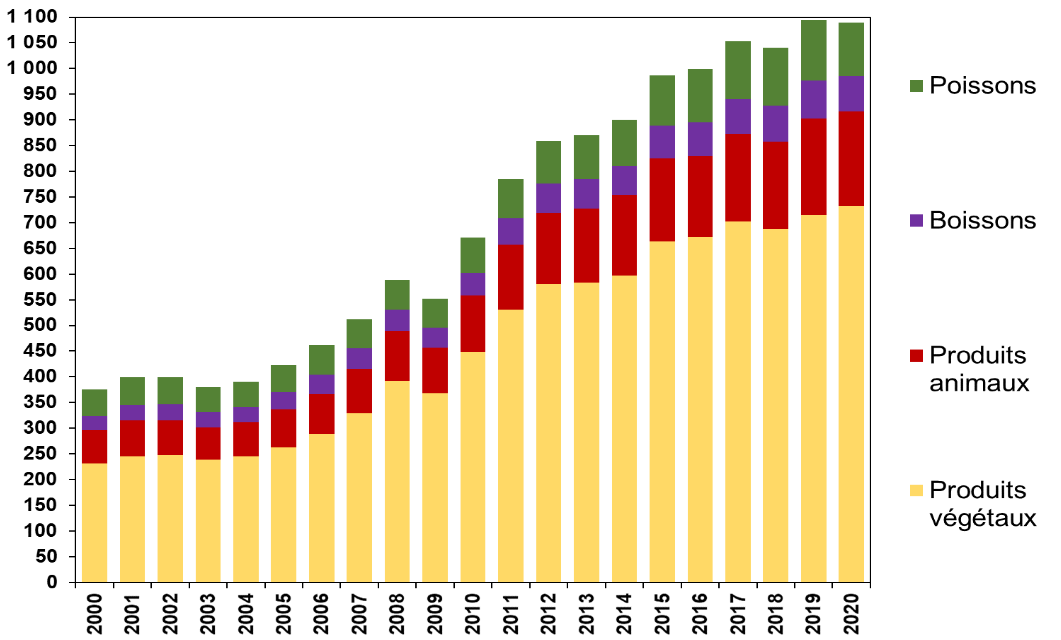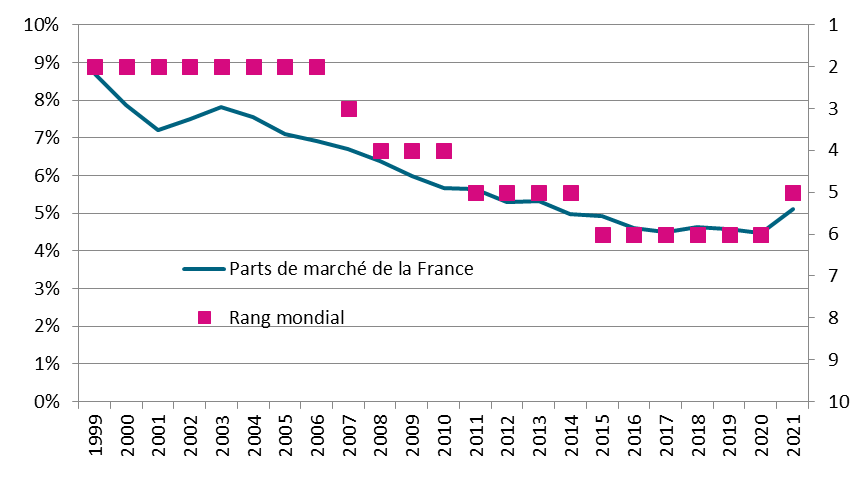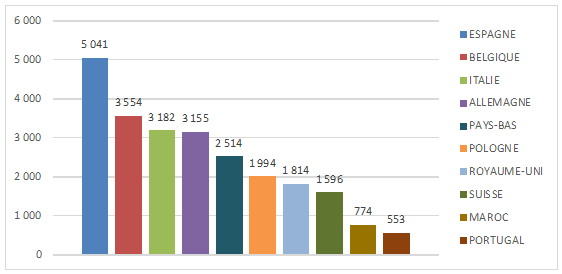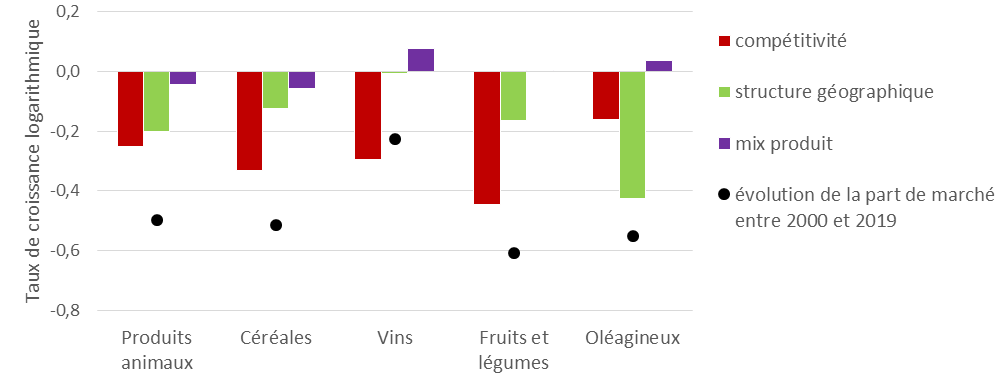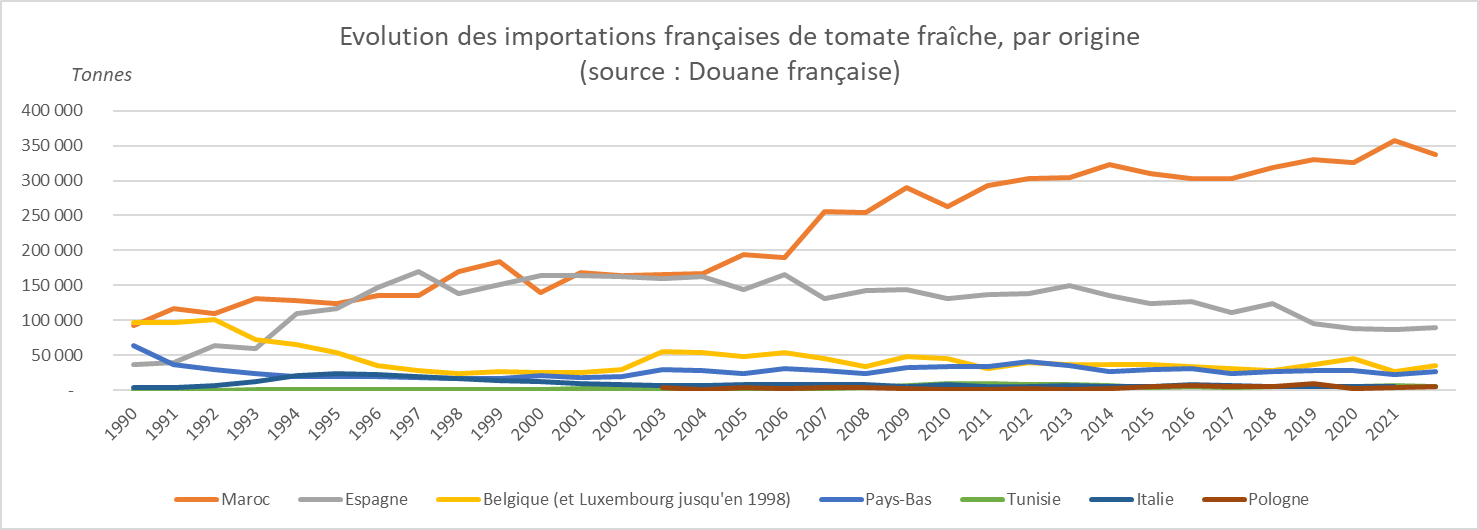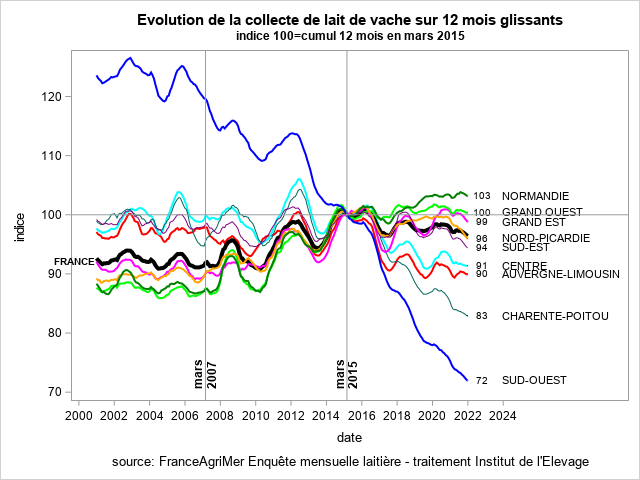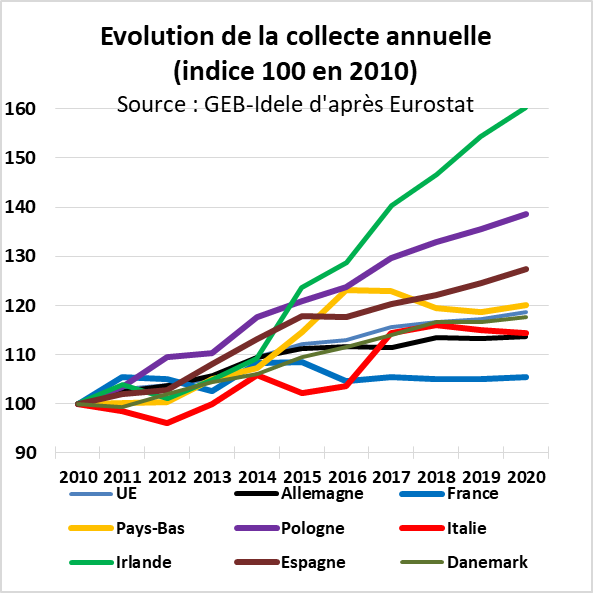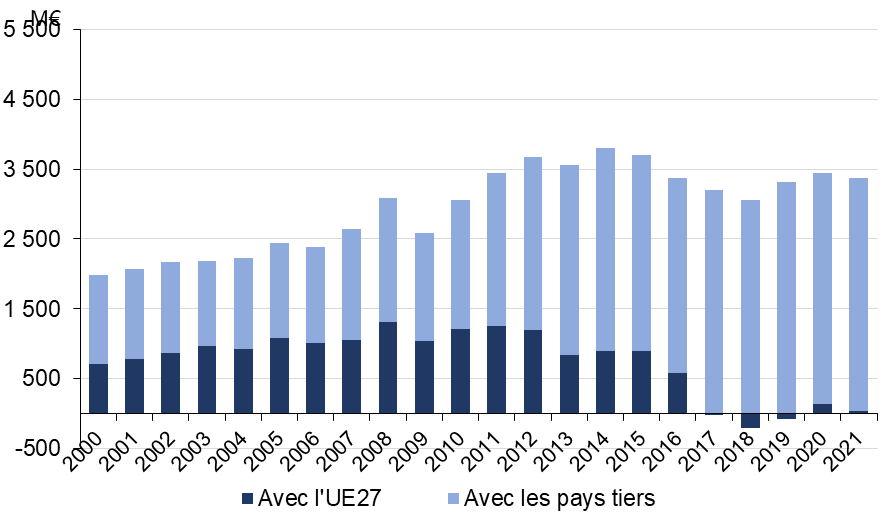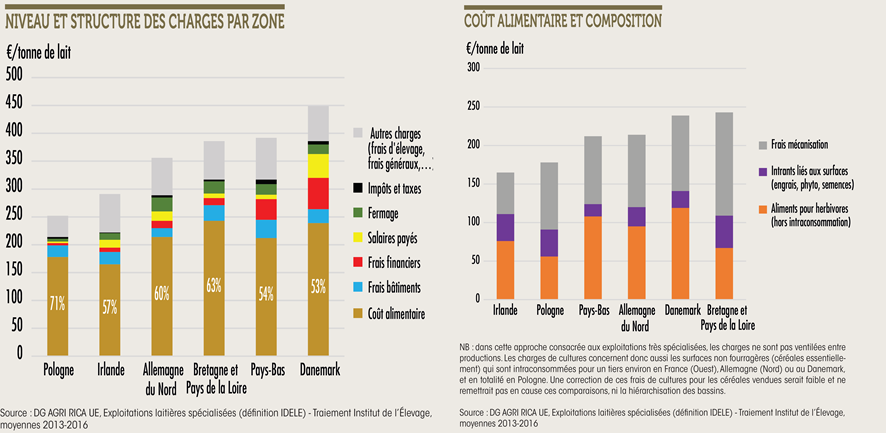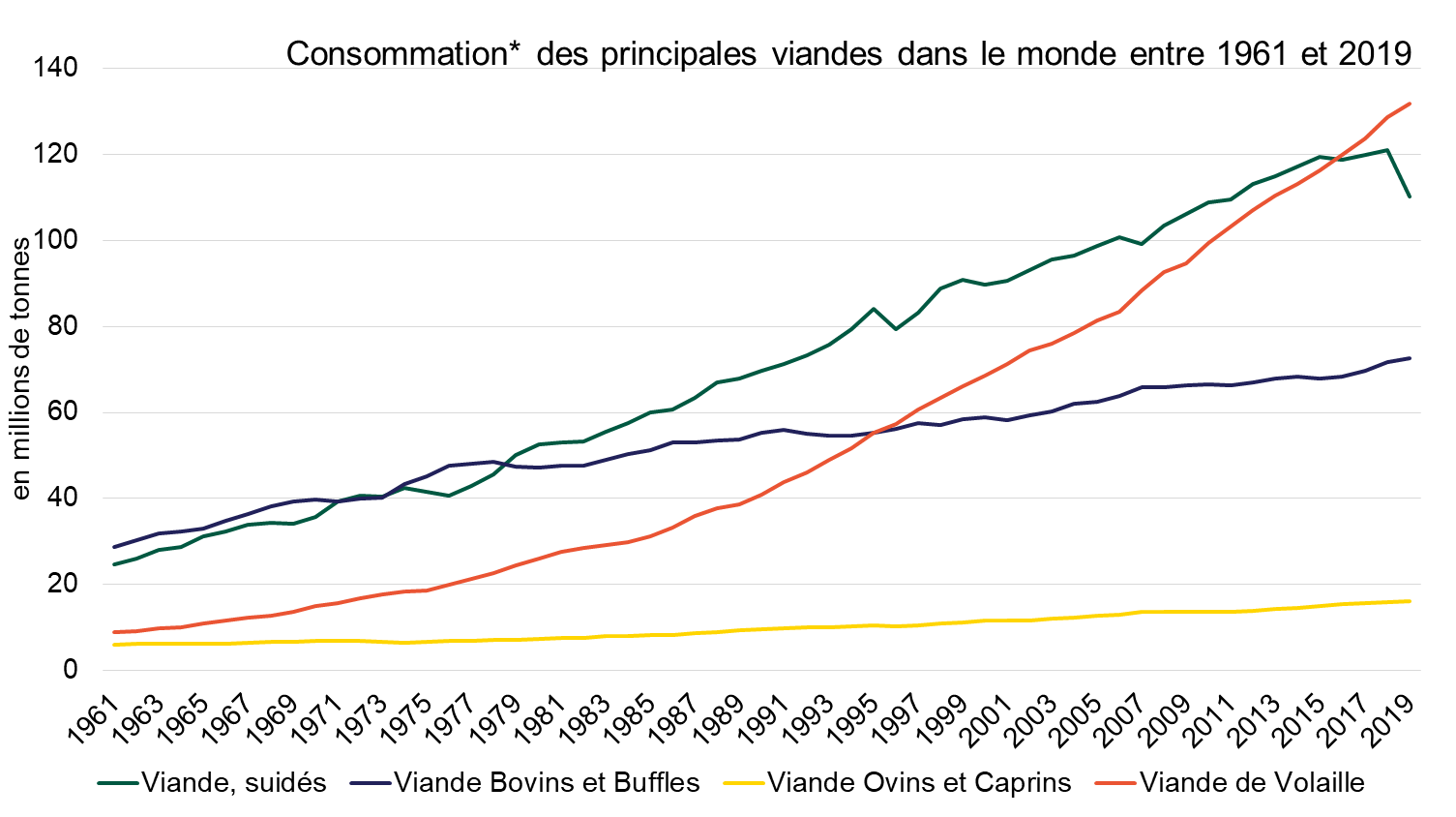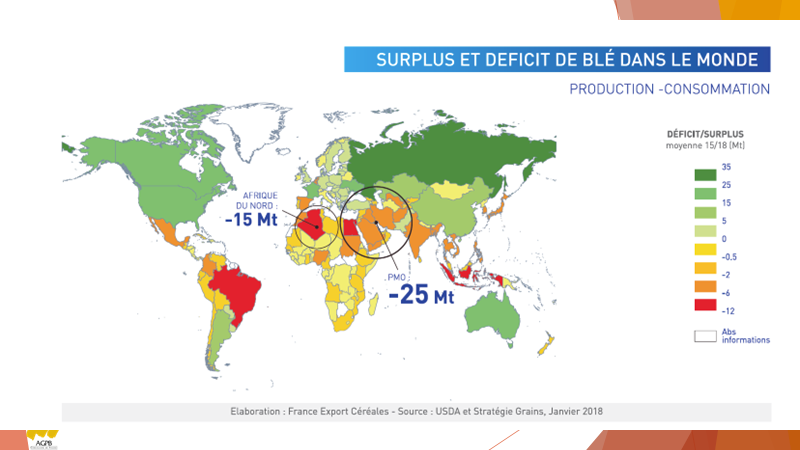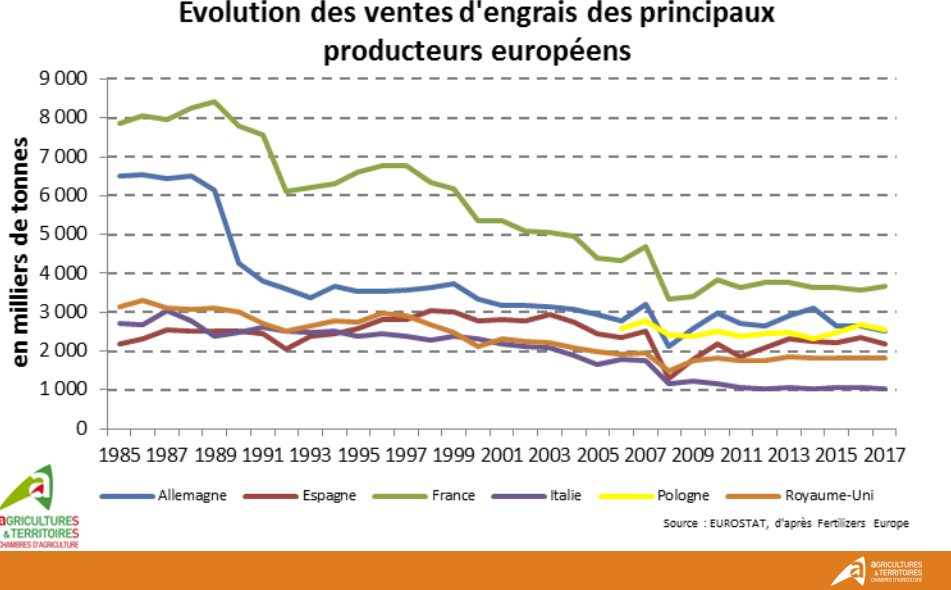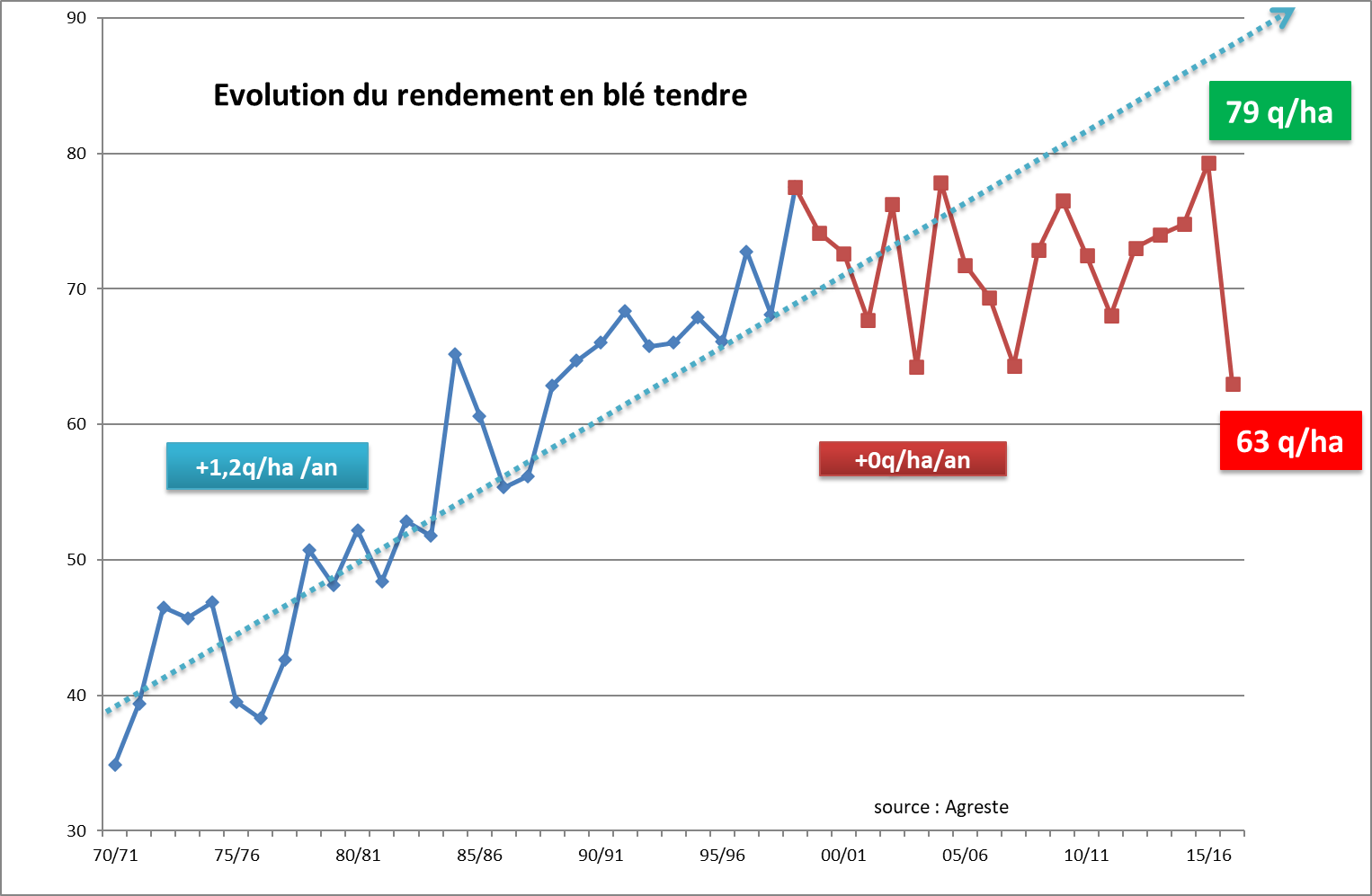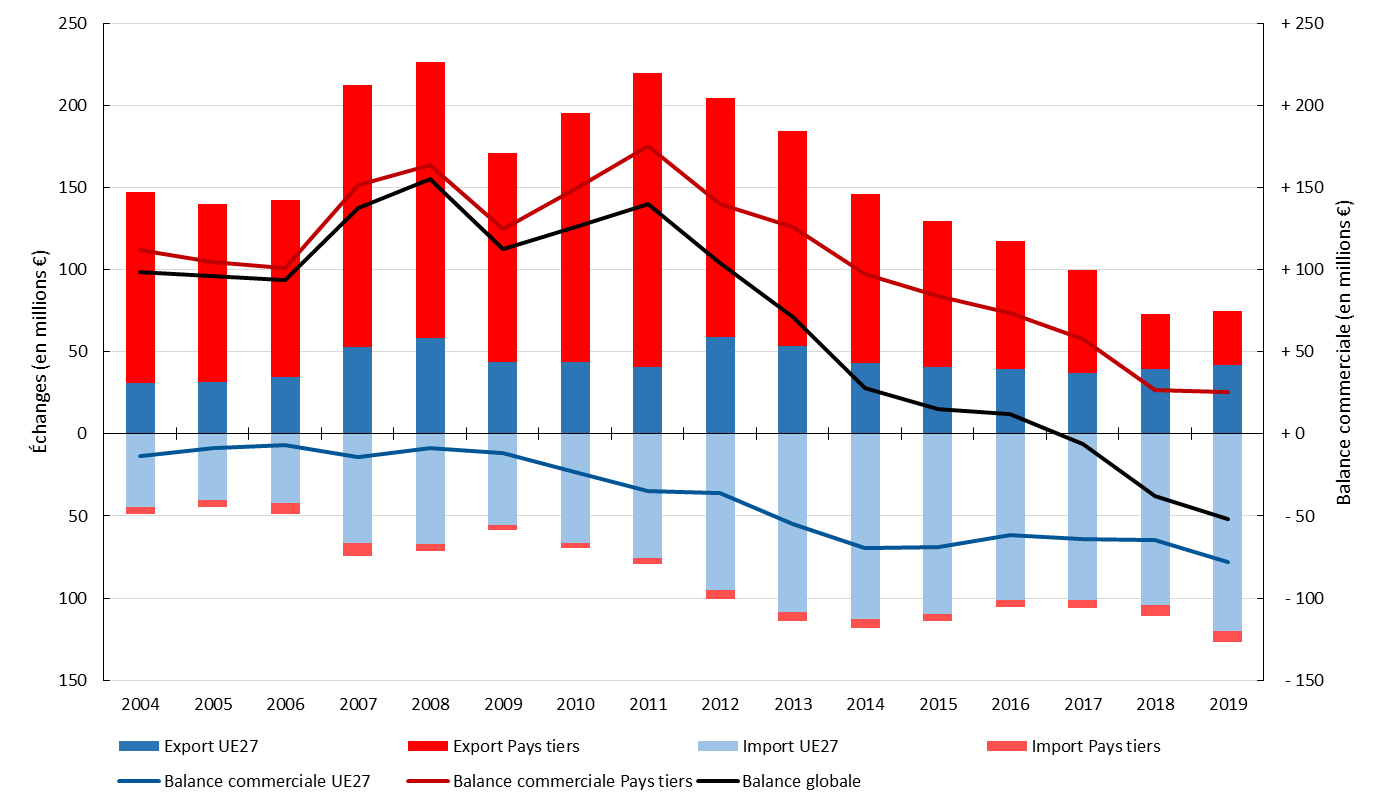- LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
- L'ESSENTIEL
- AVANT-PROPOS : QUEL BILAN AGRICOLE
POUR LA MAJORITÉ GOUVERNEMENTALE DEPUIS 2017 ?
- LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE
- I. COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME
FRANCE : LE GRAND IMPENSÉ DE LA POLITIQUE AGRICOLE MENÉE PAR
LE GOUVERNEMENT DEPUIS 2017
- A. DEPUIS 2017, UNE POLITIQUE TOURNÉE
UNIQUEMENT VERS LA « MONTÉE EN GAMME » DE
L'AGRICULTURE FRANÇAISE, À LA CHARGE DES AGRICULTEURS
- B. CETTE VISION EST À CONTRE-COURANT D'UN
MARCHÉ INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE QUI N'A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI DYNAMIQUE ET SUR LEQUEL L'UNION EUROPÉENNE DISPOSE D'UNE POSITION
DE LEADER INCONTESTÉE
- C. CETTE POLITIQUE ACCROÎT UNE TENDANCE
QUASI-UNIQUE EN EUROPE : LA FERME FRANCE PERD DES PARTS DE MARCHÉ
À L'EXPORTATION ET VOIT LES IMPORTATIONS CONQUÉRIR L'ASSIETTE DES
FRANÇAIS
- D. TOUTES LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
MENÉES SUR LE SUJET CES DERNIÈRES ANNÉES DÉMONTRENT
QUE LE FACTEUR PRINCIPAL DE DÉSTABILISATION DE L'AGRICULTURE
FRANÇAISE EST SA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ
- 1. Plusieurs études sont formelles : ce
qui explique le déclin de la Ferme France, c'est son déficit de
compétitivité
- 2. Les obstacles à la
compétitivité de la Ferme France : des charges plus
élevées sur de nombreux postes ; une productivité des
facteurs en berne ; un positionnement prix parfois hors du
marché
- 1. Plusieurs études sont formelles : ce
qui explique le déclin de la Ferme France, c'est son déficit de
compétitivité
- E. UN IMPÉRATIF ESSENTIEL EN CES TEMPS DE
CRISE : PROPOSER DES PRODUITS FRANÇAIS À TOUS, ET NON LES
RÉSERVER À QUELQUES-UNS
- A. DEPUIS 2017, UNE POLITIQUE TOURNÉE
UNIQUEMENT VERS LA « MONTÉE EN GAMME » DE
L'AGRICULTURE FRANÇAISE, À LA CHARGE DES AGRICULTEURS
- II. L'ÉTUDE DE CINQ CAS CONCRETS
DÉMONTRE QUE L'AGRICULTURE FRANÇAISE EST DEVENUE MOINS
PRODUCTIVE, MOINS ACCESSIBLE ET MOINS COMPÉTITIVE
- A. QUAND LA MONTÉE EN GAMME ENGENDRE UNE
BAISSE DE PRODUCTION ET MET EN PÉRIL LA FILIÈRE
FRANÇAISE : L'HISTOIRE D'UNE POMME FRANÇAISE QUI N'A PLUS LA
BANANE
- 1. La pomme est historiquement une filière
d'excellence française, fortement tournée à
l'export
- 2. Trois ruptures majeures témoignant d'une
crise de compétitivité sur les marchés internationaux
- a) Rupture n° 1 : la production
française a quasiment été divisée par deux depuis
1990
- b) Rupture n° 2 : des exportations en
chute libre dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel
- c) Rupture n° 3 : des importations
non négligeables, notamment dans la filière transformation
- d) À la source de ces ruptures : une
pomme française sortie des radars des marchés faute d'une
compétitivité prix suffisante
- a) Rupture n° 1 : la production
française a quasiment été divisée par deux depuis
1990
- 3. Une compétitivité sapée
par des coûts de main-d'oeuvre et des surtranspositions
franco-françaises, contraignant les producteurs à se
spécialiser de plus en plus sur du haut de gamme, au détriment de
la filière pomme transformée
- a) Une structure de charges dominée par des
coûts de main-d'oeuvre où la France perd du terrain
- b) Le lourd effet des surtranspositions accentue
encore les distorsions de concurrence
- c) Une spécialisation haut de gamme
à marche forcée qui pose des difficultés
d'écoulement en raison d'une saturation du marché
- d) Le marché des produits de base est
délaissé, ce qui menace de déstabiliser la filière
et de faire la part belle aux importations.
- e) À ces menaces économiques
s'ajoutent des menaces psychologiques
- (1) Une filière au péril du
changement climatique
- (2) Un agriculteur présumé coupable,
c'est un agriculteur qui se désinstalle
- f) Des signes préoccupants de refus de se
lancer dans la production de pommes
- a) Une structure de charges dominée par des
coûts de main-d'oeuvre où la France perd du terrain
- 1. La pomme est historiquement une filière
d'excellence française, fortement tournée à
l'export
- B. LA SEULE MONTÉE EN GAMME NE PEUT
ÊTRE LE REMÈDE AU MANQUE DE COMPÉTITIVITÉ :
L'EXEMPLE DE LA FUITE EN AVANT DE LA FILIÈRE TOMATE, FAUTE DE MISE EN
oeUVRE D'UNE POLITIQUE DE BAISSE DES CHARGES
- 1. Une production française à
l'abandon dans un marché mondial qui explose
- 2. Une consommation de tomate en France qui
dépend, en grande partie, d'importations
- 3. Des écarts de
compétitivité majeurs expliquant cette dépendance aux
importations
- a) Avec des coûts de main-d'oeuvre
17 fois plus élevés qu'au Maroc, les producteurs de tomates
nationaux ne parviennent pas à rivaliser avec le géant
méditerranéen de la tomate
- b) Une hausse des cours des intrants fortement
pénalisante
- c) Sur les intrants, là encore des
surtranspositions pénalisent l'agriculture française
- a) Avec des coûts de main-d'oeuvre
17 fois plus élevés qu'au Maroc, les producteurs de tomates
nationaux ne parviennent pas à rivaliser avec le géant
méditerranéen de la tomate
- 4. L'histoire de la « tomate
cerise » : quand la tortue française se fait doubler par
les lièvres d'autres pays dans la course aux marchés de
niche
- 5. Quand le Gouvernement donne le coup de
grâce à la filière tomates : l'exemple des droits
à l'importation et de la filière bio
- 6. La filière dispose pourtant de
considérables atouts pour rebondir
- 1. Une production française à
l'abandon dans un marché mondial qui explose
- C. POUR EXPORTER, IL FAUT PRODUIRE ET POUR
PRODUIRE, IL FAUT DES REVENUS : EN L'ABSENCE DE POLITIQUE DE
COMPÉTITIVITÉ, CE SONT LES PRODUCTEURS LAITIERS QUI PAIENT POUR
LE MAINTIEN DE LA PUISSANCE AGRICOLE FRANÇAISE
- 1. Le « miracle laitier
français » d'un modèle familial fonctionnant sur ses
deux jambes, marché intérieur et marché extérieur
- a) Une performance économique remarquable
pour un modèle familial et diversifié
- b) Une économie de filière reposant
sur deux jambes : le marché intérieur et l'exportation
- (1) Une production majoritairement
dédiée à une consommation française de produits
laitiers particulièrement importante par rapport au reste du monde
- (2) Une performance efficace sur les
marchés internationaux, grâce aux fromages et aux produits
laitiers secs techniques
- a) Une performance économique remarquable
pour un modèle familial et diversifié
- 2. Un modèle à la renverse ? Un
géant qui n'est plus performant dans un marché porteur
- a) « On n'exporte pas ce qu'on ne
produit pas »
- b) Un décrochage de l'excédent
commercial français dû aux échanges avec le reste de
l'Union européenne en termes de compétitivité prix
- (1) Une France laitière quasi
déficitaire avec ses voisins européens
- (2) Une hausse structurelle des importations, pour
couvrir des déficits de production et pour approvisionner les industries
non laitières et la restauration hors foyer à des prix
compétitifs
- (3) Des performances à l'export vers les
pays tiers qui ne compensent pas les pertes sur le marché
européen
- (4) Un positionnement sur les marchés
internationaux remis en question ?
- a) « On n'exporte pas ce qu'on ne
produit pas »
- 3. Le vrai facteur compétitif de la
France : des revenus laitiers de plus en plus décalés par
rapport aux autres grands pays laitiers de l'Union européenne
- 4. Une tempête dans nos verres de
lait : vers le plus vaste plan social laitier des dernières
années ?
- 1. Le « miracle laitier
français » d'un modèle familial fonctionnant sur ses
deux jambes, marché intérieur et marché extérieur
- D. POULET : QUAND LA PRODUCTION
FRANÇAISE, APRÈS AVOIR PERDU SES MARQUES À L'EXPORT, NE
PARVIENT MÊME PLUS À RÉPONDRE À LA DEMANDE DE SA
PROPRE POPULATION
- 1. Comment un fleuron exportateur est devenu un
des secteurs les plus dépendants des importations en moins de vingt
ans
- 2. Du poulet importé consommé
plusieurs fois par semaine contre un bon poulet français le
dimanche : le décrochage du poulet français dans la
consommation nationale
- 3. Le recul sur le marché national n'est
imputable qu'à un manque de politique de compétitivité sur
le segment le plus consommé, le filet de poulet
- 1. Comment un fleuron exportateur est devenu un
des secteurs les plus dépendants des importations en moins de vingt
ans
- E. BLÉ : QUAND L'AMONT COURT AVEC DES
BOULETS AUX PIEDS, C'EST L'AVAL QUI TRINQUE
- 1. Dans le contexte actuel, avoir une
filière céréalière forte est un atout
géopolitique majeur
- a) La filière
céréalière française : des performances
exceptionnelles au service de la puissance agricole française
- b) Faiblesses de la France : petites
exploitations performantes sur le plan économique, efforts mal
payés des agriculteurs
- c) L'organisation de la filière est l'atout
principal de la filière exportatrice céréalière
- a) La filière
céréalière française : des performances
exceptionnelles au service de la puissance agricole française
- 2. Un monde nouveau : tensions fortes avec le
conflit russo-ukrainien, percées de nouveaux acteurs, une
priorité des pouvoirs publics qui recule
- a) L'irruption des géants ukrainiens et
russes, remise en cause par le conflit de 2022 ?
- b) Après la stagnation des rendements,
l'heure de la décroissance ?
- c) Au niveau de la production, la tendance
à la surtransposition est problématique selon les
filières
- d) Danger mortel sur les facteurs exogènes
de la compétitivité du blé français : moins
d'innovation, remise en cause des aides publiques et fragilité des
maillons stockage et logistique
- a) L'irruption des géants ukrainiens et
russes, remise en cause par le conflit de 2022 ?
- 3. Quand le grenier à blé de
l'Europe importe des biscottes et de la farine : faute de
compétitivité, la filière transformatrice en
difficulté
- 1. Dans le contexte actuel, avoir une
filière céréalière forte est un atout
géopolitique majeur
- A. QUAND LA MONTÉE EN GAMME ENGENDRE UNE
BAISSE DE PRODUCTION ET MET EN PÉRIL LA FILIÈRE
FRANÇAISE : L'HISTOIRE D'UNE POMME FRANÇAISE QUI N'A PLUS LA
BANANE
- III. RELANCER UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE
COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOTRE AGRICULTURE EST UN
IMPÉRATIF STRATÉGIQUE
- A. LA FERME FRANCE EN PÉRIL, EN L'ABSENCE
DE POLITIQUE DE COMPÉTITIVITÉ
- B. LA FRANCE PEUT ENCORE AVOIR UNE AGRICULTURE
FORTE, DURABLE ET ACCESSIBLE À TOUS, SI ELLE S'EN DONNE LES MOYENS AU
TRAVERS D'UN VASTE PLAN « COMPÉTITIVITÉ
2028 »
- 1. Axe 1 : faire de la
compétitivité de la Ferme France un objectif politique
prioritaire
- 2. Axe 2 : maîtriser les charges de
production pour regagner de la compétitivité prix
- a) Priorité 1 : faire de
l'administration un partenaire, et non un frein à la
compétitivité
- b) Priorité 2 : réduire le
coût de la main d'oeuvre en agriculture et dans l'agroalimentaire sans
réduire l'attractivité des filières et résoudre les
problèmes d'embauches du secteur
- c) Priorité 3 : utiliser davantage la
carotte que le bâton pour accélérer les transitions
environnementales
- d) Priorité 4 : ne pas saper nos
atouts en termes de compétitivité prix par excès de
zèle ou en restant inactif face à des crises
internationales
- e) Priorité 5 : faire du levier fiscal
un atout en matière de compétitivité
- a) Priorité 1 : faire de
l'administration un partenaire, et non un frein à la
compétitivité
- 3. Axe 3 : relancer la croissance de la
productivité de la Ferme France en faisant de la France un champion de
l'innovation dans le domaine environnemental
- a) Priorité 1 : faire de la France un
champion de l'innovation en matière environnementale
- b) Priorité 2 : doper l'investissement
en agriculture en faveur de la productivité et du renouvellement de
l'appareil productif
- c) Priorité 3 : lutter contre les
effets du changement climatique sur les exploitations pour limiter les pertes
en cas d'aléas
- (a) Se donner les moyens techniques de limiter les
effets des aléas climatiques
- (b) Ne pas saper la réforme de l'assurance
récolte : respecter la loi à la lettre et réformer le
système de la moyenne olympique
- a) Priorité 1 : faire de la France un
champion de l'innovation en matière environnementale
- 4. Axe 4 : conquérir les
marchés d'avenir, reconquérir les marchés perdus, doper sa
compétitivité hors prix
- 5. Axe 5 : protéger l'agriculture
française de la concurrence déloyale
- 1. Axe 1 : faire de la
compétitivité de la Ferme France un objectif politique
prioritaire
- A. LA FERME FRANCE EN PÉRIL, EN L'ABSENCE
DE POLITIQUE DE COMPÉTITIVITÉ
- I. COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME
FRANCE : LE GRAND IMPENSÉ DE LA POLITIQUE AGRICOLE MENÉE PAR
LE GOUVERNEMENT DEPUIS 2017
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
N° 905
SÉNAT
2021-2022
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2022
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires économiques (1) sur la compétitivité de la ferme France,
Par MM. Laurent DUPLOMB, Pierre LOUAULT et Serge MÉRILLOU,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault, secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Françoise Férat, Amel Gacquerre, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, M. Sebastien Pla, Mme Daphné Ract-Madoux, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot.
LISTE DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
AXE 1 : FAIRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE UN OBJECTIF POLITIQUE PRIORITAIRE
Recommandation n° 1 : nommer un haut-commissaire chargé de la compétitivité de la Ferme France afin d'assurer le pilotage et le suivi du plan « Compétitivité 2028 » et le doter d'une mission de collecte d'information sur le sujet, en le plaçant au plus près des filières réunies en conférences chaque année, ainsi qu'une mission d'alerte des pouvoirs publics sur le sujet par la publication d'un rapport triennal sur la compétitivité de la Ferme France.
AXE 2 : MAÎTRISER LES CHARGES DE PRODUCTION POUR REGAGNER DE LA COMPÉTITIVITÉ PRIX
Priorité 1 : Faire de l'administration un partenaire, et non un frein à la compétitivité
Recommandation n° 2 : Donner corps au principe « Stop aux surtranspositions » en :
- conférant une valeur législative au principe de non surtransposition, sauf motif d'intérêt général suffisant ;
- renforçant la transparence sur les surtranspositions en confiant au Conseil d'État la mission de les identifier dans ses avis sur les projets et propositions de loi et dans ses avis sur les décrets ;
- rendant obligatoire la production d'une estimation du surcoût d'une surtransposition par le Gouvernement dans un délai bref ;
- confiant au haut-commissaire à la compétitivité une mission de collecte des plaintes des organisations agricoles représentatives quant à des surtranspositions, une mission d'information du Parlement à ce sujet ainsi qu'une mission de proposition pour en limiter les effets, laquelle sera assortie, pour certaines surtranspositions, d'un pouvoir d'injonction d'y mettre fin.
Recommandation n° 3 : Garantir une application pondérée du principe « pas d'interdiction sans alternative et sans accompagnement », en l'absence de situation d'urgence, en complétant les missions de l'Anses afin qu'elle dresse, dans ses avis et retraits d'autorisation de mise sur le marché, un bilan « bénéfices-risques » d'une interdiction, notamment pour mesurer les effets de bord environnementaux d'une éventuelle interdiction à court terme d'une substance active, le cas échéant en prévoyant un laps de temps nécessaire à l'émergence d'alternatives crédibles et assortir toute nouvelle interdiction d'un accompagnement technique et financier adapté des professionnels ainsi que d'un plan prioritaire de recherche d'alternatives.
Priorité 2 : réduire le coût de la main d'oeuvre en agriculture et dans l'agroalimentaire sans réduire l'attractivité des filières et résoudre les problèmes d'embauches du secteur
Recommandation n° 4 : Réduire les coûts de main d'oeuvre par une politique de baisse des charges sociales sur les travailleurs saisonniers agricoles en pérennisant le dispositif dit « TO DE », en l'étendant à certains secteurs et en sortant les entreprises agroalimentaires saisonnières de l'application du bonus-malus sur les contrats courts.
Recommandation n° 5 : activer tous les leviers pour résoudre les problèmes d'embauche du secteur en :
- renforçant la connaissance des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
- prenant mieux en compte, dans la constitution des formations, notamment au sein de l'enseignement agricole, les besoins des industries agroalimentaires ;
- créant un partenariat entre les secteurs agricoles et agroalimentaires et Pôle emploi pour en faire un secteur prioritaire afin que Pôle emploi puisse, après leur avoir proposé des formations adaptées, davantage flécher vers ces secteurs dans les offres raisonnables d'emplois qu'il propose aux personnes à la recherche d'un poste ;
- s'assurant, en cas de réforme des conditions d'accès au revenu de solidarité active, que les secteurs agricoles et agroalimentaires soient prioritaires et deviennent ainsi éligibles pour les Français concernés, afin d'en améliorer l'employabilité dans un secteur qui cherche à recruter.
Recommandation n° 6 : mettre en place un mécanisme de suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements de mécanisation dans l'agriculture ou l'agroalimentaire en faveur de la réduction des coûts du travail dans les secteurs les plus intensifs en main d'oeuvre confrontés à des difficultés de compétitivité.
Priorité 3 : Utiliser davantage la carotte que le bâton pour accélérer les transitions environnementales
Recommandation n° 7 : lancer, sous un an, un bilan des mesures du précédent quinquennat s'agissant de la consommation d'intrants (loi Egalim, mesures fiscales comme la hausse de la redevance sur les pollutions diffuses...) afin de mettre en regard l'évolution induite des quantités d'intrants consommées et le surcoût supporté par les agriculteurs.
Priorité 4 : Ne pas saper nos atouts en termes de compétitivité prix par excès de zèle ou en restant inactif face à des crises internationales
Recommandation n° 8 : mettre en oeuvre, à court terme, un plan de résilience de l'agriculture et de l'agroalimentaire face à la crise énergétique en considérant ces secteurs comme essentiels et indispensables en temps de crise, en leur garantissant un approvisionnement suffisant pour préserver notre souveraineté alimentaire et en les rendant éligibles aux aides mises en place pour les activités prioritaires.
Priorité 5 : Faire du levier fiscal un atout en matière de compétitivité
Recommandation n° 9 : prendre, dès la loi de finances pour 2023, plusieurs mesures de baisses d'impôt en faveur de la production agricole ou agroalimentaire (absence de hausse de la TICPE sur le gazole agricole, actualisation des seuils d'exonération et d'éligibilité, baisse de la taxe foncière sur la propriété non bâtie applicable aux terres agricoles, hausse du plafond de la dotation pour épargne de précaution...).
AXE 3 : RELANCER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA FERME FRANCE EN FAISANT DE LA FRANCE UN CHAMPION DE L'INNOVATION DANS LE DOMAINE ENVIRONNEMENTAL
Priorité 1 : Faire de la France un champion de l'innovation en matière environnementale
Recommandation n° 10 : prolonger le volet « Troisième révolution agricole » du plan France 2028 en :
- augmentant les crédits des plans d'investissement portant sur l'innovation agricole dans tous les domaines ;
- portant, au niveau européen, la volonté d'autoriser en réglementant les new breeding techniques, plutôt qu'une interdiction de principe.
Recommandation n° 11 : remettre la recherche agricole davantage au service des besoins techniques des agriculteurs en :
- étudiant la possibilité d'augmenter les crédits dédiés par l'Inrae à la recherche de solutions techniques pour les agriculteurs, par une redéfinition de ses missions, ou en étudiant le transfert d'une partie de son budget aux instituts techniques ;
- préservant les budgets des instituts techniques payés par les agriculteurs au travers du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (Casdar).
Priorité 2 : doper l'investissement en agriculture en faveur de la productivité et du renouvellement de l'appareil productif
Recommandation n° 12 : lancer un plan de simplification sous un an pour mettre en oeuvre un dispositif « accélérateur » limitant le champ des procédures administratives qui ralentissent aujourd'hui trop les agrandissements ou le développement de sites de production dans des secteurs stratégiques, le cas échéant en prévoyant une modification de la loi.
Recommandation n° 13 : préserver l'investissement agricole et agroalimentaire malgré la hausse des taux en :
- mettant en place un suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire ;
- prévoyant un plan d'investissement massif piloté par l'État pour la production agricole et agroalimentaire (par exemple un grand plan « Silos ») ;
- créant un « livret Agri », livret réglementé sur le modèle du livret de développement durable et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire à des conditions raisonnables, notamment à l'heure du renouvellement des générations.
Priorité 3 : lutter contre les effets du changement climatique sur les exploitations pour limiter les pertes en cas d'aléas
Recommandation n° 14 : renforcer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique en :
- favorisant les investissements destinés à réduire les dégâts liés à ces aléas par des aides dédiées comme un suramortissement ou un crédit d'impôt (stockage d'eau, filets paragrêle...) ou en simplifiant les procédures en vigueur (aspersion par exemple) ;
- développant rapidement une ambitieuse politique de gestion de stockage de l'eau autour de projets locaux de bassins versants afin de promouvoir des projets de stockage par des aides financières dédiées tout en simplifiant le déploiement de ces ouvrages, en limitant les effets délétères des contentieux abusifs contre des projets d'ouvrages de prélèvement d'eau en confiant le contentieux en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appels.
Recommandation n° 15 : appliquer pleinement et à la lettre la loi sur l'assurance récolte, comme l'a votée le Parlement, en utilisant au maximum les possibilités laissées par la réglementation européenne et s'engager dans une réforme internationale de la moyenne olympique pour l'adapter aux conséquences du changement climatique.
AXE 4 : CONQUÉRIR LES MARCHÉS D'AVENIR, RECONQUÉRIR LES MARCHÉS PERDUS, DOPER SA COMPÉTITIVITÉ HORS PRIX
Priorité 1 : à l'extérieur, conquérir de nouvelles parts de marché
Recommandation n° 16 : entamer sous un an une révision globale de la politique d'accompagnement à l'exportation dans les domaines agricoles et agroalimentaires en France en proposant aux acteurs économiques des outils répondant réellement à leurs besoins (assurance-crédit export, aides à la promotion, accès plus aisé à la logistique...).
Recommandation n° 17 : consolider l'idée de la marque France en s'appuyant davantage sur l'image de la gastronomie française pour doper les exportations de produits français.
Priorité 2 : Sur le marché intérieur, reconquérir l'assiette des Français
Recommandation n° 18 : mettre en place une réelle transparence sur l'origine des denrées agricoles et alimentaires en :
- proposant, dans le cadre de la révision du règlement INCO, l'extension de l'affichage obligatoire de l'origine à toutes les denrées agricoles (animales et végétales) et, pour les produits alimentaires transformés, en rendant obligatoire l'affichage de l'origine des trois principaux ingrédients composant le produit ;
- harmonisant les dénominations et les définitions des produits alimentaires en Europe ;
- augmentant la fréquence et le nombre de contrôles réalisés par les autorités compétentes sur ces affichages trompeurs sur l'origine ainsi que sur la traçabilité des produits importés dans les ports d'arrivée.
Recommandation n° 19 : poursuivre et intensifier la priorité donnée aux approvisionnements en produits locaux et nationaux dans la restauration collective afin de reconquérir ce circuit de distribution largement perdu au profit des importations, par la promotion d'une évolution des règles en vigueur au niveau européen pour clairement favoriser des approvisionnements issus de produits locaux.
Recommandation n° 20 : maximiser les aides agricoles et investir dans l'innovation des productions les plus menacées par une substitution par les importations.
Priorité 3 : dire non à la décroissance agricole
Recommandation n° 21 : amender la stratégie européenne « de la Ferme à la fourchette » pour faire émerger un meilleur équilibre entre les objectifs quantitatifs en matière de production pour renforcer la souveraineté alimentaire du continent et les objectifs environnementaux.
AXE 5 : PROTÉGER L'AGRICULTURE FRANÇAISE DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Recommandation n° 22 : défendre notre compétitivité européenne en s'engageant à mieux faire respecter les normes minimales de production requises au sein de l'Union européenne en :
- poursuivant le déploiement de clauses miroirs dans les législations européennes en matière agricole, notamment dès 2023 sur les textes relatifs au bien-être animal ou aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ainsi que dans les accords de libre-échange ;
- s'engageant plus activement dans les instances internationales de normalisation (notamment Codex Alimentarius) afin de faire évoluer l'ensemble des pratiques agricoles.
Recommandation n° 23 : durcir les contrôles sur les denrées alimentaires importées pour garantir le respect des normes minimales requises au sein de l'Union européenne en agissant :
- à court terme, au niveau national pour relever le niveau d'exigences, notamment i) en augmentant les effectifs des contrôles nationaux, profitant du transfert de la compétence sanitaire de la DGCCRF à la DGAL pour constituer une vraie « police sanitaire nationale » ; ii) en renforçant le nombre de contrôles aléatoires intégrés au plan de contrôle et en durcissant le contenu des analyses, notamment en renforçant le nombre de substances actives effectivement contrôlées par les laboratoires nationaux ;
- à moyen terme, au niveau européen en promouvant la constitution d'une task force européenne sur la sécurité alimentaire pour des interventions harmonisées au niveau européen, afin d'éviter les comportements de détournement des contrôles franco-français par une entrée dans d'autres pays.
Recommandation n° 24 : mener une politique active d'actualisation des valeurs forfaitaires d'importation pour répondre aux stratégies concurrentielles des partenaires commerciaux et préserver l'efficacité des outils de protection prévus dans les accords de libre-échange.
L'ESSENTIEL
I. LA FERME FRANCE DÉCROCHE
A. LA FRANCE : UNE PUISSANCE AGRICOLE QUI DÉCLINE DE PLUS EN PLUS
À l'heure où le commerce international de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi dynamique, la France est l'un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent : elle est passée de deuxième à cinquième exportateur mondial en vingt ans. Son excédent commercial, en retrait, n'est plus tiré que par l'effet prix des exportations, surtout des vins et spiritueux, et non par les volumes. En parallèle, les importations alimentaires en France explosent : elles ont doublé depuis 2000 et représentent parfois plus de la moitié des denrées consommées en France dans certaines familles. La France, « grenier de l'Europe », est désormais déficitaire avec l'Union européenne en matière alimentaire depuis 2015. Hors vins, elle est même déficitaire avec le monde entier.
Plus inquiétant encore : le potentiel productif agricole s'érode d'année en année par une baisse du nombre d'exploitations, une chute de la surface agricole utile en cultures et un plafonnement des rendements. La productivité de l'agroalimentaire, faute d'investissements suffisants compte tenu de la guerre des prix, est également en berne. Doit-on alors craindre que la France ne soit plus qu'une « puissance agricole moyenne » ?
B. DES FERMES DE MOINS EN MOINS COMPÉTITIVES
2/3 de ses pertes de marché proviennent de sa perte de compétitivité. Mise en tension par une plus grande concurrence internationale, la France décroche notamment en raison de :
- la hausse des charges des producteurs en raison de ses coûts de main d'oeuvre, de surtranspositions trop nombreuses, d'une fiscalité trop lourde... ;
- une productivité en berne liée à des manques d'investissements, principalement dans l'agroalimentaire, et d'un effet taille d'exploitation, la Ferme France ayant choisi un modèle familial loin des pratiques de ses concurrents directs en Europe ;
- une faible défense par l'État dans les accords de libre-échange ;
- un climat politico-médiatique qui vitupère un modèle agricole pourtant le plus vertueux du monde, en critiquant par exemple la taille moyenne de nos exploitations, pourtant très inférieure à celles de nos concurrents.
II. QUAND LA MODE DE LA MONTÉE EN GAMME POUR TOUS S'AVÈRE ÊTRE UN MAUVAIS CALCUL
A. LE « TOUT MONTÉE EN GAMME » : UN CHOIX QUI VISAIT À COMPENSER LA PERTE DE COMPÉTIVITÉ
La stratégie suivie par la majorité gouvernementale, depuis le discours de Rungis du président de la République de 2018 pour lutter contre cette perte de compétitivité au long cours, s'inscrit dans la lignée des politiques agricoles françaises menées depuis la fin des années 1990 : puisque les produits français ne sont plus compétitifs, il faut qu'ils montent en gamme pour atteindre des marchés de niche plus rémunérateurs. Cela s'est traduit par une politique agricole à deux faces : d'un côté, une hausse des charges des agriculteurs, afin de contraindre aux transitions environnementales (surtranspositions, hausse de la fiscalité productive, augmentation du coût des intrants avec la loi Egalim). D'un autre côté, en contrepartie, une politique législative axée sur le rééquilibrage des relations commerciales avec la grande distribution dans le but de recentrer la production agricole sur le marché intérieur, mieux rémunéré. Rien d'étonnant, alors, à ce que le promoteur de cette politique axée sur le tout haut de gamme ait promu, en même temps, la signature d'accords de libre-échange, dès lors que, trompé par le mirage d'une nourriture française « premium » préservée dans ces accords, l'État estimait obtenir de nouveaux marchés de niche à l'exportation (CETA, négociations sur le Mercosur ou avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande...). Autrement dit : on prône une montée en gamme de l'agriculture française et de l'autre, on laisse entrer des produits « coeur de gamme » plus facilement.
|
« On connaît les résultats de la loi Egalim : nuls pour les recettes des paysans, négatifs sur leurs charges. Depuis 2017, la politique agricole française a le même bilan. » |
B. UNE POLITIQUE QUI, GÉNÉRALISÉE À L'ENSEMBLE DE L'AGRICULTURE, CONDUIT À UNE IMPASSE
Quelques années plus tard, que constate-t-on ? L'agriculture française poursuit la lente érosion de son potentiel productif. Si la montée en gamme n'est pas une mauvaise solution pour certaines filières organisées ou certains produits ciblés, prise dans son ensemble et sans être accompagnée d'une politique de compétitivité, elle aboutit à mettre la France agricole dans une impasse. Trois exemples le démontrent.
1 - L'absence de politique de compétitivité affaiblit le revenu des agriculteurs et mite la filière laitière : c'est « l'effet emmental »
Faute de politique de compétitivité, le monde agricole, désirant maintenir ses parts de marché, se résigne à payer le différentiel de prix en diminuant le revenu des agriculteurs, fragilisant ainsi toute une filière. C'est l'effet « emmental », que subit la filière lait. Si la laiterie française est forte à l'export, elle ne le doit qu'à la faiblesse des revenus de ses éleveurs. Faisant peu appel à de la main d'oeuvre salariée pour limiter leurs charges, les exploitants agricoles travaillent plus de 60 heures par semaine sans s'octroyer un salaire suffisant. La France fait de la baisse des revenus de ses agriculteurs la source de sa compétitivité quand l'Allemagne le fait par des gains de productivité. Cette situation rogne petit à petit la résilience d'une filière d'ores et déjà confrontée à une décapitalisation de son cheptel ainsi qu'à une baisse du nombre de nouveaux installés.
2- Quand l'Etat veut se concentrer sur son marché intérieur par la montée en gamme et ouvre finalement ses portes aux importations : le renversant effet « tarte tatin »
Pour contrer cet effet « emmental » de baisse du revenu, les producteurs français peuvent être tentés de monter en gamme en se recentrant sur le marché intérieur, plus rémunérateur, quitte à réduire les exportations. En favorisant cela, l'État raisonne à l'envers. En réalité, par un renversement de situation, l'effet tarte tatin, applicable à la farine et à la pomme démontre qu'avec une telle stratégie les exportations baissent, mais les importations explosent, les produits étrangers plus compétitifs conquérant le « coeur de gamme » de la consommation.
3 - Vers une agriculture française qui se focalise sur le « repas du dimanche », en passe de devenir inaccessible à de nombreux Français pour les repas du quotidien ?
D'effet « emmental » en effet « tarte tartin », les producteurs sont enfin menacés de connaître l'effet « repas du dimanche », que connaissent les filières tomate et poulet, les produits français étant servis en de plus en plus rares occasions, laissant la place aux produits importés pour les repas du quotidien, en restauration hors foyer ou dans les plats transformés des familles les plus modestes.
Le poulet ne parvient plus à répondre à la demande française de filets de poulet à la coupe. Les importations ont quadruplé en 20 ans. En même temps, la consommation de poulet labellisé plafonne. Tout se passe comme si les Français consommaient un bon poulet du dimanche par mois, labellisé et produit en France, tout en acceptant de manger tous les jours du filet de poulet importé, issu d'élevages plus compétitifs.
Les producteurs de tomates se spécialisent dans des niches où la concurrence vient progressivement...les dénicher. Après avoir connu une division de la production de sauce tomate par quatre entre 1997 et 2007 (85 % d'importations en 2021), la filière tomate a voulu échapper à la concurrence marocaine en se spécialisant dans la production de tomates cerise, abandonnant ainsi le marché coeur de gamme aux tomates importées (qui ont aujourd'hui 30 % de parts de marché). Sauf que les importations de tomates cerise marocaines sont passées de 300 tonnes en 1995 à 70 000 tonnes. Les producteurs ont trouvé une nouvelle segmentation sur les tomates « anciennes », plus chères pour le consommateur, quitte à voir la production française se réduire par une baisse des rendements.
C. LA FRANCE AU RISQUE D'UNE CRISE DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET D'UNE CRISE DE POUVOIR D'ACHAT
Cette politique du « tout montée en gamme » fait naître deux risques majeurs :
- une déconnexion totale de l'agriculture française avec les attentes du consommateur français, touchée par une crise du pouvoir d'achat qui s'aggrave de jour en jour en raison de l'inflation alimentaire ces derniers mois. Or qui dit montée en gamme, dit hausse des prix des denrées françaises, pour que l'agriculteur voit ses surcoûts compensés a minima. Est-il dès lors tenable de proposer d'accélérer cette montée en gamme ? Le risque majeur serait de réserver la consommation de produits français à ceux qui peuvent se le permettre, tout en condamnant les plus modestes à ne s'alimenter qu'avec des produits importés. La situation de surproduction connue depuis deux ans par les producteurs bio le démontre : les consommateurs n'ont pas un pouvoir d'achat illimité, entraînant de nombreuses déconversions des producteurs faute de débouchés pourtant promis par l'État.
- une crise majeure en matière de souveraineté alimentaire, à l'heure où la guerre russo-ukrainienne rappelle toute l'importance géostratégique de l'arme agricole. La tendance à la réduction du potentiel productif agricole est préoccupante. Renommer le ministère de l'Agriculture est une chose : corriger le tir en est une autre.
III. METTRE LE PAQUET POUR RETROUVER LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE D'ICI 2028
Sans contester l'intérêt de stratégies de montée en gamme ciblées, la commission considère que la priorité doit aller à un « choc de compétitivité » pour remonter la pente.
AVANT-PROPOS : QUEL BILAN AGRICOLE
POUR LA
MAJORITÉ GOUVERNEMENTALE DEPUIS 2017 ?
Observant avec inquiétude les pertes de parts de marché de l'agriculture française dans le monde tout en constatant l'explosion des importations alimentaires en France, le Sénat a, sans doute, été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur l'état de notre agriculture en 2019 en publiant un rapport sous forme de question : « La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? »1(*).
Les constatations étaient fortement préoccupantes. Stagnation de la production, réduction du nombre d'agriculteurs et de la surface agricole utile, perte de parts de marché à l'export, augmentation forte des importations, érosion du solde commercial jusqu'à devenir déficitaire avec l'Union européenne... : entre 2000 et 2017, tous les indicateurs de la Ferme France sont passés au rouge. Le rapport appelait à une prise de conscience suivie d'un sursaut, pour enfin enrayer cette spirale infernale. Le Gouvernement en prit acte.
Trois années après, la commission des affaires économiques a souhaité se prêter de nouveau à l'exercice dans le but de dresser le bilan des politiques agricoles menées depuis la publication de ce signal d'alarme. Ont-elles réussi à remettre la France agricole sur les bons rails ?
La conclusion au sortir de la lecture de ce rapport ne souffre d'aucune nuance : la tendance à l'effritement de la place de la Ferme France dans le monde se poursuit et jamais les importations alimentaires n'ont pris une place aussi importante dans l'assiette des Français.
Mais que s'est donc-il passé depuis 2017 pour que rien ne change ?
Le Gouvernement, sous la précédente législature, a sans conteste agi.
Il a, certes, mené de front plusieurs combats essentiels, comme celui de la réforme de l'assurance récolte, qui a été considérablement enrichie par les débats parlementaires.
Il s'est évertué à adopter plusieurs lois « Egalim » dans le but d'améliorer le ruissellement de la valeur de la grande distribution vers les fermes, épuisant son énergie à construire un édifice législatif et réglementaire d'une remarquable complexité pour lutter contre des pratiques commerciales qui relèvent du champ de la « morale commerciale » : à peine une loi était-elle votée que les contournements étaient déjà en place. Ce fut le point de départ d'un cercle vicieux : à ces stratégies d'évitement répondait une nouvelle loi, elle-même contournée par de nouvelles pratiques qu'il convenait d'encadrer par un nouveau texte. À chaque fois, des effets indésirés apparaissaient et, à chaque fois, ce sont les agriculteurs qui ont trinqué. Et le train est toujours en marche : à l'heure de l'écriture de ce rapport, la loi « Egalim 3 » est déjà dans tous les esprits, moins d'un an après l'adoption de la loi « Egalim 2 ».
Il s'est également considérablement battu à réparer ses propres erreurs lors des négociations européennes portant sur la politique agricole commune, obtenant à l'arraché, et uniquement grâce au plan de relance lié à l'épidémie de Covid-19, un maintien du budget agricole européen qu'il avait souhaité en baisse pour valoriser de nouvelles politiques au lancement des négociations. Au passage, il a sans doute consenti à un démantèlement progressif de ce formidable outil européen par l'émergence de vingt-sept politiques agricoles nationales, et en consacrant une architecture incapable de supporter une politique agricole d'ensemble. Il a également signé, en feignant de l'ignorer, la stratégie « de la Ferme à la fourchette », qui, en l'état, constitue la plus grande feuille de route décroissante jamais signée par aucun ministre chargé de l'agriculture en France.
La majorité gouvernementale s'est donc sans conteste beaucoup agitée au service de notre agriculture, mais pour faire du « sur place ». Les rapporteurs ont acquis l'intime conviction que, plutôt que de corriger le tir, la majorité gouvernementale entre 2017 et 2022 n'a pas ralenti le déclin de notre agriculture.
Car pendant ce temps, sur le plan géostratégique des performances de l'agriculture sur le marché intérieur et extérieur, la Ferme France continuait à reculer.
Bien sûr, les tensions sur les marchés alimentaires dues à la Covid-19 et, plus récemment, liées à l'invasion russe de l'Ukraine, ont permis de voir au grand jour ces faiblesses propres à notre pays. À l'initiative du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de l'époque, la souveraineté alimentaire était, enfin, replacée au coeur des politiques publiques agricoles. Plusieurs plans de relance, inspirés bien souvent de propositions sénatoriales, ont tenté, efficacement, de corriger le tir en allant plutôt dans le bon sens. Mais, face aux défis à venir du renouvellement des générations et de la revalorisation stratégique de l'arme agricole dans l'arsenal géopolitique mondial, ils seront sans aucun doute insuffisants. Ces efforts auront toutefois permis une prise de conscience.
Mais le ver était dans le fruit depuis 2018 et le discours de Rungis du Président de la République, lorsque, récemment élu, il fit répéter en choeur aux filières agricoles présentes le credo qui serait celui de la majorité gouvernementale pour les années à venir : « le tout montée en gamme ».
L'agriculture française ne devait pas avoir peur de perdre des parts de marché pour se recentrer sur une stratégie de montée en gamme. Autrement dit : l'agriculture ne devait pas avoir peur de perdre des marchés sur la scène mondiale pour se recentrer sur un marché intérieur plus rémunérateur.
Cela s'est traduit par une politique « d'anti-compétitivité » justifiant des hausses de charges pour les agriculteurs2(*) qui, pour certaines, ont pu être évitées de justesse grâce à une fronde parlementaire3(*).
L'obsession du Gouvernement a été de travailler sur les recettes agricoles, principalement celles issues des ventes sur le marché intérieur. C'était oublier qu'un revenu est constitué de recettes diverses, venant parfois, et pour une part proche de 30 %, des exportations mais aussi surtout des charges. Et la politique agricole menée ces dernières années a clairement tout misé sur une très hypothétique hausse de certaines recettes agricoles, au détriment de certaines et, surtout, sans prendre garde à des mécanismes qui ont abouti à une augmentation certaine et irréfutable des charges d'exploitation.
Pour quels résultats ? C'est tout l'objet du rapport que de mesurer les conséquences d'une telle orientation, plus ou moins assumée par les ministres en place.
Mais certains éléments, publiés dans des rapports d'organismes gouvernementaux ou indépendants, apportent des réponses claires :
- la France continue de perdre des parts de marché à l'export et voit, dans toutes les filières, les importations venir concurrencer ses propres produits sans que les Français n'en soient clairement informés ;
- cette tendance est due, avant tout, à un décrochage en termes de compétitivité de la Ferme France par rapport à ses concurrents, ce déficit expliquant à lui seul près de 70 % de la dégradation du solde commercial4(*) ;
- dans certaines filières ayant souscrit à cette démarche de montée en gamme, on constate une chute de la production française, posant des difficultés en matière de souveraineté alimentaire, notamment sur les marchés « coeur de gamme », les plus consommés par les Français.
S'appuyant sur plusieurs documents produits ces derniers mois dressant les mêmes constatations, dont il est fait la synthèse en première partie, les rapporteurs ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice par un angle de vue sénatorial d'enquête de terrain, investiguant auprès de tous les acteurs d'une filière pour donner des exemples concrets des difficultés posées par cette stratégie de la montée en gamme.
Ils ont ainsi, pendant plusieurs mois, analysé les évolutions de marché constatées sur cinq produits phares de la consommation des Français : la pomme, la tomate, le poulet, le lait de vache et le blé.
Ils ont eu l'occasion d'échanger avec plus de 180 professionnels agricoles et agroalimentaires, du fournisseur le plus en amont de la chaîne de production au dernier échelon de transformation et aux grossistes et exportateurs.
Au terme de ces rencontres, enrichies de trois déplacements sur le terrain, auprès des acteurs locaux, dont un en Italie pour s'inspirer des réussites de leur modèle exportateur, ils en ressortent une conviction : si rien n'est fait, le « tout montée en gamme » aboutira à une réduction du potentiel productif de l'agriculture française, au détriment de notre souveraineté alimentaire, ainsi qu'à une inégalité flagrante d'accès à l'alimentation en France, la montée en gamme réservant mécaniquement les denrées françaises à ceux qui peuvent se le permettre, reléguant les plus modestes à ne consommer que des produits importés dont nous ne maîtrisons pas les normes de production.
Or la France a besoin d'une agriculture forte pour relever les défis climatiques. Nous avons besoin d'une agriculture avec de solides appuis économiques, capables d'investir et d'innover pour faire évoluer les pratiques. C'est cet objectif qui nous permettra de sauvegarder les conditions d'existence d'une agriculture demain, dès lors qu'elle est confrontée à l'immense défi du changement climatique.
C'est pourquoi en matière de politique agricole, l'État a fait fausse route ces dernières années. Car l'agriculture française doit toutefois être souveraine et fournir, comme c'est sa mission, une alimentation durable accessible à tous.
Il faut d'emblée apporter une nuance à ce propos : le message porté dans le rapport n'est pas de contester l'intérêt de stratégies de montée en gamme ciblées.
Des filières sont performantes en la matière et parviennent, grâce à la segmentation, à aller chercher de la valeur. De même, les producteurs bio se sont engagés dans une évolution de leur modèle et de leurs pratiques. À cet égard, il est nécessaire qu'une pluralité de pratiques agricoles existe en France car cette diversité est une chance pour l'avenir, source d'enrichissements mutuels entre les filières et, partant, d'améliorations continues.
Le rapport ne condamne donc aucune filière, aucun type d'agriculture, aucun agriculteur.
Il remet uniquement en cause la stratégie politique suivie par l'État qui, par souci de simplification, a fait du « tout montée en gamme » la doctrine agricole pour notre pays, sans jamais parler de compétitivité. Sans tenir compte des difficultés de pouvoir d'achat de nos compatriotes, l'État est en passe de créer une déconnexion entre les Français et l'agriculture française.
Car de ce cap fixé par l'État aux filières, il résulte des pertes de parts de marché voire, pour des producteurs, notamment bio, des difficultés majeures d'écoulement à l'heure où les consommateurs prennent davantage garde à leurs dépenses.
Pour les rapporteurs, avec ou sans montée en gamme, dans le monde que nous connaissons, une politique de compétitivité en agriculture est un impératif. Elle est indispensable pour garder des parts de marché sur le « coeur de gamme ». Elle est nécessaire pour accompagner les producteurs dans leur éventuelle stratégie de montée en gamme par de la segmentation.
La conclusion de ce rapport est claire : le Gouvernement doit infléchir la tendance et assortir sa politique agricole d'un grand volet « compétitivité ». Puisque, sans politique de compétitivité, les tendances à l'oeuvre se poursuivront.
C'est pourquoi les rapporteurs dessinent, en conclusion de ce rapport, ce que pourrait être un « plan Compétitivité 2028 » applicable à la Ferme France. Sa mise en oeuvre relève d'une urgence nationale.
LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE
I. COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE : LE GRAND IMPENSÉ DE LA POLITIQUE AGRICOLE MENÉE PAR LE GOUVERNEMENT DEPUIS 2017
A. DEPUIS 2017, UNE POLITIQUE TOURNÉE UNIQUEMENT VERS LA « MONTÉE EN GAMME » DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE, À LA CHARGE DES AGRICULTEURS
La parole de l'État compte dans nos campagnes. Pouvait-il en être autrement dans un pays centralisé doté de considérables atouts agricoles ? Les deux « mamelles de la France » de Sully ont finalement toujours été surveillées de près par l'État centralisateur né sous Richelieu puis, plus encore, sous Louis XIV. Quand l'État fixe un cap, alternant les incitations financières et les obligations nouvelles par l'édiction de normes ou de taxes, il joue, aux côtés des producteurs, un rôle majeur dans l'orientation de nos politiques agricoles.
Il est, dès lors, co-constructeur, avec les producteurs français, des plus grandes réussites de notre Ferme France. À l'inverse, quand l'agriculture va mal, il est souvent difficile d'en exonérer totalement la responsabilité de l'État.
L'intuition de ce rapport est que l'État, en matière agricole ces dernières années, a fait fausse route. Bien sûr, l'équation était complexe. Mais les résultats sont là : l'agriculture française perd de son éclat depuis de nombreuses années.
Malgré des forces encore incontestables, notre Ferme France est confrontée, aujourd'hui, à une tendance déclinante qui n'interpelle à ce stade que les experts et les acteurs des filières, tant son écho ne parvient pas à percer le mur du son médiatique fait d'anathèmes envers un monde agricole aux abois.
Mais ces chiffres sont connus de tous : plusieurs rapports, ces dernières années, ont tiré la sonnette d'alarme, que cela soit au Sénat5(*), à la Cour des comptes6(*), à la direction générale du Trésor7(*) et, même, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire8(*).
Force est de constater que depuis 2017, la politique agricole française a changé de stratégie. Cela se retrouve dans les faits : derrière un discours de façade, laissant le soin aux filières de s'organiser, l'État a, en pratique, revêtu sa casquette de capitaine de la Ferme France pour davantage piloter et administrer les campagnes. Davantage de lois, davantage de normes, davantage de taxes, davantage de stratégies : le quotidien du ministère chargé de l'agriculture n'a pas été de tout repos.
Se cache derrière cette politique « tous azimuts » un seul et même mantra, capable de guérir tous nos maux : la « montée en gamme ». Érigée en politique centrale au début du quinquennat, la stratégie a été légèrement infléchie, par le poids de l'actualité, depuis 2020. Mais elle demeure encore et toujours présente dans toutes les décisions. Autrement dit, la remontada ne pourrait avoir lieu qu'à une condition : que la Ferme France monte en gamme. Qu'elle monte « encore » en gamme devrait-on dire, puisqu'il convient de continuellement rappeler que le modèle français est déjà jugé comme le plus durable du monde9(*).
Cette stratégie de « tout montée en gamme » trouve son acte fondateur dans le discours de Rungis du Président de la République, prononcé le 11 octobre 2017 devant les États généraux de l'alimentation, dans lequel il avait affirmé : « régler le problème du porc, du boeuf, du lait, ce n'est pas aller demander l'énième plan de crise le jour où ça continuera à aller mal, c'est vous organiser dans les filières et sur le territoire pour changer les modèles productifs. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous devons regarder et accompagner les marchés export qui donneront des débouchés, [...].Continuer à accompagner la montée en qualité, la montée du bio. [...] Ça veut dire arrêter des productions, qu'il s'agisse de la volaille ou du porc, qui ne correspondent plus à nos goûts, à nos besoins et qui font que nous allons lancer la concurrence sur des marchés internationaux face à des pays contre lesquels nous ne pouvons rien et nous ne pourrons rien. Ni face aux Brésiliens ni face aux Russes ou quelques autres sur des produits de mauvaise qualité ou de qualité moyenne, nous n'arriverons raisonnablement dans la durée à accompagner nos producteurs et vous le savez bien et nous le savons bien. Nous ne leur donnerons des perspectives que si nous montons en qualité, que si nous les accompagnons. Certains l'ont déjà fait et beaucoup sur le territoire et je salue leurs efforts mais regardons en face chacun de nos défis. Chacun.10(*) ».
Cette « nouvelle France agricole » appelée des voeux du président de la République aboutissait à promouvoir une montée en gamme des productions, au risque de perdre des marchés, afin de mieux adresser le marché de la consommation française, à la condition que les prix y soient plus rémunérateurs, ce que la loi Egalim était censée permettre.
L'ensemble des outils étaient orientés vers un seul et unique objectif : une agriculture plus premium, fondée sur des circuits courts.
En témoigne l'éternel marronnier de la loi Egalim11(*), déjà modifiée à trois reprises en l'espace de quatre ans, indicateur qui donne peu d'espoir quant à ses chances de succès. Elle visait à garantir des prix plus rémunérateurs aux agriculteurs dans leurs relations contractuelles avec leurs clients en vue de la distribution de produits alimentaires en grandes et moyennes surfaces par le biais d'une contractualisation rénovée et d'une cascade de marges, depuis le distributeur, aidé en cela par le relèvement du seuil de revente à perte, jusqu'à la cour de ferme. Le sujet est bien entendu essentiel et stratégique, tant les dérives constatées auprès d'une poignée de centrales d'achats, françaises ou européennes, sont majeures et impactent négativement les revenus de milliers de producteurs agricoles. Mais les résultats sont malheureusement connus : ils sont, dans une acception pourtant optimiste, inexistants à ce stade. Le bilan devient négatif dès lors que l'on rappelle que cette loi a considérablement augmenté les charges des agriculteurs. La loi a donc promis un revenu très hypothétique aux agriculteurs en échange d'une hausse certaine de charges.
Le remède proposé par la loi Egalim pourrait, au reste, être pire que le mal car, en n'axant la politique agricole que sur ce circuit de distribution à destination du consommateur français en grandes et moyennes surfaces, consacré comme nouvel eldorado économique pour les producteurs en quête d'une amélioration de leur revenu, le Gouvernement en a oublié qu'une grande partie des débouchés agricoles sont ailleurs : sur les marchés internationaux, dans la restauration hors foyer, dans certaines industries non alimentaires12(*)...
En parallèle de cet échec programmé, dénoncé en tant que tel par le Sénat dès le départ, le Gouvernement s'est lancé, au début du quinquennat précédent, dans une politique de hausse des charges et de contraintes pour faire évoluer plus rapidement les pratiques et contraindre à la montée en gamme. C'est le sens des réformes comme l'interdiction des remises, rabais et ristournes et de la séparation de la vente et du conseil sur les produits phytopharmaceutiques. C'est également le sens de la hausse historique du montant de la redevance pour pollutions diffuses. C'était l'objectif, avant son report dû à la crise des gilets jaunes, de la réduction progressive du taux réduit applicable au gazole non routier pour les agriculteurs.
Enfin, la majorité gouvernementale a proposé de réserver une partie des approvisionnements de la restauration collective publique à quelques produits distingués par des signes de qualité, à hauteur d'un objectif de 50 % inatteignable pour l'ensemble des acteurs interrogés sans une quelconque aide de l'État. La montée en gamme devait être valorisée à tout prix par les pouvoirs publics pour sauver l'agriculture d'une concurrence effrénée sur le coeur de gamme que les producteurs français ne pourraient plus affronter.
Une augmentation tangible de charges et de contraintes contre une hypothétique hausse des revenus : telle a été la politique de la carotte et du bâton du Gouvernement lors du quinquennat 2017-2022.
La politique agricole a, néanmoins, considérablement été infléchie lors de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 et, plus récemment, à la suite de la guerre en Ukraine, mais jamais en remettant en cause ces premières dispositions. Rattrapé par la réalité, le Gouvernement n'a toutefois pas totalement fait machine arrière.
Tous les outils étaient et sont toujours tournés vers un seul et même objectif : garantir la montée en gamme de la Ferme France. Les rapporteurs estiment aujourd'hui que si le cap n'est plus clairement affiché, il demeure le même.
Loin de l'idée des rapporteurs de nier l'intérêt de promouvoir, au cas par cas, une telle évolution sur certains marchés, d'autant plus si elles peuvent garantir un revenu supplémentaire pour nos producteurs agricoles.
Mais faire de la montée en gamme le principal moteur de la politique agricole sans un raisonnement adapté par filière, par culture, par territoire, par marché, c'est méconnaître les réalités économiques agricoles de notre pays.
Pis encore : c'est une erreur stratégique qui envoie l'agriculture française dans le mur.
Pour reprendre les mots d'un professionnel entendu, « nous nous sommes réjouis de ce discours de Rungis et des perspectives de la montée en gamme. Mais les réjouissances furent courtes. »
B. CETTE VISION EST À CONTRE-COURANT D'UN MARCHÉ INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE QUI N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI DYNAMIQUE ET SUR LEQUEL L'UNION EUROPÉENNE DISPOSE D'UNE POSITION DE LEADER INCONTESTÉE
Car cette politique gouvernementale repose, en réalité, sur plusieurs idées simples mais fausses.
La première d'entre elles est la suivante : la France ne peut rivaliser avec d'autres pays du monde ayant un coût de main d'oeuvre plus bas et doit donc se spécialiser uniquement sur des productions haut de gamme vendues par le biais de circuits courts, payées à leur juste prix par des consommateurs français réputés avoir un pouvoir d'achat suffisant pour se le permettre.
L'annonce de ces temps nouveaux, qui a traversé les discours politiques de tous bords ces dernières années, a connu son acmé en mars 2020 au moment de la crise de la Covid-19, lorsque la consommation par circuit court était contrainte et forcée en raison de la fermeture des frontières.
Néanmoins, loin du cliché véhiculé à la suite de ces confinements à répétition, la France semble être la seule au monde à prendre ce virage du repli sur soi. Quand on regarde les chiffres macroéconomiques, en effet, le « tout local » n'est pas pour tout de suite : au contraire, le commerce mondial de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi élevé qu'en 2019 et 2020, crise comprise : il a atteint en valeur près de 1 100 milliards d'euros courants13(*).
Attention : cela ne signifie pas que des dynamiques particulières de marché, animées par un mouvement de fond voulu par le « consomm'acteur », n'agissent en faveur d'une relocalisation de l'alimentation par des circuits plus courts et territorialisés. Cette réorganisation plus locale de l'alimentation est à construire avec les collectivités territoriales, les agriculteurs et industries agroalimentaires et les citoyens, autour, notamment, de projets alimentaires territoriaux porteurs. En France, sur certains segments, dans certaines zones, pour certains produits, cette tendance ne peut être ignorée et pourrait être structurante. C'est pourquoi elle doit être accompagnée.
Néanmoins, en dépit de cette évolution très importante, il est anachronique d'appeler à l'apparition d'un modèle « 100 % local » dans la mesure où jamais le commerce international en matière agroalimentaire ne s'est aussi bien porté et n'a autant compté dans les décisions des acteurs économiques agricoles.
Un autre chiffre le démontre : la croissance du marché international agroalimentaire est très forte puisqu'il a presque triplé en valeur depuis 2000.
Commerce mondial de produits agroalimentaires (en milliards d'euros courants en 2020)
Source : Vincent Chatellier, Inrae.
La grande majorité de ce commerce agroalimentaire se fait sur les produits végétaux, bien que les débats en Europe se concentrent généralement sur les difficultés de la filière élevage face à ses concurrents.
Ces débats récurrents effacent, au reste, une autre réalité incontestable qui ne semble, pourtant, pas intuitive au regard de la teneur des débats généraux sur l'agriculture : l'Union européenne dispose, en matière agroalimentaire, d'un atout géostratégique majeur en étant le premier exportateur (17 % de parts de marché) et le second importateur mondial (13 % de parts de marché).
Et cet avantage s'accroît ces dernières années, l'Union européenne ayant connu une dynamique très forte de ses exportations ainsi qu'un tassement des importations en provenance de pays tiers. Il en résulte un excédent commercial annuel de près de 46 milliards d'euros en 2020, soit le second excédent le plus élevé au monde derrière le Brésil, alors qu'il était pourtant quasi nul entre 2000 et 2009.
Elle tire cet excédent :
i. de ses exportations dynamiques à destination de plusieurs clients historiques (Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Suisse, Japon), malgré des pertes de marché induites avec des clients importants comme la Russie depuis 2014.
ii. de ses positions bien assises sur certaines filières comme celle de la viande porcine (48 % des exportations mondiales), des boissons (41 %), des produits laitiers (38 %), de l'horticulture (33 %), des oeufs (31 %) et des produits animaux (27 %), qui dépassent ses fragilités rencontrées dans les secteurs de l'huile de palme et des oléagineux, de la viande ovine, des fruits et du poisson. Il est à noter que l'Union européenne dispose, à cet égard, de positions solidement établies en productions animales pour lesquelles elle dégage 47,5 milliards d'euros d'excédent toutes filières animales confondues.
L'Union européenne accuse en revanche un solde commercial négatif principalement avec le Brésil, l'Argentine, l'Indonésie et l'Ukraine, principaux fournisseurs de certains produits où l'Union européenne recourt massivement à des importations. À cet égard, la moitié des importations européennes chaque année sont constituées de fruits et légumes, d'oléoprotéagineux et de poissons.
Surtout, le mirage du « tout local » se heurte à une réalité démographique claire : la demande mondiale agroalimentaire ne va cesser d'augmenter ces prochaines années, par un effet « démographie » mais également par l'accession à la classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes, qui induit une modification des comportements alimentaires individuels.
Au total, la FAO estime que la consommation alimentaire mondiale de calories augmentera de 50 % entre 2006 et 2050, au moment même où le potentiel productif mondial est impacté à la baisse par les conséquences du changement climatique.
Évolution de la consommation mondiale de calories animales et végétales (selon la FAO)
Source : Haut-commissariat au Plan,
« L'agriculture :
enjeu de reconquête »,
juillet 2021.
Dans ce contexte géostratégique, où l'arme alimentaire va devenir majeure, l'Union européenne a clairement une carte à jouer en conservant voire accroissant ses avantages. On est là loin de l'idée fausse selon laquelle l'agriculture européenne serait condamnée face à des agricultures concurrentes à bas coût de main d'oeuvre, sans doute car la main d'oeuvre n'est pas le seul agrégat à analyser.
C. CETTE POLITIQUE ACCROÎT UNE TENDANCE QUASI-UNIQUE EN EUROPE : LA FERME FRANCE PERD DES PARTS DE MARCHÉ À L'EXPORTATION ET VOIT LES IMPORTATIONS CONQUÉRIR L'ASSIETTE DES FRANÇAIS
Si tous les feux semblent au vert au niveau de l'Union européenne sur la scène mondiale, la situation est radicalement différente en France, ce qui ne manque pas de surprendre, tant la France a incarné, des années durant, le « grenier » de l'Europe.
Il serait bien entendu trompeur de prétendre que la France agricole n'est plus un acteur qui compte.
La France, avec une production agricole estimée à 81,6 milliards d'euros en 202114(*), demeure en effet le principal producteur européen avec près de 17 % de la production totale du continent, loin devant l'Allemagne ou l'Italie.
Les classements parlent d'eux-mêmes : premier producteur européen de céréales, de viande bovine, de lin, de graines oléagineuses, de légumes en conserve, d'oeufs, de semences agricoles ; le second producteur européen de sucre de betterave, de lait ; et le troisième producteur européen de volailles et de porc. Il est le premier exportateur mondial de vins et spiritueux, de semences agricoles, de pommes de terre et occupe les places du haut du classement pour les céréales, l'orge de brasserie, les eaux minérales naturelles, le lait...
S'y ajoute une production agroalimentaire issue d'un secteur industriel très performant, représentant la première industrie en France en nombre d'emplois et en chiffres d'affaires, ce dernier représentant près de 212 milliards d'euros15(*).
Sur les marchés internationaux, là encore, la France est un acteur qui compte, étant le 5e exportateur agricole mondial et 3e exportateur et importateur européen. Cela se retrouve notamment dans le solde commercial français, puisque l'agriculture et l'agroalimentaire font partie des très rares secteurs à dégager un excédent important de 8 milliards d'euros, le troisième par ordre d'importance derrière le secteur aéronautique et spatial et la chimie. Les producteurs français disposent de positions solidement établies, dans les domaines laitier, céréalier et dans les boissons (vins et spiritueux) où ils font office de géants mondiaux.
Rang mondial parmi les exportateurs et parts de marché à l'export (tous produits agricoles et agroalimentaires)
Source : FranceAgriMer.
Toutefois, ce qui inquiète, ce n'est pas tant que la France ne soit plus une puissance agricole ; c'est qu'elle le soit de moins en moins, et qu'elle soit engagée dans une pente déclinante brutale dont on n'entrevoit pas la fin.
Ce déclin, qui ne date pas de 2017 mais qui n'a pas été résorbé pour autant depuis cette date, se mesure, par exemple, en regardant plusieurs indicateurs productifs, comme l'a démontré le rapport sénatorial de Mmes Sophie Primas, Amel Gacquerre et M. Franck Montaugé16(*), qui fait état d'un tassement de la production agricole française en volume depuis 1997 en raison :
i. du recul tendanciel de la surface agricole utile ;
ii. de la réduction du nombre d'agriculteurs en activité, phénomène qui devrait s'accélérer avec le mur du renouvellement des générations ;
iii. du plafonnement général des rendements.
Ce déclin se mesure également en analysant les évolutions récentes de la balance commerciale française en matière agricole.
À cet égard, l'effritement des positions françaises sur les marchés internationaux est récent et progressif, ce qui le rend peu visible par la société alors que les agriculteurs le vivent tous les jours.
Récent tout d'abord car, sur longue période, il est essentiel de garder à l'esprit que l'enjeu au sortir de la Seconde guerre mondiale en France était de nourrir la population, en ayant y compris recours à des produits importés. C'est seulement à partir de la seconde moitié de la décennie 1970 que la France n'a plus enregistré aucun déficit de ses échanges internationaux de produits agricoles et alimentaires, ce qui est le fruit d'un travail extraordinaire mené par toute la profession agricole.
Comme le rappelle Chambres d'agriculture France, « la mise en oeuvre de la Politique agricole commune (PAC), assortie du savoir-faire des agriculteurs, ont fait accéder la France au rang de grande puissance agro-exportatrice, alors que le début des années soixante s'est longtemps distingué par une accumulation de déficits commerciaux17(*). »
Très progressif ensuite car certains éléments demeurent, en affichage, positifs. Outre un solde commercial toujours largement excédentaire, il faut mentionner la croissance continue des exportations et des importations, qui traduit bien l'investissement toujours fort de l'agriculture française sur les marchés internationaux.
En matière agricole et agroalimentaire, la France exporte près de 70 milliards d'euros courants en 2021, soit 1,8 fois plus qu'en 2000, pour moitié environ vers les pays tiers et pour moitié vers l'Union européenne. Cela en fait le 5e ou 6e exportateur mondial selon les années. Ses principaux clients sont la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Chine et les Pays-Bas.
Elle importe près de 63 milliards d'euros de denrées alimentaires, soit 2,2 fois plus qu'en 2000, principalement d'Espagne, des pays du Benelux (où se trouvent les grands ports européens réorientant des marchandises de pays tiers au sein de l'Union européenne) et d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-Uni (et des pays du Commonwealth), de Pologne, de Suisse et du Maroc.
Toutefois, depuis 2010, elle a connu une inversion brutale de tendance.
La France, qui était encore deuxième exportateur mondial dans les années quatre-vingt-dix est devenu le quatrième en 2010, avant de passer au sixième rang depuis 2015, successivement supplantée par les Pays-Bas, l'Allemagne, et plus récemment par la Chine et le Brésil. Ses parts de marché ont fondu de 11 % en 1990 à moins de 5 % en 2021.
Les exportations ont, dans les faits, connu un relatif tassement, leur croissance n'étant plus tirée que par les flux vers les pays tiers.
En même temps, la France a considérablement accru sa dépendance aux importations agricoles et agroalimentaires, principalement vis-à-vis de fournisseurs européens18(*).
Évolution des échanges de la France
en produits agricoles
et agroalimentaires
Source : FranceAgriMer.
Dans le détail, la dynamique baissière concernant les exportations dans le secteur agroalimentaire, éventuellement hors boissons, provient, selon les personnes entendues par la mission, de plusieurs effets conjugués :
i. de « l'effet ciseau » que la France connaît avec ses partenaires européens, consistant en une perte de son statut de fournisseur pour devenir client. Chambres d'agriculture France estime qu'à « l'exception des bovins vivants, l'ensemble des secteurs perd des parts de marché sur l'UE, avec des replis parfois conséquents en blé et farine, en sucre et même en vins, jusque-là considérés comme des bastions du secteur agroalimentaire français ». Ainsi, par exemple dans ses relations avec l'Allemagne, la France disposait encore en 1990 d'un excédent agroalimentaire qui s'élevait à + 3,1 milliards d'euros. Il n'était plus que + 1,7 milliard en 2000 avant de disparaître en 2017 (+ 0,1 Md€) ;
ii. du déséquilibre, au sein des exportations françaises, entre une forte présence sur des marchés géographiques peu dynamiques (notamment les pays d'Europe occidentale, les États-Unis et le Japon) et des parts de marché limitées sur des marchés dynamiques, dont le poids relatif s'est renforcé ;
iii. des performances mitigées même pour des produits segmentés ayant un positionnement haut de gamme. La direction générale du Trésor rappelle ainsi que « même pour les produits pour lesquels le solde commercial a progressé (notamment les produits du terroir et les produits transformés vers les pays tiers), la part de marché se replie nettement. En effet, l'augmentation des exportations de ces produits masque une demande mondiale encore plus dynamique, que la France ne capte qu'en partie ».
Du côté des importations, il faut se faire l'écho des difficultés des acteurs français à répondre à la demande nationale dans un contexte de concurrence accrue de tous les pays, soit qu'ils connaissent des coûts de production réduits soit qu'il s'agisse de pays avancés comme l'Allemagne et les Pays-Bas, principalement sur des viandes et produits à base de viande. Cela se traduit par une croissance mécanique des importations agricoles et agroalimentaires dans tous les secteurs, principalement depuis l'Union européenne.
Différence du niveau d'importation entre
2021 et 2000
pour les principaux pays fournisseurs (en
M€)
Source : Direction générale de la
performance économique
du ministère de l'Agriculture et de la
Souveraineté alimentaire.
Il en résulte un taux d'auto-approvisionnement inquiétant sur certains produits et une tendance croissante sur toutes les filières à une consommation plus grande de denrées importées sur des segments de masse.
Un poids des importations alimentaires
qu'il
ne faut plus ignorer
Rien qu'en retenant les chiffres de l'élevage, la situation est préoccupante :
- 56 % de la viande ovine consommée en France est d'origine importée, en provenance des pays anglo-saxons ;
- 22 % de la consommation française en viande bovine est couverte par les importations, notamment pour les approvisionnements des préparations de viandes et des conserves ;
- 45 % de notre consommation de poulet en 2019 est importée, contre 25 % en 2000, en raison de la hausse des importations de volailles d'Europe de l'Est, en lien avec la croissance de la consommation hors domicile dont l'approvisionnement repose sur l'importation de découpes de volaille ;
- 26 % de notre consommation de porc, notamment de jambons, provient majoritairement d'Espagne ou d'Allemagne, principalement comme matière première destinée à l'industrie de transformation ;
- 30 % de notre consommation de produits laitiers provient de l'Union européenne, à la fois en achats de fromages et, plus encore, en matières grasses laitières (beurres et autres matières grasses solides), à destination de l'industrie agroalimentaire et de la restauration hors domicile ;
- entre 70 et 80 % de nos besoins de miel sont importés selon les données de FranceAgriMer, les trois principaux fournisseurs de la France étant l'Ukraine, l'Espagne et la Chine.
Le phénomène concerne également les cultures végétales :
- 28 % de notre consommation de légumes et 71 % de notre consommation de fruits est importée ;
- près de 63 % des protéines que nous consommons sont issues d'oléagineux importés à destination des élevages.
Source : Rapport d'information n° 620 (2020-2021) de MM. Laurent Duplomb, Hervé Gillé, Daniel Gremillet, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Frédéric Marchand et Mme Kristina Pluchet, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques, déposé le 19 mai 2021 - groupe de travail « Alimentation durable et locale ».
Le solde commercial a considérablement chuté ces dernières années, puisqu'il est passé de près de 12 milliards d'euros en 2011 à 8 milliards d'euros en 2021. Entre 2004 et 2021, le solde commercial agricole et agroalimentaire a connu d'abord une période de croissance culminant à 11,9 Mds€ en 2011-2012 avant de chuter à 5,5 Mds€ en 2017. S'ensuivent deux années plus encourageantes puis une rechute en 2020 dans un contexte très particulier (Covid) et une nette remontée en 2021 (8 Mds€).
Certes, ces statistiques peuvent apparaître peu alarmantes. Mais les rapporteurs entendent rappeler deux points essentiels :
1) Hors boissons, la France accuse un déficit commercial en matière agricole et agroalimentaire.
FranceAgriMer a également analysé l'évolution de ce solde par type de produits en corrigeant certains effets de l'inflation. Dès lors, avec cet agrégat dit « déflaté », la France est déficitaire sur les produits transformés hors vins depuis 2006. Elle est même devenue déficitaire pour les produits bruts depuis 2015.
Évolution du solde commercial agricole et
agroalimentaire français
depuis 2004 (en millions d'euros
déflatés)
Source : FranceAgriMer.
2) Les évolutions positives de l'excédent commercial ces dernières années ne s'expliquent que par une hausse des prix sur les marchés internationaux plus rapide que les baisses des volumes exportés.
Décomposition de l'évolution du
solde commercial agroalimentaire
de la France selon l'effet prix et l'effet
volume
Source : Agreste, Synthèses conjoncturelles
n° 386,
Commerce extérieur agroalimentaire,
mars 2022.
D. TOUTES LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES MENÉES SUR LE SUJET CES DERNIÈRES ANNÉES DÉMONTRENT QUE LE FACTEUR PRINCIPAL DE DÉSTABILISATION DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE EST SA PERTE DE COMPÉTITIVITÉ
1. Plusieurs études sont formelles : ce qui explique le déclin de la Ferme France, c'est son déficit de compétitivité
Dans ce monde où le commerce international agroalimentaire n'a jamais été aussi important, il est essentiel d'être compétitif, tant pour conquérir des parts de marché à l'exportation que pour résister à l'afflux de denrées importées exerçant une concurrence potentiellement déloyale sur nos productions.
C'est pourtant exactement là où la France pèche. Car la cause principale de son déclin est clairement identifiée : la perte de compétitivité de la Ferme France explique plus des 2/3 des pertes de parts de marché ces dernières années19(*).
Si les dynamiques propres des produits agricoles français peuvent compter, tout comme le positionnement de la France sur des secteurs géographiques, notamment car la France oriente ses exportations sur des marchés historiques relativement moins dynamiques que certains marchés émergents qu'elle a du mal à adresser, c'est bien le facteur « compétitivité » qui explique l'essentiel des difficultés de la Ferme France sur les marchés internationaux.
La direction générale du Trésor20(*) estime, par exemple, que « ce recul résulte surtout d'un déficit de compétitivité, qui expliquerait plus de 70 % de la réduction du solde, et dans une moindre mesure d'un positionnement moins favorable sur les marchés porteurs. » Avec ses partenaires européens, 85 % de la perte de parts de marché pourrait être imputée au seul manque de compétitivité.
L'Inrae, dans d'autres travaux, confirme cette analyse en estimant que la perte de compétitivité pure est le premier facteur explicatif de la baisse de parts de marché de la France sur les marchés des pays européens et tiers, loin devant la spécialisation produit ou géographique21(*) (cf. graphique ci-dessous).
Source : FranceAgriMer, auditions.
Ainsi, Chambres d'agriculture France rappelle que « si l'Allemagne et la Pologne ont pu conquérir des parts de marché sur les pays de l'Est au détriment de la France, c'est en raison d'une compétitivité-prix mieux orientée. La compétitivité sur les pays tiers apparaît tout autant vulnérable, du fait de la pression concurrentielle exercée par des concurrents souvent agressifs. »
2. Les obstacles à la compétitivité de la Ferme France : des charges plus élevées sur de nombreux postes ; une productivité des facteurs en berne ; un positionnement prix parfois hors du marché
Il importe dès lors d'identifier les racines de cette perte de compétitivité, ce que plusieurs rapports ont tenté de faire en s'appuyant sur une littérature économique relativement vaste22(*).
D'un côté, les charges productives en France sont relativement plus élevées que celles relevées dans les principaux pays concurrents.
Au premier rang des préoccupations figure, bien souvent, le coût du travail.
La France dispose, en effet, d'un coût horaire apparent dans la fourchette haute de l'Union européenne, ce qui est un facteur handicapant dans la compétition internationale.
Source : FranceAgriMer.
Toutefois, les difficultés posées sont différentes selon les filières et les maillons :
i. Dans de nombreuses filières, le recours à la main d'oeuvre salariée est plus faible qu'en Europe, le travail des exploitants étant en quelque sorte une variable d'ajustement pour maintenir un certain niveau de compétitivité. FranceAgriMer rappelle, à juste titre, que « les niveaux de salaire sont plus élevés mais l'importance de l'emploi familial non salarié fait que, toutes productions confondues, ce poste de coût est moins élevé que chez nos concurrents européens (hors Pologne). » Dès lors, le problème du coût du travail se pose surtout dans les secteurs où le recours à la main-d'oeuvre salariée est plus intensif, comme les fruits et légumes et les vins d'entrée de gamme, ce différentiel de coût du travail devenant dès lors majeur ;
ii. Le problème est néanmoins plus prégnant dans l'industrie agroalimentaire où le « coût du travail est plus élevé et a augmenté plus vite que chez ses principaux concurrents européens depuis les années 2000. » En effet, le coût horaire français dans les industries agroalimentaires s'est accru de 58 % entre 2000 et 2017 contre une hausse de 34 % en Allemagne23(*).
Bien sûr, ce seul facteur coût du travail n'explique pas tout. Comme le rappelle la Cour des comptes, dans un référé du 5 mars 2019, « d'autres pays, comme les Pays-Bas ou la Belgique, ont gagné ou préservé des parts de marché en Europe et dans le monde avec un coût horaire du travail égal ou supérieur à celui de la France. La structure du tissu industriel français n'est pas si différente de celle de nos principaux compétiteurs, notamment de ceux qui gagnent des parts de marché au détriment de la France comme l'Espagne, l'Italie ou la Belgique.24(*) »
Dès lors, d'autres « facteurs de coût » doivent être mentionnés pour ne pas passer à côté du problème. La revue de plusieurs études menées sur ce sujet distingue plusieurs éléments défavorables à la compétitivité « prix » de la Ferme France, outre le coût du travail :
- le degré d'exigence des politiques environnementales, qui, tous secteurs confondus, était supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE en 2012, la France étant, parmi les pays européens, sans doute l'un de ceux où ces exigences ont le plus augmenté selon FranceAgriMer25(*) ;
- un coût des consommations intermédiaires (engrais et produits phytosanitaires) plus élevé et plus largement un accès aux moyens de production défavorable par rapport aux concurrents étrangers26(*) ;
- une taille des exploitations (surface et cheptels) en moyenne plus petite que celle des concurrents, ce qui réduit les économies d'échelle ;
- une fiscalité de production plus élevée, sur la base d'études anciennes datant d'avant 2017 ;
- des frais de mécanisation et, partant, des frais d'entretien des matériels et bâtiments relativement élevés ;
- des coûts de production d'autres secteurs abrités de la concurrence internationale comme les services aux entreprises (juridiques et comptables par exemple), lesquels participeraient de la moindre compétitivité française, selon FranceAgriMer.
La France dispose toutefois d'atouts de taille en
matière de compétitivité prix qu'il convient de ne pas
oublier : le coût de
l'énergie, historiquement du moins,
les conditions pédologiques et climatiques de son terroir ainsi que sa
grande diversité, le savoir-faire de ses agriculteurs et des
filières organisées ainsi que, sur le poste de charges, le prix
de son foncier.
Les agriculteurs français bénéficient, par rapport à leurs concurrents européens directs, d'un avantage très net sur le prix des terres. « Dans le bilan moyen d'une exploitation agricole française tel qu'il apparaît dans le RICA, un hectare en propriété est évalué au prix de 4 508 € contre 17 879 € en Allemagne ou 11 721 € au Royaume-Uni » rappelle Chambres d'agriculture France.
Toutefois, ces atouts ne sont pas suffisants pour compenser les handicaps susmentionnés.
D'un autre côté, ces charges relativement plus élevées ne sont pas, ou plus, compensées par une évolution plus rapide de la productivité globale des facteurs de production, dans les exploitations et les industries agroalimentaires en France.
La productivité totale des facteurs a, certes, continué très lentement à progresser dans le secteur agricole mais moins vite que les concurrents. Elle a surtout légèrement régressé dans l'agroalimentaire depuis 20 ans (- 0,4 % par an entre 1995 et 2015).
FranceAgriMer rappelle que la France n'est pas au sommet du classement s'agissant du niveau de formation des salariés puisque l'organisme Eurostat la place au 6e rang de l'UE27 pour l'enseignement supérieur et seulement au 16e rang pour l'enseignement technique.
Parmi les éléments mis en avant pour expliquer cette baisse de la productivité totale des facteurs dans l'agroalimentaire ressortent, selon FranceAgriMer, « une mauvaise allocation des facteurs de production (rigidité du marché du travail et des biens ou du droit des entreprises), la faiblesse de l'investissement dans la modernisation des outils de production par rapport aux concurrents (même si le taux d'investissement dans les IAA est supérieur ces dernières années à l'ensemble du secteur manufacturier) ou encore la faiblesse de la taille d'une majorité d'entreprises. »
S'agissant de la faiblesse de l'investissement au sein de l'industrie agroalimentaire, tous les acteurs entendus par la mission en imputent la cause à l'effondrement des marges lié à une spirale déflationniste des prix des contrats avec la grande distribution. À l'inverse, le taux d'investissement a augmenté chez nos principaux concurrents, notamment allemands et néerlandais, ce qui se traduira par une croissance des écarts de compétitivité dans les années à venir.
Il convient de rappeler que la détérioration des conditions de la concurrence, bien trop exacerbée en France, fragilise toute la chaîne de valeur et partant l'ensemble de la production alimentaire française, contrairement à l'Allemagne où des partenariats de long terme mieux construits et plus structurés sont plus bénéfiques pour l'économie agricole.
C'est pourquoi Chambres d'agriculture France estime que « la dégradation de la compétitivité des filières agroalimentaires provient davantage d'une défaillance de l'aval industriel et non de l'amont agricole ».
Surtout, en sus d'une compétitivité prix contestée, ces conditions dégradées d'exercice du métier d'industriel agroalimentaire en France expliquent, sans doute, que les groupes agroalimentaires français aient davantage délocalisé leur production que leurs concurrents de l'Union européenne (52 % de leur activité à l'étranger pour les plus grosses firmes selon la Cour des comptes27(*)). « Par exemple, dans le secteur laitier, les industriels français transforment 23,8 Md de litres de lait en France et plus de 20 Md hors de France, tandis que les industriels allemands en transforment 30,3 Md en Allemagne et moins de 5 Md hors du pays ». Mécaniquement, ces délocalisations réduisent les statistiques exportatrices de la France et alimentent, en parallèle, les flux d'importations.
S'agissant de la compétitivité hors prix, la France dispose d'atouts clairs, mais se fait déborder par d'autres pays plus performants.
Sont à mentionner des atouts très clairs, notamment la traçabilité, la qualité et la sécurité sanitaire de ses produits.
Sa capacité à gagner ou maintenir des parts de marché en jouant sur d'autres leviers que le prix est par ailleurs clairement établie, la France jouant sur la différenciation qualitative, l'image de ses produits et sur les signes de qualité et de l'origine pour segmenter le marché et sortir du lot. La littérature économique reconnaît ainsi l'intérêt des SIQO afin de justifier de prix plus élevés à l'export. FranceAgriMer estime en outre qu'un fromage AOP est exporté en moyenne 11,5 % plus cher qu'un fromage sans appellation. La différenciation par l'origine et la qualité est un atout qualitatif vers les pays européens et ceux qui disposent d'un système de reconnaissance. Pour autant, cette stratégie n'est pas une garantie et a pour conséquence de bloquer, généralement, les volumes exportés.
Toutefois, il faut casser l'idée que la France n'aurait qu'à compenser son déficit de compétitivité prix par une compétitivité hors prix accrue, c'est-à-dire exactement la doctrine sous-jacente au credo de la montée en gamme. À l'inverse, d'autres pays européens sont davantage compétitifs sur le plan des prix et bénéficient, en outre, d'une compétitivité hors prix supérieure à l'image française, ce qui est le cas de l'Allemagne ou de l'Italie.
En ne retenant que l'exemple italien, l'image de la gastronomie italienne permet, partout dans le monde, d'écouler des produits italiens spécifiques, directement liés aux recettes italiennes : mozzarella, burrata, parmesan, tomates italiennes... La gastronomie française ne bénéficie pas d'un tel effet.
FranceAgriMer rappelle ainsi que « l'importance de la marque et du marketing, du packaging, de l'adaptation aux préférences et goûts différents des pays de destination sont des facteurs souvent sous-estimés » en France.
Les freins à la promotion des produits français souvent mentionnés dans les études et lors des rencontres des rapporteurs avec les professionnels sont souvent les mêmes :
- Des difficultés d'un point de vue logistique, notamment sur les segments ferroviaires, fluviaux et pour les ports maritimes ainsi que les problèmes liés au manque de chauffeurs routiers ;
- Les surcoûts élevés de la segmentation, principalement en matière de collecte ou de stockage ;
- Le manque de soutien public à l'export, qu'il
s'agisse de l'assurance-crédit, des faiblesses de la promotion
collective et des
difficultés à lever les barrières
sanitaires et phytosanitaires (SPS).
Enfin, les personnes entendues spécialisées à l'export ont fait état d'une préoccupation forte : à force de trop jouer la compétitivité hors prix, la France en retire un positionnement prix « hors marché » pouvant induire des baisses de volumes vendus importantes.
Cette intuition semble confirmer par la littérature. FranceAgrimMr rappelle que « le lien entre qualité et origine n'est pas toujours lisible pour les consommateurs étrangers. Par ailleurs, une orientation trop exclusive sur le haut de gamme peut fragiliser les entreprises françaises sur les autres gammes (induisant un recours accru aux importations). » Il en résulte que, globalement, « la France dispose d'un bon capital image mais souffre d'un rapport qualité/prix jugé défavorable. »
En conclusion, les études réalisées sur le thème aboutissent à trois idées fortes.
Premièrement, le « tout haut de gamme » n'est pas une solution globale satisfaisante pour résoudre les problèmes de l'agriculture. En cela, le discours de Rungis était une voie trompeuse qu'il faut définitivement ne plus suivre. Si la montée en gamme est adéquate pour mieux segmenter et conquérir certains marchés de niches, elle ne doit pas se substituer à une stratégie générale de production permettant de couvrir une gamme large en volume de produits agricoles.
Si pour certains produits, le positionnement sur les SIQO est, en effet, un vrai atout sur le marché domestique et à l'international, permettant soit de gagner des parts de marché, soit de vendre des produits à un prix plus élevé, FranceAgriMer rappelle que « cela ne peut pas être généralisé. Les groupes de travail confirment que certains consommateurs étrangers n'y sont pas sensibles, et certains marchés internationaux sont de fait des marchés de commodités pour lesquels les standards de qualité (propriétés technologiques, certains prérequis sanitaires) sont définis internationalement. »
Par conséquent, « la montée en gamme laisse souvent le champ libre aux importations pour les petits prix », sur lesquels les produits français ne sont pas positionnés.
Cela crée des difficultés pour garantir l'accès à une nourriture à bas prix locale, produite en France, pour tous les Français. Poussé à l'extrême, ce modèle aboutit à un système dual, réservant l'alimentation issue de l'agriculture française aux consommateurs les plus aisés, et condamnant les ménages les plus modestes à n'acheter que des produits importés plus accessibles.
Et qui dit marché haut de gamme ne dit pas forcément eldorado économique. FranceAgriMer rappelle à cet égard que « les segments de marché les plus dynamiques ne sont pas toujours ceux à plus forte valeur ajoutée », ce que l'on voit par exemple sur le marché du vin, où le prosecco italien ou les vins espagnols connaissent des dynamiques importantes sur des vins dits « plaisir ».
Deuxièmement, on ne peut faire de la compétitivité hors prix la solution miracle aux difficultés de compétitivité prix. Au contraire, pour réussir sa segmentation et performer au regard de la compétitivité hors prix, il faut conserver un prix compétitif. C'est en alliant les deux politiques que l'on crée de la valeur.
Le tableau ci-dessous démontre, à l'inverse, que la politique axée sur la compétitivité hors prix des pouvoirs publics français s'est accompagnée d'une dégradation générale de la production agricole nationale, largement accélérée par une érosion de la compétitivité prix.
Source : Chambres d'agriculture France.
Troisièmement, un affaiblissement sur les marchés extérieurs n'aboutit pas forcément à une reprise en main sur le marché intérieur. Au contraire, il faut être fort sur le marché domestique pour être compétitif à l'extérieur, ce premier permettant un effet levier.
Cette interdépendance entre marchés extérieurs et marché domestique explique, sans doute, les performances déclinantes à l'exportation de la Ferme France ces dernières années. FranceAgriMer le dit autrement : « en dehors de quelques secteurs, les perspectives de développement sur le marché national sont limitées, dans la mesure où les marchés sont matures voire en décroissance. La pression déflationniste comme le renchérissement de certains coûts ne favorisent pas cette capacité à dégager, sur le marché intérieur, les ressources permettant d'être agressif sur les marchés étrangers plus dynamiques, notamment les marchés de commodités ».
Enfin, les personnes entendues par les rapporteurs ont toutes estimé qu'elles étaient insuffisamment soutenues par l'État dans leur politique de compétitivité. Cela se traduit par une absence de politique cohérente, claire et pertinente de soutien à l'export pour conquérir des marchés. Ce manque de soutien se retrouve également dans la défense du modèle agricole français dans les arènes internationales, l'agriculture française faisant souvent l'objet de variable d'ajustement dans les négociations de traités de libre-échange. L'absence de politiques de contrôles des produits agricoles et alimentaires aux frontières pour réellement lutter contre la concurrence déloyale est une autre facette de ce quasi-abandon.
E. UN IMPÉRATIF ESSENTIEL EN CES TEMPS DE CRISE : PROPOSER DES PRODUITS FRANÇAIS À TOUS, ET NON LES RÉSERVER À QUELQUES-UNS
L'erreur de la politique de montée en gamme pour toutes les filières, abandonnant par là même toute attention publique relative aux charges des agriculteurs, a, sans doute, mis en péril l'équilibre économique des filières agricoles françaises.
Mais elle est surtout devenue, depuis 2020, totalement contradictoire avec d'autres préoccupations majeures que sont la souveraineté alimentaire et le pouvoir d'achat des consommateurs. Le discours de Rungis28(*) a, finalement, été rattrapé par l'actualité.
Par la crise du pouvoir d'achat, tout d'abord. La hausse de l'inflation, sans doute durable compte tenu du contexte géopolitique et des impacts structurels du changement climatique sur les marchés agricoles mondiaux, a rappelé aux pouvoirs publics, qui l'avaient oublié malgré les mises en garde répétées de nombreux acteurs de la société civile et du Parlement, que les Français les plus modestes éprouvent de plus en plus de difficultés à s'alimenter en qualité française, comme en quantité et en diversité.
Le problème ne date pas d'aujourd'hui.
Depuis le début des années 2000, la hausse du poids des importations dans la consommation des Français était un premier indice. Cette tendance est le reflet net d'une attention forte sur le critère du prix, à l'heure où les pouvoirs publics ont pressé l'agriculture française d'occuper les segments plus haut de gamme. Les écarts de prix au rayon fruits et légumes, dans le rayon charcuterie, dans les rayons de denrées transformées deviennent tels qu'ils justifient une consommation de produits venus d'ailleurs.
La période du confinement aurait également
dû servir de leçon. Comme le révèlent plusieurs
études de panélistes, loin des idées d'une prise de
conscience des consommateurs en faveur d'un approvisionnement plus local, ce
sont les produits sous marques de distributeur qui ont connu une croissance en
valeur durant toute la période de confinement :
+ 1,9 point alors que les autres produits, issus de grands groupes ou
de PME, ont tous reculé, principalement les grandes marques29(*). De même, les enseignes
de hard discount, qui fondent leur différenciation sur le prix, ont
connu entre 2020 et 2021 une croissance de leur chiffre d'affaires
largement supérieure à celle d'autres acteurs de la distribution.
Enfin, le panier des consommateurs s'est recentré sur davantage de
produits de base, de
fond de placard ou de produits surgelés qui ont
des prix moyens inférieurs à ceux des produits frais ou des
produits transformés.
Compte tenu de ces éléments, et comme l'explicite très bien FranceAgriMer dans le rapport précité de 2021, « ces effets possibles d'un changement de gamme ou de circuit sur le prix de produits alimentaires interrogent sur la capacité des consommateurs à traduire dans les actes et faire perdurer dans le temps leur volonté d'aller vers une consommation plus qualitative, surtout en situation de crise économique qui doit être considérée comme un frein potentiel au renforcement des tendances à une consommation vertueuse, si présente dans les déclarations des Français au lendemain du confinement. »
Autrement dit : la stratégie du président de la République de la montée en gamme nous expose à une bipartition de la consommation française, entre ceux qui pourront se payer des produits français, et les Français les plus modestes, attentifs aux prix, relégués à ne consommer que des produits majoritairement importés.
Ces alertes n'ont pas été suffisamment prises en compte et ont abouti, récemment, à ce qu'il convient d'appeler la première crise de la montée en gamme qui a eu des répercussions fortes dans les cours de ferme ces derniers mois : il s'agit des difficultés d'écoulement de la filière biologique.
Depuis le milieu des années 2010, le Gouvernement a fait de la promotion de l'agriculture biologique un ressort important de la politique agricole. Le soutien aux agriculteurs se convertissant à ce mode de production a été largement approuvé par tous les bancs politiques et doit être maintenu dans la mesure où les producteurs faisant ce choix subissent une perte de rendement dès la première année de la période de conversion, et doivent attendre en moyenne trois ans pour obtenir leur label, synonyme en général d'une meilleure valorisation des produits.
Toute la difficulté est que ce soutien des pouvoirs publics à la filière bio a conduit nombre d'agriculteurs dans le mur : récemment convertis, ils constatent que, depuis 2020, le marché s'est retourné et que la croissance de la consommation de produits bio a considérablement ralenti en France. Le chiffre d'affaires du secteur a même baissé en 2021 avec une consommation en grande surface en recul de 3 %. Les raisons de ce tassement sont évidentes : crise du pouvoir d'achat, valorisation d'autres démarches pour certains produits, mise en avant du critère du « local »...
Sauf que ce ralentissement brutal a lieu au moment même où nombre de conversions deviennent définitives. Il en résulte un croisement des courbes de l'offre et de la demande aboutissant à des situations de surproduction dans de nombreuses filières comme les oeufs, le lait, le porc.
On estime que près de 30 % du lait bio produit en 2021 a été déclassé et mélangé avec du lait conventionnel. Les chiffres sont aussi inquiétants pour les oeufs ou d'autres filières comme la pomme.
Le résultat est terrible pour le producteur investi dans l'agriculture biologique : il se retrouve rémunéré au prix du conventionnel, sans le rendement qui va avec et avec les charges de l'agriculture biologique. Les industriels préfèrent déclasser le produit, qui de toute manière ne se valorise pas. Les agriculteurs assument seuls cette charge supplémentaire, ce qui entraînera, dans les mois à venir, un taux de déconversion élevé.
Une fois la crise passée, on pourrait alors avoir atteint, selon plusieurs personnes entendues, un « plateau du bio ».
Quand l'État se mêle de faire une politique d'offre en promouvant la montée en gamme à tout va sans prendre en compte l'évolution de la demande dictée, principalement, par le critère du prix, nous en arrivons à ces difficultés pour les producteurs agricoles.
Combien d'alarmes faudra-t-il encore sonner avant que cette stratégie soit infléchie et accompagnée enfin d'une vraie politique de compétitivité, attentive aux charges des agriculteurs pour maintenir des revenus aux producteurs et, en même temps, garantir une alimentation française accessible à tous ?
D'autant que la stratégie issue du discours de Rungis est clairement remise en cause par une autre crise, celle de la souveraineté alimentaire.
À l'heure de la plus grave crise géopolitique connue en Europe au XXIe siècle, les pouvoirs européens semblent avoir repris conscience que l'arme alimentaire sera demain absolument décisive.
Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la question environnementale, qui est aussi une question de souveraineté, il importe de réduire nos dépendances et de s'assurer qu'à terme, l'agriculture française demeure accessible à tous tout en étant durable. Tel est le défi de la prochaine génération. Car manger plus local, donc français, compte tenu des normes de production applicables en France, c'est réduire l'empreinte environnementale de notre alimentation. À cet égard, retenir une montée en gamme, quitte, pour reprendre le discours du Président de la République, à arrêter certaines productions pour lesquelles nous ne serions plus compétitifs face à des concurrents étrangers, est une erreur stratégique.
Pour illustrer ce constat inquiétant et cette nécessité impérieuse de changer de cap, le Sénat est, comme souvent et c'est sa force, parti du terrain et d'exemples concrets. À travers l'étude de cas de cinq produits parmi les plus consommés par les Français, les rapporteurs ont pu mesurer l'effet de l'absence de politique de compétitivité ces dernières années en matière agricole.
Ces cinq analyses circonstanciées convergent : si l'on ne prête pas rapidement une attention particulière aux charges et à nos performances en matière de compétitivité prix et hors prix, la Ferme France sera condamnée à reculer.
C'est pourquoi la stratégie de la montée en gamme doit aujourd'hui être largement amendée. Elle ne peut, seule, être le moteur de la politique agricole de demain. Elle doit être accompagnée vivement par la mise en oeuvre d'une vraie politique de compétitivité agricole, seule à même de permettre à l'agriculture française de relever à la fois le défi de la souveraineté et de répondre aux enjeux de pouvoir d'achat des Français, tout en facilitant l'évolution des pratiques pour mieux faire face au changement climatique. Puissent ces cinq exemples trouvés sur nos territoires en convaincre le lecteur.
II. L'ÉTUDE DE CINQ CAS CONCRETS DÉMONTRE QUE L'AGRICULTURE FRANÇAISE EST DEVENUE MOINS PRODUCTIVE, MOINS ACCESSIBLE ET MOINS COMPÉTITIVE
A. QUAND LA MONTÉE EN GAMME ENGENDRE UNE BAISSE DE PRODUCTION ET MET EN PÉRIL LA FILIÈRE FRANÇAISE : L'HISTOIRE D'UNE POMME FRANÇAISE QUI N'A PLUS LA BANANE
1. La pomme est historiquement une filière d'excellence française, fortement tournée à l'export
La France est, historiquement, l'un des principaux fournisseurs de pommes dans le monde.
La pomme française fait en effet partie de ces aliments reconnus comme un des produits phares du pavillon français aux yeux du consommateur mondial, sans doute grâce à plusieurs atouts :
· Un climat favorable, avec un risque de gel limité, soumis à de moindres variations de température que chez les concurrents ;
· Une production diversifiée située dans différents grands départements de production, limitant ainsi certains risques sanitaires et climatiques géographiquement ciblés : Tarn et Garonne, Vaucluse, Maine et Loire, Bouches-du-Rhône et Lot-et-Garonne ;
· Un profil variétal équilibré, permettant d'offrir des pommes à tous les budgets. La pomme française est majoritairement de la Golden ou de la Gala, bien que certaines variétés ou démarches aient des parts de marché significatives, à l'instar de la Pink Lady ou de la Granny Smith. FranceAgriMer estime ainsi que la France a opté pour un positionnement équilibré, en esssayant de se distinguer par une part de marchés importante de la pomme dite « haut de gamme » par le biais des démarches « club » (adhésion du producteur à la marque pour produire la variété en respectant un cahier des charges30(*)) mais également de différents SIQO, très valorisés par le consommateur (AOP Pomme du Limousin, IGP Pomme de Savoie, IGP Pomme des Alpes de Haute-Durance, Pomme Label rouge) ;
· Une expérience forte en matière de production et de logistique qui rassure des clients historiques ainsi qu'un portefeuille de clients très important (105 pays clients).
Le modèle français repose sur un étrange paradoxe : en dépit des invitations de la marionnette des « Guignols de l'info » du président Chirac à « manger des pommes », les Français ont en réalité une faible consommation de pommes : ils en consomment 12,6 kg par an, ce qui est relativement limité par rapport à d'autres pays (16 kg en Allemagne, 22 kg en Italie, 35 kg en Chine, 38 kg en Turquie).
Dès lors, les producteurs ont trouvé dans le marché à l'export des débouchés essentiels pour leur équilibre économique : plus de 30 % de la production en moyenne est ainsi livrée, chaque année, partout dans le monde.
Le marché mondial de la pomme intéresse donc particulièrement les producteurs de pommes français.
Volumes de production de pommes en 2020 (en tonnes)
Source : FranceAgriMer.
La production mondiale de pommes a été de 89,5 millions de tonnes en 2020. Le marché est principalement dominé par la Chine, premier producteur, qui représente 49 % de la production mondiale et dispose d'une production très orientée vers son marché intérieur et faiblement vers l'export.
Les autres producteurs sont loin derrière avec environ 5 % de parts de marché (États-Unis, 2e). La Turquie (4,8 % de parts de marché avec un verger peu dense et faiblement productif mais une surface importante) et la Pologne (4 %) complètent le podium, en fonction de leur récolte.
La Pologne et l'Italie sont les principaux producteurs européens avec 3,5 millions de tonnes pour la Pologne (3e producteur mondial) et 2,4 millions de tonnes pour l'Italie (5e producteur mondial), loin devant la France (10e producteur mondial) et l'Allemagne (1 million de tonnes).
À noter que l'Inde, l'Iran et la Russie sont respectivement les 6e, 7e et 8e plus gros producteurs mondiaux en raison de vergers très étendus. Toutefois, en raison de faibles rendements, leur production est essentiellement tournée vers le marché domestique tout en étant insuffisante, entraînant des besoins à l'importation pour l'Inde et la Russie. L'Iran, de son côté, exporte uniquement vers ses voisins proches.
La France, en étant le 10e producteur mondial et 3e producteur européen, est donc un acteur important mais non dominant sur le marché mondial de la pomme.
Elle a produit, en 2021, 1,5 million de tonnes de pommes, répartie entre 1,3 million de tonnes pour la pomme de table (dite pomme à couteau) et 200 000 tonnes pour la pomme destinée à la transformation spécifique en cidre.
Près de 1 700 producteurs sont engagés dans la filière, occupant près de 37 000 hectares de surface agricole utilisée. La France se distingue également par une part de production issue de l'agriculture biologique élevée puisqu'elle représente près de 20 % des surfaces (21 % en Allemagne, 14 % en Italie, 6 % en Pologne, 5 % en Turquie).
2. Trois ruptures majeures témoignant d'une crise de compétitivité sur les marchés internationaux
a) Rupture n° 1 : la production française a quasiment été divisée par deux depuis 1990
La production française de pommes a chuté entre 40 et 50 % depuis le début des années 1990.
Pour les producteurs entendus par la mission, les raisons sont clairement identifiées : « stagnation du verger et de la consommation, perte de compétitivité à l'export et rendements en baisse pour des raisons essentiellement réglementaires31(*) ».
Production de pommes de table en France (en milliers de tonnes)
Source : Agreste.
La France est effectivement confrontée à un double phénomène pénalisant la production de pommes en France : un recul des facteurs de production conjugué à une baisse du rendement à l'hectare.
Depuis dix ans, chaque jour, la France perd 1,26 hectare de vergers dédiés à la production de pomme. La surface en production, qui était de 37 300 hectares en 2021, a été divisée par deux depuis 1992 et a reculé en France de 11 % depuis 2011, en dépit d'une relative stabilité depuis 2017.
En parallèle, alors qu'il est relativement bas par rapport à d'autres pays du monde, le rendement à l'hectare français recule depuis des années : alors que l'Italie ou le Chili ont atteint des rendements supérieurs à 40 tonnes à l'hectare, la France est passée de 42 tonnes à l'hectare en 2010 à 35 tonnes à l'hectare aujourd'hui.
b) Rupture n° 2 : des exportations en chute libre dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel
Cette évolution est radicalement opposée à la tendance à l'oeuvre parmi les principaux pays concurrents, où, à l'inverse, la croissance de la production est importante pour répondre à une demande mondiale exponentielle.
La production mondiale est en effet passée de 38 Mt en 1985 à 82 Mt en 2013, pour atteindre 89 Mt en 2020. Autrement dit : entre 1985 et 2020, quand la France voyait sa production reculer de 31 %, la production mondiale faisait plus que doubler (+ 115 %).
Si la tendance mondiale est principalement tirée par la Chine, premier producteur mondial qui a plus que doublé sa production depuis 2003 (passage de 20 millions de tonnes à plus de 44 millions), plusieurs pays concurrents de l'hémisphère Nord connaissent une croissance continue de leur production tandis que la croissance se tasse dans l'hémisphère Sud depuis le milieu des années 200032(*).
Parmi les principaux producteurs investis sur le marché de l'exportation, on estime, par exemple, que, depuis 1985, la production a augmenté de 22 % en Italie, 29 % aux États-Unis et qu'elle a été multipliée par 2,25 en Turquie et par 2,5 en Pologne33(*).
Évolution de la production de pommes parmi les principaux pays producteurs et exportateurs depuis 1985 (en tonnes)
Source : FAOstats.
Émergent, en outre, à la lisière de l'Europe, des concurrents majeurs depuis le milieu des années 2010, notamment depuis le début de l'embargo russe sur les pommes européennes, alors que la Russie constituait le principal marché mondial de pommes. Ainsi, outre l'explosion des volumes récoltés en Turquie, les volumes produits de pommes ont augmenté entre 2010 et 2020 de 70 % en Russie (1,4 million de tonnes en 2021), 63 % en Ukraine (1,3 million de tonnes en 2021), 140 % en Moldavie (600 000 tonnes), 217 % en Serbie (570 000 tonnes) et de 100 % en Macédoine du Nord (180 000 tonnes). La dynamique est similaire en Asie centrale.
Enfin, pour ne se comparer qu'à ses voisins européens, la production européenne a augmenté de 20 % entre 2010 et 2020, alors que, dans le même temps, la production française a enregistré un recul de plus de 20 %. Ainsi, alors que l'Italie enregistrait une hausse des surfaces productives de pommes de 10 % depuis 2015 et que la Pologne voyait ses rendements doubler depuis 2010, la pomme française voyait son potentiel productif s'éroder à la fois en rendements et en surfaces.
En résumé : alors que la production de pommes s'accroît dans le monde entier, la France fait figure d'exception et connaît une tendance baissière des volumes récoltés chaque année.
Ce déclin rapide de la production française a deux conséquences.
Premièrement, la part de marché française dans les exportations mondiales recule, sous le double effet d'une chute du volume de ses exportations et d'une croissance du marché mondial au début des années 2000 (environ entre 8 et 9 millions de tonnes depuis 2015). Les parts de marché de la France sont ainsi passées de 7 % en 2015 à 3,5 % aujourd'hui34(*). Cette tendance a abouti à un changement de hiérarchie au sein du continent, la Pologne ayant ravi la place dominatrice de la France aux côtés de l'Italie au cours des années 2000 (les deux pays se partageant 20 % du marché mondial35(*)).
Évolution de la production de pommes en Europe entre 1999 et 2021 (en tonnes)
Source : ANPP, Gefel et FNPF.
Deuxièmement, la France exporte de moins en moins de pommes dans le monde.
Dès lors, la France perd chaque année des parts de marché à l'exportation à une vitesse effrénée : le volume exporté a été divisé par deux en moins de 7 ans, passant de près de 700 000 tonnes en 2014 à moins de 350 000 tonnes en 2021.
Évolution des exportations de pommes françaises (en milliers de tonnes)
Source : ANPP, Gefel et FNPF.
Aujourd'hui, la France exporte majoritairement à destination de grands pays importateurs européens (82 % de ses exportations) comme le Royaume-Uni (90 000 tonnes, soit 28 % du marché britannique), l'Espagne (70 000 tonnes), l'Allemagne (40 000 tonnes, soit 11 % de son marché), et de quelques pays tiers.
Les producteurs de pommes françaises reculent à la fois sur le marché européen et à destination des pays tiers.
L'émergence de nouveaux acteurs sur le marché européen a progressivement rogné les volumes français à destination des partenaires communautaires qui représentaient un peu plus de 400 000 tonnes en 2014 et 2015 alors qu'ils ne pèsent plus que 250 000 tonnes en 2021.
Selon la majorité des opérateurs interrogés, « la diminution des exportations françaises a débuté avant que le marché mondial ne débute une phase de rétrécissement, à compter de 2018 », notamment avec « l'arrivée de nouveaux fournisseurs à bas prix comme la Turquie, l'Iran et l'Italie sur certaines positions historiques de la France ».
La France a par exemple perdu depuis 2015 la quasi-intégralité des marchés africains (perte d'un marché de 80 000 tonnes) et moyen-orientaux (recul du volume exporté de 60 000 tonnes). Les Italiens sont confrontés à la même dynamique avec la perte des marchés algérien en 2016 et égyptien depuis 2022.
Avec un marché qui se rétrécit où les places sont chères, « cela augmente encore les difficultés rencontrées par la France à l'export », selon l'ANPP. De surcroît, le marché européen menace d'être inondé par les productions européennes n'étant plus exportées, ce qui pourrait durablement peser sur les prix payés aux producteurs.
La chute des exportations explique l'érosion du solde commercial français de la filière pommes. Il est passé en volume en moyenne d'un solde excédentaire de 600 000 tonnes par an entre 2004 et 2015 à un niveau de 250 000 tonnes en moyenne depuis 2019.
Pour la première fois, la France est même devenue déficitaire vis-à-vis du reste de l'Union européenne en pomme en 2021, tout en maintenant un léger excédent, largement inférieur à la moyenne historique, avec les pays tiers.
Évolution du solde des échanges de la France en volume avec l'Union européenne et les pays tiers pour la pomme de 2004 à 2021 (en tonnes)
Source : FranceAgriMer.
Il en résulte un solde commercial en retrait, passant de 425 millions d'euros en 2016 à 340 millions d'euros en 2020, la baisse étant limitée par un effet prix positif sur les pommes françaises, mais qui ne compense pas l'effet de la baisse des volumes exportés.
c) Rupture n° 3 : des importations non négligeables, notamment dans la filière transformation
Les importations de pommes sont relativement stables dans le temps, à hauteur d'environ 150 à 200 000 tonnes par an. Elles visent notamment à couvrir la demande des consommateurs français en contre-saison, en s'approvisionnant auprès des producteurs de l'hémisphère Sud, ou à pallier une baisse de la production française une année en raison d'un événement climatique. En parallèle, la France importe, en moyenne, environ 40 000 tonnes de pommes à destination de l'industrie.
Sur ce segment, selon FranceAgriMer, sur le marché des fruits transformés, tirés majoritairement par la pomme, « le recours aux produits d'import est significatif, principalement de Pologne qui dispose d'une offre conséquente » :
- 37 % de la confiture consommée en général est importée ;
- 14 % de la compote consommée est importée (la France disposant d'une position dominante sur le marché européen) ;
- 95 % de la consommation de fruits en conserve est importée ;
- 96 % de la consommation en fruits congelés est importée (marché essentiellement dominé par la Pologne36(*)).
L'année 2021 pourrait bien faire figure de rupture majeure pour la filière avec un niveau d'importations dépassant les 200 000 tonnes au total. Malgré une récolte limitée, les importations destinées au marché frais ont été relativement contenues et stables voire inférieures par rapport aux années précédentes. À l'inverse, la filière a importé davantage de pommes pour approvisionner la filière de transformation que pour la filière « pommes à couteau », en ayant un recours croissant à des pommes polonaises.
Au total, en 2021, environ une pomme sur trois utilisée dans les entreprises de transformation serait importée37(*).
Toutefois, les conditions de marché particulières en 2021 peuvent expliquer ce surcroît d'importations, qui pourrait n'être que circonstanciel. En effet, s'agissant de la production de compotes, le taux d'approvisionnement en origine France oscille généralement entre 75 % et 90 %, sauf spécificités conjoncturelles. En 2021, la faible disponibilité de pommes françaises en volume, combinée à une qualité importante des pommes récoltées qui a favorisé un fléchage vers la filière « pommes fraîches », plus rémunératrice, a pu expliquer un recours plus important à des pommes importées.
La situation est différente dans la filière « jus » et « cidre », qui sont organisées autour de filières de producteurs spécialisés dotées de processus plus mécanisés.
D'une part, faute d'unité de concentration de jus de pommes en France, tous les jus de pommes à base de concentré sont produits à base de pommes importées.
D'autre part, les industriels spécialisés dans les jus entendus par la mission ont estimé qu'environ la moitié de leur approvisionnement était couvert par des pommes importées, l'autre moitié provenant de pommes françaises, récoltées dans des vergers mécanisés et spécialisés situés dans le Sud-Ouest, et, pour une part résiduelle, de pommes résultant d'écarts de tri (pommes destinées au marché frais qui ne répondent pas aux standards).
d) À la source de ces ruptures : une pomme française sortie des radars des marchés faute d'une compétitivité prix suffisante
Moins de production, des exportations en berne, des importations qui augmentent : à la source de ces maux, un décrochage en matière de compétitivité de la pomme française.
Le prix moyen à l'exportation de la pomme française est estimé à 1,18 dollar du kilogramme, soit un différentiel de 15 centimes avec l'Italie (-13 % par rapport au prix français), de 34 centimes avec l'Allemagne (-29 %), de 43 centimes avec la Belgique (-36 %) et de 66 centimes avec la Turquie et la Pologne (-56 %).
Pour les exportateurs, si la France a pu faire le choix de se positionner sur une segmentation « haut de gamme », elle peut également être « hors prix sur ces segments ». Autrement dit : les pommes françaises sont jugées trop chères sur le marché, l'image de marque ne justifiant pas un tel écart de prix. C'est, parfois, ce que ressentent également des consommateurs français. Tout l'enjeu, aujourd'hui, est de retrouver un niveau de prix « dans le marché » pour pouvoir valoriser la production sur un segment haut de gamme. Pour un exportateur, rencontré par les rapporteurs, « si l'on parvient à redonner une compétitivité prix de 20 %, nous pouvons retrouver du pouvoir pour augmenter les exportations de 40 %38(*) ».
Côté importateurs, lorsqu'en raison d'un aléa climatique ou sanitaire le prix des productions françaises augmentait ou devenait trop élevé faute de disponibilités suffisantes pour le marché transformé, certains industriels privilégient dès lors des approvisionnements étrangers, privilégiant ainsi un facteur prix.
Pour les consommateurs nationaux, « les habitudes de consommation des ménages français sont peu sensibles à la montée en gamme des producteurs français39(*) » et se traduisent par une réduction des quantités acquises à l'achat au regard de la hausse des prix.
Dans les deux cas, la compétitivité prix de la pomme française demeure un enjeu essentiel.
3. Une compétitivité sapée par des coûts de main-d'oeuvre et des surtranspositions franco-françaises, contraignant les producteurs à se spécialiser de plus en plus sur du haut de gamme, au détriment de la filière pomme transformée
a) Une structure de charges dominée par des coûts de main-d'oeuvre où la France perd du terrain
Structure des charges d'exploitations dans une exploitation produisant des pommes
Source : FranceAgriMer.
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires estime que le coût de production d'une pomme est historiquement entre 400 et 500 euros la tonne40(*). Il est principalement composé de charges de main d'oeuvre et des consommations intermédiaires.
S'y ajoutent ensuite des coûts de conditionnement puis de logistique, très dépendants des coûts de l'énergie et de la main-d'oeuvre.
Comparativement à ses concurrents, la France se distingue par une relative faiblesse des charges d'intrants par rapport à ses concurrents41(*), témoignant d'une moindre dépendance française à leur utilisation dans la filière pomme.
En revanche, elle présente une structure de charges comparativement pénalisée, par rapport à ses concurrents, par deux postes : des charges de structure (coût d'entretien des bâtiments et amortissements) et des coûts de main d'oeuvre plus élevés en moyenne.
Classement comparatif des charges d'exploitation par hectare en arboriculture
Source : Chamnbres d'agriculture France.
S'agissant des amortissements, le graphique démontre, avant tout, la montée en puissance de la Pologne où les investissements représentent une charge considérable dans le coût de production total, ce qui se traduira, à terme, par une forte hausse du potentiel productif.
Concernant les coûts de main d'oeuvre, la progressive baisse du nombre d'exploitations ainsi que la complexification technique et réglementaire à l'oeuvre dans la filière pommes comme dans d'autres filières agricoles françaises a abouti à un agrandissement et à une plus grande professionnalisation et spécialisation des exploitations.
Ce phénomène a abouti à un recours accru à une main d'oeuvre salariée, qui représente aujourd'hui entre 40 % et 60 % des charges dans les exploitations arboricoles et les stations de conditionnement.
Or la France est lourdement pénalisée dans la compétition internationale par des coûts de main d'oeuvre plus élevés que ses concurrents, la dynamique faisant progressivement perdre de la compétitivité aux producteurs nationaux.
Les producteurs entendus par la mission estiment, sur la base de données douanières, que le coût horaire minimal chargé en 2021 était en France de 12,18 € contre 9,50 € en Allemagne, 7,74 € en Italie, 9,46 € en Espagne et 4,80 € en Pologne.
Pour avoir une vision claire du différentiel de compétitivité entre la France et ses concurrents, il convient de corriger ce différentiel de coûts de main d'oeuvre de l'hétérogénéité des rendements.
Une fois les retraitements effectués, il apparaît que le meilleur rendement français ne suffit pas à compenser le différentiel de coûts de main d'oeuvre. À la tonne, le différentiel dû uniquement aux coûts de main d'oeuvre est de près de 40 € avec la pomme polonaise et de 77 € avec la pomme italienne.
|
France |
Italie |
Pologne |
|
|
Heures travaillées par hectares (h/ha) |
463 |
457 |
582 |
|
Rendement à l'hectare (t/ha) |
35 |
43 |
23 |
|
Heures travaillées pour la production d'une tonne de pommes (h/t) |
13 |
11 |
25 |
|
Coût horaire (€/h) |
12 € |
8 € |
5 € |
|
Coût horaire de la main d'oeuvre pour une tonne produire (€/t) |
159 € |
83 € |
119 € |
|
Différence à la tonne par rapport
|
-77 € |
-40 € |
Source : ANPP.
En retenant un rendement de 35,4 tonnes par hectare en France et un nombre d'heures travaillées par hectare parmi les plus bas au monde (463 heures par hectare), le nombre d'heures nécessaires à la production d'une tonne de pomme peut être estimé à 13,07 heures par tonne. En le multipliant par le coût horaire précédemment mentioné, le coût de main d'oeuvre dédiée à la production d'une tonne française est de 159 €.
En Italie, avec un coût de main d'oeuvre plus faible (7,74 €/heure), un rendement plus élevé (42,8 t/ha) et un nombre d'heures travaillées par hectare légèrement plus favorable (457 h/ha), le coût de la main d'oeuvre dédiée à la production d'une pomme italienne est de 83 €, soit environ la moitié de celui de la pomme française. Cette structure de coût s'explique, selon les témoignages recueillis par les rapporteurs lors de leur déplacement en Italie, par une des exploitations très familiales, ce qui vient écraser les coûts de main d'oeuvre tout en garantissant une productivité élevée.
En Pologne, malgré un rendement plus faible (23,4 t/ha) et un nombre d'heures travaillées à l'hectare plus élevé (582 heures/ha), le faible coût horaire de la main d'oeuvre aboutit à un coût de main d'oeuvre dédiée à la production d'une tonne de pommes polonaises estimé à 119 €, soit 40 € de différence à la tonne par rapport à la pomme française.
b) Le lourd effet des surtranspositions accentue encore les distorsions de concurrence
Un autre élément sape, selon l'intégralité des maillons de la filière entendus par la mission, la compétitivité de la France : les contraintes réglementaires franco-françaises.
Outre la multiplicité des démarches administratives à réaliser tout au long de l'année, spécialité franco-française, la France se caractérise par un environnement réglementaire reconnu comme le plus strict du monde.
Sans remettre en cause la nécessité d'avoir un cadre réglementaire précis, les rapporteurs estiment que l'administration française se caractérise par un excès de zèle, se donnant la liberté, par voie d'interprétation, de surtransposer certaines normes européennes, pénalisant en dernier ressort la compétitivité des producteurs.
Plusieurs exemples très concrets démontrent certaines aberrations.
Contre les effets désastreux du gel sur les récoltes, la filière arboricole a recours à un moyen efficace : l'aspersion. Les producteurs estiment qu'en moyenne, le besoin moyen est de 2 000 m3 par hectare, ce qui nécessite dès lors, pour réutiliser l'eau de pluie accumulée dans les périodes pluvieuses, la création de réserves d'eau. Or nombre de projets sont aujourd'hui bloqués en raison de contentieux décourageant les promoteurs de ces investissements de bon sens ainsi que par certaines contraintes réglementaires, empêchant, de surcroît, l'octroi d'autorisations de volumes de prélèvements supplémentaires.
En revanche, ces pratiques ne posent aucun problème dans d'autres pays d'Europe, où les tensions relatives à l'eau sont pourtant plus importantes qu'en France.
Au total, l'aspersion représente un investissement d'environ 1 000 € à l'hectare par an sur la durée de vie du verger.
Faute de pouvoir en bénéficier, les producteurs de pommes français sont exposés à une fréquence d'un gel tous les cinq ans avec 40 % de pertes en moyenne. Cela représente un coût inclus dans les plans de charges sur vingt ans pour les producteurs une charge potentiellement évitable d'environ 2 400 € par an à l'hectare sur la durée de vie du verger.
Autrement dit, les producteurs estiment que l'absence de politique d'aspersion par rapport à ses concurrents qui peuvent y recourir représente un différentiel de compétitivité de 280 € la tonne42(*).
Autre exemple : la surtransposition en matière de produits phytopharmaceutiques.
Source : FranceAgriMer.
Là encore, la France détient la palme du niveau d'exigence de la réglementation phytosanitaire nationale, plus restrictive que celle d'autres pays européens appliquant le niveau d'exigence européen déjà considéré comme très strict et, a fortiori, plus stricte que celle du reste du monde.
Un chiffre démontre ce cadre : l'Union européenne autorise 454 substances actives sur le continent européen au niveau agricole. Ce nombre a diminué de près de 20 % en moins de dix ans et devrait encore se réduire les prochaines années. La France va plus loin puisqu'elle n'autorise que 309 substances actives à fin 2021. Autrement dit, seuls 68 % des substances actives autorisées et utilisées en Europe peuvent être épandues en France.
Ainsi, au sein même de l'Union européenne, les agriculteurs français ne peuvent utiliser les mêmes substances que leurs voisins, sans que cela n'ait la moindre conséquence sur les produits agricoles qu'ils peuvent vendre en France. Or, bien souvent, les alternatives sont plus chères ou, dans le pire des cas, absentes, ce qui place les agriculteurs dans des impasses techniques aboutissant à des baisses aiguës de rendement. Cela induit, mécaniquement, une perte de compétitivité pour les agriculteurs français.
Par exemple, la possible interdiction d'utilisation du glyphosate, si elle était décidée en France pour la filière pomme, engendrerait un passage quasi-automatique vers un désherbage mécanique pour économiser les 700 grammes de matières actives par hectare utilisés dans la filière comme herbicide foliaire efficace sur les graminées et les dicotylédones. Il en résulterait un inévitable investissement pour acquérir des machines spécialisées (environ 90 000 € en moyenne) ainsi qu'une hausse liée des charges de gazole pour alimenter ces machines permettant de désherber les vergers. Le surplus de gazole consommé aurait en outre un impact environnemental loin d'être anecdotique43(*). En estimant que le rendement serait également légèrement réduit, il en résulterait une augmentation des coûts de production de 400 € / tonne.
Les risques d'impasse que ces interdictions franco-françaises induisent sont également majeurs. Les producteurs de pommes entendus par la mission rappellent, par exemple, que les vergers sont aujourd'hui très exposés au risque de piqûres dues au puceron cendré. Ils estiment qu'à ce stade la solution principale post-floraison est l'utilisation de spirotétramate, dont l'autorisation prendra fin dans l'Union européenne en 2024. L'alternative promue en Europe est l'utilisation d'une substance active de la famille des néonicotinoïdes, encore autorisée au niveau européen aujourd'hui, mais qui est interdite en France par l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime depuis 2018 et le vote de la loi « Biodiversité ». Seuls les agriculteurs français seront donc placés dans une impasse en 2024, alors que les arboriculteurs européens concurrents disposeront d'une solution le temps qu'émerge une alternative technique satisfaisante. Là encore, la pomme française devra faire face à des baisses de rendement et de valorisation du fruit en raison des risques accrus de présence de piqûres.
Bien entendu, dès lors que la substance active pose des risques sanitaires et environnementaux majeurs constatés par les agences sanitaires et scientifiques compétentes, il est prioritaire qu'elles soient interdites sur tout le continent européen et non uniquement dans un pays spécifique, au risque de pénaliser uniquement les agriculteurs français tout en ayant un impact nul sur l'environnement, les pratiques s'intensifiant en général dans les pays où les substances demeurent autorisées en raison des gains de parts de marché dans les productions concernées, réalisées au détriment de la production française.
Au-delà de la seule question du nombre de substances interdites en France, les conditions d'emplois des phytosanitaires subissent également des restrictions propres à la France qui viennent s'ajouter aux conditions des autorisations de mise sur le marché. Cela peut être le cas des zones de non-traitement à proximité des habitations ou bien encore de certains délais de rentrée (DRE) dans la parcelle, qui viennent, là encore, obérer la compétitivité de la filière.
c) Une spécialisation haut de gamme à marche forcée qui pose des difficultés d'écoulement en raison d'une saturation du marché
Faute d'une compétitivité prix suffisante, compte tenu des différentiels inéluctables pesant sur les coûts de main d'oeuvre, la filière française a voulu se démarquer en misant sur la compétitivité hors-prix.
De ce différentiel important en matière de coûts de production, la filière française tire en effet la conclusion qu'elle doit, pour s'en sortir, segmenter le marché pour se positionner sur des niches. Le syndicat principal des producteurs de pommes estime, par exemple, que « la stratégie française va consister à éviter l'affrontement prix avec ses concurrents, pour se positionner autant que possible sur les marchés à meilleure valeur ajoutée grâce à des produits qualitatifs et offrant toutes les garanties ».
Cela se traduit, notamment, par l'essor de certains cahiers des charges ces dernières années, notamment le bio. 1 800 exploitations engagées dans l'agriculture biologique ou en conversion sont recensées dans la filière, sur un total de 7 475 hectares (environ 20 % des surfaces pour 7 % de la production totale). Encouragés par les pouvoirs publics, les producteurs se sont massivement engagés dans des conversions afin de tirer une meilleure valorisation de leurs produits. Néanmoins, depuis 2020, les producteurs de pommes, comme d'autres filières, ont le sentiment d'arriver en « bout de course » compte tenu des difficultés d'écoulement de leurs productions.
Si le nombre de consommateurs se développe en tendance et semble se stabiliser aujourd'hui autour de 21 % de ménages acheteurs, ces nouveaux acheteurs de bio restent de petits acheteurs, plutôt occasionnels, consommant des pommes de moins en moins souvent (en moyenne 5 fois par an), ce qui entraîne un niveau d'achat plutôt en baisse en tendance, à 5,4 kg par an. L'effet prix explique, sans aucun doute, ce plafond de verre, la pomme bio étant en moyenne deux fois plus chère que la pomme conventionnelle sur les marchés. Il en résulte que « le potentiel de production bio a désormais dépassé la taille du marché intérieur, pour le marché du frais comme pour le marché de la transformation. Les dernières données montrent une stagnation (au mieux) de la taille du marché bio, tandis que le potentiel de production augmente encore44(*). »
Cette surproduction, difficile à écouler à l'étranger (le marché export valorisant d'autres démarches), aboutit, plus généralement, à ce qu'en 2020, 38 % des metteurs en marché bio ont redirigé une partie de leur offre fruits et légumes bio vers le marché conventionnel45(*). Or ce déclassement représente une perte majeure pour le producteur qui perd en moyenne 820 € de valorisation à la tonne.
Production de pommes bios certifiées en France
Source : ANPP, Gefel, FNPF.
d) Le marché des produits de base est délaissé, ce qui menace de déstabiliser la filière et de faire la part belle aux importations.
Finalement, tout se passe comme si les producteurs français, en se spécialisant volontairement, par des choix de marché, ou de manière contraignante, par le poids des normes franco-françaises, sur les niches des pommes haut de gamme, s'inscrivaient dans une tendance de délaissement du marché de la pomme entrée de gamme, compétitive à l'export et accessible aux ménages les plus modestes dans les rayons.
Sur les marchés internationaux, cela se traduit par un abandon des stratégies exportatrices de certains acteurs et par une difficulté de convaincre les acheteurs en raison des différences de prix avec les concurrents, notamment européens.
Un exportateur interrogé par les rapporteurs estime que les pommes françaises sont « hors marché » et que les producteurs nationaux sont « inaudibles » sur les marchés internationaux au regard des cours des autres pays. Si la « qualité française est clairement valorisée », le différentiel de prix acceptable n'est pas « illimité » et doit demeurer « raisonnable et justifié ». Face aux difficultés de commercialisation qui en résultent, des producteurs se diversifient ou changent de productions, ce qui devrait accélérer dans les années à venir la baisse tendancielle des volumes de pommes françaises exportées.
En outre, l'inscription, contrainte ou volontaire, de la filière dans l'unique stratégie du « haut de gamme », si elle venait à s'inscrire dans la durée, est de nature à menacer tout l'écosystème industriel national.
Si le marché du frais constitue près de 50 % des débouchés pour les producteurs français, principalement en grandes et moyennes surfaces (GMS) ou chez les détaillants, la transformation représente un marché non négligeable, estimé entre 15 et 20 % des ventes pour les producteurs de pommes, en général en retenant les fruits qui ne répondent pas aux critères demandés pour le marché du frais, ou qui sont abîmés.
Le fonctionnement de la filière industrielle est en effet exemplaire pour limiter les gaspillages tout en trouvant des valorisations pour les producteurs.
Les industriels de la transformation s'approvisionnent auprès des producteurs français de pommes de table en récupérant les « écarts de tri », c'est-à-dire les pommes qui ne répondent pas aux critères minimaux du marché du frais (calibre, forme, taille...). Il en résulte, bien entendu, une moindre valorisation pour les producteurs. Dans une chaîne descendante, les compotiers offrent une valorisation supérieure aux professionnels des jus qui, eux-mêmes, proposent des prix à l'achat plus élevé que les entreprises spécialisées dans la production de concentrés.
Schéma d'organisation de la filière pomme en France
Source : Adepale, Unijus, Afidem.
L'avantage majeur de ce fonctionnement de filière à destinations multiples est la valorisation de presque toutes les pommes issues du verger français, dans la limite de sa disponibilité.
Le choix de producteurs de la filière amont, volontaire ou contraint, de se spécialiser lentement mais sûrement sur des pommes plus haut de gamme tendra à réduire les volumes de production pour se concentrer sur la limitation des pertes afin d'obtenir une meilleure valorisation, ce qui reviendra à privilégier les débouchés sur le marché du frais.
Les industriels français se trouveront donc face à un risque de pénurie d'approvisionnements, par la baisse des écarts de tri, ou à une hausse structurelle du coût de leurs approvisionnements, dans un contexte de faibles marges compte tenu de relations commerciales dégradées avec la grande distribution.
À défaut de valorisation suffisante par le consommateur, dans un contexte de baisse accélérée de pouvoir d'achat avec une inflation forte, le recours à la pomme importée risque d'être accru.
C'est tout un paradoxe quand on rappelle que le marché de la pomme transformée est en forte croissance. Les compotiers connaissent par exemple un marché avec une croissance particulièrement dynamique ces dernières années, la production ayant progressé de 19,3 % en volume entre 2011 et 2017 alors que les denrées à base de pommes couvrent 80 % des références46(*).
Cette situation pourrait aboutir à une segmentation plus forte de la production industrielle française entre quelques références issues de pommes françaises, ayant un niveau de prix mécaniquement élevé, et des compotes moins onéreuses issues de pommes importées ou, à tout le moins, de mélanges de pommes intégrant de plus en plus de pommes venues d'ailleurs.
Le risque est alors clair : la consommation régulière de pommes françaises pourrait, à court terme, n'être réservée qu'aux ménages français les plus aisés, reléguant les ménages les plus modestes à ne manger que des pommes importées, transformées ou fraîches, alors qu'elles sont produites selon des normes inférieures à celles imposées aux producteurs français.
e) À ces menaces économiques s'ajoutent des menaces psychologiques
(1) Une filière au péril du changement climatique
La question est d'autant plus cruciale qu'elle se pose à l'heure du changement climatique qui impliquera, nécessairement, des évolutions majeures de l'appareil productif national.
La France dispose aujourd'hui d'un climat plutôt favorable, la récurrence du gel étant plus limitée qu'à l'étranger.
Toutefois, la multiplication des aléas climatiques dans la filière arboricole en général pose des difficultés économiques aux arboriculteurs, qui, en outre, peuvent éprouver un très grand découragement face à la hausse de l'intensité et de la récurrence des aléas.
L'arboriculture est une filière multi-sinistrée sur plusieurs années successives. C'est le cas, par exemple, de la région Auvergne-Rhône-Alpes où des départements ont subi la grêle puis le gel les années 2019, 2020 et 2021.
Cela pose un triple problème pour les arboriculteurs.
D'une part, ils sont pénalisés dans leur contrat d'assurance récolte puisqu'ils sont confrontés à une réduction du rendement historique, ne représentant plus le rendement moyen réel de l'exploitation, qui est pourtant la base du calcul de l'indemnisation. Plus ce rendement moyen est faible, plus l'écart avec le rendement d'une année où a lieu un aléa est réduit et plus l'indemnisation est limitée. Ce mécanisme de la moyenne olympique47(*), transposition en droit européen d'une règle de l'OMC, doit évoluer pour que l'agriculteur dispose d'outils réellement protecteurs face au changement climatique. À défaut d'action gouvernementale résolue sur le sujet dans les enceintes internationales, l'agriculteur sera le grand perdant du contrat assurantiel en agriculture, même réformé.
D'autre part, pour se prémunir au mieux des effets des aléas, l'arboriculteur devra investir massivement dans les prochaines années pour réduire les risques. Là encore, cette hausse des charges est de nature à donner un avantage comparatif aux pays bénéficiant de climats favorables pour certaines cultures.
Enfin, le changement climatique induit un risque de multiplication de ravageurs ou de maladies végétales au moment même où le nombre de solutions disponibles se réduit. FranceAgriMer place ainsi la France et l'Italie parmi les pays les plus soumis aux risques de pathogènes dans le monde. Cette moindre capacité de protection des plantes, faute de l'émergence de solutions nouvelles suffisamment rapide, est une source de préoccupation majeure pour les producteurs, dont les rapporteurs se font l'écho.
La difficulté n'est bien sûr pas d'interdire les substances actives les plus dangereuses mais de multiplier les interdictions sans faire émerger, en parallèle, des solutions alternatives, plaçant ainsi les producteurs dans des impasses dont, parfois, ils ne se relèvent pas.
(2) Un agriculteur présumé coupable, c'est un agriculteur qui se désinstalle
Au contexte macroéconomique difficile pour l'ensemble de la filière et aux aléas climatiques, s'ajoute une donnée sociale clairement soulevée par les producteurs rencontrés, qui ont de manière unanime parlé d'un « frein au renouvellement des générations, car ces dernières sont effrayées par le cadre d'exercice du métier ».
Dans ce contexte difficile, de nature à remettre en cause l'économie générale de la filière, l'État doit s'abstenir d'ajouter de nouvelles contraintes réglementaires aux seuls producteurs français, engagés dans une compétition européenne et internationale, et lutter contre sa « tendance naturelle à rendre le métier d'agriculteur impossible », pour reprendre les mots d'un producteur rencontré.
Cet accroissement des normes, obstacles et contraintes réglementaires pour les agriculteurs est, souvent, évoqué comme l'un des principaux éléments « décourageant » les agriculteurs et « aliénant le métier de paysan ».
Car la profusion de normes et contraintes difficilement vérifiables aboutit, in fine, à la judiciarisation des processus de production agricole, bien souvent instrumentalisée par des associations défendant des causes militantes, aboutissant à une culpabilisation des agriculteurs du fait même de l'exercice de leur métier. Les agriculteurs ont le sentiment de faire l'objet d'une multiplication de chefs d'accusation, d'être bien souvent présumés coupables et d'avoir, en outre, la charge de la preuve pour se dédouaner, comme si le simple métier d'agriculteur était un délit. À l'inverse, les producteurs ont le sentiment d'un système à deux vitesses, où les actions délictuelles de certains militants activistes sont peu condamnées.
En parallèle, des pouvoirs de police de l'environnement accrus ces dernières années, confiés à des agents spéciaux, se retournent vite contre les agriculteurs qui assistent à une remise en cause judiciaire de leurs pratiques, certains estimant que les inspecteurs « sont insuffisamment au fait des réalités agricoles », « recourant strictement au principe de précaution pour d'abord présumer coupables les agriculteurs, avant de mener l'enquête ». Les rapporteurs se font, ici, l'écho de nombreuses voix de producteurs sur le sujet. Leur revendication est pourtant simple : leur « laisser le droit à produire ».
f) Des signes préoccupants de refus de se lancer dans la production de pommes
Cet engrenage de la défiance aboutira, sans nul doute, aux yeux des rapporteurs, à l'arrêt pur et simple de l'exercice du métier par les nouvelles générations.
Cela se retrouve dans les statistiques de renouvellement des vergers. Le pourcentage de jeunes vergers plantés il y a moins de cinq ans est en baisse et atteint 17 % des surfaces en 2021, ce qui ne permet pas d'atteindre le seuil minimal de maintien du potentiel de production du verger français, qui nécessite un taux de jeunes vergers compris entre 20 et 24 %. Le taux de vergers plantés il y a plus de 20 ans est important (proche de 30 %), ce qui réduit le rendement et pose des difficultés de marché compte tenu de l'évolution qualitative de la demande.
Alors qu'il faudrait un taux d'environ 6 % de renouvellement, il n'atteint, malgré une politique volontariste des syndicats de producteurs, que 4 %. En 2021, le renouvellement des surfaces est en nette baisse avec seulement 788 ha plantés en 2021, soit un taux de 3 % de rénovation. Pour les producteurs entendus par la mission, « ce recul peut expliquer la fin des programmes de plantation de nouvelles variétés mais aussi par une incertitude des opérateurs sur les capacités de protection du verger à moyen terme48(*). »
L'érosion du potentiel productif pourrait encore s'accélérer, ouvrant cette fois la voie à un accroissement majeur des importations de pommes.
B. LA SEULE MONTÉE EN GAMME NE PEUT ÊTRE LE REMÈDE AU MANQUE DE COMPÉTITIVITÉ : L'EXEMPLE DE LA FUITE EN AVANT DE LA FILIÈRE TOMATE, FAUTE DE MISE EN oeUVRE D'UNE POLITIQUE DE BAISSE DES CHARGES
1. Une production française à l'abandon dans un marché mondial qui explose
La production mondiale de tomates fraîches a été multipliée par cinq depuis 1970 pour atteindre un niveau de 187 millions de tonnes. Cette tendance impressionnante se poursuit ces dernières années puisque la production en 2021 est supérieure de près de 50 % au niveau de 2004. Une tomate sur deux produite dans le monde vient de Chine, d'Inde et des États-Unis. Depuis 1996, la hausse de la production est essentiellement tirée par la Chine, qui a fait de la production de tomates une arme alimentaire, que d'aucuns ont pu intituler « l'empire de l'or rouge49(*) ».
Dans ce concert international, l'espace euro-méditerranéen occupe une place relativement mineure avec une production estimée à 31 millions de tonnes de tomates fraîches, principalement en Turquie, en Italie (5,2 millions de tonnes), en Espagne (4,3 millions de tonnes), au Portugal et au Maroc.
Cette zone se caractérise, dans un marché mondial en forte croissance, par une quasi-stabilité de la production depuis 2004 permise par des rendements en hausse, qui compensent une baisse d'un cinquième des surfaces dédiées depuis 2004.
Les spécialisations des productions sont très différentes entre ces pays. Quand le Maroc se spécialise pour adresser le marché de la tomate fraîche, l'Italie et l'Espagne dédient entre 60 et 80 % de leurs volumes à la transformation. La Turquie occupe, de son côté, une position intermédiaire (34 % des tomates produites dédiées à la transformation).
Ces spécialisations impactent mécaniquement l'organisation des filières de production et, partant, les rendements. Ils sont en effet plus élevés quand la production est sous serre : aux Pays-Bas ou en Belgique, où la production est intégralement sous serre, le rendement est estimé entre 450 et 490 tonnes à l'hectare alors qu'il n'est que de 64 tonnes à l'hectare en Italie, pays spécialisé dans la production de tomates de plein champ destinées à la conserverie.
La France occupe, au sein de cette zone, la place d'un producteur en perdition.
Pourtant, la France dispose d'une filière d'excellence, dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Sa production de tomates fraîches, de 632 000 tonnes environ, s'étend sur une superficie de 4 825 ha selon FranceAgriMer, dont les ¾ sont principalement situés en Bretagne et dans le Sud-Est et Sud-Ouest de la France.
Elle dispose en outre de 180 à 200 exploitations spécialisées en production de tomates pour l'industrie, située principalement en Nouvelle-Aquitaine et dans la région PACA. Ces exploitations occupent 2 521 ha et produisent près de 165 000 tonnes de tomates par an pour les transformer, à hauteur d'environ 51 000 tonnes, en concentré (59 %), en conserve et en jus.
Ce modèle mixte aboutit à un rendement moyen de 114 tonnes par hectare, inférieur à la moyenne euro-méditerranéenne, mais supérieur à d'autres modèles comparables.
Toutefois, c'est une culture spécifique qui a connu des mutations et un déclin majeur depuis les années 1980.
Avant 1980, les cultures de plein champ dominaient une filière française très atomisée. Avec les débuts de la production sous abri, puis progressivement, des abris chauffés et sous serres, le plein champ tend à s'effacer face à une production différente, mieux à même de répondre aux demandes de la grande distribution qui privilégie des produits standardisés, sans défaut de forme, de coloration ou d'aspect.
Jusqu'au début des années 2000, la géographie culturale française évolue, les exploitations bretonnes prenant peu à peu le pas sur celles du Sud de la France grâce au développement des cultures sous serres ou abris et en raison de l'émergence de maladies végétales. La tomate grappe devient un produit de référence, concurrençant la tomate ronde.
En 1996, point de bascule historique pour la filière tomate, l'Union européenne signe avec le Maroc un accord d'association libéralisant la circulation de produits agricoles, notamment de tomates marocaines. Accord dit « tomates contre blé » par les producteurs, il fait apparaître des tomates très compétitives sur le marché européen que la production française ne peut concurrencer.
Vient s'ajouter à cette tendance, depuis la fin des années 2000,l'apparition du « fléau de la mouche Tuta absoluta » (la mineuse de la tomate), qui condamne progressivement les productions de plein champ dans le bassin méditerranéen en raison d'impasses techniques.
Il en résulte que la production ne progresse plus en volume et à peine en valeur, alors que la production mondiale est en forte croissance. En effet, la production de tomates fraîches et transformées était de 840 000 tonnes en France en 1990 : elle était du même niveau en 2000 et se situait à un niveau de 820 000 tonnes encore en 2010.
Cette stagnation de la production est en réalité majoritairement due au recul massif de la production de tomates d'industrie, qui a été la victime d'un abandon historique de la part de l'État. La production est passée de 371 000 tonnes en 1999 à 96 000 tonnes en 2007 avant de remonter à un niveau relativement stable compris entre 150 000 et 175 000 tonnes. En parallèle, la production de tomates fraîches augmentait jusqu'en 2016 grâce à une progression du rendement à l'hectare.
Évolution du tonnage, des surfaces, du nombre de producteurs et du rendement de la filière tomate d'industrie
Source : SONITO, CETOMI.
2. Une consommation de tomate en France qui dépend, en grande partie, d'importations
Concernant la tomate fraîche, ce recul de la production a entraîné progressivement une dépendance aux importations, d'abord espagnoles et marocaines jusqu'en 2006, date à laquelle les tomates marocaines sont devenues hégémoniques dans les flux importés.
La production marocaine bénéficie de nombreux avantages concurrentiels qu'elle exploite au maximum : main d'oeuvre à faible coût, ensoleillement supérieur, régime douanier favorable... Elle est parvenue à détrôner l'Espagne et son modèle de tomates sous serres dans la région d'Almeria, à tel point que les superficies espagnoles reculent, surtout dans les tomates en vrac, pour se convertir dans des cultures où les coûts de production sont plus faibles (courgettes et poivrons) et où la valeur ajoutée est supérieure (avocats).
La France est aujourd'hui le 3e importateur mondial de tomates dans le monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne.
Elle importe plus de 507 000 tonnes de tomates fraîches en 2020, principalement du Maroc (350 000 tonnes) et d'Espagne (environ 100 000 tonnes).
Source : AOP Tomates Concombres, Légumes de France.
Les importations sont en réalité très contre-saisonnières puisque plus de 2/3 d'entre elles se font de novembre à avril, alors que la production française s'échelonne d'avril à octobre. Mais il existe tout de même des importations résiduelles y compris en pleine période de production, avec une proportion plus importante de tomates fraîches venues de Belgique et des Pays-Bas, révélant, en cela, une vraie assise des tomates importées sur le marché.
Néanmoins, une grande part de ces flux importés ne sont pas consommés en France mais ne font que transiter par le marché Saint-Charles International de Perpignan avant d'être réexportée pour environ 200 000 tonnes majoritairement au sein de l'Union européenne (vers Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou la Pologne).
Compte tenu d'un faible niveau d'exportations, il en résulte un déficit général de la balance commerciale d'environ 300 000 tonnes, ce qui représente 240 millions d'euros pour la tomate fraîche en 2020.
Au total, on estime que 36 % des volumes annuels de tomates fraîches consommées en France sont importées, principalement l'hiver mais de plus en plus toute l'année en raison du développement d'une offre marocaine, belge et néerlandaise concurrençant la production française de saison.
Cette situation est, au reste, parfois ignorée des consommateurs quand, certaines marques utilisent un étiquetage trompeur, par exemple en vendant des tomates cerises marocaines dans un conditionnement vendant ces produits comme l'emblème de l'équipe de rugby d'une ville du Sud-Ouest.
Concernant la tomate transformée, la dépendance est quasi intégrale.
Si aucune tomate fraîche destinée à la transformation n'est importée, la France n'en demeure pas moins massivement dépendante d'importations de produits transformés à base de tomates, à hauteur de 404 millions d'euros. Cela revient à importer 1,2 million de tonnes équivalent tomates fraîches50(*), soit plus du double par rapport au niveau de 1997. Il en résulte que le taux de dépendance de la France aux importations de tomates transformées est aux alentours de 85 %, alors qu'il était de 60 % à la fin des années 1990.
Dans le détail, les sauces tomates consommées par les Français proviennent majoritairement d'Espagne (45 %), d'Italie (35 %) et d'Europe du Nord 20 %) tandis que les tomates en conserves et en concentrés sont originaires d'Italie (à plus de 60 %) et d'Espagne (à plus de 25 %).
En réalité, l'abandon de la production de tomates industrie a abouti à un manque de concentration d'exploitations agricoles et d'outils industriels dans des zones de production, créant un effet « plafond de verre » sur le développement de l'industrie, qui regrette le « manque de synergies et de parentés productives au sein des bassins de production (GIE, mise en commun de ressources humaines, partenariats public-privé) constitue un frein au développement ». Dès lors que le maillage agricole et industriel est trop lâche, les coûts logistiques pèsent négativement sur la compétitivité de la production française, renchérissant in fine le prix de la matière agricole livrée « d'une dizaine d'euros par tonne » par rapport aux concurrents. Dès lors, mécaniquement, le cercle vicieux est enclenché car « le manque de compétitivité de la filière, qui ne permet pas aux industriels de se placer avantageusement en termes de prix face aux concurrents du bassin méditerranéen, ne milite pas pour un recours massif à l'origine France dans les produits de seconde transformation51(*) ».
3. Des écarts de compétitivité majeurs expliquant cette dépendance aux importations
a) Avec des coûts de main-d'oeuvre 17 fois plus élevés qu'au Maroc, les producteurs de tomates nationaux ne parviennent pas à rivaliser avec le géant méditerranéen de la tomate
Là encore, l'érosion des parts de marché des tomates françaises dans la consommation des Français s'explique, avant tout, par un différentiel croissant de compétitivité avec les tomates importées.
Il provient déjà d'écarts de modèles de production, la France se caractérisant, encore, par un modèle relativement familial, avec des surfaces moyennes des exploitations de 2,3 ha.
Au-delà de la structure du modèle se pose la question de la compétitivité prix de la filière française.
La production sous serres est en réalité fortement mécanisée, ce qui nécessite un haut niveau d'investissement. En moyenne, 1 hectare de tomates sous serre représente un investissement compris entre 1,4 et 1,8 million d'euros d'équipements. Dès lors, les amortissements représentent une part en général importante du coût de revient moyen.
Néanmoins, à ce stade, il est nécessaire de faire appel à de la main-d'oeuvre pour la partie récolte, effeuillage et palissage.
Pour les tomates fraîches, les problèmes en la matière sont très similaires à ceux rencontrés par les producteurs de pommes, ces derniers plaçant au sommet de la hiérarchie des contraintes la très forte exigence de la réglementation sanitaire franco-française ainsi que le coût de la main d'oeuvre.
Selon l'AOP Tomates et concombres, « l'écart de valorisation peut atteindre 20 à 25 % de mai à fin août sur des productions européennes et être proche de 50 % sur les origines Maroc et Tunisie ». Il en résulte que « sur les gros fruits, on a assisté à un abandon de certaines filières historiques au profit des concurrents étrangers plus compétitifs (Ronde, charnue). »
L'analyse du coût de revient met en lumière la prépondérance du coût de la main d'oeuvre dans la culture sous serres chauffées.
Répartition des postes de charges de production dans les abris chauffés
Source : Observatoire des exploitations
légumières, données 2020.
Comme pour les producteurs de pommes, les chiffres sont éloquents : lorsque le coût horaire de l'employeur est de 12,8 € en France, il est de 0,74 € au Maroc52(*).
Le différentiel est également marqué avec les autres pays européens concurrents. Les employeurs français ont un coût horaire de la main d'oeuvre similaire à celui de leurs homologues néerlandais, à l'exception des emplois de jeunes de moins de 21 ans qui peuvent être rémunérés avec salaire minimum minoré aux Pays-Bas. Le coût horaire de main-d'oeuvre est, en revanche, supérieur à tous les autres pays européens, que ce soit en Pologne où il est de 4,8 €, ou dans des pays comparables : 10,7 € en Belgique, 9,8 € en Allemagne et 7,6 € en Italie.
b) Une hausse des cours des intrants fortement pénalisante
Pour les producteurs entendus par la mission, la cause du déclin français, « c'est le différentiel de prix » avec, comme principal facteur explicatif, « le niveau de la main d'oeuvre, mais aussi, plus récemment, la hausse du prix du gaz, le facteur énergie ».
En effet, le poste « énergie » est également une charge importante des producteurs français de tomates, en raison des coûts de chauffage et d'électricité. Or ce poste subit une considérable augmentation depuis 2021, comme de nombreux autres secteurs.
Les professionnels serristes s'inquiètent, au reste, de subir des ruptures d'approvisionnement de gaz l'hiver prochain.
Là où la France performait sur les marchés internationaux par une maîtrise du coût de son énergie, cet avantage comparatif est, aujourd'hui, durablement menacé. Le coût du poste énergie des professionnels interrogés a ainsi augmenté de + 370 % entre 2021 et janvier 2022, de + 110 % pour les engrais, de + 32 % pour les emballages.
Le coût du conditionnement a également considérablement augmenté, en raison de la hausse des cours des emballages et des surcoûts induits par l'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC53(*). Les professionnels rencontrés regrettent ainsi que « les objectifs de réduction, de réemploi et de réutilisation, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique prévus dans le cadre de la loi AGEC fixent des échéances plus courtes pour les opérateurs français sur cette thématique que pour leurs concurrents européens. »
c) Sur les intrants, là encore des surtranspositions pénalisent l'agriculture française
Enfin, les intrants sont des ressources essentielles pour garantir la pousse de la tomate. Ce poste de charges inclut les charges liées aux semences et pieds, qui représentent une part prépondérante dans cette catégorie de coûts, les fournitures de cultures, substrats ainsi que la ferti-irrigation.
S'agissant de la semence, la France s'appuie sur une filière d'excellence. Pour ce qui est de la création variétale, atout majeur pour la filière de semences de tomate en France, la tomate bénéficie d'une activité créatrice très dynamique de la part de la recherche privée, sur toutes les typologies de tomates, bien que les activités de multiplication de semences et de production de plants soient davantage internationalisées.
S'agissant des traitements phytopharmaceutiques, la filière tomate est très fortement engagée dans la réduction de l'utilisation de pesticides de synthèse, à tel point qu'elle est devenue un exemple international en la matière.
Depuis 2018, la France est un des seuls pays à avoir développé pour la filière des labels « Zéro Résidu de Pesticides » et « Sans pesticides ». Dès lors, « comparativement aux autres pays européens (Belgique, Hollande, Espagne, Italie), la France (surtout au Nord-Ouest où la pression d'insectes est moindre) est probablement le pays qui utilise le moins de produits phytosanitaires de synthèse » selon l'AOP Tomates et concombres.
Bien entendu, cet engagement a un coût. Les producteurs ont recours à des produits de biocontrôle pour réaliser leurs traitements préventifs bien que ces substances actives soient plus onéreuses et nécessitent plus d'applications, donc plus de main d'oeuvre mobilisable. À défaut de politiques publiques efficaces pour réduire le surcoût d'utilisation de ces produits de biocontrôle, leur recours accru pénalisera par ce double effet la compétitivité coût de la filière.
Les producteurs de tomates plein champ destinées à l'industrie, plus exposés aux risques en raison de leur mode de culture, témoignent, de leur côté, d'une vive préoccupation sur ce sujet des intrants.
Là encore, par le biais d'interprétations restrictives ou de surtranspositions, la France demeure, selon FranceAgriMer, au sommet dans la hiérarchie du niveau d'exigence de la réglementation phytosanitaire nationale, bien devant l'Espagne, l'Italie, la Pologne ou le Maroc.
Les producteurs de tomates destinées à l'industrie estiment, par exemple, que « l'arrêt d'homologation et la mise en place de restrictions d'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, comme le désherbage de pré-plantation, ne permettent plus de lutter efficacement contre certains adventices. » C'est par exemple « le cas dans la lutte contre les noctuelles ou le mildiou ». Dès lors, ces pratiques franco-françaises « constituent une distorsion de compétitivité pour la production de tomates française dans la mesure où nos concurrents n'appliquent pas les mêmes normes54(*). »
Les conséquences sont mécaniques : baisse des rendements en raison d'impasses techniques ou d'une moindre efficacité des traitements ; hausse des coûts de production, les alternatives étant en général plus onéreuses et nécessitant davantage de passages ; dégradation des conditions de travail des agriculteurs (traitements la nuit).
Les producteurs rencontrés ne remettent pas en cause les motifs des interdictions de substances, qui sont souvent justifiées par des objectifs sanitaires ou environnementaux, mais le niveau géographique retenu pour l'interdiction. Si le produit est considéré comme dangereux, il devrait être interdit au niveau européen pour tous les producteurs de tomates. À l'inverse, s'il ne l'est qu'en France, d'aucuns s'interrogent sur les motifs de l'interdiction retenus en France, dans le même temps étudiés et rejetés par d'autres agences sanitaires européennes.
Enfin, la surtransposition va bien au-delà de la liste des substances puisqu'elle concerne également les modalités de commercialisation.
À l'initiative du Gouvernement, la France a par exemple interdit, en 2018 dans la loi dite « Egalim », le recours aux remises, rabais et ristournes lors de la vente de ces produits, estimant qu'une hausse des prix engendrerait mécaniquement une réduction des quantités utilisées. Cette justification était, aux yeux des rapporteurs, une incompréhension méprisante du métier d'agriculteur dans la mesure où elle reposait sur l'hypothèse que l'agriculteur épandait des pesticides pour le plaisir, au gré des fluctuations de marché. Le Sénat avait averti sur l'inanité de la mesure, rappelant l'élasticité quasi nulle des quantités utilisées de pesticides à leur prix d'achat. Les faits lui ont donné raison : la mesure s'est simplement traduite par une hausse des prix des intrants, donc par une baisse de la compétitivité française, sans impact sur les quantités épandues.
Là encore : aller au-delà de la norme européenne se fait au détriment de nos agriculteurs.
4. L'histoire de la « tomate cerise » : quand la tortue française se fait doubler par les lièvres d'autres pays dans la course aux marchés de niche
Concurrencés par les producteurs marocains, les maraîchers français ont décidé de conquérir des marchés de niche pour survivre. La montée en gamme a été perçue comme l'unique solution pour échapper à la crise de compétitivité.
Toutefois, ils ont été confrontés à « l'effet tomate cerise » au terme de trois étapes.
1) Investir le haut de gamme pour survivre à l'apparition d'un concurrent très compétitif
Largement soutenues par le gouvernement chérifien, par le biais du Plan Maroc Vert (PMV), les exportations vers l'Union européenne de tomates marocaines sont passées de près de 310 000 tonnes en 2012 à près de 440 000 tonnes en 2020. Par conséquent, les producteurs français ont réorienté leurs productions vers des segments à plus haute valeur ajoutée.
Les entreprises amont ont ainsi recouru à des certifications de plus en plus contraignantes (Global Gap, IFS, BRL, ISO 9001...), entraînant des dépenses importantes qui ont renchéri les coûts de structures.
En outre, la production de tomates « rondes » a été supplantée par celle de tomates grappe, qui a rapidement occupé un segment de marché majoritaire. Progressivement, d'autres variétés ont été conquises, comme les variétés allongées type Roma, des variétés dites « anciennes » (côtelées, coeur, Aumônières...) ou des plus petites variétés, cerises ou cocktail, plus sucrées.
2) Abandonner le coeur de gamme, au détriment de la productivité globale et au risque de la dépendance aux produits importés
Cette réorientation de la production vers des marchés de niche, laissant ainsi le marché de masse à des opérateurs étrangers, se retrouve dans les chiffres de rendement de la filière ces dernières années car ces variétés ont un moindre potentiel de rendement. En parallèle, le recul des surfaces en tomate ronde, qui sont des variétés à plus haut potentiel de rendement, affecte également à la baisse le rendement moyen.
Ainsi, si en 2016, la production française de tomates était de 800 000 tonnes, elle a été réduite de 23 % depuis, atteignant un niveau historiquement bas de 615 000 t en 2020. Le recul est en réalité entièrement expliqué par un recul du rendement moyen (de 176 t/ha en 2016 pour 134 t/ha en 2020) dû au développement des productions de niches comme les tomates anciennes.
3) Une fois le coeur de gamme perdu, se faire concurrencer sur les marchés de niche par les nouveaux leaders du marché
Les produits français ont rapidement été concurrencés par les leaders du marché.
Les producteurs marocains, en raison d'une augmentation des coûts de production ces dernières années et de la perte du marché russe, ont réorienté une partie de leurs surfaces consacrées à la tomate ronde vers des surfaces dédiées à la tomate cerise, mieux valorisée sur les marchés export.
L'offre marocaine est désormais axée pour plus de 50 % des volumes sur des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment les petits fruits (tomates cerises). En 2005, quand les tomates cerises représentaient 300 tonnes au sein des exportations marocaines, elles en représentent aujourd'hui 70 000 tonnes, soit une multiplication par 233 en 15 ans.
Il en résulte que « le positionnement compétitivité de la France s'est dégradé sur 10 ans notamment sur les références phares que sont les tomates cerises et les tomates cocktails. La Belgique et les Pays-Bas présentent des offres bien plus compétitives, tout comme le Maroc55(*). »
Désormais, les tomates rondes françaises occupent une place marginale, et les tomates cerises françaises sont perçues comme des produits de niche au prix plus élevé, réservé à certaines catégories de la population. En moyenne, les tomates « coeurs de pigeon » sont vendues à environ 1 € la barquette de 250 grammes, là où la barquette marocaine est à 0,54 €. Les producteurs essaient de rester attractifs en jouant sur les grammages, affichant toutefois un prix au kilo bien supérieur à celui de leurs concurrents.
Ainsi, à moyen terme, si la tendance se poursuit, la production de tomates cerises en France ne sera plus une activité lucrative faute de compétitivité. Globalement, dans la recherche d'un équilibre qualité-prix, « le Maroc, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas réussissent mieux que la France ». Enfin, les acheteurs valorisent la proposition d'une gamme complète de produits par des fournisseurs, allant de la tomate ronde à la tomate cerise, d'autant que ces productions ont lieu toute l'année.
Autrement dit : la stratégie de montée en gamme de la filière n'a pas été couronnée de succès, la France ayant été détrônée sur le coeur de gamme (tomate ronde) et le haut de gamme (tomate cerise). La course se poursuivant, les producteurs se réorientent désormais sur des variétés anciennes, espérant que, compte tenu de la distance à parcourir, certaines variétés plus fragiles (notamment les tomates côtelées) ne puissent être importées.
Cette course à la montée en gamme, justifiant de délaisser des marchés de masse du coeur de gamme pour des marchés de niche à plus forte valeur ajoutée plutôt que de mener une politique de compétitivité, est en réalité perdue d'avance, et aboutit, in fine, à la perte du marché du coeur de gamme et du haut de gamme.
Pour les rapporteurs, l' « effet tomate cerise » démontre la faiblesse de la stratégie du « tout haut de gamme » voulue par le Gouvernement. Car, sauf s'il existe des barrières à l'entrée majeure, il n'y a aucune raison pour que des concurrents plus compétitifs n'attaquent pas des niches à plus haute valeur ajoutée. Dès lors, la condition pour que la segmentation fonctionne est de mener, de front, une politique de compétitivité justifiant de ne pas abandonner le coeur de gamme.
L'ironie du sort veut, enfin, que le Gouvernement a soutenu cette stratégie marocaine de « développement accéléré d'une agriculture compétitive et à haute valeur ajoutée56(*) » en allouant une enveloppe de 151 millions d'euros au titre d'une opération à laquelle est liée l'Agence française de développement (AFD) pour promouvoir la productivité agricole, la résilience climatique et l'inclusion économique des jeunes dans les zones rurales au Maroc. Ce plan se traduira par la réalisation de certains projets, comme par exemple la construction de 5 000 ha de serres au Sahara Occidental, dont la majorité pour la culture et l'exportation de la tomate à destination de l'Europe.
Si le Gouvernement veut réellement lutter contre l'effet « tomate cerise », pourquoi ne pas mettre en oeuvre également un plan de développement d'une agriculture compétitive et à haute valeur ajoutée en France ?
5. Quand le Gouvernement donne le coup de grâce à la filière tomates : l'exemple des droits à l'importation et de la filière bio
a) Une digue à l'importation qui prend l'eau : le refus du Gouvernement de porter la révision européenne de la valeur forfaitaire à l'importation sur les tomates marocaines
Tout laisse à penser que la France a donc accepté de sacrifier sa filière tomates.
Un autre indice le démontre : l'absence de volonté du Gouvernement de revaloriser les droits à l'importation pour corriger le tir.
Les accords commerciaux signés entre l'Union européenne et les pays tiers limitent l'importation de la tomate fraîche, notamment à travers des droits de douane calculés selon une valeur forfaitaire à l'importation fixée à 0,461 € par kilogramme.
Depuis 2014, le montant des droits de douane spécifiques (qui s'ajoutent aux droits de douane ad valorem) dépend du prix d'importation. Les prix à l'importation font l'objet d'un suivi quotidien par des relevés quotidiens des prix sur les marchés de consommation, permettant d'établir des valeurs forfaitaires à l'importation. Lorsque le prix d'importation du produit est inférieur au seuil de 0,461€/kg, le droit spécifique devient très élevé, afin de limiter l'entrée de produits à bas prix en incitant les exportateurs à vendre leurs produits à des prix plus élevés.
Dès lors, en théorie, le système est favorable à la production française dans une optique de préservation des produits d'entrée de gamme.
Mais le système se retourne contre son concepteur : faute d'une actualisation de la valeur forfaire à l'importation depuis 2014, aucune évolution de la stratégie exportatrice marocaine n'est prise en compte. En effet, le mécanisme est contournable par une augmentation de la valeur moyenne de la tomate marocaine, qui passe au-dessus de la valeur forfaitaire à l'importation grâce à la montée en gamme de leur production, notamment sur le segment tomates cerises. Dès lors, conformément à l'accord, la production marocaine est exonérée de droits spécifiques.
Malgré cet outil de protection inefficace, le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir ce sujet au niveau européen, comme en témoigne l'absence de réponse aux questions parlementaires posées à ce sujet57(*).
b) Bio : quand l'État crée une distorsion majeure au détriment des producteurs français
Autre exemple démontrant l'écart entre le discours gouvernemental, théoriquement protecteur des intérêts des agriculteurs français, et la pratique ministérielle faite de surtranspositions pénalisant directement nos producteurs face à leurs concurrents : la pénalisation de la filière bio française.
Depuis 2019, la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique produits dans des serres chauffées a été encadrée : si le chauffage est autorisé, la commercialisation des produits bios issus de serres chauffées n'est pas autorisée entre le 21 décembre et le 30 avril58(*).
Mais cet encadrement de la commercialisation ne s'applique qu'en France, les principaux concurrents n'étant pas soumis à cette surtransposition. Il est donc possible de retrouver des tomates bios d'importation, non locales, issues de serres chauffées sur le marché français avant le 30 avril. Ainsi, entre janvier et avril, aucune tomate bio française ne peut être commercialisée sur les étals alors que des tomates bios produites, sous serres chauffées, en Espagne, peuvent, elles, être commercialisées dans les rayons en étant étiquetées bio. L'administration rue de Varenne a délibérément offert un monopole temporaire du marché bio à la tomate espagnole.
La situation est d'autant plus pénalisante qu'elle prive les producteurs français de la période de l'année où ils peuvent réaliser des marges intéressantes : en effet, les témoignages recueillis par les rapporteurs font état d'une acceptation du consommateur de payer plus cher des tomates premiums pour les premiers beaux jours de l'année, souvent à compter de la 10e semaine de l'année soit début mars.
Or, à ce moment où il cherche des tomates bios, il ne peut s'approvisionner qu'en tomates bios étrangères. Il ignore que les tomates françaises présentes sur les étals à ce moment, ont effectivement été cultivées selon les modes de production de l'agriculture biologique mais ne peuvent prétendre au label en raison d'un décalage calendaire.
La double peine s'applique aux producteurs français : ils commercialisent leurs tomates bios, produites avec des charges supplémentaires, au prix du conventionnel ; ils ne peuvent bénéficier d'un marché premium leur permettant de dégager des marges importantes, la réglementation ayant octroyé un monopole de fait aux tomates espagnoles.
6. La filière dispose pourtant de considérables atouts pour rebondir
« En effet, dans les années à venir, la gamme proposée par la France étant déjà très large, la difficulté pour les producteurs français sera de rester compétitifs face aux produits d'import proposés moins chers en rayons » : tels sont les termes utilisés par le consortium de producteurs entendu par les rapporteurs.
Et un producteur interrogé lors du déplacement d'ajouter : « si nous ne devenons pas plus compétitifs, on est « morts » à court terme. »
Malgré tous les éléments inquiétants relatifs à cette compétitivité, les rapporteurs ont été frappés par l'optimisme de l'ensemble des acteurs de la filière qu'ils ont rencontrés concernant les prochaines années... si toutefois la politique menée actuellement venait à être modifiée et que les impératifs de compétitivité étaient remis à l'ordre du jour, bien entendu.
Il est vrai que la filière française dispose d'un avantage majeur par rapport à ses principaux concurrents : la disponibilité en eau.
« Si le Maroc dispose de quantités appréciables d'eaux de surface et souterraine, l'accès aux ressources hydriques est marqué par une forte irrégularité annuelle, avec des épisodes de sècheresse, mais aussi d'inondations, de plus en plus récurrents et de plus en plus intenses. De plus, les ressources en eau sont très inégalement réparties sur le territoire, puisque 93 % du pays se situe en zone aride et désertique. Compte tenu des ressources disponibles et des conditions climatiques, l'irrigation est un impératif technique incontournable dont les retombées économiques et sociales sont indéniables. L'irrigation, et donc le secteur agricole, utilisent aujourd'hui 86 % des ressources en eau contre 5,5 % pour l'industrie, principalement dans le nord-ouest du pays et dans le Casablanca-Mohammedia et 8,5 % pour la consommation humaine59(*) ».
Avec le Plan Maroc Vert, d'aucuns estiment que le « développement de l'irrigation a contribué à la surexploitation de la plupart de ressources en eaux souterraines et à la baisse alarmante des niveaux de plusieurs nappes, ainsi qu'à la dégradation de la qualité de l'eau. » Dès lors, « la plupart des prévisions montrent qu'au cours des prochaines décennies, le pays affichera progressivement des signes d'aridité croissante en raison de la hausse des températures et de la diminution des précipitations60(*) (Balaghi et al., 2015). » La hausse de la température moyenne et la réduction des précipitations pourraient, en complément d'une raréfaction des ressources en eau, augmenter la pression pathogène sur les cultures. L'Institut des Ressources Mondiale (WRI) place le Maroc, au regard du risque de stress hydrique, parmi les pays « extrêmement risqués ».
La sécheresse de 2022 donne un avant-goût des défis que devra relever l'agriculture marocaine. Le cumul moyen des précipitations des cinq derniers mois affiche un déficit de 64 % par rapport à la normale climatologique. Le stress hydrique est tel que l'irrigation des terres agricoles par les barrages a déjà été quasiment interrompue en raison des volumes d'eau trop faibles. Le 17 février, le taux de remplissage moyen des barrages n'était que de 33,2 %61(*). Les pompages illégaux dans les cours d'eau se développent tandis que de nouveaux projets de dessalement pourraient, eux, voir le jour, mais d'ici quelques années.
Dans ce contexte, bien entendu, la tomate pourrait devenir une « ressource rare » pour laquelle la France pourrait retrouver une partie de souveraineté dès lors qu'en France la pression de l'agriculture sur les ressources en eau n'est que de 1 %62(*).
Mais relever ce défi ne se fera qu'à la condition de redevenir compétitif pour ne pas simplement substituer des importations d'un pays par des importations d'un autre pays moins soumis au stress hydrique mais toujours plus compétitif que la France, notamment en Europe du Nord.
Le seul moyen d'y parvenir est, selon de nombreux acteurs de la filière, d'investir.
Mettre en culture 1 hectare de tomates sous serres nécessite un investissement initial compris entre 1,4 et 1,8 million d'euros. Ces investissements très importants pourraient, à l'avenir, être complétés par des dépenses supplémentaires de mécanisation en faveur de robots de récolte et d'effeuillage, de capteurs identifiant les insectes ou champignons pour permettre des traitements localisés...
Dans un contexte d'incertitudes de marché, accrues ces derniers mois par une hausse importante des charges, tous les acteurs ont fait part aux rapporteurs de leur besoin d'un signe des pouvoirs publics pour les accompagner afin de préparer l'avenir. Or « les aides FranceAgriMer spécifiques aux investissements serres sont arrêtées depuis 2017 ». Les besoins sont pourtant colossaux : en témoigne la consommation en seulement 24 heures des 10 millions d'euros d'aides à l'investissement temporaires dans les serres agricoles, ouvertes par FranceAgriMer en janvier 2022 à la faveur du plan de relance.
De même, dans la tomate d'industrie, « l'investissement dans les outils d'automatisation et de robotisation est déterminant pour nos industries. Or, la dégradation du taux de marge des industries agricoles et alimentaires (IAA) françaises a conduit à un manque d'investissement qui a provoqué à terme une baisse de la productivité », au moment même où les concurrents de la France réalisaient des progrès rapides en la matière, aidés par les fonds structurels européens. « Aujourd'hui, le matériel est vieillissant [...]. Le manque de visibilité n'a pas poussé les agriculteurs à réinvestir à l'issue de l'amortissement du matériel63(*). »
C. POUR EXPORTER, IL FAUT PRODUIRE ET POUR PRODUIRE, IL FAUT DES REVENUS : EN L'ABSENCE DE POLITIQUE DE COMPÉTITIVITÉ, CE SONT LES PRODUCTEURS LAITIERS QUI PAIENT POUR LE MAINTIEN DE LA PUISSANCE AGRICOLE FRANÇAISE
1. Le « miracle laitier français » d'un modèle familial fonctionnant sur ses deux jambes, marché intérieur et marché extérieur
a) Une performance économique remarquable pour un modèle familial et diversifié
La production française de lait de vache est d'environ 24 milliards de litres de lait chaque année, ce qui représente environ 3 % de la collecte mondiale. La France est le deuxième producteur européen de lait, derrière l'Allemagne, avec 54 000 fermes laitières livrant du lait de vache, s'occupant de près de 3,4 millions de femelles laitières. La transformation emploie 68 000 salariés directs et est à l'origine de plus de 230 000 emplois au total.
Ces performances ne manquent pas d'étonner compte tenu du choix du modèle français, qui se veut familial et diversifié, deux caractéristiques handicapantes en termes de compétitivité « prix ».
Le modèle français se différencie de ses concurrents avant tout par sa grande diversité de produits proposés.
Cela se traduit par une grande profondeur de gamme, tant dans les produits de grande consommation (lait, crème, yaourt, desserts lactés, fromages blancs, fromages...) que dans les produits industriels (beurre, poudres de lait...).
Au niveau de la production, par exemple, la Ferme France tire ses ressources d'exploitations situées dans des régions spécialisées, offrant une véritable diversité des climats, allant des bassins laitiers de plaine, qui représentent 45 % de la production, jusqu'aux « montagnes laitières », pour 23 % de la production, avec, entre deux, un modèle de fermes situées sur l'ensemble du territoire ayant fait le choix de la polyculture-élevage. Il en résulte une présence laitière partout en France.
Plus de 20 % du lait collecté est différencié par son origine, à 11 % au travers d'appellations d'origine et à 6 % par le biais de démarcations équitables, régionales ou géographiques ou par une mention valorisant des modes de production (pâturage, sans OGM...). La France dispose de 51 AOP et de 10 IGP en produits laitiers. En outre, près de 5 % de la collecte relève de l'agriculture biologique.
La diversité se retrouve également dans les races, où le taux de diffusion de la Holstein est largement inférieur à ceux rencontrés dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple64(*). En France, la Prim'Holstein côtoie la Montbéliarde et la Normande, sans oublier l'Abondance, la Bleue du Nord, la Brune, la Jersiaise, la Rouge et la Rouge flamande, la Simmenthal française, la Tarentaise et la Vosgienne65(*). Cette diversité est, sans doute, la plus profonde dans l'ensemble des grands pays laitiers.
Au niveau de la transformation, le lait français est renforcé par une différenciation retardée qui accroît la diversité des produits proposés. Cette stratégie est appuyée sur des marques à forte image et notoriété, stratégie appuyée par des géants industriels, dont 4 figurent parmi le top 20 mondial66(*).
Ainsi, le portefeuille de produits français est composé « de produits très différents, parfois à la typicité affirmée, aux qualités spécifiques et reconnues. Cette diversité est un atout indéniable pour stimuler la demande intérieure, qui reste, par habitant, parmi les plus élevées du monde (en raison surtout des fromages) mais aussi pour s'imposer autrement que par les prix sur le marché européen et au-delà67(*). » C'est aussi, bien entendu, un handicap en matière de compétitivité-prix, notamment face aux concurrents spécialisés dans les commodités laitières standardisées à bas coût.
Un autre trait essentiel, mentionné par l'ensemble des personnes entendues par les rapporteurs, est le caractère familial du modèle de la ferme laitière française.
Selon les données de l'interprofession de la filière laitière, les exploitations laitières françaises comptent en moyenne 92 hectares, dont 32 hectares de prairies pâturées par les vaches ou produisant les fourrages. En France, une ferme laitière compte en moyenne 66 vaches.
À titre de comparaison, en Nouvelle-Zélande, pays où il y a deux fois plus de vaches laitières que d'habitants, les troupeaux sont en moyenne de 400 vaches par ferme. En Allemagne, la moyenne est d'environ 200 vaches laitières par exploitation.
En Europe, la France fait partie des modèles avec le plus faible nombre d'élevages de plus de 100 vaches laitières (sans que ce seuil ne donne pour autant d'indication pertinente sur la taille idéale d'une exploitation).
Ainsi, si au Danemark, 95 % des vaches laitières appartiennent à des troupeaux de plus de cent vaches laitières, ce taux se situant entre 40 et 60 % dans les autres pays européens, il n'est que de 30 % en France. Seule la Pologne, au modèle plus vivrier, présente un seuil inférieur proche de 10 %.
Certes, en raison de la dynamique démographique et des difficultés rencontrées par les plus petites exploitations, la concentration s'accélère. Le nombre d'étables de plus de 100 vaches laitières a ainsi augmenté entre 700 à 1 000 par an de 2013 à 2020. Toutefois, la France ne rattrape pas son retard en la matière. Au contraire, depuis 2020, la courbe s'aplatit, le nombre d'élevages de plus de 100 vaches laitières n'augmentant plus que de 200 par an en moyenne.
Il en résulte que les volumes de lait par exploitation sont plus parmi les plus faibles d'Europe.
Litres de lait produits par unité de travail agricole (UTA)
Source : Institut de l'Élevage.
Finalement, malgré ces choix pénalisant mécaniquement la compétitivité prix de la filière, notamment au regard des modèles plus intensifs des principaux concurrents, la France demeure un des principaux pays laitiers. C'est, aux yeux des rapporteurs, le « miracle laitier français ».
b) Une économie de filière reposant sur deux jambes : le marché intérieur et l'exportation
(1) Une production majoritairement dédiée à une consommation française de produits laitiers particulièrement importante par rapport au reste du monde
La réussite de la filière laitière française s'explique par sa performance à la fois sur le marché intérieur et le marché extérieur.
Car le premier marché visé par les producteurs laitiers français demeure le panier des consommateurs nationaux, où un véritable combat de captation de valeur a lieu : en effet, le marché intérieur demeure le premier débouché de la production laitière française pour environ 58 % de la collecte.
Cela s'explique par une consommation comparativement plus forte en France de produits laitiers par rapport à d'autres pays. Les Français consomment en effet l'équivalent de 561 litres par an, là où les Allemands n'en consomment que 518 litres, les Américains 350 litres, les Brésiliens 138 litres et les Argentins 197 litres. Cela fait du marché français sans doute le troisième plus gros marché au monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne, pour les producteurs de lait68(*).
Cette production, destinée à la consommation française, est essentiellement vouée à la consommation de fromages (21 %), de beurre (14 %), de laits conditionnés (9 %), d'ingrédients secs (7 %), de yaourts/desserts (5 %), et de crème (3 %)69(*).
D'autant que les habitudes de consommation des ménages les conduisent à privilégier des consommations de produits laitiers français par le biais de la vente au détail, principalement dans les grandes et moyennes surfaces (42 % de la collecte) et de manière plus marginale mais non négligeable au sein de la restauration hors domicile (5 %) et les industries agroalimentaires non laitières (11 %).
(2) Une performance efficace sur les marchés internationaux, grâce aux fromages et aux produits laitiers secs techniques
42 % de la collecte nationale est, de son côté, tournée vers l'exportation, ce qui en fait une part importante du revenu final de l'agriculteur. Les exportations sont à hauteur de 60 % à destination de l'Union européenne.
À la source de cette tournure vers les marchés extérieurs se trouve un atout essentiel de la filière française : sa compétitivité. FranceAgriMer estime en effet que la France est le pays laitier le plus compétitif du monde70(*), devant d'autres géants comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Danemark, ou d'autres acteurs majeurs comme l'Irlande.
Parmi ses principaux atouts, la France compte notamment :
- Un marché de consommation mature et diversifié, sur lequel s'appuient les producteurs ;
- Une production régulière et stable dans le temps, témoignant d'un niveau de maîtrise technique élevé ;
- Une diversité du portefeuille des marchés et des implantations industrielles à l'étranger, grâce au réseau d'implantations de géants laitiers figurant dans le top 20 mondial des entreprises laitières ;
- Un niveau de recherche reconnu et une veille sanitaire efficace ;
- Une marge sur coût alimentaire bien positionnée ;
- Un taux d'endettement maîtrisé, grâce à un prix du foncier modéré malgré des investissements en bâtiment importants ;
- Des performances logistiques dans la moyenne haute71(*).
Il en résulte un niveau d'exportations important, d'environ 10 milliards de litres de lait, conférant à la France la place de 4e exportateur mondial avec 7,5 Mds€ en moyenne 2019-2021, derrière la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l'Allemagne.
Les échanges internationaux de produits laitiers représentent, en réalité, un marché certes limité d'environ 8 % de la production mondiale mais connaissant une forte croissance (estimée à + 67 % entre 2000 et 2016) sous l'impulsion de la demande asiatique. Il attise dès lors toutes les concurrences entre pays exportateurs qui rivalisent de positionnements différents.
Premier exportateur mondial avec plus de 12 Md$ de lait exporté, la Nouvelle-Zélande est, par exemple, très compétitive en raison d'atouts indéniables pour produire des laits à bas coûts, notamment par la valorisation de l'herbe, lui permettant de détenir des positions dominantes sur le marché des commodités laitières pour le lait à bas prix et d'exporter ces produits vers les marchés porteurs, principalement asiatiques.
L'Union européenne, de son côté, se spécialise principalement dans l'exportation de fromages.
La France, de son côté, se distingue de ses concurrents par des exportations importantes de fromages (plus de 30 % de ses exportations en volume et sans doute 45 % en valeur), d'ingrédients secs et de poudres de lait infantile, qui lui permettent de dégager de la valeur ajoutée.
In fine, cet avantage comparatif se traduit par un excédent commercial important de 3,5 milliards d'euros en 2021.
2. Un modèle à la renverse ? Un géant qui n'est plus performant dans un marché porteur
a) « On n'exporte pas ce qu'on ne produit pas »
La première source de préoccupation est donc la stabilité de la collecte laitière française depuis 2011.
Depuis la fin des quotas, seule la Normandie a augmenté sa production laitière, la Bretagne ne faisant que stabiliser la sienne. Autrement dit : hormis dans le « fer à cheval laitier » breton et normand, qui représente une part importante de la production française, la collecte recule dans toutes les autres régions françaises, et de manière impressionnante dans le Sud-Ouest et en Poitou-Charentes.
Évolution de la collecte de lait de vache sur 12 mois glissants en France
Source : Institut de l'Élevage.
Malgré des atouts majeurs, la filière laitière française semble pâtir d'une dynamique négative depuis la libéralisation des quotas laitiers en 2015. Tout se passe comme si cet événement majeur sur les marchés mondiaux avait abouti à remettre en cause ce « miracle laitier français », tandis qu'il profitait, dans son ensemble, à la filière laitière européenne : quand la collecte laitière européenne a augmenté de 6 % entre 2015 et 2021, elle a été réduite de 2 % en France.
Évolution de la collecte de lait de vache annuelle en base 100 (2010)
Source : Institut de l'Élevage.
À l'heure où la Chine est devenue acheteuse sur les marchés internationaux et alors que certains concurrents majeurs ont pu s'essouffler, comme ce fut le cas avec la Nouvelle-Zélande, ou se sont concentrés sur leurs marchés proches, comme les États-Unis avec leurs voisins de l'ALENA, plusieurs pays de l'Union européenne ont profité d'un marché dynamique et ont gagné des parts de marché : l'Irlande, les Pays-Bas et, dans une moindre mesure, la Pologne, ont ainsi presque triplé leur solde commercial laitier entre la moyenne de la 2000-2009 et l'année 2021, quand l'Allemagne l'a doublé. La France, de son côté, n'a pas connu un tel niveau de croissance de son excédent commercial.
Le solde commercial des États membres de l'Union européenne en produits laitiers (en milliards d'euros courants entre 2000 et 2021)
Source : INRAE.
Le phénomène se retrouve donc mécaniquement dans le recul des parts de marché de la France dans les exportations mondiales, qui sont passées de 10,8 % en 2010 à 8,7 % en 202172(*).
Comme le rappellent les industriels entendus par la mission, « la principale explication à la stagnation des exportations est la stagnation de la collecte laitière73(*). »
La stabilité de la collecte laitière française, à l'heure où elle augmente dans d'autres pays comparables, se traduit inévitablement dans les volumes exportés, la France étant le seul pays européen dont les exportations n'ont pas augmenté en volume et en valeur depuis 2013.
Comme plusieurs interlocuteurs l'ont signalé aux rapporteurs, le problème de la filière laitière est d'avoir tous les atouts pour réussir sur un marché mondial porteur mais qu'elle ne produit pas. Autrement dit « on ne peut pas exporter ce qu'on n'a pas produit ».
b) Un décrochage de l'excédent commercial français dû aux échanges avec le reste de l'Union européenne en termes de compétitivité prix
En parallèle, l'excédent commercial français connaît une tendance à l'érosion depuis 2011 en raison de trois phénomènes :
- une disparition de l'excédent commercial laitier avec les autres pays de l'Union européenne...
- ... expliquée principalement par une hausse des denrées importées auprès de partenaires européens, traduisant des difficultés en matière de compétitivité prix...
- ... et non compensée par la croissance des exportations à destination des pays tiers.
(1) Une France laitière quasi déficitaire avec ses voisins européens
Le principal facteur réside dans la disparition de l'excédent avec les autres pays de l'Union européenne, la France laitière étant quasi déficitaire avec ses voisins européens depuis 2016 : le solde commercial est de + 110 M€ en 2021 alors qu'il était de + 1,2 Mds€ en 2010.
Solde des échanges français de produits laitiers
Source : FranceAgriMer.
Avec la hausse de la production européenne plus dynamique que la production nationale, les éleveurs ont perdu des parts de marché à l'export intra-européen, tout en étant davantage exposé à des importations plus compétitives.
Comme le rappellent les industriels entendus par la mission, « vers l'Union européenne, les exportations françaises de fromages sont restées stables alors que les exportations de produits de grande consommation crèmerie (crème, ultra frais, lait liquide) sont en baisse sur les 10 dernières années. L'Union européenne est un marché hyper concurrentiel et mature qui progresse peu. Néanmoins, pour la filière française ce marché représente une opportunité pour vendre nos produits laitiers français à haute valeur ajoutée. Sur ce segment, [...] la France est concentrée sur l'exportation de produits traditionnels vers l'Union européenne : fromages type plateaux, lait liquide et ultra frais. Sur le marché européen, ces deux derniers sont néanmoins en réduction de consommation. Pour les fromages, les fromages français ne sont autant sollicités que les fromages italiens ou les fromages industriels (de type italiens, cheddar ou feta). Les fabrications françaises ne correspondent pas avec les marchés en croissance en Europe74(*). »
En somme, la dégradation du solde avec l'Union européenne est liée à une aggravation du solde négatif sur les matières grasses solides, qui n'est plus compensé par le commerce sur les autres produits, notamment les produits ultrafrais et qui subit une concurrence accrue sur le haut de gamme et l'entrée de gamme sur le marché des fromages.
Solde des échanges français de produits laitiers par type de produits
Source : Institut de l'Élevage.
Comme le mentionnent les économistes Christophe Perrot et Vincent Chatellier, « même si elle semble avoir peu écorné la consommation intérieure de produits nationaux sur le marché des produits de grande consommation (PGC), cette production européenne supplémentaire s'est traduite par une hausse des importations françaises de fromages (ingrédients pour la plupart). Économiquement parlant, ces pertes de parts de marché sont synonymes de perte de « compétitivité prix » du secteur laitier français qui n'a pas été compensée par une amélioration de la compétitivité « hors prix75(*) » ».
Là encore, un des éléments pénalisant les producteurs français est une tendance à mettre en place des exigences non valorisées par le marché, au détriment des producteurs.
Deux exemples ont été avancés lors des auditions par les professionnels :
- Le « sans OGM » : « en France, la définition du sans OGM se fait par décret en conseil d'État alors que les autres pays européens appliquent directement les directives européennes sans transposition supplémentaire. Le résultat est que le délai de conversion en France est de 6 mois dans les élevages bovins contre 3 mois en Allemagne où la législation est régie par un cahier des charges privé » ;
- Le recyclage des eaux : « le cadre est plus restrictif en France alors que d'autres états membres de l'Union européenne sont autorisés à réutiliser les eaux issues de la transformation laitière. Dans un contexte de réchauffement climatique, d'économie circulaire et en période de vague de chaleur, la tension sur l'eau est de plus en plus forte et ce cadre doit évoluer. »
(2) Une hausse structurelle des importations, pour couvrir des déficits de production et pour approvisionner les industries non laitières et la restauration hors foyer à des prix compétitifs
La France est ainsi devenue le 4e importateur mondial de lait76(*), avec un niveau de plus de 4 milliards d'euros par an. Ce niveau a plus que doublé en valeur depuis 2000.
Elles sont principalement originaires de l'Union européenne (à plus de 95 %), et concernent principalement des matières grasses solides, pour lesquelles la France accuse un déficit de production. Ainsi, comme le rappelle FranceAgriMer dans son étude, « étant donné le mix produit de ses fabrications, très axé sur les fromages qui nécessitent une quantité de matière grasse laitière importante, et de la demande en beurre sur le marché national, tous circuits confondus, la France ne peut répondre à ses propres besoins en beurre et en est donc fortement importatrice, et ce d'autant plus que la collecte de lait de vache s'est érodée au cours des dernières années. » Elle est ainsi très largement déficitaire en beurres industriels, l'avantage étant de ne pas avoir à trouver un débouché à la matière protéique induite.
Mais la difficulté provient également d'une divergence entre l'offre et la demande dans la transformation française : « pour les fromages, la consommation en France se tourne vers les fromages italiens, obligatoirement importés, et des fromages dits industriels (mozzarella pour pizza et cheddar pour les burgers) utilisés par l'industrie agroalimentaire et qui souvent ne sont pas produits en France77(*). »
Au total, la consommation nationale de produits laitiers n'est plus assurée que par deux tiers de produits laitiers fabriqués en France, comme le montre le graphique ci-dessous78(*). Les principaux pays fournisseurs sont les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, et l'Italie. Pour deux tiers de la valeur, ces importations sont des fromages et du beurre.
Part de la production et des importations de lait par circuit de distribution
Source : Institut de l'Élevage.
Bien entendu, la pénétration dans les linéaires des supermarchés de produits laitiers importés demeure faible. En revanche, les importations privilégient l'emprunt de deux canaux, invisibles des consommateurs, où prédomine la recherche des meilleurs prix : la restauration hors domicile et les industries agroalimentaires de produits non laitiers.
La restauration hors domicile représente, pour les produits laitiers, un débouché relativement secondaire, pesant pour environ 10 % de la consommation nationale. La demande est concentrée majoritairement sur des matières grasses solides compétitives. Compte tenu de leur recherche d'un prix bas, les fluctuations des prix du lait sur les marchés internationaux ont un impact majeur sur les variations des importations : ainsi, la baisse plus rapide du prix du lait à la production entre 2015 et 2016 en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique a abouti à une forte concurrence pour les matières grasses solides françaises sur le segment et à une perte de parts de marché. On estime, aujourd'hui, que l'approvisionnement de la RHF en produits laitiers n'est plus assuré qu'à 60 % par des produits français.
Un autre débouché favorable pour les produits laitiers importés est l'industrie agroalimentaire non laitière. Ce canal est pourtant majeur puisqu'il représente près de 33 % des volumes de lait destinés au marché national. Il s'agit principalement de livrer des ingrédients issus du lait, comme la crème fraîche, le beurre, de la poudre de lait, des caséines ou des protéines sériques, à certains industriels spécialisés dans la biscuiterie, la chocolaterie, la production de glaces, la pâtisserie ou la viennoiserie voire l'alimentation animale.
Or, sur ce débouché industriel agroalimentaire, les ingrédients laitiers importés couvrent près de 60 % des besoins. Outre le manque de disponibilité de nombreux produits comme le beurre, se pose de manière prépondérante la question de la compétitivité de la ferme France pour certains ingrédients secs comme les caséines ou la poudre de lactosérum pour l'alimentation animale. Sur ces segments, les opérateurs se tournent vers les produits de commodités où règne le facteur prix, bien avant le pays d'origine, qui n'est pas apparent pour le consommateur.
Toutefois, lorsque les fabricants s'approvisionnent en ingrédients laitiers spécifiques, à haute valeur ajoutée, les producteurs français sont plutôt bien positionnés : c'est le cas par exemple de certaines poudres de lait pour les chocolatiers ou de certains beurres pour les pâtissiers.
À ce jeu où la compétitivité prix est un déterminant essentiel des achats, les producteurs néerlandais, espagnols, irlandais et italiens tirent leur épingle du jeu, ce qui se retrouve dans la dégradation du solde commercial français avec ces partenaires depuis 2010.
(3) Des performances à l'export vers les pays tiers qui ne compensent pas les pertes sur le marché européen
Le tableau n'est pourtant pas totalement noir puisque, dans le même temps, le solde commercial avec les pays tiers est en forte augmentation.
Les exportations vers les pays tiers ont pris plus d'ampleur au début des années 2010 : la hausse de plus de 2 milliards d'euros des exportations françaises de produits laitiers en l'espace de 10 ans s'explique à 75 % par la conquête de nouvelles positions auprès des pays tiers, notamment de produits secs, de matières grasses solides et de produits ultrafrais, et principalement la Chine.
(4) Un positionnement sur les marchés internationaux remis en question ?
La stratégie de filière, impulsée par l'État, vise à retrouver de la valeur sur le marché national, consolidant ainsi son marché de prédilection par la montée en puissance de la « marque France ».
Cependant, cette stratégie « de montée en gamme » présente trois limites selon les acteurs entendus par la mission :
- La stratégie de consolidation de ses assises économiques auprès de ses partenaires fait passer la France à côté de certains marchés porteurs et limite ainsi le potentiel de développement. Ses clients sont principalement le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Mais la France est faiblement présente sur des marchés porteurs comme ceux du Nigéria, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, du Mexique, de certains pays d'Asie du Sud-Est...
- Le positionnement français cherchant de la valeur ajoutée induit une moindre performance sur le marché international où la compétitivité prix domine. Sur ces marchés à l'export, la compétitivité « hors prix » est en réalité peu valorisée. Un des fleurons français, le Comté, rencontre, par exemple, des difficultés à l'export puisque seuls 8 % des volumes sont exportés, principalement à destination des pays limitrophes de la zone de production. Plusieurs personnes entendues ont rappelé, de manière très claire, que « l'origine France » n'est pas valorisée sur les marchés laitiers internationaux, ce que confirment les études économiques sur le sujet. « Quant aux commodités laitières, les poudres de lait françaises ne bénéficient pas, aux yeux des acheteurs, d'une image de qualité supérieure79(*) », rappelait par exemple l'Idele en 2020.
- Même sur ses marchés de niche à forte valeur ajoutée, la France est concurrencée. Par exemple, la stratégie de la filière fromagère française de montée en gamme trouve, également, une limite dans la percée des fromages européens premiums. Bien sûr, certains exemples sortent du lot comme celui du Comté. Mais il n'en demeure pas moins que les importations de fromages européens ont progressé depuis 2000 de près de 159 % en valeur, tirées principalement par un effet prix puisque les tonnages ont augmenté moins rapidement. Cela se traduit par la présence croissante de fromages importés de l'étranger à l'image reconnue ou associés à la gastronomie.
Ces fragilités pèsent directement sur les performances de la ferme laitière et, partant, sur le revenu des agriculteurs : « cette stratégie de repli sur le marché intérieur français des PGC, très important en valeur, ne s'est néanmoins pas avérée être un choix très profitable pour les éleveurs français. La France est le seul grand pays laitier européen dans lequel les revenus laitiers ont (très légèrement) diminué entre 2007-2012 et 2013-2017. [...] Malgré ce marché intérieur français réputé et malgré les nombreux atouts de la France laitière tant en production qu'en transformation, l'équation n'a pas été facile à résoudre pour les producteurs français qui peuvent apparaître comme les moins bien placés en Europe du Nord à l'issue de cette première manche de l'après-quota80(*). »
Dès lors, contrairement aux conclusions généralement véhiculées de spécialisation sur la « montée en gamme », quitte à réduire le potentiel productif, la conclusion semble toute différente : le lait français traverse une crise notamment due à des pertes de part de marché en Europe mais aussi sur son propre marché intérieur, faute d'une compétitivité prix suffisante et d'une production dynamique. Ce sont ces points qu'il convient de corriger, comme le rappelle FranceAgriMer : « sous condition d'une bonne compétitivité prix, l'enjeu de la France est donc de redonner une place aux produits français, à la fois sur son marché (pour limiter les importations) et sur les marchés européens81(*) ».
3. Le vrai facteur compétitif de la France : des revenus laitiers de plus en plus décalés par rapport aux autres grands pays laitiers de l'Union européenne
Comme dans de nombreux secteurs, principalement ceux déjà étudiés, la France est freinée, dans sa quête de compétitivité prix, par plusieurs handicaps structurels, au premier rang desquels figurent les coûts de main-d'oeuvre salariée et les exigences sociales et sociétales créant des distorsions de concurrence.
Bien entendu, d'autres facteurs influencent cette compétitivité générale, dans un sens positif ou négatif, comme l'exposition relativement plus maîtrisée aux incidents climatiques et une bonne gestion de la sécurité sanitaire.
Toutefois, tout au long des auditions, les professionnels ont mis en avant une antienne : « nous sommes compétitifs car les éleveurs laitiers français, fiers de leur modèle familial, ont un faible revenu. »
Autrement dit : à défaut de politique de compétitivité, les éleveurs maintiennent la France sur la scène internationale au prix d'un revenu plus faible.
Les coûts de production des exploitations laitières françaises sont effectivement dans la moyenne haute des coûts observés chez les principaux États-membres présents sur les marchés laitiers, mais ce différentiel proviendrait, surtout, d'un déficit de productivité plutôt que d'un surcoût général sur les postes de charges.
En effet, « les performances des exploitations françaises ne les situent pas en haut du tableau avec un rendement laitier moyen de 6 856 tonnes par vache (contre 7 597 en Allemagne) et un ratio total des produits/total des charges qui est tout juste égal à 100 %. La valeur de ce dernier ratio traduit bien la réalité ressentie par les éleveurs français quand ils disent que les résultats de leur activité couvrent à peine leurs dépenses. Ailleurs en Europe, les principaux concurrents des éleveurs français dégagent un ratio supérieur à 100 %82(*). »
Les chiffres sont en effet éloquents : le revenu courant avant impôt par actif non salarié français est en effet largement inférieur aux revenus des autres grands pays laitiers, principalement en raison d'une absence de dynamique de croissance.
Au total, les revenus des éleveurs français sont aujourd'hui plus proches des revenus polonais que des revenus irlandais, danois ou néerlandais.
Revenu courant avant impôts par unité
de travail agricole non salariée
dans la filière
laitière en Europe
Source : Institut de l'Élevage.
Cela découle, bien entendu, d'un prix du lait payé en lait conventionnel, autour de 353 € les 1 000 litres, insuffisant pour couvrir les coûts de revient moyen des producteurs estimés, en 2020, à 405 € les 1 000 litres83(*).
Le modèle français se situe à un niveau intermédiaire, ne disposant ni des prix du lait élevés des Néerlandais et des Danois ni du faible coût de production des Irlandais.
Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, les éleveurs laitiers français ont un point mort définissant leur rentabilité relativement avantageux à la tonne de lait. Mais dès lors que sont réintégrés des revenus identiques dans tous les pays concurrents, la France devient moins compétitive, ce qui démontre que la variable d'ajustement en matière de compétitivité laitière est bien le revenu des éleveurs.
Prix du lait et prix de revient pour 2 SMIC français
Source : Institut de l'Élevage.
Il en résulte une situation inacceptable : seuls 39 % des éleveurs laitiers atteignent le salaire médian.
Le coût de l'autonomie
fourragère : avantage ou inconvénient
pour la
compétitivité de la filière
laitière ?
Une autre explication avancée du manque de compétitivité de la filière laitière est le coût de l'autonomie fourragère, partie intégrante du modèle familial français. En effet, comme le rappelle la FNPL, « l'autonomie alimentaire pour les producteurs de lait est quasiment de 100 % : 3 kg (en moyenne) sur 70 kg de la ration de la vache sont achetés84(*) ».
Toutefois, parmi les charges de structure des principaux pays laitiers européens, la France se distingue par des coûts dans la moyenne haute, principalement en raison de coûts alimentaires plus élevés que la moyenne. Promouvant un modèle d'autoconsommation dans les fermes, le modèle laitier induit, en réalité, des coûts de mécanisation élevés qui rendent, comparativement plus onéreux, le coût alimentaire français. Toutefois, ce fonctionnement n'est pas dénué d'avantages, notamment en matière de résilience, de souveraineté et de biodiversité.
4. Une tempête dans nos verres de lait : vers le plus vaste plan social laitier des dernières années ?
La faiblesse structurelle des revenus pose une question fondamentale : comment donner envie aux jeunes générations de faire grandir la filière laitière française ?
Pour les rapporteurs, recueillant de nombreux témoignages sur le sujet, le seuil d'acceptation sociale semble avoir été dépassé par les jeunes éleveurs.
Car à la faiblesse des revenus s'ajoutent la force et le poids des critiques et des anathèmes.
Pour les rapporteurs, si le progrès technique a permis d'améliorer le quotidien des éleveurs jusqu'au début des années 2000, ce bien-être de l'éleveur est aujourd'hui remis en cause par une pression psychologique sans précédent. Quand on ajoute à cette pression psychologique une dégradation des conditions de vie économique, l'attractivité de la filière se réduit. Cela se retrouve dans plusieurs indicateurs.
Pour lutter contre la faiblesse des revenus, le nombre moyen de vaches laitières en France est passé de 40 à 66 vaches de 2005 à 2020, les écarts s'étant accentués entre les zones de plaine et de polyculture-élevage (entre 70 et 80 vaches en moyenne) et les zones à faibles densités laitières ou les zones de montagne (50 vaches).
Cette hausse structurelle de la taille des troupeaux n'a pourtant pas abouti à une amélioration des revenus, tout en accroissant la charge de travail des éleveurs en l'absence d'un recours accru à de la main-d'oeuvre salariée et à défaut d'une robotisation suffisante. Si le salariat en élevage laitier s'est considérablement développé depuis vingt ans, tout comme l'automatisation, les statistiques témoignent d'un recours moyen inférieur à des pays concurrents.
S'agissant du recours à de la main-d'oeuvre salariée, le taux de salariat est d'environ 10 % contre 15 % en Irlande, près de 30 % en Allemagne et 60 % au Danemark85(*).
Au total aujourd'hui, 10 % des exploitations laitières sont équipées d'un robot de traite, permettant à 17 % des vaches laitières françaises d'être traites par un dispositif automatisé. À titre de comparaison, le nombre d'exploitations équipées est de 25 % au Danemark et entre 20 et 25 % aux Pays-Bas. De même, le taux d'équipement des éleveurs bovins laitiers en capteurs et autres automatismes se situe sans doute entre 25 et 30 %, loin des niveaux d'autres pays86(*).
Dans la filière laitière, la spirale infernale est donc enclenchée : la faiblesse des revenus pénalise les investissements qui permettraient de déclencher de nouveau le cercle vertueux de la hausse des revenus. Dès lors, le niveau de vie des exploitants aux revenus les plus faibles ne s'améliore pas tandis que ceux qui bénéficient d'un revenu plus important, pouvant investir, voient leur revenu progresser87(*). Cette pénalisation des exploitations les moins rentables s'explique surtout par le coût incompressible du système d'alimentation.
En parallèle, ces mêmes éleveurs subissent une pression sociale et environnementale inédite alors que le modèle français est l'un des plus durables et vertueux du monde.
Pour le dire clairement, ce contexte est insupportable pour les éleveurs en place et clairement un point de blocage pour les jeunes générations candidates à l'installation.
La conséquence de ce climat délétère se retrouve brutalement dans la chute du nombre d'exploitations laitières en France, qui est plus rapide que celle connue dans les autres pays d'Europe du Nord. Le nombre de chefs d'exploitations laitières est ainsi passé de près de 250 000 à la fin des années 1970 à moins de 100 000 en 2020. D'ici à 2030, le nombre d'exploitations laitières aura été divisé par 5 en 40 ans.
Nombre de chefs d'exploitations dans les exploitations laitières
Source : Institut de l'Élevage.
Surtout, depuis 2015, un vaste mouvement de décapitalisation du cheptel s'est enclenché, entraînant une érosion massive du potentiel productif national.
Le cheptel est ainsi passé de près de 3,8 millions de têtes en 2005 à environ 3,4 millions aujourd'hui, soit un recul de 400 000 vaches laitières en l'espace de 15 ans.
Évolution de nombre de vaches laitières et allaitantes
Source : Institut de l'Élevage.
Géographiquement, cela s'est traduit, initialement, par un phénomène de spécialisation géographique, connu dans toute l'Europe, entraînant des économies d'agglomération en concentrant les zones de production là où elles sont le plus denses.
Toutefois, la brutalité de la décapitalisation semble avoir eu raison de ce phénomène d'agglomération car, depuis 2018, l'érosion de la collecte laitière due au recul de troupeaux concerne également la Bretagne et la Normandie, tout en continuant de s'accentuer dans le Sud-Ouest.
Densité d'exploitations laitières en 2006, 2015 et 2021
Source : Idele.
Ces densités de plus en plus faibles en dehors du fer à cheval laitier et en zone de montagne ont des conséquences sur le coût de la production et, partant, la pérennité de la collecte dans plusieurs zones françaises.
Ce phénomène pourrait, enfin, s'accentuer au regard du « mur du renouvellement des générations » : alors que 50 % des éleveurs laitiers partiront à la retraite d'ici 2035, moins d'un éleveur sur deux sera remplacé dans les années à venir.
En 2021, 48 % des éleveurs laitiers ont plus de 50 ans dont 28 % plus de 55 ans. Cette proportion était de 32 % en 2000. La moitié des éleveurs partira donc à la retraite d'ici 2035, surtout en Bretagne où le choc démographique est à venir.
À ce stade, la filière laitière est celle qui connaît le taux de remplacement de l'élevage le plus bas du monde avec seulement 45 % d'éleveurs laitiers remplacés (contre 83 % pour les vaches allaitantes et plus de 100 % pour les chèvres).
L'Idele estime que près de 50 % des éleveurs de bovins actifs pourraient avoir quitté le secteur avant 2030.
Ce phénomène accentuera la décapitalisation et, partant, l'érosion du potentiel productif laitier. 40 % du troupeau laitier français est élevé par au moins un éleveur co-exploitant d'au moins 55 ans. Dès lors, l'arrêt partiel d'une partie de la force de travail concernera une immense partie du monde laitier dans les années à venir.
La dynamique pourrait être aggravée par des départs anticipés d'éleveurs compte tenu de la situation de la filière, notamment dans les exploitations en polyculture-élevage (30 % des exploitations), où les exploitants pourraient procéder à des choix stratégiques plus facilement dans les années à venir.
Enfin, les installations, qui connaissent un déclin depuis 2015, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer cette tendance de fond, d'autant plus que les nouveaux installés ne se déclarent pas à la MSA « éleveurs laitiers » mais en polyculture-élevage et qu'ils font le choix d'installation en GAEC, alors qu'un tiers des GAEC échoue au bout de trois ans.
D. POULET : QUAND LA PRODUCTION FRANÇAISE, APRÈS AVOIR PERDU SES MARQUES À L'EXPORT, NE PARVIENT MÊME PLUS À RÉPONDRE À LA DEMANDE DE SA PROPRE POPULATION
1. Comment un fleuron exportateur est devenu un des secteurs les plus dépendants des importations en moins de vingt ans
La viande de volaille est celle dont la consommation augmente le plus vite au monde depuis les années 1970, à tel point qu'elle est devenue, depuis 2016, la viande la plus consommée au monde. La consommation mondiale a plus que doublé depuis 2000. La France a connu la même dynamique. Et cette croissance devrait se poursuivre puisque la FAO estime que la consommation de viande de volaille devrait continuer d'augmenter de 120 % entre 2005 et 2050. Cela s'explique d'une part par un effet démographique mais aussi et surtout par une hausse de la consommation par habitant, qui serait passée de près de 8 kg/hab au début des années 2000 à près de 13 kg/hab en 2021.
Bien entendu, le poulet joue un rôle de premier plan dans cette évolution. Plusieurs atouts indéniables expliquent ce phénomène : accessibilité économique, atouts environnementaux, absence d'interdits religieux, qualité et valeur nutritionnelle des produits, notamment en raison de la faible teneur en matières grasses.
Consommation des principales viandes dans le
monde
(en millions de tonnes)
Source : DGPE.
Bien entendu, la production mondiale de poulets s'est adaptée à cette nouvelle donne et a quasi doublé depuis 2000, passant d'un peu plus de 50 millions à plus de 100 millions de tonnes équivalent carcasse aujourd'hui.
Production de poulets dans le monde
Source : FranceAgriMer.
La France, dans cette nouvelle configuration, fait toutefois figure d'exception : autrefois grand pays volailler, elle a connu une relative stabilité de sa production de volailles depuis 2005, après une crise de baisse de production de 2000 à 2005. Environ 14 000 producteurs de volailles de chair produisent 1,7 million de tonnes de volaille, ce qui fait de la France le 3e producteur de l'Union européenne, derrière la Pologne et l'Espagne.
S'agissant plus spécifiquement de la production de poulets de chair, là encore, la croissance de la production n'a pas été aussi rapide que celle de sa consommation puisque, depuis les années 2000, sa production n'a augmenté que de 9 % en 20 ans pour atteindre 1,18 million de tonnes équivalent carcasse, quand la consommation française doublait.
Faute de production nationale disponible, il en résulte une explosion des importations de poulets en France.
En vingt ans, les importations de viandes et préparations de volailles ont été multipliées par plus de 4 passant de 150 000 en 2000 à 678 000 tonnes équivalent carcasse (T.E.C.) en 2021, principalement en provenance du reste de l'Union européenne (Belgique, Pays-Bas, Pologne et Allemagne). L'immense majorité de cette évolution provient de la hausse des importations de poulet, notamment de filet. Cela représente plus d'1,5 milliard d'euros d'importations annuelles.
Il en résulte un retournement inenvisageable encore il y a quelques années : alors que les importations couvraient 20 % de la consommation il y a vingt ans, elles couvrent désormais près de 50 % de la consommation totale.
Autrement dit : 1 poulet sur deux consommé tous les jours par les Français n'est pas d'origine française.
Part du poulet importé dans la consommation française
Source : FranceAgriMer.
Comme l'ont confirmé l'ensemble des acteurs eentendus par la mission, cette explosion provient d'une incapacité de la filière française à répondre à la matière première la plus recherchée sur le marché qui est le filet de poulet (frais, congelé ou transformé) dans des circuits de distribution hors grandes et moyennes surfaces, pour laquelle la filière française dispose d'un déficit de compétitivité.
Cela se retrouve au travers de deux indicateurs :
- entre 60 et 75 % des poulets distribués dans les circuits industriels et dans la restauration hors foyer sont importés, ces circuits, qui représentent la moitié du marché total en France, étant justement ceux où le coût de la matière première est un enjeu crucial pour la maîtrise générale des coûts ;
- parmi les principaux fournisseurs de poulets, la Pologne a réalisé, depuis 2013, une entrée fracassante, couvrant désormais près d'un tiers des importations françaises alors qu'elle était un fournisseur quasi inexistant au début des années 2000. Or la Pologne se distingue justement par une très forte compétitivité prix sur du poulet standard, en ayant armé une filière quasi exclusivement à l'export (3/4 de la production sont exportés).
Importations de poulets français depuis le reste de l'Union européenne
Source : Vincent Chatellier (Inrae).
Ce graphique, qui minore de facto le poids des pays tiers, peut toutefois être trompeur selon l'institut technique Itavi : « si les importations sont très principalement faites auprès de nos voisins européens (seuls 2,5 % sont importés directement auprès de pays tiers), il faut toutefois prendre ces chiffres avec un peu de recul. En effet, les importations belges et néerlandaises peuvent être issues du Brésil (via la Belgique principalement) et de l'Ukraine (via les Pays-Bas) même s'il est très difficile de savoir le volume réel de marchandise qui transite de cette manière. »
En parallèle, la France a également perdu des parts de marché à l'exportation.
Encore aujourd'hui, la France exporte près de 25 % de sa production, soit environ 350 000 tonnes équivalent-carcasse, principalement à destination de l'Union européenne (14 %) et du Proche et Moyen-Orient (5 %).
Toutefois, le niveau de ses exportations a été quasiment réduit par deux entre 1998 et 2020, principalement entre 1998 et 2006, avant de se stabiliser.
Au niveau des exportations, on distingue 3 principaux types de marchés :
i) le marché historique à forte valeur ajoutée qui est l'export de volaille entière congelée pour le Moyen-Orient et très majoritairement l'Arabie saoudite ;
ii) le marché vers l'Europe de l'Ouest et le Japon avec un prix moyen d'exportation qui reste « élevé » mais en deçà du marché précédent ;
iii) le marché à faible valeur ajoutée vers l'Afrique, l'Asie ou encore l'Europe de l'Est, où sont exportés des morceaux peu valorisés en Europe de l'Ouest.
Selon la FIA et le CNADEV, « les exportations françaises vers le marché mondial se sont développées au début des années 1990 à la faveur du développement d'un marché basé sur la valorisation complémentaire des pièces de la carcasse (exportation des chutes de découpes ou de la pâte fine issue des carcasses pour la fabrication de saucisses de volaille) et des volailles de réforme (poules) à destination de l'Afrique. La France exporte aujourd'hui des découpes à faible valeur ajoutée, comme des ailes, tandis qu'elle s'est progressivement mise à importer des découpes à haute valeur ajoutée (principalement filet, fortement consommé sur le marché intérieur88(*)). »
Au-delà de l'évolution du panel concurrentiel et du recentrage de la production française vers la consommation nationale, c'est en réalité l'évolution de diverses politiques publiques qui explique en partie cette érosion du potentiel exportateur, notamment :
- l'abandon des restitutions aux exportations qui fragilise la filière « poulet grand export » : avant 2013, le principal levier de soutien mobilisé était le mécanisme des restitutions aux exportations, lesquelles permettaient aux entreprises françaises de percevoir en moyenne 75 millions d'euros par an de la part de l'Union européenne. C'est une perte sèche qui vient impacter négativement la compétitivité de la filière. L'arrêt des restitutions en 2013 a entraîné une baisse drastique des exportations, notamment vers l'Arabie saoudite (baisse de 100 000 tonnes exportées). Depuis, la part française dans les exportations au niveau mondial a chuté au profit des pays tiers très tournés vers l'export : Brésil, Thaïlande, Ukraine, et également quelques pays membres : Benelux, Allemagne et plus récemment Pologne et Roumanie ;
- des contingents tarifaires permettant des niveaux d'importations élevés depuis les pays tiers, qui pourraient être encore accrus par le renforcement d'effets d'accords de libre-échange comme le Mercosur ou les accords avec l'Ukraine : 25 % des filets de volailles consommés dans l'Union européenne proviennent du Brésil, de Thaïlande ou d'Ukraine et transitent principalement par la Belgique ou les Pays-Bas.
Il résulte de ces évolutions croisées une inversion totale de situation pour la filière poulet française : autrefois largement contributrice au solde commercial positif de l'agriculture française, sa balance commerciale affiche, en quinze ans, l'un des plus lourds déficits en volume et en valeur.
En 2021, le déficit commercial de la filière poulet est estimé à - 281,1 tonnes équivalent-carcasse et à près de 665 millions d'euros selon les données du ministère chargé de l'agriculture.
Solde commercial de la filière poulet française
Source : FranceAgriMer.
2. Du poulet importé consommé plusieurs fois par semaine contre un bon poulet français le dimanche : le décrochage du poulet français dans la consommation nationale
Outre les difficultés à l'export, répondant le plus souvent à une pure logique de compétitivité, la France décroche également rapidement dans la couverture de sa consommation nationale.
Mais cela ne doit pas dissimuler certaines réussites : la France a la particularité par rapport à ses voisins européens d'avoir maintenu une très grande diversité de productions et de se positionner sur des filières de qualité.
D'une part, à côté de la filière poulet, qui pèse environ 68 % de la production française de la viande de volaille, figurent toujours des filières importantes comme la dinde (19 %), le canard (11 %) ou la pintade (2 %).
D'autre part, au sein même de la filière poulet, la France parvient à produire pour de nombreux segments, tant au travers de la certification de conformité des produits (8 %), du Label rouge (15 %) ou du bio (2 %).
Ces signes de qualité et d'origine des produits se retrouvent principalement dans les poulets « prêts à cuire », avec près de deux tiers des volumes.
Le Label rouge bénéficie par exemple d'une réputation bien ancrée chez les consommateurs compte tenu de sa différenciation et de son lien apprécié avec le terroir par son couplage avec des identifications géographiques protégées (IGP). C'est pourquoi il est très performant sur le poulet entier acheté en grandes surfaces dans le segment de l'entier, constituant de fait un élément de gamme indispensable pour les abattoirs comme pour les distributeurs. Il l'est également pour les poulets à destination des rôtisseries en vente directe.
Toutefois, ce taux de volailles sous signe de qualité (SIQO) est plafonné depuis des années à environ 20 % de la consommation française. Ceci provient d'une évolution inverse de la consommation, qui valorise davantage le poulet standard, ce qui interroge à terme la viabilité économique de la stratégie de la filière volaille.
Parmi les segments les plus dynamiques, à savoir la découpe et les poulets élaborés ou transformés (charcuterie notamment), la filière française se positionne plus difficilement, dans un segment où la qualité n'est pas le critère d'achat essentiel. Ces segments sont mécaniquement plus exposés à la concurrence directe de poulets importés.
La part des produits élaborés a par exemple quasiment doublé entre 1998 et 2022, quand les découpes ont connu une évolution dans les mêmes ordres de grandeur. Sur ces segments, le standard est très largement majoritaire (87 % standard et certifié).
Cette évolution de la consommation, qui se fait au détriment du poulet entier où la France dispose d'un avantage comparatif, est très rapide : en 20 ans, la consommation de poulets entiers ne représente plus que 22 % de la consommation des ménages, alors qu'elle pesait pour plus de la moitié avant 2000.
Une évolution de la consommation défavorable à la stratégie de différenciation par la qualité de la filière française
Source : FranceAgriMer.
Dit autrement, la filière française se trouve dans une impasse stratégique majeure : en abandonnant les circuits de masse pour des segments plus rémunérateurs, elle n'est plus capable de répondre aux besoins des consommateurs nationaux.
Des économistes de l'Inrae confirment cette analyse : « au cours des vingt dernières années, la filière française a concentré ses efforts, d'une part, sur le poulet haut de gamme (certifié et Label rouge) et, d'autre part, sur le poulet grand export, ce en délaissant un créneau en croissance celui du poulet standard destiné aux marchés européen et français. Simultanément, le marché des découpes de pou- let standard a connu une forte croissance, aux dépens du poulet entier89(*). »
La faute ne lui en est pas imputable : alors que le citoyen, entendu par le législateur et le pouvoir réglementaire, appelle à une montée en gamme forcée, le consommateur valorise les poulets standards au seul regard d'un critère prix qui dévalorise la production française.
Ainsi, tout se passe comme si les politiques publiques entendaient promouvoir un poulet français comme volaille d'exception servie dans les grands restaurants étoilés et pour le poulet du dimanche, laissant les consommateurs français acheter des poulets découpés ou transformés provenant de circuits importés.
Et cette impasse ne provient, selon plusieurs économistes, que d'un facteur : le manque de compétitivité.
« Les difficultés s'expliquent essentiellement par une perte de compétitivité de la production française vis-à-vis d'autres États membres de l'Union européenne (UE), dont surtout l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne [...]. Ces pays ont non seulement augmenté de manière rapide leur production intérieure au cours de la dernière décennie, mais ils ont développé leurs exportations, y compris à destination du marché français.90(*) »
3. Le recul sur le marché national n'est imputable qu'à un manque de politique de compétitivité sur le segment le plus consommé, le filet de poulet
Si l'on analyse les différences à l'amont agricole, sur le coût du vif, la France est déjà décrochée.
Le coût de production d'un poulet en France est estimé à 85,9 centimes d'euros par kilogramme vif, soit un coût supérieur de 4 % au coût moyen dans l'UE à 28 qui atteignait 82,6 centimes d'euros par kilogramme vif91(*). C'est un écart de plus de trois euros au kilogramme par rapport à la moyenne européenne et, par exemple, de 7,5 euros par rapport à la Pologne.
Les écarts sont plus marqués encore avec les leaders mondiaux, où les coûts sont sont inférieurs de près de 20 centimes d'euros au kilogramme vif pour les États-Unis, le Brésil et l'Ukraine.
À cet égard, la levée du plafond d'importation de viande de volaille ukrainienne décidée en juin 2022 ne manquera pas de nourrir considérablement notre dépendance déjà forte aux importations.
Différentiels de coûts de production parmi les principaux producteurs de poulet dans le monde
Source : FranceAgriMer.
Pourtant, la France dispose d'un avantage comparatif par rapport à ses concurrents sur le principal poste de charges d'un poulet, à savoir l'alimentation (60 % du coût de production, cf. graphique ci-dessus). Les poulets français sont alimentés par des formules composées de 40 % de maïs, 40 % de blé et 20 % de soja.
Toutefois, cet avantage ne compense pas des fragilités sur trois autres points au niveau de l'élevage :
- un coût du poussin de 10 à 12 % plus élevé que la moyenne européenne sur la volaille standard (entre 2 et 3 centimes du kilogramme) : cette difficulté ne traduit pas tant des défaillances du maillon sélection et accouvage, qui est une filière d'excellence française reconnue à l'échelle internationale. À cet égard, la diversité et la qualité sanitaire de ces produits permettent aux sélectionneurs d'exporter dans le monde entier. Néanmoins, les personnes entendues analysent ce désavantage paradoxal par le positionnement de la filière. D'une part, le poste « poussin », constituant une charge peu compressible, a un poids relatif plus élevé dans le coût de production au kilogramme, en raison du poids moyen du poulet français, plus petit que le poids moyen en Europe - ce qui résulte de l'orientation « poulet entier » de la filière, désavantageuse sur le marché de la découpe92(*). En outre, le prix de la diversité de la production de volailles, tant des espèces que des qualités, engendre, mécaniquement, un léger surcoût en réduisant les capacités d'économies d'échelle en France. L'amont pourrait toutefois être davantage contractualisé ;
- des coûts de main d'oeuvre plus élevés : selon la DGPE, pour la filière poulet, la France est le pays présentant les coûts de main-d'oeuvre les plus élevés parmi les principaux producteurs. À ce titre, les différences de coût de revient par rapport à la Pologne sont par exemple accrues d'environ 4 centimes d'euros par kilogramme vif rien qu'en raison du différentiel de coût de main d'oeuvre à la ferme ;
- Ddes charges fixes difficilement amorties compte tenu de la taille réduite des élevages : la France se démarque de l'ensemble de ses voisins de l'Union européenne par la structure de ses exploitations de volailles de chair, beaucoup plus petites et plus diversifiées. La capacité moyenne des ateliers poulets de chair de 1 000 places et plus en France est plus de 2 fois inférieure à la moyenne européenne ou à celle de la Belgique. Elle est 4 fois inférieure à celle de l'Allemagne et 5 fois inférieure à la moyenne hollandaise et britannique93(*). Elle serait de plus de vingt fois inférieure à la taille des élevages ukrainiens, thaïlandais ou brésiliens. Là encore, on fait bien vite le procès de l'agriculture française et de son modèle prétendument « productiviste » sans voir que les producteurs français sont déjà des « petits » face aux exploitations de nos voisins et concurrents directs européens, sans parler des concurrents plus lointains.
Finalement, la France paie le prix de ses points forts (le modèle familial et la diversification des productions) en matière de compétitivité. Les principales différences de coût de revient s'expliquent avant, et surtout, par la taille modérée des installations et la diversité des productions, qui peut limiter les économies d'échelles possibles par la production d'un produit standardisé.
S'ajoute à ces difficultés une surcharge administrative très franco-française qui, faute de recours à de la main-d'oeuvre en appui, ajoute des contraintes aux agriculteurs alors qu'il est possible de faire beaucoup plus simple, comme dans d'autres pays. De l'aveu de tous, le cadre réglementaire applicable aux éleveurs et, plus généralement, aux agriculteurs de notre pays, n'est pas adapté à l'activité d'indépendants.
Et ces difficultés au stade de la production sont ensuite aggravées au stade de l'abattage et de la transformation, où les coûts de main-d'oeuvre sont majeurs : la France se place en troisième position en termes de coûts d'abattage en Europe derrière le Danemark et les Pays-Bas. Le coût d'abattage en France est estimé à 31 centimes par kilogramme de carcasse, soit plus élevé qu'au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. C'est ce qui rend les poulets produits dans ces pays, avec des coûts de production pourtant comparables au stade de la ferme, plus compétitifs que les poulets français. L'écart est de près de 10 centimes avec la Pologne, où le coût d'abattage est estimé à 22 centimes par kilogramme carcasse, et de près de 14 centimes avec le Brésil ou la Thaïlande (17 centimes par kilogramme carcasse). La multiplicité et le manque de spécialisation des outils de découpe sont mis en avant comme facteurs déterminants de ce déficit de compétitivité. S'y ajoute un déficit de renouvellement des outils de production en raison d'un taux de rénovation ne dépassant pas 15 % depuis 2000. Cela se traduit par un poids plus élevé des charges de personnel dans le poste de charges qui pénalise les outils industriels français par rapport à des chaînes plus automatisées en Europe.
Stratégie des maillons abattage de la filière poulet en Europe
Source : FranceAgriMer.
Quand viennent s'y ajouter les distorsions de concurrence au sein du marché européen, la filière ne peut rivaliser. Le rapport sur la compétitivité de FranceAgriMer soulève notamment des inquiétudes quant aux écarts de taux de TVA sur la filière entre pays européens ainsi que des divergences sur les statuts de la main-d'oeuvre entre les États membres.
Il en résulte un coût de production en sortie d'abattoir supérieur de 5,5 % à la moyenne de l'UE94(*), de 15 % supérieur à celui d'un poulet polonais et d'environ 30 % supérieur à celui d'un poulet brésilien.
Le poulet français est donc, au terme du processus de production, plus cher que ces concurrents tout en étant plus petit d'environ 20 %.
Compte tenu des volumes de filets de poulet consommés en raison de leur attractivité tarifaire et de leur mode de distribution, dans des circuits où l'attention au prix est importante, cet écart de compétitivité ne pardonne pas.
E. BLÉ : QUAND L'AMONT COURT AVEC DES BOULETS AUX PIEDS, C'EST L'AVAL QUI TRINQUE
1. Dans le contexte actuel, avoir une filière céréalière forte est un atout géopolitique majeur
a) La filière céréalière française : des performances exceptionnelles au service de la puissance agricole française
Comme le rappelle Sébastien Abis, directeur général du club Demeter et chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), « on ne peut pas produire du blé partout. On en produit dans les climats tempérés, mais il n'y a qu'une dizaine de pays qui en produisent beaucoup et peuvent exporter - notamment Ukraine, Etats-Unis, Australie95(*). »
Dès lors, le marché mondial est dominé par un petit nombre d'acteurs : dix principaux exportateurs représentent 94 % des exportations mondiales.
Volumes de blé tendre exportés en milliers de tonnes
Source : FranceAgriMer.
En dépit de la volonté géostratégique de nombreux pays de développer une production locale de blé afin de réduire leur dépendance, la production n'évolue pas aussi rapidement que la demande intérieure.
La production de blé tendre a été multipliée par 2,5 en un demi-siècle, passant de 300 millions de tonnes à 780 millions de tonnes depuis 1970, avec un net développement de la production locale des pays consommateurs.
La Chine et l'Inde ont par exemple largement accru leur production pour subvenir à la croissance de leur population, par l'usage de de nouvelles variétés et une meilleure valorisation des apports croissants d'engrais azotés.
Toutefois, dans le même temps, les exportations ont été multipliées par 4 (passant de 50 à 200 millions de tonnes) afin de couvrir la hausse de la consommation liée à l'explosion démographique.
Outre les cas asiatiques, cela s'explique par le fait que la production stagne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient depuis 20 ans du fait de la réduction de la disponibilité en terres arables et par les effets négatifs sur la production des aléas climatiques. Or cette stagnation de la production a lieu alors que la demande en blé de la zone a été quasiment multipliée par 6.
Dès lors, le déficit entre la production et la consommation en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie n'a cessé de croître depuis les années 70. Les pays de ces régions du monde sont devenus structurellement importateurs de blé tendre.
Ce manque a dès lors pu être comblé par la hausse du surplus produit dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Argentine et d'Australie, où la consommation de blé s'est stabilisée.
Source : AGPB (données 2018).
Il en résulte un marché mondial du blé fortement dynamique, connaissant une croissance des échanges de l'ordre de 6 millions de tonnes supplémentaires par an depuis une dizaine d'années, aboutissant à une part totale de la production mondiale destinée aux échanges internationaux de près d'un quart aujourd'hui.
Dans ce contexte, comme le rappelle le principal syndicat de producteurs de blé, « peu de pays à l'échelle mondiale ont la capacité d'absorber les déficits qui ne cessent de s'accroître et la France est régulièrement dans le top 5 de ces acteurs stratégiques. »
« Grenier à blé de l'Europe », la France a en effet tous les atouts d'une grande puissance céréalière :
- une production de 70 millions de tonnes de céréales en moyenne, dont 35 millions de tonnes de blé tendre ;
- plus de la moitié de la production annuelle est exportée, soit entre 15 et 20 millions de tonnes de blé tendre environ, ce qui place la France à la quatrième position du classement mondial des exportateurs de blé ;
- un excédent commercial général sur les céréales et préparations de 6,6 milliards d'euros en 2021, représentant la vente d'environ 100 Airbus par an.
La France représente environ 11 % en volume du blé exporté dans le monde, sa production exportée étant expédiée pour près de 60 % aux pays tiers et, pour le reste, à l'Union européenne.
Dans les principaux clients figurent, parmi les pays tiers, l'Algérie, le Maroc, la Chine et, historiquement, l'Égypte ainsi que plusieurs pays africains. Toutefois, il ne faut pas écarter des marchés essentiels pour les céréaliers français en Europe comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie.
Exportations françaises en blé tendre (en millions de tonnes)
Source : Vincent Chatellier (Inrae).
b) Faiblesses de la France : petites exploitations performantes sur le plan économique, efforts mal payés des agriculteurs
Ces performances sont tout à fait paradoxales au regard des handicaps français en matière de compétitivité, qui se matérialisent par des coûts de production sortie ferme relativement élevés.
Outre le triptyque habituel (réglementation environnementale et sociale parmi les plus strictes du monde ; fiscalité défavorable ; coût de la main-d'oeuvre plus élevé qu'ailleurs), la filière blé tendre est pénalisée par certains facteurs spécifiques sur les coûts de production.
La caractéristique la plus frappante à cet égard est la modestie de la surface des exploitations françaises par rapport aux surfaces moyennes chez ses principaux concurrents : en Australie, les exploitations sont 14 fois plus grandes que les françaises ; en Russie ou en Ukraine, près de 9 fois ; aux Etats-Unis ou au Canada, le ratio est compris entre 4 et 5.
Surfaces moyennes des exploitations céréalières (en hectares)
Source : FranceAgriMer.
La France parvient toutefois à compenser cet écart de compétitivité par des rendements élevés de 72 quintaux à l'hectare en moyenne sur 2015-2019, malgré un point bas en 2016, contre une moyenne mondiale à environ 35 quintaux à l'hectare.
Malgré tout, la France a un coût de production relativement élevé en comparaison avec les principaux exportateurs mondiaux mais très largement supérieur à ses concurrents principaux d'Europe de l'Est.
Dans le détail, le coût de production du blé français est composé de quatre charges principales : le coût des intrants, le coût de mécanisation, le coût de main-d'oeuvre et le coût du foncier.
La France dispose, sans doute, d'un des modèles fonciers les plus avantageux au monde, en ce qu'il garantit des prix des terres accessibles, à un niveau « proche de ceux des concurrents de la mer Noire ou de la Lituanie » selon FranceAgriMer. Le coût serait par exemple trois fois supérieur en Argentine et près de deux fois aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie96(*).
En cela, le statut du fermage est perçu, par tous les acteurs, comme extrêmement protecteur sur le prix de la location et, partant, comme un des avantages concurrentiels les plus importants pour les producteurs français dans la compétition mondiale. De même, le prix d'achat du foncier est contenu par rapport aux autres pays européens.
La petite taille des exploitations françaises engendre, encore une fois, un double effet sur la mécanisation et les coûts de main d'oeuvre.
D'une part, le coût de la main-d'oeuvre est relativement contenu en raison du faible recours au salariat sur ces exploitations familiales, les revenus des agriculteurs devenant, dès lors, la variable d'ajustement de la compétitivité de la Ferme France.
D'autre part, les charges de mécanisation sont généralement plus importantes à l'hectare que dans d'autres pays. Un des leviers d'amélioration réside, sans doute, dans la capacité de mise en commun de l'achat de matériel par diverses structures (CUMA, copropriété, recours à des entreprises de travaux agricoles...), qui se heurte à des phénomènes d'embouteillage dans l'utilisation du matériel à certaines dates clés de moissons. C'est pourquoi, sans doute, comme l'AGPB en fait le constat, « la mise en commun des investissements entre plusieurs exploitations (CUMA, assolement en commun, gestion déléguée...) est une pratique encore relativement peu développée en France, ce qui aggrave le manque de compétitivité. »
De surcroît, en France, les pratiques relatives aux rotations peuvent également être pénalisantes par rapport à d'autres pays pour la filière blé.
Charges fixes dans les coûts de production d'une tonne de blé (en dollars à la tonne)
Source : FranceAgriMer.
S'agissant du coût des intrants, la France se situe dans la moyenne mondiale à environ 62 dollars à la tonne, loin des 118 dollars en Australie ou des 85 dollars rencontrés au Canada, avec un amortissement mécanique induit par la plus grande productivité par hectare par rapport aux principaux pays concurrents.
Le coût aurait toutefois dû être plus bas.
Les ventes de pesticides ont en effet été réduites de moitié depuis 1998 pour l'intégralité des filières agricoles. Les doses moyennes nécessaires pour la protection d'un hectare de blé ont été divisées par 34 et la toxicité moyenne des substances actives a été divisée, en 60 ans, par 8,5. Le nombre de substances autorisées a, quant à lui, été réduit de plus de 100 en quelques années97(*).
Il en résulte des quantités épandues à l'hectare dans la fourchette basse de l'Union européenne avec des indicateurs de fréquence de traitement en blé tendre inférieurs à ceux des concurrents européens (4 en France contre près de 8 au Royaume-Uni ou 6 en Allemagne98(*)).
Ce mouvement de baisse des quantités vendues, qui s'est fait à rendement constant grâce au savoir-faire des agriculteurs, aurait dû se traduire par une moindre charge d'intrants phytosanitaires. Or entre 1997 et 2013, alors que les substances actives vendues ont été réduites de 46 %, les dépenses en produits phytopharmaceutiques ont augmenté dans les comptes de résultat des exploitants agricoles de 42 %99(*).
La réduction du nombre de molécules disponibles a emporté des hausses de coût directes pour les exploitants et a pu causer, à court terme, des situations de résistances, qui limitent l'efficacité des molécules encore autorisées, impliquant des baisses de qualité sanitaire et de rendements.
Surtout, ce mouvement a été accentué récemment par des décisions publiques d'alourdir les prix des intrants comme la hausse de la redevance pour pollutions diffuses, promue par le Gouvernement en 2019, tout comme l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les ventes de produits phytopharmaceutiques, adoptée dans la loi Egalim.
Ainsi, malgré leurs efforts, les céréaliers français figurent parmi les grands perdants de la politique menée depuis quelques années sur les produits phytopharmaceutiques.
On voit là l'impasse compétitive dans laquelle nous mène cette seule logique en matière d'intrants : elle ne fait pas émerger d'alternatives tout en pénalisant les comptes de résultat des agriculteurs, même quand ils parviennent à réduire considérablement les quantités émises.
Il en va de même quand on observe la situation sur les engrais.
Là encore, la France est le pays européen où les ventes d'engrais ont le plus chuté depuis la fin des années 1980, principalement en raison de la chute d'utilisation d'engrais phosphatés et potassiques, les livraisons d'engrais azotés demeurent relativement stables.
Évolution des ventes d'engrais des principaux producteurs européens
Source : Chambres d'agriculture France, Arvalis.
Les utilisations sont, par ailleurs, strictement encadrées par une des réglementations les plus strictes du monde (notamment les directives nitrates).
Toutefois, en dépit de ce cadre protecteur et encourageant, l'Union européenne maintient des protections douanières élevées sur l'azote, entraînant un prix relativement plus élevé des engrais en Europe par rapport à d'autres pays du monde.
Les producteurs interrogés estiment ainsi que « l'existence de barrières tarifaires à l'importation des engrais azotés sur le marché unique européen explique que les prix de l'azote en Europe sont supérieurs à ceux des principaux pays concurrents. Ces barrières impactent les prix par un effet direct et un effet indirect. Effet direct du fait des droits à l'importation qui renchérissent mécaniquement les prix intérieurs et effet indirect, l'isolement du marché européen limitant le nombre de fournisseurs, ce qui aboutit à une concurrence insuffisante par effet d'oligopole », ce que le conflit russo-ukrainien a pu mettre au grand jour récemment.
La France va d'ailleurs encore plus loin en matière de réglementation sur l'azote, ce qui peut mettre en péril sa capacité à atteindre les taux de protéine ciblés par certains marchés, alors que les concurrents de la mer Noire, en raison de conditions pédoclimatiques différentes, atteignent plus facilement ces taux. Pour donner un ordre d'idée, alors que le taux de protéines sur les blés est, au niveau standard, de 11 % en France, il doit atteindre 11,5 % dans le cahier des charges Label rouge ou pour atteindre le marché algérien. Le taux attendu est même de 12 % en Égypte.
c) L'organisation de la filière est l'atout principal de la filière exportatrice céréalière
Malgré ces handicaps, le blé français reste tout à fait compétitif sur les marchés mondiaux grâce à l'organisation de la filière et aux soutiens publics.
Plusieurs personnes entendues en témoignent : « avec une part de marché de l'ordre de 10 % du marché mondial, la France est capable de rivaliser avec les grands concurrents malgré un coût sortie ferme élevé grâce à l'ensemble de sa performance dans toute la filière, mais aussi grâce à la PAC qui contribue depuis 1992 au revenu des producteurs. »
La France dispose de plusieurs atouts structurels :
- une culture céréalière très diffuse chez les agriculteurs, puisque ¾ d'entre eux cultivent des céréales sur plus de 9 millions d'hectares, soit 1/3 de la surface agricole française ;
- une excellence nationale dans la production de semences, puisque la France en est le premier producteur et exportateur mondial ;
- un potentiel agronomique élevé ainsi que des conditions climatiques favorables permettant de répondre à des cahiers des charges diversifiés ;
- une orientation de la production sur du blé meunier (97 % de la récolte en 2019) qui correspond à la demande majoritaire à l'exportation ;
- des débouchés diversifiés sur le marché intérieur assortis de fortes capacités industrielles ;
- une capacité de stockage importante permettant de garantir une offre régulière hors accident climatique majeur (7 600 silos collecteurs d'une capacité totale de 64 millions de tonnes de grains, complétées par 170 silos portuaires d'une capacité de 8 millions de tonnes) ;
- une organisation de filière ayant fait ses preuves par le biais d'organismes dédiés, de synergies inter-filières (à cet égard, la compétitivité des céréales est un facteur clé de succès pour les filières animales, qui sont les premiers clients des céréaliers), de réglementations de la collecte favorisant une recherche professionnelle, une culture du contrat et une gestion des risques de marché par le biais des marchés à terme et, plus récemment, une interprofession qui monte en puissance.
- s'y ajoute enfin une performance du maillon collecte, stockage et logistique qui redonne de la compétitivité prix au blé français sorti ferme.
Afin de mettre le blé aux normes de commercialisation, les organismes stockeurs sont garants du processus de conservation du blé qui passe par le séchage, le nettoyage, la désinsectisation, l'allotissement et la commercialisation, afin de le mettre en conformité avec la réglementation sanitaire et avec les exigences qualitatives des clients. La conservation peut ainsi durer plusieurs mois, si les conditions sont correctes, ce qui nécessite un travail régulier et technique par les agents de silos.
La France bénéficie de coûts relativement faibles sur ce poste de charges par le biais de sa géographie (proximité entre zones de production et industries ou ports d'exportation) et d'une gestion optimale des infrastructures existantes par les organisations concernées.
Coûts comparés des principaux exportateurs de céréales en 2015 (transport et travail du grain, en dollars par tonne de blé tendre)
Source : AGPB.
Enfin, il ne faut pas oublier l'importance des aides PAC dans le bilan global de la compétitivité de la filière blé tendre. Ainsi, au total, le différentiel de compétitivité à la sortie de la ferme est compensé par des éléments d'organisation de filières et des aides publiques.
Principales composantes des prix nets du blé tendre à l'arrivée au Maroc selon divers pays de provenance (en euros, en 2018)
Source : schéma fourni par l'AGPB.
2. Un monde nouveau : tensions fortes avec le conflit russo-ukrainien, percées de nouveaux acteurs, une priorité des pouvoirs publics qui recule
a) L'irruption des géants ukrainiens et russes, remise en cause par le conflit de 2022 ?
Le marché mondial du blé a connu un véritable chamboulement depuis une vingtaine d'années, avec un net recul des anciens exportateurs traditionnels bousculés par la montée en puissance des pays de la mer Noire, mais aussi d'un acteur émergent comme l'Inde.
En 1996, les cinq principaux exportateurs (Union européenne, Etats-Unis, Canada, Argentine et Australie) représentaient 90 % des exportations mondiales : ils n'en représentent plus que 60 %. Si cela s'explique par la chute vertigineuse des parts de marché américaines, notamment en raison de stratégies de rotations différentes de celles qui ont prévalu dans le passé, il convient de constater la percée impressionnante des acteurs russes, ukrainiens et kazakhs dans le jeu international. Cette région du monde concentre désormais plus de 30 % des exportations mondiales de blé tendre.
Évolution des parts de marché des principaux exportateurs de blé sur longue période
Source : Arvalis.
En dix ans, quand la production européenne augmentait de 21 % entre la moyenne 2005-2008 et 2015-2018, ce qui équivalait aux taux de croissance rencontrés au Canada, en Inde ou en Chine, la production russe augmentait de 52 % et la production ukrainienne de 73 %.
Trois facteurs expliquent cette irruption de deux acteurs majeurs au rang de principales puissances agricoles mondiales :
- une volonté politique clairement affichée d'autonomie alimentaire en Russie et de développement de la filière agricole et céréalière en Ukraine. Ainsi, à la suite de l'embargo de 2014 sur les produits alimentaires européens en réponse aux sanctions de l'UE liées à l'annexion de la Crimée, la Russie a considérablement développé sa production de blé tendre pour devenir le premier exportateur mondial de blé tendre ;
- un accroissement des surfaces agricoles en production ;
- une hausse très rapide des rendements dans ces pays avec des potentiels très élevés grâce à une politique dédiée à la productivité par le biais d'une intensification des moyens de production (intrants, machinisme, qualité des semences, progrès génétique...).
Toute la difficulté pour la France dans cette nouvelle donne est qu'elle voit apparaître deux concurrents majeurs à proximité de son bassin de clients historiques, qui seront donc moins affectés par les surcoûts logistiques dus à la distance entre le fournisseur et son client. La Russie et l'Ukraine approvisionnent désormais les principaux importateurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, en ayant capté des parts de marché françaises et européennes (Égypte, Turquie, part croissante vers le Maroc et l'Algérie). Cette tendance se retrouve même parmi les clients européens de la France. Dans les deux cas, le seul facteur avancé est celui de la compétitivité.
Un autre fait majeur est à prendre en compte : la place de la Chine en tant qu'organisme stockeur. Avec une production mondiale ayant de plus en plus de mal à suivre une demande de blé qui ne ralentit pas, les stocks des grands acteurs producteurs jouent de plus en plus un rôle stratégique. À ce jeu, la Chine détient un rôle clef puisqu'elle détiendrait, selon diverses sources, plus de la moitié des stocks mondiaux de céréales. En moins de dix ans, ces réserves ont augmenté de plus de 20 % afin de pallier la réduction de ses terres arables due à l'urbanisation et à l'industrialisation à marche forcée du pays.
b) Après la stagnation des rendements, l'heure de la décroissance ?
Or ce contexte géographique nouveau frappe la France au moment même où elle rencontre des difficultés au stade de la production, matérialisées par une stagnation des rendements et un recul massif des surfaces cultivées.
Prise dans un mouvement global de ralentissement de la tendance à la croissance des rendements céréaliers dans de nombreux pays européens durant les deux dernières décennies, la France connaît une stricte stabilité de son rendement à l'hectare depuis la fin des années 1990.
Évolution du rendement en blé tendre en France
Source : Arvalis.
Or de l'aveu même des représentants des professionnels : « l'absence de croissance est le prélude à de la décroissance ».
Une étude des années 2010 estime que « le progrès génétique n'a pas diminué mais qu'il a été en partie contrecarré, à partir de 1990, par le changement climatique qui, en général, est défavorable aux rendements céréaliers dans les climats tempérés à cause du stress thermique pendant le remplissage du grain et la sécheresse pendant l'allongement de la tige. On ne peut cependant, à partir de la décennie qui débute en 2000, écarter des causes agronomiques, liées à la politique et à l'économie, notamment le recul des légumineuses dans les rotations céréalières, remplacées par les oléagineux, et dans une moindre mesure la diminution de la fertilisation azotée100(*). »
L'institut technique Arvalis estime, de son côté, que le facteur essentiel de la stabilité du rendement est le changement climatique, qui explique environ les deux tiers de la stagnation du rendement. Les nouvelles conditions climatiques exposent depuis quelques décennies la culture du blé à des stress hydriques et thermiques plus fréquents, plus prononcés et plus variables.
Parmi les autres facteurs figure notamment le durcissement de la réglementation qui aboutit à la réduction du potentiel productif (Brisson et al., 2010), notamment sur les produits phytopharmaceutiques et la fertilisation azotée. Surtout que, dans le même temps, le recul de certaines cultures précédentes favorables comme le pois au bénéfice de cultures moins favorables comme le colza a pu également concourir à ce plafonnement des rendements.
Ainsi, même si le progrès génétique continue, son effet sur les rendements réels est masqué par ces autres facteurs négatifs.
En parallèle, les surfaces en blé ainsi que le nombre d'exploitations ont relativement peu varié depuis 50 ans.
Cette stabilité des facteurs de production combinée à une stagnation des rendements induit une production de blé tendre à l'équilibre depuis la fin des années 1990, alors que la demande mondiale explose.
Évolution de la production française de blé tendre (en millions de tonnes)
Source : Arvalis.
Mais le pire reste à venir, la production céréalière française pouvant avoir d'ores et déjà basculé dans une spirale décroissante.
D'une part, on assiste depuis une dizaine d'années, à une érosion lente mais durable du potentiel productif céréalier.
La France a connu une baisse des surfaces cultivées en céréales et oléagineux de 840 000 hectares entre 2015 et 2020101(*), dont près de 480 000 hectares en blé tendre.
Cela représente un recul d'environ 9 % de la surface agricole totale cultivée en blé chaque année. Sur la base du rendement moyen, près de 3,4 millions de tonnes de blé tendre n'ont ainsi pas été mises en production.
Plusieurs facteurs explicatifs ont été avancés par les professionnels interrogés sur ce point lors des auditions :
- Une hausse importante des surfaces toujours en herbe, principal facteur expliquant le recul des surfaces de céréales et oléagineux en culture (- 340 000 hectares) ;
- Une extension des cultures permanentes (vignes, arboriculture...), de cultures industrielles et d'autres cultures (légumes secs et frais, protéagineux) (- 300 000 hectares) ;
- Une augmentation des surfaces en jachère (- 40 000 hectares) ;
- Et un recul de la surface agricole utile due à l'artificialisation des sols et à l'extension des boisements (- 160 000 hectares).
Bien entendu, cela ne présage pas d'une augmentation des surfaces mises en culture cette année compte tenu des prix de marché. Toutefois, la tendance semble structurelle dès lors qu'elle engendre une augmentation des surfaces non productives ou affectées durablement à d'autres productions.
Si l'on peut encore douter de la pérennité de cette tendance, force est de constater qu'elle pourrait être durablement actée par la stratégie européenne de la Ferme à la fourchette, qui devrait accroître mécaniquement le poids des contraintes sur les agriculteurs afin d'atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne de baisse de 50 % de l'utilisation de pesticides d'ici 2030 et le passage à 25 % de surfaces consacrées à l'agriculture biologique.
Il n'est pas à exclure que la réduction de la baisse de fertilisation azotée promue vienne, à court terme, baisser la teneur en protéine des blés, et donc la qualité générale, venant freiner nos capacités d'exportation et la rentabilité de certaines industries (amidonnières notamment).
Autrement dit : la France tanguait au bord du précipice et l'Union européenne pourrait bien avoir achevé de l'y précipiter.
Enfin, un autre facteur est à prendre en compte selon FranceAgriMer, à savoir la diversification des qualités de production qui induit une baisse tendancielle de la production : « la réglementation environnementale nationale, privilégiant les hauts standards de production (bio, HVE, etc.) entraîne une réduction de la production française qui s'adapte ainsi à une partie de la demande nationale. D'où la difficulté pour les entreprises de répartir le risque sur plusieurs clients et plusieurs pays, qui ne sont pas demandeurs des hauts standards mais de produits répondant au quadriptyque : variétés, coloration, prix et facilité logistique. Ceci induit des situations de perte de compétitivité, certaines entreprises étant amenées à contractualiser avec des producteurs étrangers pour maintenir leurs niveaux d'exportation et être en capacité de répondre à toutes les attentes des clients. »
c) Au niveau de la production, la tendance à la surtransposition est problématique selon les filières
Le virus bureaucratique de la surtransposition n'épargne pas la filière céréalière, créant, là encore, des distorsions de concurrence intra-européennes et, plus largement, des divergences avec les concurrents internationaux.
Les filières interrogées ont mentionné plusieurs exemples concrets dans leurs contributions écrites que les rapporteurs se contentent de reprendre ici sans y porter de jugement politique.
Pour les professionnels, la France applique par exemple des normes spécifiques sur certaines pratiques liées aux engrais ou aux produits phytopharmaceutiques.
Parmi leurs retours, ont été citées, à plusieurs reprises :
- l'interdiction spécifique de substances décidées par le législateur comme ce fut le cas pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ou une plusieurs substances de la famille des néonicotinoïdes, comme le prévoit l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, alors que certaines de ces substances sont autorisées au niveau européen ;
- des procédures d'autorisation de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques plus strictes en France, l'Anses appliquant des règles plus exigeantes que d'autres pays de l'Union européenne : par exemple, s'agissant du glyphosate, des restrictions ont été mises en oeuvre relatives à l'utilisation de cette substance, notamment par un encadrement des pratiques d'épandage et par le retrait des autorisations de mises sur le marché (AMM) de certains produits contenant cette substance ;
- l'interdiction des remises, rabais et ristournes lors de la vente de produits phytopharmaceutiques, qui augmente artificiellement les prix de ces intrants ;
- la mise en place de zones de non-traitement à proximité des habitations plus larges qu'ailleurs en Europe, « près de cinq fois plus importantes que la norme européenne » ;
- l'assortiment de conditions d'emploi de ces produits par des règles plus strictes, « comme par exemple sur les délais incompressibles avant la ré-entrée au champ après traitement » ou « l'interdiction des traitements pendant la période de floraison avec un régime dérogatoire pour les produits disposant de la mention abeille » ; ;
- une multiplication de plans nationaux et de mesures spécifiques ayant des conséquences sur les filières, comme les plans pollinisateurs, le plan de sortie du glyphosate, les certificats d'économie de produits phytosanitaires, la séparation de la vente et du conseil pour ces produits. Le plan « Ecophyto » est par exemple unique en Europe : seuls 4 pays européens ont fixé des objectifs précis de réduction des risques liés à l'usage des produits phytopharmaceutiques, la France étant le seul pays à avoir fixé des objectifs précis de réduction des utilisations et non uniquement des risques ;
- des taxations spécifiques comme la redevance pour pollutions diffuses ;
- La retenue de seuils plus stricts concernant l'application de certaines directives, comme l'application de la directive nitrates, qui se décline en France par un Programme d'action national (PAN) « avec un seuil limite de nitrates présents dans les eaux fixé à 18 mg/l contre 50 mg/l dans le texte européen d'origine. De plus, les éléments intégrés dans les PAN et les PAR sont « plus disant » que les programmes des pays voisins (dates de couvertures ; interdictions d'épandage sur sol gelé...) ».
Un autre point a été régulièrement mis en avant : la difficulté à faire émerger et à bénéficier facilement de projets de stockages d'eau, « la réglementation encadrant la réalisation des stockages d'eau est si drastique qu'une telle démarche est devenue presque impossible à engager aujourd'hui ». Les professionnels rappellent que « tous les prélèvements d'eau à partir d'un certain seuil, obtenus à partir d'un forage, d'un pompage dans un cours d'eau, d'un puits, d'une retenue collinaire, sont soumis à une autorisation, pour leur ouvrage mais également pour leur exploitation destinée à un certain volume ».
Enfin, s'ajoutent à ces surtranspositions françaises, qui pénalisent les agriculteurs français par rapport à leurs concurrents européens, des blocages européens qui mettent des boulets aux pieds des exploitants du continent dans la course internationale.
Au-delà de la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques ou les engrais, qui sont les plus strictes au monde, le plus évident est, bien entendu, les cadres juridiques applicables aux new breeding technologies (NBT). Sur le continent américain, la plupart des pays autorisent les NBT, ainsi que les organismes génétiquement modifiés (OGM) sur maïs et soja. L'Argentine a également autorisé les OGM sur les blés. L'Europe a choisi, de son côté, d'encadrer les importations d'OGM, de les interdire au stade de la production. Elle restreint également l'usage des NBT dans l'attente d'une réglementation qui pourrait voir le jour dans les prochains mois : c'est, sans doute, beaucoup de temps perdu pour l'agriculture européenne quand d'autres ont déjà pris de l'avance.
Les surtranspositions concernent, également, les maillons en aval.
De la même manière, les professions rencontrées ont pu imaginer une typologie des difficultés posées par la réglementation franco-française :
- Un « surdroit du travail » et un « surdroit fiscal » ;
- Un « surdroit environnemental » : l'interprofession estime par exemple que « le suivi du marché du CO2 obligatoire réglementairement, le suivi des quotas et la baisse des allocations gratuites viennent apporter une contrainte supplémentaire forte sur nos industries, et mettent à mal la rentabilité de nos produits venant perturber les équilibres. Le décret tertiaire est extrêmement difficile à tenir pour nous, ayant de vastes zones de stockage déjà optimisées » ;
- « un surdroit d'autorisation à produire » : les meilleures techniques à suivre en France dans le cadre du respect de la directive émissions industrielles au niveau européen (les « BREF ») sont perçues comme « une contrainte constante qui va en augmentant avec le temps et qui nous obligent à réaliser des investissements parfois à contre temps de nos cycles de marché sous peine de mise en demeure de production et donc arrêt de nos sites. Toutes les études d'impacts et les demandes d'autorisations pour développer nos unités de production ou ajouter des méthaniseurs par exemple viennent freiner la rentabilité de ces projets et leur mise en oeuvre » ;
- « un surdroit à transporter » : « l'interdiction du transport à 44 tonnes en transfrontalier (qui était toléré) ; les ZFE ; la réduction des vitesses autorisées... se cumulent et viennent pénaliser la mobilité... et donc notre capacité à exporter »
d) Danger mortel sur les facteurs exogènes de la compétitivité du blé français : moins d'innovation, remise en cause des aides publiques et fragilité des maillons stockage et logistique
Comme le montre, sans doute, l'exemple susmentionné sur les NBT, la France ne prépare pas suffisamment son avenir agronomique. Un autre fait le démontre : la faiblesse vertigineuse du budget public de recherche agronomique en France par rapport aux concurrents.
Le budget public français est près de deux fois inférieur au budget russe, trois fois inférieur au budget allemand et huit fois inférieur au budget américain.
Les pouvoirs publics semblent avoir fait le choix, en France, de ne plus investir dans la recherche publique à l'heure où l'agriculture est à la croisée des chemins. Cette erreur stratégique aura de lourdes conséquences à l'avenir et impactera, directement, les performances des filières en matière de compétitivité.
Budget de la recherche publique agricole en 2019 (en millions de dollars)
Source : FranceAgriMer.
En complément de cette faiblesse structurelle du modèle céréalier français, dû à un désengagement de l'État, deux facteurs viennent rattraper le manque de compétitivité à la production de la ferme céréalière française, comme cela a été évoqué précédemment : les aides publiques à l'hectare ainsi que les performances de la chaîne collecte-stockage-logistique. Or ces deux acquis pourraient, aujourd'hui, être remis en cause.
D'une part, les céréaliers perçoivent un recul des préoccupations des pouvoirs publics à leur égard dans la construction des politiques publiques agricoles. Dit autrement : dans les différentes maquettes de la PAC retenues depuis 2007, les filières grandes cultures se considèrent comme les grandes perdantes.
D'après les chiffres transmis aux rapporteurs, en moyenne en France, les aides à l'hectare ont reculé de près de 100 € à l'hectare pour les producteurs de grain, passant de près de 380 € à l'hectare en moyenne à 250 € environ aujourd'hui, en raison de la baisse de l'enveloppe de la PAC et des transferts vers d'autres secteurs agricoles, notamment par le biais du transfert de crédits entre le premier et le second pilier, les céréaliers ne bénéficiant que peu du deuxième pilier en dehors de la subvention à l'assurance.
Pour l'AGPB, dans sa contribution écrite, « ramenés à la tonne de blé produite, les soutiens publics ne représentent plus aujourd'hui qu'environ 25 €/t en France contre environ 30 à 35€/t en Roumanie et 35 €/t en Allemagne. »
Or cette baisse des aides pourrait être de nature à remettre en cause l'équilibre économique futur des exploitations. Une étude de Pluriagri en date de mars 2020 explique que « la baisse de ces soutiens creuse l'écart de compétitivité des producteurs français vis-à-vis d'une partie des producteurs européens de l'est de l'Union européenne pour lesquels les aides constituent un levier potentiel d'investissement. » Là où en France, les aides de la PAC servent à rémunérer le travail de l'exploitant, elles servent, plus à l'Est, directement à financer de l'investissement là où la main-d'oeuvre salariée est prédominante.
Il n'est pas à exclure, hors période actuelle, que la baisse tendancielle des aides ait contribué à accompagner la transition de certains exploitants vers d'autres cultures.
La nouvelle maquette de la PAC 2023-2027 tout comme la récente réforme de l'assurance récolte ont, sans doute, limité cette tendance décroissante des aides, sans toutefois l'enrayer.
S'agissant du maillon collecte-stockage-logistique, l'ensemble des interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs ont fait part de leur vive inquiétude quant à la fragilité des outils, directement liée à un vieillissement problématique, faute d'investissements suffisants.
Concernant la logistique de transport, le camion a une position prédominante avec 79 % du fret alors que les concurrents utilisent davantage le rail et le fluvial pour acheminer le blé vers les ports d'exportation. À cet égard, les acteurs estiment que la fiabilité et la densité des lignes capillaires de fret SNCF sont un véritable frein à la compétitivité alors que le rail domine eu Ukraine (70 %), aux États-Unis (56 %) et au Canada (85 %) contre 6 % en France. En outre, de nombreux acteurs ont signalé que « les ports français n'étaient plus adaptés », ni en organisation, ni en capacité, ni en investissement de stockage, ni en capacité de chargement/déchargement.
Concernant le stockage, les rapporteurs s'inquiètent du vieillissement du parc de silos de stockage. Cela pose deux types de problèmes. D'une part, en raison du changement climatique, les silos doivent être davantage performants en matière énergétique et être désormais équipés d'instruments de lutte contre les fortes chaleurs, sauf à prendre le risque d'altérer la qualité des grains et de voir se développer les insectes au silo, alors que l'utilisation de solutions biocides sera de plus en plus encadrée. En outre, de nouveaux silos sont nécessaires pour favoriser la segmentation de la production sans remettre en cause le volume total produit.
Or, comme le rappelle La Coopération agricole - Métiers du grain, « les projets, sont financés sur les fonds propres de la coopérative. Elles bénéficient difficilement des subventions (agence de l'eau...) car la construction d'un silo ou bien d'un séchoir ne correspondent pas aux critères d'éligibilité de la ou des subvention(s). Il semblerait que celles-ci soient plus orientées pour des projets agricoles, ou développement de culture mais pas pour maintenir et renforcer la filière de stockage. Cette difficulté apparaît comme un point majeur pour permettre le développement de la filière (exemple silos dédiés au bio) et la maintenir, avec des installations plus modernes, moins coûteuses (besoin moindre en énergie...). La construction d'un silo reste un investissement fort pour une coopérative puisque cette structure devrait être exploitée pour une durée d'au moins 50 ans voir plus suivant son état de conservation. Dès lors, certaines coopératives renforcent le stockage à la ferme au détriment des silos. Ce type de stockage est indispensable mais il n'est pas intéressant de le développer car il pourrait entraîner une qualité de stockage plus difficilement maîtrisable. »
Comme dans de nombreuses filières, les acquis français sont aujourd'hui fragilisés par un manque d'investissement de nature à préserver la compétitivité de la filière tout en relevant les défis de demain, notamment environnementaux. L'État a son rôle à jouer pour accompagner les acteurs dans ces transitions. Un grand plan silos est à imaginer.
Car si ce maillon venait à être durablement affaibli, cela serait l'ensemble des performances à l'exportation des blés français qui seraient remises en cause en raison d'un décrochage majeur en termes de compétitivité.
3. Quand le grenier à blé de l'Europe importe des biscottes et de la farine : faute de compétitivité, la filière transformatrice en difficulté
Si la France parvient à demeurer compétitive sur le maillon « blé », les signaux sont plus inquiétants sur le maillon transformation.
Sur les 35 millions de tonnes de blé produites en France, entre 15 et 20 millions sont consommées par le marché domestique, soit près de la moitié. Outre l'autoconsommation et le stockage à la ferme, ces blés sont destinés pour environ un tiers à des utilisations industrielles, un tiers à l'alimentation animale et un tiers à des utilisations humaines.
Malgré une production de blé stable, la production de farine chute : elle a reculé de 17 % entre 2000 et 2021. Cette érosion s'explique principalement en raison de la disparition des débouchés.
D'une part, sur le marché domestique, la baisse de consommation de pain recule puisque les Français consommaient 500 grammes de pain par jour au début du XXe siècle, 250 grammes dans les années 1950 et désormais entre 92 grammes.
D'autre part, la farine française ne s'exporte plus. Le fait majeur sur cette période est le passage de la France du rang de premier exportateur mondial de farine de blé tendre en 1995, quand elle exportait près de 2 millions de tonnes de farine de blé tendre chaque année, à un exportateur marginal dans la compétition mondiale avec moins de 160 000 tonnes d'exportations chaque année.
Et cette chute des exportations a lieu au moment même où le marché mondial des farines échangées n'a jamais été si dynamique puisque les exportations mondiales de farine de blé tendre ont plus que doublé depuis 1990. Les meuniers français ont clairement laissé leur place aux meuniers turcs, fortement importateurs de blé, aux meuniers kazakhs et, dans une moindre mesure, aux meuniers allemands. La baisse des volumes est principalement expliquée par la perte de marchés en Afrique, en raison du développement de moulins locaux, de l'absence dans de nouveaux marchés émergents et de la perte de compétitivité.
Évolution des exportations des principaux exportateurs mondiaux de farine de blé tendre et de la France
Source : Intercéréales.
En parallèle, les importations de farine en France ont également évolué défavorablement, la France ayant importé 243 000 tonnes de farine en 2020, à deux tiers en provenance d'Allemagne notamment pour la vente directe au consommateur en grandes et moyennes surfaces où les Allemands détiennent 30 % des parts de marché.
Comme le syndicat de la meunerie française le précise dans sa contribution, « il y a de plus en plus d'importations de farine notamment d'Allemagne via le hard discount, ce qui traduit une dégradation de la compétitivité de la meunerie française sur ses marchés intérieurs, après la perte quasi-totale des marchés de la meunerie à l'exportation au cours des 20 dernières années. »
Cette pénalisation résulte d'une dynamique propre à l'industrie agroalimentaire française, exacerbée pour la meunerie qui a une valeur ajoutée parmi les plus faibles de l'industrie agroalimentaire en raison de coûts de personnel plus importants relativement que d'autres industries. Dès lors, la meunerie française, sur un marché très concurrentiel, se retrouve particulièrement pénalisée par le poids des impôts de production (5,7 % en France en 2017 contre 0,7 % en Allemagne) et des charges de personnel, ces deux postes ayant subi des évolutions défavorables ces dernières années : ainsi, le coût horaire français des IAA s'est accru de 58 % entre 2000 et 2017 contre 34 % en Allemagne, cette hausse ayant été 1,4 fois plus rapide que dans l'ensemble de l'industrie manufacturière102(*). Il en résulte une préservation des marges qui tend à réduire le taux d'investissement en France, qui est 30 % plus faible pour les machines et les équipements matériels qu'en Allemagne, en Italie ou en Espagne dans l'industrie agroalimentaire, qui vient finalement pénaliser la productivité du secteur.
En découle un solde commercial désormais déficitaire, alors qu'il était historiquement largement excédentaire.
Solde commercial français de farine de blé tendre (en millions d'euros)
Source : FranceAgriMer.
L'avenir des industriels de la farine français est un exemple typique de la dynamique de déclin rapide qui pourrait attendre d'autres filières faute de compétitivité.
Or elle commence à se retrouver chez d'autres transformateurs de blé tendre en France :
- Dans le secteur des pains, pâtisseries et viennoiseries fraîches, si la France maintient un courant élevé d'exportations avec les pays tiers, qui explique une progression du solde en valeur (environ + 400 M€), le solde vers l'Union européenne se dégrade régulièrement avec la progression des importations d'origine Union européenne ;
- De même, dans le secteur des biscottes et pâtisseries de conservation, on constate une forte dépendance aux importations depuis l'Union européenne qui s'accroissent beaucoup plus vite que les exportations vers les pays tiers. Il en résulte, au pays du blé, un solde déficitaire de plus de 500 millions d'euros en la matière, alors qu'il était de 250 millions d'euros en 2004.
III. RELANCER UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE COMPÉTITIVITÉ AU SERVICE DE NOTRE AGRICULTURE EST UN IMPÉRATIF STRATÉGIQUE
A. LA FERME FRANCE EN PÉRIL, EN L'ABSENCE DE POLITIQUE DE COMPÉTITIVITÉ
L'absence de politique de compétitivité en matière agricole ne se retrouve pas uniquement dans les manuels macroéconomiques ou les longues études universitaires : elle a des conséquences directes, mesurables empiriquement, dans les cours de ferme et l'assiette des Français.
De ces cinq exemples étudiés sur des filières très différentes, on peut mesurer les conséquences d'une telle absence de préoccupation sur les charges, la productivité et la compétitivité hors prix de nos exploitations agricoles.
Elles peuvent être résumées, de manière imagée, par trois effets successifs, illustrant la spirale infernale résultant de cette absence d'attention à la compétitivité d'une filière agricole : l'effet « emmental », l'effet « tarte tatin », et l'effet « repas du dimanche ».
L'effet « emmental », typique du cas du lait, illustre le fait que l'absence de politique de compétitivité mite le revenu des agriculteurs, car leur revenu devient la variable d'ajustement pour conserver nos parts de marché. Pour demeurer compétitifs, quand l'État ajoute des charges aux paysans, les paysans voient leur revenu diminuer afin de limiter l'étendue des pertes de marché. Il en résulte une filière laitière dont la situation, vue de l'extérieur, n'alerte pas ou peu, mais qui, quand on l'ausculte à l'intérieur, présente des failles et des trous de plus en plus grands qui menacent tout l'équilibre de la filière. Sans revenu suffisant, les jeunes de la filière laitière ne veulent plus s'installer et le cheptel connaît une décapitalisation très préoccupante, menaçant tout l'écosystème laitier en France. Durablement, le risque de l'absence de politique de compétitivité, c'est l'effondrement économique d'une filière aboutissant, résultant progressivement de la désaffection de la filière agricole, de la décapitalisation en élevage et d'une baisse de production ayant des conséquences économiques mais également sociales et environnementales.
Pour échapper à cette baisse de revenu, l'État prône la montée en gamme pour se concentrer sur le marché domestique, plus rémunérateur. C'est l'effet « tarte tatin » qui démontre, de son côté, comment l'État raisonne à l'envers. Loin de l'idée que la montée en gamme permet de se recentrer sur le marché domestique, quitte à perdre des volumes à l'extérieur, l'absence de politique de compétitivité aboutit à un renversement de situation : une perte de parts de marché à l'exportation et, en même temps, une hausse des importations sur le segment « coeur de gamme ». Les cas de la farine et de la pomme démontrent que la baisse des parts de marché à l'export, le plus souvent liée à un manque de compétitivité aboutissant à un recentrage sur le marché domestique par une montée en gamme, se traduit rapidement par une percée du poids des importations dans l'assiette des Français.
La chute des exportations de farine, faute de compétitivité a annoncé la chute de la production et la percée corrélative des importations. Alors que les exportations de farine ont été divisées par plus de dix en 25 ans, pour que la filière puisse se recentrer davantage sur le marché intérieur, la production a reculé de près de 20 % et, en parallèle, les importations de farine pour les produits sous marque de distributeur ou dans l'industrie ont explosé.
La pomme prend le même chemin : division par deux de la production et des exportations sur moyenne période, consécutive à la volonté des pouvoirs publics de développer des démarches mieux valorisées sur le marché intérieur, déstabilisation progressive de l'équilibre de la filière créant des tensions sur la filière transformation par manque d'approvisionnements, qui a, dès lors, un recours accru aux pommes importées.
Dans les deux cas, l'absence de politique de compétitivité a sacrifié deux filières d'excellence, autrefois fortement exportatrices, en les privant à la fois du marché extérieur mais aussi en ouvrant le marché des denrées de base en France aux concurrents étrangers. La France perd ainsi sur les deux tableaux : moins d'exportations et plus d'importations.
À terme, si aucune politique de compétitivité n'est mise en oeuvre, l'agriculture française est enfin touchée par l'effet « repas du dimanche », aboutissant à ce que les denrées agricoles françaises deviennent inaccessibles quotidiennement à de nombreux Français et ne soient servies qu'en de rares occasions. La place est ainsi laissée aux produits importés pour les repas du quotidien, en restauration hors foyer ou dans les plats transformés. Pour les familles les plus modestes, cela remet en cause l'accessibilité quotidienne aux produits français, les reléguant à ne consommer que des produits venus d'ailleurs.
C'est ce que connaît la filière poulet. Tout se passe comme si les Français consommaient un bon poulet du dimanche par mois, labellisé et produit en France, tout en acceptant de manger tous les jours du filet de poulet importé, issu d'élevages plus compétitifs. Près de la moitié du poulet consommé en France est aujourd'hui importé, dont près de ¾ dans les plats transformés ou dans la restauration hors foyer. Ce taux s'aggravera encore dans les prochaines années compte tenu de la dynamique de la consommation qui privilégie les coupes de poulet, où la production française a des désavantages compétitifs. Il y a encore trente ans, la France était pourtant le principal producteur de poulet au monde.
Les producteurs de tomates pourraient également être concernés. En utilisant la segmentation comme seule arme défensive en cas de manque de compétitivité ces dernières années faute de soutien de l'État, les producteurs de tomates ont fait évoluer leur production de la tomate ronde à la tomate cerise pour échapper à la concurrence marocaine. Encore une fois, il sont été délogés de leur niche : les importations de tomates marocaines, une fois conquis le coeur de gamme, ont attaqué le marché de la tomate cerise : elles sont ainsi passées de 300 tonnes en 1995 à 70 000 tonnes aujourd'hui. Sans réaction de l'État, la filière a promu une nouvelle spécialisation sur le marché des tomates anciennes pour récupérer de la valeur, quitte à perdre encore un peu plus le marché « coeur de gamme ». En attendant, les Marocains ont progressivement conquis toutes les parts de marché, qu'il soit de masse ou de niche, en s'imposant dans les assiettes des Français.
Dans les trois cas, les producteurs et l'agriculture française sont perdants.
Finalement, quand l'État propose aux producteurs de faire de la montée en gamme sans politique de compétitivité, les producteurs perdent sur tous les tableaux, d'autant qu'un marché peut être perdu en quelques années, mais s'avère alors très difficile à reconquérir.
Ces conséquences sont d'autant plus aggravées quand l'absence de politique de compétitivité devient une politique de non-compétitivité assumée, autrement appelée politique du « tout montée en gamme ».
L'ensemble des acquis de la littérature économique et des exemples concrets repris sur le terrain démontrent l'urgence pour le Gouvernement de remettre en place une politique de compétitivité dans le monde agricole.
La transition agricole ne peut se faire au prix de charges nouvelles pour les agriculteurs au risque que cette transition se fasse bien, mais sans agriculture.
Loin de l'idée des rapporteurs de recommander un arrêt de toute initiative de montée en gamme, au contraire. Pour bien des filières, des segmentations répondant à des demandes sont une voie essentielle pour dégager de la rentabilité, donc du revenu.
Mais prôner la montée en gamme pour tous les produits, toutes les filières, sans l'accompagner de politique de compétitivité, c'est :
- cautionner une hausse des charges pour les agriculteurs sans leur garantir une hausse de revenus, faute de marchés suffisants, ce qui se traduit inéluctablement par une baisse accrue de production dangereuse pour la souveraineté française ;
- accepter de voir la France perdre des marchés à l'international, ce qui réduit sa puissance agricole et sa capacité à nourrir de nombreuses personnes à travers le monde ;
- assurer que les importations de produits agricoles et alimentaires soient de plus en plus présentes dans l'assiette des Français, avec des produits qui ne respectent pas nos normes de production. Autrement dit, c'est réserver la consommation de produits français à certains consommateurs, en reléguant les plus modestes aux rayons des denrées importées.
Or le virus de la décroissance se niche derrière ce discours de la montée en gamme. Sans prendre en compte ces risques évidents, fermant les yeux sur les évolutions en cours précédemment détaillées, il prône l'érosion du potentiel productif agricole national, sans voir toutes les externalités positives et les atouts stratégiques que l'agriculture procure à la France.
Cette fatalité peut être enrayée à une condition : replacer la compétitivité au coeur des préoccupations de la politique agricole nationale après plusieurs années où la hausse des charges des agriculteurs ne préoccupait pas le Gouvernement, voire était cautionnée par ce dernier au prix de sa stratégie de montée en gamme.
Il est temps de corriger le tir.
C'est pourquoi les rapporteurs proposent la mise en oeuvre d'un plan « Compétitivité 2028 » pour la Ferme France, qui pourrait contenir l'ensemble des mesures détaillées dans la partie suivante.
B. LA FRANCE PEUT ENCORE AVOIR UNE AGRICULTURE FORTE, DURABLE ET ACCESSIBLE À TOUS, SI ELLE S'EN DONNE LES MOYENS AU TRAVERS D'UN VASTE PLAN « COMPÉTITIVITÉ 2028 »
1. Axe 1 : faire de la compétitivité de la Ferme France un objectif politique prioritaire
Pour ce faire, les rapporteurs recommandent de nommer un haut-commissaire à la compétitivité de la Ferme France, chargé notamment du pilotage de ce plan.
Il sera le référent « compétitivité » de l'ensemble des filières et des pouvoirs publics.
Il aura pour mission de rédiger un point de situation, tous les trois ans, sur le sujet, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, en s'appuyant sur l'expertise des services économiques de FranceAgriMer ainsi que sur les chercheurs spécialisés de l'Inrae.
Il présidera les conférences publiques de filières, d'ores et déjà prévues à l'article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, mais qui n'ont pas trouvé à ce stade leur place, faute de la publication de décrets d'application par le Gouvernement. Ces conférences publiques, réunissant notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile, a pour mission d'examiner « la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir ». Ces conférences, dans le contexte actuel, sont clairement utiles et doivent être un outil pertinent de remontée des informations par filière auprès du haut-commissaire chargé du plan « Compétitivité 2028 ».
Recommandation n° 1 : nommer un haut-commissaire chargé de la compétitivité de la Ferme France afin d'assurer le pilotage et le suivi du plan « Compétitivité 2028 » et le doter d'une mission de collecte d'information sur le sujet, en le plaçant au plus près des filières réunies en conférences chaque année, ainsi qu'une mission d'alerte des pouvoirs publics sur le sujet par la publication d'un rapport triennal sur la compétitivité de la Ferme France.
2. Axe 2 : maîtriser les charges de production pour regagner de la compétitivité prix
a) Priorité 1 : faire de l'administration un partenaire, et non un frein à la compétitivité
Aujourd'hui, l'administration française est unanimement perçue comme une source de complexité pour les producteurs agricoles ou agroalimentaires.
Sans rappeler dans le détail des exemples de dysfonctionnements majeurs, comme le retard de paiements des mesures agroenvironnementales et climatiques entre 2015 et 2020, la relation administration-agriculteurs doit être repensée. Aujourd'hui, trop de fonctionnaires locaux ou nationaux oublient leur stricte neutralité en matière agricole et excèdent leurs prérogatives. Les interventions de certains agents de l'Office français de la biodiversité ou de certaines directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont, souvent, fait l'objet de critiques en ce qu'elles retiennent des interprétations contestables de normes juridiques pour parvenir à des fins politiques.
S'ajoute à cette difficulté, qui ne changera que par la pratique, celle de la multiplication des échelons administratifs qui aboutit, régulièrement, à des divergences d'interprétation selon les services. Trop souvent, les agriculteurs d'un département se voient appliquer une règle différente de celle du département voisin. Le flou de ces décisions doit vite être dissipé et l'administration centrale doit jouer, plus rapidement encore, son rôle de juge de paix.
Enfin, l'administration peut même jouer contre son agriculture en multipliant les surtranspositions. Elles peuvent être législatives et réglementaires mais sont bien souvent davantage « pratiques », résultant d'une interprétation extensive et contestable des services du ministère.
Or un principe évident doit régner : pas de surtranspositions détériorant la compétitivité de nos filières agricoles. En agriculture, une norme en plus, c'est une charge supplémentaire, donc un handicap de trop pour les producteurs.
Les exemples cités dans la deuxième partie de ce rapport sont trop nombreux. Cesser les sur-transpositions, c'est, sans aucun surcoût, redonner une bouffée d'air frais à l'agriculture française, dans le plein respect des normes européennes reconnues comme étant les plus strictes, exigeantes et les plus durables du monde.
Pour donner corps au principe « Stop à la surtransposition », trop longtemps invoqué sans jamais être appliqué, plusieurs mesures techniques pourraient être prises afin de responsabiliser les acteurs :
- enrichir les missions du Conseil d'État dans ses fonctions consultatives sur les lois et les décrets, à l'article L. 112-1 du code de justice administrative, afin de prévoir une mission d'identification des surtranspositions avec le droit européen. En procédant à un contrôle de conventionnalité des mesures qui lui sont soumises dans la plupart de ses avis consultatifs, il a déjà à connaître du droit européen. Selon un principe de transparence, il pourrait dès lors inclure dans ses avis un principe d'alerte en cas de surtransposition voulue par le Gouvernement ou un parlementaire en cas d'examen d'une proposition de loi ;
- confier au haut-commissaire chargé du suivi du plan Compétitivité 2028 mentionné dans l'axe 1 une mission de recueil des plaintes des organisations professionnelles agricoles représentatives quant à une éventuelle surtransposition. Il aura pour mission d'en informer le Parlement et le Gouvernement s'il les juge avérées et, au besoin, d'enjoindre l'administration de modifier sa pratique103(*) ou de proposer des mesures pratiques pour en atténuer les effets104(*).
- en réponse aux demandes du haut-commissaire, rendre obligatoire la fourniture, par les services du Gouvernement, d'un calcul de surcoût éventuel de la mesure de surtransposition afin de mieux responsabiliser l'administration sur l'impact de ces surtranspositions. Ces études d'impact, courtes et lisibles, comprenant une fourchette du surcoût, seraient transmises dans un délai inférieur à un mois au haut-commissaire qui devra les transmettre, immédiatement, au Parlement.
- pour donner une base juridique à ce principe, il importe d'ancrer, dans la loi, le principe qu'il est d'intérêt général de lutter contre la surtransposition dans le domaine agricole et agroalimentaire pour éviter des pertes de compétitivité qui se traduisent, mécaniquement, par une hausse des importations alimentaires et une réduction de la production agricole française, au détriment de ses externalités positives.
Recommandation n° 2 : donner corps au principe « Stop aux surtranspositions » en :
- conférant une valeur législative au principe de non surtransposition, sauf motif d'intérêt général suffisant ;
- renforçant la transparence sur les surtranspositions en confiant au Conseil d'État la mission de les identifier dans ses avis sur les projets et propositions de loi et dans ses avis sur les décrets ;
- rendant obligatoire la production d'une estimation du surcoût d'une surtransposition par le Gouvernement dans un délai bref ;
- confiant au haut-commissaire à la compétitivité une mission de collecte des plaintes des organisations agricoles représentatives quant à des surtranspositions, une mission d'information du Parlement à ce sujet ainsi qu'une mission de proposition pour en limiter les effets laquelle sera assortie, pour certaines surtranspositions, d'un pouvoir d'injonction d'y mettre fin.
Sur le sujet épineux des intrants, aux yeux des rapporteurs, il importe de trouver un équilibre entre le principe de précaution et celui de réalité économique.
Bien entendu, en cas de nouvelle connaissance scientifique largement partagée par plusieurs acteurs établissant un danger grave pour l'environnement et la santé d'une substance active, il importe de l'interdire dans les plus brefs délais.
Dans ce cas, la priorité doit aller à une interdiction au niveau européen car la dangerosité sera la même pour tous. Pour mener une telle politique de précaution, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut agir.
Toutefois, dans bien des cas, des interdictions brutales, répondant au principe de précaution, aboutissent à mettre des filières entières dans des impasses techniques. Outre les effets économiques de ces mesures, le bilan environnemental de la mesure pourrait devenir négatif, dès lors que les agriculteurs se voient recommander, parfois par les mêmes autorités scientifiques, d'utiliser des combinaisons d'autres produits phytopharmaceutiques, en plus grande quantité pour compenser la moindre efficacité de ces derniers.
Pis encore : les consommateurs français importent des denrées alimentaires traitées avec les mêmes substances justement interdites par les autorités nationales, déplaçant simplement le problème environnemental ailleurs, sans résoudre le problème sanitaire.
Pour conjurer cet effet, au bilan environnemental plus problématique, les rapporteurs proposent de compléter les missions de l'Anses afin que ses avis et ses délivrances ou retraits d'autorisations de mise sur le marché dressent un bilan « bénéfices/risques » des effets d'une éventuelle interdiction d'une substance active au regard du contexte, notamment des effets des solutions alternatives voire de l'absence de solution alternative.
Étant une agence scientifique indépendante dont le rôle est d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux, l'Anses ne retiendra pas, dans son bilan « bénéfices - risques », des arguments de type économiques, qui ne relèvent pas de sa mission et pour lesquels elle n'est pas compétente.
Sa décision sera ainsi fondée sur un ensemble d'éléments objectifs lui permettant de pondérer de manière adéquate son avis en tenant compte des effets de bord environnementaux d'une éventuelle interdiction.
Elle pourra ainsi mieux l'assortir de mesures d'accompagnement dans l'utilisation d'alternatives et pourra prévoir le pas de temps le plus optimal en cas d'interdiction d'un intrant.
Recommandation n° 3 : Garantir une application pondérée du principe « pas d'interdiction sans alternative et sans accompagnement », en l'absence de situation d'urgence, en complétant les missions de l'Anses afin qu'elle dresse, dans ses avis et retraits d'autorisation de mise sur le marché, un bilan « bénéfices-risques » d'une interdiction, notamment pour mesurer les effets de bord environnementaux d'une éventuelle interdiction à court-terme d'une substance active, le cas échéant en prévoyant un laps de temps nécessaire à l'émergence d'alternatives crédibles et assortir toute nouvelle interdiction d'un accompagnement technique et financier adapté des professionnels ainsi que d'un plan prioritaire de recherche d'alternatives.
b) Priorité 2 : réduire le coût de la main d'oeuvre en agriculture et dans l'agroalimentaire sans réduire l'attractivité des filières et résoudre les problèmes d'embauches du secteur
Le coût de main-d'oeuvre est clairement ce qui ressort des rencontres avec les professionnels comme étant un des facteurs les plus pénalisants pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire française.
Certaines filières et industries agroalimentaires, fortement intensives en main d'oeuvre, sont très lourdement pénalisées par des différences de charges et de coût horaire du travail.
Il faut tenter d'aborder le problème par deux types de réponses : les réponses à court terme, qui passent par des réductions de charges sociales et par un meilleur appariement entre offre et demande d'emploi ; les réponses à long terme, qui limitent l'intensité en main d'oeuvre de la production par une plus grande mécanisation.
Pour agir à court terme, il convient de rappeler qu'outre la sempiternelle problématique liée à la directive « travailleurs détachés », qui pose des problèmes particuliers, la France est pénalisée par des choix historiques aboutissant à ce qu'elles présentent des charges sociales plus élevées qui pénalisent la production.
L'objectif n'est pas de réduire les salaires des travailleurs saisonniers : cela serait un choix problématique pour l'attractivité de ces métiers, déjà mise à mal ces dernières années.
En revanche, les cotisations sociales sont clairement un levier d'amélioration de la compétitivité, ne pénalisant pas le niveau des salaires :
- les exonérations de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi dans le monde agricole (dispositif dit « TO-DE ») doivent être enfin pérennisées. Le Gouvernement, après avoir entendu les supprimer en 2018 et devant la fronde parlementaire, en a finalement prolongé l'existence jusqu'en début 2023. Toutefois, à ce stade, elles sont condamnées à disparaître. Leur pérennisation doit être enfin écrite dans la loi, ce que le Gouvernement refuse depuis 2018 ;
- il pourrait être envisagé une extension des baisses de charges à d'autres professionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires (salariés permanents dans certaines activités saisonnières, filières rencontrant des difficultés particulières comme le lait de montagne...) ;
- l'application d'un bonus-malus aux contrats courts à compter de septembre 2022 concerne le secteur de la fabrication de denrées alimentaires, ce qui est de nature à alourdir les charges de production des entreprises. Cette réforme, surtout, s'applique uniformément, sans prendre en compte la saisonnalité des productions. À cet égard, les industriels de la tomate d'industrie estiment que « l'instauration d'un système de bonus-malus pour les contrats courts n'a pas pris en compte la saisonnalité inhérente à nos métiers et va avoir pour conséquence de n'offrir que des perspectives de malus pour les entreprises caractérisées par une forte activité saisonnière. En 2018, près 60 % des recrutements ont été des recrutements de saisonniers. Ces CDD (ou contrats de missions) saisonniers sont indispensables pour nos entreprises et ne peuvent que très difficilement être remplacés par des contrats à durée indéterminée. La responsabilisation des entreprises pour lutter contre la précarité, et in fine limiter les contrats courts, supposerait que la durée des contrats, proposés par les entreprises de notre secteur, résulte strictement d'un choix de leur part et non d'un aléa externe, tel que la saison des récoltes et de transformations des fruits et légumes. Or c'est méconnaître la réalité de l'activité. » Les rapporteurs appellent à mettre en oeuvre une dérogation pour le secteur ou, à tout le moins, d'en exclure les entreprises fabriquant des denrées alimentaires selon une saisonnalité marquée, ce qui les contraint à recourir massivement à des contrats courts.
En parallèle, la France doit s'engager dans une meilleure gestion des modalités d'accueil de ses travailleurs saisonniers étrangers, prenant exemple sur d'autres modèles, comme celui du Canada, qui est plus exigeant en matière de droit du travail tout en étant moins généreux.
Recommandation n° 4 : Réduire les coûts de main d'oeuvre par une politique de baisse des charges sociales sur les travailleurs saisonniers agricoles en pérennisant le dispositif dit “TO DE“, en l'étendant à certains secteurs et en sortant les entreprises agroalimentaires saisonnières de l'application du bonus-malus sur les contrats courts.
Un autre problème majeur se pose pour les acteurs agricoles : les difficultés qu'ils ont à recruter.
La note de conjoncture de janvier 2021 de l'Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) est très claire à ce sujet : 30 000 emplois sont non pourvus dans l'industrie agroalimentaire en 2020, contre 10 000 en 2013. Aujourd'hui, plus d'une entreprise sur deux rencontre des difficultés de recrutement, notamment dans les zones les plus rurales.
En mars 2022, 89 % des entreprises membres de l'ADEPALE constataient, de leur côté, des difficultés à recruter des salariés.
Et ce problème semble particulièrement prégnant dans le monde agricole et alimentaire compte tenu de la pénurie d'attractivité chez les étudiants, constatée par le rapport sénatorial de la mission d'information sur l'enseignement agricole105(*) : « une étude ManageriA/RegionsJob estime que 6 jeunes sur 10 disent avoir une bonne image du secteur mais seulement 30 % d'entre eux déclarent qu'ils aimeraient y travailler, la majorité s'estimant plutôt mal informés sur les métiers du secteur (59 %), et plus encore sur les formations qui y mènent (65 %) ».
C'est à un véritable déficit d'attractivité que la filière agricole et agroalimentaire doit faire face.
Aux yeux des rapporteurs, l'enseignement agricole, qui pourtant devrait favoriser la formation de la main d'oeuvre des industries agroalimentaires, ne parvient pas à réaliser suffisamment ce fléchage car uniquement 4 % des élèves de l'enseignement agricole sont inscrits dans des filières de formation destinée à la transformation agroalimentaire.
Il est essentiel de mieux prendre en compte les besoins des agriculteurs et des transformateurs agroalimentaires lors de la construction des programmes de l'enseignement agricole et des formations supérieures ou professionnelles menant à des métiers dans ces secteurs.
À cet égard, les pénuries de main d'oeuvre dans ces secteurs doivent justifier une meilleure connexion avec Pôle emploi afin de mieux orienter les personnes à la recherche d'emplois vers des filières en demande, même s'il faut envisager ce fléchage sous conditions.
Le président de la République a annoncé, dans son programme, une réforme de l'accessibilité du revenu de solidarité active à une obligation d'activité de 15 à 20 heures par semaine, afin de mieux accompagner les demandeurs d'emploi vers l'insertion professionnelle. Cette obligation pourrait être soit une formation soit une activité dans une entreprise.
Dans le cadre de cette réforme à venir, il est essentiel que l'agriculture et l'agroalimentaire figurent parmi les secteurs prioritaires afin de répondre à leurs besoins de main d'oeuvre en développant la connaissance du secteur et l'employabilité des demandeurs d'emploi, mais, aussi, dans une logique de compétitivité, en donnant un coup de pouce aux entreprises concernées qui accueilleraient ces publics.
Un calcul rapide, proposé par une personne entendue de la filière pomme, présente l'avantage d'une telle mesure : pour lui, une réduction d'environ 30 % des coûts de main d'oeuvre lui permettrait de reconquérir des marchés. Pour donner un ordre d'idées de la marche à franchir, cela reviendrait à faire prendre en charge par l'État environ 6 000 emplois annuels de 15 heures par semaine par les pouvoirs publics.
Recommandation 5 : activer tous les leviers pour résoudre les problèmes d'embauche du secteur en :
- renforçant la connaissance des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
- prenant mieux en compte, dans la constitution des formations, notamment au sein de l'enseignement agricole, les besoins des industries agroalimentaires ;
- créant un partenariat entre les secteurs agricoles et agroalimentaires et Pôle emploi pour en faire un secteur prioritaire afin que Pôle emploi puisse, après leur avoir proposé des formations adaptées, davantage flécher vers ces secteurs dans les offres raisonnables d'emplois qu'il propose aux personnes à la recherche d'un poste ;
- s'assurant, en cas de réforme des conditions d'accès au revenu de solidarité active, que les secteurs agricoles et agroalimentaires soient prioritaires et deviennent ainsi éligibles pour les Français concernés, afin d'en améliorer l'employabilité dans un secteur qui cherche à recruter.
À plus long terme, il importe, dans les secteurs les plus intensifs en main-d'oeuvre qui sont confrontés à des problématiques de compétitivité dues au coût du travail, de favoriser la substitution du capital au travail.
Cette politique apparaît d'autant plus urgente que les pénuries de main d'oeuvre saisonnière étrangère sont de plus en plus probables compte tenu des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises sur les territoires106(*).
Recommandation n° 6 : mettre en place un mécanisme de suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements de mécanisation dans l'agriculture ou l'agroalimentaire en faveur de la réduction des coûts du travail dans les secteurs les plus intensifs en main d'oeuvre confrontés à des difficultés de compétitivité.
c) Priorité 3 : utiliser davantage la carotte que le bâton pour accélérer les transitions environnementales
Le poids des consommations intermédiaires des agriculteurs français a beaucoup augmenté ces dernières années, en raison d'une politique volontaire de l'État d'augmentation du coût des intrants dans les comptes d'exploitation des agriculteurs.
Les mécanismes sont connus : interdiction des remises, rabais et ristournes sur la vente de produits phytopharmaceutiques et biocides, votée dans la loi Egalim et hausse de la redevance pour pollutions diffuses sur les pesticides les plus dangereux.
Sur la période 2017-2022, la majorité a, au moins au début de la législature, adopté une politique peu incitative en matière environnementale.
Il importe d'arrêter cet engrenage mortifère et de privilégier la transition par l'incitation à la transition par la punition.
D'autant que ces mesures comportementales augmentant le prix des intrants reposent sur un raisonnement contestable, lequel estime que si les produits phytopharmaceutiques sont plus chers, les agriculteurs en utiliseront moins. C'est estimé que l'élasticité-prix de la consommation d'intrants est forte alors, qu'empiriquement, elle est faible pour la raison suivante : les agriculteurs n'utilisent pas des intrants par plaisir ou car ils auraient bénéficié d'une promotion dessus ! Les produits phytopharmaceutiques et les engrais sont avant tout des charges contraintes pour les agriculteurs qu'ils entendent, à tout prix, réduire. Toutefois, dans leurs itinéraires culturaux, ils n'ont souvent pas le choix que d'y recourir.
C'est cette erreur qui explique que ces mesures n'ont pas abouti à une quelconque baisse des usages des intrants alors qu'elles ont considérablement augmenté les charges des producteurs, au profit des caisses de l'État.
Bien sûr, d'aucuns répondront que ces mesures ne s'appliquent pas aux solutions autorisées dans l'agriculture biologique ou aux solutions de biocontrôle, ce qui crée un différentiel de prix incitant à recourir à ces dernières. Toutefois, ces substances sont insuffisamment nombreuses et laissent, bien souvent, les agriculteurs dépendants d'une ou deux substances actives par besoin. Si leur prix augmente, ils n'ont pas d'autres choix que de payer plus cher, tout en consommant autant.
Il existe en revanche un cas où cette politique de différentiels de prix est pertinente : lorsqu'il existe des alternatives et que l'agriculteur, par différence de prix et par le poids des habitudes, demeure attaché aux anciennes solutions.
C'est sans doute au regard de ce principe qu'il convient d'adapter les mesures sur les remises, rabais et ristournes et sur la redevance pour pollution diffuse adoptées ces dernières années : concentrer les interdictions de remises, rabais et ristournes et la hausse de la redevance pour pollutions diffuses mise en oeuvre en 2019 aux seuls produits particulièrement nocifs pour lesquels il existe une alternative dûment constatée par l'État. Dans ce cas, ces mesures seront réellement incitatives pour recourir à d'autres solutions plus pertinentes en matière environnementale.
Enfin, il convient de s'interroger sur le bilan de la réforme de la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, également votée lors de la loi Egalim. Tous les acteurs entendus par la mission ont fait part aux rapporteurs de la création d'un « monstre » réglementaire pour les acteurs, qui aboutit à ce qu'il n'y ait pas moins de vente dans les fermes, mais bien moins de conseil.
Au contraire, le conseil devrait être conçu comme un outil promu par l'État pour optimiser les charges d'intrants des agriculteurs à leur strict besoin en fonction des caractéristiques de leur exploitation. Sur ce point, pourtant, le chantier est encore long.
En tout état de cause, ces mesures mériteraient d'être évaluées, en mettant en regard de leur efficacité sur la quantité d'intrants consommés le surcoût induit pour les agriculteurs et, partant, les effets nocifs sur la compétitivité prix des exploitants.
Recommandation n° 7 : lancer, sous un an, un bilan des mesures du précédent quinquennat s'agissant de la consommation d'intrants (loi Egalim, mesures fiscales comme la hausse de la redevance sur les pollutions diffuses...) afin de mettre en regard l'évolution induite des quantités d'intrants consommées et le surcoût supporté par les agriculteurs.
d) Priorité 4 : ne pas saper nos atouts en termes de compétitivité prix par excès de zèle ou en restant inactif face à des crises internationales
La France a également des atouts en matière de compétitivité prix : il importe de ne pas les affaiblir.
Parfois, pourtant, le régulateur s'en donne à coeur joie.
La filière pomme estime par exemple que l'entrée en vigueur du règlement européen n° 2016/2031 conduit à un désengagement des pouvoirs publics dans la surveillance biologique du territoire par l'arrêt du financement des organismes de quarantaine non prioritaires, l'arrêt du financement des bulletins de santé du végétal ou l'arrêt du financement des modèles qui alimentent les outils d'aides à la décision qui permettent un usage de produits phytosanitaires réduit. Ces mesures peuvent paraître anodines mais elles remettent en cause un avantage comparatif de la France induit par cette surveillance biologique reconnue dans le monde entier, cette dernière constituant un élément fondamental de la compétitivité de la filière des fruits et légumes parce qu'elle assure à la fois la préservation des productions, lève les contraintes sur les conditions d'export quant aux risques sanitaires et permet une consommation sereine des produits. Elle coûte entre 6 et 8 millions d'euros par an à l'État mais pourrait coûter davantage à terme à la filière.
Il est donc essentiel que l'État soit le garant, et non le faussaire, des atouts français en matière de compétitivité, que cela soit sur le coût de l'aliment, sur le coût de l'énergie, sur le coût du foncier ou sur la sécurité sanitaire des produits.
Dans ses décisions en cours ou à venir, il doit s'efforcer de ne toucher à ces secteurs qu'avec une main tremblante, notamment dans le cas d'une éventuelle loi foncière : une loi pour offrir des garanties pour l'avenir oui ; une loi pour garantir des contraintes supplémentaires pour le futur des agriculteurs, non.
Un autre point essentiel à court terme est de conjurer les risques d'une crise majeure de compétitivité due aux coûts actuels de l'énergie.
D'une part, devant le risque de voir les producteurs cultivant sous serre chauffée être rationnés en gaz l'hiver prochain, il est essentiel de considérer les productions agricoles de l'amont comme mission d'intérêt général au sens du décret n° 2022-495 du 7 avril 2022 relatif au délestage de la consommation de gaz naturel et modifiant le code de l'énergie.
D'autre part, la hausse des coûts de l'énergie fait peser des risques majeurs non seulement de compétitivité mais aussi de soutenabilité pour nombre d'exploitations agricoles et pour les industries agroalimentaires. Avec des cours de l'énergie aussi élevés durablement, des arrêts de production vont avoir lieu. Aux yeux des rapporteurs, il faut, au contraire, traverser cette crise avec l'idée claire de conserver nos atouts en termes de compétitivité sur les coûts de l'énergie.
Les entreprises de l'agroalimentaire ont clairement anticipé la crise en s'engageant dans un plan de baisse de la consommation énergétique depuis plusieurs années, dont les résultats sont très encourageants. Toutefois, il convient de rappeler une évidence : l'utilisation d'électricité et de gaz est essentielle à la production et à la conservation d'aliments. Faute de ces apports énergétiques, c'est une partie de la souveraineté alimentaire qui sera remise en cause. En outre, un surcoût durable sans mécanisme de compensation pénalisera lourdement les producteurs et industriels, qui perdront là un avantage comparatif par rapport à leurs concurrents. Des mécanismes à court terme doivent être mis en place pour limiter ce surcoût pour les productions agricoles et agroalimentaires. Cela peut passer par une révision des critères d'éligibilité au bouclier énergétique ou des compensations fiscales plus importantes, par le biais de la taxe carbone.
Lors de la crise de la Covid-19, l'agriculture et l'agroalimentaire ont été considérés comme des « secteurs indispensables » à l'économie. Pourquoi en serait-il autrement dans les décisions à venir ?
Enfin, à long terme, une réflexion prospective doit impérativement être menée pour revoir les modes de production les plus énergétivores afin de limiter les effets d'une nouvelle crise énergétique sur ces entreprises. L'État doit clairement jouer son rôle en la matière en accompagnant la filière agroalimentaire ainsi que la filière agricole sur des projets innovants permettant de renforcer l'autonomie énergétique en agriculture (photovoltaïque, stockage de l'énergie produite...) : c'est un enjeu d'avenir.
Recommandation n° 8 : mettre en oeuvre, à court terme, un plan de résilience de l'agriculture et de l'agroalimentaire face à la crise énergétique en considérant ces secteurs comme essentiels et indispensables en temps de crise, en leur garantissant un approvisionnement suffisant pour préserver notre souveraineté alimentaire et en les rendant éligibles aux aides mises en place pour les activités prioritaires.
e) Priorité 5 : faire du levier fiscal un atout en matière de compétitivité
Enfin, les rapporteurs estiment qu'il est nécessaire d'utiliser le levier fiscal pour redonner de la compétitivité prix à nos productions.
Il importe, avant tout, de s'assurer que la réforme proposée par le Gouvernement de gazole agricole en remplacement du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole non routier (TICPE) se fasse au bénéfice des producteurs. La réforme ne doit pas aboutir à augmenter la TICPE sur le gazole utilisé par les agriculteurs dans le cadre de leurs missions et le reste à charge doit rester le même.
D'autres mesures fiscales incitatives pourraient être imaginées.
Parmi elles, les rapporteurs plaident d'abord pour revaloriser les seuils d'éligibilité ou d'exonération dans la législation fiscale pour mieux les adapter à la réalité du monde agricole. Bien souvent, faute d'actualisation pour prendre en compte la hausse moyenne du chiffre d'affaires des exploitations due à l'effet agrandissement et à l'inflation, ces seuils s'appliquent désormais à une base taxable beaucoup plus large et sont totalement décorrelés de la Ferme France d'aujourd'hui. Leur non-actualisation a abouti à augmenter le poids relatif de la fiscalité dans les exploitations. Plusieurs mesures pourraient ainsi être prises rapidement pour corriger le tir :
- une hausse des seuils d'éligibilité aux régimes d'imposition agricoles doit être envisagée pour mieux être calibrée à l'évolution des chiffres d'affaires agricoles, que cela soit le seuil du passage au régime micro-BA ou celui au régime réel normal, qui crée des charges comptables supplémentaires. Faute de revalorisation, avec l'inflation à venir et la probable explosion des valeurs des stocks, il s'agit d'éviter des effets de bord inutiles pour les agriculteurs ;
- une actualisation du seuil d'exonération des plus-values réservé aux petites entreprises.
Une autre mesure, plus prospective, pourrait être envisagée : une hausse de l'exonération partielle de taxe foncière dont bénéficient aujourd'hui les terres agricoles, la taxe foncière s'apparentant à un impôt de production, dès lors qu'elle est compensée pour les collectivités territoriales.
Enfin, la fiscalité peut être également un levier incitatif à de bonnes pratiques pour dégager des marges de manoeuvre. La dotation pour épargne de précaution (DEP) permet un véritable lissage des agriculteurs entre les années difficiles et les bonnes années : pour le valoriser, il convient d'en augmenter le plafond de déduction. À cet égard, ce plafond pourrait être maximisé pour certaines pratiques. Certains acteurs entendus par la mission ont ainsi fait part aux rapporteurs d'une idée vertueuse : augmenter le plafond de la dotation pour épargne de précaution pour des céréaliers et des éleveurs engagés dans un contrat pluriannuel d'approvisionnement afin de lisser le coût de l'aliment et d'absorber la volatilité des cours. Cette idée doit être creusée.
Recommandation n° 9 : prendre, dès la loi de finances pour 2023, plusieurs mesures de baisses d'impôt en faveur de la production agricole ou agroalimentaire (absence de hausse de la TICPE sur le gazole agricole, actualisation des seuils d'exonération et d'éligibilité, baisse de la taxe foncière sur la propriété non bâtie applicable aux terres agricoles, hausse du plafond de la dotation pour épargne de précaution...).
3. Axe 3 : relancer la croissance de la productivité de la Ferme France en faisant de la France un champion de l'innovation dans le domaine environnemental
Outre les problèmes de charges, la compétitivité de la Ferme France passe par une attention particulière à la productivité de son agriculture.
Si aujourd'hui elle a clairement des atouts en la matière, ce qui lui permet de compenser son choix d'un modèle familial qui la handicape sur les marchés internationaux face à des concurrents ayant choisi des modèles plus intensifs avec des tailles plus importantes, l'étude des 5 filières par les rapporteurs démontre que cet avantage s'étiole, par une stagnation voire une baisse des rendements dont la diffusion atteint la quasi-totalité des filières.
La productivité est pourtant la clé pour que la France agricole puisse préserver son modèle familial si pertinent en ces temps actuels. Il convient donc d'agir sur trois leviers pour redonner de la croissance aux courbes de rendement : mettre la France à la pointe de l'innovation environnementale ; doper les investissements productifs ; limiter les effets des aléas climatiques sur les exploitations.
a) Priorité 1 : faire de la France un champion de l'innovation en matière environnementale
Face au changement climatique, qui impactera les pratiques agricoles durablement, il importe d'être à la pointe de l'innovation. C'est une source de rendement mais c'est aussi un facteur de compétitivité hors prix pour la France à l'heure où les préoccupations environnementales pourront être de plus en plus scrutées par les acheteurs et consommateurs.
Les perspectives sont en effet prometteuses et la France doit jouer le rôle de locomotive en matière de transition environnementale pour préserver ces acquis et les développer dans un monde changeant.
Les rapporteurs, tout au long de leur rencontre, ont été enthousiasmés par le foisonnement d'innovations dans chacune des filières, toute portant une espérance très grande dans l'avenir. La seule barrière à l'entrée, à chaque fois mentionnée, est le coût de déploiement de ces innovations, malgré leurs externalités économiques et environnementales positives.
Les solutions alternatives sont de plusieurs ordres. Toutes doivent être activées pour réussir le défi immense qui consiste à dessiner l'agriculture de demain.
Elles sont chimiques, mais l'innovation a plutôt tendance à se ralentir du fait du manque d'attractivité des marchés européens et français en particulier, elles-mêmes liées au degré d'exigence réglementaire.
Elles sont mécaniques, avec certaines solutions permettant de réduire considérablement les quantités épandues pour de l'agriculture de précision.
Elles consistent à faire émerger des solutions de biocontrôle, à partir de substances naturelles, qui aujourd'hui n'a pas une gamme suffisamment profonde, notamment sur le marché des grandes cultures.
Elles sont culturales, des petits gestes, des petites techniques à la fois sur les dates de semis, les mélanges variétaux, les rotations, les combinaisons de cultures pouvant avoir des effets combinés intéressants. Pour améliorer l'efficience de la fertilisation par exemple, le recours aux inhibiteurs ou aux outils d'aide à la décision est de nature à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, dans un marché qui n'a jamais été aussi incertain, il est essentiel d'accélérer les investissements vers les engrais azotés décarbonés permettant de réduire la dépendance au gaz importé.
S'ajoute l'agriculture biologique, qui est une pratique qui évolue, se solidifie, se structure et doit encore suivre sa courbe d'apprentissage pour augmenter les rendements et limiter les pertes de productivité.
Elles sont enfin génétiques. L'Union européenne a tort d'écarter, d'emblée, sans débat, la solution des « new breeding techniques » (NBT), qui sont pourtant une technique très prometteuse pour faire émerger des plantes plus résistantes au changement climatique et moins consommatrices en intrants. Accepter ne veut pas dire ne pas réglementer : au contraire, l'Union européenne a intérêt à être pionnière en la matière pour imposer ses normes, plutôt que de laisser la main à ses concurrents.
Ces solutions existent pour la plupart déjà. Si elles sont perfectibles, elles offrent des résultats très convaincants, conciliant économie et écologie. Mais elles ont un coût et, dans le contexte actuel, de nombreux agriculteurs ne franchissent pas le pas, ce qui pourrait s'aggraver encore avec la remontée des taux d'emprunts.
Des plans d'investissement ont été déployés ces dernières années. Ils ont tous rencontré un vif succès en quelques heures, démontrant les fortes attentes des filières en la matière.
C'est par exemple le cas du plan de relance agricole de 2020 ou des programmes d'investissement d'avenir au service de la troisième révolution agricole : la forte mobilisation des filières a démontré qu'ils répondaient à des besoins, mais sans doute bien supérieurs à ceux que le Gouvernement attendait. Cet accompagnement doit donc se poursuivre.
Recommandation n° 10 : prolonger le volet « Troisième révolution agricole » du plan France 2028 en :
- augmentant les crédits des plans d'investissement portant sur l'innovation agricole dans tous les domaines ;
- portant, au niveau européen, la volonté d'autoriser en réglementant les new breeding techniques, plutôt qu'une interdiction de principe.
Mais, en parallèle, la préparation de l'avenir se fait au niveau de la recherche. À cet égard, tous les acteurs agricoles entendus par la mission sont unanimes : le paradigme actuel n'est pas satisfaisant.
D'un côté, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) est perçu comme trop centré sur de la recherche fondamentale ou sur certains aspects généraux et transversaux. Il est doté d'un budget supérieur à un milliard d'euros, en constante augmentation.
D'un autre côté, les instituts techniques et les entreprises concentrent leurs efforts sur de la recherche technique, afin de faire émerger des solutions opérationnelles aux problématiques actuelles des agriculteurs, mais avec un budget très limité.
Plusieurs témoignages regrettent que l'Inrae ne s'investisse pas davantage auprès des instituts techniques et des groupements d'agriculteurs faisant des expérimentations agricoles, quittant ainsi la recherche transversale et fondamentale pour investir les domaines plus techniques et agronomiques. Qu'on ne s'y trompe pas : les rapporteurs estiment la recherche fondamentale absolument primordiale. Toutefois, la France pourrait disposer d'une recherche technique davantage en phase avec les besoins des agriculteurs, ce qui nécessite de revoir le rôle de l'Inrae pour qu'il soit partie prenante à cette évolution.
Les politiques de recherche en matière agricole, ces dernières années, reposent sur un ancien paradigme : celui où les agriculteurs étaient confrontés, par filière, avec une fréquence acceptable, à de nouvelles problématiques et qu'ils disposaient de pléthore de solutions.
Aujourd'hui, l'agriculture est en état d'urgence : disparition progressive des solutions chimiques, accélération, en raison du changement climatique, de l'apparition de problèmes agronomiques liés à des pathogènes, réduction du nombre d'agriculteurs donc du champ d'expérimentation possible, mondialisation des zoonoses...
Les agriculteurs attendent, avant tout, de la recherche publique et privée, l'émergence de solutions rapides à leurs difficultés. C'est tout le paradoxe du débat sur des interdictions d'intrants : au moment où une interdiction est décidée, ce qui est bien entendu de plus en plus fréquent, les acteurs doivent trouver en quelques mois des solutions alternatives en mobilisant les instituts techniques, ces derniers concentrant leurs efforts sur ce défi, en abandonnant les autres, faute de temps et de budget.
À cet égard, la volonté, à peine voilée depuis des années, du Gouvernement de supprimer le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » (Casdar), pourtant véhicule principal permettant le financement des instituts techniques, est symptomatique de l'absence de prise en compte de ces demandes des agriculteurs en faveur d'une recherche davantage orientée vers des solutions techniques.
C'est tout l'inverse qu'il conviendrait de faire : préserver le Casdar et les budgets dédiés aux instituts techniques, tout en trouvant des leviers pour les augmenter.
Les rapporteurs s'interrogent donc sur l'opportunité de renverser la table, et de mieux valoriser la recherche technique agricole, soit en affectant une partie du budget de l'Inrae aux instituts techniques, soit en confiant formellement à l'Inrae des missions de recherche technique, qui l'obligerait à dédier une partie de ses effectifs sur ces missions au service de la Ferme France.
Recommandation n° 11 : remettre la recherche agricole davantage au service des besoins techniques des agriculteurs en :
- étudiant la possibilité d'augmenter les crédits dédiés par l'Inrae à la recherche de solutions techniques pour les agriculteurs, par une redéfinition de ses missions, ou en étudiant le transfert d'une partie de son budget aux instituts techniques ;
- préservant les budgets des instituts techniques payés par les agriculteurs au travers du compte d'affectation spéciale Développement agricole et rural (Casdar).
b) Priorité 2 : doper l'investissement en agriculture en faveur de la productivité et du renouvellement de l'appareil productif
L'investissement d'aujourd'hui fait la productivité de demain. Or un des points faibles de la France est justement la lente décroissance de la productivité de son industrie agricole et agroalimentaire, due principalement à des marges trop faibles compte tenu de la guerre des prix entre grandes surfaces dont l'industrie agroalimentaire est l'otage.
Un grand plan favorisant l'investissement agricole et agroalimentaire doit être une priorité pour que la France agricole remonte la pente.
Cela passe avant tout par un plan de simplification massif sur les projets d'investissement. Cette réforme, qui n'a aucun coût, est susceptible de doper l'investissement de manière massive.
Des industriels entendus par la mission estiment que « les procédures pour les installations et les agrandissements d'outils sont beaucoup plus lourdes que chez nos voisins : il faut compter au minimum 12 à 18 mois de procédure administrative entre le dépôt du dossier du permis de construire et l'autorisation d'exploiter. Avec les recours, ces initiatives peuvent prendre des années107(*). »
En outre, des aides existent mais les conditions d'éligibilité ou la lourdeur des procédures de candidature créent des effets d'éviction au détriment de nos entreprises. Par exemple, les maraîchers serristes réclament un accompagnement dans leur transition énergétique par une simplification des conditions d'obtention d'aides par l'ADEME par le fonds chaleur.
Recommandation n° 12 : lancer un plan de simplification sous un an pour mettre en oeuvre un dispositif « accélérateur » limitant le champ des procédures administratives qui ralentissent aujourd'hui trop les agrandissements ou le développement de sites de production dans des secteurs stratégiques, le cas échéant en prévoyant une modification la loi.
Vient également la nécessité de soutenir tous les investissements dans le secteur afin de doper la productivité des acteurs.
Les rapporteurs ont fait, dans leur rencontre, trois types de constatations sur ce point :
- des investissements productifs doivent être réalisés mais, faute de marges, les industriels comme les agriculteurs les repoussent. Pour compléter les plans d'investissement, qui portent sur des mesures ciblant la transition environnementale, un mécanisme pourrait être intéressant dans ce contexte économique particulier : le suramortissement ;
- des investissements, à force d'être repoussés, menacent l'équilibre de la filière. Dans le blé par exemple, les silos à grains sont vieillissants et ne sont plus adaptés au changement climatique. Ce sont plusieurs milliards d'euros d'investissement qui sont à réaliser dans les années à venir inéluctablement pour conserver l'avantage compétitif de la France en la matière. Ils doivent être accompagnés par un grand plan « Silos » ;
- des investissements, enfin, peuvent amorcer toute une économie de filière. Dans la tomate d'industrie par exemple, de nombreux acteurs pourraient se lancer mais les investissements initiaux sont trop lourds. Faute de fournisseurs, des sites de production ne se créent pas, ce qui induit un cercle vicieux, au profit de nos concurrents étrangers qui captent le marché.
Toute la difficulté, dans les mois à venir, réside dans la nécessité d'investir massivement, qui se heurtera au cycle de désinvestissement lié à l'inéluctable hausse des taux bancaires.
La hausse des taux est susceptible de venir réduire les crédits disponibles et considérablement obérer l'investissement dans les domaines agricoles et agroalimentaires qui est pourtant absolument nécessaire compte tenu des défis agricoles, environnementaux et de souveraineté que la France doit relever.
Dans ces conditions, et pour prévenir toute raréfaction du crédit aux acteurs agricoles susceptible de dégrader la compétitivité française, il importe de mobiliser l'ensemble des Français, attachés à leur agriculture, qui sont prêts à s'engager pour préserver leur souveraineté alimentaire et à épargner dans des véhicules qui ont du sens.
Cela pourrait être l'objet du « livret Agri », dont le fonctionnement serait calqué sur le livet développement durable et solidaire (LDDS), et qui aurait vocation à drainer l'épargne vers le financement d'investissements dans les secteurs agricole et agroalimentaire.
Ce dispositif a déjà été adopté au Sénat en 2015 et 2016, à l'initiative du président Jean-Claude Lenoir, mais l'Assemblée nationale l'a refusé.
Depuis, les conditions ont considérablement évolué. L'explosion des taux rend ce dispositif pertinent pour proposer certains emprunts à des taux inférieurs à ceux du marché pour des politiques publiques pertinentes. Surtout, la France doit désormais faire face au plus extraordinaire défi agricole des cinquante dernières années : le renouvellement des générations.
Plus d'un quart des exploitants agricoles en 2020 ont plus de 60 ans (+ 5 points par rapport à 2010). 58 % des exploitants agricoles actifs ont plus de 50 ans. Cela signifie que, sur les vingt prochaines années, de nombreux jeunes devront racheter les fermes d'agriculteurs partant à la retraite. Sans une aide bancaire suffisante avec des taux attractifs, ce renouvellement ne se fera pas, au détriment de la souveraineté française. C'est aussi pourquoi ce « livret Agri » est une mesure essentielle.
En parallèle, un plan de relance productif massif doit être proposé par l'État. Dans le contexte budgétaire actuel, il est évident que plusieurs financements accordés ces dernières années, dans le domaine agricole comme ailleurs, n'ont pas été tirés ou ont accompagné des projets dont on ne voit pas le résultat. Par redéploiement, il est possible, dès demain, d'axer ces financements vers des projets réellement porteurs de valeur dans le monde agricole.
Recommandation n° 13 : préserver l'investissement agricole et agroalimentaire malgré la hausse des taux en :
- mettant en place un suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire ;
- prévoyant un plan d'investissement massif piloté par l'État pour la production agricole et agroalimentaire (par exemple un grand plan « Silos ») ;
- créant un « livret Agri », livret réglementé sur le modèle du livret de développement durable et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire à des conditions raisonnables, notamment à l'heure du renouvellement des générations.
c) Priorité 3 : lutter contre les effets du changement climatique sur les exploitations pour limiter les pertes en cas d'aléas
Le changement climatique, par la multiplication des aléas, a des impacts sur la compétitivité française en réduisant les rendements et en créant de l'incertitude auprès de certains partenaires commerciaux, en quête d'une stabilité des approvisionnements. En réduisant les revenus des agriculteurs les mauvaises années, il est de nature à amputer les investissements nécessaires pour maintenir l'exploitation à flot.
C'est pourquoi il est essentiel de se doter d'outils pour limiter, au maximum, les conséquences économiques des aléas climatiques sur les exploitations agricoles.
(a) Se donner les moyens techniques de limiter les effets des aléas climatiques
Au premier rang des mesures préventives figurent tous les dispositifs de nature à faciliter l'accès à l'eau.
Tous les acteurs, reconnaissant l'intérêt indéniable du Varenne de l'eau, tenu en 2021, déplorent le fait que les projets soient encore et toujours au point mort.
Bien souvent, les projets sont bloqués au stade administratif puis par une série de contentieux, de nature à dissuader les plus partisans du stockage de l'eau.
Pourtant, cette mesure relève du bon sens, en permettant d'accumuler l'eau en excès dans les saisons des pluies pour mieux faire face aux sécheresses.
L'article 33 quater de la loi ASAP, adoptée par le Parlement en 2020 avant d'être retoqué par le Conseil constitutionnel faute d'un lien même indirect avec le texte, prévoyait que les cours administratives d'appel étaient compétentes en premier et dernier ressort des recours dirigés contre des projets d'ouvrages de prélèvement d'eau. Cette solution était de nature à réduire la durée des contentieux et mériterait d'être enfin mise en oeuvre.
En matière d'eau, la France se distingue, là encore, par une politique de surtransposition problématique. Sans compter certaines interprétations de la réglementation par des agences de l'eau, qui sont aujourd'hui en cours de contentieux et sur lesquels il n'appartient pas aux sénateurs de se prononcer, ces cas de surtranspositions « pratiques » posent des problèmes dès lors qu'ils entravent la réutilisation de l'eau, malgré ses atouts environnementaux. Deux exemples le démontrent. D'une part, « les entreprises agroalimentaires ont l'obligation de laver leurs camions avec de l'eau potable, ce que ne font pas leurs concurrents », et ce qui nuit, surtout, au recyclage de l'eau. D'une part, les industries agroalimentaires plaident depuis des années pour réutiliser l'eau issue de la transformation du lait, obtenue par évaporation ou concentration, par exemple lors de la production de poudre de lait, qui est aujourd'hui considérée comme non potable et, comme telle, non utilisable dans les processus extérieurs à la production agroalimentaire. Selon des personnes entendues, pour la filière laitière, c'est une capacité de 11 millions de mètres cubes d'eau qui pourrait être directement mobilisable pour l'irrigation. D'après les mêmes personnes, cela serait déjà le cas d'Espagne, de la Belgique ou des Pays-Bas. Pourquoi attendre en France ?
Il importe de revoir la politique publique de l'eau française afin de promouvoir une gestion collective et locale des bassins, seule à même de créer un consensus suffisant permettant de capter l'eau au meilleur moment pour l'affecter, en période de sécheresse, aux usages locaux prioritaires, parmi lesquels figurent les besoins agricoles.
En parallèle, pour mieux prévenir les effets des aléas climatiques, d'autres solutions techniques existent et sont relativement efficaces. Mais elles sont insuffisamment déployées en raison de freins administratifs, alors qu'elles existent à l'étranger (aspersion par exemple pour la pomme) ou elles ont un coût trop élevé à l'hectare (filets para-grêle). Là encore, des mesures de simplification ou d'incitation pourraient utilement être mises en oeuvre pour consolider la compétitivité de la France en la matière.
Recommandation n° 14 : renforcer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique en :
- favorisant les investissements destinés à réduire les dégâts liés à ces aléas par des aides dédiées comme un crédit d'impôt ou un suramortissement (stockage d'eau, filets paragrêle...) ou en simplifiant les procédures en vigueur (aspersion par exemple) ;
- développant rapidement une ambitieuse politique de gestion de stockage de l'eau autour de projets locaux de bassins versants afin de promouvoir des projets de stockage par des aides financières dédiées tout en simplifiant le déploiement de ces ouvrages, en limitant les effets délétères des contentieux abusifs contre des projets d'ouvrages de prélèvement d'eau en confiant le contentieux en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appels.
(b) Ne pas saper la réforme de l'assurance récolte : respecter la loi à la lettre et réformer le système de la moyenne olympique
En parallèle, il est essentiel que les conséquences financières de la survenance d'aléas climatiques soient des plus limitées pour les exploitants agricoles, afin de ne pas obérer leur équilibre économique et réduire leurs investissements. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un système d'indemnisation des risques climatiques adéquat.
À ce titre, la réforme adoptée par le Parlement début 2022 de l'assurance récolte regorge de promesse... à la condition qu'elle soit pleinement appliquée !
Les rapporteurs rappellent que le Parlement a annexé un rapport à la loi précisant la trajectoire voulue par les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire en matière de budget.
Les rapporteurs se contentent donc d'écrire, une nouvelle fois, noir sur blanc les lignes rouges votées par le Parlement il y a moins de six mois :
- pleine application des possibilités laissées par le droit européen pour subventionner les contrats d'assurance récolte, ce qui permet de réduire les charges des exploitants tout en promouvant un modèle indemnisant plus rapidement des pertes moyennes subies par les exploitants. C'est simplement appliqué le règlement dit « Omnibus » qui permet de subventionner les contrats d'assurance à partir d'un seuil de 20 % de seuil de franchise à hauteur de 70 % du niveau de la prime. Les premières négociations sur le sujet laissaient entendre que le Gouvernement n'appliquera pas ce que le Parlement a voté. C'est pourtant la condition de la réussite de la réforme ;
- maintien, les premières années, d'un seuil de déclenchement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale à hauteur de 30 % pour les filières les moins assurées ;
- lancement rapide de la réforme de la moyenne olympique au niveau européen et au niveau international pour disposer d'un système d'indemnisation réellement adaptée à la nouvelle donne : la fréquence des aléas ne doit pas aboutir à ce que les agriculteurs soient moins indemnisés, sauf à vouloir les dissuader définitivement de s'assurer.
Depuis, le Président de la République a pris l'engagement, début septembre, de reprendre les taux susmentionnés. Il aura fallu plusieurs mois, animés de pléthore de réunions de la dernière chance, pour aboutir à ce résultat. Il ne fait que s'approprier tous les apports majeurs obtenus dans la négociation par les sénateurs derrière leur rapporteur, feignant d'oublier la grande réticence de la majorité gouvernementale à l'époque pour les inscrire dans la loi. Disons-le clairement : sans le Sénat, ces avancées n'auraient pas été obtenues. Ainsi, aux félicitations des professionnels adressées au Gouvernement, le Sénat se contente de saluer le fait, somme toute normal, que le Gouvernement se décide... à simplement appliquer la loi adoptée par les parlementaires et profondément modifiée par le travail de fond mené par le Sénat.
Recommandation n° 15 : appliquer pleinement et à la lettre la loi sur l'assurance récolte, comme l'a voté le Parlement, en utilisant au maximum les possibilités laissées par la réglementation européenne et s'engager dans une réforme internationale de la moyenne olympique pour l'adapter aux conséquences du changement climatique.
4. Axe 4 : conquérir les marchés d'avenir, reconquérir les marchés perdus, doper sa compétitivité hors prix
Toute politique de compétitivité ne saurait, toutefois, être uniquement défensive. La politique agricole doit redevenir résolument conquérante et afficher comme objectif de regagner les parts de marché perdues ou en voie de perdition.
Pour maintenir une France agricole exportatrice et fournissant une alimentation durable et accessible à tous sur son sol, plusieurs pistes peuvent être envisagées.
a) Priorité 1 : à l'extérieur, conquérir de nouvelles parts de marché
L'ensemble des acteurs entendus par la mission ont fait état aux rapporteurs de leur sentiment d'être moins accompagnés que leurs concurrents dans la prospection de nouveaux marchés à l'exportation. L'État, en l'espèce, est défaillant.
En matière de politique d'aide à l'exportation, il convient de passer d'une politique de procrastination technocratique, aboutissant à l'élaboration de plans stratégiques tous oubliés plus vite que les précédents, à une politique de projection économique. Entre 2012 et 2018, neuf « plans stratégiques » gouvernementaux ont été adoptés pour améliorer le sort du commerce extérieur, soit presque deux par an. Le résultat est catastrophique : alors que les administrations phosphorent dans le but d'écrire des plans stratégiques servant, au mieux, à caler les armoires, les acteurs agricoles et agroalimentaires à l'export connaissent une situation de plus en plus dégradée.
Il est temps de prendre des engagements clairs et des mesures concrètes sur les moyens mis en oeuvre pour aider résolument nos acteurs économiques dans la conquête de marchés extérieurs.
La Cour des comptes ne dit pas autre chose : « aujourd'hui, le rôle de l'État n'est plus de fixer des cibles géographiques ou sectorielles pour l'action internationale des entreprises, mais de définir et de protéger les intérêts offensifs et défensifs du pays dans les négociations commerciales internationales. Les professionnels se montrent en effet dubitatifs sur l'intérêt de certaines opérations de promotion et souhaitent plutôt que les efforts visent à lever les restrictions non tarifaires aux importations dans les pays tiers. Or, une telle stratégie interministérielle appuyée sur une analyse partagée fait défaut s'agissant de l'agriculture et de l'agroalimentaire108(*). »
Cela pourrait se traduire par une politique diplomatique ambitieuse permettant d'aider à développer des exportations agroalimentaires sur les marchés les plus dynamiques, où la France dispose de parts de marché relativement plus faibles que ses concurrents.
Cela pourrait se traduire aussi et surtout par des mesures d'aides à l'assurance-crédit à l'export sur le modèle allemand, la pérennisation et l'optimisation des outils de couvertures adaptés aux besoins des filières, par une réforme de la compétitivité des ports français, par des outils de soutien aux PME exportatrices afin de favoriser la prospection.
L'objectif est bien de faire de l'État une véritable force de propulsion à l'exportation, un capitaine pour aider les entreprises à « chasser en meute ».
À cet égard, la France devrait s'inspirer du modèle exportateur italien.
Les rapporteurs rappellent qu'il faut toujours mettre en regard le déficit commercial français, de 85 milliards d'euros en 2021, avec l'excédent commercial italien de près de 50 milliards d'euros en 2021.
S'agissant du domaine agroalimentaire, depuis 2012, les exportations de produits agroalimentaires de l'Italie affichent une croissance soutenue, continue et plus dynamique que la moyenne mondiale : entre 2012 et 2019, + 40 % contre + 27 % en moyenne dans l'UE et + 5 % par an sur la période contre + 3,5 % dans le monde. Cette croissance est encouragée par une vraie politique ambitieuse qui déploie une stratégie de « système pays » de promotion des produits nationaux à l'étranger, s'appuyant sur les ressorts permis par le cadre normatif international en matière de commerce extérieur.
Sur le terrain, en Italie, les rapporteurs ont pu constater l'extraordinaire performance des exportateurs, prêts à chasser « en meute » avec l'aide d'une administration offrant les outils pertinents aux acteurs économiques pour y parvenir et en s'appuyant sur une image de marque reconnue internationalement.
Recommandation n° 16 : entamer sous un an une révision globale de la politique d'accompagnement à l'exportation dans les domaines agricoles et agroalimentaires en France en proposant aux acteurs économiques des outils répondant réellement à leurs besoins (assurance-crédit export, aides à la promotion, accès plus aisé à la logistique, ...).
Le modèle exportateur italien : un exemple à suivre
L'Italie a su doter sa production d'une véritable image de marque, le made in Italy. En charge du soutien à l'internationalisation des entreprises, le Ministère des affaires étrangères a délégué la promotion du made in Italy au Ministère du Développement économique. Celui-ci attribue régulièrement des subventions et des prêts bonifiés pour soutenir la participation des microentreprises, des startups et des PME à des salons internationaux et financer divers événements et actions de communication sur les marchés étrangers (réunions bilatérales avec des associations étrangères, séminaires en Italie avec des opérateurs étrangers). En 2021, le ministre du développement économique a porté l'enveloppe financière à 2,5 M€/an (+ 1M€ par rapport à 2020). Il fixe le montant de la facilitation à 70 % des dépenses engagées avec un plafond à 150 000 € par sujet et élargit l'audience des bénéficiaires. Le ministère des politiques agricoles attribue chaque année des dotations financières pour la promotion des filières sur les marchés extérieurs (environ 100 M€/an pour le secteur vitivinicole sur les 5 dernières années). En sus, les consorzi jouent un rôle clé de représentation des intérêts des filières et des producteurs auprès autorités :
i) lobbying pour le bénéfice des fonds de l'UE, lobbying pour la protection des appellations face à la concurrence étrangère (vinaigre balsamique slovène, proek croate)
ii) demande d'autorisations au gouvernement central pour la création et la valorisation de produits transformés avec des ingrédients certifiés (4600 autorisations actives en 2020).
Des programmes de soutien et des financements sont parfois portés de manière spontanée par les régions : plan de soutien aux PME et à l'internationalisation, appels à projets pour la relance des filières agricoles et alimentaires, création d'un fonds de garantie pour les investissements des entreprises de l'agroalimentaire.
Plusieurs organismes et instituts spécialisés italiens participent à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de soutien au commerce extérieur grâce à un florilège d'outils, à l'image de l'Italian Trade Agency (ICE). En 2020, l'Agence italienne de crédit à l'exportation SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) a mobilisé 25Md€ d'aide à l'export et à l'internationalisation des entreprises (+ 18 % par rapport à 2019). Grâce à de solides liens avec les systèmes confindustriels locaux, les établissements d'éducation et les universités, SACE a créé des programmes de formation et d'accompagnement à destination des entreprises sur l'export, l'internationalisation et l'élaboration de stratégies. L'investissement dans les outils numériques a porté ses fruits au moment de la pandémie : 78 webinaires ont été organisés en 2020 et l'utilisation des plateformes de dialogue avec les entreprises s'est largement accru (+ 70 % d'entreprises enregistrées sur Education to Export en 2020 vs. 2019)20. Le portail export.gov propose plusieurs outils de conseil et de soutien à l'internationalisation : identification des pays-cibles, aides à la négociation de contrats commerciaux, planification de l'entrée sur le nouveau marché, élaboration d'une stratégie de croissance.
En sus, les entreprises peuvent prétendre à des prêts bonifiés, des contributions à l'exportation, des garanties (Garanzie Finanziamenti, Credito Acquirente) et des assurances crédits contre le risque d'insolvabilité. En septembre dernier, l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentari) annonce le lancement d'un nouvel outil de soutien économique aux projets de développement dans la chaîne agroalimentaire italienne, y compris des activités commerciales et logistiques liées à l'internationalisation (Ismea Investe).
Source : Ambassade de France en Italie, service économique de Rome.
En parallèle, tout en bénéficiant des avantages d'une politique de compétitivité prix indispensable, comme on l'a vu, pour maintenir des exportations dynamiques sur des marchés segmentés, les filières continueront, bien entendu, à trouver des marchés spécifiques où elles pourront se différencier. La segmentation au bénéfice de la compétitivité hors prix sur les marchés internationaux doit se poursuivre et doit davantage s'appuyer sur les atouts dont bénéficie la France en termes d'image.
C'est pourquoi une autre piste est à creuser : s'appuyer sur l'image de la « gastronomie française » pour exporter des produits français.
C'est sans doute une lacune de l'image des produits français : outre les difficultés liées à la compétitivité, ils ne parviennent pas à être exportés en même temps que les recettes françaises. En exportant les recettes de leur pizza, les Italiens sont parvenus à exporter leur mozzarella. Il faut que les Français fassent de même : en exportant la recette du pain, les Français doivent exporter du blé français.
Les industriels laitiers rappellent, par exemple que, « positionnés sur les mêmes gammes de prix, l'Italie et la France connaissent une évolution différente. Les fromages italiens profitent d'une meilleure image que les fromages français jugés trop complexes et « élitistes ». Les fromages italiens sont facilement utilisés dans la gastronomie, le parmesan avec les pâtes, la mozzarella avec la pizza ou en salade de tomate. »
C'est une vraie révolution d'image qu'il faut préparer pour que des recettes françaises, érigées en plats iconiques au niveau international, soient le moteur d'exportateurs de produits français.
Recommandation n° 17 : consolider l'idée de la marque France en s'appuyant davantage sur l'image de la gastronomie française pour doper les exportations de produits français.
b) Priorité 2 : sur le marché intérieur, reconquérir l'assiette des Français
Sur le marché intérieur, c'est une entreprise ambitieuse de reconquête de l'assiette des Français qu'il faut poursuivre. Cela passe par une politique claire de compétitivité prix. Mais cela passe aussi par d'autres pistes réclamées de longue date par les parlementaires qui nécessitent une adaptation de notre corpus juridique.
C'est par exemple le cas de l'étiquetage de l'origine des produits agricoles et alimentaires pour mettre fin aux tromperies subies par le consommateur sur des denrées, principalement transformées ou distribuées dans la restauration hors foyer ou en grandes surfaces, sur la provenance de ce qu'il mange.
Il s'agit également d'harmoniser, au niveau européen, certaines définitions en vigueur. Ainsi, le cidre français, produit à partir uniquement de pommes en lien direct avec une production locale de fruits dédiés et une transformation intégrale à la récolte nécessite de fortes capacités de pressage et de stockage, n'a rien à voir avec les « ciders » anglo-saxons, où la pomme est quasi inexistante, uniquement sous forme de concentrés acquis sur les marchés de commodités pour être mélangés avec de l'eau et du sucre. Pourtant, faute d'une définition harmonisée au niveau européen, le « cider » anglo-saxon relève de la même famille que le cidre normand ou breton et, partant, il est plus difficile au consommateur non averti de s'y retrouver.
Enfin, comme souvent, sans politique de contrôle claire et renforcée en la matière, tout renforcement des normes verra son efficacité altérée.
Recommandation n° 18 : mettre en place une réelle transparence sur l'origine des denrées agricoles et alimentaires en :
- proposant, dans le cadre de la révision du règlement INCO, l'extension de l'affichage obligatoire de l'origine à toutes les denrées agricoles (animales et végétales) et, pour les produits alimentaires transformés, en rendant obligatoire l'affichage de l'origine des trois principaux ingrédients composant le produit ;
- harmonisant les dénominations et les définitions des produits alimentaires en Europe ;
- augmentant la fréquence et le nombre de contrôles réalisés par les autorités compétentes sur ces affichages trompeurs sur l'origine ainsi que sur la traçabilité des produits importés dans les ports d'arrivée.
Une autre piste peut être d'utiliser la commande publique pour être un levier de compétitivité de nos filières agricoles.
Depuis l'adoption de la loi Climat et résilience, les circuits courts sont désormais intégrés dans les produits dont l'approvisionnement est à privilégier dans la restauration collective publique et privée109(*). Toutefois, les procédures sont encore très lourdes en la matière compte tenu d'un cadre juridique flou. Or ces produits locaux doivent être mieux valorisés encore pour que, dans le respect du droit européen, les collectivités territoriales puissent davantage les mettre en avant dans l'approvisionnement des cantines. Pour ce faire, il convient de simplifier le droit européen existant en affirmant clairement que l'approvisionnement en produits locaux doit être privilégié dans ces services de restauration collective.
Une autre piste essentielle et pratique a été adoptée, à l'initiative du Sénat l'année dernière, pour faciliter l'atteinte de cet objectif : le renforcement du poids des collectivités territoriales dans la gestion de ces approvisionnements par la signature d'une convention entre le chef d'établissement scolaire, qui assure la gestion du service de demi-pension, et la collectivité territoriale, à qui s'appliquaient les objectifs d'approvisionnement110(*).
Bien entendu, se pose la question financière à l'heure actuelle, les collectivités territoriales ne pouvant assumer seules le fardeau d'une hausse des prix des denrées alimentaires dans les services de restauration dont elles ont la charge.
Recommandation n° 19 : poursuivre et intensifier la priorité donnée aux approvisionnements en produits locaux et nationaux dans la restauration collective afin de reconquérir ce circuit de distribution largement perdu au profit des importations, par la promotion d'une évolution des règles en vigueur au niveau européen pour clairement favoriser des approvisionnements issus de produits locaux.
Enfin, cela demande de mener cette politique de reconquête des parts de marché en priorité dans les filières les plus concurrencées par des produits importés, à la condition, bien entendu, que leur production soit possible au niveau français et européens. Il pourrait être pertinent, pour matérialiser ce degré de priorité, en accord et avec l'appui des interprofessions concernées, de prendre en compte le degré de concurrence par les importations dans l'attribution des aides agricoles ou des aides aux investissements.
Recommandation n° 20 : maximiser les aides agricoles et investir dans l'innovation des productions les plus menacées par une substitution par les importations.
c) Priorité 3 : dire non à la décroissance agricole
Enfin, toutes ces mesures ne fonctionnent qu'à une condition : mettre fin à toute entreprise mettant en péril notre potentiel productif agricole.
À ce titre, cela nécessite une révision profonde de la stratégie européenne « De la ferme à la fourchette » qui porte en elle les germes d'une décroissance agricole de nature à accroître nos dépendances sur les produits importés.
D'un côté, la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 fixe un seuil de 10 % de la surface agricole dédiée en des particularités topographiques à haute diversité biologique, ce qui peut impliquer un taux minimal de mise en jachère, par essence non productive. De surcroît, la stratégie « De la ferme à la fourchette » décline en réalité le « Pacte vert » à l'agriculture européenne, sur la base d'un objectif de diminution de 50 % de l'utilisation des pesticides et de ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage, de baisse de 20 % de celle d'engrais et d'un quadruplement (à hauteur de 25 %) des terres converties à l'agriculture biologique.
Outre l'affichage de tels objectifs dans un pas de temps réduit, qui questionne leur réalisme, les études publiées par diverses institutions établissent un risque avéré de diminution de la production agricole européenne dans des proportions de 10 % à 20 %, voire davantage suivant les filières et les scénarios étudiés. Les facteurs expliquant cette chute sont la chute attendue des rendements liés à cette stratégie ainsi que la baisse des surfaces cultivées et du volume des récoltes. Il en résulte une diminution des revenus des producteurs, une l'augmentation des importations et une baisse des exportations conduisant in fine à la dégradation de la balance commerciale européenne.
Cette stratégie mérite d'être actualisée compte tenu du contexte et de ces études pour mieux concilier objectifs environnementaux et objectifs économiques en vue d'un réel développement durable.
Recommandation n° 21 : amender la stratégie européenne « De la ferme à la fourchette » pour faire émerger un meilleur équilibre entre les objectifs quantitatifs en matière de production pour renforcer la souveraineté alimentaire du continent et les objectifs environnementaux.
5. Axe 5 : protéger l'agriculture française de la concurrence déloyale
Le débat est déjà tranché : le défi environnemental répond à une urgence vitale pour la survie de notre agriculture. Il implique une nécessaire et rapide évolution des pratiques des exploitations agricoles européennes, évolution qui a débuté il y a bien longtemps dans les campagnes françaises.
Ces évolutions, les agriculteurs les pratiquent et sont prêts à accélérer. Mais à une condition : qu'ils ne voient pas à la place de leurs produits dans les rayons européens des produits venus de pays tiers ne répondant pas aux normes requises en Europe.
C'est pourquoi il est indispensable qu'il y ait des contrôles accrus sur les denrées importées, afin de s'assurer que ces mêmes réglementations soient respectées.
Dès lors que des substances ou des pratiques sont interdites en Europe pour protéger le consommateur européen ou l'environnement, elles ne peuvent être même tolérées dans des denrées alimentaires importées. À défaut, le bilan de ces interdictions est au mieux nul : elles sapent la compétitivité de nos agriculteurs et favorisent des importations de produits ne respectant pas les normes européennes ; cela ne protège pas le consommateur ; cela déplace le problème environnemental dans d'autres pays.
La politique de compétitivité ne va pas sans protection. L'avenir de notre agriculture se joue, aussi, dans les négociations commerciales à venir qui doivent impérativement prendre en compte ces éléments. À cet égard, l'intégration de clauses miroirs dans tous les accords commerciaux est un impératif, comme le recommande le Sénat depuis des années. Rappelons, à ce titre, qu'il a inscrit, dans la loi française, le principe des clauses miroirs en proposant par voie d'amendement de sa rapporteure et de plusieurs groupes politiques, dès 2018, l'article 44 de la loi Egalim, qui a été adopté en l'état par les députés.
Recommandation n° 22 : défendre notre compétitivité européenne en s'engageant à mieux faire respecter les normes minimales de production requises au sein de l'Union européenne en :
- poursuivant le déploiement de clauses miroirs dans les législations européennes en matière agricole, notamment dès 2023 sur les textes relatifs au bien-être animal ou aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ainsi que dans les accords de libre-échange ;
- s'engageant plus activement dans les instances internationales de normalisation (notamment Codex Alimentarius) afin de faire évoluer l'ensemble des pratiques agricoles.
Clauses miroirs : des progrès encourageants
« Le blocage de l'OMC depuis le cycle de Marrakech ouvre la voie à une période de bilatéralisme commercial ayant pour conséquence, pour le monde agricole, une attention plus forte à l'égard des barrières non tarifaires. Dans cette nouvelle dialectique commerciale, l'Union européenne, à l'initiative de la France, entend promouvoir un recours accru aux clauses miroirs dans le domaine agricole afin d'assurer une plus grande réciprocité dans les accords commerciaux conclus avec les pays tiers. Ces clauses permettraient d'imposer aux pays qui souhaitent exporter leurs produits agricoles vers l'Union européenne de se conformer au préalable à ses normes sanitaires et environnementales.
C'est un changement de paradigme important dans le logiciel de la Commission européenne. En effet, dans le cadre juridique actuel, l'Union européenne estime que tout produit importé en provenance de pays tiers doit être sûr, ne représenter aucun danger pour la santé des consommateurs et être conforme à la législation sanitaire et phytosanitaire (SPS) de l'UE en matière d'importation et de commercialisation. Outre certains contrôles à l'arrivée, notamment au regard de limites maximales de résidus (LMR) pour les végétaux, la Commission européenne assure régulièrement des audits des pays tiers fournisseurs, afin de s'assurer que les normes européennes sanitaires et phytosanitaires sont bien respectées. En revanche, l'UE n'exige pas que les importations en provenance de pays tiers respectent l'ensemble de ses normes liées aux modes de production, dès lors qu'elle considère que certaines de ces normes n'impliquent pas mécaniquement de risques pour la santé du consommateur. Dès lors, l'adoption de clauses miroir vient rompre avec cette logique historique. [...]
Depuis, des évolutions positives en faveur du déploiement de ces clauses miroirs dans les futurs accords de libre-échange ont permis d'aboutir à des avancées concrètes :
· l'article 118 du règlement (UE) n° 2019/6 interdit l'utilisation de certains antimicrobiens ou certains usages d'antibiotiques, par exemple en tant qu'activateurs de croissance, pour les animaux élevés dans les pays tiers dont les produits seraient importés dans l'Union européenne - c'est sans doute l'une des premières clauses de ce type intégrées au droit européen ;
· la position de la Commission européenne évolue. Elle a par exemple reconnu, dans sa communication sur le réexamen de la politique commerciale du 18 février 2021, que « dans certaines circonstances définies par les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il est pertinent que l'UE exige que les produits importés respectent certaines exigences de production ».
À l'occasion de la réforme de la PAC, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européen ont adopté des déclarations soulignant l'importance de mieux appliquer les normes de production de l'UE aux produits importés et ont demandé à la Commission de produire un rapport sur le sujet, qui n'a pas été rendu à la date de rédaction du présent rapport mais dont les premières conclusions semblent démontrer qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques majeurs s'opposant à la mise en oeuvre de ces clauses miroirs. »
Source : extrait du rapport d'information n° 755 (2021-2022) de Mmes Sophie PRIMAS, Amel GACQUERRE et M. Franck MONTAUGÉ, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 6 juillet 2022, sur la souveraineté économique de la France.
Toutefois, ces clauses miroirs ne doivent pas se transformer en l'alpha et l'omega de la politique agricole, sorte de remède miracle capable de résoudre tous les maux de l'agriculture française, car elles peuvent être un miroir aux alouettes.
D'une part, elles ne résolvent pas les différentiels de compétitivité liés au manque d'harmonisation des conditions de production au sein même de l'Union européenne, ce qui, on l'a vu, détériore au premier chef le solde commercial français.
D'autre part, ces clauses seront inapplicables sans une profonde réforme de la politique de contrôles des denrées alimentaires importées.
Les précédents rapports du Sénat, là encore, ont constaté sur le terrain des défaillances majeures :
· les contrôles aléatoires officiels, les plus efficaces, sont insuffisants : ils sont aujourd'hui centrés, quand ils concernent des denrées végétales, sur une matrice d'analyse de risques, identifiant les denrées exposées à un risque en fonction de leur origine. Cette liste étant publique, elle porte en elle des risques de contournements. Interrogée, la Commission européenne estime que rien ne s'oppose à ce que les États membres aillent au-delà, au contraire. Mais ces derniers se renvoient la balle ;
· certaines substances interdites ne sont plus contrôlées en pratique. Si l'Union européenne recense et réglemente 1 498 substances actives, elle en interdit formellement 907 parmi elles. Le plan de contrôle européen, décliné par les États membres, ne prévoit, de son côté, que 176 substances à analyser. Certes, la France va plus loin en analysant, dans ses contrôles de résidus de pesticides, 568 substances. Toutefois, au regard des 1 498 substances à contrôler, cela signifie tout de même que plus de 900 substances actives ne sont aujourd'hui presque jamais contrôlées par les autorités sanitaires ;
· le nombre de contrôles aléatoires est insuffisant faute d'un budget adapté aux enjeux de sécurité sanitaire.
Reprenant la recommandation déjà formulée à plusieurs reprises par la commission des affaires économiques du Sénat, les rapporteurs insistent sur l'urgence de l'entrée en vigueur de ces mesures.
Recommandation n° 23 : durcir les contrôles sur les denrées alimentaires importées pour garantir le respect des normes minimales requises au sein de l'Union européenne en agissant :
- à court terme, au niveau national pour relever le niveau d'exigences, notamment i) en augmentant les effectifs des contrôles nationaux, profitant du transfert de la compétence sanitaire de la DGCCRF à la DGAL pour constituer une vraie « police sanitaire nationale » ; ii) en renforçant le nombre de contrôles aléatoires intégrés au plan de contrôle et en durcissant le contenu des analyses, notamment en renforçant le nombre de substances actives effectivement contrôlées par les laboratoires nationaux ;
- à moyen terme, au niveau européen en promouvant la constitution d'une task force européenne sur la sécurité alimentaire pour des interventions harmonisées au niveau européen, afin d'éviter les comportements de détournement des contrôles franco-français par une entrée dans d'autres pays.
Enfin, l'Union européenne dispose d'autres leviers pour rééquilibrer la concurrence. C'est le cas, par exemple, des droits à l'importation. La politique de gestion de ces outils doit être plus dynamique et prendre en compte les stratégies concurrentielles des partenaires commerciaux.
Sur la tomate, la non-revalorisation de la valeur forfaitaire d'importation pour répondre à la montée en gamme des producteurs marocains sur de la tomate cerise aboutit à rendre inefficace le dispositif de protection pourtant imaginé dès la signature de l'accord de libre-échange avec le Maroc. Ce point doit rapidement être réévalué, ce que plusieurs États membres demandent depuis plusieurs années (cf. la partie dédiée à la tomate, plus haut).
Recommandation n° 24 : mener une politique active d'actualisation des valeurs forfaitaires d'importation pour répondre aux stratégies concurrentielles des partenaires commerciaux et préserver l'efficacité des outils de protection prévus dans les accords de libre-échange.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 28 septembre, la commission a procédé à l'examen du rapport d'information.
Mme Sophie Primas, présidente. - La conférence des présidents a décidé, lors de sa réunion du 30 juin dernier, que, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire, les dispositions de l'article 23 bis du règlement incitant à l'assiduité aux réunions de commissions seraient de nouveau applicables à compter du 1er octobre prochain.
Elle a également décidé le retour, à compter du 1er septembre 2022, au seul présentiel pour les réunions plénières des commissions, des délégations et des instances qui en dépendent, ainsi que pour les groupes interparlementaires d'amitié. Il pourra néanmoins être recouru à la téléconférence pour les réunions des rapporteurs, l'audition de certaines personnalités éloignées de Paris ou encore, de manière exceptionnelle, comme solution de substitution à certains déplacements.
Nous examinons aujourd'hui les conclusions de nos trois rapporteurs sur la mission d'information Compétitivité de la Ferme France. Nous allons parler concrètement de cinq produits consommés tous les jours par les Français : le blé, la pomme, la tomate, le lait de vache et le poulet. Nos rapporteurs ont en effet souhaité étudier ces exemples, en les décortiquant pour mieux comprendre le décrochage de l'agriculture française et interroger particulièrement les enjeux de compétitivité. Leur démarche a consisté à partir du quotidien de nos agriculteurs et industries agroalimentaires, mais aussi des pratiques de consommation des Français. Il en résulte un rapport d'enquête décapant qui, j'en suis sûre, animera nos débats.
Je félicite vivement nos rapporteurs : leur travail de terrain s'appuie sur plusieurs déplacements visant notamment à s'inspirer des bonnes pratiques de nos voisins et sur une concertation avec les professionnels. Les trois sénateurs, issus de bords politiques différents, n'ont cessé de rechercher le consensus au nom de l'intérêt général. C'est, pour moi, une bonne illustration de la méthode sénatoriale.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. - Le temps nous est compté et nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a trois ans, dans le cadre du groupe d'études Agriculture et alimentation que je préside, nous présentions un rapport d'information intitulé La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? L'alerte générale lancée par le Sénat en 2019 a été entendue et la souveraineté alimentaire est à la mode. Toutefois, le Gouvernement n'a pas encore pris la mesure de ce qui est en cours.
À l'heure où le commerce international de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi dynamique, la France est l'un des seuls grands pays agricoles dont les parts de marché reculent : nous étions le deuxième exportateur mondial en 2000, nous ne sommes plus que le sixième. Nos parts de marché à l'international sont passées de 11 % en 1990 à moins de 5 % en 2021. Et encore, nous devons cette place principalement au secteur viticole, non pas en raison d'une hausse des volumes, mais d'une hausse des prix.
En parallèle, nos importations alimentaires explosent. De fournisseur, la France devient cliente, notamment de ses voisins européens. Son excédent commercial est fragile. Au total, il est passé de 12 milliards d'euros en 2011 à 8 milliards d'euros en 2021. Hors vins, nous sommes en déficit. Dans le même temps, la production stagne alors que la demande est forte : les rendements s'érodent, les productions sont de moins en moins nombreuses et la surface agricole utile recule.
Cette dépendance est très inquiétante, alors que les effets de la crise covid-19 ont rappelé l'importance de notre souveraineté et que l'arme agricole redevient géostratégique. Elle ne fait malheureusement que s'aggraver.
De ces mois d'enquête, nous tirons un constat simple : toutes les filières étudiées décrochent, car elles ne sont plus compétitives. Selon les professionnels, les chercheurs et les organismes de réflexion rencontrés, 70 % des pertes de marché de ces dernières années s'expliquent uniquement par un manque de compétitivité.
Quels sont les boulets aux pieds de nos agriculteurs ? Quatre facteurs ont été identifiés : le premier est la hausse des charges des producteurs, en raison des coûts de main-d'oeuvre, de surtranspositions trop nombreuses et d'une fiscalité trop lourde ; le deuxième est une productivité en berne, due au manque d'investissement - principalement dans l'agroalimentaire, où sévit une guerre des prix dévastatrice et où la productivité a même reculé de façon continue de 1995 à 2015 - et à un effet taille d'exploitation, la Ferme France ayant choisi un modèle familial éloigné des pratiques de ses concurrents directs en Europe ; le troisième facteur est la faible défense par l'État dans les accords de libre-échange ; enfin, le quatrième facteur est le climat politico-médiatique, qui fustige un modèle agricole pourtant le plus vertueux du monde.
Depuis 2017, le Gouvernement entend résoudre le problème de compétitivité par la stratégie du « tout montée en gamme ». C'était le sens du discours de Rungis de 2018, dans lequel le Président de la République assumait promouvoir une montée en gamme pour tous, quitte à abandonner des productions non compétitives.
Cela s'est traduit par une hausse des charges, par le recentrage de la production sur le marché intérieur et par une politique en faveur des accords de libre-échange, le Gouvernement considérant que la montée en gamme pour tous préserverait les filières agricoles françaises qui gagneraient même des accords à l'export, quitte à perdre définitivement le coeur de gamme, où l'agriculture française n'avait plus vocation à figurer.
Cette politique n'a rien changé et le déclin de notre agriculture se poursuit. On me dira que, depuis 2020, une prise de conscience a eu lieu sur la souveraineté. Pourtant, la même politique continue d'être appliquée, à bas bruit. J'en veux pour preuve la circulaire publiée la semaine dernière par la Première ministre, qui fixe trois priorités au ministre de l'agriculture : souveraineté alimentaire, renouvellement des générations en agriculture et accès à une alimentation de qualité. La compétitivité ne figure pas parmi ces objectifs. On parle d'alimentation de qualité comme si le coeur de gamme produit en France, dont l'agriculture est la plus durable du monde, était d'une qualité insuffisante.
Par ce rapport, nous entendons démontrer, exemples et chiffres à l'appui, que par cette politique de montée en gamme à marche forcée, l'État fait fausse route. Au bout du compte, l'État fait courir deux risques à la France agricole : d'abord celui d'une déconnexion totale avec les attentes des consommateurs, touchés par une crise du pouvoir d'achat qui s'aggrave de jour en jour. Or qui dit montée en gamme dit hausse des prix des denrées françaises. Est-il dès lors tenable d'accélérer cette montée en gamme ? Le risque majeur serait de réserver la consommation de produits français à ceux qui peuvent se le permettre, tout en condamnant les plus modestes à ne s'alimenter qu'avec des produits importés. La situation de surproduction que connaissent les producteurs bio depuis deux ans le démontre : le pouvoir d'achat des consommateurs est limité. De nombreux producteurs ont d'ailleurs choisi la déconversion, faute de débouchés pourtant promis par l'État.
Le deuxième risque est une crise majeure de souveraineté alimentaire, car la montée en gamme favorise les importations et réduit le potentiel productif en volume, en sapant les rendements et en se spécialisant sur des niches.
Notre rapport entend conjurer ces deux risques. Notre volonté est de nous assurer que l'agriculture française suive sa vocation, la seule qui compte : nourrir les Français.
M. Pierre Louault, rapporteur. - Dans le domaine végétal, nous avons étudié les cas du blé, de la pomme et de la tomate. Ces filières en sont à trois stades différents d'une même tendance au manque de compétitivité.
La France est le quatrième exportateur mondial de blé. Elle produit 35 millions de tonnes par an, dont 15 millions à 20 millions sont exportées, pour un excédent commercial de plus de 6,5 milliards d'euros. Jusqu'ici, les handicaps français, en premier lieu la taille des exploitations - quatorze fois plus grandes en Australie, neuf fois en Russie ou en Ukraine, cinq fois aux États-Unis ou au Canada - étaient compensés par la grande diffusion des céréales sur le territoire, un coût du foncier maîtrisé, de solides performances techniques, les aides de la politique agricole commune (PAC) ou encore un système logistique avantageux bénéficiant d'une forte diffusion des silos à grains.
Or la France céréalière est en train de perdre ces atouts. Sans compter les surtranspositions, les charges explosent : le coût des intrants a par exemple augmenté de 50 % depuis la fin des années 1990, alors que les quantités vendues ont chuté de 50 %. La France investit moins dans la recherche que ses concurrents, d'où, sans doute, la stagnation des rendements. Les aides PAC sont moins orientées vers les filières céréalières et, surtout, les avantages logistiques disparaissent : nos ports sont en crise, nous sommes trop dépendants du routier à l'heure où les prix du pétrole explosent et les silos français, très vieillissants et peu adaptés au changement climatique, nécessiteraient des investissements colossaux.
Les professionnels craignent que l'absence de croissance ne soit le début d'une décroissance. C'est le cas de la meunerie, qui a voulu, à la fin des années 1990, préserver son marché intérieur plus rémunérateur en montant en gamme, quitte à réduire les exportations. Les exportations de farine ont alors baissé massivement, passant de 2 millions de tonnes en 1995 à moins de 160 000 tonnes aujourd'hui, mais, en parallèle, la production a diminué de 20 % et les importations ont augmenté, notamment depuis l'Allemagne sur des farines MDD ou distribuées en hard discount ou dans les industries agroalimentaires. En matière de biscuits et pâtisseries de conservation, nous accusons un déficit de près de 500 millions d'euros, soit un doublement en vingt ans.
Le deuxième secteur ayant suscité notre intérêt est celui de la pomme française. Cette filière d'excellence tournée historiquement vers l'export, a connu trois ruptures ces dernières années : une division par deux de sa production depuis 1990, tombée à 1,3 million de tonnes de pommes de table et 200 000 tonnes de pommes à cidre, sous l'effet conjugué d'une baisse des rendements et d'un recul des facteurs de production ; une division par deux de ses volumes exportés - de 700 000 tonnes en 2013 à 340 000 tonnes en 2021 - dans un marché mondial pourtant en croissance ; une augmentation des volumes importés, surtout dans l'industrie agroalimentaire de transformation, où une pomme utilisée en entreprise sur trois est importée.
De l'aveu de tous, la filière pomme connaît depuis des années une crise de compétitivité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le prix moyen de la pomme française est de 1,18 dollar au kilogramme, soit un coût supérieur de 15 centimes à celui des pommes italiennes et de 66 centimes à celui des pommes polonaises. La marque France ne compense pas ce surcoût.
À la source de ce déficit de compétitivité, on trouve un coût de la main-d'oeuvre trop élevé par rapport à nos concurrents et qu'une bonne productivité ne parvient pas à compenser. Les professionnels ont également cité des surtranspositions trop nombreuses en matière de règles des pratiques agricoles, d'attribution d'aides ou au niveau des intrants. Songeons que les agriculteurs polonais peuvent utiliser 454 substances quand les Français ne peuvent en utiliser que 309.
Pour sortir de l'ornière, l'État a encouragé les producteurs à monter en gamme, posant deux difficultés. D'une part, des problèmes d'écoulement en raison d'un marché saturé : 38 % des pommes bio sont ainsi aujourd'hui redirigées vers le marché conventionnel, à la seule charge du producteur. D'autre part, une fragilisation de l'aval industriel, habitué à valoriser des pommes ne pouvant se retrouver sur les étals des marchés. Or, avec des producteurs tirant leur valorisation d'une limitation de ces « écarts de tri », les industriels sont confrontés à des risques de pénurie et à des coûts d'approvisionnement justifiant un recours accru aux importations. C'est tout un équilibre de filière qui est menacé. Là encore, la montée en gamme s'est traduite par un recul des exportations, de la production, et par une valorisation des importations sur le marché coeur de gamme - essentiellement celui des produits transformés à base de pommes comme les compotes.
Enfin, la situation de la tomate est plus préoccupante encore. Depuis l'accord euro-méditerranéen de 1996 de l'Union européenne avec le Maroc dit « tomates contre blé », la filière est en crise : la production française de tomates fraîches se situe depuis 1990 sur un plateau à 600 000 tonnes dans un marché en explosion, tandis que la tomate d'industrie connaît un recul massif, de 370 000 tonnes en 1999 à 150 000 tonnes à peine actuellement.
Cette situation a conduit à une progressive dépendance aux importations de tomates fraîches. La France est aujourd'hui le troisième importateur mondial de tomates, à hauteur de 300 000 tonnes si l'on exclut les réexportations. 36 % des tomates fraîches consommées sont importées. Concernant la tomate transformée, le taux de dépendance atteint 85 %.
Là encore, les écarts de compétitivité expliquent cette dépendance. Les professionnels notent un coût horaire de la main-d'oeuvre française supérieur à celui de tous ses voisins européens et même dix-sept fois supérieur à celui du Maroc, une hausse du coût des intrants et des coûts de l'énergie et, encore et toujours, des surtranspositions, par exemple en matière de politique de l'eau, où chaque projet est d'une étonnante complexité.
Le bio offre un autre exemple de surtransposition. Les professionnels ont interdiction de commercialiser leur production en label bio, même si elle l'est effectivement, entre le 21 décembre et le 20 avril, alors que l'essentiel de la création de valeur se fait entre mars et avril. Cette décision franco-française laisse aux tomates espagnoles bio un monopole temporaire à la meilleure période.
Là encore, le comblement de ce déficit de compétitivité devait passer par une montée en gamme. Mais c'est une course perdue d'avance. C'est ce que nous avons appelé l'effet « tomate cerise ». Pour tenter de contrer la concurrence marocaine, les producteurs français, encouragés par les pouvoirs publics, se sont tournés vers la production de tomates cerises, quitte à réduire la production de tomates rondes, leur coeur de gamme. Dans le même temps, les importations marocaines de tomates cerises sont passées de 300 tonnes en 1995 à 70 000 tonnes. Les Français ont donc perdu sur les deux tableaux. Ils ciblent désormais le segment des tomates anciennes, entraînant, pour la première fois de l'histoire récente de la filière, une baisse de production en raison de la baisse du rendement. Surtout, ils se positionnent sur un segment relativement cher au kilogramme en grande surface, incitant les consommateurs les plus modestes à n'acquérir que des tomates rondes importées.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. - Il faut bien comprendre que l'accord franco-marocain de 1996 s'est traduit par une perte de nos capacités de production pour la quasi-totalité de nos tomates, désormais concurrencées par les tomates marocaines, mais aussi par la chute de nos exportations de blé à destination du Maroc.
M. Serge Mérillou, rappporteur. - Du côté de l'élevage, nous avons analysé les filières lait et poulet. Si tout semble les opposer, elles sont en réalité, elles aussi, confrontées à des difficultés communes de compétitivité.
Le modèle de la filière lait de vache - modèle familial employant directement 68 000 salariés, reposant sur 54 000 petites exploitations disséminées sur le territoire et offrant une grande diversité de productions, de grande consommation ou industrielles - peut être qualifié de « miraculeux ». Nos 3,4 millions de vaches laitières produisent environ 24 milliards de litres de lait chaque année, faisant de notre pays le deuxième producteur européen, derrière l'Allemagne. La production est tournée d'une part vers un marché intérieur très demandeur et d'autre part vers l'exportation à hauteur de 42 %. FranceAgriMer estime même que la France, dont l'excédent commercial était de 3,5 milliards d'euros en 2021, est le pays le plus compétitif du monde à l'export.
Le problème vient du fait que selon nous, la France doit sa compétitivité au seul fait que les éleveurs acceptent de compenser leurs handicaps concurrentiels par une baisse de revenu. De 2007 à 2017, le revenu des producteurs de lait a légèrement baissé, en opposition frontale à la dynamique observée chez nos voisins. Cet état de fait, bien connu dans nos campagnes, pose la question du renouvellement générationnel. Le nombre de chefs d'exploitations est en chute libre : il a été divisé par cinq en quarante ans, quand le cheptel a perdu 400 000 têtes en seulement quinze ans et devrait en perdre encore autant d'ici à 2030. Il en résulte une érosion de notre potentiel productif très importante et très inquiétante quant à notre souveraineté.
Par ailleurs, alors que, entre 2015 et 2021, la production européenne augmentait de 6 %, la production française déclinait de 2 %, faisant de la France le seul pays européen à ne pas avoir su tirer parti de la fin des quotas. Hormis la Bretagne et la Normandie, qui augmentent légèrement leurs volumes, toutes les autres régions françaises ont vu leur production décliner. Tout se passe comme si l'absence de politique de compétitivité conduisait les producteurs à être contraints de réduire leur revenu pour maintenir leurs parts de marché sur tous les segments.
J'en viens maintenant au poulet. Alors que le poulet devenait la viande la plus consommée au monde, la production française n'a augmenté que très légèrement, sans accompagner le doublement de la demande interne. En conséquence, le volume des importations a explosé et, chiffre à retenir, 50 % de notre consommation de poulet est aujourd'hui issue de l'importation. Parallèlement, les exportations françaises ont été divisées par deux depuis 1998, d'où un déficit commercial de 665 millions d'euros en 2021.
La production française se distingue par une forte présence du poulet label, qui plafonne à 20 % de la consommation. Cette spécialisation dans des poulets entiers au poids plus faible que la moyenne a certes trouvé son public, mais elle détourne les producteurs du marché le plus en croissance, celui du poulet à la découpe. Sur ce marché, notamment là où le critère prix est essentiel, en restauration hors foyer ou dans les plats transformés, la France a décroché.
Cette défaite du made in France sur le marché de masse s'explique essentiellement par un manque de politique de compétitivité. Au terme du processus de production, le poulet français est plus cher que celui de ses concurrents, tout en étant 20 % plus petit. Cela s'explique par des coûts de main-d'oeuvre plus élevés au stade de l'abattage et par des charges fixes plus élevées en raison d'élevages plus petits : la capacité moyenne en France est plus de deux fois inférieure à la moyenne européenne ou à celle de la Belgique, quatre fois inférieure à celle de l'Allemagne, cinq fois inférieure à la moyenne hollandaise et britannique et vingt fois inférieure à celle de l'Ukraine.
De ces cinq histoires, nous retenons un message : l'absence de politique de compétitivité en matière agricole est une erreur stratégique. Ne nous méprenons pas : nous ne remettons nullement en cause les stratégies ciblées de montée en gamme qui sont rémunératrices. De même, nous n'incriminons aucune filière, aucun acteur agricole ni aucun mode de production : la France agricole est riche d'une diversité qui doit être conservée, car elle est source d'enrichissements mutuels. Nous remettons toutefois en cause le choix de l'État : la montée en gamme pensée comme une solution globale applicable à tous les problèmes de compétitivité de notre agriculture n'est pas une bonne stratégie. Je pense surtout aux risques qu'elle fait peser sur les familles les plus modestes, condamnées à terme à ne consommer que des produits importés plus accessibles, pendant que d'autres pourront se permettre de manger français.
La solution unique du « tout montée en gamme » aboutit à trois effets néfastes. Le premier est l'effet « emmental » qu'a connu la filière lait, quand l'absence de politique de compétitivité affaiblit le revenu des agriculteurs et mite toute la filière, aboutissant à la décapitalisation du cheptel et au non-remplacement des départs à la retraite. Pour tenter d'y échapper, l'État a misé sur une montée en gamme centrée sur le marché intérieur, avec pour conséquence - l'exemple des filières farine et pommes l'a montré - un renversement de situation : les exportations chutent, tandis que sur le marché coeur de gamme, les importations explosent. À la fin, les producteurs ont perdu sur les deux tableaux. C'est ce que nous avons appelé l'effet « tarte Tatin », ou quand l'État raisonne à l'envers.
D'effet « emmental » en effet « tarte Tatin », les producteurs tombent, au terme du processus de montée en gamme intégrale, dans l'effet « repas du dimanche », quand les productions françaises sont, compte tenu de leur prix, réservées à une consommation occasionnelle et que les importations sont privilégiées pour la consommation de tous les jours, comme on le voit dans le cas du poulet et de la tomate.
Particulièrement en ces temps de crise du pouvoir d'achat, mener une politique de compétitivité est un impératif. Il reste néanmoins possible de monter en gamme et de mieux segmenter les filières, tout en accompagnant les agriculteurs.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. - Au terme de cette enquête, nous considérons que la priorité doit aller à un « choc de compétitivité » autour de cinq axes.
Premier axe, nous appelons le ministre à mettre en place un grand plan « Compétitivité 2028 » en matière agricole. Nous prônons la nomination d'un « haut commissaire » à la compétitivité dont les attributions seraient claires et le pouvoir suffisant pour garantir le suivi du plan, notamment en matière de surtranspositions.
Deuxième axe, il est essentiel de maîtriser des charges de production afin de regagner de la compétitivité-prix. Cela se déclinerait en cinq priorités.
La première serait de faire de l'administration un partenaire et non un frein à la compétitivité. Il s'agirait de donner corps, par des mécanismes juridiques innovants, au principe « Stop aux surtranspositions ». Le Conseil d'État serait chargé d'identifier les surtranspositions dans ses avis consultatifs et, à la demande du haut-commissaire, le Gouvernement aurait pour mission d'en communiquer le chiffrage. Le Parlement et les professionnels seraient ainsi clairement informés et décideraient en toute connaissance de cause. Pour certaines surtranspositions non législatives notamment, le haut-commissaire pourrait alerter, voire enjoindre le Gouvernement à corriger le tir. Nous proposons également de garantir une prise en compte des effets de bord liés à l'absence d'alternatives dans le cadre, par exemple, de l'interdiction d'une substance active, par le biais d'une analyse « bénéfices-risques environnementaux et sanitaires » en matière agricole. Les missions de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) seraient modifiées afin de ne plus seulement mesurer le risque, mais aussi le bénéfice.
La deuxième priorité en matière de compétitivité-prix vise à réduire le coût de la main-d'oeuvre sans détériorer l'attractivité salariale de la filière. Nous proposons de réduire les charges sociales sur les travaux saisonniers agricoles, en pérennisant le dispositif dit « TO-DE », en l'étendant à certains secteurs, par exemple à la collecte en zone de montagne et en sortant les entreprises agroalimentaires saisonnières de l'application du bonus-malus sur les contrats courts. Nous recommandons en outre d'activer tous les leviers pour résoudre les problèmes d'embauche du secteur, en tournant davantage l'enseignement agricole vers les métiers de l'agroalimentaire, en réformant la politique d'accueil des travailleurs saisonniers étrangers, en renforçant le fléchage des Français en recherche d'emploi vers les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire par l'incitation et, dans le cadre de la réforme du conditionnement du versement du revenu de solidarité active proposée par le Gouvernement, en considérant ces emplois comme des métiers d'intérêt général et, enfin, en dopant les investissements en mécanisation par un suramortissement ou un crédit d'impôt.
La troisième priorité est de préférer l'usage de la carotte plutôt que du bâton pour accélérer les transitions environnementales, en faisant notamment le bilan des mesures pénalisantes prises ces dernières années et, le cas échéant, en corriger les effets de bord.
La quatrième priorité revient à ne pas saper, par excès de zèle, nos atouts en termes de compétitivité-prix dans les prochains dossiers législatifs. Cela passe par la préservation de notre compétitivité sur le foncier dans la loi d'orientation agricole ou, à plus court terme, par la mise en oeuvre rapide d'un plan de résilience de l'agriculture et de l'agroalimentaire face à la crise énergétique.
La cinquième priorité en matière de maîtrise des charges serait de faire du levier fiscal un atout, en préservant l'avantage fiscal sur le gazole non routier agricole et en baissant les taxes de production.
M. Pierre Louault, rapporteur. - Troisième axe, il faut faire de la Ferme France un leader en matière d'innovation environnementale. Nous proposons ainsi d'augmenter les crédits des plans d'investissement portant sur l'innovation agricole, de prolonger le volet « troisième révolution agricole » du plan France 2030, de promouvoir la recherche sur les new breeding techniques et de réformer la recherche agricole pour la mettre au service des besoins techniques des agriculteurs. Sur ce point, nous proposons d'augmenter les moyens dédiés à la recherche technique, en redéfinissant les missions de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) ou, à défaut, en réorientant certains de ses crédits vers la recherche de solutions techniques utiles aux agriculteurs. Il est également indispensable de préserver les budgets des instituts techniques payés par les agriculteurs au travers du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (Casdar) et de renforcer la coopération entre l'Inrae et ces instituts.
Nous pourrions par ailleurs doper l'investissement agricole par un crédit d'impôt ou un suramortissement fiscal adapté. Aussi, nous proposons de reprendre une idée figurant dans la proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir, à savoir la création d'un livret Agri, sur le modèle du livret développement durable et solidaire ou du livret A, afin de faciliter l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire dans un contexte de remontée des taux.
Pour être compétitif, il faut être plus résilient. C'est pourquoi nous appelons le Gouvernement à appliquer pleinement et entièrement la loi sur l'assurance récolte, tout en s'engageant dans une réforme internationale de la moyenne olympique. Il faut, en parallèle, favoriser un investissement massif dans les moyens techniques de lutte contre les aléas, par exemple en mettant le paquet sur le développement du stockage de l'eau, en levant les freins actuels, financiers ou contentieux.
Quatrième axe, il faut reconquérir les marchés perdus et conquérir les marchés d'avenir. Cela passe d'abord par un changement de paradigme : quitter les visions décroissantes au niveau européen et demander à amender la stratégie européenne « de la Ferme à la fourchette », en tenant compte de la dégradation du contexte international et européen et des nécessités de maintien d'une autonomie alimentaire compatible avec nos objectifs environnementaux. C'est ce que proposait le rapport de notre commission sur la souveraineté de la France.
M. Serge Mérillou, rapporteur. - La reconquête des marchés perdus passe également par la révision globale de la politique d'accompagnement à l'exportation de la France dans les domaines agricole et agroalimentaire.
En s'inspirant par exemple du modèle italien, il nous semble essentiel de retravailler l'idée de « marque France » et de s'appuyer davantage sur l'image de la gastronomie française. Quand vous mangez une pizza aux États-Unis, elle est cuisinée avec de la mozzarella italienne. En revanche, quand vous voulez y manger du pain, il n'est pas pétri avec de la farine française. C'est sur ce point que nous devons progresser.
Nous fixons comme objectif la reconquête de l'assiette des Français, en approfondissant la transparence en matière d'affichage de l'origine des denrées composant les produits ou en augmentant les contrôles sur les affichages trompeurs et sur la traçabilité des produits importés. Nous proposons d'intensifier la priorité donnée aux approvisionnements en produits locaux et nationaux dans la restauration collective, en poussant une réforme européenne du droit de la commande publique, pour que les choses soient enfin claires.
Cinquième axe de nos recommandations, il faut protéger l'agriculture française de la concurrence déloyale, car nous aurons beau être plus compétitifs, nous devons aussi et surtout nous défendre. Cela remet complètement en cause l'engrenage politique voulu par le Gouvernement consistant à multiplier les accords de libre-échange bilatéraux où, à chaque fois, l'agriculture est la variable d'ajustement. Après le Ceta, même pas ratifié par le Parlement, le Mercosur, qui n'est bien sûr pas enterré, et désormais l'accord avec l'Océanie, nos filières refusent qu'on exige d'elles des efforts de montée en gamme quand on favorise l'entrée en masse de produits ne respectant pas nos normes. C'est pourquoi nous proposons la promotion de clauses miroirs dans tous les accords. Des clauses juridiques non contrôlées ne servent toutefois à rien : nous devons démultiplier les contrôles des denrées alimentaires importées. Enfin, nous prônons une actualisation des outils déjà en vigueur de protection aux importations, comme les valeurs forfaitaires à l'importation, notamment pour la tomate.
M. Jean-Marc Boyer. - Ce rapport est très éclairant. Vous avez dit à deux reprises que l'agriculture française était la plus vertueuse au monde. Or on entend souvent divers organismes ou associations se fonder sur des éléments scientifiques pour tenter de démontrer le contraire. Quels sont les éléments factuels et objectifs qui justifient votre affirmation ?
M. Franck Menonville. - Ce rapport confirme le constat partagé de l'érosion de notre compétitivité. Quelles sont vos préconisations pour remédier aux véritables impasses techniques et technologiques dans lesquelles se trouvent certaines filières ?
Par ailleurs, vous avez évoqué les accords internationaux de libre-échange. Peut-être pourrions-nous inscrire dans le rapport l'obligation, avant leur ratification, de ratification par le Parlement et y entrevoir la capacité du Parlement à exercer un contrôle et une évaluation de ces accords dans le temps.
M. Franck Montaugé. - Ce travail à la fois suggestif et alarmant pose en réalité des questions structurelles.
J'aimerais connaître la part que représente la main-d'oeuvre dans les prix de marché. Comment la compétitivité est-elle calculée ? Avez-vous pu décomposer la valeur ajoutée ? Qu'en est-il, en outre, du coût des surtranspositions ?
Sur la question du positionnement en bas de gamme et moyen de gamme, le rapport ne préconise pas de développer des politiques d'aide alimentaire spécifiques en direction des populations qui, effectivement, n'ont d'autre choix que de s'orienter, faute de moyens, vers des produits d'importation. Aux États-Unis, par exemple, l'aide alimentaire est un vecteur extrêmement puissant pour l'agriculture américaine, dont je ne partage pas par ailleurs le modèle. Il y a là une piste à creuser que nous pourrions proposer au Gouvernement. L'aide alimentaire en France est très réduite ; elle n'est pas à la hauteur des enjeux.
En réalité, je crois comprendre que nous sommes confrontés à un choix de modèle agricole avec, d'un côté, des exploitations familiales et, de l'autre, une agriculture sociétaire faite d'investisseurs, de financiers et finalement d'exécutants. Peut-être un modèle intermédiaire, le modèle coopératif bien compris, nous permettrait-il de préserver ce qui peut l'être. Voyez-vous le problème en ces termes ?
Enfin, vous avez rappelé la nécessité d'apporter des réponses en matière d'utilisation des ressources en eau. Sur cette question, on néglige toujours le curage et la restitution des capacités initiales de stockage de notre appareil hydraulique.
Concernant les assurances, je considère que la moyenne olympique est une affaire relevant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Que vient faire le gouvernement français sur ce sujet ? J'entends dire que les Espagnols s'affranchissent de cette règle. Si cela devait être vrai, cela poserait question.
Pour terminer, je me réjouis que vous proposiez un nouveau haut commissaire. Je ne doute pas que son action sera très efficace.
Mme Sophie Primas, présidente. - J'y vois une légère ironie !
M. Henri Cabanel. - Vous mettez en cause la surtransposition. En caricaturant, devrions-nous autoriser certains produits phytosanitaires au prétexte qu'ils ne sont pas interdits dans d'autres pays européens ? Votre rapport n'évoque pas assez, à mon sens, la problématique de la santé alimentaire.
Vous évoquez par ailleurs le coût de la main-d'oeuvre. Il est certes inférieur au Maroc, mais comparons ce qui est comparable ! Voulons-nous que les salariés français vivent comme les salariés marocains ? On parle de « charges », mais cela inclut, pour rappel, l'assurance maladie, la retraite, etc. Il s'agit pour la France d'un atout énorme que d'autres n'ont pas.
Vous opposez ensuite les exploitations familiales aux grandes exploitations d'autres pays. Faut-il pour autant revenir à l'agriculture intensive ?
Si je partage un certain nombre des recommandations du rapport, je rejoins l'interrogation de M. Montaugé : quel modèle agricole souhaitons-nous pour demain ? Au vu du contexte géopolitique et du changement climatique à l'oeuvre, les choses vont évoluer selon moi à l'échelle planétaire. Les modèles d'agricultures compétitives vantés aujourd'hui seront-ils les modèles de demain ?
En matière d'emploi, vos recommandations visant à revaloriser les métiers au travers des lycées agricoles ne me semblent pas de nature à attirer de nouveaux salariés. Le noeud du problème se situe au niveau du revenu agricole et de notre capacité à installer des jeunes.
Concernant l'assurance, je suis très heureux qu'on ait pu mettre en place ce système d'indemnisation, mais je doute qu'il permette d'atteindre une agriculture résiliente. Nous devons nous pencher effectivement sur la question de la moyenne olympique.
Sur la question de l'eau, il faudra en effet permettre à l'agriculture de recueillir l'eau qui tombe en abondance et qui, pour les trois quarts, va à la mer. Nous sommes, dans nos régions, habitués aux épisodes cévenols : il peut ne pas pleuvoir du tout pendant tout un été et tomber 300 millimètres en deux heures. Or sur ces 300 millimètres, le sol ne profite que de 20 millimètres environ. Il y a là une réflexion à mener, de même que sur la structuration des sols, si nous voulons lutter contre la sécheresse. En la matière, nous manquons encore de solutions.
Bien que « décoiffant », ce rapport a le mérite d'ouvrir le débat.
M. Joël Labbé. - Je voudrais tout d'abord saluer le travail de fond réalisé par les rapporteurs. Ceux-ci, d'une manière assumée, défendent un modèle agricole, sur lequel vous connaissez mon point de vue. On se doit de reconnaître qu'il existe et assure une part importante de l'alimentation. Mais s'il est une agriculture durable et vertueuse, tout le monde l'admet, c'est l'agriculture biologique. Il y aurait tout de même une analyse à mener sur ce sujet, au moment où un jeune sur deux aspire à devenir un exploitant agricole « bio », où 19 % des agriculteurs travaillent dans ce secteur pour 10 % des surfaces agricoles françaises. Or l'agriculture biologique souffre d'un manque d'aides, ce qui explique d'ailleurs le coût des produits qui en sont issus. Hier, j'ai assisté à Rennes à un colloque sur un sujet essentiel, la protection des eaux via les périmètres de captage ; sur ces périmètres, au moins, on doit pratiquer une agriculture durable et vertueuse.
N'opposons pas les systèmes ! Prenons-les tous en compte ! Donnons les moyens au secteur émergent de l'agriculture biologique : il n'y a pas de raison d'aider les uns plus que les autres !
M. Patrick Chauvet. - Ce rapport est, certes, décoiffant, mais il est factuel et décrit parfaitement la réalité actuelle de l'agriculture française. À ce sujet, je voudrais faire un parallèle avec le secteur de l'énergie : nous pourrions reproduire la même erreur stratégique que nous avons faite dans ce secteur !
La France, avec sa diversité de produits, est un merveilleux pays pour l'alimentation. Mais la question alimentaire dépasse de loin notre pays et, au regard des perspectives démographiques mondiales, deviendra de plus en plus prégnante dans les années à venir, le réchauffement climatique et le faible potentiel agronomique de certains pays risquant d'entraîner des flux migratoires importants.
Parmi les sujets à creuser se trouve la question de la simplification. Un travail complémentaire me semble pouvoir être réalisé concernant les démarches d'accompagnement des agriculteurs. Prenons l'exemple d'un jeune accueilli dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dans le secteur laitier. L'entreprise de collecte laitière lui propose de produire 300 000 litres de lait pour essayer de maintenir le cap. Cette proposition lui fait dépasser l'effectif de 150 vaches laitières de 12 vaches, ce qui engendre un nouveau processus administratif de déclaration et de contrôle. Deux fois sur trois, lorsqu'un jeune dans ce cas envisage la possibilité d'arrêter la production laitière, on se rend compte qu'il y gagne. Il faut mettre un terme à cette « compliquite » !
M. Bernard Buis. - Ce rapport est effectivement décoiffant. Le secteur agricole est en déclin, subissant une forte perte d'emplois depuis 1975. Néanmoins, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein : le déclin très fort que nous connaissons depuis les années 2000 semble enrayé et la situation française se redresse.
Les rapporteurs ont écarté un peu rapidement le « bio », qui peut, selon moi, faire partie des réponses. La France est le leader européen de production biologique, devant l'Espagne. Aujourd'hui, il faut jouer cette carte, comme le recommande la Cour des comptes dans un rapport de juin 2022. Cela manque dans le présent rapport, qui m'apparaît plutôt à charge.
M. Olivier Rietmann. - Je ne trouve ce rapport ni choquant ni décapant. Il met en exergue la réalité, à savoir que notre agriculture se trouve dans une situation catastrophique. Le seul modèle agricole qui vaille est celui qui permet, tout en produisant les produits les plus sains possible, d'alimenter l'ensemble de la population, d'offrir aux agriculteurs les moyens de vivre de leur activité et d'exporter les productions. Ce qui se passe, c'est que nous avons oublié la notion de business, de commerce, de vente - certes, un produit doit être sain, mais il doit aussi intéresser les clients et être abordable -, et nous avons été les seuls à le faire. Pendant ce temps, nos voisins ont continué à évoluer, sans jamais omettre ces notions. Nous nous retrouvons de ce fait avec une agriculture particulièrement vertueuse, pourvoyeuse de produits-modèles, certes, mais inaccessibles à toute une partie de notre population et n'intéressant pas les autres pays. La question n'est donc pas d'opposer deux modèles, ce qui nous ferait courir à la catastrophe ; il s'agit de provoquer un choc réel, de changer nos priorités. Sans cela, la chute sera rapide et vertigineuse. Je caricature, mais nous en sommes là ; il n'y a qu'à voir l'état de notre cheptel bovin !
La situation est critique. Notre agriculture ne remplit plus ses fonctions, ne nourrissant ni la population ni les agriculteurs. Ce rapport propose des mesures de bon sens. Encore faut-il de la volonté politique !
M. Jean-Jacques Michau. - Je souhaiterais juste une précision sur vos préconisations en matière de type d'exploitations agricoles. En début de présentation du rapport, vous avez indiqué que la petite taille des exploitations était un frein ; plus loin, vous avez loué l'intérêt des exploitations familiales. Qu'en est-il précisément ?
M. Daniel Gremillet. - Je félicite nos trois rapporteurs. La photographie qu'ils nous offrent est un peu différente de ce que l'on avait imaginé. La similitude est complète entre le dossier énergétique et celui-ci. Si je fais ce parallèle, c'est pour souligner qu'il faudra du temps pour corriger le tir !
Dans l'échec de la stratégie de montée en gamme, il faut aussi mentionner les conséquences en matière d'impact carbone. Si celui-ci est limité pour une production saisonnière, il peut être très élevé pour une production collectée tous les deux jours, comme le lait. En scindant les collectes, entre lait « bio », lait sous label et autre lait, c'est plus de camions mis sur les routes !
Territoires et agriculture sont mariés. Il faut redonner à notre administration française un rôle de « bâtisseur des territoires ». D'ailleurs, il est incroyable de parler de malbouffe en France ! Pas un produit mis à disposition des consommateurs n'enfreint les règles sanitaires de notre pays ! Il ne faut pas faire de confusion entre qualité et conditions de production...
Je suis très inquiet sur l'avenir de l'élevage. On ne mesure pas les conséquences des décapitalisations, notamment en lien avec les territoires.
Par ailleurs, avez-vous pu établir comment l'Allemagne avait pu aussi rapidement nous détrôner sur un certain nombre de marchés ? Mon constat en tant qu'élu, c'est que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en donnant une partie des financements aux collectivités régionales, a abouti à des politiques d'accompagnement très différentes d'une région à une autre. Mais surtout, dans le cadre de la politique de modernisation de l'agriculture, quand les länder allemands étaient au taux maximal autorisé par Bruxelles, soit 40 % des investissements, nous étions, nous, limités à 90 000 euros !
Merci, encore une fois, pour cette photographie, dont l'intensité risque de s'accroître avec la situation inflationniste que nous connaissons. J'insiste sur le fait que l'agriculture française doit être capable de nourrir notre population les jours de fête, mais aussi au quotidien et dans le respect de la diversité de cette population !
Mme Martine Berthet. - Ce rapport, très intéressant, met en avant plusieurs de nos faiblesses, faiblesses que nous avons nous-mêmes créées à force de vouloir laver « plus blanc que blanc ». Sur un sujet qui me préoccupe, la perte en cheptel, accentuée, cette année, par la sécheresse, le rapport mentionne, dans sa recommandation n° 14, la problématique du stockage d'eau. Que faudrait-il faire en plus ?
S'agissant du « bio », on constate, au-delà des prix de ces produits, que le consommateur préfère aussi acheter local. Il a ainsi une vision précise des conséquences de son acte : limitation du transport, impact sur les paysages ou l'emploi local, etc.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Je mesure toute l'importance du travail de nos rapporteurs. Il suffit d'avoir pris part à quelques comices agricoles cet été pour savoir que la situation est catastrophique et que les éleveurs sont dans une détresse immense. Les seuls qui s'en sortent à peu près sont ceux qui ont mis en place une méthanisation et l'ont intégrée complètement dans leur système d'exploitation. Le facteur énergétique est donc essentiel pour la pérennité des exploitations.
S'agissant des perspectives d'avenir, je m'inquiète de l'évolution des fameuses clauses miroirs, tout autant que de la taxation aux frontières. J'ai récemment entendu que les États-Unis seraient en mesure d'éviter le projet européen d'imposition de droits de douane, en raison de la similitude de leur objectif climatique avec l'Union européenne. Avez-vous exploré ces questions ? Qu'en pensez-vous ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. - Les Italiens font une promotion très poussée de leurs produits à l'étranger. Ils ont notamment créé le made in Italy. N'est-ce pas toute la politique de positionnement de nos produits agricoles à l'étranger qu'il faudrait repenser et revoir ?
M. Daniel Salmon. - Merci aux rapporteurs pour ce travail, qui présente un certain état des lieux de la production agricole française et de la compétitivité de ce secteur. Il me semble que cette notion de compétitivité est abordée avec une focale trop réduite et que d'autres sujets doivent être pris en compte, comme la durabilité des modèles, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, la santé publique ou l'épuisement des ressources. Si nous en sommes là, aujourd'hui, c'est du fait des modèles qui ont été développés pendant des années !
Le cinquième axe me semble pertinent, puisque nous faisons face aujourd'hui à une concurrence déloyale, permise par des traités de libre-échange qui nous ont mis à nu devant des pays ne se préoccupant absolument pas de l'écosystème terrestre. Par conséquent, il va falloir protéger notre agriculture, mais également se poser la question du juste prix des denrées alimentaires, dont la part dans le budget des ménages n'a cessé de baisser. On parle des gens qui ne peuvent pas se payer du « bio » ; parlons de la paupérisation de la population ! La question est bien de savoir pourquoi la population dans son ensemble ne peut pas se payer une alimentation de qualité, étant précisé qu'il y a tout de même des liens scientifiquement prouvés entre certains problèmes de santé publique et la malbouffe.
Quel modèle durable souhaitons-nous ? Voulons-nous une agriculture familiale et paysanne, ou autre chose ? Pouvons-nous lever un certain nombre de barrières pour revenir à une sorte d'âge d'or où l'on pouvait s'affranchir de certaines préoccupations environnementales ? Cela me semble problématique !
M. Claude Malhuret. - Je voudrais à mon tour remercier les auteurs de ce rapport, même s'ils risquent de me faire passer une mauvaise journée avec leurs conclusions préoccupantes. S'agissant du troisième axe, nous retrouvons les difficultés, affectant aussi d'autres domaines en France, pour passer de la recherche à l'innovation et de l'innovation à la production. Vous évoquez notamment le sujet des new breeding techniques, les NBT. Est-ce un sujet anecdotique ou une véritable révolution ? Vous semblez craindre une interdiction de principe dans ce domaine. Pouvez-vous faire un point sur l'avancée du débat au niveau européen ? Allons-nous une fois de plus être les dindons de la farce, en constatant que le reste du monde utilise ces innovations inventées en Europe, tandis que nous les aurons interdites ?
M. Sebastien Pla. - Je remercie à mon tour les rapporteurs de l'important travail réalisé. Je regrette simplement que tous les secteurs agricoles n'aient pas été abordés. Je pense notamment à celui de la viticulture, qui m'intéresse tout particulièrement. Malgré ses 15 milliards d'euros d'excédents sur la balance commerciale, celui-ci subit de plein fouet certaines crises et perd des marchés. Il n'est pas dans une situation plus simple que les autres secteurs agricoles et demande à être protégé.
Un choix a été fait dans le rapport : celui de promouvoir un modèle plutôt que l'autre, l'agriculture intensive plutôt que la biologique. Les deux doivent cohabiter, les deux doivent faire l'objet d'un travail fin et poussé. Elles cohabitent dans le secteur viticole et c'est la raison pour laquelle celui-ci fonctionne.
S'agissant enfin de la gestion de la ressource en eau, il ne faudrait pas que, demain, on ait un choix cornélien à faire entre une agriculture vivrière et une agriculture de loisirs. L'eau va manquer. Il va falloir faire des choix !
Ce rapport présente une photographie : c'est très bien ! Mais celle-ci est peu reluisante et les solutions mises sur la table ne sont pas à la hauteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. - Les questions qui nous ont été soumises sont importantes et couvrent un champ très vaste. Je vous propose de développer six points pour tenter d'y répondre, mes collègues rapporteurs apporteront les compléments nécessaires.
Premier point, nous sommes empêtrés dans nos paradoxes et nos certitudes. Notre rapport ne met pas plus en avant un modèle qu'un autre. Il est factuel. Nous avons tenté de démontrer que nous sommes à la croisée des chemins, si nous voulons garantir une certaine durabilité à notre production agricole. Nous avons empilé tant d'éléments, parfois contradictoires, que le système ne tient plus. Nous n'en sommes plus aujourd'hui à nous interroger sur la qualité de l'alimentation. La réalité est que nous ne produisons plus et importons des produits ne répondant pas au niveau de qualité que nous imposons à notre agriculture.
Deuxième point, nous n'avions pas le temps et les moyens de traiter toutes les productions agricoles dans ce rapport. Nous nous sommes donc concentrés sur cinq productions, directement liées à la consommation quotidienne des Français. Qui ne consomme pas de pomme, de tomate, de poulet, de produit laitier ou de pain ?
Troisième point, le volume de nos exportations de pommes a été divisé par deux en dix ans, passant de 700 000 tonnes à 340 000 tonnes. Parallèlement, le volume d'importation a doublé, de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes. Quelle en est la cause ? Le coût de la pomme est constitué à 60 % de coûts de main-d'oeuvre. Les pommes italiennes se vendent 15 centimes de moins que les pommes françaises à l'export, notamment parce que les Italiens sont restés sur un système où ils font appel à toute la famille pour la récolte. Mais c'est la Pologne, avec un différentiel encore plus grand, qui s'est emparée de nos parts de marché. Nous nous concentrons donc sur le marché intérieur, ce qui nous ramène à la problématique de la montée en gamme. Nous nous ajoutons des contraintes supplémentaires : quand 450 molécules sont autorisées en Europe, il n'y en a que 300 qui le sont en France et, quand nos voisins polonais disposeront de solutions alternatives après l'interdiction du spirotétramate pour lutter contre le puceron cendré, nos producteurs de pommes ne pourront que bâcher les arbres, ce qui nécessitera l'emploi d'une main-d'oeuvre dont le coût est plus élevé qu'ailleurs.
L'exemple de la pomme est parlant : nos enfants n'ont jamais mangé autant de compote et, comme, avec la montée en gamme, nous n'avons plus d'écart de tri et de pommes moches, nous fabriquons nos compotes avec des pommes polonaises ! Il en va de même pour les tomates : pratiquement toutes celles que nous retrouvons dans nos pizzas sont importées de Chine en bidon de 200 litres de coulis !
Quatrième point, avant ce rapport, je ne m'étais jamais rendu compte avec autant de force de la simplicité de notre problème. Installé comme agriculteur depuis 1995, j'ai bénéficié du progrès mécanique et technique jusqu'en 2005, ce qui a sérieusement amélioré mes conditions physiques de travail. Mais, depuis cette période, la pénibilité physique du travail de l'agriculteur a été remplacée par une pénibilité morale et psychologique, et ce sont les exploitations familiales qui subissent simultanément toutes les complications. L'éleveur laitier est payé 5 euros de l'heure et ses efforts permettent à la filière laitière française de rester la plus compétitive au monde : il faut arrêter de lui faire exploser le cerveau, de l'empêcher, en plus, de dormir la nuit pour des questions de cheptel dépassé de 12 vaches ! Savez-vous, mes chers collègues, qu'avec la prochaine réforme de la PAC, un agriculteur sera tenu d'aller lui-même photographier avec son téléphone portable tel endroit précis qu'on lui aura indiqué de sa parcelle pour justifier de ce qu'il y a planté et de ses techniques culturales ? Qui peut accepter cela ? Le patron d'une grosse exploitation agricole pourra toujours demander à l'un de ses employés d'aller prendre la fameuse photo, mais quid des exploitations familiales ? En restera-t-il encore avec de telles contraintes ?
Cinquième point, nous créons trop d'aberrations. Le coût d'investissement pour un silo de stockage de céréales passe de 400 ou 450 euros à la tonne à 1 000 euros si l'on souhaite ne pas employer d'insecticide. Dans ce cas, il faut également climatiser le grain, ce qui multiplie par six les coûts de fonctionnement. En outre, de par les contraintes que nous nous imposons en surtransposant les réglementations, nous nous retrouvons avec du blé dont la valeur nutritive est inférieure à la norme mondiale, rendant nos productions inexportables.
Sixième point, nous ne nous faisons pas assez les ambassadeurs de la qualité de nos productions. Nous sommes si empêtrés dans nos paradoxes que nous finissons par tenir un discours tuant nos propres avantages. Se pose-t-on la question de la qualité de l'eau lorsqu'il est question du rejet d'antibiotiques dans le milieu environnemental ? Non ! Car, en examinant le bénéfice-risque, nous estimons qu'il faut privilégier les soins apportés aux patients.
Avec de telles contraintes, avec de tels messages négatifs, ne nous étonnons pas de manger de plus en plus de produits importés ! Si, un jour, comme ce fut le cas pour les masques, nous ne trouvons plus aucun produit dans nos étals, je ne pense pas que nous pourrons nous regarder dans une glace et nous dire que, tout ce que nous avons fait, nous l'avons bien fait !
M. Serge Mérillou, rapporteur. - Ce rapport m'a ouvert les yeux sur une injustice sociale : près de 80 % de nos concitoyens sont contraints de se replier sur une alimentation importée, faute d'accès à une alimentation saine, de qualité et de production française. L'agriculture française est ainsi confrontée à un enjeu essentiel : comment produire une alimentation saine en rémunérant correctement ses producteurs ? Je ne suis pas sûr que le rapport réponde à la question.
Personne ne trouve à redire à cette première injustice sociale. On se résigne à faire ses courses chez Lidl ou dans des supermarchés où l'on trouve à tour de bras des denrées alimentaires produites à l'étranger, la plupart du temps sans respecter quelque norme que ce soit. À cet égard, la proposition de Franck Montaugé me semble intéressante. Comment des familles qui gagnent 1 200 euros ou 1 400 euros par mois peuvent-elles accéder à une alimentation de qualité ? Nous devons y réfléchir.
Par ailleurs, personne n'est choqué, quand on fait venir des tomates de Chine ou des pommes de Pologne, par l'empreinte carbone des importations. Cela m'interpelle, d'autant que l'emploi en France s'en trouve pénalisé.
Concernant la question de l'eau, il n'y aura pas de production agricole si nous sommes dans l'incapacité d'arroser les plantes. Le rendement, mais aussi la qualité du produit en dépendent. Dans notre pays tempéré, des quantités d'eau très importantes tombent du ciel et nous éprouvons de grandes difficultés à les stocker, parce que nous sommes enfermés dans un dogme. À côté de cela, nous acceptons d'acheter des fraises de Huelva, qui sont produites avec de l'eau, dans des conditions écologiques et sociales catastrophiques. Or cela ne choque personne. Nous devons réfléchir au stockage de l'eau en hiver. Faute de quoi, nous devrons accepter de renoncer à un certain nombre de productions dans notre pays.
M. Pierre Louault, rapporteur. - Laurent Duplomb a parfaitement décrit le processus qui nous emmène à la catastrophe. La « malbouffe » est un problème non pas d'origine des aliments, mais uniquement d'éducation alimentaire. On ne sait plus faire la cuisine ; on ne mange plus de légumes ; on mange trop gras.
Nous sommes en train de détruire l'agriculture la plus performante. Prenons l'exemple de l'élevage en zone de montagne ou en zone défavorisée. Parce que les vaches ruminent et produisent du carbone, on donne la priorité aux élevages industriels d'Europe du Nord, qui produisent à partir de céréales tout en émettant également du carbone, mais sans aucune contrepartie. Pourtant, les zones défavorisées absorbent plus de carbone qu'elles n'en produisent. Nous sommes en train de détruire ce système.
Autre exemple : celui de la pomme. On a rajouté cette année des surréglementations pour protéger les pollinisateurs. Une de mes connaissances, producteur bio, s'est fait « attraper » par la police de l'environnement : il était parti traiter sa parcelle le matin de bonne heure comme on le préconise, mais le vent s'est levé avant qu'il n'ait pu vider sa citerne. Menacé d'une amende de 50 000 euros, il m'a confié ne plus savoir que faire.
Un autre producteur a dû jeter 30 % de ses fruits après avoir rencontré des problèmes de ressources en eau. « Si je ne prends pas ma ressource, m'a-t-il dit, j'arrête. J'ai cent ruches en permanence dans mon verger et on me dit que je fais crever les abeilles ».
Les agriculteurs ont du bon sens. Ils savent les jours où le traitement des cultures est possible. On a tellement légiféré que même eux sont condamnés à mourir. Le législateur et les lobbies n'y connaissent rien. Nous sommes en train d'assécher volontairement les rivières et de détruire tous les barrages. Dans mon département pourtant, toutes les zones humides sont liées à des barrages ou des étangs créés par les moines ! Nous marchons sur la tête. Nous avons l'exemple de l'Allemagne et de son gaz et nous reproduisons la même erreur avec notre agriculture.
Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Notre rapport n'est pas complet. Nous nous sommes volontairement limités à cinq produits pour traiter le sujet en profondeur, mais le problème se pose pour tous les modèles agricoles. On nous dit qu'il ne faut plus exporter. Que va-t-on faire dès lors de l'Afrique ? La donner à Poutine et aux autres pour qu'ils se nourrissent ? Nous avons perdu, déjà, cette capacité à nourrir ceux qui souffrent de la famine. Qu'il y ait un problème de surpopulation dans le monde, nous sommes d'accord, mais on ne peut inventer tout et son contraire.
Mme Sophie Primas, présidente. - Ce débat passionne, car il touche à ce qui fait l'essence de notre pays et de notre territoire. Il touche aussi au quotidien des Français, auxquels nous sommes tous attachés, et à la notion même de vie qu'apporte la nourriture. Il y a peu de secteurs d'activité qui, comme l'agriculture et l'énergie - Sully aurait dit les deux mamelles de la souveraineté -, soient autant au fondement de notre société et de notre identité nationale.
Au vu des six mois de travail de nos rapporteurs et administrateurs, je dirai à ceux qui pensent que le prisme était trop réduit qu'ils font erreur. Nous avons choisi des produits emblématiques de la consommation du quotidien pour trouver des recommandations applicables à l'ensemble des filières agricoles.
Peut-être ne l'avons-nous pas suffisamment dit dans notre présentation liminaire : ce rapport n'est pas à charge. Il dit simplement que la politique du « tout haut de gamme » qui a été menée depuis plusieurs années par les gouvernements successifs n'est pas la seule solution. L'agriculture a bien entendu pour vocation de monter en gamme et de répondre à ce marché. Le rapport dit simplement que nous nous sommes trop focalisés collectivement sur cette solution, oubliant l'essentiel du marché en volume.
Contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce rapport n'appelle pas non plus la fin du bio et de l'exigence environnementale. Il ne remet pas en cause notre modèle de ferme et d'agriculture basé sur de nombreuses petites exploitations.
Avec certains collègues, nous nous sommes rendus cet été aux États-Unis. Nous avons vu les conditions de production maraîchère en Californie. Ce n'est pas le modèle que nous souhaitons ! Le modèle français, avec son agriculture familiale, ses cheptels et ses exploitations de petite taille, est loin d'être le pire. C'est précisément pour le protéger que nous voulons travailler sur la compétitivité. L'observation des rapporteurs selon laquelle la main-d'oeuvre coûte moins cher au Maroc ne signifie pas non plus que nous voulons importer ce système dans notre pays. Nous désirons, aussi, protéger le statut des agriculteurs et des salariés agricoles en France.
Il s'agit donc, pour nous, de travailler sur la compétitivité dans le but de protéger l'agriculture française. « Compétitivité » n'est pas un gros mot : c'est ce qui sauvera le modèle français tel que nous souhaitons le voir perdurer.
Je remercie à nouveau les rapporteurs et soumets leur rapport à votre vote.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
Jeudi 21 juillet 2022
Déplacement à Avignon : MM. Philippe HÉRIARD, directeur affaires publiques cabinet de conseil Droit Devant, conseil de l'AOPn Tomates et Concombres de France et l'Association Nationales Pommes-Poires, Pierre VENTEAU, directeur de l'ANPP (association nationale pommes poires), François MESTRE, producteur de pommes, Robert GIOVINAZZO, directeur Sonito, André BERNARD, président Sonio et CRA PACA, Frédéric BAEZA, directeur général Le Panier Provençal, Pascal LENNE, consultant SONITO et ex-directeur SONITO, Rémi PECOULT, responsable agro et logistique Le Panier Provençal, Mme Lauriane LE LESLÉ, directrice de l'AOPn Tomates et Concombres de France, Mme et M. Davy et Vincent CLÉMENT (producteurs de tomates).
Lundi et mardi 25 et 26 juillet 2022
Déplacement en Italie : M. François REVARDEAUX, consul général à Milan, Mme Claire BERGÉ, service économique près l'ambassade de France en Italie, M. Michel LODOLO, directeur de zone Europe du sud de Business France, Mme Luigina TRENTO, cheffe du pôle Agrotech, coordinatrice de Filière - zone Europe du Sud, MM. Paolo GEREVINI, directeur général du Consorzio Melinda, Maurizio GARDINI, président, Conserve Italia, Pier Paolo ROSETTI, directeur général, Conserve Italia, Nicola BERTINELLI, président Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano, Guglielmo GARAGNANI, vice-président Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano, Riccardo DESERTI, directeur Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano.
Mercredi 21 septembre 2022
Déplacement dans les Yvelines : MM. Jérôme CHARPENTIER, président de la coopérative SEVÉPI, Administrateur de l'AGPB, Thierry JEAN, vice-président délégué de la coopérative SEVÉPI, Thierry LEGRIS, membre du CA de la coopérative SEVÉPI, Président de l'UCBC et producteur bio, Cédric HUARD, membre du Conseil d'administration de la coopérative SEVÉPI, Thomas BREBION, membre du Conseil d'administration de la coopérative SEVÉPI, Aurélien CAURIER, directeur général de la coopérative SEVÉPI, Mme Claire PELLETIER, directrice terrain de la coopérative SEVÉPI, MM. Jean-Baptiste HUE, sous-directeur de la coopérative SEVÉPI, Hubert JEAN, agriculteur adhérent à la coopérative SEVÉPI, Thomas ROBIN, agriculteur adhérent à la coopérative SEVÉPI, membre du Bureau de la Chambre d'Agriculture d'Île de France, secrétaire au sein de la FDSEA.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mardi 10 mai 2022
- Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole : MM. Jean-Louis BENASSI, directeur de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole-IFPC et Thomas PELLETIER, président de la fédération des producteurs de fruits à cidre.
Mercredi 11 mai 2022
- FranceAgriMer : MM. Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective, Florian ANGEVIN, chef de l'unité filières spécialisées - service analyse économique des filières et OFPM - direction marché, études et prospectives et Mme Pauline CUENIN, chargée d'étude économique fruits et légumes frais et transformés - unité filières spécialisées - service analyse économique des filières et OFPM - direction marché, études et prospectives.
- Ministère de l'agriculture et de l'alimentation - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises : M. Philippe DUCLAUD, directeur général adjoint - service développement des filières et de l'emploi et Mme Laure-Anne MAGNARD, cheffe de bureau Fruits et légumes et produits horticoles.
- Table ronde production - Association nationale pommes-poires, GEFEL et Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : MM. Pierre VENTEAU, directeur et Daniel SAUVAITRE, co-président de la commission économie (ANPP) ; Mme Stéphanie PRAT, directrice et M. Luc BARBIER, secrétaire général (FNPF).
- Table ronde transformation - Association française interprofessionnelle des fruits et légumes à destinations multiples (Afidem), Fédération des industries d'aliments conservés (FIAC), Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits (Unijus) : M. Daniel SAUVAITRE, co-président de la commission économie, président de l'Afidem, Philippe BLOUIN, vice-président de la commission Pomme et Poire, directeur des achats du groupe MOM et Bel, représentant de la FIAC / Adepale, M. Adrien MARY, délégué général (FIAC Fruits) ; Mme Anne-Sophie ROYANT, directrice (Unijus) ; Mme Isabelle JUSSERAND, directrice (Afidem).
- Association professionnelle représentative des entreprises d'expédition-exportation de fruits et légumes (ANEEFEL) : M. Éric GUASCH, vice-président et Mme Valérie AVRIL, directrice.
- Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes (UNCGFL) : MM. Jean-Christophe GRAS, vice-président du collège GASC (Grossistes à service complet), Dominique MONLOUP, administrateur et représentant du collège grossistes sur carreau et Frédéric STEFANI, délégué général.
Jeudi 12 mai 2022
- Felccop : MM. Jacques MALAGIÉ, directeur Vergers d'Anjou, Christophe BELLOC, président Blue Whale et Jean NOUGAILLAC, président Cofruid'Oc.
Mardi 31 mai 2022
- FranceAgriMer : MM. Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective, Marc ZRIBI, chef de l'unité grains et sucre et Mme Isabelle TAILHAN, déléguée filière grandes cultures et apiculture.
- Direction générale de la performance économique - Bureau grandes cultures, semences végétales et produits transformés : MM. Thomas ROCHE, adjoint à la sous-directrice des filières agroalimentaires et Philippe DECESSE, bureau des fruits et légumes - chargé de mission céréales.
- ARVALIS - Institut du végétal : M. François ROLAND, directeur recherche - développement et Mme Valérie LEVEAU, responsable de l'équipe économie et stratégie d'exploitation - service Agronomie, économie et environnement.
- Interprofession des semences et plants (SEMAE) : M. François DEPREZ, président.
- Association générale des producteurs de blé (AGPB) : MM. Éric THIROUIN, président, Philippe HELLEISEN, directeur général et Xavier JAMET, responsable des relations institutionnelles.
- Table ronde Intercéréales : M. Maxime COSTILHES, directeur général et Mme Marine IMBAULT, responsable des affaires publiques (Intercéréales), MM. Cyril DURIEZ, vice-président et François GIBON, délégué général (FNA), M. Patrick TETARD, vice-président (Axéréal), Mmes Catherine MATT, directrice métiers du grain, Clara MOLEY, responsable marchés et commercialisation et Cécilia GOFFINET, responsable qualité et filières (LCA Métiers du grain), M. Raphaël LATZ, président (Syncomex), Mme Christelle TAILHARDAT, secrétaire générale (Symex), M. Pierre GARCIA, directeur général (Grands moulins de Paris), Mme Anne-Céline CONTAMINE, directrice générale (ANMF), M. Claude RISAC, directeur des relations extérieures et Mme Mariane FLAMARY, déléguée générale (USIPA).
- Table ronde SNIA - Coop de France : MM. David SAELENS, président, Jean-Bernard LEROUX, référent grandes cultures, Mme Valérie BRIS, directeur adjoint du Pôle animal en charge de la Nutrition Animale (La coopération agricole nutrition animale), MM. François CHOLAT, président et Stéphane RADET, directeur (SNIA).
Mercredi 1 juin 2022
- FranceAgriMer : M. Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective, Mmes Cécile GUILLOT, analyse économique des filières et OFPM, Mathilde GOUDY, chargée d'études économiques filières avicoles et cunicoles et Maryse SABOULARD, déléguée viandes et oeufs.
- Direction générale de la performance économique - Bureau viandes et productions animales spécialisées : Mme Elodie LEMATTE, sous directrice, filières agroalimentaires, M. Jonathan SAULNIER, adjoint au chef de bureau et Mme Louise BACHER, chargée de mission filière volaille - bureau des viandes.
- ITAVI : M. Jean-Michel SCHAEFFER, Président, Mme Isabelle BOUVAREL, directrice générale, MM. Maxime QUENTIN, directeur adjoint et scientifique et Simon FOURDIN, directeur service économie.
- Syndicat national des accouveurs (SNA) : M. Louis PERRAULT, président et Mme Ségolène GUERRUCCI, directrice.
- Confédération française de l'aviculture- Élevage : M. Jean-Michel SCHAEFFER, président, Mme Nathalie FEUGEAS, directrice.
- Table ronde : Association des organisations de production de volailles et Coop de France : MM. François LACOME, président section aviculture, Jacky GOUBAULT, administrateur et Stéphane RADET, directeur SNIA (représentant AOPV).
- Table ronde Fédération des industries avicoles, CNADEV et Fédération des syndicats commerce en gros produits avicoles : M. Gino CATENA, président et Mme Dominique MARTIN, secrétaire générale (FENSCOPA) ; M. Arnaud POUPART-LAFARGE, vice-président (FIA) ; M. Gérard SARREAU, président et Mme Isabelle GUILLOTEL, déléguée générale (CNADEV).
- FranceAgriMer : M. Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective, M. Thomas PAVIE, délégué filière génétique animale et filière lait, Mme Olivia PARODI, chargée d'études filière lait de vache.
- Institut de l'élevage (IDELE) : MM. Martial MARGUET, président et Christophe PERROT, chargé de mission économie et territoire.
- Table ronde Association de la transformation laitière, Fédération nationale des industries laitières et Coop métiers du lait : M. François-Xavier HUARD, directeur général, Mme Sophie GODET-MORISSEAU, directrice générale de Savencia Ressources laitières et M. Alain LE BOULANGER, délégué régional (FNIL) Grand ouest ; M. Pascal LEBRUN, secrétaire général, Mme Carole HUMBERT, directrice, M. François LACOME, président section aviculture (Coopération laitière).
- Table ronde Centre national interprofessionnel de l'économie laitière et Fédération nationale des producteurs de lait : MM. Daniel PERRIN, secrétaire général, Samuel BULOT, vice-président et producteur lait bio (FNPL) ; M. Yves SAUVAGET, administrateur - membre du collège producteur (CNIEL).
- Table ronde Institut national de l'origine et de la qualité et Conseil national des appellations d'origine laitières : MM. Philippe BRISEBARRE, président, Patrice CHASSARD, président du comité national des appellations laitières agroalimentaires et forestières et Mme Marie GUITTARD, directrice (INAO) ; MM. Sébastien BRETON, directeur et Hubert DUBIEN, président (CNAOL).
Jeudi 2 juin 2022
- Direction générale de la performance économique - Bureau du lait : Mme Valérie METRICH HECQUET, directrice générale, M. Philippe DUCLAUD, directeur général adjoint - service développement des filières et de l'emploi, Mmes Elodie LEMATTE, sous directrice, filières agroalimentaires, Émilie CAVAILLES, chef du bureau lait, produits laitiers et sélection animale, M. Emmanuel BERT, chef de bureau du lait et de la sélection animale par intérim et Mme Alice LORGE, chargée de mission filières laitières - bureau du lait.
- FranceAgriMer : Mme Pauline CUENIN, chargée d'étude économique fruits et légumes frais et transformés - unité filières spécialisées - service analyse économique des filières et OFPM - direction Marché, études et prospectives, MM. Jacques OBERTI, co-président de la commission numérique et administrateur des Interconnectés et président du Sicoval et Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective.
- Direction générale de la performance économique - Bureau des fruits et légumes : Mme Valérie METRICH HECQUET, directrice générale et M. Philippe DUCLAUD, directeur général adjoint - service développement des filières et de l'emploi.
- Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : M. Jacques ROUCHAUSSE, président, Mme Anne-Laure LEVET, directrice prospective et études économiques, MM. Eric BRAJEUL, directeur du centre opérationnel du CTIFL à Carquefou et Ludovic GUINARD, directeur général délégué du CTIFL.
- Interprofession des semences et plants (SEMAE) : M. Jacques GAUTIER, directeur général Gautier semences.
- Table ronde GEFEL, CETOMI, Felcoop : MM. Pierre-Yves JESTIN, président coopérative maraîchère de l'Ouest/Saveol, Christophe ROUSSE, président coopérative Solarenn - administrateur Felcoop, Bruno VILA, Rougeline, Mme Lauriane LE LESLE, directeur AOP Tomates et concombres de France et M. Philippe HERIARD, directeur affaires publiques.
- Table ronde Anifel - Sonito : M. André BERNARD, gérant La Comtesse, président de la chambre d'agriculture du Vaucluse, M. Jérôme FOUCAULT, président (Adepale), MM. Robert GIOVINAZZO, directeur et Pascal LENNE, conseiller (Sonito).
Mercredi 29 juin 2022
- FranceAgriMer : Mme Christine AVELIN, directrice générale et M. Pierre CLAQUIN, directeur marchés, études et prospective.
- Table ronde syndicats agricoles : M. Alain POUGET, membre du comité directeur et président de la région Occitanie (Coordination rurale), MM. Luc SMESSAERT, vice-président et Jean-Louis CHANDELLIER, directeur général adjoint (FNSEA), M. Jacques PASQUIER, agriculteur (Confédération paysanne).
- Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : M. Vincent CHATELLIER, ingénieur de recherche.
Mardi 20 septembre 2022
- Table ronde (CNIEL, Interfel, Intercéréales, ANVOL, Anifelt) : MM. Laurent GRANDIN, président d'Interfel, Alexis DEGOUY, directeur général délégué d'Interfel, Mme Muriel VENY, responsable des relations institutionnelles d'Interfel, M. Maxime COSTILHES, directeur général d'Intercéréales, Mme Marine IMBAULT, responsable des affaires publiques d'Intercéréales, M. Lionel DELOINGCE, vice-président d'Intercéréales et meunier, MM. Paul LOPEZ, président de la FIA (ANVOL), Dominique GRASSET, président du comité interprofessionnel du poulet de chair (CIPC) (ANVOL), Yann NEDELEC, directeur d'ANVOL, Yann BRICE, directeur adjoint d'ANVOL et délégué général du CIPC, M. Pascal LENNE, consultant senior Sonito (Anifelt), Mme Agnès BERNARDIN, directrice d'Anifelt, MM. Guillaume LE DUFF, délégué général FIAC-Adepale (Anifelt), Robert GIOVINAZZO, directeur de Sonito (Anifelt), André BERNARD, président de Sonito et d'Anifelt, Mmes Caroline LE POULTIER, directrice générale du CNIEL, Carole HUMBERT, directrice du collège « Coopération laitière » du CNIEL, MM. François-Xavier HUARD, Président-directeur général du collège « industriels privés » du CNIEL, Vincent BRACK, directeur du collège « producteurs » du CNIEL.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
AXE 1 : FAIRE DE LA
COMPÉTITIVITÉ DE LA FERME FRANCE |
||||
|
1 |
Nommer un haut-commissaire chargé de la compétitivité de la Ferme France afin d'assurer le pilotage et le suivi du plan « Compétitivité 2028 » et le doter d'une mission de collecte d'information sur le sujet, en le plaçant au plus près des filières réunies en conférences chaque année, ainsi qu'une mission d'alerte des pouvoirs publics sur le sujet par la publication d'un rapport triennal sur la compétitivité de la Ferme France. |
État |
2022 |
Vecteur législatif |
|
AXE 2 : MAÎTRISER LES CHARGES DE
PRODUCTION |
||||
|
2 |
Donner corps au principe « Stop aux surtranspositions » en : - conférant une valeur législative au principe de non surtransposition, sauf motif d'intérêt général suffisant ; - renforçant la transparence sur les surtranspositions en confiant au Conseil d'État la mission de les identifier dans ses avis sur les projets et propositions de loi et dans ses avis sur les décrets ; - rendant obligatoire la production d'une estimation du surcoût d'une surtransposition par le Gouvernement dans un délai bref ; - confiant au haut-commissaire à la compétitivité une mission de collecte des plaintes des organisations agricoles représentatives quant à des surtranspositions, une mission d'information du Parlement à ce sujet ainsi qu'une mission de proposition pour en limiter les effets, laquelle sera assortie, pour certaines surtranspositions, d'un pouvoir d'injonction d'y mettre fin. |
État |
2022 |
Vecteur législatif |
|
3 |
Garantir une application pondérée du principe « pas d'interdiction sans alternative et sans accompagnement », en l'absence de situation d'urgence, en complétant les missions de l'Anses afin qu'elle dresse, dans ses avis et retraits d'autorisation de mise sur le marché, un bilan « bénéfices risques » d'une interdiction, notamment pour mesurer les effets de bord environnementaux d'une éventuelle interdiction à court terme d'une substance active, le cas échéant en prévoyant un laps de temps nécessaire à l'émergence d'alternatives crédibles et assortir toute nouvelle interdiction d'un accompagnement technique et financier adapté des professionnels ainsi que d'un plan prioritaire de recherche d'alternatives. |
État, Anses, Commission européenne |
2022 |
Droit européen Vecteur législatif |
|
4 |
Réduire les coûts de main d'oeuvre par une politique de baisse des charges sociales sur les travailleurs saisonniers agricoles en pérennisant le dispositif dit « TO DE », en l'étendant à certains secteurs et en sortant les entreprises agroalimentaires saisonnières de l'application du bonus malus sur les contrats courts. |
État, Commission européenne |
2022 |
Vecteur législatif (projet de loi de finances) |
|
5 |
Activer tous les leviers pour résoudre les problèmes d'embauche du secteur en : - renforçant la connaissance des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire ; - prenant mieux en compte, dans la constitution des formations, notamment au sein de l'enseignement agricole, les besoins des industries agroalimentaires ; - créant un partenariat entre les secteurs agricoles et agroalimentaires et Pôle emploi pour en faire un secteur prioritaire afin que Pôle emploi puisse, après leur avoir proposé des formations adaptées, davantage flécher vers ces secteurs dans les offres raisonnables d'emplois qu'il propose aux personnes à la recherche d'un poste ; - s'assurant, en cas de réforme des conditions d'accès au revenu de solidarité active, que les secteurs agricoles et agroalimentaires soient prioritaires et deviennent ainsi éligibles pour les Français concernés, afin d'en améliorer l'employabilité dans un secteur qui cherche à recruter. |
Acteurs privés, État, Pôle emploi, Commission européenne |
2022 |
Véhicule législatif |
|
6 |
Mettre en place un mécanisme de suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements de mécanisation dans l'agriculture ou l'agroalimentaire en faveur de la réduction des coûts du travail dans les secteurs les plus intensifs en main d'oeuvre confrontés à des difficultés de compétitivité. |
État, Commission européenne |
2022 |
Véhicule législatif (projet de loi de finances) |
|
7 |
Lancer, sous un an, un bilan des mesures du précédent quinquennat s'agissant de la consommation d'intrants (loi Egalim, mesures fiscales comme la hausse de la redevance sur les pollutions diffuses...) afin de mettre en regard l'évolution induite des quantités d'intrants consommées et le surcoût supporté par les agriculteurs. |
État |
2023 |
Rapport au Parlement |
|
8 |
Mettre en oeuvre, à court terme, un plan de résilience de l'agriculture et de l'agroalimentaire face à la crise énergétique en considérant ces secteurs comme essentiels et indispensables en temps de crise, en leur garantissant un approvisionnement suffisant pour préserver notre souveraineté alimentaire et en les rendant éligibles aux aides mises en place pour les activités prioritaires. |
Commission européenne, État |
2022 |
Règlement européen, véhicule législatif, projet de loi de finances |
|
9 |
Prendre, dès la loi de finances pour 2023, plusieurs mesures de baisses d'impôt en faveur de la production agricole ou agroalimentaire (absence de hausse de la TICPE sur le gazole agricole, actualisation des seuils d'exonération et d'éligibilité, baisse de la taxe foncière sur la propriété non bâtie applicable aux terres agricoles, hausse du plafond de la dotation pour épargne de précaution...). |
État, Commission européenne |
2023 |
Projet de loi de finances |
|
AXE 3 : RELANCER LA CROISSANCE DE LA
PRODUCTIVITÉ DE LA FERME FRANCE EN FAISANT DE LA FRANCE UN CHAMPION DE
L'INNOVATION |
||||
|
10 |
Prolonger le volet « Troisième révolution agricole » du plan France 2028 en : - augmentant les crédits des plans d'investissement portant sur l'innovation agricole dans tous les domaines ; - portant, au niveau européen, la volonté d'autoriser en réglementant les new breeding techniques, plutôt qu'une interdiction de principe. |
État, Commission européenne |
2022-2023 |
Règlement européen, projet de loi de finances |
|
11 |
Remettre la recherche agricole davantage au service des besoins techniques des agriculteurs en étudiant la possibilité d'augmenter les crédits dédiés par l'Inrae à la recherche de solutions techniques pour les agriculteurs, par une redéfinition de ses missions, ou en étudiant le transfert d'une partie de son budget aux instituts techniques et en préservant les budgets des instituts techniques payés par les agriculteurs au travers du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural (Casdar). |
État |
2022-2023 |
Vecteur législatif et projet de loi de finances |
|
12 |
Lancer un plan de simplification sous un an pour mettre en oeuvre un dispositif « accélérateur » limitant le champ des procédures administratives qui ralentissent aujourd'hui trop les agrandissements ou le développement de sites de production dans des secteurs stratégiques, le cas échéant en prévoyant une modification de la loi. |
État |
2023 |
Décret et véhicule législatif |
|
13 |
Préserver l'investissement agricole et agroalimentaire malgré la hausse des taux en : - mettant en place un suramortissement ou un crédit d'impôt pour les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire ; - prévoyant un plan d'investissement massif piloté par l'État pour la production agricole et agroalimentaire (par exemple un grand plan « Silos ») ; - créant un « livret Agri », livret réglementé sur le modèle du livret de développement durable et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire à des conditions raisonnables, notamment à l'heure du renouvellement des générations. |
État et Commission européenne |
2023 |
Véhicule législatif et projet de loi de finances |
|
14 |
Renforcer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique en : - favorisant les investissements destinés à réduire les dégâts liés à ces aléas par des aides dédiées comme un suramortissement ou un crédit d'impôt (stockage d'eau, filets paragrêle...) ou en simplifiant les procédures en vigueur (aspersion par exemple) ; - développant rapidement une ambitieuse politique de gestion de stockage de l'eau autour de projets locaux de bassins versants afin de promouvoir des projets de stockage par des aides financières dédiées tout en simplifiant le déploiement de ces ouvrages, en limitant les effets délétères des contentieux abusifs contre des projets d'ouvrages de prélèvement d'eau en confiant le contentieux en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appels. |
État et Commission européenne |
2022-2023 |
Projet de loi de finances et véhicule législatif |
|
15 |
Appliquer pleinement et à la lettre la loi sur l'assurance récolte, comme l'a votée le Parlement, en utilisant au maximum les possibilités laissées par la réglementation européenne et s'engager dans une réforme internationale de la moyenne olympique pour l'adapter aux conséquences du changement climatique. |
État, Commission européenne |
2023 |
Droit international |
|
AXE 4 : CONQUÉRIR LES MARCHÉS D'AVENIR, RECONQUÉRIR LES MARCHÉS PERDUS, DOPER SA COMPÉTITIVITÉ HORS PRIX |
||||
|
16 |
Entamer sous un an une révision globale de la politique d'accompagnement à l'exportation dans les domaines agricoles et agroalimentaires en France en proposant aux acteurs économiques des outils répondant réellement à leurs besoins (assurance crédit export, aides à la promotion, accès plus aisé à la logistique...). |
État |
2022 |
Réforme administrative et éventuellement véhicule législatif |
|
17 |
Consolider l'idée de la marque France en s'appuyant davantage sur l'image de la gastronomie française pour doper les exportations de produits français. |
État, acteurs privés |
2023 |
Travail des acteurs privés |
|
18 |
Mettre en place une réelle transparence sur l'origine des denrées agricoles et alimentaires en : - proposant, dans le cadre de la révision du règlement INCO, l'extension de l'affichage obligatoire de l'origine à toutes les denrées agricoles (animales et végétales) et, pour les produits alimentaires transformés, en rendant obligatoire l'affichage de l'origine des trois principaux ingrédients composant le produit ; - harmonisant les dénominations et les définitions des produits alimentaires en Europe ; - augmentant la fréquence et le nombre de contrôles réalisés par les autorités compétentes sur ces affichages trompeurs sur l'origine ainsi que sur la traçabilité des produits importés dans les ports d'arrivée. |
Commission européenne et État |
2023 |
Règlement européen Hausse des contrôles |
|
19 |
Poursuivre et intensifier la priorité donnée aux approvisionnements en produits locaux et nationaux dans la restauration collective afin de reconquérir ce circuit de distribution largement perdu au profit des importations, par la promotion d'une évolution des règles en vigueur au niveau européen pour clairement favoriser des approvisionnements issus de produits locaux. |
Commission européenne |
2023 |
Règlement européen |
|
20 |
Maximiser les aides agricoles et investir dans l'innovation des productions les plus menacées par une substitution par les importations. |
État, Commission européenne |
2023 |
Projet stratégique national |
|
21 |
Amender la stratégie européenne « de la Ferme à la fourchette » pour faire émerger un meilleur équilibre entre les objectifs quantitatifs en matière de production pour renforcer la souveraineté alimentaire du continent et les objectifs environnementaux. |
Commission européenne |
2023 |
Règlement européen |
|
22 |
Défendre notre compétitivité européenne en s'engageant à mieux faire respecter les normes minimales de production requises au sein de l'Union européenne en : - poursuivant le déploiement de clauses miroirs dans les législations européennes en matière agricole, notamment dès 2023 sur les textes relatifs au bien-être animal ou aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ainsi que dans les accords de libre-échange ; - s'engageant plus activement dans les instances internationales de normalisation (notamment Codex Alimentarius) afin de faire évoluer l'ensemble des pratiques agricoles. |
Commission européenne |
2023 |
Règlement européen |
|
23 |
Durcir les contrôles sur les denrées alimentaires importées pour garantir le respect des normes minimales requises au sein de l'Union européenne en agissant : - à court terme, au niveau national pour relever le niveau d'exigence, notamment i) en augmentant les effectifs des contrôles nationaux, profitant du transfert de la compétence sanitaire de la DGCCRF à la DGAL pour constituer une vraie « police sanitaire nationale » ; ii) en renforçant le nombre de contrôles aléatoires intégrés au plan de contrôle et en durcissant le contenu des analyses, notamment en renforçant le nombre de substances actives effectivement contrôlées par les laboratoires nationaux ; - à moyen terme, au niveau européen en promouvant la constitution d'une task force européenne sur la sécurité alimentaire pour des interventions harmonisées au niveau européen, afin d'éviter les comportements de détournement des contrôles franco-français par une entrée dans d'autres pays. |
État, Commission européenne |
2023 |
Hausse des contrôles Règlement européen |
|
24 |
Mener une politique active d'actualisation des valeurs forfaitaires d'importation pour répondre aux stratégies concurrentielles des partenaires commerciaux et préserver l'efficacité des outils de protection prévus dans les accords de libre-échange. |
Commission européenne |
2023 |
Révision des clauses d'un accord international |
* 1 Rapport d'information n° 528 (2018-2019) de M. Laurent Duplomb, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la place de l'agriculture française sur les marchés mondiaux
* 2 Parmi elles, prenons par exemple la hausse de la redevance pour pollutions diffuses, l'interdiction des remises, rabais et ristournes lors de la vente de produits phytopharmaceutiques, la mise en place de zones de non-traitement à proximité des habitations sans compensations suffisantes pour les agriculteurs...
* 3 Comme ce fut le cas, par exemple, lorsque le Gouvernement souhaitait la suppression du dispositif d'exonérations de charges pour les travailleurs occasionnels et saisonniers, dit « TO-DE » ou la baisse des ressources des chambres d'agriculture.
* 4 Selon la direction générale du Trésor, sur les données 2000-2015.
* 5 Rapport d'information n° 528 (2018-2019) de M. Laurent Duplomb, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la place de l'agriculture française sur les marchés mondiaux.
* 6 Cour des comptes, référé du 5 mars 2019 sur les soutiens publics nationaux aux exportations agricoles et agroalimentaires.
* 7 Direction générale du Trésor, Trésor-Eco n° 230, « Comment expliquer la réduction de l'excédent commercial agricole et agroalimentaire ? », octobre 2018.
* 8 FranceAgriMer, Compétitivité des filières agroalimentaires françaises, juin 2021.
* 9 Chaque année, le Food sustainability index, publié dans un rapport de The Economist Intelligence Unit et du Barrila Center for Food and Nutrition Foundation, compile les résultats d'une étude comparative, permettant d'analyser les différentes façons de produire et de consommer dans plusieurs dizaines pays du monde représentant, à eux seuls, 90 % du PIB mondial et environ 80 % de la population. La France y est consacrée modèle le plus durable du monde.
* 10 Discours du Président de la République aux États généraux de l'Alimentation, publié le 11 octobre 2017.
* 11 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
* 12 Comme le rappelle l'Observatoire de la formation des prix et des marges, la consommation alimentaire, incluant la restauration, contribue pour 39 % à l'excédent brut d'exploitation de la branche agricole. Le reste de ce « revenu » est constitué par l'exportation pour 24 %, les subventions (24 %) et les demandes finales en produits non alimentaires (10 %) ainsi la formation brute de capital en produits agroalimentaires (4 %).
* 13 Source : Vincent Chatellier (Inrae), hors échanges intraeuropéens.
* 14 Insee première n° 1913, Le compte provisoire de l'agriculture pour 2021 (juillet 2022).
* 15 Insee, Caractéristiques de l'industrie agroalimentaire par activité (chiffres 2019), octobre 2021.
* 16 Rapport d'information n° 755 (2021-2022) de Mmes Sophie PRIMAS, Amel GACQUERRE et M. Franck MONTAUGÉ, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 6 juillet 2022, sur la souveraineté économique de la France.
* 17 Source : Chambres d'agriculture France, La compétitivité du secteur agricole et alimentaire : ruptures et continuité d'un secteur clé de l'économie française (1970-2020), janvier 2021.
* 18 Toutefois, il faut corriger l'effet importation des pays tiers passant par les ports belges et néerlandais qui sont, en la matière, comptabilisés comme des importations intra-européennes dès lors qu'elles transitent par ces pays.
* 19 Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Analyse n° 172 de décembre 2021, « Dégradation de l'excédent commercial agricole et agroalimentaire français : principaux facteurs explicatifs ».
* 20 Direction générale du Trésor, Trésor-Eco n° 230, « Comment expliquer la réduction de l'excédent commercial agricole et agroalimentaire ? », octobre 2018.
* 21 FranceAgriMer, contribution écrite.
* 22 Dont la synthèse la plus aboutie est le rapport de FranceAgriMer sur la question : FranceAgriMer, Compétitivité des filières agroalimentaires françaises, juin 2021.
* 23 Direction générale du trésor, ibid.
* 24 Cour des comptes, référé du 5 mars 2019 sur les soutiens publics nationaux aux exportations agricoles et agroalimentaires.
* 25 Cette étude comparative mériterait, au reste, d'être actualisée.
* 26 Comme le rappelle FranceAgriMer dans sa contribution écrite : « en agriculture, le coût des consommations intermédiaires (engrais, phytosanitaires, énergie) contribue de manière déterminante à la moindre compétitivité des exploitations françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères. On observe, en moyenne, des dépenses en protection des cultures et en travaux effectués par des tiers (respectivement 6 % et 8 % du total des charges) plus élevés que les concurrents. ».
* 27 Cour des comptes, référé du 5 mars 2019 sur les soutiens publics nationaux aux exportations agricoles et agroalimentaires.
* 28 Discours du président de la République, prononcé le mercredi 11 octobre 2017 aux états généraux de l'alimentation.
* 29 FranceAgriMer, L'impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de rupture de tendances ?
* 30 L'Italie a un mix variétal similaire (33 % de Golden et 18 % de Gala), mais s'est toutefois spécialisée sur de la pomme entrée de gamme (8/10 de la production), au détriment de la pomme haut de gamme. Aux Pays-Bas, la production est très concentrée (61 % de la production en Elstar et en Jonagold) tout comme la production chilienne (48 % Gala) ou la production chinoise (75 % Fuji) alors que les variétés sont très diversifiées en Pologne ou en Allemagne. La Nouvelle-Zélande a une offre haut de gamme très développée (3/10 de la production).
* 31 ANPP, Gefel, FNPF.
* 32 Si la production semble se stabiliser dans l'hémisphère, il n'en demeure pas moins que la production a été multipliée par 4 au Chili depuis 1985.
* 33 FAOstats.
* 34 Selon FranceAgriMer.
* 35 Selon FranceAgriMer.
* 36 FranceAgriMer, Compétitivité de la filière française fruits et légumes transformés - juin 2021.
* 37 Source : ANPP, Gefel et FNPF.
* 38 Témoignage recueilli lors d'une audition.
* 39 Chambres d'agriculture France, La compétitivité du secteur agricole et alimentaire (janvier 2021).
* 40 Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, rapport au Parlement 2021.
* 41 Y compris en réintégrant les travaux effectués par des tiers.
* 42 Selon les calculs de l'ANPP
* 43 L'ANPP, le Gefel et la FNPF estiment qu'une telle décision engendrerait une « surconsommation de gasoil estimée à 90 L/ha soit 3 870 000 litres pour tout le verger ce qui équivaut à l'émission de 10 000 tonnes de CO2/an en plus (10 000 AR Paris - New-York en avion) ».
* 44 Source : ANPP, Gefel, FNPF
* 45 Ibid.
* 46 Source : FranceAgriMer.
* 47 La moyenne olympique en agriculture est égale à la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture considérée au cours des cinq dernières années, en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.
* 48 Contribution écrite ANPP-Gefel-FNPF.
* 49 Jean-Baptiste Mallet, L'Empire de l'or rouge : Enquête mondiale sur la tomate d'industrie, 2018.
* 50 Estimations : environ 600 000 tonnes de conserves, 416 000 tonnes de sauces, 152 000 tonnes de conserves (équivalent tomates fraîches).
* 51 Source : SONITO
* 52 AOP Tomates et concombres.
* 53 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
* 54 Source : SONITO.
* 55 Source : AOP Tomates.
* 56https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-plan-maroc-vert-dans-les-regions-du-nord.
* 57 À l'Assemblée nationale, la question écrite n° 39 885 de M. Alexandre Freschi (La République en Marche - Lot-et-Garonne), posée le 29 juin 2021, est restée sans réponse pendant plus d'un an... avant d'être retirée en raison de la fin de son mandat parlementaire en juin 2022.
* 58 Selon une décision du Comité national de l'agriculture biologique de l'INAO de juillet 2019.
* 59 . Harbouze, J.-P. Pellissier, J.-P. Rolland, W. Khechimi. Rapport de synthèse sur l'agriculture au
Maroc. [Rapport de recherche] CIHEAM-IAMM. 2019, pp.104. hal-02137637v2.
* 60 Ibid.
* 61 Selon l'AOP Tomates concombres.
* 62 Selon des données de FranceAgriMer.
* 63 Rappelons, à cet égard, que le montant pour une planteuse automatique et une récolteuse est respectivement de 100 000 € et 200 000 € minimum selon les professionnels de cette filière.
* 64 Engendrant un taux de consanguinité élevé.
* 65 D'autres races suivent des programmes de conservation comme la Bordelaise, la Bretonne Pie Noir, la Ferrandaise, la Froment du Léon ou la Villard-de-Lans.
* 66 Par ordre décroissant de chiffre d'affaires : Lactalis, Danone, Sodiaal, Savencia.
* 67 Christophe Perrot, Vincent Chatellier, Daniel-Mercier Gouin, Mélanie Richard et Gérard You, « Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? », Économie rurale, 364 | 2018, 109-127.
* 68 FranceAgriMer, Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des produits laitiers, données 2020.
* 69 Christophe Perrot, Vincent Chatellier, Daniel-Mercier Gouin, Mélanie Richard et Gérard You, « Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? », Économie rurale, 364 | 2018, 109-127.
* 70 FranceAgriMer, Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des produits laitiers (2021).
* 71 Ibid.
* 72 Source : FranceAgriMer.
* 73 Contribution écrite de l'ATLA.
* 74 Contribution écrite de l'ATLA.
* 75 IDELE, Économie de l'élevage n° 502, octobre 2019 - « L'Europe laitière du Nord dans l'après-quotas ».
* 76 En incluant les importations intraeuropéennes.
* 77 Contribution écrite ATLA.
* 78 Données de 2015, estimations, graphique tiré de « La libéralisation des marchés laitiers. Quelles réponses des acteurs économiques et des politiques ? » in Économie rurale, article de Christophe Perrot, Vincent Chatellier, Daniel-Mercier Gouin, Mélanie Richard et Gérard You, « Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? », avril/juin 2018.
* 79 C. Perrot et al., « Le secteur laitier est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? », Économie rurale, avril-juin 2018.
* 80 C. Perrot et al., « Le secteur laitier est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? », Économie rurale, avril-juin 2018.
* 81 FranceAgriMer, Les échanges français de produits laitiers avec l'Union européenne (2000-2019), 2020.
* 82 Chambres d'agriculture France.
* 83 Institut de l'élevage (Idele).
* 84 Contribution écrite.
* 85 Institut de l'élevage (Idele).
* 86 Institut de l'élevage (Idele).
* 87 Selon les données de l'Idele, entre 2000 et 2018, le revenu disponible par exploitant non salarié du quartile inférieur a reculé de 14 % en euros constants quand celui du quartile supérieur a augmenté de 17 % en euros constants. Cela ne s'explique pas tant par la dimension de l'exploitation que par l'efficacité économique de celle-ci.
* 88 Source : contribution écrite.
* 89 Chatelier et al, « La compétitivité de la filière volaille de chair française : entre doutes et espoirs », INRA Prod. Anim., 28, 411-428, 2015.
* 90 Ibid.
* 91 Van Horne, 2018
* 92 Le diviseur étant le poids d'abattage, un poids faible augmente le coût du poussin à la tonne de vif.
* 93 Selon la DGPE, la moyenne était de 16 700 têtes en 2013 en France, alors que ces capacités moyennes sont de 38 800 têtes en Belgique, 69 800 têtes en Allemagne, 80 400 têtes aux Pays-Bas ou encore 87 700 têtes au Royaume-Uni. La moyenne européenne se situe à 36 500 têtes.
* 94 Van Horne, 2018.
* 95 Entretien à l'AFP en mai 2022.
* 96 Source : FranceAgriMer, AGREX - Veille blé tendre 2021.
* 97 Source : Arvalis.
* 98 Source : Arvalis, données 2006.
* 99 Arvalis.
* 100 Brisson, N.,et al.,Why are wheat yields stagnating in Europe ? A comprehensive data analysis for France, Field CropsRes, 2010.
* 101 Près de 640 000 hectares entre 2015 et 2022.
* 102 Source : FranceAgriMer.
* 103 Quand la surtransposition résulte, notamment, d'une pratique ou d'une interprétation manifestement problématique.
* 104 Principalement pour les lois et les décrets.
* 105 Rapport d'information déposé le 30 septembre 2021 de Mme Nathalie Delattre, fait au nom de la mission d'information sur l'enseignement agricole n° 874 (2020-2021).
* 106 C'est ce que rappelle le rapport d'information n° 755 (2021-2022) de Mmes Sophie PRIMAS, Amel GACQUERRE et M. Franck MONTAUGÉ, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 6 juillet 2022, sur la souveraineté économique de la France (p 179 à 182).
* 107 Contribution écrite de SONITO.
* 108 Cour des comptes, référé du 5 mars 2019 sur les soutiens publics nationaux aux exportations agricoles et agroalimentaires.
* 109 Modification de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime adoptée à l'initiative de la rapporteure du Sénat, Anne-Catherine Loisier.
* 110 Article L. 421-23 du code de l'éducation, modifié par l'article 258 de la loi dite Climat et résilience et complété par l'article 145 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, lequel instaure une autorité fonctionnelle potentielle de l'exécutif de la collectivité territoriale compétente sur l'adjoint du chef d'établissement chargé de l'approvisionnement des cantines.