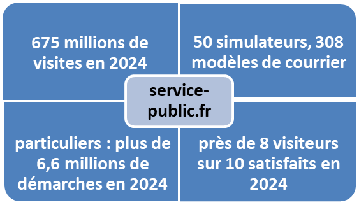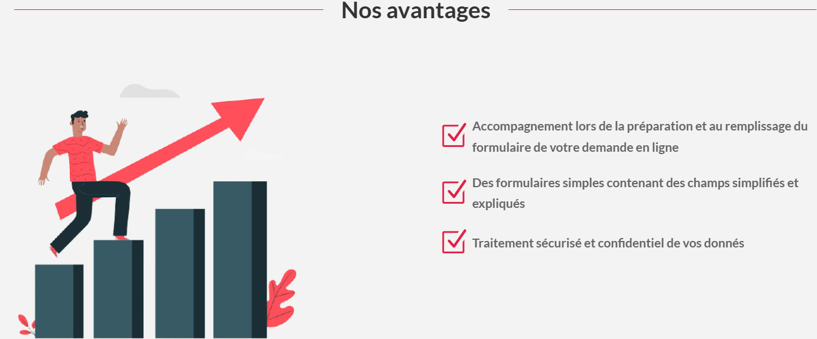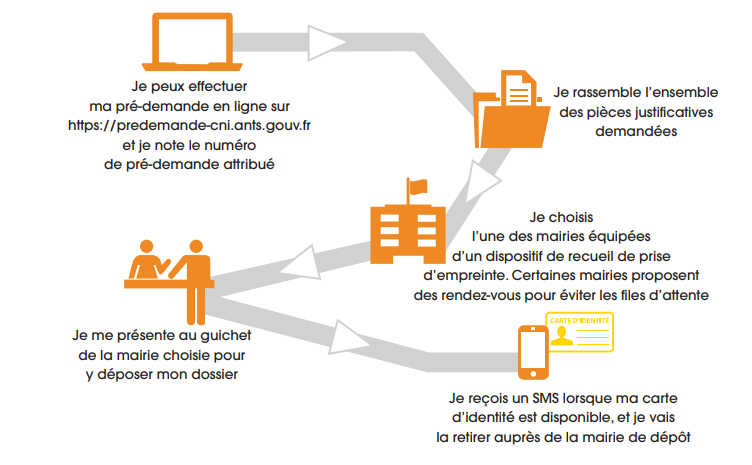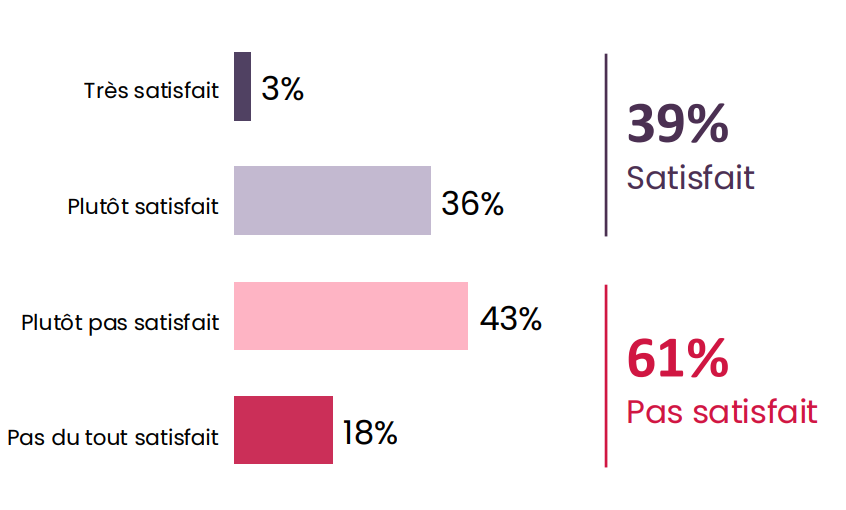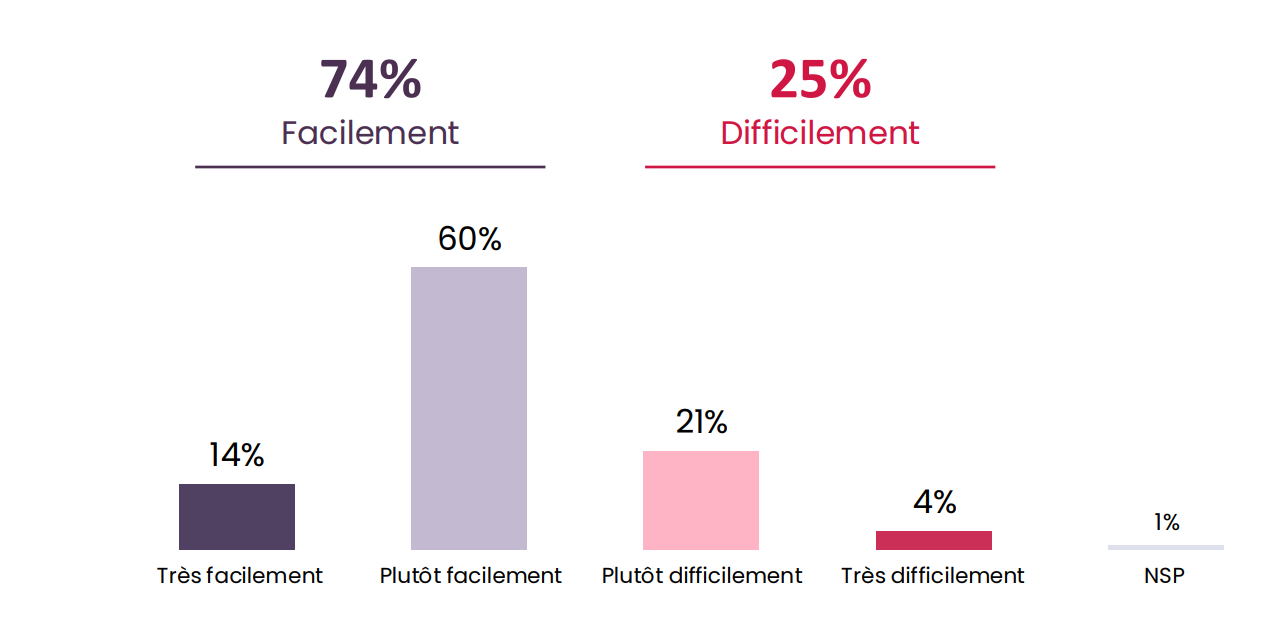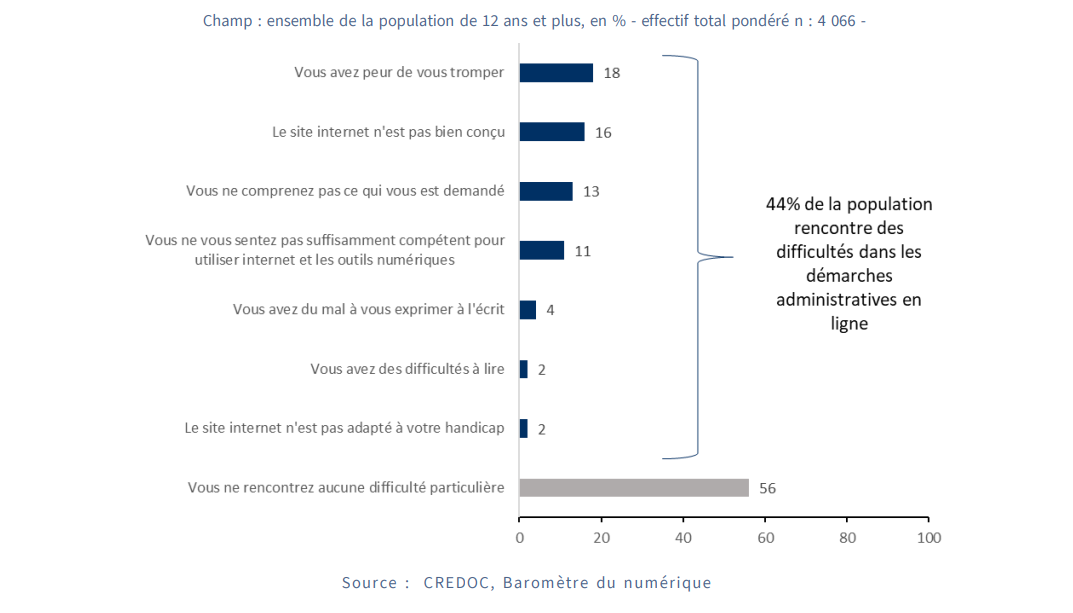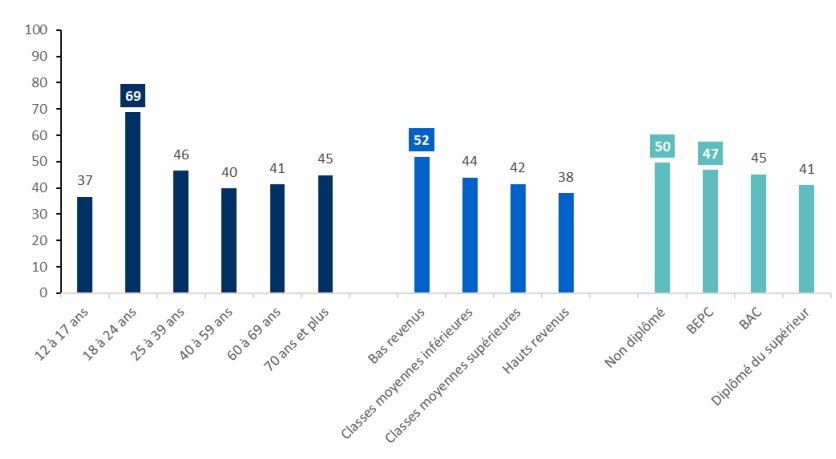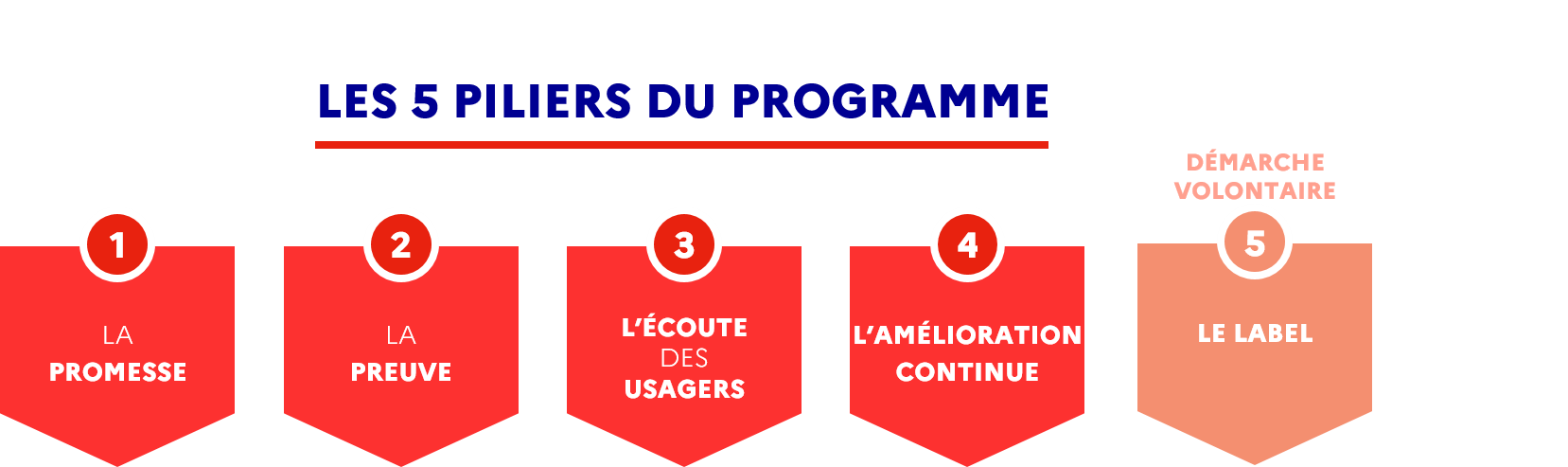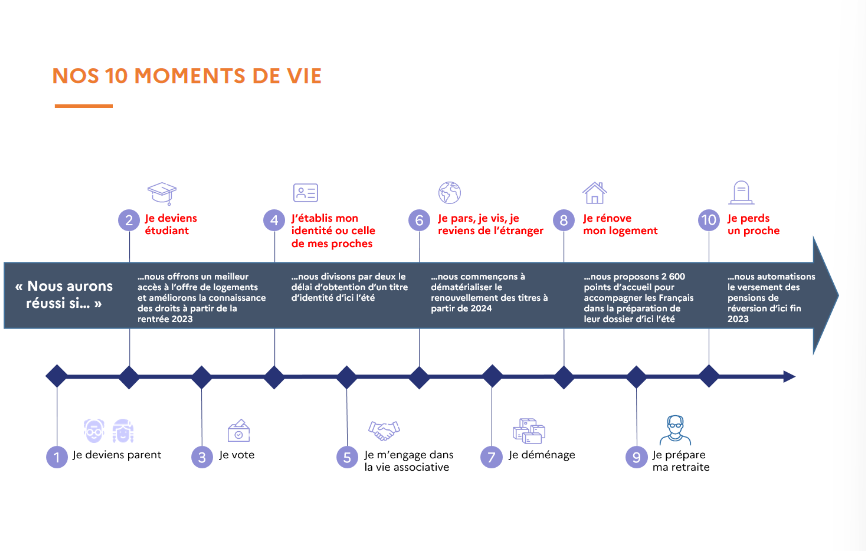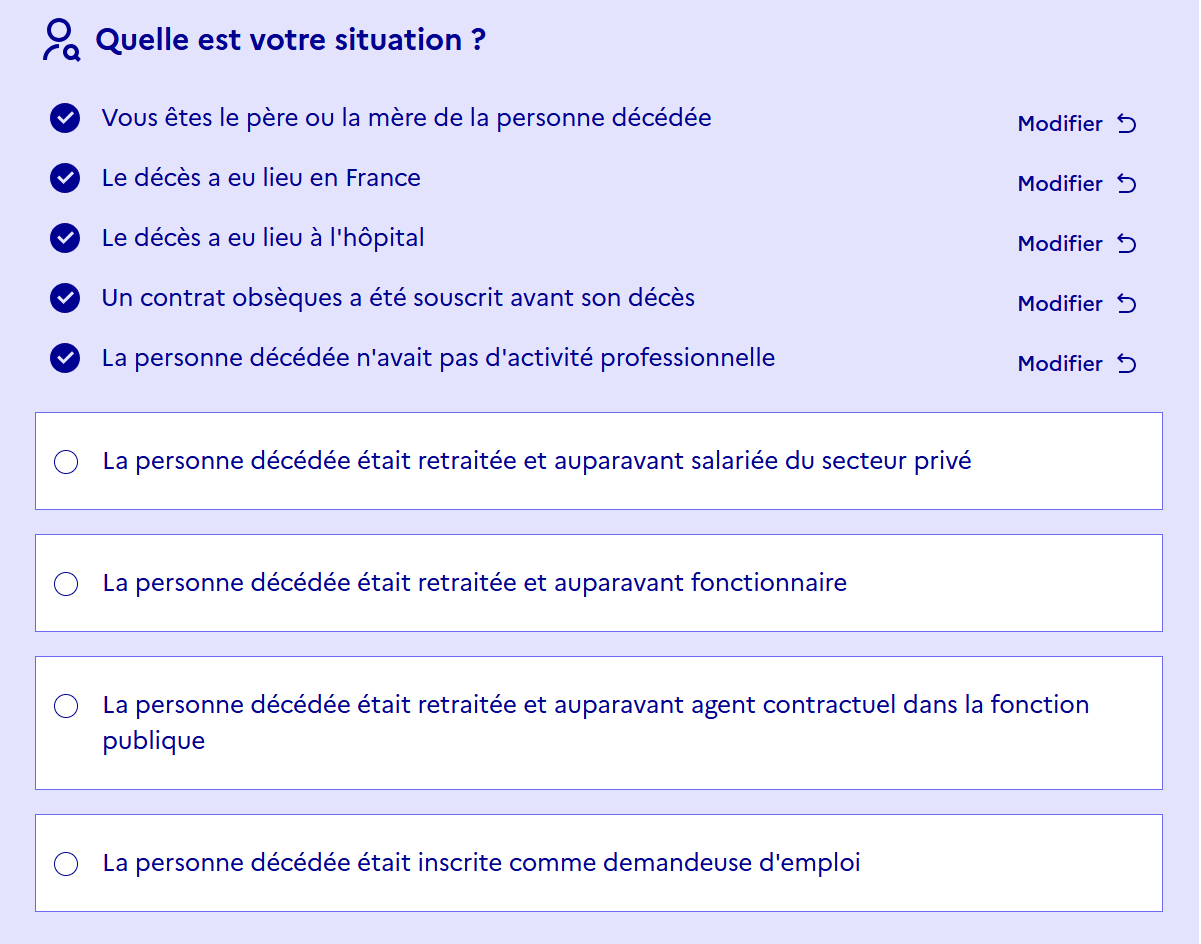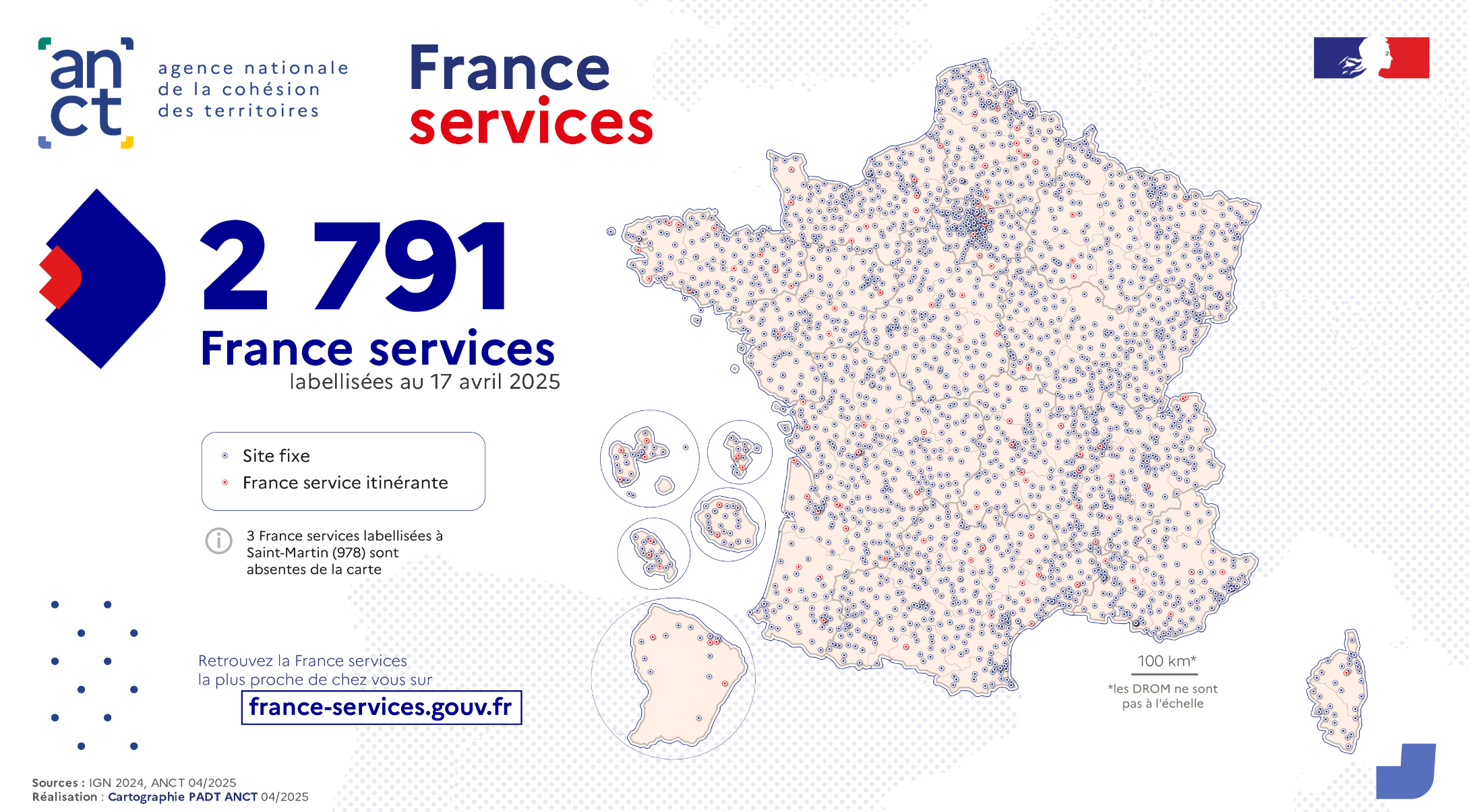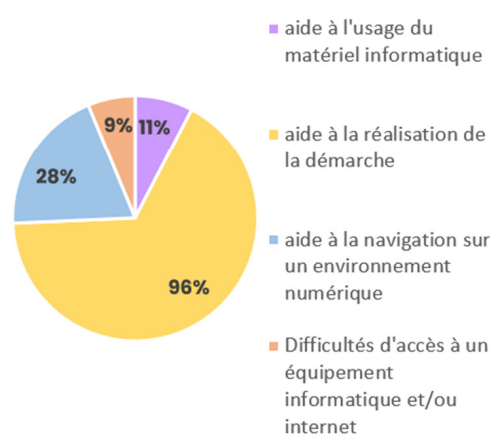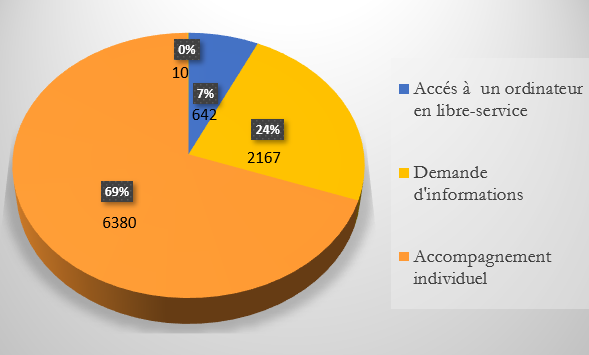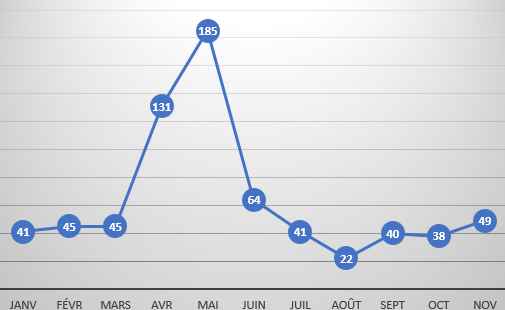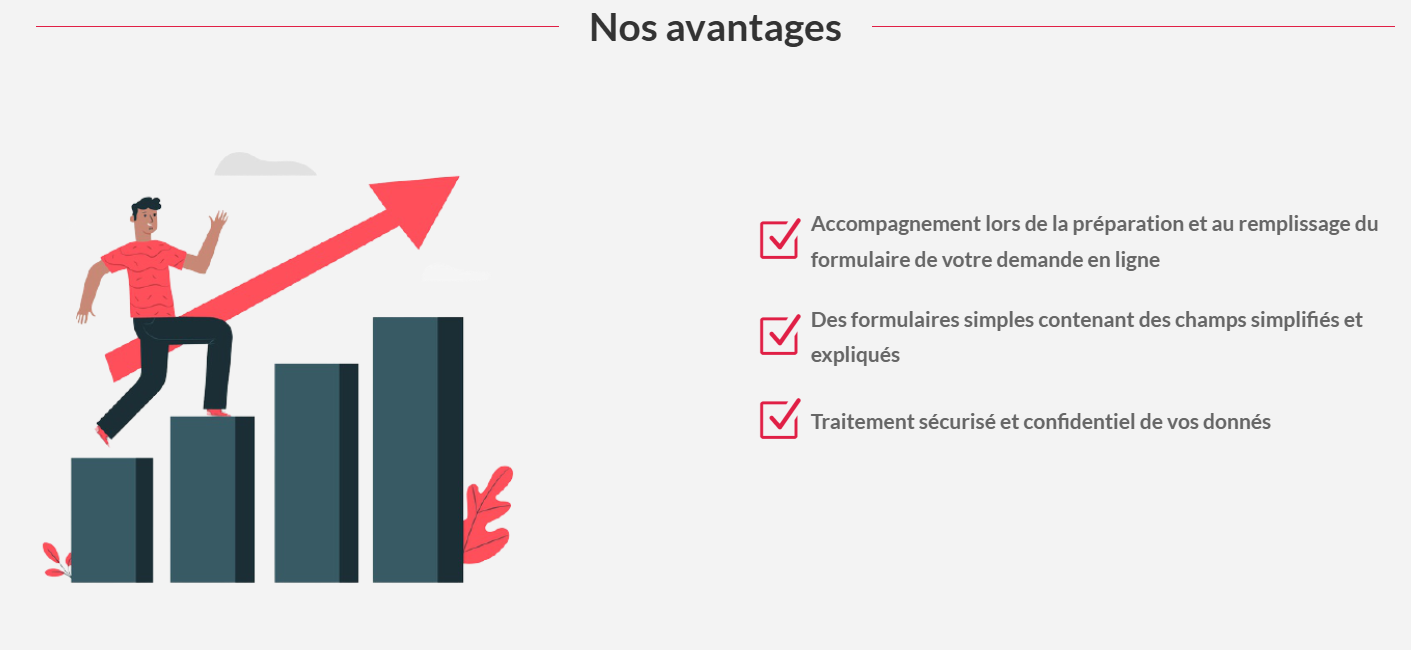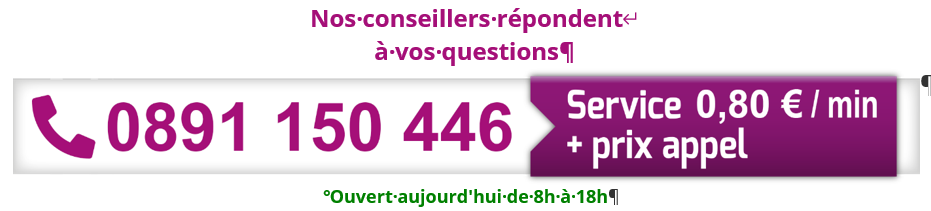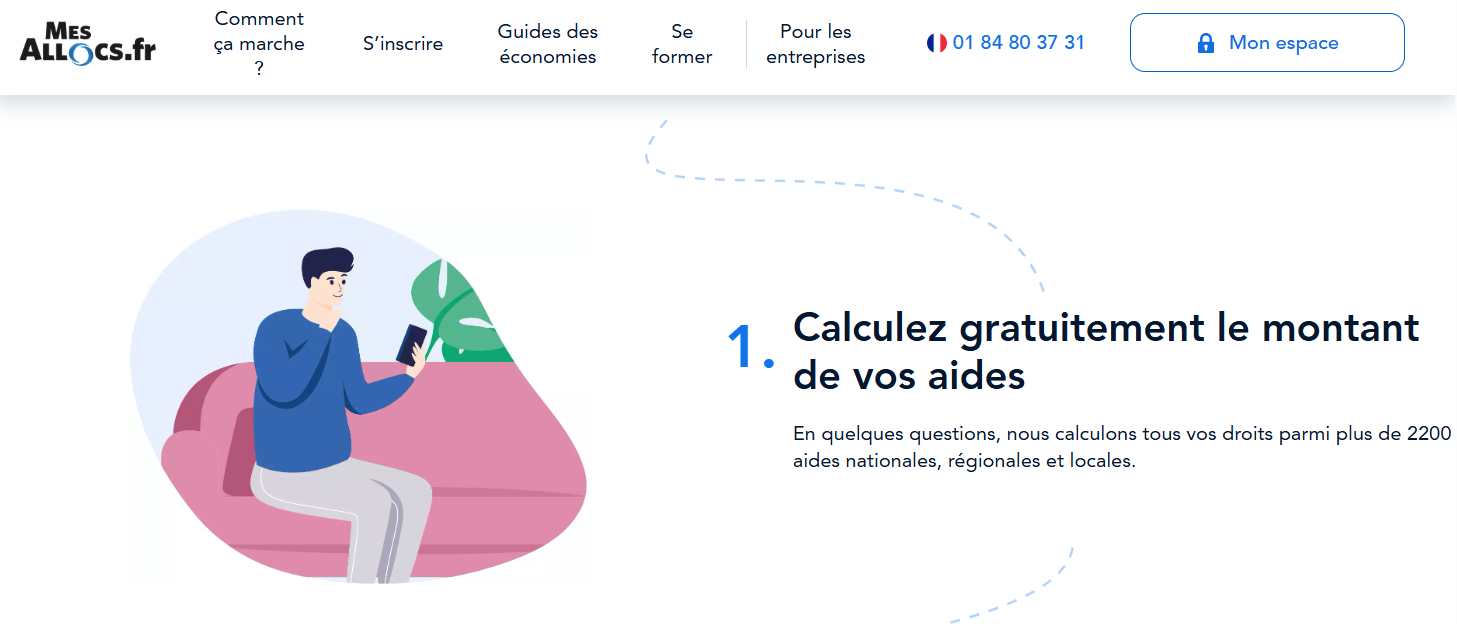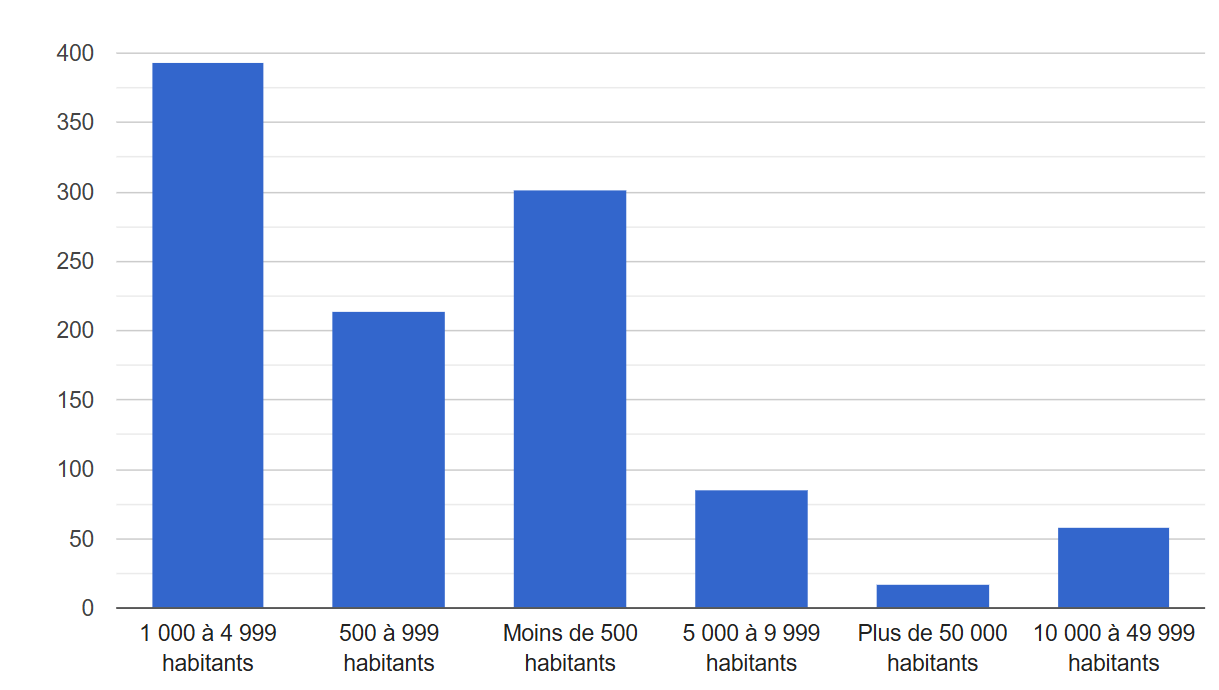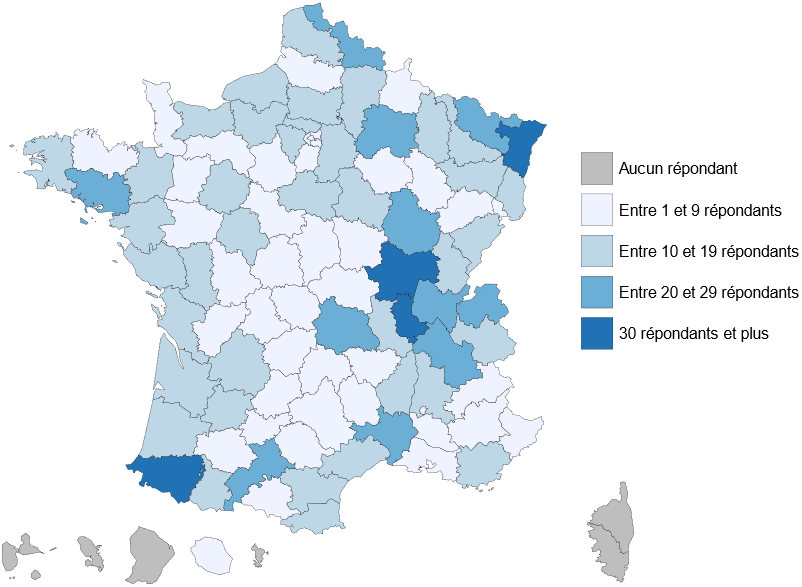- L'ESSENTIEL
- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE
FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE
- II. UNE EXIGENCE : AMÉLIORER L'ACCUEIL
ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
- III. FRANCE SERVICES : UN MODÈLE
RÉUSSI GRÂCE À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS, QU'IL
IMPORTE TOUTEFOIS DE RENDRE PLUS PERFORMANT POUR RENFORCER L'ACCÈS AUX
SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES
- IV. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS
CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION : UNE CONTREPARTIE
INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
DÉMATÉRIALISÉS
- V. METTRE À PROFIT LES AVANCÉES
TECHNOLOGIQUES POUR CONSTRUIRE UNE ADMINISTRATION NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE L'USAGER : UN BESOIN DE MISE EN COHÉRENCE
- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE
FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE
- AVANT PROPOS
- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE
DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE
- A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT
DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE
- B. LE RESSENTI DE L'USAGER : « LE
NUMÉRIQUE N'EST PAS LA RÉPONSE UNIVERSELLE »
- A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT
DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE
- II. VERS DES SERVICES PUBLICS
DÉMATÉRIALISÉS ET ACCESSIBLES À L'USAGER : PORTRAIT
D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE
- A. UN CADRE JURIDIQUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT
PRÉCISÉ AU PROFIT DES USAGERS
- 1. Un engagement résolu du
législateur au cours des années 2000 : simplifier le droit
et supprimer de nombreuses démarches au bénéfice des
usagers
- 2. Le prolongement des lois de
simplifications : le « choc de simplification » mis
en oeuvre à partir de 2013
- 3. Un changement de paradigme depuis les
années 2010 : la consécration progressive de principes
généraux de fonctionnement de l'administration et de droits
nouveaux favorables aux usagers
- a) Le droit à l'erreur
- b) La création d'un nouveau rescrit en
faveur des collectivités territoriales, sur les modèles existants
pour les usagers
- c) La consécration du principe du
« Dites-le nous une fois »
- d) La déconcentration systématique
des décisions administratives individuelles pour simplifier l'action
publique
- e) La consécration jurisprudentielle d'un
droit à l'accès multicanal pour les démarches complexes
- a) Le droit à l'erreur
- 1. Un engagement résolu du
législateur au cours des années 2000 : simplifier le droit
et supprimer de nombreuses démarches au bénéfice des
usagers
- B. DES ENGAGEMENT FORTS POUR AMÉLIORER LE
PARCOURS DE L'USAGER
- 1. Les acteurs de l'accès aux services
publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?
- 2. De la priorité au numérique
à une attention croissante aux attentes des usagers :
l'évolution des perspectives définies depuis 2018 au sein du
comité interministériel de la transformation publique
(CITP)
- 3. Trois objectifs majeurs : des services
publics plus simples, accessibles par divers canaux et centrés sur les
besoins de l'usagers
- a) Chasser la complexité : le travail
de simplification engagé par la DITP
- (1) Simplifier les procédures
- (2) Simplifier le langage administratif
- b) L'omnicanalité : une
évolution essentielle pour l'usager
- c) Le prisme des attentes et des besoins de
l'usager : une priorité indispensable, un renversement de paradigme
majeur
- (1) Services Publics+ : un programme
gouvernemental ambitieux d'amélioration des services publics
- (2) Renverser le paradigme au
bénéfice de l'usager : favoriser une logique de
« moments de vie »
- d) L'aller-vers : quand l'administration sort
de sa tour d'ivoire
- a) Chasser la complexité : le travail
de simplification engagé par la DITP
- 1. Les acteurs de l'accès aux services
publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?
- C. DES RÉUSSITES À CAPITALISER
- 1. Le prélèvement à la
source : un succès salué par la Cour des comptes, qui
contraste avec les difficultés qui ont marqué la
déclaration des biens immobiliers
- 2. Service-public.fr : le navire amiral de la
présence numérique de l'État
- a) Une offre très diversifiée
à l'attention de tous : 675 millions de visites par an
- b) Une offre spécifique à
destination des collectivités
- c) Un site très fréquenté
mais souffrant paradoxalement d'un déficit de
notoriété
- d) Les fiches
« événements de vie » : quelques
perfectionnements à envisager
- (1) Un risque de dispersion entre plusieurs
auteurs, un effort à coordonner
- (2) L'entrée dans la vie active : un
« moment de vie » à créer pour mieux
préparer les jeunes usagers aux démarches administratives
liées à l'entrée dans l'autonomie économique et
citoyenne
- (3) Le décès d'un proche : des
améliorations souhaitables
- e) Intelligence artificielle : des enjeux
considérables qui appellent une vision prospective
- a) Une offre très diversifiée
à l'attention de tous : 675 millions de visites par an
- 3. L'administration des Français à
l'étranger : un chantier de modernisation à valeur d'exemple
pour l'ensemble des administrations
- a) France Consulaire : une plateforme
téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les
recentrer sur leur coeur de métier
- b) Trois chantiers pionniers de
dématérialisation : le RECE, le vote par internet et le
renouvellement du passeport sans comparution
- (1) Le Registre d'état civil
électronique (RECE) : des délais de traitement
réduits, pour une économie substantielle
- (2) Vote par internet : une solution
appréciée des usagers
- (3) Expérimentation du renouvellement des
passeports sans comparution : libérer les guichets, faire gagner du
temps à l'usager
- a) France Consulaire : une plateforme
téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les
recentrer sur leur coeur de métier
- 4. Beta.gouv.fr : un changement d'approche de
l'administration dans la création d'outils numériques
- 1. Le prélèvement à la
source : un succès salué par la Cour des comptes, qui
contraste avec les difficultés qui ont marqué la
déclaration des biens immobiliers
- D. UN MAILLAGE TERRITORIAL ORIENTÉ VERS LES
BESOINS DES USAGERS GRÂCE AU DÉPLOIEMENT DE FRANCE SERVICES
ET À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 1. France services : des structures
désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services
publics nationaux comme locaux
- 2. Un atout des territoires : l'engagement
des collectivités territoriales et des élus au service d'un
meilleur accès aux services publics locaux et à la lutte contre
le non-recours
- a) De nombreuses initiatives d'élus pour
améliorer les services publics locaux
- b) Territoires zéro non recours : une
nouvelle approche des relations entre administrations et usagers
- c) Les MDPH : vingt ans après leur
création, des difficultés que les pouvoirs publics s'attachent
à résorber, des progrès à saluer
- (1) Missions des MDPH : rappel
- (2) Des délais de traitement qui suscitent
des critiques récurrentes des usagers et des élus
- (3) La MDPH du Finistère : une
mobilisation au niveau départemental, appuyée par l'État,
qui a produit des résultats tangibles
- a) De nombreuses initiatives d'élus pour
améliorer les services publics locaux
- 1. France services : des structures
désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services
publics nationaux comme locaux
- A. UN CADRE JURIDIQUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT
PRÉCISÉ AU PROFIT DES USAGERS
- III. DES DÉFIS À SURMONTER POUR QUE
LA DÉMATÉRIALISATION PROFITE PLEINEMENT AUX USAGERS
- A. LES ANGLES MORTS DE LA
DÉMATÉRIALISATION
- 1. D'importantes fractures territoriales qui
posent la question de l'égalité d'accès aux services
publics
- a) Les services publics dans les territoires
ruraux : un sujet majeur
- b) Le service public : « le coeur
de la politique de la ville »
- (1) Des caractéristiques
socio-économiques conditionnant les besoins des habitants en
matière de services publics
- (2) Deux exemples de guichets uniques pour
améliorer l'accès des habitants des quartiers aux services
publics : Saint Fons (Rhône) et Vendôme (Loir-et-Cher)
- c) L'accès aux services publics dans les
outre-mer : un « sujet crucial »
- a) Les services publics dans les territoires
ruraux : un sujet majeur
- 2. Des usagers au bord du chemin
- 1. D'importantes fractures territoriales qui
posent la question de l'égalité d'accès aux services
publics
- B. DES EFFORTS À AMPLIFIER
- 1. Accompagner la croissance du dispositif France
services tout en consolidant le modèle
- a) Les réserves exprimées par
certains élus consultés par la mission d'information : un
réseau rendu nécessaire par le désengagement de
l'État, qui pèse sur les finances des collectivités
- b) Garantir un lien efficace entre France services
et le back office : une exigence que les opérateurs doivent
satisfaire
- c) Consolider l'accessibilité des
structures en milieu rural : l'intérêt des formules
itinérantes illustré par le bus France services du Territoire
vendômois
- d) Le développement de permanences France
services en mairie
- e) Conforter la présence des France
services en QPV : l'exemple de l'espace France services de
Belleville-en-Beaujolais
- f) Une voie à explorer :
privilégier le déploiement de France services dans les
sous-préfectures
- g) Permettre aux jeunes de mieux identifier les
France services : un enjeu d'autonomie
- h) Consolider le réseau France services
avant toute nouvelle extension du panier de services
- i) Conforter le métier de conseiller France
services
- a) Les réserves exprimées par
certains élus consultés par la mission d'information : un
réseau rendu nécessaire par le désengagement de
l'État, qui pèse sur les finances des collectivités
- 2. Renforcer la formation des agents pour
améliorer l'information et l'accueil des usagers : un enjeu
crucial, une dynamique à développer
- a) Un besoin accru par la complexité de
normes nombreuses et changeantes
- b) Une information du public parfois
défaillante
- c) Un satisfecit : l'écoute et la
bienveillance semblent avoir été intégrées dans les
formations
- d) L'accueil du public : une
compétence à valoriser dans le déroulement de
carrière des agents
- a) Un besoin accru par la complexité de
normes nombreuses et changeantes
- 3. L'enjeu de l'intelligence artificielle :
faciliter sa diffusion au sein de l'administration, tout en gardant le
contrôle
- 4. Concevoir des outils numériques au
service de l'usager : de nombreux « irritants »
à dépasser, pour les usagers comme pour les agents
- a) Les difficultés liées, pour les
agents, à une « simplification » mal menée
- b) Le guichet unique des entreprises : un cas
d'école de numérisation manquée ?
- c) Quand l'usager n'entre pas dans les
cases
- d) L'administration numérique pour les
étrangers en France : une dématérialisation à
marche forcée, contrariée par de nombreux
dysfonctionnements
- a) Les difficultés liées, pour les
agents, à une « simplification » mal menée
- 1. Accompagner la croissance du dispositif France
services tout en consolidant le modèle
- C. DES CHANTIERS DÉCISIFS POUR LES DROITS
DE L'USAGER
- 1. Mettre en cohérence la politique de
l'inclusion numérique
- a) L'illectronisme : un
phénomène qui n'est pas appelé à
disparaître
- b) Des réponses différentes à
l'exclusion numérique : le choix assumé du « tout
numérique » au Royaume-Uni, la stratégie danoise de
l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics
numériques, la volonté de maintenir des alternatives
(omnicanalité) en France
- (1) Royaume-Uni : le numérique
à marche forcée
- (2) Danemark : l'accompagnement
renforcé à l'usage des services publics numériques
- (3) France : l'ambition d'assurer des
alternatives au numérique par l'omnicanalité
- c) Focus sur deux dispositifs d'inclusion
numérique : les conseillers numériques et Aidants
Connect
- (1) Les conseillers numériques : un
avenir à préciser
- (2) Aidants Connect : un
périmètre à trouver
- d) France Travail : des initiatives
intéressantes pour repérer l'illectronisme et développer
les compétences numériques
- a) L'illectronisme : un
phénomène qui n'est pas appelé à
disparaître
- 2. Rendre effectifs l'omnicanalité, le
principe « dites-le nous une fois » et le droit à
l'erreur de l'usager
- a) L'omnicanalité : une ambition plus
qu'une réalité
- b) Dites-le nous une fois : un chantier
ouvert dans les administrations, des progrès à
réaliser
- (1) Un effort porté par la Dinum
- (2) Des organismes de protection sociale qui se
mettent progressivement en ordre de marche
- c) Droit à l'erreur : une
généralisation indispensable qui doit être combinée
à des efforts des administrations pour éviter toute perte de
chance pour les usagers
- a) L'omnicanalité : une ambition plus
qu'une réalité
- 3. Mieux protéger l'usager contre la
concurrence des sites payants
- a) La prolifération de sites internet
marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites
ou quasi-gratuites
- b) L'attractivité du coaching privé
pour Parcoursup : une préoccupation
- c) Un arsenal législatif à
consolider et à adapter aux pratiques en ligne pour mieux
protéger l'usager
- d) Une meilleure identification des sites
officiels par les usagers : un enjeu central qui nécessite une
clarification de la communication des opérateurs et des administrations
publiques
- e) Mesdroitssociaux.gouv.fr : un exemple de
site officiel à améliorer dans une logique de lutte contre la
concurrence de sites payants
- a) La prolifération de sites internet
marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites
ou quasi-gratuites
- 1. Mettre en cohérence la politique de
l'inclusion numérique
- A. LES ANGLES MORTS DE LA
DÉMATÉRIALISATION
- IV. RECOMMANDATIONS
- A. AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS
- B. RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
DANS LES TERRITOIRES EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU RÉSEAU
FRANCE SERVICES
- C. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS
CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION
- D. METTRE À PROFIT LES RÉCENTS
PROGRÈS TECHNOLOGIQUES POUR PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES
USAGERS ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION NUMÉRIQUE
- A. AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS
- I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE
DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE
- COMPTES RENDUS DE LA MISSION D'INFORMATION
- CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K
- CONSULTATION DES ÉLUS LOCAUX :
SYNTHÈSE DES RÉPONSES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI DES
RECOMMANDATIONS
- LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- DÉPLACEMENTS DE LA MISSION
D'INFORMATION
- INTERVENTION DE M. VINCENT DUBOIS, SOCIOLOGUE (29
AVRIL 2025)
- ANNEXE
N° 895
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission d'information (1) sur le
thème :
« Faciliter
l'accès aux services
publics : restaurer le
lien de confiance
entre
les administrations et les
administrés »,
Président
M. Gilbert-Luc
DEVINAZ,
Rapporteure
Mme Nadège
HAVET,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette mission est composée de : M. Gilbert-Luc Devinaz, président ; Mme Nadège Havet, rapporteure ; MM. Jean-Luc Brault, Ronan Dantec, Éric Gold, Mmes Marianne Margaté, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, MM. Hugues Saury, Adel Ziane, vice-présidents ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Lise Housseau, secrétaires ; Mmes Catherine Conconne, Patricia Demas, MM. Éric Dumoulin, Philippe Folliot, Mmes Béatrice Gosselin, Corinne Imbert, Gisèle Jourda.
L'ESSENTIEL
Créée à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), la mission d'information « L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers » a fait le constat, face à une dématérialisation des services publics qui s'impose désormais dans de nombreuses démarches, de fractures persistantes qui sont autant de difficultés et de contraintes pour certains usagers, malgré les avancées réalisées au cours des dernières années pour améliorer l'accès aux services publics.
La mission d'information a ainsi identifié les défis à relever et les progrès à promouvoir pour parvenir à des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages d'égalité et de cohésion sociale. L'objectif est de concilier la poursuite de la modernisation des services publics, qui va de pair avec leur digitalisation, et la nécessaire attention portée tant à l'usager éloigné des nouvelles technologies qu'à celui dont le cas s'accommode mal de démarches standardisées.
Au terme de ses travaux, elle formule 20 recommandations réparties en 4 axes :
- améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers,
- rendre le réseau France services - dont les acquis doivent beaucoup à l'engagement des collectivités - plus performant afin de renforcer l'accès aux services publics dans les territoires,
- protéger plus efficacement les usagers contre les sites trompeurs et/ou frauduleux qui proposent d'effectuer des démarches administratives contre rémunération,
- mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.
I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ENTRE FRACTURE NUMÉRIQUE ET FRACTURE TERRITORIALE
« La dématérialisation des démarches administratives s'est imposée comme une nouvelle norme du service public » : « 73 % des Français ont en 2024 effectué une démarche administrative en ligne au cours de l'année ».
Le dernier Baromètre du numérique confirme ainsi que l'accès aux services publics passe désormais principalement par un canal dématérialisé : les quelque 572 millions de démarches administratives effectuées en ligne chaque année (hors école, hôpitaux, collectivités territoriales, police et gendarmerie) représentent 82 % du total des démarches réalisées sur une année.
|
Nombre de démarches administratives effectuées en ligne |
Ce vaste mouvement de dématérialisation n'est pas spécifique à la France. Au Danemark, plus de 90 % des échanges entre les usagers et l'administration sont réalisés numériquement ; la loi a rendu obligatoire l'utilisation du numérique pour l'accès aux services administratifs, les voies téléphonique ou postale devenant l'exception. L'Espagne occupait en 2020 le deuxième rang en Europe en matière d'administration numérique, avec un score nettement supérieur à la moyenne. Au Royaume-Uni, l'accès aux informations et aux démarches administratives relevant de l'État central passe désormais par un guichet unique numérique. Une résolution du Parlement européen du 18 avril 2023 encourageait une accélération de la transition numérique des services publics, notant que les citoyens de l'Union européenne « s'attendent désormais à ce que les services publics soient accessibles en ligne », car « au cours de la pandémie de COVID-19, presque toutes les activités sont passées en ligne ».
Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique estimait toutefois, en 2020, que si « un consensus assez large existe sur l'apport que peut constituer le numérique pour le fonctionnement et l'accès au service public », la dématérialisation n'en laisse pas moins de côté un grand nombre d'usagers qui, par exemple en raison de leur âge, de leur handicap ou d'un équipement défaillant, peinent à effectuer des démarches en ligne : ce constat reste d'actualité.
D'après le Baromètre du numérique de 2025, « presque un Français sur deux (44%) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches en ligne » ; près du quart des jeunes adultes de 18-24 ans, pourtant nés avec le numérique, ont « peur de se tromper » en effectuant ces démarches.
De manière très concrète, les difficultés rencontrées par certains de nos compatriotes établis hors de France pour s'identifier sur France connect, faute de numéro de téléphone français, peuvent être autant d'obstacles à l'accomplissement de démarches en ligne, notamment en matière de retraite.
Certains élus consultés par la mission d'information sur le site du Sénat en avril-mai 2025 témoignent : « La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé » ; elle est à l'origine d'une déshumanisation des services publics, voire d'une forme de « précarité relationnelle » pour les usagers qui, perdus devant leur écran, ont besoin d'un contact humain - guichet ou téléphone.
Aux effets de la fracture numérique s'ajoutent les perturbations causées par la contraction du maillage territorial de nombreux services publics (fermetures d'écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, d'organismes de protection sociale, etc.) L'éloignement géographique des services publics dits de proximité, parallèlement à leur dématérialisation qui constitue une autre forme d'éloignement, est durement ressenti dans les territoires ruraux et constituait un thème récurrent des Cahiers de doléances, ouverts dans les mairies en 2018-2019 dans le contexte de la crise des gilets jaunes.
Les élus locaux consultés par la mission d'information ont témoigné du « sentiment d'abandon » lié, dans certains territoires, à cette évolution.
« Quand on ne peut plus mettre un nom et un visage sur un agent du service public, on ne peut guère s'étonner que les termes même de "service public" n'aient plus de sens pour nos administrés. »
La fracture territoriale ne se limite pas à la France rurale ; elle est également marquée dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). Dans les outre-mer, pour accéder à certaines plateformes téléphoniques nationales, les usagers sont pénalisés par les horaires d'ouverture, alignés sur le fuseau horaire hexagonal : l'accès aux services publics peut constituer un défi pour nos concitoyens ultramarins.
II. UNE EXIGENCE : AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
A. L'OMNICANALITÉ : PLUS QU'UN OBJECTIF, UNE NÉCESSITÉ
Les résultats du dernier baromètre de l'institut Paul Delouvrier publié en décembre 2024, montrent que la progression du numérique n'est ni linéaire ni inéluctable, puisque l'on constate « une stabilité relative du téléphone et du contact physique ». De plus, « les Français souhaitent en priorité que leurs services publics soient plus facilement joignables, quel que soit le mode de contact utilisé ».
Au total, près de 43 % des sollicitations entre les usagers et le service public continuent de passer par le téléphone (numérique : 32 % ; accueil physique : 15 % ; voie postale : 10 %). Le numérique ne saurait donc être l'unique mode d'accès aux services publics.
Les besoins des usagers peuvent se résumer par ce constat du collectif Le sens du service public : « une forte attente de proximité, de simplification et d'accompagnement humain ».
Le contact humain reste en effet privilégié par de nombreux usagers ; or selon le Baromètre des services publics de 2025, 38 % des répondants utilisent, pour joindre l'administration, un mode d'accès qui n'est pas leur « moyen de contact préféré » : pour ces usagers, les démarches administratives - plus particulièrement en ligne - sont ressenties comme une contrainte.
La France a, après une phase où la priorité a été accordée à la dématérialisation et au « tout-numérique », engagé des efforts pour rendre les administrations plus accessibles par d'autres canaux que le digital. En 2023, le « plan Téléphone » fixe un objectif de taux de décroché de 85 % pour les services, parallèlement au développement de la prise de rendez-vous téléphonique et du rappel de l'usager.
On observe en effet des marges de progression en la matière : après l'enquête menée en 2022 par le Défenseur des droits et l'Institut national de la consommation (INC) sur l'accueil téléphonique des services publics, qui pointait des lacunes importantes dans l'information fournie par quatre administrations (Assurance maladie, caisses d'allocations familiales, Pôle emploi et Carsat), nombre d'usagers restent découragés par des temps d'attente excessifs et doutent de la fiabilité des réponses qui leur sont adressées, malgré les améliorations mises en place depuis 2022 par ces organismes.
« À chaque fois que l'on téléphone soit à la CAF ou à la CPAM, nous n'avons pas le même interlocuteur et cela arrive très souvent qu'il dise tout le contraire des informations reçues du conseiller précédent. Je pense qu'il y a un manque de formation. Cela m'est déjà arrivé que le conseiller ne savait pas répondre à mes questions... » (Cité dans le Baromètre du non-recours, enquête réalisée entre septembre et novembre 2024 avec la Communauté urbaine d'Arras dans le cadre du projet Territoire zéro non-recours).
Or selon le Baromètre des services publics de 2025, « le téléphone apparaît comme le moyen de contact préféré par les usagers », avant le déplacement sur place, les échanges par courriel ou l'accès via un site internet. Cette préférence confirme que le téléphone n'est pas appelé à s'effacer au profit du numérique et que des efforts doivent être poursuivis pour assurer l'efficacité de l'accueil téléphonique.
Le recours au téléphone est également une nécessité pour les usagers qui ne « rentrent pas dans les cases » des formulaires en ligne : un contact humain reste indispensable pour contourner les obstacles de menus déroulants, qui ne sont pas conçus pour les cas complexes.
Par ailleurs, l'importance déterminante de l'accueil physique a également été confirmée par les déplacements de la mission d'information dans les territoires. Points multiservices, guichets uniques, services sociaux, espaces France services : dans toutes ces structures, les personnels, dont la mission d'information a constaté l'engagement, informent et orientent l'usager et l'aident à effectuer ses démarches - un rôle crucial face à la disparition de nombreux guichets.
La mission d'information est donc parvenue à la conclusion que les pouvoirs publics doivent garantir à l'usager le choix du canal par lequel il souhaite entrer en relation avec l'administration (omnicanalité). L'exemple de la déclaration fiscale sur les propriétés immobilières, qui a mis en difficulté nombre d'usagers faute de ligne téléphonique dédiée, illustre cette impérieuse nécessité.
Convaincue de l'importance majeure de l'accueil de l'usager, qu'elle considère comme le moment le plus important du service public, la mission d'information juge également nécessaire de valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents. L'accueil nécessite en effet le développement d'un véritable « savoir-être » fait d'écoute, mais aussi de gestion des tensions et des conflits.
B. LE SITE SERVICE-PUBLIC.FR : UN ATOUT À VALORISER ET À FAIRE CONNAÎTRE
Le site service-public.fr, géré par la direction de l'information légale et administrative (Dila), est le navire amiral de la présence numérique de l'État en matière d'accès aux services publics. C'est le portail d'entrée de l'usager pour toute information ou démarche à réaliser auprès des pouvoirs publics. Le site est mis à jour de façon quasi quotidienne afin de tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires.
Service-public.fr bénéficie d'une forte fréquentation - 675 millions de visites en 2024 ; 8,1 millions par jour - notamment grâce à un travail volontariste sur les contenus et la structuration du site, qui permet un excellent référencement auprès des moteurs de recherche.
Toutefois, le site, très consulté, souffre paradoxalement d'un déficit de notoriété : si la quasi-totalité des Français l'ont utilisé ou l'utiliseront un jour, il demeure mal identifié par le public. Or il est crucial que l'usager soit en mesure de repérer les sources officielles d'information administrative, en particulier dans un contexte de prolifération d'officines parfois frauduleuses, proposant la réalisation de démarches contre rémunération.
C'est pourquoi la mission d'information recommande une campagne d'information auprès du grand public pour mieux faire connaître le site et les services qu'il propose.
Parmi les apports du site service-public.fr qu'il convient de mettre en valeur figure également une approche centrée sur l'usager lui-même, autour des « événéments de vie », fiches pratiques récapitulant les démarches nécessaires lors d'étapes importantes de la vie - départ d'un jeune de chez ses parents, recherche d'emploi, préparation de la retraite, arrivée d'un enfant, déménagement, recherche de crédit immobilier, décès d'un proche notamment.
Ce dispositif mérite d'être complété afin, notamment, de préparer les jeunes usagers à l'entrée dans la vie active avec une fiche spécifique, qui serait disponible en ligne et diffusée dans les CROUS, les associations étudiantes et le réseau des France Services.
Dans la même logique, la mission d'information estime que la fiche relative au décès d'un proche devrait être mise systématiquement mise à disposition dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres, afin de mieux atteindre le public ciblé.
III. FRANCE SERVICES : UN MODÈLE RÉUSSI GRÂCE À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS, QU'IL IMPORTE TOUTEFOIS DE RENDRE PLUS PERFORMANT POUR RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES
Le réseau France services, héritier des Maisons de services au public (MSAP), a été déployé à partir de 2020 en réponse au sentiment d'abandon ressenti dans certains territoires.
Source : France services de Belleville-en-Beaujolais
L'objectif était de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, distant de moins de 30 minutes de leur domicile. Pour certains élus locaux consultés par la mission d'information, les France services « remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». D'autres élus, convaincus que « la mairie reste le premier service public de France », critiquent des structures qu'ils considèrent comme « la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État », et qui en outre pèsent sur les finances des collectivités territoriales.
Ainsi que l'a résumé la ministre déléguée chargée de la ruralité lors de son audition : « les France services c'est le premier kilomètre et non le dernier : le service va aux administrés ! ».
Si le maillage territorial de ce dispositif est bien avancé - près de 2 800 France services sont aujourd'hui déployées sur l'ensemble du territoire national - il importe de poursuivre la consolidation de ce réseau qui réalise chaque mois près d'un million d'accompagnements, selon l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT).
Dans cette perspectives, différentes orientations ont été définies par la mission d'information :
- Poursuivre le développement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), aujourd'hui moins dotés alors-même que parmi les 10 France services les plus fréquentées, 7 se trouvent en QPV ;
- Amplifier les formules itinérantes qui permettent de rayonner au-delà des maisons France services et de se rapprocher des usagers, dans une logique d'« aller vers » ;
Source : Territoires vendômois
- Instaurer, à titre expérimental, une structure France services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger, compte tenu de besoins spécifiques à ces usagers ;
- Encourager les permanences France services dans les mairies, car « les mairies sont depuis longtemps un France service avant l'heure ! », ainsi que l'ont fait observer les élus locaux consultés sur la plateforme du Sénat - une proposition à laquelle la mission d'information a souscrit sans réserve ;
- Privilégier l'implantation des nouveaux espaces dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales : en effet, 1% seulement des espaces France services sont portés par l'État (4 se situent en préfecture et 34 en sous-préfecture) ; 67% par les collectivités.
S'agissant de l'offre de services assurée par le réseau, la mission d'information est d'avis de stabiliser le « panier » constitué des 12 opérateurs partenaires du programme (France Titres, Assurance Retraite - Carsat, Assurance Maladie - CPAM, Allocations Familiales - CAF, Finances Publiques - DGFiP, France Travail, La Poste, Mutualité sociale agricole - MSA, Point-Justice, France Rénov, Chèque Énergie et Urssaf).
En 2024, les 5 opérateurs contribuant le plus à l'activité de France services étaient France titres (21%), l'Assurance retraite (18%), la CPAM (16%), la CAF (13%) et la DGFiP (13%). L'Urssaf, qui n'a rejoint le réseau qu'en avril 2025, ne figure pas dans ces statistiques.
Sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés (par exemple en matière de retraite complémentaire avec l'Agirc-Arrco), la mission d'information juge donc indispensable de consolider ce dispositif avant toute éventuelle extension de celui-ci, dans une logique de stabilisation nécessaire pour garantir dans la durée le maintien des bons résultats du programme.
Parallèlement, la mission d'information est d'avis de consolider l'articulation entre France services et les opérateurs nationaux partenaires du réseau, une priorité pour assurer la qualité des services offerts aux usagers et sécuriser le travail des agents.
La mission d'information demande que soit garanti aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département, et que se développent des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France services, en adéquation avec les spécificités des territoires et selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.
Enfin, les déplacements de la mission d'information dans le Rhône, le Loir-et-Cher, l'Yonne et le Finistère ont confirmé le rôle essentiel des conseillers France services, qui assurent au service des usagers des fonctions d'écoute et de premier accueil tout aussi importantes que l'aide à l'accomplissement des démarches administratives. La polyvalence de ces agents est une de leurs qualités majeures : la mission fait sienne l'expression de « couteaux suisses de l'État » entendue lors de ses visites dans les territoires.
La mission recommande donc de mieux prendre en compte les évolutions du métier de conseiller France services en structurant leur formation et leur parcours professionnel et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.
IV. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION : UNE CONTREPARTIE INDISPENSABLE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS
La complexité associée aux démarches en ligne et le nombre croissant de démarches administratives dématérialisées incitent certains usagers à recourir à des offres payantes, alors-même que ces démarches sont gratuites ou quasi-gratuites. Or certains de ces sites peuvent induire l'usager en erreur, par exemple parce qu'ils reproduisent de manière trompeuse l'apparence de sites officiels, ou en raison de l'absence de transparence sur les modalités de paiement des prestations par les clients.
La mission d'information a pu mesurer la prolifération de ces sites marchands, dits « de conciergerie administrative », et le risque qu'ils représentent pour des usagers non avertis - un constat partagé par la DGCCRF, l'UFC-Que choisir et l'Institut national de la consommation.
Face à la primo-dématérialisation de certaines démarches telles que l'établissement ou le renouvellement d'un certificat d'immatriculation, dématérialisé depuis 2017, les usagers sont confrontés à un nombre important et parfois contradictoires d'informations disponibles en ligne, sans être en mesure d'en maitriser la fiabilité ou la véracité.
Ce phénomène recouvre ainsi une pluralité de risques pour les administrés : payer à un tiers une prestation pourtant délivrée gratuitement par les administrations - à titre d'exemple, la délivrance de la carte grise - , payer un service qui n'offre aucune réelle plus-value dans l'accomplissement d'une démarche administrative - par exemple, la prise de rendez-vous en mairie -, ou enfin, se retrouver sans le vouloir ou l'avoir compris sur un site imitant les sites officiels et être victime d'une arnaque.
La mission d'information note par ailleurs l'existence d'offres de services payants dans deux domaines particulièrement problématiques :
- le coaching sur Parcoursup qui, sans être illégal, peut atteindre des montants particulièrement élevés, mettant en cause l'égalité entre les futurs étudiants ;
- l'existence d'intermédiaires en ligne proposant d'effectuer contre rémunération des demandes d'aides sociales, alors-même que ces aides sont un droit pour les intéressés.
Les sites monnayant les démarches administratives en ligne valorisent trois arguments : la simplicité, l'accompagnement de la personne, le traitement sécurisé de ses données. Ce dernier argument vise à rassurer face aux risques d'arnaque ou de hacking qui ont altéré la confiance de nombreux usagers au cours de la période récente.
La mission a constaté que la protection de l'usager via la protection du consommateur en ligne est aujourd'hui un impensé de la dématérialisation des services publics.
Ainsi, face à cette myriade de pratiques commerciales a minima déloyales, voire illégales et trompeuses, la mission d'information a souhaité trouver un juste équilibre entre le contrôle et la répression de ces comportements.
Elle appelle dès lors, en premier lieu, à moderniser et à renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération :
- en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ;
- en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne ;
- et en tenant compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant leurs démarches par eux-mêmes.
Face aux risques de perte de confiance dans l'action publique du fait des pratiques frauduleuses ou contestables en ligne, la mission d'information recommande, parallèlement au renforcement des mesures de sanction, l'adoption de mesures destinées à renforcer l'identification, par les usagers, des outils et des sites officiels permettant d'accéder aux services publics et de réaliser des démarches en ligne. Ainsi, elle propose d'intensifier les efforts déjà mis en oeuvre par les administrations publiques :
- en établissant des signes distinctifs communs et infalsifiables aux sites officiels afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants ;
- en améliorant le référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivant avec détermination le déréférencement des sites frauduleux ;
- en clarifiant la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurant une communication régulière sur ce sujet ;
- et en renforçant la qualité de certains sites officiels comme mesdroitsosicaux.gouv.fr par le biais de partenariats renforcés avec les collectivités territoriales, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits.
V. METTRE À PROFIT LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES POUR CONSTRUIRE UNE ADMINISTRATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'USAGER : UN BESOIN DE MISE EN COHÉRENCE
A. BÂTIR UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L'INCLUSION NUMÉRIQUE
Le choix de proposer à tous nos concitoyens une alternative au numérique doit aller de pair avec un engagement affirmé en faveur de l'accompagnement des publics les plus éloignés du numérique. C'est notamment la mission des conseillers numériques, qui exercent dans des lieux tels que les centres sociaux, les missions locales, voire les maisons France services. Toutefois, la situation d'extrême précarité de certains publics, plus particulièrement en zone urbaine, conduit à traiter leurs démarches administratives dans l'urgence et rend difficile leur évolution vers l'autonomie numérique.
« On m'a dit d'aller sur internet. Il est où, internet ? » (Témoignage d'une conseillère numérique rencontrée lors d'un déplacement).
Le service reste néanmoins apprécié des collectivités. Outre que le financement du dispositif appelle des interrogations sur l'avenir des conseillers numériques, il importe donc de rendre plus cohérents le financement et la mise en oeuvre de la politique publique de l'inclusion numérique, afin de porter une vision stratégique claire : les lignes budgétaires mobilisées sont multiples, tout comme les opérateurs - ANCT, Banque des territoires, Dinum, etc.
C'est pourquoi la mission d'information recommande que l'inclusion numérique dans son ensemble, avec les conseillers numériques mais aussi Aidants Connect, destiné aux professionnels qui accompagnent régulièrement des personnes éloignées du numérique dans leurs démarches, soit dotée d'un véritable chef de file en mesure de penser l'articulation des différents intervenants - notamment les conseillers numériques et les conseillers France services.
La densification de cette politique est essentielle car contrairement à un cliché tenace, l'illectronisme n'est pas voué à se résorber à mesure que se diffusent les compétences numériques au sein de la population. En effet, l'apparition à un rythme rapide d'équipements et d'outils nouveaux - comme par exemple le QR code - est à l'origine d'une évolution constante des compétences numériques, qui laisse régulièrement sur le bord de la route une partie de la population. « Les fractures numériques ne sont pas statiques », et dans le domaine numérique comme en matière sociale, « la vulnérabilité est un état dynamique et changeant », soulignait à juste titre un rapport de l'ONU sur l'e-administration, publié en 2022.
B. CONTRÔLER LES USAGES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA METTRE AU SERVICE DES CITOYENS
Les avancées permises par l'intelligence artificielle sont désormais perceptibles dans presque tous les domaines de l'activité humaine. Les services publics n'y font pas exception, avec les possibilités ouvertes notamment en matière de rédaction de courriers ou courriels, ou encore de traitement de l'information.
La mission d'information a pris connaissance de chantiers ouverts dans ce domaine par plusieurs administrations comme l'Acoss, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou l'Assurance maladie, notamment pour affiner leur connaissance du public et ainsi devancer les besoins de l'usager et les questions qu'il est susceptible de se poser.
La génération de réponses automatiques à l'usager fait également partie de ces chantiers. Citons à titre d'exemple les trois fonctions de l'outil Albert, en cours d'expérimentation dans les maisons France Services :
· Accélérer la recherche d'informations administratives fiables pour les conseillers ;
· Offrir des réponses à jour et contextualisées, dans un environnement réglementaire complexe et mouvant (plus de 160 démarches couvertes, 12 opérateurs partenaires) ;
· Faciliter l'intégration des nouveaux conseillers, en leur fournissant un appui numérique quotidien, autonome et rapide d'accès.
L'enjeu consiste donc à trouver un équilibre entre le gain de temps et les économies que permettrait de dégager l'intelligence artificielle ; il s'agit aussi de répondre aux attentes d'usagers qui ressentent le besoin d'une humanisation des contacts avec l'administration, et aux exigences d'agents en quête de sens.
Si ces initiatives prises par les administrations sont à saluer, la mission d'information est d'avis :
· De les mettre en cohérence au niveau national, avec un chef de file clairement identifié ;
· De formuler une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service de l'usager - en matière de transparence, de sécurité des données, de périmètre des tâches automatisées ;
· De diffuser cette doctrine à tous les niveaux de l'administration.
La mission d'information partage pleinement le point de vue de la délégation sénatoriale à la prospective, qui soulignait dans un rapport d'information présenté par Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet en 2024 : « l'utilisation [de l'IA] au service de l'intérêt général ne [pourrait] se faire qu'à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient pleinement confiance ».
IA et information officielle : garder le contrôle
Au-delà des applications métier de l'IA, la mission d'information s'est également intéressée au problème spécifique du traitement par les opérateurs du secteur de l'information officielle délivrée par des sites comme service-public.fr. En effet, selon les équipes de la Direction de l'information légale et administrative (Dila) rencontrées par le président et la rapporteure, les outils tels que ChatGPT ou Gemini ne font pas toujours apparaître la source des réponses qu'ils apportent à l'usager. Or à terme, avec l'évolution des usages d'internet, ces outils pourraient se substituer aux moteurs de recherche traditionnels. Comme il est essentiel que l'information officielle soit clairement identifiée comme telle dans l'espace numérique, la mission d'information estime indispensable d'engager des discussions au plus haut niveau avec les principaux opérateurs afin de faire valoir cette exigence.
Plus généralement, il apparaît indispensable que la fonction publique recrute des profils qui maîtrisent tout aussi bien les aspects techniques de l'intelligence artificielle que sa dimension juridique et politique : en matière d'IA, le donneur d'ordre doit conserver le contrôle sur l'action du technicien et un regard éclairé sur la conception de l'outil.
AVANT PROPOS
« Qu'il s'agisse de préparer un départ à la retraite, de créer une entreprise ou simplement de renouveler sa carte d'identité, l'usager est confronté à l'Administration avec un grand "A" avec, chaque fois, le constat de la complexité et, souvent, le sentiment qu'il serait possible de faire plus simple »1(*) : ce constat établi en 2012 par la structure interministérielle chargée de la modernisation et de la simplification de l'action publique pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Il met en évidence, pour le lecteur de 2025, la persistance de difficultés majeures, pour l'usager, dans ses relations avec les services publics, alors même que la simplification des démarches administratives est inscrite sur la feuille de route de tous les gouvernements de notre pays depuis une vingtaine d'années et que son cadre juridique s'est renforcé au fil du temps au profit de l'usager.
Selon ce document vieux de plus de dix ans, mais qui paraîtra très actuel à nombre de nos concitoyens, la préparation de la retraite est présentée comme un « long, fastidieux et peut-être même inquiétant parcours ».
Sont tout particulièrement fléchés comme des « événements de vie » critiques pour les usagers le décès d'un proche, le handicap ainsi que le renouvellement ou l'établissement de papiers d'identité - comment ne pas évoquer, sur ce dernier point, le mécontentement causé, en 2022-2023, par des délais de délivrance des titres d'identité jamais atteints - jusqu'à six mois dans certains cas, d'après la Cour des comptes2(*) ?
De manière plus spectaculaire - et fort heureusement plus exceptionnelle - le mur de complexité auquel a été confronté un usager déclaré mort par erreur3(*) éclaire sur la réalité vécue par certaines personnes lorsqu'elles se trouvent en butte à un univers administratif régulièrement considéré comme opaque et inaccessible.
Dans certains cas, la référence qui s'impose est celle de Kafka, tant le contact avec l'administration confine à l'absurde, comme l'illustre ce passage du Quai de Ouistreham dans lequel un demandeur d'emploi dont la ligne téléphonique a été coupée tente, au guichet de Pôle emploi, d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller. Une entreprise vaine, car de nouvelles directives imposent la prise de rendez-vous exclusivement par téléphone : « On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n'est pas notre faute, ce sont les nouvelles mesures, nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. - Mais je n'ai plus le téléphone. - Il y a des postes à votre disposition au fond. Mais je vous préviens : il faut appeler un numéro unique, le 39 49, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. - Longue ? - Parfois plusieurs heures »4(*).
Dans cet esprit, une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en octobre 2021, estimait que « trop de Français sont malades de leur relation à l'administration » et, mettant en cause « une complexité administrative et une dématérialisation des démarches qui fait peser sur nombre de nos concitoyens une angoisse quasi existentielle, celle de cocher la mauvaise case, ou pire de n'en cocher aucune », invitait le Gouvernement à « reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français »5(*).
La bascule vers le digital - 82 % des démarches se font aujourd'hui en ligne - n'a fait que transposer cette complexité dans l'univers numérique : les « murailles de papier »6(*) auxquels on peut comparer les formulaires administratifs restent tout aussi infranchissables derrière un écran. L'image du « parcours du combattant » vient spontanément à l'esprit ; dans un registre humoristique, nombre d'usagers reconnaîtront leur expérience dans la recherche par Astérix du formulaire A38 dans les dédales de la « maison qui rend fou »7(*) : cette satire des guichets peut être appliquée aux démarches en ligne.
Ainsi, « Presque un Français sur deux (44%) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches en ligne »8(*) : ces contraintes concernent plus particulièrement certaines catégories de la population éloignées du numérique pour des raisons générationnelles, sociales ou économiques.
À cette fracture numérique s'ajoutent les perturbations causées par la contraction du maillage territorial de nombreux services publics (fermetures d'écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, d'organismes de protection sociale, etc.). Cet éloignement géographique des services publics dits de proximité, parallèlement à leur dématérialisation qui constitue une autre forme d'éloignement, est durement ressenti dans les territoires ruraux. Une telle évolution a inspiré un sentiment d'abandon dont les Cahiers de doléance, ouverts dans les mairies en 2018-2019 dans le contexte de la crise des gilets jaunes, se sont faits l'écho ; ce ressenti concerne aussi les quartiers de politique de la ville (QPV).
Or ces évolutions, il faut le souligner, ne sont pas le fait des seuls services publics :
- tout d'abord, l'éloignement géographique n'est pas spécifique aux administrations : en général, la fermeture des services publics accompagne ou précède la disparition de commerces ;
- de même, les administrations n'ont pas le monopole des plateformes téléphoniques et des conversations avec un robot, régulièrement déplorées par de nombreux usagers (« tapez 1, 2, 3... ») ; les longues attentes - répétées parfois plusieurs jours de suite pour obtenir une réponse - sont bien connues des clients des banques, des compagnies d'assurance et des fournisseurs de téléphonie mobile ou d'énergie. Au développement des démarches en ligne correspond en quelque sorte, dans le domaine du commerce, celui des caisses automatiques : le remplacement de l'humain par la machine n'est pas le propre de l'administration.
En revanche, l'accès aux services publics revêt une dimension spécifique et constitue un enjeu majeur en raison du lien singulier qui relie l'administration à ses usagers :
- d'une part, les services publics incarnent la présence de l'État dans les territoires : leur disparition, quels qu'en soient les motifs, est de nature à décourager des citoyens qui s'estiment négligés par l'État et qui se considèrent comme « les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales »9(*), et à les éloigner encore davantage de la politique. De manière significative, l'étude annuelle du Conseil d'État, dédiée en 2023 à L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique10(*), rappelait l'« exigence démocratique » qui caractérise l'accès aux services publics, tout autant que l'enjeu d'efficacité de l'action publique. De même, une enquête publiée en février 2025, quelques semaines avant le lancement des travaux de cette mission, portait sur « les inégalités d'accès aux services publics et l'impact sur le vote »11(*) ;
- d'autre part, les effets cumulés des deux causes d'exclusion dans l'accès aux services publics, évoquées précédemment - fracture territoriale et fracture numérique - mettent en péril l'égalité d'accès aux services publics ; or « L'égal accès effectif de toutes et tous aux services publics ne peut pas être un simple objectif de politique publique parmi d'autres : il constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants, la condition nécessaire pour former une société de citoyens libres, égaux et fraternels »12(*) : la mission d'information fait sienne cette remarque du défenseur des droits ;
- en outre, les démarches administratives, qu'elles soient ou non effectuées en ligne, concernent tout le monde : selon le Baromètre des services public dévoilé en juin 2025, 94 % des Français « déclarent avoir été en contact avec au moins un service public au cours des 12 derniers mois, à raison de 6 services publics en moyenne par personne ».
Cette quasi-universalité traduit le fait que tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, s'incarnent dans des démarches administratives : avoir un enfant, le faire garder, l'inscrire à l'école ; se déplacer - à l'intérieur de nos frontières ou à l'étranger ; adapter son logement à la transition climatique ; déménager ; participer à la vie associative ; faire des études ; se former ; créer une entreprise ou un commerce ; perdre son emploi ; être confronté à la maladie, au handicap ou au deuil...
Simplifier les démarches revient donc à simplifier le quotidien de millions de personnes.
Or selon l'INSEE, un tiers des Français avaient, en 2021, renoncé à effectuer une démarche en raison de difficultés liées à la dématérialisation13(*). De plus, les démarches administratives sont une condition de l'accès aux droits : les difficultés que présentent certains parcours administratifs ont pour conséquence le non-recours à ces droits, qui concerne jusqu'à 30% des bénéficiaires potentiels de certaines prestations sociales.
C'est dans ce contexte que le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) a demandé, dans le cadre du droit de tirage reconnu à chaque groupe politique par l'article 6 bis du Règlement du Sénat, la constitution d'une mission commune d'information sur « l'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers ».
Le Sénat a désigné les 19 membres de la mission d'information lors de la séance publique du mercredi 26 mars 2025.
Lors de sa réunion constitutive, le 8 avril 2025, la mission d'information a pris acte de la nomination de Mme Nadège Havet en tant que rapporteure, conformément au souhait du groupe RDPI de confier le rapport de cette mission à l'un de ses membres. M. Gilbert-Luc Devinaz, président, a alors rappelé les enjeux de la mission : « La proximité et l'efficacité des services publics sont évidemment un enjeu d'égalité, entre les territoires et entre les citoyens. Mais il s'agit aussi d'un enjeu démocratique, puisque le sentiment d'éloignement qu'éprouvent nombre d'usagers encourage l'abstention ».
Les travaux de la mission d'information se sont échelonnés entre le 29 avril et le 8 juillet 2025.
Au cours de douze auditions en réunion plénière et onze auditions au format « rapporteur », elle a rencontré des interlocuteurs très divers (Défenseur des droits, hauts fonctionnaires, universitaires, représentants des grands opérateurs de la sphère sociale (CNAV, CNAM CNAF, Urssaf, France Travail), d'associations de consommateurs, d'associations d'élus, de syndicats de la fonction publique), ainsi que trois membres du Gouvernement : Mmes Juliette Méadel et Françoise Gatel, ministres déléguées auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargées respectivement de la ville et de la ruralité, ainsi que M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Veillant à susciter des synergies au sein du Sénat, au-delà de la mission d'information, le président et la rapporteure ont souhaité associer à l'audition de la directrice des Français à l'étranger les membres du groupe d'études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France » ; de même l'audition du directeur général aux outre-mer a-t-elle été ouverte à la délégation sénatoriale aux outre-mer.
Une visite à la direction de l'information légale et administrative (DILA), au cours de laquelle la mission d'information a rencontré les responsables du site service-public.fr, principal site public d'information administrative, a complété les informations recueillies au cours de ces auditions.
Soucieuse de se rendre au plus près du terrain, la mission d'information a en outre effectué cinq déplacements dans les territoires : dans le Rhône (le 16 juin), le Loir-et-Cher (le 19 juin), le Finistère (les 25 et 26 juin), l'Yonne (le 30 juin) et en Seine-Saint-Denis (le 8 juillet). Ces déplacements ont, à chaque fois, permis des rencontres fructueuses avec tous ceux qui, aux côtés des élus locaux, oeuvrent au quotidien pour rendre les services publics plus accessibles aux usagers, dans leur diversité.
Parallèlement à ce cycle d'auditions et de déplacements, la mission d'information a procédé, sur le site du Sénat, à une consultation des élus locaux, entre le 14 avril et le 12 mai 2025. Les collectivités territoriales ayant la responsabilité de services publics décisifs pour le quotidien de nos concitoyens, la mission d'information a tenu à connaître le point de vue des élus sur l'évolution récente des services publics dans leurs territoires.
Les quelque 1 200 réponses recueillies à cette occasion, dont la synthèse est annexée à ce rapport, confirment l'engagement des élus pour améliorer l'accès aux services publics dans leurs territoires et soulignent la richesse des témoignages adressés à la mission d'information par ces élus, auxquels elle adresse ses plus chaleureux remerciements.
Comme cela a été précisé au cours de la réunion constitutive, la rapporteure a décidé d'écarter des travaux de la mission d'information les problématiques liées l'accès des étrangers aux services publics, qui constitue un sujet en soi, si l'on en juge par les réflexions du Défenseur des droits sur la dématérialisation des démarches administratives liées aux titres de séjour14(*). Le choix de la mission d'information a été de centrer son propos sur les dimensions territoriales de son sujet.
Compte tenu de l'ampleur de celui-ci, qui embrasse tous les aspects de la vie des personnes physiques et morales, la mission d'information a pris le parti de centrer son propos sur quelques exemples de démarches administratives qui lui ont paru représentatifs des avancées franchies au profit de l'usager et des marges de progression qui persistent dans certains domaines.
Parallèlement aux auditions et aux déplacements conduits par la mission d'information, les réflexions de celle-ci se sont nourries de rapports publiés par le Sénat, et tout particulièrement des travaux de la mission d'information de 2020 sur l'illectronisme et l'inclusion numérique15(*), de la commission des finances de 2022 sur le réseau France service16(*) ou, plus récemment, de rapports consacrés à l'IA par deux délégations :
- la délégation à la prospective, qui dans une analyse des conséquences de l'IA sur les services publics, souligne le potentiel de l'IA générative, susceptible de rendre l'action publique « plus efficace, plus accessible, plus équitable, plus individualisée et finalement plus humaine », à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient « pleinement confiance » en cet outil qui comporte aussi des risques et des limites17(*) ;
- et la délégation aux collectivités territoriales, qui aborde l'influence de l'IA sur la conduite des politiques publiques locales et évoque le risque de déshumanisation des services publics locaux18(*).
De même la réflexion de la mission d'information s'est-elle appuyée sur différents rapports publics :
- du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics, publié en 2022 ;
- du Conseil d'État, précédemment évoqué, consacré en 2023 à L'usager, du premier au dernier kilomètre ;
- de la Cour des comptes sur le prélèvement à la source, la délivrance des titres sécurisés, le programme « gérer mes biens immobiliers » et le programme France services.
Le rapport de la mission d'information, examiné le mardi 16 septembre 2025, s'articule autour des étapes suivantes :
- un rappel des circonstances de la dématérialisation des services publics, des conséquences de cette évolution majeure sur les territoires et du regard porté par les usagers sur les services publics ;
- un bilan de la politique publique destinée à améliorer l'accès aux services publics, qui s'est traduite par de vraies avancées au cours des dernières années ;
- l'identification de défis à relever et de progrès à mettre en oeuvre pour parvenir à des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages d'égalité et de cohésion sociale.
Au terme de ces travaux, la mission d'information formule 20 recommandations pour :
- améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers ;
- renforcer l'accès aux services publics dans les territoires en améliorant l'efficacité du réseau France services ;
- protéger plus efficacement les usagers contre les sites frauduleux leur proposant, contre rémunération, une aide dans leurs démarches administratives en ligne ;
- mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.
I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE
A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE
1. Les démarches administratives en ligne : une réalité pour une majorité d'usagers
a) Plus de 80 % des démarches sont désormais dématérialisées
Comme l'a indiqué le directeur interministériel de la transformation publique lors de son audition, les chiffres clé des « grands réseaux de service public à guichet » (hors gendarmerie, police, collectivités territoriales, école et hôpitaux) représentent chaque année :
- 572 millions de démarches en ligne, soit 82 % des démarches ;
- deux milliards de visites sur les sites administratifs.
L'accès aux services publics se fait donc désormais principalement en ligne : « Les démarches administratives en ligne sont devenues une pratique courante pour une large majorité de la population française », selon l'édition 2025 du Baromètre du numérique19(*), qui mesure chaque année la diffusion des équipements et des usages numériques dans la société française depuis 2000 pour évaluer comment les Français utilisent internet et les outils numériques et identifier les tendances émergentes dans ce domaine.
Selon cette enquête, 73 % des Français ont en 2024 effectué une démarche administrative en ligne au cours de l'année, ce qui constitue un « nouveau record » : « La dématérialisation (ou numérisation) des démarches administratives s'est imposée comme une nouvelle norme du service public ».
b) La transformation numérique de l'État : un processus continu depuis la fin des années 1990
Le fait que le numérique soit devenu un canal incontournable d'accès aux services publics est le résultat d'une évolution régulière depuis la fin des années 1990, dans le cadre d'une démarche de modernisation de l'administration conduite par tous les gouvernements.
- Ainsi, le programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI), lancé en 1998, est allé de pair avec un effort de publication sur internet des informations publiques essentielles dont une manifestation décisive a été la création, en 2000, du site service-public.fr, portail de l'administration devenu un site de référence pour l'information en ligne des usagers, sur lequel la rapporteure reviendra ultérieurement.
- Le plan ADministration ÉLEctronique (ADELE) pour 2004-2007 visait à faire de l'administration électronique un levier de la modernisation de l'État : présenté par le Premier ministre à Lyon le 9 février 2004, ce projet affichait l'ambition de « rendre l'administration plus performante, plus accessible et moins chère ». Parmi les 140 mesures prévues par ce plan figure le numéro unique de renseignement administratif 3939.
Le développement de l'administration électronique visait à « faire prévaloir à tous les niveaux de l'État une culture de service, en même temps qu'une culture de transparence et de résultats », l'objectif étant de permettre aux usagers de « s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée » et sans être « constamment assujettis à "l'impôt papier"»20(*).
Les objectifs du projet ADELE - février 200421(*)
« L'administration électronique, c'est en quelque sorte la promesse d'une administration rêvée, disponible 24 h sur 24, personnalisée, allant au-devant des attentes des usagers et gérant elle-même sa propre complexité, grâce aux nouvelles technologies. Une administration sans paperasse, qui libère l'énergie et la créativité des agents, pour un service public au rendez-vous de l'avenir. »
« Les Français doivent pouvoir s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée, sans avoir à maîtriser toutes les logiques internes de l'administration, sans être constamment assujettis à "l'impôt papier". Ils veulent que l'administration soit plus proche, plus attentive à leurs besoins, plus efficace. »
« Le numéro unique de renseignement administratif, 39-39, est un outil à la fois simple, performant et en parfaite adéquation avec les demandes des usagers. [...] Avant de se déplacer, les usagers veulent savoir s'ils doivent aller en mairie ou en préfecture, de quels papiers ils ont besoin, quels sont les horaires d'ouverture des services publics. Parfois, un simple renseignement téléphonique permet d'éviter un déplacement qui nécessite une demi-journée de congé ou de RTT. C'est justement ce que permet le 39-39, pour offrir à l'usager un point d'entrée unique, ouvert de 8 h à 19 h toute la semaine, ainsi que le samedi jusqu'à 14 h. L'extrême intérêt de ce service a amené le Président de la République à souhaiter sa généralisation sur tout le territoire. Ce sera chose faite dès l'automne 2004. La France disposera ainsi d'un outil unique en Europe, par sa dimension et son étendue nationale, au service des citoyens. »
« Deuxième exemple, le déménagement, parcours administratif du combattant pour 6 millions de Français chaque année, sera demain largement facilité grâce au service unique de changement d'adresse. À partir d'un site unique, l'usager bénéficiera d'un choix à la carte qui lui permettra de sélectionner les administrations qu'il souhaite informer de ce changement. Ce service ouvrira dès la fin 2004 pour la résidence principale, avec, dans une première étape, une dizaine d'administrations concernées. »
- Le plan « France numérique 2012 » a succédé à ADELE en 2008 : il s'agissait principalement d'améliorer l'accessibilité des sites internet publics et de promouvoir l'interopérabilité entre administrations, parallèlement à l'ouverture des données publiques (open data). Le bilan présenté en 2011 faisait état de la dématérialisation de 76 % des procédures administratives les plus courantes.
- En 2012, la mise en place du Secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP) s'inscrivait dans le contexte du « choc de simplification » annoncé en 2013 par le Président de la République, parallèlement à une stratégie technologique de l'État conçue dans le cadre du projet d'« État plateforme ». En novembre 2014, au terme d'une consultation du public en ligne22(*), le numérique est présenté par le gouvernement comme un vecteur de la transformation de l'État. Les 2 000 contributions ainsi recueillies ont permis au gouvernement d'identifier 40 propositions à destination des particuliers, parmi lesquelles :t
· la facilitation des démarches liées à l'obtention des papiers d'identité ;
· la dématérialisation de la carte Vitale ;
· l'accompagnement des demandeurs d'emploi en ligne ;
· la mise en ligne d'un simulateur permettant de vérifier l'éligibilité d'une personne aux minima sociaux ;
· et le projet « FranceConnect » facilitant l'identification des usagers sur les différents sites publics23(*), déployé en 2016 et donnant accès à tous les services publics en ligne au moyen d'un mot de passe et d'un identifiant uniques.
- En octobre 2017, le programme Action publique 2022 relance la transformation numérique, axe majeur de la réforme de l'État qui, parallèlement à la simplification de l'action publique, vise la dématérialisation des 500 démarches administratives les plus courantes24(*).
c) La digitalisation des services publics : une démarche mondiale, accélérée par la pandémie
La digitalisation de l'administration n'est pas spécifique à la France.
- Elle s'inscrit dans une tendance mondiale, comme le soulignait en 2022 un rapport de l'ONU qui formulait alors les constats suivants25(*) :
· « Presque tous les pays sont engagés dans le processus de numérisation » ; « les administrations et les institutions publiques du monde entier ont été irréversiblement transformées » par le digital ;
· « L'Europe reste le leader en matière de développement de l'e-Gouvernement [...], suivie par l'Asie, les Amériques, l'Océanie et l'Afrique »26(*) ;
· « Le développement numérique est inexorable et l'inaction ou les mauvaises actions [dans ce domine] peuvent être coûteuses (en termes d'opportunités de développement économique et social manquées) » ;
· Dans la plupart des pays du monde, « les particuliers et les entreprises sont de plus en plus en mesure d'interagir avec les institutions publiques par le biais de plateformes en ligne [...] et d'accéder aux contenus et aux données publics ».
- L'Union européenne est engagée dans une stratégie de développement de l'administration en ligne. Le Plan d'action européen 2016-2020 « Accélérer la mutation numérique des administrations publiques » (voir l'encadré ci-dessous), qui a succédé aux plans 2006-2010 et 2011-2015, vise à :
· « améliorer la qualité des services et d'accroître l'efficacité interne du secteur public » ;
· et à « [alléger] substantiellement les charges administratives pesant sur les entreprises et les citoyens en rendant leurs interactions avec les pouvoirs publics plus rapides, plus efficientes, plus pratiques, plus transparentes et moins coûteuses ».
Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne : principes applicables au développement de l'e-administration
- Numérique par défaut : les administrations publiques devraient, de préférence, fournir des services par voie électronique ;
- Principe d'« une fois pour toutes» : les administrations publiques devraient veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne communiquent une même information qu'une seule fois à une administration donnée ;
- Caractère inclusif et accessibilité : les administrations publiques devraient concevoir des services publics numériques qui soient inclusifs pour les personnes âgées et des handicapées ;
- Ouverture et transparence : les administrations devraient permettre aux citoyens et aux entreprises d'accéder à leurs propres données, de les contrôler et de les rectifier ;
- Transfrontières par défaut : les administrations devraient faire en sorte que les services publics numériques soient disponibles au-delà des frontières et éviter tout morcellement supplémentaire ;
- Interopérabilité par défaut : les services publics devraient être conçus de manière à pouvoir fonctionner en continu dans l'ensemble du marché unique, indépendamment des cloisonnements opérationnels ;
- Fiabilité et sécurité : toutes les initiatives devraient aller au-delà du simple respect du cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
- Le Danemark27(*), qui se situe en tête du classement des services publics numériques dans l'enquête des Nations Unies publiée en 202428(*), se caractérise par une politique de numérisation des services publics volontariste : la numérisation des services publics vise des « objectifs de réduction des charges administratives et d'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises ».
Le lancement de la numérisation des services publics remonte à la période 2000-2010 (première Stratégie nationale pour le numérique pour 2001-2004, mise en place de la déclaration d'impôts numérique, du numéro d'identification unique et du système Digital Post).
La législation danoise a, en 2015, rendu obligatoire « l'utilisation du numérique pour les communications avec l'administration et l'accès aux services administratifs (les voies téléphonique ou postale devenant l'exception) » : plus de 90 % des échanges entre les utilisateurs et l'administration sont réalisés numériquement.
Sont également devenus obligatoires, sauf exceptions, le recours des usagers :
· à un dispositif d'authentification via une identité numérique unique pour accéder à la quasi-totalité des services de l'administration (demandes de pensions, bourses, inscriptions à l'université, impôts) ;
· au service « digital post », qui permet aux autorités publiques danoises (État, régions et municipalités) de transférer des documents numériques de manière sécurisée aux usagers (courriers des hôpitaux, attribution d'une place en crèche, informations sur les bourses) : 63 millions de lettres numériques envoyées en 2023 (48 millions en 2014).
Ainsi, « la loi sur le Digital post (Lov om digital post) de 2012 oblige les administrations à utiliser Digital Post comme canal de communication officiel des documents administratifs, sauf exceptions, et instaure des obligations de clarté, de traçabilité et d'accessibilité dans les échanges numériques entre usagers et administration ».
- Au Royaume-Uni29(*), la transformation et la dématérialisation des services publics poursuivent différents objectifs :
· réduire les coûts, dans un contexte d'austérité budgétaire : le rapport « Digital Efficiency » observait en 2012 que les services numériques pouvaient coûter jusqu'à 20 fois moins cher que l'accueil par téléphone, et 50 fois moins que les guichets physiques ;
· simplifier les parcours des usagers pour garantir un meilleur accès aux services publics ;
· rationaliser l'État dans la logique de « l'État plateforme ».
Engagée dans un premier temps de manière non coordonnée, la digitalisation des services publics s'est structurée au cours des années 2010 autour du principe « digital by default » (« numérique par défaut »)30(*) : standardisation du design des services, mutualisation des outils (paiement en ligne, notifications, identification), développement d'infrastructures numériques partagées et création de standards de bonnes pratiques obligatoires pour tous les services de l'État. L'une des premières traductions de ce principe a été le lancement de la plateforme gov.uk, conçue comme un guichet unique numérique pour accéder aux informations et démarches administratives relevant de l'État central.
La période 2013-2015 a ensuite vu le lancement de 25 services pilotes entièrement numérisés, dont l'enregistrement électoral ou la demande de passeport.
- L'Espagne s'est également engagée de manière active dans la transformation numérique de ses services publics31(*), l'objectif du gouvernement étant d'atteindre en 2025 50 % de dématérialisation des démarches administratives, à travers une application mobile. Cette évolution, encouragée par la pandémie, a pour objectifs l'augmentation de l'efficacité des services publics et la réduction de leur coût.
Après avoir inscrit dans la loi, en 2007, l'obligation légale pour l'administration espagnole d'offrir aux citoyens des services numériques, l'Espagne a lancé en 2015 la stratégie « Agenda numérique pour l'Espagne ». En 2017, le programme España Digital 2025 a fléché la numérisation des PME et l'administration publique.
Au cours des années 2010, les régions autonomes ont déployé leurs propres portails, et développé des systèmes spécifiques : e-prescription, rendez-vous médicaux, dossiers scolaires, la Catalogne enregistrant en la matière des performances remarquées.
L'Espagne se classe désormais au 17e rang mondial en matière d'administration numérique, selon le dernier classement opéré par l'ONU. En 2020, elle occupait le deuxième rang en Europe, avec un score nettement supérieur à la moyenne32(*). Elle est particulièrement avancée en matière de signature électronique, d'ouverture des données et d'interopérabilité.
Ainsi, Mon dossier citoyen (Mi Carpeta Ciudadana) est une plateforme numérique qui centralise l'accès des citoyens à leurs données personnelles et aux démarches administratives. Elle permet de consulter les notifications électroniques, de prendre des rendez-vous, de suivre l'état des dossiers et de recevoir des alertes personnalisées. L'accès se fait via des systèmes d'identification électronique. Depuis avril 2025, l'Espagne a lancé le DNI numérique, une version électronique du document national d'identité, reconnu pour la plupart des activités des personnes, à l'exception des voyages internationaux33(*).
- Enfin, on observe qu'en Allemagne, une loi de 2017 sur l'accès en ligne (OZG ou onlinezugangsgesetz) obligeait les administrations fédérales, étatiques et locales à offrir leurs services publics également en ligne via des portails administratifs d'ici fin 2022. De plus, la loi sur l'administration en ligne (e-Governmentgesetz), telle que modifiée en 2024, oblige l'administration fédérale à fournir un moyen de communication sécurisé en ligne (dénommé « De-mail ») aux citoyens. Elle facilite également la présentation de justificatifs au format électronique et le paiement en ligne34(*).
- Lors de l'examen du rapport, le 16 septembre 2025, notre collègue Hugues Saury, vice-président, a attiré l'attention de la mission d'information sur les avancées constatées en matière d'accès digital aux services publics dans les pays baltes, qu'il a jugées éclairantes pour « s'inscrire dans l'avenir » : de fait, « État balte de 1 331 000 habitants, l'Estonie s'est imposée comme le leader européen, voire mondial, de l'administration numérique. [...] Les habitants peuvent ainsi voter par Internet à toutes les élections depuis 2005, créer une entreprise en un quart d'heure ou encore avoir accès à tous leurs dossiers médicaux et ordonnances en ligne grâce à leur carte d'identité nationale numérique »35(*).
- La pandémie de covid-19 et l'obligation d'assurer la continuité du service public malgré le contexte sanitaire ont contribué à accélérer des mutations déjà bien engagées en matière de digitalisation des services publics.
Une résolution du Parlement européen sur l'administration en ligne, adoptée en avril 202336(*), faisait observer que « les mesures en lien avec le numérique prises par les pouvoirs publics durant la pandémie de COVID-19 afin d'organiser les tests, la vaccination ou la traçabilité des voyages ont mis en exergue le rôle crucial que joue l'accès à internet et aux services publics électroniques pour tous ».
S'agissant plus particulièrement de l'administration en ligne, l'édition 2022 du Baromètre du numérique notait que « La fermeture temporaire des lieux d'accueil au public a accéléré les usages administratifs en ligne pendant l'épidémie, compte tenu de la migration de certains services des administrations vers des plateformes en ligne ». Le nombre de personnes ayant déjà effectué une démarche administrative sur internet est ainsi passé de 65 % en 2019 à 71 % en 2020, soit une progression de 5 points qui est restée stable en 2021.
Selon le coordinateur du projet européen TOOP37(*), qui vise à faciliter la numérisation du secteur public tout en simplifiant les procédures, « La COVID-19 est considérée comme un moteur majeur de la transformation numérique de notre société. Avoir des sociétés numériques pleinement opérationnelles nous permettra à l'avenir de mieux faire face aux situations d'urgence ».
2. La dématérialisation des services publics : conséquences pour les territoires
a) Une moindre densité du maillage territorial des services publics
Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'Illectronisme et l'inclusion numérique estimait, en 2020, que si « un consensus assez large existe sur l'apport que peut constituer le numérique pour le fonctionnement et l'accès au service public », en revanche la dématérialisation des démarches s'accompagne de la fermeture de services publics dans les territoires, avec des conséquences problématiques pour certains usagers.
La Cour des comptes faisait ainsi observer en 2019, dans un rapport sur l'accès aux services publics dans les territoires ruraux38(*), que le réseau des services publics déployé sur le territoire français était appelé à évoluer sous la double influence de la révolution numérique, à l'origine d'opportunités d'amélioration du service et de gains d'efficience, et de la nécessaire adaptation à des évolutions démographique différenciées selon les régions.
La Cour des comptes relevait ainsi :
- la suppression de 271 brigades de gendarmerie entre 2012 et 2018 (toutes les unités dissoutes ayant été localisées dans des territoires ruraux39(*)) ;
- la disparition de 1 000 écoles publiques entre 2013 et 201740(*), en lien avec une diminution d'effectifs de 3,7 % dans les écoles rurales (+1,4 % dans les écoles urbaines) ;
- la diminution de 13,2 % des bureaux de poste entre 2013 et 2017 et leur remplacement par les agences postales communales (+15,6 %) et les relais poste contact (+24,3 %).
Ces constats font écho aux regrets exprimés par les élus locaux consultés par la mission d'information à propos des fermetures d'écoles, de trésoreries et d'organismes de protection sociale (CPAM, CAF...), des baisses d'effectifs de gendarmerie, du redéploiement de casernes de pompiers, de la réduction de la présence des directions départementales des territoires (DDT) et des limitations des horaires d'ouverture des services publics classiques.
« Les services publics, c'est l'incarnation de la présence de l'État dans les territoires. C'est ainsi que le pensent les élus locaux, surtout dans les petites communes. Quand un service public disparaît, c'est le rapport avec l'État qui se détériore, ce qui peut se traduire dans les urnes, voire par une abstention de plus en plus forte »41(*) : cette remarque éclairante de notre collègue Marianne Margaté, vice-présidente de la mission d'information, illustre les enjeux de la disparition des services publics dans les territoires.
b) Le « sentiment d'abandon » lié aux difficultés d'accès aux services publics : un thème récurrent des cahiers de doléance de 2018-2019 et des témoignages d'élus locaux consultés par la mission d'information
De manière significative, les services publics sont au coeur des cahiers de doléances ouverts dans les mairies entre décembre 2018 et mars 2019 pour donner la parole aux habitants de nos territoires dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. Ces cahiers représentent un volume exceptionnel d'informations, totalisant 500 000 pages de témoignages42(*) : selon un archiviste, la longueur des contributions du seul département de la Charente maritime représente « deux fois Les Misérables »43(*).
Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier, géographe, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), entendue par la mission d'information le 28 mai 2025, a présenté les cahiers de doléances comme une « source exceptionnelle pour comprendre les attentes et les plaintes des usagers par rapport aux services publics. Cette thématique compte en effet parmi celles qui sont le plus fréquemment abordées dans les témoignages »44(*).
Les rédacteurs des cahiers de doléance soulignent le vecteur de sociabilité que représente la présence de service publics dans les villes et les villages. Les critiques qu'ils formulent portent sur :
- la rareté des services publics, liée au remplacement des guichets par des bornes automatiques ou des services en ligne ;
- les difficultés d'accès aux services publics, qu'il s'agisse de distance kilométrique ou de temps de parcours ;
- l'exclusion ressentie par les usagers qui se sentent incapables d'effectuer des démarches en ligne :
- la déshumanisation et la solitude imputées au remplacement de l'interlocuteur physique par un écran ;
- l'incompréhension suscitée par l'articulation des échelons territoriaux des services publics et la mauvaise perception de l'intercommunalité : « Communes, communautés de communes, intercommunalités, conseils régionaux, métropoles, départements, régions, état, Europe. Les citoyens lambda ne s'y retrouvent plus. On nous a promis une simplification, des économies, plus d'efficacité mais nous avons eu tout le contraire. Nous avons créé un État et une administration obèses »45(*), comme l'exprime un cahier de l'Isère.
Certes, les cahiers de doléances constituent des témoignages individuels qui ne sauraient être considérés comme les résultats d'un sondage ou d'une enquête réalisée par échantillon. Ils font plus particulièrement écho, comme l'a souligné Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier lors de son audition, au ressenti de seniors et de personnes d'âge moyen : « les cahiers notent avec acuité le vieillissement de la population et le départ des jeunes ».
En outre, comme l'a souligné notre collègue Hugues Saury, vice-président : si « ces cahiers de doléances constituent une mine d'informations, [...], ils présentent aussi un biais important : ils ont été rédigés dans un contexte éruptif, voire prérévolutionnaire, ce qui a pu amplifier et parfois caricaturer certaines critiques »46(*).
Ces documents associent la fermeture des services publics à un sentiment de déclin, d'abandon, de déclassement et d'isolement et à l'impression de désertification, expressions récurrentes sous la plume de leurs auteurs. « Le fossé se creuse entre la ville et la campagne. Nous ressentons un profond sentiment d'isolement et d'incompréhension de la part de l'État. Nous sommes souvent les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales »47(*) : cette citation d'un cahier de l'Indre illustre ce sentiment d'abandon, qui, même s'il n'est pas universellement partagé par les habitants de zones rurales ou de communes peu denses, peut encourager la défiance à l'égard des politiques et favoriser l'abstention. Dans cette logique, le Premier ministre évoquait opportunément, dans son discours de politique générale, le 14 janvier 2025, la réouverture de ces cahiers, soulignant ainsi l'actualité de certaines remarques que nos concitoyens y ont exprimées. En outre, comme l'a fait observer notre collègue Hugues Saury, « Il serait très intéressant d'avoir un nouveau retour sur l'état d'esprit de nos concitoyens en 2025, notamment sur leur rapport aux services publics », compte tenu des évolutions survenues depuis la rédaction de ces cahiers48(*).
Dans un esprit similaire, des élus de territoires ruraux, dans les témoignages transmis à la mission d'information, évoquent régulièrement le « sentiment d'abandon » qu'ils imputent à l'« érosion régulière des services publics de proximité », associée à un « désengagement de l'État » dans les territoires ruraux, sentiment que traduit de manière très éclairante la contribution ci-dessous.
Éloignement des services publics de proximité et sentiment d'abandon dans certains territoires : un élu rural témoigne
« L'accès aux services publics dans notre territoire s'est globalement dégradé au cours des dernières années. Cette dégradation s'explique principalement par l'éloignement progressif de nombreux services publics de proximité, qui ont vu leurs implantations réduites ou supprimées. Parmi les exemples les plus marquants :
- La trésorerie : sa fermeture a obligé les usagers à se déplacer beaucoup plus loin pour leurs démarches fiscales ou comptables, ce qui complique l'accès, en particulier pour les personnes âgées ou sans moyen de transport49(*).
- La DDT (Direction Départementale des Territoires) : la réduction de sa présence territoriale rend plus difficile le suivi des dossiers d'urbanisme, d'environnement ou d'agriculture, qui nécessitent désormais un accompagnement à distance, moins personnalisé et plus complexe à gérer pour les petites communes.
- La Poste : dans de nombreuses communes rurales, les bureaux de poste ont réduit leurs horaires d'ouverture, voire fermé, au profit d'agences postales communales ou de relais en commerces de proximité, avec des services souvent amoindris.
Ces évolutions s'inscrivent dans un mouvement de rationalisation des services de l'État et des grands opérateurs publics, souvent justifié par des objectifs de réduction des coûts, mais qui ont un impact direct sur l'égalité d'accès au service public, notamment en zone rurale ou peu dense. Cela génère un sentiment d'abandon chez de nombreux habitants, accentué par des difficultés d'accès au numérique (zones blanches, maîtrise des outils) alors que de plus en plus de démarches sont désormais dématérialisées. »
3. Des usagers « perdus » devant leur écran
a) Simplification des démarches ou « grande souffrance pour les usagers » ? Des élus locaux témoignent
Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique observait en 2020 l'intérêt que peut présenter la « transformation numérique » pour :
- « faciliter l'accès à l'information administrative, via des outils comme Service-public.fr » ;
- « améliorer l'accès aux droits, les usagers pouvant par exemple s'appuyer sur des simulateurs, permettant d'estimer les droits aux prestations sociales » ;
- permettre aux usagers des « gains de temps » : « d'après la Commission européenne, les usagers peuvent en moyenne gagner près de trente minutes par démarche en utilisant internet »50(*).
Dans cet esprit, certains élus locaux consultés par la mission d'information témoignent de leur intérêt pour la numérisation des services publics, facteur de simplification des démarches : « Pour les nouvelles générations, ça s'est plutôt amélioré. Nous avons accès à pratiquement tout par voie dématérialisée ». Certains voient de manière positive la prise de rendez-vous en ligne pour effectuer une démarche, par exemple en mairie ou en préfecture, à condition toutefois que les usagers soient correctement équipés et formés au numérique.
Un élu considère ainsi que « La technologie actuelle et à venir est une chance à saisir pour améliorer le service et la satisfaction [...] ; paradoxalement elle pourrait permettre de retisser des liens entre le service public et les citoyens, [nous permettant] de rendre un meilleur service et de lutter contre la grogne ambiante ».
Certains élus consultés par la mission d'information se déclarent d'ailleurs favorables à la dématérialisation des services publics locaux dont ils ont la responsabilité, au nom de l'amélioration de l'accès à ces services publics pour les usagers : « la dématérialisation est une bonne chose pour les services municipaux » ; la digitalisation de l'accès aux services publics « a aidé au développement de collectivités en milieu rural en permettant un temps de réponse réduit et une accessibilité facilitée ».
Exemples de dématérialisation des services publics municipaux - témoignages d'élus locaux consultés par la mission d'information
Sont régulièrement mentionnés dans ces témoignages :
- la dématérialisation de la gestion du périscolaire (inscription et paiement à distance : « mise en place d'un portail des familles pour les réservations de cantines et garderies et paiement en ligne ») ; guichet unique en ligne en matière de périscolaire ou de restauration scolaire pour que les familles utilisent le même portail « quel que soit le gestionnaire [...], que ce soit la commune ou l'intercommunalité »;
- la prise de rendez-vous dématérialisée, parfois commune à plusieurs municipalités, qui permet un « gain de temps lors du passage en mairie ».
La numérisation du service public de l'urbanisme ne fait toutefois pas l'unanimité : elle vise pour les uns à « simplifier l'instruction des demandes d'urbanisme », tandis que pour d'autres « la dématérialisation des demandes d'urbanisme est trop compliquée pour les petits dossiers des particuliers » : « nous avons des habitants qui ne font pas les travaux [faute d'être] en capacité de faire la déclaration préalable ».
En revanche, de nombreux témoignages mettent en évidence les obstacles insurmontables causés par la dématérialisation pour diverses catégories d'usagers parfaitement identifiées par les élus locaux :
- les seniors peu familiarisées avec le numérique : « le QR code est déjà un obstacle pour beaucoup » ;
- les « cas singuliers » qui « ne rentrent pas dans les cases » des menus déroulants ; pour ces dossiers complexes, le contact humain - guichet ou téléphone - est une nécessité, faute de quoi l'usager se sent « délaissé », « isolé », voire menacé par une forme de « phobie administrative » ;
- les jeunes, très habiles sur leur smartphone mais souvent démunis face à un ordinateur, au point qu'un élu suggère « des formations aux lycéens qui vont devoir gérer plus tard soit leurs déclarations d'impôts, leur inscription Ameli, ou toutes demandes d'aides au logement. La formation à ces sites de service doit être enseignée au lycée » ;
- les personnes en situation de handicap : un élu municipal exprime ainsi une attente forte en matière d'accessibilité, qui concerne « 12 millions de personnes en situation de handicap et 8 millions d'aidants en France », auxquels les démarches dématérialisées ne sont pas toutes adaptées à ce jour ;
- les catégories défavorisées : « La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé, accentuant un sentiment de déclassement social, non accès aux droits et source d'agressivité ».
Selon un autre témoignage, « La dématérialisation est une grande souffrance pour nos administrés ». Deux raisons expliquent ce désarroi :
- d'une part, une « précarité relationnelle », selon la formule éclairante d'un élu, résulte de la solitude de l'usager devant son écran et de la difficulté d'établir un contact direct, téléphonique ou physique, avec un agent, à l'origine d'une perte regrettable de contact humain ;
- d'autre part, la digitalisation revient, comme l'a relevé le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique, précédemment cité, à « externaliser la complexité administrative [...] vers les usagers »51(*). En d'autres termes, selon un élu consulté par la mission d'information, « Les Français ont vraiment l'impression qu'ils doivent faire le travail sur internet à la place de leurs interlocuteurs qui ont disparu ».
Alors que « nous sommes en pleine phase de dématérialisation forcée des services publics », « l'attente prioritaire des usagers est de passer du 100 % numérique au 100 % accessible », ainsi que le faisait observer à juste titre notre collègue Éric Gold, vice-président de la mission d'information52(*), faisant observer de surcroît que « la numérisation des services publics n'a pas permis une accessibilité complète et a laissé de côté bon nombre de nos concitoyens. En effet, aucune formation aux démarches administratives numérique n'a été organisée. Les usagers apprennent de façon empirique »53(*). Un constat complété par notre collègue Hugues Saury, vice-président : « Il est évident que la dématérialisation a des aspects bénéfiques, mais elle crée aussi de nouvelles fractures, en particulier dans des milieux déjà précarisés. [...] Ces fractures éloignent le citoyen des services publics »54(*).
La mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'exclusion numérique55(*) a commenté les diverses dimensions du risque d'exclusion numérique : l'exclusion par la compétence et l'exclusion matérielle, auxquelles s'ajoute l'exclusion spécifique à certains publics, qui menace par exemple les personnes âgées (notre collègue Béatrice Gosselin l'a rappelé lors de la réunion constitutive : « Les personnes âgées sont souvent éloignées du numérique et dans bien des cas se retrouvent désemparées, que ce soit dans le monde urbain ou dans le monde rural. »56(*)) ou les personnes en situation de handicap. Il s'agit là d'un point essentiel de ce rapport, qui sera développé plus en détails ultérieurement.
b) Les risques d'une digitalisation précipitée et sans alternative : l'illustration de la dématérialisation des titres d'identité
De manière presque contemporaine à la généralisation du terme d'« illectronisme », entré dans le dictionnaire Robert en 202057(*), le premier rapport du Défenseur des droits sur la dématérialisation numérique attirait l'attention, en 2019, sur les risques d'une dématérialisation « à marche forcée, sans tenir compte des réalités et des possibilités [...] des usagers »58(*).
Ce document alertait sur l'afflux de saisines concernant la délivrance de permis de conduire et de certificats d'immatriculation, dans la foulée du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG) lancé en novembre 2017.
Le plan « Préfectures nouvelle génération », déployé en novembre 2017, visait à dématérialiser les demandes de titres (passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire et carte grise), confiées à l'ANTS59(*), dénommée France titres depuis février 2024.
Telle qu'elle était présentée au public, cette réforme, qui fait intervenir de nombreux acteurs dans la chaîne de traitement des titres (voir le schéma et l'encadré ci-dessous), devait instaurer « une nouvelle relation avec l'usager » permettant en principe à celui-ci de « ne plus attendre en préfecture pour faire ses demandes », de « gagner du temps » et de « ne plus avoir à se déplacer »60(*).
Demande de titres - mode d'emploi de la téléprocédure - préfectures nouvelle génération61(*)
Les différents acteurs intervenant dans la chaîne de délivrance des titres depuis la mise en oeuvre du plan Préfectures nouvelle génération62(*)
- la réception des demandes de titres d'identité relève des mairies ;
- les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT), plateformes interdépartementales créées par le plan Préfectures nouvelle génération, assurent leur instruction ; les CERT sont spécialisés par titres (carte nationale d'identité, passeport, certificat d'immatriculation, permis de conduire) ; ils se sont substitués aux préfectures en 2017 ;
- la fabrication des titres incombe à IN Groupe ;
- l'ANTS développe, maintient et exploite les systèmes d'information dédiés à la délivrance des titres sécurisés ; son portail est l'unique point d'accès pour les demandes en ligne de titres d'identité et de circulation (en dehors du cerfa papier pour les titres d'identité) ;
- enfin, l'acheminement des titres est assuré, pour les titres d'identité, par Chronopost (envoi aux mairies) ; pour les titres de circulation, par La Poste (envoi direct aux usagers).
La mise en oeuvre de cette réforme a donné lieu à de nombreux dysfonctionnements.
Les difficultés auxquelles se sont heurtés de très nombreux usagers dans leurs démarches en ligne sont liées, selon la Cour des comptes, au développement massif des téléprocédures, avec un doublement des connexions sur le portail de l'ANTS entre 2017 (69 millions) et 2018 (177 millions). La rapidité de ce développement a mis en évidence les limites d'un site conçu initialement comme un site d'information et son inadaptation aux paiements en ligne liés aux demandes de titres63(*).
Parallèlement, la dématérialisation des titres d'identité a eu pour conséquence une augmentation très nette des délais de délivrance. La Cour des comptes rappelle qu'entre mars 2022 et juin 2023, « les délais de délivrance des titres d'identité ont atteint des niveaux sans précédent, suscitant le mécontentement des usagers : en moyenne plus de deux mois d'attente pour obtenir un rendez-vous en mairie, et plus d'un mois supplémentaire pour que leurs titres soient instruits, fabriqués et acheminés. Dans certains cas, le délai de délivrance a atteint jusqu'à six mois »64(*).
Cette crise s'explique principalement, d'après la Cour des comptes, par le rattrapage de la période de pandémie, pendant laquelle de nombreux usagers n'ont pas pu déposer leur demande de titre d'identité : cet aspect conjoncturel, amplifié par les augmentations de demandes de passeports dues au Brexit, concernerait près de 2,5 millions de cartes nationales d'identité et 3,7 millions de passeports.
Des plans d'urgence déployés à partir de mai 2023 ont permis de résorber les délais en accroissant l'offre de rendez-vous en mairie65(*), en équipant de nouveaux lieux de réception de demande de titres et en installant des centres temporaires d'accueil, ou « titrodromes », dans des villes volontaires.
Par-delà ces mesures et pour éviter que de semblables crises se reproduise, la Cour des comptes appelait en 2024 à mettre en place une véritable stratégie d'anticipation, en prévision :
- de la généralisation de la nouvelle carte d'identité biométrique, prévue pour 2031 au plus tard par le règlement n° 2019/1157 de l'Union européenne ;
- du nombre significatif de passeports qui vont expirer entre 2024 et 2028 ;
- du renouvellement des permis de conduire à organiser pour janvier 2033, conformément à la généralisation du modèle unique de permis de conduire européen rendue obligatoire par la directive 2006/126 CE du Parlement et du Conseil ;
- du renouvellement des permis de conduire délivrés à partir de janvier 2013 pour 15 ans, dont les premiers arriveront à échéance en 202866(*).
S'agissant plus particulièrement de la délivrance des titres de circulation, le Défenseur des droits67(*) a reçu « plusieurs milliers de réclamations sur le seul sujet du processus de dématérialisation de la délivrance des permis de conduire et des certificats d'immatriculation [...], faisant de ce sujet un des premiers motifs de saisine de l'institution », les réclamations ayant pour causes :
- les « nombreux dysfonctionnements techniques du site internet ants.gouv.fr empêchant de réaliser les démarches » ;
- des « problèmes de conception du site, qui n'intégraient pas certaines situations, telles que les véhicules avec des plaques d'immatriculation sous un certain format » ;
- le « sous-dimensionnement du dispositif pour absorber les flux des demandes » ;
- « l'absence de mécanisme efficace de correction des erreurs et de multiples problèmes d'accès aux services en ligne, de blocages, d'erreurs et de pannes informatiques ».
La voie dématérialisée étant devenue le seul canal d'accès à ce service public, les modalités du passage au numérique ont, selon le Défenseur des droits, empêché certains usagers « d'accéder au service public en tant que tel » et ont placé les personnes concernées « dans des situations préjudiciables, certaines ayant perdu leur emploi en raison de l'absence de titre de circulation valide et de l'impossibilité de justifier de leur droit à conduire »68(*).
Ces exemples illustrent les risques liés à une dématérialisation trop rapide, voire précipitée, a fortiori quand le basculement vers le « tout numérique » se fait « du jour au lendemain », comme l'ont dénoncé nos collègues de la mission d'information sur l'illectronisme et l'exclusion numérique, dont le rapport pointe des « guichets physiques [...] fermés sans aucune phase transitoire et sans aucun accompagnement des personnes éloignées du numérique »69(*).
La mission d'information fait donc sienne cette remarque de la défenseure des droits lors de son audition : « Lorsque la dématérialisation devient la voie exclusive de l'accès aux droits ou lorsqu'elle est mal pensée, elle éloigne un certain nombre de personnes du service public qui se sentent perdues devant des procédures parfois complexes »70(*).
B. LE RESSENTI DE L'USAGER : « LE NUMÉRIQUE N'EST PAS LA RÉPONSE UNIVERSELLE »
1. Quels services publics ? Une définition large, incluant des services privés
La conception des services publics que reflètent les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information relève d'un spectre particulièrement large qui, indépendamment de la définition juridique des services publics, peut intégrer des services privés tels que les banques, voire les commerces de proximité.
On observait la même logique dans les cahiers de doléances, comme le confirme l'encadré ci-dessous.
Les services publics dans les cahiers de doléance :
des trésoreries aux cinémas71(*)
« Il est frappant de constater à cet égard que les rédacteurs des cahiers rassemblent, dans un tout indifférencié, les services publics stricto sensu et tous les équipements et services de proximité, qu'ils soient publics ou privés. Ainsi, le commerce de proximité apparaît dans la même liste que le centre des impôts, le bureau de poste ou l'école, etc. L'image des services publics réunit ainsi les bureaux de poste, les trésoreries et services des impôts, les écoles - à travers notamment le problème des fermetures de classe -, les centres de formation professionnelle - c'est important dans le monde rural -, mais aussi les cinémas, les centres culturels, les salles de sport, les gendarmeries, dont on déplore qu'elles ne soient ouvertes que certains jours ou à certains créneaux, les commissariats de police, les services hospitaliers, etc. L'offre de soins est aussi évoquée, pour déplorer la fermeture de maternités, de certains services d'urgences ou de certains centres de soins intensifs. Ces cahiers font également écho à la réforme de la carte judiciaire - la perte d'un tribunal d'instance, par exemple, est souvent remarquée - et mettent souvent l'accent sur les transports. On déplore tantôt la fermeture d'une gare, tantôt la fermeture d'une ligne de train secondaire, etc. »
Cette approche étendue de la notion de service public traduit le lien entre la disparition progressive des services publics et celle des activités privées, à l'origine d'un cercle vicieux de désertification évoquée lors de son audition par la représentante de Départements de France, présidente du département de la Haute-Loire : « Face à la fermeture des services de trésorerie, des guichets bancaires, écoles, à laquelle s'ajoute celle des commerces de proximité, nos populations se sentent abandonnées et ont un fort sentiment d'éloignement, particulièrement dans les territoires ruraux »72(*).
Ainsi que l'a rappelé Mme Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, lors de son audition : « Sur les 35 000 communes de notre pays, 21 000 n'ont aucun commerce ».
Dans le même esprit, la présidente de l'AMF du Rhône, rencontrée par le président et la rapporteure lors de leur déplacement du 16 juin 2025, faisait observer que lorsqu'un acteur ou un service, quel qu'il soit (école, soins, La Poste, formation...), disparaît d'un territoire, c'est tout un ensemble local qui est fragilisé : elle mentionnait entre autres exemples les conséquences négatives des fermetures d'écoles sur les commerces de proximité.
Ainsi, le sondage sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote, réalisé à l'initiative du collectif Le sens du service public73(*), présente des pourcentages élevés de réponses estimant que les pharmacies (71 %) et les médecins libéraux (69 %) devraient « être considérés comme des services publics »74(*). Selon Le sens du service public, une telle approche peut faire écho à une attente de régulation destinée à garantir l'accès de tous à certains services : « il existe bien un besoin de services publics, une attente de réponse et de régulation de la part de la puissance publique pour permettre véritablement l'égal accès aux services publics »75(*).
S'agissant de l'accès aux soins, notre collègue Marie-Pierre Richer, vice-présidente de la mission d'information, a à juste titre déploré la « désertification pharmaceutique » dans les territoires lors de l'audition de Mme Françoise Gatel, qui pour sa part a souligné le lien entre fermetures des pharmacies et déserts médicaux : « Si une pharmacie ferme, vous perdez aussi médecins et infirmiers. [...] Crantez les pharmacies et vous cranterez l'accès aux soins dans les territoires ruraux ».
De manière cohérente, la conception étendue des services publics qui s'exprime ainsi est confirmée par les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information : selon un élu, « La notion de services publics est souvent comprise par la population comme un champ qui comprend les banques, les distributeurs de billets, La Poste, les transports publics et privés... ».
Les élus se réfèrent ainsi :
- aux suppressions de bureaux de poste et, de manière générale, à la « dégradation du service postal », très fréquemment citée : un élu cite parmi les causes du « sentiment d'abandon » ressenti par certains Français « le manque de présence du facteur, qui discutait avec les gens et créait ce lien social qui disparaît progressivement », concluant que « la rentabilité est l'antithèse du lien social » ;
- aux difficultés croissantes en matière d'accès aux soins, pointant aussi bien le fonctionnement des hôpitaux (fermeture, urgences saturées) et des maternités que le manque de professionnels de santé du secteur privé ;
- aux fermetures d'agences bancaires et de distributeurs de billets ;
- à la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile (attente très longue en cas d'appel, réponse par un robot, etc.) et au « manque de sérieux » des entreprises chargées du déploiement de la fibre.
2. Usagers ou consommateurs ?
Dans son ouvrage Les Normes à l'assaut de la démocratie, Jean-Denis Combrexelle, entendu par la mission d'information le 13 mai 2025, évoque à juste titre une tendance de certains usagers à ne plus être « dans une posture compréhensive de citoyen, mais dans une attitude exigeante et sans concession de consommateur. Le maire n'est plus que le gérant du magasin-mairie qui, bien que largement financé par l'impôt, trop cher, offre de bien piètres prestations. De la même façon que le client reprochera au gérant du supermarché du coin de pas avoir sa marque préférée de yaourt, on reprochera au gérant du magasin-mairie les horaires de ramassage des ordures ».
Dans cette logique, poursuit l'auteur, « Le service rendu par une mairie lors de la délivrance d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un permis de construire sera comparé, le plus souvent à son détriment, à la réactivité et à l'efficacité d'une entreprise de prestation de services comme Amazon »76(*).
De fait, les attentes de l'usager rejoignent celles du consommateur, qui valorise au premier chef la rapidité, voire le caractère instantané d'une prestation. Dans cet esprit, il est significatif que France travail se soit inspiré, pour améliorer le parcours de ses usagers, de plateformes comme Doctolib (rendez-vous en ligne) et Colissimo (tableau de bord permettant le suivi des demandes et des démarches)77(*).
La résolution du Parlement européen sur l'administration en ligne d'avril 2023, précédemment citée, considère comme naturelle la porosité entre les comportements de l'usager et ceux du consommateur : « les particuliers se sont habitués à faire des achats et à recourir à des services en ligne, qui leur permettent de satisfaire leurs besoins en quelques clics seulement ». Cette tendance s'est accélérée pendant la crise sanitaire, qui a renforcé les exigences des citoyens-consommateurs : « au cours de la pandémie de COVID-19, presque toutes les activités sont passées en ligne, ce qui a modifié les comportements des citoyens, lesquels s'attendent désormais à ce que les services publics soient accessibles en ligne »78(*). Dans cette logique, le Parlement européen encourage l'accélération de la transition numérique des services publics.
« Une demande de l'usager toujours plus exigeante, complexe et changeante » : Mme Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville, a ainsi qualifié les attentes des usagers devant la mission d'information79(*). À cet égard, un élu municipal observe : « Depuis plusieurs années, les habitants sont très exigeants [à l'égard de la commune], demandant des services dont certains sont mis en place mais qu'ils n'utilisent pas ou très peu ». Cet état d'esprit a été confirmé par la présidente de l'AMF du Rhône rencontrée par le président et la rapporteure le 16 juin 2025 (« Je paye mes impôts, donc j'y ai droit »).
3. Les baromètres des services publics : une satisfaction globale, un bilan perfectible
Le Baromètre des services publics rendu public en juin 2025 évalue la perception par les usagers80(*) de quelque dix-neuf services publics du quotidien81(*) : il constitue ainsi « un thermomètre qui mesure la qualité perçue de nos services publics et leur accessibilité »82(*).
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification a estimé, lors de son audition par la mission d'information, que ce baromètre permet un certain optimisme : « S'il ne nous annonce pas encore un temps magnifique, il ne dit pas, loin de là, que le ciel est bas et lourd ».
Pour autant, cette enquête souligne des marges de progression qui concernent tant la simplicité des démarches que les modalités d'accès à l'administration.
a) Des moyennes globalement favorables
Interrogés sur la « qualité de service fournie par le service contacté au cours des 12 derniers mois », 69 % des usagers se déclarent « globalement satisfaits », la proportion d'usagers « globalement insatisfaits » étant de 11 % (20 % d'usagers « ni satisfaits, ni pas satisfaits »)83(*).
Les délais de traitement sont jugés satisfaisants dans 68% des cas, avec un taux de satisfaction plus élevés pour les pompiers, le médecin, la mairie, l'école et la gendarmerie.
Les usagers sont satisfaits de la qualité de la relation avec le service public avec lequel ils sont été en contact : « l'accueil est généralement jugé bienveillant et respectueux (73 %), le service considéré comme attentif à la situation personnelle de l'usager (69 %) et son attitude pour aider à corriger une erreur de bonne foi jugée satisfaisante (68 % des situations concernées) »84(*).
b) Une opinion publique plus critique que l'usager
On observe une nuance certaine entre l'opinion des Français à l'égard des services publics et le niveau de satisfaction des usagers. Le Baromètre de l'Institut Paul Delouvrier sur les services publics vus par les Français et les usagers, publié en février 202585(*), établit ainsi une différence sensible (32 points d'écart) :
- entre la satisfaction globale moyenne des usagers sur les services publics étudiés86(*), qui s'établit à 77 % ;
- et l'opinion moyenne des Français à l'égard des différents services publics, qui se stabilise à 45 %, soit un niveau nettement moins élevé.
Le regard sur les services publics est donc nuancé : si la perception du grand public reste mitigée, le niveau de satisfaction croît si l'on s'adresse aux usagers. Selon M. Matthieu Delouvrier, entendu le 29 avril 2025, « Pourquoi cette différence ? La vision des usagers est fondée sur l'expérience, celle des Français en général se révèle assez désincarnée. Un citoyen peut être mécontent de l'hôpital, mais ne le sera pas du médecin ou de l'infirmière qui l'a soigné lors de son dernier séjour »87(*).
Le sondage effectué en janvier 2025 à la demande du collectif Le sens du service public sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact contribue également à nuancer l'opinion générale sur les services publics en fonction du ressenti de l'usager88(*) :
- 39 % seulement des répondants se déclarent satisfaits lorsqu'ils sont interrogés en termes généraux sur la qualité des services publics en France (61 % se déclarent insatisfaits) ;
- en revanche la question « Vous personnellement, diriez-vous que vous avez facilement ou difficilement accès aux services publics ? » donne lieu à 75 % de réponses positives89(*), ce qui selon Le sens du service public « doit nuancer notre regard »90(*) : « Six Français sur dix ont exprimé une insatisfaction globale à l'égard de la qualité des services publics. Pour autant, quand on les questionne en particulier sur tel ou tel service, et notamment sur leur expérience personnelle, la perception est bien meilleure. Peut-être le récit public extrêmement négatif dont font généralement l'objet les services publics contribue-t-il à un ressenti collectif qui, finalement, dégrade l'appréciation des citoyens ».
Sondage OpinionWay pour Le sens du service public - « Aujourd'hui, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la qualité des services publics en France ? » (point de vue de l'opinion publique)
Sondage OpinionWay pour Le sens du service public - « Vous personnellement, diriez-vous que vous avez facilement ou difficilement accès aux services publics ? » (point de vue de l'usager)
c) Des nuances selon le profil des usagers, le territoire et les services publics considérés
Par-delà les mesures moyennes de la satisfaction des usagers, le Baromètre des services publics de juin 2025 met en évidence certaines nuances :
- en fonction du profil des usagers : le niveau de satisfaction est plus élevé chez les plus âgés (25-34 ans : 62 % ; 50-64 ans : 74 % ; 65 ans et plus : 76 %) ; les retraités (75 %) et les personnes les plus à l'aise avec les outils numériques (très à l'aise : 75 % ; plutôt à l'aise : 71 % ; vraiment pas à l'aise : 50 %) ;
- en fonction du territoire d'habitation : le taux de satisfaction est inférieur en région parisienne (66 %, contre 71 % en milieu rural et 69 % dans les agglomérations de 20 000 à 99 999 habitants) ;
- en fonction des services : les pompiers, la mairie, l'école ou la gendarmerie91(*) enregistrent des scores souvent supérieurs à la moyenne nationale. Ce constat rejoint l'analyse du sondage effectué en janvier 2025 sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote92(*) : « Les services ayant maintenu un réseau de proximité - écoles, collèges, lycées, police, gendarmerie - obtiennent de bons taux de satisfaction »93(*).
En revanche, le niveau de satisfaction global concernant la qualité du service fourni est inférieur à 60 % pour les tribunaux (56 %) et France Rénov' (55 %).
Quant à l'efficacité de ces services, elle peut donner lieu à des appréciations plus sévères. En effet, le service public est qualifié d'efficace dans 65 % des cas, et de « très efficace » dans seulement 33 % des cas, ce qui laisse apparaître des marges de progression évidentes, comme le montre le tableau suivant, qui classe les services publics en fonction du ressenti de leur efficacité par les usagers interrogés.
Efficacité des services publics selon le % de satisfaction des usagers
Baromètre des services publics de juin 2025 (taux moyen de satisfaction : 65 %)
|
Services publics |
% de satisfaction des usagers |
|
Mairie |
78 % |
|
France titres, France services, hôpital public |
74 % |
|
École, établissement scolaire |
72 % |
|
Pass culture |
71 % |
|
Impôts |
70 % |
|
CPAM |
67 % |
|
CARSAT, université |
66 % |
|
Urssaf, Gendarmerie |
65 % |
|
CROUS |
62 % |
|
CAF |
61 % |
|
Police nationale |
60 % |
|
MSA |
59 % |
|
MDPH |
58 % |
|
France travail |
56 % |
|
France Rénov' |
52 % |
|
Tribunaux |
51 % |
d) Un besoin affirmé de simplicité et de contact humain
En matière d'accès aux services publics, la simplicité reste une attente prioritaire pour les usagers, qu'il s'agisse de simplicité des démarches ou de simplicité d'accès à l'administration.
- Selon le Baromètre des services publics publié en juin 2025, la simplicité des démarches reste le principal point d'amélioration selon les usagers.
Ainsi, les démarches avec le service public contacté ne sont jugées simples à réaliser que dans 65 % des cas : les pompiers, le médecin, la mairie, l'école et la gendarmerie enregistrent les scores les plus élevés.
Les appréciations sont nettement plus basses pour France Rénov', les tribunaux et la MDPH (les démarches sont jugées simples à réaliser dans moins de la moitié des cas). Il s'agit de l'un des indicateurs les moins élevés de l'enquête, 13 % des usagers estiment même que leur démarche a été compliquée dans l'ensemble, ce qui rejoint la remarque de notre collègue Béatrice Gosselin : « Beaucoup d'usagers m'ont confié avoir renoncé à solliciter la prime à cause de la complexité du dispositif. Et on dit ensuite que tous les fonds n'ont pas été utilisés... »94(*).
La complexité des démarches tient à plusieurs facteurs (voir l'encadré ci-dessous), notamment le manque de clarté des informations fournies par l'administration, la difficulté à identifier le bon interlocuteur ou la complexité de la langue administrative.
Complexité des démarches - difficultés rencontrés avec les services selon le Baromètre des services publics - Juin 2025
- Le manque de clarté, de qualité de l'information fournie
- Le manque d'explications fournies
- Les documents, courriers, formulaires sont difficiles à comprendre
- La difficulté à identifier le service compétent, l'interlocuteur à contacter
- La difficulté d'accès à un interlocuteur pour obtenir une information
- La difficulté d'accès à un interlocuteur pour obtenir un rendez-vous
- Le manque d'adaptation à votre situation personnelle
- Le délai de traitement est long
- Aucune information ne vous a été donnée sur l'avancement de votre dossier
- Aucun délai ne vous a été annoncé
- Des informations disponibles parfois divergentes entre elles
Ces difficultés concernent tout particulièrement les démarches dématérialisées : selon le CREDOC « presque un Français sur deux (44 %) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches administratives en ligne »95(*).
Or les premières causes de difficulté invoquées par les répondants sont :
- la peur de se tromper,
- la mauvaise conception du site internet,
- et l'incompréhension de ce qui est demandé.
Le sentiment d'incompétence dans le domaine numérique ne vient qu'en quatrième position.
Difficultés rencontrées pour réaliser une démarche administrative en ligne
« La plupart des démarches administratives peuvent désormais se faire sur internet. Lorsque vous rencontrez des difficultés à réaliser une démarche administrative sur internet, c'est parce que ... »
Contrairement à une idée reçue, les jeunes ne sont pas épargnés par ces difficultés d'accès aux services publics. Près du quart des jeunes adultes de 18-24 ans, réputés « natifs numériques », ont « peur de se tromper » et un sur cinq ne comprend pas ce qui lui est demandé.
Le niveau de revenus génère une fracture numérique majeure : 52 % des titulaires de bas revenus déclarent rencontrer au moins une difficulté dans leurs démarches ne ligne, contre 38 % pour les hauts revenus.
Ces données ressortent du graphique ci-dessous :
Part de la population rencontrant au moins une difficulté en effectuant des démarches administratives en ligne (Source : CREDOC, Baromètre du numérique, mars 2025).
- D'après l'association Le sens du service public, on constate de la part des usagers « une forte attente de proximité, de simplification et d'accompagnement humain »96(*).
Face à des démarches considérées comme complexes, de nombreux usagers expriment un besoin de contact humain amplifié par le développement des démarches en ligne.
Ainsi, selon le Baromètre des services publics de 2025, « le téléphone apparaît comme le moyen de contact préféré par les usagers », avant le déplacement sur place, les échanges par courriel ou l'accès via un site internet. Or « Pour 38 % des répondants, le moyen de contact utilisé n'est pas le moyen de contact préféré »97(*). Ainsi, le recours à Internet (22 %) est supérieur au souhait des usagers (19 %) ; inversement, l'utilisation du téléphone (22%) est inférieure à l'aspiration des usagers à recourir à ce mode de contact (22%).
Répartition des réponses entre les différents canaux d'accès à l'administration (question « quel moyen de contact préférez-vous ? »)
|
Mode de contact |
Préférence |
Utilisation réelle |
|
Téléphone |
25 % |
22 % |
|
Sur place |
21 % |
23 % |
|
Par mail : 20 % |
20 % |
16 % |
|
Internet (via un site) |
19 % |
22 % |
|
Internet via une application mobile |
7 % |
7 % |
|
Par courrier : 4 % |
4 % |
5 % |
|
Par visioconférence |
2 % |
1 % |
|
Par tchat : 1 % |
1 % |
1 % |
|
Autre moyen : 1 % |
1 % |
3 % |
Ces observations confirment que les usagers privilégient le contact direct avec un interlocuteur, même si d'après le baromètre le canal préféré peut varier d'un service public à l'autre, avec une prédilection particulière pour certains canaux en fonction du type de service (pompiers : le téléphone ; gendarmerie, police et mairie : le déplacement physique).
Lors de son audition par la mission d'information, le ministre de ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification l'a clairement exprimé : « les usagers ne souhaitent pas toujours entrer en contact avec les services publics par la voie numérique, même si près de huit démarches sur dix sont aujourd'hui accomplies en ligne. [...] Le tout-numérique n'est pas la réponse universelle »98(*).
II. VERS DES SERVICES PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS ET ACCESSIBLES À L'USAGER : PORTRAIT D'UNE POLITIQUE PUBLIQUE
A. UN CADRE JURIDIQUE QUI S'EST PROGRESSIVEMENT PRÉCISÉ AU PROFIT DES USAGERS
1. Un engagement résolu du législateur au cours des années 2000 : simplifier le droit et supprimer de nombreuses démarches au bénéfice des usagers
a) Le tournant franchi avec la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration
La loi n° 2000-32 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dite loi « DCRA », a marqué un tournant dans la simplification des services publics, entreprise jusqu'alors de manière globale, en prenant systématiquement en compte la situation de l'usager.
En effet, cette loi a initié une évolution de trois ordres :
- premièrement, l'ambition simplificatrice, initialement cantonnée aux administrations de l'État, a été élargie à l'ensemble des collectivités territoriales, aux établissements publics ainsi qu'aux organisations de sécurité sociale, traduisant une prise de conscience générale de la nécessité de centrer l'ensemble des services publics existants sur le service de l'usager ;
- deuxièmement, les délais et modalités des procédures administratives, en particulier s'agissant de leur contestation par les usagers au moyen de différents recours, ont été harmonisés pour simplifier les démarches des usagers. Il en va ainsi du délai - désormais de droit commun - de deux mois ouvert à compter de la notification de la décision pour introduire un recours gracieux ou hiérarchique et du délai de réponse de l'administration concernée, désormais enserré dans un délai de deux mois. En l'occurrence, la loi DCRA a encadré dans le temps la décision implicite de rejet en consacrant le principe du « silence vaut rejet » par l'administration en raison du silence gardé pendant deux mois ;
- troisièmement, le législateur a souhaité obliger l'administration saisie par l'usager à rediriger elle-même les réclamations et procédures initialement adressées par l'usager aux services dont ce n'est pas la compétence.
b) La poursuite de cette dynamique dans les années 2000-2010
L'approche simplificatrice des relations entre les services publics et les usagers marquée par la loi DCRA s'est progressivement amplifiée au cours des années 2000 sous l'effet combiné de suppressions de documents ou procédures - la suppression des fiches d'état civil individuelle et familiale ou la certification conforme à l'original des copies de documents officiels - et de l'adoption de diverses lois de simplification du droit et des procédures administratives.
Ainsi, entre 2003 et 2012, près de six lois (au rythme d'une tous les deux ans) ont eu pour ambition de simplifier les démarches et procédures administratives, amplifiant le mouvement simplificateur initié en 2000. Ces lois, souvent dues à des initiatives parlementaires témoignent de l'intérêt porté à la dynamique ainsi créée de simplification, modernisation, clarification et amélioration des relations entre administrations et usagers.
- Tout d'abord, les lois n° 2003-591 du 2 juillet 200399(*) et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004100(*) ont habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances afin d'adopter diverses mesures de simplification.
- Ensuite, la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, d'initiative parlementaire et inscrite sur l'ordre du jour réservé au groupe UMP de l'Assemblée nationale, a abrogé 126 lois obsolètes et obligé le pouvoir réglementaire à faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ou sans objet. Elle a également permis des évolutions au bénéfice des entreprises101(*) et des particuliers102(*).
- Puis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit plusieurs mesures de simplification dans le champ des collectivités territoriales, notamment en élargissant des possibilités d'inscription sur les listes électorales hors période de révision aux personnes changeant de commune pour motif professionnel, en assouplissant les règles relatives à la copropriété des immeubles bâti et en ouvrant la possibilité à tous les maires de déléguer leur signature aux responsables communaux pour accélérer le traitement des demandes des usagers.
- Enfin, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, comprenant un peu moins de 200 articles, a institué un échange direct de données entre administrations au bénéfice des particuliers et des entreprises, consacrant ainsi une base légale au principe « dites-le nous une fois », principe d'importance majeure pour l'usager, qui permet d'éviter à celui-ci de transmettre plusieurs fois le même document à des administrations différentes103(*).
Le principe de non-redondance des informations demandées aux usagers avait connu une première reconnaissance à l'égard des entreprises par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin »104(*). Son article 32 prévoyait que les données relatives aux rémunérations, gains et effectifs que les employeurs sont tenus de transmettre aux organismes de protection sociale, « [feraient] l'objet d'une seule déclaration établie sur un support unique et adressée à un unique destinataire ».
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a complété la base juridique du principe « dites-le nous une fois » en l'étendant aux déclarations fiscales et sociales, prenant en compte la redondance des informations demandées par les administrations aux usagers au titre des obligations déclaratives, posant le problème de la mise en place de la plate-forme électronique - ou « coffre-fort électronique » devant permettre à chaque usager et à chaque entreprise de stocker en un lieu unique les documents nécessaires à l'instruction de ses demandes mais au traitement de ses déclarations.
Enfin, à l'égard des entreprises, les lois n° 2012-387 du 22 mars 2012105(*) et 2014-1545 du 20 décembre 2014106(*) ont modifié le droit des sociétés, les règles applicables à la commande publique et les annonces judiciaires et légales. Plus particulièrement, ces lois ont institué la déclaration sociale nominative (DSN), document unique ayant vocation, à partir du 1er janvier 2016, à se substituer à l'ensemble des déclarations sociales périodiques et ponctuelles, auquel sera par la suite adossé le prélèvement à la source.
Ainsi, au cours des années 2000 et 2010, la démarche de simplification de l'action publique s'est traduite par l'adoption de textes dont les effets concrets sont notables :
- pas moins de 150 000 démarches administratives ont été supprimées chaque année - certaines produisant à elles seules 385 000 récépissés par an, comme le récépissé fiscal de déclaration d'ouverture de succession pour les organismes d'assurance, supprimé en 2009 ;
- ainsi que 10 000 demandes d'agrément sur l'ensemble de la période ;
- bilan auquel s'ajoute l'abrogation de 133 lois devenues obsolètes107(*).
Présentant le bilan de l'activité de la commission des lois de l'Assemblée nationale au cours de la XIIIème législature (2007-2012), le président de cette commission observait qu' « une société de plus en plus complexe est non seulement une société qui exclut - car celui qui, parce qu'il est malade ou âgé, est socialement faible a beaucoup de mal à y trouver sa place et à défendre ses droits -, mais aussi une société économiquement affaiblie ; plus les procédures sont lourdes et complexes, plus les décideurs consacrent de temps à effectuer les démarches qu'on leur impose, au détriment du développement de leur entreprise »108(*), mettant en évidence à juste titre l'exposition particulière de certains usagers, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur statut social, aux difficultés imputables à des démarches administratives complexes.
2. Le prolongement des lois de simplifications : le « choc de simplification » mis en oeuvre à partir de 2013
Fort des avancées franchies grâce au législateur en matière de simplification normative, le Gouvernement entreprend de prolonger celle-ci au niveau réglementaire en initiant un « choc de simplification » annoncé en 2013.
Ainsi, comme le relève le rapport du Conseil d'État sur le dernier kilomètre, « près de 500 mesures de simplification à destination des entreprises et 300 à destination des particuliers » sont adoptées entre 2013 et 2017, par le biais d'annonces annuelles de simplifications109(*). Selon un chiffrage assuré par le Gouvernement lors de la présentation des dernières annonces de simplification, 325 mesures pour les entreprises dont 182 étaient effectives, auxquelles s'ajoutent les 90 mesures annoncées à cette occasion ; quant aux mesures pour les particuliers, celles-ci étaient chiffrées à 132 mesures, dont 71 étaient actives, auxquelles s'ajoutent les 70 mesures annoncées à cette occasion110(*).
À titre d'exemple, pour les entreprises, plusieurs mesures dites « emblématiques » de cette simplification sont adoptées, notamment celles visant à instituer une déclaration sociale nomination pour les entreprises de plus de trois cents salariés, à instituer le titre emploi service entreprise - document réunissant l'ensemble des formalités en matière d'embauche pour les entreprises de moins de vingt salariés -, à simplifier le bilan pédagogique et financier établi par les organismes de formation, à alléger les exigences en matière de vestiaire des salariés, à dématérialiser les déclarations en douane à l'exportation pour le fret express et à offrir un simulateur du coût et des aides à l'embauche aux petites et moyennes entreprises sont à noter.
S'agissant des particuliers, le choc de simplification annoncé a permis le déploiement du paiement en ligne du timbre fiscal pour l'obtention ou le renouvellement du passeport biométrique, la création d'un dossier unique de demande de logement social, le renouvellement de la carte vitale en ligne, ou encore l'estimation des droits à prestations sociales sur le site dédié mes-aides.gouv.fr.
Par ailleurs, deux nouvelles lois ont été adoptées le 12 novembre 2013 et le 2 janvier 2014 pour amplifier la simplification des relations entre administrations et usagers.
Ainsi, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a permis au Gouvernement de légiférer par ordonnances sur six objets :
- créer le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
- instituer un droit à saisir l'administration par voie électronique et à lui répondre par cette même voie ;
- élargir les possibilités de recours aux visio et audio-conférence pour permettre aux organes collégiaux des autorités administratives de délibérer ou de rendre leur avis à distance ;
- faciliter la communication d'avis donnés par un organisme ou une autorité au cours de l'instruction d'une demande pour permettre au demandeur d'améliorer son projet et de prévenir l'intervention d'une décision défavorable ;
- simplifier le régime d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- et enfin, l'institution du principe du « silence vaut accord », modifiant alors profondément les relations entre administration et usagers.
Le principe du « silence vaut accord » et ses limites
De 1864 à 2013, le principe retenu en droit administratif français était celui selon lequel « lorsqu'un délai de plus de quatre [puis deux] mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée » en application de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1900 reprenant les dispositions de l'article 7 du décret impérial du 2 novembre 1864.
Voulue par le président François Hollande comme un « choc de simplification », la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé ce principe en modifiant plusieurs articles de la loi dite DCRA du 12 avril 2000 précitée. Ces dispositions ont, depuis lors, été codifiées aux articles L. 231-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), créé en 2115 par ordonnance prise sur habilitation donnée à l'article 3 de la loi du 12 novembre 2013.
Depuis lors, en application de l'article L. 231-1 du CRPA, le « silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ».
Toutefois, très rapidement, le législateur a précisé son objectif : il ne s'agissait pas de soumettre l'ensemble des demandes adressées aux administrations à l'application uniforme du principe du silence vaut acceptation.
En effet, des limites juridiques sont intrinsèques à l'application de ce principe :
- d'une part, ce principe ne peut s'appliquer qu'aux demandes susceptibles de ne recevoir comme réponse qu'un accord ou un rejet. Un tel principe ne peut s'appliquer aux demandes portant sur une obligation de faire ou une obligation de donner. Ainsi, le silence gardé par l'administration à la suite d'une demande indemnitaire n'emportera pas versement de la somme demandée par le pétitionnaire ;
- d'autre part, ce principe est susceptible de porter atteinte aux droits des tiers en ce qu'il peut conduire à la création de droits subjectifs indus en raison d'une absence de réponse involontaire pour le demandeur, alors que les tiers se seraient vu notifier un rejet d'une demande identique.
En conséquence, l'application de ce principe fait l'objet d'un encadrement strict : ce délai ne court qu'à compter de la saisine de l'administration compétente et la décision concernée doit avoir un caractère individuel, sans présenter de caractère financier.
Par ailleurs, par la même ordonnance instituant ce nouveau principe, ont été introduites cinq exceptions de portée globale au principe du « silence vaut acceptation » à l'article L. 231-4 du CRPA, limitant encore davantage la portée de ce dernier :
- lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
- lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
- si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
- dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
- dans les relations entre l'administration et ses agents.
En outre, l'article L. 231-5 du même code précise que des exceptions au principe peuvent être prévues par décret en Conseil d'État lorsque le justifie « l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration ».
En complément, l'article L. 231-6 ouvre la faculté de prévoir, par décret, des délais autres que celui de deux mois pour fonder les décisions implicites de rejet ou d'acceptation lorsque « l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie ».
Dès lors, des dispositions législatives ou réglementaires spéciales sont venues qualifier les effets du silence gardé par certaines administrations, pendant un certain délai, face à certaines demandes, au nombre respectivement111(*) de 185 et 718, auxquelles s'ajoutent 672 exceptions de droit. L'article R. 181-45 du code de l'environnement précise, par exemple, que le silence gardé pendant quatre mois vaut rejet implicite par le préfet de certaines demandes portant sur l'adaptation de prescriptions prévues par arrêté préfectoral.
Ainsi, le nombre de procédures bénéficiant de l'application du principe « silence vaut acceptation » a atteint, d'après les travaux du chercheur Arnaud Desprairies112(*), 46 % du nombre total de procédures, soit 1 377 procédures : les exceptions à ce principe sont plus nombreuses que son application de droit commun. Toutefois, le recensement des exceptions à ce principe n'est aujourd'hui pas assuré par le Gouvernement, ce qui n'est pas sans introduire de la complexité pour les usagers.
Si l'objectif de la réforme de 2013 conduisant à multiplier les procédures SVA a été rempli, force est donc de constater que ce résultat a été obtenu en sacrifiant la lisibilité du régime du silence gardé par l'administration prévu par le CRPA.
Par ailleurs, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a permis d'utiliser de nouveaux gisements de simplification à destination des entreprises - principalement par le biais d'habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Il en va ainsi des mesures visant à étendre de la procédure du rescrit à de nouveaux champs de l'action administrative, reconnaitre de la convention de mandat permettant aux personnes publiques de recourir à un organisme extérieur pour assurer le recouvrement de certaines recettes et le paiement de certaines dépenses, supprimer de l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cessions de leur entreprise, simplifier des règles relatives aux marchés publics, alléger des obligations comptables des très petites et des petites entreprises - notamment en supprimant l'obligation de fournir l'annexe aux comptes annuels - et développer de la télé-facturation entre l'État et ses prestataires.
La délégation aux entreprises du Sénat faisait toutefois état, dans un rapport d'information publié en février 2017, d'un bilan critique du choc de simplification :
« [L']élan s'est vite dilué : trois ministres se sont succédé à ce poste en trois ans, l'organisation administrative de la simplification a manqué de stabilité, la décision de soumettre la mesure de l'impact de tout projet de loi ou de règlement à des experts indépendants ou des acteurs économiques a été annoncée en 2014 et confirmée par le Président de la République, avant d'être abandonnée en 2015. Au total, malgré son dynamisme, le Conseil de la simplification a produit des mesures en tous genres - anecdotiques, symboliques, anti-Kafka, sans-papiers, sécurisantes, en trompe l'oeil ou carrément usurpées, voire à effet boomerang -, qui forment un tableau pointilliste : l'affichage semble avoir été privilégié. L'effectivité des mesures est loin d'être assurée (43 % des mesures annoncées par le Conseil de la simplification ne sont pas effectives), du fait d'une volonté politique défaillante du Gouvernement, voire de blocages systémiques dus à la résistance de ceux à qui profite la complexité ou à l'inquiétude liée au changement »113(*).
3. Un changement de paradigme depuis les années 2010 : la consécration progressive de principes généraux de fonctionnement de l'administration et de droits nouveaux favorables aux usagers
À la suite des grandes lois simplificatrices ayant posé les jalons d'une relation renouvelée entre administrations et usagers, le législateur a progressivement consacré, depuis les années 2010, de nouveaux droits favorables aux usagers. La consécration du droit à l'erreur ainsi que du principe du « Dites-nous le une fois » ont permis un renforcement effectif et systématique de la protection des usagers, tout en obligeant les administrations à modifier significativement leurs démarches, la bonne foi des usagers étant désormais juridiquement présupposée.
a) Le droit à l'erreur
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi « ESSOC », consacre le principe d'une relation de confiance entre les usagers et l'administration, en reconnaissant aux usagers un « droit à l'erreur ». Celui-ci permet aux usagers (particuliers comme entreprises) ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à leur situation, ou qui ont commis une erreur matérielle lors du renseignement de leur situation, de ne pas se voir infliger une sanction administrative, qui consisterait par exemple en la privation de tout ou partie d'une prestation.
En application de l'article L. 100-3 du CRPA, la notion d'usager auquel s'attache le droit à l'erreur ainsi consacré est particulièrement large, car elle englobe « toute personne physique » et « toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission ».
Le droit à régularisation en cas d'erreur a été créé par l'article 2 de la loi ESSOC. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour bénéficier du droit à l'erreur : la personne ne doit pas être de mauvaise foi et elle doit avoir régularisé sa situation, de sa propre initiative ou sur invitation de l'administration.
La notion de mauvaise foi, d'origine jurisprudentielle, est désormais définie à l'article L. 123-2 du CRPA qui dispose que la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par l'administration, au même titre que celle de la fraude.
Ces dispositions sont favorables :
- aux usagers, car elles ne permettent à l'administration de sanctionner que ceux qui enfreignent volontairement les règles et qu'elles instituent une quasi-présomption de bonne foi ;
- et à l'administration, puisqu'elles incitent les usagers à régulariser leur situation de leur propre initiative, sans attendre d'y être invités dans le cadre d'une procédure contradictoire faisant suite à l'instruction de leur dossier.
Inspirée par deux dispositifs existants en droit fiscal et en droit social, ces mesures sont complétées par des dispositions spéciales progressivement élargies et systématisées :
- en matière fiscale, M. Jean-Claude Luche et Mme Pascale Gruny, rapporteurs pour la commission spéciale du Sénat en charge de l'examen du projet de loi « ESSOC », constataient que « l'article L. 62 du livre des procédures fiscales prévoit une procédure de règlement des litiges en cas de contrôle, réservée aux contribuables de bonne foi et sous réserve que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil. Il leur permet de "régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais", moyennant le paiement d'intérêts de retard à taux réduit. De surcroît, le livre des procédures fiscales fait bénéficier les contribuables d'une présomption de bonne foi à son article L. 195 A, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière : en cas de contestation des pénalités fiscales relatives à certains impôts, "la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration" »114(*). L'article L. 62 précité a été complété par la loi ESSOC afin, notamment, d'étendre la procédure de régularisation en cours de contrôle à l'ensemble des procédures de contrôle fiscal, dont celles relatives à l'examen de la situation fiscale personnelle des particuliers et aux contrôles sur pièces en général, ainsi que d'instituer un droit à l'erreur pour les redevables de contributions indirectes ;
- en matière sociale, les rapporteurs du projet de loi ESSOC relevaient que « l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale permet [déjà] à l'employeur de rectifier les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales lors de l'échéance déclarative la plus proche, sans avoir à payer les majorations de retard et les pénalités encourues. Ce droit à l'erreur ne s'applique pas en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées, acception qui se rapproche de la notion de mauvaise foi »115(*). En outre, l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'issue d'un contrôle opéré par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement ne peut être majoré de 10 % que dans le cas où « l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle ».
Le droit à l'erreur dans le domaine de la sécurité sociale a été mis en place par un décret du 11 octobre 2019116(*) qui, à la suite des dispositions introduites dans le CRPA par la loi ESSOC, a modifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale afin d'étendre dans la même logique les droits des usagers.
Cette évolution a renversé le paradigme qui s'appliquait antérieurement aux usagers : désormais, leur bonne foi est présumée juridiquement et il revient à l'administration de démontrer que ces derniers auraient intentionnellement violé une règle à laquelle ils seraient soumis.
b) La création d'un nouveau rescrit en faveur des collectivités territoriales, sur les modèles existants pour les usagers
S'inspirant des dispositions de la loi ESSOC développant les procédures de rescrits en faveur des usagers117(*), la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement et proximité », est venue consacrer un rescrit préfectoral au bénéfice des collectivités territoriales118(*) au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Son nouvel article L. 1116-1 dispose que, « avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif ». Si l'acte pris par la collectivité est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut plus le déférer au tribunal administratif, sauf changement de circonstances.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif soit saisi par toute personne remplissant les conditions d'intérêt et de qualité à agir. Comme le soulignaient, Mme Françoise Gatel et M. Mathieu Darnaud, rapporteurs du projet de loi pour le Sénat, cette procédure « s'inscrit dans le cadre d'un dialogue déjà nourri, articulé autour du contrôle de légalité des actes adoptés par les collectivités »119(*).
De façon analogue au droit à l'erreur, il revient désormais aux préfectures d'accompagner les collectivités territoriales en sécurisant juridiquement leur projet avant qu'elles les initient, se plaçant ainsi en amont de la réalisation des projets et modifiant ainsi le lien entre les préfectures et les collectivités du contrôle vers le conseil.
c) La consécration du principe du « Dites-le nous une fois »
En vertu du principe de non-redondance des informations demandées aux usagers, dénommé « Dites-le nous une fois », créé (voir infra) par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011120(*) et modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes ou déclarations de l'usager, qui ne peut être tenu de produire des informations ou données qu'il a déjà produites.
Ce principe est désormais codifié à l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA) en application de l'article 9 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique., aux termes duquel :
- les administrations échangent entre elles les informations et données requises pour traiter une demande, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel lorsqu'elles sont habilitées à connaître de ces informations et données ;
- l'administration en charge du traitement d'une demande indique à la personne concernée les éléments qui lui sont nécessaires, et ceux qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises ;
- la personne est informée du droit d'accès et de rectification dont elle dispose sur ces informations et données.
Toutefois, lorsque l'échange d'informations ou de données se heurte à une impossibilité technique - ou que les informations ou données ne peuvent être échangées en raison de leur nature -, il appartient à l'usager de communiquer les éléments à l'administration, ainsi que le prévoit l'article L. 114-10 du CRPA.
Pour en concrétiser l'effet, deux décrets du 18 janvier 2019121(*) ont organisé les conditions des échanges d'informations entre administrations et précisé la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives.
Par la suite, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », marquée par le contexte du Grand débat de 2019, a renforcé et fluidifié les échanges d'informations entre administrations, afin d'accroître l'effectivité du principe « dites-le nous une fois ».
Elle prévoit à cet effet deux mesures :
- d'une part, elle supprime l'exigence de prendre un décret en Conseil d'État pour chacun des domaines et procédures concernés par les échanges et pour fixer la liste des administrations concernées, qui était nécessaire pour chaque nouvelle ouverture de données, Désormais, le partage d'information devient la norme. À titre d'exemple, le décret d'application122(*) - désormais décret simple et applicable à l'ensemble des administrations limitativement énumérées - impose à la direction générale des finances publiques de mettre à disposition des autres administrations la situation d'un foyer fiscal ;
- d'autre part, elle autorise les échanges qui permettent d'informer de manière proactive les usagers sur leurs droits, dans une logique de prévention du non-recours destinée à éviter que des personnes ne se prévalent pas de droits qu'elles ont pourtant vocation à percevoir ou ne sollicitent pas le bénéfice d'un avantage ou d'une prestation, souvent par ignorance de leur éligibilité à ce droit.
Ce mécanisme demeure encadré dans la mesure où :
- les données recueillies dans le cadre de ces échanges ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'information des usagers, (à titre d'exemple, elles ne pourront servir à la détection d'une fraude) ;
- les usagers sont informés de leurs droits d'accès et de rectification, ainsi que du droit d'opposition à la poursuite du mécanisme et de la possibilité, pour ces usagers, de produire eux-mêmes les données requises ;
- si le droit d'opposition est exercé par l'usager, ou si le mécanisme démontre que l'usager n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations recueillies dans le cadre de l'échange sont détruites.
À l'image de ce que prévoit déjà la loi s'agissant des échanges d'informations à la suite de demandes d'usagers, ce dispositif renvoie à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL le soin de fixer la durée et les modalités de conservation des données collectées dans le cadre du mécanisme d'échange aux fins d'information des usagers. Aujourd'hui, le décret n° 2023-361 du 11 mai 2023 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre de démarches administratives prévoit une durée de conservation ne pouvant excéder douze mois.
Cette évolution doit permettre, si elle est correctement déployée, de simplifier les démarches de l'ensemble des usagers et confère, au surplus, un rôle proactif en la matière aux administrations qui peuvent attribuer automatiquement des droits et prestations en se fondant sur des informations obtenues par un échange avec d'autres administrations.
d) La déconcentration systématique des décisions administratives individuelles pour simplifier l'action publique
La volonté d'alléger les contraintes pour les entreprises comme pour les citoyens a aussi inspiré la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « loi ASAP », qui procède notamment à la déconcentration au niveau des préfets d'un certain nombre de décisions administratives (agréments des centres de formation d'une association sportive, la qualité et la sécurité des productions végétales et animales, les décisions dans les domaines de l'eau et de la biodiversité, etc.)
Ainsi, comme l'indique le rapport précité du Conseil d'État sur le dernier kilomètre de l'action publique, « 99 % des décisions administratives individuelles devraient ainsi désormais être prises au niveau déconcentré »123(*), rapprochant de ce fait les usagers des administrations.
Au surplus, la loi ASAP comporte diverses mesures visant à alléger certaines démarches administratives pour les particuliers (dispense de justificatifs de domicile pour l'obtention des cartes d'identité, passeports et permis de conduire, formalités d'ouverture d'un livret d'épargne populaire facilitées) comme pour les entreprises (règles de la commande publique assouplies pour les PME, vente en ligne de médicaments facilitée pour les pharmaciens).
e) La consécration jurisprudentielle d'un droit à l'accès multicanal pour les démarches complexes
Parachevant la consécration par le législateur de nouveaux droits et principaux généraux au bénéfice des usagers, le Conseil d'État a récemment consacré, dans une décision du 3 juin 2022124(*), le droit à un accès multicanal pour les démarches les plus complexes, excluant ainsi l'utilisation obligatoire d'un téléservice pour assurer certaines démarches administratives sans garanties.
Plus précisément, en ce qui concerne l'obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice, si la haute juridiction a considéré que cette obligation « ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », elle a toutefois estimé que « le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits »125(*).
Le Conseil d'État a ensuite établi une grille de lecture de l'application de ce tempérament à l'introduction d'une obligation de recours à un téléservice, en imposant au pouvoir réglementaire de tenir compte :
- « de l'objet du service,
- du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés,
- des caractéristiques de l'outil numérique mis en oeuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement »126(*).
Selon cette décision, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer, pour chaque téléservice, les garanties appropriées afin que le numérique ne conduise pas à une exclusion du service public. Ces garanties doivent désormais être définies en fonction notamment de la complexité des procédures en cause et des conséquences sur la situation des usagers. Il convient dès lors au pouvoir réglementaire de prévoir, de manière complète, le dispositif de fonctionnement du téléservice au regard du principe d'accès au service public, y compris une substitution en cas de dysfonctionnement dans des cas particuliers.
En l'espèce, le Conseil d'État a considéré que l'obligation faite aux ressortissants étrangers de présenter certaines demandes de titre de séjour par la voie d'un téléservice, en ce qu'elle ne comportait pas d'exception en cas d'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de l'outil ou à son mode de fonctionnement, était illégale. Il fixe, en outre, deux conditions pour le redéploiement d'une telle obligation :
- les usagers ne disposant pas d'un accès aux outils numériques ou rencontrant des difficultés dans leur usage doivent pouvoir être accompagnés ;
- l'administration doit garantir une solution de substitution aux usagers qui sont dans l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à sa conception ou à son mode de fonctionnement.
Cette évolution jurisprudentielle a ensuite été confirmée par une décision du 31 octobre 2023 du Conseil d'État, qui a estimé que l'obligation de candidater via une plateforme dématérialisée intitulée « mon master » pour accéder à une première année de master à l'université était légale. En effet, il a jugé que cette plateforme, bien que ne proposant pas de solution de substitution ou d'accompagnement, était destinée à un public jeune et familier des usages numériques, et qu'in concreto, ce téléservice n'avait pas connu de dysfonctionnements majeurs justifiant la mise en place de solutions de substitution127(*).
Une telle évolution jurisprudentielle permet de tenir compte des besoins et difficultés de certains usagers en ce qu'elle pose des limites à la dématérialisation complète des procédures administratives et impose le déploiement de solutions de substitution sans pour autant obérer les capacités des administrations à utiliser des solutions dématérialisées lorsque celles-ci présentent des avantages pour les usagers, les agents et les administrations.
B. DES ENGAGEMENT FORTS POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE L'USAGER
La politique publique qui vise à améliorer l'accès aux services publics, parallèlement à la poursuite leur dématérialisation, est portée par quatre acteurs administratifs principaux (DITP, DINUM, DILA et ANCT). Elle s'inscrit dans le cadre des orientations définies par le Comité interministériel de la transformation publique (CITP).
1. Les acteurs de l'accès aux services publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?
- Sous l'autorité du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), dirigée par le délégué interministériel à la transformation publique, a pour missions de coordonner et d'animer les travaux d'amélioration de l'action des administrations au profit des usagers.
Missions de la DITP (décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique) :
- la DITP promeut les actions permettant de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des agents et des partenaires de l'État, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;
- elle coordonne et accompagne les actions de simplification et d'allégement des formalités administratives ;
- elle est associée aux travaux menés pour l'amélioration du langage administratif.
Son service « Expérience usagers » « coordonne et anime les travaux des administrations pour l'amélioration de l'accès aux services publics et la qualité du service rendu aux usagers, la simplification des démarches et du langage administratifs »128(*).
La DITP, et plus particulièrement son service « Expérience usagers », est donc « chargée d'assurer, au niveau interministériel, le suivi et l'amélioration de la qualité, de la simplicité et de l'accessibilité des services publics, et de veiller à ce que l'usager soit au centre de la conception des services publics mais aussi de leur évaluation »129(*).
- Placée sous l'autorité conjointe du Premier ministre et du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la direction interministérielle du numérique (Dinum), dirigée par le directeur interministériel du numérique, a pour mission d'élaborer la stratégie numérique de l'État et de piloter sa mise en oeuvre.
La Dinum, créée en octobre 2019, est l'héritière :
- de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État (Disic) créée en 2011 et rattachée aux services du Premier ministre et au secrétariat général du Gouvernement (SGG) ;
- devenue la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (Dinsic), placée sous l'autorité du ministère chargé du numérique, par délégation du Premier ministre.
À compter de juillet 2020, le ministère de la transformation et de la fonction publiques, tout récemment créé, « a autorité sur la Dinum », sans mention de la délégation du Premier ministre. Enfin, en avril 2023, un nouveau décret complète les missions de la Dinum, rattachée aux services du Premier ministre et au secrétariat général du Gouvernement.
La promotion de la dématérialisation des formalités administratives fait partie de ses missions.
Dans ce cadre, la Dinum :
- « veille à la qualité des services numériques proposés au public par les administrations » ;
- « conduit des projets d'exploitation de données pour renforcer l'efficacité des politiques publiques et améliorer les services rendus aux usagers »130(*).
À titre d'exemple, la Dinum met à la disposition des ministères des ressources adaptées à la numérisation de leurs services, tels que FranceConnect, moyen unifié d'authentification qui permet aux usagers de se connecter aux services publics avec les mêmes identifiants ; ou la plateforme « démarches simplifiées » sur laquelle ce rapport reviendra ultérieurement.
Elle pilote le suivi de l'utilisation des « 250 démarches essentielles » dont un observatoire en ligne (« vos démarches essentielles »), lancé en 2019, permet un bilan trimestriel. Les démarches essentielles sont dotées d'un bouton « je donne mon avis », qui permet d'évaluer la satisfaction de l'usager.
Via sa brigade d'intervention numérique, qui regroupe des « experts de différents domaines du numérique », la Dinum est en mesure d'assurer aux ministères et aux opérateurs un soutien et un accompagnement adaptés, afin que leurs produits numériques soient conçus de manière à « rendre le maximum de service aux usagers »131(*).
En outre, la Dinum « anime, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le dialogue et la collaboration avec les collectivités territoriales et leurs représentants dans l'objectif d'améliorer la qualité et la performance des services numériques publics fournis aux usagers, et renforcer les synergies et le partage entre le système d'information et de communication de l'État et les systèmes d'information des collectivités territoriales »132(*).
L'exemple du Royaume Uni, où la transformation numérique des services publics (« Government as a platform ») s'est développée à partir de 2010, confirme l'intérêt d'un modèle fondé sur un pilotage interministériel, assurant la mutualisation d'outils et d'infrastructures.
La numérisation des services publics
britanniques :
le Government Digital Service
(GDS)133(*)
Jusqu'en 2010, la numérisation des services publics britanniques a été mise en oeuvre par des initiatives non coordonnées, les ministères et agences développant chacun leur propre portail ou service numérique, souvent sans interopérabilité.
Cette approche ayant conduit à des plateformes disparates et peu lisibles pour l'usager, une démarche structurée de transformation numérique de l'État s'est mise en place à partir de 2010 sous l'impulsion du Government Digital Service (GDS), rattaché au Cabinet office et chargé de piloter la transition numérique des services publics.
Au niveau central, une équipe positionnée en interministériel pilote la transformation numérique en créant des plateformes numériques communes (comme des systèmes d'authentification, de paiement, de gestion d'identité, etc.) ; offrant des outils réutilisables par tous les ministères et agences, en fournissant des standards communs, de manière à garantir l'interopérabilité, l'accessibilité et la simplicité des services publics en ligne, et en concevant l'administration comme un écosystème numérique modulaire de préférence à un ensemble de services cloisonnés.
Dans un rapport sur le pilotage de la transformation numérique de l'État par la Dinum, publié en 2024134(*), la Cour des comptes observe notamment :
- une « instabilité organisationnelle » à l'origine d'un défaut « d'impulsion politique durable » dont aurait pâti la stratégie numérique de l'État : « Depuis 2011, pas moins de sept décrets ont ainsi restructuré l'organisation et réformé les missions de la direction en charge de la transformation numérique de l'État, au gré des évolutions des rattachements administratifs et de tutelles ministérielles » ;
- la pertinence d'une réflexion sur le positionnement institutionnel de la Dinum, « en privilégiant une assise interministérielle durable » ;
- une « multiplicité de vecteurs budgétaires » rendant nécessaire une « simplification de la gestion budgétaire » de l'action publique numérique ;
- une gestion des ressources humaines complexe en raison de « conditions de recrutement difficiles dans un secteur très concurrentiel », dans le contexte de « l'important enjeu que constitue la construction d'une filière des ressources humaines du numérique ».
- La direction de l'information légale et administrative (DILA), placée sous l'autorité du secrétariat général du Gouvernement, fait partie des services du Premier ministre.
Historiquement chargée de l'édition du Journal officiel et de Légifrance (« service public de la diffusion du droit »), la DILA assure la publication :
- du site vie-publique.fr, dont l'objectif est de mettre à la disposition des citoyens, à partir de sources publiques, une information complète et à jour sur l'actualité politique, économique, sociale et européenne ; il publie ainsi de nombreuses fiches sur le fonctionnement des institutions (collectivités territoriales, finances publiques, protection sociale...) et l'organisation de l'Union européenne ; la rubrique « panorama des lois » permet de suivre en temps réel toute l'actualité législative ;
- de l'annuaire de l'administration française, qui permet aux usagers d'identifier l'adresse et le numéro de téléphone d'un guichet près de chez eux, notamment dans le réseau des France Services ;
- du site officiel de l'administration française service-public.fr, auquel ce rapport consacre ci-après un développement particulier, qui met à la disposition des usagers un large spectre d'informations et permet en outre de réaliser des démarches administratives en ligne : complété par l'information administrative téléphonique (allô service public ou 3939), il constitue le « premier point d'entrée dans l'administration »135(*).
- Enfin, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) assure la responsabilité du programme France services au niveau national, les préfets intervenant en tant que délégués départementaux de l'ANCT pour piloter cette politique publique au niveau départemental.
Ces quatre acteurs (DITP, Dinum, DILA et ANCT) travaillent en partenariat dans une logique de complémentarité.
Ainsi, DITP et Dinum « abordent la question de la modernisation de l'État par des prismes différents et complémentaires », la Dinum se concentrant principalement sur les aspects technologiques et numériques alors que la DITP « inclut des questions d'organisation, de qualité de service, de territorialisation, de design... »136(*), mais collaborent sur des projets où leurs compétences se croisent, comme la simplification des démarches en ligne.
À titre d'exemple, la Dinum travaille avec la DILA à un projet destiné à « [permettre] aux usagers d'accéder à une vue personnalisée de leur situation administrative (mes données, mes rendez-vous, mes démarches en cours) ainsi qu'à une offre de service adaptée, géolocalisée et filtrée selon les intérêts de chaque utilisateur »137(*). Un partenariat entre la Dinum, la DITP et la DILA vise, à partir de fiches de Service-public.fr, à expérimenter l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative pour faciliter le travail des agents des France services138(*).
2. De la priorité au numérique à une attention croissante aux attentes des usagers : l'évolution des perspectives définies depuis 2018 au sein du comité interministériel de la transformation publique (CITP)
Entre février 2018 et mai 2024, le Comité interministériel de la transformation publique (CITP)139(*), présidé par le Premier ministre, s'est réuni huit fois. Les priorités définies à chacune de ces sessions montrent l'évolution, sur une période de quelque six années, du lien entre transformation publique et transformation numérique : la priorité au numérique, affichée en 2018, a évolué pour intégrer systématiquement des attentes des usagers telles que la proximité territoriale des services publics et la nécessité d'assurer un accueil téléphonique.
· Février 2018 : la transformation numérique, condition de la transformation publique
La première réunion du CITP a eu lieu en février 2018, dans la foulée du lancement du programme Action publique 2022 précédemment évoqué. L'objectif était, à partir de la transformation numérique de l'administration, de définir un « nouveau modèle de conduite des politiques publiques [ayant] pour ambition de renouer les fils de la confiance entre les agents et les usagers »140(*). Dans cette logique, l'ambition de « simplification d'un nouvel ensemble de démarches » s'adresse aux usagers, les agents devant avoir « l'opportunité de se libérer de tâches administratives répétitives au profit de missions d'accompagnement des usagers ».
La transformation publique est donc engagée sous l'angle quasi unique de la transformation numérique, présentée comme « au service de tous » : elle constitue « le moyen de nous rapprocher des citoyens, d'améliorer la qualité des services publics rendus, de leur facilité les démarches, d'être à leur écoute, de leur répondre simplement ». En corollaire est pris l'engagement d'« accompagner spécifiquement les plus éloignés du numérique ».
Le Gouvernement fixe comme objectif, au 1erjanvier 2022, de rendre la totalité de ses services publics accessibles en ligne, avec un calendrier accéléré pour les démarches suivantes : demandes de CMU-C/ACS, formalités de rentrée scolaire (demandes de bourses de lycée sur critères sociaux), aide juridictionnelle, demandes de permis de construire et démarches d'urbanisme.
· Octobre 2018 : l'esquisse d'une volonté de « réinventer les services publics de proximité » parallèlement à l'accélération des chantiers numériques
Tandis que la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) « trace la voie vers un État plus bienveillant, en instaurant notamment un droit à l'erreur pour les particuliers et les entreprises, qui sont présumés de bonne foi »141(*), le Gouvernement confirme l'objectif de 100 % des démarches accessibles en ligne à l'échéance de 2022. L'outil demarches-simplifiees.fr142(*) est mis à la disposition des administrations qui souhaitent s'engager dans la dématérialisation143(*).
La publication, par les administrations, d'indicateurs de résultats et de qualité de service vise à renforcer la transparence sur l'efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers.
En parallèle, le Gouvernement affirme la volonté de « réinventer les services publics de proximité ». Partant du principe que « la présence physique des services publics sur le territoire est une source de cohésion nationale et de réduction des inégalités », le CITP affiche l'ambition de « tirer parti des opportunités offertes par la révolution numérique pour créer de nouveaux services publics de proximité ». Est ainsi annoncée « l'expérimentation au niveau territorial de la construction de nouveaux points de contact pour les usagers ». Les chantiers lancés sur la base de cette réflexion visent le déploiement de « guichets multiservices et polyvalents communs à l'État, aux collectivités et aux opérateurs, qui permettront aux usagers de réaliser, en un même lieu, les démarches les plus utiles et les plus demandées ».
· Juin 2019 : après la crise des Gilets jaunes et le Grand débat national, l'affirmation de l'ambition de « replacer l'usager au coeur du service public »
L'annonce d'un « acte II pour la transformation de l'action publique »144(*) tire les conséquences de la crise des Gilets jaunes et du Grand débat national. Ainsi, les chantiers mis en oeuvre visent :
- le déploiement du réseau France Services (ouverture de 300 implantations France services dès janvier 2020) ;
- le renforcement de l'accompagnement humain à distance par une « réponse téléphonique rapide et efficace » ;
- la simplification du langage administratif, objectif qui s'incarne dans le développement d'une plateforme en ligne, le FormLab, pour signaler les documents problématiques : le choix des usagers susceptibles de faire cette démarche, par définition habitués aux usages du numérique, est toutefois de nature à introduire un biais dans le repérage de ces documents.
· Novembre 2019 : dématérialisation et accompagnement des usagers mis en difficulté par le « tout numérique »
Les objectifs définis par le quatrième CITP s'inscrivent dans la volonté de « rapprocher les administrations des citoyens et des territoires », de « mieux associer les agents à la prise de décision et au suivi des réformes » et de « mettre le numérique au service de l'efficacité publique ».
La dématérialisation des services publics doit aller de pair avec une « plus grande attention portée à la qualité et à l'accompagnement des usagers en difficulté »145(*).
Le mouvement de déploiement des espaces France Services se poursuit : il s'agit de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, distant de moins de 30 minutes de leur domicile, l'objectif étant de couvrir chaque canton par au moins une structure France Services à l'échéance de la fin de 2022.
Conduit d'abord dans six départements pilotes (Ardennes, Calvados, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Vaucluse et Vendée), le déploiement vise dans chaque structure labellisée l'accompagnement des démarches à l'égard de six opérateurs (La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale d'assurance maladie, Caisse nationale d'assurance vieillesse, Caisse nationale d'allocations familiales, Mutualité sociale agricole), et trois administrations partenaires (intérieur, impôts et justice).
L'Observatoire de la dématérialisation, créé en juin 2019, rend compte chaque trimestre de la numérisation de 250 démarches administratives jugées emblématiques sur la base de critères quantitatifs.
Le principe « dites-le-nous une fois », évoqué précédemment, vise des échanges automatiques de données entre administrations146(*), soumises à autorisation de l'usager, pour permettre le pré-remplissage de six démarches administratives en ligne : demande d'allocation logement ; simulation de droits sociaux ; demande de prime d'activité ; aide au logement étudiant ; demande ou renouvellement de logement social ; recensement citoyen obligatoire.
À l'attention des usagers rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le Gouvernement lance l'expérimentation Aidants Connect, outil permettant à un aidant professionnel de réaliser les démarches administratives en ligne pour le compte d'une personne, sans solliciter ses mots de passe.
· Février 2021 : après la crise sanitaire, accélération des réformes : numérisation, simplification des démarches et développement de l'accès téléphonique aux services publics
Le cinquième CITP tire les enseignements de la crise sanitaire, qui a « renforcé chez les Français un « "besoin de service public" »147(*). Il définit parmi ses priorités :
- la simplification des démarches et de la communication administratives : la « simplification accélérée de 10 démarches emblématiques jugées trop complexes par leurs usagers, particuliers ou entreprises148(*), comme par les agents et de 100 formulaires administratifs » ;
- la mise en oeuvre des réformes en partant du terrain, dans la logique du « dernier kilomètre », et le réarmement des services de l'État dans les territoires149(*) ;
- la simplification des démarches en ligne par l'accélération de la mise en oeuvre du principe « dites-le nous une fois », l'objectif étant que « l'échange de données entre administrations devienne la règle et non plus l'exception »150(*) ;
- la garantie d'un accès téléphonique sans surfacturation à tous les services publics, tous les sites internet publics ayant l'obligation d'afficher un numéro de téléphone pour pouvoir être contactés par ce canal ; les services publics s'engagent à assurer à terme un taux de décroché de 85 %.
Cette priorité tire les conséquences du besoin d'« aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou comme voie de recours dans les démarches complexes », et du constat que « le téléphone est le canal le plus utilisé par les usagers pour contacter l'administration (29 % des usagers déclarent utiliser en premier lieu le téléphone) et arrive au second rang des moyens de contact préférés, après l'accueil physique »151(*).
Le bilan des précédents engagements du CITP établi lors de cette cinquième session fait par ailleurs apparaître :
- l'existence de 1 123 espaces France services ouverts ou labellisés en métropole et dans les territoires ultramarins ;
- la reconnaissance de plus de 323 000 « droits à l'erreur » depuis 2019, dont plus de 162 000 dans les caisses d'allocations familiales (CAF) ; plus de 48 000 entreprises ont ainsi, en mai 2020, bénéficié d'une division par deux des intérêts de retard au titre de cotisations dues aux Urssaf (hors mesures Covid-19) et environ 2 millions d'erreurs ont été détectées à l'initiative de l'administration en faveur des usagers depuis 2019.
· Juillet 2021 : accélérer et adapter les politiques publiques à la réalité des territoires
L'objectif est, parallèlement à la poursuite des précédents engagements, de poursuivre le travail de réarmement de l'État territorial, avec le droit de dérogation et le développement de l'expérimentation reconnu au préfet ainsi que l'accent mis sur les effectifs des services déconcentrés.
Le bilan des engagements précédents présenté lors de cette sixième session est le suivant :
- 1 494 espaces France Services ont été labellisés au 1er juillet, l'objectif étant à la fin de 2022 d'atteindre 2 500 ;
- 85 % des 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français sont dorénavant réalisables en ligne ;
- au 30 juin 2021, 76 % des principaux réseaux de service public en contact avec les usagers affichent un numéro de téléphone sur leur site Internet ; 16 % de ces réseaux ont un résultat supérieur ou égal à 85 % ; tous les services publics ont mis fin à la surfacturation des appels téléphoniques ;
- en ce qui concerne le « dites-le nous une fois », 110 collectivités sont raccordées au calcul automatique du tarif de la carte de transport grâce aux informations du revenu fiscal de référence, du quotient familial et du statut étudiant et boursier.
· Mai 2023 : « placer les Français au coeur de l'action publique pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces »
Parmi les priorités du septième CITP, définies alors que « la refondation des services publics tient une place importante dans la feuille de route du Gouvernement »152(*), on relève :
- la nomination dans chaque département d'un sous-préfet chargé de la qualité et de l'accès aux services publics, dans la logique de responsabilités accrues confiées aux préfets en matière de coordination de l'accès aux services publics et de la qualité du service rendu à nos concitoyens ;
- l'importance attribuée à la méthode des « moments de vie » pour « simplifier la vie des Français », qui consiste à penser l'échelonnement des démarches administratives en se mettant à la place de l'usager en fonction de ses impératifs du moment. Cinq moments de vie ont été plus spécifiquement visés pour 2023 : Je deviens étudiant ; j'établis mon identité ; je pars ; je vis ; je reviens de l'étranger ; je rénove mon logement ; je perds un proche. L'objectif est d'analyser la complexité des démarches et des difficultés survenant dans le parcours des usagers en s'appuyant sur leur ressenti et leur expérience, loin de la logique de silo souvent propre aux administrations ;
- l'élargissement des offres du réseau France Services (France Rénov', CNOUS), le développement de formules mobiles, dans une logique d'« aller vers », et l'ouverture de nouveaux points à travers la France (objectif à la fin de 2023 : 2 750 lieux d'accueil ; 95 % des Français disposant ainsi d'un France services à moins de 20 minutes de chez eux) ;
- la mise en oeuvre du Plan téléphone pour améliorer la qualité de ce canal d'accueil privilégié par les usagers, avec l'objectif réaffirmé d'un taux de décroché de 85 % et le lancement de nouvelles fonctionnalités (prise de rendez-vous et rappel pour éviter l'attente).
- le recours aux évaluations des usagers, dans le cadre du programme « Services Publics + », qui permet à chacun de commenter les démarches effectuées et de partager d'éventuelles mauvaises expériences avec l'administration.
· Avril 2024 : « débureaucratiser l'action publique pour des services publics plus proches, plus simples et plus humains »153(*)
Le huitième CITP a défini comme priorités :
- la poursuite du développement de l'« aller vers », du travail de simplification de la langue administrative et de la suppression des formulaires inutiles (parallèlement à la simplification et au pré-remplissage des formulaires restants) ;
- l'extension de la méthode des « Moments de vie » à deux nouveaux parcours usagers en 2024 (« Je deviens parent » et « Je scolarise un enfant ») ;
- le développement du réseau France Services, le nombre de structures devant atteindre 3 000 au total à la fin de 2027, avec une offre de services étendue à l'Urssaf et un maillage territorial prenant davantage en compte les besoins des villes moyennes ;
- l'amplification du Plan téléphone : dix services proposent des rendez-vous téléphoniques à leurs usagers (France Titres, CNAF, CNAM, CNAV, CNOUS, DGFIP, MSA, France Travail, Urssaf, France Services).
3. Trois objectifs majeurs : des services publics plus simples, accessibles par divers canaux et centrés sur les besoins de l'usagers
a) Chasser la complexité : le travail de simplification engagé par la DITP
La simplification des procédures et des usages de l'administration fait partie des missions confiée à la DITP, qui a lancé un ensemble de chantiers afin de diffuser progressivement dans l'administration une culture du langage clair et de la simplicité.
Ces objectifs font écho à une remarque exprimée le 13 mai 2025 devant la mission d'information par M. Jean-Denis Combrexelle, auteur de Les normes à l'assaut de la démocratie : « Le principe fondamental devrait être de transférer la complexité de l'usager vers l'administration. En effet, ce n'est pas à l'usager de gérer la complexité administrative, mais à l'administration de gérer sa propre complexité ».
Notre collègue Hugues Saury, vice-président, soucieux de « trouver un équilibre entre protection juridique, sécurité et lisibilité sans tomber dans la dérégulation ou l'inefficacité administrative », ayant posé la question de la possibilité d'un « "grand soir" de la simplification normative en France », M. Jean-Denis Combrexelle ajoutait toutefois : « Un « grand soir » de la simplification, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut emprunter la voie de la tache d'huile, c'est-à-dire réussir dans un domaine puis étendre progressivement à d'autres secteurs »154(*).
(1) Simplifier les procédures
Dans ce but, la DITP conduit le programme France simplification, guichet interministériel créé par le CITP d'avril 2024. Selon le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification155(*) Laurent Marcangeli : « conçu pour réduire les "irritants" au plus près du terrain, ce dispositif, à la main des préfets, vise à apporter des solutions rapides aux blocages rencontrés dans la mise en oeuvre des projets des différents acteurs. Il commence à porter ses fruits, avec 465 dossiers traités depuis le second semestre 2024, dont 350 résolus » 156(*).
Plus précisément, selon la DITP qui assure le secrétariat du programme, les préfets font « remonter des blocages rencontrés par les acteurs locaux (services déconcentrés ; collectivités...) du fait d'interprétations divergentes de la norme entre échelons central et local, de vides juridiques ou bien d'une culture administrative trop centralisatrice, quand ceux-ci ne peuvent être traités par le pouvoir d'initiative locale et de dérogation dont disposent les préfets »157(*).
La DITP assure aussi le « suivi des plans de simplification des ministères, lancés en 2024 et en cours de renouvellement pour 2025, qui synthétisent l'ensemble des mesures déclinées par chaque champ ministériel pour simplifier la vie de ses agents et de ses usagers ». Ainsi ont été mis en place le pré-remplissage des bourses étudiantes pour les familles des collégiens et lycées ou encore la simplification des critères d'évaluation physique pour faciliter le recrutement dans la réserve opérationnelle des armées.
Enfin, la DITP assure la mise en oeuvre du « dites-le nous une fois », élément essentiel de la simplification administrative, abordé plus en détail infra.
(2) Simplifier le langage administratif
La DITP, qui a créé à l'attention des agents des « kits pour des formulaires simples à remplir, compréhensibles et accessibles », a également mis en place les « Simplificathons », destinés à « accompagner les administrations dans la simplification de leurs écrits et formulaires à destination du public dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective associant agents publics et usagers pour identifier les pistes d'amélioration des démarches/formulaires, prototyper une nouvelle version et la tester avec les usagers ».
Cependant, leur lancement au niveau départemental, prévu en 2025, n'a, selon la DITP, pas encore été acté. En revanche, la démarche trouve un relais dans les travaux de certains laboratoires interministériels d'innovation territoriale (LIIT), comme l'indique la DITP : « NéoLab (laboratoire d'innovation territoriale de Nouvelle-Aquitaine) et le LAB académique du rectorat de Bordeaux ont tenu un premier Simplificathon le 26 novembre 2024 portant sur la simplification de documents administratifs, à l'aide de la "Boite à outils" sur le langage clair de la DITP et la tenue d'ateliers de mise en pratique sur les documents des participants ».
La DITP suit également la simplification des Cerfa, qui est un combat ancien. Jean-Denis Combrexelle, lui-même ancien rapporteur de la commission de simplification administrative, observe ainsi que « la complexité de la construction de la norme en amont traduit en aval par des formulaires incompréhensibles [...]. Les formulaires relatifs aux prestations sociales sont conçus selon les mêmes raisonnements que ceux qui ont conduit à la création des formulaires fiscaux, lesquels s'adressent principalement à des entreprises disposant des moyens d'interpréter ces dispositifs complexes »158(*).
Ce chantier va de pair avec l'initiative « Démarches simplifiées », explorée plus en détail infra, qui consiste à aider les administrations à créer elles-mêmes leur formulaire numérique.
Ce travail de longue haleine, qui peut se comparer à un détricotage progressif de la complexité administrative, se déploie dans les administrations. Ainsi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse indique : « après la simplification de 8 Cerfa, l'Assurance retraite mène actuellement des travaux de réécriture de ses courriers les plus complexes. L'avis de panels d'assurés sera sollicité avant leur généralisation (notification de DP, agora multiCarsat). Elle participe aux travaux interministériels sur le sujet (projet de formation au Langage Clair, expérimentation à venir de kit d'aide à la rédaction ou d'IA)159(*). » L'Assurance maladie indique, quant à elle, participer au groupe de travail « langage clair » animé par la DITP160(*).
La rapporteure ne peut que se féliciter qu'un travail réclamé de longue date par les Français ait enfin été engagé de façon systématique, avec un mandat clairement donné à la DITP. Ainsi se diffusera progressivement, parmi les fonctionnaires, une culture de la simplicité des procédures et de la langue administrative.
Attention cependant, en s'éloignant du langage bureaucratique, à ne pas verser dans un autre jargon, celui du monde de l'entreprise et particulièrement des start-ups, qui semble parfois imprégner les productions de la DITP avec des termes assez peu transparents tels que « simplificathon » ou « laboratoire interministériel d'innovation territoriale ».
b) L'omnicanalité : une évolution essentielle pour l'usager
Prenant acte des nombreuses attentes des usagers en difficulté face à la dématérialisation de multiples procédures administratives, le Gouvernement et les administrations ont entrepris de diversifier les canaux d'accès des usagers aux administrations.
D'après les données inscrites dans le dossier de presse du CITP du 23 mai 2023, il est estimé que, parmi les quelque 200 millions de sollicitations adressées aux services de l'État et de la sécurité sociale, près de 43 % des contacts passaient par le téléphone, suivi du numérique (32 % des contacts), puis de l'accueil physique (15 %) et du courrier (10 %).
En effet, sans remettre en cause les effets bénéfiques de la dématérialisation, la diversité des besoins, la complexité de certaines situations et le savoir-faire numérique hétérogène des usagers ont conduit à des évolutions visant à garantir l'omnicanalité, c'est-à-dire à prévoir systématiquement des possibilités de contact entre les usagers et l'administration par d'autres canaux que la voie numérique.
Ainsi, le Gouvernement a déployé deux grandes mesures à l'occasion du CITP de 2023 : « L'accès aux services publics doit continuer à s'adapter, pour être en phase avec les usages et les attentes des Français », autour de deux priorités :
- « Pour tous les Français, améliorer les services numériques et la qualité du support téléphonique ;
- Pour ceux qui en ont le plus besoin, continuer à développer un accueil physique de proximité, humain et polyvalent. C'est pour ceux de nos concitoyens les plus éloignés des démarches administratives qu'il nous faut investir pour s'adapter le mieux possible à leurs besoins et leurs attentes »161(*).
Plus précisément, le Plan téléphone a pour objectif de faciliter l'accès aux services publics, notamment via une meilleure gestion des contacts téléphoniques.
Dans ce cadre, une série d'ateliers a été organisée par la DITP pour améliorer les échanges téléphoniques entre les usagers et l'administration. Au cours des échanges organisés avec les services publics, les solutions d'autonomisation et le rappel téléphonique automatique sont apparus comme des leviers d'amélioration, répondant à la fois aux attentes d'autonomie des usagers et à l'enjeu d'efficacité des services publics. Des groupes de travail ont ainsi été organisés pour instruire ces thématiques et aboutir à la conception de deux guides, désormais consultables en ligne : le premier destiné à mettre oeuvre le rappel automatique, le second détaillant les solutions qui permettent de répondre rapidement aux questions les plus simples des usagers tout en visant leur autonomisation dans les démarches.
Par ailleurs, le Plan téléphone fixe un objectif ambitieux de taux de décroché supérieur à 85 % par agent, alors que le taux moyen observé, aujourd'hui de 78 %, comporte de grandes disparités. Depuis l'annonce du plan, sept d'entre eux ont atteint ou dépassé un taux de décroché par un agent de 85 % : Anah, Crous, France Consulaire, France Travail, Gendarmerie nationale, MSA, Urssaf.
Au surplus, avec le Plan téléphone, les services publics s'engagent à mesurer la satisfaction de leurs usagers : sur les 18 services publics déjà engagés dans cette évaluation, le taux moyen de satisfaction est passé de 80 % à 84 %entre 2023 et 2024162(*).
Si la rapporteure ne peut que souscrire pleinement à ces annonces gouvernementales, force est de constater que nombre de démarches administratives ont déjà basculé dans l'utilisation unique de la voie numérique, voire ont tardé à rétablir un canal téléphonique parallèle malgré les obstacles auxquels ont été confrontés des usagers, comme le montre la déclaration fiscale sur les propriétés immobilières, qui a mis en difficulté nombre d'usagers faute de ligne téléphonique dédiée. Or la mission d'information est convaincue de la nécessité de préserver un canal autre que le numérique pour joindre l'administration. Ce rapport reviendra ultérieurement sur l'exigence d'omnicanalité, condition essentielle de la qualité du parcours des usagers.
c) Le prisme des attentes et des besoins de l'usager : une priorité indispensable, un renversement de paradigme majeur
Le gouvernement et les administrations, essentiellement conduites par la DITP, la DILA et la DINUM, ont entrepris de centrer leurs efforts sur les besoins exprimés par les usagers afin de faciliter leur accès aux services publics.
Pour ce faire, deux principaux chantiers ont été lancées par le Gouvernement : le déploiement de la plateforme « Services Publics+ » et l'accompagnement des usagers au travers de la logique des moments de vie, permettant de s'affranchir des silos administratifs au profit d'une logique de parcours de l'usager. Chacun d'eux constituent un renversement de paradigme majeur dans l'approche par l'administration des usagers.
(1) Services Publics+ : un programme gouvernemental ambitieux d'amélioration des services publics
Déployé au niveau national, sous le pilotage de la DITP, Services Publics+ vise à rendre plus simples, plus proches et plus efficaces les services publics du quotidien pour tous les Français et à restaurer la confiance de ces derniers, en appliquant concrètement les principes d'écoute des usagers et de transparence sur les résultats.
Ce programme repose sur 5 piliers :
· La promesse, avec la mise en oeuvre d'un socle d'engagements communs aux services publics - notamment l'obtention d'une réponse rapide, la simplification des démarches avec des informations claire et accessibles, l'utilisation de modes de communication diversifiées pour joindre l'administration, l'accueil personnalisé et bienveillant ;
· La preuve, reposant sur la mesure et l'affichage des résultats des services publics - les services publics affichent leurs résultats de qualité de service et de satisfaction usagers dans chaque site d'accueil et sur le site Services Publics+ ;
· L'écoute des usagers, comprenant des dispositifs dédiés mis à leur disposition pour les écouter et prendre en compte leurs recours, notamment avec les rubriques « Je donne mon avis + » ou « Je contribue en soumettant un document trop complexe » sur le site Services Publics+, l'utilisation de comités d'écoute locaux ou la mise en place de panels d'usagers testeurs ;
· L'amélioration continue du service rendu, qui repose sur l'association des usagers, des agents et des élus. Cette démarche, conduite sur chaque site d'accueil du public, s'appuie sur les équipes de terrain pour construire des plans d'amélioration locaux ;
· La labellisation de la qualité de service, sur la base du volontariat, permet de valoriser les efforts menés par les agents pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers.
En effet, illustrant l'ambition du programme, toutes les administrations nationales en contact avec des usagers déploient le programme et ses engagements dans le champ des administrations d'État, mais également au sein des collectivités locales qui rejoignent le programme sur la base du volontariat.
En créant un référentiel commun à tous les services publics, le programme crée un standard de qualité de service dans les administrations recevant du public, sur la base duquel suivre et mesurer les progrès réalisés en matière d'accueil, de délais et d'accessibilité.
Comme le décrit la DITP dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure : « Services Publics+ contribue ainsi à poser un cadre pour la relation usager-agent et des principes fondamentaux, adaptés par chaque service dans le quotidien vécu avec ses usagers et leurs particularités propres : des démarches simples à réaliser, un accueil de qualité et le droit à l'erreur, la facilité à entrer en contact avec un service public, l'accompagnement personnalisé pour tout usager, la visibilité sur les délais, la mesure et l'affichage des résultats de qualité de service, en particulier ».
Par ailleurs, le programme impulse et nourrit une dynamique d'amélioration continue du service à l'usager par le biais d'outils de mesures publics et régulièrement actualisés. En effet, afin de rendre ces résultats de qualité de service transparents et accessibles de tous, un tableau de bord de la qualité des services publics est disponible en ligne. Les résultats de chaque service sont mesurés et publiés sur neuf indicateurs communs et comparables :
- cinq indicateurs communs de ressenti usager : satisfaction globale des usagers, satisfaction sur les délais, simplicité des démarches, facilité à contacter un service public et qualité de la relation avec un agent. Ces cinq indicateurs sont mesurés par les réseaux de services publics à la maille locale et, pour les services publics ayant le plus grand nombre d'interactions avec des usagers, par la DITP via un baromètre national basé sur une enquête en ligne ;
- quatre indicateurs de qualité, produits par les services publics : taux de respect du délai annoncé pour une démarche « phare » de l'usager, taux de décroché au téléphone, qualité de l'accueil téléphonique et qualité des démarches en ligne.
Enfin, pour valoriser l'engagement des agents des services publics qui se distinguent par une mise en oeuvre exemplaire du programme et une qualité de service reconnue comme supérieure, la DITP a créé en 2023 le label Services Publics+. Ce label est à la fois un signal et un gage de qualité pour les usagers, mais aussi une récompense pour les agents sur le terrain. Le label SP+ a ainsi pris la suite du label Marianne.
Le processus de labellisation Services Publics+
Cette labellisation prend en compte plusieurs critères et s'appuie sur trois composantes :
- un audit tierce partie, réalisé par un organisme de certification externe habilité par la commission nationale du label, présidée par la DITP. Cet audit évalue le niveau de maîtrise des engagements Services Publics + par le candidat et la mise en oeuvre du processus d'amélioration continue ;
- une enquête usagers, réalisée à la maille locale par le service public candidat, sur la base d'un questionnaire unique. Elle vise à recueillir l'avis des usagers sur la mise en oeuvre et le respect des engagements Services Publics + par le service public candidat ;
- une enquête réalisée auprès des agents, réalisée à la maille locale par le service public candidat, sur la base d'un questionnaire unique. Elle vise à recueillir l'avis des agents et des managers sur la transformation interne induite par le programme Services Publics +.
D'après les informations transmises à la rapporteure, sept services publics sont aujourd'hui labellisés « Services publics + » :
- deux collectivités : la ville de Romans-sur-Isère et la Région Pays de la Loire ;
- cinq services publics de l'État : l'URSSAF Centre Val de Loire, le centre de contact téléphonique de la DGFIP, l'URSSAF Languedoc Roussillon, la MSA Maine et Loire et la MSA Alpes Vaucluse.
La rapporteure salue le déploiement de ce programme ambitieux qui gagnerait à être approfondi et mieux connu des agents, des collectivités comme des usagers afin d'en utiliser l'ensemble des potentialités au bénéfice de tous.
Il témoigne de l'attention portée à la qualité de l'accueil et du service tout en mettant l'usager au centre de l'action du service pour améliorer effectivement la qualité de service. En effet, la prise en compte des résultats collectés pour adapter le service rendu aux usagers est l'une des clés d'évolution des services publics. Cette orientation implique de sortir d'une logique de mesure de satisfaction des usagers au profit d'outils de recensement de leur avis et de mesure des ressentis, indispensable pour adapter les services publics aux évolutions des attentes et besoins des usagers.
Par ailleurs, la rapporteure estime particulièrement bienvenue la publication à échéances régulières des indicateurs de satisfaction et de qualité de service de chacun des services publics à l'échelle nationale, régionale, départementale voire infra-départementale. Toutefois, si cette démarche mérite à l'évidence d'être saluée par la qualité de l'effort de transparence dont elle témoigne, il apparait nécessaire d'en étendre la portée en renforçant sa visibilité : il n'est pas évident pour le simple usager d'accéder facilement à la page dédiée à ces résultats dont la lisibilité d'ensemble peut s'avérer complexe à appréhender.
(2) Renverser le paradigme au bénéfice de l'usager : favoriser une logique de « moments de vie »
Une des évolutions majeures de la simplification des démarches consiste à penser désormais l'action publique en fonction des moments de vie, qui revient pour les administrations à changer leur perspective en se mettant à la place de l'usager, au lieu de concevoir ces démarches en fonction des organismes qui les mettent en oeuvre et de leurs contraintes d'organisation.
Dès 2012, une telle approche avait été valorisée : le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, que l'on peut considérer comme un prédécesseur de la DITP, préconisait la méthode des moments de vie pour privilégier le point de vue de l'usager et atténuer les obstacles jalonnant des parcours administratifs (trois exemples de moments de vie complexes pour l'usagers étaient alors proposés : « je perds un proche », « je crée mon entreprise » et « je gère mon administration »)163(*).
Cette logique s'est systématiquement amplifiée au cours des dernières années.
C'est le sens des annonces faites par la première ministre à l'occasion du CITP de mai 2023 : le Gouvernement a choisi de fixer dix moments de vie, dont cinq moments de vie prioritaires, complétés en 2024, l'objectif étant une refonte du parcours administratif de l'usager, depuis le diagnostic au déploiement des solutions de simplification.
Source : Communiqué de presse du CITP de mai 2023
Ces moments de vie sont les suivants : j'établis mon identité, je rénove mon logement, je vis à l'étranger, je perds un proche, je deviens étudiant, je deviens parent, je scolarise mon enfant, je vote, je prépare ma retraite.
On notera que les fiches pratiques par moment de vie actuellement développées sur le site service-public.fr (voir infra) sont au nombre de 21.
Cette approche n'est pas propre à la France164(*) : ainsi, le portail fédéral allemand verwaltung.bund.de, l'équivalent de service-public.fr, est organisé par thèmes165(*) et non par acteurs, afin de mieux correspondre aux besoins des usagers ; la rubrique Leben (vie) est elle-même organisée en rubriques :
- famille : adoption, garde d'enfants et soutien financier, mariage, divorce, et séparation ;
- naissance ;
- santé, maladie, handicap ;
- urgence et assistance aux victimes ;
- décès ;
- logement (construction, achat, déménagement).
L'exemple d'un moment de vie : je perds un proche
Comme l'illustre le site modernisation.gouv.fr, l'objectif prioritaire du moment de vie intitulé « je perds un proche » est de simplifier l'information et de prévenir le non-recours à la pension de réversion.
Dans le cadre de l'élaboration de ce « moment de vie », plusieurs administrations ont été mobilisées, sous l'égide de la DITP :
- la DILA a procédé à la revue de près de 200 pages du site internetservice-public.fr ;
- la CNAV a travaillé à la simplification du formulaire de pension de reversion après le recensement de près de 30 000 avis sur ce document ;
- la DITP a construit une guide pratique « un de mes proche est décédé en France », en associant professionnels, associations et plus de 650 usagers.
Loin d'être figés, ces travaux se poursuivent afin de tenir compte des retours des usagers. Il est ainsi prévu de généraliser les actions de proactivité de la CNAV sur la pension de réversion et de généraliser le pré-remplissage d'une partie des données du formulaire de demande de pension de réversion en 2026.
Pour chaque moment de vie identifié, la DITP travaille en trois étapes afin de définir le parcours usager au cours dudit moment de vie :
- en premier lieu, elle établit une cartographie du parcours de l'usager en mettant en exergue les irritants majeurs ;
- en deuxième lieu, elle co-construit des solutions avec les usagers et les services publics. Ces solutions intègrent nécessaires des principes de proactivité dont l'application du principe du « Dites-le nous une fois » pour donner corps à la fin de la logique de silos de l'administration, le recensement des démarches essentielles liées à chaque étape des parcours pour les rationnaliser et simplifier ainsi qu'une simplification du langage pour concevoir des formulaires accessibles à tous ;
- enfin, en dernier lieu, elle expérimente les solutions imaginées avant d'envisager un déploiement à grande échelle.
Méthodologie de la DITP pour l'élaboration du guide « l'un de mes proches est décédé en France »166(*)
« Plus de 2000 usagers, trois associations d'accompagnement du deuil et une trentaine d'agents ont été associés aux travaux de simplification du parcours. Les principaux irritants rencontrés par les usagers résident dans le manque d'informations sur les démarches à mener (39%), la multiplicité des services à contacter, des documents à fournir et la réitération de contacts auprès des services publics (38%). 11% des usagers déplorent le développement des démarches à réaliser par internet, au détriment de contacts humains avec le regret de ne pas être guidés ; enfin 9% d'entre eux soulignent le manque d'empathie des services avec lesquels ils ont été en contact : courriers adressés au nom du défunt, formulations très administratives, etc. Trois pistes de simplification ont été priorisées visant à mieux informer, simplifier les démarches à réaliser en assurant les principes du « Dites-le nous une fois », renforcer l'aller vers.
Pour faciliter l'accès à l'information sur les démarches à réaliser, un guide complet a été réalisé pour préciser le parcours administratif à suivre, les démarches à réaliser par ordre chronologique, la liste des différents acteurs à contacter les liens utiles. Il est l'aboutissement d'un travail collectif réunissant des agents de la fonction publique (administrations centrales, territoriales et hospitalières), des professionnels (notaires, métiers du funéraire, banques), des associations et des usagers. Les usagers ont été largement consultés pour identifier leurs besoins et avoir leurs retours sur les différentes propositions, notamment à travers des enquêtes en ligne et la mobilisation du panel d'usagers de la DITP, composé de 8 000 usagers-testeurs volontaires. Le guide a ensuite été testé par plus de 600 usagers, ainsi que dans une soixantaine d'espaces France Services. Ce document est aujourd'hui très relayé sur les réseaux sociaux.
Ce guide est désormais hébergé par la DILA qui le met à jour régulièrement, en fonction des actualités juridiques. »
Cette nouvelle logique est particulièrement saluée par la rapporteure car elle est centrée, dans une logique de parcours, sur les besoins des usagers, singulièrement à des moments de leur vie parfois éprouvants et permet, autant que possible, d'éviter un émiettement des informations qui leur sont transmises.
d) L'aller-vers : quand l'administration sort de sa tour d'ivoire
« L'aller vers est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale, qu'elle soit d'accueil, de diagnostic, de prescription, d'accompagnement. Cette démarche rompt avec l'idée que l'intervention sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée. Elle permet d'intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics (pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans une pratique pro-active, pour entrer en relation avec ces publics. »
Ainsi est définie la notion d'aller-vers dans la note de cadrage d'une formation figurant sur le site du ministère de la santé167(*).
Dans le domaine social, elle vise avant tout à sortir l'administration d'une position d'attente, qui engendre un risque de non-recours de la part des usagers, en particulier des plus vulnérables. Mais la notion d'aller-vers s'est diffusée dans l'ensemble de l'administration, dans le sens plus général d'une réduction de la distance entre celle-ci et la population.
Cette notion revêt ainsi une double dimension : matérielle, à travers les maraudes, les services publics itinérants (bus notamment), et immatérielle, avec de multiples initiatives consistant à prendre l'initiative en allant au-devant des usagers.
Cette démarche est d'autant plus importante à certains moments de rupture ou de vulnérabilité particulière. Ainsi, selon M. Jean-Luc Tillard, vice-président de la Communauté urbaine d'Arras en charge du développement des solidarités et préventions, entendu par la mission d'information, « les services publics doivent s'adapter aux évolutions sociales ainsi qu'aux parcours de vie des individus, en particulier lors de phases de transition ou de rupture : décès d'un proche, perte d'autonomie, séparation, rupture professionnelle, naissance d'un enfant, troubles de santé mentale, etc. Ces périodes de fragilité appellent des besoins accrus d'accompagnement, ainsi qu'une capacité des services publics à anticiper ces situations. Autrement dit, une approche proactive devient indispensable »168(*).
Parmi les applications de ce principe fondateur d'une administration centrée sur les besoins de l'usager, ce rapport reviendra sur les solutions itinérantes mises en place dans de nombreux territoires pour aller au plus près de celui-ci, et sur les mesures qui concourent à réduire la précarité en luttant contre le non-recours aux droits.
En matière d'aller vers, l'exploitation de la donnée joue un rôle essentiel. Plusieurs administrations commencent également à exploiter les possibilités de l'intelligence artificielle169(*) afin de devancer les besoins des usagers. L'Acoss indique ainsi : « l'Urssaf s'engage dans une approche proactive visant à anticiper les besoins des usagers avant même qu'ils ne se manifestent. En s'appuyant sur la formalisation des parcours [des usagers], nous cherchons à identifier des scores permettant de déclencher automatiquement des campagnes de courriels personnalisés pour promouvoir des services adéquats. Par exemple, dans le cadre du parcours d'un travailleur indépendant, nous travaillons sur la construction d'un score prédictif d'une première embauche afin de proposer l'offre d'accompagnement de l'Urssaf correspondante »170(*).
La Caisse nationale d'assurance vieillesse a, quant à elle, développé une intelligence artificielle « maison » dans le même objectif d'anticipation, ici pour « disposer d'une connaissance fine des questions qu'ils se posent et de leurs préoccupations aux étapes-clés que sont la préparation du passage à la retraite et le passage à la retraite en lui-même. À ces étapes, pour une grande part de nos usagers, ceux-ci se tournent en premier lieu vers leur direction des ressources humaines ; premier interlocuteur pour les questions afférant à leur carrière et à la transition du statut de salarié à retraité. C'est pourquoi l'Assurance Retraite a investi un champ de recherche autour des entreprises, en lançant une startup interne oeuvrant au développement d'une nouvelle offre de service : IApasdequoi171(*) ».
Cet ensemble d'initiatives témoigne, au total, des capacités d'innovation de l'administration française. Le paysage des services publics évolue, certes pas aussi vite que l'on pourrait le souhaiter ; mais ces initiatives témoignent d'une véritable volonté, au niveau des collectivités comme des administrations centrales, de s'adapter aux changements et aux attentes de l'usager.
C. DES RÉUSSITES À CAPITALISER
1. Le prélèvement à la source : un succès salué par la Cour des comptes, qui contraste avec les difficultés qui ont marqué la déclaration des biens immobiliers
Le prélèvement à la source, qui consiste à prélever l'impôt directement sur les revenus du contribuable, a profondément simplifié le parcours des usagers en supprimant les acomptes provisionnels trimestriels, en adaptant l'impôt en temps réel aux revenus et aux changements de situation personnelle des contribuables (perte d'emploi, augmentation de salaire, mariage, etc.), en transférant sur l'employeur le versement de l'impôt à l'administration fiscale et en assurant aux contribuables la visibilité directe de leur revenu net après impôt, facilitant la gestion de leur budget.
a) Les raisons d'une réussite
La Cour des Comptes, dans un bilan établi en 2022, a qualifié cette réforme de « réussite opérationnelle », qu'elle a attribuée à une conjonction de facteurs favorables :
- « des impulsions politiques fortes et répétées » ;
- « une appropriation de la réforme par la DGFiP » ;
- « la mise en oeuvre préalable de la déclaration sociale nominative qui a déterminé l'architecture du PAS172(*) et facilité tant le respect des délais que la relative maîtrise des coûts »173(*).
S'agissant du pilotage de la réforme, la Cour des comptes a tout particulièrement relevé les aspects positifs suivants :
- la « grande autonomie laissée à l'administration fiscale », à laquelle a été adressée une feuille de route claire : « créer une retenue à la source la plus contemporaine possible » et « maintenir les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu, notamment celles relatives à la définition du foyer fiscal » ;
- une réforme menée dans des délais rapides : un peu plus de quatre ans, soit moins que la moyenne des grands projets de transformation des systèmes d'information de l'État selon la Dinum (sept ans, avec un écart calendaire moyen de 24 % par rapport aux objectifs initiaux). Cependant la DGFiP a pu bénéficier des acquis de réformes précédentes : la dématérialisation de la télédéclaration des revenus, qui s'est étalée sur sept années, entre 2005 et 2012, et la mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), qui a nécessité six années de déploiement entre 2013 et 2019 ;
- un pilotage conduit « directement au niveau des différents ministres en charge de la réforme, en présence des directeurs d'administration centrales concernés (DGFiP et direction de la sécurité sociale) », avec une mission « prélèvement à la source » composée d'une petite équipe de quatre à sept personnes entre juin 2016 et juin 2019, ayant travaillé sans recours à des cabinets de conseil privés, seules des expertises internes étant sollicitées ;
- l'association à la conduite de la réforme de correspondants nommés au sein des directions départementales ou régionales du réseau des finances publiques ;
- une méthode de travail qualifiée de « collaborative », sur la base de consultations des fédérations des principales organisations syndicales professionnelles174(*), des représentants des collecteurs publics ainsi que des associations d'élus, et de l'écoute des tiers collecteurs ;
- l'adossement de la réforme au dispositif de déclaration sociale nominative (DSN)175(*) : « Les données nécessaires au calcul et au prélèvement de la retenue à la source ont été intégrées dans le dispositif de la déclaration sociale nominative, sans que la création d'une nouvelle plateforme soit nécessaire »176(*) ; ainsi, le prélèvement à la source « apparaît comme une ligne supplémentaire de la DSN et n'entraîne qu'un surcroît minime de données nouvelles à intégrer pour les entreprises collectrices » ;
- la mise en place d'un dispositif de réponse personnalisée aux questions des contribuables : « L'administration fiscale a développé progressivement à partir des années 2010 une offre de service "multi-canal" pour s'adapter aux pratiques de sollicitation des usagers et gérer les flux d'échanges associés. Des plateformes téléphoniques généralistes ou thématiques ont été créées pour désengorger les services des impôts et élargir la plage horaire d'ouverture du service. Un dispositif de demande de rendez-vous en ligne a été déployé en 2017 pour fluidifier l'accueil en guichet et proposer d'autres modes d'échanges (échanges en ligne, conférences téléphoniques, visio-conférences). Une messagerie sécurisée à disposition dans l'espace particulier des contribuables a été mise en place à partir de 2016, qui permet de faciliter l'affectation des sollicitations des contribuables aux services compétents ».
Les usagers ont ainsi bénéficié de la pédagogie active de l'administration fiscale, avec la diffusion de guides pratiques et de simulateurs en ligne. L'attention portée par la DGFiP aux retours effectués par les contribuables via les canaux d'accès au service public de l'impôt a permis de garantir l'amélioration continue du dispositif. Entre 2018 et 2019, près de 2 millions de courriels supplémentaires ont été envoyés à l'administration fiscale et 2,7 millions d'appels téléphoniques de plus lui ont été adressés.
De fait, un an après la mise en place du prélèvement à la source, près de 81 % des contribuables ne souhaitaient pas le retour au système de recouvrement antérieur, signe du succès de la réforme. Cette large adhésion des usagers témoigne de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement et de la pertinence des choix techniques opérés.
S'agissant des conséquences de la réforme sur la charge de travail de la DGFiP, la Cour des comptes observe que « la réalisation de gains de productivité n'a pas été affichée comme un objectif de la réforme », car les gains de productivité ont été antérieurs (dès 2018)177(*). Toutefois, si le recouvrement à la source a permis de faire disparaître certaines tâches de l'administration (encaissement des acomptes et soldes de paiement par chèque, carte bancaire et numéraire pour les 30 % de contribuables ni mensualisés ni prélevés à l'échéance ; relance des contribuables défaillants), il en a créé de nouvelles : « les travaux de gestion du paiement des comptes dus au titre de l'impôt sur le revenu sans tiers collecteur, le contrôle des procédures de déclaration et de paiement des retenues à la source et l'assistance des contribuables à la modulation ».
b) Un défaut de retour d'expérience systématique conduisant à une regrettable perte de mémoire du suivi de la réforme
Par-delà le succès du prélèvement à la source, la Cour des comptes identifie deux défaillances dans la conduite de cette réforme :
- d'une part, celle-ci n'a donné lieu à aucun retour d'expérience, conduisant à une regrettable « perte de mémoire de la réforme », de surcroît « aggravée par la forte rotation des effectifs » et par la dissolution dès 2019 de la cellule de pilotage ;
- d'autre part, l'absence de dispositif de suivi des demandes formulées par les usagers selon le canal utilisé (téléphone, courrier électronique, accueil physique ou services en ligne) a constitué une réelle perte d'opportunité pour l'amélioration continue des services publics numériques. La Cour des comptes observe en effet que « la DGFiP part du postulat que tous les motifs de contact des contribuables sont les mêmes quel que soit le canal choisi par l'usager. Or les motifs de contact par courrier et messagerie sont susceptibles d'être plus complexes que ceux par appel téléphonique à la plateforme d'assistance car le format permet d'étayer les difficultés présentées par des pièces justificatives ». Une analyse fine des diverses sollicitations des usagers, différenciée selon le canal utilisé, aurait permis de tester des modalités de suivi différencié, de mieux connaître les publics qui rencontrent des difficultés et d'adapter les réponses apportées par l'administration selon les canaux utilisés178(*).
Ces défaillances sont d'autant plus regrettables que l'amélioration continue des services publics numériques nécessiterait la mise en place de dispositifs pérennes d'observation et d'analyse des parcours usagers, ainsi qu'une capitalisation systématique des retours d'expérience des agents de terrain.
c) Un contraste net par rapport aux difficultés caractérisant le projet « gérer mes biens immobiliers »
La réussite, par la DGFiP, du passage au prélèvement à la source contraste avec les difficultés qui ont marqué la mise en place du projet « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).
Ce projet a été conçu pour permettre à l'administration fiscale de tirer les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de permettre à l'administration fiscale d'établir le rôle des trois impôts subsistants179(*). L'outil « Gérer mes biens immobiliers » visait à faire renseigner pas les contribuables les informations nécessaires à l'administration fiscale : le statut du bien (occupé par le propriétaire, loué ou vacant) ainsi que la période d'occupation et l'identité des occupants.
Dans un rapport publié en janvier 2025, la Cour des comptes a qualifié de « chaotique » la campagne 2023 et a pointé ses « très lourdes conséquences financières pour l'État »180(*). Parmi les causes de l'échec de ce projet, la Cour des comptes a pointé :
- une « gouvernance complexe et dispersée, sans portage stratégique ni maîtrise suffisante de la gestion de projet » ;
- et le fait que le projet GMBI, contrairement au prélèvement à la source, « n'a pas bénéficié de portage politique de haut niveau qui aurait permis d'en assurer la visibilité, en externe comme au sein de la DGFiP ».
Ainsi, comme le souligne la DGFiP, « nos concitoyens ont eu du mal à comprendre le motif d'une obligation générale, alors que la taxe d'habitation disparaissait » ; de plus « la communication en direction des personnes éloignées d'internet a probablement été insuffisante »181(*).
2. Service-public.fr : le navire amiral de la présence numérique de l'État
Le site service-public.fr est géré par la Direction de l'information légale et administrative (DILA). Avec le centre d'appel Allô Service Public 3939 (238 461 appels téléphoniques traités en 2024182(*)), le site constitue un centre de renseignements administratifs multicanal183(*). Ses fonctionnalités ont été présentées à la mission d'information lors d'une visite à la DILA, le mardi 24 juin 2025.
a) Une offre très diversifiée à l'attention de tous : 675 millions de visites par an
Service-public.fr est un portail ouvrant accès à toute l'information administrative utile aux usagers, y compris les démarches de tous ordres.
Il a enregistré 675 millions de visites en 2024 (1,8 million par jour)184(*).
Outre l'annuaire complet de l'administration, fort de 78 millions de visites annuelles, le site met à disposition des internautes un ensemble de fiches pratiques :
- classées par événement de vie, qui récapitulent les informations à connaître et les démarches à accomplir en fonction des projets d'une personne ou des événements survenant dans sa vie (« je pars de chez mes parents », « J'achète un logement », « j'attends un enfant », «je prépare ma retraite », « je souhaite travailler dans l'administration », « je veux obtenir un crédit immobilier », « je pars vivre à l'étranger », « je cherche un emploi », « mon association organise un événement », etc.) ;
- classées par thème (onze thèmes principaux, tels que « papiers, citoyenneté, élections », « argent, impôts, consommation », « logement », « travail, formation », « transports, mobilité », etc.), avec une arborescence permettant d'aboutir à la fiche recherchée.
L'usager peut obtenir des renseignements adaptés à sa situation en définissant son profil (âge, situation de famille, nationalité, etc.), ou accéder à des renseignements généraux.
Le site permet également d'accéder à des « démarches et outils » (148 millions de visites par an et 9,1 millions de démarches185(*)) : ce portail contient les démarches en ligne (667 au jour de la consultation), pour lesquelles le site renvoie vers le portail pertinent (ainsi pour « S'inscrire à France Travail », l'usager est dirigé vers la page d'inscription sur le site de l'organisme).
Mais la DILA assure également en propre l'interface de 29 démarches en ligne de fort volume, telles que la demande d'acte d'état civil, la déclaration CI-PHYTO nécessaire à la vente ou à l'achat de produits phytosanitaires, le changement d'adresse, ou encore la dématérialisation, menée à titre expérimental, du renouvellement des passeports pour les Français de l'étranger186(*).
La rubrique « démarches et outils », qui comporte les éléments d'information sur 2 162 démarches en tout, donne aussi accès aux formulaires administratifs (Cerfa), à quelque 50 simulateurs (calculer le coût du certificat d'immatriculation par exemple, qui donne accès ensuite au site de France titres), et à des modèles de courriers.
À cet égard, les modèles de courriers (il en existe 308) les plus consultés, selon le site service-public.fr sont : l'attestation sur l'honneur, la lettre de démission du salarié, la demande initiale de congé parental dans le secteur privé, l'attestation d'hébergement et la déclaration de concubinage. On note aussi des modèles de lettre permettant de porter plainte avec constitution de partie civile, de mettre fin à un crédit la consommation ou de demander à son propriétaire l'autorisation de sous-louer son logement.
L'information est mise à jour régulièrement, grâce à la veille quotidienne des textes législatifs et réglementaires assurée par les équipes de la DILA ; en outre chaque fiche est systématiquement révisée tous les 18 mois, même en l'absence d'évolution des textes.
b) Une offre spécifique à destination des collectivités
La DILA propose désormais un bouquet de six services à destination des collectivités, en partenariat avec les ministères concernés, concernant les démarches suivantes : la demande d'acte d'état-civil, le recensement citoyen obligatoire, le pré-dépôt de dossiers de PACS, la déclaration d'hébergement de tourisme, le changement d'adresse en ligne et l'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme.
|
Partenaire ministériel |
Nombre de demandes reçues |
||
|
Ministère de la Justice |
2 362 518 |
||
|
Ministère des Armées |
104 935 |
||
|
Ministère de la Justice |
12 287 |
||
|
Ministère de l'économie |
2 407 |
||
|
Interministériel |
1 544 148 |
||
|
Ministère de la transition écologique et Solidaire |
2 562 |
Raccordement des communes gérés par la DHUP |
Source : support de présentation transmis par la DILA
À fin avril 2025, 6 692 communes adhéraient au bouquet de services, certaines communes pouvant avoir souscrit jusqu'à cinq abonnements. Les communes adhérentes sont très majoritairement - à raison de 61,3 % - des communes comprenant entre 500 et 10 000 habitants, les petites communes (moins de 500 habitants) représentant 27,4 % de cet ensemble.
La DILA propose également des « tutos service public », principalement sous la forme de webinaires, à destination des aidants administratifs - c'est-à-dire, principalement, des secrétaires de mairie et conseillers France Services - afin de mieux leur faire connaître les fonctionnalités du site.
Enfin, à l'attention des 14 000 communes qui ne sont pas dotées d'un site internet, une collaboration a été engagée avec l'ANCT et le site collectivite.fr, qui propose une page par défaut pour ces collectivités. Ce site étant mal référencé, la DILA a entrepris, avec l'ANCT, de densifier les pages des mairies dans l'annuaire de l'administration sur service-public.fr, en y ajoutant des informations sur les services publics situés à proximité, les établissements scolaires, les structures de santé et les équipements culturels, ainsi que la liste des élus et les comptes rendus de conseils municipaux. L'objectif est que ce projet soit « livré » à l'automne 2025, puis progressivement enrichi.
Les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information sur le site du Sénat confirment les attentes exprimées par les maires de petites communes qui souhaiteraient doter leur collectivité d'un site internet et aimeraient disposer d'une aide pour mener ce projet. La rapporteure se félicite qu'un tel outil puisse être mis gratuitement à leur disposition, tout en appelant à une communication systématique sur ce sujet, car de tels rapprochements entre la DILA et les collectivités ne peuvent qu'être encouragés. Le nombre de communes adhérentes au bouquet de services, qui représente 19 % du nombre total de communes en France, montre que le dispositif répond à un réel besoin, tout en conservant des marges de développement.
c) Un site très fréquenté mais souffrant paradoxalement d'un déficit de notoriété
La forte fréquentation du site service-public.fr est le résultat de plusieurs facteurs.
D'abord, le site, créé par un arrêté du 6 novembre 2000, bénéficie d'une forte ancienneté dans le paysage numérique. Un rapport de l'ONU publié en 2014187(*) plaçait ainsi la France au premier rang des pays développés - et au premier rang des pays européens - pour les services en ligne. Un encadré188(*) y est consacré à service-public.fr en tant qu'exemple d'un guichet unique présentant une information claire et accessible.
Outre le facteur de l'ancienneté, très important dans le référencement par les sites de recherche, la DILA avance quatre raisons189(*) pour le succès du site :
- une actualisation régulière (cf. supra),
- un haut degré de confiance dans l'information délivrée,
- la densité du site,
- la bonne structuration technique des pages.
Grâce à ces éléments, Google amène naturellement l'usager vers les pages du site : 70 % des fiches thématiques figurent dans les deux premiers résultats des recherches relatives à ces thèmes. C'est le résultat d'une stratégie de longue haleine des équipes de la DILA autour du référencement naturel190(*). Le bon référencement est d'autant plus important qu'il permet à l'information officielle de s'imposer, dans les résultats de recherche, face à des sites payants voire frauduleux prétendant offrir des services qui, en réalité, sont disponibles gratuitement191(*).
Malgré ce succès, le site souffre d'un manque paradoxal de notoriété : une enquête de 2024 a montré que la notoriété « spontanée » du site était bien moindre que sa notoriété « assistée ». En d'autres termes, les personnes n'identifient service-public.fr que lorsqu'on leur donne quelques indications sur le site. Ce résultat est en partie fonction de la structure même du site : l'usager se rend très rarement sur la page d'accueil - celle qui « identifie » le mieux le site - puisqu'il est en général dirigé directement sur la page qui apparaît dans les résultats de recherche.
Or une meilleure connaissance de service-public.fr par le grand public offrirait un meilleur positionnement à l'information délivrée par le site. L'annonce de modification prochaine de l'adresse du site par l'extension « .gouv.fr » répond partiellement à cet objectif en associant clairement service-public.fr à l'information officielle, et pourrait remédier aux chevauchements observés avec d'autres sites comme info.gouv.fr. Il conviendrait toutefois de compléter ce travail par une campagne de communication destinée à accroître la notoriété du site.
Recommandation : Mieux faire connaître le site service-public.fr ainsi que la diversité des informations et des services qu'il délivre, au moyen d'une campagne d'information grand public, sur tous médias.
d) Les fiches « événements de vie » : quelques perfectionnements à envisager
La rubrique « Fiches pratiques par événement de vie » du site service-public.fr comprend désormais 21 fiches192(*). Trois d'entre elles sont consacrées à l'expatriation (« Je pars vivre à l'étranger », « Je vis à l'étranger », et « Je rentre en France après avoir vécu à l'étranger »), deux traitent du handicap (« Je suis en situation de handicap » ; « Mon enfant est en situation de handicap »).
(1) Un risque de dispersion entre plusieurs auteurs, un effort à coordonner
La notion de « moment de vie » fait l'objet d'une certaine confusion dans la communication institutionnelle : on trouve, en même temps que les fiches « Événements de vie » sur service-public.fr, des pages de sites officiels faisant mention de dix « moments de vie »193(*), dont l'entrée dans la vie étudiante, avec un renvoi vers un « Guide de la vie étudiante à destination des lycéens » édité par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche194(*). On observe aussi, sur le site mesdroitssciaux.fr, sur lequel la rapporteure reviendra ci-dessous, 14 « événements de vie » sur des thèmes qui recoupent pour l'essentiel ceux des autres sites officiels195(*).
Il résulte de cette diversité d'outils une impression de coordination insuffisante et un risque de flottement, en conflit avec l'ambition de simplification et de clarté affichée par la DITP dans le cadre d'une démarche qui en son principe est tout à fait vertueuse. Cette remarque appelle un effort de coordination et d'harmonisation des informations mises à la disposition des usagers, plus particulièrement dans le contexte du décès d'un proche évoqué plus en détails ci-dessous.
(2) L'entrée dans la vie active : un « moment de vie » à créer pour mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne
S'agissant plus particulièrement des jeunes publics, une fiche du site service-public.fr traite du départ du domicile parental (« Je pars de chez mes parents »), une autre aborde le sujet de la formation (« Je souhaite devenir alternant »), mais aucune n'aborde l'entrée dans la vie active.
Certes, la DILA publie également, à la Documentation française, une brochure Jeune et citoyen - le guide de mes premières démarches, qui s'adresse aux 18-25 ans pour les accompagner dans l'autonomie autour des thèmes suivants : citoyenneté, études, santé, travail, impôts et cotisations sociales, engagement et droits du citoyen, logement, loisirs, vote. Mais cette brochure, par ailleurs payante, ne traite pas spécifiquement les démarches liées à l'entrée dans la vie active. Or il s'agit d'un moment charnière dans une vie, qui marque de surcroît un changement de statut vis-à-vis de nombreuses administrations.
La mission d'information suggère donc, pour mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne, la création d'une fiche pratique présentant de manière synthétique les démarches à réaliser à ce moment critique de la vie. Le guide pourrait par ailleurs être diffusé dans les CROUS et les associations étudiantes ainsi que dans les France Services, en s'inspirant d'une bonne pratique observée par la mission d'information dans le Rhône, le 16 juin 2025 (tournées de bus France Services dans les lycées).
Recommandation : Concevoir à l'attention des jeunes usagers une fiche pratique et un guide sur l'entrée dans la vie active » ; le diffuser sur le site servicepublic.fr ainsi que dans les CROUS, les associations étudiantes et le réseau France Services.
(3) Le décès d'un proche : des améliorations souhaitables
La fiche pratique « Un proche est décédé », réalisée par la DILA et la DITP, est disponible sur le site service-public.fr ainsi qu'en format PDF, sous la forme d'un guide196(*) dont le périmètre est légèrement plus restreint (« Un de mes proches est décédé en France »)197(*).
Dans le cas de la fiche pratique, comme pour l'ensemble des démarches disponibles sur le site, l'usager est invité à répondre à une série de questions afin de définir son profil et de cibler les informations adaptées à sa situation.
La fiche est structurée autour des démarches essentielles à effectuer après le décès d'un proche :
- le parcours administratif à suivre ;
- les démarches à réaliser par ordre chronologique ;
- la liste des acteurs publics ou privés à contacter ;
- des liens utiles et des modèles de lettres en ligne.
L'usager peut également se faire rappeler par le service Allô Service Public s'il préfère avoir un interlocuteur au téléphone, en conformité avec l'ambition affichée par les pouvoirs publics de proposer aux usagers plusieurs canaux de communication avec l'administration.
Cet outil précieux reste, comme tous les supports conçus pour les « moments de vie », bien pensé et très utile ; il mériterait toutefois de faire l'objet de perfectionnements.
On observe en effet que, dans la fiche pratique en ligne, aucune mention n'est faite des dispositifs d'aide psychologique éventuellement disponibles ; or le guide PDF fait bien référence au site « Mon Parcours Psy » et à la possibilité de prise en charge par l'Assurance maladie de huit séances auprès d'un psychologue. Il est donc nécessaire d'harmoniser le « moment de vie » en ligne avec la brochure.
Ensuite, la conception de la fiche pratique présente quelques défaillances qu'il semble opportun de corriger.
Précisons tout d'abord que la fiche en ligne ne traite pas le cas du décès d'un enfant mineur, le guide PDF renvoyant sur ce point au site mesdroitssociaux.fr qui prévoit un accompagnement spécifique aux démarches pour les parents ayant perdu un enfant.
En revanche, il est surprenant que lorsque l'internaute coche la case « Vous êtes le père ou la mère de la personne décédée », l'interface ne prévoie pas le cas de figure où le défunt, quoique majeur, n'était pas encore en âge de travailler, comme le montre la capture d'écran ci-dessous qui ne prévoit comme hypothèses, dans le cas du décès d'une personne qui n'avait pas d'activité professionnelle, que celles de la retraite ou de la recherche d'emploi, omettant par exemple la poursuite d'études. Il est particulièrement dommageable que ces erreurs de conception interviennent dans un contexte de deuil ; de plus si le langage utilisé est clair et accessible, il semble quelque peu désincarné et administratif eu égard au traumatisme que peut représenter un décès.
La mission d'information a également constaté, lors d'un test des différents outils proposés dans le cadre des « moments de vie », que le guide proposé par service-public.fr coexistait avec une brochure similaire élaborée par le site mesdroitssociaux.fr198(*), précédemment évoqué. Certes, l'angle choisi pour les deux guides n'est pas le même, le second mettant l'accent sur les démarches qui incombent à l'usager en tant qu'assuré social, mais dans l'ensemble ils se recoupent largement. De plus, la chronologie indiquée pour les démarches est légèrement différente dans les deux guides, ce qui entretient la confusion199(*).
Lors de la visite de la mission d'information à la DILA, il a été indiqué que les guides proposés par mesdroitssociaux sur des thématiques similaires à celles des guides service-public.fr étaient retirés du site, sauf le guide consacré au décès d'un proche qui présente des spécificités. De manière plus générale, les guides proposés par mesdroitssociaux seront, nous a-t-on expliqué, recentrés sur les simulations, tandis que service-public.fr abordera le parcours informationnel ; cette répartition des rôles apparaît tout à fait pertinente.
Le moment de vie en ligne « un de mes proches est décédé » devrait donc être complété pour y ajouter la référence au site « mon soutien psy », afin de mieux tenir compte des besoins éventuels de l'usager en soutien psychologique, et de corriger certaines imperfections du menu déroulant concernant le décès d'un enfant.
De manière générale, il convient d'assurer la cohérence entre les informations disponibles sur les différents sites officiels à l'attention des personnes ayant perdu un proche et d'améliorer certains aspects de leur conception, notamment dans l'hypothèse particulièrement douloureuse du décès d'un enfant.
Recommandation : Assurer la cohérence entre les informations disponibles sur les différents sites publics à l'attention des usagers confrontés au décès d'un proche et améliorer leur conception, en particulier le guide « Un proche est décédé » mis en ligne sur le site service-public.fr.
Enfin, l'attention de la rapporteure a été attirée sur le problème que constitue la résiliation des abonnements d'un défunt. En l'état, la fiche pratique relative au décès d'un proche propose des modèles de lettres de résiliation, mais il conviendrait d'aller plus loin.
En effet, les abonnements à prélèvement automatique, via le compte bancaire ou la carte de crédit, qu'ils aient trait au foyer (fluides, abonnement à internet, etc.) ou aux loisirs (presse, plateformes diverses, abonnement à une chaîne de télévision payante, salle de sport, SNCF, etc.) concernent une part toujours croissante de la population, et ils ne sont pas toujours connus des proches de la personne décédée. Leur résiliation est une source de soucis supplémentaire dans une période de deuil car elle implique tout d'abord de connaître les abonnements souscrits par le défunt. Si l'identification des fournisseurs de fluides et de téléphonie mobile semble relativement accessible, il est en revanche plus complexe de savoir quels abonnements ont pu être souscrits en matière de loisirs par exemple. Leur résiliation suppose fréquemment de communiquer des éléments tels que numéro d'abonné, numéro de contrat, numéro de sociétaire et codes personnels d'accès, ce qui est loin d'être évident après le décès du souscripteur.
Certes, la résiliation devient automatique lors de la fermeture des comptes bancaires du défunt, à l'issue de la période pendant laquelle ces comptes sont bloqués en l'attente du règlement de la succession. Toutefois ces abonnements, s'ils continuent à courir pendant des mois, peuvent être la source de frais non négligeables sur un compte non approvisionné.
Dans de telles circonstances, une solution pourrait consister à rendre possible la résiliation immédiate des abonnements pesant sur les comptes de la personne décédée, cette démarche étant faite auprès des différents fournisseurs par l'établissement bancaire du défunt, sur demande des héritiers transmise par le notaire. Une négociation devra être conduite par l'État avec les banques de manière à obtenir que cette formalité s'opère sans frais, ou à tout le moins que ces frais soient minimes et encadrés (les banques retirent un profit de la stabilité des fonds pendant plusieurs mois, sur un compte n'enregistrant par ailleurs plus aucun mouvement).
Recommandation : Mettre à l'étude la possibilité de résiliation immédiate des abonnements souscrits par une personne décédée, sur demande des héritiers du défunt transmise à l'établissement bancaire de celui-ci par le notaire, une négociation devant être conduite avec les banques pour obtenir que cette formalité s'opère sans frais, ou à tout le moins que ces frais soient minimes et encadrés.
Il conviendrait en outre, afin de renforcer l'accompagnement des usagers confrontés au décès d'un proche, de systématiser la mise à disposition du guide - ou la communication du lien vers la fiche pratique en ligne sur le site service-public.fr - dans les Ehpad, les hôpitaux et les services de pompes funèbres, où ces informations pourraient être communiquées aux proches, dans une logique d'aller-vers particulièrement appropriée dans le contexte d'un deuil.
Recommandation : Communiquer aux proches du défunt, dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres, le guide ou la fiche pratique en ligne « Un proche est décédé ».
e) Intelligence artificielle : des enjeux considérables qui appellent une vision prospective
Forte de l'expérience acquise dans le référencement, la DILA a développé une réflexion sur les bouleversements qu'annonce l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce domaine200(*). En effet, les grands acteurs du secteur semblent avoir pour ambition, à terme, de se substituer aux sites internet en invisibilisant leurs sources201(*). En réponse à une recherche, Google offre déjà, sur la première page, de premières informations (des horaires, par exemple). L'étape suivante est la fonctionnalité AI Overview, déjà déployée aux États-Unis et au Royaume-Uni et en phase de test dans trois pays européens, qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des réponses personnalisées directement en tête des résultats de recherche. Ainsi, à terme, l'ensemble de l'information présente sur les sites internet pourrait être filtrée par l'intelligence artificielle qui en délivrerait une synthèse à l'usager, sans que la provenance des informations soit directement affichée.
Les enjeux sont donc considérables pour les acteurs publics désireux que l'information délivrée à l'usager soit correctement sourcée, sans subir la concurrence d'acteurs dont les motivations ne relèvent pas de l'intérêt général. La DILA a déjà commencé à travailler sur le référencement par les moteurs de l'intelligence artificielle : cela consiste essentiellement à introduire dans les contenus des simulations de situations, une variété de formats, qui sont appréciés par les algorithmes des IA. Il est essentiel que les pouvoirs publics, et notamment le service d'information du Gouvernement (SIG), responsable de l'information produite par l'administration et de la gestion des différents sites de l'État, accompagnent et soutiennent la DILA dans ce chantier qui relève de l'intérêt général, en instaurant un dialogue exigeant avec les principaux acteurs de l'intelligence artificielle, afin que l'utilisation de ces outils ne conduise pas à invisibiliser les sources officielles qui garantissent la fiabilité des informations recueillies en réponse à des recherches.
Recommandation : Engager au niveau gouvernemental une discussion avec les grands opérateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin d'obtenir une identification claire des sources officielles utilisées dans les réponses aux questions des usagers, lorsque leurs recherches portent sur les institutions et les services publics.
La rapporteure a également pu constater, au cours de sa visite au siège de la DILA, que l'organisme avait également travaillé sur la génération par IA de réponses à l'usager, grâce à un outil appelé génération augmentée de récupération (RAG en anglais), en utilisant les bases de données de service-public.fr. Ces travaux se déroulent en parallèle des expérimentations conduites par d'autres administrations, notamment au sein de France Services avec l'outil Albert202(*). Il conviendrait donc de coordonner au mieux ces efforts afin de faire émerger la solution qui apportera la plus grande plus-value aux agents et à l'usager.
3. L'administration des Français à l'étranger : un chantier de modernisation à valeur d'exemple pour l'ensemble des administrations
La direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE), rattachée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, met en oeuvre depuis plusieurs années quatre chantiers de modernisation porteurs d'améliorations réelles pour les Français à l'étranger. Il faut distinguer dans cet ensemble :
- un projet de plateforme téléphonique, France Consulaire, destiné à répondre aux demandes des Français à l'étranger ;
- et trois projets de dématérialisation en cours de mise en oeuvre : le registre d'état-civil électronique (RECE), le vote par internet aux élections des conseillers des Français à l'étranger et la dématérialisation du renouvellement des passeports.
Les Français à l'étranger : un terrain favorable à la dématérialisation
La population des Français à l'étranger présente trois caractéristiques qui sont autant de facilitateurs de la dématérialisation et expliquent que la DFAE ait joué un rôle pionnier dans le travail de dématérialisation de l'administration :
- la très forte dispersion géographique des Français à l'étranger, qui résident parfois à plusieurs centaines de kilomètres d'un consulat - notamment aux États-Unis par exemple - est une très forte incitation à dématérialiser les démarches ;
- des effectifs relativement modestes - 1,75 million d'inscrits au registre en 2025, dont un tiers de binationaux - qui facilitent les expérimentations ;
- un profil socio-économique - population plus jeune et aux revenus plus élevés que la moyenne nationale - qui encourage probablement l'acceptabilité de la dématérialisation, même si les Français à l'étranger sont loin de constituer un tout homogène et si nombre de nos compatriotes établis hors de France sont confrontés à la précarité, parfois aggravée par l'isolement et/ou la barrière de la langue203(*).
a) France Consulaire : une plateforme téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les recentrer sur leur coeur de métier
Le projet France Consulaire est né du constat que les consulats français à l'étranger recevaient un grand nombre de demandes, notamment pour l'état-civil, qui appelaient une réponse simple sans requérir d'expertise particulière sur le sujet. Cela provoquait un engorgement des services et une frustration des usagers, qui devaient parfois attendre longuement au téléphone, ou s'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir une réponse.
La solution mise au point par les services a été la création d'une plateforme téléphonique : mise en service au mois d'octobre 2021 pour cinq pays européens, son périmètre a été progressivement étendu, l'objectif étant de couvrir l'ensemble du monde à la fin 2025, avec des plages horaires adaptées afin de couvrir l'ensemble des zones. Selon la DFAE, « une réponse de premier niveau (information générale dans le domaine consulaire - hors visas - et procédures simples) est confiée à un prestataire (62 téléconseillers à ce jour présents à Laval et à La Courneuve), tandis que la réponse de niveau 2 est assurée par des agents titulaires du MEAE (26 agents) sur les questions consulaires plus complexes ou nécessitant un suivi individuel par le consulat compétent. L'équipe de niveau 2 est également chargée d'alimenter, au fur et à mesure de l'intégration de nouveaux pays et en lien avec les postes, la base de connaissances qui permet de répondre aux usagers »204(*). Ainsi est mis en oeuvre un principe de subsidiarité, dans lequel les questions les plus complexes sont remontées au consulat.
Le service France Consulaire, dont le transfert à Nantes, auprès de la DFAE, sera achevé à l'été 2025, affiche :
- « un taux de décroché de 99 %, dont 98 % en moins de 15 secondes », soit plus que l'objectif fixé par le comité interministériel de la transformation publique (CITP) de mai 2023 (taux de décroché de 85 %) ;
- « des taux de satisfaction des usagers de 91 % pour la qualité de la réponse, 95 % pour la qualité de l'accueil et 95 % pour le délai d'attente (mars 2025) »205(*).
Pour le personnel consulaire, l'effet est également très positif : selon la directrice de la DFAE206(*), France consulaire « permet aux postes de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée : visites aux détenus, renforcement de la lutte contre la fraude, ouverture de guichets supplémentaires, suivi des dossiers individuels, gestion des urgences ».
La plateforme téléphonique complète donc utilement l'information disponible en ligne.
La rapporteure constate ainsi un parallélisme évident avec les France Services dans la mise en oeuvre du principe de subsidiarité : dans un cas comme dans l'autre, un premier niveau de réponse est délivré et, si la demande est complexe, l'usager est dirigé vers un agent plus spécialisé. Cette méthode devrait irriguer l'ensemble des services publics, car seule à même de concilier deux impératifs :
- la nécessité d'un contact facilité entre l'usager et l'administration ;
- le redéploiement du réseau physique des services publics, rendu possible par les avancées technologiques et nécessaire par la forte contrainte pesant sur le budget de l'État.
Si France Consulaire représente une amélioration considérable dans l'information délivrée à nos concitoyens de l'étranger, l'attention de la mission d'information a été attirée par notre collègue Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France et vice-présidente de la mission d'information, sur la problématique du retour en France. Nos compatriotes ont souvent, pendant leur séjour hors de France, eu les postes consulaires comme seul point de contact avec l'administration française ; à leur retour, bien des difficultés naissent de ce contact perdu avec nos services publics, compte tenu des nombreuses démarches à effectuer auprès de différentes administrations.
Ce constat souligne l'intérêt de la mise en place, comme l'a suggéré notre collègue Olivia Richard, d'une France Services dédiée à l'accompagnement de nos compatriotes qui, après un séjour à l'étranger, reviennent en France. Joignable par téléphone, par mail et sur place, cette structure, dont les agents devraient suivre une formation à ce public spécifique, faciliterait un retour plus serein en rétablissant ce contact avec la France et en proposant une aide aux démarches nécessaires, ménageant ainsi une forme d'atterrissage en douceur.
Recommandation : Mettre en place, à titre expérimental, une structure France Services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger.
b) Trois chantiers pionniers de dématérialisation : le RECE, le vote par internet et le renouvellement du passeport sans comparution
La DFAE s'est également engagée de manière pionnière dans la dématérialisation de services dans deux domaines régaliens : l'état-civil et le vote.
(1) Le Registre d'état civil électronique (RECE) : des délais de traitement réduits, pour une économie substantielle
« Conduite par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères depuis 2019, l'expérimentation du projet de registre d'état civil électronique (RECE) vise à dématérialiser intégralement l'état civil dont le MEAE est dépositaire, soit 16 millions d'actes » en stock, indique la DFAE207(*). Ce total inclut notamment les Français nés dans les anciennes colonies.
Depuis mars 2021, les usagers peuvent recevoir des extraits et/ou copies d'actes d'état-civil de manière entièrement dématérialisée, grâce à la signature électronique apposée par l'officier d'état-civil. En quatre ans, d'après les statistiques de la DFAE, 2,5 millions de copies intégrales et d'extraits ont déjà été délivrés. À partir de 2026, c'est l'ensemble des démarches (création, transcription, mise à jour et archivage) qui seront dématérialisées.
Selon la DFAE, le retour des usagers est extrêmement positif, avec un taux d'adhésion de 95 % à la démarche en ligne. L'économie réalisée par l'administration est estimée à 1,3 million d'euros par an, essentiellement en frais d'affranchissement et en papier sécurisé. Le service central d'état-civil a pu redéployer les 11 ETP en 2021 dans d'autres services de la DFAE, notamment France Consulaire. Les délais de traitement sont, eux, passés d'une fourchette comprise entre 15 et 30 jours à 3,4 jours : l'intérêt pour l'usager est donc manifeste.
La DFAE a porté à l'attention de la rapporteure que « le ministère de la justice a organisé, le 20 juin dernier, une Journée sur l'état civil de demain au cours de laquelle les perspectives d'extension du RECE à l'état civil communal ont été abordées, en présence notamment de l'Association des maires de France et France titres »208(*). Une telle extension serait techniquement possible, car « les développements informatiques conduits dans le cadre du RECE ont été conçus de manière à pouvoir être répliqués à l'état civil communal ». L'état-civil électronique, sans se substituer à la délivrance en version papier, serait une incontestable amélioration pour l'usager comme pour les services publics, notamment au vu de la forte réduction des délais de délivrance qu'il induit.
(2) Vote par internet : une solution appréciée des usagers
D'après les informations fournies par la DFAE, « le vote par internet a été mis en oeuvre à sept reprises pour des scrutins à l'étranger : pour les élections législatives de 2012, 2022 et 2024, les élections législatives partielles de 2023 et les élections des conseillers des Français de l'étranger de 2014 et 2021 »209(*). Les Français résidant aux États-Unis ont cependant pu voter par internet dès 2003 pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger. À partir de 2026, les modalités d'identification en ligne seront simplifiées par la mise en place de l'identité numérique régalienne. Le vote par internet reste bien sûr une option pour l'électeur, qui vient en complément des bureaux de vote tenus par les consulats.
Après des débuts assez timides, la solution a été adoptée largement par les usagers : 72,58 % des votants ont choisi l'option au premier tour des élections législatives anticipées de 2024, 77,65 % au deuxième tour. La satisfaction des votants, mesurée par une note de 1 à 10 grâce au bouton « Je donne mon avis »210(*) incorporé à l'interface de vote, était de 7,6 sur 10. L'Assemblée des Français de l'étranger, lors de sa 41e session, a salué le bon déroulement de ces élections.
La solution du vote électronique, note la DFAE, a permis de réduire le nombre de bureaux de vote, passé de 774 en 2012 à 599 pour les élections législatives de 2024. Le dépouillement, dans le cas du vote par internet, ne prend plus que quelques minutes et mobilise beaucoup moins l'administration centrale.
Enfin, même si cette statistique est à interpréter avec prudence compte tenu des spécificités de la population concernée et des autres facteurs pouvant expliquer ce résultat, la participation était largement supérieure en 2024 à ce qu'elle était en 2012 : 37 % contre 23 %.
La DFAE a indiqué à la rapporteure « qu'une éventuelle extension de cette modalité de vote à d'autres types de scrutin (élections présidentielle, élections européennes, référendums) nécessiterait de modifier plusieurs textes législatifs et en particulier la loi organique 76-97 du 31 janvier 1976 »211(*) relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. La DFAE pointe également les conséquences potentielles d'un dysfonctionnement du vote par internet pour les élections à circonscription nationale unique : à ce stade, les obstacles, notamment en termes de sécurisation du vote face aux risques de cyberattaque, restent donc trop nombreux pour envisager une généralisation. En attendant de nouveaux progrès, la DFAE a fait savoir à la rapporteure « qu'un groupe de travail DINUM-DGAFP a été mis en place pour étudier la faisabilité d'une solution interministérielle de vote électronique pour les élections professionnelles ».
Un sujet plus immédiat est la dématérialisation de la propagande électorale, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, lors de son discours devant la Conférence des ambassadeurs le 7 janvier 2025, avait appelé de ses voeux. Si le Sénat a écarté à plusieurs reprises cette solution212(*), notamment lors du vote du projet de loi de finances pour 2015, puis dans un rapport de juillet 2021213(*), la situation spécifique des Français de l'étranger justifie une approche différente. En effet, souligne Mme Carmona, « l'envoi papier au 1,7 million de Français inscrits coûte deux millions d'euros pour chaque tour, avec un bilan carbone élevé, et surtout en pure perte, puisqu'en raison des délais, de l'éloignement et de l'aléa postal, dans la quasi-totalité des cas la propagande n'arrive pas à temps dans les boîtes aux lettres des électeurs à l'étranger »214(*).
Les outre-mer sont confrontés à une problématique similaire, notamment en raison de problèmes d'adressage : selon le directeur général des outre-mer, M. Olivier Jacob, « le taux de non-distribution de la propagande électorale envoyée par courrier est significativement plus élevé dans les outre-mer que dans l'Hexagone »215(*).
Il semble donc pertinent, pour les Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer, d'expérimenter la faculté d'opter pour la transmission numérique de la propagande électorale.
Recommandation : Expérimenter la faculté d'opter en faveur de la transmission numérique de la propagande électorale pour les citoyens inscrits au registre des Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer.
(3) Expérimentation du renouvellement des passeports sans comparution : libérer les guichets, faire gagner du temps à l'usager
Le renouvellement d'un passeport implique, pour l'usager expatrié, de se rendre dans un consulat du pays où il réside, ce qui peut impliquer de longs déplacements. C'est pourquoi, entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, la DFAE a expérimenté le renouvellement sans comparution (c'est-à-dire sans que l'usager ait besoin de se déplacer) au Canada et au Portugal.
Comme l'a expliqué Mme Pauline Carmona à la mission d'information, « ce processus permet aux Français majeurs de renouveler leur passeport entièrement à distance, depuis l'introduction de la demande, le paiement et l'envoi des justificatifs jusqu'à la réception du passeport à domicile »216(*). La démarche bénéficiera d'une sécurisation supplémentaire, courant 2025, par l'accès à l'identité numérique fourni par France identité. Au total, selon la DFAE, 2 328 demandes ont été recueillies dans le cadre de l'expérimentation.
Les retours, analysés par la DFAE et la Dinum, ont été très positifs puisque 88 % des usagers ont déclaré leur accord pour recourir à nouveau à la procédure. Le rapport d'évaluation remis en janvier 2025 aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères a recommandé l'extension de l'expérimentation à l'Espagne et à l'Australie.
Là encore, les bénéfices pour l'administration et l'usager devraient être substantiels : le paiement en ligne du timbre électronique et la pré-demande en ligne de titres d'identité et de voyage produiront à terme d'importants gains de temps au guichet, et naturellement des économies en temps et en frais de déplacement pour les usagers. En revanche, pour le moment le temps de traitement de la demande est de 30 à 60 minutes, soit nettement plus que lorsqu'une demande est traitée au guichet (20 minutes), ce qui a conduit le rapport d'évaluation à formuler des propositions d'amélioration.
La rapporteure note que ces chantiers, dont les bénéfices sont tangibles, à la fois pour les usagers et pour les services publics, ont été assortis des moyens budgétaires nécessaires dans la loi de finances pour 2025, effort qui mérite d'être salué compte tenu de la très forte contrainte qui pèse sur les finances publiques, et en particulier sur la mission « Action extérieure de l'État ». Il faut observer que ces programmes libéreront à terme des moyens humains et budgétaires pour nos services publics tout en améliorant le service rendu aux Français.
4. Beta.gouv.fr : un changement d'approche de l'administration dans la création d'outils numériques
Beta.gouv est défini par la Dinum, dont il relève, comme « un programme interministériel qui aide les administrations publiques à construire des services numériques utiles, utilisés, à l'état de l'art, avec le maximum d'impact »217(*). L'outil « mes démarches simplifiées », conçu dans ce cadre, témoigne de l'intérêt potentiel de cette démarche pour les usagers comme pour les agents.
a) Une approche tournée vers l'usager
La vie de ce programme a commencé par la création, en 2013, de la première start-up d'État, data.gouv.fr, plateforme de données publiques en libre accès. Depuis lors, « plus d'une centaine de Startups d'État ont ainsi été créées, parmi lesquelles 30 services numériques à impact national ayant atteint un seuil d'impact significatif »218(*), parmi lesquels on peut citer :
- le simulateur d'aides sociales Aides Jeunes, destiné aux moins de trente ans219(*) ;
- le dispositif Pix d'évaluation des compétences numériques acquises par les élèves dans le cadre scolaire ;
- le pass Culture, application destinée aux 15 - 21 ans pour leur permettre d'accéder à des offres culturelles diverses en disposant d'un crédit utilisable de façon autonome, alloué en fonction de leur âge220(*) ;
- « administration + », messagerie sécurisée mettant en relation les conseillers France services ou les travailleurs sociaux, avec des agents d'organismes publics comme la CAF, la CPAM, la MSA, la CNAV/CARSAT, la DGFIP, France Travail ;
- plusieurs bases de données publiques comme transport.data.gouv.fr, « point d'accès national officiel pour les données de mobilités en France » qui s'étendra prochainement, selon les informations disponibles en ligne, aux offres et lignes de covoiturage, ou la Base adresse nationale, qui répertorie l'ensemble des adresses du territoire français, avec des enjeux tels que l'efficacité des services d'urgence ou le raccordement des réseaux d'énergie et de communication.
Entre autres nombreux exemples, la plateforme Jeveuxaider.gouv.fr, « plateforme publique du bénévolat », qui permet à 17 000 structures de proposer des missions bénévoles classées par thème (santé, environnement, éducation...) à des personnes souhaitant s'engager, de postuler à ces propositions, a été développée dans le cadre de beta.gouv.
Beta.gouv marque un changement d'approche de l'administration, par son fonctionnement horizontal, son approche tournée vers l'usager et une démarche ouvertement inspirée du monde de la tech. Comme l'explique la Dinum, « il repose sur une approche dite de "Startup d'État", fortement inspirée des méthodes agiles et du lean startup, qui valorise une construction incrémentale, fondée sur l'expérimentation rapide et sur les retours utilisateurs » 221(*). Beta.gouv.fr a de proches équivalents dans le monde anglo-saxon notamment, avec le Government Digital Service au Royaume-Uni et l'agence 18F aux États-Unis222(*).
Tout commence par l'identification, par un agent ou une équipe au sein d'une administration, d'un problème ou d'un manque, dont on vérifie, au cours de la phase dite d'investigation (6 à 9 semaines) s'il peut être résolu par le numérique. La solution identifiée est ensuite mise en oeuvre de manière expérimentale par l'agent qui en est à l'origine - ou « l'intrapreneur » dans le vocabulaire de beta.gouv - avec l'assistance d'équipes de la Dinum : c'est la phase de construction (6 à 12 mois). Suivent la phase d'accélération, puis la phase de pérennisation, avec un point effectué tous les six mois sur la pertinence du nouvel outil.
Beta.gouv a depuis son lancement essaimé dans l'administration, puisque la plupart des ministères se sont dotés de leur propre incubateur afin de mettre en oeuvre la démarche en interne. Certains services numériques arrivés à maturité ont également été repris par les administrations. Cela explique en partie le tassement des effectifs observé depuis la fin 2024, après une croissance continue223(*). Cependant, la contrainte budgétaire accrue a également pesé, conduisant les responsables de programmes à limiter les effectifs de prestataires et d'indépendants. De ce fait, « il arrive aussi que des services ayant trouvé leur public et démontré leur utilité soient désinvestis faute de moyens suffisants pour en assurer la continuité » 224(*).
Il y a là un point de vigilance : comme le souligne la Dinum, il convient de « sortir d'une logique à laquelle le numérique est encore souvent perçu comme un coût ponctuel, pour l'inscrire pleinement comme un levier stratégique des politiques publiques. Cela suppose de sécuriser dans la durée les financements et les équipes des services numériques qui fonctionnent » 225(*).
b) « Démarches simplifiées » : un outil de construction de formulaires, moteur de décentralisation et de simplification
Lancé voici dix ans dans le cadre de l'incubateur d'État beta.gouv, « Démarches simplifiées »226(*) consiste à « permettre à n'importe quel service public de créer rapidement un formulaire en ligne sans compétence technique, d'instruire les dossiers reçus, de dialoguer avec les usagers et de suivre les étapes de traitement ». Il est conçu pour les formulaires à volumétrie faible et moyenne, les démarches de dimension plus importante ou nationale étant gérées par la Direction de l'information légale et administrative (DILA).
Chaque démarche a son administrateur - l'agent qui a créé la démarche, et qui pourra éventuellement la clôturer dans le cas d'un dispositif limité dans le temps - et un ou plusieurs instructeurs, qui seront chargés de suivre les dossiers et de les évaluer. L'administrateur est automatiquement instructeur. Le nombre d'instructeurs peut être très élevé : d'après la Dinum, « les fonds verts accueillent plus de 1 200 agents instructeurs de plus de 150 structures publiques (Services déconcentrés, Ademe, ministères etc.) ». La plateforme permet ensuite aux différentes personnes intervenant sur chaque dossier de communiquer et de travailler ensemble.
Pour l'usager, le service est d'utilisation très simple ; la connexion peut se faire par mot de passe, par FranceConnect ou par ProConnect. Grâce à l'intégration d'API, de nombreuses rubriques peuvent être pré-renseignées, en vertu du principe du « dites-le nous une fois ». Enfin, l'usager peut compléter le dossier en plusieurs fois, grâce à la sauvegarde automatique des données renseignées.Le service est également accessible aux collectivités ; à la fois en tant qu'usagers - par exemple pour les demandes de subvention au titre de la DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) ou de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) - et en tant qu'administrateurs. Il présente un intérêt incontestable pour ces acteurs. En effet, selon les informations fournies par la Dinum, « des produits comme “ démarches-simplifiées” sont disponibles sous la forme d'application open source, et peuvent être réutilisées par les collectivités. On compte à ce jour quatre autres instances déployées du produit à destination de collectivités, opérées par des OPSN (Opérateur de Services Numériques) tels que ARNIA (Région Bourgogne-Franche-Comté), Somme Numérique, Gironde Numérique mais aussi par l'association ADULLACT qui opère au niveau national pour des services aux collectivités. En tout plus de 8 000 collectivités peuvent bénéficier de ce dispositif227(*). »
La vie d'une démarche simplifiée, de
l'expression du besoin
à la mise en ligne
Sollicitée par la rapporteure, la Dinum a détaillé le processus qui préside à la naissance d'une démarche simplifiée.
« Prenons l'exemple d'une aide d'État déployée au niveau local à destination des entreprises (exemple des aides d'urgence dans le cadre d'aléas climatiques, comme l'an dernier dans le Pas de Calais ou plus récemment à Mayotte https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fsom-chido-aide-aux-petites-entreprises). Le besoin initial émerge d'un constat local : un aléa climatique nécessite de mettre en place un dispositif multisectoriel, couvrant plusieurs politiques publiques. Les entreprises rencontrent des difficultés à identifier, comprendre et déposer les bons dossiers au bon moment. Une équipe projet, souvent dans ce cas autour d'un cadre public local (sous-préfet, responsable de service), est constituée pour mener une phase d'investigation. Après avoir rencontré les services compétents, les bénéficiaires potentiels et analysé les freins actuels, une première version du formulaire est mise en ligne.
Cette première itération est volontairement minimaliste et testée sur un périmètre restreint. Les retours utilisateurs, côté usagers et côté agents permettent d'ajuster les champs, de clarifier les justificatifs demandés et d'automatiser certaines vérifications. À mesure que la démarche est stabilisée, elle est publiée et généralisée à l'ensemble du territoire concerné, avec des indicateurs de suivi bien définis (délai moyen de traitement, taux d'abandon, satisfaction des usagers). Les démarches ainsi que l'outil continuent d'évoluer au fil du temps, à partir des retours des utilisateurs.
Les délais entre le moment où la décision est prise d'utiliser la plateforme et la publication peuvent être de quelques heures à quelques mois, selon la complexité de la démarche, du processus métiers, ou des interconnexions à établir avec des applications tierces (5 jours pour la mise en place par le ministère de l'intérieur du dispositif d'accueil des réfugiés ukrainiens en 2022 à 6 mois pour la mise en ligne par la DGFiP, le 1er juillet 2025, du remboursement de la TVA pour les transporteurs européens, qui a demandé une interconnexion avec le système d'information européen). »
À ce jour, « Démarches simplifiées » traite « plus de 16 millions de dossiers et près de 400 000 chaque mois, 35 000 démarches de mises en ligne (12 000 actives à fin mai) dans des domaines très variés : subventions, autorisations, demandes sociales, démarches internes aussi, recrutements, etc. Il est utilisé par plus de 2 000 entités administratives ». Ces chiffres établissent que le service a trouvé son public. Il répond incontestablement à un besoin de simplification et d'initiative déconcentrée des administrations, qui se voient dotées, avec « Démarches simplifiées », de la faculté de créer une démarche de manière autonome et rapide.
Une réserve toutefois semble concerner certains cas d'usage du service. Ainsi le Défenseur des droits a, dans un rapport publié en 2022228(*), critiqué les conditions de mise en place de « Démarches simplifiées » par les préfectures pour la demande de titre de séjour. Tout en reconnaissant les avantages de la plateforme pour les usagers, ce rapport estime en effet que le recours à « Démarches simplifiées » est, en l'espèce, revenu à imposer aux demandeurs de titre de séjour une dématérialisation, sans passer par la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). De plus, observe le Défenseur des droits, « cette dématérialisation qui ne semble pas avoir été encadrée par le ministère souffre d'un défaut d'uniformisation, chaque préfecture ayant établi elle-même ses formulaires. Les informations demandées et les pièces exigées peuvent ainsi varier d'un département à l'autre, ce qui n'est pas sans poser des problèmes au regard des principes de légalité et d'égalité. » Enfin, conclut le Défenseur des droits, « l'utilisation de cette plateforme est loin de faciliter l'instruction des dossiers du fait du défaut d'interconnexion entre démarches-simplifiées et l'outil métier des préfectures (application AGDREF) ».
La mission d'information n'a pu établir si ces défauts d'harmonisation avaient été corrigés à la date du rapport. Cet exemple montre toutefois la nécessité de veiller à une utilisation harmonisée d'un système qui a les défauts de ses qualités : la facilité de création d'une démarche peut le cas échéant conduire à la multiplication d'initiatives insuffisamment coordonnées.
Cette réserve faite, « Démarches simplifiées » présente de nombreux avantages en matière d'ergonomie, de facilité d'accès pour l'usager et de capacité d'initiative pour les administrations. Il convient donc que la connaissance de cet outil soit plus largement diffusée (la migration vers une plateforme gouv.fr ne pourra qu'y contribuer) en particulier auprès des collectivités territoriales, pour lesquelles il peut apporter une véritable plus-value si elles choisissent de se l'approprier.
Recommandation : Diffuser plus largement la connaissance du service « Démarches Simplifiées » auprès des collectivités territoriales, en vue de l'amélioration des services publics dont elles ont la responsabilité.
D. UN MAILLAGE TERRITORIAL ORIENTÉ VERS LES BESOINS DES USAGERS GRÂCE AU DÉPLOIEMENT DE FRANCE SERVICES ET À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. France services : des structures désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services publics nationaux comme locaux
a) Des Maisons de services au public (MSAP) au réseau France services
Héritier des maisons de services au public (MSAP), le réseau France services vise à répondre à la demande des usagers de bénéficier d'un accès de proximité aux services publics, dans le contexte issu du mouvement de dématérialisation des démarches administratives et de plusieurs années de diminution du nombre de guichets locaux des administrations nationales dans les territoires. Cette proximité est une attente forte de nombreux habitants des territoires ruraux, qui s'est notamment exprimée dans les cahiers de doléances, comme cela a été indiqué plus haut.
Le Président de la République a annoncé en avril 2019, dans des circonstances marquées par la crise des gilets jaunes, le déploiement de France Services, un réseau de services publics mutualisés, devant permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, à moins de 30 minutes de leur domicile.
La circulaire du 1 er juillet 2019 qui crée formellement France services ne fait cependant pas mystère du rôle des structures préexistantes. Elle indique notamment que « cette nouvelle ambition s'appuie sur une refonte complète du réseau existant des maisons de services au public (MSAP) ».
D'après la circulaire de 2019, le réseau France services poursuit trois objectifs :
- une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils physiques polyvalents (maisons France services proprement dites mais aussi création de formules itinérantes, les bus France Services) ;
- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu des services de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales « afin de lutter contre l'errance administrative et d'apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet » ;
- pour répondre aux critiques émises à l'encontre des MSAP, « une qualité de service substantiellement renforcée » par la définition d'un panier de services commun à l'ensemble du réseau France services.
Le cadre juridique des maisons France services a été élevé au niveau législatif en 2021, par l'article 160 de la loi dite « 3DS »229(*), qui dispose qu'« afin d'améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population ».
La loi précise que « la convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label "France services" ».
On observe que la formule consistant à implanter, dans des territoires où se pose la question de l'accès aux services publics, des structures destinées à constituer un lieu unique d'accès à ces services n'est pas spécifique à la France : ainsi, de telles structures ont été mises en place en Grèce à partir de 2000230(*), initialement pour répondre au besoin des îles les moins dotées en administrations, et dont la taille rend difficile d'y déployer la palette complète des services existants. « Les centres de services aux citoyens (Êíôñá Åîõðçñôçóçò Ðïëéôþí ; KEP) constituent des guichets uniques fournissant un accès à une large partie des procédures administratives auxquelles un citoyen peut être confronté »231(*). Dès 2002, lors de l'adoption de la loi encadrant leur activité232(*), les KEP étaient au nombre de 400.
Un exemple de guichet unique d'accès aux services publics dans les territoires : en Grèce, les centres de services aux citoyens (KEP)233(*)
À partir de 2019, à la faveur du Programme national de simplification des procédures (EPAD), le gouvernement oriente les centres de services aux citoyens (KEP) vers la couverture de l'ensemble des procédures administratives existantes, pour en faire un guichet unique universel, renforçant peu à peu leur moyens - tout spécialement en matière numérique avec, désormais, le déploiement de l'intelligence artificielle. En avril 2025, 52 KEP avaient été érigés en guichets uniques universels. Cet effort s'accompagne aussi de travaux des pouvoirs publics pour réduire le nombre de démarches administratives, en fusionnant certaines d'entre elles, voire en en supprimant d'autres.
En 2021, des sondages montraient que 90 % des Grecs étaient satisfaits des services fournis par les KEP, tandis que 88 % des sondés affirmaient les utiliser en présentiel ou en ligne. Le service de visioconférence bénéficie d'un taux de confiance de 81 %. Depuis 2014, un taux constant de 95 % des sondés demande leur transformation en guichet unique universel.
Les KEP sont administrés par les municipalités dont ils relèvent, mais leur action est supervisée par le ministère de l'intérieur (compétent pour les collectivités locales et l'action territoriale), la direction de l'administration publique (gestion des personnels et moyens), le ministère de la gouvernance numérique (stratégie d'emploi des nouvelles technologies) et le secrétariat général à la gouvernance numérique (développement et mise en oeuvre des outils informatiques).
En 2025, les 1 074 KEP de Grèce étaient armés par 3 700 agents à l'échelle nationale, soit une moyenne de 3,5 agents par centre.
Le fonctionnement des KEP s'est diversifié dans le temps. Simples bureaux administratifs en 2000, ils peuvent aujourd'hui répondre aux demandes des usagers via des rendez-vous physiques dans leurs locaux, traiter des procédures par téléphone ou visioconférences, mais mettent aussi en oeuvre l'application gouvernementale myKEPlive - lancée à partir de la loi de 2020. Cette dernière permet non seulement des échanges par forum en ligne ou visioconférences, tout en proposant des services en ligne que les usagers peuvent utiliser par eux-mêmes, mais aussi d'organiser les rendez-vous en présentiel ; elle permet en outre d'obtenir de l'information, de déposer des requêtes et de fournir des services.
Dans un esprit comparable, des guichets uniques ou Borgerservice (service aux citoyens) ont été mis en place dans les années 2000 au Danemark à l'échelon municipal. Dans un contexte de numérisation rapide des services publics, les Borgerservice assurent un accès à des services tels que : assistance numérique, délivrance de documents d'identité, soutien aux démarches de demande d'aide sociale, inscription au registre national d'identification...
Ces espaces, qui « combinent accueil physique, numérique et téléphonique, enregistrent un haut niveau de satisfaction (85 à 98 % selon les enquêtes), lié notamment à une prise de rendez-vous rapide et à un accompagnement numérique jugé efficace »234(*).
b) Un développement régulier et un maillage territorial ambitieux
La rapporteure se félicite à plusieurs égards de la réussite évidente du dispositif France services, qualifié par Mme Françoise Gatel lors de son audition d'« invention géniale », qui « fonctionne extrêmement bien ».
Ainsi que l'a résumé la ministre déléguée chargée de la ruralité lors de son audition : « les France services c'est le premier kilomètre et non le dernier : le service va aux administrés ! »235(*).
Le maillage territorial ambitieux de ce dispositif est aujourd'hui quasiment achevé : 2 791 France services (chiffres d'avril 2025) sont aujourd'hui déployées et ouvertes sur l'ensemble du territoire national (voir la carte ci-après)236(*) ; 2 804 en juin 2025, selon les éléments d'information transmis plus récemment par Mme Françoise Gatel.
Près de 60 % des France services sont situées dans un territoire rural237(*), dont 20 % dans des territoires ruraux à habitat dispersé ou très dispersé238(*), et un espace France services sur cinq est implanté dans une commune de moins de 1 500 habitants239(*).
Le récent redéploiement de ces maisons dans les zones urbaines est également à saluer : l'orientation donnée en 2019 vers une implantation croissante des maisons dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a des résultats très positifs. Rien n'interdisait théoriquement de créer une MSAP en QPV, mais la quasi-totalité d'entre elles étaient cependant localisées en zone rurale.
Aujourd'hui, plus d'un quart des France services opèrent dans de grands centres urbains ou des centres urbains intermédiaires ; environ 15 % des France services (586) sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 594 QPV sont couverts par une France services240(*).
Ainsi, « le réseau couvre désormais 97 départements, assurant une quasi-exhaustivité territoriale »241(*).
Actuellement, 99,7 % des français habituent à moins de 20 minutes d'une France services242(*). Le profil des usagers est le suivant243(*) :
- 56 % sont des femmes, contre 44 % d'hommes ;
- les tranches d'âge les plus représentées sont les 55-64 ans (20,5 %), les 65-74 ans (21,4 %) et les 45-54 ans (20,2 %) ;
- les jeunes de moins de 25 ans représentent à peine 6 % des usagers ;
- les actifs occupés (63 %) et les retraités (31 %) représentent une part prépondérante des usagers.
À titre d'exemple, la maison France services de Plabennec, visitée par la mission d'information lors de son déplacement dans le Finistère, le 26 juin 2025, accueillait en 2024 57% de femmes et une majorité de seniors. Les retraités représentaient 71% du public, composé à raison de 23% de personnes dont l'âge était compris entre 65 et 74 ans (plus de 75 ans : 13,4%). En revanche on ne comptait que 5% environ d'usagers de moins de 35 ans et 9,2% d'usagers âgés de 35 à 44 ans, la tranche d'âge 45-54 ans représentant 18% des usagers.
Les statistiques de la maison France services de Belleville-en-Beaujolais, visitée par le président et la rapporteure le 16 juin 2025, font état pour 2024 de 19% d'usagers âgées de 65 à 74 ans, de 20% pour les 55-64 ans, 12 % pour les 45-54 ans, 10% pour les 35-44 ans et 2% pour la tranche d'âge 25-34 ans (3% pour les 15-24 ans).
c) Les espaces France services, des acteurs confirmés de l'accès aux services publics
Les espaces France services ont su faire preuve de leur utilité et apporter des niveaux de satisfaction inégalés par les autres administrations aux usagers qui en bénéficient, se traduisant par une très forte fréquentation.
En effet, depuis le 1er janvier 2020, plus de 31 millions de démarches ont été accompagnées en France services (11,2 millions de démarches accompagnées en 2024)244(*), soit une moyenne d'1,2 millions d'actes traités par mois avec près de quatre démarches sur cinq résolues dès la première visite. 9 millions d'usagers ont été reçus en France services en 2024, soit 36 000 par jour en moyenne245(*).
La France services de Plabennec, visitée le 26 juin 2025, a ainsi assuré en moyenne 24,3 accompagnements par jour en 2024 ; 30 pendant le premier semestre de 2025 (avec des pics liés aux échéances fiscales de 75 par jour). Le nombre total d'accompagnements est en progression : 5 239 en 2023 ; 6 038 en 2024.
En outre, l'Agence nationale de la cohésion territoriale (ANCT) met en place progressivement un suivi de la satisfaction des usagers, à travers le baromètre Marianne, par 500 bornes de recueil d'avis implantées dans des maisons et par des enquêtes mystère. 97 % des usagers sont satisfaits de leur démarche en France services et 87 % jugent la réponse apportée adaptée à leur demande.
En troisième lieu, le dispositif France services a permis une réelle montée en gamme du dispositif préexistant des MSAP, bénéficiant de plusieurs effets favorables :
- l'élargissement du socle national d'opérateurs présents dans toutes les maisons, qui sont aujourd'hui au nombre de 12 : CNAF ; CNAM ; Carsat ; MSA ; Urssaf (depuis 2025) ; France travail ; La Poste ; la direction générale des finances publiques (DGFiP) ; France rénov' et le chèque énergie, ainsi que le ministère de la Justice et, enfin, le ministère de l'intérieur avec France titres ;
- la loi dite « 3DS » a élargi les possibilités de conventionner avec des organismes nationaux ou locaux au niveau départemental et infra-départemental, ces conventions devant respecter le référentiel en vigueur. De fait, certaines France services comptent plus d'une vingtaine de partenaires. Ainsi, la mission d'information a été informée, lors de son déplacement à Vendôme, le 19 juin 2025, que des permanences effectuées par de nombreuses associations (droit de la consommation, droit de la famille, droits des victimes, etc.) et professionnels (tels que des notaires, par exemple) permettaient aux usagers de France services de recevoir les conseils les plus adaptés à leur situation et d'être orientés vers le bon interlocuteur. Dans le même esprit, les permanences effectuées par les délégués du Défenseur du droit dans les territoires élargissent encore les services offerts par ces structures ;
- la mise en place d'un cahier des charges identique pour toutes les structures a permis de garantir la qualité et le niveau de service proposés. L'homologation des structures France services est toutefois conditionnée au respect de 30 critères obligatoires de qualité de service, grâce à la labellisation exigeant la présence, au moins 24 heures par semaine, de deux agents dans la structure, formés par les opérateurs nationaux partenaires du programme, d'équipements informatiques en libre-service et d'un système de visio-conférence pour permettre l'organisation de rendez-vous avec les opérateurs, d'outils de communication et d'un espace de confidentialité pour recevoir le public - le lieu devant être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le processus de labellisation des maisons France services
Depuis 2021, l'ANCT a eu recours aux services et à l'expertise des organismes de certification de l'Association Française de normalisation (Afnor) et Vitalis afin de mener les études de dossier et les audits de terrain visant à garantir le respect du cahier des charges nécessaire à l'obtention du label France services.
Chaque trimestre, les campagnes de labellisation suivent les étapes suivantes :
- les préfectures de département présentent à l'ANCT la liste des candidatures déposées 3 mois environ avant la phase de labellisation ;
- elles transmettent deux mois avant la labellisation les documents permettant dans un premier temps d'attester sur pièces du respect d'un certain nombre de critères du cahier des charges. Ce contrôle est mené par les équipes d'Afnor-Vitalis en lien avec l'ANCT ;
- cette analyse documentaire est ensuite complétée par des audits de labellisation systématiques, réalisés le mois précédant la labellisation ;
- Afnor-Vitalis transmet à l'ANCT les résultats de chaque visite de terrain sous la forme de rapports d'audit ;
- l'ANCT contrôle le résultat de l'étude documentaire et du rapport d'audit de chaque structure candidate ;
- l'ANCT annonce aux préfets la liste des structures ayant obtenu la labellisation dans leur département. Les préfets annoncent ensuite les résultats aux porteurs de projet.
Enfin, en dernier lieu, la rapporteure a pu mesurer le consensus des élus locaux et de l'ensemble des acteurs - administrations comme usagers - autour du dispositif France services, indépendamment des inquiétudes qui perdurent sur certains points qui seront développées ci-après.
Lors de ses déplacements, la rapporteure a pu échanger avec de nombreux porteurs de projets, usagers mais également conseillers France services : il en ressort un bilan extrêmement positif du dispositif.
Tous les intervenants entendus par la rapporteure soulignent que l'apport principal du réseau France services est à la fois la fourniture d'une aide administrative et la possibilité d'avoir un contact humain, comme le confirment de nombreuses réponses des élus locaux consultés par la mission d'information (voir l'encadré ci-dessous), ainsi que la capacité à s'adapter aux usagers et à la diversité des publics et des besoins locaux. La neutralité du lieu France services permet en outre de toucher des usagers qui, très éloignés des services publics, ne se rendraient pas aux guichets des différentes administrations.
Ainsi, les témoignages entendus lors de son déplacement dans le Loir-et-Cher, organisé le 19 juin 2025 à l'initiative de M. Jean-Luc Brault, vice-président, ont alerté la mission d'information sur l'importance des espaces France services pour détecter, à l'occasion d'une démarche anodine, des situations de précarité et de non-recours aux droits.
Les France-services, un progrès qui « remet de l'humain » dans le contact avec les administrations selon des élus consultés par la mission d'information
D'après les réponses obtenues dans le cadre de la consultation en ligne des élus locaux, les France services sont quasi-unanimement considérées comme un progrès, plus précisément « parce qu'elles remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». L'absence de France services dans une commune est généralement déplorée par les répondants qui appellent à une extension du dispositif sur le territoire (« Il n'y a pas assez de structures France services » ; « Les structures sont bien, mais il en faudrait bien plus » ; « Il y aurait intérêt à ce que des permanences aient lieu dans chaque commune, au plus près des gens »).
Les commentaires sont régulièrement élogieux : « très bon fonctionnement » ; « une grande réussite » ; « de bons retours » ; « services de très bonne qualité » ; « la satisfaction des usagers fait plaisir à voir ».
De nombreux témoignages appellent ainsi au déploiement des Frances services dans les communes non dotées et au développement de solutions itinérantes.
La qualité et l'implication des agents sont citées à l'actif des France services : « Nous devons cette qualité de service avant tout à l'équipe en place, particulièrement dynamique et engagée, qui connaît bien le territoire et ses enjeux. Leur capacité d'écoute, leur disponibilité et leur réactivité font la force de France services sur notre secteur ».
Toutefois certains élus déplorent une formation perfectible des agents et des réponses parfois imparfaites, à mettre en lien avec l'extension progressive du bouquet de services traités par ces structures et la nécessité pour ces personnels de se former à un nombre croissant d'opérateurs et de démarches.
Ainsi, la rapporteure confirme l'acuité du bilan établi dès 2022 par M. Bernard Delcros, rapporteur spécial de la commission des finances, qui estimait le « déploiement dans l'ensemble réussi des maisons France services » ainsi que « les nombreuses réussites du dispositif qui atteint sa cible »246(*).
d) France Services : un « aller vers » au coeur des territoires
La création du réseau des maisons France services procède d'une logique d'« aller-vers », puisqu'il s'agit de réimplanter les services publics dans des territoires dont ils ont tendance à disparaître. Cette logique a toutefois été poussée encore plus loin avec les versions itinérantes des France services. Selon Juliette Méadel, ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville, dans les quartiers Politique de la ville (QPV), « 46 bus France services [...] se déplacent quotidiennement à la rencontre des usagers. Ce choix d'aller-vers est également complété par 12 France services se déplaçant de site en site, souvent mis à disposition par les collectivités. Au total, près de 10 % (58) des France services en QPV sont itinérantes ».
Dans les campagnes, a souligné Mme Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, « des maisons France services mobiles sont installées dans des camping-cars et vont dans de nombreux villages au moins une fois par mois, par exemple le jour du marché. Le bus France services circule partout sur le territoire ; les gens le voient sur la place du village. Faire venir le service au plus près des gens, c'est régler une partie des problèmes de mobilité, d'accessibilité et rendre visible la présence des services publics » 247(*).
La pirogue France services de Guyane constitue un exemple particulièrement éclairant de l'atout des solutions itinérantes développées dans le cadre du programme France services, souligné par la défenseure des droits au cours de son audition :« Lors de mon déplacement en Guyane, j'ai également pu constater l'efficacité de la démarche de la “pirogue du droit” où des représentants de la CAF et des impôts se rendent en pirogue à la rencontre des usagers »248(*).
Enfin, dernier échelon de l'« aller-vers », la Banque des territoires a financé « l'AMI « Aller-vers et faire-venir en France services » qui a permis à 22 lauréats d'être accompagnés jusqu'en 2025, parmi lesquels des projets d'itinérance en scooter électrique, stand mobile ou vélo cargo (financement de 500 k€). [...] Ils facilitent l'accès des personnes en mobilité réduite ou ne disposant pas d'un véhicule à des permanences ou des sites France services »249(*).
Français des Outre-mer et de l'étranger : l'« aller-vers », une nécessité
Le fort enclavement de certains territoires ultra-marins rend plus nécessaire qu'ailleurs des initiatives de la puissance publique pour se rendre au plus près des citoyens. Ainsi, la direction générale des outre-mer (DGOM) indique qu'à La Réunion, « une maison France services disposant de l'ensemble du bouquet a été labellisée dans le cirque de Mafate où certains ilets en sont accessibles qu'à pied ». Le conseil départemental dispose de structures itinérantes telles que la « Karavane d'accès au droit » qui « depuis 2020 fait de “l'aller vers” dans les quartiers de l'île en apportant de l'information et de l'accompagnement sur l'offre de services du Département (aides PAPH, chèque santé, etc.) »250(*). La DGOM cite également les différentes pirogues mises en service en Guyane : pirogue France Services sur l'Oyapock, pirogue Titres sur le Maroni, mais aussi pirogue du droit et pirogues Éducation nationale.
Outre leur portée bien réelle, ces actions ont une forte dimension symbolique, puisqu'elles matérialisent l'unité du territoire nationale et l'égalité entre les citoyens - même si elles ne suffisent pas, tant s'en faut, à résoudre les problèmes particulièrement lourds dont souffrent nos outre-mer en matière d'accès aux services publics.
À l'étranger, la proximité est assurée par le réseau consulaire : « nos tournées consulaires restent essentielles : en 2024, a indiqué Mme Pauline Carmona, directrice des Français à l'étranger et des affaires consulaires, nos postes en ont réalisé 874, soit 10 % de plus qu'en 2023. Parfois, ces tournées vont jusqu'au domicile d'un ressortissant, comme ce Français handicapé résidant dans un île Grèce qui avait besoin d'une carte d'identité : elle lui a été délivrée par la consule générale à son domicile » 251(*).
2. Un atout des territoires : l'engagement des collectivités territoriales et des élus au service d'un meilleur accès aux services publics locaux et à la lutte contre le non-recours
Les développements ci-après se fondent pour l'essentiel sur les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information, ainsi que sur les informations réunies lors de déplacements dans les territoires.
Ces témoignages reflètent un engagement réel des élus pour « répondre au mieux aux besoins des usagers » ainsi que leur détermination à « répondre de manière plus directe et humaine aux besoins de la population, malgré les contraintes croissantes en matière de moyens et de compétences ».
L'engagement des élus s'appuie sur la conviction que la mairie demeure le premier service public de proximité et « reste le premier service public de France ». Elles sont, en effet, « depuis très longtemps un France services bien avant l'heure ! ».
Parmi les expériences et bonnes pratiques partagées avec la mission d'information, souvent très concrètes, la rapporteure a souhaité faire une place à part aux efforts réalisés par certaines MDPH, à partir de l'exemple de celle du Finistère, visitée le 26 juin 2025, ainsi qu'à l'engagement de certaines collectivités en matière de lutte contre le non-recours.
a) De nombreuses initiatives d'élus pour améliorer les services publics locaux
Nombre d'initiative visent tout d'abord à perfectionner l'accès aux services publics locaux, dans les domaines particulièrement importants au quotidien des usagers.
Ainsi, les élus ont, dans leurs réponses à la consultation de la mission d'information252(*), témoigné d'un réel dynamisme dans des domaines divers :
- enfance et petite enfance (initiatives notamment en matière d'ouverture d'écoles, de centres de loisirs, de haltes garderies, de restaurants scolaires, de crèches ou micro-crèches, d'un « foyer de vie pour personnes en situation de handicap », mise en place de structures d'accueil en temps périscolaire, développement de l'aide aux devoirs) ;
- transition écologique (par exemple, création d'un « service éco-habitat qui propose gratuitement un diagnostic pour les habitants voulant améliorer leur consommation énergétique avec des solutions et un accompagnement sur leur projet ») ;
- santé : création d'un « service municipal de santé avec quatre médecins salariés par la commune et trois assistantes à 80 % » ; projet de « pôle santé associant le Centre municipal de santé et une structure libérale dans le même bâtiment, favorisant le "mieux travailler ensemble" entre public et privé » ; « prise en charge du transport pour les visites chez les médecins, lorsque l'administré n'a pas d'autre solution » ;
- personnes âgées (financement de véhicules de fonction pour les aides à domicile ou le « portage de repas aux aînés »).
D'autres témoignages adressés à la mission d'information font état de nombreuses initiatives destinées à faciliter l'accès aux services publics locaux, telles que :
- l'adaptation des horaires d'ouverture des services administratifs de la mairie (« nocturne le mercredi jusqu'à 19h » ; « tous les matins sauf le dimanche ») ;
- des efforts en matière de « contact et explication en mairie » ; « aide aux démarches pour les seniors » ;
- l'aménagement d'une permanence « dans une partie éloignée de la commune » ;
- le renforcement des moyens du CCAS ; « cantine à un euro » ;
- la création de « Maison des solidarités, en lien avec l'ensemble des institutions traitant des questions sociales » ;
- un projet de « numéro vert » pour « compléter et fluidifier la réponse aux habitants [...] et s'assurer qu'une réponse est systématiquement apportée » ;
- la création d'une adresse mail dédiée à l'urbanisme ;
- en matière d'« aller-vers », le « déplacement de l'agent au domicile des personnes », destiné aux personnes âgées et handicapées.
Des élus locaux témoignent de leur engagement pour atténuer les effets de la dématérialisation des services publics pour certains publics et à prendre en compte les enjeux de mobilité.
De nombreux élus rencontrés ont fait valoir, à l'attention des structures France service, la mise à disposition de locaux et de solutions itinérantes. En effet, l'une des nouveautés de France services par rapport aux MSAP est la mise en place des formules mobiles, généralement sous la forme de bus. En mars 2025, 144 maisons France services sont multisites, parmi lesquelles on compte 134 bus France services, soit 9 % des structures France services. Une pirogue France services fonctionne également en Guyane, comme indiqué précédemment.
La Métropole de Lyon a par ailleurs développé des actions d'« aller vers » : « en 2024, 201 actions d'"aller-vers" ont été menées auprès de 137 structures (157 actions et 1 721 personnes reçues »253(*),. La mission d'information a pu constater cet engagement lors de son déplacement dans le Rhône, le 16 juin 2025, ainsi que celui de la communauté de communes des territoires vendômois, au cours de sa visite dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2025.
Par ailleurs, l'engagement des élus par le biais du recrutement de nouveaux agents revient régulièrement dans les témoignages transmis dans le cadre de la consultation en ligne : conseillers numériques, parfois mutualisés avec une commune voisine ; augmentation des effectifs du CCAS ; création de postes dédiés à l'urbanisme ; prise en charge du recours à une traductrice de langue des signes pour les réunions en mairie ou à l'école.
Certains élus considèrent en outre que le recrutement d'écrivains publics ou d'« accompagnateurs polyvalents pour aider les gens à rédiger leurs dossiers » serait une solution pour mettre « de l'humain au service des plus démunis sociaux et cognitifs ».
On note également des initiatives visant à :
- maintenir l'accueil physique des usagers : un élu relève l'ouverture du service de l'urbanisme « tous les matins sans rendez-vous » ainsi que, en cas de refus, un appel systématique du demandeur par l'agent « pour expliquer le motif de refus et proposer une solution ou une modification du projet » ; le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques ») ; on note également la mise en place, dans une collectivité, d'un « accompagnement des administrés en difficultés » ; parmi les initiatives ainsi déployées on peut citer la formation des agents « pour améliorer l'accueil et l'écoute », la mobilisation du « personnel de l'accueil [qui] accompagne, explique et peut aider les personnes qui viennent » ainsi que la mise en place d'une « aide aux démarches administratives » (un élu évoque l'intérêt que présenteraient des écrivains publics dans ce domaine) ;
- accompagner les usagers dans leurs démarches numériques : mise en place d'une formation à l'utilisation du « portail des familles » pour les parents au moment de la rentrée scolaire « pour expliquer comment faire les démarches » ; un élu fait état de l'engagement personnel du maire, qui « réalise les démarches des administrés depuis l'ordinateur de la mairie (demandes de cartes d'identité...) » ; un autre témoignage souligne l'importance, parallèlement au démarches en ligne depuis le site de la mairie, de rendez-vous pour les usagers ayant besoin d'aide (« Les échanges en présentiel permettent souvent de rassurer les usagers. Le fait d'être face à un interlocuteur "bien réel" y participe grandement. Il remet l'usager au centre des préoccupations du service public ».
Ainsi, la Métropole de Lyon témoigne du développement d'une « offre d'assistance numérique » pour « mieux accompagner les publics en situation de fragilité numérique » (trois services : orientation vers des espaces de médiation numérique, prise de rendez-vous avec des conseillers numériques et possibilité de contacter par téléphone des médiateurs numériques). En 2024, la hotline a ainsi enregistré 2 200 appels, avec un taux de satisfaction de 94 % : « parmi les appelants, 30 % sont des personnes sans emploi et bénéficiaires de minima sociaux, et environ 30 % sont des seniors âgés de 70 ans et plus ».
Enfin, nombre de collectivités territoriales se sont engagées ces dernières années en faveur d'un renforcement de l'accès aux droits des administrés.
Parmi les multiples témoignages en ce sens recueillis par la mission, on relève entre autres exemples l'intérêt porté par la Métropole de Lyon à la création d'« espaces multi-services, rassemblant les différents acteurs intervenant sur le champ de l'accès aux droits dans un même espace ». Cette collectivité note le bilan très positif de « réunions d'information et d'orientation à destination des bénéficiaires du RSA, rassemblant plusieurs acteurs de l'accès aux droits (CAF, CPAM, associations, etc.) ».
Le guichet unique implanté dans le quartier des Rottes (QPV), visité par la mission d'information le 19 juin 2025 à Vendôme relève d'une approche similaire : permettre à l'usager de rencontrer les interlocuteurs nécessaires grâce à un point d'accueil réunissant des acteurs divers (CIAS, services de la mairie - avec des permanences du maire sans rendez-vous -, point justice, point d'accompagnement numérique aux démarches administratives (Panda)...). Selon M. Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de la communauté d'agglomération Territoires vendômois, cette structure présente l'intérêt de faciliter l'identification d'usagers en situation de précarité qui n'auraient jamais eu accès à certaines aides sans ce contact.
b) Territoires zéro non recours : une nouvelle approche des relations entre administrations et usagers
L'expérimentation des Territoires zéro non-recours consiste à s'appuyer sur les données des organismes de protection sociale pour cibler les actions de lutte contre le non-recours aux prestations (notamment RSA et prime d'activité).
Prévue par la loi 3DS et lancée en mars 2023, l'expérimentation inclut 39 territoires retenus dans le cadre d'un appel à projets : 20 communes, 7 départements et 12 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans la description qu'en a donné un rapport d'information du Sénat254(*), « l'objectif de l'expérimentation est de détecter et de lutter contre le non-recours aux droits sociaux, tant pour ce qui concerne les prestations légales que les prestations extra-légales versées par les collectivités territoriales et les EPCI au titre de leurs compétences d'insertion ou d'action sociale. Elle comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».
L'expérimentation a reposé, pour la communauté urbaine d'Arras, pilote du projet, sur la réalisation préalable d'un baromètre du non-recours destiné à identifier les publics cibles et les raisons de ce non-recours.
L'expérimentation Territoire Zéro Non-Recours sur le territoire de la Communauté urbaine d'Arras, intégrée à la convention territoriale globale (CTG), vise, selon les réponses adressées à la mission d'information en réponse à sa consultation des élus locaux, à « réduire le taux de non-recours aux droits et aides sociales en facilitant la transversalité entre les acteurs de l'action sociale et de la solidarité, le repérage des publics en situation de "non-recours" (par la mise en place d'actions "d'aller-vers" et de "faire avec"), en renforçant l'interconnaissance des professionnels des dispositifs d'aide sociale et de solidarité afin de mieux accompagner et orienter les usagers ». Un « baromètre du non-recours » a été établi avec l'Observatoire du non-recours aux droits et services dans le cadre de cette expérimentation.
Baromètre du non-recours (enquête conduite en 2024 par la Communauté urbaine d'Arras)
« Le sujet de l'accès aux services publics est une des thématiques abordées dans un "baromètre du non-recours" aux droits sociaux diffusé sur le territoire communautaire et construit avec les partenaires communautaires de l'action sociale et de la solidarité (CAF, MSA, CPAM, France Travail, Département du Pas-de-Calais, centres sociaux, CCAS, bailleurs sociaux et structures associatives et d'intérêt communautaire) et l'Observatoire du non-recours aux droits et Services rattaché à l'Université de Grenoble.
Ce baromètre, déployé en fin d'année 2024, a permis de recueillir 2 600 réponses.
Les résultats indiquent que :
- 23 % des répondants mobilisent les organismes de sécurité sociale et le service public de l'emploi (France Travail) pour accéder à leurs droits ou disposer d'informations en matière de prestations sociales ;
- 21 % s'orientent plutôt vers les services de proximité des collectivités (Mairies, CCAS, Centres sociaux et services sociaux du Département) ;
- 4 % mobilisent le réseau des "Maison France Services".
Les usagers utilisent donc différents canaux pour accéder aux services publics, mais l'outil principalement utilisé reste internet pour s'informer et contacter les services publics (64 % s'informent sur internet et 57 % contactent les administrations par internet). Globalement, les usagers sont à l'aise avec les démarches en ligne.
Pour autant 38 % des répondants déclarent rencontrer des difficultés pour réaliser des démarches administratives. Pour les publics les plus fragiles, la complexité des démarches pour accéder à un droit et la dématérialisation constituent les freins principaux.
12 % des répondants considèrent que la fermeture d'accueils administratifs a eu un impact sur leurs droits et prestations.
L'éloignement des services publics des institutions qui délivrent des prestations sociales s'explique principalement par la réorganisation des modes d'accueils au profit de la dématérialisation des démarches.
Le "baromètre du non-recours" a permis d'identifier des difficultés dissemblables en fonction des profils. Ainsi, les publics en zone rurale du territoire sont plutôt des personnes âgées qui peuvent se trouver en situation d'illectronisme et souhaitent être accompagnées dans leurs démarches. Les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont eux exposés aux difficultés d'accès aux services publics numériques car ces personnes ne disposent pas des outils adaptés pour réaliser leurs démarches (ordinateur, scanner, imprimante, etc.). Les difficultés rencontrées par les habitants pour accéder aux services publics génèrent ainsi des situations de non-recours aux droits sociaux pour 16 % des répondants. »
Source : consultation en ligne des élus locaux par la mission d'information.
Cette démarche procède d'une approche globale, et non sectorisée par politiques publiques, du public concerné : les destinataires des aides sociales sur le territoire de la communauté urbaine. Ce faisant, celle-ci s'est heurtée à « une difficulté en matière de gestion de la donnée et de son partage par l'ensemble des partenaires institutionnels (caisse de sécurité sociale) qui y voient un risque pour les données personnelles255(*) » notamment.
L'« aller-vers » rejoint ici la problématique du partage des données entre les administrations. À terme, cependant, selon la DITP, « les Territoires Zéro non-recours vont s'appuyer sur des données des organismes de protection sociale pour mieux cibler les actions locales de lutte contre le non-recours aux prestations, notamment au RSA et à la prime d'activité »256(*).
Cette approche nouvelle a fait émerger des solutions elles aussi nouvelles : pour la communauté urbaine d'Arras, « ce rôle d'assembleur et de coordinateur, volontairement assuré par l'EPCI, permet de disposer d'une offre de services structurée, plus lisible pour les opérateurs sur le territoire et facilitante pour les usagers, quels que soient leurs besoins ».
Territoires Zéro non-recours : un foisonnement d'initiatives en milieu urbain
Territoires Zéro non-recours s'insère dans un ensemble de bonnes pratiques à l'échelle locale. « À Rennes Métropole, indique France Urbaine, un collectif ressource composé des associations Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille-et-Vilaine (Le Relais), We Ker et Breizh Insertion Sport s'est constitué avec une équipe pluridisciplinaire et mobile, composée de deux éducateurs de prévention spécialisée, une conseillère en insertion professionnelle, un éducateur socio-sportif. Sept communes ont été sélectionnées pour bénéficier de l'expérimentation “aller vers” en fonction de critères de vulnérabilité identifiés et la métropole s'interroge désormais sur l'extension du dispositif. À Dijon Métropole, l'axe prévention spécialisée est clairement identifié comme prioritaire dans l'approche à destination de la jeunesse. Paris habitat expérimente depuis avril 2025 le dispositif "Vos droits en direct", une démarche visant à lutter contre le non-recours des locataires »257(*).
c) Les MDPH : vingt ans après leur création, des difficultés que les pouvoirs publics s'attachent à résorber, des progrès à saluer
Compte tenu des critiques récurrentes dont font l'objet les délais de traitement des dossiers de handicap par les MDPH, les améliorations décisives mises en place par certains départements, à l'instar du Finistère, ont retenu l'attention de la rapporteure.
(1) Missions des MDPH : rappel
Les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap (MDPH) ont été créées par l'article 64 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap ».
Les missions des MDPH d'après la loi du 11 février 2005
- La MDPH exerce « une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap » ;
- elle « met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire [...] de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée » ;
- elle « assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir » ;
- enfin, elle « met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap »258(*).
Autrement dit, les MDPH ont été conçues comme un point d'entrée unique pour toutes les personnes atteintes d'un handicap, temporaire ou définitif.
(2) Des délais de traitement qui suscitent des critiques récurrentes des usagers et des élus
Vingt ans après l'adoption de la loi handicap, le bilan est contrasté : un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat259(*) établi à l'occasion de cet anniversaire pointait que le délai moyen de traitement des demandes, établi à 4,3 mois pour les enfants et 4,5 mois pour les adultes, cachait « d'importantes disparités en fonction des droits et prestations concernés [...] et en fonction des territoires, certains départements affichant un délai moyen supérieur à six mois ». Nos collègues faisaient également observer que le délai de traitement « [constituait] le principal motif d'insatisfaction des usagers », le taux de satisfaction vis-à-vis des délais n'étant que de 39,3%. Ce rapport de la commission des affaires sociales relevait les « lourdes conséquences » susceptibles de résulter de cette « lenteur administrative », et notamment le risque de renoncement aux droits, « la cellule familiale étant alors souvent amenée à répondre elle-même aux besoins ». Dans cette logique, l'une des recommandations concluant ce rapport appelait à généraliser la démarche de territorialisation de l'accueil de premier niveau des MDPH dans le cadre du service public départemental de l'autonomie (SPDA).
De fait, beaucoup des acteurs interrogés par la mission d'information ont pointé les délais beaucoup trop longs d'instruction des demandes, délais partiellement liés à une augmentation constante du nombre de ces demandes (voir le point suivant sur la MDPH du Finistère).
C'est ainsi que, parmi les structures dont les délais de traitement sont jugés trop longs par les usagers et les élus, les MDPH sont souvent citées en premier. À la question « Dans quels domaines des services publics départementaux les usagers expriment-ils le plus de besoins ou de critiques ? », Départements de France répond : « Les critiques portent souvent sur le traitement des dossiers MDPH du fait des délais de traitement des demandes »260(*). Ce constat a été confirmée par Mme Marie-Agnès Petit, présidente du conseil départemental de la Haute-Loire, lors de son audition en tant que représentante de Départements de France par la mission d'information : « Les usagers continuent à dire que les dispositifs sont trop complexes, qu'il faut s'adresser à plusieurs personnes pour une même démarche, auxquelles il faut d'ailleurs envoyer les mêmes documents, et que les démarches sont bien trop longues. C'est le cas, par exemple, pour les caisses d'allocations familiales (CAF), les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), où les délais de traitement varient entre trois, six et huit mois ».
La durée de traitement peut même, dans certains cas, conduire à un abandon des démarches, comme le constate le Baromètre du non-recours dans la communauté urbaine d'Arras261(*), transmis à la mission d'information par l'association France Urbaine : « Les commentaires laissés par les répondants sont illustratifs. Plusieurs d'entre eux portent sur la lenteur de la réponse des administrations (par exemple sur les dossiers MDPH), les erreurs de traitement ou encore l'absence de réponse de la part d'une administration, qui peut entraîner du découragement ou de l'abandon des démarches ».
L'une des conséquences des difficultés rencontrées par les MDPH a été un déport des sollicitations vers les mairies et les France Services. France Urbaine signale ainsi « un transfert de charge vers les acteurs généralistes de première ligne (CCAS, mairies), qui se retrouvent en situation de devoir suppléer au manque de lisibilité d'autres acteurs (la Poste, les MDPH, les préfectures, les caisses de retraite ou les CAF, par exemple)262(*) ». Un répondant à la consultation des élus lancée par la mission d'information souligne quant à lui que dans son territoire, « les agents des France Services se substituent complétement aux agents de l'État dans leurs propres structures, qui ne remplissent pas ce rôle d'aide et de prise en charge des difficultés sur les dossiers difficiles à remplir par les administrés », citant à ce propos les CAF, les caisses de retraite, les demandes de RSA et les MDPH.
Cette situation est aujourd'hui pleinement reconnue par les pouvoirs publics : M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, a déclaré à la mission d'information : « La saturation de certaines MDPH, malgré les efforts engagés, est une réalité. En tant que ministre de la simplification, je reçois beaucoup de plaintes de Français qui ne s'en sortent plus avec les démarches répétitives qu'implique la reconnaissance d'un handicap263(*). » La ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, a entamé le 20 mars 2025 un « Tour de France des solutions en vue d'amorcer une réflexion sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes en situation de handicap (MDPH) » 264(*). Un groupe de travail composé de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé (ANDASS) et de l'Association des directeurs des MDPH (ADMDPH) a été constitué pour identifier des solutions à ces défaillances.
(3) La MDPH du Finistère : une mobilisation au niveau départemental, appuyée par l'État, qui a produit des résultats tangibles
La mission d'information a souhaité se rendre compte des efforts engagés sur le terrain pour améliorer la réponse apportée aux usagers, en particulier en réduisant la durée de traitement des demandes. Elle s'est donc rendue à la MDPH de Quimper le 27 juin 2025, constatant que l'effort avait déjà été engagé au niveau local.
Le handicap a d'abord été défini comme une priorité au niveau du département, dont témoigne la signature en mars 2022 du « pacte de Pleyben » passé entre l'État et le département du Finistère présidé par M. Maël de Calan, avec trois axes de travail :
- faire de la MDPH du Finistère l'une des plus performantes de France ;
- débloquer l'offre de places en favorisant l'inclusion ;
- soutenir les aidants en faisant connaître les solutions de répit, en développant le réseau d'entraide et en aidant financièrement les associations qui les accompagnent.
La MDPH a ainsi engagé un effort considérable dès 2021 pour réduire le stock de demandes, reposant notamment sur une augmentation de 30 % des effectifs entre 2021 et 2023. La plupart des recrutements ont été pérennisés pour inscrire cet effort dans la durée.
Au-delà du recrutement, l'effort a porté sur plusieurs axes :
- la création, avec l'appui de la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie (CNSA), de pôles spécialisés sur la prestation de compensation du handicap (PCH) et les évaluations courtes (cartes de mobilité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
- l'externalisation de la numérisation des dossiers ;
- la création d'un pôle formation ;
- un pilotage renforcé de l'activité, notamment grâce au recrutement d'un data manager à temps complet ;
- le développement du réseau des référents handicap dans le département ;
- un travail de sensibilisation auprès des médecins afin que le certificat médical soit mieux rempli ;
- une collaboration régulière avec les associations représentant les personnes en situation de handicap, reposant notamment sur des groupes de travail et des rencontres régulières.
Cette politique volontariste a porté ses fruits dès 2023, le délai de traitement des demandes étant désormais inférieur à trois mois, conformément à l'objectif fixé initialement. Cette structure a ainsi substantiellement amélioré son classement.
La rapporteure observe qu'une démarche similaire a été entreprise par le département de la Seine Saint Denis : comme l'a précisé M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental, les délais de traitement des demandes par la MDPH 93 sont passés de 18 mois environ à trois mois pour les enfants et quatre mois pour les adultes. Simultanément, il a été décidé, dans une logique de simplification des démarches, de ne plus demander aux usagers d'apporter chaque année la preuve de leur handicap lorsque celui-ci est définitif.
L'équipe de la MDPH rencontrée à Quimper a par ailleurs souligné plusieurs enjeux et points d'attention :
- la nécessité de limiter le turnover des personnels, qui induit une perte d'expertise sur des procédures particulièrement complexes ;
- l'enjeu de l'interopérabilité du système d'information des MDPH avec ceux des partenaires comme la CNSA ou la MSA ;
- la complexité de la réglementation relative au handicap, chaque prestation (prestation de compensation du handicap, allocation aux adultes handicapés notamment) ayant son propre référentiel technique, ce qui induit une nécessité de polyvalence au sein des équipes ;
- une demande en augmentation tendancielle : 11 % de la population du Finistère a au moins un droit ouvert en 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023, et l'augmentation semble se poursuivre en 2024.
Cette visite a mis en valeur l'exceptionnel investissement des équipes, qui a permis en un temps relativement réduit d'améliorer considérablement le service rendu au public en agissant sur tous les leviers d'amélioration possibles. Parallèlement à l'engagement des personnels, qui doit être salué, cette réussite a reposé sur une contractualisation entre le département et l'État, qui a acté une volonté commune de réussir et fixé des objectifs partagés.
III. DES DÉFIS À SURMONTER POUR QUE LA DÉMATÉRIALISATION PROFITE PLEINEMENT AUX USAGERS
A. LES ANGLES MORTS DE LA DÉMATÉRIALISATION
La dématérialisation croissante des démarches administratives, si elle vise en principe à faciliter l'accès aux droits, tend à exclure une partie significative de la population.
1. D'importantes fractures territoriales qui posent la question de l'égalité d'accès aux services publics
a) Les services publics dans les territoires ruraux : un sujet majeur
Mme Françoise Gatel, ministre délégué chargée de la ruralité, a lors de son audition par la mission d'information qualifié l'accès aux services publics dans les territoires ruraux de « sujet majeur », qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des mobilités ou des services administratifs ; « le sentiment de déclassement ou d'abandon naît de l'éloignement ou de l'inexistence de ces services »265(*), a-t-elle observé.
Les espaces ruraux sont en effet confrontés à une double difficulté : l'éloignement géographique par rapport aux centres urbains et la disparition progressive des services publics de proximité, évoquée au début de ce rapport.
Selon le Conseil scientifique de France ruralité, chargée depuis 2023 de suivre le plan France ruralités, « les espaces ruraux rassemblent [...] 33 % de la population, répartis dans 30 710 communes »266(*), soit comme l'a rappelé Mme Gatel « 22 millions de Français et 88 % des communes ». On observe toutefois des différences notables selon les régions (de 4,5 % en Île-de-France à plus de 50 % en Pays de la Loire, en Bretagne ou en Bourgogne-Franche-Comté), la France se situant à cet égard au-dessus de la moyenne de l'Union européenne (+ 5,5 points)267(*).
La ruralité recouvre ainsi des espaces très divers, car « il faut parler des ruralités » : « Il y a des ruralités qui vont bien : ce sont des ruralités résidentielles ou des ruralités touristiques qui se développent, y compris dans l'intérieur des terres ; depuis la covid, nos concitoyens ont envie d'espace, d'évasion, de dépaysement... Et il y a une ruralité qui est aujourd'hui en difficulté : la ruralité agricole, qui est enclavée. En l'occurrence, deux phénomènes se cumulent : la baisse démographique et le vieillissement de population »268(*).
Près de 60 % des habitants des territoires ruraux en déclin identifient l'éloignement comme le principal obstacle à l'accès aux services publics, selon un sondage effectué en janvier 2025 par l'association Le sens du service public, mené auprès de 2 061 personnes. Toutefois d'après cette enquête, la question « Vous personnellement, diriez-vous que vous avez facilement ou difficilement accès aux services publics ? » appelle 61 % de réponses positives de la part d'habitants de zones rurales dites en déclin269(*).
La ministre déléguée chargée de la ruralité a souligné l'enjeu décisif que représente la jeunesse en milieu rural : « trois millions de jeunes vivent dans la ruralité ». Or, a-t-elle poursuivi, « si le niveau d'enseignement dans la ruralité est le même qu'en ville jusqu'au collège, les difficultés commencent ensuite » :
- « un tiers des jeunes en difficulté scolaire habitent dans des secteurs ruraux » ;
- s'agissant de l'accès à l'enseignement supérieur, l'orientation des jeunes ruraux vers des formations professionnelles a été qualifiée de « plus rapide »270(*).
En outre, selon une étude de la DREES de 2021 dont les estimations restent probablement d'actualité, « Les enfants ruraux disposent en moyenne de 8 places en crèche à moins de 15 minutes pour 100 enfants de moins de trois ans, contre 26 en milieu urbain. Les enfants ruraux résident en moyenne à 25 minutes en voiture d'un pédiatre contre 7 minutes en milieu urbain » ; « Les collégiens des territoires ruraux isolés mettent en moyenne quatre fois plus de temps que les collégiens urbains pour se rendre dans leur établissement »271(*).
La ministre déléguée chargée de la ruralité a rappelé lors de son audition que « Beaucoup d'enfants doivent supporter du transport scolaire parfois dès la maternelle » ; « le temps de transport scolaire [...] dépasse parfois l'heure et demie ». Elle a ainsi souligné l'enjeu que représentent les mobilités : « À l'époque de la création des cantons, la distance parcourue était en moyenne de 5 kilomètres par jour ; aujourd'hui, les personnes vivant dans un milieu rural font souvent 40 kilomètres dans la journée ».
L'absence d'alternative de transport collectif, d'ailleurs régulièrement relevée par les élus locaux dans les témoignages adressés à la mission d'information, revient à « assigner à résidence » les habitants des territoires ruraux qui ne sont pas desservis par les transports272(*).
La ministre a donc présenté, entre autres projets, des initiatives destinées à :
- développer les internats d'excellence et les formations supérieures de proximité ;
- améliorer les transports scolaires par l'équipement de bus permettant aux élèves de « travailler tranquillement à bord, comme on peut le faire, par exemple, dans un train » ;
- encourager le développement de formules itinérantes, au plus près de l'usager isolé (commerces, France services, soins - médicobus, buccobus, gynécobus -, « lignes de covoiturage » déclinées des lignes de bus273(*)).
b) Le service public : « le coeur de la politique de la ville »
« Le service public est le coeur de la politique de la ville » selon la ministre déléguée chargée de la ville, Mme Juliette Méadel, qui précise : « Cela va de la petite enfance jusqu'à l'entrée à l'âge adulte, sans oublier l'épanouissement dans la vie économique et commerciale des quartiers »274(*).
(1) Des caractéristiques socio-économiques conditionnant les besoins des habitants en matière de services publics
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) présentent en effet des caractéristiques démographiques et socio-économiques spécifiques275(*) qui conditionnent les besoins de leurs habitants en matière de services publics :
- une population jeune, avec près de 40 % d'habitants de moins de 25 ans contre 30 % dans l'environnement urbain général et 14 % dans les territoires ruraux ;
- une plus forte proportion de personnes étrangères et immigrées (dont les parts sont 2,8 à 2,5 fois plus élevées que dans les environnements urbains), avec des conséquences en termes de demandes de titres de séjour et, ainsi que l'a montré le déplacement de la mission d'information en Seine Saint Denis, organisé le 8 juillet 2025 à l'initiative de M. Adel Ziane, vice-président, d'importants besoins de traduction pour tirer les conséquences des barrières linguistiques entravant l'accès aux services publics ;
- une concentration de la pauvreté (le taux de pauvreté en QPV est trois fois plus élevé que la moyenne nationale (42,3 % contre 14,4 %), ce qui implique des besoins importants en minima sociaux) ;
- un taux de chômage particulièrement élevé (28 % au lieu de 7,4 % en moyenne nationale) ;
- un renoncement aux soins qui touche 18 % de la population, en raison d'une offre de soins insuffisante ; selon le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, rencontré par la mission d'information le 8 juillet 2025, 98,5 % du département est classé en désert médical selon l'ARS ; la barrière de la langue représente un frein supplémentaire à l'accès aux soins, comme l'a indiqué lors de ce déplacement l'équipe de la PMI de Bondy, qui consacre un important effort à la traduction et à l'interprétariat.
Cette fragilité particulière souligne l'importance de l'« aller vers » en matière de santé, mis en exergue lors du déplacement de la rapporteure et de M. Adel Ziane, vice-président, en Seine-Saint-Denis.
L'« aller vers », une priorité du département de Seine Saint Denis
Lors de la crise sanitaire, qui a causé une hausse de la mortalité dans le département de 130 %, la réticence des habitants à l'égard de la vaccination et la proportion élevée de rendez-vous vacants a conduit à la mise en place de barnum de vaccination au pied des immeubles, puis à la création d'un centre de vaccination au sein du Stade de France, avec 50 % des rendez-vous réservés aux habitants du département.
Conscient de la nécessité de travailler l'information des usagers en matière de santé, le département a mis en place une académie populaire de la santé pour former des citoyens « lambda » et leur faire diffuser des messages adaptés à des usagers éloignés des institutions officielles (langue, mots).
La PMI du département, qui reçoit chaque année en consultation médicale quelque 40 000 enfants, a mis en place des équipes mobiles (puéricultrice, médecin, sage-femme, médiatrice) à destination des bidonvilles et propose des visites à domicile de
puéricultrices et d'auxiliaires puéricultrices. Parallèlement à ces initiatives, l'équipe de la PMI de Bondy, dont la rapporteure a pu mesurer l'implication et l'engagement, a fait observer que le seul fait de disposer de 100 centres de PMI dans le département (les habitants se trouvent ainsi à 15-20 mn d'un centre) constitue en soi un exemple d'« aller vers ».
L'équipement sportif présente également des déséquilibres qualitatifs aux dépens des QPV. Si 90 % des QPV disposent d'au moins un équipement sportif, ces territoires se caractérisent par une surreprésentation des plateaux extérieurs et terrains de grands jeux, au détriment par exemple des piscines et salles fermées276(*). Cette configuration limite la diversité des pratiques et contribue à la faible représentation des licences sportives en QPV : 4 % des licences, alors que près de 10 % de la population réside dans ces territoires.
On observe par ailleurs que parmi les dix France service les plus fréquentées, sept se trouvent en QPV277(*).
Par ailleurs, les populations des QPV « souffrent de barrières psychologiques ou physiques à la mobilité »278(*) qui renforcent leur isolement territorial et peuvent constituer un frein à l'accès aux infrastructures médicales, culturelles et sportives. M. Christian Duchêne, maire de Saint-Fons, rencontré dans le cadre du déplacement de la mission d'information dans le Rhône du 16 juin 2025, a confirmé ce constat : « L'accès aux services publics est un des grands enjeux de notre commune car les gens se sentent particulièrement éloignés du centre-ville ». Il en résulte, selon M. Duchêne, un « sentiment de rupture » qui s'est exprimé lors des émeutes de l'été 2023.
Le maire de Saint Fons a ainsi souligné l'importance des difficultés d'accès aux soins - la proportion de non-vaccinés a ainsi été particulièrement élevée à Saint Fons pendant la pandémie -, l'ampleur des problèmes de mobilité - la commune a pris l'initiative d'une navette gratuite destinée aux habitants de Saint Fons - ainsi que la gravité de la fracture numérique qui caractérisent les habitants de sa commune.
Lors de son audition, Mme Juliette Méadel a plus particulièrement commenté :
- la priorité attachée à l'enfance et à l'adolescence au sein de la politique de la ville : « La garde d'enfant est le seul moyen pour les femmes de pouvoir travailler. Nous comptons ouvrir 100 nouvelles crèches prochainement »279(*). En effet, si 1 755 établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) sont implantés en QPV, soit l'équivalent de 13,7 % des structures nationales, un tiers des QPV demeurent dépourvus de crèches. Bien que 26 % des parents souhaitent confier leurs enfants de moins de 3 ans à la crèche, seulement 9 % y accèdent effectivement280(*) ;
- le soutien aux associations, qui s'inscrit dans le soutien à l'accès aux services publics : « En tant que ministre de la ville, je soutiens le tissu associatif, avec 333 contrats de ville renouvelés fin 2024 et 4 500 postes d'adultes relais, dont 77 % au sein d'associations qui concourent notamment aux démarches administratives et à l'accès au droit ».
Selon la ministre déléguée chargée de la ville, le bilan du renforcement récent des services dans les quartiers porte sur présence de « près de 1 800 établissements d'accueil du jeune enfant, 586 maisons France Services, près de 1 000 équipements sportifs et 258 agences France Travail »281(*).
Les barrières d'accès substantielles aux services publics qui persistent dans les QPV nécessitent le développement d'approches d'accompagnement spécialisées et de dispositifs d'aller-vers adaptés aux spécificités de ces territoires.
Comme l'a souligné Stéphane Troussel, président du département de Seine Saint Denis, lors du déplacement de la mission d'information dans ce département, le 8 juillet 2025, « il ne suffit pas que le service existe pour que les gens osent pousser la porte » : des réflexes d'autocensure conduisent certains habitants à estimer que « ce n'est pas fait pour moi ».
(2) Deux exemples de guichets uniques pour améliorer l'accès des habitants des quartiers aux services publics : Saint Fons (Rhône) et Vendôme (Loir-et-Cher)
Le Point multiservices (PMS) de Saint Fons, visité lors de leur déplacement dans le Rhône par le président et la rapporteure, le 16 juin 2025, constitue une manifestation particulièrement convaincante de l'engagement des élus pour répondre aux besoins spécifiques des habitants des quartiers en matière d'accès aux services publics.
Annexe de la mairie, le PMS propose de nombreux services et permanences aux habitants de Saint-Fons : tous les services de la commune y sont représentés, ce qui permet d'orienter utilement les usagers ; le PMS abrite également une agence postale communale ainsi qu'un point de vente de tickets de TCL (transports en commun lyonnais).
Il propose des permanences d'écrivain public, de conseiller numérique, de médiatrice familiale et de médiatrice santé. Son ouverture le samedi matin reflète à la fois l'ampleur des besoins des habitants et le niveau élevé des sollicitations adressées au PMS.
Les interlocuteurs de la mission d'information ont insisté sur l'importance des demandes concernant le logement social, les titres de séjour, le RSA ; de manière générale ils ont insisté sur la forte proportion de démarches relevant de la CAF et de la CPAM, soulignant l'intérêt de relations étroites entre les agents du PMS et ces organismes.
Dans un esprit comparable, la mission d'information a rencontré avec beaucoup d'intérêt les acteurs du Guichet unique du quartier des Rottes, lors de son déplacement à Vendôme dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2025.
Ouvert en février 2025 dans ses nouveaux locaux, le Guichet unique des Rottes (GUR) procède de la volonté de regrouper en un lieu unique un ensemble de services publics auparavant dispersés : mairie annexe des Rottes (démarches des familles, CNI, passeports, inscriptions aux activités...), Point d'accès au numérique pour les démarches administratives (P@nda), services du centre intercommunal d'action sociale (CIAS), Point justice de la communauté de communes. Le maire de Vendôme, M. Laurent Brillard, y reçoit sans rendez-vous deux fois par mois.
Ce projet de guichet unique s'est inscrit dans le nouveau contrat de ville 2024-2030 ; un espace France services s'y est intégré. Les démarches concernent la CAF (environ 30%), la Carsat (19%), France titres (19%), la CPAM (11%), la DGFiP (8%) et dans une moindre mesure France Renov (3%).
Entre le 1er février 2025 et le 11 juin 2025, 1 941 usagers ont été reçus et 2 146 accompagnements réalisé.
Outre les permanences de la CAF et de la Carsat, les usagers peuvent être accueillis par le service intercommunal du logement social ; le Point justice donne également accès à une information juridique diversifiée (permanences du délégué du Défenseur des droits, par exemple), à des associations telles que France Victimes, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF 41), Action Logement et UFC Que choisir ainsi qu'à des prestations d'écrivain public.
c) L'accès aux services publics dans les outre-mer : un « sujet crucial »
Lors de l'audition de M. Olivier Jacob, directeur général des outre-mer, notre collègue Micheline Jacques, présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, a souligné le « sujet crucial » que constitue l'accès aux services publics dans des territoires ultramarins « éloignés et isolés, car ils sont tous insulaires, à l'exception de la Guyane », cette situation suscitant une « perte de confiance des citoyens ultramarins en l'État et un véritable sentiment d'urgence ».
Par-delà les spécificités de chaque territoire, les difficultés d'accès aux services publics dans les outre-mer tiennent :
- à la géographie (« Même lorsqu'il ne s'agit pas d'îles, l'isolement peut être extrême : en Guyane, certaines communes de l'intérieur, très éloignées de Cayenne, ne sont accessibles qu'en avion »282(*)) ;
- à l'insuffisance des transports en commun ;
- au décalage horaire (« Lorsqu'il est 16 heures à Paris, il est quatre heures du matin en Polynésie française, tandis qu'en Nouvelle-Calédonie, il fait nuit et le jour suivant a déjà commencé »283(*)), qui fait obstacle, pour les usagers de ces territoires, à l'accès aux plateformes téléphoniques nationales telles que celle de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui fonctionnent selon les horaires hexagonaux. En Polynésie, la délivrance des titres et des documents d'identité est compliquée par « le fait que les opérations de maintenance informatique ont lieu la nuit ou le week-end, selon l'heure de Paris, ce qui correspond à la journée dans le Pacifique [et] perturbe l'activité des services des mairies ou des hauts-commissariats de la République »284(*) ;
- à l'adressage, qui peut ralentir, entre autres exemples, l'accès au droit de vote (« le taux de non-distribution de la propagande électorale envoyée par courrier est significativement plus élevé dans les outre-mer que dans l'Hexagone »285(*)) ;
- à la fracture numérique (« De nombreux territoires ne disposent pas de réseaux en fibre optique. La couverture en téléphonie mobile, en 4G ou en 5G, n'est pas toujours bonne »286(*)) ;
- à l'illectronisme et l'illettrisme, dont les taux sont plus élevés en outre-mer que dans l'hexagone287(*) ;
- à des indicateurs sociaux - taux de pauvreté, taux de chômage, part des ménages allocataires du revenu de solidarité active (RSA) - plus dégradés dans les outre-mer que dans l'hexagone, traduisant « un besoin accru de services publics, qui devrait logiquement se traduire par une plus forte présence de ces derniers » ; or « l'implantation des structures France Services est plus complexe dans les outre-mer à cause de l'immensité de certains territoires, tels que la Guyane, ou des problématiques liées à la dimension archipélagique et à la double insularité »288(*).
Par ailleurs, le déploiement systématique d'agents conversationnels et d'intelligence artificielle pour traiter les demandes est susceptible de générer des réponses-types inadaptées aux spécificités ultramarines289(*).
En outre, parmi les services publics présentant des difficultés particulières dans les outre-mer, le directeur général aux outre-mer a cité l'accès à l'eau potable, rappelant qu'à Mayotte l'eau est coupée un jour sur trois et qu'à la Guadeloupe persistent des difficultés dans la stabilisation et l'amélioration de la qualité de ses infrastructures d'acheminement de l'eau.
S'agissant de la Polynésie, il convient également de mentionner :
- que la carte d'identité y est payante (timbres fiscaux délivrés par les bureaux de poste locaux), contrairement à l'hexagone290(*) ;
- que les habitants rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs droits lorsqu'ils se trouvent en métropole : c'est le cas par exemple pour les étudiants, lorsqu'est requis un justificatif administratif qui n'existe pas en Polynésie (attestation fiscale, attestation CAF, etc.) ;
- que lorsqu'en cas de changement de territoire un automobiliste doit récupérer son permis de conduire après une suspension, il se heurte à des obstacles spécifiques en raison de l'absence de reconnaissance mutuelle des médecins agréés pour les visites médicales291(*).
La répartition institutionnelle des responsabilités peut par ailleurs générer des discontinuités dans l'offre de services publics, particulièrement manifestes en Nouvelle-Calédonie où « trois niveaux de collectivités (territoire / provinces / communes) et une répartition complexe de compétences enchevêtrées constituent une entrave structurelle supplémentaire à l'accès aux services publics, ainsi qu'une charge de fonctionnement alourdie, par la multiplication d'interlocuteurs et de circuits, tant pour les particuliers que pour les entreprises »292(*).
En outre, selon les informations transmises à la rapporteure par la direction générale aux outre-mer, les France services peuvent rencontrer dans ces territoires des difficultés de recrutement susceptibles d'empêcher de répondre au cahier des charges actuel.
De plus, les coûts de fonctionnement sont plus élevés qu'en hexagone, alors que le financement est le même. Il est donc important que chaque territoire trouve les solutions qui lui correspondent pour répondre aux attentes de la population, à l'instar de la pirogue France services qui se déplace sur le fleuve de l'Oyapock pour transporter des agents des partenaires vers les populations du fleuve.
Dans un esprit similaire, des « cabines France services » pourraient, selon la direction générale des outre-mer, permettre à des usagers, dans des sites isolés, de contacter par visioconférence des agents des services publics exerçant sur des sites plus centraux293(*). De même le Gouvernement polynésien a-t-il créé les Fare Ora, calqués sur le modèle métropolitain des France Services, pour faciliter l'accès au service public des usagers de Tahiti et des îles. Toutefois, ce dispositif, mis en place en septembre 2024 et qui regroupe essentiellement les services de la Polynésie française et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), semble connaître un « démarrage timide » et son bilan est « contrasté » 294(*).
2. Des usagers au bord du chemin
a) Des parcours de moins en moins linéaires : les cas complexes liés par exemple au parcours des polypensionnés ou à des périodes de travail à l'étranger
Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, rencontré le 8 juillet 2025, a souligné la fréquence de « parcours de moins en moins linéaires » (périodes de minima sociaux, « petits jobs », périodes de travail ou de formation à l'étranger, succession de contrats relevant de statuts et de caisses de retraites différents) qui compliquent singulièrement certaines démarches, qu'il s'agisse de demandes d'aides sociales ou de liquidation de droits à pension.
Le sociologue Vincent Dubois, entendu par la rapporteure le 29 avril 2025, a confirmé cet angle mort des services publics : « Une autre difficulté structurelle du rapport à l'administration tient à la nécessité de "rentrer dans des cases" comme on le dit ordinairement, c'est-à-dire définir une situation ou une demande qui peut être complexe, intermédiaire, non prévue par l'administration, dans des catégories administratives forcément simplificatrices et qui ne peuvent jamais prévoir tous les cas de figure possibles ». Si le contact physique avec un agent peut permettre à l'usager d'expliquer sa situation, il en va tout autrement « face à un menu déroulant qui, au mieux, comprend une rubrique "autres cas" » : « l'usager qui ne "rentre pas" dans les items préétablis peut se retrouver sans solution »295(*).
S'agissant des polypensionnés, il est significatif que l'exemple type d'une infirmière ayant travaillé d'abord en tant qu'infirmière libérale, puis en tant qu'infirmière à l'hôpital ait été choisi pour illustrer les difficultés administratives auxquelles sont confrontés de nombreux usagers dans le document du Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) cité dans les premières lignes de ce rapport296(*).
Lors de l'audition de la défenseure des droits, notre collègue Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France, a alerté sur la situation particulièrement difficile de « certains Français à l'étranger [qui] attendent leur retraite depuis près de trois ans » : les dossiers des personnes qui ont eu une carrière entrecoupée de périodes passées à l'étranger figurent en effet parmi les plus complexes que la Cnav ait à traiter. C'est du reste l'accès à la retraite qui semble poser le plus de problèmes aux Français établis à l'étranger dans leurs relations avec les administrations françaises, ce que confirment les difficultés imputables à l'identité numérique pour nombre de nos compatriotes à l'étranger, retracées dans l'encadré ci-dessous.
Français à l'étranger : les ratés de l'identité numérique
Notre collègue Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France et vice-présidente de la mission d'information, a attiré l'attention de la rapporteure sur les difficultés que rencontrent les Français résidant au Canada pour s'identifier sur France connect, prérequis de l'accès à leur dossier personnel et de la constitution d'un dossier de retraite.
Ces obstacles sont un cas d'école d'une numérisation qui est globalement source de progrès, mais dont les dysfonctionnements se traduisent au contraire par des difficultés accrues dans l'accès aux services publics.
Il existe pourtant divers opérateurs (Laposte, MSA, Yris, Ameli, Trustme, impots.gouv) grâce auxquels l'usager peut faire valider son identité en ligne, mais aucune de ces applications n'est en mesure de délivrer correctement ce service : à titre d'exemples, Laposte et Yris ne permettent pas de recevoir le SMS de l'opérateur sur les numéros canadiens, un code postal français est exigé par Ameli, Trustme ne permet pas d'ouverture de compte avec un numéro canadien et l'accès via impots.gouv est subordonné à la perception de revenus en France.
Des retraités résidant à l'étranger rencontrent ainsi des difficultés pour accéder à France connect car ils ne disposent pas d'un numéro de téléphone français (même si une quarantaine d'indicatifs téléphoniques sont en principe acceptés)
La difficulté technique à faire valider leur identité numérique a des conséquences très lourdes pour certains de nos compatriotes établis à l'étranger, contraints pour faire valoir leurs droits à pension de retraite à de longs échanges par téléphone et par courrier faute de pouvoir s'identifier sur France Connect.
Le parcours des usagers français résidant à l'étranger reste souvent complexe et il demeure difficile de faire valoir ses droits depuis l'étranger, a fortiori lorsque l'administration n'est joignable que par un numéro abrégé, non accessible depuis l'étranger, et qu'à cet obstacle technique s'ajoutent les contraintes du décalage horaire. En revanche des solutions innovantes, analysées ultérieurement dans ce rapport, ont été trouvées pour faciliter certaines de leurs démarches impliquant le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (copies d'actes d'état-civil, délivrance de passeports par les ambassades et consulats, etc.)
b) « Le nouveau visage des inégalités est numérique » : les dangers de l'illectronisme
« Le nouveau visage des inégalités est numérique » : ce constat établi par l'ONU en 2022297(*) désignent les catégories les plus exposées au risque d'être les « laissés pour compte de l'administration numérique » : ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les femmes et les filles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants et les réfugiés ainsi que « les autres populations vulnérables ».
Comme le rappelle le rapport du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics298(*), « la possibilité d'être un acteur autonome de sa vie administrative en ligne suppose que soient réunies plusieurs conditions cumulatives : le fait de disposer (ou au moins d'avoir accès) à un équipement informatique fonctionnel (ordinateur, imprimante, scanner), le fait de disposer d'une connexion suffisante pour interagir avec les sites publics et communiquer des pièces jointes, le fait de maîtriser le fonctionnement des principaux logiciels de navigation et de communication sur le web, enfin, la capacité de comprendre ce qui est attendu de l'usager dans le cadre des démarches administratives ».
La notion d'illectronisme reflète ainsi les risques d'exclusion liés à l'impossibilité d'utiliser les ressources numériques faute de disposer des équipements ou des connexions nécessaires, ou faute d'avoir acquis les compétences requises.
Rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'exclusion numérique - définition de l'illectronisme299(*)
« Néologisme et mot-valise issu de la contraction entre les mots "illettrisme" et "électronique", l'illectronisme est entré, en 2020, dans le dictionnaire Larousse, qui le définit comme "l'état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources numériques".
Si l'on en croit cette définition, l'illectronisme serait donc le prolongement contemporain de l'illettrisme, en tant qu'incapacité, par manque de compétences, à déchiffrer un langage. Bien qu'éclairante, cette comparaison est cependant réductrice. En effet, le numérique constitue le support d'usages dématérialisés, mais repose avant tout sur l'utilisation de terminaux physiques, comme les ordinateurs et les smartphones.
L'illectronisme est donc plus qu'un illettrisme : à l'absence de compétences, s'ajoutent également les formes d'exclusion matérielle du numérique, soit l'incapacité ou l'impossibilité, faute d'équipements, de se connecter aux réseaux.
Ce caractère dual de l'illectronisme est d'ailleurs retenu par la définition donnée par l'Insee, et qui sera retenue dans ce rapport : l'illectronisme désigne ainsi "le fait de ne pas posséder les compétences numériques de base (envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes en ligne, utiliser des logiciels, etc.) ou de ne pas se servir d'Internet (incapacité ou impossibilité matérielle)" ».
Une étude de l'INSEE publiée en 2023 fait ainsi observer que « En 2021, 15,4 % des personnes de 15 ans ou plus résidant en France sont en situation d'illectronisme : 13,9 % n'ont pas utilisé Internet au cours des trois derniers mois et 1,5 % l'ont utilisé mais ne possèdent pas les compétences numériques de base. L'illectronisme s'accroît nettement avec l'âge et est plus répandu parmi les personnes les plus modestes. En outre, 28 % des usagers d'Internet ont des capacités numériques faibles, c'est-à-dire qu'ils manquent de compétences dans un, deux ou trois domaines parmi les cinq que sont la recherche d'information, la communication en ligne, l'utilisation de logiciels, la protection de la vie privée et la résolution de problèmes en ligne. [...] L'illectronisme a diminué de 3 points entre 2019 et 2021, dans le contexte de la crise sanitaire »300(*).
Par-delà les difficultés tenant à un équipement insuffisant, cette étude de l'INSEE met en valeur des différences :
- générationnelles : les personnes les plus âgées sont les plus touchées par l'illectronisme : 62 % des 75 ans ou plus, contre seulement 2 % des 15-24 ans ;
- de niveau d'éducation : « les personnes sans diplôme ont un risque 7 fois plus élevé d'être en situation d'illectronisme que les personnes ayant au moins un bac+3 » ;
- de niveau de revenu : « les 20 % les plus modestes ont 6,6 fois plus de risques d'être en situation d'illectronisme que les 20 % les plus aisées ».
Enfin, certaines zones géographiques sont plus touchées que d'autres : les territoires les plus défavorisés et enclavés sont souvent des foyers d'illectronisme.
S'agissant des outre-mer, comme l'a indiqué le délégué général aux outre-mer Olivier Jacob à la mission d'information301(*), « en raison de taux de pauvreté élevés, on observe également des taux préoccupants d'illettrisme et d'illectronisme. C'est le cas notamment à Mayotte et en Guyane. À Mayotte, le taux d'illettrisme dépasse les 30 % de la population. Dès lors, dans un contexte de numérisation croissante des services publics, les difficultés d'accès deviennent particulièrement aiguës ». Selon l'Insee, le taux moyen d'illectronisme dans les outre-mer atteint 20 %, contre 15 % en métropole.
En ce qui concerne les quartiers prioritaires de politique de la ville (QPV), « le taux d'illettrisme est 3 fois plus important en QPV (13 %) qu'au niveau national (4 %) et légèrement supérieur aux régions rurales les plus défavorisées (10 %). Cette situation engendre des difficultés d'accès aux démarches administratives sur internet (26 % de la population en QPV n'opère aucune démarche internet en QPV, contre 9 % en moyenne nationale) »302(*).
À cet égard, la remarque d'une conseillère numérique rencontrée lors d'un déplacement de la mission d'information, a évoqué de manière éclairante le cas de personnes qui s'adressent à elle après avoir vainement essayé de contacter les services de la préfecture : « On m'a dit d'aller sur internet. Il est où, internet ? », insistant sur la situation particulièrement aiguë de personnes qui, faute d'adresse courriel et d'être en mesure d'envoyer un message électronique, ne peuvent par exemple faire renouveler une carte de résident périmée.
S'agissant par ailleurs des difficultés liées à un équipement défaillant, le Baromètre du numérique du CREDOC (édition 2025) révèle, en matière de connexion internet fixe à domicile, une stabilité de l'équipement en France303(*), avec des disparités géographiques persistantes et des différences selon le niveau de diplôme, parallèlement à une baisse des écarts de niveau d'équipement en fonction du revenu et de l'âge et à une dégradation de l'équipement des jeunes adultes en connexion fixe (voir l'encadré ci-dessous).
L'évolution de la connexion internet fixe à domicile selon le CREDOC : stabilité de l'équipement, disparités territoriales, diminution de certains écarts304(*)
La proportion de personnes disposant d'une connexion internet fixe à domicile s'établit à 84 % en 2024, un niveau quasi-inchangé depuis huit ans.
On observe toutefois :
- des disparités géographiques persistantes du taux d'équipement entre zones rurales (79 %) et zones urbaines (85 % ; 86 % pour l'agglomération parisienne) : ces différences restent stables, selon le CREDOC, depuis 2019 ;
- une différence sensible en fonction du niveau de diplôme : de 57 % pour les non-diplômés, le taux d'équipement atteint 88 % pour les diplômés du supérieur (85 % pour les bacheliers).
En revanche on note une baisse des écarts de taux d'équipement :
- selon le niveau de revenu (25 points en 2014 ; 5 points en 2024) : en 2024, le taux de connexion des bas revenus est de 80 % ; de 85 % pour les hauts revenus.
- en fonction de l'âge : 69 % des 70 ans et plus disposent d'une connexion fixe à domicile, soit 17 points d'écart par rapport à la population globale ; cet écart était de 37 points il y a dix ans305(*). Le taux d'équipement des tranches d'âge plus jeunes reste néanmoins plus élevé : 83 % pour les 25-30 ans ; 89 % pour les 40-59 ans ; 88 % pour les 60-69 ans.
Paradoxalement, l'enquête met en évidence une dégradation significative de l'équipement des jeunes adultes en connexion fixe. Les 18-24 ans ne représentent plus que 78 % d'équipés en connexion internet fixe domiciliaire en 2024, contre 92 % en 2019, soit une chute de 14 points. Cette régression ramène le taux d'équipement de cette tranche d'âge à des niveaux comparables à 2007, suggérant une substitution progressive par les connexions mobiles et une évolution des modes de consommation numérique chez les jeunes générations, axées sur le téléphone et la connexion mobile
Dans le même temps, le taux de connexion à domicile par la fibre continue de progresser : 75 % de la population disposant d'un accès à internet à domicile se connecte par la fibre ou le câble, soit une augmentation de 8 points en l'espace d'un an et de 46 points en l'espace de cinq ans. En outre, un rapport de la Cour des comptes publié en 2024 observe que le taux de couverture du territoire par la fibre optique s'élève à 90 % en 2024, ce qui place la France à la première place des pays européens, même si ce succès en termes de déploiement du réseau de fibre optique masque de fortes disparités territoriales306(*). Lors de la réunion constitutive de la mission d'information, notre collègue Ronan Dantec s'est d'ailleurs inquiété de « l'accès à la fibre, ou plus simplement à internet, dans les territoires »307(*). La Cour des comptes note, s'agissant de la fibre, que « Les disparités territoriales sont ainsi particulièrement fortes entre territoires ultramarins, avec un déploiement [de la fibre] de 93 % à la Réunion, 73 % en Guadeloupe, 66 % en Guyane, 61 % à Saint-Barthélemy, 57% en Martinique, 56 % à Saint-Martin. Toutefois, tous ces territoires connaissent un rattrapage rapide de leur taux de couverture dans la mesure où ils présentaient, début 2020, un déploiement de la fibre inférieur à 20 %, sauf la Réunion (73 %) »308(*).
B. DES EFFORTS À AMPLIFIER
1. Accompagner la croissance du dispositif France services tout en consolidant le modèle
a) Les réserves exprimées par certains élus consultés par la mission d'information : un réseau rendu nécessaire par le désengagement de l'État, qui pèse sur les finances des collectivités
En dépit d'un bilan jugé globalement satisfaisant du dispositif France services, certains témoignages d'élus locaux recueillis par le biais de la consultation en ligne expriment des réserves à l'égard du dispositif, qu'il convient de prendre en compte pour l'améliorer à l'avenir.
Selon ce point de vue, si les France services ont amélioré l'accès aux services publics, ce progrès n'a permis qu'un rattrapage partiel de la situation antérieure aux vagues de fermeture des services publics.
Dans cet esprit, le succès des France services est surtout le reflet du manque de services publics de proximité : « l'affluence importante et grandissante témoigne du besoin absolu qu'ont les citoyens d'avoir des structures locales et humaines. La fracture numérique doit être compensée et les services publics de proximité rétablis ».
Le déploiement des France services, porté par les collectivités territoriales, est présenté de manière récurrente une conséquence du désengagement de l'État (les France services seraient un « cache misère », un « palliatif à la carence d'État dans les territoires » ; « les maisons France service sont l'affirmation, la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État »).
Enfin, le dispositif pèse sur les finances des collectivités territoriales (40 000 euros par an selon un élu ; 120 000 euros pour une commune porteuse de deux structures, l'une mobile et l'autre en QPV) : « l'État reporte sur les municipalités la charge de ces structures qui sont cependant fort utiles » ; « Des services bien rendus mais portés à bout de bras par l'interco alors que l'État fait croire qu'il est le financeur de ce service » ; un élu exprime des doutes sur la « multiplication des agences en cette période d'économies budgétaires ». L'appel à renforcer le financement des France services par l'État est ainsi récurrent.
À cet égard, Mme Marianne Margaté, vice-présidente, a proposé lors de l'examen du rapport, le 16 septembre 2025, « que l'État finance à 100 % les maisons France services, afin de garantir un égal accès aux droits », ajoutant que « les communes, rurales ou urbaines, n'ont que peu de moyens ». Notre collègue Philippe Folliot a pour sa part estimé que le montant des subventions attribuées aux collectivités au titre de France services devrait tenir compte des efforts déployés pour assurer des horaires d'ouverture adaptés aux horaires de travail des usagers, par exemple le samedi matin.
Par ailleurs, des élus relèvent que la faiblesse des effectifs peut rendre le service « fragile puisqu'il arrive régulièrement que le lieu soit fermé pour cause de maladie », tandis que certains témoignages font état d'un « engorgement » des structures France service en raison d'un afflux de demandes, ce qui souligne selon eux l'urgence de « renforts ».
Ces réserves appellent à des réponses visant à consolider le dispositif France services qui doit, aux yeux de la rapporteure, entrer dans une phase de stabilisation afin de garantir dans la durée le maintien des bons résultats du programme.
b) Garantir un lien efficace entre France services et le back office : une exigence que les opérateurs doivent satisfaire
Nombre d'élus locaux alertent sur les risques de dévoiement du développement de ces structures, conçues initialement comme une offre complémentaire aux guichets des opérateurs, ces opérateurs diminuant progressivement leur présence territoriale. Or les France services ne peuvent en aucun cas constituer un substitut à l'offre existante de services publics. L'absence de décharge de l'État et des opérateurs sur le réseau France services doit rester la règle. Certains élus consultés par la mission d'information regrettent que France service constitue une parade à un désengagement de l'État dans les territoires.
Le lien avec les opérateurs ne se traduit que trop rarement par l'instauration de véritables permanences physiques dans les France services. La présence physique des opérateurs en France services ne doit être ni systématique ni permanente, mais elle doit rester une possibilité selon les périodes et les opérateurs. Par exemple, une permanence de la DGFiP en France services peut être très bénéfique lors des campagnes de déclaration d'impôt, là où elle ne s'impose pas le reste de l'année. Parallèlement à ces exigences de calendrier, les permanences physiques peuvent également répondre à des problématiques locales. Il convient donc de développer les permanences physiques des opérateurs dans les France services.
Recommandation : Développer des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France service, en adéquation avec les besoins du territoire et selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.
Parallèlement, les agents France services doivent théoriquement n'assurer qu'une offre de premier niveau, les demandes plus complexes ou le suivi des dossiers personnels des usagers relevant des services en titre. Toutefois, en réalité, nombre de démarches sont traitées par les agents France services alors qu'elles dépassent le strict cadre de l'accompagnement de premier niveau, nourrissant encore davantage les craintes d'un désengagement des administrations
Ce constat soulève la question de l'efficacité du back office : dans leurs réponses à la consultation de la mission d'information, des élus regrettent « un « lien complexe avec certaines administrations », qui limite l'efficacité des interventions des personnels. Cette question s'est d'ailleurs posée lors de toutes les visites de structures France services par la mission d'information, notamment lors de son déplacement dans le Finistère, le 25 juin 2025, comme le montre l'encadré ci-dessous relatif à l'espace France services de Plabennec.
L'activité d'une maison France services et les relations avec les partenaires nationaux : l'exemple de Plabennec
Le déplacement de la mission d'information dans le Finistère a été l'occasion de visiter un espace France Services à Plabennec et d'y rencontrer à la fois les agents et les représentants des partenaires nationaux. Cette structure, ouverte en 2022, forme, avec l'antenne de Lannilis, la maison France Services du Pays des Abers, rattachée à la communauté de communes du même nom. L'espace France Services de Plabennec voit son activité augmenter régulièrement, à 34 accueils par jour en 2025 contre 24 en 2024 - alors même qu'avec 35 maisons dans le département, le maillage peut être considéré comme complet.
Les partenaires contribuant le plus à son activité sont, dans cet ordre, la DGFiP (28%), France Titres (18%) et la caisse d'assurance retraite (17%). Les participants ont présenté la nature des relations avec chaque opérateur : certains, comme la CAF, ont mis en place un numéro spécifique pour les agents France services, d'autres non. Si les opérateurs représentés à la table ronde (CAF, DDFiP, Urssaf, CPAM, France Travail), ont attesté de leur implication dans le dispositif, les relations semblent beaucoup moins fluides avec d'autres, en particulier MaPrimeRénov', faute de relation directe avec l'opérateur.
Les participants à la table ronde organisée sur place, qui réunissait les élus, les services de la communauté de communes et les représentants des partenaires nationaux, ont évoqué les efforts engagés en matière d'accueil du public, malgré un recul général des implantations physiques des administrations comme les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les centres des finances publiques ou France Travail. Chaque partenaire adapte ainsi sa présence au public visé, en s'appuyant sur les France Services mais aussi sur d'autres dispositifs :
- les Urssaf assurent des permanences au sein de l'espace France Services pour les particuliers employeurs et les micro-entrepreneurs ;
- la CAF a, quant à elle, établi un partenariat avec une épicerie solidaire pour repérer les situations les plus complexes dans la zone enclavée du cap Sizun ; ensuite traitées par un agent qui se rend sur place une fois par trimestre ;
- pour toucher la population d'un quartier Politique de la ville de Quimper, France Travail s'est appuyé, de son côté, sur une tournée du véhicule « Place de l'emploi » ;
- la CPAM a noué un partenariat avec l'association « les MarSOINS du bout du monde, qui se rendent avec un camion de soins dans les zones les plus enclavées.
Les participants ont souligné plusieurs enjeux autour de l'accueil du public :
- la nécessité d'une dynamique collective entre les services locaux et les opérateurs, afin d'éviter que les partenaires ne se recentrent sur la production administrative (back office) en laissant France Services assurer le front office.
- l'impératif d'anticiper collectivement les pics d'activité liés à des facteurs saisonniers (période des déclarations par exemple), à des évolutions législatives ou réglementaires (individualisation du prélèvement à la source, qui devrait entraîner un afflux de demandes) ou à des campagnes de communication ;
- l'effort pédagogique important à engager auprès de l'usager afin de lui faire comprendre que les conseillers France Services ne sauraient avoir réponse à tout, et que le « deuxième niveau » de la réponse reste assuré par les partenaires nationaux.
L'enjeu est d'autant plus important que France services doit recréer du lien entre l'usager et les administrations : il n'est pas envisageable que la non-réponse des opérateurs en back-office entraîne des difficultés pour les conseillers France service, voire leur insécurisation dans les réponses qu'ils apporteraient aux usagers. Lors d'un déplacement, un conseiller France service a témoigné : « Pour aider un usager dans un dossier de relevé de carrière, j'ai dû essayer de lui trouver un rendez-vous à la Carsat car son parcours était compliqué. Mais ce n'est pas facile de joindre la Carsat par téléphone. Hier j'ai obtenu un rendez-vous téléphonique pour dans 15 jours ! ». On peut légitimement s'étonner de tels obstacles.
Tous les personnels rencontrés ont vivement regretté de ne pas disposer d'un contact rapide (de préférence par téléphone) permettant de joindre un interlocuteur dédié sans avoir à passer par la plateforme des usagers qui impose parfois aux conseillers France services des temps d'attente incompatibles avec l'exigence d'efficacité de leur mission. « On soulage [les opérateurs] en faisant leur accueil, ils pourraient mettre un interlocuteur à notre disposition ! » : cette remarque, entendue lors d'un déplacement, paraît plus que justifiée à la rapporteure qui s'étonne de l'absence d'un tel contact et juge que celui-ci devrait être systématique.
La mise en place d'un courriel électronique dédié (par la biais d'« administration + »), destiné en principe à pallier l'absence de canal téléphonique spécifique, a été exposé par les représentants des organismes de protection social rencontrés par la rapporteure au Sénat le 24 juin 2025. Mais cette formule ne permet pas aux conseillers France service de faire face à des situations dans lesquels une réponse urgente peut légitimement être attendue par l'usager. Elle ne saurait remplacer la mise en place d'un accès téléphonique spécifique aux conseillers France services.
De plus, l'investissement local des opérateurs est très variable en fonction des partenaires et des départements : autant de France services, autant de CAF, de CPAM, de Carsat... Pour la mission d'information, un tel aléa n'est pas acceptable.
Il convient dès lors de délimiter et de sécuriser l'intervention des conseillers France services en s'assurant de la création et du maintien de lignes téléphoniques directes et dédiées aux agents France services en back-office, qui est une obligation figurant dans le cahier des charges mais dont la réalité montre qu'elle n'est pas toujours respectée. Il est donc crucial de s'assurer du respect du cahier des charges sur ce point précis.
Recommandation : Garantir aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département, afin de faciliter et de sécuriser leurs interventions auprès des usagers.
En complément, de bonnes pratiques pourraient être déployées et formalisées lors de la prochaine convention qui devrait être signée en 2026 afin de fluidifier les relations entre les démembrements locaux des opérateurs et les espaces France services. Ainsi, l'ANCT évoque, en réponse aux questions de la rapporteure, des pistes qui méritent d'être expertisés en commun avec les conseillers France services, qui seront les premiers concernés par ces nouvelles mesures : « dispositifs de réorientation d'usager, prise de rendez-vous possible par les France services pour les opérateurs, permanence de l'opérateur en France services, rendez-vous en visioconférence ».
c) Consolider l'accessibilité des structures en milieu rural : l'intérêt des formules itinérantes illustré par le bus France services du Territoire vendômois
Les distances à parcourir pour accéder aux France services sont régulièrement déplorées : de nombreuses réponses observent que les structures France services sont implantées dans les communes principales des EPCI, aggravant la situation des « personnes en déficit de mobilité », et au premier chef des personnes âgées pour lesquelles une distance à parcourir de 30 km est excessive, a fortiori en l'absence de transports collectifs. Un élu évoque à cet égard la mise en place d'un « service de taxi à la demande » organisé par son intercommunalité. Un répondant alerte sur les conséquences possibles, dans les ZFE, de cette implantation. Dans ce contexte, les formules itinérantes parfois proposées aux habitants des petites communes sont unanimement saluées, même si certains élus regrettent la rareté des passages (le rythme d'une matinée par mois est considéré comme insuffisant compte tenu de la demande ; on note l'expression récurrente d'une demande d'amplification de ces solutions mobiles).
Lors de sa visite dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2019, à l'initiative de notre collègue Jean-Luc Brault, vice-président, la mission d'information a pu se rendre compte très concrètement de l'intérêt des structures France service itinérantes. Ainsi, le bus mis à la disposition des habitants du Vendômois couvre 65 communes et plus de 52 000 habitants. Accueillant les usagers avec ou sans rendez-vous, il permet de lever les freins à la mobilité et d'améliorer le repérage de personnes en difficultés.
Un exemple d'engagement au service des usagers éloignés des services publics et du numérique en territoire rural : le bus France services du Territoire vendômois
Mis en service en novembre 2022, ce bus comprend deux espaces d'accueil. Il est équipé de deux ordinateurs portables et de matériel de scan et d'impression ainsi que d'une tablette en libre accès.
Outre les activités liées aux opérateurs de services publics constituant le socle de France services (DGFiP, CAF, Carsat, Urssaf, France titres, etc.), il donne accès à des opérateurs tels que l'INPI, l'Ircantec, la MDPH, le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS).
Les usagers sont majoritairement des retraités (48%) ; on observe en outre une sur-représentation de femmes (45,26% des usagers).
En 2024, ce bus a accueilli 1 223 usagers dont 17,4% de primo-usagers. 1 807 accompagnements ont été réalisés soit 9,3 accompagnements par jour.
Les besoins des usagers sont principalement l'aide à la réalisation de démarches (96%), l'aide à la navigation dans un environnement numérique (28%) et l'aide à l'usage du matériel numérique (11%).
Les démarches concernent au premier chef la retraite, les pré-demandes de titres d'identité et de voyage, les impôts, les certificats d'immatriculation et les permis de conduire.
Source : Territoires vendômois, documents transmis le 19 juin 2025.
Consciente de l'importance des enjeux de mobilité, qui doivent impérativement être pris en compte pour rapprocher les usagers des services, la rapporteure souligne l'intérêt des solutions itinérantes, qui permettent de rayonner au-delà des maisons France services fixes en se rapprochant des usagers tout en s'alignant sur les temps forts de la commune. À ce titre, il semble nécessaire de renforcer la flotte de bus France services et d'en garantir le passage régulier, afin que les usagers identifient son passage en amont, et à une fréquence suffisamment rapprochée pour que le bus puisse devenir une réelle habitude et permettre un suivi des démarches les plus complexes. Dans cette logique, la ministre déléguée chargée de la ruralité a annoncé l'ouverture de 200 nouveaux espaces France service d'ici à 2027, « principalement itinérantes », pour combler le maillage territorial existant, démarche que la rapporteure estime aller dans le bon sens.
Recommandation : Poursuivre le développement de formules France services itinérantes.
d) Le développement de permanences France services en mairie
Estimant à juste titre que « les mairies sont depuis longtemps un France service avant l'heure ! », les élus consultés par la mission d'information suggèrent l'organisation de permanences France service « dans chaque mairie une fois par semaine ».
La rapporteure est convaincue de l'intérêt de développer des formules de permanences de France service en mairie. Lors de leur déplacement dans le Rhône, le président et la rapporteure ont été sensibles à la suggestion de favoriser des déplacements de conseillers France services dans des communes où les maires auraient identifié des personnes n'étant pas en capacité de se déplacer : ces rendez-vous pourraient ainsi avoir lieu, selon les besoins des usagers, en mairie ou au domicile des personnes.
Cette approche est d'autant plus légitime que « la première porte d'entrée [des citoyens dans les services publics] devrait demeurer la mairie, notamment dans les communes rurales », comme l'a fait observer notre collègue Marie-pierre Richer, vice-présidente309(*).
L'AMF rappelle ainsi, en réponse au questionnaire de la rapporteure, que « la mairie est le premier niveau de réponse aux sollicitations des habitants ».
De nombreux témoignages d'élus locaux reçus par la mission d'information le soulignent : « c'est la mairie qui est vraiment la porte d'entrée » ; « la mairie reste le premier service public de France ! » : face au désarroi qu'inspire aux usagers l'éloignement d'un certain nombre de services publics, « les mairies jouent le rôle d'amortisseur en apportant des réponses à des personnes ne sachant vers qui se tourner ». Dans cet esprit, le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques »).
Développer les permanences des France services en mairie contribuerait en outre à renforcer la visibilité des mairies, alors que celle-ci a été altérée, selon certains témoignages d'élus locaux adressées à la mission d'information, au profit des intercommunalités (« ma collectivité a été dépouillée de ses services publics au profit de la comcom qui est à 30 minutes en voiture ») : « la mairie [...] devient un bureau de renseignements » ; « les cartes d'identité se font ailleurs, les passeports également, et même le recensement se fait sans contact avec un élu ».
Un autre élu témoigne : « Nos petites mairies ressemblent à des boîtes aux lettres. Les habitants le regrettent, nous perdons au fil de l'eau notre âme de service public de proximité et il nous est bien difficile de maintenir notre lien avec les habitants. Aujourd'hui, ils viennent chercher les sacs de tri sélectif et font leurs démarchent administratives chez eux. »
Recommandation : Encourager les permanences de France services en mairie.
e) Conforter la présence des France services en QPV : l'exemple de l'espace France services de Belleville-en-Beaujolais
Les travaux de la mission d'information ont mis en lumière l'importance du développement d'espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ont longtemps été tenus éloignés de ces dispositifs. Or les bénéfices d'un tel dispositif sont significatifs dans ces territoires, comme le confirme l'exemple de l'espace France services de Belleville- en-Beaujolais, visité par le président et la rapporteure le 16 juin 2025310(*).
Héritière de la Maison des Services à la population ouverte dès 2016, labellisée France services en janvier 2022 à la suite d'une demande déposée par la commune de Belleville-en-Beaujolais (plus de 13 000 habitants), la maison France services est susceptible d'attirer des flux significatifs d'usagers en raison de l'existence d'activités commerciales, de la présence d'établissements scolaires et d'infrastructures médicales, d'un bassin d'emplois et d'une desserte assurée par un réseau de transports collectifs (cars, bus, gare) ainsi que par un accès autoroutier.
Parallèlement aux services publics constituant le coeur de cible des France services, l'espace de Belleville-en-Beaujolais propose aux usagers la présence de structures associatives locales telles que l'Union départementale des associations familiales (UDAF), Formatic, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, ou Calame Calade, spécialisée dans l'accès aux droits des personnes en difficultés, qui propose notamment des prestations d'écrivain public.
Cet espace héberge en outre des permanences du Service d'accueil et d'information du demandeur de logement (SAID), qui permet un accompagnement des personnes lors du dépôt de leur demande de logement social ainsi qu'un suivi de la demande grâce aux permanences de quatre bailleurs sociaux du territoire.
Ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin sur rendez-vous, l'espace France services de Belleville-en-Beaujolais emploie trois conseillères à temps plein. Il a accueilli en 2024311(*) 9 199 Passages, soit en moyenne 47 personnes par jour (200 personnes par semaine) au cours du premier semestre ; 53 personnes par jour (210 par semaine) pendant le second semestre. Outre l'aide aux démarches, il propose un espace accès libre équipé de deux postes informatiques pour les personnes en capacité d'effectuer de manière autonome les démarches dématérialisées.
L'accès à un ordinateur en libre-service ne concerne toutefois que 7% des besoins, l'essentiel étant constitué par l'accompagnement individuel aux démarches (69%) ; les demandes d'information représentent 24% des besoins, comme le montre le schéma ci-dessous (chiffres de 2024).
Les partenaires de France services les plus sollicités sont la Carsat (avec une augmentation des demandes dans ce domaine entre 2023 et 2024 et une moyenne de deux rendez-vous pour un dossier), la CPAM, la CAF, la DGFiP et France titres.
Le schéma ci-dessous illustre la saisonnalité des demandes concernant la DGFiP (54% des démarches se concentrent sur les trois mois de la campagne de déclaration : avril, mai et juin).
En 2024, des rendez-vous assurés sur place par la DGFiP (en mai) et la Carsat (en octobre) ont permis d'aider les conseillers France services sur les dossiers de déclaration d'impôt et de retraite les plus complexes. Dans le même esprit, la CAF a assuré six rendez-vous en visioconférence pour les dossiers dépassant le premier niveau d'information et requérant une intervention plus technique, à l'attention d'usagers rencontrant des problèmes de mobilité.
Des actions « hors les murs » ont été réalisées en 2024 pour mieux faire connaître la structure. Si la présence de conseillères sur le marché de Belleville-en-Beaujolais a été jugée peu efficiente, car les personnes approchées connaissaient déjà France services, en revanche l'initiative consistant à aller au-devant des jeunes au lycée Aiguerande de Belleville a pleinement convaincu la mission d'information (voir infra).
Lors de son audition, la défenseure des droits a confirmé la pertinence du déploiement de structures France services dans les QPV. Elle a alerté la mission sur les difficultés d'accès aux services publics propres aux quartiers de la politique de la ville, où la question ne se pose pas nécessairement en termes de mobilité ou de kilomètres, mais où « l'aller-vers » et l'accompagnement individualisé s'avèrent tout autant nécessaires312(*).
La mission d'information souscrit à cette analyse. Il est positif que, partageant cette logique, la ministre déléguée chargée de la Ville prévoie l'ouverture de 40 nouvelles maisons France services dans les quartiers à l'échéance de 2027 (« 20% des nouvelles Maisons France Services labellisées seront situées en QPV, soit 20 en 2026 et 20 en 2027 »313(*)).
Recommandation : Poursuivre le déploiement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
f) Une voie à explorer : privilégier le déploiement de France services dans les sous-préfectures
Les statistiques de 2024 font apparaître une nette disproportion entre les structures portant des espaces France services, au sein desquelles les collectivités territoriales représentent la grande majorité :
- collectivités territoriales : 67% ;
- points de contact de La Poste : 15% ;
- caisses de Mutualité sociale agricole : 2% ;
- associations : 13% ;
- préfectures et sous-préfectures : 1%.
Parmi les sous-préfectures accueillant des France services, on peut citer Thonon-les-Bains et Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), Montluçon (Allier), Fougères (Ille-et-Vilaine), Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), Château-Gontier (Mayenne) et Provins (Seine-et-Marne).
L'État occupe donc une place mineure au sein de ces structures, ce qui interroge la rapporteure.
Or un déploiement systématique de France services dans les sous-préfectures, dans le cadre de la création de nouveaux espaces annoncées pour les mois à venir, présenterait pourtant des avantages certains, selon la rapporteure :
- ces bâtiments disposent de l'infrastructure nécessaire à l'accueil du public ; ils sont faciles d'accès en raison de leur localisation en centre-ville ;
- l'implantation d'espaces France services dans les sous-préfectures contribuerait à rendre de la visibilité à l'État dans les territoires, après des années d'affaiblissement des guichets des sous-préfectures ;
- ce fléchage permettrait de rééquilibrer le financement de ce réseau, pour lequel les collectivités territoriales sont mises à contribution alors que, comme l'ont fait observer nombre d'élus locaux à la mission d'information, France services a été rendu nécessaire par le désengagement de l'État dans les territoires : « Le financement des maisons France Services repose en grande partie sur un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Si l'État impulse le dispositif, il en délègue largement la mise en oeuvre et la charge financière aux intercommunalités ou aux communes, qui doivent assurer l'accueil, le personnel et les moyens logistiques. Cela peut poser des problèmes de soutenabilité financière, notamment dans les territoires ruraux aux ressources limitées, et contribuer à un sentiment d'injonction descendante sans moyens suffisants ».
Le déploiement des nouvelles France services dans les sous-préfectures permettrait ainsi « mieux équilibrer la charge financière entre l'État et les collectivités », conformément à un souhait récurrent des élus locaux consultés par la mission, et de limiter les coûts incombant aux collectivités territoriales.
La mission d'information plaide donc pour que les nouveaux espaces France services soient implantés, dans la mesure du possible, dans les sous-préfectures.
Recommandation : Privilégier l'implantation des nouveaux espaces France services dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales.
g) Permettre aux jeunes de mieux identifier les France services : un enjeu d'autonomie
Lors de leur déplacement dans le Rhône, le 16 juin 2025, le président et la rapporteure ont été sensibles à l'initiative de la France services de Belleville-en-Beaujolais, qui organise des permanences au lycée d'Aiguerande.
La mission d'information, fortement sensibilisée à la nécessité de mieux faire connaître les démarches incombant aux jeunes majeurs, tient à saluer cette formule très prometteuse : en effet, les jeunes générations sont peu représentées parmi les usagers du réseau (pour rappel, la France services de Plabennec visitée le 25 juin 2025 comptait 2,8% d'usagers dans la classe d'âge 15-25 ans ; ce chiffre est cohérent avec les 3% observés par la France service de Belleville-en-Beaujolais). Or le jeune public est particulièrement concerné par les démarches administratives, qu'il s'agisse de l'entrée dans la vie citoyenne (recensement, appel de préparation à la défense, inscription sur les listes électorales), du financement des études ou l'accès à l'autonomie et à la vie active.
De plus, la mission d'information a fait le constat de difficultés réelles auxquelles sont exposés les jeunes pour effectuer des démarches dématérialisées, en dépit de leur familiarité culturelle avec les outils numériques314(*). Ce point a été évoqué lors de l'audition du directeur interministériel de la transformation publique par la rapporteure, le 13 mai 2025. M. Thierry Lambert a alors relevé un enjeu particulier concernant les jeunes usagers, qui peuvent avoir du mal à appréhender le concept de démarche administrative, ce qui souligne selon le DITP l'importance d'une communication des services publics adaptée à cette catégorie d'usagers.
Il convient donc d'encourager le déploiement d'initiatives destinées à mieux faire connaître le réseau France services du jeune public, en s'inspirant des permanences organisées en milieu scolaire par la France service de Belleville-en-Beaujolais. De telles permanences pourraient également être encouragées dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les Crous315(*). Parallèlement, les associations étudiantes et les Crous pourraient être invités à développer leur présence dans les espaces France services.
Cette recommandation rejoint la proposition, exprimée précédemment, consistant à l'élaboration d'un guide spécifique destiné à accompagner l'entrée dans a vie active, et à le diffuser dans les Crous, les associations étudiantes et les France services.
Recommandation : Mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne en organisant des permanences de structures France services dans les établissements scolaires et universitaires et en développant des partenariats entre France services, les associations étudiantes et les Crous.
h) Consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services
Les retours de terrain sont partagés quant à la possibilité d'un nouvel élargissement du « bouquet de services » offert par France services par rapport aux 12 opérateurs qu'il comprend à ce jour (France Travail, France Titre, l'Assurance Maladie, les Finances Publiques, Point Justice, France Rénov, le Chèque Énergie, l'Assurance Retraite, la MSA Agricole, La Poste, les Allocations Familiales et l'Urssaf).
Selon les informations transmises à la rapporteure par l'ANCT, « d'autres démarches (logement social, transport, retraite complémentaire, etc.) peuvent être sollicitées par les usagers qui interrogent les conseillers France services : ces derniers les réorientent vers le bon interlocuteur sachant que ces démarches n'entrent pas dans le bouquet de service national ». Ainsi, l'ANCT a fait état de « discussions en cours avec l'Agirc-Arrco pour une intégration dans France services »316(*).
Si certains élus consultés par la mission d'information plaident pour une extension du panier de services, d'autres, à l'inverse, alertent sur le risque lié à un élargissement excessif du panier de services, qui peut nuire à l'efficacité des agents : « En ouvrant le champ des missions données, les agents ont perdus en spécialisation et donc en qualité de réponse apportée aux usagers » ; « l'éventail excessif de leur champ d'intervention et la limite humaine de leurs compétences les conduit inexorablement à rester dans le superficiel ». Au surplus, des doutes sur la possibilité de maintenir une qualité de service équivalente avec l'extension de l'offre de services sont fréquemment exprimés : « Le panel des services est satisfaisant, son extension s'opposerait au maintien des compétences requises des agents » exprime ainsi un élu local dans un témoignage confié à la mission.
Dans une logique similaire, les interlocuteurs de la mission d'information rencontrés dans le Finistère lors de la visite de la France service de Plabennec, le 26 juin 2025, ont jugé que les 12 opérateurs nationaux constituaient une limite à ne pas franchir. M. Patrick Boucher, maire de Kersaint-Plabennec et vice-président de la Communauté de communes du Pays des Abers chargé des relations bloc local / solidarités, s'est pour sa part prononcé en faveur d'une amélioration du bouquet proposé dans les France services, par exemple en intégrant les démarches liées aux retraites complémentaires, tout en exprimant des réserves sur toute nouvelle extension de l'offre.
À court terme, il semble plus utile, aux yeux de la rapporteure, de se concentrer sur la stabilisation du dispositif avant d'envisager son élargissement à quelques nouveaux partenaires, une fois déployé le partenariat entre les France Services et l'AGIRC-ARCO, déjà initié.
À ce stade, elle partage les réserves exprimées par M. Stanislas Bourron, alors directeur de l'ANCT, lors de son audition par la mission et fait siennes les conditions qu'il pose à tout élargissement, à savoir « prendre en compte la capacité des conseillers, au nombre de deux, à accompagner des usagers pour des démarches relevant de domaines très variés (aides sociales, rénovation énergétique, impôts, handicap, etc.), (...) participation de l'organisation [nouvellement intégrée dans le panier de services] à la politique publique pour garantir un service de qualité aux usagers dans les France services (contribution financière, formation des conseillers, canal de communication dédié, soutien des France services lorsque des situations de blocage sont identifiées, etc.) ».
Recommandation : Stabiliser et consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services, sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés.
i) Conforter le métier de conseiller France services
Les qualités de polyvalence des conseillers France service sont d'autant plus mises à l'épreuve que le bouquet de services offert dans les espaces France service s'est élargi. Cette exigence a conforté la professionnalisation des agents du réseau, qualifiés de « couteaux suisses de l'État » par une conseillère France service rencontrée par le président et la rapporteure lors de leur déplacement dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2025.
« Un nouveau métier s'est créé » : cette réflexion entendue par le président et la rapporteure pendant la visite de la France services de Beaulieu dans le Rhône, le 16 juin 2025, illustre et confirme la réelle professionnalisation des conseillers France services.
La maîtrise de nombreuses procédures ainsi que la nécessité d'une actualisation régulière, voire quotidienne, des connaissances de ces agents plaident pour une meilleure prise en compte du métier de conseiller France services : le renforcement de la formation initiale et continue, l'élaboration de fiches de poste standardisées et l'engagement d'une démarche visant à mieux identifier ce métier émergent (référentiel, titre professionnel, etc.) et davantage structurer le parcours professionnel des conseillers paraissent indispensables. Ces améliorations seraient à la hauteur d'un métier dont la mission d'information a pu constater combien il est exigeant et combien l'ouverture de véritables perspectives de carrière est justifiée.
Certains élus ont cependant exprimé des réserves, dans les témoignages adressés à la mission d'information, à propos de la qualité de l'information délivrée dans les France services : selon cette approche, les France services ne répondraient qu'à des besoins « basiques » et feraient aux usagers des réponses « trop souvent incomplètes », car « les agents n'ont pas forcément des formations aussi pointues que les services concernés ».
Or cette critique peut être tempérée : le fait que l'information délivrée par les conseillers soit « basique » est en effet intrinsèque au modèle, puisque les conseillers sont formés pour délivrer un premier niveau de réponse (aide à la constitution du dossier par exemple) au-delà duquel ils mettent l'usager en relation avec un conseiller de l'administration concernée.
Un autre élu consulté par la mission d'information exprime des doutes sur la qualité des services offerts aux usagers, qu'il impute à une formation insuffisante des conseillers, voire à un « manque de compétence ou d'expertise » de ceux-ci317(*). On observe toutefois que les France services sont saluées par de nombreux élus, qui soulignent l'engagement des conseillers et la qualité de l'accueil réservée aux usagers dans les France services : autant de points très positifs constatés par la rapporteure lors de ses déplacements sur le terrain.
Comme la mission d'information a pu le constater au cours de ses visites de terrain, la formation continue représente dans les France services un enjeu considérable, peut-être plus important encore que la formation initiale. D'abord parce que la réglementation évolue constamment ; ensuite parce que cet enjeu a été particulièrement mis en évidence par les agents eux-mêmes. Les conseillers France services doivent en effet se tenir à jour des dernières évolutions chez les douze partenaires nationaux, ce qui induit un besoin quasi-permanent de formation.
Celle-ci est assurée par les représentants départementaux des partenaires nationaux, sous la forme de webinaires à la conception desquels les agents peuvent être associés318(*), mais aussi de journées d'immersion chez le partenaire. Il en résulte une sollicitation importante à laquelle les agents ne sont pas toujours en mesure de répondre sans compromettre la continuité de service. C'est peut-être la raison d'une fréquentation inégale des webinaires délivrés par le partenaire319(*).
Formation initiale et continue des conseillers France services : vue d'ensemble
Dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a détaillé les efforts déployés en vue de la formation des conseillers France Services :
« Depuis septembre 2023, le temps de formation initiale a été doublé : 4 jours pour la formation socle commun et 6 jours pour la partie métier pendant laquelle intervient les opérateurs. Pilotée par l'ANCT, la formation initiale est déployée par le CNFPT. Ainsi 1800 conseillers France services ont été formés en 2024.
En outre, des formations continues sont organisées à l'échelle nationale (webinaire national) par les opérateurs à une fréquence d'une formation par mois. Au local, des formations sont également effectuées par les opérateurs ayant des réseaux déconcentrés : DGFIP (campagne des impôts par exemple), CAF, etc.
Outre la mise à jour du contenu de la formation initiale, des formations en distanciel sous forme de e-learning sont en cours de production afin de répondre aux besoins identifiés et apporter des éléments dès la prise de poste. »
Ces constats soulignent la nécessité d'assurer aux conseillers France services un déroulement de carrière cohérent avec leurs compétences et l'importance de leur mission pour nos concitoyens.
Recommandation : Assurer une meilleure prise en compte des évolutions du métier de conseiller France services en structurant la formation, les fiches de postes et le parcours professionnel des agents et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.
2. Renforcer la formation des agents pour améliorer l'information et l'accueil des usagers : un enjeu crucial, une dynamique à développer
a) Un besoin accru par la complexité de normes nombreuses et changeantes
Le constat d'une évolution constante de normes toujours plus complexes, en lien avec l'inflation législative, est aujourd'hui très largement partagé ; il a été décrit par M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État honoraire, auteur de l'ouvrage Les normes à l'assaut de la démocratie, qui lors de son audition par la mission d'information a commenté un « besoin permanent de précision et d'exhaustivité, qui automatiquement accroît la complexité des textes normatifs »320(*), a fortiori dans le domaine social qui appelle la complexité (« plus la norme est sociale, plus elle est rendue complexe »321(*)).
Le Sénat a consacré de nombreux travaux à cette tendance322(*), qui affecte aussi bien les collectivités locales que l'administration de l'État.
Or la complexité des normes se répercute sur la complexité des démarches incombant à l'usager : « Le formulaire papier ou numérique est la transposition matérielle de la norme qui s'applique à celui qui essaie de le remplir. Si la norme est complexe, le formulaire le sera aussi »323(*).
Il en résulte un besoin toujours plus important de formation des agents face à l'évolution fréquente des règles qui induit pour les usagers un besoin croissant d'information, en particulier en matière d'aide sociale ou d'indemnisation ; or plusieurs études menées auprès des usagers, dont la mission d'information a pris connaissance, mettent en évidence une capacité variable des agents à répondre à des demandes parfois très simples.
b) Une information du public parfois défaillante
De manière éclairante, le dernier Baromètre des services publics met en évidence l'importance attachée par les usagers à la clarté de l'information délivrée par les services : « La clarté des informations reçues dans le cadre des échanges avec les services publics est mise en avant par la majorité des usagers (plus de 75 % sur la moyenne de l'ensemble des services) »324(*).
Or une enquête menée en 2023 par le Défenseur des droits et l'Institut national de la consommation (INC)325(*) sur l'accueil téléphonique des services publics pointait des lacunes importantes dans l'information fournie aux usagers de quatre administrations : l'Assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, Pôle emploi et les Carsat. Outre une « joignabilité » limitée, avec un taux d'aboutissement des appels de 60 % seulement326(*), les résultats mettaient en évidence, de manière générale, un taux assez faible de réponses satisfaisantes : plus de 50 % pour la CAF et Pôle emploi, mais 22 % pour l'Assurance maladie, et plus de 70 % de refus de réponse pour la Carsat, en l'absence de communication du numéro de sécurité sociale.
L'enquête mettait en évidence certaines lacunes même lorsque les usagers recevaient une réponse. Ainsi, à la question « Quelles sont les démarches à faire pour obtenir une carte Vitale ? », « seuls 22 % [des appelants] obtiennent une réponse acceptable et moins de 5 % obtiennent des réponses précises et conformes aux attentes. » Les résultats ne sont pas meilleurs pour la Carsat : à l'une des questions posées, « Dans plus de deux tiers des cas les usagers se disent insatisfaits par la réponse obtenue. Le taux d'insatisfaction est plus élevé pour les personnes d'âge mûr et les personnes avec des difficultés de maîtrise de la langue ».
Les quatre administrations concernées ont répondu aux observations formulées par le Défenseur des droits et l'INC. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) faisait notamment valoir un effort important de formation (deux à trois semaines pour les téléconseillers) et une démarche d'amélioration continue de la qualité : « Un suivi qualitatif des réponses est en place (écoute d'appels au hasard) et le taux de qualité de la réponse est de 85 % ». Elle notait également que la fourniture du numéro de sécurité sociale (NIR) est indispensable : « à bon droit, et en respectant les consignes, nos téléconseillers font de la fourniture du NIR, et d'éléments d'identification personnels supplémentaires, un prérequis indispensable au service », notamment pour s'assurer que l'usager relève du régime général.
Pôle emploi relevait pour sa part les éléments suivants : « Accessible le matin et l'après-midi des jours ouvrés, aux heures d'ouverture des agences, avec une attente moyenne de moins de trois minutes, le numéro de téléphone 3949 est organisé en différentes files sur lesquelles le demandeur d'emploi est dirigé en fonction des choix qu'il réalise sur le pavé alphanumérique et le degré de complexité de sa demande. Certaines files sont automatisées (réponses préenregistrées), d'autres permettent d'être mises en relation avec un assistant de premier niveau (exemple : assistance Inscription) et, enfin, certaines avec un conseiller Pôle emploi. [...] Par ailleurs, les demandeurs d'emploi ont également la possibilité de choisir d'être rappelés dans les 2 heures ou de laisser un message vocal qui sera transformé en mail pour être traité au sein de leur agence ».
Reste que les résultats ne témoignaient pas de réelle amélioration par rapport à la précédente enquête conduite en 2016. L'appréciation générale du Défenseur des droits est sans appel : « Les résultats montrent que le téléphone ne constitue toujours pas un outil satisfaisant pour l'accueil et l'information des usagers par les services publics. Comme en 2016 lors de notre première enquête, le canal téléphonique ne constitue pas une alternative de qualité au numérique ».
Ce constat concorde avec celui d'un usager cité dans une autre enquête précédemment évoquée, le Baromètre du non-recours dans la communauté urbaine d'Arras327(*) : « À chaque fois que l'on téléphone soit à la CAF ou à la CPAM, nous n'avons pas le même interlocuteur et cela arrive très souvent qu'il dise tout le contraire des informations reçues du conseiller précédent. Je pense qu'il y a un manque de formation. Cela m'est déjà arrivé : le conseiller ne savait pas répondre à mes questions... ».
On peut voir dans ces lacunes un écho des critiques que formulent les syndicats de la fonction publique entendus par la rapporteure328(*) : ceux-ci pointent notamment une perte d'expertise à force de mobilité entre les postes, et un problème de continuité du service puisque les agents expérimentés sont sollicités pour former les nouveaux « sur le tas ». Ils déplorent aussi des formations tardives, en particulier de contractuels, alors que la formation initiale devrait selon eux intervenir avant la prise de poste, et relèvent les inconvénients liés, en termes d'apprentissage, aux téléformations par rapport aux modules en présentiel.
c) Un satisfecit : l'écoute et la bienveillance semblent avoir été intégrées dans les formations
Ces réserves doivent être tempérées par les progrès constatés dans l'écoute et la bienveillance des agents. Le Défenseur des droits et l'INC prennent ainsi soin de noter que, malgré des résultats en demi-teinte, « les agents des plateformes téléphoniques eux-mêmes ne sont pas en cause - l'enquête souligne d'ailleurs leur patience et amabilité. » C'est le résultat d'un effort volontariste de formation des administrations concernées : dans sa réponse à l'enquête, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) met en avant la formation de ses agents aux principes de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, qui a pour ambition de faire passer l'administration d'une logique de contrôle à une logique d'accompagnement et de conseil, comme cela a été indiqué précédemment.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) indique quant à elle, dans sa réponse au questionnaire adressé par la rapporteure : « Un serious game329(*) dédié à l'appropriation de la loi ESSOC a été déployé, et les principes de la relation de confiance sont désormais intégrés dans les formations initiales des métiers de l'Urssaf. Ces initiatives ont permis une meilleure application de ce droit et une amélioration de la relation avec les usagers ».
Enfin, l'Assurance maladie souligne que dans le cadre de l'engagement n°1 de « Services publics + » (« Dans le respect mutuel, vous êtes accueillis avec bienveillance et avez le droit à l'erreur »), « la bienveillance et la courtoisie sont intégrées dans la formation socle de tous les conseillers avant leur prise de fonction »330(*).
La rapporteure note ainsi avec satisfaction que les administrations se sont pleinement approprié l'idée que, tout autant que les compétences relatives au poste, la bienveillance envers l'usager doit faire partie intégrante du dispositif de formation des agents.
Ainsi, selon le Baromètre des services publics publié en juin 2025, « Le sentiment d'avoir été accueilli avec bienveillance et respect obtient l'un des scores les plus élevés, tous indicateurs confondus (73 % sur la moyenne de l'ensemble des services publics) », les pourcentages les plus hauts étant attribués aux pompiers (90 %), aux hôpitaux publics (85 %), à la mairie (87 %), à la Gendarmerie nationale (83 %) et à France service (79 %).
d) L'accueil du public : une compétence à valoriser dans le déroulement de carrière des agents
L'interaction entre l'usager qui se présente dans un service public et l'agent qui traite sa demande ne se résume pas à un échange d'informations. Le sociologue Vincent Dubois a travaillé sur l'accueil de l'usager dans une caisse d'allocations familiales : « L'une des surprises de l'enquête, révèle-t-il, a ainsi été que ces guichets, qu'on voit comme anonymes et froids, sont aussi des lieux d'expression des difficultés personnelles où les visiteurs se rendent pour chercher une écoute, des conseils, et pas seulement pour remplir des formulaires ou obtenir une information »331(*).
Cette étude a été menée dans les années 1990 ; or la configuration des lieux d'accueil est très différente aujourd'hui, avec notamment la systématisation de l'agent d'accueil dans les administrations. Pour autant, ce rôle de lieu d'écoute, de rencontre, de lien social semble à présent assumé par les France Services, comme l'ont confirmé les tables rondes tenues lors des déplacements de la mission d'information. Dans l'Yonne332(*), une conseillère France services a ainsi cité ce propos d'un usager : « Vous êtes la seule personne à qui j'ai parlé cette semaine ». Cette forme d'accueil réclame une posture particulière d'écoute et d'empathie.
La posture bienveillante et empathique de l'agent public est l'un des apports de la démarche « Services Publics + », aboutissement d'une longue évolution dans la conception des rapports entre l'usager et l'administration. Mais les agents en contact avec le public doivent également savoir faire face à la frustration d'un usager à qui l'on n'est pas en mesure d'apporter la réponse qu'il attend. La gestion de cette frustration est un enjeu particulier dans les France Services, où l'on n'apporte qu'une réponse de premier niveau, et où l'agent doit parfois expliquer qu'il n'entre pas dans ses missions de traiter les demandes ne concernant pas l'un des douze partenaires du réseau.
D'où une agressivité parfois constatée chez les usagers - une agressivité que les maires et secrétaires de mairie ne connaissent que trop bien. Comme l'a exprimé de manière très directe un maire lors de la table ronde organisée dans l'espace France Services de Saint-Florentin, « il faut aussi savoir se faire respecter ! ».
C'est pourquoi l'accent doit être mis, dans la formation initiale comme continue des agents amenés à être en contact avec le public, sur le « savoir-être » indispensable à leurs fonctions. Il existe, de ce point de vue, des bonnes pratiques au niveau local : à la maison France services de Saint-Florentin, les agents suivent des formations à la gestion des conflits.
Une attention particulière doit également porter sur le premier accueil dans les bâtiments administratifs, par des agents dont c'est la fonction. Point d'entrée de l'usager dans l'administration, le premier accueil revêt une dimension fondamentale de la relation entre l'usager et les services publics et de l'image que s'en fait l'usager. L'un des représentants syndicaux de la fonction publique auditionnés par la rapporteure en fait même le moment le plus important du service public333(*) : non seulement par l'orientation de l'usager vers le service pertinent, mais aussi par l'écoute qui sera apportée à sa demande et la prise en compte de sa situation.
L'accueil : un élément décisif du parcours usager au Service social départemental de Bondy (Seine Saint Denis)
La rapporteure a pu apprécier, lors de son déplacement en Seine Saint Denis, le 8 juillet 2025, l'importance attachée à l'accueil des usagers par les responsables du Service social départemental de Bondy.
Moment clé du parcours de l'usager, l'accueil permet l'écoute et l'orientation de celui-ci ainsi que la détection d'éventuelles situations d'urgence (violences intrafamiliales, détresse psychologique, rupture alimentaire, urgence logement, etc.) nécessitant une prise en charge spécifique dans des délais rapides. Au vu de la situation exposée aux agents auxquels incombe l'accueil de premier niveau (la même équipe peut être chargée de l'accueil téléphonique ou physique en fonction du planning du service), 25 % des personnes accueillies par le service social - l'accueil est inconditionnel et n'est pas subordonné à un rendez-vous - sont reçues le jour-même par une assistante administrative (accueil de deuxième niveau), qui peut les orienter vers une assistante sociale.
Le département a embauché des assistantes administratives formées à l'accès aux droits afin d'assurer un accueil de premier niveau de qualité, avant l'intervention éventuelle d'un assistant social (une assistante sociale à temps plein assure 500 rendez-vous par an et suit quelque 200 familles ; à ce jour, selon les informations transmises à la rapporteure, quatre postes d'assistant social sont vacants, signe de la difficulté à recruter dans ce métier désormais « en tension »).
Or l'accueil semble rester un point perfectible de la formation des agents : l'un des représentants syndicaux cités décrit ainsi un accueil des préfectures assuré, faute de moyens humains, par des standardistes qui n'ont pas de compétences pour orienter les usagers, tandis qu'un autre regrette que « la filière accueil [soit] pour l'instant un métier secondaire, de reclassement des gens "cassés" par leur métier ».
La mission d'information estime, au contraire, que savoir accueillir et savoir orienter est une compétence à part entière, qui doit être valorisée en tant que telle dans la formation et dans le déroulement de carrière des personnels.
Recommandation : Valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents.
3. L'enjeu de l'intelligence artificielle : faciliter sa diffusion au sein de l'administration, tout en gardant le contrôle
L'intelligence artificielle apparaît comme une voie prometteuse pour divers axes d'amélioration des services publics : améliorer la réponse apportée aux usagers, mais aussi pratiquer des simulations, piloter l'activité, etc.
a) Des outils d'amélioration de la réponse à l'usager qui essaiment dans les administrations...
Présenté officiellement au mois d'avril 2024, un outil d'IA appelé Albert, conçu par le DataLab de la Dinum, a été mis à la disposition, à titre expérimental, de 60 conseillers de 30 espaces France Services. L'outil a trois fonctions :
- accélérer la recherche d'informations administratives fiables pour les conseillers ;
- offrir des réponses à jour et contextualisées, dans un environnement réglementaire complexe et mouvant (plus de 160 démarches couvertes, 12 opérateurs partenaires) ;
- faciliter l'intégration des nouveaux conseillers, en leur fournissant un appui numérique quotidien, autonome et rapide d'accès334(*).
Tels que présentés par l'ANCT, les premiers retours suggèrent une certaine perfectibilité de l'outil :
- « l'outil a été utilisé principalement pour des vérifications ponctuelles, et non comme appui quotidien à l'accompagnement des usagers ;
- les exigences minimales en matière de qualité, de validation métier et d'organisation produit représentent un axe d'amélioration pour le succès d'un tel outil ;
- les modèles utilisés dans Albert France services présentent des limites sur des cas d'usage opérationnels ».
Toutefois, souligne l'ANCT, « Albert France services a éveillé l'intérêt de nombreuses administrations en recherche d'illustration métier de l'usage de l'IA générative au sein de l'Administration » ; de plus, « les deux tiers des expérimentateurs recommanderaient Albert France services à leurs collègues ». On peut donc espérer qu'à terme, Albert représente une réelle plus-value dans le service rendu à l'usager, dans les France services et au-delà.
La rapporteure observe néanmoins que le sujet de l'intelligence artificielle a été très peu évoqué lors des différents déplacements de terrain de la mission d'information.
L'outil a pourtant d'ores et déjà essaimé dans l'administration : Albert nourrit notamment l'IA « maison » IApasdequoi, expérimentée par la Cnav, dont l'objectif est de « mieux cibler les questions carrière et retraite les plus fréquentes adressées par les salariés à leur entreprise, voire en fonction des typologies d'entreprise, permettre après analyse d'en tirer des enseignements sur les demandes et besoins de salariés en fonction de leur secteur d'activité »335(*). La Cnav a développé plusieurs autres outils d'IA, dont une IA spécialisée dans les relations clients développée par un prestataire externe.
L'Assurance maladie s'est pour sa part dotée d'une « stratégie IA Gen » destinée à encadrer le développement et l'usage des IA génératives, ainsi que d'un « programme de sensibilisation et de formation à l'IA générative de ses collaborateurs, incluant un module d'e-learning obligatoire pour tous ses agents et des ateliers d'idéation et des parcours de formation »336(*). Elle a enfin lancé l'expérimentation, en partenariat avec MistralAI, de « sa propre plateforme IA Générative entièrement hébergée et exploitée sur ses serveurs internes, garantissant ainsi à ses utilisateurs un niveau élevé de sécurité ».
Ce ne sont que quelques-uns des exemples d'utilisation de l'IA par l'administration : selon le site info.gouv, des intelligences artificielles réalisent également, « pour les agents de l'administration fiscale, des projets de réponses aux 16 millions de demandes qui leur sont faites en ligne chaque année, rédigent des synthèses qui serviront à la pré-instruction des 4 000 projets environnementaux déposés chaque année dans les DREAL, etc. »337(*)
Si les autres administrations développent surtout des applications métier, la Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui opère le site service-public.fr, a engagé une véritable réflexion prospective sur la manière dont l'intelligence artificielle affectera l'information qui sera délivrée aux citoyens338(*). En effet, les principaux acteurs mondiaux dans ce domaine ont l'intention de se substituer aux moteurs de recherche traditionnels, avec des conséquences très importantes sur la visibilité de l'information délivrée par les sites de l'administration. La réflexion développée au sein de la DILA dans ce domaine a attiré l'attention de la rapporteure.
b) ... mais dont l'usage doit être encadré par une vision stratégique et cohérente
S'il est indispensable que les administrations se saisissent de l'outil, il convient de prêter attention au foisonnement incontrôlé et sans vision d'ensemble.
La délégation sénatoriale à la prospective a ainsi souligné que l'« utilisation [de l'IA] au service de l'intérêt général ne [pourrait] se faire qu'à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient pleinement confiance »339(*).
Sur ce point, un récent rapport du Sens du service public publié par la Fondation Jean Jaurès souligne à juste titre la nécessité :
- de garantir à l'usager une « transparence réelle [...] quant à l'utilisation de l'IA dans les processus administratifs, notamment lorsqu'elle intervient en appui des décisions ou des réponses fournies aux usagers » ;
- de réaliser régulièrement des audits de manière à évaluer les effets réels des dispositifs automatisés ;
- de limiter l'IA à des « fonctions d'assistance dans des tâches secondaires, sans se substituer au jugement professionnel »340(*).
Afin de garantir la transparence, pour l'usager, des décisions individuelles automatisées, le Défenseur des droits a pour sa part recommandé de consacrer un « droit à l'explication » pour toutes les décisions administratives individuelles partiellement et entièrement automatisées341(*).
La mission d'information appelle donc à la formulation d'une doctrine claire en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle.
Recommandation : Formuler une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service des usagers, dans une logique de transparence des décisions individuelles automatisées, et la diffuser à tous les niveaux de l'administration.
Un récent rapport de la délégation aux collectivités territoriales rappelle en outre que le recours à l'IA pose des questions de responsabilité juridique et de sécurité (données sensibles, cyberattaques). Il estime par ailleurs que « l'IA peut permettre d'automatiser des tâches bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent »342(*) : la rapporteure souscrit à ce point de vue, d'autant que cela pourrait permettre aux agents de se recentrer sur les tâches apportant une valeur ajoutée à l'usager.
Mais il conviendra d'anticiper les risques de démotivation des agents, voire de perte de sens qui pourraient être associés à l'utilisation de l'IA. L'un des représentants syndicaux entendus en audition par la rapporteure observait ainsi : « on fait faire à la machine des tâches jusque-là dévolues à des agents, qui conservent les cas les plus difficiles. Ainsi, ils n'ont plus la satisfaction de répondre positivement sur des cas simples ».
Comme l'a souligné la délégation sénatoriale à la prospective dans son rapport précité, « L'enjeu des compétences est double : le recrutement de profils spécialisés d'une part, et l'acculturation et la formation des agents d'autre part »343(*) : ce constat implique le recrutement et la fidélisation d'experts de la donnée et la montée en compétence de l'ensemble des agents. Un effort de sensibilisation et de formation à l'IA, à ses usages et à ses risques doit donc être conduit à tous les niveaux.
S'agissant plus précisément des postes d'encadrement de l'administration, M. Jean-Denis Combrexelle a, lors de son audition, souligné que l'IA relevait pour le moment du domaine des techniciens : « Actuellement, l'IA est affaire de spécialistes, et échappe aux politiques et aux administrateurs. L'IA pourra favoriser une simplification à l'extrême, mais son usage fera surgir d'autres questionnements. Imaginons que l'on crée une nouvelle prestation sociale. [...] Si l'on recourt à l'IA, on donne des critères précis à l'algorithme, par exemple pour attribuer une prime à tout jeune médecin qui s'installe dans un désert médical : l'algorithme décidera, les médecins sauront immédiatement s'ils sont éligibles ou non, et le tour est joué. Tout devient extrêmement simple. Mais comment garantir qu'un tel processus est sécurisé ? Qui contrôle l'algorithme ? Un technicien. Comment être certain qu'il est loyal ? »344(*).
Il est donc vital que l'administration soit en mesure de porter un regard éclairé sur la conception de ces algorithmes.
M. Jean-Denis Combrexelle avertit en outre, s'agissant de l'IA, que « le recours à l'IA imposera de créer des compétences combinant vision politique, juridique et technique. Or ces profils sont encore très rares en France »345(*).
Garder le contrôle sur les outils d'intelligence artificielle impliquera donc un important effort de formation dans les niveaux d'encadrement de l'administration, afin d'assurer la cohérence entre les outils d'intelligence artificielle et les politiques publiques dont ils sont sensés accompagner la mise en oeuvre.
Recommandation : Former, dans la fonction publique, des profils susceptibles de maîtriser à la fois les aspects politiques et juridiques ainsi que la dimension technique, tant des algorithmes que de l'intelligence artificielle, afin que l'administration soit en mesure de contrôler l'utilisation de ces outils.
4. Concevoir des outils numériques au service de l'usager : de nombreux « irritants » à dépasser, pour les usagers comme pour les agents
Bien qu'un chemin considérable ait été parcouru dans les droits reconnus à l'usager dans ses relations avec l'administration, les intentions doivent se traduire concrètement par une simplification des démarches pour les usagers. Pour M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État honoraire et auteur de l'ouvrage Les Normes à l'assaut de la démocratie, « le vrai produit d'une réforme, c'est le formulaire. Du côté des administrations, le ministre veut sa loi, les cabinets suivent, puis viennent les décrets d'application. Une fois la loi et les décrets publiés, tout le monde a le sentiment du travail accompli. Le formulaire est renvoyé à la "cuisine administrative" ».
Or, explique M. Jean-Denis Combrexelle, « les gens ordinaires ne lisent pas les lois ni les décrets : ils interagissent avec un formulaire. Pourtant, on y consacre beaucoup moins de temps et d'énergie qu'à l'élaboration législative. D'ailleurs, les directeurs d'administration centrale, et moins encore les ministres, n'examinent presque jamais les formulaires qui sont l'aboutissement de la loi. »
En d'autres termes, donner de nouveaux droits aux usagers, tels que le droit à l'erreur, est nécessaire mais pas suffisant : il faut que ces droits se traduisent dans la réalité des rapports entre le public et l'administration, en particulier dans la conception des formulaires, et plus largement dans celle des outils numériques qui constituent aujourd'hui l'essentiel de l'interface entre les services publics et le citoyen. Ce constat met en évidence le besoin d'accompagnement humain évoqué à plusieurs reprises dans ce rapport, ainsi que l'a fait remarquer notre collègue Marianne Margaté : « C'est le formulaire qui rend la réforme accessible. Et le poids du formulaire est devenu d'autant plus important que les moyens humains d'accompagnement ont diminué. Or l'accompagnement humain contribue lui aussi à la perception de la réforme par les citoyens, et sans lui les réformes semblent virtuelles, vaines, effectuées pour le simple plaisir de réformer »346(*).
De fait, le bilan est inégal en matière d'interface entre services publics et citoyens : si l'administration française a consenti de réels efforts pour améliorer son interface avec les citoyens, il subsiste de nombreuses situations où, bien loin d'avoir simplifié les choses, l'outil numérique finit au contraire par les rendre plus complexes.
a) Les difficultés liées, pour les agents, à une « simplification » mal menée
La conception d'un outil numérique n'est pas un aboutissement en soi : encore faut-il que son premier utilisateur, l'administration, puisse le prendre en main dans de bonnes conditions. Or, selon plusieurs représentants des syndicats de la fonction publique entendus par la rapporteure347(*), ce n'est pas toujours le cas : « les agents ne sont ni associés à la numérisation ni consultés : on leur donne un outil, à eux de se débrouiller avec » ; c'est pourquoi « les nouveaux outils devraient être déployés dans le cadre d'une méthodologie, afin qu'ils soient moins source de tensions ou de pressions - car l'usager se retourne toujours vers les agents ».
À titre d'exemple, le médiateur de France travail observe, dans son rapport d'activité publié en avril 2024, que l'inadaptation du menu déroulant mis à la disposition des conseillers conduit à des motifs de refus de financement de formation dont l'incompréhension constitue un problème récurrent.
France Travail : un simple défaut de conception qui engendre des incompréhensions
Dans son rapport d'activité 2023348(*), le médiateur de France Travail signale un problème très spécifique rencontré par certains usagers : « les motifs des refus de financement de formation posent un problème récurrent, car ils sont souvent incompris par les candidats. Ils expriment parfois des motifs différents de ceux exprimés en agences ; l'une des raisons réside dans les motifs proposés par le système informatique, qui ne permettent pas de notifier la décision avec le motif réel de refus. De fait, les agences sont contraintes par une liste très limitée de motifs génériques et impersonnels. Les conseillers sont tributaires de cette liste exhaustive et obsolète qui les oblige à choisir le motif approximatif le plus proche de la réalité, mais qui n'est pas toujours adapté à la situation ».
b) Le guichet unique des entreprises : un cas d'école de numérisation manquée ?
Pensé au départ comme une simplification au service des entrepreneurs, le guichet unique des formalités des entreprises a été créé par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Il se substituait aux centres des formalités des entreprises (CFE) des six organismes auprès desquels les entrepreneurs devaient déclarer une création, une modification ou une cessation d'activité, en fonction de la nature de cette activité : chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, Urssaf, greffes des tribunaux de commerce, chambres de l'agriculture, centres des impôts.
Le Guichet unique des formalités des entreprises, lancé le 1er janvier 2023 et géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), relevait donc de la mise en oeuvre du « dites-le nous une fois », l'usager n'ayant plus qu'un seul interlocuteur. Il promettait également une réduction des temps de traitement, un suivi en temps réel et une réduction des erreurs liées à la transmission des informations entre les organismes gestionnaires des CFE.
Or sa mise en oeuvre a été marquée par de multiples difficultés, pour la plupart liées à des erreurs de conception : surcharge des serveurs engendrant des blocages, rejets inexpliqués de documents par le système, erreurs dans la conception des champs à remplir. La procédure elle-même était aussi en cause, notamment l'impossibilité de déclarer plusieurs modifications d'activité en une seule fois. Le guichet unique impose également à l'utilisateur de passer par la procédure d'identification France Connect+, plus sécurisée mais aussi plus lourde à mettre en oeuvre. Enfin, l'assistance fournie par l'opérateur s'est avérée défaillante.
Ces problèmes de conception ont eu de très lourdes conséquences pour les entreprises, illustrées dans l'encadré ci-dessous : délais importants, impossibilité de fournir les justificatifs demandés, etc. Le ministère de l'économie et des finances a annoncé, en décembre 2024, une nouvelle version du site pour la mi-2025, avec de nombreuses améliorations ergonomiques349(*).
INPI : quand un jour de retard grippe l'ensemble de la machine
La presse locale s'est fait l'écho350(*) des mésaventures d'une mère de famille souhaitant ouvrir un café-épicerie dans un petit bourg de Vendée. Dans cette perspective, elle a procédé, en novembre 2023, aux démarches nécessaires pour l'inscription de son établissement au Registre national des entreprises (RNE) auprès du guichet unique. Mais un acte de naissance envoyé un jour après le délai limite fixé pour la constitution du dossier a précipité la gérante dans un trou noir administratif, chacun de ses interlocuteurs (tribunal de commerce, Insee, etc.) se renvoyant la responsabilité de ce blocage qui l'empêchait de finaliser la constitution de son dossier. Pendant ce temps, son établissement, faute d'avoir reçu de l'INPI ses numéros Siren, Siret et Kbis, demeurait sans existence légale - et dans l'incapacité, de ce fait, de recevoir ses premières livraisons. Cette situation l'a contrainte à repousser l'ouverture du café de plusieurs semaines.
En Vendée, les mécontentements liés aux dysfonctionnements du guichet unique - avec notamment de très importants retards de traitement - se sont accumulés au point de contraindre le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à recruter un vigile pour protéger les agents351(*).
Le cas du guichet unique des formalités des entreprises montre comment une réforme partant de principes louables peut conduire, dans les faits, à priver les usagers de leurs droits. En l'espèce, la numérisation a même marqué une régression par rapport aux CFE, dont la création relevait à l'origine d'une simplification administrative. M. Jean-Denis Combrexelle, auditionné le 13 mai 2025, a témoigné de ce qu'il qualifie d'échec : ayant, au début de son parcours dans l'administration, participé à l'expérimentation des CFE en 1978, il était alerté, plusieurs décennies plus tard, dans ses fonctions de directeur de cabinet de la Première ministre, des graves difficultés de l'INPI : « Sans les ressources de l'informatique, le système fonctionnait. [...] On crée un système facilitant la création d'entreprise, et quarante-cinq ans après, malgré toutes les ressources à notre disposition, on constate que les arbitrages rendus n'ont pas toujours favorisé l'efficacité. C'est un terrible aveu d'échec »352(*).
c) Quand l'usager n'entre pas dans les cases
Le cas pratique suivant, issu d'un témoignage dont la mission d'information a eu connaissance, illustre les difficultés auxquelles peut se heurter un usager quand, contraint à une démarche en ligne, il n'entre pas « dans les cases » des formulaires numériques.
Environ deux jours avant leur départ, deux passagers ont été avertis par SMS que leurs places de train n'étaient « plus disponibles » « en raison d'un changement de matériel » (c'est-à-dire la suppression de voitures).
Le remboursement des deux billets annulés a été particulièrement complexe :
- sur le site de la SNCF, le « bot » a constaté que train n'avait pas été annulé, ce qui empêchait de renseigner un motif simple de remboursement ;
- seul un contact téléphonique avec un agent de la SNCF (obtenu après plus de 15 minutes d'attente) a permis de contourner l'obstacle en sélectionnant dans le menu déroulant le motif « autre », puis « pas de places assises dans le train » (ce qui n'est pas le vrai motif d'annulation des billets), permettant d'arriver à un champ libre où l'on peut expliquer sa situation et joindre des pièces justificatives.
C'est donc, finalement, l'agent contacté par téléphone qui a fourni « l'astuce » à utiliser pour obtenir le remboursement : illustration par l'exemple des vertus de l'omnicanalité.
Un autre témoignage, trouvé sur la page internet de « service public + »353(*) et daté de janvier 2025, concerne une demande de certificat d'immatriculation effectuée pour un membre de la famille de l'internaute, qui exprime une irritation compréhensible face à une « anomalie bien connue de [France titres dont les] équipes techniques font tout leur possible pour résoudre ce dysfonctionnement » :
« [...] Je travaille moi-même dans le digital, et même en étant très à l'aise sur un ordinateur, je suis consternée de la qualité des outils imposés pour réaliser cette action. C'est simple, voilà 3 jours que je bataille dans le vide sur un site mal conçu, et qui n'arrête pas de crasher. Des messages d'erreurs à n'en plus finir : - "action non autorisée" lorsque je clique sur "commencer la démarche"- "vous n'êtes pas le titulaire de cette carte grise" lorsque j'arrive à contourner les erreurs et avancer plus loin. Inutile de vous préciser que tout est en règle et que [la parente de l'internaute] elle est bien le titulaire du véhicule. [...] Nous voilà complètement bloqués pour réaliser cette démarche, on ne vous félicite vraiment pas. »
France titre fait la réponse suivante le 5 février 2025 :
« [...] Nous vous remercions pour votre retour d'expérience et nous prenons en considération les difficultés rencontrées dans vos démarches. Nous comprenons que vous souhaitez réussir à faire la demande de changement d'adresse de la carte grise de xx354(*). Rassurez-vous, vous pourrez faire la demande de changement d'adresse sans difficulté, et vous ne rencontrerez plus le message disant « Les informations relatives à votre compte ne correspondent pas à celles du titulaire de la carte grise... » en faisant la téléprocédure ci-dessous.
En cas de blocage pour réaliser la démarche via la procédure classique « Modifier l'adresse sur ma carte grise », une téléprocédure complémentaire est disponible depuis accessible uniquement en se connectant par FranceConnect.
Il convient de choisir la démarche, « Faire une autre demande concernant un véhicule » de sélectionner comme catégorie « Faire une autre demande » et en sous-catégorie « Je n'arrive pas à déclarer mon changement d'adresse dans le cadre de la téléprocédure " Je modifie l'adresse sur la carte grise ».
En ce qui concerne les problèmes de connexion, vous avez la possibilité de nous contacter directement sur notre site en cliquant sur ce lien : https://immatriculation.ants.gouv.fr/aide-et-contact en sélectionnant l'objet : VoxUsagers.
Sachez que cette anomalie est bien connue de nos services et que nos équipes techniques font tout leur possible pour résoudre ce dysfonctionnement. [...] »
d) L'administration numérique pour les étrangers en France : une dématérialisation à marche forcée, contrariée par de nombreux dysfonctionnements
Le guichet unique des formalités des entreprises n'est malheureusement que l'un des exemples de dysfonctionnements d'outils créés à l'origine pour simplifier la vie des usagers. L'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), lancée en 2014 avec l'intention de « privilégier une dématérialisation de "bout-en-bout" (de l'usager à l'agent) pour les procédures séjour et acquisition de la nationalité et une dématérialisation partielle sur les périmètres asile et éloignement »355(*) a, elle aussi, suscité de nombreuses critiques.
Deux décisions rendues par le Conseil d'État en 2019 en 2022 (voir supra) concernant la dématérialisation des démarches administratives ont été prises sur saisine d'associations contestant l'obligation imposée par l'ANEF, dans certains cas, de passer par la voie numérique. De plus, le Défenseur des droits souligne que « les droits des étrangers sont devenus à partir de 2022 le premier motif de saisine du Défenseur des droits et ont dépassé, en 2023, les 30% des saisines relatives aux services publics »356(*).
Le Défenseur des droits ainsi, à de nombreuses reprises, émis des alertes sur les dysfonctionnements de ce service : problèmes de conception du logiciel (absence d'historique des démarches réalisées, impossibilité de répondre à une demande de pièces complémentaires notamment), bugs récurrents (pièces transmises mais non reçues, impossibilité de changer le mot de passe faute de recevoir le lien)357(*). Ces problèmes sont d'autant plus dommageables qu'ils peuvent avoir des conséquences très graves :
- pour le public concerné : risque de perte d'emploi, voire de se trouver sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national faute de pouvoir renouveler son titre de séjour ;
- pour l'accès aux services publics : lors de ses déplacements dans le Rhône, le 16 juin, puis en Seine-Saint-Denis, le 8 juillet 2025, la mission d'information a été alertée sur la captation de nombreux rendez-vous en préfecture dès la mise en ligne de ceux-ci, revendus ensuite pour des sommes importantes (150 à 200 euros) par des officines que l'on peut qualifier de douteuses : « Une dame m'a dit qu'elle avait payé 300 euros pour ses papiers », selon un témoignage entendu au Point multi services (PMS) de Saint-Fons le 16 juin 2025.
Les exemples de l'ANEF et du guichet unique des formalités des entreprises ne remettent aucunement en cause les démarches de simplification et de numérisation entreprises par l'administration, qui ont également produit de nombreuses réussites, évoquées ailleurs dans ce rapport. En outre, il existe aussi des exemples de dysfonctionnements résolus, comme la dématérialisation des demandes de permis de conduire, objet de nombreux signalements au Défenseur des droits à ses débuts358(*). En revanche, ces deux cas illustrent les conséquences néfastes d'une dématérialisation menée à la hâte, voire à marche forcée. Ils plaident également pour le maintien du choix, pour le public concerné, du mode de contact - en ligne, par téléphone, en présentiel - avec l'administration.
C. DES CHANTIERS DÉCISIFS POUR LES DROITS DE L'USAGER
1. Mettre en cohérence la politique de l'inclusion numérique
a) L'illectronisme : un phénomène qui n'est pas appelé à disparaître
Il importe de dissiper un cliché tenace selon lequel internet étant apparu dans les années 1990, l'illectronisme serait voué à se résorber inéluctablement à mesure que se diffusent les compétences numériques au sein de la population.
Or la rapporteure est convaincue qu'une telle approche revient à ignorer deux réalités.
D'abord, l'apparition à un rythme rapide d'équipements nouveaux comme le smartphone ou d'outils comme les QR codes et l'intelligence artificielle est à l'origine d'une évolution constante du contenu des compétences numériques qui laisse nécessairement sur le bord de la route une partie de la population : en somme, l'effet de génération ne l'emporte pas tout à fait sur l'effet d'âge.
Ensuite, la compétence numérique ne se résume pas à la possession d'un ordinateur ou d'un smartphone et de la capacité à les utiliser : tout dépend de l'usage que l'on veut en faire. Le rapport de la mission d'information sur l'illectronisme et l'inclusion numérique359(*), précédemment cité, reproduit ainsi le témoignage éclairant d'un professeur en Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté)360(*) à Marseille : ses élèves, explique-t-il, « savent jouer à Fortnite361(*) et publier des statuts sur Facebook ou des stories sur Snapchat. Ils sont aussi capables de trouver les clips de leurs artistes préférés sur YouTube et de suivre les carrières de telle ou telle star de télé-réalité sur Instagram. C'est quand il s'agit de faire un usage éducatif de l'outil numérique qu'ils redeviennent ces êtres chétifs et impuissants qu'ils sont devant un livre ou un cahier ».
Ce constat recoupe l'analyse du sociologue Vincent Dubois, qui se déclare « sceptique quant à la thèse optimiste d'une résorption à venir de l'illectronisme dans les démarches administratives », car « au facteur générationnel et d'âge il faut en effet ajouter les caractéristiques sociales des usagers : à la fois leurs compétences techniques, linguistiques, administratives, et la complexité de leur situation ou sa plus ou moins grande concordance avec les catégories bureaucratiques »362(*).
En d'autres termes, un rapport de l'ONU précédemment cité souligne la difficulté majeure que constitue la lutte contre l'exclusion numérique, car « les fractures numériques ne sont pas statiques » et « la vulnérabilité est un état dynamique et changeant »363(*) : la mission d'information fait sien ce constat.
b) Des réponses différentes à l'exclusion numérique : le choix assumé du « tout numérique » au Royaume-Uni, la stratégie danoise de l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics numériques, la volonté de maintenir des alternatives (omnicanalité) en France
Les stratégies déployées par la France, le Danemark et le Royaume Uni illustrent des manières différentes de répondre au phénomène de marginalisation numérique.
(1) Royaume-Uni : le numérique à marche forcée
La première manière consiste à assumer la dématérialisation tout en misant sur la formation des publics au numérique. C'est la voie choisie par nos voisins d'outre-Manche : selon l'ambassade de France dans ce pays, sollicitée par la mission d'information, au Royaume-Uni « il s'agit moins d'adapter les modalités d'accès aux services publics aux besoins des personnes éloignées du numérique (par exemple en garantissant la possibilité d'un accueil au guichet), que d'équiper, accompagner et former ces publics à l'utilisation des outils numériques ("digital inclusion"). »
L'ambassade observe également que, si par la stratégie d'inclusion numérique « l'administration s'engage à rendre les démarches numériques les plus simples et intuitives possibles », « le maintien de "voies alternatives" au numérique dans l'accès aux services publics est mentionné de façon résiduelle dans cette stratégie, la concrétisation de cet objectif étant renvoyée à des partenariats locaux avec le secteur associatif et les autorités locales »364(*).
Parmi les acteurs de l'inclusion digitale on peut ainsi citer, parallèlement à des associations comme Citizen advice, les bibliothèques, qui fournissent un accès gratuit à internet et des ordinateurs ainsi que des formations aux usagers pour utiliser les services en ligne.
(2) Danemark : l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics numériques
Au Danemark365(*), où 17 à 22 % des adultes environ sont « digitalt udsatte » (éloignés du numérique), parmi lesquels des personnes âgées et handicapées, le Gouvernement a mis en place un accompagnement renforcé des citoyens à l'usage des services publics numériques : déploiement de 7 000 digital ambassadors (référents locaux qui forment et accompagnent physiquement les citoyens) dans les communes, organisation de cours de formation au numérique dans les bibliothèques municipales, etc.
Une assistance est également proposée aux usagers dans les Borgerservice, équivalent danois des espaces France service.
En parallèle, le Gouvernement danois vise « le développement d'une utilisation facilitée des services administratifs via les smartphones ».
De plus, si la transmission de documents officiels via Digital Post366(*) est en principe obligatoire depuis 2014, des exemptions à l'utilisation des services publics numériques sont prévues pour certains usagers : ces exemptions concernent « 5 % des adultes (soit environ 255 000 personnes) qui restent éligibles à l'envoi papier »367(*).
(3) France : l'ambition d'assurer des alternatives au numérique par l'omnicanalité
La démarche française consiste à maintenir pour les usagers la faculté de communiquer avec l'administration par d'autres voies que l'électronique : c'est l'exigence d'omnicanalité, un axe fort des conclusions de la mission d'information du Sénat « Lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique » : « passer d'une logique 100 % dématérialisation à une logique 100 % accessible ». « À cet effet, ajoute la mission d'information, il faut conserver la faculté d'un accès physique et/ou d'un accueil téléphonique pour l'ensemble des démarches dématérialisées des services publics ».
L'omnicanalité demeure une véritable attente pour nombre d'usagers : dans cette logique, le septième Comité interministériel de la transformation publique (CITP) a fixé, en mai 2023, parmi les objectifs du Gouvernement, celui de « Faire de l'accès aux services publics une priorité avec une action sur l'ensemble des canaux : téléphone, numérique et physique »368(*). Le Plan téléphone, précédemment évoqué, illustre cette priorité.
Deux décisions du Conseil d'État sur la saisine de l'administration par voie électronique
En 2019, le Conseil d'État a considéré, à propos des difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous en ligne dans les préfectures, qu'en créant un droit pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique, le code des relations entre le public et les administrations n'avait mis en place aucune obligation de saisine des administrations par voie électronique369(*).
En revanche, par une décision du 3 juin 2022370(*), en réponse à deux recours du Conseil national des barreaux et d'un ensemble d'associations contre la mise en place d'un téléservice pour les demandes de titre de séjour, il a validé le fait de « rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative », « à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits ». En l'espèce, et au vu des difficultés spécifiques du public visé - les étrangers demandant un titre de séjour - le Conseil d'État a annulé le décret et l'arrêté qui faisaient l'objet du recours, au motif que l'État n'avait pas mis en place de solution de substitution.
Dans sa décision du 31 octobre 2023371(*) relative à une procédure dématérialisée pour l'inscription en master, le Conseil d'État a mis en oeuvre les mêmes critères - objet, public concerné, caractéristiques de l'outil numérique utilisé - pour, cette fois, valider la procédure en question sans demander la mise en place de dispositifs spécifiques d'accompagnement ni de solution de substitution.
Pour le Défenseur des droits, « une telle logique aboutit à légitimer le développement d'un service public qui n'est pas conçu d'emblée comme inclusif ou universel, et dont l'accès ne serait garanti à tous que sous certaines conditions, par des dispositifs correctifs ou dérogatoires, lorsque l'absence de tels dispositifs porterait une atteinte trop importante aux droits des usagers concernés »372(*). Le rapport exprime la crainte de l'émergence de « services publics à deux ou à plusieurs vitesses » et recommande la mise en oeuvre systématique d'une alternative à la voie numérique. La proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics adoptée le 17 octobre 2023 par l'Assemblée nationale va dans le même sens.
L'exigence, ou à tout le moins l'ambition d'omnicanalité ne dispense évidemment pas de réduire l'exclusion numérique en aidant les publics qui en sont victimes à effectuer leurs démarches et en les formant373(*).
c) Focus sur deux dispositifs d'inclusion numérique : les conseillers numériques et Aidants Connect
La stratégie d'inclusion numérique du Gouvernement, portée par le volet « Inclusion numérique » du plan de relance doté de 250 millions d'euros, est pilotée par l'ANCT via le programme Société numérique374(*). Celui-ci repose sur trois dispositifs - les conseillers numériques, Aidants Connect et Numérique en commun(s) - dont les deux premiers seront évoqués dans ce rapport375(*).
(1) Les conseillers numériques : un avenir à préciser
Le dispositif des conseillers numériques est piloté par l'ANCT, la Banque des territoires intervenant plus particulièrement au titre du conventionnement avec les structures d'accueil et de la formation initiale et continue. Ce dispositif vise à « accompagner la population qui n'est pas à l'aise avec les usages numériques, sous forme d'accompagnements individuels ou d'ateliers collectifs »376(*). Les conseillers numériques assurent une présence de terrain « en capitalisant sur les lieux déjà fréquentés par les publics cibles (missions locales, centres sociaux, associations, mairies, espaces France services, établissements scolaires, bureaux de poste), et en articulant leurs missions avec l'ensemble des acteurs locaux intervenant dans le champ de la médiation sociale »377(*).
Au total, selon la Banque des territoires, « plus de 3,5 millions de personnes ont pu être accompagnées depuis le lancement du dispositif en 2021 ».
L'encadré ci-dessous illustre l'engagement de la Communauté urbaine d'Arras dans ce domaine.
Communauté urbaine d'Arras :
un exemple de déploiement des conseillers numériques sur le terrain
Lors de l'audition de France Urbaine par la mission d'information378(*), Jean-Luc Tillard, vice-président de la Communauté urbaine d'Arras en charge du développement des solidarités et préventions, a présenté le dispositif mis en place en faveur de l'inclusion numérique : « Nous nous sommes dotés de trois conseillers numériques, qui animent des ateliers thématiques, des séances en accès libre, ainsi que des entretiens personnalisés. Ils aident les usagers à s'approprier les outils numériques et à mener à bien leurs démarches en ligne. » Leur déploiement a été pensé pour « coller » aux besoins du territoire : « Nous avons mis en place deux modes d'organisation, selon la typologie du territoire. En zone urbaine, les conseillers numériques sont encadrés par des centres sociaux, qu'ils soient communaux ou associatifs. Ils interviennent dans le cadre des projets sociaux portés par ces structures, avec des ateliers collectifs s'inscrivant dans des démarches transversales : lien entre numérique et santé, ou encore numérique et parentalité. En zone rurale, les conseillers numériques sont employés directement par la Communauté urbaine, qui assure leur déploiement dans les communes » 379(*).
Cette organisation répond au besoin de souplesse organisationnelle décrit par la Banque des territoires : « La mobilité des conseillers numériques et leur capacité à s'intégrer à d'autres dispositifs sont des éléments-clés de la réussite du programme. La diversité de leurs missions (démarches en ligne, prise en main de matériel informatique, IA, cybersécurité, parentalité, éducation aux médias, extinction du réseau cuivre, réparation du matériel...) et la souplesse de leurs modalités d'accompagnement contribuent aussi à répondre de manière efficace aux besoins qu'ils rencontrent sur le terrain. »
La présence des conseillers numériques s'articule avec celle des conseillers France Services, qui servent des publics similaires et sont identifiés comme assurant un premier accueil pour les démarches numériques. Ainsi des permanences communes peuvent être assurées dans le cadre d'un dispositif itinérant (bus France Services)380(*). L'un des élus rencontrés lors du déplacement de la mission d'information dans l'Yonne, le 30 juin 2025, regrettait même l'impossibilité de mutualiser ces deux fonctions, déplorant une « vision très silotée » : au vu des ressources limitées de sa commune, il était impossible de financer à la fois un poste de conseiller France Services et un poste de conseiller numérique.
En revanche, dans certains territoires la mission des conseillers numériques gagnerait à être précisée. Si elle vise en principe l'accompagnement pédagogique des usagers pour leur permettre à terme un recours autonome à l'informatique, dans les territoires les plus défavorisés les conseillers numériques peuvent être conduits à effectuer eux-mêmes des démarches à la place des usagers, dans un contexte d'urgence qui se prête mal à la mise en place d'une démarche pédagogique.
Les témoignages recueillis lors du déplacement de la mission d'information à Saint-Fons, dans le Rhône, le 16 juin 2025, confirment la difficulté de mettre en place une démarche d'accompagnement pour des usagers confrontés à deux obstacles majeurs : la langue et le numérique. De même, les ateliers numériques présentés à la rapporteure par les responsables du service social départemental de Bondy, en Seine-Saint-Denis, le 8 juillet 2025, semblent peiner à trouver leur public face à des usagers « en mode survie ».
Selon la Commission supérieure du numérique et des postes (CNSP)381(*), « le profil des personnes accompagnées par les conseillers numériques est relativement diversifié même si les plus de 60 ans représentent 47 % du public accompagné (29 % pour la tranche d'âge 35-60 ans et 10 % pour les 18-35 ans). » La CSNP fait valoir un taux de satisfaction important des personnes accompagnées :
- « 97 % des personnes accompagnées ont le sentiment d'avoir progressé,
- 83 % des individus se sentent plus à l'aise avec le numérique après les accompagnements,
- 93 % estiment réussir des tâches qu'elles n'arrivaient pas réaliser avant l'accompagnement,
- 60 % estiment être moins stressées à l'idée de manipuler des outils numériques ».
Si le nombre de conseillers numériques est officiellement de 4 000, selon la Banque des territoires, la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) estimait en novembre 2024 : « entre les non-renouvellements et les renouvellements de contrats en cours ainsi que le fort turnover des contrats de conseiller numérique, ce n'est pas 4 000 conseillers numériques qui sont déployés dans les territoires mais seulement 2 600 »382(*). La CSNP pointe notamment « la réduction du nombre de conseillers numériques employés par les associations depuis son avis publié en 2022 ».
La CSNP et plusieurs acteurs comme Départements de France, par la voix de sa vice-présidente Marie-Agnès Petit383(*), se sont fortement inquiétés de l'avenir du dispositif. Mme Petit, également présidente du département de la Haute Loire, a ainsi déclaré à la mission d'information : « Tous les présidents de communautés de communes et tous les maires se demandent par ailleurs si l'État sera toujours au rendez-vous pour financer les conseillers numériques ». En effet, la loi de finances pour 2025 a réduit les crédits dédiés à l'inclusion numérique de 56 % en n'allouant que 28 millions d'euros384(*) au dispositif des conseillers numériques contre 62 millions d'euros alloués en 2024385(*).
Les fonctions des conseillers numériques par rapport à celles des conseillers France services gagneraient donc à être précisées, de même qu'il importe de clarifier l'avenir du financement des conseillers numériques.
Ces remarques conduisent la rapporteure à insister sur la nécessaire clarification du paysage institutionnel de l'inclusion numérique, où coexistent plans (plan de relance, plan France Très Haut débit386(*)), programmes (programme France Numérique Ensemble, piloté par l'ANCT) et feuilles de route (feuille de route nationale d'inclusion numérique).
Si, à travers la plateforme beta.gouv et la publication d'indicateurs et de statistiques en temps réel, une grande transparence est affichée autour de cette politique publique, la coexistence de ces multiples dispositifs comme les hésitations terminologiques (médiateur/conseiller numérique par exemple) tendent à introduire une certaine opacité.
Est-il cohérent, par exemple, que les conseillers numériques restent portés par le programme budgétaire qui met en oeuvre le plan France Très Haut débit, relatif au déploiement de la fibre optique ?
Il conviendrait donc de réfléchir non seulement à une meilleure définition de la mission des conseillers numériques, mais aussi à une clarification du financement et de la conduite de cette politique publique, qui appelle un pilotage cohérent.
Recommandation : Clarifier les missions et le positionnement des conseillers numériques, notamment vis-à-vis des conseillers France Services, et mettre en cohérence le financement et la mise en oeuvre de l'inclusion numérique en désignant un chef de file de cette politique publique.
(2) Aidants Connect : un périmètre à trouver
Au même titre que les conseillers numériques, le programme Aidants Connect fait partie du programme Société numérique de l'ANCT. Il est destiné aux professionnels qui accompagnent régulièrement des personnes éloignées du numérique dans leurs démarches, en particulier des personnes âgées, ou souffrant de handicap - ce qui exclut les proches aidants et les bénévoles. Voici comment le site de présentation du dispositif, hébergé par beta.gouv, présente les cas d'usage du dispositif :
- « lorsque j'effectue des démarches administratives régulières avec des personnes peu à l'aise avec le numérique,
- si mes usagers viennent me voir sans leur identifiant et leur mot de passe,
- si j'accompagne l'usager sur plusieurs démarches à la fois,
- lorsque l'usager a du mal à se déplacer régulièrement en agence ».
Les aidants - individuels ou structures - susceptibles d'obtenir ce label sont les travailleurs sociaux, agents publics d'accueil, médiateurs numériques, conseillers numériques. À l'issue de la procédure d'habilitation et d'une formation, ils pourront réaliser des démarches en ligne - dont le périmètre aura été défini au préalable avec la personne aidée - pour le compte de celle-ci. Selon M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, « l'ensemble des connexions et des démarches effectuées sont dès lors tracées ou stockées, ce qui donne un cadre sécurisé aux démarches »387(*).
Il subsiste une incertitude sur le nombre de professionnels et de structures labellisés à ce jour. D'après les données présentées sur le site de l'ANCT388(*), on compte aujourd'hui 15 708 aidants ; mais d'après le site aidantsconnect.beta.gouv389(*), ils seraient 7 367 aidants et 3 008 structures, pour environ 53 000 personnes accompagnées et 350 000 démarches réalisées. Le coût de ce dispositif lancé en 2019 représente, d'après M. Laurent Marcangeli, 7,6 millions d'euros.
Ce programme semble connaître un problème de positionnement. D'abord, l'habilitation ne peut être donnée à un tuteur ou mandataire judiciaire, alors que la protection juridique serait pourtant le cas d'usage le plus évident pour ce type de service. De même, les bénévoles et particuliers aidants ne sont pas éligibles au programme.
Ensuite, la CSNP, dans l'avis cité plus haut, observe « des flottements sur la notion d'Aidants Connect, parfois confondus avec les Conseillers numériques ou les "anciens" conseillers numériques France Service », et suggère notamment une clarification sur la responsabilité engagée en cas d'erreur ou de fraude des Aidants Connect. La Poste aurait ainsi fait le choix de ne pas habiliter ses facteurs, afin de ne pas engager sa propre responsabilité. La CSNP propose donc que cette garantie soit apportée par l'État.
Ces ambiguïtés expliquent les chiffres relativement modestes affichés à ce jour. Une conseillère France Services a ainsi indiqué à la mission d'information que sa structure avait reçu l'habilitation mais s'en servait peu390(*), ce qui suggère que le dispositif a des difficultés à trouver son public.
La rapporteure estime qu'un succès d'Aidants Connect reposerait nécessairement sur un élargissement du périmètre de ce dispositif.
Cette évolution comblerait un vide dans le dispositif actuel d'inclusion numérique, qui concerne les personnes réellement dépendantes, en particulier celles qui sont atteintes d'une maladie chronique ou dégénérative. Ce public n'a pas nécessairement accès aux travailleurs sociaux ou conseillers numériques qui sont concernés par l'habilitation, or il a clairement besoin d'une aide au quotidien pour ses démarches.
Recommandation : Étudier l'élargissement du périmètre d'Aidants Connect, afin de toucher les publics éloignés du numérique par la dépendance et/ou la maladie.
d) France Travail : des initiatives intéressantes pour repérer l'illectronisme et développer les compétences numériques
France Travail a développé plusieurs initiatives intéressantes en matière de repérage de l'illectronisme391(*) et de lutte contre celui-ci :
- la généralisation du diagnostic des compétences numériques Pix emploi, qui vise à évaluer la maîtrise des compétences numériques. « Les demandeurs d'emploi, indique France Travail, sont invités automatiquement à passer ce test sept jours après leur inscription, puis relancés automatiquement 30 jours après » ;
- « l'expérimentation "Territoire Zéro Illectronisme" dans l'Allier en 2024 a permis de tester un diagnostic rapide de repérage de l'illectronisme auprès des nouveaux bénéficiaires du RSA », posant les bases d'un processus de détection.
France Travail s'appuie sur 3 200 jeunes en service civique en agence pour soutenir les demandeurs d'emploi dans leurs démarches administratives, et propose des ateliers pratiques pour développer leurs compétences numériques.
Cette manière d'aborder l'inclusion numérique a suscité l'intérêt de la rapporteure, d'abord en ce qu'elle associe le développement des compétences numériques à un objectif concret, celui de la recherche d'emploi ; ensuite en ce qu'elle s'appuie sur un repérage au niveau le plus local, à l'image des initiatives espagnoles en matière d'inclusion numérique présentées dans l'encadré ci-dessous.
L'exemple espagnol : un modèle décentralisé, comportant de nombreuses initiatives locales pour l'inclusion numérique392(*)
L'Espagne est globalement plus avancée que la France dans la numérisation de son administration : elle se classe en deuxième position pour les services publics numériques dans l'index DESI 2020393(*), qui mesure les performances numériques des pays européens, quand la France se situe au douzième rang. En matière d'inclusion numérique, l'initiative va aux collectivités, d'où un foisonnement de projets locaux, principalement à destination des personnes âgées. Sollicitée par la rapporteure, l'ambassade de France à Madrid a communiqué à la mission d'information quelques exemples :
Ville de Madrid
- Volontariat numérique / Madrid te Acompaña : +18 000 volontaires qui aident quelque 665 000 personnes âgées à effectuer des démarches numériques et à utiliser l'application municipale
- Ateliers « APPrender a usar tu móvil » : en 2022, plus de 200 personnes âgées ont appris à utiliser un smartphone en collaboration avec une association locale.
Communauté de Madrid
- Plan d'autonomisation numérique (2022-2023) : priorité aux « personnes vulnérables » et aux personnes âgées sans accès ni compétences numériques.
- Tres Cantos active un canal WhatsApp pour communiquer des activités aux personnes âgées : 1 300 utilisateurs en seulement trois mois.
Comunidad Valenciana - Mairie de Villena
- Aula Innova (septembre 2024 juin 2025) : promu par le conseil municipal de Villena, il a formé 444 personnes - principalement des personnes âgées, des chômeurs ou des personnes ayant un faible accès à la technologie.
Andalousie - CIC Batá et Linares
- Le programme Conectad@s 55 (CIC Batá) formera 800 seniors dans 80 centres de participation active dans les municipalités rurales de Grenade, Malaga, Séville et Cordoue en 2024.
- À Linares, le projet Conectad@ss.ss comprend des ateliers, des guides et 4 points TIC, financés par les fonds européens.
Asturies - Gijón
- Stratégie « Gijón Yes Digital » : 395 cours gratuits (10 heures chacun) pour les personnes âgées ou à risque numérique »
2. Rendre effectifs l'omnicanalité, le principe « dites-le nous une fois » et le droit à l'erreur de l'usager
La dématérialisation des services publics, avec les garde-fous qui ont été évoqués, notamment en matière d'accompagnement numérique, peut incontestablement être une opportunité, à la fois pour l'usager et pour l'agent, à condition toutefois que soient effectivement appliqués ces droits essentiels pour l'usager :
- la possibilité pour l'usager de choisir le canal par lequel il s'adresse à l'administration (ou omnicanalité) ;
- le principe « dites-le nous une fois » ;
- le droit à l'erreur.
Certes, nous ne sommes plus à l'époque où adresser une demande à l'administration pouvait se comparer au jet d'un caillou dans un puits sans fond ; la rapporteure a pu constater que, globalement, les administrations en contact avec l'usager s'étaient mises en ordre de marche afin de donner une réalité concrète à ces droits.
Cependant, il reste du chemin à parcourir avant d'arriver à une fluidité totale dans les relations entre les usagers et les administrations qui permette à la dématérialisation des services publics de produire tous les effets positifs susceptibles d'en résulter pour l'usager.
a) L'omnicanalité : une ambition plus qu'une réalité
L'un des enseignements des auditions et des déplacements effectués par cette mission d'information est que les Français restent attachés à la possibilité de communiquer avec l'administration par d'autres voies que le numérique. C'est justement la raison d'être des France Services que d'offrir cet accueil physique devenu plus en plus rare avec la fermeture des points d'accueil des administrations déconcentrées. Quant au téléphone, il reste très utilisé : selon l'Urssaf, « le canal phare reste le téléphone avec en 2024 6,5 millions d'appels394(*) ». La CNAM souligne, quant à elle : « entre 2019 et 2023, les volumes d'appels reçus au 3646 ont augmenté de 67 %395(*) ».
Ce constat concorde avec les résultats de la dernière édition du baromètre des services publics publié par l'institut Paul-Delouvrier396(*), parue en février 2025, précédemment cité. L'un des enseignements de l'étude est le suivant : « Les Français souhaitent en priorité que leurs services publics soient plus facilement joignables, quel que soit le mode de contact utilisé.
- Il s'agit de la dimension sur laquelle ils aimeraient que les services publics fassent le plus de progrès ces prochaines années (55 %).
- En ce qui concerne les modes de contact, Internet s'impose généralement comme le premier canal par lequel les usagers entrent en relation avec les différents services publics (que ce soit par mail ou via le site web), à l'exception des forces de l'ordre pour lesquelles le contact physique via un déplacement sur place reste en tête.
- Les tendances de long terme sont les mêmes pour la plupart des services publics : progression du contact par Internet, baisse du courrier, stabilité relative du téléphone et du contact physique (même si on note un léger rebond de ce dernier pour certains services cette année) ».
Ce baromètre confirme que si internet se développe, les Français ne sont pas prêts à la dématérialisation totale.
Dans ces conditions, l'enjeu pour les administrations réside dans la mise en oeuvre d'une approche intégrée entre les différents canaux, afin d'éviter notamment toute déperdition d'information. C'est ainsi que les Urssaf assurent « une continuité digitale entre les demandes utilisateurs qui nous parviennent par différents canaux (courriel, sites internet, téléphone) et nos systèmes backoffice avec des routage automatisés par organisme et motifs », avec un centre de contact qui transmet les demandes au système d'information ; « ces informations sont intégrées dans une vision 360° permettant au collaborateur d'avoir la vision sur l'ensemble des interactions Usager - Urssaf »397(*).
Des fonctions analogues sont assumées, au sein de l'Assurance maladie, par l'outil Medialog+ qui assure :
- « La centralisation des interactions avec les assurés, quels que soient les canaux utilisés (appels, courriels, messages via le compte Ameli, rendez-vous physiques...).
- L'accès à l'historique des échanges et aux demandes en cours, garantissant une prise en charge cohérente et personnalisée.
- La remontée d'indicateurs sur les motifs de contact, les canaux utilisés, et les délais de traitement ».398(*)
Comme cela a été rappelé précédemment à propos de l'accompagnement numérique, le septième Comité interministériel de la transformation publique (CITP) a fait de l'accès aux services publics par tous les canaux une ambition du Gouvernement. Cette ambition se traduit par l'un des engagements du programme Services Publics+ : « Vous pouvez facilement entrer en contact avec vos services publics ». Il conviendrait, pour mieux incarner l'ambition d'omnicanalité, de modifier l'intitulé de cet engagement dans un sens plus explicite.
En outre, la mission d'information estime nécessaire que le CITP, qui ne s'est pas réuni depuis avril 2024, réaffirme la priorité dont doit faire l'objet l'omnicanalité parallèlement au développement de l'administration numérique et rappelle l'obligation, pour tous les services publics, de l'appliquer effectivement.
Recommandation : Garantir à l'usager un accès aux services publics selon le canal de son choix, notamment téléphonique, en réaffirmant l'obligation, pour tous les services publics, d'appliquer le principe de l'omnicanalité ; faire de ce principe la priorité du prochain Comité interministériel de la transformation publique (CITP).
b) Dites-le nous une fois : un chantier ouvert dans les administrations, des progrès à réaliser
Comme l'a reconnu le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification devant la mission d'information, « cela fait maintenant quelques années que [dites-le nous une fois] est appliqué, et je constate qu'il ne suffit pas de le dire une fois pour qu'il le soit partout, car on lui oppose des résistances... » 399(*). Le ministre a évoqué, à titre d'exemple, les déclarations de handicap : « Il est par exemple très pénible, pour les personnes lourdement handicapées ou leurs proches aidants, de devoir déclarer chaque année que leur situation n'a pas changé. Nous devons épargner à nos compatriotes ce type de démarche inutile et fatigante »400(*).
La non-reconnaissance de ce principe peut avoir des conséquences très regrettables, comme l'illustre le cas d'un candidat à un examen, rapporté dans l'encadré ci-dessous.
Les couacs du « dites-le nous une fois » : un exemple issu du rapport pour 2024 de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur401(*)
Voici un exemple de non-application du « dites-le nous une fois », avec de lourdes conséquences pour un étudiant : « Un candidat au BTS Gestion de la PME était redoublant et avait choisi de repasser l'épreuve professionnelle E4 à la session 2023 afin d'améliorer sa note de 13/20. Il avait déjà déposé un dossier complet à la session 2022 montrant qu'il avait effectué les stages nécessaires pour se présenter à l'épreuve. Il n'avait pas imaginé qu'il devrait recommencer les mêmes démarches, ayant atteint une note supérieure à 10/20. Il est convoqué à l'épreuve et la passe, mais il reçoit au mois de mars un courrier l'informant que l'épreuve est déclarée non valide pour absence de dépôt du dossier. Dans ce courrier est annoncé un courrier de relance qu'il n'a pas reçu. Cet incident constitue une véritable catastrophe pour le candidat : il va à nouveau retarder d'une année l'obtention de son diplôme. »
Le rapport de la médiatrice précise que celle-ci a pu intervenir en faveur du candidat.
(1) Un effort porté par la Dinum
La Dinum, chargée de faciliter la mise en place du « dites-le nous une fois » dans les administrations, reconnaît que la France se situe à la vingtième place en Europe sur cet indicateur402(*).
Toutefois, un effort a été engagé pour une meilleure communication des bases de données de l'administration, ce qui constitue une étape décisive puisque l'accès des administrations ou des collectivités à ces bases de données dispense l'usager de fournir lui-même l'information requise.
Ainsi, « la Dinum met à disposition un ensemble de données accessibles sur DATA.gouv comme des données des entreprises et des particuliers. Ces dispositifs ont pour objectif de permettre aux administrations de proposer des téléservices intégrant le pré-remplissage des données dans les formulaires ».
Concrètement, la Dinum, avec l'appui de la DITP, a obtenu de la direction de la sécurité sociale la création d'un « point d'accès aux données de la sphère sociale permettant d'accéder aux statuts d'allocataire du RSA, de bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, les données de quotient familial ou celles nécessaires au calcul des tarifs des crèches disponibles d'ici à la fin de l'année ».
Ces informations bénéficient également aux collectivités territoriales. Selon la Dinum, « Le quotient familial constitue l'information la plus fréquemment mobilisée, notamment pour la tarification des services municipaux liés à l'enfance, en particulier la cantine scolaire. Par ailleurs, les données de la CNAF et de la MSA sont également exploitées par les départements dans le cadre d'aides facultatives à la scolarité ».
La Dinum estime toutefois que le nombre de collectivités territoriales utilisant les données relatives aux particuliers qu'elle met à leur disposition se limite à 1 200 environ : un total modeste, qui donne une idée du chemin qui reste à parcourir.
Les données relatives aux entreprises sont en revanche davantage utilisées puisque 25 000 collectivités y ont recours, en particulier pour leur intégration dans les logiciels de la commande publique, même si « ces outils n'exploitent pas encore l'ensemble des données nécessaires à l'attribution des marchés », explique la Dinum.
Les API : une brique essentielle dans la mise en oeuvre du principe « dites-le nous une fois ».
Une API, ou interface de programmation d'application, est une « interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités403(*) ». Les API permettent donc aux administrations de se communiquer des informations et des bases de données, ce qui leur évite de les demander à l'usager. La Dinum joue un rôle moteur dans la diffusion de ces API, à travers le site data.gouv.fr/dataservices. Certaines d'entre elles sont en libre accès, comme le répertoire Sirene des entreprises : d'autres sont en accès restreint, comme l'API Impôt particuler qui donne accès aux données fiscales des citoyens.
Le partage de données via les API est naturellement encadré par la réglementation, et plus particulièrement par l'article L114-8404(*) du code des relations entre le public et l'administration. Tout projet d'échange entre administrations doit répondre aux conditions suivantes :
- l'échange doit être opéré par les administrations elles-mêmes ;
- il ne peut être mis en oeuvre que pour traiter « une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire » : tout échange ex nihilo est exclu ;
- seules les données strictement nécessaires au traitement de la demande peuvent faire l'objet de l'échange, en vertu du principe de minimisation énoncé par le règlement général sur la protection des données405(*) (RGPD)406(*).
(2) Des organismes de protection sociale qui se mettent progressivement en ordre de marche
Sollicitées par la rapporteure, l'Acoss, l'Agirc-Arrco et la Caisse nationale d'assurance maladie ont détaillé les démarches entreprises au sein de leur propre administration pour mettre en oeuvre le « dites-le nous une fois », dont voici quelques exemples407(*) :
- pour l'Urssaf, « le partage des données de statuts et de salaires des salariés déclarés au CESU ou à la PAJE avec France Travail (généralisation terminée en mars 2025) [...] permet de réduire les démarches des salariés auprès de France Travail lors d'une fin de contrat » ;
- pour l'Agirc-Arrco, « le chargement des données de la déclaration sociale nominative (DSN) pour éviter de demander les 12 derniers bulletins de salaire, ou encore le chargement du taux de CSG (échange avec la DGFiP) pour éviter de demander les deux derniers avis d'imposition » ;
- pour l'Assurance maladie, « automatiser le versement des prestations maladie des salariés CESU et PAJE en transmettant de L'urssaf vers la CNAM les pièce jointes des arrêts de travail (identification du salarié, éléments de salaire ...) ».
Comment la circulation des données se structure au sein de la Sécurité sociale
Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, la Caisse nationale d'assurance maladie a présenté le cadre général de la politique de circulation des données au sein des administrations de la sécurité sociale :
« Afin de faciliter la mise en oeuvre des échanges interbranches, une comitologie dédiée a été mise en place par la direction de la sécurité sociale à travers un COPIL interbranche « circulation de la donnée », permettant d'améliorer le pilotage de la feuille de route « dites-le nous une fois » et plus largement de l'ensemble des travaux en lien avec la circulation des données pour la sphère sociale.
Composé des représentants de chaque branche, et des membres de la direction de la sécurité sociale et de la Dinum, il a pour but de :
- définir et piloter une vision urbanisée sur le périmètre de la circulation des données, tant sur le plan fonctionnel que technique ;
- définir et piloter la feuille de route du « dites-le nous une fois » annexée aux conventions d'objectifs et de gestion du régime général et les arbitrages concernant la circulation de la donnée, tant entre les organismes de sécurité sociale qu'avec l'extérieur ;
- définir la politique d'accès aux données par les partenaires extérieurs, en relation avec les usages identifiés ;
- définir et préciser le cadre juridique afférent aux différents échanges de données. »
c) Droit à l'erreur : une généralisation indispensable qui doit être combinée à des efforts des administrations pour éviter toute perte de chance pour les usagers
Le cadre juridique du « droit à l'erreur » (loi ESSOC du 10 août 2018 ; articles L. 123-1 et L. 123-2 du CRPA) a été précédemment évoqué. Or, selon la défenseure des droits, « malgré la loi ESSOC, la reconnaissance au droit à l'erreur n'est pas encore totalement généralisée » 408(*).
Créé initialement en matière fiscale, le droit à l'erreur a été décliné au domaine social par le législateur et les administrations.
Ainsi, dans leurs réponses écrites aux questionnaires de la rapporteure, la CNAV et l'assurance maladie ont ainsi mis en avant des actions de formation spécifiques :
- pour la CNAV, « la mise en oeuvre du droit à l'erreur s'est traduite par des actions d'information et prévention à l'attention des assurés, et de formation et instructions en interne : encarts sur les courriers, articles dans Forum Retraite ; publication sur lassuranceretraite.fr et service-public.fr de conseils pour éviter et corriger les erreurs les plus fréquentes ; contacts sortants invitant à signaler un changement de situation ; instructions et modes opératoires pour articuler droit à l'erreur avec lutte contre la fraude, politique de sanctions et gestion des indus, et enregistrer les erreurs signalées ou détectées ». La Caisse nationale indique que 38 000 droits à l'erreur ont été accordés en 2024 ;
- enfin, la CNAM fait valoir une série d'initiatives :
· « Formation de l'ensemble des agents au droit à l'erreur.
· Travail en cours dans le cadre d'ateliers animés par la DITP pour contribuer à la réalisation un guide d'auto-évaluation et de bonnes pratiques et construire des indicateurs qui permettent de suivre plus facilement le recours et l'application de ce droit.
· Afin de prévenir les erreurs, nous sensibilisons sur les questions les plus fréquentes et mettons en place des systèmes d'alerte et de vérification pour éviter que ces erreurs ne soient commises lors de la réalisation des démarches. Elles sont disponibles sur Internet sur le site du ministère (« J'ai droit à l'erreur » / Conseils pour les particuliers / rubrique « Je prends soin de ma santé) »
Toutefois, le droit à l'erreur ne peut, en l'état de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, s'appliquer qu'à une double condition :
- que l'erreur soit commise par un usager vis-à-vis de l'administration ;
- qu'elle implique une sanction financière ou pécuniaire pour ledit usager.
Article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : la consécration du droit à l'erreur de l'usager
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
Or, de toute évidence, l'administration peut parfois être elle-même à l'origine d'une erreur ; celle-ci peut également induire pour l'usager non pas une sanction, mais un préjudice ou, de manière plus générale, une perte de chance. Dans l'un et l'autre cas, elle ne saurait être couverte par le droit à l'erreur.
À cet égard, l'exemple de l'éducation nationale (voir l'encadré ci-dessous sur les conséquences fâcheuses, pour un candidat au baccalauréat, de la non-reconnaissance du droit à l'erreur) montre que les efforts des administrations, quel que soit le service public concerné, doivent être poursuivis et amplifiés de façon à éviter toute perte de chance pour les usagers auxquels le droit à l'erreur ne s'applique pas strictement.
Éducation nationale : les limites du droit à l'erreur - cas d'un candidat au baccalauréat issu du rapport pour 2023 de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Voici une autre saisine reproduite par la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 2023 dans son rapport annuel : « L'élève D n'a pas été inscrit au bac dans la bonne spécialité. En effet, il faut remplacer NSI par « physique-chimie ». Cette famille ne parle pas bien le Français et n'a pas compris. [...] Étant moi-même en arrêt maladie durant cette période et notre établissement n'ayant pas de proviseur adjoint, notre pauvre CPE s'est retrouvée seule à assumer la charge des inscriptions au bac alors qu'elle ne connaissait rien. [...] N'ayant pas suivi la spécialité NSI en première, cet élève déjà faible n'aura aucune chance d'avoir son bac l'année prochaine ».
En l'espèce, la médiatrice n'a pas pu intervenir, l'alerte lui ayant été remontée trop tard. Ici l'administration n'a pas rempli son devoir de conseil auprès d'une famille qui ne maîtrisait pas la procédure d'inscription, avec des conséquences lourdes pour l'élève.
Dans ce type de cas, la médiatrice observe que le droit à l'erreur prévu par la loi n'est pas opposable : « Cette loi de portée générale n'est pas applicable aux erreurs qui peuvent être commises par un élève ou un étudiant lors de l'inscription à un examen car elles ne sont assorties d'aucune sanction au sens juridique du terme ». C'est pourquoi la médiatrice estime que « les erreurs aux conséquences les plus graves devraient être systématiquement régularisées, en suivant des orientations générales ministérielles. Cette approche éthique et bienveillante des relations entre l'administration et les usagers du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est de nature à renforcer le sens des missions accomplies par ses personnels et la confiance que les élèves, les étudiants et leur famille lui portent ».
Les erreurs répertoriées dans l'encadré ci-dessus glissent dans les interstices du système - case non cochée, dossier mal rempli, léger retard. Elles rendent indispensable une communication fluide entre l'administration et l'usager, seule susceptible d'y remédier. Comme la médiatrice de l'éducation nationale, la rapporteure estime souhaitable de promouvoir, dans tous les services publics, une « approche bienveillante » du cas de certains usagers lorsque la reconnaissance du droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation, permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance.
Recommandation : Étendre la reconnaissance du droit à l'erreur en encourageant, dans tous les services publics, une approche bienveillante du cas de certains usagers lorsque le droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation (erreur imputable à l'administration ou n'impliquant pas une sanction pécuniaire), permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance.
3. Mieux protéger l'usager contre la concurrence des sites payants
a) La prolifération de sites internet marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites ou quasi-gratuites
D'un constat partagé entre la DGCCRF, l'UFC que choisir et l'Institut national de la consommation, il résulte que le nombre croissant de démarches administratives désormais dématérialisées a eu pour effet collatéral la multiplication de sites marchands proposant des offres payantes, parfois trompeuses ou frauduleuses, pour réaliser des démarches administratives pourtant gratuites ou quasi-gratuites.
Face à la primo-dématérialisation de certaines démarches telles que l'établissement ou le renouvellement d'un certificat d'immatriculation (ex carte grise), accessible uniquement en ligne depuis 2017, les usagers sont confrontés à un nombre important et parfois contradictoires d'informations disponibles en ligne, sans être en mesure d'en maitriser la fiabilité ou la véracité.
Les causes de cette multiplication des sites marchands - frauduleux ou non - sont multiples et faciles à identifier :
- la nouveauté de certaines procédures en ligne, entraînant l'absence de référentiel ou d'habitude pour l'usager ;
- le caractère faiblement récurrent - voire ponctuel - de certaines démarches (à l'inverse des déclarations fiscales), qui ne permet pas à l'usager de se familiariser avec celles-ci ;
- la grande diversité des sites et applications des organismes et des administrations de l'État pourtant certifiées ;
- l'absence de charte graphique, de nom de domaine unifié ou de moyen d'identification unique des sites officiels, le site servicespublics.fr, à titre d'exemple, ne possédant pas à ce jour un domaine en « .gouv.fr », exigence qui d'après les informations transmises à la rapporteure sera prochainement satisfaite, ce dont il convient de se réjouir ;
- les changements d'intitulés des structures opératrices de ces démarches, susceptible de troubler l'usager peu averti (comme par exemple le passage de l'ANTS à France titres) ;
- le caractère vulnérable de certains usagers face à des démarches parfois complexes, longues ou impliquant de prendre des rendez-vous dans des administrations ou organismes parfois saturés.
Ces sites payants valorisent trois arguments, comme le montre la capture d'écran ci-dessous : la simplicité, l'accompagnement de la personne, le traitement sécurisé de ses données. Ce dernier argument vise à rassurer face aux risques d'arnaque ou de hacking qui ont altéré la confiance de nombreux usagers au cours de la période récente.
En outre, certains sites valorisent un accueil téléphonique assorti de plages horaires satisfaisantes, captant l'attention d'usagers soucieux de bénéficier d'un contact humain de préférence au « tout numérique ». Or sur la plupart de ces sites, les services de renseignement téléphonique sont payants (voir la capture d'écran ci-dessous : 80 centimes la minute), alors que les plateformes téléphoniques publiques sont désormais gratuites.
Types d'irrégularités constatées par la DGCCRF409(*)
« Les principales pratiques commerciales trompeuses relevées sont celles portant sur l'identité du professionnel, consistant à faire croire au consommateur qu'il commande un acte sur un site officiel alors qu'il s'agit d'un opérateur privé.
D'autres pratiques sont également constatées, dont celle sur les prix, en ne portant pas clairement et visiblement, à la connaissance du consommateur, le prix réel à payer, qui peut s'avérer être un abonnement.
Les manquements les plus relevés sont ceux ayant trait au défaut d'informations précontractuelles et à la mise en oeuvre du droit de rétractation.
S'agissant du défaut d'informations précontractuelles, c'est l'absence des coordonnées du médiateur qui est le plus fréquemment relevé.
Concernant le droit de rétractation, il a été constaté le défaut d'information ou une information erronée, le non-respect des conditions d'exercice du droit de rétractation et particulièrement des difficultés importantes à la mise en oeuvre du recueil de la demande expresse du consommateur qui souhaite que l'exécution de la prestation de service commence avant la fin du délai de rétractation et qui reconnaît renoncer à son droit de rétractation. »
La rapporteure a pu constater que la plupart de ces sites, par ailleurs annoncés sur la page de résultats comme « sponsorisés », affichent de manière claire sur leur page d'accueil, conformément à la règlementation, le message suivant : « service d'accompagnement indépendant de l'administration », destiné à avertir l'internaute qu'il ne se trouve pas sur un site administratif.
En revanche il faut, sur certains sites, aller en bas de page pour découvrir, en très petits caractères, le message suivant, lui aussi conforme aux exigences juridiques même s'il n'est pas clairement accessible à l'internaute : « le site et les services sont fournis à titre privé uniquement, et ne correspondent en aucune manière à une mission de service public qui lui aurait été déléguée par une quelconque administration publique ou collectivité territoriale. Possibilité d'effectuer vos démarches sans frais sur service-public.fr »
La mission a conduit un atelier afin de mesurer concrètement la fréquence de tels sites internet : une simple recherche pour établir une carte grise sur un moteur de recherche grand public a abouti à la proposition de plusieurs sites internet marchands ou frauduleux, parfois référencés avant le site officiel et, beaucoup plus rarement, avant la notice générique proposée par servicespublics.fr. De façon analogue, des sites internet possédant des noms de domaines génériques de type « demarchespubliques » (ou plus simplement « demarches », « mesdemarches », etc.) apparaissent sur les propositions des moteurs de recherche, notamment en première page.
Forte de ses travaux, la mission a établi une première typologie des sites marchands, dont certains sont légaux, proposant des démarches administratives en ligne :
- des sites marchands proposant de payer pour avoir accès à certaines démarches, en avançant l'argument d'une prise en charge totale de la démarche et d'une réponse rapide, notamment pour l'établissement d'actes d'état civil ;
- des sites marchands réalisant des démarches moyennant un abonnement, par ailleurs annoncé en petits caractères et en bas de page internet, et de surcroît pour des sommes non négligeables (37,95 euros par mois) s'ajoutant aux frais d'inscription ; à titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris a condamné, le 20 juin 2022, le gérant d'une société de droit irlandais pour pratique commerciale trompeuse sur des sites d'assistance administrative (extraits d'actes de naissance, extrait K-bis, casier judiciaire, etc...) avec « piège à l'abonnement », à 50 000 euros dont 20 000 euros avec sursis410(*) ;
- un site dénommé « service payant de conciergerie administrative », avertissant l'internaute qu'en achetant la prestation proposée il « [accepte] de communiquer les données personnelles comprises dans le présent formulaire pour un usage exclusif de la société XX, dans le cadre du traitement et de la réponse à [sa] demande » ;
- des sites marchands recensant les aides sociales et financières auxquelles serait éligible l'usager, et proposant d'effectuer pour son compte ces démarches en contrepartie d'un abonnement ou du prélèvement d'un pourcentage des aides ainsi reçues ;
- des sites marchands facturant avec une marge importante des procédures administratives quasi-gratuites, à l'exemple de l'établissement d'un certificat d'immatriculation (ex-carte grise) dont le coût des taxes et redevances obligatoires est compris entre 13,76 euros et 60 euros, mais fait l'objet de démarches facturées par des tiers habilités à plus de 70 euros ; certaines de ces démarches, gratuites comme le changement d'adresse sur un certificat d'immatriculation, sont néanmoins facturée par des tiers agréés.
En outre, la mission d'information a régulièrement été alertée, pendant ses déplacements, de l'existence de sites marchands de revente de créneaux de rendez-vous en préfecture pour réaliser des démarches d'état civil ou de droit de séjour.
Outre la vente ou revente de démarches pourtant gratuites - pratiques généralement légales -, nombre de ces sites internet entretiennent la confusion entre l'identité du professionnel et un site officiel en faisant croire au consommateur qu'il se trouve sur un site officiel et non marchand, ce qui constitue en revanche une pratique commerciale trompeuse.
Ainsi, le design, les couleurs ou la présentation de certains sites entretiennent la confusion avec les sites administratifs officiels : utilisation du bleu, du blanc et du rouge ou de la Marianne officielle de l'État. Ce type de pratique induit l'utilisateur en erreur, d'autant que l'identité de l'exploitant du site internet n'est pas toujours clairement indiquée. On observe d'ailleurs que derrière la rubrique « qui sommes-nous ? » se cache parfois, en petits caractères, une adresse à l'étranger411(*).
S'agissant spécifiquement de l'établissement des certificats d'immatriculation, certains professionnels mettent en avant un agrément préfectoral pour l'immatriculation de véhicules sans en être titulaire ou sans en respecter les conditions ; d'autres sites cachent leur identité professionnelle ou mettent en avant un nom qui semble officiel, comme « bureau des cartes grises ».
La mission d'information a constaté qu'un de ces sites de « conciergerie administrative » se prévalait d'un adresse mail @ants-demarches.fr, faisant croire l'internaute que son interlocuteur n'était autre que l'Agence nationale des titres sécurisés de l'État ou ANTS, devenue France titres.
Ces pratiques commerciales trompeuses prennent également la forme de prix et d'abonnement « cachés » qui ne sont pas clairement et visiblement portées à la connaissance du consommateur, et dont la résiliation semble problématique, selon les plaintes formulées sur les forums d'utilisateurs. Au surplus, certains sites manquent à leurs obligations de protection des consommateurs par défaut ou manque d'informations précontractuelle - notamment l'absence des coordonnées du médiateur - et la mise en oeuvre du droit de rétractation.
La protection de l'usager via la protection du consommateur en ligne est donc le grand impensé de la dématérialisation des services publics, qu'elle contribue pourtant à nourrir.
Ainsi, la DGCCRF, auditionnée par la rapporteure, a indiqué augmenter le nombre de ces contrôles en la matière, suite à de nombreux signalements par des particuliers ou des associations de consommateurs, conduisant pour la seule année 2024 au contrôle de près de 40 sites internet dont 53 % présentaient des anomalies412(*), 21 sanctions ayant été prononcées (de l'avertissement au procès-verbal pénal).
b) L'attractivité du coaching privé pour Parcoursup : une préoccupation
La rapporteure a été alertée par l'attractivité du coaching privé sur Parcoursup, qui conduit certaines familles à engager des frais importants pour accompagner leurs enfants lycéens dans leurs démarches d'inscription post-bac. D'après une analyse publiée par la revue L'étudiant en mars 2024413(*), « Parcoursup cristallise les crispations. Pourtant, les élèves sont accompagnés par leur lycée tout au long de la procédure. Un dispositif parfois jugé insuffisant par certaines familles qui font appel à des coachs privés ». Selon cette étude, les élèves bénéficient grâce à ces coachs d'une présélection d'établissements et de formations établie à la suite de tests de personnalité qui permettent au professionnel d'aider le jeune à formuler une liste de voeux qui lui correspondent. L'intervention du coach inclut également en général une assistance à la mise en valeur du parcours du lycéen (études, activités extrascolaires, goûts personnels, etc.), composante importante de son dossier. Le coaching peut aussi comprendre :
- l'inscription proprement dite sur Parcoursup, épargnant au jeune et à ses parents l'angoisse des difficultés de connexion ;
- la rédaction des lettres de motivation, susceptibles de faire la différence entre les dossiers, et dont les effets anxiogènes sont bien connus des élèves de terminale et de leurs parents.
Une élève témoigne : « Finalement, [le coach] a fait exactement le même chose qu'au lycée. [...]. On a payé pour que quelqu'un m'inscrive sur la plateforme, mais est-ce que ça vaut ce prix-là ? ».
En effet, le coût de ces prestations est compris, selon l'article précité, entre 300 et 1 000 euros en fonction de l'étendue de l'intervention du coach.
Une recherche en ligne a même permis à la rapporteure de prendre connaissance d'une offre de coaching aux prix nettement plus élevés (1 390 €, 1 690 € ou 3 590 € selon la formule sélectionnée)414(*):
- la prestation la moins coûteuse comprend le bilan d'orientation, la recherche d'établissements et de formations correspondant au profil du jeune et la réalisation d'une liste de dix voeux, ainsi que l'accès à un atelier en ligne de saisie des voeux sur Parcoursup ;
- la prestation intermédiaire s'étend à la saisie en ligne des voeux (et des sous-voeux), la rédaction des activités extrascolaires ainsi que l'accès à un atelier en ligne sur la rédaction des lettres de motivation au cours duquel le coach « donne aussi des astuces » pour aider à rédiger les lettres avec l'IA : cela se passe de commentaire ;
- la formule la plus coûteuse, qui garantit aux parents une complète sérénité, assure la saisie des lettres de motivation, limitées toutefois à 1 500 caractères, ce qui toutefois n'inclut pas les « lettres spécifiques pour Sciences Po ou certaines prépas », qui « ne sont pas comprises car elles nécessitent un temps énorme de rédaction ». Ce forfait s'étend à l'accompagnement en phase complémentaire, si le jeune n'obtient pas de réponse positive, et l'aide à la saisie de nouveaux voeux.
La rapporteure ne peut que déplorer le développement de l'activité de coaching privé, qui ne se limite pas à Parcoursup : un rapport d'information publié par la commission de la culture du Sénat constatait ainsi, en juin 2023, « l'augmentation du nombre de structures privées proposant des services de coaching scolaire ou la présence de plus en plus importante de ces entreprises dans les salons d'orientation », notant que « le développement de ce secteur privé de l'accompagnement à l'orientation contribue à aggraver les inégalités sociales entre lycéens, puisqu'y ont majoritairement recours ceux issus de milieux favorisés, compte tenu des tarifs pratiqués »415(*).
Notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur, jugeait à juste titre urgent d'assurer un « service public d'accompagnement à l'orientation adapté à la nouvelle organisation du lycée et à la maîtrise de Parcoursup », afin de répondre à l'évolution des besoins des lycéens et de réduire les inégalités dans l'accès à l'accompagnement.
c) Un arsenal législatif à consolider et à adapter aux pratiques en ligne pour mieux protéger l'usager
Issu du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, hérité des lois du 2 juillet 1963 et du 27 décembre 1973, le délit de pratique commerciale trompeuse a été introduit et défini par la loi du 3 janvier 2008 afin d'assurer la transposition de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Depuis, les pratiques commerciales trompeuses sont caractérisées, en droit français, par une double condition, non cumulative :
- l'article L. 121-2 définit les pratiques commerciales trompeuses par action. Une pratique commerciale est trompeuse si elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent, ou si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments énumérés ou si, enfin, la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ;
- l'article L. 121-3 définit les pratiques commerciales trompeuses par omission. Une pratique commerciale est trompeuse si, « compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte »416(*).
Ainsi, la définition du délit de pratique commerciale trompeuse repose sur un élément intentionnel417(*) et un double élément matériel : la pratique commerciale et le caractère trompeur de cette pratique.
La tromperie effective du consommateur n'est pas un résultat nécessaire à la constitution de l'infraction de pratique commerciale trompeuse. Pour que cette infraction soit constituée, il suffit que la pratique commerciale mise en place soit de nature à induire en erreur. Le juge pénal se livre à une appréciation par référence au standard du « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »418(*). Il vérifie l'incidence de la pratique commerciale dénoncée sur ce consommateur de référence.
Cependant, face aux difficultés récurrentes de sanctionner de telles pratiques et au caractère faiblement dissuasif de l'arsenal existant, le législateur a souhaité en 2014 par l'adoption de la loi n° 2014-344 relative à la consommation :
- d'une part, renforcer le régime de sanction pour les pratiques commerciales trompeuses en les portant à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 1,5 million d'euros pour une personne morale ;
- d'autre part, créer un régime de sanctions administratives en cas de manquements à certaines dispositions protégeant les intérêts des consommateurs. Le législateur institue ainsi plusieurs amendes administratives, soit pour remplacer certaines sanctions pénales, soit pour réprimer certains manquements prévus par le code de la consommation, qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune sanction. La DGCCRF s'est vu confier le pouvoir de prononcer ces amendes administratives qui sont, dans leur très grande majorité, des amendes de 3 000 euros lorsque le manquement est commis par une personne physique et de 15 000 euros lorsqu'il est commis par une personne morale. Certaines prévoient des amendes de 15 000 euros pour les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales : c'est le cas par exemple des articles L. 242-13 sur le droit de rétractation.
Toutefois, force est aujourd'hui de constater que de nouvelles évolutions sont nécessaires pour garantir une protection effective et efficace des usagers et des consommateurs de ces démarches administratives en ligne.
La rapporteure juge indispensable, parallèlement au développement des contrôles réalisés par la DGCCRF, de renforcer l'arsenal existant en matière d'utilisation frauduleuse ou trompeuse de signes de l'autorité administrative afin de préserver la confiance des usagers dans la dématérialisation des procédures administratives en ligne et de mieux sanctionner les pratiques identifiées par la mission d'information.
Ainsi, les sections 7 « de l'usurpation de fonctions » et 8 « de l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique » du code pénal visent à réprimer l'utilisation frauduleuse de signes distinctifs des autorités publiques par des particuliers ou des entreprises. Ces agissements sont punis de peine allant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Des peines spécifiques pour les personnes morales sont, en outre, prévues visant à en permettre la dissolution, la fermeture définitive et la confiscation de leurs biens.
Parallèlement, l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement de peines pouvant aller jusqu'à 4 500 euros d'amende.
Cependant, si ces dispositions étaient adaptées à des utilisations détournées, physiques ou téléphoniquement, les consommateurs et usagers sont trop souvent confrontés à des pratiques démultipliées par les évolutions technologiques qui permettent non seulement la diffusion de tels contenus frauduleux à une large échelle dans l'espace public, mais surtout en facilitent l'accessibilité.
Il ressort des auditions que ce régime de sanctions devrait être encore renforcé, afin d'en augmenter le caractère dissuasif.
Dès lors, il convient d'instituer une circonstance aggravante dès lors que ces infractions seraient commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, et de poursuivre un raisonnement analogue s'agissant des pratiques commerciales trompeuses définies ci-avant.
Dès lors qu'elle serait effectuée en ligne, le montant de l'amende prononcée pourrait être porté de 50 à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique commerciale trompeuse, dès lors que celle-ci viserait des démarches administratives.
Recommandation : Moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération :
- en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ;
- en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne.
Toutefois, le foisonnement de mentions et d'allégations sur les démarches administratives en ligne profitent des carences de la loi et sont aujourd'hui pour leur grande majorité légales en ce qu'elles sont protégées par la liberté d'entreprendre, constitutionnellement garantie. Face à ce constat, la rapporteure considère indispensable d'envoyer un signal fort en la matière afin de limiter ces pratiques, qui profitent des silences et de l'inadaptation de loi.
C'est pourquoi la rapporteure est d'avis de compléter la liste des pratiques commerciales trompeuses pour tenir compte de ces évolutions en y intégrant les mentions valorisantes laissant croire que le traitement des dossiers par l'administration serait différent si l'usager rétribue un tiers marchand ou réalise sa demande par lui-même.
En effet, nombre de vendeurs et de sites indiquent des délais de traitement ou des taux de réussite qui sont ceux de droit commun (par exemple, « obtenir une carte grise en sept jours », alors que c'est le délai moyen de traitement par l'administration ; ou « délivrance d'un extrait d'acte de naissance : 100 % de réussite », alors que ce document est de droit) sur lesquels ils n'ont aucune marge de manoeuvre. Cette pratique aujourd'hui à la limite de la légalité doit donc être réprimée au même titre qu'une pratique commerciale trompeuse.
Recommandation : Tenir compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant leurs démarches par eux-mêmes.
Enfin, la mission d'information soutient l'ensemble des actions engagées par les administrations françaises pour renforcer la protection des consommateurs et des usagers des services publics en ligne, qui aujourd'hui sont moins protégés du fait de l'établissement de corpus normatifs européens conçus pour la protection de la vente physique seulement. Elle appelle à une meilleure prise en compte des enjeux de la vente en ligne au niveau européen afin de protéger les fondements de la confiance en la dématérialisation et l'accès en ligne aux services publics.
d) Une meilleure identification des sites officiels par les usagers : un enjeu central qui nécessite une clarification de la communication des opérateurs et des administrations publiques
Face aux risques de perte de confiance de l'action publique du fait des pratiques frauduleuses ou contestables en ligne, il convient de prendre, parallèlement au renforcement des mesures de sanction évoquées supra, des mesures visant à renforcer l'identification et l'appropriation par les usagers des outils et des sites officiels permettant d'accéder aux services publics et de réaliser des démarches en ligne.
En effet, force est de constater que l'enjeu de l'identification des sites officiels est crucial sur l'ensemble des plateformes de recherches en ligne. Malgré les récents efforts de signalétique et la richesse du site servicespublics.fr, la rapporteure n'a pu que constater que l'identification claire de ceux-ci reste perfectible.
Pour y remédier, une campagne nationale de communication doit être envisagée à intervalles réguliers et ponctuellement lors des primo-dématérialisations ou des campagnes de déclarations.
Recommandation : Clarifier la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurer une communication régulière sur ce sujet.
En complément, il est impératif de lancer une réflexion sur les moyens d'identification uniques et numériques des sites officiels, pour éviter l'entretien de la confusion avec les sites marchands et ce, en mobilisant tous les canaux, y compris les noms de domaines aujourd'hui trop peu uniformisés. À ce titre, la rapporteure a appris avec satisfaction, comme cela est mentionné plus haut, que le site service-public.fr serait prochainement assorti de l'adresse @gouv.fr
Recommandation : Unifier la présentation des sites officiels par l'établissement de signes distinctifs communs et infalsifiables afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants.
Enfin, le travail déjà initié par les services de l'État avec les plateformes de recherche pour assurer le déréférencement de certains sites et le référencement prioritaires des sites officiels doit être maintenu et amplifié afin de garantir le bon positionnement de ces derniers.
Recommandation : Poursuivre les efforts mis en oeuvre en vue du référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivre avec détermination le déréférencement des sites frauduleux.
e) Mesdroitssociaux.gouv.fr : un exemple de site officiel à améliorer dans une logique de lutte contre la concurrence de sites payants
Le site mesdroitssociaux.gouv.fr, « porté par le ministère en charge de la santé et les organismes de protection sociale », permet via FranceConnect d'accéder à un « simulateur officiel » qui agglomère en tout 58 aides sociales :
- l'ensemble des aides sociales nationales419(*) ;
- ainsi que les aides attribuées par les collectivités territoriales suivantes : communes de Paris420(*), Antony421(*), Rennes et Brest422(*) ; Côtes d'Armor423(*) ; Eure-et-Loir424(*).
Selon le site de cette plateforme, « fruit d'un travail collectif des différents acteurs de la protection sociale, de l'emploi et de l'État »425(*), ce portail s'adresse à tous, personnes « en activité, sans emploi ou à la retraite ».
Outre les simulateurs, ce site permet de réaliser des démarches en ligne et d'accéder à des informations présentées par « moments de vie », à l'instar du site service-public.fr, bien que la présentation en soit quelque peu différente : naissance, décès d'un proche, autonomie et grand âge, handicap, enfant en situation de handicap, garde d'enfant, recherche d'emploi, préparation de la retraite, séparation, déménagement, partir de chez ses parents, partir à l'étranger, revenir de l'étranger, vivre en France.
À titre d'exemple, la rubrique « partir de chez ses parents » comporte des conseils en matière d'aide au logement et propose des outils pour personnaliser son CV.
Il semble toutefois qu'avec 58 aides référencées, ce site officiel puisse se trouver en retrait par rapport aux prestations promises par certains sites payants,dits de « conciergerie administrative ». L'un d'eux annonce « plus de 2 200 aides nationales, régionales et locales »426(*). Même si l'étendue de cette offre est vraisemblablement théorique, elle peine à concurrencer les 58 offres affichées par mesdroitssociaux.gouv.fr.
Pour rappel, comme indiqué précédemment, l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement de peines pouvant aller jusqu'à 4 500 euros d'amende. La rapporteure considère à ce titre qu'un meilleur contrôle de cette interdiction ainsi qu'un élargissement de son champ à l'ensemble des sites proposant ce type de services au-delà des seules prestations sociales sont indispensables pour renforcer la protection des usagers.
Si la simulation est gratuite, l'intervention de ce « service d'accompagnement administratif » est payante sous la forme d'un abonnement facturé 19,90 euros par mois. Le site promet en outre l'intervention d'un « expert dédié, disponible tous les jours de la semaine [...] par mail ou téléphone » et qui « vous accompagne de A à Z » afin de « demander vos aides et réduire vos factures du quotidien (électricité, gaz, internet, téléphone, assurances, mensualités de crédit) ». La prestation concerne tant l'assistance aux démarches que le suivi des dossiers des clients.
Cette concurrence est d'autant plus regrettable que ce site fait payer l'usager pour accéder à des aides auxquelles il a droit.
On note qu'en complément de cette offre, le site propose des prestations de coaching en matière de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, faisant miroiter une prise en charge au titre des droits à formation.
La rapporteure estime en conclusion qu'il convient d'encourager le site mesdroitssociaux.gouv.fr à enrichir son simulateur en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses.
Recommandation : Encourager un partenariat entre les collectivités territoriales et le site mesdroitssociaux.fr afin d'enrichir son simulateur en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits.
IV. RECOMMANDATIONS
A. AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
1. Garantir à l'usager un accès aux services publics selon le canal de son choix, notamment téléphonique, en réaffirmant l'obligation, pour tous les services publics, d'appliquer le principe de l'omnicanalité ; faire de ce principe la priorité du prochain Comité interministériel de la transformation publique (CITP).
2. Valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents.
3. Étendre la reconnaissance du droit à l'erreur en encourageant, dans tous les services publics, une approche bienveillante du cas de certains usagers lorsque le droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation (erreur imputable à l'administration ou n'impliquant pas une sanction pécuniaire), permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance.
4. Mieux faire connaître le site service-public.fr ainsi que la diversité des informations et des services qu'il délivre au moyen d'une campagne d'information grand public, sur tous médias.
5. Préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne :
- en concevant à leur attention une fiche pratique et un guide sur l'entrée dans la vie active, et en le diffusant sur le site service-public.fr ainsi que dans les CROUS, les associations étudiantes et le réseau France services ;
- et en organisant des permanences de structures France services dans les établissements scolaires et universitaires et en développant des partenariats entre France services, les associations étudiantes et les CROUS.
6. Renforcer l'accompagnement des usagers confrontés au décès d'un proche :
- en assurant la cohérence entre les informations disponibles sur les différents sites publics à leur intention et en améliorant leur conception, en particulier le guide « Un proche est décédé » mis en ligne sur le site service-public.fr ;
- en mettant systématiquement ce guide à la disposition des proches du défunt, dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres ;
- et en mettant à l'étude la possibilité de résiliation immédiate des abonnements souscrits par une personne décédée, sur demande des héritiers du défunt transmise à l'établissement bancaire de celui-ci par le notaire, une négociation devant être conduite avec les banques pour obtenir que cette formalité s'opère sans frais, ou à tout le moins que ces frais soient minimes et encadrés.
7. Expérimenter la faculté d'opter en faveur de la transmission numérique de la propagande électorale pour les citoyens inscrits au registre des Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer.
B. RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LES TERRITOIRES EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU RÉSEAU FRANCE SERVICES
8. Développer le réseau France services :
- en poursuivant le déploiement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi que des formules itinérantes ;
- en encourageant les permanences de France services en mairie ;
- en privilégiant l'implantation des nouveaux espaces dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales ;
- et en mettant en place, à titre expérimental, une structure France Services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger.
9. Stabiliser et consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services, sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés.
10. Consolider l'articulation de l'action des France services et des opérateurs nationaux partenaires du réseau :
- en garantissant aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département, afin de faciliter et de sécuriser leurs interventions auprès des usagers ;
- et en développant des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France services, en adéquation avec les besoins du territoire et selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.
11. Assurer une meilleure prise en compte des évolutions du métier de conseiller France services en structurant la formation, les fiches de poste et le parcours professionnel des agents et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.
C. PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS CONTRE LES SITES FRAUDULEUX PROPOSANT D'EFFECTUER DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES CONTRE RÉMUNÉRATION
12. Moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération :
- en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ;
- en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne ;
- et en tenant compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant leurs démarches par eux-mêmes.
13. Unifier la présentation des sites officiels par l'établissement de signes distinctifs communs et infalsifiables afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants.
14. Poursuivre les efforts mis en oeuvre en vue du référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivre avec détermination le déréférencement des sites frauduleux ; clarifier la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurer une communication régulière sur ce sujet.
15. Encourager un partenariat entre les collectivités territoriales et le site mesdroitssociaux.fr afin d'enrichir le simulateur de celui-ci en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits.
D. METTRE À PROFIT LES RÉCENTS PROGRÈS TECHNOLOGIQUES POUR PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES USAGERS ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION NUMÉRIQUE
16. Clarifier les missions et le positionnement des conseillers numériques, notamment vis-à-vis des conseillers France Services, et mettre en cohérence le financement et la mise en oeuvre de l'inclusion numérique en désignant un chef de file de cette politique publique.
17. Étudier l'élargissement du périmètre d'Aidants Connect, afin de toucher les publics éloignés du numérique par la dépendance et/ou la maladie.
18. Faire de l'intelligence artificielle un levier de l'amélioration du parcours des usagers :
- en formulant une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service des usagers, dans une logique de transparence des décisions individuelles automatisées, et la diffuser à tous les niveaux de l'administration ;
- et en engageant au niveau gouvernemental une discussion avec les grands opérateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin d'obtenir une identification claire des sources officielles utilisées dans les réponses aux questions des usagers, lorsque leurs recherches portent sur les institutions et les services publics.
19. Former, dans la fonction publique, des profils susceptibles de maîtriser à la fois les aspects politiques et juridiques ainsi que la dimension technique, tant des algorithmes que de l'intelligence artificielle, afin que l'administration soit en mesure de contrôler l'utilisation de ces outils.
20. Diffuser plus largement la connaissance du service « Démarches Simplifiées » auprès des collectivités territoriales, en vue de l'amélioration des services publics dont elles ont la responsabilité.
COMPTES RENDUS DE LA MISSION D'INFORMATION
Réunion constitutive (mardi 8 avril 2025)
M. Jean-Luc Brault, président. - J'ai l'honneur de procéder à l'ouverture de la réunion constitutive de cette mission d'information.
Cette mission d'information a été créée à la demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), dans le cadre du droit de tirage prévu à l'article 6 bis du règlement du Sénat.
Les dix-neuf membres de notre mission ont été nommés lors de la séance publique du 26 mars dernier.
Je suis reconnaissant à nos collègues du groupe RDPI d'avoir choisi ce sujet, particulièrement intéressant pour les élus des territoires que nous sommes. C'est notre responsabilité d'aider à faire en sorte que les personnes les plus éloignées des services publics, notamment pour des raisons géographiques, puissent y avoir accès dans des conditions convenables. L'accès aux services publics est à double sens : multiplier les points de contact, c'est aussi rapprocher les services publics des administrés, car l'enjeu est principalement lié à la mobilité, surtout dans les territoires ruraux. Ainsi, dans la partie nord de mon département du Loir-et-Cher, du côté de Vendôme, un bus itinérant permet d'aller vers ceux qui ont du mal à faire les démarches nécessaires au quotidien. Dans la partie sud, du côté du Controis-en-Sologne, le choix a été fait d'une ouverture des sièges à mi-temps pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CCRS), et parfois des visites à domicile sont même programmées.
Je suis certain que le rapport de notre mission d'information formulera des recommandations concrètes pour faciliter la vie de nos concitoyens.
Nous devons au cours de cette réunion procéder à la désignation du Bureau de notre mission d'information, en commençant par celle du président.
Je vous rappelle que, en application du deuxième alinéa de l'article 6 bis du Règlement du Sénat, « la fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d'un groupe minoritaire ou d'opposition, le groupe à l'origine de la demande de création obtenant de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres ».
J'ai reçu la candidature de M. Gilbert-Luc Devinaz, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
La mission d'information procède à la désignation de son président, M. Gilbert-Luc Devinaz.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Je salue moi aussi le sujet choisi par le groupe RDPI pour cette mission d'information.
Ce sujet m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai pu mesurer très concrètement, en tant qu'élu du département du Rhône, les difficultés concrètes que peuvent rencontrer les usagers du fait de la répartition parfois incompréhensible des compétences entre la Métropole de Lyon et les communes de la métropole, la Métropole de Lyon exerçant à la fois les compétences du département et de l'intercommunalité. Ainsi par exemple, quand un chantier pose problème, on vient voir le maire alors que c'est la métropole qui est le maître d'ouvrage. En effet, l'on ne connaît pas les conseillers métropolitains.
Nous avons tous en mémoire les remarques exprimées lors du grand débat qui s'est tenu à la suite de la crise des gilets jaunes : si 52 % des participants estimaient avoir accès aux services publics dont ils avaient besoin, 49 % déclaraient avoir renoncé à des droits à cause de la complexité des démarches permettant de les faire valoir. La moitié de nos concitoyens est donc en risque de non-recours.
Je ne reviendrai pas sur les évolutions qui ont conduit à cette situation : nous savons tous que les fermetures d'écoles, de bureaux de poste, d'hôpitaux et de centres de recettes des impôts, surtout quand elles s'accompagnent de la disparition des commerces de proximité, suscitent chez nombre de nos concitoyens un sentiment d'éloignement, aggravé par la dématérialisation des services publics, perçue par les uns comme un progrès tandis que d'autres la vivent comme une exclusion.
La proximité et l'efficacité des services publics sont évidemment un enjeu d'égalité entre les territoires et entre les citoyens. Mais il s'agit aussi, nous ne le savons que trop, d'un enjeu démocratique puisque ce sentiment d'éloignement encourage l'abstention, comme l'a souligné un récent sondage sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote : pour 72 % des sondés, l'état des services publics occupe une place importante dans leurs choix électoraux.
Toutes ces raisons justifient que notre assemblée se saisisse de ces problèmes. Nous avons quelques mois pour réfléchir ensemble à ces questions décisives pour nombre de nos concitoyens.
Mais avant toute chose nous allons procéder à la désignation des onze autres membres du Bureau de la mission d'information, à commencer par celle du rapporteur.
Le règlement du Sénat prévoit que le groupe à l'origine de la demande de création d'une mission d'information obtient de droit, s'il le demande, que le rapporteur soit désigné parmi ses membres.
J'ai reçu la candidature de Mme Nadège Havet, du groupe RDPI.
La mission d'information procède à la désignation de sa rapporteure, Mme Nadège Havet.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Nous poursuivons la constitution de notre Bureau.
Compte tenu de la désignation du président et du rapporteur, la répartition des postes de vice-présidents et de secrétaires est la suivante : pour le groupe Les Républicains, deux vice-présidents et un secrétaire ; pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, un vice-président ; pour le groupe Union centriste, un vice-président et un secrétaire ; pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, un vice-président ; pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, un vice-président ; pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires, un vice-président ; pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, un vice-président.
Pour les fonctions de vice-président, j'ai reçu les candidatures suivantes : pour le groupe Les Républicains, Mme Marie-Pierre Richer et M. Hugues Saury ; pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, M. Adel Ziane ; pour le groupe Union centriste, Mme Olivia Richard ; pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires, M. Jean-Luc Brault ; pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, M. Ronan Dantec ; pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, M. Éric Gold ; pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, Mme Marianne Margaté.
Pour les fonctions de secrétaire, j'ai reçu les candidatures suivantes : pour le groupe Les Républicains, Mme Catherine Di Folco ; pour le groupe Union Centriste, Mme Marie-Lise Housseau.
La mission d'information procède à la désignation des autres membres de son Bureau : Mme Marie-Pierre Richer, M. Hugues Saury, M. Adel Ziane, Mme Olivia Richard, M. Jean-Luc Brault, M. Ronan Dantec, M. Éric Gold et Mme Marianne Margaté, vice-présidents ; Mme Catherine Di Folco et Mme Marie-Lise Housseau, secrétaires.
Je donne la parole à notre rapporteure pour vous présenter les axes de réflexion qu'elle a identifiés, puis nous pourrons avoir un échange de vues et évoquer l'organisation de notre calendrier.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Le sujet que j'ai l'honneur de présenter dans le cadre du droit de tirage de mon groupe me tient particulièrement à coeur pour diverses raisons.
Tout d'abord, comme l'a très justement exprimé notre président, l'accès aux services publics est décisif pour notre pacte républicain ; veiller à l'effectivité de cet accès est un enjeu d'égalité et de cohésion nationale. Or d'après le sondage cité par le président, 74 % des personnes interrogées déclarent avoir eu « au moins une mauvaise expérience des services publics », alors que 43% des répondants déclarent subir de telles difficultés « de temps en temps ».
Selon le baromètre Paul Delouvrier qui, depuis vingt ans, mesure chaque année l'opinion des Français à l'égard des services publics, on observe que le taux d'opinions favorables reste toujours en dessous de 50 %, même si le taux de satisfaction moyen des usagers tend à progresser depuis deux ans. Nos concitoyens, dans la moitié des cas, attendent que les services publics fassent des progrès en matière d'accessibilité, de clarté des informations et de rapidité de réponse.
Ensuite, la dématérialisation des services publics, gage de leur modernisation, est de nature à décourager certains usagers, comme l'a rappelé le président. L'objectif est donc de concilier la poursuite de la modernisation des services publics, qui va de pair avec leur digitalisation, et la nécessaire attention portée à l'usager éloigné des nouvelles technologies.
Par ailleurs, je suis sensible à la situation difficile de certains agents qui, au contact des usagers, peuvent éprouver un sentiment de lassitude et de perte de sens qui, me semble-t-il, fait partie de notre sujet.
Enfin, l'efficacité et la proximité des services publics est un sujet majeur pour les collectivités territoriales, et donc pour le Sénat. En effet, de par leurs compétences, tous les échelons locaux sont pourvoyeurs de services publics déterminants pour la vie de nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'école, des titres d'identité, de la prise en charge du handicap ou de l'aide sociale. De plus, les communes, les départements et les régions peuvent être forces de proposition pour améliorer l'accessibilité des services publics dans les territoires : il est donc indispensable de leur donner la parole pour identifier les bonnes pratiques susceptibles d'émerger grâce aux initiatives des élus.
Je pense notamment aux formules itinérantes portées par certaines collectivités que notre collègue Jean-Luc Brault a mentionnées, comme les bus France services développés à l'initiative de certains départements et intercommunalités, dans une logique d'« aller-vers » qui est désormais bien identifiée comme un facteur de progrès et d'égalité dans certains territoires. Je suis sûre que notre rapport permettra de mettre en valeur d'autres exemples également stimulants.
Le sujet de la proximité des services publics n'est pas nouveau au Sénat. Notre assemblée y a déjà travaillé au cours des dernières années, qu'il s'agisse entre autres exemples de la mission d'information de 2020 sur l'illectronisme et l'inclusion numérique, du rapport de la commission des finances sur le réseau France services en 2022 ou, plus récemment, du rapport de la délégation aux collectivités territoriales sur l'intelligence artificielle (IA), qui aborde la conduite des politiques publiques locales et évoque le risque de déshumanisation des services publics locaux.
Nos réflexions pourront aussi se nourrir de rapports publics relativement récents : je pense notamment au rapport de la défenseure des droits sur la dématérialisation des services publics, publié en 2022, au rapport annuel du Conseil d'État consacré en 2023 à L'usager, du premier au dernier kilomètre, ou aux analyses du programme France services dues en 2023 à trois parlementaires en mission, dont notre collègue Bernard Delcros, puis en 2024 à la Cour des comptes.
Je suggère donc, afin de mieux cibler un sujet qui a déjà donné lieu à diverses analyses, que nous abordions la question de l'accès aux services publics à partir d'exemples concrets et précis.
Ainsi, parallèlement à un programme classique d'auditions faisant intervenir des acteurs institutionnels et associatifs, des universitaires, des élus ou des syndicats, notre réflexion se nourrira de déplacements sur le terrain, afin de prendre connaissance de bonnes pratiques susceptibles d'inspirer des recommandations. Je fais appel à vos suggestions, chers collègues, car vous connaissez certainement dans vos territoires des exemples d'initiatives intéressantes à partager.
Je souhaite aussi que nous donnions la parole aux élus locaux en procédant à une consultation en ligne sur la plateforme dédiée du Sénat afin de recueillir des témoignages susceptibles d'inspirer nos recommandations. Cette consultation devrait pouvoir être mise en ligne très prochainement.
Nous organiserons également, vraisemblablement au mois de juin, une séquence avec nos collègues de la délégation aux outre-mer, territoires particulièrement concernés par notre sujet.
Enfin, nous essaierons d'intégrer à nos travaux des analyses de cas étrangers, même si les enseignements issus des analyses de droit comparé ne sont pas nécessairement transposables au cas français.
Je précise par ailleurs que je ne souhaite pas inclure dans nos travaux la problématique de l'accès des étrangers aux services publics, qui constitue un sujet en soi, abordé du reste par la défenseure des droits. Compte tenu du temps qui nous est imparti, j'ai pris le parti de centrer notre propos sur une approche plus territoriale du sujet.
J'en viens donc aux axes de travail que je vous propose pour les mois qui viennent.
Premier axe : la nécessité d'améliorer l'accès aux services publics, pour tous les usagers et dans tous les territoires, a fait l'objet d'une prise de conscience des pouvoirs publics qui s'est traduite par de réelles avancées au cours des dernières années - le réseau France services en constitue un exemple. Nous devrons au cours de cette mission, à partir de cas concrets, tirer le bilan de cette politique publique.
Second axe : parallèlement aux progrès accomplis par cette politique publique, nous devrons, à partir de cas concrets et d'exemples de bonnes pratiques issues d'initiatives des territoires, identifier les marges de progression à franchir pour des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages de cohésion sociale.
Deux angles me paraissent pertinents pour guider notre approche des services publics dans une approche concrète : d'une part, les démarches qui accompagnent l'entrée d'un jeune dans l'autonomie, comme la première carte vitale, le premier salaire ou le premier logement, d'autre part, à l'autre bout du spectre administratif, celles qui accompagnent un décès et qui sont source de nombreux tracas pour les proches. Il nous faudra toutefois définir une méthode pour aborder ces deux aspects de notre sujet, si nous confirmons ce choix.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - En ce qui concerne l'organisation de nos travaux, nous procèderons à des auditions et tables rondes en réunions plénières ou au format rapporteur. Les auditions rapporteur seront naturellement ouvertes à l'ensemble de la mission. Elles figureront au calendrier prévisionnel qui vous sera adressé régulièrement.
Nos réunions, quel qu'en soit le format, auront généralement lieu le mardi après-midi et le mercredi avant la séance des questions au Gouvernement. Des réunions au format rapporteur pourront également se tenir à d'autres moments de la semaine. Le jeudi sera en principe réservé aux déplacements.
Mme Olivia Richard. - Ces axes de travail me paraissent pertinents. En tant que sénatrice des Français de l'étranger, j'attire votre attention sur l'existence de services publics particulièrement innovants dont bénéficient nos compatriotes à l'étranger, notamment en matière de dématérialisation. Il serait utile de recevoir en audition la directrice des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, Mme Pauline Carmona, sur ce sujet. Ainsi, l'expérimentation de la demande de renouvellement de passeport sous forme dématérialisée devrait être étendue à trois pays dans le monde. Les Français de l'étranger servent souvent d'incubateurs sur bien des aspects.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - J'ai pu le constater dans le cadre de la mission d'information sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique. Les écoles françaises à l'étranger étaient des exemples en matière d'innovation. Nous suivrons donc la piste que vous proposez et je vous remercie de l'avoir suggérée.
M. Éric Gold. - Il y a quelques années, nous avions fait une mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme et l'inclusion numérique. Depuis, des évolutions sont intervenues, mais certains blocages demeurent, notamment dans les zones périphériques. Nous pourrions reprendre le sujet.
M. Ronan Dantec. - L'accès à la fibre, ou plus simplement à internet, dans les territoires est une question qu'il faudra envisager.
M. Hugues Saury. - Il faudrait voir si certains pays sont plus avancés que nous en matière de dossier unique et dématérialisé pour l'accès à tous les services publics.
M. Adel Ziane. - En Seine-Saint-Denis, les sujets sont nombreux, qu'il s'agisse des déserts médicaux, des fermetures d'école, de l'accès à internet, etc. Je pourrai vous faire parvenir des propositions.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - On parle souvent du manque de services de proximité dans les zones rurales, mais c'est en effet une réalité qui existe aussi dans un certain nombre de quartiers.
Mme Marie-Pierre Richer. - Le département du Cher a mis en place un bus médical pour faciliter l'accès aux soins. Il y a d'abord eu une collaboration avec les sapeurs-pompiers, puis le département a acquis un véhicule en 2024. Un médecin et une sage-femme exercent dans le cadre de ce dispositif.
Mme Nadège Havet. - Sont-ils salariés ?
Mme Marie-Pierre Richer. - Le médecin est salarié du département.
Mme Béatrice Gosselin. - Les personnes âgées sont souvent éloignées du numérique et dans bien des cas se retrouvent désemparées, que ce soit dans le monde urbain ou dans le monde rural. Il faut penser à elles.
Mme Patricia Demas. - Nous pourrions aussi revenir sur l'expérimentation qui a été menée dans les caisses d'allocations familiales de cinq départements, dont celui des Alpes-Maritimes, pour modéliser la dématérialisation des questionnaires préremplis de déclaration de ressources, afin de redéployer les agents sur la logique d'« aller-vers ».
Mme Nadège Havet, rapporteure. - À titre personnel, je connais un volontaire du service civique qui recevait les personnes qui le souhaitaient dans une maison France services, ainsi qu'à l'école de musique, ou bien il se rendait chez elles pour rendre certains services, comme par exemple remettre une box en marche - un problème indépendant de l'âge... Ce lien et ce service ont été très appréciés.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Nous nous retrouverons le 29 avril prochain pour commencer nos auditions.
Mme Marie-Pierre Richer. - Quand le rapport devra-t-il être rendu ?
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Compte tenu de la date à laquelle nous commençons nos travaux, je propose de programmer l'examen du rapport à la mi-septembre.
Bilan des travaux de la mission - Échange de vues (mercredi 11 juin 2025)
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Mes chers collègues, la rapporteure et à moi-même avons souhaité vous proposer un échange de vues pour faire le point ensemble sur l'avancement de nos travaux de notre mission d'information et sur les quelques pistes qui apparaissent d'ores et déjà dans la perspective du rapport, dont je rappelle qu'il vous sera soumis pour examen en septembre.
Depuis la fin du mois d'avril, nous avons rencontré des intervenants très divers, tant en réunion plénière que dans le cadre d'auditions de la rapporteure.
Nous avons fait le point sur le programme France services avec le directeur général de l'ANCT. D'autres hauts fonctionnaires ont été entendus : la directrice des Français à l'étranger ainsi que les directeurs interministériels de la transformation publique et du numérique, acteurs majeurs de notre sujet. Ce volet institutionnel sera complété, le 17 juin, par l'audition du directeur général des outre-mer. La défenseure des droits a, pour sa part, confirmé de manière particulièrement éclairante l'importance de l'accès aux services publics dans l'accès aux droits. L'audition de Jean-Denis Combrexelle, ancien directeur général du travail, auteur de Les normes à l'assaut de la démocratie, a été particulièrement riche d'enseignements sur des sujets divers, tels que les causes de la complexité normative, la nécessaire formation des hauts fonctionnaires à la culture du résultat, ou encore les perspectives ouvertes par l'IA.
Les auditions d'universitaires nous ont permis d'appréhender notre sujet avec le regard du sociologue, mais aussi d'interroger la place de l'accès aux services publics dans les cahiers de doléance de 2018-2019.
Les auditions de l'UFC-Que choisir, de l'Institut national de la consommation et de la DGCCRF ont souligné l'importance pour notre sujet de la protection des usagers lors de leurs démarches en ligne.
Les organisations syndicales de la fonction publique, reçus hier, ont rappelé les conséquences, pour les agents, des mutations liées à la dématérialisation des démarches.
Nous avons ainsi procédé à ce jour à 7 auditions en réunions plénières et à 10 auditions de la rapporteure, avec en tout 33 personnes entendues (12 en plénière et 21 lors d'auditions de la rapporteure).
Notre cycle d'auditions comprendra en outre, jusqu'à la fin de ce mois : des opérateurs tels que la CNAV, la CNAM et la CNAF, dont l'audition complètera celle de France travail, dont les représentants ont été reçus hier par la rapporteure ; les responsables du site service-public.fr ; et trois auditions ministérielles : Mmes Juliette Méadel et Françoise Gatel, ministres déléguées auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargées respectivement de la ville et de la ruralité, ainsi que M. Laurent Marcangeli, Ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Sur le plan de la méthode, nous veillons à susciter des synergies au sein du Sénat, au-delà de notre mission d'information : dans cet esprit, nous avons ouvert l'audition de la directrice des Français à l'étranger à nos collègues du groupe d'études compétent, de même que nous inviterons nos collègues de la délégation sénatoriale aux outre-mer à l'audition du directeur général des outre-mer.
Par ailleurs, lors de nos déplacements dans les territoires (dans le Rhône, dans le Loir-et-Cher puis dans le Finistère) nous rencontrerons des acteurs de terrain, notamment des conseillers France service, ainsi que des élus de ces territoires, dont nous connaissons l'engagement. Je précise que les associations d'élus ont été associées à notre programme d'auditions : nous avons entendu France urbaine ; l'audition de Départements de France est prévue le 17 juin.
À cet égard, comme vous le savez nous avons procédé sur le site du Sénat à une consultation des élus locaux qui nous a permis de recueillir quelque 1 200 témoignages particulièrement riches, principalement d'élus de la France rurale mais également de la Métropole de Lyon. La rapporteure nous en dira quelques mots dans un instant.
Je souligne à ce propos l'importance de la dimension territoriale dans laquelle nous avons, dès le début de nos travaux, souhaité inscrire notre réflexion.
Enfin, je rappelle que notre rapport devrait être rendu public en septembre prochain. La date de cette réunion vous sera communiquée dès que possible. Puis la convocation vous sera adressée, selon l'usage, la semaine précédente.
Quelques jours avant la réunion, un exemplaire du rapport sera mis à la disposition des membres de la mission qui le souhaiteront.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Dans son baromètre des services publics pour l'année 2024, qui a ouvert notre cycle d'auditions, l'Institut Paul Delouvrier révèle un paradoxe : si l'opinion générale des Français à l'égard des services publics stagne à 45 %, la satisfaction des usagers atteint 77 %, ce qui semble plutôt rassurant.
Selon le baromètre des services publics établi pour le Gouvernement en 2025, la simplicité des démarches reste pour les usagers le principal point d'amélioration. Or seulement 63% des usagers estiment qu'il est simple de réaliser ses démarches administratives. Les mairies, la gendarmerie nationale, les impôts et l'hôpital remportent les meilleurs scores ; en revanche la palme de la complexité revient à « Ma prime rénov », aux tribunaux et aux MDPH.
Le sondage réalisé par le collectif Le sens du service public sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote, dont les résultats ont été publiés en janvier 2025, confirme l'attachement de nos concitoyens aux services publics. Il souligne également notre rapport particulier au maillage territorial : l'éloignement géographique est perçu par les répondants comme le premier critère de discrimination. Le niveau d'insatisfaction varie selon que l'on vit dans un territoire en déclin, en stagnation ou en expansion.
La dimension territoriale de notre réflexion est en effet essentielle : j'en viens à la consultation mise en ligne sur le site du Sénat, évoquée par le président. Dès le début de nos travaux, nous avons souhaité connaître le ressenti élus locaux des sur la situation des services publics dans leur territoire et identifier les bonnes pratiques mises en oeuvre par certaines collectivités pour améliorer l'accès des usagers aux services publics, tant nationaux que locaux.
Entre le 14 avril et le 12 mai, quelque 1 157 participants se sont adressés à nous. Dans leur grande majorité, ces interlocuteurs sont élus de l'échelon municipal, principalement de petites communes.
Première remarque : ces témoignages attestent une conception des services publics très large, qui comprend, parallèlement aux services publics classiques, les distributeurs de billets, La Poste ainsi que les transports publics et privés, sans oublier l'accès aux soins, qu'il s'agisse de médecine libérale ou de l'hôpital.
Ce constat rejoint ce que nous apprennent les sondages et enquêtes d'opinion sur l'attitude des Français et des usagers à l'égard des services publics, qui nous ont été présentés au cours des premières auditions.
Deuxième remarque : les réponses à la question « l'accès aux services publics s'est-il plutôt amélioré ou dégradé au cours des dernières années ? » mettent régulièrement en balance les évolutions négatives et les améliorations observées au cours de la période récente.
Quand l'approche est positive, les élus mentionnent l'apport des France services et la dématérialisation des démarches qui, lorsque les usagers sont correctement équipés et formés au numérique, est source de simplification.
Quand les élus penchent pour une dégradation de l'accès aux services publics, celle-ci est imputée à deux causes majeures : d'une part, au désengagement de l'État et à l'« érosion régulière des services publics de proximité » ; d'autre part, à la dématérialisation, source de difficultés pour certains usagers et pour les dossiers complexes.
De manière très éclairante, un élu a assimilé la dématérialisation, cause de perte de contact humain, à un risque de « précarité relationnelle ».
Lors de son audition, la défenseure des droits a d'ailleurs attiré notre attention sur le fait que lorsque la dématérialisation devient la voie exclusive de l'accès aux droits ou lorsqu'elle est mal pensée, elle peut compromettre l'accès aux droits et éloigner des services publics les personnes qui ne sont pas en capacité d'effectuer des démarches en ligne.
Troisième remarque : le fonctionnement des France services est jugé de manière globalement favorable. Ces structures « remettent de l'humain » dans le contact avec les administrations face aux plateformes téléphoniques ou à internet. La qualité et l'implication des agents sont régulièrement mentionnées. De nombreux répondants appellent ainsi au déploiement des France services dans les communes non dotées et au développement de solutions itinérantes.
Même si certains élus relativisent le succès des France services en rappelant que ces structures ne sont que la conséquence du désengagement de l'État dans les territoires et qu'elles pèsent sur les finances des collectivités territoriales, j'ai souhaité que nous fassions rapidement un bilan de ce programme, ramification territoriale essentielle de l'accès aux services publics nationaux et locaux.
L'audition du directeur général de l'ANCT, en charge de ce programme, me semble avoir confirmé que les maisons France services sont un formidable outil, tant pour les usagers que pour les opérateurs ou administrations, les élus locaux et même les agents publics qui y travaillent (selon l'ANCT, seule une structure sur les 2 700 pourrait selon l'ANCT perdre sa labellisation).
Dès lors, nos travaux pourraient illustrer les réussites de ce nouvel outil tout en traçant des pistes pour que le modèle ne s'essouffle pas et continue de progresser.
Quatrième remarque : de nombreuses réponses, rejoignant les observations formulées par certains d'entre nous lors des auditions, soulignent l'importance des mairies comme « premier service public de France » ou « premier service public de proximité ».
« Les mairies sont depuis longtemps un France services avant l'heure ! », selon l'un des répondants. Ces témoignages traduisent un engagement réel des élus pour mieux répondre aux besoins des usagers des services publics locaux. Les initiatives sont nombreuses en matière d'organisation des services municipaux : horaires d'ouverture de la mairie plus larges, aménagement de permanences délocalisées, prise de rendez-vous en ligne, mise en place de solutions France services itinérantes, création de numéros verts, recrutement de nouveau agents....
Certains répondants déplorent toutefois les exigences disproportionnées de certains citoyens, qui « attendent beaucoup des services municipaux » : ce constat rejoint une remarque de Jean-Denis Combrexelle, auteur de Les Normes à l'assaut de la démocratie, lors de son audition : « Désormais, le citoyen contribuable est consommateur des biens publics et se comporte vis-à-vis des autorités publiques, vis-à-vis du maire, comme face au directeur du supermarché qui ne vend pas sa marque de yaourt préférée ».
Cinquième remarque : des élus appellent à simplifier l'action des collectivités pour faciliter l'accès des usagers aux services publics locaux. Ils critiquent le « millefeuille administratif » et regrettent la disparition des compétences des petites communes au profit des EPCI. Certains d'entre eux appellent à une meilleure coordination des services publics nationaux et locaux, qui « fonctionnent en silo », aux dépens de l'usager.
J'en viens à l'accès proprement dit aux administrations. Voici quelques chiffres clé significatifs pour illustrer cette problématique centrale de notre futur rapport : 2 milliards de visites chaque année sur les sites administratifs, et 572 millions de démarches en ligne, ce qui correspond à 82 % des démarches.
Les démarches en ligne occupent donc une place importante dans la vie quotidienne des Français.
Deux administrations jouent un rôle majeur dans l'accès aux services publics et leur amélioration : la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la direction interministérielle du numérique (DINUM), chargée d'élaborer la stratégie numérique de l'État et de piloter sa mise en oeuvre. Nous avons auditionné leurs responsables.
L'objectif global de la politique publique que mettent en oeuvre ces directions est de parvenir à des services publics plus efficaces et plus simples, en se fondant sur des indicateurs tels que le taux de respect du délai annoncé par l'administration, la qualité des démarches en ligne, le taux de décroché téléphonique et la qualité de l'accueil téléphonique.
En effet, parallèlement aux démarches en ligne, 43% des contacts s'effectuent encore par téléphone et 10% par courrier. Le rôle décisif de ce canal de communication pour nombre d'usagers doit être souligné. Dans ce contexte, le responsable de la DITP a souligné l'importance du Plan téléphone, qui vise à améliorer l'accueil téléphonique.
De plus, la DITP privilégie une approche consistant à se mettre à la place de l'usager pour récapituler les étapes jalonnant les parcours administratifs de ces « moments de vie » (« je deviens étudiant », « je pars vivre à l'étranger », « j'établis mon identité », « je rénove mon logement », « je deviens parent », etc.)
J'en viens à une séquence importante de nos auditions : l'information et la protection de l'usager, qui s'est invitée dans notre réflexion lors des auditions d'UFC-Que choisir, de l'Institut national de la consommation et de la DGCCRF. Ces organismes s'intéressent plutôt aux enjeux liés à la consommation. Pourtant, l'Institut national de la consommation a participé, pour la défenseure des droits, à une enquête sur le taux de décroché d'acteurs tels que la CPAM, la CAF, la CARSAT et Pôle emploi. Ces auditions ont mis en évidence l'importance, pour les usagers, du maintien d'une alternative au moins téléphonique aux démarches en ligne et, surtout, l'impératif d'une véritable stratégie contre la prolifération des sites faisant payer l'accès à un service public.
L'audition de la DGCCRF, la semaine dernière, a permis de mettre en lumière un aspect souvent oublié, voire négligé, de l'accès aux services publics : l'importance de la protection des administrés qui se retrouvent, du fait de la dématérialisation, sur des sites internet marchands et payants plutôt que sur les sites officiels pour réaliser leurs démarches.
Ce phénomène recouvre une pluralité de risques pour les usagers : payer à un tiers une prestation pourtant délivrée gratuitement par les administrations - à titre d'exemple, la délivrance de la carte grise - , payer un service qui n'offre aucune réelle plus-value dans l'accomplissement d'une démarche administrative - par exemple, la prise de rendez-vous en mairie ou en consulat -, ou enfin, se retrouver sans le vouloir ou l'avoir compris sur un site imitant les sites officiels et être victime d'une arnaque.
Face à cette myriade de pratiques commerciales a minima déloyales, voire illégales et trompeuses, je souhaite que nous puissions, dans notre rapport, trouver un juste équilibre entre le contrôle et la répression de ces comportements qui induisent en erreur nos concitoyens.
Nous devrons formuler des recommandations qui permettent aux administrations et aux sites officiels de mieux communiquer afin d'enrayer cette marchandisation indue de l'accès aux services publics.
J'aborde pour finir l'exemple de la direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE), dont la responsable a été entendue sur la suggestion de notre collègue Olivia Richard. Cette audition a mis en évidence le rôle pionnier de la DFAE dans la dématérialisation des services offerts à nos concitoyens expatriés, avec quatre programmes innovants en cours de déploiement : la plateforme téléphonique France Consulaire destinée à décharger les postes consulaires de la réponse à certaines demandes, et trois projets de dématérialisation : le registre d'état-civil électronique, le vote par internet et l'expérimentation du renouvellement des passeports sans comparution.
Ces quatre expérimentations sont des exemples de modernisation réussie de l'administration et incitent à l'optimisme : les premiers résultats font état d'un taux de satisfaction très élevé des usagers et d'une économie substantielle pour l'administration, à la fois en termes de finances et de ressources humaines, permettant une meilleure allocation des moyens publics.
Il n'est pas certain cependant que l'extension et la généralisation de ces programmes puissent être envisagées. En effet, la population des Français de l'étranger présente certaines spécificités. Elle est d'abord très dispersée géographiquement, ce qui rend l'incitation à la dématérialisation plus forte. Elle présente ensuite un profil sociologique caractérisé par une forte représentation des classes moyennes et supérieures, moins touchées par l'illectronisme et probablement plus favorables à la dématérialisation. Elle a ensuite des effectifs relativement limités, avec 1,75 millions de Français inscrits au registre en 2025, ce qui facilite la mise en place de programmes innovants - l'architecture informatique nécessaire est moins lourde.
Toutefois, ces expérimentations sont riches d'enseignements au point de vue de la méthode comme des résultats, et méritent de figurer dans notre rapport pour illustrer les opportunités du numérique dans certaines configurations.
Toujours dans une perspective internationale, j'ai sollicité plusieurs de nos postes à l'étranger afin de recueillir des éléments de comparaison susceptibles d'éclairer nos travaux. Nous avons d'ores et déjà reçu des éléments intéressants en provenance du Royaume-Uni, où l'objectif est de mutualiser les ressources numériques des administrations et de créer des standards communs aux administrations. Le choix du Royaume-Uni de mettre l'accent sur la formation des populations au numérique, plutôt que sur le maintien systématique d'un accueil physique, doit également être mentionné.
Mme Catherine Conconne. - Je propose l'audition de France Titres, ex-ANTS (agence nationale des titres sécurisés). J'ai eu l'occasion de demander le renouvellement d'une carte grise à l'occasion de la revente d'une voiture. Trois mois après avoir transmis les documents nécessaires, je n'avais toujours pas de réponse. Je vous invite à faire l'expérience du 3400 : j'ai obtenu un interlocuteur après trois semaines, en appelant dix fois par jour ! Le jour où, finalement, il m'a été indiqué qu'un opérateur allait répondre, après 45 minutes d'attente celui-ci m'a expliqué qu'il manquait un document - sans me dire lequel. On vous renvoie au site internet où un chat, sans doute conçu par l'intelligence artificielle, vous délivre des banalités sans rapport avec la demande.
J'ai interrogé les entreprises qui aident à l'obtention des cartes grises, qui m'ont fait part de leur désarroi : les délais d'attente atteignent huit mois, sans interlocuteur, sans explication. Je me suis également adressée à une concession multimarques. Même constat : des mois d'attente sans explication.
France Titres semble avoir reconnu les problèmes. Tout est dématérialisé, ce qui incite les gens à se tourner vers les entreprises proposant une aide payante à l'obtention de ces papiers. Or ces dernières, comme le document n'arrive pas, se voient accuser par le client de ne pas avoir fait leur travail... Le système est grippé, et cette dématérialisation, qui se traduit par une possibilité infinitésimale d'avoir un interlocuteur au téléphone, a des conséquences pour les personnes âgées, frappées d'illectronisme ou qui, comme moi, ne sont pas très à l'aise avec ces démarches.
Je propose également d'organiser une table ronde sur la dite outre-mer. J'entends que 77% des usagers sont satisfaits des services publics ; en outre-mer, la proportion est probablement inversée... J'ai été élue locale et je continue à tenir des audiences dans ma permanence. Le motif principal des personnes qui me sollicitent le service public : MDPH, CAF, EDF. En Guadeloupe en particulier, le service public de l'eau est en panne depuis des lustres. Certains peuvent passer une semaine sans eau potable, sans communication ou réponse à leurs demandes.
Chez nous, la journée des fonctionnaires prend fin à 13 heures le mercredi et le vendredi ; certaines mairies ajoutent une fermeture le mardi après-midi - et bien sûr le samedi tout est fermé, banques comprises. L'insatisfaction est très forte. On a systématisé le mail, y compris pour les personnes qui souffrent d'illectronisme ou n'ont pas d'ordinateur. Le taux d'illettrisme est bien supérieur à ce qu'il est dans la métropole. Chez nous, le « mèl » désigne plutôt le merle, en créole, que le courriel !
La non-réponse des services publics est le sujet qui revient le plus souvent dans mes porte-à-porte, durant les campagnes électorales. La non-réponse est devenue une réponse... Dans mon programme électoral, j'avais fait figurer une réforme des horaires de travail. Cette insatisfaction est, chez nous, la cause de désertion des urnes numéro un, pour laisser la place à qui vous savez.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Le 17 juin, nous auditionnons le directeur général des outre-mer. Une table ronde sur le sujet serait difficile à organiser dans les délais impartis par notre mission d'information. Nous avons, au Sénat, une délégation aux outre-mer...
Mme Catherine Conconne. - La mission d'information me semble plus appropriée pour aborder ces sujets, j'en reste convaincue.
M. Adel Ziane. - Je serais très intéressé par les résultats de la consultation des élus. J'ai transmis le questionnaire aux élus de mon département. Une quinzaine d'élus de la Seine-Saint-Denis m'avaient contacté en se disant très intéressés par le travail de notre mission d'information.
Je vous propose également un déplacement en Seine-Saint-Denis, pour une présentation des dispositifs de lutte contre l'illettrisme, notamment des permanences en lien avec France services. La Poste souhaiterait également nous présenter ses expérimentations : nous pourrions envisager une rencontre à la fois avec la direction et avec les agents, pour évoquer ces problématiques en milieu urbain.
M. Éric Gold. - Le problème est triple : géographique, générationnel et individuel. Il ne se passe pas une semaine sans que nous soyons sollicités, dans nos permanences, sur ces sujets de complexité des démarches. Pourquoi ne pas faire des simulations, de demande à la caisse d'allocations familiales pour un étudiant, de demande d'allocation personnalisée à l'autonomie pour un aidant par exemple ? Cela permettrait de mettre en évidence les difficultés de chacun - car nous sommes tous, ici, venant de générations et de territoires différents, frappés d'une forme ou d'une autre d'illectronisme. Je propose donc une sorte de TD sur ce thème.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Nous l'avons envisagé, mais la principale difficulté est que pour ouvrir un dossier, un identifiant est nécessaire. Sinon, il faut accepter de le faire avec nos propres données personnelles.
Mme Marie-Lise Housseau. - Je partage entièrement la synthèse de nos auditions présentée par la rapporteure. J'ai été particulièrement impressionnée par ce que fait la DFAE. C'est un modèle dont il faut faire la promotion.
J'ai retenu de l'audition d'UFC-Que choisir que les trois services auxquels les Français ont le plus affaire -la CNAM, la Carsat et la CAF - fonctionnent très mal. Il faut les inciter à faire des efforts.
En revanche, France services semble faire l'unanimité, même s'il conviendrait d'homogénéiser leur présence territoriale et les prestations proposées.
Enfin, nous pourrions nous intéresser aux commerces qui, grâce à des logiciels, assurent des services bancaires pour compenser la fermeture des distributeurs automatiques de billets. Ces initiatives privées pourraient être mises en avant, voire systématisées.
Mme Béatrice Gosselin. - Je souhaite revenir sur les difficultés de MaPrimeRénov'. J'ai sollicité le ministère à propos d'un dossier : on m'a répondu que le dispositif était décentralisé. D'abord on ne répond pas et, à la énième tentative, on vous demande si la personne pour le compte de laquelle vous appelez est à vos côtés. Si elle ne l'est pas, on vous raccroche au nez ! J'ai tenté à nouveau de les contacter en passant par l'option « Suivi du dossier ». Comme on me répondait que je n'avais pas contacté la bonne personne, j'ai demandé quel interlocuteur je devais solliciter. Alors même que je me présentais comme sénatrice, on m'a à nouveau raccroché au nez !
La justification de tous ces obstacles est la nécessité d'éviter les fraudes. Or ce n'est pas là qu'il faut les chercher ! Les fraudes, ce sont ces entreprises inconnues qui promettent monts et merveilles grâce à MaPrimeRénov' - et ce sont les entreprises locales, qui font leur travail, que l'on met en difficulté en bloquant le versement de la prime.
Le dispositif MaPrimeRénov' était pleinement justifié. Mais pourquoi tant de difficultés pour joindre les conseillers, et pourquoi cet argument de la lutte contre la fraude ? Celle-ci est d'abord sur le terrain, et pas au bout d'une ligne téléphonique. Beaucoup d'usagers m'ont confié avoir renoncé à solliciter la prime à cause de la complexité du dispositif. Et on dit ensuite que tous les fonds n'ont pas été utilisés...
Mme Olivia Richard. - Je vous remercie d'avoir fait une place aux Français de l'étranger dans ce rapport. Mais ne cédons pas aux caricatures : ils n'appartiennent pas tous aux CSP+. De plus, un tiers d'entre eux ne parlent plus français, ce qui pose des difficultés pour les démarches liées à la nationalité. Certes, la dématérialisation a été très bien mise en oeuvre par le Quai d'Orsay, mais les démarches qui relèvent des autres administrations sont très difficiles, voire cauchemardesques depuis l'étranger - retraites, sécurité sociale, impôts notamment.
Mme Catherine Conconne. - Je souhaite revenir sur ma proposition d'audition : la DGOM n'est pas dans le quotidien des ultramarins, elle ne gère que deux lignes budgétaires et est la courroi de transmission vers les autres ministères.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Nous pourrions profiter des tables-rondes avec les acteurs sociaux - CAF, CNAV, CPAM - pour aborder les aspects ultramarins.
Mme Olivia Richard. - France Identité - le nouveau nom de l'ANTS - doit développer la nouvelle identité numérique notamment pour faciliter la dématérialisation complète des procurations et le vote en ligne. Je souscris à cette proposition d'audition.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Je partage ce qu'a dit Éric Gold. J'ai un seul reproche à faire sur ces plateformes : il me semble utile que l'on puisse avoir dès le départ la liste de pièces que nous allons devoir fournir. Ce qui m'a surpris, toutefois, c'est que rapidement j'ai reçu des sms frauduleux se faisant passer pour la DGFIP avec mon numéro de compte bancaire prérempli, j'ai été surpris que cela se produise dans cette temporalité. On peut s'interroger.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Pour compléter les propos d'Éric Gold, lors de l'audition de France Travail, nous avons appris que le déménagement des bénéficiaires serait désormais mieux pris en compte grâce à l'aide d'un numéro unique.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Nous pourrions programmer un atelier d'étude de cas, comme suggéré par notre collègue Éric Gold, dès mercredi prochain.
Examen du rapport d'information (mardi 16 septembre 2025)
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Nous voici donc arrivés au terme de cette mission d'information intitulée : « L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers », mise en place le 8 avril dernier à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI).
Le rapport provisoire vous a été communiqué jeudi dernier afin que vous puissiez en prendre connaissance avant cette réunion.
Dès la première réunion de cette mission d'information, nos réflexions ont fait une part essentielle aux aspects territoriaux de l'accès aux services publics, qui ont constitué le fil conducteur de nos travaux. L'accès aux services publics, à l'heure où de nombreuses démarches se font en ligne, est en effet un enjeu d'égalité : égalité entre les territoires et entre les citoyens.
Cet enjeu n'est pas propre à la France : en 2022, un rapport de l'ONU estimait à juste titre que « le nouveau visage des inégalités est numérique ». Le risque d'exclusion que comporte l'administration digitale est analysé dans le rapport, qui se réfère notamment aux travaux de la mission d'information sur l'illectronisme, à laquelle certains d'entre nous ont participé en 2020, et dont de nombreux constats demeurent d'actualité.
Ce rapport s'appuie tout d'abord sur douze auditions en réunions plénières, et sur onze auditions de la rapporteure. Ont ainsi participé à nos travaux une cinquantaine de personnes : élus, universitaires, hauts fonctionnaires, représentants d'associations de protection des consommateurs, de syndicats de la fonction publique et d'organismes de protection sociale, ainsi que trois membres du Gouvernement désormais démissionnaire. Deux de ces auditions nous ont permis d'associer à nos réflexions nos collègues de la délégation aux outre-mer et du groupe d'études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France ».
Ce cycle d'auditions a été complété par une visite de la direction de l'information légale et administrative (Dila), qui gère le site service-public.fr : un atelier pratique, organisé la veille, nous avait permis d'apprécier l'intérêt de ce site, sur lequel la rapporteure reviendra tout à l'heure à propos des recommandations qui concluent le rapport.
Parallèlement à ces auditions, des contributions écrites de qualité ont enrichi le rapport : que leurs auteurs en soient vivement remerciés. Je tiens tout particulièrement à souligner la qualité des informations qui nous ont été ainsi adressées par quatre de nos ambassades : Espagne, Royaume-Uni, Danemark et Grèce. Ces analyses, largement citées, montrent que la dématérialisation des démarches administratives ne nous est pas spécifique, même si notre pays se distingue par une volonté de préserver un accès à l'administration qui ne passe pas par le « tout numérique ». Le Royaume-Uni a ainsi fait un choix assumé en faveur de la dématérialisation des démarches. Au Danemark, le déploiement du numérique va de pair avec une politique de formation et d'accompagnement des usagers : la transmission de documents administratifs est digitale, sauf pour les 5 % des usagers éligibles à l'envoi « papier ». L'Espagne est, pour sa part, plus avancée que la France en matière de services publics numériques : selon un rapport de l'ONU de 2024, ce pays est nettement mieux classé que la France en matière d'administration numérique.
Enfin, l'exemple grec montre que la préoccupation de la fracture territoriale, qui a encouragé le développement des espaces France services, ne nous est pas spécifique, si l'on en juge par les guichets uniques mis en place en Grèce dès 2000 pour fournir un accès aux démarches administratives ; cette formule a été inspirée initialement par la nécessité de renforcer l'accès aux services publics dans les îles les moins dotées en administrations.
Je dirai un mot sur une autre source d'inspiration de ce rapport : la consultation des élus locaux à laquelle la mission d'information a procédé, dès le mois d'avril, sur le site du Sénat. Une synthèse des quelque 1 200 réponses reçues est annexée au rapport, qui se réfère par ailleurs très largement à ces témoignages particulièrement riches. Voici quelques exemples de citations qui figurent dans le rapport : « Quand on ne peut plus mettre un nom et un visage sur un agent du service public, on ne peut guère s'étonner que les termes mêmes de "service public" n'aient plus de sens pour nos administrés » ; les espaces France services « remettent de l'humain (...) face aux plateformes téléphoniques ou internet » ; inversement ces structures sont considérées par d'autres élus comme « l'affirmation, la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État » ; « La mairie reste le premier service public de France ! ».
Les élus qui ont pris le temps de s'adresser à nous par ce biais nous ont apporté un soutien précieux et je les en remercie.
Je gardais pour la fin les quatre déplacements dans les territoires qui nous ont conduits, entre le 16 juin et le 8 juillet, dans le Rhône, le Loir-et-Cher, le Finistère, l'Yonne et en Seine-Saint-Denis, aussi bien en milieu rural qu'en quartier de la politique de la ville (QPV). Je salue chaleureusement les collègues qui, en prenant l'initiative de ces déplacements, ont permis des rencontres très éclairantes avec les acteurs de terrain - conseillers France services, conseillers numériques, élus locaux - dont l'expérience a nourri et enrichi nos réflexions.
Je partage avec vous deux citations qui m'ont particulièrement marqué lors de ces déplacements. Une conseillère numérique nous a donné une illustration très significative de la précarité numérique qui fragilise de trop nombreux usagers : « On m'a dit d'aller sur internet. Il est où, internet ? ». J'ai également entendu qualifier les conseillers France services de « couteaux suisses de l'État » : une comparaison qui en dit long sur la polyvalence de ces agents, dont le rôle est décisif pour l'accès aux services publics dans les territoires.
Je tiens également à saluer, chers collègues, votre engagement et votre participation active à nos réunions, qui ont contribué au dynamisme de nos échanges. Le rapport cite autant que possible certaines de vos interventions, dans leur diversité. Dans cette logique, les développements relatifs aux Français de l'étranger font écho aux suggestions de notre collègue Olivia Richard, qui reconnaîtra dans l'une de nos recommandations une proposition qu'elle a exposée lors de l'audition de la directrice des Français à l'étranger.
Je rappellerai pour finir que les groupes politiques peuvent adresser au secrétariat d'éventuelles contributions écrites destinées à faire état, le cas échéant, de positions spécifiques. Ces contributions seront, conformément aux usages, annexées au rapport. Le délai limite de l'envoi au secrétariat, par les groupes, de ces documents est fixé à jeudi prochain,18 septembre, à 11 heures.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Je me joins aux remerciements du président et salue la participation de tous nos collègues ainsi que leurs propositions.
Je commencerai mon propos par quelques chiffres clés : on compte annuellement 572 millions de démarches en ligne - un chiffre presque effrayant ! - et 82 % des démarches sont aujourd'hui dématérialisées ; 73 % des Français ont, en 2024, effectué une démarche en ligne.
L'accès aux services publics passe donc désormais largement par le numérique. Il s'agit d'une tendance universelle, à tel point que l'ONU consacre régulièrement un bilan à l'e-administration dans le monde, dont le président a cité quelques constats. Si le digital est un gage de modernisation des services publics et, en principe, d'efficacité, il ne convient pas à tout le monde : 44 % des Français éprouvent des difficultés dans la réalisation de démarches dématérialisées - des difficultés qui, en 2021, avaient conduit un tiers des Français à y renoncer. Ces difficultés n'épargnent pas les jeunes, pourtant nés avec le numérique. Elles peuvent avoir des causes diverses : équipement insuffisant, méconnaissance des usages du numérique ou complexité d'un dossier face à des formulaires en ligne standardisés. Elles ne sont d'ailleurs pas réservées aux usagers des services publics : les clients des banques, des assurances et des fournisseurs d'énergie se plaignent également, à juste titre, des plateformes téléphoniques - qui imposent le « tapez 1, 2 ou 3 » à des clients parfois perdus.
Quelle que soit l'origine des difficultés des usagers, elles sont un facteur d'exclusion qui peut menacer notre cohésion sociale : nous avons le devoir d'y être très attentifs, a fortiori parce que tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, s'incarnent dans une démarche.
Je rejoins ici l'intitulé de cette mission d'information : « L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers ». Je n'ai pas besoin de souligner combien la notion de confiance est cruciale.
J'en viens au rapport, qui s'articule autour de trois parties.
La première partie rappelle des éléments de contexte. Tout d'abord, l'expansion des démarches en lignes est le résultat d'une évolution régulière depuis la fin des années 1990, dans le cadre d'un processus de modernisation de l'administration mené par tous les gouvernements. Un certain nombre de témoignages d'élus locaux font d'ailleurs état d'initiatives d'élus pour dématérialiser une partie des services publics dont ils ont la charge - par exemple la gestion du périscolaire ou la prise de rendez-vous en mairie.
Parallèlement à la dématérialisation de l'accès à l'administration, l'évolution du maillage territorial des services publics a conduit à un sentiment d'abandon largement relayé par les élus locaux qui se sont adressés à nous au début de cette mission d'information. Nous savons d'ailleurs que les services publics occupaient une place importante dans les cahiers de doléances de 2018-2019.
La deuxième partie présente les mesures mises en place ces dernières années en matière d'accès aux services publics.
Elle expose le cadre juridique dans lequel s'inscrit la politique publique d'accès aux services publics ainsi que son articulation administrative, répartie entre quatre principaux acteurs : la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), la direction interministérielle du numérique (Dinum), la Dila et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Cette deuxième partie présente également des exemples de réussites en matière d'administration numérique, comme le site service-public.fr évoqué par le président. Font également partie de ces progrès les avancées franchies à l'égard des Français établis hors de France pour les démarches relevant des postes consulaires. Nous avons tous été assez convaincus par les innovations que nous a présentées la directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, entendue à l'initiative de notre collègue Olivia Richard.
Le déploiement du réseau France services occupe une place particulière au sein du bilan de cette politique publique. Ces structures doivent beaucoup, nous le savons, à l'engagement des élus locaux, soucieux de mettre à la disposition de nos concitoyens des espaces accueillants, au coeur des territoires - nous avons pu constater l'intérêt des solutions itinérantes pour les usagers les plus isolés. Ces formules doivent être mis au crédit des collectivités territoriales, a fortiori parce que les espaces France services, dont 67 % sont portées par des collectivités, ne sont pas anodines pour les finances locales.
Parmi les réussites qui doivent être attribuées à l'implication des collectivités, j'ai tenu à consacrer un passage de ce rapport à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Finistère, visitée le 26 juin et où les délais de traitement, grâce à la mobilisation du département, sont désormais inférieurs à trois mois, au lieu de sept. Un progrès comparable a été réalisé en Seine-Saint-Denis, où le président du département nous a expliqué, le 8 juillet, que ces délais étaient passés de dix-huit mois à quatre pour les adultes et trois pour les enfants. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour vous dire combien j'ai été impressionnée, lors de ce déplacement, par tous les personnels rencontrés au service social départemental de Bondy et au centre de protection médicale et infantile (PMI) de Noisy-le-Sec. Je pense que notre collègue Adel Ziane, qui a pris l'initiative de ces visites, ne me contredira pas...
Parmi les autres initiatives dues à l'engagement des élus, le rapport commente aussi l'exemple des « territoires zéro non-recours », qui nous a été présentée par la communauté urbaine d'Arras.
La troisième partie du rapport expose les défis à surmonter pour que la dématérialisation produise des effets positifs pour tous les usagers.
L'analyse des « angles morts de la dématérialisation » porte sur les fractures territoriales et sur les cas complexes qui n'entrent pas dans les cases des menus déroulants - notre collègue Olivia Richard nous a indiqué des exemples très concrets de difficultés auxquelles se heurtent certains expatriés, par exemple pour s'identifier sur FranceConnect. Quant à la fracture numérique, le rapport de l'ONU cité par le président parlait des « laissés pour compte de l'administration numérique » : cela confirme que ce défi n'est pas spécifique à la France.
Les vingt recommandations que je vais vous présenter sont classées en fonction de quatre séries de priorités.
Le premier axe des recommandations concerne l'amélioration de l'accueil et de l'accompagnement des usagers.
D'abord, le constat que je viens de faire sur les fractures numériques rend impérieusement nécessaire la préservation, pour les Français, du choix de la voie par laquelle ils entrent en contact avec l'administration. Il faut reconnaître les efforts engagés par les pouvoirs publics dans cette direction, avec notamment le Plan téléphone, qui fixe un objectif de 85 % de taux de décroché. Mais ce n'est pas assez : une enquête réalisée par l'Institut national de la consommation et le Défenseur des droits en 2022 auprès de quatre administrations a montré les insuffisances de l'accueil téléphonique.
Même constat pour l'accueil physique : les maisons France services ont un rôle essentiel dans ce domaine. Elles recueillent certes des demandes d'information, mais aussi des expressions, des plaintes, des revendications. Comme l'ont confirmé les visites d'espaces France services par la mission d'information dans le Loir-et-Cher, le Rhône, et le Finistère et l'Yonne, c'est une dimension très importante du travail des agents : incarner les pouvoirs publics, et faire en sorte que les usagers se sentent écoutés.
De là la première de nos recommandations : garantir à l'usager un accès aux services publics selon le canal de son choix en réaffirmant l'obligation, pour tous les services publics, d'appliquer le principe de l'omnicanalité. Cela doit être une priorité du prochain comité interministériel de la transformation publique (CITP).
C'est également le sens de notre deuxième recommandation : l'accueil est un métier, comme l'ont souligné les représentants syndicaux de la fonction publique ; il faut donc valoriser cet aspect du travail des agents, dans la formation comme dans le déroulement de leur carrière.
L'administration doit être accessible, mais aussi bienveillante. Trop souvent, nos concitoyens victimes d'une erreur commise par eux-mêmes, mais aussi par l'administration, se voient opposer un refus de la corriger au motif que le cadre juridique du droit à l'erreur ne le permet pas. Il n'est pas normal qu'une mauvaise case cochée dans un menu déroulant empêche un élève de s'inscrire au bac dans la spécialité de son choix, comme cela s'est produit. Nous proposons donc une forme d'extension du droit à l'erreur, lorsque la perte de chance qui résulterait de cette erreur est manifeste : c'est là notre troisième recommandation.
L'accessibilité, c'est aussi, dans l'espace numérique, la possibilité pour le citoyen d'obtenir l'information qu'il recherche facilement et rapidement. La visite que certains d'entre nous ont faite au siège de la Dila, responsable du site service-public.fr, et les échanges très riches que nous avons eus sur place avec les équipes, nous ont convaincus de l'importance de ce site, véritable navire amiral de la présence numérique de l'État. Il délivre de nombreux services, pour les usagers mais aussi les collectivités, en proposant par exemple des sites internet clé en main. S'il est très bien référencé sur les moteurs de recherche, il souffre pourtant, paradoxalement, d'un déficit relatif de notoriété. C'est l'objet de notre quatrième recommandation : mieux faire connaître le site service-public.fr au moyen d'une campagne d'information grand public. C'est également le sens d'une recommandation que je présenterai ultérieurement à propos de l'intelligence artificielle (IA).
En plus d'accueillir et d'informer, notre administration doit aussi aller vers le citoyen en lui offrant une information mieux conçue et centrée autour de ses besoins. C'est la vocation des 21 fiches « moments de vie » du site service-public.fr, qui présentent de manière synthétique les démarches à réaliser aux étapes clés de notre existence. Par exemple, la fiche « Un proche est décédé » recense de manière très utile pratiquement tous les renseignements nécessaires dans ces moments très difficiles.
Ces « moments de vie » sont donc une initiative très louable, et l'on retrouve une démarche similaire par exemple chez nos voisins allemands. Or j'ai pu me rendre compte qu'aucune de ces fiches n'aborde le moment charnière qu'est l'entrée des jeunes dans la vie active : je propose donc que cette étape de leur vie fasse l'objet d'une fiche pratique spécifique, et que cette fiche soit mise à disposition dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous), les associations étudiantes et le réseau France services. C'est notre cinquième recommandation.
Dans la même logique d'« aller vers », il conviendrait de mettre la fiche « Un proche est décédé » systématiquement à la disposition des proches du défunt dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres : s'il est un moment où nous avons besoin d'être accompagnés, c'est bien celui-là. Dans un registre plus pratique, il est indispensable de faciliter la résiliation des abonnements souscrits par la personne décédée, qui constitue souvent un parcours du combattant pour ceux qui doivent s'en occuper. Tel est le sens de notre sixième recommandation.
Enfin, nos travaux ont mis en évidence les difficultés liées à la diffusion de la propagande électorale auprès de deux publics spécifiques : les Français d'outre-mer et les Français de l'étranger. Dans le premier cas, les fréquents problèmes d'adressage peuvent empêcher la propagande d'arriver en temps voulu à ses destinataires. Dans le second, elle arrive bien souvent après l'élection - pour un coût global de 2 millions d'euros à chaque tour ! Dans de telles conditions, il serait raisonnable d'expérimenter, pour ces deux publics, la faculté d'opter pour la transmission numérique de cette propagande : c'est la recommandation n° 7.
Le deuxième axe des recommandations concerne les maisons France services.
Les témoignages adressés par élus locaux montrent des points de vue différents sur ces structures. Pour certains, comme l'a rappelé le président, les maisons France services « remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». D'autres élus sont pour leur part convaincus que « Les mairies sont depuis longtemps un France services bien avant l'heure ! » et critiquent des structures qu'ils considèrent comme « la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État » et qui, en outre, pèsent sur les finances des collectivités territoriales.
Il reste toutefois indéniable que le réseau France services est un bel outil, qu'il convient de consolider et de parfaire pour simplifier les démarches des usagers et développer un accès de proximité aux services publics.
Ainsi, concernant le maillage territorial des France services, je vous propose une recommandation déclinée en cinq sous-propositions.
Il s'agit tout d'abord de poursuivre le développement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), où les besoins sont réels : 7 des 10 maisons France services les plus fréquentées se trouvent dans ces quartiers.
Ensuite, il faut amplifier les formules itinérantes qui permettent de rayonner au-delà des maisons France services et de se rapprocher des usagers.
Nous pourrions également instaurer, à titre expérimental, une structure France services dédiée aux Français revenant sur le territoire national après un séjour de longue durée à l'étranger, compte tenu des besoins spécifiques à ces usagers.
Nous proposons, en outre, d'encourager les permanences France services dans les mairies, car « les mairies sont depuis longtemps un France services avant l'heure ! », ainsi que l'ont fait observer les élus locaux consultés sur la plateforme du Sénat.
Il nous faut enfin privilégier l'implantation des nouveaux espaces dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales. Je l'ai indiqué précédemment : 67 % des espaces France services sont financés par les collectivités. Or la part de l'État se limite à 1 % (34 sous-préfectures et 4 préfectures).
Concernant l'offre de services assurée par le réseau, je suis d'avis de stabiliser le panier constitué des douze opérateurs partenaires du programme - cette recommandation émane des conseillers France services eux-mêmes. Ce dispositif s'est tout récemment, en avril 2025, étendu à l'Urssaf : il me semble indispensable de le consolider avant toute éventuelle extension, pour garantir dans la durée le maintien des bons résultats du programme.
Parallèlement, la recommandation n° 10 vise à consolider l'articulation entre France services et les partenaires nationaux du réseau : il s'agit de garantir aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département. Dans certains départements, les conseillers France services bénéficient d'une ligne directe avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la caisse d'allocations familiales (CAF) et France Travail ; dans d'autres, ils ne peuvent contacter ces services que par voie numérique. Nous proposons également de développer des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France services, selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.
Enfin, je tiens à saluer le rôle essentiel des conseillers France services, dont les qualités et l'engagement nous ont été démontrés à chacun de nos déplacements. La recommandation n° 11 appelle à mieux prendre en compte les évolutions de leur métier en structurant leur formation et leur parcours professionnel et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.
Le troisième axe des recommandations vise à protéger plus efficacement les usagers contre les sites frauduleux qui proposent d'effectuer des démarches contre rémunération. La complexité et le nombre croissant de démarches administratives dématérialisées incitent en effet certains usagers à recourir à des offres payantes, alors même que ces démarches sont gratuites ou quasi-gratuites.
Si cette activité de « conciergerie administrative » n'est pas en soi illégale, certains de ces sites peuvent induire l'usager en erreur, par exemple parce qu'ils reproduisent l'apparence de sites officiels ou par manque de transparence sur les modalités de paiement des prestations par les clients. Ces pratiques commerciales peuvent donc être a minima déloyales, voire illégales et trompeuses.
Deux domaines ont attiré mon attention.
D'une part, le coaching sur Parcoursup, sans être illégal, peut atteindre des montants particulièrement élevés, mettant en cause l'égalité entre les futurs étudiants.
D'autre part, l'existence d'intermédiaires en ligne proposant d'effectuer contre rémunération des demandes d'aides sociales pose un problème particulier, puisque ces aides sont un droit pour les intéressés.
Nous avons constaté que la protection de l'usager via la protection du consommateur en ligne est aujourd'hui un impensé de la dématérialisation des services publics. Il faut donc trouver un juste équilibre entre le contrôle et la répression de ces comportements qui induisent en erreur nos concitoyens. Tel est l'objet des recommandations nos 12 à 15.
Il m'apparaît indispensable de moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération. Nous suggérons pour cela d'introduire des circonstances aggravantes, pour renforcer les sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuse des signes d'autorité en ligne.
Il paraît également nécessaire d'étendre explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui permettre d'obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne.
Enfin, il faudrait tenir compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant eux-mêmes leurs démarches.
Parallèlement à ces mesures de sanction, je souhaite que nous adoptions des mesures destinées à renforcer l'identification, par les usagers, des outils et des sites officiels permettant d'accéder aux services publics et de réaliser des démarches en ligne. Pour cela, je propose d'établir des signes distinctifs communs et infalsifiables aux sites officiels afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants. Il serait également utile d'améliorer le référencement des sites officiels de démarches administratives et de poursuivre avec détermination le déréférencement des sites frauduleux. En outre, il faut clarifier la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur leur gratuité et assurer une communication régulière sur ce sujet.
Améliorons, enfin, la qualité de certains sites officiels, comme mesdroitsociaux.gouv.fr, par le biais de partenariats renforcés avec les collectivités territoriales, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants : en effet, ceux-ci semblent souvent plus attractifs que le site officiel puisqu'ils agrègent aux aides sociales nationales un grand nombre d'aides locales.
Le dernier axe de recommandations vise à mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.
Si la France, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark, n'a pas fait le choix du tout-numérique, les efforts menés pour aider les usagers à se servir de ces outils méritent d'être approfondis.
Notre politique publique de l'inclusion numérique repose principalement, aujourd'hui, sur les conseillers numériques, au nombre de 2 600 si l'on considère les postes effectivement pourvus. Ces acteurs réalisent un travail important auprès des publics les plus précaires, dans les centres sociaux, les missions locales, voire les maisons France services.
Si leurs services sont appréciés des collectivités, leur avenir reste incertain, en raison de la baisse de la ligne budgétaire concernée dans la loi de finances pour 2025. Au-delà de leur pérennité, il est indispensable de clarifier le paysage de l'inclusion numérique, qui est aujourd'hui trop morcelé.
La recommandation n° 16 préconise donc une programmation budgétaire claire et la désignation d'un véritable chef de file, afin de donner une impulsion décisive à la lutte contre l'exclusion numérique. Contrairement aux idées reçues, l'exclusion numérique n'est pas en voie de résorption, compte tenu des progrès continus - et souvent fulgurant - des outils, mais aussi du vieillissement de la population.
Dans le même registre de l'inclusion numérique, nous formulons également une recommandation sur le programme Aidants Connect, opéré par l'ANCT, destiné à permettre aux professionnels qui accompagnent régulièrement des personnes éloignées du numérique dans leurs démarches de se connecter sur France Connect pour les personnes que ces professionnels accompagnent. Ce programme, d'après les informations que nous avons recueillies, ne semble pas avoir encore trouvé son public - 53 000 personnes accompagnées, cela semble peu - probablement en raison de conditions trop restrictives. Il paraît pertinent d'en élargir le périmètre, notamment pour toucher les personnes, de plus en plus nombreuses, que la dépendance progressive liée à un handicap ou à une maladie chronique prive de la capacité de faire leurs démarches en ligne.
Notre mission d'information ne pouvait passer sous silence les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Dans ce domaine, les différentes administrations se sont mises en ordre de marche : plusieurs expérimentations sont en cours au sein de l'Assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Mentionnons également l'outil Albert, en phase de test dans les maisons France services. Les apports des outils développés sont multiples : utilisation des données fournies des usagers pour répondre plus efficacement à leurs besoins, aide à la formulation de réponses, voire rédaction et mise à jour automatique de l'information délivrée.
Nous estimons que ces démarches doivent converger dans la formulation d'une doctrine cohérente d'utilisation de l'IA, avec les garde-fous qui s'imposent quant à l'utilisation des données fournies, à leur conservation, à leur sécurisation. Toutefois, il faut aussi un vrai travail de réflexion sur les missions des agents et la façon dont l'IA peut les affecter. C'est la condition sine qua non d'une IA mise au service de l'usager.
Au-delà des applications métier, nos échanges avec la Dila lors de notre visite ont attiré notre attention sur une problématique très spécifique : les réponses des outils d'IA générative tels que ChatGPT tendent à occulter la source des informations recueillies. Lorsque l'information est officielle, c'est une difficulté importante : il faut donc engager au plus haut niveau une discussion avec les opérateurs de l'IA pour exiger que l'information de source officielle soit bien identifiée comme telle.
Le corollaire de cet impératif de contrôle sur l'outil surpuissant qu'est l'IA est la formation et le recrutement, au sein de la fonction publique, de profils associant capacités techniques, notamment sur le fonctionnement des algorithmes, et compétences juridiques et politiques, voire éthiques. Ces profils sont rares au sein de la haute administration ; or le problème bien connu de l'asymétrie d'information se pose avec une particulière acuité dans le cas de l'intelligence artificielle. L'autorité publique ne saurait déléguer l'ensemble du savoir technique aux opérateurs, sous peine de perdre ses capacités de supervision.
Enfin, notre mission d'information s'est intéressée au service « Démarches simplifiées », développé dans le cadre de la start-up d'État beta.gouv.fr. Il permet à tout service public de créer rapidement un formulaire en ligne sans compétence technique, d'instruire les dossiers reçus, de dialoguer avec les usagers et de suivre les étapes de traitement. Au total 35 000 démarches ont été mises en ligne - vous avez peut-être eu l'occasion de l'utiliser, car les services du Sénat y ont parfois recours. C'est un bon exemple d'innovation administrative qui bénéficie aux agents comme au public, puisque les formulaires générés sont très faciles à utiliser. Il conviendrait donc, et c'est là notre dernière recommandation, de s'assurer que cet outil est connu, particulier par les collectivités territoriales.
Mme Olivia Richard. - Je vous remercie tout particulièrement pour la place qu'occupent les Français de l'étranger dans ce rapport.
Les sites visés par les recommandations nos 12 à 15 ne sont pas illégaux, même s'ils profitent de l'aubaine que représente l'illectronisme. Nous avions notamment abordé ce sujet concernant les permis de conduire. Vous êtes-vous penchée sur cette question ?
Vous avez mentionné le programme Aidants Connect. Les élus des Français de l'étranger passent beaucoup de temps à assister leurs concitoyens dans leurs démarches. Pourrai-je devenir « aidante Connect » pour les Français de l'étranger déconnectés ?
M. Hugues Saury. - Je salue l'important travail réalisé par la rapporteure.
Ce rapport s'inscrit dans le présent, ce qui est une bonne chose. En effet, l'un des objectifs de la mission d'information était de faciliter les relations entre les usagers et l'administration des services publics. Vous y répondez entièrement, en relevant, thème par thème, les améliorations possibles. Néanmoins, il aurait été intéressant que ce rapport s'inscrive également dans l'avenir, en dressant des perspectives sur ce que sera l'accès aux services publics dans les prochaines années, afin d'émettre des recommandations. Nous pourrions notamment nous inspirer sur la démarche entamée par certains pays baltes, en particulier, qui évoluent vers une forme de guichet unique, l'idée étant qu'un seul vecteur permettrait aux usagers de se connecter à l'ensemble des services publics.
J'ai été intéressé par les comparaisons que vous proposez avec des pays voisins. Sans doute auriez-vous pu insister sur l'intérêt, dans le futur, d'une convergence de moyens pour accéder aux services publics des différents pays de l'Union européenne proposés aux administrés. Mais l'essentiel de ma remarque concerne la qualité de ce travail.
M. Éric Gold. - Je salue également la qualité de ce rapport.
L'élément majeur qu'il faut souligner reste le nombre de démarches administratives auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Or nous ne parvenons pas à répondre convenablement à la nécessité de limiter la complexité, mais surtout le nombre de démarches nécessaires pour l'usager.
Le numérique est souvent présenté comme un élément facilitateur en la matière. Cependant, l'utilisation d'un ordinateur laisse nombre de citoyens au bord du chemin. L'IA apparaît désormais comme un progrès majeur, bien qu'il faille l'encadrer. Gageons simplement que l'intelligence artificielle permettra surtout de limiter le nombre de démarches en facilitant l'accès aux services publics et aux droits élémentaires pour nos concitoyens.
Mme Marie-Pierre Richer. -Je remercie la rapporteure et le président de nous avoir véritablement donné la parole au cours des travaux de la mission d'information.
En ce qui concerne le handicap, je souhaite rappeler que le rapport de la commission des affaires sociales relatif au bilan de l'application de la loi du 11 février 2005, publié en février dernier et dont j'ai été l'un des auteurs, aux côtés de Chantal Deseyne et Corinne Féret, notait que si certaines MDPH vont de l'avant et améliorent les délais de leurs réponses, malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité d'entre elles, ce qui constitue un problème pour les personnes handicapées. C'est un point important, et le rapport de la commission des affaires sociales recommande notamment d'harmoniser les pratiques. Il faudrait le préciser expressément dans le rapport.
Je souscris complètement à l'idée que la première maison France services, c'est la mairie. Bien sûr, il faut consolider les maisons France services, mais en limitant le nombre d'opérateurs : il ne faudrait pas que ceux-ci se déchargent sur les France services !
Je crois également à la complémentarité entre le numérique et le papier, mais malheureusement le numérique ne peut pas tout remplacer. C'est vrai aussi bien dans les services publics que dans les services privés, à l'instar des banques ou des assurances, où l'accès demeure compliqué. D'ailleurs, j'ai lu récemment un document qui en faisait état, au sous-titre évocateur : « Administration : guide de survie en terre inconnue ».
Je souligne votre volonté de montrer qu'il existe des solutions ; mais n'oublions pas que la machine administrative s'enraye, au risque de compliquer encore davantage la vie des personnes.
M. Adel Ziane. - Je remercie la rapporteure, qui a repris dans son rapport les éléments évoqués lors du déplacement dans mon département de Seine-Saint-Denis. À l'origine, ce qui me tenait particulièrement à coeur était le problème de l'illectronisme, qui frappe tout le monde. Nous avons également eu l'occasion au cours de nos travaux d'aborder les difficultés liées aux démarches en ligne, en évoquant parfois notre propre expérience d'usagers. Un autre thème de nos réflexions a été l'accès aux services publics dans les territoires. Les problèmes liés à la langue ont été mis en évidence lors du déplacement en Seine-Saint-Denis. Autre sujet important : les difficultés liées à la coordination entre services publics de différents départements. Ainsi, le traitement d'un dossier peut varier entre différentes caisses d'allocations familiales (CAF) ; de même, les dossiers ne sont pas transférés avant de multiples relances... Au-delà de la question de l'accessibilité, il faut que les citoyens puissent bénéficier d'un traitement homogène de leurs dossiers quel que soit le département.
Comme l'a souligné le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, M. Stéphane Troussel, il faudrait favoriser des instances de dialogue entre collectivités territoriales, afin de favoriser des échanges de bonnes pratiques et dessiner des pistes d'amélioration au service des usagers.
Je suis, moi aussi, absolument d'accord sur ce point : les mairies sont le premier France services. Mais elles deviennent de plus en plus le réceptacle d'un grand nombre d'interrogations. Elles assument ainsi de nouvelles missions d'information des usagers, qui sont insuffisamment reconnues, ce qui soulève la question des moyens qui leur sont dévolus.
M. Philippe Folliot. - Je salue le travail de la rapporteure et du président, ainsi que de tous les collègues qui ont participé aux travaux de la mission d'information.
Certes, la dématérialisation est un moyen de faciliter les démarches pour certains usagers, mais elle est une source d'angoisse ou de difficultés pour d'autres ; ne l'oublions pas.
Les mairies sont effectivement les premiers points d'accueil des citoyens, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
L'État et les collectivités territoriales améliorent l'accès des citoyens aux services publics ; or les services au public - je pense aux agences bancaires - ferment. S'il faut faire des dizaines de kilomètres pour les démarches du quotidien - rencontrer son conseiller bancaire, par exemple -, alors que des progrès ont été réalisés pour les démarches administratives, le gain n'est-il pas limité ?
Qu'une banque restructure son réseau et ferme des agences parce qu'elle perd de l'argent peut se comprendre. Mais si elle décide de fermer des agences alors qu'elle fait du profit, cela nourrit un sentiment d'injustice chez nos concitoyens. Ce n'est pas l'objet central du rapport, mais il faut en mesurer les conséquences pour nos concitoyens, plus particulièrement en milieu rural.
Je note également que, pour un certain nombre de maisons France services, les horaires d'ouverture prennent en compte les horaires de travail des usagers. Ainsi, certaines ouvrent le samedi matin : c'est une avancée. Peut-être pourrait-on imaginer, dans les modalités de financement par l'État, une surdotation pour celles qui font cet effort, afin d'encourager cette pratique.
Mme Marianne Margaté. - Le rapport met au jour un sujet majeur : l'accès aux droits. Or le constat chiffré d'un renoncement aux droits mine la relation entre les citoyens et l'État. Les solutions concrètes proposées dans le rapport, qui reposent sur des constats et des remontées du terrain, me semblent intéressantes. Je pense ainsi à la recommandation concernant des permanences des opérateurs au sein des maisons France services. C'est leur place ! Sinon, on court le risque que l'existence des France services serve d'argument pour faire disparaître les services publics des territoires. Aussi, il faut privilégier la complémentarité entre ces opérateurs et France services, plutôt que la substitution.
De même, il faut reconnaître la spécificité professionnelle de ceux qui travaillent dans ces services : leur qualification doit être valorisée, y compris dans leur parcours.
L'État doit garantir l'accès aux droits, pour mettre en place les dispositifs que nous élaborons et votons au Sénat, au risque de mettre en péril notre modèle social. Arrêtons donc les coupes budgétaires qui menacent nos services publics. Compte tenu de la paupérisation de nos concitoyens, l'accès aux droits doit être un objectif à atteindre.
Il faut également être attentif au travail des agents des maisons France services. Ils se retrouvent à gérer non pas les dossiers simples, qui sont traités à l'aide du numérique, mais des dossiers de plus en plus complexes. La perte de professionnalisme liée à certains contrats précaires fragilise la qualité du service. Il faut reconnaître le professionnalisme de ces agents et leur donner les moyens d'agir.
Je propose que l'État finance à 100 % les maisons France services, afin de garantir un égal accès aux droits ; les élus doivent jouer un rôle de pompier dans de nombreuses situations - lorsqu'un distributeur automatique est mis hors service, quand un bureau de poste ferme... Or les communes, rurales ou urbaines, n'ont que peu de moyens.
M. Ronan Dantec. - Je salue à mon tour le travail de la rapporteure et du président.
Selon moi, le rapport ne prend pas suffisamment en compte les retours d'expérience des usagers - je pense à certains formulaires aberrants, par exemple, qu'il faudrait absolument améliorer. L'État, et les opérateurs en général, manquent de capacité d'autocritique. Si un formulaire nécessite le recours à une personne tierce, c'est qu'il y a un problème ! Et donc cela devrait alerter sur la nécessité de le changer. Permettez-moi un exemple personnel : je n'aurais jamais réussi à bénéficier des subventions pour l'installation de pompes à chaleur sans l'aide d'un professionnel. L'État met trop de temps à reconnaître ses propres difficultés, alors que nous avons besoin de retours d'expérience pour simplifier les procédures.
Je pense aussi aux entrepreneurs individuels : d'après mon expérience personnelle, ils doivent envoyer la liasse fiscale à l'administration fiscale, et la même au greffe du tribunal, accompagnée d'un chèque de 25 euros environ. Cela n'a aucun sens. Pourquoi n'y a-t-il pas un échange entre ces administrations ? Nous connaissons tous des exemples de ce type d'aberration. Il faut donc une instance qui permette de reconsidérer certaines procédures administratives, à l'aune des retours d'expérience des usagers.
De plus, le rapport n'évoque pas non plus spécifiquement les questions de handicap, notamment le handicap visuel.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Vos questions soulèvent un véritable débat : comment peut-on être girondin tout en demeurant jacobin ? Dans certains pays, la décentralisation a fonctionné, sans avoir engendré de grands drames pour les citoyens...
Par ailleurs, les agents chargés de l'accueil sont sous-estimés. Il peut s'agir de fonctionnaires de catégorie C, alors qu'ils sont de véritables « couteaux suisses », comme nous l'avons entendu lors de nos visites de terrain, que ce soit dans les maisons France services ou dans les mairies. Leur rôle mérite d'être reconnu et valorisé.
En début d'année, j'ai moi-même pu constater, grâce aux démarches en ligne, combien les outils numériques peuvent être utiles quand ils fonctionnent bien. Or, alors que tout était réglé chez le notaire, c'est au moment où j'ai voulu entamer les démarches auprès des banques que les problèmes ont commencé. Leurs services étaient en effet injoignables. En réalité, alors que toutes les démarches relevant de la sphère publique étaient réglées, celles qui relevaient du secteur privé ne l'étaient pas. Ce point mérite notre attention.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que, pour les élus locaux qui nous ont répondu au début de cette mission d'information, la notion de service public ne se limite pas aux services de l'État, des départements ou des communes, mais inclut également la boulangerie ou encore la pharmacie...
Mme Nadège Havet, rapporteure. -Concernant les recommandations portant sur les sites frauduleux, je précise à l'attention d'Olivia Richard qu'il faut revoir certaines dispositions du code pénal, pour y inclure expressément les mentions « numérique » et « en ligne ». Cette adaptation du code pénal concernera également les sites relatifs aux permis de conduire.
L'outil Aidants Connect est conçu pour les professionnels. Cet outil est assez peu connu. Ainsi, seulement 53 000 personnes ont fait une demande d'habilitation. Pour notre part, nous avons découvert ce service au cours de la mission d'information. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant.
Monsieur Saury, j'ai quelques doutes concernant la pertinence de l'ouverture d'un guichet unique, notamment au vu des difficultés rencontrées par le guichet unique consacré aux entreprises. Une fois que tous les systèmes numériques auront convergé, peut-être y arriverons-nous, mais pour l'instant cela me paraît compliqué. Des convergences de moyens sont en revanche possibles au niveau européen. Le dispositif « Dites-le nous une fois » nous vient, par exemple, d'autres pays européens. Quant à votre remarque sur l'exemple des pays baltes, je propose de la mentionner dans le rapport.
Il en est ainsi décidé.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Madame Richer, nous ferons un ajout dans le rapport concernant vos constats sur les délais de traitement des dossiers par les MDPH.
Il en est ainsi décidé.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Par ailleurs, tous les conseillers France services que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils étaient en lien avec douze opérateurs différents. Il leur faut donc être formés en conséquence, et connaître le site internet de chacun. Nous sommes effectivement parvenus au maximum de ce qu'il est possible de demander à ces agents. Les demandes concernant les retraites complémentaires sont généralement traitées, et des discussions sont en cours avec l'Agirc-Arrco pour une intégration dans France services.
Je retiens la formule « Administration : guide de survie en terre inconnue », que vous avez mentionnée.
Je suis d'accord avec Adel Ziane : nous relevons bien des problèmes de coordination entre les acteurs, en fonction des départements.
Quant à la présence des opérateurs au sein des maisons France services, évoquée par Marianne Margaté, elle varie selon les acteurs et les départements. La direction générale des finances publiques (DGFiP) organise des permanences, notamment au moment des impôts, mais à ma connaissance seule cette administration développe ce genre d'initiative sur tout le territoire national. Ainsi, si la caisse primaire d'assurance maladie se rend dans les maisons France services de certains départements, ce n'est pas le cas dans d'autres. Une harmonisation est nécessaire à cet égard, pour sécuriser les conseillers France services.
Je propose de mentionner, dans le corps du rapport, la piste formulée par Philippe Folliot concernant une évolution de la subvention lorsque des maisons France services font l'effort de décaler leurs horaires. Je ne suis toutefois pas certaine que cette pratique soit très répandue.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - La maison France services de Belleville-en-Beaujolais peut ouvrir le samedi matin pour les usagers qui travaillent. Mais je ne suis pas sûr que cette formule donne partout des résultats probants, faute de fréquentation. La réussite d'une telle initiative dépend de la réalité de la vie locale.
M. Philippe Folliot. - Dans mon village de Saint-Pierre-de-Trivisy, la mairie comme la maison France services sont ouvertes le samedi matin et de nombreux usagers s'y rendent, y compris des résidents secondaires et des personnes qui habitent dans d'autres communes des alentours.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Cela dépend donc bien des situations locales.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Nous mentionnerons votre remarque dans le corps du rapport.
Il en est ainsi décidé.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - De même, nous mentionnerons dans le corps du rapport la remarque de Marianne Margaté sur la nécessité d'un financement des France services à 100 % par l'État, pour éviter que cette charge ne repose sur les collectivités.
Il en est ainsi décidé.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - En outre, il est important de valoriser les agents des maisons France services, qui portent douze « casquettes » correspondant aux douze opérateurs qui y sont regroupés. Rappelons que la mission de l'accueil est souvent confiée aux personnels qui viennent d'arriver dans le service. Or cela les place dans une position très inconfortable, car ces agents doivent demander sans arrêt des réponses à leurs collègues. D'après mon expérience, l'accueil doit servir en réalité de gare de triage : il faut savoir donner les bonnes informations et orienter les usagers vers les bons services.
Pour ce qui est du handicap, nous pourrions lui consacrer un rapport entier ! Nous n'avons pas spécifiquement creusé cette question par manque de temps.
Sur la plateforme France Titres, les usagers sont parfois interrogés sur la qualité des formulaires à remplir. C'est ce qui alimente les remontées d'informations. Cependant, ce processus n'est peut-être pas assez rapide et n'aboutit peut-être pas assez rapidement à la transformation des formulaires concernés.
S'agissant de la pertinence du nombre de démarches demandées aux usagers, évoquée par Éric Gold, je confirme qu'il n'y a effectivement pas assez de lien entre les administrations. Certaines liaisons se font néanmoins, entre la DGFiP et France Travail, par exemple, ou entre France Travail et la caisse d'allocations familiales. Toutefois, les systèmes de données sont différents. Il faudrait tous les coordonner et les harmoniser, ce qui soulève encore à ce jour des difficultés.
Mme Marie-Pierre Richer. - J'indique que si la commission des affaires sociales a publié un rapport sur le sujet du handicap, le groupe d'études sénatorial sur le handicap a également été chargé par Gérard Larcher de dresser le bilan de la loi de 2005. Ce travail n'a pas donné lieu à un rapport, mais à une publication sous la forme d'« Essentiel », qui traite notamment de l'accès au transport et au numérique.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Mes chers collègues, je vais mettre aux voix les recommandations.
Les recommandations sont adoptées.
Mme Nadège Havet, rapporteure. - Je propose par ailleurs le titre suivant pour le rapport : « Services publics, services au public : moderniser sans exclure ».
M. Hugues Saury. - Ce rapport traite des services publics et n'inclut pas forcément les services au public, comme les banques. Ce titre me semble poser un problème.
M. Ronan Dantec. - Le titre me paraît trop large. Nous parlons de l'accès aux services publics, non des services publics en général. Il n'est pas question de réformer l'intégralité des services publics en France.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - Nous proposons donc le titre suivant : « L'accès aux services publics : moderniser sans exclure ».
Le titre du rapport d'information, ainsi modifié, est adopté.
M. Gilbert-Luc Devinaz, président. - La mission d'information donne donc son accord à la publication du rapport et autorise le secrétariat à procéder aux modifications destinées à tirer les conséquences de nos échanges ainsi qu'à d'éventuelles modifications strictement formelles.
CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE-K
Les services publics sont, depuis plusieurs décennies, mis à mal par la baisse des dépenses publiques et les mesures d'austérité, ainsi que par le pacte de stabilité européen. Cette situation n'est pas accidentelle. Elle relève d'une volonté d'affaiblir les services publics pour préparer leur privatisation. Le Comité action publique 2022 (CAP 22), un groupe composé de quarante personnalités mêlant économistes, cadres du secteur public et privé, élus, et chargé en octobre 2017 par le premier ministre Édouard Philippe de réfléchir à une réforme des missions de Service Public de l'État associée à une réduction des dépenses publiques est un moment important de cette logique austéritaire. Ce groupe, dont les travaux servent encore aujourd'hui de référence, était composé en grande partie par des personnalités issues de la finance privée, de grands groupes industriels et d'économistes libéraux. Parmi les mesures que proposait ce groupe il y avait la disparition progressive des accueils physiques pour atteindre le tout numérique.
Une des conséquences des mesures qui résultent de cette politique portée par des gouvernements suivant les injonctions du Capital, est la baisse des dotations aux collectivités territoriales, notamment en milieu rural. Il convient de poser, en préalable, cette situation, qui engendre chez les élus et les administrés de ces territoires un sentiment d'abandon, relayé d'ailleurs par de nombreuses sénatrices et sénateurs lors de nos travaux. Car les services publics, c'est l'incarnation de la présence de l'État dans les territoires. Leur disparition participe, par conséquent, au délitement de la vie démocratique et menace notre modèle social. C'est pourquoi leur renforcement est une question démocratique et sociale essentielle qui mérite l'inscription dans la Constitution d'une Charte des Services Publics comme l'ont proposé les parlementaires communistes dans une proposition de loi constitutionnelle. Cette dernière édifie les services publics au plus haut niveau de la hiérarchie des normes et oblige le législateur, le Conseil Constitutionnel tout comme les juridictions administratives et judiciaires de garantir son respect.
Ce serait une prolongation logique de cet autre article du préambule de la Constitution, l'un des éléments de l'actuel bloc de constitutionnalité, qui stipule que : “Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence“. Pourtant, en contradiction totale avec cet article la situation actuelle conduit à un renoncement aux droits de plus en plus massif générant une aggravation des inégalités. Ainsi par exemple le Revenu de Solidarité Active connaît un taux de non recours 38%, et le minimum vieillesse 50%.
Pour lutter contre cet état de fait il est urgent de mettre en place les moyens en faveur des services publics, pour attirer et fidéliser les fonctionnaires, par des augmentations de salaires ainsi que par des formations permettant de véritables évolutions de carrière, valorisant des métiers difficiles et apportant ainsi une reconnaissance à la hauteur de leur utilité sociale.
L'ensemble de ces mesures serait financé par une fiscalité moins clémente vis-à-vis du Capital et la fin du gâchis phénoménal révélé par un récent rapport sénatorial des 216 milliards d'aides aux entreprises sans aucune conditionnalité.
Par ailleurs, si la dématérialisation des services publics est une réalité de plus en plus dominante, il est essentiel de mettre en place des alternatives physiques de proximité pour les personnes fragiles et n'ayant pas les moyens matériels nécessaires ainsi que pour les dossiers complexes auxquels chacun peut devoir faire face.
Concomitamment à ces mesures matérielles, il conviendrait d'améliorer la démocratie dans ce domaine. Pourquoi ne pas créer des comités territoriaux de service public composés d'agents, d'usagers et d'élus locaux, afin qu'ils soient force de propositions et d'améliorations ?
Nonobstant ce biais de départ, la mission formule des propositions concrètes. Celles-ci n'inversent pas la logique fondamentale, mais visent à remédier à certains défauts d'une gestion verticale et technocratique, qui conduit à des choix et des situations déconnectés des besoins réels et des aspirations. Le groupe CRCE-K ne peut que l'approuver. Par ailleurs, le rapport intègre ma demande de la prise en charge à 100% par l'Etat du financement des Maisons France Services, comme le demandent de nombreux maires. Le groupe CRCE-K avait en janvier dernier porté un amendement en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2025. Cela constitue une avancée concrète dans le cadre de ce rapport mais le gouvernement devra traduire au plus vite dans la réalité cette demande.
CONSULTATION DES ÉLUS LOCAUX : SYNTHÈSE DES RÉPONSES
Convaincue de l'importance cruciale de la dimension territoriale de l'accès aux services publics, la mission d'information a mis en ligne, sur le site du Sénat, une consultation des élus locaux pour connaître leur ressenti sur la situation des services publics dans leur territoire et, grâce à leurs témoignages, identifier les bonnes pratiques mises en oeuvre par certaines collectivités pour améliorer l'accès des usagers aux services publics, tant nationaux que locaux.
Entre le 14 avril et le 12 mai, la mission a recueilli les réponses et suggestions de quelque 1 157 participants.
La mission d'information remercie chaleureusement tous les élus qui ont pris le temps de répondre à ses nombreuses questions.
Profil des répondants
Sur 1 157 répondants, on note une très large part (93%) d'élus de l'échelon municipal :
- 62% de maires ;
- 17,5% d'adjoints au maire ;
- 12,5% de conseillers municipaux ;
- 3% de représentants d'EPCI.
Les échelons départemental et régional représentent en revanche une faible proportion des réponses (4 conseillers départementaux et 7 conseillers régionaux).
Les élus municipaux (1 070 réponses) représentent dans leur très grande majorité, comme le montre le graphique ci-après, de petites communes :
- moins de 1 000 habitants : 48% (moins de 500 habitants : 28% ; entre 500 et 999 habitants : 20%)
- plus de 5 000 : 15 % (entre 1 000 et 4 999 habitants : 37% ; moins de 5 000 habitants : 85%).
Les villes de plus de 50 000 habitants représentent, avec 17 réponses, seulement 1,6% des interlocuteurs de la mission d'information ; 5,4% pour les villes de 10 000 à 49 999 habitants (58 réponses).
Élus municipaux : quelle est la taille de votre commune ? (1 070 réponses)
On observe en revanche une réelle dispersion géographique des réponses, illustrée par la carte ci-dessous : si les départements n'ayant pas répondu à la mission d'information sont rares, seuls quatre départements (Bas-Rhin, Pyrénées atlantiques, Saône-et-Loire, Rhône) ont envoyé plus de 30 réponses.
Nombre de répondants par département
I. UNE CONCEPTION EXTENSIVE DE LA NOTION DE SERVICES PUBLICS, ENVISAGÉE DANS UN SPECTRE LARGE
À cet égard un élu observe à juste titre : « Je ne suis pas certain de savoir ce qu'est le service public actuellement et ce qu'attendent les administrés de mon territoire » ; « La notion de services publics est souvent comprise par la population comme un champ qui comprend les banques, les distributeurs de billets, La Poste, les transports publics et privés... ».
Les services publics s'inscrivent ainsi dans un spectre large. Sont mentionnés non seulement les fermetures d'écoles, de trésoreries et d'organismes de protection sociale (CPAM, CAF...), les baisses d'effectifs de gendarmerie, le redéploiement de casernes de pompiers, la réduction de la présence des directions départementales des territoires (DDT) et les limitations des horaires d'ouverture des services publics classiques, jugés incompatibles avec les contraintes professionnelles des usagers, mais aussi :
- les suppressions de bureaux de poste et, de manière générale, la « dégradation du service postal », très fréquemment citée : un élu cite parmi les causes du « sentiment d'abandon » ressenti par certains Français « le manque de présence du facteur, qui discutait avec les gens et créait ce lien social qui disparaît progressivement », concluant que « La rentabilité est l'antithèse du lien social » ;
- les difficultés croissantes en matière d'accès aux soins reviennent régulièrement dans les réponses, les élus pointant aussi bien le fonctionnement des hôpitaux (fermeture, urgences saturées) et des maternités que le manque de professionnels de santé du secteur privé. Un élu dénonce, de manière plus globale, un « accès catastrophique aux organismes sociaux (CPAM, CAF, CARSAT), un accès compliqué aux services préfectoraux, hospitaliers, sociaux et médico-sociaux du département » ;
- la disparition de gares et de guichets SNCF ; la question des transports et les entraves à la mobilité des personnes sont récurrentes dans les réponses : l'insuffisance des transports en commun est très fréquemment citée parmi les causes de l'isolement des territoires, un élu notant une desserte ferroviaire « de plus en plus catastrophique ». Faute de disposer d'une solution de transport autonome ou d'avoir accès à des transports en commun, une distance de 4 kilomètres pour rejoindre une France services représente un réel obstacle pour certains usagers ;
- les fermetures d'agences bancaires et de distributeurs de billets ;
- la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile (attente très longue en cas d'appel, réponse par un robot, etc.) et le manque de sérieux des entreprises chargées du déploiement de la fibre.
II. DES RÉPONSES NUANCÉES À LA QUESTION DE L'ÉVOLUTION DE L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LA PÉRIODE RÉCENTE
Les réponses à la question « l'accès aux services publics s'est-il plutôt amélioré ou dégradé au cours des dernières années ? » sont souvent nuancées et mettent régulièrement en balance les évolutions négatives et les améliorations observées au cours de la période récente dans ce domaine.
1. Une approche positive qui tient à la simplification des démarches et à France service
Lorsque les élus penchent en faveur d'une amélioration de l'accès aux services publics, ils citent toujours les France-services, soit pour déplorer leur absence sur le territoire, soit pour se féliciter de leur existence.
Parmi les facteurs de simplification des démarches, de nombreuses réponses citent la dématérialisation, du moins lorsque les usagers sont correctement équipés et formés au numérique (« Pour les nouvelles générations, ça s'est plutôt amélioré. Nous avons accès à pratiquement tout par voie dématérialisée »). Certains élus jugent ainsi favorablement la prise de rendez-vous en ligne pour effectuer une démarche, par exemple en mairie ou en préfecture.
Dans ce registre positif, un élu estime ainsi que « La technologie actuelle et à venir est une chance à saisir pour améliorer le service et la satisfaction [...] ; paradoxalement elle pourrait permettre de retisser des liens entre le service public et les citoyens. Le numérique, des process sains et bien pensés et l'IA pourraient nous permettre de rendre un meilleur service et de lutter contre la grogne ambiante » ; un autre élu appelle les collectivités à « s'approprier l'IA générative ».
Lorsque les élus sont interrogés sur les initiatives qui ont permis, selon eux, l'amélioration des services publics dont ils ont la responsabilité, ils mentionnent fréquemment la dématérialisation (par exemple, en matière d'inscription et de paiement des activités périscolaire) comme un facteur de progrès (voir infra) : les conséquences de la numérisation diffèrent en effet selon le type de public ou de démarche.
2. Un consensus sur les deux principales causes de dégradation constatées en matière d'accès aux services publics : désengagement de l'État et dématérialisation, à l'origine d'un risque de « précarité relationnelle »
« Quand on ne peut plus mettre un nom et un visage sur un agent du service public, on ne peut guère s'étonner que les termes même de "service public" n'aient plus de sens pour nos administrés. »
Quand les réponses penchent en faveur d'une dégradation de l'accès aux services publics, elles mettent en avant :
- l'« érosion régulière des services publics de proximité », souvent associée à un « désengagement de l'État » dans les territoires ruraux ; à ce propos certains élus affirment être confrontés aux même difficultés que les usagers dans leurs contacts avec les administrations nécessaires à l'exercice de leur mandat (« pas d'interlocuteur à la CAF ou à l'Urssaf, sauf des boîtes vocales ») ; « en particulier avec les services sociaux [...], nous nous heurtons aux mêmes difficultés qu'un usager lambda, avec des interlocuteurs plus rares ») ;
- et la dématérialisation des démarches (« La dématérialisation est une grande souffrance pour nos administrés »), à laquelle sont imputées cause une perte regrettable de contact humain ainsi que des difficultés particulières pour certains usagers.
Dégradation des services publics : des causes multiples
49% des élus (sur 1 051 réponses) imputent les difficultés d'accès aux services publics aux contraintes du territoire (la plupart de ces répondants - 92,6% - viennent de territoires ruraux) 41% au profil des usagers (âge, insuffisance des réseaux et/ou de l'équipement numérique, difficultés à s'approprier les procédures dématérialisées).
Les autres réponses se partagent entre des causes telles que la dématérialisation des services publics, le manque de personnels et les difficultés de recrutement de fonctionnaires et de contractuels, la complexité des dossiers et des normes, l'insuffisance de l'information, des horaires d'ouverture des mairies et des transports en commun, le désengagement de l'État, un accès téléphonique complexe aux services publics, etc. Un élu met en cause le caractère « très inaccessible » tant des préfectures que des conseils départementaux et des EPCI.
Un élu note le lien entre un accès aux services publics jugé « dégradé à certains égard » et le « sentiment d'abandon » ressenti par certains habitants de communes rurales.
« L'accès aux services publics dans notre territoire s'est globalement dégradé au cours des dernières années. Cette dégradation s'explique principalement par l'éloignement progressif de nombreux services publics de proximité, qui ont vu leurs implantations réduites ou supprimées. Parmi les exemples les plus marquants :
La trésorerie : sa fermeture a obligé les usagers à se déplacer beaucoup plus loin pour leurs démarches fiscales ou comptables, ce qui complique l'accès, en particulier pour les personnes âgées ou sans moyen de transport.
La DDT (Direction Départementale des Territoires) : la réduction de sa présence territoriale rend plus difficile le suivi des dossiers d'urbanisme, d'environnement ou d'agriculture, qui nécessitent désormais un accompagnement à distance, moins personnalisé et plus complexe à gérer pour les petites communes.
La Poste : dans de nombreuses communes rurales, les bureaux de poste ont réduit leurs horaires d'ouverture, voire fermé, au profit d'agences postales communales ou de relais en commerces de proximité, avec des services souvent amoindris.
Ces évolutions s'inscrivent dans un mouvement de rationalisation des services de l'État et des grands opérateurs publics, souvent justifié par des objectifs de réduction des coûts, mais qui ont un impact direct sur l'égalité d'accès au service public, notamment en zone rurale ou peu dense. Cela génère un sentiment d'abandon chez de nombreux habitants, accentué par des difficultés d'accès au numérique (zones blanches, maîtrise des outils) alors que de plus en plus de démarches sont désormais dématérialisées. »
La distance qui se creuse ainsi entre l'usager et les services publics est, selon la formule éclairante d'un élu, à l'origine d'une véritable « précarité relationnelle » pour les personnes concernées.
« La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé accentuant un sentiment de déclassement social, non accès aux droits et source d'agressivité »
Un élu souligne par ailleurs les conséquences de ces évolutions sur la démotivation d'agents jugés « à bout de souffle » (« les services publics sont touchés par une certaine lassitude sociale qui impacte le service aux usagers »), dans un contexte marqué par le déclin de l'attractivité de la fonction publique, le manque de reconnaissance à l'égard des agents et le développement des incivilités.
3. Difficultés liées à la dématérialisation des services publics : des causes diverses
Les difficultés liées à la dématérialisation tiennent aux équipements nécessaires (ordinateur et imprimante-scanner, qui pèsent sur le budget de certains usagers ; raccordement à la fibre), aux difficultés liées aux mots de passe et aux connexions incertaines (un élu évoque le « parcours du combattant » pour créer un dossier FranceConnect ; un autre demande « la connexion internet pour tous »). L'exclusion de certains publics est par ailleurs dénoncée :
- la situation des seniors peu familiarisées avec le numérique est récurrente dans les réponses ; un autre élu fait valoir que « le QR code est déjà un obstacle pour beaucoup » ;
- un élu soulève également l'inadaptation des jeunes, très habiles sur leur smartphone mais souvent démunis face à un ordinateur. On note une suggestion consistant à « faire des formations aux lycéens qui vont devoir gérer plus tard soit leurs déclarations d'impôts, leur inscription Ameli, ou toutes demandes d'aides au logement. La formation à ces sites de service doit être enseignée au lycée ».
Un élu municipal exprime par ailleurs une attente forte en matière d'accessibilité, qui concerne « 12 millions de personnes en situation de handicap et 8 millions d'aidants en France ».
De nombreuses réponses soulignent en outre les obstacles considérables auxquels se heurtent les « cas singuliers », les personnes qui « ne rentrent pas dans les cases » des menus déroulants ; pour ces dossiers complexes, le contact humain - guichet ou téléphone - est une nécessité, faute de quoi l'usager se sent « délaissé », « isolé », voire menacé par une forme de « phobie administrative ».
Parmi les services publics dont la dématérialisation augmente la complexité, des élus citent les déclarations d'urbanisme et la délivrance des cartes grises (selon un maire, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) « ne sait pas traiter les cas particuliers [en matière de carte grise] et l'usager, de même que les élus, n'ont accès à aucun interlocuteur physique » : « l'État est défaillant et n'exerce pas l'autorité suffisante sur cette agence »).
Il est déploré que le remplacement des guichets ou du contact téléphonique par des démarches en ligne pèse finalement sur les usagers : « Les Français ont vraiment l'impression qu'ils doivent faire le travail sur internet à la place de leurs interlocuteurs qui ont disparu ».
4. Quelles solutions pour mieux accompagner la dématérialisation ?
Un certain nombre de réponses appellent ainsi, parallèlement à la dématérialisation des services publics :
- au maintien de l'accueil physique des usagers (parfois en accompagnement de la dématérialisation) ainsi que des conseillers numériques ; à l'amélioration de l'accueil téléphonique (notamment par la CAF et la CNAV) ;
- de revenir au papier pour les usagers qui le souhaitent (demandes de CNI, de passeports, de cartes grises et de permis de conduire) : si cette mesure n'est « pas forcément une simplification pour les collectivités, ce serait un retour de service à la population » ;
- à des efforts de simplification des sites publics, incluant le recours au « français de tous les jours » ;
- à la mise en place d'un « numéro national unique pour toute les démarches administratives » à l'attention des personnes « mal à l'aise avec les procédures dématérialisées », les répondants ayant pour instruction « d'orienter les demandeurs vers les services compétents en leur donnant un numéro de téléphone et pas une adresse mail » ; cette « plate-forme nationale avec un accueil téléphonique [permettrait] à l'usager de poser sa question et être dirigé vers les bons interlocuteurs qui peuvent accompagner sa démarche ».
5. Des élus engagés contre la fracture numérique
Nombre d'élus témoignent de leur engagement pour accompagner les usagers menacés par la fracture numérique :
Le déploiement de conseillers numériques, à l'initiative de communes ou d'intercommunalités, souligne l'engagement des élus contre la fracture numérique. Ainsi, les trois conseillers numériques déployés par la Communauté urbaine d'Arras « interviennent lors d'ateliers thématiques, d'ateliers libres (pour revoir certaines notions à la demande des usagers) et d'entretiens spécifiques (accompagnement aux démarches individuelles) » : « en 2024, 415 ateliers se sont déroulés au sein de 20 communes et 1 955 personnes ont assisté à ceux-ci ».
En revanche, un élu déplore le manque de suivi d'ateliers numériques organisés par la commune pour former les usagers : « Ma commune a mis en place l'an passé, chaque semaine, un atelier du numérique gratuit [...] mais seulement une dizaine de personnes se sont inscrites. Que faire ? » ; un autre répondant note « le manque d'envie [de certains usagers] de s'intéresser ou progresser dans les outils numériques ».
6. Les compétences des maires en question : « la mairie devient un bureau de renseignement »
L'un d'eux déplore la disparition des compétences des communes sur les sujets pour lesquels l'EPCI a pris l'ascendant (cas d'un PLUI). Dans le même esprit, un autre répondant observe que « Les habitants des zones rurales ont un sentiment d'abandon de la part de l'État. Ils se tournent vers les mairies qui perdent progressivement leurs compétences au profit des intercommunalités dont les services paraissent, parfois, bien loin des préoccupations des habitants ».
Ainsi, face à ce mouvement de centralisation par les EPCI, « la mairie [...] devient un bureau de renseignement ». Dans cette logique, un élu relève que « les cartes d'identité se font ailleurs, les passeports également, et même le recensement se fait sans contact avec un élu ».
La complexité de l'articulation des compétences (« qui fait quoi ? »), en lien avec le « mille-feuilles administratif », conduit certains usagers à s'adresser systématiquement à la mairie, considérant que celle-ci est « à leur disposition », aggravant ainsi le malaise des maires confrontées à des comportements inciviques (« La numérisation, et le non remplacement de fonctionnaires, ont aussi contribué à creuser le fossé entre les usagers et les services publics, pas seulement pour les séniors ou les personnes aux ressources modestes. Les usagers se tournent vers les mairies qui n'ont pas forcément les connaissances ou les moyens de répondre. Du coup, les usagers sont plus agressifs, ils ont le sentiment de ne pas être entendus, compris et d'être des laissés pour compte ! »).
III. UN JUGEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE SUR LE FONCTIONNEMENT DES FRANCE SERVICES, MALGRÉ LA RÉAFFIRMATION DU RÔLE DÉCISIF DES MAIRIES DANS L'ACCUEIL DES USAGERS
« En l'état actuel, il est impossible d'améliorer l'accès des administrés aux services publics locaux sauf de multiplier les structures France services. »
1. Les France services : un progrès qui « remet de l'humain » dans le contact avec les administrations
Les France services sont quasi-unanimement considérées comme un progrès, plus précisément « parce qu'elles remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». L'absence de France services dans une commune est généralement déplorée par les répondants qui appellent à une extension du dispositif sur le territoire (« Il n'y a pas assez de structures France services » ; « Les structures sont bien, mais il en faudrait bien plus » ; « Il y aurait intérêt à ce que des permanences aient lieu dans chaque commune, au plus près des gens ».
Les commentaires sont régulièrement élogieux (« très bon fonctionnement » ; « une grande réussite » ; « de bons retours » ; « services de très bonne qualité » ; « la satisfaction des usagers fait plaisir à voir »).
De nombreux répondants appellent ainsi au déploiement des Frances services dans les communes non dotées et au développement de solutions itinérantes.
La qualité et l'implication des agents sont régulièrement mentionnées : « Nous devons cette qualité de service avant tout à l'équipe en place, particulièrement dynamique et engagée, qui connaît bien le territoire et ses enjeux. Leur capacité d'écoute, leur disponibilité et leur réactivité font la force de France services sur notre secteur ».
Parmi les bonnes pratiques locales, un élu évoque la présence, dans le même local, d'un conseiller numérique, d'une cyberbase, d'un espace emploi-formation et d'un Point info senior. Un autre note les permanences appréciables que certains services publics (« impôts, CAF, La Poste notamment ») viennent tenir dans les locaux France services. D'autres collectivités mettent en place de partenariats « au-delà des services publics » : « assistante sociale, UDAF, psychologue, réflexologue, Mission Locale, agence d'insertion ». On note également l'organisation, par des collectivités, d'« expositions d'artistes locaux dans les murs de la structure » pour renforcer la notoriété de France services.
Dans une logique d'« aller-vers », la Communauté urbaine d'Arras a mis à l'étude, dans le cadre de la recherche de partenariats locaux, une action entre une France services et la Maison de l'emploi et des métiers « pour faciliter le parcours des demandeurs d'emplois ».
2. Un bémol : des structures rendues nécessaires par le désengagement de l'État dans les territoires
- Selon certains élus, si les France services ont amélioré l'accès aux services publics, cette évolution n'a permis qu'un rattrapage partiel de la situation antérieure aux vagues de fermeture des services publics.
- Dans cet esprit, le succès des France services est surtout le reflet du manque de services publics de proximité : « l'affluence importante et grandissante témoigne du besoin absolu qu'ont les citoyens d'avoir des structures locales et humaines. La fracture numérique doit être compensée et les services publics de proximité rétablis ».
- Le déploiement des France services, porté par les collectivités territoriales, est présenté de manière récurrente une conséquence du désengagement de l'État (les France services seraient un « cache misère », un « palliatif à la carence d'état dans les territoires » ; « les maisons France service sont l'affirmation, la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État »).
- Le dispositif pèse sur les finances des collectivités territoriales (40 000 euros par an selon un élu ; 120 000 euros pour une commune porteuse de deux structures, l'une mobile et l'autre en QPV) : « l'État reporte sur les municipalités la charge de ces structures qui sont cependant fort utiles » ; « Des services bien rendus mais portés à bout de bras par l'interco alors que l'État fait croire qu'il est le financeur de ce service » ; un élu exprime des doutes sur la « multiplication des agences en cette période d'économies budgétaires ». L'appel à renforcer le financement des France services par l'État est récurrent.
3. Les limites du dispositif
Certains élus expriment des réserves à l'égard des France services :
- La faiblesse des effectifs peut rendre le service « fragile puisqu'il arrive régulièrement que le lieu soit fermé pour cause de maladie ».
- Les France services ne répondent qu'à des besoins « basiques » et font aux usagers des réponses « trop souvent incomplètes » car « les agents n'ont pas forcément des formations aussi pointues que les services concernés ».
- Des réponses regrettent un « lien complexe avec certaines administrations », qui limite l'efficacité des interventions des personnels ;
- on note quelques remarques sur l'insuffisante confidentialité garantie aux usagers :
- Si certains témoignages font état d'un « engorgement » des structures France service en raison d'un afflux de demandes, ce qui souligne selon eux l'urgence de « renforts », les France services sont fréquemment jugées trop mal identifiées par les usagers : un élu observe le contraste entre un taux de satisfaction de 98 % et la faible notoriété des France services (connues par 36% des usagers potentiels). Ce point constitue une vraie limite à leur efficacité et plaide pour un effort accru en termes de communication. Ainsi, selon la Communauté urbaine d'Arras, malgré un taux de satisfaction élevé, « un travail important de communication reste à mener auprès du grand public afin de faire connaître les différentes antennes. En effet, les résultats du "baromètre du non-recours", réalisé en fin d'année 2024, montrent que seuls 4% des répondants déclarent fréquenter une Maison France services pour réaliser des démarches administratives ».
- Certains élus assument par ailleurs d'ignorer l'existence des Frances services (« Je n'en avais même pas entendu parler » ; d'après d'autres témoignages les horaires d'ouverture indiqués en ligne, parfois erronés, constituent une vraie difficulté pour les usagers qui doivent parcourir des distances importantes pour se rendre dans une France services.
- Par-delà une ouverture au public jugée insuffisante (« seulement deux journées par semaine », les horaires devraient, selon certaines réponses, mieux s'adapter aux usagers actifs en ouvrant parfois le soir et le samedi matin ; un élu pointe des « horaires sans lien avec le monde rural » ; d'autres réponses font toutefois état d'une amplitude horaire appréciable (« de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h ») ; on note également une remarque sur des « rendez-vous trop souvent espacés de plusieurs semaines, ce qui ne permet pas forcément un suivi toujours efficace » ;
- On note par ailleurs l'expression de doutes sur la qualité des services offerts aux usagers, en raison d'une formation insuffisante des conseillers, voire d'un « manque de compétence ou d'expertise » de ceux-ci ;
- Les distances à parcourir pour accéder aux France services sont régulièrement déplorées : de nombreuses réponses observent que les structures France services sont implantées dans les communes principales des EPCI, aggravant la situation des « personnes en déficit de mobilité », et au premier chef des personnes âgées (distance à parcourir : jusqu'à 30 km). Un élu évoque à cet égard la mise en place d'un « service de taxi à la demande » organisé par son intercommunalité. Un répondant alerte sur les conséquences possibles, dans les ZFE, de cette implantation. Dans ce contexte, les formules itinérantes parfois proposées aux habitants des petites communes sont unanimement saluées, même si certains élus regrettent la rareté des passages (le rythme d'une matinée par mois est considéré comme insuffisant compte tenu de la demande ; on note l'expression récurrente d'une demande d'amplification de ces solutions mobiles) ; un élu observe que, en raison de l'éloignement de la France services la plus proche, « c'est la secrétaire de mairie qui, déjà débordée, doit répondre à toutes les demandes, sans compensation financière de l'État ». Une autre réponse appelle à la mise en place de de rendez-vous à domicile pour résoudre la question de la distance ;
- On observe, sauf rares exceptions, des réserves sur les France services implantées dans les locaux de La Poste (« un pis-aller ») : sont allégués les « horaires trop restreints de La Poste », l'absence d'espace de confidentialité et un accompagnement des usagers jugé perfectible ; un élu suggère l'implantation des France services dans les mairies « pour vraiment apporter la réponse aux besoins des administrés ».
Les deux témoignages ci-dessous résument clairement les avancées permises par les France services et les défis de l'avenir du dispositif :
« La structure France services de notre Intercommunalité est devenue LA structure indispensable. Des agents compétents, efficaces, qui peuvent rendre des services très importants à la population. Mais ce bus n'est présent que deux fois par mois dans notre commune. Les agents sont très sollicités, énormément de dossiers, de plus en plus complexes. Ils se substituent complétement aux agents de l'état dans leurs propres structures, qui ne remplissent pas ce rôle d'aide et de prise en charge des difficultés sur les dossiers difficiles à remplir par les administrés. (CAF, Caisses de Retraite, MDPH, Banques, RSA...). Dans les milieux ruraux, ils sont devenus indispensables mais trop peu nombreux. »
***
« Le fonctionnement des structures France services sur notre territoire constitue une avancée intéressante, mais reste une réponse partielle face à la perte progressive des services publics en zone rurale.
Les maisons France services ont été pensées comme des supplétifs destinés à compenser les fermetures de guichets physiques (Trésoreries, DDT, CAF, CPAM, etc.). Elles offrent un accueil de proximité, souvent apprécié, avec du personnel formé pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien.
Cependant, plusieurs limites persistent :
Localisation : ces structures restent encore éloignées pour certains habitants, notamment dans les communes rurales enclavées. Les formules itinérantes, lorsqu'elles existent, sont une piste prometteuse mais encore trop rares ou peu fréquentes.
Horaires : les amplitudes horaires peuvent être insuffisantes, avec des permanences limitées qui ne couvrent pas toujours les besoins des usagers actifs ou peu disponibles.
Panel de services : même si l'offre couvre un socle commun (impôts, santé, emploi, retraite, etc.), elle ne permet pas de traiter tous les dossiers en profondeur. L'accompagnement est souvent généraliste, et de nombreux cas nécessitent encore l'intervention d'un service spécialisé, parfois situé loin et difficilement joignable.
Le financement des maisons France services repose en grande partie sur un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Si l'État impulse le dispositif, il en délègue largement la mise en oeuvre et la charge financière aux intercommunalités ou aux communes, qui doivent assurer l'accueil, le personnel et les moyens logistiques. Cela peut poser des problèmes de soutenabilité financière, notamment dans les territoires ruraux aux ressources limitées, et contribuer à un sentiment d'injonction descendante sans moyens suffisants.
Concernant les synergies avec les services publics locaux, quelques coopérations ont vu le jour, notamment avec les communes pour l'hébergement des permanences ou la diffusion d'informations, mais ces démarches pourraient être renforcées et mieux structurées à l'échelle intercommunale ou départementale.
En résumé, les maisons France services jouent un rôle utile mais complémentaire, et ne sauraient se substituer entièrement à une présence plus forte et directe des services publics sur le territoire. Leur montée en puissance est souhaitable, à condition d'en élargir l'accessibilité, les moyens et les partenariats locaux, et de mieux équilibrer la charge entre l'État et les collectivités. »
4. La question du panier de services : pour ou contre son extension ?
- Certains répondants plaident pour une extension du panier de services. Ainsi, en matière de finances publiques, un élu déplore que le panel se limite à l'impôt sur le revenu (« pour les questions relatives aux droits d'enregistrement ou aux successions, les usagers sont renvoyés sur le réseau DGFiP, dont les horaires de réception sont dorénavant limités à quelques demi-journées par semaine »).
- D'autres, à l'inverse, alertent sur le risque lié à un élargissement excessif du panier de services, qui peut nuire à l'efficacité des agents : « En ouvrant le champ des missions données, les agents ont perdus en spécialisation et donc en qualité de réponse apportée aux usagers » ; « l'éventail excessif de leur champ d'intervention et la limite humaine de leurs compétences les conduit inexorablement à rester dans le superficiel ». Des doutes sur la possibilité de maintenir une qualité de service équivalente avec l'extension de l'offre de services sont fréquemment exprimés (« Le panel des services est satisfaisant, son extension s'opposerait au maintien des compétences requises des agents »).
- Certaines réponses traduisent des interrogations sur l'extension du panier à Ma Prime Rénov, qui « ne répond pas au rôle premier de France services : les questions sur Ma Prime Rénov sont avant tout techniques, alors que France services vient en aide aux personnes bloquées informatiquement [...] ou pour lesquelles la demande n'avance pas et le service est injoignable ».
5. Une conviction partagée : « les mairies sont depuis longtemps un France services avant l'heure ! »
Considérant que la mairie demeure « le premier service public de proximité », certains élus font valoir que les usagers s'adressent d'abord à leur mairie, où ils sont orientés si nécessaire vers France services : « c'est la mairie qui est vraiment la porte d'entrée » ; « la mairie reste le premier service public de France ! Aussi, du fait de l'éloignement d'un certain nombre de services publics, les mairies jouent le rôle d'amortisseur en apportant des réponses à des personnes ne sachant vers qui se tourner » ; « les mairies sont depuis longtemps un France services bien avant l'heure ! » ; « les usagers préfèrent venir en mairie où ils connaissent la personne qui les renseigne ».
Dans cette logique, certains élus appellent à l'organisation de permanences France services « dans chaque mairie une fois par semaine ».
Selon cette approche, les avantages que présentent les mairies par rapport à France services tiennent à leur polyvalence : « Il est temps de mesurer l'efficacité des maisons France services. Le coût à la personne est très élevé. Il serait plus efficient que ces demandes soient directement faites en mairie [...]. L'avantage est que les personnes qui viennent demander de l'aide pour remplir un formulaire ont très souvent d'autres problèmes sociaux à régler. Ces personnes peuvent être mises en relation avec les adjoints chargés du social qui les aiguillent parfaitement : CCAS, banque alimentaire, assistante Sociale... ».
Un élu souligne en outre l'intérêt des CCAS en matière d'aide aux démarches et se félicite de l'« implication des élus des CCAS, [qui] peuvent aider à orienter les administrés vers le bon interlocuteur » ; « Les élus et le CCAS s'investissent pour accompagner les usagers pour les demandes d'aide sociale ou pour d'autres démarches comme les déclarations de revenus, les demandes de pension ou de pension de réversion, les inscriptions en EHPAD... ».
IV. UN ENGAGEMENT PARTAGÉ POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Les témoignages adressés à la mission d'information traduisent un engagement réel des élus pour « répondre au mieux aux besoins des usagers » et leur volonté « de répondre de manière plus directe et humaine aux besoins de la population, malgré les contraintes croissantes en matière de moyens et de compétences ».
Les initiatives et bonnes pratiques qu'ils partagent avec la mission d'information sont souvent très concrètes.
1. Des initiatives destinées à perfectionner les services publics locaux
Les élus témoignent d'un réel dynamisme en la matière :
- dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance, on note diverses initiatives (ouverture d'écoles, de centres de loisirs, de haltes garderies, de restaurants scolaires, de crèches ou micro-crèches, d'un « foyer de vie pour personnes en situation de handicap », mise en place de structures d'accueil en temps périscolaire, développement de l'aide aux devoirs) ;
- en matière de transition écologique, on note la création d'un « service éco-habitat qui propose gratuitement un diagnostic pour les habitants voulant améliorer leur consommation énergétique avec des solutions et un accompagnement sur leur projet » ;
- dans le domaine de la santé, les initiatives sont importantes : création d'un « service municipal de santé avec quatre médecins salariés par la commune et trois assistantes à 80 % » ; projet d'un « pôle santé associant le Centre municipal de santé et une structure libérale dans le même bâtiment, favorisant le "mieux travailler ensemble" entre public et privé » « prise en charge du transport pour les visites chez les médecins, lorsque l'administré n'a pas d'autre solution » ;
- à l'égard des personnes âgées, on note des initiatives concernant le financement de véhicules de fonction pour les aides à domicile ou le « portage de repas aux aînés ».
2. Bonnes pratiques pour améliorer l'accès aux services publics locaux
Les témoignages adressés à la mission d'information font état d'initiatives telles que :
- l'adaptation des horaires d'ouverture des services administratifs de la mairie (« nocturne le mercredi jusqu'à 19h » ; « tous les matins sauf le dimanche ») ;
- des efforts en matière de « contact et explication en mairie » ; l'aménagement d'une permanence « dans une partie éloignée de la commune » ;
- le renforcement des moyens du CCAS ; « cantine à un euro » ; « aide aux démarches pour les seniors » ;
- la création d'une maison des services « où seront regroupés 15 structures directement liées aux services à la population (CAF, CARSAT, CCAS, associations caritatives... ») et d'une « Maison des solidarités, en lien avec l'ensemble des institutions traitant des questions sociales » ;
- un projet de « numéro vert » pour « compléter et fluidifier la réponse aux habitants [...] et s'assurer qu'une réponse est systématiquement apportée » ;
- la création d'une adresse mail dédiée à l'urbanisme ;
- en matière d'« aller-vers », le « déplacement de l'agent au domicile des personnes », destiné aux personnes âgées et handicapées.
Certains répondants font valoir, à l'attention des structures France service, la mise à disposition de locaux et de solutions itinérantes. La Métropole de Lyon a par ailleurs développé des actions d'« aller vers » (bus itinérant) : « en 2024, 201 actions d'"aller-vers" ont été menées auprès de 137 structures (157 actions et 1721 personnes reçues) ».
Enfin, le recrutement de nouveaux agents revient régulièrement : conseillers numériques, parfois mutualisés avec une commune voisine ; augmentation des effectifs du CCAS ; création de postes dédiés à l'urbanisme (ou « embauche d'un urbaniste ») ; prise en charge du recours à une traductrice de langue des signes pour les réunions en mairie ou à l'école.
On observe en outre le recours à des prestataires privés (« La délégation à des prestataires privés a notamment facilité l'accès aux cartes grises sur le territoire », pour un coût jugé « correct ».
3. La dématérialisation, gage d'un accès élargi aux des services publics locaux
La dématérialisation des services publics locaux revient régulièrement parmi les témoignages d'élus, signe de l'ambivalence du numérique, à la fois condition de la simplification des services publics (« la dématérialisation est une bonne chose pour les services municipaux » ; la digitalisation de l'accès aux services publics « a aidé au développement de collectivités en milieu rural en permettant un temps de réponse réduit et une accessibilité facilitée ») et de la dégradation de l'accès de l'usager à ces services.
L'urbanisme illustre cette ambivalence : un répondant estime que la dématérialisation vise à « simplifier l'instruction des demandes d'urbanisme », d'autres estiment que « les administrés n'adhèrent pas toujours [à la dématérialisation de l'urbanisme », que « la dématérialisation des demandes d'urbanisme est trop compliquée pour les petits dossiers des particuliers », et que « c'est probablement [la dématérialisation de] l'urbanisme qui pose le plus de questions. Le virage de la dématérialisation s'est assez bien passé, mais pour les personnes qui ne peuvent le faire on prend toujours les dossiers papier ».
On observe donc l'absence d'unanimité à l'égard de la dématérialisation de l'urbanisme, certains élus critiquant pour leur part la persistance des documents papier, cause de « doublons », et appelant l'« arrêt des dossiers papier afin de développer la numérisation des dossiers ».
La dématérialisation de la gestion du périscolaire est souvent mentionnée (inscription et paiement à distance : « mise en place d'un portail des familles pour les réservations de cantines et garderies et paiement en ligne ») ; guichet unique en ligne en matière de périscolaire ou de restauration scolaire pour que les familles utilisent le même portail « quel que soit le gestionnaire [...], que ce soit la commune ou l'intercommunalité ».
La prise en rendez-vous dématérialisée, parfois commune à plusieurs municipalités, est fréquemment citée ; elle permet un « gain de temps lors du passage en mairie ».
Dans le sillage d'efforts relatifs à la dématérialisation des services publics locaux, des élus mentionnent le développement d'outils numériques, parfois mutualisés avec d'autres communes : mise en place de logiciels destinés à la gestion des cimetières (on note la mise en place d'un « QR code aux entrées de chaque cimetière ») ; d'autres répondants font état de la mise à disposition à la mairie d'un ordinateur et d'une connexion internet pour faciliter les démarches des habitants. Certains demandent la création d'une aide aux petites communes pour créer leur site web.
4. Des élus soucieux d'atténuer les effets de la dématérialisation pour certains publics
Certains élus considèrent que le recrutement d'écrivains publics ou d'« accompagnateurs polyvalents pour aider les gens à rédiger leurs dossiers » serait une solution pour mettre « de l'humain au service des plus démunis sociaux et cognitifs ».
On note par ailleurs des initiatives visant à :
- maintenir l'accueil physique des usagers : un élu relève l'ouverture du service de l'urbanisme « tous les matins sans rendez-vous » ainsi que, en cas de refus, un appel systématique du demandeur par l'agent « pour expliquer le motif de refus et proposer une solution ou une modification du projet » ; le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques ») ; on note également la mise en place, dans une collectivité, d'un « accompagnement des administrés en difficultés » ; parmi les initiatives ainsi déployées on peut citer la formation des agents « pour améliorer l'accueil et l'écoute », la mobilisation du « personnel de l'accueil [qui] accompagne, explique et peut aider les personnes qui viennent » ainsi que la mise en place d'une « aide aux démarches administratives » (un élu évoque l'intérêt que présenteraient des écrivains publics dans ce domaine) ;
- accompagner les usagers dans leurs démarches numériques : mise en place d'une formation à l'utilisation du « portail des familles » pour les parents au moment de la rentrée scolaire « pour expliquer comment faire les démarches » ; un élu fait état de l'engagement personnel du maire, qui « réalise les démarches des administrés depuis l'ordinateur de la mairie (demandes de cartes d'identité...) » ; un autre témoignage souligne l'importance, parallèlement au démarches en ligne depuis le site de la mairie, de ménager des rendez-vous pour les usagers ayant besoin d'aide (« Les échanges en présentiel permettent souvent de rassurer les usagers. Le fait d'être face à un interlocuteur "bien réel" y participe grandement. Il remet l'usager au centre des préoccupations du service public ».
Ainsi, la Métropole de Lyon témoigne du développement d'une « offre d'assistance numérique » pour « mieux accompagner les publics en situation de fragilité numérique » (trois services : orientation vers des espaces de médiation numérique, prise de rendez-vous avec des conseillers numériques et possibilité de contacter par téléphone des médiateurs numériques). En 2024, la hotline a ainsi enregistré 2 200 appels, avec un taux de satisfaction de 94% : « parmi les appelants, 30% sont des personnes sans emploi et bénéficiaires de minima sociaux, et environ 30% sont des seniors âgés de 70 ans et plus ».
5. Initiatives destinées à faciliter l'accès aux droits
Parmi les témoignages soulignant l'engagement des élus en faveur de l'accès aux droits, on relève plus particulièrement :
- l'intérêt, pour la Métropole de Lyon, de la création d'« espaces multi-services, rassemblant les différents acteurs intervenant sur le champ de l'accès aux droits dans un même espace » et note le bilan très positif de « réunions d'information et d'orientation à destination des bénéficiaires du RSA, rassemblant plusieurs acteurs de l'accès aux droits (CAF, CPAM, associations, etc.) » ;
- le souhait de la Communauté urbaine d'Arras de « garantir un équilibre territorial en matière d'accès aux droits et d'offre de services » : l'expérimentation « Territoire Zéro Non-Recours » sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Arras, intégrée à la convention territoriale globale (CTG), vise à « réduire le taux de non-recours aux droits et aides sociales en facilitant la transversalité entre les acteurs de l'action sociale et de la solidarité, le repérage des publics en situation de « non-recours » (par la mise en place d'actions "d'aller-vers" et de "faire avec"), en renforçant l'interconnaissance des professionnels des dispositifs d'aide sociale et de solidarité afin de mieux accompagner et orienter les usagers ». Un « baromètre du non-recours » a été établi avec l'Observatoire du non-recours aux droits et services dans le cadre de cette expérimentation.
Le baromètre du non-recours (enquête conduite en 2024 par la Communauté urbaine d'Arras)
« Le sujet de l'accès aux services publics est une des thématiques abordées dans un "baromètre du non-recours" aux droits sociaux diffusé sur le territoire communautaire et construit avec les partenaires communautaires de l'action sociale et de la solidarité (CAF, MSA, CPAM, France Travail, Département du Pas-de-Calais, centres sociaux, CCAS, bailleurs sociaux et structures associatives et d'intérêt communautaire) et l'Observatoire du non-recours aux droits et Services rattaché à l'Université de Grenoble.
Ce baromètre, déployé en fin d'année 2024, a permis de recueillir 2 600 réponses.
Les résultats indiquent que :
- 23% des répondants mobilisent les organismes de sécurité sociale et le service public de l'emploi (France Travail) pour accéder à leurs droits ou disposer d'informations en matière de prestations sociales ;
- 21% s'orientent plutôt vers les services de proximité des collectivités (Mairies, CCAS, Centres sociaux et services sociaux du Département) ;
- 4% mobilisent le réseau des "Maison France Services".
Les usagers utilisent donc différents canaux pour accéder aux services publics, mais l'outil principalement utilisé reste internet pour s'informer et contacter les services publics (64% s'informent sur internet et 57% contactent les administrations par internet). Globalement, les usagers sont à l'aise avec les démarches en ligne.
Pour autant 38% des répondants déclarent rencontrer des difficultés pour réaliser des démarches administratives. Pour les publics les plus fragiles, la complexité des démarches pour accéder à un droit et la dématérialisation constituent les freins principaux.
12% des répondants considèrent que la fermeture d'accueils administratifs a eu un impact sur leurs droits et prestations.
L'éloignement des services publics des institutions qui délivrent des prestations sociales s'explique principalement par la réorganisation des modes d'accueils au profit de la dématérialisation des démarches.
Le "baromètre du non-recours" a permis d'identifier des difficultés dissemblables en fonction des profils. Ainsi, les publics en zone rurale du territoire sont plutôt des personnes âgées qui peuvent se trouver en situation d'illectronisme et souhaitent être accompagnées dans leurs démarches. Les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont eux exposés aux difficultés d'accès aux services publics numériques car ces personnes ne disposent pas des outils adaptés pour réaliser leurs démarches (ordinateur, scanner, imprimante, etc.). Les difficultés rencontrées par les habitants pour accéder aux services publics génèrent ainsi des situations de non-recours aux droits sociaux pour 16% des répondants. »
Toutefois, un élu observe que les initiatives de sa commune pour développer les services au public (agence postale, France Service, conseiller numérique, secrétariat de mairie représentant 2,5 ETP, médiathèque) représentent un coût élevé pour la collectivité alors-même que « les subventions ne perdurent pas et les dotations ne couvent pas toutes les dépenses, d'autant plus que ces services servent à d'autres collectivités [...], sans aucun frais pour ces municipalités ». La question de moyens des collectivités est en effet un thème récurrent des témoignages adressés à la mission d'information.
De même, les exigences de certains citoyens sont soulignées : un élu déplore que les usagers « attendent beaucoup de services municipaux alors qu'ils ne payent plus du tout d'impôt local depuis la suppression de la taxe d'habitation ». Il considère que les citoyens devraient être informés de « ce que coûte chaque service public "individuel" au regard de ce que chacun paye en taxes locales et impôts » ; « Depuis plusieurs années, les habitants sont très exigeants, demandent des services dont certains sont mis en place mais qu'ils n'utilisent pas ou très peu : beaucoup de mauvaise foi ».
V. UN APPEL À LA SIMPLIFICATION DE L'ACTION DES COLLECTIVITÉS
Pour simplifier l'action des collectivités et faciliter l'accès des usagers aux services publics locaux, les répondants esquissent diverses pistes.
1. Les interrogations sur le millefeuille administratif et la question de compétences des communes
De nombreux élus regrettent la disparition (voire la « destruction ») des compétences des petites communes (« le maire n'a plus grand-chose à dire » ; « plus rien ne se fait dans notre mairie »), parallèlement à la montée en puissance des intercommunalités (« ma collectivité a été dépouillée de ses services publics au profit de la comcom qui est à 30 minutes en voiture »).
« Nos petites mairies ressemblent à des boîtes aux lettres. Les habitants le regrettent, nous perdons au fil de l'eau notre âme de service public de proximité et il nous est bien difficile de maintenir notre lien avec les habitants. Aujourd'hui, ils viennent chercher les sacs de tri sélectif et font leurs démarchent administratives chez eux. »
Ils appellent à revenir sur les inconvénients, pour l'usager, du « millefeuille administratif » et souhaitent que soit modifiée l'articulation des compétences entre collectivités, de manière à « redonner des compétences aux communes versus les EPCI et l'État » dans une logique de « vraie subsidiarité, alors qu'on fait l'inverse depuis des années ». Ce « modèle hybride, flou et coûteux [...] nous épuise », selon un élu. Un répondant estime qu'il « il entraîne de facto un coût supplémentaire et du travail supplémentaire pour les services et les élus » ; dans le même esprit, un élu appelle à la « clarification de qui fait quoi entre la mairie et la communauté de communes », « car il arrive que plusieurs collectivités traitent du même sujet ».
Il importe ainsi, selon cette approche, de renforcer la « lisibilité des compétences entre les différents niveaux de collectivités, pour éviter les aller-retours inutiles des usagers et permettre aux élus de terrain de mieux les orienter », car « la complexité administrative freine souvent la réactivité [des collectivités] ».
Un élu plaide pour la suppression des EPCI et des PETR « qui ne servent à rien (sinon à créer des frais supplémentaires » et se prononce en faveur des « anciens syndicats à géométrie variable selon les sujets et les nécessités locales ».
Certains revendiquent en outre le rétablissement des compétences communales en matière de délivrance des cartes d'identité (on note également la demande d'un élu en faveur des compétences communales en matière de permis de conduire et de carte grise).
À l'inverse, le témoignage ci-après souligne l'intérêt, pour les usagers, d'une bonne coordination entre communes et intercommunalités : « Dans notre commune, la plupart des demandes liées aux services publics sont redirigées vers les services compétents de l'intercommunalité, dans une logique de coordination et de répartition des missions. Cependant, la commune a su renforcer sa proximité avec les administrés par la mise en place de dispositifs concrets : permanence numérique pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne, notamment pour lutter contre l'exclusion numérique ; agence postale communale assurant un service de proximité essentiel, en particulier pour les personnes âgées ou peu mobiles ; [...] de nombreuses permanences thématiques ont été organisées en lien avec l'intercommunalité (impôts, accès aux droits, accompagnement social, etc.), dans une logique de guichet unique ponctuel. Ces actions sont rendues possibles par une bonne coordination entre les niveaux de collectivités, mais aussi par l'implication des agents municipaux, formés pour orienter efficacement les usagers et maintenir un lien de confiance. Parmi les bonnes pratiques à partager : l'identification claire des interlocuteurs dans chaque domaine, pour fluidifier les réorientations ; le calendrier partagé de permanences, diffusé largement (affichage, réseaux, bulletins communaux) ; et surtout, la volonté politique locale de ne jamais laisser un administré sans réponse, même si la commune n'est pas directement compétente. »
2. Une nécessaire simplification de l'action des collectivités
Des élus suggèrent, afin de « simplifier l'action des collectivités » :
- d'agir sur les procédures, « souvent trop lourdes et chronophages », qui s'imposent à elles par exemple dans le cadre des appels à projets ou des demandes de subvention (« une meilleure lisibilité des dispositifs permettrait de gagner en efficacité ») et de soutenir davantage les petites communes (« moyens humains, aide au montage de projets, accompagnement technique ») ; le renforcement de l'ingénierie locale est régulièrement cité pour permettre aux « petites communes rurales d'être plus proactives dans le portage de projets et l'accueil de services » ;
- de promouvoir un « vrai choc de simplification en termes d'urbanisme » : « nous avons des habitants qui ne font pas les travaux [faute d'être] en capacité de faire la déclaration préalable » ;
- de renforcer l'ergonomie des outils numériques destinés aux services publics locaux : un élu observe que « la multiplication des plateformes (urbanisme, état-civil, démarches sociales, etc.) génère de la confusion chez les usagers comme chez les agents » ; un élu appelle à « un marché public de grande envergure tant pour nos logiciels que nos messageries » ; une autre réponse plaide pour la mise à disposition des communes de « logiciels adéquats et efficaces », déplorant qu'en la matière les communes soient obligées de « passer par des acteurs privés où les API (interfaces de programmation d'application) sont compliquées à mettre en place » ;
- de mettre en oeuvre un travail de simplification en matière de normes et de procédures : un élu se prononce ainsi pour les cinq axes d'efforts suivants :
« 1 - Diminuer et simplifier les normes autant que possible, ne garder que celles qui sont essentielles
2 - Diminuer au maximum la taille des formulaires
3 - Expliquer clairement et simplement les choses. Des habitants ne comprennent pas le langage de l'administration
4 - Diminuer au maximum le nombre de services et institutions publics pour que le citoyen ne soit pas sans cesse ré-aiguillé
5 - Créer des passerelles entre ces institutions. »
Enfin, des élus recommandent d'organiser régulièrement des consultations citoyennes « pour recueillir l'avis [des usagers] et leurs suggestions sur l'amélioration des services publics ».
3. Une meilleure coordination des services publics nationaux et locaux, qui « fonctionnent en silo »
Un élu appelle les différents acteurs des services publics à travailler dans une logique de « transversalité » pour mieux orienter et informer le public : « Actuellement, les principaux services publics fonctionnent en silo », ce qui implique pour l'usager de « savoir vers qui s'orienter pour trouver la bonne information [...] pour accéder à un droit ou une prestation. Cette approche amène souvent à un allongement des démarches et une insatisfaction de la part des usagers. »
Certains répondants reconnaissent des défaillances de l'administration locale, qu'il s'agisse d'une insuffisante coordination des élus (« le manque d'information des élus sur les projets en cours de la commune est une source récurrente de mécontentement » : « La mutualisation des compétences des élus sur les questions de sécurité, prévention, intervention devrait être une évidence ») ; ou d'une insuffisante disponibilité des services publics municipaux (« la mairie de ma ville est désormais fermée l'après-midi pour améliorer le service ! »).
Un témoignage souligne une certaine inertie, quand l'administration tarde à répondre à certaines questions des habitants ou des associations : la question « est transmise à la DG qui la transmet au maire ou/et agents et élus. Ensuite c'est discuté en conseil d'adjoints. Ensuite c'est discuté en commission. Ensuite c'est revu en conseil d'adjoints et au final peut être en conseil municipal. Et là la personne a une réponse. Quand je vois ce qui se passe dans une mairie, je me dis qu'au niveau de l'État cela ne doit pas être facile ». Un répondant suggère d'ailleurs de « Conditionner une part des subventions DETR à la qualité des services publics et à la certification des services publics avec le label "Services Publics +" ».
Dans un registre plus technique, un élu pointe une certaine responsabilité des collectivités en matière de qualité des services publics gérés par les collectivités territoriales, regrettant qu'elles « n'aient pas standardisé les logiciels de gestion comptable, état-civil, urbanisme etc. Tous nos partenaires n'ont même pas la possibilité de recevoir par mail nos pièces jointes, dont le trésor public ».
Certains élus appellent à un effort pour améliorer l'interface :
- entre les collectivités et les services publics de l'État, « avec des interlocuteurs facilement identifiables et joignables » (« un agent de l'État qui réponde de en cas de besoin »). L'objectif est non seulement que ces référents sécurisent les collectivités dans la conduite de leurs projets (des élus expriment le besoin d'« un interlocuteur qui pré-valide la pertinence des projets de la collectivité et les soutiennent auprès des différents services de l'État »), mais aussi qu'ils permettent un meilleur service aux collectivités (« Nos employés se démènent pour trouver des solutions aux administrés. Quand il faut contacter une administration pour nous aider à régler un problème, malheureusement les contacts sont erronés ou bien on ne nous répond pas. On perd énormément de temps à chercher les solutions par téléphone ou par mail avec [ces organismes]) » ; un élu revendique ainsi « que les mairies aient accès à des lignes téléphoniques dédiées avec accès prioritaire pour tous les services publics extérieurs que nous avons besoin de contacter pour éviter les plateformes de tous les usagers (taper 1...taper 2...) ».
Certains élus appellent enfin à encourager les « démarches communes entre services de l'État, intercommunalités et communes pour offrir des réponses plus coordonnées au usagers » ;
- entre collectivités elles-mêmes : des élus jugent nécessaire que les agents municipaux disposent d'un « référent au niveau du département, de la préfecture et de la région », appelant les collectivités et l'État au même effort de communication et de disponibilité à l'attention des communes ; un élu estime ainsi souhaitable d'« avoir plus de contacts avec les services départementaux ».
Certains appellent ainsi à mettre en place un « portail unique pour toutes les collectivités et l'État [...] pour éviter à chaque collectivité de créer sa propre interface », ou à tout le moins un portail national des services publics locaux (« urbanisme, route, eau, réseaux etc. »), décliné en application, de manière à compenser l'absence de site internet pour les petites communes qui n'ont pas les moyens de se doter d'un site.
D'autres réponses jugent souhaitable de mieux communiquer auprès des usagers sur www.demarches-simplifiees.fr, jugé insuffisamment connu alors qu'il « pourrait servir de point d'entrée pour les services de l'état et des collectivités territoriales » avec les avantages suivants : « lisibilité pour les usagers, économies d'échelle, souveraineté ».
« Il nous paraît important de faire remonter à la mission d'information les points suivants :
- Le sentiment croissant d'abandon des territoires ruraux face à la disparition progressive des services publics de proximité (trésoreries, DDT, La Poste, etc.). Les maisons France Services, bien que précieuses, ne suffisent pas à recréer une véritable présence publique de terrain.
- La surcharge pesant sur les petites communes, qui doivent faire face à une complexité réglementaire croissante avec des moyens humains très limités. Le rôle des élus devient de plus en plus technique, au risque d'épuiser l'engagement bénévole, notamment dans les zones à faible densité.
- L'importance d'un accompagnement renforcé des collectivités rurales, tant en ingénierie qu'en financement, pour garantir une égalité d'accès aux droits et aux services, quel que soit le territoire.
- La nécessité d'associer davantage les élus locaux aux décisions nationales ou départementales qui impactent l'organisation des services publics. Une meilleure concertation en amont permettrait d'adapter les dispositifs aux réalités du terrain.
- Enfin, nous rappelons que les collectivités locales sont souvent les derniers points d'ancrage institutionnels dans les petites communes. À ce titre, elles méritent d'être écoutées, respectées et véritablement soutenues dans leur rôle de proximité. »
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Support |
Calendrier prévisionnel |
|
AMÉLIORER L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS |
||||
|
1 |
Garantir à l'usager un accès aux services publics selon le canal de son choix, notamment téléphonique, en réaffirmant l'obligation, pour tous les services publics, d'appliquer le principe de l'omnicanalité et faire de ce principe la priorité du prochain comité interministériel de la transformation publique. |
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique Direction interministérielle de la transformation publique |
Circulaire administrative |
Deuxième trimestre 2026 |
|
2 |
Valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents. |
Direction générale de l'administration et de la fonction publique |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
3 |
Étendre la reconnaissance du droit à l'erreur en encourageant, dans tous les services publics, une approche bienveillante du cas de certains usagers lorsque le droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation (erreur imputable à l'administration ou n'impliquant pas une sanction pécuniaire), permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance. |
Parlement Gouvernement |
Modification de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration Modification du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale |
Dernier trimestre 2026 |
|
4 |
Mieux faire connaître le site service-public.fr ainsi que la diversité des informations et des services qu'il délivre. |
Direction de l'information légale et administrative |
Instruction ministérielle organisant une campagne d'information grand public |
Deuxième trimestre 2026 |
|
5 |
Préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie en concevant une fiche pratique et un guide sur l'entrée dans la vie active et en organisant des permanences de structures France services dans les établissements scolaires et universitaires ainsi que des partenariats avec les associations étudiantes et les CROUS |
Agence nationale de la cohésion des territoires Direction de l'information légale et administrative
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Circulaire administrative |
2026 |
|
6 |
Renforcer l'accompagnement des usagers confrontés au décès d'un proche en assurant la cohérence entre les informations disponibles sur les sites publics, en mettant à disposition le guide et en mettant à l'étude la possibilité de résiliation immédiate des abonnements souscrits par une personne décédée |
Gouvernement Direction de l'information légale et administrative |
Circulaire administrative |
Deuxième trimestre 2026 |
|
7 |
Expérimenter la faculté d'opter en faveur de la transmission numérique de la propagande électorale pour les citoyens inscrits au registre des Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer. |
Parlement Gouvernement |
Modification des articles L. 165 et L. 166 du code électoral |
2026 |
|
RENFORCER L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS AU COEUR DES TERRITOIRES EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU RÉSEAU FRANCE SERVICES |
||||
|
8 |
Développer le réseau France services en poursuivant son déploiement dans les quartiers prioritaires de la ville, en encourageant ses permanences en mairie, en privilégiant l'implantation des nouveaux espaces dans les sous-préfectures et en mettant en place à titre expérimental une structure France Services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger. |
Communes Ministère de l'Intérieur Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Ministère chargé de la politique de la ville |
Bonnes pratiques Circulaires administratives Circulaire administrative Circulaire administrative |
Dernier trimestre 2026 |
|
9 |
Stabiliser et consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services, sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés. |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Agence nationale de la cohésion des territoires |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
10 |
Consolider l'articulation de l'action des France services et des opérateurs nationaux partenaires du réseau en garantissant aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux et en développant des permanences physiques des opérateurs au sein des France services. |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Agence nationale de la cohésion des territoires |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
11 |
Assurer une meilleure prise en compte des évolutions du métier de conseiller France services en structurant la formation, les fiches de poste et le parcours professionnel des agents et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences. |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Agence nationale de la cohésion des territoires Direction générale de l'administration et de la fonction publique |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
PROTÉGER PLUS EFFICACEMENT LES USAGERS CONTRE LES SITES FRAUDULEUX QUI MONNAIENT LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES |
||||
|
12 |
Moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération en introduisant des circonstances aggravantes pour en renforcer les sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses et en étendant son champ. |
Parlement Gouvernement |
Modifications des articles 433-12 à 433-16 du code pénal Modification des articles L. 554-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-4 du code de la consommation |
2026 |
|
13 |
Unifier la présentation des sites officiels par l'établissement de signes distinctifs communs et infalsifiables afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants |
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique Direction interministérielle du numérique Direction de l'information légale et administrative |
Instruction ministérielle |
Deuxième trimestre 2026 |
|
14 |
Poursuivre les efforts mis en oeuvre en vue du référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivre le déréférencement des sites frauduleux, clarifier la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurer une communication régulière sur ce sujet. |
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique Direction interministérielle du numérique |
Circulaire administrative |
2026 |
|
15 |
Encourager un partenariat entre les collectivités territoriales et le site mesdroitssociaux.fr afin d'enrichir le simulateur de celui-ci en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits. |
Direction de l'information légale et administrative Caisse centrale de la mutualité sociale agricole Collectivités territoriales |
Bonnes pratiques administratives |
2026 |
|
METTRE À PROFIT LES RÉCENTS PROGRÈS TECHNOLOGIQUES POUR PROMOUVOIR UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES USAGERS ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION NUMÉRIQUE |
||||
|
16 |
Clarifier les missions et le positionnement des conseillers numériques, notamment vis-à-vis des conseillers France Services, et mettre en cohérence le financement et la mise en oeuvre de l'inclusion numérique en désignant un chef de file de cette politique publique. |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Agence nationale de la cohésion des territoires |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
17 |
Étudier l'élargissement du périmètre d'Aidants Connect, afin de toucher les publics éloignés du numérique par la dépendance et/ou la maladie. |
Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Agence nationale de la cohésion des territoires |
Instruction ministérielle |
2026 |
|
18 |
Faire de l'intelligence artificielle (IA) un levier de l'amélioration du parcours des usagers en formulant une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service des usagers et en engageant une discussion avec les grands opérateurs dans le domaine de l'IA, afin d'obtenir une identification claire des sources officielles utilisées dans les réponses aux questions des usagers. |
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique Direction interministérielle du numérique |
Circulaire administrative |
2027 |
|
19 |
Former, dans la fonction publique, des profils susceptibles de maîtriser à la fois les aspects politiques et juridiques ainsi que la dimension technique, tant des algorithmes que de l'intelligence artificielle, afin que l'administration soit en mesure de contrôler l'utilisation de ces outils. |
Direction générale de l'administration et de la fonction publique |
Circulaire administrative |
2027 |
|
20 |
Diffuser plus largement la connaissance du service « Démarches Simplifiées » auprès des collectivités territoriales, en vue de l'amélioration des services publics dont elles ont la responsabilité. |
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique Direction interministérielle du numérique Collectivités territoriales |
Circulaire administrative Bonnes pratiques des collectivités territoriales |
2026 |
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
RÉUNIONS PLÉNIÈRES
Mardi 29 avril 2025 :
- M. Matthieu Delouvrier, responsable du Baromètre de l'Institut Paul Delouvrier sur l'opinion des Français et la satisfaction des usagers de services publics
Mercredi 30 avril 2025 :
- M. Johan Theuret et Mme Émilie Agnoux, représentants de l'association « Le sens du service public »
Mercredi 7 mai 2025 :
- Mme Pauline Carmona, directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, M. François Penguilly, chef de service des Français à l'étranger et Mme Gaëlle Le Pape, sous-directrice de l'état civil et de la nationalité (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)
Mardi 13 mai 2025 :
- M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État honoraire, auteur de Les normes à l'assaut de la démocratie (2024)
Mardi 20 mai 2025 :
- Mme Claire Hédon, défenseure des droits, et M. Daniel Agacinski, délégué général à la médiation
Mercredi 28 mai 2025 :
- Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier, géographe, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (« Les services publics dans les cahiers de doléances »)
Mardi 3 juin 2025 :
- MM. Jean-Luc Tillard, Vice-Président de la Communauté urbaine d'Arras en charge du développement des solidarités et préventions, Jérémy Sulkowski, directeur général adjoint (pôle habitat et solidarités, Communauté urbaine d'Arras), Mme Coralie Bonaventure-Mathon, chargée de mission cohésion sociale (Communauté urbaine d'Arras), M. Hubert Bonneville, directeur de la cohésion sociale, promotion et économie de la santé, renouvellement urbain (Communauté urbaine d'Arras), Mme Marion Tanniou, conseillère Solidarités et cohésion sociale (France urbaine)
Mardi 17 juin 2025 :
- Mme Marie-Agnès Petit, présidente du département de la Haute-Loire, présidente de la commission Développement et solidarités territoriales, membre du Bureau (Départements de France)
- M. Olivier Jacob, directeur général des outre-mer (Ministère des outre-mer)
- Mme Juliette Méadel, ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la Ville
Mardi 24 juin 2025 :
- Mme Françoise Gatel, ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité
Mercredi 25 juin 2025 :
- M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
AUDITIONS DE LA RAPPORTEURE
- Mardi 29 avril 2025 :
- M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
- M. Vincent Dubois, professeur de sociologie et sciences politiques (Sciences-Po, université de Strasbourg), Membre senior de l'Institut universitaire de France
Mardi 6 mai 2025 :
- Mme Stéphanie Schaer, directrice interministérielle du numérique, et Mme Marion Loustric (DINUM)
Mardi 13 mai 2025 :
- M. Thierry Lambert, directeur interministériel de la transformation publique, M. Ghislain Deriano, chef du service « Expériences usagers » et Mme Agnès de Ferry, directrice des projets transverses, appui au chef du service « Expériences usagers » (DITP)
Mercredi 14 mai 2025 :
- Mmes Hélène Pauliat et Clotilde Deffigier, professeures des universités (Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques - OMIJ, Université de Limoges)
Mardi 27 mai 2025 :
- MM. Cédric Musso, directeur de l'action politique, et Jean-Pierre Lhermitte, administrateur national, président de l'Association locale de l'Artois (UFC Que choisir)
- MM. Pierre Chambu, directeur général de l'Institut national de la consommation (INC), Alain-Henry Duval, ingénieur, et Lionel Maugain, journaliste
Mercredi 4 juin 2025 :
- M. Philippe Guillermin, chef du bureau Droit de la consommation, Mmes Marianne Lefort, adjointe au chef de bureau et Chloé Sedivy, rédactrice (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - DGCCRF)
Mardi 10 juin 2025 :
- Représentants de syndicats de la fonction publique : M. Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA ; Mmes Marie Mennella et Elisabeth Mortreux (CFDT Interco) ; Mme Alexandra Meynard et M. Olivier Villois (CGT)
- M. Thibault Romatet, directeur général adjoint délégué, en charge de la stratégie, de l'innovation et de l'expérience usager (France travail)
Mardi 24 juin 2025 : table ronde
- Mme Carole Leclerc, directrice de l'innovation et du digital, M. Bertrand Decaix, directeur de cabinet en charge du déploiement du programme et Mme Caroline Rossigneux-Meheust, chargée des relations publiques (ACOSS, caisse nationale des URSSAF)
- Mme Murielle Bialès, directrice déléguée au réseau (Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV)
- M. Marc Le Floc'h, directeur adjoint du réseau et Mme Klara Le Corre, chargée des relations institutionnelles (Caisse nationale d'allocations familiales, CNAF)
- Mme Aurélie Combas-Richard, directrice déléguée aux opérations, et Mme Veronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement (Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM)
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES427(*)
(par ordre alphabétique)
- Ambassade de France au Danemark
- Ambassade de France en Espagne
- Ambassade de France en Grèce
- Ambassade de France au Royaume-Uni
- Associations des maires de France (AMF)
- Banque des territoires
- France Titres (anciennement Agence nationale des titres sécurisés, ANTS)
DÉPLACEMENTS DE LA MISSION D'INFORMATION
DÉPLACEMENTS DANS LES TERRITOIRES
Lundi 16 juin 2025 : déplacement dans le Rhône428(*)
Visite du Point Multiservices de Saint Fons : entretien avec M. Christian Duchêne, maire de Saint Fons, M. Julien Fragnon, directeur de cabinet, les agents d'accueil et la conseillère numérique.
Rencontre avec des élus locaux : Mme Claire peigné, maire de Morancé, présidente de l'Association des maires du Rhône (AMF 69) ; MM. Christian Vivier-Merle, maire de Theizé, et Max Vincent, maire de Limonest.
Visite de l'espace France services de Beaujeu : rencontre avec les agents puis table ronde avec MM. Sylvain Sotton, maire de Beaujeu, président de l'Association des maires ruraux du Rhône (AMRF 69), Jean-Marc Galland, sous-préfet de Villefranche, Stéphane Pichon, chef du bureau de la cohésion sociale (sous-préfecture de Villefranche) et Mme Françoise Conrad, cheffe de la mission d'appui territoriale (préfecture du Rhône) en présence de M. Bernard Fialaire, sénateur du Rhône.
Visite de l'espace France services de Belleville-en-Beaujolais : rencontre avec les conseillers et présentation de la structure.
Jeudi 19 juin 2025 : déplacement dans le Loir-et-Cher429(*)
Visite du guichet unique des Rottes (QPV) : entretien avec M. Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de la Communauté d'agglomération Territoires vendômois et Mme Béatrice Arruga, adjointe au maire et conseillère communautaire ; présentation de l'activité du guichet unique par Mme Blandine Gauvin, directrice Vivre ensemble et politique de la ville Territoires vendômois - Ville de Vendôme ; rencontre avec les agents du guichet unique.
Visite d'un bus itinérant France-services à Pray : entretien avec la conseillère France service en présence de M. Philippe Lefèvre, premier adjoint de Pray.
Mercredi 25 et jeudi 26 juin 2025 : déplacement dans le Finistère430(*)
Visite de l'espace France service de Plabennec : entretien avec des agents en présence de M. Patrice Boucher, maire de Kersaint-Plabennec et vice-président aux solidarités et au bloc local du Pays des Abers ;
Table ronde, à la France service de Plabennec, avec des représentants de la Communauté de communes du Pays des Abers (MM. Patrice Boucher, vice-président, François Vinet, directeur du pôle Aménagement, économie et solidarités, Mme Christelle Hamon, responsable du service Économie et solidarités) et Mme Juliette Abalea, coordinatrice de la maison France services du Pays des Abers) ainsi qu'avec des représentants de partenaires nationaux de France service (DDFiP, Urssaf, CPAM, France travail et CAF), avec la participation de M. Daniel Impieri, directeur de l'établissement public de coopération culturelle (école de musique du Pays des Abers - Côte des légendes).
Rencontre avec les représentants des associations d'élus (M. Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas, vice-président de Brest métropole et président de l'Association des maires du Finistère (AMF 29) et Mme Nadine Kersaudy, maire de Cléden-Cap-Sizun, présidente de l'Association des maires ruraux du Finistère (AMRF 29), en présence de Mme Estelle Leprêtre, sous-préfète de Châteaulin.
Visite de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Finistère, à Quimper et entretien avec Mme Catherine Engelhard, directrice.
Lundi 30 juin 2025 : déplacement de la rapporteure dans l'Yonne
Accueil à l'espace France services de Saint-Florentin, en présence de M. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur :
- rencontre avec les représentants des bureaux des associations de maires du départements (Association des maires ruraux de l'Yonne : Mme Dominique Chapuis, présidente, maire de Rosoy, MM. Jean-Luc Liverneaux, vice-président, maire de Gurgy Johan Bloem, vice-président, maire de Saligny, Jean-Claude Lemaire, vice-président, maire de Joux la Ville, et Luc Maudet, secrétaire, maire de La Vallée de la Vanne ; Association des maires de l'Yonne : MM. Mafoud Aomar, président, maire de Valravillon, président de la communauté de communes de l'Aillantais, Xavier Courtois, premier vice -président Secteur sud, maire de Massangis, Mme Catherine Tronel, vice -présidente Secteur est, maire d'Argentenay, MM. Jean-Luc Warie, vice -président Secteur centre, maire de Bonnard, Christophe Bonnefond, vice -président Secteur Ouest) ;
- échanges avec les conseillers France services de Tonnerre, Saint Florentin, Avallon et Migennes et avec les représentants de partenaires nationaux de France services (DDFiP, CPAM, France travail, France rénov' et Urssaf).
Mardi 8 juillet 2025 : déplacement en Seine-Saint-Denis431(*)
Visite du service social départemental de Bondy : accueil par Mme Nadia Azoug, vice-présidente à l'enfance, la prévention et la parentalité (Conseil départemental) ; présentation de la circonscription de service social (CSS) par le parcours usagers (Clément Jouan, responsable de circonscription, et Flora Autefage, directrice adjointe de la direction Prévention - action sociale).
Visite du centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Noisy-le-Sec : accueil par Mmes Jeanick Solitude, responsable de circonscription PMI, et Marie Pastor, directrice du service de PMI et rencontre avec les équipes.
Entretien avec M. Stéphane Troussel, président du Conseil départemental (Hôtel du département).
DÉPLACEMENT À LA DILA
Mardi 24 juin 2025 : Direction de l'information légale et administrative (DILA)432(*)
Présentation du site service-public.fr, avec la participation de Mmes Anne Duclos Grisier, directrice de l'information légale et administrative, Lucile Josse, sous-directrice des publics et des produits, MM. Stéphane Haramburu, sous-directeur des systèmes d'information, Benjamin Berut, chef du département de l'information administrative multicanale, Mmes Karine Letrouit, cheffe du département des systèmes d'information de l'administration numérique, Peggy Rasquin, cheffe du centre d'appels interministériel, MM. Christian Boury, rédacteur en chef du site service-public, Yaël Didi, cheffe du pôle missions transverses au département de l'information administrative multicanale, Florent Charvet, chef de la section messagerie au département de l'information administrative multicanale et Mme Karine Peuvrier, cheffe du département de la communication.
INTERVENTION DE M. VINCENT DUBOIS, SOCIOLOGUE (29 AVRIL 2025)
INTERVENTION DE M. VINCENT DUBOIS, PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE À SCIENCES PO, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, MEMBRE DU LABORATOIRE SAGE (UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE 7363) ET MEMBRE SENIOR DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE433(*) (29 avril 2025)
Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous remercie vivement de cette invitation à participer à vos réflexions sur l'accès aux services publics, et espère que certains résultats de mes travaux pourront contribuer à les nourrir. Avant d'apporter des éléments de réponse au questionnaire qui m'a été proposé comme trame pour cette audition, permettez-moi de préciser rapidement les thématiques de ces travaux, afin de situer la manière dont j'ai pu aborder ces questions.
J'ai tout d'abord conduit une enquête sur l'accueil dans les administrations sociales à partir d'une observation au guichet des Caisses d'allocations familiales (Dubois 2015). Cette enquête a conduit à identifier les enjeux de ces interactions, qui ne sont pas réductibles à de simples routines administratives. S'y joue aussi pour partie l'accès à l'information et aux droits. Outre leur dimension fonctionnelle dans le traitement des dossiers, elles sont marquées par des rapports sociaux qui, selon notamment les caractéristiques respectives des agents d'accueil et des personnes qu'ils reçoivent, vont de la contrainte et de l'expression du mépris social à l'égard des pauvres, à de multiples formes de compassion et de soutien qui n'ont parfois qu'un lointain rapport avec les nécessités du travail de l'administration. L'une des surprises de l'enquête a ainsi été que ces guichets, qu'on voit comme anonymes et froids, sont aussi des lieux d'expression des difficultés personnelles où les visiteurs se rendent pour chercher une écoute, des conseils, et pas seulement pour remplir des formulaires ou obtenir une information. L'enquête étant ancienne (milieu des années 1990), ses résultats ne reflètent pas la situation actuelle, mais permettent d'identifier un certain nombre de questions qui se posent toujours, même si la manière dont elles sont traitées a pu radicalement changer.
Après ce premier travail, j'ai abordé la question sensible du contrôle des bénéficiaires d'aides sociales, et plus précisément des minimas sociaux, dans le cadre notamment des politiques de lutte contre la « fraude sociale » (Dubois 2021). Cette recherche de longue haleine a été complétée par un essai plus modeste réalisé avec des collègues sur le contrôle des chômeurs (Vivès et al. 2023). Ces travaux éclairent les conditions parfois complexes de mobilisation du droit dans des situations à la fois incertaines et tendues où l'écart peut être grand entre leur qualification administrative et la manière dont elles sont vécues par les personnes intéressées. Elles révèlent aussi une tendance marquée dans la période récente à un traitement plus sévère des cas qui peuvent être à la limite du droit. Elles révèlent enfin une tendance à une sévérité plus forte à l'égard des allocataires les plus démunis.
Après ces travaux sur l'administration de la protection sociale et de l'emploi, j'ai engagé une recherche sur le rapport des classes populaires aux institutions '(Dubois 2020 ; 2025). Il s'agit alors de restituer l'expérience que font les membres des classes populaires des différents services publics et assimilés (de l'école à la police en passant par l'aide sociale ou les services de santé) et les effets de ces expériences sur les trajectoires et les représentations sociales. C'est à ce projet que je consacre ma délégation à l'Institut Universitaire de France, sur la base d'une enquête personnelle conduite en France, et de collaborations internationales du réseau LoCI que j'anime (site : lien).
Ces précisions étant faites, je peux reprendre la trame des questions que vous souhaitez voir abordées.
I
Votre première interrogation porte sur les évolutions intervenues dans les interactions entre agents et usagers du service public au cours de la période récente, et notamment les effets de la transformation numérique sur les populations les plus éloignées des services publics.
Une première évolution tient sans doute à l'augmentation du niveau de tension lors de ces interactions. La thématique des « incivilités dans les services publics » est apparue dans le courant des années 1990, on observe d'ailleurs aussi une augmentation des récriminations à l'égard de l'inconduite des clients dans le secteur marchand. Ce rappel ne conduit cependant pas à nier qu'il puisse y avoir des problèmes particulièrement marqués, aujourd'hui, dans les services publics. Comment les expliquer ? On entend souvent dire que ce serait là le fruit d'une évolution globale des comportements, liée aux transformations des modèles éducatifs et au déclin corrélatif du respect de l'autorité. Sans remettre en cause que de tels changements aient pu avoir lieu au cours des dernières décennies, il resterait à les établir et à les expliquer plus précisément, au-delà des visions simplistes et caricaturales qui font de Mai-68 l'origine de tous les maux. Pour ma part, j'identifierais plutôt trois facteurs propres à l'action publique, qui pèsent tout particulièrement mais pas exclusivement dans le secteur social.
En premier lieu, l'augmentation des tensions procède de l'augmentation des enjeux qui trouvent à s'exprimer dans le rapport aux services publics. L'installation durable du chômage de masse, l'augmentation de la pauvreté ont rendu plus que jamais crucial l'accès à certains droits, qui se joue pour partie dans le rapport direct aux administrations (notamment en raison de l'individualisation des dispositifs, qui fera l'objet du point suivant). Une chose est d'accéder ou non à une aide lorsqu'elle est un complément de revenu, c'est une tout autre chose lorsque cette aide forme une part déterminante des ressources, sinon l'unique ressource. Cela ne peut pas ne pas avoir d'incidences sur la relation avec les organismes chargés de la verser. Plus généralement, l'intensification de certains enjeux auxquels des services publics sont associés explique aussi la possible augmentation des tensions qui s'y expriment. L'importance croissante accordée au diplôme dans la réussite sociale peut aussi, par exemple, expliquer des exigences parentales à l'égard de l'école qui peuvent parfois s'exprimer de façon agressive, ou perçue comme telle.
Un deuxième facteur tient à l'évolution des politiques publiques dans le sens de l'individualisation, de la personnalisation, ce qu'on observe peu ou prou dans tous les secteurs, du système éducatif au système pénal en passant par la santé ou l'emploi. Cette évolution peut être positive, et il n'y a pas lieu de regretter ce qui serait l'âge d'or de la standardisation. Mais elle conduit à ce que la relation directe avec l'administration devienne un enjeu beaucoup plus fort, car c'est désormais pour partie dans cette relation directe que se décide le traitement individualisé des cas : l'octroi d'une prestation, la validation d'un projet, la signature d'un contrat, parfois le prononcé d'une sanction. Or l'individualisation rend aussi l'application des règles moins claire pour les usagers puisqu'elle est désormais davantage décidée au cas par cas. Cela peut dans une certaine mesure ouvrir une marge de négociation autrefois plus réduite, mais cela fonde aussi un sentiment d'arbitraire, voire d'injustice, comme dans les cas où une personne fait l'objet d'une décision différente d'une autre alors même qu'elle considère leurs deux situations comme identiques. Cette perception n'est pas forcément fondée, mais ce qui importe ici est de noter que, qu'elle le soit ou non, la tendance à l'individualisation contribue à la nourrir, et à alimenter par la même occasion une possible source de tension.
Un troisième facteur tient à la difficulté d'accéder aux services publics. Cette difficulté s'est souvent accrue, du fait de la fermeture des guichets physiques, ou de l'organisation de filtres là où l'accès était auparavant direct, comme l'obligation de faire les première démarches en ligne ou de prendre un rendez-vous. La dématérialisation intervient dans ce contexte. C'est un phénomène massif, qui là non plus n'est pas l'apanage des services publics. Les situations peuvent être contrastées, d'une administration à l'autre, tantôt facilitant tantôt complexifiant les démarches. Leurs effets sont quant à eux variés selon les caractéristiques des usagers, les différences sociales étant fortes à cet égard. Il n'y a donc pas lieu de tirer un bilan forcément négatif de la dématérialisation dans l'accès au service public puisque, dans certains cas au moins, elle a pu faciliter les démarches. Cependant cette dématérialisation, lancée au nom de la facilitation de l'accès et de la lutte contre le non recours a dans bien des cas conduit aux conséquences inverses. On connaît l'enquête de l'INSEE de 2021 qui montrait qu'1/3 des français avaient renoncé à effectuer une démarche administrative en raison des difficultés produites par la dématérialisation. Le Défenseur des Droits a plusieurs fois alerté sur ce problème ' (« Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics » 2019; « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? » 2022), de même que l'étude du conseil d'État sur le dernier kilomètre de l'action publique '(Conseil d'État 2023). Ce sont donc des difficultés avérées, et bien identifiées par les pouvoirs publics.
Ces difficultés peuvent être éprouvées par tout un chacun, mais avec une intensité différente selon les types d'usagers. On a souvent tendance à mettre en avant un facteur générationnel, qui conduirait les personnes n'ayant pas été précocement socialisées aux usages de l'internet à avoir des difficultés là où les générations ultérieures n'en ont pas, ou en ont moins. L`âge et la génération sont assurément des facteurs qui comptent, mais cette explication ne doit pas masquer le fait que des personnes jeunes puissent également éprouver d'importantes difficultés, ce qui rend sceptique quant à la thèse optimiste d'une résorption à venir de l'« illectronisme » dans les démarches administratives dès que l'ensemble de la population sera composé de personnes ayant utilisé l'internet depuis leur plus jeune âge. Au facteur générationnel et d'âge il faut en effet ajouter les caractéristiques sociales des usagers : à la fois leurs compétences techniques, linguistiques, administratives, et la complexité de leur situation ou sa plus ou moins grande concordance avec les catégories bureaucratiques.
Ce que révèle à ce propos mon enquête en cours sur le rapport des classes populaires aux institutions c'est que si les compétences proprement techniques de maniement d'un ordinateur sont indéniablement un facteur déterminant, elles ne sont pas le seul ni même toujours le principal facteur qui expliquerait l'aisance ou non dans les démarches administratives dématérialisées. Pour le dire simplement : savoir manier un ordinateur ne prémunit pas des difficultés dans ces démarches, et des personnes qui utilisent smartphones ou ordinateur sans problème peuvent être totalement démunies lorsqu'il s'agit de démarches administratives en ligne. Le résultat de l'enquête conduit ainsi à considérer que les difficultés en la matière proviennent, au-delà du manque de compétence technique des usagers, du fait que la dématérialisation renforce les difficultés préexistantes dans le rapport à l'administration. Un premier facteur de ces difficultés est le langage, et le maniement d'une langue bureaucratique qui est souvent différente du langage ordinaire : deux personnes qui vivent ensemble ne comprendront pas nécessairement que leur situation doit être administrativement qualifiée de « vie maritale », par exemple. Les agents des services publics remplissent alors une fonction de traduction, et facilitent le passage de la langue ordinaire à la langue administrative, et inversement. Quand une personne se retrouve seule face à son ordinateur, cette fonction de traduction et d'explication fait défaut. Au-delà du vocabulaire, la même remarque s'applique aux critères et circuits administratifs, qui peuvent paraître aux usagers et usagères d'autant plus opaques qu'ils et elles y sont confrontés sans explication. Une autre difficulté structurelle du rapport à l'administration tient à la nécessité de « rentrer dans des cases » comme on le dit ordinairement c'est-à-dire de définir une situation ou une demande qui peut être complexe, intermédiaire, non prévue par l'administration, dans des catégories administratives forcément simplificatrices car elles ne peuvent jamais prévoir tous les cas de figure possibles. Face à un agent, on peut toujours s'expliquer ; il ou elle se fera alors de nouveau traducteur, de la situation réelle à la catégorie bureaucratique. Dans un courrier ou sur un formulaire papier, les usagers et usagères peuvent avoir la possibilité de s'expliquer, d'ajouter un document, une annotation marginale. Face à un menu déroulant qui, au mieux, comprend une rubrique « autres cas », il en va tout autrement. L'usager ou l'usagère qui ne « rentre pas » dans les items préétablis peut se retrouver sans solution, contraint ou contrainte à devoir essayer de joindre un agent au téléphone ou de le rencontrer directement, ce qui s'avère souvent très difficile pour ne pas dire impossible tant le tout en ligne a progressé. En fin de compte, la dématérialisation conduit pour une part à ce que les usagers et usagères ne puissent plus se faire expliquer ce qu'ils et elles ne comprennent pas, ni ne puissent expliquer ce qui ne correspond pas aux catégories administratives. Ne pas comprendre et ne pas pouvoir se faire comprendre : c'est là, aussi, une source de tensions qui génère la dégradation des relations avec les services publics.
C'est dans toutes ces difficultés que se trouvent les sources de la déshumanisation et du sentiment d'abandon nourris par la dématérialisation. Comme je l'évoquais en commençant, mon enquête au milieu des années 1990 montrait que le guichet pouvait être un lieu de socialisation. De socialisation administrative, au sens de l'apprentissage des règles bureaucratiques, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir de contraignant. De socialisation au sens ordinaire également, d'un lieu où l'on parle, où l'on vient se rassurer à propos d'un courrier non compris ou d'un versement non effectué, où l'on vient aussi pour demander des conseils. Cette fonction sociale de la relation administrative disparaît avec la numérisation. Combiné aux difficultés précédemment évoquées dans la mise en correspondance des demandes et des réponses apportées (le menu déroulant dans lequel aucun item ne convient), ce déclin de l'accompagnement par l'administration, tout particulièrement pour les catégories populaires qui en ont le plus besoin, nourrit le sentiment d'un État distant, désincarné, et ajoute au sentiment d'abandon si fréquent dans les zones rurales ou certains quartiers périphériques où se sont enchaînées la fermeture des services publics dont la présence sur le territoire marquait symboliquement la considération à l'égard des populations locales en même temps qu'elle leur en facilitait concrètement l'accès.
La dématérialisation des services publics n'est, comme on l'a vu, pas réductible à des considérations techniques et organisationnelles ; elle est aussi une question sociale en termes de différenciation sociale de l'accès aux services publics, et de manière plus diffuse, une question politique, qui renvoie au rapport entre les citoyennes et citoyens et l'État et à la confiance qu'ils et elles lui accordent.
II
Y a-t-il des secteurs de l'action publique qui posent plus de difficultés en termes de simplicité des démarches administratives ?
Avant de comparer entre eux les différents secteurs, il faut prendre en compte les différences sociales dans le rapport à chaque administration. À propos des impôts, par exemple, Alexis Spire montre contre toute attente que les membres des classes supérieures ont une expérience et une représentation beaucoup plus positive de l'administration fiscale que les membres des classes populaires. Pourtant les premiers contribuent (pour l'IRPP) davantage, et les seconds ont a priori plus intérêt à la redistribution. C'est que dans les classes supérieures prévaut le sentiment de pouvoir maîtriser les règles, les négocier, quand pour les classes populaires domine un sentiment d'arbitraire et d'injustice (Spire 2018). Dans le cas particulier du rapport aux impôts des travailleurs transfrontaliers, la thèse de Marie Quarrey montre une situation hybride : à la fois un enjeu fort et une complexité plus grande et le sentiment d'être « les vaches à lait du système », et en même temps une forme de domestication de l'impôt grâce à des collectifs de contribuables et à la connaissance parfois personnelle des agents de l'administration fiscale locale ''''(Quarrey 2022).
Au sein d'un même secteur, comme le social, les démarches peuvent très fortement varier d'un type de prestation à l'autre. Un ménage qui perçoit seulement des allocations familiales n'a quasiment aucune démarche à faire, alors qu'un ou une allocataire du RSA doit accomplir des démarches complexes, déclarer ses ressources quatre fois par an, justifier sa situation auprès de la CAF, du conseil départemental, et maintenant de France Travail, et se soumettre à des contrôles.
Pour comparer le niveau de difficulté administrative et ses incidences sur les usagers, il faut donc prendre en compte non seulement le secteur mais quatre variables principales : a) l'inégale capacité des usagers à accomplir les démarches ; b) la complexité de leur situation ; c) l'enjeu que représente pour eux ces démarches et d) la complexité des procédures et critères mis en oeuvre. Ces quatre variables se combinent au niveau le plus élevé dans les administrations sociales et d'emploi, mais aussi dans l'administration de l'immigration et de l'asile, et c'est pour cela que les démarches administratives peuvent y être particulièrement problématiques. On peut aussi trouver une conjonction comparable dans d'autres domaines, comme l'ont par exemple montré les travaux de Blandine Mesnel sur les agriculteurs face aux démarches pour obtenir les aides de la Politique Agricole Commune '''''''''''(Mesnel 2017).
III
Existe-t-il des modèles d'organisation à l'étranger susceptible d'inspirer les pratiques françaises ?
Je dirais simplement que si l'on souhaite s'inspirer de modèles étrangers, il faut le faire en prenant en compte tous les aspects, et pas de façon ponctuelle, en faisant ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire en sélectionnant les seuls éléments qui viennent justifier une opinion préétablie. Par exemple, quand on prône un accompagnement renforcé des chômeurs, en se référant au cas du Danemark, il ne faut pas oublier que dans ce pays, un conseiller pour l'emploi n'a la charge que d'un nombre très réduit de demandeurs d'emploi, quand son homologue français en a parfois plusieurs centaines dans son « portefeuille ». Le sens même de l'accompagnement s'en trouve changé, et avec lui la nature de la relation entre chômeurs et administration.
Au-delà de cette précaution méthodologique, je crains donc de ne pas pouvoir répondre à cette question, car pour aller au-delà de quelques exemples de « bonnes pratiques » décontextualisés, il faudrait une étude comparative complète, particulièrement complexe à mener puisqu'elle impliquerait de revenir à la fois sur les structures socio-économiques nationales, les rôles respectifs de l'État et du marché, de l'État central et des collectivités territoriales, des pouvoirs publics et des organisations sans but lucratif, mais aussi sur les modèles organisationnels et les « cultures du service public » propres aux différents pays. Ce serait assurément passionnant mais dépasse de loin le cadre de cette audition, et mes propres compétences.
IV
Quelles sont les disparités territoriales observées dans l'accès aux services publics et leur évolution récente, en tenant compte des spécificités des territoires urbains, périurbains, ruraux et ultramarins ?
La direction interministérielle de la transformation publique a lancé il y a quelques mois une cartographie des services publics mais c'est un travail en cours, de sorte qu'il n'y a pas à ma connaissance de données permettant de répondre de façon systématique à cette question. Je crains donc de ne pas vous apprendre grand-chose en disant que la fermeture de services publics en milieu rural, dans une moindre mesure en milieu périurbain ces dernières années est de nature à renforcer ces inégalités territoriales, ou à tout le moins la perception qu'on les populations vivant dans ces zones d'être les laissés pour compte de la modernisation de l'action publique. Ces inégalités et ce sentiment peuvent cependant être pour partie atténués par le dispositif des Maisons France Services, au moins pour les zones rurales. Mais, comme le montre Antonin Besch dans sa thèse, leur implantation, bien que présentée comme une répartition rationnelle répondant à la raréfaction des services publics, procède surtout des rapports établis localement entre les acteurs concernés (préfecture, collectivités, institutions partenaires du dispositif) '(Besch et Devez 2024).
Toujours à propos de l'implantation territoriale, je voudrais pointer les limites d'une analyse qui se limiterait à mesurer la distance ou le temps de trajet entre les usagers et les services. Certes c'est une donnée incontournable, mais la réalité des conditions d'accès ne s'y limite pas. En effet, ce qui est objectivement proche peut être subjectivement perçu comme distant. Clara Deville l'a bien montré dans son livre L'État social à distance à propos de l'accès au RSA en milieu rural (Deville 2023). De même, les cartographies mentales des habitants de certains quartiers périphériques ou zones rurales font qu'il peut leur paraître très compliqué de se rendre régulièrement dans une administration située en centre-ville ou dans la ville la plus proche quand bien même la distance objective serait somme toute réduite. Certes, tout le monde ne peut pas tout avoir en bas de chez soi, mais il me semble que les modes de vie des populations visées doivent aussi être pris en compte dans la réflexion sur l'implantation des services publics.
Trois remarques complémentaires à ce propos. D'abord, la numérisation ne réduit pas la fracture territoriale entre zones urbaines et rurales, puisque les populations rurales ont elles-mêmes moins recours aux démarches en ligne et, selon le Baromètre du numérique du Credoc, les écarts en la matière se creusent plus qu'ils ne s'estompent. Ensuite, il faut dire de nouveau que ces questions ne sont pas seulement d'ordre pratique, et qu'en plus de déterminer les conditions d'accès aux droits et aux services, elles revêtent une dimension symbolique et politique forte, la disparition ou au moins l'éloignement physique des services publics marquant une plus grande distance des citoyens à l'État et au système politique. C'est quelque chose qui revient avec insistance dans les entretiens que j'ai pu conduire. Cela dit, et c'est la troisième remarque, tout ne se limite pas à ce qu'on appelle la fracture territoriale, qui remplacerait ce qu'on a un temps appelé la fracture sociale. Car la distanciation, physique et politique joue à plein pour les classes populaires des territoires dits périphériques, beaucoup moins pour les catégories supérieures, plus connectées, plus mobiles.
V
Comment qualifiez-vous l'articulation existante entre le traitement standardisé des demandes par l'administration et la nécessité d'un accompagnement personnalisé des usagers ?
Il me semble tout d'abord qu'il faut se garder d'une opposition caricaturale entre une standardisation forcément toujours négative et une personnalisation qui représenterait forcément un progrès. La standardisation laisse échapper la complexité des situations mais elle garantit aussi un traitement égalitaire, les mêmes règles s'appliquant (théoriquement) de la même manière à toutes et tous. La personnalisation permet un meilleur ajustement aux situations, mais elle ouvre davantage à l'interprétation, et potentiellement à ce qui peut être perçu comme une forme d'arbitraire.
Ensuite, l'équilibre entre standardisation et personnalisation relève de choix en matière de contenu et d'orientation des politiques publiques. Concernant la protection sociale, par exemple, on assiste depuis la fin des années 1980 au développement de mesures ciblées, avec des critères d'éligibilité complexes pour permettre l'ajustement, aux côtés d'une protection sociale classique à vocation universelle, héritée du modèle de la Sécurité sociale d'après-guerre. On peut voir dans ce changement une réponse à de nouveaux besoins sociaux qui n'étaient pas ou seulement mal satisfaits par le système antérieur, ce qui a justifié la création du RMI devenu RSA. Mais dans le même temps, cela a contribué à la dualisation du système, reprenant la vieille distinction entre l'assurance pour les personnes socialement intégrées et l'assistance pour les pauvres. Cela a aussi clivé le rapport des individus à l'État social : des citoyens faisant valoir leurs droits d'un côté, des « assistés » demandant l'aumône de l'autre, pour reprendre l'expression de Yasmine Siblot (Siblot 2006). Or celle-ci montre que le rapport aux administrations plus généralement est beaucoup plus positif quand il s'agit de dispositifs à vocation générale, pour l'ensemble de la population, que lorsqu'il s'agit de dispositifs socialement ciblés, toujours susceptibles d'une forme de stigmatisation. Et là encore ce n'est pas sans incidence politique, comme l'a montré Joe Soss dans le cas des États-Unis, qui révèle que les personnes qui ont affaire à des programmes sociaux aux critères clairs et identiques pour tout le monde ont une participation électorale beaucoup plus fortes que celles qui sont dans des programmes de workfare, dont la mise en oeuvre est décidée au cas par cas (Soss 1999). Plus de personnalisation c'est aussi davantage de critères, parfois difficiles à apprécier, davantage de contrôles, davantage de travail pour les agents également.
Cela dit sans me faire le défenseur d'une standardisation systématique dont j'ai dit les limites, mais pour se garder à l'inverse d'une vision peut-être parfois un peu trop enchantée de la personnalisation.
En espérant que ces quelques réflexions, inévitablement partielles, puissent vous être utiles, je vous remercie pour votre attention.
Références
Besch, Antonin, et Chloé Devez. 2024. « France services : le « retour du service public au coeur des territoires », entre standardisation et adaptation localisée ». Mouvements n° 118 (3) : 120-29. https://doi.org/10.3917/mouv.118.0120.
Conseil d'État. 2023. L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique : un enjeu d'efficacité et une exigence démocratique. Étude annuelle / Conseil d'État 2023. Paris : La Documentation française.
« Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? » 2022. Paris : Défenseur des droits.
« Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics ». 2019. Paris : Défenseur des droits.
Deville, Clara. 2023. L'Etat social à distance : dématérialisation et accès aux droits des classes populaires rurales. Vulaines-sur-Seine : Ed. du Croquant.
Dubois, Vincent. 2015. La vie au guichet. Administrer la misère. Paris : Éditions Points.
2020. « Lower Classes and Public Institutions : A research program ». ResearchGate. 1 mai 2020. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13235.04648.
2021. Contrôler les assistés. Genèses et usages d'un mot d'ordre. Paris : Raisons d'agir.
2025. « Le rapport des classes populaires aux institutions : essai de construction d'objet ». Sociologies pratiques, no 51.
Mesnel, Blandine. 2017. « Les agriculteurs face à la paperasse. Policy feedbacks et bureaucratisation de la politique agricole commune ». Gouvernement et action publique VOL. 6 (1) : 33-60. https://doi.org/10.3917/gap.171.0033.
Quarrey, Marie. 2022. « De l'État de proximité à la distance d'État. Effets socio-spatiaux de l'accès à un formulaire fiscal ». Savoir/Agir N° 59-60 (1) : 153-59. https://doi.org/10.3917/sava.059.0154.
Siblot, Yasmine. 2006. Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires. Sociétés en mouvement. Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques.
Soss, Joe. 1999. « Lessons of Welfare: Policy Design, Political Learning, and Political Action ». The American Political Science Review 93 (2) : 363-80. https://doi.org/10.2307/2585401.
Spire, Alexis. 2018. Résistances à l'impôt, attachement à l'État. Enquête sur les contribuables français. Paris : Éditions du Seuil.
Vivès, Claire, Luc Sigalo Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois, et Hadrien Clouet. 2023. Chômeurs vos papiers ! contrôler les chômeurs pour réduire le chômage ? Paris : Raisons d'agir éditions.
ANNEXE
Principaux apports du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
Ce texte pose une règle de droit commun d'absence de sanction dans l'ensemble des cas de retard, d'omissions ou d'inexactitudes dans les déclarations sociales comme pour les paiements de cotisations en cas de contrôle.
1. Non-application des majorations de retard et pénalités en cas de déclaration régularisatrice
Le décret du 11 octobre 2019 confirme le principe selon lequel l'employeur doit corriger, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents. L'employeur doit alors verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. La correction peut intervenir de la propre initiative de l'employeur ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève.
En dehors des cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités ne sont pas applicables aux erreurs corrigées si l'une des conditions suivantes est remplie :
- la déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales sont adressés au plus tard lors de la première échéance qui suit celle de la déclaration et du versement initial ;
- le versement de régularisation est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales ou, depuis le 1er janvier 2020, le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
2. Non-application des majorations de retard en cas de retard de paiement des cotisations
Depuis le 1er janvier 2020, les cotisants respectant certaines conditions434(*) bénéficient d'une non-application des majorations de retard initiales et complémentaires. Par ailleurs, la non-application des majorations aux cotisants ayant obtenu un accord de délai dans les 30 jours suivant la date d'exigibilité des cotisations, est effective dès lors que les deux conditions tenant à l'absence de retard dans les 24 mois et au montant des sanctions encourues sont remplies.
3. Non-application des majorations de retard initiales suite à contrôle
Depuis avril 2020, aucune majoration de retard initiale à l'issue d'un contrôle comptable d'assiette, d'un contrôle sur pièces ou d'un contrôle demandé par l'employeur n'est appliquée, sauf dans deux types de situation (article R. 243-17 du code de la sécurité sociale) :
- application d'une majoration/pénalité au titre d'un abus de droit, de travail dissimulé ou d'obstacle à contrôle, de la non mise en conformité suite aux observations formulées lors d'un précédent contrôle ;
- montant des sommes redressées supérieur ou égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
Source : mission d'information, d'après le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
* 1 SGMAP, « Suivre pas à pas l'usager pour améliorer le service au public », Les cahiers du SGMAP, 1, 2012.
* 2 Cour des comptes, La délivrance des titres d'identité et de circulation - Une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter, communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.
* 3 « Au coeur d'un imbroglio juridique, ce retraité de Vichy doit prouver... qu'il est en vie », La Montagne, 8 février 2019.
* 4 Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham - reportage, 2011.
* 5 Proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaitre, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français, Assemblée nationale, n° 4569 (14 octobre 2021).
* 6 Audition de M. Jean-Denis Combrexelle par la mission d'information, le 13 mai 2025. Tous les comptes-rendus des auditions plénières de la mission d'information sont disponibles sur la page internet de celle-ci, sur le site du Sénat : www.senat.fr/compte-rendu-commissions/mi-services-publics.html
* 7 Dans Les 12 travaux d'Astérix, l'une des épreuves, sur le modèle des douze travaux d'Hercule, consiste à obtenir un laissez-passer, le formulaire A38, qui permet d'accéder à l'épreuve suivante. Après avoir erré d'étage en étage et de guichet en guichet dans « la maison qui rend fou », Astérix finit par récupérer le document. « - Que voulez-vous ? - Le laissez-passer A38. - Vous avez le formulaire bleu ? - Le formulaire bleu ? Non. - Et alors, comment voulez-vous obtenir le laissez-passer A38 ? - Et où trouverai-je le formulaire bleu ? - Guichet 1 ».
* 8 Baromètre du numérique, rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), mars 2025.
* 9 Vu dans un cahier de doléances de l'Indre ; cité dans Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français », n° 78 (mars à mai 2025).
* 10 Conseil d'État, L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique - un enjeu d'efficacité et une exigence démocratique, étude annuelle 2023.
* 11 « Les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote », Sondage OpinionWay pour le Sens du service public, janvier 2025.
* 12 Défenseur des droits, Rapport d'activité, 2022.
* 13 INSEE, « Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 », INSEE Focus, n° 267, 11 mai 2022.
* 14 Défenseur des droits, L'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) : une dématérialisation à l'origine d'atteintes massives aux droits des usagers, 2024.
* 15 Source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 16 Les maisons France services, levier de cohésion sociale, rapport d'information fait au nom de la commission des finances par M. Bernard Delcros (n° 778, 2021-2022).
* 17 L'IA et l'avenir du service public ; cinq rapports thématiques faits au nom de la délégation à la prospective par : M. Didier Rambaud et Mme Sylvie Vermeillet (« IA, impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude », n° 491, 2024-2025) ; M. Christian Redon-Sarrazy et Mme Anne Ventalon (« IA et santé », n° 611, 2024-2025) ; MM. Christian Bruyen et Bernard Fialaire (« IA et éducation », n° 101, 2024-2025) ; Mme Amel Gacquerre et M. Jean-Jacques Michau (« IA, territoires et proximité », n° 342, 2024-2025) ; M. Jean-Baptiste Blanc et Mmes Nadège Havet et Christine Lavarde (« IA et environnement », n° 379, 2024-2025).
* 18 Mmes Pascale Gruny et Ghislaine Senée, rapporteures.
* 19 Baromètre du numérique, rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), mars 2025.
* 20 Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur la présentation du projet ADELE (source : site vie-publique.fr).
* 21 Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur la présentation du projet ADELE (source : site vie-publique.fr).
* 22 Sur le site www.fairesimple.gouv.fr
* 23 Conseil des ministres du 5 novembre 2014, site vie-publique.fr.
* 24 Voir infra.
* 25 Nations Unies, Enquête sur l'e-gouvernement - L'avenir du gouvernement numérique, 12e édition, 2022.
* 26 Classement établi sur la base de l'« e-governement development index » (EDGI). Selon ce classement, la France se situait, en 2022, au sein des pays du continent européen ayant l'indice de développement de l'administration numérique le plus élevé, après le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Islande, l'Estonie, les Pays-Bas, le Royaume Uni, Malte, la Norvège et l'Espagne. Elle était classée avant l'Autriche, la Slovénie, l'Allemagne, la Suisse, la Lituanie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Lettonie, l'Irlande, la Grèce, la Pologne, l'Italie, le Portugal, la Belgique et la Serbie.
* 27 Source pour les développements et les citations ci-dessous, relatifs au Danemark : réponses écrites de l'ambassade de France au Danemark au questionnaire de la rapporteure.
* 28 ONU, E-Goverment survey, 2024.
* 29 Source : réponses écrites de l'ambassade de France au Royaume-Uni au questionnaire de la rapporteure.
* 30 « Tout ce qui peut être accessible en ligne devrait être accessible en ligne et seulement en ligne » (Francis Maude, ministre du Cabinet Office, 2012).
* 31 Source : réponses écrites de l'ambassade de France en Espagne au questionnaire de la rapporteure.
* 32 Selon le classement établi par la Commission européenne pour suivre les progrès des pays de l'UE en matière de compétitivité numérique (DESI ou Digital Economy and Society Index).
* 33 Source : division de la législation comparée du Sénat.
* 34 Source : division de la législation comparée du Sénat.
* 35 Léa Dudit, « Estonie : une digitalisation des services publics construite autour d'événements de vie », Action publique. Recherche et pratiques 2022/3, N° 15, pp. 40-41.
* 36 Parlement européen, résolution du 18 avril 2023 sur l'administration en ligne : accélérer les services publics numériques à l'appui du fonctionnement du marché unique européen (2022/2036(INI)).
* 37 The Once Only Principle Project ou « Dites-le nous une fois ».
* 38 Cour des comptes, L'accès aux services publics dans les territoires ruraux, enquête demandée par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, mars 2019.
* 39 Il s'agissait d'unités à très faible activité ou à faible effectif ainsi que d'unités implantées en zone police.
* 40 Dans le cadre de la création de regroupements pédagogiques intercommunaux (DGI).
* 41 Compte rendu du 30 avril 2025.
* 42 Les 20 000 cahiers remplis dans environ 17 000 communes représentent 220 000 contributions, pour un volume de 500 000 pages (source : audition de Marie-Vic Ozouf-Marignier).
* 43 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).
* 44 Les développements et citations ci-après ont pour source l'audition de Mme Ozouf-Marignier.
* 45 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).
* 46 Compte rendu du 28 mai 2025.
* 47 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).
* 48 Compte rendu du 28 mai 2025.
* 49 La Cour des comptes s'étonnait pourtant en 2019 que le réseau de la DGFiP soit encore « parmi les plus denses de la sphère publique » en dépit des avancées franchies en matière de télédéclaration et de télépaiement : avec une contraction de 5,6% seulement entre 2011 et 2016, le réseau de la DGFiP s'appuyait en 2017 sur « un très grand nombre de petites unités » (631 trésoreries employant entre un et quatre ETP ; plus de 1 600 comptant moins de dix agents). Les antennes locales étaient de ce fait « trois fois plus nombreuses qu'en Allemagne ». Elle observait toutefois que « Les décisions de réaménagement du réseau semblent trop souvent prises de façon ponctuelle, en particulier à l'occasion des départs en retraite d'agents affectés à des services devenus trop petits. Ainsi, des décisions de fermeture peuvent concerner des sites ayant réalisé des travaux immobiliers importants au cours des années précédentes. Par ailleurs, le réaménagement des niveaux d'exercice des missions de la DGFiP, qui a parfois eu pour effet de réduire sensiblement la présence de l'État dans certains territoires, a été mené sans concertation avec les entités publiques », ce qui a pu amplifier le sentiment d'abandon ressenti dans certains territoires. (Source : L'accès aux services publics dans les territoires ruraux, enquête demandée par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, Cour des comptes, mars 2019).
* 50 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 51 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 52 Compte rendu du 29 avril 2025.
* 53 Compte rendu du 20 mai 2025.
* 54 Compte rendu du 17 juin 2025.
* 55 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 56 Compte rendu du 8 avril 2025.
* 57 « L'état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources numériques » (source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 58 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019. En 2022, le Défenseur des droits a publié « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? ».
* 59 Créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur. Sa création s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation des démarches de demande de titres sécurisés mise en oeuvre lors de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Source : Cour des comptes, L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives, 9 février 2024.
* 60 Plan Préfectures Nouvelle Génération / 2017 - Actualités / Archives des actualités / Archives - Ministère de l'Intérieur (site interieur.gouv.fr).
* 61 Source : site du ministère de l'intérieur.
* 62 Source : Cour des comptes, « L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives », 9 février 2024.
* 63 Cour des comptes, « L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives », 9 février 2024.
* 64 Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.
* 65 Un quart de rendez-vous supplémentaires, soit 40 000 rendez-vous par semaine, ont été proposés en mairie pendant l'été 2023 par rapport à l'été 2022. Source : Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.
* 66 Source : Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.
* 67 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019.
* 68 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019.
* 69 Source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 70 Source : audition plénière de Mme Claire Hédon, Défenseure des droits, le 20 mai 2025.
* 71 Source : audition plénière de Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier, géographe, le 28 mai 2025.
* 72 Audition de Mme Marie-Agnès Petit, présidente du département de la Haute-Loire, représentant Départements de France, 17 juin 2025.
* 73 « Sondage OpinionWay pour le Sens du service public », janvier 2025 ; échantillon de 2061 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.
* 74 Commerces alimentaires de proximité : 42% des répondants considèrent qu'ils devraient être considérés comme des services publics (boulangeries : 39% ; cafés : 28%).
* 75 Source : audition de M. Johan Theuret et Mme Émilie Agnoux, de l'association Le Sens du service public, 30 avril 2025.
* 76 Jean-Denis Combrexelle, Les Normes à l'assaut de la démocratie, 2024.
* 77 Source : audition du directeur général adjoint délégué, en charge de la stratégie, de l'innovation et de l'expérience usager (France travail), 10 juin 2025.
* 78 Parlement européen, résolution du 18 avril 2023 sur l'administration en ligne : accélérer les services publics numériques à l'appui du fonctionnement du marché unique européen (2022/2036(INI)).
* 79 Audition plénière de Mme Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville, 17 juin 2025.
* 80 L'échantillon est important : 25 000 usagers.
* 81 Assurance maladie, service des impôts, hôpitaux publics, France titres, une école/un établissement scolaire, CAF, France travail, Assurance retraite (CARSAT), Gendarmerie nationale, France services, Police nationale, Pass culture, une université, Urssaf, agence de services et de paiement, France Rénov/MaPrimeRenov'/MaPrimeAdapt', les tribunaux, un CROUS, la MSA.
* 82 Ce baromètre évalue au total 58 016 expériences usagers, chaque répondant ayant été en mesure d'évoquer ses contacts avec différents services publics (trois au plus par personne).
* 83 Source : Baromètre des services publics, Volet grand public, Vague 2025 (Tolouna-Harris Interactive pour le Gouvernement).
* 84 Source : Baromètre des services publics, op. cit., Juin 2025.
* 85 Enquête réalisée en ligne par Toluna et Harris Interactive pour l'Institut Paul Delouvrier entre le 20 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 (échantillon représentatif de la population française comprenant 2 625 personnes, méthode des quotas).
* 86 Police et gendarmerie ; sécurité sociale ; environnement ; santé publique ; fiscalité et collecte des impôts ; logement ; éducation nationale ; emploi et lutte contre le chômage ; justice.
* 87 Audition de M. Matthieu Delouvrier (présentation du Baromètre annuel de l'Institut Paul Delouvrier sur « Les services publics vus par les Français et les usagers »), 29 avril 2025.
* 88 Sondage OpinionWay pour Le sens du service public ; échantillon de 2 061 personnes, méthode des quotas, questionnaire auto-administré, interviews effectuées entre le 7 et le 14 janvier 2025.
* 89 Même si ce sondage fait état de 74% de réponses positives à la question « Avez-vous ou non déjà vécu une mauvaise expérience avec un service public en France ? ».
* 90 Audition de M. Johan Theuret et Mme Émilie Agnoux, de l'association Le Sens du service public, 30 avril 2025.
* 91 Auxquels s'ajoute le médecin, spontanément cité par les répondants mais non intégré au questionnaire.
* 92 Sondage OpinionWay pour Le sens du service public ; échantillon de 2 061 personnes, méthode des quotas, questionnaire auto-administré, interviews effectuées entre le 7 et le 14 janvier 2025.
* 93 Audition de M. Johan Theuret et Mme Émilie Agnoux, de l'association Le Sens du service public, 30 avril 2025.
* 94 Compte rendu du 11 juin 2025.
* 95 Baromètre du numérique, rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), mars 2025.
* 96 Source : audition de l'association Le sens du service public, 30 avril 2025.
* 97 Baromètre des services publics - Volet grand public, juin 2025.
* 98 Source : audition du 25 juin 2025.
* 99 Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
* 100 Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
* 101 En supprimant la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d'apprentissage ainsi que la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés, et simplifiant les règles applicables aux avenants aux marchés publics.
* 102 Telles que la suppression du certificat médical prénuptial - qui représentait près de 270 000 déclarations annuellement -, l'octroi aux parties à un litige devant diverses juridictions de la possibilité d'être assistées ou représentées par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), ou la suppression du récépissé fiscal de déclaration d'ouverture de succession pour les organismes d'assurance.
* 103 Cette loi a également permis l'inscription du nom du partenaire de PACS sur l'acte de décès et prévu des mesures de protection des usagers contre les variations anormales de leur facture d'eau. À l'égard des entreprises, cette loi a plus particulièrement prévu l'application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif, assoupli les obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition en leur permettant de tenir une comptabilité de trésorerie et de présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé, supprimé le rapport du commissaire aux comptes en cas d'augmentation de capital d'une société anonyme avec suppression du droit préférentiel de souscription et allégé la fourniture d'attestations par les entreprises pour la lutte contre le travail dissimulé.
* 104 Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
* 105 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
* 106 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
* 107 Assemblée nationale, rapport d'information relatif au bilan d'activités de la commission des lois sous la XIIIème législature (2007-2012), fait par M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des lois, n° 442, déposé le 29 février 2012, p. 26.
* 108 Ibidem, p. 24.
* 109 Conseil d'état, L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique - un enjeu d'efficacité et une exigence démocratique, étude annuelle 2023, p. 183.
* 110 Communiqué de presse du Premier ministre Manuel Valls, 3 février 2016, « Simplifier partout où c'est nécessaire : c'est, depuis trois ans, notre mot d'ordre ! ».
* 111 Arnaud Desprairies. La décision implicite d'acceptation en droit administratif français. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2019. Annexe n°2, p. 508.
* 112 Arnaud Desprairies. opcit.
* 113 Simplifier efficacement pour libérer les entreprises, rapport d'information fait au nom de la délégation aux entreprises par Mme Élisabeth Lamure et Olivier Cadic, 2016-2017, n° 433, pp. 8-9.
* 114 Rapport n° 329 (2017-2018) fait au nom de la commission spéciale par Pascale Gruny et Jean-Claude Luche, déposé le 22 février 2018, p. 26.
* 115 Ibidem, p. 28.
* 116 Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Voir en annexe le commentaire de ce texte.
* 117 L'article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dite loi ESSOC crée une douzaine de procédures de rescrits sectoriels.
* 118 Article 74 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
* 119 Rapport fait par M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel au nom de la commission des lois, n° 12 (2019-2020) ; déposé le 2 octobre 2019, page 173.
* 120 Sur cette base, le décret n° 2011-452 du 25 mai 2011 relatif aux simplifications des démarches et formulaires administratifs prévoyait qu'une commission pour les simplifications administratives devait veiller à ce que « l'administration émettrice d'un formulaire ne réclame pas aux usagers des informations déjà détenues ou susceptibles de lui être régulièrement communiquées par une autre administration ».
* 121 Décret n° 2019-31 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un état au service d'une société de confiance et n° 2019-33 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'application de l'article l. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
* 122 Décret n° 2023-362 du 11 mai 2023 relatif à la liste des administrations chargées de mettre à la disposition d'autres administrations des informations ou données.
* 123 Conseil d'état, L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique - un enjeu d'efficacité et une exigence démocratique, étude annuelle 2023, p. 183.
* 124 Conseil d'État, sec., req. n° 452798, 3 juin 2022. Ce recours pour excès de pouvoir demandait l'annulation du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour 2°) et de l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer en date du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice.
* 125 Conseil d'État, sec., req. n° 452798, 3 juin 2022.
* 126 Ibidem.
* 127 Conseil d'État, req. n° 471537, 31 octobre 2023.
* 128 Arrêté du 19 décembre 2023 portant organisation de la direction interministérielle de la transformation publique.
* 129 Source : réponses de la DITP au questionnaire de la rapporteure.
* 130 Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'état et à la direction interministérielle du numérique, article 6 (modifié par le décret n° 2023-304 du 22 avril 2023).
* 131 Source : site https://www.numerique.gouv.fr/
* 132 Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'état et à la direction interministérielle du numérique, article 6-1 (modifié par le décret n° 2023-304 du 22 avril 2023).
* 133 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Londres au questionnaire de la rapporteure.
* 134 Cour des comptes, Le pilotage de la transformation numérique de l'État par la direction interministérielle du numérique, juillet 2024.
* 135 DILA, Rapport d'activité 2023.
* 136 Source : DITP, réponses écrites au questionnaire de la rapporteure.
* 137 Source : DINUM, réponses écrites au questionnaire de la rapporteure.
* 138 Source : DILA, rapport d'activité 2023.
* 139 Décret n° 2017-1586 du 20 novembre 2017.
* 140 Source pour ce paragraphe : Premier CITP, Dossier de presse, 1er février 2018.
* 141 Source : Deuxième CITP, Dossier de presse, 29 octobre 2018. Toutes les citations de ce paragraphe sont issues de ce document.
* 142 Ce service fait l'objet d'un focus infra.
* 143 En octobre 2018, 350 démarches ont déjà été dématérialisées grâce à cet outil, notamment le dépôt des offres de stage pour les élèves de 3ème dont les collèges sont en REP+ ou les dossiers d'études d'impact environnementales et d'attestation d'accessibilité recevant du public.
* 144 Troisième CITP, Dossier de presse, 20 juin 2019.
* 145 Source : Quatrième CITP, Dossier de presse,15 novembre 2019.
* 146 Exemples de données : revenu fiscal de référence, adresse, informations contenues dans les attestations relatives au statut étudiant, informations contenues dans les attestations relatives au chômage ...
* 147 Source : Cinquième CITP, Dossier de presse, 5 février 2021.
* 148 Par exemple : demande de permis de conduire ; demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience ; demande d'agrément d'assistant maternel ; demande MDPH ; demande d'acquisition de la nationalité française ; demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; demande de logement social ; demande de RSA et de prime d'activité.
* 149 Celui-ci consiste à mettre l'accent sur la création d'emplois dans les services départementaux de l'État et à faire du département le « premier échelon de l'action publique de la vie quotidienne des Français, en s'appuyant sur le couple maire-préfet ».
* 150 À titre d'exemple, le pré-remplissage du revenu fiscal de référence permet la simplification du simulateur de droit sociaux, la simplification de la demande ou du renouvellement de logement social et la simplification de la demande d'aide juridictionnelle. La simplification des démarches concerne naturellement aussi les collectivités territoriales, à partir d'une meilleure circulation de la donnée avec l'État : ainsi, le tarif de la carte de transport passe par le croisement des informations sur le revenu fiscal de référence, le quotient familial et les statuts étudiant et boursier.
* 151 Source : Cinquième CITP, Dossier de presse, 5 février 2021.
* 152 Source : Septième CITP, Dossier de presse, 9 mai 2023.
* 153 Source : Huitième CITP, Dossier de presse, 23 avril 2024.
* 154 Compte rendu du 13 mai 2025.
* 155 Le premier ministre de la fonction publique qui a vu la simplification ajoutée à ses attributions est Guillaume Kasbarian, prédécesseur de Laurent Marcangeli, ministre entre septembre et décembre 2024.
* 156 Audition plénière du 25 juin 2025.
* 157 Réponses écrites de la DITP à un questionnaire de la rapporteure.
* 158 Compte rendu de l'audition de M. Jean-Denis Combrexelle, 13 mai 2025.
* 159 Réponses écrites de la CNAV au questionnaire de la rapporteure.
* 160 Réponses écrites de la CNAM au questionnaire de la rapporteure.
* 161 Dossier de presse du 7e CITP du 23 mai 2023.
* 162 Ibidem.
* 163 Les cahiers du SGMAP, 1, 2012.
* 164 On observe une approche similaire en Estonie (Léa Dudit, « Estonie : une digitalisation des services publics construite autour des événements de vie », Action publique. Recherches et pratiques, 2022/ » N° 15, pp. 40-41).
* 165 Travail, éducation, impôts, vie (soit l'équivalent de nos « moments de vie »), élections, loisirs, retraite, immigration, aides sociales, protection de l'environnement, protection des consommateurs, papiers d'identité.
* 166 Source : réponses écrites de la DITP au questionnaire de la rapporteure.
* 167 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_cadrage_aller_vers.pdf
* 168 Audition plénière de France Urbaine, le 3 juin 2025.
* 169 Un développement spécifique est consacré à l'IA en dernière partie du rapport.
* 170 Réponses écrites de l'Acoss au questionnaire de la rapporteure.
* 171 Réponses écrites de la Cnav au questionnaire de la rapporteure ; voir aussi infra, le développement consacré à l'intelligence artificielle.
* 172 Prélèvement à la source.
* 173 Cour des comptes, « La mise en oeuvre du prélèvement à la source », 2022.
* 174 MEDEF, CGPME, CNRACL, FO, CFE-SGC, CGT, CFTC, CFDT.
* 175 Créée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (mise en oeuvre en 2017 puis généralisée en 2019 à l'ensemble du secteur privé).
* 176 Selon la Cour des Comptes, « Un scenario de réforme sans adossement à la déclaration sociale nominative avait été envisagé par l'administration fiscale. Il n'a pas été retenu car il aurait conduit à dépasser les délais imposés pour la réforme, à créer une nouvelle plateforme déclarative et, in fine, à devoir renoncer à un taux personnalisé de prélèvement à la source pour appliquer un taux forfaitaire se traduisant par d'importants restes à payer ou des sommes trop versées ».
* 177 À cette date en effet, selon la Cour des comptes, 84,7 % du paiement de l'impôt sur le revenu était dématérialisé et 58 % des ménages le payaient par mensualité.
* 178 La Cour des comptes a ainsi recommandé à la DGFiP, en 2021, de renforcer le suivi des questions adressées par les contribuables à l'administration fiscale en l'élargissant à l'ensemble des canaux de contact.
* 179 Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe sur les logements vacants.
* 180 Cour des comptes, « « Gérer mes biens immobiliers », une campagne 2023 chaotique aux très lourdes conséquences financières pour l'État », janvier 2025.
* 181 DGFiP, Précisions suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'outils « gérer mes biens immobiliers », communiqué de presse, 29 janvier 2025.
* 182 Source : rapport d'activité 2024.
* 183 Allô Service Public délivre par téléphone des informations généralistes (à l'exclusion de tout renseignement sur les dossiers personnels des usagers auxquels il n'a pas accès) sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans les domaines suivants : droit du travail (secteur privé), logement et urbanisme, procédures en justice, civiles et pénales, droit de la famille, droit des étrangers, des associations, état civil.
* 184 Chiffre cumulant les visites sur Service-Public.fr, Entreprendre.Service-Public.fr et Lannuaire.Service-Public.fr
* 185 La DILA opère pour ses partenaires des démarches en ligne telles que la demande d'inscription sur les listes électorales (ILE), le recensement citoyen obligatoire (RCO), la demande d'actes d'état civil (AEC) ou encore la demande de déclaration de changement de coordonnées (JCC). Source : DILA, rapport d'activité 2024.
* 186 Voir infra la partie consacrée à l'administration des Français de l'étranger.
* 187 Organisation des Nations Unies, E-Government survey 2014 - E-government for the future we want. United Nations e-Government Survey 2014.
* 188 P. 88 du rapport de l'ONU.
* 189 Données présentées lors de la visite de la mission d'information au siège de la DILA, le 24 juin 2025.
* 190 Par opposition au référencement payant (les résultats identifiés comme « sponsorisés » en tête des résultats de recherche).
* 191 C'est le cas notamment pour l'obtention du certificat d'immatriculation ; voir infra où le sujet est abordé en détail.
* 192 Je déménage en France ; Je pars de chez mes parents ; J'attends un enfant ; Un proche est décédé ; Je suis en situation de handicap ; Mon enfant est en situation de handicap ; Je souhaite devenir alternant ; Je souhaite travailler dans l'administration ; Je prépare ma retraite ; J'achète un logement ; Je veux obtenir un crédit immobilier ; Je me sépare ; J'ai besoin de faire garder mes enfants ; Je pars vivre à l'étranger ; Je vis à l'étranger ; Je rentre en France après avoir vécu à l'étranger ; Je recherche un emploi ; J'organise ma succession ; Je suis une victime ou un proche de victime d'acte terroriste ; Je crée une association ; Mon association organise un évènement.
* 193 Ainsi la page suivante du site de la DITP : https://www.modernisation.gouv.fr/simplifier-la-vie-des-usagers-et-des-agents/simplifier-les-demarches-administratives-par-moments-de
* 194 Disponible sur le site du ministère : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide-etudiant-2025
* 195 Vous attendez un enfant ; Vous devez faire face au décès d'un proche ; autonomie et grand âge ; Vous êtes en situation de handicap ; votre enfant est en situation de handicap ; Vous avez besoin de faire garder vos enfants ; Vous cherchez un emploi ; Vous préparez votre retraite ; Vous vous séparez de votre conjoint ; Vous quittez votre logement ; Vous partez de chez vos parents ; Vous partez vivre à l'étranger ; Vous êtes étranger et vous vivez en France ; Vous revenez vivre en France.
* 196 https://www.modernisation.gouv.fr/actualites/un-de-mes-proches-est-decede-un-guide-des-demarches-realiser
* 197 La fiche PDF concerne uniquement les décès en France ; la fiche disponible sur internet fait référence au cas d'une décès survenu à l'étranger, mais uniquement dans l'hypothèse d'un court séjour et non du décès d'une personne expatriée.
* 198 https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/vos-evenements-de-vie/parcours-deces.
* 199 Ainsi dans le guide proposé par service-public.fr, il est conseillé de contacter la banque du défunt dans les 24 à 72 heures ; dans le guide mesdroitssociaux.fr, sous 8 jours.
* 200 Les paragraphes qui suivent sont issus des échanges tenus avec les équipes de la DILA lors de la visite du 24 juin 2025.
* 201 Ainsi, une recherche sur les démarches de renouvellement de passeport dans Gemini, l'outil d'intelligence artificielle de Google, ne fait pas apparaître service-public.fr en tant que source de l'information délivrée.
* 202 Voir infra la présentation de cet outil.
* 203 Il est difficile d'avoir des données précises, d'abord parce qu'une grande partie des Français résidant à l'étranger ne sont pas inscrits au registre, ensuite parce que c'est une population peu suivie. La dernière étude détaillée publiée par la DFAE, reposant sur un sondage auprès de 9 000 personnes, a été conduite en 2012. Elle fait apparaître que « parmi les expatriés exerçant une activité professionnelle, plus de la moitié déclarent un niveau de revenu annuel net supérieur à 30 000 €, et 28 % plus de 60 000 € » alors que « le revenu salarial moyen en 2010, sur l'ensemble de la population salariée en France métropolitaine, était de près de 19 500 € nets annuels ». Cela n'est pas à dire que les Français à l'étranger soient une population favorisée dans son ensemble : dans de nombreuses régions du monde, en particulier au Moyen-Orient, des Français sont en situation de précarité.
* 204 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.
* 205 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.
* 206 Audition plénière de Mme Pauline Carmona, 7 mai 2025.
* 207 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.
* 208 Source : réponse à une question complémentaire adressée par la rapporteure à la DFAE.
* 209 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.
* 210 Outil mis en place par la Dinum.
* 211 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.
* 212 La Cour des comptes a à nouveau recommandé sa mise en place dans un rapport de novembre 2024.
* 213 Rapport d'information fait par M. François-Noël Buffet au nom de la commission des lois sur les dysfonctionnements constatés lors des élections départementales et régionales de juin 2021.
* 214 Audition plénière de Mme Pauline Carmona, 7 mai 2025.
* 215 Audition plénière du 17 juin 2025.
* 216 Audition plénière de Mme Carmona, 7 mai 2025.
* 217 Source : réponses écrites de la Dinum au questionnaire de la rapporteure.
* 218 Ibid.
* 219 www.jeunes.gouv.fr/le-simulateur-mes-aides
* 220 Lors de l'audition de Mme Laurence Tison-Vuillaume, présidente de la SAS pass Culture par la commission de la culture du Sénat, le 26 mars 2025, notre collègue Jacques Grosperrin a évoqué les « difficultés considérables rencontrées par les chefs d'établissement pour se connecter à la plateforme ADAGE », plateforme numérique de l'éducation nationale dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle.
* 221 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.
* 222 Le Government Digital Service a été créé en 2011. L'agence 18F est née en 2014, mais a cessé d'exister en mars 2025, victime des coupes massives dans l'État fédéral engagées par le Department of Government Efficiency (DOGE) sous la direction d'Elon Musk.
* 223 Voir les données publiées par beta.gouv sur son site.
* 224 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.
* 225 Ibid.
* 226 « Démarches simplifiées », aujourd'hui accessible sur le site demarches-simplifiees.fr, est en cours de migration sur la plateforme demarche.numerique.gouv.fr. À la date de rédaction du rapport, le site n'était pas encore accessible.
* 227 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.
* 228 « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? », rapport publié en février 2022.
* 229 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 230 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Athènes au questionnaire de la rapporteure.
* 231 Ibid.
* 232 À ce jour, le fonctionnement des KEP est encadré par les lois n°3013/2002 modifiée, n°4250/2014 (mars 2014) et n°4704/2020 (juillet 2020), qui ont progressivement modernisé l'outil en l'adaptant aux nouvelles technologies afin de simplifier et fluidifier l'accès aux services (source : ambassade de France à Athènes).
* 233 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Athènes au questionnaire de la rapporteure.
* 234 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.
* 235 Audition plénière de Mme Françoise Gatel, 24 juin 2025.
* 236 Le nombre des France services a connu depuis sa création une augmentation régulière : 460 structures en janvier 2020 ; 1123 en janvier 2021 ; 1745 en octobre 2021 ; 2198 en avril 2022 ; 2561 en novembre 2022 ; 2600 en juin 2023 ; 2700 en janvier 2024 ; 2800 en janvier 2025 (source : france-services.gouv.fr, consulté le 23 juillet 2025).
* 237 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.
* 238 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 239 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.
* 240 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 241 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 242 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.
* 243 Données : mai 2025. Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.
* 244 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 245 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 246 Les maisons France services, levier de cohésion sociale, rapport d'information fait au nom de la commission des finances par M. Bernard Delcros (n° 778, 2021-2022). Essentiel du rapport, p. 4.
* 247 Audition plénière du 24 juin 2025.
* 248 Audition plénière du 20 mai 2025.
* 249 Contribution écrite de la Banque des territoires transmise à la mission d'information.
* 250 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 251 Audition plénière du 7 mai 2025. Voir également la partie consacrée aux initiatives de la DFAE dans ce domaine.
* 252 Les citations ci-après reproduisent des passages de réponses ; la synthèse de la consultation est annexée à ce rapport.
* 253 Source : réponses adressées par les élus consultés par la mission d'information sur la plateforme en ligne du Sénat.
* 254 « Solidarité à la source : éviter les embûches pour assurer le versement à bon droit des prestations », rapport d'information de M. René-Paul Savary et Mme Raymonde Poncet-Monge pour la commission des affaires sociales, déposé le 5 juillet 2023.
* 255 Note transmise à la mission d'information par l'association France urbaine, entendue en audition plénière le 3 juin 2025.
* 256 Réponse de la DITP à un questionnaire envoyé par la rapporteure.
* 257 Contribution de France Urbaine transmise à la mission d'information.
* 258 Article L146-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 11 février 2005.
* 259 Loi handicap : 20 ans après, quel bilan ?, rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales par Mmes Chantal Deseyne, Corinne Féret et Marie-Pierre Richer, rapporteurs, N° 306 (2024-2025).
* 260 Réponses écrites de Départements de France au questionnaire de la rapporteure.
* 261 Synthèse des résultats d'une enquête menée dans la Communauté urbaine d'Arras dans le cadre du programme « Territoire zéro non-recours », reposant sur 2 605 questionnaires recueillis entre fin septembre et début novembre 2024.
* 262 Contribution transmise par France Urbaine à la mission d'information.
* 263 Audition plénière du 25 juin 2025.
* 264 https://handicap.gouv.fr/transformation-des-mdph-vers-une-simplification-des-demarches-et-des-parcours-de-vie
* 265 Audition de Mme Françoise Gatel par la mission d'information, 24 juin 2025.
* 266 Source : Conseil scientifique de France ruralité, Des campagnes aux ruralités : changer de regard sur les ruralités, pour des politiques publiques adaptées à leurs réalités et soucieuses de leur diversité, juin 2025.
* 267 Source : Conseil scientifique de France ruralité, Des campagnes aux ruralités : changer de regard sur les ruralités, pour des politiques publiques adaptées à leurs réalités et soucieuses de leur diversité, juin 2025.
* 268 Audition de Mme Françoise Gatel par la mission d'information, 24 juin 2025.
* 269 Fondation Jean Jaurès, février 2025, Enquête sur les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote, janvier 2025.
* 270 Audition de Mme Françoise Gatel par la mission d'information, 24 juin 2025.
* 271 Pauline Virot, « Grandir dans un territoire rural : quelles différences de condition de vie par rapport aux espaces urbains ? », Drees, mars 2021.
* 272 Audition de Mme Françoise Gatel par la mission d'information, 24 juin 2025.
* 273 « On n'installera pas dans la ruralité des navettes de bus ou de train, lesquelles seraient totalement inadaptées en l'absence de flux importants : les gens n'allant pas tous travailler à la même heure, il faut une offre de mobilité souple, agile » ; source : audition de Mme Françoise Gatel par la mission d'information, 24 juin 2025.
* 274 Audition de Juliette Méadel par la mission d'information, 17 juin 2025.
* 275 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 276 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 277 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 278 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 279 Audition de la ministre déléguée chargée de la ville, 17 juin 2025.
* 280 Source : réponses de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 281 Audition de la ministre déléguée chargée de la ville, 17 juin 2025.
* 282 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 283 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 284 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 285 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 286 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 287 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 288 Audition du directeur général des outre-mer, 17 juin 2025.
* 289 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 290 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 291 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 292 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 293 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 294 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.
* 295 Contribution écrite adressée à la rapporteure.
* 296 « C'est l'histoire de Mme Murat », in SGMAP, « Suivre pas à pas l'usager pour améliorer le service au public », Les cahiers du SGMAP, 1, 2012.
* 297 Nations Unies, Enquête sur l'e-gouvernement - L'avenir du gouvernement numérique, 12e édition, 2022.
* 298 Défenseur des droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en sommes-nous ?, 2022.
* 299 L'illectronisme ne disparaitra pas d'un coup de tablette magique !, rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 300 INSEE, « 15 % de la population est en situation d'illectronisme en 2021 », INSEE première, n°1953, Juin 2023.
* 301 Audition plénière du 17 juin 2025.
* 302 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 303 Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions (CREDOC), Baromètre du numérique, 2025.
* 304 Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions (CREDOC), Baromètre du numérique, 2025.
* 305 Une étude de l'INSEE observe toutefois que « sur les 91 % de personnes équipées en 2021, 6 % n'utilisent pas Internet : près des deux tiers d'entre elles sont retraitées et la plupart ne vivent pas seules, ce qui laisse présumer que la connexion Internet du domicile est utilisée par un autre membre du foyer ». Source : « 15 % de la population est en situation d'illectronisme en 2021 », INSEE première, n° 1953, Juin 2023.
* 306 Cour des comptes, Les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique - communication à la commission des finances du Sénat, avril 2025.
* 307 Compte rendu du 8 avril 2025.
* 308 Cour des comptes, Les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique - communication à la commission des finances du Sénat, avril 2025.
* 309 Lors de l'audition plénière de l'association France urbaine, le 3 juin 2015.
* 310 Les données ci-après se fondent sur les informations exposées au président et à la rapporteure lors de leur visite.
* 311 Au 30 novembre 2024.
* 312 Audition de la défenseure des droits, 20 mai 2025.
* 313 Source : réponses écrites de la ministre déléguée chargée de la ville au questionnaire de la rapporteure.
* 314 Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme relevait ainsi que « contrairement à une idée reçue, les jeunes, les millenials, y compris les étudiants, manquent également de compétences numériques » (L'illectronisme ne disparaitra pas d'un coup de tablette magique !, rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020).
* 315 Selon les réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure, « L'expérimentation menée avec les Crous de Toulouse et d'Amiens en 2023 s'est déroulée de manière satisfaisante. Cependant, les volumes de sollicitation en France services sont restés marginaux, en partie liés à la durée assez courte de l'expérimentation, qui n'a pas permis de mettre en place un relais efficace entre le Crous et les France services. L'ANCT et les Crous se sont cependant accordés sur l'intérêt d'une intégration des démarches au bouquet de services, bien que cela n'ait pas pu être réalisé en raison des moyens financiers limités soulignés par les CNOUS ».
* 316 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 317 Voir infra la synthèse de ces réponses.
* 318 C'est le cas notamment des formations délivrées par la CPAM dans le Finistère, comme il a été indiqué à la mission d'information lors de la visite de la maison France services de Plabennec (Finistère), le 26 juin 2025.
* 319 Constat recueilli auprès des représentants départementaux des partenaires nationaux, lors de la visite de la maison France Services de Saint-Florentin (Yonne), le 30 juin 2025.
* 320 Audition de M. Jean-Denis Combrexelle, 13 mai 2025.
* 321 Jean-Denis Combrexelle, Les Normes à l'assaut de la démocratie, op. cit.
* 322 Citons notamment le rapport de Françoise Gatel et Rémy Pointereau, Normes applicables aux collectivités territoriales : face à l'addiction, osons une thérapie de choc !, présenté en janvier 2023, qui a débouché sur la signature, le 16 mars 2023, d'une charte de simplification des normes entre le Sénat et le Gouvernement.
* 323 Jean-Denis Combrexelle, Les Normes à l'assaut de la démocratie, op. cit.
* 324 Baromètre des services publics - volet grand public, vague 2025, avril 2025, op. cit.
* 325 « L'accueil téléphonique de 4 services publics », enquête menée entre septembre et novembre 2022.
* 326 Cette moyenne recouvre de grandes disparités : elle est à 30% sur certaines plateformes.
* 327 Document transmis à la mission d'information par France Urbaine.
* 328 Audition du 10 juin 2025 ; la CGT, la CFDT et l'Unsa-Fonction publique étaient représentées.
* 329 Le serious game ou « jeu sérieux » est une modalité d'apprentissage et de formation utilisant des moyens ludiques, comme le jeu vidéo.
* 330 Source : réponses écrites de la Cnam au questionnaire de la rapporteure.
* 331 Audition de M. Vincent Dubois par la rapporteure, 29 avril 2025.
* 332 Table ronde à l'espace France Services de Saint-Florentin, le 29 juin 2025.
* 333 Audition par la rapporteure de représentants de la CGT, de la CFDT et de l'Unsa-Fonction publique, 10 juin 2025.
* 334 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.
* 335 Source : réponses écrites de la Cnav au questionnaire de la rapporteure.
* 336 Source : réponses écrites de l'Assurance maladie au questionnaire de la rapporteure.
* 337 https://www.info.gouv.fr/actualite/ia-connaissez-vous-albert
* 338 Source : présentation de la DILA à la mission d'information lors d'un déplacement au siège de l'organisme, le 24 juin 2025.
* 339 L'IA et l'avenir du service public, rapport thématique - impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude, rapport d'information fait au nom de la délégation à la prospective par Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet, Sénat, 2023-2024.
* 340 Le service public à l'épreuve de l'intelligence artificielle, Le sens du service public, Fondation Jean Jaurès, juillet 2025.
* 341 Défenseur des droits, Algorithmes, systèmes d'IA et services publics : quels droits pour les usagers ? Points de vigilance et recommandations, 2024.
* 342 L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'univers des collectivités territoriales ?, rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales par Mmes Pascale Gruny et Ghislaine Senée, Sénat, 13 mars 2025.
* 343 L'IA et l'avenir du service public rapport thématique - impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude, rapport d'information fait au nom de la délégation à la prospective par M. Didier Rambaud et Mme Sylvie Vermeillet, Sénat, 2023-2024.
* 344 Audition plénière du 13 mai 2025.
* 345 Audition plénière du 13 mai 2025.
* 346 Compte rendu du 13 mai 2025.
* 347 Le 10 juin 2025.
* 348 Source : France travail, Médiateur national, Rapport 2023, avril 2024. Consultable ici : https://www.vie-publique.fr/rapport/298463-rapport-2023-du-mediateur-national-de-france-travail
* 349 Communiqué de presse publié par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 11 décembre 2024.
* 350 Article publié le8 février 2024 dans Le Journal du Pays Yonnais.
* 351 « En Vendée, le Tribunal de commerce fait appel à un vigile pour protéger ses salariés », Le Journal du Pays Yonnais, 9 mars 2025.
* 352 Audition plénière du 13 mai 2025.
* 353 www.plus.transformation.gouv.fr
* 354 Anonymisé par la mission d'information.
* 355 Présentation de l'ANEF par le ministère de l'intérieur.
* 356 Défenseur des droits, « Droits des usagers des services publics : de la médiation aux propositions de réforme », rapport publié en 2024.
* 357 Source : document transmis par le Défenseur des droits à la mission d'information.
* 358 Source : document transmis par le défenseur des droits à la mission d'information.
* 359 L'illectronisme ne disparaitra pas d'un coup de tablette magique !, rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.
* 360 Classes réservées aux enfants présentant d'importantes difficultés scolaires.
* 361 Jeu en ligne très populaire chez les adolescents.
* 362 Texte de l'intervention de M. Vincent Dubois lors de son audition par la rapporteure, reproduit infra.
* 363 Nations Unies, Enquête sur l'e-gouvernement - L'avenir du gouvernement numérique, 12e édition, 2022.
* 364 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Londres au questionnaire de la rapporteure.
* 365 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.
* 366 Système sécurisé de transfert de documents entre administration et usagers.
* 367 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.
* 368 https://www.modernisation.gouv.fr/presse/7e-comite-interministeriel-de-la-transformation-publique-citp-des-services-publics-au-rendez
* 369 Décision n°422516 du Conseil d'État, 27 novembre 2019.
* 370 Décision n°452798 du Conseil d'État, 3 juin 2022.
* 371 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048300416
* 372 Défenseur des droits, Droits des usagers des services publics : de la médiation aux propositions de réforme, rapport, 2024.
* 373 Tel est l'objet des axes n°3 (« proclamer l'inclusion numérique comme priorité nationale et service d'intérêt économique général ») et n° 4 (« l'offre et l'architecture de la médiation numérique doivent être repensées ») des propositions de la mission d'information précitée sur l'illectronisme, qui prônait notamment la création d'un fonds de lutte contre l'inclusion numérique, qui financerait l'émergence d'une « véritable filière professionnelle de la médiation numérique, via un plan national de formation ».
* 374 Voir la présentation sur le site du programme.
* 375 Il n'a pas paru pertinent à la mission d'information de s'intéresser à Numérique en commun(s), qui vise à créer une communauté de professionnels autour de l'inclusion numérique, et à ce titre n'intervient pas directement au contact du public.
* 376 Contribution écrite transmise à la rapporteure par la Banque des territoires.
* 377 Ibid.
* 378 Audition plénière du 3 juin 2025.
* 379 Propos tenus par M. Jérémy Sulkowski, directeur général adjoint - pôle habitat et solidarités de la Communauté urbaine d'Arras, audition plénière de France urbaine, 3 juin 2025.
* 380 Exemple recueilli lors du déplacement de la mission d'information dans l'Yonne, le 30 juin 2025.
* 381 Avis n° 2024-08 du 28 novembre 2024 « pour une politique nationale d'inclusion numérique adaptée aux besoins de nos concitoyens ».
* 382 Pour une politique nationale d'inclusion numérique adaptée aux besoins de nos concitoyens, avis publié le 28 novembre 2024 à l'issue d'une évaluation conduite par Mme Jeanne Bretécher et le sénateur Christian Redon-Sarrazy.
* 383 Audition plénière du 17 juin 2025.
* 384 Via l'action n°03 « Inclusion numérique » du programme 343 « Plan France Très haut débit ». Voir le projet annuel de performances pour 2025.
* 385 Par une lettre datée du 7 mai 2025, cosignée par François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, le Gouvernement a finalement annoncé que le financement du dispositif serait porté à 40 millions d'euros, ce qui permettra à l'État d'honorer ses engagements, tout en rendant nécessaire une réflexion sur le déploiement des conseillers numériques et en particulier leur articulation avec les conseillers France Services.
* 386 Qui, à travers le programme budgétaire 343, finance les conseillers numériques.
* 387 Audition plénière du 25 juin 2025.
* 388 https://inclusion-numerique.anct.gouv.fr/donnees/national
* 389 https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/stats/
* 390 Déplacement de la mission d'information à la maison France Services de Saint-Florentin, Yonne, le 30 juin 2025.
* 391 Les informations présentées ci-après sont issues des réponses écrites de la direction générale de France Travail au questionnaire de la rapporteure.
* 392 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Madrid au questionnaire de la rapporteure.
* 393 Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Voir ici la présentation des résultats du rapport (en anglais).
* 394 Réponse de l'Acoss à un questionnaire envoyé par la rapporteure.
* 395 Réponse de la Cnam à un questionnaire envoyé par la rapporteure.
* 396 Baromètre de l'Institut Paul Delouvrier, « Les services publics vus par les Français et les usagers »
édition de décembre 2024. Étude menée par Toluna et Harris Interactive auprès d'un échantillon de 2 625 personnes représentatif des Français âgés de 15 ans et plus.
* 397 Source : réponses écrites de l'Acoss au questionnaire de la rapporteure.
* 398 Réponses écrites de l'Assurance maladie au questionnaire envoyé par la rapporteure.
* 399 Audition plénière du 25 juin 2025.
* 400 Voir les développements consacrés supra aux efforts engagés dans le cadre des MDPH.
* 401 https://www.education.gouv.fr/rapport-2023-de-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-414802
* 402 Réponses écrites de la Dinum au questionnaire de la rapporteure.
* 403 Source : https://www.cnil.fr/fr/definition/interface-de-programmation-dapplication-api
* 404 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045213315
* 405 Article 5, « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », : les données personnelles doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ».
* 406 Informations fournies par la Caisse nationale d'assurance maladie dans ses réponses écrites au questionnaire de la rapporteure.
* 407 Sources : réponses écrites de ces organismes aux questionnaires de la rapporteure.
* 408 Audition plénière de Mme Claire Hédon, défenseure des droits, le 20 mai 2025.
* 409 Source : réponses écrites de la DGCCRF au questionnaire de la rapporteure.
* 410 Source : réponses écrites de la DGCCRF au questionnaire de la rapporteure.
* 411 Irlande ou Espagne, par exemple, d'après les observations de la mission d'information.
* 412 Source : réponses écrites de la DGCCRF au questionnaire de la rapporteure.
* 413 L'étudiant, « Les coachs privés pour Parcoursup en valent-ils le coup ? », mars 2024.
* 414 Mots de la recherche : DGCCRF Parcoursup Coaching ; recherche effectuée le 16 avril 2025 (premier résultat affiché) puis le 15 août 2025 (quatrième résultat affiché).
* 415 Parcoursup : l'urgence à gagner la confiance des lycéens et des étudiants, rapport d'information fait au nom de la commission de la culture par M. Jacques Grosperrin, 2022-2023.
* 416 Sont considérées comme substantielles : les caractéristiques principales du bien ou du service ; l'adresse et l'identité du professionnel ; le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
* 417 Cass. crim., 15 décembre 2009, n° 09-83.059.
* 418 Cour d'appel de Paris, 13 ème chambre, 16 mai 2008.
* 419 Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), prime d'activité (PA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), complémentaire santé solidaire (C2S), aide au logement (AL), chèque énergie, logement social, revenu de solidarité active (RSA), allocation aux adultes handicapés (AAH), majoration pour la vie autonome (MVA), garantie Jeunes, allocation personnalisée d'autonomie (APA), livret d'épargne populaire, allocations familiales, allocation de soutien familial (ASF), complément familial (CF), libre choix de mode de garde (CMG), bourses de collège et de lycée...
* 420 Paris logement famille, Paris forfait familles, Paris solidarité, Paris logement, allocation de soutien aux parents d'enfants handicapés de Paris, Paris logement familles monoparentales, Paris énergie familles, complément santé Paris, Pass Paris seniors, Pass Paris access.
* 421 Bourse famille nombreuse, bourse communale, bourse du conservatoire, Noël pour tous, aide au départ en séjour adapté.
* 422 Tarification solidaire des transports.
* 423 Impayé énergie.
* 424 Aide départementale financière d'insertion personnalisée de l'Eure-et-Loir (AdéFIP), fonds départemental d'aide aux jeunes (FAJ), prêt de véhicule, transport social, aide au transport des élèves et étudiants en situation de handicap, aide sociale à l'hébergement (ASH) pour les personnes âgées ou handicapées, aide-ménagère pour les personnes âgées ou handicapées, repas en foyer pour les personnes âgées ou handicapées, prestation de compensation du handicap à domicile ou en établissement, carte mobilité inclusion « invalidité », carte mobilité inclusion « priorité », carte mobilité inclusion « stationnement », fonds de solidarité pour l'accès au logement, fonds de solidarité pour installation dans le logement, fonds de solidarité pour le maintien dans le logement, fonds de solidarité pour le maintien des fournitures (énergie eau et téléphone).
* 425 Parmi lesquels les acteurs suivants : MSA, MGEN, CNAF, CNAM, CNAV, Sécurité sociale des indépendants, France travail, Mutuelle générale, caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire...
* 426 Il s'est trouvé sur la première page des résultats lors d'une recherche en ligne portant sur les mots « aides sociales ».
* 427 Documents adressés à la rapporteure indépendamment des réponses écrites aux questionnaires de la rapporteure envoyés par les personnes et structures auditionnées.
* 428 Participants : M. Gilbert-Luc Devinaz, président, Mme Havet, rapporteure.
* 429 Participants : MM. Gilbert-Luc Devinaz, président, et Jean-Luc Brault, vice-président.
* 430 Participants : M. Gilbert-Luc Devinaz, président, Mme Havet, rapporteure, Mme Béatrice Gosselin.
* 431 Participants : Mme Nadège Havet, rapporteure, et M. Adel Ziane, vice-président.
* 432 Participants : M. Gilbert-Luc Devinaz, président, M. Éric Gold, vice-président, Mme Nadège Havet, rapporteure, Mme Marie-Lise Housseau.
* 433 Texte communiqué par l'auteur, entendu par la rapporteure le 29 avril 2025.
* 434 Aucun retard de paiement dans les 24 derniers mois ; le montant des sanctions encourues est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ; les cotisations et contributions sociales sont acquittées dans un délai de 30 jours.