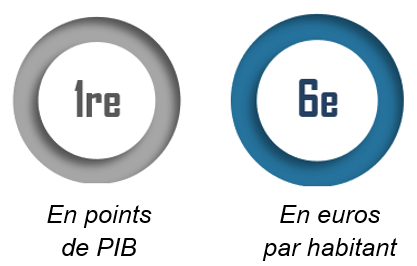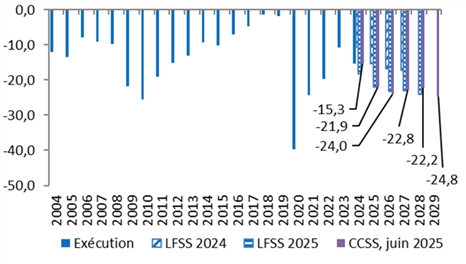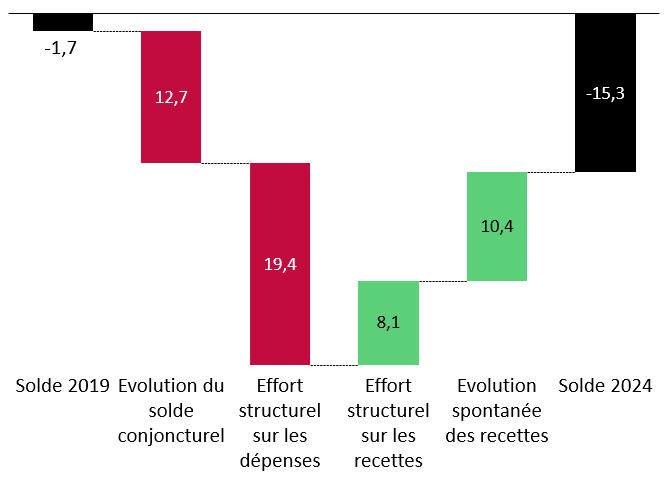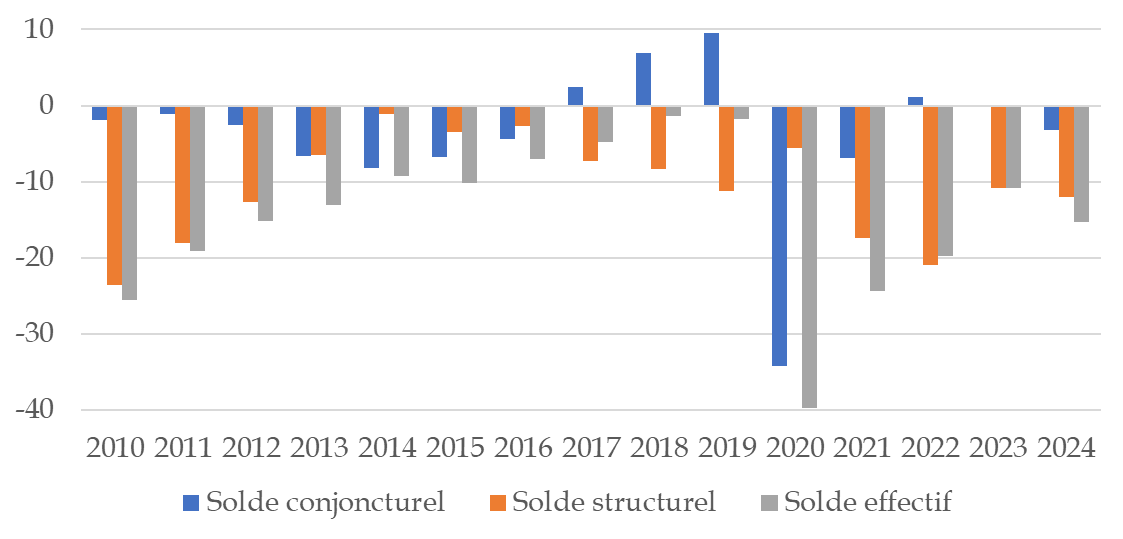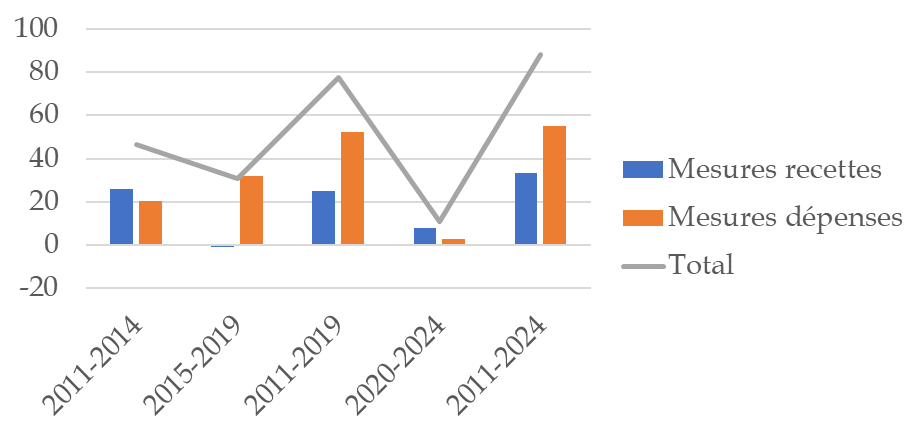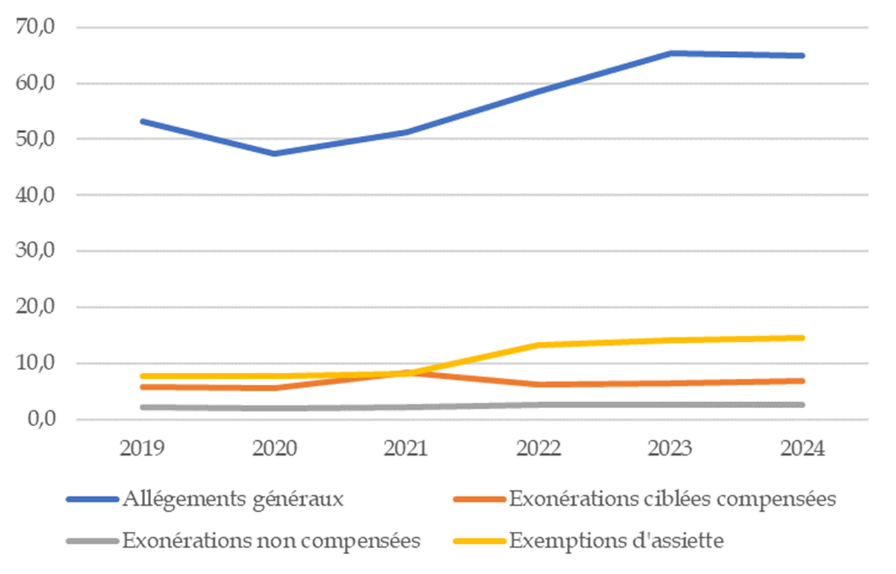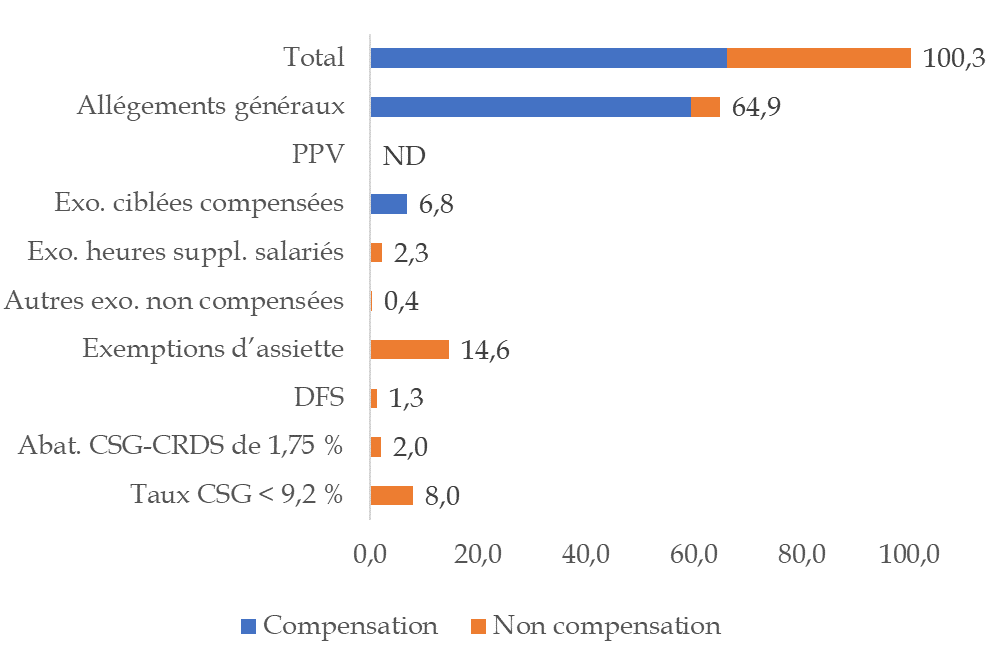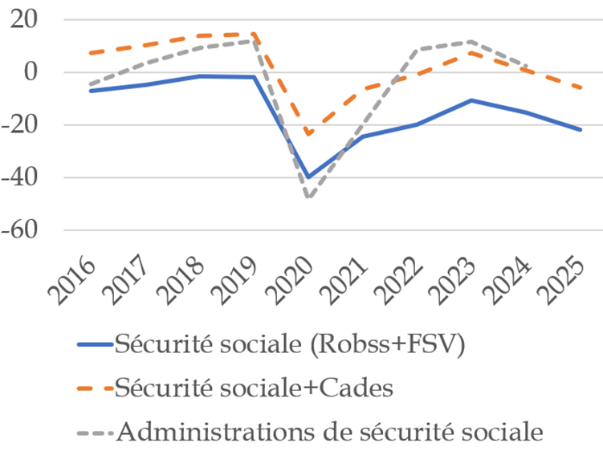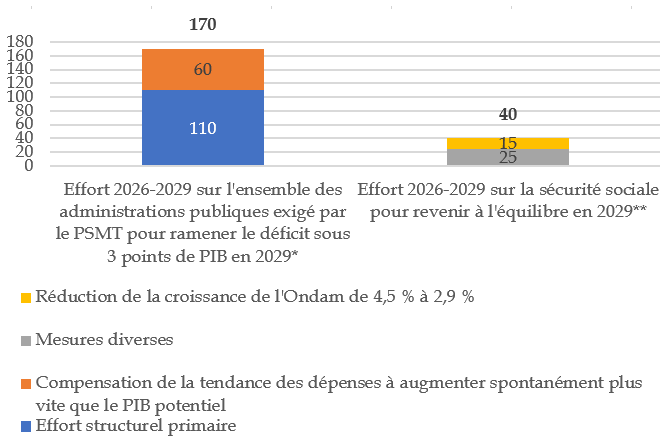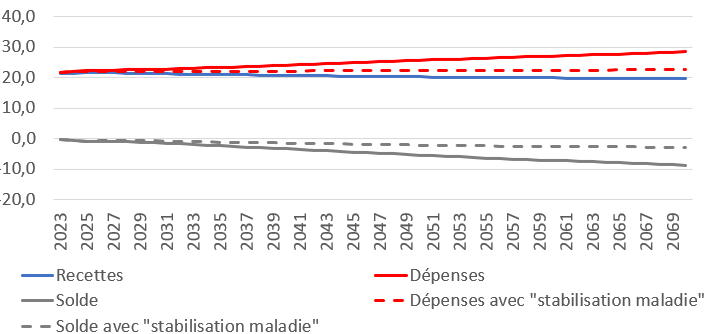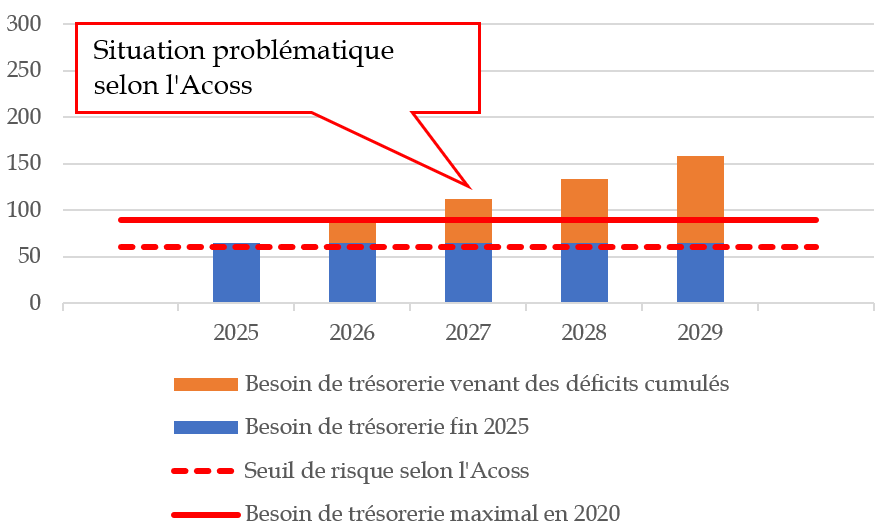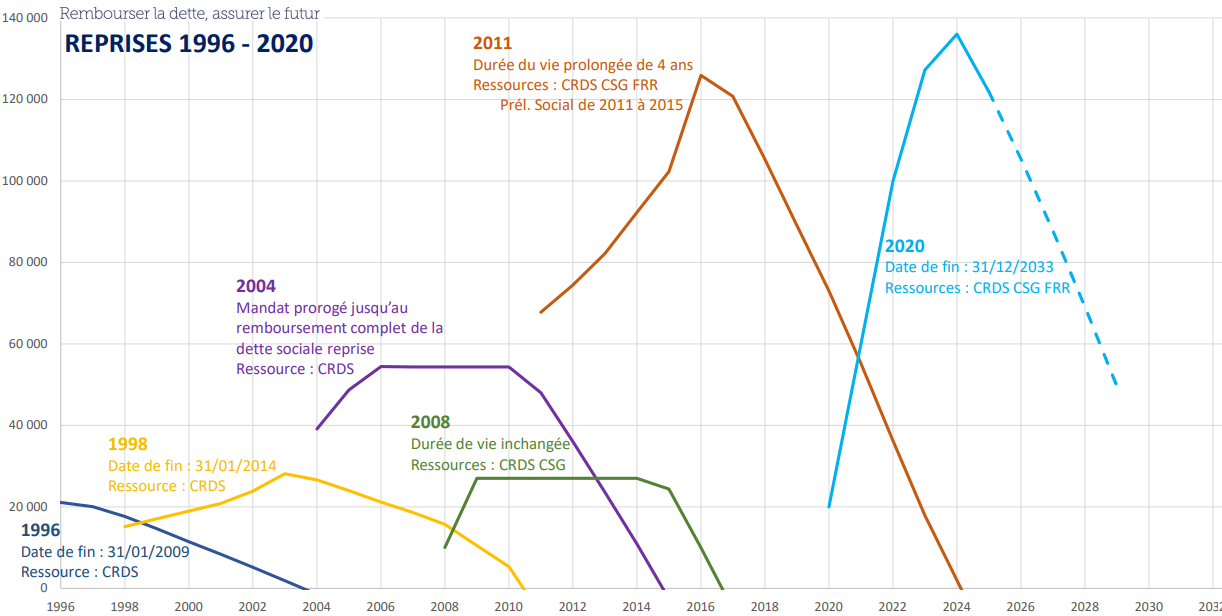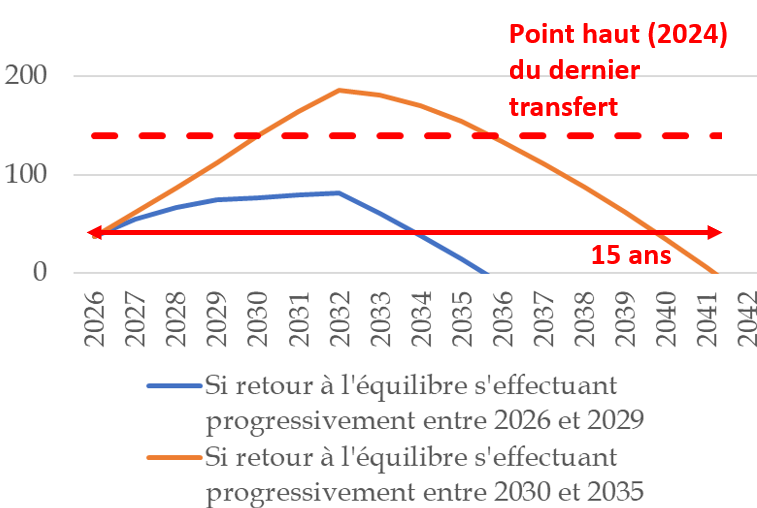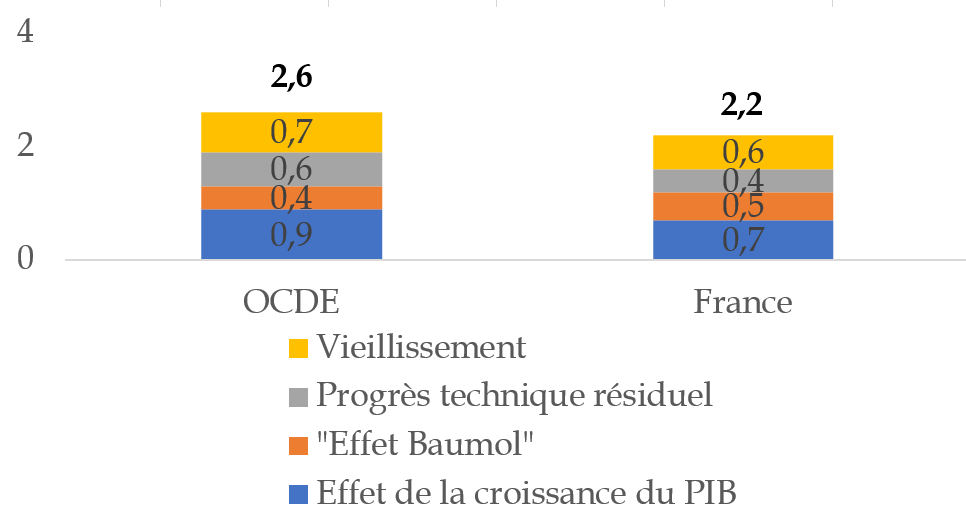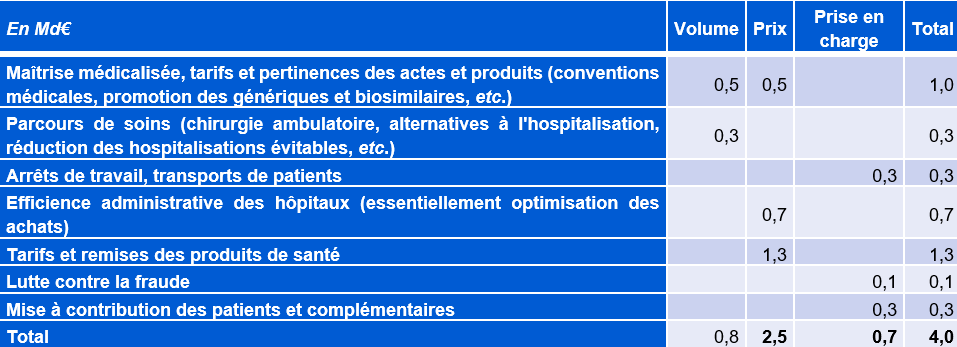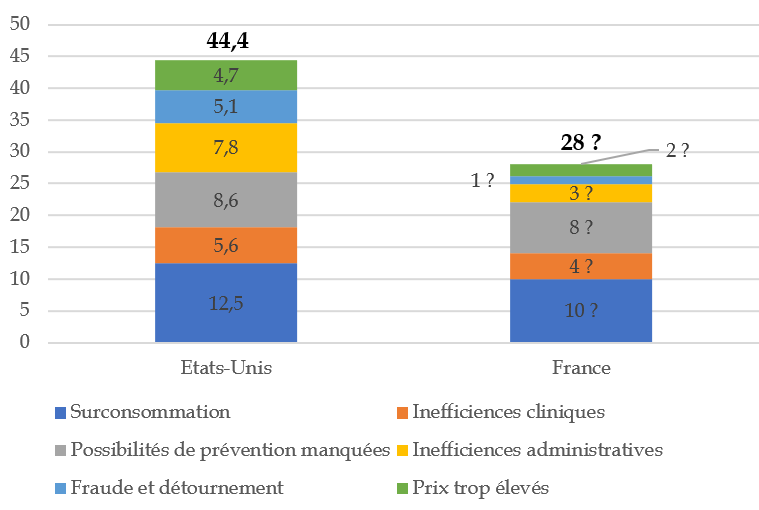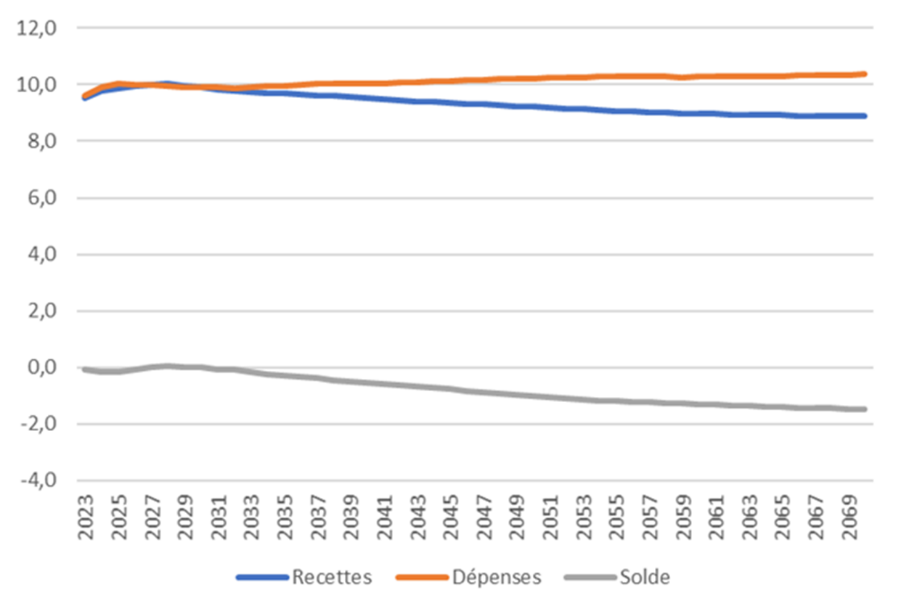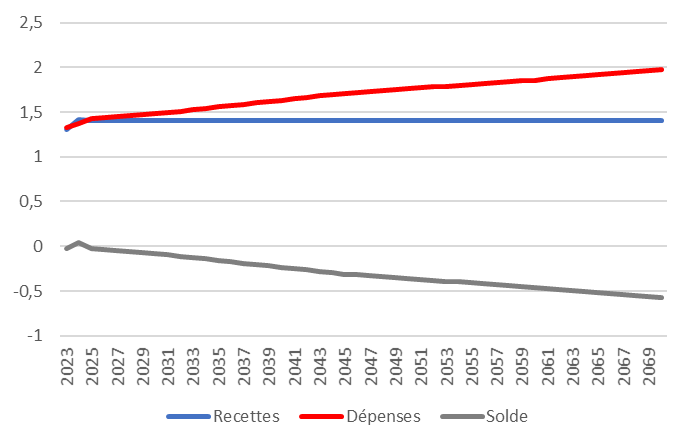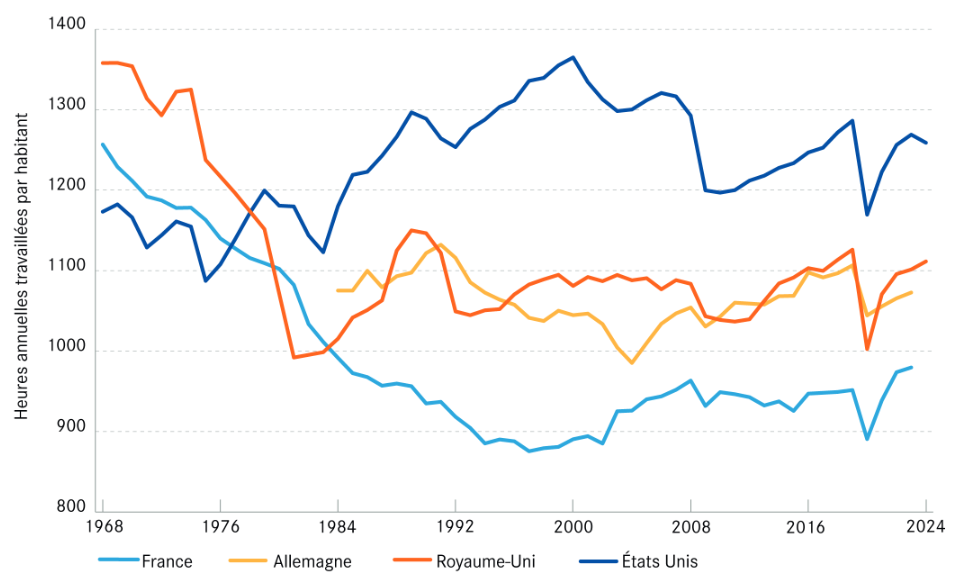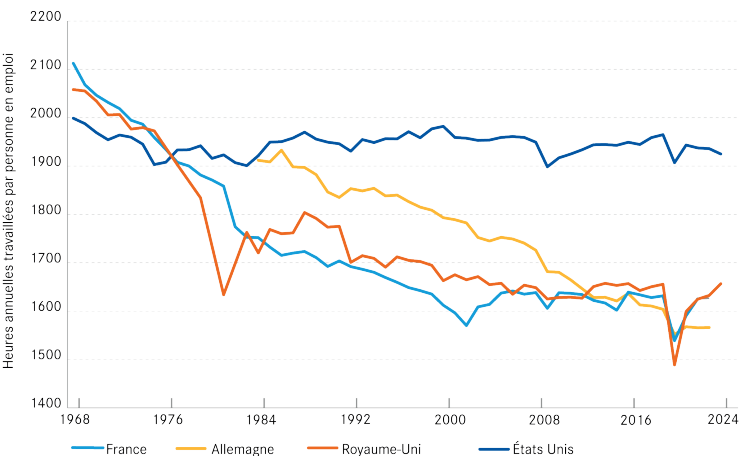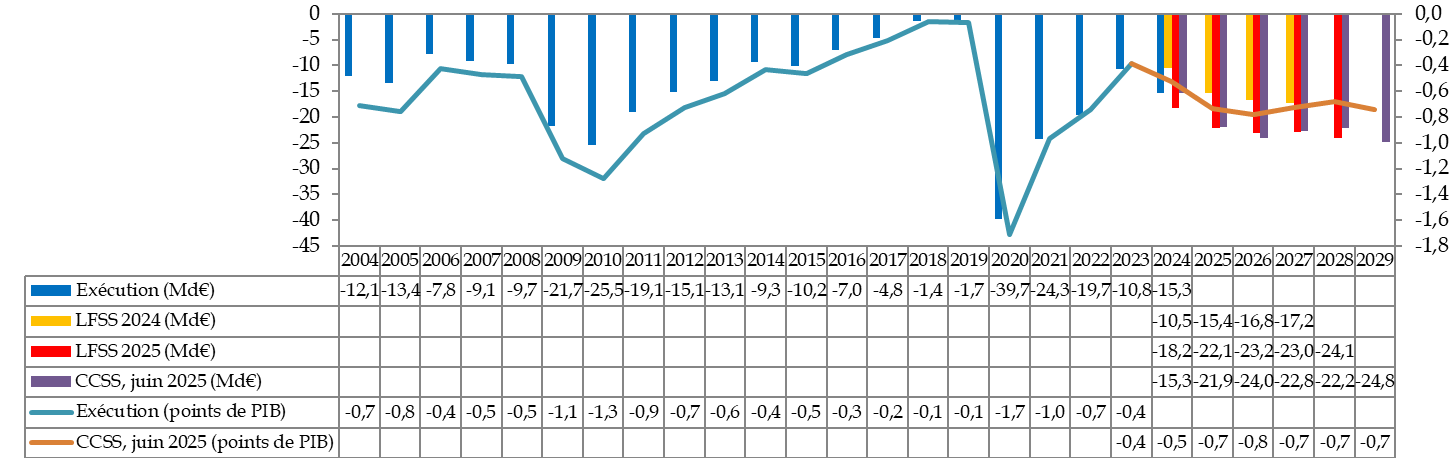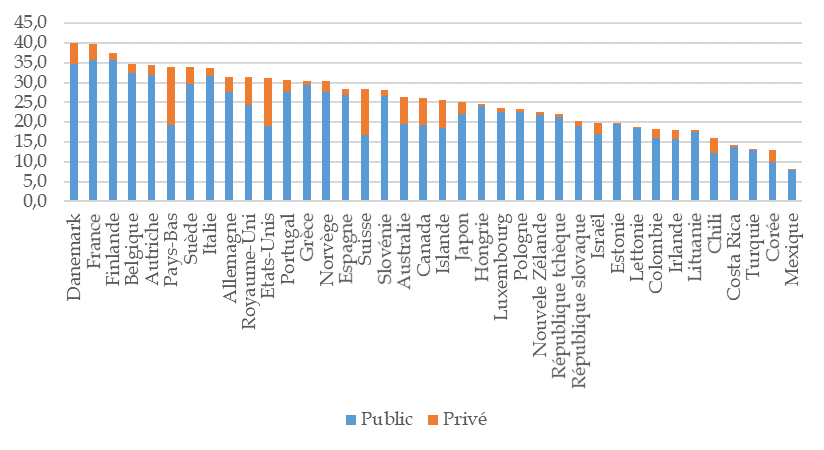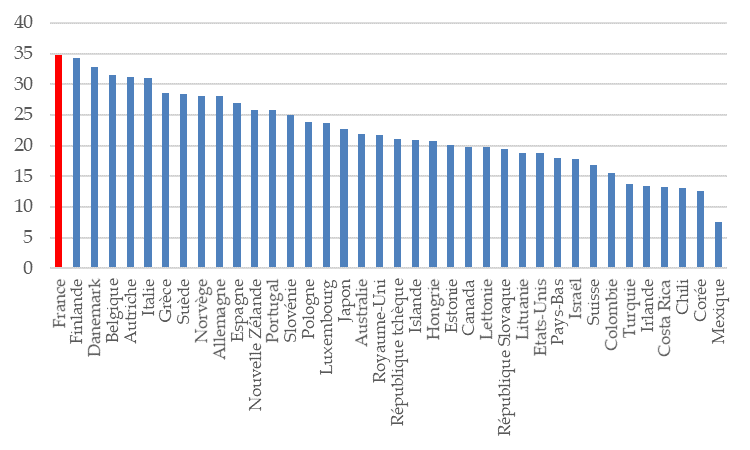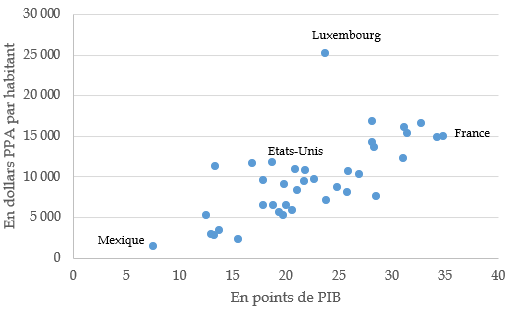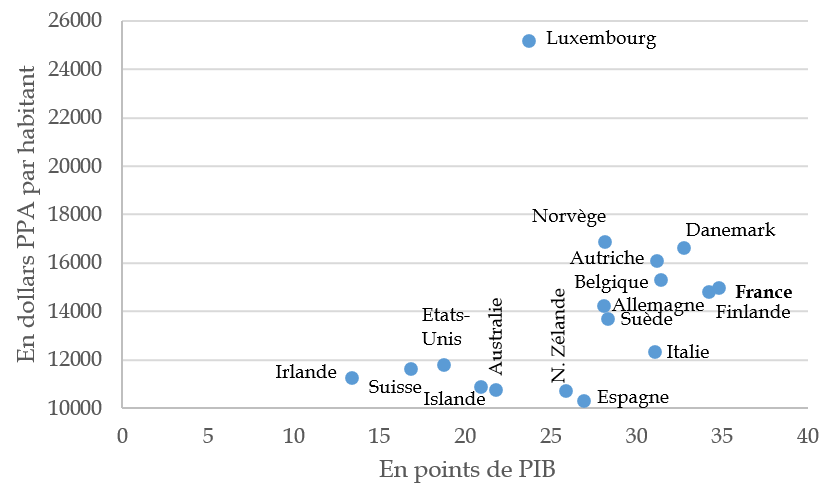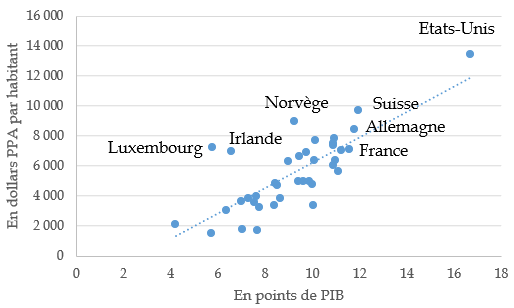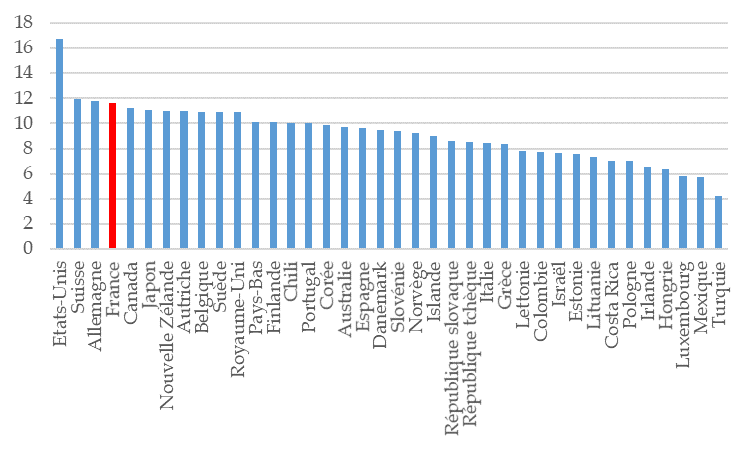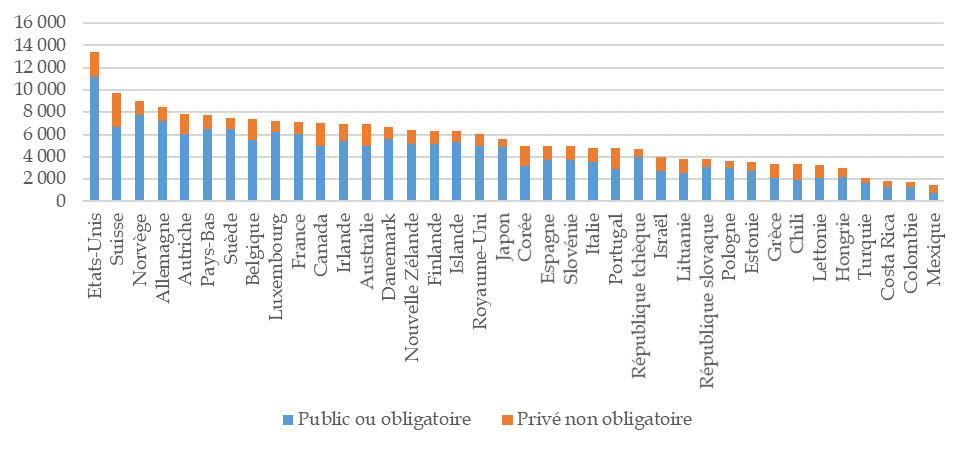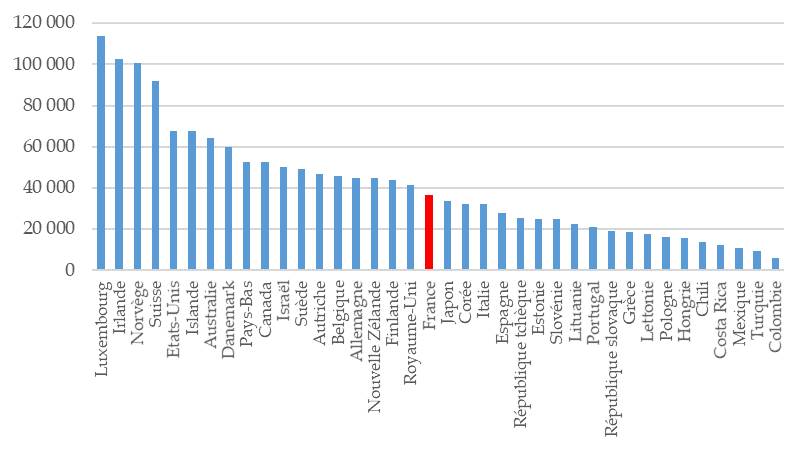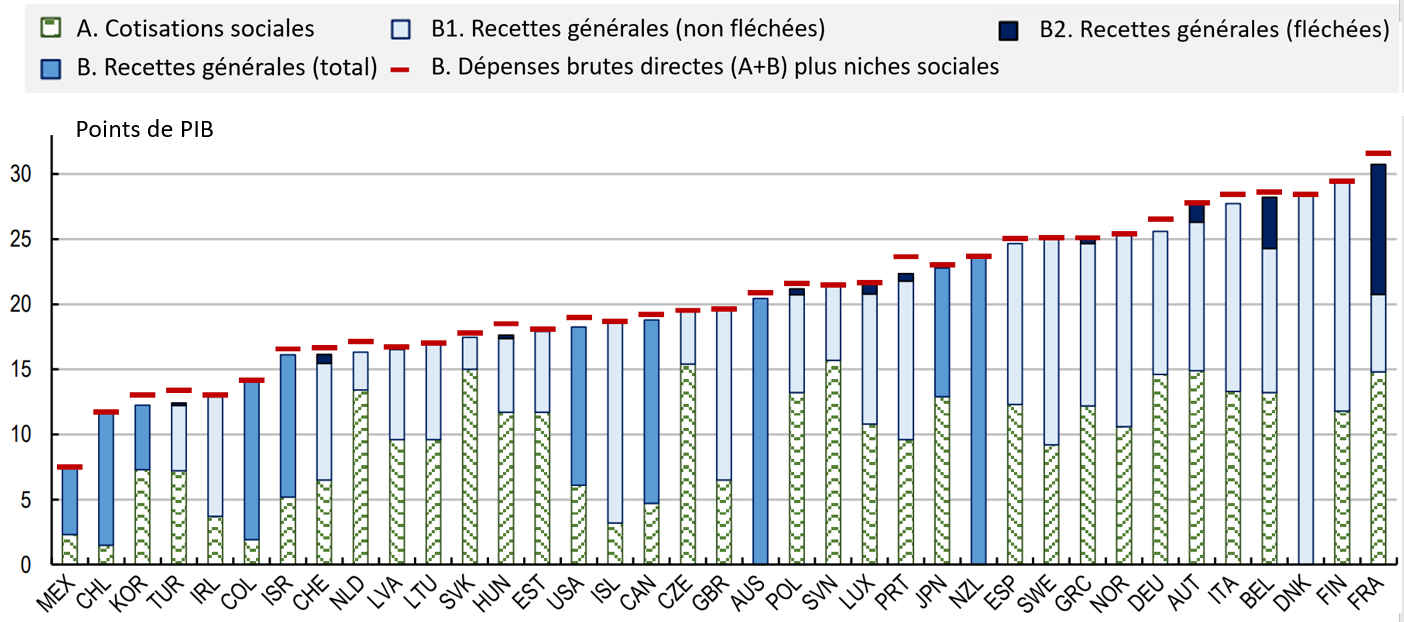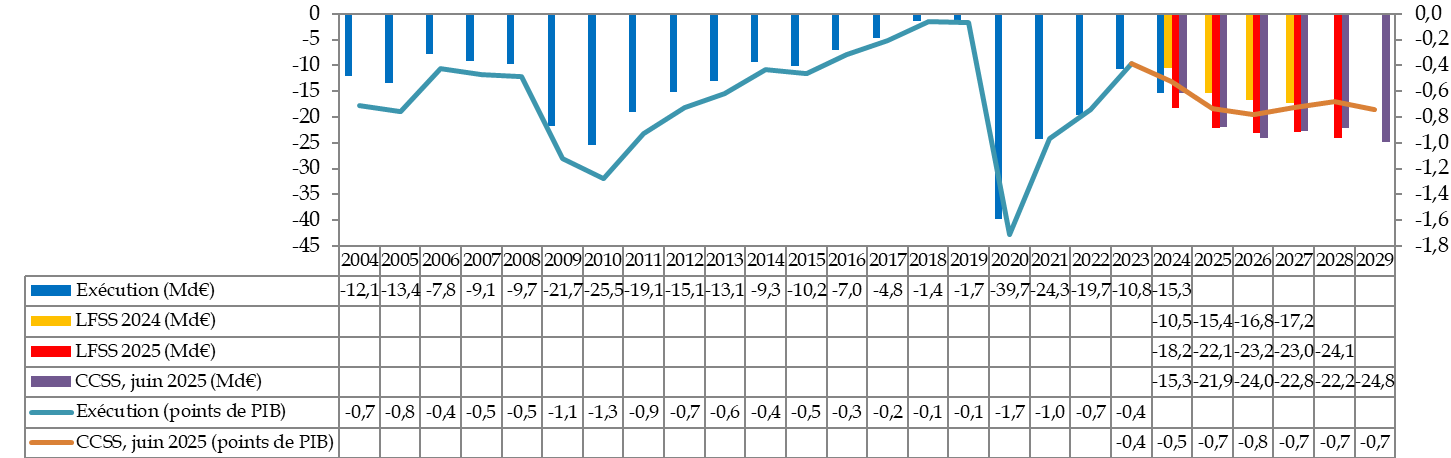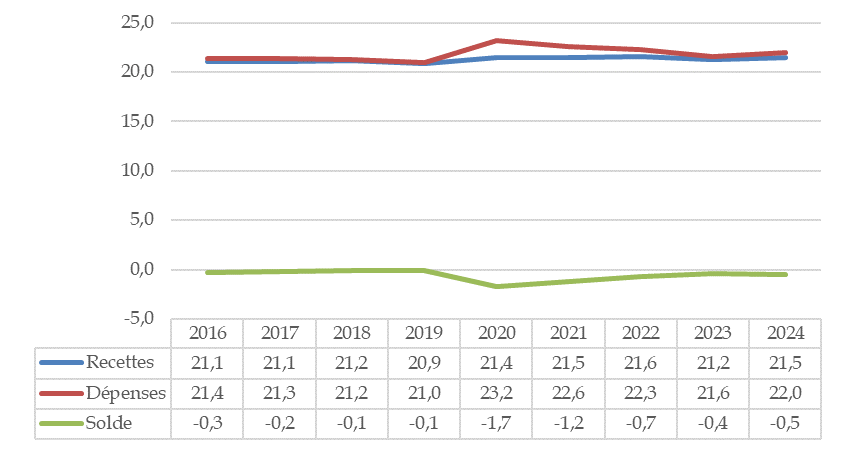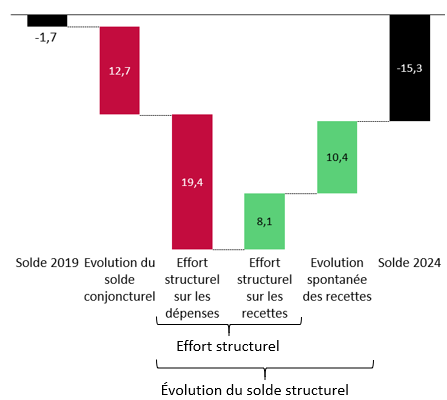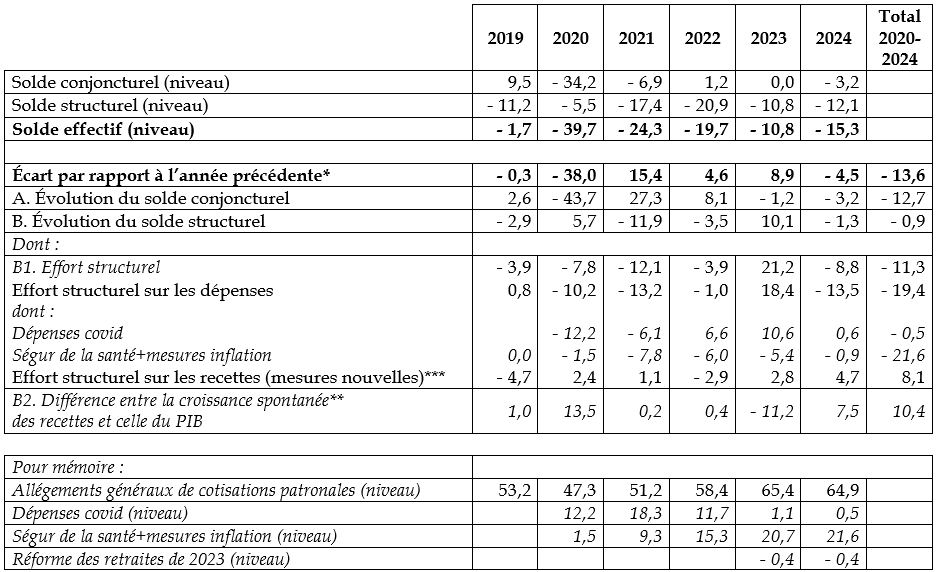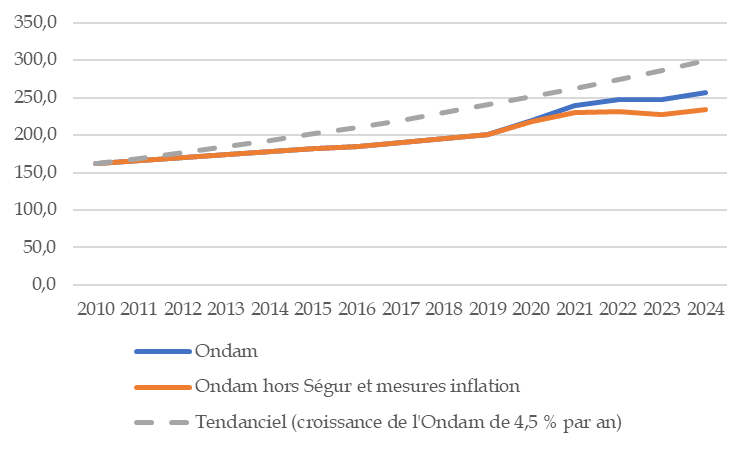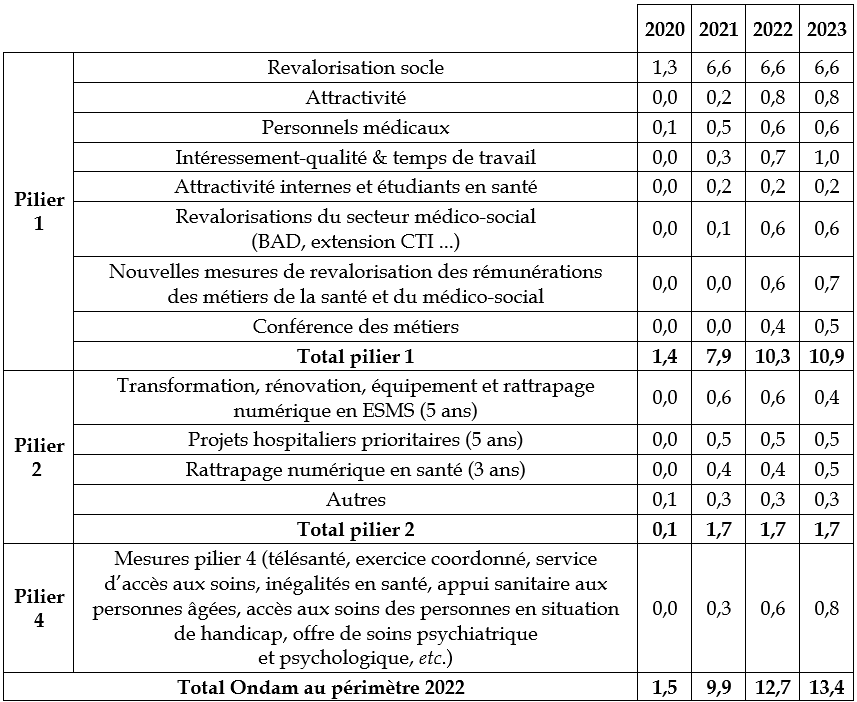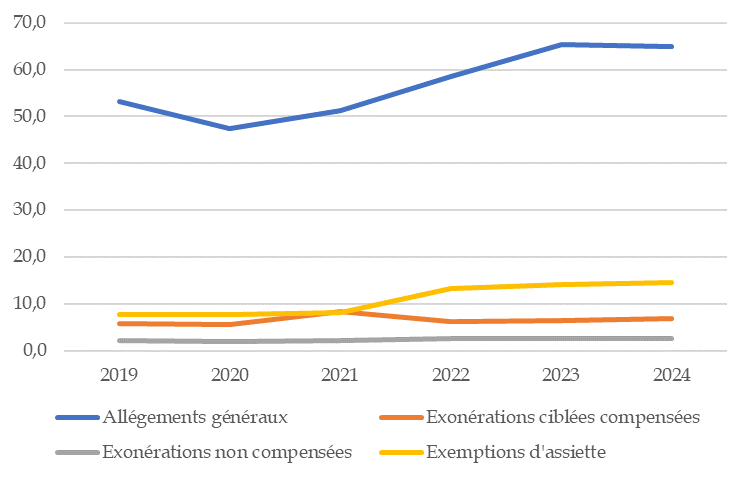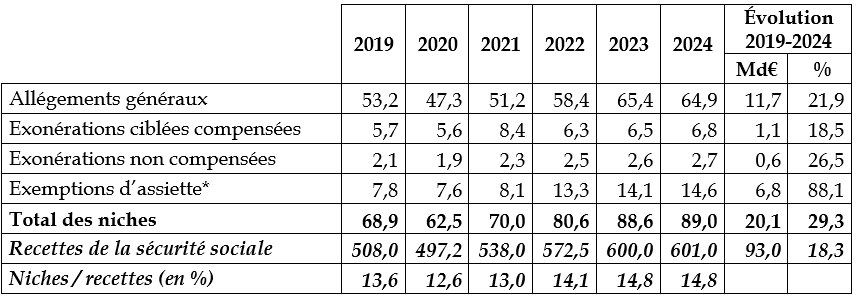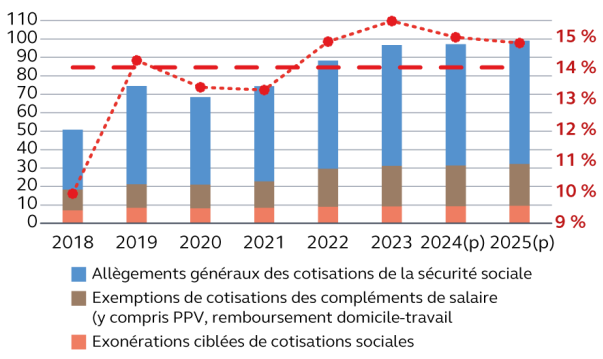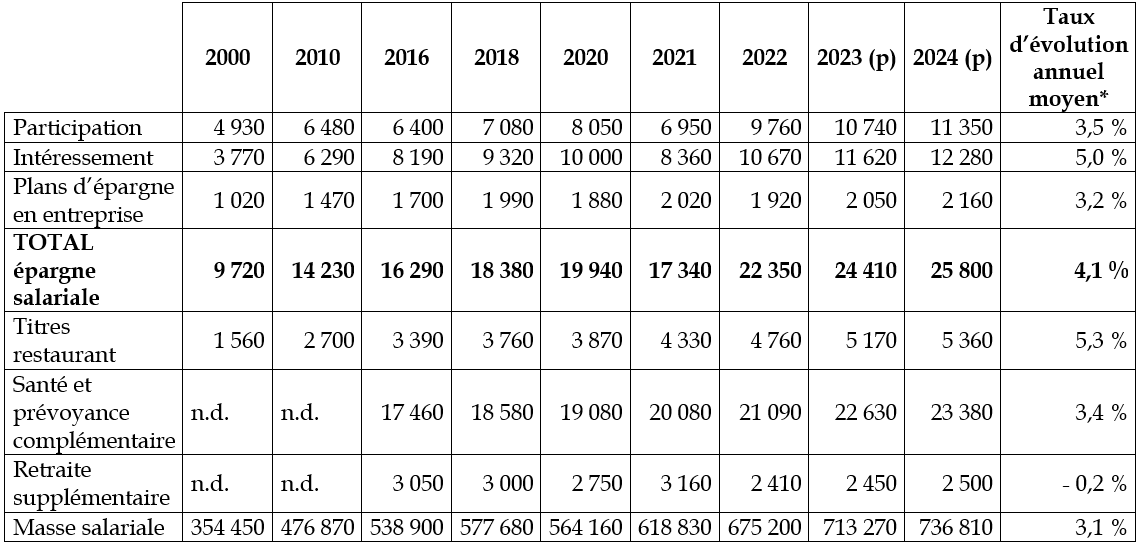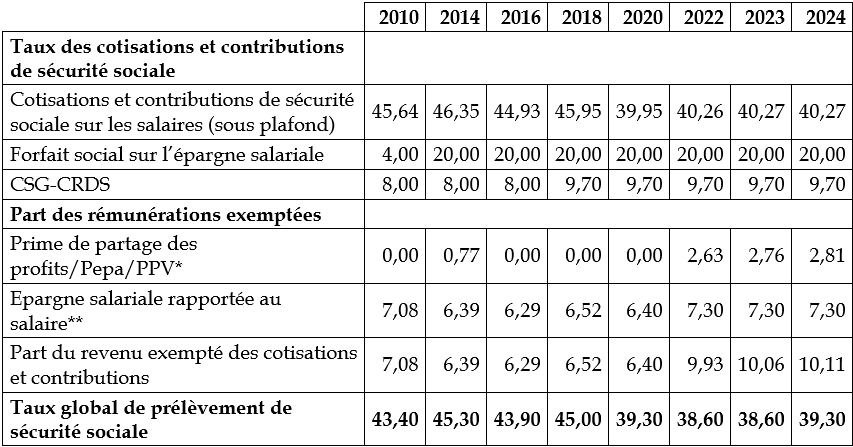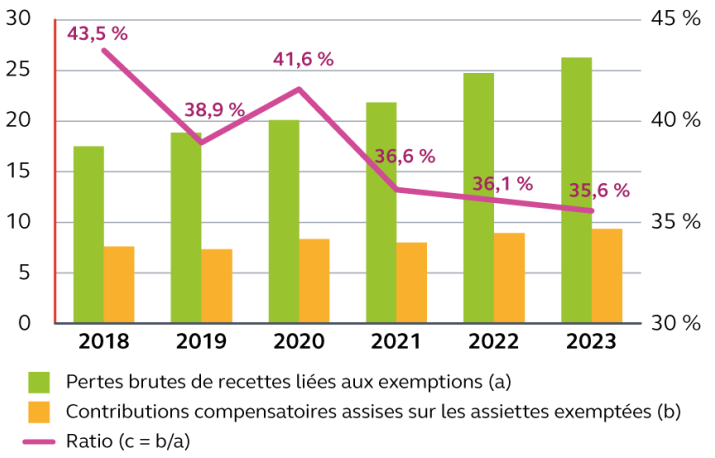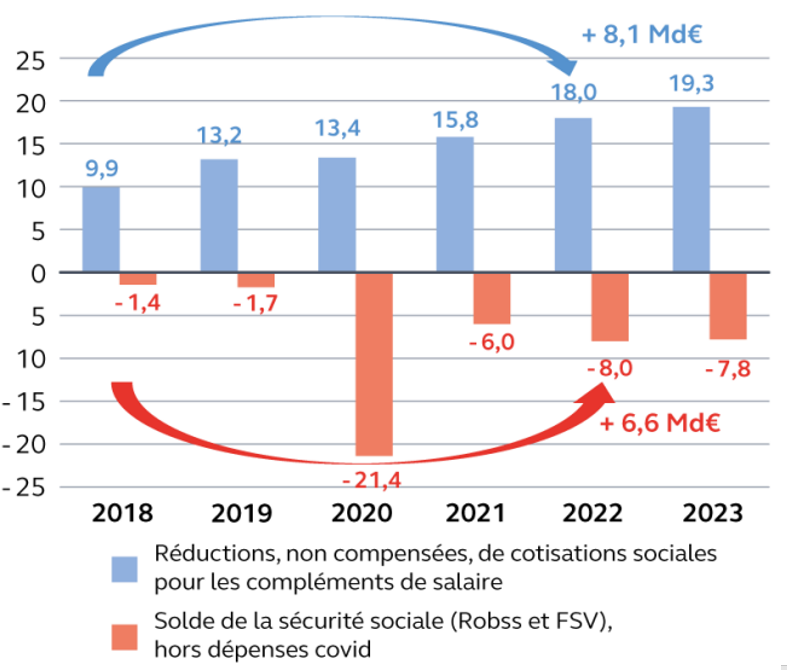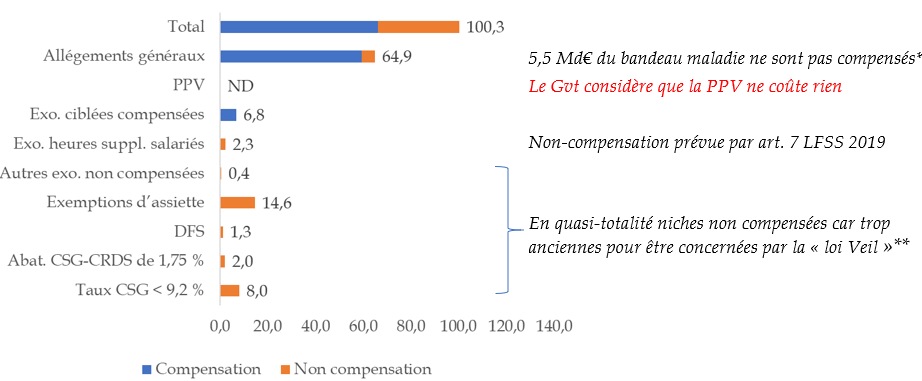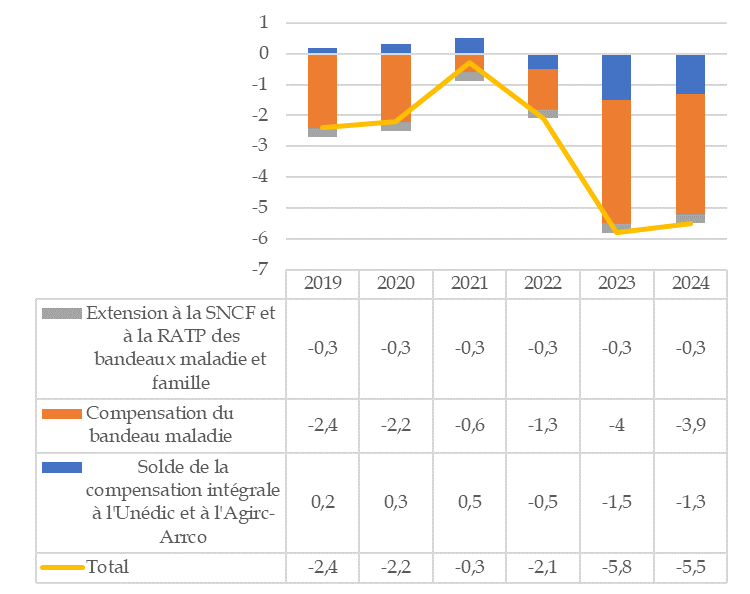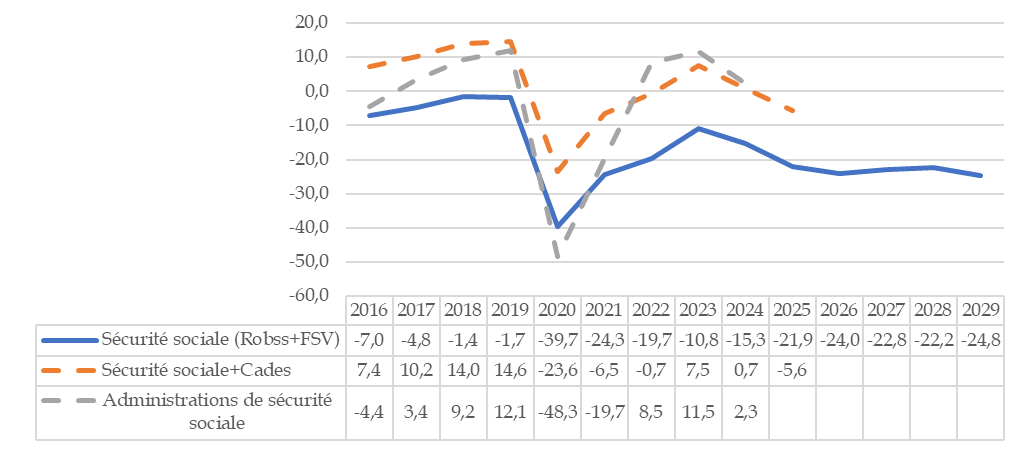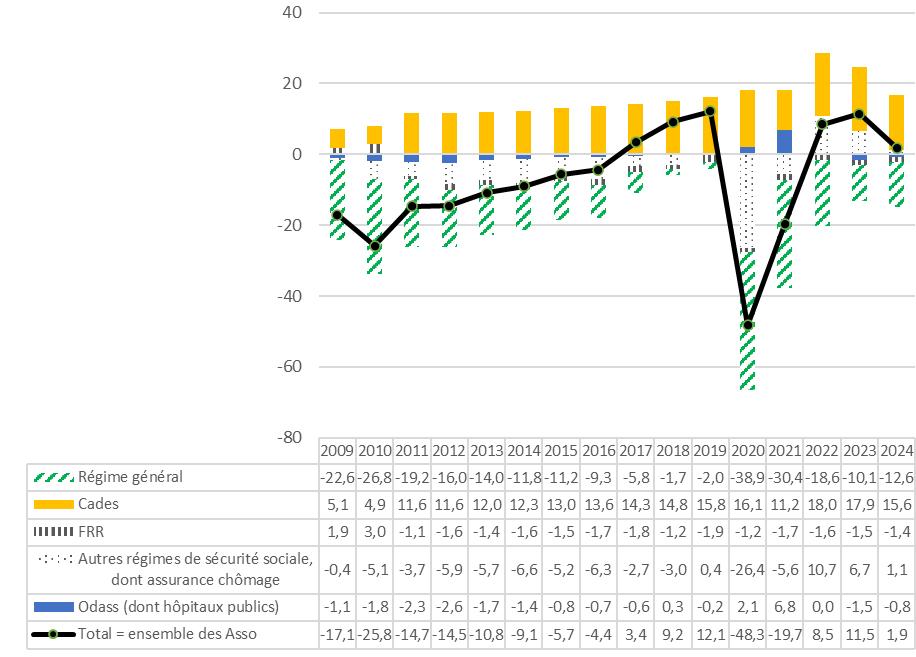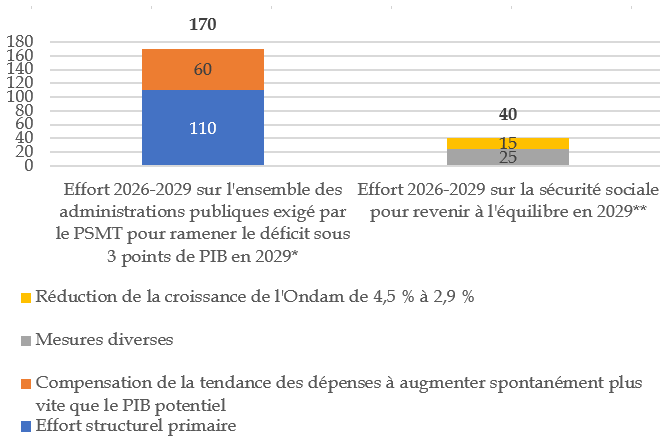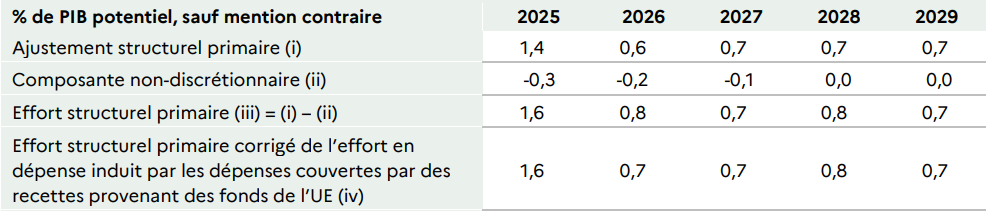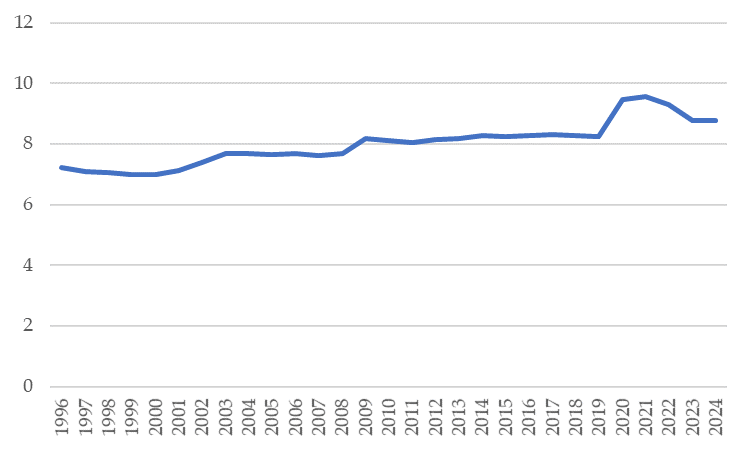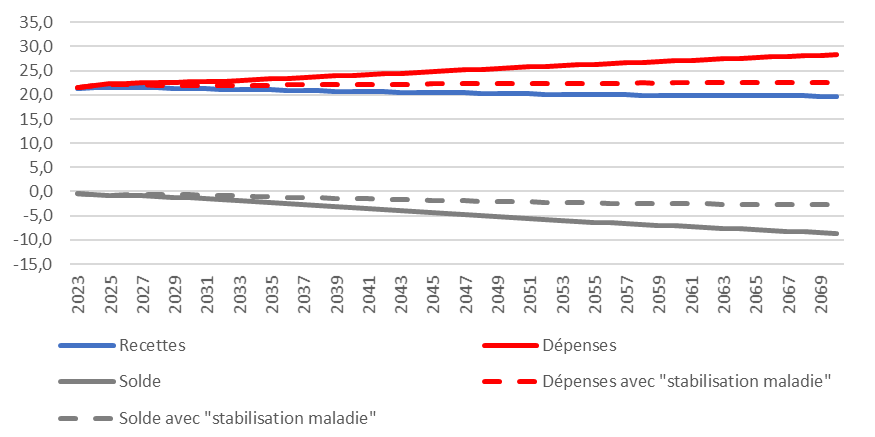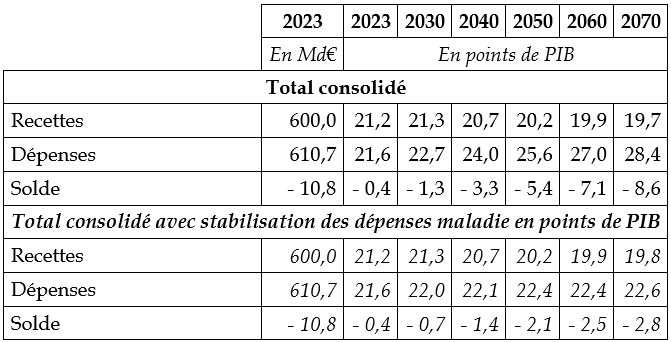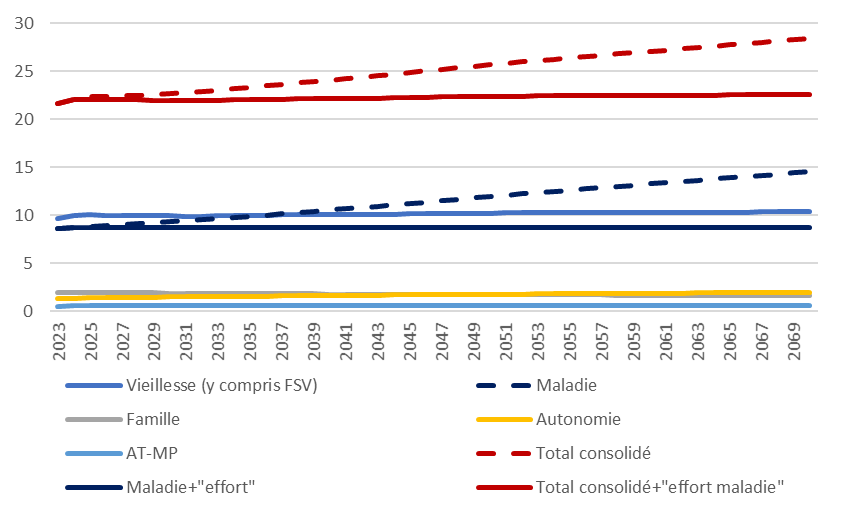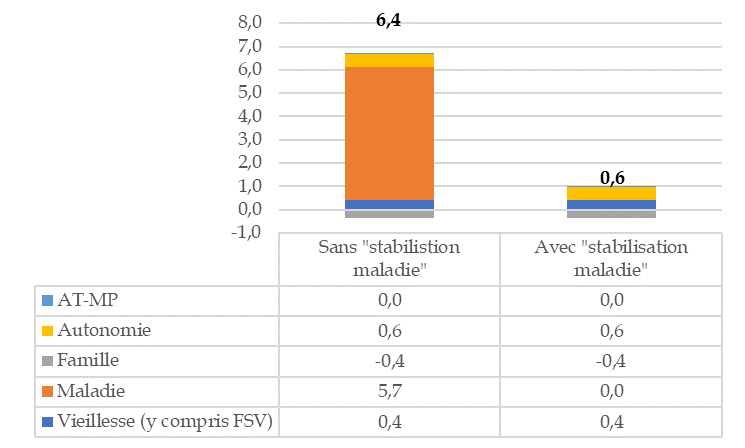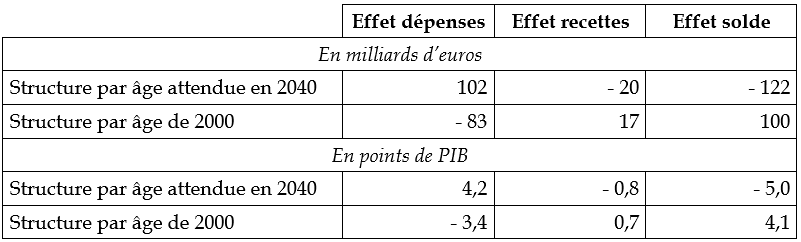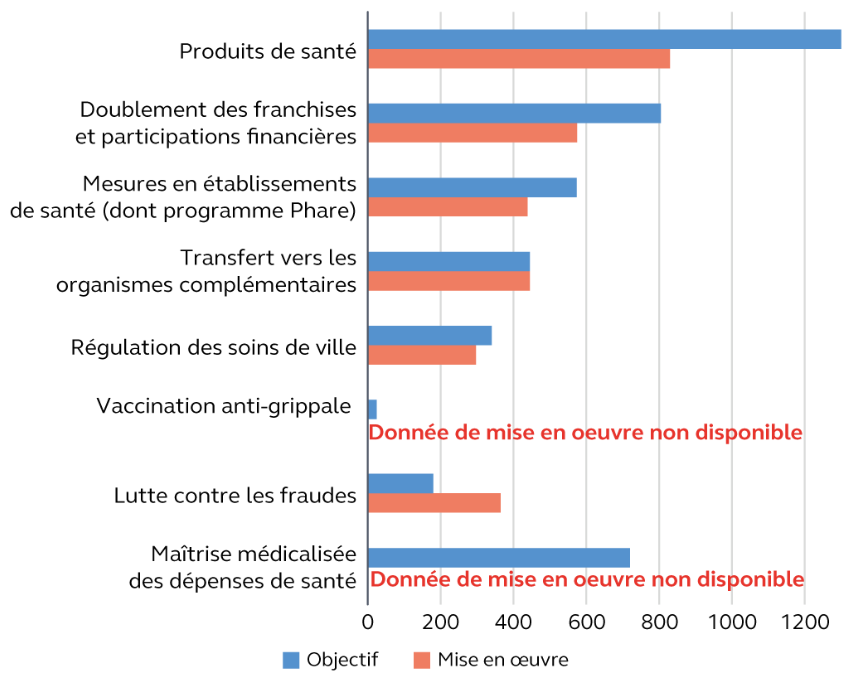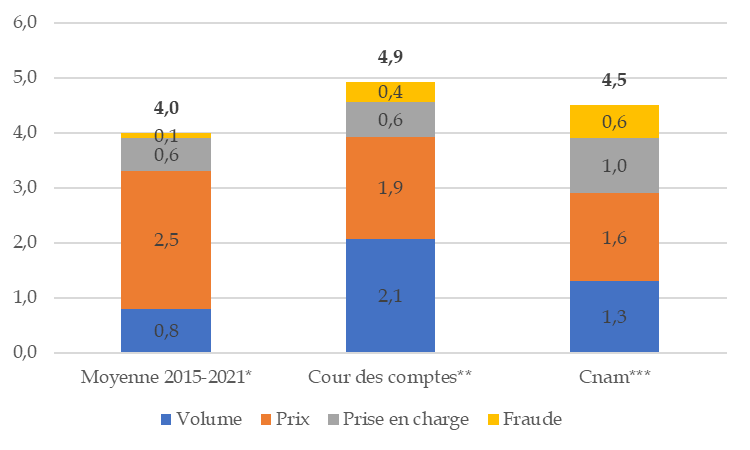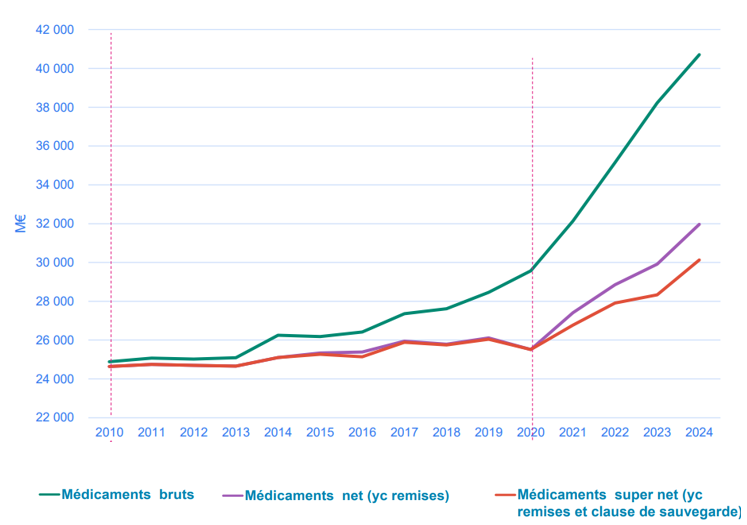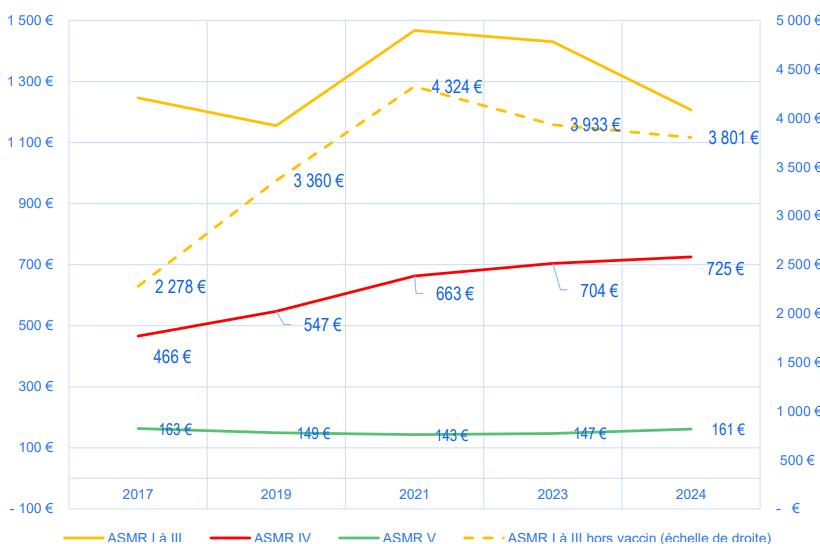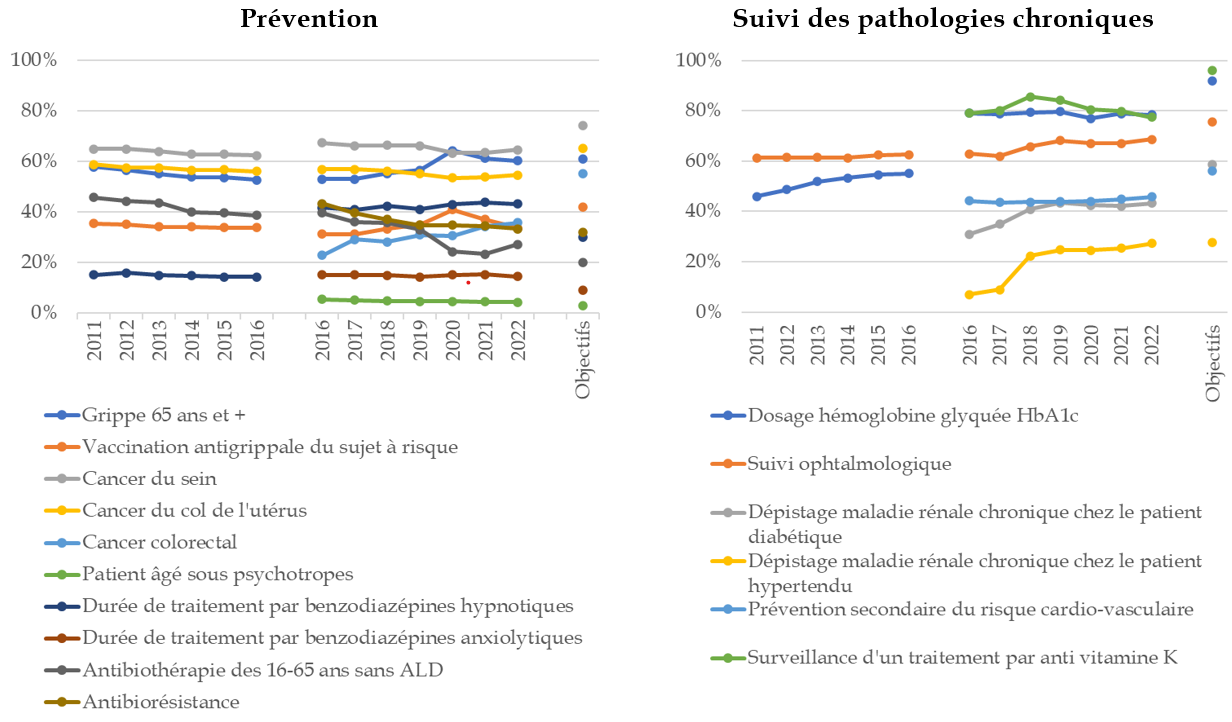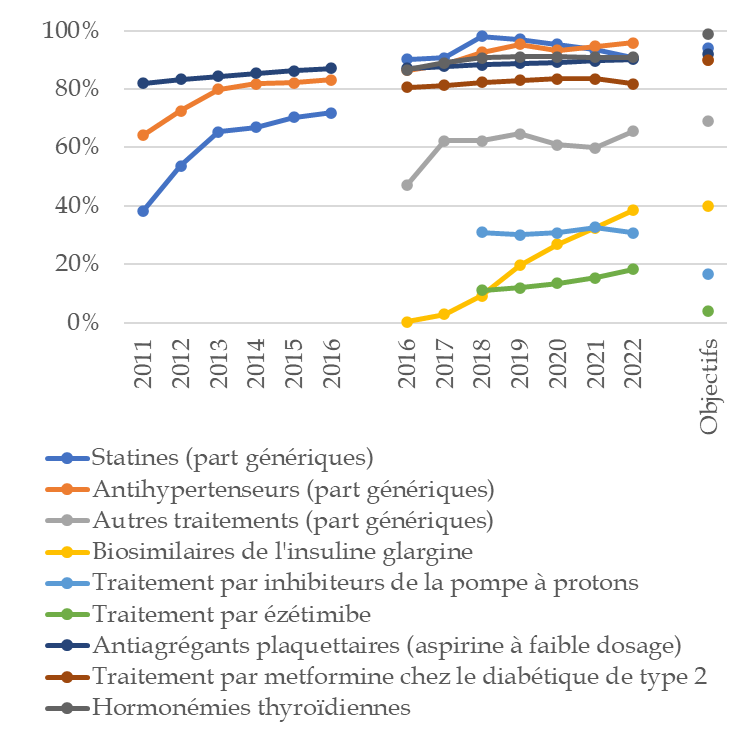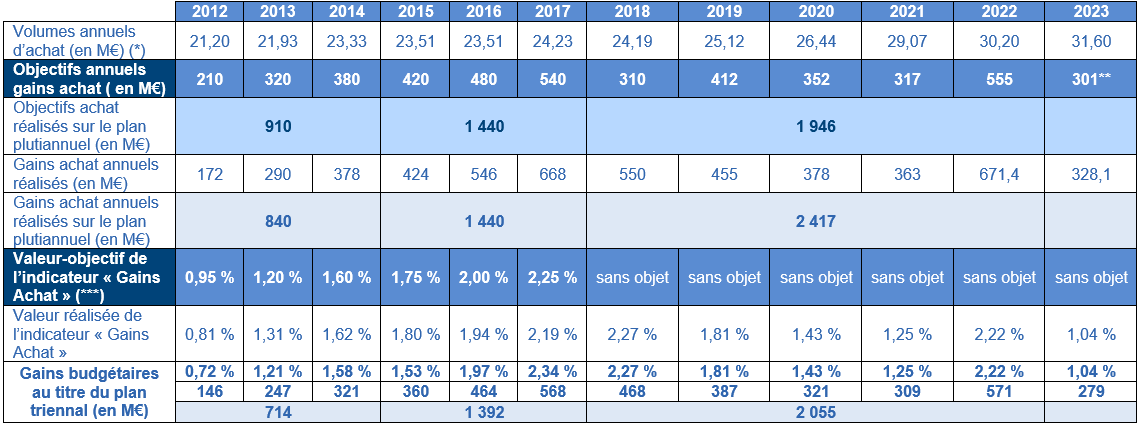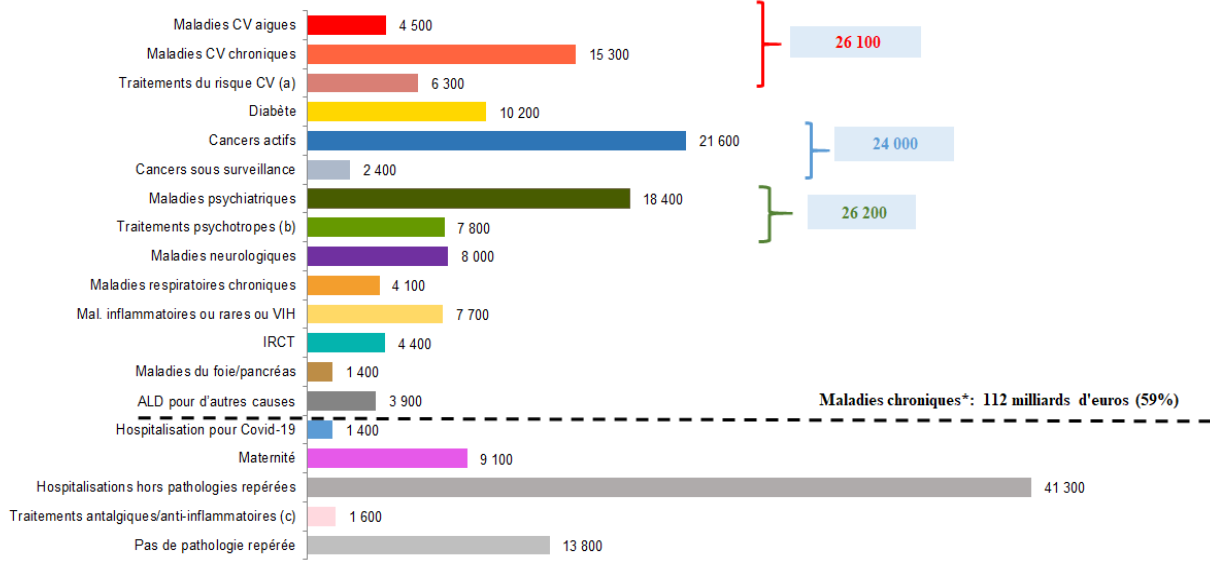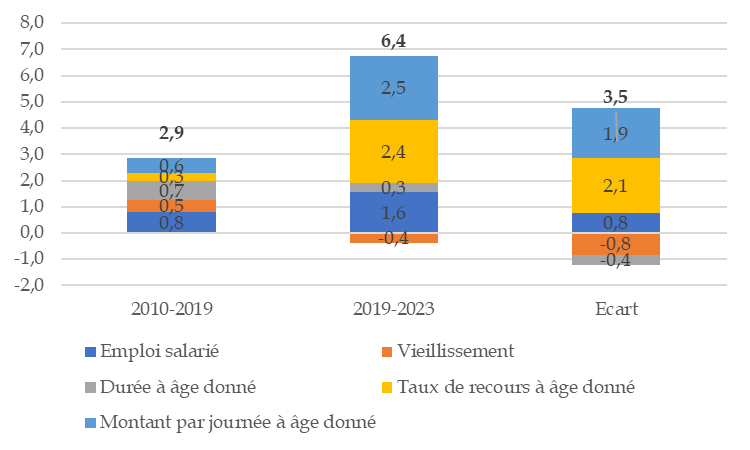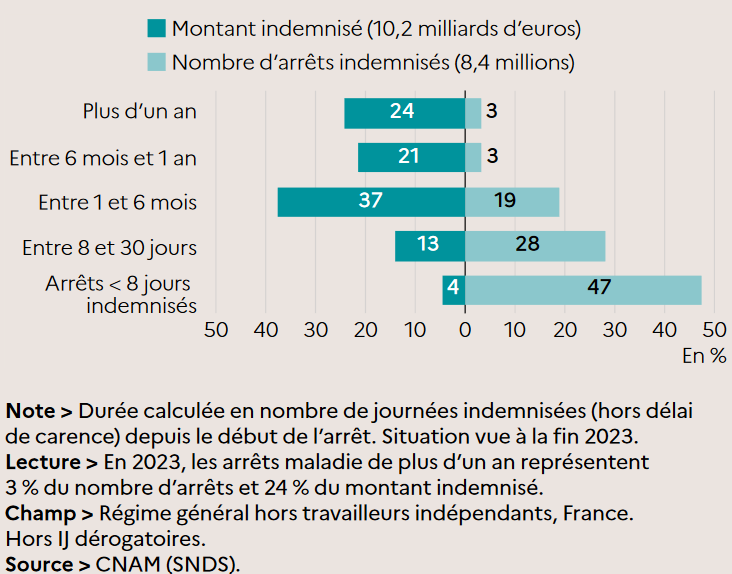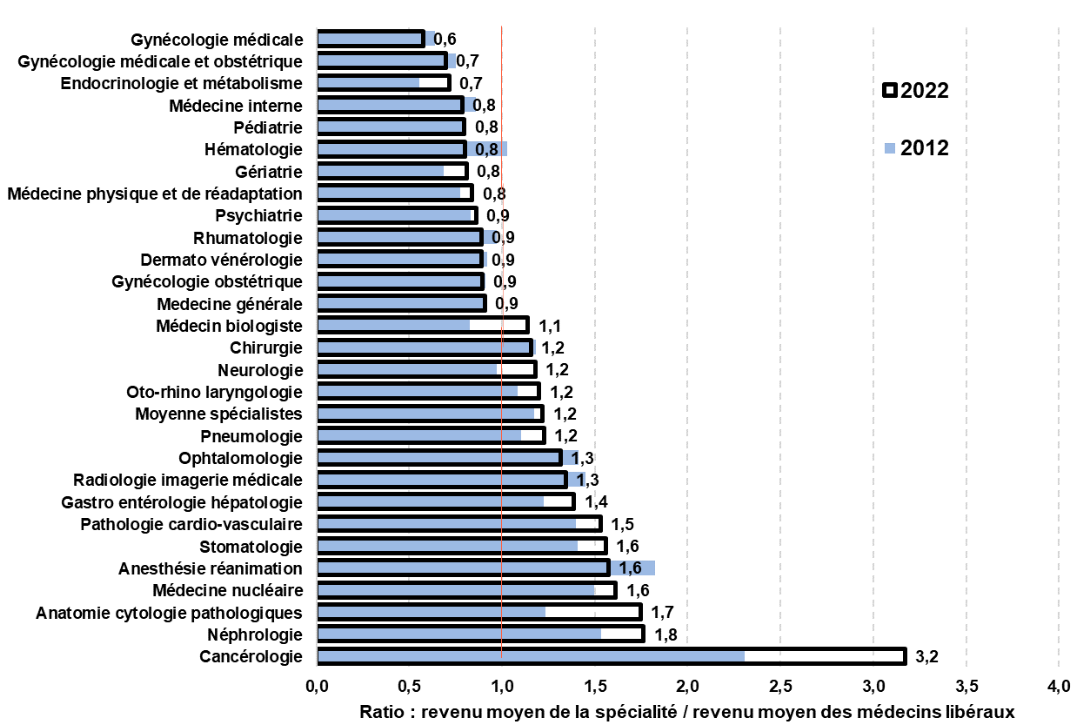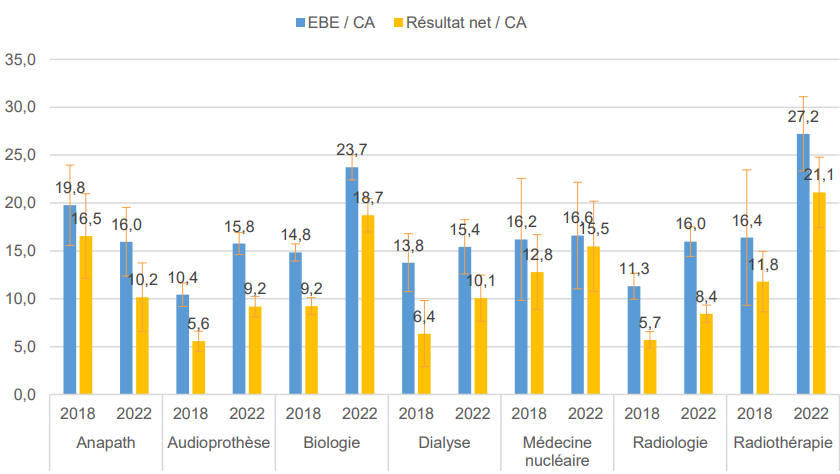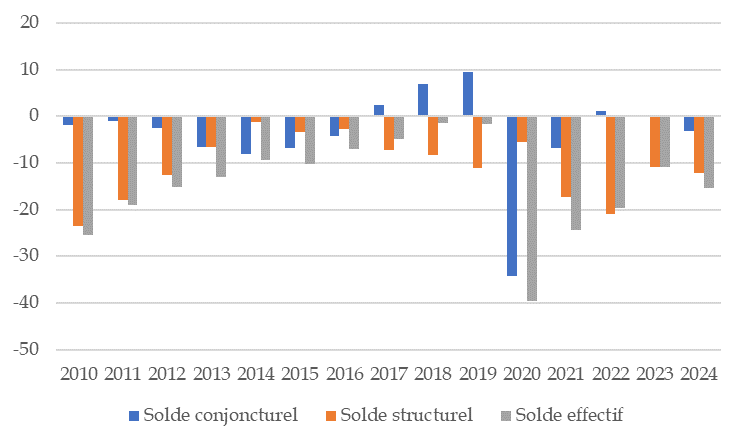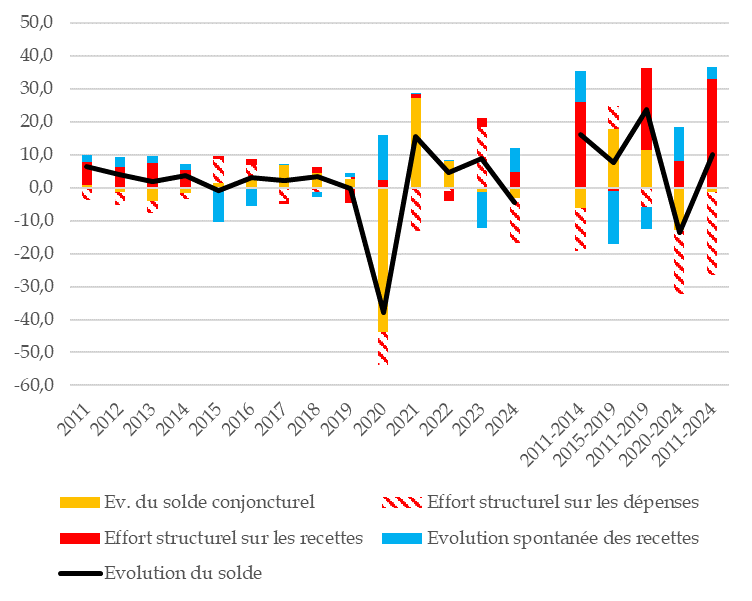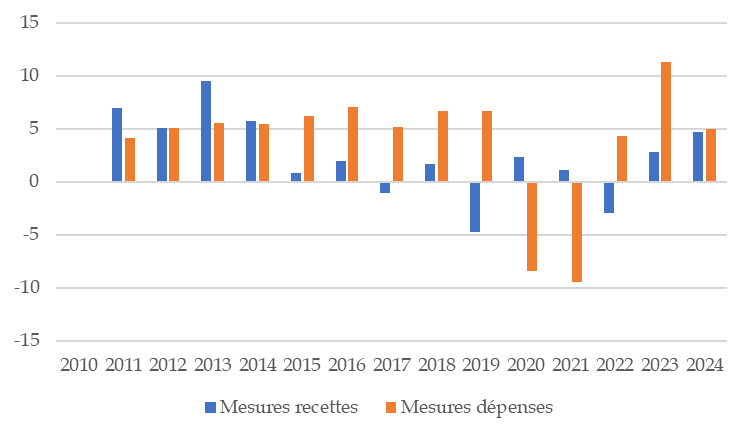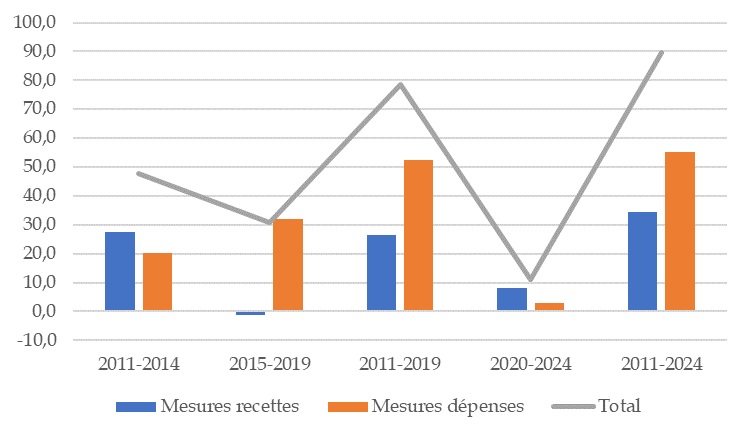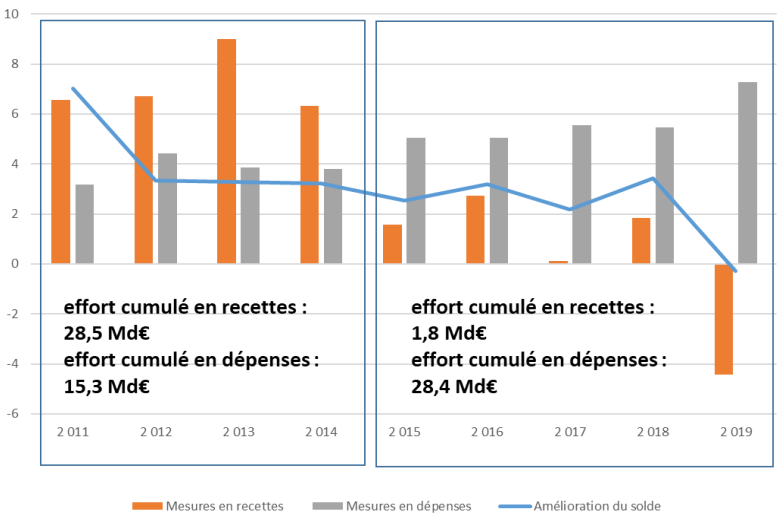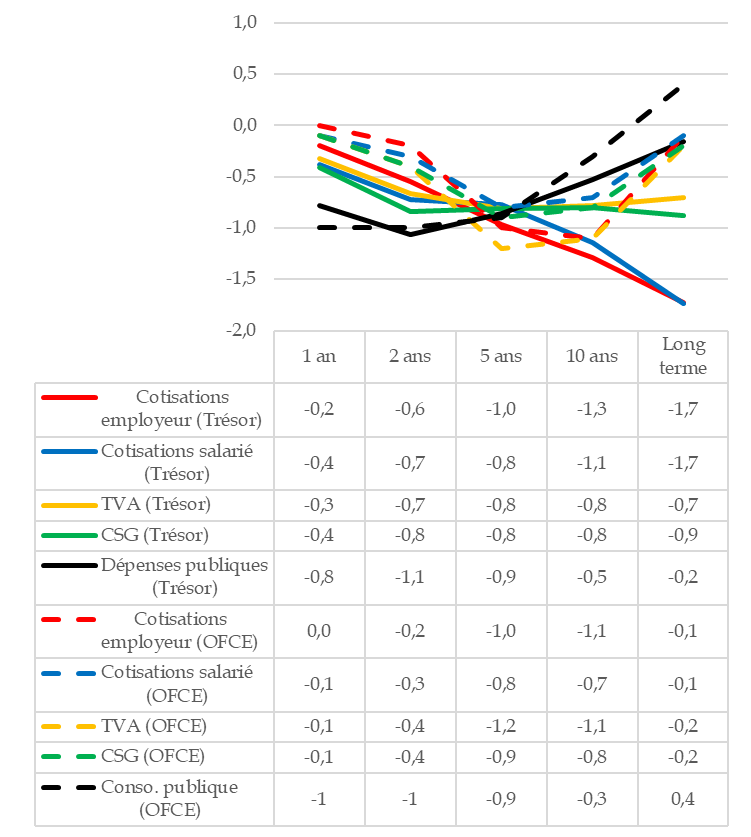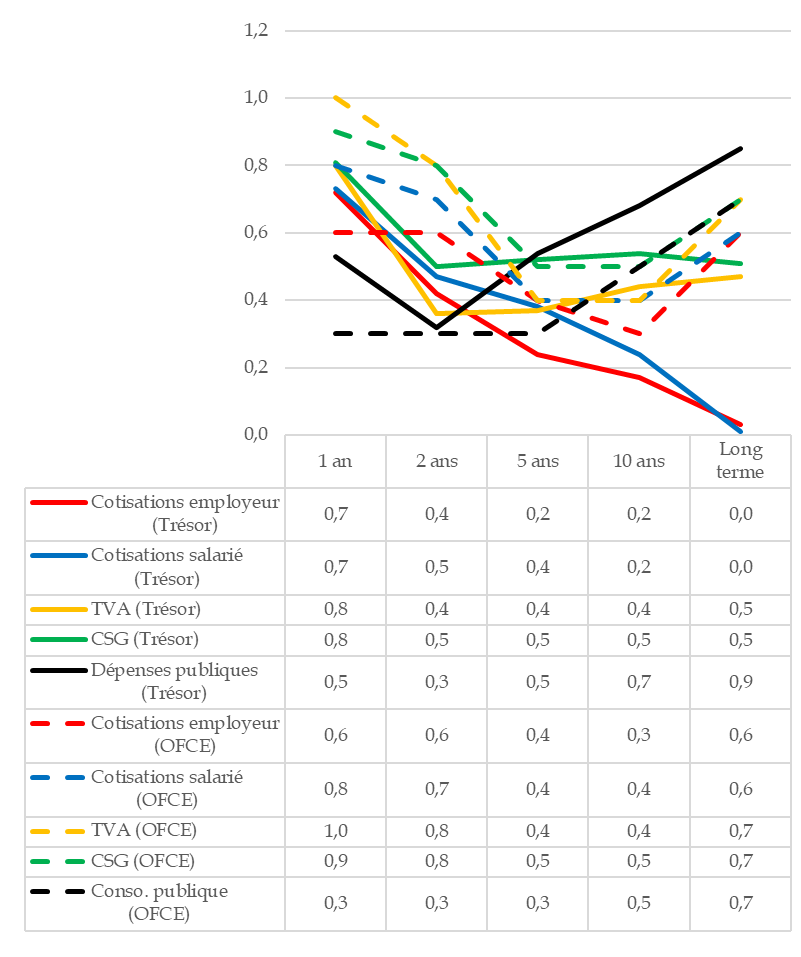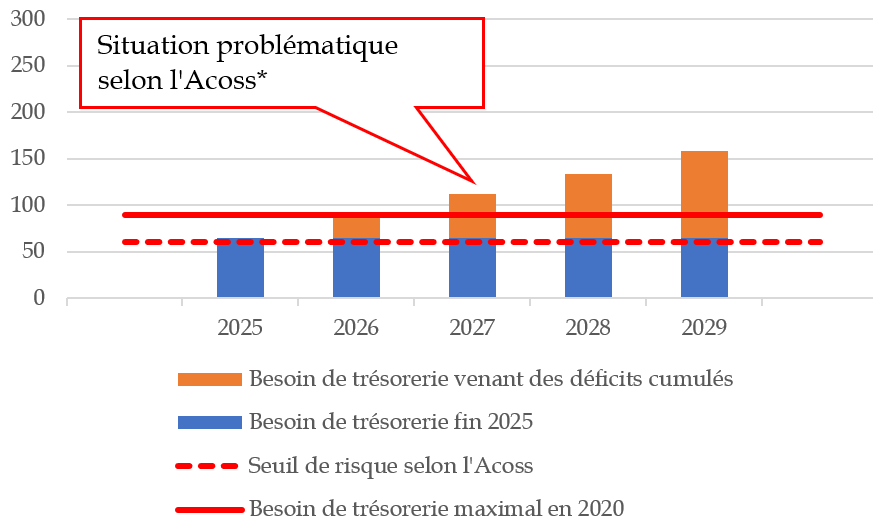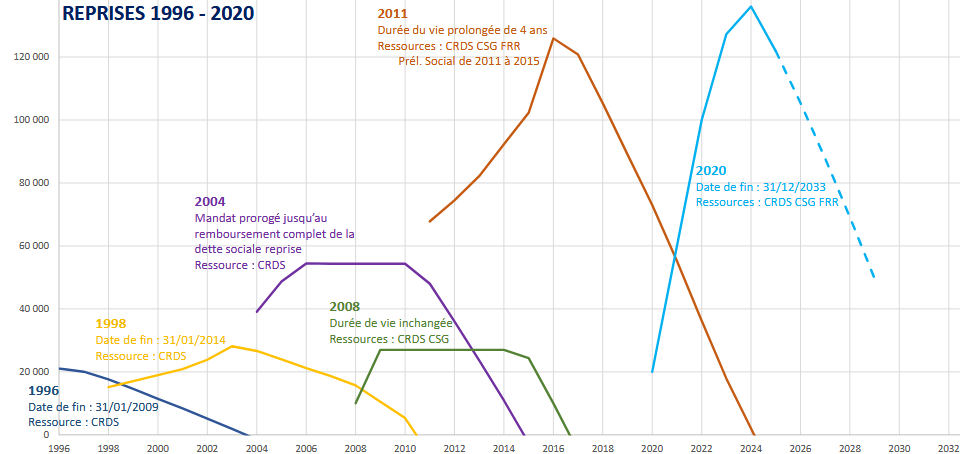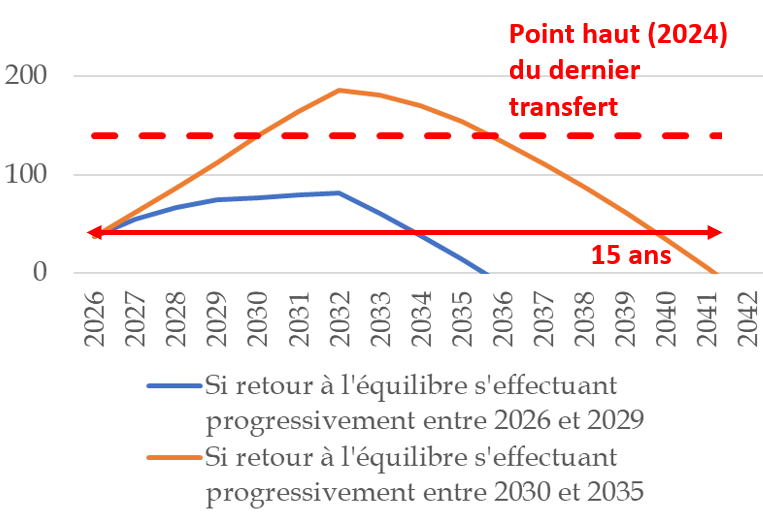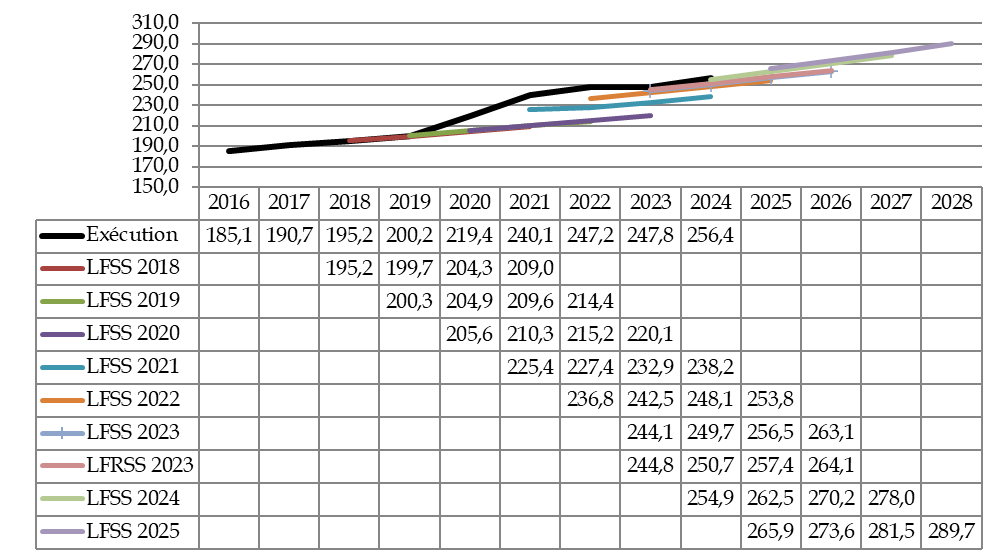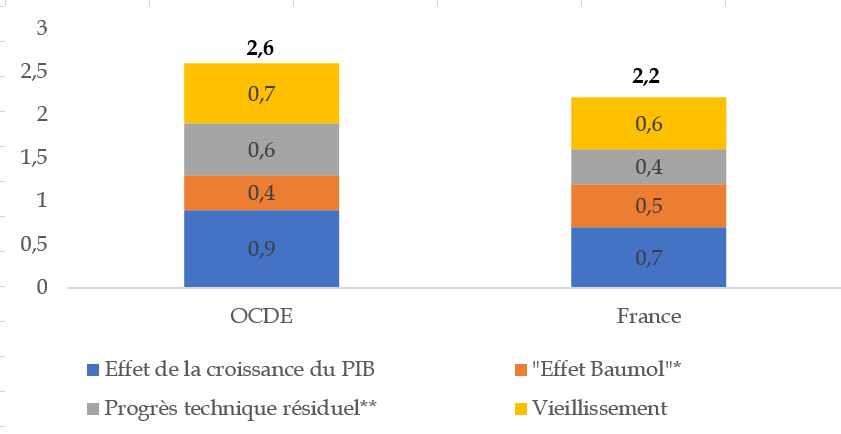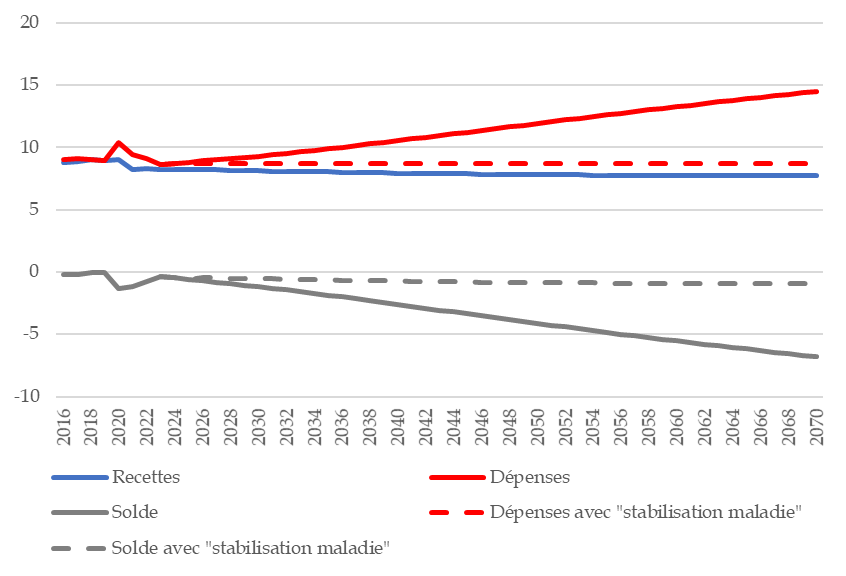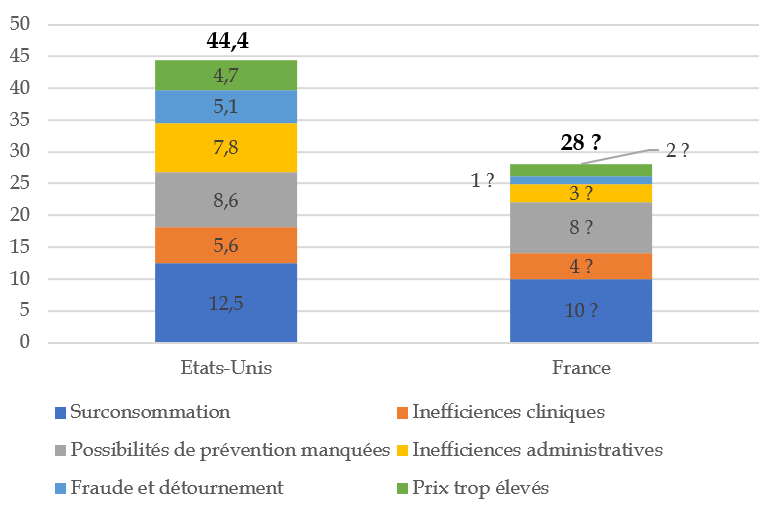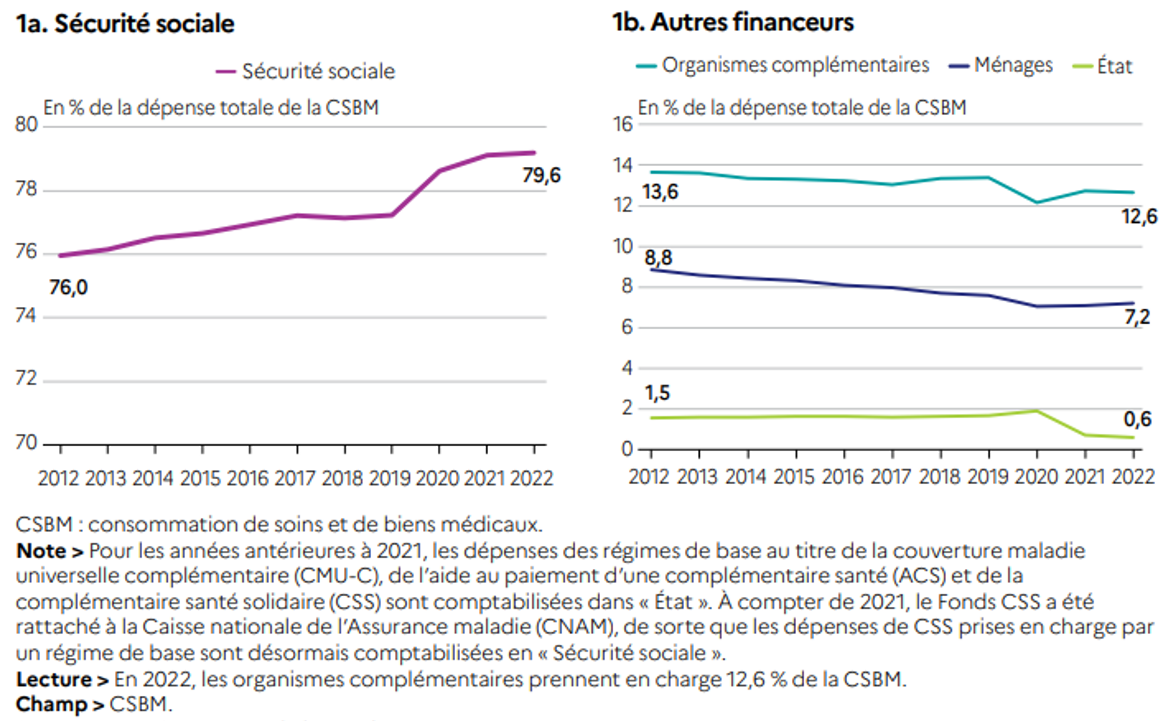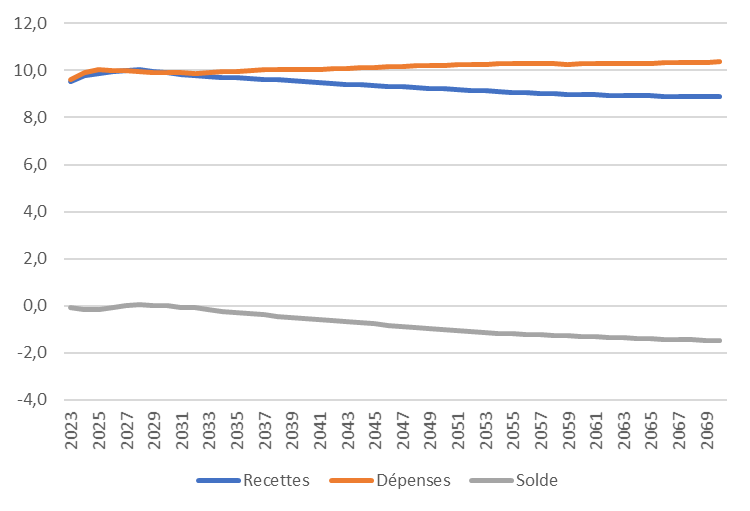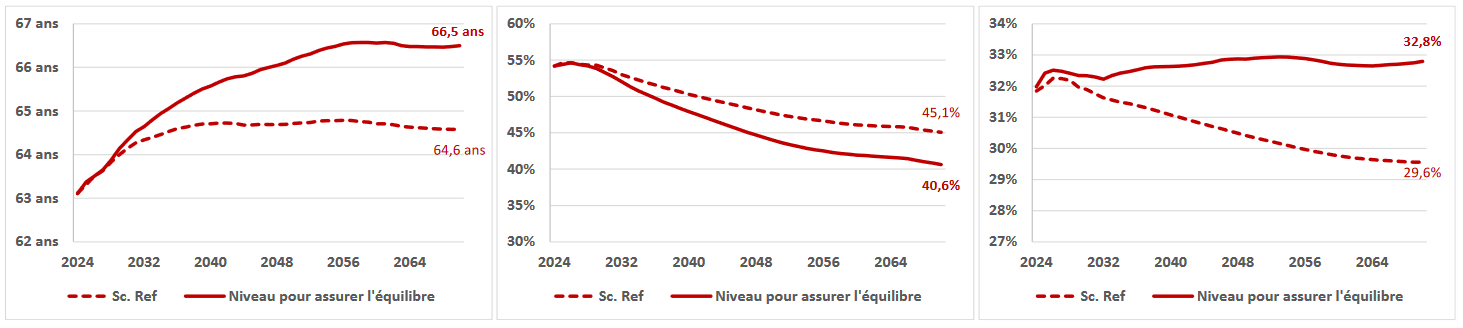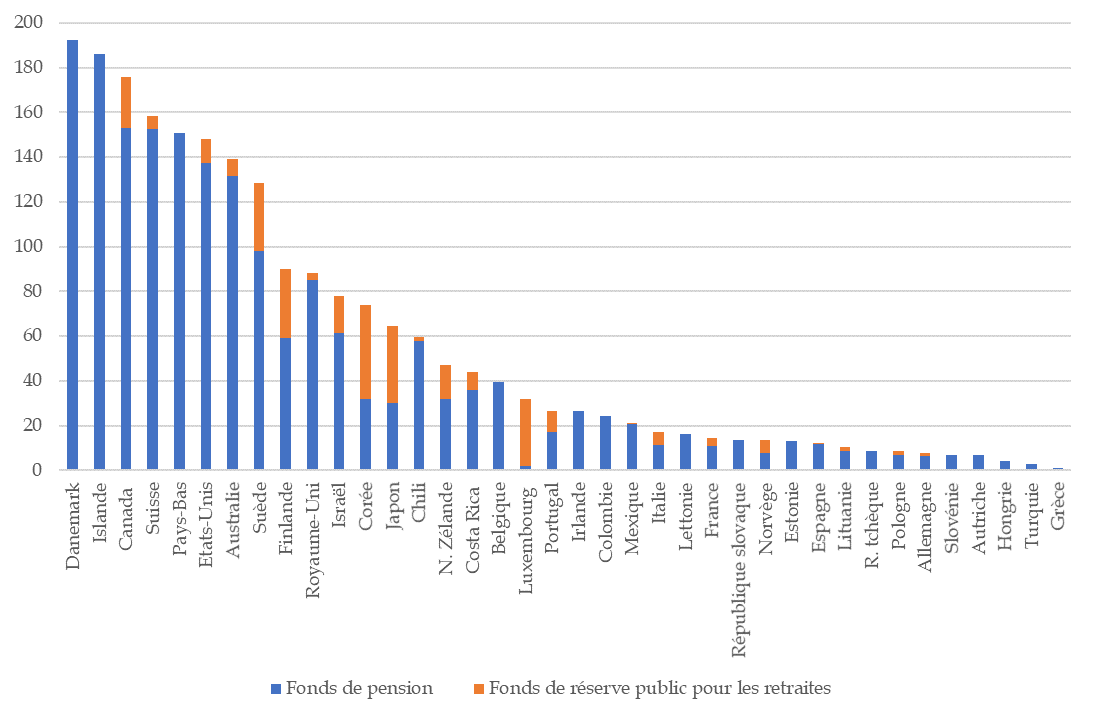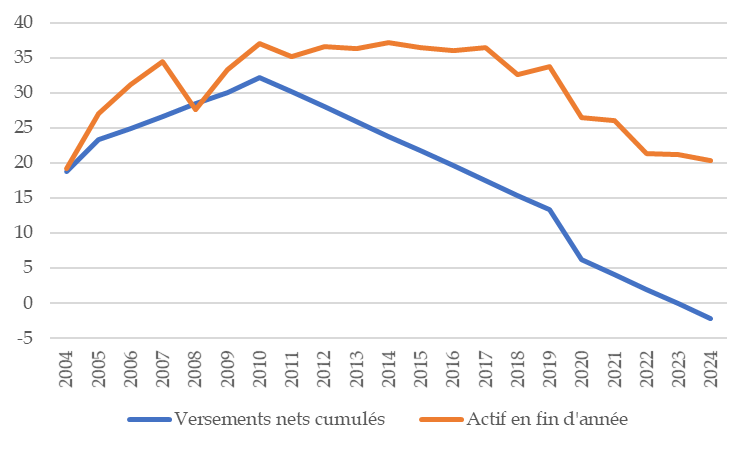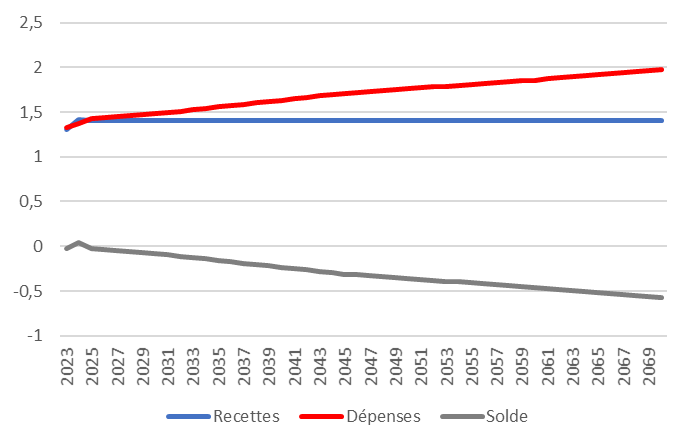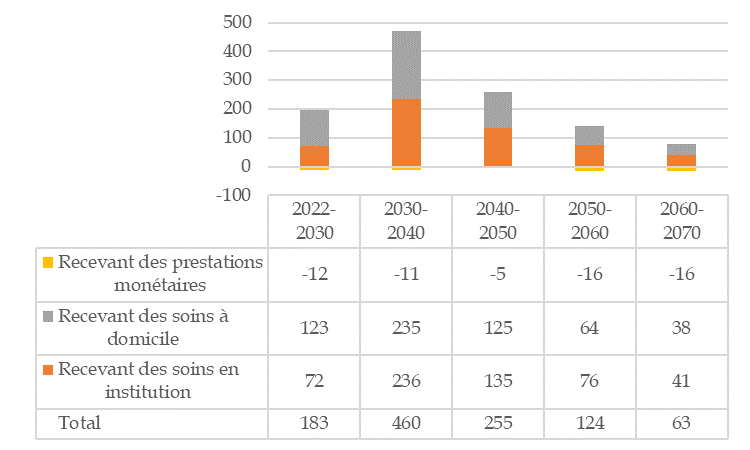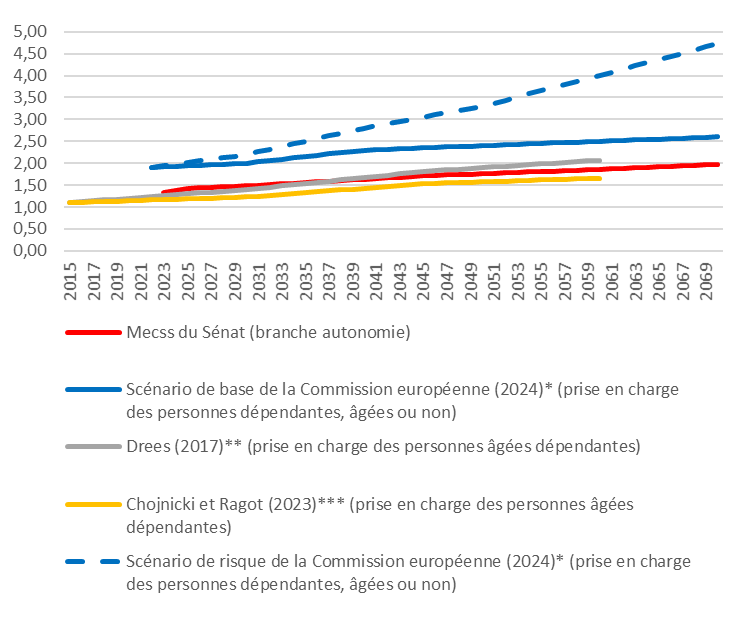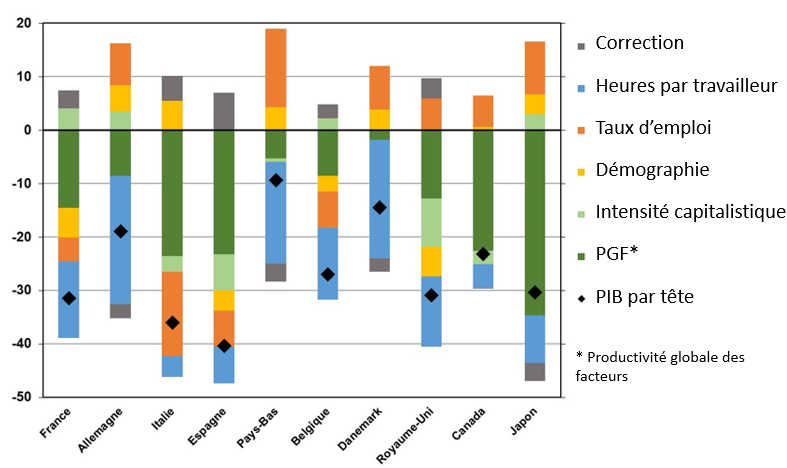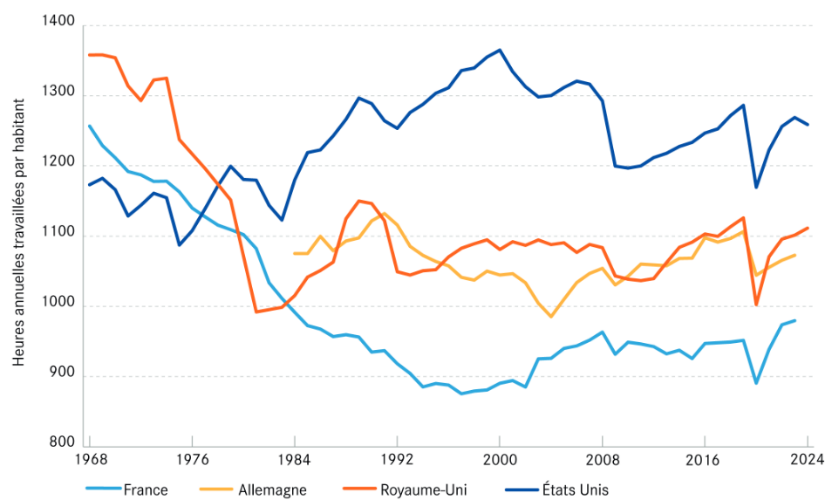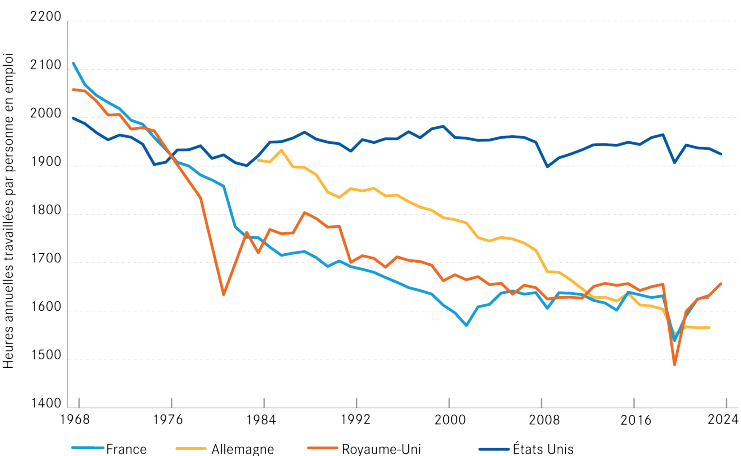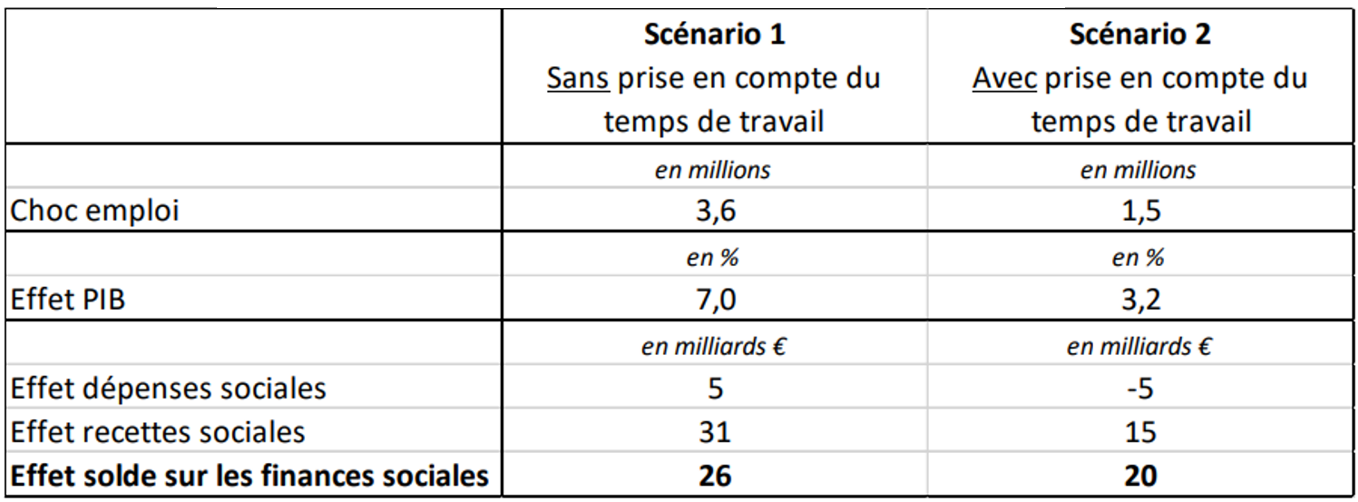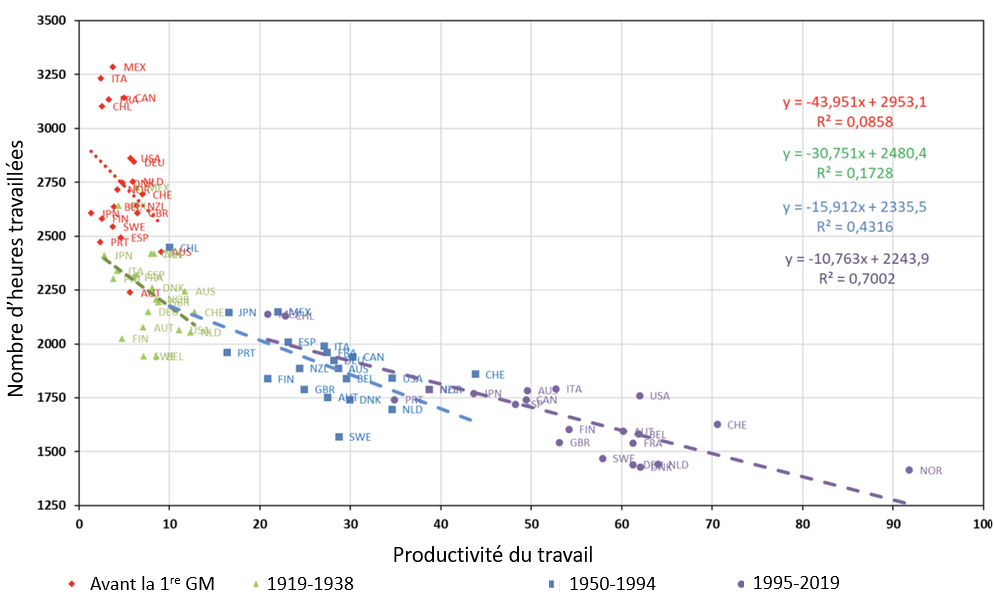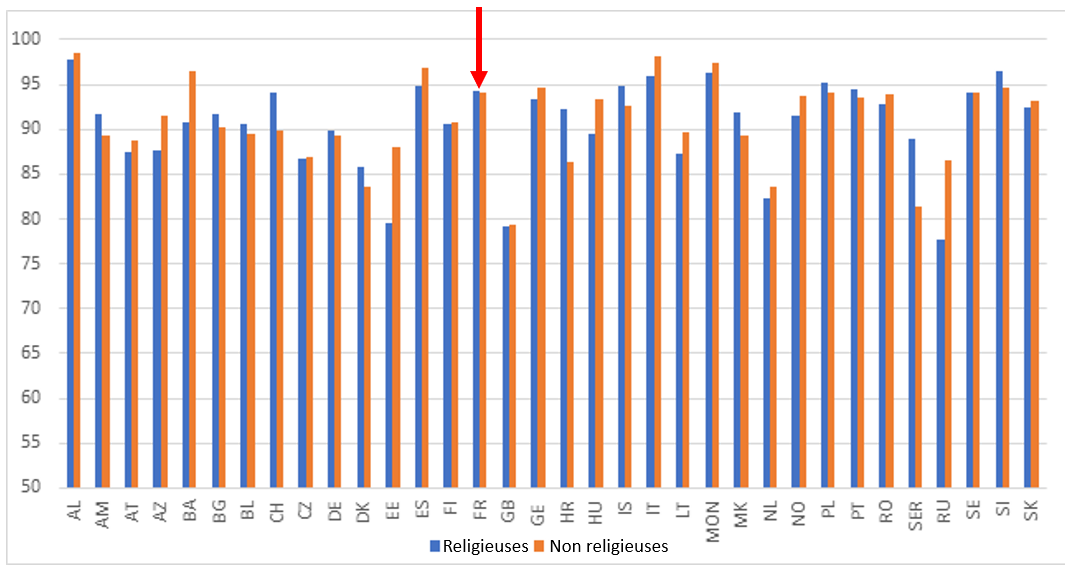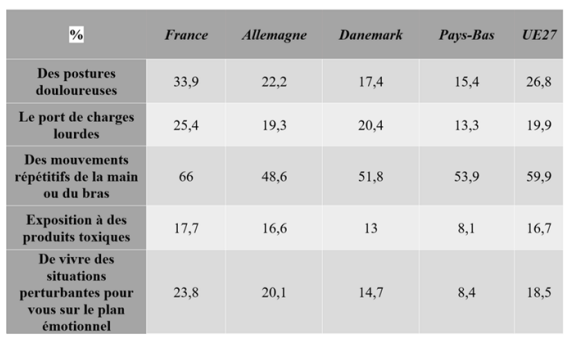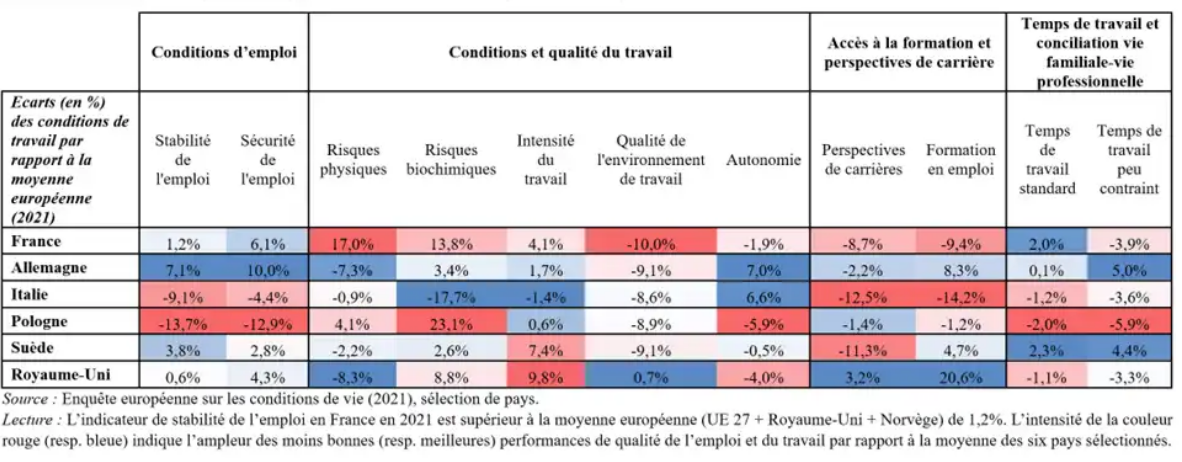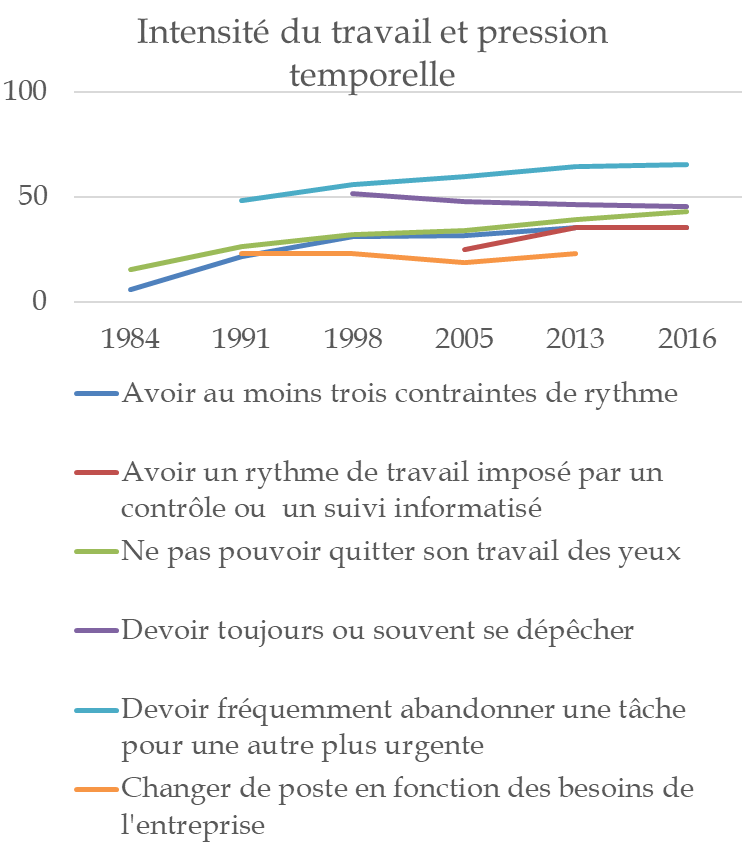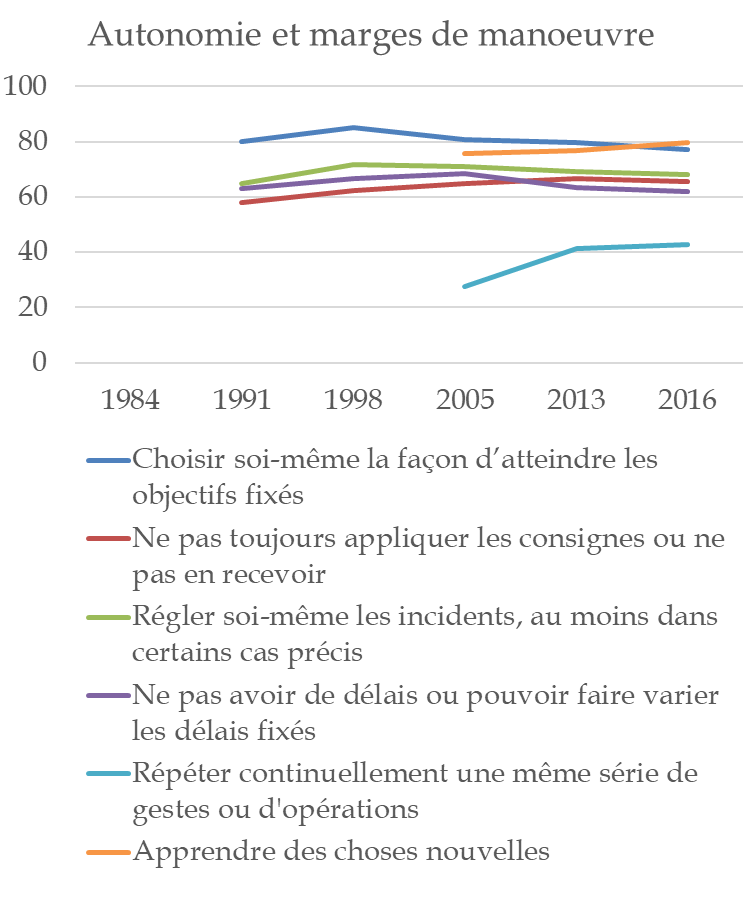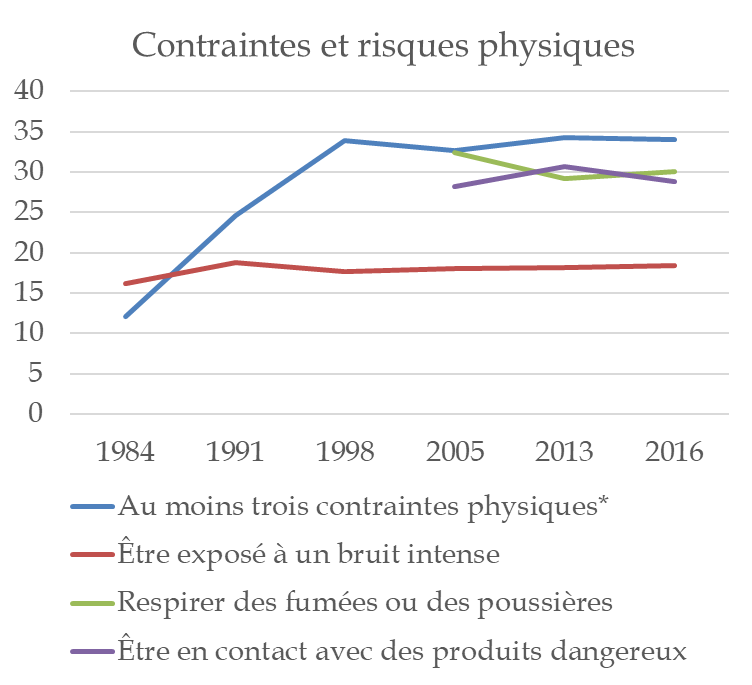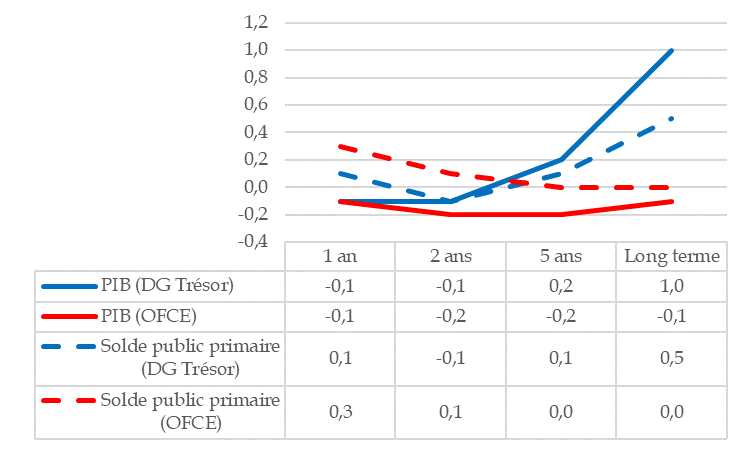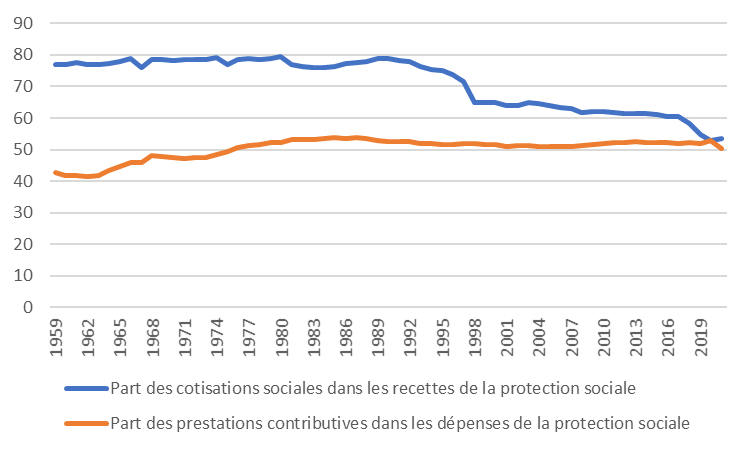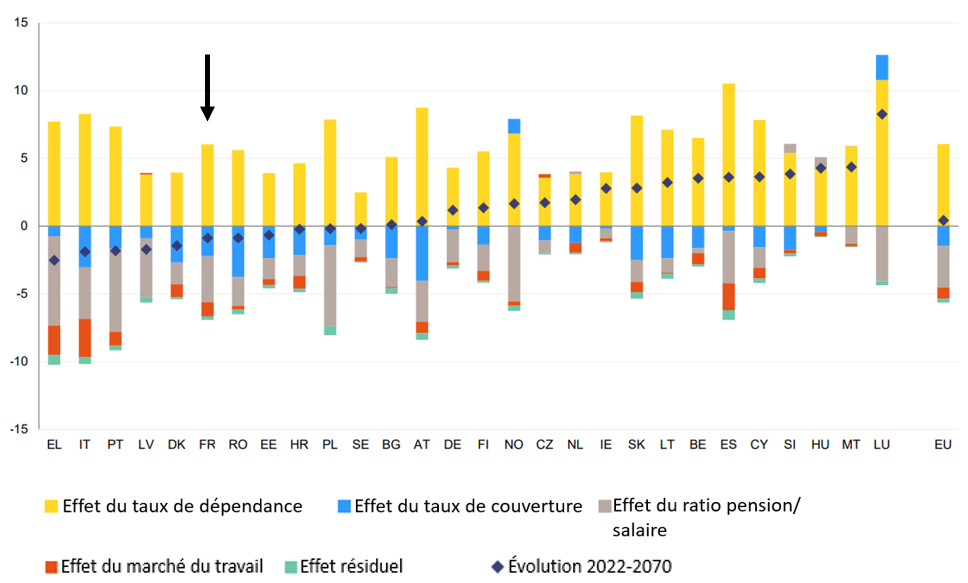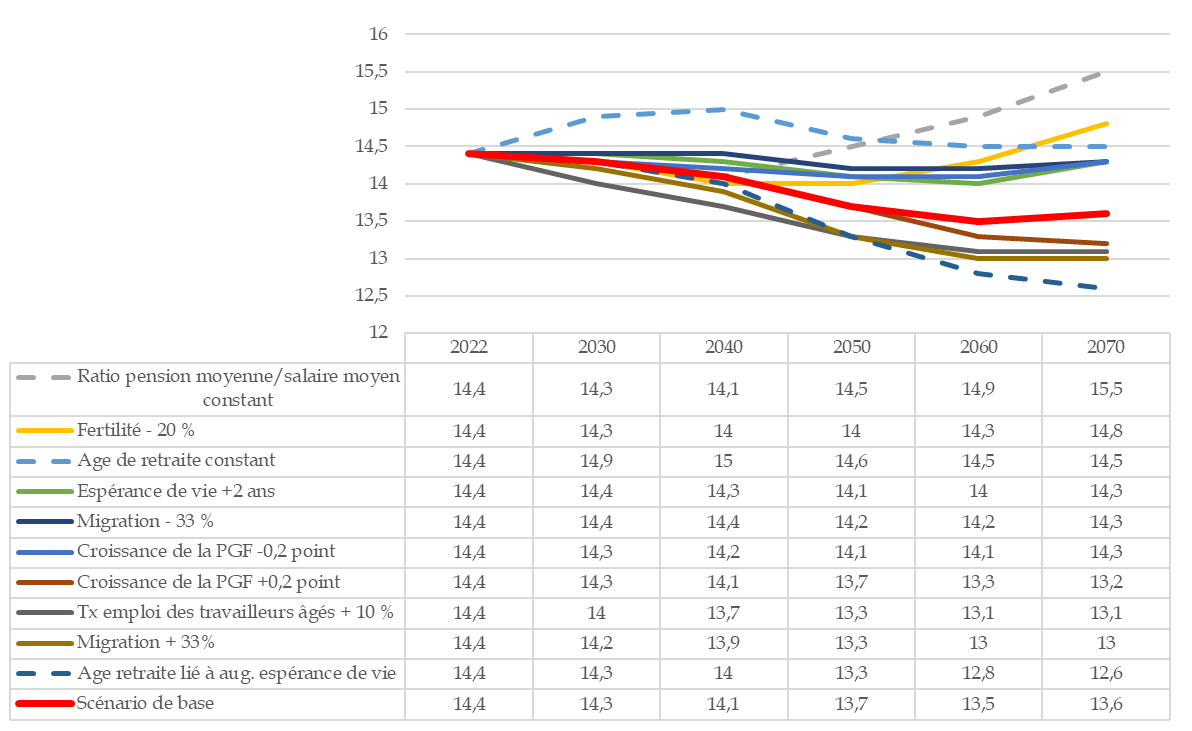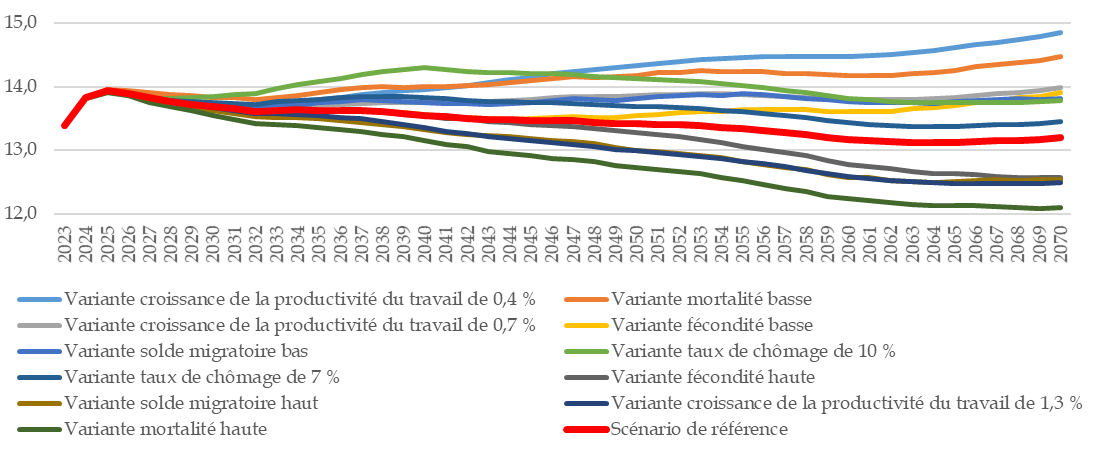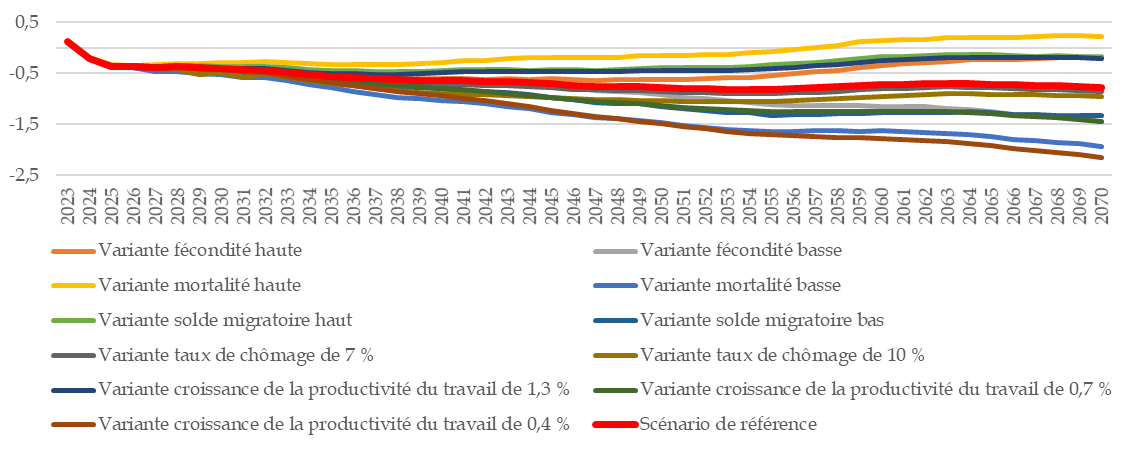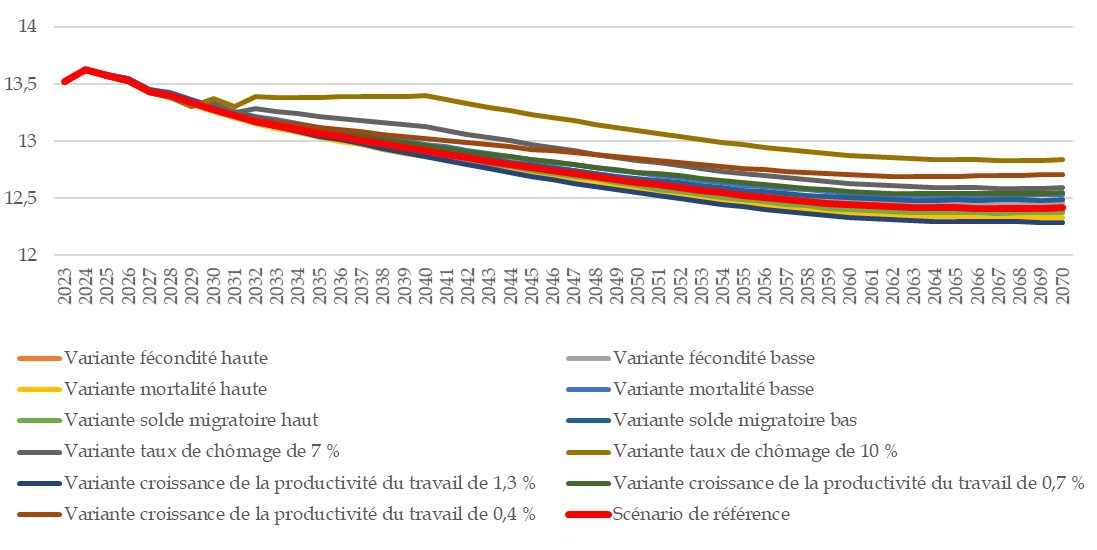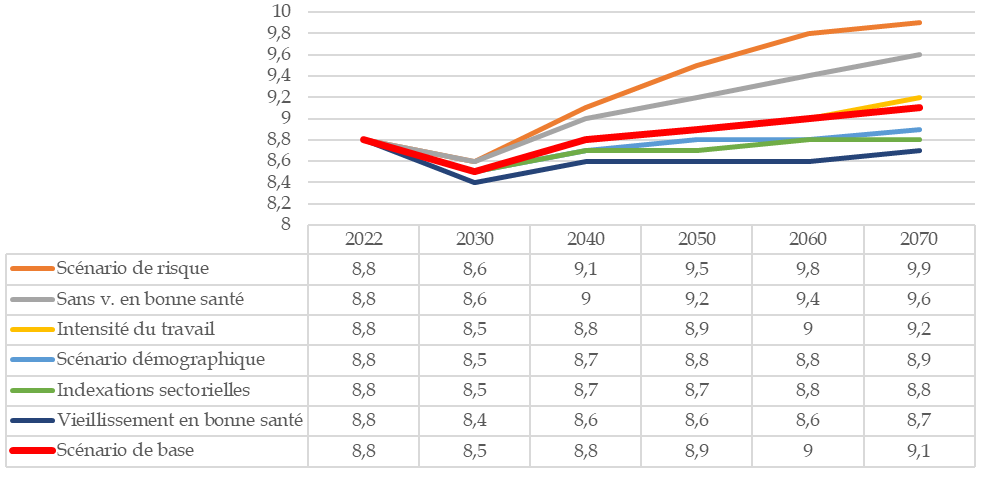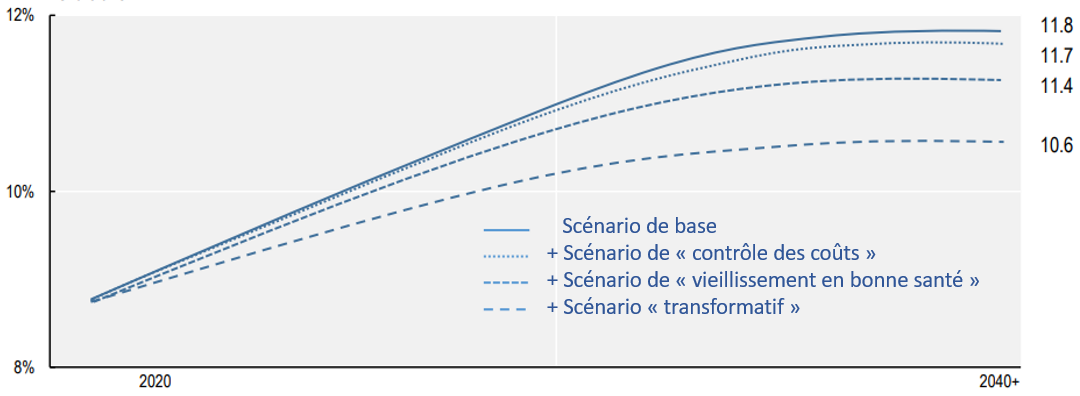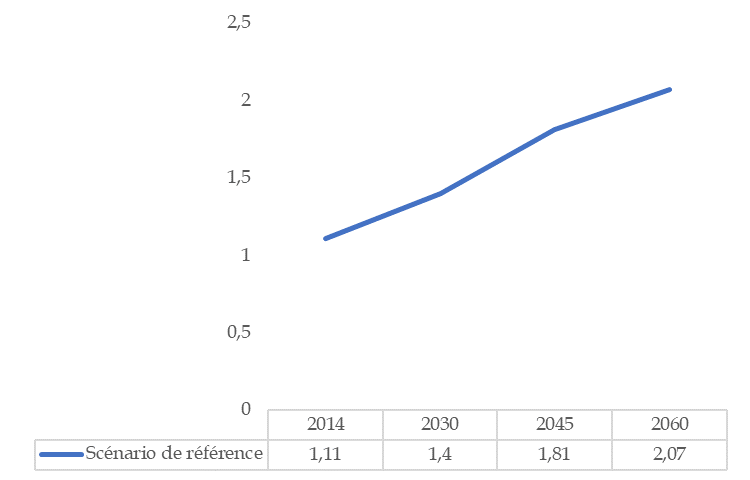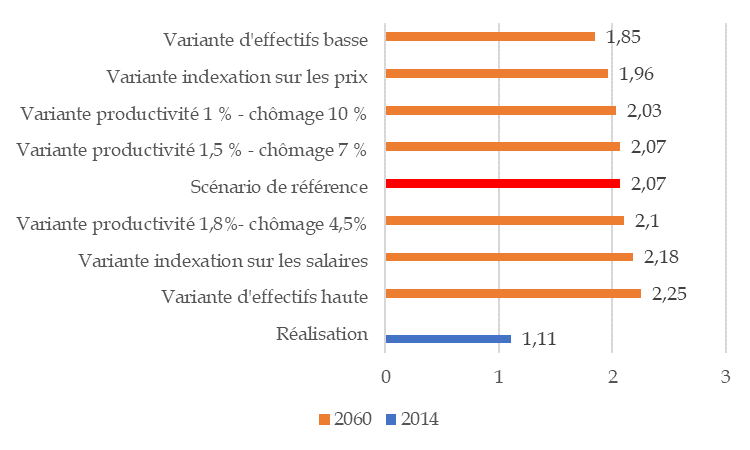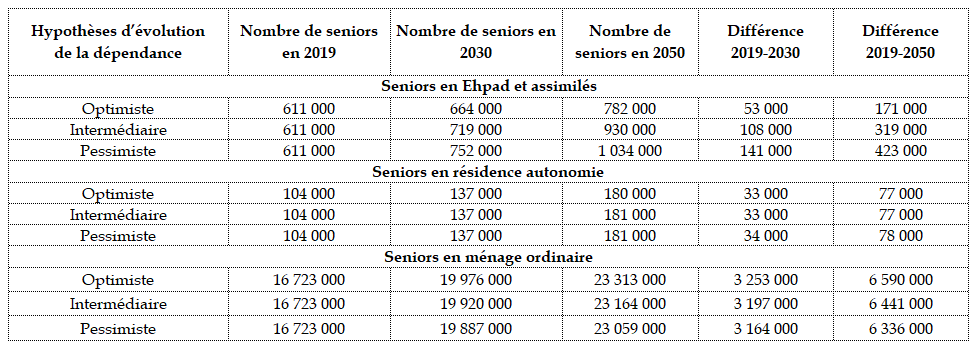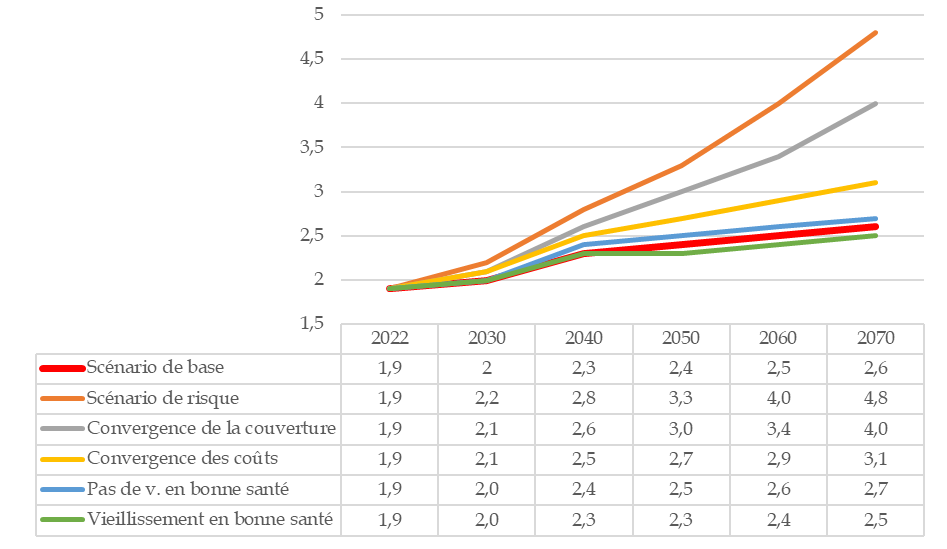- L'ESSENTIEL
- I. UNE SITUATION FINANCIÈRE NON
SOUTENABLE
- A. LES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION
SOCIALE LES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE ?
- B. DANS LE CAS DES RECETTES, UNE
« FAUSSE NORMALITÉ »
- C. UN DÉFICIT SANS PRÉCÉDENT
HORS PÉRIODE DE CRISE
- D. DES NICHES SOCIALES NON COMPENSÉES DE
35 MILLIARDS D'EUROS ?
- E. POURQUOI RÉDUIRE LE DÉFICIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE ?
- F. SANS NOUVELLES MESURES, UN DÉFICIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE QUI POURRAIT ATTEINDRE 3,5 POINTS DE PIB
EN 2040 ET 9 POINTS DE PIB EN 2070
- A. LES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION
SOCIALE LES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE ?
- II. RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE
À L'ÉQUILIBRE
- III. PRÉSERVER À LONG TERME
L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- I. UNE SITUATION FINANCIÈRE NON
SOUTENABLE
- PRINCIPAUX POINTS D'ACCORD DES
RAPPORTEURES
- INDEX DES PRINCIPAUX SIGLES ET DES PRINCIPALES
NOTIONS ET ABRÉVIATIONS
- LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE
CONTRÔLE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (MECSS)
- AVANT-PROPOS
- PREMIÈRE PARTIE
UNE SITUATION FINANCIÈRE NON SOUTENABLE
- I. DÉPENSES, RECETTES ET SOLDE
- A. EN POINTS DE PIB, LA FRANCE A LES
DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE LES PLUS
ÉLEVÉES DE L'OCDE
- B. EXPRIMÉES EN MONTANT PAR HABITANT, LES
DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FRANCE SONT LES
SIXIÈMES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE
- C. UN DÉCALAGE QUI SE CONSTATE NOTAMMENT
DANS LE CAS DE LA SANTÉ
- D. SI LES DÉPENSES SOCIALES DE LA FRANCE
SONT AUSSI ÉLEVÉES EN POINTS DE PIB, C'EST PARCE QUE SON PIB
PAR HABITANT EST SEULEMENT DANS LA MÉDIANE DES PAYS DE L'OCDE
- A. EN POINTS DE PIB, LA FRANCE A LES
DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE LES PLUS
ÉLEVÉES DE L'OCDE
- II. DANS LE CAS DES RECETTES, UNE
« FAUSSE NORMALITÉ »
- III. UN DÉFICIT SANS
PRÉCÉDENT HORS PÉRIODE DE CRISE
- A. UN DÉFICIT DE 15,3 MILLIARDS
D'EUROS EN 2024 ET QUI, SELON LE GOUVERNEMENT, APPROCHERAIT
25 MILLIARDS D'EUROS EN 2029
- 1. Une situation sans précédent hors
période de crise
- 2. Un déficit 2024 provenant de causes
multiples
- a) Une augmentation du déficit depuis 2019
venant essentiellement du fait que le PIB était alors nettement
au-dessus de son potentiel ?
- (1) Deux facteurs d'aggravation du
déficit entre 2019 et 2024 : le retour du PIB
à un niveau proche de son potentiel et une croissance des
dépenses supérieure à celle du PIB
- (a) Un PIB nettement au-dessus de son niveau
potentiel en 2019, améliorant le solde de manière non
durable
- (b) Une croissance des dépenses nettement
supérieure à celle du PIB potentiel
- (c) Un dynamisme spontané des recettes
renforcé par des mesures nouvelles
- b) De 2020 à 2023, un fort
dynamisme des niches sociales
- a) Une augmentation du déficit depuis 2019
venant essentiellement du fait que le PIB était alors nettement
au-dessus de son potentiel ?
- 1. Une situation sans précédent hors
période de crise
- B. DES NICHES SOCIALES NON COMPENSÉES
D'ENVIRON 35 MILLIARDS D'EUROS ?
- 1. Rappel des règles de compensation
- 2. La compensation des principales niches
- a) La compensation par crédits
budgétaires des exonérations dites « ciblées
compensées » : une compensation à l'euro
- b) La compensation des allégements
généraux de cotisations patronales par la TVA : un solde
négatif d'environ 5,5 milliards d'euros
- c) Les non-compensations hors allégements
généraux : environ 30 milliards d'euros, en
quasi-totalité « légales » et correspondant
à des niches anciennes ?
- a) La compensation par crédits
budgétaires des exonérations dites « ciblées
compensées » : une compensation à l'euro
- 1. Rappel des règles de compensation
- A. UN DÉFICIT DE 15,3 MILLIARDS
D'EUROS EN 2024 ET QUI, SELON LE GOUVERNEMENT, APPROCHERAIT
25 MILLIARDS D'EUROS EN 2029
- IV. POURQUOI RAMENER LA SÉCURITÉ
SOCIALE À L'ÉQUILIBRE ?
- A. UN DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE SANS GUÈRE DE SIGNIFICATION
- B. IL N'EN EST PAS MOINS NÉCESSAIRE DE
RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE
- 1. La sécurité sociale ne peut
rester durablement déficitaire
- 2. Le déficit actuel des administrations
publiques considérées dans leur ensemble n'est pas
soutenable
- a) Le déficit actuel des administrations
publiques, de près de 6 points de PIB, n'est pas soutenable
- b) Un effort prévu par le Gouvernement
démissionnaire d'environ 170 milliards d'euros d'ici 2029 pour
l'ensemble des administrations publiques
- c) Ramener la sécurité sociale
à l'équilibre en 2029 : un effort de 40 milliards
d'euros en dépenses et en recettes
- a) Le déficit actuel des administrations
publiques, de près de 6 points de PIB, n'est pas soutenable
- 1. La sécurité sociale ne peut
rester durablement déficitaire
- A. UN DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE SANS GUÈRE DE SIGNIFICATION
- V. SANS NOUVELLES MESURES, UN DÉFICIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE QUI POURRAIT ATTEINDRE 3,5 POINTS DE PIB
EN 2040 (ET 9 POINTS DE PIB EN 2070)
- A. UN DÉFICIT HORS DE CONTRÔLE SI LES
DÉPENSES DE LA BRANCHE MALADIE AUGMENTENT CONFORMÉMENT À
LEUR CROISSANCE SPONTANÉE
- B. SOUS RÉSERVE DE LA MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE SANTÉ, LES DÉPENSES DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE SONT GLOBALEMENT MAÎTRISÉES, LE
SUJET DE MOYEN TERME ÉTANT LA RÉSORPTION DU DÉFICIT
ACTUEL
- C. HORS DÉPENSES DE SANTÉ, UNE
AUGMENTATION SPONTANÉE DES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE D'ENVIRON 0,6 POINT DE PIB D'ICI 2070
- A. UN DÉFICIT HORS DE CONTRÔLE SI LES
DÉPENSES DE LA BRANCHE MALADIE AUGMENTENT CONFORMÉMENT À
LEUR CROISSANCE SPONTANÉE
- VI. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES
DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
- A. ENVIRON LA MOITIÉ DES SURCOÛTS DU
VIEILLISSEMENT PAR RAPPORT À L'AN 2000 SE FONT DÉJÀ
SENTIR
- B. Y A-T-IL DEVANT NOUS UN « MUR DU
VIEILLISSEMENT » ?
- 1. Dans le cas des retraites, l'essentiel de
l'effort a déjà été fait
- 2. Dans le cas de la santé, le
vieillissement ne devrait pas beaucoup plus majorer la croissance des
dépenses qu'actuellement
- 3. Dans le cas de l'autonomie, une augmentation
des dépenses modeste en niveau mais importante rapportée aux
dépenses de l'ensemble de la branche
- 1. Dans le cas des retraites, l'essentiel de
l'effort a déjà été fait
- A. ENVIRON LA MOITIÉ DES SURCOÛTS DU
VIEILLISSEMENT PAR RAPPORT À L'AN 2000 SE FONT DÉJÀ
SENTIR
- I. DÉPENSES, RECETTES ET SOLDE
- DEUXIÈME PARTIE
RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE
- I. QUELLE ÉCHÉANCE POUR LE RETOUR DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
À L'ÉQUILIBRE ?
- II. DES OPTIONS LIMITÉES ?
- A. POUR RESPECTER LA TRAJECTOIRE D'ONDAM DE LA
LFSS 2025, RÉALISER UN EFFORT NET SUR L'ONDAM D'ENVIRON 4 MILLIARDS
D'EUROS PAR AN
- 1. La maîtrise de l'Ondam, une
nécessité pour que la sécurité sociale reste
finançable à long terme
- 2. Des mesures de maîtrise de l'Ondam
déjà d'environ 4 milliards d'euros par an
- 3. Les propositions faites par la Cour des comptes
en avril 2025 et par la Cnam en juillet 2025 ont seulement pour objet
de permettre le respect de l'Ondam prévu par la LFSS
pour 2025
- a) Des propositions très proches par leur
nature
- b) Les propositions de la Cour des comptes
- c) Les propositions de la Cnam
- d) Par rapport à la pratique
2015- 2021, les propositions de la Cour des comptes reposent nettement
plus sur les volumes, celles de la Cnam nettement plus sur la lutte contre la
fraude, les volumes et la prise en charge
- a) Des propositions très proches par leur
nature
- 4. Limiter le coût des dépenses de
médicaments ?
- a) La forte augmentation des dépenses de
médicaments depuis 2020
- b) Les principales propositions pour
maîtriser les dépenses de médicaments
- (1) Les propositions de la Cour des comptes dans
le cas des médicaments anticancéreux (2024)
- (2) Les propositions du rapport
« charges et produits »
- (3) Les propositions du rapport des trois Hauts
Conseils
- a) La forte augmentation des dépenses de
médicaments depuis 2020
- 5. Améliorer la pertinence des
soins ?
- a) Des incitations encore insuffisantes
- (1) La situation actuelle pour la médecine
de ville
- (a) La rémunération sur objectifs de
santé publique (Rosp)
- (b) Les avancées récentes
- (2) La situation actuelle pour
l'hôpital
- b) Trouver le bon équilibre entre
incitation et contrainte
- c) Les propositions de la Cnam pour
améliorer la pertinence des soins
- a) Des incitations encore insuffisantes
- 6. Revoir l'organisation des soins ?
- 7. Développer la
prévention ?
- a) La prévention primaire implique un
fort engagement politique
- (1) Les pathologies évitables coûtent
plus de 10 milliards d'euros aux finances publiques (hors impact du
moindre PIB sur les recettes)
- (2) Développer la vaccination,
éventuellement en la rendant obligatoire pour certains
publics ?
- (3) La fréquente nécessité
d'arbitrer entre santé publique et soutien de filières
économiques
- (4) Le rapport de la Mecss sur la fiscalité
comportementale en santé (2024)
- (5) Taxer les aliments à faible
qualité nutritionnelle autres que les boissons ?
- (a) Imposer certains aliments à un taux de
TVA réduit ou nul ?
- (b) Instaurer une taxation spécifique de
certains produits alimentaires ?
- (6) Mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux ?
- (7) Étendre la fiscalité
comportementale aux « écrans » ?
- b) Renforcer la prévention
secondaire ?
- (1) Renforcer les dépistages ?
- (2) Faut-il subordonner le niveau de prise en
charge au respect des obligations de dépistage par le
patient ?
- c) Renforcer la prévention tertiaire, en
particulier dans le cas des personnes atteintes de pathologies
chroniques ?
- d) Installer une gouvernance de la
prévention en santé ?
- a) La prévention primaire implique un
fort engagement politique
- 8. Limiter le coût des indemnités
journalières (IJ) relatives aux arrêts de travail ?
- a) Des dépenses augmentant de plus de
6 % par an, du fait notamment d'une hausse de la
sinistralité
- b) Prendre des mesures
paramétriques ?
- c) Enrayer la hausse de la
sinistralité ?
- (1) Une hausse de la sinistralité
imparfaitement expliquée
- (2) Lutter contre la fraude aux arrêts de
travail
- (3) Les propositions de la Cnam dans le rapport
« charges et produits »
- (a) Prévenir la désinsertion
professionnelle ?
- (b) Veiller à la pertinence des
prescriptions ?
- (c) Inciter les employeurs à
améliorer les conditions de travail ?
- (4) Les propositions du rapport des trois Hauts
Conseils
- a) Des dépenses augmentant de plus de
6 % par an, du fait notamment d'une hausse de la
sinistralité
- 9. Réduire la prise en charge des ALD par
la branche maladie ?
- 10. Prévenir les phénomènes
de rente et d'optimisation financière ?
- 1. La maîtrise de l'Ondam, une
nécessité pour que la sécurité sociale reste
finançable à long terme
- B. QUELS EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES POUR
RÉSORBER LE DÉFICIT ?
- 1. Le levier des dépenses
- 2. Le levier des recettes
- a) Les réductions de niches : une
vingtaine de milliards d'euros de recettes potentielles ?
- (1) Réduire encore les allégements
généraux, en maîtrisant l'effet sur l'emploi ?
- (2) Augmenter certains taux réduits de
CSG ?
- (3) Réduire les niches sociales sur les
compléments de salaire ?
- (a) Supprimer les exemptions de CSG pour certains
compléments de salaire ?
- (b) Augmenter le forfait social pour certaines
niches relatives aux compléments de salaire ?
- (c) Centrer davantage l'exemption en faveur de la
prévoyance complémentaire sur la prévoyance stricto
sensu ?
- (d) Réduire l'exonération salariale
relative aux heures supplémentaires ?
- (e) Réduire l'exemption relative aux titres
restaurant ?
- (f) Réduire l'exemption relative aux
indemnités de rupture conventionnelle ?
- (4) Autres principales niches pouvant être
réduites ou supprimées
- b) Les hausses de taux :
jusqu'à 18 milliards d'euros pour une hausse d'un point de la
CSG ?
- c) Selon le récent rapport des trois Hauts
Conseils, le retour de la branche autonomie à l'équilibre
en 2030 passera par la hausse des recettes, du fait de la
nécessité de financer des dépenses
supplémentaires
- a) Les réductions de niches : une
vingtaine de milliards d'euros de recettes potentielles ?
- 3. Combiner augmentations de recettes et
maîtrise des dépenses ?
- a) Dans les années 2010, l'effort
structurel a reposé exclusivement sur les recettes
- b) Dans les années 2010, les mesures
d'amélioration du solde ont essentiellement concerné les
dépenses
- c) Impacts comparés des réductions
de dépenses et des hausses de prélèvement obligatoire,
selon le Trésor et l'OFCE
- (1) Les hausses de recettes
préférables à court terme, les baisses de dépenses
préférables à long terme : un résultat
à relativiser dans le cas de la sécurité
sociale ?
- (2) Les hausses de cotisations doivent-elles
être évitées ?
- (a) Selon la direction générale du
Trésor, les hausses de cotisations seraient fortement récessives,
ce qui ne serait pas le cas selon l'OFCE
- (b) Selon la direction générale du
Trésor, à long terme les hausses de cotisations
n'amélioreraient pas le solde public, alors que selon l'OFCE elles ne se
distingueraient pas des autres hausses de prélèvements
obligatoires
- a) Dans les années 2010, l'effort
structurel a reposé exclusivement sur les recettes
- 1. Le levier des dépenses
- A. POUR RESPECTER LA TRAJECTOIRE D'ONDAM DE LA
LFSS 2025, RÉALISER UN EFFORT NET SUR L'ONDAM D'ENVIRON 4 MILLIARDS
D'EUROS PAR AN
- III. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE : UN GAIN
POTENTIEL DE PLUSIEURS MILLIARDS D'EUROS, ESSENTIELLEMENT SUR LES
DÉPENSES ?
- A. LA FRAUDE AUX PRESTATIONS : PLUSIEURS
MILLIARDS D'EUROS DE GAIN POTENTIEL ?
- 1. Une fraude aux prestations sociales entre 6 et
10 milliards d'euros ?
- 2. Sur les dépenses, une fraude
détectée d'environ 1,5 milliard d'euros, dont une fraude
évitée de seulement quelques centaines de millions d'euros
- 3. La possibilité de réduire la
fraude aux prestations de plusieurs milliards d'euros ?
- 1. Une fraude aux prestations sociales entre 6 et
10 milliards d'euros ?
- B. LA FRAUDE AUX COTISATIONS : UN POTENTIEL
DE GAIN PLUS LIMITÉ ?
- 1. Une fraude aux cotisations de plus de
7 milliards d'euros
- 2. Sur les cotisations, une fraude
détectée d'environ 1,5 milliard d'euros, dont seulement
0,1 milliard d'euros est recouvré
- 3. Des marges de progression
limitées par la nature de la fraude ?
- 4. Les propositions de l'Acoss pour mieux lutter
contre la fraude aux cotisations
- 1. Une fraude aux cotisations de plus de
7 milliards d'euros
- A. LA FRAUDE AUX PRESTATIONS : PLUSIEURS
MILLIARDS D'EUROS DE GAIN POTENTIEL ?
- IV. SE DOTER RAPIDEMENT D'UN PLAN CRÉDIBLE
DE RETOUR À L'ÉQUILIBRE ET RÉALISER UN NOUVEAU
TRANSFERT DE DETTE SOCIALE À LA CADES
- A. UNE ACCUMULATION DE LA DETTE SOCIALE À
L'ACOSS QUI MET DÉJÀ EN PÉRIL LE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
- 1. Un besoin de financement maximal qui devrait
approcher fin 2025 son plafond de 65 milliards d'euros
- 2. Un endettement seulement à court
terme
- 3. Selon l'Acoss, si le déficit de la
sécurité sociale suivait la trajectoire prévue par la
LFSS 2025, elle pourrait ne pas parvenir à assurer son financement
dès 2027
- 1. Un besoin de financement maximal qui devrait
approcher fin 2025 son plafond de 65 milliards d'euros
- B. COMMENT FINANCER LA NOUVELLE DETTE
SOCIALE ?
- 1. La Caisse d'amortissement de la dette sociale
(Cades)
- 2. La « banalisation » de la
nouvelle dette sociale est jugée non souhaitable par la Cades et
l'Agence France Trésor
- 3. Réaliser un nouveau transfert de dette
à la Cades ?
- a) Autoriser rapidement de nouveaux transferts de
dette à la Cades (ce qui implique une disposition
organique) ?
- b) Adopter rapidement une trajectoire
crédible de retour à l'équilibre ?
- c) Sans retour à l'équilibre
en 2035, un nouveau transfert de dette sociale à la Cades
pourrait perdre son intérêt
- a) Autoriser rapidement de nouveaux transferts de
dette à la Cades (ce qui implique une disposition
organique) ?
- 1. La Caisse d'amortissement de la dette sociale
(Cades)
- A. UNE ACCUMULATION DE LA DETTE SOCIALE À
L'ACOSS QUI MET DÉJÀ EN PÉRIL LE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
- V. RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
- A. LE « COMITÉ D'ALERTE DU
BUDGET 2025 » : UNE INITIATIVE BIENVENUE MAIS DONT IL NE FAUT
PAS SURESTIMER LA PORTÉE PRATIQUE
- B. BRANCHE MALADIE : RENFORCER LA GOUVERNANCE
DE L'ONDAM
- 1. Des prévisions d'Ondam
systématiquement sous-estimées depuis 2020
- 2. Un dispositif de pilotage infra-annuel
insuffisant
- a) Un deuxième avis du comité
d'alerte trop tardif
- b) La mise en réserve prudentielle sur
l'Ondam, qui repose essentiellement sur l'hôpital et les ESMS, contribue
à aggraver leur déficit
- (1) Une mise en réserve portée
à 0,4 % en 2025
- (2) Un effort qui exclut les soins de ville et
porte presque exclusivement sur l'hôpital
- (3) Des gels qui contribuent à
l'aggravation du déficit hospitalier
- a) Un deuxième avis du comité
d'alerte trop tardif
- 3. Renforcer le pilotage des dépenses de
santé
- a) Mettre fin au biais optimiste dans la
prévision de l'Ondam, en incluant une marge de précaution, en
évitant les mesures trop coûteuses, voire en la confiant
à un organisme indépendant ?
- b) Veiller à ce que le comité
d'alerte rende son deuxième avis « au plus tard
le 1er juin », et si possible mi-mai, afin notamment de
permettre une bonne articulation avec l'examen du Placss ?
- c) Se doter de nouveaux instruments de
régulation ?
- (1) Étendre la mise en réserve aux
soins de ville ?
- (2) Développer des mécanismes
d'ajustement prix-volume ?
- a) Mettre fin au biais optimiste dans la
prévision de l'Ondam, en incluant une marge de précaution, en
évitant les mesures trop coûteuses, voire en la confiant
à un organisme indépendant ?
- 1. Des prévisions d'Ondam
systématiquement sous-estimées depuis 2020
- C. RENFORCER LE DISPOSITIF DE PROJECTION,
D'ÉVALUATION ET DE RÉFLEXION À LONG TERME SUR LES
DIFFÉRENTES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- A. LE « COMITÉ D'ALERTE DU
BUDGET 2025 » : UNE INITIATIVE BIENVENUE MAIS DONT IL NE FAUT
PAS SURESTIMER LA PORTÉE PRATIQUE
- I. QUELLE ÉCHÉANCE POUR LE RETOUR DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE
À L'ÉQUILIBRE ?
- TROISIÈME PARTIE
PRÉSERVER À LONG TERME L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- I. L'ASSURANCE MALADIE : LE PRINCIPAL
DÉFI DES PROCHAINES DÉCENNIES
- A. UNE CROISSANCE SPONTANÉE DES
DÉPENSES DE SANTÉ NETTEMENT SUPÉRIEURE À CELLE DU
PIB
- B. POURSUIVRE LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES
DÉPENSES DE SANTÉ « PAR LES PRIX » DES
ANNÉES 2010 ?
- C. RENDRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE
SANTÉ PLUS « QUALITATIVE » ?
- 1. Comme pour la fraude sociale, chiffrer les
inefficiences dans le domaine de la santé pour favoriser leur
réduction
- 2. Privilégier la réduction des
volumes d'actes évitables, peu efficaces, voire
dangereux ?
- 3. Instituer un observatoire de planification des
besoins de soins et de l'offre correspondante ?
- 1. Comme pour la fraude sociale, chiffrer les
inefficiences dans le domaine de la santé pour favoriser leur
réduction
- D. QUELLES RELATIONS ENTRE LA BRANCHE MALADIE ET
LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ?
- 1. Faut-il
« décroiser » l'assurance maladie obligatoire et
les complémentaires santé ?
- 2. Faut-il transférer des charges aux
complémentaires santé pour stabiliser sur le long terme la part
de la sécurité sociale dans les dépenses de
santé ?
- a) Du fait du développement des maladies
chroniques, la sécurité sociale supporte une part croissante des
dépenses de santé
- b) Selon la DSS et la Cnam, cela justifie des
transferts de charges vers les complémentaires santé
- c) Selon le rapport des trois Hauts Conseils, un
objectif de stabilité à long terme de la part relative de la
sécurité sociale et des complémentaires santé
pourrait avoir d'importants inconvénients
- a) Du fait du développement des maladies
chroniques, la sécurité sociale supporte une part croissante des
dépenses de santé
- 3. Réaliser des transferts d'ensembles
cohérents, accompagnés de mesures de maîtrise de la
dépense ?
- 1. Faut-il
« décroiser » l'assurance maladie obligatoire et
les complémentaires santé ?
- E. QUELLES PERSPECTIVES APRÈS
2040 ?
- 1. Une régulation agissant majoritairement
sur les volumes n'est peut-être pas soutenable à l'horizon de
plusieurs décennies
- 2. Si dans la seconde moitié du
XXIe siècle les évolutions technologiques augmentent la
croissance spontanée des dépenses, un risque de
désocialisation croissante de celles-ci ?
- 1. Une régulation agissant majoritairement
sur les volumes n'est peut-être pas soutenable à l'horizon de
plusieurs décennies
- A. UNE CROISSANCE SPONTANÉE DES
DÉPENSES DE SANTÉ NETTEMENT SUPÉRIEURE À CELLE DU
PIB
- II. RETRAITES ET AUTONOMIE : DES CHOIX
POLITIQUES
- A. DANS LE CAS DE LA BRANCHE VIEILLESSE :
ARBITRER ENTRE ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE, NIVEAU DES
PENSIONS ET AUGMENTATION DES RECETTES
- 1. Sans nouvelles mesures, un déficit de
0,7 point de PIB en 2040 et 1,6 point de PIB en 2070
- 2. Synthèse des principales mesures
envisageables dans le cadre du système par répartition
actuel
- 3. Faut-il développer le financement de la
retraite au moyen d'actifs fléchés ?
- a) Avantages et limites du recours à des
actifs fléchés pour financer la retraite
- (1) Des limites évidentes
- (2) Un intérêt particulier dans un
contexte de finances publiques contraintes
- b) Le financement de la retraite au moyen
d'actifs fléchés en France et en Europe
- c) Mettre en place une part de capitalisation
obligatoire pour le secteur privé ?
- d) Réabonder le Fonds de réserve
des retraites ?
- (1) Le dévoiement du FRR
- (2) Abonder le FRR pour lui permettre de mieux
financer les retraites ?
- a) Avantages et limites du recours à des
actifs fléchés pour financer la retraite
- 1. Sans nouvelles mesures, un déficit de
0,7 point de PIB en 2040 et 1,6 point de PIB en 2070
- B. DANS LE CAS DE LA BRANCHE AUTONOMIE :
DÉTERMINER LE PROFIL SOUHAITÉ D'ÉVOLUTION DES
DÉPENSES ET AJUSTER LES RECETTES EN CONSÉQUENCE
- 1. Un déficit en 2070 de
0,6 point de PIB en 2070 à politiques inchangées
mais davantage si la France aligne le niveau des prestations et la
probabilité d'être pris en charge sur la moyenne de l'Union
européenne
- 2. Réduire la part des dépenses
d'APA et de PCH financée par les départements ?
- 3. Comment financer l'autonomie ?
- 1. Un déficit en 2070 de
0,6 point de PIB en 2070 à politiques inchangées
mais davantage si la France aligne le niveau des prestations et la
probabilité d'être pris en charge sur la moyenne de l'Union
européenne
- A. DANS LE CAS DE LA BRANCHE VIEILLESSE :
ARBITRER ENTRE ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE, NIVEAU DES
PENSIONS ET AUGMENTATION DES RECETTES
- III. L'ACTION SUR LES RECETTES
- A. FAUT-IL AUGMENTER LA QUANTITÉ DE
TRAVAIL ?
- 1. Pourquoi le PIB par habitant est-il plus
faible en France que dans de nombreux pays ?
- 2. Porter le taux d'emploi au niveau
constaté chez nos principaux partenaires ?
- 3. Améliorer le mode de garde des enfants,
pour majorer les recettes d'un milliard d'euros ?
- 4. Augmenter la durée annuelle du travail
des personnes ayant un emploi ?
- a) Une augmentation du nombre d'heures
travaillées d'une ou deux journées, sans
rémunération supplémentaire mais avec une mesure sur les
recettes augmentant les prélèvements sur
l'employeur ?
- (1) La « journée de
solidarité » actuelle
- (2) Le projet de « contribution de
solidarité par le travail » défendu par la
majorité sénatoriale lors de l'examen du PLFSS
pour 2025
- b) Une augmentation du nombre d'heures
travaillées rémunérées et sans mesure sur les
recettes ?
- (1) Instaurer une ou plusieurs journées de
travail supplémentaires ?
- (2) Augmenter la durée de travail
hebdomadaire ?
- a) Une augmentation du nombre d'heures
travaillées d'une ou deux journées, sans
rémunération supplémentaire mais avec une mesure sur les
recettes augmentant les prélèvements sur
l'employeur ?
- 5. Augmenter la quantité de travail par la
transition énergétique ?
- 6. Améliorer la qualité de l'emploi
et les conditions de travail ?
- 1. Pourquoi le PIB par habitant est-il plus
faible en France que dans de nombreux pays ?
- B. FAUT-IL REMPLACER UNE PARTIE DES COTISATIONS
PATRONALES PAR DE LA TVA ?
- C. FAUT-IL AUGMENTER LES RECETTES POUR RESTER
À L'ÉQUILIBRE ?
- A. FAUT-IL AUGMENTER LA QUANTITÉ DE
TRAVAIL ?
- IV. MIEUX DISTINGUER PRESTATIONS CONTRIBUTIVES
(FINANCÉES PAR LES COTISATIONS) ET PRESTATIONS UNIVERSELLES
(FINANCÉS PAR L'IMPÔT) ?
- A. LE MONTANT DES PRESTATIONS CONTRIBUTIVES
CORRESPOND À PEU PRÈS AU MONTANT DES COTISATIONS
SOCIALES : UNE OCCASION HISTORIQUE ?
- B. PLUSIEURS SCÉNARIOS SONT
ENVISAGEABLES
- 1. Un scénario envisageable à court
terme : répartir différemment cotisations et impositions de
toutes natures pour que les premières financent davantage la branche
vieillesse
- 2. Une possibilité à plus long
terme : remplacer la distinction cotisations patronales/cotisations
salarié par une distinction prélèvement fiscal
progressif/prélèvement contributif
- 1. Un scénario envisageable à court
terme : répartir différemment cotisations et impositions de
toutes natures pour que les premières financent davantage la branche
vieillesse
- A. LE MONTANT DES PRESTATIONS CONTRIBUTIVES
CORRESPOND À PEU PRÈS AU MONTANT DES COTISATIONS
SOCIALES : UNE OCCASION HISTORIQUE ?
- I. L'ASSURANCE MALADIE : LE PRINCIPAL
DÉFI DES PROCHAINES DÉCENNIES
- EXAMEN PAR LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE
CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- ANNEXES
- I. PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
- II. CHIFFRAGE DES PRINCIPALES NICHES
SOCIALES
- III. PRINCIPALES PROJECTIONS DE FINANCES SOCIALES
SANS NOUVELLES MESURES
- A. RETRAITES
- B. DÉPENSES DE SANTÉ
- 1. Les travaux de projection de la Commission
européenne (2024)
- 2. Les travaux de projection de l'OCDE
(2024)
- a) Une croissance spontanée des
dépenses de santé en volume d'ici 2040 de 2,2 % dans le
cas de la France (et 2,6 % dans le cas de l'OCDE)
- b) Une croissance des dépenses nettement
supérieure à celle projetée par la Commission
européenne d'ici 2040 (2,2 %, contre environ
1,1 %)
- c) Selon l'OCDE, les économies
envisageables pour l'OCDE seraient de 1,2 point de PIB
en 2040 (mais seulement 0,4 point de PIB sans mesures
« transformatrices »)
- d) L'OCDE considère que les
dépenses de santé des pays de l'OCDE devraient encore plus
augmenter d'ici 2040, du fait de la nécessité d'augmenter la
« résilience »
- a) Une croissance spontanée des
dépenses de santé en volume d'ici 2040 de 2,2 % dans le
cas de la France (et 2,6 % dans le cas de l'OCDE)
- 1. Les travaux de projection de la Commission
européenne (2024)
- C. DÉPENSES D'AUTONOMIE
- 1. Selon les projections de la Drees de 2017,
à droit constant de 2014 à 2060 les dépenses
publiques en faveur de l'autonomie augmenteraient d'un point de PIB (environ
30 milliards d'euros sur la base du PIB actuel)
- 2. Les projections de 2024 de la Commission
européenne supposent une augmentation spontanée
légèrement inférieure à celle de la Drees, mais
soulignent un risque de forte augmentation des dépenses si le
système était rendu plus favorable
- a) Selon les projections de la Commission
européenne (2024), à droit constant de
2022 à 2070 les dépenses publiques en faveur de
l'autonomie augmenteraient de 0,7 point de PIB (environ 20 milliards
d'euros sur la base du PIB actuel)
- b) Un risque de forte augmentation des
dépenses si le système était rendu plus favorable
- a) Selon les projections de la Commission
européenne (2024), à droit constant de
2022 à 2070 les dépenses publiques en faveur de
l'autonomie augmenteraient de 0,7 point de PIB (environ 20 milliards
d'euros sur la base du PIB actuel)
- 1. Selon les projections de la Drees de 2017,
à droit constant de 2014 à 2060 les dépenses
publiques en faveur de l'autonomie augmenteraient d'un point de PIB (environ
30 milliards d'euros sur la base du PIB actuel)
- A. RETRAITES
- IV. CHIFFRAGE DES PRINCIPALES MESURES
ÉVOQUÉES DANS LE DÉBAT PUBLIC POUR RÉDUIRE LE
DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- V. FORMULATION DÉTAILLÉE DES
PROPOSITIONS FAITES PAR LA CNAM DANS SON RAPPORT « CHARGES ET
PRODUITS » DE JUILLET 2025
- A. « DÉVELOPPER LA
PRÉVENTION SECONDAIRE ET TERTIAIRE POUR RÉDUIRE LA
PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES ET LEURS COMPLICATIONS »
(0,5 MILLIARD D'EUROS)
- B. « ORGANISATION DES PARCOURS ET DU
LIEN VILLE-HÔPITAL : MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES PATHOLOGIES
CHRONIQUES » (2 MILLIARDS D'EUROS)
- C. « ARRÊTS DE TRAVAIL :
AJUSTER LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES INDEMNITÉS
JOURNALIÈRES » (2 MILLIARDS D'EUROS)
- D. « PRODUITS DE SANTÉ :
ASSURER UNE RÉGULATION COMPATIBLE AVEC LA SOUTENABILITÉ DE NOTRE
SYSTÈME DE SANTÉ » (6 MILLIARDS D'EUROS)
- E. « RÉGULATION
SECTORIELLE : PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES DE RENTE ET
D'OPTIMISATION FINANCIÈRE (2 MILLIARDS D'EUROS)
- F. « EFFICIENCE ET PERTINENCE :
DÉPLOYER À LARGE ÉCHELLE UNE POLITIQUE DE
SÉCURISATION DES PRESCRIPTIONS ET DE RESPONSABILISATION DE L'ENSEMBLE
DES ACTEURS DU SYSTÈME » (4 MILLIARDS D'EUROS)
- G. « LUTTE CONTRE LES
FRAUDES » (3 MILLIARDS D'EUROS)
- H. TRANSFERTS DE CHARGES AUX
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ (3 MILLIARDS D'EUROS)
- A. « DÉVELOPPER LA
PRÉVENTION SECONDAIRE ET TERTIAIRE POUR RÉDUIRE LA
PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES ET LEURS COMPLICATIONS »
(0,5 MILLIARD D'EUROS)
- I. PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
N° 901
SÉNAT
2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 septembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission d'évaluation et de
contrôle de la sécurité sociale (1)
de la commission
des affaires sociales (2) sur les évolutions
envisageables
du
financement de la
protection sociale,
Par Mmes Élisabeth DOINEAU, rapporteure
générale,
et Raymonde PONCET MONGE,
Sénatrices
(1) Cette mission d'évaluation est composée de : M. Alain Milon, président ; Mmes Élisabeth Doineau, Annie Le Houerou, vice-présidentes ; Mmes Solanges Nadille, Cathy Apourceau-Poly, Marie-Claude Lermytte, Raymonde Poncet Monge, Véronique Guillotin, secrétaires ; Mmes Chantal Deseyne, Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mme Corinne Imbert, MM. Bernard Jomier, Philippe Mouiller, Mmes Émilienne Poumirol, Marie-Pierre Richer, M. Jean Sol.
(2) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.
L'ESSENTIEL
Ce rapport a pour objet de contribuer à rapprocher les points de vue sur la manière de ramener la sécurité sociale à l'équilibre.
Si rien n'était fait, la sécurité sociale pourrait avoir à elle seule en 2040 un déficit de près de 1,5 point de PIB, et même de plus de 3 points de PIB si on laissait « filer » les dépenses d'assurance maladie. La situation serait encore plus dégradée en 2070.
Dans une logique de « boîte à outils », ce rapport présente les principales mesures envisageables, sans en préconiser ni en écarter aucune, et synthétise en annexe IV les principaux chiffrages disponibles.
|
Principe et champ du rapport Confié à un membre de la majorité et à un membre de l'opposition pour en garantir l'équilibre, ce rapport ne préconise ni ne rejette aucune mesure. Son objectif est de contribuer à cadrer le débat et à favoriser le rapprochement des points de vue par des constats partagés. Il ne comprend pas, comme c'est habituellement le cas, des « propositions », mais des « principaux points d'accord des rapporteures » (relatifs aux objectifs et à la gouvernance). L'annexe IV synthétise les principaux chiffrages disponibles, pour une centaine de mesures. Le rapport se limite au champ de la sécurité sociale et des organismes concourant à son financement : Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) et Fonds de réserve des retraites (FRR). Sont hors du champ du rapport les régimes complémentaires de retraite, l'assurance chômage, les complémentaires santé et la plupart des minima sociaux. |
I. UNE SITUATION FINANCIÈRE NON SOUTENABLE
A. LES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE LES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE ?
• La France est le pays de l'OCDE dont les dépenses publiques de protection sociale, exprimées en points de PIB, sont les plus élevées.
• Mais si on raisonne en euros par habitant (en neutralisant les différences de pouvoir d'achat), la France est en sixième position.
• Cela s'explique par le PIB par habitant de la France, dans la médiane des pays de l'OCDE (par exemple, celui de l'Allemagne et des Pays-Bas est plus élevé).
B. DANS LE CAS DES RECETTES, UNE « FAUSSE NORMALITÉ »
Les recettes consistent pour près de la moitié en des prélèvements sur le travail, comme dans la plupart des pays de l'OCDE.
Toutefois les allégements de cotisations patronales sur les bas salaires, dans le cadre de la politique de l'emploi, sont une spécificité française.
C. UN DÉFICIT SANS PRÉCÉDENT HORS PÉRIODE DE CRISE
1. Si rien n'était fait, un déficit qui pourrait atteindre 25 milliards d'euros en 2029
Le déficit de la sécurité sociale a atteint en 2024 un niveau de 15,3 milliards d'euros, sans précédent hors période de crise.
Selon les prévisions à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025, il augmenterait encore d'ici 2029, à politiques inchangées, pour atteindre 24,8 milliards d'euros.
Solde de la sécurité sociale : exécution et prévision
(en milliards d'euros)
Source : D'après les lois de financement de la sécurité sociale et le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025
2. Comment en est-on arrivé là ?
Pourtant, avant la crise sanitaire, la sécurité sociale était quasiment à l'équilibre.
L'écart entre le déficit de 1,7 milliard d'euros de 2019 et le déficit de 15,3 milliards d'euros de 2024 s'explique de la façon suivante.
En 2019, la sécurité sociale avait un déficit structurel (c'est-à-dire un déficit corrigé des fluctuations de la conjoncture) d'environ 10 milliards d'euros. En effet, en 2019 le PIB de la France était supérieur d'environ 2 % à son niveau potentiel (autrement dit, à son niveau corrigé des fluctuations de la conjoncture), ce qui améliorait temporairement le solde de plus de 10 milliards d'euros. Comme actuellement le PIB est légèrement inférieur à son potentiel, entre 2019 et 2024 l'évolution du solde conjoncturel a contribué à l'aggravation du déficit pour près de 13 milliards d'euros.
Le second facteur d'aggravation du déficit entre 2019 et 2024 est que l'effort structurel sur les dépenses a été négatif de près de 20 milliards d'euros. Autrement dit, les dépenses ont augmenté de près de 20 milliards d'euros de plus que celui qui aurait découlé d'une croissance au même taux que le PIB potentiel. Cela s'explique notamment par les mesures en faveur de l'hôpital consécutives à la crise sanitaire : 13 milliards d'euros pour le « Ségur de la santé » (consistant essentiellement en des augmentations salariales) et 8,6 milliards d'euros pour les « mesures inflation » en faveur de l'hôpital. Ces mesures peuvent aussi être interprétées comme le rattrapage partiel de l'effort de réduction du déficit des années 2010.
Décomposition indicative de l'évolution du solde de la sécurité sociale en 2019-2024
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat
En sens inverse, les mesures prises pour augmenter les recettes ont été d'environ 8 milliards d'euros, et les recettes ont spontanément eu tendance à augmenter plus vite que le PIB potentiel sur la période.
3. Retour sur les années 2010
La crise financière de 2009 a considérablement aggravé le déficit de la sécurité sociale. Dans les années 2010, dans un premier temps des mesures ont permis de quasiment résorber le déficit structurel (cf. graphique ci-dessous). Toutefois, alors que la conjoncture était favorable, du fait du faible dynamisme des recettes le déficit structurel s'est remis à augmenter en fin de période, pour atteindre en 2019 le montant de 10 milliards d'euros indiqué ci-avant, ce que masquait l'excédent conjoncturel.
Décomposition du solde de la sécurité sociale
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat
Dans les années 2010, la réduction du déficit structurel a été permise par une action à la fois sur les dépenses et sur les recettes, pour respectivement 50 milliards d'euros et 25 milliards d'euros environ.
L'effort sur les recettes a surtout concerné le début de la période. L'effort sur les dépenses a quant à lui été également réparti sur la totalité de la période (plus de 5 milliards d'euros par an), et concentré en quasi-totalité sur les dépenses d'assurance maladie et, dans une moindre mesure, de retraites.
Mesures sur les recettes et les dépenses
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat
D. DES NICHES SOCIALES NON COMPENSÉES DE 35 MILLIARDS D'EUROS ?
Les allégements de recettes de la sécurité sociale - qu'il est usuel d'appeler « niches sociales » - ont fortement augmenté en 2022 et 2023 (cf. graphique ci-après).
Les niches sociales
(en milliards d'euros)
Source : Annexes relatives aux projets de loi de financement de la sécurité sociale aux niches sociale
Le montant total des niches est de plus de 100 milliards d'euros, dont, selon les estimations de la Mecss, environ 35 milliards d'euros ne sont pas compensés.
La « loi Veil » de 1994 prévoit un principe de compensation des nouvelles niches. Une loi postérieure peut bien entendu y déroger.
Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024, la non-compensation depuis 2019 de l'exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) puis de la prime de partage de la valeur (1,1 milliard d'euros en 2023) n'est pas conforme à la loi.
La compensation des niches sociales à la
sécurité sociale (2024) :
synthèse des
estimations disponibles
(en milliards d'euros)
DFS : déduction forfaitaire spécifique. PPV : exonération de la prime de partage de la valeur.
Source : Mecss, d'après l'annexe 2 au projet de loi d'approbation des comptes 2024, la direction de la sécurité sociale et la Cour des comptes
Pour ce qui concerne les allégements généraux de cotisations patronales, le Ralfss souligne que la compensation du bandeau maladie est inférieure de 5,5 milliards d'euros à son coût. Cela provient de la part de TVA affectée par la loi en 2019 à la sécurité sociale, qui selon la Cour a été mal calculée.
De même, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit la non-compensation de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.
Dans la quasi-totalité des cas, les autres niches sont antérieures à la loi Veil de 1994, et ne sont donc pas compensées. Elles marquent une forte dynamique ces dernières années.
E. POURQUOI RÉDUIRE LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
1. Un déficit dépendant du périmètre retenu et des conventions juridiques de rattachement des recettes
Les débats sur la nécessaire réduction du déficit de la sécurité sociale sont complexifiés par la coexistence de plusieurs périmètres relatifs aux finances sociales.
Le graphique ci-dessous compare le solde de la sécurité sociale avec d'autres périmètres plus larges. Si on ajoute la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), qui est par nature excédentaire de 15 à 20 milliards d'euros chaque année, la sécurité sociale est à l'équilibre en 2024 et ne devient déficitaire qu'en 2025.
Comparaison du solde de la sécurité
sociale
avec celui de divers périmètres plus
larges
(en milliards d'euros)
Source : D'après les LFSS et l'Insee
La situation est analogue si l'on retient le périmètre des administrations de sécurité sociale, qui inclut en plus des organismes comme les régimes complémentaires de retraite ou l'assurance chômage.
Par ailleurs, si les dépenses de la sécurité sociale correspondent à une réalité « physique », une recette de la sécurité sociale résulte d'une convention juridique. Cela peut conduire soit à minorer le déficit de la sécurité sociale, soit, au contraire, à affirmer qu'il serait sous-estimé (comme le montre la polémique récurrente sur un « déficit caché » du système de retraites).
2. La nécessité de ramener la sécurité sociale à l'équilibre
Le retour de la sécurité sociale à l'équilibre est une nécessité. En effet, la sécurité sociale n'a pas vocation à être durablement en déséquilibre, ce qui reviendrait à instaurer une solidarité des générations futures en faveur des générations actuelles. Par ailleurs, son déficit actuel empêcherait la sécurité sociale de jouer son rôle d'amortisseur en cas de nouvelle crise. À cela s'ajoute un risque de crise de liquidité, la dette ne pouvant s'accumuler indéfiniment à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss, également connue sous le nom d'Urssaf Caisse nationale).
Ramener la sécurité sociale à
l'équilibre, un objectif mobilisateur
et protecteur pour la
sécurité sociale
PSMT : plan budgétaire et structurel national à moyen terme
Source : Mecss, d'après le PSMT, le Resf 2025, le rapport à la CCSS de juin 2025
Surtout, le déficit actuel des administrations publiques considérées dans leur ensemble n'est pas soutenable, et la sécurité sociale doit contribuer à l'effort global de réduction du déficit par son retour à l'équilibre.
Il résulte notamment du plan budgétaire et structurel national à moyen terme (PSMT), qui remplace les programmes de stabilité, que les mesures de réduction du déficit de 2026 à 2029 pour l'ensemble des administrations publiques seraient de 170 milliards d'euros.
À titre de comparaison, ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, comme le prévoyait le précédent gouvernement, impliquerait des mesures de 40 milliards d'euros.
Cet effort peut sembler raisonnable.
F. SANS NOUVELLES MESURES, UN DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI POURRAIT ATTEINDRE 3,5 POINTS DE PIB EN 2040 ET 9 POINTS DE PIB EN 2070
Afin d'avoir une vision d'ensemble des perspectives à long terme des finances de la sécurité sociale, la Mecss a élaboré une projection à long terme à droit inchangé des recettes, des dépenses et du solde des différentes branches et de la sécurité sociale dans son ensemble, essentiellement en s'appuyant sur des projections existantes.
Projection à droit inchangé de
recettes, de dépenses
et de solde de la sécurité
sociale
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat
Ces projections permettent de mettre en évidence que si les dépenses de la branche maladie ne sont pas maîtrisées, le déficit de la sécurité sociale pourrait être d'environ 3 points de PIB en 2040 (et 9 points de PIB en 2070).
Hors dépenses de santé, les dépenses de la sécurité sociale augmenteraient spontanément d'environ 0,6 point de PIB d'ici 2070 (essentiellement du fait des branches vieillesse et autonomie).
II. RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE
A. QUELLE ÉCHÉANCE POUR LE RETOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE ?
1. Selon le Gouvernement démissionnaire, un objectif de retour de la sécurité sociale à l'équilibre en 2029
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'objectif de ramener à moyen terme la sécurité sociale à l'équilibre ne figure dans aucun document annexé au PLFSS, ni même dans aucun document public.
Cette situation a provoqué l'étonnement de plusieurs personnes auditionnées par les rapporteures.
La ministre chargée des comptes publics a déclaré, le 19 avril 2025, que l'objectif était de ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2028-2029. Elle l'a confirmé le 28 mai 2025 au Sénat, lors des questions d'actualité au Gouvernement, puis le 23 juin 2025, lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024.
2. Un objectif ambitieux, mais atteignable
Ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029 est un objectif ambitieux, mais atteignable si tous les leviers sont actionnés.
La sécurité sociale devrait vraisemblablement être ramenée à l'équilibre au plus tard en 2035. En effet, à défaut un nouveau transfert de dette sociale à la Cades pourrait impliquer une durée d'amortissement excessivement longue sans augmentation des ressources de celle-ci (cf. infra).
Point d'accord n° 1 : Ramener la sécurité sociale à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
B. DES OPTIONS LIMITÉES ?
Comme indiqué supra, le rapport ne fait aucune préconisation sur les mesures concrètes à prendre pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre.
Toutefois, d'un point de vue purement arithmétique, on peut observer que si l'on souhaite ramener la sécurité sociale à l'équilibre d'ici 2029, il faut 40 milliards d'euros de mesures d'amélioration du solde, soit 10 milliards d'euros de mesures par an en moyenne.
Un premier sujet est de savoir quel taux de croissance retenir pour l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam). Par exemple, si l'on souhaite qu'il augmente de 2,9 % par an, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, au lieu d'une croissance spontanée estimée à 4,5 %, il faut des économies nettes d'environ 4 milliards d'euros par an.
Le solde (soit en ce cas 6 milliards d'euros) doit être obtenu par d'autres actions sur les dépenses et les recettes, ou par des mesures augmentant le PIB, par exemple en augmentant la quantité de travail.
Les modélisations du Trésor comme de l'OFCE suggèrent que, pour réduire le déficit, les augmentations de recettes sont plus efficaces à court terme et les diminutions de dépenses sont plus efficaces à long terme. Selon le Trésor les augmentations de cotisations sociales détruisent tellement d'emplois qu'à long terme elles ne permettent aucune amélioration du solde (alors que selon l'OFCE elles ne se distinguent pas fondamentalement des autres hausses de prélèvements).
Pour mémoire, de 2011 à 2019, les mesures d'économies se sont élevées à plus de 5 milliards d'euros chaque année. Les quatre premières années, s'y sont ajoutées des augmentations de recettes d'environ 6,5 milliards d'euros par an.
Point d'accord n° 2 : Maîtriser la dynamique des dépenses de la branche maladie rapportées au PIB, qui devront augmenter moins rapidement que leur croissance spontanée.
Point d'accord n° 3 : Cet effort ne pouvant suffire à éviter une dégradation du déficit, réaliser l'effort supplémentaire nécessaire en agissant sur les recettes, les dépenses ou le nombre d'heures travaillées dans l'ensemble de l'économie.
C. SE DOTER RAPIDEMENT D'UN PLAN CRÉDIBLE DE RETOUR À L'ÉQUILIBRE ET RÉALISER UN NOUVEAU TRANSFERT DE DETTE SOCIALE À LA CADES
1. L'Acoss en zone de risque
La sécurité sociale n'est pas censée être en déficit. La fonction « normale » de l'Acoss est de financer le besoin de trésorerie de la sécurité sociale venant du fait que les recettes et les dépenses n'ont pas lieu les mêmes jours du mois. Ainsi, la loi n'autorise l'Acoss qu'à s'endetter à court terme.
Mais en l'absence de transfert de dette à la Cades, le déficit de la sécurité sociale doit aussi être financé par l'Acoss.
Les responsables de l'Acoss ont indiqué aux rapporteures que fin 2025, le besoin de trésorerie devrait être proche du plafond de 65 milliards d'euros fixé par la LFSS 2025.
Besoin de trésorerie de l'Acoss en fin d'année
Source : Mecss, d'après les informations transmises par l'Acoss
Les années suivantes, le besoin de trésorerie devrait augmenter chaque année du montant du déficit, ce qui amènerait à dépasser le seuil de 100 milliards d'euros en 2027.
À titre de comparaison, pendant la crise sanitaire, quand l'Acoss n'était pas parvenue à se financer sur les marchés et qu'il avait fallu recourir en urgence à la Caisse des dépôts et consignations et à un pool bancaire pour financer par exemple les retraites, le besoin de trésorerie maximal sur l'année a été de « seulement » 90 milliards d'euros.
Selon l'Acoss, il n'est pas évident que l'on puisse renouveler sur la durée ce qu'on a fait de manière ponctuelle en 2020, avec en plus un déficit croissant et sans perspectives d'amélioration. La situation pourrait devenir rapidement problématique, possiblement en 2027.
L'agence pourrait même entrer en zone de risque dès fin 2025.
2. Réaliser rapidement un nouveau transfert de dette à la Cades, ce qui implique un plan crédible de retour à l'équilibre
Il faut donc réaliser rapidement un nouveau transfert de dette de l'Acoss vers la Cades.
Ce graphique, transmis par la Cades, permet de visualiser chacun des amortissements de dette réalisés par la Cades depuis l'origine.
Plus le temps a passé, plus des sommes importantes ont été transférées à la Cades, et plus la durée d'amortissement a été allongée : 13 ans pour le transfert consécutif à la récession de 2009, comme pour celui consécutif à la crise sanitaire (en supposant une fin d'amortissement en 2033).
Les amortissements de dette par la Cades
Source : Caisse d'amortissement de la dette sociale
La Cades met un certain temps à amortir sa dette, qui dépend notamment du montant de dette transféré et des ressources qu'on lui affecte.
Le graphique ci-dessous montre ce que pourrait être l'encours de dette de la Cades dans deux scénarios sans augmentation des ressources de la caisse. Dans chaque cas, on commence à transférer la dette à la Cades dès 2026 ; cet encours augmente parce qu'on transfère les nouveaux déficits ; puis la Cades commence à l'amortir à partir de 2033, quand elle a fini d'amortir son stock de dette actuel.
Si la sécurité sociale revenait à l'équilibre en 2035, l'encours de dette maximal et la durée d'amortissement deviendraient plus importants que pour les transferts précédents, avec une durée qui pourrait être de 15 ans.
Encours de « nouvelle dette
sociale » détenue par la
Cades
deux scénarios indicatifs sans ressources
supplémentaires
(en milliards d'euros)
Source : Mecss
Un retour plus tardif de la sécurité sociale à l'équilibre pourrait amener à une durée d'amortissement très longue, de par exemple 20 ans. On peut se demander si cela ne viderait pas de son sens le principe même de la Cades.
Point d'accord n° 4 : Adopter rapidement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS 2026, une trajectoire crédible de solde de la sécurité sociale, garantissant un retour à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
Point d'accord n° 5 : Réviser rapidement l'article 4 bis (à valeur organique) de l'ordonnance de 1996 sur la Cades, afin de permettre un nouveau transfert de dette de l'Acoss à la Cades.
Point d'accord n° 6 : Adopter annuellement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS, une programmation (et non une simple prévision à politiques inchangées) à moyen terme de recettes, de dépenses et de solde de la sécurité sociale.
D. RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA BRANCHE MALADIE
L'avis du comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie du 18 juin 2025, qui a indiqué l'existence d'un « risque sérieux » de dépassement de l'Ondam 2025 de 0,5 %, a mis une fois de plus en évidence les insuffisances de la gouvernance de l'Ondam.
Il convient de mettre en place une gouvernance effective de l'Ondam, reposant notamment sur des prévisions non biaisées et un renforcement des outils de régulation infra-annuelle. La proposition de la Cnam de faire examiner par le comité d'alerte la construction de l'Ondam prévisionnel mérite en particulier d'être examinée avec attention.
Point d'accord n° 7 : Mettre en place une gouvernance effective de l'Ondam, reposant notamment sur des prévisions non biaisées et un renforcement des outils de régulation infra-annuelle.
III. PRÉSERVER À LONG TERME L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. L'ASSURANCE MALADIE : LE PRINCIPAL DÉFI DES PROCHAINES DÉCENNIES
1. Des dépenses structurellement dynamiques
Les dépenses de la branche maladie sont les plus difficiles à projeter.
La croissance spontanée des dépenses de santé résulte de divers phénomènes :
- quand le PIB augmente d'un point, les dépenses de santé tendent à augmenter d'environ ¾ de point ;
- trois autres phénomènes majorent globalement ce taux d'environ 1,5 point : la tendance des salaires du secteur de la santé à augmenter plus rapidement que leur productivité (ce que les économistes appellent l'« effet Baumol »), le progrès technique et, actuellement, le vieillissement.
À cela s'ajoute l'inflation.
Croissance spontanée des dépenses de santé selon l'OCDE (2022-2040)
(volume, en %)
NB : L'« effet Baumol » est la tendance des salaires d'un secteur à augmenter plus vite que la productivité de ce secteur.
Source : OCDE (2024)
Les projections de dépenses à l'horizon de plusieurs décennies sont incertaines, en particulier en raison du rôle potentiellement disruptif de l'intelligence artificielle.
Les recettes de la branche maladie tendent spontanément à diminuer en points de PIB, du fait du faible dynamisme de certaines recettes (comme les droits sur les produits du tabac).
2. Des mesures de maîtrise des dépenses qui ont jusqu'à présent essentiellement porté sur les prix
Les données prévisionnelles figurant dans les annexes aux PLFSS suggèrent que jusqu'à présent, les mesures de maîtrise de la dépense (insuffisamment évaluées en exécution) ont été en moyenne de près de 4 milliards d'euros par an, dont 2,5 milliards d'euros de mesures portant sur les prix.
Mesures prévisionnelles de maîtrise
de l'Ondam indiquées
par les documents annexés aux PLFSS
(2015-2021)
NB : Ce tableau ne comprend pas la maîtrise de la masse salariale des établissements de santé.
Source : Mecss, d'après le HCFiPS (2021)
Il n'est pas évident que la régulation puisse porter majoritairement sur les prix pendant plusieurs décennies. En fait, pour agir efficacement sur la dépense, il faut vraisemblablement davantage agir sur les volumes, en ciblant les inefficiences.
3. Chiffrer les inefficiences des dépenses de santé pour mieux les réduire
Il n'existe pas, dans le cas de la France, de chiffrage des inefficiences des dépenses de santé (ce qu'on peut appeler, au sens large, les « gaspillages »).
Les rapporteures se sont efforcées d'ébaucher un tel chiffrage, en s'appuyant sur les données disponibles (très lacunaires) et parfois de simples hypothèses.
Le graphique ci-après suggère que les inefficiences correspondraient à environ un quart des dépenses de santé, ce qui est conforme avec les estimations usuelles obtenues pour d'autres pays (habituellement entre 20 % et 30 %).
L'OCDE préconise à ses États membres de ramener la part des dépenses de santé inefficientes, estimée de manière conventionnelle à 20 %, à 10 %.
Les inefficiences dans le domaine de la santé : ébauche de chiffrage
(% des dépenses de santé)
Source : États-Unis, Speer et al. (2020) ; France : Mecss
Les rapporteures préconisent de réaliser un chiffrage approfondi des inefficiences, et de promouvoir la réflexion publique sur les enjeux de long terme et les préoccupations d'efficience.
Point d'accord n° 8 : Publier et médiatiser, au moins tous les cinq ans, un rapport établi par une ou plusieurs entités indépendantes (comme le COR et les trois Hauts Conseils) comprenant :
- des projections de long terme (cinquante ans) pour les recettes, les dépenses et le solde de chaque branche de la sécurité sociale et de la sécurité sociale considérée dans son ensemble ;
- une estimation financière détaillée des inefficiences du système de santé ;
- des pistes pour le retour ou le maintien à l'équilibre.
Point d'accord n° 9 : Dans le domaine de la santé, rendre disponibles aux chercheurs, après anonymisation, avec une « granularité » descendant au niveau des établissements de santé et des professionnels de santé, les principaux indicateurs relatifs à la surconsommation, à l'efficience clinique, à l'efficience administrative, aux prix, à la prévention et à la fraude.
B. RETRAITES ET AUTONOMIE : DES CHOIX POLITIQUES
1. Les retraites
Selon le scénario de référence du Conseil d'orientation des retraites (COR) de juin 2025, le déficit de l'ensemble du système de retraites serait de 1,4 point de PIB en 2070.
Si on convertit cette projection du COR au périmètre de la branche vieillesse (qui ne comprend pas les régimes complémentaires), on parvient à un déficit de 1,6 point de PIB en 2070.
Les dépenses sont stables en points de PIB, l'augmentation du déficit provenant de la baisse des recettes.
Le rapport, sans prendre position, rappelle les principales mesures envisageables pour ramener la branche vieillesse à l'équilibre.
Projections pour la branche vieillesse (politiques inchangées)
(en points de PIB)
Source : Mecss, d'après le Conseil d'orientation des retraites
2. La branche autonomie
Dans le cas de la branche autonomie, il n'existe pas de projection à long terme. La Mecss s'est appuyée pour sa projection sur les projections de dépense de la Commission européenne (2024), relatives à l'ensemble des dépenses publiques en faveur de l'autonomie.
Les dépenses de la branche autonomie devraient accélérer à partir de 2030, avec un déficit qui, à politiques inchangées, pourrait atteindre 0,6 point de PIB en 2070.
Les projections de la Commission européenne suggèrent toutefois un fort aléa à la hausse, si la France souhaitait avoir des dépenses en faveur de l'autonomie plus généreuses.
Projections pour la branche autonomie (politiques inchangées)
(en points de PIB)
Source : Mecss, d'après la Commission européenne
Le rapport rappelle les principales propositions qui ont pu être évoquées pour financer les dépenses en faveur de l'autonomie, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les particuliers.
Point d'accord n° 10 : Dans le cas de l'autonomie, fixer des objectifs explicites de probabilité de prise en charge et de niveau de prise en charge, et se doter du financement permettant de les atteindre.
C. FAUT-IL AUGMENTER LA QUANTITÉ DE TRAVAIL ?
Comme indiqué supra, du fait d'un PIB par habitant proche de la médiane de l'OCDE, si les dépenses publiques de protection sociale de la France sont les plus élevées de l'OCDE en point de PIB, elles ne sont qu'en sixième position si l'on raisonne en euros par habitant.
Le PIB par habitant peut être accru par une augmentation du nombre d'emplois ou une augmentation du nombre d'heures travaillées par les personnes ayant un emploi. Le rapport rappelle les principales mesures envisageables.
Nombre d'heures annuelles travaillées par habitant (1968-2024)
Nombre d'heures annuelles travaillées par personne en emploi (marge intensive)
Source : Bozio et al. (2025)
Réunie le mardi 23 septembre 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les « points d'accord des rapporteures » présentés par Élisabeth Doineau et Raymonde Poncet Monge, rapporteures, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.
PRINCIPAUX POINTS D'ACCORD DES RAPPORTEURES1(*)
Retour de la sécurité sociale à l'équilibre
Point d'accord n° 1 : Ramener la sécurité sociale à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
Point d'accord n° 2 : Maîtriser la dynamique des dépenses de la branche maladie rapportées au PIB, qui devront augmenter moins rapidement que leur croissance spontanée.
Point d'accord n° 3 : Cet effort ne pouvant suffire à éviter une dégradation du déficit, réaliser l'effort supplémentaire nécessaire en agissant sur les recettes, les dépenses ou le nombre d'heures travaillées dans l'ensemble de l'économie.
Point d'accord n° 4 : Adopter rapidement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS 2026, une trajectoire crédible de solde de la sécurité sociale, garantissant un retour à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
Point d'accord n° 5 : Réviser rapidement l'article 4 bis (à valeur organique) de l'ordonnance de 1996 sur la Cades, afin de permettre un nouveau transfert de dette de l'Acoss à la Cades.
Gouvernance de la sécurité sociale et maintien de la sécurité sociale à l'équilibre
Point d'accord n° 6 : Adopter annuellement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS, une programmation (et non une simple prévision à politiques inchangées) à moyen terme de recettes, de dépenses et de solde de la sécurité sociale.
Point d'accord n° 7 : Mettre en place une gouvernance effective de l'Ondam, reposant notamment sur des prévisions non biaisées et un renforcement des outils de régulation infra-annuelle.
Point d'accord n° 8 : Publier et médiatiser, au moins tous les cinq ans, un rapport établi par une ou plusieurs entités indépendantes (comme le COR et les trois Hauts Conseils) comprenant :
- des projections de long terme (cinquante ans) pour les recettes, les dépenses et le solde de chaque branche de la sécurité sociale et de la sécurité sociale considérée dans son ensemble ;
- une estimation financière détaillée des inefficiences du système de santé ;
- des pistes pour le retour ou le maintien à l'équilibre.
Point d'accord n° 9 : Dans le domaine de la santé, rendre disponibles aux chercheurs, après anonymisation, avec une « granularité » descendant au niveau des établissements de santé et des professionnels de santé, les principaux indicateurs relatifs à la surconsommation, à l'efficience clinique, à l'efficience administrative, aux prix, à la prévention et à la fraude.
Point d'accord n° 10 : Dans le cas de l'autonomie, fixer des objectifs explicites de probabilité de prise en charge et de niveau de prise en charge, et se doter du financement permettant de les atteindre.
INDEX DES PRINCIPAUX SIGLES ET DES PRINCIPALES NOTIONS ET ABRÉVIATIONS
|
AAH |
Allocation aux adultes handicapés. |
|
Acoss |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (nom d'Urssaf Caisse nationale dans le code de la sécurité sociale). |
|
ALD |
Affection de longue durée. |
|
AMC |
Assurance maladie complémentaire. |
|
AMO |
Assurance maladie obligatoire (expression désignant la branche maladie). |
|
Anses |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
ANSM |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
|
APA |
Selon le contexte : « Allocation personnalisée d'autonomie » ou « activité physique adaptée ». |
|
APU |
Administrations publiques. Agrégat de comptabilité nationale, réunissant les administrations publiques centrales, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. |
|
ARS |
Agence régionale de santé. |
|
ASMR |
Amélioration du service médical rendu. |
|
Asso |
Administrations de sécurité sociale. Cette notion de comptabilité nationale regroupe, notamment, la sécurité sociale, les hôpitaux, la Cades, le FRR, les régimes complémentaires de retraite. |
|
AT-MP |
Accidents du travail-maladies professionnelles. |
|
C3S |
Contribution sociale de solidarité des sociétés. |
|
Cades |
Caisse d'amortissement de la dette sociale. |
|
CAE |
Conseil d'analyse économique. |
|
Caqes |
Contrat d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins. |
|
Casa |
Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. |
|
CCAM |
Classification commune des actes médicaux. |
|
CCSS |
Commission des comptes de la sécurité sociale. |
|
Cecics |
Cellule d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère. |
|
CMP |
Commission mixte paritaire. |
|
Cnaf |
Caisse nationale d'allocations familiales. |
|
Cnam |
Caisse nationale de l'assurance maladie. |
|
Cnav |
Caisse nationale d'assurance vieillesse. |
|
CNSA |
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (correspondant à la branche autonomie depuis la création de celle-ci en 2021). |
|
Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie |
Organe indépendant, comprenant trois membres et dont les travaux sont organisés par un magistrat de la Cour des comptes, chargé dans ses avis d'alerter sur un « risque sérieux » de dépassement de l'Ondam, correspondant à un seuil actuellement fixé à plus de 0,5 %. |
|
Complémentaire santé |
Organisme privé, ne faisant pas partie des administrations publiques, complétant la prise en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale. |
|
Comptabilité nationale |
Système comptable, harmonisé au niveau européen, utilisé par les instituts statistiques nationaux. Les données de finances publiques utilisées pour l'application du pacte de stabilité relèvent de la comptabilité nationale. |
|
Contribution sociale |
Prélèvement faisant partie des « impositions de toutes natures » (voir cette expression) et finançant la sécurité sociale (CSG, CRDS, CSA...). |
|
COR |
Conseil d'orientation des retraites. |
|
Cotisation sociale |
Prélèvement assis sur les salaires et finançant la sécurité sociale. En application de l'article 34 de la Constitution, son taux est fixé au niveau réglementaire. |
|
CPTS |
Communauté professionnelle et terroriale de santé. |
|
CRDS |
Contribution au remboursement de la dette sociale. |
|
Croissance potentielle |
Croissance du PIB corrigée des effets de la conjoncture. |
|
CSA |
Contribution de solidarité pour l'autonomie. |
|
CSG |
Contribution sociale généralisée. |
|
CSR |
Complémentaire santé responsable. |
|
CSS |
Code de la sécurité sociale. |
|
Déficit conjoncturel |
Part du déficit due à la conjoncture (c'est-à-dire à l'écart de production). |
|
Déficit structurel |
Part du déficit indépendante de la conjoncture (c'est-à-dire de l'écart de production). |
|
DFS |
Déduction forfaitaire spécifique. |
|
DMP |
Dossier médical partagé. |
|
DMTG |
Droits de mutation à titre gratuit (impôt d'État). |
|
Drees |
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des ministères sociaux. |
|
DSS |
Direction de la sécurité sociale. |
|
Écart de production |
Écart entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Également désigné par l'expression anglo-saxonne d'output gap. |
|
Effort structurel |
Évolution du solde structurel, hors évolution provenant des fluctuations spontanées de l'élasticité des recettes au PIB. |
|
Ehpad |
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. |
|
Élasticité d'une variable A par rapport à une variable B |
Rapport entre le taux de croissance de la variable A et celui de la variable B. Exemple : si la variable A augmente de 3 % et la variable B de 1,5 %, l'élasticité de A par rapport à B est de 2. |
|
Erafp |
Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (gérant le Rafp). |
|
Exemption |
Les exemptions « minorent l'assiette sur laquelle sont calculés les prélèvements sociaux » (annexe 2 au Placss relatif à l'exercice 2024). |
|
Exonération |
Les exonérations « minorent les taux de cotisations ou de contributions applicables sur l'assiette des rémunérations ou des revenus perçus, et qui prennent la forme soit d'allègements de cotisations, soit de réduction de taux » (annexe 2 au Placss relatif à l'exercice 2024). |
|
FPE |
Fonction publique d'État. |
|
FRR |
Fonds de réserve des retraites. |
|
FSV |
Fonds de solidarité vieillesse (qui, avec les Robss, constitue la sécurité sociale). |
|
GIR |
Groupe iso-ressources. |
|
HAD |
Hospitalisation à domicile. |
|
HAS |
Haute Autorité de santé. |
|
HCAAM |
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. |
|
HCFEA |
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. |
|
HCFiPS |
Haut Conseil du financement de la protection sociale. |
|
HPV |
Papillomavirus humain (Human Papillomavirus). |
|
HTA |
Hypertension artérielle. |
|
IA |
Intelligence artificielle. |
|
Idel |
Infirmier diplômé d'État libéral. |
|
Ifaq |
Incitation financière à l'amélioration de la qualité. |
|
Igas |
Inspection générale des affaires sociales. |
|
IGF |
Inspection générale des finances. |
|
IJ |
Indemnité journalière. |
|
Impositions de toutes natures |
Prélèvements dont la loi fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement (article 34 de la Constitution). Ils comprennent les impôt et taxes et les contributions sociales, mais pas les cotisations sociales (dont le taux est fixé par voie réglementaire). |
|
IPA |
Infirmier en pratique avancée. |
|
Irdes |
Institut de recherche et documentation en économie de la santé. |
|
LAP |
Logiciel d'aide à la prescription. |
|
LFSS |
Loi de financement de la sécurité sociale. |
|
Liepp |
Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. |
|
Loi de programmation des finances publiques |
Loi prévue par l'article 34 de la Constitution, définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques (non contraignantes). |
|
LPFP |
Loi de programmation des finances publiques. |
|
MCVA |
Maladies cardiovasculaires et pathologies associées. |
|
Md€ |
Milliard d'euros. |
|
MSP |
Maison de santé pluriprofessionnelle. |
|
Niche sociale |
Allégement (par rapport à une norme de référence) d'un prélèvement obligatoire concourant au financement de la sécurité sociale. |
|
OC |
Organisme complémentaire (d'assurance maladie). |
|
OCDE |
Organisation de coopération et de développement économique. |
|
Ondam |
Objectif national de dépenses d'assurance maladie. |
|
Pacte de stabilité (et de croissance) |
Ensemble de règles européennes encadrant la politique de finances publiques des États membres. |
|
Pass |
Plafond annuel de sécurité sociale. |
|
PCH |
Prestation de compensation du handicap. |
|
PDSA |
Permanence des soins ambulatoires. |
|
Pepa |
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. |
|
PHEV |
Prescriptions hospitalières exécutées en ville. |
|
PIB potentiel |
PIB corrigé des effets de la conjoncture économique. |
|
Placss |
Projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. |
|
PLFSS |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
|
PLV |
Prix limite de vente. |
|
PMI |
Protection maternelle et infantile. |
|
PPA |
Parité de pouvoir d'achat. Il s'agit d'un mode de conversion des monnaies non sur la base du taux de change, mais sur la base de leurs pouvoirs d'achat respectifs. |
|
PPC |
Pression positive continue. |
|
PPV |
Prime de partage de la valeur. |
|
Prestation contributive |
Prestation sociale dont le montant dépend des paiements préalablement effectués par le bénéficiaire (comme dans le cas des retraites). |
|
Programme de stabilité |
Document qu'avant la réforme de 2024 chaque État membre devait transmettre annuellement à la Commission européenne en avril, comprenant notamment une programmation de finances publiques à moyen terme. |
|
PSA |
Prostate Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate). |
|
PSMT |
Plan budgétaire et structurel national à moyen terme. Depuis la révision du pacte de stabilité en 2024, les États membres doivent présenter un tel plan tous les quatre ans. Il comprend notamment une programmation de finances publiques à moyen terme, définie en termes d'effort structurel (voir cette expression). Les PSMT et leurs rapports d'avancement annuels se substituent aux programmes de stabilité. |
|
Rafp |
Retraite additionnelle de la fonction publique. |
|
Ralfss |
Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (rapport annuel de la Cour des comptes). |
|
Rapport d'avancement annuel |
Rapport annuel indiquant la mise en oeuvre du PSMT. |
|
Régime général |
Principal régime de sécurité sociale (faisant partie des régimes obligatoires de base). |
|
Régime obligatoire de base |
Régime obligatoire faisant partie de l'une des branches de la sécurité sociale. Les régimes complémentaires de retraite sont obligatoires, mais ne font pas partie des régimes de base. |
|
Retraite par capitalisation |
Système de retraite consistant en l'accumulation par les travailleurs d'un stock de capital, qui permet de financer leurs pensions une fois qu'ils sont à la retraite. |
|
Retraite par répartition |
Système de retraite dans lequel les prestations sont financées par les cotisations des actifs. |
|
Rosp |
Rémunération sur objectifs de santé publique. |
|
SAD |
Service autonomie à domicile. |
|
Saad |
Service d'aide et d'accompagnement à domicile. |
|
Sécurité sociale |
Ensemble d'administrations publiques réunissant les régimes obligatoires de base et le FSV. |
|
Ségur de la santé |
Concertation, animée par Nicole Notat, du Premier ministre, du ministre en charge des solidarités et de la santé et de représentants du système de santé, qui s'est tenue du 25 mai au 10 juillet 2020, et dont le ministre a présenté les conclusions le 21 juillet 2020. Le « Ségur de la santé » a majoré les dépenses de 2024 de 13 milliards d'euros, essentiellement du fait de revalorisations salariales. |
|
SEL |
Sociétés d'exercice libéral. |
|
SMR |
Service médical rendu. |
|
SNP |
Soins non programmés. |
|
Ssiad |
Service de soins infirmiers à domicile. |
|
Système de retraites |
Ensemble des régimes de retraite (régimes obligatoires de base, réunis au sein de la branche vieillesse de la sécurité sociale, et régimes complémentaires, hors sécurité sociale). |
|
TSA |
Taxe de solidarité additionnelle (sur les complémentaires santé). |
|
Uncam |
Union nationale des caisses d'assurance maladie. |
|
Urssaf Caisse nationale |
Nom utilisé depuis 2021 par l'Acoss. |
LA MISSION
D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE (MECSS)
La Mecss du Sénat
Selon l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, « il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois ».
Ainsi, chacune des deux commissions des affaires sociales a créé en son sein une Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss).
Les commissions des affaires sociales disposent de prérogatives importantes en matière de contrôle2(*).
Dans le cas des missions d'évaluation et de contrôle, en cas de non-transmission d'informations, le président de la commission peut demander au juge statuant en référé de faire cesser l'entrave sous astreinte3(*). Par ailleurs, la mission d'évaluation et de contrôle peut adresser aux pouvoirs publics des observations, ceux-ci ayant deux mois pour y répondre4(*).
Conformément à son règlement intérieur, la Mecss du Sénat comprend 16 membres désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, auxquels s'ajoute le président de la commission. Le rapporteur général et les rapporteurs de branche sont membres de droit de la Mecss.
Déroulé des travaux
Lors de sa réunion du 17 décembre 2024, la Mecss du Sénat a adopté son programme de travail pour 2025, comprenant un contrôle sur le financement de la sécurité sociale.
Lors de sa réunion du 5 janvier 2025, la Mecss a nommé Élisabeth Doineau (groupe Union centriste, sénatrice de la Mayenne) rapporteure générale, et Raymonde Poncet Monge (groupe Écologiste - Solidarité et territoires, sénatrice du Rhône) corapporteures de ce contrôle. Cette désignation conjointe d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition sénatoriales avait pour objet de garantir l'objectivité des travaux.
Des questionnaires écrits ont été adressés à l'ensemble des personnes ou entités auditionnées, au nombre d'une quarantaine. Leur liste figure à la fin du présent rapport.
Le rapport a été examiné par la Mecss du Sénat le 1er juillet 2025. Après avoir été actualisé afin d'intégrer les propositions du rapport « charges et produits » de la Cnam5(*) et du rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre6(*). Afin notamment de ne pas empiéter sur la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne présente pas les propositions faites postérieurement à la fin du mois de juillet 2025. Il a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat le 23 septembre 2025.
AVANT-PROPOS
L'automne 2025 correspondra au 80e anniversaire de la sécurité sociale, créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, et élément essentiel du pacte républicain.
La sécurité sociale, élément essentiel du pacte républicain
En 1944, le programme du Conseil national de la résistance (CNR), intitulé Les jours heureux, prévoyait « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État » et « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ».
De même, selon le préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » ; et « tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
Par ailleurs, selon l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays ».
La sécurité sociale en crise
Près d'un siècle après sa création, la sécurité sociale est en crise.
Le vieillissement de la population majore les besoins des branches vieillesse, maladie et autonomie.
La réforme des retraites de 2023, qui prévoit le passage de l'âge d'ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, est contestée par la majorité de l'opinion7(*).
Dans le cas de la santé, l'effort de réduction du déficit de la branche maladie de 2011 à 2019, mais aussi la tendance spontanée des dépenses à croître plus rapidement que le PIB, ont conduit à des mesures de régulation contestées par certains patients et professionnels. Un nombre de médecins par habitant inférieur à la moyenne des pays comparables8(*), joint à la tendance de l'activité économique à se concentrer dans les grandes métropoles, ont renforcé les difficultés d'accès aux soins.
Le déficit de la sécurité sociale oblige, pour limiter sa dégradation, à maîtriser la dynamique des dépenses et des recettes.
Un déficit sans précédent hors période de crise
La sécurité sociale aurait, selon les prévisions du rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, un déficit de 21,9 milliards d'euros en 2025 et 24,8 milliards d'euros en 2029.
Le déficit augmenterait rapidement en 2024 et en 2025, en dehors de toute crise économique ou sanitaire ; puis il s'installerait, poursuivant son augmentation. Ce serait une situation sans précédent par rapport à ce qui, par comparaison, pourrait sembler une relative maîtrise du déficit ces vingt dernières années.
Solde de la sécurité sociale (Robss + FSV) : exécution et prévision
|
(en milliards d'euros) |
(en points de PIB) |
CCSS : Commission des comptes de la sécurité sociale. FSV : Fonds de solidarité vieillesse. LFSS : loi de financement de la sécurité sociale. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS, le Placss 2024, le rapport à la CCSS de juin 2025 et l'Insee
L'objectif du présent rapport : cadrer le débat et proposer une « boîte à outils »
La discussion du PLFSS pour 2025 a montré toute la difficulté à s'entendre sur la manière de ramener la sécurité sociale à l'équilibre9(*).
Aussi, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat a décidé le 17 décembre 2024 de réaliser un contrôle sur le financement de la sécurité sociale, portant à la fois sur les recettes et sur les dépenses, afin de déterminer les principales options envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre et l'y maintenir.
Champ du rapport
Conformément aux compétences de la Mecss, le présent rapport se limite au champ de la sécurité sociale - c'est-à-dire des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) - et des organismes concourant à son financement - Fonds de réserve des retraites (FRR) et Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).
Il ne traite donc pas, en particulier, des régimes complémentaires de retraite, de l'assurance chômage, des complémentaires santé, ou des minima sociaux.
Ce champ restreint correspond à celui des lois de financement de la sécurité sociale.
En particulier, les projections à long terme du présent rapport portent sur le périmètre de la sécurité sociale.
Compte tenu des masses financières en jeu et des perspectives des différentes branches, la quasi-totalité des mesures présentées concernent les branches vieillesse, maladie et autonomie.
Le rapport se place dans une perspective de réduction du déficit de l'ensemble des administrations publiques. Ainsi, il n'examine pas les manières de réduire le déficit de la sécurité sociale en augmentant celui de l'État (nonobstant la compensation insuffisante des exonérations sociales).
De même, il n'aborde la performance sociale que sous l'angle de l'amélioration de l'efficience, dans une perspective de maîtrise des dépenses. Il ne traite pas directement de sujets comme l'amélioration du bien-être, l'augmentation de l'espérance de vie, la redistribution, la lutte contre la pauvreté, la négociation sociale, l'aménagement du territoire.
Afin de garantir l'objectivité des travaux, le 5 février 2025, la Mecss a confié le rapport sur le financement de la sécurité sociale à un membre de la majorité, Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et à un membre de l'opposition, Raymonde Poncet Monge, vice-présidente de la commission.
Le présent rapport a pour objet non de préconiser une liste particulière de mesures pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre, mais, plus modestement, de présenter des éléments de cadrage et d'analyse destinés à favoriser le rapprochement des points de vue, dans une logique de « boîte à outils ».
Aussi, comme le rapport de la Cour des comptes sur le système de retraites de février dernier10(*), le rapport ne préconise ni ne rejette aucune mesure. Toutes les principales mesures évoquées dans le débat public dont les rapporteures ont eu connaissance sont évoquées, dans la mesure du possible assorties d'un chiffrage. Le lecteur pourra ainsi trouver, en annexe IV au présent rapport, une liste d'une centaine de mesures, qu'il ne saurait bien entendu être question de toutes mettre en oeuvre, leur rendement cumulé étant de plus de cent milliards d'euros (dont plus de la moitié pour les recettes).
À la connaissance des rapporteures, c'est la première fois que l'on publie une liste aussi importante de mesures chiffrées, souvent cantonnées aux notes internes aux administrations.
Toutefois ces mesures chiffrées figurant à l'annexe IV ne correspondent pas à la totalité des mesures pouvant être prises. Certaines mesures, non chiffrables, n'en sont pas moins essentielles, qu'elles concernent la gouvernance ou la recherche d'efficience (en particulier dans le domaine de la santé).
Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son statut de « boîte à outils », le présent rapport ne comprend pas, comme c'est habituellement le cas, des « propositions », mais les « points d'accord des rapporteures », concernant exclusivement les objectifs et la gouvernance.
Le retour de la sécurité sociale à l'équilibre ne peut être déterminé simplement en « piochant » chaque année des mesures dans une liste. Il implique la mise en oeuvre d'une stratégie, et donc une vision à long terme.
Aussi, le présent rapport présente des projections à politiques inchangées des dépenses, des recettes et du solde de chacune des branches de la sécurité sociale, à l'horizon 2070 (établies en s'appuyant sur des travaux existants).
Les montants sont exprimés en milliards d'euros courants et en points de PIB.
Des montants exprimés en milliards d'euros courants et en points de PIB
Compte tenu de l'horizon éloigné des projections, le présent rapport ne présente les montants (en particulier les soldes) en milliards d'euros (courants) qu'en début de période.
Les montants à des horizons plus éloignés sont quant à eux présentés en points de produit intérieur brut (PIB).
En effet, les montants en points de PIB sont ce qui importe du point de vue de la soutenabilité des finances publiques. Par ailleurs, deux montants en milliards d'euros correspondant à des années éloignées ne peuvent être comparés qu'en neutralisant l'inflation, ce qui oblige le lecteur à réaliser des calculs fastidieux. Pour mémoire, un point de PIB vaut actuellement environ 30 milliards d'euros11(*).
Dans son rapport12(*) de février 2025 sur les retraites, la Cour des comptes a fait le choix de de présenter les soldes en milliards d'euros de 2024. Toutefois, cette pratique étant minoritaire, cela complique les comparaisons avec les autres estimations disponibles. Par ailleurs, plusieurs personnes auditionnées ont estimé que cette convention pouvait induire le lecteur en erreur.
Les rapporteures se sont efforcées d'auditionner le plus grand nombre possible d'experts et de parties prenantes dans le bref délai qui leur était imparti13(*). Au total, près de 40 personnes ou entités (dont la liste figure à la fin du rapport) ont été entendues, ce qui est comparable au nombre d'auditions réalisées pour le rapport14(*) sur la fiscalité comportementale adopté par la Mecss en 2024. Les rapporteures ont veillé au pluralisme des points de vue exprimés.
Une centaine de sources bibliographiques ont été consultées. Les principales sont indiquées en annexe I.
Cette approche a amené à retenir pour le présent rapport une structuration en trois parties.
La première partie présente la situation actuelle de la sécurité sociale, en particulier sur le plan financier, avec une projection à politiques inchangées des recettes, des dépenses et du solde des différentes branches à l'horizon 2070.
La deuxième partie examine les principales mesures envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre d'ici 2029, sans prendre parti en faveur de telle ou telle option. Elle présente également certaines mesures relatives à la gouvernance pouvant être mises en oeuvre à court ou moyen terme.
Enfin, même si certaines mesures qu'elle envisage pourraient être mises en oeuvre d'ici 2029, la troisième partie adopte une approche à plus long terme. Elle examine les principales pistes envisageables pour maîtriser sur la durée la dynamique des dépenses de santé, équilibrer les retraites ou financer la politique en faveur de l'autonomie. Elle présente en outre des scénarios tendant à modifier plus profondément le financement de la sécurité sociale.
Le rapport a été examiné par la Mission d'évaluation et de contrôle (Mecss) du Sénat le 1er juillet 2025. Conformément à ce qui a été convenu à cette occasion, il a ensuite été actualisé afin d'intégrer les propositions du rapport « charges et produits » de la Cnam15(*) et du rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre16(*).
Afin notamment de ne pas empiéter sur la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne présente pas les propositions faites postérieurement à la fin du mois de juillet 2025.
Il a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat le 23 septembre 2025.
PREMIÈRE
PARTIE
UNE SITUATION FINANCIÈRE NON SOUTENABLE
I. DÉPENSES, RECETTES ET SOLDE
A. EN POINTS DE PIB, LA FRANCE A LES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE LES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE
1. Des dépenses de protection sociale (publiques et privées) de 40 points de PIB, comme dans le cas du Danemark
L'ensemble des dépenses de protection sociale (publiques et privées) correspond en France à environ 40 points de PIB, ce qui en fait, avec le Danemark, le pays de l'OCDE dont les dépenses de protection sociale sont les plus élevées en points de PIB.
En France, plus de 85 % des dépenses de protection sociale sont publiques, ce qui place la France dans la moyenne de l'OCDE. Les États se démarquant sur ce plan sont les Pays-Bas, les États-Unis et la Suisse, dont seulement 60 % environ des dépenses sont publiques.
Dépenses de protection sociale des pays membres de l'OCDE (2019)
(en points de PIB)
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/). L'année 2019 est la dernière permettant la comparaison de tous les pays.
2. Sur le périmètre des seules dépenses publiques, les dépenses les plus élevées de l'OCDE en points de PIB (35 points)
Si l'on se limite aux dépenses publiques, avec 34,8 points de PIB en 2019, les dépenses publiques de protection sociale de la France rapportées au PIB sont les plus élevées de l'OCDE.
Dépenses publiques de protection sociale des pays membres de l'OCDE (2019)
(en points de PIB)
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/). L'année 2019 est la dernière permettant la comparaison de tous les pays.
Certes, les comparaisons internationales doivent être considérés avec une certaine prudence, les données des différents États n'étant pas strictement comparables. Par exemple, selon un rapport17(*) de 2022 du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), la dépense publique de l'Allemagne dans le domaine de la protection sociale serait minorée de près de 3 points de PIB par rapport à celle de la France18(*).
Il n'en demeure pas moins que les dépenses publiques de protection sociale de la France figurent parmi les plus élevées au monde. Cela résulte notamment de choix politiques.
B. EXPRIMÉES EN MONTANT PAR HABITANT, LES DÉPENSES PUBLIQUES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FRANCE SONT LES SIXIÈMES PLUS ÉLEVÉES DE L'OCDE
Le panorama change quelque peu si l'on présente les dépenses non en points de PIB, mais en dépenses par habitant.
Exprimées en « dollars PPA19(*) » (c'est-à-dire correspondant au même pouvoir d'achat dans les différents pays), bien que restant parmi les plus élevées, les dépenses de protection sociale de la France n'ont plus rien d'exceptionnel.
Pour ce qui concerne les dépenses publiques, la France se retrouve en sixième position. Elle est en effet supplantée par le Luxembourg, et dans une moindre mesure par la Norvège, le Danemark, l'Autriche et la Belgique.
Dépenses publiques de protection sociale des pays membres de l'OCDE (2019)
(en dollars PPA par habitant et en points de PIB)
1° Pour tous les membres de l'OCDE
2° Pour les seuls membres de l'OCDE dont
les dépenses
sont supérieures
à 10 000 dollars PPA par habitant
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/). L'année 2019 est la dernière permettant la comparaison de tous les pays.
On peut interpréter ce constat de manière différente, en fonction notamment de sa sensibilité politique :
- on peut considérer qu'il est faux de dire que la France a des dépenses sociales trop généreuses ;
- en sens inverse, on peut considérer que la France « vit au-dessus de ses moyens ».
C. UN DÉCALAGE QUI SE CONSTATE NOTAMMENT DANS LE CAS DE LA SANTÉ
Ce décalage se constate notamment dans le cas de la santé.
1. Des dépenses de santé en quatrième position de l'OCDE en points de PIB (derrière notamment les États-Unis et l'Allemagne)
Dépenses de santé des pays membres de l'OCDE (2023)
(en dollars PPA par habitant et en points de PIB)
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/)
Ainsi, en points de PIB l'effort de la France dans le domaine de la santé est particulièrement important, seuls trois États ayant des dépenses de santé supérieures (Allemagne, Suisse et, surtout, États-Unis).
Dépenses de santé des pays membres de l'OCDE (2023)
(en points de PIB)
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/)
2. Des dépenses de santé en dixième position en montant par habitant
En revanche, la France n'est plus qu'en dixième position sur la base des dépenses de santé par habitant.
Dépenses de santé des pays membres de l'OCDE (2023)
(en milliards de dollars PPA par habitant)
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
Remarque : dans le cas de la France, la ventilation des dépenses n'est pas disponible pour 2023. La répartition a été effectuée en appliquant les mêmes taux qu'en 2022.
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/)
Une analyse analogue peut être faite dans le cas des dépenses de retraite20(*).
D. SI LES DÉPENSES SOCIALES DE LA FRANCE SONT AUSSI ÉLEVÉES EN POINTS DE PIB, C'EST PARCE QUE SON PIB PAR HABITANT EST SEULEMENT DANS LA MÉDIANE DES PAYS DE L'OCDE
Le décalage entre l'approche en points de PIB et l'approche en montant par habitant provient d'un PIB par habitant dans la médiane des membres de l'OCDE.
En Europe, seuls les pays d'Europe du Sud ou orientale ont un PIB par habitant inférieur à celui de la France. Le PIB par habitant du Luxembourg, de l'Irlande21(*), de la Norvège et de la Suisse est plus de deux fois supérieur à celui de la France.
PIB par habitant des pays membres de l'OCDE (2022)
(en dollars PPA)
PPA : parités de pouvoir d'achat. La conversion des différentes monnaies en dollars est ici effectuée non sur la base du taux de change, mais de manière à ce qu'un dollar corresponde au même pouvoir d'achat dans chaque pays.
Source : Mecss du Sénat, d'après données OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/)
Le PIB par habitant de la France dépend de sa quantité de travail par habitant (donc notamment de sa structure démographique), de son stock de capital par habitant et de sa productivité globale du travail et du capital.
Ces facteurs contribuent à expliquer le niveau élevé de son déficit public. Ainsi, si la France avait le même PIB par habitant que l'Allemagne, son PIB serait supérieur de 20 %, ce qui « mathématiquement » conduirait à un excédent de ses finances publiques.
II. DANS LE CAS DES RECETTES, UNE « FAUSSE NORMALITÉ »
A. DES RECETTES CONSISTANT POUR PRÈS DE LA MOITIÉ EN DES PRÉLÈVEMENTS SUR LE TRAVAIL, COMME DANS LA PLUPART DES PAYS DE L'OCDE
Les dépenses de protection sociale demeurent financées en France pour près de la moitié par des prélèvements sur le travail.
Il ne s'agit pas là d'une spécificité, les deux tiers des membres de l'OCDE se trouvant dans une situation analogue.
En particulier, le modèle « bismarckien » de la sécurité sociale française, initialement très majoritairement financée par des cotisations, est de plus en plus remis en cause. En effet, dans un contexte de fort taux de chômage, ont été instaurés les allégements généraux de cotisations patronales, qui coûtent 65 milliards d'euros sur le seul périmètre de la sécurité sociale.
Financement public de la dépense sociale brute dans les pays de l'OCDE (2019)
(en points de PIB)
Source : D'après Herwig Immervoll, « Financing social protection in OECD countries : Role and uses of revenue earmarking », OECD Social, Employment and Migration Working Papers n° 31, 2024
Le graphique ci-avant met en outre en évidence une autre spécificité française, qui est le recours important aux recettes générales « fléchées » (pour les deux tiers la CSG, d'autres impôts « fléchés » étant les taxes sur le tabac et l'alcool).
Par ailleurs, certaines recettes fiscales, s'élevant à environ 2 points de PIB, ont pour objet de compenser à la sécurité sociale les allégements de cotisations patronales.
B. UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE : LES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS PATRONALES SUR LES BAS SALAIRES
Le graphique précédent montre que si la France ne se caractérise pas fondamentalement par la structure des recettes finançant sa protection sociale, elle se distingue en revanche par leur montant en points de PIB, le plus élevé de l'OCDE.
Dans le cadre de sa politique de l'emploi, elle a mis en place les allégements généraux de cotisations patronales sur les bas salaires, qui en 2024 ont coûté 64,9 milliards d'euros sur le périmètre de la sécurité sociale (et environ 80 milliards d'euros sur celui de l'ensemble des administrations de sécurité sociale).
Il en découle pour les bas salaires un coin socio-fiscal acquitté par l'employeur nettement inférieur à celui de nos principaux partenaires.
III. UN DÉFICIT SANS PRÉCÉDENT HORS PÉRIODE DE CRISE
A. UN DÉFICIT DE 15,3 MILLIARDS D'EUROS EN 2024 ET QUI, SELON LE GOUVERNEMENT, APPROCHERAIT 25 MILLIARDS D'EUROS EN 2029
1. Une situation sans précédent hors période de crise
La sécurité sociale aurait, selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025, un déficit de 21,9 milliards d'euros en 2025 et 24,8 milliards d'euros en 2029, à politiques inchangées.
Le déficit augmenterait rapidement en 2024 et en 2025, en dehors de toute crise économique ou sanitaire ; puis il s'installerait, poursuivant son augmentation. Ce serait une situation sans précédent par rapport à ce qui, par comparaison, pourrait sembler une relative maîtrise du déficit ces vingt dernières années.
Solde de la sécurité sociale (Robss + FSV) : exécution et prévision
|
(en milliards d'euros) |
(en points de PIB) |
CCSS : Commission des comptes de la sécurité sociale. FSV : Fonds de solidarité vieillesse. LFSS : loi de financement de la sécurité sociale. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS, le Placss 2024, le rapport à la CCSS de juin 2025 et l'Insee
Aussi, si une nouvelle crise survenait, il ne serait pas évident que la sécurité sociale puisse jouer son rôle d'amortisseur social et de stabilisateur automatique, comme lors de la crise de 2008-2009 ou de la récente crise sanitaire.
2. Un déficit 2024 provenant de causes multiples
En 2019, la sécurité sociale a été quasiment à l'équilibre, avec un déficit de seulement 1,7 milliard d'euros. En 2024, le déficit a été de 15,3 milliards d'euros, en dehors de toute crise économique.
Comme le montre le graphique ci-après, entre 2019 et 2024 les recettes rapportées au PIB ont augmenté de 0,6 point de PIB, alors que les dépenses augmentaient de 1,1 point de PIB. Ainsi, alors que la sécurité sociale était quasiment à l'équilibre en 2019, elle est désormais déficitaire de 0,5 point de PIB.
Recettes, dépenses et solde de la sécurité sociale (Robss + FSV)
(en points de PIB)
Prévision du Gouvernement à compter de 2025.
FSV : Fonds de solidarité vieillesse. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS, le Placss 2024, le rapport à la CCSS de juin 2025 et l'Insee
Il convient de déterminer les causes de cette dégradation des finances sociales.
a) Une augmentation du déficit depuis 2019 venant essentiellement du fait que le PIB était alors nettement au-dessus de son potentiel ?
La Mecss s'est efforcée, à titre indicatif, de décomposer l'évolution du déficit de 2017 à 2025 entre ses différentes composantes, en s'appuyant sur les notions de solde structurel et d'effort structurel22(*), et en isolant l'impact de certaines mesures spécifiques.
Les résultats sont indiqués par le graphique et le tableau ci-après.
Décomposition indicative de
l'évolution du solde de la sécurité
sociale
en 2019-2024 (Robss+FSV)
(en milliards d'euros)
* En 2021, corrigée de la création de la branche autonomie.
** La croissance spontanée des recettes correspond à la croissance des recettes avant mesures nouvelles.
*** Hors prime de partage de la valeur.
Lecture : un montant positif correspond à une amélioration du solde, un montant négatif à une dégradation du solde.
Solde effectif : PLFSS 2019 à 2025, Placss 2024. Soldes conjoncturel et structurel calculés par la commission des affaires sociales d'après les estimations du PIB potentiel de la Commission européenne. Dépenses covid et Ségur, impact de la réforme des retraites : annexe 3 au Placss 2023, rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025. Mesures nouvelles sur les recettes : rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2022, septembre 2023, mai 2024, juin 2024 et juin 2025.
Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale. FSV : Fonds de solidarité vieillesse.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
Le solde structurel et l'effort structurel
Le solde structurel
Le solde public structurel se définit comme ce que serait le solde des administrations publiques (APU) si le PIB était égal à son niveau potentiel, en supposant que les recettes rapportées au PIB tendent spontanément à rester stables (on dit que leur « élasticité » au PIB est égale à 1).
En pratique, le PIB est habituellement au-dessus ou en dessous de son niveau potentiel. Cet écart, dit « écart de production » (ou output gap), a pour effet de modifier le ratio dépenses/PIB. Comme on suppose que les recettes rapportées au PIB tendent spontanément à rester stables, cet écart du ratio dépenses/PIB correspond au solde dit conjoncturel, dépendant des fluctuations de l'activité économique. La différence entre le solde total et le solde conjoncturel est le solde structurel.
Au niveau de l'ensemble des administrations publiques, comme les dépenses sont de près de 60 points de PIB, le solde conjoncturel est égal à l'écart de production multiplié par environ 0,6.
Dans le cas des administrations de sécurité sociale, qui correspondent à environ la moitié des dépenses publiques, le solde conjoncturel est égal à l'écart de production multiplié par environ 0,3 ; le coefficient est d'environ 0,2 pour la sécurité sociale.
L'estimation du solde structurel dépend donc fortement de l'estimation de l'écart de production.
Par exemple, dans le cas de l'année 2024, selon le rapport d'avancement annuel d'avril 2025, le PIB était inférieur de 0,7 point à son niveau potentiel, alors que selon les prévisions économiques de mai 2025 de la Commission européenne, l'écart de production était quasiment nul. Il en résulte, pour 2024, un déficit structurel des administrations publiques estimé à 5,3 points de PIB par le rapport d'avancement annuel et à 5,7 points de PIB par la Commission européenne (pour un déficit effectif de 5,8 points de PIB)23(*).
L'effort structurel
L'effort structurel est une notion introduite par le ministère du budget au sujet du projet de loi de finances pour 2004. Il s'agit de l'évolution du solde structurel, corrigée de l'évolution spontanée du ratio recettes/PIB (découlant des fluctuations spontanées de l'élasticité des recettes au PIB).
Concrètement, il se définit comme la somme (en points de PIB) de la diminution du ratio dépenses/PIB potentiel et des mesures nouvelles sur les recettes.
De 2019 à 2024, le déficit de la sécurité sociale s'est aggravé de 13,6 milliards d'euros (passant de 1,7 milliard d'euros en 2019 à 15,3 milliards d'euros en 2024).
(1) Deux facteurs d'aggravation du déficit entre 2019 et 2024 : le retour du PIB à un niveau proche de son potentiel et une croissance des dépenses supérieure à celle du PIB
(a) Un PIB nettement au-dessus de son niveau potentiel en 2019, améliorant le solde de manière non durable
Il résulte de l'estimation de PIB potentiel de la Commission européenne qu'entre 2019 et 2024, l'évolution du solde conjoncturel aurait contribué à l'aggravation du déficit pour environ 12,7 milliards d'euros.
En effet, si on s'appuie sur cette estimation24(*), en 2019 le PIB de la France était supérieur de 1,9 % à son potentiel, ce qui suscitait des recettes supplémentaires qui amélioraient temporairement le solde d'environ 11,2 milliards d'euros. Le PIB aurait en revanche été inférieur de 0,5 % à son potentiel en 2024, de sorte qu'au total l'évolution de la conjoncture entre 2019 et 2024 aurait contribué à aggraver le déficit d'environ 12,7 milliards d'euros.
Autrement dit, la situation financière de la sécurité sociale en 2019 était déjà loin d'être saine. Sa situation de quasi-équilibre aurait en effet consisté en un déficit structurel de 11,2 milliards d'euros, « masqué » par la conjoncture favorable.
Le déficit structurel aurait quant à lui peu évolué par rapport à 2019 : il aurait été de 12,1 milliards d'euros en 2024. À titre de comparaison, il aurait été d'environ 23,6 milliards d'euros en 2010. La politique de réduction du déficit des années 2010 n'aurait donc permis de résorber qu'environ la moitié du déficit structurel.
(b) Une croissance des dépenses nettement supérieure à celle du PIB potentiel
Le second facteur de dégradation du solde entre 2019 et 2024, qui aurait joué pour environ 19,4 milliards d'euros, est que le taux de croissance des dépenses a été supérieur à celui du PIB potentiel.
Ce montant correspond à peu près au montant cumulé du « Ségur de la santé » et des mesures de compensation de l'inflation, prises en conséquence de la crise sanitaire, mais aussi peut-être parce que la politique des années 2010 n'était pas totalement soutenable.
En particulier, le « Ségur de la santé », consistant essentiellement en des revalorisations salariales, a majoré les dépenses de 2024 de 13,4 milliards d'euros (les mesures discrétionnaires en faveur de l'hôpital atteignant même 21,6 milliards d'euros si l'on ajoute les « mesures inflation »).
Malgré leur montant élevé, le Ségur et les « mesures inflation » ne semblent avoir annulé qu'environ un tiers des économies réalisées depuis 2010, comme le montre le graphique ci-après25(*).
Ondam - comparaison de diverses trajectoires avec le tendanciel
(en milliards d'euros)
Ondam : objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Le tendanciel est assimilé par convention à une croissance de l'Ondam de 4,5 % par an par rapport à son niveau de 2010.
Source : Mecss du Sénat
On peut interpréter le « Ségur de la santé » comme un dérapage des dépenses. On peut également y voir la conséquence inéluctable de la stratégie de réduction du déficit des années 2010, la pression financière mise sur les hôpitaux les contraignant à réaliser des gains d'efficience essentiellement comptables26(*), dégradant leur capacité d'investissement et l'attractivité de leurs métiers. Il convient d'en tirer les enseignements si l'on souhaite éviter que les effets des prochains efforts de maîtrise de la dépense soient remis en cause (cf. infra).
Par ailleurs, le « Ségur de la santé » n'a pas été financé, que ce soit par de moindres dépenses ou des mesures sur les recettes.
Le « Ségur de la santé »
(en milliards d'euros)
Source : PLFSS 2025, annexe 5
(c) Un dynamisme spontané des recettes renforcé par des mesures nouvelles
Dans le cas des recettes, les mesures prises sur la période sont estimées à 8,1 milliards d'euros.
Par ailleurs, les recettes ont spontanément eu tendance sur la période à augmenter plus vite que le PIB potentiel (malgré la forte hausse des niches en 2022-2023).
Les mesures nouvelles sur les recettes depuis 2019
En 2020, en pleine crise sanitaire, les mesures nouvelles sur les recettes ont été de 2,4 milliards d'euros. Ce paradoxe résulte essentiellement de deux phénomènes en sens contraire : alors que les mesures d'urgence ont réduit les recettes de 4 milliards d'euros, le versement de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) les a majorées de 5 milliards d'euros.
En 2021, toujours en pleine crise sanitaire, les mesures nouvelles sur les recettes ont été de 1,1 milliard d'euros27(*). En particulier, alors que le contrecoup de la soulte des IEG correspondait à une mesure nouvelle négative de - 5 milliards d'euros, les mesures d'urgence ont été réduites de 3,8 milliards d'euros (essentiellement du fait de la régularisation des cotisations des travailleurs indépendants).
L'exercice 2022 est le seul où les mesures nouvelles sur les recettes ont été négatives, à - 2,9 milliards d'euros. Il s'agit toutefois d'un effet d'optique, provenant du contrecoup de la régularisation des cotisations des travailleurs indépendants.
L'exercice 2023 a vu le retour à des mesures nouvelles positives, de 2,8 milliards d'euros.
Les mesures nouvelles ont atteint 4,7 milliards d'euros en 2024, essentiellement du fait du basculement de 0,15 point de CSG de la Cades vers la branche autonomie (2,6 milliards d'euros)28(*).
Source : D'après les rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale
b) De 2020 à 2023, un fort dynamisme des niches sociales
L'annexe II au présent rapport récapitule le montant annuel des principales niches sociales depuis 2019.
Les niches sociales ont été très dynamiques depuis la crise sanitaire, en particulier en 2021-2023, comme le montre le graphique ci-après.
Les niches sociales figurant dans les tableaux synthétiques de l'annexe au PLFSS ou au Placss relative aux niches sociales
(périmètre : régimes obligatoires de base et Fonds de solidarité vieillesse)
(en milliards d'euros)
* Coût net (après prise en compte du montant des contributions compensatoires assises sur les assiettes exemptées).
NB : Les annexes aux Placss et PLFSS relatives aux niches sociales ne comprennent de tableaux synthétiques que pour les allégements de cotisations et de contributions (ce qui exclut par exemple les allégements de taxe sur les salaires). Par ailleurs, ces tableaux, contrairement aux fiches des annexes, considèrent que certains allégements (comme les taux réduits de CSG) ne sont pas des niches.
Du fait de l'impossibilité pratique de reconstituer une série homogène sur l'ensemble de ce périmètre, le tableau se limite au champ des tableaux synthétiques des Placss et PLFSS.
Source : Mecss du Sénat, d'après l'annexe 5 au PLFSS 2021, l'annexe 2 au PLFSS 2022, l'annexe 4 au PLFSS 2023, l'annexe 2 aux Placss 2022, 2023 et 2024
Les principales niches sociales sont passées de 13,6 % des recettes en 2019 à 14,8 % des recettes en 2023 et 2024. Si ce taux avait été stable (c'est-à-dire si elles avaient augmenté au même taux que les recettes), elles auraient été inférieures en 2024 d'environ 8 milliards d'euros.
Le montant des niches sociales en proportion des recettes
Le taux de 14,8 % en 2024 indiqué dans le tableau ci-avant n'est pas celui devant être utilisé pour apprécier le respect du plafond d'exonérations et d'exemptions de cotisations de la sécurité sociale de 14 % fixé par l'article 21 de la LPFP 2023-202729(*). En effet, la LPFP 2023-2027 définit un ratio légèrement différent, incluant au dénominateur les exonérations non compensées30(*).
Le Gouvernement indique, dans l'annexe 2 aux Placss 2023 et 2024, que le taux au sens de la LPFP 2023-2027 a été de 14,6 % en 2023 et 14 % en 2024, le plafond de 14 % ayant donc selon lui été respecté en 202431(*). Toutefois, comme la Cour des comptes le souligne dans son rapport sur l'application de loi de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2025, le Gouvernement minore artificiellement ce taux en ne prenant pas en compte les exemptions d'assiette, contrairement à ce que prévoit explicitement la LPFP 2023-2027.
Selon la Cour des comptes, le plafond de 14 % est en réalité dépassé depuis 2022, comme le montre le graphique ci-après.
Évolution du ratio entre les
exonérations et exemptions de cotisations sociales (hors covid) et les
ressources des régimes obligatoires de base de la sécurité
sociale
et du fonds de solidarité vieillesse, selon la Cour des
comptes
(en milliards d'euros)
Note : le ratio est calculé en incluant les exemptions de cotisations sociales concernant le remboursement domicile travail, la prime de partage de la valeur (PPV) et la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Source : Cour des comptes d'après les données des annexes aux PLFSS et de l'Acoss
Il résulte du tableau précédant l'encadré que les allégements dont le taux de croissance a été le plus élevé entre 2019 et 2024 sont les allégements généraux de cotisations patronales (+ 21,9 %) et, surtout, les exemptions d'assiette, c'est-à-dire les « niches sur les compléments de salaire » (+ 88,1 %).
En montant, les allégements généraux correspondant aux trois quarts du montant total des niches, ce sont eux qui ont le plus contribué à l'augmentation des niches (11,7 milliards d'euros, contre 6,8 milliards d'euros pour les exemptions). En effet, les fortes revalorisations du Smic (résultant de la forte inflation) ont fait augmenter les allégements généraux plus rapidement que la masse salariale.
Dans le cas des exemptions d'assiette, il est possible que la forte inflation ait amené les entreprises à accorder des hausses de salaire, en privilégiant les assiettes exemptées32(*), ce qui expliquerait la forte hausse observée depuis 2019. En effet, les assiettes sont plus dynamiques que la masse salariale, comme le montre le tableau ci-après.
Évolution des principales exemptions d'assiette entre 2000 et 2024
(montant des assiettes en milliards d'euros)
(*) Le taux d'évolution annuel moyen est calculé entre 2000 et 2024 quand la donnée est disponible, ou entre 2012 et 2024 pour la santé, la prévoyance complémentaire et la retraite supplémentaire.
Source : Annexe 4 au Placss 2024
Alors qu'avant la crise sanitaire, le taux global de prélèvement de sécurité sociale pour un salarié rémunéré au salaire moyen était de 45 %, il est désormais inférieur à 40 %. Cela provient essentiellement de la transformation en 2019 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de cotisations patronales.
Cas-type d'un salarié rémunéré au salaire moyen
(en %)
Pepa : prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. PPV : prime de partage de la valeur.
* En 2023, les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le Smic bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales (dont la CSG et la CRDS). À partir de 2024, la PPV est imposée au forfait social à 20 % dans les entreprises de plus de 250 salariés. Elle est également assujettie à la CSG/CRDS dans les entreprises de plus de 50 salariés et pour les salariés dont la rémunération exède 3 fois le Smic.
** Pour l'épargne salariale, la direction de la sécurité sociale ne dispose des données que jusqu'en 2022. Elle fait une hypothèse que sa part dans la masse salariale des salariés concernés est stable pour les années 2023 et 2024.
Source : Annexe 4 au Placss 2024
Le fort dynamisme des exemptions d'assiette a été souligné par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application de loi de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024.
Le fort dynamisme des exemptions d'assiette et
autres niches
sur les compléments de salaire, selon la Cour des
comptes
Dans son rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 202433(*), la Cour des comptes souligne le fort dynamisme des exemptions d'assiette.
Le graphique ci-après indique les pertes brutes liées aux exemptions d'assiette, c'est-à-dire les pertes avant prise en compte des contributions compensatoires (contrairement aux chiffres indiqués ailleurs dans le présent rapport). Le dynamisme des exemptions apparaît encore plus important. En effet, la part des pertes brutes compensée par les contributions compensatoires est de plus en plus faible.
Évolution du rendement des taxes
compensatoires assises
sur les compléments de salaire
exemptés
(en milliards d'euros)
Lecture : en 2022, les pertes brutes de recettes pour la sécurité sociale liées aux exemptions de cotisations sociales sont estimées à 24,8 milliards d'euros. Elles sont atténuées par des taxes compensatoires à hauteur de 8,9 milliards d'euros. Les pertes de recettes liées aux exemptions sont ainsi compensées à proportion de 36,1 %.
D'après le PLFSS 2024 (annexe 4) et le « jaune » budgétaire du PLF 2024.
Source : Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
Le graphique ci-après prend en compte le montant (net) des exemptions d'assiette, majoré des exonérations des heures supplémentaires (part salariale) et de deux niches ne figurant pas dans l'annexe (prime de partage de la valeur et remboursements des frais de transport domicile-travail)34(*). Il souligne qu'entre 2018 et 2022, l'augmentation de cet agrégat a été proche de celle du déficit de la sécurité sociale (hors dépenses covid).
L'argument est frappant35(*). Il illustre l'enjeu que représente le dynamisme de ces niches pour l'équilibre des finances sociales.
Évolutions comparées de la perte de
recettes liée aux compléments
de salaire et du déficit
de la sécurité sociale hors covid
(en milliards d'euros)
D'après le PLFSS 2024 et l'extraction de la déclaration sociale nominative par l'Acoss pour la Cour des comptes.
Source : Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
On observe toutefois une relative stabilisation du montant des niches sociales, depuis 2023 pour les exemptions d'assiette (même si depuis leur croissance reste dynamique36(*)) et depuis 2024 pour les allégements généraux. En effet, en l'absence de mesures nouvelles, sur le long terme une niche sociale ne doit normalement pas augmenter plus rapidement que le PIB en valeur.
En 2024, le coût des allégements généraux a même légèrement reculé. Cela vient notamment du gel des bandeaux (- 0,4 milliard d'euros), mais même sans cela leur coût aurait stagné. Cela s'explique par le fait qu'après les fortes revalorisations du Smic, désormais les hausses de salaires concernent des salaires plus élevés37(*). Le Gouvernement semble prévoir une poursuite de ce phénomène en 202538(*).
B. DES NICHES SOCIALES NON COMPENSÉES D'ENVIRON 35 MILLIARDS D'EUROS ?
La question de la compensation des niches sociales à la sécurité sociale ne se pose pas si l'on raisonne au niveau du solde des administrations publiques et de leur solde consolidé. Elle garde toutefois sa pertinence sur le périmètre de la sécurité sociale.
Ainsi, pour comprendre l'origine du déficit de la sécurité sociale, il convient d'analyser si les niches sociales sont correctement compensées.
Contrairement à ce que prévoit l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale39(*), il n'existe pas de suivi exhaustif des compensations de niches sociales, ni même de tableau synthétique retraçant l'ensemble des niches sociales. Les rapporteures se sont donc efforcées de synthétiser les principales données disponibles, conformément au graphique et au tableau ci-après.
Ce graphique et ce tableau, par nature approximatifs, suggèrent que, selon une approche purement comptable40(*), sur plus de 100 milliards d'euros de niches sociales, seulement 65 milliards d'euros environ seraient compensés.
Ces sous-compensations résultent en quasi-totalité de l'application de la loi. On peut toutefois mentionner l'exemption de la prime de partage de la valeur, qui selon le Gouvernement ne coûte rien, mais dont la Cour des comptes évalue le coût à environ un milliard d'euros par an. Sauf décision de prorogation par le législateur, cette exemption s'éteindra le 1er janvier 2027 pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
La compensation des niches sociales à la
sécurité sociale (2024)
Graphique
synthétique
(en milliards d'euros)
DFS : déduction forfaitaire spécifique. ND : non disponible. PPV : exemption de la prime de partage de la valeur.
Remarque : la Cour des comptes indique ne pas être en mesure de chiffrer le coût du dispositif PPV en 2024. Elle l'évalue toutefois à 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023.
* Source : Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025. Le caractère incomplet de la compensation résulte de l'application de la loi.
** La non-compensation peut aussi résulter d'une disposition spécifique (exemple : LFSS 2020 pour le taux intermédiaire de CSG à 6,6 %). L'annexe 2 au Placss 2024 indique que certaines exemptions d'assiette sont compensées.
Source : Mecss du Sénat, d'après le tableau page suivante
La compensation des niches sociales à la
sécurité sociale (2024)
Tableau
détaillé
(en milliards d'euros)
|
Niche |
Compensation |
Commentaire |
|
|
Cotisations et contributions - tableaux récapitulatifs de l'annexe 2 au Placss |
89,0 |
66,2 |
|
|
Allégements généraux de cotisations patronales |
64,9 |
59,4 |
Compensation essentiellement par des transferts de TVA, pour « solde de tout compte ». Selon la Cour des comptes (Ralfss 2005), la création du bandeau maladie serait sous-compensée de 5,5 Md€ en 2024. |
|
Exonérations dites « ciblées compensées » |
6,8 |
6,8 |
Compensation intégrale, à l'euro, par crédits budgétaires (art. L. 131-7 CSS ou compensation prévue par la loi) |
|
Exonérations dites « non compensées » |
2,7 |
02 |
Pas de compensation pour les niches créées avant 1994 ou 2004 si pas de compensation prévue par la loi ; et pour les dérogations législatives à l'art. L. 131-7 |
|
Dont exonération sur les heures supplémentaires - part salariale |
2,3 |
03 |
Non-compensation résultant de l'art. 7 de la LFSS pour 2019 |
|
Exemptions d'assiette4 |
14,6 |
Faible |
Habituellement pas de compensation par le budget de l'État (niches généralement antérieures à 2004)5 |
|
Principales niches sociales apparaissant seulement dans des fiches de l'annexe 2 au Placss |
11,3 |
||
|
Abattement de CSG et de CRDS de 1,75 % au titre des frais professionnels |
2,0 |
0 |
|
|
Taux de CSG inférieurs au taux de 9,2 % applicable aux salaires |
8,0 |
0 |
La LFSS pour 2020 prévoit la non-compensation du taux intermédiaire de CSG à 6,6 % (créé par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales) |
|
Prime de partage de la valeur |
ND |
0 |
Compensation explicitement prévue par la loi du 16 août 2022 portant création de la prime de partage de la valeur. Selon le Gouvernement cette niche ne coûte rien, ce que conteste la Cour des comptes, qui la chiffre à 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023 (la Cour estime toutefois ne pas être en mesure de fournir de chiffrage pour 2024) |
|
Déduction forfaitaire spécifique |
1,3 |
0 |
|
|
Total |
100,3 |
66,2 |
Placss : projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Ralfss : rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
1 Audition par les rapporteures.
2 « Le terme de « non compensation », dans son acception financière, est réservé, dans la présente annexe, aux dispositifs qui : - soit ont été créés avant 1994 et sont restés non compensés depuis lors ;- soit ont fait l'objet d'une disposition dérogeant à la règle de compensation budgétaire prévue par l'article L. 131-7, sans que des recettes ou reprises de dépenses aient permis d'assurer sous une autre forme la neutralité financière de cette perte de recette » (annexe 2 au Placss 2024).
3 Comme le confirme l'annexe 2 au Placss 2024 p. 29.
4 Dans l'annexe 2 au Placss, ces niches font l'objet d'un tableau séparé. L'annexe précise que certaines exemptions, qui ne s'accompagnent pas d'obligations déclaratives, ne peuvent être évaluées
5 Les exemptions d'assiette « ne donnent généralement pas lieu à compensation par le budget de l'État. En effet, l'obligation de compensation ne porte, pour les exemptions d'assiette, que sur celles créées après le 13 août 2004 [...]. La quasi-totalité des dispositifs en cause ayant été, pour la plupart, instaurés avant cette date, l'obligation de compensation ne leur est pas applicable » (annexe 2 au Placss 2024).
Source : Mecss du Sénat, sauf mention contraire d'après l'annexe 2 au Placss relatif à 2024
1. Rappel des règles de compensation
a) La règle de droit commun : une compensation par crédits budgétaires
Les règles de compensation « de droit commun » figurent à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit d'une règle de compensation par crédits budgétaires, à l'euro près.
Le montant de la compensation fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 mars 202241(*).
Schématiquement, les mesures d'exonération (c'est-à-dire de taux réduit ou nul) relatives aux cotisations sont compensées si elles sont instaurées à compter de la « loi Veil » de 199442(*), alors que pour les autres niches relatives aux cotisations (exemptions d'assiette) ou aux contributions (exonérations et exemptions) la compensation n'a lieu que si elles sont instituées à compter de 200443(*).
Il en résulte que sauf exception, les niches sociales antérieures à 1994 (exonérations de cotisations) ou 2004 (autres niches relatives aux cotisations et aux contributions) ne sont pas compensées (que ce soit budgétairement ou non). Ainsi, du fait de leur ancienneté, la quasi-totalité des exemptions d'assiette ne sont pas compensées.
À la fin des années 2010, le budget de l'État continuant d'enregistrer des déficits significatifs, contrairement à celui de la sécurité sociale, il a été décidé, à la suite du rapport de 2018 de Christian Charpy et Julien Dubertret sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, que les nouvelles pertes de recettes de celle-ci ne donneraient plus lieu par principe à une compensation systématique. Ainsi, la mesure d'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires de la LFSS 2019 n'a pas été compensée.
b) La principale dérogation : la compensation des allégements généraux par affectation de TVA
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale étant de nature législative, une autre disposition législative peut y déroger (ce qui relève du domaine exclusif des LFSS44(*)).
Il en résulte le paradoxe que les allégements généraux de cotisations sociales patronales, de loin la principale niche sociale, dérogent à la règle de droit commun, et sont aujourd'hui essentiellement compensés par des affectations de TVA réalisées pour « solde de tout compte ».
2. La compensation des principales niches
a) La compensation par crédits budgétaires des exonérations dites « ciblées compensées » : une compensation à l'euro
La compensation par crédits budgétaires des exonérations dites « ciblées compensées » n'appelle pas de commentaires particuliers.
Ces exonérations font l'objet d'une compensation à l'euro au moyen de crédits budgétaires inscrits au projet de loi de finances. Ainsi, la LFSS pour 2025 approuve un montant prévisionnel pour 2025 de 6,37 milliards d'euros45(*).
b) La compensation des allégements généraux de cotisations patronales par la TVA : un solde négatif d'environ 5,5 milliards d'euros
Il n'existe pas d'évaluation publique exhaustive des sommes effectivement perçues par la sécurité sociale en compensation des allégements de cotisations patronales.
Un tel calcul impliquerait de faire l'historique des différentes recettes affectées à la sécurité sociale en compensation des réformes successives des allégements généraux (cf. encadré ci-après), et de comparer leur produit actuel au coût des allégements généraux.
Un tel calcul serait nécessairement approximatif. En particulier, le code de la sécurité sociale n'indique pas ce que les différents impôts affectés sont censés compenser, et l'information précise n'est pas toujours disponible lors des débats (cf. encadré).
Historique de la compensation à la
sécurité sociale des allégements
généraux
de cotisations sociales patronales
Les allégements généraux de cotisations sociales patronales, en forte augmentation depuis la crise sanitaire, ont atteint en 2023 un montant de 65,5 milliards d'euros, dont :
- 26,9 milliards d'euros pour les allégements dégressifs ;
- 28,4 milliards d'euros pour le « bandeau maladie » (ex-CICE) (jusqu'à 2,5 Smic) ;
- 10,2 milliards d'euros pour le « bandeau famille » (jusqu'à 3,5 Smic).
Les allégements généraux dégressifs
Les allégements généraux dégressifs étaient compensés jusqu'en 2010 par un panier de recettes fiscales (dont la composition a été modifiée par les lois de finances successives), évoluant selon sa dynamique propre et dont le produit était réparti entre les branches au prorata de leur poids dans les allégements généraux. Depuis la LFSS pour 2011, les recettes constituant ce panier sont définitivement affectées aux régimes de sécurité sociale selon des clés définies par arrêté.
La LFSS pour 2019, qui a élargi le champ des allégements généraux aux cotisations Agirc-Arrco et d'assurance chômage (et créé le bandeau maladie, cf. infra), a prévu une compensation à l'euro près à ces organismes via l'Acoss (Urssaf caisse nationale), qui est désormais attributaire d'une fraction de TVA à ce titre. Le dispositif prévoit que tout déséquilibre de cette opération se répercute directement sur le solde des branches du régime général. Alors que jusqu'en 2021, le solde du dispositif était excédentaire, il a été déficitaire en 2022 (- 0,5 milliard d'euros) et 2023 (- 1,5 milliard d'euros), grevant d'autant le solde du régime général.
Le « bandeau maladie »
Le « bandeau maladie », créé par la LFSS pour 2019, a fait l'objet d'une compensation « pour solde de tout compte », qui a affecté à la Cnam 23,13 % de la TVA (cette recette évoluant indépendamment de la dynamique du bandeau).
Le « bandeau famille »
Le « bandeau famille » a fait l'objet d'une compensation à la Cnaf via un transfert en 2015 puis en 2016 des dépenses d'aides au logement au budget de l'État.
Les ajustements au fil des lois de finances
Le code de la sécurité sociale n'indique pas ce que les différentes affectations de recettes sont censées compenser. Ainsi, dans le cas de la TVA, il se borne à fixer, dans son article L. 131-8, la part de TVA affectée à la sécurité sociale, que ce soit ou non pour compenser les allégements généraux.
Cette part a évolué au fil des lois de finances successives, pour neutraliser tout ou partie des effets de certaines mesures affectant le solde de la sécurité sociale (pouvant ou non concerner les allégements généraux). Par exemple, l'article 131 de la loi de finances pour 2025 a modifié la part de TVA affectée à la sécurité sociale pour la ramener de 23,32 % à 23,24 %. Si les mouvements concernés et leur montant respectif étaient clairement indiqués dans l'exposé des motifs du texte initial (il s'agissait essentiellement de compenser à l'État la perte de recettes d'impôt sur les sociétés découlant de la réforme des allégements généraux46(*)), la répartition précise de la modification apportée par le texte définitif ne figure dans aucun document.
La branche maladie étant la seule à percevoir la TVA, la répartition entre branches de l'effet d'une modification de la part de TVA affectée est habituellement réalisée par une modification de la répartition entre branches de la taxe sur les salaires (figurant également à l'article L. 131-8 précité du code de la sécurité sociale), dans l'article de la LFSS dit « article-tuyau ». Comme dans le cas de l'article du PLF modifiant la fraction de TVA affectée, l'évaluation préalable de l'article-tuyau indique ce que cette modification de la répartition de la taxe sur les salaires est censée compenser (ce qui peut ne pas être uniquement une modification de la part de TVA affectée). Toutefois, dans ce cas également, l'information n'est habituellement disponible que pour le texte initial.
Source : Mecss du Sénat, d'après notamment le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de mai 2024
La compensation des allégements généraux était considérée comme à peu près équilibrée jusqu'à la réforme de 2019, qui a vu le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), créé en 2012, transformé en baisse de 6 points des cotisations maladie jusqu'à un seuil alors fixé à 2,5 Smic47(*) (ce qu'il est d'usage d'appeler le « bandeau maladie »).
Aussi, dans son rapport48(*) sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2025, la Cour des comptes se contente de chiffrer la sous-compensation du « bandeau maladie ». Selon ses estimations, cette sous-compensation a été de 5,5 milliards d'euros en 2024.
Effet sur le solde de la sécurité sociale de la création du bandeau maladie en 2019, selon la Cour des comptes
(en milliards d'euros)
Solde de la compensation intégrale à l'Unédic et à l'Agirc-Arrco : la sécurité sociale (Acoss) a bénéficié d'une fraction de TVA (5,18 points) à répartir chaque année entre l'Unédic et l'Agirc-Arrco pour leur assurer une compensation intégrale du bandeau maladie (ce dispositif pouvant avoir un solde positif ou négatif pour la sécurité sociale).
Compensation du bandeau maladie : compensation de la baisse de 6 points des cotisations maladie (19,8 milliards d'euros en 2019) par une fraction de 9,79 points de TVA (17,4 milliards d'euros en 2019).
Extension à la SNCF et à la RATP des bandeaux maladie et famille : cette extension n'a pas fait l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.
Source : D'après Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
Ce chiffrage est toutefois contesté par la direction du budget, qui considère qu'il n'y a pas de sous-compensation49(*).
Comme le souligne la Cour dans son rapport précité, « il est nécessaire de définir une méthode partagée pour chiffrer la compensation et de renforcer le suivi annuel ».
c) Les non-compensations hors allégements généraux : environ 30 milliards d'euros, en quasi-totalité « légales » et correspondant à des niches anciennes ?
Les « exemptions d'assiette » sont retracées dans un tableau de l'annexe 2 au Placss, qui les évalue à 14,6 milliards d'euros en 2024. Ces niches sont généralement antérieures à 2004 et ne sont, sauf exception, pas compensées par le budget de l'État50(*).
Par ailleurs, diverses niches ne sont pas retracées dans les tableaux récapitulatifs de l'annexe 2 au Placss, qui leur consacre toutefois une fiche. Ainsi, les taux de CSG inférieurs au taux de 9,2 % applicable aux salaires correspondraient, selon la fiche correspondante, à un coût d'environ 8 milliards d'euros, sans indication d'année. En réponse à une question des rapporteures, la DSS évalue le coût de cette niche à 11,3 milliards d'euros en 2025, pour les seules pensions de retraite, conformément au tableau ci-après.
Coût des taux réduits de CSG sur les
pensions de retraite
par rapport à un taux de 9,2 % en 2025
(hors effet sur l'impôt sur le revenu)
(en milliards d'euros)
|
Montant |
|
|
Dont taux plein 8,3 % |
1,8 |
|
Dont taux intermédiaire 6,6 % |
3,1 |
|
Dont taux réduit 3,8 % |
1,6 |
|
Dont taux nul |
4,8 |
|
Total |
11,3 |
Source : Direction de la sécurité sociale (réponse aux rapporteures)
Parmi les niches sociales non compensées, on peut également mentionner les exonérations dites « non compensées », dont la principale est l'exonération de la part salariale sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d'euros), instaurée en 2019.
Par ailleurs, alors que selon le Gouvernement l'exemption de la prime de partage de la valeur (PPV) ne coûte rien, selon la Cour des comptes elle a coûté 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023 ; toutefois si le Parlement ne décide pas de la proroger elle disparaîtra fin 2026 pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (cf. encadré ci-après).
La prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur (PPV) a été créée par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Elle succède à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa), instaurée par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 à la suite du mouvement des « gilets jaunes », et reconduite jusqu'en mars 2022, et dont le régime était analogue, avec un plafond plus bas51(*). La Pepa et la PPV sont couramment dénommées « prime Macron ».
Les employeurs peuvent attribuer sans condition jusqu'à deux PPV d'un montant global de 3 000 euros maximum par an et par bénéficiaire. Ce plafond est porté à 6 000 euros dans les entreprises mettant en oeuvre un accord d'intéressement ou de participation volontaire.
Une exonération qui pour certains salariés est étendue aux contributions sociales
La PPV est normalement exonérée des seules cotisations sociales.
Toutefois, lorsqu'elle est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 Smic, la prime est exonérée non seulement des cotisations sociales, mais aussi de l'impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, de la taxe sur les salaires et du forfait social.
Bien que seule une LFSS puisse instituer une exemption au-delà de trois ans52(*), la loi du 29 novembre 202353(*) a prorogé ce régime exceptionnel jusqu'à la fin de 2026 dans les entreprises de moins de 50 salariés, tout en instaurant un forfait social au taux de 20 % si l'effectif de l'entreprise est égal ou supérieur à 250 salariés.
Coût de la mesure
Le IX de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 précitée prévoit que « le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l'État, conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».
La PPV fait l'objet d'une fiche dans l'annexe 2 au Placss, mais celle-ci ne comprend pas de chiffrage de son coût. Cela vient du fait que, selon le Gouvernement, la fiche n'aurait pas été versée en l'absence de l'exonération, et n'aurait donc pas de coût pour la sécurité sociale.
Cet argumentaire est contesté, à juste titre, par la Cour des comptes : « Le Gouvernement a considéré que, par construction, la prime n'aurait pas été versée si elle n'avait pas été créée par la loi et ne présentait donc pas de coût direct pour la sécurité sociale. L'hypothèse sous-jacente est celle d'une absence totale de substitution avec les hausses de salaire, éventuellement admissible pour un dispositif transitoire mais pas pour un dispositif pérenne »54(*). De fait, selon l'Insee, la part de rémunération versée sous forme de Pepa ou de PPV se substituant à une augmentation de salaire serait comprise entre 15 et 40 %55(*).
La direction de la sécurité sociale n'a pas transmis le chiffrage de cette niche, demandé par les rapporteures.
Selon la Cour des comptes, la Pepa a coûté aux finances sociales 0,5 milliard d'euros en 2009, 0,6 milliard d'euros en 2010 et 0,4 milliard d'euros en 2011 ; puis la PPV a coûté 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023. La Cour des comptes indique ne pas pouvoir fournir de chiffrage pour 202456(*).
Une niche qui devrait disparaître le 1er janvier 2027 pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux
L'article 18 de la LFSS pour 2025 a inclus la PPV dans la rémunération prise en compte à compter du 1er janvier 2025 pour le calcul des seuils des allégements généraux de cotisations patronales, ce qui devrait réduire son attractivité.
Dans son Ralfss de mai 2024, la Cour des comptes préconise de « mettre en oeuvre le principe fixé par la loi du 16 août 2022 de compensation de la perte de recettes résultant de la prime de partage de la valeur, au minimum par l'application du forfait social au taux de 20 % aux entreprises de moins de 250 salariés ». Elle chiffre la mesure à 1 milliard d'euros, ce qui est proche de son estimation du montant de la PPV.
Le Conseil des prélèvements obligatoires préconise57(*), s'agissant de son volet relatif à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (borné au 31 décembre 2026), de « ne pas prolonger la prime de partage de la valeur au-delà du 31 décembre 2026 ». Selon ses estimations, il en découlerait des recettes fiscales supplémentaires comprises entre 220 et 330 millions d'euros.
IV. POURQUOI RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE ?
A. UN DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SANS GUÈRE DE SIGNIFICATION
Le solde de la sécurité sociale n'a en lui-même guère de signification.
1. La sécurité sociale n'est qu'un des périmètres possibles de la protection sociale
Tout d'abord, il ne s'agit que de l'un des périmètres possibles des différents éléments de notre protection sociale.
Les administrations de sécurité sociale, ou Asso (notion de comptabilité nationale utilisée par l'Insee), qui englobent notamment la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), structurellement excédentaire d'une vingtaine de milliards d'euros, ont actuellement un solde excédentaire - même si, en l'absence de mesures correctrices, tel ne devrait bientôt plus être le cas.
Comparaison du solde de la sécurité
sociale avec celui
de divers périmètres plus
larges
(en milliards d'euros)
Cades : Caisse d'amortissement de la dette sociale. FSV : Fonds de solidarité vieillesse. LFSS : loi de financement de la sécurité sociale. Placss : projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Sécurité sociale : exécution (LFSS 2018 à 2023, Placss 2022 à 2024) + rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025 (prévision). Cades : LFSS 2018 à 2023, Placss 2022 à 2024, LFSS 2025. Administrations de sécurité sociale : Insee.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
Les administrations de sécurité sociale (Asso)
Les administrations de sécurité sociale regroupent les régimes d'assurance sociale et les organismes dépendant des assurances sociales (principalement les hôpitaux à financement public) (Odass).
Les régimes d'assurance sociale comprennent principalement :
- le régime général ;
- divers fonds : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), mais aussi Fonds commun pour les accidents du travail (FCAT), Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), Service social d'allocation aux personnes âgées (Saspa), Fonds de compensation des organismes de sécurité sociale (FCOSS), etc. ;
- les autres régimes de base des salariés (régimes spéciaux d'entreprises et d'établissements publics, salariés agricoles, etc.) ;
- les régimes des non-salariés (dont la mutualité sociale agricole) ;
- l'Unédic ;
- les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des salariés (Agirc-Arrco...) ;
- depuis un reclassement effectué en 2011 par l'Insee, la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) et le Fonds de réserve des retraites (FRR), jusqu'alors considérés comme des organismes divers d'administration centrale (Odac).
Les organismes dépendant des assurances de sécurité sociale (Odass), qui dépendent des administrations de sécurité sociale, comprennent :
- les hôpitaux de l'assistance publique, ainsi que les hôpitaux privés financés par la dotation globale hospitalière (attribuée par les caisses de sécurité sociale) ;
- les oeuvres sociales intégrées aux organismes de sécurité sociale (oeuvres sociales de la Cnaf, écoles d'infirmiers) ;
- France travail.
Capacité de financement des administrations de sécurité sociale (Asso) : décomposition entre sous-catégories
(en milliards d'euros)
Asso : administrations de sécurité sociale. Cades : Caisse d'amortissement de la dette sociale. FRR : Fonds de réserve des retraites. Odass : organismes dépendant des assurances sociales.
Données issues du tableau 3.108 « Passage du résultat comptable du régime général au déficit des administrations de sécurité sociale (S1314) au sens de Maastricht ». Toutes les données du graphique (y compris pour le régime général) sont au sens de la comptabilité nationale. Ce tableau n'est pas parfaitement à jour, d'où pour 2024 un besoin de financement des Asso légèrement différent de celui indiqué par le graphique précédent.
Source : D'après l'Insee
2. Les recettes de la sécurité sociale dépendent par nature d'une convention juridique
Ensuite, si les dépenses de la sécurité sociale correspondent à une réalité « physique », tel n'est pas le cas de ses recettes, qui correspondent à celles que, de manière conventionnelle, la loi a décidé de lui affecter. Tel est d'autant plus le cas que les cotisations sociales représentent désormais moins de la moitié de ses recettes.
Ainsi, on peut considérer que le déficit de la sécurité sociale est au moins en partie dû au fait qu'on ne lui a pas affecté les recettes destinées à assurer son équilibre58(*).
En sens inverse, on peut estimer que le déficit de la sécurité sociale est minoré par des ressources qui ne devraient pas être prises en compte (cf. la polémique sur le « déficit caché » du système de retraite).
La polémique sur le « déficit caché » du système de retraite
Selon certains auteurs59(*), le déficit du système de retraite devrait être majoré de plusieurs dizaines de milliards d'euros, du fait du mode de financement du régime de la fonction publique locale et hospitalière (géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, CNRACL), et surtout du régime des fonctionnaires civils et militaires de l'État (régime dit de la fonction publique d'État, FPE).
En effet, le régime FPE (dont les produits ont été de 63,7 milliards d'euros en 2024) bénéficie, outre de cotisations salariales et de contributions d'employeurs autres que l'État (14,4 milliards d'euros en 2024), d'une cotisation d'équilibre de l'employeur (48,2 milliards d'euros en 2024). Dans les comptes de la sécurité sociale, cette cotisation d'équilibre constitue à la fois la cotisation employeur de l'État, la prise en charge de dépenses de solidarité et un éventuel financement d'équilibre, sans qu'il soit possible de distinguer entre ces différentes composantes60(*).
Dans une note de janvier 2025, le président du COR indique que le taux de cotisation implicite en résultant pour les fonctionnaires de l'État est de 85,4 % sur le traitement indiciaire, contre 27,9 % sur le salaire brut pour les salariés du privé61(*).
Comme il le souligne, cet écart de taux ne résulte pas d'une plus grande générosité du régime des fonctionnaires, mais de la maîtrise des effectifs et des rémunérations dans la fonction publique62(*), qui a pour effet de susciter une situation démographique défavorable63(*).
Surtout, le COR souligne qu'il applique le droit en vigueur. En particulier, l'article 51 de la loi de finances pour 2006, qui décrit l'ensemble des ressources du compte d'affectation spéciale « Pensions », mentionne bien la contribution d'équilibre du régime FPE.
Dans son rapport de février 2025 sur les retraites, la Cour des comptes conteste également l'existence d'un « déficit caché », soulignant en particulier l'importance des primes, exonérées de cotisations, dans la rémunération des fonctionnaires64(*).
B. IL N'EN EST PAS MOINS NÉCESSAIRE DE RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE
1. La sécurité sociale ne peut rester durablement déficitaire
a) La sécurité sociale ne peut pas être durablement en déséquilibre
Toutefois la sécurité sociale ne peut pas être en déséquilibre structurel entre les recettes et les dépenses.
Elle n'est en effet pas censée faire financer les dépenses des générations présentes par les générations futures.
C'est pour cette raison que l'Acoss n'est autorisée par la loi à s'endetter qu'à court terme, et que l'architecture financière actuelle prévoit que la dette de la sécurité sociale doit être amortie par la Cades.
b) La sécurité sociale risquerait de ne pas pouvoir jouer son rôle d'amortisseur en cas de nouvelle crise
La sécurité sociale aurait, selon les prévisions du rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, un déficit de 21,9 milliards d'euros en 2025 et 24,8 milliards d'euros en 2029.
Il s'agirait d'une situation sans précédent hors période de crise, d'autant plus que le déficit serait durable et s'accroîtrait.
Aussi, si une nouvelle crise survenait, il ne serait pas évident que la sécurité sociale puisse jouer son rôle d'amortisseur social et de stabilisateur automatique, comme lors de la crise de 2008-2009 ou de la récente crise sanitaire. On partirait en effet d'une situation dégradée, marquée par un déficit élevé.
c) La sécurité sociale risque une crise de liquidité
À cela s'ajoute une fragilité propre à la sécurité sociale, qui est que son mécanisme de financement, prévu pour satisfaire de simples besoins de trésorerie, n'est pas conçu pour lui permettre d'accumuler les déficits.
En effet, du fait des déficits cumulés, le plafond de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui ne peut s'endetter qu'à court terme sur les marchés financiers, atteint un niveau tel que le financement de la sécurité sociale est menacé à brève échéance. Selon les responsables de l'Acoss, auditionnés par les rapporteures, la sécurité sociale se trouvera fin 2025 dans une zone de risque, et en conséquence de l'accumulation des déficits prévisionnels, la capacité de l'Acoss à financer son besoin de trésorerie pourrait devenir critique dès 2027 (cf. infra).
2. Le déficit actuel des administrations publiques considérées dans leur ensemble n'est pas soutenable
a) Le déficit actuel des administrations publiques, de près de 6 points de PIB, n'est pas soutenable
Le déficit de la sécurité sociale n'est qu'une composante d'un déficit des administrations publiques lui aussi sans précédent hors période de crise.
Selon le Gouvernement, la France aurait en 2025 un déficit des administrations publiques de 5,4 points de PIB (après 5,8 points de PIB en 2024), ce qui en ferait le plus élevé de la zone euro65(*), loin du seuil maximal de 3 points de PIB fixé par le pacte de stabilité et de croissance.
La France ne peut conserver durablement un tel niveau de déficit, qui se traduirait par une forte augmentation de sa charge d'intérêt. Elle se trouverait alors dans l'obligation de réaliser des arbitrages difficiles entre ses dépenses dans des secteurs comme l'éducation, la recherche, la défense, la protection sociale.
b) Un effort prévu par le Gouvernement démissionnaire d'environ 170 milliards d'euros d'ici 2029 pour l'ensemble des administrations publiques
Le Gouvernement démissionnaire prévoyait donc des mesures d'ampleur afin de réduire le déficit des administrations publiques.
Ainsi, son premier plan budgétaire et structurel national à moyen terme (PSMT), transmis le 31 octobre 2024 à la Commission européenne, prévoit que le déficit des administrations publiques passerait sous le seuil de 3 points de PIB en 2029, avec un déficit de 2,8 points de PIB (cf. encadré).
Pour atteindre cet objectif, le PSMT prévoit, pour l'ensemble des administrations publiques, en cumulé de 2026 à 2029, un ajustement structurel primaire (c'est-à-dire schématiquement un effort sur les recettes et les dépenses, en prenant pour référence une croissance des dépenses égale à celle du PIB potentiel) d'environ 3 points de PIB, soit environ 110 milliards d'euros66(*). En prenant en compte le fait que les dépenses tendent spontanément à augmenter plus rapidement que le PIB, les économies à réaliser sont encore plus importantes, et peuvent être estimée à environ 170 milliards d'euros67(*).
c) Ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029 : un effort de 40 milliards d'euros en dépenses et en recettes
À titre de comparaison, l'objectif du Gouvernement démissionnaire de ramener la sécurité sociale à l'équilibre d'ici 2029 implique des mesures d'amélioration du solde d'environ 40 milliards d'euros68(*), en supposant que les hypothèses de croissance du Gouvernement sont vérifiées.
Les mesures d'amélioration du solde pour la sécurité sociale (40 milliards d'euros) représenteraient donc environ un quart de celles pour l'ensemble des administrations publiques (170 milliards d'euros). À titre de comparaison, la sécurité sociale représente 40 % des dépenses publiques.
Cet objectif de retour à l'équilibre semble suffisant.
Les mesures sur les dépenses et les recettes à prendre en cumulé en 2026-2029 pour respecter les objectifs du Gouvernement
(en milliards d'euros)
PSMT : plan budgétaire et structurel national à moyen terme (qui, avec les rapports d'avancement annuels, remplace les programmes de stabilité depuis la réforme du pacte de stabilité de 2024).
Effort structurel primaire : évolution du ratio dépenses primaires (c'est-à-dire hors charge d'intérêt)/PIB potentiel + mesures nouvelles sur les recettes. Le PIB potentiel est le PIB corrigé des effets de la conjoncture.
* Les 110 milliards d'euros figurent dans le rapport d'avancement annuel d'avril 2025. Les 60 milliards d'euros restants correspondent au cumul, sur quatre années, de l'écart entre l'effort structurel primaire prévu pour 2025 par le PSMT d'avril 2025 (1,6 point de PIB potentiel, soit environ 45 milliards d'euros) et les mesures sur les dépenses et les recettes prévues pour 2025 figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2025, de 60,6 milliards d'euros.
** Les 15 milliards d'euros correspondent à une croissance de l'Ondam de 2,9 % par an (comme prévu par la LFSS pour 2025) au lieu d'une croissance spontanée de 4,5 % par an (on fait l'hypothèse que les dépenses hors dépenses de santé tendent globalement à augmenter au même taux que le PIB). Les 25 milliards d'euros restants correspondent au montant arrondi du déficit attendu en 2029 par le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025 (24,8 milliards d'euros).
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
Le premier plan budgétaire et structurel
national à moyen terme (PSMT)
et le premier rapport d'avancement
annuel
Le premier PSMT (octobre 2024)
La réforme du pacte de stabilité d'avril 2024 remplace les programmes de stabilité et les programmes nationaux de réforme (PNR) par un document unique : les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme (PSMT), devant être transmis tous les quatre ans.
La France a transmis le 31 octobre 2024 son premier PSMT à la Commission européenne. Ce document prévoit que le déficit des administrations publiques passerait sous le seuil de 3 points de PIB en 2029, avec un déficit de 2,8 points de PIB.
L'indicateur opérationnel unique utilisé pour piloter l'ajustement est celui dit de « dépenses nettes »69(*), qui correspond schématiquement, selon la terminologie française, à un effort structurel70(*) primaire.
Le tableau ci-après indique la trajectoire d'effort structurel primaire prévue par le PSMT pour l'ensemble des administrations publiques. Après 1,6 point de PIB (soit environ 50 milliards d'euros) en 2025, cet effort serait de 0,7 ou 0,8 point de PIB (soit environ 25 milliards d'euros) chaque année jusqu'en 2029.
Effort structurel primaire prévu par le PSMT
PSMT : plan budgétaire et structurel national à moyen terme.
Source : PSMT
Dans le PSMT, l'effort, défini en termes d'effort structurel, est exprimé par construction par rapport à une situation où les dépenses augmenteraient au même taux que le PIB potentiel, soit environ 1 % par an en volume. Les dépenses publiques tendant spontanément à augmenter davantage, les mesures à prendre pour réaliser cet effort correspondent à un effort bien plus important. Ainsi, les textes initiaux des PLF et PLFSS pour 2025 prévoyaient des mesures d'amélioration du solde pour un montant de 60,6 milliards d'euros (dont 14,8 milliards d'euros pour la sécurité sociale) ; et le Gouvernement a évalué les mesures à prendre en 2026 à 43,8 milliards d'euros.
Le PSMT n'indique pas comment l'effort doit se répartir entre les différentes catégories d'administrations publiques.
Le premier rapport d'avancement annuel (avril 2025)
Le premier rapport d'avancement annuel, relatif à la mise en oeuvre du PSMT pour l'année 2025, a été adressé à la Commission européenne en avril 2025.
V. SANS NOUVELLES MESURES, UN DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI POURRAIT ATTEINDRE 3,5 POINTS DE PIB EN 2040 (ET 9 POINTS DE PIB EN 2070)
Afin d'évaluer l'effort à réaliser pour ramener les finances sociales à l'équilibre, la Mecss s'est efforcée, en s'appuyant sur des travaux existants71(*), de réaliser une projection indicative des recettes, des dépenses et du solde des différentes branches de la sécurité sociale (c'est-à-dire des régimes obligatoires de base et du FSV) à l'horizon 2070, en supposant qu'aucune mesure n'est prise.
Les projections à une échéance aussi éloignée sont bien entendu purement illustratives. L'intérêt de l'exercice est de comprendre et hiérarchiser les enjeux.
Les rapporteures jugent nécessaire que le Gouvernement mène à bien le projet de projection des finances publiques à l'horizon 2050, envisagé par le plan d'action du Gouvernement du 3 mars 2025 pour améliorer le pilotage des finances publiques72(*).
Les principales hypothèses retenues sont synthétisées par l'encadré ci-après.
Principales hypothèses utilisées
pour la projection à long terme
des finances de la
sécurité sociale, en l'absence de mesures
Dans le cas de la branche vieillesse, les projections s'appuient, par convention73(*), sur celles du COR de juin 202574(*). Le scénario retenu par la Mecss est le scénario de référence, correspondant à une croissance de la productivité du travail de 0,7 % par an (préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de février 2025 sur les retraites). Toutefois les projections du COR concernent l'ensemble du système de retraite, qui comprend, outre la branche vieillesse et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), les régimes complémentaires de retraite. Aussi, pour obtenir les résultats sur le périmètre de la sécurité sociale, les projections du rapport ont été construites en neutralisant les projections relatives aux régimes complémentaires (transmises par le COR aux rapporteures).
Les projections relatives aux autres branches sont réalisées en retenant également la projection de croissance du PIB du COR (transmise par le COR aux rapporteures, pour chaque année de la projection).
Dans le cas de la branche maladie, la projection des dépenses est réalisée au moyen d'une formule couramment utilisée par les économistes pour projeter les dépenses de santé, « calibrée » de manière à retrouver un taux de croissance des dépenses analogue à celui calculé par l'OCDE75(*) dans le cas de la France (pour la période 2022-2040). Cela conduit à retenir, de manière en partie conventionnelle, une croissance annuelle des dépenses en volume égale à 0,75 fois la croissance du PIB en volume76(*), plus un coefficient prenant en compte divers phénomènes (le vieillissement, le progrès technique et la tendance des salaires du secteur à augmenter spontanément plus vite que les gains de productivité77(*)), égal à 1,5 jusqu'en 2040 et diminuant ensuite linéairement jusqu'à 1 en 2070 (du fait du moindre impact du vieillissement). Avec une croissance du PIB de 1 % et une inflation de 1,75 %, cela conduit à une croissance annuelle des dépenses de 4 % jusqu'en 2040, légèrement inférieure à celle généralement retenue pour l'Ondam (dont le taux de croissance spontané est habituellement plutôt estimé à 4,5 % environ).
Les recettes de la branche maladie sont supposées croître au même taux que le PIB en valeur, minoré de 0,3 point en début de période78(*) (cette minoration diminuant ensuite linéairement pour s'annuler en 2070) pour prendre en compte le faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et la consommation des produits du tabac.
Dans le cas de la branche autonomie, en point de PIB, les dépenses augmentent conformément aux projections réalisées en 2024 par la Commission européenne79(*). Les recettes de la branche augmentent au même taux que le PIB en valeur.
Dans le cas de la branche famille, on fait l'hypothèse que les 2/3 des dépenses (en début de période) augmentent au même taux que l'inflation, les dépenses restantes augmentant comme le PIB en valeur80(*). Les recettes de la branche augmentent au même taux que le PIB en valeur.
Les recettes et les dépenses de la branche AT-MP sont supposées stables en points de PIB.
Ces hypothèses de projection sont par nature en partie conventionnelles. En particulier, elles supposent l'absence de crise (financière, sanitaire, etc.) réduisant le PIB de manière pérenne. Par ailleurs, elles ne prennent pas spécifiquement en compte les effets de la transition écologique sur le PIB, considérant implicitement que celle-ci ne remet pas en cause un scénario de croissance de la productivité du travail de 0,7 % par an.
L'impact de la transition écologique sur le PIB
Selon certains auteurs, « le ralentissement de la croissance de long terme, (...) demain lié aux trajectoires de transition écologique, pourrait déboucher sur une croissance durablement faible, nulle voire même négative »81(*).
De même, en 2022, la mission d'information du Sénat sur la sécurité sociale écologique soulignait l'effet de la pollution et du changement climatique sur la santé et sur la croissance. Selon elle, « la soutenabilité financière de la sécurité sociale étant particulièrement précaire, il est à craindre que celle-ci subisse un « effet de ciseau » financier, soumise à la fois à la croissance progressive de ses charges et à l'amoindrissement prévisible de ses ressources »82(*).
En sens inverse, selon le ministère de la transition écologique et solidaire, la transition écologique pourrait majorer le PIB de 3,8 points en 205083(*).
Comme indiqué, les rapporteures s'en tiennent par convention aux hypothèses économiques du COR.
Il est possible de tirer de ces projections trois enseignements essentiels.
A. UN DÉFICIT HORS DE CONTRÔLE SI LES DÉPENSES DE LA BRANCHE MALADIE AUGMENTENT CONFORMÉMENT À LEUR CROISSANCE SPONTANÉE
Le premier enseignement de ces projections, c'est qu'à moins de supposer une augmentation continue des recettes rapportées au PIB, qui ne serait pas économiquement soutenable, le déficit de la sécurité sociale deviendra hors de contrôle si les dépenses de la branche maladie augmentent conformément à leur croissance spontanée.
En effet, les dépenses de santé tendent spontanément à augmenter nettement plus vite que le PIB (environ 4 % en valeur, contre moins de 3 % pour le PIB en valeur). Ainsi, si elles augmentaient conformément à leur croissance spontanée, cette absence de maîtrise ne semblerait pas pouvoir être compensée par une plus grande maîtrise des dépenses des autres branches - ni même des autres administrations publiques.
Parallèlement, les recettes de la branche maladie tendent à augmenter moins vite que le PIB, du fait du faible dynamisme de certaines d'entre elles (comme les droits tabac, en diminution structurelle)84(*).
Afin d'isoler le supplément de la croissance spontanée des dépenses de santé par rapport à la croissance du PIB, les projections de la Mecss comprennent également un scénario dit « avec stabilisation maladie » (représenté par des courbes en pointillés), dans lequel les dépenses de la branche maladie sont stabilisées en points de PIB, comme cela a en particulier été le cas dans les années 2010 (cf. encadré). Ce scénario n'est pas prescriptif85(*).
Ondam rapporté au PIB
(en points de PIB)
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss concernés, l'Insee et, pour les années antérieures à 2004, Isabelle Hirtzlin, L'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie : d'un outil global de régulation à une simple prévision des dépenses, 2003
Projections de recettes, de dépenses et de
solde de la sécurité sociale
(en supposant l'absence de
mesures sur les dépenses et les recettes)
(en points de PIB)
Hypothèses : croissance du PIB égale à celle du scénario de référence du COR de juin 2025 (croissance de la productivité du travail de 0,7 %) ; dépenses de retraites : scénario du COR de juin 2025, retraité par la Mecss pour correspondre au périmètre de la sécurité sociale ; dépenses de santé (volume) : croissance annuelle égale à celle du PIB (volume) fois 0,75, plus 1,5 point jusqu'en 2040, cette majoration diminuant ensuite linéairement jusqu'à 1 en 2070 ; branche famille : stabilité des recettes en points de PIB, indexation de 2/3 des dépenses sur l'inflation et de 1/3 des dépenses sur la croissance du PIB en valeur ; branche autonomie : stabilité des recettes en points de PIB, dépenses rapportées au PIB évoluant conformément aux projections de la Commission européenne ; branche AT-MP : stabilité des dépenses et des recettes en points de PIB.
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
La croissance spontanée des dépenses de santé, de 2,25 % par an en volume jusqu'en 2040, est analogue à celle projetée par l'OCDE pour la période 2022-204086(*), de 2,2 % par an en volume.
Cette estimation du taux de croissance spontanée des dépenses de santé de 2,25 % en volume n'est pas « maximaliste » (cf. encadré).
Une projection non
« maximaliste » des dépenses de santé
en
l'absence de mesures
Hypothèses retenues
La formule retenue, largement conventionnelle, suppose que la croissance annuelle en volume des dépenses de santé est égale à celle du PIB en volume fois 0,75, plus 1,5 point jusqu'en 2040, cette majoration diminuant ensuite linéairement jusqu'à 1 en 2070.
Elle s'appuie sur une étude de l'OCDE87(*) portant sur la période 2022-2040 :
- le coefficient de 0,75 correspond à l'élasticité des dépenses au PIB potentiel telle qu'évaluée par l'OCDE, sans distinction de pays88(*) ;
- la majoration de 1,5 point correspond, toujours selon l'OCDE à la somme pour la France des autres effets, soit « l'effet Baumol »89(*) (0,5 point), le progrès technique (0,4 point) et le vieillissement (0,6 point).
On fait en outre l'hypothèse que cette majoration de 1,5 point diminue linéairement jusqu'à 1 en 2070, le vieillissement se faisant de plus en plus en bonne santé.
Selon le récent rapport90(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, le vieillissement majorerait le volume des soins de 0,7 point par an en 2025-2030, ce qui est proche de l'estimation de l'OCDE pour 2022-2040 (0,6 point).
Aléas
Les aléas semblent plutôt à la hausse.
Tout d'abord, l'estimation du taux de croissance spontanée des dépenses de santé retenue ici, de 2,25 % en volume (soit, sur la base d'une hypothèse d'inflation de 1,75 %, 4 % en valeur), représente le bas de la fourchette d'estimation du taux de croissance spontané actuel de l'Ondam, habituellement entre 4 % et 4,5 % par an en valeur91(*). Cette estimation est cependant cohérente avec la dernière estimation du Gouvernement, qui, en juillet 2025, considérait que de 2025 à 2029, la croissance spontanée de l'Ondam serait légèrement inférieure à 4 %92(*).
Ensuite, selon le rapport précité des trois Hauts Conseils, une étude menée en 2019 dans le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur suggère que, pour les principales pathologies chroniques, de 2016 à 2028 les évolutions épidémiologiques hors vieillissement majoreraient la croissance des dépenses de 0,9 point par an.
Enfin, bien que certaines innovations thérapeutiques soient un facteur d'économies, les années récentes ont été essentiellement marquées par la forte augmentation du coût des nouveaux médicaments relatifs à certaines pathologies93(*).
La prévision de l'Ondam par le Gouvernement
Pour prévoir l'Ondam, le Gouvernement évalue tout d'abord son taux de croissance spontanée. Par exemple, dans le cas des dépenses de ville, il prolonge à l'aide de méthodes statistiques l'évolution observée par le passé, par catégories fines de dépenses (hors dépenses de crise).
Conformément aux préconisations d'un rapport94(*) de 2021 du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), les programmes de maîtrise médicalisée de la Cnam et les mesures « habituelles » de lutte contre la fraude sont incluses au tendanciel.
Le Gouvernement augmente le résultat ainsi obtenu du montant des mesures nouvelles coûteuses, et le réduit du montant des économies.
Les projections de la Commission européenne95(*) indiquent, dans leur scénario de base, une augmentation des dépenses de santé de seulement 0,3 point de PIB entre 2022 et 2070. Toutefois ce scénario suppose de fait la poursuite de l'effort actuel de maîtrise des dépenses.
Projections de dépenses des
différentes branches de la sécurité sociale
(en
supposant l'absence de mesures sur les dépenses et les
recettes)
(en milliards d'euros et en points de PIB)
|
2023 |
2023 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
2070 |
|
|
En Md€ |
En points de PIB |
||||||
|
Vieillesse (y compris FSV) |
|||||||
|
Recettes |
274,0 |
9,7 |
9,9 |
9,5 |
9,2 |
8,9 |
8,8 |
|
Dépenses |
275,4 |
9,7 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
10,5 |
|
Solde |
- 1,4 |
0,0 |
- 0,2 |
- 0,7 |
- 1,2 |
- 1,5 |
- 1,6 |
|
Maladie |
|||||||
|
Recettes |
232,8 |
8,2 |
8,1 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
|
Dépenses |
243,9 |
8,6 |
9,3 |
10,5 |
11,9 |
13,3 |
14,5 |
|
Solde |
- 11,1 |
- 0,4 |
- 1,2 |
- 2,6 |
- 4,1 |
- 5,5 |
- 6,8 |
|
Maladie avec stabilisation de la dépense en points de PIB |
|||||||
|
Recettes |
232,8 |
8,2 |
8,1 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
|
Dépenses |
243,9 |
8,6 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
Solde |
- 11,1 |
- 0,4 |
- 0,5 |
- 0,7 |
- 0,9 |
- 0,9 |
- 0,9 |
|
Famille |
|||||||
|
Recettes |
56,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Dépenses |
55,7 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
|
Solde |
1,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Autonomie |
|||||||
|
Recettes |
37,0 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Dépenses |
37,6 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
|
Solde |
- 0,6 |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,5 |
- 0,6 |
|
AT-MP |
|||||||
|
Recettes |
16,8 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
Dépenses |
15,4 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
Solde |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Total consolidé |
|||||||
|
Recettes |
600,0 |
21,2 |
21,3 |
20,7 |
20,2 |
19,9 |
19,7 |
|
Dépenses |
610,7 |
21,6 |
22,7 |
24,0 |
25,6 |
27,0 |
28,4 |
|
Solde |
- 10,8 |
- 0,4 |
- 1,3 |
- 3,3 |
- 5,4 |
- 7,1 |
- 8,6 |
|
Total consolidé avec stabilisation des dépenses maladie en points de PIB |
|||||||
|
Recettes |
600,0 |
21,2 |
21,3 |
20,7 |
20,2 |
19,9 |
19,7 |
|
Dépenses |
610,7 |
21,6 |
22,0 |
22,1 |
22,4 |
22,4 |
22,6 |
|
Solde |
- 10,8 |
- 0,4 |
- 0,7 |
- 1,4 |
- 2,1 |
- 2,5 |
- 2,8 |
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
B. SOUS RÉSERVE DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ, LES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SONT GLOBALEMENT MAÎTRISÉES, LE SUJET DE MOYEN TERME ÉTANT LA RÉSORPTION DU DÉFICIT ACTUEL
Le deuxième enseignement de l'exercice de projection, c'est que sous réserve de la maîtrise des dépenses de santé, les dépenses sont globalement maîtrisées.
En particulier, la croissance des dépenses de la branche autonomie, quasiment invisible sur le graphique ci-après96(*), représente comparativement un enjeu beaucoup plus faible.
Projections de dépenses des
différentes branches de la sécurité sociale
(en
supposant l'absence de mesures sur les dépenses et les
recettes)
(en points de PIB)
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
Le principal enjeu de moyen terme est donc celui du rétablissement de l'équilibre de la sécurité sociale, et non de celui d'une maîtrise des dépenses que l'on aurait globalement perdue.
C. HORS DÉPENSES DE SANTÉ, UNE AUGMENTATION SPONTANÉE DES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE D'ENVIRON 0,6 POINT DE PIB D'ICI 2070
Il n'en demeure pas moins qu'à long terme, les dépenses de la sécurité sociale devraient tendre spontanément à augmenter un peu plus rapidement que le PIB, et donc à augmenter en points de PIB.
Si l'on suppose que l'on parvient à réduire la croissance des dépenses de santé de manière à ce qu'elle soit égale à celle du PIB, du fait des branches vieillesse et autonomie, en 2070 les dépenses de la sécurité sociale seraient supérieures d'environ 0,6 point de PIB à leur niveau en points de PIB de 2023.
Contribution des différentes branches de la
sécurité sociale
à l'augmentation spontanée des
dépenses (2024-2070)
(en points de PIB)
La « stabilisation maladie » correspond à la stabilisation des dépenses de la branche maladie en points de PIB.
Lecture : sans « stabilisation maladie », en 2070 les dépenses de la sécurité sociale, exprimées en points de PIB, seraient supérieures de 6,4 points de PIB à leur niveau de 2023.
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
Il ressort de ce graphique que les dépenses de la branche vieillesse augmenteraient de « seulement » 0,4 point de PIB entre 2024 et 2070 (elles passeraient en effet de 10 à 10,4 points de PIB). Pour mémoire, dans le cas des projections du COR (relatives à l'ensemble du système de retraite97(*), et transposées ici sur le périmètre de la branche vieillesse), les dépenses augmenteraient de seulement 0,24 point de PIB (passage de 13,94 points de PIB à 14,18 points de PIB). L'augmentation (de 1,3 point de PIB) du déficit de l'ensemble du système de retraite projetée par le COR de 2024 à 2070 provient en effet essentiellement de la diminution des recettes en points de PIB, du fait de la diminution de la part relative des régimes équilibrés par l'État.
VI. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
A. ENVIRON LA MOITIÉ DES SURCOÛTS DU VIEILLISSEMENT PAR RAPPORT À L'AN 2000 SE FONT DÉJÀ SENTIR
Afin d'isoler l'impact du vieillissement sur les finances sociales, on peut simuler l'impact qu'aurait, sur les dépenses de protection sociale actuelles, la pyramide des âges d'une autre année, par exemple 2000 ou 2040. Cela permet de faire l'économie des nombreuses hypothèses (économiques, juridiques...) nécessaires pour un exercice de projection.
Ainsi, selon Pierre-Yves Cusset, chef de projet à France Stratégie, en 2019, le vieillissement dégradait déjà le solde de 4,1 points de PIB, et en 2040, il le dégradera de 5 points de PIB supplémentaires (par rapport à 2019).
De ce point de vue, la France est « au milieu du gué ».
Dépenses et recettes de protection sociale
en 2019 simulées
avec une structure par âge
différente
(en milliards d'euros et en points de PIB)
Source : D'après un tableau transmis par Pierre-Yves Cusset aux rapporteures (données issues de : Pierre-Yves Cusset, « Protection sociale : le choc du vieillissement est-il (in)soutenable ? », La Note d'analyse n° 111, France Stratégie, juillet 2022)
B. Y A-T-IL DEVANT NOUS UN « MUR DU VIEILLISSEMENT » ?
On parle souvent d'un « mur du vieillissement ». En fait, il est pour l'essentiel déjà franchi.
1. Dans le cas des retraites, l'essentiel de l'effort a déjà été fait
Dans le cas des retraites, selon les projections du COR de juin 2025, le déficit du système de retraite, actuellement à peu près équilibré, augmenterait pour atteindre 0,7 point de PIB en 2040 (et 1,4 point de PIB en 2070).
À titre de comparaison, il ressort des simulations précitées de France Stratégie que si rien n'avait été fait, en 2019 le déficit du système de retraite aurait été accru de 4,1 points de PIB par rapport à 2000, et en 2040 il serait encore accru de 5 points de PIB supplémentaires par rapport à 2019.
2. Dans le cas de la santé, le vieillissement ne devrait pas beaucoup plus majorer la croissance des dépenses qu'actuellement
Dans le cas des dépenses de santé, les études disponibles suggèrent que le vieillissement, dont l'effet sur le solde aurait été négligeable jusqu'à la fin des années 199098(*), majorerait depuis le début des années 2000 la croissance annuelle des dépenses de plus de 0,5 point99(*), cet effet devant à peu près se maintenir jusqu'en 2040100(*).
Par ailleurs, dans le cas des dépenses de santé, le vieillissement n'est qu'un facteur de croissance parmi d'autres, avec en particulier le progrès technologique et ce que les économistes appellent l'« effet Baumol »101(*).
3. Dans le cas de l'autonomie, une augmentation des dépenses modeste en niveau mais importante rapportée aux dépenses de l'ensemble de la branche
Selon les projections de la Mecss indiquées ci-avant, sans mesures nouvelles de 2023 à 2070 le déficit de la branche autonomie augmenterait de seulement 0,6 point de PIB.
Toutefois cette projection « rassurante » ne traduit pas la totalité de la situation.
Tout d'abord, les dépenses de la branche ne correspondent qu'à une partie des dépenses publiques en faveur de l'autonomie, environ 1,5 fois plus élevées102(*). Ainsi, pour l'ensemble des dépenses publiques, l'augmentation des dépenses en faveur de l'autonomie entre 2023 et 2070 serait d'environ 1 point de PIB.
Ensuite, à l'échelle de la branche, cette augmentation des dépenses de 0,6 point de PIB d'ici 2070, et donc des capacités de prise en charge correspondantes, représente un défi considérable, d'autant plus que près de la moitié de la hausse aurait lieu d'ici 2040103(*).
Par ailleurs, la notion de « politiques inchangées » pourrait être peu adaptée s'agissant d'une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne104(*), dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l'autonomie105(*) passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le « scénario de référence », mais 4,8 points de PIB selon le « scénario de risque »106(*).
DEUXIÈME
PARTIE
RAMENER LA SÉCURITÉ SOCIALE À
L'ÉQUILIBRE
I. QUELLE ÉCHÉANCE POUR LE RETOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE ?
A. SELON LE GOUVERNEMENT DÉMISSIONNAIRE, UN OBJECTIF DE RETOUR DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À L'ÉQUILIBRE EN 2029
1. L'absence de document public affichant une trajectoire explicite de retour à l'équilibre
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'objectif de ramener à moyen terme la sécurité sociale à l'équilibre ne figure dans aucun document annexé aux PLFSS ou Placss, ni même dans aucun document public.
Cette situation a provoqué l'étonnement de plusieurs personnes auditionnées par les rapporteures.
En particulier, la projection à moyen terme annexée aux LFSS ne prévoit aucune mesure autre que celles déjà prévues.
Dans son premier plan budgétaire et structurel national à moyen terme (PSMT), transmis le 31 octobre 2024 à la Commission européenne, la France s'est engagée à ce que le déficit des administrations publiques passe sous le seuil de 3 points de PIB en 2029, avec un déficit de 2,8 points de PIB.
Il paraît donc logique de se fixer une cible de retour de la sécurité sociale à l'équilibre à cet horizon.
2. Un horizon de 2029 évoqué par la ministre des comptes publics
Ainsi, la ministre chargée des comptes publics a déclaré, le 19 avril 2025, que l'objectif était de ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2028-2029107(*). Elle l'a confirmé au Sénat le 28 mai 2025, lors des questions d'actualité au Gouvernement108(*), puis le 23 juin 2025, lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes (Placss) pour 2024109(*).
De même, lors de son audition par les rapporteures, le directeur de la sécurité sociale a indiqué que le Gouvernement souhaitait ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029. Il a précisé que si l'on prolongeait la projection annexée à la LFSS 2025, qui prévoyait un déficit de 24,1 milliards d'euros en 2028, on obtenait un déficit d'environ 25 milliards d'euros en 2029. Comme par ailleurs l'hypothèse de croissance de l'Ondam de 2,9 % par an en valeur impliquait des mesures de 15 milliards d'euros sur quatre ans110(*), cela impliquait de prendre d'ici 2029 des mesures d'amélioration du solde d'environ 40 milliards d'euros.
B. UN OBJECTIF AMBITIEUX, MAIS ATTEIGNABLE, D'AMÉLIORATION DU SOLDE
Ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029 est un objectif ambitieux, mais atteignable.
En effet, en supposant que les hypothèses de croissance de la LFSS pour 2025 se réalisent111(*), cela implique des mesures d'amélioration du solde d'environ 40 milliards d'euros en quatre ans, soit 10 milliards d'euros par an.
Comme on l'a vu supra, dans les années 2010 la sécurité sociale a été ramenée à l'équilibre structurel dès 2014 (le solde structurel s'étant ensuite dégradé jusqu'à la crise sanitaire). Un tel objectif ne paraît donc pas irréaliste.
La sécurité sociale devrait vraisemblablement être ramenée à l'équilibre au plus tard en 2035. En effet, à défaut un nouveau transfert de dette sociale à la Cades pourrait impliquer une durée d'amortissement excessivement longue sans augmentation des ressources de celle-ci (cf. infra).
On calcule que dans un scénario de croissance du PIB de 1 % par an en volume, plus cohérent avec une croissance potentielle d'environ 1 % et un effort de réduction du déficit, l'effort à accomplir serait majoré de 15 milliards d'euros. L'effort à accomplir serait donc d'environ 55 milliards d'euros en quatre ans, soit 14 milliards d'euros par an.
À titre de comparaison, les mesures d'amélioration du solde de la LFSS pour 2025 ont été de 9 milliards d'euros (à peu près également réparties entre économies et augmentations de recettes)112(*). De 2011 à 2019, elles ont été de 9 milliards d'euros par an (dont les deux tiers d'économies), avec des différences importantes selon la période considérée : de 2011 à 2014 elles ont été de près de 12 milliards d'euros par an (dont près de 7 milliards d'euros sur les recettes), alors que de 2015 à 2019 elles ont été de seulement 6 milliards d'euros par an (en totalité sur les dépenses).
Point d'accord n° 1 : Ramener la sécurité sociale à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
II. DES OPTIONS LIMITÉES ?
Le présent rapport présente en annexe IV un chiffrage des principales mesures envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre.
Dans les développements ci-après, les rapporteures se sont efforcées de présenter les principaux enjeux, en distinguant ce qui relève du constat de ce qui relève du choix politique.
A. POUR RESPECTER LA TRAJECTOIRE D'ONDAM DE LA LFSS 2025, RÉALISER UN EFFORT NET SUR L'ONDAM D'ENVIRON 4 MILLIARDS D'EUROS PAR AN
1. La maîtrise de l'Ondam, une nécessité pour que la sécurité sociale reste finançable à long terme
Comme on l'a vu dans la première partie, laisser les dépenses de la branche maladie suivre leur tendance spontanée conduirait à les porter de 9 à 15 points de PIB d'ici 2070.
Une telle évolution ne pourrait manifestement pas être financée, que ce soit par des baisses de dépenses ou des augmentations de prélèvements obligatoires. L'absence de maîtrise des dépenses de santé conduirait donc inévitablement à la « désocialisation » d'une part importante de celles-ci, ce que, selon les rapporteures, il convient d'éviter, afin de préserver notre modèle de protection sociale.
Aussi, la prévision pluriannuelle annexée à la LFSS pour 2025 fixe un objectif de croissance de l'Ondam de 2,9 % par an en valeur, correspondant à peu près à la prévision de croissance du PIB en valeur. Si l'on considère que les dépenses de la branche maladie tendent spontanément à augmenter de 4,5 % par an en valeur, cela implique un effort annuel d'environ 4 milliards d'euros (net des mesures coûteuses).
2. Des mesures de maîtrise de l'Ondam déjà d'environ 4 milliards d'euros par an
Il n'existe quasiment pas de données d'exécution relatives aux mesures de maîtrise de la dépense. La DSS n'a pas été en mesure de transmettre aux rapporteures un chiffrage récapitulatif des mesures mises en oeuvre ces dernières années.
L'annexe des différents PLFSS relative à l'Ondam comprenait toutefois jusqu'en 2021113(*) des données prévisionnelles, synthétisées jusqu'en 2020 par un rapport de 2021 du HCAAM114(*).
Sur la période 2015-2021, celles-ci se sont élevées à 4 milliards d'euros en moyenne, comme le montre le tableau ci-après.
Synthèse des mesures prévisionnelles
de maîtrise de l'Ondam
indiquées par les documents
annexés aux PLFSS (2015-2021)
(en milliards d'euros)
|
Volume |
Prix |
Prise en charge |
Total |
|
|
Maîtrise médicalisée, tarifs et pertinences des actes et produits (conventions médicales, promotion des génériques et biosimilaires, etc.) |
0,5* |
0,5* |
1,0 |
|
|
Parcours de soins (chirurgie ambulatoire, alternatives à l'hospitalisation, réduction des hospitalisations évitables, etc.) |
0,3 |
0,3 |
||
|
Arrêts de travail, transports de patients |
0,3 |
0,3 |
||
|
Efficience administrative des hôpitaux (essentiellement optimisation des achats) |
0,7 |
0,7 |
||
|
Tarifs et remises des produits de santé |
1,3 |
1,3 |
||
|
Lutte contre la fraude |
0,1 |
0,1 |
||
|
Mise à contribution des patients et complémentaires |
0,3 |
0,3 |
||
|
Total |
1,1 |
2,5 |
0,4 |
4,0 |
Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les efforts sur la masse salariale des établissements de santé.
* Répartition conventionnelle par la Mecss.
Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021
Les rapporteures se sont efforcées, à titre indicatif, de ventiler les mesures selon qu'elles visent à agir sur les volumes, sur les prix ou sur la prise en charge. Ainsi, sur les 4 milliards d'euros d'économies annuelles, 2,5 milliards d'euros auraient porté sur les prix (prix des médicaments, prix des achats hospitaliers, dans une moindre mesure rémunération des soins de ville).
Ce tableau doit être considéré avec prudence. En particulier, il ne concerne que les prévisions associées aux PLFSS, et il est probable que les mesures n'ont pas toutes été mises en oeuvre ou eu les rendements attendus. Ainsi, selon la Cour des comptes, en 2024, les économies auraient été inférieures de 25 % aux objectifs (cf. encadré). Par ailleurs, certains chiffrages sont contestables115(*). En outre, le tableau ne prend pas en compte d'autres instruments de maîtrise des coûts, comme la maîtrise de la masse salariale.
Le non-respect des objectifs de mesures de
maîtrise de l'Ondam en 2024,
selon la Cour des
comptes
« En 2024, selon des informations disponibles partiellement, les mesures de maîtrise des dépenses n'ont été qu'en partie mises en oeuvre. Sur un objectif de 4,4 milliards d'euros, la part non réalisée peut être estimée entre 0,7 milliard d'euros et 1,1 milliard d'euros, soit jusqu'à 25 % de l'objectif. Le doublement des franchises et participations des usagers est intervenu plus tardivement que prévu et les baisses de prix de produits de santé ont été inférieures aux attentes. Les montants de maîtrise médicalisée des dépenses de santé (720 millions d'euros attendus) ne sont pas encore disponibles. Les mesures de prévention en santé en vue de réduire la dépense de santé demeurent limitées (25 millions d'euros pour la vaccination antigrippale).
« Suivi de l'exécution des mesures de maîtrise des dépenses de l'Ondam en 2024 inscrites en loi de financement de la sécurité sociale, selon la Cour des comptes
(en milliards d'euros)
« Notes : la comparaison entre économies ex ante et ex post n'est pas aisée en méthodologie. Entre ces différentes séries d'économies, il est possible d'avoir une vision ex post précise pour certaines (participations financières et franchises mesurées mensuellement par la Cnam, baisses de prix des médicaments, etc.). Pour d'autres, la mise en oeuvre n'est pas directement observable (maîtrise médicalisée des dépenses de santé, mesures en établissements de santé).
« Le résultat de la lutte contre les fraudes correspond au montant de préjudice détecté et stoppé par la Cnam.
« Sources : Cour des comptes d'après les données de la DSS, de la DGOS, du CEPS, de la Cnam, et les annexes Ondam du PLFSS et Maladie du Placss »
Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
Ce montant de 4 milliards d'euros par an est cohérent avec les estimations disponibles par ailleurs. Ainsi, selon un rapport116(*) de l'Igas et de l'IGF, sur la période 2005-2012, la croissance de l'Ondam, de 3,2 % par an en moyenne, aurait résulté d'une croissance spontanée de 4,4 % et de mesures de régulation de 1,2 point (soit environ 3 milliards d'euros).
La maîtrise médicalisée des dépenses (environ 0,5 milliard d'euros par an)
Les seules mesures suivies en exécution dans des documents publics sont celles relatives à la maîtrise médicalisée des dépenses, d'environ 0,5 milliard d'euros par an (pour un objectif annuel d'environ 0,6 milliard d'euros). Ce suivi est assuré par la Cnam, qui renseigne l'indicateur correspondant du rapport sur l'évaluation des dépenses de sécurité sociale (Repss) relatif à la santé117(*).
En moyenne, et en chiffres arrondis, la maîtrise médicalisée se serait répartie depuis 2005 entre environ 0,3 milliard d'euros pour les prescriptions de médicaments (dont 20 % pour la réduction de la surprescription de statines118(*)), 0,1 milliard d'euros pour d'autres prestations et 0,1 milliard d'euros pour les transports médicalisés et les arrêts de travail.
3. Les propositions faites par la Cour des comptes en avril 2025 et par la Cnam en juillet 2025 ont seulement pour objet de permettre le respect de l'Ondam prévu par la LFSS pour 2025
a) Des propositions très proches par leur nature
La Cour des comptes, dans sa note sur l'Ondam d'avril 2025119(*), et la Cnam, dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025120(*), proposent des mesures devant permettre de réaliser des économies de respectivement 19,7 milliards d'euros d'ici 2029 (soit environ 5 milliards d'euros par an) et 22,5 milliards d'euros d'ici 2030 (soit environ 4,5 milliards d'euros par an).
S'y ajoutent quelques mesures relatives aux recettes, qui portent ces montants à respectivement 20,4 et 25,0 milliards d'euros. Dans le cas de la Cour, il s'agit de majorer les transferts de la branche AT-MP à la branche maladie (ce à quoi la commission s'est opposée en 2024121(*) et qui en tout état de cause n'a pas d'effet sur le solde de la sécurité sociale). Dans le cas de la Cnam, il s'agit de compenser la tendance spontanée de ses recettes à diminuer en points de PIB, du fait du faible dynamisme de certaines recettes (comme les droits tabac, en diminution structurelle)122(*).
Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, il ne s'agit pas de ramener la branche maladie à l'équilibre, mais seulement de permettre le respect de la trajectoire de l'Ondam prévue jusqu'en 2028 par la LFSS pour 2025 (qui prévoit un déficit de la branche maladie de 16,8 milliards d'euros en 2028).
Les mesures proposées sont très proches (cf. tableau).
Les propositions de mesures d'amélioration
du solde à moyen terme
de la Cour des comptes et de la
Cnam
(en milliards d'euros)
|
Amélioration du solde en 2029 (Cour des comptes) ou 2030 (Cnam) |
||
|
Cour des comptes |
Cnam |
|
|
Lutte contre la fraude |
1,5 |
3,0 |
|
« Mieux lutter contre les fraudes dans les trois branches de la sécurité sociale qui financent l'Ondam » (proposition n° 1) |
1,5 |
|
|
« Lutte contre les fraudes » |
3,0 |
|
|
Prévention /prise en charge des maladies chroniques |
1,4 |
0,5 |
|
« Améliorer la détection et la prise en charge des maladies chroniques » (proposition n° 6) |
0,4 |
|
|
« Améliorer la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et viser une réduction des chutes et des décès induits » (proposition n° 7) |
1,0 |
|
|
« Développer la prévention secondaire et tertiaire pour réduire la prévalence des maladies chroniques et leurs complications » |
0,5 |
|
|
Pertinence des soins |
4,4 |
4,0 |
|
« Amplifier la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et réduire les écarts de dépenses de santé atypiques constatés entre départements » (proposition n° 2) |
2,8 |
|
|
« Poursuivre le virage ambulatoire dans les établissements de santé » (proposition n° 8) |
0,8 |
|
|
« Viser l'amélioration de la qualité des soins pour réduire les évènements indésirables graves en établissements de santé » (proposition n° 9) |
0,8 |
|
|
« Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système » |
4,0 |
|
|
Parcours de soins/carte sanitaire |
1,0 |
2,0 |
|
« Dans la perspective d'organisation régionale des parcours de soins, restructurer les services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins » (proposition n° 10) |
1,0 |
|
|
« Organisation des parcours et du lien ville-hôpital : mieux prendre en charge les pathologies chroniques » |
2,0 |
|
|
Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |
1,7 |
3,0 |
|
« Dans une démarche partenariale et pluriannuelle avec les organismes complémentaires de santé, rééquilibrer les prises en charge des dépenses de santé » (proposition n° 11) |
1,3 |
|
|
« Mieux responsabiliser les assurés » (proposition n° 15) |
0,4 |
|
|
Stabilisation de la répartition des dépenses entre la sécurité sociale et les complémentaires santé par rapport à 2025 |
3,0 |
|
|
Produits de santé |
5,3 |
6,0 |
|
« Poursuivre la baisse des prix des produits de santé et accentuer les actions en faveur de leur bon usage » (proposition n° 5) |
5,3 |
|
|
« Produits de santé : assurer une régulation compatible avec la soutenabilité de notre système de santé » |
6,0 |
|
|
Rémunération des professionnels de santé |
0,0 |
2,0 |
|
« Régulation sectorielle : prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière » |
2,0 |
|
|
Efficience administrative |
0,6 |
0,0 |
|
« Optimiser la gestion des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics et privés à but non lucratif » (proposition n° 4) |
0,6 |
|
|
Indemnités journalières |
0,5 |
2,0 |
|
« En concertation avec les partenaires sociaux, alléger la charge pour l'assurance maladie obligatoire des indemnités journalières maladie des salariés » (proposition n° 13) |
0,5 |
|
|
« Arrêts de travail : ajuster les dispositifs de prise en charge des indemnités journalières » |
2,0 |
|
|
Transport sanitaire |
0,3 |
0,0 |
|
« Réduire la progression des dépenses de transport sanitaire » (proposition n° 3) |
0,3 |
|
|
Bonne pratique |
3,0 |
0,0 |
|
« Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS » (proposition n° 14) |
3,0 |
|
|
Total des mesures sur les dépenses |
19,7 |
22,5 |
|
Neutralisation de la tendance spontanée des recettes à diminuer en points de PIB (mesures sur les recettes) |
2,5 |
|
|
« Fixer le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie au niveau médian de l'estimation de la commission chargée de l'évaluation de la sous-déclaration des maladies professionnelles (2,8 Md€) » (proposition n° 12) |
0,8 |
|
|
Total des mesures |
20,4 |
25,0 |
Ces propositions sont présentées de manière plus détaillée dans les annexes IV et V au présent rapport.
Pour faciliter la lecture, les chiffrages indiqués sous forme de fourchette ont été remplacés par une moyenne.
Sources : D'après :
- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025
- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
b) Les propositions de la Cour des comptes
Comme le président de la sixième chambre de la Cour des comptes l'a souligné lors de son audition par la commission le 30 avril 2025, cette contribution à la revue de dépenses publiques s'appuie sur des travaux existants. Il était selon lui possible d'aller bien plus loin, en particulier dans le cas de la prévention.
La direction de la sécurité sociale estime que les mesures proposées ne sont pas toutes susceptibles de produire les montants d'économies avancés à horizon 2029. Elle souligne en outre qu'il était déjà prévu de suivre certaines pistes : transport sanitaire (protocole en cours de négociation), programme Phare, augmentation des taux d'activité ambulatoire, lutte contre la fraude.
La proposition n° 12 n'a pas d'effet sur le solde global de la sécurité sociale, et n'entre donc pas dans le champ du présent rapport.
La proposition n° 13, relative aux indemnités journalières, renvoie aux propositions plus détaillées figurant dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024.
c) Les propositions de la Cnam
Les 60 propositions de la Cnam, synthétisées dans l'annexe IV au présent rapport, sont intégralement reproduites dans son annexe V.
La Cnam propose de réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici 2030 par le levier intitulé « Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système ». La Cnam préconise notamment de mieux permettre aux professionnels de santé de comparer leurs pratiques à celles de leurs pairs, d'assurer une utilisation systématique du dossier médical partagé (DMP) en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP (biologie-radiologie en priorité), de rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec intelligence artificielle) et de sécuriser « l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».
La Cnam évalue les économies permises par la lutte contre la fraude à 3 milliards d'euros en 2030 (contre 1,5 milliard d'euros pour la Cour des comptes). Les rapporteures ne sont pas en mesure d'apprécier le réalisme de cet objectif, qui implique notamment une estimation du montant global de la fraude nettement supérieure à celle retenue jusqu'à présent par la Cnam (cf. infra).
La Cnam propose de transférer 3 milliards d'euros de charges vers les complémentaires santé, correspondant à son estimation de ce qui est nécessaire pour que les parts respectives de l'assurance maladie et des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses de santé reste constante d'ici 2030123(*).
On peut s'étonner du faible montant des économies devant résulter du développement de la prévention. Selon l'introduction au rapport « charges et produits » du directeur général de la Cnam, il faut « une mobilisation massive en faveur de la prévention, qui doit être la grande cause de la décennie ». Pourtant, les économies attendues d'ici 2030 en ce domaine sont de seulement 0,5 milliard d'euros (contre 1 milliard d'euros pour la Cour des comptes, rien que pour les personnes âgées).
d) Par rapport à la pratique 2015- 2021, les propositions de la Cour des comptes reposent nettement plus sur les volumes, celles de la Cnam nettement plus sur la lutte contre la fraude, les volumes et la prise en charge
Le tableau ci-après répartit les mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles concernent les volumes, les prix ou la prise en charge.
Répartition des mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles agissent sur les volumes, les prix ou la prise en charge
(en milliards d'euros)
|
Cour des comptes (économie en 2029) |
Cnam (économie en 2030) |
|
|
Propositions réduisant les volumes |
8,3 |
6,5 |
|
Prévention /prise en charge des maladies chroniques |
1,4 |
0,5 |
|
Pertinence des soins |
4,4 |
4,0 |
|
Parcours de soins/carte sanitaire |
1,0 |
2,0 |
|
Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les volumes* |
1,5 |
0,0 |
|
Propositions réduisant les prix |
7,4 |
8,0 |
|
Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les prix* |
1,5 |
|
|
Produits de santé |
5,3 |
6,0 |
|
Rémunération des professionnels de santé |
0,0 |
2,0 |
|
Efficience administrative |
0,6 |
0,0 |
|
Propositions réduisant la prise en charge |
2,5 |
5,0 |
|
Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |
1,7 |
3,0 |
|
Indemnités journalières |
0,5 |
2,0 |
|
Transport sanitaire |
0,3 |
0,0 |
|
Lutte contre la fraude |
1,5 |
3,0 |
|
Total des mesures sur les dépenses |
19,7 |
22,5 |
* Convention.
Sources : Mecss du Sénat, d'après :
- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025
- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, la maîtrise de la dépense cesserait de reposer majoritairement sur les prix : les mesures concernées passeraient de 60 % en 2015-2021 (en prévision) à 35 %.
Toutefois ce résultat serait atteint par des moyens différents. Dans le cas de la Cour des comptes, il s'agirait à peu près exclusivement d'agir davantage sur les volumes (les mesures concernées passant de 0,8 milliard d'euros par an à 2,1 milliards d'euros par an). Dans le cas de la Cnam, le montant des mesures relatives aux volumes augmenterait moins (passant de 0,8 milliard d'euros à 1,3 milliard d'euros), la maîtrise de la dépense reposant presque autant sur les mesures relatives à la prise en charge (passant de 0,6 à 1 milliard d'euros) ou sur la lutte contre la fraude (passant de 0,1 à 0,6 milliard d'euros).
Répartition des mesures proposées
par la Cour des comptes et la Cnam
selon qu'elles agissent sur les volumes,
les prix ou la prise en charge : comparaison avec la pratique
passée
(en milliards d'euros par an)
* Données prévisionnelles. Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021.
** Mecss du Sénat, d'après Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
*** Mecss du Sénat, d'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
4. Limiter le coût des dépenses de médicaments ?
a) La forte augmentation des dépenses de médicaments depuis 2020
On assiste depuis 2020 à une forte croissance des dépenses de médicaments, comme le montre le graphique ci-après.
Dépenses de santé remboursées par la sécurité sociale
(en millions d'euros)
Remarque : les montants remboursés bruts sont les montants calculés sur la base des prix faciaux, les montants nets sont calculés après reversements des remises des laboratoires pharmaceutiques à l'Assurance maladie et les montants super-nets sont calculés postremboursement de la clause de sauvegarde (et correspondent donc à la dépense effective de l'Assurance maladie).
Source : D'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Alors que le nombre de boîtes vendues est plutôt orienté à la baisse, et que le prix des médicaments déjà sur le marché tend à baisser au fil du temps, cet effet provient de l'introduction sur le marché de nouveaux médicaments, ainsi que de la déformation de la consommation au profit de médicaments plus récents et plus chers (« effet structure »).
L'encadré ci-après rappelle les principaux outils de régulation du médicament.
Les principaux outils de régulation du médicament
La fixation initiale du prix
L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est attribuée par l'Agence européenne du médicament (EMA) ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
La commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) rend alors un avis évaluant le service médical rendu (SMR) et l'amélioration du service médical rendu (ASMR). Dans le cas des médicaments se revendiquant innovants (ASMR I à III) et pouvant avoir un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie, la commission économique et de santé publique (Ceesp) de la HAS évalue l'efficience sur la base des données médico-économiques.
Le SMR détermine le niveau de prise en charge par l'assurance maladie (à 65 %, 30 % ou 15 %). L'ASMR et l'efficience sont quant à elles prises en compte par le comité économique des produits de santé (CEPS) lors de sa négociation du prix avec les industriels.
Les modalités de prise en charge par l'assurance maladie et le prix sont décidés par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les autres outils de régulation
Parmi les autres outils de régulation, on peut en particulier mentionner :
- la « clause de sauvegarde », instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999124(*). Il s'agit d'une « corde de rappel budgétaire », destinée à permettre le respect de l'Ondam dans le cas où les outils de régulation infra-annuelle et microéconomique du secteur ne permettraient pas de respecter le niveau de dépenses d'assurance maladie prévu. Depuis la LFSS pour 2019125(*), la clause de sauvegarde des médicaments se déclenche lorsque l'activité du secteur dépasse le seuil déterminé, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile par l'ensemble des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est supérieur au montant M fixé annuellement en LFSS. Dans ce cas, l'ensemble de ces entreprises est assujetti à une contribution, affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)126(*). En 2025, pour la troisième année consécutive, son rendement devrait s'élever à environ 1,6 milliard d'euros ;
- les remises tarifaires négociées par le CEPS ;
- les campagnes de baisses de prix conduites par le CEPS, en application de la loi, et devant permettre une diminution progressive des prix applicables dans le cycle de vie du médicament.
b) Les principales propositions pour maîtriser les dépenses de médicaments
(1) Les propositions de la Cour des comptes dans le cas des médicaments anticancéreux (2024)
Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2024127(*), la Cour des comptes a fait diverses recommandations relatives à la régulation des médicaments anticancéreux. Il s'agissait en particulier :
- de faire en sorte que la commission d'évaluation économique et de santé publique (Ceesp) de la Haute Autorité de santé (HAS) produise elle-même des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques ;
- de définir des valeurs de référence pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé) ;
- de mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, l'exploitation de données en « vie réelle » devant permettre d'observer si les résultats étaient cohérents avec ceux des essais ;
- de renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque les études montraient des résultats inférieurs à ceux attendus.
Les recommandations de la Cour des comptes
relatives à la régulation
des médicaments
anticancéreux
« 18. renforcer la capacité de la commission d'évaluation économique et de santé publique à produire des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques, en s'appuyant notamment sur les universités (Haute Autorité de santé) ;
19. en se fondant sur les études médico-économiques et en vue de la négociation du prix des médicaments, définir des valeurs de référence pour l'indicateur exprimant le rapport entre les différentiels de coût et d'efficacité entre un nouveau médicament et un médicament comparable existant (Haute Autorité de santé, Comité économique des produits de santé) ;
20. mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, financé par une contribution des laboratoires concernés (ministère du travail, de la santé et des solidarités, Institut national du cancer) ;
21. renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque des études, non disponibles au moment de la fixation du prix initial, montrent des résultats inférieurs à ceux attendus (Comité économique des produits de santé). »
Source : Cour des comptes, « Les médicaments anti-cancéreux : mieux réguler en préservant un accès rapide aux traitements innovants », in La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
(2) Les propositions du rapport « charges et produits »
Dans le rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam reprend, dans sa proposition n° 26, l'objectif de baisse de prix des médicaments anticancéreux (ce qu'elle appelle « le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie »).
Elle étend l'objectif de baisse des prix aux médicaments présentant l'amélioration du service médical rendu (ASMR) la plus faible, dont le coût par patient est en forte augmentation (cf. graphique ci-après), et souligne la nécessité de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques, auxquels s'ajoutent désormais les médicaments biosimilaires128(*).
Comparaison de la dépense remboursable, nette de remises, par patient, selon le niveau d'amélioration du service médical rendu (ASMR) entre 2017 et 2024
ASMR : amélioration du service médical rendu (ASMR I = la plus élevée ; ASMR V = la plus faible).
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
La Cnam envisage également, comme « option », de « reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030 ».
Les propositions du rapport « charges
et produits » de la Cnam
de juillet 2025 pour
maîtriser les dépenses de médicaments
Proposition 25 : Garantir une hiérarchie des prix cohérente avec le progrès thérapeutique des médicaments
- Réaliser des baisses de tarifs sur les ASMR IV représentant une baisse de 20 % des coûts par patient d'ici 2030 afin de compenser la forte hausse des coûts depuis 2017
- Réaliser des baisses de tarifs sur les médicaments à ASMR V afin de retrouver le niveau de dépenses observé en 2019
- Compte tenu de l'augmentation des dépenses de médicaments et du déficit de la sécurité sociale, il est nécessaire d'accroitre le niveau d'économies générées par ces produits en leur permettant de rentrer dans le panier de soins remboursable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- Les médicaments ASMR V (sous brevet) acceptent une baisse de prix de 20 % minimum par rapport au prix net du comparateur le moins cher
- Les médicaments ASMR IV acceptent une baisse de prix par rapport au prix net du comparateur le moins cher
- Dans les deux cas ci-dessus, les prix nets sont alignés aux prix faciaux.
Proposition 26 : Enrayer le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie
- Revoir la politique de tarifs excessifs sur les médicaments anti-cancéreux
- Réinterroger le remboursement de certains médicaments anticancéreux ne présentant aucun résultat probant dans le cadre de leurs essais cliniques et exiger des données probantes dans le cadre des nouvelles inscriptions
Proposition 27 : Instaurer un mécanisme permettant de faire financer par les acteurs du médicament et l'Assurance Maladie les essais thérapeutiques en lien avec la désescalade thérapeutique
Proposition 28 : Augmenter les économies en lien avec les génériques et biosimilaires
- Appliquer aux médicaments biosimilaires, l'ensemble des dispositifs ayant permis une pénétration forte des médicaments générique : tiers payant contre biosimilaires, alignement des remboursements bioréférents, biosimilaires au bout de deux ans de commercialisation du biosimilaires...
- Empêcher les stratégies de contournement des laboratoires par la constitution de groupe de médicaments interchangeables (« jumbo groups »)
- Les génériques génèrent des économies substantielles pour l'Assurance Maladie. Le délai d'entrée en vigueur de leur prise en charge sur la base du tarif de remboursement ajusté (TRA) est aujourd'hui de 2 ans. Or, compte tenu de la nécessité d'accélérer leur pénétration, ce délai doit être réduit à un an et leur base de remboursement pourrait être modifiée au profit de celle du générique le moins cher.
Proposition 29 : Accélérer les négociations pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce
- Renforcer les incitations au débouclage en limitant dans le temps la durée de la négociation pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce
Option non consensuelle* présentée au Conseil de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie sur le médicament
Reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
(3) Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils
Dans leur récent rapport129(*) au Premier ministre, les trois Hauts Conseils font pour l'essentiel des préconisations analogues à celles de la Cour des comptes et de la Cnam.
Ce rapport reprend l'essentiel des recommandations de la Cour des comptes relatives à la régulation des médicaments anticancéreux, en les étendant à l'ensemble des médicaments innovants. Il préconise, comme la Cnam, de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques et biosimilaires.
Il préconise en outre de « revenir sur l'extension de la liste en sus »130(*), qui depuis 2022 concerne notamment des médicaments dont l'amélioration du service médical rendu (ASMR) est mineure.
Les propositions du rapport des trois Hauts
Conseils
pour maîtriser les dépenses de
médicaments
• « La diffusion du générique au sein du répertoire est aujourd'hui acquise : la part du répertoire, le biosimilaire et les médicaments hybrides constituent de nouvelles marges d'efficience »
Le rapport préconise :
- d'augmenter la proportion de médicaments inscrits au répertoire. En effet, le taux de pénétration des génériques (92,7 % en 2023) est calculé sur la base des seuls médicaments dits « inscrits au répertoire », qui en 2024 ont représenté seulement 1,2 milliard de boîtes (soit 9,7 milliards d'euros), sur un total de médicaments remboursables correspondant à 2,4 milliards de boîtes (30,2 milliards d'euros)131(*). Il en résultait en 2021 un taux de pénétration sur la totalité du marché de seulement 30 % en nombre de boîtes, contre 52 % pour l'ensemble de l'OCDE132(*). Bien que, selon la Cnam, la France se situe dans la moyenne européenne après correction pour prendre en compte le Doliprane, elle n'en a pas moins un taux de pénétration plus faible que, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas133(*). Ainsi, selon le rapport « il est nécessaire que l'ANSM fasse évoluer sa politique d'inscription dans le répertoire pour la rapprocher des autres pays européens et de prendre des dispositions pour lutter contre les techniques de contournements des laboratoires (bithérapie changement de dosage...) » ;
- d'augmenter le taux de pénétration des biosimilaires, de seulement 32 %, en recourant aux « outils qui ont permis au générique d'atteindre ses niveaux actuels de substitution : alignement des marges des pharmacies d'officine pour encourager la substitution, tiers payant contre biosimilaires ».
• « Revenir sur l'extension de la liste en sus »
Un décret a ouvert, à compter du 1er janvier 2022, l'inscription sur la « liste en sus »134(*) à tous les médicaments auxquels la commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) a reconnu une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV). Cette mesure était alors présentée comme coûtant 370 millions d'euros sa première année.
• « Nécessité d'améliorer l'utilisation des données en vie réelle sur les médicaments innovants »
Un dispositif dit d'« accès précoce » permet, pour des maladies graves, rares ou invalidantes, la prise en charge par l'assurance maladie de médicaments innovants non encore titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM)135(*).
Le rapport préconise de mettre en oeuvre, pour l'ensemble des médicaments innovants, les recommandations 20 et 21 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes : « La contrepartie de l'accès précoce au marché de médicaments innovants devrait être l'exploitation de données en vie réelle permettent d'observer si les résultats sont cohérents avec ceux des essais. [...] Or, contrairement à plusieurs pays européens, la France ne dispose pas de registre national permettant de suivre en vie réelle les innovations thérapeutiques des médicaments anticancéreux et leurs résultats, hormis celui existant pour les traitements par cellules CAR-T. Cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense ».
• « Nécessité d'améliorer l'évaluation médico-économique et son utilisation »
Conformément aux recommandations 18 et 19 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes, le rapport préconise :
- que la Ceesp réalise elle-même les évaluations (au lieu de s'appuyer sur celles des industriels) ;
- que, pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé), elle publie, à titre de référence indicative, une valeur plafond que ce ratio ne devrait pas excéder136(*). Selon le rapport, « cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense, et donnera l'occasion de questionner l'acceptabilité du coût des médicaments onéreux dans leur ensemble. Le désarmement partiel de l'outil des baisses de prix a contribué à l'accélération de la dynamique des dépenses de médicaments. La situation financière de l'assurance-maladie ne permet pas aujourd'hui de faire l'économie de ce levier ».
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
5. Améliorer la pertinence des soins ?
a) Des incitations encore insuffisantes
(1) La situation actuelle pour la médecine de ville
(a) La rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp)
Dans le cas de la médecine de ville, la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), instaurée en 2012, est définie par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. La convention actuellement en vigueur, approuvée par arrêté le 20 juin 2024, supprime la Rosp à compter de 2026 (pour versement en 2027), du fait de l'instauration du forfait médecin traitant (intégrant les majorations prévention).
La Rosp correspond à environ 15 % des honoraires des médecins généralistes et 1 % de ceux des médecins spécialistes137(*). En 2022, 64 824 médecins ont été rémunérés dans le cadre de la Rosp « médecin traitant de l'adulte », pour un montant total de 264,6 millions d'euros (ce qui correspond à un montant moyen d'environ 4 000 euros).
Les indicateurs de la Rosp sont retracés chaque année dans le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).
Évolution des indicateurs de la
rémunération
sur objectifs de santé publique
(Rosp)
Optimisation des prescriptions
Remarques :
- Les graphiques concernent les conventions de 2011 et 2016, qui ne retiennent pas nécessairement les mêmes définitions.
- Pour favoriser la lisibilité des graphiques, les définitions des indicateurs ne sont pas reproduites ici.
- L'objectif peut correspondre à une hausse ou à une baisse.
Source : D'après le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023
Les résultats sont contrastés :
- dans le cas de la prévention, les seules avancées significatives sont la réduction du recours aux antibiotiques (toutefois toujours supérieur à l'objectif) et, depuis la crise sanitaire, le retour de la vaccination des personnes de 65 ans et plus, jusqu'alors en baisse, à son niveau de 2011 (sans que le lien avec l'action des médecins soit toutefois évident) ;
- dans le cas du suivi des pathologies chroniques, on peut mentionner l'augmentation du dosage de l'hémoglobine gliquée chez les patients diabétiques et du dépistage de la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques ou hypertendus (l'objectif n'étant toutefois atteint que dans ce dernier cas) ;
- dans le cas de l'optimisation des prescriptions, les principales avancées concernent le recours aux génériques (statines, antihypertenseurs, reste du répertoire) et aux biosimilaires (insuline glargine) - l'objectif n'étant toutefois pas atteint dans le cas des statines et du reste du répertoire.
Surtout, la Rosp est l'un des éléments de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui selon la Cnam ne permet globalement que des économies d'environ 500 millions d'euros par an. Si l'on veut réduire dans des proportions importantes la surconsommation de soins de ville, il faut donc aller plus loin.
(b) Les avancées récentes
L'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une utile règle procédurale.
Cet article prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé, d'un acte ou d'un transport de patient peut être subordonnée, « lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage », à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur et vérifié informatiquement, indiquant, « à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ».
La convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prévoit en outre de « renforcer les dispositifs de retour d'informations auprès des médecins ». Pour cela, l'assurance maladie doit notamment « partager avec l'ensemble des professionnels les référentiels de bonne pratique définis par la HAS et le ministère en charge de la santé et les informer des mises à jour » et « mieux outiller les médecins », ce qui implique en particulier de « mettre à disposition sur amelipro des outils de datavisualisation permettant aux médecins d'avoir un retour d'information sur leur pratique ». Les médecins doivent quant à eux « prescrire systématiquement via l'ordonnance numérique », ce qui doit notamment faciliter le suivi de leurs prescriptions.
Les médecins se sont également collectivement engagés à mettre en oeuvre des « programmes d'actions partagés » visant à améliorer la pertinence des soins.
Par ailleurs, la convention met en place des dispositifs d'intéressement, devant permettre un partage financier des économies permises par l'amélioration de la pertinence et de la sobriété des prescriptions (intéressement à la prescription de biosimilaires, intéressement à la dé-prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, etc.).
(2) La situation actuelle pour l'hôpital
Dans le cas des services hospitaliers, la Cour des comptes a souligné que les critères d'évaluation étaient insuffisamment tournés vers les résultats pour le patient.
La nécessité de davantage orienter
les critères d'évaluation des hôpitaux
vers les
résultats pour le patient, selon la Cour des comptes
Selon la Cour des comptes, « en 2016, le jeu des indicateurs de qualité utilisés par la HAS restait très centré sur les structures (76) et les processus (145), par comparaison avec les résultats pour le patient (39)114, tandis qu'en Allemagne, 308 indicateurs intéressaient les résultats des prestations de soins, contre seulement 19 pour les processus et quatre pour les structures. Tel est le cas aussi de l'Angleterre : 153 indicateurs suivis pour les résultats, 61 pour les structures et 12 pour les processus »138(*).
La Cour des comptes faisait déjà un constat analogue dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2002.
Les objectifs d'efficience fixés aux hôpitaux sont en effet de nature essentiellement administrative, comme dans le cas des gains achat (programme Phare).
Objectifs de gains achat fixés dans le cadre du programme Phare
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024
Les objectifs de régulation des dépenses et d'amélioration des pratiques au sein des établissements de santé font l'objet depuis 2018 de contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins (Caqes). En 2023, les gains correspondants ont été de seulement 45,2 millions d'euros, comme le montre le tableau ci-après.
Économies générées par indicateur régional des Caqes en 2023
|
Indicateur national |
Économies générées (en €) |
Nombre d'ES ciblés en 2023 (en €) |
Économies par ES ciblé (en €) |
|
Indicateur insuffisance cardiaque |
4 900 937 |
254 |
19 295 |
|
Indicateur examens pré-anesthésiques |
109 843 |
341 |
322 |
|
Indicateur Pansement |
3 134 852 |
113 |
27 742 |
|
Indicateurs transport |
29 663 493 |
335 |
88 548 |
|
Indicateur inhibiteurs pompes à protons |
540 182 |
186 |
2 904 |
|
Indicateur Perfadom |
6 841 199 |
343 |
19 945 |
|
TOTAL |
45 190 506 |
1 104 |
40 933 |
Caqes : contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins.
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024
La qualité des soins est prise en compte dans le cadre du financement hospitalier, au moyen de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (Ifaq). Toutefois celle-ci est d'un montant limité.
b) Trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte
Le récent rapport139(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre insiste sur la nécessité, pour améliorer la pertinence des prescriptions, de trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte.
L'incitation implique notamment un accès aisé du professionnel de santé à l'information pertinente. Tel n'est pas toujours le cas. Par exemple, la structuration du dossier médical partagé (DMP) peut amener le professionnel de santé à ouvrir de nombreux documents pour déterminer si l'examen qu'il prévoit a déjà été réalisé.
La seule mesure contraignante pour laquelle le rapport des trois Hauts Conseils prend explicitement parti140(*) est de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances numériques (en cours de déploiement141(*)). En effet, le fait qu'elle ne comporte pas actuellement de mention de l'indication thérapeutique, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays, empêche d'apprécier le mésusage. Afin de préserver le secret médical, l'accès à cette information, si elle devait figurer dans l'ordonnance numérique, devrait être strictement encadré. Si une exploitation statistique, éventuellement sur la base de données anonymisées, ne poserait probablement pas de difficulté, il conviendrait de définir strictement la liste des professionnels de santé pouvant, le cas échéant, y accéder142(*). Lors de son audition par les rapporteures, Yann-Gaël Amghar, président du HCAAM, a évoqué le cas du médecin-conseil de la Cnam, qui pourrait ainsi cibler ses contrôles a posteriori sur certains praticiens. L'adoption d'une telle mesure, qui existe déjà pour les examens de biologie143(*), impliquerait un débat approfondi.
Le rapport envisage également de rendre obligatoire l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) et la consultation du DMP, et d'étendre le champ de l'accompagnement à la prescription144(*), comme c'est le cas dans certains pays145(*).
Principaux outils visant à améliorer
la pertinence des soins
(actuels ou envisagés par le récent
rapport des trois Hauts Conseils)
|
Outils existants |
Outils envisagés par le rapport |
|
|
Outils non contraignants |
• Échanges numériques entre professionnels (exemple : DMP) • LAP |
• Amélioration de l'ergonomie du DMP (qui doit permettre au professionnel d'accéder facilement à l'information) et des LAP (qui doivent trouver le bon équilibre entre facilitation de la prescription et incitation au respect des recommandations) • Information des professionnels et des patients sur les coûts des prescriptions • Modification des modes de rémunération |
|
Outils contraignants |
• Prescription obligatoire de certains médicaments sur ordonnance sécurisée (exemple : Tramadol, un analgésique opioïde) • Limitation de la délivrance de certains produits (exemple : 7 jours pour les pansements) • Depuis le 1er janvier 2025, en application de la LFSS 2024, accompagnement à la prescription pour certains médicaments via un formulaire sur amelipro permettant de s'assurer que le contexte permet le remboursement (exemple : antidiabétiques AGLP-1) • Demandes d'accord préalable (traitement de l'apnée du sommeil par ventilation à pression positive continue (PPC) ou orthèse avancée mandibulaire (OAM), grand appareillage, chirurgie bariatrique...) • Prise en charge conditionnée à la réalisation d'un acte préalable (exemple : dans le cas du cancer de la prostate, prise en charge du PSA libre conditionnée au résultat du dosage du PSA total) • Mise du professionnel de santé sous objectifs ou sous accord préalable |
• Utilisation obligatoire d'un LAP • Consultation obligatoire du DMP • Extension du champ de l'accompagnement à la prescription, comme c'est le cas dans certains pays • « Il est indispensable de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances » |
AGLP-1 : antidiabétiques analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1). DMP : dossier médical partagé. LAP : logiciel d'aide à la prescription. PSA : Prostate Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate).
Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
c) Les propositions de la Cnam pour améliorer la pertinence des soins
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam fait 16 propositions pour renforcer la pertinence des soins.
Les propositions n° 41 et n° 42, contraignantes, consistent respectivement :
- à « rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) » et à « étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports) » ;
- à « sécuriser l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».
Les autres propositions tendent notamment à améliorer l'information des patients et des praticiens et à rendre le financement de l'hôpital plus incitatif à la qualité des soins.
Les propositions du rapport « charges
et produits » de juillet 2025
pour renforcer la pertinence
des soins
« Proposition 36 : Faire connaître l'investissement public dans la santé au global (campagnes sur le coût d'un accouchement, une nuit à l'hôpital, etc.) et restituer à chaque assuré ce que l'Assurance Maladie a réellement investi pour sa consommation de soins
Proposition 37 : Développer le « retour d'information aux PS » sur leurs pratiques afin de leur permettre d'adapter au mieux leur exercice professionnel par eux-mêmes, en se comparant à leurs pairs
Proposition 38 : À différents stades de la carrière du professionnel de santé conventionné, s'assurer de sa bonne connaissance des dispositifs de facturation et de l'état de l'art en matière de qualité et de pertinence
Proposition 39 : Assurer une utilisation systématique du DMP en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP-MES (biologie-radiologie en priorité)
Proposition 40 : Développer fortement la déprescription
Proposition 41 : Rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) et étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports)
Proposition 42 : D'ici 2030, viser la sécurisation de l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence
Proposition 43 : Mettre en place une plateforme de commandes de transports gérée par l'Assurance Maladie prioritairement à l'appui des médecins de ville
Proposition 44 : Diminuer l'impact carbone et environnemental des prescriptions et engager avec l'ANSM des travaux sur la réutilisation des produits de santé non-ouverts et non-périmés pour limiter le gaspillage
Proposition 45 : Déployer un nouveau dispositif d'intéressement des établissements, financé sur le risque, permettant de partager les gains réalisés en matière de PHEV (Prescriptions hospitalières exécutées en ville)
Proposition 46 : Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier, viser une part variable à la qualité et à la pertinence représentant un montant croissant de l'enveloppe financière des établissements de santé dispositif Ifaq rénové et simplifié (e.g. Rosp = 10 %)
Proposition 47 : Transférer aux établissements de santé le budget des transports des patients dialysés dont ils auront désormais la gestion
Proposition 48 : Revoir le financement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers durant un séjour d'hospitalisation en établissement public de santé
Proposition 49 : Dès 2026, revoir les modalités d'encadrement et la tarification de la PPC pour revenir à des standards proches de ceux observés à l'étranger
Proposition 50 : D'ici 2027, construire un dispositif de régulation sectorielle pour mieux encadrer les dépenses de dispositifs médicaux de la LPP
Proposition 51 : Renforcer la régulation à l'installation des infirmiers libéraux via l'extension des zones sur-denses et l'instauration d'une règle de « deux départs pour une installation » dans les zones très sur-dotées »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
6. Revoir l'organisation des soins ?
a) Améliorer les parcours de soins ?
La nécessité d'améliorer l'efficience des parcours de soins est reconnue depuis longtemps. Ainsi, de 2015 à 2021, les gains prévisionnels des actions en ce domaine étaient évalués par les annexes aux PLFSS à environ 0,3 milliard d'euros chaque année146(*).
L'idée qu'il faudrait aller plus loin semble faire consensus.
Il existe une inadéquation manifeste entre l'organisation des soins, centrée sur les établissements de santé et conçue pour traiter des pathologies aigues, et les pathologies actuelles, de plus en plus chroniques.
Une idée relativement consensuelle est qu'il convient de renforcer la gradation des soins, en développant l'exercice collectif en dehors des établissements de santé147(*) tout en renforçant l'articulation avec ceux-ci148(*), conformément à la politique menée depuis une dizaine d'années.
Une meilleure orientation des patients149(*) et le renforcement de la permanence des soins ambulatoires (PDSA)150(*) peuvent quant à eux réduire le nombre de passages aux urgences. Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « si l'on évitait, par une prise en charge adéquate, 20 % des passages aux urgences, on peut estimer à plus d'un milliard d'euros l'économie directe réalisée, et près de 2 milliards d'euros si l'on prend en compte les transports sanitaires associés et les hospitalisations consécutives pour les personnes âgées ». Ce rapport souligne en particulier que « parmi les établissements publics de santé, la moitié environ des séjours sont engendrés par des passages aux urgences, et les effets iatrogéniques sur des sujets vulnérables majorent ensuite le recours à des soins de réadaptation, voire à des admissions en institution pour personnes dépendantes ».
Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 préconise en particulier de créer de nouveaux métiers de « référent de parcours » et « d'infirmière de coordination ».
Le rapport précité des trois Hauts Conseils souligne que, d'un point de vue financier, le renforcement de la gradation des soins se heurte à une double difficulté. Tout d'abord, le renforcement des moyens en dehors de l'hôpital étant coûteux, le renforcement de la gradation des soins implique de réduire la capacité hospitalière. Ensuite, en supposant que ce soit effectivement le cas, une telle politique pourrait être coûteuse dans un premier temps, cette réduction ne survenant que dans un second temps.
Les principales propositions du rapport
« charges et produits »
de juillet 2025
relatives aux parcours de soins
« Proposition 11 : Organiser systématiquement la sortie d'hôpital en construisant un cadre opérationnel dans tous les territoires avec les CPTS et les établissements de santé pour assurer la gestion des sorties avec les professionnels de ville et le secteur médico-social
Proposition 12 : Créer de nouveaux métiers de « référents de parcours » et « d'infirmière de coordination », et généraliser la responsabilité populationnelle des organisations territoriales
[...] Proposition 17 : Établir le cahier des charges organisationnel et financier des structures de soins non-programmés parfois nécessaires à un territoire pour la prise en charge des urgences en ville, en coordination avec le médecin traitant et l'hôpital »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Les principales propositions organisationnelles du
récent rapport
des trois Hauts Conseils dans le cas de la
santé
« • Définir, conformément au code de santé publique, une stratégie nationale de santé (SNS) pluriannuelle (de 5 à 10 ans) déterminant des objectifs priorisés et qui propose des transformations du fonctionnement et du financement en profondeur du système de santé (cibles en termes d'exercices coordonnés, de rémunération actes/forfaitaire/salarié), qui structure la prévention (médicalisée, éducation thérapeutique du patient, leviers en dehors des soins, etc.). Cette SNS doit s'appuyer notamment sur le levier les innovations en santé probantes de financement au parcours et répondant en particulier aux besoins des patients, pour assurer une couverture homogène dans l'accès à la santé dans les territoires.
• Prévoir une loi de programmation, de santé publique, pluriannuelle permettant de bâtir une régulation budgétaire plus juste.
• Élargir le champ des LFSS aux règles de compétences entre professionnels de santé, délégaliser les règles qui peuvent l'être, afin de rendre le droit des compétences plus évolutif.
• Accélérer le passage en droit commun et accompagner l'usage des innovations thérapeutiques et la mise en oeuvre des innovations organisationnelles en mettant en place un accompagnement au plus proche des acteurs concernés dans tous les territoires. »
Le rapport estime en outre que « le premier levier d'économies perceptible pour l'activité hospitalière, et sur lequel il est possible de fédérer les communautés soignantes, reste, à côté des prises en charge à domicile, de parvenir à organiser les soins pour éviter au maximum le recours à des nuitées hospitalières, ainsi qu'à des séjours pendant les fins de semaine, en dehors des soins critiques. Ces périodes correspondent quoiqu'il en soit à des moments où l'intensité des soins est plus modérée et où les techniques modernes permettent d'assurer une part substantielle des soins et de la surveillance à domicile. Pour rappel, la couverture de la PDSES, permanence de soins en établissements de santé (nuits et weekends) représente plus de la moitié des moyens hospitaliers et il y a donc une capacité à dégager des moyens soignants considérables au bénéfice des usagers si ce besoin de couverture est réduit ».
Le rapport envisage en outre, notamment :
- dans le cas des GHT, de leur donner la personnalité morale et d'élargir le périmètre des mutualisations obligatoires à des activités présentant un fort potentiel d'économies d'échelles, comme la biologie ;
- dans le cas des maternités, d'en réduire le nombre, tout en permettant un hébergement temporaire à proximité d'une maternité quand la situation le nécessite151(*) ;
- de requalifier certains sites en antenne.
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
b) Revoir la carte hospitalière ?
Dans son rapport précité d'avril 2025 sur la maîtrise de l'Ondam, la Cour des comptes estime que la restructuration des services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins permettrait d'économiser entre 0,8 et 1,2 milliards d'euros152(*).
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire respecter les seuils existants d'activité minimum pour réaliser certaines activités de chirurgie » (proposition n° 19). Elle juge en outre nécessaire de « réussir la 2e vague de la chirurgie ambulatoire et ouvrir le champ de la chirurgie hors bloc » (proposition n° 18), ce qui impliquerait en particulier de « définir un plan opérationnel pour atteindre l'objectif de 80 % de taux de chirurgie ambulatoire » et de « définir le périmètre potentiel de la chirurgie hors bloc (en lien avec les sociétés savantes) ».
Le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre souligne les inégalités territoriales en ce qui concerne le nombre de lits par habitant153(*).
Toute réforme de la carte hospitalière devrait être incluse dans une réflexion plus large sur l'organisation des parcours de soins.
c) Améliorer la gouvernance pour favoriser la planification ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam propose d'« instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans ».
7. Développer la prévention ?
La nécessité de développer la prévention, qu'elle soit ciblée ou universelle, fait consensus, tant au niveau politique que parmi les experts de santé publique et les professionnels de santé.
La situation est toutefois très différente selon les différents types de prévention.
Les trois types de prévention
Il est d'usage de distinguer trois types de prévention :
- la prévention primaire, visant à éviter l'apparition de pathologies ;
- la prévention secondaire, visant à les détecter ;
- la prévention tertiaire, visant à prévenir leur aggravation.
La prévention primaire comprend notamment la vaccination, l'éducation à la santé et l'évitement des comportements à risque (tabagisme, consommation nocive d'alcool, consommation d'aliments à faible qualité nutritionnelle, etc.).
La prévention secondaire correspond principalement aux actions de dépistage.
La prévention tertiaire concerne en particulier la prise en charge des malades chroniques. Les actions d'éducation thérapeutique du patient, développées notamment dans le cadre hospitalier et impliquant le patient comme acteur de sa prise en charge, relèvent de la prévention tertiaire.
a) La prévention primaire implique un fort engagement politique
(1) Les pathologies évitables coûtent plus de 10 milliards d'euros aux finances publiques (hors impact du moindre PIB sur les recettes)
Le coût net des principales pathologies évitables pour les finances publiques154(*) est estimé, dans le cas de celles découlant de la consommation nocive d'alcool et du tabagisme, à respectivement 3,3 et 1,7 milliards d'euros en 2019155(*), et, dans le cas de l'obésité, à 9,5 milliards d'euros en 2012156(*).
(2) Développer la vaccination, éventuellement en la rendant obligatoire pour certains publics ?
La vaccination est insuffisamment développée en France.
À titre d'illustration, à l'hiver 2024-2025, la grippe a causé environ 10 000 morts, 30 000 hospitalisations et 3 millions de consultations. Cela doit être mis en relation avec une couverture antigrippale chez les 65 ans et plus de seulement 54 % et inférieure à 30 % chez les soignants.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire progresser la couverture vaccinale de la population » (proposition n° 5). Elle propose pour cela de « poursuivre la simplification du calendrier vaccinal, améliorer la lisibilité de la communication en la structurant par âge et par public, et poursuivre la dynamique d'extension du nombre de professionnels et d'établissements de santé en capacité de vacciner ».
Elle envisage (parmi les « options ») l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe en Ehpad pour les résidents » et l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé ».
(3) La fréquente nécessité d'arbitrer entre santé publique et soutien de filières économiques
Loin de se limiter à des enjeux techniques, le développement effectif de la prévention primaire est souvent un sujet essentiellement politique. En effet, les pathologies évitables découlant avant tout de comportements de consommation inadaptés, il s'agit en particulier de réaliser un arbitrage entre la santé publique et le soutien de filières économiques.
(4) Le rapport de la Mecss sur la fiscalité comportementale en santé (2024)
Un rapport157(*) de la Mecss du Sénat de 2024 sur la fiscalité comportementale en santé fait 16 propositions afin de renforcer la politique de prévention du tabagisme et de mettre en place une politique de prévention dans le cas de la consommation nocive d'alcool et de la mauvaise alimentation.
Dans le cas du tabagisme, la suppression par la commission mixte paritaire (CMP) d'un amendement du Sénat au PLFSS pour 2025, qui prévoyait pourtant une augmentation très modeste de la fiscalité du tabac158(*), montre la difficulté d'avancer en ce domaine. Comme le souligne le rapport précité, même selon les données de l'industrie du tabac, il n'y a pas d'explosion du nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle159(*), la forte augmentation de la part des cigarettes vendues dans ce cadre160(*) venant très majoritairement de la baisse du nombre de cigarettes vendues par les buralistes (qui traduit elle-même l'efficacité de la politique de lutte contre le tabagisme). Le principal enjeu des prochaines décennies est de faire en sorte que le prix des cigarettes demeure suffisamment élevé pour dissuader les jeunes d'entrer dans le tabagisme161(*), permettant ainsi de réduire la prévalence du tabagisme, particulièrement élevée en France.
Aucune avancée n'a eu lieu dans le cas de la lutte contre la consommation nocive d'alcool, au sujet de laquelle la Mecss du Sénat préconisait de réfléchir à l'instauration d'un prix minimum par unité d'alcool. Les rapporteures relèvent que le récent rapport162(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre considère que l'instauration d'un prix minimal par unité d'alcool « constitue la priorité ».
Les seules avancées sont :
- la mise en oeuvre de la proposition n° 11 par l'article 31 de la LFSS pour 2025, qui a réformé le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition (pour un rendement d'environ 0,2 milliard d'euros) ;
- la mise en oeuvre partielle de la proposition n° 6 par le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, qui interdit les produits à usage oral contenant de la nicotine (comme les « billes »).
Propositions du rapport d'information de la Mecss sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé (2024)
« Proposition n° 1 : Orienter davantage les recettes de la fiscalité comportementale vers des actions de prévention et communiquer clairement à ce sujet.
Proposition n° 2 : Concevoir et structurer une politique de prévention globale impliquant les structures scolaires et les collectivités territoriales, et intensifier les efforts en faveur de l'information et de la sensibilisation des consommateurs.
Proposition n° 3 : Assurer le respect des interdictions de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, par le renforcement des contrôles et des sanctions et la mise en place d'outils conditionnant le paiement à la vérification de l'âge.
Proposition n° 4 : Augmenter le prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation jusqu'en 2040, par la fiscalité et par une augmentation du taux de rémunération des buralistes.
Proposition n° 5 : Chiffrer selon une méthodologie fiable et transparente le nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle, et réduire ce nombre, par un renforcement de la lutte contre le commerce illicite, par des actions de prévention ciblées dans le cas du commerce transfrontalier licite, et en promouvant une révision en ce sens des directives tabac (harmonisation des prix à la hausse, application obligatoire des règles sur l'approvisionnement proportionné des marchés prévues par le protocole de 2012 à la convention de l'OMS sur la lutte antitabac).
Proposition n° 6 : Mieux encadrer la vente de produits contenant de la nicotine, en la limitant aux bureaux de tabac et aux magasins spécialisés et en interdisant leur vente aux mineurs, voire en instaurant une licence pour les magasins spécialisés.
Proposition n° 7 : Mener à bien, comme prévu par la loi, l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes.
Proposition n° 8 : Poursuivre, en associant les producteurs, la réflexion sur l'instauration éventuelle d'un prix minimum par unité d'alcool, afin notamment d'éviter que les augmentations de marge soient captées par les distributeurs.
Proposition n° 9 : Mieux encadrer la publicité pour l'alcool, en inscrivant à l'article L. 3351-7 du code de la santé publique des peines plus dissuasives et adaptées et en interdisant la publicité pour l'alcool sur internet.
Proposition n° 10 : Élaborer et rendre public un programme national de réduction des consommations nocives d'alcool.
Proposition n° 11 : Réformer le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition, afin de renforcer son efficacité et d'accentuer sa visée comportementale.
Proposition n° 12 : Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée, explicitant les objectifs poursuivis en termes de santé publique et valorisant le financement d'actions de prévention.
Proposition n° 13 : Fixer des quantités maximales de sucre, de sel ou de matières grasses pour certaines catégories d'aliments.
Proposition n° 14 : Produire et transmettre au Parlement dans les meilleurs délais le rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021, puis expérimenter un dispositif de soutien à l'achat de fruits et légumes par les ménages disposant de ressources inférieures à un seuil à déterminer.
Proposition n° 15 : Interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans.
Proposition n° 16 : Plaider pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. »
Source : Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024
(5) Taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons ?
Le rapport de 2024 précité de la Mecss du Sénat ne proposait pas de taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam suggère deux mesures à cet égard (proposition n° 8), consistant à modifier certains taux de TVA ou à instaurer une taxe sur certains aliments.
(a) Imposer certains aliments à un taux de TVA réduit ou nul ?
La directive (UE) 2022/542 a modifié l'article 98 de la directive TVA de 2006 pour prévoir que les États peuvent, en plus des deux taux réduits existant jusqu'alors (pour la France, 5,5 % et 10 %), instaurer un taux réduit supplémentaire ou un taux zéro, notamment pour les « denrées alimentaires ».
Aussi, le rapport « charges et produits » de juillet 2025 envisage d'utiliser cette nouvelle possibilité163(*) pour « redéfinir les taux de TVA sur plusieurs catégories de produits pour inciter à une consommation de produits sains et durables et à la pratique d'une activité physique ».
Il propose de réorienter ainsi la consommation vers « les produits issus d'une agriculture durable et labellisée comme telle ».
Une autre possibilité (non évoquée par le rapport « charges et produits ») serait de favoriser les fruits et légumes. En première analyse, l'instauration d'un taux de TVA nul sur les fruits et légumes pourrait coûter environ 1 milliard d'euros164(*).
Selon le rapport « charges et produits », « ce dispositif de modulation devra s'effectuer à rendement constant pour préserver les finances publiques, en augmentant le taux de certaines catégories de produits pour compenser l'application de taux réduits ou super réduits sur certains taux ».
(b) Instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires ?
Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 suggère en outre d'instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires : « sucre ajouté et produits alimentaires ultra-transformés, nitrites additifs, perturbateurs endocriniens (notamment le phtalate) ». Une mesure de ce type est également suggérée par le récent rapport des trois Hauts Conseils165(*).
Ces deux rapports ne présentent pas de chiffrage à cet égard.
Pour fixer un ordre de grandeur dans le cas du sucre, en première analyse, une taxe d'un euro par gramme de sucre pur pour les produits dont la masse comprend au moins 40 % de sucre pur pourrait rapporter près d'un milliard d'euros166(*).
Sur le modèle de la taxation des boissons sucrées résultant de la LFSS pour 2025, le barème de la taxe pourrait comprendre divers seuils afin d'inciter les entreprises à adapter leurs formules.
Il est à noter toutefois que, contrairement à ce qui est le cas pour les boissons sucrées, peu de pays appliquent aux aliments à faible qualité nutritionnelle une taxation spécifique167(*). Il est donc difficile de porter une appréciation sur l'efficacité de ce type de mesure, qui devrait vraisemblablement être incluse dans une politique nutritionnelle globale pour être efficace. Par ailleurs, le sujet est politiquement très sensible. Ainsi, la taxe sur les aliments contenant plus de 2,3 % de graisses saturées instaurée par le Danemark en 2011 a dû être abrogée 13 mois plus tard.
(6) Mieux prendre en compte les enjeux environnementaux ?
La qualité de l'environnement joue un rôle important en matière de santé, et donc de prévention. Ainsi, selon l'article 1er de la Charte de l'Environnement de 2004, « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Selon le rapport168(*) de 2015 de la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, les trois types de maladies causées par la pollution de l'air les plus communes sont les maladies respiratoires, au premier rang desquelles la bronchopneumopathie obstructive (BPCO), les pathologies cardiaques, dont les infarctus, et les cancers du poumon. Le rapport mentionne une étude de 2007 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset)169(*), qui évalue le coût global des traitements de l'asthme et des cancers imputables à la pollution de l'air à un montant compris entre 0,3 et 1,3 milliard d'euros. Il mentionne également une étude de 2015 du Commissariat général au développement durable (CGDD), qui évalue le coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins à un montant compris entre 0,9 et 1,8 milliard d'euros.
Retenant une définition « large » de la notion d'environnement, le rapport170(*) de 2022 de la mission d'information du Sénat sur la sécurité sociale écologique prend en compte non seulement la qualité de l'air et le changement climatique, mais aussi la qualité de l'alimentation, et même l'ensemble des politiques publiques. En particulier, il considère que la crise sanitaire a montré qu'il convient, dans un objectif de prévention en santé, de prendre en compte les relations avec les écosystèmes, conformément à l'approche dite « Une seule santé » (« One Health »). Cela l'amène à préconiser, notamment, de « prendre en compte l'impact environnemental dès la conception des politiques publiques afin de créer un système de protection sociale plus résilient », d'« intégrer la santé environnementale dans les études d'impact accompagnant les projets de loi » et de « diffuser le concept Une Seule Santé (One Health) dans la littératie pour prendre davantage en compte la santé environnementale ».
Les moyens à mettre en oeuvre pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux ne relèvent pas des compétences de la commission des affaires sociales.
(7) Étendre la fiscalité comportementale aux « écrans » ?
Le récent rapport171(*) des trois Hauts Conseils préconise d'instaurer ce qu'il appelle une « taxe sur les écrans ».
Sans faire de préconisation précise, il évoque deux propositions à cet égard :
- une taxe de 2 % sur les revenus des « plateformes du numérique » générés en France, dont le produit serait alloué à un fonds en faveur de la santé mentale, comme préconisé par Gabriel Attal et Marcel Ruffo172(*) ;
- une taxation de la publicité numérique, comme proposé par les prix Nobel d'économie Daron Acemoglu et Simon Johnson173(*). Ces auteurs recommandent, dans le cas des États-Unis, une taxe de 50 % pour les revenus annuels de la publicité numérique dépassant 0,5 milliard d'euros. Il s'agit explicitement d'inciter à passer d'un financement par la publicité à un financement par abonnement, dont ils considèrent qu'il susciterait moins de problèmes de santé mentale et inciterait moins à l'extrémisme et à la violence.
Pour mémoire, depuis la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, les articles 299 et suivants du code général des impôts prévoient une « taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique » (dite « taxe Gafam », ou « taxe sur les services numériques »). La taxe est de 3 % sur les « sommes encaissées par le redevable ». Son rendement prévisionnel en 2025 est de 0,8 milliard d'euros174(*).
Les rapporteures n'ont pas eu le temps d'expertiser ce sujet, qui par ailleurs dépasse les compétences de la seule commission des affaires sociales. En particulier, la « taxe Gafam » a été mentionnée par la présidence des États-Unis dans le cadre de l'actuel conflit commercial175(*).
On peut toutefois indiquer qu'en 2024, le chiffre d'affaires de la publicité digitale aurait été de 11 milliards d'euros176(*). Toutes choses égales par ailleurs, taxer cette assiette au taux de 50 % (préconisé par Acemoglu et Johnson) pourrait donc rapporter initialement plus de 5 milliards d'euros.
b) Renforcer la prévention secondaire ?
(1) Renforcer les dépistages ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire progresser les dépistages du cancer » (proposition n° 2). Il s'agirait notamment d'« interdire les dépassements d'honoraires pour les actes en lien avec les dépistages organisés (mammographie, échographie et coloscopie...) » et d'ouvrir « la possibilité de remettre le kit de dépistage du cancer colorectal aux infirmières, aux biologistes et aux sages-femmes ».
La Cnam préconise également de « faire progresser les dépistages des [maladies cardio-vasculaires] » (proposition n° 3). Elle annonce qu'une grande campagne de communication sera déployée à destination du grand public au printemps 2026. Comme pour la campagne « know your numbers »177(*) diffusée au Royaume-Uni, les assurés seront invités à « connaître leurs chiffres » (pression artérielle, glycémie, cholestérolémie, poids) et à agir sur leur santé cardiovasculaire en conséquence. Le dépistage serait en outre ouvert aux pharmaciens.
(2) Faut-il subordonner le niveau de prise en charge au respect des obligations de dépistage par le patient ?
Lors des auditions, a été envisagée la possible subordination du niveau de prise en charge de certaines pathologies par l'assurance maladie au respect par le patient de ses obligations en matière de dépistage.
Il est à noter qu'une incitation de ce type existe en Allemagne dans le cas des soins dentaires (cf. encadré).
De telles mesures, en particulier si elles devaient concerner des pathologies lourdes, poseraient des questions de principe, qui impliqueraient un débat politique approfondi.
Le rapport précité des trois Hauts Conseils considère que si elles étaient mises en oeuvre au moyen d'une prime (plutôt que par une réduction de la prise en charge par la sécurité sociale), elles constitueraient un effet d'aubaine pour une grande partie, voire la majorité, des personnes concernées. Il estime en outre qu'elles pourraient défavoriser les personnes à faibles revenus, souvent éloignées de la prévention, ou celles ayant des « difficultés d'accès aux professionnels et aux rendez-vous » (déserts médicaux, freins monétaires réels ou supposés, fracture numérique, freins à la mobilité).
Lors de son audition par les rapporteures, Yann-Gaël Amghar, président du HCAAM, a estimé que les inégalités d'accès à la prévention accentuaient les inégalités de santé.
L'incitation financière à la prévention bucco-dentaire en Allemagne
En Allemagne, pour les plafonds de prise en charge des prothèses dentaires, un système de bonus (Festzuschusssystem für Zahnersatz) vise à garantir que les assurés bénéficient de soins dentaires préventifs. L'assuré doit faire examiner ses dents au moins une fois par an et documenter ces examens dans un carnet de bonus.
Les taux de prise en charge sont en effet les suivants :
• prise en charge standard sans bonus : 60 % ;
• après 5 ans avec une documentation complète des contrôles : 70 % ;
• après 10 ans : 75 %.
c) Renforcer la prévention tertiaire, en particulier dans le cas des personnes atteintes de pathologies chroniques ?
Dans un récent article178(*) publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, préconise d'inciter les professionnels de santé à développer la prévention tertiaire. Il s'agirait en particulier d'instaurer un dispositif financier incitant à mettre en place des équipes suivant à distance, notamment par des moyens numériques179(*), les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Les propositions du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour développer la prévention tertiaire
Dans un récent article publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel considère que « c'est surtout dans le champ de la prévention tertiaire [qui s'intéresse aux personnes malades] et de la prise en charge des pathologies chroniques que se situe le coeur de la bataille et des gains d'efficience que nous pouvons espérer avec des effets potentiellement puissants et rapides ». Les parcours des patients sont en effet « heurtés, ponctués de décompensations et d'hospitalisations qui auraient pu être évitées, et par des pertes de chances parfois considérables ».
Il préconise de s'inspirer des cellules d'expertise et de coordination de l'insuffisance cardiaque sévère (Cecics) de l'AP-HP, qui font l'objet d'une expérimentation de l'article 51 de la LFSS pour 2018. Les Cecics permettent aux équipes de suivre les patients, notamment au moyen d'une télésurveillance. Il indique que « les résultats de l'expérimentation qui a permis de prendre en charge près de 2 000 patients sur trois ans ont fait apparaître une moindre mortalité précoce, une diminution des hospitalisations pour les motifs les plus graves, une diminution de la durée cumulée des hospitalisations par patient (passée de 6,4 à 1,7 jours par patient et par an) et une satisfaction des patients qui gèrent leur maladie de manière plus autonome ».
Selon lui, « sous réserve de la mise en place d'un système de financement adapté, le modèle des Cecics pourrait facilement être décliné pour d'autres maladies chroniques » : pathologies cardiovasculaires, diabète, maladies inflammatoires chroniques digestives ou rhumatologiques, bronchopneumopathie chronique obstructive, pathologies neurologiques.
Il préconise de mettre en place un financement forfaitaire prenant en charge « non seulement le suivi à distance des patients mais aussi les éventuelles consultations et hospitalisations de jour liées à ce suivi » et permettant « un « retour économique » vers les organisations de soins à hauteur d'une part des dépenses évitées ».
Source : D'après Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025
De fait, les pathologies chroniques correspondent à 60 % des dépenses d'assurance maladie remboursées, comme le montre le graphique ci-après.
Répartition des dépenses d'assurance maladie remboursées par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins (2022)
ALD : affection de longue durée
(a) Hors pathologies cardiovasculaires (CV), diabète et insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
(b) Hors maladies psychiatriques
(c) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations
* Les embolies pulmonaires sont enlevées.
Note de lecture : répartition des dépenses d'assurance maladie remboursées en 2022 par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisode de soins : 190,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes.
Pour aboutir au total de 190,3 milliards d'euros, il faut rajouter aux dépenses par pathologie les 7,2 milliards d'euros de soins courants, qui ne sont pas affectées à des pathologies spécifiques.
Source : Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, Propositions de l'Assurance Maladie pour 2025, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2025 (loi du 13 août 2004), juillet 2024
La Cnam a récemment renforcé sa prévention tertiaire dans le cas des pathologies chroniques. On peut ainsi mentionner :
- « Sophia », un service d'accompagnement, reposant sur des informations spécifiques sur le site ameli, des entetiens téléphoniques réalisés par des infirmiers et un magazine. Initialement destiné aux diabétiques, il s'adresse depuis 2025 à l'ensemble des personnes souffrant de pathologies chroniques à risque cardiovasculaire (« Sophia 2.0 ») ;
- la télésurveillance (qui dans le cas de l'insuffisance cardiaque permet de détecter la prise de poids rapide, signe de rétention d'eau) ;
- la mise en place de cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère (Cecics). Il s'agit d'une expérimentation sur la base de l'article 51 de la LFSS pour 2018, permettant à des équipes de suivre les patients, notamment au moyen d'une télésurveillance.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « sécuriser le parcours de prévention tertiaire des personnes souffrant de pathologies chroniques (éducation thérapeutique, Sophia 2.0, télésurveillance, APA180(*)) et assurer une surveillance populationnelle possiblement portée par les établissements de santé pour les patients non stabilisés, avec un financement incitatif (sur le modèle de l'expérimentation « article 51 » Cecics) » (proposition n° 20).
d) Installer une gouvernance de la prévention en santé ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025181(*), la Cnam préconise, dans sa proposition n° 1, d'« organiser une coalition des financeurs et des acteurs mobilisés en faveur de la prévention en santé ».
Il s'agirait en particulier d' « installer une gouvernance de la prévention en santé permettant la coordination nationale et locale des financeurs et acteurs mobilisés en faveur de la prévention sur la base des priorités de santé publique définies par l'État ».
Cette gouvernance permettrait notamment de développer la prévention dans les entreprises et à l'école.
8. Limiter le coût des indemnités journalières (IJ) relatives aux arrêts de travail ?
a) Des dépenses augmentant de plus de 6 % par an, du fait notamment d'une hausse de la sinistralité
Le montant des indemnités journalières (IJ) maladie du régime général est passé de 6,2 milliards d'euros en 2010 à 10,2 milliards d'euros en 2023.
Leur coût a augmenté en moyenne de 2,9 % par an en 2010-2019 et 6,4 % par an en 2019-2023 (soit environ 0,6 milliard d'euros par an). Cet écart de 3,5 points vient essentiellement du fait qu'en conséquence de l'inflation post-crise sanitaire, les salaires ont augmenté plus rapidement, ce qui s'est répercuté dans le coût par journée (1,9 point). Toutefois elle s'explique également (pour 1,5 point) par les changements de comportement (taux de recours et durée à âge donné, la durée ayant diminué).
Décomposition du taux de croissance annuel
moyen
du coût global des IJ maladie
(en % et en points)
IJ : indemnité journalière.
Source : D'après les données de Nadine Colinot, Gonzague Debeugny, Catherine Pollak, « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Études et résultats n° 1321, 13 décembre 2024
Les arrêts d'au moins un mois représentent seulement un quart du nombre d'arrêts, mais plus de 80 % des dépenses, comme le montre le graphique ci-après.
Répartition des dépenses et du
nombre d'arrêts maladie
par durée en 2023
(en %)
Source : Nadine Colinot, Gonzague Debeugny, Catherine Pollak, « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Études et résultats n° 1321, 13 décembre 2024
b) Prendre des mesures paramétriques ?
Diverses mesures d'économies paramétriques relatives au secteur privé ont été proposées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024, pour un montant variant selon le scénario retenu mais de l'ordre du milliard d'euros.
Dans sa note précitée d'avril 2025, la Cour des comptes fixe un objectif d'économies de 0,5 milliard d'euros, sans spécifier de scénario à privilégier.
Principales propositions paramétriques
tendant à réduire le coût
des indemnités
journalières
(en milliards d'euros)
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
|
|
Limitation des surprescriptions |
0,2 |
Ralfss 2024 |
Salariés abusant du système |
|
Contrôles et lutte contre les fraudes |
0,05 |
Ralfss 2024 |
Fraudeurs |
|
Réforme jours de carence et/ou suppression d'indemnisation des arrêts courts par l'assurance maladie : |
|||
|
- Suppression de l'indemnisation de la sécurité sociale sur les arrêts maladie de moins de 8 jours, et maintien d'un délai de carence de 3 jours sur les arrêts de plus de 8 jours |
0,47 |
Ralfss 2024 |
Entreprises (330 M€) et salariés (140 M€) |
|
- Allongement du délai de carence de trois à sept jours quelle que soit la durée des arrêts de travail |
0,95 |
Ralfss 2024 |
Entreprises (660 M€) et salariés (290 M€) |
|
- Mise en place d'un jour de carence d'ordre public et diminution du niveau des indemnités journalières de 50 % à 45 % du salaire |
0,6 |
Ralfss 2024 |
Salariés |
|
- Allongement du délai de carence de 3 à 7 jours combiné à l'instauration d'un jour de carence d'ordre public |
0,55 |
Mecss du Sénat |
Salariés |
|
Diminuer les indemnités journalières de 50 % du salaire à un pourcentage plus bas |
0,2 Md€ par point de pourcentage |
Ralfss 2024 |
Entreprises et salariés |
Ralfss : rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Sources : D'après Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2004 ; calculs de la Mecss du Sénat
L'allongement du délai de carence dans le secteur privé de 3 à, par exemple, 7 jours permettrait à la sécurité sociale d'économiser près d'un milliard d'euros. Les deux tiers environ des entreprises maintenant le salaire des employés en arrêt maladie malgré le délai de carence182(*), cela conduirait à des dépenses supplémentaires de 0,6 milliard d'euros pour les entreprises (et une baisse des salaires de 0,4 milliard d'euros).
Une autre possibilité, qui ne ferait pas supporter la mesure par les entreprises (mais qui la ferait en conséquence supporter par les salariés), serait d'instaurer un jour de carence d'ordre public (c'est-à-dire ne pouvant pas être indemnisé par les entreprises). La mesure permettrait aux entreprises d'économiser 1 milliard d'euros, répartis entre 0,6 milliard d'euros de salaires et 0,4 milliard d'euros de cotisations sociales. Comme cette mesure aurait donc un coût pour la sécurité sociale, il faudrait la coupler à une autre mesure, coûteuse pour les entreprises mais source d'économies pour la sécurité sociale. La Cour des comptes propose ainsi une baisse de 5 points du taux de prise en charge par l'assurance maladie183(*), ces deux mesures cumulées suscitant pour la sécurité sociale une économie de 0,6 milliard d'euros.
Une solution (non envisagée par la Cour) pourrait consister, en plus de l'instauration d'un jour de carence d'ordre public, à porter le délai de carence de 3 à 7 jours. Les deux mesures correspondraient à une économie d'environ 0,55 milliard d'euros pour la sécurité sociale et 0,34 milliard d'euros pour les entreprises (supportée par les salariés).
Le récent rapport184(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre indique que la question des jours de carence « constitue un objet important de désaccords ». Il est plutôt réservé sur le sujet, évoquant des études selon lesquelles une réduction des arrêts courts susciterait des arrêts plus longs en moyenne. Il s'interroge en outre sur la constitutionnalité d'un jour de carence d'ordre public185(*).
Rappel des règles actuellement applicables aux indemnités journalières du secteur privé
Actuellement l'assurance maladie indemnise le salarié après trois jours de carence, à hauteur de 50 % du salaire brut. À cela s'ajoutent :
- l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, dans le cadre du maintien obligatoire du salaire (loi de 1978). Cette indemnité186(*), qui s'applique après 7 jours de carence, a pour effet de porter le maintien du salaire (après prise en compte des IJ) à 90 % du salaire brut pendant 30 jours, puis 66,66 % ensuite187(*) ;
- le cas échéant, une prise en charge supplémentaire par l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise. Celle-ci peut augmenter le taux de prise en charge ou inclure des périodes supplémentaires (comme les jours de carence). En particulier, la prise en charge des trois premiers jours d'arrêt de travail n'est pas forcément incluse dans la garantie incapacité d'un contrat de prévoyance, et peut être versée directement par les établissements aux salariés.
Il résulte de ce mécanisme qu'une diminution de la prise en charge par l'assurance maladie tend à se reporter sur l'entreprise. En particulier, sur la période couverte par l'obligation de maintien du salaire par l'employeur, toute diminution de la prise en charge par l'assurance maladie se traduit mécaniquement par une augmentation à due concurrence de la prise en charge par l'employeur.
c) Enrayer la hausse de la sinistralité ?
Sur le long terme, le principal sujet est celui de la hausse du taux de recours, c'est-à-dire de la sinistralité, particulièrement marquée pour les tranches d'âge les plus jeunes.
(1) Une hausse de la sinistralité imparfaitement expliquée
Les conditions de travail semblent moins bonnes en France que dans les autres pays européens, en particulier pour ce qui concerne les risques physiques et la qualité de l'environnement de travail188(*). Toutefois il ne s'agit pas d'un fait nouveau.
Le récent rapport189(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, tout en soulignant la difficulté à expliquer la hausse de la sinistralité, envisage qu'elle puisse provenir d'une dégradation des conditions de travail, d'une évolution de la morbidité à âge donné (notamment des épisodes dépressifs, en particulier chez les jeunes adultes), de l'augmentation du taux d'emploi (qui aurait conduit à employer des personnes plus fragiles).
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam souligne que la croissance des arrêts longs provient en quasi-totalité non des personnes relevant du régime ALD, mais des personnes relevant du régime dit « ALD non exonérante » (qui n'ouvre pas droit à la prise en charge de 100 % du ticket modérateur). Les principales pathologies couvertes par ce régime sont celles liées à la dépression légère (33 % de ces situations) et aux troubles musculo-squelettiques (32 %). Les personnes concernées semblent peu suivies médicalement : par exemple, dans le cas des troubles musculo-squelettiques, seules 41 % consomment des antalgiques et 72 % ont vu un masseur-kinésithérapeute.
(2) Lutter contre la fraude aux arrêts de travail
Bien que la fraude ne représente qu'une faible partie du coût des arrêts de travail, la lutte contre la fraude est un enjeu essentiel, par principe et pour faciliter l'acceptation des autres mesures.
En 2024, le préjudice financier détecté par la Cnam au titre des faux arrêts de travail a été de plus de 30 millions d'euros (contre 8 millions d'euros en 2023). Selon la Cnam, la vente de faux arrêts de travail sur les réseaux sociaux ou sur internet est à l'origine de cette forte hausse.
Aussi, depuis le 1er septembre 2025, le recours à un formulaire sécurisé est obligatoire pour tout envoi d'avis d'arrêt de travail papier.
(3) Les propositions de la Cnam dans le rapport « charges et produits »
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam fait diverses préconisations.
(a) Prévenir la désinsertion professionnelle ?
Sa proposition 23 consiste notamment à « renforcer [les] efforts [de la Cnam] en termes de prévention de la désinsertion professionnelle ».
(b) Veiller à la pertinence des prescriptions ?
La proposition 24 du rapport « charges et produits » consiste en particulier à « limiter la durée de l'arrêt de travail pouvant être prescrit (1 mois en primo-prescription en cas d'hospitalisation et 15 jours en ville, puis par tranche de deux mois maximum) afin de garantir un vrai suivi médical de la personne arrêtée et la pertinence de l'arrêt de travail ».
En effet, selon la Cnam, « l'analyse des quatre principaux motifs d'arrêt maladie prescrits en 2023190(*) montre que la majorité des arrêts dépassent les durées recommandées ».
En cas de recours à amelipro ou à un logiciel d'aide à la prescription, le prescripteur pourrait se voir proposer une liste déroulante de motifs, puis la liste des dates d'arrêt correspondantes (tout en gardant la possibilité de modifier les dates prescrites en fonction de la situation).
(c) Inciter les employeurs à améliorer les conditions de travail ?
Le conditions de travail semblent moins bonnes en France que dans la plupart des pays européens (cf. supra).
Des « référentiels de bonnes pratiques en matière de conditions de travail » seraient diffusés aux entreprises montrant un « absentéisme atypique ».
(4) Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils
Le rapport des trois Hauts Conseils souligne que le coût des IJ ne résulte que marginalement des arrêts de courte durée. Ainsi, les arrêts dépassant six mois représentent 7 % du nombre d'arrêts mais 45 % de la dépense.
Il considère donc que le principal enjeu est de ramener à l'emploi les salariés en arrêt de longue durée (cf. encadré).
Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils pour enrayer la sinistralité191(*)
• « Les actions doivent prioritairement porter sur le retour à l'emploi des salariés en arrêt de longue durée »192(*)
• « Améliorer l'efficacité des contrôles notamment par le partage d'informations entre acteurs »
• « Agir en direction des entreprises atypiques »
• « Agir en direction des prescripteurs »193(*)
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
9. Réduire la prise en charge des ALD par la branche maladie ?
a) Les ALD
En 2023, le montant remboursé total des dépenses de santé des personnes en arrêt de longue durée (ALD) a été de 135,2 milliards d'euros194(*), soit plus de la moitié des dépenses d'assurance maladie.
En 2021, les ALD concernaient 13,7 millions de personnes, soit 20 % de la population. L'ALD a pour principale conséquence la prise en charge du ticket modérateur par la branche maladie.
Le surcoût du dispositif ALD par rapport au droit commun est estimé à 12,1 milliards d'euros en 2021, dont 11,3 milliards d'euros pour l'exonération du ticket modérateur. Jusqu'à 16 millions de personnes pourraient bénéficier du dispositif en 2030, pour une hausse du surcoût net du dispositif de 2 à 3 milliards d'euros.
b) Le rapport de l'Igas et de l'IGF (2024)
Un rapport195(*) de 2024 de l'Igas et de l'IGF - dont les données des deux alinéas précédents sont issues - présente diverses mesures, dont les chiffrages sont synthétisés dans l'annexe IV au présent rapport.
Le rapport précité propose diverses mesures à court terme. Celle au rendement le plus élevé consisterait à introduire un ticket modérateur de 5 points pour les dépenses en lien avec l'ALD, plafonné à 1 000 euros par an, pour un rendement de 2,5 milliards d'euros. Il est en outre proposé de veiller à ce que seules les dépenses en lien avec l'ALD soient prises en charge à 100 %, par exemple en intégrant aux logiciels métiers une « liste positive » d'actes et prestations exonérés (pour un gain estimé à 0,3 milliard d'euros).
Il propose également deux pistes de réforme structurelle :
- l'introduction de deux niveaux de reconnaissance en ALD, selon la sévérité des pathologies et l'intensité des soins. Dans le cas du premier niveau, qui concernerait les patients sans traitement très coûteux, l'exonération du ticket modérateur serait limitée aux produits et prestations destinés à la prévention. Le gain pour les finances publiques serait à peu près nul, les économies réalisées dans le cas des assurés non reconnus en niveau 2 étant quasiment compensées par les coûts supplémentaires des assurés reconnus en niveau 1196(*) ;
- l'instauration d'un mécanisme de plafonnement des restes à charge (« bouclier sanitaire »)197(*) pour l'ensemble des assurés, accompagnée de la suppression du dispositif des ALD. Une telle réforme ferait des gagnants (les assurés hors ALD) et des perdants (les assurés en ALD). Par exemple, pour un plafond annuel de 2 000 euros, le gain net pour la sécurité sociale serait de 4 milliards d'euros (économie de 4,7 milliards d'euros sur les ALD et surcoût de 0,7 milliard d'euros pour les autres assurés)198(*).
c) Le rapport « charges et produits » de juillet 2025
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « mettre en place une gestion plus dynamique des entrées et des sorties du dispositif des ALD » (proposition n° 21). Il s'agirait en particulier de prévoir dès l'entrée « un parcours de prévention et d'information renforcées destiné à éviter, du moins à retarder, l'aggravation de la pathologie (Sophia 2.0199(*), Mon Espace Santé, etc.) ». La Cnam préconise également d'« évaluer régulièrement la consommation de soins des personnes bénéficiant du dispositif » afin de permettre leur sortie du dispositif en cas de guérison ou de rémission.
Elle reprend également, en tant qu'« options », les propositions du rapport précité de l'Igas et de l'IGF de définir une liste de soins spécifiques et opposables à chaque ALD et de distinguer deux niveaux d'ALD, seul le second niveau disposant d'une prise en charge à 100 %200(*). Le premier niveau lui permettrait d'identifier des assurés actuellement peu coûteux et donc exclus du dispositif ALD (comme des personnes en hypertension artérielle), qui lui échappent actuellement, et d'engager des actions d'accompagnement (Sophia 2.0, campages d'aller-vers, etc.).
d) Le rapport des trois Hauts Conseils
Selon le récent rapport201(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, l'instauration d'un ticket modérateur pour les personnes en ALD ou d'un double niveau d'ALD serait dans les faits un pur transfert de la branche maladie vers les complémentaires, le ticket modérateur entraînant en outre « des restes à charge très élevés pour certains patients » dépourvus de complémentaire santé, soit moins de 3 % des assurés.
Le rapport semble plutôt privilégier le scénario du bouclier sanitaire, qu'il ne présente pas toutefois comme une piste d'économies202(*), tout en soulignant qu'il ferait des perdants. Il s'interroge en outre sur une possible modulation du plafond en fonction du revenu (qui réduirait le reste à charge en part du revenu pour les ménages modestes mais pourrait être perçue comme une rupture avec le principe d'universalité, et donc remettre en cause « l'adhésion autour du système »).
10. Prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière ?
a) D'importantes inégalités de revenus
La direction du budget203(*) souligne que la hausse du montant global des honoraires des médecins spécialistes a été de + 3,2 % par an en moyenne sur 2016-2023, alors que la patientèle a augmenté de « seulement » 4 % au global sur la période.
En effet, les médecins effectuent de plus en plus d'actes à patientèle donnée. La direction du budget constate en outre « un phénomène de forte croissance du nombre d'actes, par ailleurs très hétérogènes entre spécialités et au sein même de spécialités, peu explicables par les seuls facteurs habituellement mis en avant que sont le vieillissement de la population et la hausse de certaines pathologies ».
Plusieurs personnes auditionnées se sont interrogées sur les écarts de revenus entre secteurs ou professionnels de santé, qui ne leur ont pas toujours semblé justifiés par des niveaux de compétence ou des conditions d'exercice spécifiques. Le risque que ces anomalies de revenu, découlant pour partie des modalités de prise en charge par l'assurance maladie, déstabilise le système de santé en suscitant un désintérêt pour les secteurs ou spécialités les moins rémunérés, a été évoqué.
De fait, les écarts de revenus entre professionnels de santé sont importants. À titre d'illustration, et sans préjuger d'éventuelles anomalies, le tableau ci-après indique les niveaux de revenu des médecins libéraux exerçant en secteur 1.
Disparités de revenus des médecins libéraux exerçant en secteur 1
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « Santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024
Dans son rapport204(*) de 2024 sur la financiarisation de l'offre de soins, la commission s'est interrogée sur la pertinence de certaines rentes. De même, dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam s'interroge sur le niveau élevé de la rentabilité opérationnelle (ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaire) de certains secteurs, supérieure à 15 % (soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises, de 7,8 % en 2022).
Évolution de la moyenne des ratios de rentabilité selon le secteur d'activité, 2018 - 2022
(en %)
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
b) Mettre en place un observatoire chargé d'identifier les rentabilités anormalement élevées ?
Dans son rapport « charges et produits » précité, la Cnam préconise la mise en place d'un « observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement », qui lui serait rattaché.
De même, le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre préconise l'instauration d'un « observatoire de la situation économique et de la rentabilité ».
c) Les autres propositions de la Cnam pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière
La Cnam fait d'autres propositions pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière, concernant l'amélioration de la transparence, la réduction des tarifs et l'obligation d'un plan de continuité des soins pour les principaux acteurs.
Les propositions de la Cnam pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière
« Proposition 30 : Clarifier les règles de gouvernance des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) ayant ouvert leur capital à des acteurs financiers pour garantir l'indépendance des professionnels de santé (sur le modèle de la conciliation organisée par le Conseil d'État dans la santé animale)
Proposition 31 : Établir la transparence totale sur les situations de rentes économiques et sur la composition de l'offre de soins
- Rendre obligatoire à chaque offreur de soins la déclaration de son éventuelle appartenance à un groupe, groupement ou réseau et faire évoluer les SI de l'Assurance Maladie pour rattacher chaque acte à la fois à un praticien, à une structure d'exercice, et le cas échéant à un groupe / groupement / réseau
- Instituer et rattacher à l'Assurance Maladie un Observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement de l'ensemble des secteurs qui composent l'offre de soins
Proposition 32 : Pour répartir plus équitablement les dépenses d'Assurance Maladie, baisser les tarifs des secteurs présentant un très haut niveau de rentabilité
Proposition 33 : Prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé (maintenance de la CCAM, études régulières de coûts, etc.)
Proposition 34 : Améliorer la régulation territoriale pour s'assurer du développement ou du maintien d'une offre de soins pertinente sur l'ensemble du territoire
- Repenser le régime des autorisations des Equipements Médicaux Lourds (EML) : renforcer la transparence sur l'usage des autorisations et des équipements, geler les installations dans les zones où l'accessibilité est satisfaisante, identifier les impacts en terme de dépenses en améliorant les échanges ARS-Assurance Maladie et conditionner les nouvelles autorisations respect d'objectifs quantifiés de santé publique et à des engagements de solidarité territoriale (soutenir l'offre de zonesdoutées situées à proximité)
- Construire un cahier des charges de présence territoriale et le faire respecter par les groupes, groupements et réseaux
Proposition 35 : Pour éviter les phénomènes de « too big to fail » (prise en charge par la puissance publique des conséquences des erreurs de gestion d'un acteur privé), identifier les opérateurs de l'offre de soins dont la défaillance serait susceptible d'avoir un impact significatif sur l'offre de soins et les obliger à communiquer au régulateur un plan de continuité des soins en cas de défaut au niveau du groupe »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
B. QUELS EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES POUR RÉSORBER LE DÉFICIT ?
Du fait du dynamisme spontané des dépenses de santé, les efforts précités sur l'Ondam, devant permettre de respecter l'objectif de croissance de 2,9 % fixé par la LFSS pour 2025, ne peuvent pas suffire à rétablir l'équilibre.
Dans le cas des dépenses de santé, il semble difficile d'aller beaucoup plus loin d'ici 2029 que ce que proposent la Cour des comptes ou la Cnam.
Aussi, le présent rapport, toujours dans sa logique de « boîte à outils », s'est efforcé de déterminer, d'un point de vue arithmétique, les autres pistes envisageables.
On rappelle que le rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un déficit de 24,8 milliards d'euros en 2029. En supposant que les dépenses de santé soient effectivement tenues et que la croissance soit conforme aux hypothèses (optimistes) du Gouvernement, c'est donc - pour fixer un ordre de grandeur - environ 25 milliards d'euros de mesures supplémentaires qu'il faut mettre en oeuvre.
1. Le levier des dépenses
a) Limiter la croissance de l'Ondam à un taux inférieur à 2,9 % par an ?
Une première possibilité serait de davantage réguler les dépenses de santé que ce qu'impliquerait la croissance de l'Ondam prévue par la LFSS pour 2025 (de 2,9 % par an).
On pourrait par exemple anticiper certaines mesures destinées à améliorer l'efficience et évoquées dans la troisième partie du présent rapport.
b) Agir sur les dépenses de retraite ?
Il ressort du chiffrage de mesures figurant en annexe IV que les seules économies d'ampleur et à rendement immédiat hors de la branche maladie concernent la branche vieillesse.
En particulier, la sous-indexation d'un point des pensions une année donnée permettrait, si cet effet est repris en « base » les années suivantes, d'économiser de manière pérenne environ 3 milliards d'euros. Étendre cette sous-indexation aux prestations de la branche famille permettrait de porter cette économie à environ 3,5 milliards d'euros. Décider d'une sous-indexation plusieurs années démultiplierait l'économie en régime de croisière (par exemple, si la sous-indexation avait lieu deux années, le gain en régime de croisière serait de 6 ou 7 milliards d'euros).
Dans la logique du présent rapport, développée dans l'avant-propos, ce constat ne vaut pas préconisation. En particulier, le solde du système de retraite peut également être amélioré par des mesures sur les recettes (cf. ci-après).
2. Le levier des recettes
À moins d'une action très importante sur les dépenses, non documentée par le présent rapport, le retour à l'équilibre de la sécurité sociale implique notamment d'augmenter les recettes.
Plusieurs solutions sont envisageables (cf. chiffrages en annexe IV).
Compte tenu des sommes en jeu, on se limite ci-après aux mesures au plus fort rendement.
a) Les réductions de niches : une vingtaine de milliards d'euros de recettes potentielles ?
L'annexe II au présent rapport récapitule le montant annuel des principales niches sociales depuis 2019.
Du fait de leur montant élevé, d'environ 100 milliards d'euros (cf. tableau ci-après), les niches sociales sont fréquemment considérées comme un gisement de recettes potentielles.
Synthèse des principaux chiffrages disponibles sur les niches sociales (2024)
(en milliards d'euros)
|
Montant |
|
|
Niches sociales apparaissant dans des tableaux récapitulatifs de l'annexe 2 au Placss (niches sur les cotisations et certaines niches sur les contributions) |
89,0 |
|
Allégements généraux1 |
64,9 |
|
Exonérations ciblées compensées2 |
6,8 |
|
Exonérations non compensées3 |
2,7 |
|
Exemptions d'assiette (généralement non compensées)4 |
14,6 |
|
Principales niches sociales apparaissant seulement dans des fiches de l'annexe 2 au Placss (mais pas dans les tableaux récapitulatifs) |
11,3 |
|
Abattement de CSG et de CRDS de 1,75 % au titre des frais professionnels |
2,0 |
|
Taux de CSG inférieurs au taux de 9,2 % applicable aux salaires |
8,0 |
|
Prime de partage de la valeur6 |
ND |
|
Déduction forfaitaire spécifique (DFS)7 |
1,3 |
|
Total |
100,3 |
1 Allégements généraux de cotisations patronales.
2 Entreprises implantées en outre-mer, aide à domicile employée par un particulier fragile, aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile, apprentissage, déductions sur les heures supplémentaires (entreprises de moins 250 salariés).
3 Essentiellement l'exonération sur les heures supplémentaires.
4 Dans l'annexe 2 au Placss, ces niches font l'objet d'un tableau séparé.
5 Le chiffrage de certaines niches concerne l'exercice 2023. La principale (0,7 milliard d'euros) est l'abattement de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
6 L'exemption de prime de partage de la valeur (PPV) fait l'objet d'une fiche, mais celle-ci ne comprend pas de chiffrage. Cela vient du fait que, selon le Gouvernement, la PPV n'aurait pas été versée en l'absence de l'exonération, et n'aurait donc pas de coût pour la sécurité sociale. Cet argumentaire est contesté, à juste titre, par la Cour des comptes205(*). Selon la Cour des comptes, la mesure a coûté 1,1 milliard d'euros en 2022 comme en 2023 ; la Cour des comptes indique toutefois ne pas pouvoir fournir de chiffrage pour 2024.
7 La DFS est un abattement de l'assiette des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, représentatif des frais professionnels engagés par le salarié. À la suite de concertations menées à partir de 2020, la majorité des secteurs concernés ont accepté de sortir progressivement du dispositif.
Source : Mecss du Sénat, sauf mention contraire d'après l'annexe 2 au Placss relatif à 2024
Toutefois, l'examen des différentes lignes du tableau montre que les gains potentiels sont différenciés.
(1) Réduire encore les allégements généraux, en maîtrisant l'effet sur l'emploi ?
Les niches sociales correspondent pour 60 % aux allégements généraux de cotisations sociales patronales, dont une nouvelle réduction pourrait avoir un effet significatif sur l'emploi (cf. encadré).
Les allégements généraux de
cotisations patronales :
quel impact sur l'emploi ?
Des allégements qui permettent près d'un million d'emplois ?
L'impact sur l'emploi des trois composantes actuelles des allégements généraux est très différent :
- selon les études réalisées dans les années 2000, l'allègement dégressif entre 1 et 1,6 Smic correspondrait à environ 800 000 emplois créés ou sauvegardés206(*) ;
- l'ex-CICE, au coût analogue, correspondrait à seulement environ 100 000 emplois créés ou sauvegardés207(*) ;
- l'impact sur l'emploi du bandeau famille pour sa part supérieure à 1,6 Smic, et a fortiori à 2,5 Smic, est considéré comme très faible, voire nul.
Le « rapport Bozio-Wasmer » d'octobre 2024208(*), bien que reposant sur une hypothèse d'élasticité de l'emploi à son coût plus faible que les études du début des années 2000209(*), estime qu' « un scénario radical de suppression complète des exonérations générales conduirait, suivant les élasticités emploi retenues dans la suite de ce rapport [...], à la destruction de 980 000 ETP ».
Cela ne signifie pas que sans les allègements, il y aurait en France environ un million d'emplois de moins. En effet, ces allègements existant depuis longtemps, leur effet sur l'emploi s'est atténué (par exemple parce qu'ils ont permis d'augmenter davantage les salaires).
Toutefois il ressort de ces études que leur suppression susciterait la disparition rapide d'environ un million d'emplois. Leur réduction doit donc être envisagée avec prudence.
Une réduction à envisager avec prudence pour les salaires supérieurs à 2,5, voire 1,6 Smic
Selon les prévisions économiques de l'OFCE du 16 octobre 2024, dans sa version initiale, la réduction des allégements généraux par le PLFSS pour 2025 aurait détruit 50 000 emplois au bout de trois ans (dont 15 000 dès 2025)210(*). Le rapport211(*) de novembre 2024 du groupe d'experts sur le Smic évaluait quant à lui le nombre d'emplois détruits par le dispositif initial à 100 000.
L'idée que les baisses de charges n'auraient pas d'effet sur l'emploi à partir d'un niveau de salaire autour de 2 Smic est toutefois consensuelle parmi les économistes. Ainsi, une note212(*) de 2019 du Conseil d'analyse économique préconisait d'« abandonner [...] les baisses de charges au-dessus de 2,5 Smic voire 1,6 Smic, si les évaluations à venir de France Stratégie venaient à confirmer leurs résultats décevants ». Dans son rapport précité, le rapport du groupe d'experts sur le Smic considère qu'une sortie des allégements à 2 fois le Smic aurait permis une économie de 7 milliards d'euros sans effet négatif sur l'emploi213(*).
Un mécanisme d'action discuté
Le mécanisme d'action des allégements généraux est discuté. Selon Sophie Cottet214(*), les « allégements Juppé » de 1995 et 1996 ont créé des emplois peu qualifiés dans les entreprises qui n'en employaient que pas ou peu, et ont permis aux autres entreprises d'augmenter les emplois indépendamment de leur niveau de salaire215(*).
L'article 41 de la LFSS pour 2025 a réduit les allégements généraux de 2 milliards d'euros en 2025, augmentant d'autant les recettes de la sécurité sociale. Du fait de cette mesure, l'impôt sur les sociétés, perçu par l'État, a été réduit d'un montant estimé à 0,4 milliard d'euros. Le choix a été fait de neutraliser la mesure pour l'État, et donc de reporter ce coût sur la sécurité sociale, en réduisant à due concurrence la part de TVA affectée à la sécurité sociale. Ainsi, le gain net pour la sécurité sociale était de 1,6 milliard d'euros. Pour mémoire, le texte initial prévoyait une réduction des allégements généraux de 5 milliards d'euros, correspondant pour la sécurité sociale à un gain net de 4 milliards d'euros.
À partir de 2026, le barème des allégements généraux sera fixé réglementairement par le Gouvernement, avec toutefois pour contrainte que le point de sortie devra être à 3 Smic.
Dans son Ralfss de mai 2025216(*), la Cour des comptes recommande diverses mesures tendant globalement à réduire les allégements généraux de 6 milliards d'euros : 3 milliards d'euros pour l'inclusion de certains compléments de salaire exemptés217(*) pour le calcul des allégements généraux218(*), 2 milliards d'euros pour une « optimisation » de la courbe des allégements devant être fixée réglementairement à compter de 2026, 1 milliard d'euros pour une sortie du dispositif à 2,5 Smic.
On pourrait également prévoir que le barème des allégements généraux est défini en fonction non du ratio rémunération/Smic en vigueur, mais en fonction du ratio rémunération/Smic en vigueur l'année précédente (ce qui reviendrait à geler le barème l'année d'entrée en vigueur de ce dispositif). Le sujet est évoqué, sans chiffrage, par le « rapport Bozio-Wasmer ». Selon des estimations préliminaires, le gain pourrait être de l'ordre du milliard d'euros.
(2) Augmenter certains taux réduits de CSG ?
Certains taux de CSG sont inférieurs au taux de 9,2 % applicable aux salaires (cf. tableau).
Rappel des différents taux de CSG et de CRDS
(en millions d'euros)
|
Nature des revenus |
Taux de CSG |
Partie CSG déductible pour l'impôt sur le revenu |
Taux CRDS |
|
|
Revenus d'activité |
||||
|
Revenus d'activité salariée |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|
|
Compléments du salaire (exemple : sommes liées à l'intéressement) |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|
|
Revenus professionnels |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|
|
Revenus de remplacement |
||||
|
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) |
6,2 % |
3,8 % |
0,5 % |
|
|
Allocations chômage |
Taux zéro |
Exonération |
Exonération |
|
|
Taux réduit de 3,8 % |
3,8 % |
0,5 % |
||
|
Taux normal de 6,2 % |
3,8 % |
0,5 % |
||
|
Préretraites |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|
|
Retraite |
|
|
|
|
|
Taux zéro |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
|
|
Taux réduit |
3,8 % |
3,8 % |
0,5 % |
|
|
Taux médian |
6,6 % |
4,2 % |
0,5 % |
|
|
Taux normal |
8,3 % |
5,9 % |
0,5 % |
|
|
Pension d'invalidité |
|
|
|
|
|
Taux zéro |
Exonération |
Exonération |
Exonération |
|
|
Taux réduit |
3,8 % |
3,8 % |
0,5 % |
|
|
Taux médian |
6,6 % |
4,2 % |
0,5 % |
|
|
Taux normal |
8,3 % |
5,9 % |
0,5 % |
|
|
Patrimoine et placements |
||||
|
Revenus du patrimoine et de placements |
9,2 % |
6,8 % |
0,5 % |
|
Source : Mecss du Sénat
Les taux de CSG inférieurs au taux de 9,2 % applicable aux salaires correspondraient, selon la fiche correspondante de l'annexe 2 au Placss 2024, à un coût d'environ 8 milliards d'euros, sans indication d'année. En réponse à une question des rapporteures, la DSS évalue le coût de cette niche pour les seules pensions de retraite à 11,3 milliards d'euros en 2025, conformément au tableau ci-après.
Coût des taux réduits de CSG sur les
pensions de retraite
par rapport à un taux de 9,2 % en 2025
(hors effet sur l'impôt sur le revenu)
(en milliards d'euros)
|
Montant |
|
|
Dont taux plein 8,3 % |
1,8 |
|
Dont taux intermédiaire 6,6 % |
3,1 |
|
Dont taux réduit 3,8 % |
1,6 |
|
Dont taux nul |
4,8 |
|
Total |
11,3 |
Source : Direction de la sécurité sociale (réponse aux rapporteures)
Selon la direction de la sécurité sociale, aligner le taux réduit de CSG de 8,3 % applicable aux « grosses retraites » sur le taux de 9,2 % applicable aux salaires rapporterait 1,8 milliard d'euros.
Toutefois la question des prélèvements obligatoires sur les pensions est complexe et ne se réduit pas à la question du taux de CSG. D'un côté, après prise en compte de l'abattement de 1,75 % sur les salaires et de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), due sur les seules pensions, l'écart de taux par rapport à une pension prélevée au taux normal de 8,3 % n'est plus que de 0,43 point (cf. tableau ci-après) ; augmenter de 0,43 point le taux global applicable aux pensions rapporterait environ un milliard d'euros219(*). De l'autre, les retraités ne paient pas de cotisations sociales.
Le véritable sujet semble moins être la comparaison des actifs et des retraités sur la base d'éléments isolés (salaires et pensions bruts, prélèvements obligatoires...) que celle de leur niveau de vie relatif. Selon le rapport du COR de juin 2025, les retraités ont en France un niveau de vie légèrement inférieur à celui des actifs220(*), et la France fait partie des pays où le niveau de vie des seniors est le plus proche de celui des actifs221(*). La question du niveau de vie relatif des retraités relève d'un choix politique.
CSG-CRDS-Casa : comparaison des taux
d'imposition
pour les salaires et les pensions
(en %)
|
Salaires |
Pensions** |
|||
|
Taux nominal |
Assiette après abattement de 1,75 % |
Taux effectif* |
||
|
Contribution sociale généralisée (CSG) taux plein |
9,2 |
98,25 |
9,04 |
8,3 |
|
Contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) |
0,5 |
98,25 |
0,49 |
0,5 |
|
Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) |
0,3 |
|||
|
Total |
9,7 |
9,53 |
9,1 |
|
Remarque : la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), contrepartie de la Casa assise sur la « journée de solidarité » non rémunérée du salarié, est due par l'employeur et n'apparaît donc pas dans le tableau.
* Produit des deux colonnes précédentes.
** Cas d'une retraite appliquée au taux normal de 8,3 %.
Source : Calculs de la Mecss
Le récent rapport222(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre est favorable au principe d'une augmentation de certains taux, en particulier ceux pesant sur le patrimoine223(*).
Les niches de CSG et d'impôt sur le revenu
en faveur des retraités,
selon le Conseil des
prélèvements obligatoires
« Les avantages fiscaux dont bénéficient les pensions et retraites sous la forme d'un abattement de 10 % et de taux réduits de CSG ne sont pas assez ciblés sur les foyers aux revenus modestes et intermédiaires.
[...]
S'agissant de la CSG, les revenus de remplacement bénéficient de taux dérogatoires, fixés à 8,3 % pour les pensions de retraite et d'invalidité et à 6,2 % pour les autres revenus de remplacement, ainsi que de taux réduits dépendant du niveau de revenu du foyer fiscal.
« Pour une personne percevant des pensions à hauteur de 2,5 fois le salaire moyen, l'avantage ainsi accordé par ce taux dérogatoire est de 990 € par an. À cet avantage, centré sur les retraités les plus aisés, s'ajoute une exonération ou un taux réduit de CSG lorsque le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 24 812 € pour une personne seule et 38 059 € pour un couple. L'abattement de 10 % pour les pensions et l'abattement d'assiette bénéficiant aux contribuables âgés de plus de 65 ans étant intégrés au RFR, ces dispositifs ont pour effet d'élargir le champ d'application du taux réduit. Ainsi, un retraité célibataire de plus de 65 ans, sans personne à charge et percevant une pension allant jusqu'à 29 094 € soumis au PFU et donc non intégrés au revenu net global, sera éligible au taux réduit de CSG par effet du cumul de ces deux dispositifs*.
« Le traitement fiscal favorable des retraités aisés par rapport aux actifs ne correspond en pratique à aucune justification identifiée de politique publique.
« * Un RFR de 24 812 € peut être atteint à partir d'un revenu net global de 26 185 € lorsqu'on intègre l'abattement forfaitaire pour contribuables de plus de 65 ans ou invalides. Ce revenu net global peut lui-même être atteint avec une pension d'un montant de 29 094 € avant abattement de 10 %. »
Source : Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus, octobre 2024
(3) Réduire les niches sociales sur les compléments de salaire ?
(a) Supprimer les exemptions de CSG pour certains compléments de salaire ?
L'assiette de la CSG sur les salariés est réduite par diverses niches sociales224(*).
Le montant des assiettes exemptées figure dans l'annexe 2 au Placss. L'application aux montants des assiettes exemptées de CSG d'un taux de 9,2 % suggère que le gain résultant de leur assujettissement pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros.
Coût des principales exemptions de GSG en faveur des salariés : chiffrage indicatif
(en milliards d'euros)
|
Assiette exemptée 2024* |
Produit si imposition au taux de 9,2 %** |
|
|
Titres restaurant |
5,3 |
0,5 |
|
Chèques vacances |
1,1 |
0,1 |
|
Avantages accordés par les comités d'entreprise |
4,7 |
0,4 |
|
Cesu préfinancé |
0,2 |
0,0 |
|
Indemnités de licenciement |
2,5 |
0,2 |
|
Indemnités de rupture conventionnelle |
2,2 |
0,2 |
|
Total |
16,0 |
1,5 |
* Source : annexe 2 au Placss 2024.
** Colonne précédente × 9,2 %.
Source : Mecss du Sénat, d'après l'annexe 2 au Placss 2024
(b) Augmenter le forfait social pour certaines niches relatives aux compléments de salaire ?
Dans son chapitre du Ralfss 2024 sur les niches relatives aux compléments de salaire225(*), la Cour des comptes préconise trois mesures qui, globalement, rapporteraient 2,5 milliards d'euros.
L'une de ces mesures a été mise en oeuvre, à l'initiative du Sénat, par la LFSS pour 2025 (rétablissement du taux de 30 % pour la contribution de l'employeur sur les attributions gratuites d'actions), pour un produit de 0,5 milliard d'euros.
Les deux autres, relatives au forfait social226(*), rapporteraient chacune 1 milliard d'euros :
- convergence des différents taux du forfait social applicables aux dispositifs de partage de la valeur vers le taux de 20 % ;
- rétablissement du forfait social pour l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés (supprimé par la LFSS pour 2019).
Le récent rapport des trois Hauts Conseils mentionne la première de ces deux recommandations, indiquant que « si une telle mesure était envisagée, elle devrait être mise en place de manière progressive ainsi que le suggère la Cour des comptes ».
(c) Centrer davantage l'exemption en faveur de la prévoyance complémentaire sur la prévoyance stricto sensu ?
L'annexe au Placss 2024 relative aux niches sociales mentionne une exemption en faveur de la « prévoyance complémentaire », de 5,1 milliards d'euros en 2024.
Le récent rapport aux trois Hauts Conseils souligne que ce dispositif, qui avait pour objectif d'inciter au développement de la prévoyance stricto sensu (c'est-à-dire à des contrats couvrant les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité), est en fait « fortement concentré sur la santé ». On rappelle à cet égard que depuis 2013, les entreprises ont l'obligation de souscrire pour leurs salariés des complémentaires santé.
Aussi, le rapport précité préconise, sinon de supprimer l'aide pour la complémentaire santé, du moins de centrer davantage l'exemption sur la prévoyance. Selon lui, « le dispositif peut être rationalisé et son coût réduit, soit par l'instauration d'un plafond spécifique à chacun des risques, soit en appliquant un forfait social au taux de 20 % pour la partie « santé ». On pourrait également limiter l'exonération aux salaires inférieurs à un certain niveau (deux Smic mensuels par exemple) ».
Il ne présente pas de chiffrage.
(d) Réduire l'exonération salariale relative aux heures supplémentaires ?
Instaurée par la loi « Tepa » de 2007, l'exemption salariale de cotisations sociales relative aux heures supplémentaires a été supprimée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 et réinstaurée, cette fois sous la forme d'une exonération, par la LFSS pour 2019 (cf. encadré ci-après).
Elle a coûté 2,4 milliards d'euros en 2024 (hors droits retraite acquis gratuitement).
Le rapport précité des trois Hauts Conseils considère que « sans aller jusqu'à une suppression complète et immédiate du dispositif d'exonération retenu aujourd'hui, il pourrait être envisagé une suppression progressive de l'avantage ».
Il ne présente pas de chiffrage.
Les niches sociales relatives aux heures supplémentaires
Le dispositif dérogatoire relatif aux heures supplémentaires a été instauré par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite « loi Tepa »), avec un volet salarial (exemption) et un volet patronal (déduction forfaitaire).
Si la mesure est favorable à l'activité économique en augmentant le PIB potentiel, elle peut aussi à court terme détruire des emplois tant que le PIB n'a pas atteint son nouveau potentiel (les entreprises pouvant, comme cela a en alors été souligné par l'OFCE, préférer pendant cette période augmenter les heures supplémentaires plutôt qu'embaucher)227(*).
Le dispositif a été jugé peu efficient par le rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011. Aussi, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé l'exonération salariale et n'a maintenu la déduction forfaitaire patronale que pour les entreprises de moins de 20 salariés.
La LFSS pour 2019 a recréé un nouveau dispositif en faveur des salariés, cette fois sous la forme d'une exonération (et non plus d'une exemption) de cotisations salariales. Le recours à une exonération a pour conséquence que les heures supplémentaires sont prises en compte pour le calcul des droits à la retraite. La LFSS pour 2019 prévoit explicitement que, contrairement à la déduction forfaitaire patronale, l'exonération salariale n'est pas compensée228(*).
En 2024, la déduction forfaitaire patronale a coûté 0,9 milliard d'euros et l'exonération salariale 2,3 milliards d'euros. S'y ajoute, dans le cas du budget de l'État, une exonération de l'impôt sur le revenu, pour un coût de 1,8 milliard d'euros en 2024, ce qui en fait la dixième dépense fiscale la plus coûteuse.
Dans son rapport de mai 2024 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande de « compenser par crédits budgétaires le manque à gagner pour la sécurité sociale de l'exonération des cotisations salariales des heures supplémentaires ».
(e) Réduire l'exemption relative aux titres restaurant ?
L'exemption d'assiette relative aux titres restaurant a coûté 1,9 milliard d'euros en 2024.
Selon le rapport précité des trois Hauts Conseils, « il pourrait être proposé de ne pas prolonger l'extension de l'utilisation aux aliments non directement consommables et de limiter le plafond journalier et de revenir à la logique initiale des titres restaurants, en limitant l'exemption aux situations où le travailleur n'est pas à son domicile. Au vu des progressions constatées sur les pertes de cotisations, la mesure représenterait un surcroît de recettes de l'ordre de 0,2 Md€ à 0,5 Md€ selon les modalités retenues. On pourrait également réinterroger l'objectif de l'exonération attachée aux titres restaurants (par exemple, doit-elle bénéficier pleinement à toutes les catégories de revenus, ou serait-il opportun de la flécher sur les revenus les plus faibles ?) ».
(f) Réduire l'exemption relative aux indemnités de rupture conventionnelle ?
L'exemption d'assiette relative aux indemnités de rupture conventionnelle a coûté 0,1 milliard d'euros en 2024 (contre 0,9 milliard d'euros pour celle sur les indemnités de licenciement).
Le rapport précité des trois Hauts Conseils s'interroge sur la pertinence de cette exemption. En particulier, il souligne que si l'indemnité de licenciement a pour objet de compenser un préjudice, tel n'est pas le cas de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Ainsi, selon ce rapport, « le HCFiPS considère qu'une évolution des règles d'assujettissement est envisageable sur ce point ».
Toutefois l'enjeu financier est mineur, l'exemption ne coûtant que 0,1 milliard d'euros.
(4) Autres principales niches pouvant être réduites ou supprimées
Supprimer l'abattement de 1,75 % de CSG-CRDS au titre des frais professionnels rapporterait entre 1,3 et 2 milliards d'euros229(*).
Supprimer l'abattement d'impôt sur le revenu de 10 % pour les pensions rapporterait 5 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu étant un impôt d'État, si l'on souhaitait que le gain revienne à la sécurité sociale, une disposition spécifique serait nécessaire (comme une augmentation de la part de TVA affectée à la sécurité sociale).
b) Les hausses de taux : jusqu'à 18 milliards d'euros pour une hausse d'un point de la CSG ?
Les principaux ordres de grandeur sont les suivants :
- une augmentation d'un point des cotisations patronales ou salariales déplafonnées rapporterait respectivement 6,2 milliards d'euros et 7,6 milliards d'euros ;
- une augmentation d'un point de tous les taux de CSG rapporterait 18 milliards d'euros (dont 12 milliards pour les revenus d'activité, 4 milliards pour les revenus de remplacement, 0,8 milliard pour les revenus du patrimoine, 1,1 milliard pour les revenus de placement) ;
- une augmentation d'un point de tous les taux TVA rapporterait 3 milliards d'euros à la sécurité sociale (et 13 milliards d'euros pour l'ensemble des administrations publiques230(*)).
Dans le cas de la CSG, des solutions alternatives à une hausse des taux seraient un élargissement de l'assiette, par exemple aux transmissions de patrimoine, ou l'instauration d'une tranche supplémentaire. Le rendement d'une telle mesure dépendrait des modalités retenues.
c) Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils, le retour de la branche autonomie à l'équilibre en 2030 passera par la hausse des recettes, du fait de la nécessité de financer des dépenses supplémentaires
Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de juin 2025, à politiques inchangées la branche autonomie aurait un déficit de « seulement » 3,3 milliards d'euros en 2029. À l'échelle de la sécurité sociale (qui selon la CCSS aurait à cette échéance un déficit de 24,8 milliards d'euros), il ne s'agit donc pas d'un enjeu financier majeur.
Toutefois dans le cas de la branche autonomie il pourrait être particulièrement difficile de demeurer à « politiques inchangées », comme cela est souligné dans la troisième partie du présent rapport.
La contribution du Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge (HCFEA) au récent rapport231(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre présente, à l'horizon 2030, un « plan global transverse » relatif aux parcours gériatriques, comprenant, outre des propositions d'économies, des propositions de dépenses.
Les échanges avec le HCFEA ont permis de synthétiser ce plan par le tableau ci-après.
Synthèse du « plan global transverse » proposé par le HCFEA (montants en 2030)
(en milliards d'euros)
|
Toutes Asso |
Branche autonomie |
||
|
A |
Part du déficit 2030 de la CNSA attribuable aux dépenses en faveur des personnes âgées |
- 1,9* |
|
|
B |
Prévention primaire (nette) [C-D] |
0,3 |
0,3 |
|
C |
Economies brutes |
1,0 |
1,0 |
|
D |
Rétrocession de 2/3 des économies aux Ehpad et établissements de santé |
- 0,7 |
- 0,7 |
|
E |
Prévention secondaire et tertiaire |
0,4** |
0,4** |
|
F |
Intégration des dépenses de paramédicaux dans le tarif partiel des Ehpad |
0,1 |
0,1 |
|
G |
Économies sur les coûts de gestion de l'aide sociale à domicile et de l'APA |
À évaluer |
À évaluer |
|
H |
Économies liées au développement de l'habitat partagé |
À évaluer |
À évaluer |
|
I |
Total des économies [B+E+F+G+H] |
1,5 |
0,8 |
|
J |
Rénovation de l'APA |
- 0,4 |
- 0,4 |
|
K |
Renforcement des parcours gériatriques |
- 0,6 |
- 0,6 |
|
L |
Augmentation des moyens des caisses de retraite (prévention, action sociale) |
- 0,3 |
|
|
M |
Adaptation des logements privés (MaPrim'Adapt) |
- 0,1 |
|
|
N |
Financement Icope et Mon bilan santé |
À évaluer |
|
|
O |
Total des dépenses [J+K+L+M+N] |
- 1,4 |
- 1 |
|
P |
Solde des mesures [I+O] |
0,1 |
- 0,2 |
|
Q |
Solde de la branche autonomie en 2030 attribuable aux dépenses en faveur des personnes âgées, sans recettes supplémentaires [(A+P)] |
- 2,1*** |
|
Les mesures positives sont celles améliorant le solde, les mesures négatives celles dégradant le solde.
* Selon le rapport des trois Hauts Conseils, « les 2,2 milliards d'euros qui manquent pour remettre la CNSA à l'équilibre en 2027, recoupent un besoin de financement essentiellement lié à la dynamique des dépenses, tirée également par celles de la politique de handicap. L'application d'une quote-part sur la politique de soutien à l'autonomie des personnes âgées au prorata de l'ENSA financé par la CNSA, soit 51 %, est une façon d'approcher le déficit à combler à périmètre courant côté PA, soit 1,1 milliard d'euros ». Les mesures d'économie étant chiffrées dans le rapport des trois Hauts Conseils à l'échéance 2030, ce montant a été recalculé par la Mecss sur la base d'une hypothèse conventionnelle de déficit de la branche autonomie à politiques inchangées de 3,8 milliards d'euros en 2030. Pour mémoire, le déficit de la branche autonomie prévu par le rapport à la CCSS de juin 2025 est de 2,1 milliards d'euros en 2027, 2,6 milliards d'euros en 2028 et 3,3 milliards d'euros en 2029.
** Économie évaluée à 1 milliard d'euros en 2040.
*** Selon le rapport des trois Hauts Conseils, on peut « approximer le besoin de financement de la branche autonomie - résorption du déficit et mesures nouvelles, nets des économies proposées (0,7 milliard d'euros sur les dépenses de santé évitables des personnes âgées) - à horizon 2030 à 1,3 milliard d'euros ». Selon les indications fournies par le HCFEA aux rapporteures, ce montant concerne l'année 2028.
APA : allocation personnalisée d'autonomie. Asso : administrations de sécurité sociale. CCSS : commission des comptes de la sécurité sociale. CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ehpad : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. ENSA : effort national de solidarité pour l'autonomie. Icope : Integrated Care for Older People (soins intégrés pour les personnes âgées). PA : personnes âgées.
Source : D'après le rapport des trois Hauts Conseils de juin 2025 et les échanges avec le HCFEA
Le HFCEA propose des mesures d'économie, dont il évalue l'impact pour les administrations de sécurité sociale (Asso) à 1,5 milliard d'euros en 2030. Ces mesures concerneraient la prévention primaire (comprenant notamment un plan de prévention des chutes), les préventions secondaire et tertiaire (visant à réduire la proportion de personnes âgées devenant dépendantes) et diverses mesures d'économie, correspondant notamment au développement de l'habitat partagé.
S'agissant de la prévention primaire, les rapporteures considèrent qu'elle passe notamment par un renforcement de l'attractivité des postes en Ehpad ainsi que de ceux des professionnels du domicile (SAD). En particulier, de nombreux postes de médecin coordonnateur sont non pourvus.
Le HCFEA préconise également d'augmenter certaines dépenses, pour un montant total évalué en 2030 à 1,4 milliard d'euros sur le périmètre des Asso. En particulier, il « émet un point d'alerte sur le niveau insuffisant d'accompagnement de la perte d'autonomie au domicile par l'APA, notamment pour les personnes atteintes uniquement de restrictions cognitive ». En conséquence, il préconise une « réforme progressive de l'APA permettant d'améliorer [ses] plans d'aides et [sa] consommation, ainsi que d'inclure dans son bénéfice plus de personnes souffrant de troubles cognitifs ».
Selon le HCFEA, ce plan permettrait donc de ramener la branche autonomie à l'équilibre en 2030 pour ce qui concerne ses dépenses en faveur des personnes âgées, sous réserve d'augmenter ses recettes de 2,1 milliards d'euros. En effet, sur le périmètre de la branche, les économies et les coûts seraient de respectivement 0,8 et 1 milliard d'euros, d'où un coût net des mesures de 0,2 milliard d'euros. En évaluant, de manière en partie conventionnelle, le déficit à politiques inchangées correspondant aux dépenses de la branche en faveur des personnes âgées à 1,9 milliard d'euros en 2030, cela correspond à un déficit de 2,1 milliards d'euros en 2030.
Le rapport des trois Hauts Conseils considère que ces recettes supplémentaires pourraient provenir de l'affectation de tout ou partie d'une hausse du taux de CSG (dont l'augmentation d'un point de tous les taux rapporterait 18 milliards d'euros), du passage du taux de la CSA de 0,3 à 0,6 point (2,5 milliards d'euros)232(*), ou l'extension de l'assiette de la CSA aux revenus d'activité des indépendants, aux compléments de salaire et aux revenus de remplacement hors retraites (0,6 milliard d'euros selon le « rapport Vachey »233(*)).
3. Combiner augmentations de recettes et maîtrise des dépenses ?
Les considérations ci-avant suggèrent qu'un retour rapide vers l'équilibre des comptes de la sécurité sociale suppose de combiner augmentations de recettes et maîtrise des dépenses.
a) Dans les années 2010, l'effort structurel a reposé exclusivement sur les recettes
Le déficit de la sécurité sociale, de 25,5 milliards d'euros en 2010, a été ramené à 1,7 milliard d'euros en 2019, ce qui représente une diminution de 23,8 milliards d'euros.
Compte tenu notamment de l'impossibilité pratique de reconstituer des séries cohérentes et non biaisées234(*) pour les différents types d'économies (en particulier sur l'Ondam et les retraites), on retient ici une approche en termes de solde structurel et d'effort structurel. L'effort sur les dépenses est donc assimilé à la diminution du ratio entre les dépenses et le PIB potentiel (c'est-à-dire le PIB corrigé des effets de la conjoncture). Cette approche présente en outre l'intérêt de fournir une indication sur la soutenabilité de l'évolution des dépenses : si l'effort structurel sur les dépenses est négatif, le ratio dépenses/PIB potentiel augmente, ce qui ne peut se poursuivre indéfiniment.
Le graphique ci-après présente une décomposition indicative du solde de la sécurité sociale depuis 2010 entre déficit structurel et déficit conjoncturel (s'appuyant comme précédemment sur l'estimation du PIB potentiel par la Commission européenne).
Décomposition du solde effectif de la
sécurité sociale
entre solde structurel et solde
conjoncturel
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss, l'Insee et la Commission européenne
On observe que si de 2010 à 2014 la réduction du déficit a été structurelle, avec un quasi-retour à l'équilibre structurel en 2014, ensuite l'effort s'est relâché. En effet, le déficit structurel avait à nouveau atteint plus de 10 milliards d'euros en 2019, ce qui était alors masqué par l'excédent conjoncturel.
Le graphique ci-après décompose l'évolution du déficit d'une année à l'autre entre ses composantes, en particulier l'effort structurel sur les dépenses et les mesures nouvelles sur les recettes.
Évolution du solde de la
sécurité sociale entre 2011 et
2024 :
décomposition indicative
(en milliards d'euros)
|
Années 2010 |
2020-2024 |
2011-2024 |
|||
|
2011-2014 |
2015-2019 |
2011-2019 |
|||
|
Effort structurel1 |
13,2 |
5,9 |
19,1 |
- 11,3 |
7,9 |
|
dont : |
|||||
|
Effort structurel sur les dépenses2 |
- 12,9 |
7,0 |
- 5,9 |
- 19,4 |
- 25,2 |
|
Effort structurel sur les recettes4 |
26,1 |
- 1,1 |
25,0 |
8,1 |
33,1 |
|
Év. du solde conjoncturel5 |
- 6,2 |
17,7 |
11,4 |
- 12,7 |
- 1,3 |
|
Évolution spontanée des recettes6 |
9,2 |
- 16,0 |
- 6,8 |
10,4 |
3,6 |
|
Évolution du solde |
16,2 |
7,6 |
23,8 |
- 13,6 |
10,2 |
1 Évolution du ratio dépenses/PIB potentiel plus mesures nouvelles sur les recettes.
2 Évolution du ratio dépenses/PIB potentiel. Cette ligne prend indirectement en compte, notamment, les diverses économies (Ondam, retraites...).
3 En supposant une croissance spontanée de l'Ondam de 4,5 % par an en valeur.
4 Mesures nouvelles. Sources : HCFiPS, rapport au Premier ministre de janvier 2022 ; rapports à la commission des comptes de la sécurité sociale.
5 Solde conjoncturel estimé sur la base de l'écart de production (output gap) tel qu'évalué par la Commission européenne.
6 Effet de la fluctuation de l'élasticité au PIB. Cette élasticité est de 1 en moyenne mais peut s'écarter ponctuellement de cette valeur.
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss, les rapports à la CCSS, le HCFiPS, l'Insee et la Commission européenne
Dans le cas des années 2010, le tableau suggère que la diminution de 23,8 milliards d'euros du déficit en 2011-2019 a presque exclusivement résulté de l'effort structurel (pour 19,1 milliards d'euros).
L'effort structurel aurait porté exclusivement sur les recettes, pour un montant d'environ 25 milliards d'euros. La totalité de cet effort sur les recettes a eu lieu en 2011-2014.
Malgré les économies sur les dépenses, sur cette période l'effort structurel sur les dépenses a été négatif ; autrement dit, le ratio dépenses/PIB potentiel a augmenté.
L'augmentation du déficit structurel en 2015-2019 serait provenue d'une croissance spontanée des recettes inférieure à celle du PIB potentiel235(*).
b) Dans les années 2010, les mesures d'amélioration du solde ont essentiellement concerné les dépenses
Le graphique ci-après indique les mesures sur les recettes et les dépenses, reconstituées ici à titre indicatif à partir de sources diverses.
Il correspond donc à des concepts différents de ceux des deux graphiques précédents. En effet, dans le cas des dépenses les mesures sont ici exprimées par rapport à un scénario où elles augmenteraient conformément à leur tendance spontanée, alors que pour les deux graphiques précédents le référentiel correspond à une croissance des dépenses égale à celle du PIB potentiel.
Ce graphique doit être considéré avec prudence, du fait en particulier de l'insuffisance des données relative aux dépenses.
Reconstitution indicative des mesures sur les
recettes et les dépenses
de la sécurité sociale
(2011-2024)
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss, les rapports à la CCSS, le HCFiPS et la Cour des comptes
Sur la période 2011-2019, les mesures sur les recettes et les dépenses se seraient élevées à environ 75 milliards d'euros (soit environ 8 milliards d'euros par an).
Les mesures sur les recettes ont été on l'a vu d'environ 25 milliards d'euros, en totalité en 2011-2014, soit en moyenne 6,5 milliards d'euros par an sur ces quatre années.
Principales mesures nouvelles sur les recettes de 2011 à 2014
En 2011, les mesures nouvelles ont été de 7,0 milliards d'euros, les principales étant l'augmentation des droits sur les tabacs (1,5 milliard d'euros), l'annualisation des « allégements Fillon » sur les bas salaires (2,1 milliards d'euros) et l'affectation à la branche maladie de la TVA sur les biens et services médicaux (1,2 milliard d'euros)236(*).
En 2012, les mesures nouvelles ont été de 6,2 milliards d'euros, les principales étant le passage de 2,2 % à 3,4 % du taux du prélèvement social sur les revenus du capital (1,3 milliard d'euros) et le passage de 3,5 % à 7 % du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sur les contrats dits « solidaires et responsables » (0,8 milliard d'euros)237(*).
En 2013, les mesures nouvelles ont été de 7,6 milliards d'euros, les principales étant la hausse de deux points du taux du prélèvement social sur les revenus du capital (1,8 milliard d'euros) et le relèvement du taux du forfait social de 8 % à 20 % (1,6 milliard d'euros)238(*).
En 2014, les mesures nouvelles ont été de 5,3 milliards d'euros, les principales étant un transfert de la TVA à la Cnam (3 milliards d'euros) et l'augmentation de 0,3 point des cotisations de retraite (1,5 milliard d'euros)239(*).
Dans le cas des dépenses, les économies auraient été d'environ 50 milliards d'euros, dont les trois quarts pour l'Ondam240(*) (toujours respecté de 2011 à 2019) et un quart pour les retraites241(*).
Reconstitution indicative des mesures sur les
recettes
et les dépenses de la sécurité sociale
(2011-2024)
(en milliards d'euros)
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss, les rapports à la CCSS, le HCFiPS et la Cour des comptes
Les estimations ci-avant sont proches de celles du récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (cf. encadré).
Les estimations publiées par le récent rapport des trois Hauts Conseils
Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, le retour de la sécurité sociale à l'équilibre dans les années 2010 aurait impliqué un effort cumulé d'environ 75 milliards d'euros (soit 8 milliards d'euros par an), dont 60 % sur les dépenses et 40 % sur les recettes.
Impacts financiers des mesures en recettes et en dépenses adoptées et mises en oeuvre entre 2011 et 2019 sur le champ des régimes de base et du FSV
(en milliards d'euros)
Source : Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
Le retour de la sécurité sociale
à l'équilibre dans les années 2010,
selon la Cour des
comptes
« Après la crise financière de 2008, les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse avaient atteint un déficit historique en 2010 (29,6 milliards d'euros ou 1,4 % du PIB) et supportaient une dette sociale qui augmentait plus vite qu'elle n'était amortie. À compter de 2011, les pouvoirs publics ont conduit un processus volontariste de redressement financier.
Des ressources nouvelles ont été allouées, 7 milliards d'euros en 2011, puis 5,1 milliards d'euros en 2012, selon le chiffrage effectué à l'époque par la Cour*, et des actions de modération des dépenses ont porté sur l'ensemble des branches. L'âge légal de départ en retraite a été porté de 60 à 62 ans par la loi du 10 novembre 2010. Pour la branche famille, les prestations familiales ont été sous-indexées et des réformes de la prestation d'accueil du jeune enfant (2014) et des allocation familiales (2015) en ont réduit le coût. Enfin, l'Ondam est devenu une norme de l'évolution des dépenses de santé, jamais dépassée sur la période**.
* Cour des comptes, « Les déficits et l'endettement de la sécurité sociale : situation 2011 et perspectives », Ralfss 2012, chapitre 1.
** Cour des comptes, Les dépenses d'assurance maladie entre 2010 et 2019 : des progrès dans la maîtrise globale des dépenses, des réformes à intensifier, Ralfss 2020, chapitre 2. »
Source : Cour des comptes, « La situation financière de la sécurité sociale - un déficit devenu structurel malgré les mesures envisagées pour 2025 », communication à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et à la Commission des affaires sociales du Sénat, octobre 2024
c) Impacts comparés des réductions de dépenses et des hausses de prélèvement obligatoire, selon le Trésor et l'OFCE
Les rapporteures ont demandé à la direction générale du Trésor et à l'OFCE de leur transmettre leur estimation de l'impact sur le PIB et sur le solde des administrations publiques de diverses mesures d'amélioration du solde, pour un montant d'un point de PIB.
Pour mémoire, un point de PIB correspond actuellement à environ 30 milliards d'euros, et donc à environ 5 points de cotisations employeurs, 4 points de cotisations salariés, 2 points de TVA ou 1,7 point de CSG242(*).
Les résultats sont synthétisés par les graphiques ci-après.
Impact d'une hausse d'un point de PIB des principaux prélèvements obligatoires, selon le Trésor et l'OFCE
1° Impact sur le PIB
(en points de PIB)
Direction générale du Trésor : modèle Mésange ; OFCE : modèle EmeRaude.
NB : la direction générale du Trésor n'ayant pas transmis de simulation dans le cas des dépenses, la ligne correspondante a été complétée à partir de : Insee, direction générale du Trésor, « Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés », Document de travail de la Direction des Études et Synthèses Économique G 2017 / 04, mai 2017.
Source : Direction générale du Trésor, OFCE (réponse au questionnaire des rapporteures)
2° Impact sur le solde des administrations publiques
(en points de PIB)
Direction générale du Trésor : modèle Mésange ; OFCE : modèle EmeRaude.
NB : la direction générale du Trésor n'ayant pas transmis de simulation dans le cas des dépenses, la ligne correspondante a été complétée à partir de : Insee, direction générale du Trésor, « Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés », Document de travail de la Direction des Études et Synthèses Économique G 2017 / 04, mai 2017.
Source : Direction générale du Trésor, OFCE (réponse au questionnaire des rapporteures)
(1) Les hausses de recettes préférables à court terme, les baisses de dépenses préférables à long terme : un résultat à relativiser dans le cas de la sécurité sociale ?
Les modélisations de la direction générale du Trésor et de l'OFCE conviennent qu'à long terme, une réduction des dépenses serait moins récessive qu'une augmentation des prélèvements obligatoires.
Ainsi, la réduction des dépenses publiques serait à court terme la manière la moins efficace de réduire le déficit (à cause de son effet plus récessif) et à long terme la manière la plus efficace (parce qu'elle n'aurait pas d'effet néfaste sur l'investissement par exemple).
Il faut toutefois considérer ces simulations avec une certaine prudence, d'autant plus grande qu'il s'agit ici de réduire le déficit de la sécurité sociale. En effet, dans le cas des dépenses elles ne concernent pas les seuls transferts aux ménages, mais l'ensemble des dépenses publiques (Trésor) ou de la consommation publique (OFCE)243(*). Or, dans le cas de la sécurité sociale, une diminution des dépenses peut être économiquement très proche d'une augmentation des recettes (cf. encadré).
La question de l'arbitrage
recettes/dépenses, selon le rapport
des trois Hauts Conseils au
Premier ministre
« Dans la façon d'aborder le redressement des comptes sociaux, deux grandes postures politiques s'affrontent : l'une priorise massivement les ressources ; l'autre, la maîtrise des dépenses. Sans vouloir nier l'importance de ce débat, le HCFiPS soutient que les crispations sur ce thème relèvent parfois d'un pur dogmatisme, occultant des positions intermédiaires nuancées.
Prenons deux exemples :
1/ Il pourrait être envisagé de travailler sur une plus grande équité entre retraités et actifs.
Pour cela, il y a deux voies qui aboutissent in fine à des résultats proches sans être similaires :
• le prélèvement (soit la remise en cause de l'abattement d'impôt sur le revenu, soit l'augmentation de la CSG) ;
• la gestion des prestations par une sous-indexation des retraites.
Au final, l'une ou l'autre de ces voies aboutissent à travailler sur le revenu net respectif des pensionnés et des actifs, avec des possibilités variables de différencier salariés modestes et aisés, et un affichage différent (je contribue plus/je reçois moins).
2/ En matière d'assurance maladie, la diminution des taux de prise en charge peut apparaître comme une mesure de maîtrise de la dépense contrairement à une augmentation des recettes. Mais cette diminution de la prise en charge, dans notre système de complémentaire obligatoire pour les salariés, se traduit quasi mécaniquement par une hausse du coût des complémentaires santé (partagé entre l'employeur et le salarié), donc par un prélèvement supplémentaire, comme le serait une augmentation de la CSG ; la différence est que le prélèvement est réparti différemment (notamment si la contribution à la complémentaire santé n'est pas fonction des revenus, mais du risque, donc de l'âge, ce qui est généralement le cas dans les contrats individuels). Transférer des charges aux complémentaires, c'est bien programmer un prélèvement, mais moins solidaire que dans l'assurance maladie de base. »
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
(2) Les hausses de cotisations doivent-elles être évitées ?
(a) Selon la direction générale du Trésor, les hausses de cotisations seraient fortement récessives, ce qui ne serait pas le cas selon l'OFCE
Dans le cas de la direction générale du Trésor, on observe une différence marquée entre les deux prélèvements selon elle les moins récessifs (la TVA et la CSG) et les deux prélèvements selon elle les plus récessifs (les cotisations employeurs et salariés). Dans le premier cas, le multiplicateur serait proche de l'unité et la quasi-totalité de l'effet récessif serait atteint au bout de deux ans et se maintiendrait à long terme, alors que dans le cas des cotisations, l'effet récessif augmenterait jusqu'à atteindre 1,7 point de PIB à long terme.
Dans le cas de l'OFCE en revanche, chaque prélèvement a un effet multiplicateur autour de 1, les cotisations salariés et la CSG étant toutefois un peu moins récessives que les cotisations employeurs et la TVA. La quasi-totalité de l'effet récessif serait atteint au bout de cinq ans et se maintiendrait à peu près jusqu'à 10 ans. A long terme, les impacts de chaque prélèvement deviendraient à peu près nuls.
Ces différences s'expliquent notamment par le fait que dans le modèle du Trésor les augmentations de cotisations ont un impact permanent sur le taux de chômage, et donc sur le PIB. Par ailleurs, dans ce modèle une hausse de prélèvements obligatoires réduit durablement l'investissement, et donc le PIB, alors que pour l'OFCE il n'y aurait plus d'effet à long terme.
(b) Selon la direction générale du Trésor, à long terme les hausses de cotisations n'amélioreraient pas le solde public, alors que selon l'OFCE elles ne se distingueraient pas des autres hausses de prélèvements obligatoires
L'effet sur le solde des administrations publiques des hausses des différents prélèvements obligatoires correspond à ce que l'on peut attendre du fait de cet impact sur le PIB244(*).
Dans le cas de la TVA et de la CSG, l'amélioration du solde serait la première année quasiment égale au montant de la mesure. Toutefois, comme la mesure réduit le PIB à long terme, l'effet serait plus faible à long terme (il serait divisé par deux au bout de dix ans).
En revanche, les deux modèles conduisent à des résultats différents dans le cas d'une augmentation des cotisations employeur ou salarié. Selon le Trésor, les cotisations auraient un effet fortement récessif, et à long terme l'amélioration du solde public serait nul. En revanche, selon l'OFCE, il n'y aurait pas d'effet particulier sur l'emploi, et l'effet serait le même que pour les autres augmentations de prélèvements.
Point d'accord n° 2 : Maîtriser la dynamique des dépenses de la branche maladie rapportées au PIB, qui devront augmenter moins rapidement que leur croissance spontanée.
Point d'accord n° 3 : Cet effort ne pouvant suffire à éviter une dégradation du déficit, réaliser l'effort supplémentaire nécessaire en agissant sur les recettes, les dépenses ou le nombre d'heures travaillées dans l'ensemble de l'économie.
III. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE : UN GAIN POTENTIEL DE PLUSIEURS MILLIARDS D'EUROS, ESSENTIELLEMENT SUR LES DÉPENSES ?
Les développements ci-après s'efforcent de chiffrer les gains directs, en termes de moindres dépenses et de recettes supplémentaires, que l'on peut raisonnablement attendre d'un renforcement de la lutte contre la fraude.
La lutte contre la fraude représente toutefois un enjeu plus important que ce que pourraient suggérer ces chiffres. En particulier, elle est un facteur important du consentement aux prélèvements obligatoires et de l'acceptabilité des autres mesures de réduction du déficit.
A. LA FRAUDE AUX PRESTATIONS : PLUSIEURS MILLIARDS D'EUROS DE GAIN POTENTIEL ?
1. Une fraude aux prestations sociales entre 6 et 10 milliards d'euros ?
a) Une fraude aux prestations sociales évaluée à environ 6 milliards d'euros par un rapport de 2024 du HCFiPS
La fraude sociale (recettes et dépenses) est évaluée par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS)245(*) à 13 milliards d'euros par an246(*), à peu près également répartis entre recettes et dépenses.
La fraude relative aux dépenses correspondrait en quasi-totalité (environ 5 milliards d'euros) :
- à la fraude des professionnels de santé (1,7 milliard d'euros) ;
- à la fraude des allocataires du RSA, de la prime d'activité et des allocations logement (3,3 milliards d'euros).
Les sujets médiatiques des « fausses cartes Vitale » et du versement de retraites à l'étranger à des personnes décédées correspondraient à de faibles montants.
Estimation de la fraude annuelle aux prestations sociales par le HCFiPS
(en milliards d'euros)
|
Montants |
|
|
Cnaf |
3,87 |
|
Revenu de solidarité active (RSA) |
1,54 |
|
Prime d'activité |
1,05 |
|
Allocations logement |
0,74 |
|
Prestations d'entretien* |
0,35 |
|
Allocation aux adultes handicapés (AAH) |
0,18 |
|
Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) |
0,03 |
|
Cnam |
1,71 |
|
Infirmiers libéraux |
0,34 |
|
Masseurs kinésithérapeutes |
0,2 |
|
Médecins généralistes |
0,2 |
|
Complémentaire santé solidaire (C2S) |
0,18 |
|
Médecins spécialistes |
0,18 |
|
Transporteurs |
0,16 |
|
Invalidité |
0,16 |
|
Pharmaciens |
0,1 |
|
Dentistes |
0,08 |
|
Rentes AT-MP |
0,07 |
|
Fournisseurs dispositifs médicaux |
0,05 |
|
Laboratoires |
0,01 |
|
Cnav |
0,04 |
|
Droits dérivés (hors minimum vieillesse) |
0,04 |
|
Minimum vieillesse |
0 |
|
Droit propre |
0 |
|
France Travail |
0,11 |
|
Périodes non déclarées |
0,08 |
|
Emplois fictifs |
0,03 |
|
Total |
5,73 |
Cnaf : Caisse nationale des allocations familiales. Cnam : Caisse nationale de l'assurance maladie. Cnav : Caisse nationale d'assurance vieillesse.
* Allocations familiales, complément familial, Allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire, allocation journalière de présence parentale, allocation journalière du proche aidant.
Source : D'après Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024
b) Une fraude à l'assurance maladie sous-évaluée de près de 3 milliards d'euros, selon une estimation haute de la Cour des comptes
S'agissant de la fraude à l'assurance maladie, on souligne toutefois que dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2023, la Cour des comptes considère qu'elle pourrait atteindre 4,5 milliards d'euros.
En effet, selon ce rapport, la fraude aux prestations maladie serait comprise entre 1,1 et 1,3 milliards d'euros sur le champ, restreint à six domaines, ayant alors fait l'objet d'évaluation ; la Cour en déduit par extrapolation une fraude totale comprise entre 3,8 et 4,5 milliards d'euros. Dans sa récente note247(*) sur l'Ondam, la Cour des comptes confirme que, selon elle, le montant des fraudes relatives aux dépenses de santé est « jusqu'à 4,5 milliards d'euros ».
Par ailleurs, comme on le verra ci-après, si le rapport « charges et produits » de la Cnam reprend ce chiffrage à 1,7 milliard d'euros, il estime à 3 milliards d'euros le montant d'économies permis en 2030 par la lutte contre la fraude, ce qui suggère qu'il privilégie le chiffrage de la Cour des comptes.
2. Sur les dépenses, une fraude détectée d'environ 1,5 milliard d'euros, dont une fraude évitée de seulement quelques centaines de millions d'euros
Le montant de fraude sociale détectée (sur les recettes et les dépenses) est en augmentation, ce qui traduit une plus grande efficacité du contrôle.
Selon le Gouvernement, hors France Travail, il est en effet passé de 1,2 milliard d'euros en 2020 (dont 0,8 milliard d'euros sur les dépenses) à 2,9 milliards d'euros en 2024 (dont 1,3 milliard d'euros sur les dépenses).
Évolution des montants détectés par les caisses de sécurité sociale (régime général et agricole)
(en millions d'euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Régime agricole |
29 |
29 |
37 |
35 |
52 |
52* |
|
Vieillesse |
160 |
148 |
180 |
180 |
209 |
217 |
|
Maladie |
287 |
128 |
219 |
316 |
450 |
628 |
|
Famille |
324 |
256 |
309 |
351 |
374 |
449 |
|
Urssaf (travail dissimulé) |
708 |
605 |
789 |
788 |
1 177 |
1 586 |
|
Total |
1 508 |
1 166 |
1 534 |
1 670 |
2 262 |
2 932 |
|
Dont dépenses** |
786 |
547 |
727 |
865 |
1 059 |
1 320 |
|
Dont recettes** |
723 |
620 |
808 |
806 |
1 203 |
1 612 |
* Dans le tableau du Gouvernement, cette valeur est renseignée comme « non connue ». On calcule toutefois que le total implique un montant de 52 millions d'euros.
** Ventilation effectuée par la Mecss du Sénat (en supposant que dans le cas du régime agricole 50 % des fraudes détectées concernent les recettes).
Source : D'après Ministère des comptes publics, ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Bilan 2024 - Lutter contre toutes les fraudes, 14 mars 2025
Pour comparaison, selon le HCFiPS, la fraude sociale y compris France Travail (sur les recettes et les dépenses) détectée en 2023, de plus de 2 milliards d'euros (dont, sur ce périmètre et selon ces estimations, l'essentiel sur les dépenses), n'aurait permis d'éviter que 0,5 milliard d'euros de préjudices, concernant en totalité les dépenses.
Préjudices subis et évités (2023)
(en millions d'euros)
|
Préjudices subis |
Préjudices évités |
Préjudices totaux |
|||
|
Cotisations |
Urssaf |
Travail illégal |
814 |
** |
814 |
|
MSA |
Travail illégal |
25 |
25 |
||
|
Maladie |
Cnam |
Faute, fraude, abus |
297 |
170 |
467 |
|
MSA |
Faute, fraude, abus |
7 |
7 |
||
|
Retraite |
Cnav |
Faute, fraude |
27 |
182 |
209 |
|
MSA |
8 |
8 |
|||
|
Famille |
Cnaf |
374 |
374 |
||
|
MSA |
7 |
7 |
|||
|
Chômage |
France Travail |
102 |
109 |
211 |
|
|
Total |
1 654 |
468 |
2 122 |
||
|
Dont dépenses* |
815 |
468 |
1 283 |
||
|
Dont recettes* |
839 |
** |
839 |
||
NB : ces données, plus anciennes que celles du tableau précédent, correspondent à un total légèrement inférieur. On observe par ailleurs que, même en excluant France travail, les préjudices totaux relatifs aux dépenses seraient supérieurs à ceux relatifs aux recettes.
* Ventilation effectuée par la Mecss du Sénat.
** Le rapport du HCFiPS ne mentionne aucun préjudice évité dans le cas des cotisations. Toutefois, selon le Gouvernement, « en matière de lutte contre le travail dissimulé, les recouvrements se sont [...] élevés à 121 millions d'euros en 2024, en hausse de plus de 50 % par rapport à ceux enregistrés en 2023 » (ministère des comptes publics, ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Bilan 2024 - Lutter contre toutes les fraudes, 14 mars 2025).
Source : D'après le Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024
3. La possibilité de réduire la fraude aux prestations de plusieurs milliards d'euros ?
a) L'objectif de 3 milliard d'euros de fraudes aux prestations évitées en 2030 proposé par la Cnam peut-il être atteint ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025248(*), la Cnam évalue les économies permises par la lutte contre la fraude à 3 milliards d'euros en 2030. Ainsi, le montant du gain attendu est paradoxalement égal à plus du double du montant total de la fraude tel qu'évalué par ce même rapport « charges et produits », de 1,7 milliard d'euros249(*).
De même, dans sa note d'avril 2025 sur l'Ondam250(*), la Cour des comptes considère que sa proposition n° 1 de « mieux lutter contre les fraudes dans les trois branches de la sécurité sociale qui financent l'Ondam » (c'est-à-dire les branches maladie, autonomie état-MP) permettrait de réduire les dépenses de 1,5 milliard d'euros en 2029.
Comme indiqué supra, les estimations du montant total de la fraude sur les prestations de la branche maladie sont comprises entre 1,7 milliard d'euros selon le HCFiPS et 4,5 milliards d'euros selon une estimation haute de la Cour des comptes (sur la base d'une extrapolation) 251(*). Par ailleurs, bien que la fraude identifiée (et stoppée) ait été de 628 millions d'euros en 2024, sur ce montant seulement 263 millions d'euros de fraude ont été évités252(*).
Dans une réponse aux rapporteures, la direction de la sécurité sociale s'interroge sur l'hypothèse haute du chiffrage de la fraude par la Cour, qui lui semble trop élevée253(*).
Les rapporteures ne sont pas en mesure d'apprécier le réalisme de l'objectif de la Cnam de réduire la fraude aux dépenses d'assurance maladie de 3 milliards d'euros d'ici 2030. En supposant que la fraude aux prestations maladie est réellement d'environ 4,5 milliards d'euros, conformément à l'estimation haute de la Cour des comptes, si l'on fait l'hypothèse que le « stock de fraude » ne se renouvelle pas, identifier et stopper chaque année 600 millions d'euros de fraude (soit à peu près comme en 2024) pendant cinq ans permettrait effectivement de réduire la fraude de 3 millions d'euros.
b) Principales mesures envisageables
Selon le HCFiPS, la fraude aux prestations concerne en quasi-totalité la Cnaf et la Cnam, avec une fraude estimée à respectivement 3,9 et 1,7 milliards d'euros environ.
(1) Dans le cas de la Cnaf
Dans le cas de la Cnaf, les deux principaux postes de fraude seraient le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d'activité, avec une fraude estimée à respectivement 1,5 milliard d'euros et 1 milliard d'euros.
La généralisation par la Cnaf de la solidarité à la source au 1er mars 2025 pour le RSA et la prime d'activité devrait réduire la fraude, ainsi que les erreurs déclaratives. Il conviendra de suivre avec attention les effets de cette mesure.
(2) Dans le cas de la Cnam
Dans le cas de la Cnam, le principal enjeu financier est la fraude des professionnels de santé.
Dans son rapport « charges et produits », la Cnam propose diverses mesures, tendant notamment :
- à réduire le risque de facturation fictive dans le cas du tiers payant. Ce dernier serait conditionné à l'utilisation de la carte Vitale, et le délai de 7 jours imparti à l'Assurance Maladie pour régler les professionnels de santé en contrepartie de la pratique du tiers-payant pourrait dans certains cas être allongé pour permettre davantage de contrôles a priori avant paiement ;
- à généraliser l'ordonnance numérique à tous les types de prescription (biologie, radiologie, soins paramédicaux, transports) ;
- à développer les échanges d'informations entre la branche maladie et les complémentaires santé.
Les propositions de la Cnam pour lutter contre la
fraude
aux prestations de la branche maladie
« Proposition 52 : Conditionner le tiers payant à l'utilisation systématique de la carte Vitale, sauf cas exceptionnel.
Proposition 53 : Faciliter la qualité et le contrôle de l'exécution des prescriptions.
- Généraliser l'ordonnance numérique à tous les types de prescription (biologie, radiologie, soins paramédicaux, transports)
- Permettre aux pharmaciens de vérifier les règles de dispensation des produits
- Faciliter les contrôles de la bonne exécution des prescriptions par l'Assurance Maladie, en permettant l'utilisation des données issues de l'ordonnance numérique pour vérifier la bonne délivrance des produits ou des actes réalisés
Proposition 54 : Renforcer les capacités d'action et de contrôle de l'Assurance Maladie sur l'activité des professionnels de santé, notamment en cas de fraudes.
- Élargir les motifs existant (dépôts de plainte, récidive de fraude) permettant d'allonger le délai de 7 jours impartis à l'Assurance Maladie pour régler les PS en contrepartie de la pratique du tiers-payant, afin de pouvoir réaliser davantage de contrôles a priori avant paiement (procédures ordinales, actes fraudogènes)
- Suspendre le bénéfice de la garantie de paiement en cas de sanction pour fraude du professionnel de santé et durcir les modalités de reconventionnement des professionnels déconventionnés pour cause de fraude
- Prévenir et sanctionner les situations de suractivité par la définition, en lien avec les représentants des PS, de seuils maximum d'activité compatible avec une bonne qualité des soins
Proposition 55 : Développer les systèmes d'alerte permettant de signaler des fraudes.
- Mettre en place un système de notifications en continu de l'assuré pour chaque remboursement, afin qu'il identifie les facturations frauduleuses
- Créer un cadre de recueil de signalements de fraudes pour les assurés et les professionnels de santé efficace et transparent
Proposition 56 : Renforcer la responsabilisation des assurés à travers une intensification de l'information des assurés et du suivi des patients atypiques en termes de recours au système de santé.
- Prévenir et sanctionner les pratiques de surconsommation médicale ou médicamenteuse au travers de nouveaux programmes d'action contre le nomadisme médical et la consommation atypique de médicaments
- Suspendre le bénéfice du tiers-payant pour les assurés sanctionnés pour fraudes et mieux informer les assurés des sanctions encourues en cas de fraude
Proposition 57 : Développer les échanges d'informations entre les Assurances Maladies obligatoire et complémentaires afin de rendre la lutte contre les fraudes encore plus performante
Proposition 58 : Poursuivre et accélérer la montée en charge des nouveaux outils d'intelligence artificielle pour mieux détecter et stopper les fraudes. »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Le rapport des trois Hauts Conseils reprend les propositions de la Cnam tendant à améliorer l'articulation entre branche maladie et complémentaires santé et à réduire le risque de facturation fictive dans le cas du tiers payant. Il propose en outre d'étendre le champ de la fraude à des pratiques abusives, de rendre obligatoire l'usage d'un logiciel de géolocalisation par les transporteurs sanitaires (la disposition correspondante de la LFSS pour 2025 ayant été censurée en tant que « cavalier social ») et d'améliorer les conditions de recouvrement des montants frauduleux dans le cas des sociétés éphémères.
Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre pour lutter contre la fraude aux prestations de la branche maladie
• « Étendre le champ de la fraude à des pratiques abusives »
Il s'agit notamment d'éviter des pratiques comme celle de la « revoyure » en imagerie. Celle-ci consiste, pour contourner la règle tarifaire qui prévoit qu'en cas d'association d'actes, l'acte à la cotation la plus faible n'est facturé qu'à 50 %, à convoquer le patient quelques jours plus tard pour réaliser le second acte.
• Mieux couvrir les risques relatifs à l'ouverture des droits (travailleurs frontaliers ou détachés, expatriés...)
• « Améliorer l'articulation entre AMO et AMC dans la lutte contre la fraude »
Il s'agit en particulier de reprendre, dans un projet de loi relatif à la fraude, les dispositions de l'article 49 de la LFSS pour 2025254(*), relatif à l'échange d'informations entre les organismes d'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance maladie complémentaire, et dont le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un « cavalier social ».
• « Réduire les risques de facturation fictive »
Il s'agirait en particulier d'assouplir en cas de suspicion de fraude l'obligation de paiement en 7 jours en cas de feuille de soins électronique (FSE), afin de permettre la réalisation de contrôles préalables avant mise en paiement.
Le tiers payant pourrait en outre être subordonné à la présentation de la carte Vitale (comme c'est déjà le cas pour les audioprothèses et les médicaments onéreux), afin d'éviter la facturation d'actes fictifs à l'insu de l'assuré.
• Généraliser l'utilisation de l'ordonnance numérique
38,9 % des médecins libéraux et 75,4 % des officines utilisent l'ordonnance numérique. Il s'agirait notamment de l'étendre aux médecins hospitaliers, salariés ou retraités.
• « Rendre obligatoire l'usage d'un logiciel de géolocalisation par les transporteurs sanitaires »
L'article 60 de la LFSS 2025255(*) prévoyait que les entreprises de transport sanitaire devaient équiper l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie et d'un système électronique de facturation intégré. Le Conseil constitutionnel l'a censuré, estimant qu'il s'agissait d'un cavalier social.
• « Améliorer les conditions de recouvrement des montants frauduleux »
Il s'agit de lutter contre les sociétés éphémères organisant leur insolvabilité en cas de détection de fraudes, en étendant à la branche maladie les outils mis à disposition des Urssaf pour lutter contre ce phénomène : possibilité de faire opposition à une liquidation amiable ou à une transmission universelle de patrimoine, solidarité financière du dirigeant, rang de créancier privilégié, possibilité de recouvrer les indus sur les remboursements au professionnel.
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
B. LA FRAUDE AUX COTISATIONS : UN POTENTIEL DE GAIN PLUS LIMITÉ ?
1. Une fraude aux cotisations de plus de 7 milliards d'euros
La fraude sociale (recettes et dépenses) est évaluée par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS)256(*) à 13 milliards d'euros par an, à peu près également réparties entre recettes et dépenses.
Dans le cas des recettes, la fraude serait de 7,25 milliards d'euros pour les cotisations, dont 6,91 milliards d'euros pour les Urssaf et 0,34 milliard d'euros pour la branche autonomie.
Selon le HCFiPS, cette estimation est un minorant, parce qu'elle ne prend pas en compte les redressements comptables d'assiette (CCA), de 4,6 milliards d'euros au total et dont une partie est nécessairement intentionnelle257(*).
Lors de son audition par la commission le 2 avril 2025, Emmanuel Dellacherie, directeur du recouvrement et du contrôle de l'Acoss (Urssaf Caisse nationale), a estimé que cette évaluation pouvait être sous-estimée258(*).
2. Sur les cotisations, une fraude détectée d'environ 1,5 milliard d'euros, dont seulement 0,1 milliard d'euros est recouvré
La fraude détectée par les Urssaf est passée de 0,7 milliard d'euros en 2019 à 1,6 milliard d'euros en 2024259(*).
Par ailleurs, « en matière de lutte contre le travail dissimulé, les recouvrements se sont [...] élevés à 121 millions d'euros en 2024, en hausse de plus de 50 % par rapport à ceux enregistrés en 2023 ».
3. Des marges de progression limitées par la nature de la fraude ?
La fraude au travail dissimulé est par nature difficile à recouvrer.
Aussi, le HCFiPS préconise plutôt de chercher à la prévenir, notamment au moyen de réformes juridiques260(*).
L'Acoss a indiqué aux rapporteures qu'entre les campagnes 2012 et 2023, la part du travail dissimulé détecté par des contrôles aléatoires (visant à mesurer l'ampleur de la fraude) était restée stable261(*). L'augmentation des fraudes détectées dans le cadre de l'activité de lutte contre la fraude ne proviendrait donc pas d'une augmentation de la fraude, mais bien d'une efficacité plus grande des contrôles. Si cela peut sembler rassurant, cela suggère aussi que la lutte contre la fraude n'a pas permis de réduire celle-ci.
4. Les propositions de l'Acoss pour mieux lutter contre la fraude aux cotisations
Interrogée par les rapporteures sur le besoin de modifier le droit, l'Acoss a évoqué diverses mesures tendant à renforcer la lutte contre le travail organisé dissimulé et les entreprises éphémères et à mieux encadrer la sous-traitance (cf. encadré).
Les mesures envisagées par l'Acoss pour lutter contre la fraude aux cotisations
Lutte contre le travail dissimulé organisé
« C'est particulièrement dans la lutte contre le travail dissimulé organisé qu'il semble nécessaire de faire évoluer le cadre juridique. Plusieurs évolutions peuvent être évoquées :
- pouvoir anonymiser les coordonnées de l'agent de contrôle au regard de risques pouvant peser sur sa sécurité et son intégrité (cette disposition existe au plan fiscal) ;
- faciliter l'exploitation des données issues du droit de communication bancaire ;
- étendre les capacités de saisie conservatoire durant le contrôle et donner l'accès à de nouvelles bases de données comme le SIV (système d'immatriculation des véhicules) ;
- mettre en place une solidarité financière à l'égard du maître d'ouvrage n'ayant pas accompli ses obligations de vigilance et de diligence. »
Encadrement de la sous-traitance et lutte contre les entreprises éphémères
« S'agissant de l'encadrement de la sous-traitance, plusieurs évolutions peuvent être mises en débat : faut-il limiter le nombre de niveaux de sous-traitance sachant que la sous-traitance en cascade génère des risques de travail dissimulé importants ? Faut-il renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans le BTP, afin qu'ils soient davantage contraints de s'assurer du respect des obligations sociales de l'ensemble des entreprises/travailleurs indépendants intervenant sur un chantier ? C'est plus particulièrement sur cette dernière piste que l'Urssaf considère que des évolutions juridiques pourraient être menées, en s'inspirant par exemple des dispositions existant en Belgique.
Pour lutter contre ces entreprises « éphémères », des mesures réglementaires ont été instaurées dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes, notamment l'obligation de publier les transmissions universelles de patrimoine au Bodacc262(*) et de présenter une attestation de compte à jour en cas de liquidation amiable. Ce sont des actions à poursuivre, le droit commercial est beaucoup contourné par les fraudeurs. Au-delà du corpus juridique, la dématérialisation et la simplification des démarches, très bénéfique pour les entreprises citoyennes, rendent plus difficiles la détection des fraudes, une sensibilisation accrue aux risques de fraudes apparaît nécessaire, par exemple au niveau des greffes des tribunaux de commerce. »
Source : Réponses de l'Acoss aux rapporteures
IV. SE DOTER RAPIDEMENT D'UN PLAN CRÉDIBLE DE RETOUR À L'ÉQUILIBRE ET RÉALISER UN NOUVEAU TRANSFERT DE DETTE SOCIALE À LA CADES
A. UNE ACCUMULATION DE LA DETTE SOCIALE À L'ACOSS QUI MET DÉJÀ EN PÉRIL LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le financement de la sécurité sociale est assuré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), également dénommée depuis 2021 Urssaf Caisse nationale263(*).
1. Un besoin de financement maximal qui devrait approcher fin 2025 son plafond de 65 milliards d'euros
Le besoin de trésorerie de l'Acoss, qui varie en cours d'année, comprend plusieurs composantes :
- l'Acoss a, par construction, un besoin de trésorerie, lié au fait que les cotisations sont versées les 5 et 15 du mois, alors que les décaissements ont lieu le 5 du mois pour la branche famille et le 9 du mois pour la branche vieillesse ;
- après la crise de financement de l'Acoss en 2020 au début de la crise sanitaire, les tutelles ont demandé à l'Acoss d'ajouter un pré-emprunt correspondant à un mois de prestations ;
- s'y ajoute le besoin de trésorerie correspondant au déficit cumulé de la sécurité sociale. Schématiquement, au début de chaque année, le besoin de trésorerie est égal à celui de la fin de l'année précédente, puis il augmente progressivement du montant du déficit de la sécurité sociale de l'année en cours.
Un besoin de trésorerie de l'Acoss proche de son plafond de 65 milliards d'euros fin 2025 devrait donc se traduire, si l'on suppose que la trajectoire de déficit est celle prévue par la LFSS pour 2025, à un besoin de trésorerie accru d'environ 70 milliards d'euros en 2028, le portant alors à près de 135 milliards d'euros264(*).
Le plafond d'emprunt maximal de l'Acoss est une disposition obligatoire des LFSS265(*). Il correspond non au besoin de financement global sur l'année, mais au plafond de trésorerie, qui ne peut être dépassé à un moment donné. Il peut, le cas échéant, être augmenté en cours d'année par « décret de relèvement », après avis des commissions des affaires sociales266(*).
La LFSS pour 2025 a fixé ce plafond de trésorerie à 65 milliards d'euros en 2025. Lors de son audition par les rapporteures, l'Acoss a estimé que ce montant serait quasiment atteint fin 2025.
2. Un endettement seulement à court terme
Conformément à l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, l'Acoss ne peut s'endetter qu'à court terme.
L'article 39 de la LFSS pour 2025 a modifié l'article L. 139-3 précité pour prévoir que l'Acoss (et plus généralement les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale), qui ne pouvait alors s'endetter qu'à douze mois, puisse désormais s'endetter à vingt-quatre mois, avec une « durée moyenne annuelle pondérée [...] inférieure ou égale à douze mois ».
Il s'agissait de permettre à l'Acoss de s'endetter effectivement à un an. En effet, pour des raisons techniques, la limite d'un an ne permettait pas à l'Acoss de s'endetter à cette échéance, ce qui, compte tenu de la structuration de la demande sur le marché, l'amenait à s'endetter en moyenne à un horizon de seulement quelques mois.
La réforme de la LFSS pour 2025 doit donc lui permettre de bénéficier d'un marché plus profond.
3. Selon l'Acoss, si le déficit de la sécurité sociale suivait la trajectoire prévue par la LFSS 2025, elle pourrait ne pas parvenir à assurer son financement dès 2027
Depuis plusieurs années, la commission des affaires sociales du Sénat alerte sur le fait que l'accumulation de la dette sociale à l'Acoss, sans perspectives d'amélioration du solde, suscite un risque de crise de liquidité, pouvant empêcher la sécurité sociale de payer des prestations aussi fondamentales que, par exemple, les retraites.
Aussi, comme la Cour des comptes le soulignait à l'automne dernier, le financement des déficits par l'Acoss se fait « dans des conditions qui pourraient mettre en risque le versement des prestations »267(*).
On rappelle que, du fait de la crise sanitaire, l'Acoss a connu en 2020 une grave crise de financement, avec un besoin de financement moyen de 63,4 milliards d'euros et un besoin de financement maximal de 90 milliards d'euros, qui ont impliqué le recours à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et à un pool bancaire afin de pouvoir payer les prestations (cf. encadré).
La crise de financement de la sécurité sociale en 2020
La sécurité sociale a connu en 2020 une grave crise de financement, du fait de la crise sanitaire.
Le 12 mars, alors que sa règle de gestion était de viser une trésorerie nulle (la plus économe), l'Acoss n'avait que quatre jours de trésorerie (en 2018-2019, son horizon moyen était de 3,7 jours).
Du fait de la grave récession qui a frappé l'économie, les recettes de l'Acoss ont chuté, augmentant fortement son besoin de trésorerie.
Les marchés ne se sont pas fermés pour l'Acoss, qui a continué à y emprunter des montants analogues. Toutefois, ils n'ont pu faire face à la forte augmentation des emprunts de l'Acoss, passées de 25 milliards d'euros par mois environ à 90 milliards d'euros dès le mois de juin. Le plafond d'emprunt a été relevé par deux fois, à 70 milliards d'euros en mars et 95 milliards d'euros en mai.
Un plan de financement exceptionnel a dû être mis en place, comprenant notamment un emprunt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour près de 20 milliards d'euros et un emprunt à un pool bancaire de 31 milliards d'euros (dont 21 milliards d'euros effectivement mobilisés).
Les financements ont atteint 63,4 milliards d'euros en moyenne sur l'année. Les financements de marché ont représenté la part la plus importante (76 %) avec près de 48 milliards d'euros en moyenne, complété par les prêts de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (10 %), les prêts du pool bancaire (12 %) et, de manière marginale, les dépôts de la sphère sociale (1 %) et des opérations avec l'Agence France Trésor (AFT) (1 %).
Source : D'après les réponses de l'Acoss au questionnaire des rapporteures et l'audition des représentants de l'Acoss par les rapporteures
Les responsables de l'Acoss estiment que ce n'est pas parce qu'il a été possible en 2020 de financer un besoin de trésorerie de près de 65 milliards d'euros en moyenne, avec un besoin maximal de 90 milliards d'euros, qu'il sera forcément possible de faire la même chose sur un temps plus long.
En particulier, il existe plusieurs différences majeures par rapport à 2020 :
- un besoin de trésorerie plus important dès le départ ;
- une moins bonne notation de la France par les agences ;
- surtout, l'absence de document public affichant une trajectoire de retour à l'équilibre. En effet, les marchés comme les banques ont besoin qu'un emprunteur indique comment il entend rembourser.
Si l'on raisonne en termes de niveau d'emprunt moyen sur l'année, selon l'Acoss la zone de risque commence à 40 milliards d'euros et au-delà de 65 milliards d'euros (correspondant à peu près à la moyenne de 63,4 milliards d'euros de 2020), « les risques sont très élevés »268(*). Or, sur la base des prévisions de déficit de la LFSS pour 2025, le niveau d'emprunt moyen approcherait 60 milliards d'euros dès 2026269(*).
Si l'on raisonne en termes de niveau d'emprunt maximal sur l'année, les responsables de l'Acoss ont estimé lors de leur audition par les rapporteures que la zone de risque commençait à 60 milliards d'euros. Toujours sur la base de la prévision de déficit de la LFSS pour 2025, l'emprunt maximal de l'Acoss en 2026 dépasserait 88 milliards d'euros (proche du niveau de 90 milliards d'euros atteint en 2020). Ce plafond atteindrait même 133 milliards d'euros en 2028, ce qui selon l'Urssaf « n'est en aucun cas réalisable »270(*). Les responsables de l'Acoss ont estimé, lors de leur audition par les rapporteures, que la situation pourrait devenir « problématique » dès 2027, année où le besoin de trésorerie maximal devrait dépasser 100 milliards d'euros.
Le besoin de trésorerie maximal de l'Acoss, estimé d'après les prévisions de déficit du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale
(en milliards d'euros)
* Source : audition de l'Acoss par les rapporteures.
** L'Acoss a indiqué aux rapporteures que le besoin de trésorerie fin 2025 devrait être proche du plafond de 65 milliards d'euros fixé par la LFSS pour 2025.
*** D'après la prévision de déficit du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025.
Source : Mecss du Sénat, d'après le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025 et les informations transmises par l'Acoss
B. COMMENT FINANCER LA NOUVELLE DETTE SOCIALE ?
1. La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades)
En 1996, 1998, 2004, 2008, 2011 et 2020, la dette sociale, correspondant essentiellement à celle de l'Acoss, a été transférée à la Caisse nationale d'amortissement de la dette sociale (Cades), qui s'endette sur les marchés financiers et rembourse la dette au moyen de ressources fiscales. La Cades doit avoir achevé d'amortir la dette sociale au plus tard en 2033, cette limite étant fixée au niveau organique.
Le principe est que la Cades s'endette à moyen terme sur les marchés financiers (contrairement à l'État, qui s'endette à long terme, et à l'Acoss, qui s'endette à court terme). Toutefois, plus la Cades se rapproche de l'échéance de 2033, plus l'échéance de ses émissions va se réduire. Les taux d'intérêt étant redevenus plus faibles à court terme qu'à long terme (comme c'est habituellement le cas), son coût de financement devrait s'en trouver réduit.
Le graphique ci-après permet de visualiser les amortissements des reprises de dette successives.
Reprises de dette de la Cades : synthèse des amortissements successifs
(encours de dette en millions d'euros)
Source : Caisse d'amortissement de la dette sociale (réponse aux rapporteures)
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades)
Créée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la Cades s'endette à moyen terme sur les marchés financiers (l'Acoss s'endettant à court terme et l'État à long terme).
En 2024, les produits et les charges (correspondant à la charge d'intérêt) se sont élevés à respectivement 19,2 milliards d'euros et 3,2 milliards d'euros, d'où un résultat (correspondant à la dette amortie) de 16 milliards d'euros.
Fixée en 1998 à 2014, l'échéance d'amortissement a été progressivement repoussée jusqu'en 2024, puis fixée (par une disposition organique) à 2033 lors de la crise sanitaire.
En 2020, année lors de laquelle le déficit de la sécurité sociale approcherait 40 milliards d'euros du fait de la crise sanitaire, la loi271(*) a autorisé le Gouvernement à transférer par décret 136 milliards d'euros de dette supplémentaire à la Cades. Ce montant de 136 milliards d'euros se décomposait entre 31 milliards d'euros pour la couverture des déficits antérieurs à 2020, mais aussi 92 milliards d'euros pour la couverture des déficits 2020-2023 (c'est-à-dire la « dette covid ») et 13 milliards d'euros pour le désendettement des hôpitaux.
Certains commentateurs et responsables politiques ont critiqué ce mode de financement de la « dette covid »272(*) et des déficits des hôpitaux273(*), résultant largement dans les deux cas de décisions prises par l'État. Ont ainsi été évoqués un financement par l'État, ou, dans le cas de la « dette covid », par un dispositif ad hoc au sein de la Cades274(*). En sens inverse, d'autres ont fait observer que le choix de l'entité publique prenant en charge la dette sociale n'avait pas d'effet sur la dette ou le besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques.
Ce plafond de 136 milliards d'euros a été atteint après le transfert en 2024 de 8,8 milliards d'euros de déficit de 2023.
Fin 2024, l'encours de dette de la Cades était de 137,9 milliards d'euros.
2. La « banalisation » de la nouvelle dette sociale est jugée non souhaitable par la Cades et l'Agence France Trésor
Le principe même de la Cades est parfois contesté.
Un premier argument consiste à souligner que sans déficits passés, il n'y aurait pas de dette sociale, et donc pas besoin de Cades. Ainsi, l'économiste Ana Carolina Cordilha déplore le montant élevé de la charge d'intérêt, et considère qu'il aurait mieux valu éviter les déficits en donnant à la sécurité sociale des recettes suffisantes275(*).
Si l'on prend acte de l'existence d'une dette sociale, la question qui se pose est de savoir si la Cades est la bonne manière de la financer.
Certains considèrent que tel n'est pas le cas. Ainsi, selon l'économiste Jean-Marie Harribey, auditionné par les rapporteures, « le mécanisme est pervers car, au contraire de la dette de l'État qui « roule », ici il faut payer les intérêts et rembourser le principal ».
Il ne faut toutefois pas perdre de vue la vision d'ensemble, qui est celle du besoin de financement des administrations de sécurité sociale, et plus généralement des administrations publiques. Le besoin de financement des administrations publiques correspond, par définition, à la différence entre les recettes et les dépenses. Comme Antoine Deruennes, directeur général de l'Agence France trésor (AFT), l'a souligné lors de son audition par les rapporteures, affecter les ressources de la Cades à la sécurité sociale ne modifierait pas ce besoin de financement. Autrement dit, les administrations publiques devraient emprunter le même montant sur les marchés financiers.
Selon un autre argument, transférer au moins partiellement la dette de la Cades à l'État permettrait de bénéficier du taux d'intérêt légèrement plus bas auquel emprunte l'État. En effet, le différenciel de taux entre l'État et la Cades est habituellement compris entre 5 et 25 points de base (soit entre 0,05 et 0,25 point), avec une moyenne inférieure à 20 points de base (soit 0,2 point)276(*). Appliquer un différentiel de taux de 20 points de base à une dette sociale de 140 milliards d'euros conduit à un différentiel de charge d'intérêt d'environ 0,3 milliard d'euros.
Cependant, comme l'ont souligné l'Agence France Trésor et la Cades, il n'est pas évident que faire financer la dette sociale par l'État susciterait pour les administrations publiques une charge d'intérêt plus faible. En effet, le financement de la dette sociale par l'État augmenterait l'encours de la dette de l'État, et donc le taux d'intérêt sur la dette de l'État, ce qui, sur un montant de plus de 3 300 milliards d'euros (voire davantage si l'on prend en compte tous les opérateurs publics qui se financent par référence à ce taux), pourrait plus que compenser l'économie réalisée sur la dette sociale.
Tel est d'autant plus le cas que l'existence même de la Cades permet d'afficher le principe que la sécurité sociale ne peut pas être durablement en déficit. Jusqu'à présent, ce principe a toujours été respecté, les différents transferts de dette à la Cades ayant tous été amortis, au maximum en une dizaine d'années. La suppression de la Cades pourrait être perçue comme un abandon de ce principe d'équilibre des comptes sociaux, au moment même où la France a un déficit de ses administrations publiques sans précédent hors période de crise.
3. Réaliser un nouveau transfert de dette à la Cades ?
a) Autoriser rapidement de nouveaux transferts de dette à la Cades (ce qui implique une disposition organique) ?
Un transfert de dette à la Cades ne peut être autorisé que par la loi, qui doit elle-même se conformer à la loi organique. Or, l'article 4 bis, qui a valeur organique277(*), de l'ordonnance de 1996 instaurant la Cades, prévoit que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033 ».
Il est donc nécessaire de modifier cette disposition organique, et d'adopter dans une prochaine loi (par exemple la LFSS pour 2026) une disposition autorisant le Gouvernement à transférer un certain montant de dette à la Cades.
b) Adopter rapidement une trajectoire crédible de retour à l'équilibre ?
Un nouveau transfert de dette à la Cades devra s'accompagner d'une trajectoire crédible de retour à l'équilibre.
En particulier, comme Antoine Deruennes l'a souligné aux rapporteures, un « petit » transfert pour soulager momentanément l'Acoss ne réglerait pas le problème, parce qu'alors les investisseurs considéreraient qu'il n'y a pas de volonté de réduire le déficit, et qu'il devrait de toute façon être suivi d'autres transferts. Il serait donc préférable de réaliser un unique transfert, associé à une trajectoire crédible de retour à l'équilibre.
Or, comme on l'a indiqué ci-avant, aucun document public ne comprend de trajectoire de retour de la sécurité sociale à l'équilibre.
La lettre de l'article L.O. 111-4 précité du code de la sécurité sociale, qui indique que le rapport annexé à la LFSS décrit, « pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base », n'est pas respectée. En effet, le rapport annexé à la LFSS présente une projection purement prévisionnelle, sur la base des mesures existantes ou prévues, en faisant l'hypothèse d'un respect de l'Ondam.
La situation actuelle, où coexistent des prévisions pluriannuelles annexées aux LFSS, ne prenant en compte que les mesures connues ou prévues, et des textes programmatiques relatifs à l'ensemble des administrations publiques (lois de programmation des finances publiques et PSMT278(*)), plus volontaristes, et portant sur un périmètre différent279(*), fait perdre toute lisibilité à la programmation des finances sociales.
Il importe donc de se doter rapidement d'une loi indiquant une trajectoire crédible de retour de la sécurité sociale à l'équilibre. Il pourrait s'agir, par exemple, d'une loi de programmation des finances publiques, ou d'une annexe à la LFSS qui ne serait plus une simple prévision à droit constant.
Une solution a minima pourrait consister à préciser, au début de l'annexe à la LFSS, que celle-ci est une projection à droit inchangé sauf pour l'Ondam (ce qui est tout sauf évident) et que le Gouvernement prévoit de réaliser un certain quantum annuel de mesures sur les recettes et les dépenses restant à documenter (par exemple, 10 milliards d'euros par an).
c) Sans retour à l'équilibre en 2035, un nouveau transfert de dette sociale à la Cades pourrait perdre son intérêt
La situation actuelle se distingue de celle des précédents transferts de dette par le fait que la sécurité sociale est actuellement très déficitaire et qu'en l'état actuel du droit, cette situation s'aggraverait à moyen terme.
Pour fixer un ordre de grandeur, en cas de retour à l'équilibre en 2029, les déficits cumulés depuis 2024 auront été d'environ 70 milliards d'euros. En supposant que la capacité d'amortissement de la Cades est de plus de 20 milliards d'euros par an280(*), et que l'amortissement de cette nouvelle dette sociale commence après l'amortissement du stock de dette actuel, actuellement prévu pour 2032, la nouvelle dette pourrait être amortie vers 2036, soit plus de dix ans après le début du transfert de dette (si celui-ci commence en 2026). Cette durée est comparable à celle de la durée d'amortissement des deux derniers transferts de dette, réalisés après la crise des dettes souveraine et après la crise sanitaire, de 13 ans dans chaque cas281(*).
Si le retour à l'équilibre avait lieu en 2035, il faudrait transférer environ 160 milliards d'euros de dette à la Cades, auxquels s'ajouterait la charge d'intérêt jusqu'en 2032, l'encours total atteignant alors un point haut proche de 180 milliards d'euros ; et l'amortissement de la dette pourrait n'être achevé qu'après 2040, soit 15 ans après le début des transferts en 2026.
Sans retour à l'équilibre en 2035, en l'absence de ressources supplémentaires de la Cades, la durée d'amortissement atteindrait une durée telle qu'elle pourrait être perçue par les investisseurs comme un abandon de fait du principe d'équilibre de la sécurité sociale. Cela pourrait amener à s'interroger sur la pertinence de continuer à faire amortir la dette sociale par la Cades.
Tel est d'autant plus le cas que ces scénarios reposent sur des hypothèses peut-être optimistes en matière de croissance et de taux d'intérêt.
Encours de « nouvelle dette
sociale » détenue par la Cades :
deux
scénarios indicatifs sans ressources supplémentaires
(en milliards d'euros)
Principales hypothèses : croissance du PIB de 3 % par an en valeur, taux d'intérêt de 3 %, déficit suivant une trajectoire linéaire par rapport au début de la période de retour à l'équilibre, transfert chaque année à la Cades du déficit de l'année précédente, début d'amortissement à partir de 2033 avec les ressources actuelles de la Cades (dont on suppose qu'elles augmentent au même taux que le PIB en valeur).
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
Point d'accord n° 4 : Adopter rapidement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS 2026, une trajectoire crédible de solde de la sécurité sociale, garantissant un retour à l'équilibre structurel si possible en 2029 et au plus tard en 2035.
Point d'accord n° 5 : Réviser rapidement l'article 4 bis (à valeur organique) de l'ordonnance de 1996 sur la Cades, afin de permettre un nouveau transfert de dette de l'Acoss à la Cades.
Point d'accord n° 6 : Adopter annuellement, éventuellement dans l'annexe à la LFSS, une programmation (et non une simple prévision à politiques inchangées) à moyen terme de recettes, de dépenses et de solde de la sécurité sociale.
V. RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. LE « COMITÉ D'ALERTE DU BUDGET 2025 » : UNE INITIATIVE BIENVENUE MAIS DONT IL NE FAUT PAS SURESTIMER LA PORTÉE PRATIQUE
Le mardi 15 avril 2025 a été installé le « comité d'alerte du budget 2025 », qui s'est à nouveau réuni le 26 juin.
Il s'agit d'une instance informelle, que ne régit aucun texte juridique.
Un dossier de presse de mars 2025 (cf. encadré) mentionne une composition très large, comprenant, outre les ministres concernés, les membres des commissions des finances et des affaires sociales et des délégations parlementaires aux collectivités locales, les associations d'élus, les caisses et le Premier président de la Cour des comptes.
Pour les deux premières réunions du comité d'alerte du budget 2025, le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, chargé d'organiser les travaux du comité d'alerte des dépenses de l'assurance maladie, a été convié. Le premier avis de l'année 2025 du comité d'alerte des dépenses de l'assurance maladie a été rendu le 15 avril, jour de la tenue du comité d'alerte du budget 2025 ; et le deuxième le 18 juin, soit environ une semaine avant la réunion du comité d'alerte du budget 2025.
L'objectif est de permettre aux ministres de sensibiliser les autres participants au risque de dérapage des recettes ou des dépenses.
Toutefois le comité d'alerte n'a pas de rôle décisionnel. Par ailleurs, dans le domaine de la sécurité sociale, il existe déjà le comité d'alerte des dépenses de l'assurance maladie.
Le « comité d'alerte du budget 2025 », selon un dossier de presse de mars 2025
« Un comité d'alerte des finances publiques sera réuni autour du ministre de l'économie, de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et de la ministre chargée des Comptes publics, auxquels seront associés notamment les rapporteurs et présidents des commissions des finances et des affaires sociales, les parlementaires de ces commissions, les délégations parlementaires aux collectivités locales ainsi que les associations d'élus, les représentants des caisses de la sécurité sociale et le Premier président de la Cour des comptes.
Au cours des réunions de ce comité, seront présentés les risques d'écart aux prévisions des dépenses et recettes publiques sous-jacentes à LFI et les éventuelles mesures correctives envisagées. Ce format innovant permettra de mobiliser les gestionnaires de la dépense publique et de partager en cours d'année les données d'exécution budgétaire avec les parlementaires. »
Source : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques, 3 mars 2025
B. BRANCHE MALADIE : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE L'ONDAM
1. Des prévisions d'Ondam systématiquement sous-estimées depuis 2020
Toujours respecté de 2011 à 2019, l'Ondam est systématiquement dépassé depuis 2020.
Si cela était normal pendant la crise sanitaire, les dépassements de 2023, 2024, et vraisemblablement 2025 (cf. infra), traduisent une insuffisance de la gouvernance, résultant notamment d'un « biais optimiste » systématique.
L'irréalisme des prévisions d'Ondam pour les exercices 2023282(*) et 2024283(*) avait été souligné, notamment, par le Haut Conseil des finances publiques et par la commission des affaires sociales.
Ondam : prévision et exécution
(en milliards d'euros)
LFSS : loi de financement de la sécurité sociale. LFRSS : loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Placss : projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.
Pour chaque texte, les montants des trois dernières années sont calculés à partir des taux de croissance de l'Ondam figurant dans la progammation à moyen terme annexée.
Source : Mecss du Sénat, d'après les LFSS et Placss concernés
Avant mesures correctrices, le dépassement de la prévision pourrait avoir été encore plus élevé en 2025. Ainsi, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a publié le 18 juin son deuxième avis obligatoire de 2025 (censé être publié « au plus tard le 1er juin »284(*)), dans lequel il estime qu'il existe un « risque sérieux » que l'Ondam dépasse l'objectif fixé par la LFSS d'au moins 0,5 %, soit 1,3 milliard d'euros (le total des risques évoqués par le comité d'alerte étant toutefois supérieur à ce montant).
Synthèse des risques de dépassement indiqués par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie dans son avis du 18 juin 2025
(en milliards d'euros)
|
Montant |
Remarque |
|
|
Principaux risques mis en avant par le
comité pour justifier |
||
|
Indemnités journalières (IJ) |
0,5 |
A minima |
|
Moindres économies sur les médicaments |
0,7 |
Reposent pour 0,6 milliard d'euros sur la conclusion d'un protocole d'accord entre le Leem et l'État, non signé à ce jour. |
|
Abaissement du taux plafond de remises commerciales sur les génériques |
0,1 |
L'arrêté n'a pas été pris. |
|
Total IJ et médicaments |
1,3 |
Total mentionné dans l'avis |
|
Autres écarts par rapport à la LFSS 2025 mentionnés dans l'avis |
||
|
Dépenses 2024 inférieures aux prévisions de la LFSS 2025 |
- 0,3 |
|
|
Report de négociations conventionnelles avec certaines professions de santé |
- 0,1 |
|
|
Economies incertaines (nouvelle convention avec les taxis, transport partagé, dispositifs médicaux...) |
0,2 |
|
|
Possible dépassement de l'activité tarifaire MCO du secteur « ex-DG » |
1,0 |
|
|
Possible non-atteinte des objectifs de maîtrise médicalisée de soins de ville |
ND |
L'objectif était de 0,9 Md€ dans la construction de l'Ondam 2025, dont 0,3 Md€ hors maîtrise médicalisée relative aux indemnités journalières et aux médicaments. |
Source : Mecss du Sénat, d'après l'avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie du 18 juin 2025 (avis n° 2025-2)
La suite de la procédure, prévue par l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, est que les caisses « proposent des mesures de redressement », et que le comité d'alerte « rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'État entend prendre pour sa part ».
Le 23 juin 2025, la Cnam et la MSA ont transmis au Gouvernement une proposition de mesures, pour un montant total de 1,7 milliard d'euros, dont 0,7 milliard d'euros d'annulation de mises en réserve relatives à l'hôpital et 0,6 milliard d'euros pour la conclusion du protocole d'accord avec le Leem.
Le 25 juin 2025, le Gouvernement a annoncé des mesures quasiment identiques, également pour un montant de 1,7 milliard d'euros.
Dans son avis du 17 septembre 2025, le comité d'alerte, suggère que les mesures annoncées par le Gouvernement (qu'il évalue à 1,5 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros pour le Gouvernement) pourraient ne pas complètement suffire à respecter l'Ondam.
2. Un dispositif de pilotage infra-annuel insuffisant
a) Un deuxième avis du comité d'alerte trop tardif
Le tableau ci-après synthétise les principales échéances en matière de finances sociales au premier semestre.
Les principales échéances en matière de finances sociales au premier semestre
|
2022 (exercice 2021) |
2023 (exercice 2022) |
2024 (exercice 2023) |
2025 |
|
|
Annexes provisoires aux comptes |
31-mars |
31-mars |
entre le 8 et le 22 mars |
entre le 8 et le 22 mars |
|
Annexes définitives aux
comptes |
15-avr |
15-avr |
05-avr |
05-avr |
|
Production des comptes |
15-avr |
15-avr |
15-avr |
15-avr |
|
Publication par la Cour du rapport de certification des
comptes |
24-mai |
16-mai |
17-mai |
16-mai |
|
Réunion de la CCSS |
12-juil |
25-mai |
30-mai |
3-juin |
|
Avis du comité d'alerte |
30-mai |
07-juin |
26-juil |
18-juin |
|
Dépôt du Placss |
- |
24-mai |
31-mai |
23-mai |
|
Discussion du Placss en séance (AN) |
- |
06-juin |
15-oct |
10-juin |
AN : Assemblée nationale. CCSS : commission des comptes de la sécurité sociale. CJF : code des juridictions financières. CSS : code de la sécurité sociale. Placss : projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.
Source : Mecss du Sénat
La date de production des comptes par les caisses ne permet pas au comité d'alerte sur l'Ondam de rendre son avis sur l'exécution de l'année en cours avant le 1er juin, comme il est censé le faire285(*).
En effet, la date de production des comptes par les caisses conditionne notamment la date de la première réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), qui ne peut actuellement avoir lieu avant fin mai-début juin.
Or, le rapport à la CCSS et l'avis du comité d'alerte mettent à contribution les mêmes personnes : le secrétaire général de la CCSS (un magistrat de la Cour des comptes)286(*) est de droit l'un des trois membres du comité d'alerte, dont il est chargé d'organiser les travaux287(*), et la DSS est bien sûr sollicitée par le comité d'alerte.
Tout cela a pour effet qu'en pratique le comité d'alerte ne peut pas respecter l'échéance du 1er juin. En 2023, l'avis, appelant à « une grande vigilance [...] pour respecter l'Ondam », a été publié avec près d'une semaine de retard288(*), le lendemain de l'examen du Placss en séance publique par l'Assemblée nationale. En 2024, l'avis n'avait toujours pas été adopté lors de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, qui a conduit à en reporter encore la publication, au 26 juillet289(*). En 2025, l'avis a été publié le 18 juin en fin d'après-midi, alors que l'examen du Placss par l'Assemblée nationale avait eu lieu le 10 juin et que la commission des affaires sociales du Sénat avait examiné le texte le matin du 18 juin.
Plus des mesures correctrices sont adoptées tardivement, plus leur effet sur l'exercice concerné est faible. Toutefois le Gouvernement a présenté le 25 juin 2025 des mesures de redressement d'un montant selon lui suffisant.
Le problème semble surtout concerner les prérogatives du Parlement. La publication de l'avis dans la seconde quinzaine de juin rend en pratique impossible l'adoption de mesures législatives, par exemple dans le cadre d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS). Par ailleurs, ce calendrier n'est pas cohérent avec celui de l'examen du Placss.
b) La mise en réserve prudentielle sur l'Ondam, qui repose essentiellement sur l'hôpital et les ESMS, contribue à aggraver leur déficit
Le principal instrument de régulation infra-annuelle, la mise en réserve prudentielle sur l'Ondam, n'a pas d'effet évident sur le solde des administrations publiques.
(1) Une mise en réserve portée à 0,4 % en 2025
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 dispose qu'« à compter du 1er janvier 2024, une fraction représentant 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice »290(*).
En 2024, la mise en réserve a correspondu à ce taux de 0,3 %. Cela n'a pas empêché (malgré un gel de 0,3 milliard d'euros sur les établissements de santé) un dépassement de l'Ondam de 1,5 milliard d'euros, soit 0,6 % de l'objectif initial (le comité de suivi de l'Ondam n'ayant pas considéré en cours d'année qu'il existait un « risque sérieux » de dérapage de plus de 0,5 %).
En 2025, la mise en réserve a été portée à 1,1 milliard d'euros, soit 0,4 % du montant de l'Ondam.
La mise en réserve prudentielle sur l'Ondam en 2024 et en 2025
(en millions d'euros)
|
2024 |
2025 |
|||||
|
Ondam* |
Montants |
Ondam*** |
Montants mis en réserve |
|||
|
Sous-objectifs |
En milliards d'euros |
En milliards d'euros** |
En % du sous-objectif |
En milliards d'euros |
En milliards d'euros**** |
En % du sous-objectif |
|
Soins de ville |
108,4 |
- |
- |
113,2 |
- |
- |
|
Établissements de santé |
105,6 |
0,492 |
0,47 |
109,6 |
0,687 |
0,6 |
|
Établissements et services médico-sociaux |
31,5 |
0,134 |
0,43 |
33,3 |
0,241 |
0,7 |
|
Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement |
6,1 |
0,084 |
1,38 |
6,3 |
0,060 |
1,0 |
|
Autres prises en charge |
3,3 |
0,055 |
1,67 |
3,4 |
0,111 |
3,3 |
|
Total |
254,9 |
0,765 |
0,30 |
265,9 |
1,100 |
0,4 |
* Source : LFSS 2024.
** Source : Comité d'alerte des dépenses d'assurance maladie, avis n° 2024-2 du 26 juillet 2024.
*** Source : LFSS 2025.
**** Source : Gouvernement, Installation du comité d'alerte du budget 2025, diaporama, 15 avril 2025.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
La mise en réserve de l'Ondam
La mise en réserve d'une fraction de l'Ondam a été instituée par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2011 à 2014291(*) et reconduite par les lois de programmation successives. La loi de programmation pour les années 2023 à 2027 dispose qu'« à compter du 1er janvier 2024, une fraction représentant 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice »292(*).
Le code de la sécurité sociale293(*) dispose qu'une annexe au PLFSS doit préciser le périmètre de l'Ondam et sa décomposition en sous-objectifs, et fournir des éléments sur l'exécution de l'objectif national en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées.
Pour autant, cette annexe ne procure, chaque année, que peu d'informations sur la mise en réserve de l'Ondam ou sur les modalités de son éventuel dégel. Seuls les avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie évoquent la mise en réserve de façon plus détaillée, notamment sur sa répartition entre les sections de l'Ondam, mais là encore, le niveau d'information peut s'avérer inégal selon les années.
(2) Un effort qui exclut les soins de ville et porte presque exclusivement sur l'hôpital
Les soins de ville sont systématiquement dispensés de toute mise en réserve et peu régulés. En pratique, les mises en réserve sur l'hôpital servent à financer les dépassements des dépenses relatives aux soins de ville.
La mise en réserve en 2025 porte donc essentiellement sur les établissements hospitaliers (0,687 milliard d'euros sur 1,1 milliard d'euros), répartie entre le « coefficient prudentiel » (0,420 milliard d'euros) et les dotations (0,267 milliard d'euros).
Dans son avis du 18 juin 2025, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie estime qu'en 2025, les dépenses hospitalières de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) pourraient être supérieures d'un milliard d'euros aux prévisions. Si tel était le cas, la somme mise en réserve ne permettrait même pas de compenser les dépassements de l'hôpital.
Le coefficient prudentiel des établissements de santé
Le I de l'article L. 162-22-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs hospitaliers « peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie » et que « la valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements ». « Au regard notamment » de l'avis que le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie doit rendre au plus tard le 15 octobre, « l'État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie » des sommes mises en réserve.
Ces dispositions ont été instaurées par l'article 60 de la LFSS pour 2013294(*).
Leurs modalités d'application sont prévues par les articles R. 162-33-7 et R. 162-33-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoient respectivement que la valeur du coefficient est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et que la décision éventuelle de dégel est prise par arrêté des mêmes ministres, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée.
Fixé à 0,35 % en 2013, le coefficient a été porté à 0,5 % en 2017 puis 0,7 % en 2017. Le montant correspondant est de 420 millions d'euros en 2025.
(3) Des gels qui contribuent à l'aggravation du déficit hospitalier
Par ailleurs, les gels contribuent à l'aggravation du déficit hospitalier, en hausse continue depuis 2020.
Or, le déficit de la sécurité sociale n'a en tant que tel que peu d'intérêt. Ce qui importe du point de vue de la soutenabilité des finances publiques, c'est le déficit des administrations publiques, dont font partie les hôpitaux (qui sont des administrations de sécurité sociale).
Le déficit des établissements publics de santé, de 0,1 milliard d'euros en 2020, a été de 2,3 milliards d'euros en 2023, et pourrait selon le ministère chargé de la santé être compris entre 3 milliards d'euros et 3,2 milliards d'euros en 2024295(*).
3. Renforcer le pilotage des dépenses de santé
a) Mettre fin au biais optimiste dans la prévision de l'Ondam, en incluant une marge de précaution, en évitant les mesures trop coûteuses, voire en la confiant à un organisme indépendant ?
Le premier sujet est de mettre fin au biais optimiste dans la prévision de l'Ondam.
Cela implique d'évaluer correctement le tendanciel, les mesures coûteuses et les mesures d'économie. Or le tendanciel peut être sous-estimé (comme semble-t-il en 2025 dans le cas des indemnités journalières) ; et si les mesures coûteuses sont à peu près certaines, les mesures d'économie sont plus aléatoires (comme la Cour des comptes et le comité d'alerte des dépenses d'assurance maladie l'ont souligné s'agissant respectivement des exercices 2024 et 2025).
On pourrait donc intégrer, dans la prévision de l'Ondam, une marge de précaution.
Par ailleurs, réduire le montant annuel des mesures coûteuses, qui doivent être financées par des économies généralement surévaluées, tendrait à réduire l'erreur globale296(*).
Si les prévisions d'Ondam conservaient leur biais optimiste, il pourrait être décidé de confier le soin de leur réalisation à un organisme indépendant.
Une solution intermédiaire, que la Cnam préconise d'inclure dans le PLFSS pour 2026, serait de « soumettre chaque année le détail de la construction de l'Ondam à un examen approfondi indépendant, qui pourrait être réalisé par le comité d'alerte, et notamment sur deux volets :
- les tendanciels d'évolution, en ville comme à l'hôpital, des différents postes de dépenses (hypothèses prix/volume...) ;
- le contenu détaillé des mesures d'économies (quantum, modalités...) sous-jacentes à l'Ondam »297(*).
b) Veiller à ce que le comité d'alerte rende son deuxième avis « au plus tard le 1er juin », et si possible mi-mai, afin notamment de permettre une bonne articulation avec l'examen du Placss ?
Comme on l'a vu supra, le comité d'alerte ne peut en pratique pas respecter, pour son deuxième avis, l'échéance du 1er juin fixée par l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
Si l'on souhaitait que le comité d'alerte rende cet avis en temps plus utile, notamment pour permettre une bonne articulation avec l'examen du Placss298(*), une première possibilité serait d'anticiper la production des comptes, afin de permettre à la CSSS de se tenir plus tôt. Ainsi, la Cour des comptes, dans ses rapports sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2023, mai 2024 et mai 2025, demande que la production des comptes soit anticipée (de 15 jours selon le Ralfss 2023, de 10 jours selon les Ralfss 2024 et 2025).
Une deuxième possibilité serait de dissocier le statut d'organisateur des travaux du comité d'alerte de celui de secrétaire général de la CCSS. Toutefois une telle mesure pourrait se heurter à une faible réactivité de la DSS, fortement mise à contribution à la fois pour les travaux de la CCSS et pour ceux du comité d'alerte.
c) Se doter de nouveaux instruments de régulation ?
(1) Étendre la mise en réserve aux soins de ville ?
Une réflexion pourrait être menée sur la répartition de l'effort de régulation entre les différentes sections de l'Ondam, au regard par exemple des dépassements observés de façon récurrente pour les soins de ville.
La commission des affaires sociales avait adopté un amendement299(*) en ce sens lors de l'examen de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, pour que la mise en réserve s'applique de manière uniforme à chacun des sous-objectifs de l'Ondam. Il n'avait pas été retenu par le Gouvernement.
(2) Développer des mécanismes d'ajustement prix-volume ?
Avant la LFSS pour 2025, il existait déjà des mécanismes d'ajustement prix-volume, avec la clause de sauvegarde des médicaments et le protocole relatif à la biologie.
De tels mécanismes ont été instaurés en 2025 pour la radiologie et des transports de patients.
Les mécanismes de régulation prix-volume existants
La biologie
Le principal outil de régulation prix-volume existant dans le champ conventionnel concerne la biologie. Inscrit dans le protocole 2024-2026 conclu entre l'Assurance maladie et les biologistes, il prévoit la mise en place de mécanismes de régulation (se traduisant principalement par une « baisse du B »300(*)) en cas de dépassement prévisible de l'enveloppe de dépenses prévue pour l'année en cours.
Cette clause a été activée à plusieurs reprises (pour la dernière fois par voie conventionnelle pour un montant d'économies de 140 millions d'euros en janvier 2024, puis, en août 2024 par décision unilatérale du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) pour un montant de 360 millions d'euros d'économies en année pleine).
Elle nécessite la signature d'un avenant conventionnel, et donc l'accord des organisations syndicales. La forte mobilisation des organisations syndicales en 2024 a conduit à suspendre l'application du dispositif jusqu'à fin 2026.
L'imagerie et les transports de patients
L'article 41 de la LFSS 2025 étend la logique de ce dispositif à l'imagerie et au transport de patients (transport sanitaire et transport par taxi).
Il prévoit que des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus dans le champ de la biologie, de l'imagerie médicale et du transport de patients301(*). Ces accords doivent comprendre des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses, ainsi que des mesures correctrices à adopter en cas de non-respect annuel ou infra-annuel de ceux-ci.
Dans le cas particulier de l'imagerie médicale et des transports de patients, en l'absence de conclusion au 30 septembre 2025 d'un accord de maîtrise des dépenses permettant de réaliser, dans chaque cas, un montant d'au moins 300 millions d'euros d'économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l'Uncam peut procéder jusqu'au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d'atteindre le montant d'économies prescrit.
Le texte initial prévoyait d'autres possibilités de baisse des tarifs :
- par le directeur général de l'Uncam, en cas de dérapage des dépenses, et lorsque les mesures correctrices n'étaient pas adoptées ou étaient insuffisantes ;
- par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en l'absence de la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses dans un délai de quatre mois à compter de la saisine.
Ces possibilités d'imposer des baisses de tarifs ont été supprimées par le Parlement, à l'initiative du Sénat et de sa commission des affaires sociales. En effet, attachée à l'exercice conventionnel, la commission a souligné que les dérogations à la procédure de négociation des tarifs devaient demeurer exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation parlementaire systématique.
Des mécanismes de régulation prix-volume pourraient être étendus à d'autres secteurs.
Il paraît difficilement envisageable de transposer à la médecine de ville les dispositifs existant dans le cas de la biologie, de l'imagerie ou des transports de patients302(*). D'autres mécanismes sont toutefois techniquement concevables, comme le conditionnement des revalorisations conventionnelles à l'atteinte d'objectifs sur les volumes.
Point d'accord n° 7 : Mettre en place une gouvernance effective de l'Ondam, reposant notamment sur des prévisions non biaisées et un renforcement des outils de régulation infra-annuelle.
C. RENFORCER LE DISPOSITIF DE PROJECTION, D'ÉVALUATION ET DE RÉFLEXION À LONG TERME SUR LES DIFFÉRENTES BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Actuellement, divers organismes sont spécifiquement chargés d'alimenter la réflexion à long terme sur la sécurité sociale, notamment par la publication de rapports :
- le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) ;
- le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) ;
- le Conseil d'orientation des retraites (COR) ;
- le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA).
Ces organismes, utiles lieux d'expertise et de concertation, au secrétariat restreint, réunissent parlementaires, partenaires sociaux, administrations et personnalités qualifiées.
L'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le COR produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur divers indicateurs de suivi. Ce rapport, comprenant des projections à long terme (actuellement jusqu'en 2070), est devenu un élément essentiel du débat public sur le système de retraite.
Or, il n'existe rien de tel pour les autres branches, ou pour la sécurité sociale considérée dans son ensemble. Le dernier exercice de projection à long terme réalisé par le HCFiPS, qui ne concernait pas spécifiquement la sécurité sociale303(*) et avait pour horizon l'année 2060, remonte à 2017304(*).
Le présent rapport propose de telles projections, sur le périmètre de la sécurité sociale. Toutefois, les moyens de la Mecss la contraignent à s'appuyer sur des travaux existants.
Aussi, il paraît nécessaire qu'une entité externe à l'administration (éventuellement ces différents organismes, de manière conjointe) publie, au moins tous les cinq ans, sur le modèle du rapport annuel du COR, un rapport comprenant des projections à long terme à politiques inchangées, au moins pour chacune des branches de la sécurité sociale et pour la sécurité sociale considérée dans son ensemble. Ce rapport présenterait les principales pistes envisageables pour le retour ou le maintien à l'équilibre.
Point d'accord n° 8 : Publier et médiatiser, au moins tous les cinq ans, un rapport établi par une ou plusieurs entités indépendantes (comme le COR et les trois Hauts Conseils) comprenant :
- des projections de long terme (cinquante ans) pour les recettes, les dépenses et le solde de chaque branche de la sécurité sociale et de la sécurité sociale considérée dans son ensemble ;
- une estimation financière détaillée des inefficiences du système de santé ;
- des pistes pour le retour ou le maintien à l'équilibre.
TROISIÈME PARTIE
PRÉSERVER À LONG
TERME L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Une fois que la sécurité sociale aura été ramenée à l'équilibre - ce qui, sauf crise économique ou dysfonctionnement majeur de notre système institutionnel, devrait être atteint à moyen terme -, l'enjeu sera d'éviter l'apparition d'un nouveau déficit.
I. L'ASSURANCE MALADIE : LE PRINCIPAL DÉFI DES PROCHAINES DÉCENNIES
Comme on l'a vu ci-avant, le principal enjeu des prochaines décennies sera de continuer de maîtriser les dépenses de la branche maladie, dont la croissance spontanée, nettement supérieure à celle du PIB, pourrait les porter de 8,6 points de PIB actuellement à 10,5 points de PIB en 2040 et 14,5 points de PIB en 2070, ce qui ne serait manifestement pas finançable.
A. UNE CROISSANCE SPONTANÉE DES DÉPENSES DE SANTÉ NETTEMENT SUPÉRIEURE À CELLE DU PIB
1. Une croissance spontanée des dépenses de santé nettement supérieure à celle du PIB
Les dépenses de santé sont, par nature, les plus difficiles à projeter.
Schématiquement, les dépenses de santé résultent de quatre phénomènes :
- une élasticité au revenu (« effet richesse »), habituellement évaluée à environ 0,75 pour les principaux pays. Cela signifie que quand le revenu augmente de 1 %, les dépenses de santé augmentent de 0,75 % (avant prise en compte des autres phénomènes)305(*) ;
- trois phénomènes augmentant globalement la croissance des dépenses de santé :
o le vieillissement ;
o le fait que, le secteur de la santé étant une activité intense en main-d'oeuvre, avec moins de gains de productivité que dans l'industrie, les prix tendent à y augmenter plus vite que dans l'économie considérée dans son ensemble (ce qu'on appelle l' « effet Baumol »)306(*) ;
o le progrès technologique (en plus de celui indirectement pris en compte par les lignes précédentes)307(*).
Sur la base d'une approche de ce type, l'OCDE évalue la croissance spontanée des dépenses de santé en France à 2,2 % par an en volume en 2022-2040.
Croissance spontanée des dépenses de santé selon l'OCDE (2022-2040)
(en %)
* L'effet Baumol est la tendance des prix des secteurs intensifs en main-d'oeuvre (comme la santé) à augmenter plus rapidement que ceux du reste de l'économie, du fait de gains de productivité plus faibles dans ces secteurs.
** Progrès technique non indirectement prix en compte par les l'effet de la croissance du PIB et l'effet Baumol.
Source : D'après OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en
Cette simulation économétrique est par nature simplifiée. En particulier, elle ne prend pas en compte le fait que la morbidité à âge donné tend à augmenter et les coûts croissants des nouveaux médicaments (cf. supra).
On remarque toutefois que, sur la base d'une hypothèse d'inflation de 1,75 %, cette croissance spontanée des dépenses de 2,2 % en volume correspond à une croissance spontanée de près de 4 % en valeur, cohérente avec les estimations du Gouvernement308(*).
2. Des dépenses de santé qui, si elles n'étaient pas maîtrisées, pourraient passer de 8,6 points de PIB en 2023 à 10,5 points de PIB en 2040 et 14,5 points de PIB en 2070
Ainsi, selon les projections de la Mecss, laisser les dépenses de santé augmenter de manière spontanée les ferait passer de 8,6 points de PIB en 2023 à 10,5 points de PIB en 2040 et 14,5 points de PIB en 2070, comme le montre le graphique ci-après.
Projections de recettes, de dépenses et de
solde de la branche maladie
de la sécurité sociale
(Robss+FSV)
(en points de PIB)
|
2016 |
2023 |
2023 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
2070 |
|
|
En points |
En Md€ |
En points de PIB |
||||||
|
Maladie |
||||||||
|
Recettes |
8,8 |
232,8 |
8,2 |
8,1 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
|
Dépenses |
9,0 |
243,9 |
8,6 |
9,3 |
10,5 |
11,9 |
13,3 |
14,5 |
|
Solde |
- 0,2 |
- 11,1 |
- 0,4 |
- 1,2 |
- 2,6 |
- 4,1 |
- 5,5 |
- 6,8 |
|
Maladie avec stabilisation de la dépense en points de PIB |
||||||||
|
Recettes |
8,8 |
232,8 |
8,2 |
8,1 |
7,9 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
|
Dépenses |
9,0 |
243,9 |
8,6 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
Solde |
- 0,2 |
- 11,1 |
- 0,4 |
- 0,5 |
- 0,7 |
- 0,9 |
- 0,9 |
- 0,9 |
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
Le second scénario, non prescriptif, n'est pas à politiques inchangés. Il suppose que les dépenses de la branche maladie restent stables en points de PIB par rapport à 2024. Pour mémoire, cela correspond à ce qui se passe depuis une dizaine d'années. Ainsi, en 2016, les dépenses de la branche maladie étaient de 9 points de PIB309(*), soit plus qu'aujourd'hui. Autrement dit, les mesures d'économie sont parvenues à compenser la croissance spontanée augmentée des mesures coûteuses.
Les deux scénarios marquent une légère diminution des recettes rapportées au PIB, qui s'atténue progressivement sur la période de projection. Il s'agit de prendre en compte le fait que selon la Cnam, actuellement le taux de croissance spontané des recettes de l'assurance maladie est inférieur d'environ 0,3 point à celui du PIB en valeur, du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac310(*). Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de prendre des mesures afin de neutraliser cette tendance à la baisse.
B. POURSUIVRE LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ « PAR LES PRIX » DES ANNÉES 2010 ?
1. Des économies qui ont jusqu'à présent essentiellement consisté à agir sur les prix
Comme indiqué supra, les documents prévisionnels annexés aux PLFSS suggèrent que sur la période 2015-2021, les mesures de maîtrise de la dépense de santé se sont élevées à près de 4 milliards d'euros par an en moyenne, dont :
- 2,5 milliards d'euros pour les mesures portant sur les prix (prix des médicaments, prix des achats hospitaliers, dans une moindre mesure rémunération des soins de ville) ;
- 1,1 milliard d'euros pour les mesures portant sur les volumes (maîtrise médicalisée, parcours de soins, arrêts de travail, transport de patients) ;
- 0,4 milliard d'euros pour les mesures portant sur la prise en charge (mise à contribution des patients et complémentaires, et dans une moindre mesure lutte contre la fraude).
Ces documents prévisionnels ne comportent pas de chiffrage des économies suscitées par la maîtrise de la masse salariale hospitalière, qui ont été bien sûr importantes311(*).
2. Un type de régulation qui présente d'évidentes limites
Ce type de régulation de la dépense « par les prix » est probablement indispensable.
On peut toutefois s'interroger sur son efficacité s'il n'est pas accompagné de mesures plus « qualitatives ».
Ainsi, dans le cas de l'hôpital, la politique de maîtrise des coûts des années 2010 s'est traduite par une faible progression des rémunérations312(*), un sous-investissement et une dégradation des conditions de travail, ce qui contribue à expliquer le « Ségur de la Santé », qui majore les dépenses de 13,4 milliards d'euros par an (les mesures discrétionnaires en faveur de l'hôpital atteignant même 21,6 milliards d'euros si l'on ajoute les « mesures inflation »).
On peut donc craindre qu'en l'absence de réformes structurelles suffisantes, une politique de maîtrise des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, soit suivie tôt ou tard par un retour de ceux-ci à un niveau proche de celui qu'ils auraient eu en l'absence de ces mesures.
3. Des mesures de régulation par les prix et les déremboursements plus difficiles lors des prochaines décennies ?
Comme le directeur de la sécurité sociale l'a souligné lors de son audition par les rapporteures, les mesures potentielles de maîtrise de la dépense se « reconstituent » tous les ans. En particulier, la pertinence d'une pratique change d'une année à l'autre.
Toutefois, les efforts réalisés sur l'hôpital dans les années 2010 semblent difficilement renouvelables, en particulier dans un contexte d'endettement important de l'hôpital.
Dans le cas des produits de santé, les pénuries de certains produits, les innovations technologiques (qui, comme indiqué supra, ont suscité une forte croissance des dépenses de médicaments depuis 2020), les considérations de souveraineté et les récentes annonces du président des États-Unis conduisent à s'interroger sur la possibilité de maîtriser durablement des prix des médicaments.
Ces difficultés ont récemment été soulignées par Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
La difficulté de continuer à privilégier la maîtrise des prix et les déremboursements, selon le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Dans un récent article publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel considère que l'action sur les prix (tarifs des actes et prix des médicaments) et les moindres prises en charge ont correspondu dans les années « avant covid » « aux trois quarts de l'effort ».
Il estime que la pratique consistant à allouer aux hôpitaux des financements inférieurs à leurs besoins pour les contraindre à réaliser des gains d'efficience, sans « aucune réforme tant sur la carte sanitaire que sur les règles de gestion des établissements », a conduit pour de nombreux établissements à des « exodes massifs » après la crise sanitaire, l'AP-HP ayant ainsi perdu 12 % de ses infirmières.
Selon lui, « les leviers tarifaires sur l'hôpital et l'industrie pharmaceutique sont devenus beaucoup moins évidents à mobiliser », ne laissant d'autres choix, si on ne parvient pas à davantage réguler les volumes, que de recourir davantage aux déremboursements, ce qui ne paraît pas politiquement envisageable, surtout pendant plusieurs décennies.
Ainsi, selon Nicolas Revel, « une seule solution demeure et va s'imposer à nous : travailler sur le premier paramètre de la dépense, c'est-à-dire la demande de soins pour la resserrer sur sa partie réellement nécessaire ou non évitable ».
Source : D'après Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025
C. RENDRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ PLUS « QUALITATIVE » ?
1. Comme pour la fraude sociale, chiffrer les inefficiences dans le domaine de la santé pour favoriser leur réduction
L'insistance du Parlement à obtenir des chiffrages de la fraude sociale a contribué à enclencher la dynamique actuelle de lutte contre la fraude. De même, il pourrait être utile de chiffrer publiquement les inefficiences des dépenses de santé, afin de davantage inciter à les réduire.
a) Des dépenses de santé inefficientes d'environ un quart du total, soit environ 70 milliards d'euros ?
Contrairement à ce qui est le cas, par exemple, aux États-Unis, en Australie et aux Pays-Bas, il n'existe pas d'estimation en France des inefficiences en matière de dépenses de santé.
L'impossibilité, dans la plupart des cas, de s'appuyer sur des données solides, montre les graves lacunes de l'évaluation de la dépense de santé en France. Cette situation contribue à la difficulté à maîtriser les dépenses de santé.
Le graphique et le tableau ci-après ne prétendent pas donner autre chose que des ordres de grandeur indicatifs, en retenant une présentation analogue à celle des principales études réalisées dans le cas des États-Unis.
Ils suggèrent que les dépenses inefficientes représenteraient près de 30 % des dépenses de santé (contre environ 45 % dans le cas des États-Unis), soit 70 milliards d'euros.
Cela est cohérent avec les estimations des organisations internationales. Ainsi, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2017 estimait, de manière largement conventionnelle, que « près d'un cinquième des dépenses de santé apportent une contribution nulle, ou très limitée, à l'amélioration de l'état de santé de la population. En d'autres termes, les pouvoirs publics pourraient dépenser beaucoup moins dans ce domaine sans que cela n'ait d'impact sur la santé des patients »313(*).
Les inefficiences dans le domaine de la
santé : ébauche de chiffrage
(champ :
totalité des dépenses de santé)
(en % des dépenses de santé)
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées en notes du tableau page suivante
Les inefficiences dans le domaine de la
santé : ébauche de chiffrage
(champ :
totalité des dépenses de santé)
|
États-Unis1 |
France, 2023 |
||
|
Md$ 2019 |
Md€ |
Commentaire |
|
|
Surconsommation |
451 |
25 ? |
Source : pour la médecine de ville (15 Md€), estimation conventionnelle de la Cour des comptes2 ; pour l'hôpital (10 Md€), estimation conventionnelle de la Mecss3. Selon la Cour des comptes, ramener les départements aux dépenses de santé les plus élevées au niveau de la moyenne nationale permettrait d'économiser 2,8 Md€4. |
|
Inefficiences cliniques |
202 |
10 ? |
Convention. Selon la Cour des comptes, la réduction d'un tiers des événements indésirables graves (EIGS) permettrait une économie de 2,7 Md€4. |
|
Possibilités de prévention manquées |
310 |
20 ? |
Tabac, alcool, obésité (hors prise en compte de la perte de PIB, qui pourrait réduire les recettes d'une vingtaine de Md€ supplémentaires) : env. 10 Md€5. Prévention tertiaire (prise en charge des maladies chroniques) : env. 10 Md€ ?6 |
|
Inefficiences administratives |
281 |
7 ? |
Pour le financement de la santé, les dépenses excédentaires (en % des dépenses) par rapport aux autres pays OCDE correspondent à 7 Md€7. Selon le HCAAM, les coûts de gestion sont d'une quinzaine de Md€, se répartissant à peu près également entre branche maladie et assurances complémentaires8. |
|
Fraude et détournement |
185 |
1,7 à 4,5 ? |
Estimation basse : estimation de la fraude aux prestations d'assurance maladie par le HCFiPS9 ; estimation haute : extrapolation par la Cour des comptes (entre 3,8 et 4,5 Md€)10. |
|
Prix trop élevés |
169 |
5 ? |
Prix élevés pour les nouveaux médicaments depuis 2020 et certains équipements médicaux (lunettes, audioprothèses). Le recours aux biosimilaires pourrait être plus développé. Le rapport « charges de produits » de la Cnam (juillet 2025) identifie des rentes pour certains secteurs et professions de santé. |
|
Total inefficiences |
1 598 |
70 ? |
|
|
Total dépenses de santé |
3 600 |
24911 |
|
|
Total inefficiences en % des dépenses |
44 |
28 ? |
|
1 Source : Matthew Speer, J. Mac McCullough, Jonathan E. Fielding, Elinore Faustino, Steven M. Teutsch, « Excess Medical Care Spending : The Categories, Magnitude, and Opportunity Costs of Wasteful Spending in the United States », American Journal of Public Health, vol. 110, n° 12, décembre 2020 (méta-étude de six études existantes).
2 Cour des comptes, La sécurité sociale - Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023 (fourchette de 12 à 18 Md€). Ce chiffrage, largement conventionnel, consiste à appliquer un taux de 20 % ou 30 % à des dépenses de soins de ville d'environ 60 Md€. Le taux de 20 à 30 % est suggéré par un sondage réalisé en 2017 par Odoxa pour la Fédération hospitalière de France (selon lequel 50 % des médecins considèrent que 5 % à 20 % des actes et examens ne sont pas justifiés et 34 % d'entre eux considèrent que ce taux est supérieur à 20 %).
3 Le sondage précité d'Odoxa indique que 32 % des directeurs d'hôpital considèrent que moins de 5 % des actes et examens sont inutiles, et 51 % que ce taux est compris entre 5 % et 20 %. On suppose ici par convention que ce taux est de près de 10 % et concerne non seulement le nombre d'actes, mais aussi les coûts (appliqué à des dépenses de plus de 100 Md€).
Selon la Cour des comptes (Ralfss 2024), en 2019, la France comptait 6 lits pour 1 000 habitants, contre 4 pour la moyenne des pays comparables (13 pays de l'Union européenne plus Norvège et Suisse). L'estimation retenue ici, conventionnelle, est cohérente avec l'hypothèse que le nombre de lits pourrait être ramené de 6 à 5, et les dépenses hospitalières réduites en conséquence d'environ 15 %, soit une quinzaine de milliards d'euros (ramenés à 10 milliards d'euros du fait du développement consécutif de la médecine ambulatoire).
4 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
5 Le coût net pour les finances publiques (coût des soins et de la prévention moins économies de retraites venant des décès prématurés et recettes fiscales assises sur le comportement concerné) est estimé : dans le cas de l'alcool et du tabac, à respectivement 3,3 et 1,7 Md€ en 2019 (Pierre Kopp, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019, Observatoire français des drogues et tendances addictives, juillet 2023) ; et, dans le cas de l'obésité, à 9,5 Md€ en 2012 (Daniel Caby, « Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? », Trésor-Eco n° 179, septembre 2016). Le chiffrage global retenu ici est de 10 Md€, pour prendre en compte les personnes cumulant plusieurs comportements pathologiques et pour tenir compte du ait que les personnes dont la durée de vie serait augmentée grâce à la prévention contracteraient vraisemblablement d'autres pathologies.
Ce chiffrage ne prend pas en compte l'effet sur les recettes publiques de la perte de PIB résultant de l'absentéisme, du « présentéisme » et du moindre taux d'emploi des personnes concernées. Cet effet ne peut être évalué avec précision mais il pourrait être d'une quarantaine de milliards d'euros, dont la moitié pour la sécurité sociale (Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
6 Hypothèse de réduction de 10 % du coût de prise en charge des maladies chroniques (de plus de 100 Md€).
7 Il résulte des données de l'OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/) qu'en 2022, l'administration du financement de la santé a correspondu en France à 4,6 % des dépenses, contre 2 % dans l'OCDE (et par exemple 0,8 % en Allemagne et 2 % au Royaume-Uni). Le différentiel, de 2,6 points, correspond à des dépenses de 7,4 Md€.
8 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022.
9 Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024.
10 Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2023 ; chiffrage repris (présenté comme une estimation haute) dans Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
11 Consommation de soins et de biens médicaux en 2023.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
b) L'OCDE préconise à ses États membres de ramener la part des dépenses de santé inefficientes de 20 % à 10 % d'ici 2040
Certes, il est par nature impossible de supprimer la totalité des inefficiences.
Toutefois, l'OCDE considère que, pour ses États membres, les ramener de 20 % (hypothèse conventionnelle) à 10 % n'est pas hors de portée.
Ainsi, dans son rapport de 2024 précité sur la soutenabilité budgétaire des systèmes de santé, elle considère que les mesures « habituelles » de contrôle des coûts et la promotion du vieillissement en bonne santé ne permettront de ramener les dépenses de santé de ses États membres en 2040 que de 11,8 points de PIB à 11,4 points de PIB. Elle estime donc qu'il faut aller plus loin, la suppression de la moitié des dépenses de santé « inutiles » (soit 10 % des dépenses de santé), de 1,2 point de PIB (y compris les mesures précitées) devant permettre de ramener les dépenses de santé en 2040 de 11,8 points de PIB à 10,6 points de PIB314(*).
Dans le cas de la France, le préalable à de telles mesures est d'identifier et de chiffrer les dépenses inefficientes.
Le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre suggère de rendre publics les indicateurs de qualité développés par la Haute Autorité de santé pour l'ensemble des hôpitaux et cliniques315(*). Il serait possible de généraliser une telle démarche.
Quelques exemples de données qui pourraient alimenter le chiffrage de l'efficience et être rendues publiques
Les chiffrages des inefficiences du système de santé américain reposent notamment sur les données suivantes (les objectifs à atteindre étant souvent déterminés par des comparaisons entre professionnels, établissements ou pays analogues) :
- surconsommation : nombre d'examens par les différents types d'imagerie, proportion de médecins déclarant recourir à la « médecine défensive », recours injustifié aux antibiotiques ou à d'autres médicaments, dépenses par patient ;
- inefficiences cliniques : dépenses de fonctionnement rapportées à l'activité de l'hôpital, coût des erreurs médicales et des maladies nosocomiales, surcoût suscité par le recours inapproprié aux services d'urgence ;
- inefficiences administratives : part du budget des hôpitaux et du temps de travail des médecins consacrée aux tâches administratives ;
- prix trop élevés : prix des médicaments, rémunération des professionnels de santé.
Dans un récent article316(*) publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, préconise « d'avancer dans la voie de la mesure, de l'évaluation et de la transparence en matière de pratiques et de résultats cliniques, qu'il s'agisse des établissements de santé comme des professionnels libéraux ». Il préconise de publier au moins une partie des indicateurs relatifs aux équipes ou professionnels, s'étonnant de ce que « ce soient les classements conçus par certains journaux ou les avis publiés sur Google qui fassent office de portail de transparence ». Ce dispositif d'information devrait selon lui être « public, annuel et généralisé ».
Point d'accord n° 9 : Dans le domaine de la santé, rendre disponibles aux chercheurs, après anonymisation, avec une « granularité » descendant au niveau des établissements de santé et des professionnels de santé, les principaux indicateurs relatifs à la surconsommation, à l'efficience clinique, à l'efficience administrative, aux prix, à la prévention et à la fraude.
2. Privilégier la réduction des volumes d'actes évitables, peu efficaces, voire dangereux ?
Comme indiqué supra, au cours de la dernière décennie, sans prendre en compte la maîtrise de la masse salariale des établissements de santé, les économies auraient été d'environ 4 milliards d'euros par an, dont 2,5 milliards d'euros reposant sur les prix.
La Cour des comptes et la Cnam préconisent de porter ce montant d'ici 2029 ou 2030 à respectivement 4,9 et 4,5 milliards d'euros par an (cf. supra). Dans les deux cas les mesures relatives aux prix seraient considérablement réduites, puisqu'elles seraient ramenées à respectivement 1,9 et 1,6 milliards d'euros.
Toutefois dans le cas des propositions de la Cnam cette forte diminution des économies portant sur les prix serait permise non seulement par une augmentation de celles reposant sur les volumes, mais aussi par l'augmentation des mesures de lutte contre la fraude (qui passerait de 0,1 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros par an) et des transferts aux complémentaires santé et aux assurés (qui passeraient de 0,6 milliard d'euros à 1 milliard d'euros).
Ainsi, selon la Cnam, d'ici 2030 la fraude aura été réduite de 3 milliards d'euros. Or, la fraude est actuellement évaluée à « seulement » 4,5 milliards d'euros selon l'estimation haute de la Cour des comptes. La politque de lutte contre la fraude ne peut donc durablement contribuer à réduire les dépenses de santé.
Le principe des transferts aux complémentaires santé n'est quant à lui pas consensuel. En particulier, il est contesté par le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, qui considère qu'il suscite un risque de perte de maîtrise des dépenses de santé, tout en constituant une hausse déguisée des prélèvements obligatoires (cf. infra).
Au total, la manière la plus consensuelle en son principe de maîtriser durablement les dépenses de santé est de privilégier la réduction des volumes d'actes évitables, peu efficaces, voire dangereux.
Une telle politique serait toutefois techniquement et politiquement complexe à mettre en oeuvre. Les points d'accord n° 8 et n° 9 (cf. supra) ont pour objet de lui donner un cadre favorable.
3. Instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise (proposition n° 9) d'« instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans ».
Il s'agirait en particulier d'« identifier précisément les besoins pour chaque catégorie de professionnels (médecins par spécialités, infirmiers, dentistes, etc.) compte tenu de l'évolution démographique, de l'évolution des compétences, des organisations de travail, et des choix de carrière ».
Cela pourrait notamment permettre, dans le cas des médecins, d'éviter d'inutiles polémiques sur le niveau du numerus apertus (cf. encadré).
Les débats sur le niveau actuel du numerus apertus
Le 17 octobre 2023, Yannick Neuder, alors député, a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation317(*). Ce texte été adopté par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2023 puis par le Sénat le 18 juin 2025.
Il modifie le numerus apertus mis en place en 2019, lors de la suppression du numerus clausus, afin de mieux prendre en compte les besoins de santé du territoire et de favoriser l'accroissement des capacités d'accueil des universités.
Selon le Conseil national de l'ordre des médecins318(*), le nombre de médecins, entre 219 461 et 246 089 en 2025, serait compris entre 292 862 et 315 668 en 2040, ce qui amène son vice-président en charge de la démographie médicale à se demander, dans son éditorial, si l'on ne forme pas actuellement trop de médecins319(*).
Dans un article320(*) publié le 18 avril 2025 dans la revue numérique Telos, Gilles Johanet, ancien directeur de la Cnam et ancien procureur général près la Cour des comptes, préconise explicitement de réduire le numerus apertus actuel321(*).
Dans son article précité322(*) publié par Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, estime quant à lui que l'objectif de former 16 000 nouveaux médecins chaque année « justifierait d'être sérieusement étayé ».
Toutefois à moyen terme l'enjeu est bien d'augmenter le nombre de médecins, conformément à la politique du Gouvernement. Par ailleurs, selon le ministre de la santé, « il faut 2,3 médecins généralistes pour en remplacer un qui part à la retraite323(*) ».
D. QUELLES RELATIONS ENTRE LA BRANCHE MALADIE ET LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ?
1. Faut-il « décroiser » l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé ?
Le surcoût le plus évident de la France par rapport aux pays comparables dans le domaine de la santé concerne le financement de son système de santé, considéré dans son ensemble (public et privé).
En effet, compte tenu du montant de ses dépenses de santé, les dépenses excédentaires de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE relatives au financement du système de santé s'élèvent à environ 7 milliards d'euros324(*). Cela s'explique par la spécificité française de cofinancement des mêmes soins par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, qui n'a pas d'équivalent en Europe et suscite des doublons en gestion.
Structure du financement des dépenses de santé (DCSi*) en 2023
(en milliards d'euros)
|
Dépenses totales |
Dont : gouvernance |
Ratio ( %) |
|
|
Sécurité sociale |
239 627 |
6 727 |
2,8 |
|
Administrations publiques centrales et locales |
14 306 |
1 102 |
7,7 |
|
Organismes complémentaires |
39 342 |
8 261 |
21,0 |
|
Entreprises privées |
1 951 |
||
|
Ménages |
29 913 |
||
|
Total |
325 139 |
16 090 |
4,9 |
* Dépense courante de santé au sens international.
Source : Mecss du Sénat, d'après Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), Les dépenses de santé en 2023 - Résultats des comptes de la santé, 2024
Dans un rapport325(*) de 2022 répondant à une saisine du ministre des solidarités et de la santé, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) présente quatre scénarios d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire (cf. tableau ci-après).
Il souligne que les coûts de gestion de l'assurance maladie étaient en 2020 de 15,7 milliards d'euros, se répartissant à peu près également entre branche maladie (7,2 milliards d'euros) et assurances complémentaires (7,6 milliards d'euros), le reste (1 milliard d'euros) étant pris en charge par diverses administrations publiques.
Si le scénario n° 1 fixe l'objectif d'une réduction des coûts de gestion, une telle réduction ne découle véritablement que des scénarios n° 3 et n° 4. Tous deux suppriment les cofinancements de prestations. Le n° 3, dit de « grande sécu », augmente considérablement le périmètre de la sécurité sociale au détriment de celui des assureurs. Le scénario n° 4 (dit de « décroisement ») vise à maintenir le chiffre d'affaires des assureurs.
Le scénario n° 3 réduirait les frais de gestion de 5,4 milliards d'euros. Toutefois il impliquerait une augmentation des dépenses et des recettes publiques de plus de 20 milliards d'euros et la contraction de 70 % du marché de la complémentaire santé.
Intéressant de prime abord, le scénario n° 4, dit de « décroisement », mériterait d'être approfondi. Certes, comme le souligne le récent rapport326(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « ce scénario peut permettre de supprimer les charges de gestion qu'induit la double liquidation ». Toutefois, il n'est pas évident qu'il permette de réduire les coûts de financement globaux du système de santé327(*). La direction de la sécurité sociale a en outre souligné lors de son audition par les rapporteures que le maintien d'un financement résiduel par la branche maladie permettait à l'administration de conserver une connaissance suffisante des prestations concernées, nécessaire à la maîtrise médicalisée ; un « décroisement » devrait donc s'accompagner d'un dispositif lui permettant de conserver sa vision de ces prestations.
Ces scénarios sont loin d'être consensuels. Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « ces scénarios polaires [...] ne font pas consensus parmi les membres du Hcaam », et « au vu de l'imbrication très forte de cette architecture avec le champ professionnel et de ses multiples effets, une telle refonte supposerait au préalable une négociation interprofessionnelle ». Lors de son audition par les rapporteures, Nicolas Da Silva, maître de conférences en économie à l'Université Sorbonne Paris Nord, a souligné que les complementaires santé permettaient notamment de financer les dépassements d'honoraires des médecins.
Les quatre scénarios sont aussi évalués au regard de leurs effets redistributifs selon les âges et niveaux de vie (cf. tableau ci-après).
Les quatre « scénarios polaires » d'évolution des relations entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire proposés par le HCAAM (2022)
|
Description du schéma |
Impact sur les finances publiques |
Effets redistributifs du scénario |
Réduction des coûts de gestion |
|
|
Scénario 1 : Améliorations dans le cadre de l'architecture actuelle |
Réformes en faveur de certains publics : retraités, personnes à faibles revenus, micro-entrepreneurs, exploitants agricoles... |
- |
- |
Souhaitée, mais non documentée par le rapport |
|
Scénario 2 : Une assurance complémentaire obligatoire, universelle et mutualisée |
• Reconnaissance de la complémentaire santé comme service d'intérêt économique général (SIEG) • Péréquation pour éviter une sélection des « bons risques » • Fourniture libre des garanties relevant du 3e étage |
Risque de requalification des primes d'assurance en prélèvements obligatoires (fort encadrement, péréquation) |
Les retraités économiseraient en moyenne 260 euros par an ; les inactifs, salariés et indépendants perdraient une centaine d'euros par an |
- |
|
Scénario 3 : Augmentation des taux de remboursement de la Sécurité sociale (« grande sécu ») |
• Prise en charge par l'AMO : ticket modérateur, dépenses nécessaires pour l'optique, le dentaire et les audioprothèses... • Complémentaires santé : seulement dépenses hors panier couvert par l'AMO et dépassements d'honoraire |
• Augmentation des dépenses : 18,8 Md€ • Diminution des recettes actuelles : 3,7 Md€ (en quasi-totalité TSA) • Remplacement d'une partie des primes d'assurance par des PO • Impact sur le solde : NC |
• Gain moyen de 50 €/70 € à 20-29 ans et 360/450 € à 80 ans et plus (selon le scénario) • Réforme bénéfique pour les 8 premiers déciles et coûteuse pour les deux derniers |
Réduction de 5,4 Md€ des frais de gestion, découlant d'une contraction de 70 % du marché de la complémentaire santé |
|
Scénario 4 : Décroisement entre les domaines d'intervention de la Sécurité sociale et des assurances complémentaires |
• Passage d'une assurance « complémentaire » à une assurance « supplémentaire » (paniers de soins distincts) et optionnelle • Remboursement par l'AMO à 100 % aux tarifs de responsabilité de ce qu'elle prend en charge • Prise en charge par les complémentaires : optique, soins et prothèses dentaires, audioprothèses, médicaments remboursés à 15 % ou 30 % (voire 65 %) |
• Augmentation des dépenses : 2,7 Md€ • Diminution des recettes : 0,2 Md€ • Impact sur le solde : - 2,9 Md€ |
• Gain allant de 0 € pour les 20-29 ans à 170 € pour les 80 ans et plus • Gain allant de 10 € pour le 1er décile à - 50 € pour le dernier décile |
ND |
AMO : assurance maladie obligatoire (branche maladie).
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022
2. Faut-il transférer des charges aux complémentaires santé pour stabiliser sur le long terme la part de la sécurité sociale dans les dépenses de santé ?
a) Du fait du développement des maladies chroniques, la sécurité sociale supporte une part croissante des dépenses de santé
La part de la sécurité sociale dans les dépenses de santé est passée de 76 % en 2012 à 79,6 % en 2022. On calcule que cette augmentation, de 3,6 points, majore les dépenses de 2022 de la sécurité sociale de près de 8,5 milliards d'euros328(*).
Part des différents financeurs de la
consommation de soins
et de biens médicaux de
2012 à 2022
Source : Drees, Comptes de la santé
Cette évolution s'explique par la part croissante des maladies chroniques dans les dépenses de santé.
b) Selon la DSS et la Cnam, cela justifie des transferts de charges vers les complémentaires santé
Selon la direction de la sécurité sociale, « c'est en raison de cette distorsion que des mesures de transferts de prise en charge de l'AMO vers l'AMC ont récemment été décidées et mises en oeuvre (augmentation du ticket modérateur sur les actes dentaires, instauration d'une taxe d'un milliard sur les complémentaires). Toutefois, ces transferts ne visent pas à davantage recourir au financement privé mais plutôt à revenir à l'équilibre antérieur »329(*).
Tel est également le point de vue de la Cnam. Comme on l'a indiqué, celle-ci propose de transférer 3 milliards d'euros de charges vers les complémentaires santé, correspondant à son estimation de ce qui est nécessaire pour que les parts respectives de l'assurance maladie et des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses de santé reste constante d'ici 2030.
Plus précisément, la Cnam suggère de modifier le panier de soins remboursables à partir notamment de critères médicaux et de service médical rendu, de veiller à ce que la règle selon laquelle les patients en ALD ne bénéficient d'une prise en charge à 100 % que pour les soins réellement en rapport avec celle-ci, ou d'augmenter la participation financière des patients (ticket modérateur, franchises et participations forfaitaires).
c) Selon le rapport des trois Hauts Conseils, un objectif de stabilité à long terme de la part relative de la sécurité sociale et des complémentaires santé pourrait avoir d'importants inconvénients
Cette idée qu'il conviendrait de chercher à stabiliser sur le long terme la part de la sécurité sociale dans la prise en charge des dépenses de santé ne fait pas l'unanimité.
Ainsi, selon le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, sur le long terme, elle « remettrait en cause à la fois le principe d'une couverture de ces soins par l'AMO et la légitimité de l'AMO à les réguler ». En effet, si on voulait ramener la part de la branche maladie dans les dépenses de santé à son niveau de 2013, cela impliquerait de transférer 7,5 milliards d'euros de charges.
À titre d'illustration, cela pourrait impliquer par exemple :
- un point de ticket modérateur représentant une économie d'environ 0,5 milliard d'euros, une augmentation du ticket modérateur de 15 points, faisant passer la prise en charge de tous les honoraires (hors médecins et sages-femmes, pris en charge à 70 %) à 50 %, voire moins. Selon le rapport des trois Hauts Conseils, cela « aurait pour conséquence de faire passer le taux de prise en charge par l'AMO d'une large partie des prestations (tous les honoraires à l'exception de ceux des médecins et des sages-femmes) à 50 % ou moins, ce qui remettrait en cause à la fois le principe d'une couverture de ces soins par l'AMO et la légitimité de l'AMO à les réguler. C'est donc l'ensemble de la régulation des soins courants par l'AMO qui serait affecté » ;
- ou, la participation forfaitaire et la franchise réduisant actuellement la prise en charge d'environ 2,5 milliards d'euros, leur multiplication par 4 (à la charge des assurés, du fait de l'absence de prise en charge par les complémentaires santé responsables). Selon le rapport des trois Hauts Conseils, cela susciterait moins une « responsabilisation » des patients330(*) que « des risques de renoncement aux soins courants, y compris de diagnostic et de prévention, avec le risque d'effets négatifs pour la santé collective (retards de prise en charge) et de surcoûts in fine (report vers les services hospitaliers, prises en charge plus coûteuses du fait de situations dégradées) ».
Participation
forfaitaire et franchise nécessaires pour stabiliser
la part de la
branche maladie dans les dépenses de santé à son niveau de
2013
|
Situation actuelle |
Situation permettant de stabiliser la part de la branche maladie à son niveau de 2013 |
|
|
Participation forfaitaire (consultations médicales, actes médicaux et actes de radiologie et de biologie) |
2 €, avec un maximum de 50 €/an/assuré |
8 €, avec un maximum de 200 €/an/assuré |
|
Franchise médicale |
Plafond à 50 €/an/assuré |
Plafond à 200 €/an/assuré |
|
Boîtes de médicaments |
1 €/boîte |
4 €/boîte |
|
Actes paramédicaux infirmiers et kinésithérapie |
1 €/acte |
4 €/acte |
|
Transports sanitaires |
4 €/transport |
16 €/transport |
Rappel : la participation forfaitaire et la franchise ne sont pas remboursées par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable.
Source : Mecss du Sénat, d'après le code de la sécurité sociale et Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
Par ailleurs, d'un point de vue économique, dès lors que l'assurance complémentaire est obligatoire, il y a peu de différence entre une prime d'assurance et un prélèvement obligatoire.
Enfin, selon le rapport précité du HCAAM de janvier 2022, les complémentaires santé ont des coûts de gestion plus élevés que ceux de l'assurance maladie.
3. Réaliser des transferts d'ensembles cohérents, accompagnés de mesures de maîtrise de la dépense ?
a) Transférer des ensembles cohérents ?
Le rapport des trois Hauts Conseils préconise que les transferts, s'ils devaient avoir lieu, concernent des ensembles cohérents, et s'accompagnent de mesures tendant à maîtriser la dépense. Il propose en particulier que les complémentaires santé ne prennent plus en charge les prestations ne correspondant pas à un niveau de preuve suffisant331(*) (cf. encadré).
Les modalités envisageables de transferts
de charges de la branche maladie
aux complémentaires santé,
selon le rapport des trois Hauts Conseils
« Des mesures de périmètre :
• panier minimal couvrant les soins et biens essentiels (dont le panier minimal du contrat solidaire et responsable pour l'AMC) ;
• prestations pouvant être couvertes dans le cadre du contrat solidaire et responsable.
Des mesures de gestion du risque et de responsabilisation :
• révision des obligations/plafonds de prise en charge ;
• interdiction de la publicité en optique et audiologie ;
• introduction d'ententes préalables ou de délais de carence ;
• révision de la fréquence de renouvellement en optique et en audiologie ;
• échanges facilités de données et d'informations AMO/AMC facilitant la lutte contre la fraude.
Des mesures garantissant la liberté de choix :
• l'engagement de chaque OC de proposer au moins un contrat limité au panier de soins essentiels.
Trois ensembles de produits et de prestations appellent de ce point de vue un réexamen :
• des prises en charge de l'AMO (et, de façon facultative, de l'AMC) pour lesquelles le service médical rendu est faible ou non démontré : médicaments à 15 %, cures thermales332(*) ;
• des prises en charge assurées uniquement par l'AMC et ne correspondant pas à des soins bénéficiant de preuves ;
• des prises en charge où l'AMC joue un rôle majoritaire et très contraint dans le cadre des CSR, qui à la différence des deux ensembles précédents ont un bénéfice démontré pour la santé, mais qui ont fortement crû en période récente et posent des enjeux de régulation : le panier du « 100 % santé ». »
AMC : assurance maladie complémentaire. AMO : assurance maladie obligatoire (branche maladie). CSR : complémentaire santé responsable. OC : organisme complémentaire.
Source : Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
b) Accompagner les transferts de mesures de maîtrise de la dépense ?
Le rapport « charges et produits » de la Cnam envisage, en tant qu'« option », de « revoir le périmètre des contrats responsables, notamment en allongeant la fréquence de renouvellement des lunettes à niveau de correction inchangé » et d'« interdire la publicité pour les lunettes de vue et les audioprothèses ».
Le rapport des trois Hauts Conseils comprend des propositions spécifiques pour réduire le coût de l'optique, du dentaire et des audioprothèses pour les complémentaires santé.
Mesures proposées par le rapport des trois
Hauts Conseils
pour réduire le coût de l'optique, du dentaire
et des audioprothèses
pour les complémentaires
santé
« 1. Allonger le délai de renouvellement des équipements optiques* (actuellement de 2 ans, à 3 voire 5 ans) voire des renouvellements d'audioprothèses en allongeant le délai de garantie légale.
2. Activer la clause permettant de diminuer le PLV des audioprothèses.
3. Doter la régulation d'éléments d'observation et d'analyses des prix de vente des dispositifs médicaux par les fabricants aux distributeurs, et d'analyses de leurs coûts, permettant d'ajuster la tarification au plus juste.
4. Étendre à l'optique et aux audioprothèses l'interdiction de la publicité définie pour le reste des dispositifs médicaux remboursables.
5. Inciter les professionnels à promouvoir le 100 % santé, par davantage de transparence sur les différences entre les équipements, des recommandations de bonne pratique, et des évaluations médico-économiques, de façon à mieux guider les choix des assurés et objectiver les prix.
6. Mettre en place, à l'instar du dentaire, un panier à tarif modéré pour les audioprothèses comprenant des prix limites de vente pour les aides auditives de classe 2. Pour ce panier, comme pour le panier à tarifs maîtrisés en dentaire, l'AMC doit rembourser le ticket modérateur (TM), mais est libre de prendre en charge ou non, en totalité ou partiellement, le remboursement des dépassements.
7. Réduire la prise en charge des paniers à tarifs libres par l'AMC (c'est-à-dire hors paniers 100 % santé et paniers à tarifs maîtrisés). S'agissant de biens où le niveau des garanties de l'AMC tend à fortement orienter le niveau des prix pratiqués, la réduction du niveau de prise en charge des paniers tarifs libres doit avoir pour effets d'une part d'orienter davantage le marché vers les paniers 100 % santé (ou à tarifs maîtrisés s'agissant du dentaire) d'autre part de réduire le niveau des prix de ces paniers. Il conviendrait de ne l'appliquer qu'aux biens et prestations disposant d'une alternative thérapeutique dans le panier 100 % santé.
Trois options peuvent être envisagées :
a. Fixer les plafonds de prise en charge des paniers tarifs libres dans le cadre des CSR à des niveaux significativement inférieurs à ceux du panier 100 % santé. Cette option réduit l'impact sur les assurés en termes de reste à charge s'ils ont des difficultés à accéder à une offre 100 % santé, mais elle laisse subsister une solvabilisation qui permettrait d'y accéder. Cette option dégrade la lisibilité des contrats ;
b. Supprimer l'obligation (dans le cadre des CSR) de prise en charge du ticket modérateur pour les paniers à tarifs libres. Cette option permettrait aux OC de ne plus prendre obligatoirement en charge les paniers à tarifs libres et créerait donc une pression plus forte pour orienter vers les paniers 100 % ou tarifs maîtrisés et/ou modérer les prix des tarifs libres ; une telle option présenterait certes le risque d'un reste à charge accru pour le patient en cas de difficulté d'accès au panier A. Par ailleurs, une telle option n'aurait d'effet sur le marché qu'à condition que l'offre des OC comporte et valorise systématiquement des contrats ne prenant pas en charge ces produits à tarif libre tout en laissant un espace pour la concurrence, la différenciation commerciale entre contrats en termes de degré de couverture, et la liberté de choix des assurés sociaux ;
c. Sortir la prise en charge des paniers à tarifs libres du champ des prises en charge admises dans le cadre des CSR. Cette option est celle qui aurait l'effet régulateur le plus fort sur le marché : elle contraindrait probablement à une bascule massive vers les paniers A et à tarif maîtrisé. En revanche, elle créerait un risque de reste à charge pour les situations de difficulté d'accès aux paniers À au risque de limiter l'accès à des produits innovants.
* En précisant que ces délais s'appliquent sauf en cas d'équipement brisé ou d'évolution de la correction. »
AMC : assurance maladie complémentaire. AMO : assurance maladie obligatoire (branche maladie). CSR : complémentaire santé responsable. OC : organisme complémentaire. PLV : prix limite de vente.
Source : Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
E. QUELLES PERSPECTIVES APRÈS 2040 ?
1. Une régulation agissant majoritairement sur les volumes n'est peut-être pas soutenable à l'horizon de plusieurs décennies
Dans son article précité333(*), Nicolas Revel, estime qu'« en agissant sur l'ensemble des leviers proposés - juste prescription, qualité des soins, renforcement des dépistages, concentration de l'offre spécialisé et mise en place d'une vraie politique de suivi moderne des patients chroniques -, la progression de la dépense pourrait être freinée d'au moins un tiers par rapport à sa dynamique naturelle ».
Il précise toutefois qu'il ne s'agit que d'une « conviction ».
De fait, l'impact annuel sur le taux de croissance spontané des dépenses de santé dépendrait de la vitesse de mise en oeuvre de ces mesures (une mise en oeuvre plus étalée dans le temps correspondant à une moindre diminution du taux de croissance annuel).
Par ailleurs, une régulation essentiellement « par les volumes » ne paraît pas davantage soutenable, à l'horizon de plusieurs décennies, que la régulation essentiellement « par les prix » qui a dominé jusqu'à présent.
En effet, le « stock » d'inefficiences qu'il est possible de supprimer est par nature limité. Comme on l'a vu ci-avant, ces inefficiences peuvent être grossièrement évaluées, dans le cas de la France, à environ un quart des dépenses. Parmi elles, celles pouvant être supprimées correspondent peut-être à environ 10 % des dépenses334(*). Dans l'hypothèse où l'effort annuel de 1,5 point sur les dépenses de santé (croissance de 3 % en valeur au lieu d'une croissance spontanée de 4,5 %) se répartirait entre 0,5 point pour les mesures « habituelles » sur les prix et 1 point pour les mesures plus « qualitatives » sur les volumes, le « stock » de gains d'efficience pourrait être épuisé en une décennie - soit, si ces efforts commençaient à être véritablement réalisés en 2030, en 2040.
2. Si dans la seconde moitié du XXIe siècle les évolutions technologiques augmentent la croissance spontanée des dépenses, un risque de désocialisation croissante de celles-ci ?
a) Une croissance spontanée des dépenses de santé qui pourrait évoluer dans un sens ou dans l'autre, du fait notamment du développement de l'intelligence artificielle
L'effet du progrès technologique sur les dépenses de santé au cours des prochaines décennies est imprévisible.
Comme indiqué supra, il a été un facteur important d'augmentation des dépenses.
Il est possible que le développement de l'intelligence artificielle (IA) en médecine se traduise par un nouveau « paradoxe de Solow »335(*), selon lequel elle ne se traduirait par aucun gain de productivité mesurable. Tel serait en particulier le cas si, comme cela a pu être observé par le passé pour certaines spécialités, les gains de productivité permettaient à des acteurs privés de constituer des rentes (cf. supra).
Dans un récent rapport d'information336(*) de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin évoquent toutefois explicitement des applications qui suggèrent qu'il pourrait en aller autrement. Certes, l'IA servira notamment, comme les innovations médicales précédentes, à améliorer la qualité des soins337(*). On peut supposer que cela se traduirait par des dépenses supplémentaires. Ils estiment toutefois qu'elle pourrait également se substituer à des opérateurs humains pour le diagnostic338(*) ou la chirurgie339(*). S'ils soulignent l'intérêt de telles évolutions, en particulier dans le cas des difficultés d'accès aux soins340(*), ils considèrent qu'elles pourraient se heurter à des contraintes d'acceptabilité sociale341(*). En particulier, elles pourraient réduire les contacts entre les patients et les professionnels de santé, qui font partie intégrante du soin.
Au total, il ne paraît guère possible de faire autre chose que de distinguer deux scénarios : un scénario de baisse de la croissance spontanée des dépenses où le progrès technologique permettrait de réaliser des gains de productivité faisant que, pour la première fois, il ne contribuerait pas à la croissance spontanée des dépenses de santé ; un scénario de hausse de la croissance spontanée des dépenses où, au contraire, il majorerait celle-ci.
b) Un risque de désocialisation croissante des dépenses de santé ?
Comme on l'a indiqué ci-avant, une maîtrise des dépenses de santé se faisant essentiellement par les prix est difficilement soutenable sur le long terme (comme le montre le précédent des années 2010 et du « Ségur de la santé »). Une maîtrise des dépenses plus « qualitative », agissant davantage sur les volumes, pourrait contribuer significativement à la maîtrise des dépenses de santé, mais probablement pendant un temps limité.
Si dans la seconde moitié du XXIe siècle le progrès technologique avait pour effet d'augmenter fortement la croissance spontanée des dépenses de santé, le risque d'une désocialisation progressive des dépenses de santé et d'une santé à plusieurs vitesse s'en trouverait accru. En effet, il pourrait ne pas être possible de totalement prendre en charge ce surcoût par des économies complémentaires ou par une augmentation des dépenses publiques de santé en points de PIB.
II. RETRAITES ET AUTONOMIE : DES CHOIX POLITIQUES
Dans le cas des dépenses de santé, à moins de bouleverser notre modèle social, les mesures envisageables pour améliorer le solde relèvent avant tout d'une recherche d'efficience (même si celle-ci ne peut s'affranchir de considérations politiques, en particulier dans le cas de la prévention).
Pour la branche vieillesse et la branche autonomie, les mesures sont de nature politique. En effet, il s'agit fondamentalement de déterminer l'ampleur d'une redistribution en faveur d'un groupe de personnes (retraités ou personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie).
A. DANS LE CAS DE LA BRANCHE VIEILLESSE : ARBITRER ENTRE ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE, NIVEAU DES PENSIONS ET AUGMENTATION DES RECETTES
1. Sans nouvelles mesures, un déficit de 0,7 point de PIB en 2040 et 1,6 point de PIB en 2070
Le graphique ci-après, réalisé par la Mecss à partir des projections du COR (relatives à l'ensemble du système de retraite342(*)) de juin 2025, indique la projection des recettes, des dépenses et du solde de la branche vieillesse jusqu'en 2070.
En l'absence de mesures, la branche vieillesse serait déficitaire de 0,7 point de PIB en 2040 et 1,6 point de PIB en 2070, dégradant d'autant le solde des administrations de sécurité sociale.
Projections de recettes, de dépenses et de solde de la branche vieillesse de la sécurité sociale (Robss+FSV), calculées à partir des projections du COR pour l'ensemble du système de retraite (scénario de référence)
(en points de PIB)
|
2023 |
2023 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
2070 |
|
|
En Md€ |
En points de PIB |
||||||
|
Recettes |
274,0 |
9,7 |
9,9 |
9,5 |
9,2 |
8,9 |
8,8 |
|
Dépenses |
275,4 |
9,7 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
10,5 |
|
Solde |
- 1,4 |
0,0 |
- 0,2 |
- 0,7 |
- 1,2 |
- 1,5 |
- 1,6 |
Calculs basés sur la convention dite d'équilibre permanent des régimes (EPR) : contributions et subventions d'équilibre évoluant de manière à équilibrer chaque année le solde de ces régimes.
Conversion au périmètre de la branche vieillesse de la sécurité sociale réalisée par la Mecss.
Source : Calculs de la Mecss du Sénat, d'après Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel - Évolutions et perspectives des retraites en France, juin 2024
2. Synthèse des principales mesures envisageables dans le cadre du système par répartition actuel
Les règles relatives aux pensions impliquent, du fait de la nature du système par répartition, où les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui, des arbitrages, relatifs notamment au niveau de vie des retraités comparé à celui des actifs et, dans le cas de l'âge de départ à la retraite, au temps de travail sur une vie.
Les trois paramètres du régime de retraite déterminant son solde sont, schématiquement, l'âge de départ à la retraite (par l'âge d'ouverture des droits ou la durée d'assurance requise), le niveau des pensions et le niveau de ses recettes (soit, hors fiscalité, les taux de cotisation).
D'un point de vue économique, le recul de l'âge de la retraite a comme effet d'augmenter le nombre d'actifs, et donc le PIB, ce qui améliore le solde non seulement de la branche retraite, mais aussi des autres administrations publiques. Ainsi, au niveau de l'ensemble des administrations publiques, l'amélioration du solde découlant d'un recul d'une année de l'âge d'ouverture des droits serait d'une dizaine de milliards d'euros en 2035 (en euros constants de 2024), dont environ les deux tiers venant de recettes supplémentaires et un tiers venant de moindres dépenses343(*),344(*).
Le tableau ci-après synthétise les chiffrages des principales mesures envisageables s'agissant des retraites.
Principales mesures d'amélioration du solde de la branche vieillesse
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
|||
|
Montant des pensions |
||||
|
Indexation des retraites inférieure de 1 point à l'inflation |
2,9 Md€ (puis un montant analogue supplémentaire chaque année si on maintient la moindre indexation) |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
||
|
Age de départ à la retraite |
||||
|
APU |
Asso |
Robss |
||
|
Age d'ouverture des droits (AOD) progressivement porté à 65 ans pour les générations 1968 à 1972 (Md€ constants de 2024) |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites. L'effet indiqué est celui en 2035, en milliards d'euros constants 2024. |
|||
|
Moindres dépenses |
3,5 |
3,5 |
2,4 |
|
|
Recettes supplémentaires |
7,1 |
1,2 |
ND |
|
|
Solde |
10,6 |
4,7 |
ND |
|
|
Durée d'assurance requise (DAR) progressivement portée à 176 trimestres pour les générations 1969 à 1973 (Md€ constants de 2024) |
||||
|
Moindres dépenses |
3,9 |
3,9 |
2,9 |
|
|
Recettes supplémentaires |
5,8 |
1,3 |
ND |
|
|
Solde |
9,7 |
5,2 |
ND |
|
|
Recettes de la sécurité sociale |
||||
|
Créer une sur-cotisation sur les hauts salaires |
2,5 |
Chiffrage du programme du NFP pour les législatives 2024 par l'Institut Montaigne (hypothèses : taxation de 10 % de la part de salaire net supérieure à 5 000 €). |
||
|
Alignement du taux réduit de CSG de 8,3 % pour les « grosses retraites » sur le taux de 9,2 % applicable aux salaires |
1,8 |
DSS |
||
|
Assujettissement de toutes les retraites (y compris celles actuellement exonérées) au taux de CSG de 9,2 % applicable aux salaires |
11 |
DSS |
||
|
Augmentation d'un point du taux de : |
||||
|
Cotisation salariale sous plafond |
6,2 |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
||
|
Cotisation patronale sous plafond |
4,8 |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
||
|
Cotisation salariale déplafonnée |
7,6 |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
||
|
Cotisation patronale déplafonnée |
6,2 |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
||
|
CSG sur les revenus d'activité |
12,0 |
Mecss du Sénat, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus de remplacement |
4,0 |
Mecss du Sénat, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus du patrimoine |
0,8 |
Mecss du Sénat, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus de placement |
1,1 |
Mecss du Sénat, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
Recettes de l'État* |
||||
|
Abattement d'impôt sur le revenu de 10 % sur les pensions |
5 |
Tome 2 du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2025 (4 533 millions d'euros en 2023, 4 806 millions d'euros en 2024 et 4 956 millions d'euros en 2025) |
||
APU : administrations publiques. Asso : administrations de sécurité sociale. CCSS : commission des comptes de la sécurité sociale. CSG : cotisation sociale généralisée. DSS : direction de la sécurité sociale. Robss : régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
* Pour améliorer le solde de la sécurité sociale, il faudrait lui restituer ce produit, par exemple via une augmentation de la part de TVA affectée.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
Le tableau ci-après, issu du rapport du COR de juin 2025, indique l'ajustement à apporter à l'un des trois principaux paramètres pour atteindre l'équilibre, par le seul ajustement de ce paramètre (hors « bouclage » macroéconomique).
Ajustement des leviers disponibles pour équilibrer structurellement le système de retraite chaque année jusqu'à 2070, selon le COR
Scénario de référence : hypothèses démographiques centrales de l'Insee (poursuite des gains d'espérance de vie, fécondité de 1,8 enfant par femme et solde migratoire net de 70 000 personnes par an), croissance annuelle de la productivité horaire du travail de 0,7 % (à partir de 2040) et taux de chômage de 7,0 % (à partir de 2032).
Lecture : dans le scénario de référence, atteindre l'équilibre financier du système de retraite en 2070 nécessiterait par exemple (à législation inchangée) un âge de départ à la retraite de 66,5 ans, soit un relèvement de + 1,9 an par rapport à sa valeur projetée à législation inchangée (64,6 ans) ; ou un taux de prélèvement de 32,8 %, soit un relèvement de + 3,2 point par rapport au taux projeté à législation inchangée (29,6 %), mais une quasi-stabilité par rapport au taux actuel (du fait de sa tendance spontanée à la baisse).
Source : D'après Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, juin 2025
Le 17 janvier 2025, le Premier ministre a installé le « conclave » sur les retraites, ensuite renommé « délégation paritaire permanente » (DPP). Force ouvrière (FO), l'Union des entreprises de proximité (U2P) puis la Confédération générale du travail (CGT) ont successivement décidé de ne pas participer aux discussions. La Cour des comptes a remis deux rapports, en février et mars 2025345(*). Dans un courrier du 26 février 2025, le Premier ministre a indiqué que l'objectif était de ramener le système de retraite (soit l'ensemble constitué par la branche vieillesse, FSV compris, et les régimes complémentaires de retraite obligatoires) à l'équilibre en 2030.
Lors de sa dernière réunion, le 23 juin 2025, la délégation paritaire permanente sur les retraites a rejeté un ensemble de mesures correspondant à une économie nette de 6,4 milliards d'euros en 2030 (permettant d'atteindre l'équilibre à cette échéance) et 4,4 milliards d'euros en 2035, synthétisée par le tableau ci-après (le consensus n'ayant pu être atteint sur trois mesures).
La proposition rejetée par la délégation paritaire permanente sur les retraites le 23 juin 2025
(en milliards d'euros)
|
2030 |
2035 |
|
|
Solde Cour des comptes |
- 6,5 |
- 18,2 |
|
Améliorations du système de retraite |
- 1,5 |
- 3,1 |
|
Age d'annulation de la décote (AAD) fixé à 66,5 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1964 |
- 0,6 |
- 1,9 |
|
Réintroduire les risques ergonomiques dans le compte professionnel de prévention (C2P) à travers une cartographie des métiers pénibles |
- 0,5 |
- 0,5 |
|
Augmenter le salaire de référence de toutes les mères, salaire annuel moyen (SAM) sur 24 ans (1 enfant) ou 23 ans (2 enfants et plus). Surcote parentale inchangée |
- 0,2 |
- 0,6 |
|
Tenir compte de deux trimestres de majoration de durée d'assurance dans les retraites anticipées pour carrière longue (RACL) des mères |
- 0,2 |
- 0,1 |
|
Introduction de la RACL 17/59 |
0,0 |
0,0 |
|
Effort des actifs |
0,8 |
1,2 |
|
Durcissement des RACL 20/62 et 21/63 |
0,5 |
0,9 |
|
Rationalisation du cumul emploi retraite* |
0,3 |
0,3 |
|
Effort des employeurs |
0,9 |
1,0 |
|
Équilibre AT-MP des mesures concernant l'usure professionnelle |
0,5 |
0,5 |
|
Augmentation de 2 points du forfait social à 20 % |
0,4 |
0,5 |
|
Effort des retraités |
6,1 |
5,4 |
|
sous indexation des régimes de base de 0,8 pt 2026 |
2,0 |
1,8 |
|
sous indexation des régimes de base de 0,4 pt 2027 |
1,0 |
0,9 |
|
sous indexation des régimes de base de 0,4 pt 2028 |
0,9 |
0,8 |
|
sous indexation des régimes de base de 0,4 pt 2029 |
1,0 |
0,9 |
|
sous indexation des régimes de base de 0,4 pt 2030 |
1,2 |
1,0 |
|
Total des économies nettes |
6,4 |
4,4 |
|
Solde après mesures |
- 0,1 |
- 13,8 |
Trois mesures indiquées en italiques : absence de consensus.
* Mesure proposée par la Cour des comptes (rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025).
Source : D'après la délégation paritaire permanente
Conformément aux principes évoqués dans l'avant-propos, le présent rapport ne préconise ni n'écarte aucune mesure particulière pour améliorer le solde de la branche vieillesse.
3. Faut-il développer le financement de la retraite au moyen d'actifs fléchés ?
a) Avantages et limites du recours à des actifs fléchés pour financer la retraite
Souvent surestimé, le financement de la retraite au moyen d'actifs fléchés (ce que l'OCDE appelle un « système de pension adossé à des actifs » et qui correspond à la retraite par capitalisation, au sens large) présente néanmoins divers avantages, en particulier dans un contexte de finances publiques contraintes.
Ces actifs fléchés peuvent être détenus par des fonds de pension, habituellement privés, alimentés par les versements des salariés, mais aussi, par exemple, par des fonds publics alimentés par des versements publics (comme le Fonds de réserve des retraites - FRR - en France, servant à provisionner le système par répartition).
(1) Des limites évidentes
Le financement des pensions au moyen d'actifs fléchés présente d'évidentes limites.
La principale est que, d'un point de vue macroéconomique, aux importations près, ce sont toujours les actifs qui, par leur production économique, « font vivre » les retraités. De ce point de vue, il n'y a pas de véritable différence entre un système de retraite financé par des actifs fléchés et un système de retraite par répartition faisant face aux mêmes contraintes démographiques et de productivité. Par ailleurs, le financement des pensions peut être assuré, outre par le stock de capital, par les versements des nouveaux contractants.
En outre, les fonds de pension (une forme particulière de financement par actifs fléchés) ne sont habituellement pas à prestations définies, ce qui les rend sensible aux crises, comme l'ont démontré aux États-Unis la crise des subprimes en 2007 et ses effets sur les fonds de pension. En France, le régime général des retraites par répartition, à prestations définies, peut plus facilement jouer un effet contracyclique en cas de choc économique.
Par ailleurs, le recours à des actifs fléchés pour financer les retraites implique une longue phase de constitution du capital. Ainsi, l'introduction d'une part de capitalisation dans un système par répartition implique, si le système par capitalisation est abondé par les salariés ou les employeurs, que ceux-ci cotisent simultanément pour les deux systèmes (phénomène de « double cotisation »), ce qui alourdit le coût du travail et peut poser un problème d'équité346(*).
Enfin, le développement de la retraite par capitalisation peut impliquer de coûteuses dépenses fiscales. Ainsi, en France, les plans d'épargne retraite (PER) bénéficient de réductions de cotisations sociales et de déduction du revenu imposable, pour un coût de 1,8 milliard d'euros par an347(*).
(2) Un intérêt particulier dans un contexte de finances publiques contraintes
Toutefois, certains considèrent que le financement des pensions au moyen d'actifs fléchés présente un intérêt particulier dans un contexte de prélèvements obligatoires élevés, qui rend difficile l'équilibrage du système de retraite par de nouvelles hausses d'impôts ou de cotisations.
En effet, sur le long terme, le rendement d'un régime par répartition correspond à la croissance de la masse salariale, et donc du PIB (et du partage de la valeur ajoutée). Un régime financé par des actifs fléchés peut quant à lui capter un surplus de rendement par rapport à la croissance, lié notamment à la prime de risque des actions, et à une diversification géographique plus large. Même si les abondements du système se font par endettement, l'opération présente un intérêt patrimonial, tant que le rendement est supérieur au coût de l'endettement.
Par exemple, selon les estimations fournies aux rapporteures par le FRR, si celui-ci avait été abondé comme prévu lors de sa création, il permettrait actuellement de financer les dépenses de retraite pour un montant de 12 à 15 milliards d'euros par an.
Le recours à des actifs fléchés favorise en outre l'investissement, ce qui augmente le PIB si celui-ci est réalisé en France348(*). Elle peut notamment permettre le développement d'un fonds souverain.
b) Le financement de la retraite au moyen d'actifs fléchés en France et en Europe
Actuellement, en France le financement de la retraite par des actifs fléchés consiste en des dispositifs variés :
- pour le privé, les réserves de l'Agirc-Arrco et des dispositifs d'épargne retraite, individuels ou dans le cadre de l'entreprise. En application de la loi « Pacte » d'octobre 2019, qui a créé le PER (plan épargne retraite)349(*), depuis le 1er janvier 2020 celui-ci est le seul dispositif commercialisé350(*) ;
- pour le public, l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) ;
- pour le système de retraite dans son ensemble, le FRR.
Selon l'OCDE, le total des actifs ainsi fléchés pour les retraites correspond en France à environ 14 points de PIB, ce qui la place parmi les États pour lesquels leur encours est le plus faible. À titre de comparaison, il approche 200 points de PIB pour le Danemark et l'Islande. Il reste toutefois supérieur à celui, notamment, de l'Espagne et de l'Allemagne.
Actifs fléchés pour les retraites
dans les pays de l'OCDE
(fin 2022 ou dernière année
disponible)
(en points de PIB)
Source : D'après OCDE, Pensions at a Glance 2023, OECD and G20 Indicators, 2023
c) Mettre en place une part de capitalisation obligatoire pour le secteur privé ?
Dans une récente publication351(*) de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol), Bertrand Martinot suggère d'introduire une part obligatoire de capitalisation, qui permettrait de réduire progressivement les cotisations du système par répartition. Il ne s'agirait donc pas de compléter le régime par répartition, mais de le faire partiellement basculer vers un système par capitalisation, dans une logique de réduction du coût du travail.
Selon ses calculs, une contribution de 4 % sur les salaires permettrait de générer le même montant de droits à la retraite que le système actuel. Le stock de capital accumulé atteindrait 50 % du PIB en 2070 (année où la retraite par capitalisation correspondrait à 25 % des pensions du secteur privé) et 75 % du PIB à la fin de sa montée en puissance, vers 2105.
Toutefois la mise en place d'un « pilier » par capitalisation implique de limiter la double cotisation des actifs lors de la montée en puissance du système. L'auteur propose à cet égard quelques pistes : mobilisation des réserves actuelles du régime par répartition (FRR et Agirc-Arrco)352(*), sous-indexation temporaire des pensions, contribution de l'État, achat par l'État d'actions françaises sans droit de vote et incessibles.
d) Réabonder le Fonds de réserve des retraites ?
(1) Le dévoiement du FRR
Le Fonds de réserve des retraites (FRR) illustre l'insuffisance de la prise en compte du long terme dans la gestion des finances sociales.
Le FRR a été créé par l'article 2 de la LFSS pour 1999353(*), qui prévoyait qu'il était géré par le FSV. L'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 lui a donné le statut d'établissement public à caractère administratif354(*).
L'objectif initial, affirmé par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, était de « contribuer à la pérennité des régimes de retraite ».
Le FRR était censé permettre le passage à un système de « répartition provisionnée », en accumulant des réserves financières de l'ordre de 150 milliards d'euros à l'horizon 2020. Il s'agissait de faciliter le passage de la « bosse démographique ». Comme indiqué, selon les calculs du FRR, transmis aux rapporteures, si cet objectif avait été atteint, le FRR pourrait actuellement contribuer à la charge des retraites pour 12 à 15 milliards d'euros par an.
Ses ressources affectées (prévues par l'article L. 135-7 du même code) et divers abondements ont permis aux réserves d'atteindre le montant de 37 milliards d'euros en 2010.
L'objectif d'accumulation de réserves a ensuite été abandonné, le FRR devenant un simple « réservoir » dans lequel puiser pour financer à court terme la sécurité sociale.
Ainsi, la crise des dettes souveraines a conduit la LFSS pour 2011 à réaffecter ces ressources à la Cades et au FSV et à modifier l'article L. 135-6 précité, pour prévoir que de 2011 à 2024, « le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, [de la Cnav et du FSV] ».
De même, en conséquence de la crise sanitaire, la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a de nouveau modifié l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que de 2025 à 2033, le FRR versera chaque année à la Cades 1,45 milliard d'euros (soit 13 milliards d'euros au total) au titre du financement de l'amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Cette loi a en outre imposé au FRR de verser intégralement à la Cnav dès 2020 la soulte relative à la caisse nationale des industries électriques et gazières (Cnieg), qui était payable à partir de 2020.
Ainsi, fin 2024, le FRR a payé un montant total net355(*) de 2,2 milliards d'euros et il lui reste 20,4 milliards d'euros sous gestion, ce qui correspond à 22,6 milliards d'euros de création de valeur brute depuis l'origine.
Abondements, versements et encours d'actif du FRR
(en milliards d'euros)
|
Abondements FRR |
Abondements Cnieg |
Versements à la Cades* |
Versements Cnieg |
Actif en fin d'année |
|
|
2004 |
18,72 |
19,24 |
|||
|
2005 |
1,57 |
3,06 |
27,11 |
||
|
2006 |
1,54 |
31,19 |
|||
|
2007 |
1,74 |
34,43 |
|||
|
2008 |
1,88 |
27,63 |
|||
|
2009 |
1,48 |
33,31 |
|||
|
2010 |
2,23 |
37,02 |
|||
|
2011 |
- 2,1 |
35,11 |
|||
|
2012 |
- 2,1 |
36,6 |
|||
|
2013 |
- 2,1 |
36,29 |
|||
|
2014 |
- 2,1 |
37,22 |
|||
|
2015 |
- 2,1 |
36,38 |
|||
|
2016 |
- 2,1 |
36 |
|||
|
2017 |
- 2,1 |
36,46 |
|||
|
2018 |
- 2,1 |
32,65 |
|||
|
2019 |
- 2,1 |
33,67 |
|||
|
2020 |
- 2,1 |
- 5 |
26,41 |
||
|
2021 |
- 2,1 |
26,1 |
|||
|
2022 |
- 2,1 |
21,35 |
|||
|
2023 |
- 2,1 |
21,23 |
|||
|
2024 |
- 2,1 |
20,41 |
Cades : Caisse d'amortissement de la dette sociale. Cnieg : Caisse nationale des industries électriques et gazières. FRR : Fonds de réserve des retraites.
* Ce versement est de 1,45 milliard d'euros par an de 2025 à 2033.
Source : Données Fonds de réserve des retraites (réponse aux rapporteures) - graphique Mecss du Sénat
(2) Abonder le FRR pour lui permettre de mieux financer les retraites ?
Le versement annuel susceptible d'être réalisé par le FRR tout en maintenant son actif constant est, par définition, égal à son rendement. Ainsi, en supposant un rendement annuel de 4 %, le FRR peut verser sans entamer son capital environ 0,5 milliard d'euros par an avec un actif de 15 milliards d'euros, 1,45 milliard d'euros par an avec un actif de 40 milliards d'euros, 5 milliards d'euros par an avec un actif de 120 milliards d'euros.
Le FRR considère en particulier que, si telle était la décision des pouvoirs publics, il pourrait assurer la gestion d'un futur système d'épargne retraite collective, dans le cadre d'un système par répartition provisionné (comme envisagé à l'origine) ou, à plus long terme, dans le cadre d'un système complémentaire par capitalisation accessible directement aux épargnants.
Les analyses du FRR sur un éventuel réabondemment régulier
« Dans les conditions actuelles du FRR, les projections médianes conduisent à un actif espéré d'environ 15 Md€ en 2033. Le FRR pourrait alors verser un montant annuel de l'ordre de 500 millions d'euros aux finances sociales à compter de 2034. Ce montant permet de stabiliser l'encours réel du FRR pour lui permettre de poursuivre ses missions.
Dans le rapport produit suite à la mission flash sollicitée par le Premier Ministre, la Cour des Comptes évalue le déficit des régimes de retraite autour de 15 Md€ en 2035, et celui-ci se creuserait encore jusqu'à 30 Md€ en 2045 (dans un scénario de productivité à 0,7 %). Cela pourrait nécessiter des ajustements sur un ou plusieurs des trois leviers usuels (partage entre durée de vie active et durée de vie en retraite, niveau des pensions de retraites relativement au revenu des actifs, niveau du taux de cotisation).
Développer l'épargne retraite collective, embryonnaire aujourd'hui, permettrait de réduire le recours à ces trois leviers, en renforçant la soutenabilité de régimes de retraite fondés sur la répartition (approche à laquelle les Français sont attachés), sans que la capitalisation puisse toutefois régler seule la question des déficits de retraite.
Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) pourrait constituer un réceptacle d'une poche d'épargne retraite collective de ce type, dans un cadre de risque maîtrisé.
À titre d'illustration, pour permettre de maintenir un versement de 1,45 Md€ annuel sans remettre en cause la capacité significative de création de valeur du FRR pour les finances sociales, la taille d'actifs sous gestion du FRR devrait avoisiner les 40 Md€ (contre 20 milliards d'euros actuellement, et 15 milliards d'euros projeté à 2033). Pour contribuer à hauteur de 5 milliards d'euros annuel de façon pérenne (et conserver un actif stable), l'encours de réserves devrait avoisiner les 120 milliards d'euros.
Cela pose la question des possibilités de déploiement du FRR au-delà des 20 Md€ actuels d'encours. Dans un premier temps, la piste d'un fonctionnement constant du FRR (outil de réserve du régime général de retraites) pourrait être examinée.
À plus long terme, il pourrait être envisagé de développer une capitalisation collective accessible directement aux épargnants, sous la forme de contributions et selon des modalités qui restent toutefois largement à instruire (caractère facultatif ou obligatoire, assiette, traitement fiscal, coût de gestion, garantie, etc.). »
Source : Fonds de réserve des retraites, réponse aux rapporteures
Dans une publication récente356(*), Nicolas Marques, directeur général de l'institut économique Molinari, préoconise de reprovisionner le FRR pour financer les retraites de l'État. Il s'agirait d'abonder le FRR à hauteur d'un point de PIB pendant une quarantaine d'années, ce qui, selon ses calculs, permettrait de financer les retraites des fonctionnaires de l'État, d'actuellement 62 milliards d'euros par an. On peut toutefois s'interroger sur le réalisme de cette proposition, compte tenu de la situation actuelle des finances publiques.
B. DANS LE CAS DE LA BRANCHE AUTONOMIE : DÉTERMINER LE PROFIL SOUHAITÉ D'ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET AJUSTER LES RECETTES EN CONSÉQUENCE
1. Un déficit en 2070 de 0,6 point de PIB en 2070 à politiques inchangées mais davantage si la France aligne le niveau des prestations et la probabilité d'être pris en charge sur la moyenne de l'Union européenne
Dans le cas de la branche autonomie, les projections de dépenses de la Commission européenne à politique inchangée suggèrent, si on les transpose au périmètre de la branche, un déficit qui au cours des prochaines décennies devrait pouvoir être financé sans trop de difficultés.
Ainsi, la branche connaîtrait un déficit de « seulement » 3 milliards d'euros (0,1 point de PIB) en 2030 et 7 milliards d'euros (0,2 point de PIB) en 2040, le déficit atteignant 0,6 point de PIB en 2070.
Projection par la Mecss des recettes, des dépenses et du solde de la branche autonomie de la sécurité sociale
(en points de PIB)
|
2023 |
2023 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
2070 |
|
|
En Md€ |
En points de PIB |
||||||
|
Recettes |
37,0 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Dépenses |
37,6 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
|
Solde |
- 0,6 |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,5 |
- 0,6 |
Hypothèses : en point de PIB, les dépenses évoluent conformément aux projections de la Commission européenne pour l'ensemble des dépenses publiques en faveur de l'autonomie. Les recettes de la branche autonomie augmentent au même taux que le PIB en valeur.
Source : Calculs de la Mecss du Sénat
Les emplois impliqués par la politique en faveur de l'autonomie
« Les estimations du ministère des Solidarités et de la Santé relatives à l'accompagnement de la dépendance font (...) état d'un besoin supplémentaire d'aides-soignants et d'accompagnants de plus de 18 000 par an d'ici 2024, que notre projection prolonge à 2030 (soit 210 000 emplois créés de 2019 à 2030 dans ces deux professions). Ces estimations sont cohérentes avec l'évolution attendue de la population âgée en perte d'autonomie : si les pratiques d'entrée en institutions restaient inchangées, les besoins d'ouverture de places en Ehpad s'étageraient entre 53 000 et 141 000 à l'horizon 2030 selon l'évolution retenue de la dépendance. »
Source : Dares, Métiers 2030 - Quels métiers en 2030, mars 2022
Toutefois cette projection « rassurante » - cohérente avec la prévision 2025-2029 du rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale357(*) - ne traduit pas la totalité de la situation.
Tout d'abord, les dépenses de la branche ne correspondent qu'à une partie des dépenses publiques en faveur de l'autonomie, environ 1,5 fois plus élevées358(*). Ainsi, pour l'ensemble des dépenses publiques, l'augmentation des dépenses en faveur de l'autonomie entre 2023 et 2070 serait d'environ 1 point de PIB.
Ensuite, à l'échelle de la branche, cette augmentation des dépenses de 0,6 point de PIB d'ici 2070, et donc des capacités de prise en charge correspondantes, représente un défi considérable, d'autant plus que près de la moitié de la hausse aurait lieu d'ici 2040. Selon les projections de la Commission européenne, à politiques inchangées le nombre de personnes dépendantes prises en charge augmenterait de près de 500 000 dans les années 2030, soit environ deux fois plus que dans la décennie précédente ou dans la décennie suivante.
Augmentation par décennie du nombre de
personnes dépendantes
prises en charge en France, selon la Commission
européenne
(scénario de base)
(en milliers)
Le tableau concerne l'ensemble des personnes dépendantes prises en charge, quel que soit leur âge.
Source : D'après Commission européenne, 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, avril 2024
Par ailleurs la notion de « politiques inchangées » pourrait être peu adaptée s'agissant d'une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne359(*), dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l'autonomie 360(*) passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le « scénario de référence », mais 4,8 points de PIB selon le « scénario de risque »361(*).
On rappelle à cet égard que les dépenses publiques ne correspondent qu'à 80 % environ des dépenses en faveur de l'autonomie362(*). Par ailleurs, selon la Commission européenne, moins de la moitié des personnes dépendantes sont actuellement prises en charge, comme l'indique le tableau ci-après.
Prise en charge des personnes dépendantes, selon la Commission européenne (scénario de base)
(en milliers)
|
2022 |
2030 |
2040 |
2050 |
2060 |
2070 |
|
|
Personnes dépendantes |
6 196 |
6 679 |
7 353 |
7 689 |
7 849 |
7 919 |
|
Dont : |
||||||
|
Prises en charge : |
2 752 |
2 935 |
3 395 |
3 650 |
3 774 |
3 837 |
|
Recevant des soins en institution |
888 |
960 |
1 196 |
1 331 |
1 407 |
1 448 |
|
Recevant des soins à domicile |
1 404 |
1 527 |
1 762 |
1 887 |
1 951 |
1 989 |
|
Recevant des prestations monétaires |
460 |
448 |
437 |
432 |
416 |
400 |
|
Non prises en charge |
3 444 |
3 744 |
3 958 |
4 039 |
4 075 |
4 082 |
Le tableau concerne l'ensemble des personnes dépendantes, quel que soit leur âge.
Le nombre total de personnes dépendantes est estimé sur la base de l'enquête européenne harmonisée EU-SILC (qui demande aux personnes interrogées si elles sont sévèrement limitées depuis au moins 6 mois, pour une raison de santé, dans les activités que les gens font habituellement), auquel est ajouté le nombre de personnes en institution (qui ne sont pas destinataires du questionnaire de l'enquête). Dans le cas de la France, la proportion de personnes dépendantes selon cette enquête, de 1,5 % de 15 à 19 ans, augmente (avec une accélération à partir de 70 ans) pour atteindre 46,7 % à partir de 85 ans.
Selon les projections de la Commission européenne, la proportion de personnes dépendantes prises en charge passerait de 44 % en 2019 à 48 % en 2070 (du fait de l'augmentation de la proportion de personnes dépendantes recevant des soins en institution ou à domicile).
Source : D'après Commission européenne, 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, avril 2024
2. Réduire la part des dépenses d'APA et de PCH financée par les départements ?
La branche autonomie ne finance qu'environ 40 % de l'allocation personnalisée autonomie (APA) et 30 % de la prestation de compensation du handicap (PCH), le reste (soit respectivement 3,7 et 1,8 milliards d'euros en 2022) étant pris en charge par les départements.
Les finances des départements, déjà très contraintes, impliquent des moyens supplémentaires, alors que ces dépenses vont mécaniquement augmenter.
Part des dépenses d'APA et de PCH financée par la CNSA
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
Dépenses d'APA versées par les départements |
5 029 |
5 183 |
5 263 |
5 370 |
5 385 |
5 478 |
5 529 |
5 692 |
5 839 |
5 919 |
6 033 |
6 137 |
6 223 |
6 354 |
|
dont concours versés par la CNSA aux départements au titre de l'APA |
1 548 |
1 536 |
1 622 |
1 656 |
1 729 |
1 776 |
1 788 |
2 032 |
2 266 |
2 325 |
2 419 |
2 480 |
2 454 |
2 638 |
|
Part des dépenses d'APA financée par la CNSA ( %) |
30,8 |
29,6 |
30,8 |
30,8 |
32,1 |
32,4 |
32,3 |
35,7 |
38,8 |
39,3 |
40,1 |
40,4 |
39,4 |
41,5 |
|
Dépenses de PCH versées par les départements |
843 |
1 078 |
1 241 |
1 397 |
1 511 |
1 599 |
1 699 |
1 810 |
1 901 |
2 006 |
2 118 |
2 221 |
2 369 |
2 651 |
|
dont concours versés par la CNSA aux départements au titre de la PCH |
510 |
502 |
528 |
545 |
549 |
547 |
555 |
565 |
590 |
605 |
616 |
636 |
637 |
885 |
|
Part des dépenses de PCH financée par la CNSA ( %) |
60,4 |
46,6 |
42,5 |
39,0 |
36,3 |
34,2 |
32,7 |
31,2 |
31,0 |
30,1 |
29,1 |
28,6 |
26,9 |
33,4 |
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « Santé » annexé au Placss pour 2023
3. Comment financer l'autonomie ?
a) Comment financer la dépense publique ?
Les projections à politiques inchangées correspondent à une augmentation des dépenses publiques en faveur de l'autonomie entre 2023 et 2060 comprise entre 0,5 point de PIB (Chojnicki et Ragot) et 0,8 point de PIB (Drees).
Toutefois, dans le « scénario de risque » de la Commission européenne, qui suppose que le niveau de prise en charge et la probabilité d'être pris en charge s'alignent d'ici 2070 sur la moyenne de l'Union européenne, l'augmentation d'ici 2060 serait de prè de 3 points de PIB.
Projections des dépenses publiques en faveur de l'autonomie (à politiques inchangées sauf pour le « scénario de risque » de la Commission européenne)
Les différentes publications ne concernant pas nécessairement les mêmes années, les données manquantes ont été ajoutées par interpolation linéaire.
* Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
** Romain Roussel, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Études et résultats, n° 1032, octobre 2017.
*** Xavier Chojnicki, Lionel Ragot, « Que peut-on attendre d'une assurance autonomie universelle dans le financement de la perte d'autonomie ? Évaluation à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable », Revue d'économie financière, 152(4), 167-184, 2023.
Source : Mecss du Sénat
Ces dépenses nouvelles pourraient être financées par des réductions d'autres dépenses (à déterminer), par une augmentation de prélèvements obligatoires ou par la réduction de la part des dépenses prises en charge par la puissance publique.
Une augmentation d'un point de la CSG sur tous les types de revenus rapporterait un produit de 0,6 point de PIB (actuellement 18 milliards d'euros), ce qui correspond à l'ordre de grandeur de l'augmentation attendue du financement public d'ici 2060 dans les scénarios à politiques inchangées.
Lors de la discussion du PLFSS pour 2025, le texte adopté par le Sénat prévoyait l'instauration d'une contribution de solidarité par le travail. Collectée auprès de l'employeur en contrepartie d'une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail, elle aurait rapporté 2,5 milliards d'euros. Elle a toutefois été supprimée par la commission mixte paritaire.
Le tableau ci-après reproduit les principales propositions du « rapport Vachey » de 2020 pour financer la branche autonomie.
Principales mesures proposées par le
« rapport Vachey »
pour financer la branche autonomie
(hors réaffectations de recettes)
(en millions d'euros)
|
Intitulé de la mesure |
Remarques |
Gain en régime de croisière |
|
Économies |
840 |
|
|
Économies sur l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) |
Prise en compte d'un loyer fictif dans le calcul de la base ressource de l'APA |
440 |
|
Régulation de la dynamique de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) |
Renforcement des contrôles pour éviter que des personnes devant percevoir le RSA bénéficient indûment de l'AAH-2 (taux d'incapacité entre 50 % et 79 %)* |
400 |
|
Réductions de niches |
4 810 |
|
|
Division par 2 du plafond de l'abattement d'impôt sur le revenu de 10 % des retraités |
Plafond actuellement de 4 399 euros |
1 500 |
|
Sortie du « bandeau famille » des allégements généraux de cotisations patronales à 2,5 Smic |
Proposition caduque (la LFSS 2025 a supprimé le bandeau famille à compter du 1er janvier 2026) |
1 100 |
|
Alignement du taux de CSG de 8,3 % sur les « grosses » retraites sur celui des revenus d'activité (9,2 %), en contrepartie de la cotisation d'assurance maladie de 1 % applicable sur les retraites complémentaires |
Retraites imposées à 6,6 %
ou 3,8 % non concernées |
1630-850=780 |
|
Plafonnement à 6 000 euros du crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (service à la personne, SAP)** |
Plafond actuellement de 12 000 euros |
400 |
|
Extension de l'assiette de la CSA aux revenus d'activité des indépendants |
Hypothèse de taux de 0,3 % (comme pour les salaires) |
250 |
|
Extension de l'assiette de la CSA aux compléments de salaires |
Hypothèse de taux de 0,3 % (comme pour les salaires) |
240 |
|
Suppression de l'exonération de cotisations patronales pour les salariés intervenant auprès de « publics fragiles » quand ils interviennent auprès de personnes de plus de 70 ans non dépendantes |
Recentrage de la niche sur les seules personnes âgées dépendantes |
180 |
|
Plafonnement à 1 plafond annuel de sécurité sociale (Pass) de l'abattement de 1,75 % de frais professionnels applicable sur la CSG-CRDS |
Plafond actuel de 4 Pass |
150 |
|
Plafonnement à 5 000 euros par an de la réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes en Ehpad** |
Plafond actuellement de 10 000 euros |
110 |
|
Extension de l'assiette de la Casa aux indemnités journalières et allocations chômage |
Hypothèse de taux de 0,3 % (comme pour les salaires) |
100 |
|
Augmentation de la fiscalité des transmissions de capital à titre gratuit (successions et donations) |
600 |
|
|
Instauration d'un prélèvement de 0,8 % sur les transmissions |
Même assiette que pour les DMTG |
400*** |
|
Instauration d'une tranche de DMTG à 25 % pour les transmissions entre 284 128 euros et 552 324 euros** |
Barème de DMTG rendu plus progressif |
200 |
|
Total |
5 650 |
Casa : Contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. CSA : contribution de solidarité pour l'autonomie. DMTG : droits de mutation à titre gratuit.
* Pour mémoire, l'AAH n'est pas financée par la branche autonomie, mais par l'État.
** Cette mesure concerne les recettes de l'État.
*** Selon le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (juillet 2025), « le rendement d'un prélèvement supplémentaire de 1 % sur les flux patrimoniaux successoraux pourrait représenter un montant de l'ordre de 1 milliard d'euros ».
Source : D'après Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020
Les deux dernières propositions tendent à augmenter la fiscalité des successions et donations. Une analyse approfondie de cette fiscalité sortirait du cadre du présent rapport. On peut toutefois mentionner à ce sujet une note363(*) de 2021 du Conseil d'analyse économique, qui évalue le gain permis par la réduction des principales niches de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 1,5 milliard d'euros364(*). Les DMTG sont un impôt d'État : il faudrait donc prévoir le reversement au moins partiel du gain à la sécurité sociale, par exemple via un ajustement de la fraction de TVA qui lui est affectée.
Dans un avis de 2024365(*), le Conseil économique, social et environnemental fait des propositions synthétisées par le tableau ci-après.
Les propositions du CESE pour financer la branche autonomie (2024)
(en milliards d'euros)
|
Rendement |
Scénario 1 |
Scénario 2 |
Scénario 3 |
Scénario 4 |
|
|
Piste 1 : Créer une cotisation progressive affectée à la perte d'autonomie des personnes âgées assise sur les revenus d'activité et les pensions de retraite |
16 (1 € de cotisation en moyenne par jour) |
× |
× |
× |
|
|
Piste 2 : Diminuer les exonérations sur la part des cotisations sociales versées par l'employeur |
1,1 |
× |
× |
× |
|
|
Piste 3 : Augmenter la CSG |
5 (pour une hausse de 0,3 point) |
× |
× |
× |
|
|
Piste 4 : Réétaler dans le temps la dette de la Cades et affecter à la perte d'autonomie une partie de la CSG |
5 (pour une réaffectation de 0,3 point) |
× |
× |
× |
× |
|
Piste 5 : Faire converger le taux supérieur de la CSG applicable aux retraités et aux actifs |
1,3 (cela touche les 30 % de retraités les plus aisés pour un coût moyen de 18 €/mois) |
× |
× |
||
|
Piste 6 : étendre la CSA aux revenus d'activité des travailleurs indépendants et aux compléments de salaire aujourd'hui exonérés |
0,5 (pour les deux mesures) |
× |
× |
× |
|
|
Piste 7 : Rendre plus progressif le barème des droits de mutation à titre gratuit |
2 |
× |
× |
× |
|
|
Piste 8 : Mettre en place une redevance sur les bénéfices des Ehpad privés lucratifs |
À expertiser |
× |
× |
||
|
Total |
14,9 |
22,6 |
28 |
30,9 |
|
|
Piste 9 : créer une assurance dépendance |
Pour une rente de 500 €/mois pour les GIR 1 et 2 : - prime de 17 € si cotisation à partir de 50 ans ; - prime de 10 € si cotisation à partir de 20 ans |
× |
× |
× |
|
|
Piste 10 : encourager le viager mutualisé |
× |
× |
× |
Source : Martine Vignau, Soutenir l'autonomie : les besoins et leurs financements, avis n° 2024-005, Conseil économique, social et environnemental, 26 mars 2024
La principale proposition, retenue dans trois des cinq scénarios, consiste à « créer une cotisation progressive affectée à la perte d'autonomie des personnes âgées assises sur les revenus d'activité et les pensions de retraite » (mais pas sur les revenus du capital), pour un rendement de 16 milliards d'euros. Le CESE considère qu'« une rente de 1 275 € mensuels pourrait ainsi être accordée aux personnes les plus dépendantes (c'est-à-dire les Gir 1 et 2) et 925 € pour une dépendance plus modérée (c'est-à-dire les Gir de 3 à 4) ».
Les autres mesures comprennent, notamment, une réduction de 1,1 milliard d'euros des allégements généraux de cotisations sociales employeurs, une augmentation de la CSG de 1,3 milliard d'euros, l'alignement du taux de CSG de 8,3 % des retraites les plus élevées sur le taux de 9,2 % applicable aux salaires, une extension de l'assiette de la CSA aux revenus d'activité des indépendants et une réduction de 5 milliards d'euros des ressources de la Cades.
Une réduction importante de la part des dépenses prises en charge par la puissance publique impliquerait quant à elle vraisemblablement la mise en place d'une assurance obligatoire (cf. ci-après).
b) Pour financer la dépense privée, instaurer une assurance dépendance obligatoire ou mobiliser le patrimoine ?
(1) Instaurer une assurance dépendance obligatoire ?
Actuellement, les personnes s'assurant contre le risque de perte d'autonomie sont peu nombreuses et souvent âgées366(*), le niveau élevé des primes dissuadant les personnes jeunes de s'assurer (ce qu'on appelle un mécanisme d'« antisélection »). Or, la part des dépenses en faveur de l'autonomie supportées par les ménages est actuellement proche de 20 %, et, compte tenu des contraintes qui risquent de continuer à peser sur les finances publiques, pourrait augmenter au cours des prochaines décennies367(*).
Aussi, l'instauration d'une assurance dépendance obligatoire pour financer la dépense privée est parfois envisagée. Son caractère obligatoire permettrait d'éviter le mécanisme d'antisélection.
La Fédération française des assurances et la Fédération nationale de la mutualité française ont proposé, notamment lors de la campagne présidentielle de 2022368(*), la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire obligatoire en répartition provisionnée rattaché aux complémentaires santé responsables. Le « rapport Vachey » de 2020 juge toutefois une telle mesure peu adaptée, notamment du fait du risque d'augmentation du risque de non-assurance santé369(*). Cette limite a également été soulignée aux rapporteures par la direction de la sécurité sociale.
Une assurance dépendance obligatoire pourrait néanmoins prendre d'autres formes (cf. encadré).
La mise en place d'une assurance dépendance
obligatoire :
quelques scénarios proposés par Xavier
Chojnicki et Lionel Ragot
Dans un article publié en 2023 dans la Revue d'économie financière, Xavier Chojnicki et Lionel Ragot envisagent divers scénarios d'assurance dépendance obligatoire.
Dans tous les cas, il s'agirait de financer une prestation fixée en 2020 à 1 275 euros par mois pour une personne âgée ayant un niveau de perte d'autonomie de GIR 1-2 et à 925 euros par mois dans le cas d'un niveau de perte d'autonomie de GIR 3-4, la prestation étant ensuite indexée sur l'évolution des salaires. Les dépenses correspondantes370(*) passeraient de 0,69 point de PIB en 2020 à 1,05 point de PIB en 2100.
Dans un premier scénario, totalement public, les recettes proviendraient de cotisations sur le revenu disponible des ménages à partir de 20 ans, le taux de cotisation variant de 0,8 % pour les personnes peu qualifiées à 1,9 % pour les personnes fortement qualifiées. Le dispositif, excédentaire jusqu'en 2035, placerait alors ses excédents sur les marchés financiers ; puis il puiserait dans ses réserves jusqu'en 2045, et majorerait ensuite le déficit des administrations publiques, de 2,5 points de PIB en 2100.
Le deuxième scénario relève moins de l'assurance au sens strict que d'une extension « basique » du champ des recettes et des dépenses publiques. Il s'agirait en effet de financer la prestation par une augmentation progressive de la CSG.
Enfin, le troisième scénario consisterait à instaurer une cotisation forfaitaire à partir d'un certain âge, qui pourrait par exemple être fixé à 20 ou 40 ans (la variante à 60 ans dégradant de 6 % à 8 % les revenus disponibles des personnes autonomes de 60 ans et plus).
La perte de revenu disponible des personnes âgées dépendantes de GIR 1-2 par rapport aux autres personnes du même âge, de 30 % à 40 % actuellement, deviendrait inférieure à 10 %.
Selon les simulations des auteurs, les différents scénarios entraîneraient une réduction de PIB pour un montant autour de la somme financée (1,05 point de PIB en 2100), cette réduction étant comprise en 2100 entre 0,94 point pour la cotisation forfaitaire à partir de 40 ans et 1,56 point pour l'augmentation de la CSG371(*).
Source : D'après Xavier Chojnicki, Lionel Ragot, « Que peut-on attendre d'une assurance autonomie universelle dans le financement de la perte d'autonomie ? Évaluation à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable », Revue d'économie financière, 152(4), 167-184, 2023.
La direction de la sécurité sociale a indiqué aux rapporteures que selon elle, « en préalable à tout développement de l'assurance dépendance, l'enjeu est de renforcer l'aspect qualitatif du marché afin d'améliorer les conditions de la couverture de ce risque ». De fait, la majorité des contrats comporteraient d'importants inconvénients pour l'assuré372(*). La direction de la sécurité sociale indique mener, conjointement avec la direction générale du Trésor, des réflexions « pour apprécier l'opportunité, d'une part, de mesures protectrices applicables à l'ensemble des contrats d'assurance dépendance, et, d'autre part, de limiter l'application d'un régime socio-fiscal favorable aux seuls contrats respectant des critères de qualité à l'instar de ceux qui ont été prévus dans les PER (plans d'épargne retraite) ».
Le précédent des complémentaires santé suggère qu'une assurance dépendance obligatoire publique aurait des coûts de gestion plus faibles (économies d'échelle, moindres dépenses de publicité...). En sens inverse, même si l'effet sur le PIB serait probablement indépendant de la qualification ou non des primes comme prélèvements obligatoires (cf. encadré), il pourrait être politiquement plus compliqué d'augmenter les prélèvements obligatoires, et un taux de prélèvements obligatoires élevé pourrait rendre la France moins attractive pour certains investisseurs.
Le statut de cotisations obligatoires à
l'assurance dépendance
du point de vue de la comptabilité
nationale
Les cotisations obligatoires à l'assurance dépendance ne seraient vraisemblablement pas considérées par l'Insee et Eurostat comme des prélèvements obligatoires, sous réserve que les assureurs disposent d'une liberté suffisante.
En effet, selon système européen des comptes (« SEC 2010 »), les cotisations sociales sont versées à des « régimes de sécurité sociale », définis par le fait qu'ils « couvrent à titre obligatoire la totalité de la population ou un très large sous-ensemble de cette dernière » et qu'ils « sont imposés, contrôlés et financés par les administrations publiques ».
Ainsi, actuellement, les primes d'assurances supportées par les employeurs du secteur privé dans le cadre de la complémentaire santé d'entreprise ne sont pas classées parmi les prélèvements obligatoires, l'encadrement du dispositif laissant subsister un espace pour la négociation et les primes étant libres373(*).
(2) Mobiliser le patrimoine ?
Diverses mesures tendant à mobiliser le patrimoine des personnes dépendantes ont pu être proposées.
Le « rapport Vachey » précité de 2020 mentionne, sans prendre parti, la proposition de la Société de financement pour l'autonomie et de la dépendance (Sofipad) d'instaurer un « prêt immobilier dépendance ». Ce prêt serait attribué par la banque à l'entrée en dépendance et garanti par un bien immobilier.
Point d'accord n° 10 : Dans le cas de l'autonomie, fixer des objectifs explicites de probabilité de prise en charge et de niveau de prise en charge, et se doter du financement permettant de les atteindre.
III. L'ACTION SUR LES RECETTES
Sur le long terme, il serait bien sûr possible d'adopter des mesures d'augmentation des prélèvements obligatoires, déjà évoquées dans la deuxième partie et synthétisées en annexe.
Les développements ci-après se concentrent sur deux sujets complémentaires : l'augmentation de la quantité de travail et le basculement des cotisations vers d'autres types de prélèvements.
A. FAUT-IL AUGMENTER LA QUANTITÉ DE TRAVAIL ?
Comme on l'a indiqué dans la première partie, si les dépenses de protection sociale de la France sont les plus élevées de l'OCDE en points de PIB, elles sont plus banales si l'on raisonne en montant par habitant (sixième position), en particulier dans le cas de la santé (dixième position).
Le niveau de notre modèle social ne peut en effet être dissocié des performances de notre économie.
1. Pourquoi le PIB par habitant est-il plus faible en France que dans de nombreux pays ?
Comme indiqué supra, le PIB par habitant de la France est proche de la médiane des pays de l'OCDE.
Le graphique ci-après, transmis aux rapporteures par Gilbert Cette, président du COR, indique l'écart de PIB par habitant de différents pays par rapport aux États-Unis, en le décomposant entre ses différentes causes.
Écart de PIB par habitant relativement au
niveau des États-Unis
et contributions (2022)
(en % et en points)
Source : Graphique transmis aux rapporteures par Gilbert Cette ; traduction par les rapporteures (d'après Cette et Lecat, 2016)
La situation est différente selon qu'on compare la France aux États-Unis ou aux autres pays.
Si on compare la France aux États-Unis, le bâton de gauche montre que les deux principaux facteurs expliquant l'écart par rapport aux États-Unis sont la productivité globale des facteurs, ou « progrès technique » (c'est-à-dire à l'efficacité avec laquelle l'économie utilise le travail et le capital) et le nombre d'heures de travail par travailleur.
Si on compare la France aux autres pays, en particulier européens, on constate que la France se caractérise par le fait que son taux d'emploi (c'est-à-dire la proportion de personnes en âge de travailler ayant un emploi) est plus faible qu'aux États-Unis, alors que dans la plupart des autres pays il est plus élevé.
2. Porter le taux d'emploi au niveau constaté chez nos principaux partenaires ?
Comme le montre le graphique ci-après, issu d'une récente note du Conseil d'analyse économique374(*), depuis le début des années 1990 la France a un nombre d'heures travaillées par habitant inférieur à celui de nos principaux partenaires.
Nombre d'heures annuelles travaillées par habitant (1968-2024)
Note : Nombre moyen d'heures annuelles travaillées estimé sur l'ensemble des 16-74 ans.
Lecture : En France, en 2023, un habitant de 16 à 74 ans travaille en moyenne 980 heures par an. C'est environ 100 heures de moins qu'en Allemagne où la moyenne est à 1 070 heures par habitant et qu'au Royaume-Uni où la moyenne est à 1 100 heures. Les États-Unis se trouvent bien au-dessus, avec une moyenne de 1 270 heures travaillées par habitant.
Source : Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025
Selon le Conseil d'analyse économique, « cet écart avec l'Allemagne et le Royaume-Uni s'explique entièrement par un taux d'emploi plus faible en France et pas du tout par un nombre plus faible d'heures en emploi ».
En effet, comme le montre le graphique ci-après, le nombre d'heures annuelles travaillées par personne en emploi de la France ne se distingue pas de celui de ces deux pays. Les États-Unis, en revanche, ont conservé le nombre d'heures travaillées des années 1970.
Nombre d'heures annuelles travaillées par personne en emploi (marge intensive)
Note : Moyenne du nombre d'heures annuelles travaillées, estimée sur l'ensemble des individus en emploi parmi les 16-74 ans.
Lecture : Dès lors qu'ils sont en emploi, les Allemands, les Britanniques et les Français travaillent à peu près le même nombre d'heures par an, autour de 1600 heures. Les États-Unis se distinguent des pays européens avec plus de 1900 heures travaillées par individu en emploi.
Source : Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025
Par ailleurs, « le taux d'emploi plus bas de la France se concentre entièrement sur les jeunes et les seniors : l'insertion sur le marché du travail des jeunes est beaucoup plus lente en France, et les sorties du marché du travail sont plus précoces ».
Le CAE suggère que dans le cas des seniors, il faudrait laisser les réformes passées des retraites faire sentir leurs effets, et se contenter pour les personnes de 65 ans et plus de cibler celles effectivement capables de travailler375(*).
Le principal enjeu serait désormais celui de l'emploi des jeunes. Ainsi, selon le CAE, « la contribution des jeunes aux écarts du nombre moyen d'heures de travail par habitant est devenue aussi importante que celle des seniors et va tendre à la supplanter dans les années qui viennent. La question du taux d'emploi des jeunes doit donc devenir une priorité de politiques publiques. Ceci suppose de repenser l'organisation des parcours éducatifs, de faire des [personnes ni étudiantes ni employées ni en formation] une priorité absolue et de revoir l'ensemble des politiques d'insertion des jeunes sur le marché du travail. »
a) Un alignement du taux d'emploi de la France sur celui de l'Allemagne permettrait quasiment de résorber le déficit de la sécurité sociale
Selon une note de 2024 de la direction générale du Trésor376(*), aligner le taux d'emploi (c'est-à-dire la proportion de personnes de 15-64 ans ayant un emploi) sur celui de l'Allemagne améliorerait le solde des administrations de sécurité sociale de 20 milliards d'euros (dont 15 milliards d'euros d'augmentation de recettes et 5 milliards d'euros de réduction de dépenses).
Impact pour les administrations de
sécurité sociale d'un alignement
du taux d'emploi de la France
sur celui de l'Allemagne,
selon la direction générale du
Trésor
Source : Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la direction générale du Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024
Le chiffrage est effectué en faisant l'hypothèse que les emplois créés seraient plus souvent à temps partiel que les emplois actuels, comme les « emplois Hartz » en Allemagne377(*).
Présentation simplifiée du raisonnement
numérique
de la note de la direction générale du
Trésor
La note prend en compte deux mécanismes suscitant une « déperdition » entre l'augmentation du nombre d'emplois et celle du PIB.
Avant prise en compte de la diminution du temps de travail, l'emploi augmenterait de 3,6 millions de personnes, soit environ 14 %.
Toutefois le PIB n'augmenterait pas de 14 %, pour deux raisons.
Tout d'abord, les personnes concernées seraient deux fois moins productives par heure travaillée378(*). Ainsi, même sans diminution du temps de travail, le PIB serait accru de seulement 7 % (scénario 1).
Ensuite, les personnes concernées recourraient davantage au temps partiel, ce qui conduit à diviser le nombre d'ETP et l'impact sur le PIB par environ 2,3. Ainsi, le PIB augmenterait de seulement 3,2 % (scénario 2).
Les recettes des administrations de sécurité sociale dépendant directement de l'emploi, évaluées à environ 570 milliards d'euros, augmenteraient à un taux analogue, suscitant un produit supplémentaire de 15 milliards d'euros.
La baisse des dépenses, de 5 milliards d'euros, serait le solde de diverses évolutions379(*).
b) Continuer de favoriser l'emploi des seniors, conformément aux ANI du 14 novembre 2024 ?
Certains préconisent de favoriser l'emploi des seniors.
On peut mentionner à cet égard le projet de loi portant transposition des trois accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 14 novembre 2024380(*), déposé au Sénat et adopté en première lecture par le Sénat le 4 juin 2025.
Le projet de loi portant transposition des trois
accords nationaux interprofessionnels (ANI)
du 14 novembre 2024 :
principales dispositions relatives
aux seniors
Le projet de loi prévoit d'instaurer un rendez-vous de mi-carrière, autour de 45 ans. A la visite médicale, déjà obligatoire, à doit s'ajouter un nouvel entretien professionnel. Il s'agit notamment, sur le modèle de l'Europe du Nord, de favoriser les reconversions en milieu de carrière, ce qui devrait favoriser le maintien en emploi des personnes ayant eu en première partie de carrière un emploi « usant » physiquement.
Il prévoit également d'expérimenter, sur cinq ans, un dispositif analogue au contrat de fin de carrière, dit « CDI seniors », inséré dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat contre l'avis du Gouvernement, et censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier ». Il s'agit de créer un nouveau contrat à durée indéterminée (CDI) à destination des demandeurs d'emploi expérimentés, qui permettrait à leur employeur de procéder à leur mise à la retraite une fois l'âge d'obtention d'une pension de retraite à taux plein atteint, et de bénéficier d'une exonération de la contribution employeur spécifique sur l'indemnité de mise à la retraite.
Enfin, il prévoit d'assouplir le dispositif de retraite progressive, notamment en permettant d'y accéder plus tôt.
c) Donner désormais la priorité à l'emploi des jeunes ?
Comme indiqué supra, selon la note précitée du Conseil d'analyse économique (2025), le principal enjeu en termes de politiques publiques serait désormais celui de l'emploi des jeunes.
Cela renvoie à la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et des lycées professionnels. Ces sujets dépassent toutefois le champ du présent rapport.
L'effondrement de l'emploi des personnes les moins qualifiées
Selon la note précitée du CAE (2025), l'un des principaux changements au cours des dernières décennies, et plus particulièrement des quinze dernières années, est « la forte baisse [du nombre d'heures] des moins qualifiés ». En effet, le nombre total d'heures de travail des moins qualifiés (primaire ou secondaire) a reculé de 40 % en 30 ans (cette évolution étant « très spécifique à la France »).
Le CAE s'interroge sur les causes du phénomène381(*) et ne fait pas de recommandation spécifique.
3. Améliorer le mode de garde des enfants, pour majorer les recettes d'un milliard d'euros ?
Le taux d'emploi des femmes était en France en 2020 de 62,2 %, soit analogue à la moyenne européenne (62,4 %). L'anomalie du taux d'emploi en France concerne les hommes, dont le taux d'emploi, de 68,5 %, était nettement inférieur à la moyenne européenne (72,9 %).
Il n'en demeure pas moins que certains parents, essentiellement des femmes, voudraient travailler mais en sont empêchés par des capacités de garde insuffisantes.
Selon le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), environ 160 000 parents d'enfants de moins de trois ans demandeurs d'emploi (le plus souvent des femmes) seraient empêchés de travailler faute de solution d'accueil. Le HCFEA évalue à 1 milliard d'euros les cotisations sociales supplémentaires qui résulteraient de leur emploi382(*).
4. Augmenter la durée annuelle du travail des personnes ayant un emploi ?
Il est parfois proposé d'augmenter la durée annuelle du travail des personnes ayant un emploi.
Cet objectif n'est pas consensuel. En particulier, le Conseil d'analyse économique considère que, l'anomalie française par rapport aux autres pays européens concernant le taux d'emploi, et non la durée du travail des personnes ayant un emploi (cf. supra), c'est sur ce premier facteur qu'il convient d'agir383(*). L'augmentation de la durée du travail des personnes ayant un emploi a toutefois comme caractéristique de pouvoir être aisément et rapidement mise en oeuvre384(*).
a) Une augmentation du nombre d'heures travaillées d'une ou deux journées, sans rémunération supplémentaire mais avec une mesure sur les recettes augmentant les prélèvements sur l'employeur ?
(1) La « journée de solidarité » actuelle
Actuellement, les employeurs versent à l'État la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), instaurée par la loi du 30 juin 2004385(*) et dont le produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui assure, depuis 2021, la gestion de la branche autonomie. Elle est assise sur la masse salariale, au taux de 0,3 %.
Cette taxe repose sur une « journée de solidarité » instaurée par cette même loi, sous la forme d'une journée de travail supplémentaire de sept heures, non rémunérée et correspondant à une augmentation de la durée légale du travail d'environ 0,4 %386(*).
(2) Le projet de « contribution de solidarité par le travail » défendu par la majorité sénatoriale lors de l'examen du PLFSS pour 2025
Lors de l'examen du PLFSS pour 2025, le Sénat a adopté en première lecture un article augmentant de sept heures supplémentaires (soit également 0,4 % environ) la durée annuelle de travail, dans le cadre d'une « contribution de solidarité par le travail », et portant en conséquence de 0,3 % à 0,6 % le taux de la CSA.
Comme la journée de solidarité actuelle, la mesure aurait rapporté 2,5 milliards d'euros à la sécurité sociale.
Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, conformément aux conclusions de la commission mixte paritaire (CMP).
b) Une augmentation du nombre d'heures travaillées rémunérées et sans mesure sur les recettes ?
Une autre possibilité serait d'augmenter le nombre d'heures travaillées tout en les rémunérant normalement, et sans mesure en contrepartie sur les recettes augmentant les prélèvements sur l'employeur.
Le gain pour les finances publiques (et en particulier pour les finances sociales) viendrait alors du supplément de recettes résultant de l'activité économique supplémentaire.
Les rapporteures ont demandé à la direction générale du Trésor d'évaluer l'impact d'une telle mesure sur les finances publiques. Celle-ci n'a fourni aucun chiffrage387(*).
(1) Instaurer une ou plusieurs journées de travail supplémentaires ?
Une variante du projet de « contribution de solidarité par le travail » consisterait à instaurer une ou plusieurs journées de travail supplémentaires normalement rémunérées, sans augmentation des prélèvements obligatoires.
L'amélioration des finances publiques viendrait alors exclusivement de l'augmentation du PIB. Les recettes supplémentaires de l'État pourraient le cas échéant être réorientées vers la sécurité sociale via une augmentation de la part de TVA affectée à celle-ci.
Une telle augmentation du nombre de jours ouvrables ne peut être assimilée à l'effet ponctuel d'une augmentation équivalente résultant des fluctuations calendaires une année donnée, dont l'effet est négligeable388(*), du fait de divers phénomènes389(*). Un calcul simple suggère que si chaque personne ayant un emploi travaillait une journée de plus, le solde des administrations publiques pourrait être amélioré de 6 milliards d'euros et celui de la sécurité sociale de 2,5 milliards d'euros390(*).
Toutefois cela suppose que le PIB soit égal à son nouveau potentiel. Tant que celui-ci ne serait pas atteint, la mesure pourrait détruire des emplois (une production donnée pouvant être réalisée avec moins d'effectifs) et aggraver le déficit public. Cette période de transition pourrait être réduite si la mesure était adoptée en période de conjoncture favorable.
(2) Augmenter la durée de travail hebdomadaire ?
Une augmentation de la durée hebdomadaire du travail a pu être évoquée par le patronat ou des membres du Gouvernement démissionnaire.
Par exemple, Gérald Darmanin a proposé en octobre 2025 de supprimer les 35 heures dans le privé et de passer aux 36 ou 37 heures dans le public391(*). La CPME a quant à elle proposé en mars 2025 d'augmenter la durée hebdomadaire du travail d'une heure, la rémunération correspondante étant utilisée pour abonder un dispositif de retraite par capitalisation392(*).
La conception et le chiffrage d'une telle mesure dépassant le champ du présent rapport, les commentaires qui suivent sont purement exploratoires.
Une première question est celle des moyens juridiques à utiliser pour augmenter le temps de travail hebdomadaire de, par exemple, une heure en moyenne (soit environ 3 %). Compte tenu du temps de travail respectif des cadres et des non-cadres (respectivement 39 heures environ et un peu plus de 35 heures393(*)), une augmentation de la durée légale du travail risquerait d'avoir peu d'effet sur les premiers (qui représentent environ 20 % de la population active). Par ailleurs, la durée légale du travail pourrait devoir être fixée à plus de 36 heures pour avoir l'effet recherché. Des dispositions spécifiques pourraient en outre être nécessaires dans le cas des non-salariés.
Une seconde question est celle de l'effet sur le PIB et le solde public d'une augmentation de 3 % de la durée du travail des personnes en emploi. Si on suppose que le PIB est également accru de 3 %394(*), le solde public s'en trouve amélioré d'environ 1,5 point de PIB, soit 45 milliards d'euros, dont 20 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Mais si on suppose que le PIB est accru de seulement 1,5 %, du fait par exemple de contraintes de production395(*) ou d'un « effet fatigue »396(*), ces montants doivent être divisés par deux. On peut rappeler à cet égard que selon des simulations réalisées en 2007 par l'OFCE397(*), une augmentation de 0,8 % de la durée du travail augmenterait le PIB de seulement 0,5 % au bout de dix ans.
Un scénario où l'augmentation de la durée annuelle du travail ne se retrouverait pas intégralement dans le PIB est d'autant plus probable que la durée annuelle du travail et la productivité du travail sont fortement corrélées.
Heures travaillées et productivité
du travail :
moyennes nationales sur quatre
sous-périodes
Source : Gilbert Cette, Simon Drapala, Jimmy Lopez, A circular relationship between productivity and hours worked, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 29 mars 2024
Par ailleurs, comme dans le cas de l'augmentation du nombre de journées de travail, si la mesure était mise en oeuvre en période de conjoncture défavorable, elle pourrait dans un premier temps détruire des emplois (une production donnée pouvant être réalisée avec moins d'effectifs) et aggraver le déficit public398(*).
5. Augmenter la quantité de travail par la transition énergétique ?
La France pourrait augmenter son PIB et ses emplois, et donc améliorer ses finances publiques, en investissant et en consommant davantage. Le sujet dépasse largement le cadre de ce rapport. À titre d'illustration, on présente ci-après le cas de la transition énergétique.
Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, en 2050 la mise en oeuvre de la stratégie nationale bas carbone majorerait le PIB de près de quatre points et créerait autour de 800 000 emplois. Le supplément de croissance proviendrait essentiellement de l'investissement (en particulier dans le bâtiment et les travaux publics).
Le solde des administrations publiques serait quant à lui amélioré de 3,8 points de PIB selon le modèle de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et dégradé de 0,2 point selon celui du Cired (Centre international de recherche sur l'environnement et le développement). Il faut toutefois préciser que dans ce dernier cas, la modélisation repose sur l'hypothèse que l'accroissement des recettes publiques liées à la hausse de l'activité servirait à financer des dépenses supplémentaires ; sans cela, le déficit public serait réduit, au prix de gains de PIB moins soutenus.
Impact en 2050 de la stratégie
nationale bas carbone,
selon le ministère de la transition
écologique et solidaire
|
Modèle ThreeME (Ademe-CGDD) |
Modèle Imaclim (Cired) |
|
|
Impact sur le PIB (en points) |
3,8 |
3,7 |
|
Impact sur l'emploi (en postes) |
878 000 |
694 000 |
|
Impact sur le solde public (en points de PIB) |
3,8 |
- 0,2* |
Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; CGDD : Commissariat général au développement durable ; Cired : Centre international de recherche sur l'environnement et le développement ; Imaclim : Impact Assessment of CLIMate policies (Evaluation de l'impact des politiques climatiques) ; ThreeME : Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy (modèle macroéconomique muti-sectoriel pour l'évaluation de la politique environnementale et de l'énergie).
* Selon le rapport du ministère de la transition écologique et solidaire, « la hausse de la consommation publique liée à l'utilisation des recettes fiscales supplémentaires soutiendrait le PIB (à hauteur de 0,6 points en 2030 et de 2 points en 2050). Cela n'augmenterait pas le déficit public à long terme (moins de 0,2 point de PIB supplémentaires), en raison de l'accroissement des recettes publiques liées à la hausse de l'activité. Une règle alternative de gestion du budget public sans augmentation de la consommation publique (similaire au modèle ThreeME) permettrait de réduire le déficit public au prix de gains de PIB moins soutenus ».
Source : D'après Ministère de la transition écologique et solidaire, Stratégie nationale bas-carbone - rapport d'accompagnement, mars 2020
Dans le cas des finances publiques, on considère habituellement qu'une augmentation du PIB de 1 point réduit le déficit de 0,5 point de PIB. Cela suggérerait, toutes choses égales par ailleurs, une amélioration du solde public d'environ 2 points de PIB, intermédiaire entre les deux modélisations.
Ces simulations n'isolent pas l'effet sur les finances sociales. On peut estimer, en première analyse, qu'une augmentation du PIB d'un peu moins de 4 points de PIB en 2050 améliorerait à cette échéance le solde de la sécurité sociale d'environ 0,8 point de PIB, et le ramènerait donc à l'équilibre (le déficit actuel, de plus de 20 milliards d'euros, correspondant à environ 0,7 point de PIB).
Ces simulations doivent bien entendu être considérées avec prudence. Elles indiquent concrètement que la transition énergétique pourrait avoir pour effet d'augmenter la croissance du PIB d'environ 0,1 point par an d'ici 2050. L'augmentation du PIB pourrait toutefois être significativement inférieure, du fait par exemple de tensions sur les capacités de production399(*), de la difficulté d'adaptation de certains secteurs400(*) ou d'un reste du monde ne menant pas des politiques compatibles avec un réchauffement global limité à 2°C401(*).
6. Améliorer la qualité de l'emploi et les conditions de travail ?
Une augmentation de la quantité de travail serait favorisée par une amélioration de la qualité de l'emploi et des conditions de travail.
Les Français font partie des Européens les plus nombreux à déclarer que le travail est très ou plutôt important, comme le montre le graphique ci-après.
Proportion de personnes indiquant que le travail est très ou plutôt important dans leur vie, dans l'enquête sur les valeurs européennes de 2017
Source : European Values Study, Atlas of European Values
Par ailleurs, les conditions de travail semblent plutôt moins bonnes en France qu'ailleurs en Europe, comme le montre le tableau ci-après. Ainsi, selon Maëlezig Bigi et Dominique Méda, « la principale explication du paradoxe français concerne les conditions de travail. La France est un des pays où le fossé entre les très fortes attentes placées sur le travail et la réalité des conditions d'exercice du travail est le plus grand. Des attentes peut-être trop élevées viennent en quelque sorte se fracasser sur la réalité du travail »402(*).
« À quelle fréquence votre emploi rémunéré implique-t-il toujours ou souvent : » (enquête Eurofound, vague 2021)
Source : Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024
De fait, la France paraît singulièrement peu performante en matière de qualité du travail, en particulier pour ce qui concerne les risques physiques (ergonomie et risques biochimiques) et la qualité de l'environnement de travail, comme le montre le tableau ci-après.
Écart à la moyenne européenne
des indicateurs de qualité de l'emploi
et du travail
Source : Christine Erhel, Mathilde Guergoat Larivière, Malo Mofakhami, La qualité de l'emploi et du travail en comparaison européenne : une contre-performance française ?, 11 septembre 2024
La dernière enquête de la Dares sur les conditions de travail en France date de 2016 (une actualisation étant actuellement en cours). Les principales évolutions sont synthétisées par les graphiques ci-après.
Principales évolutions des conditions de travail en France (1984-2016)
(en % des salariés indiquant
satisfaire
le critère concerné)
|
* Parmi cinq contraintes : rester longtemps debout, rester longtemps dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations. |
Source : D'après Marilyne Beque, Amélie Mauroux, Eva Baradji, Céline Dennevault, « Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ? », Dares analyses, décembre 2017, n° 082
Les contraintes et risques physiques, plus importants en France que chez ses principaux partenaires européens, sont stables depuis la fin des années 1990. Dans les autres domaines, pour lesquels la situation de la France n'est que légèrement moins favorable, le phénomène le plus marquant depuis les années 1980 est l'augmentation de l'intensité du travail et de la pression temporelle. Les évolutions relatives à l'autonomie et aux marges de manoeuvre ont été contrastées, avec par exemple une augmentation des tâches répétitives mais une plus grande liberté vis-à-vis des consignes.
Les causes de ces moins bonnes conditions de travail ne sont pas absolument évidentes, et sortent du champ de ce rapport. Une moindre autonomie des salariés et une moindre présence des syndicats ont pu être évoquées403(*). Il y a probablement un chantier à ouvrir si l'on souhaite favoriser l'augmentation de la quantité de travail en France.
B. FAUT-IL REMPLACER UNE PARTIE DES COTISATIONS PATRONALES PAR DE LA TVA ?
1. La « TVA sociale »
La TVA sociale a été préconisée en particulier dans les années 2000 par Jean Arthuis, alors président de la commission des finances du Sénat404(*).
L'expression « TVA sociale » désigne le remplacement de cotisations patronales par de la TVA, considérée comme une manière d'améliorer la compétitivité en taxant les importations et de favoriser l'emploi en réduisant le coût du travail405(*).
Une mesure de type « TVA sociale » a été prise dans le cadre de la loi de finances pour 2012, mais elle a été abrogée avant son application par la nouvelle majorité.
Pour mémoire, en 2024 la TVA représentait déjà 7,9 % des produits de la sécurité sociale406(*). La TVA sociale existe donc déjà en pratique, d'autant plus qu'elle sert notamment à compenser le bandeau famille (non dégressif) à la sécurité sociale.
2. Une mesure dont l'opportunité est discutée
Il n'y a pas de consensus sur l'intérêt d'une mesure de type « TVA sociale ». En particulier, le Conseil des prélèvements obligatoires la juge non opportune407(*).
Un argument souvent mis en avant par les partisans de la TVA sociale est que la TVA est payée sur tous les produits, importés ou non, alors que les cotisations patronales ne reposent que sur la production réalisée en France. Toutefois il n'est pas évident qu'une baisse uniforme de cotisations patronales améliore significativement la compétitivité408(*). Par ailleurs, la hausse de prix résultant de la hausse de TVA peut se répercuter dans les salaires.
La TVA représente une part d'autant plus importante du revenu des ménages que celui-ci est faible, comme cela a été souligné, notamment, par le Conseil des prélèvements obligatoires409(*) et par divers économistes410(*). Cet effet antiredistributif est fréquemment mis en avant par les opposants à la TVA sociale.
La TVA sociale est également présentée comme un outil de la politique de l'emploi. Cependant, comme pour le CICE (devenu ensuite bandeau maladie), elle réduit le coût du travail de manière uniforme, alors que ce sont les bas salaires dont l'emploi dépend fortement du coût. Par ailleurs, l'effet sur l'emploi d'une baisse du coût du travail varie selon les modèles.
Ainsi, les simulations de l'effet sur le PIB et sur le solde public sont contrastées.
Selon des simulations de la direction générale du Trésor, un mécanisme de TVA sociale pour un point de PIB réduit au début très légèrement le PIB, puis finit à long terme par majorer celui-ci d'un point, ce qui a comme conséquence logique d'améliorer le solde public de 0,5 point411(*). L'effet sur le PIB vient du fait que si la hausse de TVA réduirait le PIB de moins d'un point, la baisse de cotisations employeurs l'augmenterait de près de 2 points, du fait d'une diminution du taux de chômage structurel412(*).
D'autres simulations, moins favorables à la TVA sociale, existent. Ainsi, selon l'OFCE, la baisse des cotisations et la hausse de la TVA auraient un effet quasiment identique, de sens contraire. Il en découlerait un effet très légèrement négatif sur le PIB comme sur le solde public.
Impact de la TVA sociale (1 point de PIB) sur le PIB et le solde public primaire
(en points de PIB)
Source : D'après des données transmises par le HCFiPS
C. FAUT-IL AUGMENTER LES RECETTES POUR RESTER À L'ÉQUILIBRE ?
La question des mesures d'augmentation des prélèvements obligatoires a été examinée dans la deuxième partie du présent rapport.
De telles mesures sont plus faciles à justifier dans un contexte de réduction du déficit, en particulier quand celui-ci découle largement de dépenses non financées, que dans un contexte de maintien sur la durée du solde à l'équilibre.
On peut toutefois observer que, selon la Cnam413(*), ses recettes tendent spontanément à diminuer de 0,5 milliard d'euros par an du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac. Des mesures régulières de hausse des prélèvements obligatoires pourraient avoir pour objet de compenser ce phénomène.
Des mesures sur les recettes pourraient en outre être rendues nécessaires si le partage de la valeur ajoutée devenait moins favorable aux salariés. En effet, les cotisations sociales sont assises sur les salaires. En sens inverse, une plus grande égalité salariale entre les femmes et les hommes pourrait susciter des recettes supplémentaires.
Quel impact pour la sécurité sociale
d'un alignement de la rémunération
des femmes sur celle des
hommes ?
Selon l'Insee414(*), en 2023, dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes a été inférieur à celui des hommes de de 22,2 %, du fait notamment d'un moindre volume de travail annuel (résultant en particulier d'un recours plus important au temps partiel) et du fait que les femmes n'occupent pas les mêmes emplois et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Cet écart est ramené à 14,2 % à temps de travail identique et à 3,8 % pour un même travail exercé dans le même établissement.
Une réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes pourrait susciter des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. Dans le cas de la seule branche vieillesse, un montant de 18 milliards d'euros à l'horizon 2050 a pu être évoqué415(*).
Toutefois le chiffrage de l'effet sur les recettes de la sécurité sociale d'un alignement de la rémunération des femmes sur celle des hommes est complexe. En particulier, cet effet dépend des modalités de cet alignement. Dans un scénario extrême, une répartition différente des emplois et du temps partiel entre les femmes et les hommes pourrait résorber l'essentiel de l'écart, sans ressources supplémentaires pour la sécurité sociale.
À titre d'illustration, toutes choses égales par ailleurs, et d'un point de vue purement comptable416(*), augmenter la rémunération des femmes de 5 % augmenterait les recettes de la sécurité sociale d'un peu moins de la moitié de ce taux, soit environ 15 milliards d'euros. Au bout d'une cinquantaine d'années, environ la moitié de l'augmentation des recettes serait compensée par celle des pensions de retraite.
IV. MIEUX DISTINGUER PRESTATIONS CONTRIBUTIVES (FINANCÉES PAR LES COTISATIONS) ET PRESTATIONS UNIVERSELLES (FINANCÉS PAR L'IMPÔT) ?
Pour les partenaires sociaux ayant participé aux travaux de la délégation paritaire permanente sur les retraites417(*), il semble exister un certain accord sur l'idée que le faible lien entre la nature contributive ou non d'une branche et le type de recettes assurant son financement aurait rendu le financement de la sécurité sociale illisible, affaiblissant le consentement au prélèvement social418(*).
Cette idée n'est pas consensuelle. En particulier, selon une récente étude419(*) exploitant le baromètre d'opinion de la Drees, il n'y aurait pas de « révolte des cotisants ». Par ailleurs, on peut se demander si le financement par des impôts souvent progressifs des branches non contributives ne risquerait pas d'amener les contribuables aux revenus les plus élevés à demander la désocialisation de certaines dépenses.
A. LE MONTANT DES PRESTATIONS CONTRIBUTIVES CORRESPOND À PEU PRÈS AU MONTANT DES COTISATIONS SOCIALES : UNE OCCASION HISTORIQUE ?
Selon la Drees, « une prestation est dite contributive si elle est versée en contrepartie de cotisations. Par exemple, les pensions de retraite sont versées en contrepartie des cotisations vieillesse payées durant la carrière. Une prestation est non contributive lorsqu'elle ne nécessite pas d'avoir cotisé pour être perçue (comme le RSA) »420(*).
Les prestations non contributives sont donc les prestations universelles. Il peut s'agir de prestations de solidarité (comme les minima sociaux, dont certains sont financés par la sécurité sociale421(*)), mais ce n'est pas nécessairement le cas (comme dans le cas de la quasi-totalité des prestations maladie).
Certes, aucune branche n'est totalement contributive ou totalement non contributive422(*). Il apparaît toutefois que le montant des cotisations sociales correspond actuellement à peu près à celui des prestations contributives, correspondant en quasi-totalité à la branche vieillesse, comme le montre le tableau ci-après.
Comparaison des montants des cotisations
sociales
et des prestations contributives (2024)
(en millions d'euros)
|
Charges nettes |
Produits nets |
||||||
|
Contributif |
Universel |
Total |
Cotisations sociales brutes |
Contributions, impôts et taxes* |
Autres |
Total |
|
|
Vieillesse |
294 054 |
294 054 |
165 675 |
48 679 |
74 050** |
288 404 |
|
|
Maladie |
253 642 |
253 642 |
87 514 |
128 917 |
22 478 |
238 909 |
|
|
Famille |
57 913 |
57 913 |
36 014 |
20 337 |
1 849 |
58 200 |
|
|
AT-MP |
15 974 |
15 974 |
15 630 |
350 |
707 |
16 687 |
|
|
Autonomie |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 633 |
297 |
40 930 |
|
|
Total consolidé (y.c. FSV) |
310 028 |
351 555 |
643 379 |
302 792 |
238 076 |
84 057 |
624 925 |
* « Impositions de toutes natures » au sens du droit constitutionnel.
** Dont contribution d'équilibre de l'employeur (48 837 millions d'euros). Dans le cas du régime de la fonction publique d'État (48 307 millions d'euros), l'essentiel de cette contribution peut être assimilé à une cotisation « fictive » de l'employeur.
Source : Mecss du Sénat, d'après le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d'octobre 2024
Ainsi, selon le « rapport Bozio-Wasmer » d'octobre 2024423(*), « le constat actuel est, qu'au niveau agrégé, on n'est plus très loin d'une parité entre les masses des cotisations sociales et les prestations contributives. Ainsi, en 2021 approximativement 50 % de la dépense de protection sociale peut être classée en prestations contributives, contre 54 % du financement apparaissant sous la forme de cotisations sociales ».
Part des cotisations sociales et des prestations contributives dans les recettes et dépenses de la protection sociale (1959-2021), selon le « rapport Bozio-Wasmer »
Lecture : en bleu foncé est indiquée la part dans les recettes de la protection sociale des cotisations sociales, en vert clair la part des prestations contributives (retraite, chômage, accidents du travail) en pourcentage des dépenses.
Source : Antoine Bozio, Étienne Wasmer, Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 octobre 2024
Il s'agit d'un simple constat arithmétique.
B. PLUSIEURS SCÉNARIOS SONT ENVISAGEABLES
1. Un scénario envisageable à court terme : répartir différemment cotisations et impositions de toutes natures pour que les premières financent davantage la branche vieillesse
a) Les propositions du HCFiPS en 2013 consistaient essentiellement à effectuer le transfert de cotisations depuis la branche famille
Dans un rapport424(*) de 2013 commandé par le Premier ministre, le HCFiPS propose trois scénarios425(*) tendant à répartir différemment les cotisations et les prélèvements de toutes natures, de manière à ce qu'ils financent davantage, respectivement, des mesures contributives ou universelles :
- le scénario n° 1 « échange » 11,9 milliards d'euros d'impôts de la branche vieillesse et de cotisations de la branche famille ;
- le scénario n° 2 « échange » également 11,9 milliards d'euros d'impôts de la branche vieillesse et de cotisations patronales de la branche famille, tout en réaffectant différemment les contributions et impôts entre les branches famille et maladie ;
- le scénario n° 3 « échange » quant à lui 20 milliards d'euros de CSG de la branche famille et 20 milliards d'euros de cotisations patronales de la branche vieillesse.
Ces scénarios tendent essentiellement à rééquilibrer les cotisations et les autres prélèvements entre les branches famille et vieillesse, sans chercher à concentrer toutes les contributions au niveau des branches vieillesse état-MP.
Comme le souligne le HCFiPS, ces scénarios impliquaient de surmonter certaines difficultés. En particulier, certains régimes de retraites ne disposaient pas de ressources fiscales suffisantes pour compenser le transfert de cotisations depuis la branche famille. Toutefois ces difficultés ne semblaient pas insurmontables.
b) Une proposition « maximaliste » : transférer la totalité des cotisations vers la branche vieillesse
Un scénario plus ambitieux consisterait à concentrer toutes les cotisations au niveau de la branche vieillesse.
En chiffres arrondis, les dépenses contributives et les cotisations sociales sont d'environ 300 milliards d'euros, ce qui correspond également aux recettes de la branche vieillesse (correspondant pour un peu plus de la moitié à des cotisations).
Un consentement plus faible pour l'impôt que pour les cotisations sociales pourrait toutefois fragiliser les autres branches.
2. Une possibilité à plus long terme : remplacer la distinction cotisations patronales/cotisations salarié par une distinction prélèvement fiscal progressif/prélèvement contributif
a) Une proposition du « rapport Bozio-Wasmer »
Le « rapport Bozio-Wasmer » propose non seulement de financer totalement la branche vieillesse par des cotisations, mais aussi de remplacer la distinction cotisations patronales/cotisations salarié par une distinction cotisations non progressives (finançant des prestations contributives)/ prélèvement fiscal progressif (finançant des prestations non contributives).
Cette mesure, déjà proposée en 2017 par une note du Trésor426(*), implique de remplacer l'actuel salaire brut, servant de base au calcul des cotisations patronales et salariales, par un salaire « complet » (salaire brut et cotisations contributives), servant de base de calcul aux différents prélèvements.
Si l'on se contentait de transférer à la branche vieillesse la totalité des cotisations, sans prendre de telle mesure, les cotisations apparaîtraient comme finançant la retraite (et le cas échéant la branche AT-MP). Pourtant, bien que les dépenses de retraite soient en quasi-totalité contributives, ce n'est pas le cas pour le minimum vieillesse. Par ailleurs, cela ne permettrait pas de flécher les cotisations vers les autres prestations contributives (indemnités journalières, pensions d'invalidité).
La mesure préconisée par le « rapport Bozio-Wasmer » permettrait en revanche de faire apparaître clairement tout cela sur la fiche de paie, permettant au salarié de mieux comprendre à quoi servent les différents prélèvements.
b) Une mesure non consensuelle
Comme le « rapport Bozio-Wasmer » le souligne, une telle réforme serait techniquement très complexe à mettre en oeuvre. En particulier, le remplacement des divers allégements de cotisations patronales (allégements généraux, régimes en faveur de la ville, des zones rurales, de l'outre-mer...) par un prélèvement fiscal progressif impliquerait d'harmoniser les nombreux régimes actuels, ce qui serait complexe techniquement427(*) et politiquement.
Plus fondamentalement, si la mesure serait neutre d'un point de vue comptable et économique, elle aurait pour effet de remplacer juridiquement un prélèvement sur l'employeur par un prélèvement sur le salarié, ce dont le principe pourrait être contesté.
Il faudrait également vérifier la compatibilité d'une telle mesure avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel428(*).
On peut en outre s'interroger sur la manière dont évoluerait, sur la durée, le consentement à l'impôt des assurés aux revenus les plus élevés, qui contribueraient le plus au titre de l'impôt progressif. Le financement des branches non contributrices par ce seul impôt pourrait affaiblir celles-ci.
EXAMEN PAR LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Réunie le mardi 1er juillet 2025, sous la présidence de M. Alain Milon, président, la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale examine le rapport d'information de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteures de la mission d'information sur le financement de la protection sociale.
M. Alain Milon, président. - Nous nous réunissons cet après-midi pour examiner le projet de rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) sur le financement de la sécurité sociale, travail confié le 5 janvier dernier à Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et à Raymonde Poncet Monge.
C'est la première fois que la Mecss examine elle-même un de ses projets de rapport. Comme vous le savez, en vertu de son règlement intérieur, cette mission n'adopte pas elle-même ses rapports : le soin en revient à la commission des affaires sociales. Il s'agit d'éviter la tenue, à quelques jours d'intervalle, de deux réunions portant sur le même sujet et rassemblant à peu près les mêmes personnes. Toutefois, sans examen par la Mecss, il est difficile de parler d'un rapport de la Mecss.
Comme je l'ai souligné le 9 octobre 2024, lors de l'examen par la commission du rapport de Marie-Pierre Richer et Annie Le Houérou sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), il me semble que la Mecss devrait examiner ses rapports préalablement à leur adoption par la commission.
Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales, a déclaré à cette occasion : « Cela ne me choquerait pas que la Mecss se prononce, de façon informelle, si elle le souhaite, avant l'examen formel du rapport d'information par la commission des affaires sociales ».
Nous sommes donc convenus, lors de la réunion de la Mecss du 17 décembre 2024, de procéder désormais ainsi. Nous verrons à l'usage s'il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur de la Mecss, ce qui ne peut être fait que par la commission.
Dans le cas présent, j'attire votre attention sur le fait que, si la Mecss examine bien ce rapport aujourd'hui, la commission ne l'examinera pas demain, comme c'était initialement prévu, mais en septembre prochain. En effet, comme Mmes les rapporteures nous l'expliqueront, ce travail est d'une nature un peu particulière : il s'agit d'une « boîte à outils », qui a vocation à présenter la totalité, ou presque, des mesures envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre, sans prendre parti pour ou contre aucune d'elles.
Ce rapport détaille ainsi les différents éléments de cadrage, ainsi que les objectifs à atteindre et les règles de gouvernance, qui font l'objet de ce que Mmes Doineau et Poncet Monge ont décidé d'appeler « points d'accord entre rapporteures ».
Le recours à cette expression, plutôt qu'au terme habituel de « propositions », a pour but d'éviter toute ambiguïté sur le fait que le rapport ne privilégie ni ne rejette aucune mesure en particulier. Par exemple, il est préconisé d'adopter rapidement une trajectoire crédible de retour à l'équilibre et de réaliser un nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).
Ces « points d'accord entre rapporteures » ayant un contenu politique - ce sont de fait des propositions, même si le terme n'est pas utilisé -, nous devons les examiner aujourd'hui.
Les « outils » sont les mesures concrètes que l'on peut prendre pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Mmes les rapporteures nous les présenteront seulement à grands traits, en raison de leur grand nombre - il y en a plus d'une centaine - et parce que le rapport ne prend pas position à leur sujet.
L'objectif est de nous doter, avant la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), d'une « boîte à outils » aussi complète que possible. Cela implique notamment de prendre en compte les mesures proposées par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) dans son Rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'assurance maladie au titre de 2026, dit rapport Charges et produits, publié la semaine dernière, et celles qui figureront dans le rapport commandé par M. le Premier ministre aux trois hauts conseils - le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) -, lequel devrait être bientôt publié.
C'est pour opérer ces ajustements que Mmes les rapporteures ont besoin d'un délai supplémentaire. Mais les orientations politiques ne changeront pas par rapport à celles que nous adopterons aujourd'hui.
Il nous a semblé préférable de maintenir l'examen du rapport prévu aujourd'hui, tout d'abord pour que vous soyez informés en temps réel de l'avancée des travaux, ensuite pour éviter un encombrement de notre calendrier en septembre prochain. Bien entendu, si le rapport était substantiellement modifié cet été, il devrait être réexaminé par la Mecss.
Je vous rappelle enfin que la commission se réunit à seize heures dans la salle Clemenceau pour une table ronde sur les expériences étrangères de soins palliatifs et d'aide à mourir. Nous devrons donc avoir achevé nos travaux un peu avant.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Monsieur le président, avant tout, je tiens à vous remercier de votre confiance.
Au cours de ce travail de longue haleine, nous avons veillé à entendre en audition le maximum de personnalités, représentants d'institutions, économistes ou encore responsables de caisses. Mais l'actualité récente a été particulièrement chargée ; elle a été notamment marquée par les travaux du Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie et par la publication du rapport de la Cnam. Nous devons évidemment en tenir compte.
J'ai été heureuse de travailler avec Raymonde Poncet Monge, qui, forte de son expertise d'économiste, a su poser les bonnes questions. Je n'oublie pas non plus les fonctionnaires de la commission, dont le concours a été précieux.
Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteure. - Notre rapport est conçu comme une boîte à outils. Nous n'y préconisons ou n'y rejetons aucune mesure a priori, qu'il s'agisse des dépenses, des recettes ou des moyens d'augmenter le PIB. En revanche, nous préconisons certaines orientations relatives à la gouvernance. Ces mesures devraient, à mon sens, recueillir le consensus au sein de la commission. Il s'agit de ce que nous nommons les « points d'accord entre rapporteures ».
Bien sûr, ce travail n'empiète pas sur les prérogatives des rapporteurs de branche, lesquels restent totalement maîtres d'apprécier ce qu'il convient de faire ou non.
Nous nous sommes efforcées de constituer une boîte à outils aussi fournie que possible. En annexe, un tableau d'une quinzaine de pages synthétisera et chiffrera les principales propositions qui ont pu être avancées dans le cadre du débat public. On y trouve par exemple la valeur d'un point d'augmentation de tel ou tel taux de contribution sociale généralisée (CSG), ou encore l'impact d'un écart d'un an de l'âge d'ouverture des droits à la retraite.
Nous sommes tous pour ou contre telle ou telle mesure, et c'est bien normal. Additionnées, ces diverses dispositions s'élèvent à une centaine de milliards d'euros : il ne s'agit évidemment pas de toutes les mettre en oeuvre.
La Mecss nous a semblé l'instance le mieux à même d'élaborer un tel rapport. Il ne s'agit certes pas d'un travail d'évaluation, mais l'approche technique retenue est celle qu'adoptent habituellement les rapports de la Mecss.
Conformément aux compétences de la Mecss, ce rapport se limite au champ de la sécurité sociale, à savoir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss) et le fonds de solidarité vieillesse (FSV), et des organismes concourant à son financement, à savoir la Cades et le fonds de réserve pour les retraites (FRR). Se trouvent hors du champ du rapport les régimes complémentaires de retraite, l'assurance chômage, les complémentaires santé et la plupart des minima sociaux.
Comme l'ont demandé les membres de la Mecss le 17 décembre 2024, notre rapport examine non seulement les recettes, mais aussi les dépenses, et leur effet sur le solde.
Les projections à long terme du rapport portent sur le périmètre de la sécurité sociale. Toutefois, compte tenu notamment des sommes en jeu, notre analyse se concentre essentiellement sur les branches vieillesse, maladie et autonomie. Elle s'inscrit, en outre, dans une perspective de réduction du déficit des administrations publiques : nous n'examinons pas les manières de réduire le déficit de la sécurité sociale en augmentant celui de l'État, nonobstant la compensation insuffisante des exonérations sociales.
Dans le domaine des finances sociales, le calendrier de ce mois de juillet est déjà chargé. C'est pourquoi, comme l'indiquait M. le président, nous allons décaler la publication du rapport à l'automne. Nous disposerons ainsi, à la veille de l'examen du PLFSS, de la liste de mesures le plus à jour possible. De surcroît, nous éviterons d'éventuelles interférences avec les prises de position politiques qui auront lieu au cours de ce mois.
(Mme la rapporteure projette une présentation PowerPoint en complément de son propos.)
Quand on évoque la situation financière de la sécurité sociale, avant de parler du déficit, il faut aborder le montant des dépenses.
Du fait de son modèle social, la France consent les dépenses publiques de protection sociale les plus élevées du monde en points de PIB : il s'agit là d'un lieu commun. Mais ce constat est moins vrai si l'on exprime ces dépenses en euros par habitant ; notre pays figure alors en sixième position, derrière le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, l'Autriche et la Belgique. Ainsi, au Danemark en 2019, les dépenses publiques de protection sociale étaient d'environ 17 000 euros par habitant, contre 15 000 euros en France.
Le PIB français par habitant est en effet dans la médiane de l'OCDE. C'est ce qui a fait dire au président du Conseil d'orientation des retraites (COR), lors de son audition, que « la France est pauvre parmi les riches ».
On peut interpréter ce fait de diverses manières, selon sa sensibilité politique. On peut estimer qu'il est faux que la France ait des dépenses sociales trop généreuses. À l'inverse, on peut considérer que la France « vit au-dessus de ses moyens ».
Dans le cas des recettes, on observe, pour ce qui concerne notre pays, une situation de fausse normalité. Notre sécurité sociale est financée pour près de la moitié par des prélèvements sur le travail, ce qui en soi n'a rien d'extraordinaire : il en est de même dans les autres pays de l'OCDE. Ce qui distingue la France, c'est le fait que, en raison de ses dépenses sociales très élevées en points de PIB - d'où des recettes sociales très élevées également -, elle a instauré des allégements généraux sur les bas salaires dans le cadre de sa politique de l'emploi.
Cela étant, l'actualité est bien sûr marquée par le déficit de la sécurité sociale. Ce déficit atteint actuellement un niveau sans précédent hors période de crise, et, à politiques inchangées, il augmenterait encore d'ici à 2029, pour approcher 25 milliards d'euros.
Il est intéressant de comprendre comment on est passé d'un quasi-équilibre en 2019 à un déficit de 15 milliards d'euros en 2024.
Tout d'abord, l'évolution du solde conjoncturel a contribué à l'aggravation du déficit pour près de 13 milliards d'euros. Concrètement, si l'on s'appuie sur l'estimation du PIB potentiel fournie par la Commission européenne, on observe qu'en 2019 le PIB de la France était supérieur d'environ 2 % à son niveau potentiel. En résultaient des recettes supplémentaires qui amélioraient temporairement le solde de plus de 10 milliards d'euros.
On relève ainsi un fait dont on n'a pas toujours conscience : en 2019, année souvent citée comme référence, la sécurité sociale souffrait en réalité d'un déficit structurel de plus de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, le PIB est un peu inférieur à son niveau potentiel. C'est pour cela que, par rapport à 2019, la conjoncture dégrade le solde de 13 milliards d'euros.
Le second facteur d'aggravation du déficit, de près de 20 milliards d'euros, correspond à l'aggravation du déficit causée par un taux de croissance des dépenses supérieur à celui du PIB potentiel. Cette somme correspond à peu près aux montants cumulés du Ségur de la santé et des mesures de compensation de l'inflation, prises pour faire face à la crise sanitaire, mais aussi parce que la politique de maîtrise de la masse salariale hospitalière de la décennie 2010 n'était pas totalement soutenable.
Chacun de ces deux facteurs d'aggravation du déficit traduit donc une limite de la politique de retour à l'équilibre de la décennie 2010, ce dont il faut avoir conscience dans le contexte actuel.
Un premier facteur d'amélioration du solde a correspondu aux mesures sur les recettes, d'environ 8 milliards d'euros. Paradoxalement, au cours de la période, les recettes ont spontanément eu tendance à augmenter plus vite que le PIB potentiel, malgré la forte hausse du montant des niches sociales en 2022 et 2023.
Nous avons également décomposé le solde de la sécurité sociale entre le solde structurel, c'est-à-dire le solde corrigé des effets de la conjoncture, et le solde conjoncturel, c'est-à-dire celui qui résulte de celle-ci.
Ce qui permet d'analyser la politique du Gouvernement, c'est avant tout - vous en conviendrez - le déficit structurel. Ce graphique montre que si, dans la première moitié des années 2010, la réduction du déficit a été structurelle, avec un quasi-retour à l'équilibre structurel, l'effort s'est ensuite relâché : le déficit structurel repart à la hausse à la veille de la crise sanitaire. En effet, le déficit structurel avait à nouveau dépassé 10 milliards d'euros en 2019, ce dont on ne se rendait alors pas compte. L'excédent structurel dégagé dans les dernières années de cette décennie n'a pas incité à prendre des mesures de réduction du déficit.
Pour approfondir l'analyse de la décennie 2010, nous avons construit deux autres graphiques. Le graphique intitulé « Évolution du solde de la sécurité sociale » repose sur une approche centrée sur le solde structurel et l'effort structurel. Selon cette approche, un effort neutre sur les dépenses équivaut à une hausse au même taux que la croissance potentielle, même si ne pas augmenter davantage la dépense implique parfois un effort considérable. L'effort structurel ne porte quasiment que sur la première moitié des années 2010 et n'a alors consisté qu'en des augmentations de recettes. L'effort structurel sur les dépenses a, lui, été négatif. En d'autres termes, les dépenses ont augmenté plus vite que le PIB potentiel.
Le graphique intitulé « Mesures sur le périmètre de la sécurité sociale » met en lumière les mesures concrètes prises au cours de la période ; il montre que les mesures d'un montant de 80 milliards d'euros, soit 9 milliards d'euros par an, ont porté pour les deux tiers sur les dépenses. Toutefois, celles qui concernent les recettes se concentrent, là encore, sur la première moitié de la décennie. Schématiquement, chaque année, nous avons ainsi enregistré des mesures d'économies sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) d'un montant de 4 milliards d'euros, ainsi qu'un milliard d'euros d'économies sur les retraites. Au cours des années 2011 à 2014, il convient d'ajouter à ces montants des hausses de recettes de plus de 6 milliards d'euros par an.
Nous nous sommes demandé dans quelle mesure le Ségur et les mesures liées à l'inflation avaient annulé l'effort de maîtrise de l'Ondam des années 2010. En retenant l'hypothèse d'un taux de croissance tendanciel de l'Ondam de 4,5 % en valeur depuis 2019, le Ségur et les mesures inflation n'auraient pas annulé l'effort de maîtrise de l'Ondam des années 2010, mais l'auraient réduit d'environ un tiers.
Nous avons abondamment parlé, l'année dernière, de la forte croissance des niches sociales après la crise sanitaire. Le coût des allégements généraux de cotisations patronales est passé de 50 milliards d'euros, en 2020, à 65 milliards d'euros en 2023. En effet, de nombreux salariés supplémentaires ont été rattrapés par le niveau du Smic, revalorisé du fait de l'inflation, d'où cette hausse du coût total des allégements. Toutefois, en 2024, ces derniers ont légèrement diminué ; ils auraient stagné sans le gel des bandeaux. Il ressort du rapport de juin 2025 à la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) que, même en neutralisant la baisse de 2 milliards d'euros consécutive à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la stagnation devrait se poursuivre en 2025. Il est vraisemblable que, le Smic suivant l'inflation, lesdits allégements généraux aient pris de l'avance pendant les périodes où elle était élevée, augmentant moins vite que la masse salariale au cours des années suivantes.
Quant aux exemptions d'assiette, c'est-à-dire l'essentiel des niches sur les compléments de salaire, elles ont fortement augmenté en 2022, hausse que la Cour des comptes a critiquée dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024.
Nous nous sommes efforcées de synthétiser les compensations des niches sociales. Le montant total des niches et allégements dépasse 100 milliards d'euros. Contrairement aux tableaux de l'annexe du Placss relative aux niches sociales, qui présentent un montant plus bas, nous prenons en compte la totalité des niches, dont les taux réduits de CSG et l'exemption de la prime de partage de la valeur (PPV), dont le coût est nul selon le Gouvernement, alors que la Cour des comptes l'estime à 1 milliard d'euros par an. Ainsi, sur l'ensemble, 35 milliards d'euros ne seraient pas compensés.
Dans ce cadre, le principal cas manifeste de non-respect de la loi est celui de l'exemption de PPV. En effet, pour les allégements généraux, la compensation du bandeau maladie serait inférieure de 5,5 milliards d'euros au coût, la part de TVA étant affectée à la sécurité sociale en 2019 ayant été, selon la Cour, mal calculée et sous-compensée. De même, la non-compensation, que l'on peut déplorer, de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, découle de la LFSS 2019. S'ajoutent un certain nombre de niches antérieures à la loi Veil du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, qui instaure l'obligation d'une compensation. Or ces dernières enregistrent une croissance dynamique depuis quelques années.
Le bandeau maladie a été instauré en 2019, en remplacement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). La baisse de 6 points des cotisations maladie, soit 19,8 milliards d'euros en 2019, n'a été compensée que par une fraction de 9,79 points de TVA, soit 17,4 milliards d'euros, soit une sous-compensation de 2,4 milliards d'euros, qui fluctue depuis lors. À long terme, la TVA évolue comme le PIB en valeur, et est donc peu susceptible d'être rognée : le problème réside donc non pas dans le principe d'y recourir, mais dans le niveau qui a été décidé par le législateur.
Nous en arrivons au déficit de la sécurité sociale. De manière provocatrice, nous affirmons d'emblée que celui-ci n'existe pas ! Je vous rassure : nous vous expliquerons tout de même pourquoi il faut le résorber... Évitons les fausses polémiques. On peut comparer le solde de la sécurité sociale avec celui de divers périmètres plus larges. La Cades est par nature excédentaire, du fait de ses recettes, de 15 milliards à 20 milliards d'euros par an, afin d'amortir la dette. En l'agrégeant à la sécurité sociale, l'ensemble est à l'équilibre en 2024 et ne devient déficitaire qu'en 2025. La situation est analogue pour le solde global des administrations de sécurité sociale (Asso), lequel inclut également, notamment, les organismes de régimes complémentaires de retraite et l'assurance chômage.
Une autre raison pour laquelle la notion de déficit de la sécurité sociale a peu de sens est que si ses dépenses correspondent à une réalité physique, ses recettes résultent d'une convention juridique. Cela peut amener à relativiser ou à nier l'existence de ce déficit ou, au contraire, à considérer qu'il est gravement sous-estimé, comme le montre la polémique autour d'un prétendu déficit caché du système de retraites.
Cela étant, la sécurité sociale n'a pas vocation à être en déséquilibre, puisque cela reviendrait à faire payer les prestations actuelles par les générations futures. En outre, en cas de nouvelle crise, la sécurité sociale aurait des difficultés à jouer son rôle d'amortisseur social : il serait difficile d'augmenter encore le déficit de 40 milliards d'euros si celui-ci est déjà de 25 milliards d'euros. Par ailleurs, si nous ne faisons rien, nous risquons une crise de liquidité à brève échéance. Enfin, le déficit des administrations publiques, de 5,8 points de PIB en 2024, c'est-à-dire le plus élevé de la zone euro, n'est pas soutenable, et l'effort ne peut reposer sur les seuls État et collectivités. La sécurité sociale doit revenir à l'équilibre pour contribuer à cet effort.
Ramener le déficit à 3 points de PIB en 2029 impliquerait de prendre des mesures d'environ 170 milliards d'euros sur les dépenses et les recettes pour l'ensemble des administrations publiques. Or, pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre à cette même échéance, l'effort représente environ 40 milliards d'euros, soit un quart du total, alors que la sécurité sociale englobe 40 % des dépenses publiques. Toutefois, nous ne proposons pas d'aller au-delà du retour à l'équilibre.
Pour sortir d'une vision à court terme et éviter une simple liste à la Prévert de mesures, nous avons réalisé des projections à long terme à politiques inchangées, en nous appuyant sur celles réalisées par d'autres organes, comme le COR ou la Commission européenne, en les mettant en cohérence entre elles et avec le périmètre de la sécurité sociale. Ces projections vont jusqu'à 2070, même si évidemment à cette échéance les résultats sont très incertains.
Ces projections suggèrent que sans agir sur la dynamique tendancielle des dépenses et des recettes, le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre 3 points de PIB en 2040, et 9 points en 2070. Ce scénario n'a pas beaucoup de sens, car il suppose de laisser advenir une hausse annuelle de 4 % des dépenses d'assurance maladie, ce qui ne sera évidemment pas le cas.
Ainsi, nous avons conçu un scénario dit de « stabilisation maladie », c'est-à-dire comprenant une stabilité des dépenses de l'assurance maladie en points de PIB, correspondant à peu près à l'hypothèse de la LFSS 2025 jusqu'à l'année 2028. Cela suppose quelque 4 milliards d'euros d'économies par an. Conformément à la logique du rapport, ce scénario n'a rien de prescriptif, même si nous convenons qu'il ne faut pas laisser filer les dépenses. Dans ce cadre, le déficit atteindrait 1,4 point de PIB en 2040 et 3 points en 2070. Cela reste important dans l'absolu : le déficit serait d'environ 45 milliards d'euros en 2040. La moitié de ce déficit serait imputable aux retraites, avec un déficit de la branche vieillesse de 1,6 point de PIB, régimes complémentaires exclus.
La maîtrise des dépenses de la branche maladie correspond de loin à l'enjeu financier le plus important. En effet, comme le souligne le COR, les dépenses liées aux retraites sont stables en proportion du PIB : le déficit de la branche vieillesse est lié à la diminution de la part des régimes équilibrés par l'État. Par ailleurs, à politique inchangée, les dépenses de la branche autonomie augmenteraient de 0,6 point de PIB sur la période. C'est beaucoup à l'échelle de la branche, mais très peu à celle de la sécurité sociale.
Entre 2024 et 2070, l'évolution spontanée des dépenses des branches est variable. Ainsi, sans contrainte sur la branche maladie, les dépenses de la sécurité sociale augmenteraient de 6,4 points de PIB sur la période, ce qui n'est évidemment pas soutenable. En revanche, si les dépenses de l'assurance maladie étaient stables en points de PIB, la hausse globale serait bien plus faible. Ainsi, les dépenses de la branche vieillesse augmenteraient de 0,4 point de PIB, celles de la branche autonomie de 0,6 point, et celles de la branche famille, essentiellement indexées sur l'inflation, baisseraient de 0,4 point.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. - Nous en venons aux moyens de ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Ce n'est pas techniquement difficile, le défi est surtout de nature politique.
La première question est celle de l'échéance. Le Gouvernement souhaite un retour à l'équilibre en 2029. Ainsi, la ministre chargée des comptes publics a, à plusieurs reprises, fait état de cet objectif, notamment en séance publique au Sénat, le 28 mai dernier. Pour ma part, je n'ai pris conscience de cet objectif que quand nous avons auditionné le directeur de la sécurité sociale, le 15 mai dernier. Il est en effet frappant qu'un tel objectif de retour à l'équilibre ne figure dans aucun document, particulièrement parmi les annexes de la loi de financement de la sécurité sociale, dont l'usage est qu'elles s'entendent à droit inchangé.
Or il serait utile de disposer d'un document décrivant où nous allons, ne serait-ce que pour rassurer les créanciers de l'Urssaf caisse nationale, c'est-à-dire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). En effet, les marchés ne détestent rien plus que l'incertitude.
Le premier de nos dix points d'accord est donc la nécessité de ramener la sécurité sociale à l'équilibre structurel, si possible en 2029 et au plus tard en 2035. Dans les années 2010, la sécurité sociale a été ramenée à l'équilibre structurel dès 2014, le solde s'étant dégradé ensuite. Ce n'est donc pas irréaliste. S'il paraît difficile, compte tenu du contexte politique et économique, d'atteindre cet objectif en quatre exercices, l'échéance de 2035 nous paraît néanmoins impérative. En effet, un nouveau transfert de dette sociale à la Cades serait alors peut-être impossible sans augmentation des ressources de la Cades.
Examinons d'un point de vue arithmétique les contraintes d'un retour à l'équilibre. Si l'échéance visée est 2029 par exemple - cela n'est pas prescriptif -, nous savons qu'il faudra prendre des mesures de réduction des dépenses et d'augmentation des recettes à hauteur d'environ 40 milliards d'euros.
L'étape suivante consiste à fixer le taux de croissance de l'Ondam. La croissance spontanée de l'Ondam est estimée à environ 4,5 % par an. C'est là notre point d'accord n° 2 : il convient de maîtriser la dynamique des dépenses de la branche maladie rapportées au PIB, qui devront augmenter moins rapidement que leur croissance spontanée. Pour stabiliser l'Ondam en points de PIB, il faudrait réaliser environ 4 milliards d'euros d'économies chaque année. Le rapport ne dit pas lesquelles ; il se contente de reprendre en annexe les principales mesures envisagées, notamment celles qui figurent dans le rapport de la Cour des comptes publié en avril 2025.
Cet effort ne pouvant suffire à éviter une dégradation du déficit, il convient ensuite - c'est notre point d'accord n° 3 - d'agir sur les recettes, les dépenses ou le nombre d'heures travaillées dans l'ensemble de l'économie. Par exemple, s'il a été décidé de réduire l'Ondam de 4 milliards d'euros, il faudra trouver 6 milliards d'euros ailleurs pour atteindre les 10 milliards d'euros par an.
Regardons maintenant ce que disent les modèles de simulation respectifs de la direction du Trésor - Mésange - et de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) - EmeRaude - afin de déterminer s'il est plus efficace, pour réduire le déficit, d'augmenter les recettes ou de réduire les dépenses d'un montant donné. En d'autres termes, quel est l'effet sur le solde des administrations publiques d'une augmentation des recettes ou d'une diminution des dépenses d'un point de PIB, soit 30 milliards d'euros ?
Selon les deux modèles, la réduction des dépenses est à court terme la manière la moins efficace de réduire le déficit en raison de son effet plus récessif, mais à long terme la manière la plus efficace de le faire, car elle n'a pas d'effet néfaste sur l'investissement par exemple. Les deux modèles convergent sur un autre point : dans le cas de la TVA et de la CSG, l'amélioration du solde est proche la première année du montant de la mesure, mais l'effet est plus faible à long terme.
En revanche, les deux modèles divergent quant à l'effet d'une augmentation uniforme des cotisations patronales et salariales. Selon le Trésor, les cotisations ont un effet tellement récessif, à cause des emplois détruits, qu'à long terme l'amélioration du solde public est nulle. En revanche, selon l'OFCE, il n'y a pas d'effet particulier sur l'emploi, et l'effet est le même que pour les autres augmentations de prélèvements. Le rapport se contente de présenter ces résultats sans prendre parti.
Nous devons nous doter rapidement d'un plan crédible de retour à l'équilibre et réaliser un nouveau transfert de dette à la Cades. En effet, même si nous parvenions à ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, nous ne serions pas tirés d'affaire. Lors de leur audition, les responsables de l'Acoss ont clairement tiré le signal d'alarme. Comme vous le savez, la sécurité sociale n'est pas censée être en déficit, la fonction normale de l'Acoss étant de financer le besoin de trésorerie lié au décalage temporel entre les recettes et les dépenses. C'est la raison pour laquelle la loi n'autorise l'Acoss qu'à s'endetter à court terme.
Toutefois, en l'absence de transfert de dette à la Cades, le déficit de la sécurité sociale doit aussi être financé par l'Acoss. Les responsables de l'Acoss nous ont indiqué que, à la fin de 2025, le besoin de trésorerie devrait être proche du plafond de 65 milliards d'euros fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Les années suivantes, ce besoin devrait augmenter chaque année du montant du déficit, ce qui entraînerait un dépassement du seuil de 100 milliards d'euros en 2027. À titre de comparaison, pendant la crise sanitaire, le besoin de trésorerie maximal sur l'année a été de 90 milliards d'euros... Les responsables de l'Acoss ont ainsi considéré qu'il n'était pas évident, qui plus est dans un contexte de déficit croissant sans perspectives d'amélioration, que l'on puisse renouveler durablement ce qui avait été fait de manière ponctuelle en 2020. Ils estiment que la situation pouvait devenir rapidement problématique dès 2027. En réalité, nous entrerions selon eux en zone de risque à la fin de l'année 2025.
Il faut donc transférer rapidement de la dette de l'Acoss à la Cades. Comme le montre l'historique des amortissements de dette réalisé par la Cades, plus le temps a passé, plus on a transféré des sommes importantes à la Cades, et plus la durée d'amortissement a été importante : elle a été de treize ans pour le transfert suivant la crise des dettes souveraines et pour le transfert consécutif à la crise sanitaire, alors que, par le passé, les sommes étaient moins élevées et étaient plus vite remboursées.
On pourrait avoir l'impression que la Cades est une sorte de solution magique permettant d'effacer la dette sociale. Ne perdons pas de vue cependant que pour amortir la dette, la Cades met un certain temps, qui dépend notamment du montant transféré et des ressources qu'on lui affecte. Jusqu'à présent, nous avons fait en sorte que ses ressources lui permettent d'amortir la dette une dizaine d'années après le début du transfert. Quel serait cependant l'encours de dette de la Cades sans augmentation de ses ressources ? Nous avons simulé deux scénarios, l'un avec un retour à l'équilibre en 2029, l'autre avec un retour en 2035, et un transfert qui débute dans les deux cas dès 2026. On constate que l'encours augmenterait dans un premier temps, puis que la Cades commencerait à amortir la nouvelle dette à partir de 2033, une fois le stock de dette actuel amorti. En cas de retour de la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, la courbe d'amortissement serait analogue à celle des derniers transferts, mais si l'équilibre est atteint en 2035, alors l'encours de dette maximal et la durée d'amortissement seraient sans précédent. Qu'adviendrait-il si le retour de la sécurité sociale à l'équilibre était tardif au point de susciter une durée d'amortissement de, par exemple, vingt ans ? Cela ne serait-il pas perçu par les investisseurs comme un abandon de fait du principe d'équilibre de la sécurité sociale ? Y aurait-il alors un sens à continuer de confier à la Cades la mission d'amortissement de la dette sociale ? Je n'en sais rien ; je pose simplement la question.
Les analyses qui précèdent nous ont conduites à trois nouveaux points d'accord qui, comme les précédents, concernent non pas des mesures concrètes sur les dépenses ou les recettes, mais des objectifs et des règles de gouvernance, et correspondent à des préconisations déjà formulées par notre commission. Le point d'accord n° 4 consiste à se doter rapidement - en toute rigueur, il faudrait le faire dès cet automne - d'une trajectoire crédible de retour de la sécurité sociale à l'équilibre. À ce moment-là seulement, il sera possible de réaliser un nouveau transfert de dette à la Cades, avec un nouveau butoir vraisemblablement entre 2035 et 2040.
Comme l'échéance actuelle de 2033 pour la fin de l'amortissement de la dette sociale est définie par une disposition organique, un nouveau transfert de dette impliquerait une disposition organique. Le point d'accord n° 5 consiste donc à réviser rapidement l'article 4 bis de l'ordonnance de 1996 sur la Cades, afin de permettre un nouveau transfert de dette de l'Acoss à la Cades.
Enfin, point d'accord n° 6, il convient d'adopter annuellement une programmation à moyen terme - et non une simple prévision à politiques inchangées - des recettes, des dépenses et du solde de la sécurité sociale. Il serait certes très étonnant que le Parlement s'entende sur un tel plan dès cet automne, mais il y a néanmoins urgence.
J'en viens à la dernière partie de ce chapitre : renforcer la gouvernance de l'assurance maladie. L'un des principaux enjeux, si l'on souhaite ramener la sécurité sociale à l'équilibre, est de reprendre le contrôle de l'Ondam. Après avoir été respecté systématiquement de 2011 à 2019, l'Ondam est systématiquement dépassé depuis 2020. Le Gouvernement ayant indiqué l'importance qu'il accordait au retour de la sécurité sociale à l'équilibre, on aurait pu supposer - ou du moins espérer - que l'Ondam revienne sous contrôle en 2025. Or ce n'est pas le cas, comme le montre le récent avis du comité d'alerte. Il y a en fait deux problèmes : d'une part, depuis la crise sanitaire, les prévisions sont systématiquement optimistes ; d'autre part, les instruments de régulation infra-annuelle sont insuffisants. Le Gouvernement a communiqué en début d'année sur l'augmentation du montant de la réserve prudentielle, portée à 0,4 % en 2025, mais celle-ci ne concerne pas la médecine de ville. Elle a notamment pour effet de transférer du déficit de la sécurité sociale vers les hôpitaux, ce qui n'a pas d'intérêt. Il en découle notre point d'accord n° 7 : mettre en place une gouvernance effective de l'Ondam, reposant notamment sur des prévisions non biaisées et un renforcement des outils de régulation infra-annuelle.
Je passe au dernier chapitre : le maintien de la sécurité sociale à l'équilibre une fois que ce dernier aura été atteint. L'assurance maladie est le principal défi des prochaines décennies. Alors que le débat se focalise sur les retraites et dans une moindre mesure sur l'autonomie, on parle très peu du problème de financement des dépenses de santé, qui est pourtant « l'éléphant dans la pièce ». En effet, si l'on ne fait rien, les dépenses de la branche maladie pourraient passer de 8,6 points de PIB actuellement à plus de 10 points en 2040 et à environ 15 points en 2070. À cela s'ajoute le fait que les recettes de la branche maladie tendent spontanément à augmenter un peu moins vite que la richesse nationale. Selon la Cnam, le taux de croissance spontané des recettes de l'assurance maladie est en effet inférieur d'environ 0,3 point à celui du PIB en valeur, du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac. C'est comme si nous prenions chaque année des mesures d'un montant d'environ 0,75 milliard d'euros pour réduire les recettes de la Cnam ! Ainsi, même si les dépenses étaient stabilisées par rapport au PIB, en l'absence de mesures d'augmentation des recettes, le déficit augmenterait. Sans maîtrise des dépenses de santé, nous assisterions probablement à leur désocialisation croissante. Les inégalités d'accès aux soins se creuseraient encore davantage.
Nous avons essayé de lever le nez du guidon et de nous extraire des prévisions à moyen terme des lois de financement de la sécurité sociale pour nous pencher sur les prévisions des économistes sur les déterminants à long terme des dépenses de santé. Selon l'OCDE, ces dernières devraient augmenter mécaniquement de 2,2 % par an en volume entre 2022 et 2040. Avec une inflation de 1,8 %, l'augmentation serait ainsi de 4 %, ce qui correspond à peu près à l'estimation de la croissance spontanée de l'Ondam. Cette augmentation de 2,2 % en volume proviendrait pour 0,7 point de la croissance du PIB, pour 0,5 point de l'« effet Baumol » (c'est-à-dire la tendance des salaires à augmenter plus vite que leur productivité dans certains secteurs, notamment dans le secteur de la santé), pour 0,4 point du progrès technologique et pour 0,6 point du vieillissement.
Bien entendu, le Gouvernement ne laisse pas filer les dépenses d'assurance maladie. Il réalise bien près de 4 milliards d'euros d'économies par an. Toutefois, le suivi des mesures en exécution est quasi inexistant. Les principales données sont prévisionnelles ; elles se trouvent dans l'annexe au PLFSS relative à l'Ondam. En 2022 et 2023, le Gouvernement n'a affiché aucun objectif pour les établissements hospitaliers et, depuis lors, les annexes sont devenues très vagues.
Si l'on réalise un tableau - par ailleurs incomplet, car il ne prend pas en compte, par exemple, les efforts sur la masse salariale des établissements de santé -, on observe que, sur les 4 milliards d'euros d'économies annuelles sur la période 2015-2021, 2,5 milliards d'euros ont porté sur les prix, essentiellement ceux des médicaments et des achats hospitaliers. Il n'est pas évident que la régulation puisse porter majoritairement sur les prix pendant plusieurs décennies. En fait, pour agir efficacement sur la dépense, il faut vraisemblablement davantage agir sur les volumes, en ciblant les inefficiences.
Malheureusement, contrairement à ce qui existe aux États-Unis, il n'y a pas, en France, de chiffrage des inefficiences des dépenses de santé (ce qu'on peut appeler, au sens large, les « gaspillages »). Nous nous sommes donc efforcées de réaliser un tel chiffrage. Il en ressort que les inefficiences correspondraient à environ un quart des dépenses de santé, soit un niveau conforme aux estimations usuelles des pays de l'OCDE. Toutefois, en regardant précisément chaque composante, on se rend compte que ces inefficiences demeurent parce que leur réduction se heurte souvent à un obstacle économique ou politique. Par exemple, les possibilités de prévention manquées correspondent à près de 8 % des dépenses. Une piste serait d'améliorer la prévention tertiaire, en assurant un meilleur suivi des personnes déjà malades. Il semble en revanche peu probable que la France décide, par exemple, de mettre en place une véritable politique pour lutter contre la consommation nocive d'alcool. Au total, l'OCDE estime que ses États membres pourraient tout de même diviser par deux les inefficiences de leurs dépenses de santé.
Conformément au principe que nous avons adopté pour ce rapport - mais aussi parce que Corinne Imbert est plus compétente sur ce sujet -, nous ne prenons pas position, évidemment, sur ce qu'il convient de faire concrètement. Le rapport rappelle toutefois les principales pistes habituellement évoquées, comme l'amélioration des parcours de soins ou le renforcement de la prévention. L'aspect politique de certaines décisions y est souligné. Techniquement, nous pourrions par exemple contraindre les médecins à renseigner l'indication thérapeutique dans l'ordonnance électronique, comme le préconise le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Cette mesure impliquerait toutefois un débat politique approfondi.
Cela m'amène à deux nouveaux points d'accord, qui concernent la seule gouvernance.
Le point d'accord n° 8 est le suivant : nous avons besoin de disposer d'un rapport approfondi, mis à jour régulièrement, proposant des projections à long terme et chiffrant les inefficiences. Il s'agit de contribuer à créer une dynamique. Ce rapport devra donc être médiatisé. La réalisation de chiffrages a contribué à renforcer la lutte contre la fraude ; de même, documenter les inefficiences du système de santé pourrait tous nous inciter, y compris les usagers, à en faire plus pour les réduire.
Dans le cas du point d'accord n° 9, l'idée est de favoriser le développement d'un écosystème, notamment universitaire, réfléchissant aux questions d'efficience dans le domaine de la santé. Nous ne pouvons pas nous réveiller à chaque fin de printemps en nous demandant quelles mesures d'économies sur l'Ondam nous allons bien pouvoir prendre dans le prochain PLFSS...
J'en viens maintenant aux retraites. Autant, dans le cas de la branche maladie, les enjeux financiers sont considérables et les aspects techniques très complexes, autant dans le cas de la branche vieillesse nous sommes face à des questions avant tout politiques. Les dépenses de la branche vieillesse sont stables en points de PIB. Cependant, les recettes baissent, en raison de la diminution de la part relative des régimes équilibrés par l'État.
Dans son dernier rapport, le COR projette pour 2070 un déficit de 1,4 point de PIB pour l'ensemble du système de retraite. Comme on s'intéresse ici à la seule branche vieillesse, il faut retirer les régimes complémentaires, ce qui conduit à un déficit de 1,6 point de PIB en 2070.
Le rapport ne contient rien d'extraordinaire sur les retraites. Nous nous sommes contentées, pour l'essentiel, de reprendre, sans prendre parti, les chiffrages figurant dans le rapport de la Cour des comptes de février dernier. Le rapport comprend en outre des développements nuancés sur le financement des retraites au moyen d'actifs fléchés, comme des fonds de pension ou le fonds de réserve pour les retraites, en rappelant les arguments en faveur de cette solution et ceux qui s'y opposent. Dans l'hypothèse où il serait décidé de développer ce recours à des actifs fléchés, on pourrait envisager, notamment, de choisir le fonds de réserve pour les retraites. Nous avons auditionné les dirigeants du FRR, qui nous ont dit explicitement que ce fonds pourrait assurer la gestion d'un futur dispositif.
Dans le cas de l'autonomie, également, les choix sont politiques. À politiques inchangées, les dépenses de la branche autonomie devraient accélérer à partir de 2030, avec un déficit atteignant 0,6 point de PIB en 2070. Cette part n'est pas colossale si on la rapporte à l'ensemble des finances publiques, mais elle l'est dès lors qu'on la remet dans la perspective de la branche.
Il y a toutefois un fort aléa à la hausse. Selon les projections de la Commission européenne, les dépenses d'autonomie de la France pourraient considérablement augmenter en points de PIB si, pour chaque tranche d'âge, la probabilité et le coût de prise en charge étaient alignés sur la moyenne de l'Union européenne. Le rapport de la Commission européenne ne permet pas de voir précisément en quoi la France serait actuellement moins généreuse que ses voisins, mais il faut retenir que réfléchir à politiques inchangées n'est pas forcément la manière la plus adéquate pour projeter l'évolution des dépenses de la branche autonomie.
Sur les mesures à prendre pour financer l'autonomie, le rapport se borne à rappeler les principales propositions, telles que celles qui sont émises dans le rapport intitulé La Branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement de Laurent Vachey de 2020, portant notamment sur le financement de la dépense privée, l'instauration d'une assurance obligatoire ou encore la mobilisation du patrimoine.
Cela nous conduit à notre dernier point d'accord, le point n° 10, qui est simplement qu'il nous faut prendre des décisions sur l'autonomie !
Nous avons vu tout à l'heure que, si la France est le pays dont les dépenses sociales sont les plus élevées en points de PIB, ce constat n'est plus vrai si l'on raisonne en euros par habitant. En effet, la France est, pour reprendre une expression utilisée par Gilbert Cette lors de son audition, « pauvre parmi les riches » ; d'où l'idée, fréquemment mise en avant, d'augmenter le PIB pour financer la sécurité sociale.
Intéressons-nous à l'écart de PIB par habitant entre les États-Unis et différents pays. Tout d'abord, si l'on compare la France aux États-Unis, on constate que la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire à l'efficacité avec laquelle l'économie utilise le travail et le capital, également appelée progrès technique, est la première grande cause qui explique que le PIB par habitant est plus faible en France qu'aux États-Unis. La deuxième est liée au nombre d'heures de travail par travailleur.
Ensuite, si l'on compare la France aux autres pays, en particulier européens, on voit que la faiblesse de notre taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes en âge de travailler ayant un emploi, pèse sur notre PIB par habitant. Aligner le nombre d'heures de travail par travailleur sur celui des États-Unis serait la solution la plus efficace, mais, d'un point de vue politique, elle est difficile à mettre en place. Aussi les économistes préconisent-ils plutôt de chercher à augmenter le taux d'emploi, étant donné que c'est notre principale anomalie par rapport à des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas.
La manière la plus simple, et la seule qui soit fiable, d'augmenter le PIB, c'est d'accroître la quantité de travail. Si l'on compare la France à ses voisins, on voit qu'elle se distingue par un faible taux d'emploi des jeunes et des seniors. Or avec un taux d'emploi similaire à celui de l'Allemagne, il n'y aurait quasiment plus de déficit de la sécurité sociale.
Dans ce rapport, nous ne prenons pas parti sur ce sujet. Nous soulignons la difficulté politique actuelle à reculer encore l'âge de départ à la retraite et la complexité de la question de l'emploi des jeunes, et nous constatons qu'il serait sans doute plus facile d'améliorer le taux d'emploi des jeunes si les conditions de travail étaient meilleures.
Nous envisageons également une autre manière d'augmenter le temps de travail, bien qu'elle ne réponde pas à la tendance actuelle, qui consisterait à accroître la durée du travail de ceux qui ont un emploi. Nous présentons quelques pistes sur ce point, sans prendre parti, et en soulignant que le sujet n'est pas consensuel au sein de la commission.
Mme Annie Le Houérou. - Je remercie les rapporteures pour leur travail. Les auditions qu'elles ont réalisées et les débats qui les ont suivies étaient passionnants.
Les enjeux du retour à l'équilibre sont très politiques. La boîte à outils que vous présentez est intéressante, car chaque suggestion pourra être expertisée. En tout cas, je me réjouis que vous ayez pris le parti de maintenir un régime de sécurité sociale solidaire et que vous ayez examiné les pistes pour y parvenir à différents termes.
Vous avez ainsi adopté une approche transversale, quelque peu différente de celle des nombreux rapports que vous avez étudiés. Il nous reste désormais à analyser ces divers outils afin de préparer au mieux le PLFSS à l'automne. Il est dommage, à ce titre, que nous ne puissions pas nous appuyer dès à présent sur le rapport écrit. En effet, nous devons nous positionner sur ces choix, en particulier sur la question des dépenses et des retraites, qui nécessitent de trouver un équilibre.
Concernant la gouvernance de l'Ondam, votre proposition est intéressante. Les pistes d'évaluation que vous proposez, notamment en matière d'efficience des dépenses de santé, méritent toute notre réflexion. On en appelle sans arrêt à la liberté des médecins - liberté d'installation, de prescription -, mais, dans nos territoires, on constate surtout que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas la liberté d'accéder aux soins...
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - Je salue ce travail remarquable, bien que je n'aie jamais douté de la capacité des rapporteures à nous présenter des pistes intéressantes, qui méritent une analyse fine et approfondie.
Sur la branche maladie, nous disons depuis plus de dix ans qu'il faut agir pour limiter les soins redondants ou inutiles. Vous estimez que les dépenses de santé correspondant à des inefficiences s'élèveraient à 28 % des dépenses de santé. Il se trouve que ce taux est exactement le même que la proportion des soins redondants ou inutiles indiqués par une enquête de la Fédération hospitalière de France, mentionnée par un rapport de 2012 d'Alain Milon et Jacky Le Menn. Il faut aller plus loin, plutôt que d'en rester à ce constat sans rien faire. Chaque ministre de la santé nous annonce 800 millions d'euros ou 1 milliard d'euros d'économies sur la redondance des soins, mais à quoi cela correspond-il ? On n'en sait rien ! Il est indispensable de procéder à une analyse précise et de produire un rapport sur l'efficience des soins, que la HAS devrait d'ailleurs être en mesure de documenter.
Concernant les retraites, il faut bien distinguer le public et le privé. Le financement des retraites du privé, que ce soit pour le régime de base ou les complémentaires, est bien connu. Les dépenses, de même, sont bien documentées par le COR jusqu'en 2070. Cependant, les médias se content souvent d'annoncer un chiffre global sur le déficit : 1 milliard d'euros en 2030 et 15 milliards en 2035. Or cela ne veut rien dire ! Surtout, cela représente bien peu de choses, sur 250 milliards d'euros de dépenses de retraites du privé. On peut donc y arriver, surtout quand on sait qu'il y a 86 milliards d'euros de réserves sur les complémentaires pour 100 milliards d'euros de dépenses. C'est bien pour cela que nous devrons prendre position sur une gouvernance paritaire du système des retraites du privé.
Pour le public, le problème est évidemment démographique : il y a de moins en moins de fonctionnaires. Il faut trouver d'autres solutions. Par exemple, nous pourrions recourir aux fonds de pension et au FRR. Il faut alimenter ce fonds. C'est ce qui est fait au Québec.
M. Khalifé Khalifé. - Les rapports de la Mecss sont-ils pris en compte par les dirigeants de la Caisse nationale de l'assurance maladie ? J'ai le sentiment qu'ils en font bien peu de cas !
Vous n'avez pas beaucoup évoqué la fraude. J'ai récemment demandé à mes collaborateurs de travailler sur l'intérêt de l'intelligence artificielle pour détecter ces fraudes : j'y vois une piste intéressante.
Vous n'êtes pas non plus revenues sur la financiarisation. Il ne me semble pas opportun de reporter la date du retour à l'équilibre structurel de la sécurité sociale de 2029 à 2035. D'ici là, de mauvaises habitudes auront été prises, et il sera bien difficile de revenir en arrière...
Enfin, est-il pertinent de comparer notre système de santé à celui des États-Unis, qui n'est pas idéal tant du point de vue des cotisations que de la financiarisation ?
M. Olivier Henno. - Je salue à mon tour ce magnifique travail, qui souligne bien la différence de nature entre les trois sujets évoqués. Les branches autonomie et retraites sont assez paramétriques et, donc, politiques. En revanche, la branche maladie est beaucoup plus difficile à maîtriser. Parmi les champs d'économies possibles, beaucoup de pistes dépassent le paramètre : je pense par exemple à la prévention, aux innovations thérapeutiques ou encore à l'apparition des biotechnologies, qui, certes, peuvent représenter des coûts nouveaux, mais également des sources d'économies. Ainsi, le véritable défi de la maîtrise des dépenses de sécurité sociale réside bien dans la maladie et la santé. Abordez-vous la question des possibilités d'évolutions technologiques ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. - Je remercie nos rapporteures d'avoir entamé ce travail difficile. La boîte à outils a l'avantage de dresser une liste de possibilités, mais elle présente aussi le danger - dans lequel vous n'êtes pas tombées ! - de laisser penser qu'il faudrait choisir une mesure au détriment des autres. J'attends pour ma part avec impatience d'entrer dans le détail d'un certain nombre de propositions.
Concernant l'évaluation des futures dépenses en matière de vieillissement de la population, les deux branches les plus importantes en volume sont les retraites et la maladie. Cependant, on sous-évalue beaucoup les dépenses en matière d'autonomie, dont le caractère exponentiel est souvent supérieur à celui des dépenses de maladie. Cette question nécessite sans doute un approfondissement particulier.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - L'ensemble du rapport compte près de 300 pages. Vous y trouverez donc de nombreux développements sur des sujets tels que les fraudes. Dans notre présentation, nous avons moins parlé de certaines questions, notamment celles qu'a abordées Olivier Henno, comme la prévention ou la redondance des soins.
Je vous invite donc à vous saisir des différentes propositions de ce rapport.
Nous tenions avant tout à vous montrer qu'il existe de très nombreuses pistes. Certains préconiseront de diminuer les dépenses, d'autres d'augmenter les recettes. Ma certitude, c'est qu'on devra faire l'un et l'autre !
Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteure. - La branche autonomie est la seule pour laquelle nous suggérons qu'il pourrait falloir davantage de dépenses que ce qu'impliqueraient des politiques inchangées. En réalité, si l'on a pu contenir l'autonomie, c'est parce que les enveloppes sont, pour l'essentiel, fermées. Mais il faudra bien les ouvrir un jour.
La fraude provient des surfacturations, en partie, mais aussi de la financiarisation de la santé.
Je vous rejoins dans vos propos sur le tournant préventif.
Enfin, n'oublions pas que notre rapport est essentiellement un texte financier. Un point aveugle demeure : chacun doit pouvoir bénéficier du système de soins selon ses besoins. Nous devons donc garantir l'égalité territoriale et sociale, ainsi que la fonction redistributive du système. Concernant les retraites, le taux de pauvreté des personnes âgées doit diminuer. Toutefois, notre rapport ne traite pas de ces sujets. Il nous faudra nous interroger sur les conséquences des mesures que nous proposerons en matière d'égalité territoriale, et les analyser au regard de leur efficacité par rapport aux objectifs de la sécurité sociale.
M. Alain Milon, président. - Je vous remercie de votre présentation.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 23 septembre 2025, sous la présidence de M. Philippe Mouiller, président, la commission examine le rapport d'information de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteures de la mission d'information sur le financement de la protection sociale.
M. Philippe Mouiller, président. - Nous allons maintenant examiner le rapport d'information qu'Élisabeth Doineau et Raymonde Poncet Monge ont réalisé au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) sur les évolutions envisageables du financement de la protection sociale.
Je vous précise que nos collègues ont déjà présenté leurs travaux à la Mecss le 1er juillet dernier, sous la présidence d'Alain Milon, ici présent et que je salue.
Je vous indique que nous procédons à un exercice quelque peu inédit. En effet, le rapport comprend un catalogue de mesures sur l'évolution des comptes sociaux, qui pourront ou non se traduire en propositions. Les deux rapporteures n'étant pas de la même sensibilité, l'idée était que chacune puisse proposer des mesures, quitte à ce que certaines d'entre elles soient très éloignées les unes des autres.
Il ne s'agit donc pas de formuler des propositions à proprement parler. Je vous inviterai simplement à prendre acte des travaux de la Mecss et à autoriser la publication de ce rapport d'information.
M. Alain Milon, président de la Mecss. - Les rapporteures ont présenté un premier rapport au début de l'été. Il a été convenu qu'elles travailleraient durant l'été pour pouvoir vous présenter la version qui vous est soumise aujourd'hui. J'ai eu la chance de le lire et je salue le travail très important qu'elles ont réalisé, en bonne intelligence.
Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteure. - Nous vous présentons notre projet de rapport pour la Mecss, que nous proposons d'intituler : « Sécurité sociale : la boîte à outils du Sénat ». Ce titre comprend l'expression « boîte à outils », pour des raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il est légèrement plus court que celui proposé à la Mecss en juillet.
Mme la rapporteure projette une présentation PowerPoint en complément de son propos.
Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler brièvement la procédure d'examen du rapport.
Le règlement intérieur de la Mecss ne prévoit explicitement d'examen - et, a fortiori, d'adoption - des rapports de la Mecss que par la commission des affaires sociales.
En octobre dernier, lors de l'examen du rapport de la Mecss sur la branche AT-MP, réalisé par Marie-Pierre Richer et Annie Le Houérou, le président Milon a exprimé le souhait que la Mecss examine ses rapports préalablement à leur adoption par la commission. Le président Mouiller ayant donné son accord, la Mecss a décidé, en décembre 2024, lors de l'adoption de son programme de travail, de procéder de la sorte à l'avenir.
Le rapport que nous vous présentons est le premier que nous examinons selon cette nouvelle procédure. Il a donc déjà été examiné par la Mecss, le 1er juillet dernier. Nous avons décidé de décaler son examen par la commission, initialement prévu le lendemain, au mois de septembre, afin de nous permettre de l'actualiser.
En effet, ce rapport a vocation à être une boîte à outils : il doit présenter les différentes mesures envisagées dans le débat public pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Or deux rapports importants devaient être publiés au mois de juillet, comprenant de nombreuses propositions : l'habituel rapport Charges et Produits de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), dont seule une version provisoire avait alors été publiée, mais aussi un rapport commandé par le Premier ministre aux trois hauts conseils - le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) et le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA).
Afin de préserver le caractère non polémique du rapport, nous avons arrêté les compteurs, si je puis dire, à la fin de mois de juillet. Aucune proposition formulée depuis lors n'est mentionnée dans le rapport.
Ces actualisations ne modifient bien entendu pas le fond du rapport. Notre diaporama sera donc strictement identique à celui présenté début juillet à la Mecss, sous réserve de quelques corrections de chiffres à la marge. En particulier, nos préconisations relatives à la gouvernance n'ont pas changé.
Notre rapport est une boîte à outils, parce qu'il ne préconise ni ne rejette aucune mesure. Il relève de la même logique que le rapport de la Cour des comptes de février 2025 sur les retraites, la différence étant qu'il concerne l'ensemble de la sécurité sociale.
Nous souhaitons que ce rapport contribue à cadrer le débat et à favoriser le rapprochement des points de vue en formulant des constats partagés.
Si nous ne préconisons pas de mesures particulières sur les dépenses, les recettes ou la manière d'augmenter le PIB, nous préconisons en revanche certaines orientations relatives à la gouvernance. Celles-ci devraient, nous semble-t-il, faire l'objet d'un consensus au sein de la commission.
Toutefois, nous suggérons d'appeler ces préconisations non pas des « propositions », mais des « points d'accord des rapporteures ». Il s'agit d'éviter toute ambiguïté, et d'établir clairement que ce rapport ne lie pas la commission pour l'avenir, en particulier en ce qui concerne le prochain PLFSS. Ce rapport n'empiète aucunement sur les prérogatives des rapporteurs de branche, qui restent totalement maîtres d'apprécier ce qu'il convient de faire ou pas.
Nous nous sommes efforcées de faire en sorte que notre boîte à outils soit aussi fournie que possible. En annexe, un tableau d'une vingtaine de pages synthétise et chiffre les principales propositions qui ont pu être formulées dans le débat public. On y trouve par exemple la valeur d'un point d'augmentation de tel ou tel taux de contribution sociale généralisée (CSG), ou les effets d'un écart d'un an de l'âge d'ouverture des droits à la retraite.
Il va sans dire que chacun d'entre nous sera favorable à certaines mesures et défavorable à d'autres ; c'est tout à fait normal. Si nous devions toutes les appliquer, le rendement de l'ensemble de ces mesures s'élèverait à une centaine de milliards d'euros. Il ne s'agit donc évidemment pas de toutes les mettre en oeuvre.
La Mecss nous a semblé être l'instance adaptée pour établir un tel rapport. S'il ne s'agit pas d'une évaluation, l'approche technique du rapport correspond à celle qu'ont habituellement les rapports de la Mecss.
Conformément aux compétences de la Mecss, le présent rapport se limite au champ de la sécurité sociale - les régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss) et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) - et des organismes concourant à son financement - la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) et le fonds de réserve pour les retraites (FRR).
Les régimes complémentaires de retraite, l'assurance chômage, les complémentaires santé et les minima sociaux sont hors du champ du rapport. Comme l'ont demandé les membres de la Mecss le 17 décembre 2024, le rapport porte non seulement sur les recettes, mais aussi sur les dépenses et sur le solde.
Les projections à long terme du rapport portent sur le périmètre de la sécurité sociale. Compte tenu des sommes en jeu, le rapport se concentre sur les branches vieillesse, maladie et autonomie.
Nous nous sommes placées dans une perspective de réduction du déficit des administrations publiques : il ne s'agit pas d'examiner les manières de réduire le déficit de la sécurité sociale en augmentant celui de l'État, bien que la compensation des exonérations sociales soit insuffisante.
Notre premier constat est le suivant : la situation financière n'est pas soutenable.
Pour le formuler, nous nous fondons tout d'abord sur des comparaisons internationales.
Quand on évoque la situation financière de la sécurité sociale, il convient, avant de parler du déficit, de mentionner le montant des dépenses. Dire que la France a les dépenses publiques de protection sociale les plus élevées au monde en points de PIB relève du lieu commun. Or cette affirmation est moins vraie si l'on exprime ces dépenses en euros par habitant : dans ce cas, la France occupe le sixième rang des pays de l'OCDE en matière de dépenses publiques de protection sociale.
En effet, la France a un PIB par habitant dans la médiane de l'OCDE, ce qui a fait dire au président du Conseil d'orientation des retraites (COR), Gilbert Cette, lors de son audition : « La France est pauvre parmi les riches. »
Ce constat peut être interprété de manière différente selon sa sensibilité politique : d'aucuns considéreront qu'il est faux de dire que la France a des dépenses sociales trop généreuses ; d'autres estimeront que la France vit au-dessus de ses moyens.
La sécurité sociale française est financée pour près de la moitié par des prélèvements sur le travail. Cela n'a rien d'extraordinaire ; les autres pays de l'OCDE procèdent de la même manière. La France se distingue sur un point : ses dépenses sociales - et donc ses recettes sociales - étant très élevées en points de PIB, elle a mis en place des allégements généraux sur les bas salaires dans le cadre de sa politique de l'emploi.
Mais l'actualité, c'est bien sûr le déficit de la sécurité sociale, qui atteint actuellement un niveau sans précédent hors période de crise. En outre, en cas de politiques inchangées, il continuerait d'augmenter d'ici à 2029.
Nous montrons dans un premier graphique comment nous sommes passés d'un quasi-équilibre en 2019 à un déficit de 15 milliards d'euros en 2024. L'évolution du solde conjoncturel a contribué à aggraver le déficit à hauteur de près de 13 milliards d'euros. Si nous nous appuyons sur l'estimation du PIB potentiel de la Commission européenne, cela signifie, concrètement, que le PIB de la France était, en 2019, supérieur d'environ 2 % à son niveau « normal », ce qui suscitait des recettes supplémentaires. Aussi le solde était-il temporairement amélioré de plus de 10 milliards d'euros.
Ce chiffre peut être retrouvé facilement : il correspond peu ou prou à 2 % des 500 milliards d'euros de recettes de cette année. Autrement dit, la sécurité sociale était en réalité en situation de déficit structurel de plus de 10 milliards d'euros en 2019, sans que nous en ayons forcément conscience. À l'heure actuelle, le PIB est un peu en dessous de son niveau « normal ». Ainsi, la conjoncture dégrade le solde de 13 milliards d'euros par rapport à 2019.
Le fait que depuis 2019 le taux de croissance des dépenses ait été supérieur à celui du PIB potentiel a aggravé le déficit 2024 de 20 milliards d'euros. Cela correspond à peu près au montant cumulé du Ségur de la santé et des mesures de compensation de l'inflation décidées à la suite de la crise sanitaire. Peut-être aussi que la politique des années 2010 n'était pas totalement soutenable.
Ces deux chiffres traduisent chacun une limite de la politique de retour à l'équilibre de la décennie 2010. Dans le contexte actuel, il est important d'en avoir conscience.
Par ailleurs, les mesures nettes d'augmentation des recettes représentaient environ 8 milliards d'euros. Paradoxalement, les recettes ont eu tendance sur la période à augmenter spontanément plus vite que le PIB potentiel, malgré la forte hausse des niches en 2022-2023.
Nous allons revenir sur le déficit année par année pour bien comprendre de quoi il retourne. Pour cela, nous avons réalisé un graphique décomposant le solde de la sécurité sociale. Comme le précédent, ce graphique n'existe pas ailleurs. En effet, la direction de la sécurité sociale (DSS) ne s'intéresse pas aux notions de solde structurel et d'effort structurel, et Bercy ne s'intéresse pas au périmètre de la sécurité sociale. Il en résulte une analyse incomplète des déterminants de l'évolution du solde de la sécurité sociale.
Notre graphique indique, pour chaque année depuis 2010, non seulement le déficit de la sécurité sociale, que chacun connaît, mais également le solde conjoncturel, qui résulte du fait que le PIB est au-dessus ou en dessous de son niveau « normal », et le déficit structurel, c'est-à-dire le déficit corrigé des fluctuations de la conjoncture.
Pour comprendre les effets réels de la politique du Gouvernement, il faut se pencher sur le déficit structurel. Si, dans la première moitié des années 2010, la réduction du déficit a été structurelle, avec un quasi-retour à l'équilibre structurel, l'effort s'est ensuite relâché. En effet, comme je vous l'ai dit, le déficit structurel avait à nouveau atteint plus de 10 milliards d'euros en 2019. Nous ne nous en rendions alors pas compte parce que l'excédent conjoncturel le masquait.
Nous avons cherché à comprendre ce qui s'est passé dans les années 2010.
Nous avons d'abord adopté une approche en termes de solde structurel et d'effort structurel. Dans le cas des dépenses, cette approche considère, par convention, qu'il n'y a pas d'effort sur la dépense lorsque celle-ci augmente au même taux que le PIB potentiel, et ce même si un effort considérable a dû être consenti pour qu'elle n'augmente pas davantage - par exemple dans le cas de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam).
Nous n'observons un effort structurel significatif sur les recettes que dans la première moitié des années 2010. Celui-ci a uniquement consisté en des augmentations de recettes. L'effort structurel sur les dépenses a, pour sa part, été négatif. Autrement dit, les dépenses ont augmenté plus vite que le PIB potentiel.
Par ailleurs, les mesures concrètes qui ont été prises dans les années 2010 sur les recettes et les dépenses, qui sont d'un montant global de 75 milliards d'euros - soit 8 milliards d'euros par an -, ont porté pour les deux tiers sur les dépenses. Toutefois, les mesures sur les recettes ont uniquement concerné la première partie de la période.
Pour schématiser, des mesures d'économies étaient réalisées chaque année sur l'Ondam pour 4 milliards d'euros, et sur les retraites pour un 1 milliard d'euros. Dans la première moitié de la période, cela s'est accompagné de mesures sur les recettes : chaque année pendant quatre ans, des mesures d'augmentation des recettes s'élevant à environ 6,5 milliards d'euros ont été prises.
Nous nous sommes demandé dans quelle mesure le Ségur et les mesures liées à l'inflation avaient annulé l'effort de maîtrise de l'Ondam des années 2010. En retenant l'hypothèse d'un taux de croissance tendanciel de l'Ondam de 4,5 % en valeur depuis 2019, le Ségur et les mesures inflation n'auraient pas annulé l'effort de maîtrise de l'Ondam des années 2010, mais l'auraient réduit d'environ un tiers.
Nous avons abondamment parlé, l'année dernière, de la forte croissance des niches sociales après la crise sanitaire. Le coût des allégements généraux de cotisations patronales est passé de 50 milliards d'euros en 2020 à 65 milliards d'euros en 2023. En effet, de nombreux salariés supplémentaires ont été rattrapés par le niveau du Smic, revalorisé du fait de l'inflation, d'où cette hausse du coût total des allégements. Toutefois, en 2024, ces derniers ont légèrement diminué ; ils auraient stagné sans le gel des « bandeaux ». Il ressort du rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) que, même en neutralisant la baisse de 2 milliards d'euros consécutive à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2025, la stagnation devrait se poursuivre en 2025. Il est vraisemblable que, le Smic suivant l'inflation, lesdits allégements généraux aient pris de l'avance pendant les périodes où elle était élevée, augmentant moins vite que la masse salariale au cours des années suivantes.
Quant aux exemptions d'assiette, c'est-à-dire l'essentiel des niches sur les compléments de salaire, elles ont fortement augmenté en 2022. La Cour des comptes a critiqué cette hausse dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2024.
Nous nous sommes efforcées de synthétiser les compensations des niches sociales. Le montant total des niches et allégements dépasse 100 milliards d'euros. Contrairement aux tableaux de l'annexe du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) relative aux niches sociales, qui présentent un montant plus bas, nous prenons en compte la totalité des niches, dont les taux réduits de CSG et l'exemption de la prime de partage de la valeur (PPV), dont le coût est nul selon le Gouvernement, alors que la Cour des comptes l'estime à 1,1 milliard d'euros en 2023. Ainsi, sur l'ensemble, 35 milliards d'euros ne seraient pas compensés.
Dans ce cadre, le principal cas manifeste de non-respect de la loi est celui de l'exemption de PPV. Certes, pour les allégements généraux, la compensation du bandeau maladie serait inférieure de 5,5 milliards d'euros au coût, la part de TVA affectée à la sécurité sociale en 2019 ayant été, selon la Cour, mal calculée. Toutefois cette compensation correspond bien à celle prévue par la LFSS pour 2019. De même, la non-compensation, que l'on peut déplorer, de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires, découle de la LFSS 2019. S'ajoutent un certain nombre de niches antérieures à la loi Veil du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, qui instaure l'obligation d'une compensation. Dans certains cas, elles font l'objet d'une dérogation législative explicite. Il est possible que quelques niches ne soient pas compensées alors qu'elles devraient l'être, mais nous n'avons pas eu le temps de les examiner une à une.
Le bandeau maladie a été instauré en 2019, en remplacement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). La baisse de 6 points des cotisations maladie, soit 19,8 milliards d'euros en 2019, n'a été compensée que par une fraction de 9,79 points de TVA, soit 17,4 milliards d'euros, soit une sous-compensation de 2,4 milliards d'euros, qui fluctue depuis lors selon le plus ou moins grand dynamisme de la TVA. À long terme, la TVA évolue comme le PIB en valeur, et cette compensation est donc peu susceptible d'être rognée : le problème réside donc non pas dans le principe d'y recourir, mais dans la sous-compensation décidée par le législateur.
Nous en arrivons au déficit de la sécurité sociale. De manière provocatrice, je dirais d'emblée que celui-ci n'existe pas ! Mais rassurez-vous : nous vous expliquerons tout de même pourquoi il faut le résorber...
Évitons les fausses polémiques. On peut comparer le solde de la sécurité sociale avec celui de divers périmètres plus larges. La Cades est par nature excédentaire de 15 milliards à 20 milliards d'euros par an, ce qui lui permet d'amortir la dette sociale. En l'agrégeant à la sécurité sociale, l'ensemble est à l'équilibre en 2024 et ne devient déficitaire qu'en 2025. La situation est analogue pour le solde global des administrations de sécurité sociale (Asso), lequel inclut également, notamment, les organismes de régimes complémentaires de retraite et l'assurance chômage.
Une autre raison pour laquelle la notion de déficit de la sécurité sociale a peu de sens est que si ses dépenses correspondent à une réalité physique, ses recettes résultent d'une convention juridique. Cela peut amener à relativiser voire à nier l'existence de ce déficit ou, au contraire, à considérer qu'il est gravement sous-estimé, comme le montre la polémique autour d'un prétendu déficit caché du système de retraites.
Cela étant, la sécurité sociale n'a pas vocation à être en déséquilibre, puisque cela reviendrait à faire payer les prestations actuelles par les générations futures : ce n'est pas ainsi que la solidarité nationale doit fonctionner. En outre, en cas de nouvelle crise, la sécurité sociale aurait des difficultés à jouer son rôle d'amortisseur social contracyclique : il serait difficile d'augmenter encore le déficit de 40 milliards d'euros si celui-ci est déjà de 25 milliards d'euros. Par ailleurs, si nous ne faisons rien, nous risquons une crise de liquidité à brève échéance. Enfin, le déficit des administrations publiques, de 5,8 points de PIB en 2024 - le plus élevé de la zone euro - n'est pas soutenable, et l'effort ne peut reposer sur les seuls État et collectivités locales. La sécurité sociale doit revenir à l'équilibre pour contribuer à cet effort.
Ramener le déficit à 3 points de PIB en 2029 impliquerait de prendre des mesures d'environ 170 milliards d'euros sur les dépenses et les recettes pour l'ensemble des administrations publiques. Or, pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre à cette même échéance, l'effort représente environ 40 milliards d'euros, soit un quart du total, alors que la sécurité sociale représente 40 % des dépenses publiques. Toutefois, nous ne proposons pas d'aller au-delà du retour à l'équilibre.
Pour sortir d'une vision à court terme et éviter une simple liste de mesures « à la Prévert », nous avons réalisé des projections à long terme à politiques inchangées, en nous appuyant sur celles réalisées par d'autres organes, comme le COR, en les mettant en cohérence entre elles et avec le périmètre de la sécurité sociale. Ces projections vont jusqu'à 2070, même si évidemment à cette échéance les résultats sont très incertains.
Ces projections suggèrent que, si l'on n'agit pas sur la dynamique tendancielle des dépenses et des recettes, le déficit de la sécurité sociale pourrait exploser et atteindre 3 points de PIB en 2040, et 9 points en 2070. Ce scénario n'a pas beaucoup de sens, car il suppose de laisser advenir une hausse annuelle de 4 % des dépenses d'assurance maladie, ce qui ne sera évidemment pas le cas.
Ainsi, nous avons conçu un scénario dit de « stabilisation maladie », c'est-à-dire comprenant une stabilité des dépenses de l'assurance maladie en points de PIB, correspondant à peu près à l'hypothèse de la LFSS 2025 jusqu'à l'année 2028. Cela suppose quelque 4 milliards d'euros d'économies par an. Conformément à la logique du rapport, ce scénario n'a rien de prescriptif, même si nous convenons qu'il ne faut pas laisser filer les dépenses. Dans ce cadre, le déficit atteindrait 1,4 point de PIB en 2040 et 3 points en 2070. Cela reste important dans l'absolu : sur la base du PIB actuel, le déficit serait d'environ 45 milliards d'euros en 2040. La moitié de ce déficit serait imputable aux retraites.
La diminution des recettes en points de PIB - de 1,4 point d'ici à 2070 - s'explique pour les deux tiers des retraites - baisse de la part relative des régimes équilibrés par l'État - et pour un tiers de la branche maladie, dont les recettes augmentent spontanément moins vite que le PIB - du fait notamment de la diminution du rendement des droits sur les tabacs.
La maîtrise des dépenses de la branche maladie est, de loin, l'enjeu financier le plus important. En effet, comme le souligne le COR, les dépenses liées aux retraites sont stables en proportion du PIB : le déficit de la branche vieillesse est lié à la diminution de la part des régimes équilibrés par l'État. Par ailleurs, à politique inchangée, les dépenses de la branche autonomie augmenteraient de 0,6 point de PIB sur la période. C'est beaucoup à l'échelle de la branche, mais très peu à celle de la sécurité sociale.
Entre 2024 et 2070, l'évolution spontanée des dépenses des branches est variable. Ainsi, sans contrainte sur la branche maladie, les dépenses de la sécurité sociale augmenteraient de 6,4 points de PIB sur la période, ce qui n'est pas soutenable. En revanche, si les dépenses de l'assurance maladie étaient stables en points de PIB, la hausse globale serait bien plus faible. Ainsi, les dépenses de la branche vieillesse augmenteraient de 0,4 point de PIB, celles de la branche autonomie de 0,6 point, et celles de la branche famille, essentiellement indexées sur l'inflation, baisseraient.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Nous en venons aux moyens de ramener la sécurité sociale à l'équilibre. Ce n'est pas techniquement difficile, le défi est surtout de nature politique. Ce qui sera en revanche techniquement difficile, c'est de maintenir cet équilibre.
La première question est celle de l'échéance. Le Gouvernement démissionnaire souhaitait un retour à l'équilibre en 2029. Ainsi, la ministre chargée des comptes publics a fait état de cet objectif, notamment au Sénat le 28 mai dernier. Pour ma part, je n'ai pris conscience de cet objectif que lors de l'audition du directeur de la sécurité sociale, le 15 mai dernier. Il est en effet frappant qu'un tel objectif de retour à l'équilibre ne figure dans aucun document, particulièrement parmi les annexes de la loi de financement de la sécurité sociale, dont l'usage est qu'elles s'entendent à droit inchangé.
Or il serait utile de disposer d'un document décrivant où nous allons, ne serait-ce que pour rassurer les créanciers de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). En effet, les marchés ne détestent rien plus que l'incertitude.
Le premier de nos points d'accord est donc la nécessité de ramener la sécurité sociale à l'équilibre structurel, si possible en 2029 et au plus tard en 2035. Dans les années 2010, la sécurité sociale a été ramenée à l'équilibre structurel dès 2014, le solde s'étant dégradé ensuite. Ce n'est donc pas irréaliste. S'il paraît difficile, compte tenu du contexte politique et économique, d'atteindre cet objectif en quatre exercices, l'échéance de 2035 nous paraît néanmoins impérative. En effet, un nouveau transfert de dette sociale à la Cades serait alors peut-être impossible sans augmentation des ressources de la Cades.
Examinons d'un point de vue arithmétique les contraintes d'un retour à l'équilibre. Si l'échéance visée est 2029 par exemple - cela n'est pas prescriptif -, nous savons qu'il faudra prendre des mesures de réduction des dépenses et d'augmentation des recettes à hauteur d'environ 40 milliards d'euros.
Regardons maintenant ce que disent les modèles de simulation respectifs de la direction du Trésor - Mésange - et de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) - EmeRaude -, afin de déterminer s'il est plus efficace, pour réduire le déficit, d'augmenter les recettes ou de réduire les dépenses d'un montant donné. En d'autres termes, quel est l'effet sur le solde des administrations publiques d'une augmentation des recettes ou d'une diminution des dépenses d'un point de PIB, soit 30 milliards d'euros ? Je rappelle que 30 milliards d'euros cela représente l'équivalent de 5 points de cotisations employeur, 4 points de cotisations salarié, 2 points de TVA ou 1,7 point de CSG.
Il apparaît, selon les deux modèles, que la réduction des dépenses est, à court terme, la solution la moins efficace pour réduire le déficit, en raison de son effet récessif, mais il s'agit à long terme de la mesure la plus efficace, notamment parce qu'elle n'a pas d'effet néfaste sur l'investissement.
En outre, pour les deux modèles, dans le cas de la TVA et de la CSG, l'amélioration du solde est la première année quasiment égale au montant de la mesure, mais comme le PIB est réduit à long terme, son effet est plus faible à long terme - divisé par deux en dix ans.
En revanche, les deux modèles sont en désaccord sur les conséquences d'une augmentation des cotisations employeur ou salarié. Il est ici question d'une augmentation uniforme : il ne s'agit pas de savoir ce qui se passerait en cas de réduction des allégements généraux, le Trésor et l'OFCE étant à peu près d'accord sur les destructions d'emplois qui résulteraient de telles mesures. Selon le Trésor, les cotisations ont un effet tellement récessif, à cause des emplois détruits, qu'à long terme l'amélioration du solde public serait nulle. En revanche, selon l'OFCE, il n'y aurait pas d'effet particulier sur l'emploi, et l'effet serait le même que pour les autres augmentations de prélèvements.
Même si nous parvenions à ramener la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, nous ne serions pas nécessairement tirés d'affaire. Lors de leur audition, les responsables de l'Acoss ont ainsi clairement tiré le signal d'alarme. Comme vous le savez, la sécurité sociale n'est pas censée être en déficit. La fonction normale de l'Acoss est de financer le besoin de trésorerie venant du fait que les recettes et les dépenses n'ont pas lieu les mêmes jours du mois. Pour cette raison, la loi n'autorise l'Acoss à s'endetter qu'à court terme, même si nous avons augmenté le délai en question d'un an dans le dernier PLFSS.
Toutefois, en l'absence de transfert de dette à la Cades, le déficit cumulé de la sécurité sociale doit aussi être financé par l'Acoss. Les responsables de l'Acoss nous ont indiqué que, à la fin de 2025, leur besoin de trésorerie devrait être proche du plafond de 65 milliards d'euros fixé par la LFSS 2025. Les années suivantes, ce besoin devrait augmenter chaque année du montant du déficit, ce qui amènerait à dépasser le seuil de 100 milliards d'euros en 2027.
À titre de comparaison, pendant la crise sanitaire, quand l'Acoss n'était pas parvenue à se financer sur les marchés et qu'il avait fallu recourir en urgence à la Caisse des dépôts et consignations et à des banques notamment pour financer les retraites, le besoin de trésorerie maximal sur l'année avait seulement été de 90 milliards d'euros.
Les responsables de l'Acoss ont considéré qu'il n'était pas évident que l'on puisse reproduire sur la durée ce qu'on avait fait de manière ponctuelle en 2020, surtout si le déficit continue de croître, sans perspectives d'amélioration. Ils ont donc estimé que la situation pouvait rapidement devenir problématique, dès 2027. Selon eux, nous entrerons à la fin de 2025, donc demain, en zone de risque.
Il faut donc transférer rapidement de la dette de l'Acoss à la Cades. Comme le montre l'historique des amortissements de dette réalisé par la Cades, plus le temps a passé, plus on a transféré des sommes importantes à la Cades, et plus la durée d'amortissement a été importante : elle a été de treize ans pour le transfert suivant la crise des dettes souveraines et pour le transfert consécutif à la crise sanitaire, alors que, par le passé, les sommes étaient moins élevées et étaient plus vite remboursées.
On pourrait avoir l'impression que la Cades est une sorte de solution magique permettant d'effacer la dette sociale. En réalité, il ne faut pas perdre de vue que l'amortissement de sa dette prend un certain temps, qui dépend notamment du montant de dette transféré et des ressources qu'on lui affecte.
Jusqu'à présent, nous avons fait en sorte que ses ressources lui permettent d'amortir sa dette une dizaine d'années après le début du transfert. Quel serait cependant l'encours de dette de la Cades sans augmentation de ses ressources ? Nous avons simulé deux scénarios indicatifs, l'un avec un retour à l'équilibre en 2029, l'autre avec un retour en 2035, et un transfert qui débute dans les deux cas dès 2026. On constate que l'encours augmenterait dans un premier temps, puis que la Cades commencerait à amortir la nouvelle dette à partir de 2033, une fois le stock de dette actuel amorti. En cas de retour de la sécurité sociale à l'équilibre en 2029, la courbe d'amortissement pourrait être analogue à celle des derniers transferts - la durée d'amortissement pouvant même être un peu plus courte -, mais si l'équilibre est atteint en 2035, alors l'encours de dette maximal et la durée d'amortissement seraient sans précédent. En d'autres termes, plus nous tardons à transférer la dette, moins la mesure est profitable.
Nous pourrions considérer qu'une durée d'amortissement de quinze ans telle que celle que suggère le second scénario serait supportable, mais que se passerait-il si le retour de la sécurité sociale à l'équilibre était tardif au point de susciter une durée d'amortissement de vingt ans, par exemple ? Cela ne serait-il pas perçu par les investisseurs comme un abandon de fait du principe d'équilibre de la sécurité sociale ? Cela aurait-il encore un sens de continuer à faire amortir la dette sociale par la Cades ? Le rapport ne prend évidemment pas position sur cette question.
Les analyses qui précèdent nous ont conduites à trois nouveaux points d'accord. Comme les précédents, ceux-ci ne concernent pas des mesures concrètes sur les dépenses ou les recettes, mais des objectifs et des règles de gouvernance. Les points d'accord nos 4, 5 et 6 n'ont rien de nouveau, et correspondent à des préconisations précédentes de notre commission.
Le point d'accord n° 4 consiste à se doter rapidement - en toute rigueur, il faudrait le faire dès cet automne - d'une trajectoire crédible de retour à l'équilibre de la sécurité sociale. Quand nous disposerons d'une trajectoire explicite et crédible, il sera possible de réaliser un nouveau transfert de dette à la Cades, en lui fixant une nouvelle date butoir.
Comme l'échéance actuelle de 2033 est définie par une disposition organique, un nouveau transfert de dette impliquera une disposition de cette nature. Bien entendu, il serait très difficile que le Parlement s'entende sur un tel plan cet automne. Toutefois il y a réellement urgence.
J'en viens au renforcement de la gouvernance de la branche maladie. Ainsi que Mme Poncet Monge l'a rappelé à l'instant, l'assurance maladie est comme l'éléphant dans la pièce. Pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre, l'un des principaux enjeux est de reprendre le contrôle de l'Ondam, comme nous le rappelle l'avis de juin dernier du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
Dans un graphique illustrant le besoin d'un Ondam réaliste et respecté, nous indiquons le montant de l'Ondam en exécution, le niveau des programmations successives des LFSS et des lois de programmation des finances publiques, ainsi que les dépassements de l'Ondam. En effet, après avoir été respecté entre 2011 et 2019, l'Ondam est depuis systématiquement dépassé.
Le Gouvernement ayant indiqué l'importance qu'il accordait au retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, nous aurions pu supposer ou du moins espérer que l'Ondam repasse sous contrôle en 2025. Or le comité d'alerte a estimé en juin dernier qu'il existait un « risque sérieux » que l'Ondam soit dépassé de plus de 0,5 %, soit de 1,3 milliard d'euros. Le dernier avis du comité d'alerte, publié la semaine dernière, suggère que les mesures annoncées par le Gouvernement, qu'il évalue à 1,5 milliard d'euros, contre 1,7 milliard d'euros pour le Gouvernement, pourraient ne pas complètement suffire à respecter l'Ondam.
Il y a en fait deux problèmes : d'une part, depuis la crise sanitaire, les prévisions sont systématiquement optimistes ; ensuite, les instruments de régulation infra-annuelle doivent être renforcés.
Le Gouvernement a communiqué en début d'année sur l'augmentation du montant de la réserve prudentielle, qui a été portée à 0,4 % en 2025. Rappelons toutefois que cette réserve ne concerne pas les soins de ville, et qu'elle a notamment pour effet de transférer du déficit de la sécurité sociale vers les hôpitaux, ce qui ne présente pas d'intérêt.
Il en découle notre point d'accord n° 7, relatif à la mise en place d'une gouvernance effective de l'Ondam. Le rapport présente diverses pistes de mise en oeuvre, bien entendu sans prendre parti.
J'en viens à la dernière partie de mon exposé. Le retour de la sécurité sociale à l'équilibre n'est pas techniquement compliqué, les principales difficultés étant de nature politique, comme je l'ai déjà indiqué. En revanche, il sera techniquement plus compliqué de maintenir la sécurité sociale à l'équilibre sur la durée.
Il est frappant de voir qu'alors que le débat se focalise sur les retraites, et dans une moindre mesure sur l'autonomie, nous parlons très peu du financement des dépenses de santé, qui est pourtant l'éléphant dans la pièce. En effet, si nous ne faisons rien, les dépenses de la branche maladie pourraient passer de 8,6 points de PIB actuellement à 10,5 points de PIB en 2040 et 14,5 points de PIB en 2070.
À cela s'ajoute le fait que les recettes de la branche maladie tendent spontanément à augmenter un peu moins vite que la richesse nationale. En effet, selon la Cnam, le taux de croissance spontané des recettes de l'assurance maladie est actuellement inférieur d'environ 0,3 point à celui du PIB en valeur, du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac. Autrement dit, c'est comme si l'on prenait chaque année des mesures d'environ 0,75 milliard d'euros pour réduire les recettes de la Cnam. Ainsi, même si les dépenses étaient stabilisées en points de PIB, en l'absence de mesures d'augmentation des recettes, le déficit augmenterait.
Évidemment ce scénario ne se produira pas, parce qu'il ne serait pas soutenable financièrement. Si les dépenses de santé n'étaient pas maîtrisées, nous constaterions probablement leur désocialisation croissante et l'augmentation des inégalités d'accès aux soins.
Nous avons essayé de sortir un peu le nez du guidon et des prévisions à moyen terme des LFSS pour regarder ce que les économistes disent au sujet des déterminants à long terme de la croissance spontanée des dépenses de santé, afin de bien comprendre la nature du problème. Selon l'OCDE, les dépenses de santé de la France devraient mécaniquement augmenter de 2,2 % par an en volume entre 2022 et 2040. L'OCDE ne précise pas cette évolution en valeur, mais en prenant en compte une inflation de 1,8 %, l'augmentation serait de 4 %, proche de l'estimation de la croissance spontanée de l'Ondam, qui, je vous le rappelle, est de 4,5 %. Je précise que les économistes appellent « l'effet Baumol » la tendance des salaires à augmenter plus vite que leur productivité dans certains secteurs.
Bien entendu, le Gouvernement ne laisse pas les dépenses d'assurance maladie filer, et réalise bien près de 4 milliards d'euros d'économies par an. Toutefois il n'existe quasiment pas de suivi des mesures en exécution. Les principales données, prévisionnelles, se trouvent dans l'annexe au PLFSS relative à l'Ondam. En 2022 et en 2023, le Gouvernement n'a affiché aucun objectif pour les établissements hospitaliers ; depuis, les annexes sont devenues très vagues.
Nous avons réalisé un tableau rappelant les mesures prévisionnelles de maîtrise de l'Ondam sur la période 2015-2021, selon les documents annexés aux PLFSS. Ce tableau est par ailleurs incomplet, car il ne prend pas en compte, par exemple, les efforts sur la masse salariale des établissements de santé. Sur cette période, les mesures prévues étaient d'environ 4 milliards d'euros par an ; en exécution, elles ont forcément été plus faibles.
Nous proposons une typologie répartissant les mesures en trois catégories, selon qu'elles visent à agir sur les volumes, sur les prix ou à reporter l'effort sur les patients et les complémentaires santé. Sur les 4 milliards d'euros d'économies annuelles, 2,5 milliards d'euros auraient porté sur les prix, essentiellement sur ceux des médicaments et des achats hospitaliers. Il n'est pas évident que la régulation puisse porter majoritairement sur les prix pendant plusieurs décennies. En fait, pour agir efficacement sur la dépense, il faut vraisemblablement davantage agir sur les volumes, en ciblant les inefficiences.
Malheureusement, il n'existe pas en France de chiffrage des dépenses de santé inefficientes, que l'on peut appeler, au sens large, les gaspillages. Nous nous sommes efforcées de réaliser un tel chiffrage, en précisant lorsque nous nous appuyons sur des sources précises ou sur de simples hypothèses. Il ressort de nos réflexions que les inefficiences correspondraient à environ un quart des dépenses de santé, conformément aux estimations usuelles pour les pays de l'OCDE, qui se situent entre 20 % et 30 %.
Toutefois, si l'on regarde précisément chaque composante, on se rend compte que si ces inefficiences existent, c'est parce que leur réduction se heurte souvent à un obstacle économique ou politique. Par exemple, les possibilités de prévention manquées correspondent à peut-être 8 % des dépenses. Mais que fait-on ? Il est sans doute possible d'améliorer la prévention tertiaire, c'est-à-dire celle qui concerne les personnes déjà malades, en assurant un meilleur suivi. Cependant, il semble peu probable que la France décide de mettre en place, par exemple, une véritable politique pour lutter contre la consommation nocive d'alcool.
L'OCDE estime que ses États membres pourraient diviser les inefficiences de leurs dépenses de santé par deux, et nous nous sommes intéressées à ce sujet. Rappelons-le, il y a quelques années, on ne s'intéressait pas encore à la fraude, et c'est à la suite de travaux du Sénat que l'on a commencé à évaluer son montant et que la lutte contre la fraude a été renforcée. Pourquoi dès lors ne pas travailler sur le gaspillage qui existe dans tous les pays, qui est d'ailleurs évalué aux États-Unis ou dans d'autres pays européens ?
Le rapport ne prend évidemment pas position sur ce qu'il convient de faire concrètement. Nous rappelons simplement les principales pistes habituellement évoquées, comme l'amélioration des parcours de soins ou le renforcement de la prévention, tout en soulignant l'aspect politique de certaines décisions. Par exemple, techniquement, il serait possible de contraindre les médecins à renseigner l'indication thérapeutique dans l'ordonnance électronique, comme le préconise le président du HCAAM, mais cette mesure impliquerait un débat politique approfondi.
Cela m'amène à deux nouveaux points d'accord, qui concernent également la seule gouvernance. Le point d'accord n° 8 est que nous avons besoin de disposer régulièrement d'un rapport approfondi comportant des projections à long terme et chiffrant les inefficiences. Il s'agit non pas, comme pour la plupart des demandes de rapport, de demander à l'administration de faire en quelque sorte notre travail à notre place, mais bien de contribuer à créer une dynamique. Ce rapport devra donc être médiatisé. La réalisation de chiffrages a contribué à renforcer la lutte contre la fraude ; de même, le chiffrage des inefficiences du système de santé pourrait inciter les uns et les autres, y compris les usagers, à en faire plus pour les réduire.
Le point d'accord n° 9 a pour but de favoriser le développement d'un écosystème, notamment universitaire, pour réfléchir aux questions d'efficience dans le domaine de la santé. En particulier, nous ne pouvons pas continuer de nous réveiller à la fin de chaque printemps en nous demandant quelles mesures d'économies sur l'Ondam nous allons bien pouvoir prendre dans le prochain PLFSS.
Autant les enjeux financiers sont considérables dans le cas de la branche maladie, celle-ci pouvant à elle seule rendre les finances publiques non soutenables, les aspects techniques y étant également très complexes, autant dans le cas de la branche vieillesse, les questions sont avant tout politiques.
Les dépenses de la branche vieillesse sont en effet stables en points de PIB. Le sujet, c'est que ses recettes baissent, à cause de la part relative des régimes équilibrés par l'État. Dans son dernier rapport, le COR projette pour 2070 un déficit de 1,4 point de PIB pour l'ensemble du système de retraite. Comme nous nous intéressons ici à la seule branche vieillesse, il faut retirer les régimes complémentaires, ce qui conduit à un déficit de 1,6 point de PIB en 2070.
Nous ne disons rien d'extraordinaire sur les retraites dans notre rapport. Celui-ci se contente pour l'essentiel de reprendre, sans prendre parti, les chiffrages figurant dans le rapport de la Cour des comptes de février dernier. Il comprend en outre des développements nuancés sur le financement des retraites au moyen de fonds, qu'il s'agisse de fonds de pension ou du FRR, en rappelant les arguments en sa faveur comme en sa défaveur. Dans l'hypothèse où le recours à des fonds serait développé, le rapport envisage, en présentant cela comme un scénario parmi d'autres, d'en charger le FRR, dont les dirigeants, lors d'une audition très intéressante, nous ont dit explicitement qu'il pourrait assurer la gestion d'un tel dispositif.
Les dépenses de la branche autonomie devraient accélérer à partir de 2030, du fait de l'arrivée à l'âge de la perte d'autonomie des baby-boomers, le déficit pouvant atteindre 0,6 point de PIB en 2070. Ce chiffre n'est pas colossal au regard de l'ensemble des finances publiques, mais il l'est par rapport au financement de la branche.
Dans un graphique, nous comparons nos projections des dépenses de la branche autonomie du rapport avec d'autres projections, ce qui permet de mettre en évidence un fort aléa à la hausse. Les projections de la Commission européenne concernent la totalité des dépenses publiques, à la fois pour les handicapés et pour les personnes âgées dépendantes. Il est intéressant de remarquer - c'est vraiment un point d'attention - que l'un de ses scénarios, impliquant une forte augmentation des dépenses en points de PIB, n'est pas établi à politiques inchangées, mais suppose qu'en France, pour chaque tranche d'âge, la probabilité d'être pris en charge et le coût de la prise en charge seront alignés sur la moyenne de l'Union européenne. Le rapport de la Commission européenne ne permet pas de voir précisément en quoi la France serait actuellement moins généreuse que ses voisins, mais il faut retenir que réfléchir à politiques inchangées n'est pas forcément la manière la plus adéquate pour projeter l'évolution des dépenses de la branche autonomie.
Sur les mesures à prendre pour financer l'autonomie, le rapport se borne à rappeler les principales propositions du rapport La Branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement de Laurent Vachey de 2020 et de celui du Conseil économique, social et environnemental (Cese) de 2024. Cela nous conduit à notre dernier point d'accord, qui est simplement qu'il faut enfin décider ce qu'on fait sur l'autonomie, au lieu de revenir sur le sujet à chaque PLFSS ou à l'occasion de l'examen de propositions de loi.
Nous avons vu tout à l'heure que si la France est le pays dont les dépenses sociales sont les plus élevées en points de PIB, ce constat n'est plus vrai si nous raisonnons en euros par habitant, la France étant, pour reprendre une expression utilisée par Gilbert Cette lors de son audition, « pauvre parmi les riches ». D'où l'idée, fréquemment mise en avant, d'augmenter le PIB pour réduire le déficit de la sécurité sociale, et plus généralement des administrations publiques. Gilbert Cette, lors de son audition, nous a transmis un graphique qui indique l'écart de PIB par habitant de différents pays par rapport aux États-Unis, en le décomposant entre ses différentes causes.
Les deux principaux éléments qui font que le PIB par habitant est plus faible en France qu'aux États-Unis sont la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle l'économie utilise le travail et le capital, que l'on appelle souvent le progrès technique, et le nombre d'heures de travail par travailleur.
Ensuite, si l'on compare la France aux autres pays, en particulier européens, on voit que la faiblesse de notre taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes en âge de travailler ayant un emploi, pèse sur notre PIB par habitant. Aligner le nombre d'heures de travail par travailleur sur celui des États-Unis serait la mesure la plus efficace, mais elle est probablement impossible politiquement. Aussi, les économistes préconisent plutôt de chercher à augmenter le taux d'emploi, pour corriger notre principale anomalie par rapport à l'Allemagne ou aux Pays-Bas.
La manière la plus simple et la plus fiable d'augmenter le PIB à moyen terme, c'est d'augmenter la quantité de travail. Si l'on compare la France à ses voisins, on voit que ce qui la distingue, c'est un faible taux d'emploi des jeunes et des seniors. Si ce taux d'emploi était similaire à celui de l'Allemagne, il n'y aurait quasiment plus de déficit de la sécurité sociale.
Le rapport ne prend pas parti à ce sujet. Il souligne notamment la difficulté politique actuelle à reculer encore l'âge de départ à la retraite, la complexité de la question de l'emploi des jeunes, et le fait qu'il serait probablement plus facile de faire que les gens travaillent plus si les conditions de travail étaient meilleures. Il envisage une autre manière d'augmenter le temps de travail, qui est d'augmenter la durée du travail de ceux qui ont un emploi. Nous présentons quelques pistes à ce propos, en soulignant que le sujet n'est pas consensuel au sein de la commission.
Je remercie le président de la Mecss, Alain Milon, pour la confiance qu'il nous a témoignée, ainsi que Raymonde Poncet Monge pour son investissement. Son regard d'économiste nous a été précieux. Nous sommes toutes deux très heureuses d'avoir trouvé des points d'accord au cours de ce travail d'ampleur.
Ce rapport, en particulier l'annexe IV, qui comporte le chiffrage des principales mesures évoquées dans le débat public, pourra servir à chacun d'entre vous lors de l'examen du prochain PLFSS.
M. Alain Milon, président de la Mecss. - Je vous invite à lire ce rapport très complet, ainsi que ses annexes, qui devraient vous donner matière à déposer des amendements au PLFSS 2026.
Le véritable problème de l'assurance maladie tient aux recettes. Lors de la mandature de François Hollande, les budgets ont certes été respectés, mais les dépenses étant contraintes par un Ondam en progression de seulement 1,7 %, de nombreux hôpitaux étaient en déficit et la délivrance de certains soins était restreinte. Il faudrait faire en sorte de trouver les recettes pour financer une progression de 4 % de l'Ondam.
Ma seule réserve sur ce rapport concerne l'allongement de la durée d'amortissement de la Cades, qui prolongera d'autant la CRDS, qui n'est assise que sur les revenus d'activité ou de remplacement.
Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour ce travail magnifique et pour les points d'accord que vous avez su trouver.
M. Olivier Henno. - Je salue à mon tour le travail des rapporteures.
J'ai parfois l'impression que l'on a perdu le volant pour conduire l'assurance maladie et que, contrairement à ce qui se passe dans les autres branches de la sécurité sociale, il n'y a plus réellement de pilotage. Au-delà des choix politiques que nous pouvons faire, force est de constater que nous ne maîtrisons plus les dérapages. Or je ne suis pas certain que notre mode d'organisation nous permette de reprendre le contrôle, et si tel n'est pas le cas, il nous faudra sans doute engager de lourdes réformes structurelles pour remédier à cette situation. Partagez-vous cette inquiétude ?
M. Khalifé Khalifé. - Je remercie à mon tour nos collègues pour ce travail de qualité. Je regrette toutefois que certains diagnostics, par exemple sur la durée du travail, soient à ce point occultés en dehors de cette enceinte.
Je regrette également le défaut de gouvernance de la sécurité sociale. Il faut bien dire que l'on ne contrôle plus rien - la financiarisation de la médecine en est un exemple parmi d'autres. Les prescriptions ne sont plus encadrées, si bien que c'est désormais open bar. En tant qu'ancien praticien, je le déplore.
M. Daniel Chasseing. - En ce qui concerne les retraites, le rapport ne tranche pas la question d'un éventuel abaissement de l'âge de départ à la retraite, mais je ne vois pas comment nous pourrions équilibrer notre système si nous prenions une telle décision.
Pour ce qui est de l'autonomie, compte tenu du doublement attendu du nombre de personnes de plus de 85 ans entre 2020 et 2040, il est grand temps d'adopter un plan Grand Âge.
L'augmentation des dépenses de la branche maladie appelle une augmentation des recettes. En 2012, 2 millions de personnes étaient en ALD, contre 13 millions aujourd'hui. Or ces prises en charge représentent 85 % des dépenses de l'assurance maladie. Le remboursement des médicaments et des dépassements d'honoraires pourrait certes être restreint aux besoins en lien avec l'affection concernée, et nous pourrions faire des progrès en matière de prévention et d'encadrement des arrêts de travail, mais compte tenu de l'augmentation du nombre de patients en ALD, il sera difficile de faire 4 milliards d'euros d'économie.
Si cela paraît difficilement envisageable pour l'heure, il serait par ailleurs souhaitable de baisser la CRDS, qui mine le pouvoir d'achat des salariés.
Mme Corinne Imbert. - Il y a trois ou quatre ans, je m'interrogeais sur notre faculté à piloter l'Ondam et j'avais proposé qu'en cas de dérapage, le comité d'alerte nous saisisse plus vite.
La branche maladie porte l'essentiel du déficit, en partie du fait du contexte démographique, du souhait de chacun de bénéficier des meilleurs soins et du choix politique de sélectionner les médicaments les plus innovants, même si ces derniers ne comptent que pour une petite part dans le déficit actuel.
L'année dernière, lorsque nous avons demandé des efforts, tout le monde a ronchonné. C'est donc l'ensemble de nos concitoyens qu'il faudra convaincre.
Ayant passé l'été avec ma blouse blanche, j'ai pu constater en discutant avec les patients que de nombreux médecins prescrivent des examens d'imagerie sans même effectuer d'examen clinique. C'est un exemple de ce qu'il nous faudrait changer.
Mme Anne-Marie Nédélec. - Depuis l'instauration du tiers payant, on a totalement perdu la notion du coût, notamment des médicaments, si bien que personne ne sait combien il a pu coûter à la sécurité sociale durant l'année écoulée. S'il nous faut trouver de nouvelles recettes sans alourdir encore les cotisations - ce qui suppose d'augmenter le nombre d'actifs ou d'allonger la durée du travail -, il nous faut également réduire les dépenses, en commençant par la suppression du gaspillage.
Mme Émilienne Poumirol. - J'ai assisté à de nombreuses auditions de grande qualité et je vous en remercie, car nous avons beaucoup appris.
Toute socialiste que je suis, dans les années 2010, j'ai eu beaucoup de mal à digérer les mesures de Marisol Touraine. Nous avons certes réduit le déficit, mais ce fut au prix d'une croissance très faible de l'Ondam, même si celle-ci fut atténuée par une inflation contenue autour de 1 %.
L'Ondam n'a peut-être plus réellement de sens. Il n'y a pas de solution simple, et sans doute faudra-t-il réduire les dépenses. Il faudrait par exemple que les médecins auscultent davantage les patients avant de leur prescrire des examens d'imagerie, ou que certains aient la main plus légère sur les prescriptions de biologie.
Du reste, il est indéniable que, sans agir sur les recettes, nous n'arriverons pas à l'équilibre.
Je veux enfin revenir sur un dernier point : dans son rapport Construire la sécurité sociale écologique du 21e siècle de 2022, Mélanie Vogel montrait que nous n'avions pas réellement pris la mesure de l'importance de la prévention au sens global et des richesses dont elle pourrait être synonyme. Nous n'insistons jamais assez sur la prévention - je ne parle pas de la vaccination, mais plutôt des mesures d'ordre environnemental, qui pourraient réellement faire la différence en matière de dépenses de santé.
Mme Anne Souyris. - Serait-il possible de quantifier les coûts et les gains induits par la prévention ?
La dette des hôpitaux est un sujet majeur. Le Président de la République avait promis qu'elle serait totalement remboursée. Or cela n'a été fait qu'en partie, et l'endettement a progressé une nouvelle fois. Il faudra bien remettre le compteur à zéro : est-il bien sérieux de penser que les hôpitaux pourront rembourser leur dette ?
Enfin, comme pour la prévention, il faudrait quantifier la financiarisation du système de santé et émettre des propositions. Serait-il envisageable de baisser les tarifs dans les secteurs où la rentabilité est jugée excessive ? Quand un très grand nombre d'actes du même type, sans être illégaux, semblent pratiqués de manière démesurés, il y a quelque chose à faire. Une taxe pourrait être instaurée sur ces actes à but lucratif.
Mme Raymonde Poncet Monge, rapporteure. - Mme Doineau et moi-même avons évoqué notre entente durant la préparation de ce rapport. Surtout, ni l'une ni l'autre n'avons défendu une position selon laquelle il faudrait uniquement augmenter les recettes ou uniquement maîtriser les dépenses pour résoudre tous les problèmes. Par exemple, je suis d'accord avec le fait qu'il faut mesurer et cibler l'inefficience des dépenses, afin de se donner les moyens de la combattre, comme c'est le cas pour la fraude.
Ainsi, les 10 milliards de mesures annuelles dont il est question relèvent d'un effort structurel sur les recettes aussi bien que sur les dépenses. Dans le passé, il y a eu des choses à la fois bonnes et mauvaises dans le retour à l'équilibre auquel nous sommes parvenus dans les années 2010, en particulier sous la présidence de François Hollande. Ce qui était positif, c'est qu'il y avait un effort sur les deux leviers - pour deux tiers, sur les dépenses, et pour un tiers, sur les recettes. En revanche, le problème, c'est que l'Ondam de l'hôpital a dû supporter la non-régulation de l'Ondam de la médecine de ville. Et on en est toujours là : on sait piloter les dépenses de l'hôpital - il suffit de ne pas lui donner assez, et il finit en déficit... -, mais pas celles de la médecine de ville. Ainsi, au début des années 2010, l'équilibre s'est aussi fait au détriment de l'Ondam hospitalier.
Je vous invite à lire, dans notre rapport, cet éclairage historique sur la décennie 2010 : la bonne santé conjoncturelle a masqué la persistance d'un important déficit structurel en 2019, aujourd'hui révélé par l'attrition des recettes.
Le rapport évoque la question de l'écologie. Cependant, il n'envisage pas de financer la sécurité sociale par une taxe carbone. En effet, nous nous sommes limitées aux créations ou augmentations de prélèvements obligatoires présentant un lien direct et incontestable avec la sécurité sociale.
Il est possible d'augmenter le PIB en augmentant la quantité de travail. Cependant, nous avons pointé que la France ne se distingue pas des autres pays européens par la durée de travail par emploi, mais par le nombre d'emplois.
La croissance du PIB est le troisième moteur du retour à l'équilibre, avec les dépenses et les recettes. On sait que la croissance annuelle sera faible. Mais lorsque le PIB croît, les dépenses n'augmentent pas de la même façon, et libèrent une certaine marge.
C'est donc une boîte à outils que nous vous proposons. Bien sûr, il y a des divergences de point de vue sur les leviers qui ont été utilisés par le passé et sur ceux que nous prévoyons de mobiliser. Mais ni Mme Doineau ni moi-même ne défendons le recours à un seul de ces leviers.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale. - Monsieur Milon, la CRDS n'est pas uniquement à la charge des salariés : elle est également prélevée sur les pensions, et plus généralement sur l'ensemble des revenus de remplacement, tout comme la CSG.
Je reviens sur la capacité de pilotage. Un jour, on nous annonce la baisse du remboursement des frais liés aux soins des ALD, puis, le lendemain, celle de la prise en charge des cures thermales... En réalité, puisque nous ne sommes pas en mesure, politiquement, de nous mettre d'accord sur des décisions structurelles et de défendre un véritable projet de loi, seules des mesures réglementaires peuvent être prises. C'est un syndrome des difficultés politiques actuelles. Et il est bien normal que le Gouvernement décide de telles mesures : sans cela, la situation ne serait plus maîtrisable. Tout cela se fait par à-coups, car nous ne pouvons pas proposer de projets structurants.
Monsieur Khalifé, l'Ondam est en effet très compliqué. Faut-il le remettre en question ? Pour notre part, nous préconisons d'en changer la gouvernance. C'est l'objet des points d'accord nos 7 et 8. Les outils de régulation doivent être renforcés.
En 2022, 12,7 milliards d'euros ont été consacrés à la prévention, dont 6,1 milliards d'euros en dehors de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Cela n'est pas suffisant. Mme Poncet Monge et moi-même sommes d'accord pour dire qu'il faudrait faire plus - mais avec quels moyens, grâces à quelles recettes ? Nous n'avons pas travaillé davantage sur le sujet, du fait de la mission d'information en cours sur la prévention en santé.
Les bénéfices de la prévention s'observent sur le long terme. Pour l'heure, nous en sommes réduits au court-termisme, puisque nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur des mesures structurantes. Nous soulignons la nécessité de renforcer la prévention, mais les mesures que nous chiffrons en annexe se limitent à des décisions rentables rapidement pour combler le déficit.
Concernant le coût de la santé, lors de son audition, Catherine Vautrin avait indiqué qu'elle souhaitait, à l'avenir, rendre plus lisibles les dépenses de santé, non pas pour stigmatiser qui que ce soit, mais pour qu'on se rende mieux compte du coût des dépenses de santé. Cela ne me paraît pas anormal. En outre, cela permettrait sans doute d'éviter, chez nos concitoyens, le sentiment que certains cotisent plus qu'ils ne reçoivent, et inversement. J'y suis donc favorable.
Enfin, il est évident que nous devons embarquer les citoyens. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Il faudra donc faire preuve de pédagogie. Pour l'heure, nous sommes tous dans le même bateau - un bateau qui coule !
M. Philippe Mouiller, président. - Je vous remercie.
Je vous invite à prendre acte des travaux de la Mecss et à autoriser la publication de ce rapport d'information.
La commission adopte le rapport d'information, à l'unanimité, et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
· Michaël Zemmour, professeur de sciences économiques à l'université Lumière Lyon 2
· Jean-Marie Harribey, professeur de sciences économiques et sociales, ancien maître de conférences à l'université de Bordeaux, ancien co-président d'Attac et des Économistes atterrés
· Clément Carbonnier, codirecteur de l'axe « Politiques socio-fiscales » du LIEPP et professeur d'économie à l'université Paris 8
· Mathilde Viennot, économiste et co-fondatrice de l'Institut Avant-garde
· Nicolas Da Silva, maître de conférences en économie à l'Université Sorbonne Paris Nord
· Henri Sterdyniak, économiste, cofondateur de l'OFCE, signataire du manifeste d'économistes atterrés
· Elvire Guillaud, maître de conférences en Économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au CES et affiliée au LIEPP
· Direction du budget
Élise Delaître, sous-directrice - finances sociales
David Bethoux, chef du bureau des comptes sociaux et de la santé
· Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades)
Pierre Ricordeau, président
Philippe Petitbon, secrétaire général
· Fonds de réserve des retraites (FRR)
Sandrine Lémery, présidente du conseil de surveillance
Adrien Perret, membre du Directoire
· Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)
Marc Scholler, directeur délégué de l'audit, des finances et de la lutte contre la fraude
Damien Vergé, directeur de la stratégie, des études et des statistiques
Antoine-Mathieu Nicoli, directeur de la gestion du risque
Veronika Levendof, chargée des relations avec le Parlement
· Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav)
Renaud Villard, directeur
Valérie Albouy, directrice statistiques, prospective et recherche
· Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Aude Muscatelli, directrice générale adjointe
· Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)
Benoît Ourliac, sous-directeur de l'observation de la santé et de l'assurance maladie
Franck Arnaud, sous-directeur des synthèses, des études économiques et de l'évaluation
· Haute Autorité de santé (HAS)
Pr Lionel Collet, président
Jean Lessi, directeur général
· Benjamin Ferras, enseignant à Sciences Po Paris et à l'université Paris-Panthéon-Assas
· Direction générale du Trésor
Dorothée Rouzet, cheffe économiste
Bruno Quille, chef du bureau de la politique économique
Rémi Monin, chef de bureau santé et comptes sociaux
· Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
Elliot Aurissergues, économiste, pôle modélisation
· Antoine Bozio, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
· Olivier Redoulès, directeur du pôle Études de Rexecode
· Nicolas Marques, directeur général de l'institut économique Molinari
· Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Alain Galopin, responsable du service protection sociale
· Confédération générale du travail (CGT)
Patrice Bossard, membre de la direction fédérale
· Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Léonard Guillemot, conseiller confédéral
· Confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC)
Philippe Baux, délégué national protection sociale
Christelle Thieffinne, secrétaire nationale à la protection sociale
Anne Bernard, cheffe de service économie et protection sociale
· Mouvement des entreprises de France (Medef)
Diane Milleron Deperrois, présidente de la commission protection sociale
Nathalie Buet, directrice de la protection sociale
Adrien Chouguiat, directeur adjoint du pôle affaires publiques
· Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Éric Chevée, vice-président chargé des affaires sociales
Gwendoline Delamare-Deboutteville, directrice des affaires sociales
Adrien Dufour, responsable des affaires publiques
· Union des entreprises de proximité (U2P)
Michel Picon, président
Christian Pineau, chef du pôle social
Thérèse Note, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement
· Direction de la sécurité sociale (DSS)
Pierre Pribile, directeur
Anne Fichen, ajointe du sous-directeur des études et des prévisions financières
Charles Boriaud, adjoint du sous-directeur du financement de la sécurité sociale
· Pierre-Yves Cusset, chef de projet à France Stratégie, département société et politiques sociales
· Urssaf Caisse nationale
Damien Ientile, directeur général
Emmanuel Laurent, directeur central trésorerie, banque, financement, investissement
Emmanuel Dellacherie, directeur de la réglementation du recouvrement et du contrôle
· Agence France Trésor (AFT)
Antoine Deruennes, directeur général
Mathieu Marceau, responsable du bureau de la trésorerie de l'État
Maelle Viale, chargée de communication
· Les entreprises du médicament (Leem)
Laurence Peyraut, directrice générale
Juliette Moisset, directrice de l'accès et des affaires économiques
Laurent Gainza, directeur des affaires publiques
· Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS)
Dominique Libault, président
· Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM)
Yann-Gaël Amghar, président
Catherine Pollak, secrétaire générale
· Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)
Hélène Périvier, présidente
Laurence Rioux, secrétaire générale
Marco Geraci, secrétaire général adjoint
· Conseil d'orientation des retraites (COR)
Gilbert Cette, président
Emmanuel Bretin, secrétaire général
· Jean-Jacques Marette, animateur de la délégation paritaire permanente sur les retraites
· Mathilde Guergoat-Larivière, économiste, professeure d'économie à l'université de Lille, chercheuse au Clerse et au Cnam-CEE, membre du Comité scientifique de l'Ires
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
· Confédération Force ouvrière (FO)
ANNEXES
I. PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Acemoglu Daron, Johnson Simon, « The Urgent Need to Tax Digital Advertising », Network Law Review, printemps 2024
Aïchi Leila, Pollution de l'air : le coût de l'inaction, rapport n° 610 (2014-2015), commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, Sénat, 8 juillet 2015
Artus Patrick, « Le problème de la France : le niveau de production est trop bas », Les Échos, 27 janvier 2025
Attal Gabriel, Rufo Marcel, « Il faut interdire l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux réseaux sociaux », tribune publiée dans Le Figaro, 29 avril 2025
Bac Catherine, Cornilleau Gérard, « Comparaison internationale des dépenses de santé : une analyse des évolutions dans sept pays depuis 1970 », Études et résultats, n° 175, juin 2002
Beaufret Jean-Pascal, « Retraites obligatoires et déficits publics - pour la clarté », Commentaire, été 2023
Beaufret Jean-Pascal, « Les trois singes et les finances publiques - retour sur 1000 milliards de dette additionnelle (2016-2024) », Commentaire, automne 2024
Bérard Jean Luc, Oustric Stéphane, Seiller Stéphane, Plus de prévention, d'efficacité, d'équité et de maîtrise des arrêts de travail - neuf constats, vingt propositions, rapport au Premier ministre, janvier 2019
Bozio Antoine, Wasmer Étienne, Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 octobre 2024
Bozio Antoine, Ferreira Jean, Landais Camille, Lapeyre Alice et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025
Caby Daniel, « Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? », Trésor-Eco n° 179, septembre 2016
Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les soins, Propositions de l'Assurance Maladie pour 2025 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2025 (loi du 13 août 2004), juillet 2024
Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Caisse nationale de l'assurance maladie, Lutte contre les fraudes : en 2024, des résultats records et une mobilisation renforcée, dossier de presse, 20 mars 2025
Carbonnier Clément, « La TVA sociale s'inscrit dans la lignée des politiques inefficaces de baisse du coût du travail », entretien publié dans Alternatives économiques, 26 mai 2025
Cette Gilbert, « Le débat sur les retraites doit être fructueux », Telos, 5 mars 2025
Clouet Hadrien, Rist Stéphanie, Conclusion des travaux d'une mission d'information sur la gestion de la dette sociale, rapport d'information, n° 302, 17e législature, Mecss de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, 2 octobre 2024
Colinot Nadine, Debeugny Gonzague, Pollak Catherine, « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Études et résultats n° 1321, 13 décembre 2024
Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024
Commission européenne, « The 2021 Ageing Report - Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070) », Institutional Paper 148, mai 2021
Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus, octobre 2024
Conseil d'orientation des retraites, La mesure du solde du système de retraite dans les rapports du COR, janvier 2025
Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, juin 2024
Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, juin 2025
Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale en France, mars 2025
Cordilha Ana Carolina, « L'assurance maladie, otage des marchés financiers », Alternatives économiques, 24 mars 2025
Cottet Sophie, « Payroll Tax Reductions for Minimum Wage Workers : Relative Labor Cost or Cash Windfall Effects ? », CESifo Working Paper, No. 11 076, 2004
Cour des comptes, Accélérer la réorganisation des soins de ville pour en garantir la qualité et maîtriser la dépense, contribution à la revue des dépenses publiques, juillet 2023
Cour des comptes, Impacts du système de retraites sur la compétitivité et l'emploi, communication au Premier ministre, 10 mars 2025
Cour des comptes, La sécurité sociale - les résultats de la sécurité sociale en 2019 : l'interruption d'une longue séquence de retour à l'équilibre, juin 2020
Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale - un déficit devenu structurel malgré les mesures envisagées pour 2025, communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et à la commission des affaires sociales du Sénat, octobre 2024
Cour des comptes, Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité, rapport public thématique, octobre 2023
Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025
Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025
Cusset Pierre-Yves, « Protection sociale : le choc du vieillissement est-il (in)soutenable ? », La Note d'analyse n° 111, France Stratégie, juillet 2022
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), La protection sociale en France et en Europe en 2022 - résultats des comptes de la protection sociale, édition 2023
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), Les dépenses de santé en 2023 - Résultats des comptes de la santé, 2024
Direction de la sécurité sociale et président du Comité d'alerte sur les dépenses de l'assurance maladie, Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (en particulier ceux d'octobre 2024 et juin 2025)
Doineau Élisabeth, Apourceau-Poly Cathy, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024
Ducoulombier Juliette, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la DG Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024
France assureurs, Construire une nouvelle solution solidaire et transparente face à la dépendance liée à l'âge, livre blanc, décembre 2021
Groupe d'experts sur le Smic, Salaire minimum interprofessionnel de croissance, 28 novembre 2024
Haute Autorité de santé, Efficacité et efficience des hypolipémiants - Une analyse centrée sur les statines, juillet 2010
Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP - 2022 - 4 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023, 21 septembre 2022
Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP - 2023 - 8 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024, 22 septembre 2023
Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024
Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022
Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d'étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013
Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale, juin 2017
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022
Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021
Herlin Antoine, « Pour une clarification de la contributivité de la protection sociale », Trésor-Eco n° 200, juin 2017
Imbert Corinne, Jomier Bernard, Henno Olivier, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024), commission des affaires sociales du Sénat, 25 septembre 2024
Immervoll Herwig, « Financing social protection in OECD countries : Role and uses of revenue earmarking », OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 31, 2024
Insee, Note de conjoncture, 15 mars 2023
Insee, direction générale du Trésor, « Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés », Document de travail de la Direction des Études et Synthèses Économique G 2017 / 04, mai 2017
Johanet Gilles, « Santé et système de soins : changer de paradigme », Telos, 18 avril 2025.
Kakemam Edris, Zozani Morteza Arab, Raeissi Pouran, Albelbeisi Ahmed Hassan, « The occurrence, types, reasons, and mitigation strategies of defensive medicine among physicians : a scoping review », BMC Health Services Research (2022)
Kopp Pierre, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019, Observatoire français des drogues et tendances addictives, juillet 2023
L'Horty Yannick, « Dix ans d'évaluation des exonérations sur les bas salaires », in Connaissance de l'emploi, n° 24, janvier 2006
L'Horty Yannick, Martin Philippe, Mayer Thierry, « Baisses de charges : stop ou encore ? » Les notes du conseil d'analyse économique, n° 49, janvier 2019
L'Horty Yannick, Quinet Alain, Rupprecht Frédéric, « Expliquer la croissance des dépenses de santé : le rôle du niveau de vie et du progrès technique », in Économie & prévision, n° 129-130, 1997-3-4
Lidsky Vincent, Thiard Pierre-Emmanuel, Le Brigronen Maryvonne, Thomas Jérôme, Olivier Matthieu, Jeantet Quentin (IGF), Giorgi Dominique, Garrigue-Guyonnaud Hubert, Jeantet Marine, Cayre Virginie, Davenel Jeanne (Igas), Propositions pour la maîtrise de l'Ondam 2013-2017, juin 2012 (IGF N° 2012-M-007-03 /Igas n° RM2012-083P)
Lindgren Bjorn, « The Rise in Life Expectancy, Health Trends among the Elderly, and the Demand for Care - A Selected Literature Review », NBER Working Paper No. 22 521, août 2016
Madec Pierre, « Quel impact de la suppression de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions et retraites ? », Blog de l'OFCE, 9 janvier 2025
Marques Nicolas, Économiser 60 milliards d'euros avec un Fonds de réserve pour les retraites (FRR) redimensionné, Institut économique Molinari, 4 novembre 2024
Martinot Bertrand, Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation, Fondation pour l'innovation politique, mars 2025
Ministère des comptes publics, ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Bilan 2024 - Lutter contre toutes les fraudes, 14 mars 2025
Ministère de la transition écologique et solidaire, Stratégie nationale bas-carbone - rapport d'accompagnement, mars 2020
Neuder Yannick, entretien avec le Quotidien du médecin, 19 mars 2025
Observatoire français des conjonctures économiques, « La croissance à l'épreuve du redressement budgétaire, Perspectives 2024-2025 pour l'économie française », OFCE policy brief n° 137, 16 octobre 2024
OCDE, Lutter contre le gaspillage dans les systèmes de santé, 2017
OCDE, Ready for the Next Crisis ? Investing in Health System Resilience, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, 2023
Perronnin Marc, « L'enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise 2017 », Les rapports de L'Irdes n° 572, novembre 2019
Redoulès Olivier, « Augmenter la quantité de travail : enjeux et leviers », Repères n° 13, Rexecode, 10 mars 2025
Revel Nicolas, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025
Roussel Romain, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Études et résultats n° 1032, octobre 2017
Sabatou Alexandre, Chaize Patrick, Narassiguin Corinne, ChatGPT, et après ? Bilan et perspectives de l'intelligence artificielle, rapport d'information n° 642 (17e législature)/170 (2024-2025), OPECST, 28 novembre 2024
Treilhou Aurélie, Afrache Hicham, Rodrigues Henri-Pierre, Touze Vincent, Le marché de la dépendance : état des lieux, actualités et projets de place, atelier technique de l'Institut des actuaires, 21 novembre 2024
Vachey Laurent, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020
Viennot Mathilde, « Notre modèle de protection sociale est-il soutenable ? », Regards n° 58, Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, avril 2021
Vogel Mélanie, Construire la sécurité sociale écologique du 21e siècle, mission d'information sur la sécurité sociale écologique, rapport d'information n° 594 (2021-2022), Sénat, 30 mars 2022
Von Lennep Franck, « La régulation des dépenses de santé : l'impossible défi ? », Les tribunes de la santé n° 8, été 2024
II. CHIFFRAGE DES PRINCIPALES NICHES SOCIALES
Les niches sociales figurant dans les tableaux
synthétiques de l'annexe au PLFSS ou au Placss relative aux niches
sociales
(périmètre : régimes obligatoires de base
et Fonds de solidarité vieillesse)
(en millions d'euros)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Allégements généraux |
53 225 |
47 328 |
51 200 |
58 447 |
65 391 |
64 902 |
|
Exonérations ciblées compensées |
5 735 |
5 572 |
8 389 |
6 319 |
6 518 |
6 796 |
|
dont : |
||||||
|
Entreprises implantées en outre-mer |
995 |
943 |
1 019 |
1 147 |
1 012 |
1 056 |
|
Aide à domicile employée par un particulier fragile |
997 |
818 |
930 |
941 |
996 |
1 049 |
|
Aide à domicile employée par une assoc. ou une entreprise auprès d'une personne fragile |
870 |
865 |
901 |
712 |
768 |
815 |
|
Apprentissage |
399 |
452 |
658 |
845 |
974 |
1 081 |
|
Déductions sur les heures supplémentaires (entreprises de moins 250 salariés) |
513 |
519 |
600 |
702 |
845 |
865 |
|
Exonérations non compensées |
2 134 |
1 931 |
2 267 |
2 538 |
2 606 |
2 700 |
|
dont : |
||||||
|
Exonération sur les heures supplémentaires - part salariale |
1 715 |
1 601 |
1 912 |
2 185 |
2 277 |
2 342 |
|
Exemptions d'assiette |
7 763 |
7 640 |
8 100 |
13 300 |
14 100 |
14 600 |
|
dont : |
||||||
|
Participation financière et actionnariat salarié |
1 104 |
1 689 |
1 690 |
3 400 |
3 700 |
3 900 |
|
Participation aux résultats de l'entreprise |
289 |
378 |
350 |
800 |
900 |
1 000 |
|
Intéressement |
397 |
866 |
750 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
|
Plan d'épargne en entreprises (PEE) |
149 |
138 |
160 |
400 |
400 |
500 |
|
Stock options et attributions gratuites d'actions |
268 |
307 |
430 |
700 |
800 |
800 |
|
Protection sociale complémentaire en entreprise |
3 605 |
2 837 |
2 990 |
4 900 |
5 300 |
5 500 |
|
Prévoyance complémentaire |
3 395 |
2 644 |
2 780 |
4 600 |
4 900 |
5 100 |
|
Retraite supplémentaire (y compris retraites chapeaux) |
140 |
115 |
130 |
200 |
300 |
300 |
|
Plan d'épargne retraite collective (PERCO) |
70 |
78 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
Aides directes consenties aux salariés |
2 450 |
2 488 |
2 720 |
3 700 |
4 000 |
4 100 |
|
Titres restaurant |
1 306 |
1 280 |
1 430 |
1 700 |
1 900 |
1 900 |
|
Chèques vacances |
211 |
319 |
330 |
400 |
400 |
400 |
|
Avantages accordés par les comités d'entreprises |
867 |
817 |
890 |
1 600 |
1 600 |
1 700 |
|
CESU préfinancé |
67 |
73 |
70 |
100 |
100 |
100 |
|
Indemnités de rupture |
604 |
626 |
700 |
1 200 |
1 100 |
1 100 |
|
Indemnités de licenciement |
551 |
553 |
620 |
900 |
900 |
900 |
|
Indemnités de mise à la retraite |
- 12 |
- 10 |
- 10 |
0 |
0 |
0 |
|
Indemnités de rupture conventionnelle |
65 |
83 |
90 |
400 |
300 |
100 |
|
Total |
68 857 |
62 471 |
69 956 |
80 604 |
88 615 |
88 998 |
Source : Mecss du Sénat, d'après l'annexe 5 au PLFSS 2021, l'annexe 2 au PLFSS 2022, l'annexe 4 au PLFSS 2023, l'annexe 2 aux Placss 2022, 2023 et 2024
III. PRINCIPALES PROJECTIONS DE FINANCES SOCIALES SANS NOUVELLES MESURES
A. RETRAITES
1. Commission européenne (2024)
La Commission européenne a publié en 2024 la dernière version de son rapport sur le vieillissement429(*), qui comprend notamment des projections des dépenses publiques de retraite à droit constant (c'est-à-dire, dans le cas de la France, prenant en compte les effets de la réforme de 2023).
Dans le cas de la France, dans le cas du scénario de base, toutes choses égales par ailleurs, l'augmentation du ratio de dépendance majorerait les dépenses de retraite de 6 points de PIB en 2070, ce qui montre le fort impact du vieillissement. En sens inverse, trois facteurs tendraient à réduire les dépenses en points de PIB : la diminution de la pension moyenne rapportée au salaire moyen (réduction des dépenses de 3,4 points de PIB), la diminution du taux de couverture (réduction des dépenses de 2,2 points de PIB) et l'augmentation du taux d'emploi (réduction des dépenses de 0,9 point de PIB). Au total, les dépenses de retraites diminueraient de 0,8 point de PIB, passant de 14,4 points de PIB en 2022 à 13,6 points de PIB en 2070430(*).
Contribution à l'évolution des dépenses publiques de retraites, 2022-2070 (scénario de base)
(en points de PIB)
Taux de dépendance : nombre de personnes de 65 ans et plus/ nombre de personnes de 20-64 ans.
Taux de couverture : nombre de retraités/nombre de personnes de 65 ans et plus.
Ratio pension/salaire : pension moyenne/salaire moyen.
Effet du marché du travail : en quasi-totalité, augmentation du taux d'emploi (nombre de personnes de 20-64 ans ayant un emploi/nombre de personnes de 20-64 ans).
Source : D'après Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024
La Commission européenne présente, outre le scénario de base présenté ci-avant, dix scénarios variantiels.
L'ensemble des scénarios sont synthétisés par le graphique ci-après.
Ils indiquent les dépenses publiques de retraites en points de PIB, sur la base des hypothèses de croissance potentielle de la Commission européenne : actuellement de 1 % environ, elle devrait baisser à 0,6 % en 2030 avant de remonter à 1,5 % en 2040, du fait des évolutions démographiques431(*).
Projections de dépenses publiques de
retraite de la France
par la Commission européenne
(en points de PIB)
|
Droit constant* |
Différence par rapport au scénario de base |
|
|
Ratio pension moyenne/salaire moyen constant |
Quand le ratio pension moyenne/salaire moyen diminue de 10 % par rapport à 2022, des mesures sont prises pour stabiliser le ratio à ce niveau. |
|
|
Fertilité - 20 % |
× |
Taux de fertilité inférieur de 20 % sur la totalité de la période de projection |
|
Age de retraite constant |
Age légal de départ à la retraite, âge de départ à taux plein et critères de carrière maintenus au niveau de début de période |
|
|
Espérance de vie + 2 ans |
× |
Augmentation de l'espérance de vie à la naissance majorée de 2 ans en 2070 |
|
Migration - 33 % |
× |
Immigration non UE minorée de 33 % sur toute la période de projection |
|
Croissance de la PGF - 0,2 point |
× |
La croissance de la PGF converge vers 0,6 % (au lieu de 0,8 %) |
|
Croissance de la PGF + 0,2 point |
× |
La croissance de la PGF converge vers 1 % (au lieu de 0,8 %) |
|
Taux d'emploi des travailleurs âgés + 10 % |
× |
Taux d'emploi des travailleurs âgés (55- 74 ans) majoré de 10 points par rapport au scénario de base |
|
Migration + 33 % |
× |
Immigration non UE majorée de 33 % sur toute la période de projection |
|
Age de la retraite lié à l'augmentation de l'espérance de vie |
Changement de l'âge effectif de départ à la retraite = 3/4 du changement anticipé de l'espérance de vie |
* Les scénarios autres qu'à droit constant apparaissent en pointillés sur le graphique.
Scénario de base : droit constant, prévisions démographiques d'Eurostat, croissance de la PGF convergeant vers 0,8 %.
PGF : productivité globale des facteurs.
Source : D'après Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024
Trois scénarios, qui ne sont pas à droit constant, sont représentés en pointillés sur le graphique. Il en ressort que, par rapport au scénario de base, figer les conditions légales d'âge de départ à la retraite à leur niveau de 2022 majorerait les dépenses de 0,9 point de PIB en 2070 et que stabiliser le ratio pension moyenne/salaire moyen à son niveau de 2022 les majorerait de 1,9 point de PIB. En sens inverse, lier l'âge de départ à la retraite à l'évolution de l'espérance de vie (comme le font dix États de l'Union européenne) réduirait les dépenses de retraite en 2070 d'un point de PIB.
Les scénarios à droit constant illustrent l'importance des enjeux démographiques :
- le scénario correspondant aux dépenses en points de PIB les plus élevées en 2070 est celui correspondant à un taux de fertilité inférieur de 20 %. Les dépenses seraient alors supérieures de 1,2 point de PIB à celles du scénario de référence ;
- le scénario correspondant aux dépenses en points de PIB les plus faibles en 2070 est celui supposant une majoration de l'immigration extra-européenne de 33 % sur la période de projection. Les dépenses seraient alors inférieures de 0,6 point de PIB à celles du scénario de référence.
2. Conseil d'orientation des retraites (2024)432(*)
Le Conseil d'orientation des retraites publie chaque année des projections du système de retraite.
Selon le scénario de référence du COR de juin 2024, les dépenses passeraient de 13,4 points de PIB en 2023 à 13,2 points de PIB en 2070, ce qui représente une diminution de 0,2 point de PIB.
Ce résultat est proche de celui de la Commission européenne, qui, sur la base d'un périmètre inférieur de 0,8 point de PIB433(*), prévoit une diminution de 0,1 point de PIB.
Les scénarios variantiels retenus conduisent à une amplitude plus importante que pour ceux de la Commission européenne :
- le scénario correspondant aux dépenses en points de PIB les plus élevées en 2070 est celui correspondant à une croissance de la productivité du travail de seulement 0,4 % (au lieu de 1 %). Les dépenses seraient supérieures de 1,7 point de PIB à celles du scénario de référence ;
- le scénario correspondant aux dépenses en points de PIB les plus faibles en 2070 est celui supposant des gains d'espérance de vie inférieurs de 2,7 ans d'ici 2070 à la projection de l'Insee. Les dépenses seraient inférieures de 1,1 point de PIB à celles du scénario de référence.
La Cour des comptes, dans son rapport de février 2025 sur les retraites, préconise de retenir une hypothèse de croissance de la productivité horaire du travail de 0,7 %, conforme à celle observée ces dernières années, et non 1 % comme dans le scénario de référence du COR de juin 2024. Selon ce scénario, les dépenses seraient majorées de 0,8 point de PIB en 2070 (14 points de PIB au lieu de 13,2 points de PIB).
Projections de dépenses du système
de retraite de la France
par le Conseil d'orientation des retraites
(COR)
(en points de PIB)
|
2023 |
2070 |
Gains d'espérance de vie (2070) |
Fécondité (enf./femme) |
Solde migratoire net |
Croissance annuelle de la productivité horaire du travail ( %)* |
Taux de chômage** ( %) |
|
|
Scénario de référence |
13,4 |
13,2 |
F : + 31,3 H : + 29,3 |
1,8 |
70 000 |
1,0 |
5 |
|
Variante croissance de la productivité du travail de 0,4 % |
13,4 |
14,9 |
0,4 |
||||
|
Variante mortalité basse |
13,4 |
14,5 |
+ 3,5 ans*** |
||||
|
Variante croissance de la productivité du travail de 0,7 % |
13,4 |
14,0 |
0,7 |
||||
|
Variante fécondité basse |
13,4 |
13,9 |
1,6 |
||||
|
Variante solde migratoire bas |
13,4 |
13,8 |
20 000 |
||||
|
Variante taux de chômage de 10 % |
13,4 |
13,8 |
10 |
||||
|
Variante taux de chômage de 7 % |
13,4 |
13,5 |
7 |
||||
|
Variante fécondité haute |
13,4 |
12,6 |
2,0 |
||||
|
Variante solde migratoire haut |
13,4 |
12,5 |
120 000 |
||||
|
Variante croissance de la productivité du travail de 1,3 % |
13,4 |
12,5 |
1,3 |
||||
|
Variante mortalité haute |
13,4 |
12,1 |
- 2,7 ans*** |
Calculs basés sur la convention dite d'équilibre permanent des régimes (EPR) : contributions et subventions d'équilibre évoluant de manière à équilibrer chaque année le solde de ces régimes.
Pour faciliter la lecture, seuls les écarts par rapport au scénario de référence sont indiqués.
* À partir de 2040.
** À partir de 2030.
*** Écart par rapport au scénario de référence.
Source : D'après Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel - Évolutions et perspectives des retraites en France, juin 2024
Contrairement à la Commission européenne, le COR fait des projections de solde, sur lesquelles tend à se focaliser le débat public. Ces projections sont synthétisées par le graphique ci-après.
Projections de solde du système de retraite
de la France
par le Conseil d'orientation des retraites (COR)
(en points de PIB)
|
2023 |
2070 |
Gains d'espérance de vie (2070) |
Fécondité (enf./femme) |
Solde migratoire net |
Croissance annuelle de la productivité horaire du travail ( %)* |
Taux de chômage** ( %) |
|
|
Scénario de référence |
0,1 |
- 0,8 |
F : + 31,3 H : + 29,3 |
1,8 |
70 000 |
1 |
5 |
|
Variante mortalité haute |
0,1 |
0,2 |
- 2,7 ans*** |
||||
|
Variante solde migratoire haut |
0,1 |
- 0,2 |
120 000 |
||||
|
Variante fécondité haute |
0,1 |
- 0,2 |
2 |
||||
|
Variante croissance de la productivité du travail de 1,3 % |
0,1 |
- 0,2 |
1,3 |
||||
|
Variante taux de chômage de 7 % |
0,1 |
- 0,9 |
7 |
||||
|
Variante taux de chômage de 10 % |
0,1 |
- 0,9 |
10 |
||||
|
Variante solde migratoire bas |
0,1 |
- 1,3 |
20 000 |
||||
|
Variante croissance de la productivité du travail de 0,7 % |
0,1 |
- 1,4 |
0,7 |
||||
|
Variante fécondité basse |
0,1 |
- 1,4 |
1,6 |
||||
|
Variante mortalité basse |
0,1 |
- 1,9 |
+ 3,5 ans*** |
||||
|
Variante croissance de la productivité du travail de 0,4 % |
0,1 |
- 2,1 |
0,4 |
Calculs basés sur la convention dite d'équilibre permanent des régimes (EPR) : contributions et subventions d'équilibre évoluant de manière à équilibrer chaque année le solde de ces régimes.
Pour faciliter la lecture, seuls les écarts par rapport au scénario de référence sont indiqués.
* À partir de 2040.
** À partir de 2030.
*** Écart par rapport au scénario de référence.
Source : D'après Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel - Évolutions et perspectives des retraites en France, juin 2024
Un élément important des projections de solde est que les recettes tendent à diminuer en points de PIB. Ce résultat, qui pourrait a priori surprendre, vient du fait que les recettes comprennent les contributions d'équilibre de l'État à certains régimes, comme celui de la fonction publique d'État, qui tendent à baisser au cours du temps.
Projections de recettes du système de
retraite de la France
par le Conseil d'orientation des retraites
(COR)
(en points de PIB)
Calculs basés sur la convention dite d'équilibre permanent des régimes (EPR) : contributions et subventions d'équilibre évoluant de manière à équilibrer chaque année le solde de ces régimes.
Hypothèses des scénarios : cf. graphique précédent.
Source : D'après Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel - Évolutions et perspectives des retraites en France, juin 2024
B. DÉPENSES DE SANTÉ
1. Les travaux de projection de la Commission européenne (2024)
a) Une augmentation des dépenses de santé de la France de - 0,1 à 1,1 point de PIB d'ici 2070
La Commission européenne a publié en 2024 la dernière version de son rapport sur le vieillissement434(*), qui comprend notamment des projections des dépenses de santé.
Tous les scénarios sont à politiques inchangées. Ils sont synthétisés par le graphique ci-après.
Ils indiquent les dépenses de santé en points de PIB, sur la base des hypothèses de croissance potentielle de la Commission européenne : actuellement de 1 % environ, elle devrait baisser à 0,6 % en 2030 avant de remonter à 1,5 % en 2040, du fait des évolutions démographiques435(*).
Projections de dépenses de santé de la France par la Commission européenne
(en points de PIB)
|
Dépenses en fonction de l'âge |
Indexation du coût unitaire |
Élasticité des dépenses au revenu |
|
|
Scénario de risque |
1,5 en 2022, convergeant à 1 en 2070 |
||
|
Sans vieillissement en bonne santé |
Profils de 2022 constants |
||
|
Intensité du travail |
PIB/heure travaillée |
||
|
Scénario démographique |
1 |
||
|
Indexations sectorielles |
En fonction du secteur |
||
|
Vieillissement en bonne santé |
Décalage des profils de 2022 de la totalité de l'augmentation de l'espérance de vie de la tranche d'âge concernée |
||
|
Scénario de base |
Décalage des profils de 2022 de la moitié de l'augmentation de l'espérance de vie de la tranche d'âge concernée |
PIB par tête |
1,1 en 2022, convergeant à 1 en 2070 |
Pour faciliter la lecture, pour les scénarios autres que le scénario de base, seules sont indiquées les différences par rapport au scénario de base.
Le périmètre combine les comptes de santé (hors soins de long terme) et la classification des fonctions du Gouvernement (pour l'investissement).
Source : D'après Commission européenne, 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, avril 2024
Le scénario de base (rouge sur le graphique) considère que la moitié des années d'augmentation de l'espérance de vie sont des années en bonne santé, ce qui minore les dépenses. En sens inverse, il suppose qu'en début de période une augmentation du revenu national de 1 % suscite une augmentation des dépenses de santé de 1,1 %, ce qui majore les dépenses.
Selon ce scénario, les dépenses de santé augmenteraient à peine en points de PIB, passant de 8,8 points de PIB en 2022 à 9,1 points de PIB en 2070.
Le scénario de « vieillissement en bonne santé », selon lequel la totalité des années supplémentaires d'espérance de vie seraient en bonne santé, susciterait même d'ici 2070 une diminution de 0,1 point des dépenses de santé rapportées au PIB par rapport à 2022.
En sens inverse, dans le scénario de risque, qui suppose une élasticité au revenu de 1,5 (et non 1,1) en début de période, les dépenses de santé atteindraient 9,9 points de PIB en 2070, en augmentation de 1,1 point par rapport à 2022.
Ces projections doivent être considérées avec prudence :
- tout d'abord, les spécificités éventuelles de l'année de départ doivent être correctement prises en compte. Ainsi, dans l'Ageing Report de 2021436(*), le scénario correspondant à l'actuel « scénario de base »437(*) projetait des dépenses de santé de 9,5 points de PIB (et non 9,1 points de PIB) en 2070. La Commission attribue cet écart, que l'on constate également au niveau de l'Union européenne, à une mauvaise prise en compte des dépenses liées à la crise sanitaire ;
- ensuite, à l'horizon de plusieurs décennies, une faible différence de croissance annuelle des dépenses peut conduire à des différences considérables. Ainsi, dans l'Ageing Report de 2021, le scénario dit de « déterminants non démographiques », aux hypothèses pourtant analogues à celles du « scénario de risque » du rapport de 2024, conduisait à des dépenses de 11,9 points de PIB (et non 9,9 points de PIB) en 2070.
b) Une croissance spontanée des dépenses de 1,2 % par an en volume (dans une fourchette de 1,1 % à 1,3 %)
La Commission européenne n'indique pas à quel taux de croissance des dépenses correspondent ses différents scénarios. On calcule toutefois, sur la base de ses hypothèses de croissance du PIB438(*), que cela correspond :
- pour le scénario de base, à une croissance des dépenses en volume d'environ 1,2 % (soit 2,9 % en supposant une inflation de 1,7 %) ;
- pour le scénario de « vieillissement en bonne santé », à une croissance des dépenses en volume légèrement inférieure à 1,1 % (soit 2,8 % en supposant une inflation de 1,7 %) ;
- pour le scénario de risque, à une croissance des dépenses en volume d'environ 1,3 % (soit 3 % en supposant une inflation de 1,7 %).
2. Les travaux de projection de l'OCDE (2024)
a) Une croissance spontanée des dépenses de santé en volume d'ici 2040 de 2,2 % dans le cas de la France (et 2,6 % dans le cas de l'OCDE)
L'OCDE a publié439(*) en 2024 une projection des dépenses de santé de ses États membres à l'horizon 2040. Dans le scénario de base, « à politiques inchangées », la croissance annuelle des dépenses de santé (en volume) serait de 2,2 % dans le cas de la France (et 2,6 % dans le cas de l'OCDE).
Ce taux se décompose conformément au tableau ci-après.
Croissance annuelle des dépenses de
santé en 2023-2040,
selon le scénario de base de l'OCDE
(en volume)
(en %)
|
OCDE |
France |
|
|
Vieillissement « pur » |
1,0 |
0,9 |
|
Croissance du PIB |
0,9 |
0,7 |
|
Prix augmentant plus vite que dans l'ensemble de l'économie |
0,4 |
0,5 |
|
Progrès technique* |
0,6 |
0,4 |
|
Augmentation de l'espérance de vie se traduisant, pour les personnes âgées, par de moindres dépenses de santé (sauf pour la période précédant le décès) |
- 0,3 |
- 0,3 |
|
Total |
2,6 |
2,2 |
* Il s'agit ici d'un facteur résiduel. Le progrès technique est aussi en partie pris en compte, de manière indirecte, par les deux lignes précédentes.
Le scénario de base est un scénario à politiques inchangées.
Source : D'après OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en
Le vieillissement « pur » (c'est-à-dire en supposant que le coût par tranche d'âge reste inchangé) contribuerait à la croissance des dépenses pour 0,9 point.
Toutefois, les dépenses de santé connaissent un « pic » les années précédant le décès. L'OCDE suppose, dans son scénario de base, que l'allongement de l'espérance de vie se traduit pour moitié par des années en bonne santé. Cela a pour effet de réduire l'impact du vieillissement « pur » de 0,3 point.
La croissance du PIB contribuerait pour 0,7 point à la croissance des dépenses de santé. Alors que des études anciennes suggéraient une élasticité au PIB des dépenses de santé supérieure à l'unité440(*), les études récentes, qui prennent mieux en compte les autres facteurs d'augmentation, parviennent à la conclusion que cette élasticité est inférieure à l'unité. Ainsi, selon l'OCDE elle serait de 0,77 au niveau de l'ensemble des États membres (autrement dit, une croissance du PIB de 1 % susciterait une croissance des dépenses de santé de 0,77 %). Bien entendu, cela ne signifie pas que les dépenses de santé tendent à augmenter moins vite que le PIB ; toutefois cette augmentation plus rapide provient des autres facteurs indiqués dans le tableau (vieillissement, prix augmentant plus rapidement que dans le reste de l'économie, progrès technique).
Le prix des dépenses de santé tend spontanément à augmenter plus rapidement que les prix de l'ensemble de l'économie. Cela vient du fait que la santé étant intensive en main-d'oeuvre, elle fait partie des secteurs dont les coûts augmentent plus vite que sa productivité. Pour évaluer cet effet, l'OCDE calcule au niveau de l'ensemble de l'économie le supplément de croissance des salaires par rapport à la productivité (ce qu'on appelle « l'effet Baumol »441(*)), et le multiplie par un coefficient, évalué à 0,482. Ainsi, un supplément de croissance des salaires par rapport à la productivité de 1 point augmente les dépenses de santé de 0,482 %. Dans le cas de la France, cela contribuerait à la croissance des dépenses de santé pour 0,5 point.
Enfin, les dépenses de santé dépendent des évolutions technologiques. Cet effet est le plus difficile à modéliser. L'hypothèse sous-jacente est que l'impact sur les dépenses des évolutions technologiques à venir ne sera pas significativement différent de ce qu'il a été par le passé. L'OCDE évalue cet impact à environ 0,4 point de croissance par an pour la France. Toutefois le progrès technique est aussi en partie pris en compte, de manière indirecte, par l'élasticité au PIB et l'effet Baumol.
De 2023 à 2040, le taux de croissance des dépenses de santé serait à peu près deux fois supérieur à celui de l'ensemble des recettes publiques442(*).
Le fait qu'à politiques inchangées la France, dont depuis la crise sanitaire les dépenses de santé augmentent plus rapidement que celles de la moyenne de l'OCDE, verrait ses dépenses augmenter moins vite que celles de la moyenne de l'OCDE (2,2 % contre 2,6 %), peut a priori sembler paradoxal. La décomposition de la croissance des dépenses entre ses contributions ne permet pas d'identifier une spécificité française (ce sont en effet la quasi-totalité des contributions qui seraient inférieures).
b) Une croissance des dépenses nettement supérieure à celle projetée par la Commission européenne d'ici 2040 (2,2 %, contre environ 1,1 %)
Contrairement aux projections de l'OCDE pour la France, celles de la Commission européenne sont exprimées sous la forme d'une évolution des dépenses de santé rapportées au PIB (et non de leur taux de croissance) et s'arrêtent en 2070 (et non 2040).
La Commission européenne indique toutefois la croissance potentielle du PIB projetée pour 2022, 2030 et 2040443(*), ainsi que les dépenses de santé en point de PIB en 2022 (8,8 points de PIB) et 2040 (8,9 points de PIB pour le scénario de base).
Sur cette base, on calcule que la croissance des dépenses de santé prévue par le scénario de base de la Commission européenne est d'environ 1,1 % par an en 2022-2040 (contre 2,2 % par an en 2023-2040 dans le scénario de référence de l'OCDE).
c) Selon l'OCDE, les économies envisageables pour l'OCDE seraient de 1,2 point de PIB en 2040 (mais seulement 0,4 point de PIB sans mesures « transformatrices »)
L'OCDE fait diverses variantes, dont les résultats ne sont toutefois pas détaillés par pays. Elles n'incluent pas de mesures « transformatrices ». Leurs hypothèses sont synthétisées dans le tableau ci-après.
Comparaison des différents scénarios de croissance des dépenses de santé par l'OCDE (ensemble de l'OCDE)
(en %)
|
Hypothèses |
Résultats 2023-2040 (pour l'ensemble de l'OCDE) |
||||||||
|
Élasticité au PIB |
Coefficient à utiliser pour calculer le supplément de hausse des prix par rapport au reste de l'économie |
Part des années de vie supplémentaires correspondant à des années de vie en bonne santé |
Progrès technique (contribution à la croissance des dépenses, en points) |
Croissance annuelle des dépenses publiques de santé ( %) |
Augmentation des dépenses publiques de santé en points de PIB |
Dépenses publiques de santé en 2040 en points de PIB |
|||
|
2018 |
2040 |
2018 |
2040 |
||||||
|
Scénario de base |
0,767 |
0,767 |
0,482 |
0,434 |
0,5 |
0,4 % |
2,6 |
1,8 |
8,6 |
|
Scénario de contrôle des coûts |
0,691 |
0,386 |
0,5 |
0,4 % |
2,5 |
1,7 |
8,5 |
||
|
Scénario de tensions sur les coûts |
0,843 |
0,482 |
0,5 |
0,4 % |
2,7 |
2,0 |
8,8 |
||
|
Scénario de vieillissement en bonne santé |
0,767 |
0,434 |
1 |
0,4 % |
2,3 |
1,4 |
8,2 |
||
Le scénario de base est un scénario à politiques inchangées.
Les résultats indiqués ici concernent l'ensemble de l'OCDE (les données propres à la France ne sont pas disponibles).
Source : D'après OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en
Ainsi, pour l'ensemble des pays de l'OCDE, l'aléa à la hausse serait faible : taux de croissance des dépenses majoré de 0,1 point dans le scénario dit de « tension sur les coûts » (supposant une plus forte élasticité au PIB et un plus grand supplément d'augmentation des prix par rapport à l'ensemble de l'économie).
En revanche, l'OCDE considère que des politiques appropriées, non « transformatrices », pourraient réduire la croissance annuelle des dépenses :
- dans le scénario de « contrôle des coûts » (supposant une moindre élasticité au PIB et un moindre supplément d'augmentation des prix par rapport à l'ensemble de l'économie), de 0,1 point ;
- dans le scénario dit de « vieillissement en bonne santé » (supposant que ce sont la totalité des années de vie supplémentaires, et pas juste la moitié, qui sont des années en bonne santé), de 0,4 point.
Ces scénarios, reposant sur des hypothèses purement numériques, ne simulent pas de mesures particulières.
Le scénario de « contrôle des coûts » est peu ambitieux. En effet, dans le cas de la France, cela reviendrait prendre sur le périmètre de l'Ondam des mesures de réduction nettes annuelles de seulement 0,3 milliard d'euros.
Dans le cas du scénario du « vieillissement en bonne santé », l'OCDE estime qu'il impliquerait notamment l'adoption de modes de vie plus sains, et donne l'exemple de la lutte contre la consommation nocive d'alcool.
En cumulé, ces deux scénarios ne réduisent la croissance des dépenses que d'environ 0,5 point par an, conduisant en 2040 à une réduction des dépenses de santé de 0,5 point de PIB.
Aussi, l'OCDE conclut que la maîtrise des dépenses de santé implique de prendre des mesures allant au-delà de ces scénarios. Elle rappelle que, selon une étude de 2017 de l'OCDE, 20 % des dépenses de santé seraient inefficaces. Aussi, elle préconise de réduire cette proportion de plus de la moitié. Compte tenu de l'augmentation projetée des dépenses de santé en points de PIB d'ici 2040, cela susciterait selon elle une économie de 1,2 point de PIB en 2040 pour l'ensemble de l'OCDE (soit 0,7 point de PIB de plus que le cumul des scénarios de « contrôle des coûts » et du « vieillissement en bonne santé »).
L'OCDE donne comme exemples de mesures « audacieuses » le développement des infirmiers en pratique avancée et le renforcement du rôle des pharmaciens, la télémédecine, le recours à des outils robotiques, la réduction des erreurs médicales et des maladies nosocomiales, l'harmonisation des pratiques médicales.
d) L'OCDE considère que les dépenses de santé des pays de l'OCDE devraient encore plus augmenter d'ici 2040, du fait de la nécessité d'augmenter la « résilience »
Les scénarios ci-avant ne prennent pas en compte les dépenses de santé supplémentaires que l'OCDE juge nécessaires pour augmenter la « résilience ».
En effet, dans un rapport de 2023444(*), elle estime que pour faire face à une nouvelle crise sanitaire dans de bonnes conditions, des dépenses supplémentaires de 1,4 point de PIB en moyenne sont nécessaires (entre 0,6 et 2,5 points de PIB selon les pays).
Les dépenses publiques de santé
supplémentaires nécessaires
dans les pays de l'OCDE afin
d'améliorer la résilience
en cas de nouvelle crise sanitaire,
selon l'OCDE
(en points de PIB)
|
OCDE |
Pays ayant besoin de l'augmentation minimale |
Pays ayant besoin de l'augmentation maximale |
|
|
Protéger les fondamentaux de la santé |
0,28 |
0,13 |
0,53 |
|
Renforcement de la prévention (lutte contre la consommation nocive d'alcool, l'obésité...) |
0,1 |
0,03 |
0,26 |
|
Programmes populationnels de masse (vaccination...) |
0,18 |
0,06 |
0,42 |
|
Fortifier les fondations des systèmes de santé |
0,41 |
0,26 |
0,63 |
|
Équipements de base suffisants (nombre de lits...) |
0,13 |
0,0 |
0,34 |
|
Bonne exploitation de l'information en santé |
0,28 |
0,18 |
0,34 |
|
Renforcer les professionnels de santé de première ligne |
0,69 |
0,03 |
1,55 |
|
Professionnels de santé et de soins de long terme en nombre suffisant |
0,66 |
0,0 |
1,52 |
|
Réserve médicale |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
Total |
1,38 |
0,56 |
2,51 |
Remarques :
Les minima et maxima (deux dernières colonnes) sont déterminés de manière indépendante pour chaque ligne. Les sous-totaux et le total ne correspondent donc pas aux sommes des lignes correspondantes.
Contrairement au graphique ci-après, le tableau prend en compte les seules dépenses publiques de santé.
Source : D'après OCDE, Ready for the Next Crisis ? Investing in Health System Resilience, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, 2023, https://doi.org/10.1787/1e53cf80-en
L'OCDE n'indique pas le résultat pour les différents pays. Il est vrai que, comme c'est inévitable dans ce type d'étude, la méthodologie suivie implique souvent de fortes simplifications445(*).
On observe toutefois que la France a des lacunes dans de nombreux domaines : prévalence particulièrement élevée du tabagisme et de la consommation nocive d'alcool, insuffisance de la vaccination chez les personnes âgées, nombre de médecins par millier d'habitants inférieur à l'objectif retenu par l'OCDE dans son rapport446(*).
En tout état de cause, le système de santé français actuel est loin d'être parfait, et il faudra manifestement augmenter les dépenses dans certains domaines au cours des prochaines décennies.
Dans son rapport précité de 2024, l'OCDE combine, au niveau agrégé de l'ensemble des États de l'OCDE, les scénarios ci-avant avec l'augmentation des dépenses de 1,4 point de PIB destinée à améliorer la résilience. Il en résulte des dépenses totales de santé qui, avant mesures d'économies, passeraient de 8,8 points de PIB en 2018 à 11,8 points de PIB en 2040.
Dépenses totales de santé des pays de l'OCDE, y compris dépenses de 1,38 point de PIB destinées à améliorer la résilience
(en points de PIB)
Remarques :
Contrairement au tableau ci-avant, le graphique prend en compte l'ensemble des dépenses de santé (publiques et privées), de 8,8 points de PIB en 2018.
Sans les dépenses destinées à améliorer la résilience de 1,38 point de PIB préconisées par le rapport de 2023, le scénario de base correspondrait à des dépenses de 11,2 points de PIB en 2040.
Le graphique, qui prend en compte ces dépenses destinées à améliorer la résilience, indique toutefois des dépenses de seulement 11,8 points de PIB en 2040, soit seulement 0,6 point de plus (et non 1,38) que dans le cas du scénario de base. Cela vient tout d'abord du fait que ce 1,38 point de PIB comprend 0,13 point de PIB correspondant à des dépenses d'investissement, dont l'OCDE considère qu'ils auront été réalisés dès 2035. Surtout, l'OCDE fait l'hypothèse que le 1,25 point de PIB restant, correspondant aux dépenses de fonctionnement, et qui comprend notamment des dépenses de prévention, permettra de faire des économies, pour un montant estimé, de manière conventionnelle, à 0,65 point de PIB.
Source : D'après OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en
C. DÉPENSES D'AUTONOMIE
1. Selon les projections de la Drees de 2017, à droit constant de 2014 à 2060 les dépenses publiques en faveur de l'autonomie augmenteraient d'un point de PIB (environ 30 milliards d'euros sur la base du PIB actuel)
Les travaux de projection réalisés par l'administration française n'ont pas été actualisés depuis 2017.
Réalisés par la Drees pour le rapport du HCFiPS de juin 2017447(*), ils ont aussi fait l'objet d'une publication indépendante par la Drees448(*).
Leur périmètre correspond aux comptes de la dépendance, c'est-à-dire aux seules personnes âgées dépendantes.
Dans le scénario de référence, les dépenses publiques449(*) de prise en charge des personnes âgées dépendantes, estimées à 1,11 point de PIB en 2014, atteindraient en 2060 un niveau de 2,07 points de PIB, ce qui représente un quasi doublement et une augmentation de près de 1 point de PIB (environ 30 milliards d'euros sur la base du PIB actuel). L'augmentation serait la plus forte entre 2030 et 2045, pour des raisons démographiques.
Les dépenses publiques de prise en charge des personnes âgées dépendantes, selon la Drees (2017) : scénario de référence
Scénario de référence : productivité réelle 1,3 % - chômage 7 %, effectifs de personnes âgées dépendantes intermédiaires (GIR 1 à 4, tous modes d'hébergement confondus, France entière) et indexations « mi-prix, mi-salaires ».
Source : D'après Romain Roussel, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Etudes et résultats, n° 1032, octobre 2017
Ce scénario de référence suppose une croissance de la productivité élevée, de 1,3 %450(*). Le scénario de croissance de la productivité à 1 % conduit à des dépenses un peu plus faibles en 2060 (en points de PIB et en milliards d'euros), vraisemblablement du fait de l'hypothèse d'indexation (pour moitié sur les prix et pour moitié sur les salaires).
Les deux principaux aléas concernent :
- l'indexation des prestations. Actuellement, le droit prévoit généralement que les prestations monétaires sont indexées sur les prix. Le scénario de référence suppose que les prestations, considérées globalement, sont indexées pour moitié sur les prix et pour moitié sur les salaires. Une indexation seulement sur les prix conduirait à des dépenses moins élevées (1,96 point de PIB en 2060), et une indexation seulement sur les salaires à des dépenses plus élevées (2,18 points de PIB en 2060) ;
- surtout, les effectifs de personnes dépendantes, qui dépendent notamment du partage plus ou moins équilibré des gains d'espérance de vie entre années avec ou sans incapacités. Dans un scénario plus favorable les dépenses seraient de seulement 1,85 point de PIB en 2060, alors que dans un scénario moins favorable elles seraient de 2,25 points de PIB.
Les dépenses publiques de prise en charge des personnes âgées dépendantes, selon la Drees (2017) : comparaison des différents scénarios
Scénario de référence : productivité réelle 1,3 % - chômage 7 %, effectifs de personnes âgées dépendantes intermédiaires (GIR 1 à 4, tous modes d'hébergement confondus, France entière) et indexations « mi-prix, mi-salaires ».
Source : D'après Romain Roussel, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Etudes et résultats, n° 1032, octobre 2017
Ces projections sont à politiques inchangées. Elles ne prennent pas en compte, par exemple, une possible augmentation de la proportion de personnes dépendantes prises en charge, ou des prestations par personne prise en charge (au-delà de l'indexation sur les prix et/ou les salaires).
Projections par la Drees d'effectifs des personnes en Ehpad (2020)
Projection du nombre de seniors entre les trois
lieux de vie entre 2019 et 2050,
à politique publique
de maintien à domicile inchangée
Source : Albane Miron de l'Espinay et Delphine Roy, « Perte d'autonomie : à pratiques inchangées, 108 000 seniors de plus seraient attendus en Ehpad d'ici à 2030 », Drees, Etudes et résultats, n° 1172, décembre 2020
2. Les projections de 2024 de la Commission européenne supposent une augmentation spontanée légèrement inférieure à celle de la Drees, mais soulignent un risque de forte augmentation des dépenses si le système était rendu plus favorable
a) Selon les projections de la Commission européenne (2024), à droit constant de 2022 à 2070 les dépenses publiques en faveur de l'autonomie augmenteraient de 0,7 point de PIB (environ 20 milliards d'euros sur la base du PIB actuel)
Le rapport précité de 2024 de la Commission européenne sur le vieillissement présente des projections des dépenses publiques en faveur de l'autonomie (qu'elles concernent ou non des personnes âgées dépendantes).
La prévision à long terme des dépenses en faveur de l'autonomie est moins évidente qu'on pourrait le penser de prime abord. En effet, elle ne dépend pas mécaniquement de l'augmentation du nombre de personnes âgées, mais aussi, notamment, de l'évolution des profils de dépenses ou de dépendance en fonction de l'âge (l'allongement de l'espérance de vie peut en effet amener certaines personnes à devenir dépendantes plus tard451(*)), de l'évolution de la probabilité de prise en charge (selon la Commission européenne, en France moins de la moitié des personnes dépendantes seraient actuellement prises en charge) et de l'hypothèse retenue d'évolution du coût des prestations452(*).
Ces considérations ont amené la Commission européenne à distinguer six scénarios.
Projections de dépenses publiques de
« soins de long terme »
(c'est-à-dire en faveur
de l'autonomie)
de la France par la Commission européenne
(en points de PIB)
|
Droit constant |
Projection de population |
Profil de dépendance lié à l'âge |
Profil de dépenses lié à l'âge |
Probabilité de prise en charge |
Coût unitaire |
Elasticité de la demande au revenu |
|
|
Scénario de base |
× |
Eurostat |
Profil 2022 |
Profil 2022 |
Probabilité de 2022 |
Prest. en nature : prix* Prest. monétaires : PIB/tête |
Quartile supérieur : 1 Autres : 1,1 en 2022, convergeant vers en 2070 |
|
Scénario de risque |
Si coût/tranche d'âge < moyenne européenne, il l'atteint en 2070 |
Si taux de prise en charge < moyenne européenne, il l'atteint en 2070 |
|||||
|
Convergence de la couverture |
Si taux de prise en charge < moyenne européenne, il l'atteint en 2070 |
||||||
|
Convergence des coûts |
Si coût/tranche d'âge < moyenne européenne, il l'atteint en 2070 |
||||||
|
Vieillissement en bonne santé |
× |
Toutes les années d'augmentation de l'espérance de vie sont sans handicap |
|||||
|
Pas de vieillissement en bonne santé |
× |
Taux de déoendance 2019-2021 par tranche d'âge constants |
Pour faciliter la lecture, pour les scénarios autres que le scénario de base, seules sont indiquées les différences par rapport au scénario de base.
* Pour prendre en compte la spécificité française, selon laquelle juridiquement les prestations monétaires sont indexées sur l'inflation (pour les autres pays l'hypothèse est celle d'une indexation sur le PIB/tête). Aux arrondis près, cela ne modifie pas la projection pour 2070 en points de PIB (2,6 points de PIB dans le scénario de base dans les deux cas).
Source : D'après Commission européenne, 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070), Institutional Paper 279, avril 2024
Selon le scénario de base, à droit constant et qui suppose que la moitié des gains d'espérance de vie sont sans dépendance (en rouge sur le graphique), les dépenses en faveur de l'autonomie, actuellement de 1,9 point de PIB, passeraient de 2 points de PIB en 2030 à 2,3 points de PIB en 2040, puis augmenteraient de 0,1 point de PIB par an pour atteindre 2,6 points de PIB en 2070. Les dépenses augmenteraient donc de 2022 à 2050 de 0,7 point de PIB (soit actuellement environ 20 milliards d'euros).
Ce scénario de base prévoit des dépenses inférieures à celles des projections précitées de 2017 de la Drees. En effet, dans ce scénario, l'augmentation des dépenses de 2019 à 2060 (échéance des projections de la Drees) serait de 0,6 point de PIB, contre environ 1 point de PIB selon les projections de la Drees de 2014 à 2060. Toutefois le périmètre de dépenses prises en compte par la Commission européenne est plus large.
b) Un risque de forte augmentation des dépenses si le système était rendu plus favorable
Les coûts pourraient être considérablement plus élevés s'il était décidé d'améliorer la prise en charge. Le scénario projetant les dépenses les plus élevées est le « scénario de risque », qui suppose que pour chaque tranche d'âge les dépenses par bénéficiaire et la proportion de personnes prises en charge sont portées à la moyenne européenne (quand elles lui sont actuellement inférieures).
Dans ce scénario, le principal déterminant des dépenses ne serait plus la démographie, et les dépenses augmenteraient de manière linéaire jusqu'à atteindre 4,8 points de PIB en 2070, ce qui correspond à une augmentation de près de 3 points de PIB (soit actuellement environ 90 milliards d'euros).
IV. CHIFFRAGE DES PRINCIPALES MESURES ÉVOQUÉES DANS LE DÉBAT PUBLIC POUR RÉDUIRE LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Remarque : sauf exception, les tableaux ci-après se limitent aux mesures les plus facilement chiffrables. Les chiffrages réalisés par la Mecss s'appuient sur les données publiquement disponibles. Sauf indication contraire les gains indiqués s'entendent selon une logique purement comptable, à comportements inchangés.
1. Lutte contre la fraude
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
|
|
Lutter contre les fraudes sociales |
En 2029, 3 Md€ (pour une fraude estimée à 10-15 Md€, à peu près également répartie entre fraude aux cotisations et fraudes aux prestations) ? |
Estimation conventionnelle
|
Fraudeurs |
• La Cnam prévoit de réduire la fraude (qui concerne essentiellement les professionnels) de 3 Md€ d'ici 2030, ce qui est proche du double de son estimation de la fraude (1,7 Md€) mais compatible avec l'estimation haute de la Cour des comptes, réalisée à partir d'une extrapolation (4,5 Md€). • La Cour des comptes propose de retenir un objectif de 1,5 Md€ d'ici 2029 pour la Cnam. • La fraude semble plus difficile à réduire dans le cas des cotisations (renouvellement permanent du « stock » de fraude). |
2. Mesures sur les recettes
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
|
|
Réductions de niches |
||||
|
Niches sociales des compléments de salaire453(*) |
||||
|
Convergence des différents taux du forfait social applicables aux dispositifs de partage de la valeur vers le taux de 20 % |
1 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Entreprises et salariés |
|
|
Rétablissement du forfait social pour la prime de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 250 salariés (supprimé par la LFSS 2019) |
1 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Entreprises et salariés |
|
|
Créer une sur-cotisation sur les hauts salaires |
2,5 |
Chiffrage du programme du NFP pour les législatives 2024 par l'Institut Montaigne : 2,5 Md€ (hypothèses : taxation de 10 % de la part de salaire net supérieure à 5 000 €) |
Hauts salaires |
|
|
Alignement du taux réduit de CSG de 8,3 % pour les « grosses retraites » sur le taux de 9,2 % applicable aux salaires |
1,8 |
DSS (information transmise à la Mecss) |
Retraités aisés |
|
|
Idem + suppression de la cotisation d'assurance maladie de 1 % applicable sur les retraites complémentaires + neutralisation des gains liés à cette suppression pour les pensions assujetties à 6,6 % |
0,8 |
« Rapport Vachey » (2020) |
Retraités aisés |
|
|
Assujettissement de toutes les retraites (y compris celles actuellement exonérées) au taux de CSG de 9,2 % applicable aux salaires |
11,3 |
DSS (information transmise à la Mecss) |
Retraités |
Dont : - taux plein 8,3 % : 1,8 Md€ ; - taux intermédiaire 6,6 % : 3,1 Md€ ; - taux réduit 3,8 % : 1,6 Md€ ; - taux nul : 4,8 Md€. L'annexe 2 au Placss 2024 indique (sans préciser l'année) un coût de l'ensemble des taux réduits de CSG de 8 Md€. |
|
Suppression des exemptions de CSG pour les salariés |
1,5 |
Mecss |
Salariés |
Il s'agit de la suppression de la partie « CSG » de diverses niches (titres restaurant, chèques vacances, avantages accordés par les comités d'entreprise, Cesu préfinancé, indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle) |
|
Assujettissement à la CSG des prestations familiales, des aides au logement et de la prime d'activité |
3,7 |
Mecss |
Bénéficiaires de prestations familiale, d'aide au logement ou de prime d'activité |
Ces prestations sont déjà assujetties à la CRDS |
|
Centrer davantage l'exemption en faveur de la prévoyance complémentaire sur la prévoyance stricto sensu |
< 5,1 Md€ (montant de la niche) |
- |
Salariés |
Mesure envisagée par le rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025), qui ne présente pas de chiffrage |
|
Réduire l'exonération salariale relative aux heures supplémentaires |
< 2,3 Md€ (montant de la niche) |
- |
Salariés |
Mesure envisagée par le rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025), qui ne présente pas de chiffrage |
|
Réduire l'exemption relative aux titres restaurant |
• < 1,9 Md€ (montant de la niche) |
- |
Salariés |
Mesure envisagée par le rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025) |
|
• Revenir sur les évolutions récentes454(*) rapporterait de 0,2 Md€ à 0,5 Md€ |
Rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025) |
|||
|
Réduire l'exemption relative aux indemnités de rupture conventionnelle |
< 0,1 Md€ (montant de la niche) |
- |
Salariés |
Mesure envisagée par le rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025), qui ne présente pas de chiffrage |
|
Suppression de l'abattement d'impôt sur le revenu de 10 % sur les pensions de retraite |
5 |
Tome 2 du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2025 (4 533 millions d'euros en 2023, 4 806 millions d'euros en 2024 et 4 956 millions d'euros en 2025) |
Retraités aisés |
Pour améliorer le solde de la sécurité sociale, il faudrait lui restituer ce produit, par ex. via une augmentation de la part de TVA affectée |
|
Division par 2 du plafond de l'abattement d'impôt sur le revenu de 10 % des retraités |
1,5 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Retraités aisés |
• Plafond actuellement de 4 399 euros • Pour améliorer le solde de la sécurité sociale, il faudrait lui restituer ce produit, par ex. via une augmentation de la part de TVA affectée |
|
Suppression de l'abattement de 1,75 % de CSG-CRDS au titre des frais professionnels |
1,3-2 |
DSS : 1,3 Md€ sur le champ des salariés du privé en 2025 (réponse à la Mecss) Annexe 2 au Placss 2024 : « Perte de CSG et de CRDS : de l'ordre de 2 Md€ par an en 2023 » |
Salariés |
|
|
Plafonnement à 1 Pass de l'abattement de 1,75 % de frais professionnels applicable sur la CSG-CRDS |
0,15 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Salariés |
Plafond actuel de 4 Pass |
|
Extension de l'assiette de la CSA aux revenus d'activité des indépendants |
0,25 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Travailleurs indépendants |
|
|
Extension de l'assiette de la CSA aux compléments de salaires |
0,24 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Salariés bénéficiant de compléments de salaires |
|
|
Extension de la CSA aux revenus d'activité des travailleurs indépendants et aux compléments de salaire aujourd'hui exonérés |
0,5 |
Conseil économique, social et environnemental, avis n° 2024-005, 26 mars 2024 |
Travailleurs indépendants et salariés bénéficiant de compléments de salaires |
|
|
Extension de l'assiette de la Casa aux indemnités journalières et allocations chômage |
0,1 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Bénéficiaires d'IJ ou d'allocations chômage |
|
|
Plafonnement à 5 000 euros par an de la réduction d'impôt sur le revenu pour les personnes en Ehpad |
0,11 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Personnes « aisées » en Ehpad |
Plafond actuellement de 10 000 euros |
|
Suppression, parmi les cas permettant de bénéficier de l'exonération de cotisations patronales pour les salariés intervenant auprès de « publics fragiles », de celui où l'intervention concerne une personne de plus de 70 ans (même non dépendante) |
0,18 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Personnes de plus de 70 ans non dépendantes |
|
|
Intégration des compléments de salaire relevant de la participation financière et de l'actionnariat salarié dans la rémunération servant à déterminer les seuils des allégements généraux de cotisations patronales |
3 |
Cour des comptes, Ralfss 2025 (partie de la reco. n° 6) |
Entreprises + effet emploi (à préciser) |
|
|
Fixation du profil de l'allégement applicable à partir de 2026 de manière à dégager des économies supplémentaires |
2 |
Cour des comptes, Ralfss 2025 (partie de la reco. n° 6) |
Entreprises + effet emploi (à préciser) |
|
|
Fixation du point de sortie des allégements généraux à 2,5 Smic (au lieu de 3 à partir de 2026) |
1 |
Cour des comptes, Ralfss 2025 (partie de la reco. n° 6) |
Entreprises + effet emploi (à préciser) |
|
|
Gel du barème des allégements généraux |
1,5 |
Mecss |
Entreprises + effet emploi (à préciser) |
Chiffrage à préciser |
|
Réduction des principales niches de DMTG |
1,5 |
Conseil d'analyse économique455(*) |
Bénéficiaires de successions |
Réduction des exemptions Dutreil de 75 à 50 % (le taux qui prévalait au début des années 2000) + élimination du dispositif de réduction additionnelle des droits de 50 % en cas de donation avant 70 ans Impôt d'État : il faudrait prévoir le reversement du gain à la sécurité sociale, par ex. via un ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale |
|
Augmentation de prélèvements existants |
||||
|
Augmentation d'un point du taux de : |
||||
|
Cotisation salariale sous plafond |
6,2 |
Cour des comptes, rapport de
février 2025 |
Contribuables concernés |
Absence de consensus sur les destructions d'emplois : selon le Trésor elles seraient beaucoup plus importantes pour les cotisations sociales que pour les autres hausses de PO, alors que selon l'OFCE n'y aurait pas de différence significative |
|
Cotisation patronale sous plafond |
4,8 |
Cour des comptes, rapport de
février 2025 |
||
|
Cotisation salariale déplafonnée |
7,6 |
Cour des comptes, rapport de
février 2025 |
||
|
Cotisation patronale déplafonnée |
6,2 |
Cour des comptes, rapport de
février 2025 |
||
|
CSG sur les revenus d'activité |
12,0 |
Mecss, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus de remplacement |
4,0 |
Mecss, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus du patrimoine |
0,8 |
Mecss, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
CSG sur les revenus de placement |
1,1 |
Mecss, d'après le rapport à la CCSS d'octobre 2024 |
||
|
TVA à 2,10 % |
0,2 (0,7) |
Mecss, d'après la décomposition du produit de TVA entre taux de 2015456(*), la prévision pour 2025 et la part affectée à la sécurité sociale (entre parenthèses : montants toutes APU) |
||
|
TVA à 5,5 % |
0,6 (2,5) |
|||
|
TVA à 10 % |
0,4 (1,8) |
|||
|
TVA à 20 % |
2,1 (8,9) |
|||
|
Tous les taux de TVA |
3,2 (13,8) |
|||
|
Augmentation du forfait social à 20 % d'un point |
0,2 |
D'après la délégation paritaire permanente |
La DPP indique 0,4 Md€ (en 2030) pour 2 points. |
|
|
CSA portée de 0,3 % à 0,6 % |
2,5 |
Mecss |
Lors de la discussion du PLFSS 2025, le Sénat a adopté une telle mesure, couplée à une augmentation de 7h de la durée annuelle du travail. Elle a été supprimée en CMP. |
|
|
Augmentation de 50 % de la fiscalité sur le tabac (par exemple augmentation de 15 % trois ans de suite) |
1-3 (en tenant compte de la diminution des ventes de cigarettes mais pas des économies, à plus long terme) |
Mecss |
Fumeurs et industriels du tabac |
Chiffrage par nature imprécis, du fait de l'incertitude sur l'évolution des comportements |
|
Alignement de la taxation de l'alcool du vin sur celle de l'alcool de la bière |
2,5 |
Rapport « fiscalité comportementale » de la Mecss457(*) |
Producteurs, vendeurs et consommateurs de vin |
Le rapport « fiscalité comportementale » de la Mecss ne préconise pas d'augmenter la fiscalité sur le vin, mais de réfléchir à l'instauration d'un prix minimum par unité d'alcool. |
|
Augmentation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) sur les cotisations des contrats d'assurance maladie |
0,5 Md€ pour une augmentation des taux applicables de 1 point 1 Md€ pour une augmentation des taux applicables de 2 points |
Mecss |
Complémentaires santé, et surtout assurés (environ 2/3) et entreprises (environ 1/3, via la contribution employeur) |
|
|
Création de nouvelles taxes / fortes modifications de taxes existantes |
||||
|
Imposition des dépassements d'honoraires |
0,4 |
Mecss (taxe ad hoc de 10 % sur des dépassements d'honoraires de 3,7 Md€ en 2022) |
Médecins libéraux pratiquant les dépassements d'honoraires (secteur 2) |
|
|
Prélèvement supplémentaire de 1 % sur les flux patrimoniaux successoraux |
1,0 |
Rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025) |
Bénéficiaires de successions |
|
|
Instauration d'une tranche de DMTG à 25 % pour les transmissions entre 284 128 euros et 552 324 euros |
0,2 |
« Rapport Vachey » de 2020 |
Bénéficiaires de successions |
Impôt d'État : il faudrait prévoir le reversement du gain à la sécurité sociale, par ex. via un ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale |
|
Rendre plus progressif le barème des droits de mutation à titre gratuit |
2 |
Conseil économique, social et environnemental, avis n° 2024-005, 26 mars 2024 |
Bénéficiaires de successions |
Impôt d'État : il faudrait prévoir le reversement du gain à la sécurité sociale, par ex. via un ajustement de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale |
|
Taxation supplémentaire de 0,2 % du stock de l'assurance vie |
4,0 |
Rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025) |
Titulaires de contrats d'assurance vie |
Le rapport des trois Hauts Conseils suggère que cette taxation soit temporaire |
|
Instauration d'une CSG progressive |
? |
Le rendement dépend du barème retenu |
Contribuables ayant des revenus élevés |
Il faudrait être attentif à la constitutionnalité du dispositif. Le Conseil constitutionnel a censuré l'instauration par la LFSS 2021 d'une CSG progressive, parce que la disposition ne prenait pas correctement en compte la capacité contributive des ménages458(*). Il a censuré la disposition de la LFRSS pour 2014 instaurant une progressivité des cotisations salariales (mais cela ne concernait pas la CSG). Il a censuré la disposition de la LF 2016 instaurant une CSG progressive parce qu'elle ne respectait pas le principe d'égalité (elle ne s'appliquait qu'aux salariés)459(*). Cette difficulté pourrait être contournée par l'instauration d'un prélèvement complémentaire. |
|
Cotisation progressive affectée à la perte d'autonomie des personnes âgées assise sur les revenus d'activité et les pensions de retraite (1 € de cotisation en moyenne par jour) |
16 |
Conseil économique, social et environnemental, avis n° 2024-005, 26 mars 2024 |
Actifs et retraités |
|
|
Taxe sur les produits alimentaires les plus riches en sucre |
1 Md€ ? |
Mecss - chiffrage à préciser |
Producteurs et consommateurs de produits sucrés |
Hypothèse conventionnelle de taxe de 1 euro par kg de sucre pur pour les produits dont la masse comprend au moins 40 % de sucre |
|
Taxation des « écrans » |
Le rendement dépendra du régime retenu |
• Mesure préconisée par le rapport des trois Hauts Conseils (juillet 2025), qui s'interroge sur ses modalités (« taxe Attal-Ruffo » ou « taxe Acemoglu-Johnson »). • Enjeu des relations avec les États-Unis. |
||
|
Taxe de 2 % sur les revenus des plateformes générés en France (allouée à un fonds en faveur de la santé mentale) |
? |
- |
Gafam, consommateurs |
Mesure proposée par Gabriel Attal et Marcel Ruffo |
|
Taxe de 50 % sur la publicité en ligne |
5 Md€ ? |
Estimation indicative par la Mecss (en 2024, le chiffre d'affaires de la publicité digitale aurait été de 11 M€) |
Gafam, entreprises faisant de la publicité en ligne, consommateurs |
Mesure proposée par les prix Nobel d'économie Daron Acemoglu et Simon Johnson |
3. Mesures sur les dépenses
3 a. Dépenses de santé
Remarque : les propositions faites par la Cnam dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025 sont présentées plus en détail dans l'annexe V au présent rapport.
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
|
|
Prévention, prise en charge des maladies chroniques |
||||
|
« Développer la prévention secondaire et tertiaire pour réduire la prévalence des maladies chroniques et leurs complications » |
0,5 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
- |
|
|
« Améliorer la détection et la prise en charge des maladies chroniques »460(*) |
0,4 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 6) |
- |
|
|
« Améliorer la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et viser une réduction des chutes et des décès induits »461(*) |
0,8 à 1,2 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 7) |
- |
|
|
Pertinence des soins |
||||
|
« Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système » |
4,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
Assurés et professionnels abusant du système |
|
|
« Amplifier la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et réduire les écarts de dépenses de santé atypiques constatés entre départements »462(*) |
2,8 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 2) |
Professionnels de santé |
|
|
« Poursuivre le virage ambulatoire dans les établissements de santé »463(*) |
0,8 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 8) |
- |
|
|
« Viser l'amélioration de la qualité des soins pour réduire les évènements indésirables graves en établissements de santé »464(*) |
0,5 à 1 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 9) |
- |
|
|
Parcours de soins/carte sanitaire |
||||
|
« Organisation des parcours et du lien ville-hôpital : mieux prendre en charge les pathologies chroniques »465(*) |
2,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
- |
|
|
« Dans la perspective d'organisation régionale des parcours de soins, restructurer les services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins »466(*) |
0,8 à 1,2 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 10) (économie estimée en retenant un objectif de réduction d'un tiers à la moitié d'ici 2029 des économies potentielles chiffrées) |
- |
Sujet très sensible localement |
|
Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |
||||
|
Stabilisation de la répartition des dépenses entre la sécurité sociale et les complémentaires santé par rapport à 2025 |
3,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
Assurés |
|
|
« Dans une démarche partenariale et pluriannuelle avec les organismes complémentaires de santé, rééquilibrer les prises en charge des dépenses de santé »467(*) |
1 à 1,5 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 11) |
Assurés |
|
|
« Mieux responsabiliser les assurés »468(*) |
0,3 à 0,5 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 15) |
Assurés |
|
|
Plus grande participation des assurés au financement des dépenses de santé (à l'exclusion de ceux ayant les plus faibles revenus), avec ou sans prise en charge par les complémentaires santé |
Dépend du calibrage retenu |
Mecss. Une participation de 10 € par hospitalisation (quelle que soit sa durée) correspondrait à 0,2 Md€. Les augmentations de la contribution forfaitaire et de la franchise réalisées en 2024 étaient chiffrées à l'automne 2023 par la DSS à 0,8 Md€. Le Gouvernement démissionnaire envisageait de doubler à nouveau les franchises et participations forfaitaires, cette fois également en doublant leur montant annuel plafonné par assuré (de 50 à 100 euros), pour des économies potentielles évaluées par la Mecss à environ 1,8 Md€ |
Assurés |
|
|
Déremboursement des médicaments au service médical rendu (SMR) faible |
0,2 Md€ |
Mecss. Les médicaments remboursés à 15 % ont coûté 0,5 Md€ en 2022. On suppose ici que le déremboursement est de seulement les 2/3 (prise en charge passant de 15 % à 5 %), afin de conserver la traçabilité des délivrances |
Assurés |
|
|
Modulation de la prise en charge des frais de santé en fonction du revenu |
Non chiffrable (dépend des paramètres retenus) |
- |
Assurés aisés |
Selon le Figaro du 26 février 2024, le Gouvernement envisageait que « certains frais de santé » soit « remboursés en fonction des revenus ». Le mardi 26 mars 2024, Bruno Le Maire a dit qu'une telle mesure était « exclue par le gouvernement »469(*). |
|
Produits de santé |
||||
|
« Produits de santé : assurer une régulation compatible avec la soutenabilité de notre système de santé »470(*) |
6,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
Industrie pharmaceutique |
|
|
« Poursuivre la baisse des prix des produits de santé et accentuer les actions en faveur de leur bon usage »471(*) |
5,3 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 5) |
Industrie pharmaceutique |
|
|
Rémunération des professionnels de santé |
||||
|
« Régulation sectorielle : prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière »472(*) |
2,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
Professionnels de santé |
|
|
Efficience administrative |
||||
|
« Optimiser la gestion des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics et privés à but non lucratif »473(*) |
0,6 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 4) |
Fournisseurs, créanciers, personnel des hôpitaux |
|
|
Divers |
||||
|
« Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS »474(*) |
Jusqu'à 3 Md€ d'ici 2029 |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 14) |
||
|
Transfert depuis une autre branche (NB : sans effet sur le solde de la sécurité sociale) |
||||
|
« Fixer le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie au niveau médian de l'estimation de la commission chargée de l'évaluation de la sous-déclaration des maladies professionnelles (2,8 Md€) » |
0,8 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 12) |
La CAS a exprimé un point de vue défavorable à la mesure en 2024475(*) |
|
|
Affections de longue durée |
||||
|
Diminution de trois à deux ans de la durée maximale d'indemnisation continue des arrêts de travail des salariés en ALD |
0,75 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Personnes en ALD |
|
|
Franchise spécifique au transport sanitaire plafonnée à 50 € par personne |
0,091 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Franchise spécifique au transport sanitaire plafonnée à 100 € par personne |
0,123 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Hausse des franchises |
0,01 ou 0,02 Md€ |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Fusion et rehaussement les plafonds annuels de l'ensemble des participations forfaitaires et franchises avec un plafond à 100 € |
0,14 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Suppression exonération du ticket modérateur sur les SMR faibles |
0,09 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Suppression exonération du ticket modérateur sur les cures thermales |
0,025 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Suppression exonération du ticket modérateur sur les thérapeutiques non spécifiques de l'ALD : estimation sur le paracétamol |
0,033 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Introduction d'un ticket modérateur sur les dépenses en lien avec l'ALD : 1 point de ticket modérateur plafonné à 1 000 € par an |
0,65 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Introduction d'un ticket modérateur sur les dépenses en lien avec l'ALD : 5 points de ticket modérateur plafonné à 1 000 € par an |
2,5 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Introduction d'un ticket modérateur sur les dépenses en lien avec l'ALD : 1 point de ticket modérateur sur les soins de ville, plafonné à 500 € par an |
0,31 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Introduction d'un ticket modérateur sur les dépenses en lien avec l'ALD : 5 points de ticket modérateur sur les soins de ville, plafonné à 500 € par an |
1,3 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à court terme |
|
Assujettissement à l'IR des IJSS pour 50 % (comme les IJ AT-MP) |
0,3 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Piste à cour terme L'IR étant un impôt d'État, le « retour » du gain à la sécurité sociale implique une mesure ad hoc (comme une modification de la clé de répartition de la TVA). |
|
Assujettissement à l'IR des IJSS pour 100 % |
0,6 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
|
|
Recentrer les critères de sévérité des ALD liste sur les situations médicales les plus graves et les traitements les plus onéreux |
0,36 |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Mesure de moyen terme |
|
Assurer le respect de l'ordonnancier bizone, avec une imputation automatique lors de la délivrance des produits de santé en pharmacie, en fonction de listes intégrées aux logiciels métiers à partir de listes « positives » ou « négatives » d'actes et prestations |
0,15 à 0,3476(*) |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Règle de gestion |
|
Renforcer la maîtrise des dépenses par un approfondissement des actions de gestion du risque dans le champ des ALD, sur la base d'évaluations des écarts de pratiques aux référentiels HAS et d'analyses internationales comparées des coûts et des pratiques de soins |
Jusqu'à 0,5 Md€ pour la seule réduction de la iatrogénie médicamenteuse liée à la polymédication |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Bonnes pratiques |
|
Introduire deux niveaux de reconnaissance en ALD, selon la sévérité des pathologies et l'intensité des soins, pour mieux tenir compte de la diversité des pathologies et des besoins des patients |
Assurés non reconnus en niveau 2 : entre 0,45 et 0,6 Md€ Mais coûts supplémentaires pour le niveau 1 : entre 0,2 et 0,46 Md€ |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Réforme structurelle |
|
Substitution au régime ALD d'un mécanisme de plafonnement des restes à charge (« bouclier sanitaire ») |
Rapport Igas-IGF sur les ALD de juin 2024 |
Personnes en ALD |
Réforme structurelle |
|
|
Plafond de 1 000 € |
0,8 |
|||
|
Plafond de 1 500 € |
2,7 |
|||
|
Plafond de 2 000 € |
4,0 |
|||
|
Plafond de 5 000 € |
7,7 |
|||
|
Passage du taux de prise en charge de 100 % à 90 % sur l'ensemble des soins |
Entre 8 et 9 |
Mecss |
Personnes en ALD |
|
|
Passage du taux de remboursement des transports sanitaires pour les patients en ALD de 100 % à 80 % |
Entre 0,7 et 0,8 |
Mecss |
Personnes en ALD |
|
|
Indemnités journalières |
||||
|
« Arrêts de travail : ajuster les dispositifs de prise en charge des indemnités journalières »477(*) |
2,0 (2030) |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2025 |
||
|
« En concertation avec les partenaires sociaux, alléger la charge pour l'assurance maladie obligatoire des indemnités journalières maladie des salariés » |
0,5 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 13) |
Renvoi aux recommandations du Ralfss 2024 |
|
|
Limitation des surprescriptions |
0,2 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Salariés abusant du système |
|
|
Contrôles et lutte contre les fraudes |
0,05 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Fraudeurs |
|
|
Réforme jours de carence et/ou suppression d'indemnisation des arrêts courts par l'assurance maladie : |
||||
|
- Suppression de l'indemnisation de la sécurité sociale sur les arrêts maladie de moins de 8 jours, et maintien d'un délai de carence de 3 jours sur les arrêts de plus de 8 jours |
0,47 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Entreprises (330 M€) et salariés (140 M€) |
|
|
- Allongement du délai de carence de trois à sept jours quelle que soit la durée des arrêts de travail |
0,95 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Entreprises (660 M€) et salariés (290 M€) |
|
|
- Mise en place d'un jour de carence d'ordre public et diminution du niveau des indemnités journalières de 50 % à 45 % du salaire |
0,6 |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Salariés |
|
|
- Allongement du délai de carence de 3 à 7 jours combiné à l'instauration d'un jour de carence d'ordre public |
0,55 |
Mecss |
Salariés |
|
|
Ramener les indemnités journalières de 50 % du salaire à un pourcentage plus bas |
0,2 Md€ par point de pourcentage |
Cour des comptes, Ralfss 2024 |
Entreprises et salariés |
|
|
Transport sanitaire |
||||
|
Réduction de la prise en charge du transport sanitaire |
Passage du taux de remboursement des transports sanitaires de droit commun de 55 % à 40 % : 0,3 Md€ |
Mecss |
Malades hors ALD recourant au transport sanitaire |
|
|
« Réduire la progression des dépenses de transport sanitaire »478(*) |
0,3 (2029) |
Cour des comptes, note d'avril 2025 sur l'Ondam (proposition n° 3) |
Malades, transporteurs |
|
|
Mise à contribution des industriels du médicament |
||||
|
Remboursement par les industriels de la part de marge de distribution indûment payée par l'assurance maladie du fait de la différence entre les prix faciaux (sur lesquels les marges sont calculées) et les prix nets de remises, sauf en cas d'engagement pour une convergence rapide des deux prix |
0,15 |
Cnam, rapport « charges et produits » de juillet 2024 |
Industrie pharmaceutique (les remises concernent, pour l'essentiel, les produits innovants et onéreux) |
|
3 b. Dépenses de la branche vieillesse
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
||
|
Indexation des retraites inférieure de 1 point à l'inflation |
2,9 Md€ (puis un montant analogue chaque année si on maintient la moindre indexation) |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
Retraités |
||
|
Indexation des retraites au 1er juillet au lieu du 1er janvier |
Robss et FSV : 3,1 Md€ en 2025479(*) |
PLFSS 2025 |
Retraités |
Avec une inflation constante de 1,75 %, le rendement serait d'environ 2 Md€ |
|
|
Indexation des retraites au 1er avril au lieu du 1er janvier (comme pour les autres prestations) |
2,0 Md€ en 2025 |
Mecss, sur la base du PLFSS 2025 |
Retraités |
Avec une inflation constante de 1,75 %, le rendement serait d'environ 1 Md€ |
|
|
Sous-indexation des régimes de base de 0,8 point en 2026 |
2030 : 2,0 2035 : 1,8 |
Délégation paritaire permanente |
Retraités |
||
|
Système de retraites |
Robss |
||||
|
AOD 65 ans générations 1968 à 1972 (en Md€ constants de 2024) |
Dépenses : éco. de 3,5 Md€ Recettes : 1,2 Md€ Solde : 4,7 Md€ |
Dépenses : éco. de 2,4 Md€ |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
Retraités |
Effet en 2035, en milliards d'euros constants 2024. Toutes APU : amélioration du solde de 10,6 Md€ |
|
DAR 176 trimestres générations 1969 à 1973 |
Dépenses : éco. de 3,9 Md€ Recettes : 1,3 Md€ Solde : 5,2 Md€ |
Dépenses : éco. de 2,9 Md€ |
Cour des comptes, rapport de février 2025 sur les retraites |
Retraités |
Effet en 2035, en milliards d'euros constants 2024 Toutes APU : amélioration du solde de 9,7 Md€ |
|
Durcissement des retraites anticipées pour carrière longue (RACL) 20/62 et 21/63 |
2030 : 0,5 2035 : 0,9 |
Délégation paritaire permanente |
Retraités |
||
|
Rationalisation du cumul emploi retraite |
2030 : 0,3 2035 : 0,3 |
Délégation paritaire permanente |
Retraités |
Recommandation Cour des comptes (Ralfss 2025) |
|
3 c. Dépenses de la branche famille
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
|
|
Indexation des dépenses de la branche famille inférieure de 1 point à l'inflation |
0,4 |
Mecss |
Bénéficiaires de prestations familiales |
|
|
Suppression de la majoration pour âge des allocations familiales |
1,6 |
Rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (juillet 2025) |
Bénéficiaires de prestations familiales |
Le Conseil de la famille est unanimement contre |
|
Report à 16 ans de la majoration pour âge des allocations familiales |
0,75 |
Rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (juillet 2025) |
Bénéficiaires de prestations familiales |
Le Conseil de la famille est unanimement contre |
|
Réforme de la majoration de pension de retraite de 10 % pour trois enfants et plus (à la charge de la branche famille) |
? |
- |
Retraités avec trois enfants et plus |
Réforme envisagée dans le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (juillet 2025). La majoration coûte 5,5 Md€. |
3 d. Dépenses de la branche autonomie
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
Remarques |
|
|
Prise en compte d'un loyer fictif dans le calcul de la base ressource de l'APA |
0,44 |
Rapport Vachey (2020) |
Bénéficiaires de l'APA |
Cette mesure pourrait bénéficier aux départements |
V. FORMULATION DÉTAILLÉE DES PROPOSITIONS FAITES PAR LA CNAM DANS SON RAPPORT « CHARGES ET PRODUITS » DE JUILLET 2025
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
Les titres (A, B, C, etc.) avec les chiffrages sont issus du tableau récapitulatif p. 224.
A. « DÉVELOPPER LA PRÉVENTION SECONDAIRE ET TERTIAIRE POUR RÉDUIRE LA PRÉVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES ET LEURS COMPLICATIONS » (0,5 MILLIARD D'EUROS)
Proposition 1 : Organiser une coalition des financeurs et des acteurs mobilisés en faveur de la prévention en santé :
- Installer une gouvernance de la prévention en santé permettant la coordination nationale et locale des financeurs et acteurs mobilisés en faveur de la prévention sur la base des priorités de santé publique définies par l'État.
- Faire des entreprises un lieu de prévention en développant une offre proposée aux salariés via les contrats collectifs et instaurer une demi-journée de dépistage (vaccination, dépistages du cancer, dépistage HTA, dépistage MCVA, Mon Bilan Prévention) au profit des salariés (ajout au contrat responsable).
- École : en lien avec les PMI et la médecine scolaire, organiser le dépistage systématique des troubles visuels, du langage et de l'apprentissage en classe de maternelle, et généraliser la promotion de la santé en classe (nutrition et activité physique, sommeil, vaccination, brossage de dents, etc.)
Proposition 2 : Faire progresser les dépistages du cancer
- Interdire les dépassements d'honoraires pour les actes en lien avec les dépistages organisés (mammographie, échographie et coloscopie...)
- Élargir les compétences de certains professionnels de santé pour une plus large mobilisation dans la promotion des dépistages organisés, en ouvrant la possibilité de remettre le kit de dépistage du cancer colorectal aux infirmières, aux biologistes et aux sages-femmes.
Proposition 3 : Faire progresser les dépistages des MCVA
- Déployer une campagne de sensibilisation grand public sur l'hypertension artérielle (« Know your numbers »).
- Organiser un dépistage systématique de l'HTA et ouvrir ce dépistage aux pharmaciens.
Proposition 4 : Développer une approche personnalisée de la prévention pour chaque assuré
- Intégrer à Mon Espace Santé un tableau de bord prévention individualisé propre à chaque assuré couvrant les actes de vaccination, de dépistages (cancers, MCVA) et de suivi (diabète et MRC) à partir des données de l'Assurance Maladie (comme pour les médecins traitants à compter de 2026).
Proposition 5 : Faire progresser la couverture vaccinale de la population
- Poursuivre la simplification du calendrier vaccinal, améliorer la lisibilité de la communication en la structurant par âge et par public, et poursuivre la dynamique d'extension du nombre de professionnels et d'établissements de santé en capacité de vacciner.
Proposition 6 : Renforcer et réintroduire certains contrôles
- Déployer massivement des contrôles « clients mystères » sur la vente d'alcool et de tabac aux mineurs et renforcer les sensibilisations des établissements vendeurs, les contrôles et les sanctions dissuasives en partenariat avec des associations (Comité national contre le tabagisme (CNCT) et Addictions France.
- Réintroduire une limitation des achats transfrontaliers de tabac vers la France.
Proposition 7 : Faire du Nutri-Score la clef de la politique de prévention nutritionnelle
- Rendre le Nutri-Score obligatoire pour les produits emballés.
- Rendre obligatoire l'affichage du Nutri-Score dans les publicités alimentaires dès 2026.
- Limiter la publicité à certaines heures de la journée (exposition des enfants) aux produits classés D et E.
Proposition 8 : A taux de prélèvements obligatoires constant, repenser la fiscalité comportementale
- À rendement constant, redéfinir les taux de TVA sur plusieurs catégories de produits pour inciter à une consommation de produits sains et durables et à la pratique d'une activité physique.
- À taux de prélèvement obligatoire constant, renforcer et élargir progressivement les taxes comportementales (à mesure que leur rendement à assiette et taux constants baisse de par leur efficacité), afin de rendre les produits les plus nocifs pour la santé moins attractifs pour les consommateurs (sucre ajouté et produits alimentaires ultra-transformés, nitrites additifs, perturbateurs endocriniens (notamment le phtalate), boissons sucrées, tabac, alcool).
Options non
consensuelles* présentées au Conseil
de la Caisse nationale de
l'assurance maladie sur la prévention
Options pour faire progresser la vaccination et protéger les publics fragiles
• Instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe en Ehpad pour les résidents.
• Instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé travaillant en Ehpad / en établissement de santé et médico-social / en contact avec tout patient (incluant la ville).
• Solliciter l'avis de la HAS pour abaisser la vaccination HPV à 9 ans.
Options pour renforcer l'engagement des assurés dans la prévention grâce à des incitations financières
• Mettre en place des incitations personnalisées à la prévention.
- Remettre un bon de réduction sur les primes d'assurance complémentaire pour les assurés à jour de leurs actes de prévention.
- Expérimenter une incitation financière à l'arrêt du tabac en sus de la mesure du CO expiré pendant la grossesse.
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
B. « ORGANISATION DES PARCOURS ET DU LIEN VILLE-HÔPITAL : MIEUX PRENDRE EN CHARGE LES PATHOLOGIES CHRONIQUES » (2 MILLIARDS D'EUROS)
1. Coordination ville-hôpital
Proposition 9 : Instituer un Observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans
- Identifier précisément les besoins pour chaque catégorie de professionnels (médecins par spécialités, infirmiers, dentistes, etc.) compte-tenu de l'évolution démographique, de l'évolution des compétences, des organisations de travail, et des choix de carrière. Rétroagir sur les places d'université et en centre de formation.
Proposition 10 : Réguler plus fortement l'activité médicale conventionnée
- Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non-conventionnés.
- Mieux identifier la part que représentent les activités non conventionnées (médecine esthétique, sophrologie...) dans l'activité des médecins, et définir en concertation avec les médecins des actions de régulation (ex. seuil pour rester conventionné).
Proposition 11 : Organiser systématiquement la sortie d'hôpital en construisant un cadre opérationnel dans tous les territoires avec les CPTS et les établissements de santé pour assurer la gestion des sorties avec les professionnels de ville et le secteur médico-social
Proposition 12 : Créer de nouveaux métiers de « référents de parcours » et « d'infirmière de coordination », et généraliser la responsabilité populationnelle des organisations territoriales
- Généraliser la responsabilité populationnelle des organisations territoriales : les CPTS, les MSP pour leurs patients, les structures hospitalières pour les patients en sortie d'hospitalisation et jusqu'à stabilisation de leur état médical (rémunération variable sur résultats).
- Leur permettre de recruter des professionnels de la coordination médicale (suivi et surveillance, y.c. télésurveillance) et administrative (prise de RDV, réservation de transport, suivi des droits), pour assurer la coordination du parcours des patients nécessitant un suivi attentionné (patients en ALD / âgés / à domicile /en situation de précarité).
- Pour les patients stabilisés, des infirmières de coordination et des référents parcours doivent être recrutées au sein des MSP. Pour les patients non stabilisés, a fortiori après un épisode de soins aigus, assurer une surveillance articulée de deuxième niveau portée par les structures de second ou de troisième recours (établissements de santé / équipes de soins spécialisées) sur le modèle de l'expérimentation A51 CECIS.
Proposition 13 : Favoriser autant que possible le domicile et les structures intermédiaires (habitats inclusifs), en s'appuyant sur les différents acteurs du domicile (Idel, Ssiad, Saad, HAD) et médicaliser les EHPAD pour éviter les allers-retours hôpital-EHPAD
Proposition 14 : Renforcer l'accès aux soins spécialisés en travaillant à des évolutions des modes de régulation des dépassements d'honoraires dans le cadre de la mission parlementaire lancée par le Premier Ministre
Proposition 15 : Prévenir et repérer plus précocement les troubles de santé mentale
- Lutter contre les facteurs de risques (interdire l'exposition aux écrans avant 3 ans, instaurer une limite d'âge pour accéder aux réseaux sociaux, promouvoir l'activité physique, faire de la promotion en santé sur le sommeil, les addictions et la santé sexuelle chez les adolescents).
- Dans le cadre de la Grande Cause 2025, poursuivre la sensibilisation du grand public pour dé stigmatiser les troubles psychiques et construire une cartographie interactive de l'ensemble des lieux d'écoute et de soins (applications numériques validées scientifiquement, dispositifs d'écoute, maisons des adolescents, professionnels libéraux, établissements spécialisés...).
- Former 1 million de secouristes en santé mentale (référents en entreprise, enseignants, travailleurs sociaux, associations sportives et culturelles, agents des services publics accueillant du public...) pour repérer plus tôt les signes de détresse psychique et orienter vers une prise en charge adaptée.
Proposition 16 : Favoriser l'accès aux soins en santé mentale et structurer une filière de prise en charge pour soulager les urgences psychiatriques
- Renforcer le premier niveau de prise en charge (MG et psychologues) pour éviter une concentration des prises en charge en psychiatrie : outiller les médecins généralistes dans le diagnostic et l'orientation vers le second recours (notamment via la télé-expertise), développer massivement le recours aux infirmiers psy (IDE ou IPA) dans les équipes de soins primaires pour coordonner les parcours des patients (dans les suites de l'expérimentation Article 51 SESAME), poursuivre le développement de Mon Soutien Psy et construire un référentiel de formation afin d'envisager l'extension des dispositifs aux troubles plus sévères.
- Augmenter la capacité de la psychiatrie " générale " (libérale ou de secteur) à prendre en charge le second recours et mieux s'articuler avec le 1er niveau : instaurer des équipes de soins spécialisés (ESS) en santé mentale sur tout le territoire, déployer des équipes mobiles pour interventions rapides de diagnostic et soutenir les filières de prise en charge de l'urgence en santé mentale (SAS psychiatrique, SAMU psy).
Proposition 17 : Etablir le cahier des charges organisationnel et financier des structures de soins non-programmés parfois nécessaires à un territoire pour la prise en charge des urgences en ville, en coordination avec le médecin traitant et l'hôpital
- Création d'une nouvelle forme juridique pour ces structures.
- Création d'un modèle de financement adapté, intégré au système conventionnel.
Proposition 18 : Réussir la 2e vague de la chirurgie ambulatoire et ouvrir le champ de la chirurgie hors bloc
- Définir un plan opérationnel pour atteindre l'objectif de 80 % de taux de chirurgie ambulatoire.
- Définir le périmètre potentiel de la chirurgie hors bloc (en lien avec les sociétés savantes), les niveaux d'environnement techniques adaptés aux prises en charge (sous l'égide de la Haute Autorité de santé), le cadre réglementaire et créer une prestation pour couvrir les frais d'environnement.
Proposition 19 : Faire respecter les seuils existants d'activité minimum pour réaliser certaines activités de chirurgie afin de garantir une égale qualité des soins pour tous, tout en maintenant une prise en charge de proximité
2. Pathologies chroniques
Proposition 20 : Sécuriser le parcours de prévention tertiaire des personnes souffrant de pathologies chroniques (éducation thérapeutique, Sophia 2.0, télésurveillance, APA) et assurer une surveillance populationnelle possiblement portée par les établissements de santé pour les patients non stabilisés, avec un financement incitatif (sur le modèle de l'expérimentation « article 51 » Cecics)
Proposition 21 : Mettre en place une gestion plus dynamique des entrées et des sorties du dispositif des ALD :
- Améliorer l'accompagnement des patients à leur entrée dans le dispositif ALD via un parcours de prévention et d'information renforcées destiné à éviter, du moins à retarder, l'aggravation de la pathologie (Sophia 2.0, Mon Espace Santé, etc.).
- Évaluer régulièrement la consommation de soins des personnes bénéficiant du dispositif afin de réévaluer l'exonération pour les personnes en situation de guérison ou de rémission de certaines pathologies (cancers en phase de rémission, certaines affections cardio-vasculaires après une période active de soins lorsque la personne se retrouve sans incapacité), remplacé par un dispositif de suivi et surveillance renforcée. En cas de rechute ou d'aggravation de la pathologie, le dispositif ALD serait à nouveau déclenché.
Proposition 22 : Ne plus permettre la prise en charge à 100 % des prestations ou des produits de santé dont l'efficacité ne justifie pas ce remboursement intégral (par exemple cures thermales).
Options non consensuelles* présentées au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur la prise en charge des pathologies chroniques
• Définir une liste de soins spécifiques et opposables à chaque ALD.
• Créer un statut supplémentaire en amont de l'ALD.
• Créer un statut de « risque chronique » au moment du diagnostic par le médecin traitant d'une HTA, d'une obésité, d'un risque cardiovasculaire, d'une hypercholestérolémie, ou d'un diabète de type 2 sans comorbidité. Ce statut doit permettre la mise en place d'un parcours de prévention adapté pour éviter ou retarder l'aggravation de la pathologie (par ex : bilan diététique, bilan activité physique, éducation thérapeutique, accompagnement Mon soutien psy) avec une prise en charge par l'Assurance maladie obligatoire et complémentaire de droit commun évitant la chronicisation et le développement de comorbidités.
• Recentrer le statut ALD et la prise en charge à 100 % par l'AMO lorsque le patient passe une étape dans sa maladie qui deviendra inévitablement longue et couteuse, avec un fort recours au système de santé.
Dans ce schéma, les associations de patients et les sociétés savantes pourraient déterminer, pathologie par pathologie, la gradation de la prise en charge médicale et financière en lien avec la HAS.
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
C. « ARRÊTS DE TRAVAIL : AJUSTER LES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES » (2 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 23 : Améliorer et simplifier la prise en charge des assurés dans le cadre des arrêts maladie
- Mettre en oeuvre une équité des conditions d'ouverture de droits quelle que soit l'activité de l'assuré (salarié ou indépendant) et son ancienneté dans l'entreprise pour que les contrats précaires ne soient pas exclus de la prévoyance.
- Rendre la subrogation des arrêts maternité et des arrêts maladie obligatoire pour les employeurs.
- Renforcer nos efforts en termes de prévention de la désinsertion professionnelle.
Proposition 24 : Lutter contre l'absentéisme de courte durée en améliorant les conditions de vie au travail et en responsabilisant davantage les différents acteurs impliqués : l'entreprise, le prescripteur, l'assuré
- Limiter la durée de l'arrêt de travail pouvant être prescrit (1 mois en primo-prescription en cas d'hospitalisation et 15 jours en ville, puis par tranche de deux mois maximum) afin de garantir un vrai suivi médical de la personne arrêtée et la pertinence de l'arrêt de travail.
- Rendre pour les prescripteurs les motifs d'arrêt obligatoires et indiquer les durées prévues par les référentiels scientifiques.
- Permettre la prescription de télétravail.
- Rendre effectif le contrôle de l'absentéisme par les employeurs en simplifiant les procédures.
- Diffuser au plus grand nombre possible d'entreprises les référentiels de bonnes pratiques en matière de conditions de travail, diffusés lors des campagnes sur l'absentéisme atypique.
Options non consensuelles* présentées au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur les indemnités journalières
• Lutter contre l'absentéisme de courte durée
- Prévenir les arrêts courts évitables (grippe via des dispositifs de vaccination en entreprise, douleurs évitables par des aménagements de postes, amélioration de la qualité de vie au travail, etc.) en introduisant un bonus/malus employeur sur l'absentéisme de court terme
- Transférer le financement les 7 premiers jours d'arrêt de travail à l'employeur avec un maintien du niveau de couverture actuel pour le salarié (période sur laquelle il a des leviers de prévention) et instaurer en contrepartie une journée de carence d'ordre publique pour dissuader les arrêts sans lien avec la maladie
• Mieux protéger les personnes en arrêt long et éviter leur désinsertion professionnelle
- Supprimer le régime dit d'« ALD non-exonérante » au profit des deux régimes de droit commun (ALD ou non-ALD) avec, en parallèle, un renforcement des actions pour éviter la désinsertion professionnelle
- Instaurer un « contrat de prévoyance responsable » basculant une partie des financements complémentaires de l'entreprise sur les arrêts de long terme, source de paupérisation. Le contrat responsable pourrait prévoir une indemnisation obligatoire pendant toute la durée de l'arrêt, en sus des 50 % de l'Assurance Maladie (par exemple de 10 %), en contrepartie d'une indemnisation plafonnée à 90 % du revenu net du salarié pour les arrêts courts (par exemple de moins d'un mois). En tant que contrat responsable, il bénéficierait dès lors d'une fiscalité incitative.
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
D. « PRODUITS DE SANTÉ : ASSURER UNE RÉGULATION COMPATIBLE AVEC LA SOUTENABILITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ » (6 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 25 : Garantir une hiérarchie des prix cohérente avec le progrès thérapeutique des médicaments
- Réaliser des baisses de tarifs sur les ASMR IV représentant une baisse de 20 % des coûts par patient d'ici 2030 afin de compenser la forte hausse des coûts depuis 2017.
- Réaliser des baisses de tarifs sur les médicaments à ASMR V afin de retrouver le niveau de dépenses observé en 2019.
- Compte tenu de l'augmentation des dépenses de médicaments et du déficit de la sécurité sociale, il est nécessaire d'accroitre le niveau d'économies générées par ces produits en leur permettant de rentrer dans le panier de soins remboursable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- les médicaments ASMR V (sous brevet) acceptent une baisse de prix de 20 % minimum par rapport au prix net du comparateur le moins cher ;
- les médicaments ASMR IV acceptent une baisse de prix par rapport au prix net du comparateur le moins cher ;
- dans les deux cas ci-dessus, les prix nets sont alignés aux prix faciaux.
Proposition 26 : Enrayer le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie
- Revoir la politique de tarifs excessifs sur les médicaments anti-cancéreux
- Réinterroger le remboursement de certains médicaments anticancéreux ne présentant aucun résultat probant dans le cadre de leurs essais cliniques et exiger des données probantes dans le cadre des nouvelles inscriptions
Proposition 27 : Instaurer un mécanisme permettant de faire financer par les acteurs du médicament et l'Assurance Maladie les essais thérapeutique en lien avec la désescalade thérapeutique
Proposition 28 : Augmenter les économies en lien avec les génériques et biosimilaires
- Appliquer aux médicaments biosimilaires, l'ensemble des dispositifs ayant permis une pénétration forte des médicaments générique : tiers payant contre biosimilaires, alignement des remboursements bioréférents, biosimilaires au bout de deux ans de commercialisation du biosimilaires...
- Empêcher les stratégies de contournement des laboratoires par la constitution de groupe de médicaments interchangeables (« jumbo groups »).
- Les génériques génèrent des économies substantielles pour l'Assurance Maladie. Le délai d'entrée en vigueur de leur prise en charge sur la base du tarif de remboursement ajusté (TRA) est aujourd'hui de 2 ans. Or, compte tenu de la nécessité d'accélérer leur pénétration, ce délai doit être réduit à un an et leur base de remboursement pourrait être modifiée au profit de celle du générique le moins cher.
Proposition 29 : Accélérer les négociations pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce
- Renforcer les incitations au débouclage en limitant dans le temps la durée de la négociation pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce.
Option non consensuelle* présentée au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur le médicament
Reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030.
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
E. « RÉGULATION SECTORIELLE : PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES DE RENTE ET D'OPTIMISATION FINANCIÈRE (2 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 30 : Clarifier les règles de gouvernance des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) ayant ouvert leur capital à des acteurs financiers pour garantir l'indépendance des professionnels de santé (sur le modèle de la conciliation organisée par le Conseil d'État dans la santé animale)
Proposition 31 : Établir la transparence totale sur les situations de rentes économiques et sur la composition de l'offre de soins
- Rendre obligatoire à chaque offreur de soins la déclaration de son éventuelle appartenance à un groupe, groupement ou réseau et faire évoluer les SI de l'Assurance Maladie pour rattacher chaque acte à la fois à un praticien, à une structure d'exercice, et le cas échéant à un groupe / groupement / réseau.
- Instituer et rattacher à l'Assurance Maladie un Observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement de l'ensemble des secteurs qui composent l'offre de soins.
Proposition 32 : Pour répartir plus équitablement les dépenses d'Assurance Maladie, baisser les tarifs des secteurs présentant un très haut niveau de rentabilité
Proposition 33 : Prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé (maintenance de la CCAM, études régulières de coûts, etc.)
Proposition 34 : Améliorer la régulation territoriale pour s'assurer du développement ou du maintien d'une offre de soins pertinente sur l'ensemble du territoire
- Repenser le régime des autorisations des Equipements Médicaux Lourds (EML) : renforcer la transparence sur l'usage des autorisations et des équipements, geler les installations dans les zones où l'accessibilité est satisfaisante, identifier les impacts en terme de dépenses en améliorant les échanges ARS-Assurance Maladie et conditionner les nouvelles autorisations au respect d'objectifs quantifiés de santé publique et à des engagements de solidarité territoriale (soutenir l'offre de zonesdoutées situées à proximité).
- Construire un cahier des charges de présence territoriale et le faire respecter par les groupes, groupements et réseaux.
Proposition 35 : Pour éviter les phénomènes de « too big to fail » (prise en charge par la puissance publique des conséquences des erreurs de gestion d'un acteur privé), identifier les opérateurs de l'offre de soins dont la défaillance serait susceptible d'avoir un impact significatif sur l'offre de soins et les obliger à communiquer au régulateur un plan de continuité des soins en cas de défaut au niveau du groupe
Option non consensuelle* présentée au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur les phénomènes de rente
• De manière complémentaire aux baisses de tarifs, instaurer un mécanisme de régulation sectorielle (type « clause de sauvegarde ») pour les secteurs à forte rentabilité, qui se déclencherait lorsque la régulation tarifaire est temporairement insuffisante.
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
F. « EFFICIENCE ET PERTINENCE : DÉPLOYER À LARGE ÉCHELLE UNE POLITIQUE DE SÉCURISATION DES PRESCRIPTIONS ET DE RESPONSABILISATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU SYSTÈME » (4 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 36 : Faire connaître l'investissement public dans la santé au global (campagnes sur le coût d'un accouchement, une nuit à l'hôpital, etc.) et restituer à chaque assuré ce que l'Assurance Maladie a réellement investi pour sa consommation de soins
Proposition 37 : Développer le « retour d'information aux PS » sur leurs pratiques afin de leur permettre d'adapter au mieux leur exercice professionnel par eux-mêmes, en se comparant à leurs pairs
Proposition 38 : À différents stades de la carrière du professionnel de santé conventionné, s'assurer de sa bonne connaissance des dispositifs de facturation et de l'état de l'art en matière de qualité et de pertinence
Proposition 39 : Assurer une utilisation systématique du DMP en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP-MES (biologie-radiologie en priorité)
Proposition 40 : Développer fortement la déprescription
Proposition 41 : Rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) et étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports)
Proposition 42 : D'ici 2030, viser la sécurisation de l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence
Proposition 43 : Mettre en place une plateforme de commandes de transports gérée par l'Assurance Maladie prioritairement à l'appui des médecins de ville
Proposition 44 : Diminuer l'impact carbone et environnemental des prescriptions et engager avec l'ANSM des travaux sur la réutilisation des produits de santé non-ouverts et non-périmés pour limiter le gaspillage
Proposition 45 : Déployer un nouveau dispositif d'intéressement des établissements, financé sur le risque, permettant de partager les gains réalisés en matière de PHEV (Prescriptions hospitalières exécutées en ville)
Proposition 46 : Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier, viser une part variable à la qualité et à la pertinence représentant un montant croissant de l'enveloppe financière des établissements de santé dispositif Ifaq rénové et simplifié (e.g. Rosp = 10 %)
Proposition 47 : Transférer aux établissements de santé le budget des transports des patients dialysés dont ils auront désormais la gestion
Proposition 48 : Revoir le financement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers durant un séjour d'hospitalisation en établissement public de santé
Proposition 49 : Dès 2026, revoir les modalités d'encadrement et la tarification de la PPC pour revenir à des standards proches de ceux observés à l'étranger
Proposition 50 : D'ici 2027, construire un dispositif de régulation sectorielle pour mieux encadrer les dépenses de dispositifs médicaux de la LPP
Proposition 51 : Renforcer la régulation à l'installation des infirmiers libéraux via l'extension des zones sur-denses et l'instauration d'une règle de « deux départs pour une installation » dans les zones très sur-dotées
G. « LUTTE CONTRE LES FRAUDES » (3 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 52 : Conditionner le tiers payant à l'utilisation systématique de la carte Vitale, sauf cas exceptionnel
Proposition 53 : Faciliter la qualité et le contrôle de l'exécution des prescriptions
- Généraliser l'ordonnance numérique à tous les types de prescription (biologie, radiologie, soins paramédicaux, transports).
- Permettre aux pharmaciens de vérifier les règles de dispensation des produits.
- Faciliter les contrôles de la bonne exécution des prescriptions par l'Assurance Maladie, en permettant l'utilisation des données issues de l'ordonnance numérique pour vérifier la bonne délivrance des produits ou des actes réalisés.
Proposition 54 : Renforcer les capacités d'action et de contrôle de l'Assurance Maladie sur l'activité des professionnels de santé, notamment en cas de fraudes
- Élargir les motifs existant (dépôts de plainte, récidive de fraude) permettant d'allonger le délai de 7 jours impartis à l'Assurance Maladie pour régler les PS en contrepartie de la pratique du tiers-payant, afin de pouvoir réaliser davantage de contrôles a priori avant paiement (procédures ordinales, actes fraudogènes).
- Suspendre le bénéfice de la garantie de paiement en cas de sanction pour fraude du professionnel de santé et durcir les modalités de reconventionnement des professionnels déconventionnés pour cause de fraude.
- Prévenir et sanctionner les situations de suractivité par la définition, en lien avec les représentants des PS, de seuils maximum d'activité compatible avec une bonne qualité des soins.
Proposition 55 : Développer les systèmes d'alerte permettant de signaler des fraudes
- Mettre en place un système de notifications en continu de l'assuré pour chaque remboursement, afin qu'il identifie les facturations frauduleuses.
- Créer un cadre de recueil de signalements de fraudes pour les assurés et les professionnels de santé efficace et transparent.
Proposition 56 : Renforcer la responsabilisation des assurés à travers une intensification de l'information des assurés et du suivi des patients atypiques en termes de recours au système de santé
- Prévenir et sanctionner les pratiques de surconsommation médicale ou médicamenteuse au travers de nouveaux programmes d'action contre le nomadisme médical et la consommation atypique de médicaments.
- Suspendre le bénéfice du tiers-payant pour les assurés sanctionnés pour fraudes et mieux informer les assurés des sanctions encourues en cas de fraude.
Proposition 57 : Développer les échanges d'informations entre les Assurances Maladies obligatoire et complémentaires afin de rendre la lutte contre les fraudes encore plus performante
Proposition 58 : Poursuivre et accélérer la montée en charge des nouveaux outils d'intelligence artificielle pour mieux détecter et stopper les fraudes
H. TRANSFERTS DE CHARGES AUX COMPLÉMENTAIRES SANTÉ (3 MILLIARDS D'EUROS)
Proposition 59 : Réunir l'ensemble des parties prenantes afin de déterminer les modalités de la participation financière des patients et de l'intervention des organismes complémentaires pour stabiliser la part financée par l'AMO à 80 %
Proposition 60 : Rehausser le plafond de la complémentaire santé solidaire pour que tous les assurés dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté y soient éligibles
Options non consensuelles* présentées au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur la couverture complémentaire santé
• Revoir le périmètre des contrats responsables, notamment en allongeant la fréquence de renouvellement des lunettes à niveau de correction inchangé. Interdire la publicité pour les lunettes de vue et les audioprothèses.
• Définir un contrat socle devant être proposé par l'ensemble des organismes complémentaires couvrant strictement (ni plus, ni moins) les garanties du contrat responsable, afin que chaque assuré puisse avoir le choix d'un contrat « bon-marché ».
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
* 1 L'objet du présent rapport n'est pas de préconiser une manière particulière de ramener la sécurité sociale à l'équilibre, mais de favoriser le rapprochement des points de vue, reposant sur des constats partagés. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son statut de « boîte à outils », il ne comprend pas, comme c'est habituellement le cas, des « propositions », mais des « points d'accord des rapporteures ».
* 2 Les pouvoirs de contrôle de la commission sont définis par l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils [le président, le rapporteur général, le président de la Mecss, les rapporteurs, les membres désignés à cet effet] demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis ».
* 3 Article L.O. 111-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 4 Article L.O. 111-9-3 du code de la sécurité sociale.
* 5 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 6 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 7 Selon un sondage Elabe pour BFMTV de janvier 2025, 62 % des Français souhaitent revenir à un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, tandis que 31 % veulent le maintenir à 64 ans.
* 8 En 2023, il y avait en France 3,2 médecins pour 1 000 habitants (comme au Royaume-Uni), contre 4,6 pour l'Allemagne, 4,3 pour l'Espagne et 4,2 pour l'Italie ( https://data-explorer.oecd.org).
* 9 Les mesures d'amélioration du solde, de 15 milliards d'euros dans le texte initial (dont la moitié de mesures législatives) et 16 milliards d'euros dans le texte du Sénat (avec une proportion analogue de mesures législatives), ont été ramenées à seulement 9 milliards d'euros (dont seulement un tiers de mesures législatives).
* 10 Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025.
* 11 Selon l'Insee, le PIB, exprimé en euros courants, a été de 2 919,9 milliards d'euros en 2024.
* 12 Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025.
* 13 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n'ayant été adoptée que fin février 2025, leurs travaux n'ont pu commencer que mi-mars, les auditions s'étant étendues sur trois mois (entre le 31 mars et le 25 juin). Le rapport a été examiné par la Mecss le 1er juillet 2025, puis a été actualisé pour prendre en compte les propositions du rapport « charges et produits » de la Cnam (juillet 2025) et du rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre (3 juillet 2025).
* 14 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 15 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 16 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 17 Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022.
* 18 Du fait notamment du traitement en activité marchande de la fourniture de soins par les hôpitaux publics (0,9 point de PIB environ) et d'une différence de périmètre relative au régime public de retraite (1 point de PIB environ).
* 19 Pour « parité de pouvoir d'achat ».
* 20 Comme Gilbert Cette, président du Conseil d'orientation des retraites, le souligne : « Le constat des difficultés récurrentes à financer les retraites amène certains intervenants dans le débat public à avancer que les retraites représenteraient un trop fort pourcentage du PIB en France, comparée aux autres pays avancés. [...] Mais ce constat appelle deux observations qui en modèrent la réelle portée. La première est que le rapport de la [Cour des comptes] comme ceux du COR montrent que ce pourcentage devrait spontanément baisser en France sur les prochaines décennies, du fait de l'indexation des retraites sur la seule inflation, pour passer d'environ 14 % actuellement à environ 13 % en 2070. La seconde, plus importante à nos yeux, est que ce pourcentage est relativement élevé en France du fait, surtout, de la faiblesse du PIB ! » (Gilbert Cette, Le débat sur les retraites doit être fructueux, Telos, 5 mars 2025).
* 21 Dans le cas de l'Irlande, le PIB par habitant est artificiellement majoré par les bénéfices de sociétés multinationales attirées par sa fiscalité et qui n'y réalisent pas leur activité.
* 22 Les notions de solde structurel et d'effort structurel sont définies par l'encadré à la suite du tableau.
* 23 Ces ordres de grandeur peuvent être retrouvés simplement à partir des dépenses publiques rapportées au PIB (57 %). Selon le rapport d'avancement annuel, le solde conjoncturel de l'ensemble des administrations publiques est d'environ 0,57×(-0,7)-0,4 point de PIB, donc le déficit structurel est d'environ 5,8-0,4=5,4 points de PIB (5,3 points de PIB selon le rapport d'avancement annuel). Selon la Commission européenne, l'écart de production étant quasiment nul, le solde structurel est quasiment égal au solde effectif.
* 24 L'estimation de l'écart de production (c'est-à-dire du supplément de PIB par rapport à son niveau potentiel) est en partie conventionnelle.
Ainsi, le Gouvernement estimait l'écart de production pour 2019 à seulement 0,3 point de PIB potentiel, amenant la Cour des comptes a évaluer le déficit structurel du régime général et du FSV à seulement 2,5 milliards d'euros (Cour des comptes, La sécurité sociale - les résultats de la sécurité sociale en 2019 : l'interruption d'une longue séquence de retour à l'équilibre, juin 2020).
L'estimation de l'écart de production pour 2019 par la Commission européenne (1,9 point de PIB potentiel) est néanmoins au milieu de l'intervalle retenu par l'Insee dans sa note de conjoncture de mars 2025, entre environ 1,5 et 2,4 points de PIB potentiel selon la méthode retenue (Insee, Désordre mondial, croissance en berne, note de conjoncture, 18 mars 2025).
* 25 En supposant que chaque année l'Ondam tende spontanément à augmenter de 4,5 % en valeur, les économies nettes réalisées chaque année sur la période 2011-2019 sont de près de 4 milliards d'euros. L'effet cumulé des économies est toutefois supérieur à leur simple somme, du fait de la forte croissance spontanée des dépenses.
* 26 Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « les dépenses effectuées dans le cadre du Ségur de la Santé ont été souvent considérées comme la suite de la trop forte pression ayant pesé sur ce secteur à la fin des années 2010 » ; « on considère que [le Ségur] comporte une composante de rattrapage d'évolutions salariales qui ont fait défaut au cours de la décennie 2010-2019 ».
* 27 6,3 milliards d'euros sans corriger du changement de périmètre correspondant à la création de la branche autonomie.
* 28 En 2024, les recettes ont augmenté de 4,6 %, dont 0,8 point du fait des mesures nouvelles.
* 29 Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques 2023-2027.
* 30 L'article 21 de la LPFP 2023-2027 prévoit que le ratio devant être pris en compte est « le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédits budgétaires ne peut excéder 14 % pour chacune des années de la période 2023-2027 ».
* 31 « En 2024, le coût des allègements de cotisations s'élève à 64,9 milliards d'euros, celui des exonérations ciblées et exceptionnelles à 9,8 milliards d'euros et celui des exemptions d'assiette et de la déduction forfaitaire spécifique à 15,9 milliards d'euros, portant ainsi le coût total de ces dispositifs à 90,6 milliards d'euros. Ce niveau est en faible augmentation par rapport à 2023 (+ 1 %), dans un contexte de ralentissement des salaires et de l'emploi, mais aussi en raison des mesures de réduction du coût des allègements généraux intervenues en 2024. Le poids de ces niches sociales par rapport à l'ensemble des recettes se réduit en 2024 pour s'établir à 14 % dans le total des recettes des régimes, soit exactement le niveau maximal prévu par l'article 21 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques 2023-2027 » (annexe 2 au Placss 2024).
* 32 « Si [l]es restrictions légales remplissent leur rôle à court terme (on ne peut diminuer le salaire pour augmenter un avantage exempté), elles sont impuissantes à enrayer un effet dynamique sur longue période (l'octroi d'un bénéfice exempté permet de réduire ou de différer une hausse de salaire) » (annexe 2 au Placss 2024).
* 33 Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 34 L'annexe 4 au PLFSS pour 2024, utilisé par la Cour des comptes, évaluait pour 2022 les exemptions d'assiette à 14,5 milliards d'euros (contre 13,3 milliards d'euros selon le Placss 2024, utilisé pour le présent rapport) et l'exonération des heures supplémentaires (part salariale) à 2,2 milliards d'euros. La Cour des comptes ajoute à ces montants ses estimations de deux niches non chiffrées par l'annexe au PLFSS : la prime de partage de la valeur (1 milliard d'euros) et les remboursements des frais de transport domicile-travail (0,3 milliard d'euros). Le total de l'agrégat retenu par la Cour est donc de 18 milliards d'euros en 2022.
* 35 Selon une autre approche, la contribution de ces niches à l'augmentation du déficit correspondrait plutôt à leur supplément d'augmentation par rapport à ce qui découlerait d'une croissance au même taux que celle des recettes.
* 36 Le montant des exemptions d'assiette a augmenté de plus de 60 % en 2022, 6 % en 2023 et 3,5 % en 2024.
* 37 Selon le rapport à la CCSS de juin 2024, « la croissance du Smic, inférieure de 0,7 point à celle du SMPT (respectivement + 2,2 % et + 2,9 % en moyenne annuelle), a ralenti la progression des allégements généraux de cotisations patronales et, ce faisant, a contribué à accroître les produits de cotisations sociales ».
* 38 Selon le rapport à la CCSS de juin 2025, les allégements généraux passeraient de 64,9 milliards d'euros en 2024 à 62,4 milliards d'euros en 2025 et leur réforme par la LFSS 2025 (hors inclusion de la PPV dans les rémunérations prises en compte) les réduirait en 2025 de 2 milliards d'euros. Le rapport à la CCSS n'isole pas l'effet de l'inclusion de la PPV dans les rémunérations prise en compte, incluse dans une autre ligne intitulée « réduction des niches sociales » ; toutefois l'évaluation préalable évaluait l'effet à 0,4 Md€. Hors mesures nouvelles, le coût des allégements généraux serait donc en 2025 d'environ 62,4+2+0,4=64,8 Md€, soit sensiblement le même qu'en 2024.
* 39 Selon l'article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale, l'annexe au PLFSS relative aux niches sociales sur les cotisations et contributions indique « les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu ».
* 40 Nonobstant l'effet sur l'emploi des allégements généraux de cotisations patronales et les cotisations supplémentaires en découlant.
* 41 Article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, prévoit que seules les LFSS peuvent créer ou modifier des niches sociales non compensées.
* 42 Plus précisément, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »).
* 43 Plus précisément, à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
* 44 Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
* 45 Les montants de la compensation par l'État, reposant sur un calcul en comptabilité de caisse, ne peuvent pas être directement rapprochés des coûts des exonérations figurant dans les tableaux habituellement utilisés pour chiffrer le coût des exonérations, établis sur la base des droits constatés.
* 46 Les autres mouvements concernaient la compensation des gains de la réforme des retraites de 2023 pour la fonction publique d'État (FPE), les conséquences de la réforme de l'exonération « jeunes agriculteurs » et la reprise de la dotation exceptionnelle à l'Établissement français du sang.
* 47 Seuil ramené à 2,25 Smic par la LFSS pour 2025.
* 48 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 49 Selon la Cour des comptes, « la direction du budget, en se fondant sur des champs différents et sur des périodes d'analyse plus longues, conclut à l'absence de sous-compensation ».
Par ailleurs, certains considèrent (comme Gilbert Cette et la direction générale du Trésor) qu'il faudrait inclure dans le calcul les cotisations supplémentaires résultant des emplois permis par les allégements généraux. La Mecss ne dispose pas de ces chiffrages alternatifs.
* 50 Les exemptions d'assiette « ne donnent généralement pas lieu à compensation par le budget de l'État. En effet, l'obligation de compensation ne porte, pour les exemptions d'assiette, que sur celles créées après le 13 août 2004 [...]. La quasi-totalité des dispositifs en cause ayant été, pour la plupart, instaurés avant cette date, l'obligation de compensation ne leur est pas applicable » (annexe 2 au Placss 2024).
* 51 Exonération des cotisations sociales et de certaines contributions sociales pour tous les salariés et de CSG-CRDS, de forfait social et d'impôt sur le revenu pour les salariés rémunérés jusqu'à 3 Smic. Son plafond de 1 000 € était doublé en cas de mise en oeuvre d'un accord d'intéressement.
* 52 La durée de ce régime temporaire, après prorogation, atteint donc quatre ans et demi. Le Gouvernement considère qu'il s'agit non d'une prorogation, mais de la création d'un nouveau dispositif. La Cour des comptes estime qu'il s'agit « d'une irrégularité, seule une loi de financement de la sécurité sociale pouvant instituer une exemption au-delà d'une durée de trois ans » (Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024).
* 53 Loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur en entreprise.
* 54 Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 55 Insee, Note de conjoncture, 15 mars 2023.
* 56 Du fait de l'instauration au 1er janvier 2024 d'un forfait social au taux de 20 % si l'effectif de l'entreprise est égal ou supérieur à 250 salariés (cf. supra).
* 57 Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition des revenus, octobre 2024.
* 58 Ainsi, selon Henri Sterdyniak, « la baisse des ressources propres de la sécurité sociale (exonération de cotisations sociales [...]) compensée (ou non) par des transferts de l'État, l'attribution de certaines ressources fiscales à certains régimes de sécurité sociale, [...] font que les soldes des régimes de la sécurité sociale n'ont plus guère de signification » (réponse au questionnaire des rapporteures).
* 59 Cf. en particulier Jean-Pascal Beaufret, « Retraites obligatoires et déficits publics - pour la clarté », Commentaire, été 2023 ; Jean-Pascal Beaufret, « Les trois singes et les finances publiques - retour sur 1 000 milliards de dette additionnelle (2016-2024) », Commentaire, automne 2024.
* 60 Il existe toutefois des taux de cotisation employeur, par nature fictifs, fixés par décret. Le taux de cotisation employeurs est, pour les militaires, de 126,07 % depuis 2013 et, pour les fonctionnaires civils, de 78,28 % depuis le 1er janvier 2025.
* 61 Selon la note précitée, ramener le taux de 85,4 % à 27,9 % dégraderait le solde du système de retraite d'environ 35 milliards d'euros en 2023 (et même 42 milliards d'euros en prenant également en compte le fait que la CNRACL a un taux employeur plus élevé que celui du privé).
* 62 « Il faut se garder des raisonnements rapides et partiels : le taux implicite de 85,4 % appliqué aux fonctionnaires de l'État permettant de garantir l'équilibre de leur régime de retraite n'est pas lié à une générosité plus élevée des régimes de la fonction publique par rapport aux régimes du secteur privé. Selon une étude de la Drees de 2022, en appliquant les règles du privé au public, les pensions des fonctionnaires sédentaires (ie en excluant les catégories actives) nés en 1958 auraient été en moyenne de 1,5 % plus élevées, sous l'hypothèse d'une rémunération brute égale et d'un âge de départ inchangé. Si le taux implicite de cotisation employeur est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est qu'il est lié à une faible dynamique de l'assiette cotisante associée à une modération des embauches et des coûts salariaux dans la fonction publique de l'État (effectifs maitrisés, gel du point d'indice, part croissante de la part des primes dans la rémunération [...]). Ce qui est parfois présenté comme une indigence résulte en fait d'une gestion très exigeante de la masse salariale publique. Un parallèle peut être fait avec d'autres régimes qui connaissent des évolutions démographiques défavorables : il en est ainsi des régimes des exploitants agricoles et des mineurs qui doivent compléter leurs recettes de cotisations par d'autres sources de financement. »
* 63 Le régime FPE souffre d'un fort déséquilibre démographique : on y compte 0,9 cotisant pour 1 bénéficiaire, contre 1,7 cotisant pour 1 bénéficiaire pour l'ensemble des régimes (Haut-commissariat au Plan, Retraites : une base objective pour le débat civique, 8 décembre 2022).
* 64 Selon la Cour des comptes, « rapporté à la rémunération totale, le taux de cotisation est de l'ordre de 58 % pour les fonctionnaires civils et de 80 % pour les militaires ».
* 65 Selon les prévisions de la Commission européenne du 19 mai 2025, le déficit de la France en 2025, de 5,6 points de PIB (contre 5,4 points de PIB selon le Gouvernement), serait suivi de ceux de la Belgique (5,4 points de PIB), de la Slovaquie (4,9 points de PIB), de l'Autriche (4,4 points de PIB), de la Finlande (3,7 points de PIB), de l'Italie (3,3 points de PIB) et de Malte (3,2 points de PIB).
* 66 Ce montant est confirmé par le rapport d'avancement annuel d'avril 2025 : le retour sous le seuil des 3 points de PIB en 2029 implique « un effort cumulé entre 2026 et 2029 de l'ordre de 110 milliards d'euros ».
* 67 L'effort structurel primaire prévu en 2025 par le PSMT d'octobre 2024 était de 1,6 point de PIB, soit environ 45 milliards d'euros. Le rapport économique, social et financier (Resf) annexé au projet de loi de finances pour 2025 prévoyait, avant la discussion des textes financiers, des mesures d'amélioration du solde de 60,6 milliards d'euros en 2025. Sur cette base, on peut évaluer les mesures à prendre concrètement chaque année pour respecter la trajectoire à environ 15 milliards d'euros de plus que le montant de l'effort structurel primaire.
* 68 Dont 15 milliards d'euros correspondant à une croissance de l'Ondam de 2,9 % par an au lieu d'une croissance spontanée de 4,5 % par an, et 25 milliards d'euros correspondant au déficit attendu en 2029 par le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025 (24,8 milliards d'euros).
* 69 Les « dépenses nettes » sont en effet définies comme « les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d'intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l'Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l'Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l'Union, des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires ».
* 70 L'effort structurel est une notion introduite par le ministère du budget au sujet du projet de loi de finances pour 2004. Il s'agit de l'évolution du solde structurel, corrigée de l'évolution spontanée du ratio recettes/PIB (découlant des fluctuations spontanées de l'élasticité des recettes au PIB). Concrètement, il se définit comme la somme (en points de PIB) de la diminution du ratio dépenses/PIB potentiel et des mesures nouvelles sur les recettes.
* 71 Les principales projections de finances sociales disponibles sont synthétisées en annexe III au présent rapport.
* 72 Ce plan indique qu'« en lien avec les grandes tendances à l'oeuvre (vieillissement de la population, baisse de la productivité, transition écologique, impacts de l'intelligence artificielle, besoins dans la défense, etc.), cette mission pourra proposer en 2026 un portrait des finances publiques de la France à horizon 2050, afin d'anticiper les défis structurels auxquels nous devrons faire face dans les vingt-cinq prochaines années et mieux s'y préparer ».
* 73 Comme toute projection, celles du COR sont en partie conventionnelles. Elles sont en effet sensibles au taux de fécondité, à l'espérance de vie, au solde migratoire, au taux de chômage, à la croissance de la productivité horaire du travail, etc.
* 74 Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France, rapport annuel, juin 2025.
* 75 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.
* 76 Selon les études récentes, la santé, bien que correspondant à une part croissante dans le PIB, n'est pas à proprement parler un « bien supérieur », l'augmentation de sa part dans le PIB provenant des autres phénomènes pris en compte par l'équation.
* 77 Il s'agit de ce que les économistes appellent l'« effet Baumol » : les salaires dans certains secteurs comme la santé tendent spontanément à augmenter plus vite que la productivité de l'ensemble de l'économie, ce qui majore les coûts.
* 78 Selon la Cnam, actuellement le taux de croissance spontané des recettes de l'assurance maladie est inférieur d'environ 0,3 point à celui du PIB en valeur, du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac (source : réponse au questionnaire des rapporteures).
* 79 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
* 80 Il s'agit d'une hypothèse haute, l'évolution de la natalité, qui réduit mécaniquement les dépenses, n'étant pas prise en compte.
* 81 Mathilde Viennot, « Notre modèle de protection sociale est-il soutenable ? », Regards n° 58, École nationale supérieure de sécurité sociale, avril 2021.
* 82 Mélanie Vogel, Construire la sécurité sociale écologique du 21e siècle, mission d'information sur la sécurité sociale écologique, rapport d'information n° 594 (2021-2022), Sénat, 30 mars 2022.
* 83 Ministère de la transition écologique et solidaire, Stratégie nationale bas-carbone - rapport d'accompagnement, mars 2020.
* 84 Selon la Cnam, actuellement le taux de croissance spontané des recettes de l'assurance maladie est inférieur d'environ 0,3 point à celui du PIB en valeur, du fait du faible dynamisme des recettes assises sur la masse salariale du secteur public et sur la consommation de produits du tabac (source : réponse au questionnaire des rapporteures).
* 85 En particulier, une légère augmentation d'ici 2070 des dépenses de la branche maladie rapportées au PIB est possible sans mettre en péril la soutenabilité des finances publiques.
* 86 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.
* 87 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.
* 88 L'OCDE retient une estimation d'élasticité des dépenses de santé au PIB potentiel de 0,767.
* 89 C'est-à-dire de la tendance des salaires de certains secteurs à croître plus rapidement que la productivité du secteur concerné.
* 90 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 91 Par exemple, selon un rapport de l'Igas et de l'IGF, sur la période 2005-2012, la croissance de l'Ondam, de 3,2 % par an en moyenne, aurait résulté d'une croissance spontanée de 4,4 % et de mesures de régulation de 1,2 point (soit environ 3 milliards d'euros) (Vincent Lidsky, Pierre-Emmanuel Thiard, Maryvonne le Brigronen, Jérôme Thomas, Matthieu Olivier, Quentin Jeantet (IGF), Dominique Giorgi, Hubert Garrigue-Guyonnaud, Marine Jeantet, Virginie Cayre, Jeanne Davenel (Igas), Propositions pour la maîtrise de l'Ondam 2013-2017, juin 2012 (IGF n° 2012-M-007-03/ Igas n° RM2012-083P). Lors de son audition par les rapporteures, le 15 mai 2025, Pierre Pribile, directeur de la sécurité sociale, a estimé la croissance spontanée de l'Ondam à 4-4,5 %. En réponse à une question des rapporteures, la DSS indique que la croissance spontanée de l'Ondam en 2024-2028 est estimée à 4,5 %.
* 92 Selon le Gouvernement, sans mesures nouvelles, l'Ondam passerait de 265,9 milliards d'euros en 2025 (montant de la LFSS 2025) à 309,4 milliards d'euros en 2029 (présentation du Premier ministre du 15 juillet 2025). On calcule que cela correspond à une croissance annuelle de 3,86 %.
* 93 « Au global, les dépenses d'Assurance maladie pour les cancers en phase active sont passées de 13,7 milliards d'euros en 2015 à 24,6 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de près de 9 % par an, du fait de l'augmentation des effectifs de malades, mais plus encore de l'augmentation des coûts unitaires de traitement. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause le progrès apporté par ces innovations, qui permettent d'améliorer significativement la survie des patients. Ainsi entre 1990 et 2015, le taux de survie à cinq ans est passé de 71 % à 92 % pour le cancer de la prostate, de 79 % à 89 % pour le cancer du sein, de 51 % à 63 % pour les cancers du côlon et du rectum, de 12 % à 22 % pour le cancer du poumon. Mais l'augmentation des coûts de traitement pose un défi pour la soutenabilité du système » (Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025).
* 94 Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021.
* 95 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
* 96 Les dépenses de la branche autonomie passeraient de plus de 1,3 point de PIB en 2023 à près de 2 points de PIB en 2070, ce qui représente une augmentation de 0,6 point de PIB à politiques inchangées.
* 97 Donc y compris les régimes complémentaires de retraite.
* 98 Catherine Bac, Gérard Cornilleau, « Comparaison internationale des dépenses de santé : une analyse des évolutions dans sept pays depuis 1970 », Études et résultats, n° 175, juin 2002.
* 99 L'effet de l'âge sur le taux de croissance des dépenses de santé serait passé de 0,3 point de 1992 à 2000 à 0,7 point en 2000-2008 et 0,6 point en 2000-2008 (Brigitte Dormont, Hélène Huber, Vieillissement de la population et croissance des dépenses de santé, rapport de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012 (hal-01520109)) ; et il aurait été de 0,6 point en 2011-2015 (Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022).
* 100 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.
* 101 L'effet Baumol est la tendance des prix des secteurs intensifs en main-d'oeuvre (comme la santé) à augmenter plus rapidement que ceux du reste de l'économie, du fait de gains de productivité plus faibles.
* 102 Les dépenses de la branche autonomie sont actuellement de 1,4 point de PIB, alors que la Commission européenne retient un périmètre de dépenses de 2 points de PIB. Elle intègre en effet notamment les dépenses des départements et certains soins de longue durée pris en charge par le système de santé.
* 103 Selon les projections de la Commission européenne, à politiques inchangées le nombre de personnes dépendantes (âgées ou non) prises en charge augmenterait de près de 500 000 dans les années 2030, soit environ deux fois plus que dans la décennie précédente ou dans la décennie suivante.
* 104 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
* 105 Personnes handicapées et personnes âgées dépendantes.
* 106 Supposant, pour chaque tranche d'âge, un alignement du coût de prise en charge individuelle et de la probabilité d'être prise en charge sur la moyenne de l'Union européenne.
* 107 « En juin, le conclave sur les retraites se termine. On se penchera alors sur la sécurité sociale et ses 22 milliards d'euros de déficit. L'objectif est un retour à l'équilibre en 2028-2029 » (Amélie de Montchalin, interview au Parisien, 19 avril 2025).
* 108 « Nous nous fixons comme objectif de revenir à l'équilibre avant 2029 » (compte rendu intégral des débats, séance du 28 mai 2025).
* 109 « Nous sommes parvenus à rééquilibrer les comptes sociaux entre 2010 et 2019 ; entre 2020 et 2028, ou au plus tard en 2029, nous devrons avoir reconstruit une telle trajectoire » (compte rendu intégral des débats, séance du 23 juin 2025).
* 110 On calcule que cela implique une hypothèse de croissance spontanée de l'Ondam légèrement supérieure à 4 %.
* 111 1,1 % en 2025, 1,4 % en 2026, 1,5 % en 2027, 1,5 % en 2028.
* 112 Les mesures du texte initial étaient de 15 milliards d'euros.
* 113 Dans le cas de l'hôpital, l'annexe 7 au PLFSS 2022 et l'annexe 5 au PLFSS 2023 indiquent explicitement qu'aucune mesure de régulation n'est prévue ; l'annexe 5 aux PLFSS 2024 et 2025 n'a pas retrouvé le niveau de précision antérieur à la crise sanitaire et est peu exploitable (en particulier elle ne comprend plus le tableau synthétisant le montant des différentes mesures de régulation prévues pour l'exercice à venir).
* 114 Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021.
* 115 Par exemple, comme le souligne le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, la mesure dite de « rééquilibrage » (en fait, de réduction) de la contribution de l'Ondam à l'objectif global de dépense (OGD) de la branche autonomie, chiffrée autour de 200 millions d'euros par an sur la période, revient en réalité à mobiliser une source de financement extérieure (les réserves de la CNSA), ce qui n'améliore pas la situation des finances publiques (« La mesure de « rééquilibrage » de la contribution de l'Ondam à l'OGD réduit de 247 millions d'euros les dépenses de l'Ondam et est présentée à ce titre comme une mesure d'économie alors qu'elle consiste à mobiliser une source de financement extérieure (les réserves de la CNSA) en atténuation de la dépense Ondam ») (Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, avis du Comité d'alerte n° 2019-3, 15 octobre 2019).
* 116 Vincent Lidsky, Pierre-Emmanuel Thiard, Maryvonne le Brigronen, Jérôme Thomas, Matthieu Olivier, Quentin Jeantet (IGF), Dominique Giorgi, Hubert Garrigue-Guyonnaud, Marine Jeantet, Virginie Cayre, Jeanne Davenel (Igas), Propositions pour la maîtrise de l'Ondam 2013-2017, juin 2012 (IGF N° 2012-M-007-03 /Igas n° RM2012-083P).
* 117 Annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).
* 118 Prescrites en prévention des maladies cardiovasculaires, les statines ne sont considérées comme présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant que pour la prévention primaire des patients à haut risque cardiovasculaire et pour la prévention secondaire, mais pas pour la prévention primaire des patients à faible risque cardiovasculaire (Haute Autorité de santé, Efficacité et efficience des hypolipémiants - Une analyse centrée sur les statines, juillet 2010).
* 119 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
* 120 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 121 Rapport d'information de Mmes Richer et Le Houérou sur la branche AT-MP (2024) : « Proposition n° 2 : Prendre en compte la sur-reconnaissance des AT-MP dans la détermination du montant versé à la branche maladie au titre de la sous-déclaration ».
* 122 La Cnam considère que de 2026 à 2030, ses recettes augmenteront spontanément chaque année de 0,5 milliards d'euros de moins que ce qu'impliquerait une croissante spontanée identique à celle du PIB en valeur, et préconise donc des mesures augmentant ses ressources de 2,5 milliards d'euros d'ici 2030.
* 123 « Entre 2013 et 2023, le taux de prise en charge par l'AMO a [...] progressé de 75,5 % à 79,5 % soit une hausse de 4 points en 10 ans. Cette déformation représente environ 600 millions d'euros par an de moindre dynamisme de la dépense pour les organismes complémentaires. À l'horizon 2030, la stabilisation de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire nécessiterait donc de programmer un nouveau partage de prise en charge de certains soins avec les organismes complémentaires et les patients à hauteur de 3 milliards d'euros. »
* 124 Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 125 Article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 126 Article L. 138-16 du code de la sécurité sociale.
* 127 Cour des comptes, « Les médicaments anti-cancéreux : mieux réguler en préservant un accès rapide aux traitements innovants », in La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 128 Les médicaments biosimilaires sont l'équivalent des médicaments génériques dans le cas des médicaments biologiques (comme l'insuline ou l'hormone de croissance).
* 129 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 130 Il s'agit de médicaments hospitaliers pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Selon le rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, leur coût a augmenté de 7,1 % en 2024, pour atteindre 10,9 milliards d'euros.
* 131 Source : réponse de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 132 Source : Repss « maladie » annexé au Placss 2024.
* 133 « La particularité de la France par rapport aux autres pays est l'absence d'existence de groupe générique doliprane. La part des médicaments génériques dans le marché global est, en intégrant le Doliprane®, dans la moyenne européenne (54 %). Elle est cependant nettement moins élevée que dans des pays voisins comme l'Allemagne ou les Pays-Bas où les génériques représentent respectivement 83 % et 79 % du marché global en 2021 » (réponse aux rapporteures).
* 134 Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d'hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
* 135 L'accès précoce vise les médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, innovants et pour lesquels le laboratoire s'engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une demande de remboursement de droit commun. Les autres procédures d'accès dérogatoire au marché sont celle dite d'« accès compassionnel » (qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique non couvert), ainsi que la procédure, en cours d'expérimentation, dite d'« accès direct post-HAS ».
* 136 Selon le rapport, « le Royaume-Uni, qui a été pionnier dans cette démarche, a d'abord utilisé cette notion de seuil (fixé initialement à 20 000 £ à 30 000 £ par année de vie gagnée en bonne santé) comme critère de décision pour accepter ou refuser la prise en charge d'un médicament ».
* 137 Source : Cour des comptes, Accélérer la réorganisation des soins de ville pour en garantir la qualité et maîtriser la dépense, contribution à la revue des dépenses publiques, juillet 2023.
* 138 Cour des comptes, Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité, rapport public thématique, octobre 2023.
* 139 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 140 « Il est indispensable de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances. »
* 141 Au 31 mars 2025, 38 944 médecins (38,9 % des médecins libéraux) ont créé une ordonnance numérique et 15 079 pharmacies (75 %) ont exécuté une ordonnance numérique.
* 142 Par exemple, les études internationales soulignent l'absence de consensus sur l'opportunité de permettre aux pharmaciens d'accéder à l'indication thérapeutique, certains médecins considérant qu'ils n'ont pas nécessairement la formation appropriée (Amina Hareem, Joshua Lee, Ieva Stupans, Joon Soo Park, Kate Wang, « Benefits and barriers associated with e-prescribing in community pharmacy - A systematic review », Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, volume 12, décembre 2023).
* 143 L'article L. 6211-8 du code de la santé publique prévoit qu'« un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents ». Toutefois souvent cette obligation n'est pas respectée par le prescripteur.
* 144 Il s'agirait de prévoir le renseignement en ligne d'un formulaire permettant de s'assurer que la prescription est conforme aux recommandations et peut donc être remboursée.
* 145 « Dans nombre de pays la prescription médicamenteuse fait l'objet d'un contrôle plus important par les payeurs. Les médicaments sont classés en plusieurs catégories en fonction des risques qu'ils présentent, risques financiers liés à leur coût mais aussi risques de mésusage, et pour certains la prise en charge financière peut être conditionnée au respect de conditions de prescription qui peuvent être contrôlées soit a posteriori, à charge pour le praticien de tenir ces éléments à disposition, soit a priori (accord préalable). Ces procédures ont longtemps été génératrices de surcharges administratives mal vécues par les professionnels, mais aujourd'hui l'ordonnance numérique peut permettre de les intégrer de manière beaucoup plus fluide dans le fonctionnement du système. Le dispositif d'accompagnement à la prescription issu de la LFSS pour 2024, qui repose sur un téléservice à remplir par le prescripteur, constitue un bon équilibre entre une contrainte permettant d'infléchir les pratiques et la souplesse nécessaire. »
* 146 D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021.
* 147 Comme actuellement avec par exemple les maisons de santé pluridisciplinaires et les centres de santé.
* 148 Comme actuellement avec par exemple les communautés professionnelles et territoriales de santé.
* 149 En particulier grâce au service d'accès aux soins (SAS), accessible par le 15 et qui oriente le patient vers le Samu ou les soins non programmés (SNP) de la médecine de ville.
* 150 Mission de service public assurée par les médecins généralistes libéraux et les médecins salariés des centres de santé.
* 151 « L'obstétrique soulève de manière plus impérative des enjeux de maillage territorial liés aux délais d'accès, 45 minutes au plus d'une maternité. L'expérience d'autres pays montre qu'il est possible de fonctionner autrement, mais cela implique un suivi resserré de l'ensemble de la grossesse et un hébergement temporaire à proximité d'une maternité dès que la probabilité d'accoucher le nécessite. »
* 152 Proposition n° 10.
* 153 « Le taux d'équipement en lits de médecine rapporté à la population varie du simple au triple, sans que les impacts en termes de résultats de santé soient immédiatement perceptibles. Paris figure parmi les départements les plus dotés, alors que le taux de personnes âgées est parmi les plus faibles de France aux côtés d'autres départements de petite couronne (cela s'explique toutefois par des mouvements de patients depuis les départements de petite couronne). »
* 154 Coût des soins et de la prévention moins économies de retraites venant des décès prématurés et recettes fiscales assises sur le comportement concerné.
* 155 Pierre Kopp, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019, Observatoire français des drogues et tendances addictives, juillet 2023.
* 156 Daniel Caby, « Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? », Trésor-Eco n° 179, septembre 2016.
* 157 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 158 Lors de l'examen du PLFSS 2025 l'amendement du Sénat visait seulement à augmenter légèrement le barème de l'accise sur les produits du tabac afin de s'approcher dès 2025 de l'objectif d'un paquet de cigarettes à 13 euros en 2027 figurant dans le plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027 (qui, selon les indications alors fournies par l'administration à la commission, n'aurait pas été atteint en 2027 à droit constant).
* 159 C'est à dire le commerce transfrontalier légal, la contrebande et la contrefaçon.
* 160 Passée de 20 % en 2010 à 40 % en 2022 selon l'industrie du tabac.
* 161 Alors qu'en 2011 la prévalence du tabagisme quotidien des lycéens était de 30,8 %, soit un taux analogue à celui observé en population générale, elle était en 2022 de 6,2 %.
* 162 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 163 « L'évolution récente de la législation européenne autorise le recours à un taux de TVA inférieur à 5 % ou un taux zéro pour une catégorie limitée de biens et services dont certains types de denrées alimentaires. »
* 164 La consommation de fruits et légumes frais par les ménages français est estimée à environ 20 milliards d'euros. Passer d'un taux de 5,5 % à un taux nul coûterait donc environ 1 milliard d'euros.
* 165 « La hausse rapide de l'obésité chez les jeunes suppose également de travailler à un renchérissement substantiel de l'accès aux produits transformés gras et sucrés. »
* 166 Selon le ministère de l'agriculture des États-Unis ( https://www.ers.usda.gov), les produits dont la masse est supérieure à 40 % de sucre pur sont les céréales pour petit déjeuner et barres céréalières ; les viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés ; les confiseries et chocolats. Il résulte des données de l'Anses (Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (Inca 3), avis de l'Anses - rapport d'expertise collective, juin 2017) relatifs à chacun de ces produits que ceux-ci correspondent globalement à une consommation journalière de 70 grammes par personne, dont (sur la base des données du ministère de l'agriculture des États-Unis) plus de 30 grammes de sucre pur. Appliquée à l'ensemble de la population française, une taxe assise sur ces produits d'un euro par kilogramme de sucre pur, ajouté ou non, rapporterait donc environ 68×365×0,03800 millions d'euros.
* 167 On peut toutefois mentionner, notamment, les cas de la Hongrie (aliments transformés préemballés) et du Mexique (produits dont la valeur calorique excède 275 kilocalories pour 100 grammes).
* 168 Leila Aïchi, Pollution de l'air : le coût de l'inaction, rapport n° 610 (2014-2015), commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, Sénat, 8 juillet 2015.
* 169 Remplacée le 1er juillet 2010 par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
* 170 Mélanie Vogel, Construire la sécurité sociale écologique du 21e siècle, mission d'information sur la sécurité sociale écologique, rapport d'information n° 594 (2021-2022), Sénat, 30 mars 2022.
* 171 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 172 « Le tabac et l'alcool sont surtaxés, mais on ne demande rien aux plateformes du numérique. Nous proposons donc que 2 % des revenus des plateformes générés en France soient allouées à un fonds dédié au financement de la recherche et de la prise en charge de la santé mentale » (Gabriel Attal, Marcel Rufo, « Il faut interdire l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux réseaux sociaux », tribune publiée dans Le Figaro, 29 avril 2025).
* 173 Daron Acemoglu, Simon Johnson, « The Urgent Need to Tax Digital Advertising », Network Law Review, printemps 2024.
* 174 Source : fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 175 « Bien que les États-Unis n'aient pas de telles taxes, et que seuls les États-Unis devraient être autorisés à taxer les entreprises américaines, leurs partenaires commerciaux facturent aux entreprises américaines quelque chose appelé une taxe sur les services numériques. Le Canada et la France utilisent ces taxes pour collecter chacun plus de 500 millions de dollars par an auprès des entreprises américaines » (« Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces “Fair and Reciprocal Plan” on Trade », présidence des États-Unis, 13 février 2025 ; traduction des rapporteures).
* 176 Source : Syndicat des régies internet (SRI), Union des entreprises de conseil et d'achat média (Udecam), 33ème Observatoire de l'e-pub, étude réalisée par le cabinet Oliver Wyman, février 2025.
* 177 « Connaissez vos chiffres ».
* 178 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.
* 179 Par exemple, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, la télésurveillance permet de détecter la prise de poids rapide (signe de rétention d'eau).
* 180 Activité physique adaptée.
* 181 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 182 En 2017, 63,5 % des salariés travaillaient dans une entreprise indemnisant les trois premiers jours d'arrêt de travail (répartis entre 38 % dans des entreprises effectuant cette indemnisation pour tous les salariés et 25,5 % dans des entreprises effectuant cette indemnisation pour seulement certains salariés) (Marc Perronnin, « L'enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise 2017 », Les rapports de L'Irdes n° 572, novembre 2019).
* 183 Le taux de prise en charge passerait donc de 50 % à 45 %, suscitant pour la sécurité sociale une économie d'1 milliard d'euros, en quasi-totalité compensée aux salariés par les entreprises, dans le cadre de leur obligation de maintien du salaire.
* 184 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 185 « La constitutionnalité d'une telle mesure devrait être évaluée. En effet, une telle mesure reviendrait à écarter toute possibilité pour les partenaires sociaux de branche ou d'entreprise de négocier et d'adopter une clause plus favorable que l'absence de jour de carence : une telle restriction constituerait plutôt une exception par rapport au droit de la négociation collective (ainsi qu'au droit de la négociation individuelle). Elle constituerait donc une atteinte forte à la liberté contractuelle, qui est un principe constitutionnel consacré dont les atteintes ne peuvent être que justifiées par un objectif d'intérêt général, et à condition d'être nécessaires et proportionnées. L'objectif d'équilibre de la sécurité sociale ne peut être mobilisé comme élément de justification dès lors que la mesure porte précisément sur des prises en charge qui ne relèvent pas de la sécurité sociale. »
* 186 Qui n'est due qu'aux salariés disposant d'une certaine ancienneté (1 an).
* 187 Pendant 30 jours supplémentaires, cette durée étant augmentée de 30 jours par tranche de 5 années d'ancienneté.
* 188 Cf. notamment Christine Erhel, Mathilde Guergoat Larivière , Malo Mofakhami, La qualité de l'emploi et du travail en comparaison européenne : une contre-performance française ?, 11 septembre 2024.
* 189 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 190 Troubles anxio-dépressifs mineurs, lombalgie commune, sciatique, tendinopathie de la coiffe des rotateurs (douleur à l'épaule).
* 191 Le rapport envisage également, comme la Cour des comptes, de confier à l'employeur la totalité de l'indemnisation des arrêts maladie de courte durée et d'augmenter le nombre de jours de carence, sans prendre parti sur ces deux points.
* 192 Le rapport renvoie au rapport de Jean Luc Bérard, Stéphane Oustric et Stéphane Seiller (Plus de prévention, d'efficacité, d'équité et de maîtrise des arrêts de travail - neuf constats, vingt propositions, rapport au Premier ministre, janvier 2019). Il insiste sur la préconisation d'assouplir l'accès des salariés en arrêt maladie à des périodes de formation permettant de faciliter leur retour à l'emploi et une diversification des outils possibles en alternative à l'arrêt maladie à temps plein, avec l'accord du salarié à temps partiel thérapeutique, prescription de travail à domicile pour raison de santé, « essai encadré » permettant de tester pendant trois jours le retour à l'emploi.
* 193 Il s'agit notamment de réserver la prescription d'arrêts maladie au médecin traitant (pour éviter le « nomadisme médical »).
* 194 Source : rapport « charges et produits » de juin 2025.
* 195 Pascale Dugos, Pierre Prady, Gabrielle Gauron, Marie Truffier-Blanc, Philippe Fontaine, Mathias Albertone, Émilie Fauchier-Magnan, Emmanuelle Michaud, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - Pour un dispositif plus efficient et équitable, rapport de l'Igas et de l'IGF (IGF N° 2023-M-109-03/Igas N° 2023-126R), juin 2024.
* 196 Maintien pour certains actes de l'exonération de ticket modérateur et prise en charge de nouvelles prestations.
* 197 Le bouclier sanitaire ne concernerait ni les équipements (audioprothèses, dentaire, optique), ni les dépassements d'honoraire.
* 198 Pour que les assurés en ALD ne soient pas perdants il faudrait fixer le plafond à environ 500 euros, mais alors la mesure serait coûteuse pour les finances publiques (2,6 milliards d'euros pour ce niveau de plafond).
* 199 Sophia est un service d'accompagnement, reposant sur des informations spécifiques sur le site Ameli, des entetiens téléphoniques réalisés par des infirmiers et un magazine. Initialement destiné aux diabétiques, il s'adresse depuis 2025 à l'ensemble des personnes souffrant de pathologies chroniques à risque cardiovasculaire (« Sophia 2.0 »).
* 200 Et, dans le cas de la proposition de la Cnam, du statut d'ALD (le premier niveau étant dénommé « statut de risque chronique »).
* 201 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 202 Il souligne que selon le rapport Igas-IGF, « le niveau de plafond financièrement neutre pour les finances publiques se situe entre 500 et 1 000 euros par an ».
* 203 Réponse aux rapporteures.
* 204 Corinne Imbert, Bernard Jomier, Olivier Henno, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024), commission des affaires sociales du Sénat, 25 septembre 2024.
* 205 « Le Gouvernement a considéré que, par construction, la prime n'aurait pas été versée si elle n'avait pas été créée par la loi et ne présentait donc pas de coût direct pour la sécurité sociale. L'hypothèse sous-jacente est celle d'une absence totale de substitution avec les hausses de salaire, éventuellement admissible pour un dispositif transitoire mais pas pour un dispositif pérenne » (Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024).
* 206 Ce chiffre de 800 000 emplois figure notamment dans un article publié en janvier 2006 par Yannick L'Horty (« Dix ans d'évaluation des exonérations sur les bas salaires », in Connaissance de l'emploi, n° 24, janvier 2006), synthétisant la quinzaine d'études qui avaient été faites sur le sujet.
* 207 « Une partie du débat sur l'efficacité du CICE a été accaparée par la comparaison des effets emploi entre les deux équipes de recherche mandatées par France Stratégie (effets nuls pour le LIEPP, effets positifs pour le TEPP), entraînant des commentaires précis de plusieurs discutants ainsi qu'une tentative de réconciliation des résultats par l'Insee. Le comité de suivi du CICE a retenu finalement l'ordre de grandeur de 100 000 emplois créés ou sauvegardés » (France Stratégie, 2018, 2020) » (Antoine Bozio, Étienne Wasmer, Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 octobre 2024).
* 208 Antoine Bozio, Étienne Wasmer, Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 octobre 2024
*
209 Le « rapport Bozio-Wasmer »
retient une hypothèse d'élasticité de la demande de
travail à son coût de - 0,6 au niveau du Smic. Les
évaluations réalisées dans les années 2000
conduisaient à des élasticités souvent plus fortes,
comprises entre - 0,2 et - 0,9 (cf. en particulier l'article de
Crépon et Desplatz de 2001). Toutefois dans le cas du CICE une
hypothèse d'élasticité au niveau du Smic de
- 0,9
conduit à une estimation ex ante du nombre de
créations d'emplois nettement supérieure à celle
observée ex post, et pour retrouver les créations
d'emplois ex post il faut retenir une élasticité de
- 0,3. Cela conduit le rapport à retenir une estimation
intermédiaire de - 0,6.
* 210 Observatoire français des conjonctures économiques, « La croissance à l'épreuve du redressement budgétaire, Perspectives 2024-2025 pour l'économie française », OFCE policy brief n° 137, 16 octobre 2024.
* 211 Groupe d'experts sur le Smic, Salaire minimum interprofessionnel de croissance, 28 novembre 2024.
* 212 Yannick L'Horty, Philippe Martin, Thierry Mayer, « Baisses de charges : stop ou encore ? », Les notes du Conseil d'analyse économique, n° 49, janvier 2019.
* 213 « Quant au scénario de sortie des allègements à 2 fois le Smic - qui ne modifie pas le niveau des allègements au niveau du Smic (...) - il génère des économies (...) de l'ordre de 7 milliards d'euros, (...) sans effet négatif sur l'emploi. (...) Le scénario de sortie à 2 Smic génère un effet global positif estimé entre 34 000 et 53 000 emplois, selon l'hypothèse retenue sur l'élasticité de la demande de travail au niveau du Smic » (groupe d'experts sur le Smic, Salaire minimum interprofessionnel de croissance, 28 novembre 2024).
* 214 Sophie Cottet, Payroll Tax Reductions for Minimum Wage Workers: Relative Labor Cost or Cash Windfall Effects ?, 2020 (ffhalshs-03010943).
* 215 Clément Carbonnier, codirecteur de l'axe « Politiques socio-fiscales » du Liepp, auditionné par les rapporteures, estime, s'appuyant notamment sur cette étude, que « les études indiquent que baisser le coût du travail, y compris le travail à bas salaire, a très peu, voire pas du tout, d'effet sur l'emploi » (« Clément Carbonnier : « La TVA sociale s'inscrit dans la lignée des politiques inefficaces de baisse du coût du travail », entretien publié dans Alternatives économiques, 26 mai 2025). Le « rapport Bozio-Wasmer » estime quant à lui que le travail de Sophie Cottet « montr[e] de façon convaincante et graphique, les effets des réductions de cotisations employeur sur l'emploi dans les entreprises bénéficiaires, confirmant ainsi les analyses initiales de Crépon et Desplatz (2001) ».
* 216 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025.
* 217 Compléments de salaire relevant de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement.
* 218 Pour mémoire, dans le cadre de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales par la LFSS pour 2025, la prime de partage de la valeur (PPV) a été incluse à la rémunération prise en compte pour le calcul des allégements généraux, pour un gain estimé à 0,4 milliard d'euros par l'évaluation préalable.
* 219 Selon la direction de la sécurité sociale, le taux réduit de 8,3 % coûte 1,8 milliard d'euros par rapport au taux de 9,2 % applicable aux salaires, ce dont il découle une valeur du point du taux réduit de 2 milliards d'euros ; 2 milliards d'euros × 0,43 point = 0,9 milliard d'euros.
* 220 En 2022, avec loyers imputés nets des intérêts d'emprunts, les revenus des actifs et des retraités étaient égaux à respectivement 107,0 % et 104,8 % des revenus de l'ensemble des ménages. Sans loyers imputés, ces taux étaient de respectivement 109,5 % et 97 %.
* 221 Pour la dernière année disponible (entre 2020 et 2022), dans les onze pays habituellement suivis par
le COR, le niveau de vie des personnes âgées de 65 ans et plus est le plus faible en Belgique et aux Pays-Bas, où il représente respectivement 76 % et 80 % du niveau de vie de l'ensemble de la population, et le plus élevé en France, en Espagne et en Italie, où ce taux atteint respectivement 94 %, 97 % et 98 %.
* 222 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 223 « Le Haut Conseil souhaite souligner ici que, au regard de son rendement et de sa logique, la CSG doit demeurer une ressource essentielle de la sécurité sociale ; il souhaite toutefois ajouter que le caractère équitable du prélèvement peut être encore renforcé, certains revenus étant moins taxés que d'autres et qu'une progressivité plus forte peut être introduite, en majorant certains taux, notamment ceux pesant sur les revenus du patrimoine. »
* 224 Qui concernent également les cotisations salariales.
* 225 Cour des comptes, « Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun », in Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 226 Convergence des différents taux du forfait social applicables aux dispositifs de partage de la valeur vers le taux de 20 % et rétablissement du forfait social pour l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés (supprimé par la LFSS pour 2019).
* 227 Selon l'OFCE, cette mesure aurait détruit 30 000 emplois en 2011, ce qui aurait porté son coût de 4,5 milliards d'euros pour les finances publiques (dont 1,4 milliard d'euros d'impôt sur le revenu) à 6,8 milliards d'euros (Eric Heyer, La suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires va-t-elle créer des emplois ?, post sur le blog de l'OFCE, 18 juillet 2012).
* 228 Article 7 de la LFSS pour 2019.
* 229 Selon la DSS, le rendement serait de 1,3 milliard d'euros sur le champ des salariés du privé en 2025 (réponse aux rapporteures). Selon l'annexe 2 au Placss 2024, la perte de CSG et de CRDS serait (sur un champ non défini) « de l'ordre de 2 milliards d'euros par an en 2023 ».
* 230 Seulement 23,24 % du produit de la TVA est affecté à la sécurité sociale, en application de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
* 231 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 232 Lors de la discussion du PLFSS 2025, le Sénat a adopté une telle mesure, couplée à une augmentation de 7 heures de la durée annuelle du travail. Elle a été supprimée par la commission mixte paritaire.
* 233 Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020.
* 234 Les gouvernements successifs ont tendance à surestimer le montant des économies.
* 235 Autrement dit, d'une élasticité des recettes au PIB inférieure à l'unité.
* 236 Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport 2012 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2012.
* 237 Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2013.
* 238 Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2014.
* 239 Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2015.
* 240 En supposant une croissance spontanée de l'Ondam de 4,5 % par an.
* 241 Les économies sur les retraites sont estimées par le HCFiPS à 12 milliards d'euros en 2011-2019 (HCFiPS, Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022).
* 242 Les modèles sont habituellement linéaires, ce qui permet de convertir l'impact de mesures portant sur des montants plus faibles ou plus élevés au moyen d'une règle de proportionnalité. Il s'agit toutefois d'une hypothèse simplificatrice.
* 243 Les rapporteures avaient demandé de simuler l'effet d'une diminution d'un point de transfert générique aux ménages, ce qui n'a pas été possible.
* 244 Schématiquement, une baisse du PIB d'un point augmente le déficit des administrations publiques d'environ 0,5 point de PIB.
* 245 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024.
* 246 Le rapport du HCFiPS n'indique pas d'année.
* 247 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
* 248 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 249 Somme des montants du tableau p. 222 (moyenne des estimations basse et haute).
* 250 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
* 251 Source : rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2023.
* 252 Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Lutte contre les fraudes : en 2024, des résultats records et une mobilisation renforcée, dossier de presse, 20 mars 2025.
* 253 « Le chiffrage de la Cour des comptes apparaît particulièrement élevé par rapport aux estimations réalisées par la Cnam, qui évalue la fraude à 1,9 milliards d'euros en fourchette haute. Les premiers champs réévalués récemment font état d'estimations à la hausse, mais de moins de 10 % » (réponse aux rapporteures).
* 254 Inséré en première lecture par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et de deux amendements identiques de Xavier Iacovelli et du Gouvernement.
* 255 Inséré lors de la première lecture au Sénat par l'adoption d'un amendement n° 1130 de Nathalie Goulet, non défendu en séance publique mais repris par la commission des affaires sociales.
* 256 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024.
* 257 « Ce chiffre n'inclut pas les manques à gagner liés aux contrôles comptables d'assiettes qui s'apparentent à des erreurs de bonne foi [note de bas de page : représentant 4,6 milliards d'euros y compris les chiffres sur les micro entrepreneurs]. Le chiffre de 13 milliards d'euros est donc un minorant, puisqu'une partie des résultats du contrôle comptable d'assiette peut vraisemblablement être la résultante d'anomalies intentionnelles ».
* 258 « L'évaluation de la fraude est très compliquée. Nous ne pouvons prendre en compte que ce que nous parvenons à détecter. Par définition, tout ce qui touche au travail partiellement dissimulé est plus difficile à détecter qu'une situation d'absence complète de déclaration d'un salarié. Les chiffres évoqués sont donc probablement sous estimés par rapport à la réalité du travail dissimulé. »
* 259 Ministère des comptes publics, ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Bilan 2024 - Lutter contre toutes les fraudes, 14 mars 2025.
* 260 Comme un meilleur encadrement de la sous-traitance ou des entreprises éphémères.
* 261 « Aucun secteur n'a enregistré d'évolution statistiquement significative entre 2012 et 2023. Globalement, le taux de cotisations éludées est compris entre 1,5 % et 2,0 % en 2023, contre 1,5 % à 1,9 % en 2012 » (source : réponse de l'Acoss aux rapporteures).
* 262 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
* 263 Le code de la sécurité sociale continue de mentionner l'« Agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
* 264 Comme cela a été confirmé par l'Acoss.
* 265 Selon l'article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale, « la loi de financement de l'année [...] Arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leurs financements habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ».
* 266 Article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale.
* 267 Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale - un déficit devenu structurel malgré les mesures envisagées pour 2025, communication à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et à la commission des affaires sociales du Sénat, octobre 2024.
* 268 « Le niveau de dette qui peut être tenu durablement (en moyenne annuelle) est de 40 milliards d'euros sans risque, jusqu'à 60/70 milliards d'euros avec un niveau de risque plus élevé (en tenant compte de la modalité permettant l'emprunt jusqu'à 24 mois), et au-delà de 60/70 milliards d'euros les risques sont très élevés » (source : réponse au questionnaire des rapporteures).
* 269 « Sur la base de la trajectoire pluriannuelle LFSS 2025, en l'absence de nouvelle reprise Cades, un niveau d'emprunt de 60 milliards d'euros en moyenne serait atteint dès 2026. En effet, la moyenne prévisionnelle des financements pour 2025 est de 45,2 milliards d'euros, elle passerait à 58,5 milliards d'euros » (source : réponse de l'Acoss aux rapporteures).
* 270 « Sur la base de la LFSS 2025, il y aurait près de 68 milliards d'euros de déficits cumulés sur 2026-2028. Si l'on considère le plafond d'emprunt 2025 à 65 milliards d'euros et que l'on y ajoute ces 68 milliards d'euros, le plafond d'emprunt 2028 atteindrait 133 milliards d'euros, ce qui n'est en aucun cas réalisable par l'Urssaf. En prenant uniquement le déficit prévisionnel 2026 (23,2 milliards d'euros), le plafond d'emprunt 2026 dépasserait 88 milliards d'euros, proche des niveaux de 2020-2021 qui avaient nécessité un plan de financement exceptionnel » (source : réponse aux rapporteures).
* 271 Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie.
* 272 Qui résultait au moins partiellement de décisions prises par l'État, comme le report d'échéances de versement des cotisations sociales et la mise en place d'un régime d'activité partielle. Ce point de vue a été défendu notamment par Michaël Zemmour, qui, dans une tribune publiée dans Le Monde du 26 mai 2020, préconisait que les dépenses correspondantes soient compensées par l'État.
* 273 Lors de l'examen en 2020 du projet de loi relative à la dette sociale et à l'autonomie, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant le transfert à la Cades de ces 13 milliards d'euros, considérant que cette dette était constituée principalement d'investissements immobiliers lancés à l'initiative de l'État, et que c'était donc à ce dernier d'en supporter le coût.
* 274 En 2022, le HCFiPS écrivait : « Une distinction de la dette Covid et de la dette « non Covid » pourrait être envisagée de telle sorte que ces deux dettes soient traitées de manière différenciée, éventuellement au sein de la Cades, en supprimant toute prédétermination stricte de recettes affectées et tout horizon temporel préfixe de remboursement pour la dette Covid » (HCFiPS, Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022).
* 275 Ana Carolina Cordilha, « L'assurance maladie, otage des marchés financiers », Alternatives économiques, 24 mars 2025.
* 276 Source : Cades.
* 277 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 relative à la LOLFSS, a reconnu la valeur organique de cet article 4 bis. En effet, cet article, qui prévoyait alors que « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale », avait été inséré par l'article 20 de la LOLFSS.
* 278 Depuis la révision du pacte de stabilité en 2024, les États membres doivent présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme (PSMT) tous les quatre ans. Il comprend notamment une programmation de finances publiques à moyen terme, définie en termes d'effort structurel. Les PSMT et leurs rapports d'avancement annuels se substituent aux programmes de stabilité.
* 279 Contrairement aux programmes de stabilité, les PSMT n'indiquent même pas de trajectoire de solde des administrations de sécurité sociale. Par ailleurs la LPFP de décembre 2023 prévoyait pour la sphère sociale des économies supplémentaires, restant à documenter, sans indiquer comment elles devraient se répartir entre la sécurité sociale et les autres administrations de sécurité sociale.
* 280 Le montant du PIB aura alors augmenté, augmentant dans une proportion analogue les ressources de la Cades.
* 281 En prenant dans ce dernier cas pour date de fin de l'amortissement l'année 2033, correspondant à la prévision initiale.
* 282 « Des risques de dépassement affectent par ailleurs certaines dépenses. En particulier, les dépenses sur le champ de l'Ondam comprennent une provision de seulement 1 milliard d'euros au titre des dépenses de covid 19 sur les achats de vaccins et la campagne de tests. Cette provision, qui suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se révéler très insuffisante » (Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP - 2022 - 4 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023, 21 septembre 2022).
* 283 « Le Gouvernement prévoit un net ralentissement de l'Ondam (+ 3,2 % après + 4,8 %), supposant un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d'économies de 3,5 milliards d'euros. Un tel montant d'économies a déjà été atteint par le passé, mais paraît plus difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l'offre de médicaments » (Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP - 2023 - 8 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024, 22 septembre 2023).
* 284 Article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. Cette échéance n'est jamais respectée.
* 285 Article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. Trois avis sont obligatoires, devant être rendus au plus tard le 15 avril, le 1er juin et le 15 octobre.
* 286 L'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la CCSS « est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports ». Selon son article D. 114-2, « le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport [...]. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale ».
* 287 Selon l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, « le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique, social et environnemental ». L'article D. 114-4-0-18 du même code précise : « Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale ».
* 288 Le 7 juin 2023.
* 289 Pour mémoire, le second tour des élections législatives s'est tenu le 7 juillet.
* 290 Article 20 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 291 Article 8 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 292 Article 20 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 293 Article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
* 294 Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Les dispositions figuraient alors à l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale.
* 295 Source : comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, avis n° 2025-2, 18 juin 2025.
* 296 La LFSS 2024 prévoyait des dépenses supplémentaires et des économies de respectivement 4,5 milliards d'euros et 3,5 milliards d'euros ; pour la LFSS 2025, ces montants étaient de respectivement 6,2 milliards d'euros et 4,3 milliards d'euros (source : comité d'alerte, avis du 18 juin 2025).
* 297 Source : Cnam, MSA, Mesures proposées par les Caisses nationales d'assurance maladie suite à l'avis n° 2025-2 du comité d'alerte relatif au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 23 juin 2025.
* 298 Par exemple, en 2025, l'avis du comité d'alerte a été publié le 18 juin après-midi, alors que le Placss avait été examiné par l'Assemblée nationale en séance publique le 10 juin et par la commission des affaires sociales du Sénat le 18 juin matin.
* 299 Amendement COM-47 du 26 octobre 2022, article 19 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027.
* 300 Le B est l'unité de base de la tarification.
* 301 Ce dernier ayant été inclus dans le champ du dispositif par un amendement du Gouvernement.
* 302 Selon la direction de la sécurité sociale, « les mécanismes de régulation prix-volume ne peuvent pas s'envisager de la même manière pour tous les professionnels de santé. Ils se sont développés dans des secteurs très concentrés (la biologie et l'imagerie) et sont beaucoup plus difficiles à répliquer pour des professionnels de santé libéraux en exercice isolé, au regard des variations qu'ils font peser sur leurs revenus » (réponse aux rapporteures).
* 303 Son champ comprenait, outre la sécurité sociale, les régimes complémentaires de retraite et les collectivités territoriales.
* 304 HCFiPS, Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale, juin 2017.
* 305 Les premières études réalisées à ce sujet parvenaient habituellement à une élasticité supérieure à 1, suggérant que, d'un point de vue collectif, la santé était un « bien supérieur » (dont la part dans les dépenses tendait spontanément à augmenter). Toutefois les études récentes considèrent que cela vient d'une prise en compte insuffisante des autres déterminants de la dépense de santé.
* 306 Du fait de l'impossibilité pratique de mesurer la productivité dans le secteur de la santé, l'OCDE a évalué pour chaque État membre, au niveau de l'ensemble de l'économie, le supplément de croissance des salaires par rapport à la croissance de la productivité par travailleur. Son estimation de l'effet Baumol pour les dépenses de santé correspond à ce supplément de croissance, multiplié par le coefficient (de 0,482) évalué économétriquement pour l'ensemble des États.
* 307 « On considère généralement que les innovations en technologie médicale sont le principal moteur des dépenses de santé. Des estimations récentes suggèrent que la technologie médicale explique 27 à 48 % de la croissance des dépenses de santé depuis 1960 (Smith et al., 2009). Willemé et Dumont (2015) ont estimé la contribution de la technologie médicale à la croissance passée des dépenses de santé pour 18 pays de l'OCDE sur la période 1980-2009 à 37 % en moyenne, allant de 19 % en Irlande à 56 % en Italie. » (Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024 ; traduction par les rapporteures).
* 308 Selon le Gouvernement, l'Ondam passerait spontanément de 265,9 milliards d'euros en 2025 (montant de la LFSS 2025) à 309,4 milliards d'euros en 2029 (présentation du Premier ministre du 15 juillet 2025). On calcule que cela correspond à une croissance annuelle de 3,86 %.
* 309 200,7 milliards d'euros, pour un PIB de 2 231,8 milliards d'euros.
* 310 Source : réponse au questionnaire des rapporteures.
* 311 Malgré divers coûts induits (développement du recours à l'intérim...).
* 312 Les effectifs ont en revanche poursuivi leur augmentation. Ainsi, les effectifs médicaux au 31 décembre sont passés, dans l'hôpital public, de 119 271 personnes en 2011 à 135 608 personnes en 2019 et 144 617 personnes en 2022 (source : Repss « maladie » annexé au Placss 2024).
* 313 OCDE, Lutter contre le gaspillage dans les systèmes de santé, 2017, p. 3.
* 314 « Des changements politiques plus ambitieux et transformateurs sont donc nécessaires pour freiner la croissance des dépenses de santé tout en renforçant la résilience et en maintenant des soins de qualité et accessibles à tous. Si les pays parviennent à éliminer la moitié des dépenses inefficaces et inutiles identifiées dans une précédente analyse de l'OCDE, des économies de coûts nettement plus importantes pourront être réalisées, équivalant à 1,2 point de pourcentage du PIB » (OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en).
* 315 « Une politique plus vigoureuse pour inciter à la qualité reste nécessaire, et peut passer notamment par une diffusion plus large et transparente permettant à chacun de s'informer sur le niveau de qualité et de sécurité des soins, à commencer par les indicateurs de qualité développés par la HAS pour l'ensemble des hôpitaux et cliniques (Qualiscope). »
* 316 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.
* 317 Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (texte de la commission, n° 713, 2024-2025).
* 318 Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale en France, mars 2025.
* 319 « Il faut néanmoins se poser d'ores et déjà la question de savoir si nous ne sommes pas en train de former trop de médecins. Cette question peut sembler contre-intuitive au vu de la situation actuelle mais celle-ci est appelée à changer. Très prochainement et au moins jusqu'en 2040, la population médicale devrait croître de 2 % de médecins supplémentaires par an, et les discours malthusiens risquent de s'inviter dans les débats, à l'instar de ce qu'ils furent de la fin des années 70 à la décennie 90. Il est de notre responsabilité collective de se poser cette question centrale et d'établir une méthodologie robuste de travail pour apprécier au mieux les besoins de santé de demain au plus près des territoires et en correspondance les besoins de formation des médecins » (Jean-Marcel Mourgues, in Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale en France, mars 2025).
* 320 Gilles Johanet, « Santé et système de soins : changer de paradigme », Telos, 18 avril 2025.
* 321 Il souligne que le numerus apertus actuel, conduisant à 11 000 médecins formés par an, conduirait au bout de quarante ans à 450 000 médecins en exercice, contre 230 000 actuellement. Il estime que cette évolution, « avec maintien du conventionnement automatique, aboutirait à des inégalités géographiques majeures d'offre de soins et risque d'être peu soutenable financièrement en termes de prélèvements obligatoires ».
* 322 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.
* 323 Yannick Neuder, entretien avec le Quotidien du médecin, 19 mars 2025.
* 324 Il résulte des données de l'OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/) qu'en 2022, l'administration du financement de la santé a correspondu en France à 4,6 % des dépenses, contre 2 % dans l'OCDE (et par exemple 4,2 % en Allemagne et 0,8 % au Royaume-Uni). Le différentiel, de 2,6 points, correspond à des dépenses de 7,4 milliards d'euros.
* 325 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022.
* 326 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 327 Interrogée à ce sujet par les rapporteures, la Drees indique en effet : « Son objectif [du scénario 4] n'est pas de réduire les frais de gestion de l'assurance maladie complémentaire, dans la mesure où celle-ci serait invitée à davantage réguler l'offre de soins sur son propre périmètre d'intervention, où les effets sur la taille de son marché sont incertains (dépendant des choix de partage de panier de soins retenus), et où la concurrence serait renforcée. Les effets sur les frais de gestion de l'assurance obligatoire de ce scénario paraissent également indéterminés, dans la mesure où celle-ci se désengagerait de la régulation de quelques secteurs (comme les soins dentaires ou l'optique, les contrats responsables) mais pourrait être amenée à la modifier sur d'autres (médicaments, dispositifs d'accès aux soins des plus modestes et des plus malades, incitations à la souscription de complémentaires santé ou de prévoyance) ».
* 328 La consommation de soins et biens médicaux a été de 235,8 milliards d'euros en 2022.
* 329 Source : Réponse aux rapporteures.
* 330 Selon le rapport, « l'effet « responsabilisant » de ces outils, parfois mis en avant, se heurte au fait que l'élasticité-prix de la demande de soins est très dépendante de la situation financière du ménage : alors que la franchise est pour des ménages aisés suffisamment accessoire pour n'entraîner aucun effet modérateur sur la demande, elle peut aboutir pour les ménages défavorisés à des renoncements très importants et préjudiciables à la santé ».
* 331 Selon le rapport, « une exclusion du champ des CSR des activités de soins ne faisant pas l'objet d'une évaluation et d'un niveau de preuve suffisant mettrait fin à un subventionnement public de ces pratiques non conventionnelles et permettrait de réaliser des économies pour l'AMC. Elle devrait s'accompagner d'une exclusion de ces garanties du champ des garanties souscrites par les employeurs publics dans le cadre de la couverture de leurs agents ».
* 332 Selon le rapport des trois Hauts Conseils, « la France est l'un des derniers pays de l'OCDE à prendre en charge dans un cadre socialisé les soins de cure thermale. La suppression de leur prise en charge représenterait une économie de 240 millions d'euros pour l'AMO ».
* 333 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.
* 334 L'OCDE préconise à ses États membres de ramener la part des dépenses de santé inefficaces et inutiles, estimée à environ 20 %, à 10 % (OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en).
* 335 Du nom de l'économiste américain Robert Solow, qui en 1987 déclarait : « Vous pouvez voir l'ère de l'ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité » (Robert Solow, « We'd better watch out », New York Times Book Review, 12 juillet 1987).
* 336 Alexandre Sabatou, Patrick Chaize, Corinne Narassiguin, ChatGPT, et après ? Bilan et perspectives de l'intelligence artificielle, rapport d'information n° 642 (17e législature)/170 (2024-2025), OPECST, 28 novembre 2024.
* 337 Analyse d'images médicales, détection de prédispositions génétiques aux maladies, amélioration de la précision des interventions chirurgicales, simulation d'essais cliniques.
* 338 « Aujourd'hui, des plateformes comme Ada Health ou Babylon Health permettent des diagnostics grâce à l'IA, y compris dans des zones sans offre de soins médicaux. »
* 339 « Les robots chirurgicaux autonomes équipés d'IA pourront exécuter des interventions complexes avec une supervision humaine minimale, ce qui est très efficace dans des zones éloignées ou en cas d'urgence ».
* 340 « L'utopie de cliniques mobiles basées sur l'IA, combinant robots et diagnostics automatisés, pouvant fournir des soins de haute qualité dans des zones rurales ou difficiles d'accès ou encore lors de crises humanitaires ou de conflits armés pourrait devenir une réalité à moyen terme. »
* 341 « L'adoption de ces technologies reste, en outre, soumise à des contraintes assez fortes d'acceptabilité sociale. L'IA peut rencontrer une résistance chez les patients comme chez les professionnels de santé. »
* 342 Qui comprend, outre la branche vieillesse de la sécurité sociale, les régimes complémentaires de retraite obligatoires.
* 343 Selon le rapport de la Cour des comptes d'où sont issues ces simulations, « lorsqu'un assuré recule son départ, il a été supposé demeurer dans la même situation vis-à-vis de l'activité et avoir un salaire (s'il est en emploi) qui progresse au rythme de l'évolution du salaire moyen par tête » (Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025).
* 344 Les moindres dépenses concernent la branche vieillesse et, dans une moindre mesure, les régimes complémentaires. A terme ces économies seront légèrement réduites par le fait que les retraites de base et complémentaires augmenteront légèrement du fait de cet allongement d'activité.
* 345 Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025 ; Cour des comptes, Impacts du système de retraites sur la compétitivité et l'emploi, communication au Premier ministre, 10 mars 2025.
* 346 Pendant cette montée en charge, les versements sont supérieurs aux pensions versées. Par exemple, dans le cas de la retraite additionnelle de la fonction publique (Rafp), en 2024 les produits techniques, correspondant principalement aux cotisations, ont été de 2,2 milliards d'euros, pour des prestations versées de seulement 0,5 milliard d'euros (source : rapport annuel 2024 de l'Erafp). De même, les plans d'épargne retraite (PER) représentaient en 2022 8,3 milliards d'euros de prestations pour 18,5 milliards d'euros de cotisations (source : Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025).
* 347 Source : Cour des comptes, Situation financière et perspectives du système de retraites, communication au Premier ministre, février 2025.
* 348 Ce qui peut impliquer des contraintes en ce sens. Par ailleurs, privilégier des investissements en France peut réduire le rendement des actifs par rapport à une allocation mondiale.
* 349 Le PER est un dispositif d'épargne retraite facultative par capitalisation et à cotisations définies. Il se décline sous trois formes : PER individuel (souscription individuelle), PER d'entreprise collectif et PER d'entreprise obligatoire (souscription collective).
* 350 Depuis le 1er janvier 2020, le Perco (plan d'épargne pour la retraite collectif), le PERE (plan d'épargne retraite d'entreprise) et le PERP (plan d'épargne retraite populaire) ne sont plus commercialisés.
* 351 Bertrand Martinot, Retraites : optimiser les dépenses, introduire une part de capitalisation, Fondation pour l'innovation politique, mars 2025.
* 352 Dans le cas du FRR, mobilisation des réserves affectées au remboursement de la dette sociale ; dans le cas de l'Agirc-Arrco, mobilisation de la réserve de précaution de six mois de prestations.
* 353 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 354 Loi portant diverses dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale.
* 355 Total des versements moins total des abondements.
* 356 Nicolas Marques, Économiser 60 milliards d'euros avec un Fonds de réserve pour les retraites (FRR) redimensionné, Institut économique Molinari, 4 novembre 2024.
* 357 Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2025, en 2029 les recettes, les dépenses et le solde de la branche autonomie seraient de 46,2, 49,5 et - 3,3 milliards d'euros (soit respectivement 1,4, 1,5 et - 0,1 point de PIB, ce qui se trouve correspondre exactement à la projection de la Mecss).
* 358 Les dépenses de la branche autonomie sont actuellement de 1,4 point de PIB, alors que la Commission européenne retient un périmètre de dépenses de 2 points de PIB. Elle intègre en effet notamment les dépenses des départements et certains soins de longue durée pris en charge par le système de santé.
* 359 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
* 360 Personnes handicapées et personnes âgées dépendantes.
* 361 Supposant, pour chaque tranche d'âge, un alignement du coût de prise en charge individuelle et de la probabilité d'être prise en charge sur la moyenne de l'Union européenne.
* 362 Les dépenses publiques représentaient en 2014 seulement 79 % des dépenses totales (Romain Roussel, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Études et résultats, n° 1032, octobre 2017).
* 363 Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais et Stefanie Stantchevad, « Repenser l'héritage », Les notes du conseil d'analyse économique, n° 69, décembre 2021.
* 364 Réduction des « exemptions Dutreil » de 75 à 50 % (le taux qui prévalait au début des années 2000) et élimination du dispositif de réduction additionnelle des droits de 50 % en cas de donation avant 70 ans.
* 365 Martine Vignau, Soutenir l'autonomie : les besoins et leurs financements, avis n° 2024-005, Conseil économique, social et environnemental, 26 mars 2024.
* 366 Fin 2023, 6,4 millions de personnes étaient assurées pour la couverture du risque dépendance, pour un âge moyen de souscription de 63 ans (Aurélie Treilhou, Hicham Afrache, Henri-Pierre Rodrigues, Vincent Touze, Le marché de la dépendance : état des lieux, actualités et projets de place, atelier technique de l'Institut des actuaires, 21 novembre 2024).
* 367 Proche de 80 % en 2015, la part financée par les administrations publiques atteindrait en 2060 74 % selon la Drees et 64 % selon Chojnicki et Ragot. Elle pourrait être nettement plus faible si le « scénario de risque » de la Commission européenne se concrétisait et si la puissance publique ne pouvait prendre en charge les dépenses correspondantes.
* 368 France assureurs, Construire une nouvelle solution solidaire et transparente face à la dépendance liée à l'âge, livre blanc, décembre 2021.
* 369 « La mission rejoint le rapport Libault sur le fait que la création d'une assurance privée obligatoire présente des inconvénients importants. Adossée à la complémentaire santé responsable, une telle mesure conduirait à renchérir significativement les contrats d'assurance santé, au risque d'accroître la non-assurance. Ce type de dispositif entrainerait un transfert de charges intergénérationnel au détriment des actifs. Par ailleurs, s'agissant d'un dispositif par répartition, rien ne démontre que l'acceptabilité sociale d'une cotisation privée obligatoire soit supérieure à celle d'un prélèvement obligatoire » (Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020).
* 370 Il ne s'agit ici que des dépenses du projet d'assurance autonomie, et non de la totalité des dépenses en faveur de l'autonomie.
* 371 En effet, selon le modèle utilisé, la croissance dépendrait fortement de l'épargne des ménages, à l'origine de l'accumulation de capital physique. Par conséquent, plus les recettes sont progressives en fonction du revenu, plus le PIB est réduit. Par ailleurs, la CSG pèse surtout sur la population active, dans la phase d'accumulation de son capital financier.
* 372 « La majorité des contrats comprennent une garantie dépendance annuelle qui ne couvre la personne que sur la durée du contrat alors qu'une couverture viagère aurait plus de sens pour ce type de risque ; en cas de résiliation par l'assureur, cette garantie n'est pas maintenue » (direction de la sécurité sociale, réponse aux rapporteures).
* 373 Cf. notamment Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022.
* 374 Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025.
* 375 « Pour les 60-64 ans, il subsiste un écart substantiel, qui se résorbe lentement du fait de la montée en charge des réformes passées (augmentation de l'âge d'ouverture des droits, puis réforme Touraine), mais reste substantiellement inférieur au taux d'emploi de nos voisins. L'emploi des individus de 65 ans et plus, qui a progressé dans la plupart des autres pays par le biais de la hausse de l'emploi qualifié, reste très minoritaire en France. Or augmenter l'emploi de cette catégorie n'équivaut pas à augmenter l'emploi des 55-64 ans car, à 65 ans et plus, la santé se dégrade beaucoup plus vite. Le coût du maintien en emploi de cette catégorie augmente fortement et de manière très hétérogène. Ceci nécessite donc de procéder via des réformes qui ciblent efficacement ceux qui sont les plus susceptibles de continuer à travailler et les moins vulnérables. »
* 376 Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la DG Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024.
* 377 « Parmi les individus en emploi en 2022, la part d'emploi à temps partiel est supérieure de plus de dix points en Allemagne par rapport à la France (28 % contre 17 %). L'emploi à temps partiel en Allemagne a connu une forte hausse durant les années 2000 en lien avec les réformes Hartz qui ont élargi la gamme des emplois dits « minimes » (les mini et midi-jobs, des contrats à volumes horaires et cotisations salariales limités) et assoupli leurs conditions d'application. Le temps partiel en Allemagne est particulièrement utilisé au sein des catégories professionnelles moins employées en France, c'est-à-dire les femmes, les plus jeunes et les séniors. Parmi les femmes d'âge intermédiaire notamment, l'emploi à temps partiel représente 47 % de l'emploi en Allemagne, contre 24 % en France ; les seniors et jeunes allemands ont une part de temps partiel dans l'emploi un demi à un tiers supérieur aux seniors et jeunes français, respectivement. »
* 378 Comme le confirment diverses études. Ainsi, selon le Conseil d'analyse économique, l'élasticité du PIB au nombre d'heures travaillées serait « clairement inférieure à 1 », et d'« environ 0,5 » (Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025). Rexecode retient une estimation analogue : « La recherche économique estime qu'une hausse des heures travaillées de 1 % réduit la productivité horaire de 0,5%, ce qui signifie que la moitié de la hausse de la quantité de travail est absorbée par la baisse de la productivité » (Olivier Redoulès, « Augmenter la quantité de travail : enjeux et leviers », Repères n° 13, Rexecode, 10 mars 2025).
* 379 Diminution des prestations de solidarité et des revenus de remplacement (IJ, indemnités chômage...), augmentation des dépenses de retraite (à long terme) et de la masse salariale des administrations de sécurité sociale.
* 380 Portant sur l'emploi des seniors, le dialogue social et l'assurance chômage.
* 381 Selon la note précitée, ce phénomène ne provient pas de l'évolution du coût du travail (favorable les quinze dernières années) ou de la générosité de l'indemnisation du chômage (le problème étant celui du taux d'emploi, et non du taux de chômage). Elle considère qu'il convient « de creuser plutôt du côté de la forte proportion de NEET [Not in Education nor in Employment nor in Training], de leur faible intégration ou des discriminations qui les éloignent du marché du travail », ainsi que « du côté des politiques sectorielles et des déterminants de la demande de travail peu qualifié ».
* 382 « On estime qu'environ 160 000 parents d'enfants de moins de 3 ans demandeurs d'emploi (le plus souvent des femmes) seraient empêchés de travailler faute de solution d'accueil. En supposant que l'ensemble de ces parents reprendraient un emploi à temps plein rémunéré au salaire minimum, le gain en cotisations sociales pour la sécurité sociale serait de l'ordre de 1 milliard d'euros hors compensation par l'État des exonérations de cotisations sociales » (Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025).
* 383 « Le problème en France concerne le taux d'emploi (marge extensive) et non pas le nombre d'heures travaillées par actif en emploi (marge intensive). La focalisation du débat sur des politiques qui s'attachent à la marge intensive du travail, du type réduction des jours de congé, dérégulation des heures de travail, défiscalisation des heures supplémentaires, semble donc peu pertinente. De la même façon, au sein de la marge extensive, les écarts de taux d'emploi sont expliqués en très large partie par des écarts de participation au marché du travail et beaucoup moins par des écarts de taux de chômage. La priorité devrait donc être donnée aux politiques qui encouragent la participation plutôt qu'aux politiques exclusivement centrées sur la réduction supplémentaire du taux de chômage » (Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025).
* 384 En particulier si l'on considère (comme le Conseil d'analyse économique) qu'une augmentation générale supplémentaire de l'âge de départ à la retraite n'est pas souhaitable et qu'il convient donc de se concentrer sur l'emploi des jeunes.
* 385 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
* 386 Passage de 1 600 heures à 1 607 heures.
* 387 La direction générale du Trésor se limite pour l'essentiel à indiquer que « l'impact sur le PIB d'une hausse de la durée travaillée dépend des modalités de sa mise en oeuvre (hausse de la durée légale hebdomadaire ou instauration d'une journée travaillée supplémentaire, de type journée de solidarité). Les deux scénarios peuvent avoir un effet positif sur le PIB, en lien avec la hausse de la productivité par tête du travail ».
* 388 Il résulte des estimations de l'Insee qu'une année donnée, un dimanche en moins et un lundi en plus augmentent le PIB de seulement 0,05 % (Insee, Les corrections des jours ouvrables dans les comptes trimestriels : le cas des années 2021 à 2024 - refonte de la méthodologie : présentation et illustration sur la croissance du PIB, 29 juillet 2022).
* 389 Limitation de la durée du travail à 1 607 heures, effet de la conjoncture économique...
* 390 En 2024, l'ensemble des actifs ont travaillé en moyenne une durée annuelle effective de 1 592 heures. L'augmentation de cette durée de 7 heures correspond à une augmentation de 0,4 %. Si on suppose que la totalité de cette augmentation se retrouve dans le PIB, qui augmenterait donc de 0,4 %, le solde des administrations publiques s'en trouverait amélioré d'environ 0,2 point de PIB, soit 6 milliards d'euros.
* 391 « On peut aussi mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et renvoyer le temps de travail au dialogue dans l'entreprise en échange d'intéressement et de participation et passer à 36 ou 37 heures dans le public, bien sûr payées en conséquence. [...] Le gain serait de 4 milliards d'euros rien que dans le public » (Gérald Darmanien, entretien au journal Les Échos, 6 octobre 2024).
* 392 L'idée a été présentée le 10 mars 2025 sur Sud Radio par Eric Chevée, vice-président de la CPME, et le 11 mars 2025 sur BFMTV/RMC par Amir Reza-Tofighi, président de la CPME.
* 393 En 2023 selon l'Insee les cadres ont travaillé 1 798 heures par an, les professions intermédiaires 1 621 heures par an, les employés 1 615 heures par an et les ouvriers 1 646 heures par an. Sur la base de 46 semaines (permettant de passer de 1 607 heures à 35 heures), cela correspond à une durée de travail hebdomadaire d'environ 39 heures pour les cadres, près de 36 heures pour les ouvriers et un peu plus de 35 heures pour les professions intermédiaires et les employés.
* 394 Ce qui peut n'être le cas qu'au bout de plusieurs années, en particulier si, du fait d'une conjoncture défavorable, le PIB est initialement inférieur à son potentiel.
* 395 Selon les estimations usuelles de la fonction de production dite de « Cobb-Douglas », dans le cas de la France, une augmentation de 1 % de la quantité de travail (le stock de capital était maintenu inchangé) augmente le PIB d'environ 0,7 %. Toutefois cette fonction de production n'a pas spécifiquement pour objet de chiffrer l'effet d'une évolution du temps de travail des personnes en emploi.
* 396 Par exemple, une étude suggère qu'à partir de 2 000 heures par an environ le rendement marginal d'une heure de travail est nul, l'augmentation du temps de travail étant annulé par la réduction de la productivité (Gilbert Cette, Samuel Chang, Maty Konte, « The decreasing returns on working time: An empirical analysis on panel country data », Applied Economics Letters 18(17): 1677-1682, 2011).
* 397 Eric Heyer, La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macroéconomiques ?, OFCE, 2007.
* 398 Ainsi, en 2007, l'OFCE estimait qu'une augmentation de 0,8 % de la durée du travail aurait comme conséquence non seulement d'augmenter à long terme le PIB (de 0,1 point la première année et de 0,5 point la dixième année), mais aussi d'augmenter à court terme le taux de chômage (de 0,4 point la première année et 0,1 point la dixième année) (Eric Heyer, La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macroéconomiques ? OFCE, 2007).
* 399 En particulier, la création de 800 000 emplois environ prévue par les deux scénarios pourrait buter sur des difficultés de recrutement, ou susciter un effet d'éviction pour d'autres secteurs.
* 400 Comme l'industrie automobile.
* 401 Le non-respect de cette hypothèse, retenue par les simulations, pourrait notamment augmenter les prix en France par rapport au reste du monde.
* 402 Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024.
* 403 « La France se singularise par une proportion beaucoup plus importante qu'ailleurs d'un type d'organisation du travail caractérisé par une autonomie et une participation plus faible. Les travailleurs n'ont que très peu d'influence sur leur propre travail et les décisions de leur entreprise. Exploitant la vague 2015 de l'enquête européenne sur les conditions de travail, Agnès Parent-Thirion et ses collègues avaient mis en évidence la plus forte présence dans les pays nordiques d'organisations du travail dites apprenantes, associées à plus de bien-être au travail. À la recherche des variables clés expliquant cette situation ils en avaient trouvé une seule : la forte présence syndicale » (Dominique Méda, « De la crise du travail en France », Le Monde, 29 et 30 janvier 2023).
* 404 Jean Arthuis, TVA sociale : comment redonner de la compétitivité à l'économie française, rapport d'information n° 283 (2006-2007), commission des finances du Sénat, 29 mars 2007.
* 405 Une variante consiste à réduire les cotisations salariales, comme le propose Antoine Foucher dans Sortir du travail qui ne paie plus.
* 406 Produit de TVA affectée à la sécurité sociale de 49,4 milliards d'euros, pour des produits totaux de la sécurité sociale de 627,8 milliards d'euros.
* 407 « Il n'est pas opportun, dans le contexte actuel, de recourir à des politiques de type « TVA sociale ». Les effets d'une TVA sociale sont difficiles à estimer et dépendent de nombreux facteurs qui agissent dans des sens contradictoires. Un certain consensus se dégage cependant au sein des études pour conclure à un effet positif, mais limité et décroissant avec le temps. Des effets de bord ne doivent par ailleurs pas être négligés : effets redistributifs entre secteurs de l'économie et entre ménages, réactions en cascade provoquées par une politique non coopérative. En outre, augmenter la TVA afin de baisser les prélèvements pesant sur le travail n'apparaît pas opportun dans le contexte actuel français, la France souffrant davantage de difficultés de compétitivité hors coût » (Gaspard Bianquis, Ivan Salin, La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique, Conseil des prélèvements obligatoires, rapport particulier n° 4, décembre 2022).
* 408 « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 Smic) n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité : nous ne trouvons pas d'impact positif sur les exportations, alors qu'elles étaient en grande partie motivées par un objectif de compétitivité » (Yannick L'Horty, Philippe Martin, Thierry Mayer, « Baisses de charges : stop ou encore ? » Les notes du conseil d'analyse économique, n° 49, janvier 2019).
* 409 S'appuyant sur une étude de 2013 de la Commission européenne, le Conseil des prélèvements obligatoire indique qu'en France, une TVA sociale « classique » (avec une baisse des cotisations quel que soit le niveau de salaire) augmenterait le revenu des trois derniers déciles et réduirait celui de tous les autres (Gaspard Bianquis, Ivan Salin, La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique, Conseil des prélèvements obligatoires, rapport particulier n° 4, décembre 2022).
* 410 « Nous réalisons une comparaison internationale sur 26 pays de l'effet des taxes à la consommation sur les inégalités. Dans chaque pays étudié, la part du revenu des ménages consacrée aux taxes à la consommation est deux fois plus importante pour les 10 % les plus pauvres que pour les 10 % les plus riches. Les taxes à la consommation engendrent ainsi une hausse significative des inégalités » (Julien Blasco, Elvire Guillaud, Michaël Zemmour, « La TVA réduit-elle l'efficacité des systèmes socio-fiscaux de redistribution ? », Liepp Policy Brief n° 51, 2021).
* 411 Si on suppose que les recettes tendent spontanément à augmenter au même taux que le PIB, du fait du montant des dépenses publiques rapportées au PIB, une augmentation du PIB de 1 point améliore le solde public d'environ 0,5 point.
* 412 Cf. Insee, direction générale du Trésor, « Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveautés », Document de travail de la Direction des Études et Synthèses Économique G 2017/04, mai 2017.
* 413 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 414 Source : Mathilde Gerardin, « Écart de salaire entre femmes et hommes en 2023 - entre 1995 et 2023, l'écart de revenu salarial a diminué d'un tiers », Insee Focus n° 349, 4 mars 2025.
* 415 En février 2023, l'Ugict-CGT (Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens) et le collectif féministe « NousToutes » ont remis un chèque symbolique de 5,5 milliards d'euros devant l'Assemblée nationale, montant correspondant selon eux au gain résultant d'un alignement des salaires des femmes et des hommes. Ils s'appuyaient sur une étude de 2011 de la Cnav commandée par l'Ugict-CGT. Selon cette étude, à cette échéance la hausse des ressources pour le régime de retraites aurait été d'environ 18 milliards d'euros, en partie compensée par des dépenses supplémentaires d'environ 13 milliards d'euros (résultant de pensions de retraite plus élevées).
* 416 Donc sans prendre en compte d'effet sur l'emploi.
* 417 Soit hors la CGT, FO et l'U2P.
* 418 « Tous les participants ont jugé nécessaire de remettre à plat les circuits de financement des différentes prestations, en distinguant celles dites contributives (ce que sont les retraites), de celles de solidarité (comme l'assurance-maladie et les allocations familiales), dont les droits ne sont pas conditionnés à une activité, salariée ou non » (« Protection sociale : le conclave retraites phosphore sur la complexité du financement », Les Échos, 18 avril 2025).
* 419 « Dans un contexte général pourtant marqué par la défiance vis-à-vis de l'impôt, nous n'observons pas de signe d'une « révolte des cotisants ». Au contraire, l'opposition à la baisse conjointe des prélèvements et des prestations est de plus en plus large. De plus, les épisodes de hausse des cotisations identifiés sur les vingt dernières années ne provoquent pas de changement d'opinion chez les assurés, tant que ces hausses sont graduelles et concernent des prestations auxquelles ils sont éligibles » (Florian Baudoin, Elvire Guillaud, Michaël Zemmour, « Les déterminants du soutien au financement de la protection sociale : une étude sur les données du baromètre DREES », Sciences Po Liepp Working Paper n° 149, 25 juillet 2023).
* 420 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), La protection sociale en France et en Europe en 2022 - résultats des comptes de la protection sociale, édition 2023. On précise que le revenu social d'activité (RSA) est une prestation de solidarité, hors du champ de la sécurité sociale.
* 421 Minimum vieillesse, allocation veuvage, aides au logement.
* 422 En 2014, sur le champ plus large de la protection sociale, les prestations contributives étaient évaluées par le Trésor à 57 % des prestations sociales. Le taux était de 22 % pour le risque santé (indemnités journalières, pensions d'invalidité et rentes AT-MP), 96 % pour le risque vieillesse (minimum vieillesse et prestations liées à la dépendance), 13 % pour le risque famille (indemnités journalières de maternité et supplément familial de traitement versé par les administrations publiques à leurs agents) (Antoine Herlin, « Pour une clarification de la contributivité de la protection sociale », Trésor-Eco n° 200, juin 2017).
* 423 Antoine Bozio, Étienne Wasmer, Les politiques d'exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire, 3 octobre 2024.
* 424 Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport d'étape sur la clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale, 7 juin 2013.
* 425 On ne présente pas ici leurs variantes, ni les combinaisons envisagées par le HCFiPS.
* 426 Antoine Herlin, « Pour une clarification de la contributivité de la protection sociale », Trésor-Eco n° 200, juin 2017.
* 427 Lors de son audition par la commission le 22 octobre 2024, Antoine Bozio a indiqué qu'il existait 1,7 milliard de combinaisons de barèmes possibles, résultant en particulier de 3 066 définitions différentes de l'assiette des cotisations sociales et de 18 barèmes d'allègements de cotisations sociales. Le « rapport Bozio-Wasmer » préconise de s'en tenir à deux barèmes, un barème « normal » et un barème « renforcé ».
* 428 Selon le « rapport Bozio-Wasmer », si la jurisprudence du Conseil constitutionnel « a validé la progressivité des cotisations employeur, elle a censuré la mise en progressivité de la CSG au motif qu'elle ne respecterait pas la prise en compte des facultés contributives. Pour respecter cette jurisprudence, il faudrait ainsi modifier le prélèvement non-contributif pour prendre en compte les revenus du foyer fiscal et les charges de famille. Une telle contrainte n'est pas dirimante, rien n'imposant l'usage de la technique du quotient conjugal et familial, mais complique singulièrement toute tentative de clarification ».
* 429 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.
* 430 Le total des trois facteurs de réduction des dépenses indiqué dans le texte est légèrement inférieur à 0,8 point de PIB, en raison d'un facteur résiduel.
* 431 L'estimation retenue de la croissance potentielle est de 1,1 % en 2022, 0,6 % en 2030, 1,5 % en 2040, 1,3 % en 2050, 1,3 % en 2060, 0,9 % en 2070. Dans deux scénarios, la croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) converge vers un taux majoré ou minoré de 0,2 point en 2070, majorant ou minorant d'autant la croissance du PIB.
* 432 Les projections du COR ont depuis été actualisées en juin 2025.
* 433 Les dépenses indiquées pour 2022 sont de 13,6 points de PIB pour le COR et 14,4 points de PIB pour la Commission européenne.
* 434 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024
* 435 L'estimation retenue de la croissance potentielle est de 1,1 % en 2022, 0,6 % en 2030, 1,5 % en 2040, 1,3 % en 2050, 1,3 % en 2060, 0,9 % en 2070.
* 436 Commission européenne, « The 2021 Ageing Report - Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070) », Institutional Paper 148, mai 2021.
* 437 Le « scénario de référence du groupe de travail sur le vieillissement ».
* 438 1,1 % en moyenne de 2022 à 2070.
* 439 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.
* 440 Autrement dit, ces études suggéraient que quand le PIB augmentait de 1 %, cela avait pour effet d'augmenter les dépenses de santé de plus de 1 %.
* 441 Cet effet a été mis en évidence par les économistes américains William Baumol et William Bowen à partir de 1965, initialement pour le monde du spectacle.
* 442 En volume, respectivement 2,6 % et 1,3 % pour l'ensemble de l'OCDE et 2,2 % et 1,1 % pour la France.
* 443 L'estimation retenue de la croissance potentielle est de 1,1 % en 2022, 0,6 % en 2030, 1,5 % en 2040.
* 444 OCDE, Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, 2023, https://doi.org/10.1787/1e53cf80-en.
* 445 Par exemple, dans le cas du système d'information en santé, l'OCDE se contente de comparer les dépenses 2016-2019 en points de PIB et à considérer que tous les États devraient atteindre le 75e percentile, soit environ 0,4 point de PIB (pour des dépenses de moins de 0,25 point de PIB pour la France).
* 446 L'OCDE retient un objectif de 3,5 médecins par millier d'habitants, contre environ 3,2 pour la France.
* 447 HCFiPS, Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale, juin 2017.
* 448 Romain Roussel, « Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à 2060 », Drees, Études et résultats, n° 1032, octobre 2017.
* 449 Les dépenses privées de prise en charge de la dépendance (hors aide informelle) auraient été de 0,29 point de PIB en 2014.
* 450 Dans le scénario de référence du COR de juin 2025, cette croissance est de 0,7 %, conformément aux tendances passées et comme le préconise la Cour des comptes dans son rapport de février 2025 sur les retraites.
* 451 Le vieillissement de la population entraîne mécaniquement une augmentation du nombre de personnes atteintes de certaines pathologies, comme la démence. Toutefois, selon certaines études, les progrès médicaux, mais aussi le recours accru à des technologies d'assistance et l'amélioration de l'accessibilité des locaux, repoussent dans le temps l'apparition du handicap (cf. Bjorn Lindgren, The Rise in Life Expectancy, Health Trends among the Elderly, and the Demand for Care - A Selected Literature Review, NBER Working Paper No. 22521, août 2016).
* 452 Bien qu'en France les prestations monétaires soient juridiquement indexées sur les prix, sur le long terme il est plus probable que des revalorisations conduisent à ce qu'elles évoluent comme le PIB par habitant. Les prestations en nature devraient quant à elles voir leur prix augmenter comme le coût du travail. Toutefois ces hypothèses sont en partie conventionnelles.
* 453 La recommandation du Ralfss 2024 de rétablissement du taux de 30 % pour la contribution de l'employeur sur les attributions gratuites d'actions (0,5 milliard d'euros) a été mise en oeuvre par la LFSS 2025, à l'initiative du Sénat.
* 454 Ne pas prolonger l'extension de l'utilisation aux aliments non directement consommables, limiter le plafond journalier et limiter l'exemption aux situations où le travailleur n'est pas à son domicile.
* 455 Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais et Stefanie Stantchevad, « Repenser l'héritage », Les notes du conseil d'analyse économique, n° 69, décembre 2021.
* 456 « Le modèle d'estimation de la TVA théorique », Document de travail de la DG Trésor n° 2016/02, avril 2016.
* 457 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 458 Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.
* 459 Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.
* 460 Définir une feuille de route « maladies respiratoires chroniques » assortie d'objectifs quantitatifs afin de limiter le nombre d'hospitalisations évitables de patients à risque en raison de maladies respiratoires (économie de 0,1 milliard d'euros) ; limiter la progression de la file active de patients admis en traitement pour insuffisance rénale chronique terminale (économie de 0,2 milliard d'euros) ; réduire les tarifs des séances de dialyse en centres et en unités de dialyse médicalisée (économie de 0,1 milliard d'euros).
* 461 Définir un objectif de réduction de l'incidence des chutes et des décès induits des personnes âgées en donnant aux agences régionales de santé les outils nécessaires de recueil statistique (économie de 0,3 à 0,45 milliard d'euros, représentant entre un tiers et la moitié de la dépense évitable) ; encourager les professionnels de santé à infléchir leurs pratiques (détection des signes de fragilité, prescription d'activité physique adaptée, réexamen de la pertinence des médicaments) ; limiter les hospitalisations évitables des personnes âgées en adaptant les parcours de soins par une coordination territoriale des secteurs hospitalier, médico-social et de ville et par un plan d'action chiffré dans chaque projet régional de santé (économie de 0,5 à 0,75 milliard d'euros représentant entre un tiers et la moitié de la dépense évitable).
* 462 Automatiser la mesure des écarts aux référentiels de prescription et aux recommandations de bonnes pratiques ; analyser systématiquement les pratiques et les dépenses standardisées de santé entre départements et mobiliser les agences régionales de santé et les caisses primaires d'assurance maladie autour de l'objectif de réduction des écarts territoriaux en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de santé ; justifier les économies attendues en matière de maîtrise médicalisée des dépenses de santé en loi de financement de la sécurité sociale en précisant les déterminants de la dépense (prix et volume) retenus et retracer les résultats obtenus.
* 463 Augmenter les taux d'activité ambulatoire de 60 % à 80 % pour la chirurgie et de 33 % à 45 % pour la médecine.
* 464 Faire de la réduction des coûts induits par l'insuffisance de qualité des soins une priorité dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des autorisations de soins et des projets régionaux de santé (économie d'ici 2029 en retenant un objectif jusqu'à environ un tiers du coût des évènements indésirables graves).
* 465 « La meilleure organisation des parcours et le renforcement du lien ville, hôpital pourraient permettre de générer 2 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030 en lien notamment avec le développement de la chirurgie ambulatoire, de la chirurgie hors bloc avec des potentiels d'économies importants sur la chirurgie de la cataracte et du canal carpien mais également le déport d'une partie des urgences pris en charge à l'hôpital vers la ville. »
* 466 Définir un régime d'autorisation d'activité par établissement et par spécialité en fixant des seuils d'activité par site géographique d'établissement, assortis de contrôles rigoureux ; sur le fondement des constats de certification de la Haute Autorité de santé et des analyses des agences régionales de santé, identifier les services ou les établissements de santé qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins ; engager en conséquence un regroupement ou une fermeture dans le cadre d'une réorganisation de l'offre régionale de soins ; attribuer la personnalité morale aux groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour organiser une offre de soins efficace sur un territoire.
* 467 Développer une approche pluriannuelle des relations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires de santé sur les soins courants, les soins paramédicaux et la prévention en santé ; développer leurs coopérations sur la lutte contre les fraudes, la prévention en santé ou les prescriptions inutiles ; réexaminer le périmètre des obligations du contrat responsable et solidaire des organismes complémentaires de santé.
* 468 Encadrer la délivrance des antalgiques de palier 1, hors enfant et affection de longue durée ; réexaminer la liste des médicaments remboursés à 15 % (service médical faible) ; augmenter le ticket modérateur sur les remboursements des soins de cure thermale ; supprimer la participation de l'assurance maladie aux frais de transport et d'hébergement hors affection de longue durée.
* 469 Contexte, dépêche du 27 mars 2024.
* 470 « La régulation des produits de santé doit permettre de générer de l'ordre de 6 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030. Les baisses de tarifs importantes permettant de retrouver une hiérarchie cohérente dans le niveau des prix en fonction de l'amélioration du service médical rendu mais également la mise en oeuvre de mesures fortes sur les biomédicaments afin de rendre la dépense de médicament la plus pertinente possible devraient participer de façon conséquente à cet objectif. Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs médicaux, la régulation notamment des dispositifs de pression positive continue mais également la régulation tarifaire menée par le Comité économique des produits de santé doit permettre de compléter les économies sur les produits de santé. »
* 471 Viser une progression davantage maîtrisée des dépenses de produits de santé en définissant des mécanismes nouveaux comme une trajectoire pluriannuelle de baisse de leur prix ; renforcer l'évaluation médico-économique afin d'étayer les négociations entre le Comité économique des produits de santé comité économique des produits de santé (CEPS) et les industries pharmaceutiques ; mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, évaluer leurs résultats et renégocier les prix des médicaments innovants selon leur efficacité (poursuite du montant annuel d'économies de 2025 fixé à 1,2 milliard d'euros, soit 4,8 milliards d'euros d'ici 2029) ; réguler davantage la dépense de médicaments par une relance du recours aux médicaments génériques, par une augmentation du recours aux médicaments biosimilaires et par une réduction de la consommation d'antibiotiques (économie de 0,3 milliard d'euros) ; réviser les nomenclatures des dispositifs médicaux remboursés par l'assurance maladie à combiner avec des objectifs de baisse tarifaire pour favoriser le bon usage et la maîtrise des volumes (économie de 0,2 milliard d'euros).
* 472 « La régulation sectorielle en lien avec les analyses menées sur la rentabilité des différents secteurs doit permettre de définir les contours des futurs protocoles d'accord traçant des trajectoires de régulation tarifaire en lien avec des objectifs de rentabilité compatibles avec un financement socialisé. Ces actions doivent permettre de générer 2 milliards d'euros à l'horizon 2030. »
* 473 Maintenir le rendement des mesures du programme de performance hospitalière pour des achats responsables (Phare) des hôpitaux publics (0,35 milliard d'euros) et étendre ce programme aux établissements de santé privés à but non lucratif et aux établissements et services médico-sociaux (0,1 milliard d'euros) ; optimiser la gestion de l'encours de dette des établissements sanitaires et médico-sociaux publics (0,1 milliard d'euros) ; renforcer l'encadrement des rémunérations des personnels intérimaires médicaux et paramédicaux.
* 474 Limiter l'ampleur des revalorisations concernant les mesures conventionnelles en soins de ville et les mesures salariales en établissements de santé et médico-sociaux.
* 475 Rapport d'information de Mmes Richer et Le Houérou sur la branche AT-MP (2024) : « Proposition n° 2 : Prendre en compte la sur-reconnaissance des AT-MP dans la détermination du montant versé à la branche maladie au titre de la sous-déclaration ».
* 476 Il s'agirait d'intégrer aux logiciels métiers soit une « liste négative » d'actes et prestations sans lien avec les ALD (le gain étant alors estimé à 150 millions d'euros), soit une « liste positive » d'actes et prestations exonérés (le gain étant alors estimé jusqu'à 300 millions d'euros).
* 477 « Les évolutions de la prise en charge des arrêts maladie ainsi que les actions pour rendre la dépense plus pertinente notamment en limitant les durées de prescriptions afin d'assurer un meilleur suivi des assurés mais également à travers les actions envers les prescripteurs pour un plus grand respect des référentiels et une plus grande homogénéité des comportements de prescription doivent permettre de générer 2 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030. »
* 478 Finaliser le transfert au budget des établissements de santé de la totalité des dépenses de transport qui y sont prescrites ; renforcer les contrôles (prescriptions et dépenses atypiques, application des règles du transport sanitaire) ; expérimenter une démarche de meilleure efficience des achats publics en ce domaine.
* 479 A ce montant s'ajoute une économie d'1 Md€ pour l'État, correspondant à la réduction de sa contribution d'équilibre.