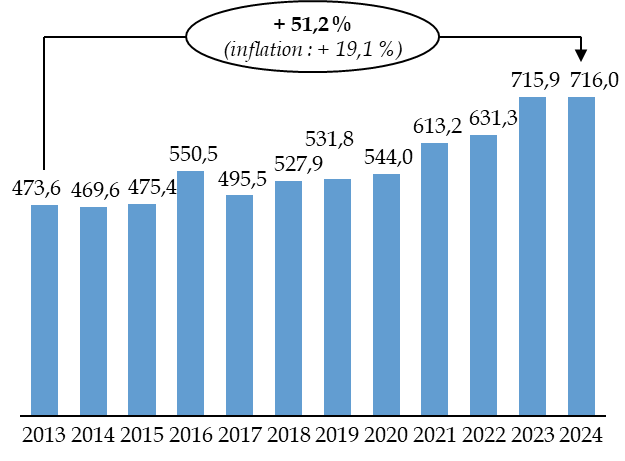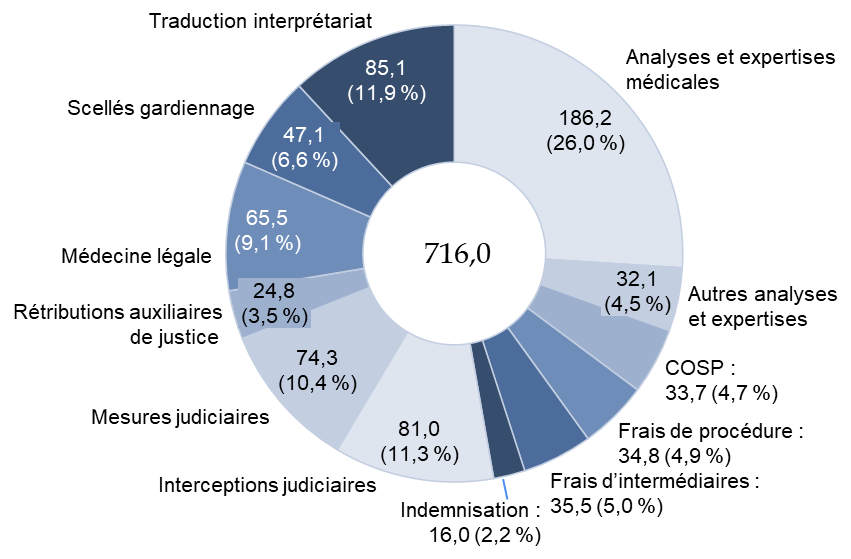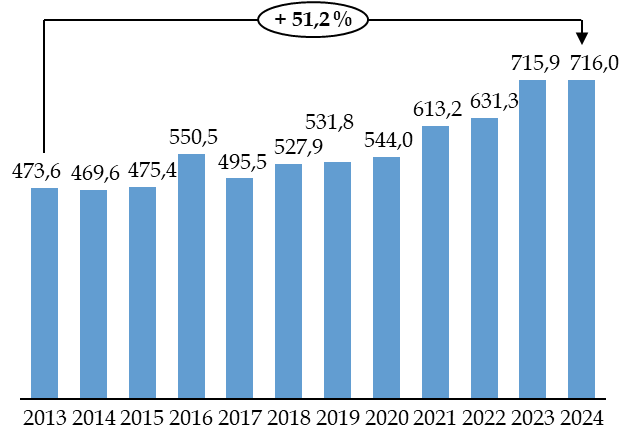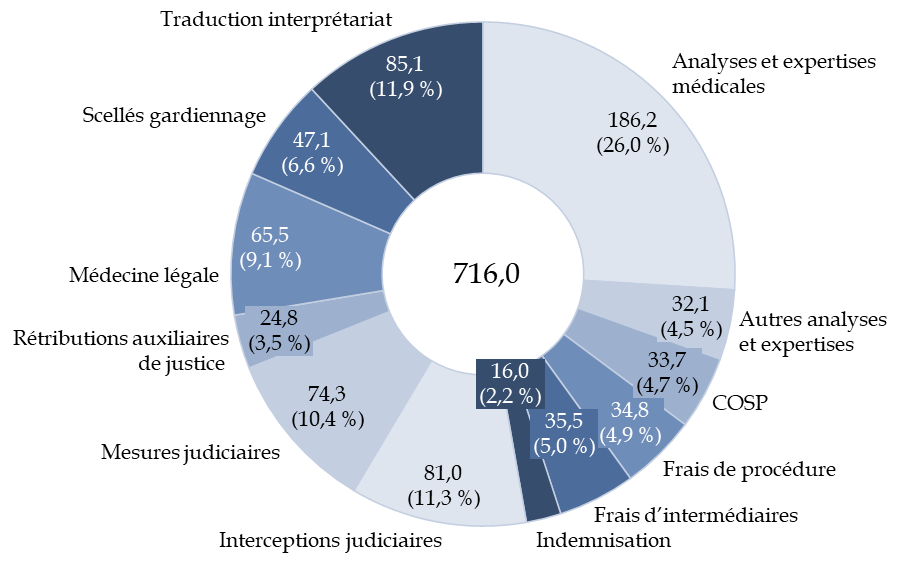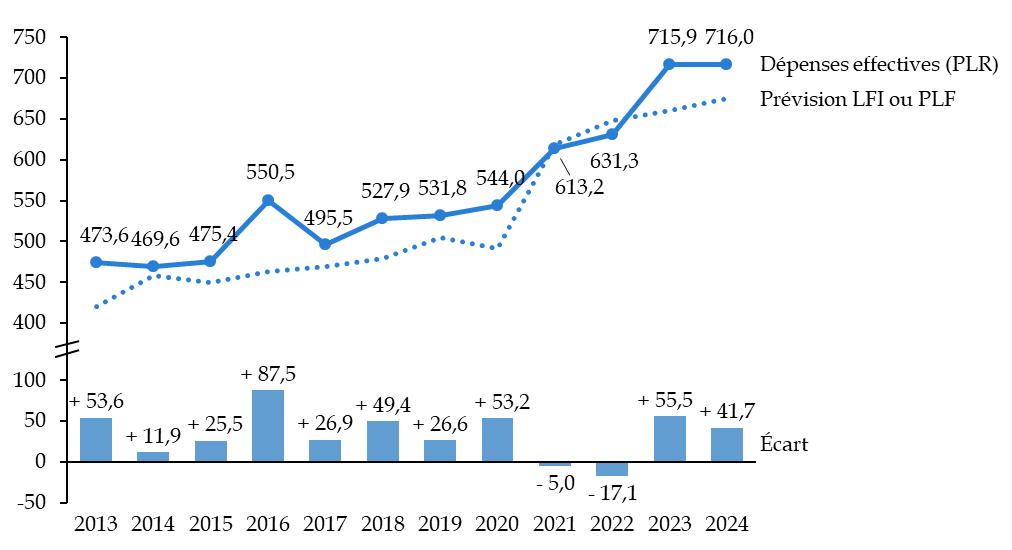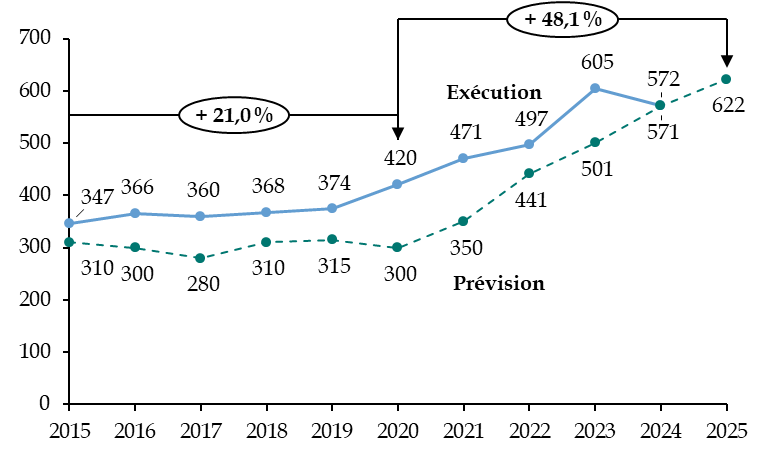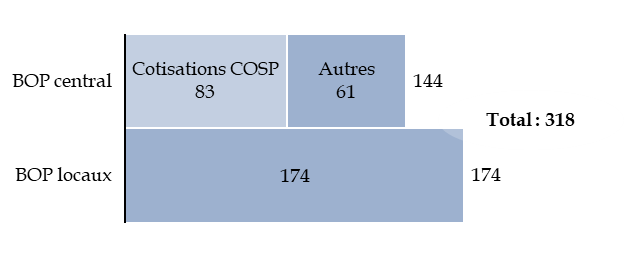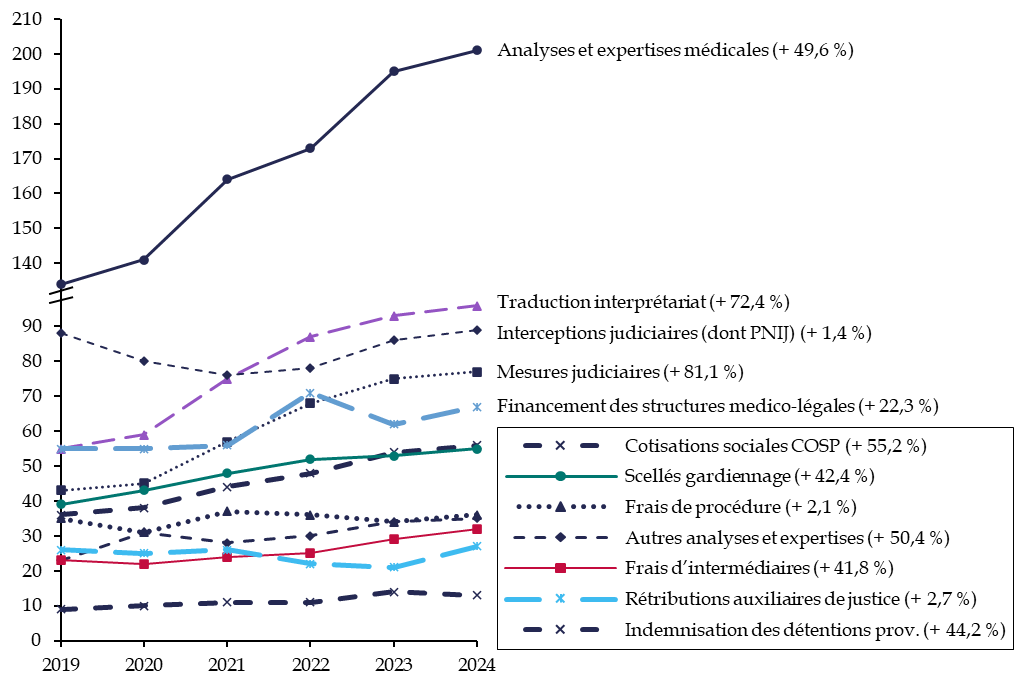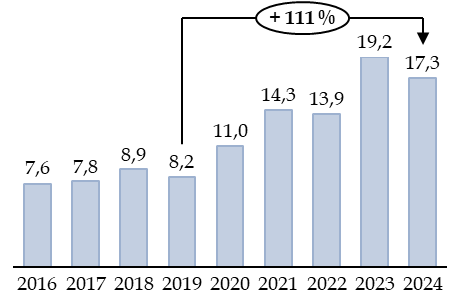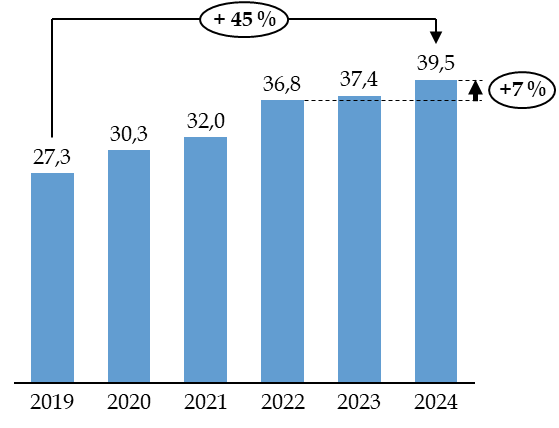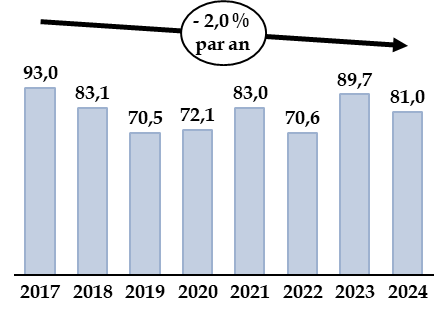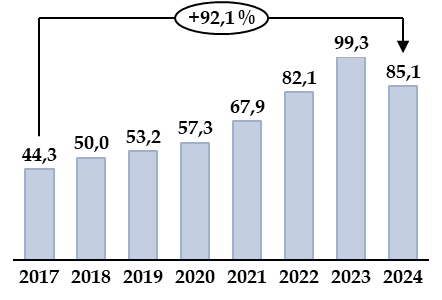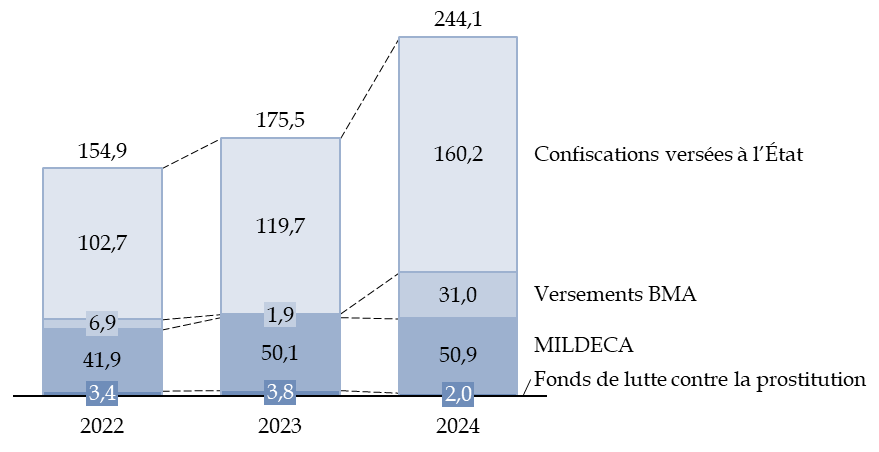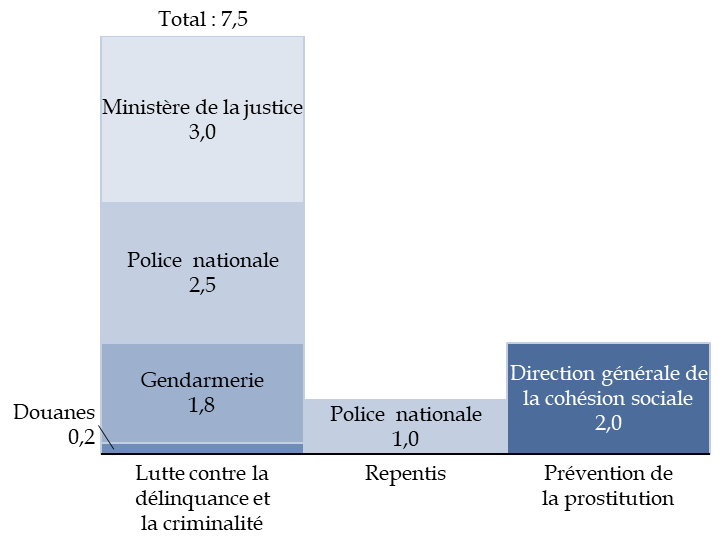- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- PREMIÈRE PARTIE
MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE
LES FRAIS DE JUSTICE
- I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI
PARLE-T-ON ?
- II. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU
PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE
CROISSANTE POUR L'ÉTAT
- III. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE
PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE
- IV. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE
FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET
PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE
- A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE
D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES
ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX
NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS
- 1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment
informés de l'impact financier de leur demande
- 2. Les coûts complets des expertises
devraient être mieux connus afin d'éclairer les choix des
prescripteurs
- 3. Les plans de maîtrise des frais de
justice lancés par les Gouvernements successifs doivent être
poursuivis et amplifiés
- 1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment
informés de l'impact financier de leur demande
- B. LES FRAIS DE JUSTICE DEVRAIENT ÊTRE CONNUS
DÈS L'ENGAGEMENT DE LA DÉPENSE, ET PAS SEULEMENT LORS DU
PAIEMENT
- C. LE PROJET DE PROCÉDURE PÉNALE
NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE MENÉ À SON TERME AFIN DE
RATTACHER LES FRAIS DE JUSTICE À UNE ENQUÊTE
- D. L'ACTION DOIT ÊTRE MENÉE AU NIVEAU
INTERMINISTÉRIEL, EN CONCERTATION AVEC LA POLICE ET LA GENDARMERIE
NATIONALES
- A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE
D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES
ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX
NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS
- I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI
PARLE-T-ON ?
- DEUXIÈME PARTIE
MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR
DU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
- I. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE
FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE
- A. LES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE FONT
L'OBJET D'UN CONTRÔLE PAR LES GREFFES OU LES MAGISTRATS AVANT MISE EN
PAIEMENT
- B. LE RETARD DU PAIEMENT DES PRESTATIONS DES
EXPERTS N'EST PAS ACCEPTABLE
- C. UNE BUDGÉTISATION INITIALE
RÉALISTE DOIT PERMETTRE DE RÉSORBER PROGRESSIVEMENT LA DETTE
ÉCONOMIQUE, LA DÉPENSE ÉTANT DE TOUTE MANIÈRE
INÉLUCTABLE
- A. LES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE FONT
L'OBJET D'UN CONTRÔLE PAR LES GREFFES OU LES MAGISTRATS AVANT MISE EN
PAIEMENT
- II. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE
CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE
- A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE
SCELLÉS
- 1. Les coûts sont en augmentation constante,
quoique ralentie depuis quelques années
- 2. Les actions conduites par les juridictions
nécessitent la mise en place d'outils de gestion performants
- 3. L'action doit combiner mesures de court terme
et transformation de moyen terme des systèmes d'information
- 1. Les coûts sont en augmentation constante,
quoique ralentie depuis quelques années
- B. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA
PLATEFORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ)
- 1. La dépense est plutôt en baisse,
tout en étant variable d'une année à l'autre
- 2. Les données de connexion sont
désormais indispensables pour les enquêtes, mais leur
régime juridique est soumis à des incertitudes
- 3. La création de la PNIJ a permis de
réaliser des économies très importantes
- 4. L'outil connaît toutefois encore des
limitations concernant ses fonctionnalités comme son ergonomie, avec le
risque d'une course entre prestataire public et prestataires
privés
- 5. En contrepartie de l'effort important
assuré par l'État, inciter très fortement au recours
à la PNIJ
- 1. La dépense est plutôt en baisse,
tout en étant variable d'une année à l'autre
- C. RÉEXAMINER LE CARACTÈRE
OBLIGATOIRE DE CERTAINES EXPERTISES
- D. METTRE À PROFIT L'ÉVOLUTION DES
TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER LES FRAIS D'INTERPRÉTARIAT ET DE
TRADUCTION
- A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE
SCELLÉS
- III. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS
- A. CONTINUER À DÉVELOPPER LA VENTE
ET L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS OU CONFISQUÉS
- B. FAVORISER LA PARTICIPATION DES PARTIES AUX
COÛTS DU PROCÈS
- 1. Rendre enfin plus efficace le circuit de
recouvrement des amendes et des frais de justice
- 2. Étendre le recouvrement des frais de
justice en matière pénale à de nouvelles catégories
de personnes
- 3. Compléter le champ d'application du
droit fixe de procédure, déjà doublé par la
dernière loi de finances
- 4. Réintroduire la contribution au titre de
l'introduction d'une instance devant une juridiction
- 1. Rendre enfin plus efficace le circuit de
recouvrement des amendes et des frais de justice
- A. CONTINUER À DÉVELOPPER LA VENTE
ET L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS OU CONFISQUÉS
- I. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE
FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES,
CONTRIBUTION ÉCRITE ET DÉPLACEMENT
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
N° 3
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur les frais de justice,
Par M. Antoine LEFÈVRE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
I. MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES FRAIS DE JUSTICE
Les frais de justice : de quoi parle-t-on ?
Les frais de justice sont aussi des frais d'enquête. Ils englobent les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Il s'agit par exemple des honoraires des experts et des interprètes-traducteurs, des frais de gardiennage de biens saisis, des interceptions téléphoniques et des frais résultant de nombreuses autres mesures ordonnées par un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les frais de justice ne comprennent pas les rémunérations et les dépenses courantes du ministère de la justice, ni les frais d'avocat payés par les parties au procès ou l'aide juridictionnelle dont certaines de ces parties peuvent bénéficier.
A. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT
Évolution des frais de justice depuis 2013
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget
Au 19e siècle, les frais de justice étaient, au moins en principe, recouvrés sur les parties au procès, même s'ils étaient avancés par l'État. Les droits de timbre et d'enregistrement ont été supprimés sur les actes de la justice civile en 1977 et le principe de la mise à la charge de l'État des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police a été confirmé en 1993. Ces frais ont augmenté de manière importante au début des années 2000.
Les crédits de frais de justice étaient toutefois évaluatifs jusqu'en 2006, c'est-à-dire que la dépense pouvait dépasser l'évaluation faite en loi de finances initiale. Lors de l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ils ont été intégrés au programme 166 « Justice judiciaire », dont les crédits ne doivent pas dépasser l'autorisation donnée en loi de finances. Grâce à un programme volontariste de meilleure maîtrise, ils ont diminué pendant quelques années, mais la hausse a repris depuis les années 2010.
B. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE
L'augmentation des frais de justice ne s'explique pas par une augmentation du nombre des affaires traitées devant les juridictions pénales. Le nombre des affaires poursuivables est même plutôt en baisse, de quelque 1,3 million par an entre 2014 et 2019 à 1,2 million en 2022 et 2023, tandis que le nombre des affaires faisant effectivement l'objet d'une poursuite est stable autour de 600 000 par an.
Répartition des frais de justice en 2024
(en millions d'euros)
COSP : contributeurs occasionnels du service public.
Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performances et des données transmises par la direction du budget
En revanche, le nombre des actes prescrits au cours d'une enquête par les juges ou les officiers de police judiciaire a augmenté, en particulier s'agissant d'actes coûteux. Par exemple, une enquête pour narcotrafic, face à des réseaux dotés de moyens financiers et techniques importants, nécessite souvent un grand nombre d'interceptions judiciaires afin de retracer les parcours des trafiquants. La progression des enquêtes pour violences sexuelles et intrafamiliales a également pour conséquence la réalisation d'enquêtes sociales rapides ainsi que la prise en charge médicale ou psychologique des victimes. D'une manière générale, la justice est passée d'une culture de la preuve par l'aveu à une culture de la preuve matérielle ou scientifique.
Le juge, aujourd'hui, s'attend, dans de nombreuses affaires, à trouver dans son dossier des preuves tirées d'interceptions judiciaires ou de l'exploitation du téléphone portable de la victime.
La hausse des coûts n'est toutefois pas suffisamment anticipée dans les prévisions budgétaires, de sorte que la dépense effective, au cours d'une année, est presque systématiquement supérieure à la prévision en loi de finances initiale. Les crédits étant insuffisants, certains paiements sont repoussés, conduisant à la formation d'une « dette économique » estimée à 318,4 millions d'euros, qui constituent une dépense future certaine.
716,0 M€
+ 51%
318,4 M€
C. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE
Pour les magistrats comme pour les enquêteurs, la résolution de l'enquête et le jugement constituent légitimement l'objectif premier et la priorité : chercher à maîtriser le coût des mesures d'enquête en comparant les devis, en négociant des conventions pour réduire les coûts, est difficile et chronophage.
« Il est plus simple de ne pas faire d'effort »
Les magistrats ou les officiers de police judiciaire sont pourtant pleinement conscients de l'enjeu financier que représentent les frais de justice. Toutefois, ils ne sont pas toujours informés du coût réel des mesures qu'ils ordonnent, ou de ce qui constituerait un coût « normal » pour les prestations qui ne sont pas soumises à un tarif réglementaire.
Il est donc indispensable que les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes, disposent de la meilleure information possible et des outils leur permettant d'ordonner des mesures d'enquête qui contribuent pleinement à la manifestation de la vérité, sans entraîner des coûts excessifs et inutiles.
Les plans de maîtrise des frais de justice lancés par les Gouvernements successifs depuis 2021 ont créé une dynamique en ce sens : ils doivent être poursuivis et amplifiés.
Enfin cette action doit être menée au plus près des utilisateurs, aussi bien des officiers de police judiciaire que des magistrats, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les projets numériques du ministère de la justice.
II. MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR DU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
A. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE
L'insuffisance budgétisation en loi de finances initiale oblige le ministère et les juridictions à faire des arbitrages en cours d'année.
Le surcroît de dépense de frais de justice en cours d'année, par rapport à la prévision en loi de finances initiale, s'impacte sur les autres postes de dépenses du programme 166 « Justice judiciaire », c'est-à-dire les dépenses d'investissement ou de fonctionnement courant.
Les juridictions sont parfois même obligées de suspendre les paiements dès le mois de septembre pour les experts, qui seront payés avec des mois de retard, au risque de mettre certains en difficulté ou d'en décourager d'autres d'apporter leur contribution aux procédures judiciaires.
B. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE
Si certaines dépenses sont légitimes et nécessaires pour atteindre à la vérité, d'autres ne sont guère utiles.
Malgré des efforts conduits depuis des années, les frais de gardiennage et de scellés ont été de 47,1 millions d'euros en 2024, soit 6,6 % du montant total des frais de justice. Parmi ceux-ci, le gardiennage des véhicules saisis ou immobilisés représente une dépense généralement peu utile, qu'une connaissance insuffisante du parc de véhicules accroît encore. L'action conduite dans certaines juridictions montre qu'une meilleure évaluation du stock, partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice, pourrait aider à réduire la dépense de manière importante.
De même, les interceptions judiciaires (réquisitions de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques, interception des appels, géolocalisation des téléphones...) peuvent, aujourd'hui, être réalisées en grande partie en recourant à un outil public : la plateforme nationale d'interceptions judiciaires (PNIJ), gérée par l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ). Cette plateforme, largement automatisée, a permis de réduire fortement les coûts unitaires. Son développement et l'amélioration de son ergonomie doivent être poursuivis.
Par ailleurs, certaines lois ont, au fil des années, rendu obligatoires les expertises psychologiques et psychiatriques ou les enquêtes sociales rapides, dans un certain nombre de cas où l'expérience montre que des mesures tantôt moins, tantôt plus approfondies auraient été plus efficaces. Des expertises sont ainsi conduites davantage pour satisfaire les exigences légales que pour résoudre l'affaire : il pourrait être laissé aux magistrats, connaisseurs du dossier, la liberté de décider des mesures d'expertises réellement nécessaires.
De même, le recours à des interprètes humains reste imposé par la loi, alors que les outils de traduction automatique ont connu des améliorations tout à fait considérables au cours des dix dernières années. Ces outils pourraient être mieux utilisés afin de réduire les coûts et de faire gagner du temps dans certaines procédures.
C. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS
La justice a un coût, mais elle apporte également des ressources à l'État ou lui permet de réaliser des économies.
Il s'avère possible d'agir pour favoriser certaines recettes qui permettent de compenser, en partie, le coût des frais de justice pour l'État.
Tout d'abord, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) est chargée de la vente avant jugement ou de l'affectation à des services publics de biens saisis, notamment des véhicules, tâche qu'elle accomplît avec un succès reconnu. Son activité pourrait encore être développée pour que « le crime ne paie pas ».
Ensuite, le principe de recouvrement des frais de justice dans un procès pénal pourrait être étendu à l'ensemble des personnes condamnées. Le juge pourrait écarter cette règle lorsqu'il n'est pas réaliste de demander aux personnes condamnées de payer l'ensemble des coûts du procès, non seulement parce que beaucoup d'entre elles, en matière pénale, manquent de ressources, mais aussi parce que les systèmes d'information ne permettent pas, à l'heure actuelle, de calculer aisément le coût de l'ensemble des mesures ordonnées au cours d'une procédure. Il faudrait donc également améliorer le circuit de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales, qui présente actuellement de nombreuses limites.
Enfin, le Sénat avait adopté l'an passé un amendement tendant à instaurer de nouveau une contribution au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction, non conservée finalement dans la loi de finances mais qui pourrait être proposée de nouveau.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Mieux connaître et faire connaître les frais de justice
1. Rétablir une présentation détaillée des frais de justice dans les documents budgétaires, avec notamment le montant et l'évolution des charges à payer et de la dette économique, ainsi qu'avec les mesures prises en exécution dans le cas des sur-exécutions.
2. Informer de manière plus systématique les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le coût des mesures avant de les ordonner (comparatifs de coûts moyens pour une prestation donnée) et après (coût des mesures effectivement ordonnées).
3. Établir les coûts complets des analyses génétiques et toxicologiques par les laboratoires publics.
4. Pour un meilleur suivi des frais de justice, fixer comme objectif un enregistrement des frais de justice dans Chorus dès l'engagement.
5. Mener à son terme le projet de procédure pénale numérique (PPN) afin de pouvoir retrouver et suivre, au moyen d'un identifiant de dossier judiciaire, l'ensemble des frais de justice associés à une procédure donnée.
6. Mettre en place un réseau de référents « frais de justice » dans les services de police judiciaire, chargés de faire le lien entre les informations apportées par le ministère de la justice, les instructions émanant du ministère de l'intérieur et les enquêteurs.
Mettre fin aux dépenses qui ne
contribuent pas
à la résolution de
l'enquête
7. Prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice, notamment pour des prestations d'expertise, afin de réduire les délais de paiement et les besoins d'ouvertures de crédit en cours d'année.
8. Rationaliser les frais de gardiennage de véhicules :
- à court terme, conduire une évaluation du stock de véhicules en gardiennage avec l'objectif de le réduire d'un tiers ;
- à moyen terme, mieux connaître et interconnecter les systèmes développés dans certains services, à commencer par le système d'information des fourrières, afin de mettre à disposition un outil de suivi de l'ensemble des véhicules ;
- définir une méthodologie partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice pour les saisies ;
- prévoir des conventions avec les garages incluant l'envoi d'une facture périodique.
9. Poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) :
- en lien avec les magistrats et les officiers de police judiciaire utilisateurs, poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la PNIJ afin de favoriser la prise en main et réduire le recours à des prestataires externes ;
- en échange de l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités, généraliser l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à des prestations hors PNIJ.
10. Adapter les expertises aux besoins de l'enquête.
En particulier :
- étudier une gradation des tarifications des expertises psychologiques et psychiatriques en fonction de la complexité de l'analyse demandée ;
- envisager de laisser aux magistrats l'appréciation de la nécessité de l'expertise psychologique ou psychiatrique, ainsi que de l'enquête sociale rapide, dans les cas où ces mesures sont actuellement prévues de manière automatique par le code de procédure pénale.
11. Moderniser la gestion des prestations d'interprétariat et de traduction :
- augmenter le nombre d'interprètes traducteurs contractuels pour certaines langues, après évaluation coût/bénéfice en fonction du volume de prestations nécessaire dans une juridiction donnée ;
- en lien avec la direction interministérielle du numérique (Dinum) et les autres directions des ministères de la justice et de l'intérieur, expérimenter le recours à l'intelligence artificielle afin de déterminer dans quels cas l'intervention d'un interprète traducteur assermenté pourrait être rendue facultative, sous le contrôle du magistrat.
12. Poursuivre la montée en puissance de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en considérant les retours financiers apportés par son activité, et mieux intégrer l'Agence dans les systèmes d'information et projets numériques du ministère de la justice, afin qu'elle puisse identifier plus aisément les opportunités de vente de biens confisqués ou saisis.
13. Compléter le plan de maîtrise des frais de justice par un plan d'amélioration du recouvrement incluant les bonnes pratiques des juridictions pour identifier et recouvrer les frais de justice relatifs à une procédure ; améliorer le circuit de recouvrement, notamment en facilitant le paiement à la sortie du procès.
14. Étendre le principe de recouvrement des frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques, avec possibilité d'exonération par le juge.
15. Appliquer le droit fixe de procédure aux personnes condamnées devant une cour criminelle départementale.
16. Proposer d'instaurer à nouveau une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction.
PREMIÈRE PARTIE
MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE
LES FRAIS DE JUSTICE
Le ministère de la justice possède des dépenses bien identifiées et compréhensibles de tous, qui ne diffèrent guère - sinon par l'ampleur des besoins - de celles relevant des autres ministères et administrations : construction et rénovation de bâtiments (établissements pénitentiaires, tribunaux...), rémunérations (magistrats, greffiers, surveillants pénitentiaires...), investissements informatiques, dépenses courantes de fonctionnement.
Les frais de justice sont en revanche d'une nature différente et spécifique à ce ministère, puisqu'il s'agit de dépenses afférentes à la conduite d'une procédure judiciaire, relevant du principe de la liberté des magistrats de prescrire les actes d'enquête qu'ils jugent nécessaires à la manifestation de la vérité. En conséquence, les outils habituels de pilotage des dépenses ne s'appliquent que partiellement aux frais de justice et la maîtrise de leur coût, en rapide croissance, passe d'abord par une meilleure connaissance de leur nature et des possibilités existantes de les réduire.
I. LES FRAIS DE JUSTICE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Si plusieurs définitions des frais de justice sont possibles, le présent rapport se concentrera sur ceux qui sont identifiés dans les documents budgétaires, limités à des dépenses assumées par l'État dans le cadre d'une procédure judiciaire. Les dépenses d'aide juridictionnelle, autrefois incluses dans la notion de frais de justice, ne seront donc pas considérées, pas plus que les frais exposés par les parties et non avancés par l'État, comme les frais d'avocat.
A. DÉFINIS PAR LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, LES « FRAIS DE JUSTICE » SONT AUSSI DES FRAIS D'ENQUÊTE
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont définis par le code de procédure pénale.
Définition des frais de justice
« Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. »
Article R. 91 du code de procédure pénale
L'appellation traditionnelle de « frais de justice » ne se limite pas à des prestations qui relèvent de l'acte de jugement, mais aussi à celles qui relèvent de la phase de poursuite et d'instruction : on peut donc, comme le fait parfois le garde des Sceaux1(*), parler de frais d'enquête et de frais de justice. Les autorités requérantes, ou « prescripteurs », sont ainsi des magistrats de toutes juridictions2(*), mais aussi des officiers de police judiciaire (policiers ou gendarmes).
1. La catégorie des frais de justice recouvre des actes d'une très grande variété
Les frais de justice pénale, énumérés à l'article R. 92 du même code, se distinguent des frais de justice « assimilés », c'est-à-dire relatifs à des procédures civiles, sociales ou commerciales, recensés par l'article R. 93.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police comprennent par exemple les frais des translations et extractions exécutées par la police nationale ou la gendarmerie nationale sur la réquisition de l'autorité judiciaire ; les frais d'extradition des prévenus ; les honoraires des experts, interprètes-traducteurs et autres tiers ; les indemnités accordées aux témoins ; les frais de mise sous séquestre ou de saisie ; les dépenses diverses liées aux enquêtes ; les interceptions téléphoniques.
Ces frais sont, sauf cas particulier, à la charge définitive de l'État.
S' agissant des frais de justice civile, ou sociale ou commerciale, en revanche, certains sont recouvrables sur les parties et les autres demeurent à la charge définitive de l'État.
À titre d'exemple, les expertises prévues par le code de la santé publique dans le cadre de soins psychiatriques et les mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs sont recouvrables. Dans diverses procédures civiles relatives aux mineurs, certains frais (rémunération des administrateurs ad hoc représentant un mineur, enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption...) sont recouvrables, mais d'autres demeurent à la charge de l'État (frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés).
Sur le plan budgétaire, les frais de justice font l'objet d'une brique budgétaire « Frais de justice » du programme 166 « Justice judiciaire » de la mission « Justice ».
Liste de prestations occasionnant des frais de justice
|
Catégorie de prestataire |
Domaine |
Exemples de prestations |
|
Administrateurs ad hoc |
pénal, civil |
représentation d'un mineur, audition d'un enfant |
|
Associations habilitées |
pénal |
enquêtes de personnalité, enquête sociale rapide, indemnités de comparution d'experts, permanences, contrôle judiciaire, etc. |
|
civil |
enquête sociale pour enfance en danger, représentation d'un mineur par un administrateur ad hoc, etc. |
|
|
Autres prestataires de services |
pénal |
fournitures, services, gardiennage, destruction de scellés, nettoyage de scène de crime, etc. |
|
Avocats |
civil, commercial |
rémunérations réglementées des avocats |
|
BODACC |
civil, commercial |
charges de publicité et de publication, frais en matière de rétablissement personnel |
|
Commissaire aux comptes |
commercial |
frais et dépens, travaux techniques |
|
Commissaire de justice |
civil, commercial |
frais d'inventaire et prisée |
|
Contrôleur judiciaire |
pénal |
contrôle judiciaire |
|
Délégués du procureur |
pénal |
actes de procédure, représentation |
|
Enquêteur de personnalité |
pénal |
enquête de personnalité, indemnités de comparution d'experts lors d'un jugement |
|
Enquêteur social |
pénal |
enquête sociale rapide lors de l'instruction |
|
civil |
enquête sociale rapide (enfance en danger, tutelle), audition d'un enfant par un tiers |
|
|
Experts médicaux |
pénal |
expertise médicale, psychiatrique, odontologique, radiologique, levée de corps, autopsie, etc. |
|
civil |
examen médical, expertise psychiatrique |
|
|
Experts psychologues |
pénal |
expertise psychologique, indemnité de comparution d'experts |
|
civil |
expertise psychologique |
|
|
Experts techniques |
pénal |
expertise aéronautique, automobile, balistique, comptable ou financière, en matière de construction ou d'environnement, indemnité de comparution d'experts, etc. |
|
civil, commercial |
travaux techniques |
|
|
Garagistes, fourrières |
pénal |
gardiennage de véhicules sous scellés ou immobilisés, enlèvement et destruction de véhicules, examens techniques |
|
Gardien de scellés (hors véhicules) |
pénal |
gardiennage de scellés biologiques, conservation de corps, enlèvement et destruction de scellés |
|
Greffiers des tribunaux de commerce |
commercial |
taxes, redevances ou émoluments des greffiers, charges de publication et de publication, etc. |
|
Commissaires de justice |
pénal |
citation ou signification par commissaire de justice, service d'audience d'un commissaire de justice |
|
civil, commercial |
actes divers |
|
|
Institut médico-légal, unité médico-judiciaire |
pénal |
autopsie, analyse toxicologique, examen radiologique, gardiennage de scellés biologiques, conservation du corps, enlèvement et destruction de scellés, examen médical |
|
civil |
examen médical (notamment tutelle) |
|
|
Journal local |
pénal, civil |
charges de publicité et de publication |
|
Laboratoires d'analyses toxicologiques, génétiques et autres |
pénal |
analyses toxicologiques et génétiques, gardiennage de scellés biologique, conservation du corps, enlèvement et destruction de scellés, etc. |
|
civil |
analyses toxicologiques et génétiques |
|
|
Mandataires |
civil |
frais de mandataire |
|
Médiateurs |
pénal |
médiation |
|
Opérateurs de communications électroniques |
pénal |
réquisitions d'interception judiciaire |
|
Pompes funèbres |
pénal |
frais de transport de corps, gardiennage de scellés, conservation de corps, enlèvement et destruction de scellés biologiques ou de corps |
|
Sociétés de location de matériels |
pénal |
frais de locations mobilières |
|
Tiers bénéficiaire d'une indemnisation, autres actes |
pénal, civil |
audition d'un enfant par un tiers |
|
Traducteurs et interprètes |
pénal |
traduction, interprétariat, retranscription d'écoutes téléphoniques |
|
civil, commercial, social |
traduction, interprétariat |
|
|
Transporteur aérien, routier et ferroviaire |
pénal |
Transfèrement, fournitures et services, transport de prélèvement biologique |
Source : commission des finances du Sénat, à partir du référentiel des prestations de frais de justice (Chorus)
2. Ces actes relèvent de nombreux professionnels pouvant apporter leur éclairage ou leurs concours à la justice
Comme le montre la liste qui précède, il existe plus de vingt catégories de prestataires de frais de justice, c'est-à-dire de personnes agissant sous la direction ou le contrôle de l'autorité judiciaire dans le cadre des investigations relatives à la manifestation de la vérité.
Certains de ces prestataires relèvent de la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public (COSP)3(*). Les COSP sont des personnes qui contribuent de manière occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif et ne sont pas affiliées à un régime de travailleurs non-salariés. L'appartenance à la catégorie des COSP a pour conséquence leur affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale et, pour l'État, le paiement des cotisations et contributions sociales, imputées sur les frais de justice.
La plupart des COSP qui exercent leur activité en qualité de travailleur indépendant non salarié et immatriculé, au titre de cette activité, auprès d'un organisme d'affiliation, peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus issus d'activité non salariée4(*). Ils sont alors payés à un tarif plus élevé, car ils doivent régler eux-mêmes leurs charges sociales.
B. LE COÛT DE CERTAINES PRESTATIONS EST SOUMIS À DES TARIFS RÉGLEMENTÉS
De nombreuses prestations demandées à des professionnels par l'autorité judiciaire présentent un caractère suffisamment standardisé pour permettre d'en fixer un tarif, déterminé par arrêté5(*).
La tarification présente plusieurs avantages : les coûts sont connus a priori et sont prévisibles pour autant que le nombre d'actes puisse être estimé à l'avance ; ils sont harmonisés entre les juridictions et ils empêchent les prestataires de facturer des montants excessifs. Enfin, la tarification permet une mise en paiement plus rapide.
Pour autant, toutes les prestations ne peuvent pas être soumises à un tarif réglementaire : selon la direction des services judiciaires (DSJ), les trois quarts du montant total des frais de justice relèveraient de prestations tarifées.
Pour les prestations non tarifées, il est demandé aux magistrats d'établir au moins deux à trois devis, mais les besoins de l'enquête peuvent pousser à choisir le prestataire qui est en mesure de réaliser le plus rapidement la prestation, ou celui dont la qualité est reconnue.
Exemples de prestations tarifées et non tarifées
|
Prestations tarifées |
interprétariat-traduction actes de médecine légale actes de psychiatrie et de psychologie légale diverses analyses toxicologiques gardiennage mesures judiciaires : DPR6(*), contrôle judiciaire, enquête sociale rapide, enquête de personnalité |
|
Prestations non tarifées |
conservation et transport de corps expertise informatique expertise financière ou comptable |
Source : direction des services judiciaires
Un tarif insuffisant risque de rendre les experts plus réticents à offrir leurs services et les évolutions technologiques peuvent réduire le coût réel d'une prestation : les tarifs doivent alors être adaptés à l'évolution des coûts. À l'inverse, les progrès des technologies peuvent réduire le coût réel d'une prestation pour le professionnel.
Or la modification d'un tarif nécessite la prise d'un arrêté ministériel et de nombreux tarifs ne prennent en compte l'évolution des coûts, y compris les effets de l'inflation, que par à-coups. À cet égard, si l'existence d'un tarif réglementé protège le prescripteur contre la tentative d'un professionnel de facturer un montant excessif, la révision du tarif, elle, peut dépendre de l'importance et de l'efficacité des revendications des organisations professionnelles et pas uniquement de l'évolution réelle des coûts.
À titre d'exemple, le tarif d'une expertise psychiatrique réalisée par un expert ne relevant pas du statut COSP, qui était de 429 euros entre 1er juillet 2017 et le 31 août 2021, est passé à 507 euros le 1er septembre 2021, puis à 552,5 euros à compter du 1er avril 2022, soit une hausse de 28,7 % en moins de cinq ans7(*).
En revanche, le tarif de l'autopsie avant inhumation est demeuré stable sur la période (138 euros). Ce montant remonte même à 1979.
Une étude relative à un centre hospitalo-universitaire8(*) a montré en 2011 que, en incluant l'examen interne (33 euros) et la radioscopie (33,40 euros), le tarif total versé au titre des frais de justice était de 204,40 euros9(*). Or la même étude estimait entre 426 et 470 euros, voire 1 000 euros dans certains cas, le coût réel moyen de l'autopsie dans un centre hospitalier universitaire, compte tenu du temps passé et du matériel utilisé. Sur une année, l'activité d'autopsie et de levée de corps était, dans cet établissement, déficitaire de près de 126 613 euros, pour des dépenses totales de 256 863 euros. Il convient toutefois de noter que, depuis 2011, les autopsies médico-légales sont financées sur dotation budgétaire lorsqu'une juridiction est rattachée à une structure hospitalière dédiée à la médecine légale ; elles restent toutefois payées à l'acte au tarif des frais de justice dans le cas contraire10(*).
II. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT
Au 19e siècle, la notion de frais de justice était beaucoup plus large et désignait l'ensemble des charges devant être réglées par les parties au procès, c'est-à-dire une grande partie du coût de justice avant l'instauration du principe de gratuité : frais d'avocat, frais de greffe avant la fonctionnarisation de cette fonction, émoluments du juge dits « épices »11(*)...
Aujourd'hui, le terme définit plutôt, au contraire, l'ensemble des dépenses de procédure qui restent à la charge de l'État.
A. À L'ÉPOQUE MODERNE, L'ÉTAT A PEU À PEU PRIS EN CHARGE UNE PART CROISSANTE DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES PROCÈS
Selon l'historien Jean-Charles Asselain12(*), qui a retracé l'histoire du budget de la justice, les frais de justice représentaient environ 15 % des dépenses judiciaires13(*) au début du 21e siècle, comme c'était déjà le cas vers 1820. Les crédits budgétaires étaient déjà, bien souvent, inférieurs aux dépenses effectives : on verra plus loin que la pratique d'une sous-budgétisation s'est perpétuée.
L'aide juridique était alors englobée dans le chapitre des frais de justice. Elle en a été disjointe à partir de 1992.
Toutefois, une grande partie des frais retracés par le chapitre « Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » étaient alors récupérables sur les personnes condamnées. Si, en pratique, le taux de recouvrement était inférieur à 50 %, le budget général de l'État était abondé de sommes importantes à ce titre. Il est ainsi estimé que, vers 1880, le produit des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe couvrait environ 80 % du total des dépenses judiciaires.
Quant à l'aide juridictionnelle, elle prenait la forme au 19e siècle d'une assistance judiciaire accordée de manière restrictive et dont le financement pesait sur les professions de justice elles-mêmes.
Au 20e siècle, et tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, une série de réformes ont marqué un vaste transfert de charge des justiciables vers l'État. Les greffiers sont fonctionnarisés dans les années 1960 , l'assistance judiciaire est remplacée en 1972 par l'aide juridique, accordée selon des conditions plus larges et comportant désormais une indemnisation des avocats par l'État ; les droits de timbre et d'enregistrement sont supprimés sur les actes de la justice civile en 197714(*). Demeure toutefois la nécessité de régler un timbre fiscal de 225 euros en cas d'appel.
De même, en matière pénale, l'article 800-1 du code pénal prévoit depuis 199315(*) que « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article ».
Plusieurs limitations à ce principe ont cependant été apportées :
- en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, le coût des expertises ordonnées à sa demande peut être mis à sa charge16(*) ;
- lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge, sauf si la juridiction en décide autrement17(*) ;
- lorsqu'une personne prévenue est absente à l'audience alors que des frais d'interprétariat ont été engagés, ceux-ci peuvent être mis à sa charge par la juridiction18(*).
Par ailleurs, la personne condamnée doit régler un droit fixe de procédure d'un montant variant de 62 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle à 1 054 euros pour les décisions des cours d'assises19(*). Si elle a été condamnée pour conduite sous l'influence de stupéfiants, le montant est rehaussé d'une somme forfaitaire correspondant aux indemnités maximales prévues pour les analyses toxicologiques.
Au total, alors que le budget du ministère de la justice consacré aux institutions judiciaires, et notamment les frais de justice, constituait autrefois une avance de la part de l'État, qui se remboursait au moins en partie par des recettes revenant au budget général, ces dépenses représentent aujourd'hui un coût net.
B. LE « MIRACLE » DU MILIEU DES ANNÉES 2000 A PERMIS DE CONTENIR, MAIS SEULEMENT POUR UN TEMPS, LA CROISSANCE DES FRAIS DE JUSTICE
Avant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), effective à compter du budget relatif à l'exercice 2006, les crédits des frais de justice, comme ceux de l'aide juridictionnelle, étaient « évaluatifs », qualité accordée « à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances »20(*).
En conséquence, les montants faisant l'objet de l'autorisation parlementaire en loi de finances initiale n'étaient qu'indicatifs et les dépenses relatives à ces chapitres pouvaient les excéder en cas de besoin.
L'article 10 de la LOLF ne reconnaît comme crédits évaluatifs que ceux relatifs « aux charges de la dette de l'État, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'État ». Les autres dépenses du budget général, dont les frais de justice, sont par conséquent limitatives.
Le passage des frais de justice en crédits limitatifs, en imposant soudainement une contrainte stricte à ces dépenses, a révélé, selon le mot du rapporteur spécial de la commission des finances, Roland du Luart, l'existence d'une « crise des frais de justice »21(*), la dépense ayant doublé entre 2001 (262 millions d'euros) et 2005 (487 millions d'euros).
Or cette crise a rapidement laissé la place à ce que Jean-Charles Asselain a qualifié de « miracle des frais de justice »22(*), car la mise en place des crédits limitatifs, loin de causer des difficultés dans les paiements, s'est au contraire accompagnée d'une décrue subite de la dépense. Alors que les frais de justice avaient augmenté de 10,7 % en 2002, 17,7 % en 2003 et 22,9 % en 200423(*), l'année 2006 est marquée par une diminution de 22,1 % de la dépense en frais de justice pénale par rapport à 200524(*).
Une partie de cette amélioration était liée à des changements de nomenclature25(*), mais elle résulte d'abord de mesures fortes engagées par le ministère.
Une mission « frais de justice » a été créée en 2005 dans le ministère et a visité l'ensemble des cours d'appel. Des actions de sensibilisation et de formation ont été conduites à l'égard des magistrats et chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance a été invitée à désigner un « référent frais de justice ».
S'agissant par exemple des interceptions téléphoniques, la progression des frais de justice, avant la mise en oeuvre de la LOLF, résultait notamment de la hausse du coût des réquisitions aux opérateurs de communication électronique (OCE), pour fournir des données relatives aux connexions26(*) et pour intercepter les communications. Entre 2006 et 2009, la mise en place d'une tarification pour ces prestations, ainsi que d'une « mini-plateforme » d'interception des SMS et de recueil des données de connexion pour les officiers de police judiciaire, a permis de réduire la dépense27(*).
De même, la mise en concurrence permet de réduire les coûts des analyses génétiques. Le ministère obtient même un rabais de 4 % sur les frais postaux28(*).
Cette amélioration n'est toutefois que temporaire et la hausse reprend au bout de quelques années pour s'accentuer au cours des années 2010.
Évolution des frais de justice depuis 2013
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget
III. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE
« Depuis plusieurs années, explique un quotidien français en 201229(*), le travail de police technique et scientifique s'est démocratisé en France. La recherche des empreintes génétiques n'est plus l'apanage de ceux travaillant sur les affaires criminelles mais s'étend à toute la délinquance dite de masse. »
Cette « démocratisation » de moyens d'enquête sophistiqués, mais coûteux, est l'un des facteurs principaux de la croissance des frais de justice depuis le début des années 2000, plus que la croissance de l'activité judiciaire.
A. LES FRAIS DE JUSTICE EXÉCUTÉS SONT COMPOSÉS DE POSTES D'IMPORTANCE TRÈS DIFFÉRENTE
Les documents budgétaires ne donnent qu'une vision agrégée des frais de justice relevant du programme 166 « Justice judiciaire ». Le projet annuel de performances indique que leur montant prévu en 2025 est de 742,7 millions d'euros.
Ils font partie des crédits de fonctionnement (1 260,7 millions d'euros), avec les dépenses liées à l'immobilier occupant (257,0 millions d'euros), les dépenses de fonctionnement courant (211,9 millions d'euros) et celles de l'École nationale de la magistrature (49 millions d'euros).
Les frais de justice s'imputent essentiellement sur les actions 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » et 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ».
Les frais de justice commerciale et de justice civile constituent la quasi-totalité des crédits, hors titre 2, de l'action 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » du programme 16630(*). Les frais de justice en matière pénale constituent la totalité des crédits, hors titre 2, de l'action 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales ».
Répartition des frais de justice en 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, à partir des réponses apportées par la direction du budget au rapporteur spécial
En exécution, les frais de justice sont dépensés :
- d'une part par le budget opérationnel de programme (BOP) central : interceptions judiciaires, analyses génétiques et toxicologiques, cotisations COSP ;
- d'autre part par les BOP locaux des cours d'appel31(*) : analyses et expertises médicales, autres analyses et expertises, frais de procédure, frais d'intermédiaires, interceptions judiciaires (résiduel), mesures judiciaires, rétributions des auxiliaires de justice, dépenses de scellés et de gardiennage, traduction-interprétation.
La définition budgétaire des frais de justice a légèrement évolué au cours du temps. Ainsi, depuis 2013, les frais de transport des magistrats et greffiers dans le cadre de l'exercice de leur fonctions juridictionnelles, les frais de transport des procédures et pièces à conviction ainsi que les frais postaux ne relèvent plus des frais de justice et sont pris en charge sur le fonctionnement courant32(*).
Par ailleurs, certains frais occasionnés par les enquêtes de police ou de gendarmerie ne sont pas refacturés au ministère de la justice. La direction générale de la police nationale (DGPN) estime ainsi à 77 millions d'euros environ33(*) en 2024 le coût des analyses réalisées dans les laboratoires du service national de la police scientifique (SNPS) en réponse à une demande judiciaire, mais budgétairement inscrites au 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités » : en effet, ces demandes émanent de policiers ou de gendarmes et ne sont donc pas facturés, mais ils agissent sous l'autorité du parquet. De même, selon la direction générale de la gendarmerie nationale, des analyses d'un montant pouvant être évalué à 8 millions d'euros sont réalisées chaque année par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), et financées par le programme 152 « Gendarmerie nationale » de la même mission « Sécurités », sans être refacturés à la mission « Justice ».
Un chiffrage exhaustif du montant des frais de justice pour l'État serait donc plus proche de 800 millions d'euros. Les investigations du rapporteur spécial se sont toutefois limitées au budget du ministère de la justice, qui représente de très loin la très grande majorité des frais de justice.
B. LA DÉPENSE EFFECTIVE EST GÉNÉRALEMENT SUPÉRIEURE À LA PRÉVISION EN LOI DE FINANCES INITIALE
Tous les rapports sur les frais de justice constatent que la budgétisation initiale ne permet que rarement de couvrir la dépense. Le Premier président de la Cour des comptes jugeait ainsi, au milieu des années 2000, que la dotation budgétaire des frais de justice était « manifestement et gravement insincère »34(*).
La comparaison entre la budgétisation en loi de finances initiale et la dépense constatée en loi de règlement, désormais loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, confirme l'existence quasi-systématique d'un écart significatif, souvent de l'ordre de 5 à 10 %.
Budgétisation initiale et dépenses effectives de frais de justice
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires et des réponses de la direction du budget au rapporteur spécial
L'insuffisance de prévision concerne aussi les indicateurs budgétaires. L'indicateur 3.1 du programme 166 « Justice judiciaire » porte sur les dépenses moyennes de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale. Cet indicateur se limite donc aux frais de justice pénale et présente l'intérêt d'être indépendant du volume d'affaires, afin de donner une certaine idée du coût que représente une procédure pénale.
Or plus encore que le montant absolu des frais de justice, la prévision du montant par affaire est systématiquement inférieure à la budgétisation : la sous-évaluation ne semble donc pas porter sur le volume des affaires, mais sur le coût d'une procédure elle-même.
Dépense moyenne de frais de justice par
affaire
faisant l'objet d'une réponse pénale
(en euros par affaire)
Indicateur 5.1 du programme 166 « Justice judiciaire » : dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale. Prévision selon le projet annuel de performances (loi de finances initiale). Exécution selon le rapport annuel de performances (loi de règlement ou relative aux résultats de la gestion).
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
Or les dépenses budgétaires constatées chaque année ne donnent qu'une idée partielle de la charge réelle représentée par les frais de justice.
En raison du niveau insuffisant de la budgétisation, mais aussi de la charge pesant sur les services des greffes, le règlement de certaines factures est décalé d'une année sur la suivante. Le rapporteur spécial a reçu plusieurs témoignages sur ce sujet.
La Cour des comptes cite ainsi la direction des services judiciaires (DSJ), qui indique que « le niveau des dépenses annuelles reste plus dépendant des ressources budgétaires que de l'activité réelle sur la période, induisant ainsi une variation des charges à payer d'une année sur l'autre »35(*). En d'autres termes, le ministère fait patienter ses prestataires jusqu'à l'année suivante lorsqu'il n'a plus de crédits pour régler les prestations de l'année en cours.
Cette difficulté du ministère de la justice à traiter les mémoires déposés par les prestataires pour des raisons techniques, d'engorgement et de manque de ressources, a pour effet la formation d'une « dette économique » en forte hausse : elle s'établissait à 318,4 millions d'euros en 2024, contre 227,6 millions d'euros en 2021.
Cette dette économique se répartit entre le budget opérationnel de programme (BOP) central, à hauteur de 144 millions d'euros, dont 83 millions d'euros au titre des cotisations sociales des COSP, et les BOP locaux à hauteur de 174 millions d'euros.
La dette économique des frais de justice en 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial
Sur les BOP locaux, la dette économique inclut des charges à payer d'un montant de 92,7 millions d'euros, des dettes fournisseurs de 3,4 millions d'euros ; les autres charges comprennent les mémoires non certifiés.
Charges à payer, dettes fournisseurs et dette économique des frais de justice
Les charges à payer, notion de comptabilité générale, recouvrent les dépenses pour lesquelles le service fait (exécution de la prestation, livraison de marchandises) a été constaté au titre de l'exercice N, alors que la facture définitive et la mise en paiement ne sont enregistrées que postérieurement au 31 décembre de l'exercice.
Les dettes fournisseurs, notion de comptabilité générale, recouvrent les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié et pour lesquelles la facture est parvenue, la mise en paiement n'ayant toutefois pas eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice, par exemple en raison du manque de crédits.
La dette économique des frais de justice comprend en outre le montant des mémoires non encore certifiés.
Source : commission des finances, à partir de l'exposé général du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024
Cette situation se reflète également dans la progression du montant des mémoires (demandes de paiement) déposés par les prestataires, qui est un indicateur plus fiable de la charge pesant sur l'État que le niveau des dépenses.
Entre 2019 et 2024, le montant des mémoires déposés est passé de 566,0 à 783,4 millions d'euros (+ 38,4 %, alors que l'inflation hors tabac a été de + 14,4 % sur la même période), hausse qui affecte l'ensemble des catégories de frais de justice mais à des degrés très différents.
Évolution du coût des mémoires
déposés,
par catégorie de frais de justice
(en millions d'euros et en pourcentage)
Lecture : le coût des mémoires déposés pour des prestations d'analyses et expertises médicales a augmenté de + 49,6 % entre 2019 et 2024.
Source : commission des finances, à partir des données transmises par la direction des services judiciaires
Selon les indications données au rapporteur spécial par le ministère de la justice, le nombre de mémoires déposés serait toutefois en diminution de 0,3 % en avril 2025.
Sur cette question, l'information disponible dans les documents budgétaires s'est malheureusement réduite au cours des années récentes. Jusqu'à l'exercice 2021, les rapports annuels de performances annexés au projet de loi de règlement donnaient des informations plus ou moins détaillées sur les charges à payer, la dette économique et les mesures de fongibilité mises en oeuvre afin de financer la sur-exécution des crédits. Ces informations ont disparu et la seule information donnée est celle du montant exécuté, qui ne reflète que très partiellement la réalité de l'impact budgétaire des frais de justice et ne permet pas d'en comprendre la dynamique.
D'une manière générale, la qualité de la présentation des crédits du programme 166 a été fortement réduite : la répartition des crédits par titre et par brique de budgétisation (frais de justice, fonctionnement courant, immobilier occupant, etc.) a disparu, ce qui réduit l'information du Parlement et des citoyens.
Recommandation : rétablir une présentation détaillée des frais de justice dans les documents budgétaires, avec notamment le montant et l'évolution des charges à payer et de la dette économique, ainsi qu'avec les mesures prises en exécution dans le cas des sur-exécutions.
C. LES ENQUÊTES REPOSENT DE PLUS EN PLUS SUR DES MESURES TECHNIQUES OU D'EXPERTISE COÛTEUSES
L'évolution des postes de frais de justice permet de mieux comprendre d'où provient l'augmentation des frais de justice.
En premier lieu, l'augmentation des frais de justice ne s'explique pas par une augmentation du nombre des affaires traitées devant les juridictions pénales.
Le nombre des affaires poursuivables36(*) est même plutôt en baisse, de quelque 1,3 million par an entre 2014 et 2019 à 1,2 million en 2022 et 2023, tandis que le nombre des affaires faisant effectivement l'objet d'une poursuite est stable autour de 600 000 par an37(*).
Selon les éléments communiqués au rapporteur spécial, il apparaît en revanche que le nombre des actes prescrits au cours d'une enquête par les juges ou les officiers de police judiciaire a augmenté, en particulier s'agissant d'actes coûteux.
À titre d'exemple, une enquête pour narcotrafic, face à des réseaux aux moyens financiers et techniques importants, nécessite souvent un grand nombre d'interceptions judiciaires afin de retracer les parcours des trafiquants. L'évolution technologique contribue à renchérir certaines mesures : les téléphones et les ordinateurs sont de plus en plus sécurisés, alors que leur décodage est indispensable pour les enquêtes relatives au narcotrafic.
La progression des enquêtes pour violences sexuelles et intra-familiales, qui ont constitué une priorité de la justice ces dernières années, a également pour conséquence la réalisation d'enquêtes sociales rapides (ESR) ainsi que la prise en charge médicale ou psychologique des victimes. Une enquête pour viol donne également lieu à des analyses biologiques.
Dans certains cas, toutefois, les actes générateurs de frais de justice à court terme peuvent être en réalité utiles sur le plan financier à long terme. Lorsque le garde des Sceaux, par une circulaire de politique pénale générale du 27 janvier dernier, encourage à la mise en oeuvre des dispositifs de saisie et confiscations prévus par la loi, l'effet immédiat est une hausse des coûts de gardiennage des biens saisis, souvent des véhicules ; mais ces biens peuvent ensuite être revendus, ou confiés à des services de police, et apporter ainsi des ressources sur lesquelles on reviendra plus loin dans le présent rapport.
La hausse du coût des frais de justice provient donc, au moins en partie, des inflexions de la politique pénale, et reflète les évolutions de la société.
Il a ainsi été indiqué au rapporteur spécial que le juge, aujourd'hui, s'attend, dans de nombreuses affaires, à trouver dans son dossier des preuves tirées d'interceptions judiciaires ou de l'exploitation du téléphone portable de la victime.
D'une manière plus générale, plusieurs personnes auditionnées ont rappelé que la justice est passée d'une culture de la preuve par l'aveu à une culture de la preuve matérielle. La preuve scientifique apparaît plus « solide » qu'un aveu qui peut toujours être rétracté ou contesté. Or la preuve matérielle requiert des actes d'investigation ou d'analyse plus poussés et plus coûteux, comme l'observait déjà la commission des finances en 201238(*).
IV. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE
A. « IL EST PLUS SIMPLE DE NE PAS FAIRE D'EFFORT » : UNE MEILLEURE INFORMATION DES MAGISTRATS ET DES ENQUÊTEURS DOIT LEUR PERMETTRE D'ADAPTER LES MESURES QU'ILS DEMANDENT AUX NÉCESSITÉS DE LEURS INVESTIGATIONS
« Il est plus simple de ne pas faire d'effort », c'est-à-dire de commander des expertises ou de réaliser d'autres actes d'enquête sans se préoccuper de leur coût, ni chercher à le réduire : cette phrase, entendue par le rapporteur spécial au cours des auditions ne signifie pas que les juges, les enquêteurs n'auraient pas conscience de l'enjeu des frais de justice. Bien au contraire, tous sont conscients de l'enjeu que ce poste de dépense représente pour les finances publiques, mais aussi pour celles du ministère de la justice.
Ils savent que, le budget de la justice n'étant pas illimité, le financement des surcoûts sur le poste des frais de justice implique de décaler la construction d'une prison, la rénovation d'un palais de justice ou l'amélioration d'un système informatique - tous des projets pourtant indispensables pour améliorer leurs conditions de travail et rendre une justice de qualité pour les citoyens.
Or maîtriser les frais de justice est d'abord chronophage : il est plus simple d'accepter un devis provenant d'un prestataire connu que de se renseigner sur les prix couramment pratiqués, de solliciter plusieurs prestataires et de négocier un prix en fonction de la qualité de la prestation. Ces tâches ne correspondent pas aux priorités d'un magistrat qui traite 700 à 1 000 affaires par an39(*) et a donc d'abord pour objectif, fort légitimement, de rendre la meilleure décision dans le délai le plus bref possible.
Un exemple concret a été donné au rapporteur spécial : s'il est nécessaire d'accéder à un local dont l'occupant est absent, il est plus simple et plus rapide de réquisitionner un serrurier que de prendre le temps de chercher l'occupant. Lorsqu'une enquête urgente est en cours, on peut comprendre que ce type de coût paraisse secondaire par rapport aux besoins de l'investigation.
Il paraît donc indispensable que les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes, disposent de la meilleure information possible et des outils leur permettant d'ordonner des mesures d'enquête qui contribuent pleinement à la manifestation de la vérité sans entraîner des coûts excessifs et inutiles.
1. Les prescripteurs ne sont pas suffisamment informés de l'impact financier de leur demande
Plusieurs organisations auditionnées par le rapporteur spécial ont signalé que les juridictions ne sont informées que de manière insuffisante sur les coûts occasionnés par les frais de justice.
Par exemple, un relevé annuel est envoyé à la fin de l'année et indique le coût moyen de l'enquête dans une juridiction. Si l'information est intéressante, elle ne donne pas les éléments suffisants pour savoir où les coûts pourraient être réduits.
Pour certaines prestations, certes, le juge ou l'officier de police judiciaire est pleinement informé du coût. Le rapporteur spécial, au cours d'une visite dans les locaux de l'ANTENJ, a pu constater que le coût de chaque mesure demandée (identification d'un utilisateur de téléphone, interception judiciaire, etc.) apparaissait sur l'écran avant que l'utilisateur confirme l'envoi de la réquisition. De même, le juge est nécessairement informé lorsqu'il signe un devis d'expertise.
D'une manière générale, toutefois, de nombreuses prestations sont gérées par les services centraux et les juges semblent assez peu informés des coûts.
Des alertes sont certes émises lorsque l'enveloppe globale risque d'être dépassée, avec le risque de devoir repousser des paiements à l'année suivante, mais bien souvent les prescripteurs ne sont pas informés sur l'augmentation anormale du coût d'une mesure particulière.
Les officiers de police judiciaire ont encore moins connaissance du coût des mesures qu'ils demandent. La direction nationale de la police judiciaire indique ainsi qu'elle ne dispose pas d'outil permettant de calculer le coût moyen d'une enquête relative à des violences intra-familiales, alors que le nombre de cette catégorie d'enquêtes progresse rapidement40(*). Les enquêteurs ne sont pas directement conscients des conséquences budgétaires induites pour le ministère de la justice, c'est-à-dire pour l'État, par les mesures qu'ils engagent dans le cadre de leurs travaux.
La direction générale de la gendarmerie nationale a indiqué pour sa part au rapporteur spécial que la notion de « devis judiciaire » était enseignée lors de la formation des enquêteurs. Cet outil permet, en lien entre le magistrat et le service d'enquête, de mieux hiérarchiser les actes d'enquête afin de limiter les investigations aux actes strictement indispensables. Il ne semble toutefois pas utilisé par la police nationale.
Le devis judiciaire
Le « devis judiciaire » consiste à formaliser dans un document transmis par la hiérarchie au magistrat les objectifs et les étapes de l'enquête dès la saisine de l'affaire. Ce type de contractualisation qui résulte d'une analyse partagée des deux acteurs a pour but d'évaluer au début de l'enquête les moyens humains et les diligences nécessaires au regard de la complexité et des circonstances de l'affaire. L'enjeu est de rationaliser le processus d'enquête et maîtriser davantage les délais de l'enquête, dans un objectif de meilleur rapport coût-efficacité et de maîtrise des dépenses de justice.
Introduite au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale par une instruction en date du 26 janvier 2015, son utilisation dépend toutefois des orientations pénales décidées localement. Plusieurs protocoles ont été signés en matière de délinquance économique et financière entre les procureurs généraux et les commandants de région de gendarmerie en Occitanie, en Corse ou encore à la Réunion. Plus qu'une formalisation écrite transmise au magistrat, cette pratique consiste en une démarche intellectuelle et une discussion avec l'autorité judiciaire visant à analyser les dossiers et leurs perspectives afin d'adapter les moyens aux stratégies d'enquête. La police nationale n'utilise pas cet outil et se montre assez réservée.
Source : Cour des comptes, 202341(*)
Recommandation : informer de manière plus systématique les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le coût des mesures avant de les ordonner (comparatifs de coûts moyens pour une prestation donnée) et après (coût des mesures effectivement ordonnées).
2. Les coûts complets des expertises devraient être mieux connus afin d'éclairer les choix des prescripteurs
L'information des magistrats et enquêteurs dépend toutefois, pour certaines prestations, de la connaissance de leurs coûts réels, qui n'est pas toujours disponible.
On citera ainsi le cas des analyses génétiques et toxicologiques d'une part, des expertises informatiques d'autre part.
a) Les analyses génétiques et toxicologiques
À l'intérieur de la catégorie des analyses et expertises médicales, le coût des analyses génétiques et toxicologiques est partagé entre les ministères de l'intérieur et de la justice.
Le coût des analyses génétiques facturé au ministère de la justice a été de 37,3 millions d'euros en 2024 (dont 24,1 millions d'euros pour des prestations dont le prix est déterminé par un tarif) et celui des analyses toxicologiques s'est élevé à 38,8 millions d'euros la même année42(*).
Toutefois, comme il a déjà été indiqué, des analyses sont également demandées, soit par les magistrats, soit par des enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationales, aux laboratoires publics placés sous le contrôle du service national de la police scientifique (SNPS). Auditionné par le rapporteur spécial, ce service dispose de cinq laboratoires de police scientifique de haut niveau, d'un plateau national de révélation de traces papillaires, d'un plateau national d'odorologie et un laboratoire central de criminalistique numérique.
Les analyses réalisées par les cinq laboratoires de police scientifique sur demande des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationale, bien que ceux-ci agissent sous l'autorité du parquet, ne sont pas facturés. Leur coût est toutefois estimé à 77 millions d'euros pour l'année 2024 et relève du programme 176 « Police nationale » de la mission « Sécurités ».
Les analyses réalisées par ces laboratoires sur ordonnances de commission d'expert43(*), donc sur la demande des magistrats instructeurs, sont facturées en fonction de tarifs proposés par le SNPS, pour un montant de 8,7 millions d'euros en 2024.
Or les analyses demandées par les magistrats sont, en moyenne, bien plus complexes et coûteuses : elles ne représentent que 1,1 % de l'ensemble des analyses, mais 10 % du coût environ.
Un constat similaire pourrait être fait pour des analyses traitées, dans le cadre de la délinquance de masse, par l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), qui sont financées par le programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités ». Comme indiqué supra, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a signalé au rapporteur spécial que le coût, s'il était facturé, serait de l'ordre de 8 millions d'euros par an.
Les analyses réalisées à la demande des magistrats ou, dans le cadre d'une procédure judiciaire, par les enquêteurs, peuvent donc, selon le cas, être réalisées par des laboratoires privés ou par des laboratoires publics.
L'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a indiqué au rapporteur spécial que les magistrats ont souvent recours aux laboratoires publics parce que leurs prestations sont moins coûteuses, mais que les délais de réponse sont excessifs : le recours aux laboratoires privés permettrait, selon cette association, de faire gagner beaucoup de temps dans de nombreuses enquêtes.
Le SNPS n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au rapporteur spécial si ses prestations étaient plus ou moins coûteuses que celles des laboratoires privés sur certains types d'analyses.
De fait, il est difficile de comparer les prestations et les coûts des laboratoires, car les coûts complets des laboratoires publics ne sont pas connus, faute de mise en place d'une comptabilité analytique. Les prestations des laboratoires privés, pour leur part, entraînent nécessairement une facturation, mais le prix peut aussi être différent des coûts réels afin d'acquérir des parts de marché.
Il paraît donc difficile de conduire une réelle politique de maîtrise de ce poste de dépense sans cette connaissance.
Recommandation : établir les coûts complets des analyses génétiques et toxicologiques par les laboratoires publics afin de permettre une évolution future.
Des instructions ont toutefois été diffusées dans les services de police : dans le cadre de la police scientifique de masse, c'est-à-dire par exemple pour les cambriolages, le nombre de prélèvements d'ADN est limité à trois. En outre ces prélèvements sont réalisés au moyen d'écouvillons standardisés dont l'acquisition fait l'objet d'un marché public.
S'agissant de même de la gendarmerie nationale, l'IRCGN a diffusé en 2024 une directive relative aux prélèvements génétiques qui a réduit de 26 % le nombre de prélèvements traités.
b) Les expertises informatiques
Le coût des expertises informatiques, qui a été de 17,3 millions d'euros en 2024, a plus que doublé en cinq ans, signe de la technicisation croissante des enquêtes et de la dépendance de plus en plus grande aux preuves numériques.
Coût des expertises informatiques au titre des frais de justice
(en millions d'euros)
Source : rapports annuels de performance et Chorus
Les expertises informatiques, ou investigations numériques, consistent à analyser des ordinateurs, téléphones portables ou disques durs, afin de produire des éléments susceptibles d'être utiles à l'enquête ou à l'instruction. Il peut aussi s'agir de comprendre comment une faille de sécurité a été exploitée dans le cas d'une cyberattaque.
Comme pour les expertises génétiques et toxicologiques, les experts sollicités peuvent être des prestataires privés ou des laboratoires publics relevant de la police ou de la gendarmerie nationales. Les actes ne sont facturés que lorsqu'elles résultent d'une ordonnance de commission d'expert de juges d'instruction.
La police nationale dispose ainsi d'un laboratoire central de criminalité numérique (LCCN), rattaché au SNPS, et de section de criminalité numérique (SCN) dans les régions. La gendarmerie nationale possède une unité nationale cyber (UNCyber) et un centre national d'expertise numérique (CNENUM).
L'AFMI, comme pour les analyses médicales, souhaite que l'accès à l'expertise privée ne soit pas limité afin de préserver la qualité et la rapidité des procédures d'enquête.
Or ces expertises, d'une haute technicité, ne sont pas actuellement soumises à des tarifs réglementés qui faciliteraient la maîtrise de leur coût. La tarification semble en effet difficile à mettre en place en raison de l'hétérogénéité des systèmes techniques concernés et de la rapidité de l'évolution technologique.
Les magistrats ne disposent pas toujours, pour les mêmes raisons, des connaissances nécessaires pour comparer réellement les devis établis par les prestataires. En outre, les coûts complets des expertises ne sont pas connus, ce qui rend plus difficile aussi bien la comparaison entre prestataires privés et laboratoires publics que la définition de tarifs ajustés aux coûts.
Le plan de maîtrise des frais de justice prévoit certes d'« envisager la tarification de certaines prestations informatiques », mais un groupe de travail, qui s'est réuni avec la Compagnie nationale des experts de justice en informatique et techniques associées (CNEJITA) dans l'objectif de définir une stratégie de tarification pour les analyses portant sur huit catégories de supports numériques44(*), n'a pas pu aboutir.
Au total, la haute technicité des analyses et la diversité des supports informatiques semble rendre difficile, à l'heure actuelle, la définition de tarifs standardisés pour ces prestations.
3. Les plans de maîtrise des frais de justice lancés par les Gouvernements successifs doivent être poursuivis et amplifiés
La maîtrise des frais de justice est un objectif constamment affiché par le ministère de la justice et rappelé dans les documents budgétaires. Le rapport annuel de performances relatif à l'année 2007 salue ainsi la « réussite du plan de maîtrise des frais de justice » mis en oeuvre l'année précédente, mais, comme on l'a vu supra, cette réussite n'a été que temporaire et la volonté de réduire, ou du moins de limiter la progression de ces frais est affirmée chaque année, tantôt pour certaines catégories de frais de justice, tantôt dans le cadre de plans plus ambitieux.
Une nouvelle impulsion est donnée à compter de 2021 à la définition d'un plan global de maîtrise des frais de justice45(*), dont l'objectif est :
- de sensibiliser l'ensemble des acteurs des règles, par la formation et la diffusion de données budgétaires ;
- d'agir sur certains segments de dépenses tels que les analyses et expertises médicales, les prestations d'interprétariat et de traduction et les scellés, sans interférer sur la liberté de prescription ;
- de renforcer le contrôle de gestion et le contrôle interne.
Un chargé de mission est ainsi nommé au début 2022 à la direction des services judiciaires (DSJ), puis une comitologie est mise en place afin de susciter les échanges.
Le plan est organisé autour de 15 actions en 2023, l'accent étant mis sur le pilotage par les responsables de BOP, au moyen de tableaux de bord mensuels46(*). Une dizaine de chargés de mission « maîtrise des frais de justice » ont été recrutés, ainsi que des contrôleurs de gestion. Dans le même temps, les services centralisateurs régionaux se développent et des actions de sensibilisation et de formation sont menées à destination des agents et des magistrats.
Les services centralisateurs locaux et régionaux
Le traitement des mémoires de frais de justice occupe environ 170 équivalents temps plein (ETP) dans les services centralisateurs localisés au sein de chaque juridiction. Ceux-ci ont traité en 2022 plus de 1,2 million de mémoires, dont 1,1 million ont fait l'objet d'un paiement pour un montant total de 460 millions d'euros.
Afin de mieux professionnaliser l'activité de certification et de contrôle des mémoires et d'harmoniser les procédures, des services centralisateurs régionalisés sont mis en place (Toulouse en 2021, Basse-Terre, Bordeaux, Chambéry, Dijon, Douai, Lyon et Rennes en 2024, Amiens au 1er mai 2025).
Il ressort de l'expérience de la cour d'appel de Toulouse une meilleure qualité des contrôles avec un délai de certification souvent réduit, des rejets plus importants de mémoires et une meilleure gestion du stock. Le rejet des mémoires erronés permet, à terme, d'en améliorer la qualité47(*).
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial
Au niveau national, les actions sont coordonnées par le bureau du pilotage des frais de justice (FIP4), précédemment « bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense »48(*), qui fait partie de la sous-direction des finances, de l'immobilier et de la performance (SDFIP) de la DSJ.
En 2024, le plan est recentré sur une dizaine d'actions, en insistant particulièrement sur les analyses génétiques et toxicologiques, les prestations d'interprétariat et de traduction, la généralisation du recours à la PNIJ et le gardiennage des véhicules49(*). Au-delà de la DSJ, il associe désormais la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et l'agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ). Le ministère de l'intérieur est lui-même associé au plan, par l'intermédiaire de la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Les actions se poursuivent en 2025 et sont au nombre de 11. La DSJ met l'accent tout particulièrement sur les géolocalisations et les interceptions, le gardiennage des véhicules et le recours aux devis pour les prestations non tarifées50(*).
Sur la période, les principales priorités demeurent, mais certains objectifs nouveaux apparaissent, comme les expertises psychiatriques en 2025, ainsi que la volonté de développer les recettes liées aux frais de justice (doublement des droits fixes de procédure, finalement intégrée à la loi de finances publiée le 14 février 2025, amélioration du taux de recouvrement des amendes pénales).
Certaines actions progressent toutefois difficilement, comme le montre l'exemple du groupe de travail conjoint avec la CNEJITA, qui n'a pas pu aboutir pour mettre en oeuvre l'objectif de tarification des expertises informatiques pour certains supports numériques. L'objectif est reconduit pour 2025 mais la mise en oeuvre passerait plutôt par l'analyse des coûts des principaux prestataires afin de faciliter la comparaison et la mise en concurrence.
Les actions des plans de maîtrise des frais de justice successifs
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
Maintenir et animer les instances de dialogues |
Renforcer la sensibilisation et la formation de l'ensemble des acteurs des frais de justice à la maitrise des frais de justice |
|
|
Sensibiliser les acteurs des frais de justice à la maîtrise des frais de justice |
||
|
Former les acteurs des frais de justice |
||
|
Renforcer le pilotage du responsable du BOP dans les plans de maitrise |
||
|
Poursuivre l'expérimentation des services centralisateurs régionalisés |
Poursuivre la régionalisation des services centralisateurs des frais de justice |
Amélioration du circuit de la dépense |
|
Améliorer la gestion des stocks et des flux des véhicules sous main de justice entrants et sortants |
Poursuivre l'amélioration de la gestion des stocks et des flux de véhicules sous main de justice entrants et sortants |
|
|
Expérimenter un nouveau processus de destruction des armes en lien avec le ministère de l'intérieur |
Poursuivre l'expérimentation du nouveau processus de destruction des armes en lien avec le ministère de l'intérieur et préparer sa généralisation |
|
|
Expertises psychiatriques |
||
|
Expertiser de nouveaux outils en matière d'interprétariat-traduction |
Optimiser les prestations d'interprétariat-traduction |
|
|
Clarifier la prise en charge financière des analyses toxicologiques par les laboratoires publics |
Renforcer le recours aux laboratoires publics |
|
|
Envisager la tarification des prestations génétiques des 7 laboratoires privés |
Renforcer la maitrise des frais d'analyses génétiques |
|
|
Envisager la tarification des prestations informatiques les plus courantes |
Envisager la tarification de certaines prestations informatiques |
|
|
Améliorer l'efficience de l'expertise numérique avec la méthode dite du triage |
||
|
Améliorer la gestion des scellés biologiques gardés par les hôpitaux ou des laboratoires |
||
|
Généraliser la passation des marchés de transport de corps aux dernières cours d'appel |
||
|
Parvenir à une généralisation du recours à la PNIJ |
||
|
Poursuivre l'évaluation des actions générant des recettes |
Augmenter les recettes et réduire les frais de justice |
|
Source : commission des finances, à partir des documents transmis au rapporteur spécial
Le rapporteur spécial ne peut qu'encourager à poursuivre la mise en oeuvre de ce plan.
Les magistrats auditionnés par le rapporteur spécial ont confirmé que les chefs de cour, sous la pression de la chancellerie, rappellent régulièrement aux magistrats les priorités de réduction des frais de justice, de manière à diffuser peu à peu une « culture budgétaire » sans pour autant remettre en cause le principe d'indépendance de la justice. La sensibilisation passe par des notes écrites ou des communications orales. Des groupes de travail sont régulièrement mis en place concernant la gestion des scellés, à l'initiative des directeurs de greffe qui en sont gardiens.
Du côté du ministère de l'intérieur, la DGGN indique également s'investir dans un dialogue régulier en matière de frais de justice avec le ministère de la justice et les services d'enquête, ainsi que par la diffusion de guides de bonnes pratiques et de formations sur les coûts des actes et sur l'utilisation raisonnée des dispositifs.
La Cour des comptes fait toutefois observer que les quatre priorités identifiées en 2024 (analyses génétiques et toxicologiques, prestations d'interprétariat et de traduction, recours à la PNIJ et gardiennage des véhicules) ne correspondent qu'à 54 % du montant des frais de justice en 2024, voire moins encore car ces segments de dépense ne sont pas entièrement couverts par les mesures envisagées51(*).
Il convient en effet de chercher à amplifier le plan en intégrant la plus grande proportion possible des frais concernés, sachant que ces quatre catégories sont les plus importantes et présentent des marges de progression. Certains segments de dépense présentent toutefois une rigidité plus grande que d'autres et laissent moins de marges de pilotage au ministère de la justice : c'est le cas des frais de procédure, des frais liés à la médecine légale ou aux cotisations sociales des contributeurs occasionnels du service public.
B. LES FRAIS DE JUSTICE DEVRAIENT ÊTRE CONNUS DÈS L'ENGAGEMENT DE LA DÉPENSE, ET PAS SEULEMENT LORS DU PAIEMENT
Une difficulté particulière rencontrée lors du suivi des frais de justice est que, contrairement à d'autres prestations, l'engagement juridique, c'est à dire la commande faite à un prestataire par un magistrat ou un officier de police judiciaire, n'est pas enregistré dans le système d'information comptable Chorus. Si les greffes conservent des traces de ces commandes, elles ne sont connues de l'administration centrale que lorsque les mémoires sont saisis, c'est-à-dire à l'issue de la prestation.
Cette situation a été justifiée au rapporteur spécial par le respect de la liberté du magistrat et par le secret de l'instruction.
Elle semble toutefois résulter aussi de la complexité et de l'inadaptation des outils d'information. En 2006, lors de la mise en oeuvre de la LOLF et de l'instauration des crédits limitatifs pour les frais de justice, le logiciel spécifique FRAIJUS a été déployé afin de permettre un suivi des engagements. Ce système, de courte durée, a laissé en 2011 la place à l'application « Chorus formulaires », mais, en pratique, les saisies n'étaient pas exhaustives, ou bien les engagements étaient saisis de façon ouverte et non sur un montant certain au bénéfice d'un tiers identifié. En 2014, il a été décidé de ne plus enregistrer les frais de justice qu'au moment de la demande de paiement et la Cour des comptes a constaté l'échec des tentatives de les suivre dès l'engagement52(*).
Dès lors, le seul suivi possible est celui des factures ou « mémoires » déposées par les prestataires sur la plateforme Chorus Pro (si la dépense relève d'un BOP local) ou remontées au responsable du BOP central de la DSJ.
Or cette situation n'est pas satisfaisante.
L'impossibilité de connaître, à un moment donné, l'état réel des engagements réduit en pratique la portée du caractère limitatif des crédits consacrés aux frais de justice et pose la question de la comptabilité de la gestion de ces frais avec la loi organique relative aux lois de finances, en particulier ses articles 8 (limitation des engagements au montant des autorisations d'engagement) et 30 (« La comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. »).
En outre, la méconnaissance des engagements réels limite fortement les possibilités de suivre et de piloter, en cours d'année, le coût des frais de justice. Le coût ne peut être estimé que lorsque les prestataires déposent leurs mémoires sur la plateforme Chorus Pro pour les dépenses relevant des BOP locaux, ou à partir des informations diverses dont dispose le BOP central. Or les mémoires ne sont déposés que postérieurement à l'exécution de la prestation et l'émission d'une attestation de fin de mission, dans un délai qui peut atteindre un an53(*).
Une saisie dans Chorus des commandes d'expertises et autres prestations devrait être mise en place en prenant en compte la charge pesant ainsi sur les prescripteurs, ainsi que le principe de liberté de prescription des magistrats. Une autre contrainte à prendre en compte est le caractère de confidentialité qui s'attache à certaines prestations, au regard du déroulement de l'enquête, qui risque d'entraîner des réticences des enquêteurs à les inscrire dans un système utilisé par l'ensemble de l'administration de l'État.
En dépit de ces difficultés et sans les négliger, mais compte tenu du poids financier croissant des frais de justice, le rapporteur spécial considère qu'il est nécessaire de se fixer à nouveau comme objectif de réaliser un suivi réaliste et le plus exhaustif possible des frais de justice dès la commande des prestations.
Recommandation : pour un meilleur suivi des frais de justice, fixer comme objectif un enregistrement des frais de justice dans Chorus dès l'engagement.
C. LE PROJET DE PROCÉDURE PÉNALE NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE MENÉ À SON TERME AFIN DE RATTACHER LES FRAIS DE JUSTICE À UNE ENQUÊTE
Une meilleure maîtrise du coût des frais de justice ne doit pas se contenter d'une approche ciblée sur chaque catégorie de prestation, mais doit aussi reposer sur une vision de l'ensemble des actes réalisés au cours d'une enquête.
Une telle vision d'ensemble permettrait, a posteriori, de mieux déterminer quelles mesures ont été réellement utiles pour la manifestation de la vérité. Elle permettrait aussi de dresser des comparaisons et d'améliorer la détermination des bonnes pratiques.
En outre elle faciliterait le recouvrement des frais sur la personne condamnée dans les cas où cela est possible.
Or il a été plusieurs fois confirmé au rapporteur spécial qu'il n'est pas, aujourd'hui, possible de dresser la liste de l'ensemble des actes réalisés au cours d'une enquête et de calculer son coût global.
Pour que cela soit possible, il faudrait en particulier que l'ensemble de ces actes soient reliés à un identifiant de dossier judiciaire partagé entre l'ensemble des agents (magistrats, officiers de police judiciaire, greffiers...) qui interviennent tout au long de l'enquête et du jugement et saisissent les informations relatives à ces actes dans Chorus ou dans d'autres systèmes d'information.
S'ajoutant à une saisie des actes dès leur engagement et non, comme il a été vu supra, lors de la présentation des mémoires, un tel système d'information permettrait enfin de réaliser un suivi réel des frais de justice.
Un projet est en cours depuis 2018 : la procédure pénale numérique (PPN), avec laquelle les ministères de l'intérieur et de la justice cherchent à dématérialiser l'ensemble des pièces constituant le dossier d'une procédure pénale, depuis le dépôt de la plainte jusqu'à la décision judiciaire et son archivage.
Un identifiant unique devrait alors être défini dès l'ouverture de la procédure, permettant de suivre le cours de celle-ci et de l'ensemble des actes qui l'accompagnent, dans les services de police ou de gendarmerie comme dans son parcours judiciaire (parquet, instruction, juridiction de jugement).
Il s'agit de l'un des plus importants projets numériques du ministère de la justice avec un coût prévisionnel de 121,7 millions d'euros. Le déploiement est réalisé progressivement54(*).
Ce projet semble avoir été ralenti mais sa réalisation et son déploiement généralisé doivent être poursuivis et prendre en compte la nécessité d'inclure un suivi enfin exhaustif et chiffré des coûts de frais de justice occasionnés par une procédure pénale.
Recommandation : mener à son terme le projet de procédure pénale numérique (PPN) afin de pouvoir retrouver et suivre, au moyen d'un identifiant de dossier judiciaire, l'ensemble des frais de justice associés à une procédure donnée.
D. L'ACTION DOIT ÊTRE MENÉE AU NIVEAU INTERMINISTÉRIEL, EN CONCERTATION AVEC LA POLICE ET LA GENDARMERIE NATIONALES
1. S'il paraît complexe, à l'heure actuelle, de définir un schéma exhaustif de refacturation au ministère de l'intérieur des frais engagés par le ministère de la justice...
Le rapporteur spécial s'est posé la question de la possibilité, dans un objectif de meilleure compréhension des coûts, de revoir l'imputation du montant des frais de justice entre les ministères de la justice et de l'intérieur, dans la mesure où plus de 50 % des prescripteurs sont des officiers de police judiciaire, qui relèvent de la police ou de la gendarmerie nationales.
Plusieurs arguments s'opposent toutefois à la mise en place d'un schéma de refacturation du coût de chaque acte au ministère de l'intérieur.
Le premier est un argument de principe : les officiers de police judiciaire, comme leur qualification l'indique, sont réputés agir « sous la direction du procureur de la République », « sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction »55(*).
La Cour des comptes nuançait certes cet argument en 201456(*) : une partie des prescriptions sont réalisées sans contrôle préalable du magistrat, notamment en cas de flagrant délit, et certaines prescriptions ont lieu en dehors de toute procédure ouverte, comme l'indemnisation des interprètes et des honoraires des médecins désignés par l'officier de police judiciaire pour les étrangers faisant l'objet d'une vérification de leur droit de circulation ou de séjour sur le territoire français57(*). Ces cas ne semblent toutefois concerner qu'une part minoritaire des frais de justice.
En second lieu, le ministère de l'intérieur supporte lui-même des coûts dont une partie relèvent de prescriptions de l'autorité judiciaire. Certains sont refacturés au ministère de la justice, comme on l'a vu dans le cas des analyses génétiques et toxicologiques réalisées par les laboratoires publics de la police et de la gendarmerie nationales sur ordonnance de commission d'expert.
Toutefois, il a été indiqué au rapporteur spécial que le SNPS ne facture pas au ministère de la justice la conservation des scellés biologiques, qui nécessite des équipements (congélateurs, réfrigérateurs) dont ne disposent pas les greffes58(*). D'une manière générale, il serait extrêmement complexe de faire la part des frais supportés par les programmes 176 « Police nationale » et 152 « Gendarmerie nationale » et qui pourraient être rattachés au segment des frais de justice.
Un mécanisme d'imputation des frais de justice sur chaque ministère serait d'autant plus complexe, voire illusoire, à mettre en place que les coûts réels et complets des prestations ne sont pas toujours connus, comme il a été constaté supra, et que l'absence d'identifiant de dossier judicaire s'oppose au rattachement des frais de chaque acte à une affaire donnée. Un tel mécanisme supposerait de mettre en place un circuit de saisie et de validation entre les deux ministères, source de complexité et de temps passé pour les personnels.
Il ne paraît donc pas réaliste, à l'heure actuelle, de chercher à mettre en place un mécanisme de facturation systématique et exhaustif entre deux ministères qui, en dernière analyse, font tous deux partie du budget général de l'État.
2. ... le pilotage des frais de justice devrait associer d'une manière plus approfondie les deux ministères
Le pilotage des frais de justice étant assuré par le ministère de la justice, il est naturel que les instructions soient diffusées de manière plus aisée à l'intérieur de ce ministère, par l'intermédiaire des chefs de cour d'appel.
Si des chargés de mission et des contrôleurs de gestion, en cours de déploiement, assurent le contrôle et la coordination de cette action dans le ministère de la justice, le lien paraît plus distant avec le ministère de l'intérieur, et en particulier avec les enquêteurs sur le terrain, malgré la volonté clairement affirmée au niveau des directions des deux ministères.
Le dialogue entamé au niveau des comités stratégiques entre les directions des deux ministères devrait donc se décliner au niveau des juridictions et des services de police judiciaire. Un moyen d'y parvenir serait de mettre en place des référents frais de justice dans les services de la police judicaire, aussi bien au sein de la police nationale que de la gendarmerie nationale, au même niveau géographique que les juridictions (département, région).
Ces référents, en lien direct avec la juridiction, seraient destinataires des instructions, diffusées par leur direction nationale, mais aussi des informations et analyses conduites par les juridictions. Leur rôle serait de les diffuser auprès des enquêteurs et des services locaux, mais aussi de leur apporter des réponses. Face aux juridictions, ils pourraient aider à analyser l'évolution des coûts sur certains segments.
Recommandation : mettre en place un réseau de référents « frais de justice » dans les services de police judiciaire, chargés de faire le lien entre les informations apportées par le ministère de la justice, les instructions émanant du ministère de l'intérieur et les enquêteurs.
DEUXIÈME
PARTIE
MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR
DU BON FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE
Il n'existe pas de recette « miracle » pour réduire la dépense en frais de justice, les mesures d'expertise et autres actes d'enquête étant nécessaires à la conduite d'une enquête moderne.
Il est toutefois possible, et nécessaire, d'éviter des dépenses qui pourraient l'être et, dans une certaine mesure, de développer à nouveau des recettes permettant de rembourser partiellement à l'État les frais d'enquête et de justice.
Avant tout, une budgétisation correcte des frais de justice s'impose afin de mettre fin aux retards de paiement et au développement d'une dette s'accumulant d'année en année.
I. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE
A. LES MÉMOIRES DE FRAIS DE JUSTICE FONT L'OBJET D'UN CONTRÔLE PAR LES GREFFES OU LES MAGISTRATS AVANT MISE EN PAIEMENT
Les frais de justice sont traités selon deux procédures distinctes selon qu'ils relèvent des budgets opérationnels de programme (BOP) locaux ou du BOP central.
Les prestataires de BOP locaux (cours d'appel) déposent leur mémoire sur la plateforme Chorus Pro59(*). Auparavant, ces mémoires étaient transmis par courrier.
Les mémoires sont alors transmis à Chorus Formulaires60(*) et contrôlés par les services centralisateurs décrits précédemment, qui sont situés soit au niveau des tribunaux judiciaires, soit à titre expérimental au niveau régional. Les services centralisés certifient ou « taxent » les mémoires.
Certification et taxation
Deux procédures de validation des mémoires de frais de justice selon le montant et la nature des frais :
- les frais soumis à tarif, résultant de réquisitions judiciaires relatives à des communications électroniques ou encore d'un montant inférieur à 460 euros, ainsi que certains autres frais, font l'objet d'une certification par un greffier ou un autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires61(*) ;
- les autres mémoires sont transmis au parquet du ressort dans lequel la juridiction à son siège, où un magistrat (souvent par ailleurs désigné comme « référent » pour les frais de justice) est chargé de les taxer, c'est-à-dire qu'il définit le montant à payer. Si ce montant est différent de celui demandé par le prestataire, celui-ci dispose d'un recours de dix jours à compter de la notification qui lui est faite62(*).
Source : commission des finances, à partir des réponses apportées au rapporteur spécial et du code de procédure pénale
Les services centralisateurs transmettent ensuite les mémoires au pôle Chorus Coeur63(*) des cours d'appel pour mise en paiement. Après paiement d'un mémoire qui a fait l'objet d'une certification, le prestataire dispose d'un délai d'un mois pour adresser une réclamation, laquelle est transmise au magistrat chargé de la taxation.
Toutefois, un mode de paiement en régie est conservé pour les indemnités des jurés, témoins et parties civiles, dont le montant est inférieur à 2 000 euros.
Les frais de justice relevant du BOP central sont gérés par la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice et ne transitent pas par Chorus Formulaires. Ces frais incluent la subvention versée aux établissements de santé au titre du schéma directeur de la médecine légale, les prestations de la plateforme nationale d'interceptions judiciaires (PNIJ) et le paiement des cotisations des collaborateurs occasionnels du service public (COSP).
La mise en place de Chorus pour le traitement des mémoires a indéniablement permis d'assurer un meilleur suivi des mémoires de frais de justice. Toutefois la qualité du contrôle, selon l'administration elle-même, demeure variable selon les juridictions, où les moyens ne sont pas toujours suffisants.
C'est pourquoi il convient d'approuver la mise en place de services régionalisés où la certification des mémoires peut s'organiser de manière plus efficace, avec le double objectif de mieux contrôler les montants demandés, ainsi que les pièces justificatives, et d'assurer une mise en paiement plus rapide.
L'efficacité de la procédure dépend toutefois de la capacité du personnel à traiter un grand nombre de mémoires, ainsi que de la disponibilité des crédits. Or, en pratique, les prestataires, notamment les experts, font face à des retards de paiement de la part de l'État qui sont difficiles à justifier.
B. LE RETARD DU PAIEMENT DES PRESTATIONS DES EXPERTS N'EST PAS ACCEPTABLE
Dans la pratique judiciaire actuelle, les experts interviennent dans un très grand nombre de domaines.
Un décret du 23 décembre 200464(*) fixe les conditions générales d'inscription d'un expert, par discipline et par spécialité, soit sur une liste nationale, soit sur une liste par cour d'appel. Refondue en 2023, la nomenclature des experts ne compte pas moins de 9 branches, 103 rubriques et 590 spécialités65(*).
Les spécialités des experts de justice
A - Agriculture, agro-alimentaire, animaux, forêts (32 spécialités)
B - Arts, culture, communication, médias (39 spécialités)
C - Bâtiment, travaux publics, gestion immobilière (95 spécialités)
D - Économie, finances, calculs préjudiciels (21 spécialités)
E - Industrie (67 spécialités)
F - Santé (85 spécialités)
G - Criminalistique, sciences criminelles, médico-légales (42 spécialités)
H - Interprétariat, traduction (193 spécialités)
I - Environnement (29 spécialités)
Source : commission des finances, à partir de l'arrêté du 5 décembre 2022
Le rapporteur spécial, au cours de ses auditions avec les experts mais aussi avec les magistrats, a été saisi du problème que représente le paiement des experts avec des retards atteignant souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. L'État est débiteur de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros auprès de certains experts qui se retrouvent alors en difficulté financière. Le syndicat professionnel des traducteurs a ainsi alerté en mars 2025 sur les disparités dans les délais de paiement selon les juridictions66(*).
Le caractère limitatif des frais de justice alloués en début d'exercice ne permet en effet plus de payer au-delà d'une certaine date. Les experts sont alors payés au début de l'année suivante, pour autant que leur mémoire de frais ait été traité.
Le risque posé par cette situation est une désaffection des experts pour les prestations demandées par l'autorité judiciaire. Les représentants du Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ) ont souligné ce risque. La qualité d'expert judiciaire auprès de la cour d'appel représente certes, pour de nombreux experts, une preuve de compétence qu'ils peuvent faire valoir auprès de leurs clients privés, mais les jeunes générations seraient moins prêtes à accepter les conditions particulières qu'impose l'État.
Les magistrats constatent par exemple une difficulté croissante à trouver des experts psychiatres ou psychologues, alors même que l'intervention de ceux-ci est requise par la loi et donc indispensable à la poursuite de la procédure.
C. UNE BUDGÉTISATION INITIALE RÉALISTE DOIT PERMETTRE DE RÉSORBER PROGRESSIVEMENT LA DETTE ÉCONOMIQUE, LA DÉPENSE ÉTANT DE TOUTE MANIÈRE INÉLUCTABLE
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice en loi de finances initiale, ainsi que dans l'enveloppe mise à disposition des chefs de cour en début d'exercice.
Comme vu précédemment, la dépense effective en frais de justice a été supérieure à la prévision au cours de dix des douze dernières années, avec un écart de 55,5 millions d'euros en 2023 et 41,7 millions d'euros en 2024, sans parvenir à résorber une dette économique s'établissant à 318,4 millions d'euros en 2024.
Or les frais de justice ne dépendent qu'assez peu, à court terme, des choix faits par l'administration et représentent une quasi-dépense de guichet, donc la sous-budgétisation ne peut en rien constituer un moyen de pression efficace sur les acteurs pour limiter la dépense.
Une budgétisation insuffisante ne constitue donc qu'un décalage dans le temps de la dépense, qui conduit à payer en début d'année les prestataires pour lesquels on n'avait plus de crédits l'année précédente.
En outre le surcroît de dépenses sur les frais de justice, lorsque des crédits nouveaux ne sont pas ouverts pour le programme en cours d'année, a pour conséquence nécessaire, comme le fait observer la Cour des comptes67(*), une réduction des dépenses sur d'autres postes, à savoir les investissements immobiliers ou informatiques dont la justice judiciaire a pourtant le plus grand besoin, même si ces postes présentent régulièrement des sous-consommations qui contribuent parfois au financement des frais de justice.
Enfin la sous-budgétisation caractérise une information insuffisante du Parlement, auquel est présenté un budget qui ne constitue qu'un panorama approximatif des dépenses qui seront effectivement réalisées.
Le rapporteur spécial considère donc qu'il est impératif de prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice, afin de ramener à zéro, dès l'exercice 2026, l'écart entre la prévision et l'exécution.
Recommandation : prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice, notamment pour des prestations d'expertise, afin de réduire les délais de paiement et les besoins d'ouvertures de crédit en cours d'année.
II. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE
Le rapporteur spécial propose plusieurs pistes sur lesquelles l'accent pourrait être mis, encore plus qu'aujourd'hui, afin de réduire les dépenses peu utiles. Les raisons pour lesquelles ces dépenses paraissent excessives sont diverses : manque d'information (véhicules saisis et oubliés), recours à des prestataires privés alors qu'une alternative publique existe (interceptions judiciaires), obligations légales pouvant être rediscutées (pour certaines expertises), insuffisante mise à profit des innovations technologiques (interprétariat et traduction).
A. RATIONALISER LES FRAIS DE GARDIENNAGE ET DE SCELLÉS
L'un des postes de dépense importants en frais de justice dans les juridictions est celui consacré aux scellés et à leur gardiennage, lorsqu'ils ne peuvent être conservés par la juridiction elle-même68(*). Si ces scellés sont de natures très diverses, le gardiennage des véhicules constitue sans doute le segment sur lequel une action décidée paraît la plus utile.
Le rapporteur spécial a constaté en effet, au cours de ses auditions, à quel point les dépenses de gardiennage de véhicules constituent une dépense inutile, renforcée par la durée de l'enquête et parfois même gonflée par les retards de facturation : il arrive que des juridictions ne se rappellent de l'existence d'un stock de véhicules gardiennés que lorsque le garage envoie une facture tardive - et d'autant plus élevée.
1. Les coûts sont en augmentation constante, quoique ralentie depuis quelques années
Les frais de gardiennage et de scellés représentent un montant de 47,1 millions d'euros en 2024, soit 6,6 % du montant total des frais de justice.
Le gardiennage des véhicules en représente la majeure partie, avec un montant de 39,5 millions d'euros selon les mémoires déposés en 2024, en hausse de 45 % par rapport à 2019. Selon le ministère de la justice, cette augmentation est notamment liée à la pratique des « rodéos urbains ».
Montant des mémoires de gardiennage déposés
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial
Des signaux encourageants permettent d'espérer un renversement de tendance, qui serait toutefois limité. La hausse a été de seulement 7 % depuis 2022 et le stock de véhicules « gardiennés » est de 29 589 au 31 décembre 2024, en diminution de 9 % par rapport à 2023.
Le ministère a indiqué au rapporteur spécial que l'objectif était de revenir, en 2025, au coût des mémoires de 2021. Une baisse de 19 % du flux net a été constatée entre le 1er trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025.
Les résultats sont toutefois variables selon les juridictions. Entre 2023 et 2024, le stock de véhicules en gardiennage a diminué de 28 % à Paris, de 25 % dans la région Sud-Ouest et de 20 % dans la région Sud, mais il a augmenté de 13 % dans le Grand-Nord et de 8 % dans le Sud-Est69(*). Ces écarts montrent qu'il reste des marges de progression.
Certaines juridictions disposent de stocks très importants, comme à Lyon (1 150 véhicules en 2024), Marseille (972 véhicules) et Créteil (949 véhicules). D'autres n'ont pratiquement aucun véhicule en gardiennage.
Une observation d'un rapport relatif à l'enquête des véhicules en gardiennage en 2024, transmis au rapporteur spécial, permet toutefois de relativiser ces données : « la mise en regard des stocks de véhicules et des coûts de gardiennage démontre soit une absence de maîtrise du rythme de facturation, soit une insuffisante fiabilisation des stocks ». De fait, le rapport entre le montant des mémoires en 2024 et le nombre des véhicules en stock est très variable selon les juridictions, dépassant 1 900 euros dans certaines d'entre elles et inférieur à 750 euros dans d'autres, ce qui peut s'expliquer soit par un niveau de stock incorrectement mesuré, soit par l'absence d'émission de facture par l'entreprise assurant le gardiennage.
Le gardiennage d'un véhicule peut résulter de plusieurs procédures, chacun étant doté d'un cadre juridique distinct.
La saisie judiciaire est réalisée au cours d'enquêtes judiciaires lorsque le véhicule peut servir d'élément de preuve, à l'initiative de l'officier de police judiciaire lors d'une enquête de flagrance (article 56 du code de procédure pénale), du procureur de la République lors d'une enquête préliminaire (article 76) ou du juge d'instruction en phase d'instruction (article 97).
L'immobilisation judiciaire résulte de la constatation de certaines infractions au code de la route.
Ces deux procédures, temporaires, interviennent avant le jugement, lequel peut prononcer la confiscation, entraînant alors la perte définitive du bien par son propriétaire. La confiscation du véhicule est notamment obligatoire à titre de peine complémentaire de diverses infractions au code de la route.
L'immobilisation judiciaire présente l'intérêt de permettre à l'État, en principe, de recouvrer les frais de gardiennage auprès du propriétaire, sauf si le véhicule est finalement confisqué.
En cas de saisie judiciaire, en revanche, les frais de gardiennage sont placés à la charge de l'État. Ce régime présente toutefois l'avantage de permettre de réduire le coût net pour les finances publiques et mettant en place des mesures de gestion rappelées par une circulaire du 22 juillet 2025.
En premier lieu, des biens dont la conservation n'est plus nécessaire pour les besoins de l'enquête peuvent être mis à disposition de certains services de l'État, en particulier des services de police et de gendarmerie70(*), à titre temporaire en attendant le jugement. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) fait le lien entre le magistrat chargé de la gestion du bien et les services qui pourraient en solliciter l'affectation.
Cette procédure est particulièrement adaptée pour les véhicules, dont la valeur diminue fortement en cas de gardiennage prolongé, au point que certains propriétaires ne viennent pas les récupérer après le jugement.
En second lieu, les biens saisis sont susceptibles de rapporter des recettes à l'État en faisant l'objet d'une mise en vente par l'Agrasc, selon une procédure qui sera décrite infra.
2. Les actions conduites par les juridictions nécessitent la mise en place d'outils de gestion performants
Face à l'enjeu que représente le coût du gardiennage, les juridictions, fortement sensibilisées, cherchent à rationaliser la gestion des véhicules.
Les procureurs assurent ainsi un suivi de plus en plus strict des véhicules saisis, ce qui constitue une charge de travail supplémentaire.
Plusieurs parquets ont signé des conventions avec des garages partenaires et diffusent des instructions aux services d'enquête afin de limiter les saisies et immobilisations judiciaires de véhicules, ainsi que de gagner en lisibilité et en traçabilité dans le suivi des véhicules en gardiennage. Ces conventions ne progressent toutefois que lentement : à la fin 2024, 329 fouriéristes, sur près de 3 000 ayant des véhicules en gardiennage, avaient signé une convention avec une cour d'appel71(*).
Certaines juridictions contractualisent également avec les collectivités locales afin de bénéficier d'espaces gratuits de stockage des véhicules.
Toutefois, les outils demeurent insuffisants.
Au lieu de s'appuyer sur un système de gestion partagé, les juridictions utilisent des outils variés, souvent des fichiers Excel mis au point au niveau de la cour d'appel. Il existe pourtant un système d'information sur les fourrières (SI fourrières), qui n'est pas utilisé par les magistrats selon ce qui a été indiqué au rapporteur spécial. Conçu par les services de police et de gendarmerie, cet outil permet notamment de gérer les mises en fourrières administratives prévues par la loi n? 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), d'une durée de sept jours : les immobilisations ou saisies judiciaires n'en font pas partie.
Le ministère de la justice a indiqué au rapporteur spécial qu'il est envisagé de l'étendre aux fourrières judiciaires, ce qui permettrait aux juridictions de connaître en temps réel les stocks et les flux de véhicules. Des adaptations seront cependant nécessaires.
De même, il serait souhaitable que ce logiciel soit interfacé avec le système « Cassiopée scellés », utilisé par le ministère de la justice pour la gestion des scellés, qui gère toutes les saisies pénales effectuées par une juridiction, en les associant à une affaire, un lieu de conservation et un gardien.
L'ergonomie de cet outil devrait toutefois être améliorée, selon les associations de magistrats. En outre il n'est pas en capacité de satisfaire les besoins de toutes les juridictions puisque, comme l'a expliqué la Cour des comptes dans une enquête commandée par la commission des finances en 2022 sur le plan de transformation numérique du ministère de la justice, un logiciel spécifique, METIS, a été développé pour le tribunal judiciaire de Paris en raison de la très forte quantité de scellés gérés par cette juridiction.
En outre, il ressort de l'enquête 2024 relative au gardiennage que la gestion des véhicules par les juridictions est d'autant plus difficile que les services de police ou de gendarmerie ne renseignent pas toujours de manière exhaustive les fiches d'information, de sorte qu'il n'est pas toujours possible de déterminer s'il s'agit d'une immobilisation ou d'une saisie72(*).
Par ailleurs, l'affectation du véhicule aux services de police peut causer des difficultés : le véhicule n'ayant pas changé de propriétaire, il arrive que celui-ci reçoive des amendes liées en réalité à ses nouveaux utilisateurs.
3. L'action doit combiner mesures de court terme et transformation de moyen terme des systèmes d'information
Le rapporteur spécial considère que la dépense de gardiennage est l'un des postes de frais de justice contre lesquels il faut conduire l'action la plus vigoureuse, car il s'agit d'une dépense sans aucune utilité pour les besoins de l'enquête, contrairement aux expertises et analyses, aux interceptions judiciaires ou à l'interprétariat-traduction.
L'exemple de la réduction des stocks, ces dernières années, dans certaines juridictions montre qu'une action résolue en ce sens est possible. Il paraît donc possible et nécessaire d'amplifier cette action sur l'ensemble du territoire afin de mieux connaître et de réduire sensiblement le stock de véhicules en gardiennage, soit par l'affectation des véhicules à des services de l'État, soit par la vente.
Cette action doit aller de pair avec l'adaptation du SI fourrières aux besoins des juridictions et son interfaçage avec les autres outils du ministère de la justice, en particulier Cassiopée scellés. À cette fin, une revue des outils développés dans les différentes juridictions est nécessaire afin de dégager les meilleures pratiques et les fonctionnalités attendues par les utilisateurs que sont les magistrats et les greffiers.
En outre, alors que la situation actuelle oppose une phase administrative des saisies gérée par la police et la gendarmerie nationales, et les immobilisations et saisies judiciaires qui sont sous la responsabilité de la justice, les deux ministères devraient considérer de manière commune l'enjeu de conservation des scellés, et tout particulièrement des véhicules. Une méthodologie partagée devrait permettre en particulier de réduire les saisies de biens qui représenteront un coût de stockage élevé pour une utilité faible au regard des besoins de l'enquête ou de la possibilité de valorisation.
Enfin, le conventionnement avec les garages doit être généralisé afin, notamment, de garantir l'envoi de facture à un rythme permettant d'éviter l' « oubli » de véhicules dont le gardiennage est ensuite facturé au prix fort.
Recommandation : rationaliser les frais de gardiennage de véhicules :
- à court terme, conduire une évaluation du stock de véhicules en gardiennage avec l'objectif de le réduire d'un tiers ;
- à moyen terme, mieux connaître et interconnecter les systèmes développés dans certains services, à commencer par le système d'information des fourrières, afin de mettre à disposition un outil de suivi de l'ensemble des véhicules ;
- définir une méthodologie partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice pour les saisies ;
- prévoir des conventions avec les garages incluant l'envoi d'une facture périodique.
B. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME NATIONALE DES INTERCEPTIONS JUDICIAIRES (PNIJ)
En 2024, le coût des interceptions judiciaires a été de 81,3 millions d'euros, soit 11,3 % du coût total des frais de justice (716 millions d'euros).
1. La dépense est plutôt en baisse, tout en étant variable d'une année à l'autre
Cette dépense évolue de manière variable selon les années, mais suit une tendance plutôt à la baisse, contrairement à la plupart des catégories de frais de justice.
Évolution de la dépense de frais de justice pour les interceptions judiciaires
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial
L'exécution de 81,0 millions d'euros en 2024 est toutefois très supérieure à celle prévue en début d'exercice par le document de programmation unique (DPU)73(*), qui était de 61,1 millions d'euros, soit + 32,6 %. Les interceptions judiciaires expliquent à elles seules près de la moitié de la sur-exécution totale des frais de justice (+ 41,2 millions d'euros en 2024).
Cet écart peut s'expliquer par le caractère relativement imprévisible des dépenses en interception judiciaire, qui dépend du nombre et de la nature des enquêtes conduites en cours d'année.
L'année 2024, à cet égard, a été marquée par une enquête lancée à la suite de l'évasion d'un narco-trafiquant ayant causé, le 14 mai, la mort de deux surveillants pénitentiaires lors de l'attaque d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville74(*). Cette enquête, d'une ampleur et d'une technicité exceptionnelles, a reposé, comme cela a été confirmé au rapporteur spécial, sur une utilisation très importante des données issues des interceptions judiciaires. Bien au-delà de la personne même du fugitif, qui a finalement été arrêté en Roumanie le 22 février 2025, l'enquête a permis de mettre à jour de nombreuses ramifications dans les réseaux de la criminalité organisée75(*).
L'évolution des dépenses peut aussi s'expliquer par des circonstances conjoncturelles : le « creux » constaté en 2022 semble lié aux incertitudes rencontrées cette année-là sur le régime d'accès aux données de connexion, qui pourrait représenter un risque dans les années à venir pour la conduite des enquêtes.
2. Les données de connexion sont désormais indispensables pour les enquêtes, mais leur régime juridique est soumis à des incertitudes
Comme indiqué supra, les données issues des interceptions judiciaires (données de connexion, géolocalisation...) constituent aujourd'hui des éléments essentiels dans de nombreuses enquêtes.
Elles reposent toutefois sur un régime juridique soumis à certains risques.
Le régime de conservation des données par les opérateurs de communications électroniques (OPE), qui prévoyait auparavant une obligation très large de conservation des données, a été modifié par l'article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement afin de conformer ce régime au droit européen. Les opérateurs sont tenus de conserver76(*) :
- les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
- les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ;
- les informations relatives au paiement et les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Il s'agit de l'adresse IP attribuée à la source de la connexion et du port associé, du numéro d'identifiant de l'utilisateur, du numéro d'identification du terminal et enfin du numéro de téléphone à l'origine de la communication.
En outre, dans des cas particuliers, c'est-à-dire « pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière », le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, des données supplémentaires de trafic et de localisation : les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; les données techniques mentionnées supra, permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ; enfin, pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.
En pratique, le régime particulier est appliqué en permanence depuis 2021, les Premiers ministres successifs ayant pris des décrets d'injonction chaque année depuis la promulgation de la loi de 202177(*).
Nos collègues Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère, rapporteurs, en 2023, d'une mission d'information de la commission des lois sur l'usage des données de connexion dans les enquêtes pénales78(*), ont constaté que ces modifications ont permis de préserver, pour l'essentiel, la possibilité pour les enquêteurs d'accéder aux données, mais que ce régime n'apparaît pas pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, depuis 2014, a limité la conservation des données de trafic et de localisation par les États, ainsi que l'accès à ces données par les enquêteurs.
En particulier, un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 202279(*), tirant les conséquences de la jurisprudence européenne, a jugé que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'accès aux données de connexion par un officier de police judiciaire (lors d'une enquête en flagrant délit) ou sur autorisation du procureur de la République (lors d'une enquête préliminaire)80(*) sont contraires au droit de l'Union en ce qu'ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Ce contrôle peut être réalisé par le juge d'instruction, considéré comme indépendant, mais pas par le procureur81(*).
Cet arrêt a semblé remettre en cause une grande partie des accès aux données de connexion réalisés dans les enquêtes pénales. Toutefois il prévoit que cette non-conformité ne sera sanctionnée que si la juridiction constate que l'irrégularité a occasionné un grief au requérant, lequel doit démontrer la réalité d'une ingérence dans sa vie privée et d'une atteinte à la protection de ses données à caractère personnel non justifiées par les besoins de l'enquête.
Les conséquences de cet arrêt ont été plusieurs fois évoquées par les personnes auditionnées par le rapporteur spécial.
Dès le 13 juillet 2022, le ministère a constaté une chute du nombre de demandes de données de connexion, les juridictions se retrouvant dans une certaine confusion. En pratique, toutefois, aucune procédure n'a été annulée pour ce motif, conduisant le nombre des demandes a retrouver progressivement son niveau antérieur, mais le sentiment d'insécurité juridique est grand chez les procureurs comme chez les enquêteurs.
Ne sont pas concernées, en revanche, les interceptions judiciaires autorisées par les juges d'instruction, qui présentent les garanties d'indépendance requises.
Or, la mise en place d'un contrôle systématique et préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante représenterait un changement de pratique considérable. Compte tenu du nombre des interceptions judiciaires pratiquées chaque année, il s'agirait d'un chantier extrêmement complexe et coûteux, pouvant causer des retards importants dans le déroulement des enquêtes.
D'ores et déjà, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a indiqué au rapporteur spécial que cette jurisprudence a poussé les parquets à renforcer le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des réquisitions aux fins d'accès aux données de connexion en temps différé. Les officiers de police judiciaire doivent désormais consacrer plus de temps non seulement pour demander l'autorisation, mais aussi pour motiver leurs demandes, puis pour attendre la réponse. Les pratiques semblent différer selon les juridictions : alors que certains procureurs donnent l'autorisation pour chaque interception séparément, d'autres l'accordent pour l'ensemble de l'enquête.
Le régime juridique des interceptions judiciaires pourrait donc être amené à évoluer encore au cours des années à venir.
Il paraît toutefois impensable que ces difficultés remettent en cause de manière générale le recours aux interceptions judiciaires, dont le volume continuera à nécessiter une attention forte au regard du coût qu'elles représentent pour les finances publiques.
C'est pourquoi l'outil original que représente la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) conservera son utilité et son développement devra être poursuivi.
3. La création de la PNIJ a permis de réaliser des économies très importantes
Les interceptions judiciaires constituent l'un des rares domaines, parmi les frais de justice, où les magistrats et les enquêteurs peuvent s'adresser à un prestataire public, fourni par un service de l'État, avec un coût très inférieur aux prestataires privés.
En pratique, les interceptions judiciaires relevant de la catégorie des frais de justice correspondent à plusieurs catégories de prestations :
- les réquisitions de données : l'enquêteur demande par exemple le détail des appels entrants et sortants sur une ligne ou l'identification de l'utilisateur à partir de son numéro d'appel ;
- les interceptions proprement dites, comme l'enregistrement vocal d'un appel entre deux appareils ;
- les géolocalisations : il s'agit de connaître, en temps réel, la position géographique d'un téléphone mobile.
Une fois les données obtenues, il est nécessaire de les traiter, ce qui représente un coût supplémentaire lorsqu'il est fait appel à des prestataires privés.
Afin de réduire les coûts, mais de faciliter l'accès aux réquisitions qui, auparavant, pouvaient entraîner des délais de plusieurs jours82(*), la création d'une plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été décidée dès 2005.
La genèse du projet a toutefois été difficile, le marché de conception et réalisation n'étant notifié au titulaire qu'en 2010. En février 2016, la Cour des comptes notait le retard considérable pris par le programme, alors que les interceptions judiciaires avaient représenté en 2015 un coût de 110,27 millions d'euros au titre des frais de justice, contre 89,78 millions d'euros en 2005. Selon ses calculs, chaque année de retard empêchait l'État de réaliser 65 millions d'euros d'économies brutes83(*).
La PNIJ a finalement été mise en oeuvre en 2016 et inscrite dans le code de procédure pénale84(*).
L'année suivante a été créé un service à compétence nationale, l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ)85(*), chargée de la mise en oeuvre de la PNIJ. Elle est également compétente, de manière plus générale, pour l'ensemble des techniques d'enquête numérique au sujet desquelles elle apporte aux enquêteurs son expertise technique.
Dès son inscription dans le code de procédure pénale, le recours à la PNIJ a été rendu obligatoire, « sauf impossibilité technique ». Cette obligation a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2024, indiquant que le recours à un prestataire hors PNIJ pourrait être un motif d'annulation de la procédure si la PNIJ présente la capacité technique de fournir la prestation86(*).
En 2024, la PNIJ a servi plus de 3,5 millions de prestations, en hausse de 10,9 % sur un an. Ses utilisateurs sont la gendarmerie nationale (34 203 utilisateurs uniques, la police nationale (26 638), la justice (969) et les douanes (270). Le volume de données interceptées est également considérable : 31 millions d'appels voix, presque autant de SMS, 500 000 MMS et près de 500 tébioctets87(*) de data.
Les fonctionnalités de la PNIJ ont progressé au cours des années et couvrent aujourd'hui la quasi-totalité des besoins des enquêteurs, comme le rapporteur spécial a pu le constater lors d'une visite dans les locaux de l'ANTENJ en septembre 2025.
La fonctionnalité de géolocalisation, qui était l'un des principales fonctionnalités manquantes aux débuts de la PNIJ, a été introduite en 2023 et a très rapidement pris les parts de marché détenues auparavant par un prestataire privé, de sorte que, depuis la mi-2025, environ 90 % des demandes de géolocalisation passent aujourd'hui par la PNIJ.
Les économies permises par la PNIJ sont considérables et évaluées, selon les estimations communiquées au rapporteur spécial, à 572 millions d'euros entre 2015 et 2024, pour un coût de développement de 329 millions d'euros, soit une économie nette de près de 200 millions d'euros entre 2010 et 2024.
Les économies portent sur la centralisation et l'automatisation des réponses, qui a permis de réduire les tarifs des réquisitions adressées aux opérateurs, mais aussi sur le remplacement des prestataires privés qui louaient des centrales d'écoute et de géolocalisation dans les postes de police.
Ces économies sont appelées à s'amplifier en 2025 grâce au basculement sur la PNIJ des demandes de géolocalisation, ainsi qu'avec les économies supplémentaires que l'automatisation des réquisitions envoyées aux opérateurs devrait permettre dans les années à venir.
Certains gains ne sont d'ailleurs pas chiffrables : l'automatisation réduit de manière considérable le temps passé par l'enquêteur. La PNIJ, accessible depuis le poste du magistrat, permet aussi de diffuser le contenu d'une écoute lors d'une audience.
Malgré ces résultats indéniablement positifs, le rapporteur spécial comprend bien les critiques provenant de ses utilisateurs et est conscient du chemin qui reste à parcourir.
4. L'outil connaît toutefois encore des limitations concernant ses fonctionnalités comme son ergonomie, avec le risque d'une course entre prestataire public et prestataires privés
La première limitation de la PNIJ est géographique : elle n'est pas connectée à certains opérateurs de petite taille et n'est pas accessible dans tous les territoires d'outre-mer, en particulier dans le Pacifique.
Sur le territoire métropolitain même, son utilisation continue à susciter des réticences certaines.
La notion d'« impossibilité technique », qui rend obligatoire le recours à la PNIJ, n'a pas été clarifiée par la Cour de cassation. Certains enquêteurs souhaiteraient qu'elle inclue des éléments relatifs à l'ergonomie, celle de la PNIJ étant jugée moins fluide ou efficace que des outils fournis par des prestataires privés.
Le ministère de la justice rappelle pour sa part que « le recours à la PNIJ doit désormais constituer le mode quasi exclusif pour les magistrats et services d'enquête pour répondre aux besoins de géolocalisation et interception »88(*). Des tableaux de bord d'activité et des états reçus des prestataires hors PNIJ sont communiqués aux juridictions afin de les inciter à veiller à la limitation « très stricte » du recours aux opérateurs non publics.
Les pressions du ministère ne sont d'ailleurs pas toujours appréciées des magistrats instructeurs, qui critiquent la diffusion de coûts d'interceptions téléphoniques par juge d'instruction89(*), et se considèrent en capacité de déterminer dans quels cas la loi leur permet de faire appel à des prestataires hors PNIJ.
Le rapporteur spécial a également été saisi de la nécessité d'améliorer certains points d'ergonomie.
Les enquêteurs ont besoin de fonctionnalités spécifiques, qui sont parfois proposées par des outils réalisés par des prestataires privés avant d'être intégrées à la PNIJ. Les représentants des magistrats instructeurs ont, eux aussi, fait part au rapporteur spécial du caractère, selon eux, peu intuitif de la plateforme. Leur réticence vient aussi du souci de ne pas se voir transférer des tâches qui, aujourd'hui, relèvent des enquêteurs.
Il a par ailleurs été suggéré au rapporteur spécial que des économies pourraient être faites si la PNIJ utilisait la localisation des bornes de téléphone mobile de la part de l'Agence nationale des fréquences (ANfr), au lieu de les demander aux opérateurs moyennant facturation. L'ANTENJ lui a toutefois expliqué, lors de sa visite, que les informations fournies par les opérateurs étaient beaucoup plus précises et, au-delà des coordonnées géographiques de l'antenne, incluaient par exemple la puissance de l'émetteur à un moment donné, nécessaire pour affiner la géolocalisation de l'appareil faisant l'objet de l'enquête.
Le défi de l'ANTENJ est que cette agence est placée dans une situation de concurrence avec les prestataires privés qui développent des fonctionnalités appréciées des enquêteurs. L'agence prend donc le risque, vis-à-vis de ses utilisateurs, d'un retard technologique.
D'une manière générale, le processus de développement de la PNIJ rejoint celui de nombreux outils informatiques du ministère de la justice et doit faire l'objet du constat que faisait le rapporteur spécial en janvier 2022, lors de la remise de l'enquête précitée de la Cour des comptes sur le plan de transformation numérique de la justice : les utilisateurs, qui sont ici les magistrats et les enquêteurs, n'ont pas été suffisamment associés au développement et au pilotage du logiciel90(*).
L'ANTENJ dispose toutefois d'atouts importants, à commencer par la volonté affirmée par les gouvernements successifs de poursuivre le développement de la plateforme. Placée dans une situation de concurrence, elle doit y répondre en mettant à profit sa grande proximité vis-à-vis des utilisateurs qui, comme elle, appartiennent à l'État.
S'agissant des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales, il serait nécessaire que soient remontées à l'agence les demandes prioritaires des enquêteurs et les raisons pour lesquelles certains font appel à des prestataires extérieurs. Les référents « frais de justice » dont la systématisation est proposée par le rapporteur spécial joueraient un rôle clé à cet égard.
Les échanges doivent également aller dans les deux sens. L'ANTENJ dispose en effet d'une expertise sur les enquêtes numériques qui, selon ce qui a été indiqué au rapporteur spécial lors de sa visite, reste insuffisamment connue des enquêteurs qui pourraient en bénéficier pour leurs enquêtes.
Enfin, un officier de liaison, installé dans les locaux de l'ANTENJ, assure d'ores et déjà une communication permanente avec la gendarmerie nationale, contribuant à la transmission d'informations et contribuant même à la résolution des enquêtes. Le recrutement d'un officier de liaison pour le compte de la police nationale, pourtant prévu par le plan de maîtrise des frais de justice pour l'année 2024, n'avait toujours pas été réalisé à la mi-2025 ; le rapporteur spécial se réjouit d'avoir appris, lors de sa visite dans les locaux de l'agence, que ce poste allait être prochainement pourvu.
Par ailleurs, l'hébergement des données est actuellement assuré par la société Thalès, ce qui était justifié au démarrage par l'absence d'infrastructures techniques suffisamment dimensionnées dans les ministères de l'intérieur et de la justice.
Il a certes été indiqué au rapporteur spécial que les personnels de cette société n'ont pas accès aux données elles-mêmes sans la présence d'un agent de l'ANTENJ. Pour autant, la sensibilité des informations contenues dans la PNIJ devrait amener à réexaminer le choix d'un prestataire privé, en s'appuyant le cas échéant sur les infrastructures techniques des ministères de l'intérieur ou des armées. Il a été indiqué que des travaux sont prévus afin d'internaliser l'hébergement, ce qui impliquerait une augmentation sensible de personnel.
5. En contrepartie de l'effort important assuré par l'État, inciter très fortement au recours à la PNIJ
Le rapporteur spécial est conscient de la nécessité de laisser aux enquêteurs et aux magistrats les moyens de conduire les enquêtes de la manière la plus efficace possible.
La forte croissance de l'usage de la plateforme et les efforts entrepris pour compléter les fonctionnalités et l'ergonomie doivent toutefois conduire à considérer que la PNIJ constitue d'ores et déjà un outil satisfaisant pour de nombreux cas d'utilisation, et que l'enjeu financier mérite d'être pris en considération.
Il apparaît par exemple, selon les éléments communiqués au rapporteur spécial, que le surcoût de l'utilisation de solutions privées pour la mise en oeuvre de mesures d'interception et de géolocalisation est sans commune mesure avec le coût d'un passage par la PNIJ. À titre d'exemple, le recours à la PNIJ implique seulement l'envoi d'une réquisition à l'opérateur de communication électronique, facturé 16 euros hors taxes, alors que, en passant par une solution privée, il faut payer en plus un coût journalier du même ordre que le coût de la réquisition. Le surcoût est considérable en cas de mesure d'interception ou de géolocalisation qui dure plusieurs semaines.
Il paraît donc raisonnable, en échange des efforts importants consentis par l'État, de prévoir l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à un prestataire autre que la PNIJ pour les interceptions judiciaires, ce qui accroîtrait également la sécurité juridique de ces procédures.
Recommandation : poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) :
- en lien avec les magistrats et les officiers de police judiciaire utilisateurs, poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la PNIJ afin de favoriser la prise en main et réduire le recours à des prestataires externes ;
- en échange de l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités, généraliser l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à des prestations hors PNIJ.
C. RÉEXAMINER LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CERTAINES EXPERTISES
Les juges disposent de la liberté de prescrire les actes d'enquête qui leur semblent nécessaires à la manifestation de la vérité, à laquelle ils sont légitimement attachés.
L'obligation légale de passer par la PNIJ pour réaliser des mesures d'interception judiciaire est l'un des rares cas dans lesquels la loi leur donne une obligation, mais il s'agit de limiter le choix des prestataires et non de leur interdire de prescrire des mesures.
En sens inverse, toutefois, la loi leur fait fréquemment obligation de prescrire, dans le cadre d'une procédure pénale ou civile, des mesures qui tendent à la manifestation de la vérité et, ce faisant, génèrent des frais de justice.
Exemples d'actes d'enquête obligatoires en
application
du code de procédure pénale
- Une expertise médicale est obligatoire en cas de soumission à une injonction de soins (acte 706-47-1, pour des infractions de nature sexuelle) ou pour prononcer une suspension de peine pour un condamné atteint d'une pathologie grave (article 720-1-1).
- Une expertise psychiatrique est réalisée obligatoirement pour accorder une réduction de peine ou une autorisation de sortie à une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire (article 712-21). Une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est nécessaire pour accorder la libération conditionnelle (article 730-2). Une évaluation de la responsabilité pénale est obligatoire pour tout jugement au fond d'un majeur protégé91(*) (article 706-115).
- Une enquête sociale rapide (ESR), prévue par les articles 41 et 81, est obligatoire notamment en cas de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
- L'assistance d'un interprète est obligatoire à tous les stades d'une procédure pénale pour des personnes ne maîtrisant pas la langue française. En outre, certaines pièces rédigées en langue étrangère doivent obligatoire être traduites (divers articles du code).
Source : commission des finances, à partir des éléments communiqués au rapporteur spécial
Des mesures permettant de mieux connaître les parties au procès, comme les enquêtes sociales rapides et les expertises psychiatriques et psychologiques, sont certes nécessaires afin de permettre au juge de prendre la décision la plus éclairée.
Sur le plan financier, elles peuvent même contribuer à la réduction d'autres postes de dépense du ministère de la justice lorsqu'elles conduisent à décider du recours aux alternatives à l'incarcération et aux aménagements de peine.
Toutefois, comme l'ont souligné plusieurs personnes entendues par le rapporteur spécial, l'obligation systématique prévue par la loi n'est pas toujours pertinente. Pour certains délits mineurs, comme dans l'exemple du vol d'une bouteille d'alcool par une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'expertise médicale obligatoire tendant à évaluer sa responsabilité pénale peut représenter un coût disproportionné par rapport à l'enjeu du délit.
À l'inverse, il arrive que des expertises psychologiques plus approfondies soient nécessaires, rendant inutile la première expertise imposée par la loi : selon ce qui a été indiqué au rapporteur spécial, cela arrive pour des expertises psychiatriques en garde à vue, dont la qualité est inégale et pour lesquelles il est d'ailleurs difficile de trouver des spécialistes.
Les délais de l'enquête sont ainsi rallongés pour des mesures dont l'utilité n'est pas toujours démontrée.
On ne peut également éviter de mentionner l'enjeu financier, le tarif d'une expertise psychiatrique réalisée par un expert ne relevant pas du statut COSP ayant, comme on l'a vu supra, augmenté de 28,7 % depuis 2021. De même, le coût des enquêtes sociales rapides a été revalorisé en 2021, conduisant à une hausse de 63 % de la dépense entre 2021 et 2022.
Le plan de maîtrise des frais de justice prévoit deux mesures concernant les expertises psychiatriques : poursuivre l'étude d'une éventuelle refonte des grilles des expertises et poursuivre l'étude d'une éventuelle suppression du caractère obligatoire du recours à une expertise psychiatrique pour les délits prévus à l'article 706-47 du code de procédure pénale, lequel concerne la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes.
Ces deux mesures, souvent évoquées au cours des auditions, devraient être mises en oeuvre en cherchant à adapter les prestations aux besoins et à rendre au juge son pouvoir d'appréciation des mesures à prendre, qui ne peut s'apprécier qu'au regard des circonstances de l'affaire et non de manière générale par la loi.
Recommandation : adapter les expertises aux besoins de l'enquête.
En particulier :
- étudier une gradation des tarifications des expertises psychologiques et psychiatriques en fonction de la complexité de l'analyse demandée ;
- envisager de laisser aux magistrats l'appréciation de la nécessité de l'expertise psychologique ou psychiatrique, ainsi que de l'enquête sociale rapide, dans les cas où ces mesures sont actuellement prévues de manière automatique par le code de procédure pénale.
D. METTRE À PROFIT L'ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER LES FRAIS D'INTERPRÉTARIAT ET DE TRADUCTION
C'est aussi l'un de ceux qui a le plus progressé ces dernières années, avec un quasi-doublement de la dépense depuis 2019.
Évolution de la dépense en frais de justice sur le poste interprétariat-traduction
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur spécial
Selon les explications données au rapporteur spécial, cette augmentation est à relier au renforcement constant des droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes.
Sur ce poste, les magistrats n'ont guère de marge de manoeuvre sur le volume de prestations, l'assistance d'un interprète et la traduction des pièces en langue étrangère étant imposée par la loi, et nécessaire en tout état de cause pour le bon déroulement de l'enquête et du procès.
Toutefois le contrôle semble être à améliorer concernant les mémoires déposés : le bilan du plan de maîtrise des frais de justice en 2024 indique ainsi qu'une note a été diffusée début 2024 afin de mieux contrôler la réalité de la mission et les horaires effectués de nuit.
Deux autres types de mesures, également évoquées dans le plan de maîtrise des frais de justice en 2025, devraient toutefois être explorées afin de contenir cette dépense.
1. Le recours à des contractuels pourrait réduire les coûts
La constance du besoin à des interprètes ou des traducteurs pour les langues les plus répandues peut, dans certaines juridictions où l'activité est particulièrement importante, justifier le recours à l'embauche de contractuels.
Outre les aspects financiers, on peut s'attendre à ce qu'un interprète ou un traducteur travaillant à temps plein pour la justice, et dont la compétence a été soigneusement vérifiée lors de l'embauche, produise une prestation de meilleure qualité que celui qui se consacre à d'autres domaines d'activité. En outre, la contractualisation réduirait la charge des greffes pour la recherche d'interprètes et le traitement de leurs mémoires.
Des expérimentations ont été conduites en ce sens, de manière puisque 55 interprètes-traducteurs contractuels ont été embauchés selon les éléments apportés par le ministère au rapporteur spécial.
2. Explorer la piste de l'utilisation de l'intelligence artificielle
La spectaculaire amélioration, depuis une dizaine d'années, des outils de traduction automatisée, y compris pour une utilisation d'interprétation en temps presque réel, conduit nécessairement à envisager le recours à ces solutions, fondées sur l'intelligence artificielle, pour les besoins de la justice.
Les expérimentations sont nombreuses. Selon un rapport de la Cour de cassation92(*), en Chine, la cour primaire de la région de Hunchun, à la frontière de la Corée du Nord et de la Russie, a mis en place le modèle I-Court, qui permet la transcription et la traduction en temps réel des interventions des parties ainsi que des documents soumis par les avocats. De même en Inde, le système SUVAS (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) traduit automatiquement les documents judiciaires entre l'anglais et les langues locales.
En France, le droit actuel ne laisse certes qu'une place limitée, voire nulle, à des solutions automatisées.
Le code de procédure pénale prévoit que, dans tous les cas où un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci doit être choisi sur une liste nationale ou locale d'experts judiciaires, ou à défaut sur la liste des interprètes et traducteurs prévue pour les procédures relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne majeure n'ayant pas la qualité d'expert pouvant toutefois être désignée en cas de nécessité.
Le droit européen semble, lui aussi, imposer le recours à des interprètes humains93(*).
La mise en place d'outils de transcription automatique des échanges lors des auditions ou audiences présenterait sans doute moins de difficulté juridique, et pourrait alléger ou compléter le travail effectué par les greffes94(*), mais ce poste de dépense n'entre pas dans la catégorie des frais de justice.
L'opportunité apportée par les nouvelles technologies justifie de mettre l'accent sur leur exploration afin de déterminer les cas d'usage et préparer, le cas échéant, une évolution de la législation sur le sujet.
Sur cette question, une collaboration interministérielle s'impose, par exemple avec la police et la gendarmerie nationales qui expérimentent des outils de transcription et de traduction automatisées, tels que le logiciel PAROLE pour la police. La délégation interministérielle au numérique (Dinum) devrait également être pleinement associée à ces travaux. Enfin, au sein même du ministère de la justice, l'administration pénitentiaire pourrait tirer elle aussi parti de solutions sécurisées d'interprétariat instantané pour les échanges avec des détenus maîtrisant mal la langue française95(*).
Recommandation : moderniser la gestion des prestations d'interprétariat et de traduction :
- augmenter le nombre d'interprètes-traducteurs contractuels pour certaines langues, après évaluation coût/bénéfice en fonction du volume de prestations nécessaire dans une juridiction donnée ;
- en lien avec la direction interministérielle du numérique (Dinum) et les autres directions des ministères de la justice et de l'intérieur, expérimenter le recours à l'intelligence artificielle afin de déterminer dans quels cas l'intervention d'un interprète-traducteur assermenté pourrait être rendue facultative, sous le contrôle du magistrat.
III. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS
La justice a un coût, mais elle apporte également des ressources à l'État ou lui permet de réaliser des économies.
En premier lieu, une enquête qui réussit, ce qui implique souvent le déboursement pour l'État de frais de justice, rapporte ensuite, non seulement par le paiement d'amendes mais aussi, et surtout, à terme, par la réduction de la criminalité : un tel retour, qui constitue un objectif fondamental du système de la justice, est impossible à chiffrer mais doit être pris en compte dans tout discours sur le « prix » de la justice.
S'agissant des retours plus strictement financiers, sans revenir aux années 1880 où, comme indiqué supra, le produit des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe couvrait environ 80 % du total des dépenses judiciaires, il est possible de chercher à développer les recettes pouvant être apportées en compensation des frais de justice engagés par l'État.
Deux pistes doivent à cet égard être poursuivies : d'une part la vente de biens saisis et confisqués, d'autre part une meilleure participation des parties au paiement des frais de justice.
A. CONTINUER À DÉVELOPPER LA VENTE ET L'AFFECTATION DE BIENS SAISIS OU CONFISQUÉS
Alors que les biens saisis ou confisqués étaient, traditionnellement, considérés uniquement comme des pièces à conviction dans une procédure, ils font aujourd'hui également l'objet d'une perspective patrimoniale.
1. Les biens saisis sont désormais considérés comme des biens valorisables
La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a créé à cette fin acteur bien identifié qui est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)96(*), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la justice et du ministère chargé des comptes publics, afin d'améliorer la saisie, la gestion puis la confiscation et la vente des avoirs criminels. Elle participe à la lutte contre l'économie souterraine afin que « le crime ne paie pas » : comme le faisait remarquer le rapporteur spécial lors d'un précédent rapport de contrôle budgétaire consacré à l'Agrasc97(*), les confiscations sont, dans bien des cas, plus efficaces que les peines de prison.
L'Agrasc gère des biens saisis et confisqués sur l'ensemble du territoire national, procède à leur vente le cas échéant et veille à l'indemnisation prioritaire des parties civiles sur les biens confisqués à la personne condamnée.
Elle procède ainsi à des ventes aux enchères au cours desquelles elle vend les biens qui lui sont remis, parmi lesquels on trouve des maisons, appartements ou immeubles, des véhicules de toute nature, des lingots d'or, meubles, de la vaisselle, des bijoux, de la maroquinerie98(*)... La vente d'un yacht de luxe a, à elle seule, rapporté 10 millions d'euros le 27 mars dernier, soit le montant le plus élevé de l'histoire de l'Agrasc pour un bien non immobilier99(*).
Sur l'année 2024, le produit total des ventes a été de 17,1 millions d'euros ; ce montant est d'ores et déjà dépassé en 2025.
L'Agrasc est également chargée d'affecter à des services de l'État des biens dont la gestion lui est confiée. En 2024, 3 825 biens ont été affectés aux services enquêteurs et judiciaires.
Deux immeubles confisqués ont même été affectés à des associations hébergeant des personnes en état de précarité. L'affectation sociale de biens immobiliers devrait également être ouverte à des collectivités territoriales, en application d'une disposition introduite par le Sénat dans la loi « Rénovation de l'habitat dégradé » du 9 avril 2024100(*). Comme le fait toutefois observer l'Agrasc dans son rapport d'activité 2024101(*), l'application de cette disposition pourrait être limitée par l'absence de mention des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les affectations sont susceptibles d'appel, ce qui peut accroître les coûts de gardiennage en raison du délai nécessaire pour les procédures : près de 1 million d'euros ont ainsi été dépensés pour le gardiennage du yacht de luxe précité.
2. Le produit des ventes revient principalement au budget général de l'État
Avant le jugement, les ventes font l'objet d'un monopole de la part de l'Agrasc, en application de deux dispositions du code de procédure pénale102(*) par lesquelles le procureur de la République ou le juge d'instruction peut remettre à l'Agrasc, en vue de leur vente, des biens dont la confiscation est prévue par la loi et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Une décision du Conseil constitutionnel a très récemment confirmé la conformité à la Constitution de cette procédure103(*).
Bien que cette mesure survienne avant le jugement, elle ne nuit pas aux intérêts de la personne prévenue dans le cas où elle est finalement innocentée : en effet, son application est limitée aux cas où le maintien en saisie diminue la valeur du bien ou représente un coût de gardiennage excessif, et le produit de la vente est consigné pour être remis au propriétaire après le jugement, s'il n'est pas condamné ou que la confiscation du bien n'est finalement pas ordonnée.
Après le jugement, la vente des biens meubles corporels pour lesquels une décision de confiscation a été prise relève en principe de la compétence du Domaine, mais l'Agrasc peut également être saisie à la demande du procureur de la République104(*).
Le produit total des confiscations a été de 255,1 millions d'euros en 2024, dont 160,2 revenant au budget général de l'État. Le reliquat a les usages suivants :
- 31,0 millions d'euros ont été versés au titre des « biens mal acquis » (BMA)105(*) ;
- 2,0 millions d'euros ont été versés au fonds de lutte contre la prostitution ;
- 50,9 millions d'euros sont revenus à la mission interministérielle de lutte contre les addictions (MILDECA), qui reçoit le produit des décisions de confiscations prononcées dans des dossiers concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Versements réalisés par l'AGRASC de 2022 à 2024
(en millions d'euros)
Dans le même temps, l'Agrasc gère un dispositif qui permet d'intéresser les acteurs de la chaîne pénale à développer les saisies et les confiscations, à travers des fonds de concours.
Sur le montant de 160,1 millions d'euros revenant au budget général de l'État, 9,9 millions d'euros sont affectés à l'Agrasc. Ce montant est fixé en loi de finances. L'Agrasc reçoit également une subvention pour charges de service public versée par le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice », à hauteur de 11,2 millions d'euros en 2024.
Ces ressources sont utilisées partiellement pour alimenter plusieurs fonds de concours des ministères. Les sommes sont attribuées à des projets préalablement sélectionnés par la justice, la gendarmerie nationale, la police nationale et les douanes106(*). La direction générale de la cohésion sociale lance également un appel à projets pour l'utilisation du fonds de concours qui lui revient.
Les fonds de concours alimentés par l'Agrasc en 2024
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir du rapport d'activité de l'Agrasc en 2024
Ces dispositifs ne sont toutefois qu'indirectement liés au produit des ventes et ne bénéficient pas réellement de sa dynamique, car aussi bien la subvention de charge pour service public que la fraction du produit des ventes affectés à l'agence sont fixés en loi de finances et ne dépendent donc pas réellement du niveau des ventes. Ces ressources peuvent d'ailleurs être soumises aux mesures de régulation budgétaire en cours d'année (mise en réserve initiale ou surgels, voire annulations de crédits).
En conséquence, si « le crime ne paie pas » les criminels grâce à l'action de l'Agrasc, on ne saurait dire pour autant que « la lutte contre le crime paie » les services du ministère de la justice et l'intérieur : c'est au budget général de l'État que reviennent les sommes qui, le cas échéant, excèdent les prévisions faites en début d'année.
3. L'action de l'agence doit être poursuivie et encouragée
L'Agrasc a fait l'objet d'appréciations positives de la part des procureurs auprès du rapporteur spécial, qui ont considéré que l'Agence était à l'écoute des magistrats et que la vente avant jugement permettait de réduire les frais de gardiennage. Les déplacements de l'Agrasc dans les juridictions pour former les personnels concernés sont particulièrement appréciés. La création récente d'antennes régionales permet d'ailleurs de rapprocher l'agence des juridictions.
Ils ont toutefois souligné, comme les magistrats instructeurs, que cette procédure est très consommatrice de temps pour le magistrat et pour les greffiers, ce qui peut conduire à relativiser le gain obtenu.
L'agence considère pour sa part qu'elle pourrait être mieux intégrée dans certains projets du ministère de la justice, tels que le projet de procédure pénale numérique (PPN).
Elle souligne également que ses résultats sont directement liés aux moyens, notamment humains, dont elle dispose. Ses emplois étaient de 67 équivalents temps plein travaillés (ETPT) en 2024.
Le rapporteur spécial, qui suit le développement de l'Agrasc depuis longtemps, considère que l'efficacité de son action et les retours financiers qu'elle apporte au budget de l'État doivent conduire à poursuivre son développement.
Recommandation : poursuivre la montée en puissance de l'Agrasc en considérant les retours financiers apportés par son activité, et mieux intégrer l'Agence dans les systèmes d'information et projets numériques du ministère de la justice, afin qu'elle puisse identifier plus aisément les opportunités de vente de biens confisqués ou saisis.
B. FAVORISER LA PARTICIPATION DES PARTIES AUX COÛTS DU PROCÈS
L'article 800-1 du code de procédure pénale, déjà mentionné, pose le principe selon lequel « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie », sauf dans certains cas.
La situation est différente dans d'autres pays européens. En Allemagne, par exemple, les frais de la procédure sont à la charge du condamné107(*). Au Royaume-Uni, les tribunaux peuvent mettre également à sa charge les frais de poursuite (« prosecution costs ») pour autant que les juges le considèrent « juste et raisonnable »108(*).
En outre, les frais de justice peuvent d'ores et déjà, comme on l'a vu supra, être mis à la charge des personnes condamnées dans certains cas en France : en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, lorsque la personne condamnée est une personne morale et lorsqu'une personne prévenue est absente à l'audience alors que des frais d'interprétariat ont été engagés.
Par ailleurs, le principe de gratuité de la justice connaît certains tempéraments, comme le paiement d'un droit fixe de procédure par les personnes condamnées.
Or le code de procédure pénale mettait les frais de justice à la charge du condamné avant 1993. Si la loi du 5 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a mis fin à ce principe, c'était, selon les termes du rapporteur de la loi au Sénat, en raison des inconvénients liés « notamment à la complexité du calcul des dépens, aux problèmes posés par la gestion d'une masse importante de mémoires et à l'importance des redevables sans domicile fixe »109(*). Plus de trente ans plus tard et avec les progrès considérables des systèmes d'information, notamment l'enregistrement des mémoires dans Chorus, cette argumentation - que la commission des lois, déjà à l'époque, jugeait « peu convaincante » - devrait pouvoir trouver une réponse.
Il paraît donc envisageable d'examiner de quelle manière il serait possible de faire mieux participer les parties et notamment les personnes condamnées aux frais de l'enquête et du procès.
Une participation des parties ou des personnes condamnées ne pourrait toutefois avoir lieu que de manière limitée. Une imputation de l'ensemble des frais de justice sur les personnes condamnées supposerait en effet que le magistrat ou le greffe soit en mesure de déterminer de manière précise et exhaustive la liste et le coût des mesures d'enquête mises en oeuvre au cours de la procédure, ce qui serait extrêmement difficile et nécessiterait des recherches approfondies de la part du greffe, en l'absence de mise en oeuvre de l'identifiant de dossier judiciaire.
En outre, les personnes condamnées ne sont pas toujours solvables et beaucoup d'entre elles ne pourraient rembourser les frais de l'enquête. C'est tout particulièrement vrai des détenus, dont le pécule ne suffit bien souvent pas à assurer l'indemnisation des victimes.
Enfin, la comparaison avec d'autres pays européens doit être nuancée. Selon ce qu'a indiqué au rapporteur spécial l'Association française des magistrats instructeurs (AFMI), la situation est différente en Allemagne dans la mesure où, par exemple, les interceptions judiciaires y sont beaucoup moins nombreuses, ce qui facilite le remboursement de leur coût.
1. Rendre enfin plus efficace le circuit de recouvrement des amendes et des frais de justice
La première difficulté qui se présente, pour la mise en place d'une participation des personnes condamnées au remboursement des frais de justice, est celle du circuit de recouvrement, qui se pose en termes similaires pour le recouvrement des amendes pénales.
En 2019, le rapporteur spécial notait que le taux de recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure (le Trésor public n'étant pas en mesure de distinguer ces deux catégories de ressources) était estimé à 48 %110(*).
Or il semble que les difficultés qu'il avait notées soient toujours largement présentes.
Selon les chiffres recueillis par le rapporteur spécial, les amendes pénales n'ont été recouvrées en 2023 qu'à hauteur de 46 % de la somme due, soit 193 millions d'euros recouvrés pour 420 millions d'euros recouvrables.
Alors qu'il constatait en 2019 l'obsolescence de l'application AMD utilisée pour le recouvrement, le remplacement de ce logiciel a connu de très grandes vicissitudes avec les projets Rocade, puis ROCSP (recouvrement optimisé des créances du service public)111(*), et enfin Nara (nouvelle application du recouvrement des amendes). Ce nouveau projet reprend la partie « amendes » de ROCSP en raison des « nombreuses difficultés » de ce projet112(*), mais sa mise en oeuvre n'est pas prévue avant 2027.
Le rapporteur spécial s'inquiète, une nouvelle fois, des difficultés majeures que rencontrent tant de projets numériques portés par le Gouvernement, alors même que, s'agissant du recouvrement des amendes, chaque année perdue correspond probablement à des recettes manquées pour l'État.
L'enjeu n'est, en tout état de cause, pas seulement lié à l'état des systèmes informatiques, mais aussi à la difficulté à recouvrer les amendes, qui est liée à de difficultés pratiques : alors que, pour des faibles sommes, il serait possible de faire payer la personne à la sortie de l'audience, la limitation des horaires d'ouvertures ou l'absence de terminal pour payer par carte bleue s'y opposent souvent.
Au minimum, il serait nécessaire de définir, en parallèle au plan de maîtrise des frais de justice, un plan d'amélioration du recouvrement des frais de justice et amendes pénales incluant le partage des pratiques entre les juridictions en matière d'identification et de recouvrement.
Recommandation : compléter le plan de maîtrise des frais de justice par un plan d'amélioration du recouvrement incluant les bonnes pratiques des juridictions pour identifier et recouvrer les frais de justice relatifs à une procédure ; améliorer le circuit de recouvrement, notamment en facilitant le paiement à la sortie du procès.
2. Étendre le recouvrement des frais de justice en matière pénale à de nouvelles catégories de personnes
Même si la portée d'un accroissement du nombre de cas dans lesquels les frais de justice peuvent être recouvrés sur les personnes condamnées serait limitée par les difficultés du système de recouvrement, certains ajustements de l'article 800-1 du code de procédure pénale pourraient utilement être étudiés afin d'en déterminer la pertinence et le produit prévisionnel, compte tenu des coûts de mise en oeuvre.
Dans un second temps, l'article 800-1 du CPP pourrait être étendu, par principe, à l'ensemble des personnes physiques condamnées, en permettant au juge la possibilité de les exonérer en tout ou partie, afin de ne mettre en oeuvre les procédures de recouvrement que dans les cas où celui-ci a une bonne probabilité d'aboutir.
Recommandation : étendre le principe de recouvrement des frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques, avec possibilité d'exonération par le juge.
3. Compléter le champ d'application du droit fixe de procédure, déjà doublé par la dernière loi de finances
En supprimant l'imputation des frais de justice aux personnes condamnées, la loi précitée du 5 janvier 1993 a accru le niveau du droit fixe de procédure dû par toute personne condamnée par une juridiction répressive113(*).
Le montant de ces droits a en outre été multiplié par deux par la dernière loi de finances et s'établit désormais à un montant variant entre 62 et 1054 euros en fonction de la nature de la condamnation.
|
Nature de la décision |
Montant du droit fixe de procédure |
|
Ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle |
62 euros |
|
Autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond |
62 euros |
|
Décisions des tribunaux correctionnels |
254 euros114(*) |
|
Décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police |
338 euros |
|
Décisions des cours d'assises |
1 054 euros |
|
Décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police |
422 euros |
Source : article 1018 A du code général des impôts
En outre, lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de stupéfiants, les droits fixes de procédure sont augmentés d'une somme forfaitaire représentative des indemnités maximales prévues pour les analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.
Or l'article 1018 A n'inclut pas la mention des décisions des cours criminelles départementales (CCD). Ces nouvelles cours, créées à titre expérimental en 2019 puis généralisées en 2023115(*), jugent en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale. Elles jugent à plus de 85 % des crimes de viols116(*).
Si l'article 380-19 du code de procédure pénale prévoit que les CCD appliquent, sauf mentions spéciales, les dispositions de ce code relatives aux cours d'assises, le droit fixe de procédure est régi par le code général des impôts et il paraît donc nécessaire de les y mentionner explicitement. Le rapporteur spécial propose de corriger cet oubli en appliquant aux décisions des CCD le même droit de procédure que pour les décisions des cours d'assises.
Recommandation : appliquer le droit fixe de procédure aux personnes condamnées devant une cour criminelle départementale.
4. Réintroduire la contribution au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction
Enfin, certains pays prévoient le paiement d'une contribution lors du dépôt d'une instance devant une juridiction.
En France, une telle contribution avait été créée en 2011, payée par toute personne qui lance une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, puis supprimée dès 2013117(*). En revanche, un timbre fiscal de 225 euros doit être réglé pour un appel, sauf pour les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou ont proposé, en 2019, dans un rapport sur l'aide juridictionnelle118(*), de mettre de nouveau en place un tel timbre pour les contentieux civils et administratifs, d'un montant de 50 euros, et d'en affecter le produit au financement d'une extension de l'aide juridictionnelle.
Le Sénat, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, a adopté, sur la proposition de notre collègue Christine Lavarde119(*), un amendement tendant à recréer une telle contribution, fixée à un montant de 50 euros, sans prévoir d'affectation. Cet amendement n'a pas été retenu ensuite dans le texte de la loi de finances élaboré par la commission mixte paritaire.
Un tel droit constituerait des ressources de quelques dizaines de millions d'euros et pourraient donc constituer une compensation partielle du coût de l'enquête et du procès.
Recommandation : proposer d'instaurer à nouveau une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence de M. Stéphane Sautarel, vice-président, la commission a entendu une communication de M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial, sur les frais de justice.
M. Stéphane Sautarel, président. - Nous entendons ce matin la communication de notre collègue Antoine Lefèvre, rapporteur spécial de la mission « Justice », sur les frais de justice. Je salue également la présence parmi nous d'une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. - J'ai souhaité travailler cette année sur les frais de justice. Il est peut-être plus simple de dire ce qu'ils ne sont pas que ce qu'ils sont : les frais de justice n'incluent pas les rémunérations des magistrats et des greffes, ni les frais d'avocats payés par les parties aux procès, ni l'aide juridictionnelle dont ils bénéficient, ni les frais de fonctionnement courant. Il s'agit donc des autres dépenses liées à une procédure judiciaire qui sont à la charge de l'État : les expertises médicales, les analyses génétiques, les frais d'interprétariat et de traduction, les interceptions judiciaires, le gardiennage des véhicules saisis, etc. Le garde des sceaux les a d'ailleurs requalifiés en « frais d'enquête ».
Toutes ces prestations sont commandées par les magistrats ou, sous leur contrôle, par les officiers de police judiciaire. Chacune n'a qu'un coût limité, mais en les additionnant, on atteint un budget de 716 millions d'euros en 2024, en hausse de 51,2 % par rapport à 2013.
Si cette question faisait régulièrement l'actualité dans les années 2000 et 2010, cela fait quelques années qu'il y a peu de travaux publiés sur le sujet, en dépit de cette augmentation. C'est pourquoi j'ai souhaité, cette année, mieux comprendre quels en sont les déterminants, et sur quels leviers on peut agir.
En premier lieu, il faut souligner que le nombre de procès n'augmente pas : c'est plutôt la complexité croissante des enquêtes et la nature de certaines d'entre elles qui expliquent l'augmentation des coûts. Par exemple, les enquêtes relatives au narcotrafic nécessitent un très grand nombre d'interceptions judiciaires afin de parvenir à suivre à la trace des criminels qui, eux-mêmes, mettent en oeuvre des techniques de plus en plus sophistiquées pour brouiller les pistes. L'année 2024 a ainsi été marquée par une enquête exceptionnelle, lancée après l'évasion d'un narcotrafiquant au péage d'Incarville le 14 mai 2024 - cette évasion avait causé la mort de deux surveillants pénitentiaires et l'enquête, grâce aux interceptions judiciaires, a permis de mettre à jour de nombreuses ramifications des réseaux criminels.
La lutte contre cette inflation des coûts doit donc être conduite avec précaution : commander une expertise lorsqu'elle est nécessaire à la manifestation de la vérité, ce n'est pas une dépense de fonctionnement courant dont on pourrait s'abstenir ; c'est un acte lié à l'exercice de l'autorité judiciaire, dont la Constitution garantit l'indépendance. Avant l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), les crédits de frais de justice étaient d'ailleurs évaluatifs, et non limitatifs. Les magistrats qui exercent cette autorité disposent d'une liberté de prescription d'actes d'enquête qui est indispensable pour l'efficacité même de la justice.
Dans cet esprit, j'ai cherché à regrouper des propositions, d'une part pour améliorer l'information des magistrats et enquêteurs pour les aider à maîtriser les coûts sans nuire à la qualité de l'enquête, d'autre part pour réduire et annuler certaines dépenses qui ne contribuent en rien à la manifestation de la vérité.
En effet, il n'est pas simple pour des magistrats, des policiers ou des gendarmes de se poser la question des économies à faire lorsqu'ils ont besoin d'une expertise et que la rapidité est souvent le critère déterminant. Tous m'ont dit qu'ils étaient conscients de la nécessité de dépenser avec modération, mais il faut les y aider, par exemple en fournissant des comparatifs de prix, ou bien des guides de bonnes pratiques. Lorsque des prestataires à la fois publics et privés existent, comme c'est le cas pour certaines analyses biologiques, la comparaison est rendue plus difficile par l'absence de connaissance des coûts complets des laboratoires publics, qu'il faudrait parvenir à déterminer.
Améliorer l'information, c'est aussi être capable de calculer le coût d'une enquête par addition de l'ensemble des frais de justice : c'est aujourd'hui impossible, car l'information sur les prestations commandées est disséminée entre les greffes ou les services de police et de gendarmerie. La solution réside dans le projet de procédure pénale numérique (PPN), lequel se met peu à peu en place, mais il faudra qu'il aille à son terme en instaurant un « identifiant de dossier judiciaire » qui devra permettre de rattacher tous les frais de justice à une procédure, depuis son lancement jusqu'à l'étape de l'audience.
Ces actions doivent être conduites en lien étroit avec les utilisateurs, notamment les officiers de police et de gendarmerie qui sont plus éloignés que les magistrats et les greffiers des plans de maîtrise des frais de justice que le ministère de la justice renouvelle chaque année depuis 2021. Je propose donc de systématiser un réseau de référents « frais de justice » dans les services de police judiciaire.
Enfin, sur le plan budgétaire, le suivi est rendu plus difficile pour les services du ministère par le fait que les frais de justice, contrairement à l'esprit, voire à la lettre de la Lolf, ne sont pas enregistrés dans le système Chorus dès l'engagement, c'est-à-dire lorsque le magistrat commande la prestation. Ils sont comptabilisés après coup, lorsque le prestataire présente sa demande de paiement. Pour nous, parlementaires, les documents budgétaires sont d'ailleurs moins précis qu'il y a quelques années sur l'exécution budgétaire des frais de justice. Ces deux insuffisances devraient être corrigées.
Ma seconde série de constats et de recommandations concerne des dépenses qui sont peu utiles, voire inutiles, et que l'on ne soupçonne généralement pas.
Il faut commencer par la question de la sous-budgétisation. De nos jours, les frais de justice sont des quasi-dépenses de guichet, mais les crédits inscrits en loi de finances initiale sont le plus souvent insuffisants. Il faut donc, en cours d'année, exercer la fongibilité - autrement dit, puiser dans les crédits prévus à d'autres usages, par exemple les projets de rénovation ou de construction de tribunaux, ou encore les projets informatiques. Sinon, les juridictions sont contraintes d'arrêter de payer les experts dès le mois de septembre et accumulent peu à peu une dette économique, estimée à 318 millions d'euros.
Comme il s'agit d'une dépense future inéluctable, il me paraît indispensable de prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice.
S'agissant des dépenses sans utilité pour l'enquête, la plus évidente concerne les frais liés aux biens saisis, à commencer par le gardiennage de véhicules qui restent pendant des mois, voire des années dans des garages - à tel point que la juridiction se rappelle parfois de l'existence d'un véhicule lorsqu'elle reçoit la facture finale du gardiennage. Or, bien souvent, ces véhicules, qui perdent rapidement leur valeur, auraient pu être vendus ou affectés à des services de police ou de gendarmerie. Un effort important pourrait être conduit afin de réduire le stock de véhicules entreposés, mais il faut aider les juridictions en mettant à leur disposition le système d'information utilisé par le ministère de l'intérieur.
Une dépense utile, mais parfois excessive, concerne les interceptions judiciaires - ce terme désigne les traditionnelles écoutes téléphoniques, mais aussi, et de plus en plus, le recueil des données de connexion et de géolocalisation des criminels, car les communications vocales sont souvent cryptées de nos jours. Alors que le recours à des prestataires privés était autrefois la règle, avec des coûts élevés, il existe aujourd'hui une plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) gérée par l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (Antenj). Je m'y suis rendu il y a trois semaines et j'ai constaté leur efficacité et leur engagement. Les utilisateurs critiquent certaines insuffisances d'ergonomie, des fonctionnalités à améliorer : il faut répondre à ces demandes, car ces interceptions sont nécessaires pour les besoins des enquêtes. Il faut aussi encourager à l'usage généralisé de cette plateforme, sauf dans certaines parties du territoire, comme le Pacifique, où elle n'est pas accessible.
Je souhaiterais également souligner qu'un certain nombre d'expertises ne sont pas choisies par le magistrat, mais imposées par la loi : on m'a cité le cas d'une expertise qui doit être conduite lorsqu'une personne placée sous curatelle vole une bouteille de whisky dans un supermarché. Les coûts sont souvent disproportionnés, et parfois sans utilité : il arrive que le magistrat ordonne une seconde expertise pour obtenir les renseignements dont il a réellement besoin. Je pense donc qu'un débat devrait être engagé sur cette question, qui tendrait probablement à rétablir la liberté de prescription du magistrat pour les expertises.
Une dernière catégorie d'expertises sur laquelle des marges d'économies existent est celle des prestations d'interprétariat et de traduction. Là aussi, la loi impose l'intervention d'un interprète humain. Or le développement extraordinaire des technologies de traduction automatisée, depuis une dizaine d'années, devrait permettre de réduire les coûts et les délais, tout en maintenant le contrôle par un humain lorsque c'est nécessaire. Cette piste n'a pas encore été suffisamment étudiée, alors qu'elle concerne plusieurs ministères, qui pourraient collaborer.
J'aborderai pour finir quelques recettes qui peuvent compenser, dans une certaine mesure, le coût des frais de justice pour l'État.
En 2017, j'ai consacré un rapport à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), chargée de vendre des biens saisis ou confisqués, ou de les mettre à disposition des services de l'État - par exemple les services de police ou de gendarmerie - et, depuis peu, des collectivités locales. En 2024, l'Agrasc a versé 244 millions d'euros à l'État et à plusieurs fonds, comme la mission interministérielle de lutte contre les addictions (Mildeca). Compte tenu du nombre et de la valeur des biens saisis et confisqués, son action pourrait encore être étendue, par exemple en s'assurant qu'elle est mieux informée des opportunités existantes.
La compensation des frais de justice peut aussi passer, comme c'était le cas autrefois, par des recettes demandées aux justiciables eux-mêmes.
La première nécessité serait toutefois, à cet égard, d'améliorer le système de recouvrement des amendes pénales et des frais de justice, car les amendes pénales ne sont recouvrées qu'à hauteur de 46 % de la somme due. Là aussi, il faut améliorer le dispositif. Les remarques que j'ai faites devant cette commission en 2019 sur le caractère obsolète des logiciels semblent malheureusement être encore largement d'actualité.
Si les frais de justice sont aujourd'hui à la charge de l'État pour les personnes privées, ce n'était pas le cas avant 1993, et ce n'est toujours pas le cas lorsque la personne condamnée est une personne morale. La distinction n'a pas de justification précise et je proposerai de rétablir un principe de recouvrement de frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques. Il ne faut certes pas en espérer une recette trop importante : d'abord parce qu'il est très difficile, à l'heure actuelle, de retracer la totalité des frais liés à une procédure, ensuite parce que les condamnés n'ont souvent pas les moyens de payer les indemnisations dues aux victimes, donc a fortiori les frais de justice. Le juge aura une marge d'appréciation pour écarter le recouvrement dans ces cas.
S'agissant en outre du droit fixe de procédure, qui est une somme forfaitaire payée par les personnes condamnées, il a été doublé l'an dernier. Toutefois, les cours criminelles départementales, qui ont été généralisées en 2023, ne sont pas mentionnées dans l'article du code général des impôts qui institue ce droit et nous pourrions mettre à profit la prochaine loi de finances pour corriger cet oubli.
Enfin, toujours dans le cadre de la loi de finances, nous avons voté l'an dernier, sur la proposition de notre collègue Christine Lavarde, la réintroduction d'une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction. Cette mesure avait finalement été écartée par la commission mixte paritaire, mais je propose de la reprendre, car elle contribue, elle aussi, à compenser quelque peu le coût des frais occasionnés par le procès.
Voici les principales analyses et propositions que je vous soumets sur un sujet qui n'est guère nouveau, mais qui n'avait pas été suffisamment mis en lumière, me semble-t-il, ces dernières années.
La somme de 716 millions d'euros est certes importante, mais il ne faut pas y voir uniquement un coût. Une enquête bien menée, c'est aussi des recettes financières pour l'État, avec le produit des amendes, et c'est surtout un maintien de l'ordre, dont le bénéfice est difficile à chiffrer, mais indéniable. Certaines politiques font l'objet d'un « compte », comme le compte du logement publié par le ministère de la transition écologique, qui fait le bilan des dépenses et des recettes liées à cette politique. Si un tel compte était établi pour l'ensemble des dépenses de la justice, aussi bien judiciaires que pénitentiaires, peut-être se rendrait-on compte que les 12 milliards d'euros qui lui ont été consacrés en 2024 ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, des dépenses inutiles pour la société.
Mme Lauriane Josende, rapporteure pour avis de la commission des lois. - Il s'agit d'un rapport essentiel, qui traite d'un sujet central, mais épineux. Les frais de justice sont en effet très mal contrôlés, et ils comprennent à la fois des dépenses inutiles et d'autres qui sont indispensables à la manifestation de la vérité.
Notre collègue Antoine Lefèvre avance des mesures très concrètes. La commission des lois les soutiendra, en espérant qu'elles figureront dans la loi de finances, car il en va de l'efficacité et de la crédibilité de notre justice.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. -Les propositions formulées dans ce rapport sont précises et visent à rendre le système plus efficace, mais pas nécessairement plus simple...
Nous sommes face à un paradoxe. Nous voulons une justice plus rapide, plus efficace, mais nous constatons dans le même temps que les recettes diminuent pour des dossiers toujours plus nombreux.
Nous sommes tous comptables des deniers publics, plus encore par les temps qui courent, et c'est pourquoi ce rapport me semble particulièrement bienvenu.
Il est parfaitement légitime de vouloir mieux maîtriser les frais de justice, dans le but, in fine, de mieux rendre la justice.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Je salue à mon tour les propositions très précises qui ressortent de cette analyse particulièrement fouillée. Les frais de justice explosent, mais ils agrègent des dépenses très différentes. Certains postes augmentent-ils plus que d'autres ? Au contraire, la dérive concerne-t-elle l'ensemble des dépenses ?
M. Thierry Cozic. - Le groupe socialiste défend le principe de l'accès à la justice pour tous et craint que les mesures proposées n'aboutissent à une financiarisation de la justice. Si certaines nous semblent aller dans le bon sens, l'instauration d'une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction constitue pour nous une ligne rouge. Sans évolution sur cette disposition, nous nous opposerons à ce rapport.
Mme Christine Lavarde. - Je rappelle à Thierry Cozic que ces frais de 50 euros ont existé par le passé, et que des frais de 250 euros s'appliquent quand on veut contester la première décision qui a été rendue. Vous proposez donc un système à deux vitesses, qui permet d'attaquer tout et n'importe quoi en justice à titre gracieux, et qui nuit en définitive à l'efficacité de la justice.
L'an dernier, à la demande expresse du garde des sceaux, nous avions accepté de retirer cette disposition en commission mixte paritaire, puisqu'il nous avait assuré qu'il allait entreprendre des consultations. Le rapporteur spécial dispose-t-il d'informations sur la tenue de ces consultations et leur éventuelle concrétisation dans le PLF ?
Mme Nathalie Goulet. - Les propos du rapporteur ne sont pas sans lien avec le travail que Rémi Féraud et moi-même avons effectué sur les frais de justice liés au contentieux des visas : nous avons mis en exergue leur augmentation exponentielle et leur répartition pour le moins baroque.
Je soutiens pleinement la promotion d'un guide de bonne conduite. À la suite de la commission d'enquête que j'ai menée avec Raphaël Daubet sur la criminalité organisée, nous avons constaté qu'un certain nombre de ministères procédaient à des appels d'offres séparés, aboutissant à l'utilisation de logiciels de décryptage incompatibles et à l'impossibilité d'échanger les données.
Enfin, le taux de recouvrement des avoirs criminels s'établissant à seulement 2 % pour 50 milliards d'euros d'argent blanchi, j'estime qu'il nous faut en effet pousser les feux en la matière.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. - L'extension des frais fixes pour les personnes condamnées est une mesure de cohérence. Elle pourra d'ailleurs être écartée par le juge, notamment pour les personnes ne disposant pas de ressources.
Les frais d'expertise et d'analyse médicales ont crû de près de 50 % depuis 2013, notamment en raison de l'inflation du nombre d'expertises psychiatriques, tandis que les frais de traduction et d'interprétariat ont augmenté de 72 %. Les frais d'écoute téléphonique sont pour leur part quasiment stables, puisque grâce à la mise en place de la PNIJ, ils n'ont augmenté que de 1,2 %.
Je vous confirme que pour les raisons évoquées par Mme Lavarde, je maintiens la proposition, que j'avais du reste déjà défendue dans le passé, d'une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction. En ce qui concerne la consultation menée par le garde des sceaux sur cette question, je ne dispose pas d'élément nouveau, mais je pourrai l'interroger à l'occasion de la présentation que je lui ferai du présent rapport.
Je vous remercie de souligner l'importance du guide de bonne pratique des juridictions, madame Goulet. Il est incompréhensible que les difficultés relatives aux incompatibilités de logiciels ne soient pas surmontées à ce stade. Dans le rapport d'information sur le recouvrement des amendes pénales que j'ai commis en 2019, j'indiquais que plus de 500 000 fiches avaient été ressaisies manuellement en raison de l'incompatibilité des systèmes d'information des services de justice et financiers. Nous avons là une forte marge de progression, tout comme en matière de recouvrement des avoirs criminels.
La commission a adopté les recommandations du rapporteur spécial et autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES
PERSONNES ENTENDUES,
CONTRIBUTION ÉCRITE ET DÉPLACEMENT
Audition commune : administrations judiciaires
Direction des services judiciaires (DSJ)
- M. Roland de LESQUEN, directeur adjoint des services judiciaires ;
- Mme Christine JULARD, sous directrice des finances, de l'immobilier et de la performance ;
- M. Cizia CERT, chef de bureau du budget ;
- M. Nuri ALIRKILICARSLAN, contrôleur de gestion du bureau du pilotage.
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
- M. Jean-Baptiste BOUGEROL, adjoint à la cheffe du bureau de la police judiciaire.
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
- Mme Émilie AUGUSTIN, rédactrice du bureau du droit processuel et du droit social.
Audition commune : Secrétariat général du ministère de la Justice et ANTENJ
Secrétariat général du ministère de la Justice
- M. Philippe CLERGEOT, directeur, secrétaire général du ministère de la Justice.
Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ)
- M. Jean-Julien XAVIER-ROLAI, directeur ;
- M. Yves BRONOËL, directeur adjoint.
Direction générale de la police nationale (DGPN)
Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ)
- M. Aymeric SAUDUBRAY, directeur national adjoint de la police judiciaire ;
- Mme Séraphia SCHERRER, commissaire divisionnaire, sous-directrice adjointe de la stratégie et du pilotage territorial ;
Service national de police scientifique (SNPS)
- Mme Corinne GROULT-MAÏSTO, contrôleuse générale, adjointe au chef du SNPS, intérim du poste de chef du SNPS.
Direction du budget - Sous-Direction Budgets des secteurs de la culture, de la jeunesse, de la vie associative, des sports, de l'économie, des finances, de l'outre-mer, de la justice et des médias - Bureau Justice et Médias (8BJM)
- Mme Carole ANSELIN, sous-directrice ;
- M. Jean-Baptiste LE VERT, chef du bureau de la justice et des médias ;
- M. Yannick CARTHERY, adjoint au chef du bureau.
Conférence nationale des procureurs de la République
- M. Olivier CARACOTCH, procureur de Dijon.
Association française des magistrats instructeurs (AFMI)
- Mme Lucie DELAPORTE, vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal judiciaire de Paris, vice-présidente de l'AFMI.
Conseil national des compagnies d'experts de justice
- M. Guillaume LLORCA, président ;
- Mme Annie VERRIER, commissaire aux institutions et présidente d'honneur du Conseil.
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
- Mme Virginie GENTILE, secrétaire générale ;
- M. Aurélien LETOCART, magistrat coordonnateur des antennes de Paris et Ultra-Marine ;
- Mme Emmanuelle EYMOND, cheffe par intérim du département mobilier ;
- Mme Catherine JORGE, directrice de la communication.
*
* *
- Contribution écrite -
Direction générale de la gendarmerie nationale
*
* *
- Déplacement -
Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ)
Personnes rencontrées :
- Mme Carine CHEVRIER, secrétaire générale du ministère de la justice ;
- M. Jean-Julien XAVIER-ROLAI, directeur de l'ANTENJ ;
- M. Yves BRONOËL, directeur adjoint de l'ANTENJ.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Rétablir une présentation détaillée des frais de justice dans les documents budgétaires, avec notamment le montant et l'évolution des charges à payer et de la dette économique, ainsi qu'avec les mesures prises en exécution dans le cas des sur-exécutions. |
Direction des services judiciaires (DSJ) / direction du budget (DB) |
Printemps 2026 |
Documents budgétaires annexés aux projets de loi de finances et aux projets de loi relative au règlement des comptes et portant approbation des comptes de l'année |
|
2 |
Informer de manière plus systématique les magistrats et les officiers de police judiciaire sur le coût des mesures avant de les ordonner (comparatifs de coûts moyens pour une prestation donnée) et après (coût des mesures effectivement ordonnées). |
DSJ / direction générale de la police nationale (DGPN) / direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) |
2026 |
Instructions, circulaires |
|
3 |
Établir les coûts complets des analyses génétiques et toxicologiques par les laboratoires publics. |
DGPN / DGPN |
2026-2027 |
Études |
|
4 |
Pour un meilleur suivi des frais de justice, fixer comme objectif un enregistrement des frais de justice dans Chorus dès l'engagement. |
DB / DSJ / DGPN / DGGN |
2026-2027 |
Études, instructions |
|
5 |
Mener à son terme le projet de procédure pénale numérique (PPN) afin de pouvoir retrouver et suivre, au moyen d'un identifiant de dossier judiciaire, l'ensemble des frais de justice associés à une procédure donnée. |
DSJ / DGPN / DGGN |
2027 |
Développement informatique |
|
6 |
Mettre en place un réseau de référents « frais de justice » dans les services de police judiciaire, chargés de faire le lien entre les informations apportées par le ministère de la justice, les instructions émanant du ministère de l'intérieur et les enquêteurs. |
DGPN / DGGN, en lien avec la DSJ |
2026 |
Instructions, circulaires |
|
7 |
Prévoir une budgétisation plus sincère des frais de justice, notamment pour des prestations d'expertise, afin de réduire les délais de paiement et les besoins d'ouvertures de crédit en cours d'année. |
DSJ / DB |
2026 |
Projet de loi de finances |
|
8 |
Rationaliser les frais de gardiennage de véhicules : - à court terme, conduire une évaluation du stock de véhicules en gardiennage avec l'objectif de le réduire d'un tiers ; - à moyen terme, mieux connaître et interconnecter les systèmes développés dans certains services, à commencer par le système d'information des fourrières, afin de mettre à disposition un outil de suivi de l'ensemble des véhicules ; - définir une méthodologie partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice pour les saisies ; - prévoir des conventions avec les garages incluant l'envoi d'une facture périodique. |
DSJ / DGPN / DGGN |
2026-2027 |
Circulaires, instructions, développement informatique |
|
9 |
Poursuivre la mise en oeuvre de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) : - en lien avec les magistrats et les officiers de police judiciaire utilisateurs, poursuivre l'amélioration de l'ergonomie de la PNIJ afin de favoriser la prise en main et réduire le recours à des prestataires externes ; - en échange de l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités, généraliser l'obligation d'une autorisation écrite des magistrats en cas de recours à des prestations hors PNIJ. |
Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) / DSJ / DGPN / DGGN |
2026-2027 |
Circulaires, instructions, développement informatique |
|
10 |
Adapter les expertises aux besoins de l'enquête. En particulier : - étudier une gradation des tarifications des expertises psychologiques et psychiatriques en fonction de la complexité de l'analyse demandée ; - envisager de laisser aux magistrats l'appréciation de la nécessité de l'expertise psychologique ou psychiatrique, ainsi que de l'enquête sociale rapide, dans les cas où ces mesures sont actuellement prévues de manière automatique par le code de procédure pénale. |
DSJ / direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) / DGPN / DGGN |
2026-2027 |
Loi, décrets et arrêtés |
|
11 |
Moderniser la gestion des prestations d'interprétariat et de traduction : - augmenter le nombre d'interprètes traducteurs contractuels pour certaines langues, après évaluation coût/bénéfice en fonction du volume de prestations nécessaire dans une juridiction donnée ; - en lien avec la direction interministérielle du numérique (Dinum) et les autres directions des ministères de la justice et de l'intérieur, expérimenter le recours à l'intelligence artificielle afin de déterminer dans quels cas l'intervention d'un interprète traducteur assermenté pourrait être rendue facultative, sous le contrôle du magistrat. |
DSJ / direction interministérielle du numérique (Dinum) / direction de l'administration pénitentiaire (DAP) / ministère de l'intérieur |
2026 |
Études, avant modification éventuelle de la loi |
|
12 |
Poursuivre la montée en puissance de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en considérant les retours financiers apportés par son activité, et mieux intégrer l'Agence dans les systèmes d'information et projets numériques du ministère de la justice, afin qu'elle puisse identifier plus aisément les opportunités de vente de biens confisqués ou saisis. |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) / DSJ |
2026 |
Instructions, circulaires |
|
13 |
Compléter le plan de maîtrise des frais de justice par un plan d'amélioration du recouvrement incluant les bonnes pratiques des juridictions pour identifier et recouvrer les frais de justice relatifs à une procédure ; améliorer le circuit de recouvrement, notamment en facilitant le paiement à la sortie du procès. |
DSJ |
2026 |
Instructions, circulaires |
|
14 |
Étendre le principe de recouvrement des frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques, avec possibilité d'exonération par le juge. |
DSJ / DACG |
2026 |
Loi |
|
15 |
Appliquer le droit fixe de procédure aux personnes condamnées devant une cour criminelle départementale. |
DSJ / direction de la législation fiscale (DLF) |
2026 |
Loi de finances initiale |
|
16 |
Proposer d'instaurer à nouveau une contribution de 50 euros au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction. |
DSJ / direction de la législation fiscale (DLF) |
2026 |
Loi de finances initiale |
* 1 Voir notamment sa Lettre aux magistrats et aux agents du ministère de la justice, en date du 12 mai 2025.
* 2 Le référentiel des prestations de frais de justice, diffusé sur le portail Chorus, mentionne la Cour de cassation, la cour d'appel, la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs, la cour criminelle départementale, le tribunal correctionnel, le tribunal de police, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge civil, le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, le juge des contentieux de la protection, le juge et le tribunal de l'application des peines, le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, etc.
* 3 21° de l' article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
* 4 Article D. 311-4 du code de la sécurité sociale.
* 5 La plupart des tarifs de prestations liées aux frais de justice sont inscrits aux articles A. 43-4 et suivants du code de procédure pénale.
* 6 Les délégués du procureur de la République (DPR) sont des citoyens ou des associations habilités par le procureur de la République pour participer à la mise en oeuvre de la politique pénale, à la demande et sous le contrôle du procureur (site du ministère de la justice, Le délégué du procureur de la République).
* 7 Ministère de la justice, Frais de justice : les tarifs applicables pour les médecins et psychologues, mis à jour le 27 mars 2025.
* 8 L. Benali, F. Abriat, C. Chevalier, S. Gromb, Coût des opérations thanatologiques au centre hospitalo-universitaire de Bordeaux, La revue de médecine légale (2011) 2, p. 125-131.
* 9 Tarif pour un cadavre frais (321,45 euros pour un corps en état de décomposition avancée).
* 10 Circulaire du 28 décembre 2010 relative à la mise en oeuvre de la réforme de la médecine légale.
* 11 Les épices étaient, sous l'Ancien Régime, un « présent constitué d'abord de dragées et de confitures, offert aux juges par les plaideurs à l'occasion d'un procès. Par extension. Taxe due aux juges lors d'un procès. Il fallait payer les épices pour lever l'arrêt. » (dictionnaire de l'Académie française, 9e édition).
* 12 Jean-Charles Asselain, « Le budget du ministère de la Justice de la Restauration au seuil du XXIe siècle », dans L'invention de la gestion des finances publiques, édité par Philippe Bezes et al., Institut de la gestion publique et du développement économique, 2010, https://doi.org/10.4000/books.igpde.1739.
* 13 Donc hors dépenses liées à l'administration pénitentiaire, qui n'a été rattachée au ministère de la justice et à son budget qu'en 2011, et à la protection judiciaire de la jeunesse, devenue une charge de l'État après la Seconde Guerre mondiale.
* 14 Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Le principe de gratuité de la justice est aujourd'hui inscrit à l' article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire.
* 15 Article 120 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
* 16 Article 21 de la loi n° 2007 291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
* 17 Article 12 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les personnes morales condamnées, avec extension aux personnes morales ayant conclu une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) par l' article 14 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen.
* 18 Article 17 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* 19 Article 1018 A du code général des impôts.
* 20 Article 9 de l' ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
* 21 Roland du Luart, Frais de justice : l'impératif d'une meilleure maîtrise, Rapport d'information n° 216 (2005-2006), fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 22 février 2006.
* 22 Jean-Charles Asselain, L'argent de la justice, presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p. 500 et suivantes, citant Roland du Luart, annexe 15 au rapport général n° 99 (2005-2006), tome III, relatif aux crédits de la mission « Justice », fait au nom de la commission des finances du Sénat.
* 23 Roland du Luart, La Lolf dans la justice : indépendance de l'autorité judiciaire et culture de gestion, rapport d'information n° 478 (2004-2005), fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 juillet 2005.
* 24 Rapport annuel de performances de la mission « Justice » annexé au projet de loi de règlement pour 2005.
* 25 Le rapport annuel de performances de la mission « Justice » annexé au projet de loi de règlement pour 2005 précise ainsi que des frais postaux, en matière civile, étaient désormais imputés sur une action distincte du programme 166 « Justice judiciaire », alors qu'ils étaient auparavant imputés sur le chapitre des frais de justice.
* 26 Identification d'abonnés à partir de leur numéro d'appel, détail des appels, géolocalisations...
* 27 Rapport annuel de performances de la mission « Justice », annexée au projet de loi de règlement pour 2011.
* 28 Jean-Charles Asselain, ouvrage cité.
* 29 Angélique Négroni, Ce robot traque l'ADN de milliers de cambrioleurs, Le Figaro, 8 août 2012.
* 30 Ces crédits comprennent aussi les menues dépenses de conciliateurs, de l'ordre de 2 millions d'euros par an.
* 31 L'exécution budgétaire du programme 166 « Justice judiciaire » s'articule en particulier autour d'un BOP central et de 17 BOP confiés à des cours d'appel, tandis que les autres cours d'appel ont le statut d'unité opérationnelle de programme (UOP).
* 32 Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice et réponse au questionnaire du rapporteur spécial.
* 33 Ce montant correspond à une valorisation théorique de cette activité sur la base de la grille tarifaire, le SNPS n'étant pas en mesure de comptabiliser ces dépenses séparément de ses autres activités.
* 34 Courrier de Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, à Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, 14 novembre 2005, annexée au rapport d'information n° 216 (2005-2006) de Roland du Luart, fait au nom de la même commission, déposé le 22 février 2006.
* 35 Cour des comptes, note d'exécution budgétaire de la mission « Justice » en 2024, p. 45.
* 36 Selon le ministère de la justice, une affaire est « non poursuivable » lorsqu'elle a été classée sans suite parce que les poursuites étaient impossibles, soit pour un motif de fait (auteur inconnu par exemple), soit pour un motif de droit (absence d'infraction par exemple). Une affaire est poursuivable s'il n'existe aucun motif de fait ou de droit rendant impossible la poursuite devant une juridiction pénale. Une affaire poursuivable peut elle-même donner lieu à un classement sans suite pour inopportunité aux poursuites, à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, ou à une poursuite.
* 37 À l'exception de l'année 2020, durant laquelle l'activité des juridictions a été ralentie par la crise du Covid (Ministère de la justice, service statistique, des études et de la recherche (SSER), Dix ans de traitement des affaires pénales par la justice, Infostat Justice n° 199, avril 2025).
* 38 Pour une meilleure maîtrise des frais de justice, rapport d'information n° 31 (2012-2013) d'Edmond Hervé, fait au nom de la commission des finances, déposé le 10 octobre 2012.
* 39 Indicateur 1.4 du programme 166 « Justice judiciaire » : 735 affaires par an en 2024 pour les magistrats du siège en affaires civiles, 980 pour les magistrats du siège et 940 pour les magistrats du parquet en affaires pénales (hors appel et cassation).
* 40 En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 82 800 victimes de violences intrafamiliales non conjugales, soit une progression annuelle moyenne de + 14 % pour les mineurs et + 8 % pour les majeurs depuis 2016 (ministère de l'Intérieur, Les violences intrafamiliales non conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023, janvier-avril 2025).
* 41 Cour des comptes, Les moyens affectés aux missions de police judiciaire, exercices 2017-2022, mai 2023.
* 42 Source : restitutions Chorus mises à disposition du Parlement, crédits consommés en 2024.
* 43 L'ordonnance de commission d'expert est l'acte par lequel un juge désigne un expert et lui confie une mission précise dans le cadre d'une procédure judiciaire.
* 44 Disque dur externe, disque d'ordinateur, téléphone simple, smartphone, carte SIM seule, clé USB / carte mémoire / CD-DVD ROM, box, console.
* 45 Rapport annuel de performances de la mission « Justice », exercice 2021.
* 46 Courrier de la DSJ aux premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel (22 mars 2023).
* 47 S'agissant par exemple des prestations des interprètes-traducteurs, un contrôle renforcé permet de vérifier que le même interprète ne présente pas deux mémoires distincts pour des prestations portant sur une plage horaire identique.
* 48 Le traitement du précontentieux, c'est-à-dire notamment des indemnisations versées à des particuliers dont la porte a été endommagée par erreur par les forces de l'ordre au cours d'une opération de police judiciaire (site https://mon-indemnisation.justice.gouv.fr), a été transféré à un bureau séparé.
* 49 Courriers de la DSJ aux premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel, d'une part (9 avril 2024), et à la DNPJ et la DGGN, d'autre part (22 mai 2024).
* 50 Courriers de la DSJ aux premiers présidents et procureurs généraux de cours d'appel, d'une part (14 mai 2025), et à la DNPJ et la DGGN, d'autre part (même jours).
* 51 Voir la note d'exécution budgétaire de la Cour des comptes relative à la mission « Justice » en 2024, p. 45. Voir également, supra, la description de la répartition des frais de justice en 2024.
* 52 Cour des comptes, Les frais de justice depuis 2011, communication à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, septembre 2014.
* 53 Ce délai de forclusion n'a été introduit que récemment, par l'article 236 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, modifiant l' article 800 du code de procédure pénale.
* 54 Rapport annuel de performances de la mission « Justice », annexé au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024.
* 55 Articles 12 et 13 du code de procédure pénale.
* 56 Cour des comptes, Les frais de justice depuis 2011, communication à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, septembre 2014.
* 57 Article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 58 Ce coût est toutefois limité, puisque le SNPS l'estime à 131 500 euros par an pour les cinq laboratoires du SNPS.
* 59 Le portail Chorus Pro est utilisé par des acteurs extérieurs à l'administration : prestataires de frais de justice pour la saisie de leurs mémoires, mais aussi professionnels agricoles pour saisir leurs de demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation (TIC) et de la taxe intérieur de consommation sur le gaz naturel (TICGN), ainsi que, depuis 2017, par les fournisseurs de l'État et des autres administrations publiques pour déposer leurs factures.
* 60 Chorus Formulaires est destiné aux services de l'administration n'ayant pas un accès direct à la solution Chorus Coeur.
* 61 Articles R. 224-1 et suivants du code de procédure pénale, article A. 43-16 du même code (seuil de taxation).
* 62 Articles R. 226 et suivants du code de procédure pénale.
* 63 Chorus Coeur, souvent appelé simplement Chorus, est l'application utilisée par les gestionnaires et comptables de l'État pour gérer la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de l'État. Son développement a permis de mettre en oeuvre les principes de comptabilité issus de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 64 Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
* 65 Calculs commission des finances, à partir de l' arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
* 66 Société française des traducteurs, Des conditions de paiement pour les collaborateurs occasionnels de justice, communiqué de presse, 4 mars 2025.
* 67 Cour des comptes, note d'exécution budgétaire relatif à l'exécution des crédits de la mission « Justice » en 2024, p. 6.
* 68 Ou, comme vu supra par les laboratoires de la police scientifique pour ce qui concerne les scellés biologiques.
* 69 Les données sont présentées par budget opérationnel de programme (BOP), au nombre de 11 en métropole : Centre, Centre-Est, Grand-Est, Grand-Nord, Grand-Ouest, Normandie, Paris, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest et Versailles. Six BOP sont définis en outre-mer : Atlantique, Basse-Terre, Cayenne, Nouméa, Papeete et Saint-Denis.
* 70 Les autres affectataires possibles sont les services judiciaires, les services de l'administration pénitentiaire, les établissements publics du ministère de la justice, la marine nationale, l'Office français de la biodiversité (OFB) et les placés sous l'autorité du ministère chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
* 71 Rapport relatif à l'enquête sur les véhicules en gardiennage (2024).
* 72 Cour des comptes, Point d'étape du plan de transformation numérique du ministère de la justice, janvier 2022.
* 73 Le document de programmation unique (DPU), mis en place par certains programmes budgétaires à titre expérimental depuis 2020, présente le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel sur deux ans, la répartition de ces crédits entre les BOP et une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus (Cour des comptes, La préparation et le suivi du budget de l'état : redonner une place centrale à la maîtrise des dépenses, décembre 2023, p. 68).
* 74 Pour mémoire, aucun surveillant pénitentiaire n'avait été tué dans l'exercice de ses fonctions depuis 1992.
* 75 Voir Le Monde, Capture de Mohamed Amra : le récit d'une enquête « exceptionnelle », qui « ne fait que commencer », 15 mars 2025.
* 76 II de l' article 34-1 du code des postes et des communications électroniques, articles R. 10-2 et suivants du même code.
* 77 Décrets n° 2021-1363 du 20 octobre 2021, n° 2022-1327 du 17 octobre 2022, n° 2023-933 du 10 octobre 2023 et n° 2024-901 du 7 octobre 2024 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion.
* 78 Agnès Canayer et Philippe Bonnecarrère, Surveiller pour punir ? Pour une réforme de l'accès aux données de connexion dans l'enquête pénale, rapport d'information n° 110 (2023-2024), déposé le 15 novembre 2023 au nom de la commission des lois du Sénat, en particulier la troisième partie « Les limites des tentatives françaises de mise en conformité avec le droit de l'Union européenne ».
* 79 Cour de cassation, arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022, pourvois n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652.
* 80 Articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.
* 81 Cour de cassation, Note explicative relative aux arrêts de la chambre criminelle du 12 juillet 2022 (pourvois n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652).
* 82 Le rapporteur spécial a pu constater, lors d'une visite à l'ANTENJ (voir infra), que l'identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel peut être aujourd'hui obtenue en moins d'une minute.
* 83 Cour des comptes, Les interceptions judiciaires et la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), référé adressé au Premier ministre, 18 février 2016.
* 84 Article 230-45 du code de procédure pénale,
* 85 Décret n° 2017-614 du 24 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires » et d'un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires.
* 86 Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2024, 23-86.738. En l'occurrence, la Cour de cassation constate que l'impossibilité technique était caractérisée, la prestation de géolocalisation n'étant pas proposée par la PNIJ à la date de la demande de prestation.
* 87 1 tébioctet correspond à 1 099 511 627 776 (240) octets, soit légèrement plus de 1 téraoctet (1 000 milliards d'octets).
* 88 Courriers du 14 mai 2025 adressés aux premiers présidents et procureurs de cours d'appel d'une part, aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales d'autre part.
* 89 Le bilan du plan de maîtrise des frais de justice en 2024 indique en effet qu'a été réalisée une « communication de tableaux de suivi nominatif des dépenses d'interceptions judiciaires et géolocalisations aux chefs de Cour ».
* 90 Rapport d'information n° 402 (2021-2022) d'Antoine Lefèvre, pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le plan de transformation numérique de la justice, fait au nom de la commission des finances, déposé le 26 janvier 2022.
* 91 Les mesures de protection juridique prévues par les articles 489 et suivantes du code civil sont la tutelle, la curatelle et le placement sous la sauvegarde de la justice.
* 92 Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain : Cour de cassation et intelligence artificielle, avril 2025.
* 93 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
* 94 Réalisation de procès-verbal d'auditions, notes d'audience, retranscription des échanges en phase d'instruction, etc.
* 95 Voir L'IA au service de la justice : stratégie et solutions opérationnelles, rapport au garde des sceaux d'un groupe de travail coordonné par Haffide Boulakras, directeur adjoint de l'école nationale de la magistrature (ENM), juin 2025.
* 96 Les dispositions sont aujourd'hui inscrites aux articles 706-159 et suivants du code de procédure pénale.
* 97 Pour que le « crime ne paie pas » : consolider l'action de l'Agrasc, rapport d'information n° 421 (2016-2017) d'Antoine Lefèvre, fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 février 2017.
* 98 Agrasc, Les ventes aux enchères (site Internet).
* 99 Gendinfo (actualités de la gendarmerie nationale), Un yacht saisi par la section de recherches de Marseille vendu aux enchères au profit de l'État français, 11 avril 2025.
* 100 Neuvième alinéa de l' article 706-160 du code de procédure pénale, modifié par l'article 32 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.
* 101 Agrasc, rapport d'activité 2024.
* 102 Articles 41-5 (à l'initiative du procureur de la République) et 99-2 (à l'initiative du juge d'instruction) du code de procédure pénale.
* 103 Décision n° 2025-1156 QPC du 12 septembre 2025.
* 104 Article 707-1 du code de procédure pénale.
* 105 L'Agrasc est chargée de la vente des biens de Rifaat al-Assad, frère de l'ancien président syrien Hafez al-Assad, dont les biens ont été confisqués à la suite de sa condamnation en 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, notamment pour blanchiment du produit du détournement de fonds publics syriens. Le produit des confiscations est versé au programme 370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement », en vue de leur restitution au profit des populations locales syriennes par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
* 106 Le rapport d'activité précise que « la direction ni le conseil d'administration de l'Agrasc n'ont de marge de manoeuvre sur ces projets qui sont présentés dans une liste immuable à l'euro près par les ministères ».
* 107 Strafprozeßordnung (code de procédure pénale), § 465.
* 108 Voir notamment, pour l'Angleterre et le Pays de Galles, le Prosecution of Offences Act 1985. section 18.
* 109 Rapport n° 44, tome I (1992-1993) de Jean-Marie Girault, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant réforme de la procédure pénale, déposé le 12 novembre 1992.
* 110 Antoine Lefèvre, Amendes pénales : l'urgente modernisation du recouvrement, rapport d'information n° 330 (2018-2019), fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 février 2019.
* 111 Voir Le recouvrement des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement : un système grippé ?, Rapport d'information n° 651 (2018-2019) de Thierry Carcenac et Claude Nougeain, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 10 juillet 2019.
* 112 Projet annuel de performances de la mission « Gestion des finances publiques », annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 113 Article 1018 A du code général des impôts.
* 114 Ce droit est doublé si le prévenu n'a pas comparu personnellement et qu'il ne s'acquitte pas volontaire du droit dans un délai d'un mois.
* 115 Articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale, introduits par l'article 9 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
* 116 Rapport d'information n° 1687 sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales, présenté par Pascale Bordes et Stéphane Mazars, déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république de l'Assemblée nationale, 9 juillet 2025.
* 117 Article 1635 bis Q (ancien) du code général des impôts, créé par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et abrogé par l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
* 118 Rapport d'information n° 2183 sur l'aide juridictionnelle présenté par Philippe Gosselin et Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale, déposé le 23 juillet 2019.
* 119 Amendement n° 1703 au projet de loi de finances pour 2025, présenté par Christine Lavarde et plusieurs de ses collègues, enregistré le 22 novembre 2014.