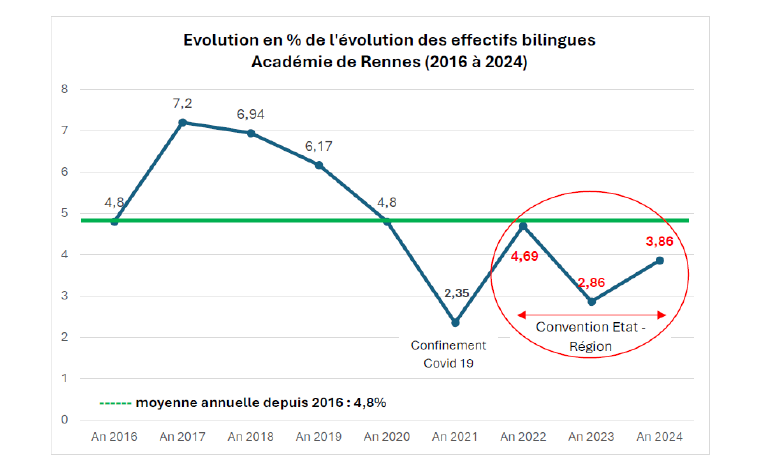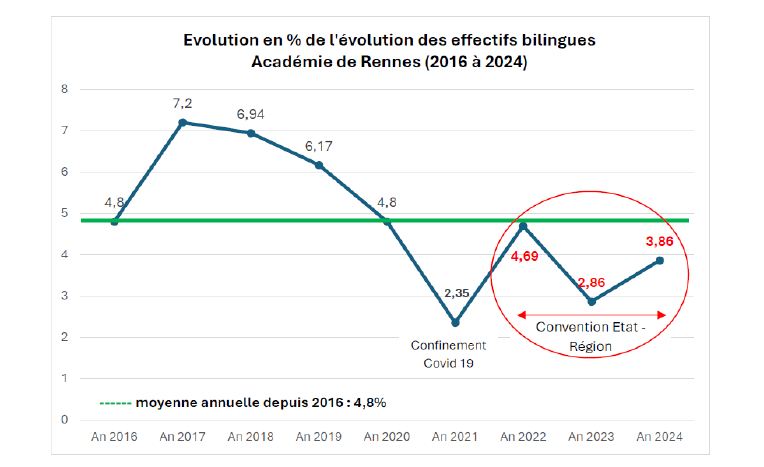- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
DE LA MISSION D'INFORMATION
- AVANT-PROPOS
- I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF
ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES
RÉGIONALES
- A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES
RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE
- B. UNE INSCRIPTION DES LANGUES RÉGIONALES
DANS LA CONSTITUTION EN 2008 SANS EFFETS MAJEURS SUR LA DÉFENSE DES
LANGUES RÉGIONALES
- C. LA LOI MOLAC : UNE LOI AMBITIEUSE POUR
PROTÉGER ET PROMOUVOIR LES LANGUES RÉGIONALES
- D. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE ENTRAÎNANT
DES INQUIÉTUDES ET MÉCONTENTEMENTS DANS LES TERRITOIRES
- A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES
RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE
- II. QUATRE ANS APRÈS LA LOI MOLAC : UNE
APPLICATION DÉCEVANTE ET DE NOMBREUX POINTS DE BLOCAGE
- A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS
INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN
TERME
- 1. Une progression des effectifs dans le premier
degré, avec d'importantes disparités entre les langues
régionales
- 2. Un effort toutefois insuffisant au regard de la
perte de vitesse des langues régionales et inégal selon les
territoires
- 3. L'abandon de l'apprentissage des langues
régionales au collège et au lycée
- 1. Une progression des effectifs dans le premier
degré, avec d'importantes disparités entre les langues
régionales
- B. DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT DANS
L'APPLICATION DU FORFAIT SCOLAIRE
- C. UN SENTIMENT D'INSATISFACTION DES ACTEURS DE
PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES QUANT À LA SIGNATURE ET MISE EN
oeUVRE DES CONVENTIONS
- A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS
INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN
TERME
- III. AU-DELÀ DES ANNONCES POLITIQUES :
L'URGENCE DE SE DONNER LES MOYENS CONCRETS D'UNE PRÉSERVATION ET D'UNE
TRANSMISSION DES LANGUES RÉGIONALES
- A. DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR
DES LANGUES RÉGIONALES
- B. DÉVELOPPER MASSIVEMENT L'ENSEIGNEMENT DES
LANGUES RÉGIONALES À L'ÉCOLE PUBLIQUE
- C. SÉCURISER FINANCIÈREMENT
L'ENSEIGNEMENT IMMERSIF PRIVÉ
- D. RENFORCER LES MOYENS HUMAINS
- 1. La nécessité d'utiliser davantage
les ressources dormantes de l'éducation nationale
- 2. La réforme de la formation
initiale : un virage à ne pas manquer
- 3. Le nombre de places ouvertes aux concours
dédiés : un enjeu de valorisation des langues
régionales
- 4. Renforcer et relancer l'apprentissage des
langues régionales dans la formation continue
- 5. Un accompagnement renforcé des
enseignants
- 1. La nécessité d'utiliser davantage
les ressources dormantes de l'éducation nationale
- E. MIEUX VALORISER LES LANGUES RÉGIONALES
DANS LE CURSUS SCOLAIRE
- F. FAIRE VIVRE LES LANGUES RÉGIONALES EN
DEHORS DE L'ÉCOLE
- A. DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR
DES LANGUES RÉGIONALES
- I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF
ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES
RÉGIONALES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES
CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LISTE DES DÉPLACEMENTS
N° 31
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission de la culture, de
l'éducation, de la communication
et du sport (1) par la mission
d'information sur la mise en oeuvre
de la loi du 21 mai 2021 relative
à la protection
patrimoniale
des
langues régionales,
dite loi Molac,
Par M. Max BRISSON et Mme Karine DANIEL,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.
L'ESSENTIEL
Plus de 70 langues régionales sont encore parlées en France. La Constitution reconnaît à son article 75-1 leur appartenance « au patrimoine de la France ». Leur utilisation et leur visibilité se sont toutefois progressivement estompées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans sursaut politique et sociétal fort, ces langues seront quasiment éteintes d'ici une à deux générations.
La loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac », vise à apporter des solutions concrètes à ce déclin des langues à travers trois axes : renforcer leur enseignement, sécuriser leur usage dans l'espace public et reconnaitre leur valeur patrimoniale. Adopté dans un large consensus, ce texte a fait naître de grands espoirs et attentes parmi les défenseurs des langues régionales, mais aussi beaucoup d'incompréhension et de la colère à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de deux de ses articles, dont celui relatif à l'enseignement immersif.
Quatre ans après l'adoption de ce texte, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a souhaité évaluer son application. Parce que la transmission familiale a quasiment disparu et que l'avenir de ces langues dépend désormais de l'école, les rapporteurs ont concentré leurs travaux sur les dispositions relatives à l'enseignement.
Malgré des avancées en termes de reconnaissance, le nombre de locuteurs continue de s'effondrer. Aussi, la commission a adopté 23 recommandations visant les objectifs suivants : renforcer leur enseignement, mieux valoriser ces langues tout au long du parcours scolaire et former davantage d'enseignants capables de les transmettre.
I. UNE LOI DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES ATTENDUE DEPUIS LONGTEMPS
A. LA LOI MOLAC : PREMIÈRE LOI DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES
À bien des égards, la loi Molac représente la première loi de promotion des langues régionales. En effet, la loi Deixone de 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux est davantage un texte de tolérance de ceux-ci que de valorisation. Quant à la réforme constitutionnelle de 2008 qui a inséré dans la Constitution un article 75-1 disposant que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », elle n'a pas eu d'effets concrets majeurs en faveur de celles-ci.
Aussi, la loi Molac a suscité auprès des défenseurs de ces langues beaucoup d'attentes et d'espoirs. Outre la sécurisation de leur usage dans l'espace public et un renforcement de leur protection patrimoniale, ce texte constitue la première loi en faveur de leur apprentissage scolaire.
Au regard de la quasi-disparition de la transmission familiale, l'école représente l'avenir des langues régionales. Aussi, les rapporteurs ont centré leurs travaux sur les articles relatifs à l'enseignement.
Ils se sont également concentrés sur les langues de France métropolitaine, la transmission familiale des langues ultramarines étant encore très forte.
La loi Molac prévoit notamment :
· un renforcement de l'enseignement des langues régionales : l'État et des collectivités territoriales deviennent les acteurs de la promotion, de l'enseignement et de la diffusion des langues régionales. En effet, dans le cadre de conventions entre l'État et les collectivités territoriales, leur enseignement peut avoir lieu lors des heures normales de cours.
· Une clarification de la participation financière des communes à la scolarisation de leurs élèves dans des établissements privés d'enseignement bilingue.
· La levée des restrictions pour l'enseignement des langues régionales à Mayotte.
B. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRAGILISANT L'AVENIR DE CES LANGUES ET SOURCE D'INCOMPRÉHENSION DANS LES TERRITOIRES
La censure partielle par le Conseil constitutionnel de deux articles de ce texte, dont celui relatif à l'enseignement immersif a conduit à une incompréhension et de nombreuses manifestations dans les territoires.
Cette décision remet en cause la possibilité du recours à l'enseignement immersif. Elle affaiblit très fortement les réseaux privés d'enseignement immersif (Diwan, Seaska, Bressola, Calandreta, ABCM-Zweitsprachigkeit et Scola corsa), alors même que des contrats d'association lient certains de ces établissements avec l'éducation nationale depuis plus de 30 ans.
En outre l'immersion a prouvé son efficacité pour former des locuteurs de bon niveau sans préjudice de la maîtrise par les élèves du français et des autres savoirs fondamentaux à la fin du primaire.
C. LA CIRCULAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021 : UNE VOIE D'APAISEMENT ET UN CADRE MODERNISÉ POUR LES LANGUES RÉGIONALES
La circulaire du 14 décembre 2021 propose un cadre modernisé à l'enseignement des langues régionales. Elle reconnait l'intérêt éducatif d'un bilinguisme français/langue régionale et appelle à développer les ouvertures de classes bilingues à l'école, au collège et au lycée.
Elle ouvre également une voie de passage pour l'enseignement immersif, renommé « méthode bilingue par enseignement immersif » en assouplissant la manière d'apprécier le respect du principe de parité horaire. Celle-ci peut désormais être calculée à l'échelle des cycles scolaires, les trois premiers cycles scolaires (jusqu'en 6ème) formant un tout.
Elle permet l'enseignement de trois langues régionales supplémentaires (le kibushi, le shimaoré et le flamand occidental) et impose le développement par le CNED d'une offre d'enseignement du basque, du breton, du corse et de l'occitan.
II. QUATRE ANS APRÈS, UN BILAN CONTRASTÉ : LES LANGUES RÉGIONALES TOUJOURS MENACÉES
A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES QUI RESTE INSUFFISANTE AU REGARD DE LA CHUTE DU NOMBRE DE LOCUTEURS
À la rentrée 2023, plus de 107 000 élèves de primaire suivent un enseignement de langue vivante régionale.
De la maternelle au lycée, ce sont 168 000 élèves qui sont concernés.
Les effectifs de primaire sont en progression de 47 % entre 2021 et 2023, soit une augmentation de près de 35 000 élèves. Cette augmentation est d'autant plus remarquable que sur la même période le nombre d'écoliers chute de 172 000 en raison de la déprise démographique.
Le nombre de filières bilingues augmente également légèrement. Les filières immersives à l'école primaire publique, bien que restant pour l'instant relativement confidentielles, se développent.
Cette évolution doit toutefois être nuancée sur trois points :
· Le rythme du développement de l'enseignement est insuffisant pour compenser la diminution du nombre de locuteurs. À titre d'exemple, plus de 60 % des brittophones sont actuellement âgés de plus de 60 ans.
· Les ouvertures de filières bilingues sont décrites comme un parcours du combattant par les acteurs concernés, avec un manque d'information des parents par l'éducation nationale et des règles d'ouverture qui changent d'une année sur l'autre.
· Les données sur les effectifs transmises par le ministère de l'éducation nationale ne font pas la distinction entre les différentes intensités dans l'apprentissage de ces langues, qui peuvent varier de quelques heures par an dans le cadre d'une sensibilisation ou initiation à un volume hebdomadaire plus élevé avec l'enseignement renforcé (3 heures par semaine), la parité horaire voir l'enseignement immersif.
B. UN ABANDON MASSIF DE L'APPRENTISSAGE DES LANGUES RÉGIONALES À L'ENTRÉE DANS LE SECONDAIRE
L'entrée au collège constitue souvent une première rupture dans l'apprentissage des langues régionales qu'accentue ensuite l'entrée au lycée. La réforme du lycée et du baccalauréat, en marginalisant la place des options dans les emplois du temps et leur reconnaissance au baccalauréat, a accéléré la chute des effectifs.
|
ont présenté une LVC langue régionale au baccalauréat |
ont présenté une discipline non linguistique en langue régionale au baccalauréat |
ont conservé une spécialité LLCR-langue régionale en terminale |
C. DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT DANS L'APPLICATION DU FORFAIT SCOLAIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT IMMERSIF
Les modifications apportées aux conditions de versement du forfait scolaire pour les établissements d'enseignement privés n'ont pas permis d'apaiser les tensions. Celles-ci portent sur le principe même de ce versement, sur les conditions permettant aux communes d'en être exonérées ainsi que sur le montant du forfait scolaire.
D. DES ATTENTES DÉÇUES QUANT À LA SIGNATURE ET LA MISE EN oeUVRE DE CONVENTIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES
Quatre ans après le vote de la loi, le bilan des conventions signées entre l'État et les collectivités territoriales pour la promotion des langues régionales est très mitigé. Ces conventions devraient constituer un élément structurant pour l'ensemble des partenaires et permettre de fixer des trajectoires.
Toutefois, la déception est forte pour les promoteurs des langues régionales : des territoires ne sont toujours pas couverts, certaines conventions n'ont pas été renouvelées ou ne sont pas appliquées.
Enfin, la mise en oeuvre de ces conventions bute sur un contexte budgétaire tendu et incertain, ainsi que sur une très forte carence en ressources humaines : trop peu d'enseignants maîtrisent les langues régionales, ce qui freine l'ouverture de nouvelles filières d'enseignement renforcé (3 heures par semaine), bilingues, voire immersives.
III. UNE URGENCE : SE DONNER LES MOYENS CONCRETS DE LA
PRÉSERVATION ET DE LA TRANSMISSION DES LANGUES
RÉGIONALES
Nombreux ont été les ministres à affirmer leur attachement aux langues régionales. Ces propos tenus à la tribune des assemblées doivent se concrétiser dans les politiques publiques.
La commission a défini 5 axes d'actions, qui doivent être mis en oeuvre sans délai, pour contrer le déclin rapide du nombre de locuteurs des langues régionales. Si rien ne change, celles-ci pourraient être définitivement éteintes à court terme.
Axe n° 1 : élaborer au niveau national une politique publique en faveur des langues régionales. La promotion et l'enseignement des langues régionales relèvent aujourd'hui davantage de rapports de force et de négociations bilatérales que d'une politique nationale assumée. Il en résulte d'importantes différences dans leurs prises en compte par les services déconcentrés et un manque d'impulsion au niveau national.
Axe n° 2 : développer une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique. Une politique ambitieuse en faveur des langues régionales implique que leur apprentissage ne soit plus l'apanage de l'école privée. L'école publique doit se donner les moyens de former des locuteurs de bon niveau, à travers le développement de filières bilingues et immersives ainsi que la mise en place d'une continuité des parcours bilingues de la maternelle au lycée.
Axe n° 3 : sécuriser financièrement les réseaux privés associatifs d'enseignement privé. Ces réseaux participent à la sauvegarde des langues régionales et leur action est reconnue par l'État depuis plus de 30 ans.
Axe n° 4 : renforcer les moyens humains. La carence en moyens humains est le principal frein au développement de l'enseignement des langues régionales. Pour y remédier, une triple action est nécessaire : utiliser davantage les ressources dormantes de l'éducation nationale, renforcer la place de ces langues dans la formation initiale et accroitre les efforts dans l'accompagnement des personnels (formation continue, matériel pédagogique).
Axe n° 5 : mieux valoriser les langues régionales tout au long de la scolarité. Une meilleure reconnaissance passe par la possibilité de composer certaines épreuves des examens (brevet, baccalauréat) en langue régionale ainsi que par la mise en place d'une certification du niveau de langue.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
DE LA MISSION D'INFORMATION
· Axe n° 1 - Pour une politique publique nationale en faveur des langues régionales
Recommandation n° 1 : Définir une stratégie nationale de l'enseignement et de la promotion des langues régionales afin de garantir une égale impulsion dans l'ensemble des territoires concernés.
Recommandation n° 2 : Prévoir pour chaque langue régionale une convention couvrant l'ensemble du territoire linguistique entre l'État, les collectivités territoriales et lorsqu'il existe l'office public de la langue concernée, et le cas échéant prévoir a minima une déclinaison académique de celle-ci.
Recommandation n° 3 : Réunir régulièrement les comités académiques des langues régionales et renforcer les liens entre ceux-ci et les observatoires des dynamiques rurales, afin de mettre en place à l'échelle territoriale une stratégie pluriannuelle de promotion des langues régionales.
Recommandation n° 4 : Préciser que la reconnaissance des langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France (Art. 75-1 de la Constitution) implique de pouvoir former des locuteurs complets dans ces langues, condition indispensable à leur sauvegarde. Il s'agit de sécuriser l'enseignement immersif, méthode pédagogique visant au bilinguisme intégral et à former des locuteurs complets en français et en langue régionale. Une révision de la Constitution pourrait être utile afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale.
Recommandation n° 5 : Assurer le renouvellement des conventions entre l'État et chacun des réseaux d'enseignement immersif.
· Axe n° 2 - Pour le développement d'une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique
Recommandation n° 6 : Développer pour l'ensemble des langues régionales un enseignement bilingue à parité horaire à l'école primaire et offrir la possibilité d'un enseignement immersif dans les cycles 1 et 2 de l'école primaire.
Recommandation n° 7 : Mettre fin à l'érosion des effectifs entre le primaire et le secondaire en assurant la continuité des parcours scolaires.
Recommandation n° 8 : Instaurer, dans les territoires où la demande d'ouverture de filières bilingues émanant des parents est globalement satisfaite, une politique fondée sur l'offre afin de rendre ces filières accessibles au plus grand nombre, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La scolarisation des enfants dans une filière bilingue resterait soumise à la libre adhésion des parents.
· Axe n° 3 - Pour une sécurisation financière des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif
Recommandation n° 9 : Afin d'apaiser les tensions relatives au versement du forfait scolaire dans le cadre d'un enseignement des langues régionales :
- définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire ;
- clarifier les cas où le versement du forfait scolaire est dû au regard du volume horaire d'enseignement de la culture et langue régionales proposé dans une école de la commune ;
- préciser la procédure de médiation conduite par le préfet ;
- faire assurer par les préfets le mandatement d'office, lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord trouvé avec l'établissement scolaire.
· Axe n° 4 - Pour un renforcement des moyens humains
Recommandation n° 10 : Recenser nationalement et dans les départements concernés pour chaque langue régionale les professeurs maîtrisant celle-ci à un niveau suffisant pour l'enseigner (niveau B2 ou C1 du cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) et souhaitant l'enseigner. Faire de même avec ceux disposant d'un niveau inférieur mais volontaires pour être formés afin de l'enseigner.
Recommandation n° 11 : Permettre à des professeurs titulaires du CAPES dans une discipline non linguistique (DNL), de dispenser une partie ou la totalité de leur cours en langue régionale, après vérification de leur niveau de langue et de leur capacité à le faire par un inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) - langue régionale afin de faciliter le développement de l'enseignement de DNL en langue régionale au collège.
Recommandation n° 12 : Permettre un amorçage puis un ancrage de l'enseignement d'une langue régionale au sein d'une école :
- par le recours aux postes à profil (POP) impliquant un engagement de trois ans sur le même poste dans les filières bilingues ou immersives ;
- par l'attribution d'une bonification au barème en cas d'engagement du professeur à rester 6 ans soit le double de la durée de l'engagement actuel lié à un POP.
Recommandation n° 13 : Dans le cadre de la réforme de la formation initiale, prévoir :
- parmi les licences de préparation aux concours d'enseignant du premier degré qu'une partie du volume horaire se fasse en langue régionale ;
- en master, qu'au moins 50 % des enseignements soient en langue régionale
pour les lauréats des CRPE spécifiques ;
- la possibilité, tout au long du parcours universitaire, de suivre des cours de langue régionale ainsi que des cours de matière disciplinaire en langue régionale, pour permettre aux futurs professeurs - y compris ceux ne préparant pas le CRPE spécial - d'enseigner en langue régionale.
Recommandation n° 14 : Prévoir systématiquement l'organisation des stages en master dans des classes bilingues ou immersives pour les étudiants lauréats des CRPE spéciaux langue régionale.
Recommandation n° 15 : Afin de favoriser le développement de filières bilingues dans le secondaire et de garantir la qualité des enseignements, élargir la liste des bivalences possibles entre une DNL et une langue régionale.
Recommandation n° 16 : Poursuivre les efforts en matière de formation continue en sécurisant les financements et en communiquant davantage auprès des professeurs sur l'existence de stages intensifs en langue régionale.
Recommandation n° 17 : Développer des matériels pédagogiques adaptés, notamment des documents traduits pour les disciplines non linguistiques.
Recommandation n° 18 : Créer une spécialité « langue régionale » au sein du corps des IA-IPR pour mieux accompagner les professeurs et nommer dans tous les départements concernés par les langues régionales un conseiller pédagogique « langue régionale ».
Recommandation n° 19 : Autoriser l'élargissement des périmètres d'action des IA-IPR et des conseillers pédagogiques « langue régionale », afin que les limites administratives d'une académie n'entravent pas l'accompagnement des professeurs et l'apprentissage linguistique par les élèves dans le territoire voisin partageant la même langue régionale, notamment en cas de vacance de postes.
· Axe n° 5 - Pour une meilleure valorisation des langues régionales tout au long de la scolarité
Recommandation n° 20 : Réaffirmer, à la suite de la réforme du diplôme national du brevet pour la session 2026, la possibilité pour les élèves volontaires de composer certaines épreuves du brevet en langue régionale. Inscrire cette possibilité dans un cadre national pour assurer une équité entre les élèves qui reçoivent un enseignement en langue régionale.
Recommandation n° 21 : Permettre aux élèves volontaires de passer en langue régionale la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. Élargir cette possibilité aux spécialités ou au grand oral.
Recommandation n° 22 : Procéder dans chaque académie au recensement des correcteurs disposant d'un niveau suffisant en langue régionale.
Recommandation n° 23 : Proposer aux élèves à la fin du primaire, du collège et en classe de terminale une certification en langue régionale visant à évaluer leur niveau au regard du cadre européen commun de référence (A1 à C2) sur le modèle d'Ev@lang au collège pour l'anglais afin que les langues régionales bénéficient du même niveau de reconnaissance que les autres langues vivantes européennes. Inscrire cette certification sur le diplôme national du brevet ou du baccalauréat.
AVANT-PROPOS
Dès la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, la consolidation de notre République est caractérisée par une volonté farouche d'éradiquer, au nom de l'unité nationale, les particularismes locaux, au premier rang desquels figurent ce que nous appelons aujourd'hui les langues régionales et de les reléguer dans la sphère privée.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de manière variable selon les régions, leur transmission au sein des familles décline progressivement au profit du français, symbole de modernité et d'ascension sociale. Cette rupture, particulièrement forte sur le territoire hexagonal, se manifeste au sein d'une même famille où la langue régionale maternelle est pratiquée avec les enfants nés à la fin des années 50 et non leurs frères et soeurs nés une dizaine d'années plus tard.
La loi Deixonne de 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux reconnaît certes leur existence, mais est davantage un texte de tolérance de ceux-ci à l'école au service des apprentissages fondamentaux que de valorisation.
Face au déclin de ces langues, les militants associatifs puis les élus locaux se mobilisent à partir des années 1970. Les premières classes bilingues publiques et les premières écoles immersives associatives, bientôt fédérées en réseaux et passant sous contrat d'association avec l'État dans les années 1990, apparaissent. La question de la ratification par la France de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1999 met sur le devant de la scène sociétale et politique le débat sur la place et la reconnaissance de ces langues, mais aussi alerte sur les dangers qui pèsent sur celles-ci, en raison de la diminution du nombre de locuteurs.
Neuf ans plus tard, les langues régionales sont inscrites dans la Constitution à l'article 75-1 qui dispose qu'« elles appartiennent au patrimoine de la France ».
Toutefois, cette modification du texte fondamental de notre pays reste à l'état de symbole, sans conséquences concrètes.
Constatant cette inertie, notre collègue député Paul Molac, dépose le 30 décembre 2019 sa proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Faisant l'objet d'un large consensus au sein des deux chambres, tout groupe politique confondu, elle est adoptée le 8 avril 2021.
À bien des égards, il s'agit du premier texte concret de promotion des langues régionales. Son adoption fait naître de nombreuses attentes et espoirs - mais aussi des inquiétudes et une certaine colère sur les territoires à la suite de la censure de deux articles par le Conseil constitutionnel dont celui relatif à l'enseignement immersif.
Quatre ans après le vote de cette loi, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a inscrit dans son programme de contrôle une évaluation transpartisane de ce texte.
Les rapporteurs, dans un souci de précision et d'efficience, ont souhaité centrer leurs travaux sur les articles relatifs à l'enseignement. En effet, alors que, pour beaucoup de langues, la transmission familiale est devenue marginale, le futur des langues régionales passe nécessairement par l'école.
Par ailleurs, ils ont également restreint pour l'essentiel le champ de leur rapport au territoire métropolitain. À cet égard, ils soulignent la spécificité des langues ultramarines sur deux points :
- d'une part, l'usage social de ces langues, tout comme leur utilisation dans un contexte familial sont encore importants ;
- d'autre part le cadre applicable aux territoires d'outre-mer est différent en raison de lois organiques spécifiques.
Les auditions et travaux des rapporteurs mettent en évidence l'urgence de la situation : leurs locuteurs étant très majoritairement âgés de plus de 60 ans - témoins d'une transmission dans un cadre familial aujourd'hui quasiment disparue - la plupart des langues régionales s'éteindront en l'espace d'une génération1(*) si une politique publique ambitieuse n'est pas mise en oeuvre immédiatement.
I. LA LOI MOLAC : UN TEXTE LÉGISLATIF ATTENDU FACE À LA MENACE D'EXTINCTION DE NOMBREUSES LANGUES RÉGIONALES
A. LE LONG CHEMIN DE LA RECONNAISSANCE DES LANGUES RÉGIONALES PAR L'ÉDUCATION NATIONALE
On dénombre plus de 70 langues régionales en France. Si plusieurs d'entre elles font l'objet d'un usage quotidien et d'une transmission familiale dans les territoires d'outre-mer, on constate sur le territoire métropolitain une très forte diminution de leur utilisation.
Il n'existe pas de recensement exhaustif du nombre de locuteurs de langues régionales. Toutefois, les rapporteurs ont pris connaissance d'enquêtes sociologiques d'utilisation et de compréhension de certaines langues régionales, réalisées par les offices publics ou des collectivités territoriales. Le constat est sans appel : la transmission familiale est désormais extrêmement minoritaire et le pourcentage de locuteurs diminue.
Éléments de pratiques de langues régionales
L'enquête sociologique réalisée par la région Bretagne en 2024 montre une baisse du nombre de locuteurs, aussi bien pour le breton (2,7 % des personnes interrogées déclarent le parler très bien ou bien - soit une baisse de 3 points par rapport à 2018) que pour le gallo (3,3 % déclarent le parler très bien ou bien - soit une baisse de 1,8 %). Si pour le gallo, le principal moyen de transmission reste la cellule familiale (68 %) tandis que l'apprentissage est minoritaire (17 %), pour le breton, l'apprentissage par l'enseignement prédomine (78 % avec une progression de 10 points par rapport à 2018) tandis que la transmission familiale baisse de 10 points pour atteindre 16 %. Enfin, 60 % des locuteurs ont plus de 60 ans.
Pour l'alsacien, 36 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage réalisé en 2022 par la collectivité européenne d'Alsace2(*) déclarent le parler très bien, 10 % assez bien, 19 % comprendre quelques mots et 34 % ne pas le parler du tout. Surtout, cette enquête montre une baisse de la maîtrise de cette langue chez les jeunes générations. La maîtrise de l'alsacien est de 70 % à partir de 55 ans ; elle n'est plus que de 9 % chez les 18-24 ans. Cette enquête met également en avant la perte de la transmission familiale. Seuls 30 % des personnes déclarant bien ou très bien parler l'alsacien indiquent que leurs enfants parlent très bien cette langue.
Pour le basque, 70 % des personnes interrogées dans le pays basque français 3(*) indiquent ne pas être bascophones, en progression de 6 points par rapport à 2021.
Enfin, pour l'occitan, 7 % des personnes interrogées dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ainsi que dans le Val d'Aran en Espagne4(*) déclarent parler occitan sans difficulté ou suffisamment pour tenir une conversation simple. Cette proportion varie fortement selon les départements. Elle n'est que de 2 % dans les départements fortement urbanisés, mais atteint 22 % pour les territoires plus ruraux.
Alors que la population concernée indique être attachée aux langues régionales5(*), leur renouveau passe nécessairement par un apprentissage scolaire.
Or, l'école sous la Troisième République s'est construite contre les langues régionales. Il est d'ailleurs à noter que la méfiance de la République vis-à-vis de ces langues susceptibles de remettre en cause son unicité reste latent comme en témoignent les discussions au Conseil constitutionnel sur la charte des langues régionales en 1999 - « Qu'est-ce que l'engagement des parties à éliminer toute action ayant pour but de “décourager, de mettre en danger le maintien ou le développement d'une langue régionale ?” Qu'est-ce que cet engagement sinon la négation des principes sur lesquels a été fondée la République ? Faut-il vraiment rappeler le combat des instituteurs de Jules Ferry, ces “hussards noirs de la République”, qui n'ont justement eu de cesse de décourager le maintien ou le développement des langues régionales, pour édifier l'unité du pays ? »6(*) - ou plus récemment le discours du Président de la République à l'Académie française en 2024 : « la langue a été le creuset de l'unité du Pays d'abord de ses textes administratifs, des lois et des jugements prononcés elle a été la fabrique d'une nation qui sinon s'échappait entre ses langues vernaculaires, ses patois, ses différentes langues régionales, qui pour nombre d'entre elles existent encore mais étaient un instrument au fond de division de la Nation »7(*).
La loi du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, dite loi Deixonne, est le premier texte législatif à reconnaître l'existence des langues régionales et la possibilité de leur utilisation et apprentissage dans un cadre scolaire. Toutefois, il s'agit davantage d'une tolérance de celles-ci que de leur valorisation. Leur apprentissage est certes permis, mais en dehors du temps scolaire normal. Par ailleurs, elles sont perçues comme une ressource pédagogique à disposition des enseignants pour faciliter les apprentissages du français. Ainsi, l'article 2 de cette loi précise que « des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française ».
D'abord limité au basque, au breton, à l'occitan et au catalan, l'enseignement des langues régionales a progressivement été élargi au corse (1974), au tahitien (1981), ou encore aux langues régionales d'Alsace et langues régionales des pays mosellans.
Une nouvelle étape est franchie avec la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de refondation de l'école de la République. Elle prévoit que l'enseignement des langues régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, prioritairement dans les régions où elles sont pratiquées, sous forme d'un enseignement facultatif de la langue et de la culture régionale ou d'un enseignement bilingue. Par ailleurs, les activités périscolaires organisées dans les établissements scolaires par les collectivités territoriales peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
Enfin, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dispose que le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations portant sur l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale.
Un cadre spécifique pour la Corse et l'Outre-mer
La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse reconnait une spécificité pour l'apprentissage de la langue corse : en application de l'article L. 312-11-1 du code de l'éducation la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
Les langues régionales ultramarines bénéficient également d'une reconnaissance particulière. La loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion donne compétence aux conseils régionaux ultramarins pour définir « les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région ».
La loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 dispose que « les langues régionales en usage dans les départements d'Outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage ». Depuis la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, toutes les langues régionales ultramarines font partie « du patrimoine linguistique de la Nation ».
Les langues kanak en Nouvelle-Calédonie ont un statut particulier. En effet, l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 qui a été constitutionnalisé dispose que « les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie ».
Quant aux langues polynésiennes, l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 2 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française ».
B. UNE INSCRIPTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS LA CONSTITUTION EN 2008 SANS EFFETS MAJEURS SUR LA DÉFENSE DES LANGUES RÉGIONALES
Lors des débats en 2008 sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République, à l'initiative de plusieurs députés, l'Assemblée nationale a introduit dans la Constitution le principe selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »8(*). Il s'agissait de permettre le vote d'une loi sur les langues régionales promise par Christine Albanel, alors ministre de la Culture à l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale le 7 mai 2008. Cette intervention en elle-même était porteuse de promesses : pour la première fois, un gouvernement de la Vème République prenait l'initiative d'organiser un débat sur ce sujet, dans un contexte marqué par la ratification du traité de Lisbonne9(*).
Toutefois, l'inscription des langues régionales dans la Constitution n'a pas modifié le carcan des modalités de leur enseignement. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2011-130 du 20 mai 2011, l'article 75-1 de la Constitution ne constitue ainsi pas un droit ou une liberté opposable à un particulier ou aux collectivités territoriales. En l'espèce, les requérants représentant plusieurs associations de promotion des langues régionales estimaient que les dispositions du code de l'éducation relatives à l'apprentissage des langues régionales ne garantissaient pas une protection efficace et effective de l'enseignement de ces langues.
Le cadre constitutionnel préexistant à la réforme de 2008 reste applicable. Afin de respecter le principe constitutionnel selon lequel la langue de la République est le français (article 2 de la Constitution), l'apprentissage des langues régionales :
· ne peut avoir un caractère obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants (DC n° 2001-454 du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, DC n° 2004-490 du 12 février 2004 sur la loi portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Ce caractère facultatif s'applique même si l'enseignement des langues régionales se fait dans le cadre de l'horaire normal des écoles ;
· et ne doit pas avoir pour objet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l'ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celuici (DC n° 91-290 du 9 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse) ;
· de plus, l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves ni dans la vie de l'établissement ni dans l'enseignement des disciplines autres que celle de la langue considérée (même décision).
Malgré les promesses gouvernementales, aucun projet de loi relatif à la promotion des langues régionales n'a été déposé depuis 2008. Comme le souligne notre collègue député Paul Molac dans le cadre de l'examen de sa proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, « en tant que tel, l'article 75-1 ne donne en effet aucun droit sans déclinaison législative ultérieure ».
C. LA LOI MOLAC : UNE LOI AMBITIEUSE POUR PROTÉGER ET PROMOUVOIR LES LANGUES RÉGIONALES
À bien des égards, la loi Molac constitue la première loi de défense et de promotion des langues régionales. Pour la première fois depuis longtemps, ce sujet a pu être traité sans polémique autour d'une remise en cause de l'unité de la République. C'est dans un contexte serein et technique que les débats se sont déroulés au Sénat.
Cette loi contient trois volets : le renforcement de l'enseignement des langues régionales, la sécurisation juridique de leur utilisation dans l'espace public et la reconnaissance de leur valeur patrimoniale.
· Le renforcement de l'enseignement des langues régionales
L'article premier fait de l'État et des collectivités territoriales les acteurs de la promotion, de l'enseignement et de la diffusion des langues régionales. Lors de son audition par les rapporteurs, Paul Molac, auteur du texte, a souligné l'importance de cet article qui reconnaît le rôle des collectivités territoriales, notamment en matière d'enseignement et sécurise leurs actions. Prenant l'exemple de l'apprentissage du breton, il a souligné la position en retrait du rectorat « qui a déjà beaucoup d'autres sujets à traiter » en comparaison au volontarisme de la région Bretagne. Selon lui, pour que la promotion des langues régionales et leur enseignement avancent, « il faut que les collectivités territoriales s'en emparent ». Les rapporteurs partagent cet avis sur le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités - qui selon les territoires peuvent être le conseil régional, le département, le bloc communal ou un groupement rassemblant plusieurs d'entre elles à l'image de l'office public de la langue basque10(*).
Autre disposition de cette loi, l'article 5 supprime les restrictions à l'enseignement des langues régionales à Mayotte.
Enfin, l'article 6 clarifie la participation financière des communes à la scolarisation dans un établissement privé sous contrat proposant un enseignement de langue régionale situé sur une autre commune lorsque la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
Cet article vise à préciser les modalités de paiement du forfait scolaire aux écoles privées proposant un enseignement en langue régionale. En effet, la rédaction issue de la loi pour une école de la confiance de 2019 était source de crispation entre les maires, les parents d'élèves et les écoles privées proposant un enseignement en langue régionale.
L'existence d'un forfait scolaire pour les
écoles privées immersives associatives :
les contours
flous dans la loi pour une école de la confiance de 2019
Le débat sur la possibilité de permettre aux écoles bilingues sous contrat de bénéficier du versement communal des communes est ancien, notamment en Bretagne en faveur du réseau Diwan. En février 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait indiqué dans son discours sur les principaux volets du contrat public pour la Bretagne, en accord avec Loïg Chesnais-Girard, Président du conseil régional « laisser aux communes de Bretagne, représentées au sein de la conférence territoriale de l'action publique, et à la CTAP [conférence territoriale de l'action publique] plus globalement, le soin de se prononcer sur la possibilité d'élargir le forfait scolaire aux écoles bilingues sous contrat. Si les maires sont d'accord et que la CTAP émet un avis favorable, alors le Gouvernement en tiendra compte pour proposer les modifications législatives nécessaires ».
Afin de traduire cet engagement, le Sénat avait voté lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance un amendement de Maryvonne Blondin prévoyant pour les établissements privés sous contrat du premier degré dispensant un enseignement de langue régionale, et après accord de la CTAP, que la commune de résidence de l'élève et la commune d'accueil de l'école privée sous contrat s'accordent sur le montant d'une participation financière - à la condition que la commune de résidence ne dispense pas d'enseignement de langue régionale. À défaut d'accord, le préfet réunit les maires afin de permettre la résolution de ce différend financier.
Toutefois, lors de la commission mixte paritaire, cette rédaction a connu une double évolution. Premièrement, la référence à un accord de la CTAP a été supprimée. Deuxièmement et surtout, cette contribution a pris un caractère facultatif. Il en est résulté dans de nombreux cas, un refus de contribution de la part de la commune de résidence ou une contribution fortement inférieure à celle due au titre du forfait communal. Comme l'a souligné l'un des rapporteurs, par ailleurs auteur de l'amendement créant l'article 6 dans la loi Molac, « rien qu'en Bretagne, 56 demandes d'arbitrage sont à la charge des préfets. Les relations entre élus communaux, en premier lieu les maires, d'une part, et les parents et les structures des écoles, d'autre part, se tendent ».
L'article 7 permet, dans le cadre de conventions signées entre l'État et les collectivités territoriales concernées, l'enseignement de la langue régionale dans le cadre de l'horaire normal des cours, avec pour objectif de proposer cet enseignement à tous les élèves des territoires concernés et ainsi entrer dans une logique de l'offre afin de généraliser la possibilité de leur apprentissage.
Enfin, la loi prévoit deux rapports annuels relatifs à l'enseignement des langues régionales. Le premier doit permettre de dresser un état des lieux de l'accueil des enfants dont les familles ont fait une demande de scolarisation en langue régionale le plus près possible de leur domicile dans une école maternelle ou infantile.
Le deuxième porte notamment sur l'opportunité pour les établissements scolaires associatifs proposant un enseignement immersif en langue régionale de bénéficier d'un contrat simple ou d'association avec l'État.
À ce jour, quatre ans après l'adoption de la loi, aucun de ces rapports n'a été remis par le Gouvernement au Parlement.
· Une sécurisation juridique de leur usage dans l'espace public
La promotion des langues régionales passe par leur inscription et leur visibilité dans l'espace public. Force est de constater que ni le constituant, ni le législateur, ni le gouvernement n'ont souhaité empêcher leur utilisation de manière concomitante au français. La décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 du 29 juillet 1994 sur la loi relative à l'emploi de la langue française est d'ailleurs explicite sur la compatibilité entre le français et les langues régionales : « Considérant que la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l'usage obligatoire de la langue française dans les lieux ouverts au public, dans les relations commerciales, de travail, dans l'enseignement et la communication audiovisuelle ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée (etc.) ».
Il en est de même des prises de position des gouvernements successifs, comme en témoignent les propos de Christine Albanel, alors ministre de la Culture en 2008 devant le Sénat « Qui, par exemple, même parmi les législateurs et parmi les élus, sait qu'une collectivité territoriale peut publier les actes officiels qu'elle produit dans une langue régionale, dès lors que ces textes apparaissent comme une traduction du français, qui naturellement - puisque “la langue de la République est le français” - seul fait foi ? ».
Toutefois, certains élus ont été confrontés à une interprétation parfois trop stricte par le juge administratif de la « loi Toubon ».
Afin de lever toute ambiguïté, l'article 8 de la loi Molac permet aux services publics de recourir à des traductions bilingues sur la signalétique, mais aussi sur les principaux supports de communication institutionnelle.
· La reconnaissance de leur valeur patrimoniale
En inscrivant la notion de « patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » dans le code du patrimoine, l'article premier de la loi souligne leur valeur patrimoniale, au même titre que le patrimoine bâti. Il permet également de rappeler que l'État et les collectivités territoriales participent à leurs valorisation, promotion et diffusion.
D. UNE CENSURE PARTIELLE DU TEXTE ENTRAÎNANT DES INQUIÉTUDES ET MÉCONTENTEMENTS DANS LES TERRITOIRES
1. Deux articles de la loi censurés par une interprétation stricte du Conseil constitutionnel
À la suite de la saisine par 61 députés, le Conseil constitutionnel a censuré11(*) deux articles de cette loi, à savoir l'utilisation des signes diacritiques (art. 9) et la possibilité du recours à l'enseignement immersif (art. 4).
Une saisine parlementaire du Conseil constitutionnel chaotique
Contre la position des principaux groupes majoritaires, 61 députés de la majorité ont saisi « à titre individuel » le Conseil constitutionnel. 4 députés signataires ont ensuite demandé à ne pas être comptés parmi les signataires « en invoquant le fait qu'ils auraient soit exprimé leur souhait de retirer leur signature auprès d'un de leur collègue avant le dépôt officiel de la saisine, soit signé “de manière précipitée”, soit commis une “erreur” sans autre précision »12(*). La comptabilisation ou non de ces 4 parlementaires est particulièrement importante : sans ceuxci, le nombre minimal de 60 députés ou sénateurs, prévus par l'article 61 de la Constitution pour saisir le Conseil constitutionnel n'est pas atteint.
Le Conseil constitutionnel estimant, au regard des précisions apportées par les députés pour préciser leurs demandes de retrait, qu'il ne s'agissait ni d'erreurs matérielles, ni de fraude ou de vice de consentement, a refusé cette demande. En effet, comme il avait eu l'occasion de le rappeler dans une précédente décision13(*), « aucune disposition de la Constitution non plus que de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité engagé. Dès lors, hormis les cas d'erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens ».
Si la censure de l'article 9 relative à la reconnaissance des langues régionales dans les actes civils a davantage une portée symbolique, celle de l'article 4, qui reconnaît la possibilité d'un enseignement immersif en langue régionale « sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française » a été un séisme pour les acteurs locaux de défense des langues régionales. En effet, en déclarant non conforme à la Constitution l'enseignement immersif, cette décision crée une insécurité juridique forte :
· pour les réseaux associatifs d'enseignement immersif des langues régionales qui ont recours à cette méthode et dont certains de leurs établissements ont signé un contrat d'association avec le ministère de l'éducation nationale depuis près de trente ans (1994 pour les premiers) ;
· pour les projets pédagogiques de certains établissements publics : en 2021, il existait au Pays Basque quatre écoles publiques qui, à titre expérimental, avaient recours à un enseignement immersif du basque.
Or, l'article L. 314-2 du code de l'éducation qui autorise les expérimentations pédagogiques les limite également dans le temps - cinq années maximum. La décision du Conseil constitutionnel semble fermer la porte à toute extension ou reconduction de celles-ci.
Sensibilisation renforcée, bilinguisme et
immersion :
trois modalités d'apprentissage des langues
régionales
L'article L. 312-10 du code de l'éducation prévoit deux modalités d'enseignement des langues et cultures régionales :
L'enseignement de la langue et de la culture régionale, qui peut prendre la forme d'une initiation ou d'un enseignement renforcé représentant alors un volume horaire de 3 heures. Au collège, afin de favoriser l'enseignement des langues régionales, si l'enfant a appris au primaire une langue régionale ou une langue autre que l'anglais, il pourra poursuivre son apprentissage en plus de l'anglais. Cet enseignement facultatif sera alors de 2 heures (contre 4 heures pour la LV1 obligatoire). De la 5ème à la 3ème, la langue régionale peut être choisie comme langue vivante, pour un volume horaire de 3 heures par semaine pour la LV1 et 2h30 pour la LV2.
L'enseignement bilingue : il repose sur le principe d'un enseignement de la langue régionale et d'une utilisation de celle-ci pour l'enseignement d'autres disciplines, pouvant aller jusqu'à la parité horaire (soit un maximum de 12 heures d'enseignement de et en langue régionale et au moins 12 heures d'enseignement en français au primaire).
Par ailleurs, l'enseignement immersif s'est également développé, principalement dans les réseaux privés d'enseignement des langues régionales (diwan, seaska, calandreta, bressola, scola corsa, ABCM-Zweitsprachigkeit). Les enseignements se déroulent dans une très large proportion en langue régionale, voire dans certains réseaux intégralement en langue régionale dans les petites classes, le français étant progressivement introduit au cours élémentaire.
La décision du Conseil constitutionnel, notamment la censure de l'article de loi reconnaissant la possibilité de l'enseignement immersif a suscité une incompréhension forte ainsi que de nombreuses manifestations dans les territoires concernés.
Lors de leurs auditions, l'ensemble des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif ont alerté sur les conséquences de cette décision pour leurs établissements. Comme l'a souligné Joseph Turchini, Président d'Eskolim, la fédération des réseaux d'enseignement des langues régionales en immersion, « cette décision du Conseil constitutionnel fait que l'existence même de nos réseaux - qui font un travail fondamental pour l'enseignement des langues régionales et la transmission de ce patrimoine - peut être remise en cause du jour au lendemain ».
Face à ce constat, le Premier ministre, Jean Castex, a confié à deux députés, Christophe Euzet et Yannick Kerlogot, une mission sur l'enseignement des langues régionales14(*) visant spécifiquement à examiner les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l'article relatif à l'enseignement immersif, tant pour l'enseignement public que pour les réseaux associatifs.
Il s'agissait notamment « d'analyser les effets concrets de cette décision au regard de sa portée juridique, tant sur le plan pédagogique que sur les aspects partenariaux et financiers » ainsi que de « formuler des propositions tenant au cadre juridique et aux modalités pratiques de l'offre pédagogique (scolaire, périscolaire et extrascolaire) permettant de conforter l'action des réseaux associatifs »15(*).
Ceux-ci estiment notamment que l'enseignement immersif des langues régionales peut être conforme à la Constitution si quatre conditions sont réunies :
· le caractère facultatif de l'enseignement immersif ;
· la maîtrise des deux langues : à cet égard, ils préconisent de mettre en évidence la qualité des résultats des élèves en français ;
· le français comme langue de communication de l'établissement : ils suggèrent de rappeler que la langue de communication des établissements avec les acteurs institutionnels (lors des conseils d'école) ou avec les parents usagers est le français ;
· le français comme langue principale d'enseignement : ils proposent pour cela de tenir compte du temps scolaire calculé sur l'ensemble de l'année voire sur un ou plusieurs cycles d'enseignement - par exemple en introduisant plus tôt le français, dès le CE1 et « d'engager une discussion en vue d'aménager un temps supplémentaire réservé à l'enseignement du français dès la maternelle », tout en reconnaissant que ce point « est susceptible de rencontrer davantage de résistances ».
Si les trois premiers points ne soulèvent pas de difficultés particulières - notamment pour la langue de l'établissement, celui-ci ayant généralement recours à une communication bilingue car de nombreux parents ne maîtrisent pas la langue régionale - le dernier point apparaît plus problématique. Certes, l'introduction du français a déjà lieu en CE1 pour la plupart des réseaux comme le montre l'encadré ci-après. En revanche, l'introduction du français en maternelle représenterait un changement de philosophie profond pour ces établissements qu'aucun des acteurs de terrain ne souhaite actuellement.
Les établissements associatifs d'enseignement immersif : une introduction tardive du français assumée au service d'une meilleure maîtrise de la langue régionale
Les établissements d'enseignement immersif se caractérisent par l'utilisation exclusive de la langue régionale en classe maternelle et en CP. Le français est progressivement introduit en CE1, selon des modalités qui varient en fonction des réseaux.
Pour le réseau calendreta (occitan), les enfants ont 3 heures de cours en français en CE1, 4 heures en CE2, 5 heures en CM1 et 6 heures en CM2 (soit un quart du volume hebdomadaire de cours qui est de 24 heures en primaire).
Pour le réseau diwan (breton), le français est introduit à partir du deuxième trimestre de CE1, à raison de 2 heures par semaine. Ce volume horaire est porté à 4,25 heures en CE2 et à 5 heures auxquelles s'ajoute 1 heure de mathématiques en français en CM1 et CM2.
Pour le réseau seaska (basque), les élèves ont 3 heures de cours en français en CE1, 5 heures en CE2 et 8 heures en CM1 et CM2.
Pour le réseau scola corsa (corse), les enfants ont 3 heures de cours en français en CE1 avec une augmentation progressive pour atteindre 8 heures en CM2.
Enfin, pour le réseau bressola (catalan), le français est introduit en CE2 à raison de 6 heures hebdomadaires jusqu'en CM2.
Enfin, face aux inquiétudes politiques nées de la décision du Conseil constitutionnel, les deux députés préconisent à court terme de sécuriser les pratiques par un texte réglementaire via certains aménagements. À plus long terme, outre « l'opportunité éventuelle d'une révision de la Constitution », ils proposent la création d'un organe national de concertation réunissant l'ensemble des acteurs, un renforcement de l'évaluation des résultats de l'enseignement immersif sur la maîtrise des compétences par les élèves, mais aussi une consolidation des chiffres et données disponibles sur cet enseignement, ainsi qu'une attention toute particulière à avoir vis-à-vis de l'Outre-mer.
2. La circulaire du 14 décembre 2021 sur les cultures et langues régionales : un texte pris en urgence à la suite de la décision du Conseil constitutionnel
À l'initiative de Matignon, le ministère de l'éducation nationale a publié le 14 décembre 2021 une circulaire sur le cadre applicable aux langues régionales et à la promotion de leur enseignement. Celle-ci reconnait « l'intérêt éducatif d'un bilinguisme français - langue régionale et appelle à développer les ouvertures de classes bilingues à l'école, à les consolider et étendre celles-ci aux collèges et lycées ».
Elle reprend plusieurs pistes proposées par le rapport remis au Premier ministre, notamment la possibilité d'un enseignement immersif pensé sur plusieurs cycles d'enseignement. Le texte prévoit explicitement la possibilité de faire varier le temps de pratique de chacune des langues « dans la semaine, l'année scolaire ou encore à l'échelle des cycles ». Il permet en cela d'apporter un cadre juridique à la pratique d'un enseignement allant au-delà de la parité horaire dans un laps de temps défini16(*).
Il s'agit d'un progrès indéniable par rapport à la précédente circulaire du 12 avril 2017 qui posait le principe de la parité horaire hebdomadaire dans l'usage de la langue régionale et du français en classe, sans qu'aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné exclusivement en langue régionale.
La circulaire de décembre 2021 prévoit également « dans la perspective d'un "pilotage" de l'enseignement des langues et cultures régionales », une évaluation des performances des élèves en français et dans la langue régionale, et la création d'un conseil supérieur des langues, disposant d'un collège « langues régionales ».
Au-delà de la reprise des recommandations du rapport Euzet-Kerlogot, la circulaire tire d'autres conséquences de la loi Molac. Elle ajoute trois langues régionales à la liste de celles pouvant faire l'objet d'un enseignement à l'école : le kibushi et le shimaoré, deux langues présentes à Mayotte dont l'enseignement devient possible du fait de l'abrogation de l'article L. 372-1 du code de l'éducation par l'article 5 de la loi Molac. Elle reconnaît également le flamand occidental comme langue à enseigner.
Enfin, le CNED doit développer une offre d'enseignement à distance dans quatre langues régionales : le basque, le breton, le corse ainsi que l'occitan langue d'oc.
Une offre d'enseignement à distance via le CNED pour quatre langues régionales
Le CNED propose des cours de langue vivante en basque, breton, corse et occitan langue d'oc pour les classes de première et de terminale, en tant que LVC. En 2024-2025, 44 personnes suivaient ces cours, toutes langues et toutes modalités (cours réglementé, à la carte, formation libre) confondues. Il est à noter que le nombre d'élèves en cours à la carte réglementé - qui sont conditionnés à un avis favorable délivré par le chef d'établissement et dont les notes et appréciations obtenues dans les devoirs rendus au CNED sont transmises à l'établissement et intégrées à son bulletin scolaire - a plus que doublé depuis la création de ces filières en 2021 : il est passé de 11 élèves à 27 élèves. Le breton est la principale langue suivie en cours à la carte réglementée, avec 10 élèves en première et 7 en terminale.
Les cours ont été élaborés avec l'appui de la DGESCO, de l'IGESR et des IA-IPR. Ces derniers ont notamment communiqué des noms d'enseignants du second degré et de l'enseignement supérieur susceptibles de concevoir des contenus de cours. Les variantes dialectales ont été prises en compte.
Source : CNED
Cette circulaire fait figure de texte de référence pour de nombreux acteurs locaux en encourageant le développement de l'enseignement des langues régionales.
Toutefois, l'une des avancées majeures qu'elle porte, à savoir la mise en place d'un cadre pour l'enseignement immersif, reste fragile.
Le texte précise que « l'enseignement par immersion est possible » en tant que « stratégie d'apprentissage de l'enseignement bilingue » et que « le temps d'apprentissage de chacune des deux langues peut varier dans la semaine, l'année scolaire ou encore à l'échelle des cycles, en fonction des besoins effectivement constatées ». Pour autant dans les réseaux d'enseignement immersif, le volume horaire en français est minoritaire quelle que soit la période de référence (hebdomadaire, cycle scolaire, primaire dans sa globalité).
II. QUATRE ANS APRÈS LA LOI MOLAC : UNE APPLICATION DÉCEVANTE ET DE NOMBREUX POINTS DE BLOCAGE
À plusieurs reprises lors des auditions, les rapporteurs ont entendu que cette loi a permis de conforter et légitimer les discours favorables aux langues régionales. Ce texte a suscité de nombreuses attentes parmi les défendeurs de ces langues.
Il en résulte aussi des déceptions face à des avancées qui restent poussives et insuffisantes pour inverser la tendance de la diminution du nombre de locuteurs de ces langues.
A. UNE PROGRESSION DES EFFECTIFS SCOLAIRES MAIS INSUFFISANTE POUR SAUVER LES LANGUES RÉGIONALES À MOYEN TERME
1. Une progression des effectifs dans le premier degré, avec d'importantes disparités entre les langues régionales
À la rentrée 2023, les enseignements de langue vivante régionale, sous toutes leurs formes concernent plus de 168 000 élèves, dont près des deuxtiers dans le premier degré.
Dans le primaire, les effectifs sont en progression de 47 % entre 2021 et 2023, soit une augmentation de près de 35 000 enfants. Cette hausse est d'autant plus remarquable que dans le même temps le nombre d'enfants dans le primaire diminue de manière significative, avec plus de 172 000 écoliers de moins sur cette période.
Nombre d'élèves du premier degré suivant un enseignement de langue régionale (public et privé sous contrat)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Variation En nombre* |
Variation En pourcentage |
|
|
Auvergnat |
/ |
1 |
1 |
0 |
0 % |
|
Basque |
7 637 |
7 848 |
11 311 |
+ 3 674 |
+ 48 % |
|
Breton |
10 712 |
12 444 |
19 941 |
+ 9 229 |
+ 86 % |
|
Catalan |
12 964 |
12 764 |
13 289 |
+ 325 |
+ 3 % |
|
Corse |
12 141 |
12 684 |
20 326 |
+ 8185 |
+ 67 % |
|
Créole |
4 643 |
5 230 |
8 896 |
+ 4253 |
+ 92 % |
|
Gallo |
76 |
114 |
126 |
+ 50 |
+ 66 % |
|
Gascon |
554 |
621 |
866 |
+ 312 |
+ 56 % |
|
Languedocien |
/ |
257 |
575 |
+ 318 |
+ 123 % |
|
Limousin |
74 |
86 |
112 |
+ 38 |
+ 51 % |
|
LR Alsace |
495 |
348 |
458 |
- 37 |
- 7 % |
|
LR Moselle |
125 |
284 |
178 |
+ 53 |
+ 42 % |
|
Mélanésien |
55 |
56 |
147 |
+ 92 |
+ 167 % |
|
Nissart |
71 |
56 |
58 |
- 13 |
+ 18 % |
|
Occitan |
20 067 |
20 283 |
26 099 |
+ 6032 |
+ 30 % |
|
Provençal |
1 630 |
1 376 |
1 244 |
- 386 |
- 24 % |
|
Tahitien |
1 453 |
1 354 |
3 565 |
2 112 |
+ 145 % |
|
Total |
72 697 |
75 805 |
107 192 |
34 495 |
+ 47 % |
* Pour l'auvergnat et le languedocien, la variation
correspond aux rentrées scolaires 2022 et 2023
Source :
Questionnaires budgétaires PLF 2023, 2024 et 2025.
Les rapporteurs ont également pu constater, dans un contexte de déprise démographique scolaire entraînant sur l'ensemble du territoire des fermetures de classe dans le primaire, un effort des services académiques afin d'ouvrir des filières bilingues, voire immersives. D'après les données transmises par le ministère de l'éducation nationale, 13 classes proposant un enseignement de l'alsacien de manière renforcée pouvant aller jusqu'à la parité horaire ont ouvert en 2022 et 2023, portant leur nombre à 1 670. Pour l'occitan, 239 classes de plus entre 2021 et 2023 proposent cet enseignement. Pour le breton, ce nombre est passé de 202 classes en 2021 à 684 en 2023. En ce qui concerne le catalan, l'office public de la langue catalane a indiqué aux rapporteurs l'absence d'ouverture de filières bilingues entre 2012 et 2024, mais a également souligné plusieurs projets d'ouvertures dans le primaire pour 2025 et 2026 à l'instar du secondaire dont l'ouverture d'une filière est actée à la rentrée 2025. Par ailleurs, deux écoles publiques proposent un enseignement bilingue immersif dans cette langue17(*).
Pour le basque, dans l'enseignement public primaire, les chiffres sont globalement stables entre 2020 et 2024 (respectivement 6 042 et 6 070 élèves concernés). Toutefois, on constate une évolution des modalités d'enseignement au profit de l'enseignement immersif, au service d'une meilleure maîtrise de la langue régionale : l'initiation au basque devient ainsi marginale (200 élèves en 2024), tandis que l'enseignement à parité horaire diminue de 6,72 % à la rentrée 2024 (4 859 élèves à la rentrée 2023). En revanche, les effectifs de l'enseignement immersif doublent pour dépasser le millier d'écoliers concernés (1 011 élèves).
2. Un effort toutefois insuffisant au regard de la perte de vitesse des langues régionales et inégal selon les territoires
Si le ministère de l'éducation nationale et les rectorats mettent en avant les ouvertures de filières ces dernières années, ainsi que l'augmentation des effectifs d'élèves bénéficiant d'un enseignement en langue régionale, ce bilan doit toutefois être nuancé.
· Un rythme de développement de l'enseignement insuffisant pour compenser la diminution du nombre de locuteurs
Au rythme de la baisse du nombre de locuteurs des langues régionales, les quelques milliers d'élèves en plus par territoire ces dernières années ne permettent pas de compenser ces pertes. Ainsi, pour le breton, selon l'association Kelennomp ! (représentant les enseignants de breton et en langue bretonne) en 2018, avec 2,3 % des moins de 15 ans scolarisés en filière bilingue, le pourcentage de brittophones dans la société continuera à chuter dans les années à venir si l'enseignement bilingue ne se développe pas plus vite. En effet, 60 % des brittophones sont actuellement âgés de plus de 60 ans dont près des deux tiers ont plus de 70 ans. Dans le cadre du plan de réappropriation des langues de Bretagne, adopté en 2023, il est prévu la scolarisation de 30 000 élèves dans des filières bilingues bretonnes à l'horizon 2027. Il s'agit pour Fulup Jakez, président de l'office public de la langue bretonne « de travailler sur du long terme, à deux ou trois générations ».
Toutefois, le rythme d'ouverture de filières bilingue bretonne a ralenti dans l'académie de Rennes. Tant le rectorat que l'office public ont dressé le constat que cet objectif d'une scolarisation de 30 000 élèves dans une filière bilingue d'ici 2027 est inatteignable.
Source : Association Kelennomp ! et
fédération Div Yezh Breizh à partir des sources
statistiques
de l'office public de la langue bretonne.
Ce constat du recul de la langue est encore plus frappant pour le gallo dont la connaissance même de son existence diminue fortement. Selon l'enquête de 2024, sur la transmission et l'usage du breton et du gallo, commandée par la région Bretagne18(*), 51 % des habitants de Bretagne interrogés indiquent ne pas savoir ce qu'est le gallo, soit une hausse de plus de 11 points par rapport à la précédente enquête datant de 2018.
· Une couverture inégale des territoires reposant majoritairement sur une demande sociale des parents
Pour la plupart de ces langues régionales, l'éducation nationale développe des filières d'enseignement en réponse à la demande des parents. Il en résulte des disparités importantes d'une commune à une autre, en fonction de la mobilisation des parents et des élus pour que la langue régionale soit enseignée à l'école.
À cet égard, Mme Marie-Jeanne Verny, représentante de la FELCO (fédération des enseignants de langue et culture d'Oc) alerte sur le risque, notamment pour l'occitan dont la zone géographique historique de pratique est étendue, de la création « d'oasis linguistiques » dans les métropoles que sont Toulouse, Montpellier et Béziers, au milieu de « déserts linguistiques » sur le reste du territoire. Elle souligne ainsi l'existence de « départements occitans sinistrés » à l'instar de l'Ardèche et des départements alpins de l'académie d'Aix-Marseille où aucun écolier ne suit un enseignement d'occitan.
· L'ouverture de filières bilingues décrite comme un parcours du combattant par les acteurs concernés
L'ouverture d'un enseignement de la langue régionale et, a fortiori, d'une filière bilingue est perçue par les représentants des offices publics rencontrés, les élus locaux concernés et par les parents d'élèves comme un parcours du combattant, notamment si cette problématique linguistique ne constitue pas une priorité pour le rectorat.
La création d'une filière bilingue peut également devenir une source de tension parmi le personnel enseignant. En effet, ces postes transformés en postes bilingues ou immersifs deviennent inaccessibles aux professeurs monovalents touchés par une mesure de carte scolaire supprimant leur poste ou plus généralement demandant une mutation.
· Au-delà de l'aspect quantitatif, la question de l'effectivité et de l'intensité de l'enseignement pour parvenir à des locuteurs de bon niveau en langue régionale
Il est ainsi nécessaire de se pencher sur le contenu de cet enseignement.
En ce qui concerne les filières bilingues, les rapporteurs ont été alertés sur le remplacement d'un enseignant bilingue absent par un enseignant ne maîtrisant pas la langue régionale. La problématique du remplacement des enseignants, connue de longue date par la commission, est d'autant plus forte pour les langues régionales du fait de la carence en ressources humaines d'enseignants maîtrisant ces langues. Dans d'autres cas, bien que certains postes aient été fléchés comme filière bilingue, le rectorat ne parvient pas à recruter un enseignant maîtrisant les deux langues et est donc contraint d'y mettre un enseignant ne maîtrisant pas la langue régionale.
En ce qui concerne l'initiation et la sensibilisation des élèves, de grandes disparités peuvent exister d'un département à l'autre. Le cas de l'occitan permet de mettre en avant ces disparités : cette sensibilisation peut varier fortement en fonction des territoires, allant d'une session unique sur l'année à un cycle approfondi de plusieurs heures. Il n'y a ainsi que l'équivalent de 1,5 ETP itinérant pour l'ensemble des écoles primaires du Cantal, ce qui ne permet d'acquérir que des compétences linguistiques très limitées. Par ailleurs, l'intervention dans les classes n'est pas systématique mais se fait sur demande des écoles auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale.
Des associations, souvent financées par les conseils départementaux, peuvent également intervenir sur le temps scolaire et en présence de l'enseignant. Les documents transmis par l'office public de la langue occitane19(*) mentionnent par exemple une association soutenue par le conseil départemental de l'Aveyron qui intervient auprès de 30 % des écoliers du département. Sur l'ensemble des cycles du primaire, cela correspond environ à 80 heures, soit l'équivalent de 10 heures par année scolaire. Dans le Gers et les Hautes-Pyrénées, deux associations interviennent dans le sud du département et proposent 30 minutes d'initiation hebdomadaire pour les élèves de maternelle et une heure pour ceux d'élémentaire. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, 15 séances de 40 minutes sont également proposées à plusieurs milliers d'élèves par le milieu associatif.
Les rapporteurs tiennent toutefois à souligner les limites de cette initiation ou sensibilisation qui ne permet pas de former des locuteurs complets.
Enfin, les rapporteurs ont été alertés sur l'apprentissage du provençal, assimilé par l'éducation nationale dans certains textes et discours à une variante de l'occitan. D'une part, l'utilisation de la terminologie occitane pour présenter l'enseignement du provençal n'est pas comprise par les parents qui pensent que cette langue est celle parlée dans une autre zone géographique et donc ne comprennent pas le lien entre celle-ci et le territoire provençal. D'autre part, la graphie, l'orthographe et la syntaxe du provençal présentent des spécificités. En fonction de la formation de l'enseignant, les élèves peuvent ainsi apprendre l'une ou l'autre de ces variantes, avec des évolutions au gré des mutations des personnels de l'éducation nationale, des remplacements, ou encore entre le primaire et le collège.
3. L'abandon de l'apprentissage des langues régionales au collège et au lycée
Au passage au collège, de nombreux élèves interrompent leur apprentissage d'une langue régionale et cette diminution des effectifs s'accentue encore au lycée.
Pour apprécier correctement ces variations, il importe cependant de rapporter les effectifs à la durée propre de chaque cycle : le primaire s'étend sur huit années, le collège sur quatre et le lycée sur trois. Le tableau ci-après présente, à la rentrée 2023, les effectifs par langue régionale au primaire et au secondaire ; leur comparaison doit donc intégrer cette différence de nombre de cohortes entre les niveaux.
S'agissant de la méthode, les rapporteurs ont retraité les données communiquées par la direction générale de l'enseignement scolaire afin d'établir, pour chaque langue, un effectif moyen annuel par niveau (primaire, collège, lycée). Cette normalisation vise à mesurer la baisse des effectifs en neutralisant la longueur des cycles. Ils appellent toutefois à la prudence dans l'interprétation de ces résultats. La démarche retient en effet l'hypothèse d'une répartition homogène des élèves entre les années de chaque niveau et celle de cohortes de taille constante ; elle ne prend pas non plus en compte la déprise démographique observée en primaire. Ces limites doivent être gardées à l'esprit.
Toutefois, à défaut de disposer des effectifs des classes charnières CM2/6ème et 3ème/2nde, permettant une comparaison beaucoup plus précise, cette méthodologie permet d'obtenir un ordre de grandeur de la poursuite de l'apprentissage des langues régionales.
Nombre d'élèves suivant un enseignement de langue régionale à la rentrée 2023
|
Langue régionale |
Premier degré |
Second degré |
Total |
||
|
Collège |
Lycée |
Total 2d degré |
|||
|
Auvergnat |
1 |
203 |
203 |
204 |
|
|
Basque |
11 311 |
4 138 (- 26,8 %) |
1 748 (- 43,7 %) |
5 886 |
17 197 |
|
Breton |
19 941 |
5 171 (- 48,1 %) |
1 118 (-71,2 %) |
6 289 |
26 230 |
|
Catalan |
13 289 |
1 322 (-80,1 %) |
491 (- 50,5 %) |
1 813 |
15 102 |
|
Corse |
20 326 |
7 546 (- 25,7 %) |
1 412 (-75,1 %) |
8 958 |
29 284 |
|
Créole |
8 896 |
5 511 (+ 23,9 %) |
2 845 (-31,2 %) |
8 356 |
17 252 |
|
Gallo |
126 |
193 (+ 206 %) |
29 (-80,0 %) |
222 |
348 |
|
Gascon |
866 |
- |
- |
- |
866 |
|
Languedocien |
575 |
- |
- |
- |
575 |
|
Limousin |
112 |
- |
- |
- |
112 |
|
LR Alsace |
458 |
746 (+ 225 %) |
131 (-76,6 %) |
877 |
1 335 |
|
LR Moselle |
178 |
867 (+ 874 %) |
349 (-46,3 %) |
1 216 |
1 394 |
|
Mélanésien |
147 |
2 968 (+ 3938 %) |
455 (-79,6 %) |
3 423 |
3 570 |
|
Nissart |
58 |
267 (+ 820 %) |
328 (+ 63,8 %) |
595 |
653 |
|
Occitan |
26 099 |
8 434 (-35,4 %) |
1 023 (-83,8 %) |
9 457 |
35 556 |
|
Provençal |
1 244 |
1 559 (+ 150,6 %) |
317 (-72,9 %) |
1 876 |
3 120 |
|
Tahitien |
3 565 |
8 957 (+ 402,5 %) |
2 845 (-57,6 %) |
11 802 |
15 367 |
|
Total |
107 192 |
47 882 |
13 091 |
60 973 |
168 165 |
Source : Ministère de l'éducation nationale, questionnaire budgétaire, PLF 2025 ; pourcentage de variation des effectifs calculé par la mission d'information.
* La variation entre le primaire et le collège est calculée en divisant par deux le nombre d'écoliers, afin de comparer des chiffres concernant 4 niveaux de classes.
** Pour le calcul de la variation des effectifs entre le collège et le lycée, celle-ci est calculée pour chaque langue sur la base du nombre moyen d'élèves par niveau de classe (4 années au collège et 3 au lycée)
La diminution du nombre d'élèves à l'entrée au collège est particulièrement forte pour le catalan, et dans une moindre mesure pour le breton et l'occitan. Bien que moins forte, le basque et le corse sont également concernés par cette baisse. Quant au gascon, languedocien ou limousin, ces langues ne sont plus enseignées dans le secondaire.
En revanche, on constate une progression de certaines langues, à la faveur de la mise en place d'options langues régionales au collège. C'est notamment le cas des langues ultramarines, ainsi que du gallo, du nissart, du provençal et des langues régionales d'Alsace et de Moselle.
La chute des effectifs est particulièrement brutale au lycée et ceci pour toutes les langues à l'exception du nissart. Cette fracture est notamment due à la réforme du lycée qui a « oublié » les langues régionales. Les rapporteurs soulignent que celles-ci ont été rattrapées « in extremis », mais sous forme d'options et de LVC, souvent placées en fin de journée ou sur la pause déjeuner.
Marie-Jeanne Verney, professeure d'occitan au lycée désormais à la retraite, a ainsi témoigné que « auparavant, je regardais les emplois du temps des élèves et le mien et je proposais des cours d'occitan sur des créneaux libres communs. La réforme du lycée a fait exploser le groupe classe. Il n'existe ainsi plus de créneaux libres communs pour les élèves permettant d'y “glisser” des cours d'occitan ». Et de conclure : « la réforme du lycée a vidé tout ce qui était facultatif ».
L'effet délétère de cette réforme sur l'accessibilité des enseignements a été renforcé par celle du baccalauréat qui a porté un coup fort à leur valorisation. En effet, les langues régionales ne bénéficient plus d'une notation à part dont seuls les points au-dessus de la moyenne compte et sont ajoutés au total des points obtenus : elles sont désormais prises en compte, comme n'importe quelle autre discipline, et la moyenne obtenue intégrée dans le calcul de la note de contrôle continu.
Selon les chiffres de la DGESCO, toutes langues régionales confondues, seuls 956 lycéens ont présenté en LVC une langue régionale au baccalauréat en 2024 : 440 en langue occitane (dont 104 en nissart, 100 en provençal), 214 en créole, 116 en langue corse, 60 élèves en langue basque, 48 en langue catalane, 29 en langues régionales d'Alsace, 25 en langue bretonne, 14 en langue du pays Mosellan, 9 en langue gallo.
Le nombre d'élèves ayant passé une discipline non linguistique en langue régionale au baccalauréat est également très faible : 348 élèves à la session 2025. À l'exception de l'académie de Bordeaux où certains candidats ont présenté en basque l'enseignement scientifique, la DNL en langue régionale est l'histoire-géographie. Avec 184 candidats, le breton est la langue la plus représentée, suivi du basque.
Nombre de candidats inscrits au
baccalauréat dans une DNL
adossée à une langue
régionale (session 2025)
|
Académie |
Épreuve de DNL |
Langue régionale |
Nombre d'inscrits |
|
Bordeaux |
Histoire-géographie |
basque |
100 |
|
Bordeaux |
Enseignement scientifique |
basque |
14 |
|
Rennes |
Histoire-géographie |
breton |
184 |
|
Montpellier |
Histoire-géographie |
catalan |
32 |
|
Corse |
Histoire-géographie |
corse |
8 |
|
Toulouse |
Histoire-géographie |
occitan - langue d'oc |
10 |
Source : DGESCO
Quant à l'enseignement de spécialité LLCR (langues, littératures et civilisations étrangères) avec une orientation « langue régionale »20(*), celui-ci est finalement très peu choisi par les élèves comme le montrent les chiffres cidessous pour la session 2023.
Nombre d'élèves suivant un
enseignement de spécialité LLCR
par langue
régionale
|
Basque |
Breton |
Catalan |
Corse |
Créole |
Occitan-langue d'oc |
Tahitien |
|
|
Première |
32 |
14 |
14 |
67 |
100 |
24 |
85 |
|
Terminale |
27 |
5 |
6 |
32 |
75 |
8 |
77 |
Source : DGESCO
Or, ce « trou d'air » dans le secondaire a des répercussions immédiates sur la poursuite de l'étude de ces langues dans l'enseignement supérieur, et in fine sur la maîtrise de ces langues par les étudiants se préparant au concours de l'enseignement.
B. DES DIFFICULTÉS QUI PERDURENT DANS L'APPLICATION DU FORFAIT SCOLAIRE
Les rapporteurs ont mesuré les tensions nées de l'application de l'article 6 de la loi Molac relatif au financement des établissements d'enseignement proposant un enseignement bilingue.
Lors de leurs auditions, les différents réseaux d'enseignement immersif ont souligné leurs difficultés à percevoir l'intégralité des financements qu'ils estiment dus. Celles-ci sont pour eux de trois ordres.
Elles concernent tout d'abord le principe même du versement. Certaines communes refusent de le verser ou ne s'acquittent que d'un montant très faible par rapport à celui qui devrait être perçu. Le réseau ABCM Zweisprachigkeit a ainsi indiqué s'être vu opposer un refus de participation par 20 % des 110 communes contactées. Le réseau Seaska pour sa part dénombre 11 communes qui ne versent pas le montant dû et estime le manque à gagner à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Il en est de même pour le réseau Calandreta, avec 31 communes concernées dans le seul département des Hautes-Pyrénées. Diwan pour sa part estime à 250 000 euros par an pour les cinq départements concernés par le breton son manque à gagner, soit la moitié des 500 000 euros de trésorerie qui lui manquait en septembre 2024 pour finir l'année comptable, et mettant le réseau en difficulté financière.
Les raisons de ce refus varient en fonction des communes : certaines estiment que la commune n'a pas à payer pour un choix d'éducation des familles, d'autres soulignent la mise en place d'une initiation dans leur école publique, d'autres enfin indiquent ne pas avoir les moyens de le faire. Ces tensions sont accentuées dans un contexte de déprise démographique où certaines communes voient les classes de leur école publique fermer avec un sentiment de double peine : devoir à la fois payer la scolarisation de quelques élèves dans une autre commune et dans le même temps constater la disparition d'un poste d'enseignant dans leur commune à deux ou trois élèves près.
La deuxième difficulté concerne les modalités de calcul du montant à verser. À la différence des trois autres cas de versement du forfait scolaire prévus par l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation21(*) pour lesquelles les modalités de calcul sont précisées par le texte et font l'objet d'une jurisprudence détaillée, pour les établissements d'enseignement immersif, le texte précise que la participation financière doit faire l'objet d'un accord. À défaut, le préfet doit « réunir le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés ». Plusieurs élus rencontrés se sont émus d'avoir reçu une facture envoyée par l'établissement scolaire sans aucune concertation et soulignent qu'un accord sur le montant nécessite la participation des deux parties.
La mise en oeuvre de ces dispositions par les préfets est très disparate, et peut consister, selon les départements, en un simple envoi de courrier aux communes, en l'organisation de réunions entre les collectivités et établissements concernés pour essayer de trouver un accord ou encore en le calcul d'un forfait départemental moyen présenté ensuite aux collectivités concernées.
Enfin se pose le problème du recouvrement. Il a été indiqué aux rapporteurs que plusieurs communes ont provisionné les sommes dues au titre de cette participation, mais attendent un ordre de mandatement de la préfecture ce que refusent de faire certains préfets. Les réseaux d'enseignement immersif ont signalé aux rapporteurs que des consignes avaient été données aux préfets pour ne pas mandater d'office cette dépense.
Le texte législatif, fruit d'un compromis, mériterait sans doute d'être clarifié. Toutefois, le financement des réseaux d'enseignement immersif a paradoxalement été profondément fragilisé par la loi Molac du fait de la décision du Conseil constitutionnel qui remet en question cette méthode pédagogique d'enseignement. Certes, la circulaire de décembre 2021 est venue reconnaître la possibilité de recours à l'enseignement immersif, mais en tant que stratégie possible d'apprentissage de l'enseignement bilingue, sans que le ratio français/langue régionale ne soit explicitement mentionné. Plusieurs réseaux associatifs d'enseignement ont ainsi souligné leur hésitation à s'engager sur le terrain du contentieux au sujet du forfait scolaire, craignant une remise en cause par le juge de leur modèle pédagogique.
C. UN SENTIMENT D'INSATISFACTION DES ACTEURS DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES QUANT À LA SIGNATURE ET MISE EN oeUVRE DES CONVENTIONS
Les articles 1er et 7 de la loi Molac ouvrent la voie à la signature de conventions entre l'État, les collectivités territoriales et les offices publics pour la valorisation, l'enseignement et la diffusion des langues régionales.
Il ressort des auditions une attente forte des acteurs de promotion des langues régionales et une certaine déception quant à la signature, au contenu ou à la mise en oeuvre de ces conventions.
Les raisons sont nombreuses et reflètent la diversité des situations rencontrées sur le terrain.
Tout d'abord, certains territoires ne sont pas inclus dans les conventions relatives à leur langue régionale. Tel est le cas de la LoireAtlantique. Alors que la précédente convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne incluait partiellement la Loire-Atlantique, notamment pour la formation professionnelle, la nouvelle convention couvrant la période 20222027 ne le prévoit plus. Certes, il existe des échanges informels entre toutes ces collectivités territoriales concernées par la même langue régionale, mais l'absence de conventionnement avec la Loire-Atlantique freine la promotion du breton dans ce territoire.
Certaines conventions arrivées à échéance n'ont pas été renouvelées. C'est notamment le cas en Corse, où il existait une convention antérieure à la loi Molac couvrant la période 2016-2021 entre l'État représenté par le préfet et le recteur et la collectivité territoriale de Corse. Dans un contexte politique particulier lié aux débats sur l'autonomie de la Corse, aucune nouvelle convention n'a été signée à l'heure actuelle. Toutefois, selon le recteur de l'académie de Corse, l'absence de nouvelles conventions n'empêche pas la mise en place d'un politique publique forte en faveur de la langue. Par ailleurs, l'écriture d'une nouvelle convention a été actée entre le recteur et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et évoquée lors de la réunion du groupe partenarial le 7 mai dernier.
Le renouvellement de certaines d'entre elles fait l'objet de désaccords entre les acteurs concernés. Pour l'occitan, la précédente convention devait arriver à échéance en 2022. Les négociations de la nouvelle convention ont pris du retard, conduisant à une prorogation de la précédente. La pierre d'achoppement des négociations porte sur l'inscription dans le texte d'engagements précis sur le nombre de sites à ouvrir par an et par département ou sur des objectifs chiffrés en termes de pourcentage d'élèves concernés d'une manière ou d'une autre (initiation/sensibilisation, enseignement renforcé, parité horaire, immersion), par l'enseignement de l'occitan.
Pour le catalan, il n'existe toujours pas de conventions avec l'éducation nationale malgré la création de l'office public de la langue catalane il y a cinq ans.
Les rapporteurs ont également été interpellés par les acteurs locaux de promotion des langues régionales - et notamment par les offices publics - concernant le non-respect des stipulations de la convention. L'office public de la langue bretonne a ainsi souligné le retard pris dans le développement de filières bilingues pour atteindre la cible de 30 000 élèves à y être scolarisés en 2027, dans la généralisation progressive de l'enseignement du breton dans le cadre de l'horaire normal des cours dans le premier degré ou encore l'absence d'initiatives par le rectorat pour recenser les personnels aptes et volontaires pour enseigner la langue. Interrogé à ce sujet, le rectorat de Rennes reconnait que certains des objectifs ne seront pas atteints mais souligne les efforts faits en faveur du breton ces dernières années en application de la convention.
En ce qui concerne la convention relative à l'alsacien, le rectorat de Strasbourg est également conscient que les objectifs « ambitieux » fixés par la convention - 50 % des élèves inscrits en section langue régionale à parité horaire en maternelle en 2030 - ne seront pas atteints. En effet, le saut quantitatif est trop important : à la rentrée 2024, seuls 20 % des élèves du public et 21 % de ceux du privé sont scolarisés dans de telles filières.
Le manque d'enseignants capables d'enseigner en langue régionale nécessaire à la mise en oeuvre de ces conventions a également été souligné. Pour l'office public de la langue occitane, la convention « reste un fourreau sans sabre », même en présence de personnes volontaristes au sein des rectorats en raison d'un manque de ressources humaines : malgré une demande forte des communes, seules deux classes bilingues ont ouvert ces dix dernières années - les deux à la rentrée scolaire 2024.
Enfin, le contexte budgétaire contraint également la mise en oeuvre de ces conventions. Ainsi, pour l'alsacien, la convention-cadre entre l'État, la communauté européenne d'Alsace et la région Grand Est couvre la période 2015-2030 et se décline normalement en convention opérationnelle de trois ans. Or, en raison des incertitudes pesant sur le budget des collectivités territoriales, les conventions opérationnelles sont devenues annuelles ces deux dernières années, ce qui diminue la capacité de l'ensemble des acteurs à se projeter sur plusieurs années.
Les rapporteurs constatent ainsi que des progrès sont possibles. Mais ils tiennent toutefois à souligner que la loi Molac a eu comme effet positif de remettre sur le devant de la scène ces conventions et de relancer des négociations qui s'enlisaient. Lors de l'audition de la directrice générale de l'enseignement scolaire, les rapporteurs ont pris connaissance avec intérêt des dernières avancées pour l'occitan. Il semblerait ainsi que l'office public de la langue occitane et le cabinet de la ministre de l'éducation nationale aient validé le principe d'objectifs non chiffrés. Celui-ci devrait ensuite être décliné dans chacune des académies concernées par l'occitan pour un engagement réciproque de chacun des acteurs correspondant au plus près à la réalité des territoires.
Par ailleurs, la première convention relative à l'enseignement du provençal vient d'être signée entre le rectorat et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur.
Ainsi, même si elles ne sont qu'imparfaitement suivies, ces conventions sont, pour reprendre les propos de Jean-Marc Huart, recteur de l'académie de Bordeaux « un élément structurant pour l'ensemble des partenaires et permettent d'avoir des trajectoires » d'enseignement de ces langues.
III. AU-DELÀ DES ANNONCES POLITIQUES : L'URGENCE DE SE DONNER LES MOYENS CONCRETS D'UNE PRÉSERVATION ET D'UNE TRANSMISSION DES LANGUES RÉGIONALES
A. DÉFINIR UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DES LANGUES RÉGIONALES
1. Renforcer la coordination et la promotion des langues régionales à l'échelle nationale et territoriale
Depuis les années 2000, nombreux ont été les ministres à affirmer devant les parlementaires leur attachement aux langues régionales. Toutefois, les rapporteurs regrettent que ces propos à la tribune des assemblées ne se concrétisent pas suffisamment dans les politiques publiques.
Dès lors, la promotion et l'enseignement des langues régionales relèvent aujourd'hui davantage de rapports de force, de statuts dérogatoires ou d'expérimentations, dont certaines existent désormais depuis plus de dix ans, obtenus dans des négociations bilatérales, que d'une politique nationale assumée. Comme le souligne Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire, ce phénomène de successions de dialogues bilatéraux entraîne un héritage de situations très différentes qui pèsent sur les académies, ainsi que sur les langues, leurs prises en compte et leurs reconnaissances par les services déconcentrés de l'État.
Il en résulte des différences de traitement entre les langues, parfois entre deux académies, mais aussi entre les élèves - par exemple sur la possibilité de passer des épreuves d'examen en langue régionale.
Surtout, cette absence de cadre national conduit à un manque de directives claires pour les services déconcentrés, notamment ceux de l'éducation nationale qui doivent déjà mettre en oeuvre de nombreuses priorités nationales. Le développement des langues régionales à l'échelle des territoires dépend aujourd'hui de l'appétence et du volontarisme des services déconcentrés sur ces questions. À cet égard, les langues régionales, présentes sur un large territoire, permettent de constater les effets de l'absence d'impulsion nationale sur les politiques déconcentrés. La prise en compte de l'occitan varie fortement entre les trois académies concernées. Ce constat est le même entre les dix-neuf départements concernés. Quant au breton, les efforts en faveur du développement de cette langue sont sensiblement différents entre les quatre départements de la Région Bretagne et celui de la Loire-Atlantique, qui dépendent de deux académies différentes.
Recommandation n° 1 : Définir une stratégie nationale de l'enseignement et de la promotion des langues régionales afin de garantir une égale impulsion dans l'ensemble des territoires concernés.
Cette stratégie nationale se traduit notamment dans les territoires par deux aspects.
Il s'agit tout d'abord, de veiller à ce que les conventions, régulièrement renouvelées, couvrent l'ensemble des territoires concernés par une langue régionale. Comme l'a souligné Paul Molac aux rapporteurs, la rédaction des articles 1er et 7 est très souple concernant le type de collectivités territoriales signataires : il peut ainsi s'agir de la région, du département ou même d'intercommunalités.
Recommandation n° 2 : Prévoir pour chaque langue régionale une convention couvrant l'ensemble du territoire linguistique entre l'État, les collectivités territoriales et lorsqu'il existe l'office public de la langue concernée, et le cas échéant prévoir a minima une déclinaison académique de celle-ci.
Par ailleurs, les comités académiques des langues régionales (CALR) doivent devenir des instances privilégiées de dialogue et de programmation du développement des langues régionales. Plusieurs personnes auditionnées ont d'ailleurs souligné le rôle de ces CALR permettant de rassembler autour de la table l'ensemble des acteurs locaux. Lorsque ceux-ci fonctionnent bien, le cas échéant, précédés par des groupes de travail infra-régionaux pour les langues régionales présentes sur un large territoire, de réelles avancées deviennent possibles.
Pour les rapporteurs, les CALR doivent également être le lieu de suivi de la mise en oeuvre des conventions et de planification du développement de l'enseignement des langues régionales, en tenant compte des demandes des collectivités territoriales, de la stratégie académique pour permettre une continuité de parcours pendant la scolarité, des mouvements potentiels de personnels au sein des écoles à l'échelle de deux ou trois ans, mais aussi de l'évolution de la carte scolaire. À cet égard, des rapprochements avec les observatoires des dynamiques rurales22(*) - lieu d'échange et de partage des perspectives de démographie scolaire à trois ans - sont nécessaires.
Par ailleurs, il convient d'élargir la liste des langues concernées par un CALR afin que celle-ci corresponde à celles de langues régionales enseignées. L'arrêté du 19 avril 2002 fixant la liste des académies dans lesquelles est créé un CALR ne mentionne pas l'académie de Lille ni celle de Mayotte. Or, la circulaire du 14 décembre 2021 mentionne le flamand occidental, le picard, le kibushi et le shimaoré parmi les langues pouvant faire l'objet d'un enseignement.
Recommandation n° 3 : Réunir régulièrement les comités académiques des langues régionales et renforcer les liens entre ceux-ci et les observatoires des dynamiques rurales, afin de mettre en place à l'échelle territoriale une stratégie pluriannuelle de promotion des langues régionales.
2. Garantir la constitutionnalité du système de l'enseignement immersif privé
La censure par le Conseil constitutionnel de l'article 4 de la loi Molac a fragilisé la possibilité de recourir à l'enseignement immersif au sein des établissements scolaires qui sont associés au service public de l'enseignement.
Les rapporteurs souhaitent souligner trois points qui leur semblent essentiels :
· en raison de la très forte diminution de l'usage des langues régionales dans le cadre familial et dans l'espace public, le recours à l'enseignement immersif au moins sur une partie du primaire est le moyen le plus efficace pour former des locuteurs de bon niveau. Ce constat est encore plus fort pour les langues régionales qui n'ont pas de racines latines : un enseignement de quelques heures par semaine, à raison de 36 semaines par an, n'est pas suffisant tant la structure de langue et des mots est différente,
· par ailleurs, le législateur n'a jamais eu l'intention à travers cet article 4 de remettre en cause la langue française comme langue de la République, mais de valoriser l'immersion comme une méthode pédagogique. Il a également fixé comme objectif une maîtrise égale des deux langues. Le texte censuré précisait d'ailleurs que l'enseignement immersif pouvait se faire mais « sans préjudice de l'objectif d'une bonne connaissance de la langue française »,
· L'enseignement immersif est donc une méthode pédagogique et il apparaît clairement que pour les rapporteurs les différentes modalités d'apprentissage d'une langue n'auraient pas dû relever du domaine de la loi.
Toutefois, il faut désormais tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel. Comme l'ont unanimement exprimé les représentants des réseaux d'enseignement immersif : « nous avons une épée de Damoclès juridique au-dessus de nos têtes »23(*).
Pour les rapporteurs, la possibilité de recourir à l'enseignement immersif s'inscrit dans la philosophie de l'article 75-1 de la Constitution qui précise que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Parce que l'incertitude sur la possibilité de recourir à cette méthode d'apprentissage est désormais de niveau constitutionnel, il revient désormais au constituant de préciser les grands axes de protection de ce patrimoine afin qu'il reste vivant.
Recommandation n° 4 : Préciser que la reconnaissance des langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France (Art. 75-1 de la Constitution) implique de pouvoir former des locuteurs complets dans ces langues, condition indispensable à leur sauvegarde.
Il s'agit de sécuriser l'enseignement immersif, méthode pédagogique visant au bilinguisme intégral et à former des locuteurs complets en français et en langue régionale. Une révision de la Constitution pourrait être utile afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale.
Les rapporteurs souhaitent réaffirmer le rôle crucial joué par les associations d'enseignement immersif dans la sauvegarde des langues régionales. D'ailleurs, une part significative des enseignants bascophones ou brittophones de l'enseignement public sont d'anciens élèves des réseaux immersifs Seaska et Diwan.
Ces réseaux sont reconnus par l'État à travers les conventions qui les lient directement à ce dernier ou via les contrats d'association entre leurs établissements d'association et le ministère de l'éducation nationale.
Pour les rapporteurs, il convient de finaliser les renouvellements en cours des conventions entre certains de ces réseaux et l'État. C'est le cas de la convention avec Seaska en attente depuis plusieurs mois.
Ces conventions et la connaissance de leurs contenus par l'ensemble des personnels des services de l'éducation nationale doivent permettre de mieux accompagner ces établissements d'enseignement, dont l'existence reste souvent précaire.
Recommandation n° 5 : Assurer le renouvellement des conventions entre l'État et chacun des réseaux d'enseignement immersif.
B. DÉVELOPPER MASSIVEMENT L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES À L'ÉCOLE PUBLIQUE
L'école publique a longtemps été un lieu de mise à l'écart des langues régionales. Ce sont donc les réseaux d'enseignement privé, et principalement les réseaux associatifs d'enseignement immersif, qui ont porté - à bout de bras - la sauvegarde des langues régionales. L'État a bien souvent estimé que les quelques familles qui souhaitaient que leur enfant apprenne ces langues pouvaient le faire dans ces réseaux d'établissements scolaires. L'éducation nationale, sous la pression des familles et des élus locaux s'est contentée, à de rares exceptions, de proposer quelques heures d'initiation à l'école publique saupoudrées au gré des ressources disponibles, mais sans véritable politique, ce qui ne permet pas de former de bons locuteurs.
Pour les rapporteurs, les langues régionales doivent trouver toute leur place au sein de l'école publique : à l'instar de l'école privée, l'école publique doit se donner les moyens pour former des locuteurs de bons niveaux à la fois en français et en langue régionale.
1. Développer dans le premier degré public les sections immersives
Dans un contexte de quasi-disparition de la transmission des langues régionales par la famille, les rapporteurs sont convaincus que la méthode immersive, notamment pour les langues non latines, est la seule à même de former des locuteurs complets à la fin du primaire. Par ailleurs, l'expérience des réseaux d'enseignement privé immersif montre que cette méthode pédagogique ne porte pas préjudice à une bonne maîtrise du français24(*).
Aussi, les rapporteurs souhaitent que « l'enseignement bilingue par la méthode dite immersive » ne soit plus l'apanage de l'école privée sous contrat. Ils soulignent que la circulaire du 14 décembre 2021 fait de l'immersion « une stratégie possible d'apprentissage de l'enseignement bilingue » et précise que « le temps de pratique de chacune des deux langues peut varier dans la semaine, l'année scolaire ou encore à l'échelle des cycles, en fonction des besoins effectivement constatés ».
La direction départementale des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques s'est saisie de l'opportunité offerte par cette circulaire pour renforcer le nombre d'écoles maternelles publiques proposant un enseignement immersif. Celui-ci existe dans le département depuis 2006 avec deux écoles initialement concernées, mais dans un cadre précaire : celui de l'expérimentation prévue par l'article 34 de la loi n° 2005-380 du 30 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui permet la réalisation d'expérimentations notamment en matière d'organisation pédagogique et d'enseignement disciplinaire.
La circulaire du 14 décembre 2021 permet de sortir du cadre expérimental et d'offrir un cadre juridique plus stable pour le recours à cette méthode pédagogique d'apprentissage d'une langue. À la rentrée 2024, on dénombre ainsi 31 écoles publiques concernées avec 1 011 élèves concernés.
Surtout, depuis la parution de cette circulaire, le rectorat a lancé quatre nouveaux projets25(*) d'immersion en cycle 2 (CPCE1CE2), en lien avec un cycle de maternelle intégralement en basque. Cette immersion totale se poursuit en CP jusqu'à janvier, puis les élèves auront trois journées d'enseignement en basque et une journée en français - ou 1h30 de français quotidiennement.
En Alsace, les rapporteurs soulignent également le lancement par l'académie des parcours allemand, alsacien, français « Tomi Ungerer ». Depuis la rentrée 2023, ce parcours propose en petite section 75 % du volume horaire (18 heures) en allemand et alsacien et 25 % du volume horaire (6 heures) en français. Il en existe désormais cinq, trois situés dans le Bas-Rhin et deux situés dans le Haut-Rhin.
En Corse, l'académie comptait 14 écoles proposant un enseignement immersif à la rentrée 2024, dont 10 écoles publiques (8 écoles maternelles et 2 élémentaires) et 4 écoles associatives. Dans le cadre du plan Scola 2030, l'effort en faveur de l'enseignement immersif se poursuit : à la rentrée 2025, 70 nouvelles classes immersives ont ouvert.
Les rapporteurs souhaitent que l'ouverture de ces filières immersives à l'école publique se poursuive et se développe dans l'ensemble des territoires concernés par les langues régionales.
Recommandation n° 6 : Développer pour l'ensemble des langues régionales un enseignement bilingue à parité horaire à l'école primaire et offrir la possibilité d'un enseignement immersif dans les cycles 1 et 2 de l'école primaire.
2. Construire une cartographie cohérente des implantations des filières bilingues et immersives pour assurer une montée de cohorte de la maternelle jusqu'au lycée
La mise en place de classes bilingues en primaire varie fortement selon les langues régionales.
En région Bretagne, il existe 234 écoles publiques qui proposent un enseignement à parité horaire. Ce sont 18 filières bilingues qui ont ouvert ces trois dernières rentrées scolaires. À titre de comparaison, on dénombre 81 écoles privées proposant une filière bilingue auxquelles s'ajoutent 38 écoles diwan (immersives).
En ce qui concerne le basque, 105 écoles publiques proposent un enseignement à parité horaire.
Pour l'occitan, le résultat est plus contrasté : certes, on constate une augmentation du nombre de filières bilingues créées, avec là encore des variations entre les académies, mais ces créations restent en deçà des objectifs de la convention. Selon les informations transmises par l'office public de la langue occitane, sur l'académie de Bordeaux, 14 cursus ont été créés entre 2017 et 2023 sur les 42 prévus par la convention. Dans l'académie de Limoges, aucune filière complète n'a été créée. Quant à l'académie de Toulouse, s'il y a eu des ouvertures de filières bilingues, cela représente une augmentation de 5 % des effectifs, contre 26 % à atteindre. En revanche, dans l'académie de Montpellier, les effectifs des filières bilingues publiques ont augmenté de plus de 90 % (par rapport au 26 % attendus).
Pour l'alsacien, selon la FLAREP Eltern Alsace, il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles ouvertures de sites bilingues en cinq ans.
Pour les rapporteurs, il est urgent de poursuivre les efforts engagés et d'accroitre, pour toutes les langues, le nombre de filières à parité horaire. Toutefois, ils constatent également que l'ouverture des filières à parité horaire répondent à une logique de demande sociale - sous l'impulsion des familles et des élus locaux - mais sans que ne soit pensée une continuité de parcours. Il en résulte un effondrement des effectifs en filière bilingue au collège. Les raisons sont diverses. Les rapporteurs ont ainsi pu entendre des personnels des rectorats indiquer avoir ouvert, sous la pression des parents et des élus locaux, une filière bilingue dans une école primaire isolée en matière d'enseignement de la langue, mais souligner l'absence de possibilité de poursuivre l'étude de la langue, car le collège de secteur ne propose pas de filière bilingue et les effectifs potentiels d'élèves bilingues de cette seule école sont trop réduits pour en créer une. De leur côté, des élus ou des représentants des offices publics dénoncent la position du rectorat qui refuse la création d'une dérogation de droit à la carte scolaire du collège pour poursuivre une filière bilingue en l'assimilant à une demande pour convenance personnelle.
Aussi, pour mettre fin à cette structure pyramidale des effectifs en filière bilingue il convient d'inscrire les prochaines ouvertures de filières dans une continuité des parcours allant de la maternelle au lycée. Il s'agit par exemple d'ouvrir des filières bilingues, voire immersives, dans des écoles appartenant à un même collège de secteur où sera ouverte une filière bilingue, pour que cet établissement scolaire puisse bénéficier d'un vivier potentiel d'élèves plus large pour celle-ci.
Recommandation n° 7 : Mettre fin à l'érosion des effectifs entre le primaire et le secondaire en assurant la continuité des parcours scolaires.
En fonction des langues, des stratégies différentes doivent être mises en place dans le choix des écoles et des collèges accueillant une filière bilingue.
S'agissant des langues pour lesquelles il existe encore peu de filières bilingues, les rapporteurs estiment essentiel, en tenant toutefois compte de la nécessité d'une meilleure planification et d'organisation dans un objectif de continuité des parcours exposé ci-dessus, de poursuivre la logique de la demande sociale avérée - c'est-à-dire, l'ouverture d'une filière en réponse à une demande des parents. Cependant, il est impératif de clarifier les conditions d'ouverture de ces filières et de mieux accompagner les acteurs locaux.
Les rapporteurs ont constaté que, dans certains cas, les parents manquent d'informations sur l'ouverture possible d'une filière bilingue dans l'école de leur enfant. N'étant pas au courant, ils ne peuvent donc pas manifester un intérêt pour y inscrire leur enfant, le nombre d'élèves potentiels est alors trop faible pour que les services académiques puissent répondre favorablement à une demande d'ouverture formulée par une commune.
Par ailleurs, l'attention des rapporteurs a été attirée sur l'évolution des critères de comptabilisation des familles intéressées. Selon les informations transmises aux rapporteurs lors de leur déplacement à Nantes, alors que le rectorat jusqu'à présent ne prenait en compte que les petites et moyennes sections - « les enfants de grande section ne sont pas comptabilisables, car l'ouverture d'une classe maternelle breton ne leur permettrait pas de suivre cet enseignement que durant une année scolaire »26(*) -, pour la rentrée 2025, ce sont les enfants nés en 2022 et entrant en petite section en septembre qui n'ont pas été comptabilisés.
Les rapporteurs ont pris connaissance avec intérêt de la mise en place par les services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques d'un guide pour l'ouverture de filières bascophones, qui est, selon Dominique Malroux, directeur académique des services de l'éducation nationale dans ce département, un héritage direct de la loi Molac. Ce guide précise notamment la procédure de recueil des intentions, ainsi que la démarche à suivre pour les premières enquêtes auprès des parents.
Pour certaines langues régionales, dont le basque pour lequel près d'un enfant sur deux de primaire scolarisé sur le territoire bascophone du département des Pyrénées-Atlantiques l'est dans une filière bilingue ou le breton dans l'académie de Rennes27(*), la présence d'un réseau important de filières bilingues permet de répondre globalement à la demande sociale des parents. Ceux attachés à un enseignement renforcé de cette langue pour leur enfant peuvent trouver relativement facilement un établissement scolaire à proximité de leur domicile.
Les rapporteurs souhaitent dans ces cas aller plus loin afin que l'éducation nationale ouvre des filières bilingues sans attendre une demande des parents. Les rapporteurs constatent que cette politique de l'offre est celle habituellement suivie par l'éducation nationale, par exemple pour l'ouverture de sections européennes ou internationales ou encore pour les dispositifs EMILE28(*).
Il s'agit d'aller vers les familles qui pourraient être intéressées si l'enseignement est proposé dans leur école de secteur, mais qui ne se mobilisent pas pour demander la création d'une telle filière. A cet égard, les rapporteurs plaident pour la mise en place de filières bilingues dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans tous les cas, la scolarisation des enfants dans une filière bilingue reste soumise à la libre adhésion des parents.
Recommandation n° 8 : Instaurer, dans les territoires où la demande d'ouverture de filières bilingues émanant des parents est globalement satisfaite, une politique fondée sur l'offre afin de rendre ces filières accessibles au plus grand nombre, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La scolarisation des enfants dans une filière bilingue resterait soumise à la libre adhésion des parents.
Enfin, les rapporteurs sont conscients que le développement de filières bilingues et immersives représente un coût, qu'il y ait un enseignant pour chaque langue, ou un seul enseignant pour les deux langues. En effet, le nombre d'élèves par classe est souvent plus faible. L'académie de Bretagne chiffre ainsi à 53 ETP pour le 1er degré public et 76 ETP pour le 2nd degré public, le surcoût lié à la différence des taux d'encadrement entre filières bilingues et monolingues. Elle a également précisé aux rapporteurs ne pas bénéficier de dotations budgétaires particulières pour financer le développement de l'enseignement des langues régionales.
Le poids sur les budgets académiques de l'enseignement bilingue des langues régionales, qui n'est aujourd'hui pas pris en compte, y compris dans le cadre de « l'allocation progressive des ressources » prévue pourtant pour tenir compte des spécificités des territoires, a également été souligné par Dominique Malroux, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques.
C. SÉCURISER FINANCIÈREMENT L'ENSEIGNEMENT IMMERSIF PRIVÉ
L'article 6 de la loi Molac prévoit une participation financière des communes à la scolarisation des élèves dans une école proposant un enseignement bilingue, si la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
Lors des auditions, les rapporteurs ont entendu des représentants des réseaux associatifs d'enseignement immersif alertant sur leurs difficultés à percevoir le forfait scolaire, mais aussi des élus locaux pointant du doigt les sommes élevées demandées alors même que leur école rurale est menacée de perdre une classe ou encore les efforts qu'ils font déjà en faveur de la langue régionale dans leur territoire.
Pour les rapporteurs, il est urgent d'apaiser les tensions nées de cet article.
Ils rappellent la volonté du législateur sous-jacent à cet article qui est d'inciter les maires à soutenir les demandes d'enseignement de langue régionale dans l'école de leur commune dans un objectif de généralisation de l'offre. Cette généralisation ne repose toutefois pas uniquement sur les élus locaux. Les rapporteurs soulignent le rôle de l'éducation nationale, que ce soit pour la définition de la carte des filières d'enseignement renforcé, à parité horaire voire immersif, ou en lien avec l'enseignement supérieur, dans la formation des enseignants et futurs enseignants. Résoudre la pénurie de ressources humaines est le premier obstacle à lever pour généraliser l'offre de formation.
Dans l'attente de ce développement, le réseau d'enseignement immersif joue un rôle décisif de service public dans la sauvegarde des langues. Aussi, il est impératif de clarifier les modalités de versement du forfait scolaire dû à ces établissements. Parmi les points de blocage à lever, les rapporteurs ont notamment noté la nécessité de mieux définir le contenu de l'enseignement de la langue régionale dans une école de la commune levant l'obligation de participation financière pour un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement immersif d'une autre commune. En effet, si la circulaire de décembre 2021 précise que cette participation financière est due en cas d'absence « d'école bilingue », l'article 6 de la loi Molac précise simplement une absence « d'école dispensant un enseignement de langue régionale ».
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu constater, à l'occasion de leurs travaux sur cette question, que dans un certain nombre de départements, il n'existe pas de forfait scolaire départemental calculé pour la maternelle et l'élémentaire. Ce calcul est pourtant un élément factuel essentiel et de nature à apaiser les débats sur le montant de la participation financière.
En outre, le rôle du préfet doit être clarifié. En effet le texte de loi ne prévoit rien en cas d'absence d'accord à la fin de la procédure actuelle de médiation.
Enfin, il est urgent de faire assurer par les préfets le mandatement d'office lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord financier trouvé entre celle-ci et l'établissement d'enseignement.
Recommandation n° 9 : Afin d'apaiser les tensions relatives au versement du forfait scolaire dans le cadre d'un enseignement des langues régionales :
- définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire,
- clarifier les cas où le versement du forfait scolaire est dû au regard du volume horaire d'enseignement de la culture et langue régionales proposé dans une école de la commune,
- préciser la procédure de médiation conduite par le préfet,
- faire assurer par les préfets le mandatement d'office, lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord trouvé avec l'établissement scolaire.
D. RENFORCER LES MOYENS HUMAINS
L'ensemble des acteurs rencontrés ont indiqué comme principal frein au développement de l'enseignement des langues régionales le manque de ressources humaines.
Pour y remédier, une triple action est nécessaire : utiliser davantage les ressources dormantes au sein de l'éducation nationale, renforcer la place des langues régionales dans la formation initiale et accroitre les efforts dans l'accompagnement des personnels, que ce soit à travers la formation continue ou le matériel pédagogique.
1. La nécessité d'utiliser davantage les ressources dormantes de l'éducation nationale
Les auditions ont montré que l'éducation nationale ne disposait pas de données complètes et fiables sur le nombre d'enseignants en capacité d'enseigner les langues régionales, notamment dans le premier degré. Dans certaines académies, il n'existe ainsi aucun recensement des enseignants ayant une maîtrise suffisante de la langue et disposés à l'enseigner. Or il s'agit d'éléments nécessaires pour pouvoir planifier et structurer un enseignement de la langue régionale, dans ces différents composants : enseignement renforcé (3 heures par semaine), enseignement bilingue à parité horaire et enseignement immersif.
Lors de son audition, Dominique Malroux, directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en Pyrénées-Atlantiques, a indiqué qu'il existe dans son département une enquête régulière permettant de recenser les compétences linguistiques des enseignants du primaire. Il souhaite toutefois aller plus loin dans celle-ci afin d'identifier également les enseignants ne maîtrisant pas ou pas suffisamment une langue régionale pour pouvoir l'enseigner mais étant prêts à se former et, plus généralement, identifier leurs besoins.
Tant le DASEN des Pyrénées-Atlantiques que celui des HautesPyrénées ont mis en avant la nécessité d'un travail de prospection pour identifier les ressources dormantes ou potentielles sur lesquelles ils pourront s'appuyer dans une logique de développement de filières d'enseignement des langues régionales.
En ce qui concerne le breton, l'office public de la langue bretonne a indiqué aux rapporteurs regretter que l'engagement, prévu par la convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne 2022-2027 de procéder par l'État « au recensement exhaustif des enseignants brittophones et de leurs niveaux », n'ait pas encore été mis en oeuvre.
Recommandation n° 10 : Recenser nationalement et dans les départements concernés pour chaque langue régionale les professeurs maîtrisant celle-ci à un niveau suffisant pour l'enseigner (niveau B2 ou C1 du cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) et souhaitant l'enseigner. Faire de même avec ceux disposant d'un niveau inférieur mais volontaires pour être formés afin de l'enseigner.
En ce qui concerne le secondaire, les rapporteurs ont été alertés dans l'ensemble des académies sur les difficultés à recruter des enseignants pour enseigner une discipline non linguistique (DNL) en langue régionale. Cette problématique rejoint pour certaines disciplines celle plus large de l'attractivité du métier d'enseignant. Mais pour la DNL, elle est accentuée par la nécessité que le professeur soit à la fois titulaire d'un CAPES en langue régionale et de la DNL à enseigner.
Afin de pallier les manques de ressources, certaines académies ont recours à des contractuels recrutés principalement pour leur compétence linguistique. Toutefois, les services des rectorats ont insisté sur la nécessité pour ces personnes de disposer d'une solide connaissance du contenu de la DNL ainsi que des compétences pédagogiques pour l'enseigner à des collégiens et lycéens. Au-delà de la langue, c'est la qualité de l'enseignement de la discipline qui est en jeu.
Conscients du « trou d'air » dans les effectifs à partir du collège et de la nécessité d'avoir une progression plus cylindrique, les rapporteurs estiment urgent d'enrichir l'offre au collège en DNL, pour aller vers une parité horaire ou a minima proposer une ou deux DNL dans les collèges.
C'est pourquoi, face à la carence de professeurs bivalents langue régionale - DNL et afin d'assurer un enseignement de qualité, les rapporteurs souhaitent que les professeurs volontaires du second degré possédant un niveau de langue suffisant, puissent enseigner tout ou partie de leur discipline en langue régionale. Pour les rapporteurs, ce niveau doit a minima être le niveau B2.
Les rapporteurs rappellent que pour les langues étrangères, la procédure de certification complémentaire permet « l'enseignement en langue étrangère d'une discipline non linguistique au sein des sections européennes et de langues orientales des collèges et lycées, des sections binationales et de tout autre dispositif spécifique ou contexte (classes Émile à l'école ou au collège par exemple) où l'enseignement d'une discipline non linguistique se fait en langue étrangère ». Dans ce cadre, la maîtrise de la langue d'enseignement « au niveau B2 ou C1 selon le contexte d'enseignement » est nécessaire.
Les rapporteurs soulignent également que pour les langues étrangères, cette certification en DNL est ouverte aux enseignants du premier degré pour enseigner dans le secondaire. Par parallélisme, cette possibilité doit également être possible pour les langues régionales.
Recommandation n° 11 : Permettre à des professeurs titulaires du CAPES dans une discipline non linguistique (DNL), de dispenser une partie ou la totalité de leur cours en langue régionale, après vérification de leur niveau de langue et de leur capacité à le faire par un inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) - langue régionale afin de faciliter le développement de l'enseignement de DNL en langue régionale au collège.
Enfin, pour le premier degré et du fait de l'existence d'un concours académique, les rapporteurs sont conscients que certains candidats maîtrisant une langue régionale ont fait le choix de se présenter à un concours autre que celui de l'académie où cette langue est pratiquée. Lauréats du concours, ils se trouvent alors affectés dans une académie où cette compétence linguistique ne peut pas être utilisée.
Les rapporteurs connaissent les difficultés de mobilité d'un département à un autre : outre le barème, un enseignant doit obtenir à la fois un ineat du département qu'il souhaite intégrer et un exeat du département qu'il veut quitter.
Ils ont également été informés de l'existence de stratégies consistant à demander des postes fléchées « langues régionales » pour pouvoir entrer dans un département puis postuler les années suivantes sur un autre poste ne proposant plus cet enseignement. Selon Katia Béguin, rectrice de l'académie de Nantes, cette stratégie permet de gagner vingt ans au regard des règles habituelles de mobilité de l'éducation nationale. Il en résulte une instabilité dans le maintien d'un enseignement de ou en langue régionale au sein de l'école, au gré des départs des enseignants postulant ensuite sur un autre poste de la circonscription.
Pour cette raison, les rapporteurs appellent à privilégier le recours aux postes à profil (POP) lors de la création d'un parcours langue régionale au sein d'une école.
La procédure spécifique de recrutement par les postes à profil
Les postes à profil (POP) sont des postes pour lesquels les modalités de recrutement diffèrent du mouvement de mobilité, qui se fait au barème (nombre de points obtenus en raison de l'ancienneté, de caractéristiques spécifiques du poste, de raisons familiales ou professionnelles).
Ces postes correspondent à des besoins particuliers, ou nécessitent des compétences, qualifications ou aptitudes spécifiques et font l'objet d'une fiche de poste. Tout enseignant à partir du moment où il remplit les conditions exigées de titre ou de certification, quelles que soient son ancienneté ou son académie d'exercice peut postuler à un POP, même si celui-ci est dans une autre académie.
Pour postuler, l'enseignant doit joindre, outre son CV, une lettre de motivation et les justificatifs demandés par le poste. Les candidatures sont examinées par les DSDEN. L'enseignant est recruté après un entretien devant une commission départementale. L'obtention du poste vaut automatiquement exeat du département d'origine et ineat dans le département d'accueil. L'enseignant recruté via un POP s'engage à rester sur celui-ci pendant trois ans.
En 2024, un peu plus de 600 postes à profil ont été inscrits dans le mouvement national POP. 21 d'entre eux concernent un poste d'enseignant du 1er degré bilingue breton, 2 concernent l'occitan dont un pour une filière bilingue, 1 le basque - avec une précision supplémentaire que cet enseignement a lieu en milieu rural. Il est difficile de comptabiliser les postes pour l'alsacien, car cette langue est souvent assimilée à l'allemand dans les postes. Dans ce cadre, 9 POP concernent des postes relatifs à l'allemand, dont un pour une filière bilingue.
Les POP permettent en effet le maintien pendant trois ans de la même personne sur le poste, durée nécessaire pour amorcer un enseignement en langue régionale dans une école.
Par ailleurs, pour permettre un ancrage de l'enseignement de la langue au sein de l'établissement scolaire et éviter que les POP ne soient utilisés uniquement pour entrer dans le département souhaité sans volonté ensuite de poursuivre l'enseignement de la langue, les rapporteurs proposent la mise en place d'une bonification au barème en cas d'engagement de l'enseignant à enseigner pendant six ans consécutifs sur ce poste - soit le double de la durée minimale d'un POP.
Recommandation n° 12 : Permettre un amorçage puis un ancrage de l'enseignement d'une langue régionale au sein d'une école :
- par le recours aux postes à profil (POP) impliquant un engagement de trois ans sur le même poste dans les filières bilingues ou immersives ;
- par l'attribution d'une bonification au barème en cas d'engagement du professeur à rester 6 ans soit le double de la durée de l'engagement actuel lié à un POP.
2. La réforme de la formation initiale : un virage à ne pas manquer
La prise en compte des langues régionales dans la formation initiale des enseignants doit être au coeur de la politique publique de promotion et de sauvegarde de celles-ci.
Certaines régions, en lien avec l'université et, dans certains cas, avec l'éducation nationale, se sont emparées de ce sujet. C'est notamment le cas pour le breton avec la mise en place d'un parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) au lycée d'Iroise à Brest dédié au CRPE spécial. Ouvert à la rentrée 2022, celui-ci a séduit de nombreux étudiants : on dénombre à la rentrée 2024, 261 candidatures sur Parcoursup pour 30 places - la capacité initiale de cette préparation a d'ailleurs été augmentée de 6 places en l'espace de trois ans face à l'engouement qu'elle suscite. Sur trois années, ce sont ainsi 80 étudiants qui suivent cette formation spécifique. Ce parcours est ouvert aux étudiants des filières bilingues bretonnes, mais aussi aux étudiants ayant suivi un cursus classique - la région prenant alors en charge le financement d'une préparation linguistique supplémentaire pour une mise à niveau. Pour le rectorat de Rennes, « l'un des grands enjeux de [cette] licence est de permettre une appropriation de la langue et de la culture bretonne aux étudiants qui en sont relativement éloignés ». L'enjeu est important : à la rentrée 2025, seuls 13 % des candidats retenus sont issus d'un cursus scolaire bilingue.
L'INSPÉ de Bretagne propose pour sa part un parcours immersif « Kelenn » qui consiste en une formation en immersion bilingue pendant les deux années de master, afin de préparer les étudiants au concours de recrutement en langue régionale.
L'université Bordeaux Montaigne, en lien avec l'INSPÉ de Bordeaux, a créé dans le cadre de son Master MEEF 1er degré, un parcours bilingue français-occitan (qui accueille 13 étudiants) et un parcours bilingue français-basque (qui accueille 18 étudiants) afin de préparer aux CRPE spéciaux dans ces deux langues. Spécificité du Master MEEF françaisbasque, celui-ci forme les étudiants souhaitant ensuite enseigner dans une classe bilingue ou immersive des trois systèmes d'enseignement : l'éducation nationale, le réseau associatif immersif Seaska ou l'enseignement catholique. Afin de les préparer au mieux à leurs futures modalités d'enseignement, l'université a fait le choix que 30 % du volume horaire soit en langue régionale, notamment pour des disciplines non linguistiques.
Or, la réforme de la formation initiale des enseignants - dont les contours restent encore très flous - fait naître de nombreuses inquiétudes quant à la prise en compte des langues régionales. Ainsi, le devenir des parcours préparatoires du professorat des écoles est en suspens, notamment celui de Brest.
Pour les rapporteurs, la mise en place du concours à la fin de la licence 3 impose d'avancer aux années de licence des cours spécifiques de et en langue régionale, au risque de voir chuter le nombre de candidats aux CRPE spécifiques.
Dans le cadre des auditions menées, les rapporteurs ont obtenu les informations suivantes sur les projets de mise en oeuvre de la réforme dans l'académie de Bordeaux.
Pour la langue occitane, il est prévu la mise en place à la rentrée 2026 d'une licence de professorat des écoles bilingues occitan à l'université Bordeaux Montaigne, en plus du master MEEF 1er degré bilingue. Les rapporteurs saluent cette démarche qui pourrait servir de modèle pour d'autres langues régionales dans d'autres académies.
Par ailleurs, depuis cette année scolaire, l'INSPÉ propose un cours d'initiation pour les non spécialistes aux langues d'Aquitaine basque et occitan d'un volume horaire de 12 heures. Si cette initiative contribue à mieux faire connaître les langues régionales, les rapporteurs soulignent que celle-ci n'est pas suffisante pour former des locuteurs complets de niveau C1 - notamment pour les langues non romanes - qui est le niveau demandé pour enseigner en langue régionale. Ils alertent ainsi le ministère sur toute tentative de réduire la prise en compte des langues régionales dans la formation initiale des enseignants à des cours de sensibilisation ou d'initiation.
En revanche, selon les informations transmises, il n'est pas prévu pour le moment de préparation au CAPES occitan - langue d'oc dans l'académie de Bordeaux.
En ce qui concerne le basque, la licence LLCER Parcours d'études basques propose depuis cette rentrée universitaire un module de préparation au concours du 1er degré. Pour les étudiants actuellement en L3, un module de langue et culture régionales basque de 34 heures est prévu par l'INSPÉ de Bordeaux à destination des étudiants des six universités de l'académie qui souhaitent préparer le CRPE spécial langue régionale. Un module de préparation au concours de professorat des écoles est proposé aux étudiants de L3 suivant la licence LLCER Études basques. Par ailleurs, une licence bilingue de professorat des écoles devrait être créée à la rentrée 2026-2027, ainsi que de nouveaux Masters M2E (master enseignement et éducation) prévoyant un renforcement linguistique. Parallèlement, un parcours facultatif d'enseignement pour les premier et second degrés devrait également être lancé au sein de la licence LLCER Études basques.
Il est toutefois à noter que la langue basque n'est pas prise en compte dans les licences et masters disciplinaires (histoire-géographie, mathématiques, etc.) qui sont les études supérieures suivies par la plupart des candidats aux CAPES.
Recommandation n° 13 : Dans le cadre de la réforme de la formation initiale, prévoir :
- parmi les licences de préparation aux concours d'enseignant du premier degré qu'une partie du volume horaire se fasse en langue régionale,
- en master, qu'au moins 50 % des enseignements soient en langue régionale pour les lauréats des CRPE spécifiques,
- la possibilité, tout au long du parcours universitaire, de suivre des cours de langue régionale ainsi que des cours de matière disciplinaire en langue régionale, pour permettre aux futurs professeurs - y compris ceux ne préparant pas le CRPE spécial - d'enseigner en langue régionale.
En ce qui concerne le contenu du nouveau Master « M2E », selon les informations transmises aux rapporteurs et en fonction des négociations en cours avec les universités, chaque université aura la possibilité de consacrer 10 % du volume horaire de la maquette à une adaptation aux spécificités territoriales, pouvant inclure un enseignement de langue régionale.
Les nouveaux M2E doivent également prévoir des périodes de stages en classe. Les rapporteurs estiment nécessaire que les stages des Masters M2E bilingue se fassent dans des classes bilingues voire immersives.
Recommandation n° 14 : Prévoir systématiquement l'organisation des stages en master dans des classes bilingues ou immersives pour les étudiants lauréats des CRPE spéciaux langue régionale.
3. Le nombre de places ouvertes aux concours dédiés : un enjeu de valorisation des langues régionales
À de nombreuses reprises, les rapporteurs ont été interpellés sur le nombre de places ouvertes aux différents concours d'enseignement en langues régionales et les modalités d'accessibilité de ceux-ci.
Les rapporteurs soulignent un point : les concours d'enseignement dédiés aux langues régionales participent à leur valorisation et à la reconnaissance de leur place dans l'espace public.
C'est pourquoi, les rapporteurs ont interrogé la direction générale de l'enseignement scolaire sur l'opportunité d'ouvrir davantage de places aux concours des CRPE spéciaux et aux différents CAPES langues régionales.
Les rapporteurs entendent les arguments du ministère sur la nécessité de trouver un équilibre afin de garantir l'attractivité d'un concours : en effet, les postes ouverts en langue régionale chaque année ne sont déjà aujourd'hui pas tous pourvus. Augmenter le nombre de places risque d'accentuer ce phénomène et de réduire encore le taux de réussite à ce concours, ce qui peut décourager de potentiels candidats de s'y présenter. Toutefois, ils soulignent également les besoins importants afin de soutenir le développement de l'enseignement des langues régionales. Par ailleurs, le nombre de places ouvertes à un concours participe à l'attractivité de la filière de formation et à la mise en place de celle-ci.
En ce qui concerne le second degré pour lequel les postes sont globalement mieux pourvus, les rapporteurs constatent que le système actuel des CAPES des langues régionales, mis en place dans les années 1980, n'est plus adapté. En effet, il ne tient pas compte de l'existence de filières bilingues dans les collèges et de la nécessité de maîtriser à la fois une langue régionale et une matière disciplinaire. Aussi les rapporteurs souhaitent l'ouverture d'une réflexion sur les concours du second degré, afin d'adapter la bivalence aux besoins de construction des parcours bilingues (langue régionale/mathématiques, langue régionale/histoire-géographie, etc.).
Recommandation n° 15 : Afin de favoriser le développement de filières bilingues dans le secondaire et de garantir la qualité des enseignements, élargir la liste des bivalences possibles entre une DNL et une langue régionale.
4. Renforcer et relancer l'apprentissage des langues régionales dans la formation continue
Enfin, l'augmentation des ressources humaines capables d'enseigner en langue régionale passe nécessairement par un renforcement de la formation continue.
Selon les chiffres transmis par la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), toutes académies confondues, dans le cadre des écoles académiques de formation continue29(*), on compte pour l'année scolaire 20242025, 444 enseignants inscrits à au moins un module de formation continue lié aux langues régionales, et parmi eux 383 enseignants présents. Les trois principales langues concernées sont le basque (116 enseignants formés), le breton (48 enseignants formés) et le corse (39 enseignants formés).
S'y ajoutent des dispositifs académiques locaux fréquemment cofinancés et développés par les collectivités territoriales et l'office public de la langue régionale concernée. À cet égard, les rapporteurs saluent le rôle essentiel joué par ces acteurs locaux, qui sont des partenaires indispensables de l'éducation nationale pour former ses enseignants - et souvent pionniers pour proposer aux enseignants des modules de formation linguistique.
Un engagement des acteurs locaux au service
de
l'enseignement des langues régionales
Les auditions ont permis de mettre en avant l'engagement fort des acteurs locaux pour proposer une formation continue aux enseignants, afin de leur permettre d'augmenter leur maîtrise de la langue régionale - y compris pour des débutants - et pouvoir ensuite enseigner celle-ci à leurs élèves.
Depuis la rentrée 2024, l'académie de Rennes a mis en place un dispositif de décharge à temps plein sur la durée de l'année scolaire pour les enseignants souhaitant se former à l'enseignement bilingue breton. 20 postes de professeur des écoles y sont consacrés pour le premier degré public et 5 postes pour le second degré public.
La rectrice de Nantes a indiqué aux rapporteurs que les demandes de congés formation en breton sont prioritaires. Par ailleurs, à la rentrée scolaire 2025, l'académie de Nantes a mis en place, à titre expérimental, la prise en charge d'une décharge complète pour se former en breton et ensuite enseigner à Nantes. Toutefois, selon les informations données aux rapporteurs, aucune candidature sur cette proposition de formation, puis de poste, n'a été déposée.
En ce qui concerne l'occitan, l'office public de la langue occitane a mis en place, en collaboration avec les rectorats de Bordeaux, Limoges, Montpellier et Toulouse, le dispositif Ensenhar. Celui-ci a pour objectif de former sur une année scolaire des enseignants titulaires à enseigner la langue occitane soit comme langue vivante, soit dans le cadre d'une DNL30(*).
Pour le basque, il existe depuis 2016 une convention régulièrement renouvelée entre l'office public de la langue basque et l'éducation nationale pour former des enseignants titulaires exerçant en français et volontaires pour enseigner en langue basque. Les modalités de partenariat ont évolué à la rentrée 2025 : les enseignants concernés se forment dans l'organisme de formation de leur choix qui met en place l'organisation de la formation (test de positionnement avant la formation, organisation logistique et pédagogique, formation). L'éducation nationale prend en charge le maintien du salaire des enseignants ainsi que leur remplacement. L'office public finance le coût de la formation. Les enseignants pouvant bénéficier de cette formation sont choisis en collaboration avec l'éducation nationale.
Par ailleurs, l'office public de la langue basque a mis en place des formations de perfectionnement du niveau de langue basque proposées à tous les enseignants volontaires des 1er et 2nd degrés des 3 filières d'enseignement. Celles-ci prennent la forme pour 20252026 de 6 séances de 3 heures réparties sur des mercredis après-midi sur un semestre pour un travail sur l'écrit (grammaire, syntaxe, etc.), et de deux fois deux journées entières pendant des vacances scolaires pour la fluidité à l'oral. Des formations spécifiques sur les mots techniques ont également été créées à destination des enseignants.
De son côté, l'office public de la langue catalane, en lien avec l'université de Perpignan, finance un diplôme universitaire en langue pour les enseignants.
Pour le corse, le rectorat a lancé son grand plan de formation en langue corse. Dans ce cadre sont notamment organisés des stages tournants sur toute la Corse. L'INSPÉ est associé à ce plan, notamment à travers l'examen de certification « langue corse » organisé par l'Università di Corsica et l'examen d'habilitation.
La formation continue est une voie essentielle pour le développement de l'enseignement des langues régionales. Entre 2016 et 2020, ce sont ainsi 19 enseignants du 1er degré et 20 enseignants de DNL du 2nd degré qui ont été formés à la langue basque. À titre d'exemple, 2 enseignants sont actuellement en formation (l'un enseigne l'EPS et l'autre la physique-chimie). Pour l'occitan, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ce sont 7 enseignants qui ont été formés à un niveau au moins égal à B2, sur les cinq dernières années. Sur l'académie de Toulouse, ce sont 24 enseignants qui ont bénéficié de la formation continue Ensenhar sur la période 2018-2023.
L'académie de Corse : un investissement massif dans la formation continue dans un contexte « d'institution de la langue corse en savoir scolaire fondamental »
Le projet académique corse « Scola 2030 » couvrant la période 2025-2030 définit comme premier axe l'institution de la langue corse en savoir scolaire fondamental. Il fixe notamment comme objectifs de généraliser l'enseignement bilingue et de développer l'immersif en visant un haut niveau de maîtrise linguistique, ainsi que d'assurer la continuité des parcours bilingues de la maternelle au lycée.
Pour y parvenir, l'académie de Corse a lancé un plan ambitieux de formation. Sur les trois dernières années, 284 enseignants du 1er degré et 60 enseignants du 2nd degré ont suivi une formation dispensée par des enseignants de langue et culture corses, des conseillers pédagogiques et des professeurs habilités des disciplines non linguistiques. Le niveau de maîtrise de langue visée est le niveau B2. Selon le recteur, cette dynamique de formation est à poursuivre de manière à viser, à terme, dans le cadre du nouveau projet académique, la généralisation de l'enseignement bilingue dans le 1er degré et 200 nouveaux professeurs du 2nd degré habilités dans les 5 prochaines années.
Si ces dispositifs ont prouvé leur efficacité, force est de constater qu'ils s'essoufflent. Les raisons sont diverses.
Du côté de l'éducation nationale, il a été indiqué, par les services académiques aux rapporteurs, le coût RH important de ces formations qui nécessitent de mobiliser pendant plusieurs mois un remplacement sur le poste occupé par l'enseignant formé. Par ailleurs, notamment pour les langues non latines, l'enseignant doit disposer d'une maîtrise minimale de la langue avant la formation intensive sans quoi celle-ci ne permet pas d'atteindre le niveau demandé pour pouvoir enseigner. Enfin, les rapporteurs ont entendu les regrets des services du rectorat de ne pas pouvoir tirer tout le temps profit de ces formations en citant deux exemples : dans un cas, l'enseignant formé postule ensuite sur un POP dans une autre académie, dans l'autre les services académiques soulignent l'absence d'obligation pour l'enseignant formé d'enseigner ensuite la langue régionale ainsi apprise.
Face à ce constat, certaines académies conditionnent l'acceptation de la demande de cette formation longue à un engagement de ce dernier d'enseigner ensuite sur un poste qu'elles ont fléché. C'est notamment le cas de l'expérimentation menée dans l'académie de Nantes pour une prise de poste qui serait ensuite, selon les informations données aux rapporteurs, dans l'agglomération nantaise.
Toutefois, cette condition peut conduire à freiner les demandes de formation des enseignants qui ne souhaitent pas enseigner sur les postes ainsi fléchés.
Du côté des offices publics, ceux-ci ont souligné le manque d'information des enseignants sur l'existence de ces formations. Pour l'office public de la langue bretonne, ce manque de communication est la principale explication des difficultés pour le rectorat de Nantes à trouver un enseignant intéressé par la formation intensive d'un an.
Par ailleurs, ils ont fait part de leur inquiétude sur une remise en cause, même partielle, des co-financements de ces formations par les collectivités territoriales.
Recommandation n° 16 : Poursuivre les efforts en matière de formation continue en sécurisant les financements et en communiquant davantage auprès des professeurs sur l'existence de stages intensifs en langue régionale.
5. Un accompagnement renforcé des enseignants
Les rapporteurs ont entendu avec intérêt les propos de Dominique Malroux, directeur des services académiques des Pyrénées-Atlantiques, soulignant qu'un certain nombre d'enseignants abandonnent l'enseignement en langue régionale en raison, d'une part, de la difficile gymnastique en cours entre les deux langues et, d'autre part, d'un moindre nombre de ressources pédagogiques disponible en langue basque. Les professeurs en langue régionale doivent trop souvent « tout fabriquer » ce qui demande un investissement considérable. Cette absence de matériel pédagogique a également été pointée du doigt au lycée immersif Extepare : alors que l'enseignement se fait en langue basque, les élèves doivent utiliser un manuel en français. La fabrique des ressources repose sur des structures très différentes, fruit d'une histoire contrastée : ainsi au Pays basque, c'est une association IKAS qui est le principal producteur de ressources.
TES, la maison d'édition historique des
manuels
d'histoire-géographie en langue bretonne
Créée il y a une vingtaine d'années, TES est la maison d'édition de contenus pédagogiques en langue bretonne. Financée principalement par la Région et l'éducation nationale et adossée Canopée, elle conçoit et édite des ressources pédagogiques pour les trois filières d'enseignement du breton, publique, privée catholique et Diwan.
Témoin d'un lien fort entre cette maison d'édition et l'éducation nationale, les choix éditoriaux de TES sont faits par un conseil d'édition constitué de l'inspecteur pédagogique régional de langue et culture bretonnes, des inspectrices de l'éducation nationale et de conseillers pédagogiques 1er et 2nd degrés des trois filières d'enseignement.
Ses premières parutions ont été des traductions de manuels d'histoire-géographie de collège, avant de se diversifier progressivement. Son champ de production s'est progressivement étendu aux mathématiques, à l'éducation physique et sportive, à la lecture et l'étude de la langue ou encore, aux arts et, suivant les disciplines, aux niveaux de maternelle, d'élémentaire ou de collège.
Il est important que l'éducation nationale s'empare de ce sujet et soutienne les différentes structures chargées de mettre à disposition des enseignants des matériels pédagogiques adaptés, le cas échéant, en lien avec les offices publics.
Il convient également de permettre aux enseignants de disposer de personnes ressources. Les rapporteurs ont constaté que la présence d'un conseiller pédagogique dans la langue régionale est de nature, d'une part, à dynamiser et structurer l'enseignement de celui-ci et, d'autre part, à faire office de personne ressource pour les enseignants. Or, ils constatent que les départements concernés par une langue régionale ne disposent pas tous d'un conseiller pédagogique dédiée.
De même, alors que la circulaire du 14 décembre 2021 sur les langues régionales constate que « la création d'une agrégation des langues de France en 2017 permet désormais la création d'un vivier d'IA-IPR de langues de France recruté nationalement et chargé de remplir auprès des recteurs des missions de conseillers et de veiller en particulier à la qualité des enseignements dispensés », la création d'une spécialité « langues de France » au sein du corps des IA-IPR n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Pour les rapporteurs, la création de ce corps participerait, d'une part, à la reconnaissance par l'éducation nationale de la place des langues régionales dans l'enseignement et, d'autre part, permettrait la création d'une structure encadrant IA-IPR/conseillers pédagogiques sur laquelle pourraient s'appuyer les enseignants ainsi que le directeur des services académiques pour dynamiser et animer l'enseignement de ces langues.
Enfin, les rapporteurs ont été alertés par Katia Béguin, rectrice de l'académie de Nantes, sur l'absence au sein de ses équipes de personnels encadrants maîtrisant la langue bretonne. Comme l'a indiqué la rectrice, « lorsque nous recrutons des contractuels, nous n'avons pas les moyens de vérifier sa maîtrise du breton » ni le contenu des cours. Actuellement, ce sont des personnels de l'académie de Rennes qui procèdent à la vérification, à la suite d'un accord informel entre les deux académies. Toutefois, l'existence des limites académiques et donc de périmètre d'action des IA-IPR et des inspecteurs de l'éducation nationale peut constituer des obstacles administratifs pour la réalisation de missions en dehors de la circonscription.
Si les rapporteurs plaident pour la présence dans chaque académie d'un IPR de la ou des langues régionales de ce territoire et d'un conseiller pédagogique dédié dans chaque département, ils sont conscients de contraintes pesant également sur les moyens humains des services encadrants des rectorats. Aussi, à court terme ou en cas de vacances de poste, ils appellent à permettre l'élargissement des périmètres des missions de ces personnels au département voisin partageant la même langue : les limites administratives ne doivent pas constituer une entrave à l'accompagnement des enseignants et l'apprentissage d'une langue régionale commune à deux territoires.
Recommandation n° 17 : Développer des matériels pédagogiques adaptés, notamment des documents traduits pour les disciplines non linguistiques.
Recommandation n° 18 : Créer une spécialité « langue régionale » au sein du corps des IA-IPR pour mieux accompagner les professeurs et nommer dans tous les départements concernés par les langues régionales un conseiller pédagogique « langue régionale ».
Recommandation n° 19 : Autoriser l'élargissement des périmètres d'action des IA-IPR et des conseillers pédagogiques « langue régionale », afin que les limites administratives d'une académie n'entravent pas l'accompagnement des professeurs et l'apprentissage linguistique par les élèves dans le territoire voisin partageant la même langue régionale, notamment en cas de vacance de postes.
E. MIEUX VALORISER LES LANGUES RÉGIONALES DANS LE CURSUS SCOLAIRE
1. Un besoin urgent de prévisibilité et d'égalité entre les langues régionales au brevet des collèges
La possibilité pour les élèves en filière bilingue ou immersive de pouvoir présenter une partie des épreuves en langue régionale - qui est la langue d'apprentissage de la discipline tout au long du collège, voire de leur scolarité - est une question particulièrement sensible et récurrente pour le diplôme national du brevet depuis plus de vingt-cinq ans.
Comme sur de nombreux autres points en ce qui concerne l'enseignement des langues régionales, l'autorisation de composer dans une langue autre que le français résulte de négociations bilatérales entraînant des différences de traitement entre langues régionales, mais aussi pour une même langue régionale selon que l'élève fréquente un établissement privé immersif associatif, un autre type d'établissement privé ou l'école publique.
Ainsi, depuis 1994, les collégiens du réseau Diwan peuvent composer l'épreuve d'histoire-géographie en breton. Cette possibilité de rédiger en langue régionale a été élargie par arrêté du 18 août 1999 à l'ensemble des élèves de troisième des sections bilingues français-langue régionale, les élèves devant faire connaître leur choix de la langue de composition au moment de l'inscription à l'examen.
En 2011, sur dérogation, la possibilité de passer les épreuves de mathématiques en langue régionale a été ouverte aux élèves de l'enseignement privé immersif associatif avant de l'élargir à l'ensemble des élèves en 2022. Ce schéma s'est répété pour l'épreuve de sciences ouverte en 2023, uniquement aux élèves des réseaux associatifs de l'enseignement privé immersif, avant d'être élargie à tous les élèves en 2025.
L'annonce d'une réforme des modalités d'examen pour le diplôme national du brevet suscite de nombreuses interrogations auprès des élèves, de leurs familles et des enseignants des filières bilingues. En effet, à la différence de l'épreuve d'histoire-géographie pour laquelle les textes prévoient explicitement la possibilité de rédaction en langue régionale, aucune précision n'est apportée sur les épreuves de sciences et de mathématiques. À ce stade, les élèves et enseignants ne savent donc pas si le régime dérogatoire est maintenu dans la nouvelle mouture de cet examen. Les réponses de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) aux questions des rapporteurs alimentent ce flou : « l'évolution du DNB à compter de la session 2026 implique de revoir la place des langues régionales dans ce nouveau cadre ».
Pour les rapporteurs, il est urgent de clarifier cette situation en précisant dans l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du DNB - texte de référence qui définit le cadre de cet examen - la possibilité pour les élèves volontaires des filières bilingues français-langue régionale de passer les épreuves de mathématiques et de sciences en langue régionale, dans les mêmes conditions que celle d'histoiregéographie - éducation morale et civique.
Cette modification réglementaire s'inscrirait dans la création d'un cadre national pour les langues régionales que les rapporteurs appellent de leurs voeux.
Recommandation n° 20 : Réaffirmer, à la suite de la réforme du diplôme national du brevet pour la session 2026, la possibilité pour les élèves volontaires de composer certaines épreuves du brevet en langue régionale. Inscrire cette possibilité dans un cadre national pour assurer une équité entre les élèves qui reçoivent un enseignement en langue régionale.
Se pose également la question de la langue utilisée pour les énoncés et les documents. En novembre 2023, le ministère de l'éducation nationale a transmis un courrier à l'ensemble des recteurs et des chefs d'établissement concernés pour indiquer qu'« afin de respecter l'équité de traitement pour tous les élèves lors des examens et de sécuriser la passation, il convient de rappeler que, quelle que soit la langue de composition, les sujets et les documents d'accompagnement des sujets ne sont pas traduits en langue régionale et demeurent en français ». Ce courrier, à rebours de la pratique observée dans certaines académies, notamment pour les élèves brittophones et bascophones, a suscité un vif émoi parmi les élèves.
Après plusieurs interventions des parents, des enseignants et des élus locaux, le ministère est finalement revenu sur sa décision en avril 2024. Par un courrier aux élus locaux, Nicole Belloubet, alors ministre de l'éducation nationale indique que « pour cette session 2024, les modalités de traitement des langues vivantes régionales des sujets du DNB et de leur traduction, [sont reconduites] afin de maintenir une stabilité du cadre d'évaluation pour cette dernière session du DNB actuel ».
Au nom de l'équité entre élèves, les rapporteurs appellent à maintenir cette traduction des énoncés et des documents en langue régionale. Disposer de documents dans une langue et devoir composer dans une autre rend plus difficile pour les élèves la reformulation et l'appui sur les documents qui font pourtant partie des critères d'évaluation des candidats au brevet des collèges.
2. La nécessité d'une meilleure reconnaissance des langues régionales au baccalauréat
L'ensemble des acteurs constatent que le passage du collège au lycée constitue le deuxième moment majeur de décrochage dans l'apprentissage des langues régionales, après le passage de l'école au collège.
Les langues régionales, comme toutes les options, souffrent très fortement de la réforme du lycée et du baccalauréat. D'une part, elles sont beaucoup moins valorisées qu'auparavant dans le calcul de la note du baccalauréat. D'autre part, les heures d'option sont souvent reléguées à des horaires peu attrayants, quand celles-ci ne sont pas supprimées en raison d'une dotation horaire globale absorbée pour la mise en oeuvre des différentes spécialités et des demi-groupes dans les autres langues vivantes.
L'annonce à la rentrée 2025, de la création dès la session 2026 d'une épreuve anticipée de mathématiques, suscite de nombreuses questions de la part des élèves et des enseignants, notamment au Pays Basque. En effet, entre 2012 et 2018, dernière année de l'ancien baccalauréat, les élèves de terminale avaient la possibilité de passer l'épreuve de mathématiques en langue basque31(*). Depuis la réforme du baccalauréat, il n'existe plus, en tant que telles, d'épreuves terminales en langue régionale : l'histoiregéographie, discipline reine pour parmi DNL, est désormais évaluée en contrôle continu. Il en est de même pour l'enseignement scientifique.
Depuis septembre se fait entendre une demande de pouvoir passer cette épreuve de mathématiques en langue régionale, comme cela était possible avant 2019. Les rapporteurs sont favorables à cette demande, d'autant plus qu'il s'agit de la langue dans laquelle ont lieu les apprentissages.
Plus généralement, les rapporteurs souhaitent que davantage de disciplines, notamment des épreuves de spécialité ou une partie du grand oral, puissent être présentées en langue régionale.
La préparation aux épreuves de
spécialités mathématiques au lycée
Extepare
entre cours en basque et préparation d'une épreuve en
français
M. Garikoitz Mujika Zubiarrain, directeur de l'établissement, a précisé les conditions dans lesquelles les bacheliers de Seaska préparent l'épreuve de spécialité de mathématiques. Les cours ont lieu intégralement en langue basque alors que l'épreuve doit être présentée en français. Lors du premier bac blanc, les élèves ont la possibilité de rédiger en basque ou en français. En revanche, pour le deuxième bac blanc, leur copie doit être en français afin de les préparer aux conditions de passage de l'épreuve.
Les rapporteurs sont conscients de la difficulté supplémentaire qu'est celle de trouver des correcteurs de copie et examinateurs maîtrisant à la fois le contenu disciplinaire et la langue régionale.
Aussi, ils proposent que dans chaque académie, il soit procédé au recensement des correcteurs disposant d'un niveau suffisant en langue régionale susceptibles d'être mobilisés pour corriger des copies d'examen ou les épreuves orales des disciplines linguistiques. Lors de son audition, l'office public de la langue basque a indiqué avoir transmis à l'académie de Bordeaux une telle liste.
Recommandation n° 21 : Permettre aux élèves volontaires de passer en langue régionale la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. Élargir cette possibilité aux spécialités ou au grand oral.
Recommandation n° 22 : Procéder dans chaque académie au recensement des correcteurs disposant d'un niveau suffisant en langue régionale.
3. Une même importance à accorder aux langues régionales qu'aux autres langues vivantes européennes
Paradoxalement, si les sondages réalisés dans les territoires concernés par les langues régionales montrent un attachement de la population aux langues régionales, celles-ci pâtissent encore d'un manque de reconnaissance dans la sphère publique. Un responsable de l'éducation nationale a ainsi indiqué aux rapporteurs que la mention de l'apprentissage de ces langues sur Parcoursup reste très peu valorisée par les établissements de l'enseignement supérieur.
Pour les rapporteurs, un signe fort doit être envoyé afin de montrer que ces langues sont des langues vivantes comme les autres langues européennes. L'évaluation de leur maîtrise par l'éducation nationale et les objectifs de niveau à atteindre se font d'ailleurs en référence au cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL), également utilisé pour les autres langues enseignées à l'école en LVA, LVB ou LVC, telles que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
Les rapporteurs soulignent la mise en place pour l'anglais du test Ev@lang collège depuis la rentrée scolaire 2021-2022, afin d'évaluer leur niveau au regard de référentiel européen des langues. Celui-ci, qui est un test 100 % en ligne, concerne tous les élèves scolarisés en classe de troisième. Ce test est conçu par France éducation international qui est un organisme expert en matière de certification linguistique et opérateur public sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Sur ce modèle, ils préconisent que les élèves volontaires suivant un enseignement en langue régionale puissent bénéficier à différents moments de leur scolarité - par exemple à la fin du CM2, du collège et au baccalauréat - d'une certification de leur niveau de langue régionale.
Recommandation n° 23 : Proposer aux élèves à la fin du primaire, du collège et en classe de terminale une certification en langue régionale visant à évaluer leur niveau au regard du cadre européen commun de référence (A1 à C2) sur le modèle d'Ev@lang au collège pour l'anglais afin que les langues régionales bénéficient du même niveau de reconnaissance que les autres langues vivantes européennes. Inscrire cette certification sur le diplôme national du brevet ou du baccalauréat.
F. FAIRE VIVRE LES LANGUES RÉGIONALES EN DEHORS DE L'ÉCOLE
La sauvegarde des langues régionales relève de deux responsabilités :
· celle de l'État est de construire une offre riche et cohérente d'enseignement afin de permettre aux enfants qui le souhaitent d'apprendre cette langue régionale pour devenir des locuteurs complets ;
· celle des collectivités territoriales est de proposer un environnement complémentaire de cette offre, permettant de montrer l'utilité sociale de cette langue et de son apprentissage. La langue régionale ne doit pas être qu'une simple discipline scolaire.
De nombreuses collectivités territoriales ont mis en place des actions en faveur des langues régionales. Nombre d'entre elles, notamment les régions ou départements concernés, ont des délégations à la promotion de la langue. Certaines proposent des documents bilingues, que ce soit sur la totalité de celui-ci ou partiellement. La signalétique bilingue y participe également. La loi Molac, en cela, a permis de sécuriser cette pratique. Le renouvellement des panneaux au fur et à mesure de leur usure doit être l'occasion de mettre en place une nouvelle signalétique bilingue.
En ce qui concerne les enfants, les rapporteurs ont pris connaissance avec intérêt des initiatives des collectivités territoriales, notamment sur les temps périscolaires, afin d'augmenter le temps d'exposition des enfants à la langue régionale. C'est notamment le cas de la communauté européenne d'Alsace qui a mis en place depuis 2021 « les mercredis de l'alsacien ». Celle-ci prend en charge 50 % du coût d'intervenants en langue alsacienne dans le cadre du temps périscolaire.
L'enjeu est celui de la présence de la langue dans la vie sociale. Si les rapporteurs n'ont pas centré leur étude sur ce sujet, ils en rappellent l'importance. Il est ainsi déterminant que les collectivités mobilisent et accompagnent les associations qui oeuvrent dans les domaines de la culture et du sport à développer des activités en langue régionale. Au-delà du temps d'exposition à la langue, elles donnent un caractère ludique et de plaisir à l'usage des langues qui ne doivent pas être réduites au statut de discipline scolaire.
Pour autant, les rapporteurs sont conscients des restrictions budgétaires qui pèsent sur les finances publiques des collectivités territoriales. Ils appellent toutefois à la vigilance sur une diminution voire une suppression des soutiens aux associations et évènements publics de promotion des langues régionales. En effet, c'est en maintenant une visibilité et une vivacité de ces langues dans l'espace public qu'est démontrée l'utilité de leur sauvegarde. C'est le renforcement de l'usage social des langues régionales qui suscite chez certaines personnes l'envie de renouer avec une langue parlée dans leur famille il y a encore une ou deux générations mais qui risque de s'éteindre progressivement faute de transmission.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 15 OCTOBRE 2025
___________
M. Laurent Lafon, président. - Notre ordre du jour appelle à présent l'examen du rapport préparé par Max Brisson et Karine Daniel consacré à la mise en oeuvre de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales, dite loi Molac.
M. Max Brisson, rapporteur. - À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la consolidation de notre République s'est faite par une relégation des particularismes locaux dans la sphère privée, au nom de l'unité nationale. Parmi ces derniers figurent ce que nous appelons aujourd'hui les langues régionales et qui étaient autrefois connus sous le nom de patois, dialectes ou idiomes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, leur transmission dans le cadre familial a également commencé à décroître, entraînant à partir des années 60 un recul spectaculaire de leur pratique.
La loi Deixonne de 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux est davantage un texte de tolérance que de valorisation. Les professeurs peuvent recourir à ces langues pour aider leurs élèves à mieux assimiler les savoirs fondamentaux, dont le français.
Quant à la réforme constitutionnelle de 2008 qui introduit la reconnaissance des langues régionales, elle est la conséquence d'un sursaut militant qui s'intensifie à partir des années 70. L'article 75-1 de la Constitution précise que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Cette révision constitutionnelle n'a toutefois pas eu d'effets concrets majeurs.
Aucun projet de loi n'est venu tirer profit de cette révision constitutionnelle.
Dans le même temps, et malgré le sursaut militant, le nombre de locuteurs diminue inexorablement. Voici quelques chiffres pour mesurer cette chute : 60 % des locuteurs en breton ont plus de 60 ans. Pour le gallo, plus de la moitié de la population de Bretagne ignore même l'existence de cette langue. Je pourrais multiplier les exemples. Je citerai seulement les chiffres pour l'alsacien qui sont significatifs de cette perte de transmission intergénérationnelle : 70 % de la population alsacienne de plus de 55 ans maîtrise cette langue ; mais ce taux n'est plus que de 9 % chez les 18-24 ans.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Sans sursaut politique et sociétal fort, nos langues régionales, à de rares exceptions, seront quasiment toutes éteintes d'ici une à deux générations.
C'est dans ce contexte que notre collègue député Paul Molac a déposé la proposition de loi qui porte son nom. Je tiens à le souligner : pour la première fois, nous avons débattu des langues régionales dans un climat serein et apaisé, loin des invectives sur une remise en cause de l'unité nationale.
Notre commission a souhaité en janvier dernier lancer de manière transpartisane une mission d'évaluation de cette loi.
Nous avons centré notre rapport sur les articles relatifs à l'enseignement de cette loi pour deux raisons.
Tout d'abord, parce que l'article relatif au bilinguisme dans les communications institutionnelles et les panneaux de signalisation ne pose pas de problème.
Ensuite et surtout, parce que la transmission familiale, à de rares exceptions, est désormais marginale. L'avenir des langues régionales est désormais à l'école.
Pour cette même raison, nous nous sommes concentrés sur les langues de France en métropole. La transmission familiale est encore forte dans les départements et territoires d'outre-mer. Par ailleurs, une réglementation particulière s'y applique en matière de reconnaissance de ces langues et de rôle des collectivités territoriales, dans les territoires d'outre-mer, mais aussi dans les départements ultramarins.
En revanche, nos recommandations sont applicables à l'ensemble du territoire sur lequel l'État est compétent en matière d'enseignement scolaire. Nous avons également demandé au ministère les effectifs pour toutes les langues enseignées : cela inclut le créole, le tahitien et le mélanésien.
M. Max Brisson, rapporteur. - Que prévoit la loi Molac en matière d'enseignement des langues régionales ? Il s'agit de le renforcer, de prévoir la signature de conventions entre l'État et les collectivités territoriales et de clarifier la participation financière des communes au financement des établissements d'enseignement privés en langue régionale.
Cette loi a fait naître de nombreuses attentes et espoirs parmi les défenseurs des langues régionales. C'est aussi la raison pour laquelle la censure partielle du Conseil constitutionnel de ce texte, notamment de l'article relatif à l'enseignement immersif, a suscité une vague de mécontentement et d'incompréhension sur nos territoires. Elle a frappé des structures qui en 40 ans ont acquis une légitimité, un savoir-faire et une reconnaissance.
Je tiens à l'affirmer avec force : les réseaux privés d'enseignement immersif ont pendant longtemps porté seuls et à bout de bras la survie des langues régionales. Leur rôle ne doit pas être sous-estimé.
L'État a d'ailleurs souvent considéré que les familles souhaitant offrir un enseignement en langue régionale n'avaient qu'à se tourner vers cet enseignement privé.
Celui-ci a une mission de service public reconnue par l'État : les premiers contrats d'association entre le ministère de l'éducation nationale et ces établissements scolaires datent de 1994, soit il y a plus de 30 ans.
C'est aujourd'hui tout un écosystème qui est remis en cause par cette décision constitutionnelle.
A l'initiative du Premier ministre, le ministère de l'éducation nationale a publié le 14 décembre 2021 une circulaire proposant un cadre modernisé pour l'enseignement des langues régionales. Elle reconnaît l'intérêt éducatif du bilinguisme français/langue régionale et appelle à développer les ouvertures de classes bilingues au primaire, collège et lycée.
Surtout, elle trouve une voie de passage pour l'enseignement immersif dans les premiers cycles du primaire. Elle assouplit ainsi l'obligation de parité horaire - comprise dans la précédente circulaire comme l'impossibilité d'avoir plus de 50 % du volume hebdomadaire de cours dans une langue autre que le français - en permettant de calculer ce quota à l'échelle de plusieurs cycles scolaires.
Ce texte permet l'ouverture de filières immersives dans l'enseignement public, avec un cycle de maternelle en langue régionale, qui peut se prolonger sur une partie du cours préparatoire (CP). Le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de mon département s'est d'ailleurs saisi de cette possibilité pour ouvrir quatre CP immersifs en basque en cette rentrée scolaire dont trois dans le public, dans la suite de parcours immersifs en maternelle. La première partie de l'année de CP est en basque, le français est progressivement introduit à partir de janvier. Aujourd'hui 34 école primaires publiques accueillent au Pays basque une filière immersive en maternelle et en CP.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Quatre ans après le vote de cette loi, quel bilan peut-on en tirer ?
Un point positif tout d'abord : ce texte a permis une reconnaissance des langues régionales et conduit les pouvoirs publics à devoir les prendre en compte.
Toutefois, au-delà de ce symbole, les effets concrets de cette loi restent insuffisants.
Commençons par les effectifs scolaires. À la rentrée 2023, plus de 168 000 élèves suivent un enseignement d'une langue régionale. Les deux tiers d'entre eux sont scolarisés dans le premier degré. D'ailleurs, dans le primaire, les effectifs sont en progression de 47 % entre 2021 et 2023. Cette augmentation est d'autant plus remarquable que dans le même temps le nombre d'écoliers chute de 172 000 en raison de la déprise démographique.
De leur côté, le nombre de filières bilingues augmente. Enfin, bien qu'encore confidentielles, les filières immersives commencent à se mettre en place, y compris dans le public, notamment pour le basque, le corse ou l'alsacien.
Cette évolution positive doit toutefois être nuancée pour trois raisons.
Tout d'abord, le rythme de développement de l'enseignement est insuffisant pour compenser la rapide diminution du nombre de locuteurs.
Par ailleurs, les ouvertures des filières bilingues sont décrites comme un parcours du combattant par les acteurs concernés.
Enfin, ces chiffres du ministère de l'éducation nationale, qui montrent une croissance des effectifs, ne font pas de distinction entre les différentes intensités d'enseignement. Ils regroupent à la fois des élèves en filière bilingue voire immersive, mais aussi des élèves bénéficiant d'une simple initiation de quelques heures par an. Celle-ci est pourtant insuffisante pour former des locuteurs complets.
Par ailleurs, cette satisfaction sur le primaire cache l'effondrement des effectifs à l'entrée dans le secondaire. Ils poursuivent d'ailleurs leur chute dans la suite de la scolarité. Les réformes du lycée puis du baccalauréat ont été très fortement préjudiciables aux langues régionales. Elles ont été oubliées dans le projet initial et rattrapées in extremis, de manière bancale.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : moins de 1 000 élèves de terminale présentent une langue régionale en LVC au bac. Ils sont moins de 400 à présenter une discipline non linguistique - l'histoire géographique dans la très grande majorité des cas - en langue régionale. Quant à la spécialité « littérature, langue et culture », présentée par le ministère comme leur prise en compte dans les nouvelles spécialités, à peine 230 lycéens, toute langue régionale confondue, l'ont conservée en terminale en 2023.
M. Max Brisson, rapporteur. - Deuxième point de vigilance : les difficultés perdurent dans l'application du forfait pour les établissements d'enseignement privés immersifs. La modification apportée par la loi Molac n'a pas permis de régler la situation.
D'un côté, des réseaux d'établissements d'enseignement immersif nous ont indiqué continuer à avoir des difficultés à percevoir ces sommes. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros sont en jeu en fonction des réseaux.
Ils hésitent à aller plus loin et à s'engager dans une démarche contentieuse par peur d'une remise en cause de leur méthode pédagogique par le juge administratif au regard de la décision du Conseil constitutionnel.
De l'autre, des élus se sont émus d'avoir reçu des factures sans aucune forme de négociations, et rappellent que la participation financière de la commune résulte d'un accord. Par ailleurs, certaines communes rurales alertent sur une double peine : devoir payer pour les élèves de leur territoire scolarisés dans ces établissements scolaires, et subir une fermeture de classe dans leur école publique à quelques élèves près.
Quoi qu'il en soit, il est urgent de clarifier la rédaction de cette disposition législative.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - Je finirai ce bilan par les conventions prévues par la loi entre l'État et les collectivités territoriales pour la promotion et l'apprentissage des langues régionales.
De l'avis des personnes que nous avons rencontrées, ces conventions constituent un élément structurant et permettent de fixer des trajectoires.
La loi a également permis de relancer des discussions qui s'enlisaient.
Mais parce que les attentes par rapport à ces documents sont fortes, la déception l'est tout autant. Là encore, les raisons sont multiples. Certains territoires ne sont pas couverts par des conventions. C'est le cas du département de la Loire-Atlantique pour le breton.
Des conventions arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.
Par ailleurs le contenu de la convention n'est pas respecté. Pour l'alsacien, le rectorat a conscience que l'objectif de 50 % des élèves inscrits en section langue régionale à parité horaire en maternelle en 2030 est inatteignable. À la rentrée 2024, seuls 20 % des élèves de maternelle du public et 21 % des élèves de maternelle du privé sont scolarisés dans de telles filières. Il en est de même pour le breton sur le nombre d'élèves en filières bilingue à l'horizon de 2027.
Enfin, le contexte budgétaire impacte nécessairement la mise en place des conventions. Certaines déclinaisons opérationnelles sur trois ans de convention ont désormais pris un rythme annuel, ce qui limite la capacité à se projeter sur le moyen terme pour l'ensemble des parties prenantes.
M. Max Brisson, rapporteur. - Une fois ce bilan dressé, quelles sont nos recommandations ?
Le constat est sans appel : sans sursaut d'envergure, la plupart de nos langues régionales sont condamnées à très court terme.
Nombreux ont été les ministres à affirmer devant les parlementaires leur attachement aux langues régionales. Il est désormais temps que ces propos tenus à la tribune des assemblées se concrétisent dans les politiques publiques. Nos recommandations s'articulent autour de cinq axes.
Il s'agit tout d'abord de définir une stratégie nationale de promotion et d'enseignement des langues régionales.
Le développement de l'enseignement de ces langues relève aujourd'hui de rapports de force, de statuts dérogatoires obtenus dans des négociations bilatérales entre le territoire concerné et l'État. Ces multiples héritages entraînent des différences de traitement entre les langues, parfois pour la même langue entre deux académies.
Cette stratégie nationale doit pour nous se concrétiser de plusieurs manières : il s'agit tout d'abord de renforcer la coordination et la promotion de politiques linguistiques à l'échelle nationale et territoriale. Ce sont nos recommandations nos 1 à 3.
Je m'attarderai un peu plus longtemps sur les recommandations nos 4 et 5. Elles découlent directement de la censure par le Conseil constitutionnel de l'article relatif à l'enseignement immersif.
Il me paraît important de rappeler quatre points. Tout d'abord, en raison de la quasi-extinction de la transmission familiale, le recours à l'enseignement immersif est le moyen le plus efficace pour former des locuteurs de bon niveau dans les deux langues.
Par ailleurs, les réseaux d'enseignement immersifs jouent un rôle de service public qui va au-delà de ce que prévoit leur contrat d'association avec l'État, notamment en termes de transmission linguistique. Nombreux sont les enseignants brittophones ou bascophones de l'école publique qui sont d'anciens élèves des réseaux Diwan ou Seaska.
Le législateur avait pour objectif, lors de l'introduction de cet article, de former des locuteurs de bon niveau dans les deux langues, sans préjudice à l'apprentissage du français.
Enfin l'enseignement immersif est avant tout une méthode pédagogique qui n'aurait pas dû relever du domaine de la loi. Toutefois, il faut désormais tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel qui fragilise cette modalité d'enseignement.
La Constitution prévoit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Il doit pour nous en découler la possibilité de prendre les mesures nécessaires à leur sauvegarde, notamment en formant des locuteurs complets.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - J'en viens à notre deuxième axe : le développement d'une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique. Elle a longtemps été un lieu de mise à l'écart de ces langues. C'est donc l'école privée qui, à bout de bras, a porté la sauvegarde des langues régionales. L'éducation nationale, sous la pression des familles et des élus locaux, s'est longtemps contentée, dans de nombreux territoires, de saupoudrer au gré des ressources disponibles, quelques heures dans les écoles publiques, mais sans véritable politique.
À l'instar de l'école privée, l'école publique doit se donner les moyens de former des locuteurs de bon niveau dans les deux langues.
Tel est l'objet des recommandations nos 6 à 8. Elle porte sur le développement de l'enseignement immersif dans les premiers cycles du primaire public ainsi que sur la construction de parcours bilingues de la maternelle au lycée pour permettre la montée de cohortes.
Par ailleurs, nous plaidons pour les langues pour lesquelles il existe déjà un nombre significatif de filières bilingues de passer à une logique de l'offre sans attendre une mobilisation des parents pour ouvrir une telle filière dans leur école publique de secteur.
Cette politique de l'offre est d'ailleurs celle employée par l'éducation nationale dans de nombreux autres domaines, notamment pour les langues étrangères. Bien évidemment, la scolarisation d'un enfant dans une filière bilingue restera facultative et soumise à l'accord des parents.
M. Max Brisson, rapporteur. - Notre troisième axe vise à sécuriser financièrement les réseaux d'enseignement privés immersifs. La rédaction de l'article 6 de la loi Molac n'a pas permis d'apaiser les tensions sur le terrain. Il est nécessaire que soient clarifiées les conditions d'enseignement d'une langue régionale au sein d'une école de la commune pour que cette dernière soit dispensée du paiement du forfait scolaire. Il est également nécessaire d'indiquer ce que la médiation du préfet recouvre et de rappeler la nécessité dans chaque département de se doter d'un forfait départemental moyen, pour que la contribution demandée à la commune puisse être objectivement analysée.
L'axe 4 concerne l'accroissement des ressources humaines disponibles pour enseigner ces langues. L'ensemble des personnes rencontrées ont pointé comme frein principal au développement de l'enseignement des langues régionales les carences en ressources humaines. C'est d'ailleurs le coeur de notre rapport avec les recommandations nos 9 à 18.
Nous proposons quatre pistes d'action : tout d'abord identifier les ressources dormantes, c'est-à-dire un professeur qui maîtrise une langue régionale mais ne l'enseigne pas dans les académies concernées ou dans toute la France.
Ensuite, il faut davantage inclure les langues régionales dans la formation initiale des enseignants et ne pas manquer le virage de la réforme en cours qui avance le concours à bac+3.
Nous souhaitons mettre en garde le ministère contre toute tentative de réduire la prise en compte des langues régionales dans la formation initiale des enseignants à des cours d'initiation ou de sensibilisation. Un volume horaire conséquent est nécessaire pour disposer d'une bonne maîtrise de la langue. Par ailleurs, maîtriser une langue et être capable d'enseigner une discipline en langue régionale sont deux choses différentes.
Troisième piste d'action face à la carence en ressources humaines : la formation continue. Je profite de ce point pour saluer le travail remarquable que font les collectivités territoriales et les offices publics des langues régionales, qui sont des partenaires essentiels des rectorats pour la formation continue des professeurs - et bien souvent pionniers en la matière.
Enfin, les enseignants doivent être davantage accompagnés. Cela passe par un soutien aux structures produisant des contenus pédagogiques en langue régionale, ainsi que par la mise en place de cadres de l'éducation nationale spécialisés en langue régionale dans chaque territoire concerné. Je pense aux conseillers pédagogiques ou aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR). Ils sont essentiels pour animer une politique à l'échelle territoriale et soutenir les enseignants.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - J'en viens à notre cinquième et dernier axe : une meilleure valorisation des langues régionales tout au long de la scolarité. Il regroupe les recommandations nos 19 et 23.
La possibilité pour les élèves en filière bilingue ou immersive de pouvoir présenter une partie des épreuves en langue régionale est une question particulièrement sensible pour le diplôme national du brevet (DNB) depuis plus de vingt-cinq ans. Après de longs combats, les textes prévoient cette possibilité pour l'épreuve d'histoire-géographie. Par dérogation, cette possibilité a été élargie aux mathématiques puis à l'épreuve de sciences. Or le brevet est modifié en 2026. De nombreux élèves et enseignants s'interrogent pour savoir si la dérogation pour les épreuves de mathématiques et de sciences est maintenue.
Nous avons interrogé la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) il y a un mois sur ce sujet. Voici la réponse obtenue dans un contexte certes particulier - à savoir un gouvernement démissionnaire : « l'évolution du DNB à compter de la session 2026 implique de revoir la place des langues régionales dans ce nouveau cadre ». J'espère que le nouveau ministre de l'éducation tranchera rapidement ce point.
J'en viens au baccalauréat. Entre 2012 et 2018, dernière année de l'ancien baccalauréat, les élèves bascophones de terminale avaient la possibilité de passer l'épreuve de mathématiques en langue régionale. Les élèves bretons avaient d'ailleurs la même revendication, quatorze d'entre eux ayant rédigé leur copie en breton. De même l'histoire-géographie, épreuve reine des disciplines non linguistiques (DNL), pouvait être passée en langue régionale. Avec la réforme du baccalauréat, ces deux matières font l'objet d'un contrôle continu.
Nouveauté pour la session 2026, il y aura désormais une épreuve anticipée de mathématiques. Nous souhaitons, comme c'était le cas auparavant que les élèves volontaires puissent composer en langue régionale. Plus généralement, nous demandons à ce qu'un nombre plus important d'épreuves puissent être passées en langue régionale au baccalauréat, notamment une partie du grand oral.
Enfin, les langues régionales continuent de pâtir d'une moindre reconnaissance par rapport aux autres langues vivantes. Nous devons changer le regard que nous portons sur celles-ci. Aussi, nous proposons une certification du niveau de langue pour les élèves volontaires de CM2, troisième et en classe de terminale.
Mes chers collègues, les langues régionales appartiennent au patrimoine immatériel de notre Nation. Soyons-en fiers et prenons toutes les mesures nécessaires pour le préserver.
Mme Annick Billon. - Le sujet des langues régionales revient régulièrement dans l'actualité, souvent sous la forme de revendications et d'attentes très fortes. Les vingt-trois recommandations des rapporteurs sont ambitieuses et couvrent l'ensemble des enjeux relatifs à ces langues, de leur préservation à leur diffusion.
J'ai le sentiment que vous appelez à un renforcement des écoles immersives, notamment privées. Est-ce bien votre objectif ? Il est également question de la langue régionale pour le concours d'enseignement du premier degré, avec l'instauration d'une bonification. Ces mesures me laissent penser que le rapport s'inspire directement du modèle catalan, lequel fait l'objet de critiques sur plusieurs points : ostracisation des personnes ne parlant pas catalan, impossibilité d'accéder à certains emplois dans la fonction publique sans maîtriser cette langue. Souhaitez-vous dupliquer ce modèle ou vous en rapprocher ?
Je m'interroge aussi sur les difficultés de mise en oeuvre des recommandations lorsque la langue régionale ne correspond pas à une région administrative, ce qui est le cas du basque. La région Nouvelle-Aquitaine est extrêmement vaste, allant du Pays basque à Niort et plusieurs langues régionales y sont parlées.
Par ailleurs, les propositions ne risquent-elles pas, in fine, d'imposer une deuxième langue officielle plutôt que de préserver la langue régionale ? N'est-ce pas vers cela que l'on se dirige ?
Je m'interroge également sur les moyens, financiers et matériels, nécessaires à la mise en oeuvre de ces propositions. Elles me paraissent ambitieuses et exigeraient des moyens tout aussi considérables. Vos recommandations conduisent-elles inéluctablement à une révision constitutionnelle ?
Enfin, quid de la charge que ces mesures pourraient induire pour les collectivités ?
Mme Sylvie Robert. - Je remercie nos deux rapporteurs pour ce rapport, dont nous partageons à la fois la philosophie et les recommandations. Vous avez eu raison de souligner qu'aujourd'hui l'avenir des langues régionales passe par l'école.
Vous avez également eu raison de qualifier l'enseignement immersif de méthode pédagogique, considérant qu'il constitue le moyen le plus efficace de former les locuteurs dans les deux langues. Je partage pleinement ce constat : il n'est pas anodin de l'affirmer aujourd'hui, surtout au regard des décisions récentes du Conseil constitutionnel.
Je voudrais, en revanche, revenir sur la recommandation n° 9, relative à la question du forfait scolaire. Pour « apaiser les tensions » - ce qui est nécessaire, car le sujet demeure toujours une source de conflits - vous proposez de « définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire ». Cela signifie-t-il qu'il faille l'imposer ? Cet aspect reste-t-il soumis à un accord ? Qui détermine le montant de ce forfait ?
Quant à la procédure de médiation et à la possibilité pour les préfets d'assurer le mandatement d'office, c'est une disposition bienvenue.
Nous savons que la question du forfait est singulière - comme l'a mentionné Max Brisson -, notamment lorsqu'il s'agit du déplacement d'enfants dans une commune entraînant la fermeture d'une classe. Cela génère de fortes tensions, même à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un territoire. Cette éventualité restera-t-elle soumise à un accord et à une médiation, ou ira-t-on plus loin en imposant ce forfait à la commune tierce, au motif qu'il fait partie des coûts engendrés par les enseignants ? J'espère que nous pourrons, lors de l'audition du nouveau ministre de l'éducation nationale, recueillir son point de vue sur ce sujet.
Mme Sabine Drexler. - L'adoption de la loi Molac a été une étape historique. Pour la première fois, un texte législatif de portée nationale reconnaissait clairement le rôle et la valeur des langues régionales dans notre pays. Pour beaucoup d'acteurs associatifs et culturels, c'est un vrai pas en avant.
Toutefois, la réalité est plus nuancée, puisque le Conseil constitutionnel a malheureusement censuré la partie de la loi qui prévoyait la possibilité d'un enseignement immersif dans les écoles publiques, ce qui a fortement réduit sa portée.
Au quotidien, en particulier dans certains territoires, les difficultés sont nombreuses : manque d'enseignants formés, moyens financiers insuffisants et, surtout, la dépendance persistante à l'égard des décisions des rectorats et des académies, qui peuvent, selon les cas, freiner ou au contraire soutenir ces projets. En d'autres termes, la loi Molac a ouvert une porte, mais son application reste très inégale et fragile.
En Alsace, nous voyons bien ce décalage. La loi a marqué une avancée, mais nous sommes encore loin d'une véritable politique de revitalisation du dialecte. Certains vont même jusqu'à craindre un linguicide sans stratégie forte et volontariste. La défense de notre langue régionale - portée par la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) - a connu de réelles avancées ces dernières années. Cependant, comme partout ailleurs, les moyens financiers diminuent.
La question du forfait scolaire crée aujourd'hui des tensions extrêmement fortes entre les communes, en particulier dans mon département, le Haut-Rhin. Certaines communes vivent très mal la contrainte de financer des dispositifs qui, in fine, entraînent la fermeture de leurs classes, voire de leurs écoles, tandis que la non-application de ce forfait prive les écoles privées sous contrat d'association - comme les écoles ABCM Zweisprachigkeit en Alsace - de ressources essentielles à leur maintien.
S'ajoute à cela le manque de postes sous contrat, générant un coût important pour la Collectivité européenne d'Alsace, qui cofinance les postes hors contrat à hauteur de 740 000 euros par an, pour des postes non pris en charge par l'éducation nationale.
Le développement de l'enseignement immersif, pourtant le plus efficace, demeure bloqué par le rectorat, alors que l'Alsace ne dispose que de quatre sites, ce qui est largement insuffisant.
Seule une politique volontariste, avec des moyens stables et une vision claire, permettra de véritablement revitaliser nos langues régionales. Sans cela, la loi risque de rester une déclaration d'intention sans effet réel sur la transmission de ces langues aux générations futures. C'est bien là tout l'enjeu : comment passer d'un cadre légal à une véritable dynamique de terrain ? Nous souhaitons que vos recommandations soient très vite mises en oeuvre.
Mme Monique de Marco. - Les langues régionales appartiennent au patrimoine immatériel de la France. Leur valorisation et leur promotion passent par leur utilisation et leur transmission. C'est pour cette raison que nous nous étions saisis du texte de Paul Molac en décembre 2020, que nous avions inscrit dans notre niche parlementaire. Celui-ci a ensuite été adopté à l'Assemblée nationale le 21 mai. Il est très intéressant que nous ayons pu faire un point d'étape, quatre ans après, sur les freins, les tensions, les avancées, les limites et les perspectives en cours. Je vous remercie donc pour tout le travail d'audition que vous avez mené, qui était assez complet.
Pour nous, la loi Molac a représenté une avancée législative importante, avec une reconnaissance plus forte des langues régionales dans la loi et des structures également créées pour soutenir leur promotion. Cependant, beaucoup restait à faire pour que les effets soient tangibles partout : sécurisation des dispositifs, clarté juridique, moyens suffisants, formation, etc.
Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions, notamment celles qui concernaient l'enseignement immersif. Cette décision a été peu compréhensible à l'époque.
La loi Molac devrait permettre une plus grande reconnaissance et une meilleure accessibilité des langues régionales dans le système éducatif. Comme je l'ai souligné, des progrès ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Il y a des écueils d'un territoire à l'autre : offre d'enseignement variable par manque de ressources humaines ; absence de cadrage national ; fragilité juridique de l'enseignement immersif, qui repose sur une simple circulaire. Vous l'avez rappelé, il importe de promouvoir une stratégie à l'échelle nationale et de ne pas s'appuyer exclusivement sur le tissu associatif ou privé. Cette stratégie doit couvrir l'ensemble du parcours scolaire - primaire, collège et lycée.
Lors des auditions, des associations comme la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public (Flarep) ont fait part d'une application erratique et d'un non-respect de la loi. Elles estiment que le ministère de l'éducation nationale n'a pas encore pris, quatre ans après la publication de la loi, les mesures et les moyens visant à organiser la généralisation de l'enseignement des langues régionales.
Concernant cette liste de vingt-trois recommandations, très intéressante et complète, quelles sont les premières que vous pourriez proposer en priorité au nouveau ministre de l'éducation nationale afin qu'elles soient efficaces le plus rapidement possible ?
M. Pierre Ouzoulias. - Le limousin est parlé par plus de 30 000 locuteurs, avec une moyenne d'âge de 80 ans. C'est une langue qui disparaîtra dans très peu de temps, d'ici dix à vingt ans. C'est un drame culturel, car le limousin constitue la langue d'expression poétique la plus ancienne en France : celle des troubadours, au XIII? siècle. Quand on perd une langue, on perd une part de civilisation.
Je partage totalement le constat que vous faites et les préconisations que vous formulez pour défendre ces langues. J'ajouterai un point : elles sont encore plus mal enseignées à l'université. On assiste à un abandon absolu des langues régionales dans l'enseignement supérieur. À plusieurs reprises, j'ai signalé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le problème des « disciplines rares », c'est-à-dire des disciplines qui intéressent peu de personnes, mais qu'il faut absolument continuer à enseigner, car elles permettent de conserver un patrimoine très précieux.
Aujourd'hui, à la fois avec l'autonomie des universités et la volonté d'offrir de plus en plus de formations répondant aux besoins du marché, les universités marginalisent ces formations, les considérant comme totalement inutiles. Là aussi, un plan national s'impose pour permettre à certaines universités de continuer à enseigner les langues régionales.
Je prends l'exemple de la Haute-Corrèze, plus précisément de la commune de Tarnac. Une communauté arrivée de nulle part y a ouvert une école calandreta pour des enfants qui n'avaient jamais parlé l'occitan. Il s'agissait de « bobos » parisiens poursuivant un objectif séparatiste, et ils ont réussi : l'école du village a fermé. La calandreta occitane est devenue le coeur d'un conflit entre le maire communiste de Tarnac et cette petite communauté. Il faut donc dire les choses : les langues régionales peuvent servir d'instrument de contournement de la carte scolaire, comme d'autres disciplines, ce que je regrette.
Sur l'enseignement immersif, la position de notre groupe est parfaitement connue. Nous avons été les seuls, lors de l'examen de la loi Molac, à voter contre l'article 4 et les seuls à avoir suivi le ministre Jean-Michel Blanquer.
Que le Conseil constitutionnel ait censuré cette disposition relève de son rôle. Il n'a pas fragilisé les langues régionales : il défend la Constitution de 1958, qui dispose que le français est la langue de la République. J'ajoute que la loi Toubon dispose que le français est la langue de l'enseignement, des examens et du service public. Lorsque l'État finance quelque chose, cela devient un service public et doit être en français. Je suis profondément attaché aux langues régionales, mais tout aussi respectueux de la Constitution française. Il ne me semble donc pas possible, par le biais d'un rapport ou d'une mission d'information, de rouvrir le débat constitutionnel sur l'unicité de la République.
Un autre cadre permettra de le faire : la loi sur la Corse. Dans le projet gouvernemental tel qu'il nous sera présenté, la co-officialité de la langue corse est prévue, ce qui constitue une rupture totale avec la République telle que nous la connaissons. Nous aurons ce débat au moment de la réforme constitutionnelle pour la Corse. Aujourd'hui, nous ne pouvons voter ce rapport pour les mêmes raisons qui nous avaient conduits à refuser l'article 4 de la loi Molac.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. - Vous avez mis l'accent sur le déploiement d'une politique publique nationale en faveur de nos langues régionales et j'y suis particulièrement sensible. Je dois reconnaître que je suis très inquiète d'apprendre que ces dernières pourraient s'éteindre d'ici à une ou à deux générations. En effet, elles constituent une richesse inestimable de notre patrimoine national. Cette diversité culturelle de la France participe à la vitalité de nos territoires.
Dans le prolongement de la reconnaissance, symbolique mais essentielle, de ces langues à l'article 75-1 de la Constitution, la loi Molac a eu pour objet de renforcer leur visibilité dans la vie publique. Je constate avec satisfaction que cet attachement se traduit sur le terrain, au travers d'initiatives locales, mais également au sein de notre chambre haute, avec la récente création de l'association des amis du Félibrige et de la langue d'oc.
Ces démarches témoignent d'une volonté sincère et partagée de participer à la transmission de nos traditions linguistiques et culturelles. Au même titre que nos fêtes traditionnelles locales ou que notre patrimoine culinaire, nos langues régionales doivent continuer de bénéficier de mesures de protection et de valorisation : il faut assurer la préservation de notre héritage commun. Toutes reflètent une culture vivante et un enracinement profond. Les préserver revient à entretenir le lien qui unit les générations et les territoires.
M. Claude Kern. - Comme l'a indiqué Sabine Drexler, la région Grand Est et surtout la Collectivité européenne d'Alsace soutiennent énormément le bilinguisme. De nombreuses actions sont également menées par les intercommunalités, les communes et de nombreuses associations.
À l'heure actuelle, la formation des enseignants est notre véritable problème. Notre difficulté tient à la proximité de la frontière allemande : quand un enseignant est bien formé, il part dans le pays voisin parce qu'il y gagne deux fois et demie ce qu'il gagne en France.
J'émets des doutes sur la recommandation n° 9, car il ne faut pas trop charger les communes, et sur l'axe 5, notamment les recommandations nos 20 et 21. Je vois mal les examens, notamment les mathématiques, se dérouler en langue régionale. Le baccalauréat est un diplôme national.
M. Stéphane Piednoir. - Le recul de l'apprentissage intrafamilial des langues régionales est indéniable, d'où la nécessité d'une transmission dès le plus jeune âge par le vecteur le plus puissant et le plus universel qui soit : l'école. Elles sont une richesse. Je doute que les vingt-huit que compte la Nouvelle-Calédonie, pour moins de 300 000 habitants, soient enseignées. C'est dire à quel point la situation est inégale d'un territoire à l'autre.
Par ailleurs, je constate que si nous n'avons aucune difficulté à discuter des identités régionales, il en est tout autre lorsque l'on évoque l'identité nationale.
Je tiens à préciser que nous sommes tous très soucieux des finances locales. Dès lors, faire payer l'enseignement de ces langues aux collectivités et non plus à l'État serait dangereux. Je vous encourage donc à la plus grande vigilance sur ce point.
J'émettrai une réserve sur la généralisation à toutes les disciplines de l'enseignement en langue régionale. Dans le contexte budgétaire actuel de la France, nous devons accepter de prioriser l'allocation des moyens. Il ne faut pas s'éparpiller ! Je ne sais pas s'il faut rendre possible l'enseignement supérieur en langues régionales.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - La singularité de ce rapport est que nous avons mis l'accent sur l'enseignement dans les écoles publiques, lesquelles sont, dans certains territoires, en concurrence avec des écoles privées sous contrat. Celles-ci sont plus attractives, mais nous ne pouvons nous satisfaire de ce constat.
Aussi, nous affirmons qu'il faut mener une politique de l'offre dans l'école publique, si la demande est suffisamment présente et si le territoire est volontaire. Cela participerait de l'attractivité de l'école publique qui ne doit plus uniquement être sur la défensive. J'y insiste : nos recommandations ne renforceraient ni les écoles privées sous contrat ni le système associatif, au contraire ! Nous souhaitons, grâce à des filières d'immersion ou, selon les territoires, à des filières pleinement bilingues, le développement d'une offre accessible à toutes et à tous, et pas seulement aux enfants dont les parents sont des militants.
Se pose alors la question du forfait pour les établissements d'enseignement privés immersifs. La situation actuelle est pour le moins confuse. M. Brisson et moi-même avons assisté à des tables rondes d'élus locaux remontés. Effectivement, le forfait scolaire est particulièrement important pour les écoles rurales, faute des économies d'échelle que l'on observe dans les écoles urbaines. Pour cette raison, nous prônons un calcul du forfait à l'échelle départementale. Comme celui-ci intègre les forfaits des communes urbaines, généralement moins élevés, il est souvent d'un montant inférieur à celui calculé pour une commune rurale.
En plus de faire baisser le niveau du forfait pour les écoles rurales, donner davantage de responsabilités aux préfets de département permettra d'apaiser les discussions entre les écoles, les réseaux d'écoles et les élus locaux, car ces derniers sont en première ligne pour négocier des tarifs sur lesquels ils n'ont pas la main. Le calcul départemental des forfaits existe déjà, par exemple dans l'Ouest.
Pour réussir à créer cette politique de l'offre et développer ainsi l'enseignement des langues régionales, la priorité est la formation des professeurs sur le terrain. Il faut donc prendre en compte cet enjeu dans la mise en oeuvre de la réforme de la formation des enseignants.
M. Max Brisson, rapporteur. - Premièrement, une heure d'enseignement de mathématiques ne coûte pas plus cher selon qu'elle est dispensée en langue basque ou en langue française. Par conséquent, je ne supporte pas le discours de certains recteurs et directeurs académiques des services de l'éducation nationale (Dasen) qui comptabilisent toutes les heures de cours en langue régionale comme une dépense supplémentaire. Catalan, français, occitan : les élèves ont le même nombre d'heures de cours et de professeurs par enseignement ! Nous n'avons donc pas voulu tomber dans un débat sur les moyens.
Deuxièmement, l'école publique doit assumer ses missions en matière de langues régionales. Les réseaux immersifs existent précisément du fait d'une défaillance passée. Nous souhaitons que l'école publique joue son rôle car c'est celle que fréquente la très grande majorité des élèves. C'est le coeur de notre rapport. Cela doit particulièrement être le cas dans les territoires où les parents n'expriment pas d'attente à l'égard de l'institution scolaire. À titre d'exemple, je travaille actuellement avec le recteur de ma circonscription au développement de classes bilingues français-basque dans les quartiers nord de Bayonne. Ces derniers relèvent de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les parents n'y expriment pas davantage d'attentes sur la langue basque qu'ils n'en ont pour la musique, le théâtre ou d'autres formes de parcours éducatifs particuliers.
J'y insiste : nous souhaitons que l'éducation nationale bascule peu à peu dans une politique de l'offre, alors que la logique a été jusqu'à présent de répondre à une demande sociale avérée. Encore faut-il que cette demande s'exprime, sans parler du parcours du combattant nécessaire pour qu'elle puisse le faire ! D'ailleurs, pour les langues régionales où leur enseignement est déjà significativement développé, on peut constater qu'il n'est que très rarement présent dans les quartiers de la politique de la ville ou en REP (réseaux d'éducation prioritaire).
Soyons clairs : la République française est « une et indivisible ». Nous ne souhaitons ni ostraciser les langues régionales ni les officialiser, quoique leur reconnaissance soit une revendication politique de certains territoires, par exemple celui où je suis élu. Il est évident que le modèle des communautés autonomes catalane ou basque, au sein du Royaume d'Espagne, n'est pas envisageable en France hexagonale. Cela n'interdit pas de prendre des mesures pour assurer la transmission des langues régionales.
Par ailleurs, il est important de rappeler, comme l'indiquait à juste titre Sylvie Robert, que l'immersion n'est qu'une méthode pédagogique. L'objectif est d'atteindre un bilinguisme complet à la fin du parcours scolaire en français et en langue régionale. Introduire l'immersion dans la loi Molac a peut-être été une erreur. D'ailleurs, nous ne critiquons pas le Conseil constitutionnel dans notre rapport : nous relevons seulement le problème que sa censure pose.
Nous ne demandons pas non plus de révision constitutionnelle, même si cette question politique se pose dans certains territoires, comme au Pays basque. Une solution intermédiaire serait d'inscrire dans la loi, pour les sécuriser, les dispositions de la circulaire du 14 décembre 2021, laquelle intégrait les remarques exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa censure partielle de la loi Molac. Une telle loi ne satisferait peut-être pas les mouvements militants, mais elle pourrait constituer une évolution.
Le forfait pour les établissements d'enseignement privés immersifs se trouve dans la loi Molac. Face aux problèmes de financement que rencontrent les réseaux d'enseignement, il est possible d'objectiver les discussions avec les communes en permettant au préfet de définir ce forfait à l'échelle départementale. La compétence est de son ressort mais il peut s'appuyer sur le directeur académique. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet, pour calculer cette moyenne, a lancé une enquête auprès des communes ; de toute manière, elles ne sont appelées à payer le forfait qu'en cas d'absence d'enseignement de la langue régionale à l'école publique dont elles dépendent.
Qu'entendre, néanmoins, par « enseignement de la langue régionale » ? Une simple sensibilisation ou des heures optionnelles sont-elles satisfaisantes ou faut-il une classe bilingue ? Tout dépend également de la langue dont il s'agit. Le nombre d'heures d'enseignement nécessaires à la maîtrise d'une langue latine est bien différent de celui requis pour des langues non latines, comme le basque ou le breton : les liens entre le français et ces dernières sont beaucoup moins forts.
Sabine Drexler a parlé de « linguicide ». Le mot est fort ! Serons-nous la génération qui n'aura pas assuré la transmission de ce patrimoine ? Dans le département où je suis élu, je constate que les personnes qui ont autour de la trentaine reprochent à ma génération de ne pas leur avoir permis de maîtriser la langue basque ou le gascon, sachant que les plus jeunes suivent désormais un tel enseignement.
Le basculement vers une logique de l'offre doit reposer sur le principe de la libre adhésion des parents, qui reste la règle. Personne n'est obligé de suivre une voie bilingue en langue basque ou en langue bretonne. Ceci dit, l'éducation nationale prend moins de gants lorsqu'elle développe une offre d'enseignement du théâtre, de la musique ou du latin : on ne demande pas systématiquement de réaffirmer cette libre adhésion !
De surcroît, certains recteurs, Dasen ou préfets appliquent de manière extrêmement stricte la loi Toubon et l'article 2 de la Constitution lorsqu'il s'agit des langues régionales, mais font montre d'un laxisme total pour l'anglais. Ce « deux poids, deux mesures » donne aux territoires le sentiment insupportable d'un État fort avec les faibles et faible avec les forts : trop souvent, on s'abrite derrière la loi fondamentale pour empêcher le développement de classes bilingues que certains parents souhaitent, outrepassant la volonté du législateur.
J'en viens à nos recommandations sur les examens. Pourquoi un élève ayant reçu un enseignement en basque, en breton ou en alsacien ne passerait-il pas certaines épreuves du baccalauréat ou du brevet dans cette langue régionale, comme le demandent les territoires ? La possibilité existe déjà, mais des reculs ont eu lieu ces dernières années à la suite d'une circulaire d'un ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Les sections internationales, elles, ne donnent lieu à aucun débat... Pourquoi ce qui vaut pour l'allemand, l'anglais ou l'espagnol ne vaudrait-il pas pour le catalan ou l'occitan ?
Le coût de la formation, essentielle, varie d'un territoire à l'autre, car toutes les collectivités locales ne s'impliquent pas. Ainsi, la Collectivité européenne d'Alsace est investie, mais celles de mon territoire ne le sont pas. Notre rapport est extrêmement clair : puisque la formation des professeurs relève de la compétence de l'éducation nationale, cette dernière doit en assumer la charge. Il ne doit pas y avoir de transfert aux collectivités, même si certaines d'entre elles, comme la Bretagne ou la Collectivité européenne d'Alsace, participent sur la base du volontariat, un choix politique que je salue.
Plusieurs facteurs expliquent l'absence d'adéquation entre la carte des langues régionales et l'organisation administrative de notre pays. La différence de prise en compte du breton entre la région Bretagne et la Loire-Atlantique est inacceptable. Des harmonisations sont donc nécessaires. Les Pyrénées-Atlantiques ont réglé le problème en créant un groupement d'intérêt public réunissant l'État, représenté par les ministères de l'intérieur, de l'éducation nationale et de la culture, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et la communauté d'agglomération Pays basque, qui couvre la totalité de l'aire linguistique bascophone.
Je conclurai en précisant que l'ancienne ministre de l'éducation nationale m'a assuré plusieurs fois attendre ce rapport avec beaucoup d'impatience. J'espère que le nouveau ministre témoignera du même sentiment.
Mme Karine Daniel, rapporteure. - La situation en Loire-Atlantique, à l'origine de ce rapport, est clairement inacceptable. Dans ce département, un inspecteur pédagogique régional (IPR) de mathématiques est complètement réfractaire aux langues régionales. Il pourrait y avoir une coopération entre le rectorat de Nantes et celui de Rennes en matière de langues régionales. Une convention, de fait, permettrait des mutualisations pour améliorer la situation sans en passer par une révolution. Parfois, un peu de bonne volonté suffit ! Ce rapport nous permet de mettre en avant des constats aussi simples.
Ne parlant pas mais comprenant pour ma part le gallo, j'ai constaté que l'apprentissage des langues régionales permet d'être plus à l'aise dans le reste du monde. Je suis attachée à la défense et à la promotion des langues régionales non pas dans une visée de repli sur le territoire, mais dans une visée universaliste.
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
MERCREDI 12 MARS 2025
M. Paul MOLAC, député du Morbihan, auteur de la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
MERCREDI 19 MARS 2025
Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public (FLAREP) : M. Thierry DELOBEL, président.
MERCREDI 26 MARS 2025
Collectivité européenne d'Alsace : M. Nicolas MATT, vice-président.
MERCREDI 2 AVRIL 2025
Fédération des réseaux d'enseignement des langues régionales en immersion (Eskolim) : M. Joseph TURCHINI, président d'Eskolim et de Scola Corsa, M. Jean Pierre LUCIANI, vice-président d'Eskolim, M. Yann UGUEN, président de Diwan, Mme Anne-Sophie BRATS, vice-présidente de Diwan, Mme Sophie LAYUS, coprésidente de Seaska, M. Antton ETXEBERRI, coprésident de Seaska, M. Hur GOROSTIAGA, directeur général de Seaska, M. Guillem NIVET, président de La Bressola, Mme Karine SARBARCHER, résidente d'ABCM-Zweisprachigkeit, et Mme Cristèla SIMONATO, coordinatrice de la confédération Calandreta.
LUNDI 7 AVRIL 2025
Table ronde des offices publics de langues régionales
- Office public de la langue occitane (OPLO) : MM. Jean-Luc ARMAND, président, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et Gautier LAGALAYE, directeur,
- Office public de la langue catalane (OPLC) : MM. Pierre LISSOT, directeur, et Nicolas GARCIA, premier vice-président du département des Pyrénées-Orientales en charge de la Catalanité,
- Office public de la langue basque (OPLB) : Mme Maïder BEHOTEGUY, présidente,
- Office public de la langue bretonne (OPLB) : M. Fulup JAKEZ, directeur général.
MERCREDI 30 AVRIL 2025
M. Sèrgi JAVALOYÈS, écrivain, ancien co-président de la confédération occitane des établissements laïcs Calandreta.
LUNDI 12 MAI 2025
Table ronde des recteurs de Bordeaux, Corse, Rennes, Strasbourg et Toulouse
- M. Jean-Marc HUART, recteur de la région académique NouvelleAquitaine, recteur de l'académie de Bordeaux,
- M. Rémi-François PAOLINI, recteur de la région académique de Corse, recteur de l'académie de Corse,
- Mme Hélène INSEL, rectrice de la région académique de Bretagne, rectrice de l'académie de Rennes,
- M. Olivier KLEIN, recteur de l'académie de Strasbourg,
- M. Karim BENMILOUD, recteur de l'académie de Toulouse.
Association des régions de France : Mme Anne-Laure SANTUCCI, conseillère exécutive culture et sports de la collectivité de Corse.
LUNDI 19 MAI 2025
Institut supérieur des langues de la République française (Islrf) : M. JeanLouis BLENET, président.
Table ronde des associations bretonnes
- Association Kelennomp : M. Renan KERBIQUET, coordinateur,
- Association Div Yezh Breizh : MM. Eddy PENVEN, président, et Olivier GUILLIN, directeur.
MARDI 2 SEPTEMBRE 2025
Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) : Mme Caroline PASCAL, directrice générale, et M. Jean HUBAC, chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives.
LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025
Fédération des enseignants de langue et culture d'Oc (FELCO) : Mme MarieJeanne VERNY, cosecrétaire, professeure émérite langue et littérature occitane.
MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
Université Rennes 2 - Centre d'Études des Langues, Territoires et Identités Culturelles - Bretagne et Langue Minoritaires (CELTIC-BLM) : M. Philippe BLANCHET, directeur de recherches, professeur des universités en sociolinguistique et didactique des langues.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Ø Centre national d'enseignement à distance (CNED),
Ø Conseil des jeunes générations Div Yezh.
Par ailleurs, les contributions suivantes ont été reçues à la suite de l'envoi d'un questionnaire à la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public (FLAREP) :
Ø Eltern Alsace,
Ø Ikas bi,
Ø Fédération Div Yezh Breizh,
Ø Association pour l'enseignement du catalan (APLEC),
Ø Association LANTANT LKR,
Ø Institut de la langue régionale flamande,
Ø Association d'enseignants du gallo,
Ø Fédération des enseignants de langue et culture d'Oc,
Ø Agence régionale de la langue picarde,
Ø Association Òc-bi.
LISTE DES DÉPLACEMENTS
JEUDI 12 JUIN 2025 : NANTES (44)
Table ronde d'élus locaux
· M. Vincent DANIS, vice-président du conseil départemental de Loire-Atlantique en charge de l'éducation et de la politique éducative,
· Mme Danielle CORNET, maire de Pontchâteau, et vice-présidente jeunesse et citoyenneté, égalité femmes/hommes, éducation populaire, enjeux bretons au conseil départemental de Loire-Atlantique,
· M. Morvan DUPONT, conseiller municipal à la diversité culturelle et linguistique et à la coopération internationale de la ville d'Orvault,
· M. François CHÉNEAU, maire de Donges,
· M. Florian LE TEUFF, adjoint à la Maire en charge des enjeux bretons de la ville de Nantes,
· M. Gwenvaël DURET, adjoint au maire en charge de l'aménagement du territoire de la ville d'Indre.
Visite de l'école Diwan : Mmes Liz-Erell CHOUTEAU, cheffe d'établissement et directrice de la partie, Mathilde LAHOGUE, directrice, Marielle CHEVALEREAU, présidente de l'association d'éducation populaire, Noémie LEBRETON-RIVIÈRE, vice-présidente de l'association d'éducation populaire, et Felicia POCHART, directrice de la maternelle.
Rectorat de Nantes : Mme Katia BÉGUIN, rectrice de l'Académie de Nantes, M. Philippe DIAZ, secrétaire général, M. Jean-Michel MOREAU, directeur de cabinet, Mme Véronique BLUTEAU-DAVY, directrice de la pédagogie, et M. Cédric MICHEL, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la LoireAtlantique (IA-DAASEN).
Office public de la langue bretonne (OPLB) : MM. Fulup JAKEZ, directeur général, Visant ROUE, directeur du pôle étude et développement, et Maxime MALETTE, chargé de mission enseignement.
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 : TARBES (65) et PAU (64)
Réseau Calandreta : Mmes Cristèla SIMONATO, coordinatrice de la confédération Calandreta, et Gaëlle PUJOL, coordinatrice de la Fédération régionale Calandreta pour l'Académie de Toulouse.
Table ronde d'élus locaux
M. Jérôme CRAMPE, maire de Bordères-sur-l'Échez, M. Michel MANSE, maire de Mérilheu, Mme Gisèle DUBARRY, maire de Gerde, M. Dominique PUJOL, maire de Montgaillard, M. Florent ANGLADE, maire d'Antist, et M. Boris LAURINE, adjoint au maire d'Azereix.
Académie des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées : Mme Anne MIQUEL VAL, directrice académique des services de l'éducation nationale.
Direction académique des services de l'éducation nationale des PyrénéesAtlantiques : M. Dominique MALROUX, directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 : BAYONNE (64)
Visite du lycée Bernat Etxepare : M. Garikoitz MUJIKA ZUBIARRAIN, directeur.
Seaska : Mme Sophie LAYUS, co-présidente, et M. Hur GOROSTIAGA, directeur général.
Office public de la langue basque (OPLB) : Mme Maïder BEHOTEGUY, présidente, Mme Frédérique ESPAGNAC, membre représentant la Région Nouvelle-Aquitaine, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, M. Antton CURUTCHARRY, membre représentant la Communauté d'agglomération du Pays-Basque, M. Mathieu DUHAMEL, membre représentant l'État, sous-préfet de Bayonne, et M. Christophe BETBEDER, directeur.
Direction départementale de l'Enseignement catholique (DDEC) : MM. Vincent DESTAIS, directeur diocésain, et Sébastien IRAZOQUI, chargé de mission bilinguismes.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
DES
RECOMMANDATIONS
|
Recommandations |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
AXE N° 1 : Pour une politique publique nationale en faveur des langues régionales |
|||
|
Recommandation n° 1 : Définir une stratégie nationale de l'enseignement et de la promotion des langues régionales afin de garantir une égale impulsion dans l'ensemble des territoires concernés. |
Ministère de l'éducation nationale |
Dès janvier 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 2 : Prévoir pour chaque langue régionale une convention couvrant l'ensemble du territoire linguistique entre l'État, les collectivités territoriales et lorsqu'il existe l'office public de la langue concernée, et le cas échéant prévoir a minima une déclinaison académique de celle-ci. |
Recteurs, collectivités territoriales, offices publics de la langue régionale |
Dès janvier 2026 |
Conventions |
|
Recommandation n° 3 : Réunir régulièrement les comités académiques des langues régionales et renforcer les liens entre ceux-ci et les observatoires des dynamiques rurales, afin de mettre en place à l'échelle territoriale une stratégie pluriannuelle de promotion des langues régionales. |
Recteurs |
Dès janvier 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 4 : Préciser que la reconnaissance des langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France (Art. 75-1 de la Constitution) implique de pouvoir former des locuteurs complets dans ces langues, condition indispensable à leur sauvegarde. Il s'agit de sécuriser l'enseignement immersif, méthode pédagogique visant au bilinguisme intégral et à former des locuteurs complets en français et en langue régionale. Une révision de la Constitution pourrait être utile afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale. |
Pouvoir législatif |
Moyen terme |
Loi |
|
Recommandation n° 5 : Assurer le renouvellement des conventions entre l'État et chacun des réseaux d'enseignement immersif. |
Recteurs |
Dès janvier 2026 |
Conventions |
|
AXE N° 2 : Pour le développement d'une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique |
|||
|
Recommandation n° 6 : Développer pour l'ensemble des langues régionales un enseignement bilingue à parité horaire à l'école primaire et offrir la possibilité d'un enseignement immersif dans les cycles 1 et 2 de l'école primaire. |
Ministère de l'éducation nationale, recteurs |
À partir de la rentrée scolaire 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 7 : Mettre fin à l'érosion des effectifs entre le primaire et le secondaire en assurant la continuité des parcours scolaires. |
Recteurs, collectivités territoriales |
À partir de la rentrée scolaire 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 8 : Instaurer, dans les territoires où la demande d'ouverture de filières bilingues émanant des parents est globalement satisfaite, une politique fondée sur l'offre afin de rendre ces filières accessibles au plus grand nombre, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La scolarisation des enfants dans une filière bilingue resterait soumise à la libre adhésion des parents. |
Recteurs |
À partir de la rentrée 2026 |
Circulaire |
|
AXE N° 3 : Pour une sécurisation financière des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif |
|||
|
Recommandation n° 9 : Afin d'apaiser les tensions relatives au versement du forfait scolaire dans le cadre d'un enseignement des langues régionales : - définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire ; - clarifier les cas où le versement du forfait scolaire est dû au regard du volume horaire d'enseignement de la culture et langue régionales proposé dans une école de la commune ; - préciser la procédure de médiation conduite par le préfet ; - faire assurer par les préfets le mandatement d'office, lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord trouvé avec l'établissement scolaire. |
Recteurs, préfets, législateur |
2026 |
Loi et texte réglementaire |
|
AXE N° 4 : Pour un renforcement des moyens humains |
|||
|
Recommandation n° 10 : Recenser nationalement et dans les départements concernés pour chaque langue régionale les professeurs maîtrisant celle-ci à un niveau suffisant pour l'enseigner (niveau B2 ou C1 du cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL) et souhaitant l'enseigner. Faire de même avec ceux disposant d'un niveau inférieur mais volontaires pour être formés afin de l'enseigner. |
Ministère de l'éducation nationale, Recteurs |
Dès janvier 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 11 : Permettre à des professeurs titulaires du CAPES dans une discipline non linguistique (DNL), de dispenser une partie ou la totalité de leur cours en langue régionale, après vérification de leur niveau de langue et de leur capacité à le faire par un inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) - langue régionale afin de faciliter le développement de l'enseignement de DNL en langue régionale au collège. |
Ministère de l'éducation nationale, Recteurs |
Rentrée scolaire 2026 |
Arrêté et circulaire |
|
Recommandation n° 12 : Permettre un amorçage puis un ancrage de l'enseignement d'une langue régionale au sein d'une école : - par le recours aux postes à profil (POP) impliquant un engagement de trois ans sur le même poste dans les filières bilingues ou immersives ; - par l'attribution d'une bonification au barème en cas d'engagement du professeur à rester 6 ans soit le double de la durée de l'engagement actuel lié à un POP. |
Ministère de l'éducation nationale |
Dès le mouvement de mobilité 2026 |
Note de service |
|
Recommandation n° 13 : Dans le cadre de la réforme de la formation initiale, prévoir : - parmi les licences de préparation aux concours d'enseignant du premier degré qu'une partie du volume horaire se fasse en langue régionale ; - en master, qu'au moins 50 % des enseignements soient en langue régionale pour les lauréats des CRPE spécifiques ; - la possibilité, tout au long du parcours universitaire, de suivre des cours de langue régionale ainsi que des cours de matière disciplinaire en langue régionale, pour permettre aux futurs professeurs - y compris ceux ne préparant pas le CRPE spécial - d'enseigner en langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale, universités |
Dès la rentrée universitaire 2026 |
Arrêté et bonne pratique |
|
Recommandation n° 14 : Prévoir systématiquement l'organisation des stages en master dans des classes bilingues ou immersives pour les étudiants lauréats des CRPE spéciaux langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale |
Dès la rentrée 2026 |
Arrêté |
|
Recommandation n° 15 : Afin de favoriser le développement de filières bilingues dans le secondaire et de garantir la qualité des enseignements, élargir la liste des bivalences possibles entre une DNL et une langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale |
Session d'examen 2027 |
Arrêté |
|
Recommandation n° 16 : Poursuivre les efforts en matière de formation continue en sécurisant les financements et en communiquant davantage auprès des professeurs sur l'existence de stages intensifs en langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale, collectivités territoriales, offices publics des langues régionales |
Dès janvier 2026 |
Bonne pratique |
|
Recommandation n° 17 : Développer des matériels pédagogiques adaptés, notamment des documents traduits pour les disciplines non linguistiques. |
Structures en charge de la production de documents pédagogiques en langues régionales, ministère de l'éducation nationale |
Dès janvier 2026 |
Circulaire |
|
Recommandation n° 18 : Créer une spécialité « langue régionale » au sein du corps des IA-IPR pour mieux accompagner les professeurs et nommer dans tous les départements concernés par les langues régionales un conseiller pédagogique « langue régionale ». |
Ministère de l'éducation nationale |
Session d'examen 2027 |
Arrêté et circulaire |
|
Recommandation n° 19 : Autoriser l'élargissement des périmètres d'action des IA-IPR et des conseillers pédagogiques « langue régionale », afin que les limites administratives d'une académie n'entravent pas l'accompagnement des professeurs et l'apprentissage linguistique par les élèves dans le territoire voisin partageant la même langue régionale, notamment en cas de vacance de postes. |
Ministère de l'éducation nationale |
Dès janvier 2026 |
Circulaire |
|
AXE N° 5 : Pour une meilleure valorisation des langues régionales tout au long de la scolarité |
|||
|
Recommandation n° 20 : Réaffirmer, à la suite de la réforme du diplôme national du brevet pour la session 2026, la possibilité pour les élèves volontaires de composer certaines épreuves du brevet en langue régionale. Inscrire cette possibilité dans un cadre national pour assurer une équité entre les élèves qui reçoivent un enseignement en langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale |
Session d'examen 2026 |
Circulaire et arrêté |
|
Recommandation n° 21 : Permettre aux élèves volontaires de passer en langue régionale la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. Élargir cette possibilité aux spécialités ou au grand oral. |
Ministère de l'éducation nationale |
Session d'examen 2026 |
Arrêté |
|
Recommandation n° 22 : Procéder dans chaque académie au recensement des correcteurs disposant d'un niveau suffisant en langue régionale. |
Ministère de l'éducation nationale |
Session d'examen 2026 |
Bonne pratique |
|
Recommandation n° 23 : Proposer aux élèves à la fin du primaire, du collège et en classe de terminale une certification en langue régionale visant à évaluer leur niveau au regard du cadre européen commun de référence (A1 à C2) sur le modèle d'Ev@lang au collège pour l'anglais afin que les langues régionales bénéficient du même niveau de reconnaissance que les autres langues vivantes européennes. Inscrire cette certification sur le diplôme national du brevet ou du baccalauréat. |
Ministère de l'éducation nationale |
Dès juin 2026 |
Circulaire |
* 1 L'atlas des langues en danger dans le monde de l'Unesco classait en 2010 la plupart des langues métropolitaines dans la catégorie des langues « sérieusement en danger ».
* 2 Étude sociologique sur l'alsacien et l'allemand, mai 2022, sondage réalisé auprès de personnes résidant dans la collectivité européenne d'Alsace.
* 3 VIIème étude sociologique sur la situation de la langue basque, 2021, étude menée en partenariat entre l'office public de la langue basque, le gouvernement basque et le Gouvernement de Navarre.
* 4 Langue occitane, état des lieux 2020, enquête réalisée par l'office public de la langue occitane, 2020.
* 5 64 % des personnes interrogées se disent attachées au breton, 43 % au gallo, 92 % des personnes s'expriment en faveur du maintien ou du développement de la langue occitane et 81 % sont favorables au développement d'une offre d'enseignement de l'occitan de la maternelle au lycée, 60 % des personnes interrogées déclarent un intérêt pour la langue basque, 83 % des personnes interrogées ayant un enfant sont favorables à un enseignement de l'alsacien à l'école.
* 6 Michel Ameller, membre du Conseil constitutionnel, extrait de la séance de la séance du 15 juin 1999 portant sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
* 7 Discours du Président de la République le 14 novembre 2024, à l'occasion de la 9ème édition du Dictionnaire de l'Académie française.
* 8 Initialement introduite à l'article premier de la Constitution, la reconnaissance des langues régionales a été ensuite déplacée à un nouvel article 75-1. Comme le soulignait François Bayrou, alors député : « la reconnaissance des langues régionales ne me semble pas avoir sa place à l'article 1er de la Constitution, car il ne s'agit pas d'un principe fondamental de la République [...] Il s'agit, au contraire, de régler un problème technique né d'une mauvaise interprétation du premier alinéa de l'article 2 - “La langue de la République est le français” -, qui a donné lieu à une jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel hostiles aux langues régionales. [...] Je suis ravi que les langues régionales soient inscrites dans la Constitution, mais il faudrait qu'elles figurent à un autre article, car cette bizarrerie me semble être de nature à troubler le bon ordonnancement de la Constitution, au motif de régler un problème, certes réel et profond, mais qui ne tient pas aux principes de la République ».
* 9 Le traité de Lisbonne mentionne le respect de la richesse de la diversité culturelle et linguistique de l'Union européenne ainsi que la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel européen.
* 10 L'office public de la langue basque est un groupement d'intérêt public regroupant l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d'agglomération du Pays basque et le conseil des élus du Pays Basque.
* 11Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.
* 12 Décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.
* 13 Décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996 relative à la loi de finances rectificative pour 1996.
* 14L'enseignement des langues régionales, état des lieux et perspectives après la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021, rapport de M. Christophe Euzet et Yannick Kerlogot au Premier ministre, juillet 2021.
* 15 Lettre de mission du Premier ministre à MM. Euzet et Kerlogot.
* 16 Elle rappelle notamment le cadre constitutionnel de l'enseignement dit immersif : le recours à l'enseignement bilingue par méthode immersive est nécessairement facultatif pour l'élève et la langue de communication utilisée par les personnels de l'école ou de l'établissement à destination des parents d'élèves et des partenaires institutionnels est le français. Le cas échéant, des documents bilingues peuvent être utilisés.
* 17 L'association lantan LKR pour le créole réunionnais, affiliée à la fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public a indiqué par écrit aux rapporteurs qu'il existe environ 60 classes bilingues, la plupart étant des maternelles. L'offre d'enseignement évolue faiblement. Elle note toutefois la volonté académique de développer quelques parcours de continuité dans l'enseignement de la langue régionale.
* 18 Transmission et usage du breton et du gallo : résultats de l'étude sociologique 2024, institut TMO, 2024.
* 19 Convention-cadre pour le développement de l'enseignement et l'usage social de l'occitan, Rapports de bilan et de prospective, 7 mars 2025.
* 20 Les élèves de cette spécialité choisissent une orientation au choix entre anglais, anglais monde contemporain, allemand, espagnol, italien, basque, breton, catalan, corse, occitan langue d'oc, tahitien ou créole.
* 21Il s'agit des obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune n'assurant pas directement ou indirectement la restauration ou la garde des enfants, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune où se situe l'établissement privé sous contrat, ou pour des raisons médicales.
* 22 Les rapporteurs rappellent la position de la commission de la culture de permettre la réunion d'instances similaires aux observatoires des dynamiques rurales dans des zones plus urbaines qui sont également concernées par la déprise démographique et les évolutions de carte scolaire.
* 23 Joseph Turchini, président d'Eskolim.
* 24 Cf pour le breton, le rapport de l'IGESR n° 2019-053 de juillet 2019 sur l'enseignement immersif dans une langue vivante régionale : le réseau Diwan : « le réseau [Diwan] obtient aux évaluations d'entrée en 6ème, au diplôme national du brevet, au baccalauréat, des résultats meilleurs que ceux de la moyenne nationale. Les résultats des évaluations d'entrée en 6ème montrent que les compétences attendues sont bien atteintes à la fin du CM2 » et pour le basque, l'étude comparative des filières de maternelle 100 % basque, bilingue et française », qui montre que les résultats des élèves scolarisés dans des écoles maternelles 100 % basque ont de meilleurs résultats en français au CP et CE1 ainsi qu'en mathématiques au CP. Les résultats sont cependant légèrement en retrait pour les mathématiques en CE1 (septembre 2019, académie de Bordeaux).
* 25 Trois dans des écoles publiques et un dans un établissement privé catholique sous contrat.
* 26 Extraits de courriers reçus par des maires de Loire-Atlantique demandant l'ouverture d'une filière bilingue dans l'école de leur commune.
* 27 Le rectorat de Rennes a ainsi indiqué aux rapporteurs que « la demande sociale sur l'enseignement en classe bilingue semble malgré tout avoir atteint un plateau et progresse peu ».
* 28 Enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère à l'école. Ce dispositif existe depuis les années 1990. Les écoles dites EMILE proposent un parcours linguistique renforcé avec des enseignements hebdomadaires de trois heures à la parité horaire, en incluant l'horaire réglementaire d'1h30 hebdomadaire. À la rentrée scolaire 2023, ce dispositif concernait 272 955 élèves, majoritairement en allemand (174 086 élèves) et anglais (91 673 élèves).
* 29Aux formations portées par l'éducation nationale doit également être ajouté l'institut supérieur des langues de la République française (ISLRF) qui forme les enseignants des réseaux associatifs d'enseignement privé immersif. Depuis 30 ans, ce sont plus de 430 professeurs des écoles qui ont été formés pour l'un de ces six réseaux (diwan, seaska, bressola, calandreta, ABCM-Zweisprachigkeit et scola corsa). En 2024-2025, il accueillait 20 inscrits en Master 1, 13 en Master 2 et 15 professeurs des écoles stagiaires.
* 30 À ce dispositif s'ajoute une formation hybride en deux ans qui s'articule entre un parcours sur m@gistère (5 niveaux de langue et 80 heures de formation environ par niveau) et des formations en présentiel animés par les conseillers pédagogiques départementaux en charge de l'occitan.
* 31 En 2018, une demande similaire a été portée par des lycéens de la filière bilingue breton. 14 d'entre eux du lycée Diwan de Carhaix ont d'ailleurs composé leurs épreuves de mathématiques en breton en signe de protestations vis-à-vis de la différence de traitement avec leurs homologues basques et corses.