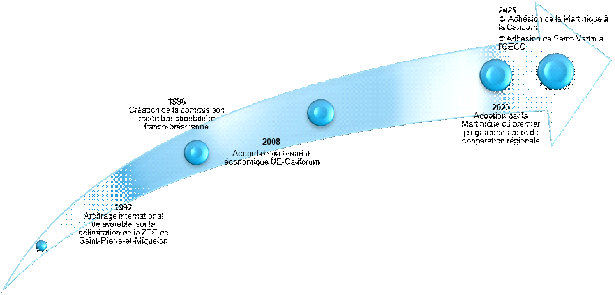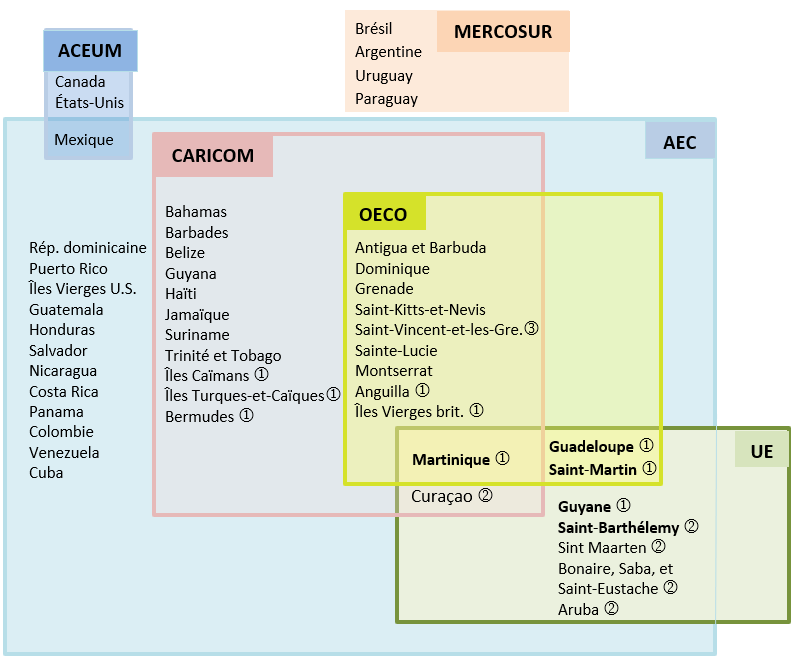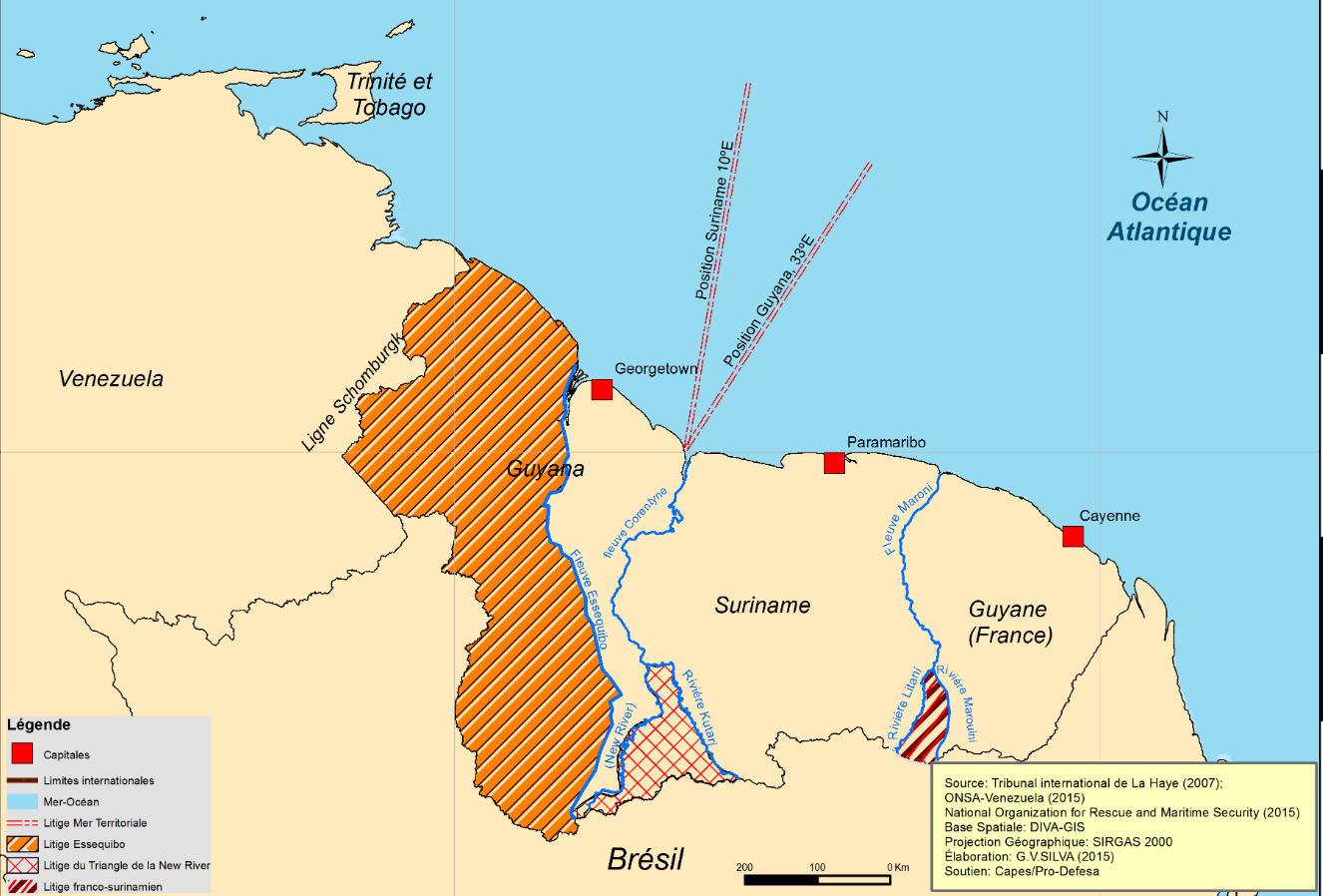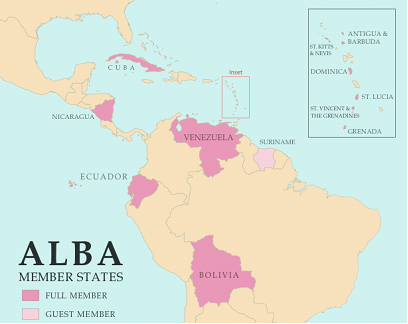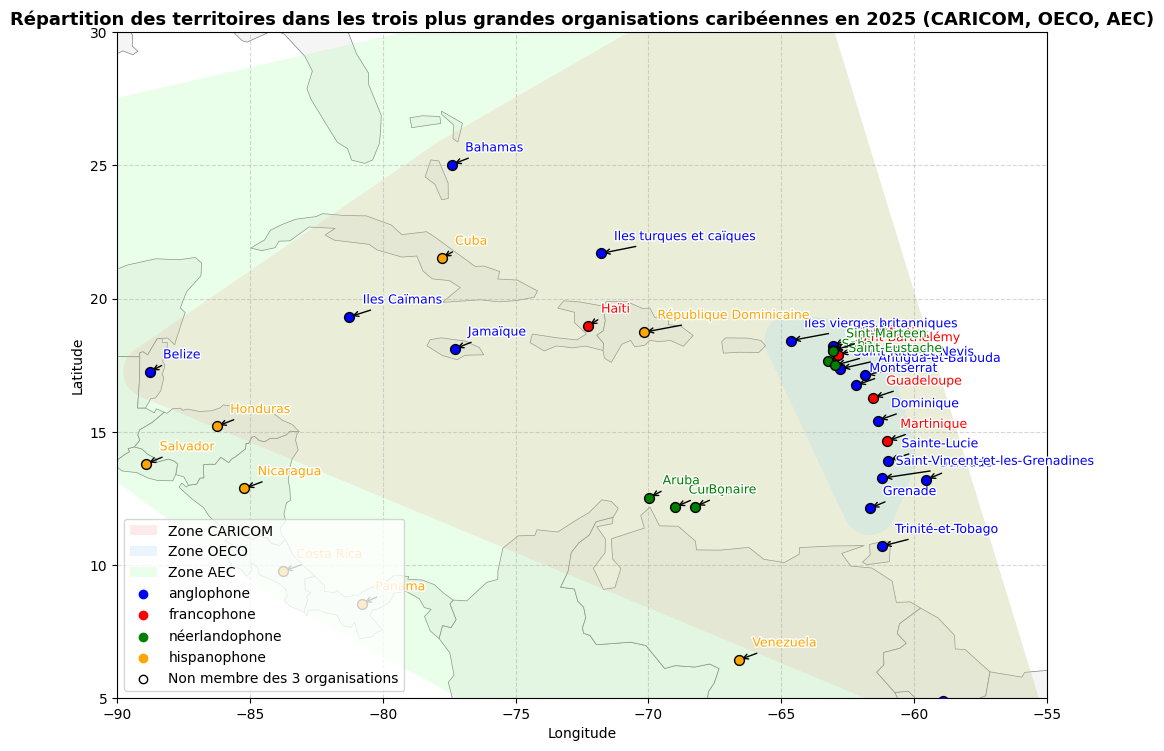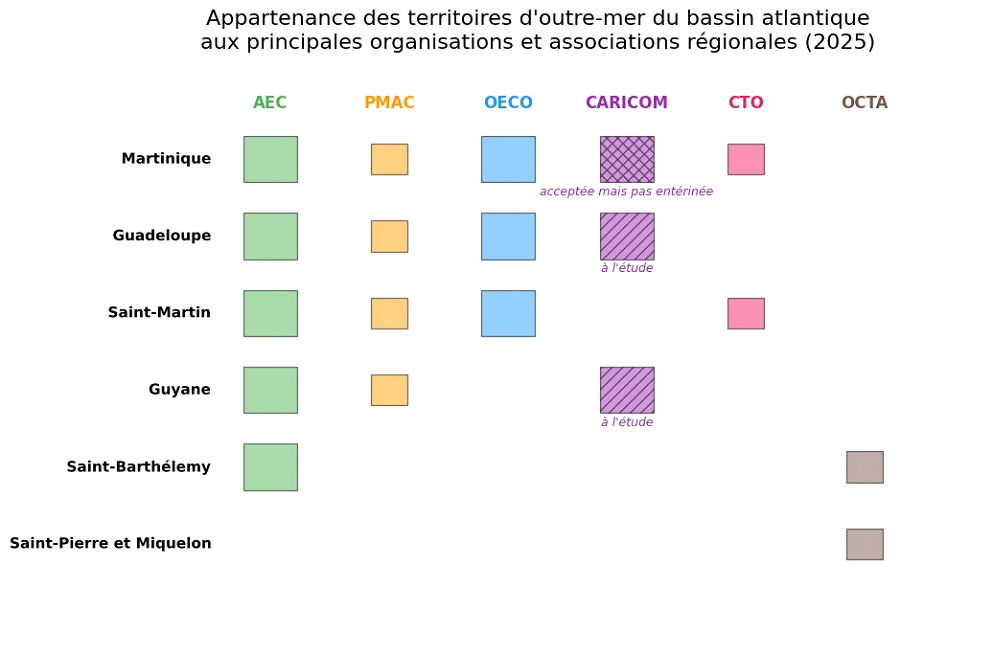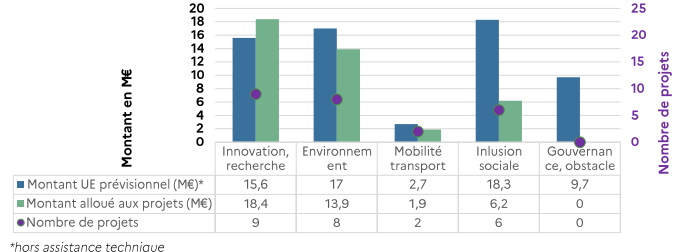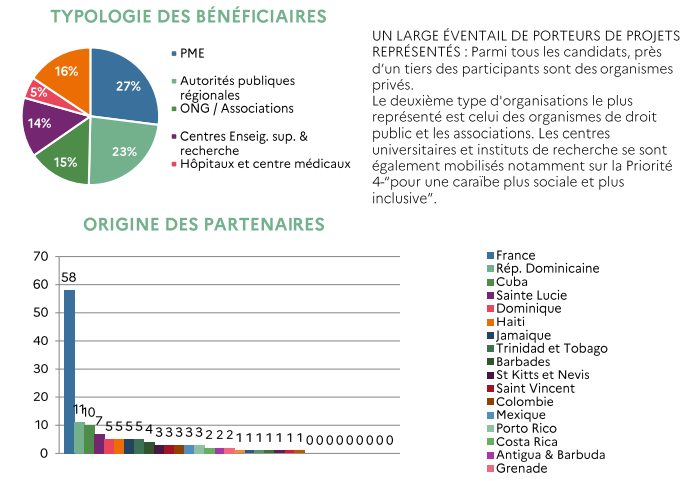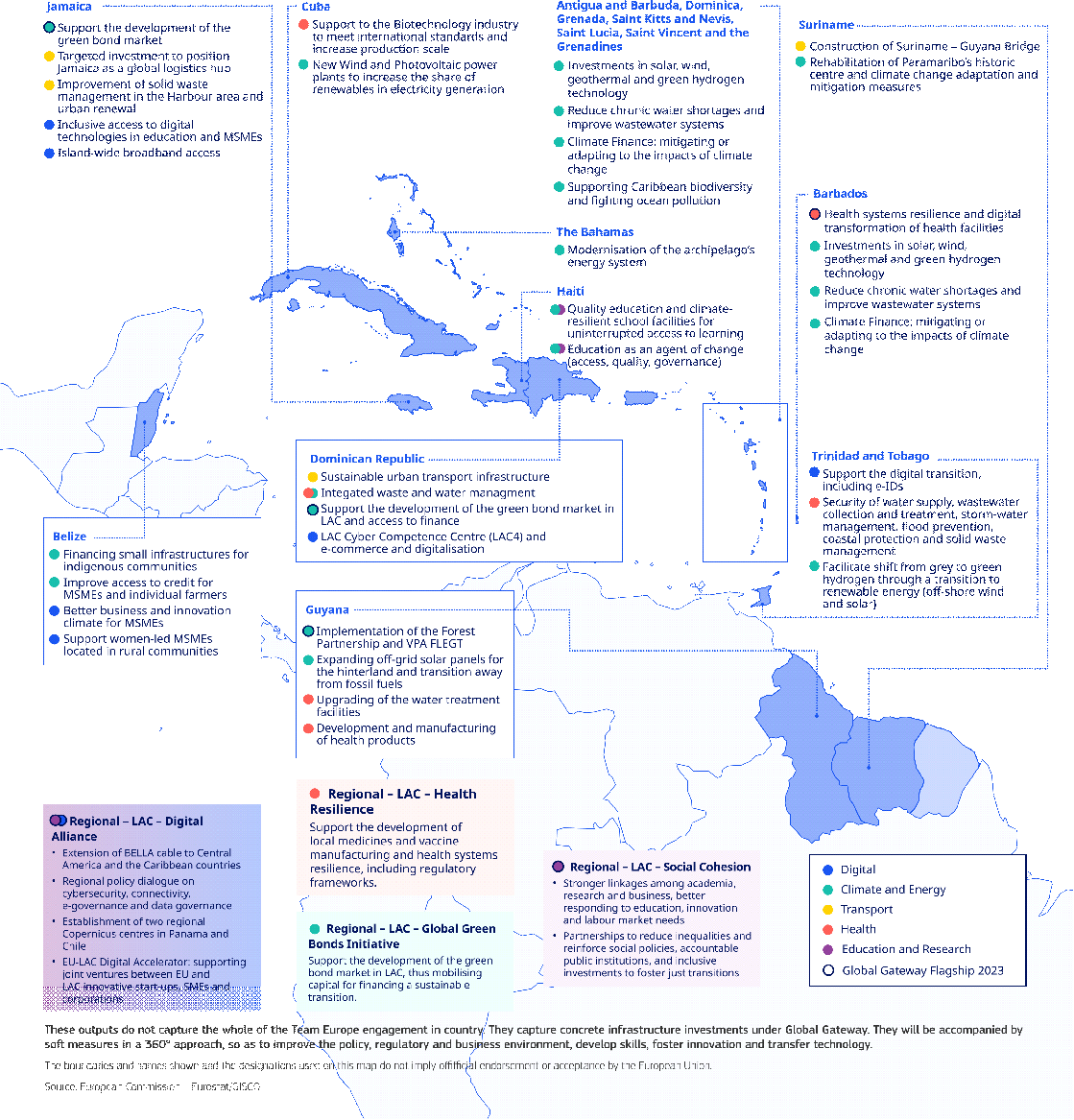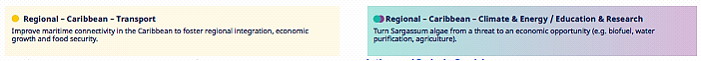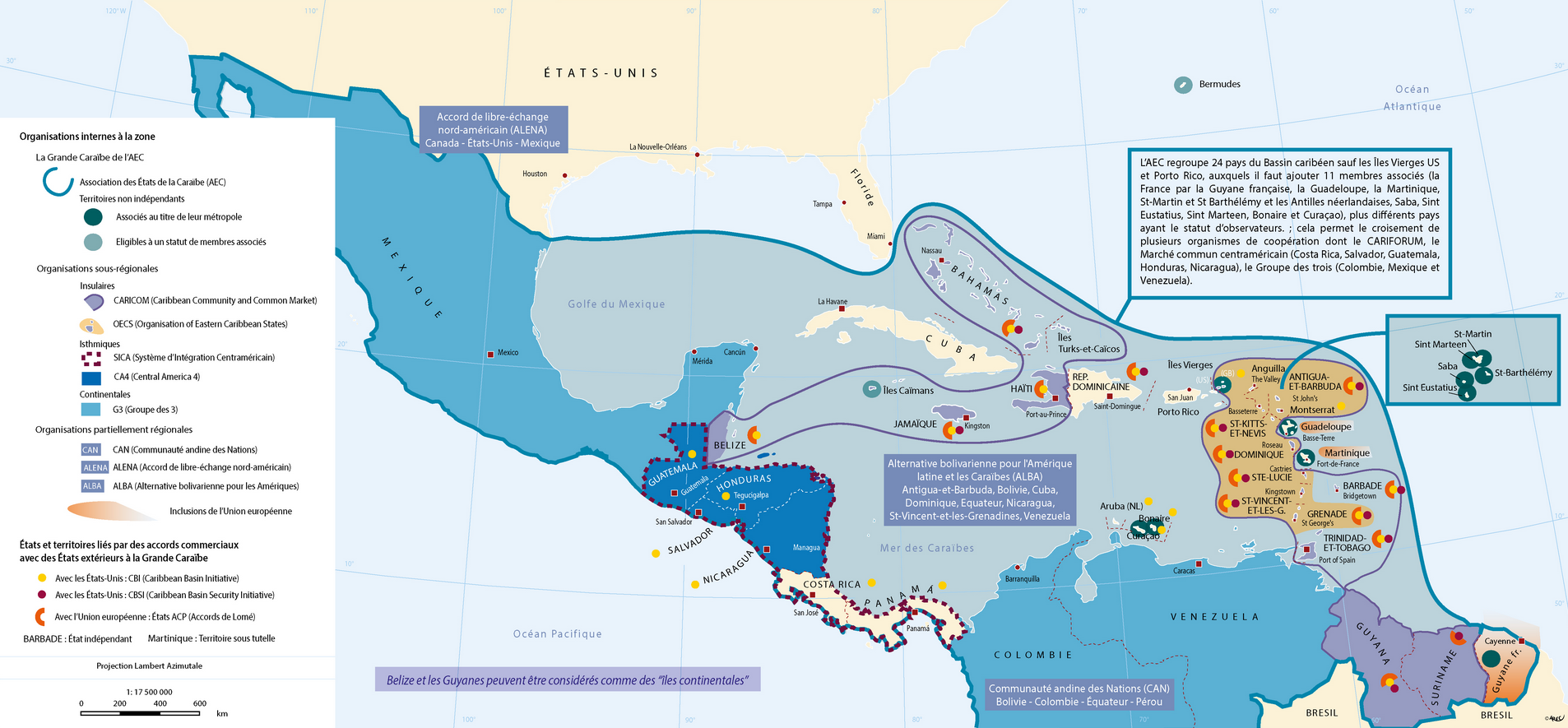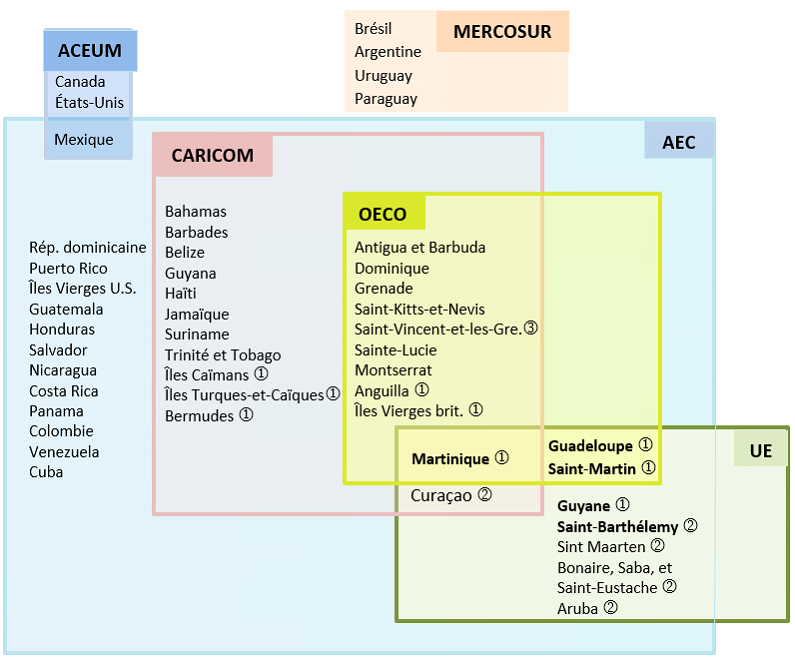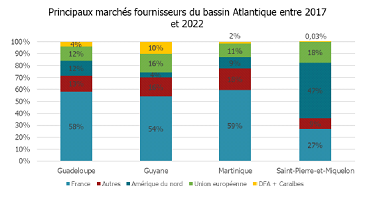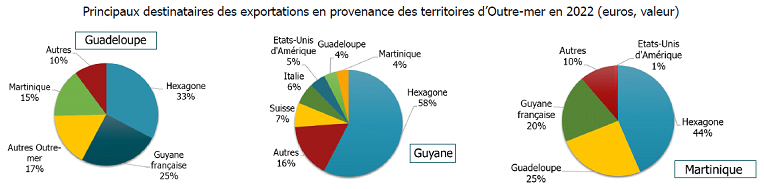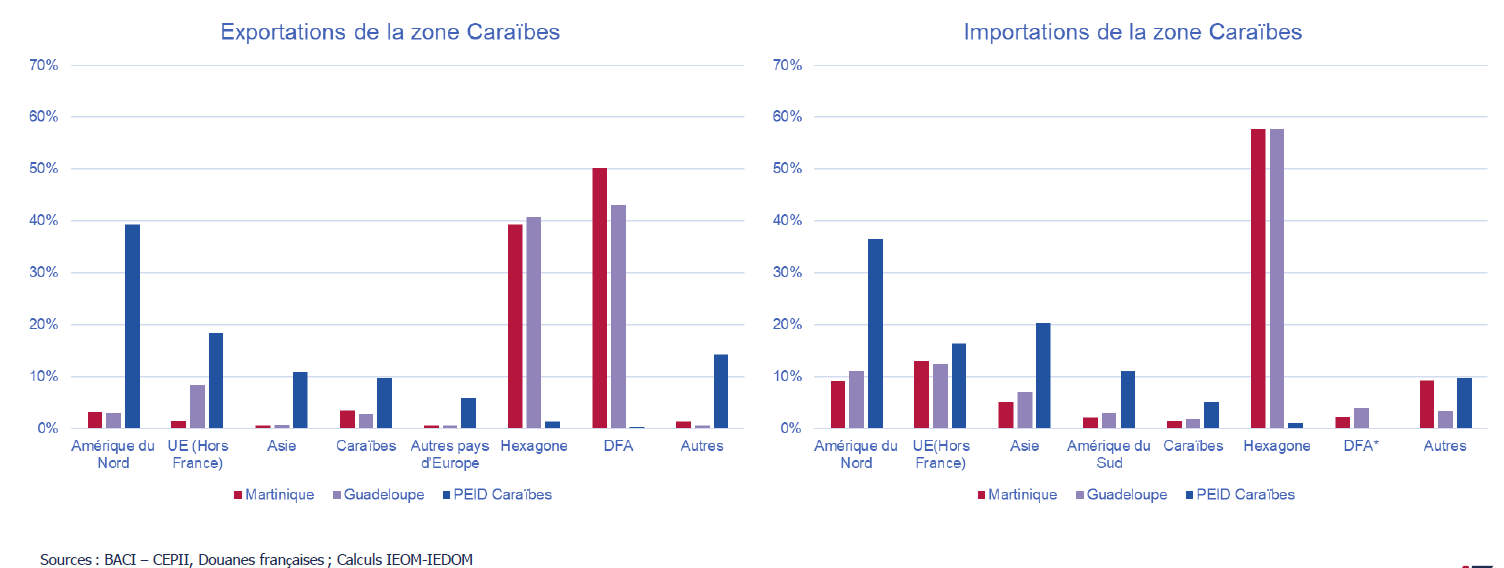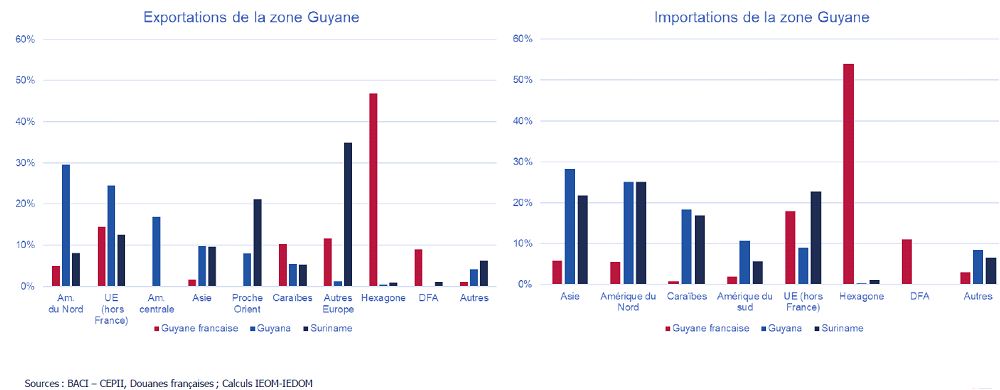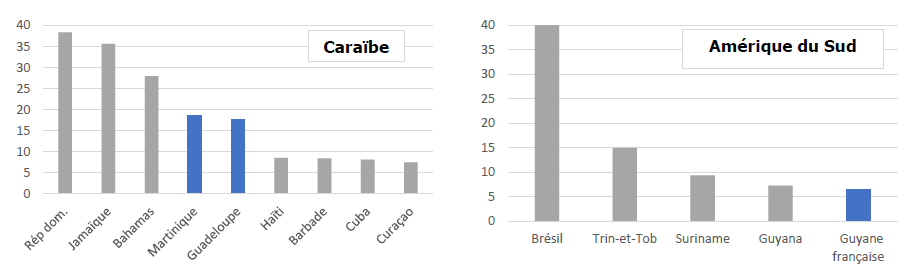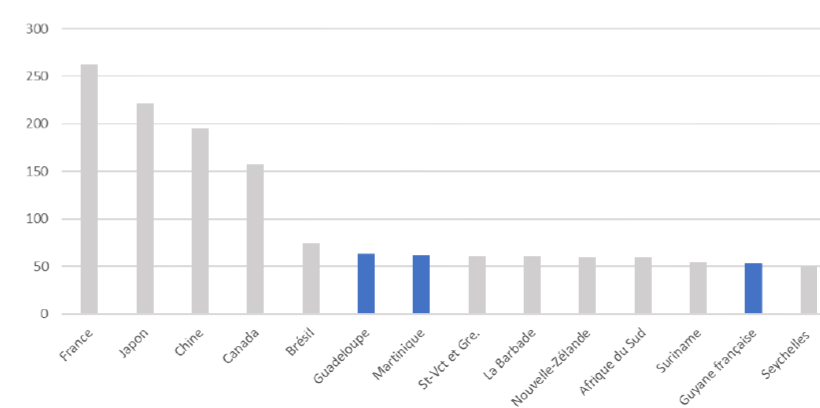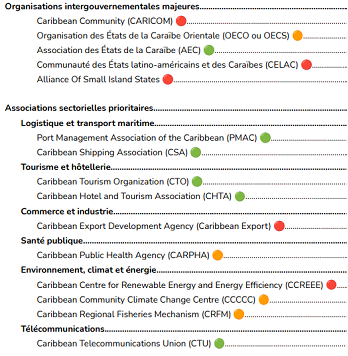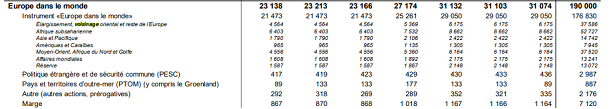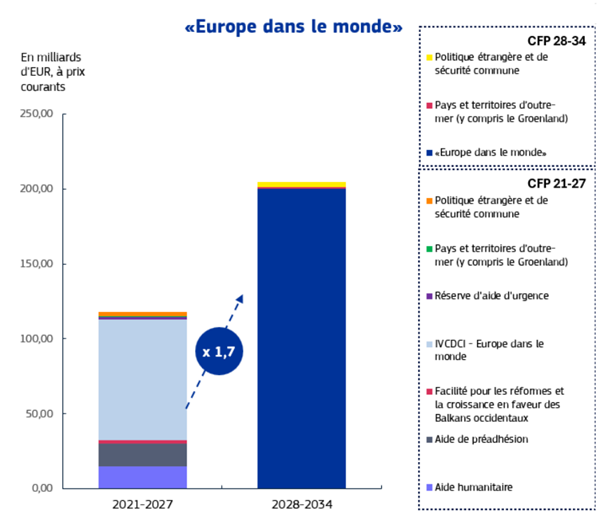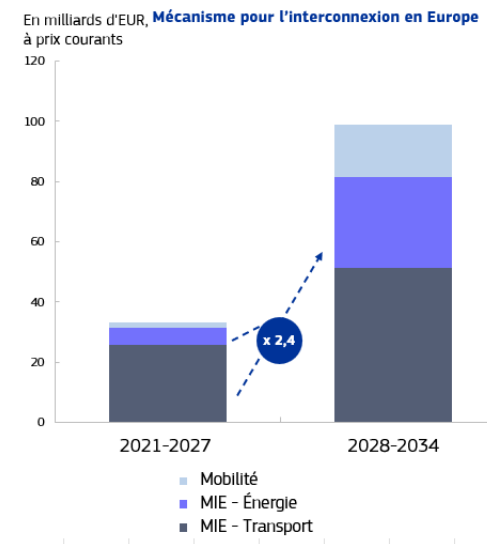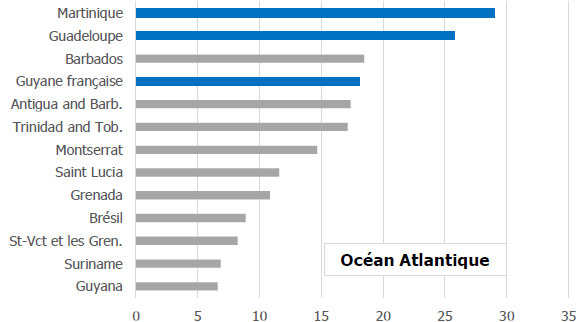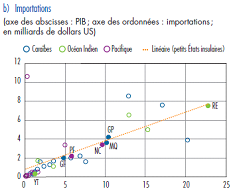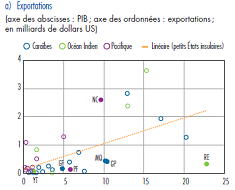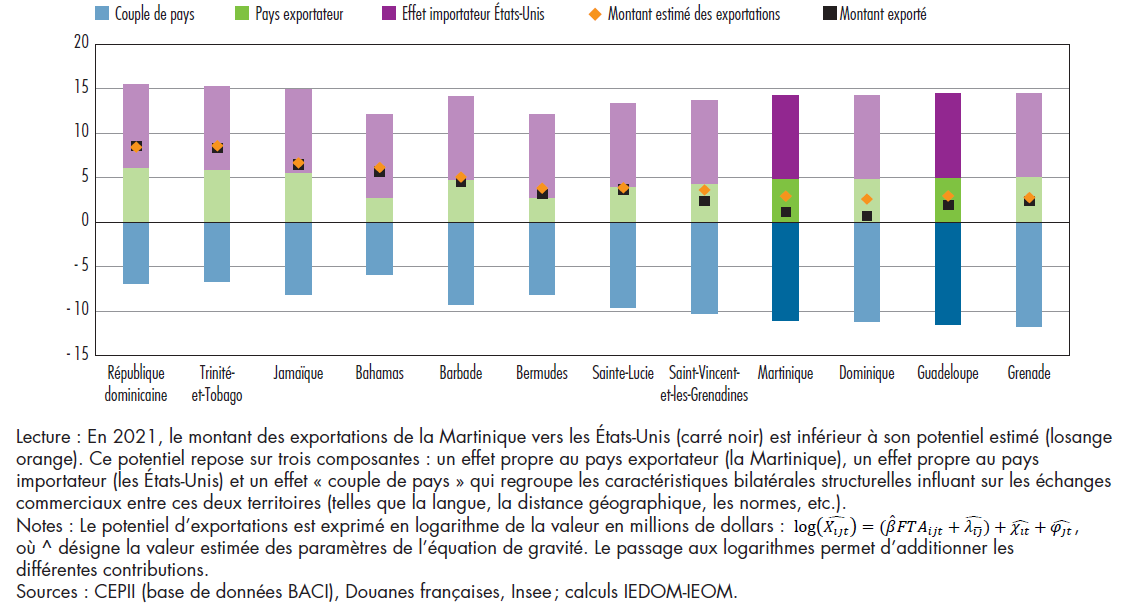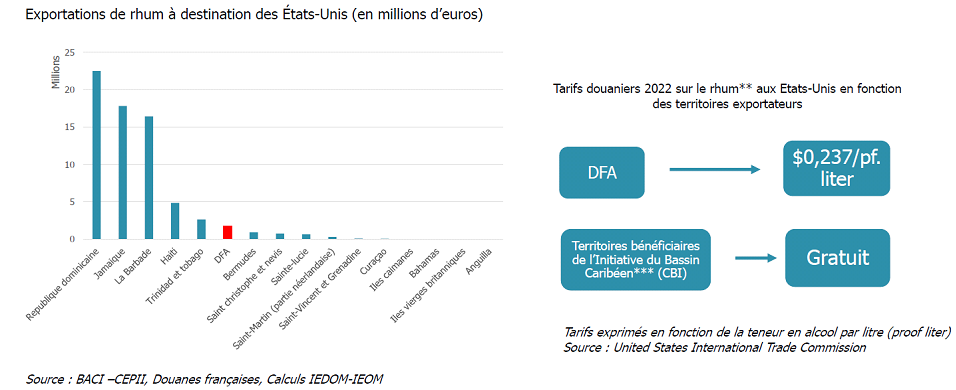- L'ESSENTIEL
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- AVANT PROPOS
- I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE
- A. UN BASSIN FRAGMENTÉ AUX CONTEXTES ET AUX
ENJEUX HÉTÉROGÈNES
- 1. Un espace redevenu géopolitiquement
sensible
- 2. Trois sous-bassins très
différents
- 3. Des organisations régionales
nombreuses : entre complémentarité et concurrence
- 4. L'OECO : un modèle
d'intégration régionale
- 5. Le plateau des Guyanes en pleine
transformation
- 6. L'inquiétude face à la crise en
Haïti et ses effets de bord
- 1. Un espace redevenu géopolitiquement
sensible
- B. UNE COOPÉRATION RÉGIONALE QUI
PROGRESSE : L'ESQUISSE D'UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE ?
- 1. Un réseau diplomatique
renforcé
- 2. L'intégration croissante des
collectivités françaises dans les organisations
régionales
- 3. Le coup d'accélérateur de la
coopération militaire, policière et judiciaire
- 4. La consolidation des relations
bilatérales
- 5. Des projets de coopération multiples
sous financement européen
- 6. Le rayonnement de nos territoires en
matière sanitaire, environnementale et culturelle
- 1. Un réseau diplomatique
renforcé
- C. DES POINTS FAIBLES PERSISTANTS
- A. UN BASSIN FRAGMENTÉ AUX CONTEXTES ET AUX
ENJEUX HÉTÉROGÈNES
- II. DES FREINS ENCORE IMPORTANTS À LEVER
POUR CHANGER DE DIMENSION
- A. AFFIRMER ET ACCÉLÉRER UNE
DIPLOMATIE TERRITORIALE DIFFÉRENCIÉE
- 1. Un espace géopolitique à
réinvestir entre la Chine et les États-Unis
- 2. Des collectivités qui doivent afficher
une stratégie et s'affirmer en chef de file
- 3. Mieux tirer parti des organisations
régionales
- 4. Inscrire les outre-mer aux agendas France-Chine
et UE-Chine
- 5. Parfaire la coopération en
matière de sécurité et de justice
- 6. Désenclaver la Guyane et réussir
la cogestion des bassins de vie le long des fleuves
- 7. La Guadeloupe et la Martinique : cap sur
le développement économique
- 8. Les trois
« Saints » : des enjeux très
hétérogènes
- 9. Soutenir la francophonie et l'apprentissage des
langues régionales
- 1. Un espace géopolitique à
réinvestir entre la Chine et les États-Unis
- B. L'UNION EUROPÉENNE : UNE
OPPORTUNITÉ UNIQUE À CONDITION DE RÉFORMER SON
ACTION
- 1. Vers la Politique européenne de
voisinage ultrapériphérique, la PEVu
- 2. Les financements européens : faire
converger tous les crédits de la coopération extérieure et
du voisinage
- 3. Les normes européennes : de la
souplesse absolument
- 4. Partager les clés de la politique
commerciale avec les territoires
- 5. Vers des Erasmus
régionalisés
- 1. Vers la Politique européenne de
voisinage ultrapériphérique, la PEVu
- C. LES SECTEURS D'AVENIR : CAP SUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- 1. Un potentiel de commerce qui attend
d'être exploité
- 2. Améliorer inlassablement la
connectivité maritime
- 3. Le traitement des déchets :
atteindre l'effet masse
- 4. Faire face à un fléau
commun : les sargasses
- 5. La production électrique : imaginer
des interconnexions et prendre la tête d'un écosystème de
la géothermie
- 6. L'agroalimentaire : vers une
souveraineté régionale ?
- 7. L'environnement et les sciences : faire
grandir les compétences locales et éviter la dispersion des
forces
- 1. Un potentiel de commerce qui attend
d'être exploité
- A. AFFIRMER ET ACCÉLÉRER UNE
DIPLOMATIE TERRITORIALE DIFFÉRENCIÉE
- I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES
DÉPLACEMENTS
- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
- GLOSSAIRE
- COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA
DÉLÉGATION
- Jeudi 10 avril 2025
Audition de Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes, ministère de l'Europe et des affaires étrangères
- Mardi 13 mai 2025
Audition de M. Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux
- Jeudi 10 juillet 2025
Audition de M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique
- Jeudi 10 juillet 2025
Audition de S.E. M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France
- Jeudi 16 octobre 2025
Audition de M. Manuel Marcias,
- Jeudi 10 avril 2025
N° 113
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation
sénatoriale aux outre-mer (1) sur la
coopération
et
l'intégration régionales des
outre-mer
volet 2 : bassin
océan Atlantique,
Par M. Christian CAMBON, Mmes Evelyne CORBIÈRE
NAMINZO
et Jacqueline EUSTACHE-BRINIO,
Sénateur et Sénatrices
(1) Cette délégation est composée de : Mme Micheline Jacques, président ; Mmes Audrey Bélim, Annick Girardin, Jocelyne Guidez, M. Victorin Lurel, Mme Viviane Malet, M. Akli Mellouli, Mmes Annick Petrus, Marie-Laure Phinéra-Horth, M. Teva Rohfritsch, Mme Lana Tetuanui, MM. Pierre-Jean Verzelen, Robert Wienie Xowie, vice-présidents ; Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Frédéric Buval, Mme Vivette Lopez, M. Georges Naturel, secrétaires ; Mme Viviane Artigalas, MM. Olivier Bitz, Christian Cambon, Mme Agnès Canayer, M. Guillaume Chevrollier, Mmes Catherine Conconne, Evelyne Corbière Naminzo, M. Stéphane Demilly, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Philippe Folliot, Stéphane Fouassin, Éric Jeansannetas, Mikaele Kulimoetoke, Antoine Lefèvre, Alain Milon, Thani Mohamed Soilihi, Mme Solanges Nadille, MM. Saïd Omar Oili, Georges Patient, Jean-Gérard Paumier, Mme Évelyne Perrot, MM. Laurent Somon, Rachid Temal, Dominique Théophile.
L'ESSENTIEL
Après un premier volet consacré à l'océan Indien, publié en septembre 2024, la délégation poursuit son étude relative à la coopération et l'insertion régionales des outre-mer en abordant dans ce deuxième volet le bassin océan Atlantique. Six outre-mer sont concernés et forment ensemble les collectivités françaises d'Amérique (CFA) : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et les « 3 Saints » - Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le choix a été fait de concentrer l'analyse sur les enjeux les plus importants pour ce bassin, compte tenu de ses singularités et de son hétérogénéité :
- les perspectives économiques de l'insertion régionale ;
- la dimension européenne, et incidemment celle de l'impact des normes ;
- les enjeux de souveraineté et de sécurité, notamment au regard de l'essor du narcotrafic.
La coopération régionale dans l'océan Atlantique en quelques dates
2019
Adhésion de la Guadeloupe
à l'OECO
2012
Création du Conseil du fleuve Oyapock
2014
Adhésion de la Martinique
et la Guadeloupe
à l'AEC
z
1994
Création de l'AEC
1981
Création de l'OECO
Source : DSOM
1973
Création de la CARICOM
I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE
Le bassin Atlantique est très hétérogène. La zone Caraïbe en particulier est une mosaïque fragmentée... Les petites Antilles et le plateau des Guyanes en sont deux sous-bassins. Saint-Pierre-et-Miquelon évolue dans un espace dominé par les deux géants canadiens et américains.
La Caraïbe est redevenue un espace géopolitique sensible. Longtemps considérée comme la « Méditerranée des États-Unis », elle est aujourd'hui le théâtre de la compétition mondiale entre Washington et Pékin. C'est aussi la zone de rebond des narcotrafics vers l'Europe et l'Amérique du nord. Toutefois, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour l'Europe et la France, les partenaires de la région ne voulant pas s'enfermer dans la rivalité sino-américaine. Par ailleurs, le plateau des Guyanes va connaître une croissance économique majeure avec l'exploitation des hydrocarbures.
La coopération et l'intégration régionales des CFA progressent depuis 10 ans et accélèrent dans la plupart des domaines (culturels, scientifiques, sanitaires, sécurité civile, judiciaires...).
Ces progrès butent néanmoins sur plusieurs obstacles. En matière économique et commerciale, le bilan demeure maigre. L'absence d'échanges intrarégionaux et les flux prépondérants vers l'Union européenne (UE) sont une spécificité des CFA.
Les organisations internationales régionales sont nombreuses (AEC, Caricom, OECO...). Mais la superposition des organisations nuit aussi à l'efficacité et à la lisibilité des projets de coopération. Les CFA, bien que membres associés, restent « à part ».
Source : DSOM
Schéma
« simplifié » de l'architecture des organisations
régionales
dans la Grande Caraïbe
m.a : Membre associé
PTOM : Pays et territoires d'outre-mer, n'appartient pas au territoire de l'UE, mais y est associé et leurs citoyens sont des citoyens européens
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Les normes européennes protègent, mais dressent aussi des barrières. Enfin, l'accord de partenariat économique UE-Caraïbes ne prend pas assez en compte les intérêts des CFA.
II. DES FREINS ENCORE IMPORTANTS À LEVER POUR CHANGER DE DIMENSION
Le rapport formule 20 recommandations autour de 4 axes principaux pour que les outre-mer du bassin Atlantique, la France et l'UE se renforcent mutuellement.
A. AFFIRMER UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE AMBITIEUSE, DIFFÉRENCIÉE ET RÉACTIVE
La première priorité consiste à ordonner une diplomatie territoriale des outre-mer, en particulier dans le bassin Atlantique, pour que leurs intérêts prévalent dans les arbitrages. Les briques de cette diplomatie existent, mais il manque une architecture globale pour lui donner une ambition.
Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs (recommandation n° 1).
Ce pôle aurait pour principal objectif d'accompagner la mise en oeuvre des programmes-cadres de coopération régionale approuvés par les collectivités. Cet outil créé par la loi Letchimy de 2016 doit placer chaque outre-mer en position de chef de file de la coopération régionale.
Ce pôle doit aussi faire avancer beaucoup plus rapidement les dossiers, comme l'adhésion de la Martinique à la Caricom ou le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes.
Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités (recommandation n° 2).
B. LUTTER CONTRE L'INSÉCURITÉ SANS NIER LES BASSINS DE VIE
Les progrès accomplis en matière de coopération policière et judiciaire sont incontestables. Il faut néanmoins aller plus loin en portant des initiatives à impact régional, pas seulement bilatéral.
Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises (recommandation n° 6).
Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France (recommandation n° 7).
S'il faut renforcer la sécurité régionale, il faut aussi veiller à ne pas ériger des barrières infranchissables. Les bassins de vie dans la Caraïbe, mais encore plus le long des fleuves Maroni et Oyapock en Guyane, doivent être développés.
Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière (CCP), en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock (recommandation n° 8).
Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten (recommandation n° 10).
C. TRANSFORMER LES VERROUS DE L'UNION EUROPÉENNE EN ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
Les régions ultrapériphériques (RUP) et pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de la région sont perçus comme un « petit plus », alors qu'ils devraient être au coeur de l'agenda UE-Caraïbes et Amérique latine, et en être un des piliers.
À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 :
- obtenir de l'UE la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ;
- définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI (recommandation n° 12).
À plus long terme, une véritable PEVu appelle la création d'instruments de voisinage dédiés - par analogie avec la PEV. Un programme Erasmus RUP par bassin irait aussi en ce sens.
Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'Union européenne (recommandation n° 14).
D. MISER SUR LES SECTEURS D'AVENIR : TRANSPORT MARITIME RÉGIONAL, AGROALIMENTAIRE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, ENVIRONNEMENT
Les récents travaux de la Banque de France et de l'IEDOM montrent que le potentiel de commerce des RUP est sous-exploité. Pour enclencher le rattrapage, il faut cibler quelques secteurs prometteurs.
Premier secteur clef : le transport maritime régional. La modernisation des infrastructures douanières et portuaires est le premier niveau de réponse. Il faut aussi créer un cadre réglementaire favorable, en révisant le règlement européen du 7 décembre 1992 sur le cabotage.
Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom (recommandation n° 16).
Le traitement des déchets devrait être un autre secteur majeur de coopération régionale, à la condition que la réglementation européenne soit enfin adaptée.
En matière de souveraineté alimentaire, elle devrait être pensée à l'échelle régionale en s'appuyant sur le cabotage maritime redynamisé.
Enfin, la protection de la biodiversité peut aussi être un facteur régional d'attractivité et d'intégration politique. Pour la Guyane, l'enjeu est de se reconnecter à la sphère amazonienne.
Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation d'Interreg sur cet objectif (recommandation n° 19).
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Affirmer une diplomatie territoriale ambitieuse, différenciée et réactive
Recommandation n° 1 : Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs.
Recommandation n° 2 : Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités.
Recommandation n° 3 : Accélérer le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, après deux années perdues depuis les annonces du Ciom 2023.
Recommandation n° 4 : Déposer en urgence le projet de loi portant ratification de la convention sur les privilèges et les immunités, afin d'entériner l'adhésion de la Martinique à la Caricom.
Recommandation n° 5 : Clarifier l'applicabilité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'action extérieure, en saisissant pour avis le tribunal administratif et en complétant la loi organique si nécessaire.
Lutter contre le fléau de l'insécurité sans nier les bassins de vie
Recommandation n° 6 : Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises.
Recommandation n° 7 : Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France.
Recommandation n° 8 : Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière, en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock.
Recommandation n° 9 : Réexaminer l'obligation de visa entre le Brésil et la Guyane en lui substituant un mécanisme inspiré du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) européen, et élargir la liste de produits ouverts au libre commerce entre les deux rives du fleuve, voire entre les deux territoires.
Recommandation n° 10 : Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten.
Recommandation n° 11 : Faire enfin de la promotion de la francophonie dans le voisinage des outre-mer une priorité stratégique et modifier en ce sens les contrats d'objectifs et de moyens des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de l'Institut français.
Transformer les verrous de l'Union européenne en accélérateur de la coopération régionale
Recommandation n° 12 : À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 :
- obtenir de l'Union européenne la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ;
- définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI.
Recommandation n° 13 : Dans le cadre d'un avenant à l'Accord de partenariat économique UE-Caraïbes, autoriser la conclusion d'accords régionaux ou bilatéraux de libre-échange entre un ou des RUP et des États tiers voisins/organisations régionales, le cas échéant sur un nombre limité de produits.
Recommandation n° 14 : Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'UE, et d'étendre à l'enseignement scolaire le volet international de ce programme.
Miser sur les secteurs d'avenir : transport maritime régional, environnement, sciences, agroalimentaire, traitement des déchets
Recommandation n° 15 : Modifier le règlement européen du 7 décembre 1992 afin de faciliter la création de lignes de cabotage maritime entre les RUP et leurs partenaires régionaux.
Recommandation n° 16 : Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom.
Recommandation n° 17 : Suspendre en urgence l'application de la directive européenne « ETS » dans les RUP, pour maintenir la compétitivité des escales maritimes et aériennes face à celles de leurs voisins proches et engager des discussions avec les organisations régionales pour la création d'un système de taxe carbone à cette échelle.
Recommandation n° 18 : Pour permettre outre-mer des coopérations régionales de traitement des déchets :
- faire application de l'article 349 du TFUE pour obtenir l'adaptation des règlements européens (UE) 1257/2013 et (UE) 2020/1056 aux contraintes des régions ultrapériphériques ;
- ouvrir des discussions dans le cadre de la convention de Bâle afin de conclure des accords régionaux.
Recommandation n° 19 : Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation de crédits Interreg sur cet objectif.
Recommandation n° 20 : Rapprocher les organismes de recherche outre-mer, en particulier l'INRAE, le Cirad et l'IRD pour porter une diplomatie scientifique puissante et lisible sur les sujets de souveraineté alimentaire et de santé.
AVANT PROPOS
Après un premier volet consacré à l'océan Indien, publié en septembre 2024, la délégation sénatoriale aux outre-mer a poursuivi son étude relative à la coopération et l'insertion régionales en abordant dans un deuxième volet l'océan Atlantique.
À la lumière de ses précédentes analyses, elle a dû prendre la mesure des enjeux spécifiques à ce bassin qui réunit la moitié des outre-mer français : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et les « 3 Saints » : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Comme l'an passé, la formule de Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique et initiateur de la loi éponyme du 5 mars 2016, « les outre-mer sont étrangers à leur géographie » a trouvé un plein écho lors des travaux préparatoires. Plus qu'ailleurs peut-être les relations historiques et des liens économiques avec la « métropole » hérités de la période coloniale ont façonné la faiblesse des relations de ces territoires avec leur environnement. Comme pour les collectivités de l'océan Indien, les flux d'échanges, notamment commerciaux, peinent à se développer et à produire les effets attendus sur les économies concernées.
Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, de nombreux freins persistent.
Un binôme de rapporteurs a été désigné - Evelyne Corbière Naminzo (CRCE K - La Réunion) et Jacqueline Eustache-Brinio (LR - Val-d'Oise) - pour conduire ces travaux, Christian Cambon, ancien président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, demeurant le rapporteur coordonnateur des trois volets.
Comme pour le volet précédent, le choix a été fait de concentrer l'analyse sur les enjeux les plus importants pour ce bassin, compte tenu de ses singularités :
- la dimension économique de l'insertion régionale et les opportunités de lutte contre la vie chère ;
- la dimension européenne, et incidemment celle de l'impact des normes ;
- les enjeux de souveraineté et de sécurité, notamment au regard de l'essor du narcotrafic.
Tout en constatant les faiblesses et handicaps actuels (un cadre de coopération encore trop peu lisible, une mobilité largement entravée, des liens commerciaux encore trop modestes, l'ampleur des trafics illicites sur la zone Antilles-Guyane), les rapporteurs ont aussi relevé le dynamisme des relations bilatérales, la densité des organisations régionales et le développement des politiques sectorielles. Ils soulignent aussi le retour de la géopolitique mondiale dans la Caraïbe et les opportunités pour l'Europe et la France de faire valoir une autre voie.
L'appartenance à l'Union européenne y apparaît à la fois comme une clé et un verrou à l'action. Par ailleurs, une vigilance particulière est à porter au futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne (CFP 2028-2034).
Les rapporteurs formulent 20 propositions articulées autour des quatre axes suivants :
- affirmer une diplomatie territoriale ambitieuse, différenciée et réactive ;
- lutter contre le fléau de l'insécurité sans nier les bassins de vie ;
- transformer les verrous de l'Union européenne en accélérateur de la coopération régionale ;
- miser sur les secteurs d'avenir : transport maritime régional, environnement, sciences, agroalimentaire, traitement des déchets.
I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE
A. UN BASSIN FRAGMENTÉ AUX CONTEXTES ET AUX ENJEUX HÉTÉROGÈNES
1. Un espace redevenu géopolitiquement sensible
La Caraïbe est traditionnellement perçue comme la Méditerranée des États-Unis. L'influence géopolitique nord-américaine est prédominante, en particulier dans un espace très éclaté et fragmenté composé d'une multitude de petites îles aux statuts très différents. Situé sur la route du canal du Panama, l'espace caraïbe est stratégique et considéré comme la chasse gardée des États-Unis conformément à la doctrine Monroe.
Toutefois, derrière cette apparence de calme géopolitique, des forces nouvelles travaillent la région, à la faveur notamment d'un relatif retrait américain depuis quelques années. Les États-Unis ont en effet semblé se détourner de la région, considérée comme acquise et sans défis majeurs. Plus récemment avec la présidence Trump II, la réduction drastique des crédits de l'aide au développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde (USAID) a pu donner le sentiment de laisser encore un peu plus le champ libre à d'autres acteurs mondiaux.
Le principal d'entre eux est incontestablement la Chine dont l'influence est croissante et solidement ancrée.
Fiona Ramsey, ambassadrice de l'Union européenne à la Barbade et ambassadrice désignée auprès des États des Caraïbes orientales, constate la montée en puissance méthodique et stratégique de la Chine dans la région.
Après l'Afrique et le Pacifique, la Chine investit pleinement cet espace géopolitique très fragmenté et fragilisé à certains égards.
La présence chinoise s'appuie sur un narratif attrayant, dans une relation sud-sud débarrassée du poids colonial et du passé de l'esclavage. Son influence s'appuie sur des outils soft power : création de centres Confucius, bourses d'études, développement de liens humains et culturels.
Elle se traduit aussi par l'offre d'une technologie performante et peu chère, notamment en matière d'énergie solaire et de mobilité électrique. Plusieurs États sont aujourd'hui fortement endettés à son égard. Par ailleurs, le personnel diplomatique chinois est de grande qualité, signe de l'attention particulière pour cette région du monde. La Chine assume pleinement cette diplomatie active et offensive. Depuis la fin 2023 et surtout en 2024, la Chine prend la parole et réagit à tout ce qui touche la zone. Elle n'hésite pas à critiquer les États-Unis et toute personne qui n'irait pas dans le sens des intérêts chinois.
À titre d'illustration, la Chine tend à freiner les initiatives onusiennes pour aider Haïti à sortir de la crise sécuritaire actuelle, Haïti ayant eu le tort de reconnaître officiellement Taïwan.
Francis Etienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie, replace cette présence chinoise dans le contexte de la lutte d'influence avec Taïwan. Dans la Caraïbe orientale, la géographie impose une vision duale : tous les territoires commençant par « Saint »1(*) sont pro-taïwanais, les autres sont pro-Pékin avec des degrés d'engagement variables.
À la Barbade, cette influence reste contenue, le Gouvernement veillant à préserver les équilibres. En revanche, des territoires comme Antigua-et-Barbuda au nord de l'arc antillais ont une inclination beaucoup plus marquée. À la Dominique, « c'est devenu colossal et pratiquement hors de contrôle » pour reprendre les termes d'un diplomate : « on ne parle plus simplement de présence, mais c'est bien de puissance. La Chine finance des infrastructures : réseau routier refait après l'ouragan Maria, hôpital, écoles, aéroport international gigantesque, qui pourraient ouvrir la porte à des installations militaires... »
La situation à la Dominique est particulièrement préoccupante pour la Martinique et la Guadeloupe. En effet, les investissements chinois font notamment sortir de terre et de mer un port en eau profonde et un aéroport international qui seraient en capacité de concurrencer directement les plateformes de nos deux départements.
Au Suriname, les entreprises chinoises sont très impliquées et répondent massivement aux appels d'offres. Par ailleurs, la logistique de l'orpaillage illégal est entre les mains d'acteurs chinois, notamment de la diaspora, une grande partie de l'or étant ensuite orientée vers le marché chinois.
Pour Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « la Chine s'emploie à renforcer sa présence au sein de l'Organisation des États américains (OEA), dont dix membres sont issus de la Caraïbe. Elle y voit un levier d'influence diplomatique majeur. À ce titre, des soupçons circulent sur une participation chinoise au financement du prochain sommet de l'OEA, alors même que l'OEA traverse une crise financière liée au retrait partiel de l'USAID, qui assurait jusqu'ici près de la moitié de son budget. Ce type d'intervention illustre la capacité de Pékin à investir les espaces laissés vacants ».
Cette influence chinoise commence néanmoins à se heurter à une réaction américaine, qui après un long retrait amorce un retour en force, du moins sur le plan diplomatique et militaire.
Autre point d'agacement américain : les services financiers chinois sont des intermédiaires incontournables des programmes dits CBI (Citizenship By Investment) qui permettent d'obtenir un passeport de certaines îles indépendantes de la Caraïbe en contrepartie de l'obligation d'investir une somme minimale dans le pays. Depuis 1984, on estime à 88 000 le nombre de passeports ainsi délivrés, souvent à des personnalités peu recommandables. Ces programmes CBI sont désormais très contestés pour l'absence de transparence.
À côté de cette rivalité montante, la Caraïbe et le plateau des Guyanes sont traversés par des tensions et des crises multiples.
Le Brexit a laissé un vide. Les cinq territoires sous souveraineté britannique - Anguilla, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Montserrat et les îles Turks-et-Caicos - ont perdu leur lien avec l'Union européenne et se sont paradoxalement éloignés du Royaume-Uni.
La crise en Haïti a un potentiel de déstabilisation plus large, à la fois par la diffusion de la violence et par les flux de migrants haïtiens qui fuient l'horreur.
L'explosion des narcotrafics et des trafics organisés, en particulier du trafic d'armes, fracturent et fragilisent les sociétés caribéennes. Elles sont traversées par ces trafics, dont elles ne sont que des points de rebond ou de transit, qui visent l'Europe et les États-Unis. Ces groupes criminels menacent les populations, les citoyens, mais aussi les institutions locales exposées à la corruption au plus haut niveau. Plusieurs États de la région sont soupçonnés de se muer progressivement en narco-États.
Les différentiels de niveau de richesse sont aussi importants et ne favorisent pas un développement harmonieux de la région.
Comme évoqué ci-dessus, depuis le début de la présidence Trump II et malgré le désengagement d'USAID, les États-Unis sont de retour avec force en affirmant leur supériorité militaire et leur rôle de « sherif » de la région. Le déploiement d'une flotte de guerre américaine menace directement le Venezuela, après la destruction sans préavis de plusieurs bateaux soupçonnés de trafic de drogue et l'autorisation donnée à la CIA de mener des opérations clandestines au sol. Le Gouvernement vénézuélien est accusé d'organiser le narcotrafic. D'autres Gouvernements sont aussi dans la ligne de mire, à tort ou à raison. La Colombie, mais aussi d'autres territoires, sont potentiellement visés. L'escale rapide de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, au Suriname en avril dernier aurait notamment été l'occasion d'exprimer l'inquiétude des États-Unis sur l'influence chinoise dans cet État et le Guyana voisin.
2. Trois sous-bassins très différents
Le bassin Atlantique se compose en réalité de trois sous-bassins très hétérogènes. Ils diffèrent par leur géographie, leur histoire, leur peuplement, leur climat. Ils se rejoignent en revanche par leur isolement par rapport aux grands centres économiques mondiaux et leur dépendance économique aux importations.
a) La Caraïbe et les Petites Antilles
La Caraïbe est une mosaïque de territoires, principalement insulaires, aux statuts multiples et souvent de superficie et de populations réduites. La plupart des États entrent dans la catégorie des Petits États insulaires en développement (PEID).
Cette région est marquée par une histoire commune - la colonisation européenne à partir de la fin du 15e siècle et l'esclavage - et souvent une identité créole en partage, avec ses mille nuances.
Les populations sont aussi mélangées, avec des communautés souvent présentes dans plusieurs îles. Le multilinguisme est une réalité quotidienne (anglais, créole, français, espagnol, néerlandais...).
Très fragmenté, cet espace n'en est pas moins relié par cette identité. Il est également solidaire face à des catastrophes naturelles fréquentes : séismes, éruptions volcaniques, ouragan. La récurrence des cyclones majeurs ces dernières années est d'ailleurs un facteur de renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité civile et de lutte contre les effets du réchauffement climatique.
Cet espace régional est enfin exposé à des phénomènes criminels croissants. Sur la route de la drogue vers l'Europe et les États-Unis, la Caraïbe et l'arc antillais sont des zones de rebond vulnérables et difficiles à contrôler car morcelées.
Les outre-mer français sont au nombre de quatre et scandent l'arc des Petites Antilles du nord au sud : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, l'archipel de la Guadeloupe et la Martinique. Le poids de la France dans les Petites Antilles est fort, par sa population (plus de 800 000 personnes), ses acteurs économiques et sa superficie à l'échelle des territoires voisins. Ces territoires sont aussi des portes d'entrée vers la France et l'Union européenne.
L'île de Saint-Martin est un territoire binational, constitué pour moitié d'un pays et territoire d'outre-mer (PTOM) néerlandais, Sint Maarten, et de l'autre d'une région ultrapériphérique (RUP) française Saint-Martin. La coopération transfrontalière se vit au quotidien à Saint-Martin. Sa frontière est est une frontière active de l'Europe.
L'Union européenne est en effet un autre acteur présent politiquement, économiquement et aussi géographiquement dans cette région, à la différence de la Chine. Outre les RUP et PTOM français, les PTOM néerlandais assurent un rayonnement européen important avec Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba et Saint-Eustache.
b) Le plateau des Guyanes
Le deuxième sous-bassin est celui du plateau des Guyanes qui regroupe approximativement le Guyana, le Suriname, la Guyane française et l'État brésilien de l'Amapa, voire celui du Para.
Cet ensemble géographique fait encore l'objet de contestations territoriales importantes. Certaines de ces tensions latentes et anciennes sont réactivées par la découverte de ressources naturelles.
Les contestations frontalières sur le plateau des Guyanes
Source : Capes/Pro-Defesa
La Guyane est le seul outre-mer continental, avec des relations frontalières d'une nature très différente de celles vécues par les outre-mer insulaires. Cette spécificité renforce les attentes autour de la coopération régionale et une forme d'incompréhension face à l'isolement de la Guyane.
Les frontières sont soit infranchissables - la jungle au sud -, soit extrêmement perméables et très difficiles à contrôler - à l'est le long du fleuve Oyapock, à l'ouest le long du Maroni. Les zones frontalières des fleuves sont des bassins de vie naturels, à la fois culturels, économiques, familiaux...
L'enjeu de la circulation des personnes et des biens est donc central, en particulier dans une région gangrenée par des réseaux criminels puissants. La coopération est indissociable de la possibilité, pour les habitants des fleuves, de se rencontrer.
Toutefois, les deux voisins de la Guyane sont très différents. Le Suriname est un petit État centralisé, indépendant depuis 1975, de taille comparable à la Guyane et doté d'une population modeste (650 000 habitants). Le Brésil est un État continent, à l'organisation administrative très complexe, dont l'État de l'Amapa est situé aux confins de la région la moins développée. L'Amapa et le Para, les deux États fédérés les plus proches de la Guyane, sont aussi les plus pauvres et les plus isolés. Pour Brasilia, les difficultés de l'Amapa ne sont pas une priorité, et la frontière avec la Guyane très secondaire.
Malgré cette réalité bien différenciée, le point de vue depuis Paris demeure trop souvent dominé par l'angle Antilles-Guyane et l'appréhension des enjeux peine parfois à dissocier ces deux espaces.
Pour Florian Raffatin, directeur de l'Agence française de développement (AFD) à Cayenne, cette perception s'explique par le fait que la Guyane continue de tourner le dos au grand continent sud-américain, l'histoire et les contraintes de la géographie conduisant ce territoire à regarder vers l'Union européenne et la Caraïbe.
Il n'en demeure pas moins que la Guyane est le seul bout de France et d'Europe en Amérique du Sud. Selon les mots du colonel Thierry Crampé, commandant en second de la gendarmerie de Guyane, « la Guyane, c'est l'Europe et la France à portée de pirogue ».
c) Saint-Pierre-et-Miquelon : seul en face de deux géants
Dans l'Atlantique nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire insulaire de 6 000 habitants, a un positionnement à part au large des côtes de Terre-Neuve (Canada) et à proximité des États-Unis, deux géants.
Son espace maritime est aussi très contraint depuis l'arbitrage international de 1992 qui a laminé son économie et une part de son identité par la même occasion.
L'architecture de la coopération régionale et les enjeux se résument à la relation bilatérale avec le Canada qui est le point d'entrée quasi-unique de l'archipel, à l'exception de quelques liaisons maritimes et aériennes directes depuis l'Hexagone à certaines périodes de l'année.
Les principaux enjeux sont économiques et sanitaires.
3. Des organisations régionales nombreuses : entre complémentarité et concurrence
L'extrême fragmentation et l'isolement de ces territoires ont très tôt poussé leurs Gouvernements à s'engager dans la voie de la coopération régionale. L'arc antillais et caribéen - et dans une moindre mesure le plateau des Guyanes - foisonne d'initiatives de coopération régionale depuis les années 70. Ce foisonnement se traduit notamment par la création de plusieurs organisations intergouvernementales ou d'ONG, poursuivant ces objectifs de coopération régionale à tous les niveaux.
Il faut distinguer plusieurs cercles de coopération.
a) Les trois piliers de la coopération régionale caraïbéenne : Caricom, OECO et AEC
Les territoires ultramarins de la Caraïbe appartiennent à un environnement régional majoritairement composé de petits États insulaires en développement (PEID), confrontés à des défis contemporains majeurs et partageant une vulnérabilité commune. Face à ces enjeux, les territoires trouvent leur force au sein d'une dynamique de coopération forte, incarnée par trois grandes organisations régionales aux périmètres et degrés d'intégration variés : la Communauté caribéenne (Caricom), l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et l'Association des États de la Caraïbe (AEC).
La Caricom est la plus ancienne et la plus emblématique de ces organisations. Créée en 1973, elle rassemble majoritairement des États issus de l'Empire britannique, mais a su s'élargir progressivement à des membres francophones et néerlandophones, dont Haïti et le Suriname. Cette organisation oeuvre à une intégration progressive à travers des projets sectoriels dans la santé, l'éducation, la sécurité ou encore la gestion des risques environnementaux, tout en jouant un rôle diplomatique majeur au sein de la région. Les territoires français, en particulier la Martinique qui est sur le point d'en devenir un membre associé, ont manifesté leur volonté d'y adhérer avant de rejoindre d'autres organisations, symbolisant un pont incontournable entre les collectivités françaises d'Amérique (CFA) et leurs voisins.
L'OECO, fondée en 1981, se distingue par un degré d'intégration plus poussé (voir infra), notamment grâce à son union économique qui institue la libre circulation des personnes et l'usage d'une monnaie commune entre ses membres fondateurs. Cette organisation, bien qu'elle tire son identité du noyau anglophone de la Caraïbe orientale, s'est révélée plus ouverte à l'adhésion des territoires francophones en qualité de membres associés, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, ce qui permet à l'OECO de couvrir un archipel continu. S'ils sont exclus de l'application des normes supranationales par leur statut institutionnel et leur appartenance au régime communautaire européen, l'OECO représente néanmoins pour eux un cadre privilégié d'émancipation politique et de coopération régionale fonctionnelle, et où leur participation aux programmes est réclamée.
Enfin, l'AEC, créée en 1994, couvre une zone géographique plus vaste, incluant l'ensemble des pays d'Amérique centrale et du Sud bordant le littoral, du Mexique à la Guyane, en plus des membres de la Caricom. Organisation la plus récente et la moins intégrée des trois, elle agit principalement comme un forum diplomatique réunissant une grande diversité linguistique et culturelle. Son rôle est de favoriser le dialogue régional, notamment autour des enjeux du développement durable et de la gestion des risques naturels comme l'érosion côtière, domaines dans lesquels les territoires français bénéficient de programmes européens tels que Carib-Coast qui représente la principale valeur ajoutée concrète de cette organisation2(*).
Ainsi, ces trois organisations constituent les piliers de l'intégration régionale dans la Caraïbe, chacune avec ses spécificités : la Caricom, la plus ancienne organisation et donc incontournable, l'OECO, la plus intégrée économiquement et institutionnellement, et l'AEC, la moins opérationnelle, mais offrant un cadre diplomatique élargi.
b) Une architecture de la coopération régionale complétée par une multitude d'organisations et associations de la Caraïbe
La coopération dans la Caraïbe ne se limite pas aux trois grandes organisations régionales décrites ci-dessus, elle s'appuie également sur une pluralité d'institutions et de plateformes qui témoignent d'une réelle vitalité et d'une culture de la coopération ancrée dans la région.
La Banque de développement des Caraïbes (BDC), créée en 1970, est une institution financière multilatérale qui soutient la coopération régionale en favorisant une croissance harmonieuse et la réduction des inégalités de développement. Avec 19 membres emprunteurs majoritairement anglophones et des membres non emprunteurs comme le Canada, le Royaume-Uni ou la Chine, la BDC finance des projets majeurs comme la première centrale géothermique de la Caricom située en Dominique, en plus d'apporter des conseils et de l'assistance technique aux États. Elle s'inscrit aussi dans une logique de solidarité et de résilience, comme en témoignent ses interventions pendant la pandémie de Covid-19. Les collectivités françaises d'Amérique (CFA) pourraient en bénéficier par la voie du retour de la France au capital de la banque3(*), ou en candidatant en tant que membres à part entière conformément aux dispositions prévues par la loi Letchimy de 2016, ce qui offrirait par exemple aux entreprises ultramarines un accès aux appels d'offres et une meilleure visibilité auprès des territoires voisins.
La Port Management Association of the Caribbean (PMAC), fondée en 1998, est une plateforme collaborative dédiée aux ports de la région. Elle favorise le partage d'expérience, la formation et la représentation des intérêts portuaires au niveau multilatéral. Les ports des territoires français comme la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin y participent activement.
La Caribbean Tourism Organization (CTO), depuis 1989, rassemble les États caribéens et des acteurs privés autour du développement d'un tourisme durable, vecteur de croissance économique et sociale. La Martinique et Saint-Martin sont membres de cette organisation.
La Caribbean Public Health Agency (CARPHA), créée en 2011, regroupe les institutions régionales de santé publique pour coordonner la prévention et la gestion des urgences sanitaires afin de renforcer la solidarité dans la Caraïbe et l'efficacité que traduit la démarche « one health »4(*). Ouverte aux membres de la Caricom, elle accueille aussi d'autres territoires de la région en qualité de membres associés.
La Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) vise à renforcer l'union politique, économique et sociale de ses membres souverains, tout en limitant l'influence extérieure d'acteurs comme les États-Unis et le Canada. Les CFA n'y sont cependant pas éligibles en raison de leur statut institutionnel. Elle se conçoit comme une alternative à l'Organisation des États américains (OEA) perçue comme dominée par les États-Unis.
L'Alliance of Small Island States (AOSIS) est une coalition des petits États insulaires en développement qui joue un rôle important en tant que porte-voix des territoires vulnérables face aux enjeux climatiques. Les CFA n'y sont pas éligibles au regard de leur catégorie de développement.
Enfin, au sein de la zone caribéenne, comme l'indique Francis Étienne, ambassadeur de France à Castries de septembre 2022 à septembre 2025, il ne faut pas négliger d'autres structures qui oeuvrent bien au-delà de l'espace géographique caribéen, comme le groupement Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP) avec lequel commerce l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Accord de partenariat économique (APE), ou encore le cadre des Régions ultrapériphériques (RUP) qui relie des territoires fragmentés par leur appartenance commune à l'Union européenne.
L'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA)
Source : Evan Centanni
L'ALBA est une organisation internationale d'intégration régionale de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Son nom complet en espagnol est Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. L'idée est de raviver l'esprit de Simon Bolivar et de créer une Grande Nation en Amérique latine et dans Caraïbes.
Elle a été officiellement lancée le 14 décembre 2004 lors d'une déclaration conjointe entre les présidents Hugo Chávez (Venezuela) et Fidel Castro (Cuba) à La Havane.
Les membres sont Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua, la Dominique, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Grenade et Saint-Kitts-et-Nevis. ALBA compte aussi deux observateurs officiels (Haïti, Suriname).
L'ALBA-TCP (Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traités de Commerce des Peuples) reposerait sur la solidarité et la coopération entre les pays afin de favoriser le bien-être des peuples. Elle s'oppose au modèle néo-libéral et souhaite redonner une place centrale à la politique face à l'économie. Les Traités de commerce des peuples (TCP) sont des traités d'échange de biens et services entre les pays membres. La réciprocité et la solidarité sont censées permettre la mise en place d'échanges de technologie et de concessions d'avantages réciproques entre les États parties.
L'ALBA s'est dotée d'une monnaie virtuelle de référence, le SUCRE (Système unique de compensation régionale de paiements, en espagnol : Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), destinée à se substituer au dollar dans les échanges entre États bolivariens. Entrée en vigueur le 1e janvier 2010, le SUCRE a pour mission de renforcer le développement interne en faisant circuler les capitaux sur le continent latino-américain, de réduire les importations extérieures, de réduire la dépendance des États au dollar et de placer les échanges commerciaux à l'abri de la spéculation.
Une particularité structurelle de l'ALBA réside dans l'existence d'un Conseil des organisations sociales qui représente les mouvements sociaux et qui est doté du même statut que le Conseil des ministres.
Parmi d'autres projets, l'ALBA envisage de créer une compagnie pétrolière commune aux États d'Amérique latine, Petrosur, sur le modèle de PétroCaribe qui regroupe les États membres du Caricom.
Source : Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des États américains
S'agissant enfin de Saint-Pierre-et-Miquelon, il importe de mentionner l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO), bien que l'archipel n'y occupe pas de siège en son nom propre. Seule la France peut être directement représentée au sein de cette organisation intergouvernementale.
Source : DSOM
c) Synergies et complémentarités entre organisations régionales
Les organisations régionales de la Caraïbe ne fonctionnent pas en silo, mais entretiennent des liens étroits de complémentarité.
Complémentarité diplomatique tout d'abord.
La Caricom, pilier de la coopération caribéenne, trouve dans l'Association des États de la Caraïbe (AEC) qu'elle a contribué à créer sa propre extension. Cette dernière pallie certaines limites de la Caricom dans des contextes complexes. C'est le cas de la demande d'adhésion de la République dominicaine, ne recevant pas de réponse favorable à cause des tensions persistantes avec Haïti, déjà membre de la Caricom. En revanche, la République dominicaine a pu intégrer l'AEC, permettant une forme alternative de coopération régionale avec ce territoire sans déstabiliser la Caricom5(*).
Complémentarité institutionnelle ensuite.
L'OECO se soumet au champ d'application de certaines institutions rattachées à la Caricom, comme la Cour de justice caribéenne qui fait office d'autorité judiciaire suprême pour plusieurs États. D'autres structures et dispositifs qui émanent de la Caricom bénéficient également aux membres de l'OECO. Ainsi la CARPHA coordonne la santé publique régionale, tandis que le Caricom IMPACS assure la sécurité. L'OECO entretient plus généralement des relations solides avec la Caricom, l'AEC et la Banque de développement des Caraïbes (BDC), travaillant en collaboration pour offrir des biens publics régionaux essentiels.
Complémentarité technique également.
Sous l'impulsion du directeur général de l'OECO, Dr Didacus Jules, les équipes de l'OECO coopèrent étroitement avec les organes de la Caricom, comme le Conseil du commerce (COTED), le Conseil du développement social (COHSOD) et le Conseil des relations extérieures (COFCOR). Cette collaboration sert à garantir la cohérence des politiques régionales en évitant les redondances. Sur le plan commercial, l'OECO est également présente dans les groupes de travail de la Caricom destinés à l'agriculture, les services, la concurrence et les négociations internationales, afin d'assurer une mise en oeuvre coordonnée des différents traités régionaux. La commission de l'OECO siège enfin au conseil d'administration de l'Organisation du tourisme des Caraïbes (OTC) dans le but de contribuer au programme touristique régional.
Complémentarité financière enfin.
Sur le plan financier, la coopération entre l'OECO, la Banque de développement des Caraïbes (BDC), Compete Caribbean, Caribbean Export et le Fonds de développement de la Caricom, est décrite par le directeur général de l'OECO comme fructueuse. La BDC complète par ailleurs le rôle de la Banque centrale des Caraïbes orientales. Tandis que la première finance les infrastructures et le développement social, la seconde gère la stabilité monétaire.
4. L'OECO : un modèle d'intégration régionale
a) La Caraïbe orientale : noyau dur de la coopération régionale
La zone orientale de la Caraïbe joue un rôle central et structurant dans la coopération régionale. Elle s'appuie sur un chapelet d'îles anciennement sous domination britannique qui ont décidé de s'unir au sein de l'OECO. Qualifiée par l'ambassadeur de France auprès de l'OECO de 2016 à 2020, Philippe Ardanaz, d'« organisation régionale la plus intégrée au monde après l'Union européenne », l'OECO incarne une forme d'intégration à la fois économique et politique particulièrement aboutie.
L'OECO s'enracine historiquement dans une dynamique de décolonisation et de coopération qui remonte à l'initiative de la Fédération des Indes occidentales (1958-1962), à laquelle ont succédé les États associés des Indes occidentales (1967). Elle tire sa force dans la conviction des petites îles anglophones qu'elles doivent travailler ensemble pour gagner en résilience et en prospérité. Créée en 1981 avec la signature du traité de Basseterre, l'OECO regroupe sept États souverains : Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Leur proximité géographique, historique et linguistique leur permet de former jusqu'à ce jour le noyau dur de l'organisation, dont ils demeurent aussi les premiers bénéficiaires. L'OECO s'est ensuite progressivement élargie, tout en veillant à suivre une parfaite continuité territoriale. Des îles britanniques non souveraines comme les Îles Vierges britanniques (1984) et Anguilla (1995) ont d'abord rejoint l'organisation en tant que membres associés, et bien plus récemment elle s'est ouverte à l'espace francophone, en accueillant la Martinique (2015), la Guadeloupe (2019) et enfin Saint-Martin (mars 2025).
Bien plus qu'une plateforme diplomatique, l'OECO fonctionne comme un espace d'élaboration d'une stratégie régionale dont la démarche traduit une communauté de destins6(*). Celle-ci repose sur un ensemble de feuilles de route cohérentes : le Cadre des priorités stratégiques, le Plan triennal de travail et la Stratégie de développement 2020-2030. Ces documents balisent l'action commune et définissent des engagements dans des domaines tels que l'accélération de l'intégration, la réinvention des économies, le renforcement de la résilience, la valorisation de l'environnement et la promotion de l'équité et de l'inclusion, comme l'énonce le directeur général de l'OECO, Dr Didacus Jules. Grâce à cette programmation rigoureuse et aux moyens opérationnels qui l'accompagnent, des résultats quotidiens sont visibles pour les citoyens, comme l'accès à des médicaments moins coûteux et à une mobilité facilitée.
Le niveau d'opérationnalité de l'OECO lui confère un rôle moteur au sein de l'architecture des organisations régionales. L'OECO apporte son soutien technique à plusieurs organes de la Caricom et contribue à l'application coordonnée des traités des différentes organisations. Réciproquement, elle garantit la prise en compte des intérêts de la Caraïbe orientale dans les institutions où elle contribue, par exemple, en siégeant au conseil d'administration de la OTC. Preuve encore de leur crédibilité à échelle internationale, l'OECO est un partenaire privilégié dans la mise en oeuvre de projets financés par l'Union européenne auprès des CFA qui font alors office d'autorité de gestion.
b) Vers une organisation supranationale
Dès 1983, les États membres anglophones de l'OECO se sont dotés d'une monnaie commune, le dollar des Caraïbes orientales, émise par la Banque centrale des Caraïbes orientales (BCEA). Localisée à Saint-Kitts-et-Nevis, cette dernière constitue la première banque centrale régionale au monde, ayant alors servi en partie de modèle à la Banque centrale européenne. L'union monétaire a joué un rôle de stabilisateur macro-économique, notamment en période de crise.
La révision du traité de Basseterre en 2010 marque ensuite une nouvelle étape en établissant l'union économique. Celle-ci consacre la libre circulation des personnes entre les États membres du Protocole7(*). Tout citoyen peut désormais s'établir, travailler et résider dans le territoire de son choix, muni de sa seule pièce d'identité. Une législation complémentaire est en cours d'élaboration pour faciliter l'accès des familles aux services sociaux, garantissant ainsi un exercice harmonisé des droits dans l'ensemble de l'espace OECO. Toutefois, l'effectivité de la libre circulation repose aussi sur l'amélioration de la connectivité entre les îles. Par conséquent, l'OECO compte parmi ses priorités le développement de liaisons maritimes régionales.
Depuis 2025, l'organisation a engagé la mise en place d'une union douanière, visant la libre circulation des biens. L'Assemblée de l'OECO a ainsi récemment adopté un ensemble de textes relatifs à la sécurité sanitaire, aux normes techniques, aux douanes et à la protection des végétaux, en juin 2025. Ces textes doivent ensuite être soumis à l'Autorité de l'OECO puis transposés par les législations nationales. Le marché commun vise à tenir compte des normes françaises et européennes, ce qui garantirait son accès aux CFA, et permettrait également aux États membres du Protocole de l'OECO d'exporter vers l'espace européen.
Les organes décisionnels principaux de l'OECO
Les membres fondateurs de l'OECO ou membres du Protocole (Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) siègent à la plus haute instance décisionnelle de l'OECO, l'Autorité, qui se compose de leurs chefs de Gouvernement. Ils peuvent également adopter des décisions juridiquement contraignantes, preuve supplémentaire du caractère supranational de l'organisation.
S'agissant des CFA (Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin) qui ont acquis la qualité de membres associés, ils sont dépourvus de pouvoir de décision au sein de l'Autorité. Ils sont néanmoins représentés à l'Assemblée, autre organe de l'OECO qui se charge de débattre autour des priorités de l'organisation. Les États associés y disposent chacun de trois sièges (contre cinq sièges pour les États membres du Protocole).
Loin de se limiter à l'économie, le caractère supranational s'incarne aussi dans des institutions communes qui interviennent dans la vie quotidienne des citoyens. Sur le plan judiciaire, la Cour suprême des Caraïbes orientales est l'instance judiciaire supérieure commune aux États fondateurs de l'OECO. L'Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales (ECCAA) veille au respect des normes de sécurité aérienne. Le Service commun d'approvisionnement pharmaceutique (PPS) permet de mutualiser les achats de médicaments et de réduire leur coût. Dans le domaine sécuritaire, plusieurs membres participent enfin au Système de sécurité régionale (RSS), mécanisme de réponse aux menaces criminelles ou aux catastrophes naturelles.
c) Un laboratoire de coopération fonctionnelle entre l'Union européenne, les CFA et leurs voisins caribéens
L'OECO offre un espace de coopération fonctionnelle et privilégié où l'Union européenne, les CFA et les États indépendants de la Caraïbe orientale s'associent dans des projets concrets et à forte valeur ajoutée, en particulier dans les domaines de l'environnement et de la santé.
Si l'OECO est principalement financée par les contributions de ses États membres, elle bénéficie aussi de partenariats de développement avec des bailleurs tels que la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD). L'OECO prend part également aux programmes Interreg, pilotés par les Régions ultrapériphériques dans le bassin Atlantique, notamment la Guadeloupe et la Martinique qui jouent ainsi un rôle de pont entre l'Europe et leurs voisins caribéens. À ce titre, les CFA remplissent bien davantage qu'un simple rôle d'intermédiaire, mais forment un maillon incontournable, voire incarnent un catalyseur de l'action régionale. En mobilisant leur expertise, leurs réseaux de recherche et leurs capacités de gestion, ils permettent d'attirer les financements européens dans des projets qui rejoignent les intérêts des États de l'OECO, qui apporte réciproquement son savoir-faire en termes de coordination entre les territoires, notamment à travers la circulation des compétences techniques.
Le programme REMAR (Resilient Ecosystems through Mangrove Restoration) incarne cette dynamique. Financé à hauteur de 5,5 millions d'euros par l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), il vise à restaurer les mangroves sur six sites pilotes à travers les Caraïbes orientales. Au-delà de ses objectifs écologiques que sont la lutte contre l'érosion, le stockage du carbone et la protection de la biodiversité, le programme REMAR permet la mutualisation des bonnes pratiques et des expertises entre les CFA (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin) et les États indépendants. Ce projet, par définition ancré dans une temporalité longue, illustre la capacité de l'OECO à s'inscrire durablement dans des feuilles de route partagées à échelle internationale, la mangrove étant un puits de carbone précieux pour l'ensemble de la planète.
Le projet SARGCOOP, cette fois tourné vers la lutte contre l'échouage massif des sargasses, s'inscrit dans une même logique. Piloté par la Guadeloupe, il a permis de fédérer plusieurs États membres autour d'une stratégie intégrée de gestion de crise. Sa seconde phase, SARGCOOP 2, poursuit cette coopération à travers un financement de plus de 4 millions d'euros et une structuration autour de trois axes qu'annonce le directeur général de l'OECO : un centre régional dédié à la centralisation des connaissances, une stratégie de plaidoyer international et une évaluation des impacts sanitaires et économiques.
Plusieurs de ces projets sont donc rendus possibles grâce à la position stratégique et à l'implication des Régions ultrapériphériques françaises dans le bassin Atlantique. En agissant comme autorités de gestion de programmes européens, elles peuvent aussi affirmer leur leadership sur des enjeux techniques tout en approfondissant leur ancrage régional.
5. Le plateau des Guyanes en pleine transformation
Le plateau des Guyanes est en train de connaître des bouleversements économiques majeurs du fait de la découverte et de l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures.
Le Guyana est désormais présenté comme le nouveau Qatar de la région. Des gisements de plus de 5 milliards de barils y ont été découverts, qui pourraient faire de cet État, aujourd'hui l'un des plus pauvres d'Amérique du Sud, le cinquième producteur mondial de brut dès 2025. Ces réserves gigantesques ont réveillé la convoitise du Venezuela sur la région de l'Essequibo où se situent les principaux gisements. Caracas n'a en effet jamais accepté le rattachement de cette région au Guyana8(*). Ce conflit dure depuis le XIXe siècle.
S.E. M. Ryan Nawin Nannan, ambassadeur du Suriname en France de février 2024 à avril 2025, a cité les prévisions de la banque Lazard : le PIB du Suriname augmenterait de 2 à 3 % en 2026-2027, puis 28 % en 2028, 20 % en 2029 et 2030. Le français TotalEnergies est un acteur de ces projets, en particulier au Suriname avec l'annonce le 1er octobre 2024 d'un projet d'investissement de 13 milliards de dollars.
Au Brésil, l'exploitation pétrolière va aussi démarrer au large d'Oiapoque, à la frontière avec le Guyana. Une très forte croissance démographique et économique de la région d'Oiapoque est annoncée, laquelle est aujourd'hui l'une des plus pauvres du Brésil.
Ces perspectives et nouvelles réalités vont transformer le plateau des Guyanes en pôle de richesse et de développement, tiré par l'exploitation des hydrocarbures.
Il est encore trop tôt pour savoir si la manne pétrolière se traduira par un développement économique bénéficiant à l'ensemble des populations. Mais il est certain que pour la Guyane, à défaut de détenir des gisements exploitables dans ses eaux, des opportunités économiques majeures seront à saisir. Déjà dans l'État de l'Amapa, la fin de l'aménagement de la route reliant la Guyane à la capitale Macapa est une conséquence directe de ce boom économique attendu. De meilleures infrastructures côté brésilien devraient faciliter les échanges avec la Guyane.
À terme, un rééquilibrage, voire un renversement des niveaux de vie, est envisageable. La Guyane a aujourd'hui le PIB par habitant le plus élevé. Demain, si les taux de croissance annoncés sont confirmés, cette hiérarchie sera bouleversée avec des conséquences sur les mouvements de population. Terre d'immigration, la Guyane pourrait perdre une partie de ses habitants attirés par les eldorados voisins.
6. L'inquiétude face à la crise en Haïti et ses effets de bord
Depuis l'assassinat le 7 juillet 2021 du dernier président haïtien élu, la crise de violence a été poussée à son paroxysme en accélérant l'effondrement des institutions et la mise en coupe réglée de Port-au-Prince et de sa région par des gangs.
Depuis 2021, les autorités de transition se sont succédé en cascade, échouant à rétablir la sécurité, afin de créer les conditions de l'organisation d'élections. Pour rappel, le dernier scrutin remonte à 2016.
La prochaine échéance est fixée au 7 février 2026 - date de fin du conseil présidentiel de transition. L'objectif est de soumettre avant cette échéance à référendum une nouvelle Constitution - en cours d'élaboration par un comité - et d'organiser des élections générales.
Toutefois, ce calendrier est intenable en l'absence de retour à l'ordre pour des élections libres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de faire intervenir une force multinationale, tandis que le Gouvernement s'efforce de renforcer les capacités opérationnelles de la police haïtienne et de l'armée.
Malheureusement, en dépit du déploiement de soldats de la force multinationale, qui compte près d'un millier de soldats et policiers, les zones contrôlées par les gangs se sont étendues.
Face à cette impasse tragique, la coopération régionale et la diplomatie internationale peinent à peser d'une façon quelconque.
Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a rappelé que la France reste l'un des seuls États membres de l'Union européenne à maintenir une présence diplomatique à Port-au-Prince.
La coopération avec la France a une forte dimension sécuritaire. Des formateurs du Raid interviennent auprès d'une unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. La France a aussi récemment fait don d'équipements à la police nationale d'Haïti. La coopération s'ouvre aussi au domaine de la défense. Les forces armées aux Antilles (FAA) ont accueilli, à deux reprises, un contingent de vingt-cinq soldats haïtiens en formation en Martinique.
Par ailleurs, il existe un réseau culturel français très important en Haïti, qui s'appuie notamment sur l'Institut français de Port-au-Prince, sur les alliances françaises établies dans cinq villes - Jacmel, Jérémie, Les Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien.
Toutefois, hormis en matière sécuritaire, toutes les coopérations ont été suspendues, y compris avec les collectivités ultramarines.
S.E. M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France, a demandé que la France prenne l'initiative d'une Conférence internationale sur Haïti. Il a aussi plaidé pour une coopération militaire et policière d'une toute autre ampleur : « il nous faut du concret avant tout, à savoir comment passer, par exemple, de 1 500 à 5 000 soldats opérationnels en trois ou cinq ans ».
Cette crise sans fin et insaisissable n'est pas sans conséquence sur les outre-mer de la région.
En Guyane, où une communauté haïtienne est installée depuis longtemps, mais encore souvent sans titre de séjour régulier, la crise et la dégradation tragique des conditions de sécurité a conduit l'OFPRA à accorder le droit d'asile aux ressortissants haïtiens. La reconnaissance du statut de réfugié est quasi-systématique9(*). Cette révision bénéficie aussi bien aux Haïtiens présents en Guyane depuis plusieurs années - plus de 17 000 personnes ont régularisé ainsi leur situation - qu'à ceux fuyant la crise et récemment arrivés.
Des filières d'immigration irrégulière depuis Haïti via le Suriname ont été stoppées en 2024. Elles profitaient d'un pont aérien entre Port-au-Prince et Paramaribo avec la complicité probable de certaines autorités surinamiennes. Une intervention politique ferme de la France a permis d'y mettre fin. Le Suriname a rétabli l'obligation de visa pour les ressortissants d'Haïti. Quelques centaines d'Haïtiens en auraient bénéficié.
Pour autant, le flux ne s'est pas tari et la Guyane reste perçue comme une porte d'entrée vers l'Europe.
Aux réfugiés haïtiens, s'ajoutent en effet de nombreux demandeurs en provenance du Proche-Orient, du Maghreb ou d'Afghanistan qui arrivent par le Brésil. Les services de l'État sont débordés. En 2024, le nombre de demandeurs a atteint 21 000, contre 6 900 en 2023, dont une majorité de ressortissants haïtiens et quelque 2 500 d'autres nationalités.
En Martinique, à Saint-Martin et en Guadeloupe, une diaspora haïtienne importante est aussi présente depuis longtemps. Mais les conséquences de la crise haïtienne y sont plus limitées. Une vigilance reste néanmoins nécessaire, tant les perspectives de résolution de cette crise demeurent incertaines.
Le retour à une situation de sécurité à peu près sous contrôle est dans toutes les hypothèses le prérequis à toute forme de coopération régionale. En revanche, dès que cela sera le cas, la France et ses territoires ultramarins devront réactiver rapidement les partenariats dormants.
B. UNE COOPÉRATION RÉGIONALE QUI PROGRESSE : L'ESQUISSE D'UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE ?
1. Un réseau diplomatique renforcé
La France a incontestablement musclé son dispositif diplomatique dans la région au cours des dernières années, à rebours de la tendance négative ailleurs.
À la suite du Ciom de juillet 2023, la nomination d'un conseiller diplomatique respectivement auprès des préfets de la Guadeloupe et de la Martinique a été effective dès fin 2023-début 2024.
L'ambassade auprès de Sainte-Lucie a par ailleurs été renforcée, en particulier avec l'affectation d'un attaché de sécurité intérieure et la création d'un poste de magistrat de liaison. Ce dernier a été pourvu il y a un an par Emmanuelle Doffe.
Au Guyana, comme l'a relevé Nathalie Estival-Broadhurst, « la décision de la France d'ouvrir à la rentrée une ambassade s'explique par des enjeux stratégiques, tant en Amazonie que sur le plateau des Guyanes, et par les perspectives économiques liées à la récente découverte de gisements pétroliers. Nos relations avec cette région reposent aujourd'hui sur un socle de consultations politiques régulières ». La création de ce poste diplomatique coïncide aussi avec l'adhésion de la Martinique à la Caricom laquelle a son siège à Georgetown (Guyana).
Pour autant, elle souligne que « le réseau diplomatique et culturel français, bien que dynamique, reste relativement peu dense. Certaines ambassades, comme celle de Castries à Sainte-Lucie, couvrent jusqu'à huit pays. D'autres ne sont représentées que par des postes de présence diplomatique, à l'instar de Trinité-et-Tobago ou de la Jamaïque. ».
Le réseau des ambassades françaises
dans la région Caraïbe
et le plateau des Guyanes
La France est représentée dans le bassin océan Atlantique - Caraïbe et plateau des Guyanes - par onze ambassades : au Brésil, à Cuba, en Haïti, en Jamaïque, au Panama (compétente pour les Bahamas), en République dominicaine, au Suriname, à Trinité-et-Tobago, au Venezuela, à Sainte-Lucie (pour les États membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), le secrétariat de l'OECO et La Barbade) et, depuis le 1er septembre 2025, au Guyana.
Trois ambassades sont spécifiquement en charge des relations avec les organisations régionales de la Caraïbe : l'ambassade de France à Sainte-Lucie pour l'OECO, l'ambassade de France à Trinité-et-Tobago pour l'Association des États de la Caraïbe (AEC) et l'ambassade de France au Guyana pour la Caricom.
À Sainte-Lucie, l'ambassade de France, en résidence à Castries, est accréditée auprès des six États anglophones de la Caraïbe orientale : Antigua-et-Barbuda (depuis 1982), Commonwealth de Dominique (depuis 1979), Grenade (depuis 1975), Saint-Christophe-et-Nievès (depuis 1984), Sainte-Lucie (depuis 1979) et Saint-Vincent-et-les-Grenadines (depuis 1982). Depuis 2014, elle est également accréditée auprès de la Barbade. Elle a également compétence consulaire pour les territoires britanniques d'outre-mer Tortola, Anguilla et Montserrat. En outre, elle est en charge des relations diplomatiques de la France avec le secrétariat de l'OECO.
Outre le suivi de l'actualité politique et économique et de la politique extérieure des États membres de l'OECO et de la Barbade, l'appui aux ressortissants français et européens dans cette zone et la préparation des négociations officielles de la France avec les autorités de ces territoires, l'ambassade de France en résidence à Castries est également chargée de « poursuivre l'insertion harmonieuse de la Guadeloupe et de la Martinique dans leur environnement régional ». Elle a en outre pour mission le renforcement de la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, en lien avec les ambassades des autres États membres dans la région et avec la délégation de l'Union européenne pour la Barbade, les États de la Caraïbe orientale, l'OECO et la Caricom.
L'ambassade de France à Trinité et Tobago est en charge des relations avec l'Association des États de la Caraïbe (AEC) dont le siège est à Port d'Espagne.
Annoncée en mars 2024 par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à l'occasion de la première visite d'un ministre français des Affaires étrangères au Guyana, l'ouverture d'une ambassade de France à Georgetown est intervenue au 1er septembre 2025. Outre la représentation de la France au Guyana, cette nouvelle ambassade est également en charge des relations avec la Caricom, missions auparavant assurées par l'ambassade de France au Suriname.
L'ouverture de cette nouvelle ambassade répond à la volonté de la France de renforcer sa coopération avec les deux pays grâce à deux ambassades distinctes et plus généralement, d'accroître sa présence dans la région du plateau des Guyanes.
Certains services de l'ambassade de France au Suriname - tels que ceux en charge des visas, du suivi des questions de défense, de coopération policière et de sécurité régionale - conservent néanmoins la compétence pour les deux pays.
Source : DSOM
2. L'intégration croissante des collectivités françaises dans les organisations régionales
a) Un besoin naturel et nécessaire
L'intégration des outre-mer français dans leur environnement régional ne relève pas seulement d'une option stratégique ou d'une émancipation statutaire, elle découle avant tout d'un besoin naturel, lié à leur géographie, leur histoire, leur identité et leurs vulnérabilités contemporaines communes, se traduisant par une communauté de destins10(*). Par conséquent, la coopération transfrontalière, en Guyane comme dans les Antilles, n'est pas une construction artificielle, mais une réalité ancienne11(*), qui s'est toujours mise oeuvre y compris à travers des rapports informels. Elle se révèle enracinée dans les pratiques des acteurs locaux et le quotidien de populations qui sont reliées par la culture créole.
L'exposition accrue au changement climatique et à l'érosion côtière, la gestion des risques cycloniques, la lutte contre les épidémies, la protection de la biodiversité, les effets des crises migratoires ou encore le trafic d'armes et de drogues sont autant de défis communs que les CFA partagent avec leur voisinage. Comme l'avait souligné Antonio Guterres, ancien secrétaire général de l'ONU, la Caraïbe est à l'avant-poste de l'urgence climatique mondiale, de même que Saint-Pierre-et-Miquelon dont le recul du trait de côté conduit à envisager le déplacement complet et ambitieux du village de Miquelon. La gestion spontanée de certaines catastrophes communes et chocs exogènes ont pu créer des précédents utiles. Le passage de l'ouragan Maria tout comme les dégâts causés par Irma à Saint-Martin ont montré la capacité des territoires à mettre en réseau leurs infrastructures, leurs expertises et leurs moyens. Mais cette logique de mobilisation ponctuelle tend à laisser place à une stratégie plus durable et formalisée de coopération.
Cette « géopolitique de la survie », d'après l'expression de Laurent Giacobbi, transforme ainsi profondément les priorités diplomatiques des États et territoires de la région. Elle impose de sortir d'une vision néocoloniale des relations extérieures pour construire, à l'échelle des bassins, des politiques de proximité fondées sur la réciprocité et la solidarité qui garantissent plus de résilience. Les collectivités ultramarines, bien qu'attachées à leur statut français et européen, ne peuvent rester en dehors des dynamiques régionales qui se renforcent autour d'elles.
Pourtant, les chiffres témoignent d'un décalage persistant. En 2020, la Martinique ne voyait que 4,4 % de ses importations et 2,5 % de ses exportations se réaliser avec la zone Amérique-Caraïbes d'après le rapport du Ciom 2023. La Guyane, quant à elle, échangeait moins de 1 % de ses flux avec le Brésil et le Suriname. Ce paradoxe traduit le maintien d'une dépendance presque exclusive à l'ancienne métropole, là où la proximité géographique devrait inciter au développement de circuits courts, plus efficaces et plus résilients. Le cas de la Guyane, contrainte de s'approvisionner en pétrole de la mer du Nord via la SARA en dépit de la proximité du Venezuela et demain du Guyana, du Suriname et de l'Amapa, illustre l'absurdité d'un système qui ignore encore trop souvent les réalités régionales. À l'heure où les ambitions d'une plus grande autonomie alimentaire apparaissent parmi les priorités de la zone, elles se heurtent à un « enfermement logistique » (Anthony Farisano, Cirad) qu'il convient à la coopération régionale de conjurer.
b) Les leviers juridiques : une combinaison des prérogatives de l'État et des collectivités
La coopération régionale repose sur un équilibre institutionnel, où les compétences de l'État et des collectivités territoriales s'imbriquent dans un cadre juridique désormais bien défini. D'un côté, les relations diplomatiques demeurent du monopole régalien de l'État, via ses représentations ministérielles ou ses relais préfectoraux. De l'autre, les collectivités ultramarines disposent depuis plusieurs années d'outils juridiques leur permettant d'exercer une action extérieure dans le respect des engagements internationaux de la France.
Comme le relate le rapport du CESECE de Guyane d'octobre 2024, le mouvement s'est structuré dès les années 1980 avec la reconnaissance de la capacité des entités infra-étatiques à tisser des relations au-delà des frontières nationales. Cette dynamique s'est traduite dans le droit français à travers plusieurs textes majeurs. La loi de décentralisation de 1982, puis surtout la loi du 6 février 1992, autorisent les collectivités à signer des conventions avec des partenaires étrangers dans leur champ de compétences. Ce cadre a été consolidé des échanges très formalisés par la loi d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 puis renforcé par la loi du 5 décembre 2016, dite « loi Letchimy », laquelle constitue aujourd'hui la pierre angulaire de l'action extérieure des territoires relevant de l'article 73 de la Constitution (voir le volet 1 de la présente étude12(*)).
Toutefois, les disparités constitutionnelles entre territoires ultramarins limitent l'application uniforme de ce dispositif. Les régions relevant de l'article 74, comme Saint-Martin, bénéficient d'une autonomie certes plus poussée, mais aussi encadrée par une loi organique, qui en réalité restreint ses marges de manoeuvre. Ainsi, les conventions conclues avec la partie néerlandaise siamoise de l'île ne s'inscrivent pas encore dans un cadre légal national cohérent, alors que l'île pourrait faire office de laboratoire en matière de coopération transfrontalière et plus largement de coopération décentralisée, ce que réclame le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin, Louis Mussington. Ce paradoxe législatif révèle l'importance d'un traitement juridique prenant mieux en compte la diversité statutaire, non seulement pour distribuer de nouvelles prérogatives, mais aussi pour formaliser des pratiques déjà en vigueur qui s'opèrent naturellement entre des territoires voisins.
La montée en puissance des collectivités dans la sphère régionale ne se fait donc pas en opposition à l'État, mais dans une logique de complémentarité. L'État accompagne cette dynamique, notamment par la désignation de conseillers diplomatiques auprès des préfets et l'intégration de représentants des collectivités dans certaines ambassades, comme c'est le cas pour la Martinique à Castries ou la Guyane au Suriname. Saint-Martin devrait nommer prochainement un agent auprès de l'OECO. Parallèlement, l'État reste garant de la légalité des actes de coopération conclus par les collectivités, via le contrôle préfectoral.
c) La levée d'une réticence anticoloniale envers la France et l'Europe
Les réserves des organisations régionales envers l'intégration des CFA connaissent depuis quelques années un infléchissement notable13(*). Ces territoires renvoyaient à l'histoire coloniale de la France, en plus d'appartenir au régime communautaire européen. Or, à la différence du bassin Indien, les territoires ultramarins de l'Atlantique font désormais peu l'objet de contestation de la part de leurs voisins, à la faveur de la reconfiguration géopolitique de la zone où la France et l'Europe peuvent incarner des partenaires stables contrairement aux États-Unis. Dans ce contexte, les liens entre les CFA et leur environnement géographique s'approfondissent de sorte à être les vecteurs d'une coopération « internalisée »14(*) avec l'Europe pour les organisations régionales, en plus de représenter pour les CFA des leviers d'autonomie.
Le processus d'adhésion de la Martinique à la Caricom illustre cette évolution. Initiée dès 2012, sa candidature avait soulevé de vives réticences : son absence de souveraineté, son appartenance à l'espace économique européen et son statut francophone venaient s'opposer à une communauté historiquement anglophone et tributaire du processus de décolonisation. Mais d'après Nathalie Estival-Broadhurst, un changement de doctrine s'est amorcé à partir de 2021, avec la nomination de Carla Barnett à la tête de la Caricom. Cette inflexion a permis d'envisager l'adhésion de collectivités non souveraines et francophones, à condition qu'elles s'impliquent dans des projets concrets et respectent les règles communes. Ainsi, la Martinique a pu signer son accord d'adhésion en tant que membre associé en février 2025, une avancée historique soulignée par le ministre Thani Mohamed Soilihi15(*).
Particulièrement à l'OECO, le partenariat avec les CFA est perçu comme une opportunité. Le directeur général, Dr Didacus Jules, désigne l'Union européenne comme « le partenaire de développement le plus durable » pour l'espace caribéen. Les territoires français y sont vus comme des vecteurs de montée en compétence, apportant de l'expertise technique, ouvrant la voie à un rehaussement des normes et donnant accès à des financements internationaux. Leur intégration est perçue non pas comme un « cheval de Troie » de la France ou de l'Europe, mais comme un levier de renforcement des capacités régionales.
d) Une intégration en progrès et différenciée
L'intégration des CFA dans les organisations régionales caribéennes se caractérise par une progression nette ces dix à quinze dernières années tout en restant marquée par des rythmes différenciés.
Appartenance des territoires d'outre-mer du bassin Atlantique aux principales organisations et associations régionales (2025)
Source : DSOM
La Martinique, pionnière en la matière dès 2012, avait engagé son processus d'adhésion dans la Caricom, plateforme emblématique dans la région. Encadrée par la loi de 2000 qui autorise les collectivités ultramarines à signer certains accords internationaux, cette démarche a vu sa légitimité augmenter par la « loi Letchimy » en 2016 et les orientations prises par le Ciom 2023. L'adhésion de la Martinique en tant que membre associé à la Caricom est aujourd'hui proche d'être entérinée, avec la ratification de la convention sur les privilèges et immunités par le Parlement français prévue pour début 2026.
La Guyane, forte de l'expérience martiniquaise, ambitionne à son tour d'accélérer son intégration avec le soutien de l'État et en coopération étroite avec ses partenaires régionaux. La préparation de la Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane qui en est à sa 18e édition, programmée en décembre 2025, s'inscrit également dans cette volonté de consolider des priorités communes. Celles mises à l'honneur cette année seront les échanges commerciaux et linguistiques et les modes de coopération transfrontalière sur le plateau des Guyanes.
À l'inverse, la Guadeloupe adopte une posture plus prudente, questionnant les bénéfices réels d'une adhésion à la Caricom, préférant s'impliquer voire faire preuve de leadership dans d'autres coopérations régionales. Dans la gestion du fléau des sargasses, elle assume actuellement la présidence du Comité de gestion de la biodiversité et des écosystèmes (BEMC) au sein de l'OECO. L'implication des territoires français dans l'OECO est d'ailleurs exemplaire : la Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin participent activement à ses projets, financent directement l'organisation et contribuent à des initiatives stratégiques telles que la restauration des mangroves et la transition énergétique.
Saint-Martin, île à la situation singulière car partagée entre la France et les Pays-Bas, joue un rôle croissant dans la coopération régionale. Devenue membre associé de l'OECO en mars 2025, elle a aussi accueilli la 17e Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane (CCRAG).
L'ensemble de ces territoires, auxquels s'ajoute Saint-Barthélemy, font enfin tous partie de l'AEC qui, par la souplesse de sa procédure d'intégration, vient assoir plus librement la place naturelle des CFA dans leur espace géographique.
3. Le coup d'accélérateur de la coopération militaire, policière et judiciaire
Nécessité fait souvent loi. La montée des enjeux multiples de sécurité dans la région (orpaillage illégal, pêche illicite, narcotrafics, trafics d'armes, phénomène des gangs, immigration irrégulière...) a poussé à avancer vite ces dernières années pour « combler les trous ». Les réseaux criminels de plus en plus structurés se jouent de la fragmentation politique et juridique de la Caraïbe pour passer entre les mailles des filets que chaque territoire met en oeuvre.
Au niveau militaire, la loi de programmation militaire en cours consolide les moyens des forces de souveraineté outre-mer. Les Forces armées aux Antilles et les Forces armées en Guyane (FAG) remontent en capacité après des années d'attrition. Elle permet d'asseoir la crédibilité française dans la région et d'attirer les demandes de coopération des forces armées étrangères. L'attaché de défense pour la Caraïbe réside en Martinique auprès des Forces armées aux Antilles et est compétent pour la zone régionale. Pour ce qui concerne le plateau des Guyanes, la France dispose d'attachés de défense au Brésil et au Suriname.
Sur le plateau des Guyanes, une coopération militaire se tisse, en particulier avec le Suriname, le Guyana, la Colombie et le Brésil. La France forme des militaires surinamais. Ce dialogue stratégique grandit en dépit des contestations qui peuvent subsister sur le tracé exact des frontières. Il est important dans un contexte de transformation économique profonde du plateau avec l'exploitation pétrolière.
En matière de coopération contre les narcotrafics et les trafics en mer, le contre-amiral Nicolas Lambropoulos auditionné dans le cadre du rapport sur l'action de l'État outre-mer16(*) avait souligné la coopération étroite des nombreuses forces de sécurité dans la région, en particulier pour l'échange de renseignements. Aux États-Unis, le Joint InterAgency Task Force-South (JIATF-S), basée à Key West en Floride, est une sorte de centre inter-agences. Il réunit quinze pays et toutes les agences qui, de près ou de loin, luttent contre la criminalité, le crime organisé, le narcotrafic, et essaient de coordonner les moyens des différents pays (République dominicaine, Colombie, France, Pays-Bas, etc.). C'est une organisation militaire, qui travaille sous les ordres du commandement militaire américain pour le Sud. La France y dispose d'un officier de liaison et la JIATF-S. La France travaille aussi étroitement avec les forces des Pays-Bas basées à Curaçao, en première ligne face aux go-fast qui partent des côtes du Venezuela.
S'agissant de la coopération policière, elle monte aussi en puissance avec des avancées décisives.
Les ambassades de France au Brésil, à Cuba, en Haïti (avec une antenne à l'ambassade de France en République dominicaine), à Sainte-Lucie, au Suriname et au Venezuela disposent chacune d'un attaché de sécurité intérieure. Le poste d'attaché de sécurité intérieure à Sainte-Lucie, compétent pour la Caraïbe orientale, a été créé en 2024, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le narcotrafic.
Un exemple de ces progrès est le récent accord quasi historique dans la Caraïbe conclu le 30 septembre dernier lors du 9e comité de sécurité mixte entre la France et Sainte-Lucie. Cet accord doit permettre aux forces de l'ordre de contrôler dans les eaux territoriales des îles respectives. Ce droit de poursuite en mer est une novation essentielle.
Les autorités des deux îles se sont aussi entendues pour renforcer l'échange de renseignements, renforcer la coopération judiciaire et veiller au respect des accords bilatéraux en matière de libre circulation des personnes, notamment pour les patients sainte-luciens qui viennent se soigner en Martinique.
Cet accord conclu lors de ce 9e comité s'ajoute à d'autres avancées obtenues ces dernières années :
- l'installation d'un attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de Sainte-Lucie, ainsi que d'un magistrat de liaison ;
- des échanges et formations des forces de police et de gendarmerie martiniquaises et sainte-luciennes.
De manière générale, la dynamique bilatérale avec Sainte-Lucie est très porteuse. Ce « momentum » très porteur, pour reprendre le mot du préfet Etienne Desplanques, doit être entretenu et amplifié avec ce partenaire essentiel dans la région.
Avec la Dominique, une commission mixte de sécurité sur le modèle de Sainte-Lucie devrait être installée prochainement.
Sur le plateau des Guyanes, un centre de coopération policière (CCP) à la frontière avec le Brésil est opérationnel depuis 2010 à Saint-Georges de l'Oyapock. Le capitaine Flavien Besnehard, responsable du CCP, a indiqué à la délégation que l'activité du CCP était en hausse permanente.
Le CCP de Saint-Georges-de-l'Oyapock
Le CCP compte 6 agents : 3 gendarmes, 1 policier national et 2 agents fédéraux brésiliens. Le travail se fait en portugais. Les échanges sont réguliers avec la police fédérale, la police fédérale routière et la police de l'Amapa.
Le CCP permet la consultation rapide des fichiers des personnes recherchées respectifs (environ 1 400 consultations de fichiers par an).
De nombreuses demandes concernent aussi le suivi de la population pénitentiaire, de nombreux Brésiliens étant incarcérés en Guyane. L'identification des gangs brésiliens est une des priorités des forces de sécurité en Guyane. On estime à 280 le nombre de Brésiliens en Guyane (libres ou en prison) appartenant à des factions. La menace de ces factions est un sujet de préoccupation majeure. L'identification rapide de ces individus doit permettre de les interpeler et de les expulser ou extrader le plus rapidement possible pour éviter toute forme d'enracinement dans la société guyanaise.
Le CCP est aussi consulté pour avis avant la délivrance des cartes de circulation transfrontalière, qui permet aux habitants des rives de l'Oyapock de circuler librement sans visa entre les deux pays. Il permet de vérifier les antécédents des demandeurs.
Source : DSOM
Des discussions sont en cours pour élargir le mandat du CCP à la coopération avec le Suriname.
Néanmoins, l'absence de CCP n'empêche pas le développement d'une coopération fructueuse entre la police française et leurs homologues surinamais. L'accord de coopération policière, signé le 29 juin 2006 et ratifié par la France, a été ratifié par le Suriname en octobre 2017, notamment grâce à l'intervention active de l'ambassadeur de France au Suriname et au Guyana. Cet accord a fait l'objet de protocoles d'application entre la gendarmerie et les forces de sécurité surinamaises (KPS). Mais le vrai changement d'attitude est observé depuis trois ans. Pour le colonel Thierry Crampé, un délinquant ne peut plus se réfugier au Suriname en toute quiétude. Depuis l'été 2024, 11 personnes recherchées ont été remises à la police aux frontières à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Maripasoula. Par ailleurs, pour la première fois, une commission rogatoire internationale a été acceptée par le Suriname. Des patrouilles miroirs le long du fleuve sont aussi organisées.
Enfin, complément indissociable, la coopération judiciaire commence à rattraper le retard par rapport aux avancées de la coopération policière.
Il existe dans la zone régionale deux postes de magistrats de liaison : l'un à l'ambassade de France au Brésil (pour le Brésil, le Guyana et le Suriname) ; l'autre à l'ambassade de France à Sainte-Lucie, poste créé en 2024 dans le cadre du renforcement de la lutte contre le narcotrafic, comme évoqué supra.
L'arsenal conventionnel, pauvre dans la région, commence à s'étoffer. Avec Sainte-Lucie, des accords de coopération, d'entraide judiciaire et d'extradition avec remise de personnes recherchées ont été signés en 2018. En pratique, ces accords n'avaient toutefois pas été mis en oeuvre avec seulement deux extraditions de 2018 à 2024. L'installation d'un magistrat de liaison en 2024, et la construction patiente d'un réseau de contacts opérationnels devraient porter leurs fruits. En 2025, 4 extraditions ont déjà eu lieu et 4 devraient suivre avant la fin de l'année.
L'identification des personnes ressources et la consolidation d'un réseau judiciaire sont une clef essentielle. À la Dominique, des interlocuteurs sont enfin identifiés. Pour Emmanuelle Doffe, magistrate de liaison à Sainte-Lucie, ce travail doit se faire aussi avec discernement pour identifier des responsables fiables, certains micro-États étant plus vulnérables à la corruption.
Du côté du plateau des Guyanes, un accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname a été signé en 2021 et devrait être définitivement ratifié dans les prochaines semaines (voir infra). Il représente une avancée significative dans la coopération bilatérale. Ce texte établit un cadre juridique complet et adapté aux réalités du terrain :
- un champ d'application large, couvrant l'ensemble des infractions pénales punies d'au moins un an d'emprisonnement selon les législations des deux États. Cette disposition permet d'englober les infractions environnementales liées à l'orpaillage illégal ;
- la possibilité de créer des équipes communes d'enquête. Ces unités mixtes, composées d'enquêteurs et de magistrats des deux pays, pourront mener des investigations coordonnées sur des affaires complexes à dimension transfrontalière ;
- le transfert temporaire de personnes détenues à des fins d'audition ;
- une innovation majeure : la possibilité de procéder à des livraisons surveillées, technique d'enquête particulièrement efficace dans la lutte contre les trafics transfrontaliers. Cette méthode consiste à suivre des cargaisons illicites sans les intercepter immédiatement, permettant ainsi de remonter les filières criminelles jusqu'aux organisateurs.
Cet accord bilatéral complète le dispositif juridique déjà existant avec le Brésil. La France et le Brésil ont signé en 1996 un accord d'entraide judiciaire en matière pénale, complété en 2013 par un accord de coopération transfrontalière. La combinaison de ces instruments juridiques avec les deux pays frontaliers de la Guyane crée un cadre cohérent pour lutter contre la criminalité dans cette région.
Cet accord pourrait servir de modèle pour une coopération judiciaire plus large à l'échelle du plateau des Guyanes, englobant le Guyana, le Suriname, la Guyane française et une partie du Brésil. Des discussions existent pour établir un mécanisme de concertation régulier entre les procureurs généraux de ces territoires.
La magistrate Emmanuelle Doffe travaille également à identifier d'autres outils de coopération judiciaire, différents des accords bilatéraux qui présentent l'inconvénient de devoir être multipliés, parfois avec des États peu coopératifs ou avec lesquels la fréquence des contacts est très limitée. Le cadre de la Caricom, qui prévoit un mécanisme d'extradition, pourrait être intéressant. La Caricom est d'ailleurs déjà un outil intéressant en matière d'échanges de renseignement sur le trafic d'armes comme l'a confirmé le préfet de la Martinique Etienne Desplanques.
Quelques grands programmes de coopération ont été lancés pour consolider le travail en commun, au-delà des accords bilatéraux que la France peut conclure. On citera en particulier les programmes ALCORCA et EL PAcCTO.
Le programme ALCORCA
Programme de coopération policière et judiciaire de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le programme « ALCORCA » (Accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes) a été mis en place en 2016, afin de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic de drogue dans la zone régionale. Il concernait initialement la République dominicaine, le Mexique, Cuba, la Jamaïque et Haïti.
Renouvelé en 2019 sous l'intitulé « ALCORCA 2 », qui vise plus spécifiquement la lutte contre le trafic de cocaïne et les infractions qui lui sont liées, le programme a alors été étendu à plusieurs États des Petites Antilles - Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Barbade -, rejoints en 2024 par le Panama et le Costa Rica.
Son budget d'intervention était d'environ 180 000 euros pour l'exercice 2024, au titre du programme 105 (« Action de la France en Europe et dans le monde »).
En 8 ans, le programme a permis l'organisation d'une quarantaine de formations et séminaires, visant à former plus de 1 200 membres des forces de lutte anti-drogue des pays partenaires. Par ce renforcement des capacités locales, l'objectif du programme est d'optimiser l'efficacité des opérations de lutte contre la criminalité dans la zone régionale et de renforcer la coopération entre les services des États participant au programme, afin de favoriser la sécurité intérieure dans la zone régionale, en particulier au bénéfice des collectivités françaises des Amériques.
L'impact d'« ALCORCA » pourrait être accru par la recherche de synergies avec les programmes européens mis en oeuvre dans la zone Amérique latine - notamment EL PAcCTO 2 -, mais également par un travail en « équipe Europe » à la préfiguration d'une académie régionale en charge de lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants pour la Caraïbe, s'appuyant sur la République dominicaine. À cette fin, des contacts s'organisent avec la DG Intpa de la Commission européenne et une recherche de partenaires est lancée au niveau européen.
Source : DSOM
Le programme EL PAcCTO
EL PAcCTO (Programme Europe-Amérique latine d'assistance contre la criminalité transnationale organisée - Europe Latin America Programme of Assistance against Transnational Organized Crime) est un programme de coopération internationale financé par l'Union européenne visant à renforcer les capacités de lutte contre les trafics illicites et les narcotrafics, ainsi que la coopération régionale et internationale dans ce domaine.
Après une première phase initiée en 2017 avec un champ d'action centré sur l'Amérique latine, une deuxième phase du programme (EL PAcCTO 2.0), lancée le 11 mars 2024 à Panama City à la suite de l'accord sur EL PAcCTO 2.0 de novembre 2023, résultant du sommet UE-CELAC de juillet 2023, étend le périmètre du programme à la Caraïbe. Il concerne au total 18 pays de la zone régionale : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.
Entre sa première phase de mise en oeuvre et EL PAcCTO 2.0, le programme a vu son budget doublé, sa structure élargie pour des résultats plus durables et plus ambitieux et l'inclusion des pays des Caraïbes, ce qui illustre la volonté de promouvoir le dialogue et la coopération multirégionaux dans la lutte contre la criminalité organisée.
Relevant de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne (DG Intpa) et doté d'un financement de 58,8 millions d'euros, le programme EL PAcCTO 2.0 fonctionnera jusqu'à fin 2027.
Il est mis en oeuvre par un consortium d'États membres de l'UE, dirigé par la Fondation pour l'Internationalisation des Administrations Publiques espagnole (FIAP - Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), en collaboration avec ses partenaires français (Expertise France), italien (IILA - Institut Italo-Latino-Américain) et portugais (Institut Camões).
Ce programme englobe la chaîne pénale dans son ensemble, en incluant les acteurs des services de police, des systèmes judiciaires et des systèmes pénitentiaires, en favorisant le dialogue, un échange de bonnes pratiques et d'expériences positives entre pairs, une meilleure compréhension mutuelle, des dynamiques communes et l'interopérabilité des systèmes.
EL PAcCTO concentre son action sur cinq domaines : la cybercriminalité, la corruption, le blanchiment des capitaux, les droits humains et les problématiques liées au genre, grâce à de nombreux moyens d'action : ateliers de travaux pratiques, réforme et développement de la législation, création de protocoles entre institutions, impulsion de réseaux informatisés et de processus interopérables, renforcement des institutions et des outils régionaux, création de mécanismes entre l'Amérique latine et l'Union européenne...
Le programme est activé à la demande d'un des 18 pays de la zone régionale, avec les objectifs suivants :
- renforcer les capacités des forces de sécurité et des parquets en matière d'enquêtes pénales et d'opérations conjointes à l'échelle régionale et internationale ;
- renforcer les capacités des forces de sécurité, des acteurs des systèmes judiciaires et du personnel pénitentiaire dans la lutte contre la cybercriminalité à l'échelle nationale, régionale et internationale ;
- améliorer les cadres législatifs et réglementaires et renforcer les réseaux pour une coopération régionale plus efficace ;
- faciliter les processus de confiscation des avoirs criminels ;
- moderniser la gestion des systèmes pénitentiaires et implanter des processus modernes, effectifs et efficaces contre la criminalité organisée ;
- promouvoir une participation plus active des membres de la police, des institutions judiciaires et des systèmes pénitentiaires aux opérations régionales pour lutter conjointement contre la criminalité organisée.
Les pays destinataires de ce programme doivent participer activement et nommer plusieurs points focaux, à la fois transversaux et par secteur (police/justice/pénitentiaire), qui coordonnent les actions d'EL PAcCTO dans leur pays. En outre, une articulation avec d'autres projets dans la région est recherchée.
Il existe des liens étroits entre EL PAcCTO et AMERIPOL, soutenus par EL PAcCTO, et INTERPOL, qui intervient au soutien d'EL PAcCTO grâce au programme INTERPOL Support to EL PAcCTO financé par l'UE, mené par la sous-direction d'appui aux enquêtes sur les fugitifs d'INTERPOL.
Source : DSOM
Lors de leurs auditions par la délégation aux outre-mer les 10 avril et 10 juillet 2025, Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, ont souligné l'importance des financements européens dans le cadre de ce programme, face à une problématique régionale majeure.
4. La consolidation des relations bilatérales
a) Sainte-Lucie : une dynamique forte à amplifier
Comme vu supra, la coopération entre la Martinique et Sainte-Lucie est très positive, aussi bien sur les questions de sécurité que d'économie. Les réseaux de transport maritime entre les deux îles se densifient et des échanges nombreux dans les domaines sanitaires, culturels ou universitaires se développent.
La présence du siège de l'OECO à Castries, organisation régionale la plus opérationnelle, et dont sont membres la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, est aussi un facteur de dynamisation de la relation avec cette île.
b) Une relation franco-guyano-brésilienne en net progrès
La coopération avec le Brésil est empreinte d'un dialogue constructif et une volonté commune d'avancer. Toutefois, la lourdeur des procédures et l'éloignement de Brasilia, principal centre de décision, ralentissent les progrès.
La coopération transfrontalière avec le Brésil est caractérisée par les similitudes que connaissent les territoires de la Guyane et de l'Amapa - couverts à plus de 90 % par la forêt amazonienne - avec un fort retard de développement par rapport à leurs États centraux, un sous-équipement et un enclavement importants face à une croissance démographique continue et rapide.
Depuis le 18 mars 2017, le pont de l'Oyapock relie la France (Guyane) et le Brésil (État d'Amapa). Au-delà de son impact symbolique, il constitue un vecteur de développement potentiel, mais il fait également naître des inquiétudes fortes vis-à-vis du poids que représente le Brésil. En effet, côté français, Saint-Georges de l'Oyapock est très peu développé. 5 000 habitants environ et une activité économique très faible. Côté brésilien, Oyapoque compte au moins 40 000 habitants et l'activité économique est en pleine effervescence. Ce déséquilibre crée des tensions et des opportunités.
Deux enjeux dominent avec le Brésil :
- gérer le bassin de vie le long de l'Oyapock ;
- développer l'insertion régionale plus globalement, notamment le développement des échanges commerciaux.
La gouvernance de cette relation bilatérale est désormais bien articulée. Au niveau de la frontière, le conseil du fleuve est l'instance locale consultative créée par la déclaration d'intention du 14 décembre 2012. Il se réunit régulièrement pour aborder les problèmes quotidiens de la gestion d'une frontière pour des populations qui vivent de part et d'autre.
La commission mixte transfrontalière (CMT)17(*) franco-brésilienne est l'instance supérieure qui aborde la relation Guyane-Brésil dans son ensemble. La collectivité territoriale de Guyane participe à l'ensemble de ces instances.
La CMT transmet ensuite ses orientations au niveau du dialogue politique bilatéral France-Brésil.
Au niveau politique, la récente visite du président de la République au Brésil en mars 2024 a permis de faire avancer la reconnaissance de la dimension amazonienne de la Guyane, et donc de la France. Un partenariat stratégique a été approuvé par déclaration commune des deux chefs d'État.
S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), elle dispose de deux antennes, l'une dans l'Amapa, l'autre dans le Para. Elles sont localisées dans le bâtiment du Gouverneur. La CTG a également signé une convention de coopération avec l'Amapa pour promouvoir la bioéconomie et l'économie circulaire.
Cette relation au beau fixe s'est matérialisée encore lors de la 14e CMT en juin 2025, lors de laquelle la suppression de l'obligation de visa pour les habitants de l'Amapa a été annoncée. Par ailleurs, la question de l'intégration de la Guyane dans les débats sur l'accord UE/Mercosur a été soulevée.
c) La relation avec le Suriname : un réchauffement encore fragile
Le contentieux frontalier brouille depuis des décennies la relation franco-surinamaise, le Suriname ne reconnaissant pas le tracé de frontière sur le fleuve Maroni18(*) (voir la carte au I.A.2.b). Toutefois, à la faveur d'une majorité parlementaire et d'un Gouvernement mieux orientés à l'endroit de la France, cet irritant n'a pas empêché la réalisation de progrès important. En particulier dans le domaine de la sécurité comme vu supra. Par ailleurs, l'accord-cadre en matière de coopération et d'amitié signé en 2018 et ratifié en 2021 permet notamment la signature ultérieure d'accords pour répondre aux nombreux enjeux de la coopération transfrontalière.
Dans le domaine économique, TotalEnergies est un opérateur majeur des programmes d'exploitation des hydrocarbures en cours (13 milliards de dollars d'investissement annoncés en 2024). Lors de l'entretien avec la délégation, le président de la République Chandrikapersad Santokhi s'est exprimé en faveur de la création d'une chambre de commerce franco-surinamaise à l'exemple de celle très dynamique existant entre le Guyana et son pays. Par ailleurs, le ministre des Finances Stanley Raghobarsing a salué le rôle de la France au sein du Club de Paris lors de la restructuration de la dette publique surinamaise en octobre 2022) ainsi que l'apport des conseils de la banque Lazard dans le redressement économique du pays.
L'AFD est aussi présente au Suriname, particulièrement dans le domaine de la santé : elle a participé à la création de l'hôpital d'Albina (voir infra). Les ministères de la Santé français et surinamais espèrent aussi aboutir à un accord de coopération portant sur la contamination aux métaux lourds, fléau qui touche notamment les communautés amérindiennes. Ils ont signé en octobre 2023 une déclaration d'intention visant à renforcer les coopérations dans le secteur de la santé. L'AFD a également participé au renforcement d'infrastructures routières, en particulier de la route qui relie l'est du pays à sa capitale Paramaribo. La délégation qui l'a empruntée regrette qu'aucun panneau ne le rappelle. Encore un exemple d'action invisibilisée de la France.
Le retour au pouvoir de l'opposition, à la suite des dernières élections législatives, devra être observé de près. Un refroidissement de la relation est à craindre, mais pas certain.
La coopération transfrontalière avec le Suriname est en effet caractérisée par des défis communs à relever, notamment en termes d'infrastructures. Concernant le franchissement du Maroni, le remplacement du bac actuel assurant la liaison fluviale entre Saint-Laurent du Maroni et Albina par un bac de grande capacité a fait l'objet d'un accord entre la France et le Suriname depuis 2014. Le projet est néanmoins toujours enlisé dans des problèmes techniques difficilement compréhensibles par les populations.
Le dialogue institutionnel repose principalement sur le Conseil du fleuve Maroni. En effet, la commission mixte instituée par la déclaration d'intention du 24 novembre 2009 ne s'est plus réunie depuis son installation. L'accord-cadre de 2018 doit renouveler ce cadre institutionnel du dialogue bilatéral et prévoit d'établir une commission mixte qui se réunira alternativement en France et au Suriname.
En matière de contrôle de l'immigration, des progrès sont aussi enregistrés. L'accord de réadmission des personnes en situation irrégulière du 30 novembre 2004, déjà ratifié par la France, est toujours en attente de ratification par le Suriname. Cependant le Suriname accepte la réadmission de ses ressortissants. Par ailleurs, la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni étant la deuxième de France après Mayotte, du fait notamment que de nombreuses mères surinamaises viennent y accoucher, un représentant de l'État civil surinamais est directement implanté au sein du Centre hospitalier de l'Ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni. Cet agent évite les erreurs de transcription et vérifie la nationalité des parents surinamais.
La poursuite de ce rapprochement avec le Suriname est essentielle tant les liens sont forts entre les populations. On rappellera que le Maroni est historiquement un bassin de populations plus qu'une frontière hermétique. La guerre civile surinamaise (1986-1992) a provoqué l'afflux en Guyane de réfugiés surinamais Noirs-marrons de l'intérieur (les Bushinengués), dont des milliers sont restés sur place après la fin des hostilités. On estime que près de 25 000 personnes ont été déplacées durant ce conflit.
d) Le Guyana : une relation stratégique à construire
La coopération avec le Guyana n'est pas institutionnalisée. Cependant, le programme européen de coopération Interreg Amazonie (PCIA), géré par la collectivité territoriale de Guyane, a été élargi pour la première fois au Guyana sur la période 2014-2020 et confirmé pour 2021-2027.
L'ouverture d'un poste diplomatique en septembre 2025 doit ouvrir une nouvelle ère.
5. Des projets de coopération multiples sous financement européen
Les projets de coopération régionale sont foisonnants et couvrent tous les domaines.
Comme dans l'océan Indien, le principal financeur est l'Union européenne, suivie de l'AFD, et plus marginalement d'autres acteurs (collectivités, préfecture via le fonds de coopération régionale (FCR)).
a) La stratégie « Trois Océans » de l'AFD : la bonne approche à creuser encore
L'AFD est un autre financeur majeur de la coopération régionale, parfois sur fonds européens. En 2024, 357 millions d'euros ont été versés par le groupe AFD dans cette zone régionale.
Lors de son audition par la délégation aux outre-mer le 15 février 2024, Charles Trottmann, alors directeur du département des Trois Océans de l'AFD, estimait à cet égard que l'AFD « dispose d'une large palette d'instruments. Cependant, ils demeurent construits en silo, si bien que l'assemblage des différents fonds demeure malaisé. Au niveau européen, comme au niveau national, il manque un outil dédié permettant de construire des projets intégrés de coopération régionale. Nous en discutons avec nos ministères. ».
L'AFD dans la zone Antilles-Guyane
Dans le cadre de sa stratégie Trois Océans adoptée en 2019, l'AFD a pour objectif l'accompagnement des territoires ultramarins dans leur projet de développement durable et le renforcement de leurs liens avec leur voisinage, dans les bassins Atlantique, Indien et Pacifique, avec des directions régionales qui regroupent territoires ultramarins et États du même bassin.
1. Organisation et missions
Pour le bassin Atlantique, la direction régionale océan Atlantique (DROA) de l'AFD, basée à Fort-de-France, couvre 16 territoires de la Caraïbe et du plateau des Guyanes à partir de représentations dans trois départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane), deux collectivités françaises d'outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy) et trois États étrangers voisins (Haïti, République dominicaine, Suriname (représentation compétente également sur le Guyana)). La DROA intervient également à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la Martinique.
Constatant que les territoires du bassin Atlantique faisaient face à des défis majeurs (biodiversité remarquable, changement climatique, fortes disparités économiques, politiques ou culturelles), le groupe AFD a déterminé quatre axes d'action pour ce bassin :
- agir en faveur de la préservation de la diversité biologique et de l'adaptation des populations au changement climatique dans ces territoires vulnérables ;
- entreprendre des initiatives régionales afin de renforcer la sécurité sanitaire des populations ;
- renforcer la prise en compte des enjeux de genre et de dignité humaine ;
- accompagner la jeunesse par l'insertion professionnelle, la mobilité estudiantine et la consolidation des liens intergénérationnels.
Au sein du groupe AFD, les actions de l'Agence française de développement (AFD) - destinées au soutien du secteur public et des organisations de la société civile - sont complétées par celles de Proparco, filiale dédiée au financement et à l'accompagnement du secteur privé, et d'Expertise France, filiale mettant en oeuvre des projets de coopération technique visant à renforcer les politiques publiques de ses partenaires.
2. Modalités d'action
L'AFD accompagne tant des projets propres à chaque territoire, que des opérations de portée régionale.
Elle intervient grâce à une pluralité d'instruments :
- actions financées par des subventions de l'État français, grâce aux crédits du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre du « programme 209 », notamment pour celles touchant à la biodiversité ou la lutte contre le changement climatique ;
- actions financées par des subventions déléguées de l'Union européenne : la Commission européenne délègue à l'AFD la mise en oeuvre de certains fonds européens dans le cadre d'un accord de gestion indirecte ;
- actions financées grâce à des fonds du ministère de l'Intérieur et des outre-mer, à travers le « programme 123 » notamment, lorsqu'il s'agit d'infrastructures publiques, d'énergie et d'environnement ; ce fonds outre-mer (FOM) peut également appuyer la coopération régionale à partir des collectivités ultramarines françaises ;
- instruments orientés vers des acteurs spécifiques, comme la Facilité de financement des collectivités locales (FICOL) ou le Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences (FEXTE) :
• la FICOL est dédiée au soutien des actions décentralisées des collectivités locales ; cet instrument produit un effet de levier très puissant, jusqu'à 70 % du financement, pour inciter les collectivités à mener des actions à leur initiative ;
• le FEXTE, fonds confié par le ministère de l'économie et des finances, permet de recourir à des acteurs français de toute nature (entreprises ou agences publiques) pour financer des prestations d'expertise auprès d'États étrangers ;
- actions financées grâce à des prêts accordés à des collectivités locales, établissements publics ou entreprises du secteur privé en charge de missions de service public.
Exemples de projets phares de l'AFD associant
territoires ultramarins
et États voisins de la zone
régionale19(*)
|
Titre et objet du projet |
Moyen(s) d'action et montant |
Partenaire(s) / bénéficiaire(s) |
Localisation |
|
Soutien à l'agence de santé publique caribéenne (CARPHA) Renforcement de la sécurité sanitaire régionale, en favorisant les partenariats interrégionaux, notamment avec l'ARS et le Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique |
Subvention de l'État français (1,5 million d'euros) |
CARPHA |
Pays membres de la Caricom |
|
Analyse des possibilités de développement de l'accès des patients internationaux à l'institut caribéen d'imagerie nucléaire (ICIN) de Martinique Accès à des soins de santé de qualité pour les patients de la Caraïbe, tout en contribuant à dynamiser le tourisme médical dans la région |
Subvention Fonds outre-mer (FOM) (200 000 euros) |
Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) |
Martinique |
|
Déploiement de la technologie des filtres plantés de végétaux (CARIBSAN II) Sur la base des retours d'expérience de la Martinique et de la Guadeloupe, projet de construction de 3 stations pilotes à Sainte-Lucie, la Dominique et Cuba, pour une adoption progressive de cette méthode d'assainissement - climato-résiliente, adaptée aux conditions tropicales et économiquement viable - à l'échelle de la Caraïbe |
Subvention de l'État français (3 millions d'euros) |
Office de l'Eau de Martinique (ODE) |
Sainte-Lucie, Dominique et Cuba |
|
Recycle OECS Réduction de la production de déchets et adoption de meilleures pratiques en termes de gestion des déchets dans le cadre de l'initiative « Zéro déchet dans les Caraïbes » de l'Union européenne |
Subvention déléguée de l'Union européenne (2,5 millions d'euros) |
OECO |
Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique |
|
Préservation et restauration des mangroves de la Caraïbe Soutien à des actions de restauration et de conservation des mangroves dans la Caraïbe orientale sur 6 sites pilotes, vers une gestion durable de ces écosystèmes à l'échelle régionale |
Subvention de l'État français et du Fonds français pour l'environnement mondial (5,5 millions d'euros au total) |
OECO |
Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Grenade |
|
Initiative régionale de lutte contre le phénomène sargasses Mené par Expertise France, projet régional rassemblant les territoires ultramarins et les États de la Caraïbe concernés, en abordant l'ensemble des dimensions du phénomène (recherche scientifique, détection et suivi en mer, protection des littoraux et écosystèmes, collecte et valorisation des algues) |
Subvention de l'État français déléguée à Expertise France (8 millions d'euros) |
OECO, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), entreprises, laboratoires et centres de recherche des filières de gestion et de valorisation des sargasses |
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, République dominicaine, Belize, Mexique, Guadeloupe, Martinique |
|
Subvention à la plateforme d'intervention régionale des Amériques et Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française Renforcement de la gestion des risques de catastrophe en favorisant la production et le partage des connaissances (formations ciblées, programme éducatif...) : environ 1,4 million de personnes dans la région devraient bénéficier de ces actions |
Subvention de l'État français (4,5 millions d'euros) |
Croix-Rouge française |
Bassin caribéen |
|
Partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes La Banque de développement des Caraïbes finance grâce à deux lignes de crédit d'un total de 93 millions d'USD des projets à forts impacts en matière de lutte contre le changement climatique et d'égalité femmes-hommes. |
Prêt (accompagné d'une subvention déléguée de l'Union européenne pour financer assistance technique, sensibilisation, études...) |
Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank) |
Bassin caribéen |
b) Les programmes Interreg
Deux programmes Interreg couvrent la région.
Le programme Amazonie était doté de 22,2 millions d'euros sur la période 2014-2020 (dont 18,48 du Feder). Pour la période 2021-2027, la dotation s'élève à 19 millions d'euros. Il couvre le plateau des Guyanes, de l'est du Brésil20(*) au Guyana.
Le programme Caraïbe était doté de 85,7 millions d'euros sur la période 2014-2020 (dont 64,2 au titre du Feder). Pour la période 2021-2027, la dotation s'élève à 79,9 millions d'euros (dont 67,8 du Feder).
Un premier bilan à mi-parcours a été fait. Pour Interreg Caraïbes, 60 % du montant prévisionnel a été alloué au bénéfice de 26 projets.
c) L'action extérieure de l'UE et le projet Global Gateway : un financement européen massif dans le voisinage des RUP et PTOM
L'Europe consacre des budgets importants à son action extérieure dans la région Caraïbe. Elle passe par différents canaux.
Le programme d'investissement Global Gateway pour l'Amérique latine et les Caraïbes est l'un des principaux résultats du sommet UE-CELAC des 17 et 18 juillet 2023. La participation de l'UE se concentre sur les transitions écologique et numérique équitables et exige l'adhésion des États membres et des institutions financières de l'UE pour être couronnée de succès. La réussite de Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes dépendra notamment de la mobilisation du secteur privé. Les principales priorités du programme d'investissement sont les suivantes : les sargasses, le transport maritime, les énergies renouvelables et la gestion des ressources en eau. Au total, ce sont 45 milliards d'euros que l'UE mobilise sous des formes diverses sur la période 2021-2027 en direction de ce partenariat.
Ces montants colossaux sont sans commune mesure avec les crédits limités des programmes d'Interreg. Les masses financières sont du côté du Global Gateway, et notamment du fonds NDICI.
La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'autre acteur clef de cette équipe Europe. À titre d'exemple, la BEI et la Banque de développement des Caraïbes (BDC) ont annoncé en octobre 2024 une nouvelle opération conjointe pour apporter un soutien au secteur de l'approvisionnement et de la gestion de l'eau ainsi qu'à l'écosystème océanique dans les Caraïbes. Le prêt de la BEI de 100 millions d'euros (109,4 millions de dollars) doit permettre à la BDC de soutenir davantage de projets qui garantissent l'approvisionnement en eau potable, améliorent la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets solides.
Les pays admissibles à ces investissements financés par la BEI seront les suivants : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago.
Présentation du Global Gateway dans la Caraïbe21(*)
6. Le rayonnement de nos territoires en matière sanitaire, environnementale et culturelle
La coopération régionale dans le bassin Atlantique rayonne dans les domaines sanitaire, environnemental, scientifique et culturel.
Ce dynamisme reflète la qualité de plusieurs établissements publics présents dans les territoires :
- les centres hospitaliers de Guyane, Martinique et Guadeloupe dotés de matériels de pointe, l'Institut Pasteur dans le domaine de la santé ou l'IRD ;
- le Cirad en matière d'agronomie ;
- l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Office national des forêts (ONF) ou l'Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan (Ifremer) en matière environnementale ;
- l'Université des Antilles ou l'Université de Guyane...
Au niveau des collectivités, la politique culturelle et éducative se diffusent dans la région. Les échanges scolaires avec les îles voisines sont très importants.
La liste des projets conduits sur financement Interreg ou AFD est longue. On en citera quelques uns.
Dans le domaine de la santé, grâce au soutien de l'Agence française de développement (AFD) et à la Caribbean Public Health Agency (CARPHA), des réseaux de veille épidémiologique ont été mis en place, notamment pour répondre aux épisodes de dengue, de zika ou encore à la pandémie de Covid-19.
L'ambassadeur Arnaud Mentré a mis en avant le programme Caribsan, développé par l'agence de l'eau de Martinique. Ce projet est un exemple de solution concrète qui peut avoir, à terme, un effet important sur la pollution de la mer des Caraïbes, notamment s'il est utilisé par des partenaires qui se trouvent dans des situations difficiles, comme Cuba. Doté d'une enveloppe de 8 millions d'euros, il porte sur le développement de systèmes de filtration par les plantes pour l'assainissement collectif ou semi-collectif.
C. DES POINTS FAIBLES PERSISTANTS
« Beaucoup d'ambitions dans la région, mais peu d'actions ». L'ambassadrice de l'Union européenne dans la région exprime avec ces mots forts le ressenti partagé par de nombreux acteurs.
La lenteur des processus et des projets est pointée, ainsi que la complexité de l'architecture de la coopération.
Les capacités administratives limitées de la plupart des îles ou petits États de l'arc antillais sont une explication. Une autre connexe est le caractère très fragmenté de cet espace qui se traduit souvent par une compétition peu efficiente entre les territoires.
Cette concurrence peut aussi exister entre les outre-mer français, notamment la Guadeloupe et la Martinique. Quant à la Guyane, elle tend plutôt à se dissocier de l'arc antillais, à s'autonomiser, et se tourne vers son voisinage immédiat et le continent sud-américain.
1. Un cadre de coopération complexe et pas toujours lisible
Les formes de coopérations transnationales dans le bassin caribéen
Source : « Défis et limites de
la coopération transnationale dans les Caraïbes ».
Article de Frédérique Loew-Turbout paru dans la Revue belge
de géographie (2024 n° 4)
a) Un chevauchement d'organisations régionales multiples et concurrentes
Selon Xavier Lédée, président de la collectivité de Saint-Barthélemy, la région souffre d'une multiplication d'organisations régionales dont les CFA sont parfois membres simultanément, sans gain évident d'efficacité.
On s'aperçoit notamment de la superposition de structures économiques et de marché, comme celle entre le Caribbean Single Market and Economy (CSME) de la CARICOM, instituée en 2002 pour faciliter la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux, et l'union économique créée en 2010 par l'OECO. Tous les membres protocoles du CSME sont également membres de cette union économique, ce qui génère des redondances, bien que l'union économique de l'OECO semble en réalité la seule véritablement en application. De plus, la Caricom fait face à des obstacles liés aux fortes asymétries entre ses membres dont les tailles de marché et les caractéristiques socio-économiques divergent, tandis que l'OECO, restreinte à des petits territoires insulaires, permet une meilleure effectivité.
Schéma
« simplifié » de l'architecture des organisations
régionales
dans la Grande Caraïbe
Source : DSOM
m.a : Membre associé
PTOM : Pays et territoires d'outre-mer, n'appartient pas au territoire de l'UE, mais y est associé et leurs citoyens sont des citoyens européens
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Sur le plan judiciaire, une observation inverse s'impose : la Cour suprême de la Caraïbe orientale, initialement créée en 1967 sous l'impulsion des États associés des Indes occidentales, organisme précurseur de l'OECO hébergeant désormais la Cour, se voit répliquée en 2001 par la création de la Cour caribéenne de justice reliée à la Caricom, aux prérogatives plus précises et dont l'autorité est davantage reconnue par les États.
Ce chevauchement institutionnel nuit aussi à la concertation stratégique régionale, ce qui peut avoir des répercussions géopolitiques préoccupantes. Dr Didacus Jules, directeur général de l'OECO, souligne notamment que des partenariats internationaux majeurs, comme certains conclus avec la Chine, ont parfois été établis sans consultation préalable avec l'OECO en dépit des risques de déstabilisation.
Enfin, la duplication des mandats et parfois la multiplication d'initiatives similaires entre ces diverses organisations peuvent mettre à rude épreuve les ressources limitées des États membres et réduire l'efficacité globale de la coopération régionale.
L'empilement des formes de coopération complique le choix des priorités et dilue l'engagement politique et financier sur quelques projets forts.
b) L'adhésion des CFA aux organisations régionales : un retour sur bénéfice encore insuffisant
L'intégration des territoires ultramarins français dans leur environnement régional reste globalement insuffisante, malgré la mise en place de cadres institutionnels et les mouvements d'adhésion à des organisations.
Pour les outre-mer français, qui sont membres associés de ces organisations et qui ne pèsent pas autant que les membres fondateurs de plein exercice, il est encore plus difficile de s'imposer et de faire prévaloir une position d'influence.
Serge Letchimy a le sentiment que l'adhésion des CFA aux organisations régionales est un symbole utile pour la diplomatie française et les organisations, mais que les résultats et la capacité des territoires à affirmer leurs priorités dans ces enceintes tardent à se matérialiser. Les CFA, du fait de leur statut, demeurent des acteurs mineurs de la diplomatie régionale.
Cette réalité se manifeste notamment par des coopérations qui peinent à se structurer de manière concrète, comme le note Arnaud Mentré : « À Saint-Martin, pourtant entourée d'îles anglophones, hispanophones et néerlandophones, la diplomatie de terrain reste trop souvent théorique. »
Sur le plan économique, la coopération est particulièrement peu développée, alors qu'elle est indispensable à une insertion effective dans l'environnement régional. Les Antilles apparaissent bien plus repliées sur elles-mêmes, notamment en raison de coûts de production inégaux dans la zone, des différences normatives et fiscales et d'acteurs économiques tournées vers le marché européen et hexagonal. Le « mur économique » demeure infranchissable à la coopération régionale.
L'ensemble de ces limites conduit à se recentrer vers des initiatives plus ciblées, en particulier dans les secteurs sanitaires, environnementaux et sécuritaires, comme le résume le préfet de Martinique Etienne Desplanques.
La Guadeloupe a ainsi participé à des projets majeurs comme le dépistage néonatal de la drépanocytose à travers le dispositif Interreg Cares l'associant avec des États de l'OECO et plus récemment à la lutte contre l'invasion des sargasses encadrée par le projet SARGCOOP 2. La coopération en matière de sécurité est quant à elle très porteuse avec Sainte-Lucie dans le cadre de la Caricom, face à la prolifération du trafic d'armes et de stupéfiants qui profite de la position de la Martinique et la Guadeloupe comme porte d'entrée stratégique en Europe.
Ces dispositifs répondent malgré tout au besoin d'« expérimentation » de la diplomatie territoriale, définie comme la « petite politique étrangère » conduite par les collectivités locales. Pour Serge Letchimy, « nous sommes à l'an primaire d'un besoin vital de diplomatie territoriale ».
c) Une tuyauterie financière peu lisible
Comme dans le bassin Indien, les financements de la coopération régionale sont complexes et font appel à de nombreux partenaires : programme Interreg, NDICI, programmes horizontaux de l'Union européenne, aides de l'AFD, prêts de la BEI, de la Banque mondiale ou de la Banque de développement des Caraïbes...
Le montage des projets reste complexe.
Le premier volet de la présente étude avait déjà montré la complexité du programme Interreg pour les porteurs de projet. Grâce à un travail d'accompagnement très fort de la région Réunion, de nets progrès ont été enregistrés ces dernières années. Toutefois, dans le bassin Atlantique, on ne retrouve pas encore ce niveau d'ingénierie mis à la disposition des porteurs de projet.
D'autres défauts d'Interreg ont aussi été soulevés. L'absence de préfinancement tout d'abord. Ensuite, le fait qu'avec Interreg, les partenaires des États tiers ne peuvent pas bénéficier directement des financements. Le porteur de projets doit être originaire d'un RUP. Cela limite l'attractivité d'Interreg. Les partenaires étrangers privilégient alors la recherche de financements NDICI dont ils peuvent bénéficier directement. Cette différence de financement, pour des projets de coopération régionale souvent similaires, crée une concurrence entre Interreg et NDICI au détriment du premier.
Un des objectifs de la période 2021-2027 est justement de rapprocher les fonds Interreg et NDICI pour faciliter des cofinancements. Toutefois, à ce jour, les progrès restent timides, voire nuls dans le bassin Atlantique.
Pour l'Ambassadeur Francis Etienne, la faible consommation des crédits Interreg est un gâchis - un quart des crédits réellement consommé sur Interreg Caraïbe - et la principale explication serait le manque d'ingénierie pour concevoir les projets et monter les dossiers. Le programme Interreg Amazonie 2014-2020 atteindrait un taux de consommation d'environ 60 %.
Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental22(*) pointe encore la consommation très médiocre des programmes Interreg, en particulier le programme Caraïbes : « La programmation en Outre-mer des fonds Interreg pour la période 2014-2020 s'est heurtée à des difficultés traduites par une faible certification des crédits FEDER-CTE et par des dégagements de crédits, procédure prévue par les règlements européens qui consiste en la reprise en année n+3 des crédits non-consommés. Ces crédits récupérés par l'UE ne seront donc pas versés. Ces difficultés de gestion ont conduit la Commission européenne à initier une procédure de suspension du versement des fonds européens pour les programmes Interreg Saint-Martin (désormais levée) et Interreg Caraïbes. La programmation 2021-2027 a connu un lancement tardif. La crise sanitaire a retardé l'adoption du règlement UE 2021/1059 relatif à Interreg et, du même coup, l'adoption des programmes Interreg. L'année 2023 a vu la mise en place technique des programmes (adoption du règlement intérieur du comité de suivi, mise en place du processus de sélection des projets, etc.). À fin avril 2025, les taux de programmation sont de 27 % pour le programme Océan Indien, 42 % concernant le programme Canal du Mozambique et 50 % pour le programme Caraïbes. Aucune opération n'est encore programmée pour le programme Amazonie ».
Ces retards exposent les programmes Interreg à des dégagements d'office dès fin 2025.
La collectivité territoriale de Guyane fait aussi le constat d'un programme Interreg Amazonie qui offre peu de visibilité sur les projets conduits et les opportunités économiques qui en découlent. La collectivité travaille à une étude d'opportunité sur les secteurs porteurs et à la création d'une application pour mettre en réseau tous les interlocuteurs de la coopération régionale. Elle constate aussi que les partenaires étrangers ont du mal à s'impliquer sur les programmes Interreg, faute de pouvoir en être chef de file.
Du côté de l'AFD, la stratégie « Trois Océans » garantit une meilleure cohérence des projets aidés. Toutefois, l'agence n'échappe pas à la complexité financière. Les outils de l'AFD ne sont toujours pas adaptés aux réalités ultramarines.
La principale limite pour une intégration plus systématique des outre-mer dans les projets régionaux réside dans la conception même des instruments, puisque l'AFD doit faire appel à des programmes budgétaires différents pour ses interventions dans les outre-mer et dans les territoires étrangers : le programme 12323(*) de la mission budgétaire « Outre-mer » pour les premiers, le programme 20924(*) de la mission budgétaire « Aide publique au développement » pour les seconds.
Cette dichotomie programme 123/programme 209 s'apparente beaucoup à celle que l'on retrouve au niveau européen entre Interreg/NDICI.
Il manque un outil commun budgétaire aux deux ministères pour financer la coopération régionale de manière globale et cohérente.
2. Les échanges commerciaux toujours atones
Le premier volet relatif au bassin Indien avait rappelé et précisé le constat ancien et documenté de l'extrême faiblesse des relations commerciales et économiques des outre-mer français avec leur environnement régional proche.
Lors de son audition le 1er février 2024, Ivan Odonnat avait livré de nombreuses données pour le bassin Indien, mais aussi les collectivités des Amériques et du Pacifique.
Source : Douanes, IEDOM
Une récente étude de la Banque de France publiée le 23 septembre 2025 a encore actualisé et affiné ce constat inquiétant25(*). Elle enrichit aussi l'analyse par des éléments de comparaison avec des Petits États insulaires en développement (PEID) proches des outre-mer.
Les partenaires du
commerce extérieur de marchandises (comparaison Martinique, Guadeloupe
et Petits États insulaires en développement (PEID)
des
Caraïbes)
Les partenaires du commerce extérieur de
marchandises
(comparaison Guyane-Guyana-Suriname)
Cette étude permet aussi de mieux mesurer le retard propre aux outre-mer français par rapport à d'autres petites économies insulaires similaires.
S'agissant de Saint-Martin, depuis 2013, les statistiques d'échanges extérieurs de Saint-Martin sont intégrées dans celles de la Guadeloupe, sans possibilité de les isoler. Votre délégation ne peut que le regretter. Alors que l'on crée une préfecture de plein exercice, une telle situation statistique est de plus en plus anachronique.
Ces données traduisent aussi l'incapacité des outre-mer français, RUP ou PTOM, à se positionner comme des portes d'entrée vers l'Union européenne. Ces territoires, à leur échelle respective, pourraient développer une activité de transformation de produits provenant des partenaires régionaux à destination de l'UE.
Ces chiffres montrent que la singularité principale des collectivités françaises des Antilles et de la Guyane tient à leur dépendance commerciale vis-à-vis de la France hexagonale, et dans une moindre mesure à l'Europe. Les PEID ou territoires voisins ont mieux su diversifier leurs clients et fournisseurs.
En revanche, s'agissant de l'intégration régionale, ces territoires font certes mieux que les outre-mer français en s'approvisionnant et exportant plus dans leur environnement proche. Toutefois, les données montrent que l'essentiel du commerce extérieur se fait aussi en dehors de la zone régionale.
La Caraïbe et le plateau des Guyanes sont dans leur ensemble assez éloignés des chaînes de valeur et de production mondiales. L'émergence d'un marché caribéen reste compliquée.
3. Une mobilité contrariée
Comme dans l'océan Indien, la mobilité maritime et aérienne des personnes et des biens reste souvent compliquée, en particulier pour les liaisons intrarégionales.
Indice de connectivité des transports maritimes réguliers au quatrième trimestre 2022 dans la Caraïbe et le plateau des Guyanes
Comparaison des potentiels de marché pour
une sélection d'économie
(base 100 = valeur
moyenne)
Ce dernier schéma illustre l'éloignement des outre-mer français, en particulier la Guyane, des principaux pôles économiques mondiaux. La connectivité des transports maritimes est l'une des explications.
S'agissant de l'intégration régionale et du développement des échanges dans la zone Caraïbe ou le plateau des Guyanes, ils semblent buter sur la faiblesse du transport maritime régional et du cabotage.
La réorganisation en cours du transport maritime mondial à la faveur des nouvelles règles de l'Organisation maritime internationale (OMI) ne laisse pas d'inquiéter les PEID les plus éloignés des hubs régionaux.
À cet égard, la réorganisation des lignes de CMA-CGM autour de deux hubs régionaux en Guadeloupe et en Martinique, pour accueillir des porte-conteneurs toujours plus grands, est perçue favorablement dans ces deux territoires. Pour se conformer aux objectifs de décarbonation fixés par l'OMI aux compagnies maritimes dès 2023, le groupe CMA-CGM comme les autres grandes compagnies mondiales, doit adopter des navires plus respectueux de l'environnement, fonctionnant au gaz liquéfié (GNL) et au biométhane, avec une capacité de transport accrue. Les nouveaux navires pourront transporter jusqu'à 7 700 conteneurs de 20 pieds, soit 26 % de capacité en plus par rapport aux navires actuels. Les navires desservant actuellement Sint-Maarten et Pointe-à-Pitre ont des capacités respectives de 2 200 EVP et 3 900 EVP.
En revanche, elle est accueillie très froidement par les autres CFA qui craignent de n'être plus desservis que par des lignes secondaires avec des temps de transbordement allongés. En tout état de cause, les nouveaux navires au tirant d'eau plus important seront dans l'incapacité d'accoster dans les ports de Dégrad-des-Cannes à Cayenne ou de Philipsburg à Sint Maarten.
La Guyane est la première concernée. Déjà située en bout de ligne, le port de Dégrad-des-Cannes ne pourra plus être desservi que par des bateaux plus petits destinés au seul trafic régional. Des solutions sont évoquées à long terme, comme la création d'une plateforme maritime multiusage au large. Mais le coût annoncé serait de 2 milliards d'euros...
Saint-Barthélemy et Saint-Martin expriment aussi des craintes. La ligne directe Le Havre-Philipsburg sera arrêtée dans les prochaines semaines. Le délai d'approvisionnement de Saint-Barthélemy devrait théoriquement être maintenu à 11 jours mais avec moins de rotations, ce qui entraînera des besoins de stockage de conteneurs démultipliés. À Saint-Martin, le délai théorique serait allongé de deux jours.
L'essor d'un réseau dense de transport régional et de cabotage achoppe sur l'équation économique de ce modèle : comment atteindre un niveau de chargement des navires suffisant ? En effet, les outre-mer comme les autres PEID sont d'abord des territoires d'importation. Les exportations sont marginales. Le flux retour n'est pas rentable. En Guyane, 90 % des conteneurs repartent vides.
Le Grand port maritime de Guyane travaille sur cet enjeu depuis de nombreuses années. Après de premières études il y a 10 ans, les projets commencent à mûrir.
Pour les outre-mer français, une marge de progrès existe pour renforcer les approvisionnements dans la zone de chalandise régionale. Si l'on compare aux voisins, une progression de la part des importations régionales à 10 % est un objectif atteignable, contre les 2 à 3 % actuels.
L'ouverture du premier et seul poste d'inspection frontalier (PIF) de Guyane, en mai dernier seulement, grâce à un projet financé par l'AFD et l'Union européenne, rend enfin possible des importations en direct de produits agroalimentaires venant d'ailleurs que de l'Union européenne ou des Antilles françaises. Déjà, on observe quelques flux nouveaux comme des sardines du Maroc sans passer par le Havre. Il reste maintenant à offrir le même service aux deux entrées terrestres, à Saint-Georges côté Brésil et Saint-Laurent côté Suriname.
Par ailleurs, le développement d'une industrie régionale de transformation alimentaire stimulerait aussi les flux intra-zones. Là encore, la Guyane, mais aussi la Martinique, étudient la possibilité d'importer de l'alimentation animale du Brésil pour une activité d'élevage dans les outre-mer. La Guyane, qui dispose de beaucoup de foncier en théorie, pourrait fournir la Caraïbe, au-delà de sa seule demande intérieure.
Le Grand port de Guyane et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) sont moteurs sur ce sujet. En 2022, une conférence économique du plateau des Guyanes s'est tenue à Bélem avec tous les opérateurs du Para et de l'Amapa. En 2024, une seconde conférence s'est tenue cette fois à Cayenne en présence du régulateur maritime et du ministère de la planification du Brésil.
Tous les acteurs se mettent en ordre de marche pour préparer cette nouvelle orientation du développement économique. Reste à convaincre des acteurs économiques, en particulier les distributeurs souvent étroitement liés à des centrales d'achat situées en métropole, de faire le pari d'une croissance pérenne des flux.
À côté du problème général du modèle économique du transport régional, certaines infrastructures de transport ne sont carrément pas à la hauteur des enjeux.
Là encore, la Guyane s'illustre par le fiasco du bac entre Albina et Saint-Laurent-du Maroni. Depuis plus de 10 ans, le remplacement du vieux bac actuel - la Gabrielle - par un nouveau plus grand - le Malani - est un feuilleton qui désespère les populations.
Le dossier du Malani du nom de ce ferry qui doit, un jour, faire le lien entre les deux rives du Maroni, est le contre-exemple d'un projet de coopération bien mené.
La France et le Suriname ont signé une déclaration d'intention le 22 mars 2014 pour la construction d'un nouveau bac à grande capacité assurant la liaison entre Saint-Laurent du Maroni et Albina avec un emport 4 fois plus important, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale de Guyane. Parallèlement, la CTG a obtenu une habilitation officielle afin de négocier un accord intergouvernemental avec le Suriname sur la gestion et l'exploitation du futur bac. Le budget global était estimé à 5 millions d'euros avec un large financement Interreg.
Mauvaise coordination des travaux, mauvaise conception des nouvelles cales, mauvaise identification des besoins et des spécifications du ferry... Lancé en 2012 et largement financé par le programme Interreg, le projet n'est pas opérationnel et le Malani est toujours bloqué à quai.
S'agissant des liaisons aériennes, le constat est identique. Les liaisons intercontinentales, notamment transatlantiques et vers l'Amérique du nord, sont correctes, en dépit des prix toujours jugés trop élevés. Le flux touristique nourrit la demande de siège. Seule la Guyane est très mal desservie, l'activité touristique y étant beaucoup plus modeste.
En revanche, les liaisons intrarégionales demeurent très insuffisantes. Là encore, la difficulté est le modèle économique comme pour le cabotage maritime. Les défaillances de plusieurs compagnies régionales, pas seulement françaises, ont marqué l'actualité économique de la Caraïbe et du plateau des Guyanes ces dernières années.
Par ailleurs, les CFA se retrouvent relativement exclus du maillage aérien infrarégional non français. La COPA Airlines, première compagnie de la zone, n'affiche par exemple aucune liaison directe ou indirecte en direction de ces territoires. De la Martinique, il faut donc jusqu'à une à trois escales pour se rendre dans les petites îles anglophones, excepté Sainte-Lucie, et hollandaises.
Par ailleurs, l'Ambassadeur Arnaud Mentré a rappelé que les compagnies aériennes surinamaises avaient été placées sur la liste noire de l'Union européenne. Cela a entraîné la fermeture de lignes avec la Guyane.
Pour tenter d'impulser une nouvelle dynamique, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a simplifié depuis deux ans la conclusion d'arrangements administratifs avec les pays voisins, alors qu'il fallait auparavant attendre la conclusion d'accords aériens en bonne et due forme. La DGAC vient d'en conclure un avec la Barbade et a signé toutes sortes d'accords avec différents États de la zone. Cela doit faciliter l'ouverture rapide de nouvelles lignes, sous réserve que des compagnies estiment qu'un marché suffisant existe.
Parallèlement à cette initiative étatique, la tenue de la première conférence aérienne Antilles- Guyane le 3 et 4 octobre 2024 à Fort-de-France, censée être reconduite fin octobre 2025 à Cayenne, témoigne de la volonté de dresser une feuille de route régionale, où se dessine comme priorité la stimulation d'une plus grande compétitivité.
L'ouverture de lignes régionales depuis Cayenne, vers le Brésil en particulier, mais aussi de petites lignes vers le Suriname, est le signe d'un frémissement positif. L'enjeu est surtout de créer une demande supplémentaire pour le transport aérien. Cela passe par une politique de visas révisée et la promotion d'un tourisme régional. Les destinations se vendent encore trop isolément, y compris entre les outre-mer français. À cet égard, le plateau des Guyanes, en particulier entre la Guyane et l'Amapa ou le Para, est en train de définir une stratégie touristique partagée pour vendre une expérience amazonienne.
4. La réalité des bassins de vie reste mal appréhendée
Ce constat est particulièrement aigu pour la Guyane et les bassins de vie situés le long des deux fleuves frontaliers.
Des Conseils du fleuve sont en place et servent d'instance consultative. Ils fonctionnent bien et se réunissent régulièrement.
En revanche, la traduction des souhaits et des propositions remontées pêche souvent par lenteur, inertie, voire opposition. Les enjeux de sécurité sont un des principaux freins. La recherche de l'équilibre demeure compliquée, écartelée entre des injonctions contradictoires.
Créé par une déclaration d'intention signée le 14 décembre 2012 entre la France et le Brésil, le Conseil du Fleuve Oyapock (CDF) est une instance consultative paritaire qui réunit deux fois par an les acteurs institutionnels et les acteurs de la société civile du bassin de l'Oyapock, fleuve qui constitue la frontière binationale entre la Guyane française et l'État brésilien d'Amapá.
La délégation française est conduite par le sous-préfet de Saint-Georges tandis que la délégation brésilienne est conduite par le Secrétaire d'État aux relations internationales et au commerce extérieur d'Amapá.
Le Conseil du Fleuve vise à répondre aux besoins quotidiens des populations riveraines des communes de Camopi, Saint-Georges et Ouanary côté français, et d'Oiapoque côté brésilien. Il possède trois objectifs principaux :
- discuter des initiatives en vue de promouvoir le développement harmonieux de la zone transfrontalière ;
- faciliter le dialogue entre les sociétés civiles locales, les Gouvernements locaux et régionaux
- promouvoir le respect de la dignité humaine par des actions de prévention et de sensibilisation.
Mais la formalisation des échanges entre la Guyane et l'Amapá se heurte à la réglementation différenciée de part et d'autre, le Brésil ne faisant pas partie de l'espace européen. Cette question représente le principal défi.
Depuis l'ouverture du pont sur l'Oyapock en 2017, la question des assurances des véhicules demeure non résolue. Les véhicules brésiliens ne peuvent circuler en Guyane. En effet, en l'absence d'accord bilatéral sur les assurances, la France propose aux véhicules entrant sur le territoire l'achat d'une assurance-frontière auprès des douanes, afin de respecter l'obligation d'assurance sur le territoire français. Cette assurance-frontière d'une durée de 1 mois ou 3 mois renouvelable une fois, n'est pas adaptée à une circulation permanente sur un pont ou bien à des séjours touristiques de courte durée. De plus, ses tarifs sont considérés comme trop onéreux et constituent un obstacle de fait à la circulation pour les véhicules brésiliens.
De son côté, le Brésil ne propose aucune solution d'assurance aux véhicules français, l'assurance n'étant pas obligatoire sur le territoire.
La question des visas est centrale. En effet, pour circuler entre le Brésil et la Guyane, un visa est obligatoire pour les ressortissants brésiliens. Il en est de même côté surinamais.
En particulier dans les régions frontalières du Maroni et de l'Oyapock, les obstacles à la libre circulation ou à une circulation facilitée entre les deux rives impactent directement la vie quotidienne de ces populations, au-delà même des objectifs plus lointains de coopération et d'intégration régionales.
Chaque assouplissement ou raidissement est immédiatement ressenti. Le réseau consulaire français, absent des États de l'Amapa et du Para, est mal organisé pour répondre à ce besoin aux confins du Brésil.
Ces difficultés se retrouvent aussi le long du fleuve Maroni. Elles sont encore plus sensibles compte tenu des problèmes de délinquance et de violences à Saint-Laurent du Maroni. Saint-Laurent attire une immigration massive et connaît une croissance démographique exponentielle. L'ouest guyanais, très éloigné de Cayenne, est en train de faire basculer le centre démographique de la Guyane. L'enjeu frontalier y est donc vital pour l'ensemble de la Guyane.
Le réchauffement des relations franco-surinamaise a permis quelquesprogrès (voir supra), mais ils demeurent insuffisants.
Des projets de coopération ont été portés. Mais ils se sont soldés plutôt par des fiascos. Le feuilleton du bac Malani en est l'illustration la plus célèbre (voir supra).
Il faut y ajouter celui aussi de l'hôpital d'Albina, côté surinamais, que la délégation a pu visiter. Financé intégralement par un prêt de 15 millions d'euros de l'AFD (en cours de remboursement), cet hôpital devait permettre de soulager la pression sur le système de santé de Saint-Laurent, en fixant une partie de la demande de soins des Surinamais sur Albina. Simultanément, le nouveau centre hospitalier Ouest Guyanais (CHOG) de Saint-Laurent est sorti de terre avec une offre de soins réhaussée pour les Guyanais.
Le résultat est calamiteux. Terminé en 2015, l'hôpital est vide au sens littéral du terme. La délégation l'a constaté. Le Suriname n'a pas été capable de mettre en place un projet d'établissement en près de 10 années. Le directeur de l'établissement a été remplacé il y a un an. L'objectif est de tenter de relancer le projet. Une expertise a confirmé, fort heureusement, que le bâti était toujours en bon état, malgré 10 années d'abandon. Un projet de remise en état a donc été initié en 2024 avec quelques travaux. À ce jour, une salle est louée pour des dyalises et entre 3 et 4 patients viennent chaque jour pour des consultations auprès des trois jeunes médecins (deux Cubains et un Vénézuélien) en poste (sous réserve que ces professionnels acceptent de rester malgré cette activité dérisoire).
Dans l'attente d'une hypothétique relance de l'hôpital d'Albina, le CHOG de Saint-Laurent accueille jusqu'à 70 % de patients surinamais dans certaines spécialités.
En matière scolaire, Saint-Laurent doit aussi absorber une partie des besoins des habitants d'Albina. En plus de la croissance de la population scolaire de Saint-Laurent, 434 enfants surinamais franchissent chaque matin le Maroni en pirogue pour se rendre dans des établissements scolaires côté français.
Lors de ses entretiens à Paramaribo, notamment avec le président de la République, la délégation a clairement indiqué que ces situations n'étaient plus tenables. La France est consciente de ses responsabilités, mais il est impératif que le Gouvernement surinamais s'engage sur un vrai développement de la région d'Albina, notamment à la faveur du démarrage de l'exploitation pétrolière dans le pays.
Enfin, de nombreux enjeux frontaliers ne sont pas traités, comme la gestion des déchets.
5. L'orpaillage illégal et la pêche illicite : le pillage organisé de la Guyane continue
La coopération régionale, en particulier dans les domaines policier et judiciaire, a fait des progrès importants ces dernières années. Mais elle n'a pas encore suffi à endiguer les narcotrafics ou le trafic d'armes. Les chiffres de saisies de cocaïne dans les eaux françaises ou internationales ou le nombre d'homicides par armes dans chacun des DFA témoignent du contraire.
À ces deux phénomènes communs à tous les outre-mer des Antilles et de la Guyane, deux autres sont spécifiques à la Guyane : l'orpaillage illégal et la pêche illicite.
Le déplacement en Guyane n'a pu que mettre en évidence l'enkystement de l'orpaillage clandestin sur le territoire guyanais.
Avec une centaine de sites miniers, la production d'or déclarée en 2023 a été d'1,1 tonne, stable par rapport à la production déclarée les années précédentes. La production d'or par les activités d'orpaillage illégal est estimée entre 6 et 10 tonnes.
Environ 10 000 garimpeiros, pratiquement tous brésiliens, viennent tenter leur chance sur des chantiers d'orpaillage illégal sur le sol français, considérés comme plus rentables ou moins dangereux. Si le phénomène d'orpaillage illégal provoque des atteintes à l'environnement, il est aussi à l'origine de multiples infractions liées au code minier mais aussi au code pénal, notamment en termes de trafics de biens volés, d'armes, de stupéfiants, d'êtres humains ou d'homicides.
C'est enfin et surtout un drame sanitaire avec la contamination des eaux et des terres par des métaux lourds qui empoisonnent les populations de l'intérieur et des fleuves, en particulier les populations amérindiennes. Les cas de saturnisme et de malformation des nouveau-nés atteignent des taux alarmants dans certaines régions et chez les populations les plus précaires.
La mesure du phénomène demeure difficile. Le projet BIO-PLATEAUX (Pour l'Articulation Transfrontalière de l'Eau et de la Biodiversité), cofinancé par l'Union Européenne au travers du programme Interreg Amazonie, vise précisément à développer le partage de données, informations et expériences sur l'eau et la biodiversité en milieu aquatique entre la Guyane Française, le Brésil et le Suriname, en particulier dans les deux bassins transfrontaliers des fleuves Oyapock et Maroni.
Depuis 2014, la lutte contre l'orpaillage illégal (LCOI) s'est intensifiée. L'opération Harpie, c'est 350 militaires mobilisés 24 heures sur 24 dans la forêt guyanaise.
Lors de sa visite en mars 2024, le Président de la République a annoncé le lancement prochain de l'opération Harpie III, visant à intensifier la lutte contre l'orpaillage illégal et à renforcer la coopération avec le Brésil. De plus, l'or saisi sera désormais vendu et les recettes réinvesties localement pour lutter contre les conséquences de l'orpaillage illégal. Le plan Harpie 3 change d'angle d'attaque. Il ne vise plus seulement les orpailleurs, mais le système derrière lui. Un volet diplomatique et judiciaire est indispensable pour atteindre cet objectif.
Les moyens considérables consacrés à la lutte contre l'orpaillage, sans cesse renouvelés et adaptés, ne parviennent qu'à contenir ou endiguer cette activité, sans la faire refluer dans des proportions décisives.
Un constat similaire peut être fait dans la lutte contre la pêche illicite.
La Guyane dispose d'une vaste zone économique exclusive (ZEE) de 121 746 km qui fait partie intégrante de l'« Europe bleue », la politique commune de la pêche (PCP) de l'UE. À ce titre, la réglementation des pêches et le droit d'accès relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne.
La filière pêche génère 800 emplois directs et près de 2 400 emplois indirects. 420 à 450 marins occupent environ 350 postes de travail embarqués. La pêche fluviale est une activité également répandue dans l'Ouest guyanais, bien qu'elle ne soit pas réglementée en Guyane. En effet, le poisson constitue traditionnellement une importante ressource alimentaire pour les Amérindiens et les Bushinengués.
Mais cette filière est menacée par la pêche illicite pratiquée par les tapouilles brésiliennes et surinamaises, voire guyaniennes.
Les forces armées en Guyane (FAG) sont en première ligne pour faire respecter nos eaux. Les tactiques de lutte ont été musclées : coupe des filets, destruction rapide des bateaux saisis à la pelleteuse...
Mais cela n'emporte pas de résultats décisifs. Lors d'une intervention récente, la Marine a arraisonné un navire en métal, plus moderne que les tapouilles habituelles. Un changement d'échelle est à surveiller. Sur ce bateau, 17 tonnes de poissons ont été trouvées et 600 kg de vessies natatoires d'acoupa rouge, équivalentes à plusieurs tonnes d'acoupas, directement rejetés en mer. Les vessies se vendent 500 dollars le kilogramme et sont destinées au marché chinois.
II. DES FREINS ENCORE IMPORTANTS À LEVER POUR CHANGER DE DIMENSION
Si la coopération régionale dans le bassin Atlantique connaît une montée en puissance indéniable et un changement de rythme dans plusieurs domaines, en particulier la sécurité, elle peine encore à dessiner des stratégies de long terme et à se transformer en une véritable diplomatie territoriale des outre-mer.
La dimension politique manque encore pour enclencher de vrais changements. Surtout, les résultats ne sont pas au rendez-vous dans le domaine économique. C'est là que les principaux efforts doivent porter. L'Europe peut être l'atout maître si la France parvient à l'aiguillonner dans la bonne direction.
A. AFFIRMER ET ACCÉLÉRER UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE DIFFÉRENCIÉE
1. Un espace géopolitique à réinvestir entre la Chine et les États-Unis
Pour Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « les pays des Caraïbes, de l'Amazonie et, plus largement, de l'Amérique du Sud, rejettent la logique des blocs, refusant de choisir entre les États-Unis et la Chine ».
Cette tension géopolitique ouvre un espace pour une troisième voie franco-européenne.
Dr Didacus Jules, directeur général de l'OECO, exprime incidemment son inquiétude face à cette confrontation binaire en soulignant que l'Europe est pour l'OECO « le partenaire de développement le plus durable ». L'adhésion des Antilles francophones à l'OECO, espace anglophone à l'origine, doit être interprétée à cette aune. Ces adhésions permettent de se rapprocher de la France, mais aussi de l'Union européenne à travers elle.
Le relatif retrait américain ces dernières années a dégagé un espace pour la Chine qui a ancré son influence, ses réseaux et ses intérêts dans plusieurs territoires. Le récent retour « en force » des États-Unis n'est toutefois pas de nature à rassurer les acteurs régionaux, compte tenu de la tournure très militaire de celui-ci, dans un contexte de réduction drastique de l'aide au développement américaine. La récente destruction par l'US Navy, sans préavis, de plusieurs bateaux vénézuéliens suspectés de trafic de drogues, a « jeté un froid » dans toute la région, indépendamment de l'objectif partagé de lutte contre les narcotrafics26(*).
Cette volonté de consolidation du lien avec l'Union européenne a été encore renforcée par le Brexit. Beaucoup d'ex-PTOM britanniques, qui pourtant jouissaient déjà d'une forte autonomie par rapport à Londres, ressentent un effritement du lien avec leur métropole.
Inversement, en incluant les territoires caribéens des Pays-Bas, l'Union européenne peut s'appuyer dans cette région sur un nombre important de territoires, sous statut RUP ou PTOM. Cette présence territoriale « européenne », hors de l'Europe, n'a pas d'équivalent dans les autres régions du monde. Encore faut-il que l'Union européenne en prenne conscience (voir infra).
Thani Mohamed Soilihi, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a rappelé lors de son audition que le président de la République avait fait de l'insertion des outre-mer dans leur environnement régional une priorité stratégique.
Cette priorité est louable, mais se situe en deçà de ce qui est nécessaire, à savoir une véritable diplomatie territoriale des outre-mer portée par un réengagement diplomatique fort de la France (et de l'Europe) dans cette région du monde. Pour Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique et promoteur infatigable de l'action extérieure des outre-mer, la coopération régionale est nécessaire, mais insuffisante pour débloquer les verrous puissants qui enserrent le rayonnement régional des outre-mer. Il rappelle à cet égard le voeu ancien de Laurent Fabius, alors ministre chargé des affaires étrangères, en faveur d'une diplomatie territoriale. Sans ce changement de nature, la coopération régionale court le risque de s'enliser dans une succession de projets divers, sans changer de dimension.
La visite d'État du président de la République au Brésil en mars 2024 fut bénéfique pour tracer un nouveau chemin aux relations entre la Guyane et son continent.
En revanche, la région Caraïbe n'a pas encore reçu de message fort de la France, en dépit des nombreux signaux positifs relevés supra (réseau diplomatique renforcé, signature d'accords de coopération dans de nombreux domaines, adhésion de la Martinique à la Caricom...).
La signature de l'adhésion de la Martinique en tant que membre associé à la Caricom, lors du sommet des chefs d'État de la Caricom en février dernier à la Barbade, était l'aboutissement d'un long processus engagé depuis 2012. Ce sommet s'est ouvert en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le Gouvernement français était représenté par le ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux qui a également signé l'accord d'adhésion de la Martinique au nom de la France. L'engagement indéfectible du ministre délégué ne fait aucun doute. Néanmoins, cet événement aurait certainement mérité la présence du ministre des affaires étrangères et de l'Europe.
Cette timidité politique et diplomatique est pourtant bien identifiée.
L'Ambassadeur Arnaud Mentré propose notamment, pour investir l'espace laissé par les États-Unis, de relancer « l'élan des rencontres France-Caraïbes d'il y a une dizaine d'années, et en proposant une nouvelle initiative commune avec la France et l'Union européenne (UE) ».
Sans geste politique fort, il sera également difficile de développer la dimension guyanaise et amazonienne de notre relation avec le Brésil. La visite d'État de mars 2024 précitée est un premier pas important. Arnaud Mentré a récemment rencontré le secrétaire général de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), lors d'un déplacement à Brasilia. Toutefois, les réticences du Brésil restent fortes, privilégiant la relation bilatérale France-Brésil à une approche plus régionale.
Pour faire émerger cette diplomatie territoriale autour et pour les outre-mer, vos rapporteures s'inscrivent dans la continuité des recommandations formulées par le premier volet de la présente étude27(*).
Le renforcement du réseau diplomatique dans la Caraïbe et le plateau des Guyanes ne suffit pas à faire évoluer le cadre conceptuel de notre action extérieure.
Au sein du MEAE, la prise en considération de l'enjeu particulier des outre-mer paraît diluée au sein des directions géographiques ou des directions thématiques. La singularité ultramarine française, unique dans le monde, se reflète peu dans l'organisation du ministère. Seuls les ambassadeurs à la coopération régionale, un par bassin, portent cet enjeu immense, sans être épaulés par des équipes derrière eux. Une lecture optimiste de cet état de fait laisserait penser que l'enjeu ultramarin est naturellement intégré par les directions géographiques et thématiques du MEAE. Si cette lecture est partiellement vraie, elle reste insatisfaisante.
La longue vacance de septembre 2024 à mars 2025 du poste d'ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique n'est pas de nature à rassurer sur la constance et la consistance de la priorité proclamée en faveur de la coopération régionale.
Cette période de vacance plaide plus que jamais en faveur de la création d'un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer ». Celui-ci serait en charge de la continuité et de la cohérence de la diplomatie territoriale des outre-mer au sein de l'action extérieure de la Nation. Il serait placé sous la double tutelle du MEAE et de la DGOM, regrouperait les trois ambassadeurs régionaux à la coopération.
Pour animer et tenir les fils de la coopération régionale entre une multitude d'acteurs, l'ambassadeur délégué doit être doté d'une équipe en capacité de jouer son rôle interministériel en lien avec tous les acteurs des territoires. Ces missions ne peuvent être pleinement assumées, si l'ambassadeur est seul, d'autant plus qu'il est amené à se déplacer régulièrement sur zone. Le regroupement au sein d'un pôle fédérant les expériences et les pratiques communes en matière de coopération régionale garantirait également la continuité de l'action, en cas de vacance provisoire du poste. L'expérience des grands sommets régionaux, par exemple, pourrait être mieux mutualisée au service de l'action des ministres respectifs.
Sans définir le format exact, il est donc impératif de renforcer ses moyens à Paris, en lien avec les préfets et leurs conseillers diplomatiques, les ambassadeurs de la région et les collectivités. Ainsi dimensionné, ce pôle stratégique s'imposerait comme une plateforme diplomatique et interministérielle opérationnelle en lien étroit avec les territoires. Il ne paraît pas nécessaire en revanche de renforcer encore le nombre et les moyens des conseillers diplomatiques auprès des préfets.
Ce pôle ou direction aurait en particulier pour principal objectif d'accompagner et d'épauler la mise en oeuvre des programmes-cadres de coopération régionale approuvés par les collectivités.
Recommandation n° 1 : Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs.
2. Des collectivités qui doivent afficher une stratégie et s'affirmer en chef de file
Si un grand geste diplomatique et politique franco-européen manque sans doute encore, les collectivités françaises d'Amérique pêchent aussi parfois par des stratégies mal affirmées et qui peinent à franchir le cap opérationnel.
Le ressenti de plusieurs auditions est celui d'une multiplication de projets, mais qui ne sont pas toujours orientés vers des objectifs clairs et une stratégie de long terme, tout particulièrement dans le domaine économique et de la mobilité. Les projets peinent à faire bouger les lignes au service de stratégies de développement concertées.
La Martinique est toutefois en pointe, en particulier depuis son adhésion à la Caricom. Cette adhésion s'inscrit dans le droit fil du programme-cadre de coopération régionale adopté par l'Assemblée de Martinique en mars 2023. Le président Serge Letchimy a fait de son adoption un acte fondateur d'une nouvelle diplomatie territoriale portée et conduite par le territoire.
Ce programme-cadre prévoit entre autres la signature d'accords ciblés pour ouvrir le marché de Sainte-Lucie, et potentiellement derrière elle les marchés de l'OECO et de la Caricom, aux exportations de la Martinique sur une quinzaine de produits bien ciblés.
Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais l'expérimentation est en cours et tente de faire bouger les lignes.
Le premier volet de la présente étude sur la coopération régionale avait déjà souligné l'importance pour les collectivités ultramarines de se saisir pleinement de l'outil des programmes-cadres.
La délégation ne peut que réitérer cette recommandation majeure.
Pour rappel, le cadre légal de la coopération régionale a été forgé par des lois successives, dont la loi « Letchimy » du 5 décembre 2016. Ce cadre crée quelques obligations pour l'État et offre des outils importants aux collectivités ultramarines. Or, le constat est d'abord celui d'une application a minima de la loi. Malgré des lacunes ou des abstentions de faire, les travaux de la délégation ne font pas ressortir, à cadre constitutionnel constant, la nécessité de modifier le cadre légal en vigueur relatif à la coopération régionale.
Le changement des pratiques et des méthodes de travail paraît être une piste plus prometteuse dans le prolongement du Ciom. À cet égard, l'outil le plus prometteur est le programme-cadre (article L. 4433-4-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)), qui fut la principale novation de la loi « Letchimy ».
L'adoption d'un programme-cadre par toutes les collectivités - la Martinique est la seule à s'en être saisie à ce jour devrait être une priorité. En terme politique, le programme-cadre permet d'afficher une stratégie de long terme, concertée avec l'État. Il renforce à la fois la légitimité interne - vis-à-vis de l'État et de la société civile - et externe - vis-à-vis des États voisins. En terme opérationnel, il évite aux collectivités d'avoir à solliciter, au coup par coup, des autorisations de l'État toujours longues à obtenir pour conclure des accords avec des États tiers.
La première étape consisterait pour les collectivités à élaborer ou mettre à jour leur stratégie de coopération régionale. Cette démarche coïnciderait avec les mesures 9 et 54 du Ciom. Mayotte dispose d'un document stratégique depuis 2017 qui mériterait d'être actualisé.
Une fois cette stratégie arrêtée, un programme-cadre serait sollicité dans un ou des domaines déterminés pour négocier et signer, au nom de l'État, les accords internationaux nécessaires. Ce document consacre aussi une répartition des rôles et des priorités entre l'État et les collectivités, le programme-cadre pouvant s'apparenter à un mandat donné par l'État pour déployer une activité diplomatique en son nom dans des domaines prédéfinis.
Pour réussir, la mise en oeuvre des programmes-cadres doit se faire sous la responsabilité de la collectivité, mais avec le soutien ou le concours de l'État qui a approuvé le programme en amont. Le programme-cadre doit amener l'État à se mettre au service de la stratégie et des actions conduites par la collectivité. Ce devrait être un des objectifs du « Pôle stratégique », sous double tutelle MEAE et DGOM, prévu par la recommandation n° 1.
Ces deux conditions doivent être réunies simultanément.
Serge Letchimy a par exemple regretté l'absence d'appui de l'État dans ses démarches pour conclure un contrat de coopération avec l'État du Para au Brésil. Un appui diplomatique de concert manque.
En revanche, aucune autre collectivité ne s'est dotée d'un tel programme-cadre. Certes, elles sont toutes dotées d'un Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ou d'un document équivalent. Mais ces documents de pure orientation ne donnent pas de facultés pour agir ou de prérogatives particulières. Ils n'engagent pas non plus l'État de la même manière qu'un programme-cadre.
Recommandation n° 2 : Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités.
Cette montée en responsabilité des collectivités, en qualité de chef de file ou de partenaire, doit aussi se traduire dans les instances de coopération bilatérale.
Cette critique a notamment été entendue en Guyane à propos des relations avec le Brésil. Le conseil des fleuves se réunit fréquemment et fait remonter des problèmes ou propositions. La commission mixte transfrontalière (CMT) franco-brésilienne met certains d'entre eux à son ordre du jour. La collectivité territoriale de Guyane (CTG) est de facto étroitement associée à la préparation de la CMT et y participe. Toutefois, ce rôle de la CTG au sein de la CMT mériterait d'être formalisé. Lors de son audition, Thani Mohamed Soilihi a indiqué qu'une révision de l'accord intergouvernemental du 28 mai 1996 était nécessaire et s'y est déclaré favorable sous réserve de l'accord des autorités brésiliennes.
3. Mieux tirer parti des organisations régionales
Les organisations régionales dans la Caraïbe et en Amérique du Sud sont nombreuses et se superposent souvent. Leurs domaines d'action également. À l'inverse, certains sont très spécialisés.
Cette diversité oblige à faire des choix et à cibler les organisations présentant le meilleur « retour sur investissement ».
Un travail intéressant est celui fait par le CESCE de Saint-Barthélemy dans un récent rapport de septembre 2025 intitulé « Saint-Barthélemy a-t-il intérêt à rejoindre des associations régionales ? »28(*). Ce rapport procède à une analyse coûts-avantages de l'adhésion à quinze organisations intergouvernementales ou associations sectorielles. Sur 15, seules 6 ont été identifiées comme méritant une adhésion prochaine. Il s'agit essentiellement d'associations sectorielles spécialisées. Cette approche ciblée et pragmatique prend en considération les capacités administratives limitées d'un petit territoire comme Saint-Barthélemy.
Cette approche pourrait être reprise par les autres territoires qui ont souvent le sentiment d'appartenir à des organisations, souvent en qualité de simple membre associé, mais sans peser réellement. Cette position de spectateur, plutôt qu'acteur, alimente des frustrations plus qu'elle n'ouvre des perspectives.
À côté de cette revue des organisations et associations régionales, le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) a été réclamé par les territoires et approuvé par le Gouvernement lors du Comité interministériel des Outre-mer (Ciom) de juillet 2023.
La France fut autrefois membre non emprunteur de la BDC, de 1984 à 2000. Son retrait est venu du constat que ses intérêts économiques, notamment les retombées pour les entreprises françaises, étaient insuffisamment pris en compte, et que l'impact de la Banque sur la réduction de la pauvreté, en particulier à Haïti, restait limité. La France estimait également que la BDC contribuait peu à l'intégration régionale des territoires français du bassin. Depuis, une participation indirecte de la France s'est néanmoins maintenue par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), qui a octroyé une ligne de crédit de 33 millions d'euros en 2013.
Cependant, plusieurs facteurs et évolutions récentes plaident aujourd'hui en faveur d'une ré-adhésion de la France, mise à l'ordre du jour par le Ciom de juillet 2023. Le retour au capital renforcerait la crédibilité et la présence stratégique de la France dans la région caribéenne, actuellement sujette à la montée des intérêts de la Chine. Il permettrait également de favoriser le développement endogène et l'intégration régionale de la Martinique et la Guadeloupe, qui pourraient candidater en tant que membres à part entière de la BDC conformément aux dispositions prévues par la loi dite « Letchimy » de 2016. Ce retour, dont les modalités sont néanmoins floues, offrirait des opportunités économiques concrètes, comme un accès aux appels d'offres de la Banque, une meilleure visibilité des entreprises françaises dans les projets régionaux et un ancrage plus important dans un marché de près de 40 millions d'habitants.
La Banque de développement des Caraïbes
Créée en 1970 dans la continuité d'une conférence entre les États membres du Commonwealth dans la Caraïbe et le Canada, la Banque de développement des Caraïbes (BDC) a été instituée pour soutenir la coopération régionale en favorisant une croissance harmonieuse qui réduit les inégalités de développement entre les territoires. Son siège est à la Barbade.
La BDC est une institution financière multilatérale, fondée par des États souverains, à la fois bénéficiaires de financements dans les secteurs public et privé, mais aussi de conseils stratégiques et d'assistance technique. Elle compte aujourd'hui 19 membres emprunteurs, majoritairement des États et territoires anglophones issus de processus de décolonisation. Elle couvre en particulier l'intégralité des pays membres de la Caricom. Leurs intérêts sont représentés au sein du Conseil des gouverneurs, organe suprême de décision qui compte un mandataire par État. Le Conseil se charge de désigner un président à la tête de la Banque, responsable du suivi opérationnel avec l'appui d'un Conseil d'administration. À ces membres bénéficiaires s'ajoutent des membres non emprunteurs, tels que le Canada, le Royaume-Uni, la Chine ou encore l'Allemagne, qui apportent des contributions financières significatives. Ils détiennent ensemble 44,74 % des droits de vote, ce qui leur confère un poids décisionnel non négligeable sur l'orientation stratégique de l'institution.
Au 31 décembre 2023, l'actif total de la BDC se montait à 3,43 milliards de dollars répartis comme suit : ressources en capital ordinaires (2,03 milliards de dollars) et fonds spéciaux (1,40 milliard de dollars). La BDC est notée Aa1 (perspectives stables) par Moody's, AA+ (perspectives stables) par Standard & Poor's et AA+ (perspectives stables) par Fitch.
Dès sa création, la BDC s'est insérée dans un réseau international de partenaires de développement. Elle a bénéficié d'un appui technique et institutionnel de la part d'organisations comme la Banque mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) ou encore le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Pour atteindre ses objectifs de convergence économique, elle intervient dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie durable et la protection sociale. La Banque mobilise pour cela divers instruments financiers : prêts concessionnels, subventions et garanties. En 2024, d'après son dernier rapport d'activité, la BDC a investi 303,5 millions de dollars, dont 245,8 millions sous forme de prêts et 66,5 millions en subventions. Parmi ses actions notables, elle co-finance des infrastructures d'envergure régionale, à l'image de la première centrale géothermique de la Caricom située en Dominique, le coût du projet étant évalué à 68,3 millions de dollars. Ses liens sont multiples avec les organisations de coopération régionale auprès desquelles elle incarne un acteur clé, contribuant à piloter des initiatives structurantes. C'est le cas du programme d'évaluation renforcée de la pauvreté (eCPA), développé avec l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO). Elle joue également un rôle d'amortisseur lors des crises. Face à la pandémie de Covid-19, conjointement à la Banque Européenne d'Investissement, elle est venue en renfort en destinant 30 millions d'euros destinés aux systèmes de santé des pays membres.
Outre les financements, l'un des volets essentiels de l'action de la BDC consiste à fournir des conseils stratégiques et un appui à la gestion macroéconomique de ses membres. À titre d'exemple, elle a récemment soutenu la rédaction d'un projet de loi sur les marchés publics au Belize, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2025.
Source : Délégation sénatoriale aux outre-mer (DSOM)
Toutefois, cette annonce forte du Ciom peine à se concrétiser. Deux ans après ce comité interministériel, rien ou presque ne s'est passé. Lors de son audition, Arnaud Mentré a reconnu l'urgence de ce dossier qui paraît délaissé à maints égards. Il a précisé qu'en mars-avril 2025, la concertation interministérielle a été réactivée, afin qu'une lettre signée par les trois ministres - affaires étrangères, économie, francophonie et partenariats internationaux - soit adressée dans les meilleurs délais au secrétariat de la BDC, afin d'acter le souhait de réintégrer le capital et de commencer des négociations en vue d'un accord. La délégation regrette cette lenteur extrême qui ne présage pas d'un retour à court terme au capital de la BDC qui serait pourtant un marqueur fort du réinvestissement de la France dans cette région clé pour ses territoires.
Recommandation n° 3 : Accélérer le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, après deux années perdues depuis les annonces du Ciom 2023.
Un autre exemple de l'inertie à faire avancer la coopération régionale est le dossier de l'adhésion de la Martinique à la Caricom.
En février 2025, la Martinique a rejoint l'organisation en tant que membre associé lors du sommet de la Barbade. Thani Mohamed Soilihi, alors ministre délégué à la Francophonie et aux Partenariats internationaux, a participé aux travaux de la 48e réunion régulière des chefs de Gouvernement de la Commission de la Caraïbe (Caricom) au cours de laquelle il a signé un accord bilatéral d'accession de la France au Protocole de la Caricom sur les privilèges et immunités datant du 14 janvier 1985.
La ratification de cet accord par le Parlement est la dernière étape qui permettra l'entrée en vigueur de l'autre texte signé le même jour au nom de la République française par Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Martinique, portant sur l'adhésion en tant que membre associé de la Martinique à la Caricom.
Malheureusement, le projet de loi de ratification n'a toujours pas été déposé sur le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le 8 juillet 2025, dans un courrier officiel, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait annoncé que « le projet de loi d'approbation de l'accord relatif aux privilèges et immunités signé avec la Caricom » serait transmis au Parlement dès septembre. L'actualité politique ne l'a pas encore permis.
Lancé en 2012, le processus d'adhésion de la Martinique depuis les premières demandes est donc sur le point d'aboutir... au bout de 13 ans. Lors de son audition, Serge Letchimy se réjouissait de cette étape historique, aboutissement d'un long combat, tout en en faisant l'illustration des difficultés extrêmes pour concevoir et déployer une diplomatie territoriale des outre-mer performante : « Quand l'État met 12 ans pour que nous devenions seulement membre associé, c'est ingérable ».
Le prochain chantier sera celui de l'adhésion de la Guyane à la Caricom, dans les traces de la Martinique. La collectivité territoriale de Guyane a confirmé à Arnaud Mentré qu'elle en fait une priorité. Une lettre du ministre de l'Europe et des affaires étrangères a réaffirmé le souhait de voir la Guyane, comme les autres collectivités françaises d'Amérique (CFA), devenir membre associé de la Caricom. Il faut souhaiter que le travail précurseur de la Martinique permette d'aboutir dans des délais raisonnables.
Recommandation n° 4 : Déposer en urgence le projet de loi portant ratification de la convention sur les privilèges et les immunités, afin d'entériner l'adhésion de la Martinique à la Caricom.
Enfin, un problème ponctuel, mais important a été soulevé par Louis Mussington, président du Conseil territorial de Saint-Martin. Lors de son audition, il a indiqué que « l'action extérieure et la coopération décentralisée sont reconnues dans le cadre de la loi organique de Saint-Martin, mais demeure sujet à interprétation tantôt favorable, tantôt défavorable par le service juridique de la préfecture. Très récemment, le droit d'exercer une coopération décentralisée a été déclaré « inexistant » pour Saint-Martin ».
Le service juridique de la préfecture de Saint-Martin a présenté un argumentaire catégorique affirmant « l'inapplicabilité des dispositions en matière de coopération décentralisée » à la collectivité de Saint-Martin. La préfecture base son approche sur l'article L. 6313-7 du CGCT relatif aux dispositions applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à l'action extérieure [dispositions générales, Livre 1, chapitre 5, Action extérieure des collectivités territoriales (articles L. 1115-1 à L. 1115-7)] ont été, en effet, exclues par l'article L. 6313-7.
En conséquence, le détachement à Sainte-Lucie de l'agent en charge de la diplomatie territoriale auprès de l'OECO, à laquelle Saint-Martin vient précisément d'adhérer, a été rejeté par la préfecture.
Toutefois, les dispositions organiques applicables à Saint-Martin, en particulier les LO. 6352-15 à LO. 6352-19 du même code, reconnaissent des compétences importantes à la collectivité, qui est dotée de l'autonomie au sens de la Constitution et de la loi organique.
En tout état de cause, il y a un paradoxe incontestable à autoriser l'adhésion à une organisation intergouvernementale et, dans le même temps, de refuser d'y être représenté par un agent.
Cette interprétation par la préfecture de Saint-Martin doit faire l'objet d'une clarification rapide. Comme le permet le statut de Saint-Martin, une saisine du tribunal administratif pour avis sur l'interprétation de la loi organique serait judicieuse, avant d'envisager si nécessaire une modification de la loi organique pour lever tout doute. Cet avis vaudrait aussi pour Saint-Barthélemy qui est régie par des dispositions similaires.
Recommandation n° 5 : Clarifier l'applicabilité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'action extérieure, en saisissant pour avis le tribunal administratif et en complétant la loi organique si nécessaire.
4. Inscrire les outre-mer aux agendas France-Chine et UE-Chine
Comme vu supra, la Chine et les intérêts chinois dans la région sont de plus en plus présents depuis plusieurs années. Le phénomène est massif et s'accélère de l'avis de tous les observateurs dans un grand nombre de territoires de la Caraïbe, y compris des voisins immédiats des outre-mer (la Dominique, Suriname...).
Les réponses de la France et de l'Union européenne à cette tendance inquiétante pour les intérêts de nos outre-mer doivent passer par un réinvestissement de la région à la faveur de l'espace politique ouvert entre la Chine et les États-Unis, comme vu supra.
Toutefois, de manière plus ciblée, la délégation juge que deux dossiers méritent d'être directement inscrits à l'ordre du jour de la relation bilatérale France-Chine, ainsi que des relations avec l'Union européenne : l'orpaillage illégal en Guyane et la pêche illicite dans les eaux guyanaises.
Ces deux phénomènes pillent les richesses de la Guyane, détruisent son patrimoine naturel et empoisonnent les populations. Or, les intérêts chinois les alimentent et les encouragent directement.
L'infrastructure de l'orpaillage illégal au Suriname et en Guyane, ainsi que les filières d'achat et d'export de cet or sont majoritairement soutenus par des intérêts chinois. De même, une part importante de la pêche illicite dans les eaux guyanaises répond directement à la demande du marché chinois, en particulier la pêche des vessies natatoires de l'acoupa rouge.
Les actions conduites par la France depuis plus de 20 ans permettent au mieux de contenir ces activités clandestines, mais au prix de moyens humains et matériels toujours plus importants, et parfois du sang de nos militaires.
Arnaud Mentré, ambassadeur à la coopération régionale, a mis en avant les efforts récents portés sur des études académiques menées par l'intermédiaire de centres de recherche comme la Fondation pour la recherche stratégique. Celle-ci a élaboré un rapport public qui commence à nommer les choses, notamment les approvisionnements en mercure dans les zones concernées, l'absence de traçabilité sur le suivi du mercure et les exportations d'or. Pour Arnaud Mentré, « l'ambassade de Chine à Paris lit absolument tout ce qui concerne son pays ; les autorités chinoises savent donc que le sujet commence à être dans le viseur des autorités françaises. C'est une première manière de leur signifier que quelque chose doit être fait ; cela permet également de documenter précisément la situation ».
Cette approche graduelle et implicite était sans doute un préalable nécessaire. Mais face à l'urgence en Guyane et la dramatique ancienneté de ce pillage organisé, la tactique des petits pas doit monter en cadence et impliquer l'Union européenne. À cet égard, on rappellera que la pêche en Guyane est régie par la politique commune de la pêche.
Recommandation n° 6 : Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises.
5. Parfaire la coopération en matière de sécurité et de justice
Les progrès accomplis dans ces deux matières au cours des dernières années ont été importants avec des résultats opérationnels.
Cette dynamique doit être poursuivie et tous les fruits des récents investissements (signature de convention, créations de postes de magistrats de liaison, d'attaché de défense ou de sécurité intérieure) n'ont pas encore été récoltés. Elle doit s'inscrire dans la durée.
C'est la raison pour laquelle, à côté de ces avancées ponctuelles de la coopération, le besoin d'une initiative politique d'ampleur régionale a été exprimé à plusieurs reprises.
Pour Serge Letchimy, la France et l'Union européenne ont réagi trop tardivement à la vague des narcotrafics. Des mesures à la hauteur du cataclysme commencent seulement à être mises en oeuvre pour que la Martinique, ainsi que les autres collectivités françaises d'Amérique, cessent d'être les victimes de leur appartenance à l'Union européenne sur la route de la drogue.
Face à ce défi qui concerne l'ensemble de la région, l'idée d'une Conférence régionale de sécurité suit son chemin. Arnaud Mentré a indiqué réfléchir aux modalités concrètes de sa mise en oeuvre : son format, les partenaires à associer, etc. Politiquement, dans le cadre de sa visite officielle en Martinique en août 2025 et en réponse à Serge Letchimy, Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, s'était engagé dans une conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe. Ce sommet, qui pourrait également associer certains pays européens « avancés » dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et d'armes, devrait permettre la mobilisation de moyens internationaux plus importants permettant de mettre un terme à l'essor des trafics illicites entre la Caraïbe, les Amériques et l'Europe.
Il faut espérer que l'engagement pris tienne malgré les changements ministériels. Cette conférence donnerait un coup d'accélérateur aux projets de coopération engagés.
Cet événement serait l'occasion de lancer des projets structurants, notamment la création d'une Académie régionale de la sécurité à l'initiative de la France et de l'Europe. Ce projet d'Académie serait le pendant de l'Académie de l'océan Indien, annoncée le 24 avril 2025 par le président de la République lors du Sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. La concrétisation de cette académie satisfait directement à l'une des recommandations du premier volet de la présente étude.
Extrait du rapport n° 763 (2023-2024)
...La multiplication des projets dans les domaines de la sécurité maritime, de la sécurité civile ou de la sécurité atteint désormais une masse critique.
Les synergies possibles ont fait émerger l'idée de créer une Académie de sécurité qui fédérerait notamment ces réalisations et projets. Bien que cela ne relève pas des compétences de la région, la région Réunion souhaite mobiliser des financements NDICI (instrument de financement de l'Union européenne pour la coopération extérieure) et Interreg (projet de coopération entre différents partenaires d'États membres de l'Union européenne) pour appuyer ces structures. Un partenariat État-Région s'est mis en place pour ce projet. Dans un premier temps, la priorité serait donnée aux questions de sécurité et de sûreté maritimes. La dimension judiciaire pourrait s'y greffer dans un second temps, au service de la coopération judiciaire à construire.
La création d'une Académie de la sécurité de l'océan Indien permettrait de faire faire un saut qualitatif important au rayonnement régional de la France et de La Réunion sur l'ensemble des sujets régaliens, tout en apportant une plus-value majeure pour la stabilité de la zone et en contribuant à la montée en compétences des autres pays.
Ce projet recevrait à ce stade le soutien de la Commission européenne ainsi que du Service européen d'action extérieure (SEAE), avec un double financement NDICI et Interreg.
Le soutien au projet d'Académie de la sécurité de l'océan Indien est une priorité...
Dans le contexte de la Caraïbe, une Académie de la sécurité pourrait agréger et pérenniser les acquis de plusieurs initiatives en cours ou achevées, notamment les programmes ALCORCA et EL PAcCTO (voir supra).
Recommandation n° 7 : Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France.
6. Désenclaver la Guyane et réussir la cogestion des bassins de vie le long des fleuves
Si les relations bilatérales avec le Suriname et le Brésil se sont améliorées, elles restent très perfectibles comme vu supra.
Deux objectifs potentiellement contradictoires doivent être pris en compte : désenclaver la Guyane et faciliter la vie des habitants le long des fleuves, d'une part, et contrôler les flux pour garantir la sécurité des biens et des personnes, d'autre part.
Coté Suriname, la non-reconnaissance de la frontière reste l'irritant majeur qui bloque des avancées.
Les membres de la délégation sénatoriale ont marqué leur incompréhension face à la non-ratification par le Suriname du protocole du 15 mars 2021 sur la reconnaissance de la frontière. Le Suriname est l'un des rares pays avec lequel la France n'a pas d'accord frontalier sur la délimitation de la frontière. Une telle ratification dégripperait le développement des relations bilatérales.
Lors du déplacement à Paramaribo, le député Rabin Parmessar (parti NDP, opposition à l'époque et parti au pouvoir depuis les élections du 25 mai dernier) a présenté aux membres de la délégation des « excuses au nom du parlement surinamais » pour la non-ratification du traité et a indiqué que ce dossier constituerait une priorité de la nouvelle majorité.
Les élections législatives de mai 2025 ont en effet porté au pouvoir l'opposition traditionnellement plus hostile à la coopération avec la France. Toutefois, à l'occasion des cérémonies du 14 juillet, l'ambassadeur de France avait convié le président sortant Chan Santokhi et sa successeure Jennifer Geerlings-Simons, la passation de pouvoir devant avoir lieu le 16 juillet.
Son excellence Nicolas de Bouillane de Lacoste a saisi cette opportunité pour évoquer devant les deux présidents la priorité pour la France de voir ce traité enfin ratifié par le Suriname quatre ans après sa signature.
Remerciant la France, qualifiée de partenaire de confiance, Chan Santokhi s'est dit « confiant que, sous le mandat de son successeur, la présidente élue Jennifer Geerlings-Simons, la coopération avec la France se poursuivra ». Les prochains mois diront si la dynamique demeure favorable.
Pour lever les réticences politiques côté surinamais et répondre à une demande des populations du fleuve, des suites positives pourraient être données à la demande régulière de création d'une carte de circulation transfrontalière. Cette carte serait inspirée de celle en place le long du fleuve Oyapock à la frontière avec le Brésil. Elle permet d'offrir un cadre légal et régulé aux échanges quotidiens pour les populations riveraines. L'obligation de visa serait levée pour les titulaires de la carte. Un volet commercial pourrait aussi y être inclus. Cette proposition recueille le soutien des autorités locales et des acteurs économiques.
Conjointement à la ratification du traité, la coopération policière et judiciaire serait renforcée.
Côté français, il est urgent d'accélérer la ratification du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname. Cette fois-ci, c'est la France qui accuse un retard coupable. Cette convention a en effet été signée en mars 2021 et a fait l'objet d'un avenant en juin 2023. Ce projet de loi a été adopté en première lecture en juin dernier. Son adoption définitive attend encore son examen par l'Assemblée nationale. Si l'actualité gouvernementale et le calendrier parlementaire le permettent, une adoption avant la fin de l'année est donc possible.
Enfin, toujours par symétrie avec la gestion de la frontière avec le Brésil, la création d'un Centre de coopération policière (CCP) ancrerait la nette amélioration de la coopération entre les forces de sécurité françaises et surinamaises.
Recommandation n° 8 : Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière, en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock.
Sur l'autre frontière avec le Brésil et l'État de l'Amapa, la question de la circulation des personnes et des marchandises est aussi centrale. Le potentiel d'échanges et d'intégration est brimé. La coopération qui devrait être naturelle ne parvient pas à vivre, en particulier depuis que le pont sur l'Oyapock a été ouvert à la circulation.
L'obligation de visas demeure mal comprise. Les demandes sont compliquées en l'absence de consulat dans les États de l'Amapa et du Para. Cet obstacle est d'autant plus mal ressenti par les autorités brésiliennes que le visa n'est pas requis pour les voyages entre le Brésil et l'Hexagone.
Une solution pourrait être de remplacer l'obligation de visa par un système de pré-déclaration obligatoire, sur le modèle de l'ESTA américain (système électronique d'autorisation de voyage) ou de l'ETIAS européen (système européen d'information et d'autorisation de voyage). Cette solution permettrait de contrôler les flux entrants et sortants sans les dissuader par des démarches administratives à l'efficacité relative compte tenu de la perméabilité des frontières naturelles. À défaut, il conviendrait de rendre possible la délivrance de visas à Macapa, la capitale de l'Amapa.
Parallèlement, la carte de circulation transfrontalière, qui dispense ses titulaires de visas, pourrait être aussi revue. À ce jour, elle n'autorise que le transport d'un nombre limité de produits de subsistance à titre non-commercial. L'accord du 30 juillet 2014 prévoit en effet l'instauration d'un régime spécial exonérant de taxes les seuls biens de subsistance entre les résidents des deux communes. Afin de dynamiser les échanges, cette liste serait revue et ouverte à des échanges commerciaux.
Pour Filip Van den Bossche, vice-président de la CCI Guyane et de la commission transfrontalière et coopération régionale, il est urgent d'aller plus loin. L'étude de juillet 2025 du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane29(*) va dans le même sens en appelant à l'instauration d'une zone de libre-échange Oiapoque - Saint-Georges pour bénéficier des répercussions de la dynamique actuelle de développement économique du Gouvernement de l'Amapa. Coté Oiapoque, un projet d'installation d'une zone commerciale duty free est en cours ou encore la mise à disposition de concessions pour l'aménagement forestier aux entreprises qui souhaitent développer des activités durables telles que la transformation du wassaï et de la biomasse.
Pour Filip Van den Bossche, des opportunités sont à saisir pour profiter de la croissance de Oiapoque. La commune de Saint-Georges pourrait accueillir des activités de transformation en vue d'une distribution vers le reste de la Guyane.
Recommandation n° 9 : Réexaminer l'obligation de visa entre le Brésil et la Guyane en lui substituant un mécanisme inspiré du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) européen, et élargir la liste de produits ouverts au libre commerce entre les deux rives du fleuve, voire entre les deux territoires.
7. La Guadeloupe et la Martinique : cap sur le développement économique
Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les régions ont perdu la clause de compétence générale et se sont vues confier la définition des orientations en matière de développement économique. Les termes de l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales sont clairs : « La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique ».
À ce titre, elle élabore un « schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation » (SRDEII). L'article L. 4251-13 du même code précise que « ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. [...] Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes ».
À ce titre, les régions ultramarines devraient avoir la main, ou du moins fixer le cap de leur politique commerciale.
Au coeur de l'arc antillais, la Guadeloupe et la Martinique ont une opportunité de s'affirmer comme des hubs régionaux avec le développement de leurs activités portuaires de transbordement.
Forte de son programme-cadre de coopération régionale approuvé par l'État, la Martinique veut déployer une diplomatie économique pour diversifier ses approvisionnements et débouchés sur quelques produits identifiés. Des accords avec Sainte-Lucie doivent identifier une quinzaine de produits bénéficiant de conditions d'échanges privilégiées. Des contacts ont également été pris avec l'État du Para au Brésil pour importer des productions agricoles. L'objectif à terme serait de créer des activités de transformation agroalimentaire en Martinique, avant réexportation dans la région ou vers l'Union européenne. La Martinique peut jouer la carte de porte d'entrée vers l'Europe continentale.
La Guadeloupe a un positionnement similaire, même si sa diplomatie économique est plus discrète et son engagement dans les organisations régionales plus prudent.
Sur ce volet du commerce extérieur, l'État doit renoncer à piloter et se mettre au service des stratégies régionales, d'autant plus que les territoires ont la maîtrise de l'outil fiscal de l'octroi de mer.
Contrairement à ce que prévoit la mesure 9 du Ciom de juillet 2023, il ne devrait pas revenir à l'État d'élaborer des stratégies commerciales par bassin. Cette mission devrait incomber aux territoires avec l'accompagnement de l'État.
Au niveau européen, la négociation et le suivi des accords des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont un autre irritant majeur pour les collectivités françaises d'Amérique. Directement voisines d'États ACP, elles ne sont pas associées ou même informées des discussions entre l'Union européenne et ces pays.
Le volet 1 de la présente étude relevait déjà que les outre-mer sont absents du processus décisionnel européen. Les négociations ACP-UE n'intègrent pas un groupe de travail RUP. Pourtant, la Conférence des présidents des RUP plaide depuis de nombreuses années en ce sens, en particulier depuis les premiers accords de partenariat économique (APE) en 2000. Une résolution du Parlement européen en 2021 demandait à la Commission européenne de « s'assurer que les RUP bénéficient pleinement des accords internationaux (APE), accords de libre-échange (ALE), etc., conclus entre l'Union et les pays tiers en créant une task force « Conséquences de la politique commerciale sur les RUP » qui associerait de manière effective les RUP, y compris les représentants des filières des RUP ».
La délégation ne peut que réitérer ses recommandations à savoir :
- faire des régions Guadeloupe et Martinique les chefs de file de leur développement économique et de leur stratégie commerciale extérieure, l'État devant se positionner en soutien et non en pilote ;
- impliquer directement les RUP dans les négociations avec les pays ACP, en rendant obligatoires les études d'impact des projets d'accords commerciaux sur les RUP et en les y associant dès l'ouverture des négociations ;
- organiser au moins deux fois par an une réunion de suivi entre les autorités des RUP, des représentants des filières économiques, l'État et la Commission européenne à haut-niveau.
8. Les trois « Saints » : des enjeux très hétérogènes
a) Saint-Martin : encore tant à faire avec sa moitié soeur
Des coopérations existent avec Sint Maarten. Comme l'a rappelé Annick Petrus, sénatrice de Saint-Martin, il existe déjà des coopérations transfrontalières concrètes, notamment pour la gestion partagée du radar météo ou pour des actions communes en matière de santé ou de sécurité civile.
Mais tous les observateurs s'accordent sur le point que cette coopération reste anecdotique au regard de son potentiel.
Le cadre institutionnel d'une telle coopération reste à construire pour surmonter les problèmes de normes et de statuts.
Dans le cadre d'un précédent rapport de la délégation sur l'évolution institutionnelle des outre-mer30(*), Alex Richards, conseiller spécial du président du Conseil territorial de Saint-Martin, avait mis en avant les perspectives prometteuses d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) pour gérer les affaires d'intérêt partagé entre les deux parties de l'île. Il rappelait que « Saint-Martin est le seul cas de coexistence sur un territoire de deux régimes européens différents sans démarcation ni contrôle précis. Comment améliorer une telle situation ? Il serait judicieux de s'intéresser à la possibilité offerte par le droit européen de créer un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT), qui réunirait des représentants de la partie française et des représentants de la partie hollandaise pour gérer les problématiques communes à l'ensemble du territoire ».
Il avait indiqué que Saint-Martin formaliserait auprès de l'État une demande d'accompagnement auprès de Bruxelles afin d'en étudier la faisabilité31(*). Sur 2014-2020, l'Union européenne avait débloqué à titre exceptionnel un programme opérationnel de coopération territoriale (POCTE), accompagné d'une enveloppe de 10 millions d'euros, afin de porter des projets conjoints aux deux parties de l'île. Néanmoins, cet outil n'a pas fonctionné correctement et est devenu désormais le sous-programme du programme Interreg Caraïbes géré par la Région Guadeloupe.
La solution avant-gardiste et innovante d'un GECT restait donc à explorer, car il offrirait un cadre pérenne de gouvernance partagée.
Près de trois ans plus tard, le dossier a peu avancé, mais conserve toute sa pertinence. La collectivité de Saint-Martin a confirmé à la délégation son intérêt pour la formule du GECT et sa volonté de faire franchir un cap à la coopération transfrontalière.
En premier lieu, Saint-Martin a élaboré une stratégie territoriale de coopération transfrontalière. Ce document demeure à ce jour un document technique en attente d'une approbation politique. Techniquement, il identifie 45 objectifs stratégiques entre les deux Saint-Martin. Par exemple, des objectifs stratégiques ont été identifiés sur l'eau : assainissement, approvisionnement, résilience climatique, gestion institutionnelle...
En matière de gouvernance, un comité de pilotage de la stratégie transfrontalière et un comité technique pourraient respectivement définir les orientations stratégiques et assurer la supervision. Un comité plus opérationnel serait chargé de la mise en oeuvre.
Le format juridique définitif de la coopération demeure un enjeu. Au niveau politique, les deux Saint-Martin ont déjà réaffirmé leur volonté d'établir une entité légale favorisant la coopération transfrontalière entre les deux territoires.
Le statut de GECT paraît toujours le plus intéressant, mais avec des limites à lever et des améliorations à apporter.
La part de financement hors fonds européens peut être limitée par l'État membre.
Il convient aussi d'analyser les dispositions de la loi relative au GECT aux Pays-Bas. En effet, en France, selon les services de la collectivité de Saint-Martin, la loi nº 2008-352 du 16 avril 2008 a retenu une lecture plus restrictive de la notion de pays tiers voisins que le règlement européen. Le règlement (CE) nº 1082/2006 modifié par le règlement (UE) nº 1302/2013 a notamment introduit une simplification dans la composition des membres d'un GECT tout en favorisant la participation de pays tiers tels que les PTOM.
En France, la constitution d'un GECT par une collectivité territoriale ultramarine est limitée, voire impossible. La constitution d'un GECT n'est possible qu'avec des pays tiers voisins qui sont des États frontaliers membres du Conseil de l'Europe ou les États membres de l'Union qui ne sont donc pas les voisins des RUP. Dans les faits et eu égard à la loi française, seul Saint-Martin pourrait à priori, avec Sint-Maarten, PTOM des Pays-Bas, créer un GECT contrairement au DROM.
Enfin, la procédure de demande d'autorisation de création d'un GECT auprès de l'État membre s'inscrit, en pratique, dans un temps long (2 à 3 ans).
Malgré ces freins, la piste d'un GECT, adapté aux spécificités de Saint-Martin, doit être suivie, quitte à modifier les textes européens et nationaux (français et néerlandais) pour imaginer un GECT ad hoc. La situation de l'île de Saint-Martin est sans équivalent et appelle des solutions sur-mesure.
Une initiative conjointe de la France et des Pays-Bas, à la demande des deux territoires, permettrait sans doute de lever ces freins et incertitudes. Le format dit Q432(*) devrait prévaloir.
Par ailleurs, Saint-Martin déplore de ne plus disposer d'un programme propre dédiée à la coopération transfrontalière (l'ex-POCTE) placé sous l'autorité des services déconcentrés de l'État, comme ce fût le cas pour la période 2014-2020. Pour la période de programmation actuelle, Saint-Martin bénéficie d'une ligne budgétaire de 4,5 millions d'euros au sein du programme Interreg Caraïbes 2021-2027 et de sa priorité 5 « Pour une coopération renforcée Saint-Martin - Sint Maarten » en vue de soutenir des projets de coopération transfrontalière. Ce programme est géré par la région Guadeloupe. Les particularités institutionnelles, géographiques et socio-économiques de l'île appellent, néanmoins, à privilégier un programme Interreg propre pour Saint-Martin, a fortiori au moment où pour la première fois, une préfecture de plein exercice a été créée, détachée de celle de la Guadeloupe.
Pour la collectivité, le maintien du taux historique de cofinancement à 85 %, voire son renforcement, dans le programme Interreg constitue aussi un enjeu fondamental pour garantir l'accessibilité des projets, compte tenu des capacités de financement propres des petits opérateurs locaux.
Recommandation n° 10 : Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten.
b) Saint-Barthélemy : une expertise pour rayonner
Relativement à l'écart des actions de coopération régionale, Saint-Barthélemy s'implique plus nettement depuis quelques années.
La collectivité a ainsi accueilli du jeudi 15 mai au samedi 17 mai 2025 le séminaire « Zéro déchet dans les Caraïbes », réunissant des représentants de plusieurs territoires de la Caraïbe. À l'issue, les représentants de Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla, la Guadeloupe et Saba ont signé l'appel de Gustavia appelant à une meilleure coopération régionale en matière de déchets.
En juin de cette année, Saint-Barthélemy a aussi accueilli la Caribavia qui est une rencontre annuelle centrée sur l'aviation, le tourisme, le transport inter-îles et le développement économique dans la région des Caraïbes.
Par ailleurs, pour la première fois, Saint-Barthélemy assumera cette année la présidence de l'OCTA, l'association des pays et territoires d'outre-mer.
Dans le même temps, comme évoqué supra, le CESCE de Saint-Barthélemy a remis un récent rapport interrogeant l'intérêt pour l'île de rejoindre des associations ou organisations régionales. Les capacités administratives forcément limitées de cette petite île et le souci d'efficacité obligent à cibler les participations sur les organisations les plus pertinentes. La dispersion des actions de coopération est un des écueils à éviter.
Ce rapport invite à concentrer les moyens sur quelques associations spécialisées dans des domaines directement utiles aux enjeux de développement de l'île : tourisme, aviation, transport maritime, cybersécurité, numérique.
Extrait du rapport du CESCE de Saint-Barthélemy de septembre 2025 « Saint-Barthélemy a-t-il intérêt à rejoindre des associations régionales ? »
Cette stratégie permet de faire rayonner l'expertise reconnue de Saint-Barthélemy dans les secteurs du traitement des déchets, du tourisme ou de l'aviation. Elle ouvre des perspectives pour partager ou exporter son savoir-faire et ses services, et en retour conserver son excellence au contact des partenaires. La Caribavia permet par exemple de nourrir les discussions avec l'aéroport international de Juliana à Sint Maarten sur une éventuelle ouverture de nuit des pistes pour accueillir des vols en provenance de la côte Ouest des États-Unis.
Pour Xavier Lédée, le statut de PTOM de l'île facilite la participation à des projets portés par des territoires étrangers, par exemple le projet de câble sous-marin CELIA-CETC (Caribbean ELIte Alliance - Caribbean European Territories Cable). Ce projet porté par Orange et l'Union européenne, notamment avec d'autres opérateurs étrangers, vise à établir un nouveau câble sous-marin à fibre optique reliant Aruba et la Martinique à la Floride, renforçant ainsi la connectivité dans les Antilles-Guyane (voir infra). Le statut de PTOM est aussi attractif pour les partenaires qui sollicitent des fonds européens conditionnés à la présence d'au moins un PTOM parmi les bénéficiaires du projet de coopération.
Enfin, un point d'attention mérite d'être souligné. Les pêcheurs de Saint-Barthélemy travaillent depuis des décennies dans la ZEE d'Anguilla. Cette habitude ancienne ne posait pas de difficultés particulières, s'agissant d'une activité de pêche artisanale et traditionnelle (la flotte ne compte que des bateaux non pontés de type saintoise). Toutefois, cette cohabitation ne va plus aussi aisément de soi, à mesure notamment que la filière pêche se structure. Xavier Lédée a saisi le préfet du dossier, la question de la délimitation des zones de pêche supposant une action diplomatique. Le conseiller diplomatique auprès du préfet de la Guadeloupe devrait s'en saisir.
c) Saint-Pierre-et-Miquelon : surmonter le traumatisme de la décision arbitrale de 1992
À la suite de la décision arbitrale de 1992 qui a décimé l'économie locale, un accord de coopération lie depuis 1994 l'archipel au Canada et à ses quatre provinces insulaires que sont Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et l'île du Prince Edouard. La commission mixte de coopération régionale se réunit une fois par an pour des échanges très formalisés. Cette plateforme diplomatique se révèle sous-investie. Elle reste également marquée par une centralité des acteurs régaliens et un formalisme qui contrastent avec la vitalité et la réactivité recherchées par les acteurs territoriaux.
Cette commission connaît de sujets importants comme la sécurité civile, les contrôles sanitaires ou la lutte contre les espèces invasives (comme le crabe vert). Mais on ne peut parler de dynamiques fortes.
Cette gouvernance de la coopération régionale demeure associée, inconsciemment à la décision arbitrale de 1992. Il en découle une grande méfiance. Bernard Briand, président du conseil territorial, lui préfère le terme de partenariat transfrontalier.
Malgré ces tensions géostratégiques, les relations entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada s'expriment au quotidien dans plusieurs domaines concrets. L'archipel est entièrement dépendant du Canada pour ses approvisionnements ou ses déplacements, à l'exception de quelques cargos venant directement de l'Hexagone ou de liaisons aériennes directes avec Paris à la belle saison.
Dans le domaine du transport, 35 000 passagers transitent chaque année sur les deux bateaux possédés par la collectivité, un flux constant encadré par une relation étroite avec l'Agence des services frontaliers du Canada (CBSA) et l'agence Gouvernementale Transport Canada. Dans le secteur halieutique, qui fonde l'identité économique de l'archipel, les produits de la pêche sont pour les deux tiers exportés vers le Canada, qui dispose des infrastructures de transformation manquantes sur le territoire33(*).
Sur le plan sanitaire, la coopération se traduit par la complémentarité des équipements de Terre-Neuve, en particulier de l'hôpital Saint-John, en plus des migrations sanitaires enregistrées vers l'Hexagone et la partie continentale du Canada. En matière de sécurité maritime, des coopérations opérationnelles existent sur l'île de Langlade, permettant également l'épanouissement du tourisme. Enfin au sujet de l'éducation et de la formation, près d'un tiers des jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon poursuivent leurs études au Canada, principalement à Montréal où ils bénéficient d'un environnement académique souple et personnalisé.
D'autres modes de coopération ont fait l'objet d'expérimentations ponctuelles et prometteuses, sur la base d'initiatives décentralisées que défend le président de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard Briand. C'est ainsi qu'ont été organisées des cérémonies et actions pédagogiques conjointement avec des provinces alentours en mémoire de la Seconde Guerre mondiale, afin d'illustrer la profondeur des liens historiques franco-canadiens. C'est encore un mode de coopération directe qui est mis en oeuvre dans le cadre des instances de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO).
Deux priorités se dessinent alors pour soutenir l'intégration régionale. D'abord, celle de surmonter le blocage historique dû au contentieux autour de la ZEE. Une approche pragmatique s'impose, à travers des négociations ciblées sur des activités précises quant à l'exercice de la souveraineté dans la zone. C'est ce qui figurait déjà dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'environnement international des départements et collectivités d'outre-mer (février 2019), en prenant l'exemple de l'accord signé entre la France et le Mexique sur l'île de Clipperton, qui reconnaît aux pêcheurs mexicains le droit d'accéder à la ZEE française sous réserve de la notification des campagnes de pêche.
À cette prérogative régalienne censée libérer les potentialités s'ajoute le soutien à une plus grande implication des élus et des acteurs économiques de l'archipel dans les instances de dialogue, dans le sens d'une coopération plus opérationnelle.
9. Soutenir la francophonie et l'apprentissage des langues régionales
Francis Étienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie de septembre 2022 à septembre 2025, plaide pour une relance forte de la francophonie autour de nos territoires. En 2022, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ne comprenait que deux membres États de la zone (Sainte-Lucie et la Dominique). En 2025, à la suite notamment d'une action d'influence, Saint-Kitts-et-Nevis et la Grenade ont marqué leur souhait de rejoindre l'OIF.
Un peu plus loin, seul Haïti est membre de l'OIF, la République dominicaine étant simple observatrice. Il n'y a aucun membre ou observateur sur le plateau des Guyanes.
Le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et Institut français34(*)
Carte du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger pour l'année scolaire 2023 2024 dans la région
Code couleur des points de localisation des établissements : bleu pour les établissements conventionnés avec l'AEFE et orange pour les établissements partenaires de l'AEFE.
Le réseau des AEFE est composé de huit établissements.
Il s'agit de35(*) :
- trois établissements au Brésil : lycée français François Mitterrand à Brasilia (conventionné) - 732 élèves de la petite section à la terminale ; lycée Molière à Rio de Janeiro (conventionné) - 855 élèves de la toute petite section à la terminale ; lycée international français de São Paulo (conventionné) - 1 160 élèves de la toute petite section à la terminale ;
- un établissement au Venezuela : lycée français de Caracas - Colegio Francia (conventionné) - 441 élèves, de la toute petite section à la terminale ;
- un établissement en Haïti : lycée Alexandre-Dumas, Port-au-Prince (conventionné) - 170 élèves de la petite section à la terminale ;
- un établissement à Cuba : lycée français international de La Havane Alejo-Carpentier (conventionné) - 165 élèves de la toute petite section à la terminale ;
- deux établissements en République dominicaine : lycée français de Saint-Domingue (conventionné) - 705 élèves de la petite section à la terminale ; lycée français international de Las Terrenas Théodore-Chassériau (partenaire) - 204 élèves, de la toute petite section à la terminale.
En complémentarité avec les établissements d'enseignement français à l'étranger, la diffusion de la langue française et de la culture francophone est assurée dans la zone régionale Caraïbe orientale par huit alliances françaises, situées à la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago.
Par ailleurs, dans les Caraïbes, on recense deux alliances françaises à Cuba, un institut français et six alliances françaises en Haïti, quatre alliances françaises en République dominicaine et une en Jamaïque.
Pour le plateau des Guyanes, on dénombre un institut français et 38 alliances françaises au Brésil, 9 alliances françaises au Venezuela, une au Suriname et une au Guyana36(*).
À côté de ces efforts diplomatiques, il est nécessaire que les établissements d'enseignement et le réseau culturel français dans la région bénéficient de moyens renforcés dans le cadre d'une stratégie régionale de rayonnement autour de nos territoires ultramarins.
Dans le premier volet de la présente étude, la délégation appelait déjà de ses voeux une meilleure prise en compte des outre-mer proches par les opérateurs de l'État situés dans leur environnement. Le rapport relevait notamment que les contrats d'objectifs et de moyens de l'AEFE ou de l'Institut français, ne contenaient aucune référence aux outre-mer.
Malheureusement, le récent contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2025-2027 de l'Institut français37(*), signé en juillet dernier, n'y remédie toujours pas. Les mots « outre-mer » ou le nom de certains d'entre eux n'y figurent tout simplement pas ! Une telle invisibilisation de ces territoires français implantés au coeur de régions essentielles pour la francophonie est incompréhensible.
En sens inverse, il faut aussi constater en le regrettant que l'enseignement des langues régionales dans les outre-mer est encore trop timide. C'est en particulier le cas en Guyane où le néerlandais et le portugais sont peu pratiqués.
L'enseignement bilingue se développe en revanche beaucoup à Saint-Martin depuis quelques années, ainsi qu'à Saint-Barthélemy. La binationalité de Saint-Martin l'exige. Par ailleurs, les îles du Nord ont toujours été plus tourné vers le monde nord-américain.
Cette politique innovante et récente pourrait inspirer des initiatives en Guyane, en particulier dans les zones frontalières. À défaut de créer des classes bilingues, les échanges scolaires ou universitaires doivent être encouragés pour développer la curiosité vis-à-vis des voisins si proches et si lointains.
Recommandation n° 11 : Faire enfin de la promotion de la francophonie dans le voisinage des outre-mer une priorité stratégique et modifier en ce sens les contrats d'objectifs et de moyens des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de l'Institut français.
B. L'UNION EUROPÉENNE : UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE À CONDITION DE RÉFORMER SON ACTION
Dans un bassin Atlantique comportant 4 RUP et 2 PTOM, l'appartenance à l'Union européenne est perçue de manière ambivalente à la lumière des objectifs de coopération et d'intégration régionale. La question se pose de savoir si l'atout de l'appartenance à l'Union européenne, en particulier pour les régions ultrapériphériques (RUP), en est toujours un, hormis pour l'accès à des financements européens importants.
En effet, plusieurs critiques sont régulièrement émises : des normes inadaptées, des accords ACP déséquilibrés au détriment des RUP, des financements complexes, une politique extérieure de l'Union mal coordonnée, une prise de conscience insuffisante de l'atout RUP et PTOM pour l'Europe...
Les recommandations ci-après tendent à répondre à ces critiques pour faire de l'Union européenne un catalyseur de l'intégration régionale et du rayonnement des RUP, pas un simple financeur.
Du côté de l'Union européenne, l'enjeu fondamental est de changer sa vision sur les RUP et PTOM, en rejetant un traitement « misérabiliste » de ces territoires qui passe à côté des enjeux géopolitiques. C'est grâce aux outre-mer français que l'Europe partage des frontières avec des pays situés à des milliers de kilomètres. C'est notamment grâce à la Guyane que l'Union européenne a une frontière de 730 kilomètres avec le Brésil, principale puissance commerciale de l'Amérique du Sud et partenaire du projet d'accord sur le Mercosur.
Lors de leur déplacement conjoint à Bruxelles en mai 2025, la délégation aux outre-mer et la commission des affaires européennes du Sénat ont échangé avec Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen, qui a livré une analyse optimiste : « J'ai la conviction depuis quelques semaines qu'il y a un contexte géopolitique nouveau qui devrait s'opérer afin que les RUP et les PTOM soient regardés différemment. Ils deviennent des acteurs incontournables, [...] des postes avancés de l'Union européenne ».
Mais pour que cette évolution advienne, plusieurs changements sont nécessaires.
1. Vers la Politique européenne de voisinage ultrapériphérique, la PEVu
Dans le volet 1 de la présente étude, l'une des propositions phares était la création d'une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu), à destination des États voisins les plus proches des RUP.
Cette proposition forte issue des travaux de notre délégation commence à se diffuser. Elle s'est traduite par ailleurs par l'adoption de la résolution n° 90 (2024-2025) du Sénat le 25 mars 202538(*).
L'idée de la création de la PEVu part du constat qu'une vision d'ensemble manque encore.
Une anecdote résume bien le chemin qu'il reste à parcourir. Lors du déplacement de la délégation à Bruxelles en mai dernier pour porter le message politique de la résolution du Sénat précitée, une rencontre réunissait un responsable de la DG REGIO en charge notamment du suivi des programmes Interreg et une responsable du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en charge de la Caraïbe. Le premier a regretté que la présidente de la Commission européenne n'ait fait aucune mention des RUP lors de sa visite au 48e sommet de la Caricom à la Barbade, au cours duquel notamment l'adhésion de la Martinique a été signée. Le SEAE a été aveugle aux RUP au coeur même de la région du monde qui en concentre le plus grand nombre.
Pour rebondir sur les propos précités de Younous Omarjee, la PEVu doit donc participer à la prise de conscience que les frontières de l'Union européenne ne se situent pas seulement à l'est ou au sud de l'Europe continentale, mais aussi dans la Caraïbe, en Amazonie, dans le canal du Mozambique ou dans le Pacifique sud.
L'Union européenne a développé une politique dite de voisinage (PEV) pour encadrer les relations entre l'Union européenne et 16 pays qui partagent une proximité géographique. Au moyen d'une aide financière et d'une coopération politique et technique avec ces pays, elle vise à établir un espace de prospérité et de bon voisinage. Cette PEV se limite aujourd'hui aux bordures Est - le partenariat oriental - et Sud - Union pour la Méditerranée - de l'UE.
La Politique européenne de voisinage (PEV)
La politique européenne de voisinage (PEV) a été instituée en 2004, à l'issue d'une réflexion visant à prévenir l'émergence de nouvelles lignes de division entre l'Union élargie et nos voisins et pour, au contraire, renforcer la prospérité, la stabilité et la sécurité pour tous. Cette politique est basée sur les valeurs de démocratie, d'État, de droit et de respect des droits de l'Homme. La politique européenne de voisinage a été consacrée dans le Traité de Lisbonne.
La PEV régit les relations entre l'UE et seize de ses voisins du pourtour de la Méditerranée dans le cadre du voisinage sud (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie) et à l'Est, dans le cadre du partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine).
Après une première revue en 2011 pour tenir compte des développements liés aux « printemps arabes », la PEV a fait l'objet d'une revue générale en 2015. La PEV révisée place la stabilisation du voisinage de l'UE, du point de vue politique, économique et sécuritaire, au coeur de l'action de l'UE, et prévoit la mise en place d'une approche différenciée entre les différents pays partenaires.
La PEV s'appuie, pour la plupart des pays concernés, sur des accords bilatéraux (selon les cas, accords d'association ou accord de partenariat et de coopération) et des documents conjoints (priorités de partenariat), agréés avec les pays partenaires, qui fixent le cadre politique de la coopération bilatérale et guident la programmation de l'assistance de l'UE à ces pays sur une période de plusieurs années. Lors du premier semestre 2022, les réunions des conseils d'association UE-Jordanie, le 2 juin à Amman, et UE-Égypte, le 19 juin à Luxembourg, ont permis d'adopter les nouvelles priorités de partenariat de l'UE avec ces pays pour la période 2021-2027.
Dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le nouvel instrument NDICI prend le relais des instruments financiers pour les pays du voisinage, en particulier de l'Instrument européen de voisinage qui a représenté l'essentiel du soutien apporté par l'UE à ses partenaires du voisinage sur la période 2014-2020 (15,4 milliards d'euros).
Source : Représentation permanente de la France auprès de l'UE
Par analogie, les RUP faisant partie du territoire de l'Union, une PEV ultrapériphérique doit être imaginée.
En premier lieu, la PEVu devrait assurer la cohérence entre les projets financés par le NDICI et ceux financés par les programmes Interreg de l'environnement proche des RUP (voir infra). La question de la cohérence des financements européens dans l'espace régional des RUP et des PTOM, dans un objectif d'intégration et de rayonnement de ceux-ci, est fondamentale.
En deuxième lieu, le réseau diplomatique de l'UE doit intégrer mieux qu'aujourd'hui la dimension RUP. Par exemple, la délégation de l'Union européenne à la Barbade, qui a dans sa zone de compétence plusieurs îles de l'arc antillais ainsi que la Caricom, gagnerait à se doter de conseillers spécialistes des RUP.
En troisième lieu, l'association directe des RUP aux politiques de l'Union européenne dans la région est impérative. Ainsi, les RUP de la Caraïbe devraient participer en tant qu'observateurs à l'institution commune du Conseil des ministres, du comité mixte et de l'assemblée parlementaire de la Caraïbe-UE39(*). Le dialogue interinstitutionnel dans la région ne peut se faire sans les RUP.
À plus long terme, une véritable PEVu appelle la création d'instruments de voisinage dédiés - par analogie avec la PEV - et la conclusion de partenariats renforcés bilatéraux avec les principaux partenaires des RUP (par exemple un accord UE-Suriname, UE-Sainte-Lucie ou UE-République dominicaine pour le bassin Atlantique).
German Esteban, chef d'unité des régions ultrapériphériques à la DG REGIO rencontré lors du déplacement à Bruxelles, a souligné que, malgré des résistances de la Commission, les RUP sont désormais explicitement mentionnées dans le nouvel agenda des relations entre l'Union européenne, l'Amérique latine et les Caraïbes (ALC)40(*). Parmi 10 actions clés proposées, l'une prévoit en effet de « renforcer la coopération entre l'ALC et les régions ultrapériphériques de l'UE, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer situés dans la région ALC dans des domaines d'intérêt commun ».
C'est une première avancée, mais fort timide. Les RUP et PTOM de la région sont perçus comme un atout ou un « petit plus », alors qu'ils devraient être mis au coeur de l'agenda UE-Caraïbes et Amérique latine, en être un des piliers.
La décision de construire une nouvelle relation de voisinage pourrait être l'objet d'un sommet UE-Caraïbes-plateau des Guyanes-France-Pays-Bas avec les représentants des RUP et des PTOM en fer de lance.
Cette initiative politique interviendrait dans le contexte décrit précédemment d'une concurrence entre la Chine et les États-Unis. Il offre une « fenêtre d'opportunité » pour reprendre les mots de Nathalie Estival-Broadhurst : « ces pays commencent à percevoir l'intérêt d'un engagement européen plus conséquent, d'autant plus que l'aide des États-Unis s'est souvent accompagnée de tensions diplomatiques. La Chine, quant à elle, s'est implantée de longue date, avant même l'initiative Belt and Road. Plusieurs États sont aujourd'hui fortement endettés à son égard. Le sommet de la Caricom a mis en lumière une forme de résignation : certes, la Chine suscite des critiques, mais les États-Unis n'ont jamais offert de concessions réelles. De ce fait, plusieurs pays refusent d'entrer dans un schéma d'opposition binaire ».
En articulant cette politique autour des RUP et PTOM, le partenariat entre l'Europe et les États de la Caraïbe ou du plateau des Guyanes se fondera sur des intérêts communs et des besoins partagés, à la différence des États-Unis et de la Chine qui demeurent des partenaires extérieures à la région.
Pour Francis Étienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie et auprès de la Caricom entre septembre 2022 et septembre 2025, il faut jouer à 100 % le voisinage européen : « Tous les partenaires sont prêts à y participer. Il y a une vraie volonté de la part des pays tiers de vouloir faire plus avec les RUP ».
Cette politique de voisinage n'est pas exclusive d'une politique de fermeté et de dialogue exigeant lorsque les intérêts de l'Union européenne ou des RUP/PTOM sont en jeu. Au contraire, la PEVu doit aussi permettre de peser plus fort.
La liste noire de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, adoptée par le Conseil le 14 février 2023, comprend 12 États, dont cinq sont dans les Caraïbes (Anguilla, Antigua et Barbuda, Îles Vierges britanniques et américaines, Panama, Trinidad-et-Tobago).
En matière de lutte contre la pêche illicite dans les eaux guyanaises, l'Union européenne peut aussi faire la différence en parlant d'une voix forte en appui des actions opérationnelles conduites par notre Marine contre les tapouilles brésiliennes ou surinamiennes.
Lors d'une rencontre avec les Forces armées de Guyane (FAG), dont l'une des missions est la lutte contre la pêche illicite, il a été souligné que la menace d'un « carton jaune » de la Commission européenne a mis la pression sur les autorités surinamiennes accusées d'être un « pays non coopératif ». Ce premier avertissement pourrait être suivi d'un carton rouge synonyme d'interdiction d'exportation vers l'UE. Or, 30 % des prises officielles du Suriname y sont exportées. La fermeture de ce marché serait un coup très dur pour ce secteur d'activité. Par ailleurs, cela entacherait la réputation du Suriname avec le risque d'interdictions d'importations prises par d'autres pays.
L'effet de levier politique d'une PEVu serait majeur et renforcerait l'action extérieure de la France dans la région.
La construction de la PEVu, notamment la définition des relations privilégiées que l'UE proposerait aux États les plus proches des RUP, devra se faire en associant non seulement les États membres les plus concernés (France et Pays-Bas en particulier), mais aussi les autorités locales de RUP. Une gouvernance ad hoc de cette politique de voisinage particulière sera à inventer.
2. Les financements européens : faire converger tous les crédits de la coopération extérieure et du voisinage
La « tuyauterie financière » décrite supra - Feder, Interreg, NDICI, Global Gateway - a fait l'objet de tentatives de rationalisation ou de coordination depuis 2014. L'enjeu est d'autant plus fort que les moyens financiers consacrés par l'UE à la coopération régionale et à son action extérieure sont à proprement dit « colossaux » et font de l'UE un partenaire incontournable.
Le premier volet de l'étude avait montré les solutions mises en place ou autorisées par les programmes opérationnels 2014-2020 puis 2021-2027. Des progrès ont été réalisés avec notamment la création de passerelles entre les programmes Interreg et le fonds NDICI (qui a succédé au Fed) pour faciliter des cofinancements. La concertation et les échanges entre les différentes autorités en charge de ces fonds ou programmes ont également été intensifiés pour casser le travail en silo.
Ces solutions demeurent néanmoins complexes et impliquent une ingénierie financière encore lourde que seules les autorités de gestion les mieux armées, comme La Réunion, ou l'AFD parviennent à gérer.
Lors du déplacement de la délégation à Bruxelles en mai dernier, Pierre-Emmanuel Leclerc, responsable Interreg auprès de la DG REGIO, a indiqué que des transferts de fonds NDICI sur des programmes Interreg, pour un montant cumulé d'environ 15 millions d'euros, étaient en cours de finalisation. Ces transferts de gestion de fonds NDICI ont permis le lancement d'un appel à projets Feder-NDICI par La Réunion41(*). L'autre programme concerné est celui de Madère, des Açores et des Canaries (MAC).
Les réflexions sur la coordination ou le rapprochement Interreg-NDICI pour les RUP se poursuivent donc, comme en témoigne le récent évènement en ligne dédié à ce seul sujet le 18 septembre dernier. Une étude de Jean-Michel Salmon, universitaire, spécialement consacrée à ce thème a été présentée.
Ces nouvelles pistes d'amélioration, dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034, devraient s'inspirer de la stratégie « Trois Océans » amorcée par l'AFD depuis 2019.
S'il est encore un peu tôt pour tirer un bilan de la programmation 2021-2027 et des premières expérimentations de gestion déléguée de fonds NDICI sur des appels à projets Interreg, plusieurs pistes solides sont évoquées pour le post-2027 :
- réaffirmer que les programmes Interreg outre-mer sont une composante à part entière de la gestion des frontières extérieures de l'UE, et non simplement des programmes de coopération régionale. L'objectif est de transformer la perception de ces programmes et de les assimiler à une politique de voisinage aux frontières de l'UE ;
- renforcer la coordination DG REGIO et DG Intpa. Par ailleurs, les autorités de gestion d'Interreg ou les représentants des RUP devraient être impliqués dans l'élaboration de la politique extérieure de l'UE, au niveau de la DG Intpa et du SEAE. En sens inverse, on notera que les délégations de l'Union européenne situées dans les pays partenaires participent déjà aux comités de suivi des programmes Interreg. Les délégations de l'UE mériteraient aussi de compter dans leurs équipes des spécialistes des RUP ;
- prévoir dans le futur règlement Interreg une réglementation propre aux Interreg outre-mer, intégralement rédigé et ne se limitant pas à des renvois à la réglementation générale avec des exceptions ou exemptions.
Toutefois, pour franchir une véritable étape, il faut de manière structurelle et systématique associer une partie des fonds NDICI à Interreg, dès la première phase de programmation et d'appel à projets. Pour placer les RUP au centre du jeu, l'autorité de gestion Interreg serait responsable.
Un examen des fonds NDICI au profit de l'espace régional des RUP et PTOM devrait être réalisé dès le début de la programmation pour distinguer les aides relevant strictement d'une relation bilatérale de celles destinées à des projets de dimension régionale, voire à des organisations régionales (OECO, AEC...).
S'agissant des premières, une information préalable des RUP et PTOM serait néanmoins nécessaire, afin de veiller à l'absence de contradiction ou d'atteinte aux intérêts directs des outre-mer.
S'agissant des secondes, il reviendrait de déterminer rapidement celles pouvant faire l'objet d'une délégation aux autorités de gestion Interreg.
Il faut aligner les plans conjointement dès le départ, et ne pas laisser cheminer Interreg, la stratégie UE-Caraïbes/Amérique latine et le Global Gateway de façon autonome en organisant ponctuellement des rapprochements ou des initiatives communes.
Cette préoccupation rejoint celle exprimée par Arnaud Mentré, ambassadeur à la coopération régionale dans le bassin Atlantique, qui cite les exemples du programme EL PAcCTO et des sargasses : « nous nous efforçons de faire en sorte que les régions ultrapériphériques (RUP) soient davantage prises en compte par ce programme. EL PAcCTO relève actuellement d'une logique de guichet : si des États tiers se montrent intéressés par une coopération, l'Union européenne les accompagne. Or il faut que les États membres aient davantage leur mot à dire sur la manière dont sont fixées les priorités d'EL PAcCTO, même si cela emporte un renversement de perspective pour la DG Intpa, qui considère plutôt que la demande doit venir de l'État tiers. Il nous faut donc trouver une voie d'équilibre. Il est fondamental d'intégrer nos collectivités françaises d'Amérique dans un plan stratégique avec l'Europe. J'ai du reste indiqué à la DG Intpa qu'une telle approche était nécessaire sur les sargasses. Mais au-delà de l'aspect financier, il nous faut également « forcer » la Commission à s'assurer régulièrement de la bonne articulation du marché européen et des enjeux d'insertion régionale, en particulier pour les RUP ».
La question des financements européens et de leur cohérence ramène donc inévitablement à celle de la vision et de la stratégie communes pour la zone géographique. Cette stratégie doit être arrêtée par l'UE en concertation étroite avec les RUP et les États membres. Au niveau de la délégation de l'UE dans la région, cela pourrait impliquer par exemple la présence en son sein de représentants des RUP, comme c'est déjà parfois le cas au sein des ambassades de France.
Il faut enfin, pérenniser et institutionnaliser des comités conjoints Interreg/Global Gateway pour veiller à la convergence systématique des projets soutenus.
La création d'un instrument de voisinage dédié, comme pour le partenariat oriental ou la Méditerranée, devrait être envisagée à terme. Sa gouvernance serait complexe, en raison de l'implication étroite et nécessaire des RUP en plus des États membres et de la Commission européenne.
La récente communication de la Commission européenne sur le prochain cadre financier pluriannuel 2028-203442(*) donne peu d'orientations claires sur le futur mode de gestion de ces fonds. Mais la création d'un instrument de voisinage dédié n'apparaît pas.
Extrait de la proposition de cadre financier pluriannuel 2028-2034 - Pilier « Europe dans le monde »
Par ailleurs Interreg demeurerait dans un autre pilier. L'architecture générale du CFP évoluerait donc peu en première intention, du moins en ce qui concerne le voisinage des RUP. En revanche, les moyens globaux de l'action extérieure de l'UE augmenteraient sensiblement.
On notera également la hausse sensible de nouveau mécanisme pour l'interconnexion en Europe. C'est d'ailleurs à son propos que les RUP sont citées pour la seule et unique fois dans la communication sur le CFP : le mécanisme « donnera un nouvel élan à ces investissements essentiels dans la résilience et la sécurité de l'Europe, notamment en soutenant des projets dans les régions les moins connectées de l'Union, telles que les îles et les régions ultrapériphériques. Elle investira dans les interconnexions et les réseaux transfrontières, les liaisons de transport transfrontières, dans les réseaux en mer, les sources d'énergie renouvelables et le stockage des énergies renouvelables, les infrastructures pour carburants alternatifs, soutenant ainsi les ambitions de l'Union en matière de climat ».
Cet outil financier pourrait être une opportunité pour porter des projets forts de coopération régionale dans les domaines de l'énergie et des transports.
Source : Commission européenne
Ces premières orientations pour la période 2028-2034 invitent donc à la mobilisation afin, d'une part, de faire inscrire la notion de politique de voisinage ultrapériphérique et, d'autre part, d'obtenir des précisions rapides sur les modalités concrètes d'un rapprochement de la gestion des fonds Interreg et NDICI.
Recommandation n° 12 : À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 :
- obtenir de l'Union européenne la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ;
- définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI.
3. Les normes européennes : de la souplesse absolument
Le double diagnostic de normes européennes qui protègent le consommateur, mais qui freinent l'intégration régionale des RUP, voire des PTOM, est connu.
Dans le volet 1 de la présente étude, il a justifié la recommandation d'un paquet législatif européen RUP, qui adapterait simultanément plusieurs politiques sectorielles aux spécificités et contraintes de RUP. Cette approche horizontale et transversale permettrait d'aller plus vite - sans attendre la réforme de chaque secteur - et d'avoir un impact systémique sur les modèles de développement des RUP. Les législations applicables par exemple aux déchets, transports, productions agroalimentaires, énergies seraient adaptées simultanément. La résolution n° 90 (2024-2025) du Sénat précitée fait sienne cette recommandation.
Les travaux de ce volet 2 relatif au bassin Atlantique n'ont pas démenti ce diagnostic. Les normes européennes sont perçues en Guyane, à Saint-Martin, en Martinique ou en Guadeloupe comme un frein aux échanges économiques de proximité ou régionaux et inversement, comme un facteur du lien de dépendance excessive aux marchés européens.
L'idée d'un paquet législatif RUP rejoint celle exprimée par Younous Omarjee ou le commissaire européen Raffaele Fitto en faveur d'un « omnibus RUP » qui permettrait de balayer l'ensemble des politiques sectorielles et de corriger les normes inadaptées, sans rouvrir en totalité les négociations sur le règlement concerné.
Le précédent de la réforme de la réglementation UE sur les matériaux de construction dans les RUP a ouvert une voie qu'il faut poursuivre.
Outre l'adaptation des normes européennes, une autre approche serait de reconnaître des équivalences de normes. C'est en partie celle retenue pour les matériaux de construction depuis l'adoption du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées pour la commercialisation des produits de construction. Ce règlement permet de déroger aux normes européennes à la condition que les matériaux importés le soient pour le seul marché du RUP importateur.
L'adhésion des RUP françaises à l'OECO et à la Caricom (en cours), deux espaces économiques relativement intégrées, doit pousser l'Union européenne à explorer la solution d'une reconnaissance des équivalences de normes. Cette reconnaissance pourrait se développer dans le cadre des accords ACP et de l'accord de partenariat économique UE-Cariforum de 2008 auxquels les RUP ne sont pas suffisamment associés, alors même qu'elles sont les premières exposées.
La binationalité de l'île de Saint-Martin, avec une frontière fictive séparant un RUP et PTOM, est la situation qui illustre le mieux la nécessité d'introduire des formes de souplesse dans l'application des normes européennes dans les RUP.
La collectivité de Saint-Martin cite notamment l'exemple de la production d'oeufs à Saint-Martin. Les producteurs locaux, de petites tailles, font face à une concurrence féroce des oeufs en provenance de la République dominicaine dont le prix de vente est ultra-compétitif : 3,50 euros la douzaine contre 5 euros pour la production saint-martinoise. Les réglementations européennes viennent, de surcroît, rajouter des contraintes supplémentaires. Ainsi en l'absence d'un centre de conditionnement agrée sur l'île, les producteurs locaux qui tentent de développer la filière ont l'interdiction de vente auprès des principaux points d'écoulement : supermarché, supérette.
En effet, d'une manière générale, le cadre normatif européen en matière d'élevage ne tient pas compte des petites unités de production (faiblement mécanisées, ramassage des oeufs à la main). La législation européenne comme française s'intéresse aux filières industrielles et ne reconnaît pas la place de ces producteurs de proximité, véritable moteur des petites communautés locales des RUP. La vente directe est la seule ouverture commerciale autorisée en circuit court avec un seuil trop bas (250 poules).
D'autres contraintes pèsent sur les producteurs, notamment l'approvisionnement en médicaments. Les produits autorisés selon des normes vétérinaires ne sont pas disponibles sur l'île, ce qui rajoute un surcoût.
Le Règlement (CE) 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires en son annexe II, Chapitre 2, 3) impose que les surfaces en contact avec les aliments (y compris les surfaces des équipements) soient construites avec des matériaux lisses, lavables, résistants à la corrosion, non toxique. L'usage du bois fait l'objet, de facto, d'un interdit indirect dans la législation européenne comme française. Si cette interdiction de l'usage du bois brut est compréhensible (porosité), le bois traité, vernis offre des solutions hygiéniques, à moindre coût, dans un contexte caribéen. En contexte insulaire, l'importation d'une installation métallique, à surface lisse, surenchérit le coût de l'installation tandis que l'usage d'un bois traité est plus avantageux, tout aussi respectueux de l'hygiène et relève d'une approche traditionnelle.
Une dérogation européenne pour les petits producteurs de proximité issus des RUP devrait contribuer à alléger les fortes contraintes (marquage, centre de conditionnement, contrôles) qui pèsent sur la filière, sans pour autant diminuer la qualité et l'hygiène.
Cet exemple très concret montre que le cadre normatif doit être interrogé, non pas uniquement en termes de facilitation des importations régionales, mais aussi de compétitivité des petites productions insulaires en milieu tropical destinées au marché local. L'objectif de souveraineté alimentaire des RUP doit passer par la baisse des coûts de production, sauf à compenser financièrement les surcoûts.
Ce travail sur la compétitivité et la productivité des RUP suppose un travail de fond sur les normes relatives aux produits, procédés de transformation, packaging, étiquetage, stockage et transport.
Plus que jamais, le paquet RUP ou omnibus RUP est indispensable, en laissant notamment aux RUP la faculté de définir des équivalences de normes pour faciliter les échanges régionaux.
4. Partager les clés de la politique commerciale avec les territoires
Pour Fiona Ramsey, ambassadrice de l'Union européenne à la Barbade et ambassadrice désignée auprès des États des Caraïbes orientales l'accord de partenariat économique entre l'UE et les États de la région demeure sous-utilisé par l'ensemble des parties prenantes. Les entreprises européennes s'engagent peu, ces marchés paraissant lointains et très limités. Inversement, l'Union européenne n'apparaît pas comme un débouché pour les productions locales.
Ce constat décevant rejoint celui de la littérature économique sur les accords non réciproques.
Par ailleurs, lors de son audition, Manuel Marcias a estimé que les chiffres du commerce extérieur dans la région ne démontraient pas que les barrières tarifaires et douanières fussent des facteurs déterminants de la faiblesse des échanges : « dans (les raisons de) la vie chère, les importations sont au centre. Nous nous sommes interrogés sur les conséquences de l'accord entre le Forum Caribéen des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Cariforum) et l'Union européenne, notamment sur les Antilles et la Guyane : on pourrait penser que, si l'on diminue les tarifs douaniers, cela permettra d'importer davantage des pays alentour. Les premiers résultats de travaux prospectifs montent qu'a priori, cela n'a pas eu d'impact. La baisse des droits de douane n'est donc pas la solution à tout et ne suffira pas à mieux intégrer les outre-mer. D'autres choses jouent, qu'on appelle les barrières non tarifaires ».
En effet, les résultats de l'estimation montrent que les importations des DFA depuis la Caraïbe ont diminué après la mise en place de l'accord. La signature de l'accord commercial pourrait avoir créé un phénomène de diversion en incitant les pays caribéens à échanger avec l'Europe continentale, au détriment des économies régionales. Ces résultats illustrent que ce ne sont pas uniquement les barrières tarifaires qui sont à l'origine des faibles échanges entre les territoires ultramarins et leurs voisins, mais une somme de barrières non tarifaires : normes, méconnaissance des marchés, chaînes logistiques intégrées avec l'Hexagone, langues différentes, etc.
L'accord de partenariat économique Cariforum-UE
L'accord de partenariat économique Cariforum-UE a été signé en octobre 2008. Il ne s'agit pas seulement d'un accord sur le commerce des marchandises ; il comprend des engagements sur le commerce des services, les investissements, les questions liées au commerce telles que la politique de concurrence, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que les aspects liés au développement durable.
Il ouvre progressivement le marché des services de l'UE, y compris les secteurs de la création et du divertissement, ainsi que le marché caribéen pour les prestataires de services de l'UE. Il garantit l'accès au marché de l'UE en franchise de droits et de contingents pour tous les produits. Il prévoit une clause de préférence régionale pour le commerce dans la région des Caraïbes, favorisant l'intégration régionale et les chaînes de valeur régionales.
L'APE Cariforum-UE est le premier accord commercial dans lequel l'UE a spécifiquement inclus des dispositions complètes sur la culture.
Les 14 pays bénéficiaires sont : la République dominicaine, Antigua-et-Barbuda, Les Bahamas, Barbade, Belize, la Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Christophe-et-Niévès, Suriname, Trinité-et-Tobago.
Haïti a également signé l'accord en décembre 2009, mais ne l'applique pas encore, en attendant sa ratification par son parlement.
L'APE prévoit des asymétries en faveur des pays ACP, telles que l'exclusion des produits sensibles de la libéralisation, de longues périodes de libéralisation, des règles d'origine flexibles et des garanties et mesures spéciales pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la protection des industries naissantes.
Alors que les marchés de l'UE sont immédiatement et pleinement ouverts, les États du Cariforum ont 15 à 25 ans pour s'ouvrir aux importations de l'UE. En outre, les producteurs de 17 % des produits les plus sensibles (provenant principalement des chapitres 1 à 24 du SH) bénéficieront d'une protection permanente contre la concurrence.
Source : Commission européenne
Au niveau de la zone caraïbe, c'est aussi un échec. Les États de la Caraïbe maintiennent des barrières douanières très élevées vis-à-vis des productions des collectivités françaises d'Amérique (CFA). En sens inverse, les RUP peuvent solliciter le déclenchement de clauses de sauvegarde si les productions locales des CFA étaient durement affectées par ces accords.
Ces résultats décevants à l'échelle de la Caraïbe pour les RUP trouvent une partie de leur explication dans l'absence d'association des RUP à la négociation de ces accords. Le même constat est fait par la Guyane, dont la situation géographique n'est pas prise en compte dans la négociation d'un accord entre l'UE et le Mercosur. La région Guadeloupe déplore aussi de ne pas avoir la faculté d'engager des négociations dans la zone pour ses productions agricoles.
Dans le cadre de l'APE UE-Caraïbes, il paraît donc important de revoir cet accord afin d'y aménager des dispositions particulières aux RUP. L'objectif serait triple :
- associer les RUP aux instances de suivi et de négociation ;
- autoriser les RUP à négocier des accords régionaux ou bilatéraux pour les besoins de leurs marchés locaux ;
- rendre possible d'adjoindre à ces accords un volet normatif pour offrir un avantage compétitif à ces échanges régionaux, sans toutefois remettre en question les protections sanitaires ou environnementales.
Dans le cadre de son programme-cadre de coopération régionale, la Martinique essaie de conclure des accords sectoriels ciblés sur une quinzaine de produits. Ces accords peinent à aboutir et Serge Letchimy ne peut que constater que la validation de Bruxelles ou Paris reste requise.
Pour aller plus vite, il faut donc aménager au sein de l'APE un dispositif spécial pour les RUP. Une démarche limitée à quelques produits ciblés est aussi la plus opérationnelle et utile, les économies insulaires ayant des capacités productives et industrielles limitées.
Recommandation n° 13 : Dans le cadre d'un avenant à l'Accord de partenariat économique UE-Caraïbes, autoriser la conclusion d'accords régionaux ou bilatéraux de libre-échange entre un ou des RUP et des États tiers voisins/organisations régionales, le cas échéant sur un nombre limité de produits.
5. Vers des Erasmus régionalisés
Les modalités de participation au programme Erasmus+ et les possibilités offertes varient selon deux groupes de pays :
- les 33 pays qui financent le programme et peuvent profiter de l'ensemble des possibilités offertes, à savoir les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que les 6 pays tiers associés au programme - Islande, Liechtenstein, Serbie, Macédoine du Nord, Norvège et Turquie ;
- les pays tiers non associés au programme, pouvant participer à certaines actions du programme ; ils sont regroupés en 14 zones régionales, dont le découpage détermine l'allocation des financements et les conditions de participation.
Ainsi, afin de bénéficier de l'ensemble des actions proposées par le programme Erasmus+ et de toutes les subventions afférentes, les jeunes des RUP sont amenés, dans le cadre de ce programme, à se tourner prioritairement vers les pays membres de l'Union européenne pour effectuer des mobilités.
Conformément à l'article 349 du TFUE, la situation particulière des RUP est certes prise en compte dans le cadre d'Erasmus+ par l'attribution aux étudiants ultramarins du montant maximum de bourse (786 €/mois), ainsi que par une contribution aux frais de voyage, calculée selon la distance parcourue et pouvant aller jusqu'à 1 735 € par participant. De surcroît, dans le cas où cette contribution ne couvrirait pas au moins 70 % des frais engagés, un autre soutien financier peut être mis en oeuvre au titre des « coûts exceptionnels », dans la limite de 80 % des coûts éligibles.
Ces mobilités vers le continent européen dans le cadre d'Erasmus+ engendrent ainsi un coût important et méconnaissent des opportunités qui permettraient de renforcer l'intégration des outre-mer dans leur zone régionale.
Au cours de son audition par les rapporteurs le 18 septembre 2025, Thierry Devimeux, préfet de la Guadeloupe, a indiqué que dans le cadre de l'« omnibus européen », les préfets avaient été amenés à faire remonter des propositions en vue de la réforme d'Erasmus+. Il suggère que le champ de ce programme, trop complexe et inadapté à la situation des RUP, soit élargi afin de saisir des opportunités régionales (universités de la Barbade, de Porto Rico, de Floride...).
En mars 2017 déjà, le mémorandum conjoint des régions ultrapériphériques pour un nouvel élan dans la mise en oeuvre de l'article 349 du TFUE, jugeait le programme Erasmus+ « trop restrictif dans son champ d'application puisqu'il ne comprend pas les pays tiers d'intérêt ou de voisinage pour les RUP ». Soulignant l'importance de la mobilité régionale au sein des bassins respectifs, une position de la Conférence des présidents des RUP du 30 mai 2017 dans le cadre de la consultation publique pour l'évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2014-2020 réaffirmait qu' : « il importe donc de soutenir de manière appropriée tant la mobilité des résidents des RUP vers le continent (...) que celle vers les pays tiers de leur zone », proposant ainsi de « développer le volet international d'Erasmus+ pour permettre une mobilité effective vers les pays tiers de leur voisinage (géographique, culturel et historique) en octroyant aux RUP les mêmes conditions de soutien que dans le volet interne de ce programme, tout en s'assurant que la gouvernance ne représente pas d'obstacles additionnels ».
Le sujet demeure d'actualité. En effet, la mission d'évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2021-2027 conduite par Pierre Van de Weghe et Morgane Le Bras-Caraboeuf, inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, relève, en avril 2024, l'existence d'enjeux propres à certains territoires, notamment les outre-mer, en soulignant que « les subventions allouées concernent principalement les frais de déplacement vers l'Europe continentale, sans prendre en considération une possible stratégie régionalisée », alors qu'« une telle stratégie peut malgré tout être envisagée entre RUP voisins, mais aussi, plus largement, dans le cadre de la dimension internationale du programme qui s'est étendue à l'EFP [enseignement et formation professionnels] en 2021 et devra s'étendre à l'enseignement scolaire en 2028 »43(*).
Les mobilités à destination et en provenance de pays tiers non associés au programme peuvent donc être développées en exploitant davantage la dimension internationale d'Erasmus+ et en s'appuyant sur d'autres programmes européens visant à renforcer la coopération régionale.
Ø Exploiter davantage la dimension internationale d'Erasmus+
Les projets impliquant des pays tiers non associés au programme Erasmus+, ne relevant pas de l'article 19 du Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+44(*), s'inscrivent dans la dimension internationale d'Erasmus+.
La mise en oeuvre de cette dimension internationale est conditionnée par l'inscription des actions envisagées dans le cadre des priorités de politique extérieure de l'UE, définies pour chacune des 14 zones régionales dans le Erasmus+ Multiannual Indicative Programme (MIP).
En outre, le champ d'action de la dimension internationale d'Erasmus+ est beaucoup plus restreint que celui du volet interne du programme. Concernant la mobilité, cette dimension internationale offre deux possibilités :
- un établissement de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement et de la formation professionnels peut dédier 20 % de ses financements au titre de l'« action clé 1 - mobilité (AC 1) » à des projets de mobilité en lien avec des pays tiers non associés au programme ;
- un établissement de l'enseignement supérieur peut demander des financements spécifiques dans le cadre de l'action « Mobilité de l'enseignement supérieur soutenue par les fonds de politique extérieure (AC 171) », afin de financer des mobilités sortantes et des mobilités entrantes, sous réserve d'une évaluation qualitative.
Il convient néanmoins de souligner que, sur un budget global de 26 milliards d'euros sur la période 2021-2027, le budget dédié à la dimension internationale d'Erasmus+ est de 2,2 milliards d'euros, financés par l'Instrument de Voisinage, de Coopération au Développement et de Coopération Internationale (NDICI) et par l'Instrument d'Aide de Préadhésion (IPA) - pour les pays concernés uniquement.
S'il s'agit d'un outil dont les territoires ultramarins pourraient davantage se saisir afin de mettre en oeuvre des mobilités avec des pays voisins hors UE de la zone régionale, son champ d'action et les financements alloués restent modestes, en comparaison avec le volet interne du programme.
Le périmètre de la dimension internationale d'Erasmus+, étendu à l'enseignement et la formation professionnels en 2021, pourrait être étendu en 2028 à l'enseignement scolaire, afin de promouvoir la mobilité des jeunes vers des pays de la zone régionale que cherchent à développer les académies concernées.
Ainsi, avec la signature, au cours de l'année scolaire 2024-2025 de cinq conventions-cadres académiques avec les ministères de l'Éducation de Sainte-Lucie, la Dominique, la République dominicaine, Antigua-et-Barbuda et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l'académie de Martinique souhaite pérenniser et élargir ses partenariats régionaux au sein de l'espace caribéen. À cette fin, une évolution du cadre Erasmus+ qui étendrait l'éligibilité des subventions scolaires aux 20 % de financements mobilisables hors Europe permettrait à tous les élèves de la maternelle aux baccalauréats généraux et technologiques de bénéficier de ces mobilités régionales et valoriserait ainsi l'ancrage caribéen de l'académie.
Ø Mettre en oeuvre des mobilités en ayant recours à d'autres programmes européens
Des projets visant à promouvoir la mobilité dans la zone régionale, entre territoires ultramarins et pays non membres de l'UE, peuvent être initiés au titre du programme Interreg de l'Union européenne en faveur du renforcement de la coopération transfrontalière et régionale.
À ce titre, le projet ELAN « Échanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité », porté par le Groupement d'Intérêt Public-Formation continue Insertion Professionnelle (GIP-FCIP) de l'académie de Martinique, a été lancé en 2019 dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. Doté d'un budget de 3 millions d'euros (dont 2,2 millions d'euros provenant de l'UE au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen de développement), ce projet qui s'est poursuivi jusqu'en 2024, associait de nombreux partenaires communautaires et extra-communautaires : l'Académie de Martinique et le GIP-FCIP, la collectivité territoriale de Martinique, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), l'agence Campus France, la délégation des Alliances françaises des Petites Antilles, l'université des West Indies (Antigua, Barbade, Jamaïque, Trinité-et-Tobago), l'université Quisqueya (Haïti), l'université d'État d'Haïti et l'université des Antilles.
Le projet ELAN poursuivait un triple objectif : favoriser l'émergence d'une identité caribéenne partagée, soutenir l'intégration régionale des RUP françaises dans leur environnement géographique immédiat, et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes du bassin caribéen, en accompagnant la dynamique économique et d'innovation des territoires de ce bassin45(*). En plus d'échanges scolaires, d'ateliers linguistiques et de la réalisation d'une cartographie des offres de formation au sein du bassin caribéen, le projet ELAN a encouragé la mobilité d'études et de stages, ainsi que des missions universitaires grâce à des dispositifs de bourses et à la conclusion d'accords de coopération entre les établissements et institutions du supérieur ou de la formation professionnelle. Environ 2 800 membres des communautés éducatives du bassin caribéen - étudiants, enseignants stagiaires, stagiaires de la formation professionnelle, institutions universitaires - ont pu bénéficier d'actions mises en oeuvre dans le cadre de ce programme.
Des initiatives similaires pourraient s'inspirer de ce programme afin de développer les opportunités de mobilités dans une zone régionale composée de territoires membres de l'UE et de pays voisins hors UE.
Le CESECE de Guyane vient de lancer une étude sur la création d'un Erasmus du bassin amazonien. Dans le même sens, Serge Letchimy plaide pour un Erasmus Caraïbe.
Ces convergences de vue plaident en faveur de la création de sous-programmes Erasmus RUP, par bassin.
Recommandation n° 14 : Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'UE, et d'étendre à l'enseignement scolaire le volet international de ce programme.
C. LES SECTEURS D'AVENIR : CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1. Un potentiel de commerce qui attend d'être exploité
L'étude la Banque de France précitée montre qu'il existe des marges de progression importante pour les exportations et importations dans l'espace régional proche ou large. Les départements français d'Amérique disposent d'un potentiel commercial encore largement sous-exploité, notamment vis-à-vis de leurs voisins régionaux.
PIB par habitant dans la Caraïbe et le
plateau des Guyanes
en 2019 (milliers de dollars US)
Les chiffres du PIB montrent que les outre-mer français sont des marchés potentiellement intéressants pour les petits territoires proches.
Par ailleurs, le potentiel d'exportation serait sous-exploité.
Échanges de marchandises des petits États insulaires en fonction de leur niveau de PIB en 2022
Lecture : Les économies ultramarines de chaque bassin sont représentées par les cercles pleins. GF : Guyane française, GP : Guadeloupe, MQ : Martinique, NC : Nouvelle-Calédonie, PF : Polynésie française, RE : La Réunion, YT : Mayotte.
Sources : CEPII (base de données BACI), Douanes
françaises, Insee, ISEE,
ISPF, Banque mondiale.
Sur ce schéma, l'écart par rapport à la ligne orangée montre que les outre-mer français, et notamment les DFA, ont un niveau d'exportation nettement inférieur à celui qu'il devrait être compte tenu de leur PIB et des contraintes propres aux PEI (à l'exception de la Nouvelle-Calédonie en 2022). En revanche, le niveau des importations est conforme à la moyenne attendue (à l'exception de Mayotte, tous les outre-mer français sont très proches de la ligne orangée).
L'étude de la Banque de France a spécifiquement analysé le potentiel d'exportation vers les États-Unis de la Martinique et de la Guadeloupe (modèle de gravité à effet fixe).
Décomposition du potentiel d'exportation des Caraïbes vers les États-Unis en 2021 (en log de millions de dollars US)
Les exportations de la Guadeloupe et de la Martinique vers les États-Unis sont respectivement à 30 % et 12 % de leur potentiel estimé en 2021.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où la Martinique et la Guadeloupe auraient les mêmes contraintes bilatérales d'échange avec les États-Unis que leurs voisins, le potentiel de la Martinique serait encore triplé et celui de la Guadeloupe doublé. Pour les seuls produits agroalimentaires, le potentiel d'exportations de la Martinique pourrait être 5,5 fois plus élevé et celui de la Guadeloupe 3,6 fois plus.
L'étude de la Banque de France et l'audition de Manuel Marcias montrent donc que l'intégration régionale des outre-mer, et particulièrement ceux du bassin Atlantique, peut être porteuse de développement économique pourvu qu'elle s'appuie sur des stratégies territoriales ciblées sur certaines filières et secteurs (voir le compte-rendu annexé).
2. Améliorer inlassablement la connectivité maritime
Facteur déterminant de l'intégration régionale et du développement économique, la connectivité maritime demeure un point faible des outre-mer comme vu supra. La délégation y insiste régulièrement dans ses différents travaux. Le volet 1 de la présente étude sur la coopération régionale pointait notamment les graves lacunes du port et de l'aéroport de Mayotte et l'impérieuse nécessité d'une modernisation.
La connectivité maritime est un facteur clé pour développer tout le potentiel d'exportation, importer à moindre coût ou diversifier les approvisionnements et les marchés d'export. Elle en est le catalyseur.
Ce volet 2 consacré au bassin Atlantique, dans un contexte différent, plaide sans surprise pour les mêmes efforts en faveur :
- de la modernisation des infrastructures, y compris douanières ;
- de la promotion du cabotage maritime et de liaisons aériennes régionales ;
- de l'allègement du cadre normatif et fiscal.
a) La Guyane : un continuum logistique qui reste à construire
Les infrastructures portuaires en Guadeloupe et Martinique sont globalement satisfaisantes et font l'objet de modernisations importantes. C'est en particulier le cas des ports pour accueillir les nouveaux hubs de CMA-CGM. Les services douaniers sont également satisfaisants.
En revanche, en Guyane, de nombreuses insuffisances demeurent qui limitent le potentiel d'intégration régionale et les opportunités économiques qui en sont le corollaire (voir supra).
Il paraît donc urgent de garantir une continuité des liaisons d'ouest en est pour éviter que la Guyane soit enjambée par le développement économique rapide du Guyana et du Suriname à l'ouest et de l'Amapa à l'est.
Les projets prioritaires, qui pour certains sont embourbés depuis plus de 10 ans sont :
- l'aménager du port fluvial de Saint-Laurent-du-Maroni ;
- la mise en service (enfin) du nouveau ferry fluvial le Malani entre les rives de Saint-Laurent du Maroni et d'Albina ;
- de poursuivre la modernisation du port de Degrad-des-Cannes ;
- de moderniser le port sec de transbordement à Saint-Georges de l'Oyapock.
Côté brésilien, la route BR156 entre Oiapoque et Macapa de 576 km devrait enfin être entièrement enrober. Le dernier tronçon de 100 km en latérite et la dizaine de ponts en bois devraient être aménagés ou remplacés d'ici trois à quatre ans. Cet investissement de l'État fédéral doit accompagner l'essor économique annoncé de cette région à l'approche de l'arrivée de l'industrie pétrolière. Plus qu'une route, la BR156 est une ligne de vie qui devra permettre de désenclaver Oiapoque, en facilitant la circulation des hommes et des marchandises, et indirectement l'Est guyanais.
Cette modernisation des transports transfrontaliers pourrait aller de pair avec la création d'une zone franche à Saint-Georges pour attirer des activités de transformation des productions agroalimentaires brésiliennes à destination du marché guyanais ou de l'arc antillais.
b) L'appel unanime au développement du cabotage maritime face au dilemme « de l'oeuf et de la poule »
Ancienne, la demande d'un réseau plus dense et performant de liaisons maritimes intrarégionales pour développer les échanges commerciaux a encore été accentuée par la réorganisation en cours du commerce maritime international autour de hubs pour des porte-conteneurs toujours plus grands.
Le développement de lignes régionales ou du cabotage se heurte à des contraintes réglementaires et à des modèles économiques fragiles.
Toutefois, les acteurs économiques et portuaires tentent de se fédérer pour relancer des projets.
Le GPM de Guyane a réalisé en 2016-2019 une étude pour la création d'un cabotage maritime sur le plateau des Guyanes avec une connexion possible vers la Caraïbe.
Pour l'ensemble des acteurs rencontrés en Guyane, les conditions se mettent progressivement en place pour une filière de cabotage, en particulier depuis l'ouverture cette année du poste d'inspection frontalier (PIF) sur le port de Dégrad des Cannes. Ce nouveau service douanier doit permettre d'importer en direct des produits agroalimentaires et d'élevage, sans passer par les ports antillais ou l'Europe. Les mêmes facilités douanières devraient être offertes aux deux autres points d'entrée en Guyane, à Saint-Georges de l'Oyapock et à Saint-Laurent du Maroni. C'est indispensable si l'on veut rentabiliser les infrastructures existantes et les projets de coopération économique.
Dans la Caraïbe, des initiatives aussi se multiplient.
Un consortium privé basé à la Barbade est à l'origine d'un projet de réseau de ferry dénommé Connect Carib. Les Gouvernements et autorités de plusieurs îles de la Caraïbe membres de la Caricom ont été approchés pour être partenaire de ce projet. L'agence Caribbean Export46(*) accompagne ce projet. Ce consortium disposerait de trois ferries pour assurer des liaisons maritimes régionales pour les passagers et les marchandises tout le long de l'arc antillais. Le démarrage des liaisons avait été annoncé pour début 2025 puis pour la fin d'année. Toutefois, il semble que le projet prenne plus de retards que prévu, voire soit à l'arrêt.
Une autre initiative, moins globale, mais sans doute plus robuste et réaliste à court terme, est celle s'appuyant sur le développement des liaisons de l'Express des îles. L'Express des îles a en effet permis de mettre en place un service de ferry inter-îles moins cher, fiable et relativement rapide entre Sainte-Lucie, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Dr Didacus Jules, secrétaire général de l'OECO, a indiqué que son organisation soutenait la création de liaisons maritimes supplémentaires. Par ailleurs, l'OECO travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale sur une étude de préfaisabilité pour un service régional de ferry.
L'exemple de l'Express des îles montre aussi que des solutions régionales existent, mais qu'elles demeurent parfois mal connues des acteurs économiques. Ce constat avait été aussi relevé dans le premier volet relatif au bassin Indien.
Le rapport précité du CESCE de Saint-Barthélemy le reconnaît en soulignant que « compte tenu des rotations existantes, il est d'ores et déjà possible d'importer et d'exporter à une fréquence hebdomadaire des marchandises en provenance d'Anguilla, Sainte-Croix, Saint-Thomas, Tortola, Puerto Rico, Saint-Kitts, la Guadeloupe et la Martinique ».
En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, un cap crucial a été franchi au moment de l'inauguration le 13 octobre 2025 à Nantes du Neoliner Origin, plus grand cargo à voiles au monde. Capable de transporter jusqu'à 5 000 tonnes de marchandises tout en consommant cinq fois moins de carburant qu'un cargo classique, il a pour mission d'assurer chaque mois une liaison directe et stratégique entre la France hexagonale, Saint-Pierre-et-Miquelon, le Canada et les États-Unis. Il emportera notamment des véhicules, des produits frais, des cosmétiques et du champagne, tout en ouvrant la voie à des exportations depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des solutions s'esquissent, mais il faut lever les derniers obstacles et les accompagner d'une initiative politique forte, tant la précarité des modèles économiques, en particulier au démarrage, fragilise ces projets auprès des investisseurs.
Une première réponse serait de réviser le règlement (CEE) 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime). Ce règlement conçu pour le continent européen n'est pas adapté au cabotage depuis ou vers un port des RUP, ceux-ci étant surtout connectés à des ports étrangers situés à proximité. Lors de la rencontre avec les opérateurs du Grand port maritime de Guyane, cette question du cadre légal du cabotage a été soulignée.
Recommandation n° 15 : Modifier le règlement européen du 7 décembre 1992 afin de faciliter la création de lignes de cabotage maritime entre les RUP et leurs partenaires régionaux.
Une seconde serait de lancer une initiative politique forte conjointement entre l'UE, la France, les Pays-Bas, l'OECO ou le Caricom.
L'absence de transport maritime régional efficace est citée unanimement comme le principal obstacle au déploiement de projets plus ambitieux dans la région : coopération pour le traitement des déchets, la souveraineté alimentaire, le développement de filières, la lutte contre la vie chère, le transport des passagers à moindre coût. Le transport régional est le trait d'union manquant ou perdu entre tous ces petits territoires.
Cette initiative politique, s'appuyant sur les financements européens, pourrait porter la création d'une communauté caribéenne du transport maritime régional. Cette communauté ciblerait un secteur catalyseur qui peut dénouer de nombreux projets, comme le fut la Communauté européenne du charbon et de l'acier (la CECA) en Europe au lendemain de la guerre. Un projet de cette ampleur serait prioritaire pour les financements européens, notamment le nouveau mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe et les fonds de coopération régionale (voir supra).
Recommandation n° 16 : Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom.
c) Préserver la compétitivité des escales françaises
Le système ETS de taxe carbone européenne est entré en vigueur dans les outre-mer depuis le 1er janvier 2024. Il s'applique sur tous les navires en provenance de pays tiers, hors RUP, touchant un territoire européen.
Ce système fragilise la compétitivité des escales françaises qu'il s'agisse du transport de marchandises et de la croisière, car les escales dans les ports voisins non européens, souvent situés à quelques dizaines de kilomètres seulement dans la Caraïbe, ne sont pas touchées.
Pour l'Union maritime et portuaire de France, le spectre de la fuite de compagnies maritimes étrangères, comme l'exemple récent de Costa Croisières qui déplace son port de base de la Guadeloupe vers la République dominicaine, va devenir une réalité. La Martinique devrait perdre des escales dès 2026.
Cette taxe dessert tous les flux aussi bien maritimes qu'aériens des Antilles. L'ETS impliquerait par exemple une augmentation de 200 euros sur les billets d'avion en 2030.
Cette alerte sur les conséquences pour les outre-mer, et en particulier les RUP des Antilles et de Guyane, avait déjà été lancée par la délégation lors de ses travaux sur la vie chère. L'impact des ETS sur le prix des carburants avait été signalé, avec un risque de hausse du prix au litre de 15 à 20 centimes à partir de 2027.
Pour la compétitivité du transport maritime et aérien des RUP dans un contexte régional entièrement différent de celui du territoire européen continental, une adaptation de la réglementation européenne est indispensable et urgente, sauf à mettre en place des instruments d'accompagnement et de compensation face à la concurrence extra-européenne.
Un système équivalent à l'ETS ou coordonné avec le système européen devrait être débattu à l'échelle régionale, dans le cadre de l'OECO ou de la Caricom. La France et l'UE pourraient porter une telle initiative politique forte.
Recommandation n° 17 : Suspendre en urgence l'application de la directive européenne « ETS » dans les RUP, pour maintenir la compétitivité des escales maritimes et aériennes face à celles de leurs voisins proches et engager des discussions avec les organisations régionales pour la création d'un système de taxe carbone à cette échelle.
3. Le traitement des déchets : atteindre l'effet masse
La délégation réclame depuis plusieurs années une évolution de la réglementation européenne, voire internationale, en matière de transferts transfrontaliers de déchets, afin de prendre en considération la situation particulière des outre-mer français. Les travaux sur le présent rapport n'ont fait que confirmer et illustrer cette nécessité.
Le rapport d'information de décembre 2022 sur la gestion des déchets dans les outre-mer47(*) relevait déjà les obstacles de plus en plus insurmontables pour transférer les déchets dangereux, y compris vers l'Union européenne, ainsi que les déchets non dangereux.
La convention de Bâle , ainsi que la réglementation européenne et de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) , imposent des règles strictes pour s'assurer que les pays membres de l'OCDE exportent leurs déchets dangereux à des fins de traitement vers des pays de l'OCDE.
Les compagnies maritimes ont surinterprété des textes déjà complexes, notamment :
- en ajoutant des pays de transit, pour faire face à l'hypothèse où les navires seraient déroutés ;
- en exigeant des consentements explicites de certains pays hors OCDE pour éviter tout risque d'immobilisation de container dans ces pays de transit, alors que le consentement peut être considéré favorable tacitement ;
- en réduisant la durée de validité des consentements.
S'agissant des déchets non dangereux, la récente révision du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 a encore durci les règles de transferts hors OCDE, sans prendre en considération la situation singulière des territoires ultramarins. En effet, le règlement n° 2024/1157 interdit complètement l'exportation de certains déchets dangereux, dont les plastiques, vers des pays hors OCDE.
Malgré une résolution européenne du Sénat48(*) et la mobilisation de nombreux professionnels et acteurs de la gestion des déchets outre-mer, le texte européen est resté sourd aux demandes d'adaptation aux RUP, à la seule exception des transferts de déchets depuis les territoires ultramarins vers l'Hexagone qui sont facilités grâce à la mise en place d'un consentement tacite de l'autorité de transit des États membres.
Cette réglementation empêche la mise en place de projets de gestion concertée du traitement de certains déchets entre des territoires de petites tailles, produisant des volumes réduits de déchets et aux statuts très différents. Les outre-mer français sont entourés d'États non membres de l'UE ou de l'OCDE. Or, la création de filières de traitement des déchets pourrait être optimisée à l'échelle de plusieurs territoires en massifiant les gisements.
Xavier Lédée, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, a par exemple évoqué des pistes de coopération avec Anguilla. Ce territoire dispose d'un foncier important, mais offre pour seul exutoire à ses déchets une décharge à ciel ouvert. Inversement, Saint-Barthélemy a élaboré une gestion très moderne de ses déchets, mais doit exporter les déchets valorisables loin en Europe ou aux États-Unis. Un plan inter-îles de traitement des déchets pourrait prévoir une répartition et un partage de certaines filières. La gestion des sargasses pourrait s'intégrer à ce plan.
Même chose en Guyane. À Saint-Georges-de-l'Oyapock, les déchets doivent être transférés par camion vers Cayenne situé à trois heures de route. Une coopération avec Oiapoque de l'autre côté du pont à quelques kilomètres seulement serait plus pertinente et efficace, d'autant que la région d'Oiapoque va connaître une croissance économique et démographique très forte dans les prochaines années.
Ces perspectives de coopération, dans un domaine où la France et l'Union européenne ont acquis une expertise mondialement reconnue, sont imaginables dans l'ensemble de l'arc antillais, entre des îles proches et confrontées aux mêmes défis.
Pour y parvenir, une simplification et un allègement de la réglementation européenne dans les bassins régionaux des RUP devraient être défendus auprès des institutions européennes. On rappellera que la convention de Bâle prévoit que des accords régionaux peuvent être signés entre États tant qu'ils sont compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets (dangereux et autres).
Recommandation n° 18 : Pour permettre outre-mer des coopérations régionales de traitement des déchets :
- faire application de l'article 349 du TFUE pour obtenir l'adaptation des règlements européens (UE) 1257/2013 et (UE) 2020/1056 aux contraintes des régions ultrapériphériques ;
- ouvrir des discussions dans le cadre de la convention de Bâle afin de conclure des accords régionaux.
4. Faire face à un fléau commun : les sargasses
Apparues massivement depuis une quinzaine d'années, les sargasses ont envahi non seulement les Antilles, mais aussi la Guyane, l'Amérique centrale, le golfe du Mexique et certaines côtes d'Afrique de l'Ouest. Outre la question environnementale, elles représentent désormais un enjeu économique, social et sanitaire, avec des effets dévastateurs pour le tourisme, la pêche et la vie des habitants.
En France, l'État a réagi en adoptant successivement plusieurs plans et en apportant son aide aux collectivités concernées. Le premier plan national de prévention et de lutte contre les sargasses, lancé en octobre 2018, a ouvert la voie à la première Conférence internationale sur le sujet pour mobiliser la recherche dans les différents pays concernés. Le Gouvernement a adopté en 2022 un deuxième plan interministériel pour la période 2022-2025, doté de près de 36 millions. Lors du Comité interministériel de la mer qui s'est tenu en mai 2025 à Saint-Nazaire, un troisième plan de lutte contre les sargasses a été dévoilé visant à renforcer les actions de collecte et de destruction de ces algues. Le recours à des navires spécialisés (appelés Sargator), capables de collecter jusqu'à seize tonnes d'algues par heure ainsi que l'utilisation de grues et de barges de stockage dédiées ont été annoncés.
Comme l'a indiqué Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, « nous sommes progressivement passés d'une période où l'on s'interrogeait sur l'origine du phénomène et sur la gestion des afflux, qui étaient irréguliers - massifs certaines années, moins d'autres - à une réalité où ces afflux sont désormais à la fois massifs et réguliers ». L'année 2025 semble devoir battre tous les records, avec environ 70 % de masse de sargasses supplémentaires dans l'Atlantique par rapport aux années records de 2022-2023. Si la Guadeloupe et la Martinique sont particulièrement impactés, des territoires comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy qui étaient relativement épargnés, sont touchés. Seule la Guyane y échappe encore du fait de courants favorables.
Sous l'impulsion de la France, le sujet a pris une dimension internationale. En collaboration avec la région Guadeloupe, une initiative internationale de lutte contre les sargasses a été présentée en décembre 2023 à Dubaï, à l'occasion de la COP28 climat. La Guadeloupe avait déjà accueilli en octobre 2019 la première conférence internationale sur les sargasses. Après le premier programme SARG'COOP financé par Interreg, le projet SARG'COOP 2 toujours piloté par la région Guadeloupe a pris la suite. Doté d'un budget de 4,4 millions d'euros, il doit préparer le basculement vers une coopération régionale concrète.
À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC3), à Nice du 9 au 13 juin 2025, la France, le Costa Rica, le Mexique et la République dominicaine ont organisé un événement parallèle intitulé : « Crise des sargasses : coopération régionale et réponse face à de nouveaux défis ». La France a proposé dans le cadre multilatéral un cadre d'action commun pour mieux anticiper, répondre et coopérer face à cette crise. Le sujet devrait être à nouveau à l'ordre du jour lors de la prochaine conférence sur les changements climatiques, ou COP 30, qui se tiendra à Belém au Brésil en novembre 2025.
Par ailleurs, la question de la valorisation et de l'implication du secteur privé, afin de trouver une chaîne de valeur viable qui permette une solution pérenne, progresse.
À Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un projet pilote visant à récolter et recycler ces algues envahissantes, financé par la Banque mondiale et l'OECO49(*), se met en place. L'entreprise britannique Seafields Solutions Ltd, spécialisée dans l'aquaculture et les technologies marines, s'est associée à la société Private Refuse and Garbage Disposal (PRGD). Ensemble, ils piloteront un projet de récolte et de transformation des sargasses entre septembre 2025 et avril 2026.
En janvier 2025, la Banque interaméricaine de développement (BID) et son laboratoire d'innovation, IDB Lab, ont dévoilé les projets retenus dans le cadre du Sargassum Innovation Quest, un concours visant à trouver des solutions pour gérer les sargasses dans les Caraïbes et en Amérique latine. En partenariat avec l'USAID (l'Agence des États-Unis pour le développement international), plusieurs initiatives ont été sélectionnées : Caribbean Chemicals (Barbade, Belize, Jamaïque, Trinité-et-Tobago) pour fabriquer des produits agricoles, C-combinator (Mexique) pour créer des produits naturels qui aident les plantes à pousser et du cuir écologique, et SOS Carbon et Origin by Ocean (République dominicaine) pour récolter les algues et les transformer en engrais, aliments pour animaux ou produits chimiques.
Les projets de valorisation se développent aussi en Guadeloupe (Pyrosar, INRAE, ...) en vue de produire du charbon actif, du lubrifiant ou encore du biogaz. Toutefois cette valorisation des sargasses se heurte encore au défi sanitaire50(*) : elles sont chargées en métaux lourds (arsenic ou cadmium) auxquels il faut ajouter, une fois près des côtes antillaises de la chlordécone. Les produits issus de leur transformation devront présenter toutes les garanties pour la santé des consommateurs.
Les organisations régionales sont aussi parties prenantes. Dr Didacus Jules a souligné l'implication de l'OECO. Après avoir participé au programme SARG'COOP, l'OECO co-dirigera trois domaines majeurs du programme SARG'COOP 2 : l'évaluation des impacts sanitaires et économiques des sargasses, la mise en commun des données et des connaissances via un « centre d'information sur les sargasses » et la promotion d'un plaidoyer international afin que la voix des Caraïbes soit entendue dans les discussions mondiales sur les politiques et le financement.
Parallèlement, l'OECO met en oeuvre un volet du projet SARSEA, financé par l'AFD et Expertise France, qui concerne la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ce projet est étroitement aligné sur le projet SARG'COOP II afin d'assurer leur complémentarité, et l'un de ses principaux objectifs est d'élaborer une stratégie régionale de gestion des sargasses qui sera officiellement adoptée par tous les États membres de l'OECO.
La valorisation des sargasses se heurte aussi à l'équation économique. L'installation de capacités industrielles de traitement et de transformation des algues requerra probablement des capitaux importants et une massification des apports en volume et en régularité. Une coopération entre les îles paraît indispensable. Xavier Lédée, président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, réfléchit à un système de barges qui pourrait récupérer les sargasses entre des îles relativement proches pour les concentrer sur un site unique de valorisation. Des flux retours devront être imaginés pour rentabiliser le transport, par exemple d'autres types de déchets qui seraient traités sur un site mutualisé implanté dans une autre île. À la suite de l'appel de Gustavia en mai 2025, des réflexions sont engagées entre Saint-Barthélemy, Sint Maarten et Anguilla notamment.
Incontestablement, le défi posé par les sargasses peut être un puissant fédérateur et catalyseur d'une coopération régionale, à la fois sur les plans scientifiques, sanitaires, environnementaux et industriels. Les outre-mer doivent demeurer à la pointe de la dynamique actuelle.
5. La production électrique : imaginer des interconnexions et prendre la tête d'un écosystème de la géothermie
Dans la zone géographique, plusieurs projets régionaux ont été mis en oeuvre afin de favoriser la coopération en matière d'énergie, notamment pour le développement d'énergies renouvelables.
Lancé en 2019, le projet TEC « Transition Énergétique dans la Caraïbe », qui s'inscrivait dans le cadre d'Interreg V Caraïbes, visait à instaurer une coopération active en matière de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables entre la Guadeloupe, les autres territoires ultramarins de la zone et les États du bassin caribéen membres de l'OECO. Il avait également pour objectif de renforcer la résilience des systèmes énergétiques insulaires face au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes qu'il engendre.
Doté d'un budget total de 3,6 millions d'euros, co-financé à hauteur de 75 % par le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds européen de développement (Fed), le projet TEC était conduit par la Région Guadeloupe, en partenariat avec les directions régionales Guadeloupe de l'Agence de Développement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) et du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), et avec l'OECO. Il s'est poursuivi jusqu'à fin 2023.
Il comprenait trois dimensions principales : la performance énergétique des bâtiments, l'énergie propre dans les transports et le développement régional de la ressource géothermique.
Au vu du potentiel géothermique exceptionnel de la Caraïbe, et face aux défis rencontrés (projets complexes, défis techniques lors de la phase d'exploration notamment...), la coopération régionale permet d'élaborer de nouvelles méthodes d'exploration et de faciliter les transferts de technologie. Ainsi, dans le cadre du projet TEC, ont été élaborés des guides méthodologiques pour l'intégration socio-environnementale des projets de production d'électricité géothermique en milieu insulaire et pour l'exploration des ressources dans le contexte volcanique insulaire typique de la zone régionale.
L'expertise de production d'énergie géothermique de la Guadeloupe, pionnière en la matière avec la centrale de géothermie de Bouillante en activité depuis 40 ans, a pu être valorisée. La centrale de Bouillante qui a une capacité globale de 15,5 MW électriques répartie sur deux unités de production représente actuellement 7 % du mix électrique guadeloupéen. Cette part devrait être portée à 12 % d'ici mi-2026, à l'issue de l'extension initiée en 2024 et bénéficiant d'un financement de 22 millions d'euros de l'AFD, en partenariat avec le Groupe BPCE, BpiFrance, Caisse d'épargne CEPAC et BNP Paribas.
Dans le cadre du projet TEC s'inscrivait la création d'un Centre d'excellence caribéen de la géothermie (CECG), basé en Guadeloupe eu égard à l'expérience du territoire en matière de géothermie, avec pour missions de fournir une expertise technique de haut niveau aux pays de la Caraïbe, de constituer un forum de collaboration et d'échange d'expériences au sein de la zone régionale et de jouer un rôle clé dans la promotion et le déploiement de l'énergie géothermique. Appelé de ses voeux par le ministère de la transition écologique pour 2024 dans le cadre des mesures de développement de la géothermie dans les outre-mer, la mise en place de ce CECG n'est néanmoins pas encore finalisée.
Outre le projet TEC, le projet GEOBUILD axé exclusivement sur l'énergie géothermique a été mis en place dans la zone régionale par l'OECO. En effet, constatant les atouts que pourraient représenter le développement de la géothermie dans les Caraïbes, qui n'était alors exploitée qu'en Guadeloupe, mais également les défis soulevés, l'OECO a lancé en 2022 le projet GEOBUILD (Geothermal Energy: Capacity Building for Utilization, Investment and Local Development - l'énergie géothermique : Renforcement des capacités pour l'utilisation, l'investissement et le développement local), pour répondre aux capacités limitées en matière de ressources humaines, d'institutions et de cadre réglementaire pour le développement de l'énergie géothermique. La Banque interaméricaine de développement, le Fonds d'Investissement de l'Union européenne pour l'Amérique latine et les Caraïbes ainsi que la Banque de développement des Caraïbes sont partenaires du projet GEOBUILD.
Ce projet bénéficie à cinq États membres participants de l'OECO qui développent l'énergie géothermique : le Commonwealth de la Dominique, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Avec l'ouverture d'une centrale de 10 MW à Laudat d'ici fin 2025, la Dominique deviendrait le deuxième producteur d'énergie géothermique de l'OECO après la Guadeloupe. Saint-Kitts-et-Nevis envisage la construction d'une centrale et cinq entreprises d'Islande, du Royaume-Uni, des États-Unis ont répondu à un appel d'offres pour les forages sur le site de Hamilton (Nevis) à partir de 2026. D'ici 2026, la Grenade prévoit également l'ouverture de ses ressources géothermiques à l'exploration.
Une visite d'étude d'une délégation de l'OECO en Guadeloupe, et notamment à la centrale de Bouillante, considérée comme modèle de réussite géothermique dans la région, a été réalisée dans le cadre du projet GEOBUILD en juin 202551(*).
Partenaire du projet TEC et acteur principal du projet GEOBUILD, l'OECO a fait de la transition vers une énergie durable dans la Caraïbe orientale une priorité. Elle a ainsi défini un cadre énergétique durable visant à relever les défis énergétiques des États membres selon trois axes :
- promouvoir le développement et le déploiement de systèmes énergétiques durables tout en réduisant les coûts de l'énergie ;
- renforcer la sécurité et l'efficacité énergétiques ;
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Avec la Déclaration de Basseterre adoptée à l'unanimité le 5 février 2025, au cours de la troisième réunion du Conseil des ministres de l'Énergie de l'OECO à Saint-Kitts-et-Nevis, l'OECO a lancé la décennie d'action pour le développement de l'énergie durable 2025-2035. Au travers d'une feuille de route passant notamment par l'augmentation de la capacité de production d'énergies renouvelables - solaires, éoliennes, géothermiques et d'hydrogène vert - en adéquation avec les besoins de la région, la Décennie d'action vise des bénéfices concrets pour les citoyens des États membres de l'OECO : réduction du coût de l'énergie, création d'emplois dans les secteurs des énergies renouvelables, renforcement de la résilience face au changement climatique et aux chocs économiques, croissance économique avec la réorientation des fonds alloués aux importations de carburant vers des investissements locaux en faveur du développement des énergies renouvelables.
« Reconnaissant que le développement de l'énergie durable constitue une opportunité de transformation pour la réinvention économique de notre région et représente un objectif stratégique majeur pour le développement de la Caraïbe », la Déclaration de Basseterre ouvre des perspectives pour le renforcement de la coopération régionale en matière d'énergies renouvelables, « en appel[ant] les partenaires régionaux et internationaux, les entreprises, les institutions financières et les organisations académiques à soutenir cet agenda transformateur à travers la coopération technique, l'investissement et le partage de connaissances ».
Un écosystème de la géothermie émerge dans la région. L'expérience précurseur de la Guadeloupe, ainsi que l'expertise mondialement reconnue de la France dans ce domaine, invitent à faire de ce secteur d'activité une des priorités de la coopération régionale.
L'augmentation annoncée des moyens alloués au nouveau mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe 2028-2034, qui cite expressément les RUP et les investissements dans les réseaux transfrontières, les réseaux en mer et les sources d'énergie renouvelables, pourrait doter les RUP d'une force de frappe financière pour porter des projets structurants à l'échelle de l'arc antillais.
6. L'agroalimentaire : vers une souveraineté régionale ?
Tous les territoires de la Caraïbe et du plateau des Guyanes se fixent désormais des objectifs ambitieux en matière de souveraineté alimentaire, conscients que la dépendance excessive aux importations a détruit des filières, effacé des modes de consommation traditionnelles et atteint la santé des populations.
Toutefois, les contraintes insulaires rendent difficile l'atteinte de tous les objectifs à l'échelle de chaque territoire pris isolément.
Une souveraineté pensée au niveau régional paraît en revanche offrir des perspectives intéressantes, en favorisant des circuits courts, en solvabilisant des systèmes de transport inter-îles (masse critique et flux retour suffisant), en spécialisant chaque territoire sur quelques productions et atteindre des tailles critiques intéressantes et compétitives.
Pour Xavier Lédée, le renforcement de la souveraineté alimentaire passe par des coopérations régionales étroites. Saint-Barthélemy ne dispose pas de foncier agricole ou très marginalement. Une solution pour se fournir en produits frais de bonne qualité, en circuits courts et à des prix compétitifs, serait de s'approvisionner dans les îles les plus proches disposant du foncier utile et offrant des coûts du travail plus faibles. Des contacts auraient été pris avec l'île voisine de Nevis, dotée de terres agricoles importantes et fertiles. Une coopération bilatérale pourrait orienter une part de la production locale vers les besoins exprimés par Saint-Barthélemy. Le principal obstacle à ce projet serait néanmoins l'absence de lignes de cabotage entre les îles pour acheminer régulièrement et à un coût acceptable les productions de Nevis.
Le rapport précité du CESCE de Saint-Barthélemy note aussi le potentiel de la République dominicaine dont la production agricole, y compris en bio, est importante et souvent aux normes européennes.
Cette démarche ciblée est aussi celle de la Martinique qui souhaiterait conclure des accords de partenariat sur quelques produits avec Sainte-Lucie.
Pour réussir une souveraineté alimentaire pensée au niveau régional, plusieurs conditions sont requises. Elles recoupent largement plusieurs des recommandations du présent rapport :
- un réseau de transport de marchandises inter-îles ;
- des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux avec les RUP françaises ;
- une revue générale des normes de production agroalimentaire pour renforcer la compétitivité prix des productions sous climat tropical.
L'Ambassadeur Arnaud Mentré souligne aussi l'inadaptation de la PAC actuelle, encore très centrée sur des productions à destination de l'UE comme la banane : « la PAC n'a pas été conçue autour de la coopération régionale. Nous n'avons donc que peu de marge de manoeuvre financière pour développer la coopération régionale par ce biais ».
La réorientation de la PAC, et du programme POSEI en particulier, est donc un autre chantier clé à ouvrir.
À côté de cette stratégie de souveraineté alimentaire, des stratégies de filières d'excellence à l'export peuvent aussi se mettre en place, ciblées sur des productions à forte valeur ajoutée.
Pour nos outre-mer, comme vu supra, le potentiel de commerce est sous-exploité, en particulier vers les États-Unis.
L'exemple du rhum est parlant. Contrairement à leurs voisins, les DFA sont peu présents sur le marché américain, pourtant deuxième importateur mondial de rhum. Les droits de douane plus élevés sur le rhum français ne sont probablement pas l'explication principale. Un travail de pénétration du marché américain reste à mener pour diversifier les marchés du rhum et conquérir un marché à fort pouvoir d'achat.
7. L'environnement et les sciences : faire grandir les compétences locales et éviter la dispersion des forces
Dans les domaines de la protection de l'environnement, de la recherche scientifique ou de la santé, l'expertise française et des outre-mer de la région est immense et reconnue par les partenaires de la région. De nombreuses coopérations font déjà rayonner nos territoires (voir supra).
Il est nécessaire d'accentuer encore les projets pour exporter des prestations de services et notre expertise. Dans ces domaines, le différentiel du coût du travail par rapport aux territoires voisins est un obstacle moindre que pour les exportations de marchandises. L'avantage comparatif des outre-mer français est réel.
En matière environnementale, un projet majeur doit être soutenu en raison de sa dimension politique majeure et des enjeux pour la préservation de la forêt amazonienne : le rapprochement du Parc amazonien de Guyane (PAG) et du parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque qui est le plus grand parc brésilien et d'une superficie légèrement supérieure au PAG.
À la suite de la visite du Président de la République française au Brésil fin mars 2024, une lettre d'intention a été signée avec pour objectif la construction d'une feuille de route pour le développement de la coopération transfrontalière entre le PAG et le parc national des Montagnes des Tumucumaque (PNMT).
Le PAG est le plus grand parc national français et la plus grande aire protégée de l'Union européenne. Depuis 2017, le PAG porte déjà un projet RENFORESAP (Renforcement du réseau des Aires Protégées du plateau des Guyanes), visant à réunir les gestionnaires des aires protégées voisines du Suriname et du Guyana pour échanger sur des problématiques communes telles que l'écotourisme, la transmission des patrimoines culturels, l'orpaillage ou sur l'implication citoyenne dans la recherche.
Depuis 2024, l'AFD finance par une subvention l'élaboration d'un projet de coopération technique bilatérale entre le PAG et le PNMT. Un des objectifs est d'assurer une continuité de la protection entre des aires proches ou contigües. Le rapprochement des plus grands parcs européens et brésiliens serait porteur d'une symbolique forte. Il permettrait aussi d'apporter une réponse à l'échelle du plateau des Guyanes.
L'AFD a néanmoins pointé des obstacles pour mobiliser les financements, le PAG étant un organisme divers d'administration centrale (ODAC). La réglementation applicable en matière d'endettement est contraignante. Le Feder ou le programme Interreg ne seraient pas mobilisables par le PAG. Une évolution de la réglementation paraît nécessaire pour faciliter la mobilisation des crédits Interreg. Pourtant, dans la région, le PAG est un acteur solide de premier plan doté de moyens considérables par rapport à ses voisins. À titre de comparaison, le PAG compte 90 ETP contre 3 pour le PNMT. Cette force de frappes et de rayonnement doit être mobilisée pour la coopération régionale et orienter la Guyane vers son continent naturel.
Enfin, ce rapprochement serait un levier politique important pour infléchir la position du Brésil qui jusqu'à aujourd'hui ferme la porte à une adhésion de la France et de la Guyane à l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA).
Recommandation n° 19 : Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation de crédits Interreg sur cet objectif.
Un autre domaine d'excellence est la recherche agronomique et en agroécologie en milieu équatorial et tropical. Plusieurs organismes reconnus y concourent, et particulièrement dans la Caraïbe et en Guyane. L'INRAE, le Cirad ou l'IRD, dans des domaines souvent proches, sont fortement implantés dans la plupart des outre-mer du bassin Atlantique (voir supra). Ces établissements disposent de moyens importants avec plusieurs centaines d'ETP chacun dans les territoires.
Leurs travaux les conduisent par ailleurs à développer des coopérations avec de nombreux pays de la région. Cette dimension régionale ou internationale est même au fondement de la création de l'IRD et du Cirad.
De nombreuses interactions existent aussi entre ces organismes, en particulier le Cirad et l'INRAE qui travaillent sur des thèmes identiques ou proches :
- un comité de direction commun par an ;
- un comité d'éthique commun INRAE-Cirad-IFREMER-IRD ;
- une unité mixte d'appui aux relations internationales (UMARI)
- des projets communs co-portés ou des unités mixtes de recherche (CAVALBIO, CAMBIONET qui regroupe une dizaine d'états et de territoires, ECOFOG, ASTRE...).
Toutefois, un rapprochement plus marqué de ces organismes est sans doute indispensable. Un accord-cadre entre l'INRAE et le Cirad devrait être envisagé, à défaut d'une fusion éventuelle. L'IRD pourrait aussi être partie prenante à ces rapprochements.
La lisibilité y gagnerait, notamment vis-à-vis des collectivités et des partenaires extérieures. Les actions de recherche locales manquent de visibilité, car elles sont souvent menées de manière isolée et pas assez partagée à l'échelle de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Cela conduit à une multitude de projets au rayonnement parfois trop limité.
La diplomatie territoriale des outre-mer ne peut se passer d'une diplomatie scientifique. Pour être efficace, elle requiert d'être rationalisée en rapprochant plus étroitement les organismes de recherche, avant d'envisager une éventuelle fusion.
Recommandation n° 20 : Rapprocher les organismes de recherche outre-mer, en particulier l'INRAE, le Cirad et l'IRD pour porter une diplomatie scientifique puissante et lisible sur les sujets de souveraineté alimentaire et de santé.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Mme Micheline Jacques, présidente. - Après nos précédentes réunions consacrées à la définition de notre programme de travail pour la session, je suis heureuse de vous retrouver pour l'examen d'un rapport sur un sujet particulièrement important et d'actualité : la coopération et l'intégration régionales de nos outre-mer.
Je tiens tout d'abord à saluer le retour au sein de notre délégation de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, après ses responsabilités ministérielles dans lesquelles il a porté la voix de nos outre-mer, de la francophonie et des enjeux de développement qui sont au coeur des travaux de notre délégation. Nous sommes heureux de le retrouver et savons que nous pourrons compter sur son expertise pour faire avancer nos propositions. Le hasard fait que son retour coïncide avec l'examen de ce rapport pour lequel il avait été auditionné en sa qualité de ministre. « La boucle est bouclée », oserais-je dire.
Nous examinons donc ce matin les conclusions du deuxième volet du rapport sur la coopération et l'intégration régionales des outre-mer, consacré au bassin Atlantique.
Je vous rappelle que l'étude lancée en 2024 à vocation à couvrir les trois bassins océaniques, et que nous aborderons au cours de la présente session le troisième et dernier volet, dédié au bassin Pacifique.
Initialement, notre objectif était de disposer d'un état des lieux actualisé des différentes dimensions de la coopération régionale - diplomatique, économique, culturelle, etc. - pour mesurer la réalité d'un regard généralement assez critique sur la situation économique de nos outre-mer, encore très marquée par leurs liens historiques avec Paris. L'inventaire devait aussi tenir compte des enjeux géopolitiques et de sécurité croissants. La question d'un autre modèle de développement a aussi été sous-jacente à notre choix.
Sur la base de chaque constat, les rapporteurs sont chargés de formuler des recommandations adaptées et opérationnelles.
L'an passé, sur le premier volet de cette étude consacré à l'océan Indien, nos rapporteurs, Christian Cambon, Stéphane Demilly et Georges Patient, ont dressé le constat d'une intégration obstinément insuffisante de La Réunion, de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) dans leur environnement régional. Ils ont formulé vingt propositions, qui ont reçu un large écho dans la presse et auprès des acteurs concernés - cela nous a été dit à maintes reprises lors de nos récentes auditions.
Dans le prolongement, je suis particulièrement heureuse de saluer aujourd'hui le travail de nos deux excellentes rapporteures Jacqueline Eustache-Brinio et Evelyne Corbière Naminzo, qui se sont investies avec passion et opiniâtreté dans les méandres complexes et mouvants de la coopération de l'immense bassin Atlantique, là où se situe la moitié des outre-mer français ! Je tiens à souligner l'ampleur de l'étude réalisée par nos collègues.
Les six mois de travaux préparatoires, engagés en avril 2025, ont donné lieu à une quarantaine d'auditions, dont beaucoup sous forme d'auditions menées par les rapporteurs, en visioconférence et sur le terrain. Au total, une centaine de personnes ont été entendues - élus, hauts fonctionnaires, responsables d'organisations régionales, ambassadeurs, etc.
Un déplacement a été organisé en avril, en Guyane et dans l'État voisin du Suriname où je me suis aussi rendue avec nos rapporteures, sur différents sites. Nous y avons rencontré des acteurs impliqués dans les différents types de coopération, notamment politique, diplomatique, économique, scientifique et culturelle.
Chaque jour nous apporte la preuve de l'absolue nécessité de resserrer les liens régionaux. Je citerai l'exemple des sargasses : le projet Stratégies régionales de lutte contre les sargasses pour l'élaboration d'actions fondées sur l'écosystème (Sarsea) vient d'être lancé le 28 octobre à Sainte-Lucie. Les nombreux représentants gouvernementaux, institutionnels et scientifiques venus de toute la région caribéenne se sont enfin unis pour « développer une réponse régionale coordonnée ».
La France y apporte son expertise, en mobilisant l'État et les collectivités locales en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin pour améliorer le suivi, la collecte et le traitement de ces algues. Le travail conjoint, mené depuis une dizaine d'années, entre institutions nationales et autorités locales va pouvoir être partagé à l'échelle régionale afin de construire une réponse cohérente et coordonnée dans la Caraïbe orientale.
Par ailleurs, je rappelle que nos travaux sur le premier volet ont dégagé des pistes prometteuses pour l'océan Indien bien sûr, mais aussi pour les autres bassins, plusieurs recommandations étant a priori valables pour d'autres territoires.
Je pense en particulier à l'idée très forte de la création d'une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) inspirée de la politique européenne de voisinage.
Cette proposition importante et innovante a abouti à l'adoption de la résolution européenne du Sénat le 24 mars 2025. Ce texte, nous l'avons porté et défendu à Bruxelles en mai dernier. Nous devons continuer à tracer ce chemin.
Je me réjouis que les rapporteures du deuxième volet parviennent à des conclusions similaires sur l'Europe. Il s'agit au final d'un travail approfondi et sans précédent, qui met à l'honneur l'engagement des membres de notre délégation. Je ne doute pas de l'excellence des propositions de nos collègues, établies à partir d'un état des lieux minutieux.
Pour suivre cette présentation, plusieurs supports sont disponibles : une note de synthèse du rapport - L'Essentiel -, la liste des recommandations, et une version provisoire du rapport. Enfin, une conférence de presse se tiendra à l'issue de la réunion.
Je vous prie de bien vouloir excuser Christian Cambon, retenu par une contrainte d'agenda ce matin.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous présenter le deuxième volet de l'étude sur la coopération et l'insertion régionales des outre-mer français, consacré cette fois au bassin Atlantique.
Je remercie à cet égard nos collègues Georges Patient et Stéphane Demilly. Leur rapport sur le premier volet a tracé des orientations inspirantes pour nos réflexions et travaux.
Notre volet concerne six territoires français : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensemble, ils représentent près de la moitié des outre-mer français, des territoires très divers, proches et à la fois éloignés.
Comme l'an passé, la formule de Serge Letchimy - « les outre-mer sont étrangers à leur géographie » - a trouvé un plein écho lors des travaux préparatoires. Plus qu'ailleurs peut-être, les relations historiques et les liens économiques avec la métropole ont façonné la faiblesse des relations de ces territoires avec leur environnement. Nous avons touché du doigt cette réalité souvent absurde lors de notre déplacement en Guyane.
Comme pour les collectivités de l'océan Indien, les flux d'échanges, notamment commerciaux, peinent à se développer et à produire les effets attendus sur les économies concernées.
Si des progrès ont été accomplis ces dernières années dans tous les domaines, hormis économiques, de nombreux freins persistent. Il est d'autant plus urgent de les lever et d'accélérer le processus que la Caraïbe et le plateau des Guyanes sont des espaces en pleine transformation. Des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires de première importance s'y jouent.
Pour saisir les opportunités, il faut donc changer de braquet. C'est le sens des vingt recommandations que nous vous proposerons aujourd'hui.
Je commencerai par le constat.
Le bassin Atlantique est hétérogène et très fragmenté, ce qui le différencie nettement du bassin Indien. C'est aussi un bassin sous tension géopolitique.
La Caraïbe et le plateau des Guyanes forment un espace à la fois unifié par des défis communs et divisé par des réalités très différentes. La Grande Caraïbe est un véritable patchwork, un espace maritime transfrontalier de plus de 4,3 millions de kilomètres carrés autour duquel sont regroupés quinze pays continentaux et quarante-quatre îles regroupées pour certaines en archipels.
Se côtoient, dans cette vaste zone, des entités aux statuts différents, des États-nations, des États souverains, des territoires rattachés à leurs anciennes métropoles, comme les îles Vierges anglaises et américaines, Bonaire dépendant de la couronne néerlandaise, Anguilla, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, membres du Commonwealth. Sans parler naturellement des outre-mer français où l'on retrouve cette complexité : régions ultrapériphériques (RUP) et pays et territoires d'outre-mer (PTOM), collectivités dotées de l'autonomie et départements d'outre-mer...
La superficie de ces entités varie également énormément : de quelques kilomètres carrés à des centaines de milliers. Il en va de même pour les populations. Quant à la richesse, les écarts sont tout aussi importants : en Haïti, le revenu national brut (RNB) par habitant était de 3 100 dollars en 2020, contre 54 000 dollars dans les îles Caïmans.
On distinguera notamment deux sous-bassins : les Petites Antilles et le plateau des Guyanes. Chacun a ses spécificités, mais tous partagent une même vulnérabilité face aux crises climatiques, aux narcotrafics et aux rivalités internationales.
La Caraïbe est en effet redevenue un espace géopolitique sensible. Longtemps considérée comme la « Méditerranée des États-Unis », elle est aujourd'hui le théâtre d'une compétition accrue entre Washington et Pékin. La Chine y déploie une stratégie méthodique : investissements massifs, endettement des États, influence culturelle via les instituts Confucius, et même, dans certains cas, des projets d'infrastructures. À la Dominique, par exemple, Pékin finance un aéroport international et un port en eau profonde, susceptibles de concurrencer directement nos plateformes en Martinique et en Guadeloupe.
Face à cette montée en puissance chinoise, les États-Unis reviennent en force, après des années de désengagement. Leur présence militaire et diplomatique se renforce, notamment pour contrer les trafics de drogue et l'influence de Caracas.
Mais cette rivalité ne doit pas nous faire oublier un autre acteur : l'Europe, et donc la France. Grâce à nos territoires ultramarins, nous sommes présents, stables et crédibles dans cette région. Grâce à l'Europe, des financements très importants via le budget ou la Banque européenne d'investissement (BEI) sont orientés vers les pays de la région et des programmes de coopération régionale. L'accord entre l'Union européenne (UE) et le Forum caribéen des États de l'Afrique, la Caraïbe et du Pacifique (Cariforum), dans le cadre des accords du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), est un autre marqueur politique et économique fort. Une envie d'Europe est donc exprimée par la plupart des partenaires de la région qui ne veulent pas s'enfermer dans la compétition sino-américaine. Le Brexit a par ailleurs laissé un vide, le Royaume-Uni se détournant de ses PTOM dans la région. Mais cette présence européenne doit se traduire par une action plus ambitieuse et plus ordonnée.
Le plateau des Guyanes, quant à lui, est en pleine transformation économique. La découverte de gisements pétroliers géants au Guyana, au Suriname et dans l'État de l'Amapá, au Brésil, bouleversera les équilibres régionaux. Le Guyana, aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, pourrait devenir le cinquième producteur mondial de pétrole brut. Ces changements offrent des opportunités majeures pour la Guyane, mais ils posent aussi des défis : comment éviter que nos territoires ne deviennent des zones de transit ou des territoires enclavés ? Comment tirer parti de cette dynamique pour développer des partenariats « gagnant-gagnant » ? Il faut ajouter que le plateau des Guyanes fait encore l'objet de contestations territoriales qui sont des irritants des relations bilatérales, notamment entre la France et le Suriname. Ces contestations peuvent aussi virer au risque d'affrontement armé, comme entre le Guyana et le Venezuela.
Enfin, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord, à proximité du géant canadien, appartient à un tout autre sous-bassin. Saint-Pierre-et-Miquelon, bien que géographiquement isolé, reste un territoire stratégique, notamment pour les relations avec le Canada. Mais son avenir dépendra de sa capacité à s'intégrer davantage dans son environnement nord-américain sans perdre son identité.
Dans ce paysage, la coopération régionale apparaît en progrès, mais encore insuffisante, car trop lente et trop peu visible. Plusieurs avancées méritent d'être soulignées.
Sur le plan diplomatique, la France a renforcé son réseau dans la région. Nous avons ouvert une ambassade au Guyana, nommé des conseillers diplomatiques en Guadeloupe et en Martinique, et renforcé nos représentations à Sainte-Lucie et au Suriname. Ces efforts sont essentiels pour affirmer notre présence et faciliter les échanges entre nos territoires et leurs voisins.
L'intégration de nos collectivités dans les organisations régionales est aussi une avancée majeure. La Martinique est sur le point de devenir membre associé de la Communauté caraïbéenne (Caricom), une première historique et l'aboutissement d'un très long chemin depuis les premières déclarations en 2012. La Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin - depuis mars 2025 seulement - sont membres associés de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), entité la plus intégrée de la Caraïbe. Ces adhésions sont des symboles forts, mais elles doivent maintenant se traduire par des actions concrètes.
Parallèlement, les relations bilatérales entre Sainte-Lucie et la Martinique, ou entre la Guyane et le Suriname ou le Brésil, sont de plus en plus dynamiques.
La coopération sécuritaire a également progressé. Nous avons signé des accords de poursuite en mer avec Sainte-Lucie, créé un centre de coopération policière à Saint-Georges-de-l'Oyapock, et renforcé les échanges de renseignements avec nos partenaires. La lutte contre les trafics illicites et l'orpaillage clandestin est une priorité absolue, et nos forces de l'ordre travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues régionaux.
Enfin, des projets concrets et foisonnants voient le jour, financés principalement par l'UE et l'Agence française de développement (AFD).
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Les progrès réalisés en matière de coopération régionale sont indéniables. Cependant, plusieurs obstacles majeurs subsistent, limitant l'efficacité et la visibilité des actions engagées. Ces freins, à la fois institutionnels, économiques, logistiques et financiers, entravent le plein épanouissement de nos territoires dans leur environnement régional.
Premièrement, le cadre institutionnel est complexe et peu efficace.
La Caraïbe et le plateau des Guyanes sont caractérisés par une multiplicité d'organisations régionales, chacune avec ses propres règles, priorités et mécanismes de financement. Trois structures principales coexistent : la Caricom, l'OECO et l'Association des États de la Caraïbe (AEC). Pourtant, leur superposition entraîne des chevauchements, des concurrences et une dilution des responsabilités, ce qui nuit à l'efficacité globale de la coopération.
La Caricom, bien qu'historique et influente, peine à concilier les intérêts divergents de ses quinze États membres, dont les niveaux de développement et les priorités varient considérablement. Les décisions y sont souvent lentes, et les projets peinent à se concrétiser.
L'OECO, plus intégrée avec sa monnaie commune et sa libre circulation, reste limitée par le statut de membre associé de nos collectivités ultramarines.
L'AEC, enfin, bien que couvrant une zone géographique étendue, manque de moyens opérationnels et sert davantage de cadre diplomatique que de levier d'action concrète.
En conséquence, nos territoires, membres associés de ces organisations, peinent à y faire valoir leurs intérêts. Leur participation reste trop souvent symbolique, et les résultats concrets se font attendre. L'adhésion des collectivités françaises d'Amérique (CFA) aux instances régionales doit se traduire par une réelle capacité d'influence, et non par une simple présence un peu trop formelle.
Deuxièmement, les échanges commerciaux sont toujours insuffisants.
Nos territoires ultramarins échangent très peu avec leur voisinage immédiat, malgré leur proximité géographique. Les chiffres sont éloquents : la Martinique et la Guadeloupe ne réalisent que 4 % à 5 % de leur commerce avec la zone Caraïbe, le reste provenant de la France ou de l'UE ; la Guyane, frontalière du Brésil et du Suriname, n'échange que 1 % de ses flux avec ces deux pays, alors qu'elle pourrait s'approvisionner localement en produits agroalimentaires, énergétiques ou manufacturés.
Pourquoi une telle situation ?
Le premier volet de l'étude y avait déjà beaucoup insisté : les normes européennes sont souvent inadaptées. Nos RUP doivent se conformer à des règles conçues pour le marché continental, ce qui les rend non compétitives face à leurs voisins, qui bénéficient de coûts de production plus bas et de circuits plus courts.
Par ailleurs, il existe un manque de circuits économiques régionaux : nos territoires n'ont pas de stratégie commune pour développer des filières intégrées - agroalimentaire, énergie, gestion des déchets.
De plus, une dépendance historique à la métropole perdure : les centrales d'achat, les subventions et les habitudes de consommation orientent nos économies vers l'Hexagone, plutôt que vers leur environnement naturel.
Résultat : nos RUP ratent des opportunités économiques. Pire, alors que le Guyana et le Suriname deviennent des puissances pétrolières, la Guyane française risque de rester en marge de cette dynamique, faute de liens économiques solides avec ses voisins.
Troisièmement, la mobilité est toujours entravée.
Les liaisons maritimes et aériennes entre nos territoires et leurs voisins restent insuffisantes, ce qui limite les échanges humains et économiques. Le cabotage est quasi inexistant. Les conteneurs qui arrivent en Guyane ou aux Antilles repartent vides à 90 %, faute de flux retour rentables. Aucun modèle économique viable n'a encore émergé pour développer un réseau régional dense.
Par ailleurs, les bassins de vie le long des fleuves Maroni et Oyapock restent mal appréhendés.
S'agissant des formalités administratives, un Brésilien ou un Surinamais souhaitant se rendre en Guyane doit obtenir un visa, alors que ces populations partagent souvent des bassins de vie transfrontaliers.
Pour ce qui est des contrôles douaniers, les produits agroalimentaires en provenance du Brésil ou du Suriname ne peuvent pas entrer facilement en Guyane, alors qu'ils pourraient alimenter nos marchés à moindre coût.
Le réchauffement des relations franco-surinamaises a permis quelques progrès, mais ils demeurent insuffisants.
Des projets de coopération ont été portés. Mais ils se sont soldés plutôt par des fiascos. Le feuilleton du bac Malani en est l'illustration la plus connue.
Il faut y ajouter celui de l'hôpital d'Albina, côté surinamais, que la délégation a visité. Financé intégralement par un prêt de 15 millions d'euros de l'AFD - en cours de remboursement -, cet hôpital devait permettre de soulager la pression sur le système de santé de Saint-Laurent, en déplaçant une partie de la demande de soins des Surinamais sur Albina. Simultanément, le nouveau Centre hospitalier de l'Ouest guyanais (Chog) de Saint-Laurent est sorti de terre, ce qui rehausse l'offre de soins pour les Guyanais.
Le résultat est calamiteux. Terminé en 2015, l'hôpital est vide au sens littéral du terme. En conséquence, les populations ne circulent pas, les économies ne s'intègrent pas, et les trafics illicites prospèrent dans ces zones mal contrôlées.
Quatrièmement, l'orpaillage illégal et la pêche illicite constituent un véritable pillage organisé et un double fléau pour la Guyane.
L'or extrait est exporté illégalement, souvent vers le Suriname ou le Brésil, avant d'être racheté par des réseaux internationaux, dont une partie est liée à la Chine. De plus, les tapouilles surinamaises et brésiliennes, voire guyaniennes, pêchent illégalement dans nos eaux. Là encore, la Chine joue un rôle clé en alimentant la demande pour les vessies natatoires de l'acoupa rouge.
Cinquièmement, enfin, la tuyauterie financière est illisible.
L'Europe et l'État français consacrent beaucoup d'argent à la coopération régionale. Pourtant, ces fonds restent complexes à mobiliser et découragent les porteurs de projets.
L'impossibilité pour les partenaires étrangers de bénéficier directement des fonds Interreg est notamment une difficulté. Aujourd'hui, seuls les RUP peuvent être chefs de file d'un projet Interreg. Les partenaires caribéens ou sud-américains doivent passer par eux, ce qui les décourage et les pousse à préférer d'autres financements - comme le NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) -, dont ils peuvent être les bénéficiaires directs. Résultat : les projets Interreg peinent à trouver des partenaires, et les fonds ne sont pas consommés.
Les fonds NDICI de l'UE concurrencent ou se conjuguent mal avec les fonds Interreg, qui relèvent du Fonds européen de développement régional (Feder), alors que les deux concourent à la coopération régionale.
Le manque d'ingénierie est aussi un frein. Le projet du bac Malani entre la Guyane et le Suriname en est un exemple révélateur. Financé majoritairement par l'UE et lancé en 2012, ce projet, qui doit considérablement améliorer les échanges entre les deux pays, n'est toujours pas opérationnel, alors que des travaux ont été réalisés et que le nouveau bac a été livré depuis des années. Le coût total atteint les 5 millions d'euros pour un bac qui ne navigue toujours pas...
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - J'en viens à présent à nos vingt recommandations, que nous avons organisées autour de quatre axes stratégiques : affirmer une diplomatie territoriale ambitieuse, différenciée et réactive ; lutter contre le fléau de l'insécurité sans nier les bassins de vie ; transformer les verrous de l'Union européenne en accélérateur de la coopération régionale ; enfin, miser sur les secteurs d'avenir : transport maritime régional, environnement, sciences, agroalimentaire, traitement des déchets.
En voici les principales, celles qui nous semblent les plus urgentes et les plus structurantes.
Premier axe : il faut affirmer une diplomatie territoriale ambitieuse, différenciée et réactive. Nos territoires ne peuvent plus se contenter d'une coopération à la marge. Ils doivent devenir des acteurs à part entière de leur environnement régional. Quant à l'État, il doit agir en bloc cohérent et affirmer une vraie diplomatie des outre-mer.
Pour ce faire, nous proposons de créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer ». Celui-ci serait chargé de la continuité et de la cohérence de la diplomatie territoriale des outre-mer au sein de l'action extérieure de la Nation. Il serait placé sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et de la direction générale des outre-mer (DGOM), et regrouperait les trois ambassadeurs régionaux à la coopération.
Pour animer et coordonner la coopération régionale entre une multitude d'acteurs, l'ambassadeur délégué doit être doté d'une équipe en mesure de jouer son rôle interministériel en lien avec tous les acteurs des territoires. Ces missions ne peuvent être pleinement assumées si l'ambassadeur agit seul, d'autant plus qu'il est amené à se déplacer régulièrement sur le terrain. Le regroupement au sein d'un pôle fédérant les expériences et les pratiques communes en matière de coopération régionale garantirait également la continuité de l'action, en cas de vacance provisoire du poste. L'expérience des grands sommets régionaux, par exemple, pourrait être mutualisée de façon plus efficace au service de l'action des ministres respectifs.
Sans définir le format exact, il est donc impératif de renforcer les moyens de ce pôle stratégique à Paris, en lien avec les préfets et leurs conseillers diplomatiques, les ambassadeurs de la région et les collectivités. Ainsi dimensionné, il s'imposerait comme une plateforme diplomatique et interministérielle opérationnelle en lien étroit avec les territoires. Il ne paraît pas nécessaire, en revanche, de renforcer encore le nombre et les moyens des conseillers diplomatiques auprès des préfets.
Cette direction aurait en particulier pour principal objectif d'accompagner et d'épauler la mise en oeuvre des programmes-cadres de coopération régionale approuvés par les collectivités. Il faut en effet que, à côté de l'État, les collectivités ordonnent leur action extérieure et s'approprient les outils responsabilisants de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, dite loi Letchimy.
Pour s'emparer de ce rôle de chef de file de la coopération régionale, chaque outre-mer devrait donc approuver rapidement son programme-cadre de coopération régionale, l'État s'engageant à soutenir résolument les initiatives entrant dans le champ du programme-cadre. Il est anormal que seule la Martinique en soit dotée depuis 2023.
Nous demandons aussi à accélérer l'adhésion de la Martinique à la Caricom. Le Parlement doit ratifier la convention sur les privilèges et immunités d'ici à 2026. Chaque mois de retard affaiblit notre crédibilité et prive nos territoires d'opportunités concrètes.
Autre priorité : le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes (BDC). Nous en sommes sortis en 2000 et c'était une erreur. La BDC est un levier essentiel pour financer des projets régionaux et permettre à nos entreprises ultramarines d'accéder aux appels d'offres. Il faut y revenir sans tarder. Or là encore, malgré la décision du Comité interministériel des outre-mer (Ciom) en juillet 2023, quasiment rien n'avance concrètement.
Enfin, il est temps de clarifier le statut de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en matière d'action extérieure. Ces territoires sont en première ligne dans la coopération régionale, mais leur cadre juridique reste trop flou. Il faut saisir le tribunal administratif et, si nécessaire, compléter la loi organique pour leur donner les moyens d'agir.
Deuxième axe, nous devons lutter contre le fléau de l'insécurité, sans nier les réalités des bassins de vie.
La Caraïbe et le plateau des Guyanes sont gangrenés par les trafics illicites : drogue, armes, orpaillage clandestin, pêche illégale. Ces activités criminelles déstabilisent les États, menacent les populations et sapent les économies locales.
Pour y faire face, nous proposons d'inscrire la lutte contre l'orpaillage et la pêche illicite à l'agenda des dialogues France-Chine et UE-Chine. La Chine est un acteur clé de ces trafics, notamment en Guyane. Il faut en parler clairement avec Pékin et exiger des engagements concrets pour endiguer ces pratiques.
Nous appelons aussi à l'organisation d'une conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe, sous l'égide de l'UE et de la France, dans l'objectif de créer une académie régionale de la sécurité, qui formerait les forces de police et les magistrats de toute la région. Cette initiative s'inspirerait de celle en cours dans le bassin de l'océan Indien. La coopération judiciaire et policière doit devenir une priorité absolue.
Sur le plateau des Guyanes, il est urgent de finaliser l'accord frontalier avec le Suriname - seul un tiers de la frontière a été validé - et de créer un centre de coopération policière le long du fleuve Maroni. En échange, la France pourrait proposer une carte de circulation transfrontalière, comme celle qui existe déjà à la frontière avec le Brésil. Il faut aussi assouplir le régime des visas entre le Brésil et la Guyane, en s'inspirant du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (Etias) pour faciliter les échanges sans sacrifier la sécurité. Un premier signe positif a été envoyé récemment avec la suspension annoncée de l'obligation de visa pour les habitants de l'Amapá.
Enfin, Saint-Martin doit devenir un laboratoire de coopération transfrontalière. Nous proposons de créer un groupement européen de coopération territoriale (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, et de rétablir un programme Interreg dédié à cette coopération. Cette île, partagée entre deux nations, peut montrer la voie. Le statut de GECT mériterait d'être adapté pour répondre aux spécificités de Saint-Martin.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Troisième axe, il faut transformer les contraintes européennes en leviers de coopération.
L'Union européenne est à la fois une clé et un verrou pour nos territoires. D'un côté, elle offre des financements massifs et une légitimité diplomatique. De l'autre, ses règles, conçues pour des réalités continentales, étouffent souvent nos RUP. Il est temps de réformer cette action pour en faire un accélérateur de coopération.
Nous reprenons donc l'idée de nos collègues Georges Patient et Stéphane Demilly de créer une PEVu dans le cadre du futur budget européen 2028-2034. Cette politique ciblerait spécifiquement les régions voisines des RUP et des PTOM, avec des financements dédiés et des règles adaptées. Les frontières de nos RUP et de nos PTOM sont des frontières extérieures de l'UE et appellent des politiques de voisinage au même titre que les frontières continentales de l'Union L'objectif serait de faire des outre-mer des ponts entre l'Europe et leur environnement régional, et non des territoires enclavés.
Il est aussi crucial d'autoriser les RUP à signer des accords de libre-échange limités avec leurs voisins. Aujourd'hui, nos territoires ne peuvent pas conclure d'accords commerciaux avec les États de la région, même sur des produits spécifiques. C'est absurde. Nous devons obtenir de Bruxelles le droit de négocier des partenariats ciblés, par exemple dans l'agroalimentaire ou l'énergie, pour dynamiser les échanges et réduire la dépendance à l'Hexagone. L'accord de partenariat économique UE-Caraïbe pourrait être modifié pour le permettre.
Enfin, l'éducation doit devenir un outil de coopération. Nous proposons de créer des sous-programmes Erasmus RUP, qui permettraient à nos étudiants d'étudier dans les universités caribéennes, et inversement. La mobilité étudiante est un vecteur d'intégration régionale. Pourquoi un étudiant martiniquais ne pourrait-il pas suivre un cursus en médecine à la Barbade, ou un étudiant guyanais un master en environnement au Suriname ? L'Europe doit financer cette ambition.
Ce sujet de l'éducation m'invite à dire quelques mots de la francophonie et des échanges linguistiques. Il manque une politique de la francophonie renforcée dans les pays voisins de nos RUP. Cela devrait aller de soi, et pourtant les contrats d'objectifs et de moyens (COM) de l'Institut français ou de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ne mentionnent même pas les outre-mer. En sens inverse, il me paraît essentiel que l'éducation nationale prête une plus grande attention à l'enseignement des langues parlées dans les pays voisins. Je sais qu'à Saint-Martin le bilinguisme a fait d'énormes progrès. Ces stratégies doivent inspirer d'autres territoires, notamment la Guyane avec l'espagnol et le portugais.
Quatrième axe, il faut miser sur les secteurs d'avenir pour bâtir une économie régionale résiliente.
Nos territoires ont des atouts majeurs : une position géographique stratégique, des ressources naturelles abondantes, une expertise reconnue en santé, en environnement et en énergie. Pourtant, ces potentiels restent sous-exploités.
Le transport maritime est un enjeu clé. Aujourd'hui, nos ports sont en bout de ligne, nos conteneurs repartent vides à 90 %, et le cabotage régional est quasi inexistant. Nous proposons de modifier le règlement européen de 1992 pour faciliter la création de lignes de cabotage entre les RUP et leurs voisins. Il faut aussi étudier la création d'une communauté caribéenne du transport maritime, qui serait promue par l'Union européenne, la France et l'OECO, afin de construire un réseau régional dense, compétitif et décarboné.
La fiscalité carbone menace aussi nos ports ultramarins. La directive européenne relative au système d'échange de quotas d'émissions, dite ETS, si elle s'applique sans adaptation, rendra nos escales non compétitives face à celles de nos voisins. Nous demandons une suspension urgente de son application dans les RUP, le temps de négocier un système régional de taxe carbone avec la Caricom et l'OECO. Sinon, nos ports perdront du trafic.
Les déchets et les sargasses sont des fléaux, mais aussi des occasions d'agir. Nos territoires suffoquent sous les déchets, et les sargasses étouffent nos côtes. Pourtant, ces défis peuvent devenir des leviers de coopération. Nous proposons de faire appliquer l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pour adapter les règles européennes et autoriser des accords régionaux de gestion des déchets. Nos collègues Viviane Malet et Gisèle Jourda avaient déjà fait des recommandations à ce sujet en 2022. Il faut évidemment rester mobiliser jusqu'à ce que l'UE accède enfin à nos demandes. Il faut aussi créer un centre régional de lutte contre les sargasses, avec un financement européen, pour coordonner la recherche, la collecte et la valorisation de ces algues.
L'énergie et la biodiversité sont des secteurs où la Guyane peut devenir un leader. Le plateau des Guyanes abrite la plus grande forêt tropicale intacte du monde. Nous soutenons l'idée de rapprocher le parc amazonien de Guyane et le parc brésilien de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale au monde. Ce projet pourrait être financé par Interreg, et deviendrait un symbole de la coopération franco-brésilienne. Il contribuerait à ancrer politiquement la Guyane dans sa géographie amazonienne.
Enfin, l'agroalimentaire et la recherche doivent devenir des piliers de notre souveraineté régionale. Nos territoires ont une expertise reconnue en agronomie, avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), mais aussi en santé, avec l'Institut Pasteur et les centres hospitaliers universitaires (CHU).
Toutefois, celle-ci est souvent dispersée vis-à-vis de nos partenaires régionaux. Il faut rapprocher ces acteurs, en particulier le Cirad, l'INRAE et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) afin de promouvoir une diplomatie scientifique puissante et lisible sur les sujets de souveraineté alimentaire et de santé.
En conclusion, notre rapport dresse un constat lucide, mais optimiste.
Nous avons formulé vingt recommandations concrètes. Certaines peuvent être mises en oeuvre dès demain : ratifier les accords, revenir à la Banque de développement des Caraïbes, créer le pôle stratégique de coopération. D'autres demandent des négociations plus longues, comme la PEVu ou l'adaptation des règles européennes.
Mais une chose est sûre : si nous ne bougeons pas, d'autres le feront à notre place. La Chine avance. Les États-Unis reviennent. Les organisations régionales se structurent. La Caraïbe et le plateau des Guyanes ne resteront pas en attente.
Nos territoires ont tout à gagner d'une meilleure insertion régionale : désenclavement, développement économique, sécurité, rayonnement culturel. La France a tout à gagner à renforcer son influence dans une région stratégique. L'Europe a tout à gagner à faire de nos RUP des avant-postes dynamiques.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Merci pour ce travail exceptionnel. Le déplacement au Suriname restera gravé dans nos mémoires. Être plongé au coeur des réalités est extrêmement important pour se rendre compte de ce que vivent au quotidien nos compatriotes ultramarins.
Mme Vivette Lopez. - Je remercie nos collègues de ce rapport, certes, alarmiste, mais réaliste.
Qu'en est-il aujourd'hui de la mise en oeuvre des recommandations relatives aux déchets que nos collègues Viviane Malet et Gisèle Jourda avaient formulées en 2022 ? Au bout de trois ans, nous devrions tout de même commencer à voir quelques petites avancées.
Comment expliquez-vous que l'hôpital auquel vous faites référence dans le rapport soit totalement vide ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Cela a été l'une des plus grandes surprises de ma vie : l'hôpital est tout beau, tout neuf, avec des salles entières pour les dialyses, mais il est vide de personnel. En effet, compte tenu du contexte politique au Suriname, les médecins, les infirmiers ou les spécialistes vont se former aux Pays-Bas et ne reviennent pas. L'hôpital n'a donc pas de personnel, et il n'a pratiquement jamais fonctionné. J'ai du mal à comprendre que l'on ait pu concevoir un hôpital aussi cher sans prévoir le personnel.
M. Rachid Temal. - Combien y a-t-il de lits ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - De mémoire, je crois qu'il y en a une centaine.
Mme Vivette Lopez. - Cet hôpital était-il une nécessité ?
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Oui. Il s'agissait d'éviter que les habitants n'aillent se faire soigner de l'autre côté du fleuve.
Le problème se pose dans des termes comparables pour les écoles. Celles qui se situent le long du fleuve sont toutes cassées, pour diverses raisons. Quand on a fait observer au président de la République du Suriname que son pays aurait de l'argent grâce aux forages, il a répondu que, certes, ils allaient réparer les écoles, mais que la France devait envoyer des enseignants. Vous le voyez, c'est compliqué...
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Les recommandations relatives aux déchets datent de 2022. Depuis, notre vie politique nationale a tout de même connu quelques soubresauts. À mon sens, c'est un travail de fond qu'il faut mener. Pour l'instant, le sujet n'a pas encore été mis à l'agenda.
Nous reprenons ces recommandations à notre compte en insistant sur leur importance : il n'y a pas de développement possible sur des territoires contraints et insulaires comme les nôtres sans une politique commune de gestion des déchets, en parallèle de mesures en faveur du développement économique.
Mme Micheline Jacques, présidente. - La proposition de résolution européenne que nous avons déposée mentionne d'ailleurs que le projet de texte « omnibus » européen relatif aux RUP devrait notamment contenir des dispositions sur les transferts et le traitement de déchets dans l'espace régional de ces territoires.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Je le précise, les trois médecins présents à l'hôpital d'Albina sont des médecins cubains qui sont missionnés en début de carrière au sein de cet établissement.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Mais l'hôpital est vide ! Je crois qu'il y a seulement deux consultations par jour.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Mes chers collègues, je suis ravi de vous retrouver.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Nous aussi, cher Thani Mohamed Soilihi, même si nous aurions préféré que vous restiez au Gouvernement !
M. Thani Mohamed Soilihi. - Je rends hommage à Salama Ramia, qui a occupé ma place avec brio ; je regrette qu'elle parte, tant le travail qu'elle a fourni a été excellent.
Heureux hasard du calendrier, mon retour au Sénat coïncide avec l'examen par notre délégation de cet excellent rapport, dont je soutiens totalement les recommandations.
Je le rappelle, la France compte trente-cinq pays frontaliers. C'est le pays du monde qui en a le plus, grâce à nos outre-mer. Il faut renforcer notre influence auprès de ces pays.
L'idée d'un pôle stratégique de coopération régionale outre-mer est une excellente recommandation. De même, l'adhésion de la Guadeloupe, de la Guyane et d'autres territoires ultramarins à la Caricom permettra d'accélérer un mouvement qui n'a que trop traîné avec la Martinique. J'avais évoqué ce point avec Jean-Noël Barrot au mois de juillet dernier. Certes, la situation chaotique qui règne à l'Assemblée nationale ne facilite pas l'inscription de projets de loi à l'ordre du jour parlementaire. Peut-être pourrions-nous examiner le texte d'abord au Sénat ?
Je rejoins les auteurs du rapport. La francophonie est un trésor partagé par 90 États, dont la France, et que nous ne valorisons pas suffisamment. Ce n'est pas seulement une question de langue : la francophonie, ce sont aussi des valeurs de paix, de démocratie, de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le français, nous dit-on, serait en déclin. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes 321 millions de locuteurs francophones, et nous allons passer à 750 millions d'ici à 2050. La vraie question est de savoir comment nous pouvons accompagner ce mouvement. Il faut notamment travailler sur la formation des enseignants. Le collège international de Villers-Cotterêts, dernier établissement que j'ai inauguré - c'était au mois de septembre -, aura cette tâche.
Nous avons créé un Erasmus francophone, le programme international de mobilité et d'employabilité francophone (Pimef), qui a été lancé hier et qui a vocation à permettre la mobilité et l'employabilité des jeunes dans l'espace francophone au sein des 1 100 universités qui composent l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). C'est une aubaine dont il faut absolument se saisir.
Nous avons des champions - je pense au Cirad, à l'INRAE, à l'IRD et même à l'AFD - qui sont des opérateurs efficaces. Mais il faut les valoriser, car tout le monde ne sait pas forcément que la France est derrière.
Je connais un autre hôpital vide. Celui-là a été construit au mois de juin par les Chinois à Anjouan. À chaque fois, on pense à l'investissement, mais pas à la suite. Une idée à creuser serait de confier aux ONG, toujours si promptes à fustiger les politiques migratoires de la France, une mission pour faire fonctionner ces hôpitaux.
M. Rachid Temal. - Je salue le rapport de nos collègues, qui est à la fois révélateur de nombreuses difficultés, mais aussi porteur de beaucoup de promesses.
Toutefois, à la recommandation 14, je pense qu'il vaudrait mieux éviter de parler de « sous-programme » Erasmus. Un sous-programme, c'est moins bien qu'un programme. J'entends les justifications techniques d'une telle formulation, mais, en termes de présentation, elle ne me paraît pas très heureuse.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Nous pouvons très bien écrire « programme ».
M. Rachid Temal. - J'ai un désaccord, déjà ancien, avec mon collègue Thani Mohamed Soilihi sur l'AFD. Je n'arriverai jamais à comprendre que l'outil mobilisé en l'espèce soit le même que celui qui est utilisé pour aider, par exemple, le Mali. On me répondra sans doute que c'est un « pôle d'excellence ». Dans ce cas, pourquoi ne pas faire appel à Bpifrance ? « L'Agence » française de développement n'a d'agence que le nom ; en réalité, c'est une banque. Regardez ses comptes : la principale activité de l'AFD, c'est du placement de prêts. Le recours à l'AFD serait justifié par son « expertise » ? Mais l'expertise, elle est avant tout chez les hommes et les femmes qui sont à l'AFD et qui pourraient être ailleurs !
Le rapport met en lumière combien la dimension européenne est centrale. J'appartiens à une famille politique très pro-européenne. À mon sens, il serait temps d'avoir une véritable politique européenne à l'égard des territoires ultramarins.
Nous voterons ce rapport avec enthousiasme.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Je pense que des réformes s'imposent, y compris s'agissant de l'AFD. Hormis La Réunion, nos territoires ultramarins n'arrivent pas à mobiliser les fonds structurels européens, en raison de problèmes de préfinancement. Pourquoi ne pas avoir l'AFD en support pour accompagner les collectivités dans le préfinancement, le suivi, l'ingénierie et l'expertise ? En République dominicaine, grâce à un tel accompagnement, un métro et des téléphériques ont pu être réalisés.
M. Rachid Temal. - Précisément, il s'agit d'un État, donc avec une capacité d'emprunt.
Autre problème, personne ne sait que l'AFD, c'est la France. Moi, je préférerais une banque française de développement, avec l'adjectif « française ». Aujourd'hui, la France finance des projets, mais, quand elle le fait, personne ne le sait !
M. Thani Mohamed Soilihi. - Nous sommes en train d'y remédier. Un logo - il a été validé - sera désormais apposé partout où il y aura des projets AFD à l'international.
Mme Solanges Nadille. - Ce rapport, dont je remercie les auteures, est très pertinent. Il ne fait qu'étayer ce que nous savons déjà et apporter des exemples concrets de la réalité ultramarine. J'aimerais aborder plusieurs éléments.
D'abord, il y a des normes qui nous bloquent lorsque nous voulons faire de la coopération avec nos pays voisins.
Ensuite, les politiques publiques que l'État décide dans l'Hexagone ne sont pas adaptées à nos territoires ultramarins. Ce sont les préfets qui doivent adapter les dispositifs. Nous devons alerter les différents gouvernements pour qu'ils aient conscience de la nécessité d'adapter d'emblée aux territoires ultramarins les politiques publiques qu'ils conçoivent.
Enfin, pouvons-nous garantir qu'il y aura assez de sargasses pour qu'une entreprise développe un mécanisme de valorisation de ces algues ? Pour qu'une entreprise investisse, il faut qu'il y ait des sargasses pendant une quarantaine d'années au moins. Or ce n'est pas exactement la dynamique que nous souhaitons soutenir...
M. Jean-Gérard Paumier. - Ce rapport, de très grande qualité, dresse un constat assez déprimant. Laissons respirer les outre-mer ! Assez de cette approche verticale, dans laquelle Paris sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour le reste du pays ! Si nos concitoyens avaient connaissance de certains des exemples désespérants qui sont évoqués dans le rapport - je pense au fameux cas de l'hôpital -, cela nourrirait encore les extrêmes !
Il est également fait référence à la présence de la Chine et des États-Unis dans les Caraïbes. Face à ces deux mammouths, la France n'a pas la taille critique suffisante. C'est à l'Europe de prendre conscience de la nécessité d'agir dans ces territoires. Pour moi, l'une des clés est non pas à Paris, mais à Bruxelles. Or, aujourd'hui, l'outre-mer est le cadet des soucis de Bruxelles ! Si nous voulons peser davantage auprès des instances européennes, travaillons avec les autres pays européens qui ont aussi des territoires ultramarins, comme l'Espagne et le Portugal. C'est un enjeu stratégique. Songeons par exemple à la manière dont l'Union européenne réagit lorsque les Américains s'intéressent au Groenland.
Nos territoires ultramarins sont une chance extraordinaire ; ils nous permettent - cela a été rappelé - d'avoir trente-cinq pays frontaliers. Mais, pour l'instant, ils sont parfois perçus comme un handicap. C'est dramatique.
Je félicite les auteures de ce rapport, et j'espère qu'il y a au moins deux ou trois recommandations sur lesquelles nous finirons par voir des avancées.
M. Rachid Temal. - Je vais être un peu taquin. Pour faire ce que notre collègue suggère, il faudrait déjà que la France soit puissante à l'échelon européen, par exemple en y envoyant des commissaires avec de l'influence...
Pour ma part, j'ai toujours plaidé pour que nous puissions avoir des ministres ou des secrétaires d'État de zone, comme cela existe outre-Atlantique. Dans les grandes conférences internationales, nos ministres se font souvent remplacer par des directeurs d'administration centrale, qui, pour des raisons protocolaires, n'ont le droit de prendre la parole qu'en fin de réunion seulement. Avoir des ministres de zone permettrait d'aller voir des partenaires et de faire avancer certains dossiers. Un ministre de plein exercice qui doit être à Paris pour assister à la séance des questions d'actualité au Gouvernement n'a pas nécessairement le temps de s'occuper de l'IndoPacifique ! Aux États-Unis, il y a un sous-secrétaire pour l'Afrique qui se déplace dans tous les pays concernés. Nous pourrions nous inspirer d'une telle pratique.
Mme Annick Petrus. - Je félicite mes collègues de ce rapport extraordinairement pertinent.
J'espère que, grâce à toutes ces recommandations, les choses bougeront et que la coopération régionale, à laquelle nous sommes tous si attachés, ne restera pas un voeu pieux.
J'ai toujours pensé que la France ne profitait pas suffisamment de la position géographique de ses outre-mer, de l'ensemble de ses outre-mer. Par exemple, Saint-Martin pourrait avoir un leadership en matière de coopération régionale dans la zone. À nous de définir lequel.
Ce morceau de France dans cette zone caribéenne pourrait être une chance pour notre Nation, qui n'en profite pas suffisamment. Puissent quelques-unes des recommandations du rapport retenir l'attention de nos dirigeants.
Cela a été dit, il va falloir que l'Europe se mouille ! Il va falloir que tout le monde se mette autour de la table pour revoir les normes. Il va falloir que le Gouvernement et le Parlement se souviennent que les outre-mer ont des spécificités dont il faut tenir compte dans l'élaboration des textes législatifs.
J'adresse un grand bravo à nos collègues, qui ont mis le doigt sur la réalité de nos outre-mer. Nous nous battrons pour que leurs recommandations soient suivies d'effets.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Merci, ma chère collègue, de ces mots d'encouragement, qui font plaisir.
Il faudra effectivement que l'Union européenne prenne conscience de l'apport des outre-mer français au sein de l'Europe. N'oublions pas que l'importante biodiversité européenne est en grande partie française et, en l'occurrence, ultramarine.
Nous avons centré le rapport sur la coopération régionale et l'intégration de nos territoires au sein des zones géographiques concernées. Mais nous avons aussi pointé des risques environnementaux majeurs, comme la pêche illicite, l'orpaillage illégal, sans oublier la pollution de la forêt et de la ressource en eau, notamment en Guyane. Songeons également aux risques sanitaires, avec l'empoisonnement au mercure, dont les populations subissent chaque jour les conséquences.
Oui, nos économies ultramarines sont sous perfusion. Mais, dans nos outre-mer, il y a aussi des urgences sur des sujets qui sont au coeur des politiques européennes, à commencer par l'environnement et la santé humaine.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Je pense qu'il nous faudra nous rendre à Bruxelles pour présenter ce rapport. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à lâcher le morceau. Allons exposer nos recommandations à Bruxelles, à la nouvelle ministre des outre-mer et au ministre des affaires étrangères !
Notre rapport est révélateur d'une réalité, tant territoriale qu'humaine. Il n'est pas question qu'il reste dans un tiroir. Nous allons nous attacher à faire en sorte que nos recommandations, en tout cas les plus importantes, soient rapidement suivies d'effets. Elles ont été formulées dans l'intérêt des territoires et de la France au sens large. Nous devrons nous battre pour obtenir des résultats.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Je profite de l'occasion pour remercier nos collaborateurs et l'équipe de la délégation.
Pour nous, ce travail a été une expérience très forte. Nous nous sommes rendus dans les territoires français, mais également dans les territoires frontaliers. Cela nous a permis de toucher du doigt certaines réalités. La France rayonne en matière de santé. Les Surinamais préfèrent venir se faire soigner en France, en l'occurrence en Guyane - en plus, c'est gratuit - plutôt qu'à Albina, où l'hôpital est entièrement équipé, mais non utilisé, ce qui est dramatique.
Les recommandations sont adoptées.
La délégation adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
La réunion est close à 9 h 50.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Réunions plénières de la délégation
|
Jeudi 10 avril 2025 |
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
· Nathalie ESTIVAL-BROADHURST, directrice Amérique et Caraïbes,
|
Mardi 13 mai 2025 |
Gouvernement
· Thani MOHAMED-SOILIHI, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux
|
Jeudi 10 juillet 2025 |
Ministère des outre-mer
· Arnaud MENTRÉ, Ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique
Ambassade d'Haïti en France
· S.E. M. Louino VOLCY, Ambassadeur d'Haïti en France
· Ricardo LAMBERT, responsable Communication
|
Jeudi 16 octobre 2025 |
Banque de France
· Manuel Marcias, auteur
Auditions rapporteurs de la délégation
|
Jeudi 10 avril 2025 |
Ambassade du Suriname en France
· S.E. M. Nawin Ryan NANNAN, ambassadeur
· Seema BALDEWSINGH, première secrétaire de l'ambassade
Préfecture de la Guyane
· Laurent DELAHOUSSE, conseiller diplomatique
|
Mardi 16 septembre 2025 |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad)
· Anthony FARISANO, directeur général délégué aux ressources et dispositifs
· Léonard LIVERT, chargé d'affaires publiques
· Magalie LESUEUR-JANNOYER, directrice régionale Antilles-Guyane-Caraïbes
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE)
· Harry ARCHIMÈDE, président du centre INRAE Antilles-Guyane
· Dominique GREVEY, directeur de l'enseignement supérieur, des sites et de l'Europe (DESSE)
· Marc GAUCHÉE, conseiller du P-D.G. pour les relations parlementaires et institutionnelles
Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
· Cyrille LE VÉLY, préfet
· Fabrice THIBIER, secrétaire général
Collectivité territoriale de Martinique
· Serge LETCHIMY, Président de la collectivité territoriale de Martinique
Conseil régional de la Guadeloupe
· Ary CHALUS, Président du Conseil régional
· Patrick SELLIN, conseiller régional en charge de la commission intégration régionale et affaires européennes
|
Mercredi 17 septembre 2025 |
Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO)
· Didacus JULES, directeur général
· Cyrielle CUIRASSIER, commissaire de Saint-Martin auprès de l'OECO et conseiller spécial pour les affaires extérieurs
Ambassadeur de France à Castries (Sainte-Lucie)
· Francis ETIENNE, ambassadeur de France à Castries (Sainte-Lucie) pour plusieurs États de la Caraïbe et l'OECO
Association des États de la Caraïbe (AEC)
· Natasha GEORGE, ACS Legal Advisor
Collectivité de Saint-Martin
· Louis MUSSINGTON, Président
|
Jeudi 18 septembre 2025 |
Préfecture de la Martinique
· Étienne DESPLANQUES, préfet
Préfecture de la Guadeloupe
· Thierry DEVIMEUX, préfet de la Guadeloupe
Ambassade de France à Castries (Sainte-Lucie)
· Francis ETIENNE, ambassadeur pour plusieurs États de la Caraïbe et l'OECO
Ministère de la justice
· Emmanuelle DOFFE, magistrat de liaison à Castries
|
Mercredi 1er octobre 2025 |
Conseil territorial de Saint-Barthélemy
· Xavier LÉDÉE, président
Ambassade de l'Union européenne à la Barbade
· S.E. Mme Fiona RAMSEY, Ambassadeur de l'Union européenne à la Barbade, dans les États des Caraïbes orientales, dans l'OECO et dans la Caricom/CARIFORUM
|
Mardi 14 octobre 2025 |
Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
· Bernard BRIAND, président
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES LORS DES DÉPLACEMENTS
Déplacement en Guyane et au Suriname
du
12 au 18 avril 2025
|
Samedi 12 avril 2025 - Cayenne |
Préfecture de Guyane
· Antoine POUSSIER, préfet
|
Dimanche 13 avril 2025 - Saint-Georges de l'Oyapock |
Préfecture de Guyane
· Michaël DIDIER, sous-préfet
Sous-préfecture de saint-georges de l'Oyapock
· Priscilla THEBAUX, chargée de coopération transfrontalière
Centre de coopération policière en Guyane
· Flavien BESNEHARD, capitaine
Maire de Saint-Georges de l'Oyapock
· Georges ELFORT, maire et président de la Communauté de communes de l'Est Guyanais (CCOG)
Association des commerants d'Oyapoque
· Lilma CAMPOS, présidente
· Genival CAMPOS, Chef d'entreprise
· Jean-Pierre PEREIRA, Chef d'entreprise
|
Lundi 14 avril 2025 - Cayenne |
Grand Port Maritime de la Guyane
· Stéphane TANT, directeur général
· Clémentine JOHANÈS, secrétaire générale et membre du directoire
· Patrick TOULEMONT, directeur des infrastructures et de l'exploitation et membre du directoire
· Michael NICOLAS, directeur de la prospective et du développement
· Vannia BONNETON, responsable du pôle aménagement et développement, en charge de la coopération
· Jean Bernard MANDRON, commandant de port
Marfret
· Xavier ROSE, responsable Guyane
· Véronique PASSARELLI, directrice exploitation des lignes
· Olivier LECROCQ, direction commerciale de la ligne Guyane/Antilles
Direction des douanes de Guyane
· Catherine LE GOFF, cheffe du pôle orientation des contrôles aux douanes
CMA-CGM Guyane
· Cyril BAUMANN, directeur
Chambre de commerce et d'industrie de Guyane (CCI)
· Carine SINAÏ-BOSSOU, présidente
· Filip VAN DEN BOSSCHE, président de la commission coopération internationale
Business France
· Patricia CALUT, responsable Étude et Export
Agence française de développement de Cayenne
· Florian RAFFATIN, directeur
· Paul DE MONTMORILLON, directeur adjoint
Aéroport de Cayenne
· Éric BOISSEAU BÉHARN, directeur-CEO
|
Mardi 15 avril 2025 - Cayenne - Saint-Laurent-du-Maroni |
Forces armées en Guyane (FAG)
· Marc LE BOUIL, commandant supérieur
· Pierre JUBELIN, commandant de Zone Maritime - adjoint Inter Armée
· Christophe DEGAND, chef d'État-major Inter Armée
· Nicolas AMBROSI, commandant base navale de dégrad des Cannes
· Pauline DELABALLE, commissaire capitaine, action de l'État en mer
· Frédéric VUILLEMIN, lieutenant-colonel, bureau relations internationales
· Pierre-Yves WAQUEZ, lieutenant de vaisseau J3 mer
Commandement de la gendarmerie nationale de Guyane
· Thierry CRAMPÉ, commandant en second
· José SZLOWIENIEC, chef du service territorial de la police aux frontières
· Laurent AUDOUIN, chef du centre opération Harpie
· Xavier MESSAGER, chef de la section de recherche
Direction générale de la police nationale
· Christian NUSSBAUM, chef de la mission outre-mer
Collectivité territoriale de Guyane
· Jean-Paul FERERA, 1er vice-président
· Mylène ELI, directrice de cabinet
· Tiarrah STEENWINKEL, déléguée à la coopération
· Marie-Lucienne RATTIER, conseillère territoriale en charge du numérique et de la transformation digitale
Système U Guyane
· Guillaume REYNAL DE SAINT-MICHEL, directeur d'exploitation
|
Mercredi 16 avril 2025 - Saint-Laurent-du-Maroni - Paramaribo |
Sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni
· Gérard MARIN, sous-préfet
· Capucine FRASIE, chargée de mission à la coopération de la préfecture
Maire de Saint-Laurent-du-Maroni
· Sophie CHARLES, maire et présidente de la communauté de communes de l'Ouest Guyanais (CCOG)
· Bernard SELLIER, adjoint au maire
· Mickle PAPAYO, adjoint au maire
· Dominique CASTELLA, adjoint au maire
Communauté de communes de l'Ouest Guyanais (CCOG)
· Christelle SABAYO, directrice générale des services
Ambassade de France au Suriname
· Nicolas DE BOUILLANE DE LACOSTE, Ambassadeur
Agence française de développement du Suriname
· Pierre BOURGUIGNON, représentant de l'AFD pour le Suriname et le Guyana
Hôpital régional Marwina
· Henk LAVENTA IGNATIUS LAVENKOI, directeur
|
Jeudi 17 avril 2025 - Paramaribo |
Ambassade de France au Suriname
· Nicolas DE BOUILLANE DE LACOSTE, Ambassadeur
· Christian BROSSERON, Premier conseiller
· Jean-Marc MOULIN, lieutenant-colonel, attaché de défense
Collectivité territoriale de Guyane
· Anne MATHIEU, responsable de l'antenne
Rudisa International NV
· Warsha SARDJOE, présidente directrice générale
Assemblée nationale du Suriname
· Rabindre T. PARMESSAR, député, chef du groupe NPD
· Ronny ALOEMA, député du groupe VHP
Ministère des Finances du Suriname
· Stanley RAGHOEBARSING, ministre des finances
République du Suriname
· Chan SANTOKHI, président de la République
TotalEnergies au Suriname
· Artur NUNEZ DA SILVA, responsable
TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
|
N° |
Objet (formulation synthétique) |
Acteurs concernés |
Support |
Mise en application |
|
1 |
Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs |
Ministères en charge des affaires étrangères et des outre-mer |
Arrêté Mesures administratives |
2026 |
|
2 |
Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités |
Gouvernement Collectivités territoriales |
Délibérations des collectivités Décisions ministérielles |
2026 |
|
3 |
Accélérer le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, après deux années perdues depuis les annonces du Ciom 2023. |
Gouvernement Parlement Banque de développement des Caraïbes |
Accord international et/ou loi de finances |
2027 |
|
4 |
Déposer en urgence le projet de loi portant ratification de la convention sur les privilèges et les immunités, afin d'entériner l'adhésion de la Martinique à la Caricom |
Gouvernement Parlement |
Loi autorisant la ratification |
2025-2026 |
|
5 |
Clarifier l'applicabilité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'action extérieure, en saisissant pour avis le tribunal administratif et en complétant la loi organique si nécessaire |
Président et Conseil exécutif des collectivités Tribunal administratif |
Délibération du conseil exécutif Avis interprétatif |
2025-2026 |
|
6 |
Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises |
Présidence de la République Gouvernement Service européen d'action extérieure |
Orientations diplomatiques |
2026 |
|
7 |
Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France |
Gouvernement Ministère de l'intérieur Commission européenne |
Orientations diplomatiques CCRAG Programme Interreg et NDICI |
2027-2028 |
|
8 |
Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière, en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock |
Gouvernement français Autorités surinamaises |
Accord international |
2026-2027 |
|
9 |
Réexaminer l'obligation de visa entre le Brésil et la Guyane en lui substituant un mécanisme inspiré du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) européen, et élargir la liste de produits ouverts au libre commerce entre les deux rives du fleuve, voire entre les deux territoires |
Gouvernements français et brésiliens |
Accord international Arrêté |
2026 |
|
10 |
Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten |
Conseil territorial Préfecture Ministères en charge des collectivités et des affaires étrangères Autorités de Sint Maarten et des Pays-Bas |
Convention Délibération Arrêté préfectoral |
2028 |
|
11 |
Faire enfin de la promotion de la francophonie dans le voisinage des outre-mer une priorité stratégique et modifier en ce sens les contrats d'objectifs et de moyens des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de l'Institut français |
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Ministère de l'éducation nationale |
Convention d'objectifs et de moyens |
2027 |
|
12 |
À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 : - obtenir de l'Union européenne la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ; - définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI |
Gouvernement Union européenne |
Actes européens Cadre financier pluriannuel 2028-2034 |
2028 |
|
13 |
Dans le cadre d'un avenant à l'Accord de partenariat économique UE-Caraïbe, autoriser la conclusion d'accords régionaux ou bilatéraux de libre-échange entre un ou des RUP et des États tiers voisins/organisations régionales, le cas échéant sur un nombre limité de produits |
Commission européenne RUP |
Accord international |
2028 |
|
14 |
Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'UE, et d'étendre à l'enseignement scolaire le volet international de ce programme |
Gouvernement Union européenne |
Règlement européen Cadre financier pluriannuel 2028-2034 |
2028 |
|
15 |
Modifier le règlement européen du 7 décembre 1992 afin de faciliter la création de lignes de cabotage maritime entre les RUP et leurs partenaires régionaux |
Gouvernement Union européenne |
Règlement européen |
2027 |
|
16 |
Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom |
Gouvernement Union européenne CFA OECO et/ou Caricom |
Accord international Programme Interreg et fonds NDICI |
2028 |
|
17 |
Suspendre en urgence l'application de la directive européenne « ETS » dans les RUP, pour maintenir la compétitivité des escales maritimes et aériennes face à celles de leurs voisins proches et engager des discussions avec les organisations régionales pour la création d'un système de taxe carbone à cette échelle |
Gouvernement Union européenne |
Directive européenne |
2026 |
|
18 |
Pour permettre outre-mer des coopérations régionales de traitement des déchets : - faire application de l'article 349 du TFUE pour obtenir l'adaptation des règlements européens (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 aux contraintes des régions ultrapériphériques ; - ouvrir des discussions dans le cadre de la convention de Bâle afin de conclure des accords régionaux |
Gouvernement Union européenne |
Règlement européen Accords régionaux |
2027 |
|
19 |
Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation de crédits Interreg sur cet objectif |
Gouvernement Collectivité territoriale de Guyane Parc amazonien de Guyane AFD Autorités brésiliennes |
Décisions administratives Programme Interreg |
2027 |
|
20 |
Rapprocher les organismes de recherche outre-mer, en particulier l'INRAE, le Cirad et l'IRD pour porter une diplomatie scientifique puissante et lisible sur les sujets de souveraineté alimentaire et de santé |
Ministères de tutelle INRAE Cirad IRD |
Convention Convention d'objectifs et de moyens |
2027 |
GLOSSAIRE
· ACP : Pays d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique
· Ademe : Agence de Développement et de la Maîtrise de l'Énergie
· AEC : Association des États de la Caraïbe
· AEFE : Établissements d'enseignement français à l'étranger
· AFD : Agence française de développement
· ALBA : Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique
· ALBA-TCP : Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traités de commerce des peuples
· ALCORCA : Accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes
· ALE : Accord de libre-échange
· ANCT : Agence nationale de la cohésion des territoires
· AOSIS : Alliance of Small Island States
· APE : Accords de partenariat économique
· ASI : Attachés de sécurité intérieure
· BCEA : Banque centrale des Caraïbes orientales
· BDC : Banque de développement des Caraïbes
· BEMC : Comité de gestion de la biodiversité et des écosystèmes
· BID : Banque Interaméricaine de Développement
· BINUH : Bureau intégré des Nations Unies en Haïti
· BRGM : Bureau de recherche Géologique et Minière
· Caricom ou CC : Communauté caribéenne ou Communauté des Caraïbes
· CARPHA : Caribbean Public Health Agency
· CBI : Citizenship By Investment
· CBSA : Agence des services frontaliers du Canada
· CCI : Chambre de commerce et d'industrie
· CCP : Centre de coopération policière
· CCRAG : Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane
· CDEMA : Caribbean Disaster Emergency Management Agency
· CDF : Conseil du Fleuve Oyapock
· CECG : Centre d'excellence caribéen de la géothermie
· CELAC : Communauté des États latino-américains et des Caraïbes
· CESCE : Conseil économique, social, culturel et environnemental
· CESECE : Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation
· CFA : Collectivités françaises d'Amérique
· CGCT : Code général des collectivités territoriales
· CHOG : Centre Hospitalier Ouest Guyanais
· CIA : Central Intelligence Agency - agence centrale de renseignement des États-Unis
· Ciom : Comité interministériel des outre-mer
· Cirad : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
· CMT : Commission mixte transfrontalière
· COFCOR : Conseil des relations extérieures
· COHSOD : Conseil du développement social
· COI : Commission de l'Océan Indien
· COM : Contrats d'objectifs et de moyens
· COTED : Conseil du commerce
· CTG : Collectivité territoriale de Guyane
· CTO : Caribbean Tourism Organization
· DCIS : Direction de la coopération internationale de sécurité
· DCSD : Direction de la coopération de sécurité et de défense
· DESSE : Directeur de l'enseignement supérieur, des sites et de l'Europe
· DGAC : Direction générale de l'aviation civile
· DGCL : Direction générale des collectivités locales
· DG Intpa : Directorate-General for International Partnerships
· DGOM : Direction générale des outre-mer
· DG Regio : Directorate-General for Regional and Urban Policy
· DGRIS : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
· DROA : Direction régionale océan Atlantique
· DCSD : Direction de la coopération de sécurité et de défense
· ECCAA : Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales
· eCPA : Programme d'évaluation renforcée de la pauvreté
· EFP : Enseignement et formation professionnels
· ELAN : Échanges linguistiques et apprentissage novateur par la mobilité
· EL PAcCTO : Programme Europe Amérique latine d'assistance contre la criminalité transnationale organisée
· ESR : Enseignement supérieur et de la recherche
· ESTA : Système électronique d'autorisation de voyage
· ETIAS : Système européen d'information et d'autorisation de voyage
· ETS : Taxe carbone européenne
· FAA : Forces armées aux Antilles
· FAG : Forces armées de Guyane
· Fed : Fonds européen de développement
· Feder : Fonds européen de développement régional
· FCIP : Formation continue Insertion Professionnelle
· FCR : Fond de coopération régionale
· FEXTE : Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences
· FFEM : Fonds français pour l'environnement mondial
· FICOL : Facilité de financement des collectivités locales
· FOM : Fonds outre-mer
· GECT : Groupement européen de coopération transfrontalière
· GIP : Groupement d'Intérêt Public
· GNL : Gaz liquéfié
· ICIN : Institut caribéen d'imagerie nucléaire
· IEDOM : Institut d'émission d'Outre-mer
· Ifremer : Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan
· INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
· Interreg : Projet de coopération entre différents partenaires d'États membres de l'Union européenne
· IORA : Indian Ocean Rim Association
· IPA : Instrument d'Aide de Préadhésion
· IRD : Institut de recherche pour le développement
· JIATF-S : Joint InterAgency Task Force-South
· KPS : Forces de sécurité surinamaises
· LCOI : Lutte contre l'orpaillage illégal
· MAC : Madère, des Açores et des Canaries
· MEAE : Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
· MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
· MIP : Multiannual Indicative Programme
· MOT : Mission opérationnelle transfrontalière
· NDICI : Instrument de financement de l'Union européenne pour la coopération extérieure
· NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la République
· ODAC : Organisme divers d'administration centrale
· OEA : Organisation des États américains
· OEACP : Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
· OECO : Organisation des États de la Caraïbe orientale
· OFB : Office français de la biodiversité
· OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides
· OIF : Organisation internationale de la francophonie
· OFAST : Office anti-stupéfiants
· OIM : Organisation internationale pour les migrations
· OMI : Organisation maritime internationale
· ONF : Office national des forêts
· OPANO : Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest
· OTC : Organisation du tourisme des Caraïbes
· OTCA : Organisation du traité de coopération amazonienne
· PAC : Politique agricole commune
· PAG : Parc amazonien de Guyane
· PAM : Programme alimentaire mondial
· PCFOI : Plateforme de coopération régionale de la France dans l'océan Indien
· PCIA : Programme européen de coopération Interreg Amazonie
· PCP : Politique commune de la pêche
· PEID : Petits États insulaires en développement
· PEV : Politique européenne de voisinage
· PEVu : Politique européenne de voisinage ultrapériphérique
· PIF : Poste d'inspection frontalier
· PMAC : Port Management Association of the Caribbean
· PNMT : Parc national des Montagnes des Tumucumaque
· PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
· PPS : Service commun d'approvisionnement pharmaceutique
· POCTE : Programme opérationnel de coopération territoriale
· Poséi : Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité
· PRGD : Private Refuse and Garbage Disposal
· PTOM : Pays et territoire d'outre-mer
· Raid : Recherche, assistance, intervention, dissuasion
· REMAR : Resilient Ecosystems through Mangrove Restoration
· RENFORESAP : Renforcement du réseau des Aires Protégées du plateau des Guyanes
· RSS : Système de sécurité régionale
· RUP : Région ultrapériphérique
· SEAE : Service européen d'action extérieure
· SER : Service économique régional
· SRDEII : Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
· SUCRE : Système unique de compensation régionale de paiements
· TCP : Traités de commerce des peuples
· TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
· UBEC : Unleashing the Blue Economy in the Caribbean
· UE : Union européenne
· UNOC 3 : Sommet mondial pour l'océan
· USAID : Agence des États-Unis chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde
· ZEE : Zones économiques exclusives
COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION
Jeudi 10 avril 2025 : Audition de Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes, ministère de l'Europe et des affaires étrangères 187
Mardi 13 mai 2025 : Audition de M. Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux 201
Jeudi 10 juillet 2025 : Audition de M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique 221
Jeudi 10 juillet 2025 : Audition de S.E. M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France 235
Jeudi 16 octobre 2025 : Audition de M. Manuel Marcias, 245
Jeudi 10 avril 2025
Audition de Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice
Amérique et Caraïbes, ministère de l'Europe et des affaires
étrangères
Mme Micheline Jacques, président. - Chers collègues, dans le cadre du second volet de notre étude consacrée à la coopération régionale dans le bassin atlantique, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Madame la directrice, nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le constat d'une intégration encore insuffisante des outre-mer à leur environnement régional, déjà mis en évidence l'an dernier à propos des collectivités du bassin Indien, a conduit notre délégation à approfondir la réflexion sur les leviers susceptibles d'améliorer la coopération entre les territoires ultramarins et les États voisins.
Pour ce second rapport, nous avons confié la mission à un binôme de rapporteures : Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion en visioconférence, et Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise. Je les remercie vivement pour leur engagement, ainsi que Christian Cambon, chargé de la coordination des trois volets de cette étude.
Madame la directrice, nous attendons de votre intervention un panorama précis des accords de coopération conclus entre la France et les États de la Caraïbe ainsi que ceux du bassin nord-amazonien. Quels sont les principaux domaines couverts par ces accords ? Quels efforts restent à consentir ? Quels sont les projets structurants actuellement engagés dans cette zone ?
Nous souhaitons également recueillir votre analyse sur le rôle que les outre-mer français occupent, ou pourraient occuper, dans la définition et la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France vis-à-vis de ses voisins régionaux. Comment, à l'échelle de votre direction comme au sein des ambassades de France dans la région, l'enjeu ultramarin est-il pris en compte dans la réflexion stratégique et dans l'action quotidienne de vos services ?
Cette audition précède de quelques jours un déplacement en Guyane et au Suriname que j'aurai l'honneur de conduire. La délégation se rendra également à Bruxelles le 22 mai afin de porter la proposition, formulée dans notre précédent rapport - des rapporteurs Georges Patient et Stéphane Demilly -, en faveur d'une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu).
Comme de coutume, un questionnaire indicatif vous a été adressé pour structurer nos échanges. Après votre propos liminaire, je laisserai la parole à nos rapporteures pour un premier tour de questions, puis à nos collègues présents s'ils souhaitent intervenir.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. - Madame le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, je suis très honorée de m'adresser à vous ce matin. Bien que mon quotidien soit actuellement largement accaparé par les développements à Washington, soyez assurés que mon équipe et moi-même demeurons pleinement mobilisés sur l'ensemble du continent, notamment sur les enjeux caribéens.
J'ai eu récemment l'opportunité d'accompagner le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux de la France, Thani Mohamed Soilihi, au sommet de la Communauté caribéenne, ou Communauté des Caraïbes (Caricom), aux côtés d'Alexandra Mengue, rédactrice Caraïbes, outre-mer et Caricom au sein de la direction. Ce déplacement nous a permis de mesurer l'ampleur des défis et des difficultés, mais également les immenses opportunités qu'offre cette relation régionale.
Le président de la République a clairement exprimé sa volonté de mieux comprendre le rôle, les atouts et les potentialités de nos collectivités ultramarines en matière d'intégration régionale. En effet, nombre de nos collectivités demeurent davantage reliées à leurs grands voisins ou partenaires commerciaux traditionnels qu'à leurs voisins immédiats. La Caricom constitue à ce jour l'organisation régionale la plus avancée en matière d'intégration, portée par le dynamisme de Mia Mottley, sa présidente pour six mois depuis le 1er janvier 2025. Néanmoins, des obstacles subsistent, et cette difficulté n'épargne aucune des îles ou zones concernées.
La décision de la France d'ouvrir à la rentrée une ambassade au Guyana s'explique par des enjeux stratégiques, tant en Amazonie que sur le plateau des Guyanes, et par les perspectives économiques liées à la récente découverte de gisements pétroliers. Nos relations avec cette région reposent aujourd'hui sur un socle de consultations politiques régulières. Le réseau diplomatique et culturel français, bien que dynamique, reste relativement peu dense. Certaines ambassades, comme celle de Castries à Sainte-Lucie, couvrent jusqu'à huit pays. D'autres ne sont représentées que par des postes de présence diplomatique, à l'instar de Trinité-et-Tobago ou de la Jamaïque. L'ambassadeur de France au Suriname est également accrédité auprès de la Caricom, dont le siège se trouve à Georgetown. L'ouverture prochaine d'une ambassade dans cette ville facilitera indéniablement les relations avec l'organisation.
Nos ambassadeurs s'efforcent d'entretenir un dialogue politique soutenu malgré des moyens parfois contraints. Le manque de visites officielles se fait ressentir, et votre déplacement sera donc particulièrement bienvenu. La coordination entre les ambassades, les collectivités, et l'État constitue une clé essentielle. Des mesures importantes ont été prises en ce sens, notamment la désignation de conseillers diplomatiques auprès des préfets de région en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Réciproquement, des représentants des collectivités ultramarines sont désormais accueillis au sein de certains postes diplomatiques, à l'image du représentant de la Martinique à Castries. Ces échanges favorisent l'émergence de coopérations nouvelles, qui n'auraient pu voir le jour sans cet appui local. Plusieurs formations en matière de sécurité, destinées à l'armée haïtienne, sont également organisées à la Martinique.
L'articulation des efforts entre nos services et nos collectivités revêt une importance croissante. L'action de notre ambassadeur thématique en charge de la coopération régionale, nommé récemment, consiste à fédérer les acteurs diplomatiques et territoriaux autour d'objectifs communs et d'une vision partagée. À ses côtés, nous avons engagé les travaux préparatoires à la Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane (CCRAG 2025) prévue à la Martinique, autour de priorités constantes : changement climatique et biodiversité ; lutte contre la criminalité organisée, constituant un enjeu majeur qui dépasse la zone Caraïbe-Guyane ; développement économique, encore très marqué par les conséquences de la crise sanitaire et les écarts persistants de niveau de vie ; et échanges humains, culturels et linguistiques, y compris la promotion de la francophonie. Le cadre institutionnel de cette coopération régionale s'est consolidé avec le Comité interministériel des outre-mer (Ciom) de 2023. Néanmoins, les moyens demeurent parfois insuffisants.
S'agissant de l'Union européenne (UE), les fonds mobilisables - en particulier ceux du programme Interreg - constituent des leviers puissants. La Guadeloupe coordonne le programme pour la Caraïbe, tandis que la Guyane pilote celui de l'Amazonie. Toutefois, l'accès à ces dispositifs reste freiné par leur complexité administrative et le manque de ressources humaines pour élaborer et instruire les dossiers. Nos conseillers diplomatiques, tout comme l'ambassadeur thématique, jouent un rôle central pour accompagner les porteurs de projets. Votre déplacement à Bruxelles s'inscrit dans cette dynamique utile, visant à mieux articuler les instruments européens aujourd'hui trop compartimentés, aux calendriers souvent déconnectés les uns des autres. Il convient, en effet, de plaider pour une intégration plus cohérente et plus efficace des instruments communautaires au bénéfice des régions ultrapériphériques.
L'adhésion de la Martinique à la Caricom en tant que membre associé nécessite désormais la ratification, par le Parlement français, de la Convention sur les privilèges et immunités de la Caricom. La Guyane manifeste également son souhait de rejoindre rapidement l'organisation tandis que la Guadeloupe semble adopter une posture plus attentiste, en s'interrogeant sur les bénéfices potentiels.
Historiquement, la Caricom s'opposait à l'adhésion de collectivités françaises, considérant que leur intégration au marché commun de l'Union européenne posait un problème de compatibilité avec leur propre processus d'intégration économique. Ce n'est qu'avec l'arrivée en 2021 de Carla Barnett, secrétaire générale, que cette doctrine a évolué, permettant l'ouverture à certaines collectivités françaises et néerlandaises.
La Martinique souhaite aujourd'hui jouer pleinement la carte de l'intégration régionale. Certaines initiatives bilatérales en témoignent, notamment avec Sainte-Lucie, où un dispositif d'échanges sans taxe ni octroi de mer sur une dizaine de produits a été mis en place. Ce type d'expérimentation mérite d'être soutenu et élargi, tant il illustre les bénéfices concrets que peuvent retirer nos territoires d'une insertion plus étroite dans leur environnement régional, à tous les niveaux : économique, humain, culturel.
Mme Micheline Jacques, président. - Je vous remercie pour cet exposé liminaire qui nous encourage à poursuivre nos travaux, en particulier sur les volets liés à la coopération et à la défense des intérêts de nos territoires auprès de l'Union européenne (UE).
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Madame, je vous remercie pour la qualité de votre propos.
Trois priorités se dessinent : les enjeux sécuritaires, migratoires, puis économiques. La sécurité constitue en effet un préalable indispensable au développement économique d'un territoire.
Par ailleurs, pensez-vous que l'UE constitue, en l'état, un frein significatif au développement de ces territoires, en raison de normes identiques appliquées à l'ensemble des territoires français ?
Plus largement, que pensez-vous de la proposition d'élaborer une politique européenne de voisinage propre aux régions ultrapériphériques ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - L'accès de nos collectivités aux fonds européens demeure complexe et souvent laborieux. Pour autant, ces financements représentent une opportunité réelle, et parfois unique, compte tenu des contraintes budgétaires nationales. Ils permettent en effet de mobiliser des ressources plus substantielles, assorties d'une visibilité pluriannuelle, ce que les dispositifs nationaux ne peuvent que rarement offrir. Je ne connais pas dans le détail les règles opérationnelles de l'Agence française de développement (AFD) pour les collectivités ultramarines, toutefois en ce qui concerne la zone caribéenne, les possibilités restent fortement restreintes.
Dans certains cas, les fonds européens ont permis un véritable changement d'échelle dans la conduite de projets structurants. Par exemple, le CHU de la Martinique a récemment obtenu une enveloppe de 10 millions d'euros pour soutenir le développement de son cyclotron. Dans le domaine de la sécurité, le programme EL Pacccto (Europe Latin America Programme of Assistance against Transnational Organized Crime ou programme Europe-Amérique latine d'assistance contre la criminalité transnationale organisée), piloté par l'Espagne, dispose également de ressources budgétaires considérables.
À l'échelle nationale, nous avons mis en place un programme plus modeste, baptisé Accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes (ALCORCA), qui permet d'organiser des formations spécialisées destinées à renforcer les capacités locales, et nous ambitionnons de créer une académie régionale de formation en République dominicaine.
Pour l'ensemble de la zone, le ministère ne dispose actuellement que d'un million d'euros, dont la reconduction n'est pas garantie. Nous plaidons activement pour une réaffectation de certains crédits sécuritaires, aujourd'hui en réduction dans d'autres zones, afin de renforcer notre action dans la Caraïbe. L'explosion du trafic de cocaïne constitue un facteur majeur d'insécurité dans l'ensemble des îles, mais également au Costa Rica ou en Équateur. Ces dynamiques produisent un impact sur des territoires tels que le Suriname ou la Guyane, souvent utilisés comme zones de rebond dans les circuits de trafic.
Il apparaît essentiel d'attirer l'attention de Bruxelles sur la nécessité de mettre en oeuvre une politique spécifique pour les régions ultrapériphériques. Ces dispositifs doivent être considérés non pas uniquement comme un frein, malgré les obstacles persistants liés à leur complexité, mais bien comme des leviers stratégiques. Il nous revient, à nous comme à nos partenaires institutionnels, de soutenir nos collectivités dans l'élaboration de projets solides, crédibles et adaptés aux exigences communautaires. L'agence Expertise France accomplit déjà un travail remarquable dans ce domaine. Toutefois, cette ingénierie nécessite elle aussi des moyens, car elle suppose un accompagnement en amont, pour conférer aux dossiers toute la rigueur et la cohérence nécessaires.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'aéroport de Cayenne dispose-t-il de moyens techniques permettant d'intercepter les mules avant leur embarquement, afin d'éviter qu'elles n'alimentent, à leur arrivée à Paris, un véritable marché de la cocaïne ? Au-delà de l'enjeu sécuritaire, il s'agit également d'une question humaine, tant ce trafic exploite des jeunes fragiles, attirés par un gain immédiat pour soutenir leurs familles.
Par ailleurs, la frontière avec le Suriname suscite des situations comparables à celles entre Mayotte et les Comores : des femmes viendraient accoucher en Guyane pour bénéficier du système français, avant de regagner rapidement leur pays. Ce phénomène fait-il l'objet d'un suivi précis ou d'une coopération spécifique ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - S'agissant de la détection des mules, je m'exprime avec prudence, car ces éléments relèvent davantage de la compétence de la préfecture. L'Office anti-stupéfiants (OFAST) observe que les efforts de détection au Brésil ont conduit à une baisse relative des mules, même si les chiffres demeurent préoccupants. Je ne saurais dire si cette évolution se vérifie en Guyane.
Concernant la frontière avec le Suriname, les services de l'État sont en contact régulier avec le ministère de l'Intérieur, notamment à propos de la frontière brésilienne, où des réseaux très structurés organisent des passages vers le territoire français avant un départ vers l'espace Schengen. Ces trafics impliquent également des filières venant de bien plus loin, notamment du Maroc.
Le président Lula estime incohérent que les citoyens brésiliens puissent se rendre en France hexagonale sans visa, tout en demeurant soumis à une obligation de visa pour entrer en Guyane. Le ministère de l'Intérieur entend maintenir cette exigence, au regard des enjeux migratoires et sécuritaires, notamment en lien avec le trafic de drogue et l'orpaillage illégal. L'obligation de visa reste aujourd'hui l'un des rares leviers pour contenir certains flux irréguliers, en particulier ceux liés à la traite des êtres humains.
Concernant le Suriname, une partie de la frontière demeure contestée. La ratification de l'accord bilatéral trouvé en 2021 reste actuellement bloquée par le vice-président surinamais, dans un contexte de tensions politiques internes. Il convient toutefois de souligner un changement structurel : le niveau de vie au Suriname et sur le plateau des Guyanes augmente rapidement, porté par les récentes découvertes de gisements pétroliers. Ce décalage de développement risque de devenir difficilement compréhensible pour les populations locales voisines. Si les flux migratoires restent aujourd'hui majoritairement orientés du Suriname vers la Guyane, cette dynamique pourrait à terme s'inverser.
Notre conseiller diplomatique auprès du préfet de Guyane demeure pleinement mobilisé sur ces enjeux, en lien étroit avec notre ambassade au Suriname. Toutefois, nous manquons de moyens humains, notamment en matière d'attachés de sécurité intérieure (ASI).
M. Jean-Gérard Paumier. - N'est-il pas urgent que l'UE reconnaisse pleinement la spécificité de ces territoires et adapte ses mécanismes d'appui ? Ceux-ci représentent un enjeu stratégique pour l'Europe dans son ensemble, bien au-delà des seuls États membres concernés.
Cette exigence vaut tout particulièrement pour les régions ultrapériphériques, qui ne pourront se développer sans un soutien européen renforcé, notamment le Groenland, Madère, les Açores, ou les Terres australes et antarctiques, aujourd'hui au centre d'intérêts géopolitiques croissants.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Dans le contexte actuel, la diversification de nos partenariats et le renforcement de notre présence dans certaines régions longtemps négligées deviennent essentiels. Les pays des Caraïbes, de l'Amazonie et, plus largement, de l'Amérique du Sud, rejettent la logique des blocs, refusant de choisir entre les États-Unis et la Chine. Or, l'Europe ne se manifeste souvent qu'au moment où elle a besoin d'eux, notamment pour solliciter leur appui lors d'échéances aux Nations Unies. Cette approche opportuniste doit être dépassée. Nous devons aller vers eux autrement, en cherchant à mieux comprendre leurs besoins et à bâtir des partenariats durables fondés sur des intérêts communs.
Face aux pressions croissantes - multiplication des droits de douane, politiques tarifaires agressives, désengagement progressif de l'agence des États-Unis pour le développement international (USAID) -, nous disposons d'une véritable fenêtre d'opportunité. Ces pays commencent d'ailleurs à percevoir l'intérêt d'un engagement européen plus conséquent, d'autant plus que l'aide des États-Unis s'est souvent accompagnée de tensions diplomatiques.
La Chine, quant à elle, s'est implantée de longue date, avant même l'initiative Belt and Road. Plusieurs États sont aujourd'hui fortement endettés à son égard. Le sommet de la Caricom a mis en lumière une forme de résignation : certes, la Chine suscite des critiques, mais les États-Unis n'ont jamais offert de concessions réelles. De ce fait, plusieurs pays refusent d'entrer dans un schéma d'opposition binaire.
Face à cette logique, j'ai tenu à affirmer une autre voie, fondée sur les valeurs partagées, le multilatéralisme et les principes démocratiques. Ces pays y sont profondément attachés, comme en témoigne l'engagement actif de la Caricom au sein des Nations Unies. Dès lors, il nous appartient de valoriser ce socle commun, entretenir un dialogue plus constant et cesser de ne les solliciter que lorsqu'un vote nous est nécessaire.
Mme Évelyne Perrot. - Quel impact la situation en Haïti exerce-t-elle actuellement sur les territoires ultramarins ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - La situation en Haïti est extrêmement préoccupante. Face à l'insécurité croissante, notre ambassade a été relocalisée à Pétion-Ville, dans les locaux de la délégation de l'UE. La capitale est désormais contrôlée à près de 90 % par les gangs, avec un bilan dramatique : plus de 5 600 morts en 2024, déjà plus de 1 000 depuis le début de l'année, et plus d'un million de déplacés.
Cette dégradation massive produit des répercussions directes sur l'ensemble de la région, notamment une pression migratoire forte. La République dominicaine a repris la construction de son mur frontalier et renvoie massivement les Haïtiens. L'an dernier, la France a soutenu un programme de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour favoriser leur réinsertion après ces expulsions.
Lors du sommet de la Caricom, la situation en Haïti a été inscrit à l'ordre du jour, témoignant d'une prise de conscience régionale, mais également d'un certain désarroi. Personne ne semble en mesure de proposer une solution. Le plaidoyer de la France en faveur du rétablissement d'une opération de maintien de la paix s'est heurté à l'opposition du Secrétaire général. Cette position s'explique par le traumatisme laissé par le précédent déploiement, marqué par des événements désastreux : épidémie de choléra, violences sexuelles, et procédures judiciaires contre l'ONU.
Aujourd'hui, la présence onusienne se limite au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), une mission politique spéciale de 260 personnes, chargée d'accompagner le processus de transition politique et l'organisation des élections. Ses moyens restent notoirement insuffisants pour faire face à l'ampleur de la crise.
Le Secrétaire général des Nations Unies privilégie désormais une mission de soutien logistique à la police haïtienne, appuyée par le déploiement de 1 000 policiers kényans. La France soutient cette démarche, malgré ses limites évidentes, en espérant éviter un veto de la Chine, qui tend à entraver les dispositifs d'aide en raison de la reconnaissance officielle de Taïwan par Haïti.
Sur le plan bilatéral, nous renforçons notre appui à la police nationale haïtienne : formations, équipements, véhicules blindés et, pour la première fois, envoi de munitions. Le système judiciaire haïtien est en ruine : les prisons ont été détruites et la chaîne pénale rompue. Même une hypothétique victoire contre les gangs ne résoudrait pas l'effondrement institutionnel. La préparation d'élections, censées légitimer les autorités de transition, relève davantage du symbole que d'une perspective réaliste. Malgré tout, il apparaît essentiel d'en préserver le principe.
L'effort de 40 millions d'euros consenti l'an dernier par la France ne pourra pas être reconduit cette année, eu égard aux contraintes budgétaires. La crise humanitaire demeure pourtant considérable : près de la moitié de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire grave. Dans ce cadre, la pression migratoire sur les territoires voisins s'annonce tangible et durable.
Mme Micheline Jacques, président. - Il est par ailleurs estimé qu'environ 30 % des enfants haïtiens rejoignent les gangs.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Le véritable problème réside dans l'absence totale de perspective : aucune figure haïtienne ne semble en mesure de sortir le pays de cette situation.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Nous pouvons compter sur un ambassadeur remarquable sur place. Les comptes rendus de ses entretiens redonnent une part d'espoir, témoignant de la présence d'acteurs locaux sincèrement engagés. Cependant, la peur pose un obstacle majeur. Jovenel Moïse, jugé trop passif, a pourtant été assassiné. Ariel Henry a été écarté. De nombreuses formations politiques ont tissé des liens, directs ou indirects, avec les gangs, attirées par des réseaux économiques particulièrement lucratifs : contrôle des ports, des importations, des infrastructures routières et des douanes. Il devient très difficile d'identifier les interlocuteurs sincères. Pourtant, il existe en Haïti des personnes de grande qualité, de bonne volonté et porteuses d'une vraie vision pour leur pays. Il ne faut pas renoncer à croire en eux.
Les États-Unis, avant de solliciter le Kenya, ont tenté de convaincre des partenaires régionaux majeurs. Les Brésiliens, marqués leur engagement massif dans la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), ont opposé une réponse sans équivoque : « Haïti, plus jamais ». Quant à la Colombie, elle a exprimé une volonté éventuelle de contribuer sur le volet judiciaire, mais refuse toute implication sur le plan sécuritaire.
Mme Micheline Jacques, président. - Que pensez-vous de l'idée de constituer un consortium international placé sous leadership français ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - La position de la France en Haïti est à la fois centrale et délicate. Nous sommes attendus, mais notre passé historique complexifie notre rôle, notamment en raison de la question de la dette dite de l'Indépendance. Celle-ci, qui ressurgira sans doute autour du 17 avril, date marquant les 200 ans de l'ordonnance de Charles X, ayant imposé à Haïti le versement de 150 millions de francs en échange de la reconnaissance de son indépendance, alimente une mémoire douloureuse. Pour l'opinion publique haïtienne, il serait difficilement acceptable que la France prenne davantage de poids, même si les responsables politiques ne l'admettront pas ouvertement.
Sur le plan européen, la France demeure l'un des rares pays - avec l'Espagne - à conserver une représentation diplomatique sur place. C'est sous l'impulsion française que l'UE a engagé un régime de sanctions à l'encontre des chefs de gangs. La France a instruit l'ensemble des dossiers, ce qui a déjà permis de sanctionner quatre chefs de gangs. D'autres sont en cours d'instruction.
Nous avons également convaincu l'UE d'abonder à hauteur de 10 millions d'euros le Fonds Fiduciaire des Nations Unies, destiné à soutenir la mission kényane. Sans notre action, l'UE ne serait pas intervenue, en raison d'obstacles techniques et bureaucratiques.
Par ce biais, la France agit déjà comme moteur d'un consortium international, articulé à la fois autour des Nations Unies, de l'UE, et de son propre engagement bilatéral. Néanmoins, nous ne pouvions pas être désignés comme Nation-cadre de la mission internationale d'appui à la sécurité. Les États-Unis ont cherché à confier ce rôle au Canada, qui a finalement renoncé. Le Rwanda avait exprimé son intérêt, mais les États-Unis s'y sont opposés, en raison de considérations liées à la protection des populations civiles. C'est finalement le Kenya qui a été retenu, au terme d'un processus complexe et prolongé. Le contingent déployé se limite pour l'instant à 1 000 policiers kényans, auxquels s'ajoutent de petits effectifs venus des Caraïbes, du Guatemala, de la Jamaïque ou de la Barbade.
Cependant, deux policiers kényans ont déjà été tués, l'un d'eux dans des conditions atroces, dont les images ont été diffusées par les gangs à des fins d'intimidation. Ce type d'acte dissuasif refroidit évidemment les velléités d'engagement d'autres pays, qui souhaitent contribuer dans la mesure de leurs moyens, mais sans s'exposer directement à des représailles d'une telle violence.
Mme Micheline Jacques, président. - Disposez-vous d'une étude sur l'impact du Brexit sur les petits territoires précédemment associés à l'UE, aujourd'hui isolés dans ce nouveau contexte ?
Par ailleurs, vous avez évoqué la présence croissante de la Chine dans les eaux caribéennes. Selon vous, quels effets les puissances asiatiques exercent-elles actuellement sur ces territoires ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Dans le cadre de leur stratégie dite Global Britain, les Britanniques ont cherché à compenser le Brexit par la signature de nombreux accords commerciaux à travers le monde, notamment avec la Caraïbe. Toutefois, les retours obtenus lors du sommet de la Caricom font état d'un désengagement progressif. Autrefois, les Britanniques jouaient un rôle déterminant au sein de l'UE pour faciliter l'accès aux aides, aux programmes et aux canaux de financement. Depuis leur départ, ils ont perdu cette capacité d'influence, y compris aux Nations Unies, où leur poids, autrefois significatif, tend à s'amenuiser.
Concernant la Chine, la situation semble plus contrastée. Si sa présence reste limitée dans certaines zones d'Amérique centrale, elle s'est renforcée dans la Caraïbe, dans une logique stratégique d'encerclement discret du voisin nord-américain. La Chine déploie dans la région des initiatives relevant de la Belt and Road Initiative, bien qu'à une échelle moins visible que dans le cône Sud, où elle est fortement implantée, notamment en Argentine, au Chili, au Pérou et au Brésil. Dans la Caraïbe, son influence repose sur des outils d'influence douce : création de centres Confucius, bourses d'études, développement de liens humains et culturels.
Par ailleurs, la Chine s'emploie à renforcer sa présence au sein de l'Organisation des États américains (OEA), dont dix membres sont issus de la Caraïbe. Elle y voit un levier d'influence diplomatique majeur. À ce titre, des soupçons circulent sur une participation chinoise au financement du prochain sommet de l'OEA, alors même que l'OEA traverse une crise financière liée au retrait partiel de l'USAID, qui assurait jusqu'ici près de la moitié de son budget. Ce type d'intervention illustre la capacité de Pékin à investir les espaces laissés vacants.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Ne serait-il pas pertinent de réfléchir à une structuration pérenne, permettant d'associer pleinement les collectivités ultramarines à la définition et à la mise en oeuvre d'une stratégie locale de coopération régionale ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Nous pourrions aller plus loin, c'est une évidence, mais il existe déjà plusieurs cadres dans lesquels les collectivités territoriales sont pleinement associées.
La Commission mixte transfrontalière réunit chaque année les partenaires institutionnels locaux : services de l'État, préfecture, mais aussi représentants de la collectivité territoriale de Guyane, et leurs homologues brésiliens. Cette instance aborde l'ensemble des problématiques transfrontalières : migrations, coopération économique, reconnaissance des diplômes, éducation, etc. La prochaine édition se tiendra en juin à Cayenne, et sera présidée par mon adjoint, en raison d'un conflit d'agenda.
Concernant l'adhésion de la Martinique à la Caricom, nous souhaitons proposer à l'organisation la mise en place d'un dialogue stratégique structuré, intégrant les collectivités françaises concernées. Si la Guyane rejoint prochainement la Caricom -- ce qui est envisagé --, elle serait naturellement incluse dans ce dispositif. Il en va de même pour la Guadeloupe.
Certains membres de la Caricom conservent une forme de réticence à l'égard de la France, perçue encore comme puissance coloniale. Il apparaît d'autant plus important de structurer un dialogue fondé sur des projets concrets, et d'y associer pleinement les collectivités ultramarines.
Par ailleurs, plusieurs collectivités disposent déjà de représentants au sein de nos ambassades, comme la Martinique, qui possède un représentant à l'ambassade de France à Castries. En lien étroit avec le Service économique régional (SER), il bénéficie ainsi d'analyses économiques, de veille stratégique et de propositions d'opportunités de coopération ou d'investissement. Ce dispositif mérite d'être renforcé, car il favorise l'ancrage territorial dans nos réseaux diplomatiques. À ma connaissance, la Guadeloupe n'a pas encore mis en place un tel poste.
Enfin, une convention-cadre entre l'État et les collectivités a été signée en 2024 dans le cadre de la CCRAG, dont l'édition 2025 constituera une excellente opportunité pour relancer la dynamique et approfondir cette structuration.
Mme Micheline Jacques, président. - Que pensez-vous de l'idée d'une révision visant à mieux harmoniser les statuts des régions ultrapériphériques/pays et territoires d'outre-mer (RUP/PTOM) ? Une telle démarche permettrait-elle, selon vous, de fluidifier les coopérations régionales pour les territoires de la Caricom ?
Par ailleurs, comment envisagez-vous une meilleure intégration des territoires ultramarins dans les accords commerciaux bilatéraux entre la France et les pays de la zone ?
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Lorsque j'évoquais le fonctionnement en silo au sein de l'UE, je faisais notamment référence à cette distinction entre les dispositifs RUP et PTOM. Ces instruments reposent sur des processus distincts, avec leurs propres calendriers, critères d'éligibilité et modalités d'exécution. Il me paraît indispensable, dans la réflexion que vous porterez à Bruxelles, d'envisager une meilleure articulation entre ces régimes, voire, à terme, une certaine fongibilité, ou du moins une harmonisation partielle. Certes, les RUP et les PTOM répondent à des logiques et des objectifs différents, mais leur cloisonnement excessif constitue un frein majeur, en particulier dans les zones comme la Caraïbe où les interactions territoriales sont fortes.
Les accords commerciaux devraient figurer à l'ordre du jour du prochain sommet UE-Caricom. Il s'agit de mieux intégrer les territoires ultramarins français aux accords bilatéraux, tout en préservant la capacité d'action propre des États et territoires de la zone. Il ne faudrait pas, sous prétexte d'alignement avec les accords européens, entraver leur faculté à saisir des opportunités locales ou à adapter leurs partenariats aux réalités régionales. Ce sujet résidait au coeur des hésitations autour de l'adhésion de la Caricom à des partenariats impliquant des membres de l'UE.
Mme Micheline Jacques, président. - Le marché ultramarin demeure étroit et largement tourné vers l'Hexagone. La différence de développement entre les territoires français ultramarins et les petits territoires autonomes voisins entrave, pour l'instant, toute véritable ouverture commerciale. Permettre à ces territoires de monter en compétence favoriserait une meilleure intégration régionale et contribuerait à diversifier les approvisionnements.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - Cette problématique concerne également de nombreuses petites îles sous dépendance américaine ou du Commonwealth, comme Porto Rico ou les îles Vierges. La vie reste extrêmement chère, les produits étant majoritairement importés depuis des territoires comme les États-Unis.
À la Martinique, par exemple, le développement agricole reste très insuffisant, ce qui renforce cette dépendance aux importations.
Mme Micheline Jacques, président. - Les normes européennes et l'absence de flux bilatéraux freinent les échanges entre territoires. Il convient de créer du flux dans les deux sens, ce qui suppose des moyens logistiques adaptés. Aujourd'hui, un entrepreneur guadeloupéen souhaitant se rendre en Jamaïque ou à Cuba doit souvent passer par Paris ou Miami. Sans amélioration de la mobilité régionale, il sera difficile de stimuler les échanges économiques.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - La question des normes phytosanitaires constitue un enjeu majeur pour le développement agricole. L'harmonisation des normes figure parmi les axes de travail du programme européen de développement Global Gateway. Par ailleurs, l'Accord de Samoa, conclu avec les pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), représente également une perspective encourageante.
Mme Micheline Jacques, président. - Je vous remercie sincèrement pour la richesse de vos éclairages. Les pistes évoquées renforcent la pertinence de nos travaux, que nous poursuivrons avec d'autant plus de détermination.
Mme Nathalie Estival-Broadhurst. - J'espère que nous pourrons échanger à votre retour. Je vous souhaite une excellente mission.
Mardi 13 mai
2025
Audition de M. Thani
Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du
ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de
la Francophonie et des Partenariats internationaux
Mme Micheline Jacques, président. - Monsieur le Ministre, cher Thani, chers collègues, dans le cadre du rapport d'information sur la coopération et l'intégration régionale des outre-mer, nous avons l'honneur d'auditionner M. Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
Je tiens à exprimer l'émotion et le plaisir sincères qui nous animent en accueillant Thani, dont la présence parmi nous revêt une signification toute particulière. En effet, sa contribution passée aux travaux de notre délégation a laissé une empreinte durable par la pertinence de ses analyses, la rigueur de ses rapports et ses qualités humaines unanimement saluées.
Monsieur le Ministre, nous vous remercions chaleureusement pour votre précieuse participation à nos réflexions sur la coopération régionale. Cette thématique, retenue comme axe de travail prioritaire l'an dernier, a déjà fait l'objet d'un premier rapport consacré à l'océan Indien, brillamment conduit par le président Christian Cambon, aux côtés de nos collègues Georges Patient et Stéphane Demilly.
Comme vous le savez, la coopération régionale dans les outre-mer demeure malheureusement insuffisamment développée, alors même qu'elle constitue un levier majeur pour renforcer le rayonnement international de la France et soutenir le développement des territoires ultramarins. Dans cette perspective, notre délégation poursuit ses travaux en abordant à présent le bassin Atlantique, sous l'impulsion de nos deux rapporteures, Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion, et Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise, que je remercie vivement pour leur engagement.
Monsieur le Ministre, qui pourrait mieux que vous porter nos propositions ? Votre participation récente, aux côtés du Président de la République, au 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien (COI) à Madagascar, représente un moment fort. Cette instance, qui rassemble les États insulaires du sud-ouest de l'océan Indien, constitue en effet un espace privilégié de coopération, et nous sommes ravis de pouvoir recueillir votre analyse de la situation actuelle et des perspectives à venir. À cet égard, nous accordons une attention singulière à la question de l'intégration de Mayotte, qui nous tient particulièrement à coeur et que nous avions déjà identifiée comme un enjeu prioritaire dans notre précédent rapport.
Notre audition s'inscrit également dans le prolongement d'un déplacement effectué en Guyane et au Suriname par nos rapporteures, qui ne manqueront pas de vous faire part de leurs observations.
Une interrogation récurrente mérite à nouveau d'être posée, et plus encore à vous, Monsieur le Ministre, qui portez désormais cette responsabilité au sein de l'exécutif : existe-t-il réellement une diplomatie française des outre-mer ?
Plus précisément, dans quelle mesure les intérêts spécifiques des collectivités ultramarines influencent-ils les orientations prises dans les relations de la France avec les pays riverains ? Quel rôle concret les outre-mer peuvent-ils jouer dans la définition et la conduite de la politique étrangère de la France à l'échelle régionale ? Enfin, en quoi la francophonie pourrait-elle constituer un levier stratégique pour servir cette ambition ?
Ces questionnements, parmi d'autres, permettront de structurer nos échanges, dont je présage qu'ils seront particulièrement fructueux. Conformément à nos usages, cette audition fait l'objet d'un enregistrement et d'une diffusion en direct sur le site du Sénat. À l'issue de votre propos liminaire, nos rapporteures vous adresseront leurs questions, suivies de nos collègues qui souhaiteront également vous interroger.
Vous avez la parole, Monsieur le Ministre.
Thani Mohamed-Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux. -Madame le Président, chère Micheline, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Chers collègues, chers amis, je tiens à vous témoigner ma profonde reconnaissance pour votre invitation à m'exprimer devant votre délégation. C'est avec une émotion sincère que je retrouve cette maison à laquelle je demeure très attaché, et dont j'ai eu l'honneur de partager les travaux sur de nombreux sujets relatifs aux outre-mer.
Permettez-moi de structurer mon propos autour de trois axes : les enjeux et perspectives de la coopération régionale ; les actions concrètes conduites dans les trois bassins océaniques ; et, enfin, quelques éléments de réponse aux propositions formulées dans votre rapport sur l'océan Indien.
Comme l'a rappelé le Président de la République en début d'année, l'insertion des outre-mer dans leur environnement régional constitue une priorité stratégique. Je salue à cet égard l'attention constante que votre délégation accorde à cette ambition essentielle.
Les outre-mer partagent avec leur voisinage des liens historiques, culturels et sociaux profonds. Il apparaît désormais nécessaire que cette proximité s'exprime davantage dans les échanges économiques. Il convient, en ce sens, de consolider la relation naturelle qu'entretiennent les territoires ultramarins avec leur environnement géographique immédiat, sans pour autant affaiblir les liens structurants qui les unissent à l'Hexagone.
Cette dynamique suppose un travail déterminé pour lever les obstacles entravant la circulation des biens et des services, fluidifier les échanges et créer un environnement propice à l'investissement privé. Cette orientation permettra également de renforcer la solidarité régionale et de mieux répondre à la problématique de la vie chère. L'amélioration de la connectivité aérienne et maritime s'impose par ailleurs comme un chantier prioritaire : tant que les territoires demeureront difficilement accessibles entre eux, toute ambition de coopération régionale restera stérile.
Dans cette perspective, j'ai souhaité consolider notre stratégie dite « Trois Océans », en m'appuyant sur des ambassadeurs de coopération régionale désignés pour chaque zone, en associant étroitement les représentants des collectivités territoriales aux travaux, notamment à travers les conférences de coopération régionale organisées chaque année. Je rappelle ici le fondement juridique posé par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, renforcée par la loi du 5 décembre 2016, qui a permis des avancées significatives, notamment dans les départements et régions d'outre-mer.
Les collectivités ultramarines peuvent et doivent devenir des vecteurs d'influence pour la France dans leurs zones respectives. À cet égard, le développement de la coopération décentralisée offre un levier encore trop peu exploité.
Je me suis rendu en février dernier à la Barbade et à la Martinique afin d'accompagner l'adhésion de cette dernière à la Communauté des Caraïbes (Caricom). Cette avancée majeure devrait, je l'espère, être suivie par la Guadeloupe et la Guyane.
Nos priorités dans cette zone concernent la sécurité régionale, avec un accent mis sur la lutte contre les trafics, la criminalité transfrontalière, l'orpaillage illégal et les flux migratoires qui déstabilisent notamment Haïti.
L'action sanitaire figure également parmi nos priorités. Grâce au soutien de l'Agence française de développement (AFD) et à la Caribbean Public Health Agency (CARPHA), des réseaux de veille épidémiologique ont été mis en place, notamment pour répondre aux épisodes de dengue, de zika ou encore à la pandémie de Covid-19.
L'adaptation au changement climatique constitue un enjeu transversal : cyclones, séismes, montée des eaux, et prolifération des algues sargasses nécessitent une approche coordonnée. La préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC 3), co-organisée par la France et le Costa Rica à Nice, ainsi que le Forum mondial des îles que je présiderai s'inscrivent dans cette dynamique.
La France intervient également en matière de sécurité civile, en mobilisant des moyens en soutien aux États voisins, comme lors de l'éruption de la Soufrière à Saint-Vincent ou du cyclone Irma. Cette solidarité renforce notre présence dans un espace marqué par une forte concurrence d'influences - latino-américaine, nord-américaine, caribéenne, chinoise, africaine et orientale.
Enfin, les partenariats universitaires et scientifiques, tels que ceux avec l'Université des Antilles, le Campus caribéen des arts, la Caribbean Maritime University ou encore Sciences Po, favorisent les échanges académiques et la recherche appliquée, et participent au rayonnement de la francophonie dans la région.
Le bassin Pacifique revêt une importance stratégique pour la France, qui y compte 600 000 ressortissants et des zones économiques exclusives (ZEE) calédoniennes, polynésiennes et wallisiennes couvrant les deux tiers de sa ZEE nationale.
Les forces armées stationnées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie contribuent à la stabilité régionale et aux interventions humanitaires en cas de catastrophe naturelle. Lors d'un déplacement à Perth, j'ai réuni les ambassadeurs de la région ainsi que les élus locaux pour faire un point de situation sur les perspectives de coopération. Nous poursuivons notre engagement dans les principales organisations régionales : la Communauté du Pacifique, le Forum des îles du Pacifique, le Programme régional océanien pour l'environnement, et l'Association des États riverains de l'océan Indien (Indian Ocean Rim Association - IORA), dans le cadre de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. J'ai veillé à ce que nos collectivités soient pleinement associées à la révision en cours de cette stratégie.
Nous soutenons également des projets d'amélioration de la connectivité, qu'elle soit aérienne, maritime ou numérique. Le programme régional de mobilité lancé en 2024 favorise par ailleurs les échanges académiques et scientifiques entre les États insulaires du Pacifique et les collectivités françaises.
Nous entendons structurer et consolider cette dynamique prometteuse.
La région de l'océan Indien constitue un espace éminemment stratégique, tant par sa démographie - plus d'un million de ressortissants français y résident - que par son rôle dans les échanges mondiaux : un tiers du commerce mondial d'hydrocarbures y transite, et le canal du Mozambique a vu son trafic croître de 50 % en lien avec la crise sécuritaire en mer Rouge.
L'intégration de Mayotte à la COI constitue une priorité de notre diplomatie régionale. Ce point a été réaffirmé par le Président de la République et par moi-même lors du dernier Sommet des chefs d'État à Madagascar. Si les résistances demeurent vives du côté comorien, nous sommes déterminés à poursuivre le dialogue, et je me tiens prêt à me rendre à Moroni pour avancer sur ce dossier.
La France s'engage avec fierté au sein de la COI pour faire face aux problématiques régionales : pollutions marines, trafic de drogue, pêche illégale ou sauvetage maritime. Notre pays contribue activement à la sécurité maritime dans cette zone, notamment à travers une architecture régionale structurée autour de deux centres dédiés à la fusion des informations et à la coordination opérationnelle. La Réunion joue un rôle moteur à cet égard, et le projet de création de l'Académie de l'océan Indien, annoncé par le Président de la République, renforcera encore notre capacité à faire face aux défis sécuritaires communs.
Sur le plan agricole, des initiatives avec Madagascar visent à structurer un espace d'échanges agroalimentaires au sein de la COI. Le programme Varuna, soutenu par l'AFD, accompagne la préservation de la biodiversité et du parc naturel marin.
Nous soutenons également des coopérations bilatérales, notamment avec le Kenya, où un accord a été conclu entre la Chambre de commerce et d'industrie du Kenya et l'ADIM de Mayotte. Je m'y rendrai prochainement avec une délégation d'entreprises kenyanes. Par ailleurs, je soutiens pleinement le programme Interreg porté par le conseil départemental de Mayotte, axé sur le canal du Mozambique.
Je souhaite saluer la qualité du rapport produit par votre délégation, dont l'approche méthodique et pragmatique alimente utilement les politiques publiques. Je ne saurais prétendre à l'exhaustivité, au regard du travail minutieux que vous avez mené. Néanmoins, permettez-moi d'y apporter quelques éléments de réponse en trois volets : la structure administrative du MEAE, les orientations de politique étrangère, et la mobilisation européenne.
Je souscris pleinement à l'objectif d'un renforcement du dispositif de coopération régionale de l'océan Indien. Nous avons créé un poste de conseiller politique dédié à la coopération régionale, qui prendra prochainement ses fonctions à Maurice. Par ailleurs, les postes de conseillers diplomatiques des préfets sont aujourd'hui pourvus dans les trois bassins. Une convention signée en avril avec le conseil départemental de Mayotte permettra d'affecter des agents départementaux dans nos ambassades, selon un modèle déjà en place pour les collectivités françaises d'Amérique.
La plateforme de coopération régionale de la France dans l'océan Indien (PCFOI) a été réactivée, avec des réunions en mars et en juin. Cette instance constitue un pilier essentiel de notre politique de coopération régionale.
Soyez assurés de notre attachement à associer systématiquement les élus mahorais aux démarches diplomatiques. Le président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, a ainsi participé au Sommet de la COI. Cette dynamique représente une priorité de notre stratégie. Concernant votre proposition d'une meilleure intégration de Mayotte dans son environnement économique, nous avons engagé une stratégie commerciale régionale en ce sens, avec une finalisation prévue cet été.
En matière migratoire, le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte prévoit des mesures concrètes, tandis qu'un dialogue étroit s'organise avec les Comores pour lutter contre les départs irréguliers.
Quant au croisement des lignes budgétaires entre l'aide au développement et les crédits ultramarins, il constitue une nécessité. Nous travaillons activement avec le ministère des Outre-mer en ce sens.
Nous enregistrons toutefois un point de divergence, mineur mais réel, s'agissant de la représentation française au sein de la COI. Le rôle de La Réunion dans ce cadre s'avère central, et nous lui réservons une attention particulière. Toutefois, la représentation nationale au sein de cette instance ne saurait être déléguée exclusivement aux collectivités réunionnaises. Confier un mandat permanent de représentation à La Réunion contredirait l'objectif poursuivi d'associer pleinement Mayotte à l'ensemble des programmes de cette organisation.
Une représentation portée par l'État garantirait ainsi un équilibre entre nos deux territoires, chacune pleinement légitime dans cette enceinte. Par ailleurs, nombre de thématiques traitées relèvent de compétences régaliennes, et ne peuvent dès lors être assumées par les seules collectivités territoriales.
Je ne doute pas du succès d'une telle complémentarité entre l'État et les collectivités.
Plusieurs des recommandations formulées par votre délégation appellent une mobilisation accrue au niveau européen. Nous partageons la même analyse quant à la position stratégique des territoires ultramarins : ils constituent, à bien des égards, des avant-postes de l'Union européenne dans leurs bassins géographiques respectifs. Il nous revient ainsi d'exploiter cet atout structurel et de veiller à ce que les outre-mer en tirent tous les bénéfices.
S'agissant de votre proposition relative à l'élaboration d'une politique européenne de voisinage spécifiquement conçue pour les régions ultrapériphériques (RUP), il me semble que les fondations en sont d'ores et déjà posées, à travers les dispositifs d'adaptation existants, notamment les programmes Interreg. Toutefois, je partage votre conviction : il s'agit là d'un point de départ, et non d'un aboutissement. Des instruments analogues à la politique de voisinage appliquée aux frontières continentales de l'Union pourraient en effet être envisagés, afin de renforcer l'intégration régionale des territoires ultramarins.
Nos partenaires européens, souvent moins exposés à ces enjeux, doivent être sensibilisés avec constance. Cette pédagogie diplomatique constitue un impératif, et je m'y emploie systématiquement lors de chaque séquence de travail européenne. À cet égard, il semblerait opportun que votre délégation présente les conclusions de ce rapport devant le Parlement européen. Je crois savoir que cette démarche est déjà engagée - preuve, s'il en fallait, de la parfaite convergence de nos intentions.
Par ailleurs, vous soulignez avec justesse les contraintes juridiques et réglementaires qui freinent la coopération régionale, en particulier en matière d'approvisionnement et de gestion des déchets. Le Président de la République a d'ailleurs mis en lumière ces difficultés lors de son déplacement d'avril dernier. La France continuera de défendre, dans le respect des traités européens, une évolution du cadre réglementaire permettant une meilleure prise en compte des spécificités ultramarines, afin d'améliorer concrètement les conditions de vie et le pouvoir d'achat de nos compatriotes, sans jamais compromettre les exigences en matière de santé publique.
Madame la Présidente, j'espère avoir exposé de manière claire les grandes lignes de notre action en matière de coopération régionale, ainsi que les principales réponses aux propositions émises par votre délégation au sujet de la zone océan Indien. Je souhaite remercier à nouveau l'ensemble des contributeurs pour la qualité du travail accompli.
Vous pouvez compter sur mon engagement pour prolonger et mettre en oeuvre les orientations que nous partageons. À cet effet, j'ai d'ailleurs procédé à la désignation, au sein de mon ministère, d'une conseillère spécifiquement chargée du suivi de la coopération régionale.
Mme Micheline Jacques, président. - Merci, Monsieur le Ministre, pour ces annonces porteuses d'espoir.
La délégation a récemment déposé une proposition de résolution européenne visant à élargir le cadre législatif applicable aux RUP, notamment sur les volets alimentation, énergie et traitement des déchets, qui constituent des enjeux fondamentaux pour nos territoires. Dans cette perspective, nous nous rendrons à Bruxelles le 22 mai, en partenariat avec la commission des affaires européennes du Sénat, dans le cadre d'une mission conduite avec le président Jean-François Rapin. Le programme prévoit, entre autres, un entretien avec M. Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour le soutien que vous nous témoignez dans cette démarche.
Je cède à présent la parole à nos rapporteures.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Monsieur le Ministre, je suis très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui.
Notre récente visite en Guyane et au Suriname a mis en évidence les défis majeurs auxquels ce territoire est confronté : orpaillage illégal, trafics, pêche illicite -- cette dernière constituant également un véritable fléau.
Sans une diplomatie structurée, nos marges de manoeuvre demeureront limitées. De surcroît, malgré les difficultés, il convient impérativement d'instaurer un dialogue avec la Chine, particulièrement installée dans la région. Les élus locaux, en première ligne, ne peuvent être laissés seuls face à ces enjeux de sécurité et de développement. Leur implication dans l'action diplomatique paraît indispensable.
Notre mission nous a également permis de rencontrer le Président du Suriname, qui attend beaucoup de la France pour accompagner son développement. Cependant, une relation de confiance suppose un engagement réciproque. Or, un accord frontalier, signé par la France, reste à ce jour non ratifié par le Suriname. Ce point mérite une attention particulière, car ces tensions affectent non seulement la Guyane, mais également la Guadeloupe et la Martinique.
Ainsi, ne conviendrait-il pas de renforcer notre action diplomatique dans la région, en y associant étroitement les élus locaux, souvent démunis face à des enjeux d'envergure ?
Par ailleurs, l'Union européenne continue d'imposer un cadre uniforme, inadapté à la réalité des territoires ultramarins. En Guyane, par exemple, l'interdiction d'importer du boeuf brésilien - pourtant traditionnellement consommé - encourage le développement de circuits illégaux.
Il apparaît désormais indispensable que l'Union européenne reconnaisse pleinement la spécificité de ces territoires et adapte ses règles en conséquence. La France, seule à disposer d'une telle présence dans plusieurs bassins océaniques, doit porter cette exigence au niveau européen.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteur. - Monsieur le Ministre, je vous remercie pour la clarté de votre intervention.
Vous avez rappelé à juste titre que la coopération régionale repose à la fois sur des enjeux sécuritaires et sur la qualité des relations de voisinage avec les États riverains. À ce titre, je souhaiterais vous interroger sur un levier important de cette coopération : la langue. En effet, la francophonie joue un rôle structurant dans l'intégration régionale, comme l'illustrent, par exemple, les cours de français développés au Suriname.
Pourrions-nous envisager, en retour, de favoriser dans les outre-mer l'apprentissage des langues régionales, notamment le portugais - langue du Brésil, frontalier de la Guyane, mais aussi du Mozambique, proche de Mayotte et de La Réunion ?
Le développement de programmes d'échanges, inspirés du modèle Erasmus, dans les bassins géographiques des outre-mer, mériterait d'être étudié.
Je souhaiterais également évoquer le sujet de la coopération sanitaire. La Guyane et l'Amapá au Brésil font face à des défis communs en matière de santé publique. Les épisodes épidémiques à La Réunion et à Mayotte rappellent l'ampleur de ces enjeux, qu'il s'agisse de maladies infectieuses, de prévention ou de vaccination. Des initiatives telles que la Semaine de la santé, relancée en 2024 par l'ARS de Guyane, s'inscrivent dans une dynamique vertueuse, d'autant plus que le changement climatique favorise l'expansion de virus dans des zones jusqu'alors peu exposées.
Pourrions-nous, en matière de santé publique, également aller plus loin dans la structuration d'une coopération régionale durable et ambitieuse ?
M. Thani Mohamed-Soilihi. - Je vous remercie, Mesdames les rapporteures.
Nous avons mis en place une coopération diversifiée avec le Suriname, afin d'apporter une réponse coordonnée aux différentes problématiques transfrontalières, auxquelles j'ajouterais la lutte contre les narcotrafics. Or, l'absence de ratification d'un protocole par le parlement surinamais constitue un obstacle majeur à toute négociation substantielle. Nous appelons à cette ratification avec insistance, sans toutefois tomber dans l'ingérence.
Je partage pleinement votre constat selon lequel nos territoires ultramarins constituent de véritables fers de lance diplomatiques, et nous devons intensifier les relations entre ceux-ci et leurs voisins. Des initiatives existent déjà, comme les programmes Interreg, qu'il convient désormais de développer. Les visites de terrain que vous effectuez, ainsi que les événements internationaux comme la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'Océan, représentent autant d'occasions de renforcer cette dynamique. Nous y travaillons activement.
À cet égard, je propose que des membres de votre délégation puissent m'accompagner lors de déplacements liés à ces thématiques, afin de porter ensemble ces enjeux sur le terrain.
S'agissant des règles européennes, le traité permet de faire valoir certaines exceptions. Ce travail, engagé ici depuis de nombreuses années, notamment à l'initiative du sénateur Michel Magras, se poursuit. Naturellement, toutes les contributions visant à lever les obstacles normatifs, tout en assurant la protection de nos concitoyens, recevront notre plein soutien.
L'apprentissage du français relève principalement du ministère de l'Éducation nationale, mais il s'agit effectivement d'un sujet fondamental dans le cadre de la francophonie. Celle-ci ne se limite pas à une langue ; elle véhicule également des valeurs, au rang desquelles figure le multilinguisme, que nous encourageons vivement. L'exemple du portugais semble particulièrement pertinent, compte tenu de notre environnement caribéen et de la proximité du Mozambique. Nous devrions effectivement promouvoir et encourager son apprentissage.
Parmi les initiatives récentes, je souligne la création prochaine du Collège international de la langue française à Villers-Cotterêts, destiné à former des professionnels dans les domaines de l'enseignement et de l'interprétariat. Par ailleurs, une intelligence artificielle dédiée à la langue française, issue des engagements du dernier sommet sur l'IA, permettra d'améliorer les outils de traduction vers et depuis le français, et d'apporter ainsi une innovation au service du multilinguisme. J'en profite pour réaffirmer notre attachement à la valorisation des langues régionales, notamment le créole, le shimaoré ou le kibushi. Ces sujets demeurent au coeur de nos préoccupations.
Sur l'aspect sanitaire, nous disposons d'opérateurs reconnus tels que l'AFD, l'Institut de recherche pour le développement (IRD), ou l'Institut Pasteur, dont l'expertise nous permet de mener des actions efficaces. Toutefois, je souhaite ici exprimer une vigilance particulière : la politique de développement, dont ces actions relèvent, fait l'objet de fortes contraintes budgétaires. Le récent vote du Parlement a réduit sensiblement ses moyens, et je me permets d'en alerter collectivement cette assemblée. Cette politique, portée historiquement par l'AFD depuis sa création par le général de Gaulle, demeure essentielle pour anticiper les crises, notamment sanitaires. La pandémie de Covid-19 a rappelé à quel point la capacité à prévenir et à agir en amont conditionne notre sécurité collective. Si demain une nouvelle épidémie survenait, amoindrir notre action en matière de développement reviendrait à affaiblir notre propre protection.
De ce fait, nous travaillons actuellement à l'affinement de cette politique stratégique afin qu'elle soit résolument orientée dans l'intérêt des Français.
M. Christian Cambon, rapporteur. - Monsieur le Ministre, je m'exprime ici à la fois comme sénateur et rapporteur pour la commission d'évaluation de l'aide publique au développement.
Je partage pleinement votre alerte sur ce budget, qui a été l'un des plus touchés par les restrictions l'an dernier. Alors que nous préparons le budget 2026, avec un besoin de 40 milliards d'euros, il faudra nous mobiliser pour éviter une nouvelle réduction. Cela dit, l'efficacité de chaque euro engagé doit rester une exigence. En effet, si l'AFD demeure un opérateur essentiel, il convient de rester collectivement attentifs à son action.
Je souhaite revenir sur une préoccupation majeure de notre délégation : l'implication des outre-mer dans la diplomatie française. Cette question, soulevée depuis le lancement de nos travaux, appelle des orientations claires, des décisions fortes et des moyens adaptés. Nous sommes, au sein de l'Union européenne, le seul État membre à disposer d'une telle présence outre-mer.
Comment l'intégrons-nous réellement dans notre diplomatie ?
Dans mes fonctions passées de président de la commission des affaires étrangères, puis aujourd'hui comme envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales, j'ai régulièrement entendu nos partenaires régionaux exprimer une attente forte, en réclamant des relations plus étroites, plus concrètes, et davantage de décisions communes avec la France. À cet égard, je tiens à attirer l'attention de la délégation sur les tentatives de déstabilisation visant certains territoires ultramarins, notamment Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie. J'ai pu constater sur place que nos moyens militaires y demeurent modestes au regard des enjeux.
S'agissant de la diplomatie, ne serait-il pas pertinent de créer une direction de la coopération régionale des outre-mer, capable de coordonner les trois ambassadeurs délégués et de renforcer l'action du ministère ?
Enfin, quel bilan dressez-vous de notre participation aux organisations régionales telles que l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), l'Association des États de la Caraïbe (AEC) ou la Caricom ? Il importe d'y faire valoir les intérêts de nos territoires, notamment face à des partenaires qui, eux-mêmes, peinent à reconnaître pleinement leur rôle diplomatique autonome.
Quel diagnostic portez-vous sur les moyens actuels de la diplomatie française pour répondre aux attentes des outre-mer en matière de sécurité, d'approvisionnement, de santé publique ou de développement économique ? Chacun se souvient de l'intervention du sénateur Georges Patient, soulignant que la Guyane se voit contrainte de s'approvisionner en pétrole en Norvège, alors qu'elle pourrait, pour des raisons de proximité et d'efficacité, développer des partenariats avec des fournisseurs régionaux comme le Venezuela.
Comment pouvons-nous, en tant que parlementaires, vous aider à obtenir les moyens nécessaires pour renforcer cette diplomatie ?
Je me réjouis de vous savoir au sein du MEAE, tout en demeurant conscient de l'ampleur du travail à accomplir. Nous sommes prêts à vous accompagner dans cette direction.
Mme Lana Tetuanui. - Je suis ravie de retrouver notre ancien collègue, dont l'engagement en Polynésie française, notamment sur la question du foncier, a marqué les esprits.
La diplomatie française dans le bassin Pacifique demeure insuffisamment structurée. Alors que l'attention internationale se tourne massivement vers l'Ouest, les fragilités pourraient bien surgir à l'Est. L'influence croissante de la Chine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que celle de plusieurs petits États insulaires, interroge la capacité de la France à s'affirmer autour de ses trois « vaisseaux amiraux » que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Sur ce plan, il faut le dire clairement : la diplomatie française pèche par son manque de présence.
Par ailleurs, je souhaite insister sur les programmes d'échanges universitaires. Pourquoi nos jeunes Polynésiens devraient-ils systématiquement venir en Europe pour bénéficier d'un programme de type Erasmus, alors que des opportunités existent dans notre environnement immédiat, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans les États voisins ? Ces destinations sont culturellement plus proches, les liens sont anciens, les coûts bien moindres, et les perspectives d'intégration régionale bien plus cohérentes.
Enfin, la stratégie dite « Indo-Pacifique » suscite, sur le terrain, une forme d'incompréhension. Nous en entendons parler régulièrement, mais les déclinaisons concrètes peinent à se matérialiser. Les élus locaux doivent être impérativement associés aux programmations concernées.
Ce soir, les trois entités françaises du Pacifique sont représentées dans cette salle. J'y vois un signal fort et une opportunité que nous devons saisir collectivement.
M. Thani Mohamed-Soilihi. - La meilleure implication de nos territoires dans la diplomatie constitue effectivement un enjeu central. Vous soulignez la nécessité de mieux associer les élus : c'est une démarche que je m'efforce de mettre en oeuvre au quotidien. Dans quelque temps, nous pourrons tirer pleinement les enseignements de mes premiers mois de fonction et formuler des propositions structurées. L'adhésion de la Martinique à la Caricom, par exemple, constitue l'aboutissement d'un processus engagé depuis les années 2000, renforcé par la loi dite « Letchimy ». J'espère que la Guadeloupe et la Guyane pourront suivre cette voie, qui permet aux exécutifs locaux de dialoguer plus directement avec leur environnement régional.
J'ai moi-même constaté la qualité des relations entre La Réunion et l'île Maurice. Il s'agit d'un exemple de coopération concrète qu'il importe d'améliorer et de valoriser. Notre objectif doit être clair : favoriser l'adhésion des outre-mer aux organisations régionales, dans le cadre d'une stratégie de bassins portée par le ministère des Outre-mer et articulée avec notre politique de développement. Le rythme d'avancement peut sembler insuffisant, mais la dynamique engagée est réelle et porte déjà ses premiers résultats.
Nous disposons, avec nos outre-mer, de joyaux stratégiques que nos compétiteurs ont parfaitement identifiés. Aussi, certains cherchent à les fragiliser, à travers des campagnes de désinformation ou des stratégies de déstabilisation dans chacun des bassins océaniques.
Je vous informerai à l'avance de mes prochains déplacements, afin que nous puissions conjuguer nos efforts. Car, au-delà du langage diplomatique, la voix des élus, votre légitimité et votre liberté de ton représentent des atouts essentiels. Nous avons besoin de cette complémentarité.
Mme Annick Petrus. - Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur le territoire de Saint-Martin, que j'ai l'honneur de représenter au Sénat. Cette île singulière, partagée entre deux États, dispose d'un potentiel régional important qu'il convient aujourd'hui de consolider.
Le 19 mars dernier, notre collectivité a rejoint l'OECO en tant que membre associé, devenant ainsi le troisième territoire français ultramarin à y adhérer, après la Martinique et la Guadeloupe. Cette adhésion historique marque une volonté forte de renforcer notre insertion dans l'espace caribéen, autour de coopérations accrues dans les domaines sanitaire, économique, culturel et éducatif.
Par ailleurs, depuis le 4 janvier 2025, un projet structurant s'engage dans le cadre du programme Interreg Caraïbes 2021-2027, soutenu par les fonds européens de développement régional. Cette initiative répond aux ambitions de la Commission européenne à l'égard des RUP dans sa communication du 24 octobre 2017 appelant à un partenariat renforcé par la coopération régionale. Saint-Martin vise ainsi à bâtir une stratégie commune de développement avec Sint Maarten autour de problématiques partagées : mobilité, santé, sécurité, économie, environnement. Le radar météorologique commun, inauguré en 2024, constitue un exemple emblématique de cofinancement par l'Union européenne, la Collectivité de Saint-Martin et le Gouvernement de Sint Maarten.
En avril 2024, Saint-Martin a également accueilli la 17e Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane, organisée pour la première fois sur notre territoire. Présidée par la ministre déléguée des Outre-mer de l'époque, cette rencontre a réuni élus, diplomates et acteurs économiques autour de quatre thématiques clés : intégration régionale, sécurité globale, exportations, échanges culturels et linguistiques. Cet événement confirme le rôle croissant que Saint-Martin peut jouer en tant que plateforme régionale d'échange, de dialogue et de convergence, dans une logique d'intégration renforcée en lien avec les grandes organisations caraïbéennes - l'AEC, l'OECO et le Cariforum.
Enfin, le président de la collectivité, Louis Mussington, a participé à la 19e Conférence des Présidents des RUP à La Réunion. Cette rencontre a permis de réaffirmer une position commune des RUP au sein de l'Union européenne et de rappeler l'importance d'intégrer pleinement leur dimension géopolitique dans la diplomatie française, notamment dans un contexte mondial incertain où solidarité et action collective s'avèrent plus que jamais nécessaires.
Monsieur le Ministre, à travers ces trois niveaux d'engagement - régional, transfrontalier et européen - Saint-Martin affirme sa volonté d'être pleinement actrice de son avenir. Dans cette perspective, le soutien de l'État apparaît indispensable. Je souhaiterais, à ce titre, vous poser trois séries de questions :
S'agissant de l'adhésion à l'OECO, quels moyens la France envisage-t-elle de mobiliser pour accompagner ses collectivités ultramarines dans le renforcement de leur intégration régionale dans la Caraïbe ?
Existe-t-il, entre la France et les Pays-Bas, des mécanismes bilatéraux ou multilatéraux permettant de soutenir concrètement les projets portés localement sur cette île partagée ? Quel rôle votre ministère peut-il jouer pour appuyer cette diplomatie de proximité ?
Enfin, comment votre ministère collabore-t-il avec les institutions européennes pour défendre les intérêts des RUP dans leur environnement régional ? Selon vous, cette dimension géographique est-elle aujourd'hui suffisamment prise en compte dans la diplomatie française ?
Monsieur le Ministre, pour Saint-Martin comme pour l'ensemble de la Caraïbe, la coopération régionale incarne une promesse d'avenir. Notre ambition est claire : renforcer notre ancrage, intensifier nos échanges, et garantir une intégration harmonieuse dans cet espace stratégique.
Avec votre soutien, cette ambition peut devenir une réalité concrète et porteuse d'espoir pour nos territoires.
Mme Viviane Artigalas. - Les Alliances françaises font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part de la Chine, qui déploie une stratégie active de soft power en promouvant sa langue et sa culture à travers les Instituts Confucius. Cette dynamique s'inscrit dans une volonté d'expansion de son influence culturelle à l'échelle mondiale. Malgré ces pressions, le réseau des Alliances françaises a su faire preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, en particulier lors de la crise sanitaire de 2020. L'accélération de sa transition numérique a permis d'assurer la continuité des cours et des activités culturelles à distance, préservant ainsi sa mission fondamentale.
Ce réseau culturel et diplomatique constitue un levier stratégique pour maintenir et renforcer l'influence française, notamment dans les pays limitrophes de nos territoires ultramarins. Or, le contexte international représente un moment charnière.
Quelle stratégie le Gouvernement entend-il déployer pour assurer la préservation et le renforcement des Alliances françaises ?
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. - Monsieur le Ministre, j'aimerais à mon tour évoquer la situation spécifique de la Guyane.
Quelle place cette dernière occupe-t-elle dans la stratégie française de coopération régionale dans le bassin Atlantique, en particulier dans ses relations avec le Brésil et le Suriname ?
La Guyane cherche depuis de nombreuses années à diversifier et à intensifier ses échanges économiques avec ces pays frontaliers, notamment le Brésil. En tant que ministre chargé des partenariats internationaux, quelles actions concrètes envisagez-vous pour accompagner ce territoire - unique département français en Amérique du Sud - dans son intégration régionale ?
Enfin, je participerai prochainement à une nouvelle réunion de la Commission transfrontalière à Cayenne. À ce titre, envisagez-vous une évolution du rôle des élus guyanais au sein des instances de coopération bilatérale ?
M. Thani Mohamed-Soilihi. - Vous avez rappelé à juste titre les trois niveaux de coopération auxquels Saint-Martin est désormais associée. La politique visant à améliorer l'insertion dans le bassin régional tend précisément à conférer des marges de manoeuvre plus directes aux collectivités vis-à-vis de leur environnement régional. Dès lors, une éventuelle intervention de l'État devra impérativement reposer sur une approche concertée. Si la délégation sollicite effectivement une contribution étatique plus importante, nous veillerons à nous appuyer sur les propositions émanant directement de la collectivité de Saint-Martin. Les mécanismes bilatéraux existants posent nécessairement l'enjeu de leur coordination, imposant un dialogue renforcé entre l'État et la collectivité. Concernant les relations spécifiques avec les Pays-Bas, je n'ai pas à ce stade d'éléments précis à vous apporter, mais je m'engage à revenir vers vous avec des informations complètes sur ce point.
Ensuite, je confirme que la promotion de la francophonie constitue l'une de nos priorités. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie et nos partenaires bilatéraux à l'étranger. Les Alliances françaises jouent un rôle central dans cette stratégie. Avec plus de 800 implantations dans le monde, elles forment le coeur battant de notre diplomatie culturelle, bien que le MEAE n'exerce pas de compétence directe sur ces structures. Je porterai ce sujet à l'attention des services concernés et vous tiendrai informés des développements.
Enfin, la Guyane occupe une place essentielle dans notre stratégie de coopération régionale dans cette zone géographique. La frontière qu'elle partage avec le Brésil et le Suriname représente une plateforme d'échanges quotidiens, marquée par une forte mobilité des populations. Cette situation justifie une coopération dense et multithématique : migrations, sécurité, santé, culture, éducation, populations autochtones, agriculture, etc.
Des structures spécifiques, comme les Conseils du fleuve Maroni et Oyapock, permettent d'intégrer les spécificités locales, tout comme les Commissions mixtes transfrontalières (CMT). Après une suspension liée à la pandémie, les réunions annuelles de la CMT franco-brésilienne ont repris depuis 2024. Nous avons également renforcé notre présence au Suriname, avec l'arrivée d'un attaché de sécurité intérieure et la création en cours d'une commission de gestion commune des bassins hydriques du Maroni et de l'Oyapock. La CMT franco-brésilienne, créée en 1996, demeure l'outil principal de coopération dans cette région. Elle permet aux acteurs locaux de faire remonter leurs besoins et de proposer des solutions concrètes. Nous continuerons à la soutenir activement.
Pour accompagner l'intégration régionale de la Guyane, une procédure d'adhésion à la Caricom a été lancée en partenariat avec l'État. Forts de l'expérience martiniquaise, nous sommes déterminés à accélérer cette dynamique. L'ambassadeur prépare actuellement la 18e Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane, prévue au second semestre 2025 en Martinique. Elle permettra de faire le point sur les priorités identifiées précédemment : sécurité, environnement, diplomatie territoriale, économie et échanges culturels. Ces travaux compléteront les coopérations transfrontalières déjà en place, notamment avec le Suriname et le Brésil.
En outre, nous associons étroitement les élus en amont de la CMT, comme ce fut le cas lors de la réunion préparatoire du 11 mars dernier avec la collectivité territoriale de Guyane. Une évolution formelle de leur rôle nécessiterait une révision de l'accord intergouvernemental du 28 mai 1996. Je n'y suis pas opposé, mais cette démarche suppose l'accord des autorités brésiliennes. En attendant, nous pouvons et devons continuer à impliquer pleinement les élus dans la préparation des travaux.
Je me tiens à votre disposition pour poursuivre ces échanges en amont des prochaines échéances régionales. Mon ministère reste ouvert et mobilisé sur l'ensemble de ces sujets.
Mme Audrey Bélim. - Monsieur le Ministre, je souhaiterais profiter de votre récente participation au déplacement dans l'océan Indien aux côtés du Président de la République pour vous interroger plus précisément sur le bilan que vous tirez de ce Sommet de la COI, ainsi que sur les projets concrets de coopération qui en découlent.
Depuis plusieurs années, nous évoquons l'opportunité d'un véritable projet de coopération alimentaire et agricole dans la zone, visant à confier à Madagascar un rôle structurant - celui de « grenier régional », pour reprendre l'expression consacrée - en matière de production rizicole. Sa superficie agricole permettrait en effet de couvrir une part significative des besoins en riz de La Réunion, de Mayotte et de Maurice, que nos propres territoires ne peuvent satisfaire. Un tel projet, économiquement et écologiquement cohérent, renforcerait nos approvisionnements intrarégionaux.
Quelles perspectives concrètes identifiez-vous à ce sujet ?
Je souhaite également rappeler l'urgence de voir disparaître les structures de domination anciennes et de traduire nos ambitions régionales en actions concrètes : en matière de solidarité, de protection de l'environnement, mais aussi de coopération opérationnelle. Face aux défis sanitaires ou climatiques - lutte contre les épidémies, prévention des risques cycloniques -, une intégration régionale plus aboutie devient indispensable. Or, à ce jour, Mayotte ne figure toujours pas parmi les membres de la COI.
Quelles avancées ont été réalisées récemment dans les négociations pour permettre son adhésion pleine et entière ?
Enfin, je me permets de revenir sur un point que nous avons déjà évoqué ensemble : la signature, après plus de 60 ans, de l'extension de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins.
Dans quel délai l'ajout des outre-mer pourrait-il se concrétiser ?
M. Frédéric Buval. - Monsieur le Ministre, comme l'ensemble de mes collègues, je me réjouis sincèrement de vous revoir au sein de notre délégation.
Je souhaite aujourd'hui attirer votre attention sur un enjeu sanitaire, environnemental et économique majeur pour nos territoires : la prolifération massive des sargasses. En avril et mai 2025, la Guadeloupe et la Martinique ont une nouvelle fois été confrontées à d'importants échouements, avec des conséquences particulièrement lourdes pour les populations côtières.
En Guadeloupe, les zones de Marie-Galante, Petit-Bourg, La Désirade et Saint-François ont franchi les seuils de préalerte en raison de fortes émissions de gaz toxiques. En Martinique, les communes du Robert, du Vauclin, de Sainte-Anne, du François, du Diamant, de la Trinité et de la côte Caraïbe ont été sévèrement impactées, tant sur le plan sanitaire qu'économique.
Pour y faire face, un groupement d'intérêt public « Services publics anti-sargasses » a été mis en place en Martinique, réunissant l'État, la collectivité territoriale de Martinique, les EPCI et les communes concernées. Cependant, ce phénomène transfrontalier, aggravé par les effets de l'agriculture intensive en Amérique du Sud, exige une réponse coordonnée à l'échelle régionale.
Dans ce contexte, quelles démarches concrètes votre ministère entend-il engager, en lien avec les pays de la Caraïbe et les organisations internationales, pour renforcer la coopération scientifique et opérationnelle face à ce fléau ? Et surtout, comment cette coopération renforcée se traduira-t-elle, de manière tangible, pour nos collectivités les plus exposées ?
M. Thani Mohamed-Soilihi. - Le déplacement du Président de la République à Madagascar a permis de réaffirmer la qualité de nos relations bilatérales et notre volonté commune de renforcer la coopération avec ce partenaire essentiel dans l'océan Indien. Un mois plus tôt, j'y avais déjà signé plusieurs accords, notamment dans les domaines de la santé et de la nutrition, pour un montant de 5 millions d'euros.
Sur le plan économique, notre coopération bilatérale s'intensifie, atteignant chaque année environ un milliard d'euros. Nous souhaitons approfondir ces échanges, en particulier dans le domaine agricole, en misant sur la proximité géographique. L'expression de « grenier » peut prêter à discussion, mais elle renvoie à une réalité historique : Madagascar a longtemps approvisionné la région, comme en témoignent de nombreux récits transmis localement.
Le Président de la République a également engagé plusieurs accords structurants, parmi lesquels le projet de barrage hydroélectrique de Volobe, porté par EDF, destiné à améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau.
En matière d'aide au développement, l'action de la France à Madagascar s'élève à environ 130 millions d'euros annuels. Le Président a également rappelé l'engagement de la France en faveur du dialogue mémoriel et des coopérations patrimoniales, à travers notamment la restitution annoncée des crânes Sakalava. Par ailleurs, la présence d'une importante communauté francophone à Madagascar a donné lieu à plusieurs séquences autour de la francophonie.
S'agissant de la Charte sociale européenne, je vous confirme que le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé l'extension de son application aux territoires ultramarins. Nous avons officiellement notifié cette intention au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Le processus est désormais en cours, et je reste bien entendu disponible pour vous fournir toute précision complémentaire.
Enfin, concernant les sargasses, je partage entièrement votre analyse : il s'agit d'un phénomène transfrontalier qui nécessite une réponse concertée. Le Forum des îles, que je présiderai en marge du sommet UNOC 3, réunira les petits États insulaires et les territoires ultramarins autour de pratiques et solutions partagées face aux défis communs.
Je vous invite à participer à cet événement, qui constituera une étape importante vers une réponse régionale coordonnée.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Permettez-moi de revenir sur la place croissante de la Chine dans les enjeux qui concernent nos territoires ultramarins.
La présence chinoise dans nos outre-mer constitue une réalité préoccupante, qu'il s'agisse de la multiplication des Instituts Confucius ou de l'influence économique et commerciale. En Guyane, la pêche illégale qui ravage nos ressources halieutiques s'explique en grande partie par la forte demande du marché chinois. Sur les bords du fleuve Maroni, le matériel utilisé pour l'orpaillage clandestin provient principalement de commerces tenus par des ressortissants chinois, de l'autre côté de la frontière.
Par ailleurs, l'or extrait illégalement en Guyane transite par le Suriname avant d'être exporté vers la Chine, sans aucune traçabilité, laissant derrière lui des conséquences environnementales désastreuses, notamment liées à l'usage du mercure.
Cet enjeu d'envergure ne peut pas être occulté. Sans verser dans l'ingérence, il nous revient de garantir une meilleure protection de nos territoires face à ces dynamiques. Bien que ce sujet ne relève pas exclusivement de votre portefeuille, il me paraît essentiel qu'il soit pleinement intégré à la réflexion sur les outre-mer.
Mme Micheline Jacques, président. - Monsieur le Ministre, je souhaiterais conclure en évoquant la situation en Haïti, dont l'instabilité croissante produit des répercussions directes sur nos territoires ultramarins. En Martinique, nous observons une recrudescence inquiétante de violences, parfois à l'arme lourde.
Quelle place la crise haïtienne occupe-t-elle dans votre feuille de route diplomatique ? Que pensez-vous de l'hypothèse d'un état civil biométrique, sur le modèle expérimenté notamment en Guinée équatoriale ? La France pourrait-elle y apporter une contribution ?
Je vous laisse, bien entendu, le soin de répondre maintenant ou ultérieurement par écrit, selon les contraintes de votre emploi du temps.
M. Thani Mohamed-Soilihi. - S'agissant de la Chine, j'entends votre plaidoyer. Ce sujet dépasse en effet le périmètre de mon portefeuille, mais je tiens à vous assurer que la France adopte une posture beaucoup moins naïve qu'il n'y paraît. Nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre la désinformation, et renforçons nos coopérations internationales en privilégiant nos intérêts face aux principaux compétiteurs, qu'il s'agisse de la Chine ou, par exemple, de l'Azerbaïdjan.
Concernant Haïti, je rappelle que la France reste l'un des seuls États membres de l'Union européenne à maintenir une présence diplomatique à Port-au-Prince. Nous apportons un soutien constant au processus de transition, même si celui-ci demeure complexe, notamment en l'absence d'un engagement américain clairement défini. Par ailleurs, nous restons ouverts à tout dialogue approfondi, tant sur le plan sécuritaire que sur les dimensions historique et mémorielle.
Je pourrai vous faire parvenir une réponse écrite plus détaillée, conformément à votre suggestion. En tout état de cause, je vous confirme que la France continue de se tenir aux côtés d'Haïti.
Mme Micheline Jacques, président. - Votre vision de la coopération régionale et du rôle des territoires ultramarins dans la diplomatie française rejoint pleinement celle portée par notre délégation.
La création d'un poste de conseiller à la coopération au sein de votre ministère témoigne de votre engagement, et je vous en remercie. Votre proposition d'associer les membres de la délégation à vos déplacements est très favorablement accueillie : elle contribuera à renforcer le lien avec les élus locaux et à mieux ancrer nos représentants dans leur environnement régional.
Enfin, les travaux de notre délégation demeurent à votre disposition pour alimenter la réflexion Gouvernementale dans tous les domaines concernés.
Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que vous en serez le meilleur ambassadeur.
M. Thani Mohamed-Soilihi. - Merci beaucoup, Madame le Président, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs.
Nombre d'entre vous ont déjà été reçus au ministère dans le cadre de nos travaux sur l'aide au développement ou la francophonie. Les portes vous restent bien entendu ouvertes, en particulier sur ce sujet qui me tient à coeur : celui d'une meilleure intégration de nos territoires ultramarins dans leur environnement régional.
Encore une fois, merci pour la qualité de nos échanges.
Jeudi 10 juillet
2025
Audition de M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de
la coopération régionale dans la zone Atlantique
Mme Micheline Jacques, président. - Nous reprenons ce matin les auditions pour le second volet de notre étude sur la coopération régionale consacré au bassin Atlantique. Pour ce rapport, je vous rappelle que nous avons désigné un binôme de rapporteures : Mme Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion, et Mme Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise, que je remercie chaleureusement pour leur implication.
Nous accueillons aujourd'hui M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, récemment nommé - monsieur l'ambassadeur, vous avez pris vos fonctions en mars dernier.
Comme vos collègues pour les autres bassins - M. Jean-Claude Brunet, pour la zone de l'océan Indien, que nous avons entendu l'an dernier, et Mme Véronique Roger-Lacan, pour la zone Pacifique, que nous auditionnerons sur le dernier volet -, vous êtes spécifiquement chargé de renforcer la coopération entre les territoires ultramarins et les États voisins.
Nous vous remercions donc vivement d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de participer à cet échange.
L'insuffisante intégration des outre-mer dans leur environnement proche, déjà observée l'an dernier pour les collectivités du bassin Indien, a conduit notre délégation à se pencher sur les pistes d'amélioration de la coopération régionale, car les défis sont nombreux et d'envergure !
J'en citerai quelques-uns : la lutte régionale contre le narcotrafic dans les Antilles et en Guyane, les questions transfrontalières, les normes européennes et le développement des échanges commerciaux, ou encore le suivi des conséquences régionales de la crise haïtienne. J'ajouterai également le fléau des sargasses, une invasion qui affecte l'ensemble des territoires de la zone Caraïbe.
Nous attendons de vous, monsieur l'ambassadeur, un panorama des accords de coopération entre la France et les États de la Caraïbe et du bassin nord-amazonien. Dans quels domaines principaux ont-ils été conclus ? Où faut-il porter les efforts ? Quels sont les grands projets structurants de la coopération dans cette région ?
Nous nous interrogeons aussi sur le rôle que jouent ou pourraient jouer les outre-mer français dans la définition et l'animation de la politique étrangère de la France avec les pays voisins. Comment l'enjeu ultramarin est-il intégré à vos réflexions et à votre travail quotidien ?
Je vous précise que notre délégation s'est déplacée en Guyane et au Suriname, et s'est aussi rendue à Bruxelles, car nous défendrons notamment l'idée d'une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu), telle qu'elle figure dans une proposition issue de notre précédent rapport sur le bassin Indien.
Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges. Je vous propose d'intervenir pour un exposé liminaire, après quoi nos rapporteures, puis les membres de la délégation qui le souhaitent, vous questionneront.
M. Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique. - C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport que vous avez rédigé sur le bassin océan Indien, et je serai heureux de contribuer à votre rapport sur le bassin Antilles-Guyane, ou plus largement la Grande Caraïbe, qui constitue un espace tout à fait riche. Nous y comptons un nombre important de collectivités françaises d'Amérique et, au vu de la qualité de votre premier rapport, je serais très heureux de contribuer au second.
Comme vous l'avez rappelé, ma nomination est récente : elle date de la mi-mars 2025. Dès lors, l'agenda a été extrêmement chargé, avec la conférence de Nice qui se profilait début juin. Celle-ci a toujours été considérée comme un rendez-vous très important, notamment en matière de lutte contre les afflux massifs de sargasses. Le projet de plan d'action avait été évoqué, mais tout restait à construire en mars.
Nous avons donc préparé un projet de plan d'action international, d'abord en interministériel, puis avec la région Guadeloupe. C'est, je crois, un très bel exemple de partenariat et de la façon dont nos collectivités françaises d'Amérique peuvent travailler conjointement avec les services de l'État dans le cadre de notre diplomatie. Le travail mené sur les sargasses en est une bonne illustration.
Il s'agissait ensuite de consolider ce plan avec nos partenaires dominicains, costaricains et mexicains pour le présenter à Nice, puis d'envisager ensemble les suites à donner à ce dossier.
Le deuxième dossier très urgent concernait la Banque de développement des Caraïbes (BDC). Le retour de la France dans le capital de cette banque était prévu par le Comité interministériel des outre-mer (Ciom) de 2023. À partir de mars-avril, nous avons pu accélérer la concertation interministérielle, afin qu'une lettre signée par les trois ministres - affaires étrangères, économie, francophonie et partenariats internationaux - soit adressée dans les meilleurs délais au secrétariat de la BDC, marquant ainsi notre souhait de réintégrer le capital et de commencer des négociations en vue d'un accord.
Troisième sujet important : la Communauté des Caraïbes (Caricom). La Martinique a rejoint l'organisation en tant que membre associé lors du sommet de la Barbade en février dernier. Deux chantiers sont engagés : d'abord, un travail interne pour faire approuver, par le Parlement, l'accord sur les privilèges et immunités, nécessaire pour rendre effective l'adhésion de la Martinique comme membre associé ; ensuite, un chantier avec la Guyane, qui veut également rejoindre la Caricom.
C'est d'ailleurs une priorité affirmée par la collectivité territoriale de Guyane, comme elle me l'a confirmé lors de mon déplacement voilà un mois. À ce titre, nous avons obtenu une lettre du ministre des affaires étrangères réaffirmant le souhait de voir la Guyane, comme les autres collectivités françaises d'Amérique (CFA), devenir membre associé de la Caricom. Il nous faut désormais avancer dans la négociation d'un accord en prévision de cette adhésion.
La visite d'État du président brésilien en France s'inscrivait également dans cette séquence, de même que l'ensemble des dossiers transfrontaliers avec la Guyane, qui revêtent une importance particulière. La commission mixte transfrontalière s'est tenue début juin, ce qui nous a permis d'avancer sur ces différents sujets.
Après cette période initiale très intense, j'espère pouvoir désormais disposer d'un peu plus de temps pour faire avancer les grands chantiers. Je conçois véritablement mon rôle comme celui d'un catalyseur interministériel au service des collectivités d'outre-mer. C'est, me semble-t-il, l'ADN même de ce poste, tel qu'il a été pensé lors de sa création, à la suite de l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Je me suis déjà rendu en Guyane, et je reviens de Martinique où j'étais encore avant-hier. J'y ai rencontré le président Serge Letchimy ainsi que plusieurs acteurs martiniquais, à qui j'ai exprimé ma vision de ce poste : être, au sein de l'État, une porte d'entrée pour soutenir les initiatives internationales qu'ils souhaiteraient mener, mais aussi, et surtout, assurer ici à Paris la coordination interministérielle, qui est cruciale sur des dossiers souvent transversaux et assez complexes. De nombreux intervenants sont impliqués, et sans tête chercheuse à Paris pour animer cette concertation, les choses avancent lentement.
Ces grands chantiers s'inscrivent dans la perspective de la prochaine Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane (CCRAG), dont la date reste à fixer. Il s'agit de concilier les agendas de deux ministres : le ministre d'État chargé des outre-mer et le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, qui suit de très près ces enjeux de politique régionale et constitue un appui précieux au sein du ministère des affaires étrangères.
La CCRAG devrait se tenir en fin d'année 2025, en Martinique, conformément au cycle agréé lors de la précédente édition confiée à Saint-Martin, qui a été un très grand succès.
Quels sont les grands chantiers ? Ce sont ceux que vous connaissez bien, et qui ont été formulés dans la stratégie de bassin, agréée par l'État et les cinq collectivités françaises d'Amérique lors de la CCRAG de Saint-Martin : sécurité, environnement, économie, ainsi que les échanges humains et culturels.
Sur les questions de sécurité, de nombreuses initiatives ont été engagées, et une réorganisation de notre réseau est en cours. Je serais heureux d'échanger avec vous sur ce sujet, qui rejoint l'un de vos centres d'intérêt, et qui répond à l'évolution du phénomène des trafics illicites, en particulier des narcotrafics.
Pour dresser les grandes lignes, on observe aujourd'hui une réorientation des flux des narcotrafics. Alors que ces flux allaient historiquement d'Amérique du Sud vers les États-Unis, puis vers l'Europe, le marché américain tend désormais à se tourner vers d'autres drogues, notamment les drogues de synthèse comme le fentanyl. Cela conduit à un redéploiement croissant de la cocaïne vers l'Europe. C'est un sujet majeur, qui mobilise de nombreux acteurs ; il importe désormais de créer une véritable synergie.
Depuis plusieurs années, l'idée d'organiser une conférence régionale de sécurité est évoquée. Il faut désormais réfléchir aux modalités concrètes de sa mise en oeuvre : son format, les partenaires à associer, etc.
Parmi les outils existants, figure le programme baptisé Accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes (ALCORCA), porté depuis 2015 par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère des affaires étrangères. Il s'apparente aux académies régionales de sécurité développées dans les bassins de l'océan Indien et du Pacifique, mais demeure encore limité dans ses moyens et ses ambitions. Il y a sans doute là un chantier à approfondir.
En matière de sécurité civile - deuxième pilier de ces enjeux sécuritaires -, de nombreuses actions sont déjà engagées. Des exercices sont organisés, et les forces armées françaises présentes aux Antilles et en Guyane travaillent activement avec leurs partenaires. Nous souhaitons désormais négocier un accord avec la CDEMA - Caribbean Disaster Emergency Management Agency -, l'agence de la Caricom chargée de la sécurité civile. Il s'agit d'un véritable casse-tête juridique, mais s'il aboutit, il offrira un cadre structurant pour développer nos actions. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir plus en détail.
Sur les sujets environnementaux, chacun sait que la Caraïbe est l'une des régions les plus fragiles du monde face aux évolutions environnementales en cours, et les sargasses en sont un exemple. Nous sommes progressivement passés d'une période où l'on s'interrogeait sur l'origine du phénomène et sur la gestion des afflux, qui étaient irréguliers - massifs certaines années, moins d'autres - à une réalité où ces afflux sont désormais à la fois massifs et réguliers.
Cette année 2025 bat tous les records, avec environ 70 % de masse de sargasses supplémentaires en Atlantique par rapport aux années records de 2022-2023. Des territoires comme Saint-Martin, qui étaient épargnés, commencent à être touchés, alors que la Guadeloupe et la Martinique étaient les plus touchées auparavant. Les images qui nous parviennent sont particulièrement choquantes, et celles que j'ai pu voir en Martinique avant-hier en témoignent également.
Il faut donc absolument continuer notre initiative internationale sur les sargasses. Je crois que la perspective ultime est aussi de renforcer nos efforts en termes de valorisation et d'implication du secteur privé, afin de trouver une chaîne de valeur viable qui permette une solution pérenne face à ces afflux massifs qui sont amenés à se répéter.
Les sargasses constituent le dossier environnemental le plus visible, mais il existe bien d'autres enjeux. La mer des Caraïbes est un écosystème extrêmement fragile qui nécessite une action collective, notamment en matière d'assainissement. De très beaux projets sont d'ailleurs menés dans ce domaine par l'Agence de l'eau de la Martinique. Il est également essentiel de se concentrer sur la préservation du littoral et de répondre à des problématiques émergentes, telles que les brumes de sable, qui préoccupent de plus en plus nos compatriotes des Caraïbes. Ces phénomènes ont des répercussions directes sur leur environnement et leur santé.
En ce qui concerne les enjeux économiques, comme l'a très justement souligné Mme le président, il est essentiel de mener une réflexion approfondie sur les raisons de l'isolement de nos collectivités françaises d'Amérique au sein de leur environnement régional. Cette problématique repose sur une approche multifactorielle. La question logistique est cruciale ; nous pourrons y revenir plus en détail.
Actuellement, les liaisons commerciales passent encore par l'Hexagone avant d'être redistribuées vers d'autres destinations. Les liaisons aériennes, elles, représentent un frein important à la promotion des services. Il est essentiel d'améliorer ces connexions pour soutenir les prestations intellectuelles des entreprises basées à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane.
Un autre enjeu majeur est la question des normes, que nous pourrons aborder plus en profondeur. Enfin, la compétitivité doit nécessairement être prise en compte.
En ce qui concerne les échanges humains et culturels, beaucoup reste à faire pour améliorer l'attractivité des études dans nos territoires, comme j'en discutais récemment avec le vice-président de l'université des Antilles à Fort-de-France. Si elle est bien calibrée, cette attractivité pourrait également favoriser l'immigration qualifiée. En tant qu'ancien chef du service des visas au ministère de l'intérieur, je suis particulièrement attentif à cette question. Pour les territoires concernés, à l'exception de la Guyane, qui font face à un vieillissement démographique, il est crucial de réfléchir à moyen terme aux solutions à apporter pour répondre à leurs besoins, notamment en matière de services de santé.
Voilà les priorités que je considère comme essentielles, et qui, je pense, sont partagées par tous les acteurs de la coopération régionale dans la Caraïbe. Plusieurs évolutions sont en cours dans la zone, offrant un moment stratégique à saisir.
D'abord, on observe une plus grande acceptabilité de la diversité régionale, notamment au sein de la Caricom, qui, historiquement anglophone, montre désormais un intérêt pour la Caraïbe francophone. Mme Mia Mottley, la présidente actuelle de la Caricom, l'a d'ailleurs exprimé au Président de la République lors de leur échange en marge du sommet de Nice. Un véritable intérêt existe aujourd'hui pour développer les liens avec toute la Caraïbe francophone.
Des opportunités s'ouvrent donc, non seulement au sein de la Caricom, mais aussi dans d'autres instances comme l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO), qui développe des programmes intéressants de promotion du français. L'adhésion de Saint-Martin à cette organisation alimente aussi cette impulsion.
Dans le même temps, on observe un relatif retrait américain, ou du moins une relation plus complexe avec les États-Unis, y compris de la part d'acteurs traditionnellement proches comme la République dominicaine. Cela crée un espace que nous pourrions investir, en relançant par exemple l'élan des rencontres France-Caraïbes d'il y a une dizaine d'années, et en proposant une nouvelle initiative commune avec la France et l'Union européenne (UE).
La question est désormais de savoir comment structurer cette ambition. C'est à cela que je travaille, pour porter un message politique fort.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - À la suite de notre déplacement en Guyane et au Suriname, je souhaite évoquer plusieurs sujets, notamment le narcotrafic, une priorité pour le bassin des Caraïbes. Comment améliorer la coopération dans la région pour lutter contre ce fléau ?
Il y a aussi le problème majeur de la pêche illégale, et celui de l'orpaillage, en particulier en Guyane, à propos duquel la Chine joue un rôle qui n'est pas anodin.
La question de la frontière entre la Guyane et le Suriname se pose également. Des discussions ont eu lieu, mais rien n'a été signé pour l'heure, ni par la France ni par le Suriname. Des élections récentes ont eu lieu au Suriname ; le président a été remplacé par une présidente. Un accord pourrait-il enfin aboutir ?
Il me semble important également d'aborder le transport aérien et maritime, la question des déchets et celle des échanges agricoles. Des projets de coopération sont-ils en cours ? Que fait-on pour lever d'éventuels blocages normatifs, budgétaires ou diplomatiques ? Vu de l'extérieur, on a l'impression que la coopération ne fonctionne pas bien, malgré le potentiel et la richesse de ces territoires.
M. Arnaud Mentré. - S'agissant des questions de sécurité, beaucoup a été fait. C'est un sujet largement balisé, notamment en Guyane, et nous avançons au rythme de nos partenaires. Côté français, il n'y a pas eu de déficit de mobilisation. Nous avons créé des centres de coopération policière avec le Brésil et le Suriname. Nous essayons également de faire avancer au mieux les enjeux d'aménagement de la plus longue frontière terrestre de la France au sein des commissions mixtes transfrontalières avec le Brésil et des conseils du fleuve.
L'orpaillage est un véritable fléau. Il cause des préjudices environnementaux par le déversement de mercure dans les fleuves, sans compter qu'il s'agit d'une exploitation illégale de nos réserves minières.
Si nous avons des dialogues bilatéraux de qualité avec le Suriname et le Brésil, nous ne disposons pas encore de structure permettant un dialogue approfondi sur une base régionale. La direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des armées a développé une initiative intéressante de dialogue stratégique sur le plateau des Guyanes, qui se tient à peu près chaque année et permet des échanges d'informations. Cependant, il nous manque un dialogue proprement politique sur ces questions, et c'est un sujet auquel nous devons nous atteler.
Je souhaite associer davantage de partenaires étrangers aux conférences de coopération régionale Antilles-Guyane, qui ont été très productives en termes d'échanges d'informations entre collectivités territoriales d'Amérique, mais qui pourraient devenir plus opérationnelles et plus ouvertes sur l'environnement proche. Je vais faire des propositions en ce sens à mes deux ministres de tutelle.
Nous pourrions ainsi utiliser la prochaine conférence, en Martinique, pour avancer sur un dialogue de sécurité proprement antillais, puis la suivante, qui se tiendra à Cayenne en 2026, pour progresser sur un dialogue de sécurité relatif au plateau des Guyanes. L'orpaillage a lieu massivement au Suriname, mais il est surtout le fait de ressortissants brésiliens.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - On nous laisse le mercure et on nous vole notre or, qui part ensuite au Suriname, où il est acheté par les Chinois, sans aucune traçabilité... Nous n'allons pas faire les lois à la place du Suriname, mais il y a peut-être des points à aborder dans le cadre de notre coopération avec ce pays, qui nous prend tout de même beaucoup et ne nous donne pas grand-chose en retour. Nous rencontrons à la frontière avec le Suriname des problèmes assez proches de ceux que nous connaissons à Mayotte, et cela déstabilise une partie de nos territoires.
La pêche illégale a également des conséquences environnementales dramatiques sur nos fonds marins au nord de cette frontière. Nous devons agir dès aujourd'hui.
M. Arnaud Mentré. - S'agissant de la Chine, nos efforts ont pour l'instant assez habilement porté sur des études académiques menées par l'intermédiaire de centres de recherche comme la Fondation pour la recherche stratégique. Celle-ci a élaboré un rapport public qui commence à nommer les choses, notamment les approvisionnements en mercure dans les zones concernées, l'absence de traçabilité sur le suivi du mercure et les exportations d'or. L'ambassade de Chine à Paris lit absolument tout ce qui concerne son pays ; les autorités chinoises savent donc que le sujet commence à être dans le viseur des autorités françaises. C'est une première manière de leur signifier que quelque chose doit être fait ; cela permet également de documenter précisément la situation.
Des efforts importants sont aussi en cours avec le Brésil afin de pouvoir mener des patrouilles conjointes, et non plus seulement coordonnées. Ces questions de sécurité, de même que celle des visas, ont été au coeur de la feuille de route bilatérale adoptée lors de la visite d'État du Président de la République au Brésil en 2024, puis lors de la visite du président brésilien à Paris. Nous voulons mettre l'accent sur ce dialogue de sécurité, et je serais bien entendu très intéressé par les éventuelles préconisations que pourrait formuler la délégation, car tout est à construire.
Le dialogue doit aussi porter sur les sujets environnementaux. Nous cherchons à nous rapprocher de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA). J'ai rencontré son secrétaire général lorsque j'étais à Brasilia il y a quelques mois. Nous voulons nous rapprocher de cette organisation, mais le Brésil, qui a tendance à segmenter les dialogues bilatéraux, se montre plus réticent sur tout ce qui est régional.
La pêche illégale est un autre sujet important, souvent évoqué sur place, qui pose la question du poids de notre Marine et de l'utilisation de nos forces pour faire respecter nos zones économiques exclusives (ZEE). Se pose aussi la question de la reconstitution des flottes de pêche dans les collectivités et territoires d'outre-mer, un sujet qui revêt aussi un aspect européen, sur lequel la direction générale des outre-mer (DGOM) est pleinement mobilisée.
Je ne me suis pas encore rendu au Suriname, ayant préféré me consacrer au flanc brésilien, à Brasilia, Cayenne et Saint-Georges-de-l'Oyapock, où les sujets sont nombreux. De l'autre côté de la frontière, des projets d'exploitation de champs de pétrole pourraient transformer l'État de l'Amapá, actuellement assez pauvre, en une zone beaucoup plus riche, avec d'autres problèmes qui pourraient apparaître et un potentiel de déstabilisation pour la région de Saint-Georges-de-l'Oyapock.
Je préférais attendre aussi de voir les orientations du futur Gouvernement surinamais issu des élections du 25 mai. La présidente vient d'être élue et a réussi à obtenir sa majorité des deux tiers au Parlement. Mais elle s'appuie sur certains partis dont on sait qu'ils ne sont pas favorables à la coopération avec les partenaires étrangers en général, et avec l'Union européenne en particulier. Le parti historique de la présidente lui-même est issu d'orientations qui n'étaient pas spontanément favorables à la coopération internationale, même si, une fois au pouvoir, les autorités surinamaises constateront certainement que cette coopération est essentielle pour le développement du pays.
Les grands projets pétroliers sont évoqués dans un calendrier très resserré, puisque l'on parle des premières exploitations dès 2027. Notre ambassadeur sur place, Nicolas de Lacoste, fait un travail remarquable pour baliser le terrain. Il a parlé à toutes les parties de façon à ce que nous ne nous enfermions pas dans une relation bilatérale avec l'ancien président.
Sur l'accord frontalier avec le Suriname, notre position est constante : nous n'aborderons pas le dernier tiers avant que l'accord sur les deux premiers tiers - la partie la moins contestée - ne soit ratifié. La présidente elle-même s'était exprimée contre cet accord, dans un contexte de politique intérieure surinamaise. La situation se présentera peut-être différemment dans les prochains mois ; c'est un dossier que nous suivons avec beaucoup d'attention.
De manière générale, le Suriname est un partenaire important. Le ministère des affaires étrangères le montre en nommant des ambassadeurs très expérimentés comme Nicolas de Lacoste. On peut saluer plus largement, sur l'ensemble de la zone, la nomination d'ambassadrices et d'ambassadeurs de très grande qualité, ce qui reflète aussi l'adaptabilité du ministère.
Concernant le transport aérien, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) fait son maximum. Une impulsion nouvelle a été donnée depuis deux ans pour simplifier la conclusion d'arrangements administratifs avec les pays voisins, alors qu'il fallait auparavant attendre la conclusion d'accords aériens en bonne et due forme. La DGAC vient d'en conclure un avec la Barbade et a signé toutes sortes d'accords avec différents États de la zone.
Cependant, une fois les accords signés, les lignes aériennes n'apparaissent pas spontanément, car des logiques privées entrent en jeu. Nous devons donc réfléchir à des incitations qui pourraient faciliter le développement de nouvelles lignes et améliorer la connectivité dans la zone, qui reste défaillante, voire en recul. Beaucoup d'efforts avaient été consacrés au développement de liaisons avec la République dominicaine, notamment, mais l'opérateur privé a ensuite décidé de fermer sa ligne, car elle n'était pas rentable selon ses projections.
Nous avons également eu des difficultés avec le Suriname, puisque les compagnies aériennes surinamaises ont été placées sur la liste noire de l'Union européenne. Cela a entraîné la fermeture de la ligne sur laquelle nous comptions pour développer la connectivité aérienne de la Guyane. Mais nos compatriotes sont aussi satisfaits de savoir que, lorsqu'ils prennent un avion, celui-ci est sûr. Il faut donc essayer de concilier ces différents objectifs et contraintes.
Il y a des aspects importants sur lesquels nous pouvons travailler, mais c'est un sujet auquel je commence seulement à m'atteler. Je serai en mesure de vous en parler plus en détail dans quelques mois. Je songe notamment aux contraintes européennes en matière d'aides d'État, à la possibilité de conclure des contrats sur plusieurs années, avec des pertes dans un premier temps et des anticipations de bénéfices futurs. Bref, je pense à toutes sortes d'instruments sur lesquels nous devons trouver le moyen d'alléger les contraintes du droit européen.
Tous les acteurs locaux citent la convention de Bâle comme un obstacle à la recherche de coopération en matière d'exportation de déchets. Toutefois, le coût du transport maritime est tel que l'on peut se demander si le recyclage de déchets dans d'autres territoires aux normes moins contraignantes constitue réellement une perspective économique crédible. La réponse n'est pas évidente, et la même question se pose pour les sargasses. La valorisation de sargasses collectées au large de la Guadeloupe et de la Martinique dans des États comme la Grenade serait-elle envisageable ? Compte tenu du coût très important du transport, ce n'est pas certain. Cela démontre en tout cas la nécessité d'une coordination interministérielle et interservices approfondie en la matière.
Des initiatives très intéressantes sont menées à l'échelle du bassin sur cette question des déchets. Le programme Interreg a financé des coopérations, principalement des échanges de bonnes pratiques et d'informations sur les technologies, qui nous ont permis de découvrir que la meilleure manière de répondre à ces enjeux environnementaux était de développer de nombreuses petites structures robustes et peu coûteuses. On constate en effet que les équipements nécessitant une maintenance lourde ne résistent pas à l'épreuve des années.
Le programme Caribsan, développé par l'agence de l'eau de Martinique, est un bel exemple de solution concrète qui peut avoir, à terme, un effet important sur la pollution de la mer des Caraïbes, notamment s'il est utilisé par des partenaires qui se trouvent dans des situations difficiles, comme Cuba. Doté d'une enveloppe de 8 millions d'euros, il porte sur le développement de systèmes de filtration par les plantes pour l'assainissement collectif ou semi-collectif.
Il y a aussi beaucoup d'échanges de bonnes pratiques en matière de modernisation agricole, notamment un très beau programme mené entre 2021 et 2024 par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) de la Guadeloupe, sur financement Interreg, dont le volet scientifique était mené par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), un acteur dont la qualité des projets est à souligner, et qui s'était notamment illustré dans la coordination de l'aide internationale à Mayotte après le cyclone.
Enfin, il y a la question de nos échanges agricoles, et plus largement de nos échanges économiques, sur laquelle je pourrai revenir si vous le souhaitez.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Ma première question concerne le rôle de l'Europe, qui paraît bloquant, alors même que d'importants financements proviennent de l'Union européenne. Comment envisagez-vous le soutien de l'Europe ?
Quels programmes éducatifs et pédagogiques pourraient par ailleurs renforcer les échanges de manière pérenne dans le bassin Atlantique ? Dans l'Académie de La Réunion, nous n'avons par exemple qu'un seul professeur de portugais. Dans ces conditions, il est difficile d'établir des échanges fluides avec le Mozambique, comme nous le souhaitons. Comment donc convaincre les États voisins de s'engager dans des programmes de développement et d'échanges au sein des écoles françaises ultramarines ?
M. Arnaud Mentré. - L'Europe est un acteur tout à fait important, d'abord par ses financements économiques.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Dans mon territoire, cette action se résume à peu près aux financements...
M. Arnaud Mentré. - Les financements européens sont assez cloisonnés : la DG Regio (Directorate-General for Regional and Urban Policy) mène sa politique régionale, la politique agricole commune (PAC) sa politique agricole et la DG Intpa (Directorate-General for International Partnerships) sa politique de coopération.
Les fonds structurels européens sont généreux avec l'outre-mer. Le programme Interreg représente beaucoup d'argent : 60 millions d'euros pour le programme Caraïbes, géré par la région Guadeloupe, et un peu moins de 10 millions d'euros pour le programme Amazonie, géré par la collectivité territoriale de Guyane.
Le Fonds européen de développement régional (Feder), la PAC et le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (Poséi) sont également généreux.
Dans nos collectivités françaises des Amériques, qui exportent essentiellement des bananes vers l'Europe, la PAC n'a pas été conçue autour de la coopération régionale. Nous n'avons donc que peu de marge de manoeuvre financière pour développer la coopération régionale par ce biais.
Au directeur de la DG Intpa chargé des Amériques et des outre-mer, que j'ai rencontré à Bruxelles, j'ai indiqué que la conférence sur les sargasses qui devait se tenir à Bruxelles le 8 juin dernier entrait en concurrence avec la conférence des Nations unies sur l'océan de Nice... Pour diverses raisons, la conférence sur les sargasses a finalement été reportée au 8 octobre. Nous nous rencontrerons de nouveau le 18 juillet pour discuter notamment des perspectives de valorisation des sargasses.
La DG Intpa finance de nombreuses actions en ce sens, car elle a compris qu'il s'agissait d'une problématique régionale majeure et d'une porte d'entrée pour intéresser les États de la Caraïbe aux relations avec l'Union européenne. Elle finance aussi d'autres actions dans le domaine de l'environnement, ainsi que le programme Europe-Amérique latine d'assistance contre la criminalité transnationale organisée (EL PAcCTO), qui vise à renforcer les capacités de lutte contre les trafics illicites et les narcotrafics.
Nous nous efforçons de faire en sorte que les régions ultrapériphériques (RUP) soient davantage prises en compte par ce programme. EL PAcCTO relève actuellement d'une logique de guichet : si des États tiers se montrent intéressés par une coopération, l'Union européenne les accompagne. Or il faut que les États membres aient davantage leur mot à dire sur la manière dont sont fixées les priorités d'EL PAcCTO, même si cela emporte un renversement de perspective pour la DG Intpa, qui considère plutôt que la demande doit venir de l'État tiers. Il nous faut donc trouver une voie d'équilibre.
Il est fondamental d'intégrer nos collectivités françaises d'Amérique dans un plan stratégique avec l'Europe. J'ai du reste indiqué à la DG Intpa qu'une telle approche était nécessaire sur les sargasses. Mais au-delà de l'aspect financier, il nous faut également « forcer » la Commission à s'assurer régulièrement de la bonne articulation du marché européen et des enjeux d'insertion régionale, en particulier pour les RUP.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - L'Europe s'étant construite sans tenir compte de nos outre-mer, les règles qui s'appliquent à ces territoires sont bien souvent inadaptées. Nous les empêchons par exemple d'acheter de la viande brésilienne au motif qu'elle ne correspond pas à nos normes, alors que cette viande est consommée en Guyane depuis cinq générations.
Sans mettre nos populations en danger, il serait sans doute possible d'alléger ces procédures ou, du moins, de prendre réellement en compte nos territoires ultramarins.
Mme Annick Petrus. - Je me prends à espérer. La nomination d'un ambassadeur chargé de la coopération régionale signifie que l'on a enfin compris que nous avions une carte à jouer.
Cette coopération est indispensable pour la France, qui ne profite pas assez de ses territoires ultramarins, de leur proximité avec les États voisins et la richesse que nous pourrions mettre en commun, pour résoudre de nombreuses situations.
En tant qu'élue de Saint-Martin, je suis particulièrement sensible à l'enjeu de l'intégration régionale des outre-mer, notamment dans des domaines prioritaires comme la santé, la formation professionnelle ou la transition énergétique. En dépit des accords-cadres qui existent, les coopérations concrètes peinent à se structurer. À Saint-Martin, pourtant entourée d'îles anglophones, hispanophones et néerlandophones, la diplomatie de terrain reste trop souvent théorique.
La volonté d'intégration régionale est pourtant réelle et assumée. Notre territoire s'est engagé activement dans cette dynamique, avec son adhésion historique, en mars dernier, à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. La coopération transfrontalière est renforcée avec Sint Maarten, notamment à travers le partage d'un radar météorologique et la mise en oeuvre d'une stratégie commune dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. Nous avons aussi organisé sur notre île la 17e conférence de coopération régionale Antilles-Guyane et participé activement à la 29e conférence des présidents des RUP.
Pour Saint-Martin comme pour l'ensemble de la Caraïbe, la coopération régionale n'est pas un concept abstrait : c'est une promesse d'avenir. Notre ambition est claire : renforcer notre ancrage régional, intensifier nos échanges et bâtir une intégration plus harmonieuse dans cet espace stratégique.
Quels leviers la diplomatie française peut-elle mobiliser pour lever les freins juridiques, budgétaires ou institutionnels qui entravent encore l'implication active des collectivités d'outre-mer dans les organisations régionales ? Nous avons besoin d'outils simples, souples et efficaces, de projets transfrontaliers à effet immédiat pour nos populations.
Il existe déjà des coopérations transfrontalières concrètes avec nos voisins du Sud, notamment pour la gestion partagée du radar météo ou pour des actions communes en matière de santé ou de sécurité civile. La diplomatie française envisage-t-elle de consolider ces coopérations au travers de mécanismes bilatéraux ou multilatéraux plus robustes avec les Pays-Bas ? Quel rôle votre ministère peut-il jouer pour soutenir cette diplomatie de proximité, si essentielle sur une île partagée ?
Enfin, comment articulez-vous votre action avec celle des institutions européennes pour défendre les intérêts géopolitiques, économiques ou sociaux des RUP dans leur environnement régional ? La dimension stratégique des RUP, notamment dans la Caraïbe, est-elle aujourd'hui suffisamment prise en compte dans la diplomatie française ?
Mme Micheline Jacques, président. - Haïti est une plaque tournante du narcotrafic. Il en résulte, en Guadeloupe et en Martinique, une hausse inquiétante des meurtres et des actes violents. Quelles actions envisagez-vous de mener pour sécuriser ces territoires ?
La décision des États-Unis de suspendre le partage des données satellitaires pour la surveillance des cyclones crée un climat très anxiogène. Quels en seront les impacts ?
En ce qui concerne les sargasses, j'ai découvert qu'à la Barbade, un véhicule fonctionnant au gaz naturel compressé, créé à partir des eaux usées des distilleries et d'un biométhane à base de sargasses a été expérimenté par la start-up Rum & Sargassum, en partenariat avec The University of the West Indies. En 2019, les entreprises étaient réticentes à investir, car on ne savait pas si les arrivages de sargasses se poursuivraient. Or force est de constater que le phénomène s'amplifie. Au-delà des échanges culturels, que nous avons évoqués, la France ne devrait-elle pas encourager des échanges scientifiques avec ces territoires ?
Vous avez évoqué les normes européennes. Le bois du Brésil doit par exemple passer par Le Havre pour revenir en Guyane...Il est essentiel de les adapter, tout comme il me paraît essentiel de trouver des solutions de recyclage des batteries électriques dans l'environnement proche des territoires ultramarins. Les entreprises maritimes considèrent en effet qu'il est trop dangereux de faire traverser l'Atlantique aux batteries usagées - un cargo a récemment coulé dans le Pacifique après que des véhicules électriques chinois qu'il contenait ont pris feu.
Il convient enfin de préserver les territoires français et l'impact de la France dans la zone Caraïbe. La Barbade a signé un accord pour l'ouverture d'une ligne aérienne avec l'Hexagone. Il serait pourtant plus judicieux de développer des hubs en Guadeloupe et en Martinique, à l'image de l'aéroport Princesse Juliana dans la partie néerlandaise de Saint-Martin.
Nous attendons donc votre contribution écrite et nous restons à votre écoute. Je vous remercie pour cette audition très éclairante.
M. Arnaud Mentré. - Je reste à votre entière disposition pour répondre à toute question qui pourrait survenir dans le cadre de votre travail.
Nous avons peu évoqué Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ayant été sous-directeur d'Amérique du Nord à la direction des Amériques et des Caraïbes du Quai d'Orsay et consul général à Boston, j'aurai à coeur de faciliter autant que possible les relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec le Canada.
Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont parvenus à s'imposer comme de véritables phares du tourisme caribéen. Il convient bien sûr de renforcer les relations avec les Pays-Bas, mais aussi avec les États-Unis, ce que ces collectivités font déjà très bien, en lien avec Atout France. En tout état de cause, je m'emploierai à les épauler, sur ces sujets comme sur d'autres.
Jeudi 10 juillet
2025
Audition de S.E. M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en
France
Mme Micheline Jacques, président. - Chers collègues, après l'audition de l'ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, nous recevons à présent Son Excellence M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France, qui est accompagné de M. Ricardo Lambert, responsable de la communication à cette ambassade.
Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de participer à cet échange.
Nous avions eu l'occasion d'évoquer l'histoire et la situation complexe de votre pays lors de la projection du film documentaire Haïti : la rançon de la liberté que j'ai organisée au Sénat le 25 mars dernier. Comme vous le savez, la crise haïtienne nous préoccupe particulièrement, car elle est facteur de déstabilisation pour toute la région.
Aujourd'hui, dans le cadre de notre étude sur la coopération régionale dans le bassin de l'océan Atlantique, nos deux rapporteures, Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion, et Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val d'Oise, que je remercie pour leur implication, et moi-même souhaitons vous entendre sur les relations franco-haïtiennes, en particulier sur les liens entre Haïti et les outre-mer français de la région - Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Face aux problèmes de sécurité, notamment, quel est l'état de la coopération entre Haïti et la France, ainsi que les autres États de la région dans ce domaine ? Comment les territoires ultramarins peuvent-ils y contribuer ?
Nous savons que de nombreux ressortissants haïtiens vivent et travaillent dans les outre-mer français. Quelles en sont les conséquences régionales ?
Je laisserai nos rapporteures vous interroger sur ces différents sujets et bien d'autres, après votre exposé liminaire. Nos autres collègues vous poseront à leur tour les questions qu'ils souhaiteront.
M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France. - Madame le président, c'est un honneur d'être auditionné par votre délégation. Je salue votre engagement en faveur de la cause haïtienne : outre la projection du documentaire en mars dernier que vous avez mentionnée, vous avez rappelé au ministre de l'intérieur Bruno Retailleau, il y a quelques semaines, que la France ne devait pas abandonner Haïti - j'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'entretenir avec M. Retailleau à Lyon, lors d'une cérémonie de sortie de promotion dont faisait partie un policier haïtien. Votre déclaration, qui a été vivement appréciée, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux en Haïti. Je me félicite, plus largement, de l'attention accordée par votre délégation à Haïti.
Vous m'avez demandé d'apporter mon éclairage sur les relations entre Haïti et la France, les collectivités françaises d'outre-mer et ses voisins.
Haïti entretient des liens d'amitié avec la France. Les visites du président du Conseil présidentiel de transition en France, en janvier 2025, en témoignent. M. Voltaire a eu l'occasion d'échanger avec le président de la République M. Emmanuel Macron, qui l'a reçu à l'Élysée, pendant plus d'une heure. En avril, en outre, le Président de la République a annoncé la création, de concert avec les autorités haïtiennes, d'une commission mixte d'historiens chargée d'étudier notamment la question de la dette de l'indépendance. Une cérémonie s'est également tenue à Port-au-Prince pour marquer le bicentenaire de la dette de l'indépendance. Sous réserve de confirmation et de l'aboutissement des démarches de visa, une délégation officielle composée de cinq ministres du Gouvernement haïtien et de trois membres du Conseil présidentiel de transition se rendra en Guadeloupe le 18 juillet pour y rencontrer le préfet, le maire de Pointe-à-Pitre, et les présidents des conseils régional et départemental. La délégation empruntera le premier vol international depuis l'aéroport de les Cayes - la troisième ville du pays - à destination de Pointe-à-Pitre, qui préfigure l'établissement d'une liaison aérienne entre ces deux villes.
La coopération avec la France a une forte dimension sécuritaire, en lien avec l'actualité haïtienne depuis quelques années. Des formateurs du Raid (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) interviennent auprès d'une unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. La France a aussi récemment fait don d'équipements à la police nationale d'Haïti, ainsi que de blindés, il y a plusieurs années.
Désormais, la coopération s'ouvre aussi au domaine de la défense. Les forces armées aux Antilles (FAA) ont accueilli, à deux reprises, un contingent de vingt-cinq soldats haïtiens en formation en Martinique. Cependant, nous souhaiterions que la France nous aide à former des effectifs plus importants. Alors que la force armée haïtienne est en reconstruction depuis 2017, c'est la première fois qu'un pays occidental accepte d'accueillir nos soldats dans ce cadre.
À Paris, j'ai assisté à une réunion de travail avec la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des armées. J'ai également été reçu par la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l'intérieur, pour échanger sur la nécessité de renforcer les coopérations en matière de défense et de sécurité.
J'en viens à la situation actuelle en Haïti. Nous faisons face à une crise dont l'une des dimensions est humanitaire. À cet égard, la France a apporté son soutien, notamment au travers de financements octroyés à des agences onusiennes, comme le Programme alimentaire mondial (PAM), pour venir au secours de nombreux Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire.
La France intervient aussi, à titre bilatéral, pour nous aider à faire avancer le dossier haïtien, qui est sur la table du Conseil de sécurité des Nations unies depuis bien longtemps. Cependant, au cours des cinq dernières années, de nombreuses actions ont été entreprises par le Conseil de sécurité pour aider Haïti à faire face à la crise. La France, en tant que membre permanent, a plaidé en faveur de l'envoi d'une force multinationale pour aider la police à maîtriser la situation en Haïti. En octobre prochain, le renouvellement du mandat de cette force multinationale pilotée par les Kényans - qui a néanmoins suscité une forme d'insatisfaction - devra être décidé par le Conseil.
Par ailleurs, le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) doit être renouvelé au cours du mois de juillet. Nous nous attendons au soutien de la France à ce titre.
Il en est de même pour la contribution française au fonds fiduciaire destiné à soutenir financièrement la force multinationale. La France a été le premier pays à abonder ce fonds : sa contribution s'élève aujourd'hui à plus de 9 millions d'euros. En outre, la France a oeuvré pour que l'Union européenne participe à l'alimentation de ce fonds, à hauteur de 10 millions d'euros.
L'Union européenne a aussi fait don de 20 millions d'euros en 2024 pour apporter une aide humanitaire à Haïti, la France ayant, à titre bilatéral, contribué à hauteur de 16 millions d'euros.
La coopération franco-haïtienne présente plusieurs volets. Sur le plan sécuritaire, on considère que la France, aux côtés des États-Unis et du Canada, fait partie des pays qui ont porté sur les fonts baptismaux le projet de création de la police nationale d'Haïti, en 1995. La France contribue depuis des années à la formation des différentes promotions de cette police.
Au-delà de la sécurité et de la défense, la France est aussi un partenaire d'Haïti en matière d'éducation et de culture.
Concernant l'éducation, plus de 4 700 étudiants haïtiens réalisent leurs études en France, en mobilité libre. Chaque année, la France octroie environ 500 visas étudiants à des Haïtiens, essentiellement dans le cadre de licences, de masters ou de doctorats. Cependant, là où le bât blesse, c'est que seule une quarantaine de bourses sont allouées à des étudiants haïtiens, au travers de deux programmes, l'un géré par l'ambassade de France à Port-au-Prince, l'autre financé par l'État haïtien par l'intermédiaire de la Banque de la République d'Haïti. Nous appelons donc à la création d'un programme ambitieux de bourses pour les jeunes Haïtiens qui pourraient être formés dans des domaines clés pour le relèvement national. La France gagnerait à faire d'Haïti une vitrine de ce qu'elle peut accomplir, notamment en matière de coopération universitaire.
Par ailleurs, il existe un réseau culturel français très important en Haïti, qui s'appuie notamment sur l'Institut français de Port-au-Prince, sur les alliances françaises établies dans cinq villes - Jacmel, Jérémie, Les Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien. Cette présence soutenue témoigne de l'importance des relations franco-haïtiennes dans le domaine culturel. De nombreux écrivains haïtiens ont également bénéficié de bourses pour des résidences littéraires en France. Toutefois, depuis 2020-2021, en raison de la situation dans le pays, ces programmes se sont interrompus.
Je conclus sur la coopération régionale, notamment avec les départements et collectivités d'outre-mer. Ces relations ont connu un certain dynamisme, en particulier après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Beaucoup de coopérations décentralisées ont été établies entre des communes haïtiennes et des collectivités françaises, notamment avec le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil régional de Guyane, Pointe-à-Pitre, Cap Excellence ou d'autres villes des Caraïbes.
Ces coopérations ont porté sur des domaines tels que la gouvernance locale, la formation des agents techniques, l'appui budgétaire ou l'environnement. Toutefois, en raison de la crise, un grand nombre de ces programmes ont été interrompus. Aussi, lorsque la situation se sera stabilisée, j'espère que les coopérations avec les collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou même de Saint-Barthélemy pourront reprendre.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous connaissons fort bien, hélas, les difficultés auxquelles est confronté Haïti, l'image actuelle du pays nous peinant beaucoup. Des élections sont-elles prévues afin de permettre au pays de retrouver de la stabilité ?
La France apporte son aide en contribuant à la formation des policiers et en fournissant des équipements afin de tenter de préserver un minimum de sécurité, la principale conséquence des événements actuels étant une crise humanitaire. Nous souhaitons vraiment que les liens qui unissent nos deux pays soient maintenus, même si la situation géopolitique ne nous aide pas.
De manière concrète, quels pourraient être les liens entre Haïti et les outre-mer de cette région, c'est-à-dire Saint-Martin, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe ? Un certain nombre de vos compatriotes y résident déjà, et nous pourrions réfléchir collectivement à des actions de coopération, de manière à favoriser le développement de votre pays.
Mme Evelyne Corbière Naminzo, rapporteure. - Pourriez-vous nous en dire plus sur les ressortissants haïtiens qui vivent et travaillent dans les territoires ultramarins ? Apportent-ils une plus-value à leur pays d'origine ?
De la même manière, comment le retour des étudiants haïtiens accueillis dans l'Hexagone se passe-t-il ? Si les bourses sont en nombre insuffisant, le programme a le mérite d'exister. En tant qu'élue ultramarine, je suis attachée à ce que les jeunes puissent revenir chez eux une fois leurs études terminées : comment appréhendez-vous cet aspect pour l'avenir, une fois que la crise sera terminée ?
M. Louino Volcy. - Madame Eustache-Brinio, la crise haïtienne est multidimensionnelle, le drame humanitaire n'en étant que l'une des facettes. De fait, la crise actuelle revêt une triple dimension, à la fois nationale, transnationale et internationale.
Sur le plan national, tout d'abord, nous venons de commémorer - le 7 juillet - l'assassinat du dernier président haïtien élu, assassinat survenu il y a quatre ans. Cet événement a poussé la crise à son paroxysme en accélérant l'effondrement des institutions.
Depuis 2021, les autorités de transition se sont succédé en cascade. Le premier objectif de la transition consiste à rétablir la sécurité et à libérer certaines zones de l'emprise des gangs, afin de créer les conditions de l'organisation d'élections, le dernier scrutin ayant eu lieu en 2016, soit il y a bientôt une décennie.
La résorption de la crise sécuritaire constitue donc un impératif pour les autorités de transition, dans l'optique d'organiser ensuite un référendum qui permettrait au pays de se doter d'une nouvelle Constitution. Le texte actuel comporte en effet des éléments de blocage et nous souhaiterions faire de cette transition un moment de refondation institutionnelle. La troisième composante, enfin, correspond à l'organisation d'élections générales dans le pays.
La prochaine échéance est fixée au 7 février 2026 - date de fin du conseil présidentiel de transition -, ce qui m'amène à faire le point sur les avancées enregistrées jusqu'à présent. Le Gouvernement de transition a d'ores et déjà mis en place un comité chargé d'élaborer une nouvelle Constitution, un projet de nouveau texte ayant déjà été publié ; les élections et le référendum devraient se tenir en novembre prochain, de manière à ce que le président élu puisse prendre les rênes du pouvoir dès le 7 février.
Précisons, néanmoins, que le respect de cette échéance a été subordonné au rétablissement de la sécurité : c'est pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de faire intervenir une force multinationale, tandis que le Gouvernement a massivement investi dans le renforcement des capacités opérationnelles de la police haïtienne.
En dépit du déploiement de soldats de la force multinationale, qui compte près d'un millier de soldats et policiers, les zones contrôlées par les gangs se sont étendues : Mirebalais est récemment tombée dans leur escarcelle, tandis que la pression s'accentue sur Lascahobas. Nous n'avons même pas réussi, depuis le lancement de ce combat contre les gangs armés il y a quatre ans, à tuer un de leurs chefs.
Une autre solution consisterait à organiser des élections partielles là où c'est possible, la crise de sécurité étant concentrée dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Le blocage des routes constitue l'un des aspects les plus critiques de cette crise, car le pays est désormais divisé en plusieurs parties. De surcroît, et alors que la voie maritime était utilisée pour continuer à transporter les produits agricoles vers Port-au-Prince, les gangs armés y ont développé la piraterie : ils ont récemment attaqué un bateau de fortune dont plusieurs occupants se sont noyés en cherchant à éviter les balles.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - C'est terrifiant !
M. Louino Volcy. - Oui, d'autant plus que certains territoires, qui font office de greniers agricoles du pays, ne peuvent plus approvisionner la capitale.
Les élections doivent se tenir, mais à la condition qu'une sécurité minimale soit garantie. La solution d'un scrutin limité à une partie du territoire risque de mécontenter l'opposition, ainsi que la communauté internationale.
J'en viens aux outre-mer, avec lesquels Haïti entretient une relation étroite de longue date : d'après la maire de Cayenne, plus de 100 000 ressortissants haïtiens sont présents en Guyane, par exemple. De manière générale, il est difficile pour un Haïtien de quitter le territoire à l'heure actuelle, en raison de l'absence de liaison aérienne opérationnelle, puisque les gangs ont également réussi à faire fermer l'aéroport international de Port-au-Prince.
Dans ce contexte, d'autres villes pourraient se développer : tel est le cas de Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, qui s'érige en capitale de fait en accueillant les visiteurs étrangers. De la même manière, une nouvelle liaison aérienne permettra de relier la ville de les Cayes à la Guadeloupe, ce qui favorisera l'essor des relations commerciales.
Plus globalement, nous gagnerions à relancer les coopérations « dormantes », entre les communes par exemple. La délégation sénatoriale peut d'ailleurs inciter les municipalités et collectivités à maintenir un minimum de lien avec les collectivités haïtiennes qui en ont besoin dans le contexte actuel.
Je souhaiterais faire une demande à la délégation. Étant donné le contexte géopolitique actuel, la question haïtienne est occultée. La délégation pourrait-elle faire une demande officielle au Gouvernement pour que Paris organise une conférence internationale sur Haïti ? Paris l'a fait pour la Syrie et pour le Soudan. Un tel événement diplomatico-politique susciterait un intérêt renouvelé pour Haïti.
Mme Annick Petrus. - Excellence, je souhaite, au nom de tous les Saint-Martinois, témoigner notre solidarité au peuple haïtien. Cette crise systémique affecte profondément l'ensemble de la région, y compris les territoires français les plus proches.
La communauté haïtienne fait partie intégrante de l'île de Saint-Martin, de notre vie sociale, de notre économie et de notre quotidien. Elle contribue activement à la richesse et à la diversité de notre territoire. Nous ne parlons pas de population étrangère, mais bien de voisins, de collègues, d'amis et de famille.
Nous devons bâtir ensemble des réponses coordonnées, ancrées dans la réalité du terrain. Quelles sont vos attentes précises en matière de coopération vis-à-vis de la France et de ses territoires d'outre-mer, qu'elles soient humanitaires, sanitaires, éducatives ou sécuritaires ?
Sans institutions fonctionnelles, sans justice ni sécurité, aucune reconstruction durable n'est possible. Que prévoit votre Gouvernement pour renforcer l'État et la gouvernance ? Comment pouvons-nous accompagner ce redressement ?
Face aux défis, la réponse ne peut être uniquement bilatérale. Une coordination régionale avec les pays voisins est indispensable. Y a-t-il une volonté politique de relancer ce dialogue régional ? Je pense à la Communauté des Caraïbes (Caricom) ou à d'autres enceintes. Comment la France et ses collectivités d'outre-mer peuvent-elles être associées ?
Haïti, pays frère, ne peut être abandonné. Nos territoires au plus près de sa détresse veulent agir pour construire des ponts, et non des murs.
Mme Micheline Jacques, président. - La diaspora haïtienne est très active. Quel est le rôle des associations ? L'association franco-haïtienne Haïti Futur réalise un travail important en matière de scolarisation des enfants et de lutte contre l'illettrisme.
La diaspora contribue à un développement limité, mais foisonnant. Les initiatives locales sont nombreuses, le potentiel et la volonté sont immenses. Il est dommage que les gangs gangrènent cette dynamique.
La diaspora américaine, très importante, contribue financièrement au développement économique du pays. Or Trump a annoncé l'expulsion de 520 000 Haïtiens en septembre. Quelles sont les réactions au sein de la population ?
M. Louino Volcy. - De nombreux étudiants haïtiens souhaiteraient rentrer au pays. Une première limite, matérielle, est l'impossibilité d'atterrir à Port-au-Prince. S'ils trouvent un emploi, ces jeunes transiteront via la Guadeloupe ou Saint-Martin pour rejoindre Cap-Haïtien.
Tous les Haïtiens sont affectés par la crise. Tous ont des proches qui sont kidnappés, tués ou violés. L'ambassade et le consulat sont à leur disposition et les accompagnent dès qu'ils ont besoin de documents administratifs. Même à distance, nos ressortissants restent très actifs. Ils envoient des fonds, mais travaillent aussi à des projets de développement local. Haïti Futur n'est qu'un exemple parmi d'autres. La communauté haïtienne en France et en outre-mer est très courageuse et dynamique.
En matière de coopération, notre priorité est la sécurité. Nous souhaiterions que la France puisse nous aider à former plus de policiers et de soldats. Le nombre de forces de l'ordre disponibles par rapport à la population est totalement en deçà de la norme internationale. En matière d'armement, le déséquilibre avec les gangs est patent. Les policiers manquent de munitions face à des gangs bien ravitaillés - selon les Nations Unies, 90 % de ces armes viennent d'Amérique du Nord. Haïti et les outre-mer doivent travailler ensemble pour lutter contre la criminalité transnationale.
Envoyer des agents du Raid est certes très efficace, mais il faut avant tout que la France nous aide à former massivement plus de policiers et de soldats. Nous aurions besoin d'une marine professionnelle pour surveiller les côtes, notamment pour éviter le trafic d'armes et de munitions, alors que 600 000 armes circulent de manière illégale dans le pays selon les Nations Unies.
Bref, nous souhaiterions un renforcement de la coopération avec la France dans le domaine sécuritaire et de défense. Il nous faut du concret avant tout, à savoir comment passer, par exemple, de 1 500 à 5 000 soldats opérationnels en trois ou cinq ans. Nous devrions aussi instaurer une police municipale.
Il existe bien une volonté de coopérer avec les organisations internationales. Haïti est membre de la Caricom, qui a repris les échanges avec les acteurs haïtiens pour faciliter le dialogue interhaïtien, rétabli depuis le 1er juillet. La Caricom joue un rôle de médiateur, car la crise, multiple, est aussi politique, et tout part de là.
La crise est sécuritaire, mais aussi humanitaire et économique. La pauvreté grandit. Certains n'arrivent même pas à faire transiter leurs productions agricoles. Une paupérisation silencieuse sévit dans les régions reculées du pays, conséquence de cette crise sécuritaire et de l'action des gangs armés en lien avec les cartels.
Les expulsions décidées par les États-Unis sont un sujet de préoccupation. Nous essayons de poursuivre le dialogue diplomatique, mais l'immigration relève de la souveraineté des pays. Nous demandons que nos ressortissants soient traités humainement, mais nous ne pouvons mener d'action en justice contre les décisions américaines.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. - Aux Américains de prendre leurs responsabilités.
Mme Micheline Jacques, président. - Cette audition n'est qu'un début. Vous pourrez compter sur la France ; le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a dit que la France était amie d'Haïti. La France a réellement la volonté de vous accompagner. Nous espérons aller plus loin, car la sécurité est la pièce maîtresse du développement d'Haïti.
Quand je vois l'énergie de la diaspora, je ne doute pas que ce pays pourra se développer comme il le mérite.
Jeudi 16 octobre 2025
Audition de M. Manuel Marcias,
Mme Micheline Jacques, présidente. - Chers collègues, dans le cadre de notre étude sur la coopération régionale dans le bassin Atlantique, que nos deux rapporteures Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion, et Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice du Val-d'Oise, sont en train de finaliser, nous accueillons ce matin M. Manuel Marcias, économiste, auteur d'une étude récente et remarquée de la Banque de France intitulée « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ? ». Nous sommes vraiment dans le vif du sujet.
Monsieur Marcias, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux outre-mer.
Vous êtes économiste, chargé d'études économiques au sein des instituts d'émission d'outre-mer (Iedom-Ieom). Vos missions incluent la réalisation d'études sectorielles et macroéconomiques, ainsi que la participation à des rapports sur l'attractivité des territoires ultramarins.
L'insuffisante intégration des outre-mer dans leur environnement proche, déjà observée l'an dernier pour les collectivités du bassin océan Indien, et leur dépendance marquée à l'Hexagone ont conduit notre délégation à rechercher des pistes d'amélioration concrètes pour nos outre-mer.
Votre étude nous a intéressés, car elle établit l'existence pour ces territoires d'un potentiel de commerce encore largement sous-exploité avec leur environnement régional.
En conséquence, nos interrogations concernent en particulier la politique commerciale que vous recommandez pour les différents territoires, en particulier la Guyane, les Antilles françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon. Quels accords manquent, selon vous ? Faut-il par exemple privilégier des accords ciblés par produit ?
Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges.
Je laisserai nos rapporteures vous poser des questions après votre exposé liminaire. Puis, ce sera le tour des autres collègues qui le souhaitent. Je salue nos collègues qui assistent à cette réunion en visioconférence.
M. Manuel Marcias, auteur de l'étude de la Banque de France intitulée « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ? ». - Merci de nous permettre de vous présenter les résultats de nos travaux. J'ai préparé un diaporama qui présente le contexte de notre étude et quelques résultats.
D'où vient notre volonté de mener cette étude ? La question du commerce extérieur des territoires français ultramarins, qui est essentielle, a été remise à l'ordre du jour par la publication de nombreux rapports, du conseil économique, social et environnemental (Cese) comme du Parlement, sur le problème de la vie chère et son impact sur les populations ultramarines. La plupart des biens consommés outre-mer sont importés, ce qui a une incidence sur leur coût.
Il s'agit donc d'abord d'un intérêt de politiques publiques, auquel s'ajoute un intérêt scientifique. Les douanes transmettent à l'Iedom (Institut d'émission des départements d'outre-mer) des données très précises sur les exportations des territoires ultramarins, ainsi que sur le commerce entre les territoires ultramarins et le reste du monde (autres territoires ultramarins, Hexagone, pays étrangers). Cela nous donne une base de travail très précise et assez unique.
Nous souhaitions enfin compléter la littérature sur ce sujet et renouveler des études produites il y a une dizaine d'années en remettant à jour nos modèles.
Dans cette étude, nous parlons exclusivement de commerce de marchandises et de biens et non de commerce de services.
Les outre-mer souffrent d'une double « insularité ». Les guillemets s'imposent. En effet, si tous les territoires ultramarins ne sont pas des îles, en revanche, d'une part, tous sont isolés dans leur environnement géographique, au sens où ils appartiennent à un bassin isolé (Caraïbes, océan Indien...), c'est-à-dire des territoires avec de petites économies insulaires - c'est la première insularité - ; d'autre part, ils sont victimes d'un isolement au sein de territoires déjà isolés - c'est la seconde insularité.
Les territoires ultramarins se trouvent donc dans un environnement géographique « insulaire » qui vont contraindre leur accès au commerce international.
D'abord, le marché intérieur est très étroit, du fait du faible nombre d'habitants. Il est difficile de développer une industrie large et compétitive. Qui imaginerait développer l'industrie automobile en Guadeloupe ?
Ensuite, certains territoires sont isolés économiquement : ils sont loin de l'Union européenne continentale, de l'Asie ou des États-Unis.
Enfin, leur économie faible limite le nombre de produits qu'ils peuvent exporter et crée un risque lié aux fluctuations de ces biens spécifiques sur les marchés internationaux. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie avec le nickel.
Comment rendre les territoires ultramarins plus autonomes, moins dépendants de l'Hexagone, et améliorer la diversification de leurs exportations ?
Si l'on ne prend que la dimension géographique, on se rend compte à quel point certains territoires sont éloignés des principaux pôles économiques mondiaux et l'on s'aperçoit que nos territoires ultramarins ont des valeurs d'indices très faibles, surtout les bassins Indien et Pacifique. Pour ces territoires, les distances à parcourir pour écouler leurs marchandises et accéder à des marchés sont beaucoup plus importantes que pour le reste du monde. Cela pose des problèmes de coût, mais aussi de connaissance des marchés étrangers. La distance a un effet de complexification. La Guadeloupe et la Martinique sont deux exceptions, en raison de leur proximité avec les États-Unis.
L'isolement est également logistique. La plupart des marchandises arrivent et partent par voie maritime. Le niveau d'intensification des lignes maritimes est donné par l'indice de connectivité (fréquence des bateaux, nombre de lignes connectées, tonnages...). Si les territoires ultramarins ont des performances plutôt faibles, certains d'entre eux arrivent à se distinguer. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, grâce au nickel, et de la Polynésie française, tellement isolée que des lignes ont dû être créées.
Les ports ultramarins français sont à la charnière : ils ont une faible connectivité à l'échelon international, mais ils parviennent à concurrencer les plus grands ports régionaux. C'est le cas de la ligne La Réunion-île Maurice, grâce au hub CMA CGM situé à La Réunion.
Même si c'est difficile, les territoires ultramarins exportent-ils ? Oui, et certains plus que d'autres. Ces territoires répondent à des spécialisations sectorielles qui sont communes à l'ensemble des petits États insulaires en développement.
Deux possibilités s'offrent à eux : soit les territoires ultramarins exploitent une ressource naturelle - le nickel en Nouvelle-Calédonie - qu'ils exportent, avec une spécialisation totale ; soit ils profitent d'un avantage comparatif dans des secteurs agricoles - le sucre à La Réunion, la banane à la Martinique, ou encore le rhum à la Martinique et en Guyane. Je signale une spécificité pour la Martinique où l'implantation de la société anonyme de la raffinerie des Antilles (Sara) permet une exportation importante d'hydrocarbures.
On le voit, la première insularité a un impact sur le commerce international. Ces territoires possèdent des similarités avec leurs voisins en matière d'exportations : ils sont soumis aux mêmes contraintes.
Pour autant, au sein de leur environnement géographique, ils peinent à s'intégrer. C'est ce que j'ai appelé la double insularité.
Ils ont des PIB par habitant beaucoup plus importants que les pays voisins. Si le niveau de développement est beaucoup plus important, le niveau de vie et les coûts de production le sont également beaucoup plus.
Ainsi, les logiques de spécialisation sont les mêmes : ils produisent les mêmes biens, mais plus cher, ce qui pose des problèmes d'exportation.
Par ailleurs, la faible intégration des économies ultramarines dans leur environnement régional et à l'international est également un facteur d'isolement.
Dans leur commerce, les outre-mer français dépendent de façon quasi-exclusive de l'Hexagone et des autres territoires ultramarins. Si l'on prend l'exemple de la Guadeloupe et de la Martinique, cela représente 80 % des exportations et 60 % des importations.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Quel est le poids des normes ?
M. Manuel Marcias. - Nous n'avons pas réalisé d'étude spécifique sur les normes, mais nous avons montré que l'impact des droits de douane était assez limité. Ce sont d'autres causes qui expliquent cette situation.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Le président Trump a initialement annoncé 10 % de droits de douane pour les territoires insulaires et ultramarins, mais ce sont finalement les mêmes que pour l'Hexagone qui ont été décidés. Cela a-t-il un impact sur les exportations et les importations ?
M. Manuel Marcias. - Les droits de douane ont un impact sur le commerce international, les études le montrent, mais ce n'est pas l'objet de notre travail.
Appartenir à une zone de libre-échange a une incidence et facilite le commerce. Qui dit droits de douane dit prix plus élevés pour le consommateur et baisse de la demande. Sur les droits de douane aux États-Unis, il y a eu beaucoup de revirements : il est donc difficile d'avoir une idée précise de ce qui se passera.
Globalement, les exportations des outre-mer vers les États-Unis, à part pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française, n'atteignent pas des niveaux très élevés : pour la Guadeloupe et la Martinique, elles représentent moins de 5 %. Il faut aider les entreprises guadeloupéennes et martiniquaises à pénétrer le marché américain, qui est un marché potentiel, et explorer d'autres pistes. Ce n'est pas uniquement dû aux droits de douane.
En revanche, près de 40 % des importations de la zone Caraïbes viennent d'Amérique du Nord, contre moins de 10 % pour la Martinique et la Guadeloupe.
En Guyane, qui se trouve pourtant dans un environnement économique qui n'est pas comparable, les constats sont très similaires. En matière d'exportations comme d'importations, la dépendance vis-à-vis de la France est très forte, alors même que la Guyane se trouve à proximité immédiate du Brésil, qui pourrait être un fournisseur de nombreux biens.
On raisonne sur des valeurs théoriques, mais on n'étudie pas la dimension logistique. Ainsi, il n'existe pas de liaison directe entre le Brésil et la Guyane qui permettrait des exportations importantes ; une grande ligne CMA CGM relie la France, la Guyane et le Brésil, puis revient en Europe. La logistique est capitale : il faut développer les ports et les lignes maritimes.
Pour revenir à notre question de départ, c'est-à-dire la vie chère, les départements et régions d'outre-mer (Drom) se fournissent principalement sur le marché européen à des prix bien plus élevés que dans leur zone, ce à quoi s'ajoutent des frais de transport et des frais de grossistes.
Mon graphique s'appuie sur les statistiques produites par l'Autorité de la concurrence en 2019 à propos des coûts moyens dans les cinq Drom.
Deux blocs nous intéressent : le premier, c'est le prix des marchandises à l'origine, qui représente 50 % du prix final. Le deuxième, ce sont les frais d'approche - grossistes, octroi de mer et transport -, qui en représentent 32 %. En faisant venir les marchandises de moins loin, nous pourrions agir sur ces deux facteurs. Notez que nous n'avons pas abordé la question de l'octroi de mer dans notre étude...
M. Manuel Marcias. - Mais le protocole de Fort-de-France a ouvert la question ; il sera intéressant de voir les effets de ce protocole très ambitieux sera appliqué en Martinique.
Revenons à notre étude scientifique théorique, consistant à soumettre des données à un modèle pour obtenir à travers des estimations statistiques une image de ce qui est envisageable.
Je ne vous présente pas d'équations - sinon dans une diapositive en annexe ; pour faire simple, nous cherchons à expliquer les exportations d'un pays I vers un pays J en fonction de trois groupes de facteurs. Le premier concerne la capacité du pays exportateur à exporter : coût du travail, conditions à l'export, infrastructures. Le second porte sur la capacité du pays importateur à importer : niveau de vie, ouverture du marché, etc. Le troisième agrège des caractéristiques de chaque couple de pays : l'échange est-il facile ou non ? quels sont les coûts au commerce, les liens historiques, la distance, etc. ?
Cela nous permet d'obtenir un graphique pour l'ensemble des situations envisageables. Nous constatons un gros défaut d'export de la Martinique et de la Guadeloupe vers les États-Unis. Dans mon graphique, le point rouge représente ce que chaque territoire exporte vraiment vers les États-Unis en 2021 ; le point noir représente ce que, selon notre modèle, la géographie devrait déterminer. En comparaison avec les autres économies de la région, la Martinique et la Guadeloupe exportent plutôt peu vers les États-Unis ; surtout, elles sont assez loin de leur potentiel, alors que, pour les économies les plus exportatrices, le réel égale plus ou moins le potentiel.
Reprenons les trois groupes de facteurs ou effets. La capacité à exporter est globalement assez élevée : aucune contrainte n'empêche les exportations et celles-ci sont fortes vers l'Hexagone. La capacité générale à importer des États-Unis est la même pour tous. Reste l'effet « couple de pays ». Avec les États-Unis, il est plus fort pour la Martinique et la Guadeloupe que pour les autres pays de la zone.
La Martinique et la Guadeloupe présentent des coûts au commerce vers cette destination plus importants : cela représente 30 % du potentiel pour la Guadeloupe et 12 % pour la Martinique.
Allons plus loin dans l'analyse. Le potentiel est donc plus bas que pour les voisins, mais imaginions qu'il soit le même. La Martinique et la Guadeloupe pourraient exporter respectivement 25 millions et 33 millions de dollars de plus par an vers les États-Unis. Le potentiel est inexploité et même sous-estimé.
Intéressons-nous spécifiquement aux produits agroalimentaires. La Barbade, île voisine, exporte en effet énormément vers les États-Unis, principalement des produits agroalimentaires, notamment du rhum. C'est sans commune mesure : le rhum de la région s'exporte en effet très bien vers les États-Unis, sauf depuis la Martinique et la Guadeloupe. Ces exportations pourraient être multipliées par 5 pour la Martinique et par 3,6 pour la Guadeloupe.
Ces deux Drom sont les deux pays de la zone qui pâtissent le plus de l'effet couple pays avec les États-Unis. Pourquoi ? nous n'avons pas de réponse définitive, mais nous avons des pistes.
Première piste : les droits de douane. La différence entre les territoires ultramarins et les pays voisins est que ces derniers font partie des pays d'Afrique, Caraïbe, Pacifique (ACP) bénéficiant d'accords préférentiels avec la plupart des pays développés. Ils ne paient donc pas de droits de douane à l'export vers les États-Unis, tandis que la Martinique et la Guadeloupe paient les mêmes droits que l'Union européenne. Cela peut changer avec la stratégie de Trump de différencier les droits pour les territoires insulaires, mais il restera malgré tout des tariffs.
Deuxième piste : la logistique. Il faudrait mener des études sur les difficultés de ce côté-là, qui obèrent la capacité à exporter vers les États-Unis. Actuellement, ce que ces derniers achètent passe d'abord par le marché européen avant d'être réexporté aux États-Unis.
Enfin, pour exporter, il est nécessaire de connaître le marché de destination. Il est plus facile d'exporter vers une métropole avec laquelle on partage la langue, à travers des circuits logistiques peu coûteux. Pour exporter aux États-Unis, il faut trouver un distributeur, traduire les étiquettes, choses très coûteuses pour des entreprises, surtout ultramarines, faute d'expérience en la matière.
Vous m'interrogez sur le rôle que pourraient jouer les grands acteurs du développement des entreprises en France. Je travaillais à Business France avant de travailler à l'Iedom ; je connais donc mieux cet acteur que les chambres de commerce et d'industrie. Son rôle est très important. Il dispose d'une expertise importante sur les marchés à haut niveau de vie, notamment les États-Unis, une connaissance sectorielle, lui permettant de réaliser des études de marché. Les entreprises ultramarines peuvent demander à Business France d'organiser des voyages pour rencontrer des distributeurs ; elles peuvent demander des subventions pour payer les prestations de cet organisme, qui peuvent être chères. Pour cette projection, qui n'est ni facile ni innée, les entreprises ultramarines doivent être accompagnées par des acteurs publics.
Dans la vie chère, les importations sont au centre. Nous nous sommes interrogés sur les conséquences de l'accord entre le Forum Caribéen des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Cariforum) et l'Union européenne, notamment sur les Antilles et la Guyane : on pourrait penser que, si l'on diminue les tarifs douaniers, cela permettra d'importer davantage des pays alentour. Les premiers résultats de travaux prospectifs montent qu'a priori, cela n'a pas eu d'impact. La baisse des droits de douane n'est donc pas la solution à tout et ne suffira pas à mieux intégrer les outre-mer. D'autres choses jouent, qu'on appelle les barrières non tarifaires.
Les normes, d'abord : pour la construction, les Drom importent des biens de l'Union européenne aux normes CE, alors qu'on pourrait faire venir de pays plus proches des matériaux qui, quoique non conformes à ces normes, pourraient s'avérer plus adaptés aux conditions climatiques.
Il y a eu une avancée : un vote du Parlement européen en juin 2024 ouvre une négociation sur des normes relatives aux régions ultrapériphériques (RUP), ce qui a été validé au niveau français. Des comités consultatifs des normes doivent être mis en place dans chaque territoire pour déterminer des normes RUP permettant l'import de biens ne respectant pas les normes CE. Cela devrait avoir un effet important.
On ne peut pas faire d'étude a priori sur ce sujet ; il faudra donc en faire une a posteriori. Les comités consultatifs devront établir des normes protégeant la sécurité des consommateurs, mais adaptées aux territoires.
C'est aussi pour des raisons logistiques que les Drom importent de l'Hexagone : les lignes arrivent depuis l'Europe ; les grandes enseignes se fournissent sur leurs plateformes logistiques : en Nouvelle-Calédonie, Super U propose des produits U. C'est plus simple de les faire venir de l'Hexagone.
C'est enfin en raison des liens historiques : l'habitude de commercer, la langue, l'absence de formalités, et les habitudes culturelles concernant les biens à consommer.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Merci infiniment. Vous clôturez nos auditions et votre analyse technique nous éclaire sur les sujets que nous avons abordés auparavant. Vous êtes très clair, et votre analyse correspond à notre ressenti. N'étant pas élue des outre-mer, j'ai appris beaucoup de choses. La situation est complexe, mais rien n'est impossible !
Vous avez parlé tout à l'heure du rhum qui n'est pas exporté aux États-Unis. Quelle ne fut pas ma surprise de constater, au tout début de nos auditions, que l'on trouve, aux États-Unis, du rhum en provenance de tous les autres pays - Colombie, etc. -, mais pas le nôtre ! Il est vrai qu'il existait, bien avant la taxe Trump, une taxe très importante sur les rhums. Cependant, rien n'est impossible pour autant. Il faut que nous arrivions à percer ce marché.
Sur la barrière de la langue, je pense qu'il n'est pas compliqué de coller des étiquettes bilingues... Il faut peut-être que nous essayions de pousser un peu les choses, car ces territoires ont besoin de se développer avec les acteurs locaux.
Je pense que vous avez posé aujourd'hui certaines clés que tout le monde devra s'approprier.
On peut peut-être aussi se demander s'il n'y a pas une complexité qui tient à la manière dont la vie et le développement de ces îles sont organisés. Il me semble que c'est le cas : tout le monde s'occupe de tout, mais pas de manière individualisée, si bien que l'on n'avance pas beaucoup. Nous savons que, partout, y compris dans l'Hexagone, des mille-feuilles nous empêchent d'avancer. Ces mille-feuilles sont peut-être cependant encore plus handicapants dans ces territoires. Avez-vous pu avoir une réflexion à ce sujet ?
M. Manuel Marcias. -Non, je n'ai pas du tout étudié la complexité liée à l'existence de différentes structures.
Lors d'une conférence Arum (Actes de la recherche ultramarine) sur l'économie ultramarine - ces conférences Arum sont organisées tous les deux ans -, une élue du bassin Atlantique a déclaré que nous disposions de financements, mais que nous manquions d'ingénierie de projet, ce qui ne nous permet pas de répondre de manière satisfaisante aux demandes d'aides. Nous proposons des aides, mais nous ne donnons pas aux territoires les moyens de s'en saisir. Accorder des aides ne suffit pas ! Il faut également accompagner les entreprises. Il est nécessaire que les organismes tels que Business France ou les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, les aident à intégrer ces financements dans leur développement.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Vous avez également abordé un vrai sujet, qui est mentionné quasiment à chaque audition : celui des normes européennes. Vous avez raison de rappeler qu'elles protègent, au niveau sanitaire ou en matière de sécurité. Cependant, nous nous apercevons qu'elles sont aussi très bloquantes pour les territoires ultramarins. Comme je le dis souvent, nous avons construit l'Europe sans songer que nous avions des territoires ultramarins. Il faut dire que, parmi les pays européens, la France est celui qui a le plus de territoires ultramarins ! Les autres n'en ont pas, ou quasiment pas. Le sujet n'a donc pas dû s'y poser de la même manière. C'est, pour nous, une double difficulté d'adaptation.
Vous avez parlé du lien entre la Guyane et le Brésil. Nous avons pu constater le poids des contraintes lors d'un déplacement que nous avons effectué. Il existe même parfois des infrastructures qui permettraient une gestion différente, mais cela ne se fait pas. C'est un vrai sujet, que vous avez raison de soulever. Sur cette question des liens, la logistique est fondamentale.
M. Manuel Marcias. - Nous pourrons proposer tous les dispositifs possibles et imaginables, s'il n'y a pas de liens de transport entre deux pays, les exportations et les importations ne se feront pas.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Bien sûr !
Je vous remercie, car vous avez répondu à toutes les questions que nous vous avions fait passer. Vos schémas sont très éclairants sur les forces et faiblesses de nos territoires.
Mme Solanges Nadille. - Merci pour vos premiers propos.
Vous êtes-vous intéressé à la question des monopoles dans les territoires ultramarins et à leurs conséquences ?
Je vous rejoins sur de nombreuses conclusions de votre étude, mais il y a une particularité que vous n'avez pas citée : la triple insularité pour les territoires qui sont eux-mêmes composés de plusieurs îles, comme la Guadeloupe ou la Polynésie. Il me semble que ce problème n'est pas pris en compte au niveau national.
Pour ma part, je considère que l'ingénierie ne manque pas : c'est une stratégie nationale qui consiste à empêcher l'ouverture vers le continent américain. De fait, si nous exportons vers l'Amérique, nous pouvons aussi chercher à importer. Il faut pousser la réflexion et se demander s'il n'est pas opportun d'en rester à la situation actuelle, même si les coûts de production sont élevés. N'oublions pas la valeur des territoires ultramarins pour la balance commerciale de la France.
M. Jean-Gérard Paumier. - Je souhaite prolonger les propos de notre rapporteure sur l'Europe. Il y a une sensibilisation très importante à mener, car nous nous rendons bien compte qu'un certain nombre de normes et de règles sont inadaptées aux territoires ultramarins - c'est mon sentiment depuis que je suis sénateur.
Une étude comparative a-t-elle été menée avec les autres pays de l'Union européenne qui ont des territoires ultramarins ? Constate-t-on chez eux les mêmes phénomènes que ceux que vous avez relevés ? Si nous sommes plusieurs dans la même situation, nous serons peut-être un peu plus forts pour sensibiliser davantage l'Union européenne à l'importance de faire évoluer les normes.
Enfin, quelles propositions ou orientations que nous pourrions défendre auprès de l'Union européenne en tant que parlementaires pourriez-vous nous suggérer, au-delà de vos très justes constats ?
Mme Marie-Do Aeschlimann. - Je vous remercie pour les éclairages que vous nous avez apportés.
Vous avez évoqué un certain nombre de freins au développement d'une véritable politique de commerce extérieur pour les territoires ultramarins, dans une optique de lutte contre la vie chère dans ces territoires. Vous avez également esquissé l'idée d'une spécialisation, qui pourrait être sectorielle, avec un ou plusieurs produits par territoire. Dans cette optique, la problématique des chaînes d'approvisionnement ne doit-elle pas être prise en compte ? Celles-ci sont importantes, puisqu'elles concernent les matières premières, mais aussi tout ce qui peut concourir à la construction d'une activité industrielle ou de production. Elles peuvent également freiner la stratégie de construction d'une véritable économie productive à partir d'une idée de spécialisation sectorielle.
Je n'ai pas le sentiment que la question des infrastructures logistiques, notamment portuaires, ait été prise en compte dans votre étude et dans votre modèle de gravité. Considérez-vous que cette donnée n'a pas beaucoup d'importance ? À moins que ce sujet n'ait fait l'objet d'une autre étude ? En particulier, les caractéristiques des infrastructures portuaires, notamment l'accès ou les tonnages, peuvent limiter ou faciliter l'activité maritime. Les caractéristiques des ports dans nos territoires leur permettent-elles d'avoir une taille critique pour s'insérer véritablement dans le commerce international ? Je songe notamment au tirant d'eau.
Par ailleurs, dans ces territoires, les considérations écologiques et environnementales sont importantes, en particulier les problématiques de dragage, qui peuvent constituer des entraves. Le développement d'une véritable activité commerciale extérieure est-il compatible avec la protection des littoraux et des environnements physiques de ces territoires ? Si oui, dans quelle mesure ?
Enfin, a-t-on tenté d'évaluer ce que représenterait une mise à niveau des infrastructures maritimes sur un plan financier ? Quelles pourraient être les sources de financement pour nous permettre de nous insérer véritablement dans le commerce maritime international ?
M. Manuel Marcias. - Le problème des monopoles, que nous n'avons pas abordé dans cette étude, est réel. Dans les chaînes logistiques intégrées, que j'évoquais tout à l'heure, ce sont ces monopoles qui interviennent. Concernant la distribution, il s'agit plutôt d'oligopoles, avec une concurrence très faible. Ces oligopoles ont un impact sur les prix. Ces éléments seront étudiés dans une étude que mène actuellement la Cour des comptes, me semble-t-il, sur les marges des entreprises. Il existe aussi un monopole en matière de transport : vers la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, c'est principalement CMA CGM qui assure les transports et qui peut donc fixer les prix. Oui, ces éléments jouent un rôle très important. L'absence de concurrence impacte toujours les prix à la hausse. Une réflexion doit être menée pour limiter ces monopoles et oligopoles, y compris pour lutter contre la vie chère.
Sur la triple insularité, je ne peux que vous rejoindre. Cette situation existe effectivement dans de nombreux territoires ultramarins. Les îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie, en sont un exemple. Il y a donc, au sein même de nos territoires déjà isolés, des territoires qui subissent des contraintes encore plus fortes.
Je suis assez réservé sur l'analyse concernant les exportations de rhum à destination des États-Unis et les importations. Le fait d'exporter permettra à la fois d'augmenter la production et de se tourner vers un marché avec des prix plus élevés, pour retirer des marges plus importantes sur nos productions. Il est donc dans notre intérêt de nous orienter vers ces marchés. Nous avons intérêt à diversifier nos marchés de destination, d'autant que nous produisons des rhums de qualité qui ont toute leur place sur le marché américain, lequel est l'un des premiers marchés consommateurs de rhum au monde.
Se restreindre au seul marché hexagonal ne suffit pas. Surtout, cela ne permet pas de valoriser notre production ! Nous produisons un rhum de qualité, que nous n'arrivons pas à exporter vers des marchés pour lesquels nous savons qu'il y aurait un potentiel. Il serait important que nous ayons une meilleure connaissance de ces marchés.
Pour rebondir sur ce qui a été dit, traduire une étiquette en anglais ne suffit pas. C'est un peu plus compliqué que cela : il faut contacter - en anglais - des distributeurs, rédiger des contrats...
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - Oui, mais ce n'est pas insurmontable ! D'autres pays ont réussi à le faire.
M. Manuel Marcias. - Oui, mais ce sont des démarches qui peuvent donner lieu à une demande d'accompagnement.
Plus de 60 % des importations de ces territoires viennent de l'Hexagone. Je ne pense pas que la création d'un lien commercial avec les États-Unis pour le rhum changera cet équilibre du tout au tout ! Comme le montrent les graphiques que nous avons projetés, l'Amérique du Nord représente, pour la Caraïbe, un importateur important - de l'ordre de 40 % -, mais le taux n'est pas de 60 % ou 70 % comme il peut l'être avec la métropole.
Je vois deux intérêts à l'ajout de concurrence : il fait venir des biens extérieurs, qui seront parfois moins chers ; pour les produits venant de métropole qui étaient en situation de monopole, ces monopoles seront dans l'obligation de diminuer leurs prix ou d'offrir une palette de biens plus importante. Cette concurrence m'apparaît donc plutôt positive. Elle ne viendra pas, à mon sens, remplacer le lien étroit qui existe entre l'Hexagone et les territoires ultramarins.
Mme Solanges Nadille. - Pour qui cette concurrence est-elle positive ?
M. Manuel Marcias. - Elle sera positive pour les habitants, en ce sens qu'elle permettra une baisse des prix. Je suis incapable de vous dire la part de marché que les États-Unis pourraient prendre. Nous aurons, bien sûr, des entreprises qui exportent vers les Antilles et la Guyane qui perdront des parts de marché. Peut-être que cette concurrence accrue leur fera changer leur stratégie concernant les produits qu'ils envoient en outre-mer. Les prix baisseront, et un équilibre se créera.
Ce qu'il faut voir, c'est que la situation de monopole ou d'oligopole a un impact sur le niveau des prix. Si nous voulons baisser les prix, il faut un peu de concurrence.
J'émettrais juste une réserve très importante : la politique commerciale doit être réfléchie, certes en termes de prix, mais aussi en termes de protection des productions locales. Cette volonté d'augmenter la production locale est l'un des points importants du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère qui a été proposé en Martinique l'année dernière. La meilleure production que nous pourrons avoir est celle qui sera faite par les territoires eux-mêmes. De nombreux apports très intéressants ont été proposés dans ce protocole, notamment le développement d'une autonomie alimentaire, avec le passage des aides Poséi (programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) de 15 % à 30 %. Il faut prendre en compte que les coûts de production dans nos territoires, notamment pour l'agriculture, sont très importants, alors qu'il est normal que nos territoires ultramarins se fournissent auprès de leurs agriculteurs pour leur consommation. Ce changement de paradigme impose de développer la production vivrière, avec l'aide des pouvoirs publics. Pour ce qui n'est pas produit localement, il faut parvenir à diversifier les fournisseurs et à offrir une gamme plus importante de produits aux consommateurs.
Non, aucune comparaison n'a été faite avec les autres pays qui possèdent des territoires ultramarins. C'est un point qui pourrait être étudié. Il faudra simplement que nous vérifiions la disponibilité des données. Pour l'ensemble des Drom, les douanes nous fournissent des données sur leurs échanges avec l'Hexagone. Si nous voulons étudier la situation des Canaries, par exemple, il faudra sûrement établir un partenariat avec les douanes espagnoles.
Il faut noter que le statut des outre-mer européens - mis à part le cas de Madère, des Açores et des Canaries, qui sont aussi des régions ultrapériphériques (RUP) - est principalement celui de pays et territoire d'outre-mer (Ptom), qui les fait disposer de droits très larges en matière d'autonomie : ils ont la capacité de signer des accords, ils possèdent leur propre monnaie, leur propre banque centrale... Ils sont donc plus indépendants que nos propres territoires. La comparaison est intéressante à faire, mais il faudra garder cet élément à l'esprit.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Pour le marché américain, quel volume de production permettrait d'être rentable, compte tenu des contraintes logistiques et des coûts de transport des marchandises ?
Par ailleurs, l'Union européenne vient de créer la taxe carbone aux frontières, qui contraint les pays importateurs européens, donc les territoires ultramarins, à déclarer le contenu carbone des produits importés. Cela n'aurait-il pas un impact supplémentaire si l'on veut s'orienter vers le marché américain ? Nous sommes un peu pris en otage par toutes ces taxes. À cela s'ajoute la BAF (Bunker Adjustment Factor), qui est liée au carburant consommé. Compte tenu de la distance qui sépare les territoires ultramarins de la France, nous sommes aussi assujettis à cette taxe.
Comment amoindrir tous ces coûts ?
M. Manuel Marcias. - On envisage plus les États-Unis comme un marché potentiel à l'export, puisque c'est un pays à un revenu et à coût du travail élevés. La valeur critique dépendra en effet des coûts du transport.
De mémoire, pour aller aux États-Unis, il faut passer par la Jamaïque ; cela suppose d'avoir la capacité de remplir un « équivalent vingt pieds », donc d'avoir des volumes assez importants.
Entre 2013 et 2022, sur l'ensemble des exportations des territoires du bassin Caraïbes vers l'international, à l'exception de la Jamaïque et de la République dominicaine qui sont des cas particuliers, on constate que la Martinique, parce qu'elle exporte beaucoup d'hydrocarbures, et la Guadeloupe ont des niveaux d'exportation qui ne sont pas si faibles par rapport aux îles alentour, alors même que ces dernières exportent vers les États-Unis.
Si elles y arrivent, pourquoi pas nous ? Tout cela reste toutefois très théorique : il faudrait connaître les données du coût du commerce, de transport, etc.
En revanche, pour répondre à votre question sur la taxe carbone, je ne pense pas qu'il faille forcément viser les États-Unis pour les importations, puisque c'est un pays plutôt cher. Il faudrait préférer les pays de la Caraïbe, de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Il faut bien comprendre que produire a un coût environnemental qu'il faut bien payer à un moment donné.
Se fournir directement auprès de ces pays éviterait que ces produits passent d'abord par l'Union européenne, pour être ensuite de nouveau transportés, comme c'est le cas actuellement, avec des coûts de transport encore plus importants.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Pendant très longtemps, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se sont approvisionnés en produits américains via Puerto Rico. Il faudrait pouvoir créer des flux. La CMA CGM nous a expliqué que, pour créer une ligne maritime, il fallait du flux et du reflux. En d'autres termes, pour importer, il faut être en mesure d'exporter. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de lignes maritimes entre les petits territoires. En outre, il faut tenir compte du verdissement du transport maritime.
La CMA CGM a décidé de créer deux hubs en Guadeloupe et en Martinique. Plus aucune ligne ne rejoint directement Saint-Martin et chaque container doit faire je ne sais combien d'escales avant d'arriver en Guyane. Il faudrait lancer une étude approfondie sur les possibilités d'import-export entre ces îles.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - J'ai bien conscience que, s'agissant des États-Unis, il vaut mieux exporter qu'importer.
Reste qu'il faut trouver d'autres possibilités d'y arriver : il y a tout de même des monopoles sur les transports maritimes qui posent question ! Il y va de l'intérêt et du développement des territoires.
Je suis très inquiète sur l'avenir de ces territoires en matière de développement économique et d'emploi. Quid du devenir de ces îles demain et après-demain pour une jeunesse qui a moins de perspectives ? C'est pourquoi il faut peut-être bousculer les choses, développer les points forts de ces territoires et interroger la réalité de nos liens avec l'environnement. Tous les ans, certaines îles perdent des habitants.
M. Manuel Marcias. - Je rappelle que notre étude ne porte que sur les biens. Toutefois, une meilleure intégration régionale permettra un développement plus important. Je pense à des coopérations régionales scientifiques sur l'impact du réchauffement climatique ou les sargasses dans le bassin Atlantique, ainsi qu'à des coopérations régionales de services.
Il ne faut pas non plus oublier le tourisme. Alentour, la plupart des économies dépendent très largement du tourisme. Un bien qui est consommé sur place par un touriste, c'est aussi un bien exporté ! L'exportation au sens propre ne doit pas être l'unique objectif. Un touriste qui consomme sur place, c'est de la création de valeur venue de l'extérieur sur le territoire.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure. - En Guadeloupe et en Martinique, de jeunes femmes développent des soins écolos, un peu bobo - ce n'est pas péjoratif ! Ce faisant, ces jeunes valorisent leur territoire, ses forces et la nature. Cela peut favoriser un tourisme un peu différent, qui viendra de métropole, mais aussi d'un environnement plus proche. C'est important et source d'espoir.
Mme Solanges Nadille. - Je conclurai sur une note positive. Pendant longtemps, la canne à sucre et la banane ont été les seuls produits d'exportation majeure ; aujourd'hui, la Guadeloupe développe une culture très sélective de la vanille qui est exportée à l'international, en particulier au Japon. De la même façon, si les États-Unis ne connaissent pas encore notre rhum, ce n'est pas le cas du Japon ! C'est bien la preuve que c'est possible.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Il ne faut pas oublier le marché canadien, qui a développé des liens avec les territoires ultramarins grâce à des étudiants partis y suivre leurs études.
Vous avez parlé de coopération scientifique. Une start-up a inventé un processus de fabrication de biocarburant à partir des rejets des distilleries et de sargasses. C'est prometteur, c'est aussi une ouverture vers de l'exportation de la production locale.
Nos territoires regorgent de potentiels, mais nous n'arrivons pas encore à bien les mettre en valeur.
M. Manuel Marcias. - J'ai dû enlever de nombreux éléments pour respecter les critères de la Banque de France, mais à l'origine, nous parlions bien des éléments portuaires. Les outre-mer ont un indice de connectivité assez faible au niveau international. En revanche, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, qui ont des ports plus petits, les infrastructures portuaires de nos Drom se situent plutôt bien dans l'environnement régional, entre les ports des petites économies et les grands ports régionaux. La Guadeloupe et la Martinique, par exemple, sont derrière la Jamaïque ou la République dominicaine, mais bien devant la Barbade.
Nous disposons donc d'infrastructures de qualité. Le port de la Guadeloupe possède, il me semble, la plus importante zone réfrigérée de l'arc caribéen. Nous avons des ports technologiques, avec des infrastructures récentes, de qualité, rénovées relativement récemment, des longueurs de quais très importantes et des tirants d'eau assez élevés par rapport à la région. Il ne faut pas se laisser distancer sur la compétitivité des ports, mais il faut garder à l'esprit qu'ils sont déjà très compétitifs et voir ce que nous pouvons faire avec cet atout.
Concernant l'aspect environnemental, des études d'impact doivent être menées, mais nos ports figurent parmi les plus efficaces de la zone. J'exprime ici une opinion personnelle : la richesse de nos outre-mer étant aussi leur richesse écologique, il faut déterminer si nous avons atteint un niveau de saturation de nos ports ou si, dans un avenir proche, les bateaux ne s'y arrêteront plus. La question est là. À un horizon de quelques années, la réponse est non, mais il faudra voir à terme ce qui sera nécessaire.
Enfin, nous sommes dépendants d'un seul armateur : s'il estime qu'un plus gros bateau est nécessaire, que faisons-nous ? Cette question est un peu trop complexe pour ma modeste étude. J'ai une opinion personnelle sur le sujet, mais qui ne saurait permettre de répondre de manière politique à cette question.
Mme Micheline Jacques, présidente. - Merci. Vous faites le lien avec les travaux futurs de la délégation sur les filières d'excellence, les atouts et la croissance économique des outre-mer. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas assez d'études statistiques permettant de mettre en lumière les pistes pour le développement économique des outre-mer. Merci infiniment de vous intéresser à ces territoires.
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 10 h 30.
* 1 Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Saint-Kitts-et-Nevis. Cette reconnaissance a des contreparties, notamment le bénéfice d'un programme d'aides important. Elle permet aussi de donner des gages vis-à-vis des États-Unis.
* 2 Cf « 3. La montée en puissance des organisations internationales à caractère régional » du rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 3528, déposé le vendredi 6 novembre 2020, sur l'« Environnement international des départements et collectivités d'outre-mer ».
* 3 Question au gouvernement n°286 publiée le 16 novembre 2022 sur le « Retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes ».
* 4 Audition d'Anthony Farisano, directeur général délégué du CIRAD le 16 septembre 2025.
* 5 François Taglioni, « L'association des États de la Caraïbe dans le processus d'intégration régionale. Quelle insertion pour les Départements Français d'Amérique ? », des Annales d'Amérique latine et des Caraïbes, n° 14-15, 1997.
* 6 Laurent Giaccobi, « Les Outre-mer caribéens : interface géopolitique ? », dans « Outre-mer : la France contestée », Politique étrangère, 2025/1, p. 40.
* 7 Les sept membres fondateurs bénéficiant de la pleine adhésion.
* 8 Le Venezuela a organisé le 3 décembre 2023 sur son seul territoire un référendum visant à annexer le territoire de l'Essequibo, revendiquant « les droits inaliénables du Venezuela et de son peuple sur le territoire d'Essequibo ». En mars 2024, le Venezuela adopte une loi qui désigne l'Essequibo en tant qu'État constitutif du Venezuela.
* 9 En 2024, l'OFPRA a admis 75 % des demandes en Guyane, contre 40 % au niveau national.
* 10 Laurent Giaccobi, « Les Outre-mer caribéens : interface géopolitique ? », dans « Outre-mer : la France contestée », Politique étrangère, 2025/1, p. 40.
* 11 Étude sur « La circulation des biens et des personnes dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la Guyane, le Brésil, le Suriname et le Guyana », CESECE Guyane, octobre 2024, p.6.
* 12 https://www.senat.fr/notice-rapport/2023/r23-763-notice.html
* 13 Audition de Nathalie Estival-Broadhurst, 10 avril 2025.
* 14 Audition du Dr Didacus Jules, 17 septembre 2025.
* 15 Article sur « L'entrée de la Martinique dans la Caricom, « un événement historique » pour Thani Mohamed Soilihi », RCI, 21 février 2025.
* 16 Rapport d'information du Sénat n° 264 (2024-2025) déposé le 23 janvier 2025 par Philippe Bas et Victorin Lurel, intitulé « L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien ».
* 17 Elle a été formalisée par l'accord-cadre de coopération franco-brésilien du 28 mai 1996.
* 18 Dans une convention signée en 1915, dite de Paris, la frontière a été délimitée entre l'île Portal (à hauteur de Saint-Laurent du Maroni) et l'île Stoelman (à hauteur de Grand-Santi) selon le principe de la ligne médiane. Elle a ensuite été précisée de l'embouchure jusqu'au début de la rivière Lawa, avec des points GPS, par un protocole additionnel signé en 2021 et non ratifié à ce jour. Enfin, la troisième partie de la frontière ne fait pas l'objet d'un consensus ; elle se situe sur la rivière Litani selon les cartes françaises et sur la Marouini sur les cartes surinamaises. La ratification de ce protocole mettrait fin à une période de plus d'un siècle d'incertitudes sur le tracé frontalier et permettrait d'établir cette délimitation dans le respect des règles du droit international et de renforcer la coopération des deux Parties dans toutes les activités liées à la gestion du fleuve, dont le commerce, les mouvements de personnes et de biens.
* 19 https://www.afd.fr/sites/default/files/2025-05-03-18-01/FR_WEB_AFD-Projets%20Ocean%20Atlantique.pdf
* 20 L'État de l'Amapa et du Para ont signé la lettre d'intention. L'Amazonie, sollicité, n'a pas encore signé.
* 21 EU - Latin America and Caribbean Insvestment Agenda. Partnerships on Digital, Climate and Energy, Transport, Health, Education and Research, July 2023.
* 22 Avis relatif à la complexité des aides de l'Union européenne et visibilité de son action d'octobre 2025 par Catherine Lion et Catherine Pajares Y Sanchez, rapporteures. 2025_19_aides_ue.pdf
* 23 Programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».
* 24 Programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement ».
* 25 Bulletin n° 260 de la Banque de France « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ? » de Manuel Marcias. BDF260_1_Iedom_web_pdf (1).pdf
* 26 L'actualité récente montre l'accélération du déploiement des forces navales américaines dans la zone.
* 27 Rapport d'information n° 763 (2023-2024) du 17 septembre 2024 relatif à la coopération et l'intégration régionales des outre-mer - volet 1 : bassin océan Indien par Christian Cambon, Stéphane Demilly et Georges Patient.
* 28 https://cesce-stbarth.fr/etudes-rapports/
* 29 Étude du CESECE Guyane de juillet 2025 sur la circulation des biens et des personnes dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la Guyane, le Brésil, le Suriname et le Guyana CESECE_Guyane_Etude_circulation-des-biens-et-des-personnes.pdf
* 30 Rapport d'information n° 361 (2022-2023) du 16 février 2023, relatif à l'évolution institutionnelle des outre-mer par Stéphane Artano et Micheline Jacques.
* 31 En 2018, la collectivité de Saint-Martin, alors Présidente de la Conférence des RUP, a mandaté la mission opérationnelle transfrontalière (MOT) pour une analyse juridique des typologies d'entité légale envisageable dans le cadre d'une coopération renforcée entre les RUP. Divers statuts ont été présentés pour cette coopération entre régions européennes. Cette analyse qui traite également des possibilités d'intégration d'un partenaire issu d'un pays tiers demeure pertinente dans le cas de la réflexion en cours pour Saint-Martin-Sint Maarten. Le statut du GECT semble être, à priori, l'entité la plus idoine en matière de gouvernance pour formaliser cette coopération transfrontalière. Ce statut comporte, toutefois, quelques limites.
La mission opérationnelle transfrontalière (MOT) est une association créée en 1997 par le Gouvernement français. Forte d'une centaine de membres, elle fédère les acteurs de la coopération transfrontalière aux frontières françaises : structures transfrontalières, régions, départements, communes, groupements de communes et de collectivités, États, fédérations et réseaux, agences d'urbanisme, etc. Au niveau national, elle est soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
* 32 Réunions Quadripartites (ou Q4) impliquant la France, les Pays-Bas, et les autorités locales des deux parties de l'île.
* 33 Un atelier local de transformation devrait néanmoins rouvrir dans les prochaines semaines.
* 34
* 35 État actualisé au 25 novembre 2024 : https://aefe.gouv.fr/fr/carte-des-etablissements ; un établissement partenaire au Brésil n'y figurant plus par rapport à la carte de l'année scolaire 2023-2024 supra.
* 36 https://www.institutfrancais.com/fr/reseau-culturel-francais-monde
* 37 Le COM de l'AEFE 2024-2026 n'a pas encore été approuvé.
* 38 https://www.senat.fr/leg/tas24-090.html
* 39 Une des trois sous-assemblées de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à la suite de la signature de l'accord de Samoa en 2023 et qui succède à l'accord de Cotonou de 2000.
* 40 Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 7 juin 2023 « Un nouveau programme pour les relations entre l'UE et l'Amérique latine et les Caraïbes » eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0017
* 41 La Région Réunion a lancé le 28 août 2025 un appel à projets Feder-NDICI dans le cadre du programme Interreg VI océan Indien 2021-2027. Cet appel vise à renforcer la coopération régionale en soutenant des initiatives autour de la sécurité alimentaire et de la prévention des risques naturels. Une enveloppe de 5 millions d'euros de NDICI est confiée à la Région Réunion par la Commission européenne pour financer des projets conjoints Feder-NDICI.
* 42 COM (2025) 570 final du 16 juillet 2025 eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2025:570:FIN
* 43 Évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ 2021-2027, p.28.
* 44 Ni de l'article 13 de la proposition de règlement de la Commission européenne du 16 juillet 2025, établissant le programme Erasmus+ pour la période 2028-2034, prochainement examinée par le Parlement européen, qui conserve le même périmètre pour les pays associés au programme.
* 45 https://gipfcip-martinique.fr/mobilite-cooperation/
* 46 Caribbean Export a été créée en 1995 en tant qu'unique agence régionale de promotion du commerce du Forum des Caraïbes (CARIFORUM), qui regroupe la Communauté des Caraïbes (Caricom) et la République dominicaine.
* 47 Rapport d'information du Sénat n° 195 (2022-2023), déposé le 8 décembre 2022, par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, rapporteures.
* 48 Résolution n° 167 du Sénat (2022-2023) du 25 juillet 2023 https://www.senat.fr/leg/tas22-167.html
* 49 Dans le cadre du programme « Unleashing the Blue Economy in the Caribbean » (UBEC), porté par l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et la Banque mondiale, qui consacre 15 millions de dollars au territoire test.
* 50 Les députés Mickaël Cosson et Olivier Serva ont présenté les conclusions d'une mission flash sur la valorisation des sargasses et des algues vertes, en avril 2025, recommandant de renforcer la filière française et de lever les nombreux freins actuels.
* 51 https://pressroom.oecs.int/la-commission-de-loeco-annonce-le-succes-du-voyage-detude-geothermique-en-guadeloupe-une-nouvelle-avancee-pour-la-transition-energetique-dans-la-caraibe-orientale