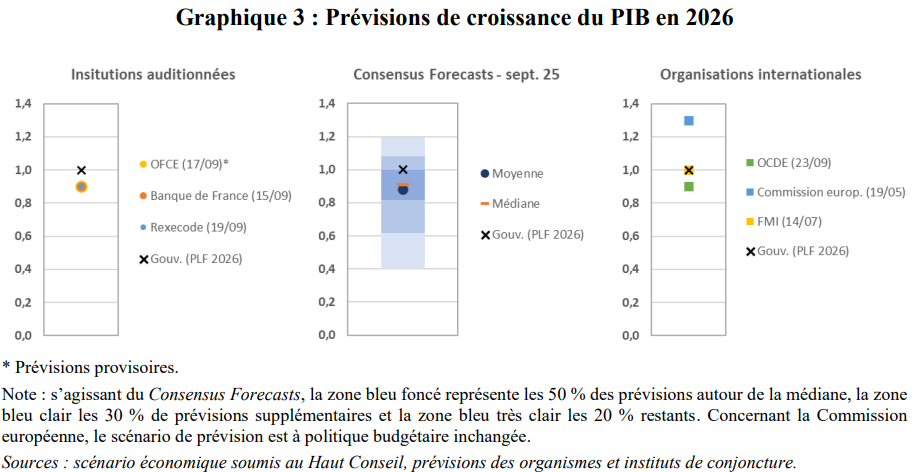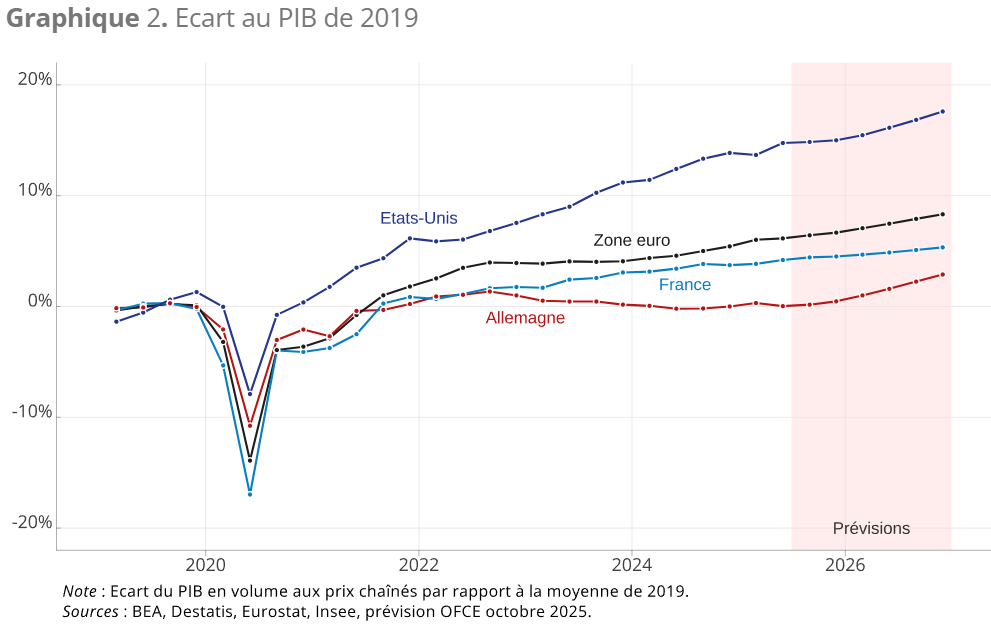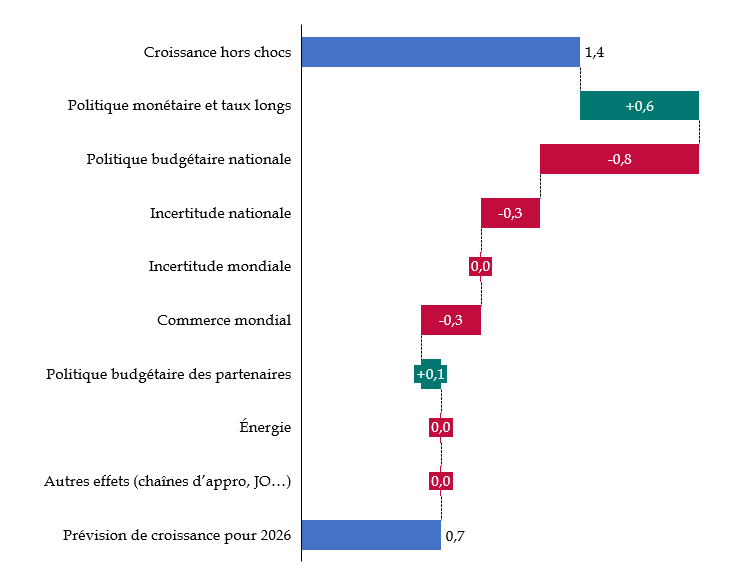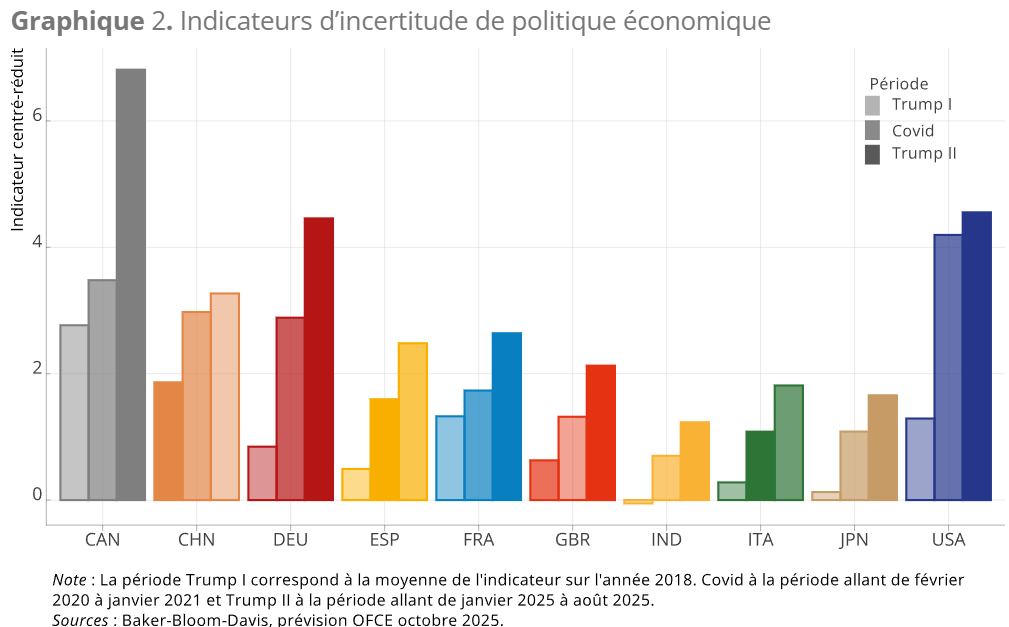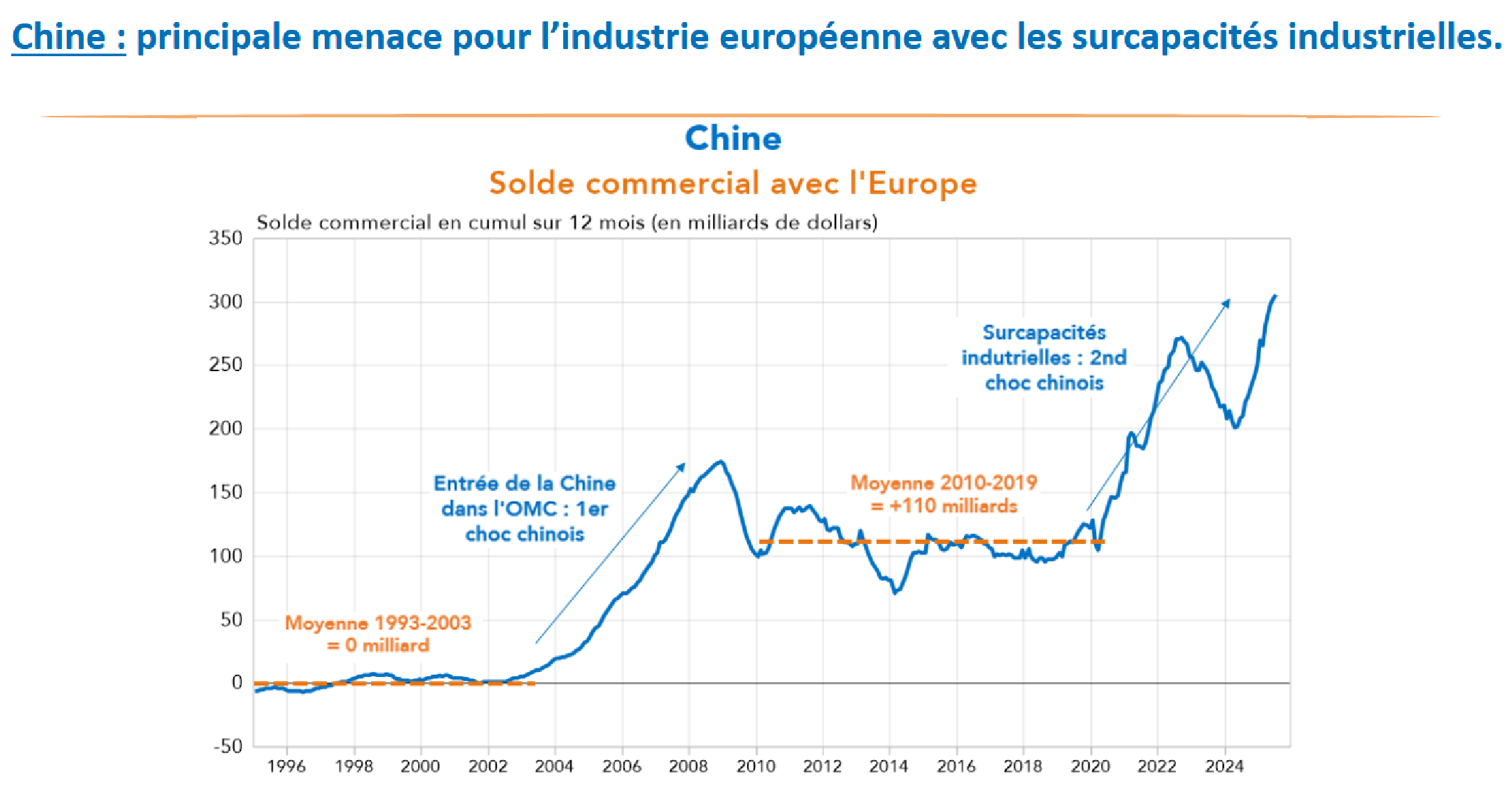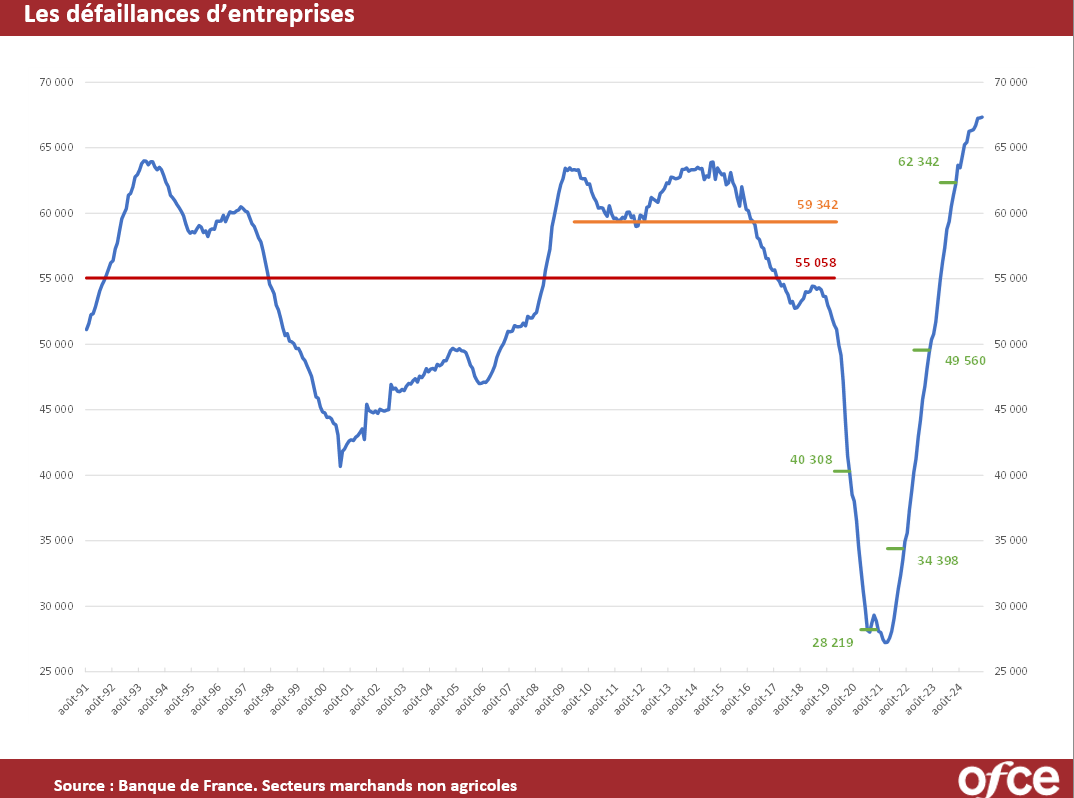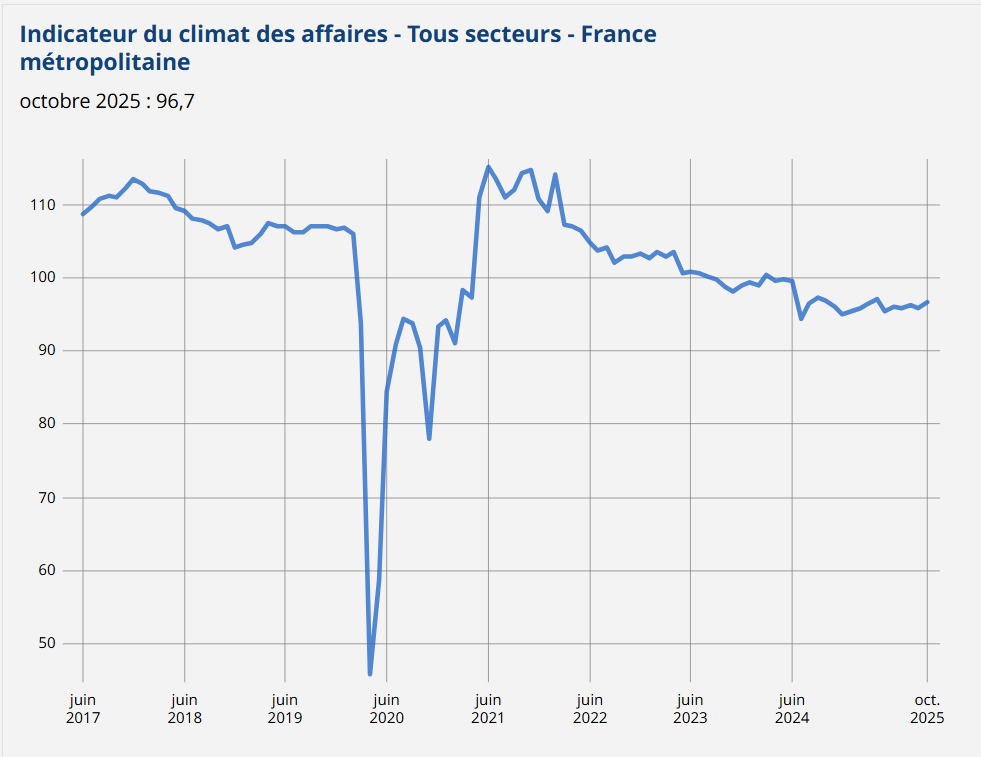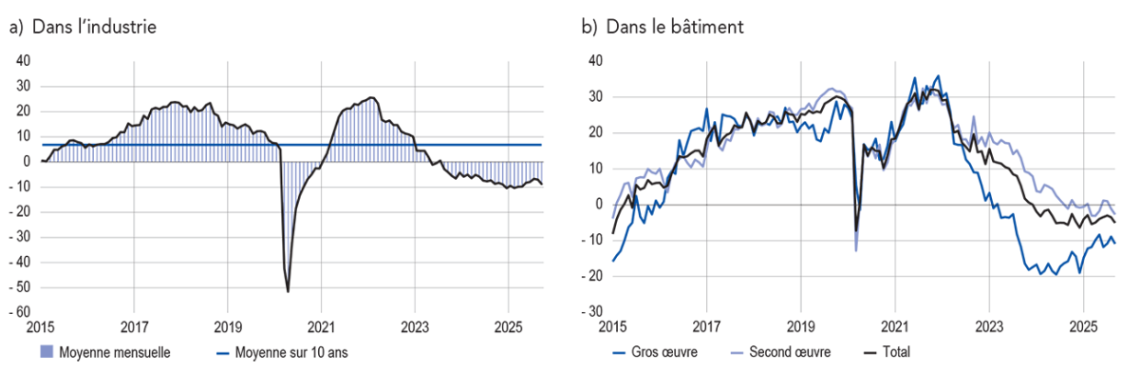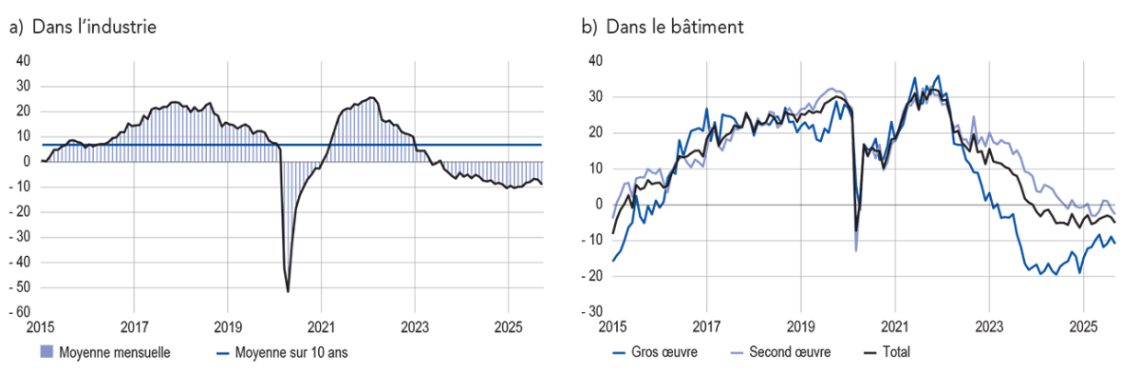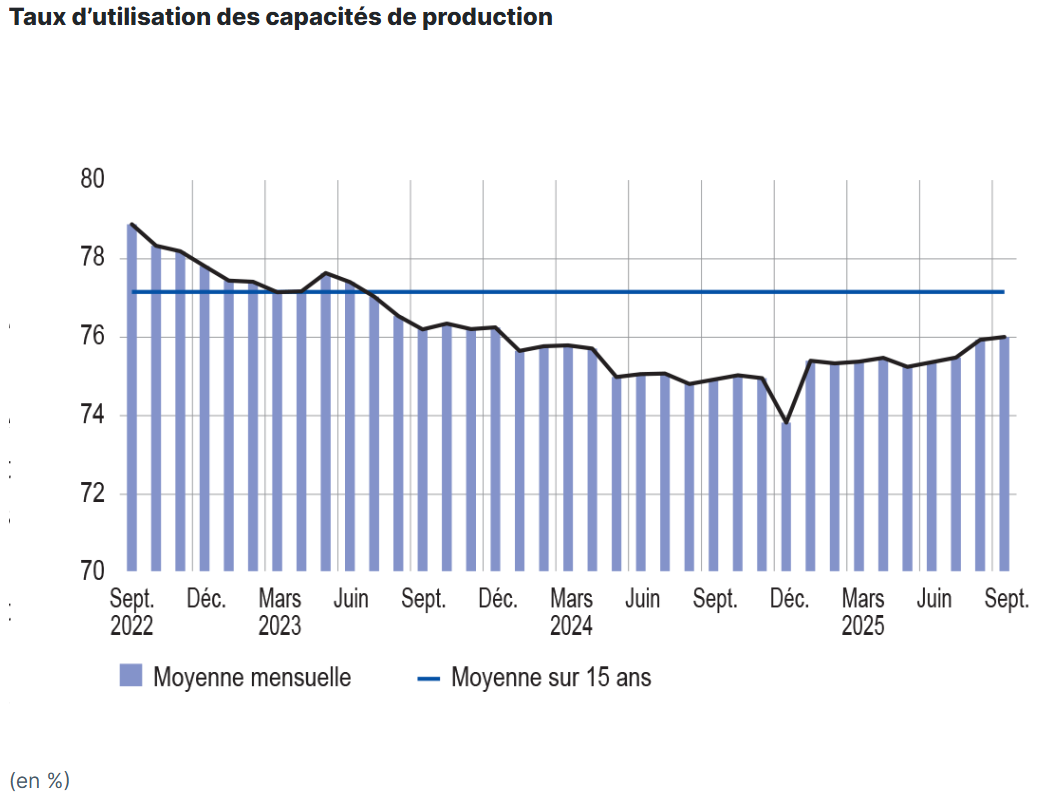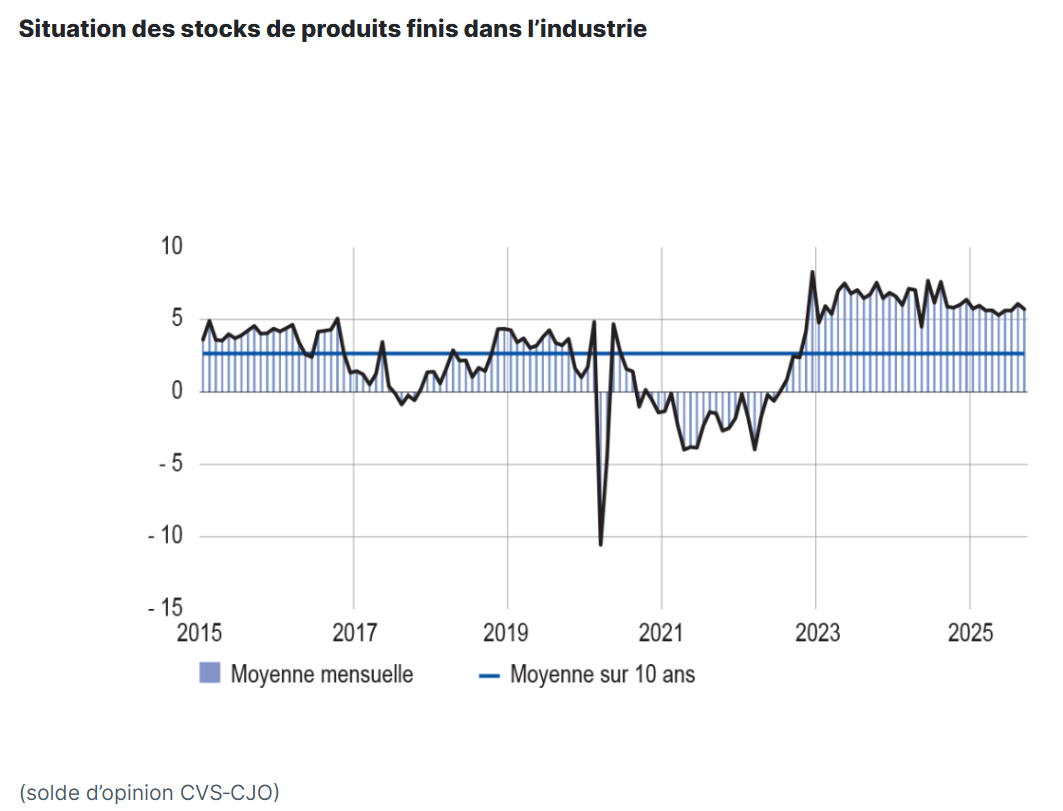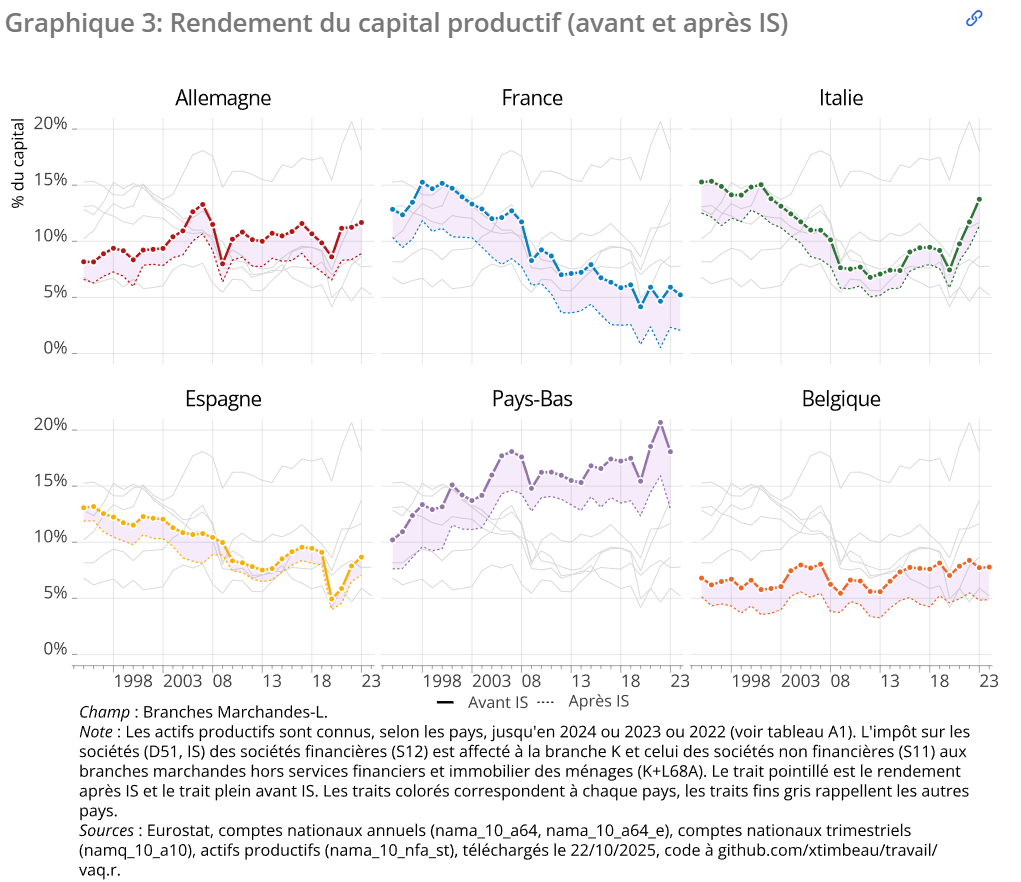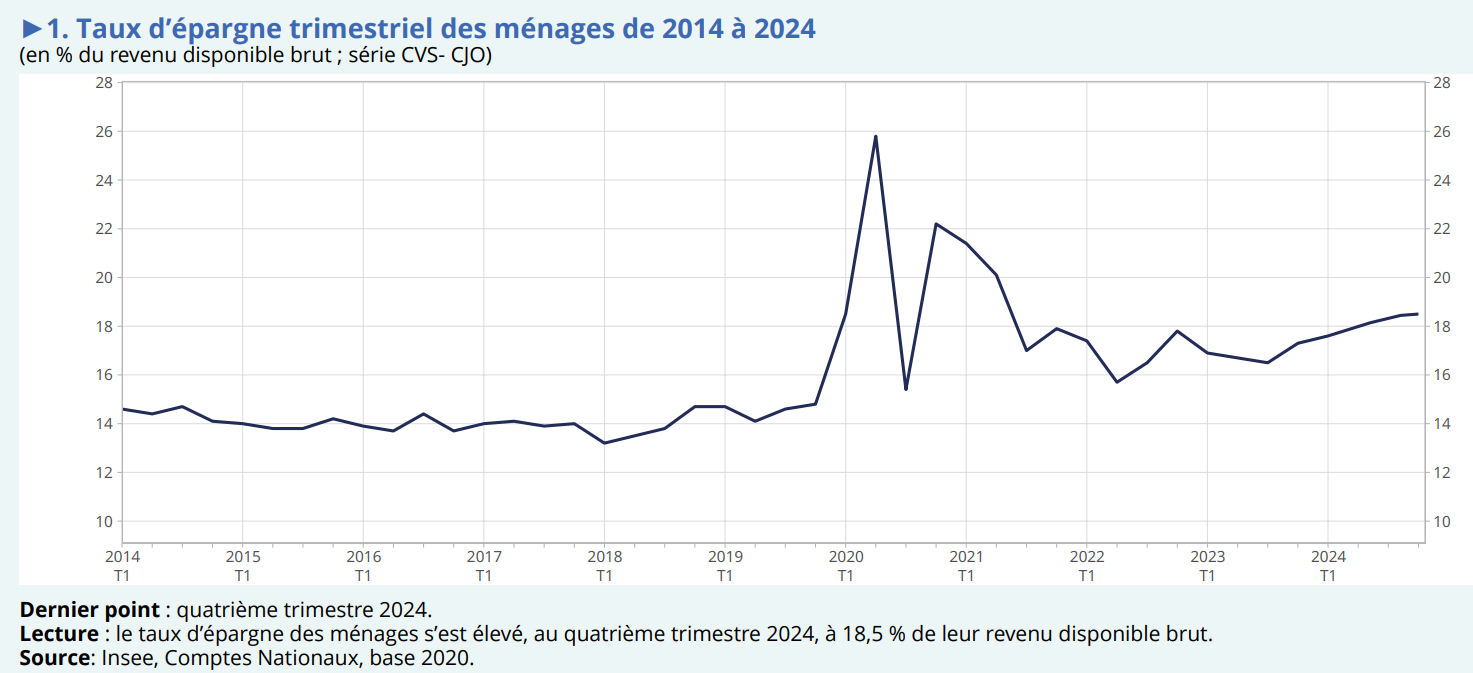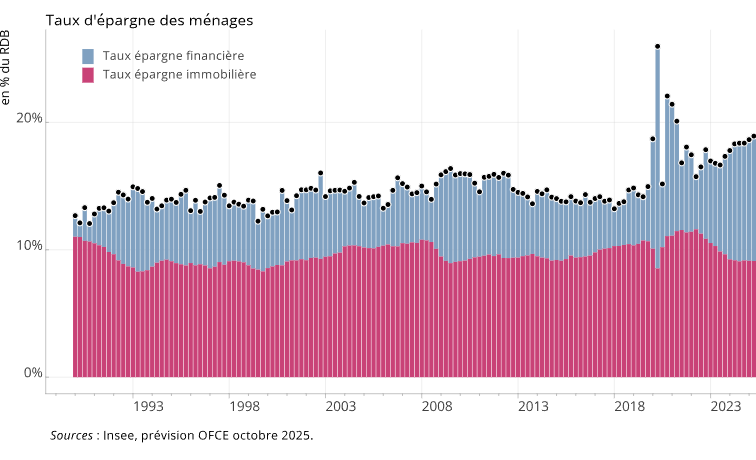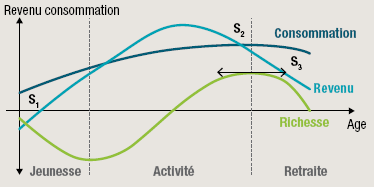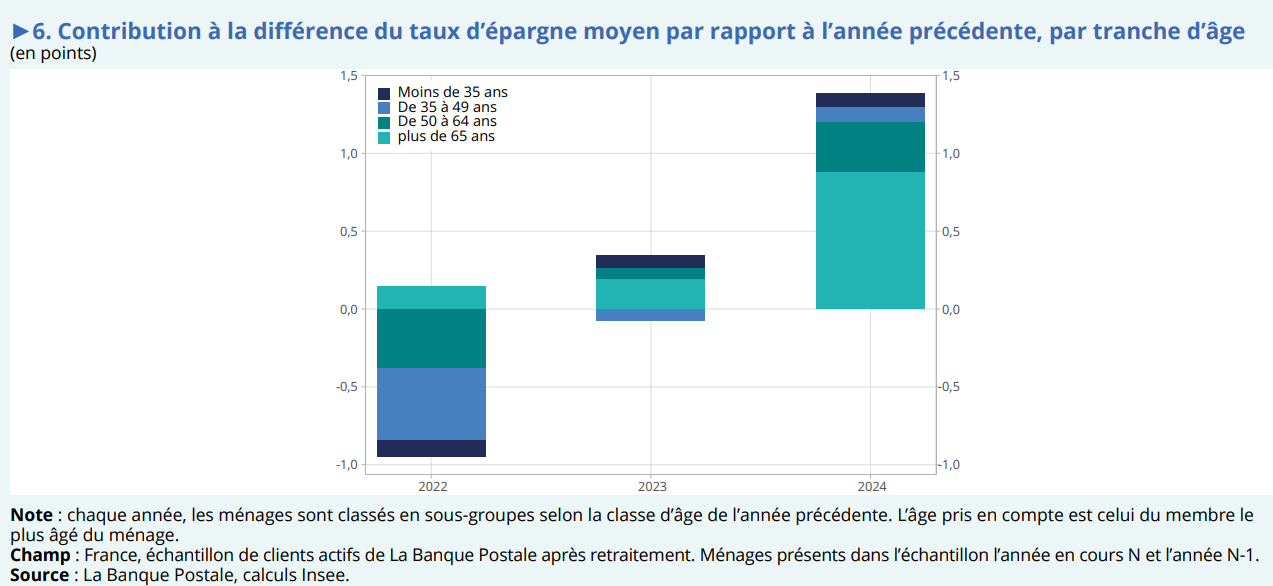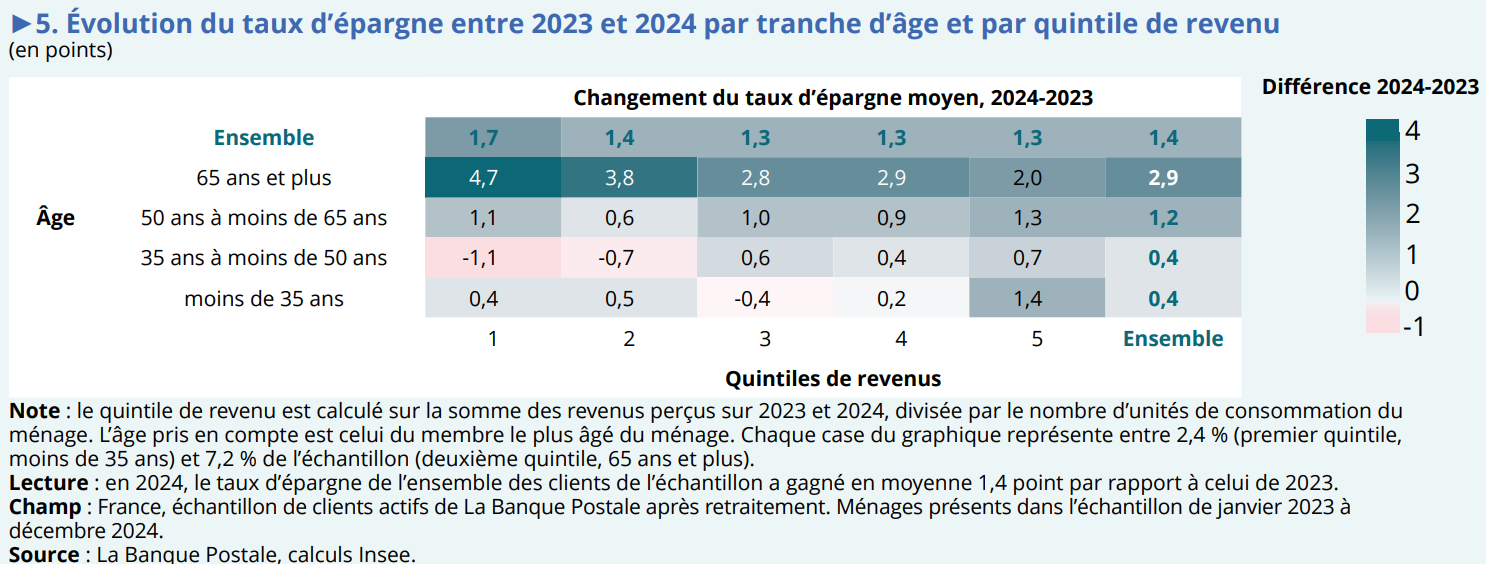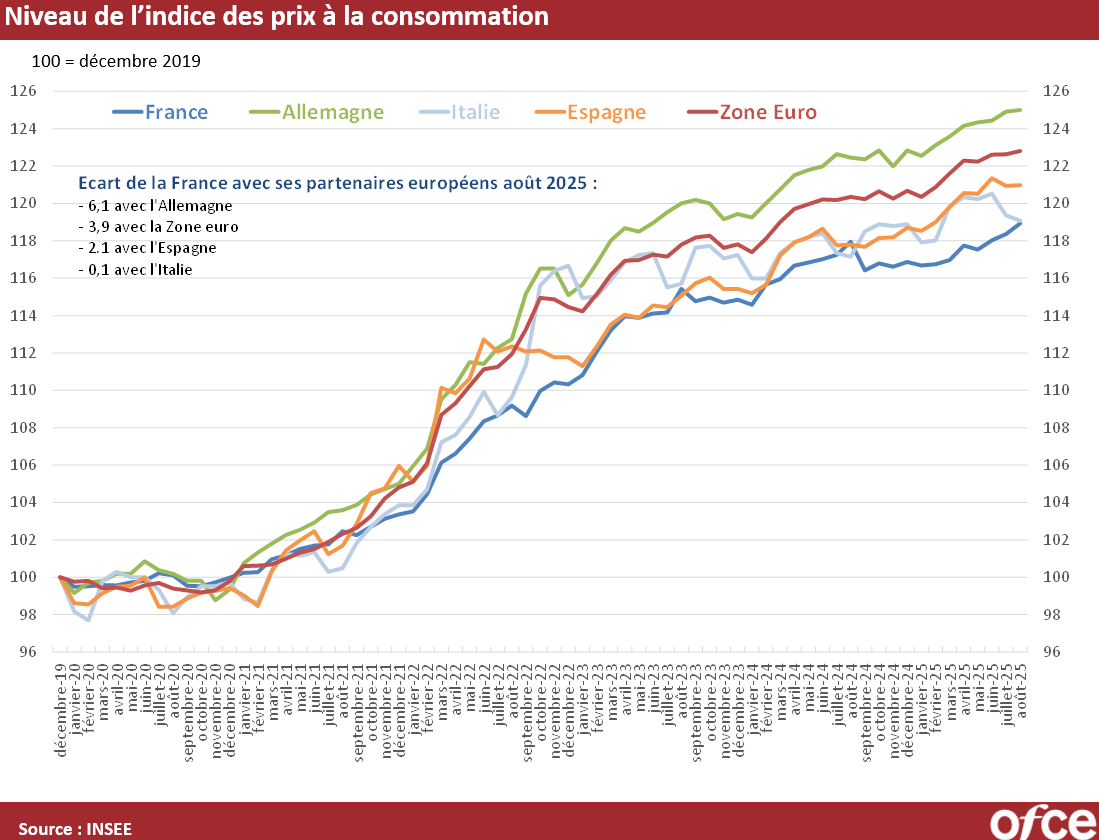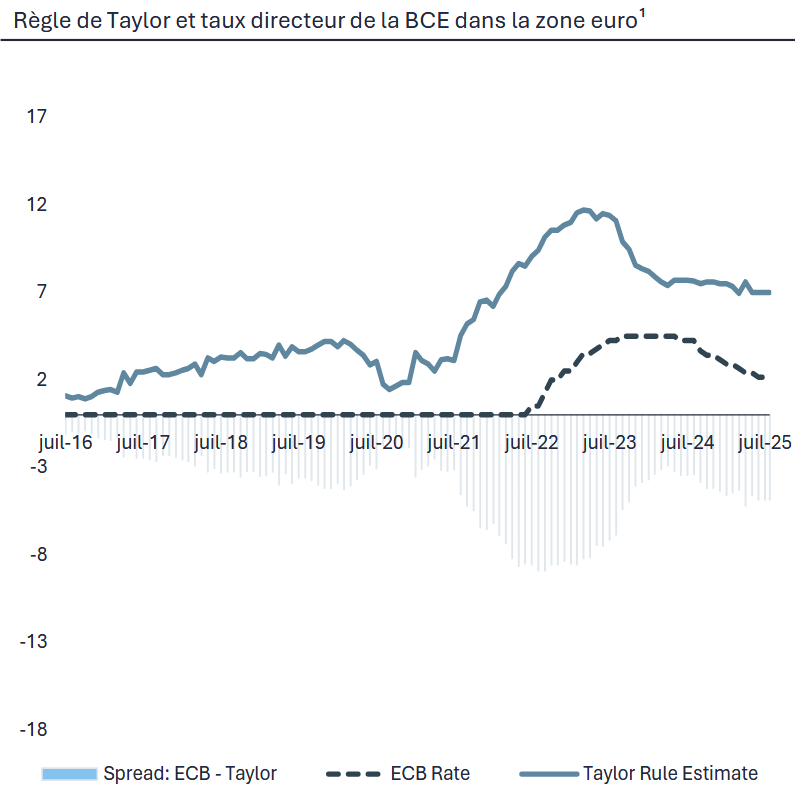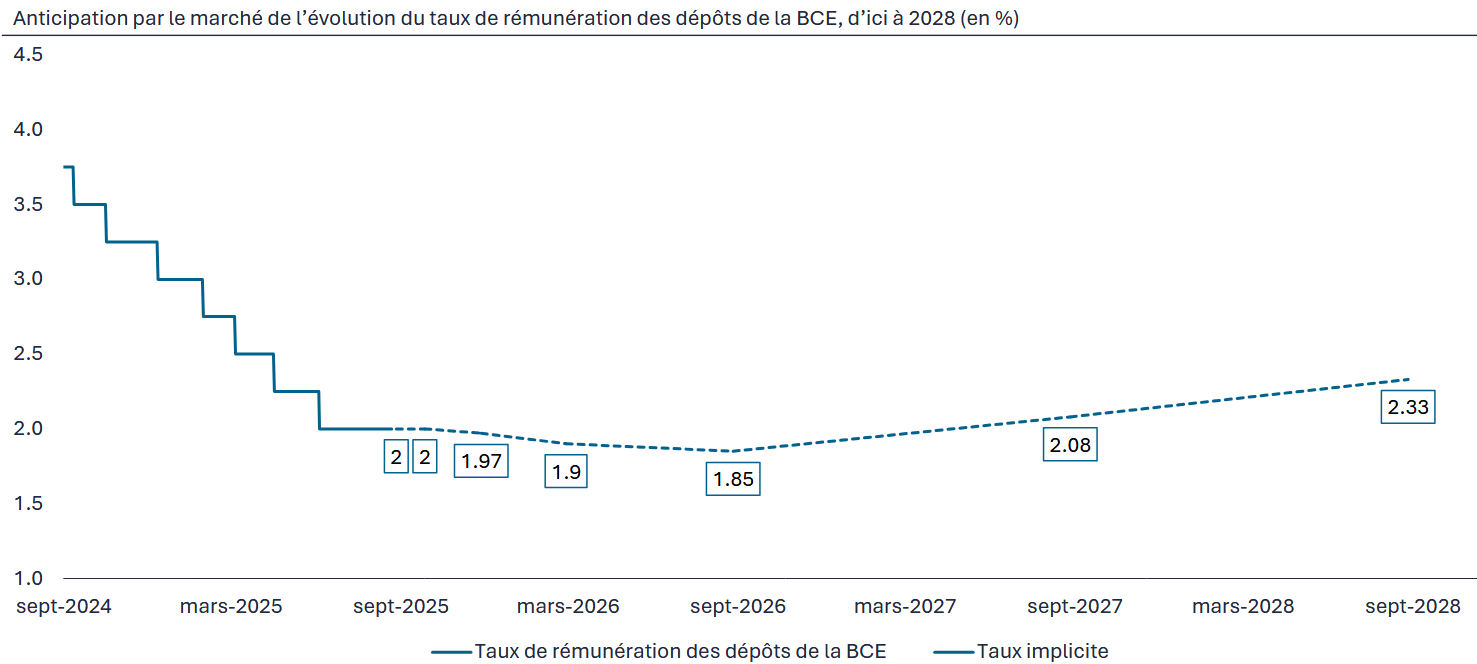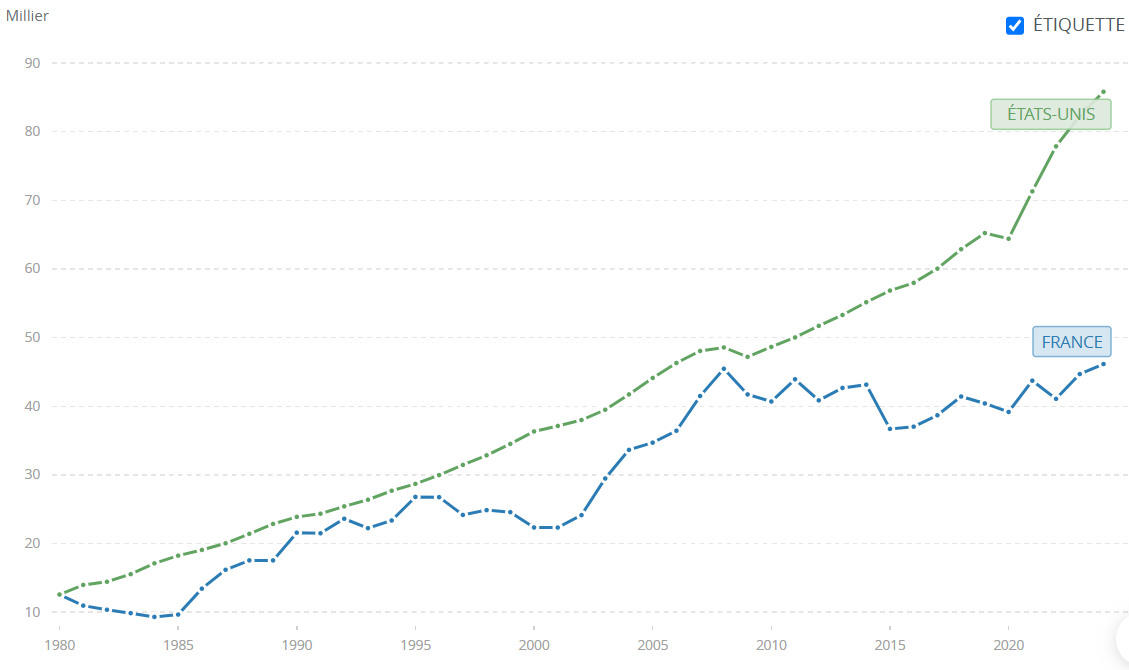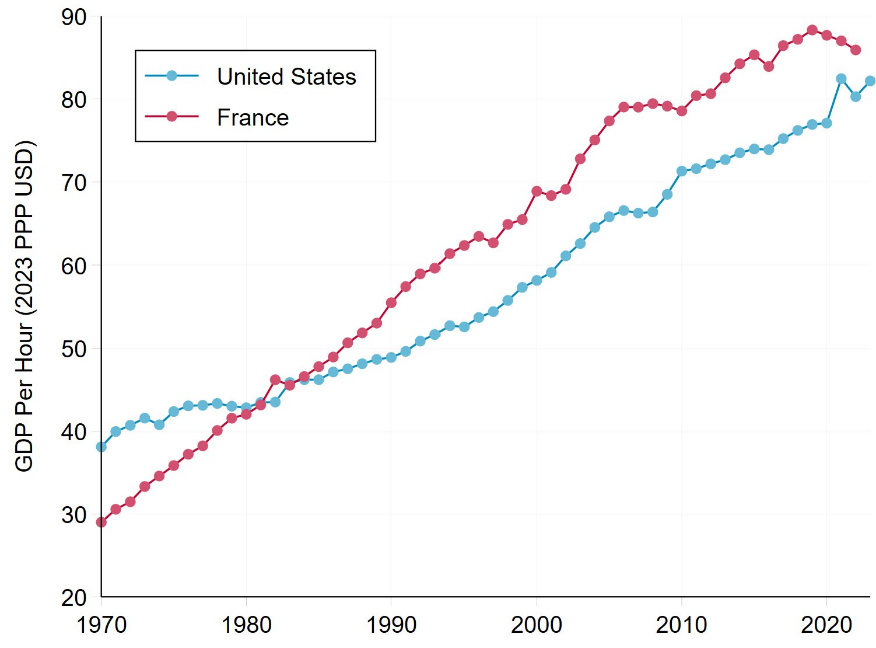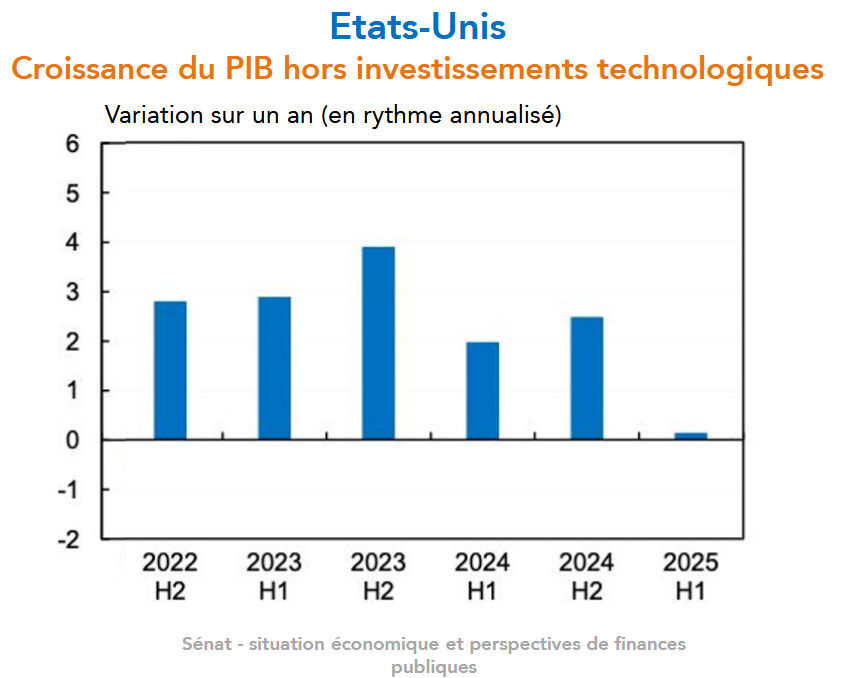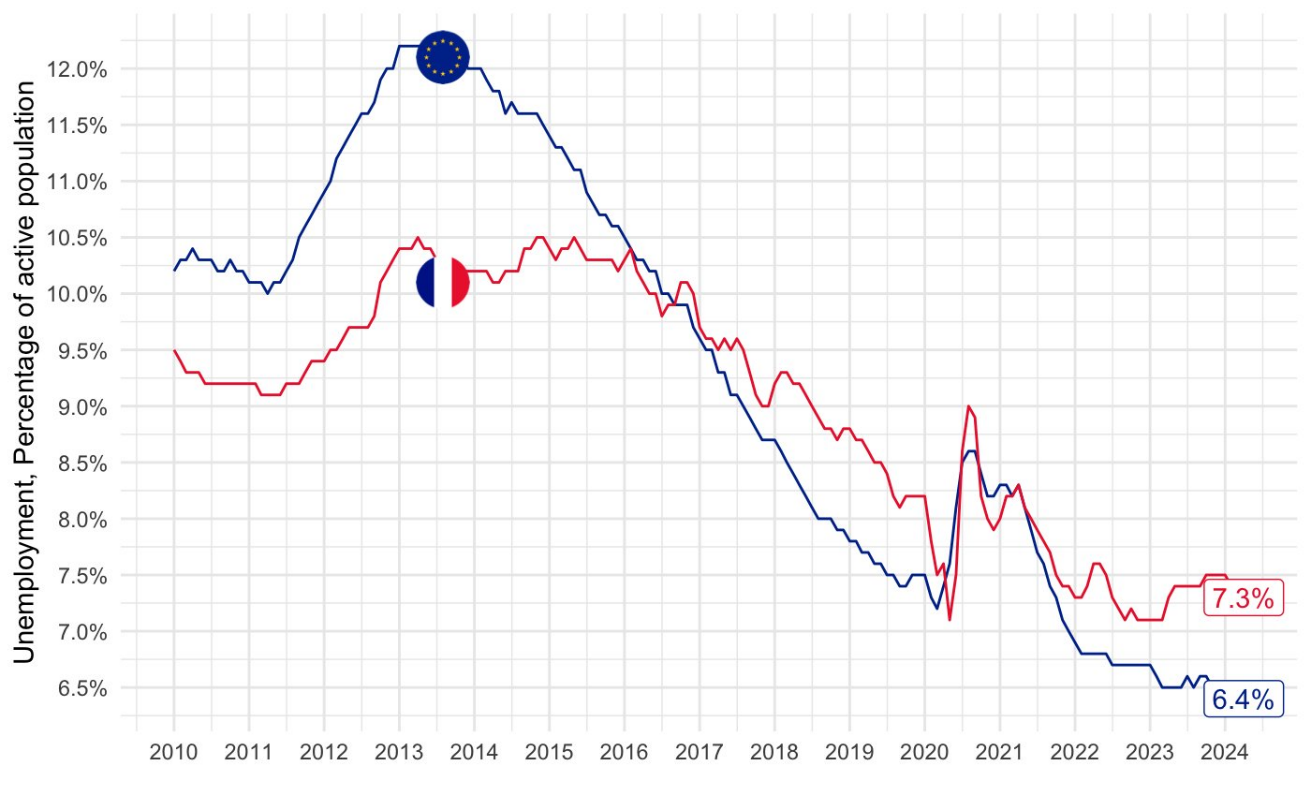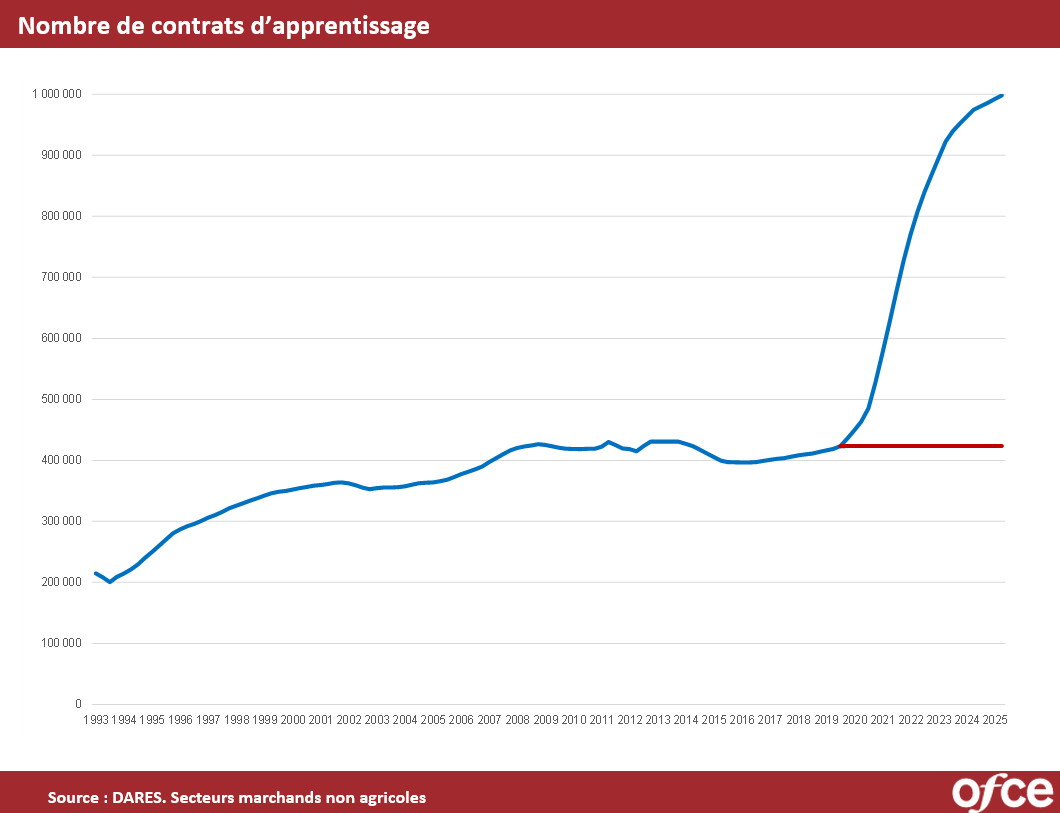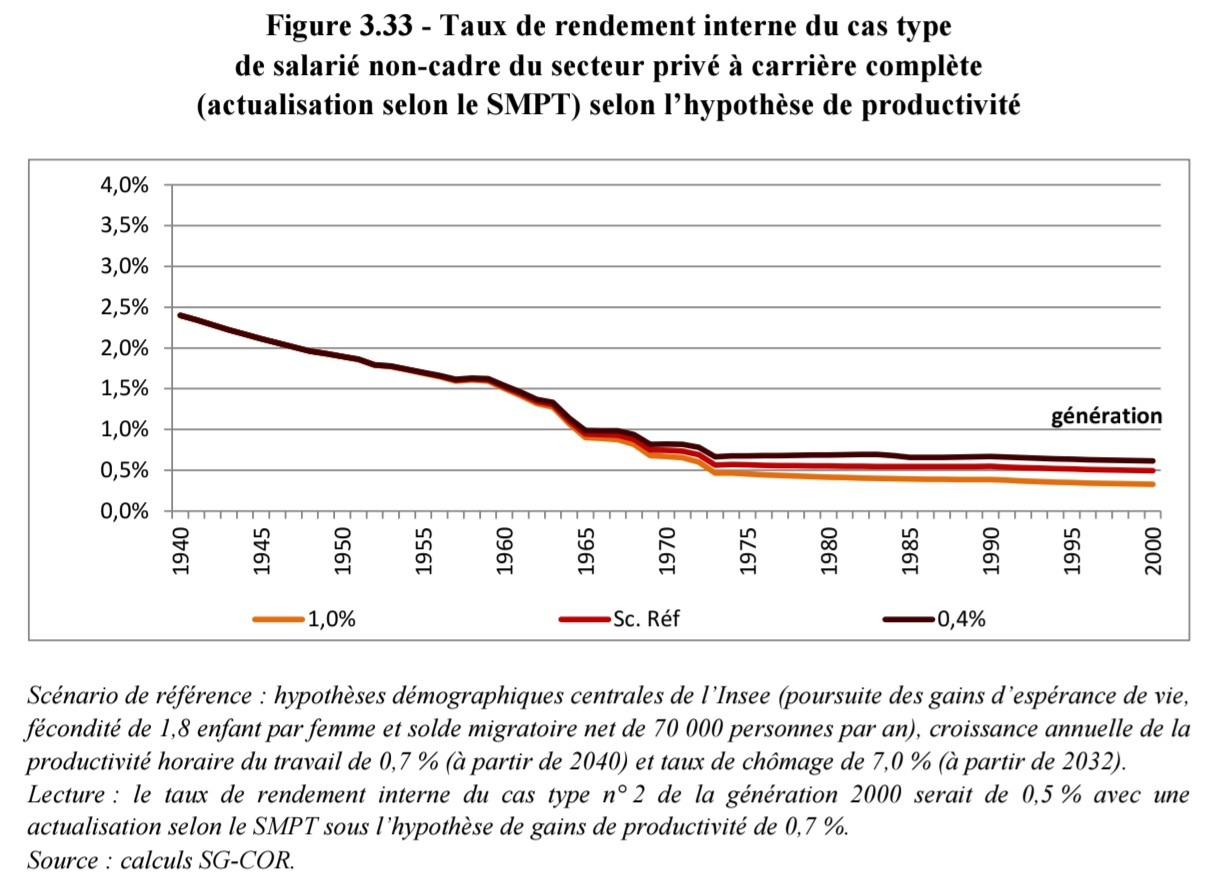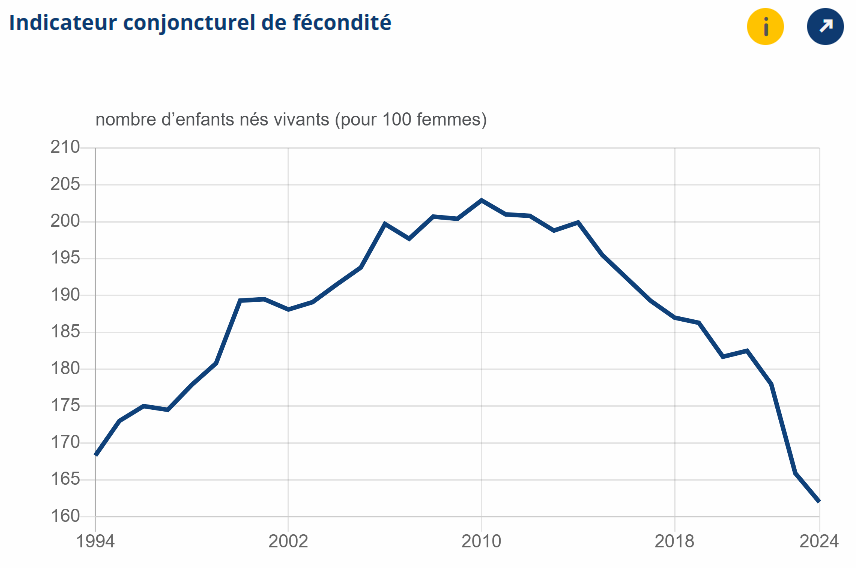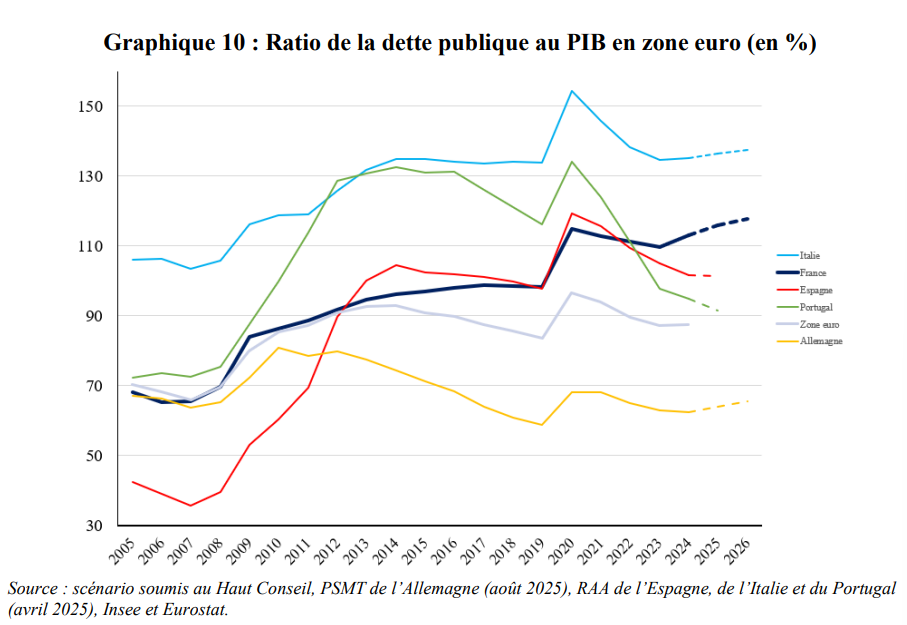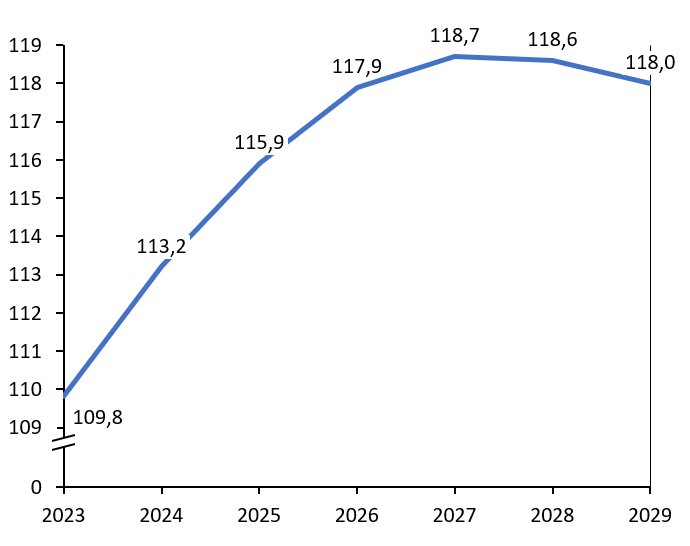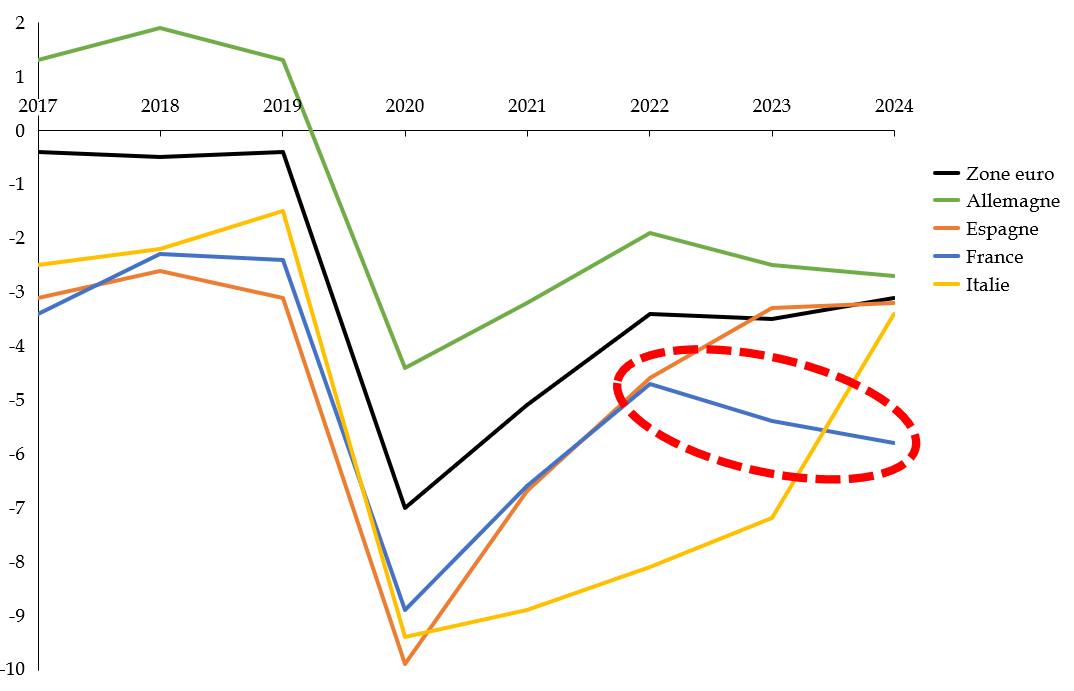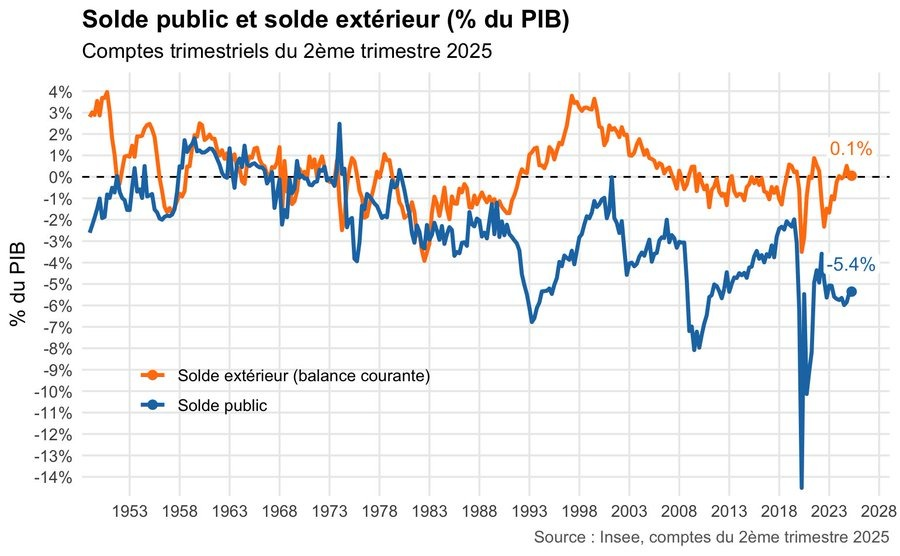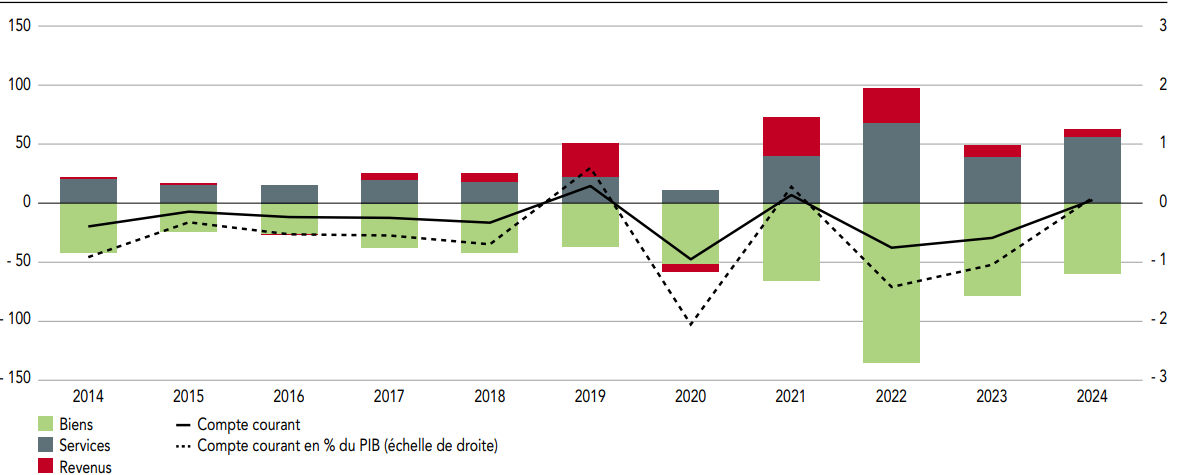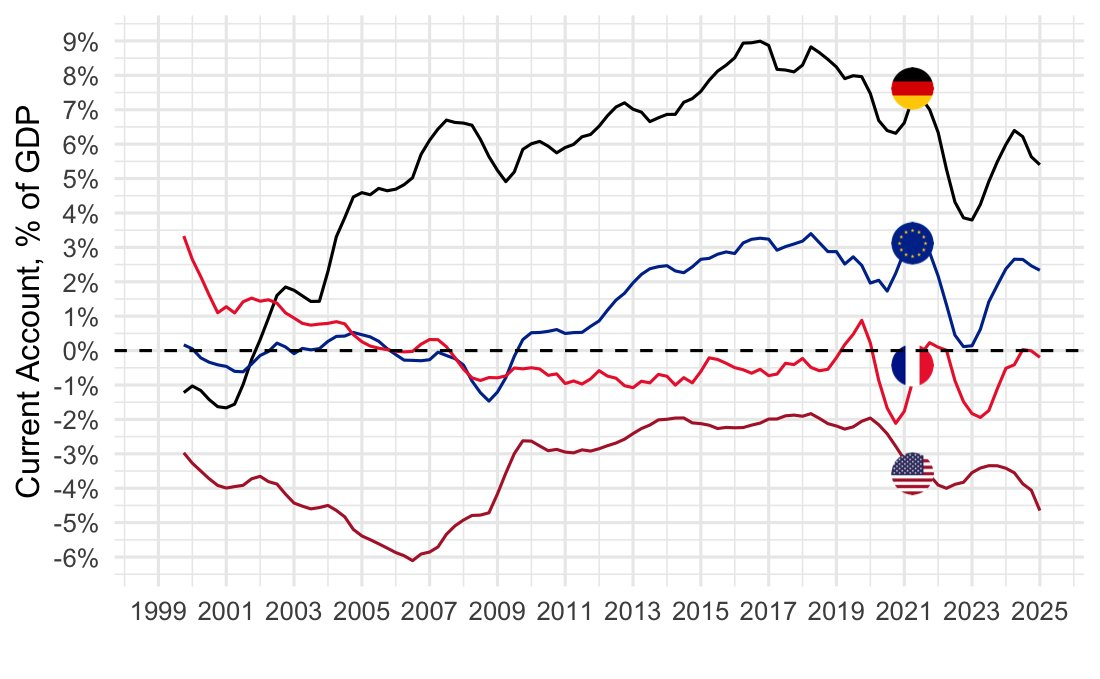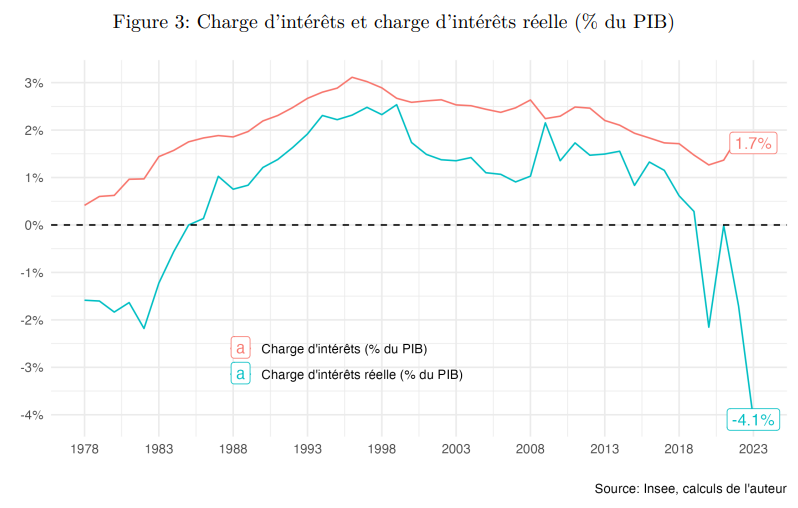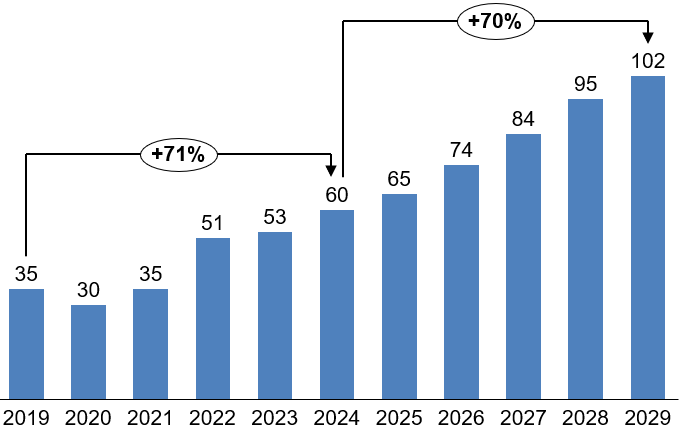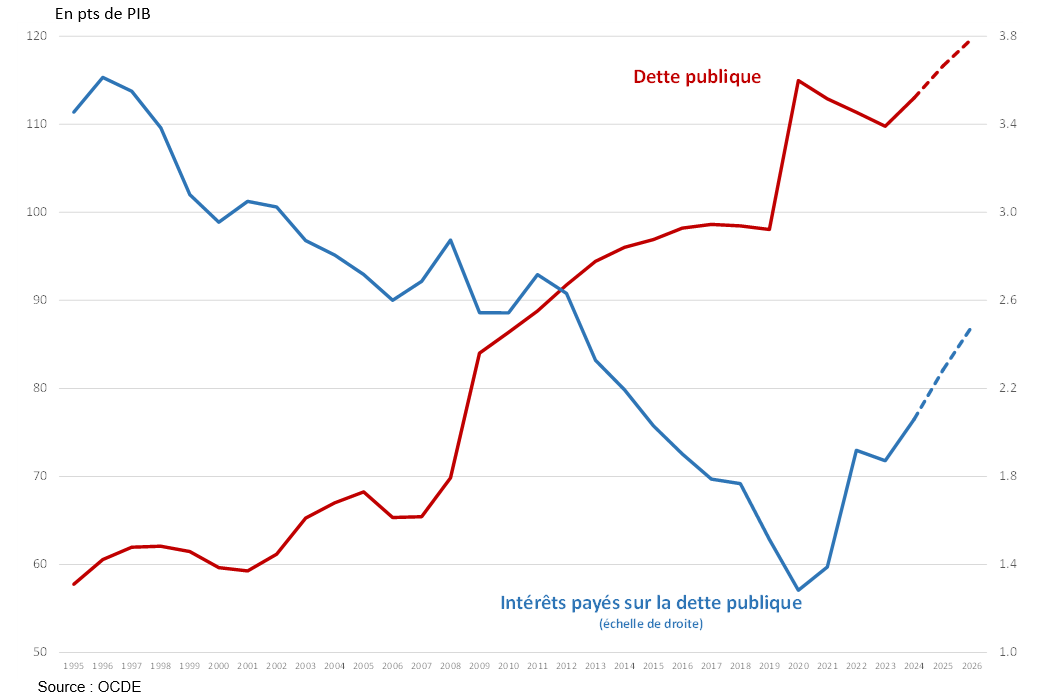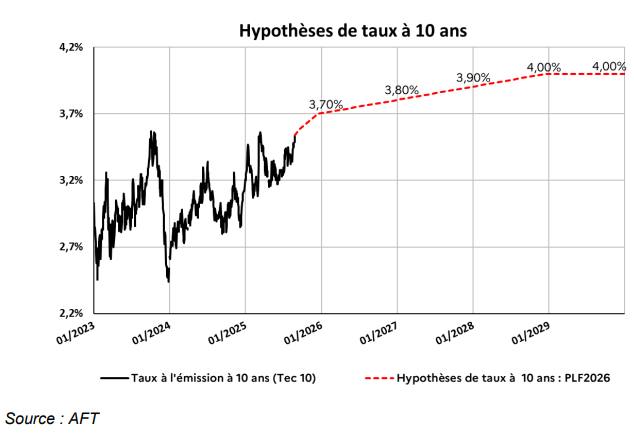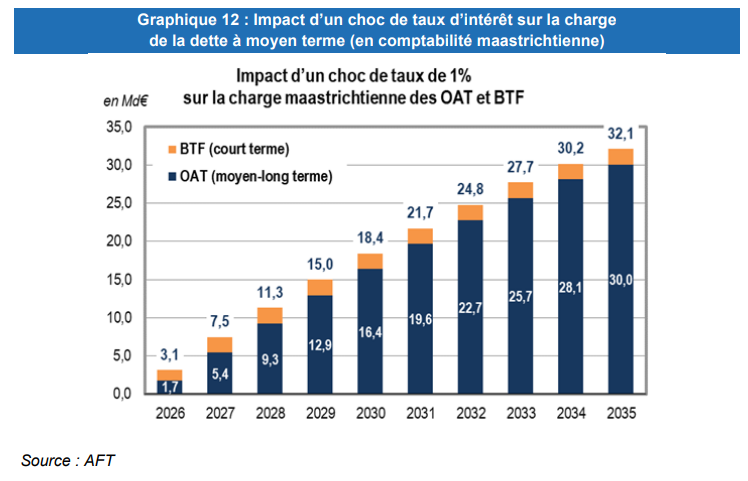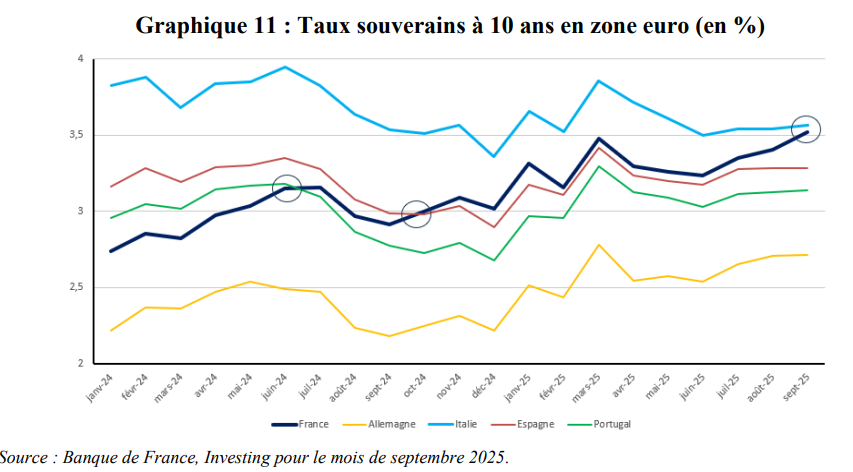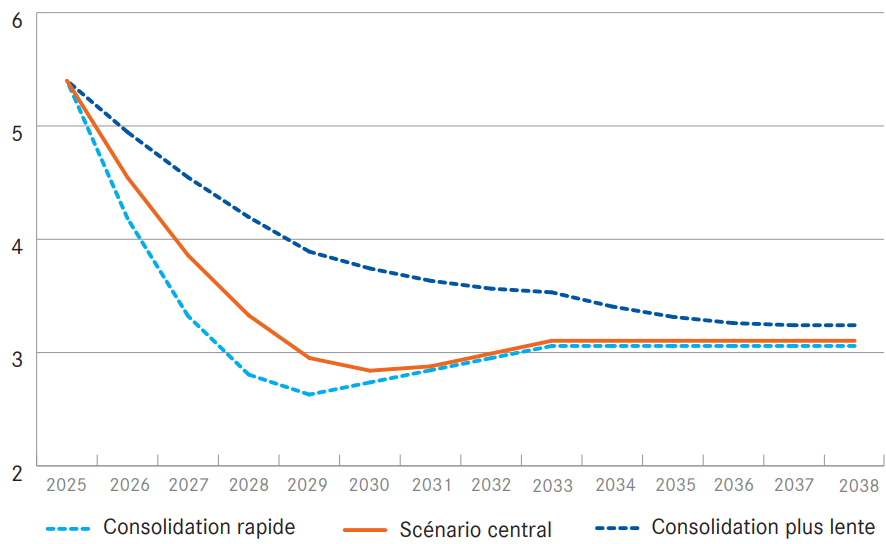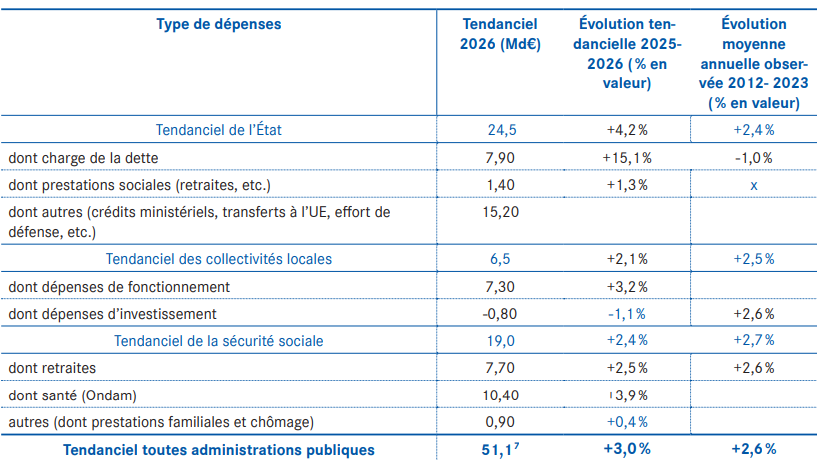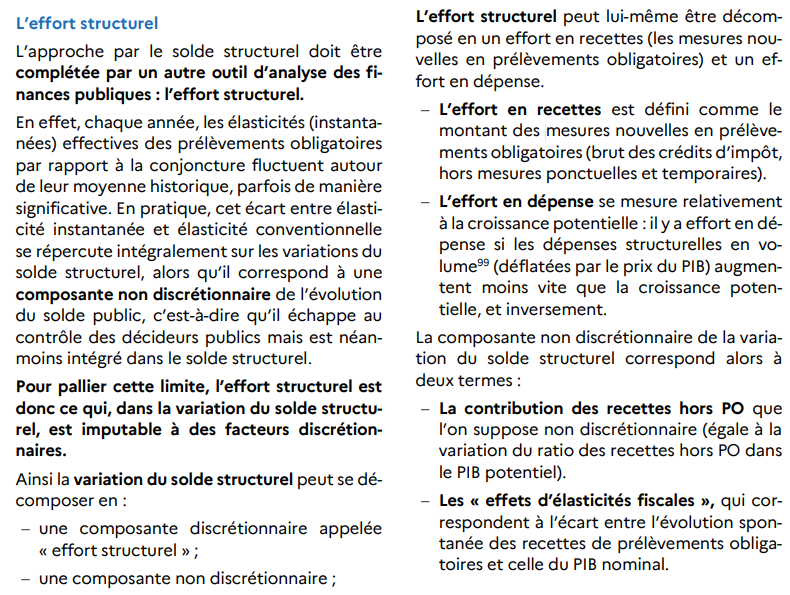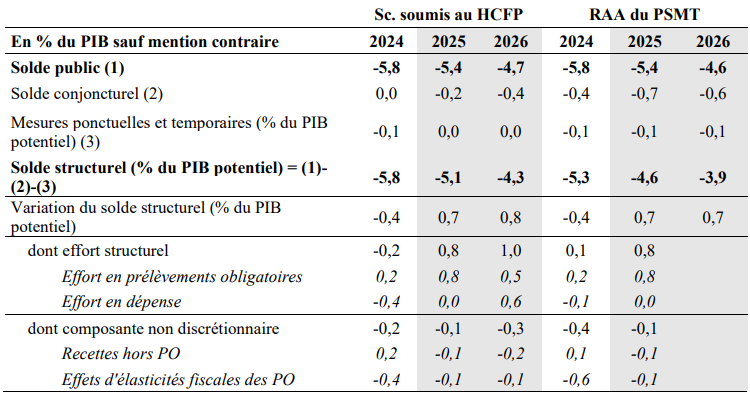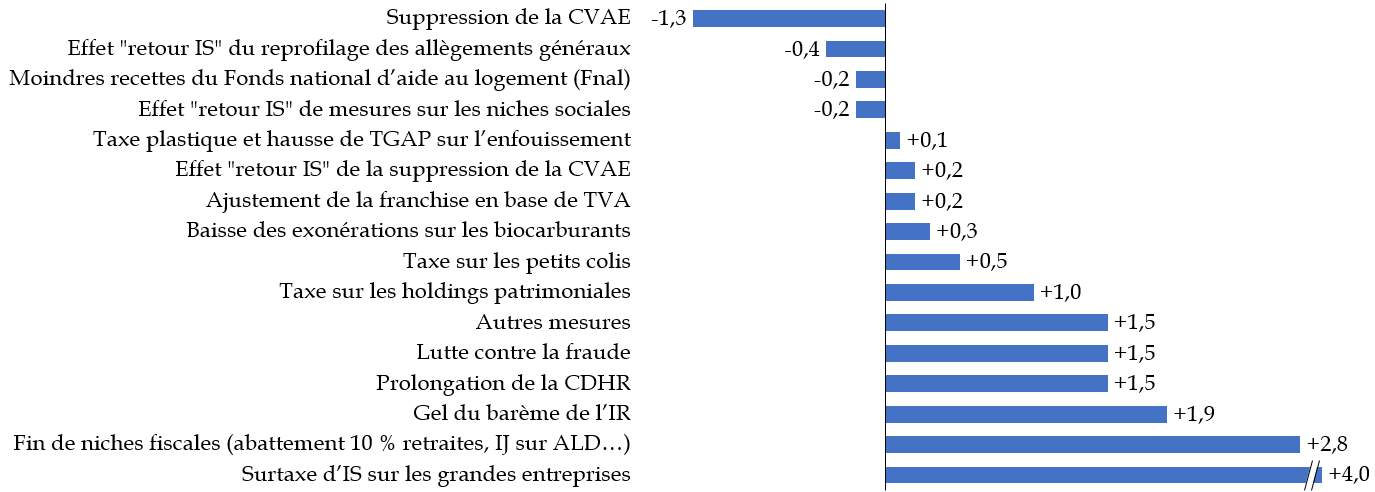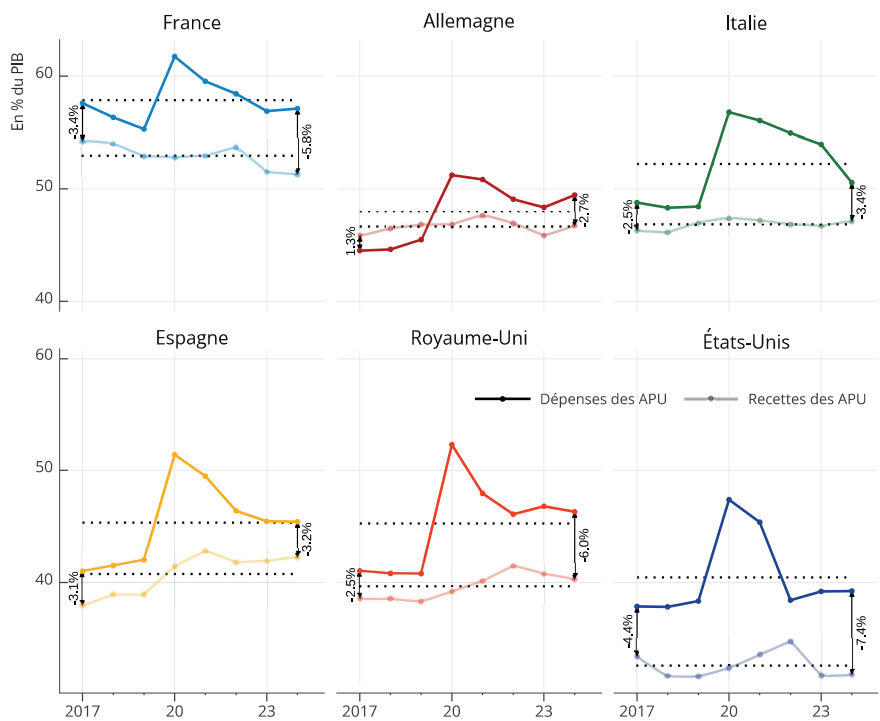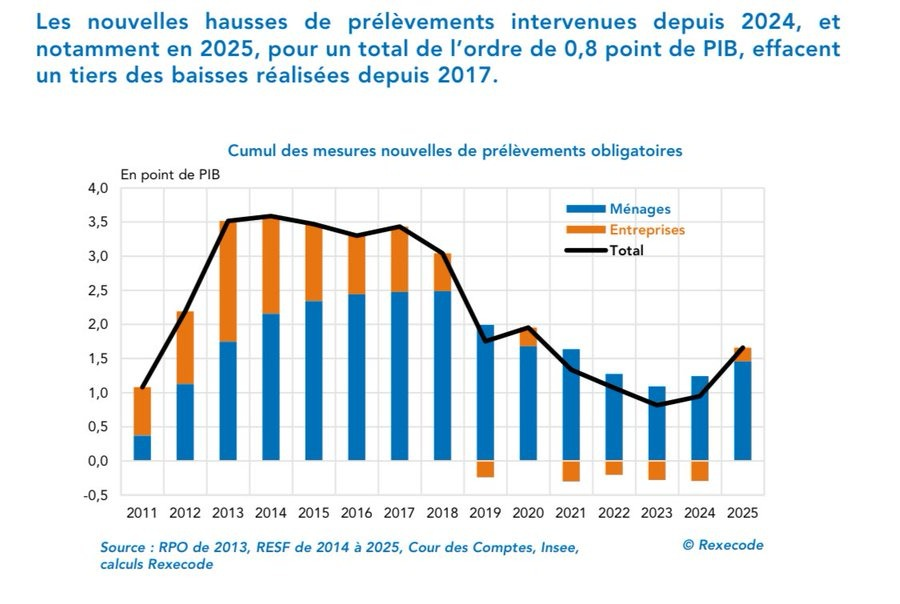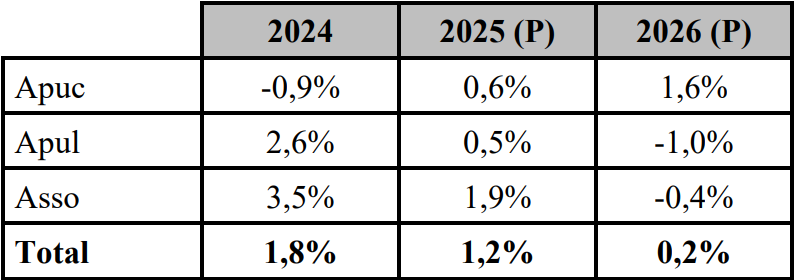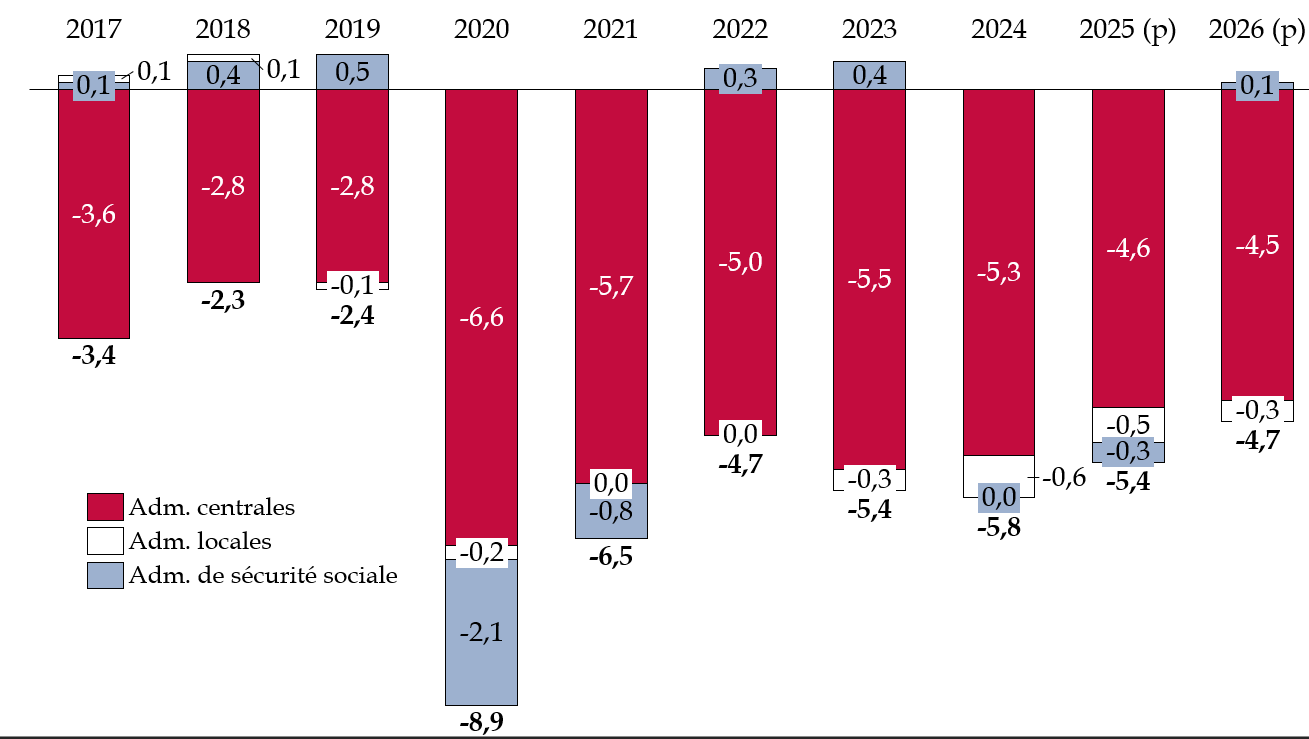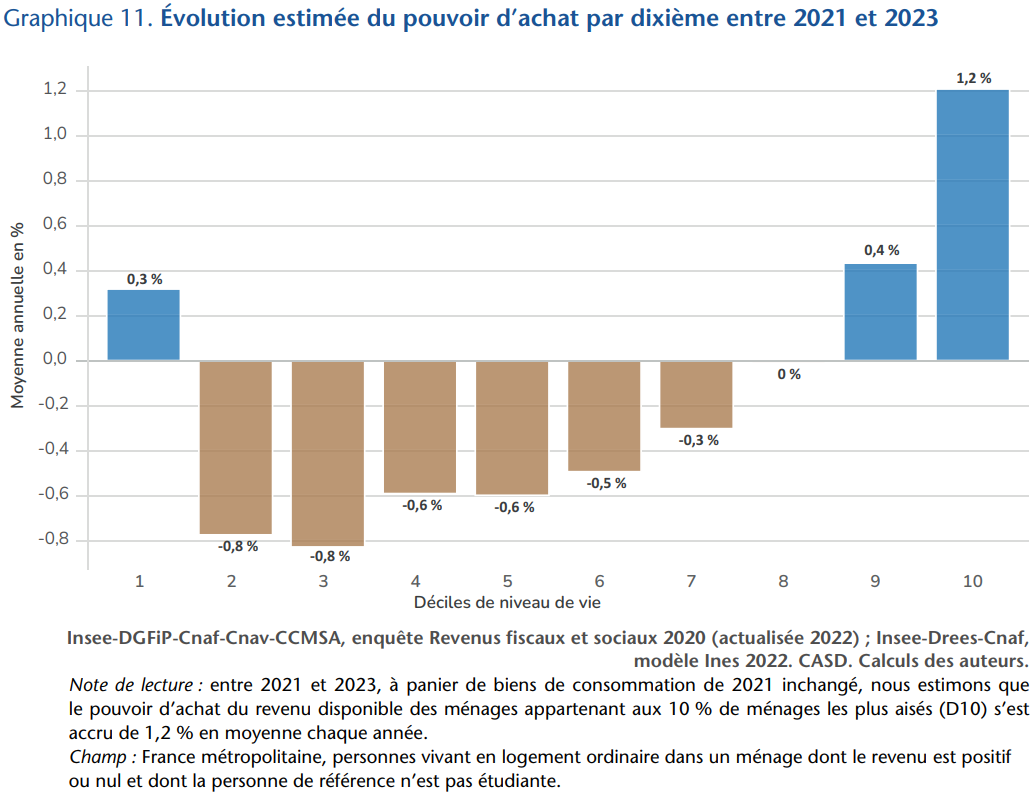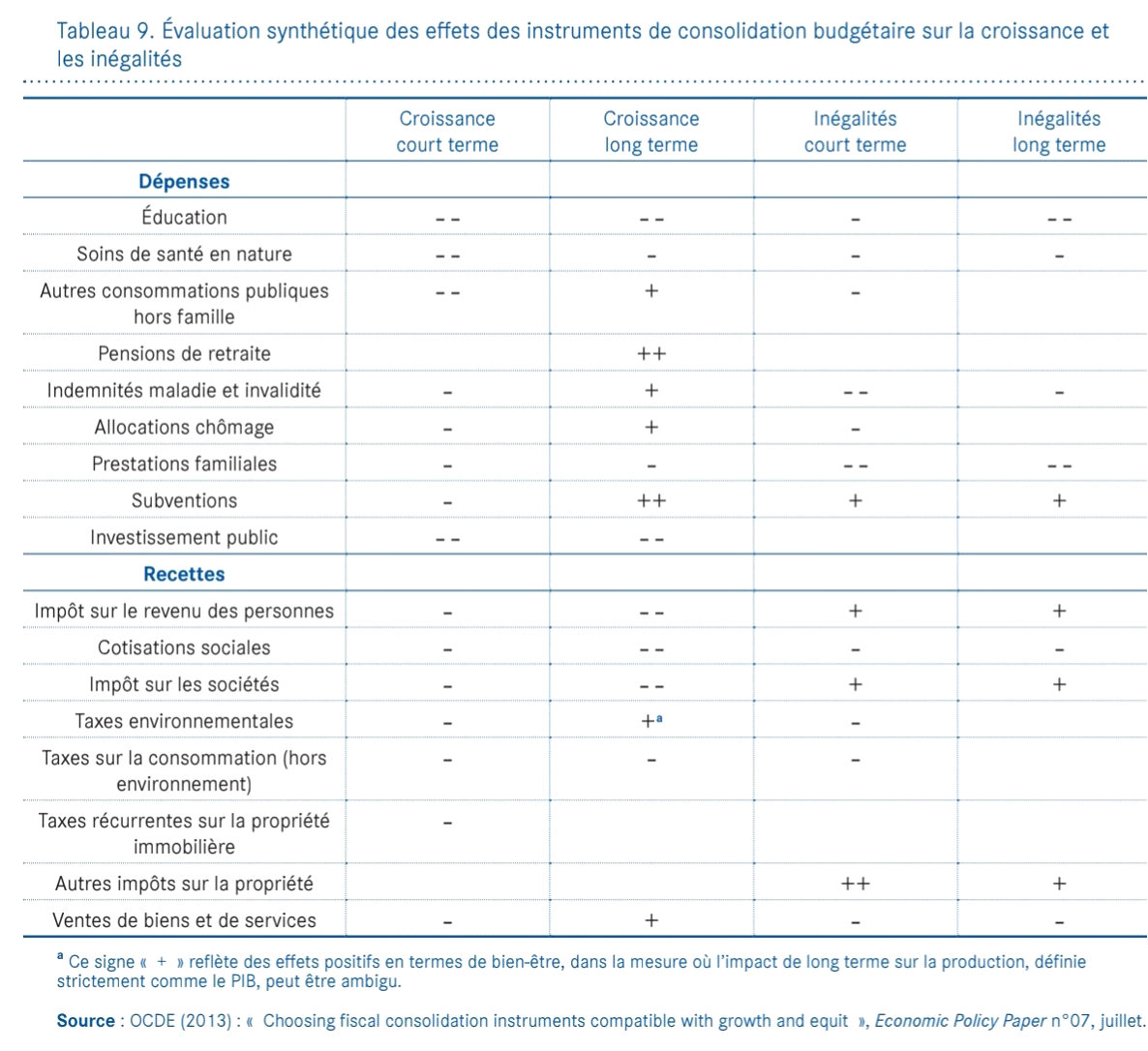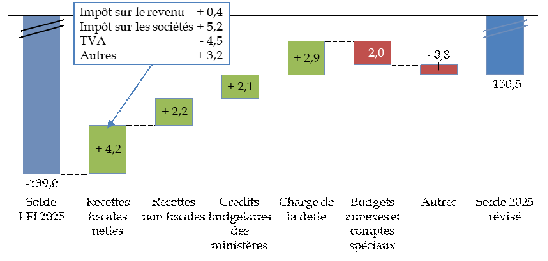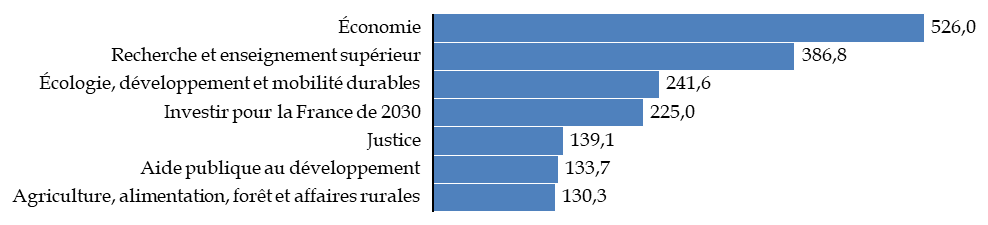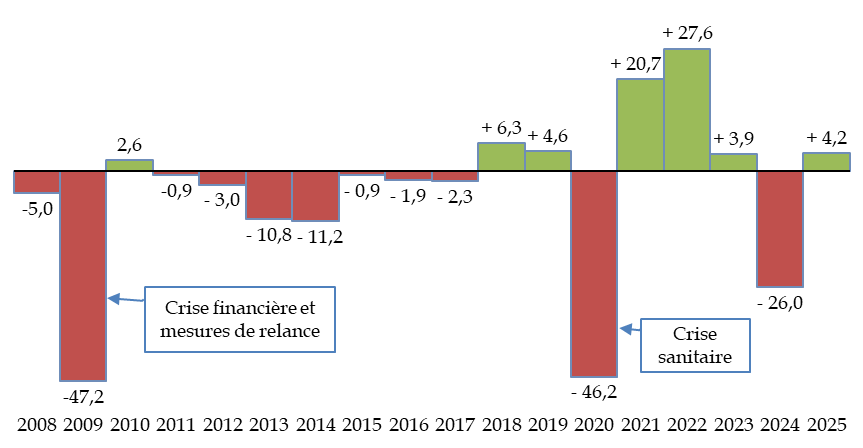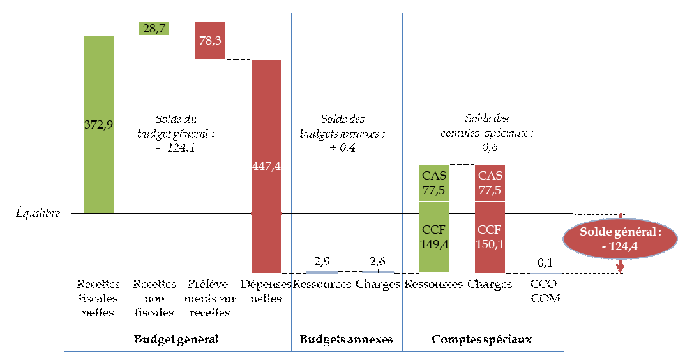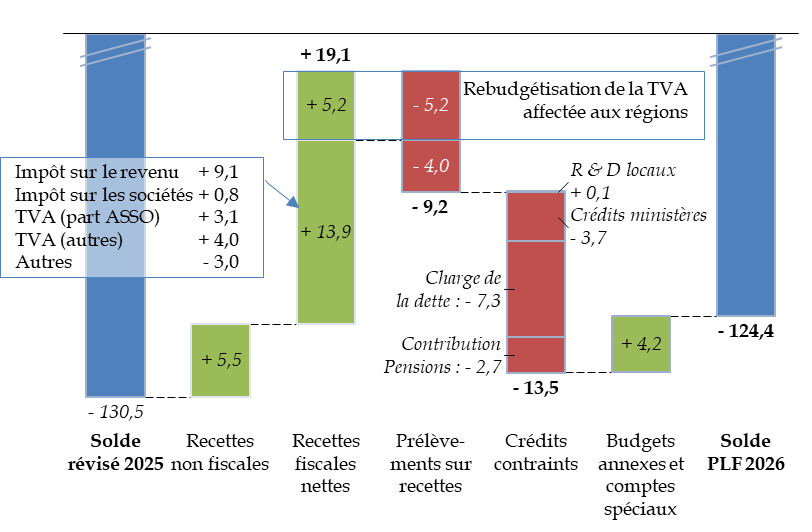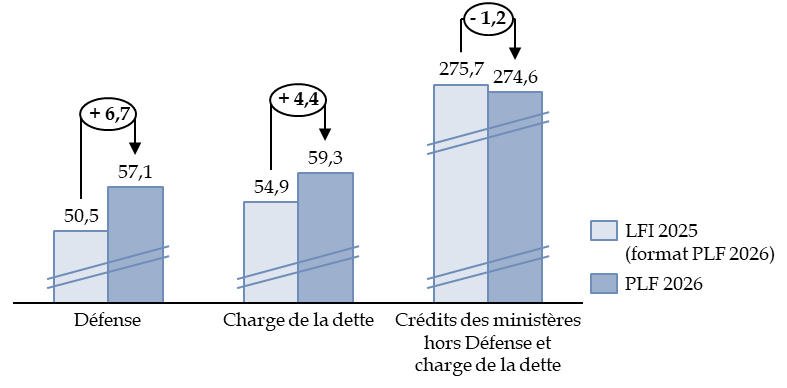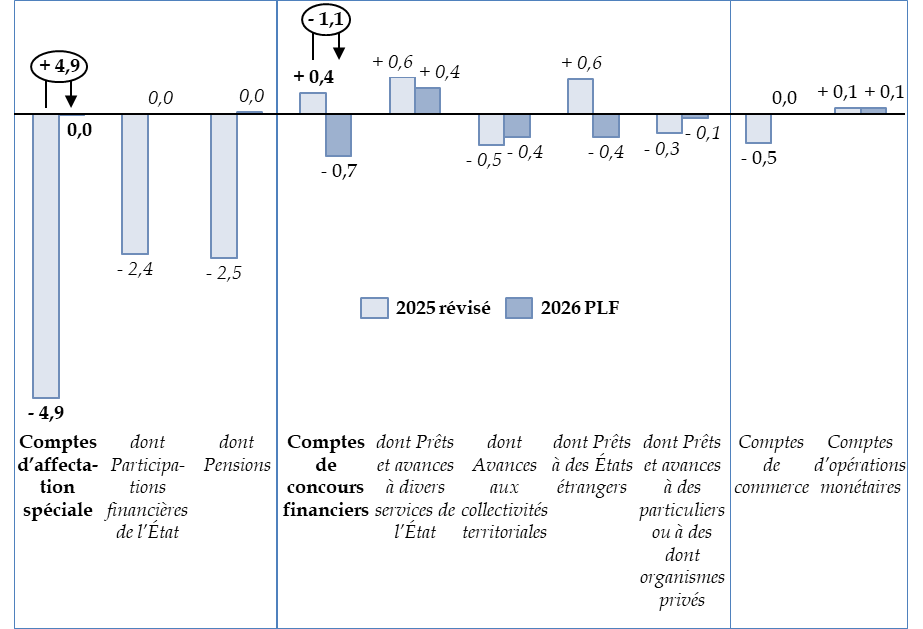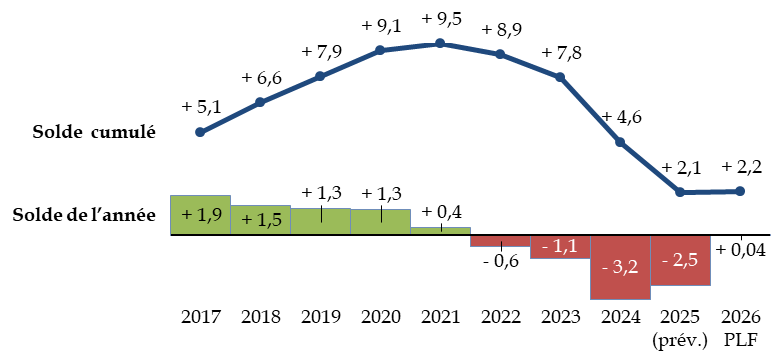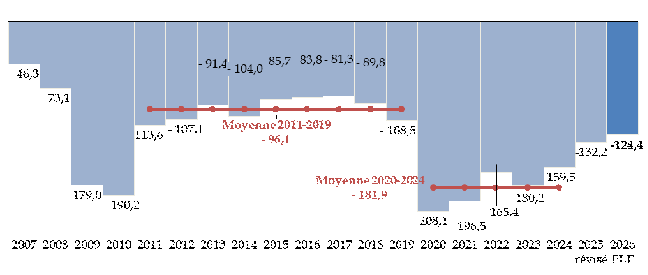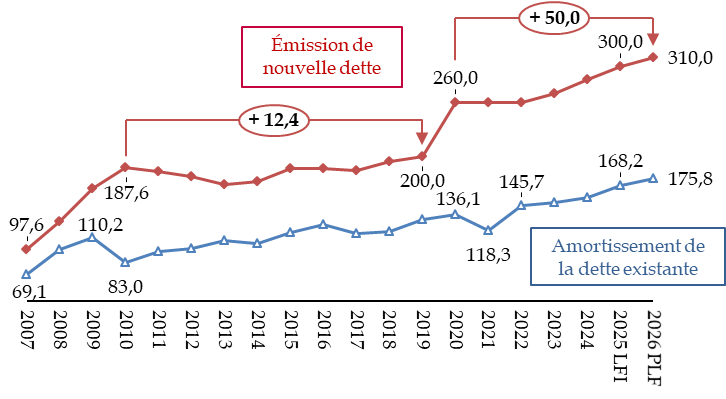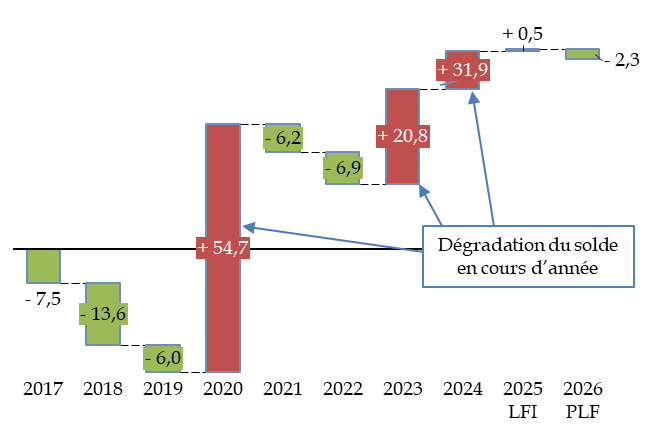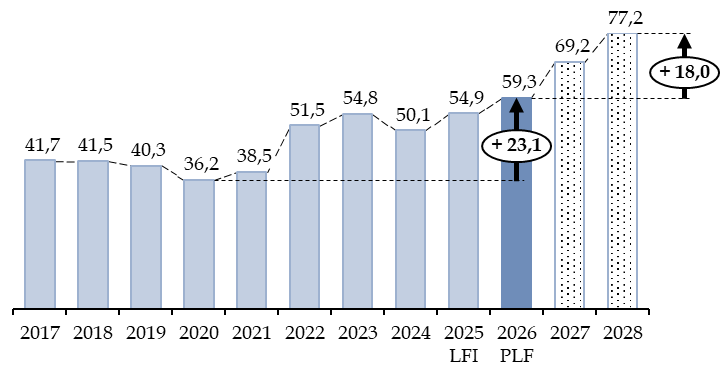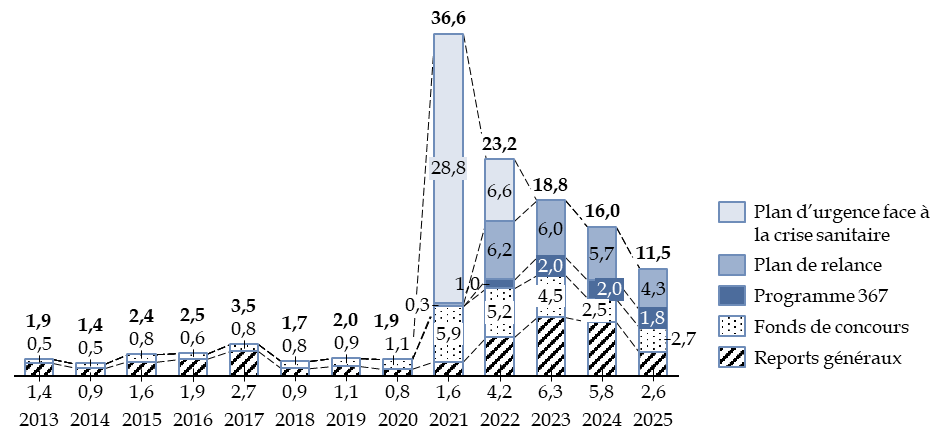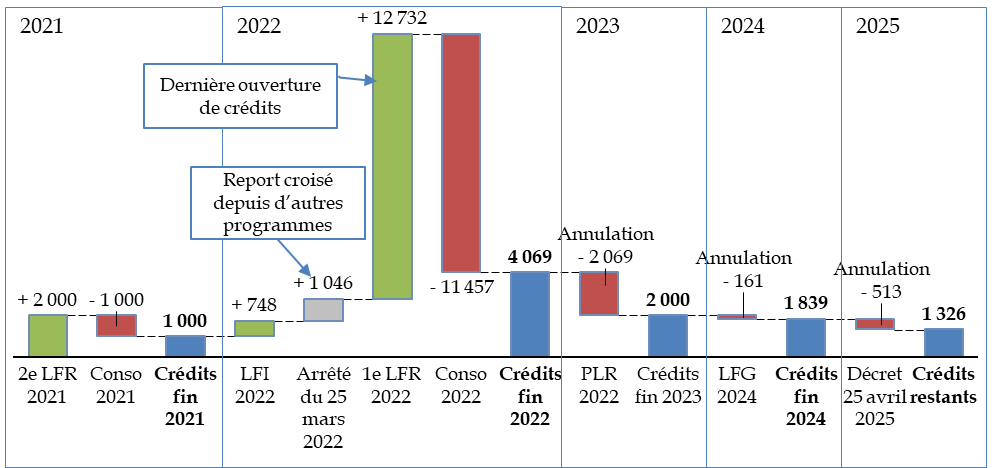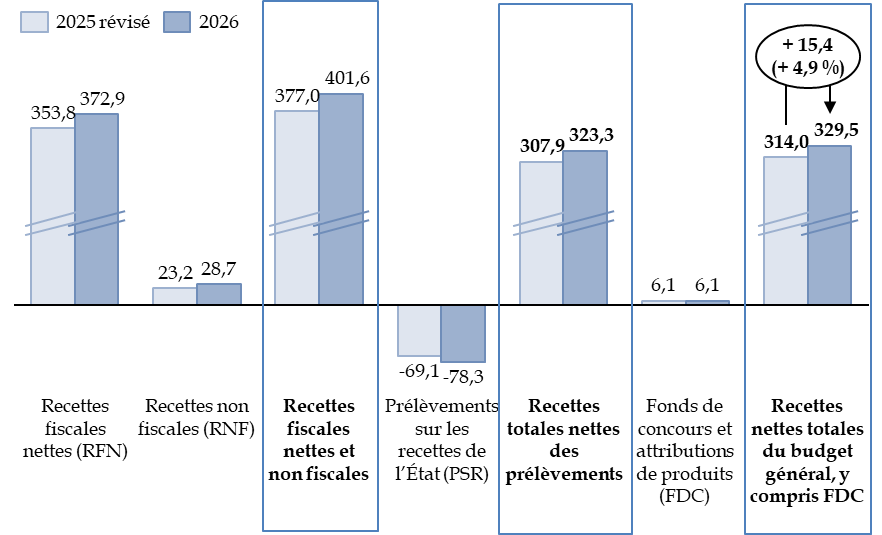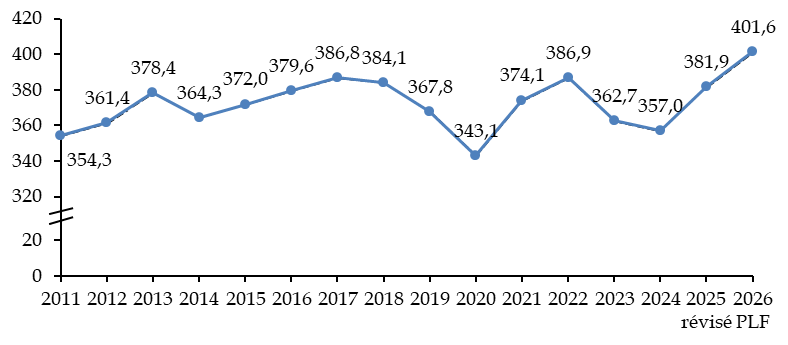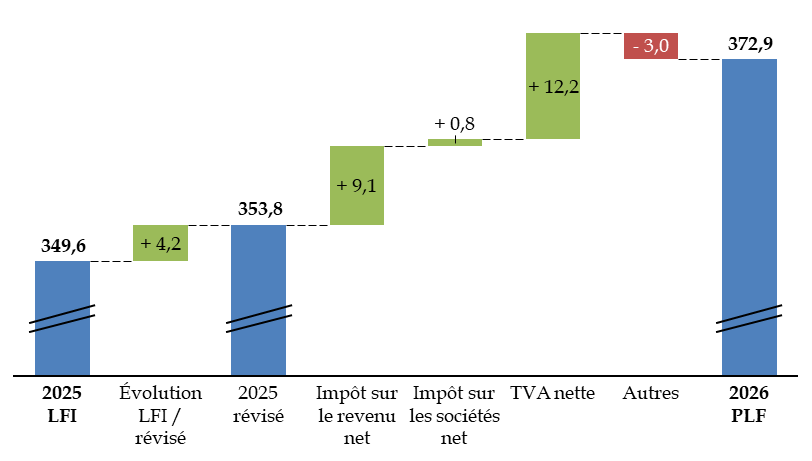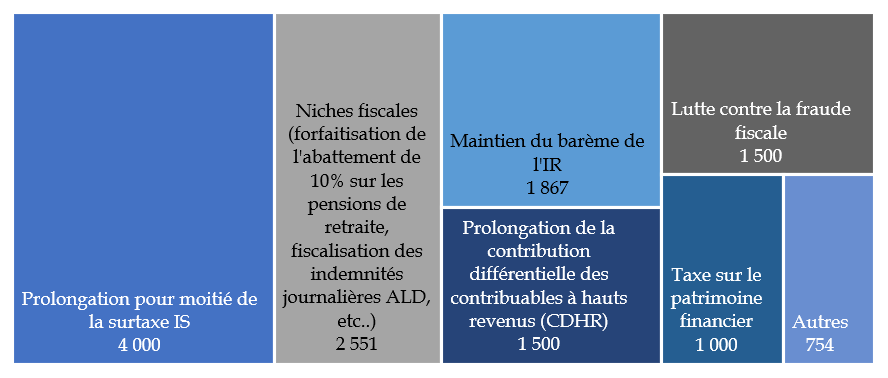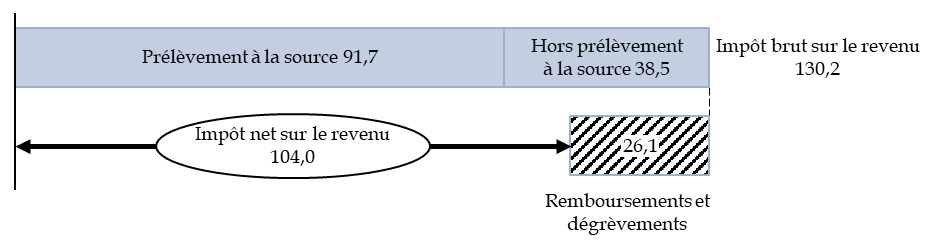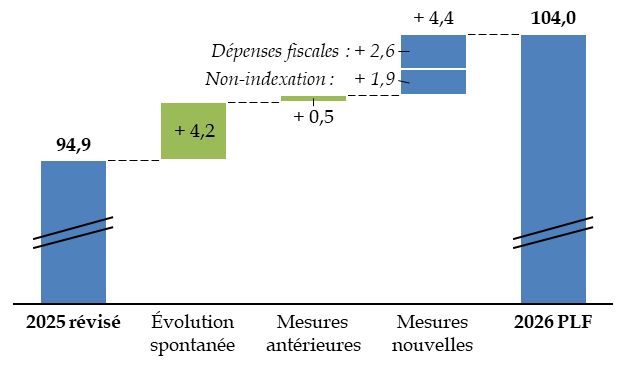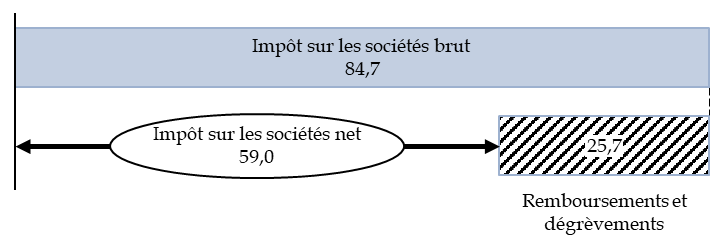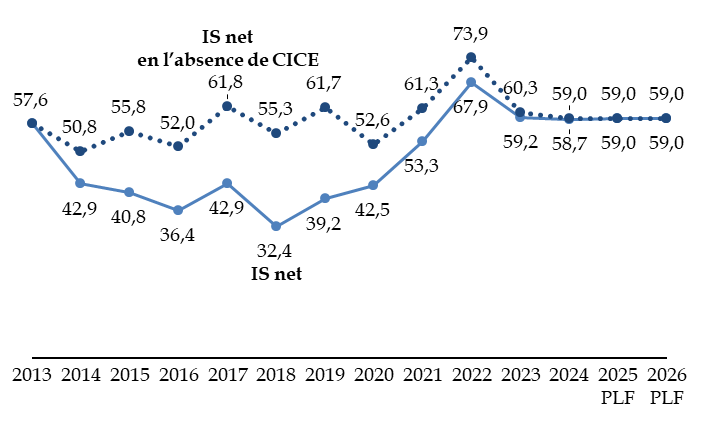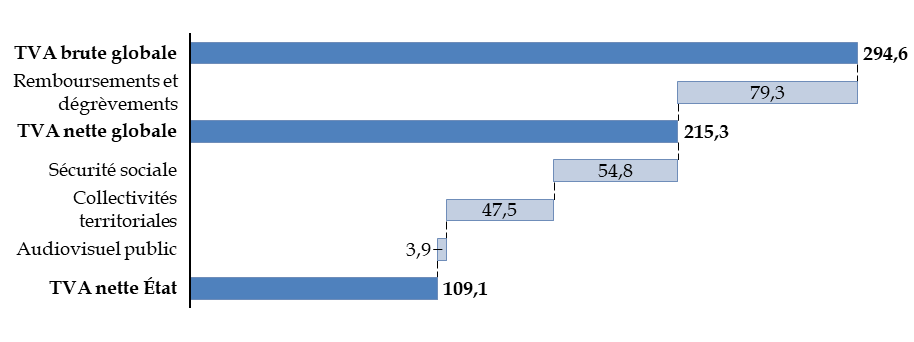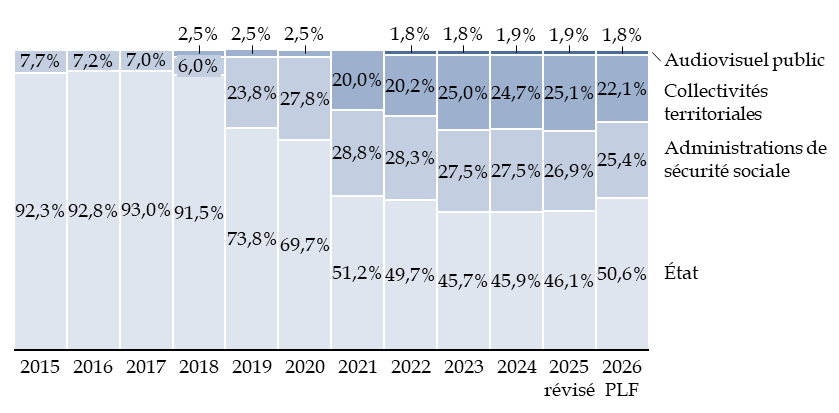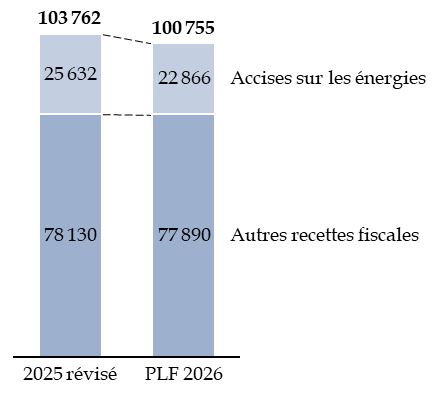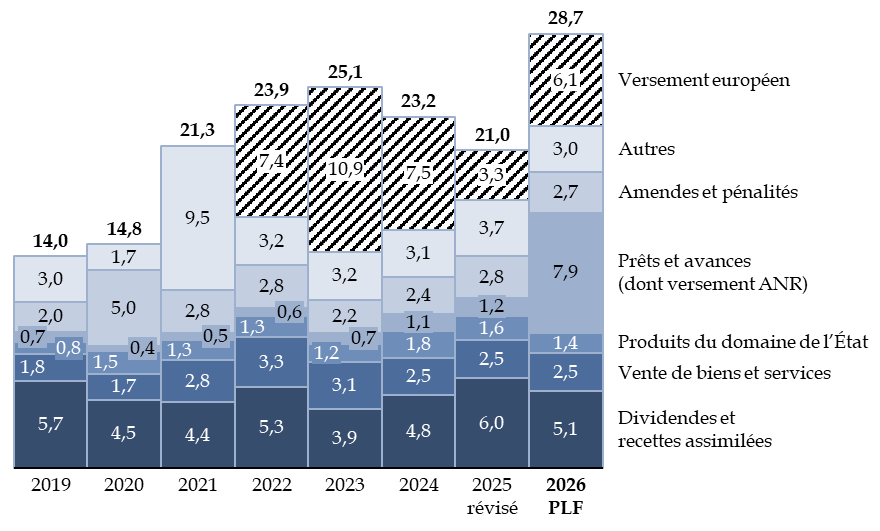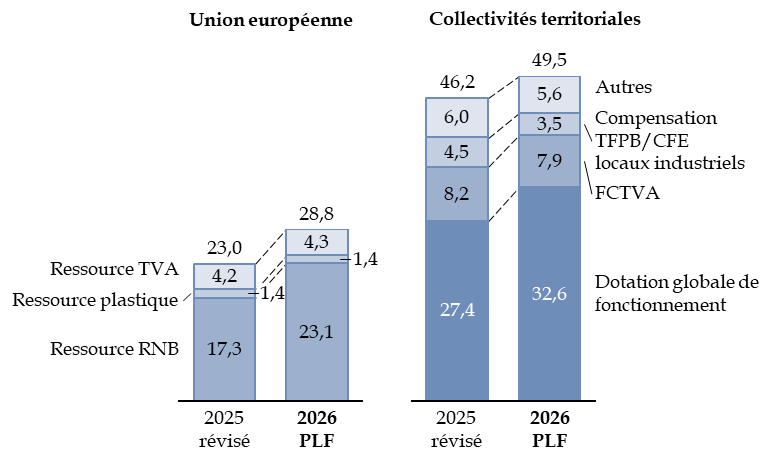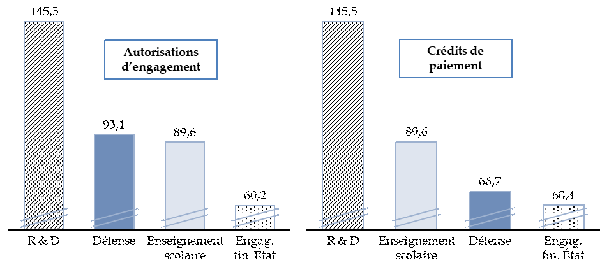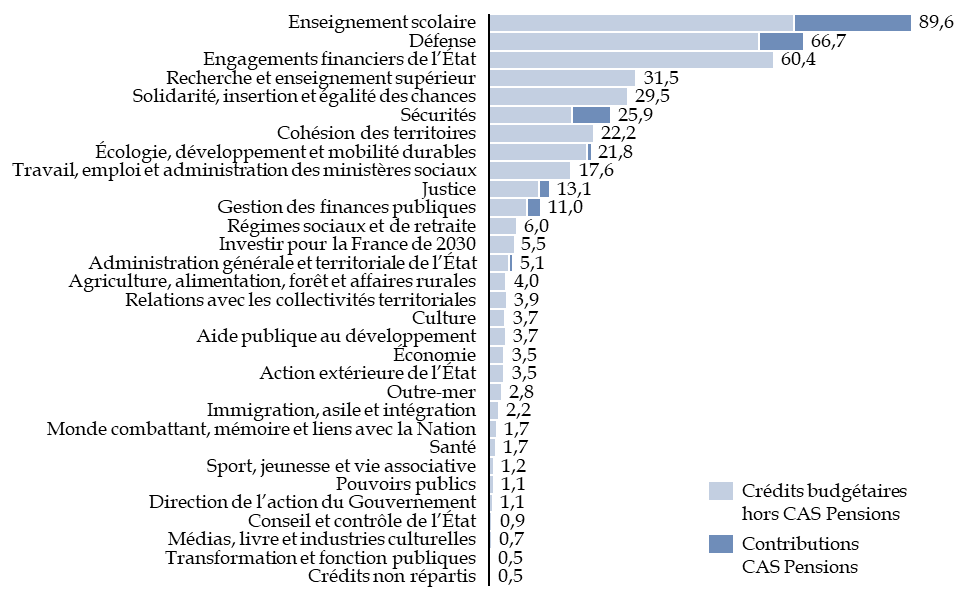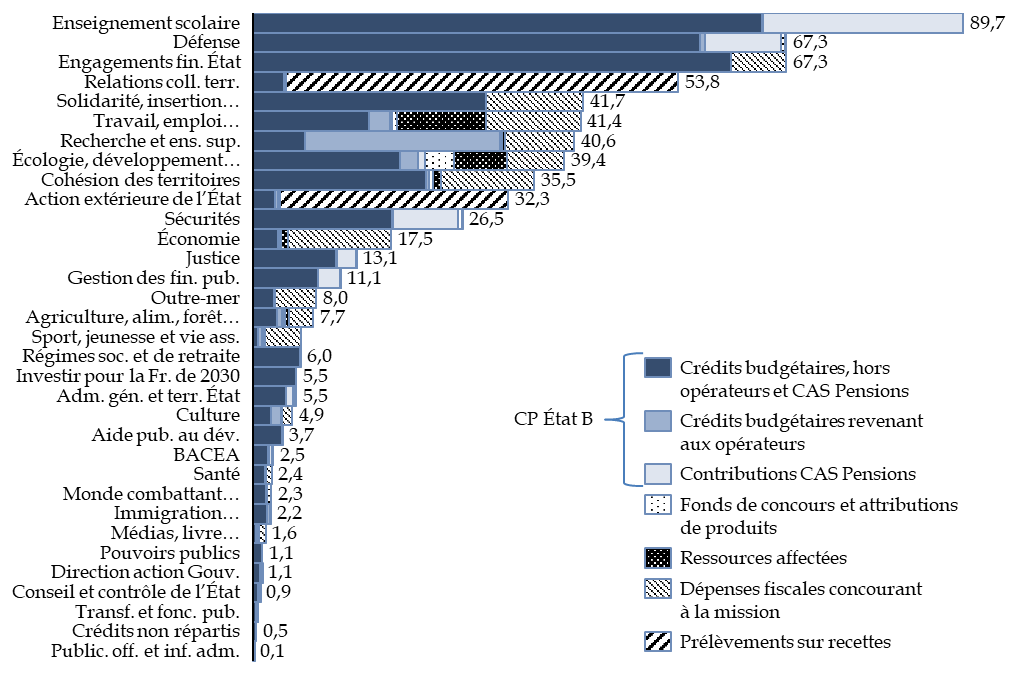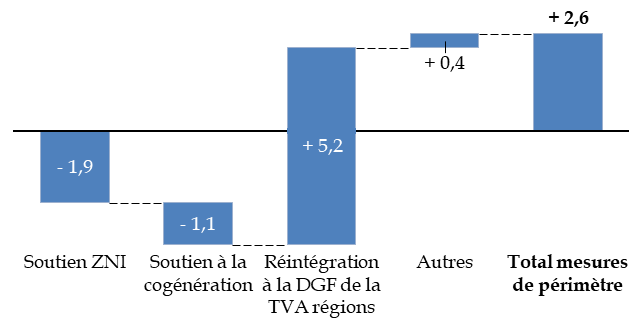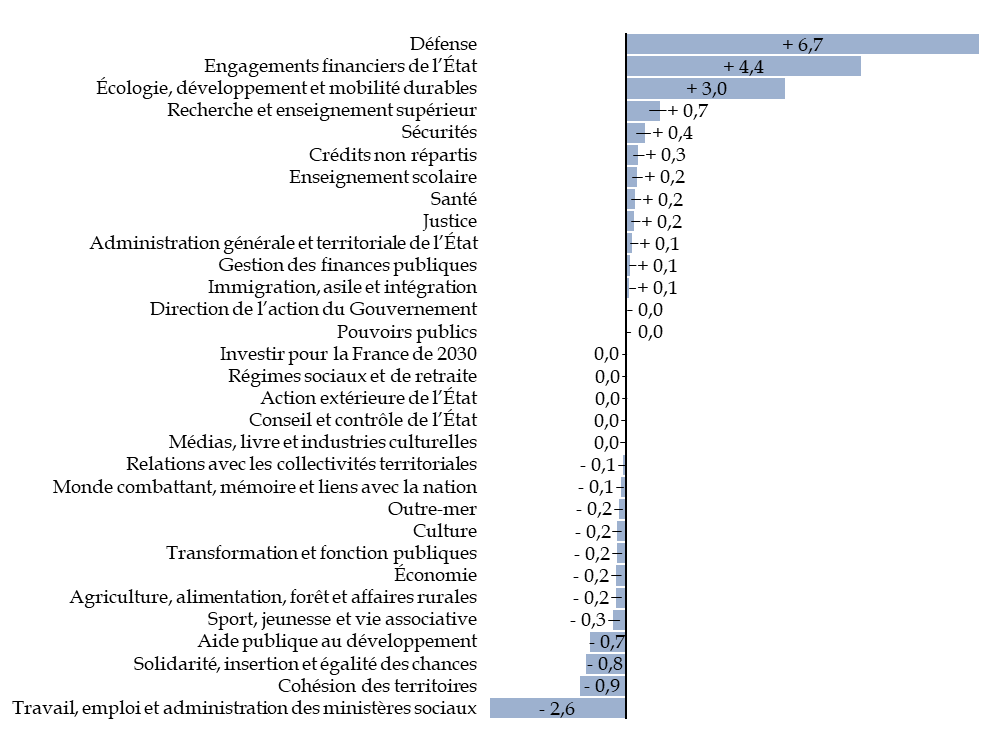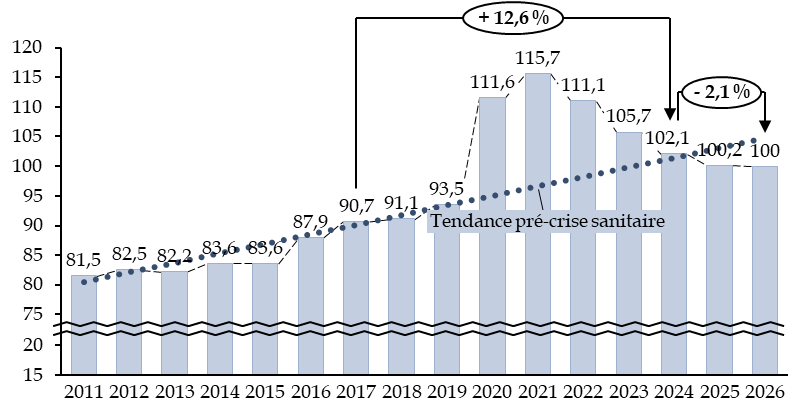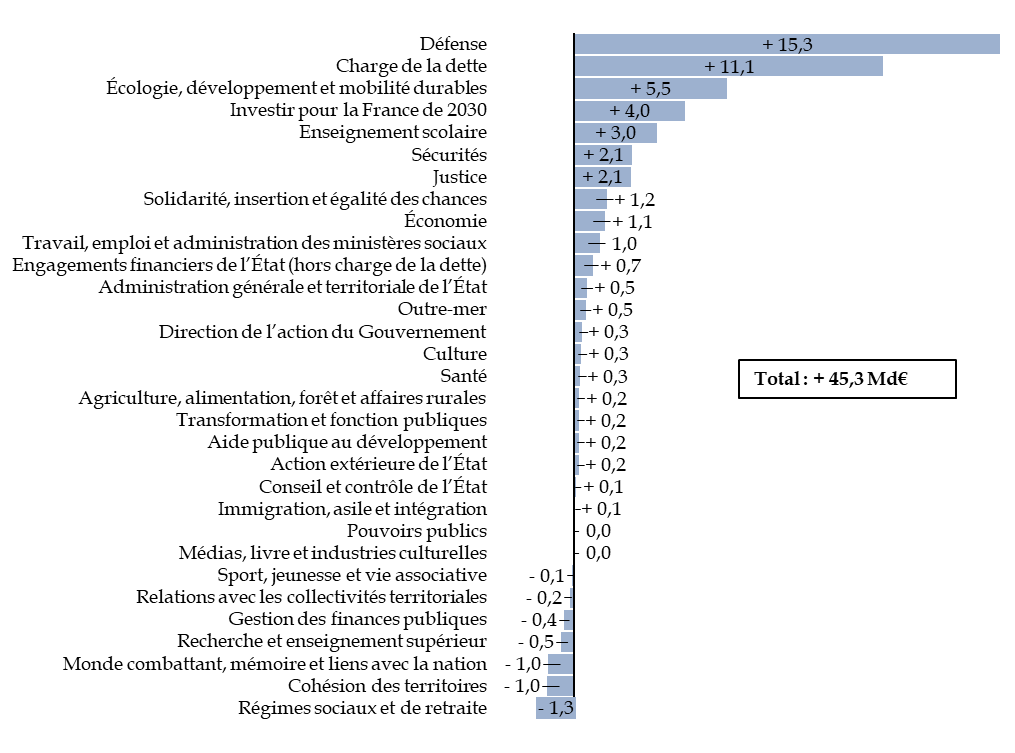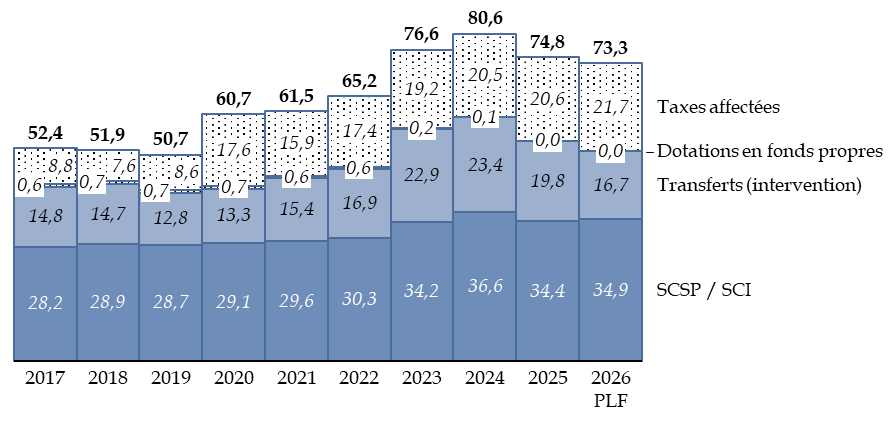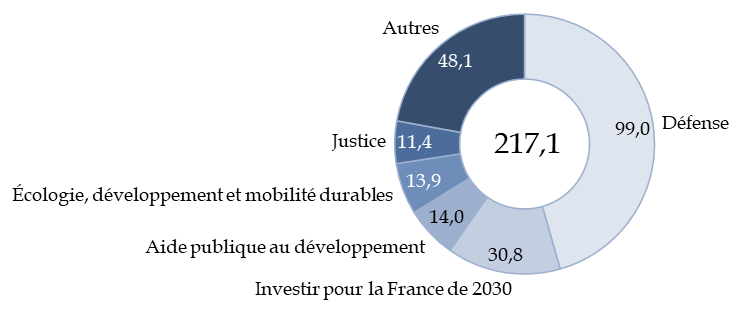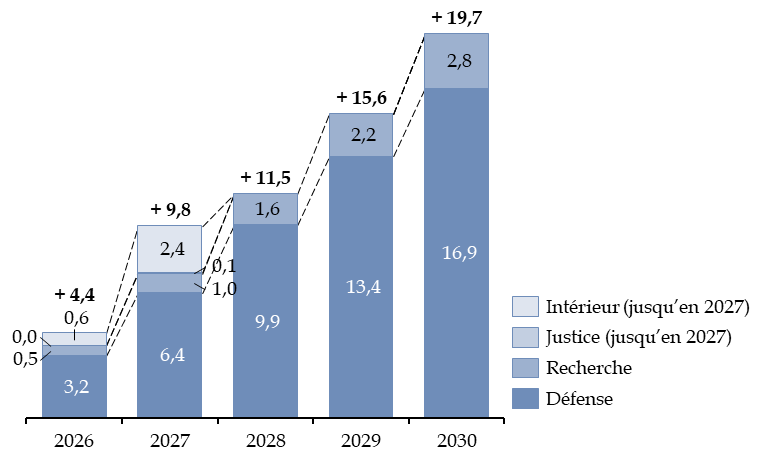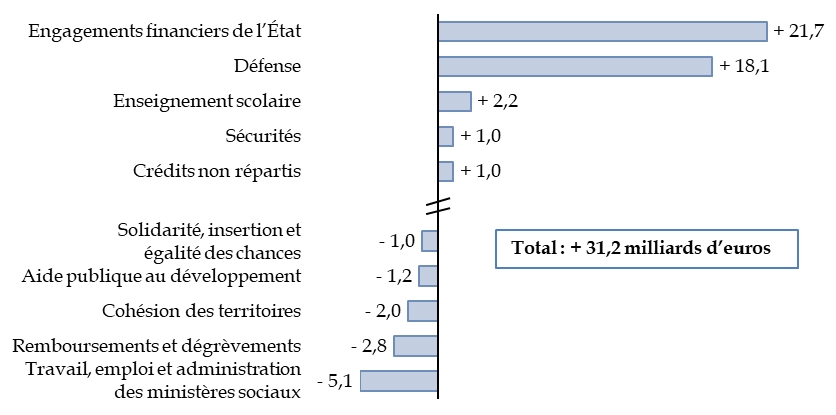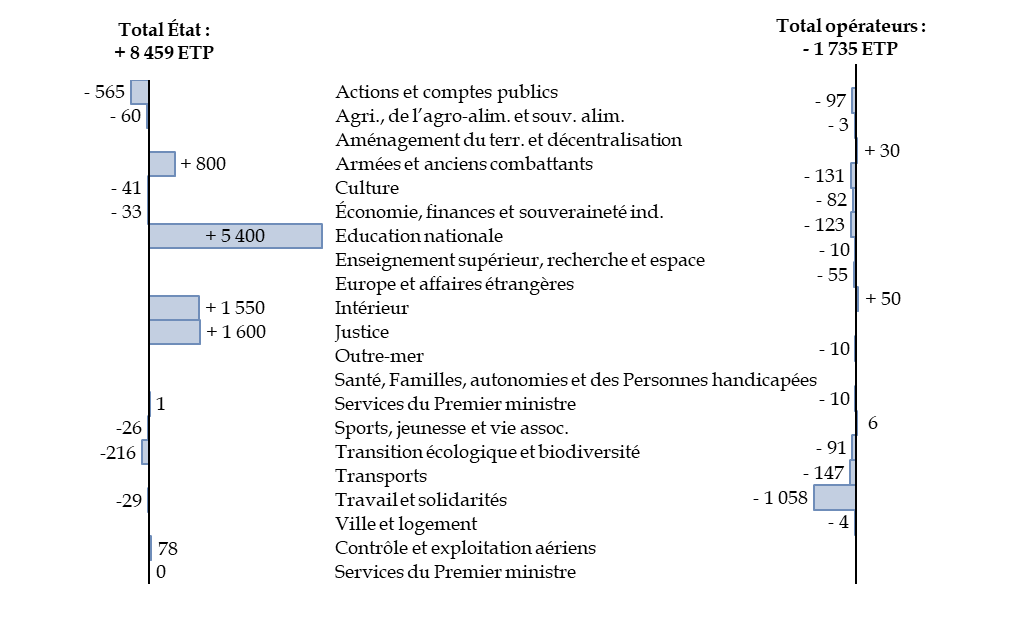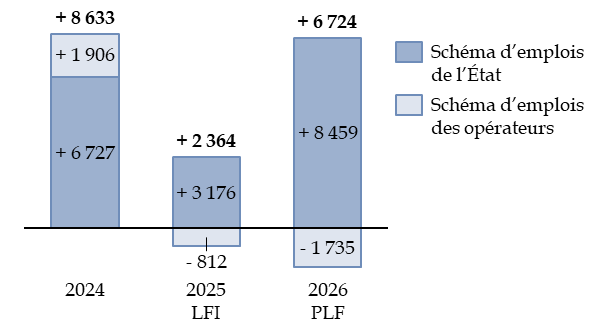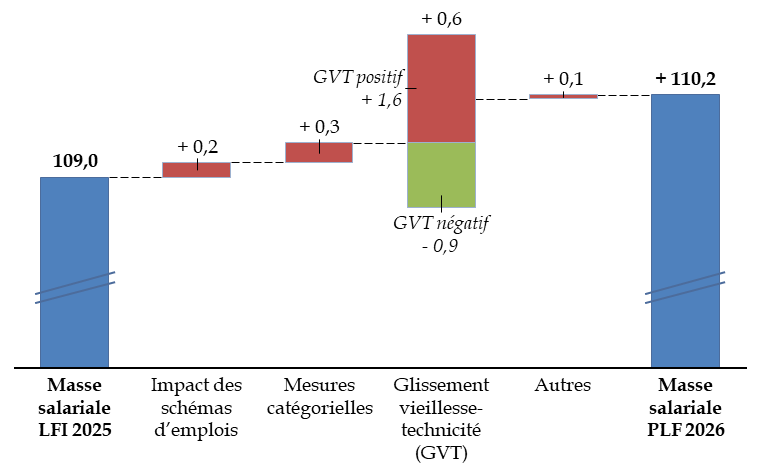- PRÉAMBULE
- PREMIÈRE PARTIE
POUR REPRENDRE SON DESTIN EN MAIN,
LA FRANCE NE PEUT SE CONTENTER D'UN SIMPLE PARI SUR LA LEVÉE DES INCERTITUDES
- I. UNE CROISSANCE FRANÇAISE TOUJOURS
AFFECTÉE À COURT TERME PAR UN NIVEAU ÉLEVÉ
D'INCERTITUDE ET D'ÉPARGNE, ET DES FONDAMENTAUX ENCORE PLUS
INQUIÉTANTS À LONG TERME
- A. À COURT TERME, UN SCÉNARIO DE
CROISSANCE OPTIMISTE, QUI TRADUIT LE PARI DU GOUVERNEMENT SUR UNE LEVÉE
DES INCERTITUDES
- 1. Le scénario de croissance du Gouvernement
se situe dans la fourchette haute du consensus des économistes
- 2. Le Gouvernement mise sur les effets positifs
d'une hypothétique levée des incertitudes
- a) Au plan intérieur, si le coût de la
non-adoption d'un budget en temps utile serait vraisemblablement
élevé, à l'inverse sa simple adoption ne suffira pas
à effacer le coût de l'instabilité
- b) Sur le plan extérieur, le flou demeure
sur l'ampleur de la contribution du commerce mondial à la croissance
française
- a) Au plan intérieur, si le coût de la
non-adoption d'un budget en temps utile serait vraisemblablement
élevé, à l'inverse sa simple adoption ne suffira pas
à effacer le coût de l'instabilité
- 3. Aucun poste de la demande privée ne
semble assez dynamique pour apporter une contribution significative à la
croissance
- a) Une reprise des investissements peu plausible en
l'absence de signaux crédibles de nature à rétablir la
confiance des entreprises
- b) Une amorce de désépargne des
ménages qui pourrait enfin se concrétiser, à un rythme
cependant encore faible en l'absence de réelles mesures pour
l'encourager
- (1) Une
« sur-épargne » liée à l'inflation
qui serait en voie de s'estomper
- (2) Une hausse de l'épargne liée
à la hausse des revenus financiers
- (3) L'invalidation de la théorie du
« cycle de vie » par la sur-épargne des
retraités
- a) Une reprise des investissements peu plausible en
l'absence de signaux crédibles de nature à rétablir la
confiance des entreprises
- 4. L'économie française devra
naviguer contre le courant d'une politique budgétaire qui pourrait
être récessive en 2026, alors que la politique
monétaire ne serait que d'une aide relative
- a) Un niveau des prix et des salaires en
décalage avec le reste de la zone euro, conséquence à
retardement du bouclier tarifaire, limitant l'influence de la politique
monétaire
- b) L'impulsion budgétaire des lois de
finances et de financement de la sécurité sociale devrait
contracter le PIB
- c) La France ne semble bénéficier que
marginalement d'une hausse de la demande adressée par ses voisins
européens, même en cas de stimulus budgétaire dans ces
pays
- a) Un niveau des prix et des salaires en
décalage avec le reste de la zone euro, conséquence à
retardement du bouclier tarifaire, limitant l'influence de la politique
monétaire
- 1. Le scénario de croissance du Gouvernement
se situe dans la fourchette haute du consensus des économistes
- B. À PLUS LONG TERME, DES FONDAMENTAUX
ÉCONOMIQUES DÉGRADÉS, QUI NE PERMETTENT GUÈRE
D'ESPÉRER UN REDRESSEMENT FACILE
- 1. Des performances productives
présentées comme relativement résilientes mais encore
médiocres, au sein d'un continent lui-même atone
- a) Un modèle de croissance trop
centré sur la dépense publique et la consommation des
ménages, qui obère les capacités productives de la France
et accroît son déficit public
- b) Une France qui glisse dans le ventre mou de
l'Europe, avec un niveau de richesse bientôt deux fois moins
élevé que celui des États-Unis et un décrochage
technologique vis-à-vis de la Chine
- a) Un modèle de croissance trop
centré sur la dépense publique et la consommation des
ménages, qui obère les capacités productives de la France
et accroît son déficit public
- 2. La fin de l'exception française en
matière de productivité et de démographie compromet les
perspectives à long terme de la croissance française
- a) Une productivité en berne en lien avec
des performances de taux d'emploi et de chômage pour partie
achetées à crédit par le « quoi qu'il en
coûte »
- (1) Une priorité gouvernementale...
- (2) ... mais une baisse de taux de chômage
qui n'a rien de spécifique à la France
- (3) Une amélioration du taux d'emploi
indéniable...
- (4) ... mais au prix d'un déclin de la
productivité
- (5) Un faible impact sur les finances
publiques
- b) La fin de l'exception démographique
française met son modèle social au défi de se
réinventer rapidement
- (1) Le vieillissement de la population
- (2) La chute de la natalité, le
« dividende démographique » et le déclin du
taux de couverture
- a) Une productivité en berne en lien avec
des performances de taux d'emploi et de chômage pour partie
achetées à crédit par le « quoi qu'il en
coûte »
- 1. Des performances productives
présentées comme relativement résilientes mais encore
médiocres, au sein d'un continent lui-même atone
- A. À COURT TERME, UN SCÉNARIO DE
CROISSANCE OPTIMISTE, QUI TRADUIT LE PARI DU GOUVERNEMENT SUR UNE LEVÉE
DES INCERTITUDES
- II. L'ÉROSION PROGRESSIVE DE NOS
MARGES DE MANoeUVRE BUDGÉTAIRES APPELLE UNE RÉDUCTION VIGOUREUSE
DE NOTRE DÉFICIT DÈS 2026
- A. L'ACCROISSEMENT CONTINU DE LA DETTE PUBLIQUE
EST EN PASSE D'ANESTHÉSIER L'ACTION PUBLIQUE
- 1. Une forte dynamique de hausse de la dette
publique en France, dont les choix de politique budgétaire et fiscale
depuis 2020 sont responsables
- a) Bien qu'un haut niveau de dette publique
s'observe dans un grand nombre d'économies, sa dynamique en France se
singularise fortement depuis 2020
- b) Héritée pour partie seulement de
dépenses de crise, la dette a en majeure partie augmenté
depuis 2017 du fait de déficits liés aux mesures
discrétionnaires des gouvernements successifs
- a) Bien qu'un haut niveau de dette publique
s'observe dans un grand nombre d'économies, sa dynamique en France se
singularise fortement depuis 2020
- 2. Une illusion de soutenabilité de la
dette que l'appartenance de la France à la zone euro, ainsi que le
léger excédent de son compte courant, ont contribué
à entretenir
- a) Une intervention du FMI est improbable en
France et il serait imprudent d'escompter davantage de la BCE que sa garantie
implicite
- (1) Une intervention du Fonds monétaire
internationale (FMI) est juridiquement et économiquement peu
plausible
- (2) Si une intervention directe de la BCE est
strictement conditionnée, celle-ci apporte en réalité
déjà une aide par sa garantie implicite
- (3) Le recours à d'autres outils
d'assistance ne devrait, pour certains économistes, plus être un
tabou
- b) Si, à la différence de ses
administrations publiques, la France ne vit pas au-dessus de ses moyens, son
compte courant étant à l'équilibre grâce à un
niveau élevé d'épargne privée, sa balance des
revenus pourrait se dégrader
- a) Une intervention du FMI est improbable en
France et il serait imprudent d'escompter davantage de la BCE que sa garantie
implicite
- 3. La dégradation des conditions de
financement de la dette menace de faire entrer la France dans un cercle vicieux
dont il sera difficile de s'extraire
- a) Le coût réel de la dette augmente
inexorablement, après plusieurs années d'emprunt à taux
bas voire négatif, une aubaine transformée en
malédiction
- (1) L'« aubaine » des taux
nuls voire négatifs
- (2) La malédiction de la charge de la
dette
- (3) Une exposition à un risque de taux
désormais très forte
- (4) La « pentification » de
la courbe des taux et la hausse des taux longs
- b) Le « spread » entre le
taux d'intérêt de la dette française et celui de la dette
de ses principaux voisins s'est creusé au détriment de la
France
- (1) La dégradation des spreads de la France
et de ses conditions de financement relatives
- (2) La dégradation de la note souveraine de
la France de « très haute qualité »
à « haute qualité »
- (3) Une concurrence accrue entre actifs sûrs
en 2027
- c) Le « noeud coulant » de
la hausse de la charge de la dette prive la puissance publique d'autant de
moyens pour affronter l'adversité d'aujourd'hui et anticiper les crises
de demain
- (1) Le risque d'une anesthésie de l'action
publique par l'effet « boule de neige » de la
dette
- (2) Un « accident de
marché » ne pouvant jamais être totalement exclu, la
souveraineté de l'État est de facto limitée
- (3) La France peine à avoir les moyens de
la politique de puissance industrielle et de défense qu'elle a toujours
défendue en Europe
- a) Le coût réel de la dette augmente
inexorablement, après plusieurs années d'emprunt à taux
bas voire négatif, une aubaine transformée en
malédiction
- 1. Une forte dynamique de hausse de la dette
publique en France, dont les choix de politique budgétaire et fiscale
depuis 2020 sont responsables
- B. DES CHOIX STRUCTURANTS DOIVENT ÊTRE
OPÉRÉS DÈS AUJOURD'HUI POUR NOUS ÉVITER DES CHOIX
PLUS DRASTIQUES DEMAIN, LA FACILITÉ N'ÉTANT PLUS UNE
OPTION
- 1. Après un premier succès en 2025
et avant un exercice peut-être plus difficile en 2027, il existe une
fenêtre de tir en 2026 pour fournir un effort significatif
- a) L'exécution du solde de l'année
2025 est en passe d'être tenue, un succès pour la feuille de route
initiée par l'ancien Premier ministre Michel Barnier
- b) Pour 2026, le Gouvernement a
relâché la bride de 0,4 point avant même le
début des débats, ce qui augure mal du point
d'atterrissage
- c) Le respect du PSMT est pour l'heure
assuré, mais pas celui de la LPFP, et la prudence doit rester de mise au
cas où la trajectoire de dépenses primaires nettes
dériverait après 2026
- d) Ambitieuse au regard des exemples de
consolidation réussies par le passé, la trajectoire du projet de
loi initial apparaît pourtant nécessaire pour stabiliser la
dette
- a) L'exécution du solde de l'année
2025 est en passe d'être tenue, un succès pour la feuille de route
initiée par l'ancien Premier ministre Michel Barnier
- 2. La multiplication de méthodes
concurrentes pour présenter l'effort budgétaire et fiscal nuit
gravement à la clarté et à la sincérité des
débats
- 3. Une répartition de l'effort qui devra
évoluer pour renforcer les baisses de dépenses et alléger
les hausses de recettes
- a) Les baisses de dépenses doivent
être préférées aux hausses de recettes, dans un
contexte où les dépenses comme les recettes sont très
élevées en France
- b) Avec près de 40 milliards d'euros
de hausses d'impôts « rustines » en deux ans,
la mise à contribution des ménages et des entreprises est, de
toute évidence, excessive
- a) Les baisses de dépenses doivent
être préférées aux hausses de recettes, dans un
contexte où les dépenses comme les recettes sont très
élevées en France
- 4. Au-delà de la différence entre
dépenses et recettes, c'est la nature de l'ajustement qui fera la
différence à long terme
- a) Un plus juste partage de l'effort doit
être organisé entre administrations publiques centrales, de
sécurité sociale, et locales
- (1) Des efforts partagés
- (2) Des efforts justes
- b) Il devrait être davantage tenu compte de
l'impact des mesures nouvelles sur le consentement à l'impôt, la
capacité contributive de chacun et donc la distribution des
revenus
- c) Les mesures de consolidation qui devraient
être recherchées en priorité sont celles dont l'efficience
et l'effet sur la croissance à long terme sont favorables
- a) Un plus juste partage de l'effort doit
être organisé entre administrations publiques centrales, de
sécurité sociale, et locales
- 1. Après un premier succès en 2025
et avant un exercice peut-être plus difficile en 2027, il existe une
fenêtre de tir en 2026 pour fournir un effort significatif
- A. L'ACCROISSEMENT CONTINU DE LA DETTE PUBLIQUE
EST EN PASSE D'ANESTHÉSIER L'ACTION PUBLIQUE
- I. UNE CROISSANCE FRANÇAISE TOUJOURS
AFFECTÉE À COURT TERME PAR UN NIVEAU ÉLEVÉ
D'INCERTITUDE ET D'ÉPARGNE, ET DES FONDAMENTAUX ENCORE PLUS
INQUIÉTANTS À LONG TERME
- DEUXIÈME PARTIE
LE BUDGET DE L'ÉTAT : APRÈS DES ANNÉES DE DÉRIVE, LES PREMIERS PAS D'UN RETOUR VERS L'ÉQUILIBRE
QUI DEVRA ÊTRE AMPLIFIÉ
- I. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE POURSUIT
UNE TRAJECTOIRE DE REDRESSEMENT ENCORE TROP DÉPENDANTE DE MESURES
PROVISOIRES
- A. EN 2025, L'EFFORT ENGAGÉ EN LOI DE
FINANCES INITIALE SE CONCRÉTISE
- 1. La France a vécu pendant un mois et demi
en régime de « services votés »
- 2. Le solde budgétaire n'est plus
« extrême », mais il demeure historiquement
élevé
- 3. Un décret d'annulation pris au mois
d'avril a contribué à la modération des
dépenses
- 4. Les recettes fiscales seraient
supérieures de 4,2 milliards d'euros au niveau attendu, ce qui
contraste avec l'écart constaté en 2024
- 5. Le déficit des comptes spéciaux
est plus élevé qu'attendu de près de 3 milliards d'euros,
malgré un remboursement anticipé de prêt par la
Grèce
- 1. La France a vécu pendant un mois et demi
en régime de « services votés »
- B. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE RESTERAIT
TROP ÉLEVÉ EN 2026 , SON AMÉLIORATION DEMEURANT
LÉGÈRE ET REPOSANT SUR DES ÉLÉMENTS TROP
CONJONCTURELS
- 1. La poursuite de la réduction du
déficit se fonde sur une maîtrise des dépenses, hors
dépenses contraintes, mais aussi sur des recettes temporaires
- 2. La situation des budgets annexes et des comptes
spéciaux contribue à l'amélioration du solde
- 3. Le solde budgétaire de l'État
confirme une sortie de la période 2020-2024 marquée par un
niveau exceptionnel de déficit budgétaire, sans achever la
normalisation budgétaire
- 1. La poursuite de la réduction du
déficit se fonde sur une maîtrise des dépenses, hors
dépenses contraintes, mais aussi sur des recettes temporaires
- C. DANS LES ANNÉES À VENIR, LA DETTE
EXERCERA UNE PRESSION TOUJOURS PLUS FORTE SUR LA CAPACITÉ DE
L'ÉTAT À FINANCER LES POLITIQUES PUBLIQUES
- D. UNE NORMALISATION QUI COMMENCE S'AGISSANT DES
PRATIQUES BUDGÉTAIRES
- A. EN 2025, L'EFFORT ENGAGÉ EN LOI DE
FINANCES INITIALE SE CONCRÉTISE
- II. L'ACCROISSEMENT DES RECETTES DE L'ÉTAT
DE PLUS DE 15 MILLIARDS D'EUROS EN 2026 EST LE SIGNE D'UN
ACCROISSEMENT MASSIF DES PRÉLÈVEMENTS FISCAUX
- A. LA CROISSANCE DES RECETTES FISCALES NETTES EST
FAVORISÉE PAR LA CRÉATION OU LA PROROGATION D'IMPÔTS
- 1. Pour la première fois depuis 2012, le
barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas modifié,
accroissant mécaniquement son produit
- 2. Hors « surtaxe »
exceptionnelle, le produit de l'impôt sur les sociétés
serait stable en 2026, en l'absence de réforme importante
- 3. La TVA nette progresserait de
12,2 milliards d'euros, sous l'effet d'importantes mesures de
périmètre
- 4. Le produit des « petits
impôts » est soutenu par la création d'impôts
nouveaux ou la prorogation d'impositions temporaires
- 1. Pour la première fois depuis 2012, le
barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas modifié,
accroissant mécaniquement son produit
- B. UN VERSEMENT DE 6,9 MILLIARDS D'EUROS DE
L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE ACCROÎT LES RECETTES NON
FISCALES
- C. LES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES
PROGRESSENT EN RAISON DU CYCLE DE DÉPENSES EUROPÉENS ET PAR
L'EFFET DE LA REBUDGÉTISATION DE LA TVA DESTINÉE AUX
RÉGIONS
- A. LA CROISSANCE DES RECETTES FISCALES NETTES EST
FAVORISÉE PAR LA CRÉATION OU LA PROROGATION D'IMPÔTS
- D. III. LES DÉPENSES DE L'ÉTAT, HORS
DÉFENSE ET CHARGE DE LA DETTE, SONT MAÎTRISÉES MAIS RESTENT
À UN NIVEAU SUPÉRIEUR À CELUI D'AVANT LA CRISE
SANITAIRE
- A. LE PANORAMA DES DÉPENSES DE
L'ÉTAT
- B. LE PROJET DE LOI DE FINANCES PRÉVOIT
ENFIN UNE CERTAINE MODÉRATION DES DÉPENSES, HORS
DÉFENSE
- C. POUR GARANTIR LE RÉTABLISSEMENT DES
COMPTES PUBLICS, IL FAUT POURSUIVRE UN OBJECTIF DE RETOUR AU NIVEAU DE
DÉPENSES DE 2019
- 1. Le nécessaire effort sur les missions
régaliennes de l'État doit être compensé sur ses
autres charges
- 2. Le projet de loi de finances pour 2026 poursuit
l'effort entamé par la loi de finances initiale pour 2025 sur les
dépenses des opérateurs
- 3. L'objectif de maîtrise des
dépenses est toutefois rendu difficile par le poids des engagements
passés, qui conduit d'ores et déjà à un socle
de dépenses futures d'un niveau élevé
- 1. Le nécessaire effort sur les missions
régaliennes de l'État doit être compensé sur ses
autres charges
- D. MASQUÉS PAR UNE PRÉSENTATION
TROMPEUSE, LES EFFECTIFS DE L'ÉTAT POURSUIVENT LEUR CROISSANCE EN
2026
- A. LE PANORAMA DES DÉPENSES DE
L'ÉTAT
- I. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE POURSUIT
UNE TRAJECTOIRE DE REDRESSEMENT ENCORE TROP DÉPENDANTE DE MESURES
PROVISOIRES
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I. AUDITION DE M. ROLAND LESCURE, MINISTRE DE
L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE,
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE, ET
MME AMÉLIE DE MONTCHALIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES
COMPTES PUBLICS (15 OCTOBRE 2025)
- II. AUDITION DE M. PIERRE MOSCOVICI,
PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES
(15 OCTOBRE 2025)
- III. TABLE RONDE SUR LES PERSPECTIVES DE
L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES
(22 OCTOBRE 2025)
- IV. EXAMEN DU RAPPORT
(5 NOVEMBRE 2025)
- I. AUDITION DE M. ROLAND LESCURE, MINISTRE DE
L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE,
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE, ET
MME AMÉLIE DE MONTCHALIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES
COMPTES PUBLICS (15 OCTOBRE 2025)
- LA LOI EN CONSTRUCTION
|
N° 139 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2025 |
|
RAPPORT GÉNÉRAL FAIT au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, pour 2026, |
|
Par M. Jean-François HUSSON, Rapporteur général, Sénateur TOME I LE BUDGET DE 2026 ET SON CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER |
|
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel. |
|
Voir les numéros : Assemblée nationale (17ème législ.) : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063 et T.A. 180 Sénat : 138 et 139 à 145 (2025-2026) |
PRÉAMBULE
Le rapporteur général a fondé le présent rapport sur les données figurant dans le projet de loi de finances pour 2026 et ses annexes dans leur version initiale. C'est également sur ces seuls documents, qui lui avaient été transmis le 2 octobre dernier, puis qui ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 octobre, que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a pu lui-même se fonder pour émettre son avis, exigé par la Constitution et la loi organique.
Or, ainsi que l'a rappelé le président du HCFP devant la commission des finances le 13 octobre, « il semble très hypothétique que les mesures qui sous-tendent ces prévisions soient mises en oeuvre totalement en l'état - c'est un euphémisme. Des modifications substantielles au PLF et au PLFSS ont déjà été évoquées publiquement par M. le Premier ministre. L'avis rendu par le HCFP est donc hypothétique, ou spéculatif, et ce dès sa publication. [...] Le budget discuté par le Parlement va différer très fortement de la copie soumise au HCFP. C'est en ce sens que nous avons dû mener, en quelque sorte, un exercice « à blanc1(*) ». »
Il convient de lire les développements du présent tome I en ayant à l'esprit qu'ils sont sujets aux mêmes limites que l'avis du HCFP, bien que le rapporteur général ne soit pas privé, lorsque cela le justifiait, de commenter les orientations budgétaires ou fiscales esquissées lors des débats à l'Assemblée nationale.
L'ampleur sans précédent des modifications en cours à l'Assemblée nationale, l'incertitude totale sur l'issue du vote et le contenu du texte qui sera, le cas échéant, voté par l'Assemblée auront nécessairement un fort impact sur les analyses et développements du présent rapport.
PREMIÈRE PARTIE
POUR REPRENDRE SON DESTIN EN MAIN,
LA FRANCE NE
PEUT SE CONTENTER D'UN SIMPLE PARI SUR LA LEVÉE DES INCERTITUDES
I. UNE CROISSANCE FRANÇAISE TOUJOURS AFFECTÉE À COURT TERME PAR UN NIVEAU ÉLEVÉ D'INCERTITUDE ET D'ÉPARGNE, ET DES FONDAMENTAUX ENCORE PLUS INQUIÉTANTS À LONG TERME
A. À COURT TERME, UN SCÉNARIO DE CROISSANCE OPTIMISTE, QUI TRADUIT LE PARI DU GOUVERNEMENT SUR UNE LEVÉE DES INCERTITUDES
1. Le scénario de croissance du Gouvernement se situe dans la fourchette haute du consensus des économistes
Entendu par la commission des finances, le président du Haut conseil des finances publiques, Pierre Moscovici, a alerté les sénateurs sur des prévisions du Gouvernement qualifiées de façon générale d'« optimistes », s'agissant en premier lieu de la croissance. Après 0,7 % attendus en 2025, celle-ci est en effet estimée à 1 % pour 2026 alors que le consensus des économistes la situe plutôt à 0,9 %, en tout état de cause entre 0,5 et 1,2 %.
Une prévision de croissance du Gouvernement optimiste pour 20262(*)
Source : avis du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) sur le PLF et le PLFSS pour 2026
Selon les perspectives de l'OFCE publiées mi-octobre après l'avis du HCFP, la prévision centrale de croissance pourrait finalement plutôt se situer dans la moyenne basse de ce consensus, à 0,7 % en 2026.
De la nécessité d'une trajectoire macroéconomique crédible
Il n'est que de lire les éléments de la DG Trésor elle-même, dont le rapporteur général a obtenu communication sur le fondement de l'article 57 de la Lolf, pour s'apercevoir que le Gouvernement fait reposer le projet de budget sur un scénario macroéconomique optimiste. En effet, une « note présentant la trajectoire macroéconomique à horizon 2029 retenue dans le scénario d'amorçage des budgets économiques d'été 2025, en vue du PLF 2026 » faisait état, pas plus tard qu'en juillet, de prévisions actualisées de croissance, à 0,6 % pour 2025 (soit - 0,1 point par comparaison au rapport annuel d'avancement), puis 0,9 % pour 2026 (soit - 0,3 point par rapport au RAA). C'est, dans un cas comme dans l'autre, 0,1 point de moins que ce que le Gouvernement a retenu comme hypothèse sous-jacente au présent projet de loi de finances.
La DG Trésor accompagnait ses prévisions de cette recommandation, qui ne semble avoir été qu'en partie suivie : « Il est crucial que la trajectoire macroéconomique sous-jacente aux textes financiers à venir soit jugée crédible, aussi bien par le HCFP qui rendra un avis sur le PLF 2026 que par la Commission européenne et nos partenaires européens ainsi que par les investisseurs. Il est donc recommandé de retenir ce scénario technique de croissance et d'emploi pour construire les trajectoires budgétaires. »
Source : commission des finances
L'acquis de croissance s'élève à 0,8 % en 2025 (+ 0,1 % au premier trimestre, + 0,3 % au deuxième, + 0,5 % au troisième). Le HCFP souligne dans son avis précité que « pour 2025, la composition de la croissance a en revanche été nettement revue : la consommation des ménages serait bien moins dynamique qu'anticipé dans le RAA et la contribution de l'extérieur dégradée, la progression de l'activité résultant surtout de l'accroissement des stocks », ce qui laisse entrevoir de moindres consommations intermédiaires par la suite.
Signe d'une dynamique de croissance qui ne s'améliore pas, le Cepremap a souligné dans ses perspectives macroéconomiques d'octobre que les prévisions de croissance de l'OCDE pour 2025 et 2026 ont été révisées à la hausse de 0,2 point de pourcentage pour la plupart des pays, mais pas pour la France, où les prévisions sont inchangées et restent inférieures aux taux de croissance précédents3(*).
Quand bien même la prévision à 1 % viendrait à être atteinte, cette réalisation serait inférieure de 0,2 point à la prévision de croissance du rapport annuel d'avancement du plan structurel et budgétaire à moyen terme (PSMT) d'avril 2025.
Elle situerait toujours la France à un niveau inférieur de 0,5 point à la moyenne de la zone euro (hors France) et de 0,6 point à l'Union européenne.
Surtout, pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, la croissance allemande dépasserait la croissance française, ce malgré plusieurs « vents contraires » outre-Rhin, dont une démographie déclinante et une forte exposition au commerce international, actuellement déstabilisé.
Ainsi, alors que la croissance cumulée de l'Allemagne depuis les mesures de confinement face au Covid-19 a été nulle, la plupart des instituts de prévision anticipent désormais une reprise en 2026, à hauteur de 1,2 %, à la faveur notamment du stimulus budgétaire lié aux plans d'investissement annoncés dans la défense, les infrastructures et l'environnement. Incluant le plan d'investissement dans la défense, l'OFCE envisage même une croissance de 1,7 % en Allemagne, qui pourrait donc être deux fois supérieure à la croissance française.
L'année 2026 serait donc largement celle d'un rattrapage de la croissance allemande, « homme malade de l'Europe » ces dernières années, sur la croissance française. Comme le montre le rapprochement des courbes de croissance cumulée dans le graphique ci-dessous, l'écart de croissance cumulée depuis 2019 passerait de 4,2 points au mi-20254(*) à 2,4 points fin 20265(*).
Croissance cumulée du PIB par rapport à la moyenne de 2019
Source : OFCE, à partir des statistiques des instituts nationaux
C'est en grande partie la conséquence de la politique économique du Gouvernement, et notamment de l'effet récessif de la consolidation budgétaire, celle-ci s'imposant aujourd'hui pour compenser plusieurs années de dérive injustifiée des comptes publics.
Dans son scénario de croissance à 0,7 % pour 2026, l'OFCE identifie, à partir d'une croissance « hors chocs » estimée à 1,4 %, un impact de - 0,8 point lié à l'effet de la politique budgétaire nationale, ce qui en fait, de loin, le « choc » ayant le plus fort impact sur la croissance en 2026 (les autres éléments conjoncturels sont présentés infra).
Décomposition de la croissance prévue en 2026 par postes de contribution
(en points de PIB)
Source : commission des finances à partir des perspectives 2026 de l'OFCE
Au-delà de cette dimension conjoncturelle de la croissance, la croissance potentielle a été abaissée à 1,2 % pour la troisième année consécutive - alors qu'elle s'établissait à 1,35 % dans la prévision de la LPFP. La Commission européenne continue de juger cette prévision de croissance potentielle, pourtant abaissée, trop élevée. Le Haut Conseil des finances publiques l'a jugée « raisonnable », mais seulement « sous l'hypothèse cruciale que les réformes favorables à la croissance et au plein emploi » soient mises en oeuvre, qui ne semble pas en voie de se réaliser dans les circonstances politiques actuelles.
2. Le Gouvernement mise sur les effets positifs d'une hypothétique levée des incertitudes
a) Au plan intérieur, si le coût de la non-adoption d'un budget en temps utile serait vraisemblablement élevé, à l'inverse sa simple adoption ne suffira pas à effacer le coût de l'instabilité
La stabilité dans le temps du cadre institutionnel et des politiques menées présente d'importantes externalités positives sur l'économie. Natacha Valla a rappelé devant la commission des finances le 20 octobre 2025 que « la France est un pays très attractif, notamment par le biais de ses politiques publiques, de ses institutions, et de ce que les Anglais appellent « rule of law », qui ont beaucoup de valeur. Les Américains découvrent ainsi que la solidité de la démocratie [...] a une grande valeur, qu'il convient de préserver ».
Dans la période récente, en France, l'incertitude sur la politique économique du Gouvernement a pu conduire à un attentisme prenant la forme de projets d'investissement différés pour les entreprises ou, pour les ménages, d'une « sur-épargne ».
De nombreux chiffres ont circulé dans le débat public sur le coût de cette incertitude politique, ce qui a pu laisser accroire que la simple adoption d'un budget en temps utile suffirait à engendrer un surcroît de croissance économique. Il est cependant très difficile d'isoler l'effet économique de l'instabilité.
Les conséquences de l'incertitude politique sur le PIB
Les montants de 15 milliards puis 20 milliards d'euros ont largement été repris dans le débat public à la rentrée 2025 pour être, un peu rapidement, présentés comme le « coût d'une dissolution » pour les finances publiques. Il s'agit en réalité de l'effet de l'incertitude politique nationale6(*) - notion plus large, donc, que la seule dissolution - sur la croissance économique - et non sur les finances publiques, celles-ci étant certes affectées en retour par de moindres recettes liées à la contraction de l'activité économique. L'évaluation initiale de perte de 0,4 point de PIB (du fait de la séquence politique de juin à novembre 2024, avant la censure du gouvernement de Michel Barnier) a été réévaluée en octobre 2025 à 0,8 point de PIB sur la période 2024-2026, soit environ 24 milliards d'euros.
Ce montant a été calculé7(*) par Raul Sampognaro, économiste à l'OFCE, à partir d'un modèle reliant les grandes variables macroéconomiques et un indicateur disponible en ligne, appelé EPU (Economic Policy Uncertainty Index), tiré d'un article très cité de Baker et al. (2016), qui fournit cet indicateur faisant autorité dans le monde académique. Par comparaison avec le même indicateur des économies voisines, l'effet de l'incertitude mondiale est, lui, neutralisé. La méthode de calcul paraît cependant loin d'être infaillible (le « nombre d'articles contenant au moins un mot portant sur l'économie et un domaine de politique économique et un terme associé avec l'incertitude » dans deux journaux par pays, en France, Le Monde et Le Figaro).
Source : commission des finances
Pour justifier une suspension de la réforme des retraites adoptée en 2023, présentée comme une condition de l'adoption d'un budget par le Parlement, le coût de l'incertitude politique a été mis en regard du coût d'une telle suspension pour les finances publiques, estimé à 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027.
Le coût de cette suspension pour l'économie est toutefois estimé à environ 3 milliards d'euros dès 2027 - outre les prestations supplémentaires, elle a également pour conséquence une moindre activité -, un montant dynamique, une suspension continuant de produire ses effets pendant plusieurs années. Le président du HCFP a ainsi déclaré devant la commission des finances que la mise en oeuvre de la réforme « devait dégager d'ici à 2030 environ 10 milliards d'euros ».
Or, force est de constater que toutes les incertitudes ne pourront être levées par la simple perspective d'une adoption du budget en temps utile. Comme l'a précisé le HCFP dans son avis, « l'hypothèse de la dissipation des incertitudes est fortement fragilisée par le contexte politique actuel ».
Pour s'en rendre compte, sans même qu'il soit besoin d'envisager des évènements politiques « extrêmes » - à l'instar, par exemple, d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou d'une démission du président de la République suivie d'une élection présidentielle anticipée -, il n'est que d'observer la multiplication des prises de parole contradictoires de la part du Gouvernement sur un grand nombre de sujets, et y compris sur la cible de déficit public, un indicateur pourtant particulièrement structurant pour l'action publique (cf. infra, partie b du 1 du B du II).
De façon plus générale, le baromètre de la confiance politique8(*) du Cevipof 2025 fait apparaître que « la France se distingue par son niveau de confiance extrêmement faible envers la politique. Seuls 26 % des Français déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47 % en Allemagne et 39 % en Italie. La défiance est particulièrement marquée envers le gouvernement, qui n'inspire confiance qu'à 23 % des Français, contre 38 % en Allemagne et 35 % en Italie. »
Enfin, il convient de rappeler qu'il est dans la nature même de la démocratie que le résultat des prochaines élections constitue un aléa.
b) Sur le plan extérieur, le flou demeure sur l'ampleur de la contribution du commerce mondial à la croissance française
Le rebond postérieur à la crise liée au Covid-19 s'étant estompé, la croissance mondiale tend actuellement à diminuer : « après 3,4 % en 2024, elle n'augmenterait que de 3 % en 2025 et à hauteur de 2,8 % en 2026 », selon Olivier Redoulès de Rexecode, entendu par la commission des finances le 20 octobre. Selon les chiffres, proches, de l'OFCE, la croissance mondiale passerait « de 3,2 % en 2024 à 3 % en 2025 puis 2,9 % en 2026 ».
Ainsi que le rappelle l'OFCE dans ses perspectives européennes et mondiales pour 20269(*) « le désordre économique mondial n'a jusqu'ici pas provoqué de choc de même nature que celui de la crise financière de 2008, de la pandémie ou encore de la flambée des prix de l'énergie en 2022 ». La croissance mondiale se montre jusqu'ici relativement résiliente, dans un contexte de tensions commerciales pourtant peu usuelles au regard des dernières décennies.
La hausse des droits de douane américains sur les importations depuis l'UE
Le président des Etats-Unis Donald Trump avait appliqué une première hausse de droits de douane sur environ 300 milliards de dollars d'importations, centrée en particulier sur la Chine, en 2018-19. Maintenue par son successeur Joe Biden, qui a en outre introduit des critères de préférence américaine au travers de l'Inflation Reduction Act, la hausse a surtout eu pour effet une réorganisation des chaînes de valeur américaines autour d'approvisionnements en provenance du Mexique ou du Vietnam, sans réduction réelle des dépendances indirectes des Etats-Unis à la Chine (Alfaro et Chor, 202310(*)).
De retour à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump a directement appliqué en avril 2025 des droits de douane additionnels de 10 % (« baseline ») en plus des droits résiduels existants, sur l'ensemble de importations américaines sauf exceptions11(*), quel que soit le pays d'origine, soit sur un total d'environ 3 000 milliards d'euros, un volume de marchandises concernées à peu près dix fois plus important qu'en 2018-19.
Le même mois, lors du « jour de la Libération », ont également été annoncés des droits de douane « plus élevés, réciproques et personnalisés » (D. Trump) sur les importations de plus de cinquante partenaires commerciaux, dont l'UE, selon une règle de calcul inédite12(*) en vertu de laquelle l'UE aurait écopé de 20 points supplémentaires13(*) pour atteindre un taux de 30 %. Le président des Etats-Unis Donald Trump avait indiqué précédemment que l'Europe était « l'un des pires partenaires commerciaux » et qu'elle était « brutale ».
L'application de ces droits « réciproques14(*) » a été repoussée plusieurs fois, un accord conclu en juillet et formalisé en septembre ayant finalement limité ce taux à 15 % tout compris, avec des exemptions de droits reconnues pour des avantages comparatifs européens que sont les secteurs aéronautique et pharmaceutique, en échange de contreparties de l'Union européenne - baisses tarifaires ciblées et engagements non contractuels d'achat d'énergie américaine et d'investissements aux Etats-Unis. Des accords bilatéraux similaires ont été conclus avec de nombreux autres partenaires commerciaux.
Si l'accord obtenu par la Commission durant l'été 2025 a permis de gagner du temps, il repose sur une ambiguïté puisque l'Union européenne s'est engagée à des acquisitions d'énergie et à des investissements qui ne relèvent pas de sa compétence. Qu'adviendra-t-il si ces orientations ne sont pas respectées ?
Pour l'heure, en absence d'escalade tarifaire, les exportations européennes n'ont pas diminué en volume en 2025 par rapport à 2024.
En 2025, ce sont les entreprises américaines importatrices qui auraient payé les hausses de droits de douane sur leurs consommations intermédiaires (Hufbauer et Zhang, 202515(*)), ces droits n'étant ni répercutés à la hausse sur le prix final (seulement + 2 % de hausse des prix relatifs des produits importés), ni à la baisse sur le prix de vente des exportateurs. Le niveau d'inflation en octobre 2025, de 3 %, ne reflète pas encore, en lien avec les droits de douane, de hausse importante des prix. Ceux-ci devraient cependant sous quelques mois se répercuter sur les consommateurs américains, à mesure que les surstocks constitués précédemment s'épuisent. Fajgelbaum et al. (2019) ont en effet calculé16(*) que les droits de douane s'étaient intégralement transmis (« pass-through ») aux prix à la consommation lors de la hausse de 2018-19.
Source : commission des finances
Les États-Unis représentent seulement 8 % des exportations françaises, et près de deux tiers des échanges commerciaux de la France ont lieu au sein du marché intérieur, sans aucun droit de douane. Dans ce contexte, l'impact macroéconomique des décisions du président américain semble avoir pu être absorbé sans difficulté, en dehors de certains secteurs pour lesquels la dépendance au marché américain est plus substantielle - à titre d'exemple, 24 % des exportations françaises dans le secteur des boissons (vins, spiritueux, eaux minérales) sont destinées aux Etats-Unis - ou pour lesquels les droits demeurent plus élevés - acier, aluminium.
Les économistes du Cepii et de l'OFCE ont été surpris d'observer que les mêmes modèles qui prédisaient des gains à l'échange et à la conclusion d'accords de libre-échange fournissent, de façon consensuelle, une estimation de l'impact du commerce international, et notamment de la hausse des droits de douane américains, sur la croissance, relativement faible (- 0,3 % en 2026). La décomposition de ce faible impact de la politique commerciale fait en outre apparaître que la presque totalité proviendrait non des flux commerciaux constatés - quand bien même ils ont connu une volatilité accrue en 2025 - mais du surcroît d'incertitude.
Or, cette incertitude demeure particulièrement élevée. L'indicateur d'incertitude de politique économique de Baker, Bloom et Davis17(*), repris ci-dessous par l'OFCE, est plus élevé dans tous les pays que pendant la crise liée au Covid-19.
Indicateurs d'incertitude de politique économique
Source : OFCE, « Jusqu'ici, la croissance résiste18(*) », à partir de Baker-Bloom-Davis
Le président des Etats-Unis peut en effet, sur simple décret (executive order) - tant que la décision de la Cour suprême attendue sur sa compétence en la matière n'a pas été rendue -, décider de hausses de droits de douane générales ou ciblées. Le président des Etats-Unis a ainsi annoncé porter les droits de douane sur la Chine à 100 % au 1er novembre - annonce finalement non suivie d'effets - en réaction à l'exigence de la Chine de licences d'exportation pour les terres rares.
Le différentiel de droits de douane entre l'Union et les autres partenaires commerciaux des Etats-Unis, s'il joue aujourd'hui en la faveur de l'Europe, renforce également le risque de redirections du commerce mondial, qui seraient déstabilisatrices pour le tissu productif européen et français, déjà affaibli.
Observe-t-on un « second choc chinois » ?
L'OFCE note, dans ses perspectives 2025-2026 pour l'économie française19(*), « une forte baisse des exportations de la Chine vers les Etats-Unis entre janvier et juin 2025, et une progression des importations chinoises en biens (+ 6 % entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période l'année précédente alors que les importations de biens stagnent en valeur sur la période) qui pourrait laisser présager un phénomène de « déversement » de la production chinoise dans les pays européens ». Bien que « le phénomène soit pour le moment quantitativement limité, de l'ordre de 0,1 point de PIB », une escalade commerciale supplémentaire entre la Chine et les Etats-Unis ne peut être exclue.
Le constat effectué devant la commission des finances le 20 octobre, par l'économiste Olivier Redoulès, d'un « second choc chinois » depuis 2020, après le premier choc du début des années 2000 lors de l'admission de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce, paraît de mieux en mieux établi. Il est attesté par les flux commerciaux UE-Chine enregistrés depuis cette date (cf. graphique ci-dessous) et l'existence de « surcapacités industrielles de la Chine, en conjonction avec la fermeture partielle du marché américain ».
Solde commercial de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne, cumulé sur un an (en milliards de dollars)
Source : institut Rexecode, documents transmis à la commission
La Chine n'aurait pas vu ses prix à l'exportation augmenter autant que l'UE, engendrant « des gains en termes de compétitivité-prix pour la première, désormais capable d'exporter des produits de qualité comparable à celle des produits de la seconde, mais à des prix 20 % ou 30 % moins élevés » (O. Redoulès). Ni le doublement annoncé des droits de douane sur les importations d'acier et la réduction de moitié des quotas d'acier exemptés de droits, ni la mise en place dans le présent projet de loi (art. 22), et bientôt au niveau européen, d'une taxe forfaitaire de deux euros par article sur les colis d'un montant inférieur à cent cinquante euros (habillement, ameublement) n'épuisent, de toute évidence, la problématique de ce « second choc chinois », qui relève aussi d'une stratégie de dumping.
Source : commission des finances
Au titre des éléments de conjoncture mondiale qui pourraient, en sens inverse, présenter un effet favorable sur la croissance en 2026, il faut relever enfin « un excédent d'offre sur le marché pétrolier » qui pourrait conduire à « anticiper une modération future des prix pétroliers, même s'il faudra étudier la manière dont la Chine interviendra et absorbera une part dudit excédent », comme l'a rappelé Olivier Redoulès devant la commission. L'OFCE estime ainsi le baril à 65 dollars dans ses perspectives pour 2026. Le HCFP précise que la prévision du Gouvernement (67,5 dollars) intègre déjà cet effet favorable de la baisse du prix du pétrole.
Au total, selon les perspectives de l'OFCE pour 2026, alors que « le rebond du commerce extérieur avait fortement contribué à la croissance en 2023 et 2024 (contributions positives de respectivement 1 et 1,2 point à la croissance française) », « les exportations françaises progresseraient un peu moins rapidement que la demande adressée en raison d'une composition sectorielle relativement défavorable et d'une dégradation de la compétitivité prix consécutive à la hausse de l'euro. Les importations progresseraient plus rapidement que le PIB en raison d'une composition de la croissance favorable aux composantes à fort contenu en importations. La contribution du commerce extérieur à la croissance serait positive en raison d'un acquis favorable à la fin 2025 ».
3. Aucun poste de la demande privée ne semble assez dynamique pour apporter une contribution significative à la croissance
a) Une reprise des investissements peu plausible en l'absence de signaux crédibles de nature à rétablir la confiance des entreprises
Alors que la contribution de l'investissement à la croissance est restée relativement modeste en France ces dernières années par contraste avec la consommation (cf. infra), le Gouvernement fait reposer sa prévision de croissance pour 2026 sur un fort regain de l'investissement des entreprises.
Au regard des prévisions du consensus des économistes, l'ampleur prévue de ce regain apparaît éminemment contestable. L'hypothèse gouvernementale de reprise de l'investissement des entreprises est située, en dépit de toute indication crédible en ce sens, à 2,6 %, quand la prévision centrale du consensus des économistes d'octobre est une hausse de l'investissement des entreprises de 0,6 % en 2026 - un niveau qui s'est encore dégradé de 0,1 point par rapport aux données de septembre prises en compte par le HCFP. Le consensus des économistes anticipe une évolution du niveau des investissements comprise entre 2,3 % et - 2 % et, à en croire les perspectives de l'OFCE publiées mi-octobre, plus pessimistes, non seulement l'investissement des entreprises n'augmenterait pas en 2026, mais il diminuerait même fortement20(*) (- 1,7 %).
Au-delà des chiffres des principaux organismes de prévision, quatre indicateurs confirment que l'optimisme du Gouvernement est particulièrement marqué, laissant craindre un niveau d'investissement moindre qu'anticipé par le Gouvernement.
Premièrement, le nombre de dépôts de bilan d'entreprises est remonté à un niveau historiquement élevé en septembre 202521(*), laissant craindre un nombre de l'ordre de 67 500 faillites annuelles. Cette donnée ne serait pas particulièrement alarmante si elle correspondait uniquement, ainsi que le suggère le ministre de l'Économie Roland Lescure, à des faillites d'auto-entreprises, ce qui permettrait de relativiser le nombre de destructions d'emploi induites.
Il est à craindre toutefois que l'on s'approche plutôt de l'« heure de vérité » des mesures massives de soutien à l'économie prises pendant la pandémie de Covid-19 puis la crise énergétique. L'OFCE estime qu'après un pic de près de 165 000 entreprises « zombies22(*) » maintenues en vie fin 2023, il en demeurerait encore plus de 100 000 mi-2025 - notamment dans l'hébergement-restauration, les services aux ménages et la construction, secteurs les plus sensibles à la conjoncture.
Directeur des investissements du groupe Allianz, Ludovic Subran confirme dans un article paru dans Les Échos23(*) que « le niveau d'avant-crise est largement dépassé », en lien avec le fait que « le filet d'amortissement constitué pendant la pandémie s'est dissous, tandis que les aides publiques se sont retirées ».
Défaillances d'entreprises (secteurs marchands non agricoles)
Source : OFCE à partir des données de la Banque de France
Deuxièmement, l'indicateur du climat des affaires calculé par l'Insee à partir de ses enquêtes de conjoncture, reste sur une dynamique baissière depuis le début de l'année 2022, atteignant 96,7 % en octobre 2025. On peut présumer que les incertitudes, tant internationales que nationales, pèsent sur la décision d'investissement des entreprises.
Indicateur du climat des affaires (tous secteurs, France métropolitaine)
Source : Insee24(*)
Troisièmement, « les carnets de commandes sont toujours jugés dégarnis, nettement au-dessous de leur moyenne de long terme dans tous les secteurs, à l'exception de l'aéronautique », et notamment dans l'industrie et le bâtiment, selon la Banque de France25(*). Or, selon une approche keynésienne, soutenue par l'économiste Éric Heyer, la décision d'investissement serait d'abord et avant tout motivée par la perspective de ventes futures. Ces anticipations des dirigeants d'entreprises devraient conduire, en toute logique, à différer des projets d'investissements.
Carnets de commande des entreprises dans l'industrie et dans le bâtiment
Source : Banque de France
Quatrièmement, même dans le cas où un regain d'activité devait finalement se confirmer en 2026, cela ne se traduirait pas nécessairement pas un surcroît d'investissement, dans la mesure où le taux d'utilisation des capacités de production (TUC), de 76 %, demeure inférieur de plus d'un point à sa moyenne de long terme (77,2 %) et de plus de deux points par rapport à son niveau d'il y a trois ans (plus de 78,5 %) - alors qu'à l'inverse, les stocks sont à un niveau très supérieur à leur moyenne de long terme.
Taux d'utilisation des capacités de production (en %)
Source : Banque de France
Situation des stocks de produits finis dans l'industrie
Source : Banque de France (solde d'opinion CVS-CJO)
On voit mal, de toute façon, comment l'optimisme du Gouvernement, qui s'apparente à la méthode Coué, pourrait réellement redonner confiance aux entrepreneurs dans le contexte d'une hausse proposée des impôts pesant sur les entreprises, contraire aux déclarations constantes et répétées de l'exécutif, à l'instar de la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (cf. infra).
Au-delà de ces indications conjoncturelles, il convient de répéter que l'environnement fiscal et réglementaire demeure structurellement défavorable à l'investissement des entreprises en France. L'économiste Xavier Timbeau montre que le « rendement net d'impôts du capital productif » se situe en France à un niveau anormalement bas en comparaison européenne, et qu'il n'a fait que se stabiliser depuis 2018 - là où il s'est amélioré chez nos voisins.
Rendement du capital productif26(*) (avant et après IS)
Source : Xavier Timbeau (OFCE27(*))
b) Une amorce de désépargne des ménages qui pourrait enfin se concrétiser, à un rythme cependant encore faible en l'absence de réelles mesures pour l'encourager
Dans son avis sur les textes financiers de 2026, le Haut Conseil des finances publiques juge relativement favorable « la prévision de consommation des ménages établie par le Gouvernement à + 0,9 % (contre + 0,5 % en 2025) » parce qu'il n'y aurait pas « de gain de pouvoir d'achat net » en 2026 et parce que « le gel des prestations sociales a sans doute un impact négatif sur la consommation » dans la mesure où il touche des ménages dont la propension à consommer est élevée.
Ce regain de consommation ne provenant pas du pouvoir d'achat, il repose donc sur « l'hypothèse [sous-jacente] d'un repli du taux d'épargne de 0,6 point, de 18,4 % à 17,8 % », que le HCFP et l'OFCE28(*) jugent plausible.
Si cela se confirmait, il s'agirait d'une bonne nouvelle, tant la « surépargne » des ménages sur la période récente nuit à l'économie française.
Une épargne excessive et de surcroît
mal orientée,
faisant défaut à l'économie
française
La plupart des observations sur le phénomène récent de hausse de l'épargne en France ont insisté sur ses effets négatifs. Un taux d'épargne anormalement élevé peut freiner le potentiel de croissance d'une économie en ce qu'il annihile l'effet multiplicateur de la dépense et désemplit les carnets de commande des entreprises. Il peut également créer des risques financiers à l'échelle mondiale.
A contrario, les tenants de l'école néoclassique postulent cependant que c'est de l'épargne que naissent les investissements et qu'à ce titre un taux d'épargne élevé est avantageux pour la croissance économique.
Encore faudrait-il pour cela que cette surcapacité de financement française et européenne rencontre le besoin de financement des entreprises françaises et européennes. Or, selon une note de l'institut Rexecode29(*), les placements financiers dans la zone euro sont « moins risqués et moins rémunérateurs qu'aux Etats-Unis » : « largement dirigée vers des dépôts rémunérés, [l'épargne] est relativement peu rentable ». En conséquence, « comme l'Europe, la France est concernée par le risque de fuite de capitaux vers les Etats-Unis ».
Le rapport « Letta30(*) », qui propose une « Union de l'épargne et des investissements », dresse aussi le constat d'un marché européen des capitaux fragmenté, sur lequel la rentabilité est faible, ce qui se traduit chaque année par une fuite de 300 milliards d'euros d'épargne européenne investie dans les entreprises américaines.
Rejoignant ces constats, l'économiste Natacha Valla a insisté lors de son audition par la commission des finances sur le fait que « l'économie américaine s'est financée jusqu'à présent dans de bonnes conditions en absorbant une forte partie de notre épargne » : selon elle, la France serait exposée aux titres américains - dette publique, actions - à hauteur de 30 % de son PIB, soit deux fois plus que l'Allemagne.
Elle a formé le voeu « que cette épargne soit investie ailleurs, dans les structures productives de notre pays », lançant même un appel aux parlementaires : « Toutes les incitations que vous pourrez créer seront à cet égard les bienvenues. »
Source : commission des finances
Il convient pourtant de se montrer prudent sur le « phénomène annoncé depuis des années et qui ne se produit jamais » (P. Moscovici) de baisse du taux d'épargne.
À l'instar de nombreux économistes, la DG Trésor continue de s'interroger en 2025 sur « les facteurs qui pourraient expliquer le taux d'épargne élevé en France31(*) ». Le taux d'épargne des ménages, qui s'établissait autour de 14 à 15 % depuis les années 1980, est en effet désormais supérieur de plus de 4 points à cet étiage, pour atteindre, selon la dernière donnée, 18,4 % du revenu disponible brut32(*).
Taux d'épargne trimestriel des ménages de 2014 à 2024
(en % du revenu disponible brut)
Source : note de conjoncture de l'Insee (juin 2025), « L'épargne des ménages au sommet33(*) » (série CVS-CJO)
Le premier motif de cette sur-épargne a été le maintien du revenu disponible par des revenus de transfert, au travers du chômage partiel et du fonds de solidarité pendant les fermetures administratives prises en prévention du Covid-19, expliquant un pic de taux d'épargne à 26 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2020. À l'inverse, le taux d'épargne n'avait pas augmenté après la crise financière de 2009.
Si le taux a fortement diminué dès le deuxième trimestre de l'année 2020, la tendance à la hausse du taux d'épargne, « commune à la plupart des pays européens, mais plus marquée en France », s'est depuis lors à nouveau confirmée, avec notamment une hausse très marquée de 1,2 point entre 2023 et 2024.
(1) Une « sur-épargne » liée à l'inflation qui serait en voie de s'estomper
En l'absence de choc exogène qui expliquerait la hausse récente de l'épargne de manière aussi univoque que la crise sanitaire, de premières explications se sont concentrées sur la psychologie et les anticipations des ménages, dans le contexte inflationniste de la crise énergétique.
Des effets contradictoires de l'inflation sur l'épargne
S'agissant des effets de l'inflation sur les décisions d'épargne, deux mécanismes contradictoires trouvent à s'appliquer :
- d'une part, un effet « Mundell-Tobin », poussant le taux d'épargne à la baisse, qui verrait les ménages renoncer à épargner pour maintenir leur consommation inchangée dans un contexte de hausse des prix. C'est la fonction classique de l'épargne de lissage des revenus dans le temps ;
- d'autre part, poussant le taux d'épargne, en sens inverse, à la hausse, un effet « Pigou », qui conduirait les ménages à un surcroît d'épargne pour maintenir la valeur réelle de leurs actifs et ainsi faire face à la perspective d'une érosion de leurs revenus futurs.
Bien que le premier mécanisme puisse paraître plus intuitif, il ressort des équations de l'OFCE que le second aurait eu un impact prépondérant sur la période récente, l'effet net de ces deux effets comportementaux contribuant ainsi à la hausse du taux d'épargne.
Source : commission des finances
On pourrait s'attendre à une normalisation du taux d'épargne avec le retour, depuis 2024, à une inflation plus modérée.
Pour autant, l'incertitude nationale et internationale - agression de l'Ukraine par la Russie, déstabilisation du commerce international - demeure propice à ces comportements de précaution.
De plus, on peut gager que le retour à intervalles réguliers dans le débat public du thème de la « faillite » de la France ou les doutes de plus en plus répandus sur la pérennité du système de répartition des retraites, assimilé par certains à une « pyramide de Ponzi », ne contribuent pas à améliorer la confiance des ménages dans l'avenir.
Un « effet d'équivalence ricardien » a également pu jouer en lien avec la diminution des recettes publiques (en % du PIB) non financée par des baisses équivalentes de dépenses publiques, les ménages anticipant que la dégradation du solde public finisse par conduire le Gouvernement à lever davantage d'impôts. Alors que la France se trouve au début d'une trajectoire de consolidation, les ménages ont toujours de quoi se montrer inquiets.
L'Insee met enfin en avant « l'attentisme concernant l'achat de certains produits (automobiles notamment) ». On peut présumer que la forte instabilité réglementaire et fiscale entourant ce secteur n'a pas été de nature à favoriser des décisions de consommation lourdes.
(2) Une hausse de l'épargne liée à la hausse des revenus financiers
Des explications moins psychologiques ont cependant également pu être mises en avant pour expliquer la « sur-épargne » récente, liés à la « composition du revenu (les revenus du patrimoine, faiblement consommés, ont fortement augmenté)34(*) ».
Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, les revenus financiers ont augmenté, tandis que les revenus salariaux ont enregistré dans un premier temps une baisse en termes réels, le rattrapage des salaires par rapport aux prix ne s'opérant que partiellement et avec retard. Ce type de revenus financiers est en outre plus souvent épargné - et cette épargne, mieux rémunérée, engendre en retour encore davantage de revenus financiers.
L'économiste Éric Heyer met aussi en avant cet effet favorable à l'épargne de la hausse marquée des revenus financiers, bénéficiant aux ménages les plus aisés, disposant d'une propension à consommer plus faible que la moyenne.
Il souligne notamment que l'épargne financière (en bleu ci-dessous), historiquement plus faible en France que l'épargne immobilière (en rouge ci-dessous), doublant par rapport à 2019 en proportion du revenu disponible brut, est devenue prépondérante sur ces dernières années,
Fait notable, la France aurait pour la première fois - hors Covid-19 -, enregistré en 2025 une épargne financière plus élevée qu'en Allemagne, pays où elle est pourtant historiquement deux fois supérieure à la moyenne de la zone euro.
Taux d'épargne financière et
immobilière des ménages
(en % du revenu disponible
brut)
Source : Éric Heyer (OFCE)
(3) L'invalidation de la théorie du « cycle de vie » par la sur-épargne des retraités
« L'épargne des ménages se compren[ant] classiquement comme un arbitrage entre une consommation présente et un usage futur », l'allongement de la durée de vie présente un effet favorable aux comportements d'épargne en raison d'« un poids subjectif plus important associé à l'avenir ». Comme le résume l'économiste Hippolyte d'Albis, professeur à l'Essec, « si vous savez que vous avez de bonnes chances de vivre longtemps, vous avez intérêt à épargner davantage pour financer cette longévité35(*) ».
Pour autant, usuellement, ce ne sont pas les personnes âgées qui épargnent le plus - un fait stylisé remarquablement persistant sur les comportements de consommation, d'investissement et d'épargne des ménages, connu sous le nom de « théorie du cycle de vie ».
La théorie du cycle de vie
Exposée par Franco Modigliani en 1961, la « théorie du cycle de vie », correspond simplement à la modélisation de l'observation selon laquelle les jeunes ménages s'endettent (phase A), avant de progressivement rembourser leurs dettes et de constituer un capital (phase B), et enfin de consommer l'épargne ainsi accumulée pour subvenir à leurs besoins (phase C) après avoir mis fin à leur activité professionnelle.
Source : Alternatives économiques
Source : commission des finances
Or, cette théorie se vérifie de moins en moins en France où ce sont désormais les ménages retraités qui contribuent le plus à la hausse de l'épargne, ce qui constitue une exception historique.
L'Insee a estimé dans sa note de conjoncture de juin 202536(*) qu'« environ deux tiers de la hausse du taux d'épargne entre 2023 et 2024 » proviendrait des personnes âgées de 65 ans ou plus (partie en vert clair dans le graphique ci-dessous), dans un échantillonnage des données bancaires de 180 000 ménages représentatifs de la clientèle de La Banque Postale - qui peut différer quelque peu de la population française.
Cela s'expliquerait par « la forte progression de leur revenu, en particulier pour les plus modestes, portée par les revalorisations de pensions de retraite qui ont répercuté, avec retard, l'inflation survenue en 2023 ».
Contribution à la différence du taux
d'épargne moyen
par rapport à l'année
précédente, par tranche d'âge37(*) (en points)
Évolution du taux d'épargne entre
2023 et 2024 par tranche d'âge
et par quintile de
revenu
Source : Insee38(*), à partir de données de La Banque Postale
Alors que des débats se font jour sur l'équité du système de retraite39(*), l'article 6 du présent projet de loi prévoit de remplacer l'abattement de 10 % sur les frais professionnels des retraités par un abattement forfaitaire de 2 000 euros sur les pensions de retraite. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit également une non-indexation sur l'inflation des pensions de retraite de base. Si ces mesures subsistaient dans les textes adoptés, elles pourraient inciter les ménages concernés à puiser en partie dans cette épargne excédentaire.
4. L'économie française devra naviguer contre le courant d'une politique budgétaire qui pourrait être récessive en 2026, alors que la politique monétaire ne serait que d'une aide relative
a) Un niveau des prix et des salaires en décalage avec le reste de la zone euro, conséquence à retardement du bouclier tarifaire, limitant l'influence de la politique monétaire
Le Gouvernement retient comme hypothèse une inflation de 1,3 % en 2026, ce qui est proche de l'estimation du consensus des économistes (valeur centrale de 1,4 %, valeur basse à 1,1 % et valeur haute à 1,8 %), soit un léger regain par rapport au taux estimé de 1,1 % en 2025, notamment tiré par les services. Cela signifierait, après un taux de 2 % en 2024, deux années consécutives d'inflation nettement inférieure à la cible de niveau des prix de 2 % qui figure dans le mandat de la Banque centrale européenne40(*).
L'inflation observée et prévue en France est en effet bien inférieure à celle de la zone euro, ce qui se traduit notamment par une inflation cumulée plus faible en France que chez ses principaux voisins depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19 : depuis le dernier trimestre 2019, l'inflation cumulée de la France est inférieure de 6,1 points à celle de l'Allemagne et de 3,9 points à celle de la zone euro.
Niveau de l'indice des prix à la consommation (base 100 = décembre 2019)
Source : OFCE à partir des données Insee
Cela s'expliquerait notamment par l'efficacité du « bouclier tarifaire » pour pondérer les salaires et les prix pendant la crise inflationniste, et éviter la mise en place d'une boucle prix-salaires.
Le bouclier tarifaire français : une mesure non ciblée et non financée
Une crise énergétique a affecté l'Union européenne à partir de septembre 2021 dans un contexte de tensions sur les approvisionnements liées à la reprise post-Covid, puis s'est aggravée du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'un des principaux fournisseurs de gaz de l'UE, en février 2022. Cela a notamment mis en difficulté l'industrie, qui consomme un tiers de l'électricité et du gaz de l'Union européenne, mais aussi les ménages.
La réponse de la France s'est nettement distinguée de celle de ses voisins : elle s'est traduite par la mise en place d'un « bouclier tarifaire » ayant consisté, plutôt qu'en des transferts ou crédits d'impôt, en une limitation des prix de l'électricité (+ 4 % au lieu de + 30 % en 2022, et + 15 % au lieu de + 100 % en 2023) et du gaz (gel à leur niveau du T4 de 2021, tout au long de l'année 2022, et + 15 % au lieu de + 100 % en 2023), directement incorporée dans les tarifs réglementés des ménages.
Par construction, cette mesure a bénéficié à l'ensemble des consommateurs. Elle n'a, de façon notable, fait l'objet d'aucun plafond en cas, par exemple, de dépassement d'une certaine consommation en kWh, ni d'aucune condition de ressource - alors même que la consommation énergétique des ménages les plus aisés est faiblement élastique.
Cette absence de ciblage a entraîné un coût pour les politiques publiques estimé à cinquante milliards d'euros stricto sensu. Au total, l'ensemble des mesures prises pour atténuer les effets de la crise de l'énergie sur les consommateurs (incluant des mesures telles que les chèques énergie exceptionnels, des subventions exceptionnelles aux entreprises les plus consommatrices d'énergie, et la ristourne sur les prix à la pompe des carburants) auraient coûté entre deux points de PIB (soit environ 60 milliards d'euros) pour le Conseil d'analyse économique et 100 milliards d'euros pour la Commission européenne.
Selon l'OFCE, cette politique a créé un décalage durable du niveau des prix entre la France et ses voisins, qui pourrait être assimilable à une « désinflation compétitive » cachée potentiellement plus puissante que l'effet produit, en son temps, par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Source : commission des finances
Coûteuse pour les finances publiques et à ce titre largement responsable de la dérive du solde public après 2022, cette politique place désormais la France dans une situation où le niveau des prix est plus faible que dans le reste de la zone euro, sans possibilité pour la politique budgétaire, compte tenu de l'état des finances publiques, de compenser une politique monétaire légèrement restrictive au regard du niveau des prix observés.
La politique monétaire est beaucoup moins accommodante pour la France que pour ses voisins, l'inflation moyenne étant de 2,2 % dans la zone euro. Nos voisins bénéficient au contraire d'une politique monétaire plus en phase avec le niveau des prix dans leur économie.
Le « policy mix » de la France se caractérise donc par une politique monétaire relativement restrictive alors qu'une politique budgétaire plus clairement encore restrictive s'impose. Cette conjonction ne devrait pas rapidement disparaître, une consolidation budgétaire étant nécessaire et les marges de la politique monétaire étant limitées par une anticipation d'inflation dans la zone euro en 2026 qui se situe autour de 2,2 % - un niveau proche, mais légèrement supérieur à la cible d'inflation de 2 % objectif à moyen terme sur lequel repose le mandat de la Banque centrale européenne. Afin de respecter cette cible, la Banque centrale européenne (BCE), qui avait procédé à huit baisses de taux consécutives, entre juin 2024 et juin 2025, le portant de 4 à 2 %, a donc dû depuis lors maintenir inchangé à ce niveau, trois fois de suite, la facilité de dépôt.
La situation ne devrait, de surcroît, pas s'améliorer, dans la mesure où l'économiste Natacha Valla a expliqué devant la commission que « la politique monétaire restait plus accommodante que suggéré », comme en attesterait « un écart croissant [entre les taux observés et] les taux [auxquels aboutiraient l'application de] la règle de Taylor41(*) ».
Taux de Taylor et taux directeur de la BCE (en %)
Courbe pleine : estimation du taux en appliquant la règle de Taylor
Courbe pointillée : taux de la BCE
Barres verticales : écart entre le taux de la BCE et la règle de Taylor
Source : document remis à la commission des finances par Natacha Valla
Cela limite encore davantage les perspectives de contribution de la politique monétaire à la croissance française, le marché anticipant désormais au mieux un très léger assouplissement et probablement une stabilisation des taux directeurs.
Anticipation par le marché de
l'évolution du taux de rémunération des
dépôts
de la BCE, d'ici à
2028 (en %)
Source : document remis à la commission des finances par Natacha Valla
La politique monétaire ne sera certes pas d'aucun secours en 2026 via ses outils conventionnels que sont les taux directeurs, puisqu'une décision de politique monétaire ne produit tous ses effets qu'environ dix-huit mois après avoir été prise par le conseil des gouverneurs. C'est ainsi que, selon l'OFCE, « l'impact de la politique monétaire et des taux longs augmenterait à 0,6 point de contribution, contre 0,3 en 2025 ». La prévision du Gouvernement intègre déjà cet effet positif des effets différés de l'assouplissement monétaire, comme le souligne le HCFP.
b) L'impulsion budgétaire des lois de finances et de financement de la sécurité sociale devrait contracter le PIB
Au-delà du simple fait d'adopter les textes financiers de la nation en temps utile, ce qui peut certes, en soi, présenter un impact sur la croissance en réduisant l'incertitude sur la politique économique, le contenu de ces textes emporte des effets plus significatifs encore.
Ce « contenu » peut s'entendre à la fois du niveau agrégé des dépenses et des recettes publiques, de leur composition, et, surtout, de leur évolution dans le temps. L'agrégation de l'effet des « mesures nouvelles » ou « mesures discrétionnaires » donne notamment lieu à l'identification de ce que les observateurs des finances publiques appellent « impulsion budgétaire » - cette impulsion pouvant être positive ou négative.
Il existe une riche littérature économique sur l'effet différencié des impulsions budgétaires, en fonction de la position dans le cycle - phase expansive ou récessive -, de la prédominance d'efforts en dépenses ou en recettes, de leur nature - consommation directe, investissement, dépenses de transfert, fiscalité sur les ménages ou sur les entreprises.
En effet, les incidences d'un effort en dépenses ou en recettes ne sont pas strictement équivalentes. L'économiste Alberto Alesina tend à montrer que, toutes choses égales par ailleurs, les réductions de dépenses seraient les moins récessives.
La logique keynésienne, peu appliquée en pratique, veut par ailleurs que le solde public soit négatif en période de crise, avant d'être compensé par des excédents en période d'expansion.
L'effet multiplicateur d'une variation du déficit public
L'effet multiplicateur d'une variation du déficit public désigne l'effet d'une augmentation de déficit public sur l'économie, selon François Ecalle. Ce dernier rappelle qu'en 2017 le modèle Mésange utilisé par la DG Trésor identifiait un effet multiplicateur sur le PIB à deux ans d'une hausse de 1 % du déficit public à :
- 1,4 pour une hausse de l'investissement public,
- 1,1 pour une hausse générique de la dépense publique,
- 0,8 pour une baisse de la CSG,
- 0,6 pour une baisse des cotisations sociales des employeurs.
Cela signifie, à l'inverse, que pour une réduction du déficit de 1 Md€ permise par une baisse de l'investissement public, l'effet récessif sur le PIB serait de 1,4 Md€.
Coenen et al. (201042(*)) avaient quant à eux estimé, dans une revue des principaux modèles utilisés par les institutions internationales, réalisée pour le FMI, que le multiplicateur était :
- « en moyenne proche de 1 pour une baisse de l'investissement ou de la consommation,
- de l'ordre de 0,7 pour une baisse des transferts sous condition de ressources,
- entre 0 et 0,5 pour une baisse des transferts sans condition de ressources,
- et de l'ordre de 0,2 pour une hausse des impôts ».
L'estimation du multiplicateur demeure un exercice très délicat parce que les ajustements budgétaires interviennent souvent en réaction à un événement économique préexistant, et qu'il est de ce fait malaisé d'isoler l'effet de l'ajustement de celui du contexte économique.
Une baisse de dépense publique pourrait en théorie se traduire par une dépense privée équivalente des ménages ou des entreprises. Cela implique toutefois que la baisse soit accompagnée d'une baisse d'impôts équivalente. Or, en contexte de déficit budgétaire, la baisse de dépense publique est absorbée par la réduction du déficit public.
À supposer même que la baisse de dépenses publiques se traduise par une baisse d'impôts équivalente, la dépense privée n'a en outre rien de certain, puisque la somme en question peut aussi bien être épargnée. En outre, certaines dépenses privées qui auraient pu être entraînées par un effet multiplicateur de la dépense publique peuvent finalement ne plus être programmées.
Source : commission des finances
Selon le HCFP, l'hypothèse de multiplicateur budgétaire moyen retenue par le Gouvernement pour 2026, de l'ordre de 0,5, est « un chiffre assez faible relativement aux valeurs usuelles ». Le HCFP juge plutôt que l'ajustement budgétaire du Gouvernement « aurait un impact sur la croissance de 0,6 point ».
Un effet récessif de l'ajustement budgétaire sous-estimé selon le HCFP
« L'ajustement budgétaire envisagé en 2026 (0,8 point de PIB potentiel) pèserait négativement pour 0,4 point de croissance, correspondant à un multiplicateur budgétaire moyen évalué à ½. Cette estimation appelle deux observations :
- d'une part, l'ampleur de la consolidation budgétaire est plus élevée en effort structurel (1,0 point), voire en effort structurel primaire (1,2 point) : le multiplicateur budgétaire moyen sous-jacent est donc plutôt de l'ordre de 0,4, un chiffre assez faible relativement aux valeurs usuelles. L'administration le justifie par la composition de l'effort, qui serait ciblé vers des ménages dont la propension marginale à consommer est plus faible, et vers des grandes entreprises à larges capacités de financement : cette explication est qualitativement plausible mais difficile à expertiser, faute du détail des multiplicateurs retenus pour chacune des mesures en dépense et en recettes. La composition de l'effort en dépense d'une part, entre ce qui relève de la demande publique et des autres dépenses, et en recettes d'autre part, entre ce qui relève des différents types de prélèvements obligatoires, suggérerait néanmoins un multiplicateur un peu plus élevé que celui retenu par le Gouvernement ;
- d'autre part, la croissance en 2026 devrait aussi être affectée par l'effort budgétaire déjà opéré en 2025 (0,8 point de PIB). Ainsi, en prenant en compte les effets retardés de l'ajustement en 2025, tout en tenant compte de la composition des mesures, l'effort budgétaire prévu pèserait davantage qu'affiché sur la croissance en 2026, d'au moins 0,2 point supplémentaire sur la base de multiplicateurs usuels. »
Source : avis du Haut Conseil des finances publiques sur le PLF et le PLFSS pour 2026
Du reste, le multiplicateur associé à l'ajustement structurel de 0,8 point de PIB potentiel proposé par le Gouvernement était plutôt estimé à environ 0,5 par la Direction Générale du Trésor, selon des éléments fournis au rapporteur général. L'administration de Bercy identifie ainsi plus en détail des multiplicateurs par nature de l'effort.
Effets multiplicateurs en fonction de la nature des économies
|
Ajustement structurel |
Effet multiplicateur associé à court terme |
Impact sur l'économie |
|
|
Effort en dépenses (baisse) |
17,3 Md€ |
- 0,60 |
- 10,4 Md€ |
|
Effort en prélèvements obligatoires (PO) |
11 Md€ |
- 0,35 |
- 3,7 Md€ |
|
dont hausse des PO sur les ménages |
5,8 Md€ |
- 0,40 |
- 2,3 Md€ |
|
dont hausse des PO sur les entreprises |
1 Md€ |
- 0,10 |
- 0,1 Md€ |
|
dont hausse de la fiscalité indirecte |
4,2 Md€ |
- 0,30 |
- 1,3 Md€ |
|
Effort en recettes hors PO |
- 5,1 Md€ |
- 0,40 |
+ 2 Md€ |
|
Total |
23,2 Md€ |
- 0,50 |
- 12,1 Md€ |
Source : commission des finances, d'après des éléments fournis par la DG Trésor
Se montrant beaucoup plus sceptique, l'OFCE estime pour sa part que la consolidation budgétaire aurait un effet récessif notable, chiffré à 0,8 point de PIB dans l'hypothèse pourtant très prudente d'un déficit public à 5 % du PIB - soit un effort structurel plus proche de 0,7 point, et donc un multiplicateur, plus classiquement, proche de 1.
Il ne s'agit pas de remettre en question la nécessité d'une consolidation budgétaire, mais de pointer la situation dans laquelle des années de croissance achetées à crédit par le déficit public nous placent aujourd'hui.
Pour reprendre l'argumentaire développé dans une note de la DG Trésor de janvier 2025 communiquée au rapporteur général, qu'une moindre consolidation n'aurait pas forcément un effet positif sur l'activité si elle s'accompagne d'une incertitude accrue pour les agents économiques, ceux-ci pouvant anticiper une dégradation des conditions de crédit et de futures mesures fiscales. Olivier Redoulès confirme que « l'impact conjoncturel négatif des mesures budgétaires s'estompera trimestre après trimestre » et estime que, la France étant proche de son potentiel de production (écart de production proche de 0), une consolidation budgétaire ne risque pas d'être autodestructrice (self-defeating) comme en 2012.
c) La France ne semble bénéficier que marginalement d'une hausse de la demande adressée par ses voisins européens, même en cas de stimulus budgétaire dans ces pays
L'OFCE souligne, dans ses perspectives européennes et mondiales pour 2026, qu'« à l'exception de l'Allemagne, qui dispose de marges de manoeuvre et des Etats-Unis qui font fi de la dynamique de la dette, les impulsions seront le plus souvent négatives » en matière de politique budgétaire en 2026. Selon l'observatoire, « en Europe, le souci de réduire ou du moins de stabiliser la trajectoire de la dette publique en points de PIB pousserait plusieurs pays à mettre en oeuvre une politique budgétaire restrictive ; notamment la France, l'Espagne et le Royaume-Uni ».
Depuis la pandémie de Covid-19, deux pays qui avaient subi une crise de leur dette souveraine, l'Espagne et l'Italie, ont enregistré une croissance élevée. Cela s'est notamment expliqué, dans ces deux pays, par un le plan Next Generation EU. Davantage que les prêts, dont il semble se confirmer qu'ils ne seront pas « consommés » à hauteur de ce qu'ils auraient pu dans la plupart des États membres, du fait notamment de la remontée des taux d'intérêt à partir de 2022, les subventions ont permis un important stimulus.
Pour ce qui concerne l'Italie, les très bonnes performances post-Covid en 2021 et au premier semestre 2022 se sont expliquées par la mise en place d'un « superbonus43(*) » pour la rénovation énergétique et sismique des bâtiments consistant en un crédit d'impôt de 110 % du montant du devis entre 2020 et 2022, un taux progressivement ramené à 60 % en 2025.
Pour autant, les effets de la demande adressée par l'Espagne et l'Italie à la France les années passées n'ont pas semblé très puissants.
Une explication peut être que le dispositif italien a produit ses effets avant tout sur le secteur de la construction, peu sujet aux fuites à l'importation car il est implanté localement. Il n'aurait ainsi que peu contribué à la demande adressée à la France et donc peu bénéficié à la croissance française.
Pour l'avenir, s'agissant du cas allemand, l'impulsion budgétaire pourrait s'avérer importante, un fonds ayant été créé en 2025 pour investir 500 milliards d'euros dans les infrastructures, le climat, mais aussi le numérique, l'éducation et la recherche sur la période 2025-2036 (soit plus de 40 milliards d'euros par an). L'Allemagne a assoupli sa limite constitutionnelle du déficit public de 0,35 % du PIB, appelé « frein à la dette », en exemptant les dépenses relatives à la défense au-dessus de 1 % du PIB.
Or, la France figure parmi les principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne et dispose d'une base industrielle, technologique et de défense française (BITD) importante.
On eût pu s'attendre à une demande adressée à la France importante dans le contexte où la première économie de l'Union européenne connaîtrait un rebond à 1,2 % de croissance en 2026. Néanmoins, les instituts de prévision allemands ne tablent pas sur des commandes importantes à la base industrielle, technologique et de défense française (BITD) française, mais plutôt aux entreprises américaines du secteur des équipements de défense. S'agissant du plan dans les infrastructures et le climat, on peut présumer que l'avance chinoise dans les technologies vertes sera difficile à contester pour la France, qui reste cependant bien positionnée dans les services à l'environnement.
Il en résulte que la contribution de la politique budgétaire de nos partenaires commerciaux à la croissance française s'élèverait à seulement de + 0,1 point en 2026, un montant loin de compenser l'effet récessif de la politique budgétaire nationale (- 0,8 point).
B. À PLUS LONG TERME, DES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DÉGRADÉS, QUI NE PERMETTENT GUÈRE D'ESPÉRER UN REDRESSEMENT FACILE
1. Des performances productives présentées comme relativement résilientes mais encore médiocres, au sein d'un continent lui-même atone
a) Un modèle de croissance trop centré sur la dépense publique et la consommation des ménages, qui obère les capacités productives de la France et accroît son déficit public
Dans la présentation des orientations budgétaires de son gouvernement pour l'année 2026, mi-juillet 2025, l'ancien Premier ministre François Bayrou avait pris soin de mettre en regard la question de la dette et celle de la hausse de la production. Ainsi, à côté d'un plan « Stop à la dette », un second volet du plan budgétaire a été présenté à la presse, qualifié de plan « En avant la production ! », comprenant comme mesure principale la suppression de deux jours fériés.
Bien que la commission des finances ait indiqué par la voix de son rapporteur général que la suppression des deux jours fériés - depuis lors abandonnée - « devrait faire partie d'un dialogue avec les partenaires sociaux avant d'arriver au Parlement44(*) », l'accent mis de façon générale sur l'importance de la production et du travail pour redresser les comptes publics rejoint un constat qu'elle avait déjà effectué depuis plusieurs années.
Les économistes Carl Grekou et Thomas Grjebine, du programme scientifique Macroéconomie et finance internationales du Cepii, considèrent que le modèle de croissance français reposerait, à l'instar pendant longtemps des modèles espagnol ou italien, excessivement sur la demande, et donc sur la dépense publique et la consommation des ménages.
Or, « bénéfiques sur l'activité à court terme, les politiques de relance ne sont pas sans conséquences sur le solde commercial et la compétitivité industrielle45(*) ». Elles ont en effet pour double défaut d'induire des « fuites à l'importation » d'une part, et, d'autre part, un important besoin de financement pesant sur les entreprises via la fiscalité.
Les politiques budgétaires expansionnistes contribueraient largement, in fine, à la persistance du déficit commercial de la France ainsi qu'à sa désindustrialisation.
Par conséquent, au-delà de son coût immédiat pour nos finances publiques, ce modèle accentuerait à long terme l'érosion de notre base productive, diminuant encore nos recettes publiques et augmentant le besoin en dépenses de transfert. Il placerait la France dans un équilibre dont il serait difficile de s'extraire, ce que les années récentes et le présent budget ne font que confirmer.
Les auteurs n'appellent pas à une compression de la demande, mais plutôt à une meilleure coordination au sein de l'Union européenne.
Dans une veine plus narrative et moins statistique, l'essayiste Jérôme Fourquet aboutit à des constats similaires. Il identifie en France un « modèle stato-consumériste », qui « repose sur deux postulats et piliers que sont, d'une part, l'extension permanente de la dépense et de la sphère publiques (financée par un niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE) et, d'autre part, le primat accordé à la consommation comme principal moteur économique, au détriment de la production46(*) ».
Cette dépense publique présenterait « à court terme un effet dopant » et permettrait « d'apaiser quelque peu les tensions sociales de la France », mais elle aurait « un coût à long terme faramineux », avec pour effet que « de très nombreuses filières productives, lestées d'un haut niveau de prélèvements obligatoires et d'un carcan réglementaire de plus en plus incapacitant, n'ont pas pu lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers ».
L'essayiste rappelle qu'« en cumulant la consommation des ménages (56 % du PIB) et celle des administrations (23,2 %), la consommation représente aujourd'hui 79,2 % du PIB, contre par exemple 71,8 % en Allemagne selon l'OCDE ».
b) Une France qui glisse dans le ventre mou de l'Europe, avec un niveau de richesse bientôt deux fois moins élevé que celui des États-Unis et un décrochage technologique vis-à-vis de la Chine
Le diagnostic d'une divergence croissante du niveau de richesse et de technologie entre les Etats-Unis et l'Europe, et en particulier la France, a abondamment nourri le débat public des derniers mois, sur fond de craintes d'un décrochage de l'Europe, et de la France en son sein.
Ainsi, dans une tribune parue dans Challenges47(*), l'économiste Christian Gollier, professeur à l'école d'économie de Toulouse, avance qu'« entre 1980 et 2024, le PIB par habitant de la France envers les Etats-Unis est passé de la parité à la moitié ». Les données de PIB par habitant en dollars courants de la Banque mondiale attestent ci-dessous de cette quasi-parité en 1980 (12 575 $ aux Etats-Unis contre 12 565 $ en France) et de cet écart proche du double en 2024 (85 800 $ aux Etats-Unis contre 46 150 $ en France).
PIB/habitant en dollars courants annuels (en milliers)
Source : Banque mondiale
Il en résulterait, selon Christian Gollier, un « déclassement économique et un mécontentement social », le pays s'enfonçant dans « le cercle vicieux de la stagnation compensée par la hausse de la fiscalité pour financer leur système social ». Plusieurs témoignages individuels de cette divergence ressentie de pouvoir d'achat ont pu être relevés dans la presse généraliste48(*).
Chercheur associé à Bruegel, l'économiste Zsolt Darvas, invitait certes à nuancer ce constat dans une tribune au « Monde » de mars 202449(*). Selon lui, la comparaison de PIB par tête entre l'Union européenne et les Etats-Unis serait en effet affectée par deux biais statistiques importants.Le premier serait que le PIB par tête n'est généralement pas exprimé en parité de pouvoir d'achat, ce qui inclut donc les variations du taux de change entre l'euro et le dollar. Or, celles-ci ont été importantes depuis la création de l'euro : ainsi, alors que 1 euro valait 0,92 dollar en 2000, il valait 1,47 dollar en 2008 à son plus fort, avant de redescendre à 1,09 dollar au moment de la publication de la tribune. Le constat d'une divergence du niveau de richesse entre Europe et Etats-Unis, prenant souvent comme point de référence la crise financière mondiale de 2008, inclut donc le déclin relatif de la valeur de l'euro sur cette période, passé de près de 1,50 dollar en 2008 à environ 1,10 dollar début 2025.
Le second biais proviendrait du fait que le PIB par tête serait une donnée moins pertinente que celle du PIB par heure travaillée pour déterminer la capacité d'un pays ou d'une zone à créer de la richesse. En effet, « en Europe, les salariés ont tendance à travailler moins d'heures qu'aux Etats-Unis, en partie parce qu'il y a plus de congés payés, que la semaine de travail typique d'un salarié à temps plein est plus courte et qu'il y a plus de travailleurs à temps partiel ». L'écart de richesse s'expliquerait donc par un choix, en quelque sorte une « préférence européenne pour le loisir ».
Au total, après retraitement de ces deux variables, « le PIB par heure travaillée, après ajustement de la parité de pouvoir d'achat, représentait 95 % de la valeur américaine en Allemagne et 92 % en France, soit un niveau de productivité proche de celui des Etats-Unis ».
Dans ce graphique issu des travaux de Gethin et Saez (2025), le PIB par heure travaillée en parité de pouvoir d'achat est même estimé à un niveau supérieur en France. Cela s'explique notamment par une estimation du nombre d'heures travaillées différente de celle de l'OCDE qui est souvent reprise dans le débat public pour des comparaisons entre pays, alors que l'organisation défend de le faire50(*).
PIB par heure travaillée (en dollars de 2023 en parité de pouvoir d'achat)
Source : Amory Gethin, à partir des données sur le PIB de la World Inequality Database et des données sur les heures travaillées de Gethin et Saez (202551(*))
Olivier Redoulès de l'institut Rexecode a par ailleurs expliqué devant la commission des finances le 20 octobre que, « s'agissant des États-Unis, la croissance est désormais uniquement tirée par le secteur technologique, le reste de l'économie ayant tendance à stagner », ce que montre le graphique ci-dessous. Jason Furman, professeur d'économie à Harvard et ancien conseiller économique de Barack Obama, confirme que le PIB des Etats-Unis n'aurait augmenté que de 0,1 % sur le premier semestre de 2025 sans les investissements dans les équipements informatiques et les logiciels.
Croissance du PIB américain hors investissements technologiques,
en rythme annualisé
Source : institut Rexecode, document remis à la commission des finances par Olivier Redoulès
Cependant, ces précautions statistiques ne retirent rien au constat que le niveau de richesse observé - incluant donc la quantité d'heures travaillées et le pouvoir d'achat associé à la monnaie - a divergé de façon importante depuis de trop nombreuses années, signe d'un continent à la croissance atone.
La donnée à retenir pour décrire le niveau de richesse réel d'une économie demeure en effet la production totale, à savoir le produit intérieur brut, et non la production par tête, ce d'autant plus que la productivité marginale est présumée décroissante : cela signifie que si la France ou l'Europe cherchaient à produire autant par tête que les Etats-Unis, leur productivité par heure travaillée diminuerait certainement.
Par ailleurs, le taux de change repose au moins dans une certaine mesure sur des fondamentaux économiques et entre réellement dans la détermination du pouvoir d'achat.
Enfin, les comparaisons excluant le secteur technologique demeurent des exercices largement théoriques. Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis J. Powell considère qu'à l'inverse de la bulle internet qui a éclaté en 2001, les entreprises de l'intelligence artificielle « ont en fait des modèles économiques, des bénéfices, etc. C'est donc vraiment quelque chose de différent52(*) ». Le rapport de Mario Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne insistait, précisément, sur le déficit d'innovation de l'Union européenne, qui lui aurait fait manquer la révolution technologique liée à l'internet et expliquerait son retard dans la révolution liée à l'intelligence artificielle. Le déficit d'investissement des entreprises européennes dans la recherche et l'innovation est particulièrement préoccupant.
Plusieurs annonces au niveau européen53(*), qui ne semblent pour l'instant pas avoir été suivies d'effets, ont porté sur la perspective d'imposer des transferts de technologie et de propriété intellectuelle aux entreprises chinoises qui seraient bénéficiaires de subventions européennes, dans le domaine des technologies vertes et notamment des batteries. Ces annonces marquent un tournant, au moins sur le plan psychologique, dans la relation Chine-UE.
Ce tableau très négatif de la production en Europe et en France vient obscurcir considérablement les perspectives de redressement des comptes publics par la croissance.
2. La fin de l'exception française en matière de productivité et de démographie compromet les perspectives à long terme de la croissance française
a) Une productivité en berne en lien avec des performances de taux d'emploi et de chômage pour partie achetées à crédit par le « quoi qu'il en coûte »
(1) Une priorité gouvernementale...
L'un des paris de la politique économique menée depuis une décennie en matière d'emploi a été que les politiques actives du marché du travail pourraient constituer un levier efficace de redressement des comptes publics.
Le retour à l'emploi de personnes qui en étaient éloignées - chômeurs de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux - ou de catégories qui se caractérisaient traditionnellement par un taux d'emploi plus faible - jeunes de 16 à 24 ans, seniors de 55 à 64 ans, personnes handicapées dans le cadre de politiques d'inclusion - présente en effet, du point de vue des finances publiques, un double bénéfice. Au numérateur, le nombre de personnes en emploi augmente, ce qui stimule l'activité et les recettes publiques ; au dénominateur, le nombre d'inactifs diminue, ce qui a pour effet de réduire les revenus de transfert ou les prestations sociales.
Cette politique prioritaire qui a traversé les dix dernières années a pris la forme d'allègements de cotisations sociales, de la mise en place de la prime d'activité puis de la prime dite « Macron », d'assouplissements du droit du travail, de réformes successives des indemnisations chômage, d'une hausse de la durée légale de départ à la retraite à taux plein, de contreparties demandées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et enfin de primes à l'apprentissage.
(2) ... mais une baisse de taux de chômage qui n'a rien de spécifique à la France
S'agissant du taux de chômage, contrairement à ce qui a souvent pu être avancé dans le débat public, les performances françaises depuis le point haut du taux de chômage en 2015 (10,5 % de la population active) ne se sont pas particulièrement distinguées de l'évolution du taux de chômage dans le reste de l'Union européenne.
Ce serait même, en réalité, plutôt l'inverse, a fortiori dans le contexte où certains pays, comme l'Allemagne, étaient déjà au plein emploi et ne pouvaient de ce fait enregistrer des baisses supplémentaires de chômage aussi importantes que la France. Il convient de noter que la démographie plus favorable de la France a toutefois nécessité davantage de création d'emplois que dans d'autres économies.
Taux de chômage entre 2010 et 2024 en France et dans l'Union européenne
Source : François Geerolf (OFCE), à partir des données Eurostat
La France semble avoir atteint un plateau bas. Le taux de chômage a légèrement remonté depuis fin 2023, restant sous 7,5 %. Le HCFP juge la « légère baisse de l'emploi (- 0,1 % en 2026) prévue par le Gouvernement », après - 0,5 % en 2025, cohérente.
Le HCFP rappelle également que « le climat de l'emploi est à un niveau inférieur à sa moyenne historique, suggérant au total un aléa plutôt baissier ». L'OFCE s'attend à + 0,4 point de hausse du chômage en 2025 et encore + 0,5 point en 2026, pour atteindre un taux de chômage 8,2 %. Éric Heyer a expliqué devant la commission des finances le 20 octobre qu'une grande partie de la baisse du chômage « a été financée par les déficits publics et les salariés. Or, à présent que les finances publiques veulent se rétablir et les salariés retrouver du pouvoir d'achat, qui paiera cette chute de productivité, sachant que les entreprises veulent conserver leurs marges aujourd'hui pour assurer l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain ? Si personne ne veut le faire, la productivité repartira à la hausse. Or, la productivité sans croissance économique engendre des destructions d'emplois. Penser que nous pourrons créer des emplois l'année prochaine avec un taux de croissance à 0,9 % me semble très optimiste ».
(3) Une amélioration du taux d'emploi indéniable...
Force est de reconnaître toutefois que le paquet de réformes français s'est traduit par un succès indéniable sur le plan du taux d'emploi des 20-64 ans, qui n'a jamais été aussi élevé en France (75,1 %) et aussi proche de la moyenne de l'UE, même s'il demeure encore en retrait par rapport aux taux d'emploi enregistrés en Allemagne (81,3 %), aux Pays-Bas (83,5 %) ou encore, par exemple, en Suède (81,9 %).
Un défi subsiste pour l'emploi de certaines catégories, comme les seniors ou les femmes. Le taux d'emploi des femmes de 20-64 ans en France est de 72,2 %, contre 77,7 % en Allemagne. L'économiste Anne-Sophie Alsif estime entre 65 et 70 Mds€ la réduction de déficit public qui serait permise par un relèvement du taux d'emploi des seniors (55-64 ans) au même niveau que l'Allemagne (60,4 % en France contre 75,2 % en Allemagne). Ces politiques seraient toutefois complexes à mettre en oeuvre, nécessitant notamment des politiques ambitieuses d'inclusion sur le marché du travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie privée. De ce fait, elles n'apporteraient pas nécessairement tous les gains escomptés pour les finances publiques, et en tout état de cause pas dans des délais rapides.
La catégorie des jeunes a fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics, au travers d'une politique très volontariste de soutien à l'apprentissage qui a augmenté le taux d'emploi des 20-24 ans, mais semble avoir créé des effets d'aubaine en ciblant mal les jeunes les moins diplômés, qui en avaient le plus besoin. Le nombre de contrats d'apprentissage annuel est ainsi passé de 400 000 à 1 million entre 2020 et 2025.
Nombre de contrats d'apprentissage (secteur marchand hors agricole)
Source : OFCE, à partir des données de la Dares
(4) ... mais au prix d'un déclin de la productivité
Il en a résulté un déclin de la productivité, comme l'avaient montré Askenazy et al.54(*) en 2024 : d'abord pour une raison comptable (« un alternant n'est pas présent à 100 % en entreprise alors qu'il est comptabilisé toute l'année dans l'emploi »), mais aussi en raison de « la faible ancienneté des alternant dans les entreprises » et enfin du nécessaire « accompagnement par un maître apprentissage ». Sur 5,5 points d'écart à la tendance pré-Covid, selon des hypothèses de production nulle ou d'un quart d'un non-alternant, 0,9 à 1,2 points seraient attribuables à l'effet de l'apprentissage.
Selon l'Insee, le nombre de contrats d'apprentissage devrait baisser de 65 000 dans les trimestres à venir. Le HCFP pointe que « le moindre recours à l'apprentissage, qui justifie en partie le rebond de la productivité et l'accélération des salaires, ne semble pas se refléter dans la prévision d'emploi » du Gouvernement.
De façon générale, un phénomène d'enrichissement de la croissance en emploi - selon Éric Heyer simple synonyme de baisse de la productivité - a pu expliquer la baisse de productivité, dans la mesure où il aurait « concerné en premier lieu les personnes les plus éloignées du marché du travail » (Askenazy et al.).
Les effets discutés de l'enrichissement de
la croissance
en emploi sur la productivité
« Empiriquement la quantification fait aussi débat : Rexecode (2023) retient une contribution très élevée en supposant une productivité très faible des nouveaux entrants sur le marché du travail. L'OCDE (2009) montre sur un panel de pays en séries temporelles qu'une hausse de 1 % de l'emploi se traduit en moyenne par une baisse de 0,24 à 0,35 point de la productivité agrégée. Bourlès et al. (2012) obtiennent une élasticité plus élevée de l'ordre de 0,5. En retenant cette élasticité de 0,5, la Banque de France juge que cet effet d'enrichissement de la croissance en emploi hors alternants explique 1,4 point de recul de productivité sur la période. De son côté, l'OFCE (2023) justifie un enrichissement de la croissance en emploi, pour 0,7 point environ, du fait de la baisse du coût du travail sur la période découlant notamment des allègements généraux. En supposant une élasticité de l'ordre d'un quart à un tiers, la hausse de l'emploi salarié marchand hors alternants, qui explique 2,7 points de hausse totale de l'emploi entre 2019 et 2023, se serait traduite par une contribution à la baisse de productivité d'ensemble de l'ordre de -0,7 à -0,9 point. Cet effet d'enrichissement de la croissance n'est toutefois pas nécessairement spécifique à la France, car d'autres pays européens (en particulier l'Espagne et l'Italie) ont connu un recul important du chômage sur la période, même si la progression de l'emploi est significativement plus forte en France. Une fourchette de 0 à 0,9 point peut ainsi être retenue. »
Extrait d'Askenazy et al., « À la recherche des gains de productivité perdus depuis la crise sanitaire », blog de l'Insee, juillet 2024
Alors que la France s'illustrait historiquement par une des productivités par tête les plus élevées de l'OCDE, cette singularité française s'est atténuée entre 2020 et 2022, la France affichant une productivité désormais plus proche de celle de ses principaux voisins.
Si la productivité par tête a fini par se redresser quelque peu après 2022, à un taux annuel moyen de + 1,3 %, elle reste, début 2025, légèrement en dessous de son niveau de 2019. Surtout, elle demeure à un niveau inférieur de cinq points, comparée à ce qu'elle aurait été en suivant sa tendance de long terme sur la période (+ 0,9 % par an). Trois quarts de l'écart à la tendance antérieure s'expliqueraient économétriquement, selon Bruno Coquet et Éric Heyer, selon les ordres de grandeur suivants :
- 30 % pour le soutien à l'apprentissage ;
- 17 % pour le soutien aux entreprises ;
- 13 % pour la baisse du coût du travail, en lien notamment avec l'indexation avec retard des salaires par rapport aux prix ;
- 9 % pour l'inclusion d'actifs moins productifs qui étaient éloignés de l'emploi, grâce à la baisse du chômage ;
-et 6 % pour la continuation de la baisse de la durée du travail.
Au total, l'économiste Éric Heyer pointe le paradoxe d'une politique de l'offre en faveur de la compétitivité et de l'emploi qui a certes amélioré le second, mais n'a produit que des résultats mitigés voire adverses pour la compétitivité si l'on se réfère aux deux principaux indicateurs de la compétitivité d'une économie - ses parts de marché et sa productivité.
Selon Olivier Redoulès, de Rexecode, « nous n'avons peut-être pas assez pensé aux incitations. La question de la progressivité des prélèvements sur le travail est un sujet majeur. Une partie des mesures prises après 2017, par exemple la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, ont renforcé cette progressivité. Or si elles ont eu des impacts positifs en matière d'emploi, il n'en a pas forcément été de même pour la qualité de l'emploi. »
(5) Un faible impact sur les finances publiques
Le financement des administrations publiques est assis en grande partie sur l'activité économique et l'emploi, la réussite des politiques de l'emploi menées par le Gouvernement aurait dû se traduire en théorie par un surcroît de recettes potentielles et une baisse simultanée des dépenses de transfert. L'« achat à crédit » de l'amélioration du taux d'emploi et du taux de chômage - ce dernier n'ayant, du reste, pas connu d'évolution plus favorable depuis 2017 que chez nos voisins -, n'a donc constitué un pis-aller.
Pourquoi la hausse du taux d'emploi n'a pas suffi
à réduire le déficit public en
France ?
« La hausse du taux d'emploi a été significative en France depuis son point bas de 2014, mais elle n'a pas permis de créer suffisamment de richesse pour endiguer la dérive du déficit public par rapport au PIB. Les dépenses du « quoi qu'il en coûte » sont passées par là, mais surtout, la spécialisation française dans des emplois faiblement rémunérés s'est significativement renforcée. Le résultat d'un système socio-fiscal qui sanctuarise le bas de l'échelle des salaires et pénalise les emplois les plus qualifiés.
[...] La hausse du taux d'emploi intervenue depuis dix ans et le tournant de la politique favorable à l'offre productive n'a pas empêché la dérive persistante des comptes publics.
[...] Une première explication tient à ce que les baisses de prélèvements obligatoires décidées à partir de 2014 pour alléger le fardeau illustré par le ras-le-bol fiscal de 2012-13 n'ont pas été financées par une baisse des dépenses publiques. Les interventions massives et successives face à la pandémie de Covid-19, puis face au choc des prix de l'énergie, ont aussi laissé une empreinte durable sur le niveau de la dette.
Mais une seconde explication est à rechercher dans le type d'emplois créés : la spécialisation française dans des emplois faiblement rémunérés s'est significativement renforcée durant cette période.
[...] Les allègements de cotisations représentent désormais une moindre recette théorique de l'ordre de 75 milliards d'euros. Ils reflètent la prise en charge croissante par l'impôt ou par le budget général de l'État de la dépense sociale originellement financée par les cotisations. [...] La France connaît ainsi le plus faible coin socio-fiscal (l'écart entre le salaire chargé et le salaire nets d'impôts et de cotisations) des pays européens pour les salaires les plus bas.
[...] En contribuant à favoriser l'emploi faiblement qualifié et en bridant l'emploi très qualifié à la compétitivité érodée, ce système produit un rendement fiscal et social médiocre. »
Source : Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, dans Les Echos55(*)
b) La fin de l'exception démographique française met son modèle social au défi de se réinventer rapidement
L'économie de la démographie est rarement mobilisée pour discuter des options de politique économique, alors qu'elle présente des effets très structurants sur la croissance économique et les finances publiques d'un État56(*).
(1) Le vieillissement de la population
Conséquence d'un allongement de l'espérance de vie qui est, fondamentalement, un phénomène souhaitable, le vieillissement de la population fait l'objet d'une forte attention depuis plusieurs années au titre de son poids sur les finances publiques.
Ce poids ne se manifeste en réalité que depuis quelques années en France. En effet, la pertinence d'une mesure de vieillissement de la population par référence à un âge constant dans le temps (par exemple, plus ou moins de 60 ans) est fragilisée par les progrès en matière « de santé, de capacités physiques et intellectuelles et d'espérance de vie restante57(*) ». Une approche plus dynamique a par exemple été proposée par Ryder (1975), consistant à calculer l'âge d'entrée dans la vieillesse selon la formule : « espérance de vie - 20 ans ». En suivant cette méthode, le vieillissement de la population « n'augmente que depuis les années 2010 » dans les pays à revenu élevé.
Encore faut-il, pour que le vieillissement en bonne santé soit neutre pour les finances publiques, que l'âge effectif de cessation de l'activité évolue au diapason du recul de l'« âge d'entrée dans la vieillesse ». La suspension annoncée du repoussement de l'âge légal de départ à la retraite adopté en 2023 et de l'accélération de la réforme « Touraine » allongeant la durée de cotisation ne vont malheureusement pas en ce sens.
Or, Darvas et al. (202558(*)) estiment que, « pour un pays médian de l'UE, l'augmentation des coûts liés au vieillissement, telle qu'elle est supposée dans le scénario de référence, nécessiterait un ajustement supplémentaire de 2 % du PIB dans le budget non lié au vieillissement entre 2024 et 2052 ». La difficulté est que pour assurer la viabilité de la dette à horizon 2052, « les pays de l'UE devront améliorer leurs soldes primaires au cours de la période d'ajustement initiale de quatre à sept ans débutant en 2025, puis maintenir ces soldes à des niveaux globalement stables », alors que « dans la plupart des pays, les ajustements budgétaires sur la partie du budget non liée au vieillissement démographique doivent se poursuivre et atteindre des niveaux historiquement élevés ».
Les auteurs ajoutent que « d'un point de vue politique, il est important d'anticiper ces besoins d'ajustement afin d'éviter des ajustements perturbateurs et inefficaces. De bonnes politiques d'ajustement chercheraient à s'attaquer à la fois aux facteurs du changement démographique - par des politiques visant à accroître la fécondité et une bonne politique d'immigration - et à apporter des réponses efficaces de la part des marchés du travail, des systèmes de retraite et de soins à ce changement : augmenter la participation au marché du travail, encourager les départs à la retraite tardifs lorsque les personnes sont en bonne santé et aptes à travailler, et rendre les soins plus efficaces ».
Cette anticipation ne transparaît pas de la politique économique menée ces dernières années, qui semble plutôt relever d'un ajustement subi, avec « des taux de cotisation qui ont quasi doublé, de 15-20 % à 28-30 % », pour compenser un ratio de couverture passé « de 3 travailleurs pour 1 retraité à 1,7 pour 1 retraité ».
Ainsi, le consultant et essayiste Antoine Foucher relève qu'« en 1975, selon l'Insee, les dépenses publiques de la France consacrées à l'éducation et aux retraites étaient à peu près les mêmes : respectivement 6,5 % et 7 % du PIB. Cinquante ans plus tard, la part de l'éducation n'a pas changé (6,7 %) pendant que les pensions de retraite ont doublé (14 %). Le vieillissement démographique explique une part de l'évolution. En 1975, la France comptait un peu plus de 6 millions de retraités (12 % de la population), contre 18 millions aujourd'hui (26 %). Mais le nombre d'étudiants a lui aussi triplé (de 1 à 3 millions) et le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire et secondaire a quasiment doublé (de 7,3 à 12,6 millions d'enfants59(*)). »
Antoine Foucher observe que « la dépense a donc suivi l'évolution démographique d'un côté, mais pas de l'autre, de sorte qu'il est incontestable que les priorités de la France de 2025 ne sont pas celles de 1975 ».
L'essayiste met en regard la vingt-cinquième place de la France dans les classements Pisa et Piacc de l'OCDE, qui évaluent le niveau scolaire des élèves et les compétences des travailleurs, avec la troisième place mondiale de la France en dépenses de retraites et sa première place s'agissant du revenu des retraités par rapport aux actifs.
Le taux de rendement interne des retraites de base du régime général (autour de 2 % pour la génération née en 1945, contre 0,5 % pour celles nées après 1975, quelles que soient les hypothèses de productivité retenues) tend en effet à attester un problème d'équité intergénérationnelle.
Taux de rendement interne (TRI) du cas type de
salarié non-cadre
du secteur privé à carrière
complète selon l'hypothèse de productivité60(*)
Source : rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, juin 2025
Antoine Foucher conclut qu'il faut « non pas dépenser plus, mais réorienter nos dépenses publiques vers tout ce qui prépare l'avenir », « l'école, le travail, l'effort méritocratique ».
(2) La chute de la natalité, le « dividende démographique » et le déclin du taux de couverture
Alors que la France se distinguait au sein de l'Union européenne, à l'orée du XXe siècle, par une hausse du nombre d'enfants par femme qui s'est approché autour de 2010 du seuil de remplacement - soit 2,1 enfants par femme -, son taux de fécondité a depuis lors rejoint la tendance générale, suivant même un rythme de baisse légèrement plus prononcé.
On relevait ainsi en 2014 (donnée la plus ancienne disponible sur le Eurostat) exactement 2 enfants par femme en France, contre 1,54 dans l'UE ; en 2023 (donnée la plus récente disponible sur Eurostat), le taux de fécondité s'élevait à 1,66 enfants par femme en France, contre 1,38 dans l'UE.
Indicateur conjoncturel de fécondité
(nombre d'enfants nés vivants
pour 100 femmes)
Source : Insee
Pour réelle qu'elle puisse être à long terme, la menace que constituerait la baisse de la natalité pour l'économie et les finances publiques de la France doit être mise en contexte.
D'une part, elle s'inscrit dans une tendance mondiale affectant l'ensemble des pays à revenu élevé et des pays à revenu intermédiaire, qui ont déjà achevé leur « transition démographique », seuls les pays à faible revenu se trouvant encore dans la fenêtre « naissances élevées - mortalité faible ». Les démographes font, du reste, remarquer, que l'exception démographique française n'a pas toujours été en ce sens : la France est ainsi le premier pays à avoir connu une forte baisse de la natalité, au XIXe siècle.
D'autre part, ce déclin de la natalité, est lu, de façon précipitée, comme un fardeau immédiat pour les finances publiques, ce qui n'a rien d'évident. Le premier phénomène ne semble que faiblement contribuer à expliquer la crise des finances publiques actuelle, quand le second pourrait même, à court terme, contribuer à en masquer l'ampleur.
En outre, l'effet de la chute de la natalité est, à court terme, inverse à ce qui est souvent postulé dans le débat public. L'économiste Hippolyte d'Albis, professeur à l'Essec, rappelle61(*) que, de façon contre-intuitive, pour une économie et ses finances publiques, « une baisse des naissances engendre, dans un premier temps, un effet bénéfique : moins d'enfants à charge signifie plus de ressources disponibles par habitant. C'est ce que l'on appelle le « dividende démographique ». Mais cette amélioration se transforme ensuite en un manque de travailleurs, lorsque les cohortes moins nombreuses arrivent sur le marché du travail. Cet effet est qualifié par les économistes de « fenêtre d'opportunité », période pendant laquelle la pression exercée par de nombreux enfants diminue. Mais cette fenêtre n'est que temporaire. Ce moment doit être judicieusement utilisé pour réaliser les investissements nécessaires, en infrastructures et en éducation, afin d'anticiper le futur papy-boom. »
Cette « fenêtre d'opportunité » devrait normalement permettre, toutes choses égales par ailleurs, de baisser les dépenses publiques à court terme. Si ce n'est pas le cas, c'est que les postes de dépense actuels bénéficient d'une hausse cachée, rarement relevée dans les débats, pour une part par facilité et pour une autre parce qu'elle n'a pas sans doute pas encore fait l'objet d'une véritable prise de conscience. Une solution est également d'affecter les économies à des postes de dépense permettant de faire face au vieillissement de la population ou de préparer la hausse de la dépendance à long terme.
Cependant, le seul domaine de politique publique dans lequel l'allocation du « dividende démographique » fait l'objet d'un débat explicite est celui l'éducation, l'évolution de la démographie scolaire donnant lieu à un arbitrage, chaque année, entre légère réduction du nombre d'élèves par classe ou absorption intégrale par le besoin de financement des administrations publiques. Si le souci d'équité intergénérationnelle justifie aujourd'hui en France de privilégier la réduction du déficit public en présence d'un risque d'« effet boule de neige de la dette », les dépenses d'éducation sont aussi parmi les plus rentables à long terme et pourraient à ce titre s'inscrire dans le cadre d'une stratégie d'anticipation de la dégradation du ratio de dépendance62(*).
Au total, l'économie et les finances publiques ont bénéficié de la baisse de natalité davantage qu'elles ne l'ont subi depuis dix ans, ce qui constitue une circonstance aggravante pour la dérive des comptes publics sur les dernières années. Cette aubaine à court terme, peu commentée et dilapidée, est d'autant plus inquiétante que les effets à long terme d'une baisse de natalité sur le ratio de dépendance, eux bien connus, ne manqueront pas de se manifester.
Au-delà de la simple gestion de la baisse de natalité, une politique plus volontariste peut donc chercher à « encourager la natalité par des politiques natalistes pour atténuer les effets du vieillissement ». Là encore, de façon contre-intuitive, cela risque cependant « d'entraîner un effet doublement récessif » si cela se traduit dans l'immédiat par « une baisse de la participation des femmes au marché du travail ». Angrist et Evans (1998) ont en effet montré un effet positif sur le taux d'emploi d'une baisse du taux de fécondité. Dès lors, des « politiques favorisant la conciliation entre vie privée et vie professionnelle » peuvent être mises en place pour atténuer ces effets en permettant de concilier emploi et parentalité, à l'image des pays nordiques (Petrongolo et Olivetti, 2017).
Pour compenser l'évolution du solde naturel, une autre option peut être de recourir à l'immigration. H. d'Albis souligne que « le processus migratoire concerne essentiellement de jeunes adultes » et qu'à ce titre « il n'y a pas trois périodes pertinentes comme dans le cas de la natalité [inactivité-activité-inactivité] mais seulement deux [activité-inactivité] » : ainsi, malgré « un taux d'emploi des immigrés souvent plus faible que celui des nationaux » en raison de barrières à l'entrée sur le marché du travail, « une augmentation de l'immigration entraîne un accroissement de la proportion de personnes en âge de travailler dans la population, ce qui est favorable à la croissance ». Le Conseil d'analyse économique observait63(*) en 2021 que, « réduite au respect des droits individuels familiaux et humanitaires, l'immigration en France est, comparativement à nos principaux partenaires de l'OCDE, peu qualifiée, aux origines géographiques peu diversifiées et faible en volume ».
II. L'ÉROSION PROGRESSIVE DE NOS MARGES DE MANoeUVRE BUDGÉTAIRES APPELLE UNE RÉDUCTION VIGOUREUSE DE NOTRE DÉFICIT DÈS 2026
A. L'ACCROISSEMENT CONTINU DE LA DETTE PUBLIQUE EST EN PASSE D'ANESTHÉSIER L'ACTION PUBLIQUE
1. Une forte dynamique de hausse de la dette publique en France, dont les choix de politique budgétaire et fiscale depuis 2020 sont responsables
a) Bien qu'un haut niveau de dette publique s'observe dans un grand nombre d'économies, sa dynamique en France se singularise fortement depuis 2020
Dans sa publication d'octobre 2025 du « Moniteur budgétaire64(*) », le Fonds monétaire international (FMI) alerte sur le fait que « la dette publique mondiale dépassera les 100 % du PIB d'ici 2029, soit son plus haut niveau depuis 1948 », ce qui « reflète une trajectoire plus élevée et plus abrupte que celle prévue avant la pandémie ».
Le FMI rappelle que sept des vingt membres du G20 présentent une dette publique supérieure à 100 % du PIB ; il s'agit du Canada, de la Chine, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces éléments témoignent de ce que la France n'est pas un cas isolé. Le Japon et l'Italie connaissent un niveau de dette plus élevé que la France.
Par ailleurs, le poids de la dette publique, même rapporté au PIB65(*), est loin de constituer l'unique métrique pour appréhender le risque budgétaire (en anglais, fiscal risk). Ainsi que le rappelle le FMI, les pays du G20 enregistrant plus de 100 % de dette sur PIB « disposent généralement de marchés obligataires souverains profonds et liquides et ont souvent un large éventail de choix politiques, ce qui fait que leur risque budgétaire est considéré comme modéré » - c'est en principe le cas de la France - à la différence « de nombreux marchés émergents et pays à faible revenu [qui] sont confrontés à des défis budgétaires plus difficiles, malgré leur dette relativement faible ».. Ainsi, « cinquante-cinq pays sont en situation de surendettement ou courent un risque élevé de surendettement, bien que leur ratio d'endettement soit souvent inférieur à 60 % du PIB ».
Pour autant, avec 115,8 % de dette publique rapportée au PIB, la France présente le troisième ratio de dette publique le plus élevé de la zone euro après la Grèce (151,8 %) et l'Italie (138,3 %).
À en croire le FMI, la trajectoire de la France se singularise en ce que « le nombre de pays dont la dette est supérieure à 100 % diminuera régulièrement au cours des cinq prochaines années » et « le nombre de pays dont la dette publique est inférieure à 60 % du PIB est passé à plus de cent en 2021 et devrait continuer d'augmenter ».
Or, la dynamique de la dette demeure l'un des premiers critères pour apprécier de la soutenabilité d'une dette.
Ainsi, alors que les autres économies du G7 ont toutes réduit le poids de leur dette publique dans leur PIB entre 2021 et 2024, lors des années de reprise post-Covid, la France est la seule à n'avoir pas réduit son ratio d'endettement.
Variation du ratio de dette publique (% de PIB) des économies du G7 (2021-24)
|
Japon |
Italie |
Etats-Unis |
Royaume-Uni |
Allemagne |
Canada |
France |
|
- 17 |
- 10 |
- 4 |
- 4 |
- 4 |
- 2 |
0 |
Source : DG Trésor (cité in Rapport sur la dette des administrations publiques)
Plus inquiétante encore est la trajectoire de forte augmentation du ratio d'endettement de la France depuis 2023, qui est unique au sein de la zone euro, à l'intérieur de laquelle le ratio de dette a en moyenne décru depuis le Covid-19 avant de se stabiliser.
La hausse est par exemple beaucoup plus marquée que celle anticipée en Italie (pays pourtant handicapé par une charge de la dette sans comparaison avec la France, où le ratio d'endettement est « proche d'être stabilisé » selon l'avis du HCFP sur le PLF 2026) ou en Allemagne (pays qui dispose d'importantes marges de manoeuvre du fait de son faible ratio d'endettement, d'ailleurs encore en baisse jusqu'à 2024, pour s'établir à 62,5 points de PIB).
L'évolution diverge encore plus fortement de la baisse observée en Espagne et au Portugal, dont le ratio d'endettement est en conséquence devenu inférieur à celui de la France depuis 2022.
Ratio de la dette publique au PIB en zone euro (en %)
Source : Haut Conseil des finances publiques, avis sur le PLF et le PLFSS 2026 (à partir des PSMT et RAA des pays concernés)
Symptomatique de cette dérive de l'endettement français, est le fait que la France a basculé de la catégorie des pays à « équilibre budgétaire sain » vers celle des pays à « équilibre budgétaire stagnant », selon un article66(*) récemment présenté à la Banque centrale européenne (BCE).
En effet, là où la Belgique, l'Italie, le Japon et le Portugal sont classés dans cet article « pays à dette élevée » (supérieure à 90 % du PIB) au regard des ratios des trente dernières années, la France appartenait encore à la catégorie des « autres pays » (avec l'Australie, le Canada, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et les Etats-Unis).
Or, la démonstration de cet article est précisément qu'il s'agit, en théorie, d'équilibres durables, desquels il est difficile de sortir, un fort endettement ayant un impact négatif sur la productivité : il existe un équilibre à forte croissance et faible endettement et un équilibre à faible croissance et fort endettement.
Alors qu'elle avait tous les atouts pour stabiliser sa dette, la France s'est donc mise en difficulté toute seule.
Le HCFP souligne de même dans son avis sur le PLF 2026 que « l'écart entre les ratios d'endettement de la France et de l'Allemagne dépasse désormais 50 points de PIB, alors qu'ils étaient au même niveau il y a vingt ans ».
Les perspectives présentées par le Gouvernement ne sont donc guère rassurantes pour la suite.
Il est ainsi prévu, dans l'hypothèse d'un déficit public à 4,7 % du PIB qui n'est officiellement déjà plus la cible du Gouvernement, que la dette publique augmenterait encore, en proportion de la richesse nationale créée chaque année, de 115,9 % du PIB en 2025 à 117,9 % du PIB en 2026, et même à 118,7 % du PIB en 2027.
Le ratio ne redescendrait ensuite que très lentement, à 118,6 % en 2028, puis 118 % du PIB en 2029, soit une proportion du revenu national toujours significativement plus élevée qu'en 2025, et plus encore qu'en 2024 (113,2 %).
L'endettement public rapporté au PIB augmenterait ainsi de 5,5 points en quatre ans (2023-2027), alors même que le PIB devrait lui aussi augmenter en l'absence de toute crise de quelque nature que ce soit. Cette forte dynamique de la dette risque rapidement de s'autoentretenir et met la France à la merci de tout choc exogène sur la croissance.
Prévisions du ratio d'endettement des administrations publiques
(en % du PIB)
Source : rapport sur la dette des administrations publiques
b) Héritée pour partie seulement de dépenses de crise, la dette a en majeure partie augmenté depuis 2017 du fait de déficits liés aux mesures discrétionnaires des gouvernements successifs
La singularité de la dérive du ratio d'endettement de la France est qu'elle ne provient que partiellement des crises récentes ayant justifié une intervention de la puissance publique.
Ainsi, entre 2007 et 2023, la dette publique de la France est passée de 64,5 % à 110,6 % du PIB, soit une hausse de 45 points de PIB. En se concentrant sur la seule période 2016-2023, donc essentiellement depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, ce ratio a augmenté de 12,6 points de PIB.
Lors d'un précédent abaissement de la note de crédit de la France par l'agence Standard & Poor's, en mai 2024, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie pendant les sept dernières années, s'était justifié en avançant : « J'ai sauvé l'économie française en évitant la récession, la destruction sociale et les inquiétudes des citoyens face à l'augmentation du prix de l'essence. Je les ai protégés. »
Il est vrai que les crises économiques dégradent les finances publiques, d'un côté parce que la contraction de l'économie réduit les recettes fiscales, et de l'autre, parce qu'elles appellent des mesures dites « contracycliques » exceptionnelles.
En toute logique, les dépenses budgétaires supplémentaires décidées en ces circonstances ne sont pas pérennes : chômage partiel pour les salariés, fonds de solidarité pour les entreprises et dépenses de santé pendant la pandémie de Covid-19, boucliers tarifaires, remise carburant, chèques aux ménages modestes et aides sectorielles aux entreprises pour faire face aux effets de la crise énergétique, etc.
Dans une note de blog, trois économistes de l'OFCE67(*) ont cherché à estimer la contribution des crises, par opposition à des mesures budgétaires pérennes, à la hausse du taux d'endettement de la France. D'après leurs calculs :
- entre 2016 et 2023, plus des deux tiers (69 %) de la hausse du ratio dette publique/PIB s'expliquerait par les crises (8,3 points sur les 12,6 points de hausse mentionnés supra). Si, toutefois, l'on considère le plan de relance comme une mesure plus structurelle et non comme une simple réaction à la crise, ce qui est sans doute plus réaliste, seulement la moitié (52 %) de la hausse du taux d'endettement public s'expliquerait par les crises (6,6 points sur les 12,6 points de hausse mentionnés supra) ;
- en suivant deux méthodes différentes, sur la période plus longue allant de 2007 à 2023, 44 à 47 % de la hausse de l'endettement s'expliquerait par les crises, le reste étant dû à des mesures budgétaires pérennes.
Ces économistes en concluent que « la hausse structurelle de la dette publique depuis 2017 est en grande partie attribuable à des mesures budgétaires non financées », c'est-à-dire à des choix discrétionnaires durables « non liés aux gestions des crises », à hauteur de 170 milliards d'euros (6 points des 12,6 points de hausse mentionnés plus haut). Parmi ces mesures, on trouve :
- pour moitié des mesures de pouvoir d'achat en réponse à la crise des gilets jaunes : renoncement de la hausse de la taxe carbone, annulation de la hausse de CSG pour les retraités modestes, baisse de l'impôt sur le revenu et élargissement supérieur à ce qui était prévu de la prime d'activité ;
- et pour moitié des mesures de compétitivité (baisse des impôts de production) et la suppression de la taxe d'habitation pour tous (pour les 20 % des ménages les plus aisés).
En particulier, le déficit public de la France, qui avait suivi une évolution à peu près similaire à celui de ses principaux voisins depuis 2017 et à travers les crises successives - Covid-19, crise énergétique -, s'est nettement désynchronisé depuis 2022. La trajectoire la plus proche est celle de l'Allemagne, qui a cependant bénéficié d'une croissance bien moins favorable sur la période, un « vent contraire » dont n'a pas pâti la France.
Il en résulte pour la France un déficit atteint en 2024, de - 5,8 %, complètement inédit hors période de crise.
Solde public nominal au sein de la zone euro depuis 2017 (en % du PIB)
Source : commission des finances à partir des données d'Eurostat
Jusqu'ici, la dérive de l'endettement public français ne provient pas d'un « effet boule de neige de la dette », c'est-à-dire d'une situation dans laquelle la charge de la dette expliquerait une part importante du déficit public68(*) : « la dette publique correspond à l'accumulation des déficits primaires passés, l'effet « boule de neige » étant proche de zéro en moyenne entre 1970 et 2023 ».
Or, la France se caractérise par un niveau de déficit primaire (hors charges d'intérêts) très important, encore de l'ordre de 2,5 % de PIB en 2026, dans l'hypothèse, déjà officiellement abandonnée par le Gouvernement, d'un déficit public de 4,7 % du PIB.
Encore une fois, ce sont donc bien les choix discrétionnaires du Gouvernement qui expliqueront en 2026 la dérive du ratio d'endettement.
2. Une illusion de soutenabilité de la dette que l'appartenance de la France à la zone euro, ainsi que le léger excédent de son compte courant, ont contribué à entretenir
a) Une intervention du FMI est improbable en France et il serait imprudent d'escompter davantage de la BCE que sa garantie implicite
La crise actuelle des finances publiques a alimenté des discussions sur la nécessité qui pourrait se présenter d'une assistance extérieure, qu'il s'agisse de celle du Fonds monétaire international (FMI) ou de la Banque centrale européenne (BCE).
La question est sensible, pour l'opinion comme pour les créanciers. Il est vrai que l'intervention d'institutions internationales dans la prise de décisions nationales, notamment budgétaires, touchant au coeur de la souveraineté et du rôle démocratique des parlements nationaux, a pu susciter des récriminations, y compris celle du Parlement européen69(*). L'opinion publique a été marqué par le précédent créé par les interventions de la « troïka », instance d'abord informelle70(*) réunissant la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, pour négocier les modalités de l'assistance financière octroyée à la Grèce, et notamment les réformes appelées en contrepartie.
À proprement parler, des interventions directes de ces institutions paraissent toutefois peu plausibles.
(1) Une intervention du Fonds monétaire internationale (FMI) est juridiquement et économiquement peu plausible
Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Éric Lombard, a indiqué le 26 août « [ne pas pouvoir] affirmer que le risque d'une intervention du FMI n'existe pas », avant de devoir rectifier son propos l'après-midi même, indiquant à l'inverse que la France n'est « aujourd'hui sous la menace d'aucune intervention du FMI ou de la BCE ».
Cela témoigne de la sensibilité, déjà évoquée, de la question. Une intervention du Fonds monétaire international (FMI), parfois assimilée dans le débat public à une « mise sous tutelle » en ce qu'elle implique la mise en oeuvre d'un « programme d'ajustement structurel » négocié avec l'institution, serait en effet perçue comme un témoignage de l'échec du Gouvernement, et notamment de son impuissance à endiguer la dérive de l'endettement public devenue hors de contrôle ces dernières années.
Un précédent d'intervention du Fonds monétaire international (FMI) dans une grande économie d'Europe occidentale s'est produit par le passé, au Royaume-Uni en 1976. Seulement, selon Xavier Ragot de l'OFCE71(*), cette intervention a répondu à une triple crise « idéologique, intellectuelle et institutionnelle », davantage qu'à une situation économique la justifiant objectivement72(*) : elle aurait eu pour fonction de « contribuer à une évolution du paradigme économique au Royaume-Uni, le pays ayant eu besoin de cette référence externe pour résoudre des crises internes ». Il n'en reste pas moins que « la presse et l'opinion publique ont alors critiqué la faillite des élites, ce qui a alimenté un sentiment d'humiliation nationale ».
Plus récemment, le FMI est intervenu, conjointement à l'Union européenne, lors des crises des dettes souveraines, en Grèce (2010 et 2011), en Irlande (2010), au Portugal (2011) et à Chypre (2013).
Dans le cas de la France, une telle intervention semble cependant aujourd'hui exclue, pour une raison juridique et pour une raison économique.
En premier lieu, les statuts du FMI prévoient que le Fonds « peut adopter, pour des problèmes spéciaux de balance des paiements, des politiques spécifiques qui aident les États membres à surmonter les difficultés qu'ils ont à équilibrer leur balance des paiements » (article V, section 3). Or, la balance des paiements de la France ne présente pas de déséquilibre particulier (cf. partie infra).
En second lieu, si le FMI dispose d'une capacité de prêt totale de l'ordre de 1 000 milliards de dollars, l'accès à ses ressources pour un État est plafonné à hauteur de 200 % de sa quote-part chaque année, 600 % en cumulé, selon le rapport annuel du FMI 2025. La quote-part de la France représentant 20,2 milliards de droits de tirage spéciaux (soit environ 24 milliards d'euros à date), son accès aux ressources générales du FMI serait en principe limité à 48 milliards d'euros sur un an, et 144 milliards d'euros au total.
Or, à titre de comparaison, le programme de financement de l'Agence France Trésor (AFT) était, selon son rapport annuel 2024, de 285 milliards d'euros en 2024 (339,8 milliards d'euros de dette émise, et 54,8 milliards d'euros de rachats). Une intervention du FMI en France ne serait donc pertinente qu'en complément d'un recours à des instruments européens, comme le Mécanisme européen de stabilité (MES).
Pour autant, l'improbable intervention du FMI ne doit pas être lue comme le signe que la situation française n'est pas alarmante. Au contraire, ces données juridiques et économiques, en éloignant la perspective d'une intervention du FMI en France, privent la France d'outils qui auraient pu s'avérer utiles en cas de dérive incontrôlable de son endettement public.
(2) Si une intervention directe de la BCE est strictement conditionnée, celle-ci apporte en réalité déjà une aide par sa garantie implicite
Directrice générale adjointe de la Banque centrale européenne de 2018 à 2020, l'économiste Natacha Valla a alerté, devant les sénateurs de la commission des finances, sur les conditions parfois nombreuses qui doivent être réunies pour permettre le recours aux outils européens. Ces conditions existent pour prémunir la zone euro d'un « aléa moral73(*) ».
Au sein de la zone euro, la Banque centrale européenne est d'abord contrainte par l'interdiction explicite par les traités du financement monétaire direct des États74(*), sur le marché primaire.
Le financement indirect, via le rachat de titres de dette sur le marché secondaire a en revanche, lui, été admis par la Cour de justice de l'Union européenne75(*) (CJUE). Toutefois, s'agissant de ces politiques « non conventionnelles », il convient de relever que la BCE continue actuellement de réduire son bilan (resserrement quantitatif), par un arrêt des réinvestissements APP (Asset Purchase Programme, soit programme d'achats d'actifs, mis en place en 2015) depuis mi-2023 et des réinvestissements PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme, ou programme d'achats d'urgence, mis en oeuvre en 2020) depuis fin 2024. Cela induit un effet restrictif qui, parallèlement à la poursuite de la baisse des taux directeurs, contribue à la remontée des taux longs.
Par ailleurs, Natacha Valla a indiqué devant la commission des finances lors de son audition du 20 octobre « ne pas penser que nous puissions compter, comme nous avons pu le faire en 2008 ou lors de la crise de la dette souveraine au sein de la zone euro, sur un engagement aussi libre et important de la Banque centrale européenne ». La France présente en effet un déséquilibre de paiement dit « Target 276(*) » vis-à-vis des autres pays de la zone euro, d'environ 200 milliards d'euros, qui s'est constitué en seulement trois ans. Selon l'économiste, cet élément « très peu commenté dans le débat public [...] ne passe pas inaperçu au Conseil des gouverneurs ». Bien que ce critère n'entre pas en compte dans l'appréciation juridique de la situation, elle suggère que ce déséquilibre du solde Target 2 rendrait certains gouverneurs plus réticents à une intervention asymétrique de la BCE, par crainte d'accentuer les déséquilibres à la zone euro.
Du reste, Natacha Valla rappelle qu'« une forte conditionnalité s'observe, attachée aux deux grands programmes de la BCE que sont les opérations monétaires sur titres (OMT) et l'instrument de protection de la transmission (ITP ou, en anglais, TPI) monétaire. » L'économiste va jusqu'à considérer que « ces instruments sont un peu hors d'atteinte pour un pays comme la France ».
Le recours aux Opérations monétaires sur titre (ou en anglais Outright Monetary Transactions, OMT), dont le principe a été arrêté par le Conseil des gouverneurs en septembre 2012, puis jugées conformes au traité en 2015, a été en pratique limité. Cela s'explique notamment par les craintes d'États membres en lien avec la conditionnalité, liée à l'implication obligatoire du Mécanisme européen de stabilité (MES) et possible du FMI, en cas de recours aux OMT. L'Italie a par exemple renoncé à demander l'activation de cet outil en 2020, pour ces raisons.
C'est pourquoi un outil plus souple a été mis en place par la Banque centrale européenne (BCE) en juillet 2022, appelé Instrument de protection de la transmission de la politique monétaire (ou Transmission Protection Instrument, ou TPI). À la différence des OMT, l'outil ne doit pas nécessairement être sollicité par l'État membre, mais peut être activé par la BCE seule. Surtout, il ne nécessite pas le recours conjoint au Mécanisme européen de stabilité.
Plusieurs conditions sont cependant fixées, la première étant que la BCE juge que « des dynamiques de marché injustifiées et désordonnées constituent une menace grave pour la transmission de la politique monétaire dans l'ensemble de la zone euro77(*) ». Par ailleurs, l'État bénéficiaire doit conduire « des politiques budgétaires et macroéconomiques saines et durables » et ne doit pas être sous le coup d'une procédure pour déficit excessif (PDE), ce qui exclut la France, à nouveau dans ce cas depuis juillet 202478(*).
L'ancien sénateur belge libéral Paul de Grauwe, professeur d'économie à la London School of Economics, prétend certes qu'en cas de crise, « la BCE trouverait toujours un narratif cohérent pour justifier son action. Elle pourrait affirmer qu'il s'agit de préserver la transmission de la politique monétaire, car elle ne peut pas se permettre qu'un pays soit « déconnecté » du reste du système. Autrement dit, elle trouverait une justification économique et institutionnelle à une telle intervention79(*) ». Il serait toutefois particulièrement imprudent de compter sur une hypothétique transgression des règles européennes en cas difficulté de refinancement de la dette française.
En réalité, la simple existence de l'instrument de transmission de la politique monétaire exercice déjà un effet protecteur. Comme l'indique le même Paul de Grauwe, « l'effet recherché est celui d'une assurance de marché : le simple fait que la BCE dispose d'un instrument capable de soutenir la dette d'un État membre exerce un effet stabilisateur très visible ».
De façon plus générale, la BCE apporte déjà une aide au financement des États membres de la zone euro, dont la France, par sa garantie implicite. Dans le contexte de la crise des dettes souveraines du début des années 2010, son ancien président Mario Draghi avait déclaré à Londres, à l'été 2012, que la BCE agirait quoi qu'il en coûte (« whatever it takes »). On imagine mal que la doctrine de l'institution ait changé depuis lors.
Les spreads des pays anglo-saxons, plus élevés que ceux de l'Europe, soulignent par contraste l'effet de cette garantie (+ 145 points de base aux Etats-Unis par rapport à l'Allemagne, + 146 points de base pour la Nouvelle-Zélande, + 168 points de base en Australie, + 178 points de base au Royaume-Uni).
(3) Le recours à d'autres outils d'assistance ne devrait, pour certains économistes, plus être un tabou
L'économiste Natacha Valla a indiqué aux sénateurs de la commission des finances « des solutions ex ante existent et il serait intéressant de réfléchir à la façon dont nous pourrions les activer ». Il s'agit des trois « lignes de crédit » du FMI80(*) ou des deux « lignes de crédit de précaution81(*) » du Mécanisme européen de stabilité (MES), « censément non stigmatisantes, bien que souvent considérées comme telles ». À cet égard, selon elle, « une acculturation est ici nécessaire. Il faut faire tomber les tabous sur ces mécanismes qui rendent possible une résilience européenne au-delà de notre monnaie commune ».
L'économiste rappelle que « les incidents sur les marchés de dette souveraine proviennent souvent de problèmes de liquidités, que même un pays solvable peut rencontrer ». Ces outils visent, précisément, à faire face à un problème de liquidité, et ne font l'objet que d'une conditionnalité en principe limitée.
b) Si, à la différence de ses administrations publiques, la France ne vit pas au-dessus de ses moyens, son compte courant étant à l'équilibre grâce à un niveau élevé d'épargne privée, sa balance des revenus pourrait se dégrader
La récurrence systématique de déficits publics après 1974 a entretenu l'idée que « la France vivrait au-dessus de ses moyens ». Cette assertion, souvent relevée dans le débat public, mérite pourtant d'être nuancée, car elle repose sur une confusion entre la sphère publique (solde public) et l'économie française (solde courant).
Selon l'économiste François Geerolf, la métrique pertinente pour déterminer si un pays vit « au-dessus de ses moyens » est plutôt, à un instant T, le solde courant, à savoir la somme du solde des biens ou solde commercial - souvent seul commenté alors qu'il ne donne qu'une image partielle de la situation d'une économie à l'égard du reste du monde -, mais aussi de celui des services, et enfin de celui de la balance des revenus.
Solde public et solde du compte courant (en % du PIB, jusqu'au T2 2025)
Source : François Geerolf, à partir de données Insee et Banque de France
Or, les données publiées mi-2025 par la Banque de France portant sur l'année 2024 font apparaître qu'à la faveur d'une amélioration de son solde des biens consécutive à la sortie de crise énergétique et de son solde des services en raison de services aux entreprises en hausse, la France connaît un équilibre de sa balance courante (excédent de 3 milliards d'euros). En détail, un excédent dans les services (+ 57 Md€) et dans les revenus (+ 6 Md€) fait plus que compenser un déficit commercial (- 60 Md€).
Solde du compte courant de la France
(en milliards d'euros (échelle de gauche) et en % du PIB (échelle de droite)°
Source : rapport de la balance des paiements et de la position extérieure de la France 202482(*)
Une explication sous-jacente du solde courant de la France est que l'épargne y est désormais abondante, la désépargne publique étant plus que compensée, selon l'économiste François Geerolf, par de la surépargne privée. Cette épargne privée est importante non au titre qu'elle serait directement prélevée en cas de crise des finances publiques, bien qu'elle constitue à long terme une garantie de solvabilité. Il s'agit surtout d'une indication sur l'équilibre entre offre et demande au sein d'une économie. Or, selon ce critère, la France vivrait à peu près selon ses moyens, l'Union européenne en dessous, l'Allemagne très en dessous, et les Etats-Unis au-dessus des siens.
Solde du compte courant de la France, de
l'Allemagne, de l'Union européenne
et des Etats-Unis
(en % du PIB)
Source : François Geerolf, à partir des données nationales de la balance des paiements
Il convient toutefois de relativiser ce diagnostic favorable. En effet, l'équilibre courant de la France reste fragile, et pourrait notamment connaître une dégradation subite en cas de nouvelle augmentation des prix de l'énergie, comme lors des années 2022 et 2023.
En outre, la position extérieure nette de la France - différence entre les actifs détenus par les résidents français à l'étranger et les actifs détenus par les résidents étrangers en France -, demeure, elle, dégradée. La France enregistre une position extérieure nette débitrice de 670 milliards d'euros.
Selon l'OFCE, « la coexistence d'une position extérieure négative et d'une balance des revenus positive s'explique par le rendement supérieur des actifs français détenus à l'étranger (dont beaucoup d'IDE et d'actions) par rapport aux actifs étrangers détenus en France (dont beaucoup de dette publique dont le rendement est faible). »
Or, la hausse rapide du coût auquel la France émet sa dette pourrait rapidement dégrader la balance des revenus en augmentant le rendement des actifs français détenus à l'étranger.
3. La dégradation des conditions de financement de la dette menace de faire entrer la France dans un cercle vicieux dont il sera difficile de s'extraire
a) Le coût réel de la dette augmente inexorablement, après plusieurs années d'emprunt à taux bas voire négatif, une aubaine transformée en malédiction
(1) L'« aubaine » des taux nuls voire négatifs
La phase de taux d'intérêt réels nuls voire négatifs de la fin des années 2010 et du début des années 2020, sur les actifs sûrs, tels que les obligations d'État des pays les plus riches, est bel et bien révolue, pour au moins plusieurs années.
Cela signe la fin d'un contexte dans lequel les indications des économistes sur le faible niveau des taux d'intérêts sûrs ont été interprétées par les pouvoirs publics comme une invitation à profiter d'une aubaine. Ainsi, dans une conférence d'avril 2024, l'économiste Olivier Blanchard expliquait83(*) « que les taux d'intérêt sûrs devraient rester inférieurs aux taux de croissance pendant longtemps » et que « le refinancement de la dette, c'est-à-dire l'émission de dette sans augmentation ultérieure des impôts, pourrait bien être envisageable » et que « la dette publique pourrait n'avoir aucun coût budgétaire ». Olivier Blanchard ajoutait que « l'argument de l'existence d'équilibres multiples dans lesquels les investisseurs considèrent la dette comme risquée et, en exigeant une prime de risque, augmentent la charge fiscale et rendent la dette effectivement plus risquée [...] est très pertinent mais n'a pas d'implications directes sur le niveau approprié de la dette ».
Les conclusions qui en ont été tirées par les décideurs publics relèvent néanmoins d'une extrapolation de la littérature académique, Olivier Blanchard précisant bien, dans son exposé, que « son objectif n'était pas de plaider en faveur d'une augmentation de la dette publique, en particulier dans le contexte actuel ».
Ainsi, interrogé début 2021 quant au fait de savoir si « s'endetter aujourd'hui est une bonne chose », le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire répondait sans ciller que « c'est une nécessité » en raison de taux négatifs des obligations assimilables au Trésor à 10 ans (de - 0,33 %), ajoutant qu'emprunter à cinquante ans à 0,59 %, aux yeux de « tous ceux qui ont emprunté pour leur logement », « c'est quand même formidable ». Il n'oubliait pas, certes, de rappeler qu'« il faudra rembourser la dette, le moment venu, par de la croissance et le rétablissement de nos finances publiques84(*) » - prescience que la crise actuelle des finances publiques ne fait que confirmer jour après jour.
La « taxe inflationniste » aura eu un fort effet pondérateur sur le coût du refinancement de la dette française exprimé en termes réels, mais seulement de façon transitoire.
L'effet de la « taxe inflationniste » sur le coût réel de l'endettement
L'économiste François Geerolf met en avant85(*) le concept de « taxe inflationniste », déjà identifié sous d'autres vocables par Keynes ou Friedman, et qui « repose sur l'idée que le coût réel de l`emprunt est déterminé par le taux d'intérêt réel et non par le taux d'intérêt nominal ». De même, selon l'économiste, « le déficit public est bien moins élevé que ce que les chiffres de la comptabilité nationale indiquent » car « la taxe inflationniste, qui signifie que l'État rembourse ses dettes avec une monnaie dévaluée par rapport à celle empruntée, n'est pas comptabilisée comme un revenu pour l'État, bien qu'elle contribue à réduire son endettement ». Selon lui, « diviser par le PIB nominal ne suffit pas car il ne faut pas seulement déflater le flux d'intérêts, mais le stock de dette » lui-même.
Il en résulte selon l'auteur que « la charge d'intérêt ne représente pas le coût de l'endettement et ne peut pas être comparé par exemple au budget de l'éducation nationale, et que le déficit public est moins important que ce que disent les chiffres officiels ».
Ce phénomène a été particulièrement marqué lors de la phase de forte inflation récente (charge d'intérêts négative de 4,1 % du PIB en 2023), avant que les taux d'intérêt ne s'ajustent à la hausse. Pour 2026, la prévision d'inflation à 1,3 % serait de loin inférieure au taux moyen auquel la France se finance (en incluant le stock de dette déjà émise), et a fortiori au taux marginal de refinancement de la dette (pour les émissions nouvelles), compris entre 3,7 % et 3,8 % pour les obligations à dix ans.
Par ailleurs, l'émission d'obligations assimilables au Trésor indexées sur l'inflation française (OATi) et européenne (OAT€i), à hauteur respectivement de 54,2 Md€ et de 181,4 Md€, soit environ 12 % du total de l'encours de dette, a également pour effet de limiter l'effet de cette « taxe inflationniste ».
Charge d'intérêts et charge d'intérêts réelle
(% du PIB)
Source : François Geerolf86(*), à partir des données Insee
(2) La malédiction de la charge de la dette
Avec le retour de taux d'intérêt réels plus élevés, et à mesure que le stock de dette (d'une maturité moyenne de plus de huit ans selon l'Agence France Trésor) est renouvelé, la charge de la dette, qui était relativement indolore, est en passe de devenir beaucoup plus élevée.
Dans cette circonstance, les appels à profiter de taux d'intérêts réels très faibles voire négatifs lors de la période précédente de taux nuls voire négatifs paraissent, avec le recul, bien déraisonnables, sauf à supposer que cette dette supplémentaire ne sera pas « roulée » lorsqu'elle arrivera à échéance, ce qui supposerait de réduire fortement le besoin de financement des administrations publiques d'ici là.
Or, la charge de la dette connaît une forte dynamique, assimilable en fait à un emballement, à la fois en raison de l'augmentation du stock de dette et de l'augmentation des taux réels.
Après avoir atteint 60 milliards d'euros courants soit 2,1 points de PIB en 2024 (toutes APU, en comptabilité nationale), et plus de 65 milliards d'euros courants soit 2,2 points de PIB en 2025, la charge de la dette atteindrait 74 milliards d'euros courants en 2026, soit 2,4 points de PIB, et ce dans le cas où « le scénario présenté par le Gouvernement », jugé « hypothétique » par le HCFP dans son avis sur le PLF 2026, se réaliserait.
Charge de la dette des administrations publiques (en Md€)
Source : commission des finances, d'après l'avis du HCFP sur le PLF et le PLFSS 2026 pour la période 2024-2026, et calculs d'après les documents budgétaires pour la période 2027-2029
Encore faut-il souligner que deux données sous-jacentes à cette estimation d'évolution de la charge d'intérêts sont d'ores et déjà très optimistes pour l'année 2026, à savoir un déficit public de 4,7 % du PIB - 5 % ont déjà été annoncés par le Premier ministre - et, dans une moindre mesure, une croissance économique de 1 % - le consensus des économistes l'estimant à 0,9 %. Même en supposant que la prévision de croissance se réaliserait, il faut s'attendre à un besoin d'emprunt supplémentaire de 0,3 point de PIB à un taux marginal des OAT à 10 ans compris entre 3,7 et 3,8 % en 2026.
Ainsi, l'aubaine des taux d'intérêts bas ayant déjà été dilapidée, la charge de la dette est en passe de retrouver un poids dans la richesse nationale annuelle similaire à celui qu'elle avait avant la décrue de ces taux tout au long des années 2010.
Ratio d'endettement (échelle de
gauche)
et charge d'intérêts de la dette (échelle de
droite)
(en % du PIB)
Source : OFCE (à partir de données OCDE), éléments remis par la commission par Éric Heyer
La différence avec la situation antérieure est que le stock de dette de la France est aujourd'hui sensiblement plus élevé, ce qui la place dans une situation d'extrême dépendance à l'évolution de ses conditions de financement.
(3) Une exposition à un risque de taux désormais très forte
Le Gouvernement s'appuie sur des prévisions de taux des obligations à 10 ans établies par l'Agence France Trésor. Alors qu'ils étaient de 3 % en moyenne en 2024, et atteindraient 3,7 % fin 2025, les taux augmenteraient d'un dixième de point par an entre 2026 et 2029 avant de se stabiliser, en raison de la « pentification » de la courbe des taux et de l'allongement des taux longs : 3,8 % fin 2026 ; 3,9 % fin 2027 ; 4 % fin 2028.
Taux à 10 ans constatés et anticipés par le Gouvernement entre 2023 et 2030
Source : Agence France Trésor
On peut constater toutefois que les taux observés sont toujours plus volatils que les prévisions. Du reste, comme l'affirme le HCFP dans son avis sur le PLF pour 2026, « il est possible, notamment si l'ajustement budgétaire prévu pour 2026 était révisé à la baisse, que la perception par les marchés financiers des risques pesant sur la trajectoire budgétaire se dégrade davantage, ce qui pourrait encore pousser à la hausse les taux d'intérêt et la charge de la dette ».
Or, en l'état actuel de l'encours de dette de la France, une simple hausse de 1 % des taux d'intérêt en année N (2026) provoquerait une hausse de la charge de la dette de 32,1 Md€ en année N+9 (2035).
Impact d'un choc de taux de 1 % sur la
charge maastrichtienne
des obligations assimilables au Trésor (OAT)
et des bons à taux fixe (BTF)
Source : Agence France Trésor (cité in Rapport sur la dette des administrations publiques, annexé au PLF 2026)
Or, une hausse des taux d'intérêt présenterait un double effet, sur le numérateur - hausse des coûts d'emprunt de la France - mais également sur le dénominateur - baisse du PIB -, le modèle Mésange de la DG Trésor calculant par ailleurs qu'une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt induirait une perte cumulée de PIB de 0,8 point en seulement trois ans.
(4) La « pentification » de la courbe des taux et la hausse des taux longs
Un autre motif d'inquiétude pour le refinancement de la dette de la France a trait au phénomène de pentification de la courbe des taux, c'est-à-dire à la hausse des taux longs par rapport aux taux courts.
Le Gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a fait part de ses interrogations, dans un discours prononcé en janvier 2025, sur « une divergence inhabituelle entre les taux à court et à long terme87(*) », en particulier aux Etats-Unis, mais également en Europe.
Cette question est d'apparence technique, mais présente des conséquences importantes : en effet, si les rendements des obligations à dix ans continuent d'augmenter à moyen terme, cela risque de limiter l'influence d'une éventuelle poursuite de l'assouplissement monétaire sur les conditions de financement de la dette, en France comme ailleurs en Europe et dans le monde.
Le Haut Conseil des finances publiques relève dans son avis sur le présent projet de loi de finances, que « tandis que les taux directeurs ont baissé de 150 points de base sur la période, les taux à 10 ans ont progressé, à des rythmes relativement similaires, en France et en Allemagne ».
La DG Trésor indique dans le rapport annuel sur le financement de la dette que, selon ses hypothèses, « le taux à 10 ans s'élèverait à 3,7 % fin 2025 puis augmenterait de 10 points de pourcentage jusqu'à fin 2028 pour atteindre 4,0 % ».
L'économiste Natacha Valla a expliqué devant la commission des finances que « cette nouvelle pentification se compos[ait] d'un élément assez sain, consistant à redonner un prix positif au temps : ce qui est loin dans le temps doit être rapporté à une valorisation présente, selon un facteur positif et non négatif ».
Une explication potentielle de cette repentification, donnée par François Villeroy de Galhau, réside également dans le resserrement quantitatif actuellement opéré par la Banque centrale européenne (baisse des achats voire hausse des ventes de titres). L'assouplissement quantitatif ayant notamment consisté en des rachats d'obligations à 10 ans, pour assouplir les conditions d'emprunt des États membres de la zone euro, il avait eu pour conséquence d'aplanir la courbe des taux.
Natacha Valla a toutefois également souligné que l'écart entre la valorisation future et la valorisation présente « comprenait aussi plusieurs primes, dont des primes de risque, à commencer par la prime de risque politique ». Le HCFP juge aussi que cette hausse des taux longs est « en lien notamment avec la situation politique et budgétaire en France et avec l'inflexion de la politique budgétaire outre-Rhin ».
Or, si les trajectoires de dette souveraine et la forte incertitude politique avaient pour effet d'accroître fortement le coût de financement de la dette, tous les éléments seraient réunis pour placer la France dans un cercle vicieux.
b) Le « spread » entre le taux d'intérêt de la dette française et celui de la dette de ses principaux voisins s'est creusé au détriment de la France
L'évolution de l'écart des taux (ou spread) auxquels la France emprunte, vis-à-vis de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce, ainsi que les dégradations successives de la note souveraine de la France ont témoigné ces derniers mois d'une dégradation relative de nos conditions de financement.
(1) La dégradation des spreads de la France et de ses conditions de financement relatives
Autour d'environ 80 points de base, le spread de la France vis-à-vis de l'Allemagne est proche de son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro en 2012, niveau déjà été atteint en décembre 2024 les jours précédant la censure du gouvernement de Michel Barnier.
Ainsi que le résume le HCFP dans son avis sur le PLF et le PLFSS 2026, « les conditions d'emprunt public de la France se sont nettement dégradées en termes absolus et au regard de ses partenaires de la zone euro, notamment du sud de l'Europe ».
Ainsi, depuis le début de l'année 2024, les conditions auxquelles la France refinance sa dette sont devenues successivement moins favorables que celles accordées au Portugal (juin 2024) puis que celles de l'Espagne (octobre 2024), la parité avec l'Italie ayant été atteinte en septembre 2025 du fait d'un regain d'incertitude politique en France (cf. graphique infra).
La convergence des taux de la dette française à 10 ans (OAT, Obligations assimilables au Trésor) et de la dette italienne à 10 ans (BTP, Buoni del Tesoro poliennali) est particulièrement marquante. Alors que l'écart entre la France et l'Italie était supérieur à 100 points de base début 2024, les taux sont désormais identiques, certes du fait d'une légère amélioration des conditions de financement italiennes (- 30 points) mais, surtout, d'une dégradation des conditions de financement françaises (+ 70 points). Lors de la rédaction du présent rapport, le spread italien vis-à-vis de l'Allemagne (75 points de base) est même légèrement inférieur à celui de la France (79 points de base).
Confirmation que la France converge avec les États qui ont historiquement le plus de difficultés à se financer, le spread grec vis-à-vis de l'Allemagne est, dans le même temps, de 69 points de base.
Taux souverains à 10 ans en zone euro
(en %)
Source : avis du HCFP sur le PLF 2026, à part des données de la Banque de France (et du site Investing pour septembre 2025)
Deux éléments de contexte seraient cependant à prendre en compte pour nuancer l'idée que l'économie française serait pénalisée par une « prime de risque » liée aux fondamentaux de son économie.
En premier lieu, une façon positive d'appréhender cette convergence des spreads de la France, de l'Espagne et de la Grèce, privilégiée par l'économiste Éric Heyer, pourrait être de considérer que la situation actuelle traduit « une tendance plus favorable pour la vision qu'ont les investisseurs de l'Europe que celle qui prévalait lorsque les spreads étaient très fragmentés ». Selon cette vision, l'homogénéité croissante au sein de la zone euro serait le signe d'une confiance retrouvée des marchés dans son unité et sa solidité.
Il est vrai que la tendance la plus marquée des dernières années au sein de la zone euro, davantage que la dégradation relative des taux à 10 ans de la France, est l'amélioration des conditions de financement « des Italiens et des Espagnols, qui ont affiché par le passé des spreads de plus de 7 % » (E. Heyer), respectivement à l'automne 2011 et à l'été 2012, la Grèce ayant même subi, pour sa part, une hausse de taux, passant de moins de 15 % en juillet 2011 à 40 % au début de l'année 2012, ce qui avait de fait privé ce pays d'accès au financement sur le marché obligataire. Ces États ont pu redresser leurs comptes grâce à une assistance financière du FMI et des États membres, à l'influence de la BCE, et à des consolidations budgétaires que la France s'est refusée jusqu'ici à mettre en oeuvre.
En second lieu, l'écart de 0,3 point observé entre le spread de mai 2024 et celui d'octobre 2025 proviendrait quasi exclusivement de l'incertitude politique actuelle, en réaction à des décisions ou annonces politiques, telles que celle de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République (dimanche 9 juin 2024) ou celle de la sollicitation d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale par le Premier ministre (lundi 25 août 2025).
Le fait que la France - dont le déficit est de 5,4 % du PIB - puisse se financer au même taux que l'Italie - un pays qui dégage pour la deuxième année de suite un excédent primaire - pourrait être rassurant sur la façon dont les marchés évaluent l'économie française.
En dépit de ces deux éléments de contexte, il n'en reste pas moins que des taux supérieurs de 0,8 points par rapport à l'Allemagne, plus élevés que ceux du Portugal, de la Grèce, de l'Espagne et désormais de l'Italie se traduisent par une pénalité objective pour la France. L'instabilité politique s'étant installée en France dans la durée, il ne peut être exclu, par ailleurs, qu'elle finisse par devenir un trait caractéristique de l'économie française.
(2) La dégradation de la note souveraine de la France de « très haute qualité » à « haute qualité »
En parallèle de l'évolution des spreads, la dégradation successive de la note souveraine de la France confirme la tendance négative de ses conditions de financement.
C'est l'émetteur qui est noté, mais la note des titres d'État est généralement alignée, de même que la dette des autres administrations publiques (la note souveraine jouant en pratique le rôle de plafond pour cette dette).
Lors de la rédaction du présent rapport, la note de la France par les principales agences de notation va de Aa388(*) (avec perspective négative) pour Moody's à A + (avec perspective stable) pour Fitch et Standard & Poor's89(*).
Cela résulte d'une dégradation récente de sa note successivement par Fitch (12 septembre) puis par Standard & Poor's (17 octobre), alors que les notes précédentes étaient de AA-, dans le premier cas avec perspective négative, dans le second avec perspective stable90(*). Moody's (24 octobre) a confirmé la note de la France mais l'a placée en perspective négative (à horizon 12-18 mois).
Le passage de la note AA- à la note A+ emporte comme conséquence le passage de « très haute qualité » (double A) à « haute qualité » (simple A). La France a donc atteint les quatrième et cinquième échelons sur une vingtaine de notes possibles. Elle reste dans la catégorie investment grade (ensemble des notes supérieures à A).
Les conséquences de la dégradation de la note de la dette
par les agences de notation
Deux questions ont été débattues à l'occasion de dégradations successives de la note de la France en septembre et en octobre.
D'une part, les observations des derniers mois confirment que les agences de notation enregistrent avec un léger retard la réalité des conditions de financement accordées à un État, les notes souveraines reflétant des perspectives à moyen terme davantage qu'une évolution au jour le jour. C'est pourquoi les dégradations récentes de la note de la France ne se sont pas traduites par une évolution notable des taux octroyés à la France sur les obligations à terme (OAT) à 10 ans. Alors que les primes de risque ou de liquidité sont déjà internalisées en temps réel dans les prix de marché, les agences de notation ne font, en quelque sorte, qu'entériner a posteriori ce signal à partir des informations déjà publiquement disponibles. La Banque des règlements internationaux a mis en évidence en 2018 que le plus fort effet des annonces des agences de notation provenait du changement de « perspectives », davantage que des notes elles-mêmes91(*).
On peut par ailleurs imaginer qu'une dégradation en l'absence de « perspectives négatives » pourrait prendre de court les investisseurs et entraîner une « fuite vers la qualité » (flight to quality). Toutefois, même la dégradation d'octobre de la note de la France, qui correspond à ce cas, n'a pas donné lieu à une réaction particulière des marchés prêteurs.
Le seul cas dans lequel une dégradation pourrait produire des effets serait l'atteinte d'un seuil en dessous duquel des investisseurs seraient contraints de se désengager (cf. infra).
D'autre part, en dépit de l'absence d'effets macroéconomiques significatifs d'une dégradation sur les conditions de financement (en matière de taux, notamment), la question s'est posée de savoir si une telle dégradation pouvait avoir pour effet de priver la France de l'accès à certains investisseurs, qui seraient conduits, par exemple, à réduire leur exposition aux titres français ou à raccourcir la maturité de la dette acquise. Les investisseurs ont effet souvent l'obligation de disposer d'actifs d'une certaine qualité dans leur enveloppe globale. Le seuil atteint par la France reste cependant pour le moment supérieur aux seuils généralement retenus pour être éligible aux principaux indices obligataires (au moins A voire BBB-) ou même aux seuils des mandats privés.
Source : commission des finances
(3) Une concurrence accrue entre actifs sûrs en 2027
Les spreads et les notes souveraines donnent d'utiles indications pour situer les conditions de financement de la dette de la France par rapport à celles de ses voisins. Dans ce contexte, il est utile de garder à l'esprit que l'année 2027 sera « une échéance importante, car la majeure partie des dettes souveraines et des dettes des entreprises arriveront alors à maturité » : « le besoin de financement mondial sera massif, et les investisseurs devront arbitrer entre différents objets et différents émetteurs92(*) ».
La perspective d'un arbitrage entre dettes émises par différents émetteurs et de différentes natures place la France en situation particulièrement risquée.
Il a été souligné que les taux atteints par les obligations à 10 ans étaient désormais supérieurs à ceux de certaines obligations d'entreprises.
Par ailleurs, comme évoqué, les taux souverains des pays du Sud de l'Europe sont successivement devenus inférieurs à ceux de la France, signe que les obligations de ces pays sont jugées plus sûres et peuvent, dès lors, être préférées à celles de la France.
C'est a fortiori le cas de l'Allemagne, dont les émissions sont jugées si sûres que leur taux est inférieur de 80 points de base à ceux de la France. Dans un contexte où ce pays envisage d'augmenter substantiellement ses volumes d'émissions de dette, deux effets contraires peuvent se manifester :
- d'une part, il ne peut certes être exclu que le risque associé à la dette allemande soit jugé plus élevé en lien avec l'assouplissement du frein à la dette et la perspective d'une hausse de son ratio d'endettement ;
- d'autre part, on peut surtout craindre que ces nouvelles émissions n'absorbent la demande d'actifs sûrs, asséchant le marché des prêteurs pour la France. Natacha Valla prédit ainsi qu'« un changement de structure de l'offre se produira probablement dans la dette publique, sous la forme d'un appétit pour une dette sans risque. Or la dette sans risque de référence dans l'environnement européen reste la dette allemande ».
Sur une note plus positive, dans un contexte où les États-Unis continuent d'enregistrer des déficits publics venant augmenter la dette publique américaine, et où l'incertitude politique est relativement forte aux États -Unis, « il est possible qu'une appétence réduite pour la dette américaine joue en faveur de la France » (N. Valla). Il n'est toutefois pas certain que la France en bénéficie, car « la situation reste défavorable pour notre pays, par rapport aux émetteurs de dette considérés comme sûrs ».
Il convient enfin de garder à l'esprit que la forte demande en actifs sûrs lors des dernières années est une résultante de l'excès d'épargne à l'échelle mondiale. Sous des hypothèses de baisse de l'épargne mondiale, on peut présumer que la demande en actifs sûrs baisserait, ce qui pourrait présenter un effet haussier sur les taux des obligations souveraines.
c) Le « noeud coulant » de la hausse de la charge de la dette prive la puissance publique d'autant de moyens pour affronter l'adversité d'aujourd'hui et anticiper les crises de demain
(1) Le risque d'une anesthésie de l'action publique par l'effet « boule de neige » de la dette
Si jusqu'ici, selon le Conseil d'analyse économique, la dette publique s'explique par l'addition des déficits publics passés plutôt que par la charge de la dette, celle-ci devrait rapidement contribuer elle aussi à la dynamique de la dette, et de façon substantielle. La trajectoire de hausse des taux d'intérêt réels et de hausse du stock de dette émis par la France augmente considérabement ce risque.
Du fait de cette dynamique de sa charge d'intérêts, la France pourrait se retrouver dans la même situation que l'Italie depuis les années 1980, avec l'apparition d'un effet « boule de la neige », un solde public à l'équilibre étant loin, dès lors, de suffire à assurer la stabilisation de la dette publique.
La contrainte de cette dépense « non pilotable » sur les autres politiques publiques produirait en cette circonstance un effet anesthésiant, comme en Italie, pays obligé depuis plusieurs années de dégager des excédents primaires (hors charge de la dette) s'il souhaite stabiliser sa dette.
Aux origines de la dette publique italienne
Le ratio dette publique/PIB de l'Italie est le deuxième plus élevé de la zone euro après celui de la Grèce, et la dette y est « souvent considérée comme un fardeau et un frein à la croissance, en particulier après un choc économique profond ». Dans ce contexte, un article de D'Elia et Zeli (2024) cherche à « déterminer si l'augmentation globale de la dette est liée à la dynamique des taux d'intérêt ou à celle des dépenses sociales ».
Il en ressort que « le déficit budgétaire principalement lié à des réformes de la protection sociale a été la cause de la dette dans les années 1960 et 1970 jusqu'au début des années 1980 ».
Après quoi, « en particulier entre le début des années 1980 et le processus de création d'une monnaie unique européenne (1993), les intérêts payés sur la dette publique, étroitement liés à la dynamique du marché financier international, qui est presque exogène » (augmentation des taux au long des années 1980) ont été « le principal facteur d'augmentation de la dette ». En effet, à partir des années 1981-1984, ce qu'il est convenu le « divorce » entre le Trésor et la Banque d'Italie - nouvelle politique de financement de la dette mise en place afin de lutter contre l'inflation - a conduit le Trésor à se financer sur les marchés financiers, à un taux supérieur à la simple couverture de l'inflation qu'exigeait la Banque d'Italie. Ce mode de financement a « accéléré la croissance de la dette publique pour un déficit donné ».
Il en a résulté un doublement de la charge d'intérêts et de la dette entre 1981 et 1987 puis une hausse nouvelle de 50 % de la charge d'intérêts entre 1988 et 1993, une diminution n'étant intervenue qu'après 1996 dans le cadre d'un assainissement budgétaire en vue de l'introduction de l'euro.
C'est ce qui fait dire aux auteurs qu'à l'inverse des années 1960-70, lors desquelles les politiques sociales expliquaient la dette, dans les années 1980-90, ce sont « les politiques de réduction de la dette [qui] ont influencé la réduction des dépenses sociales ».
Source : commission des finances, à partir de D'Elia et Zeli (202393(*))
(2) Un « accident de marché » ne pouvant jamais être totalement exclu, la souveraineté de l'État est de facto limitée
Moins probable mais plus violent que cette lente anesthésie de l'action publique, un accident de marché, se traduisant en particulier par une perte de l'accès au marché et une crise de liquidité, ne peut jamais être totalement exclu. Le président du HCFP Pierre Moscovici l'a suggéré devant la commission des finances : la dette française est « susceptible de faire l'objet de dynamiques de marché disruptives ».
L'essayiste Robin Rivaton anticipe ainsi depuis plusieurs semaines, sur le réseau social X, la possibilité avant 2027 d'un « moment Liz Truss » qui verrait un accident de marché précipiter une crise politique, du nom d'une éphémère Première ministre britannique rapidement forcée à la démission.
Le « moment Liz Truss »
Nommée Première ministre du Royaume-Uni le 6 septembre 2022 en remplacement de Boris Johnson, la dirigeante du Parti conservateur d'inspiration libérale Liz Truss, a dû présenter sa démission le 25 octobre de la même année, ne se maintenant en fonction que quarante-neuf jours.
Le « mini-budget » présenté le 23 septembre par son chancelier de l'Échiquier Kwasi Kwarteng, comprenant un stimulus budgétaire inédit depuis 1972, de près de 45 Md£ (environ autant en euros) de réductions d'impôt non financées par des baisses de dépenses équivalentes, avait provoqué une chute de la livre sterling et une hausse quasi-instantanée de 50 points de base du taux de refinancement de la dette de l'État britannique.
L'Institute for Fiscal Studies (IFS), think tank spécialisé sur les questions budgétaires, avait alors considéré qu'il était « plus probable qu'à un moment donné, les réductions d'impôts actuelles devront être compensées par de futures hausses d'impôts ou réductions des dépenses » - décrivant une situation d'équivalence ricardienne. Il déplorait que « le plan semble consister à emprunter des sommes importantes à des taux de plus en plus élevés, à mettre la dette publique sur une trajectoire ascendante insoutenable et à espérer une meilleure croissance », concluant que « la crédibilité budgétaire est difficile à gagner, mais facile à perdre ».
Depuis lors, le « moment Liz Truss » désigne ce moment de révélation soudaine du caractère non crédible ou non soutenable d'une politique économique et de sa sanction par les marchés financiers, pouvant fragiliser l'exécutif au point d'entraîner jusqu'à sa démission. Cet événement a révélé de façon frappante la perte de souveraineté qu'implique la dépendance aux marchés financiers pour le financement d'une dette excessive.
Source : commission des finances
(3) La France peine à avoir les moyens de la politique de puissance industrielle et de défense qu'elle a toujours défendue en Europe
L'aspect le plus regrettable de la dérive des comptes publics des dernières années est qu'elle met notre pays dans l'incapacité de se montrer à la hauteur d'un moment historique qui donne pourtant raison à ses positions historiques sur la scène européenne et la scène internationale.
Comme l'ont rappelé plusieurs économistes et décideurs économiques de renom - dont Patrick Martin, président du Medef - en cosignant une tribune parue à la fin de l'été 2025, intitulée « Le nouveau consensus européen et le contretemps français94(*) » : « Notre pays est ainsi à l'origine d'une politique économique qui fait aujourd'hui consensus en Europe mais qu'il ne peut plus poursuivre faute d'avoir agi à temps. En appelant à la fin de la naïveté européenne, la France a eu raison vingt ans avant ses partenaires, c'est-à-dire trop tôt ; en n'adoptant pas leur gestion raisonnable de ses finances publiques, elle prend conscience trop tard que les choix d'aujourd'hui se préparaient il y a vingt ans. Résultat de cette politique à contretemps : nous regardons avec envie une Allemagne qui annonce des centaines de milliards d'euros d'investissement dans ses armées et ses infrastructures, et une Union européenne qui évolue, à pas comptés, sur les positions françaises historiques, sans que nous ne puissions y prendre, nous aussi, une part active. »
À l'heure où les relations internationales, y compris sur le plan économique, deviennent plus dures, les politiques industrielles actives, la réciprocité dans les relations commerciales avec le reste du monde ou encore la préférence européenne s'agissant des technologies de pointe ont regagné du crédit en Europe et sont désormais à l'agenda de la Commission européenne et des autres États membres.
La notion de « contretemps français » résume l'absurdité de la situation dans laquelle tant d'années de dérive budgétaire ont plongé la France, qui ne peut peser de tout son poids sur les sujets stratégiques pour l'avenir de l'Union européenne.
Pour le mesurer, il n'est que de constater la différence entre le plan d'investissement massif de l'Allemagne dans la défense (500 milliards d'euros à brève échéance), et dans les infrastructures et la transition écologique (500 milliards d'euros en douze ans), avec la « surmarche » de 3,5 milliards d'euros, par rapport à la trajectoire de la loi de programmation militaire (LPM), proposée dans le présent budget.
Une Allemagne sortie de sa crise passagère,
et disposant des moyens de ses ambitions
Si l'Allemagne a connu une crise passagère, se traduisant par une stagnation de son PIB depuis la crise liée à la pandémie de Covid-19, l'année 2026 devrait apporter la preuve que l'Allemagne avait, à l'inverse de la France, les moyens de rebondir.
Ces moyens sont le fruit de nombreuses années de gestion raisonnable et prudente des comptes publics. il en résulte qu'en 2026 « l'Allemagne se distinguerait par une politique budgétaire expansionniste, facilité par le faible niveau de la dette publique. En effet, rapportée au PIB, la dette allemande n'est que de 62,5 % du PIB, alors qu'elle dépasse 100 % en France, Italie, Espagne et au Royaume-Uni. Le gouvernement allemand dispose donc de marges de manoeuvre pour mettre en oeuvre une politique d'investissement en infrastructures, de relance des dépenses militaires et de soutien aux entreprises permettant de relancer la croissance95(*). »
Le Haut Conseil des finances publiques rappelle dans son avis sur le PLF 2026 que, « selon le PSMT allemand, le ratio de dette de l'Allemagne augmenterait de 3 points en deux ans pour s'établir à 65,5 points de PIB en 2026 ». Il souligne que « malgré cette inflexion majeure de la politique budgétaire et de la trajectoire d'endettement outre-Rhin, l'écart entre les ratios de dette de nos deux pays continuerait de s'accroître », le ratio français augmentant plus rapidement encore.
Source : commission des finances
Ce surcroît de dépenses, pour quiconque est décidé à affronter sérieusement le défi du réarmement dans un contexte international de plus en plus conflictuel, est une nécessité. C'est vrai, du reste, de l'ensemble des dépenses régaliennes - défense, sécurité - et, de façon générale, de l'ensemble des politiques publiques prioritaires pour anticiper les défis de demain : innovation, numérique, éducation, transition écologique, logement...
Le rapport Draghi estime à 800 Md€ par an le surcroît d'investissement - public ou privé - nécessaire au sein de l'Union européenne pour que le continent puisse soutenir la compétition mondiale, notamment américaine et chinoise. Le rapport Pisani-Ferry évalue à 60 Mds€ le besoin d'investissement total, dont 30 Mds€ en provenance de la sphère publique, pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050.
La France compromet donc sans équivoque son avenir en n'investissant pas dans ces domaines.
B. DES CHOIX STRUCTURANTS DOIVENT ÊTRE OPÉRÉS DÈS AUJOURD'HUI POUR NOUS ÉVITER DES CHOIX PLUS DRASTIQUES DEMAIN, LA FACILITÉ N'ÉTANT PLUS UNE OPTION
1. Après un premier succès en 2025 et avant un exercice peut-être plus difficile en 2027, il existe une fenêtre de tir en 2026 pour fournir un effort significatif
a) L'exécution du solde de l'année 2025 est en passe d'être tenue, un succès pour la feuille de route initiée par l'ancien Premier ministre Michel Barnier
Entendu par la commission des finances, le président du Haut Conseil des finances publiques Pierre Moscovici a adressé à plusieurs reprises un satisfecit à la feuille de route initiée par le gouvernement de Michel Barnier pour l'année 2025, qui a constitué « une première étape » d'autant plus cruciale qu'elle est intervenue dans le double contexte d'un déficit public inédit hors période de crise d'une part, et d'écarts jamais observés entre prévision et exécution des finances publiques, d'autre part.
S'agissant du niveau du solde public, selon le HCFP, « l'exercice 2025, après deux années noires, marquerait une toute première étape, certes limitée, mais réelle, de redressement des comptes publics ».
S'agissant des prévisions économiques et de finances publiques figurant dans la loi de finances pour l'exercice 2026, il a jugé qu'elles étaient « dans l'ensemble crédibles », ajoutant que « des aléas restent bien entendu possibles d'ici à la fin de l'année, mais [que] les prévisions actualisées dont [le HCFP] dispose semblent assez équilibrées ».
La prudence du HCFP est de bon aloi dans la mesure où les données stabilisées sur l'année N produites par l'Insee ne sont connues qu'à la fin du mois de mars de l'année N+1. En effet, c'est seulement à cette date qu'intervient la notification par l'Insee à Eurostat du déficit et de la dette au sens de Maastricht de l'année passée, après les dernières remontées comptables des différentes administrations. Les chiffres sont susceptibles d'être ajustés jusqu'à cette date.
La vigilance du Parlement et notamment du Sénat n'a pas été étrangère à cette amélioration puisque l'administration a entrepris un travail de fiabilisation des prévisions, avec mise en place d'un « plan d'action pour améliorer le pilotage des finances publiques » et d'un comité scientifique autour des prévisions, notamment pour tenir compte des recommandations de la mission d'information de la commission des finances sur la dégradation des finances publiques en 2023 et 202496(*).
b) Pour 2026, le Gouvernement a relâché la bride de 0,4 point avant même le début des débats, ce qui augure mal du point d'atterrissage
Dans un premier temps, la cible de déficit public pour 2026, annoncée par le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse du 15 juillet, était de 4,6 % du PIB, sans que les mesures en recettes et en dépenses ou les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes ne soient, du reste, précisément chiffrées.
Elle a été réhaussée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans une interview à Ouest-France du 13 septembre, à 4,7 % du PIB, du fait du retrait annoncé de la suppression de deux jours fériés, dont le bénéfice pour les finances publiques était estimé à « plus de 4 milliards d'euros » (soit un peu plus de 0,1 point de PIB).
Cette cible de - 4,7 % du PIB correspond au solde figurant à l'article liminaire du projet de loi de finances, tel que soumis pour avis au Haut Conseil des finances publiques le 2 octobre et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 octobre.
Cependant, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a entretemps déclaré, lors d'un point presse dans la cour de l'hôtel de Matignon le 8 octobre : « tout le monde s'accorde à dire, en tout cas dans les rendez-vous que j'ai eus hier, que la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5 % de déficit, c'est-à-dire, en clair, entre 4,7 et 5 %, de manière définitive. En tout cas, je vous rends compte de ce qui m'a été dit par les différentes formations politiques, qui témoigne, d'ailleurs, d'un chemin de responsabilité ».
Il a confirmé le 14 octobre, jour même du dépôt, lors de sa « déclaration suivie d'un débat » sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution, que « dans la copie proposée par le Gouvernement, [le déficit public] est réduit à 4,7 % du PIB » et que « dans tous les cas de figure à la fin de la discussion budgétaire, il devra être à moins de 5 % du PIB car cet impératif de souveraineté s'impose à nous tous ». Il a ajouté qu'il « ne serait pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics ».
Interrogée le 13 octobre par le rapporteur général de la commission des finances pour faire la lumière sur les intentions du Gouvernement qui n'apparaissaient pas d'une grande clarté, la ministre de l'action et des comptes publics Amélie de Montchalin a répondu que « ce budget prévoit un déficit de 4,7 % du PIB. Dans le cadre des débats budgétaires, j'aimerais que devant chaque « plus » l'on retrouve un « moins ». Toutefois, le Premier ministre a affirmé qu'il était essentiel de rester sous les 5 %. On ne peut pas entrer dans une négociation en annonçant que tout est fixé. Par ailleurs, les 5 % ne sont pas un fétiche ».
Si ce respect du travail parlementaire est louable, force est de constater que la seule clarification de cette prise de parole réside dans sa dernière phrase, qui laisse craindre un dérapage supplémentaire de la cible de déficit public adoptée dans le projet de loi de finances, au-delà du seuil psychologiquement important de 5 % du PIB, ce qui enverrait un signal terrible sur l'impuissance du Gouvernement à redresser les comptes publics.
L'hypothèse de 5 % de déficit public est de facto considérée comme actée par les principaux organismes de prévision - institut Rexecode, Observatoire français de la conjoncture économique (OFCE).
Plusieurs prévisionnistes tablent même sur un déficit public encore plus dégradé, compte tenu de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale pour la coalition qui dirige l'exécutif. Des investisseurs, tels qu'Alexandre Stott, de la banque Goldman Sachs « tablent plutôt sur un déficit encore proche de 5 % du PIB en 2026, en baisse, mais légère, par rapport à cette année97(*) ». Le Fonds monétaire va encore plus loin puisqu'il anticipe 5,8 % de déficit public en 202698(*).
c) Le respect du PSMT est pour l'heure assuré, mais pas celui de la LPFP, et la prudence doit rester de mise au cas où la trajectoire de dépenses primaires nettes dériverait après 2026
D'un point de vue réglementaire, le projet de loi de finances initial, avec un déficit public de 4,7 %, est a priori conforme à la trajectoire à laquelle la France est tenue par les règles budgétaires européennes.
De l'insuffisance du solde public comme indicateur des efforts budgétaires
L'atteinte de cette seule cible de déficit public rapporté au produit intérieur brut ne garantit pas la conformité au droit de l'Union européenne, car c'est une donnée qui n'entre qu'indirectement dans l'appréciation de la conformité de la trajectoire de redressement des comptes publics de la France. En effet, le déficit public constaté en fin d'année N relète imparfaitement les efforts fournis par la sphère publique, que ce soit en dépenses ou en recettes : il comporte une composante structurelle mais également une composante conjoncturelle.
Un engagement sur un solde public rapporté au PIB comporte en effet l'inconvénient important de reposer pour moitié sur la croissance économique, un indicateur qui ne dépend que partiellement de l'action des administrations publiques. Pour les pouvoirs publics, le PIB est une variable essentiellement exogène - hormis pour la contribution de l'impulsion budgétaire de l'année à la croissance, directement ou, indirectement, par le biais des multiplicateurs -, sur laquelle ils n'ont qu'une prise indirecte. À titre d'exemple, un choc haussier sur les prix du pétrole, des rétorsions impliquant la mise en place de droits de douane supplémentaires à l'échelle mondiale ou une crise financière ou sanitaire auraient pour effet de dégrader substantiellement le solde public rapporté au PIB - tant au numérateur, du fait d'éventuelles interventions publiques, qu'au dénominateur, puisqu'un tel choc aurait vraisemblablement un impact sur la croissance.
Dit autrement, le solde public reflète assez mal les intentions et réalisations du Gouvernement et demeure assez largement indépendant de l'effort structurel fourni par la France. C'est la raison pour laquelle la notion de « trajectoire de dépenses nettes » ou d'« ajustement structurel » sont préférées.
Source : commission des finances
Dans son avis, le HCFP constate, s'agissant d'une cible à 4,7 % de déficit public, « que l'évolution prévue de la dépense primaire nette peut être jugée globalement compatible avec nos engagements européens (plan budgétaire et structurel à moyen terme, PSMT) et est conforme aux recommandations adressées à la France, mais regrette le dépassement de 0,2 point anticipé pour 2025 et souligne la difficulté à tenir la cible pour 2026. »
L'indicateur considéré par le Conseil et la Commission européenne est la trajectoire de dépense primaire nette (DPN). Le scénario présenté au HCFP par le Gouvernement prévoit une progression de 0,6 % de la dépense primaire nette en 2026, quand les recommandations du Conseil du 21 janvier 2025 n'exigeaient de limiter la trajectoire qu'à 1,2 % de hausse de DPN. Il existe, du reste, un seuil de tolérance de 0,3 point (que l'exécution de l'année 2025 aurait déjà en partie entamée, puisque la DPN serait de + 1 %, contre 0,8 % attendus par le Conseil).
Du reste, comme l'a rappelé le président du Haut Conseil des finances publiques devant la commission, « une année présidentielle - ce sera le cas en 2027 - n'est généralement pas propice à un durcissement de l'ajustement ; l'effort devra être reporté à une autre année ». La littérature économique sur le cycle budgétaire politique (PBC ou Political Budget Cycle) fait en effet apparaître un surcroît de dépenses lors des années électorales.
C'est pourquoi, selon l'économiste Éric Heyer, la trajectoire initiale présentée par le Gouvernement se caractériserait par un effort plus soutenu en 2026, afin de sécuriser la trajectoire. La partie la plus substantielle de l'ajustement est concentrée au début de la période, une répartition de l'effort que les spécialistes des questions budgétaires qualifient de « frontloading » (ou concentration en début de période), dans le but de prendre de l'avance sur ses engagements.
À l'inverse, chaque année qui passe confirme la divergence inéluctable de la trajectoire actuelle de celle qui avait été fixée dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP).
Si le Haut Conseil se montre rassurant sur le respect du PSMT, il relève dans son avis « le hiatus persistant entre la LPFP et le PSMT, qui soulève la question d'une révision du droit organique. »
LPFP 2023-2027 : un Sénat constant
dans sa volonté de rétablir
les comptes publics par la
réduction des dépenses
Caduque à peine votée, car contraire au projet de loi de finances qui était en cours d'examen concomitamment, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 202799(*) fixait pourtant un horizon atteignable. Il convient de rappeler que le Sénat avait proposé à la fin de l'année 2022, dans le cadre de l'examen de ce texte à la portée pluriannuelle, un effort supplémentaire de 37 milliards d'euros d'économies. Il n'avait malheureusement pas été entendu.
Le simple respect du cadre qu'elle donnait aurait sans doute suffi à prémunir la France de la crise des finances publiques qu'elle traverse aujourd'hui. Ce modeste effort, alors caricaturé, aurait permis de dispenser les pouvoirs publics des choix difficiles auxquels ils sont désormais confrontés pour stabiliser voire réduire le poids de la dette publique dans le PIB, c'est-à-dire un effort structurel de 120 milliards d'euros à horizon 2029.
Source : commission des finances
d) Ambitieuse au regard des exemples de consolidation réussies par le passé, la trajectoire du projet de loi initial apparaît pourtant nécessaire pour stabiliser la dette
Davantage encore que pour le respect, certes nécessaire, de la trajectoire de dépenses nettes primaires exigée par la Commission européenne, c'est pour des raisons économiques que la consolidation budgétaire s'impose aujourd'hui aux pouvoirs publics.
En effet, la cible de 4,6 % en 2026 qui figure dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029, n'a pas été choisie pour faire plaisir à la Commission européenne, ni pour satisfaire nos créanciers sur les marchés financiers. C'est l'effort requis pour ne pas se retrouver paralysé par une charge de la dette improductive et permettre d'investir dans nos priorités que sont la défense, l'innovation et la transition écologique, afin de faire face aux prochaines crises.
Les 3 % de déficit public dans le PIB en 2029 devraient correspondre à peu près, toutes choses égales par ailleurs, au solde stabilisant la dette.
Le solde stabilisant la dette
Plus concrètement, il s'agit de la trajectoire visant à éviter que des effets cumulatifs ne créent ce qu'il est convenu d'appeler un « effet boule de neige » de la dette, celle-ci finissant par s'autoentretenir et emporter les finances publiques dans une dynamique incontrôlable et irrémédiable.
Un « effet boule de neige » se met en place dès lors qu'un déficit primaire est constaté alors que les taux d'intérêt (r) sont plus importants que la croissance (g), soit r > g.
L'endettement public de la France sur les cinquante dernières années ne résulte pas d'un effet boule de neige selon le Conseil d'analyse économique : qualifiant ce fait de « remarquable et quelque peu inattendu », il en tire la conclusion « qu'on ne doit pas attendre de miracle macroéconomique : il est très peu probable que l'inflation ou la croissance fassent systématiquement diminuer la dette publique sans effort budgétaire ». Il n'y aurait donc pas moyen de sortir par le haut, c'est-à-dire par la croissance, de la dérive de nos comptes publics.
En même temps, « l'écart entre le taux d'intérêt des emprunts publics (r) et le taux de croissance (g) est à présent positif », rappelle le HCFP, et le déficit primaire de la France (hors charge d'intérêts) dépasse 70 Md€.
Source : commission des finances
La France serait donc loin de pouvoir stabiliser son ratio de dette simplement par de la croissance. Autrement dit, plus nous tardons à redresser les comptes publics, plus il nous en coûtera.
À l'inverse, cependant, un effort trop brusque peut aussi se retourner contre son initiateur s'il produit des effets récessifs ayant pour conséquence d'exiger un effort encore plus important par la suite. Les effets récessifs d'une consolidation budgétaire sont indéniables, tant directement, parce que la dépense publique est, en soi, l'une des composantes du produit intérieur brut100(*), qu'indirectement, parce que la dépense publique présente un effet multiplicateur susceptible d'augmenter le PIB, en suscitant d'autres dépenses. À cet égard, Éric Heyer, économiste à l'OFCE, alerte sur le risque de reproduire l'erreur de la consolidation précipitée de 2011-2013, qui avait produit des effets récessifs importants. Or, selon lui, l'effort demandé en dépense et en recettes dans le cadre du plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) serait plus massif que ce qui avait alors été adopté.
La détermination de la trajectoire de consolidation budgétaire optimale d'un point de vue économique est donc un exercice délicat.
Un focus récent du Conseil d'analyse économique tente de tenir compte de ces effets contraires pour proposer la trajectoire qui minimise l'effet récessif et maximise l'effet cumulatif.
112 milliards - 24 milliards d'euros = toujours 112 milliards d'euros
Dans une note publiée en juillet 2024, le Conseil d'analyse économique (CAE) propose un ajustement « modéré mais soutenu », impliquant « une réduction du déficit primaire d'environ 4 points de PIB, soit 112 milliards d'euros, étalée sur 7 à 12 ans, avec un effort initial plus important », pour viser, par précaution, un surplus primaire de 1 % afin de faire face aux éventuelles crises.
Mise à jour par le CAE dans un focus publié en octobre 2025, cette estimation de l'ajustement budgétaire nécessaire est... toujours fixée à 112 milliards d'euros par an - et même 127 milliards en cas de hausse des taux -, à un horizon repoussé d'un an. Ce surplace s'explique par « un point de départ légèrement détérioré » entre les deux documents : hausse du niveau de dette et du taux apparent sur la dette, charges d'intérêts passées de 1,9 % à 2,1 % du PIB entre 2023 et 2024.
L'ajustement proposé par le CAE se mesure par rapport au niveau des dépenses et des recettes constatées en 2025. Il diffère donc de la notion d'« ajustement structurel » désormais retenue par le Gouvernement - qui implique de calculer un effort en dépenses par rapport à ce que serait l'évolution des dépenses au rythme de la croissance potentielle - ou de la notion précédemment retenue d'effort par rapport à un « tendanciel de hausse spontanée des dépenses ». Dans ces derniers deux cas, en effet, la dépense peut continuer d'augmenter. Ce n'est pas possible dans le cas du CAE.
L'ajustement structurel médian proposé par le CAE serait d'environ 27 milliards d'euros en première année, un montant légèrement moins ambitieux que le plan initial du Gouvernement, à 31 milliards d'euros.
Soldes publics (en % du PIB) dans trois scénarios de consolidation
Source : commission des finances, à partir du focus du CAE, « Comment stabiliser la dette publique ? »
Le scénario du Conseil d'analyse économique prône, pour stabiliser la dette, de ne pas repousser l'effort, car plus ce dernier est fait tôt, plus son impact sur la dette est important, tandis que l'effet récessif d'une consolidation sera le même, qu'il soit réalisé aujourd'hui ou demain.
L'économiste Olivier Blanchard a reconnu que « la réduction du déficit risque de réduire la demande et la croissance à court terme ». Mais, comme il l'a aussi rappelé, « si l'alternative est l'absence d'ajustement et, par implication, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés sur la dette, l'alternative est pire101(*) ». L'alternative n'est donc pas entre des choix douloureux ou des choix faciles aujourd'hui, mais entre des choix douloureux aujourd'hui ou des choix encore plus douloureux demain.
Quelle trajectoire emprunter au regard des
expériences étrangères réussies
de
consolidation ?
Dans L'Économie du bien commun (2016), l'économiste Jean Tirole, président honoraire de l'École d'économie de Toulouse, cite les cas suédois, finlandais et canadiens des années 1990 et le cas allemand des années 2000 pour écarter l'argument selon lequel « ce [ne serait] pas le moment de faire des réformes dans une conjoncture difficile », rappelant que dans ces pays « la grande majorité des réformes ont été faites justement dans des circonstances difficiles », une conjecture difficile devant selon lui « encourager, non pas décourager les réformes ».
Le politiste François Godard102(*) constate lui aussi que « l'augmentation des dépenses publiques n'est pas inéluctable : la Suède a baissé d'un montant représentant 10 % de son PIB ses dépenses publiques entre 1991 et 1997 ; grâce à des contrats privés, elle a diminué le nombre de fonctionnaires de 400 000 à 250 000 dans les années 1990. Elle n'a conservé que quelques centaines de fonctionnaires dans les ministères, chargés de l'élaboration de la stratégie, de l'arbitrage des choix budgétaires et de l'organisation des débats ; et elle délègue l'opérationnel à une centaine d'agences spécialisées et indépendantes dans leurs décisions de recrutement et de rémunérations. »
Il tire cependant comme leçon de cet expérience réussie de consolidation que « des réformes ponctuelles sont difficiles à réaliser : les lobbies concernés se déchaînent alors que les bénéficiaires soit ne sont pas informés des gains qu'ils réaliseraient, soit restent simplement apathiques en raison du problème du passager clandestin. Une réforme globale offre une vue d'ensemble d'un gâteau plus gros et accompagne les perdants. »
Il préconise d'appliquer cet enseignement : « la recherche des économies potentielles pourrait adopter la méthodologie suivie au Canada. Pour chaque programme, les Canadiens se sont posé les questions pertinentes : le programme sert-il l'intérêt public ? Si oui, pourrait-il être fourni par une autre branche du secteur public ou par le secteur privé ? Le coût est-il abordable et y a-t-il des alternatives ? Sans considération de vaches sacrées, mais dans un dialogue et avec une pédagogie constante. De simples réflexions de ce type peuvent mener à des solutions originales. Par exemple, des collectivités territoriales, plutôt que d'extérioriser des services publics, ont encouragé et aidé leurs agents à créer leur propre entreprise de fourniture déléguée de ces services. »
Plus récemment, les trajectoires de l'Espagne et du Portugal, mais aussi de l'Italie, de la Grèce, qui présentent désormais des excédents primaires, ont pu inspirer les observateurs.
Source : commission des finances
2. La multiplication de méthodes concurrentes pour présenter l'effort budgétaire et fiscal nuit gravement à la clarté et à la sincérité des débats
Les débats budgétaires ne sont pas facilités par la multiplication des chiffres concurrents relatifs aux finances publiques, qui ajoute à la confusion budgétaire et fiscale.
Si l'on ajoute à ce brouillard une situation exceptionnelle de présentation du budget en dehors des délais qui se répète pour la deuxième année de suite, rien n'est fait pour aider les parlementaires.
a) La notion de « tendanciel » de hausse spontanée des dépenses et recettes publiques
La notion de « tendanciel » de hausse spontanée des dépenses publiques « n'est jamais un exercice neutre. Elle repose sur des conventions de calcul et sur une interprétation de ce que l'on considère être la « politique inchangée », ce qui peut conduire à des confusions dans l'interprétation des efforts à fournir », comme l'a récemment rappelé le CAE.
Ainsi, le tendanciel des dépenses de + 3 % calculé par le Gouvernement entre 2025 et 2026 repose sur les hypothèses suivantes.
Décomposition du tendanciel des dépenses pour 2026
Source : focus du CAE, « Comment stabiliser la dette publique ? », oct. 2025
La notion de tendanciel permet parfois d'exagérer la réalité de l'effort fourni par la sphère publique, puisqu'elle permet d'afficher un effort plus élevé qu'il ne l'est en réalité par rapport à l'année précédente. Cette mesure permet en effet de « naturaliser » une trajectoire haussière des dépenses.
Il est ainsi techniquement possible, sur le fondement de cette méthode, de présenter un effort facialement très élevé, quand bien même le solde public se dégraderait par rapport à l'exercice précédent et les dépenses augmenteraient par rapport à l'exercice précédent. Cette approche permet également de jouer sur la répartition de l'effort entre recettes et dépenses, biaisant la façon dont le budget est appréhendé dans les débats en gonflant l'effort en dépenses et en minimisant l'effort en recettes.
Les conséquences d'une loi spéciale sur le solde public
Une loi spéciale peut être adoptée pour garantir la continuité de l'État, le bon fonctionnement des services publics, la possibilité de prélever les impôts et le recours à l'endettement pour l'État et les administrations publiques en cas d'absence de loi de finances votée avec la fin de l'exercice précédent.
L'OFCE a calculé les effets qu'aurait eus le maintien en vigueur, sur l'ensemble de l'année 2025, d'une loi spéciale (article 45 de la Constitution), sans adoption de la loi de finances de février 2025. En effet, « si une loi spéciale est exempte de tout choix politique, elle n'est pas sans incidence budgétaire » en ce qu'elle « empêche de prendre des mesures nouvelles aussi bien sur les prélèvements obligatoires (PO) que sur les dépenses publiques ».
L'OFCE montre que l'effort budgétaire structurel primaire aurait été de 11 Md€ (0,4 point de PIB) en 2025 dans le cas d'une loi spéciale, contre 45,3 Md€ (1,5 point de PIB) dans le PLF 2025, soit une « différence significative d'ajustement budgétaire (1,1 point de PIB) entre le PLF 2025 et la loi spéciale ».
Pour l'année 2026, le maintien des prélèvements obligatoires inchangé par rapport à 2025 conduirait à une baisse de 6,5 Md€ des PO (0,2 point de PIB), en raison de la fin de la surtaxe d'IS et de la CDHR (- 10 Md€ au total), le gel du barème de l'IR et les mesures contre la fraude fiscale atténuant la baisse totale.
Mais, rappelle l'OFCE, « l'essentiel des effets budgétaires passe par la dépense, le principe général étant que les dépenses de l'État soient gelées en valeur, tandis que les autres dépenses, celles des administrations de sécurité sociale et des collectivités locales, ne peuvent pas être pilotées à travers une loi spéciale ». S'ajoutent des dépenses non pilotables de l'État (charge d'intérêts, contribution au budget de l'UE) qui s'établissent en hausse de 0,5 point de PIB en 2026. Ainsi, « l'effort en dépenses publiques induit par le passage par une loi spéciale s'établit à 3 milliards d'euros (soit 0,1 point de PIB) », l'essentiel de l'effort venant de l'État.
Source : commission des finances
Rapporter notre déficit public à la richesse que nous créons chaque année paraît plus pertinent que la méthode du tendanciel, car cela éclaire mieux notre capacité de remboursement. C'est surtout plus lisible pour nos concitoyens que de le rapporter à un tendanciel de hausse spontanée des dépenses, qui repose sur des hypothèses discutables et pouvant évoluer en cours de discussion.
b) Les notions d'effort structurel et d'ajustement structurel
Alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a abandonné la notion de « scénario tendanciel » autour du 20 septembre 2025103(*), on eût pu s'attendre à ce que la présentation du budget pour 2026 prenne pour point de comparaison les dépenses et recettes arrêtées dans la loi de finances de l'année précédente.
Aussi perfectible soit-elle104(*), cette unité de mesure a pour mérite d'être intelligible pour le sens commun et de favoriser, autant que faire se peut, la clarté et la sincérité des débats, qui sont des principes constitutionnels. Elle laisse entière la question de la prise en compte de l'inflation.
Pourtant, les deux chiffres ayant bénéficié de la plus grande couverture médiatique - aux côtés de la cible de déficit public comprise « entre 4,7 et 5 % du PIB » - ont été les « 17 milliards d'euros d'effort structurel en dépenses » et « 14 milliards d'euros d'effort structurel en recettes » annoncés par le Gouvernement et que le Haut Conseil des finances publiques confirme avoir pris en compte. Cette façon de calculer est certes la plus usuelle pour les institutions budgétaires indépendantes.
La composition de ces deux agrégats n'apparaît pas avec immédiateté à la lecture de la documentation budgétaire.
Il est expliqué dans le rapport économique, social et financier (RESF) que l'effort en recettes est défini comme le montant des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires et que l'effort en dépense est calculé par la comparaison des dépenses structurelles105(*) en volume - c'est-à-dire auxquelles on applique le déflateur du PIB - et de la croissance potentielle.
On mesure bien, à la lecture de ces méthodes de calcul, qu'il ne s'agit que partiellement de données directement observables.
L'effort structurel selon le RESF
Source : rapport économique, social et financier annexé au PLF pour 2026
Le déficit structurel serait réduit de 0,8 point de PIB, et l'effort structurel atteindrait + 1,0 point de PIB (plus de 30 Md€) - la différence entre les deux provenant de la composante non discrétionnaire du solde structurel (recettes hors prélèvements obligatoires et effets d'élasticités fiscales des prélèvements obligatoires, notamment).
Ainsi, en 2026, l'effort proviendrait majoritairement de moindres dépenses, pour environ 17 Md€, complété par les hausses de prélèvements obligatoires, pour près de 14 Md€.
Prévision de solde public et de solde structurel soumise au HCFP
Source : HCFP, avis sur le PLF et le PLFSS 2026
Or, plusieurs des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires sont associées à des montants qui apparaissent particulièrement fragiles :
- c'est le cas, au premier chef, des mesures de lutte contre la fraude - figurant dans un projet de loi distinct, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, déposé en parallèle -, pour lequel il paraît particulièrement ambitieux d'attendre un gain aussi élevé pour les finances publiques (1,5 Md€) ;
- c'est également le cas de la taxe sur les holdings patrimoniales (art. 3 du PLF), estimé à 1 Md€ ici, mais à 0,9 Md€ dans l'évaluation préalable de l'article, dont le montant ne peut en réalité être connu avec prévision. Le maintien de contribution différentielle pour les hauts revenus (CDHR) a aussi pour conséquence un aléa fort, tant cette mesure fiscale a vu son produit varier, entre l'évaluation préalable fournie au moment de son vote en PLF 2025, à 2 milliards d'euros, les estimations les plus récentes par le Gouvernement (1,5 milliard d'euros) ou celles, par exemple, de l'institut des politiques publiques (1,2 milliard d'euros)106(*).
Pour les dépenses, le président du HCFP a plusieurs fois mis en doute la capacité de l'exécutif comme du Parlement à appliquer les mesures figurant dans le projet de loi de finances initial, parlant même, devant la commission des finances le 13 octobre, de « l'hypothèse théorique d'une mise en oeuvre complète des mesures annoncées dans la saisine ».
Effet, pour l'État, des mesures nouvelles
en prélèvements obligatoires
du PLF 2026 et du PLFSS 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances à partir des données du RESF107(*)
3. Une répartition de l'effort qui devra évoluer pour renforcer les baisses de dépenses et alléger les hausses de recettes
a) Les baisses de dépenses doivent être préférées aux hausses de recettes, dans un contexte où les dépenses comme les recettes sont très élevées en France
La France est, de longue date, l'un des champions mondiaux à la fois des dépenses publiques et de l'impôt. Ainsi que l'a résumé Natacha Valla devant la commission des finances, « en matière de finances publiques, avec 57 % de dépenses et 50 % de recettes, la France marque un certain décalage par rapport à ses voisins européens et aux membres de l'OCDE ».
Or, cet « équilibre » haut, ou plutôt ce « déséquilibre » haut, que d'aucuns attribuent à une préférence collective plus élevée qu'ailleurs pour une prise en charge commune des risques ou pour la prise en charge par l'État de certains domaines pouvant aussi bien être gérés par la sphère privée, est manifestement de plus en plus subi. Du reste, il ne s'agit même pas réellement d'un équilibre, les recettes ne suffisant pas, de façon chronique, à financer les dépenses.
Dans ce contexte, le rapporteur général estime donc que Natacha Valla a donc raison quand elle dit aux membres de la commission des finances qu'« il semble prioritaire d'étudier la composition des dépenses et leur volume avant d'envisager des augmentations d'impôts. Cela n'empêche pas, toutefois, d'étudier la composition de ces derniers, mais ce sujet n'en reste pas moins secondaire ».
La Cour des comptes avait certes souligné dans son rapport sur la situation des finances publiques que le creusement du déficit depuis 2017 s'était notamment expliqué par 62 milliards d'euros de baisses de recettes.
Olivier Redoulès de l'institut Rexecode a en effet déploré devant la commission des finances, le 13 octobre, que « nous n'ayons pas diminué les dépenses corrélativement aux politiques de l'offre ». La dépense publique a continué d'augmenter dans le même temps : le ratio de dépenses publiques par rapport au PIB est plus élevé de 2,1 points en 2024 qu'avant-crise (56,7 % par rapport à 54,6 % en 2019). En 2024, la croissance des dépenses en volume a encore été de 1,7 %.
Cela eu pour effet que « la fiscalité des entreprises a certes été rapprochée des moyennes européennes, mais [que] cela ne s'est pas fait dans un cadre de finances publiques équilibré » : « la crédibilité de la durabilité de cette politique de l'offre s'en [est] trouv[ée] compromise ».
Évolution des dépenses et des
recettes des administrations publiques
entre 2017 et 2024
Source : Eric Heyer (OFCE)
Le HCFP pointe dans son avis pour 2026 qu'« en 2025, l'effort structurel est provenu intégralement des hausses de prélèvements obligatoires, qui totalisent plus de 24 Md€, tandis que l'effort en dépense est nul, la dépense en volume augmentant à peu près en ligne avec la croissance potentielle ». Ainsi la loi de finances du Premier ministre François Bayrou s'est-elle montrée assez éloignée de l'ambition initiale du gouvernement de Michel Barnier.
Sans juger opportun pour le prochain exercice de s'engager en amont des débats sur une cible de répartition entre mesures d'effort en dépenses et mesures d'efforts en recettes, la commission estime qu'un objectif atteignable pourrait être de tendre à un effort en recettes de deux tiers de l'ajustement structurel - et donc à un effort en dépenses d'un tiers.
b) Avec près de 40 milliards d'euros de hausses d'impôts « rustines » en deux ans, la mise à contribution des ménages et des entreprises est, de toute évidence, excessive
D'après la prévision inscrite dans le RESF, le montant en valeur des prélèvements obligatoires s'élèverait à 1 345,1 Mds€ en 2026, contre 1 302,0 Mds€ en 2025 (prévision également). Cela représenterait une augmentation du taux de prélèvements obligatoires, qui passerait de 43,6 % du PIB en 2025 à 43,9 % en 2026, entièrement due à des mesures nouvelles, et non à quelque évolution spontanée du rendement des impôts existants. Pour rappel, ce taux était de 42,8 % en 2024 et avait augmenté, déjà en 2025, du seul fait des mesures nouvelles.
Il est pourtant clair qu'aucune solution durable ne pourra venir d'une hausse des prélèvements obligatoires, dans un contexte où la France a déjà le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE.
La France n'a toujours « pas complètement absorbé le choc des mesures fiscales nouvelles mises en oeuvre entre 2010 et 2013, qui représentaient environ 3,6 points de PIB » (O. Redoulès), et qui ont pesé d'abord sur les entreprises puis ont été progressivement reportées sur les ménages : « les recettes ont certes légèrement diminué en 2014, mais elles partaient d'un niveau tellement élevé qu'il était jugé intenable. C'était toute l'idée du Pacte de responsabilité et de solidarité et, auparavant, l'option défendue par le rapport Gallois. Les impôts et prélèvements des entreprises ont donc diminué, via le CICE, puis des mesures ont été prises pour les ménages à partir de 2017-2018 : suppression de la taxe d'habitation et suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu. »
Olivier Redoulès souligne que « les ménages enregistrent toujours un point de PIB de prélèvements supplémentaires par rapport à 2010 », que « les entreprises étaient à peu près au même niveau après la surtaxe de l'impôt sur les sociétés (IS) » de 2025, et que « les nouvelles hausses de prélèvements intervenues depuis 2024, et notamment en 2025, pour un total de l'ordre de 0,8 point de PIB, effacent un tiers des baisses réalisées depuis 2017 ».
Cumul des mesures nouvelles de prélèvements obligatoires (en % de PIB)
Source : Olivier Redoulès (institut Rexecode)
La prolifération d'« impôts rustines » qui visent à rétablir, sous des formes plus compliquées, des baisses d'impôts non financées depuis 2017, et pesant sur la production, est particulièrement regrettée par le rapporteur général.
Si des économies devaient être réalisées, elles seraient davantage à rechercher dans une rationalisation de nos dépenses fiscales, parfois mal calibrées.
4. Au-delà de la différence entre dépenses et recettes, c'est la nature de l'ajustement qui fera la différence à long terme
a) Un plus juste partage de l'effort doit être organisé entre administrations publiques centrales, de sécurité sociale, et locales
Ainsi que l'avait indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu dans une interview au Parisien, « l'État doit donner l'exemple et il faut également une meilleure maîtrise des dépenses sociales et des collectivités territoriales. Ces efforts ne seront compris que s'ils sont partagés et justes. »
(1) Des efforts partagés
En premier lieu, la répartition des efforts entre secteurs institutionnels - administrations publiques centrales (État et organismes divers d'administration centrale), administrations publiques locales, administrations de sécurité sociale - ne peut être partagée et juste que si chacun de ces secteurs est mis à contribution de façon équilibrée.
Or, de ce point de vue, le projet de loi de finances pour 2026 est déséquilibré, la contribution demandée aux administrations publiques locales (- 1 % de dépenses en volume) paraissant disproportionnée, surtout comparée à l'évolution des dépenses en volume des administrations centrales (+ 1,6 %).
Évolution des dépenses publiques par
sous-secteurs
des administrations publiques
(en volume, en utilisant le déflateur du PIB)
Apuc = administrations publiques centrales ; Apul = administrations publiques locales ; Asso = administrations de sécurité sociale
Source : avis du Haut Conseil des finances publiques sur le PLF et le PLFSS 2026
Les collectivités territoriales de la République sont trop souvent apparues, ces dernières années, comme un bouc-émissaire facile de la crise des finances publiques.
Sur tendance longue, la suppression de la taxe d'habitation a privé les collectivités territoriales (15 Mds€ par an pour les communes et 7 Mds€ par an pour les EPCI) d'une ressource fiscale qu'elles pouvaient maîtriser, et qui, à la différence de la baisse des impôts de production qui s'inscrivait dans le cadre de la politique de l'offre, n'était justifiée par aucun effet attendu sur l'activité des entreprises ou sur la compétitivité. Cela a, du reste, accru le contrôle de l'État sur ces collectivités, via le levier des dotations budgétaires.
En 2026 comme en 2025, une contribution totale des
collectivités territoriales
qui ne devrait pas dépasser 2
milliards d'euros
Le Sénat saura se montrer responsable, comme lors de l'examen du PLF 2025, en adoptant des dispositifs raisonnables de mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques.
Du côté des recettes, la commission des finances du Sénat relève la volonté du Gouvernement dans ce projet de loi de finances de maîtriser les prélèvements sur recettes (PSR) et de revoir les modalités d'attribution du FCTVA. Le doublement proposé par le Gouvernement du « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivité territoriales » (Dilico), mise en réserve des recettes de certaines collectivités, avec restitution échelonnée ensuite, devra faire l'objet d'aménagements.
Du côté des dépenses, la commission craint une dilution des dotations budgétaires, qui mettrait à mal l'autonomie des collectivités territoriales. Elle constate qu'une baisse de l'investissement des APUL de 2,5 % en valeur est prévue par le Gouvernement, ce qui s'entend compte tenu du cycle de l'investissement communal. Elle souhaite en particulier préserver la capacité d'action départements, dont une grande partie des dépenses sont contraintes.
La commission des finances accueille favorablement la proposition du Premier ministre de « clarification des compétences de chaque acteur public », et juge indispensable d'y inclure une réflexion sur le transfert de nouvelles responsabilités aux collectivités territoriales, pour poursuivre la décentralisation.
Source : commission des finances
Les administrations de sécurité sociale seraient également mises à contribution (- 0,4 % en volume), une baisse « tranchant nettement avec la dynamique des années récentes », comprenant un effort sur l'Ondam « nettement plus important que les années précédentes », selon le HCFP, qui estime qu'« au global, la cible de dépenses sociales est très ambitieuse ». De fait, une partie des mesures d'économies ont d'ores et déjà été abandonnées par le Premier ministre, qui s'est par ailleurs engagé à une suspension de la réforme des retraites, ce qui rend l'analyse de ce volet malaisé.
(2) Des efforts justes
En second lieu, la répartition des efforts ne peut être partagée et juste que si elle tient compte de la responsabilité de chacun des secteurs dans la dégradation des comptes publics.
À cet égard, faut-il rappeler que, sur 40 euros de hausse de la dette publique depuis 2019, seulement 1,1 euro est imputable aux collectivités territoriales ? Leur dette n'est que de 8 % du PIB et leur déficit, stable dans le temps, n'est que de 0,6 %, ce qui s'explique par le fait qu'elles sont soumises au principe vertueux de la règle d'or budgétaire.
Sur les huit précédents exercices (2017-2024), le déficit des administrations centrales a en moyenne été de 4,7 % du PIB ; celui des administrations de sécurité sociales de 0,1 % du PIB, en lien notamment avec des dépenses exceptionnelles en 2020 pour faire face à la pandémie de Covid-19 ; et celui des collectivités territoriales également de 0,1 % du PIB.
Pour l'année 2026 encore, le secteur des administrations publiques centrales - au sens large, incluant l'État et les organismes divers d'administration centrale - serait de nouveau le contributeur quasi exclusif au déficit des administrations publiques, avec 4,5 points sur 4,7 % de déficit public toutes administrations publiques confondues. Par comparaison, les administrations publiques locales n'y contribueraient qu'à hauteur de 0,3 point tandis que les administrations de sécurité sociale seraient légèrement excédentaires, à hauteur de 0,1 point.
Solde public des administrations publiques et
contribution
des sous-secteurs institutionnels
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat à partir des données du RESF
b) Il devrait être davantage tenu compte de l'impact des mesures nouvelles sur le consentement à l'impôt, la capacité contributive de chacun et donc la distribution des revenus
Le Gouvernement a pris pour habitude de présenter l'effet des mesures du projet de loi de finances de l'année sur les ménages, d'une part, et les entreprises, d'autre part, bien qu'une partie non négligeable des mesures échappent à cette classification. Par ailleurs, l'incidence fiscale d'une mesure peut aboutir à ce qu'une mesure pesant sur les entreprises soit répercutée sur les ménages.
Effet net des mesures en prélèvements obligatoires entre 2024 et 2026
(en milliards d'euros)
|
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Ménages |
3,7 |
5,4 |
8,3 |
|
Entreprises |
3,6 |
15,3 |
1,9 |
|
Autres108(*) |
-4,6 |
4,1 |
3,7 |
|
Total |
2,7 |
24,7 |
13,7 |
Source : commission des finances à partir du RESF
Il a également pris pour habitude de distinguer les efforts en dépenses et les efforts en recettes. Cependant, les différences de répartition entre efforts en dépenses ou efforts en recettes n'emportent pas, par principe, de conséquence pour le pouvoir d'achat des ménages. La dépense publique étant en quelque sorte une « recette privée » et les recettes publiques des « dépenses privées », elles peuvent présenter, l'une et l'autre, des effets équivalents.
La différence entre hausses d'impôts
et baisses dépenses
pour le pouvoir d'achat des
ménages
La différence entre efforts en recettes et efforts en dépenses ne doit pas devenir un fétiche. En effet, d'un point de vue économique, il s'agit dans les deux cas d'une contraction du pouvoir d'achat des ménages ou des entreprises.
En outre, du point de vue des ménages, la différence n'est pas nécessairement immédiatement perceptible entre une baisse de revenus de transfert ou une hausse d'imposition - au contraire, une désindexation des retraites peut même s'avérer plus visible qu'une augmentation de l'imposition sur les retraites.
Du reste, des baisses de dépenses ou hausses de recettes d'un montant identique en année N ne le sont pas nécessairement les années suivantes et peuvent même produire des effets fort différents. Un exemple caractéristique est celui de désindexations du montant de prestations, par exemple de retraites : elles continueraient de déployer leurs conséquences ad vitam aeternam, par l'entremise du décalage d'un an du montant actualisé de la prestation, tandis qu'une hausse ciblée d'impôt, comme la contribution sociale généralisée (CSG) peut aisément ne durer qu'une seule année s'il en est ainsi décidé.
Source : commission des finances du Sénat
Aussi est-il plus parlant, du point de vue des ménages, d'agréger l'ensemble des mesures socio-fiscales - prestations sociales et prélèvements directs - portant sur eux et d'essayer, en les combinant avec l'évolution des revenus109(*) et du niveau des prix, de mesurer leur impact sur le pouvoir d'achat110(*) des ménages, à panier de consommation inchangé.
Un graphique de l'OFCE de février 2024111(*) retrace ainsi l'évolution du pouvoir d'achat en France chaque année par décile de population sur la période 2021-2023, qui comprend l'épisode inflationniste lié au choc énergétique.
Évolution estimée du pouvoir d'achat par décile entre 2021 et 2023
(moyenne annuelle en %)
Source : OFCE
Ce graphique montre que le premier décile (D1) a vu son pouvoir d'achat augmenter légèrement (+ 0,3 % par an), soutenu par les indexations des minimas sociaux sur l'inflation, et que les deux derniers déciles (D9 et surtout D10) ont bénéficié de hausses de pouvoir d'achat plus importantes encore (respectivement + 0,4 % et 1,2 %), en lien avec des revenus, notamment du capital, dynamiques. Le fait marquant est que l'évolution du pouvoir d'achat par décile est très hétérogène : celui du décile D8 a, lui, stagné, tandis que 60 % des ménages (déciles D2 à D7) ont enregistré dans la période une baisse de pouvoir d'achat, allant de - 0,3 % par an pour le décile D7 à - 0,8 % par an pour les déciles D2 et D3.
Une analyse plus fine des caractéristiques des ménages par l'OFCE met au jour que « les ménages dont la personne de référence est en emploi ont connu des évolutions de pouvoir d'achat plus favorables que les ménages ayant des caractéristiques similaires (dixième de niveau de vie et tranche d'unité urbaine) mais qui ne sont pas en emploi (inactifs, chômeurs, retraités...) ».
Devant ce constat d'efforts réels qui ont reposé majoritairement sur la « classe moyenne », l'économiste de l'OFCE Éric Heyer a averti sur le risque d'érosion du consentement à l'impôt et de retour de protestations fiscales du même ordre que le mouvement des Gilets jaunes en 2019112(*). L'on ne peut que s'interroger en effet sur les conséquences politiques et sans doute électorales, qu'un tel profil d'évolution du pouvoir d'achat pourrait emporter.
L'apport des sciences cognitives pour mesurer le consentement à l'impôt
S'agissant du consentement à l'impôt comme, de façon générale, de « l'adhésion aux politiques publiques » - efforts de sobriété écologique, recommandations de santé publique... -, l'apport d'« un ensemble très important d'études en économie et en psychologie expérimentale » a été de mettre en évidence le fait que la « confiance interpersonnelle » est la « ressource la plus précieuse d'un État », en ce sens qu'« une grande partie de la capacité de [ce dernier] à impulser des changements réside dans sa capacité à mobiliser les citoyens en proposant des règles justes, qui inspirent la confiance et qui sont fondées sur la conditionnalité ».
Les chercheurs en sciences cognitives Nicolas Baumard et Coralie Chevallier rappellent ainsi « que les comportements altruistes obéissent à une logique de conditionnalité. Les humains savent faire preuve d'altruisme - ils donnent leur sang, envoient de l'argent aux ONG, donnent du temps pour le bien commun -, mais ils le font d'autant plus volontiers qu'ils ont le sentiment de ne pas être les seuls à contribuer. Autrement dit, les humains coopèrent « à condition » que les autres coopèrent. » Aussi conviendrait-il, selon ces chercheurs, de tenir compte non seulement du rendement direct, parfois anecdotique, de certaines mesures, mais aussi de leur impact indirect sur la confiance interpersonnelle, qui peut s'avérer bien plus significatif113(*).
Source : commission des finances
Or, l'évaluation de l'incidence des articles du projet de loi de finances sur la distribution des revenus demeure encore très imparfaite, bien qu'elle soit formellement réalisée article par article. Une circonstance atténuante de cette défaillance est que certaines études ont pu montrer l'existence d'une forte hétérogénéité à caractéristiques socio-économiques égales, des différences pouvant ne pas être bien capturées par la statistique publique114(*).
Pour autant, des exercices d'évaluation des effets de mesures de consolidation sur la croissance et sur les inégalités existent. En croisant ces deux critères d'appréciation, les décideurs publics peuvent ainsi opter pour des mesures qui laissent subsister des inégalités si elles sont au plus grand bénéfice des plus désavantagés.
Le Conseil d'analyse économique, par exemple, reprend une classification proposée par l'OCDE, selon laquelle une baisse des dépenses d'éducation serait particulièrement pénalisante pour la croissance à court terme comme à long terme, et pour les inégalités à long terme ; à long terme, selon cette analyse, une baisse des pensions de retraites serait très favorable à la croissance de long terme. Pour l'OCDE, une hausse de l'impôt sur les sociétés serait négative pour la croissance à court terme, et plus encore à long terme, mais réduirait les inégalités à court comme à long terme.
Évaluation synthétique des effets des instruments de consolidation budgétaire sur la croissance et les inégalités
Source : focus du CAE, « Comment stabiliser la dette publique » à partir d'OCDE (2013)115(*)
c) Les mesures de consolidation qui devraient être recherchées en priorité sont celles dont l'efficience et l'effet sur la croissance à long terme sont favorables
Si l'appréciation de l'impact des mesures nouvelles à l'aune du critère de la distribution des revenus ou du secteur institutionnel relève pour partie de considérations d'opportunité, à propos desquelles l'analyse économique est d'une aide assez réduite, un critère sur lequel les économistes s'accordent aisément est celui de l'efficience de la dépense (ou de la recette) publique et de son impact sur la croissance à long terme.
À la différence des deux précédentes nomenclatures de répartition des efforts - par secteur institutionnel ou par capacité contributive des ménages - un intérêt de cette typologie reposant sur l'efficience des dépenses est que, si l'on s'y fiait pour arbitrer entre différentes mesures, personne ne devrait payer à long terme le coût de la consolidation, qui serait en quelque sorte autofinancée par des gains d'efficience et de la croissance à long terme.
Comme l'avait indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu dans une interview au Parisien le 26 septembre, sélectionner des mesures selon cette grille de lecture implique d'« accepter d'engager aujourd'hui des chantiers de réformes qui ne rapportent rien à court terme, mais qui serviront à nos successeurs ». Comme l'a rappelé Olivier Redoulès devant la commission des finances, « toutes les mesures n'ont pas forcément le même impact sur la croissance économique. Certaines sont plus favorables à moyen terme, d'autres à court terme. Or le contexte politique pousse les acteurs à privilégier le court-termisme, susceptible de peser sur la croissance potentielle et sur la capacité de production d'économies futures ». Une meilleure diffusion et compréhension des résultats des évaluations de différents dispositifs de politique publique serait de nature à favoriser des choix de long terme.
Dans une note de juillet 2017116(*), le Conseil d'analyse économique montrait déjà « qu'une baisse ambitieuse des dépenses publiques est compatible avec une reprise de la croissance si elle est sélective, structurelle et accompagnée d'un programme temporaire d'investissement ». Cette méthode implique « une revue rapide des politiques publiques, via des analyses coût-bénéfice, afin de redéfinir le périmètre des dépenses ou les instruments de l'action publique ».
L'économiste Jean Tirole rappelait dans L'Économie du bien commun, par contraste, que « des coups de rabot uniformes, peu souhaitables car ils touchent ce qui est indispensable autant que ce qui l'est moins, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ».
Des revues de dépenses ont été menées par le Gouvernement, sur des politiques présentant un coût total indiqué de 140 Md€, mais elles n'ont été que partiellement communiquées au Parlement.
De même que les dépenses, les différents types d'impôts sont loin d'avoir les mêmes incidences sur le potentiel de croissance. Olivier Redoulès de l'institut Rexecode a par exemple indiqué devant la commission des finances le 20 octobre, que la fiscalité sur le patrimoine est « parmi les moins pénalisantes pour la croissance à court terme » - tout en alertant sur le risque de conduire à l'éclatement des entreprises dans le cadre de transmissions.
Dans un même esprit, Natacha Valla a invité, lors de son audition par les membres de la commission des finances, à consulter « certaines estimations d'efficacité des dépenses, notamment sur l'appareil industriel, visant la complémentarité de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data et de l'automatisation de nos usines », publiées et mises à jour par le Conseil national de productivité.
Dans son rapport de 2023, l'économiste Jean Pisani-Ferry suggère117(*), lui, de s'appuyer sur la suppression de dépenses budgétaires ou fiscales dites « brunes », c'est-à-dire défavorables à l'environnement, pour contribuer au financement de la transition écologique. La suppression de ces dépenses brunes présenterait en effet un « double dividende », pour les finances publiques et la préservation de l'environnement - étant admis, de plus, que celle-ci exigera des dépenses de plus en plus élevées au fil du temps pour un effet équivalent118(*). Ces dépenses étaient estimées lors de la publication dudit rapport à environ 10 milliards d'euros, selon une définition relativement restrictive. Ces dépenses sont énumérées dans la nomenclature du budget vert de l'Etat119(*).
Les investissements se prêtent particulièrement à ces doubles dividendes parce qu'il s'agit des dépenses « qui ont le multiplicateur le plus fort » (Natacha Valla, devant la commission des finances). La recherche, l'innovation, la transition écologique et l'éducation sont des postes de dépenses dont le financement est rentable à long terme.
Dans une note du Conseil d'analyse économique120(*), les chercheurs Julien Grenet et Camille Landais proposent d'évaluer les 180 milliards d'euros de dépense publique en faveur de l'éducation à l'aune d'un indice d'efficacité de la dépense publique (EDP), « qui mesure le rendement social net de chaque euro investi ». Ils identifient ainsi plusieurs politiques éducatives comme « autofinancées », c'est-à-dire qu'elles engendrent à terme « des hausses de salaires et donc de recettes fiscales supérieures à leur coût pour les finances publiques121(*) ». Les orientations issues de ces calculs coûts-bénéfices favorables se dégagent d'autant plus nettement dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie et de la vie active qui a pour effet d'accroître la rentabilité d'un investissement en formation initiale122(*), celle-ci pouvant être valorisée, par exemple, sur quarante-cinq ans au lieu de trente-cinq.
Ces conclusions justifient d'autant plus une sincérité accrue dans la comptabilité des dépenses. En effet, une étude de l'Institut des politiques publiques123(*) a confirmé le fait qu'en raison d'une convention comptable, 9,37 % de la dépense intérieure d'éducation est fléchée vers le financement des retraites des fonctionnaires d'État. Or, l'indice d'efficacité de la dépense publique n'est pas le même pour ces revenus de transfert que pour des investissements par élève.
DEUXIÈME PARTIE
LE BUDGET DE L'ÉTAT :
APRÈS DES ANNÉES DE DÉRIVE, LES PREMIERS PAS D'UN RETOUR
VERS L'ÉQUILIBRE
QUI DEVRA ÊTRE AMPLIFIÉ
I. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE POURSUIT UNE TRAJECTOIRE DE REDRESSEMENT ENCORE TROP DÉPENDANTE DE MESURES PROVISOIRES
Le déficit budgétaire de l'État est prévu en 2026 à un niveau de 124,4 milliards d'euros par le présent projet de loi de finances dans sa version initiale, en amélioration de 6,1 milliards d'euros par rapport au déficit prévisionnel révisé de 2025, prévu à 130,5 milliards d'euros.
A. EN 2025, L'EFFORT ENGAGÉ EN LOI DE FINANCES INITIALE SE CONCRÉTISE
Le déficit budgétaire pour l'année courante 2025, désormais prévu à un niveau de 130,5 milliards d'euros (solde révisé124(*)), serait inférieur de 8,5 milliards d'euros à celui prévu en loi de finances initiale (139,0 milliards d'euros)125(*).
L'exécution budgétaire en 2025 a été marquée par une promulgation tardive, suivie d'une annulation importante de crédits.
1. La France a vécu pendant un mois et demi en régime de « services votés »
Pour la première fois depuis 45 ans, en 2025, la loi de finances initiale n'a pas été promulguée avant le 1er janvier, mais le 14 février seulement.
Les ministères ont dû fonctionner pendant un mois et demi sous l'empire des « services votés », c'est-à-dire avec des crédits répartis par décret en application d'une loi spéciale adoptée par le Parlement en fin d'année 2024126(*).
Des modalités exceptionnelles de gestion ont alors été mises en place. 25 % seulement des crédits budgétaires de l'exercice 2024, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, ont été rendus disponibles sur les programmes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux en début d'exercice 2025, le reste des crédits faisant l'objet d'un blocage. Des exceptions ont été prévues, par exemple pour les dépenses d'investissement liées à la reconstruction à la suite du cyclone Chido à Mayotte127(*).
Le fonctionnement des administrations en a été significativement affecté. Par exemple, les études préalables à une opération ne pouvaient pas être lancées et devaient être décalées, sauf s'il était démontré que retarder leur lancement entrainerait une augmentation du coût de l'opération. De même, toute dépense d'attribution d'aide devait être suspendue.
Cette période n'a pas fait l'objet d'une évaluation précise, ce qui est regrettable, alors que la situation politique ne permet pas d'écarter la possibilité qu'une telle période se présente de nouveau.
Reçue le 19 mars dernier par la commission des finances128(*), la ministre chargée des comptes publics a estimé que le régime de services votés avait beaucoup pesé sur la croissance et qu'il avait bloqué les collectivités dans leur capacité à établir elles-mêmes des budgets et à connaître les recettes qui leur seraient octroyées. Le 17 juin, elle a estimé que le régime des services votés s'est révélé « particulièrement rudimentaire et, en réalité, peu adapté à la gestion d'un pays »129(*). À la mi-février 2025, les autorisations d'engagement affichaient une baisse de 46 % par rapport à l'année 2024, tandis que les crédits de paiement étaient en retrait de près de 8 %. Cette période a par exemple causé du retard dans les commandes du ministère des armées.
2. Le solde budgétaire n'est plus « extrême », mais il demeure historiquement élevé
Après cinq années consécutives de déficit supérieur à 150 milliards d'euros, le déficit budgétaire en 2025 devrait atteindre 130,5 milliards d'euros, soit une amélioration de 8,5 Mds€ par rapport à la prévision en loi de finances initiale, par l'effet aussi bien d'une diminution des dépenses que d'un surcroît de recettes. Le déficit quitte la zone des « déficits extrêmes », évoquée par le rapporteur général au cours des années passées, mais appartient toujours à celle des déficits très élevés.
Évolution du solde budgétaire
en 2025
entre la loi de finances initiale et le solde
révisé
(en milliards d'euros)
LFI : loi de finances initiale.
Source : commission des finances, d'après les documents budgétaires
Avec une amélioration du solde en cours d'exercice, l'année 2025 se distinguerait par ailleurs des années précédentes, qui avaient toutes, depuis cinq ans, connu un déficit supérieur, voire très supérieur en exécution à celui présenté dans le projet de loi de finances initiale : le dépassement avait atteint 85,0 milliards d'euros en 2020, année du déclenchement de la crise sanitaire, de 17,9 milliards d'euros en 2021, de 8,1 milliards d'euros en 2022, de 14,5 milliards d'euros en 2023 et de 9,0 milliards d'euros en 2024.
3. Un décret d'annulation pris au mois d'avril a contribué à la modération des dépenses
Le Gouvernement a pris, le 25 avril dernier, un décret d'annulation de crédits130(*) pour un montant de 3,0 Mds€ en autorisations d'engagement et 2,7 Mds€ en crédits de paiement afin, selon le rapport accompagnant ce décret, de « prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire sur le budget de l'État » qui résulterait d'une dégradation des perspectives macroéconomiques. La prévision de croissance pour 2025 venait en effet d'être révisée à 0,7 %, alors que la loi de finances reposait sur une hypothèse de 0,9 %. L'estimation de 0,7 % est maintenue dans le présent projet de loi de finances.
Ce décret a porté sur 78 programmes budgétaires, dont 74 des 136 programmes du budget général131(*). Les annulations ont concerné en premier lieu les missions « Économie » (526,0 M€, portant sur le programme 367 relatif aux participations financières de l'État, qui sera présenté infra), « Recherche et enseignement supérieur » (386,8 M€), « Écologie, développement et mobilité durables » (241,6 M€) et « Investir pour la France de 2030 » (225,0 M€).
Principales missions concernées par les annulations de crédits du 25 avril 2025
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir du décret d'annulation, en crédits de paiement
En proportion par rapport aux crédits complets132(*), les missions les plus touchées ont été « Économie » (11,0 %), « Sport, jeunesse et vie associative » (6,5 %) et « Transformation et fonction publiques » (5,6 %).
Au niveau des programmes budgétaires, quatre d'entre eux ont subi une annulation supérieure à 100 millions d'euros en crédits de paiement.
Liste des programmes affectés par les annulations de crédits les plus importantes
(en millions d'euros)
|
Programme |
Mission |
AE annulées |
CP annulés |
|
367 - Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » |
Économie |
513,5 |
513,5 |
|
424 - Financement des investissements stratégiques |
Investir pour la France de 2030 |
0 |
216,0 |
|
172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
307,3 |
199,4 |
|
149 - Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
110,6 |
105,1 |
Source : commission des finances, à partir du décret d'annulation du 26 avril 2025
Certaines annulations correspondaient certainement à la constatation de dépenses qui n'auraient de toute manière pas eu lieu, par exemple sur le programme 367, qui reporte ses crédits d'année en année sans les consommer, ou le programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 ». Toutefois, la plupart des annulations semblent avoir exercé une réelle pression à la baisse sur les dépenses des ministères, contribuant effectivement à la préservation du solde budgétaire.
Par ailleurs, un autre décret, pris le 8 septembre133(*), soit le jour même où l'Assemblée nationale a rejeté le vote de confiance demandé par le Gouvernement, a annulé des crédits d'un montant de 44 M€ en autorisations d'engagement et 12,4 M€ en crédits de paiement sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles et les a ouverts, en application de l'article 11 de la loi organique relative aux lois de finances, sur le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ». Le rapport relatif à ce décret indique que l'ouverture de ces crédits était nécessaire pour renforcer de manière immédiate les capacités de résilience nationale et de renseignement de la nation dans un contexte d'augmentation des attaques hybrides, notamment informatiques et informationnelles.
Pour mémoire, six décrets de dépenses accidentelles ont été pris en 2024, pour un montant total de 119,9 millions d'euros, ce qui représente un nombre et un montant élevés par rapport aux années précédentes, surtout pour une année qui n'a pas connu un nombre exceptionnel de calamités134(*).
Les décrets de dépenses accidentelles de 2018 à 2024
(en nombre de décrets et en millions d'euros)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Nombre de décrets |
5 |
2 |
5 |
0 |
2 |
2 |
6 |
|
Montant total |
113,3 |
83,6 |
631,2 |
0,0 |
17,9 |
33,0 |
119,9 |
Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance de la mission « Crédits non répartis »
Si certaines dépenses urgentes justifient l'utilisation de cette dotation, il est nécessaire de rappeler qu'elle est destinée par l'article 7 de la loi organique aux lois de finances à faire face à des calamités ou à des dépenses imprévisibles. Il s'agit d'une dérogation forte au principe de spécialité budgétaire et d'autorisation parlementaire qui, comme toute dérogation, devrait être interprétée de manière stricte. En particulier, elle ne saurait pallier des sous-budgétisations, ni des dépenses qui pourraient être assurées par redéploiement au sein d'un programme ou mobilisation des crédits mis en réserve et le rapporteur général invite le Gouvernement à y veiller.
4. Les recettes fiscales seraient supérieures de 4,2 milliards d'euros au niveau attendu, ce qui contraste avec l'écart constaté en 2024
Pour mémoire, l'exercice 2024 avait connu un écart très important sur les recettes entre la prévision et l'exécution des recettes fiscales nettes. L'estimation révisée publiée en début du mois d'octobre 2025, lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2025, avait été inférieure de 26,0 Mds€ à la prévision faite en loi de finances initiale, écart ramené à 22,8 Mds€ dans le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes pour l'année 2024.
Cet accident de prévision ne se reproduit pas cette année, l'écart étant positif et un écart de + 4,2 Mds€ n'ayant rien d'extraordinaire compte tenu de l'incertitude inhérente aux prévisions de recettes, qui n'ont qu'un caractère évaluatif en loi de finances initiale.
Évolution de l'écart entre les prévisions de recettes initiale et révisée
(en milliards d'euros)
Prévision initiale : sous-jacente à la loi de finances initiale de l'année N. Prévision révisée : présentée lors de la présentation du projet de loi de finances pour l'année N+ 1.
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
Le principal effet est un surcroît de recettes d'impôt sur les sociétés. Prévues à un niveau de 53,0 Mds€ en loi de finances initiale, alors qu'elles avaient été de 57,4 Mds€ en 2024, elles atteindraient finalement 58,2 Mds€ (+ 5,2 Mds€). La principale raison est une révision à la hausse de l'hypothèse d'évolution du bénéfice fiscal entre 2023 et 2024, ce qui accroît à la fois le solde d'impôt sur les sociétés versé en 2025 au titre de 2024 et le niveau des acomptes versés en 2025.
Il est nécessaire de rappeler la difficulté à prévoir les recettes d'impôt sur les sociétés. En 2024, leur niveau avait été inférieur de 14,6 Mds€ en exécution à la prévision en loi de finances initiale. L'estimation révisée présentée au mois de septembre ou, comme cette année, au mois d'octobre, reste elle-même soumise à un aléa non négligeable portant sur le niveau du « cinquième acompte » versé au mois de décembre, dont le montant dépend des comportements des entreprises.
Un autre effet remarquable, qui transparaît depuis quelques mois dans les situations budgétaires publiées par la direction du budget, est la confirmation d'une estimation de recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) inférieure de 4,5 Mds€ à la prévision en loi de finances initiale, s'établissant à un niveau de 96,9 Mds€. Cette moindre ressource est attribuée à une croissance moins forte qu'anticipé des emplois taxables, ceux-ci augmentant de + 1,7 % contre une prévision de + 2,4 % en loi de finances initiale. Ceci résulterait du ralentissement de la consommation des ménages, mais aussi d'effets de structure pouvant expliquer que la TVA n'évolue pas au même rythme que la croissance économique.
Si cette estimation porte sur la TVA nette revenant à l'État en comptabilité budgétaire135(*), elle correspond à l'évolution de la TVA nette toutes administrations confondues, dont les recettes sont en diminution de près de 1,3 Md€ à la fin août 2025, par rapport à la même période en 2024136(*).
Les recettes d'impôt sur le revenu, pour leur part, seraient supérieures de 0,4 Md€ seulement à la prévision faite en loi de finances initiale, pour atteindre 94,9 Md€. La hausse par rapport à 2024 serait de 6,9 Mds€, principalement du fait de la hausse des revenus réels, mais aussi de plus-values mobilières en forte hausse137(*).
Enfin, le produit des autres recettes fiscales serait supérieur de 3,2 Mds€ à la prévision. Un surcroît de recettes de 1,6 Md€ concernerait les accises sur l'énergie, davantage pour celles perçues sur l'électricité (+ 1 225 M€) que sur le gaz (+ 364 M€), celles perçues sur les autres produits énergétiques restant quasiment dans la prévision.
En outre, certaines recettes fiscales auraient un produit plus élevé qu'anticipé (+ 0,4 Md€ pour l'impôt sur la fortune immobilière et + 0,5 Md€ pour le produit des jeux).
S'agissant des recettes non fiscales, des amendes d'un montant important ont été prononcées en 2025, ce qui explique pour une part essentielle la révision à la hausse de + 2,2 Mds€ du produit de ces recettes.
5. Le déficit des comptes spéciaux est plus élevé qu'attendu de près de 3 milliards d'euros, malgré un remboursement anticipé de prêt par la Grèce
L'amélioration du solde bénéficie également d'événements non reproductibles. La Grèce a ainsi remboursé de manière anticipée certaines échéances 2033 à 2041 prévues dans le cadre des prêts consentis à ce pays en 2010, contribuant à l'amélioration de 1,1 Md€ du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers ». Il en résulte une réduction du déficit budgétaire en 2025, mais aussi, nécessairement, un accroissement du déficit des années à venir, qui ne bénéficieront pas de ce remboursement.
En dépit de ce remboursement, le solde des comptes spéciaux serait de - 4,9 Mds€ en 2025, contre - 2,1 Mds€ prévus en loi de finances initiale. En particulier, le solde du compte d'affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l'État » est dégradé de 2,6 Mds€ en raison de la réalisation d'opérations par l'utilisation d'un solde comptable excédentaire accumulé sur les exercices précédents. Le solde du CAS « Pensions » est également moins élevé de 0,6 Md€ en raison d'une baisse de la prévision des contributions employeurs.
B. LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE RESTERAIT TROP ÉLEVÉ EN 2026 , SON AMÉLIORATION DEMEURANT LÉGÈRE ET REPOSANT SUR DES ÉLÉMENTS TROP CONJONCTURELS
Le projet de loi de finances prévoit un déficit budgétaire de 124,4 milliards d'euros en 2026, en amélioration très limitée par rapport au solde prévisionnel de 2025.
Ce solde est la somme des soldes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
La construction du solde budgétaire de
l'État
dans le projet de loi de finances pour 2026
(en milliards d'euros)
CAS : comptes d'affectation spéciale. CCF : comptes de concours financiers. CCO-COM : solde des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires.
Source : commission des finances, à partir du tableau d'équilibre du projet de loi de finances
Ce solde est en amélioration de 6,1 milliards d'euros par rapport à l'estimation révisée pour 2025, qui est de - 130,5 milliards d'euros.
Évolution du solde budgétaire entre 2025 et 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances. ASSO : administrations de sécurité sociale
Cette amélioration demeure très limitée. Pour mémoire, le déficit budgétaire était de 92,7 Mds€ en 2019, ce qui représenterait 108,5 Mds€ en euros de 2026 : la parenthèse des années « Covid et inflation » n'est donc que partiellement refermée.
L'amélioration du solde porte sur l'accroissement des recettes et l'amélioration du solde des budgets annexes et des comptes spéciaux, tandis que les dépenses augmentent sous la contrainte de la situation internationale et de la charge de la dette.
1. La poursuite de la réduction du déficit se fonde sur une maîtrise des dépenses, hors dépenses contraintes, mais aussi sur des recettes temporaires
L'amélioration du solde budgétaire en 2026, par rapport à l'estimation révisée pour 2025, provient d'abord d'une augmentation de 19,1 Mds€ des recettes fiscales nettes de l'État.
Le produit serait en effet en nette hausse pour l'impôt sur le revenu (+ 9,1 Mds€) comme pour la TVA (+ 12,2 Mds€). L'augmentation de la TVA résulte toutefois en grande partie d'un effet de structure survenant en 2026, avec la rebudgétisation de la part de TVA qui était affectée depuis 2017 aux régions138(*) (+ 5,2 Mds€), ainsi que de la réforme des allègements généraux, qui conduit à réduire la part de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale139(*) (+ 3,1 Mds€). La rebudgétisation de la TVA affectée aux régions ne contribue pas à la réduction du déficit, car elle est compensée par une augmentation de la dotation générale de fonctionnement (DGF) versée par l'État aux régions. Hors effets de périmètre, la TVA ne progresserait que de 4,2 Mds€.
La croissance des recettes repose également sur la prolongation de mesures pourtant votées par le Parlement pour être temporaires, telles que la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) et qui visaient à répondre à l'urgence de remédier à la dégradation des comptes publics à l'arrivée au pouvoir du Gouvernement de Michel Barnier.
De même, l'augmentation des recettes non fiscales de 5,5 Mds€ est entièrement due à une circonstance temporaire qui ne se reproduira pas au cours des années à venir. L'Agence nationale de la recherche (ANR) doit en effet procéder en 2026 à un versement exceptionnel de 6,9 Mds€ au titre de dotations non consommables non dévolues.
La recette exceptionnelle de restitution
de
dotations non consommables non dévolues
Les deux premiers programmes d'investissement d'avenir (PIA) ont mis en place des dotations non consommables (DNC), dont seuls les intérêts ont vocation à être utilisés. Ces dotations représentent un capital de 18,3 Mds€, géré par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Ces montants ont alors fait l'objet d'ouvertures de crédits sur le budget général140(*).
Une convention conclue le 22 novembre 2021 entre l'État et l'ANR prévoit l'arrivée à échéance d'une partie de ces dotations (DNC dites non dévolues141(*)) au 31 décembre 2025. En conséquence, l'Agence devrait reverser à l'État un montant estimé à 6 852 M€.
À ces dotations non dévolues seront substituées des crédits nouveaux ouverts en loi de finances, pour un montant de 450 M€ sur trois ans142(*).
Source : commission des finances, à partir des informations communiquées au rapporteur général
Sans la ressource exceptionnelle issue de l'ANR, le déficit budgétaire ne s'améliorerait pas dans le présent projet de loi de finances, par rapport au solde 2025. De fait, le solde de l'État en comptabilité nationale, qui ne tient pas compte de ce versement, se dégrade de - 4,3 % du PIB en 2025 à - 4,5 % en 2026143(*).
Un premier facteur pesant sur le solde est l'évolution des prélèvements sur recettes (PSR). Si leur augmentation de 9,2 Mds€ est due pour 5,2 Mds€ à la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions, qui a pour effet une augmentation parallèle de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui leur est versée, elle est aussi due à la progression du PSR à destination de l'Union européenne (+ 5,8 Mds€), suite à la mise en oeuvre de la programmation 2021-2027, qui devrait rattraper des retards accumulés au cours des années précédentes et, en conséquence, occasionner des décaissements plus importants.
Enfin, il convient de noter que l'augmentation des dépenses est largement due à des dépenses contraintes : renforcement des capacités de défense rendue nécessaire par le contexte international, progression de la charge de la dette avec le redressement des taux, hausse tendancielle du coût des pensions.
Ainsi, par rapport à la loi de finances pour 2025, les crédits des ministères, hors dépenses de défense, diminuent en valeur de plus de 1 milliard d'euros.
Évolution des crédits entre la loi
de finances initiale 2025
et le projet de loi de finances pour
2026
(en milliards d'euros)
Crédits hors contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions » et hors mission « Remboursements et dégrèvements ». Crédits de la LFI 2025 retraités des modifications de périmètre. Charge de la dette mesurée par les crédits des programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État » et 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État » de la mission « Engagements financiers de l'État ».
Source : commission des finances, à partir des données transmises par le Gouvernement
Les mouvements prévus par le projet de loi de finances en recettes, d'une part, et en dépenses, d'autre part, sont présentés plus en détail infra.
2. La situation des budgets annexes et des comptes spéciaux contribue à l'amélioration du solde
En 2026, le solde des budgets annexes serait positif de 376 M€, soit une légère dégradation par rapport au solde positif de 468 M€ prévu en 2025.
Celui des comptes spéciaux serait négatif de - 0,6 Md€, niveau faible par rapport à celui des crédits (77,5 Mds€ pour les comptes d'affectation spéciale et 150,1 Mds€ pour les comptes de concours financiers). Ce léger déficit correspondrait à une amélioration par rapport au solde révisé pour 2025, qui atteindrait - 4,9 Mds€.
Les budgets annexes et les comptes spéciaux participeraient ainsi à l'amélioration du solde pour + 4,2 Mds€ par rapport au solde révisé, et de + 2,2 Mds€ par rapport à la loi de finances pour 2025.
Toutefois, l'amélioration n'est que de + 0,1 Md€ pour les comptes spéciaux inclus dans le périmètre des dépenses de l'État, norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques qui exclut les comptes d'affectation spéciale liés au remboursement de la dette ou à des opérations patrimoniales, ainsi que l'ensemble des concours financiers hors audiovisuel public144(*).
Le rétablissement de l'équilibre sur deux comptes d'affectation spéciale (CAS) contribuerait particulièrement à cette amélioration.
En premier lieu, le solde du CAS « Pensions », négatif à hauteur de - 2,5 Mds€ en 2025, reviendrait à l'équilibre et serait même positif de 38,6 M€ en 2026 en raison de l'augmentation du taux de contribution employeur au titre des personnels civils.
En second lieu, le solde du CAS « Participations financières de l'État », négatif à hauteur de - 2,4 Mds€ en 2024, reviendrait lui aussi à l'équilibre en 2026 en raison de cessions importantes et d'un versement de 1,2 Md€ en provenance du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » » de la mission « Économie ».
Solde des principaux comptes spéciaux en 2025 et 2026
(en milliards d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances
Comme l'a signalé le rapporteur général l'an dernier, l'amélioration du solde du CAS « Pensions » était nécessaire car l'accumulation des déficits risquait, à court terme, de rendre négatif le solde cumulé de ce compte, ce qui est prohibé par l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances. En conséquence, le taux de contribution employeur au titre des fonctionnaires civils augmentera à nouveau de quatre points au 1er janvier 2026, après une augmentation équivalente en 2025.
Solde annuel et solde cumulé
du compte
d'affectation spéciale « Pensions »
(en milliards d'euros)
Source : calculs commission des finances, à partir des documents budgétaires
S'agissant des comptes de concours financiers, la dégradation de 1,3 Md€ du solde du compte « Prêts à des États étrangers » serait liée au contre-coup du remboursement exceptionnel assuré par la Grèce en 2025, déjà évoqué supra.
Enfin, les comptes de commerce connaîtraient un léger déficit de 1,0 M€, contre un déficit de 0,6 Md€ en 2025, tandis que les comptes d'opérations monétaires seraient, comme en 2025, en excédent de 0,1 Md€.
3. Le solde budgétaire de l'État confirme une sortie de la période 2020-2024 marquée par un niveau exceptionnel de déficit budgétaire, sans achever la normalisation budgétaire
Après une réalisation en 2025 qui devrait être meilleure que la prévision, le déficit budgétaire serait inférieur à 150 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive.
Malgré cette évolution significative, le déficit resterait très élevé, puisqu'il serait encore nettement supérieur, en euros constants, au déficit moyen connu au cours des années 2010, période qui ne peut pourtant être qualifiée de particulièrement vertueuse puisque le déficit public était encore supérieur à 3 % du PIB, ou proche de ce seuil.
Évolution du solde budgétaire de
l'État
en euros constants depuis 2007
(en milliards d'euros de 2026)
Actualisation des soldes passés en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires
En conséquence, les années 2025 et 2026 ne sauraient constituer qu'une étape dans l'amélioration continue et nécessaire du solde budgétaire de l'État, indispensable pour ramener le déficit public en-dessous du seuil de 3 % du PIB d'ici à 2029, afin de permettre enfin à la puissance publique de maîtriser l'endettement et de retrouver des marges de manoeuvre.
C. DANS LES ANNÉES À VENIR, LA DETTE EXERCERA UNE PRESSION TOUJOURS PLUS FORTE SUR LA CAPACITÉ DE L'ÉTAT À FINANCER LES POLITIQUES PUBLIQUES
Malgré la réduction du déficit, le niveau de la dette et le poids annuel de la charge de la dette continueront à croître pendant plusieurs années, et seule une action résolue permettra de renverser la courbe.
1. L'accroissement des émissions de dette à moyen et long termes, malgré la diminution du déficit à financer, confirme que la dette se nourrit d'elle-même
En 2026, le Gouvernement prévoit d'emprunter un montant record de 310 milliards d'euros d'obligations à moyen et long termes.
Alors que les émissions annuelles de dette avaient augmenté de 12,4 milliards d'euros dans les neuf années qui ont suivi les pics de déficit atteints lors de la crise financière de 2009 et 2010, les cinq années qui ont suivi la crise sanitaire et le confinement de 2020 ont vu ces émissions bondir de 50 milliards d'euros. Non seulement l'endettement continue à augmenter, mais il accélère.
Évolution des émissions et des amortissements de dette
(en milliards d'euros)
Amortissement de la dette à moyen et long termes et émission de dette à moyen et long terme, nette des rachats.
Source : commission des finances, à partir du tableau de financement des lois et projets de loi de finances et de règlement
Ces émissions annuelles de dette sont égales à plus du double du déficit annuel de 124,4 milliards d'euros, car elles doivent faire face à l'arrivée à échéance de titres de dette qui ont été émis dans le passé et que l'absence d'excédent budgétaire oblige à renouveler.
Or, la croissance du montant de dette émis chaque année a pour conséquence nécessaire, quelques années plus tard, une augmentation du stock de dette à refinancer.
En conséquence, une stabilisation ou, comme en 2025 et 2026, une diminution, même nette, du déficit ne suffit pas à réduire le besoin d'endettement. Seule une diminution plus franche encore, et inscrite dans la durée, permettra de compenser l'augmentation du montant de dette à refinancer et de réduire le besoin de financement.
S'agissant des ressources de financement à court terme, le projet de loi de finances pour 2026 confirme la tendance à la modération entamée par la loi de finances 2025. Alors que l'ensemble de ces ressources145(*) augmentait chaque année de 14 à 50 milliards d'euros par an entre 2019 et 2024, elles ont été quasi stables en 2025 selon la prévision en loi de finances (+ 3,5 Mds€) et décroîtraient en 2026 (- 4,3 Mds€).
En particulier, l'encours de titre d'État à court terme serait en légère diminution. Cet encours a beaucoup augmenté ces dernières années, car il a servi de variable d'ajustement lorsque le déficit à financer, comme indiqué précédemment, s'est révélé plus élevé que prévu en début d'année. L'encours de dette à court terme constitue en effet, pour l'État, un outil plus souple que les émissions de dette à moyen et long terme qui font l'objet d'un calendrier d'émission établi par l'Agence France Trésor dès le début de l'année.
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
(en milliards d'euros, en variation annuelle)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
L'évolution du stock d'endettement est d'autant plus préoccupante que la hausse des taux d'intérêt entraîne une hausse du coût de cet endettement, mesuré par la charge budgétaire de la dette. Le taux d'intérêt a en effet été de 2,91 % en moyenne pour les émissions de moyen et long terme réalisées en 2024, alors qu'il était de 0,11 % seulement en 2019146(*).
La durée de vie moyenne de la dette à moyen et long terme étant, au 30 septembre dernier, de 9 ans et 41 jours selon l'Agence France Trésor147(*), une grande partie de titres émis à la fin des années 2010 lorsque les taux étaient très bas, voire négatifs, devront être renouvelés dans les années à venir à un taux beaucoup plus élevé, nourrissant la croissance de la charge d'intérêts.
2. Dès 2026, la charge budgétaire de la dette dépassera les crédits de la défense nationale
En 2026, la charge budgétaire de la dette148(*) est déjà prévue à un niveau de 59,3 milliards d'euros, en augmentation de 4,4 milliards d'euros par rapport à 2025.
La charge de la dette occupera, dès 2026, une place plus grande dans le budget de l'État que n'importe laquelle des missions régaliennes de l'État. Le montant des intérêts payés aux créanciers sera supérieur aux crédits consacrés à la défense, hors contributions au CAS « Pensions » (57,1 Mds€), et quasiment égal à la somme des crédits consacrés à la recherche et l'enseignement supérieur (31,3 milliards d'euros), à la police et à la gendarmerie (mission « Sécurités », 17,7 milliards d'euros) et à la justice (10,6 Mds€).
Or, cette augmentation va non seulement se poursuivre, mais s'amplifier. La charge budgétaire de la dette a augmenté de 23,1 milliards d'euros dans les six années séparant 2020 et 2026, et elle devrait encore augmenter encore de 18,0 milliards d'euros dans les deux prochaines années, selon la prévision triennale des dépenses présentée dans les documents budgétaires149(*).
Évolution de la charge de la dette du budget général
(en milliards d'euros)
Crédits de paiement exécutés,
estimés ou prévus dans la présentation pluriannuelle pour
le programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de
l'État » et, à compter de 2020, le programme
355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par
l'État ».
Source : commission des finances, à
partir des documents budgétaires.
D. UNE NORMALISATION QUI COMMENCE S'AGISSANT DES PRATIQUES BUDGÉTAIRES
Le rapporteur général a plusieurs fois dénoncé, au cours des années passées, le recours à des pratiques budgétaires extraordinaires, qui étaient de moins en moins justifiées alors que la situation exceptionnelle de 2020 s'éloignait. Il constate donc avec satisfaction que, sur plusieurs points, les observations de la commission des finances ont été entendues afin d'améliorer la lisibilité du budget, au service d'une meilleure information du Parlement dans les documents budgétaires, mais aussi dans le texte même du projet de loi de finances150(*).
1. Les reports de crédits poursuivent leur décrue mais n'ont pas encore, en 2025, retrouvé leur niveau antérieur à la crise sanitaire
L'article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) dispose que les crédits de paiement ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes. Le principe d'annualité budgétaire a pour conséquence que ces crédits budgétaires doivent, chaque année, être autorisés par le Parlement. La LOLF a renforcé ce principe en supprimant l'ancienne distinction entre services votés, reconduits par un vote unique, et mesures nouvelles, qui faisaient l'objet d'une discussion approfondie.
Une souplesse permet toutefois de reporter jusqu'à 3 % des crédits de paiement, hors titre 2, non consommés l'année précédente, par un arrêté pris avant le 15 mars de l'année nouvelle. Ce plafond s'exprime par rapport aux crédits initiaux, constituant ainsi une dérogation limitée au principe d'autorisation annuelle des crédits.
Au-delà même de cette souplesse, la loi organique permet de majorer cette limite de 3 % par une disposition expresse de loi de finances. Cette possibilité, qui était utilisée de manière très modérée jusqu'en 2020, a été au contraire mise en oeuvre massivement lors de l'exercice 2021 pour les crédits ouverts sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » et non encore consommés. Si le contexte d'urgence permettait de comprendre ce choix, le Gouvernement a utilisé la même technique, au cours des années suivantes, pour reporter des crédits non seulement sur une autre mission à vocation temporaire, la mission « Plan de relance », mais aussi, de manière générale, sur un grand nombre de missions du budget général.
Il est même arrivé que des crédits ne soient reportés que pour être immédiatement annulés et permettre ainsi, par compensation, l'ouverture de crédits nouveaux, sur d'autres programmes, par voie de décret151(*).
Le rapporteur général, qui a régulièrement dénoncé ces pratiques152(*), prend note avec satisfaction de la réduction progressive des reports de crédits.
Les reports généraux, hors missions temporaires, ont retrouvé un niveau inférieur à 3 Mds€. Le niveau global des reports est toutefois demeuré encore élevé en 2025, à 11,5 Mds€, en raison des crédits restant encore, en 2025, sur la mission « Plan de relance », de la persistance du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » », mentionné infra, et de l'importance des reports de crédits sur fonds de concours. Ces derniers ne sont pas concernés par la limite de 3 % de report des crédits, car leur utilisation est liée par la volonté exprimée par la partie versante.
Reports des crédits non consommés vers l'exercice suivant
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
Si le Gouvernement, dans ses réponses apportées au rapporteur général, refuse de donner une estimation du montant des reports qui seront réalisés entre 2025 et 2026, certains sont d'ores et déjà décidés et sont d'ailleurs indiqués explicitement dans les projets annuels de performance : c'est le cas pour le programme 367 précité et pour le programme 362 « Écologie - mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Pour ces deux programmes, le projet de loi de finances n'ouvre aucun crédit, alors que le gestionnaire de programme disposera de crédits importants par voie de reports.
L'effort de stricte limitation des reports de crédits doit être poursuivi afin, sur ce point comme sur les autres, de revenir à une pratique conforme à l'esprit de la loi organique, c'est-à-dire plus transparente vis-à-vis de l'autorisation parlementaire et de l'information communiquée dans les documents accompagnant le budget.
2. Plusieurs programmes dérogeant fortement à l'esprit de la loi organique ont été supprimés
Le programme 369 « Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 » de la mission « Engagements financiers de l'État » a ouvert 165 milliards d'euros d'autorisations d'engagement en loi de finances pour 2022, soit le montant, estimé par le Gouvernement d'alors, de la dette supplémentaire contractée pour lequel ce programme tendait à afficher une trajectoire de remboursement.
Dès l'année de sa création, la commission des finances a dénoncé le caractère artificiel de ce programme qui, en ouvrant des crédits budgétaires, accroissait le déficit budgétaire et donc le besoin de financement, que venait combler pour un montant équivalent la dotation faite à la Caisse de la dette publique. Au total, l'endettement n'était en rien modifié par cette mécanique complexe. Le Sénat, sur la proposition du rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l'État », a voté chaque année la suppression de ce programme, le Gouvernement n'étant pas en capacité d'expliquer l'utilité de ce programme.
Le Sénat a été finalement été entendu dans le cadre de la loi de finances pour 2025, la commission mixte paritaire ayant conservé cet apport, et ce programme a en conséquence été supprimé.
De même, la mission « Plan de relance », créée par la loi de finances pour 2021, avait pour objectif de contribuer à relancer l'économie gravement atteinte par les périodes de confinement successives, tout particulièrement au printemps de 2020. Si la commission des finances a partagé l'objectif de cette mission, elle a regretté le caractère hétéroclite des trois programmes qui la composaient, comprenant de nombreuses mesures qui n'avaient pas de réel lien avec l'objectif de relance.
De surcroît, l'objectif de retour au niveau de croissance antérieur a été atteint dès le troisième trimestre 2021, de sorte que cette mission apparaissait de plus en plus comme un doublon des missions « de droit commun » du budget. Enfin, la sous-consommation des crédits votés initialement a eu pour effet, non pas des annulations de crédits en fin d'année, mais des reports considérables de crédit d'année en année.
Le Sénat a voté la suppression des crédits de cette mission dans les projets de loi pour 2024 et 2025 afin de marquer sa volonté de revenir à une gestion budgétaire conforme à l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire qu'« une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie »153(*), ce qui n'était manifestement pas le cas de cette mission qui réunissait des mesures aux objectifs très différents et qui auraient, pour beaucoup, dû trouver leur place dans les autres missions du budget général.
Le présent projet de loi de finances acte la suppression de cette mission, ce dont la commission ne peut que se réjouir, ainsi que le rapporteur général en sa qualité de rapporteur spécial des crédits de cette mission.
Un dernier programme issu des pratiques budgétaires hors norme de la période 2020-2023 existe toutefois encore dans le budget.
Le programme 367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » » de la mission « Économie » est issu d'un programme similaire créé par la première loi de finances rectificative pour 2021, qui l'avait doté de 2 milliards d'euros154(*), complétés de 748 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2022 et surtout de 12,7 milliards d'euros par la première loi de finances rectificative pour 2022, dans le cadre de la renationalisation d'EDF155(*). Le programme a également bénéficié de crédits reportés depuis d'autres programmes, notamment en provenance de l'ancien plan d'urgence ouvert pendant la crise sanitaire.
Toutefois, cette mission, une fois réalisée cette dernière opération, a conservé un important reliquat de crédits qui a été reporté d'année en année, à hauteur de 2 milliards d'euros, de 2022 vers 2023, puis de 2023 vers 2024, aucun crédit n'étant consommé au cours de ces années. Un montant de 1,8 milliard d'euros a été reporté une fois de plus de 2024 vers 2025, sur lequel 0,5 milliard d'euros ont été annulés, comme on l'a vu précédemment, par le décret d'annulation du 25 avril dernier.
Ouvertures, annulations et consommations de crédits sur le programme 367
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires, des décrets d'annulation et des arrêtés de report de crédits
Il reste donc, sur ce programme, 1,3 milliard d'euros de crédits qui sont toujours à la disposition du gestionnaire de programme alors qu'ils n'ont été soumis à l'autorisation parlementaire qu'en 2022, à une époque où ce programme était présenté comme « dédié et temporaire »156(*).
La Cour des comptes recommande la clôture du programme 367, notant qu'une partie des crédits non utilisés a permis, en 2024, d'équilibrer une ouverture de crédits de paiement sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la même mission, à hauteur de 161 M€, « confirmant que le programme 367 fonctionne comme une provision pour l'ensemble de la mission permettant de couvrir des ouvertures de crédits réalisées par ailleurs et pour d'autres finalités que celle du programme »157(*).
Le Gouvernement indique dans l'exposé général du projet de loi de finances que ce compte serait mobilisé à hauteur de la quasi-totalité de cet encours en 2026. Le rapporteur général en prend acte, mais rappelle que l'utilisation en 2026 de crédits ouverts en 2022 constitue une dérogation sérieuse aux principes d'annualité et de spécialité budgétaires, même si les opérations financées par ce crédit, qui sont de nature patrimoniales, n'ont pas d'effet sur le déficit maastrichtien.
II. L'ACCROISSEMENT DES RECETTES DE L'ÉTAT DE PLUS DE 15 MILLIARDS D'EUROS EN 2026 EST LE SIGNE D'UN ACCROISSEMENT MASSIF DES PRÉLÈVEMENTS FISCAUX
Les recettes du budget général de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements d'État, seraient en 2026 de 401,6 milliards d'euros, en hausse de 24,6 milliards d'euros par rapport à l'estimation révisée pour 2025.
En les minorant des prélèvements sur recettes (PSR) et en prenant en compte les estimations de versements de fonds de concours, les recettes totales nettes seraient de 329,5 milliards d'euros, soit une hausse de 15,4 milliards d'euros, soit une hausse de + 4,9 % en euros courants ou de + 3,6 % en euros constants.
Évolution des recettes totales nettes du
budget général
entre 2025 et 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances pour 2026
Avec des recettes, hors PSR, supérieures à 400 milliards d'euros, l'année 2026 atteindrait un point de recettes haut après un creux marqué entre 2022 et 2025.
Évolution à moyen terme des recettes
fiscales nettes
et non fiscales de l'État, corrigées de
l'inflation
(en milliards d'euros de 2026)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
A. LA CROISSANCE DES RECETTES FISCALES NETTES EST FAVORISÉE PAR LA CRÉATION OU LA PROROGATION D'IMPÔTS
Les recettes fiscales brutes s'établiraient en 2026 à un niveau de 513,8 Mds€ (+ 18,7 Mds€ par rapport à l'estimation révisée pour 2025), tandis que les remboursements et dégrèvements d'État seraient de 140,8 Mds€ (- 0,4 Md€), de sorte que les recettes fiscales nettes atteindraient 372,9 Mds€ (+ 19,1 Mds€).
Principaux facteurs d'évolution des
recettes fiscales nettes de l'État
selon le projet de loi de
finances pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, à partir de l'exposé général du projet de loi de finances
Les principaux facteurs seraient l'évolution de l'impôt sur le revenu et de la TVA nette, avec des effets importants liés aux mesures nouvelles, comme la non-revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, et la rebudgétisation en 2026 de la TVA affectée actuellement aux régions.
Les mesures nouvelles du projet de loi de finances contribuent au total pour + 13,1 Mds€ à l'augmentation des recettes fiscales nettes.
Effet des mesures nouvelles sur les recettes fiscales nettes
(en millions d'euros)
ALD : affections de longue durée. IS : impôt sur les sociétés.
Source : commission des finances, à partir du fichier de données de la direction du budget associé au document « Voies et moyens », tome I
Les mesures de périmètre et transferts sont également importantes, puisqu'elles conduisent à une augmentation des recettes fiscales nettes de + 6,7 Mds€, dont + 5,2 Mds€ pour la rebudgétisation de la TVA affectée aux régions.
1. Pour la première fois depuis 2012, le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas modifié, accroissant mécaniquement son produit
Le produit prévisionnel de l'impôt net sur le revenu pour 2026 est de 104,0 milliards d'euros, en hausse de 9,1 milliards d'euros par rapport à 2025.
Ce montant correspond à la différence entre l'impôt brut (130,2 Mds€ en 2025), qui résulte principalement du prélèvement à la source, et les remboursements et dégrèvements (26,1 Mds€).
Impôt brut et net sur le revenu en 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir de l'annexe « Voies et moyens », tome 1
L'augmentation du produit net serait autant due à l'évolution spontanée (+ 4,2 Mds€) qu'aux mesures nouvelles (+ 4,4 Mds€).
Le présent projet de loi de finances propose, pour la première fois depuis la loi de finances pour 2012, de maintenir le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui constitue une « mesure nouvelle » selon les documents budgétaires, bien qu'il s'agisse, sur le plan législatif, d'une absence de mesure car l'indexation sur l'inflation n'est pas de droit. L'augmentation attendue du produit de l'impôt liée à cette absence d'indexation est de 1,9 Md€158(*).
Le projet de loi de finances comprend également d'autres mesures qui tendent à accroître le produit net de l'impôt sur le revenu : forfaitisation de l'abattement de 10 % sur les pensions de retraite (+ 1,2 Md€) et suppression ou réforme d'autres dépenses fiscales.
Décomposition de l'évolution du produit de l'impôt sur le revenu entre 2025 et 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir de l'annexe « Voies et moyens », tome 1 et fichier de données associé
2. Hors « surtaxe » exceptionnelle, le produit de l'impôt sur les sociétés serait stable en 2026, en l'absence de réforme importante
Les recettes d'impôt net sur les sociétés sont prévues en 2026 à un niveau de 59,0 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,8 Md€ par rapport à l'estimation révisée pour 2025 qui, comme il a déjà été dit, est supérieure de 5,2 Mds€ à l'estimation initiale.
Ce montant n'inclut pas la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, classée parmi les « autres recettes fiscales » (voir infra).
Comme l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés net est inférieur de près d'un tiers au produit brut de cet impôt, par l'effet des remboursements et dégrèvements.
Impôt sur les sociétés brut et net en 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir de l'annexe « Voies et moyens », tome I
Les documents budgétaire fondent l'estimation pour 2026, notamment, sur la faible progression du bénéfice fiscal entre 2024 et 2025 (+ 1%), qui est prise en compte dans les acomptes versés en 2026.
Il convient de rappeler que l'impôt sur les sociétés, qui dépend des bénéfices des entreprises, est plus volatile et plus difficile à prévoir que des impôts qui sont plus liés au niveau général de l'activité, comme la TVA et l'impôt sur le revenu. L'estimation pour 2025 est elle-même susceptible d'être revue à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau du cinquième acompte versé au mois de décembre prochain.
L'impôt sur les sociétés
L'impôt sur les sociétés (IS) s'applique aux sociétés de capitaux, même si certaines sociétés de personnes peuvent opter pour l'IS. L'IS est versé selon un système d'acomptes et de solde. Les sociétés redevables versent ainsi, hors opérations de contrôle ou remboursements et dégrèvements :
- d'une part, un solde portant sur l'impôt dû au titre de l'année passée, ajouté ou soustrait aux acomptes versés cette année-là ;
- d'autre part, quatre acomptes aux mois de mars, juin, septembre et décembre, correspondant à l'impôt dû au titre de l'année en cours, mais calculés d'après le bénéfice fiscal de l'exercice précédent. Cependant, les grandes sociétés ajustent le dernier acompte en fonction de leur résultat fiscal estimé pour l'année en cours (« cinquième acompte ») et les autres sociétés peuvent moduler leurs acomptes lorsque leur bénéfice diminue (« autolimitation »).
Dans la présentation budgétaire (état A annexé à la loi de finances), l'impôt net sur les sociétés (ligne 1301-Net) est distinct de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (ligne 1302), de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés (ligne 1303) et de l'impôt minimum mondial à 15 % (nouvelle ligne 1304), qui relèvent de la catégorie des autres recettes fiscales nettes.
Source : commission des finances, à partir du tome I de l'annexe « Voies et moyens »
L'impôt sur les sociétés se stabiliserait ainsi à un niveau inférieur à celui, exceptionnellement élevé, qu'il avait atteint en 2022, année caractérisée par une élasticité très importante du produit de l'impôt à la croissance.
Cette stabilité est encore plus remarquable si on considère le produit corrigé de l'inflation. Une comparaison sur le moyen terme montre également une certaine stabilité en euros constants, si on retraite le produit de l'effet des remboursements de crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) qui, entre l'année 2014 et le début des années 2020, a réduit de manière importante le produit net de cet impôt159(*).
Produit de l'impôt net sur les
sociétés depuis 2013
avec et sans CICE
(en milliards d'euros de 2026 et en pourcentage)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
3. La TVA nette progresserait de 12,2 milliards d'euros, sous l'effet d'importantes mesures de périmètre
Le projet de loi de finances prévoit des recettes de taxe valeur ajoutée (TVA) nette revenant à l'État d'un montant de 109,1 milliards d'euros en 2026, soit une hausse de 12,2 Mds€ par rapport à la prévision révisée pour 2025.
Le montant de la TVA brute est, comme l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les sociétés, diminué d'un montant élevé de remboursements et dégrèvements. Il est en outre, pour plus de la moitié du produit restant, affecté aux administrations de sécurité sociale et aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de l'audiovisuel public.
De la TVA brute globale à la part de TVA revenant à l'État
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, d'après l'annexe « Voies et moyens », tome I, annexée au projet de loi de finances pour 2026
L'État s'est ainsi progressivement séparé de plus de la moitié du produit de cet impôt, mais l'année 2026 marque une inflexion, puisque le projet de loi de finances prévoit deux mesures de transfert qui conduisent à accroître de 8,0 milliards d'euros la part de la TVA nette revenant à l'État.
Évolution des parts de l'État et des
autres affectataires
dans le produit de la TVA nette
(en pourcentage)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
La première mesure est la rebudgétisation de la part de TVA affectée aux régions, compensée par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF), ce qui occasionne un transfert de fiscalité en faveur de l'État de 5,2 milliards d'euros. Cette mesure est neutre pour le solde budgétaire de l'État, s'agissant d'une augmentation simultanée d'une recette et d'une dépense.
La deuxième mesure est la réforme des allègements généraux qui conduit à réduire la part de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale (+ 3,1 Mds€).
En sens inverse, un abondement exceptionnel au fonds de sauvegarde des départements, de 300 millions d'euros en 2026 au lieu de 100 millions d'euros, réduit de 0,2 Md€ le produit de la TVA revenant à l'État.
4. Le produit des « petits impôts » est soutenu par la création d'impôts nouveaux ou la prorogation d'impositions temporaires
Outre les trois « grands impôts » que sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA, les recettes fiscales incluent de très nombreuses ressources regroupées dans deux catégories : les accises sur les énergies et les autres recettes fiscales.
La nouvelle nomenclature budgétaire des recettes d'accises sur les énergies
Le code des impositions sur les biens et services, issu de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, a pour effet une modification de la nomenclature budgétaire des recettes. À compter de l'exercice 2026, la catégorie consacrée à la taxe intérieure de consommation sur produits énergétiques (TICPE) est remplacée par celle des accises sur les énergies, dont la base est plus large :
- fraction, perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, de l'accise sur les énergies (ancienne TICPE) : rendement de 16,8 Mds€ prévu en 2026 ;
- accise sur l'électricité (ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ou TICFE) : rendement de 5,5 Mds€ ;
- accise sur les gaz naturels (ancienne taxe intérieure de consommation sur les gaz naturels ou TICGN) : rendement de 2,3 Mds€ ;
- autres accises sur l'énergie : rendement de 9 millions d'euros.
Source : commission des finances, à partir de l'annexe « Voies et moyens », tome I
La distinction faite dans les documents budgétaires entre les accises sur les énergies et les autres recettes fiscales ne paraît toutefois guère justifiée, car certaines recettes fiscales « autres » ont, depuis quelques années, un rendement comparable, voire supérieur, aux principales accises sur les énergies.
Recettes fiscales, hors grands impôts, dont
le produit prévisionnel
est supérieur ou égal à
4 milliards d'euros
(en millions d'euros)
|
Ligne |
Libellé |
Produit 2025 (révisé) |
Produit 2026 (PLF) |
Évolution |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès (successions) |
16 233 |
16 995 |
+ 763 |
|
1501 |
Accises sur les énergies (ex-TICPE) |
18 121 |
16 839 |
- 1 282 |
|
1427 |
Prélèvement de solidarité |
15 680 |
15 635 |
- 45 |
|
1503 |
Accises sur les énergies (ex-TICFE) |
5 758 |
5 546 |
- 212 |
|
1799 |
Autres taxes |
4 964 |
5 024 |
+ 61 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
5 000 |
4 800 |
- 200 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
4 521 |
4 423 |
- 98 |
|
1441 |
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises |
8 000 |
4 000 |
- 4 000 |
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
L'ensemble de ces recettes représente un montant de 100,8 milliards d'euros prévus en 2026, en diminution de 3,0 Mds€ par rapport à l'estimation révisée pour 2025.
Évolution du produit des accises sur
l'énergies
et des autres recettes fiscales nettes entre 2025 et
2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
La diminution du produit des accises sur l'énergie, qui porte principalement sur les anciennes TICPE (- 1,3 Md€) et TICGN (- 1,3 Md€ également), résulte du versement d'une partie des recettes d'accises sur les énergies au financement de la péréquation tarifaire en faveur des zones non-interconnectées au territoire continental (ZNI) à partir d'août 2025.
Le montant brut des accises sur l'énergie ex-TICPE augmente en effet, passant de 31,4 à 31,5 Mds€, mais la mesure précitée a conduit à créer une nouvelle affectation, d'un montant de 0,1 Md€ en 2025 et de 1,6 Md€ en 2026. La principale affectation demeure celle destinée aux collectivités territoriales (11,7 Mds€, contre 12,0 Mds€ en 2025), tandis que l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (Afitf) reçoit 1,6 Md€, en augmentation de 0,4 Md€.
Hors accises sur les énergies, le produit des autres recettes fiscales nettes diminue légèrement, de 0,2 Md€, malgré la création de plusieurs impositions nouvelles.
Il est toutefois difficile d'y voir une diminution de la pression fiscale.
L'article 11 du projet de loi de finances propose certes une véritable mesure de diminution de l'impôt en accélérant la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le produit diminue en conséquence en 2026, passant de 4,1 Mds€ à 2,7 Mds€ (- 1,3 Md€).
Toutefois la principale baisse de produit fiscal est celle de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui passe de 8,0 Mds€ en 2025 à 4,0 Mds€ en 2026. Or, ce produit aurait dû devenir nul car cette taxe avait été créée par la loi de finances pour 2025 avec une vocation temporaire. Le projet de loi de finances propose finalement, dans son article 4, de la proroger pour une année supplémentaire avec des taux et un rendement divisés par deux.
Cette baisse est presque compensée par la création ou l'entrée en vigueur de plusieurs taxes. Le présent projet de loi de finances instaure en effet :
- dans son article 3, une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales, dont le rendement est chiffré à 1 Md€ dans le projet de loi de finances160(*) ;
- dans son article 22, une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance des pays tiers, au produit estimé à 0,5 Md€161(*).
Par ailleurs, l'impôt minimum mondial à 15 % « pilier 2 », inscrit dans le droit national par la loi de finances pour 2023162(*), qui intervient en complément des impôts existants, tend à garantir un niveau minimum mondial d'imposition de 15 % pour les bénéfices des groupes d'entreprises multinationales disposant d'une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français. Son produit est estimé à 500 millions d'euros en 2026.
Enfin, une autre hausse importante de recettes fiscales concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) par décès, qui atteignent 17,0 Mds€ (+ 0,8 Md€, notamment par l'effet de la reprise du marché immobilier) et dépassent ainsi l'ex-TICPE.
Si cet impôt reste peu commenté comparativement, par exemple, aux accises sur l'énergie163(*), la croissance de son produit est un fait notable de la fiscalité d'État au cours des années récentes. Le produit global des DMTG, en incluant les donations entre vifs, serait de 21,4 Mds€ en 2026, soit plus du double de 2014 (10,3 Mds€).
B. UN VERSEMENT DE 6,9 MILLIARDS D'EUROS DE L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE ACCROÎT LES RECETTES NON FISCALES
Les recettes non fiscales s'établiraient en 2026 à 28,7 Mds€, en hausse de 5,5 Mds€.
Cette catégorie regroupe des recettes très diverses, telles que les dividendes et recettes assimilées (5,1 Mds€), les amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite (2,7 Mds€) et les produits de la vente de biens et de services (2,5 Mds€), soit en tout 57 lignes de recettes, dont la moitié ont un rendement inférieur à 50 millions d'euros.
Cette diversité s'est accrue depuis plusieurs années avec les versements de l'Union européenne correspondant au remboursement du plan de relance (6,1 Mds€ en 2026, en hausse de + 2,9 Mds€ par rapport à 2025).
Évolution des recettes non fiscales depuis 2019
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires et des fichiers de données publiés par la direction du budget
Une nouvelle recette exceptionnelle, mais ponctuelle, survient en 2026, avec le un versement de 6,9 Mds€, déjà mentionné, en provenance de l'Agence nationale de la recherche au titre des dotations non consommables.
Les recettes issues des dividendes et recettes assimilées, en revanche, seraient en diminution de 1,2 Md€ par rapport à 2025, notamment parce qu'EDF a effectué cette année un versement exceptionnel de 2 Mds€.
De même, le produit des amendes serait en diminution de 1,8 Md€ parce que l'année 2025 est marquée par la perception d'amendes exceptionnelles.
C. LES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES PROGRESSENT EN RAISON DU CYCLE DE DÉPENSES EUROPÉENS ET PAR L'EFFET DE LA REBUDGÉTISATION DE LA TVA DESTINÉE AUX RÉGIONS
Les prélèvements sur recettes (PSR) s'établiraient en 2026 à 78,3 milliards d'euros, en forte hausse de 9,2 Mds€ en raison, d'une part, de la mise en oeuvre des dépenses de la programmation pluriannuelle de l'Union européenne et, d'autre part, de la compensation aux régions de la suppression de la part de TVA qui leur est affectée.
Évolution des prélèvements sur recettes
(en milliards d'euros)
RNB : revenu national brut. Ressource plastique : prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la contribution déchets plastiques non recyclés. Compensation TFPB/CFE locaux industriels : prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. FCTVA : fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. DGF : dotation globale de fonctionnement.
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
S'agissant du PSR à destination de l'Union européenne, il augmente dans le cadre de l'exécution du cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui a été révisé en 2024 afin de renforcer certains financements (Ukraine, technologies stratégiques, migrations).
Cette hausse inclut un rattrapage de paiements au titre de la politique de cohésion, qui accélère après avoir été sous-exécutée au cours des exercices antérieurs.
Les PSR à destination des collectivités territoriales correspondent à 30 lignes budgétaires, concentrées à plus de 90 % sur quatre PSR, dont 66 % sur la dotation générale de fonctionnement (DGF).
Leur hausse de 3,4 Mds€ correspond, en réalité, à une diminution à périmètre constant des dotations attribuées aux collectivités.
L'augmentation de la DGF de 5,2 Mds€ résulte en effet, comme il a été dit supra, de la nécessité de compenser aux régions la rebudgétisation de la part de TVA qui leur était affectée. La DGF connaît aussi des mesures de périmètre d'un montant bien moins important : une diminution de 1,0 M€ résultant de la recentralisation de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ille-et-Vilaine, d'une part, et la rétrocession au sein de la DGF de 13 M€ accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d'aide sociale, d'autre part.
Cet accroissement de périmètre est partiellement compensé par des réductions d'autres prélèvements sur recettes.
Le PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels a ainsi un produit en baisse de 1,0 Md€. L'article 39 du projet de loi de finances prévoit en effet la réduction de 25 % de la compensation afférente à l'abattement de 50 % applicable aux valeurs locatives des établissements industriels.
Le PSR au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) serait, lui aussi, en baisse avec un niveau de 7,9 Mds€, contre 8,2 Mds€ en 2025, car l'article 32 de projet de loi de finances modifie l'assiette des dépenses éligibles au fonds sur les seules dépenses d'investissement et prévoit que les versements du FCTVA pour les groupements de communes et les établissements publics territoriaux seront effectués l'année suivant la dépense d'investissement.
D. III. LES DÉPENSES DE L'ÉTAT, HORS DÉFENSE ET CHARGE DE LA DETTE, SONT MAÎTRISÉES MAIS RESTENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR À CELUI D'AVANT LA CRISE SANITAIRE
A. LE PANORAMA DES DÉPENSES DE L'ÉTAT
Les dépenses de l'État peuvent être appréciées sur plusieurs périmètres.
Les dépenses brutes, c'est-à-dire les crédits de paiement ouverts aux ministres, sont dans le projet de loi de finances pour 2026 de 588,3 milliards d'euros en crédits de paiement sur le budget général, de 2,6 milliards d'euros sur les budgets annexes, de 77,5 milliards d'euros sur les comptes d'affectation spéciale et de 150,1 milliards d'euros sur les comptes de concours financiers164(*).
En dépenses brutes, la mission la plus importante du budget général est la mission « Remboursements et dégrèvements », qui ne présente toutefois que des marges de manoeuvre limitées car elle porte des décaissements liés à des dégrèvements d'impôts, des remboursements et restitutions de crédits d'impôts, ou encore des opérations comptables liées à des remises gracieuses, annulations, abandons de créances.
Hors remboursements et dégrèvements, la mission recevant les crédits les plus élevés est, de manière constante, la mission « Enseignement scolaire ». Depuis 2025, toutefois, c'est le cas uniquement en crédits de paiement. Pour la deuxième année consécutive, c'est la mission « Défense » qui ouvre le montant le plus élevé d'autorisations d'engagement, ce qui montre l'importance donnée à l'effort de défense au-delà de l'année en cours.
Les quatre premières missions du budget
général
en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances pour 2026
Les dépenses nettes du budget général, comptabilisées à l'article d'équilibre du budget165(*), s'entendent hors remboursements et dégrèvements d'État166(*). Leur montant est de 447,4 milliards d'euros en projet de loi de finances pour 2026.
1. L'appréciation des crédits des missions varie selon que l'on inclut, ou non, la contribution au financement des pensions
Certaines de ces dépenses étant considérées comme contraintes à court terme, il est d'usage de considérer les dépenses des missions du budget général hors remboursements et dégrèvements et hors contributions au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », comme le fait le Gouvernement dans le dossier de presse du projet de loi de finances. Le montant total des contributions au CAS « Pensions » est de 51,8 milliards d'euros pour les missions du budget général et de 0,4 milliard d'euros pour les budgets annexes.
Si la mission « Enseignement scolaire » est la première mission du budget général, hors remboursements et dégrèvements, la deuxième est la mission « Défense » si l'on inclue les contributions aux pensions, ou la mission « Engagements financiers de l'État », c'est-à-dire principalement la charge de la dette de l'État, si l'on comptabilise hors pensions.
Crédits des missions du budget
général en crédits de paiements,
et hors
remboursements et dégrèvements, avec et sans contribution au CAS
« Pensions »
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, à partir des données transmises par le Gouvernement
La question de la comptabilisation des sommes versées par l'État pour le financement des pensions de ses agents a fait l'objet de débats récents au sujet d'un supposé « déficit caché » du système de retraite.
Une enquête de l'Institut des politiques publiques (IPP)167(*) a souligné, au mois de juin dernier, que la convention comptable actuelle ne tient pas compte du déséquilibre démographique du régime, c'est-à-dire de la différence entre le ratio actifs / retraités dans la fonction publique et dans le secteur privé. L'IPP a proposé de ne plus inclure, dans les crédits budgétaires de chaque mission budgétaire, la part de la contribution de l'État qui correspond au rééquilibrage démographique et d'ajouter au contraire une correction à la prise en compte d'avantages associés à des métiers spécifiques, notamment dans le secteur de la défense. Le budget du ministère de l'éducation nationale passerait ainsi, en 2023, de 81,3 à 70,7 milliards d'euros, ce qui, selon les auteurs de l'étude, assurerait un meilleur cadre de référence pour des comparaisons internationales.
Budget des ministères en 2023
« corrigés »
selon l'étude de
l'Institut des politiques publiques
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des données IPP
En réponse à ces débats et tout particulièrement à cette étude, la ministre de l'action et des comptes publics a indiqué le 22 octobre dernier, devant l'Assemblée nationale168(*), que les méthodes de comptabilisation seraient revues dans le projet de loi de finances pour 2027. Dès le présent projet de loi de finances, l'annexe budgétaire « Pensions »169(*) inclut une section nouvelle, relative à l'équilibre du CAS « Pensions », dans laquelle il est indiqué que « le total des contributions employeurs des fonctionnaires civils et militaires s'élèverait à 11 Mds€, contre 52,4 Mds€ selon la présentation actuelle ». Cette présentation ne retient pas la distinction que fait l'IPP entre le rééquilibrage démographique et les mesures professionnelles spécifiques.
Les conventions comptables peuvent être discutées en fonction de ce que l'on souhaite représenter et il serait complexe, peut-être impossible de trouver un mode de comparaison unique entre deux régimes de retraite aux fondements très différents, comme l'indique l'annexe budgétaire « Pensions » : le régime de la fonction publique d'État inclut à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire, son taux de cotisation s'applique aux rémunérations hors primes et il finance, outre les retraites proprement dites, certains droits familiaux qui, dans le secteur privé, relèvent de la Caisse nationale des allocations familiales.
Ce débat permet toutefois de constater que la contribution au CAS « Pensions » est une sorte d'« angle mort » de la présentation budgétaire.
Alors que le montant le plus souvent présenté dans le débat public exclut les contributions au CAS « Pensions »170(*), c'est le montant incluant cette contribution qui fait l'objet de l'autorisation parlementaire dans la loi de finances et les documents budgétaires. Les parlementaires peuvent modifier par voie d'amendement les crédits de titre 2, mais sans distinction entre ce qui relève des rémunérations proprement dites (qui peuvent faire l'objet d'un arbitrage annuel, par des mesures salariales catégorielles ou par des choix de politique d'embauche) et ce qui est nécessaire pour le paiement des pensions (lesquelles dépendent plutôt de mesures générales et non de mesures spécifiques au ministère responsable du programme budgétaire).
La réflexion actuelle est donc bienvenue et devra aboutir à une réforme de la comptabilisation des contributions des missions au CAS « Pensions » ou, en tout cas, à une meilleure information du Parlement sur le mécanisme et la décomposition de ces contributions.
2. Les politiques portées par les missions budgétaires bénéficient de financements qui, pour certaines d'entre elles, vont bien au-delà des crédits budgétaires
La présentation la plus large de l'effort de l'État en faveur des politiques publiques portées par les missions a été introduite par la révision de la loi organique en date du 28 décembre 2021. L'état F annexé au projet de loi de finances regroupe désormais les moyens globaux alloués à chaque mission, c'est-à-dire qu'aux crédits budgétaires sont ajoutés l'ensemble des moyens contribuant aux politiques publiques visées par la mission : fonds de concours, dépenses fiscales, ressources affectées aux opérateurs, prélèvements sur recettes171(*).
Moyens globaux alloués aux missions du
budget général,
hors dépenses des comptes
spéciaux et remboursements et dégrèvements
(en milliards d'euros)
Montants hors contributions des comptes spéciaux et hors mission « Remboursements et dégrèvements »172(*).
Source : commission des finances, à partir de l'état F annexé au projet de loi de finances et des réponses au questionnaire du rapporteur général
Une telle présentation met par exemple en évidence l'importance du financement apporté aux collectivités territoriales par l'intermédiaire des prélèvements sur recettes173(*) et le rôle majeur des taxes affectées dans le financement des politiques du travail et de l'emploi, des crédits des opérateurs dans la recherche et l'enseignement supérieur, ou encore des dépenses fiscales pour de nombreuses missions. Pour certaines missions, les crédits budgétaires sont largement dépassés par les financements extra-budgétaires ou revenant aux opérateurs, alors même que les objectifs de la mission sont assignés à une administration qui ne dispose que des crédits budgétaires.
B. LE PROJET DE LOI DE FINANCES PRÉVOIT ENFIN UNE CERTAINE MODÉRATION DES DÉPENSES, HORS DÉFENSE
En considérant le montant des crédits hors contributions au CAS « Pensions » et hors « Remboursements et dégrèvements », le total des crédits du budget général passerait, selon le projet de loi de finances pour 2026, de 381,1 milliards d'euros en loi de finances 2025 à 391,0 milliards d'euros en 2026, soit une augmentation de 9,9 milliards d'euros.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 définit le « périmètre des dépenses de l'État », sur lequel est fixé un objectif de maîtrise des dépenses : crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux (hors remboursements et dégrèvements, dépenses liées à la dette et participations financières de l'État), montant cumulé des plafonds de taxes affectées à des tiers et des prélèvements sur recettes174(*). Sur ce périmètre, le montant des dépenses est de 501 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2026, en hausse de 10,5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2025.
Dans les deux cas, le montant indiqué pour la loi de finances 2025 est calculé par le Gouvernement en retraitant les modifications affectant le périmètre respectif de l'État et des autres administrations dans le présent projet de loi de finances, dont le niveau est particulièrement important.
Les retraitements de périmètre
Les principaux changements de périmètre concernent la mission « Écologie, développement et mobilité durables » et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales :
- débudgétisation du soutien du mécanisme de solidarité avec les zones non interconnectées ou ZNI (- 1,9 Md€)175(*) et soutien à la cogénération (- 1,1 Md€)176(*) ;
- réintégration au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des montants attribués aux régions depuis 2018 sous forme de fractions de taxe sur la valeur ajoutée (+ 5,2 Mds€).
Mesures de périmètre concernant le
budget général de l'État
dans le projet de loi de
finances pour 2026
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir du projet de loi de finances pour 2026177(*)
Toutefois, les hausses de crédits sont largement concentrées sur un petit nombre de missions qui demandent à être considérées de manière spécifique.
L'augmentation des crédits de la mission « Défense » (+ 6,7 milliards d'euros) résulte d'un choix fort. Il paraissait en effet nécessaire, compte tenu du contexte international, de renforcer les capacités de défense française, au-delà de l'accroissement de crédits déjà prévu pour l'année 2026 par la loi de programmation militaire, soit + 3,2 milliards d'euros178(*).
Évolution des crédits des missions
entre la loi de finances initiale pour 2025
et le projet de loi de finances
pour 2026
(en milliards d'euros)
Crédits hors remboursements et dégrèvements, hors contributions directes de l'État au compte d'affectation spéciale « Pensions ». Crédits de la loi de finances initiale pour 2025 au format du projet de loi de finances pour 2026.
Source : commission des finances du Sénat, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur général
La charge de la dette179(*), pour sa part, constitue à court terme une donnée exogène, qui dépend de l'évolution de l'inflation (pour le stock de dette indexée) et des taux de marché (pour les émissions nouvelles faites chaque année, notamment en remplacement de titres arrivés à échéance).
Les crédits des ministères hors mission « Défense » et hors « charge de la dette » sont dans le présent projet de loi de finances égaux à 274,6 milliards d'euros, contre 275,7 millions d'euros en loi de finances pour 2026. Cette baisse de 1,2 milliard d'euros en euros courants, soit - 1,7 % en euros constants, témoigne d'un effort budgétaire qu'il convient de souligner sur le périmètre de l'État.
Enfin, les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » évoluent principalement sous l'effet des charges prévisionnelles de soutien à la production d'énergie renouvelable, liées à l'évolution des prix de l'électricité. Ces charges, telles que mesurées par l'action 09 du programme 345 « Service public de l'énergie », seraient de 7,3 Mds€ en 2026, contre 4,4 Mds€ en loi de finances initiale 2025, soit une augmentation de 2,9 Mds€. Si l'on neutralise cette variation des coûts, qui résulte de la simple constatation de l'évolution des prix par une autorité indépendante de l'État, la Commission de régulation de l'énergie, la baisse des crédits des ministères est de 4,0 milliards d'euros, soit - 2,8 % en euros constants.
Les autres augmentations de crédits sont peu nombreuses et d'un montant bien moins important.
Elles reflètent en premier lieu l'accent mis, comme les années précédentes, sur les missions régaliennes de l'État, en valeur mais aussi en volume : les crédits de la mission « Sécurités » augmentent de 371 M€ (soit + 0,8 % en euros constants) et ceux de la mission « Justice » de 166 M€ (soit + 0,3 % en euros constants).
Les crédits des politiques de recherche et d'éducation sont préservés, au moins en euros courants. Les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » augmentent de 661 M€ (soit + 0,8 % en euros constants) et ceux de la mission « Enseignement scolaire » de 261 M€ (soit une diminution de - 1,0 % en euros constants).
La mission « Santé » connaît aussi une augmentation de crédits relativement importante de 193 M€ (soit + 11,6 % en euros constants), mais elle porte sur le programme 379 qui constitue un simple canal de reversement à la Sécurité sociale des financements européens relatifs au volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR).
Enfin, la hausse des crédits de la mission « Crédits non répartis », à hauteur de + 250 M€ entre la loi de finances 2025 et le présent projet de loi de finances pour 2026, n'est pas significative à ce stade de la discussion car elle porte sur la provision relative aux rémunérations publiques, qui peut être répartie sur d'autres programmes du budget entre le dépôt du projet de loi de finances et sa promulgation.
S'agissant des diminutions de crédits, ceux de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » diminuent de 2,6 Mds€ d'euros (soit - 12,9 % en euros constants), par une diminution de l'enveloppe prévue pour les aides à l'alternance et aux demandeurs d'emploi.
Les crédits de la mission « Cohésion des territoires » diminuent de 893 M€ (soit - 5,1 % en euros constants), par une réforme des aides personnelles au logement (APL) et du financement de la rénovation des logements privés, notamment par un transfert partiel de ce financement vers le mécanisme des certificats d'économie d'énergie.
Ceux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont réduits de 788 M€ (soit - 3,9 % en euros constants) avec une réforme de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année.
Les crédits de la mission « Aide publique au développement » sont réduits de 704 M€ par rapport à 2025 (soit - 17,2 % en euros constants). Pour mémoire, les crédits de cette mission avaient connu une hausse importante dans les années passées, de sorte que, avec un niveau de 3,7 Mds€ dans le projet de loi de finances pour 2026, ils demeurent toujours supérieurs au niveau de 2019 (3,0 Mds€).
Enfin, les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » sont également en baisse significative, avec une diminution de 265 M€ (soit - 19,2 % en euros constants) portant sur plusieurs dispositifs, dont le service civique (- 114 M€).
Au total, le projet de loi de finances pour 2026 confirme l'effort entrepris dans la loi de finances initiale pour 2025 : les dépenses nettes du budget général, hors charge de la dette, sont désormais passées en-dessous de la tendance d'augmentation antérieure à la crise sanitaire.
Évolution en volume des dépenses
nettes du budget général,
hors charge de la dette, en euros
constants
(en euros de 2026)
Dépenses brutes moins remboursements et dégrèvements d'État, hors programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) » et 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) », actualisés en fonction de l'indice des prix harmonisé hors tabac. Tendance calculée par interpolation linéaire des moyennes sur trois ans calculées en 2012 et en 2018.
Source : commission des finances, à partir des lois et projets de loi de finances
Cette situation ne doit pas encore être considérée comme satisfaisante, compte tenu de l'ampleur du déficit budgétaire, qui est toujours supérieur à 120 milliards d'euros. En effet, le niveau global des dépenses de l'État reste très largement supérieur à celui de 2019, actualisé en fonction de l'inflation.
C. POUR GARANTIR LE RÉTABLISSEMENT DES COMPTES PUBLICS, IL FAUT POURSUIVRE UN OBJECTIF DE RETOUR AU NIVEAU DE DÉPENSES DE 2019
1. Le nécessaire effort sur les missions régaliennes de l'État doit être compensé sur ses autres charges
L'année 2019, dernière année avant la crise sanitaire, est aussi la dernière au cours de laquelle le déficit public n'a pas dépassé de 3 % du PIB180(*). Il paraît donc utile de considérer, au niveau du budget de l'État, l'évolution des crédits consacrés à chaque mission budgétaire entre 2019 et le présent projet de loi de finances.
Il en ressort que la plupart des missions du budget général ont, dans le projet de loi de finances pour 2026, des crédits supérieurs, même en euros constants, à ceux dépensés pendant l'année 2019. Ceci est vrai même de certaines missions auxquelles un effort particulier a été demandé, comme les missions « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » et « Aide publique au développement ».
Évolution des crédits des missions
du budget général entre 2019
et le projet de loi de finances
pour 2026, en euros constants
(en milliards d'euros de 2026)
Dépenses de l'État en 2019 corrigées de l'inflation (indice des prix à la consommation hors tabac) et retraitées des changements de périmètre survenus depuis 2019. Hors contributions au CAS Pensions et missions « Crédits non répartis » et « Remboursements et dégrèvements ».
Source : commission des finances du Sénat, à partir des documents budgétaires et des données transmises au rapporteur général
Certaines augmentations de crédits sont imposées par les menaces extérieures (Défense) ou par l'évolution des marchés de taux (charge de la dette). Le financement de ces dépenses supplémentaires ne devra pas reposer sur déficit, mais sur des redéploiements de crédits.
L'augmentation totale des crédits, ainsi calculée, est de + 45,3 milliards d'euros : c'est cet effort qu'il conviendrait de réaliser sur les crédits autres que ceux consacrés à la défense et à la charge de la dette pour retrouver le niveau de dépenses de l'État en 2019.
La hausse en volume de la quasi-totalité des missions du budget général traduit une extension toujours plus poussée du champ d'intervention de l'État, alors que l'impératif de maîtrise de la dépense publique devrait pousser celui-ci à revenir, hors dépenses prioritaires, au champ qui était le sien en 2019.
2. Le projet de loi de finances pour 2026 poursuit l'effort entamé par la loi de finances initiale pour 2025 sur les dépenses des opérateurs
Le montant des financements publics alloués aux opérateurs est de 73,3 milliards d'euros dans le présent projet de loi de finances, contre 74,8 milliards d'euros en loi de finances pour 2025 (soit une diminution de 3,4 % en euros constants). Le montant du financement public consacré aux opérateurs se réduit donc pour la deuxième année consécutive en valeur, après avoir suivi une forte hausse depuis 2019. Le montant de ces financements sera en effet supérieur de 44,6 % en 2026 par rapport à 2019, soit + 23,5 % en chiffres corrigés de l'inflation.
Évolution du financement des opérateurs
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des annexes budgétaires « Opérateurs » aux projets de loi de finances pour 2018 à 2026
La diminution porte principalement sur les dispositifs d'intervention portés par l'Agence de services et de paiements (ASP), l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et l'Ademe181(*).
Elle repose toutefois partiellement sur une diminution de la trésorerie de ces agences : celle de l'ANAH diminuerait ainsi de moitié, soit - 511 millions d'euros, en 2026, permettant de compenser une baisse équivalente du financement par l'État.
Pour mémoire, dès le mois de juillet 2023, l'Inspection générale des finances avait identifié l'excédent de trésorerie des opérateurs à environ 2,5 milliards d'euros182(*), qui pouvait être réduit par une limitation ponctuelle du concours de l'État ou une ponction sur la trésorerie. Il convient de se réjouir que ce projet de loi de finances, comme le précédent, utilise ces moyens pour exercer une pression qui ne peut que pousser à une amélioration de la gestion. Un opérateur public n'a généralement pas besoin, contrairement à une entreprise privée indépendante, de disposer d'une trésorerie particulièrement abondante, car l'État peut toujours lui apporter des fonds nouveaux s'il en démontre la nécessité.
Les économies engendrées ne sont toutefois que limitées et ne peuvent être répétées chaque année. Elles ne sauraient donc remplacer une réflexion d'ensemble sur l'organisation de l'État et les missions qu'il exerce soit directement, soit par l'intermédiaire des opérateurs.
Les opérateurs ne sont toutefois pas les seuls tiers financés par l'État.
Les corps d'inspection de l'État ont ainsi consacré, en mai 2025, une revue de dépenses consacrée à celles destinées aux associations183(*). Il en ressort que la somme des dépenses budgétaires de l'État, de ses opérateurs et des collectivités territoriales destinées aux associations a dépassé 49 Mds€ en 2023. La revue de dépenses identifie 3 Mds€ d'économies potentielles sur ces dépenses, réparties à part égales sur celles émanant de l'État et de ses opérateurs, sur celles provenant des collectivités territoriales et sur les dépenses fiscales dont bénéficient les associations.
3. L'objectif de maîtrise des dépenses est toutefois rendu difficile par le poids des engagements passés, qui conduit d'ores et déjà à un socle de dépenses futures d'un niveau élevé
Les efforts de réduction du déficit devront prendre en compte l'importance des « coups partis » hérités des années passées, ainsi que les engagements prévus par le présent projet de loi de finances.
Le montant des autorisations d'engagements ouvertes par le projet de loi de finances pour 2026 est en effet de 613,1 Mds€, contre 588,3 Mds€ de crédits de paiement, toutes missions du budget général confondues. Le surcroît d'autorisations d'engagement de 24,8 Mds€ nécessitera, dans les années à venir, l'ouverture des crédits de paiement correspondants, même si certaines autorisations d'engagement peuvent être abandonnées ou réduites.
Les missions qui ouvrent le surcroît le plus important d'autorisations d'engagement, par rapport aux crédits de paiement, sont les missions « Défense » (+ 26,4 Mds€) et « Écologie, développement et mobilité durables » (+ 2,4 Mds€). À l'inverse, la mission « Investir pour la France de 2030 » ouvre un surcroît de crédits de paiement de 5,0 Mds€ d'euros, cette mission finançant progressivement des projets dont les autorisations d'engagement ont, en quasi-totalité, été ouvertes par les lois de finances pour 2022 et 2023.
Certaines missions dont les crédits baissent dans le présent projet de loi de finances, comme les missions « Aide publique au développement » et « Sport, jeunesse et vie associative », ouvrent dans le même temps des autorisations d'engagement nettement plus importantes que les crédits de paiement (à hauteur de, respectivement, 120,6 % et 129,1 % des crédits de paiement), ce qui correspond, d'une part, à des engagements pris dans le cadre de programmes d'aide internationaux (programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement ») et, d'autre part, à la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 (programme 385 consacré à cet événement).
Correspondant à l'accumulation, sur plusieurs années, des autorisations d'engagement non couvertes par des crédits de paiements, les restes à payer s'accumulent et représentaient à la fin 2024 un montant de 217,1 milliards d'euros pour les programmes du budget général. Ils constituent un indice des dépenses futures qu'il sera difficile d'éviter, par exemple des travaux dont le marché a été attribué mais dont l'exécution n'est pas encore terminée.
Répartition des restes à payer sur
les missions
du budget général à la fin
2024
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur général. Hors programme 369 « Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 »
Près de la moitié des restes à payer concernent la mission « Défense », résultant notamment de la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire. L'abondance des autorisations d'engagement ouvertes par la loi de finances pour 2025 et le présent projet de loi de finances pour 2026 devraient encore accroître le niveau des restes à payer pour cette mission.
À l'inverse, les restes à payer de la mission « Investir pour la France de 2030 » devraient progressivement diminuer, pour la raison déjà indiquée supra, à savoir que les crédits de paiement ouverts dans chaque loi de finances couvrent progressivement les autorisations d'engagement ouvertes par les projets de loi de finances pour 2022 et 2023. Cette mission n'en constitue pas moins, avec plus de 30 milliards de restes à payer, une contrainte directe sur les dépenses des années à venir.
Une autre rigidité sur la dépense provient des lois de programmation sectorielles, qui décident plusieurs années à l'avance l'augmentation des crédits consacrés à certaines politiques. Si leur valeur juridique est limitée par le principe d'annualité des crédits, qui permet à la loi de finances de l'année d'y déroger, elles ont en pratique été en grande partie suivies et celle relative à la défense est même rehaussée en cours d'exécution.
Sur les quatre lois de programmation en cours, celles relatives aux ministères de l'intérieur184(*) et de la justice185(*), toutefois, ne devraient plus entraîner qu'une hausse limitée des crédits, car elles cessent leur effet en 2027, tandis que celles consacrées à la défense186(*) et à la recherche187(*) portent jusqu'à l'année 2030.
En application de ces lois, les crédits de ces quatre missions augmenteraient de 15,6 milliards d'euros d'ici à 2029 et 19,7 milliards d'ici à 2030, ce qui accroît d'autant les économies à réaliser sur les autres politiques pour revenir à un ratio de déficit public par rapport au PIB de 3 % d'ici à cette date.
Dépenses supplémentaires
prévues par les
lois de programmation sectorielles par rapport
à 2025
(en milliards d'euros)
Crédits Défense hors annonces faites par le président de la République le 13 juillet 2025.
Source : calculs commission des finances, à partir des lois de programmation sectorielles.
L'augmentation tendancielle des dépenses est confirmée par l'examen de l'échéancier triennal des dépenses qui est inscrit dans chaque projet annuel de performances en application de la révision de la loi organique relative aux lois de finances du 28 décembre 2021. Il en ressort que les dépenses des missions188(*) augmenteraient de 31,2 milliards d'euros de 2025 à 2028.
Évolution des crédits des missions entre 2025 et 2028
(en milliards d'euros)
Seules les variations supérieures ou égales à 1 milliard d'euros sont représentées.
Source : commission des finances, à partir du fichier des dépenses pluriannuelles publié par la direction du budget
Toutefois, hors missions « Engagements financiers de l'État » (c'est-à-dire, pour l'essentiel, la charge de la dette) et « Défense », l'évolution entre 2025 et 2028 est orientée à la baisse en euros courants (- 8,6 milliards d'euros), ce qui confirme encore une fois l'effort engagé.
D. MASQUÉS PAR UNE PRÉSENTATION TROMPEUSE, LES EFFECTIFS DE L'ÉTAT POURSUIVENT LEUR CROISSANCE EN 2026
Le projet de loi de finances prévoit une poursuite de l'augmentation des effectifs de l'État, malgré un certain effort réalisé sur les opérateurs.
1. Les effectifs de l'État poursuivent une hausse en 2026, alors que la communication du Gouvernement insiste de manière biaisée sur une baisse des emplois
Le Gouvernement, dans les documents budgétaires comme lors de son audition devant la commission des finances, évoque une diminution de 3 000 emplois. Selon la section de l'exposé général du projet de loi de finances consacrée aux efforts réalisés sur l'État, « en intégrant les réductions de postes prévues au sein des caisses de sécurité sociale, c'est au total 3 000 emplois qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l'emploi public ».
Cette formulation est pour le moins étonnante, et peut induire en erreur, car les caisses de sécurité sociale ne font pas partie de l'État et leurs agents sont recrutés sur contrat de droit privé.
Il apparaît que ce chiffre est mesuré sur un périmètre taillé sur mesure à la seule fin d'afficher une diminution des emplois. Alors qu'il associe de manière artificielle les caisses de sécurité sociale à l'État, il exclut de ce dernier de nombreux recrutements effectués au ministère de l'éducation nationale.
La réalité est que l'État a un schéma d'emploi positif de + 8 459 ETP pour l'État, partiellement compensé par une légère diminution des emplois des opérateurs (- 1 735 ETP).
Évolution des effectifs dans les
ministères et
leurs opérateurs en 2026
(en équivalent temps-plein)
Source : commission des finances du Sénat, à partir du projet de loi de finances
La hausse des effectifs au ministère de l'éducation nationale est liée à la réforme de la formation initiale des enseignants. Les ministères régaliens (défense, intérieur, justice) poursuivent le plan de recrutement prévu par leurs lois de programmation respectives.
Les autres ministères voient leurs effectifs rester stables ou diminuer.
En particulier, le nombre d'emploi chez les opérateurs du ministère du travail et des solidarités diminue de plus de 1 000 ETP, portant notamment sur les agences régionales de santé (ARS, - 200 ETP) et France Travail (- 515 ETP).
Cette hausse de l'emploi reste limitée au regard de l'ensemble des effectifs de l'État, le plafond d'emploi de l'État et de ses opérateurs étant de 2,4 millions d'équivalents temps plein travaillés (ETPT). Toutefois, la hausse même modérée des années 2024, 2025 et 2026 risque de compromettre l'atteinte de l'objectif de stabilité de l'emploi inscrit dans la loi de programmation des finances publiques189(*) pour la période 2023-2027.
Évolution des effectifs de l'État et de ses opérateurs en 2024, 2025 et 2026
(en équivalents temps plein ou ETP)
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur général
2. La masse salariale progresse, malgré l'absence de mesures de revalorisation
En 2026, le montant des charges de personnel sur le budget général et les budgets annexes serait de 162,7 milliards d'euros, contre 158,5 milliards d'euros en loi de finances initiale pour 2025. Sur ce montant, 52,5 milliards d'euros correspondent aux contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions » et 110,2 milliards d'euros à la masse salariale190(*).
La masse salariale est en augmentation de 1,2 Md€ d'euros par rapport à celle prévue en loi de finances initiale pour 2025 (soit 109,0 Mds€191(*)). Cette augmentation est inférieure à l'inflation : en euros constants, la masse salariale diminue de 0,2 %.
Le projet de budget prévoit en effet que les ministères excluent toute nouvelle mesure catégorielle192(*). Toute mesure en faveur d'une catégorie de personnel devrait donc être financée à enveloppe globale fixe.
La hausse de la masse salariale n'est nourrie que par l'impact sur 2025 des recrutements réalisés en 2024 ou en 2025 (schémas d'emplois), par la mise en oeuvre (notamment l'exécution en année pleine) de mesures catégorielles décidées antérieurement et par les effets du glissement vieillesse-technicité (GVT).
Facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025
(en milliards d'euros)
GVT : glissement vieillesse-technicité. Budget général et budgets annexes.
Source : commission des finances, à partir des réponses au questionnaire du rapporteur général
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DE M. ROLAND LESCURE, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE, ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE, ET MME AMÉLIE DE MONTCHALIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS (15 OCTOBRE 2025)
Réunie le mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics, sur le projet de loi de finances pour 2026.
M. Claude Raynal, président. - Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics, qui, tout juste renommés dans leurs fonctions dimanche, viennent nous présenter le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, délibéré hier matin en conseil des ministres. Je vous souhaite à l'un comme à l'autre la bienvenue et vous adresse tous mes voeux de réussite dans cette période qui, nous le savons, ne sera pas de tout repos.
L'objectif est ambitieux : faire adopter par le Parlement un budget pour la France d'ici au 31 décembre en répondant non seulement aux exigences de maîtrise des déficits et de la dette publique, mais aussi à la demande forte des Français d'une juste imposition des revenus et des patrimoines. Il vous faudra également rassurer face à l'incertitude pesant actuellement sur l'investissement des entreprises et sur la consommation des ménages.
Vous devrez donc trouver la bonne formule, laquelle, me semble-t-il, ne figure pas encore dans ce projet de loi de finances, tel qu'il a été transmis au Parlement. Et comment le pourrait-elle, alors que les grandes orientations budgétaires et fiscales ont, finalement, si peu varié depuis leur présentation en juillet par l'ancien Premier ministre François Bayrou ? Le Premier ministre actuel l'a reconnu en affirmant ceci : « nous savons déjà qu'à la fin, cela ne sera pas le budget Lecornu » ; « le budget qui sera voté ne sera pas le budget initial du Gouvernement ». Je ne peux que vous le confirmer...
Autant avais-je déploré, l'an dernier, un budget préparé à la va-vite, autant, cette année, la couleur était-elle annoncée depuis quelques semaines. Il est donc d'autant plus regrettable que ce budget soit transmis au Parlement au dernier jour permettant de l'adopter dans les délais constitutionnels, soit une semaine après le délai limite prévu par la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), à savoir le premier mardi d'octobre.
Selon le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dont le président vient de nous présenter l'avis, le scénario macroéconomique pour 2026 repose sur des hypothèses optimistes compte tenu de l'orientation plus restrictive des finances publiques, qui pèserait davantage à court terme sur l'activité, et repose sur une hypothèse de reprise de la demande intérieure volontariste au regard, précisément, de ce contexte d'incertitude.
Monsieur le ministre, madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur cette rétroaction entre mesures d'économies, qu'il s'agisse de hausses d'impôts ou de coupes dans les dépenses, d'une part, et dynamisme de l'activité économique, d'autre part ? Dans le détail des recettes et des économies, dans quelle mesure votre budget et ses mesures nouvelles répondent-ils à l'objectif de produire davantage que défend, à en croire sa déclaration de politique générale, M. le Premier ministre ?
M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. - La période que nous traversons a usé les mots, jusqu'à parfois les vider de leur sens. Je pèse chacun des miens ; ils m'engagent. L'instabilité de notre situation politique rend plus pressante encore notre responsabilité d'assurer stabilité, visibilité et confiance aux Français, aux ménages, aux entreprises, aux investisseurs.
Cela suppose, ce qui est un bon début, de doter la France d'un budget pour 2026. Cette exigence de responsabilité est collective. Notre premier devoir était de déposer ce projet de budget dans le respect des délais prévus par la Constitution. Nous sommes aujourd'hui dans les temps pour que les soixante-dix jours du débat parlementaire puissent avoir lieu.
Ce projet de budget est le fruit d'un travail de longue haleine. Je vous remercie, madame la ministre, pour le travail exceptionnel que vous avez accompli depuis que vous avez été nommée, le 23 décembre dernier. Je souhaite aussi saluer l'action exemplaire des agents de nos ministères, qui ont oeuvré sans relâche à la préparation du texte que nous vous présentons aujourd'hui, malgré les soubresauts du calendrier politique.
Ce budget tend à définir un point d'équilibre possible, sans exclure que d'autres soient envisageables. Il constitue un point de départ, et non le point d'arrivée. S'ouvre donc le chapitre des discussions parlementaires. Le Premier ministre l'a dit, nous serons à l'écoute de vos propositions. En outre, il s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution pendant les débats. Nous sommes donc tous garants de l'aboutissement d'un compromis si nous voulons doter la France d'un budget pour 2026.
Toutefois, concession ne veut pas dire déraison. Justice fiscale ne veut pas dire surenchère fiscale. Le compromis politique que nous atteindrons ne fera pas de lui-même disparaître notre dette. Je serai donc intraitable sur notre trajectoire budgétaire.
Nous conserverons l'objectif d'un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2029. Ce n'est pas pour faire plaisir à Bruxelles. Jeudi et vendredi, à Luxembourg, mes collègues européens m'ont dit leur préoccupation quant à la situation française, mais ils soutiennent nos efforts de redressement et nous font confiance. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir aux marchés financiers, même si cela est important pour notre souveraineté. Cependant, un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2029 permettra de stabiliser notre dette, alors même que notre objectif à toutes et à tous doit être sa décrue.
Voici donc la vision que je défendrai sans relâche : adopter un budget qui mette un coup d'arrêt à la hausse de la dette et rétablisse nos comptes publics, en préservant la croissance, l'emploi et la transition écologique, impératif absolu, avec un effort équitablement réparti.
Il y va de la pérennité de nos services publics comme de celle de notre modèle social. Il y va de la préservation de notre souveraineté et de la crédibilité de la signature de la France et de nos engagements envers nos partenaires européens et internationaux. Il y va de notre responsabilité face aux générations futures. Je connais bien le Sénat, puisque cela fait huit ans que nous oeuvrons ensemble, et sais que cette notion de responsabilité est inhérente à la manière dont vous travaillez.
Pierre Moscovici vous a dit que ce budget relève un peu d'une construction parfaite, d'un plan d'architecte, mais c'est vous qui en serez les bâtisseurs. Et afin de partager cette responsabilité commune et que nous soyons au même niveau d'informations, Amélie de Montchalin et moi-même vous transmettrons régulièrement des éléments sur les conséquences des dispositions qui auront été votées en commission comme en séance, en dépenses, en recettes et en déficit. Certes, certains amendements ne pourront être chiffrés en temps réel, mais ces estimations permettront d'éclairer vos débats. Elles devront être notre boussole, le fil d'Ariane des compromis qui émergeront.
En 2025, nous tous, les parlementaires - j'en étais à l'époque -, avons été au rendez-vous en adoptant un budget, avec une cible de déficit à 5,4 % du PIB. À ce stade de l'année, cet objectif est à portée de main. Notre responsabilité consiste à nous assurer que ce chiffre soit tenu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Voilà qui nous change !
M. Roland Lescure, ministre. - Je tiens d'ailleurs à saluer les collectivités territoriales, qui ont accompli des efforts significatifs.
Il ne faut cependant pas nous en tenir à cela : toutes les administrations publiques ont des efforts à faire. Elles ont été au rendez-vous en 2025. Je voudrais saluer ici l'action de mon prédécesseur, Éric Lombard, qui, avec Amélie de Montchalin, a permis de faire voter le budget et d'avoir un pilotage renforcé de nos finances publiques. Nous poursuivrons cet effort de maîtrise de l'exécution du budget et de transparence renforcée auprès des représentants de la nation.
La croissance a résisté, avec un acquis de 0,6 % à l'issue du deuxième trimestre. Compte tenu des prévisions de la Banque de France et de l'Insee d'une croissance de 0,3 % au troisième trimestre, le total pour 2025 devrait atteindre 0,7 %, ce qui est conforme à la prévision du Gouvernement actualisée au printemps, contre 0,2 % en Allemagne. Notre taux de chômage reste stable à 7,5 %, proche de son plus bas niveau depuis quarante ans. La crise inflationniste est définitivement derrière nous, avec une inflation de 1,1 %, contre 2 % en 2024. Ainsi, le pouvoir d'achat des Français progresse de 0,8 % cette année, après 2,6 % en 2024.
Toutefois, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Le contexte international incertain constitue un aléa important pour l'année prochaine. Malgré une lueur d'espoir au Proche-Orient depuis deux jours, la guerre persiste aux portes de l'Europe et le climat d'incertitude internationale affecte notre économie, sans compter les secousses liées aux droits de douane imposées par les États-Unis et aux pressions agressives de la Chine. Cela engendre des comportements plus attentistes de la part des ménages et des entreprises, dont l'investissement a fléchi cette année.
Cela étant, les fondamentaux de notre économie sont sains. Ainsi, pour l'année 2026, nous prévoyons une croissance de 1 %, en légère accélération tirée par la demande domestique, grâce à une inflation maîtrisée de 1,3 %, nettement inférieure à la moyenne européenne. Je vous rappelle que le taux d'épargne atteint 18 % en 2025, soit quatre points de plus qu'avant la crise de la covid, ce qui traduit une inquiétude. La baisse modeste du taux d'épargne que nous prévoyons marque un rétablissement de la confiance. Or les incertitudes politiques génèrent de l'inquiétude économique. Notre capacité à faire voter un budget en temps et en heure sera donc un gage très fort pour les marchés, pour nos partenaires européens et, avant tout, pour nos concitoyens.
Le point faible de notre pays n'est pas son économie, mais ses finances publiques, précisément ses dépenses. Ainsi, notre déficit public est le plus élevé de la zone euro en 2024, le troisième de l'Union européenne après la Roumanie et la Pologne. En 2029, nous serons les derniers de la zone euro, avec la Belgique, à voir notre déficit passer en dessous de 3 % du PIB. Notre dette, à la fin du premier trimestre, s'élevait à 114 % du PIB, la troisième la plus élevée derrière la Grèce et l'Italie. Au cours des deux dernières années, nous avons été dégradés par les principales agences de notation. Le 12 septembre, Fitch a retiré la France de la catégorie des émetteurs de très haute qualité. Nous avons changé de division...
Le coût de notre dette a augmenté significativement et le taux de nos obligations à dix ans dépasse de plus de 80 points de base celui de l'Allemagne, même si, depuis hier, cela va un peu mieux, car les marchés financiers considèrent que la stabilité politique est un gage de stabilité tout court. La charge de la dette de l'ensemble de nos administrations publiques était de 60 milliards d'euros l'année dernière, et atteindra 65 milliards cette année. L'année prochaine, elle approchera les 74 milliards d'euros.
Si ces indicateurs sont inquiétants, ils ne sont pas irrémédiables. Ils nous invitent à une action résolue et immédiate. D'autres avant nous l'ont fait : le Canada et la Suède dans les années 1990 et, plus récemment, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Ce budget nous met sur ce chemin en fixant une trajectoire de redressement ambitieuse, mais atteignable. Nous prévoyons donc une réduction du déficit des administrations publiques à 4,7 % pour 2026 ; notre dette publique atteindra 118 % du PIB, soit deux points de plus que cette année, et le programme de financement de l'État sera de 310 milliards d'euros.
Au regard de tous ces indicateurs et du risque encouru, notre devoir à tous et notre responsabilité, à Amélie de Montchalin et à moi, c'est d'être intraitables sur le respect de notre trajectoire budgétaire. Cet objectif est cohérent avec un retour du déficit sous les 3 % à l'horizon 2029.
Ce budget est d'équité ; il mobilise les plus fortunés. C'est un budget souverain, ce qui est important pour le ministre de l'industrie que j'ai été durant deux ans et demi. Je salue Sébastien Martin, qui m'a rejoint pour être chargé de ce dossier important. L'industrie est la colonne vertébrale de notre souveraineté. C'est la raison pour laquelle nous proposons de poursuivre la baisse des impôts de production. Ainsi, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) baissera de 1,3 milliard d'euros en 2026. Il ne s'agit pas d'un cadeau pour les grands patrons, mais bien d'un investissement dans 300 000 entreprises pourvoyeuses de millions d'emplois partout en France afin de de poursuivre la réindustrialisation de notre pays, parce que l'industrie est le nerf de la guerre.
L'innovation est également au coeur de notre stratégie industrielle depuis des années. Nous avons des ingénieurs et des chercheurs de qualité. J'en profite pour saluer les travaux de Philippe Aghion, qui a reçu avant-hier le prix Nobel d'économie, sur le rôle crucial des politiques économiques en soutien à l'innovation, qui visent à encourager la recherche et à faciliter l'émergence d'entreprises innovantes. C'est pourquoi les moyens en faveur de la recherche seront accrus. Le crédit d'impôt recherche (CIR), atout clé pour notre compétitivité depuis quarante ans, sera préservé.
Ce budget, enfin, poursuit le verdissement de notre économie. Dans un environnement budgétaire contraint, chaque euro compte : notre maître mot en la matière est l'efficacité, qu'elle soit budgétaire, économique ou environnementale. Nous prévoyons 500 millions d'euros de nouveaux engagements pour la décarbonation de l'industrie et 500 millions d'euros pour la production d'hydrogène décarboné. Nous avons relancé MaPrimeRénov' le 30 septembre dernier et nous la pérennisons, en finançant une partie de son coût par la hausse du volume des certificats d'économie d'énergie. Nous continuons à soutenir la production d'énergie renouvelable, tout en mettant à contribution les installations ayant bénéficié d'un soutien important par le passé.
Le projet de budget que nous vous présentons est responsable dans son ambition de redressement et équitable dans la répartition de l'effort. Il est réaliste, bien qu'ambitieux, dans ses orientations. Ce budget lucide concilie les urgences d'aujourd'hui et les besoins de demain. Je souhaite profondément que le compromis vers lequel nous nous dirigerons préserve ces équilibres. Je serai le garant déterminé de notre impérieux devoir de redresser les finances de ce pays : face à chaque « plus », il nous faudra trouver un « moins ». Ce texte est désormais le vôtre. Discutez-le, critiquez-le, amendez-le et, je l'espère de tout mon coeur, votez-le ! Offrez un budget à la France !
Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. - Politiquement, le moment est nouveau : il est temps d'assumer le fait que nous n'avons pas de majorité absolue et que c'est bien au Parlement d'exercer toutes ses prérogatives, alors que le monde a changé. Pour assurer la stabilité et la prospérité du pays, comme je suis souvent venue vous le dire ces derniers mois, il nous faut trouver un chemin d'efficacité et, surtout, d'humilité.
Nous avons la responsabilité de trouver des solutions, des compromis et, avant tout, un budget pour la nation avant le 31 décembre. Vous aurez, comme en février 2025, beaucoup de pouvoir : celui d'aider le pays à bâtir ce compromis. Nous l'avons fait une fois et nous pouvons, à mon sens, le refaire.
Vous me connaissez : ma méthode a été de vous dire toute la vérité et d'être la plus transparente possible avec vous. Cela a permis de bâtir le compromis du mois de février. Depuis, au travers des comités d'alerte et des auditions - je tiens à remercier M. le président et M. le rapporteur général de nos échanges nourris -, nous avons obtenu ensemble un résultat : celui d'avoir tenu notre cible de déficit pour 2025. De manière assez solide, crédible et réaliste, comme l'a reconnu Pierre Moscovici - mais restons humbles, car il peut encore se passer beaucoup de choses -, le déficit atteint 5,4 % du PIB. Ce n'est ni un miracle ni de la magie, c'est de la méthode : au compromis a succédé, tous les mois, un suivi des recettes et des dépenses par Éric Lombard et moi. Nous avons informé le Parlement des ajustements et décisions en cours. Cela est essentiel à la confiance entre nous et afin de bâtir le compromis suivant.
Ce budget est un projet. Cela tombe bien, car sur tous les documents, il est mentionné : « projet de loi de finances ». Ce n'est donc pas le point d'arrivée. Il s'agit d'une base pour préserver notre souveraineté en réduisant une nouvelle fois notre déficit, tout en ayant bien conscience que ce n'est qu'une étape vers la stabilisation, puis la baisse, de notre dette par rapport à notre PIB. Il manifeste le double engagement de concilier les priorités stratégiques du pays et celles du quotidien des Français.
Ce budget contient des choix forts. D'abord, celui de réinvestir dans notre défense et notre sécurité, avec 6,7 milliards d'euros de plus pour nos armées, 600 millions de hausse pour le ministère de l'intérieur et 200 millions supplémentaires pour le ministère de la justice. Les priorités sont la lutte contre la criminalité organisée, le narcotrafic et l'insécurité.
Nous assumons aussi de poursuivre nos investissements pour l'éducation nationale, en recrutant les jeunes au niveau de la licence et non plus du master, afin de mieux les former. Nous assumons d'investir dans la recherche. Même si les hausses concernées ne sont pas considérables, c'est un choix politique que de poursuivre ce soutien.
Nous assumons, enfin, de continuer notre appui à la transition écologique et énergétique, ainsi que le fait de regarder en face le coût du vieillissement, qui va nous amener à augmenter nos dépenses de santé et d'autonomie de 5 milliards d'euros l'année prochaine.
Dans cette optique, il nous faut cependant retrouver des marges de manoeuvre, ce que nous assumons également. Bien loin d'un rabot généralisé, nous avons fait des choix. Ainsi, chaque ministre pourra vous indiquer où se trouvent les augmentations et réductions de moyens. Il ne s'agit pas de faire des calculs arithmétiques boutiquiers, mais bien de remettre les politiques publiques au centre des arbitrages, même si les choix sont parfois difficiles. Cela amène à une baisse des crédits des ministères hors défense, ainsi qu'une diminution des dépenses de fonctionnement en valeur hors ministères régaliens avec, par exemple, 20 % de moins sur les dépenses de communication. Une partie de la baisse des crédits concerne la lutte contre la fraude, en particulier s'agissant du compte personnel de formation (CPF).
Sur la sécurité sociale, notre choix est de stabiliser le poids de notre dépense de santé dans le PIB, qui a augmenté d'un point depuis la période du covid et augmente cette année encore. Cette part s'accroît en raison de la forte dynamique des médicaments, ainsi que de la croissance de 6 % sur un an des arrêts maladie et des indemnités journalières, aboutissant à une progression de plus de 25 % en quelques années.
Nous devons encore travailler sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais là aussi, nous cherchons à maîtriser nos dépenses. Sur les retraites et les prestations, nous avons fait le choix de ne pas procéder à une revalorisation au niveau de l'inflation, qui serait de 1,3 % l'année prochaine. Toutefois, pour les retraites, la seule démographie, avec 330 000 retraités de plus, décès compris, entraînera des dépenses supplémentaires de 6 milliards d'euros. Il nous faut assumer nos obligations vis-à-vis des générations qui arrivent à la retraite, mais aussi tenir compte du coût de ce virage démographique.
Là où l'État, hors défense, s'impose une stabilité des dépenses en valeur, ou « zéro valeur », nous proposons que les dépenses de fonctionnement des collectivités augmentent de 2,4 milliards d'euros, tandis que leurs recettes s'accroîtraient de 4,2 milliards d'euros. La différence, à peu près 2 milliards d'euros, serait consacrée aux investissements ou à l'épargne. La croissance des dépenses de fonctionnement sera certes limitée à l'inflation, donc à un niveau moindre qu'au cours des années précédentes, mais elle existe. Il n'y a donc pas de saignée, c'est-à-dire une baisse nette.
Nous faisons également un effort de simplification des normes. Vous m'avez souvent interrogée sur le décret « tertiaire » ou sur des normes qui créent des dépenses contraintes. Pour une valorisation d'environ 1,6 milliard d'euros, nous souhaitons réviser un certain nombre de normes, non pas pour ignorer nos objectifs, mais pour simplifier la manière, par exemple, de rénover les bâtiments publics et les écoles. Aujourd'hui, les surcoûts liés à l'excès de normes découragent les maires de s'engager dans ces grands projets nécessaires.
Enfin, sur la fiscalité, nous aurons ensemble de très nombreux débats, dans la plus grande transparence possible. Nous pourrons nous retrouver sur quatre sujets.
Premièrement, nous voulons mettre fin à la dérive liée au maniement par certains contribuables des holdings : le détournement d'une fiscalité pensée pour le monde de l'entreprise afin de se constituer un patrimoine personnel. Pour ce dernier, la fiscalité est connue : le plan d'épargne en actions (PEA), l'assurance vie et le prélèvement forfaitaire unique (PFU). Nous proposons donc de taxer les actifs de holdings non investis dans les PME européennes, dans des entreprises ou au service de l'innovation.
Deuxièmement, nous pourrions nous rassembler autour de la taxe sur les petits colis. Il est en effet inacceptable que les commerces de toute la France soient confrontés à une concurrence très déloyale due à l'inondation de biens produits dans des circonstances sociales et environnementales très dégradées et qui, par ailleurs, sont à 80 % des produits non conformes, que ce soit en matière de sécurité ou de qualité, ou encore parce qu'il s'agit de contrefaçons.
Troisièmement, sur les niches fiscales et sociales, nos propositions ne sont que le strict reflet de vingt ans de rapports parlementaires, de la Cour des comptes ou du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) sur des dispositifs obsolètes ou mal ciblés. Nous aurons ces débats.
Quatrièmement, nous entendons lutter activement contre la fraude, notamment sociale, en musclant notre arsenal juridique.
En conclusion, ce budget prévoit un déficit de 4,7 % du PIB. Il tend à définir un choix pour réconcilier nos besoins et nos moyens, les contraintes d'aujourd'hui et la protection de demain et des générations futures, et chercher une forme d'équité entre les générations, entre les secteurs et entre les acteurs publics. C'est un projet : une fois ce cadre posé, les équilibres comme la manière de faire peuvent changer. Vous me trouverez au banc pour accompagner ce qui sera un moment de compromis.
Nous aurons donc des débats sur le pouvoir d'achat, sur les entreprises, sur la fiscalité, sur les services publics, sur la transition écologique. Désormais également en charge de la fonction publique, je m'engagerai résolument pour qu'il y ait, en porte-étendard de nos décisions, non pas des slogans, mais bien une vision claire des conséquences de ce que nous bâtissons ensemble.
Nous devons tout faire pour que les Français retrouvent de la stabilité, pour leur donner un budget. Nous devons le faire avec la détermination et le sens collectif que nous leur devons.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Madame la ministre, monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission, qui adore travailler et débattre. Il est heureux que vous souhaitiez le faire, mais cela n'est ni plus ni moins que la norme : le Gouvernement propose, nous débattons et nous votons : nous n'allons pas inventer l'eau tiède !
Comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, la réalité des faits, c'est le déficit fort préoccupant de nos comptes publics. Les comptes sont à la dérive : qui les assume et quelles en sont les raisons ? Nous avons conduit une mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Vos réponses permettront un débat plus serein, indispensable à tout compromis.
La France a changé de division, dites-vous : en termes sportifs, cela s'appelle une relégation ! Quant à l'image de la France, il est certes agréable que des Français aient obtenu deux prix Nobel, mais si un prix devait concerner les comptes publics, nous ne pourrions que le voir passer...
Ma circonspection est grandissante sur la « méthode Macron » : baisser les impôts de production et l'imposition des sociétés, celle des hauts patrimoines et celle des ménages pour constater, quelques années plus tard, que faute de mesures d'économies simultanées, il faut réintroduire des ersatz de ces prélèvements, sous forme de dérogations ou de rustines temporaires, souvent complexes et génératrices de rentes pour ceux qui savent manoeuvrer dans le code général des impôts.
Mettez-vous à la place des entreprises et de nos concitoyens : de quelles visibilité, lisibilité et, surtout, mises en perspectives bénéficient-ils pour leurs décisions stratégiques ? Je m'étonne d'ailleurs du niveau particulièrement élevé des prévisions d'investissement associées au PLF 2026, à rebours de ce que l'on entend dans le monde de l'entreprise.
En réalité, à quoi avons-nous assisté ? À une baisse de l'impôt sur les sociétés avant la mise en place d'une surtaxe exceptionnelle sur celui-ci ; à une trajectoire de baisse de la CVAE, étalée, puis reportée, puis anticipée ; à une suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), suivie de la création d'une taxe sur les holdings patrimoniales ; à une réforme des retraites présentée comme inéluctable, puis suspendue, suspension devant être compensée financièrement, mais sans proposition concrète à ce stade...
Il n'est pas surprenant, dans ce contexte, que les entreprises reportent leurs investissements et que les ménages épargnent 19 % de leur revenu, un niveau jamais atteint. Il manque, de toute évidence, un cap. La feuille de route exposée par le Premier ministre en septembre - « certains impôts augmenteront, mais d'autres diminueront » - ne me semble pas aller dans le sens d'une réelle clarification. L'automne arrive, les temps brumeux aussi...
Je m'interroge, premièrement, sur ce projet de budget qui comporte quatre-vingts articles, soit 70 % de plus que dans le PLF 2023 et trois fois plus d'articles fiscaux qu'alors. Cela donne à réfléchir, l'effort d'équilibre pour l'exercice 2025 ne venant que des recettes fiscales. Or l'on ne cesse de nous répéter que les circonstances sont inédites, que ce gouvernement « de mission » a pour seul objectif de faire adopter un budget et qu'il faudrait pour cela trouver le plus petit dénominateur commun. Par ailleurs, alors que le temps d'examen de ce budget sera particulièrement contraint, n'est-il pas contre-productif de présenter un texte aussi dense ?
Deuxième interrogation : sur 30 milliards d'euros d'effort structurel de réduction du déficit, le HCFP nous dit que 17 milliards d'euros proviennent de baisses de dépenses et que près de 14 milliards d'euros correspondent à de nouvelles hausses d'impôts. Ne faudrait-il pas faire porter davantage l'effort sur la dépense publique qui a, malheureusement, fortement augmenté depuis 2019 ? Le Gouvernement est-il ouvert à davantage de mesures de baisse de dépenses permettant d'alléger cette fichue charge fiscale pesant sur nos concitoyens ?
Par ailleurs, dans sa déclaration d'hier, le Premier ministre a indiqué qu'il ne serait « pas le Premier ministre du dérapage des comptes publics ». Pouvez-vous confirmer que l'objectif du Gouvernement, pour 2026, reste bien un déficit public de 4,7 % du PIB et non de presque 5 % du PIB ? Je rappelle que la France s'était engagée, dans le cadre du plan budgétaire et structurel de moyen terme (PSMT), à atteindre un déficit de 4,6 % du PIB pour l'année qui vient. Surtout, cette cible correspond à la trajectoire que nous nous sommes fixée pour revenir à 3 % en 2029, afin d'éviter une hausse incontrôlée de notre dette publique.
Je rappelle que la loi de programmation des finances publiques, adoptée le 18 décembre 2023, soit il y a moins de deux ans, prévoyait un déficit public à 4,4 % du PIB en 2024, contre 5,8 % réalisé ; pour 2025, 3,7 % contre 5,4 % ; enfin, pour 2026, 3,2 % - bien en dessous de 5 % donc - contre 4,7 % à 5 % prévus actuellement.
Au sein de la commission des finances, nous devons contempler la brutalité incontournable des chiffres, avec laquelle il n'est malheureusement pas possible de faire des compromis. Compte tenu du noeud coulant de la hausse de la charge de la dette, qui pourrait approcher les 110 milliards d'euros en 2029, les choix difficiles que nous refusons de faire aujourd'hui pourraient devenir impossibles demain. Or nous avons un grand besoin de marges de manoeuvre pour investir dans l'innovation, la défense et la transition écologique, sans oublier le domaine régalien. Pouvez-vous donc nous rassurer sur vos intentions ? Prévoyez-vous de mettre à jour le PSMT pour nous dire à quel rythme la cible de 3 % en 2029 sera atteinte, ce qui serait un gage de crédibilité ?
Par ailleurs, sur l'exécution budgétaire en 2025, confirmez-vous l'atteinte de la cible de déficit de 5,4 % cette année ? L'exposé général du PLF indique que la part attribuée à l'État des recettes de TVA diminuerait de 4,5 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale, principalement en raison de la baisse de la croissance des emplois taxables et de la consommation des ménages. Or il n'est pas habituel que la TVA diminue, alors que la croissance est positive.
En outre, chaque mot compte, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre. Or vous avez affirmé que le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ne serait pas utilisé pendant les débats. Le sera-t-il à leur issue ?
M. Roland Lescure, ministre. - Peut-être n'avons-nous pas inventé l'eau tiède, monsieur le rapporteur général, mais l'eau est un peu plus chaude que d'habitude : renoncer à l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution marque un changement de méthode. Bien sûr, nous respecterons la Constitution. Le Premier ministre a mentionné le non-recours pour l'ensemble de la procédure budgétaire. L'obtention d'un résultat dépendra donc de nous tous. Au cours des trois années précédentes, à l'Assemblée nationale, où je siégeais, les votes étaient vus comme étant sans conséquence en raison de l'usage de cet instrument. Cette fois-ci, nous devrons être conscients de l'impact des mesures votées. Voilà une nouveauté.
Qui assume ? Amélie de Montchalin et moi assumons le point où nous sommes aujourd'hui. Depuis 2017, j'ai été président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, ministre de l'industrie et vice-président de l'Assemblée nationale. J'assume le bilan, mais n'oublions pas le positif : chômage au plus bas depuis quarante ans, usines qui rouvrent, crédibilité sans égale de la France, pays le plus attractif d'Europe depuis six ans. Mais j'assume aussi le moins positif, notamment notre situation budgétaire.
Vous avez, tout comme nous, travaillé sur les raisons du déficit : multiples crises, mais aussi erreurs de prévision ayant entaché notre capacité à atteindre les objectifs votés, comme le montrent les écarts observés en 2023 et en 2024. Nous faisons en sorte que cela ne se reproduise pas avec, notamment, le cercle des prévisionnistes, mais aussi des mécanismes d'alerte. Au moins, pour 2025, nous semblons respecter les prévisions. Cela n'implique pas de le faire sur toutes les lignes : ainsi, pour la TVA, nous sommes en dessous, mais pour l'impôt sur les sociétés, nous les dépassons.
Certes, la France a été reléguée, mais il faut viser la remontée. Le Canada était bien plus bas que nous durant les années 1990, mais ils sont revenus en ligue des champions avec une notation AAA. C'est donc possible et nous devons y arriver.
Vous avez eu raison d'insister, monsieur le rapporteur général, sur la lisibilité et la visibilité à moyen terme, pour les entreprises comme pour les ménages. Or nous souhaitons que ces derniers puisent dans leur épargne.
Je serai le garant de nos objectifs pour 2029. Nous sommes là pour mettre en oeuvre la stratégie de moyen terme sur laquelle nous nous sommes engagés auprès de la Commission européenne, et nous devons la tenir. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Bruxelles, même si les ministres des finances de la zone euro ont les mêmes préoccupations que nous. Nous agissons surtout pour nos concitoyens. Afin de stabiliser la dette, nous devons atteindre un déficit inférieur à 3 % du PIB en 2029, et pour donner de la visibilité, il faut lever les incertitudes politiques et s'appuyer sur des prévisions ambitieuses, mais crédibles. C'est le cas : nous sommes en ligne avec le consensus pour l'année prochaine.
Ce budget prévoit un déficit de 4,7 % du PIB. Dans le cadre des débats budgétaires, j'aimerais que devant chaque « plus » l'on retrouve un « moins ». Toutefois, le Premier ministre a affirmé qu'il était essentiel de rester sous les 5 %. On ne peut pas entrer dans une négociation en annonçant que tout est fixé. Par ailleurs, les 5 % ne sont pas un fétiche ; mais si l'on veut atteindre les 3 % en 2029, nous ne pouvons pas trop relever la marche. Nous construisons un escalier dont les marches doivent être égales.
Enfin, au 1er janvier prochain, nous aurons 8 milliards d'euros de dépenses supplémentaires incompressibles, du fait de la charge de la dette. D'ailleurs, la Commission européenne retire cette dernière des mesures de dépense, se concentrant sur les éléments sur lesquels nous avons la main. Pour atteindre une réduction de 17 milliards d'euros, il faut donc faire un effort de 25 milliards d'euros.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. - Votre question principale porte sur nos ambitions en termes d'économies. La France est toujours intéressée par les impôts, la dépense apparaissant plus intangible.
Nous avons fait le choix, tout d'abord, de ne pas faire de rabot. Notre budget, qui n'est qu'un projet, est construit sur le principe du zéro valeur pour les dépenses de l'État hors défense, c'est-à-dire aucune croissance en euros sonnants et trébuchants. Au sein de chaque mission, vous trouverez des économies, mais aussi des hausses de dépenses, le tout aboutissant à des dépenses de fonctionnement et de crédits ministériels en baisse, hors défense.
Pour les collectivités, nous faisons le choix du « zéro volume » pour les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire une hausse limitée à l'inflation, soit un effort réel, mais moindre que celui de l'État.
Quant aux dépenses de santé, nous visons une part de PIB stable. L'effort est donc différencié entre ces trois versants.
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a clairement affirmé que, pour atteindre un déficit à 3 % du PIB en 2029, la France, pendant trois ans, devait avoir une dépense totale stable en volume hors charge de la dette. Ce projet de budget suit cette ligne, puisque la dépense totale, en volume, augmente de 0,3 %, tandis que notre dépense totale primaire, c'est-à-dire hors charge de la dette, évolue de 0 % en volume. C'est assez inédit.
Bien évidemment, la croissance ne peut qu'aider, de même qu'une reprise de l'activité. Mais cette proposition est intéressante et éloignée de ce qu'ont fait la Grèce, l'Italie et l'Espagne sous les ordres de la troïka avec, par exemple, une baisse des retraites en valeur. Nous, nous les stabilisons, en assumant que les nouveaux retraités ne subissent pas de baisse de pension par rapport aux anciens. La hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités devrait atteindre 1,1 %, contre 1,7 % pour leurs recettes. Ce n'est pas du tout ce que la troïka proposait pour les collectivités portugaises...
Sur la fiscalité, j'assume notre choix d'une hausse du taux de prélèvements obligatoires à 43,9 % du PIB. Et nous assumons sa concentration sur les grandes entreprises, les plus fortunés, les holdings et les niches fiscales bénéficiant aux ménages les plus aisés. Cependant, ce taux reste inférieur aux 44 % enregistrés en 2019. Le déficit était alors inférieur à 3 % du PIB et la sécurité sociale à l'équilibre. Par conséquent, nous devons aboutir à une réduction des dépenses, que nous avons enclenchée. Ainsi, en 2025, les dépenses publiques représentaient 56,8 % du PIB, contre 56,4 % prévus pour 2026. La part des dépenses dans le PIB diminue alors et celle de la fiscalité augmente, tout en restant inférieure au niveau de 2019.
Pourquoi tant d'articles, monsieur le rapporteur général ? Pour bâtir un compromis, il faut être clairs, avec des études d'impact et des textes. Habituellement, un projet de loi comporte quatre-vingts articles une fois adopté, dont seulement vingt étaient présents dans le texte initial, le reste étant adopté par des amendements, parfois déposés par un ami député ou sénateur... Si l'on croit à la transparence et aux pouvoirs du Parlement, sans usage de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, ni au début, ni au milieu, ni à la fin de l'examen du texte, nous vous devons un travail sérieux et des articles amendables.
Bien des mesures sont d'ailleurs le fruit de vos travaux, ainsi que de ceux du CPO ou de la Cour des comptes, remontant parfois à des décennies. Les rapports s'empilent, sans que nous en tirions les conséquences : je serai, au banc, ouverte à transcrire leurs recommandations dans le PLF.
Enfin, j'ai lancé une mission afin de comprendre l'origine du décalage, qui semble désormais structurel, entre croissance et TVA. L'on a d'abord pensé à un problème d'élasticité, puis aux exportations... Désormais, nous devons examiner la question de la fraude ou des franchises de TVA. J'ai demandé à mes équipes une vision plus transversale et créative. Je présenterai les résultats de ces travaux et, surtout, j'espère pouvoir proposer des solutions. Par ailleurs, si nous sommes en dessous de la prévision pour la TVA, nous la dépassons dans d'autres domaines. Ainsi, le caractère crédible et réaliste de nos prévisions, selon le HCFP, montre que nous avons été sérieux et méthodiques. Nous continuerons, parce que nous vous le devons.
M. Vincent Delahaye. - Vous avez mentionné les travaux parlementaires. Je signale que, en juillet, j'ai présenté le rapport intitulé L'aide médicale de l'État, une réforme nécessaire.
Sur les recettes, il nous a été promis le détail des prévisions sur la TVA. J'espère qu'il en sera de même pour l'impôt sur le revenu. En effet, les recettes de ce dernier devraient augmenter de 9 milliards d'euros en 2026, à quoi s'ajouteraient 12 milliards d'euros supplémentaires pour la TVA. Je trouve ces hausses, de plus de 10 %, très optimistes.
Quant aux dépenses du budget général de l'État, elles augmentent de 13,5 milliards d'euros, soit 3,1 %, le triple de l'inflation, quand les collectivités sont limitées à une fois... En outre, le personnel employé par l'État augmenterait de 8 800 postes, pour une diminution totale de 3 700 postes, sécurité sociale incluse, soit 10 000 postes économisés sur celle-ci. Pourriez-vous nous le confirmer ?
Enfin, quel est le détail de l'effort demandé aux collectivités territoriales ? Atteint-il 2 milliards d'euros ou 5 milliards d'euros ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Hier, le Premier ministre a évoqué un nouvel acte de la décentralisation, disant qu'il ne faut pas décentraliser des compétences, mais des responsabilités, avec des moyens budgétaires et fiscaux, ainsi que des libertés, y compris normatives. Si c'est bien le cas, vous trouverez au sein du groupe Les Indépendants - République et Territoires des alliés fidèles. Mais quel est le sens, alors, des coupes dans les budgets de nos collectivités à travers ce projet de loi de finances ? La suppression d'un échelon serait-elle à l'ordre du jour ?
Ensuite, sur les holdings patrimoniales, ne risquons-nous pas de briser l'élan d'acculturation des business angels dans notre pays, ainsi que du financement des start-up et des petites entreprises ?
Enfin, notre groupe émet un satisfecit sur la mesure tendant à taxer les petits colis, qui reprend un amendement de Pierre Jean Rochette et moi-même déjà adopté par le Sénat.
Mme Christine Lavarde. - Nous souscrivons à votre constat sur l'économie, monsieur le ministre. Cependant, il appelle à un véritable sursaut. Or il ne nous semble pas que revenir sur la réforme des retraites soit un acte responsable.
Par ailleurs, vous vous déclarez satisfait du niveau du chômage, alors que nous enregistrons 6 400 dépôts de bilan d'entreprise en septembre, ce qui est un record.
Madame de Montchalin, vous avez déclaré, le 16 juin dernier, devant cette commission : « D'aucuns diront qu'il nous faut des recettes ; d'autres, dont je suis, estiment que l'on pourrait commencer par réduire la hausse de la dépense. » Or, compte tenu du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), des dépenses liées à la défense et de la charge de la dette, nous relevons une hausse des dépenses de l'État sur le périmètre du budget général et du prélèvement sur recettes au profit des collectivités. Pour trouver la baisse annoncée, il faut inclure les comptes spéciaux et les budgets annexes, pour aboutir à une réduction des crédits. Nous n'avons donc pas la même lecture que vous sur le budget de l'État...
Sur le sujet des agences, il nous manque le « jaune opérateurs ». Cela étant, après un examen rapide des plus grosses agences, je ne retrouve pas les baisses de dépenses promises. Si j'approuve votre action sur le budget de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), tendant à le rendre plus transparent, je n'identifie pas de baisse de la dépense. Et il est désobligeant pour des parlementaires de lire que le budget d'intervention sera déterminé en décembre par le conseil d'administration...
Enfin, sur un plan technique, le 16 juin dernier, vous vous disiez favorable au fait de ne plus parler en points de PIB, par souci de transparence. Or c'est toujours le cas, la dépense étant la seule donnée macroéconomique libellée en milliards d'euros.
J'émets toutefois un satisfecit aux équipes de la direction du budget : je constate que des amendements, jugés inopérants l'année dernière, sont désormais repris dans le projet de loi de finances, par exemple sur la fiscalité du petit nucléaire...
M. Pierre Barros. - J'espère que les débats sur le projet de loi de finances iront jusqu'au bout. Cependant, la copie initiale annonce la couleur. Même sans utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, restent tout de même ses articles 47 et 34, ainsi que le vote bloqué et la seconde délibération... Si les débats n'aboutissent pas en raison de telles méthodes, vous en serez comptables !
Ce PLF est explosif, notamment pour les collectivités. Par exemple, sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico), vous proposez une ponction plus forte sur les communes, portée à 720 millions d'euros contre 250 millions d'euros l'année dernière, ainsi qu'un abaissement du seuil d'éligibilité. Plus de communes seront donc prélevées, ainsi que tous les EPCI, et les reversements seront lissés sur cinq ans au lieu de trois. Cela servirait à abonder le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic), sans reversement si la croissance des dépenses est supérieure à celle du PIB plus un point, soit 1,7 % pour 2026, ce qui est très ambitieux. Sur ce point, il y aura débat, combat, et chacun votera !
M. Thomas Dossus. - Vos interventions font tomber la fable d'un budget écrit à la craie blanche, auquel nous pourrions tous contribuer... Nos débats seront en fait très cadrés.
Outre l'usage du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, renoncez-vous également aux secondes délibérations, mal vécues au Sénat l'an dernier, et qui ont précédé la chute du gouvernement Barnier ?
Quant à la suspension de la réforme des retraites, dépendra-t-elle d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), conditionnant ainsi l'adoption de celui-ci, ce qui nous poserait problème vu les orientations prises, ou d'un texte de loi, et selon quel calendrier ?
Enfin, le Haut Conseil pour le climat (HCC) a alerté, cet été, sur la sortie de la trajectoire carbone prévue par les accords de Paris. Nous vous avions mis en garde, l'an dernier, sur des réductions portant sur les crédits consacrés à l'écologie. Aujourd'hui, vous annoncez une stabilité de ceux-ci et une division par deux du fonds vert. Dans ces conditions, comment la trajectoire climatique de la France sera-t-elle respectée ? À Bruxelles, des discussions ont même lieu sur une modification des objectifs, c'est-à-dire une annulation de nos engagements, ce qui ne manque pas de nous inquiéter à l'approche d'une COP de Belém qui ne s'annonce guère positive.
M. Didier Rambaud. - Dans mon groupe, le Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), siègent de nombreux élus ultramarins. Je me fais donc leur porte-parole quant à la portée de l'article 7 tendant à réformer le régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer, contre lequel ils sont vent debout. Pour une économie de 350 millions d'euros, la cohésion de ces territoires est en jeu - mes collègues parlent de suicide social, de bombe, d'un projet dangereux.
Par ailleurs, j'approuve le principe de la transformation de l'abattement de 10 % sur les pensions de retraite en un forfait de 2 000 euros par personne. En effet, je ne supporte pas la sacralisation des retraités, qui ne sont pas un monde homogène. En particulier, beaucoup vivent mieux que leurs enfants. Néanmoins, certains, qui touchent des retraites inférieures à 1 700 euros, paieront plus d'impôts. Le forfait devrait aboutir à une économie de 800 millions d'euros. Quel serait le coût s'il était fixé à 2 500 euros ?
M. Thierry Cozic. - Madame la ministre, monsieur le ministre, vous consacrez beaucoup d'énergie à ignorer l'éléphant dans la pièce : la taxation des plus aisés. Initialement, j'ai beaucoup apprécié la nouvelle taxe de 2 % sur le patrimoine des holdings. Mais en Macronie, le diable est dans les détails : en effet, le dispositif tend à exonérer presque toute la fortune détenue dans les holdings. Par exemple, la taxe ne s'appliquerait ni aux titres de participation, comme des actions Hermès, ni aux immeubles utilisés pour une activité, comme les bureaux. Ainsi, comme pour la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, vous avez imaginé tous les moyens de neutraliser son rendement et au moins 90 % de la fortune des milliardaires ne sera pas concernée. Vous avez dit vous inspirer de la taxe sur les holdings en vigueur aux États-Unis depuis 1937, mais vous omettez de préciser que celle-ci ne contient aucune exonération. Pour nous faire avaler la mesure, vous promettez un rendement de 1 milliard d'euros. Mais si l'on suit l'exemple de la contribution sur la production d'électricité dont je viens de parler, le montant atteindrait plutôt quelques centaines de millions d'euros...
En définitive, ce projet de loi de finances comprend vingt-neuf nouvelles mesures fiscales, de la hausse de l'imposition des retraités aux écotaxes. Cependant, aucune ne fait entrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale. Encore une fois, vous restez sourds à la demande de justice fiscale. Pendant les débats, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain veillera à y remédier.
Mme Isabelle Briquet. - Les collectivités sont grandement mises à contribution.
L'article 11 accélère le rythme de suppression de la CVAE, pourtant repoussée à 2030 par la loi de finances pour 2025, une compensation à l'euro près via la TVA étant annoncée. Or la dynamique de celle-ci est à la baisse. Quelles garanties apporterez-vous en matière de compensation ? Cette dernière sera-t-elle territorialisée, pour ne pas pénaliser les territoires industriels ? Surtout, comment justifiez-vous l'aggravation de la dette par des baisses d'impôt non compensées ?
Ensuite, je relève la création du fonds d'investissement pour les territoires (FIT), fusion de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et de la dotation politique de la ville (DPV). C'est l'occasion pour le Gouvernement de réduire le montant total de 200 millions d'euros, soit 12 %, ce qui s'ajoute à la baisse de 150 millions d'euros de 2025.
En outre, ce nouveau dispositif, aux critères d'éligibilité curieux, constitue un second mécanisme d'encadrement des dépenses. Ainsi, en 2026 et en 2027, l'enveloppe par département des communes éligibles à la DETR ne pourra être inférieure à celle de 2025, de même que pour la DPV. Qui, alors, supporte la baisse des dotations ?
Mme Frédérique Espagnac. - En tant que rapporteure spéciale de la mission « Économie », j'associe Thierry Cozic à ma question sur le montant de l'enveloppe allouée au déploiement de la fibre, de 250 millions d'euros, quand la Cour des comptes recommande un minimum de 343 millions d'euros. Comment justifiez-vous cet écart ?
Au-delà de la baisse de la dotation aux collectivités évoquée par Isabelle Briquet, je suis inquiète quant aux critères d'éligibilité. Ainsi, seules les communes et les EPCI ruraux au sens de l'Insee seront éligibles. Beaucoup de communes éligibles à la DETR ne le seront donc pas dans le nouveau dispositif. En outre, les communes n'ont presque plus d'autres aides. Ainsi, dans mon département, le préfet a décidé d'un plafonnement de l'aide aux communes. Je ne vois donc pas comment les communes rurales et de montagne pourront faire face à leurs difficultés. Le groupe socialiste s'opposera fermement à la suppression de la DETR.
Enfin, je reprends les propos de mon collègue sur les outre-mer : ce qui se prépare est une bombe sociale. Nous ne pouvons l'accepter !
Mme Nathalie Goulet. - Nous allons aborder, au Sénat, un « tunnel antifraude », ce qui est une bonne nouvelle. Ainsi, le 5 novembre, sera examiné un texte issu de la commission d'enquête constituée aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, présidée par Raphaël Daubet, et qui contient des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Seront ensuite présentés le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puis le projet de loi de finances.
Madame la ministre, comment tout cela s'organisera-t-il ? Consentirez-vous, s'agissant du texte relatif à la fraude qui sera examiné en première lecture au Sénat, à nous laisser de la latitude, en particulier au vu des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'Assemblée nationale ? Qu'en sera-t-il pour le PLF et le PLFSS ? Il ne faudrait pas que le dispositif destiné à lutter contre la fraude soit par trop morcelé, et donc illisible. Rappelons-nous que le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques...
M. Roland Lescure, ministre. - Madame la sénatrice Lavarde, s'il convient de dresser un constat sans concession et lucide de la situation, il ne faut pas pour autant nier nos atouts. Aujourd'hui, l'économie française ne se porte pas si mal. Au deuxième trimestre 2025, nous avons fait mieux que l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'ensemble de la zone euro, et ce grâce aux entrepreneurs, aux salariés et aux exportateurs. La courbe de nos exportations a commencé à se redresser et nous retrouvons des marges de manoeuvre dans ce secteur.
Aujourd'hui, nous faisons face à de très fortes incertitudes et la pression politique doit diminuer pour que les investissements repartent. Mais, encore une fois, les choses ne vont pas si mal.
Le nombre de défaillances d'entreprises est certes élevé, mais je dois préciser que les chiffres du mois de septembre émanent d'un cabinet de conseil et que ceux de la Banque de France pour la période n'ont pas encore été publiés.
Il est vrai que 67 000 défaillances d'entreprises, c'est considérable ; nous vivons l'heure de vérité du « quoi qu'il en coûte ». Durant la crise de la covid, nous avons évité ces défaillances, qui désormais augmentent. Plus précisément, les chiffres du deuxième trimestre 2025 indiquent une hausse de 2 % sur un an des défaillances, dont un grand nombre concernent des entreprises d'un seul salarié, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs, dont l'activité est très volatile.
J'en viens à la réforme des retraites, que j'ai soutenue. J'ai participé à un gouvernement qui l'a défendue et qui a failli tomber pour cette raison ! Pour autant, sa suspension est le prix du compromis que nous devons faire. Or la culture du compromis, le Sénat l'a davantage que l'Assemblée nationale ; il conviendrait de prendre exemple sur vous... Grâce à ces pas en avant, à ces victoires pour les uns qui sont forcément des défaites pour d'autres, nous disposerons d'un budget d'ici à la fin de l'année, ce qui permettra de rassurer tout le monde et de rendre 2026 lisible pour les entrepreneurs, les investisseurs et nos partenaires européens. Cela en vaut la peine !
S'agissant des impôts de production, malgré toutes les baisses que nous avons décidées, ils sont cinq fois plus importants en France qu'en Allemagne - 3,5 points de PIB contre 0,7 point dans ce pays. C'est énorme ! Pour les investisseurs internationaux, c'est l'un des freins à l'investissement sur le sol français. Bien que nous soyons contraints, nous devrons faire tout ce qui est possible pour les diminuer. Par ailleurs, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un élément moteur pour ces investisseurs, car il permet d'ouvrir des centres de recherche employant des ingénieurs et des chercheurs ; il faut donc le maintenir.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. - Je commencerai mon propos en évoquant les prévisions en matière de TVA et d'impôt sur le revenu. Le projet prévoit des mesures de périmètre sur la TVA, notamment une mesure liée à la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions - un montant de 5 milliards d'euros. Par ailleurs, nos prévisions sont toutes revues dans le détail par le Haut Conseil des finances publiques, présidé par le Premier président de la Cour des comptes, lequel a considéré qu'elles n'étaient pas décorrélées de la croissance prévue, mais que cette dernière était quelque peu élevée. Je le rappelle, la différence entre la prévision du consensus économique et la nôtre est de 0,1 point. Cela signifie que notre modèle de prévision est juste. Par ailleurs, il faut distinguer les données brutes et les données nettes, c'est-à-dire hors dégrèvements, niches fiscales et remboursements. On compare souvent des éléments qui ne sont pas tout à fait comparables.
Concernant les dépenses de l'État, les crédits budgétaires ministériels passent de 326 milliards à 331 milliards d'euros, soit une augmentation de 5 milliards. Le budget du ministère de la défense est en hausse de 6,7 milliards d'euros, et ceux des autres ministères en baisse de 1,5 milliard. Le périmètre des dépenses de l'État, hors charge de la dette, augmente de 10 milliards d'euros.
En d'autres termes, sachant que le budget des armées doit augmenter de presque 7 milliards d'euros et que notre pays doit contribuer au budget européen à hauteur de 5,7 milliards d'euros supplémentaires, on constate, toutes arguties comptables mises à part, une baisse effective des crédits ministériels, hors crédits de la défense, de 1,5 milliard d'euros.
Si l'on excepte l'éducation nationale et la réforme de la formation des enseignants, le nombre des emplois publics est en baisse d'environ 3 000 postes : 2 000 sur le périmètre de l'État et 1 000 sur celui des caisses de sécurité sociale. Les emplois qui relèvent de mon ministère, celui des finances publiques, diminuent également, soit une baisse de 550 effectifs qui fait suite à la réorganisation d'ores et déjà engagée. En tant que ministre de la fonction publique, je considère que comptabiliser le nombre d'emplois comme s'il s'agissait de bâtons n'a aucun sens si l'on n'a pas une vision des politiques publiques, des services publics et de leur organisation.
La hausse de 8 000 emplois que l'on observe inclut donc la réforme du recrutement des enseignants : le fait que nous les recrutions deux ans plus tôt donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Nous avons souhaité, aussi, accompagner les écoles rurales. Pour autant, cette dynamique, que le ministre de l'éducation nationale vous présentera, est maîtrisée.
L'effort de 5 milliards d'euros demandé aux collectivités s'inscrit dans une analyse tendancielle : si l'on conservait les règles fiscales et de dépenses actuelles, les dépenses de fonctionnement augmenteraient à peu près de 6,5 milliards d'euros. Nous proposons que ces dépenses progressent de 2,4 milliards d'euros, ce qui correspond à la hausse de l'inflation. Les dépenses de fonctionnement des collectivités sont donc, dans notre projet de budget, en augmentation de 1,1 %. Quant aux recettes globales des collectivités, elles augmentent de 1,7 %, soit + 4,2 milliards d'euros.
Il s'agit d'un effort certain pour les collectivités, mais celui de l'État est quasiment double en proportion, puisque nous nous astreignons à un zéro valeur - nous ne répercutons ni l'inflation ni la hausse du PIB.
Concernant le Dilico, nous proposons d'instaurer une différenciation lors du reversement aux collectivités afin d'inciter celles-ci à investir davantage. Nous souhaitons valoriser les dépenses d'investissement par rapport à celles de fonctionnement. Vous aurez l'occasion de débattre de ce mécanisme.
Concernant la taxe sur les holdings, sur laquelle m'ont interrogé Mme Paoli-Gagin et M. Cozic, nous ne souhaitons pas vider le dispositif de sa substance. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet : les mécanismes fiscaux à l'oeuvre montrent que notre système permet aujourd'hui, légalement, d'utiliser la fiscalité des entreprises à des fins d'optimisation de la fiscalité sur le patrimoine personnel. Nous souhaitons exclure du champ de la taxe tous les éléments qui correspondent à un investissement productif - le capital-investissement, les PME européennes, etc. Soyez donc rassurée, madame Paoli-Gagin, nous protégeons l'investissement productif.
Nous assumons, monsieur Cozic, de ne pas inclure dans l'assiette de la taxe les titres de participation. Les seules personnes concernées par la non-fiscalisation des titres de participation sont celles qui exercent un contrôle sur l'entreprise. Si j'investis dans l'entreprise Accor alors que mon métier n'a rien à voir avec l'hôtellerie, cet investissement sera considéré non pas comme un titre de participation, mais comme un placement financier, et sera donc taxé. En revanche, si j'investis en tant qu'actionnaire actif dans une entreprise qui est mon outil de travail, alors cet investissement ne sera pas taxé. Il s'agit de distinguer entre l'investissement, par lequel on s'engage dans l'entreprise, et le placement, qui est similaire à celui que nous faisons tous en souscrivant un PEA ou une assurance vie.
Sur le plan immobilier, les bureaux qui servent, au sein d'une holding, aux activités professionnelles ne seront pas taxés. En revanche, un chalet ou un avion qui serait utilisé à des fins personnelles sera taxé. La ligne de partage est claire. Elle l'est tout autant entre la trésorerie qui est utile à l'entreprise, au réinvestissement, et celle qui est destinée à être transmise, dans le cadre du pacte Dutreil par exemple.
Le rendement de cette taxe serait de 1 milliard d'euros ; selon le député Jean-Paul Mattei, qui connaît bien le sujet, ce chiffre serait sous-estimé. Il y aura débat...
Madame Lavarde, 60 % des dépenses de l'État correspondent à des transferts effectués au bénéfice de la sécurité sociale, des collectivités, des entreprises et des ménages. Ces transferts bénéficient donc à l'économie réelle, raison pour laquelle il est difficile de réduire ces dépenses.
Concernant les opérateurs de l'État, nous avions identifié des économies à hauteur de 2 milliards d'euros et une diminution possible de 1 700 équivalents temps plein (ETP). Elles concerneraient l'Agence française de développement (AFD), les chambres de commerce, des parcs nationaux pouvant être fusionnés, l'Institut national de la consommation, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Ce travail a passablement souffert du contexte politique, mais le Premier ministre souhaite reprendre plusieurs desdites propositions.
Nous allons établir le tableau liminaire, en milliards d'euros, et nous vous le transmettrons afin que vous disposiez d'un document lisible.
Concernant le fonds vert et l'écologie, les crédits de paiement (CP) de la mission « Écologie, développement et mobilités durables », hors engagements contractuels liés à la transition écologique et aux contrats d'énergies renouvelables - ces charges augmentent avec les prix de l'énergie, que nous ne contrôlons pas -, augmentent de 0,5 %, et les autorisations d'engagement (AE) de 5,7 % pour atteindre 24,2 milliards d'euros. Par ailleurs, les certificats d'économie d'énergie (C2E) sont en hausse de 2,5 milliards d'euros ; ils devraient atteindre à terme 9,5 milliards d'euros. Nous débattrons de la répartition des dépenses et des crédits. Nous ne sacrifions donc pas nos dépenses « vertes ».
Pour ce qui est du fonds vert, nous tenons compte du cycle électoral - en l'occurrence les élections municipales de 2026. Il en est d'ailleurs de même, à hauteur de 200 millions d'euros, en ce qui concerne les dotations des collectivités que nous fusionnons.
Madame la sénatrice Briquet, la CVAE ne bénéficie plus aux collectivités - certains s'en plaignent, d'ailleurs, en particulier à ma droite... - ; en conséquence, elle n'a pas d'impact sur leurs recettes.
Concernant les outre-mer, je souhaite rappeler quel est le contexte général.
Le budget des outre-mer est de 5 milliards d'euros. Une grande part de ces crédits provient des exonérations prévues dans la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodéom). Les crédits effectifs dépensés dans ces territoires pour l'accès à l'eau, le logement, la cohésion sociale, en bref les politiques publiques, représentent moins de la moitié du budget des outre-mer. À ces 5 milliards d'euros de crédits budgétaires, qui incluent cette compensation pour charges sociales exonérées, il faut ajouter 5,5 milliards d'euros correspondant à des niches fiscales. La proposition que nous faisons dans le projet de loi de finances aurait, sur ces niches fiscales, un impact de 100 millions d'euros en 2026, sur un total de 5,5 milliards d'euros. Par ailleurs, nous proposons une réforme de la Lodéom dont l'impact serait de 350 millions d'euros, sur un total de 1,5 milliard. Vous en débattrez.
Le projet de loi que nous présentons contient aussi des dispositions relatives à la transcription des mesures sur la vie chère outre-mer, à la stratégie quinquennale pour reconstruire et développer Mayotte, aux nouveaux moyens techniques et humains dédiés à la sécurité et à la lutte contre la criminalité organisée ou au soutien exceptionnel à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, nous stabilisons les crédits de paiement en matière de logement, alors même, comme je le disais à l'instant, que le cycle électoral pourrait justifier une baisse.
Avec la ministre des outre-mer, nous sommes prêtes à travailler avec les élus ultramarins, territoire par territoire, car nous considérons que les outre-mer ne sont pas des variables d'ajustement. Pour autant, il convient d'aménager les niches fiscales dont le ciblage n'est pas satisfaisant. Nous mènerons un travail très sérieux à cet égard.
J'en viens à la réforme de l'abattement fiscal des retraités.
Cet abattement représente aujourd'hui 10 % des revenus avec, pour un couple, un plafond de 4 400 euros. La réforme que nous proposons est de nature sociale, car un quart des ménages retraités en seraient bénéficiaires, les gagnants étant les plus modestes d'entre eux. Par ailleurs, 84 % du rendement proviendraient des 20 % de retraités les plus aisés. Cette réforme permettra donc une redistribution.
L'abattement actuel est anti-progressif : plus vos revenus sont élevés, plus vous en bénéficiez. Un abattement forfaitaire, en revanche, bénéficie davantage aux retraités modestes qu'à ceux qui sont aisés. Pour de nombreux ménages, cet abattement sera plus généreux qu'il ne l'est aujourd'hui.
Concernant la fibre, je vais me pencher sur cette différence entre 250 millions et 343 millions d'euros qui a été évoquée, avant de vous répondre...
Madame la sénatrice Goulet, vous aurez toute latitude pour déposer des amendements sur le texte relatif à la fraude. Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas des outils que le Conseil constitutionnel considère comme viables pour ce type de dispositions. Je préconise donc que nous travaillions plutôt dans le cadre du texte sur la fraude, afin de donner une vision globale. Nous sommes prêts à accueillir une grande partie des propositions issues de la commission d'enquête dont vous étiez le rapporteur.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Concernant la taxe sur les petits colis postaux, et au vu de l'ampleur de l'effort que doivent fournir les douanes, pourquoi se limiter à une taxe de 2 euros sur chaque colis expédié ? Quel délai vous donnez-vous pour convaincre la Commission européenne d'instituer des droits de douane sur les colis de moins de 150 euros ?
Pierre Moscovici nous a dit tout à l'heure qu'en 2025 le redressement du déficit avait reposé exclusivement sur les prélèvements obligatoires, lesquels représentent cette année 14 milliards d'euros de l'effort, contre 17 milliards pour les dépenses. Vous engagez-vous à ne pas accepter une dégradation de cette répartition ?
Quelle est la ventilation, entre âge de départ et nombre de trimestres, du coût pour 2026 et 2027 de la suspension de la réforme des retraites ?
Dans le code de la sécurité sociale, à compter de quelle génération l'âge de la retraite sera-t-il fixé à 64 ans ?
Mme Florence Blatrix Contat. - La baisse de 3,3 milliards d'euros des niches fiscales concerne essentiellement les ménages, les étudiants, les retraités, et elle épargne largement les entreprises. Or la commission d'enquête sénatoriale sur les aides aux entreprises a démontré que ces niches coûtaient 43 milliards d'euros et qu'il fallait les rationaliser.
Le Comité d'évaluation des politiques d'innovation (Cnepi) a certes indiqué que le CIR avait des effets positifs pour les PME, mais que ce n'était pas avéré pour les grandes entreprises. Pourquoi n'a-t-on pas cherché à supprimer ce crédit d'impôt dans les cas où il est moins efficient ?
Si la création d'une taxe spécifique sur les emballages non recyclés va dans le bon sens, elle s'accompagne d'une augmentation trop lourde de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur le stockage et la valorisation énergétique. Cette hausse pourrait représenter de 260 millions à 480 millions d'euros supplémentaires d'ici à cinq ans, pour atteindre 1,2 milliard d'euros. Le paradoxe est total : vous prétendez verdir la fiscalité, mais in fine ce sont les collectivités et les contribuables locaux qui supporteront cette charge. Les metteurs sur le marché de produits jetables demeurent largement épargnés. Dans votre projet, à peine 100 millions d'euros issus de la TGAP seraient réaffectés au fonds économie circulaire. Pourquoi le Gouvernement choisit-il, à nouveau, de faire peser le coût de la transition écologique sur les collectivités plutôt que sur les producteurs de déchets ?
Mme Ghislaine Senée. - Je reviens sur le sujet de la taxe Zucman. Les mesures que vous présentez, notamment la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, permettront-elles de « rétablir la balance », alors que la situation actuelle est très défavorable à nos concitoyens ? Pouvez-vous nous assurer que les foyers particulièrement ciblés par la taxe que vous proposez paieront leur impôt à hauteur de leurs capacités financières, comme le dispose l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
J'aimerais partager votre optimisme sur la vitalité des entreprises. Les défaillances sont à un niveau jamais été atteint depuis 2009, à l'époque de la crise des subprimes. Les petites entreprises sont très inquiètes. Or le CIR bénéficie surtout aux grandes entreprises, lesquelles profiteront aussi de la réduction de la surtaxe dite Barnier, quand les PME souffrent de l'inondation de notre marché par les produits chinois. Par ailleurs, les crédits de la mission « Travail et emploi » vont diminuer à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Que comptez-vous faire, de manière très concrète, pour ces PME en très grande difficulté ?
M. Pascal Savoldelli. - Le CIR représente entre 6,6 milliards et 7 milliards d'euros d'argent public. Les cinquante premières entreprises bénéficient de 45 % du bénéfice du dispositif ; les deux cents premières, les deux tiers. Le ruissellement vers l'ensemble des entreprises n'est pas au rendez-vous : il faut corriger cela.
Ghislaine Senée a évoqué les défaillances d'entreprises. La CGT a recensé 300 plans de sauvegarde de l'emploi et estime à 300 000 le nombre d'emplois menacés. Les 13 000 emplois de la métallurgie et les 4 000 de l'industrie chimique ne sont pas des auto-entrepreneurs... Il faut le dire, les 211 milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises ne ruissellent pas !
Vous nous dites que vous n'utiliserez pas le 49.3 - dont acte. Supposons que l'Assemblée nationale adopte de nouvelles recettes. Le Gouvernement s'engage-t-il alors à relever, à la même hauteur, le niveau des dépenses dans le tableau d'équilibre ? Comment ventilerez-vous ces nouveaux crédits ?
Pourquoi ne vous est-il pas venu à l'esprit de toucher au pacte Dutreil ? En cas de transmission d'une entreprise à un héritier ou à un donataire, l'exonération des droits de mutation est de 75 %. Il faut réduire la voilure !
M. Michel Canévet. - Le groupe de l'Union Centriste est attaché au respect de la trajectoire dans laquelle nous sommes engagés en ce qui concerne les comptes publics. Les « pays du Club Med » ont réussi à améliorer significativement leur situation. La France, quant à elle, est parmi les plus mauvais élèves de l'Europe : nous ne pouvons l'accepter.
Pour tenir la trajectoire, différentes mesures peuvent être mises en oeuvre. Nous ne sommes pas opposés à l'instauration de nouvelles formes de taxation dès lors que celles-ci contribuent au développement économique, via une amélioration de la compétitivité de l'économie de notre pays.
Nous demandons qu'un effort soit fait en matière de lutte contre les fraudes de toute nature et l'évitement fiscal. En ce sens, la taxation sur les holdings qui est proposée nous paraît aller dans le bon sens.
Le rendement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, que nous avons adoptée cette année, a été évalué à 8 milliards d'euros. Allons-nous effectivement encaisser cette somme ? Idem pour les 2 milliards d'euros de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Lors les débats sur l'instauration d'une taxe supplémentaire sur les « ultrariches », certain ont imaginé des rendements totalement farfelus. Il faut ramener les choses à leur juste réalité.
M. Bernard Delcros. - Votre budget intègre plusieurs mesures de justice fiscale qui vont dans le sens de ce qu'a défendu le groupe Union Centriste ces dernières années. Nous nous en réjouissons ; elles sont d'ailleurs attendues par nos concitoyens.
Ma première question porte sur les rachats d'actions. Nous avions fait des propositions lors des précédents budgets : la mesure a finalement été mise en place dans le projet de loi de finances pour 2025, via une taxe de 8 % sur ces opérations. Le rendement n'est pas au rendez-vous, car la taxation est assise sur la valeur vénale des actions et non sur leur valeur réelle. Or nous savons qu'il y a un décalage très important - de 1 à 1 000, voire de 1 à 2 000 - entre ces deux valeurs. Quand nous avions mis en avant ce point l'année dernière, vous aviez évoqué une question de compatibilité avec le droit européen. Quelles pistes pourrions-nous suivre pour lever cet obstacle ?
Ma seconde question concerne les collectivités. Si je me réjouis que vous ayez préservé le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), dont l'effet de levier est important, je suis en revanche opposé à la disparition de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) - c'est bien de cela qu'il s'agit. En effet, seront éligibles au nouveau fonds d'investissement pour les territoires des communes rurales, bien sûr, mais également des villes dès lors qu'elles répondent aux critères de population des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Comme son nom l'indique, la DETR était, quant à elle, réservée aux communes rurales. Pour moi, il s'agit donc bel et bien d'une disparition de la DETR. Et je ne parle même pas du montant global, qui passe de 1,6 milliard à 1,4 milliard d'euros... C'est un très mauvais message qui est adressé aux territoires ruraux.
Mme Sylvie Vermeillet. - Ma première question concerne le compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », dont je suis la rapporteure spéciale. Les pensions civiles et militaires représenteront 66 milliards d'euros en 2026 ; le CAS « Pensions » s'élèvera, lui, à un peu plus de 69 milliards d'euros. L'État devra augmenter son taux de contribution employeur, de 78 % à 82,28 %. Comment répartirez-vous les 69 milliards d'euros du CAS « Pensions » ? Uniformément sur l'ensemble des ministères ou en imputant à chaque ministère ce qui relève de ses pensions ?
Ma seconde question concerne les CEE, qui sont abondés de 2,5 milliards d'euros. La Cour des comptes a indiqué, dans un rapport de juillet 2024, que leur reconduction ne pouvait perdurer sans réforme d'ampleur. Le dispositif est coûteux pour des effets difficilement estimables, puisque les économies d'énergie sont surestimées d'au moins 30 % et que la lutte contre la fraude est quasi inexistante. Allez-vous réformer le dispositif ?
M. Roland Lescure, ministre. - Madame la sénatrice Carrère-Gée, je rappellerai que le Premier ministre a parlé hier de suspension, et non d'abrogation. Suspendre, ce n'est pas abroger. Abroger, c'est faire sauter la caisse, et pour longtemps. Suspendre jusqu'à l'élection présidentielle, c'est se donner le temps d'avoir un débat, dans le cadre d'une conférence sociale, sur l'élaboration de réformes alternatives qui permettraient de garantir dans la durée le financement du modèle de retraite par répartition, auquel nous sommes tous attachés.
Je tiens à saluer le Premier ministre, qui a fait cette annonce importante, mais aussi l'ensemble des groupes républicains à l'Assemblée nationale, qui étaient contre la dissolution et qui ont décidé de faire des efforts pour aller les uns vers les autres. Boris Vallaud et Laurent Wauquiez ne sont d'accord sur pas grand-chose ; je les ai pourtant entendus dire hier qu'ils étaient prêts à débattre grâce aux avancées faites par le Gouvernement. Tel est le prix de la stabilité politique.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Mais quel en est le coût ? À partir de quelle génération s'appliqueront les 64 ans ?
M. Roland Lescure, ministre. - Le Premier ministre a évoqué un coût de 400 millions d'euros en 2026 et de 1,8 milliard d'euros en 2027.
Madame la sénatrice Senée, vous avez évoqué la nécessité d'aider les petites et moyennes entreprises, notamment pour faire face à une concurrence internationale très forte. Oui, il faut les aider, et nous l'avons déjà beaucoup fait. Notre pays connaît un niveau historique de créations d'entreprises, et ce depuis quelques années. Mais le libre-échange n'est pas une religion : il s'agit d'un modèle économique qui ne fonctionne que si tout le monde joue le jeu. Nous avons commencé à agir sur ce point, avec la taxe sur les petits colis et la clause de sauvegarde sur l'acier. Cette dernière mesure est une décision européenne très importante, à laquelle j'ai beaucoup oeuvré lorsque j'étais ministre de l'industrie, pour protéger nos aciéries, pour produire de l'acier non seulement made in Europe, mais aussi plus vert - je sais que vous y êtes sensible.
Les bonus automobiles sont aujourd'hui réservés à des véhicules produits en Europe, ce qui était interdit il y a encore trois ans. Nous avons convaincu la Commission européenne qu'il fallait intégrer le bilan carbone de la production automobile. Le leasing social concerne des véhicules produits en Europe. Aujourd'hui, le véhicule électrique le plus vendu en France est la Renault 5 : elle est fabriquée à Douai. Je suis convaincu que l'on peut à la fois faire croître la production et faire décroître les émissions.
Monsieur le sénateur Savoldelli, la France est le pays qui taxe le plus les entreprises et qui les aide le plus. Je remercie votre collègue Fabien Gay pour le travail qu'il a accompli comme rapporteur de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Les aides versées aux entreprises à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros - je ne donnerai pas de chiffre, car les avis sur la question sont partagés - représentent de l'argent public. Nous vous devons la transparence en la matière, et c'est ce que nous ferons dans le cadre des exercices budgétaires à venir.
N'oublions jamais que nous sommes le pays qui taxe le plus et qui aide le plus. Je suis satisfait que la CVAE baisse de 1,5 milliard d'euros, mais, quand on soustrait l'ensemble des aides que nous apportons aux entreprises des taxes qu'elles paient, nous continuons de prélever davantage que partout ailleurs en Europe. De mon point de vue, le CIR est donc un outil extrêmement utile, qu'il faut préserver.
Nous avons créé 130 000 emplois industriels, après en avoir détruit des millions pendant des années. Il faut continuer sur cette lancée. Je ne vais pas crier victoire, mais nous avons au moins stabilisé la situation ; nous ne sommes plus en train de détruire notre appareil productif. Depuis trois ans, nous ouvrons plus d'usines dans notre pays que nous n'en fermons.
Concernant l'impôt sur les sociétés, monsieur le sénateur Canévet, nous aurons « la vérité des prix » sur la surtaxe à la fin de l'année, au moment du dernier acompte. Le montant sera peut-être un peu en dessous de 8 milliards d'euros. Nous disposons des chiffres du premier semestre : ils sont légèrement supérieurs à nos prévisions, notamment du fait de bénéfices plus importants que prévu en 2024.
Monsieur le sénateur Delcros, la taxe sur les rachats d'actions fait partie des taxes qui ont vocation à s'étendre si elles marchent bien. J'ai été investisseur pendant vingt-cinq ans : je déteste les entreprises qui rachètent leurs actions. Avec l'argent gagné, on peut faire mieux qu'améliorer le bénéfice par action. Il est préférable d'augmenter le bénéfice ou les dividendes, de continuer à investir dans l'économie. Soyons clairs, l'objectif de cette taxe est d'aller vers son extinction, parce que nous souhaitons désinciter les entreprises à faire ce type d'opérations. Se pose la question de l'assiette : si vous avez trouvé la pierre philosophale qui consiste à s'éloigner de la valeur vénale en allant vers la valeur de marché, qui est très volatile, nous sommes preneurs...
Mme Amélie de Montchalin, ministre. - Madame Carrère-Gée, concernant les petits colis, nous avons réussi à trouver un accord sur l'union douanière : à partir du 1er janvier 2028, une taxation pourra être appliquée aux colis qui ne sont pas soumis à des droits de douane. Cela nécessitera un travail très important ; nous sommes d'ailleurs candidats pour accueillir l'Autorité douanière de l'Union européenne à Lille.
Pourquoi 2028 ? Quand M. Trump annonce qu'il décide de taxer les importations, les bureaux de poste cessent d'envoyer des colis aux États-Unis tant la mise en place de ces droits de douane est complexe à réaliser en raison de l'énorme volume à traiter.
Par ailleurs, 80 % des biens que nous importons ne sont pas conformes, soit parce qu'ils ne respectent pas les normes de sécurité, soit parce qu'ils sont issus de la contrefaçon, soit parce que leur valeur déclarée n'est pas conforme. Il faut donc mener des contrôles. Deux options se présentent : soit nous utilisons les impôts des honnêtes contribuables pour payer les scanners, les douaniers et la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ; soit nous demandons à ceux qui nous envoient ces biens de payer les contrôles. C'est ce que nous mettons en place avec la redevance sur les petits colis.
La France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se sont coordonnés. Notre objectif est de mettre en oeuvre cette taxe le 1er janvier 2026 ; des débats auront donc lieu dans chaque parlement. Mais nous avons surtout obtenu un accord en Conseil Ecofin (affaires économiques et financières) il y a quelques mois pour que l'ensemble des pays européens instituent une taxe de 2 euros par article à partir du 1er novembre 2026. Les colis arrivent massivement en France, en Belgique et aux Pays-Bas : nous sommes inondés de produits, mais nous sommes aussi devenus une plateforme pour toute l'Europe. Si nous sommes les seuls à taxer, les colis arriveront de l'autre côté de la frontière et le problème ne sera en rien résolu.
Le calendrier est donc le suivant : les redevances le 1er novembre 2026, les droits de douane le 1er janvier 2028. Pourquoi ne pas avoir prévu un montant supérieur à 2 euros par article ? Parce que, dans le droit actuel, la taxe doit être proportionnée aux dépenses de contrôle.
Sur les aides aux entreprises, comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances, nous vous devons la transparence. J'irai même plus loin : il faut faire preuve de transparence à l'égard du comité social et économique (CSE). Une loi de 2008, qui n'est toujours pas appliquée, prévoit qu'il n'est pas possible d'avoir accès au guichet d'aides publiques si les minima de branche sont inférieurs au Smic. Il faut mettre cette mesure en oeuvre.
Il faut aussi aller plus loin dans les outils de partage de la valeur : les distributions d'actions gratuites devraient être soumises à des taux minimaux quand elles concernent toute l'entreprise et à des taux majorés quand les dirigeants sont les seuls concernés. Nous devons progresser sur de nombreux sujets - partage de la valeur, intéressement, protection et transparence du dialogue social -, parce que les entreprises touchent des aides ; néanmoins, ces aides sont une contrepartie à des impôts beaucoup trop élevés pour permettre aux entreprises d'être compétitives.
Sur les déchets, votre question concerne l'article 21 du projet de loi de finances. Avant tout, je veux vous faire remarquer, puisque vous êtes les premiers à ne cesser de me demander de la simplification, que cet article en comprend une très importante : la TVA sera désormais de 5,5 % sur toutes les activités de collecte et de traitement des déchets. Auparavant, on comptait soixante-dix catégories, ce qui était totalement illisible et très coûteux pour les collectivités. L'État compensera les éventuelles diminutions de recettes liées à cette baisse de TVA.
La France est le pays ayant les plus mauvais résultats en matière de recyclage du plastique. Elle paie 1,6 milliard d'euros d'amendes à la Commission européenne. Nous ne recyclons que 26 % du plastique, contre 42 % dans le reste de l'Union européenne. Il ne me semble donc pas absurde que l'incinération et la mise en décharge continuent d'être largement désincitées, sinon on ne recycle pas !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'incinération des déchets peut servir à alimenter les réseaux de chaleur.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. - Certes, mais de nombreux incinérateurs ne sont pas branchés à des réseaux de chaleur : il s'agit alors d'une perte sèche.
J'en viens au débat sur la taxe Zucman. Notre proposition permet-elle de lutter contre des abus d'utilisation du droit commercial et fiscal pour se constituer un patrimoine personnel ? Elle constitue, selon moi, un très grand progrès. Permet-elle de taxer les biens professionnels des entrepreneurs ? C'est là le coeur du débat. Notre gouvernement a fait le choix de dire non.
Monsieur le sénateur Savoldelli, j'ai beaucoup aimé votre question ! Vous me demandez si une augmentation des recettes votée par les députés conduirait automatiquement à des dépenses à se répartir. Mais la procédure budgétaire n'est pas faite ainsi. C'est seulement à la fin de vos délibérations que l'on établit le solde. Il n'y a pas de cagnotte !
M. Pascal Savoldelli. C'est bien vous qui arbitrez le tableau d'équilibre !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je n'arbitre pas le tableau d'équilibre : je transpose le résultat de vos débats dans un tableau. Si je pouvais arbitrer, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir recours au 49.3 !
Monsieur Delcros, je vous remercie de votre satisfecit sur le FNADT. En ce qui concerne la DETR, l'article de fusion préserve l'enveloppe pour les communes rurales. Ce sujet nous occupera largement, mais il n'est pas écrit que les communes rurales seront pénalisées par la fusion. J'ai repris une demande que vous aviez formulée depuis des mois. Vous avez en effet tous souhaité que le préfet de département soit l'acteur central et unique, afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des demandes de soutien à des projets de territoire. Nous tenons compte du cycle électoral dans lequel nous nous trouvons ; cette fusion n'est pas un moyen déguisé de réaliser des économies.
Enfin, s'agissant du CAS « Pensions », madame la sénatrice Vermeillet, nous essayons de sortir de la dialectique entre ce qui correspond à l'équivalent d'une cotisation retraite et ce qui est l'équivalent d'une cotisation d'équilibre. C'est la suite du fameux débat lancé par M. Bayrou lorsqu'il était Premier ministre sur le coût caché des retraites. Ce coût caché n'existe pas, mais nous essayons de rendre la discussion plus compréhensible. L'étape suivante consistera à transcrire cela en chiffres. Il faut que nous cessions de faire ce que vous avez décrit, c'est-à-dire de faire monter le taux, ce qui correspond simplement à un ajustement de la subvention d'équilibre. L'année 2026 est donc, à mon sens, une année intermédiaire. Les services se préparent à mettre en place cette réforme structurelle en 2027. Dans l'intervalle, nous conservons le mécanisme actuel, perfectible et peu lisible, qui entraîne de nombreuses polémiques inutiles.
M. Claude Raynal, président. - Je vous remercie pour les premières explications que vous nous avez apportées sur le projet de loi de finances pour 2026.
II. AUDITION DE M. PIERRE MOSCOVICI, PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES (15 OCTOBRE 2025)
Réunie le mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, sur le projet de loi de finances pour 2026.
M. Claude Raynal, président. - Nous recevons ce matin M. Pierre Moscovici, après l'avoir entendu hier en tant que président de la Cour des comptes, cette fois en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), institution budgétaire indépendante placée auprès de la Cour des comptes.
En application de l'article 61 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), le HCFP rend un avis sur les prévisions macroéconomiques qui sous-tendent le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) de l'année, ainsi que sur la cohérence de l'article liminaire au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques. Il se prononce également sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du PLF.
L'exercice de cette mission a de nouveau été quelque peu contrarié en 2025. En janvier dernier, le Haut Conseil a déjà été conduit à publier un avis sur les nouvelles prévisions macroéconomiques et la prévision de finances publiques actualisée du PLF et du PLFSS, dont l'examen parlementaire s'est prolongé, comme vous le savez tous ; et voilà que le PLF pour 2026, dont le Parlement entame l'examen, est déposé en pleine crise gouvernementale.
Monsieur le président, cette situation vous a conduit à vous prononcer, comme à l'accoutumée, dans un temps très court, mais aussi à rappeler, notamment à la presse, que le texte transmis au Parlement « ne pouvait pas être différent » de celui que vous avez examiné. Ce point de vue me semble être celui d'une grande majorité des membres de notre commission.
Comme vous l'avez, de même, opportunément rappelé, les avis du Haut Conseil « sont obligatoires et sont un facteur de constitutionnalité d'un budget ». J'ajoute qu'ils sont très précieux pour juger de la crédibilité des équilibres et trajectoires esquissés par le Gouvernement : l'histoire récente nous apprend qu'elle mérite parfois d'être discutée.
Vous estimez que le scénario macroéconomique pour 2026 « repose sur des hypothèses optimistes », compte tenu de l'« orientation plus restrictive des finances publiques, qui pèserait davantage à court terme sur l'activité ». En parallèle, vous pointez une hypothèse de « reprise de la demande intérieure privée volontariste » au regard du contexte d'incertitude qui pèse sur les investissements.
Si, du point de vue des recettes, la prévision paraît « globalement acceptable », l'évaluation du rendement des mesures nouvelles serait « fragile ». Surtout, la hausse des dépenses publiques paraît « très ambitieuse au regard du passé ». Elle suppose que l'intégralité des mesures évoquées dans la saisine soit mise en oeuvre, ce qui est « peu probable ».
Je vous cède la parole pour présenter en détail l'avis du HCFP et revenir sur ces différents points. Je vous rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat ainsi que sur les comptes du Sénat sur les réseaux sociaux.
M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques. - Notre avis a été rendu le jeudi 9 octobre dernier, dans un contexte effectivement très particulier.
Le Haut Conseil a reçu le 2 octobre, c'est-à-dire dans les temps, à quelques heures près, les prévisions macroéconomiques et de finances publiques du PLF et du PLFSS. Cette saisine était nécessaire pour qu'un budget soit déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, puis examiné par les deux chambres dans les délais fixés par la Constitution.
Or, le 6 octobre, le Gouvernement a démissionné : lorsque le Haut Conseil a examiné ces textes budgétaires, nous n'avions pas de gouvernement. Nous étions donc face à une incertitude majeure quant à leur devenir : y aurait-il ou non un PLF ? Serait-il, oui ou non, celui qui nous avait été adressé ? De facto, ce ne pouvait être que celui-ci. Mais y aurait-il tout simplement un gouvernement ?
Depuis, les discussions entre forces politiques ont commencé. Il semble très hypothétique que les mesures qui sous-tendent ces prévisions soient mises en oeuvre totalement en l'état - c'est un euphémisme. Des modifications substantielles au PLF et au PLFSS ont déjà été évoquées publiquement par M. le Premier ministre.
L'avis rendu par le HCFP est donc hypothétique, ou spéculatif, et ce dès sa publication. Je préside la Cour des comptes depuis maintenant cinq ans, et je n'avais jamais vu un tel cas de figure.
Ce constat me semble assez symptomatique du fonctionnement actuel de nos institutions, mis à mal par la crise politique que nous traversons. Le budget discuté par le Parlement va différer très fortement de la copie soumise au HCFP. C'est en ce sens que nous avons dû mener, en quelque sorte, un exercice « à blanc ».
Pourtant, la consultation du HCFP n'est pas une simple étape formelle. Le Haut Conseil n'émet pas un énième avis dont on pourrait se dispenser : il n'est pas là par hasard. Nous avons tenu à créer cette instance indépendante - j'ai moi-même défendu cette initiative devant le Parlement lorsque j'étais ministre des finances - à la suite de la crise des dettes souveraines. En effet, avec l'ensemble de nos partenaires européens, nous avons alors jugé qu'il était essentiel, pour la France, de disposer d'une institution budgétaire indépendante, chargée de rendre un avis objectif et neutre sur la trajectoire des finances publiques. Un tel avis, qui a fait cruellement défaut à la Grèce en 2008, doit servir de corde de rappel en cas de déviation de la trajectoire.
Dans ce contexte inédit, les membres du Haut Conseil se sont posé une première question. En l'absence de gouvernement et dans l'incertitude totale quant au PLF, fallait-il rendre un avis ? Cette question a été évacuée en quelques secondes : il nous paraissait évident que nous devions prendre nos responsabilités en jouant le rôle institutionnel que nous confient les articles 61 et 62 de la Lolf. Si cette procédure n'avait pas été respectée, le PLF et le PLFSS auraient été entachés d'un risque majeur d'inconstitutionnalité. À tout le moins, l'absence d'avis du HCFP aurait posé un problème très difficile à trancher par le juge constitutionnel, ces documents étant obligatoires et indispensables.
Le mieux pour le pays est de disposer d'un PLF adopté par le conseil des ministres, puis déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait hier, débattu dans les temps par les deux chambres et, si possible, adopté, ce qui suppose un délai de 70 jours. Le HCFP a donc joué son rôle, en remettant son avis sur le PLF comme sur le PLFSS. J'ajoute qu'il a respecté le délai d'une semaine fixé par la loi organique.
Nous nous sommes fondés sur la copie qui nous a été transmise, et sur cette base seulement. C'est d'ailleurs la version qui, à quelques petites modifications près, lesquelles n'affectent pas les équilibres fondamentaux, a été adoptée par le conseil des ministres, puis transmise à l'Assemblée nationale. Néanmoins, nous n'avons pas ignoré le contexte. Ainsi avons-nous souligné les difficultés méthodologiques, les aléas et les incertitudes de l'exercice.
Ces textes budgétaires contiennent un certain nombre d'éléments solides ; d'autres peuvent être qualifiés d'assez robustes ; d'autres encore sont plus hypothétiques.
Les éléments solides sont ceux qui ont trait à l'exercice 2025, lequel, après deux années noires, marquerait une toute première étape, certes limitée, mais réelle, de redressement des comptes publics. Il s'agit là d'une bonne nouvelle, dans un contexte par ailleurs très dégradé : les prévisions économiques et de finances publiques pour l'année 2025 sont dans l'ensemble crédibles. Des aléas restent bien entendu possibles d'ici à la fin de l'année, mais les prévisions actualisées dont nous disposons nous semblent assez équilibrées.
Concernant le scénario économique, les prévisions sont jugées réalistes. Le Gouvernement table sur une croissance de 0,7 % en 2025, chiffre inchangé par rapport à avril dernier. Au regard de l'acquis de croissance pour l'année en cours, qui est de 0,6 % au deuxième trimestre, l'atteinte de cette cible semble crédible. La situation politique provoque certes un surcroît d'incertitude, mais pas au point, selon nous, de remettre en cause le chiffre de la croissance annuelle.
J'en viens aux prévisions d'inflation. La hausse des prix anticipée pour 2025 est de 1,1 %. Cette prévision est abaissée de 0,3 point par rapport à celle d'avril dernier, du fait de la baisse des prix du pétrole et de l'appréciation de l'euro. Jugée à l'origine un peu élevée, elle apparaît maintenant plausible.
Qu'il s'agisse des recettes ou des dépenses, les prévisions relatives aux finances publiques sont, de même, jugées crédibles pour 2025. Comme toujours, des aléas demeurent, mais ces estimations sont cohérentes avec le scénario économique constaté et les informations disponibles à date.
D'après le Gouvernement, les prélèvements obligatoires augmenteraient de 4,1 % en 2025. La prévision a été révisée à la hausse de 2,2 milliards d'euros par rapport à avril dernier, ce qui nous semble réaliste. S'il existe encore des aléas significatifs pour les mois à venir, ils jouent dans les deux sens, en particulier pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). L'écart majeur observé en 2023, puis a fortiori en 2024, ne s'est pas reproduit : à l'évidence, l'ajustement aurait pu être assuré plus tôt.
En parallèle, le Gouvernement anticipe une progression des dépenses publiques de 2,7 % en valeur et de 1,2 % en volume. Cette prévision actualisée semble vraisemblable. Comme la prévision des prélèvements obligatoires, la prévision de dépenses pour 2025 a été légèrement revue à la hausse depuis avril dernier, de l'ordre de 3 milliards d'euros. D'un côté, la dépense de la sphère sociale devrait être un peu plus élevée que prévu, notamment compte tenu de la situation financière très dégradée des hôpitaux. De l'autre, les administrations locales connaissent un ralentissement de leurs dépenses d'investissement plus marqué qu'attendu dans les prévisions antérieures.
Au total, le scénario présenté pour 2025 repose sur un déficit public de 5,4 %, inchangé depuis avril dernier. Ce chiffre semble crédible. Le déficit structurel se réduirait ainsi de 0,7 point du PIB, ce qui est substantiel. Toutefois, j'attire l'attention sur le fait que l'effort structurel proviendrait intégralement de la hausse des prélèvements obligatoires - cette augmentation dépasserait 24 milliards d'euros. À l'inverse, l'effort en dépenses serait nul. Ce constat trahit une fois de plus notre incapacité à agir de manière résolue sur le niveau et la qualité de nos dépenses.
Il y a un an, Michel Barnier certifiait que le PLF pour 2025 assurerait un certain volume de réduction du déficit, composé à 70 % de baisses de dépenses et à 30 % de hausses des prélèvements obligatoires. Le Haut Conseil estimait que ce serait la proportion inverse. Et, in fine, l'effort structurel résulte à 100 % de hausses de prélèvements obligatoires. C'est dire s'il reste à travailler sur les dépenses : je le dis pour l'avenir.
En résumé, les prévisions économiques et budgétaires fournies par le Gouvernement pour 2025 nous paraissent crédibles. De plus, elles marquent un tout début de redressement des comptes publics. C'est un premier pas, certes limité, mais il mérite d'être souligné. En 2025, nous avons inversé la tendance.
J'en viens aux éléments d'analyse que je qualifierai de robustes. Ces derniers relèvent du scénario économique retenu pour l'année 2026, qui repose selon nous sur des hypothèses optimistes.
Certes, l'hypothèse de croissance retenue pour 2026, de 1 % en volume, n'est que très légèrement supérieure à celles des autres prévisionnistes, lesquelles sont en moyenne de 0,9 %. Mais ce scénario nous semble reposer sur un pari favorable.
Ainsi, la croissance serait plus vigoureuse en 2026 qu'en 2025, alors que la conjoncture internationale n'est pas porteuse et que l'ajustement budgétaire serait beaucoup plus important que cette année.
Dans le scénario soumis par le Gouvernement, le budget est plus restrictif. L'effet de frein sur l'activité à court terme doit donc, logiquement, être un peu plus marqué, à cause du net ralentissement de la demande publique en 2026, des effets des hausses de prélèvements et du gel des revalorisations. En théorie, ces éléments devraient se traduire par une estimation de croissance plus faible que le consensus, lequel ne repose pas sur un ajustement budgétaire si important.
En parallèle, le scénario transmis table sur une reprise de la demande privée dont l'ampleur nous paraît quand même assez volontariste.
Je pense en particulier à l'investissement des entreprises, qui rebondirait de plus de 2 % en 2026, selon ces prévisions, contre 1 % au mieux d'après les prévisionnistes. Or les comportements actuels ne permettent pas d'anticiper une telle évolution. Depuis juin 2024, l'investissement des entreprises a reculé de 1,2 %.
Quant à la consommation des ménages, elle rebondirait de 0,9 %, malgré l'absence de gains de pouvoir d'achat. Cette hypothèse suppose une baisse du taux d'épargne, phénomène annoncé depuis des années et qui ne se produit jamais. Une telle baisse est possible, elle est même plausible, le taux d'épargne atteignant désormais le record de 19 %. Mais l'ampleur du reflux de l'épargne risque fort de décevoir, comme par le passé, d'autant que l'instabilité politique accroît, comme toute forme d'incertitude, la frilosité des agents économiques et qu'il n'y a pas de stimulus à attendre du commerce extérieur. La guerre tarifaire et l'appréciation de l'euro vont limiter le rebond des exportations l'an prochain. La contribution du commerce extérieur à la croissance serait ainsi à peu près neutre en 2026.
Au total, ce scénario économique pour 2026 associe un ajustement budgétaire marqué, qui aurait un impact sur la croissance de 0,6 point de PIB, et une accélération de l'activité. Il est, selon le Haut Conseil, plutôt volontariste. Cette hypothèse est favorable, sans être impossible : une telle prévision économique n'est pas hors-sol. L'hypothèse de croissance était de 1,2 point en avril dernier : elle a été abaissée à 1 point. Elle diverge moins du consensus que lors des exercices passés - en 2024, le Gouvernement annonçait ainsi 1,4 % de croissance, alors que le consensus était à 0,8 %. Le Haut Conseil, à l'époque, s'était montré « sympa »...
Quant à la prévision d'inflation, elle est plausible, la prévision de la masse salariale étant un peu élevée.
Enfin, un certain nombre d'éléments sont plus hypothétiques. C'est en ce sens que l'avis du HCFP est un exercice « à blanc ».
Dans ce scénario, le Gouvernement prévoit une réduction du déficit public à 4,7 % du PIB l'an prochain. Ce serait là une baisse notable, de 0,7 point de PIB par rapport à 2025. Toutefois, la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé de nouveaux chiffres, moins ambitieux. Il les a répétés hier, en mentionnant même le chiffre de 5 %. Ce n'est pas la cible figurant dans la copie qui nous a été transmise, ainsi qu'au Parlement, et les moyens permettant de l'atteindre restent encore à préciser. Nous n'avons donc pas pu expertiser ces éléments.
J'en viens à la cohérence interne du scénario sur lequel nous avons été tenus de travailler. En prenant pour base un déficit à 4,7 %, le Haut Conseil émet une première réserve, au regard du caractère un peu volontariste des hypothèses économiques qui sous-tendent cette prévision.
La prévision de croissance dite spontanée des prélèvements obligatoires nous semble globalement acceptable, et même quelque peu prudente par rapport aux hypothèses économiques. En revanche, le Haut Conseil émet des interrogations assez fortes sur les mesures d'économies en dépenses et sur les recettes nouvelles présentées.
À n'en pas douter, des mesures d'économies substantielles sur la dépense figurent dans le projet qui nous a été transmis : une année blanche sur les prestations sociales et les salaires publics ; une baisse des crédits ministériels, exception faite des crédits dédiés à la défense, qui, eux, progresseraient fortement ; un resserrement des transferts de l'État vers les collectivités territoriales ; un paquet d'économies significatif sur l'assurance maladie, notamment avec la hausse des franchises et autres participations des assurés. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour 2026 est un Ondam record : sa progression se limiterait à la moitié de la progression de l'année 2025. Au total, ces efforts représenteraient une économie de l'ordre de 17 milliards d'euros sur les dépenses publiques, par rapport à un scénario stabilisant le poids de la dépense dans le PIB.
Ce projet comprend aussi une hausse assez notable des prélèvements obligatoires en 2026. L'augmentation serait de près de 14 milliards d'euros, avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu, de nouvelles économies sur les allégements généraux, des mesures relatives aux niches fiscales et sociales, la reconduction pour moitié de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et, enfin, une taxe sur les holdings. Le projet inclut aussi une reprise de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), interrompue l'an dernier.
Le quantum de mesures est donc très substantiel. Toutefois - je passe à la cohérence externe -, le Haut Conseil se doit d'émettre de sérieux doutes quant à leur mise en oeuvre.
Tout d'abord, même en retenant l'hypothèse, désormais très théorique, selon laquelle l'ensemble des mesures présentées seraient adoptées et mises en oeuvre, les cibles visées sont tout de même ambitieuses.
Les mesures en recettes ont un rendement parfois difficile à confirmer. Je pense par exemple au gain de 1,5 milliard d'euros escompté d'un nouveau projet de loi de lutte contre la fraude.
Du côté des dépenses, l'évolution prévue est de 0,2 % en volume. L'effort n'est pas inédit, mais il est faible, dans une perspective historique. Or, pour tenir cet objectif, il faudrait non seulement que l'ensemble des économies escomptées soient réellement dégagées, ce qui est tout de même une gageure, mais aussi que la gestion fasse l'objet d'une grande vigilance, ce qui ne fut pas tout à fait le cas ces dernières années.
Surtout, les annonces publiques et les discussions récentes laissent supposer qu'une pleine mise en oeuvre des mesures évoquées est peu probable. En parallèle, des mesures nouvelles, qui ne figurent pas dans le projet soumis au Haut Conseil, sont susceptibles de remettre fortement en cause le scénario présenté. Je pense, bien sûr, à une suspension de la réforme des retraites. Certes, le Premier ministre a annoncé que cette décision serait compensée, mais il faut s'interroger sur son coût net.
En définitive, le Haut Conseil estime que la prévision de solde public qui lui est soumise pour 2026 est fragilisée par un scénario économique volontariste et, surtout, par un risque de sous-réalisation, voire d'absence de réalisation de tout ou partie des mesures de recettes et d'économies affichées.
Les textes budgétaires étant susceptibles d'être profondément remaniés, il me semble important de rappeler quelques messages essentiels que le Haut Conseil adresse, année après année, à l'ensemble des décideurs publics, au nombre desquels les membres de la commission des finances du Sénat.
Le Haut Conseil a pour mission essentielle de s'assurer de la cohérence de la trajectoire budgétaire avec les objectifs que la France s'est elle-même fixés et les engagements qu'elle a pris à l'égard de ses partenaires européens.
Nous avons dévié plusieurs fois de cette trajectoire. Désormais, nous avons reporté à 2029 l'atteinte de l'objectif de 3 % de déficit. En avril dernier, le Haut Conseil identifiait déjà un important écart, qui a conduit au déclenchement du mécanisme de correction.
En soi, l'objectif de 3 % de déficit en 2029 n'est pas monstrueux. La France a le plus haut déficit de la zone euro, à savoir 5,4 %, le déficit moyen y étant de 3,1 %. Nous sommes en procédure de déficit excessif. En outre, je rappelle que le seuil de 3 % de déficit est celui au-delà duquel la courbe de la dette s'inverse.
Pour atteindre cet objectif, pleinement nécessaire pour arrêter l'envolée de notre dette, nous devons mener un effort de redressement dans la durée. À ce titre, l'année 2025 est une première étape. Dans le scénario soumis par le Gouvernement, la marche à franchir serait beaucoup plus haute en 2026. L'effort structurel ne serait pas de 24 milliards d'euros, mais de plus de 30 milliards d'euros, soit 1 point de PIB - 17 milliards d'euros en dépenses et 14 milliards d'euros de recettes additionnelles. À ma connaissance, un tel effort n'a été accompli qu'une fois, pendant l'année 2013.
Or, même dans ce cas, la dette continuerait à croître dans des proportions très préoccupantes. Elle augmenterait de plus de 2,5 points de PIB en 2025 et encore de 2 points en 2026 - ce sont les chiffres du Gouvernement - pour atteindre 118 points de PIB, à condition que les objectifs assez ambitieux fixés par le PLF soient atteints. À défaut, la dette s'aggravera encore.
Par cette dynamique, la France se singularise clairement de ses partenaires. En pourcentage du PIB, sa dette est la troisième de la zone euro, et c'est le seul grand pays dont la dette augmente. Au rythme où nous allons, l'inversion de la courbe avec l'Italie se produira probablement en 2029.
J'ai été commissaire européen de 2014 à 2019. À l'époque, il était presque inimaginable que la dette française dépasse celle de la Belgique, de l'Espagne ou encore du Portugal ; il était invraisemblable que nos taux d'intérêt emprunteurs soient plus élevés que ceux de ces pays et même que ceux de la Grèce. Les spreads avec l'Italie étaient de 80 points de base en juin 2024. Ils sont aujourd'hui d'à peu près zéro. Si nous continuons ainsi, nous risquons fort de payer les taux d'intérêt les plus élevés de la zone euro. D'ailleurs, les taux d'intérêt sur lesquels se fonde le PLF pour 2026 sont de 3,8 %. Ils étaient de 3 % il y a un an.
Il reste beaucoup de chemin à faire pour reprendre le contrôle de nos finances publiques, mais c'est notre devoir d'avancer en ce sens.
À cet égard, il me semble nécessaire de renforcer le rôle du Haut Conseil et d'améliorer les conditions dans lesquelles il est appelé à exercer ses missions. En étant plus exigeants à l'égard du Gouvernement sur ces sujets budgétaires, en renforçant encore nos analyses de soutenabilité de la dette, nous ne ferons qu'accroître l'information du Parlement, d'autant que le Gouvernement sera tenu de présenter des documents plus sérieux. Renforcer le Haut Conseil, c'est renforcer le Parlement.
J'y insiste, nous sommes face à un noeud coulant qui réduit progressivement nos capacités budgétaires. Nous risquons, à l'avenir, de ne pouvoir faire face à un éventuel choc conjoncturel. Notre crédibilité diminue aux yeux de nos partenaires. Le coût de la dette augmente. Pour ce qui concerne nos investissements d'avenir, nos marges de manoeuvre se réduisent, qu'il s'agisse d'écologie - c'est vital -, de sécurité - c'est essentiel -, d'innovation ou de compétitivité - comment pouvons-nous exister sans ces investissements ?
Un État trop endetté est un État impuissant. Désormais, nous devons impérativement inverser la courbe.
M'exprimant pour la dernière fois en cette qualité devant votre commission, je tiens à remercier l'équipe du Haut Conseil, qui, malgré son faible effectif, sait produire en des temps records des analyses remarquables. Je remercie également les membres du Haut Conseil, dont certains sont d'ailleurs nommés par le président du Sénat. Cette instance, extrêmement discrète et mal connue, est à la fois pluraliste et pleinement indépendante. J'espère que ses avis continueront de vous être utiles.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Au nom de la commission, je salue à mon tour le travail du Haut Conseil. Ses analyses à la fois solides et sérieuses, toujours formulées dans des délais très resserrés, sont particulièrement utiles pour éclairer le débat public et notamment les débats parlementaires.
La gravité de la situation n'échappe à personne. Nous devons être à la hauteur des circonstances : aussi, nous ne saurions reporter à demain les mesures qui s'imposent aujourd'hui.
Vous avez qualifié de « sympa » l'avis rendu par le HCFP sur le budget de 2024. Or, lorsque nous nous sommes penchés sur la dérive des comptes publics déplorée en 2024, un haut responsable de l'administration de l'État a déclaré que, du point de vue des prévisions, il s'agissait de « l'année pas de bol »... Notre commission a consacré deux rapports à cet exercice. On a pu qualifier ce travail de sévère, alors qu'il était purement factuel - qu'on les habille ou non, les chiffres sont têtus.
En outre, vous avez évoqué les réductions de dépenses mentionnées pour 2025, avant de relever que l'on aboutit à un effort constitué à 100 % de hausses de la fiscalité. Quant aux hypothèses retenues pour 2026, vous les qualifiez d'optimistes en ajoutant qu'elles vous inspirent de sérieux doutes.
Cette année, le Parlement doit certes jouer un rôle encore plus grand que d'ordinaire dans l'élaboration du budget, mais il ne sera bien sûr pas seul à décider. Il se prononcera aussi sur la base des hypothèses qui lui sont soumises. François Bayrou, alors Premier ministre, avait retenu comme objectif un déficit public de 4,6 %. Hier, Sébastien Lecornu a évoqué une cible de 4,7 %, en tout cas de « moins de 5 % ». L'effort de réduction du déficit, qui ne serait plus dès lors que de 0,4 point, serait diminué de moitié. L'objectif de 3 % de déficit en 2029 ne s'en trouve-t-il pas compromis ? On ne peut pas reporter tous les efforts et toutes les questions après l'élection présidentielle prévue en 2027. L'enjeu, c'est évidemment l'avenir des Français et la place de la France dans le concert européen. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, notre pays reçoit le bonnet d'âne pour l'état de ses comptes publics : je n'en suis ni heureux ni fier.
J'en viens à une question méthodologique, qui n'est pas anecdotique.
La nouvelle présentation des efforts budgétaires retient désormais non pas le tendanciel de hausse des dépenses spontanées, dont on a beaucoup entendu parler, mais la part des dépenses rapportée à la richesse créée chaque année. Cette approche paraît, à certains égards, plus concrète et plus lisible. Quel en est, selon vous, l'intérêt ? D'ailleurs, à la fin du mois d'août dernier, vous avez publié une note méthodologique intitulée « L'Évolution des dépenses publiques « à politique inchangée » », dans laquelle vous montrez qu'il s'agit d'une convention qui, comme toute convention, est discutable.
Dans ce cadre, comment appréciez-vous le choix retenu pour le présent budget, qui affiche une économie d'environ 30 milliards d'euros, alors que l'ancien Premier ministre François Bayrou estimait qu'il eût fallu 44 milliards d'euros d'économies pour être dans la bonne marge ?
M. Vincent Delahaye. - Dans votre rapport, vous évoquez 30 milliards d'euros d'économies structurelles. Auparavant, l'analyse se fondait plutôt sur le tendanciel ; or, les deux approches semblent désormais se mêler, ce qui rend plus difficile le raisonnement.
Le Gouvernement avait indiqué que les hypothèses servant à établir ce tendanciel seraient transmises au Haut Conseil des finances publiques. Cela a-t-il été fait ? La représentation nationale n'en a, à ce jour, pas connaissance ; or j'aimerais pouvoir en disposer.
Il me semble que la majeure partie des 17 milliards d'euros d'économies faites sur les dépenses concerne celles des administrations de sécurité sociale. Quelle part relève du budget de l'État ? Ces économies sont-elles bien documentées ?
Par ailleurs, vous estimez que l'hypothèse de hausse de la masse salariale à 2,3 % est peut-être un peu élevée. Dans le même temps, les prévisions de recettes font apparaître une progression de plus de 9 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu, soit plus de 10 %, et une hausse de la TVA de 12,5 %, représentant plus de 12 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Vous ne qualifiez pas ces prévisions de recettes : pour 2025, vous les jugez crédibles, mais vous ne les qualifiez pas pour 2026. Pourriez-vous préciser votre appréciation devant nous ?
M. Thierry Cozic. - Au regard de la situation politique actuelle, j'ai le sentiment que le projet de loi de finances est déjà caduc.
Le Haut conseil relève que le scénario économique présenté par le Gouvernement repose sur des hypothèses « optimistes » ; je partage cette appréciation.
L'hypothèse de croissance à 1 % est légèrement supérieure à celle qu'a chiffrée le consensus des économistes, qui s'élève à 0,9 % ; compte tenu de l'effort de redressement et de son effet négatif sur l'activité, cette hypothèse me paraît trop élevée. Le Gouvernement estime l'incidence de ses mesures sur l'activité à 0,4 point ; le Haut conseil juge ce chiffre faible ; je souscris à cette analyse.
S'agissant du déficit, la cible affichée à 4,7 %. Or, hier, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a laissé la possibilité d'aller jusqu'à 5 %. Cela me conduit à considérer que l'avis est déjà caduc et que la cible ne tient plus.
Aussi, alors que l'euro a reculé d'environ 0,8 % face au dollar en une semaine, que les trajectoires du plan budgétaire et structurel de moyen terme (PSMT) ne pourront pas être respectées et que les marchés renchérissent le coût de la dette, ce budget est-il de nature à redresser les comptes publics, durablement endommagés par huit années de macronisme ?
M. Pascal Savoldelli. - Nous avons besoin d'un débat argumenté, calme et raisonné. Prétendre, par exemple, que la dissolution - et ce, quoi qu'on en pense - se chiffrerait à 15 milliards d'euros, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), n'est pas sérieux. Les marchés financiers, les plateformes de trading, l'évolution du spread ou des taux d'intérêt n'ont pas à dicter la vie politique.
Le Gouvernement retient l'hypothèse d'un rebond de la consommation populaire. Je suis dubitatif : d'une part, le taux d'épargne, autour de 18 %, n'en est pas le signe ; d'autre part, je ne vois rien sur les salaires, et je constate des gels des retraites, des pensions et des prestations - « année blanche » pour les uns, « année noire » pour les autres. Tenez-vous pour fondée l'hypothèse d'un tel rebond ?
Les holdings ont parfois servi de parade pour contourner l'impôt. Que pensez-vous du rendement de la taxe sur ces structures proposée dans le projet de loi de finances ? Quel est le risque de contournement ?
M. Michel Canévet. - Le Haut Conseil fait apparaître le caractère hypothétique des perspectives qui nous ont été présentées dans le projet de loi de finances.
Le groupe Union Centriste estime nécessaire de respecter les trajectoires pour lesquelles nous nous sommes engagés à Bruxelles et de ramener le déficit à un niveau raisonnable. Deux voies existent : la première serait de faire un effort sur les dépenses. D'où ma question : à combien évaluez-vous l'effort de réduction des dépenses à réaliser en 2026 pour tenir le cap du PSMT ? La deuxième serait de prévoir des recettes supplémentaires. Aussi, quelle est votre appréciation sur une taxe sur les très hauts patrimoines, qui agite une partie de la classe politique, dont le rendement serait, aux dires de certains, de 20 milliards d'euros ? Ce chiffrage vous paraît-il crédible ? Enfin, selon vous, l'instauration d'une telle taxe aurait-elle un effet positif sur le développement économique de la France ? On constate souvent que de nouveaux outils fiscaux rapportent moins qu'attendu et peuvent avoir un effet récessif. Serait-ce le cas ici ?
M. Hervé Maurey. - Peut-on réellement parler d'un « début de redressement des finances publiques », comme vous l'avez fait, alors que la dette a continué d'augmenter en 2025 et que, selon vos propres termes, la France est le seul pays d'Europe où elle progresse encore ? Peut-on également se réjouir d'une amélioration qui tiendrait surtout à une hausse des prélèvements obligatoires, déjà très élevés en France, sans économies avérées ?
Pour 2026, le scénario semble identique : pas moins de 14 milliards d'euros supplémentaires de fiscalité ont été annoncés ; et rien ne prouve que les économies proposées soient tenues, puisqu'elles ne l'ont pas été en 2025. La situation est-elle aussi encourageante que vous le dites ? Sommes-nous incapables de réduire nos dépenses ?
Quel serait, pour 2026, le volume nécessaire d'économies budgétaires pour tenir nos objectifs, et surtout le volume possible et atteignable ?
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Depuis hier, nous savons que la suspension de la réforme des retraites sur l'âge et l'accélération de la réforme Touraine seront intégrées au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Quelle est votre appréciation du montant des dépenses supplémentaires à intégrer ? Il appartiendra, semble-t-il, au Parlement de déterminer les mesures d'économie nécessaire.
M. Bernard Delcros. - Ma question porte sur l'imposition des rachats d'actions instaurée l'an passé : le taux de 8 % demeure largement symbolique, l'assiette étant limitée à la valeur nominale des actions, et non à leur valeur réelle, alors même que l'écart entre les deux peut être considérable. On nous a opposé un impératif de conformité au droit européen. Partagez-vous ce diagnostic ? Existe-t-il, dans le respect du droit, une voie permettant de prendre en compte la valeur réelle des actions pour asseoir plus justement l'imposition ?
M. Pierre Moscovici. - Les questions relatives à la fiscalité des holdings ou à une taxe sur les actions ne relèvent pas de nos attributions et nous ne disposons d'aucune information particulière à leur sujet.
Dès 2024, nos avis avaient relevé le caractère optimiste des hypothèses retenues, qu'il s'agisse de la croissance, des composantes de la demande ou de la trajectoire de déficit : nous n'avons pas donné les félicitations du jury ! Nous aurions pu être plus sévères...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Vous auriez pu ou dû ?
M. Pierre Moscovici. - Je ne suis pas homme à regretter beaucoup : je dirais « pu ». Au cours de ces cinq années, je me suis toujours gardé d'invoquer la notion d'insincérité, dont les conséquences constitutionnelles sont lourdes et qui placerait le Haut Conseil dans une position délicate. Simplement, nous l'avons dit, un écart de 0,6 point, ce n'est vraiment pas bien. Le Haut Conseil fait son office honnêtement.
S'agissant de la méthode, ni la Cour ni le Haut Conseil ne travaillent à partir du tendanciel, qui aboutit à un effort plus élevé, parce qu'il inclut une dégradation implicite du solde structurel - la dépense, à politique inchangée, est supposée augmenter plus vite que la croissance potentielle ; nous fondons nos travaux sur la définition européenne de l'effort structurel. Ainsi, aucun chiffre relatif au tendanciel n'a été transmis au HCFP. Que le Gouvernement revienne, cette année, aux notions européennes nous paraît plus clair et plus conforme aux standards : l'effort présenté s'établit ainsi à environ 30 milliards d'euros.
La question centrale demeure la cohérence du PLF pour 2026 avec les engagements européens de la France : la trajectoire vise un déficit inférieur à 3 % en 2029, avec une étape à 5,4 % en 2025. Le PLF retient 4,7 % pour 2025, proche des 4,6 % envisagés dans le PSMT transmis par le gouvernement de Michel Barnier ; en revanche, un déficit à 5 % marquerait un écart significatif. Au rythme d'un effort annuel de 0,4 à 0,5 point de PIB - les annonces nous conduiraient plutôt à 0,4 en réalité -, le passage sous les 3 % dériverait vers 2031. J'ajoute qu'une année présidentielle - ce sera le cas en 2027 - n'est généralement pas propice à un durcissement de l'ajustement ; l'effort devra être reporté à une autre année. Atteindre le seuil des 3 % en 2029 est incertain, c'est une évidence.
La Commission européenne pourra sans doute - je n'en suis pas le porte-parole - faire preuve d'une petite tolérance, mais celle-ci n'est pas illimitée dès lors qu'elle compromettrait l'atteinte crédible de l'objectif.
Oui, il y a un début d'amélioration de nos finances publiques. Le déficit est passé de 5,8 % à 5,4 %, après des années d'augmentation : il s'agit bel et bien d'une inflexion ; mais elle n'est pas suffisante, si l'on veut être en dessous du seuil des 3 % en 2029. Le rythme de réduction du déficit devra accélérer.
La France est encore loin de stabiliser son ratio de dette sur PIB. L'écart entre les ratios d'endettement de la France et de l'Allemagne dépasse désormais 50 points de PIB, alors que nos niveaux étaient identiques au lancement de l'euro, à savoir 58,9 % pour chaque pays.
La dynamique de la dette est en baisse en Espagne et au Portugal ; elle est proche de la stabilisation en Italie, même si son niveau est plus élevé que le nôtre.
Les conditions d'emprunt public de la France se sont dégradées. La charge de la dette, passée de 35 milliards d'euros en 2021 à 74 milliards l'an prochain, devrait dépasser le budget de l'éducation nationale en 2027, devenant le premier poste budgétaire de la Nation, pour la première fois de l'histoire financière de la Ve République.
Si nous ne faisons pas l'effort nécessaire, nous serons incapables de maîtriser notre dette ; aussi, repousser l'effort à plus tard pour revenir sous le seuil des 3 % est une faute à l'égard des générations futures.
Du côté des recettes, les prévisions d'évolution spontanée fournies par l'administration sont globalement acceptables et parfois prudentes - je pense à la TVA et aux cotisations -, ce qui compense partiellement les prévisions macroéconomiques un peu optimistes. Du côté des dépenses de l'État, l'effort annoncé - environ 6 milliards d'euros d'économies - est partiellement documenté ; il porte notamment sur la masse salariale : près de 3 000 emplois de l'État seraient supprimés, le point d'indice serait gelé et des mesures catégorielles sont envisagées. Ces mesures survivront-elles au débat budgétaire ?
En revanche, l'effort des administrations de sécurité sociale est considérable : fixer l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 1,5 % est sans précédent.
La prévision de consommation des ménages pour 2026, établie à + 0,9 % contre + 0,5 % en 2025, suppose un repli du taux d'épargne de 0,6 point, de 18,4 % à 17,8 %, en l'absence de gain de pouvoir d'achat net. Cette hypothèse nous paraît favorable, notamment parce que le gel des prestations sociales a sans doute un impact négatif sur la consommation.
À l'inverse, la prévision d'investissement apparaît élevée. L'effort de réduction des dépenses publiques prévu pour 2026 serait de 0,6 point de PIB, soit environ 17 milliards d'euros. J'y insiste : la copie qui vous est présentée témoigne incontestablement d'un progrès de cohérence interne par rapport aux exercices antérieurs, notamment l'abandon de pratiques consistant à présenter des hausses d'imposition comme des économies, ce que nous avions qualifié d'économies façon Canada Dry l'an dernier.
Reste la question du portage politique et de l'effectivité de ce budget : que subsistera-t-il des propositions initiales à l'issue du débat parlementaire ? C'est une copie très bien réalisée par les administrations dans une période de flottement politique. C'est en ce sens que notre exercice demeure, pour partie, à blanc. Je relève tout de même que l'effort de 0,6 point de PIB est conforme à la règle européenne de dépense primaire nette en situation de déficit excessif.
Enfin, s'agissant des retraites, une suspension - et non une abrogation - jusqu'à l'élection présidentielle aurait, à court terme, un coût de quelques centaines de millions d'euros en 2026 et d'environ 2 milliards d'euros en 2027 - je n'ai pas de raison de mettre en doute les chiffres avancés par le Premier ministre hier. Aujourd'hui, le déficit des régimes de retraite s'établit à 6,6 milliards d'euros. Il resterait globalement à ce niveau jusqu'en 2030, si la réforme était mise en oeuvre. Sans me prononcer sur l'opportunité de cette réforme, j'en rappelle l'effet financier : elle dégagerait d'ici à 2030 environ 10 milliards d'euros. À l'inverse, si la réforme était stoppée, il faudrait trouver 10 milliards d'euros pour éviter que le déficit ne se dégrade vers 17 milliards d'euros en 2030. Au-delà de 2030, nos estimations indiquent une accélération marquée de la dégradation : un déficit proche de 15 milliards d'euros en 2035, puis de 30 milliards d'euros en 2045.
Il subsiste donc, au total, des enjeux d'équilibre du système de retraite et, plus largement, de soutenabilité de nos finances publiques, qui devront être pleinement assurés, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre du débat public - dès à présent et, le cas échéant, lors de la prochaine élection présidentielle.
En somme, deux horizons se dessinent : le court terme, dont l'évaluation rejoint les indications données hier par le Premier ministre, et le long terme, qui engage des choix fondamentaux - choix de société autant que choix financiers. Il appartiendra au législateur de les trancher, d'abord à l'occasion du présent PLF.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre appréciation. Je vous souhaite bon courage pour ce débat budgétaire et je salue le rôle déterminant que le Parlement, et singulièrement le Sénat, est appelé à jouer dans la période particulière que traverse notre vie politique.
M. Claude Raynal, président. - Je vous remercie, monsieur le Premier président, de vos réponses et de l'action menée. Depuis cinq ans, nous avons beaucoup travaillé ensemble ; nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG), sans certitude. En tout état de cause, je salue, à travers vous, l'engagement du Haut Conseil et de la Cour des comptes et vous adresse, à titre personnel, mes voeux les plus sincères pour la suite.
III. TABLE RONDE SUR LES PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES (22 OCTOBRE 2025)
Réunie le mercredi 22 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu MM. Éric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Olivier Redoulès, directeur des études de l'Institut Rexecode et Mme Natacha Valla, présidente du Conseil national de productivité (CNP).
M. Claude Raynal, président. - Mes chers collègues, nous recevons ce matin trois économistes - que notre commission a déjà eu le plaisir d'entendre par le passé - pour la traditionnelle audition sur les perspectives de l'économie française et la situation des finances publiques, alors que nous débutons l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
Nous aurons donc le loisir de poser toutes nos questions à Mme Natacha Valla, présidente du Conseil national de productivité (CNP) et spécialiste notamment des questions monétaires ; à M. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), spécialiste également des questions de productivité du travail ; et enfin à M. Olivier Redoulès, directeur des études de l'Institut Rexecode et fin prévisionniste. Un panel complémentaire pour nous aider à appréhender enjeux structurels et conjoncturels, et questionner les hypothèses sous-tendant ce budget, ce dont nous avons bien besoin en cette période d'incertitude.
Nous avons reçu la semaine dernière les ministres de l'économie et des comptes publics ainsi que le président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Ce dernier nous a alertés sur des prévisions optimistes du Gouvernement, s'agissant en premier lieu de la croissance - estimée à 1 % alors que le consensus des économistes la voit plutôt à 0,9 %, en tout cas entre 0,5 % et 1,2 %. Cet optimisme est plus marqué encore s'agissant de l'hypothèse gouvernementale de reprise de l'investissement des entreprises située, en dépit de toute indication crédible en ce sens, à 2,6 %, quand le consensus des économistes de septembre anticipe au maximum une hausse de 2,3 %. Et la prévision moyenne de hausse de l'investissement des entreprises en 2026 s'est encore dégradée de 0,1 point selon le consensus des économistes d'octobre, par rapport aux données de septembre prises en compte par le HCFP, pour atteindre désormais 0,6 %.
Selon les perspectives de l'OFCE, la prévision centrale de croissance pourrait être encore plus basse que le consensus, à 0,7 % en 2026. Dans ce scénario, l'incertitude continuerait de peser sur la croissance à hauteur de 0,3 point en 2026 ; l'investissement des entreprises, non seulement n'augmenterait pas, mais diminuerait même fortement, et le taux d'épargne des ménages ne se réduirait que de façon modérée - alors que le phénomène de « sur-épargne » ne cesse d'interroger les économistes.
Surtout, la consolidation budgétaire aurait un effet potentiellement récessif, chiffré à 0,8 point de PIB dans l'hypothèse - pourtant très prudente - d'un déficit public à 5 % du PIB. Je demanderai à M. Redoulès s'il partage l'analyse de l'OFCE et s'il fait lui aussi de l'impulsion budgétaire un déterminant économique aussi fondamental pour 2026.
Enfin, si les prévisions du Gouvernement sont incertaines, il est une chose qui ne fait guère de doute, c'est le risque d'emballement de la dette publique, à politique inchangée, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt réels. Une analyse récente du Conseil d'analyse économique (CAE) prône, pour stabiliser la dette, de ne pas repousser l'effort, car plus ce dernier est fait tôt, plus sa contribution à la maîtrise de la dette est important, tandis que l'effet récessif d'une consolidation serait de toute façon le même, qu'il soit réalisé aujourd'hui ou demain.
Partagez-vous cet avis ? N'y aurait-il pas un moyen de sortir par le haut, c'est-à-dire par la croissance, de la dérive de nos comptes publics ? Quelle trajectoire faudrait-il emprunter au regard des expériences étrangères sur la dette souveraine - dont voudra je crois nous parler Mme Valla - pour atteindre le solde stabilisant notre dette ou, prenons-nous à rêver, permettant de la diminuer ?
M. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. - Depuis la crise sanitaire, la France a enregistré une croissance cumulée de 5,1 % en cinq ans, soit légèrement en deçà de la moyenne européenne, qui s'est établie à 6 %. Il est à noter que si les pays méditerranéens sous-performaient habituellement, c'est désormais l'Allemagne qui est à la peine dans la mesure où elle a connu la croissance la plus faible, alors que l'Italie et l'Espagne ont enregistré une croissance relativement soutenue.
Malgré toute l'incertitude qui caractérise la période, nous sommes surpris de constater que la croissance résiste. Selon notre indicateur avancé de prévision immédiate (nowcasting), actualisé tous les mardis, la France devrait enregistrer une croissance de 0,2 % à 0,3 % au troisième trimestre : le pays n'est donc pas en récession.
Les réponses des chefs d'entreprise aux questionnaires permettent de constater que les freins ont changé de nature : de 2021 à 2023, il s'agissait de freins d'offre, avec de sérieux problèmes d'approvisionnement et de recrutement, tandis que la demande ne posait aucune difficulté ; à l'inverse, le frein principal tient aujourd'hui à la demande, comme c'était le cas avant 2019.
Ce constat est important si l'on considère les effets multiplicateurs en fonction du cycle économique, car adopter des restrictions lorsque le principal problème vient de la demande peut avoir des conséquences plus fortes sur l'activité. Cela est confirmé par l'étude publiée en octobre par la Banque de France, les industriels et chefs d'entreprise du bâtiment ayant indiqué que le niveau de leurs carnets de commande se situent très nettement en deçà de la moyenne, et même à un point bas rarement observé.
Par ailleurs, le moral des ménages demeure très dégradé et se situe en dessous des niveaux observés au moment de la contestation des « gilets jaunes » et du confinement du printemps 2020, ce qui ne laisse guère augurer une reprise de la consommation alors même que l'incertitude politique atteint des sommets.
Il en résulte un taux d'épargne des ménages très élevé et qui devrait le rester en 2026, même si une légère baisse est à entrevoir : les revenus financiers, la taxe inflationniste et les hausses de taux d'intérêt, qui avaient contribué à le maintenir à un niveau élevé, vont subir une petite pression à la baisse.
En termes de composition, l'épargne était essentiellement immobilière par le passé ; là encore, la situation évolue, l'épargne financière représentant désormais la majeure partie de l'épargne et plus de 10 points du revenu des ménages. Par conséquent, la France est désormais le pays dans lequel le taux d'épargne financière est le plus élevé, alors que cette caractéristique était propre à l'Allemagne précédemment.
S'agissant du marché du travail, un retournement est à l'oeuvre : avant la crise, la productivité des salariés augmentait de 0,9 point par an, avant de s'effondrer de 3 points entre 2020 et 2022 par rapport à 2019 et de 6,5 points par rapport à nos partenaires. Cette spécificité française récente peut être lue de deux manières, soit en évoquant une « perte de productivité », soit en parlant, comme le fait le Gouvernement, d'un « enrichissement de la croissance en emplois ». S'il s'agit du même phénomène, les économistes préfèrent la première formule dans la mesure où la perte de productivité doit être payée par quelqu'un : il s'agit soit des salariés, soit des entreprises, soit des finances publiques.
Néanmoins, un retour des gains de productivité s'observe depuis 2023, le rattrapage étant relativement rapide. L'écart par rapport à 2019 et par rapport à nos partenaires se résorbe donc en partie, mais il faut prêter attention au fait que l'accroissement de la productivité sans croissance économique risque d'aboutir à des destructions d'emplois.
Les marges des entreprises n'ont pas chuté au cours de cette période et se situent 1 point au-dessus du niveau de 2018 - souvent retenue par ailleurs, l'année 2019 n'est peut-être pas l'année de référence la plus pertinente dans ce cas, compte tenu du versement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) qui était alors intervenu concomitamment à une baisse des exonérations sociales des entreprises.
Si certains secteurs ont vu leurs marges reculer, les entreprises n'ont globalement pas eu à payer les pertes de productivité, qui ont été absorbées d'un côté par les salariés, avec une perte sur le salaire mensuel de base évaluée par l'Insee à hauteur de 2,2 points au cours des dernières années et, de l'autre côté, par les finances publiques, avec un déficit qui a connu une hausse, de 3,4 % à environ 6 % du PIB en 2024.
Sur la dernière décennie, nous ne constatons pas un dérapage des dépenses publiques, restées relativement stables puisqu'elles s'établissent à 57,1 % du PIB en 2024 contre 57,3 % du PIB en 2019 : l'apparition des déficits est davantage liée à la diminution des recettes, ramenées de 54 % du PIB à 51,3 % du PIB. C'est donc bien la baisse des prélèvements obligatoires qui explique en partie la dérive des finances publiques.
Certes, les niveaux de dépenses publiques et de recettes restent très élevés par rapport à nos partenaires, ce qui traduit bien un choix collectif français, mais on observe que la dépense publique a progressé en Espagne, au Royaume-Uni, un peu en Allemagne et en Italie, compensée - sauf dans le cas britannique - par une augmentation des prélèvements obligatoires. La France se distingue des autres pays non pas en ce qui concerne le dérapage des dépenses, mais plutôt par ce choix de baisse des recettes.
Les principaux bénéficiaires desdites baisses sont plutôt les ménages sur la période récente, mais il faut rappeler que les prélèvements obligatoires qui pesaient sur eux avaient fortement augmenté entre 2010 et 2017. Les prélèvements obligatoires sur les entreprises, qui se situaient sur un plateau plutôt orienté à la baisse depuis un certain nombre d'années, ont quant à eux légèrement diminué au cours de cette période.
Ces phénomènes se sont produits dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, ce qui m'amène à évoquer l'écart des taux à dix ans sur la dette publique avec l'Allemagne, c'est-à-dire le spread. Globalement, les spreads convergent en Europe, ce que j'aurais tendance à considérer comme une bonne nouvelle. Il est cependant exact que le spread avec l'Allemagne est passé de 0,5 % à 0,8 % depuis la dissolution, l'incertitude politique ayant bien joué un rôle.
Selon nos prévisions, la dette et les charges d'intérêts liés vont augmenter dans la mesure où la diminution des déficits ne suffira pas à stabiliser la dette. Afin de bien situer le débat relatif aux charges d'intérêts de la dette, il convient de préciser que nous n'atteindrons pas des niveaux records : lesdites charges représentent actuellement 2,1 % du PIB, contre 3 % au début des années 2000 et 3,5 % en 1995.
Ces charges sont même inférieures à celles des autres grands pays qui y consacrent, à l'exception de l'Allemagne, entre 2,4 % du PIB et 4,7 % du PIB. S'il est toujours préférable de limiter ce poids, nous avons donc déjà connu une situation plus dégradée, tandis que les pays qui assument des charges plus élevées ne sont pas empêchés de mener leurs politiques.
En conclusion, nous estimons qu'il reste de l'activité en réserve et que nous aurions pu atteindre 1,4 % de croissance en 2025 et en 2026, mais des chocs sont survenus. L'un d'entre eux est positif : il s'agit du choc de politique monétaire, étant précisé qu'il existe un laps de temps de dix-huit mois entre la baisse des taux et sa traduction concrète sur l'activité. L'année 2026 sera donc soutenue par la politique monétaire, mais ce mouvement sera malheureusement contrebalancé par les effets de la politique budgétaire, qui risque de faire perdre 0,4 % de croissance en 2025 et 0,8 % de croissance en 2026.
En outre, l'incertitude globale amputerait la croissance de 0,6 % cette année et de 0,3 % l'année prochaine. S'y ajoutent les effets de la politique commerciale et tarifaire américaine, qui entraînerait une diminution de la croissance de 0,1 % en 2025 et de 0,2 % en 2026.
Au total, la croissance devrait atteindre 0,7 %, dans un contexte où l'inflation repartira légèrement à la hausse en 2026, essentiellement pour les services. Le taux d'épargne, certes en légère baisse, devrait rester à un niveau très élevé.
Concernant le marché du travail, nous prévoyons 170 000 destructions d'emplois salariés entre 2025 et 2026, qui seront légèrement compensées par l'emploi non salarié. In fine, le taux de chômage repartirait à la hausse et pourrait atteindre 8,2 % à la fin 2026. Je précise que nous n'avons pas pris en compte une éventuelle suspension de la réforme des retraites, qui pourrait avoir une incidence sur la population active.
Les charges d'intérêts continueraient quant à elles à progresser pour atteindre 2,5 % du PIB en 2026, tandis que le déficit baisserait très légèrement pour s'établir à 5,4 % en 2025 puis à 5 % en 2026. La dette, quant à elle, s'établirait à 117,6 % du PIB en 2026.
M. Olivier Redoulès, directeur des études de l'Institut Rexecode. - J'aborderai la situation économique avant d'évoquer celle des finances publiques.
Dans l'univers économique que nous connaissons, la croissance mondiale comme la croissance française résistent plutôt bien jusqu'à présent, malgré l'ensemble des chocs qu'elles ont subi. Ainsi, les indicateurs de mesure de l'activité du secteur manufacturier se situent aux alentours du seuil de 50, ce qui correspond plutôt à un rythme de croissance à moyen terme. Les indicateurs pour les services atteignent même des niveaux élevés après des points bas en 2023 et en 2024, des redressements étant intervenus récemment.
Par ailleurs, le ralentissement du commerce mondial, qui était fortement redouté, ne s'est pas encore concrétisé. S'agissant des États-Unis, la croissance est désormais uniquement tirée par le secteur technologique, le reste de l'économie ayant tendance à stagner : nous prévoyons donc un ralentissement de l'ensemble de l'économie américaine dans les mois à venir.
Pour sa part, la Chine inonde l'Europe de ses produits : il est bien question d'un « second choc chinois » après celui qu'avait constitué l'entrée de ce pays dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au début des années 2000. Les surcapacités industrielles de Pékin sont à l'origine de ce nouveau choc d'ampleur, qui se produit en conjonction avec la fermeture partielle du marché américain.
À ce sujet, les problématiques se posent à la fois en termes de quantité et de prix. En effet, la Chine n'a pas vu ses prix à l'exportation augmenter alors que l'Europe a connu de fortes hausses, d'où des gains en termes de compétitivité-prix pour la première, désormais capable d'exporter des produits de qualité comparable à celle des produits de la seconde, mais à des prix 20 % ou 30 % moins élevés. Il s'agit bien d'une nouvelle donne qui est en train de s'installer sous nos yeux.
Parmi les éléments positifs qui pourraient survenir à court terme, je partage avec Éric Heyer l'idée que les taux d'intérêt pourraient sans doute s'assagir. Par ailleurs, nous observons qu'il existe un excédent d'offre sur le marché pétrolier, même s'il faudra étudier la manière dont la Chine interviendra et absorbera une part dudit excédent. Nous pourrions même anticiper une modération future des prix pétroliers.
La croissance devrait être modérée en 2026 au niveau mondial, après un premier ralentissement en 2025. Le PIB mondial, qui a progressé de 3,4 % en 2024, n'augmenterait que de 3 % en 2025 et à hauteur de 2,8 % en 2026.
Parallèlement au ralentissement déjà en cours aux États-Unis, nous observons une forme de résilience dans la zone euro. En Allemagne, des mesures de soutien budgétaire devraient favoriser l'activité - sous réserve que le gouvernement allemand puisse les mettre en oeuvre - et permettre un redressement de la croissance. Pour sa part, la France devrait connaître une croissance de 0,7 % en 2025 et de 0,9 % en 2026, bien loin d'une récession.
Nous avons pu être parfois surpris par la bonne tenue de la croissance économique, mais n'oublions pas qu'elle recouvre des réalités sectorielles disparates, avec un secteur de la construction qui connaît toujours un niveau d'activité inférieur de 5 points à celui de 2019, tandis que l'industrie manufacturière stagne au niveau de 2019 ; à l'inverse, les services se portent plutôt bien.
La demande des ménages, quant à elle, a fortement augmenté pour les services, mais s'avère complètement atone pour les biens, avec un niveau inférieur de 3 ou 4 % à celui de 2019. On vit par ailleurs une crise de la production de logements.
Du côté des entreprises, l'histoire est un peu plus positive, sous réserve de l'incertitude politique. Nous avions tous été surpris par leur forte dynamique d'investissement en France au sortir de la crise du covid-19, assez proche de la trajectoire américaine, alors qu'un décrochage était observé sur ce plan en Allemagne. En la matière, la France dépassait à l'époque les autres pays européens.
Cependant, cette tendance s'est arrêtée mi-2023 en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'impact de la crise énergétique. Les investissements des entreprises ont alors fortement diminué, jusqu'à mi-2024. Depuis lors, ils sont à peu près stables, malgré la dissolution, mais ils se maintiennent environ dix points en dessous de la tendance enregistrée à l'issue de la crise du covid-19.
Ce déficit d'investissement traduit à la fois les difficultés du secteur de la construction - pour les logements comme pour les locaux de production - et le recul des dépenses des entreprises en biens manufacturés. En revanche, les entreprises ont continué à investir de manière dynamique dans les services marchands, notamment dans le domaine du numérique.
Nous observons donc une forme de retard d'investissement des entreprises par rapport à la valeur ajoutée.
Par ailleurs, le taux d'utilisation des capacités de production, qui était tombé assez bas mi-2024, remonte depuis quelques trimestres. Et les conditions de financement des entreprises deviennent plus favorables.
Je formule ici une nuance par rapport aux propos d'Éric Heyer : les difficultés liées à l'insuffisance de la demande ont augmenté après la crise du covid-19, mais elles restent nettement inférieures à la moyenne enregistrée sur longue période. En revanche, les difficultés liées à l'offre sont proches de la moyenne de long terme et supérieures au niveau relevé lors de la période de récession du début des années 2010.
Dans les enquêtes réalisées auprès des secteurs qui fournissent des biens d'équipement aux autres entreprises, le solde des investissements se redresse par ailleurs nettement.
À partir de ces éléments, nous pouvons anticiper un redressement modéré de l'investissement des entreprises dans les prochains mois, moyennant les nuances liées aux incertitudes politiques. La moitié des réponses à la dernière enquête trimestrielle que nous avons menée avec Bpifrance nous est parvenue juste avant l'annonce du vote de confiance par le Premier ministre, et l'autre moitié après. Nous avons alors relevé un net changement d'intention des entreprises quant au maintien, au report ou à l'annulation de leurs investissements ou de leurs futures embauches.
Sous réserve de l'impact des incertitudes politiques, les données et les enquêtes tendent plutôt à montrer que l'investissement pourrait donc être un moteur de croissance modeste pour 2026. Nous évaluons les effets cumulés des incertitudes politiques à environ 0,2 point de baisse de PIB à fin 2026. Notre estimation de leur impact négatif sur l'activité est donc un peu plus faible que celle de l'OFCE.
Dans notre scénario, la croissance se redresse légèrement en 2026, mais reste inférieure à son potentiel ; l'investissement croîtrait de 1 %, ce qui compenserait à peine la baisse enregistrée en 2025 ; le taux d'épargne des ménages diminuerait un peu, ce qui soutiendrait la consommation, mais resterait très élevé ; le solde budgétaire serait proche de 5,3 % du PIB en 2025 et de 5 % en 2026. Nos prévisions de déficit public sont donc assez proches de celles de l'OFCE, malgré des hypothèses macroéconomiques légèrement différentes.
Ce déficit de 5 % auquel nous arrivons dans nos projections a été annoncé par le Premier ministre. Tous scénarios confondus, il apparaît comme un point d'atterrissage réaliste.
Qu'en est-il de la trajectoire des finances publiques après 2026 ? Elle s'annonce très dégradée, le déficit structurel étant attendu à environ cinq points de PIB. La modération de la dépense publique sur les ménages et l'économie semble difficile à mettre en oeuvre. Et les options qui circulent dans le débat politique nous éloignent de la trajectoire présentée par le Gouvernement aux autorités bruxelloises.
Par ailleurs, toutes les mesures présentées n'ont pas forcément le même impact sur la croissance économique. Certaines sont plus favorables à moyen terme, d'autres à court terme. Or le contexte politique pousse les acteurs à privilégier le court-termisme, susceptible de peser sur la croissance potentielle et sur la capacité de production d'économies futures.
En 2010, nous avons eu le réflexe de consolider les finances publiques en activant le levier de la fiscalité. Cette fois-ci, il faut se montrer plus précautionneux en la matière. Le quantum d'efforts à réaliser est en effet très important. De plus, nous n'avons pas complètement absorbé le choc des mesures fiscales nouvelles mises en oeuvre entre 2010 et 2013, qui représentaient environ 3,6 points de PIB.
Les recettes ont certes légèrement diminué en 2014, mais elles partaient d'un niveau tellement élevé qu'il était jugé intenable. C'était toute l'idée du Pacte de responsabilité et de solidarité et l'option défendue par le rapport Gallois. Les impôts et prélèvements des entreprises ont donc diminué, via le CICE, puis des mesures ont été prises pour les ménages à partir de 2017-2018 : suppression de la taxe d'habitation et suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu. Mais les ménages enregistrent toujours un point de PIB de prélèvements supplémentaires par rapport à 2010. Les entreprises étaient à peu près au même niveau après la surtaxe de l'impôt sur les sociétés (IS).
Les entreprises françaises pâtissent donc d'une forme de surfiscalité par rapport à leurs concurrentes européennes, qui représente un écart de 4,4 points de valeur ajoutée, soit environ 65 milliards d'euros. Nous devons en tenir compte lorsque nous nous interrogeons sur la pertinence d'un effort de consolidation budgétaire.
Nous nous sommes demandé par ailleurs, en fonction des options de politique économique qui seraient retenues, quelles mesures seraient les plus compatibles avec la soutenabilité des finances publiques et la stabilisation de la dette publique à moyen terme. Nous avons donc examiné plusieurs scénarios.
Si nous faisons l'effort qui avait été affiché par le Gouvernement dans le plan budgétaire et structurel de moyen terme (PSMT) de l'an dernier, soit 4,6 points de PIB d'ajustement structurel d'ici à 2031, nous pourrons assurer la soutenabilité des finances publiques. Il serait même possible de ralentir cet effort. En revanche, si nous faisons moitié moins, nous risquons d'entrer dans un équilibre instable. Il suffirait alors d'une petite hausse des taux d'intérêt pour que la trajectoire de la dette devienne explosive.
Par conséquent, soit nous faisons l'effort prévu, qui avait été sans doute concerté avec la Commission européenne, soit nous ne le faisons pas, et nous prenons un risque.
Il existe ensuite deux scénarios intermédiaires, le premier dans lequel nous ne faisons l'effort qu'à moitié, mais dans un contexte de plus forte croissance et le second dans lequel l'effort s'accompagne de mesures potentiellement préjudiciables à la croissance, comme la remise en cause de la réforme des retraites. Dans les deux cas, la soutenabilité des finances publiques et la stabilisation de la dette publique à moyen terme ne paraissent pas garanties.
Nous pourrions donc ralentir l'effort si nous veillions sur les conditions de croissance et de croissance potentielle.
Mme Natacha Valla, présidente du Conseil national de productivité (CNP). - Je vous remercie de nous consacrer ce temps d'échanges sur la conjoncture et les finances publiques françaises.
Les chiffres qui ont été présentés sur la conjoncture, les perspectives de croissance et les anticipations relatives aux finances publiques correspondent à ceux qui ont été présentés à Washington lors des réunions d'automne de la Banque mondiale et du FMI la semaine dernière.
La stabilité des prix est revenue, l'inflation est plutôt bien tenue. L'euro est fort, et depuis un moment. Cela fait partie des éléments du contexte international qu'il faut prendre en compte pour définir nos politiques et donc garder en tête pour l'examen du PLF 2026.
Nous n'avons jamais vu de stock de dette aussi important, que ce soit pour la dette publique ou pour la dette des entreprises. L'endettement mondial excède la valeur du PIB mondial, ce qui soulève nombre de questions. Les discussions internationales de l'automne ont mis ce sujet en avant. Il est intéressant de noter que, s'il a été peu question d'Europe à Washington, on y a beaucoup parlé de la France et de ses finances publiques. Si les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt, entre la France et l'Allemagne ne semblent pas si inquiétants que cela lorsqu'on les regarde de loin, ils préoccupent beaucoup de monde, à commencer par les investisseurs internationaux, qui sont d'importants détenteurs de notre dette.
Par ailleurs, en Europe comme dans les autres zones monétaires des pays avancés, les banques centrales réduisent la taille de leurs bilans. Les encours de dette publique sur les bilans de banques centrales accumulés depuis 2008 ont été restreints. Nous sortons d'un environnement marqué par de nombreux soutiens monétaires au financement des dettes publiques. Ce retrait a commencé il y a quelques années. Les banques centrales ne sont plus là pour absorber des volumes d'émissions nettes de dette publique, comme elles ont pu l'être jusqu'à très récemment.
En outre, les monnaies fiduciaires des banques centrales sont fortement remises en cause, dans leur dimension démocratique. C'est un point d'attention absolument majeur. Cela se produit par le biais de la multiplication de transactions en bitcoins et de stablecoins, c'est-à-dire d'instruments qui échappent au contrôle de l'émission monétaire par l'État, via sa banque centrale. J'ose espérer que ce mouvement n'ira pas jusqu'à une véritable remise en cause, même si l'histoire nous livre des épisodes assez illustres dans ce domaine. Il reste que l'on utilise souvent l'argument de la structure du bilan des banques centrales et de l'interaction entre l'émetteur de dette publique et l'émetteur monétaire pour dénigrer le dollar, l'euro et la livre sterling.
Nous ne soulignons pas suffisamment ce point, pourtant essentiel pour le fonctionnement de notre démocratie et le financement de notre dette publique.
J'en tirerai deux conséquences concernant la confiance que nous pouvons avoir dans l'environnement du débat sur les finances publiques. Tout d'abord, je ne pense pas que nous puissions compter, comme nous avons pu le faire en 2008 ou lors de la crise de la dette souveraine au sein de la zone euro, sur un engagement aussi libre et important de la Banque centrale européenne. Cela tient également à la situation particulière de notre pays.
Il existe en effet des déséquilibres de paiement entre les membres de la zone euro, que l'on appelait autrefois déséquilibres Target2, du nom du système de paiements interbancaires transfrontaliers entre les pays membres de la zone euro. Or la France, qui s'était toujours plus ou moins maintenue à zéro en la matière, affiche une tendance négative depuis deux ou trois ans. Son déséquilibre s'élève à présent à 200 milliards d'euros. Il en allait autrement lorsque les mécanismes de soutien ont été mis en oeuvre pour sauver l'euro. Cet élément ne passe pas inaperçu au Conseil des gouverneurs, même s'il est très peu commenté dans le débat public.
Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir le statut de la France, qui dispose de nombreuses forces, trop peu soulignées. Nous nous concentrons en effet sur les éléments liés à l'incertitude ambiante, par nature assez paralysants. Comme le rappelait Éric Heyer, la productivité française, notamment celle du travail, n'affiche pas une bonne performance. Ce phénomène, qui s'explique par les politiques conduites pendant et après la crise du covid-19, ne me paraît pourtant pas particulièrement préoccupant, compte tenu de la qualité de l'appareil productif français.
La France est un pays très attractif, notamment par le biais de ses politiques publiques, de ses institutions, et de ce que les Anglais appellent « rule of law », qui ont beaucoup de valeur. Les Américains découvrent ainsi que la solidité de la démocratie, dans un environnement capable, en théorie, de produire une croissance économique suffisante pour financer un modèle social, a une grande valeur, qu'il convient de préserver. Mais, pour y parvenir, il faut préserver le statut de la France en tant qu'émetteur souverain sur les marchés domestiques et les marchés internationaux.
En matière de finances publiques, avec 57 % de dépenses et 50 % de recettes, la France marque un certain décalage par rapport à ses voisins européens et aux membres de l'OCDE.
Il semble prioritaire d'étudier la composition des dépenses et leur volume avant d'envisager des augmentations d'impôts. Cela n'empêche pas, toutefois, d'étudier la composition de ces derniers, mais ce sujet n'en reste pas moins secondaire.
Concernant la composition de la dépense publique, la nécessité de financer l'effort de défense, qui n'était pas aussi imminente dans les discussions budgétaires précédentes, est à mettre en avant. En pourcentage de PIB consacré à la défense, la France n'était pas la moins bien placée des pays de l'Union européenne. Mais il faudra tout de même prendre ce paramètre en compte.
Par ailleurs, si l'on observe les catégories de dépenses publiques, l'on constate que l'investissement présente, à moyen terme, le multiplicateur de croissance le plus important. Faisons donc de l'investissement public et tâchons de modérer les dépenses publiques d'une autre nature. Il nous faut également soutenir la croissance potentielle à long terme par l'articulation entre cet investissement public et l'investissement privé, au niveau national comme au niveau européen. Outre son prochain rapport, qui paraîtra sans doute l'été prochain, le Conseil national de productivité a publié et mis à jour certaines estimations d'efficacité des dépenses, notamment sur l'appareil industriel, visant la complémentarité de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data et de l'automatisation de nos usines.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une précédente audition par une autre commission du Sénat, cela me semble prioritaire pour l'État comme pour la Caisse des dépôts et consignations et ses différentes filiales.
Il existe un risque politique sur les marchés pour la France, qui a une incidence sur la croissance attendue l'an prochain et l'année suivante, évaluée à 0,2 point de PIB, et de 20 à 30 points de base sur les taux d'intérêt. Cet état de fait est malheureusement difficilement modifiable.
Contrairement à ce que disait Éric Heyer, le niveau de spread me semble préoccupant. Ce signal persiste. Or les incidents sur les marchés de dette souveraine proviennent souvent de problèmes de liquidités, que même un pays solvable peut rencontrer. L'Europe bénéficie toutefois d'un système de stabilisation financière des États au-delà de la Banque centrale européenne, laquelle n'est pas l'outil le plus adapté actuellement. Le mécanisme européen de stabilité contient des lignes de crédits de précaution censément non stigmatisantes, bien que souvent considérées comme telles.
Une acculturation est ici nécessaire. Il faut faire tomber les tabous sur ces mécanismes qui rendent possible une résilience européenne au-delà de notre monnaie commune.
Le deuxième grand sujet pour le soutien de la croissance, c'est la mobilisation de l'épargne, abondante, qui n'est pas investie au bon endroit.
L'échéance importante est l'année 2027, car la majeure partie des dettes souveraines et des dettes des entreprises arriveront alors à maturité. Le besoin de financement mondial sera massif, et les investisseurs devront arbitrer entre différents objets et différents émetteurs.
Comme l'a montré l'OCDE dans un travail auquel le CNP a collaboré, la dette émise par le secteur privé n'a malheureusement pas toujours été utilisée à des fins d'investissement productif. Nous avons relevé de nombreux refinancements de financements précédents ainsi que des remboursements aux actionnaires. Les projections de croissance future réalisées sur la base de séries temporelles d'investissements privés passés devront donc être mitigées par l'emploi qui a été fait de ces financements.
La dette publique coûtera plus cher dans le futur qu'aujourd'hui. Elle coûte déjà plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années. La charge d'intérêts représente donc une part croissante des déficits publics mondiaux. La charge de la dette française est ainsi importante et aura vocation à augmenter. La Grèce, l'Italie et le Portugal affichent en revanche des surplus primaires, que nous pouvons mettre en perspective avec ce qu'a été la crise des dettes souveraines de la zone euro.
La France affiche le troisième déficit le plus élevé parmi les quinze principales économies de l'Union européenne. La question du déficit est donc cruciale. Et le spread se maintient à un niveau trop élevé, susceptible de faire l'objet de dynamiques de marché disruptives.
J'en viens enfin à l'emploi de l'épargne européenne. L'observation de la détention des titres du Trésor américain à long terme montre que deux tiers de cette dette sont détenus par les Américains et un tiers par des non-résidents, dont l'Union européenne. L'économie américaine s'est donc financée jusqu'à présent dans de bonnes conditions en absorbant une forte partie de notre épargne - 1,6 billion de dollars.
Or si l'on étudie la ventilation par pays du G7 de l'exposition de l'épargne européenne au financement de l'économie américaine - par la détention de titres américains, souverains, de grandes agences ou d'entreprises, ou d'actions - l'on s'aperçoit que la France est bien plus exposée que l'Allemagne. Ainsi, cette exposition équivaut à 30 % du PIB - majoritairement constitués de dette publique américaine et d'actions - contre 16 % pour l'Allemagne. Les valorisations actuelles des marchés boursiers américains augmentent un peu ces chiffres. J'aimerais néanmoins que cette épargne soit investie ailleurs, dans les structures productives de notre pays. Toutes les incitations que vous pourrez créer seront à cet égard les bienvenues.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Au regard des multiplicateurs économiques que vous étudiez, comment appréciez-vous la répartition des efforts demandés dans le PLF, entre les dépenses - 17 milliards d'euros - et les recettes - 14 milliards d'euros, chiffres du HCFP ?
La croissance de l'Union européenne marque un décrochage par rapport à celle des États-Unis, comme le rapport Draghi l'a souligné ainsi qu'une publication récente de l'OFCE. Quels leviers d'action faudrait-il actionner en priorité pour améliorer notre productivité ?
Quelles sont vos anticipations concernant l'évolution de l'épargne, dont on nous dit qu'elle devrait diminuer ? Certaines mesures fiscales pourraient-elles être choisies en priorité pour réduire ce niveau d'épargne et, le cas échéant, lesquelles ?
Enfin, la baisse du taux de chômage relevée en France depuis 2017 n'a pas été plus forte que dans le reste de la zone euro. Cette amélioration de la performance française résulte-t-elle de mesures comme la pérennisation des exonérations de cotisations, la prime à l'apprentissage, le bouclier tarifaire pour l'énergie ou les prêts garantis par l'État (PGE), auquel cas cela signifierait que ce progrès s'appuie beaucoup, voire trop, sur le déficit public ?
Mme Isabelle Briquet. - Merci à nos trois intervenants. Depuis plusieurs années, le débat public sur nos finances est devenu, par une lecture quasi exclusive du problème, centré sur la maîtrise de la dépense publique. Cette préoccupation est certes légitime, et personne ne conteste la nécessité d'un examen exigeant de l'efficacité et de la soutenabilité de la dépense publique. Mais cette approche reste incomplète si nous n'interrogeons pas, en parallèle, la structure de nos recettes, comme le montrent vos analyses.
Depuis 2017, les gouvernements successifs ont en effet poursuivi une politique de l'offre très marquée : suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de la taxe d'habitation, réduction des impôts de production, etc. Or plusieurs études, dont une étude récente de l'Institut des politiques publiques (IPP), peinent à démontrer un impact macroéconomique significatif de ces baisses d'impôt.
La politique de l'offre, dans sa version française, a-t-elle donc encore du sens au regard des résultats observés sur la croissance, l'investissement ou la productivité ?
M. Stéphane Sautarel. - J'aurais aimé évoquer le sujet majeur de la démographie, mais le temps nous manque malheureusement.
Plusieurs économistes considèrent que le modèle de croissance français repose beaucoup sur la demande, la dépense publique et la consommation des ménages, ce qui induit des fuites à l'importation assez importantes, qui pèsent sur nos entreprises, notamment via la fiscalité, et engendre un déficit commercial. Ce modèle de croissance constitue par ailleurs, si vous me passez l'expression, un véritable « boulet » pour nos finances publiques, car une érosion de notre activité productive conduit mécaniquement à diminuer les recettes publiques et à augmenter les dépenses de transfert. Le PLF qui nous est soumis répond-il à cet enjeu ?
M. Thierry Cozic. - Alors que nous cherchons des marges de manoeuvre budgétaires, je voudrais vous interroger sur la fiscalité patrimoniale. Pas moins de huit Français sur dix sont favorables à une baisse des impôts sur l'héritage, mais seulement un quart d'entre eux connaissent le taux de cette imposition. C'est d'autant plus étonnant que la plupart ne sont pas concernés par celle-ci. Quelque 50 % des Français ne touchent pas plus de 70 000 euros, et 87 % des Français héritent de moins de 100 000 euros sans taxe sur l'héritage. Le taux moyen d'imposition en ligne directe est de 3,1 %, soit un niveau bien éloigné du taux maximal, tant mis en avant, de 45 %.
Pourtant, les très riches ne sont pas assujettis à ce taux maximal. Proportionnellement, les milliardaires paient moins grâce aux dispositifs fiscaux : contrats d'assurance-vie ou pacte Dutreil. Cette taxation rapporte aux finances publiques 17 milliards d'euros par an, soit 0,7 % du PIB, alors que la transmission patrimoniale en représente 15 %. La fortune héritée représente 60 % du patrimoine total, contre 35 % dans les années 1970.
Une note de la Fondation Jean-Jaurès annonce que, d'ici à 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par les Français les plus âgés seront transmis à leurs descendants, soit 677 milliards d'euros par an. Il s'agira du plus important transfert de richesse de l'histoire. La France du XXIe siècle est donc redevenue une société d'héritiers, comme au XIXe siècle.
Au regard de ces chiffres, le levier de la fiscalité patrimoniale ne pourrait-il pas être raisonnablement actionné pour dégager de nouvelles marges de manoeuvre ?
Mme Christine Lavarde. - Monsieur Heyer, comment calculez-vous le pourcentage de 0,8 % de baisse du PIB cumulée en raison des incertitudes dues au contexte national, qui diffère des chiffres avancés par Olivier Redoulès ?
Partagez-vous l'interrogation voire l'inquiétude, exprimée par le gouverneur de la Banque de France en janvier 2025, sur la divergence entre les taux à court terme et les taux à long terme et, si non, pourquoi ?
Le Premier ministre François Bayrou évoquait 44 milliards d'euros d'efforts tendanciels. Comme le relève l'avis du Haut Conseil des finances publiques, le nouveau Premier ministre parle de 30 milliards d'euros d'efforts structurels, soit environ 1 point de PIB. En conjuguant ce montant au déficit public annoncé de 4,7 %, pouvons-nous conclure qu'à politique inchangée nous aurions eu un déficit de 5,7 % ?
Mme Florence Blatrix Contat. - Comment l'épargne des ménages se répartit-elle et à partir de quels déciles augmente-t-elle significativement ? Comment limiter l'impact de la politique budgétaire, évalué par l'OFCE à 0,8 point, en préservant les déciles dont la propension à consommer est la plus forte ? Quelles mesures fiscales seraient susceptibles de relancer la consommation et quelles autres sont à éviter dans le cadre du PLF ?
Enfin, comment mieux mobiliser l'épargne privée au niveau national comme au niveau européen, dans la perspective de l'union de l'épargne et des investissements ?
M. Jean-Baptiste Blanc. - Les constructions de logement ne sont plus en rapport avec nos besoins. Le problème est que la planification écologique - à l'image du « zéro artificialisation nette » (ZAN) - n'est ni concertée ni accompagnée et encore moins financée. Pouvons-nous évaluer les pertes de recettes liées aux mesures de la planification écologique qui relèvent de la décroissance ? Nous privons les collectivités locales de foncier, puisqu'elles doivent en consommer deux fois moins d'ici à 2031 pour atteindre le « zéro compensé » en 2050. Cette perte de foncier, qui est l'une des raisons de la crise du logement social, est-elle évaluée ? Bercy est incapable de livrer une estimation à cet égard. Auriez-vous des chiffres à nous fournir ?
M. Vincent Capo-Canellas. - Les chiffres de l'épargne m'étonnent toujours. En moyenne, nous épargnons certes plus que d'autres, mais, si certains Français ont la capacité d'épargner, d'autres peinent à boucler les fins de mois. Faut-il une relance par la demande ? En avons-nous les moyens budgétaires ?
L'Allemagne prévoit de faire de nombreuses émissions l'année prochaine, dans des volumes considérables. Comment pouvons-nous évaluer l'impact de cette mesure sur la France, alors que sa note vient d'être à nouveau dégradée ?
La Banque centrale européenne peut intervenir si la situation se complique, mais cela doit se faire à certaines conditions. Des programmes budgétaires crédibles sont notamment requis. Cela vous semble-t-il possible ?
M. Claude Raynal, président. - La question est de savoir comment faire pour corriger, dans le budget, les distorsions observées sur le plan macroéconomique.
Mme Natacha Valla. - Un changement de structure de l'offre se produira probablement dans la dette publique, sous la forme d'un appétit pour une dette sans risque. Or la dette sans risque de référence dans l'environnement européen reste la dette allemande.
Il est possible que le fait que l'appétence pour la dette américaine soit réduite joue en faveur de la France. Toutefois, la situation reste défavorable pour notre pays, par rapport aux émetteurs de dette considérés comme sûrs.
Une forte conditionnalité s'observe, attachée aux deux grands programmes de la BCE que sont les opérations monétaires sur titres (OMT) et le programme de protection de la transmission monétaire. Ces instruments sont un peu hors d'atteinte pour un pays comme la France, mais il existe également des solutions ex ante. Il est intéressant de réfléchir à la façon dont nous pourrions les activer. À titre d'exemple, le FMI a mis en place des lignes de précaution pour les pays qui ont recours à ses programmes. Or ces lignes sont encore assez peu employées.
Dans un environnement monétaire international où l'euro a une chance de devenir une monnaie de premier plan, la stabilité est de mise en matière de dette publique souveraine.
Concernant les inquiétudes exprimées par le gouverneur de la Banque de France, nous avons des taux d'intérêt à long terme beaucoup plus élevés que les conditions de financement que nous avons pu connaître pendant plusieurs décennies. Cette nouvelle pentification se compose d'un élément assez sain, consistant à redonner un prix positif au temps : ce qui est loin dans le temps doit être rapporté à une valorisation présente, selon un facteur positif et non négatif. Mais elle comprend aussi plusieurs primes, dont des primes de risque, à commencer par la prime de risque politique, qui prend toute sa pertinence dans le contexte actuel.
La démographie est un facteur essentiel. La pyramide des âges en Europe et en Asie sera très défavorable aux ratios de couverture du marché du travail. Dans quelques décennies, les générations qui travaillent devront donc couvrir des dépenses de plus en plus importantes. Les scénarios de risques sur les dépenses publiques associées à la vieillesse et au grand âge recoupent d'ailleurs les problématiques budgétaires dans la santé.
Mais au-delà des dépenses sociales, nous devons également tenir compte des dépenses relatives à l'éducation. Lorsque nous parlons d'éducation, nous pensons souvent à l'école primaire. Or le sujet de l'éducation doit toucher tous les âges : enseignement supérieur, formation professionnelle, etc. La démographie nous placera devant cette évidence.
Concernant la répartition des efforts prévue dans le PLF pour 2026 entre les dépenses et les recettes, l'enjeu est surtout d'étudier, avec beaucoup de courage, la structure des dépenses, indépendamment de l'incontournable nécessité de réduire, au moins à la marge, le volume total de celles-ci.
Le rapport du Conseil national de productivité montre que la France est à la croisée des chemins. Nous devons choisir entre une croissance de moyenne gamme, mais qui sera spontanément riche en emplois, dans un environnement de concurrence internationale marqué par une nouvelle arrivée en force de la Chine ; et une montée en gamme, vers la compétitivité hors prix. Nous avons tous les atouts pour le faire, à commencer par les potentialités de développement de notre appareil industriel et de notre système éducatif, qui demeurent très performant. Cela me semble une priorité pour la France, et pour l'Europe dans son ensemble.
M. Olivier Redoulès. - Le plan Bayrou et le PLF pour 2026 s'appuient sur la même projection de croissance de la dépense publique, à 1,7 % en valeur. En revanche, l'estimation du tendanciel varie entre les deux.
Les 4 milliards d'euros de recettes attendues dans le plan Bayrou du fait de la mesure relative aux deux jours fériés ne figurent plus dans le projet. En revanche, la surtaxe sur les entreprises de 4 milliards d'euros a été maintenue.
Les mesures fiscales sont celles qui sont susceptibles d'avoir le plus fort impact sur la croissance potentielle. Le coût du travail risque d'augmenter, autour de 5,6 milliards d'euros. Sachant que le coût du travail était déjà élevé, augmenter encore les prélèvements sur le travail ne semble pas très adapté. Il faudra également tenir compte de la progressivité des prélèvements.
La fiscalité du patrimoine est assez neutre sur la croissance, à court comme à moyen terme. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure la transmission du patrimoine permet de maintenir le financement des entreprises, les entreprises devant parfois être vendues en pièces détachées pour payer l'impôt sur la succession. Il y a donc sans doute une réflexion à avoir sur le sujet, mais cette taxe compte probablement parmi les moins pénalisantes pour la croissance à très court terme.
Notre écart de production est proche de zéro. Il s'est légèrement creusé en 2025 et se creusera davantage en 2026, mais nous ne sommes pas face à un scénario semblable à celui de l'année 2012, où les mesures de consolidation budgétaire risqueraient de devenir self-defeating, c'est-à-dire autodestructrices. Nous disposons donc d'une certaine marge, sachant que les mesures budgétaires auront un impact conjoncturel négatif, qui s'estompera trimestre après trimestre.
Nous observons par ailleurs une perte de productivité tendancielle par rapport à l'avant-crise. Un ajustement des niveaux de vie s'avère, par conséquent, nécessaire, via une nouvelle trajectoire de revenu par tête. L'enjeu est d'éviter de trop attendre et d'avoir à prendre des mesures plus violentes, dans un contexte plus tendu, où des multiplicateurs importants risqueraient de s'appliquer. Cet élément éclaire les arbitrages à réaliser sur les effets économiques, à court et moyen terme, des mesures prises.
Le vrai risque serait d'éviter d'entrer dans un scénario de rupture, ou d'équilibres multiples, et de basculer du mauvais côté de la courbe de la dette. Le risque d'une hausse des taux d'intérêt serait alors réel, susceptible de placer la dette sur une trajectoire de hausse exponentielle. C'est ce que nous voulons éviter à tout prix. Malheureusement, les taux d'intérêt sont plus importants que la croissance potentielle en valeur. Il existe donc une forme de mécanique d'auto-entretien de la dette.
En outre, nous n'avons pas diminué les dépenses corrélativement aux politiques de l'offre, comme l'a souligné Éric Heyer. Il en a résulté trois conséquences. Premièrement, des ressources économiques ont continué à être mobilisées par la dépense publique. Une des idées de la politique de l'offre consisterait à libérer des ressources du secteur public vers le secteur privé. Deuxièmement, la crédibilité de la durabilité de cette politique de l'offre s'en trouve compromise. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La fiscalité des entreprises a certes été rapprochée des moyennes européennes, mais cela ne s'est pas fait dans un cadre de finances publiques équilibré. Troisièmement, nous n'avons peut-être pas assez pensé aux incitations. La question de la progressivité des prélèvements sur le travail est un sujet majeur. Une partie des mesures prises après 2017, par exemple la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, ont renforcé cette progressivité. Or si elles ont eu des impacts positifs en matière d'emploi, il n'en a pas forcément été de même pour la qualité de l'emploi.
La question de la consommation se pose en réalité au niveau européen. Le taux d'épargne dépend en partie de revenus financiers. Nous devons disjoindre l'épargne de la consommation. Habituellement, les macroéconomistes avaient pour réflexe de faire converger les taux d'épargne au niveau d'avant-crise. Or nous nous sommes aperçus que cela ne fonctionnait pas. Il existe en réalité une dynamique disjointe, liée pour partie à la structure du revenu. Ainsi, les retraités sont responsables des deux tiers ou des trois quarts de la hausse du taux d'épargne depuis 2019. Ce constat soulève des interrogations tant sur la structure des revenus que sur l'allocation de la dépense publique.
Le sujet de l'épargne et de la consommation doit donc être traité au niveau européen. L'une des premières recommandations du rapport Draghi est d'ailleurs de bâtir un vrai marché européen. En effet, les 540 millions de consommateurs européens ne tirent pas la croissance européenne comme le font les consommateurs américains pour la croissance américaine. Le déficit de demande au niveau européen est un sujet majeur, que la France pourrait mettre davantage en avant.
Enfin, je ne suis pas en mesure d'évaluer l'impact du ZAN. Le principal facteur de la diminution des investissements dans la construction a été la hausse des taux d'intérêt. Mais à cela se sont ajoutées des contraintes réglementaires, comme le ZAN ou le diagnostic de performance énergétique (DPE) ainsi que le changement de la fiscalité locale. La question se pose d'ailleurs de savoir comment inciter des collectivités locales à construire ou laisser construire davantage, leurs recettes étant décorrélées, pour partie, des constructions d'entreprises ou de ménages, ce qui induit des difficultés structurelles.
M. Éric Heyer. - Je n'ai pas dit que l'écart entre les spreads français et allemand était une chose positive. En revanche, il est intéressant de voir que les spreads diminuent en Europe. L'Italie et l'Espagne, qui affichaient des spreads de plus de 7 %, reviennent ainsi à des niveaux à 0,7 % ou 0,8 %, ce qui est une tendance plus favorable pour la vision qu'ont les investisseurs de l'Europe que celle qui prévalait lorsque les spreads étaient très fragmentés. Nous empruntons comme les Italiens et les Espagnols, ce qui est plus rassurant. Les niveaux de spread élevés pour la France tiennent à mon sens davantage à l'incertitude politique qu'à des fondamentaux économiques.
Concernant le calcul d'incertitude, je vous renvoie à un article qui développe le modèle grâce auquel je suis parvenu à ce résultat. Ce modèle s'appuie sur un indicateur d'incertitude qui a été élaboré par des économistes - Baker, Bloom et Davis - dans une importante revue académique, et donc validé par les pairs. L'idée est de chercher des liens de long terme entre l'incertitude et le comportement des ménages, des entreprises, les taux d'intérêt, etc.
La question était aussi la suivante : si nous étions restés au niveau d'incertitude qui prévalait au moment de la dissolution, où en serait la croissance économique ? Sans cette incertitude, le taux de croissance supplémentaire en 2025 a été estimé à 0,4 % et celui de 2026 à 0,3 %.
Le taux de chômage a diminué beaucoup moins en France qu'en moyenne dans les autres pays de la zone euro, d'autant que certains pays, comme l'Allemagne, étaient au plein emploi. Les performances françaises ne sont donc pas du tout extraordinaires. Cependant cela tient aussi au fait que notre démographie est un peu plus dynamique, et qu'il nous faut davantage de créations d'emplois pour faire baisser le taux de chômage.
De quelle politique de l'offre parlons-nous ? Il existe d'autres politiques de l'offre qu'une politique de l'offre fiscale, comme Natacha Valla l'a souligné, qui seraient bien plus intéressantes. Plusieurs études, comme la dernière étude de l'IPP, montrent d'ailleurs que les résultats de cette politique ne sont pas visibles. Certes, le fait que l'on n'arrive pas à mettre en avant un phénomène d'un point de vue économétrique ne signifie pas qu'il n'existe pas. Les techniques économétriques sont peut-être insuffisantes. Il reste que les performances françaises demeurent dans la moyenne. En matière de création d'emplois, la France ne fait pas mieux que les autres pays. Et la politique de l'offre a diminué en réalité la productivité, alors qu'elle aurait dû avoir l'effet inverse, ainsi que la compétitivité, puisqu'on observe en outre une baisse des parts de marché de la France depuis 2017.
Cette politique de l'offre ne semble donc pas avoir fonctionné. Si des emplois ont été créés, c'est au moyen d'un financement public. De plus, le nombre d'apprentis est passé de 400 000 à 1 million. Or chaque apprenti est comptabilisé par l'Insee dans ses statistiques comme un emploi à temps plein. Les chiffres de l'emploi s'en trouvent gonflés, pourtant il n'est pas certain que ces emplois perdurent. Selon l'Insee, qui a un modèle plus précis que le nôtre, le nombre d'apprentis devrait diminuer de 65 000 apprentis dans les trimestres à venir. Il faudra attendre que la poussière retombe pour vérifier que cela crée bien de l'emploi.
Par ailleurs, il faut tenir compte de ce que Bercy a appelé la « zombification de l'économie ». Grâce aux aides, de nombreuses entreprises ont été sauvées. Selon nos estimations, entre 110 000 et 165 000 entreprises peu productives qui auraient dû faire faillite ont été sauvegardées, soit 150 000 emplois au total.
Une grande partie de cette chute de productivité a été financée par les déficits publics et les salariés. Or à présent que les finances publiques veulent se rétablir et les salariés retrouver du pouvoir d'achat, qui paiera cette chute de productivité, sachant que les entreprises veulent conserver leurs marges aujourd'hui pour assurer l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain ? Si personne ne veut le faire, la productivité repartira à la hausse. Or la productivité sans croissance économique engendre des destructions d'emplois. Penser que nous pourrons créer des emplois l'année prochaine avec un taux de croissance à 0,9 % me semble donc très optimiste.
La France s'est engagée à réaliser des efforts budgétaires à hauteur de 120 milliards d'euros en cinq ans. Cela n'a jamais été fait. Et ces efforts sont liés aux aides fournies pendant la crise sanitaire et la crise énergétique. Les boucliers énergétiques ont certes diminué l'inflation, mais tous les usagers en ont bénéficié, sans distinction. Selon la Commission européenne, les aides représentaient alors 3,5 points de PIB, soit plus de 100 milliards d'euros. Et tout le monde était logé à la même enseigne : ménages aisés, urbains, comme ruraux.
Ce n'est pas la répartition entre les dépenses et les recettes qui importe, mais la répartition entre les contributeurs. Si la voie de l'impôt est la plus pertinente pour faire participer les ménages les plus aisés, pourquoi ne pas la choisir ? De même, savoir s'il est préférable de passer par la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation sans impôt supplémentaire, ou d'opter pour une mesure fiscale n'est pas le sujet principal. L'enjeu est de fixer le niveau de contribution de chacun.
Le montant de 17 milliards d'euros annoncé ne tient pas compte par ailleurs de l'augmentation de la charge d'intérêts, du budget européen et de l'effort requis en matière de défense. Les efforts qui seront réellement demandés aux Français s'élèveront à 35 milliards d'euros. Il me semble peu probable que cela n'ait pas d'effet sur la croissance. Mais prenons garde aux risques d'augmentation des inégalités.
Selon le Conseil d'analyse économique (CAE), les taux d'épargne sont concentrés sur les 20 % de ménages les plus aisés. Il s'agit essentiellement d'épargne financière. Or quand le patrimoine financier augmente, avec des taux d'intérêt en croissance, les revenus du patrimoine sont également en hausse. Les 20 % plus aisés ont donc gagné en pouvoir d'achat grâce aux revenus du capital. L'Insee a montré par ailleurs que le pouvoir d'achat des 10 % les plus modestes a été maintenu grâce à l'indexation du Smic et des prestations sociales sur l'inflation. En revanche, 60 % des ménages ont perdu en pouvoir d'achat, car leurs salaires n'ont pas suivi les prix.
Comment faudrait-il répartir les 120 milliards d'euros d'efforts budgétaires requis ? Si l'on veut préserver les plus modestes, mais ne pas toucher aux plus aisés, car on ne souhaite pas augmenter les impôts, ces efforts se concentreront donc sur les 60 % de ménages qui ont déjà perdu en pouvoir d'achat. C'est possible, mais penser que cela n'aura aucune incidence sur la consommation, les carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi faibles et seront encore plus réduits par la guerre commerciale, les projets d'emploi et d'investissement des entreprises, me semble un pari risqué. Certains risquent de s'habiller de nouveau en jaune.
M. Olivier Redoulès. - La perte de productivité s'explique également par une forte hausse de l'emploi. Près de 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2015. La croissance a donc été enrichie en emplois, ce qui constitue un fait positif.
M. Éric Heyer. - En réalité, cela revient au même : nous pouvons dire soit que la croissance a été enrichie en emplois soit que l'on a perdu en productivité. Ce sont deux perceptions d'un même phénomène.
Mme Natacha Valla. - Il n'y a pas de mécanisme économique causal selon lequel la productivité diminue quand l'emploi augmente. L'équivalence présentée relève donc davantage d'une lecture de la situation. Il est aussi possible d'avoir à la fois plus d'emploi et plus de productivité. En ce cas, un pays s'avère prospère.
M. Claude Raynal, président. - Merci de vos apports.
IV. EXAMEN DU RAPPORT (5 NOVEMBRE 2025)
M. Claude Raynal, président. - Nous examinons ce matin les principaux éléments de l'équilibre du projet de loi de finances pour 2026.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je vous présente ce matin mon analyse des prévisions macroéconomiques et de l'équilibre général du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.
Je précise en préambule que mon exposé se fonde uniquement sur le texte initial déposé par le Gouvernement. Comme l'an dernier, l'Assemblée nationale n'a toujours pas terminé l'examen de la première partie du texte. Mais, cette fois, il est possible qu'elle adopte au moins la première partie du PLF, ou qu'elle n'en finisse même pas l'examen, de sorte que le Sénat pourrait avoir à se prononcer sur les mesures fiscales adoptées par l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le feuilleton de ces mesures. Pour moi, c'est un peu comme si on jouait à la roulette russe avec chaque article du code général des impôts en attendant de voir où tout cela nous mène - en tout cas, pas sur les chemins de la stabilité ni du redressement des comptes publics.
Toujours est-il que les votes de l'Assemblée, mais aussi les engagements du Gouvernement, tant en dépenses qu'en recettes, n'ont à ce stade plus rien à voir avec le texte initial du PLF, ce qui, sur certains points, pourra avoir des conséquences sur l'exposé que je vais vous présenter.
Ce qui me paraît le plus marquant dans le projet de loi de finances initial qui nous est proposé, c'est que le Gouvernement effectue un pari sur la « levée des incertitudes ». Or, ce n'est pas en faisant des paris que l'on reprend son destin en main.
Que la prévision de croissance soit trop optimiste ne vous étonnera guère : le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) l'a déjà noté ; nous y sommes malheureusement habitués. Mais je crois important de souligner que, même en retenant les hypothèses favorables du Gouvernement, la croissance française, de 1 %, demeurerait inférieure de 0,5 point à la moyenne de la zone euro, et de 0,2 à 0,7 point à l'Allemagne. Notre grand voisin a traversé une crise passagère après la pandémie de covid-19, mais il pourrait rapidement nous distancer grâce à l'impact de ses plans d'investissement dans les infrastructures - 40 milliards d'euros par an pendant douze ans - et dans la défense. L'Allemagne dispose en effet de marges de manoeuvre que nous n'avons plus...
Je voudrais revenir rapidement sur l'estimation de l'effet de l'incertitude nationale sur le PIB, qui nous coûterait 0,3 point, c'est-à-dire 9 milliards d'euros en 2026. Les analystes sont formels : le simple fait d'adopter un budget ne dissipera pas toutes les incertitudes sur la politique économique. Du reste, il suffit de suivre les débats à l'Assemblée ou d'écouter nos ministres, qui juraient que jamais, au grand jamais, la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés (IS) sur les grandes entreprises ne serait prorogée au-delà de 2025... Qui, par ailleurs, est capable de nous dire quel est l'objectif de solde public du Gouvernement aujourd'hui ? Un gouvernement dont je rappelle qu'il est censé déterminer et conduire la politique de la Nation.
C'est pourquoi je crois que ce coût de l'incertitude ne doit pas nous conduire à accepter n'importe quoi, et surtout à voter un budget pour le simple principe de voter un budget. D'autant que les incertitudes à l'échelle mondiale restent fortes, plus fortes encore que pendant la crise du covid-19. Certes, la politique commerciale des États-Unis a eu un moindre impact que prévu à ce jour, mais nous assistons à un risque de report des exportations chinoises vers l'Union européenne, qui pourrait porter préjudice à certaines de nos filières en cas d'escalade commerciale supplémentaire.
Sur le plan interne, l'optimisme du Gouvernement frise la méthode Coué, notamment s'agissant de l'investissement des entreprises : ses hypothèses sont supérieures de deux points au consensus des économistes. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) prévoit même une baisse et non une hausse !
Autre sujet sur lequel le Gouvernement se montre optimiste : il prévoit une baisse de l'épargne, qui passerait de 18,4 % du revenu disponible brut à 17,8 %, par la vertu d'une sortie de crise. Nous pronostiquions déjà cela l'année dernière et les années précédentes, mais l'épargne n'a fait qu'augmenter. Notre niveau d'épargne financière a dépassé celui, traditionnellement très élevé, de l'Allemagne - c'est dire à quel point les Français sont devenus prudents.
Par ailleurs, deux tiers de la hausse de l'épargne proviendraient des seuls retraités, ce qui remet en cause la « théorie du cycle de vie », qui voulait que les jeunes s'endettent, les générations intermédiaires épargnent et les personnes âgées désépargnent.
Au-delà de ce tableau conjoncturel, il est inquiétant de constater que les fondamentaux de notre économie ne permettent pas d'espérer un redressement facile de nos comptes publics.
Un fait stylisé désormais bien connu depuis le rapport Draghi est le décrochage de l'Europe avec les États-Unis. On peut trouver toutes les circonstances atténuantes que l'on veut : ce décrochage ne date pas d'hier, il a commencé en 2005. Nous étions presque à la parité en revenu par habitant il y a vingt ans ; nous serons bientôt deux fois moins riches...
En matière d'emploi, je voudrais faire pièce à un mythe tenace : non, le taux de chômage n'a pas diminué plus vite en France que dans le reste de la zone euro depuis 2017 - c'est même plutôt l'inverse. Surtout, l'amélioration a été achetée en France à crédit, par de l'argent public et de manière non financée, ce que l'on constate aujourd'hui. Il en résulte que les créations d'emplois n'ont pas soulagé nos comptes publics à la hauteur de ce que nous aurions espéré.
Ces perspectives peuvent nous conduire à la paralysie, mais la réalité est que l'endettement nous conduit déjà à une certaine anesthésie. La dynamique de la dette publique est en effet très inquiétante et nous singularise des autres pays comparables sur la période post-covid-19. Cette hausse de l'endettement n'est pas due, comme on a pu nous le dire, à une perfect storm, à un effet « boule de neige » ou à un « pas de bol », mais simplement à l'accumulation de nos déficits passés. Ce sont nos politiques budgétaires et fiscales depuis 2020 qui en sont responsables et, surtout, celles menées depuis 2022, qui nous distinguent de nos partenaires européens.
Bruno Le Maire déclarait au début de l'année 2021 : « Je vais peut-être vous surprendre comme ministre des finances, mais je pense que [nous endetter] est une nécessité en période de taux bas. » Il en a résulté une forte hausse de notre stock de dette. Avec la hausse en cours des taux, l'aubaine se transforme en malédiction : elle entraîne une explosion de la charge de la dette, conséquence de ce recours immodéré à l'emprunt. Nous faisons à présent face à un véritable noeud coulant, avec une charge de la dette, toutes administrations publiques confondues, qui pourrait dépasser les 100 milliards d'euros en 2029 !
De plus, notre stock de dettes nous met à la merci d'un choc de taux : 1 % de hausse sur les obligations assimilables du trésor (OAT) se paie 32 milliards d'euros dix ans plus tard. Or, nos conditions de financement se sont dégradées rapidement : en seulement dix-huit mois, nous empruntons désormais plus cher que le Portugal, la Grèce ou l'Espagne, et notre courbe a désormais croisé celle de l'Italie.
Dans ces conditions, il faut agir dès ce budget, car tous les choix, parfois difficiles, que nous refusons aujourd'hui s'imposeront à nous et seront encore plus difficiles demain. La consolidation s'impose donc aujourd'hui, pour solder les erreurs passées, et davantage pour des raisons économiques que pour respecter les règles budgétaires européennes.
Le Gouvernement a abandonné la notion de tendanciel de hausse spontanée des dépenses, qui exagérait quelque peu les économies réalisées, pour en revenir à la notion plus classique d'effort structurel. L'effort structurel prévu est ainsi de 1 % du PIB potentiel, c'est-à-dire environ 30 milliards d'euros, dont 14 milliards de recettes nouvelles (0,5 % du PIB potentiel) et 17 milliards de modération des dépenses (0,6 % du PIB potentiel). Cela ne vous surprendra pas, cet effort me semble déséquilibré : il devrait porter davantage sur les baisses de dépenses et moins sur les hausses de recettes.
Comme à l'accoutumée, c'est à ce stade l'État qui serait le principal responsable du déficit public en 2026. Selon moi, chaque secteur institutionnel doit être mis à contribution à hauteur de sa responsabilité dans la dégradation de nos comptes publics. Or, ce n'est pas le cas dans ce budget pour 2026, qui prévoit une baisse de dépenses en volume de 1 % pour les administrations publiques locales et de 0,4 % pour les administrations de sécurité sociale, quand ces dépenses en volume augmenteraient de 1,6 % pour les administrations publiques centrales. C'est la raison pour laquelle le Sénat proposera de réduire à 2 milliards d'euros l'effort de redressement des comptes publics à la charge des collectivités territoriales, au lieu des 4 milliards prévus dans le texte initial.
Nous allons à présent examiner comment le contexte macroéconomique et les choix de finances publiques que je vous ai exposés se traduisent dans le projet de budget de l'État soumis au Parlement au travers du projet de loi de finances.
Pour résumer, je reconnais certains des efforts entrepris, mais ils me semblent encore insuffisants.
La dérive des comptes des années passées a laissé la place en 2025 à une réduction du déficit en loi de finances initiale (LFI), à 139 milliards d'euros, qui semble se confirmer en cours d'année à un niveau de 130,5 milliards d'euros, alors même que la prévision de croissance a été revue à la baisse. Non seulement la loi de finances initiale était en amélioration par rapport à 2024, mais son exécution est pour la première fois depuis 2020 meilleure qu'elle n'avait été anticipée. Cela ferait donc 25 milliards d'euros d'amélioration de solde par rapport à 2024.
Le décret d'annulation du 25 avril dernier a certainement joué un rôle dans la modération des dépenses, mais je dois aussi noter que la France a bénéficié d'un remboursement de prêt anticipé par la Grèce, soit une recette inattendue de 1,1 milliard d'euros.
Cette amélioration du déficit en 2025 permet de mettre en perspective l'amélioration de 6,1 milliards d'euros seulement du solde budgétaire prévue pour 2026. À première vue, on croirait que s'opposent un mouvement favorable - l'augmentation des recettes - et un mouvement défavorable - l'accroissement, dans le même temps, des dépenses.
En y regardant de plus près, les recettes non fiscales progressent parce que l'Agence nationale de la recherche (ANR) remboursera en 2026 un montant considérable de dotations qui lui avaient été consenties en 2011 dans le cadre des premiers programmes d'investissement d'avenir (PIA). Je note que, sans cette recette exceptionnelle et ponctuelle de 6,9 milliards d'euros, le déficit budgétaire de l'État ne s'améliorerait pas en 2026 ! Cet effet n'existe qu'en comptabilité budgétaire, car le remboursement d'un prêt ne modifie pas le déficit public.
S'agissant des recettes fiscales, leur augmentation résulte en partie d'effets de périmètre, comme la rebudgétisation de la TVA qui est actuellement affectée aux régions, mais aussi d'une augmentation de la pression fiscale avec une série de mesures sur lesquelles je reviendrai.
Du côté des dépenses, elles augmentent à cause des dépenses contraintes, notamment la charge de la dette et les contributions aux pensions, et des dépenses que je juge indispensables, en particulier l'augmentation des dépenses de défense.
Sur les autres ministères, les crédits diminuent de 1,2 milliard d'euros en valeur, ce qui doit être mis à l'actif de ce projet de loi de finances, même si cette baisse limitée est loin de compenser les hausses.
Il faut aussi mettre à l'actif des gouvernements qui ont préparé ce budget l'amélioration de certaines pratiques budgétaires, avec la fin de la mission « Plan de relance » et la réduction progressive des reports de crédits. Sur ce point et quelques autres, je note avec satisfaction que les recommandations de la commission des finances du Sénat ont été suivies d'effets, ce qui montre qu'il faut parfois savoir faire preuve de persévérance pour être entendu.
La charge de la dette pèsera dès 2026 plus lourd dans le budget de l'État que les dépenses de défense, pourtant en forte croissance également. Elle équivaut à l'addition des crédits ministériels de la recherche et de l'enseignement supérieur, de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Le renouvellement des emprunts contractés vers la fin des années 2010, lorsque les taux étaient au plus bas, sera particulièrement coûteux. La diminution du déficit budgétaire est insuffisante pour réduire le besoin d'emprunt parce que la dette existante doit être renouvelée à hauteur de 175 milliards d'euros en 2026. C'est pour cela que la France devra emprunter 310 milliards d'euros en 2026 : pour 1 euro de déficit, nous devrons emprunter 2,5 euros sur les marchés financiers. Le montant annuel des emprunts a ainsi augmenté de 12,4 milliards d'euros entre 2010 et 2019, puis de 50 milliards entre 2020 et 2026 : l'endettement ne se contente pas de croître, il s'accélère.
Il faut donc voir le budget qui nous est soumis comme un premier pas, qui devra être maintenu sur la durée et amplifié si l'on veut parvenir, dans quelques années, à renverser enfin les courbes et permettre à la puissance publique de retrouver des marges de manoeuvre.
Examinons à présent plus en détail les recettes de l'État. Elles font l'objet de nombreuses mesures dans ce projet de loi de finances, comme en témoigne la première partie du PLF, qui, avec 48 articles, est la plus fournie depuis 2006.
L'ensemble des recettes fiscales nettes et des recettes non fiscales dépasse, pour la première fois de l'histoire de notre pays, le seuil de 400 milliards d'euros. C'est un niveau record en valeur absolue, mais aussi en chiffres corrigés de l'inflation. La hausse des recettes fiscales, évaluée à 19,1 milliards d'euros, est liée à d'importantes mesures qui, je le note avec regret, conduisent à accroître la pression fiscale qui pèse sur nos concitoyens et sur nos entreprises.
La surtaxe d'IS sur les grandes entreprises - nous l'avons approuvée l'an dernier à la condition qu'elle disparaisse ensuite - serait prolongée et rapporterait 4 milliards d'euros. La contribution différentielle sur les hauts revenus serait également prorogée, une taxe sur les holdings patrimoniales serait créée, de même qu'une taxe sur les plastiques, une taxe sur les petits colis et un retour de la réforme de la franchise en base de TVA. Enfin, plusieurs « niches fiscales » seraient supprimées ou réduites. Le barème de l'impôt sur le revenu ne serait quant à lui pas indexé, ce qui accroîtrait son produit de près de 2 milliards d'euros. Au total, la méthode est connue : c'est l'outil fiscal qui est utilisé pour obtenir des recettes supplémentaires, dont certaines ont d'ailleurs vocation à disparaître à l'avenir - ou pas...
Je dirai quelques mots sur les grands impôts.
Le produit de l'impôt sur les sociétés reste à un niveau stable. Alors qu'un ministre avait prédit, s'appuyant sur les chiffres fragiles de 2022, que le produit de cet impôt croîtrait toujours plus grâce à la baisse des taux, nous constatons que c'est en fait un impôt très stable en euros constants, si l'on prend en compte dans les années 2010 l'effet du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
S'agissant de la TVA, après avoir constaté, année après année, que l'État se défaisait de parts toujours plus importantes de cet impôt, qui est le plus productif et le mieux corrélé à l'activité économique, on relève un changement de direction : avec la fin de l'affectation de TVA aux régions, la part revenant à l'État repasse enfin juste au-dessus de 50 %.
Les autres recettes fiscales regroupent de très nombreuses ressources, dont deux blocs majeurs, les droits de donation et de succession, dont le produit a plus que doublé depuis 2014, et les accises sur l'énergie, c'est-à-dire les anciennes taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) et taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). Le produit de ces dernières est affecté par la diminution tendancielle de la consommation de carburants, mais aussi par le transfert opéré pour financer la péréquation dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental (ZNI).
Les recettes non fiscales, quant à elles, bénéficient principalement de deux recettes temporaires : un versement plus important qu'en 2025 de la part de l'Union européenne, au titre du remboursement partiel du plan de relance, et le versement de l'Agence nationale de la recherche précédemment évoqué.
Les prélèvements sur recettes (PSR) augmentent pour leur part de manière notable. Celui à destination de l'Union européenne est contraint par les dépenses dues en application du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Quant à la hausse des PSR à destination des collectivités territoriales, elle correspond en réalité à des effets de structure - il s'agit en particulier de compenser, pour les régions, la fin de l'affectation de TVA.
Je relève en conclusion que les dépenses du budget général connaissent une évolution modérée, même si le contexte de hausse des taux et de tensions internationales doit conduire à aller plus loin encore dans la maîtrise des dépenses de l'État.
Hors défense, charge de la dette et contributions au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », les crédits diminuent de 1,2 milliard d'euros. Cet effort, qu'il convient de saluer, est d'autant plus notable que les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » augmentent de 3 milliards d'euros à cause de la progression des charges de service public liées au prix de l'électricité. Il aura toutefois fallu attendre cinq ans après la crise du covid pour que les dépenses de l'État cessent de connaître des hausses annuelles incontrôlées, comme si l'argent tombait du ciel - cinq ans perdus, dont nous allons subir le contrecoup pendant de nombreuses années.
Les crédits des missions régaliennes - missions « Défense » bien sûr, mais aussi « Sécurités » et « Justice » - sont préservés, ainsi que, en euros courants, les crédits relatifs à l'éducation et à la recherche.
Les crédits de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » diminuent en raison, notamment, de la réduction de l'enveloppe prévue pour les aides à l'alternance et aux demandeurs d'emploi. La baisse des crédits de la mission « Cohésion des territoires » résulte également des réformes des aides personnelles au logement (APL) et du financement de la rénovation des logements privés.
L'effort devra toutefois être renforcé et pérennisé, car les années récentes de dépenses inconsidérées ne constituent pas une référence pertinente. Je vous propose, dans la droite ligne des travaux menés par le Sénat avant l'été, une comparaison avec la dernière année au cours de laquelle l'objectif de 3 % de déficit a été atteint, à savoir l'année 2019. Cela permet de relativiser les baisses ou la stabilité des crédits affichées sur certaines missions aujourd'hui, car presque toutes conserveront, en 2026, des crédits supérieurs à ceux de 2019. Et je précise qu'il s'agit d'une comparaison en euros constants : les chiffres de 2019 ont été retraités de l'inflation et des modifications de périmètre entre missions.
Cette hausse en volume de la quasi-totalité des missions du budget général traduit un phénomène d'accoutumance à l'extension toujours plus poussée du champ d'intervention de l'État : toute dépense nouvelle, présentée comme temporaire, est rapidement perçue comme normale et définitive. Or, il faut le répéter : l'impératif de maîtrise de la dépense publique devrait le pousser à revenir, hors dépenses prioritaires, au champ qui était le sien en 2019.
Cet effort devra tout particulièrement concerner les politiques portées par les opérateurs de l'État. En effet, les financements publics des opérateurs sont passés de 50,7 milliards d'euros en 2019 à 73,3 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2026, après avoir atteint un maximum de 80,6 milliards d'euros en 2024. Cela nécessite bien entendu une réflexion de fond sur les politiques que doit ou ne doit pas porter l'État, car une simple suppression des opérateurs aurait surtout pour effet de reporter ces charges sur l'État lui-même.
Enfin, les emplois de l'État continuent de croître : les effectifs augmentent de près de 8 500 emplois en 2026, en parfaite contradiction avec l'objectif de la loi de programmation des finances publiques, qui visait une stabilité de l'emploi de l'État et de ses opérateurs sur la période 2023-2027.
Certes, vous avez pu entendre les ministres présenter, lors de leur audition ici même, une diminution des emplois de 3 000 équivalents temps plein (ETP), mais c'était une présentation contestable, voire trompeuse : pour parvenir à ce résultat, le Gouvernement rassemble artificiellement l'État et les caisses de sécurité sociale, tout en omettant les créations d'emploi dans l'éducation nationale. Il est regrettable que le Gouvernement ait recours à de tels expédients de communication alors qu'il est facile de consulter les chiffres dans les documents budgétaires.
Mes chers collègues, ce projet de budget, comme celui qui a été présenté l'an passé, témoigne d'une prise de conscience manifeste de la nécessité de rétablir les finances publiques et prévoit un certain effort sur les dépenses. J'en donne acte au Gouvernement.
Toutefois, je considère que l'effort reste encore insuffisant, et très inférieur à celui qui avait été accompli l'an dernier. Le projet de loi de finances repose en outre sur une quantité excessive de ressources temporaires, il crée trop de nouvelles recettes fiscales et ne présente pas assez de perspectives pour un recentrage de l'État sur ses missions indispensables.
La maîtrise du budget est pourtant la condition de notre liberté d'action. Le Sénat, avec notre commission des finances et ses rapporteurs spéciaux, devra, une nouvelle fois, jouer pleinement son rôle dans le débat. La France a besoin de stabilité et ce n'est pas la copie budgétaire mouvante d'un gouvernement sans boussole qui peut la lui offrir.
M. Vincent Delahaye. - J'aurais préféré que le titre du diaporama mentionne le « déséquilibre » plutôt que « l'équilibre » général...
J'aborderai trois points.
Le premier concerne la composition de la croissance. Quelle est la part de la dépense publique dans le taux de croissance prévu ? À mon sens, la dépense publique entraîne un ralentissement de la croissance de la TVA.
Le deuxième point porte sur les prévisions de recettes, qui me surprennent. Le rapporteur général juge-t-il crédibles les prévisions en matière de TVA ? Idem pour les 9 milliards d'euros de recettes supplémentaires d'impôt sur le revenu. Je m'interroge également sur les 7 milliards d'euros d'apport de l'Agence nationale de la recherche aux recettes de 2026. A-t-elle encore des réserves ? Avons-nous repris la totalité de ses dotations ou seulement une partie ? Si nous n'en avons repris qu'une partie, est-ce suffisant ?
Enfin, troisième point, on note que les efforts portent principalement - en 2025, c'était à 100 % - sur les recettes. Pour ma part, j'estime qu'ils devraient porter à 100 % sur les dépenses. Les administrations publiques centrales prévoient d'augmenter ses dépenses en volume de 1,6 % en 2026, alors que celles des collectivités locales doivent a priori diminuer, et les effectifs de l'État sont en augmentation de 8 500 équivalents temps plein (ETP) : les efforts sont, à ce stade, vraiment insuffisants.
M. Albéric de Montgolfier. - Je partage l'analyse du rapporteur général. On nous parle des déficits de la sécurité sociale et des collectivités, mais l'origine des déficits réside, à plus de 83 %, dans l'accumulation des déficits primaires de l'État, année après année. Réduire ce déficit primaire devrait être le premier objectif.
En tant que rapporteur spécial du programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État », je sais que le sujet n'est pas de savoir si nous remboursons notre dette, mais si nous sommes capables de payer plus de 100 milliards d'euros d'intérêts à une échéance relativement brève.
J'attire votre attention sur le fait que nous parlons de grandes masses financières : toute modification a un impact considérable. Si les taux augmentent de 0,1 point, cela représente, à terme, 3,2 milliards d'euros. S'ils augmentent de 1 %, c'est plus de 32 milliards d'euros qu'il faudra trouver...
Or les taux risquent de rester à un niveau élevé, et ce pour deux raisons.
D'abord, parce qu'en raison de la dégradation de notre notation nous nous privons d'un certain nombre d'investisseurs : ils n'investiront plus dans la dette française pour des raisons prudentielles.
Ensuite, parce que, à ce niveau de montants financiers, une étincelle peut tout de suite avoir de lourdes conséquences. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et en Italie. Les banquiers que j'ai entendus dans le cadre de mes travaux me disent tous que nous sommes arrivés à de tels niveaux de dette que les taux peuvent, à tout moment, monter à 5 % ou 7 %.
Nous allons donc continuer à payer notre dette durablement plus cher.
M. Marc Laménie. - Avons-nous une idée des conséquences financières, en termes d'endettement, des aides mises en place au moment de la crise du covid-19 ?
Les crédits de la défense sont en augmentation de 6,7 milliards d'euros. Ce secteur est une priorité, et il représente aussi des emplois, directs et indirects. Mais cela n'est pas toujours bien compris par l'opinion publique.
On évoque l'augmentation de l'épargne des ménages : quelles en sont les conséquences ?
M. Christian Bilhac. - On peut résumer ce projet de loi de finances par la formule : « le rabot sanctuarisé. » Le rabot, instrument mythique de Bercy, a été ressorti : excepté la défense, on rabote tout ! Ce budget aurait pu être fait par un élève de CM1 avec une petite calculette.
Et pourtant les Français se plaignent : du secteur de la santé, qui est dans un état catastrophique ; de la sécurité, qui est une de leurs préoccupations principales ; du système éducatif, qui dégringole dans le classement Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), établi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Les maires se plaignent de ne rien pouvoir faire, d'être freinés, bloqués, par l'administration. On entend le même discours chez les agriculteurs et les chefs d'entreprise. Récemment, lors de la visite d'une cave coopérative, on m'a expliqué qu'entre l'adoption du projet en conseil d'administration et l'inauguration, il s'était passé neuf ans !
Et on ne fait rien pour remédier à cette situation. On conserve tous nos opérateurs, une administration pléthorique, des doublons, des triplons, des quadruplons dans tous les domaines !
Le rapporteur général nous dit que la suppression des opérateurs conduirait à aggraver la charge qui pèse sur le reste du secteur public ; je n'en suis pas certain.
Prenons l'exemple du logement. Si l'on supprimait l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et tous les « machins » qui gravitent autour du ministère du logement, leurs crédits pourraient être gérés par les départements, peut-être en recrutant des personnels supplémentaires, mais qui ne seraient pas aussi nombreux que les effectifs de tous ces organismes.
Autre exemple, les Ehpad, qui sont sous le double contrôle du conseil départemental et de l'agence régionale de santé (ARS). Pourquoi ce double contrôle, qui fait perdre un temps considérable aux directeurs de ces établissements ?
Des économies peuvent être faites sur le budget de l'État. Les frais de structure, les frais administratifs, sont les seuls à n'être jamais rabotés, ils sont intouchables : on rabote donc toujours l'opérationnel.
Enfin, je souhaiterais savoir si les 401 milliards d'euros de recettes fiscales incluent la totalité de la TVA, ou seulement la moitié ?
M. Grégory Blanc. - Il est inquiétant d'entamer la discussion du budget en partant d'une prévision de croissance de 1,4 %, qui est loin, à la fois, du consensus des économistes et des constats du Haut Conseil des finances publiques (HCFP). Cela signifie qu'il va falloir trouver des marges de manoeuvre dans la discussion budgétaire pour respecter la trajectoire que le pays s'est fixée.
En dehors des dépenses pour la dette et la défense, il n'y a rien dans ce budget qui permette de préparer l'avenir, notamment en relançant la demande. Le rendement des impôts liés à la consommation est en baisse ; je pense notamment à l'ex-TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). S'agissant de la TVA, des interrogations demeurent.
Des impôts créés l'année dernière et prétendument temporaires sont reconduits. Nous aurait-on menti ? Ce qui était temporaire a-t-il vocation à devenir permanent ? Concernant la surtaxe « Barnier » d'impôt sur les sociétés, faudrait-il repenser le système de manière plus permanente au regard de la baisse des impôts assis sur la consommation ? Il en est de même pour la contribution différentielle sur les hauts revenus : faut-il envisager les choses dans une trajectoire plus large ?
Par ailleurs, rien dans ce budget ne vise à encourager la désépargne, pour relancer la consommation et, partant, la TVA. Comment abordons-nous ce sujet ?
Enfin, je m'associe aux propos de Christian Bilhac sur les collectivités. Celles-ci vont supporter près de la moitié des économies attendues. Le Sénat peut-il considérer cela comme normal, alors même que les transferts de charges continuent ? Je songe aux polices municipales, pour lesquelles un projet de loi nous sera bientôt soumis, ou aux charges sociales assumées par les départements.
M. Thierry Cozic. - Ce projet de loi de finances, qui traduit un budget d'austérité, est un texte de souffrance pour les Français : il cherche dans la poche de ceux qui n'ont pas créé de problème des solutions qui ne fonctionnent pas.
L'effort de consolidation budgétaire qui est demandé est estimé à une trentaine de milliards d'euros : 17 milliards d'euros de baisse de dépenses et 14 milliards d'euros de hausse de recettes, dans une période de croissance atone - celle-ci devrait être de 0,7 % selon l'OFCE. Nous savons que l'austérité freine la croissance. Vouloir corriger le déficit par la baisse des dépenses publiques a donc un effet récessif deux fois plus fort que si cela était fait par une hausse de la fiscalité.
Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? C'est le résultat de huit ans de macronisme : nous avons là les fruits de la politique de l'offre. Les 60 milliards de recettes manquantes chaque année représentent un déficit record hors période de crise. Les dividendes et les rachats d'actions explosent, et le nombre de milliardaires s'accroît fortement. Dans le même temps, le nombre de défaillances d'entreprises est de 68 000 et le taux de chômage repart à la hausse.
L'austérité n'est acceptable que si l'effort est justement réparti, en fonction des capacités contributives de chacun. En l'état, ce projet de loi de finances n'est satisfaisant pour personne, car il pénalise ceux qui n'ont pas contribué à la crise des finances publiques.
Nous avons appris que la majorité sénatoriale voulait effacer l'ensemble des recettes fiscales votées à l'Assemblée nationale, lesquelles permettent aux classes moyennes et populaires de se délester un peu du fardeau imposé par le budget Lecornu. Mes chers collègues, vous voulez laver plus blanc que blanc !
Monsieur le rapporteur général, vous avez dit que nous ne toucherions pas aux recettes. Dans le même temps, vous annoncez que l'effort sur les collectivités sera diminué à hauteur de 2 milliards d'euros. L'an dernier, j'avais émis des réserves sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico), que j'estimais mal calibré. Aujourd'hui, le Gouvernement l'utilise au détriment des collectivités. À l'avenir, elles seront ponctionnées sans aucune certitude de retour. Comment, sans recettes nouvelles, comptez-vous diminuer l'effort demandé aux collectivités et équilibrer le budget ?
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Je partage l'ensemble des observations du rapporteur général.
On entend dire que l'importance du taux d'épargne des retraités montrerait que le niveau des pensions est trop élevé en France. À ma connaissance, il n'existe pas de statistiques sur le taux d'épargne des retraités, mais seulement des statistiques d'épargne par âge. Les 60-69 ans, dont beaucoup sont retraités, ont un taux d'épargne identique à celui des 50-59 ans, et on observe que le taux d'épargne des plus de 70 ans augmente.
Toutefois, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les plus de 70 ans ne sont pas une catégorie homogène. Ainsi, il faut différencier ceux qui sont locataires et ceux qui sont propriétaires de leur logement, voire qui disposent d'un patrimoine financier ou immobilier important. Le niveau des prix de l'immobilier serait une explication aussi plausible, si ce n'est davantage, que celle du niveau des pensions pour expliquer le niveau du taux d'épargne des retraités.
M. Vincent Capo-Canellas. - Nous abordons un exercice budgétaire qui sera particulièrement compliqué cette année. Il le sera pour les raisons financières rappelées par le rapporteur général, mais aussi pour des raisons politiques. C'est sans doute un projet de budget mal né, dans un contexte d'incertitude et de volatilité, en particulier à l'Assemblée nationale.
Nous sommes face à un dilemme. D'un côté, nous ressentons la nécessité, le besoin, l'envie de corriger, et de corriger fortement, le budget, tout en sachant que les réformes prennent du temps et qu'elles interviendront plutôt après l'élection présidentielle. De l'autre, nous souhaitons que les apports du Sénat demeurent dans le texte final. Car il faut garder à l'esprit que la commission mixte paritaire pourrait être conclusive.
Monsieur le rapporteur général, en ce qui concerne l'exécution 2025, vous faites le pari que nous tiendrons bien les 5,4 % de déficit. Il devrait y avoir un acquis de croissance : quel en sera l'impact ?
Nous entendons beaucoup de choses sur le coût de l'incertitude. Pour que nous puissions évaluer la situation - faut-il un compromis et quel en sera le prix ? -, il serait bon que vous puissiez nous éclairer.
Je m'interroge également sur le chiffrage des mesures votées à l'Assemblée nationale. Certaines doivent inévitablement, me semble-t-il, être corrigées. Pourrons-nous parvenir à une forme d'équilibre ?
Enfin, nous savons que c'est rarement au stade du projet de loi de finances que l'on peut baisser les dépenses ; cela se fait en amont. Quelle est donc, selon vous, l'élasticité en matière de dépenses ?
M. Emmanuel Capus. - Monsieur le rapporteur général, votre travail sur le projet de loi de finances présente un intérêt tout particulier cette année. En effet, si la commission mixte paritaire n'était pas conclusive, c'est bien le budget qui nous a été présenté que le Gouvernement promulguerait par voie d'ordonnance.
Cependant, ce n'est pas la version que nous devrions examiner en séance, puisque le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait transmettre la version amendée. Votre rapport porte sur le budget initial. Au stade où nous en sommes, la discussion étant presque terminée à l'Assemblée nationale sur la première partie, comment imaginez-vous « l'atterrissage » du budget, à la suite de la frénésie d'amendements fiscaux du Rassemblement national et de la gauche à l'Assemblée nationale ?
Je relève l'augmentation très importante du nombre d'ETP - 5 400 - à l'éducation nationale. Il me semblait que le baby-boom de l'an 2000 était passé, et que le nombre d'élèves scolarisés était en baisse. Qu'est-ce qui justifie une telle hausse ?
M. Michel Canévet. - Alors que les chefs d'entreprise mettent sur pause leurs investissements et que le contexte est très anxiogène, une croissance de l'ordre de 1 % est-elle réaliste ?
Il est étonnant d'envisager que l'apport des administrations de sécurité sociale au PIB puisse être positif en 2026. On peut en effet s'attendre à ce que le déficit soit au moins aussi important que celui de cette année. Cette contribution de 0,1 % est-elle plausible ?
Mme Ghislaine Senée. - Les débats, notamment à l'Assemblée nationale, montrent une véritable contradiction. On ne parle que de dette et de charge de la dette, mais on refuse la taxe Zucman, et donc la taxation des ultra-riches, et on annonce le gel de la réforme des retraites. Dans l'esprit des Français, cela se résume par toujours moins de recettes et toujours plus de dépenses...
Monsieur le rapporteur général, j'ai noté votre volonté de limiter la contribution des collectivités à 2 milliards d'euros. Pour sa part, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) évoque une amputation de 7,6 milliards d'euros. Nous sommes tout à fait favorables à votre proposition, mais comment comptez-vous parvenir à ce résultat ?
M. Pascal Savoldelli. - Des comparaisons sont faites avec les années passées, mais tous les budgets précédents avaient bien été adoptés. On ne peut pas s'exonérer des choix qui ont été faits, même s'il est normal que la commission des finances ne mette pas en exergue le fait que le Sénat ait voté les budgets Attal, Barnier et Bayrou... Nous évoquerons lors des débats les responsabilités des uns et des autres.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'exercice budgétaire, qui n'est déjà pas simple, est rendu encore plus complexe par le fait qu'il faut essayer d'anticiper toutes les situations. Nous préparons donc les arbitrages sur une deuxième version, amendée, du budget - sera-t-elle le fruit des votes actuels ou y aura-t-il une seconde délibération ? Il faut faire intervenir des constitutionnalistes ; au paradis de l'invention, nous n'avons pas encore tout vu !
Monsieur Delahaye, vous avez ressorti le marronnier du « déséquilibre » général !
En ce qui concerne la croissance, je pense qu'elle est un peu surestimée. Nous avons eu une bonne surprise au troisième trimestre de cette année : la croissance a été dopée par trois secteurs d'activité, que sont la défense nationale, l'aéronautique et la santé. Mais là nous n'envisageons que 1 %, ce qui n'est tout de même pas énorme...
J'entends ceux qui estiment que l'augmentation des recettes fiscales permet d'augmenter la croissance. Lors d'une table ronde avec des économistes, j'ai fait remarquer que, les années passées, nous aurions dû avoir une très forte croissance vu les dépenses publiques très importantes mobilisées au bénéfice des Français... Il faut plutôt faire le pari d'une croissance qui repose sur les moteurs de l'économie que sont les acteurs économiques : la première entreprise de France - l'artisanat -, les TPE, les PME, les ETI et l'agriculture. C'est ainsi que la vie économique se développe dans les territoires.
Par conséquent, le Gouvernement et les entreprises auraient intérêt à nouer un nouveau pacte de confiance et de croissance. Si l'on donnait un coup d'accélérateur en s'appuyant sur les grands secteurs que je viens d'évoquer, la croissance serait plus forte dans les territoires, car l'industrie n'est pas dans les villes. Tel est le pari qu'il faut aujourd'hui relever, en faisant preuve d'imagination et d'audace.
S'agissant des prévisions de recettes de TVA et d'impôt sur le revenu, je n'ai pas de raison de remettre en cause les chiffres qui nous ont été communiqués.
En ce qui concerne l'ANR, il reste 11 milliards d'euros de dotations, qui seront normalement conservées par certains opérateurs qui continuent à utiliser les intérêts.
Sur les effectifs, les efforts sont insuffisants. Concernant l'éducation nationale, le nombre d'enfants scolarisés baisse considérablement, et cette tendance va s'accentuer à la rentrée de 2026. En effet, on a constaté un décrochage du nombre des naissances en 2023 : ces enfants doivent entrer à la maternelle en 2026.
Monsieur de Montgolfier, nous sommes parfaitement d'accord sur le risque d'accident de crédit. Il faut faire attention, car il y a là un enjeu de souveraineté. Le rapport que vous nous aviez présenté montrait qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter outre mesure que les investisseurs étrangers achètent de la dette : paradoxalement, c'est un signe de confiance.
Monsieur Laménie, s'agissant du niveau important du taux d'épargne, plusieurs raisons peuvent être avancées. L'inflation a permis une épargne de précaution, et on constate que ce sont bien sûr les ménages les plus aisés qui ont tendance à épargner davantage. On assiste également à une remise en cause de la théorie du cycle de vie, qui voudrait que les plus âgés d'entre nous désépargnent.
Il faut effectivement trouver des dispositifs pour mobiliser cette épargne. Je suis frappé de voir à quel point les personnes âgées pensent avant tout à leurs petits-enfants, c'est-à-dire aux jeunes générations. Sur ce point, nous avons certainement des choses à imaginer.
Monsieur Bilhac, je ne partage pas votre avis sur le rabot pour des raisons factuelles, mais nous sommes en revanche d'accord sur un point : il n'y a pas le début du commencement d'un mouvement de simplification. C'est un véritable sujet sur lequel je vous invite à prendre des initiatives.
Nous allons, pour notre part, essayer d'aider le Gouvernement à lutter contre l'empilement des normes et des contraintes qui ralentissent les procédures et augmentent les coûts. Je citerai deux exemples : Notre-Dame de Paris et les jeux Olympiques. Grâce à des dispositions singulières, nous avons pu agir beaucoup plus rapidement, avec efficacité et en tenant les budgets. Il faut en tirer des enseignements : nous ne l'avions pas fait après la pandémie de covid-19, et nous avons laissé repartir la folle machine... Je confirme que les annonces de la ministre Amélie de Montchalin sur ce sujet ne sont, pour l'instant, suivies d'aucun effet.
Pour répondre à la question précise que vous m'aviez posée, je vous indique que la part de TVA affectée à l'État représente 51 %, contre 46 % l'an passé.
Monsieur Grégory Blanc, vous avez fait une erreur : la prévision de croissance est de 1 %, et non de 1,4 %, qui correspond au taux d'inflation sous-jacente. Normalement, les chiffres qui nous sont transmis concernant les impôts sur la consommation comme la TVA s'avèrent plutôt exacts.
Monsieur Cozic, vous avez évoqué les éléments de langage qui vont vous guider pendant l'examen du projet de loi de finances en séance publique : « austérité », « souffrance »... Nous sommes en désaccord sur le lien entre croissance économique et dépense publique. Je le répète, quand on voit le niveau de croissance obtenu après une telle débauche d'argent public ces dernières années, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres chemins à emprunter... C'est le message que nombre de Français nous envoient.
Concernant les efforts, nous allons avoir le débat budgétaire. Nous parlons là du tome I du rapport général, gardons-en un peu pour la suite !
Madame Carrère-Gée, en ce qui concerne le taux d'épargne des retraités, les statistiques ont un mérite : celui de donner des ordres de grandeur. Il faut cibler les mesures ; nous regrettons de ne pas l'avoir fait lors de la crise sanitaire. Nous évoquons le sujet de la surépargne depuis plusieurs années. Si de grands théoriciens, qui sont d'ailleurs à la tête des banques, nous expliquent que ce n'est pas le cas, que toute l'épargne est mobilisée, il me semble au contraire que nous pouvons peut-être mieux la mobiliser, afin qu'elle crée davantage de richesses.
Monsieur Capo-Canellas, vous avez parlé d'un projet de loi de finances « mal né ». Comment les choses vont-elles maintenant se passer ? Si vous m'aviez posé la question la semaine dernière, je vous aurais peut-être fait une réponse différente de celle que je vais faire aujourd'hui ou que je ferai demain, car il s'est passé bien des choses incongrues en huit jours à l'Assemblée nationale... Je ne suis pas certain que nous soyons au bout de nos surprises.
Nous allons essayer de produire une copie qui soit dans la lignée des travaux habituels du Sénat : je pense notamment à notre volonté de baisser le niveau des dépenses publiques.
C'est l'Assemblée nationale qui donne le « la », avec le Gouvernement, qui « détermine et conduit la politique de la Nation ». Le Premier ministre étant nommé par le Président de la République, il a déposé le projet de loi de finances plus qu'il ne l'a proposé. Je vois davantage de changements de pied que des lignes directrices. Il est tout de même plus facile de travailler lorsque le cadre ne bouge pas que lorsqu'on ne cesse de le modifier, tout en ajoutant des touches de peinture ici ou là...
J'en viens aux questions sur l'exécution du budget 2025. Je pense que l'objectif de déficit public de 5,4 % du PIB a toutes les chances d'être tenu, au prix, d'une part, des gels et surgels mis en place par le Gouvernement et, d'autre part, d'un non-respect partiel de la copie votée par le Parlement en commission mixte paritaire. Cela doit donc nous inciter à faire preuve de vigilance.
Comme il nous est difficile de chiffrer les mesures votées à l'Assemblée nationale, je reprends les montants avancés par le Gouvernement. Il semblerait que, à ce stade, ces mesures soient évaluées à 36 milliards d'euros.
Nous proposerons des baisses de dépenses, et je note, mes chers collègues, que vous vous employez à le faire sur vos missions, avec plus ou moins de réussite. Ce n'est jamais facile, mais il faut prendre du muscle pour gagner en performance. Les chiffres de la croissance, de la dette et du commerce extérieur montrent que la France n'est pas vraiment la première de la classe en Europe.
Monsieur Savoldelli, vous avez indiqué la ligne qui serait la vôtre durant la discussion du budget.
Monsieur Canévet, la croissance de 1 % est-elle atteignable ? Par rapport aux prévisions, elle est fixée à un niveau un peu élevé, mais il faut toujours faire preuve d'ambition. Je souhaite que nous ayons de bonnes surprises, à l'instar de ce qui s'est passé au troisième trimestre de cette année.
La croissance doit être portée par les acteurs économiques. Il faut travailler davantage pour gagner davantage, avec plus de personnes en activité. Entre les générations qui prennent leur retraite aujourd'hui et celles qui entrent dans la vie active, il y a un différentiel d'au moins 100 000 unités. Or il existe 500 000 emplois non pourvus. Nous marchons sur la tête !
Madame Senée, vous avez mis en exergue la taxe Zucman et la suspension de la réforme des retraites. Heureusement, il n'y a pas que cela ! Je ne fais pas partie de ceux qui opposent une génération à une autre. Il faut plutôt essayer de faire converger les points de vue.
J'évoquerai rapidement le sujet des retraites. J'ai entendu, lors du débat sur la réforme des retraites, que, entre 62 et 64 ans, c'était les plus belles années de la vie. Comme j'ai dépassé cet âge, cela m'attriste, mais je vous remercie, mes chers collègues, d'avoir contribué à rendre ces deux années particulièrement agréables !
Les collectivités doivent faire un effort de 4,6 milliards d'euros dans la copie du Gouvernement. La situation est la même que l'an dernier, lorsqu'on nous avait annoncé un effort de 5 milliards d'euros sans tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres : indices, revalorisation des salaires, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Nous proposons un effort de de 2 milliards d'euros - et il serait bon que le Sénat le fasse de manière unanime.
Si l'on considère l'évolution de la dette entre 2019 et 2026, sur 40 euros d'augmentation, les collectivités pèsent pour 1,1 euro. Je propose donc au Gouvernement de s'occuper en priorité des 38,90 euros restants. Quant à nous, nous ferons notre part du travail. Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons. Nous proposerons d'autres solutions, y compris par rapport au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico) que nous avions imaginé.
M. Claude Raynal, président. - Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2026.html
* 1 « Projet de loi de finances pour 2026 et projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 - Audition de M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, sur l'avis du Haut Conseil », réunion du 20 octobre 2025. En ligne : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20251013/fin.html#toc7.
* 2 S'agissant du Consensus Forecasts, la zone bleu foncé représente les 50 % des prévisions stables autour de la médiane, la zone bleu clair les 30 % de prévisions supplémentaires et la zone bleu clair les 20 % restants. Concernant la Commission européenne, le scénario de prévision est à politique budgétaire inchangée.
* 3 Cepremap, Perspectives macroéconomiques, octobre 2025. En ligne : https://www.cepremap.fr/depot/2025/10/Macroeconomic-outlook-17-october-2025.pdf.
* 4 4,2 % en France contre 0 en Allemagne, au T2 2025.
* 5 5,3 % en France contre 2,9 % en Allemagne, au T4 2026.
* 6 À savoir « l'incertitude politique générée par 1) le résultat des élections européennes, 2) la dissolution de l'Assemblée nationale, 3) le résultat des élections législatives et 4) les difficultés à constituer un gouvernement », donc la séquence de l'été 2024, puis l'incertitude engendrée par « 5) les difficultés à voter les textes budgétaires dans les délais usuels ».
* 7 Raul Sampognaro (2024), « Effet d'un choc d'incertitude politique sur le PIB français », Revue de l'OFCE, n° 187.
* 8 https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/actualites/barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof-2025-le-grand-desarroi-democratique/.
* 9 Département analyse et prévision de l'OFCE, « Jusqu'ici la croissance résiste. Perspectives 2025-2026 pour l'économie européenne et mondiale », 15 octobre 2025. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2025/OFCEpbrief150.pdf.
* 10 https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/18457.html.
* 11 15 % pour l'automobile, 50 % pour l'acier et l'aluminium, par exemple, au titre de la section 232 de la loi de 1962 pour l'expansion du commerce - le taux de 50 % demeure même après l'accord de septembre 2025.
* 12 Déficit commercial des Etats-Unis avec un pays donné a été rapporté au total des importations depuis ce pays. Les économistes s'accordent pourtant à dire que le solde courant est indicateur plus pertinent.
* 13 L'« excédent de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis » masque en fait une forte hétérogénéité, plus de la moitié de cet excédent provenant en réalité de l'Allemagne. En 2024, la France, qui accuse un important déficit vis-à-vis de l'Allemagne, a exporté 83 milliards d'euros de biens vers les États-Unis et en a importé exactement le même montant.
* 14 Ces droits sont dits « réciproques » en ce qu'ils s'appliqueraient en représailles à des droits imposés par leurs partenaires commerciaux sous la forme de « manipulations de devises et barrières non tarifaires ».
* 15 Gary Hufbauer et Ye Zhang, `Who is paying for Trump's tariffs? So far, it's US businesses », Peterson Institute for International Economics. En ligne : https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2025/who-paying-trumps-tariffs-so-far-its-us-businesses.
* 16 P. Fajgelbaum, P. Goldberg, P. Kennedy, A. Khandelwal, « The Return to Protectionism », The Quarterly Journal of Economics. En ligne : https://academic.oup.com/qje/article-abstract/135/1/1/5626442.
* 17 Indices de mesure de l'incertitude politique de Baker-Bloom-Davis. En ligne : https://www.policyuncertainty.com/bbd_monetary.html.
* 18 Perspectives européennes et mondiales de l'OFCE, « Jusqu'ici la croissance résiste ». En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/prev/prev2509/inter/synthese.html
* 19 OFCE, « Perspectives 2025-2026 pour l'économie française », octobre 2025. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/prev/prev2509/france/comext.html.
* 20 Perspectives de l'OFCE pour 2026. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/prev/prev2509/france/investissement.html.
* 21 Chiffres provisoires encore à confirmer par la Banque de France.
* 22 Entreprises qui auraient fait faillite en l'absence de mesures de soutien.
* 23 Ludovic Subran, « La marée montante des défaillances d'entreprises », Les Echos, 23 octobre 2025. En ligne : https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-maree-montante-des-defaillances-dentreprises-2194064.
* 24 « Indicateur du climat des affaires - Tous secteurs - France métropolitaine », Insee. En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001565530#Graphique.
* 25 Banque de France, Enquête mensuelle de conjoncture, octobre 2025. En ligne : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/enquete-mensuelle-de-conjoncture-debut-octobre-2025.
* 26 Source : Eurostat. Le trait pointillé est le rendement après IS et le trait plein avant IS. Les traits colorés correspondent à chaque pays, les traits fins gris rappellent les autres pays. Les actifs productifs sont connus, selon les pays, jusqu'en 2024 ou 2023 ou 2022. L'impôt sur les sociétés des sociétés financières est affecté à la branche K et celui des sociétés non financières aux branches marchandes hors services financiers et immobilier des ménages.
* 27 https://xtimbeau.github.io/travail/.
* 28 L'OFCE anticipe cependant le taux d'épargne à 18,7 % en 2025 et 18,2 % en 2026.
* 29 « Épargne des ménages français : pourquoi est-elle si élevée et où va-t-elle ? », Analyse et Diagnostic, Paul Berthier, institut Rexecode, février 2025. En ligne : https://www.rexecode.fr/conjoncture-previsions/notes-d-analyse/analyse-et-diagnostic/a-d-france/epargne-des-menages-francais-pourquoi-est-elle-si-elevee-et-ou-va-t-elle.
* 30 Rapport d'Enrico Letta, « Bien plus qu'un marché. Renforcer le marché unique afin d'assurer un avenir durable et la prospérité pour tous les citoyens de l'UE », avril 2024. En ligne : https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf.
* 31 DG Trésor, « Flash conjoncture France - Quels facteurs pourraient expliquer le taux d'épargne élevé en France ? », juin 2025. En ligne : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2025/06/06/flash-conjoncture-france-quels-facteurs-pourraient-expliquer-le-taux-d-epargne-eleve-en-france.
* 32 Il est important de noter que les données relatives à l'épargne sont des données provisoires, qui peuvent connaître des révisions parfois importantes jusqu'à deux ans et demi après la publication de la première estimation.
* 33 En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8594943.
* 34 Note de conjoncture de l'Insee (juin 2025), « L'épargne des ménages au sommet ». En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8594943.
* 35 Hippolyte d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! », in L'économie mondiale 2026.
* 36 « L'épargne des ménages au sommet », note de conjoncture de l'Insee, juin 2025. En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8594943.
* 37 Chaque année, les ménages sont classés en sous-groupes selon la classe d'âge de l'année précédente. L'âge pris en compte est celui du membre le plus âgés du ménage. Calculs Insee à partir de données de La Banque postale, sur un échantillon de clients actifs.
* 38 « L'épargne des ménages au sommet », note de conjoncture de l'Insee, juin 2025. En ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8594943.
* 39 Le rendement d'un euro cotisé pourrait en effet fortement diminuer pour les générations futures.
* 40 Cette cible est dite « symétrique » depuis juillet 2021, à savoir que la BCE ne doit plus nécessairement rechercher à maintenir l'inflation « inférieure à, mais proche de 2 % ». Voir en ligne : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/la-bce-adopte-une-cible-dinflation-claire-et-symetrique-de-2.
* 41 La règle de Taylor est une règle de détermination des taux d'intérêts couramment utilisée par les banques centrales depuis son énonciation en 1993 par l'économiste John Taylor, popularisée par la banque d'investissement Goldman Sachs en 1996.
* 42 Coenen G. et al. (2010) : « Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models », IMF Working Paper, n° 10/73.
* 43 Benoît Williatte, « Italie : reprise fragilisée par la fin du Superbonus », revue de l'OFCE. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/5-186OFCE.pdf.
* 44 « Budget 2026 : « Les deux jours fériés, cela doit faire partie d'un dialogue avec les partenaires sociaux », estime le rapporteur général du Sénat », Public Sénat. En ligne : https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/budget-2026-les-deux-jours-feries-cela-doit-faire-partie-dun-dialogue-avec-les-partenaires-sociaux-estime-le-rapporteur-general-du-senat.
* 45 Carl Grekou et Thomas Grjebine, « Déficits commerciaux et désindustrialisation : la faute de la demande ? », Cepii, 2022. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2022/let426.pdf.
* 46 Jérôme Fourquet, « L'État-guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire », Le Figaro, mai 2024. En ligne : https://blogs.alternatives-economiques.fr/system/files/inline-files/Fourquet%20-%20stato-consume%CC%81risme%20%28Mai%202024%29.pdf.
* 47 Christian Gollier, « Le dumping fiscal rend impossible la taxe Zucman », Challenges, octobre 2025.
* 48 « Lorsque je reviens à Paris, j'ai l'impression d'être super-riche. Quand je sors avec mes amis, je paie l'addition, cela me coûte le prix d'un repas pour deux à New York. » Cité in Leparmeneier, Arnaud, « Plongée dans une Amérique devenue hors de prix pour les Européens », Le Monde, 28 avril 2024.
* 49 Darvas, Zsolt, « L'idée selon laquelle les performances économiques de l'Europe seraient inférieures à celles des Etats-Unis est erronée », Le Monde, 15 mars 2024. En ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/03/15/l-idee-selon-laquelle-les-performances-economiques-de-l-europe-seraient-inferieures-a-celles-des-etats-unis-est-erronee_6222180_3232.html.
* 50 OCDE, heures travaillées. « Les données visent à effectuer des comparaisons de tendances dans le temps, [mais] à cause de la disparité des sources et des méthodes de calcul, elles ne permettent pas de comparer les volumes moyens d'heures travaillées d'une année donnée. » En ligne : https://www.oecd.org/fr/data/indicators/hours-worked.html.
* 51 Gethin, Amory et Saez, Emmanuel, « Global Working Hours ». En ligne : https://amory-gethin.fr/files/pdf/GethinSaez2025.pdf.
* 52 En ligne : https://finance.yahoo.com/news/powell-says-unlike-dotcom-boom-210422880.html.
* 53 Hancock, Alice, Bounds, Andy, Russell, Alec, "EU to demand technology transfers from Chinese companies", 19 novembre 2024, Financial Times. En ligne : https://www.ft.com/content/f4fd3ccb-ebc4-4aae-9832-25497df559c8. « EU floats conditions such as tech transfers for China investments », 15 octobre 2025, Reuters. En ligne : https://www.reuters.com/world/china/eu-floats-conditions-such-tech-transfers-china-investments-2025-10-14/.
* 54 Philippe Askenazy, Emilie Cupillard, Guillaume Houriez, Yves Jauneau, Dorian Roucher, « À la recherche des gains de productivité perdus depuis la crise sanitaire », juillet 2024, blog de l'Insee. En ligne : https://blog.insee.fr/la-productivite-du-travail-fr-depuis-la-crise-sanitaire/.
* 55 Denis Ferrand, « Pourquoi la hausse du taux d'emploi n'a pas suffi à réduire le déficit public en France », Les Échos. En ligne : https://www.rexecode.fr/l-institut/rencontres-et-debats/rexecode-dans-les-medias/pourquoi-la-hausse-du-taux-d-emploi-n-a-pas-suffit-a-reduire-le-deficit-public-en-france.
* 56 À titre d'exemple, l'essor de la Chine depuis la fin du XXe siècle a pu être lu, entre autres, comme un effet du « dividende démographique » (cf. infra) lié à la politique de l'enfant unique, abandonnée seulement en 2016.
* 57 H. d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! », in L'Economie mondiale 2026. En ligne : https://shs.cairn.info/l-economie-mondiale-2026--9782348089299-page-99?lang=fr.
* 58 Zsolt Darvas, Lennard Welslau, Jeromin Zettelmeyer, « Les changements démographiques auront un impact sur la viabilité de la dette publique dans les pays de l'Union européenne », 2025, Journal of Policy Modeling.
* 59 Antoine Foucher, « Budget : Privilégier les retraites à l'école est un choix suicidaire », Les Echos, 22 octobre 2025. En ligne : https://www.la-croix.com/a-vif/depenser-pour-les-retraites-plutot-que-pour-l-ecole-est-un-choix-suicidaire-20251022.
* 60 Scénario de référence : hypothèses démographiques centrales de l'Insee (poursuite des gains d'espérance de vie, fécondité de 1,8 enfant par femme et solde migratoire net de 70 000 personnes par an), croissance annuelle de la productivité horaire du travail de 0,7 % (à partir de 2040) et taux de chômage de 7 % (à partir de 2032).
* 61 Hippolyte d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! », in L'économie mondiale 2026.
* 62 Dans l'article précité, H. d'Albis évoque le fait que les cohortes moins nombreuses connaissent généralement une élévation de leur niveau d'éducation : « avec moins d'enfants à éduquer, les ressources disponibles par personne pour l'éducation sont plus grandes, ce qui favorise une amélioration du niveau moyen de capital humain. Cette amélioration qualitative peut largement compenser la diminution quantitative des effectifs (Bloom et al., 2003). Cette dynamique s'observe particulièrement bien dans les pays asiatiques, qui ont connu des baisses rapides de fécondité accompagnées d'investissements massifs dans l'éducation. La Corée du Sud, Taïwan ou Singapour illustrent parfaitement ce mécanisme où la qualité a compensé la quantité. »
* 63 Emmanuelle Auriol, Hillel Rapoport, « L'immigration qualifiée : un visa pour la croissance », note du Conseil d'analyse économique n° 67. En ligne : https://cae-eco.fr/limmigration-qualifiee-un-visa-pour-la-croissance.
* 64 FMI, « Dépenser plus intelligemment. Comment des dépenses publiques efficaces et bien réparties peuvent stimuler la croissance économique », octobre 2025. En ligne (en anglais) : https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2025/10/07/fiscal-monitor-october-2025.
* 65 La comparaison entre un stock (la dette) et un flux (le PIB annuel) ne va certes pas de soi. Cette convention, désormais bien établie, permet cependant de visualiser le nombre d'années nécessaires pour rembourser l'intégralité de la dette, dans l'hypothèse où l'intégralité du revenu serait utilisée à cette fin. En toute rigueur, la mesure devrait être exprimée en nombre d'années - elle n'en serait pas moins inquiétante pour la France.
* 66 Luca Fornaro, « Perspectives sur la dette publique et la croissance de la productivité dans la zone euro », BCE, 2025. En ligne : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/sintra/ecb.forumcentbankpub2025_Fornaro_presentation.en.pdf.
* 67 Mathieu Plane, Xavier Ragot, Raul Sampognaro, « Les crises expliquent-elles la hausse de la dette publique en France ? », OFCE, mai 2024 ( en ligne).
* 68 Adrien Auclert, Thomas Philippon et Xavier Ragot (Conseil d'analyse économique), « Quelle trajectoire pour les finances publiques françaises ? », note n° 82, juillet 2024. En ligne : https://cae-eco.fr/quelle-trajectoire-pour-les-finances-publiques-francaises.
* 69 Résolution adoptée par le Parlement européen le 13 mars 2014. En ligne : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0239_FR.html?redirect.
* 70 Puis consacrée par le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES).
* 71 Xavier Ragot, « Politique et déficits publics : l'Angleterre en 1976 », blog de l'OFCE, septembre 2025. X. Ragot s'appuie notamment sur la thèse de Kevin Hickson, 2002, « The 1976 IMF Crisis and British Politics », University of Southampton. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/blog2024/fr/2025/20250908_XR/.
* 72 En toile de fond, une crise budgétaire avait été provoquée par une relance budgétaire du parti travailliste ayant créé une boucle prix-salaires et conduit à la stagflation - coexistence d'une inflation élevée et d'un faible taux d'activité - alors que l'insuffisance de l'offre nécessitait sans doute une approche différente.
* 73 Selon le FMI, « idée que le seul fait d'assurer un risque en augmente du même coup la probabilité, l'assuré étant moins enclin à prendre des mesures pour prévenir les risques ».
* 74 Article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « [...] Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit [à des autorités publiques]. L'acquisition directe, auprès [d'autorités publiques], par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est [...] interdite. »
* 75 CJUE, grande chambre, 16 juin 2015, Peter Gauweiler e.a. c. Deutscher Bundestag, aff. C-62/14.
* 76 Acronyme de l'anglais : Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. Selon la DG Trésor, il s'agit d'un « système propre à l'Eurosystème qui permet le règlement de transactions financières entre banques commerciales situées dans différents pays de la zone ».
* 77 En effet, dans ce cas, la BCE serait fondée à intervenir, dans le cadre de son mandat, au motif que la transmission de la politique monétaire serait empêchée à cause d'une fragmentation de la zone euro - en clair, une divergence des conditions de financement de la dette des États membres.
* 78 Si le commissaire européen à l'économie et à la productivité et commissaire à la mise en oeuvre et à la simplification Valdis Dombrovskis a indiqué en juin 2025 que « la procédure pour déficit excessif est en suspens pour la France » alimentant certaines spéculations, il ne s'agissait que de la mise en suspens de certaines mesures correctrices, la France demeurant bel et bien concernée par une procédure pour déficit excessif.
* 79 Cité par Thibault Marotte, « Dette : le TPI, l'arme méconnue de la BCE qui protège la France », L'Express, octobre 2025. En ligne : https://www.lexpress.fr/economie/dette-le-tpi-larme-meconnue-de-la-bce-qui-protege-la-france-IVXOPKRBWVHWJGO4TCG23MGVGA/.
* 80 Lignes de crédit modulable (LCM, ou flexible credit line) pour les pays qui présentent une politique et des antécédents économiques très solides pour prévenir et résoudre des crises ; ligne de précaution et de liquidité (LPL, ou precautionary and liquidity line), pour répondre aux besoins de liquidité des pays membres dont l'économie est foncièrement solide, mais qui restent exposés à quelques facteurs de vulnérabilité les empêchant d'avoir recours à la ligne de crédit modulable (LCM) ; ligne de liquidité à court terme (LLCT) pour les pays membres dont les fondamentaux macroéconomiques et les cadres de politique économique sont très solides, et qui sont susceptibles de connaître des besoins de liquidité modérés à court terme imputables à des chocs extérieurs qui créent des difficultés de financement de la balance des paiements.
* 81 Ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution (PCCL en anglais), réservée aux États respectant six critères, dont celui d'une dette soutenable ; ligne de crédit assortie de conditions renforcées (ECCL en anglais), pour les États non éligibles à la précédente ligne de crédit, sous condition d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding). En ligne : https://www.esm.europa.eu/content/what-type-esm-precautionary-credit-lines-are-available.
* 82 Banque de France, « Rapport de la balance des paiements et de la position extérieure de la France 2024 », 10 juillet 2025. En ligne : https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/la-balance-des-paiements-et-la-position-exterieure-de-la-france-2024.
* 83 Olivier Blanchard, « Public Debt and Low Interest Rates », 2019, American Economic Review. En ligne : https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.109.4.1197.
* 84 Dans Les Matins de France Culture : « Je vais peut-être vous surprendre comme ministre des Finances, mais je pense que c'est une nécessité [de s'endetter]. Il est moins coûteux pour la France et les Français de s'endetter à taux négatif. Quand nous empruntons de l'argent à dix ans, nous payons un taux à - 0,33 %. Même à très long terme, nous avons fait une levée de dette, la semaine dernière, de 7 milliards d'euros et il y avait 75 milliards d'euros de demande ; nous avons obtenu un taux à cinquante ans à 0,59. Tous ceux qui ont emprunté pour leur logement doivent se dire qu'emprunter à cinquante ans à 0,59, c'est quand même formidable. [...] Après, comment remboursera-t-on et faudra-t-il rembourser ? Évidemment qu'il faut rembourser. Nous rembourserons le moment venu, c'est-à-dire quand la croissance reviendra et que l'épidémie sera derrière nous. [...] Il faudra rembourser la dette par de la croissance. Et aussi, c'est plus difficile à entendre mais c'est indispensable, par le rétablissement de nos finances publiques. »
* 85 Cf. en particulier p. 6 de ce document : https://fgeerolf.com/taxe-inflationniste.pdf.
* 86 François Geerolf, « La taxe inflationniste, le pouvoir d'achat », 2024, site de l'auteur. En ligne : https://fgeerolf.com/taxe-inflationniste.pdf.
* 87 Discours de François Villeroy de Galhau, « Taux à court et long terme : une perspective divergente ? », 31 janvier 2025. En ligne : https://www.banque-france.fr/fr/interventions-gouverneur/taux-court-et-long-terme-une-perspective-divergente.
* 88 Équivalent de AA- pour les autres agences de notation.
* 89 Voir cette page de l'Agence France Trésor pour un récapitulatif : https://www.aft.gouv.fr/en/frances-credit-ratings.
* 90 Cette seconde dégradation a de ce fait davantage surpris et a été appréhendée comme une sanction de l'instabilité politique actuelle.
* 91 Mahir Binici, Michael Hutchison, Evan Weicheng Miao, « Are credit rating agencies discredited? Measuring market price effects from agency sovereign debt announcements », 2018, Banque des règlements internationaux. En ligne : https://www.bis.org/publ/work704.htm.
* 92 Natacha Valla, devant la commission des finances, le 20 octobre 2025.
* 93 Enrico D'Elia, Alessandro Zeli, « At the Origins of the Italian Public Debt », 2023. En ligne : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4678509.
* 94 Philippe Aghion et co-auteurs, « Le Nouveau Consensus européen et le contretemps français », août 2025. En ligne : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/08/29/nouveau-consensus-europeen-contretemps-francais/.
* 95 Éric Heyer et Xavier Timbeau, « Jusqu'ici, la croissance résiste. Perspectives 2025-2026 pour l'économie européenne et mondiale », OFCE, octobre 2025. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2025/OFCEpbrief150.pdf.
* 96 « Dégradation des finances publiques : entre pari et déni », mission d'information de la commission des finances du Sénat, rapport d'information n° 685.
* 97 https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/10/03/les-investisseurs-ne-croient-guere-a-la-baisse-annoncee-du-deficit_6644285_823448.html.
* 98 Moniteur budgétaire d'octobre 2025, (p. 48). En ligne : https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2025/10/07/fiscal-monitor-october-2025.
* 99 Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 100 Il s'agit même d'une composante importante, cf. supra.
* 101 Cité dans Marc Vignaud, « Réduction du déficit : il n'y a pas d'alternative », L'Opinion. En ligne : https://www.lopinion.fr/economie/reduction-du-deficit-il-ny-a-pas-dalternative.
* 102 François Godard, « Comment sort-on d'une crise budgétaire ? Les leçons de la Suède et du Canada », Le Grand Continent, juillet 2025. En ligne : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/07/24/comment-sort-on-dune-crise-budgetaire-les-lecons-de-la-suede-et-du-canada/.
* 103 Cosnard, Denis et Segaunes, Nathalie, « Budget : Sébastien Lecornu abandonne le mode de calcul de François Bayrou », Le Monde. En ligne : https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/09/20/budget-sebastien-lecornu-abandonne-le-mode-de-calcul-de-francois-bayrou_6641937_823448.html.
* 104 Elle ne permet que très imparfaitement de tenir compte des mesures de régulation budgétaire infra-annuelles ainsi que des recettes constatées, en fonction de l'activité et des élasticités des prélèvements obligatoires au PIB.
* 105 Ces dépenses structurelles correspondent, selon le RESF, « à la dépense publique y compris crédits d'impôt, hors mesures ponctuelles et temporaires en dépense et effets de la conjoncture sur les dépenses chômage ».
* 106 Voir sur ce point le commentaire de l'article 2 du présent PLF au sein du tome II du présent rapport.
* 107 Rapport économique, social et financier, annexé au projet de loi de finances pour 2026, p. 177.
* 108 Cette catégorie regroupe des mesures telles que la contribution sur les rentes infra-marginales, la hausse de taux de cotisations maladie FPH FPT, l'instauration de la montée en charge du Fonds de résolution unique, l'effet temporaire de la bascule CICE cotisations, la hausse des taux d'imposition des impôts directs locaux, la lutte contre la fraude fiscale...
* 109 Issus du patrimoine, des salaires ou des revenus de transfert.
* 110 Le pouvoir d'achat par unité de consommation étant défini comme le revenu disponible brut (RDB) réel des ménages, rapporté au déflateur de la consommation des ménages et au nombre d'unités de consommation (UC). Au sein d'un ménage, le premier adulte compte pour 1 UC, les autres personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC, et celles de moins de 14 ans pour 0,3 UC.
* 111 Ombeline Jullien de Pommerol, Pierre Madec, Mathieu Plane, Raul Sampognaro, « De la crise Covid au choc inflationniste. Une analyse macro/micro du pouvoir d'achat en France », Policy Brief n° 124, OFCE, 15 février 2024. En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2024/OFCEpbrief124.pdf.
* 112 « C'est possible, mais penser que cela n'aura aucune incidence sur la consommation, les carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi faibles et seront encore plus réduits par la guerre commerciale, les projets d'emploi et d'investissement des entreprises me semble un pari risqué. Certains risquent de s'habiller de nouveau en jaune. »
* 113 Nicolas Baumard et Coralie Chevallier, « L'impact environnemental des jets privés est largement sous-estimé », 9 septembre 2022, Le Monde. En ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/09/l-impact-environnemental-des-jets-prives-est-largement-sous-estime_6140838_3232.html.
* 114 Il en était ainsi, par exemple, des effets différenciés de l'inflation sur les ménages « en fonction des habitudes de consommation et du cadre plus ou moins contraint de celles-ci, du lieu de vie, de la façon dont évoluent les revenus, les ménages sont susceptibles d'être différemment exposés aux conséquences de l'inflation ». Conseil d'analyse économique, « Mesurer les effets hétérogènes de l'inflation sur les ménages ». En ligne : https://cae-eco.fr/mesurer-les-effets-heterogenes-de-linflation-sur-les-menages.
* 115 Cournède, Goujard, Pina, de Serres, « Choosing fiscal consolidation instruments compatible with growth and equity », Economic Policy Paper, 2013. En ligne : https://www.oecd.org/en/publications/choosing-fiscal-consolidation-instruments-compatible-with-growth-and-equity_5k43nxq6dzd4-en.html.
* 116 Bacache-Beauvallet, Bureau, Giavazzi et Ragot, « Quelle stratégie pour les dépenses publiques ? », note du Conseil d'analyse économique n° 43, juillet 2017. En ligne : https://cae-eco.fr/static/pdf/cae-note043v2.pdf.
* 117 Jean Pisani-Ferry, Selma Mahfouz, « Les incidences économiques de l'action pour le climat », 2023, Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan. En ligne : https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/incidences-economiques-de-laction-climat.
* 118 Cf. les travaux de l'économiste Christian Gollier, qui a occupé la chaire annuelle « Avenir commun durable » au Collège de France, sur la valeur d'actualisation.
* 119 La nomenclature ne correspond toutefois pas nécessairement au même périmètre de dépenses « vertes » ou « brunes » que les obligations assimilables au Trésor « vertes », ce qui appelle une mise en cohérence.
* 120 Julien Grenet, Camille Landais, « Éducation : comment mieux orienter la dépense publique », note du Conseil d'analyse économique n° 84, mai 2025. En ligne : https://cae-eco.fr/education-comment-mieux-orienter-la-depense-publique.
* 121 Il s'agit notamment « du dédoublement des classes au primaire, du tutorat, des outils numériques d'apprentissage adaptatif en mathématiques, de certaines interventions visant à renforcer les compétences socio-comportementales, des formats intensifs de formation continue pour les enseignants, des inspections pédagogiques, et des dispositifs favorisant l'implication des parents ».
* 122 Ben-Porath, « The production of human capital and the life cycle of earnings », Journal of Political Economy, 1967 ; Hazan, « Longevity and lifetime labor supply : evidence and implications », 2009, Econometrica. Cités par d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! » in L'économie mondiale 2026.
* 123 Patrick Aubert, Maïlys Pedrono, Maxime Tô, Todor Tochev, « Retraites des fonctionnaires d'État : faut-il changer la convention comptable ? », juin 2025. En ligne : https://www.ipp.eu/publication/retraites-des-fonctionnaires-detat-faut-il-changer-la-convention-comptable/.
* 124 Le projet de loi de finances pour 2026 révise en effet les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, encore en cours.
* 125 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 126 Voir le décret n° 2024-1253 du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025, pris en application de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 127 Voir ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Gestion budgétaire de l'État et des organismes publics nationaux et opérateurs financés par l'État en période de services votés, 4 février 2025.
* 128 Audition de M. Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et Mme Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'exécution budgétaire en 2025, devant la commission des finances du Sénat, 19 mars 2025.
* 129 Audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, devant la commission des finances du Sénat, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes pour l'année 2024 ainsi que sur l'exécution 2025, 17 juin 2025.
* 130 Décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits et rapport relatif à ce décret.
* 131 Les quatre autres programmes ont été les trois programmes du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et le programme 824 « Prêts et avances à des services de l'État » de la mission Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ».
* 132 Crédits disponibles au 10 avril 2025.
* 133 Décret n° 2025-951 du 8 septembre 2025 portant ouverture et annulation de crédits et rapport relatif à ce décret, publiés au Journal officiel du 9 septembre 2025.
* 134 Ces décrets ont permis de financer le paiement des primes d'épargne logement (PEL), les dépenses liées aux élections législatives de la mi-année, les premiers besoins urgents à la suite du passage du cyclone Chido à Mayotte et enfin de lancer un projet de regroupement immobilier des services de l'administration centrale, ainsi que, par deux fois, d'abonder les fonds spéciaux de la direction générale de la sécurité extérieure ( rapport n° 743 (2024-2025), tome II, annexe 15, volume 1, de Claude Nougein, rapporteur spécial, sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024, déposé le 18 juin 2025).
* 135 Donc en retirant de la TVA brute totale (288,2 Mds€ en 2025) les remboursements et dégrèvements (78,2 Mds€) et les parts de TVA attribuées à la sécurité sociale (56,4 Mds€), aux collectivités territoriales (52,7 Mds€) et à l'audiovisuel public (4,0 Mds€).
* 136 Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2026, p. 74.
* 137 Annexe « Voies et moyens », tome I, au projet de loi de finances pour 2026.
* 138 Article 31 du projet de loi de finances.
* 139 Article 50 du projet de loi de finances.
* 140 Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
* 141 Une dotation peut être, dans certaines conditions, dévolue définitivement au projet soutenu.
* 142 Ce montant fait l'objet d'une ouverture d'autorisations d'engagement sur le programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investir pour la France de 2030 ».
* 143 Rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2026, p. 68.
* 144 Article 10 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 145 Le besoin de financement de l'État est financé (II de l'article 48 du présent projet de loi de finances) par des ressources de long terme (émission de dette à moyen et long terme, nettes des rachats ; ressources affectées au désendettement) et par des ressources de court terme, exprimées en variation de solde entre le début et la fin de l'année (variation nette de l'encours des titres d'État à court terme ; variation des dépôts des correspondants ; variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État ; autres ressources de trésorerie).
* 146 Rapports annuel de performance de la mission « Engagements financiers de l'État » pour les exercices 2019 et 2024.
* 147 Agence France Trésor, Principaux chiffres. La durée de vie moyenne était, à la fin septembre 2025, de 9 ans et 24 jours pour la dette de moyen et long terme et de 8 ans et 173 jours pour l'ensemble de la dette négociable.
* 148 La charge budgétaire de la dette inclut les crédits de deux programmes de la mission « Engagements financiers de l'État » : le programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État », qui inclut, d'une part, la charge de la dette proprement dite résultant des intérêts d'obligations assimilables du Trésor (OAT, 53,4 Mds€) et de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF, 4,6 Mds€) et, d'autre part, la charge liée à la trésorerie (0,6 milliard d'euros) ; le programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État » (0,7 Md€).
* 149 Projet annuel de performances de la mission « Engagements financiers de l'État », annexé au projet de loi de finances pour 2026.
* 150 La présentation des affectations de taxes a ainsi été nettement améliorée, en réunissant l'ensemble des mesures en un seul tableau (voir l'article 36 du projet de loi de finances et sa présentation dans le tome II du présent rapport). De même l'alinéa final de l'article d'équilibre (article 48), qui prévoit l'affectation des excédents de recette à la réduction du déficit, a été restauré après avoir été omis deux années de suite dans le projet de loi de finances, et restauré l'an passé à l'initiative du Sénat.
* 151 Un décret ne peut ouvrir de crédits nouveaux que s'il annule un volume au moins égal de crédits. Le décret d'avance n° 2022-512 du 7 avril 2022 a ainsi été « gagé » par le report, quelques jours auparavant, de crédits non consommés l'année précédente sur la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » (voir le rapport d'information n° 600 (2021-2022), de Jean-François Husson , rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 31 mars 2022.
* 152 Le Sénat a ainsi, sur sa proposition, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, refusé d'autoriser les dérogations à la limite de 3 % des reports de crédits de paiement.
* 153 Article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 154 Programme « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » ».
* 155 Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
* 156 Exposé général du premier projet de loi de finances rectificative pour 2021, déposé à l'Assemblée nationale le 2 juin 2021.
* 157 Cour des comptes, note d'exécution budgétaire relative à l'exécution 2024.
* 158 Chiffrage des mesures nouvelles, tableau associé au document « Voies et moyens », tome 1.
* 159 Selon l'annexe « Voies et moyens », tome II, la défense fiscale 210324 « Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi » aurait un coût résiduel de 35 millions d'euros en 2026, alors qu'elle avait atteint 19,4 milliards d'euros en 2018.
* 160 État A annexé au projet de loi de finances. L'évaluation préalable de l'article estime le gain entre 0,8 et 1 Md€ selon les hypothèses retenues.
* 161 Cette évaluation est fournie par le document « Voies et moyens », tome 1, annexé au projet de loi de finances, et inscrite à la ligne 1442 dans l'état A. L'évaluation préalable de l'article 22 prévoit plutôt un rendement de 0,6 Md€ à compter de 2026, mais, comme pour toute taxe comportementale, le produit réel dépendra de l'impact que la taxe aura sur le trafic de colis.
* 162 Article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, transposant la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.
* 163 Le document « Voies et moyens », tome 1, consacre une demi-page aux deux DMTG et quatre pages et demie aux accises sur l'énergie.
* 164 Articles 49 à 51 du présent projet de loi de finances, dont les montants sont répartis par missions et programmes budgétaire dans les états annexés B, C et D.
* 165 Article 48 du présent projet de loi de finances.
* 166 Depuis la révision de la loi organique relative aux lois de finances du 28 décembre 2021, les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux sont comptabilisés comme des dépenses et ne sont plus retranchés des dépenses nettes.
* 167 Patrick Aubert, Maïlys Pedrono, Maxime Tô, Todor Tochev, Retraites des fonctionnaires d'État :
faut-il changer la convention comptable ?, juin 2025.
* 168 Assemblée nationale, Questions au Gouvernement (vidéo), mardi 22 octobre 2025.
* 169 Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique, annexe au projet de loi de finances pour 2026.
* 170 Dossier de presse du projet de loi de finances, mais aussi lois de programmations sectorielles (Défense, Sécurités, Justice, Recherche).
* 171 L'état F inclut également les dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission. Cependant, les avances aux collectivités territoriales ne peuvent être considérées comme une véritable dépense de l'État puisqu'elles sont remboursées en cours d'année par le produit des impositions locales ; en outre la majeure part des dépenses du compte d'affectation spéciale « Pensions » sont en doublon avec les contributions des missions du budget général et des budgets annexes à ce compte. En conséquence les dépenses des comptes spéciaux ne sont pas prises en compte dans la présentation qui suit.
* 172 Les remboursements et dégrèvements sont partiellement pris en compte à travers l'imputation des dépenses fiscales sur les moyens globaux de chaque mission.
* 173 Le prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne est, pour sa part, rattaché dans cette présentation à la mission « Action extérieure de l'État ».
* 174 Article 10 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
* 175 Effet en année pleine d'une disposition prévue par l' article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 176 Disposition portée par l'article 42 du présent projet de loi de finances pour une entrée en vigueur au 1er mai 2026.
* 177 Annexe 1 « Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025 » à l'exposé général du projet de loi de finances pour 2026.
* 178 Article 4 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
* 179 La charge de la dette considérée ici correspond aux crédits des programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État » et 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État » de la mission « Engagements financiers de l'État ».
* 180 Le déficit public a été de 2,3 % du PIB en 2018 et 2,4 % en 2019, tel que mesuré après le passage des comptes nationaux en base 2020 (rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2024).
* 181 Annexe « Opérateurs », p. 24.
* 182 Inspection générale des finances, Analyse du niveau de trésorerie des opérateurs de l'État et du modèle de relations financières entre l'État et ses opérateurs, juillet 2023.
* 183 Inspection générale des finances (IGF) et inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Revue de dépenses publiques en direction des associations, mai 2025.
* 184 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
* 185 Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
* 186 Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
* 187 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
* 188 Crédits de paiement ouverts en loi de finances, y compris les remboursements et dégrèvements et les contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions ».
* 189 Article 11 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques.
* 190 Source : données transmises au rapporteur général.
* 191 Dépenses de personnel hors contribution au CAS Pensions, retraitées.
* 192 Dossier de presse du projet de loi de finances.