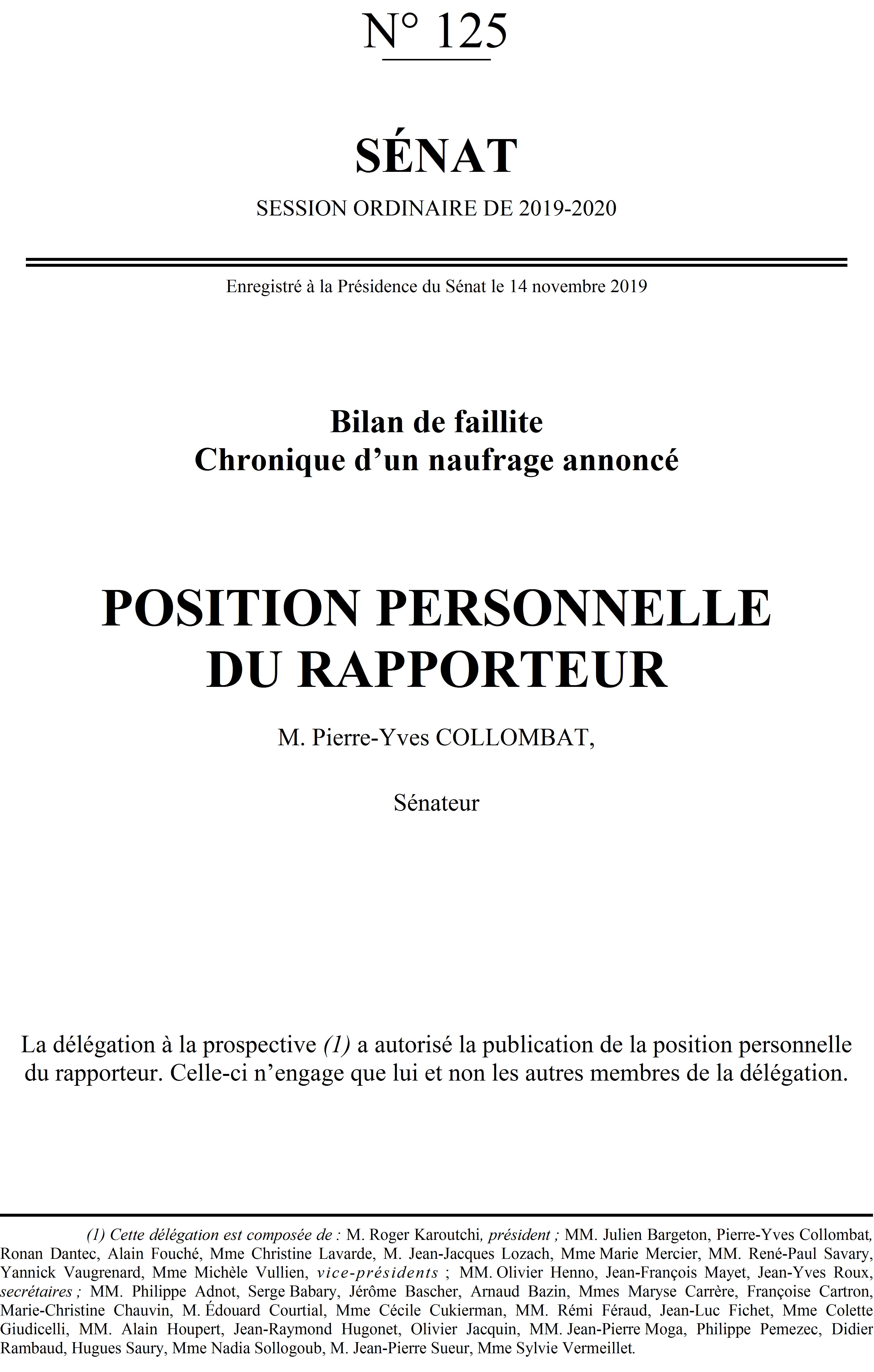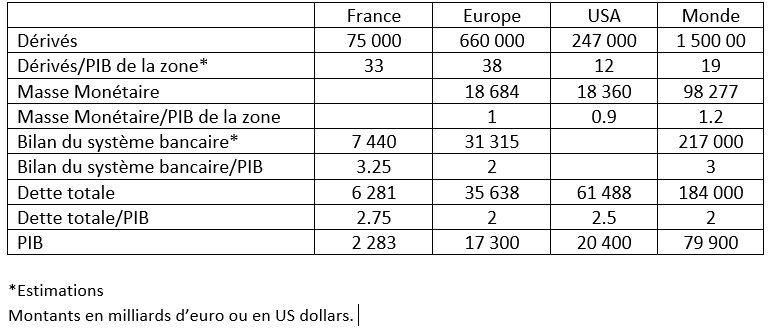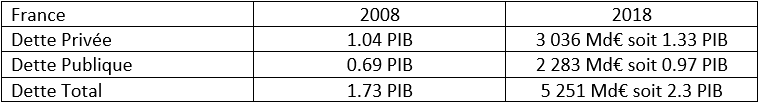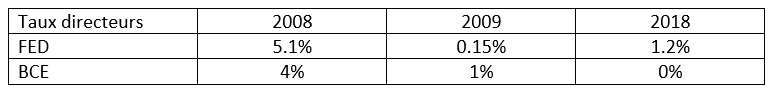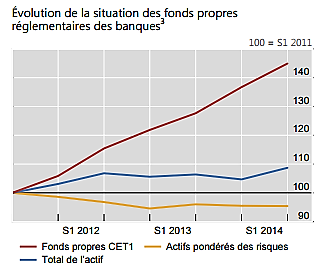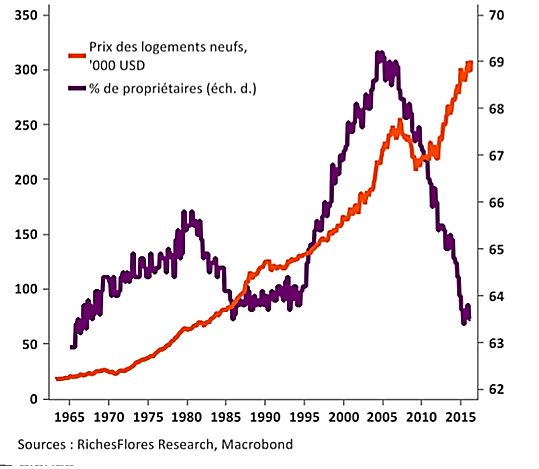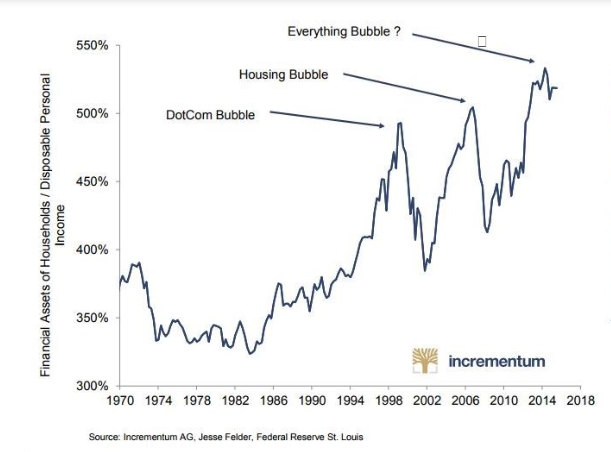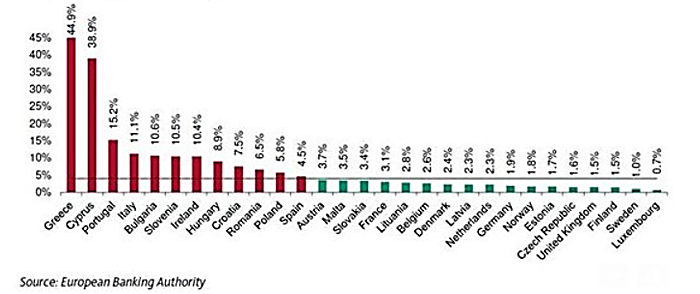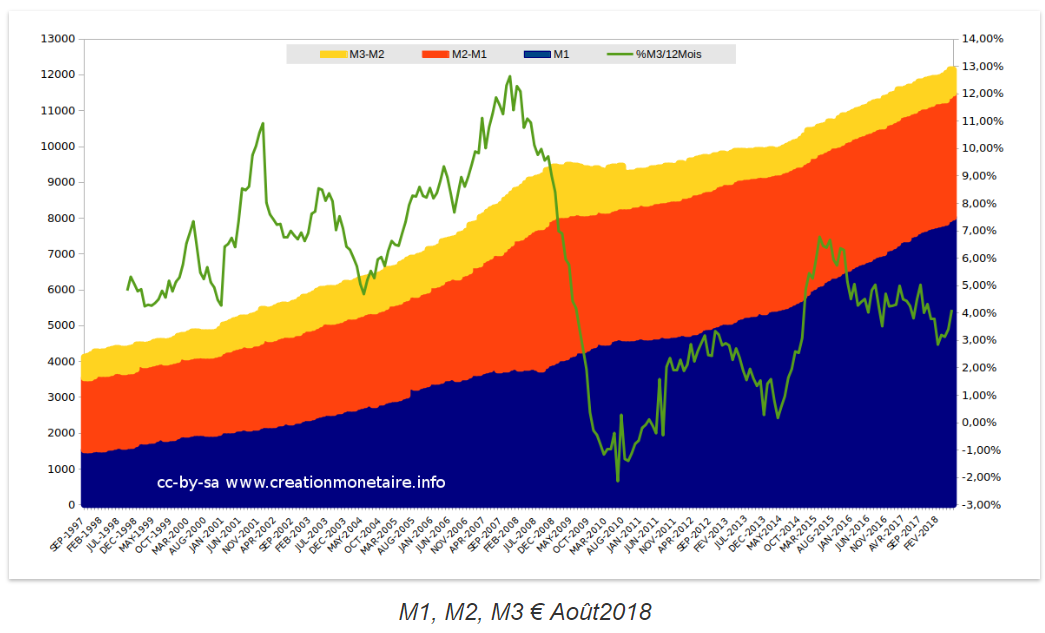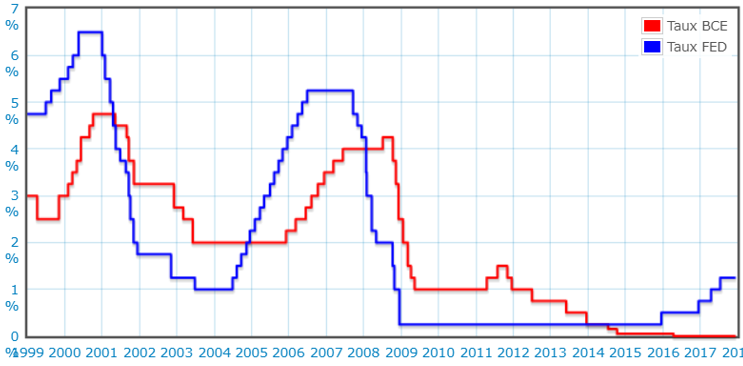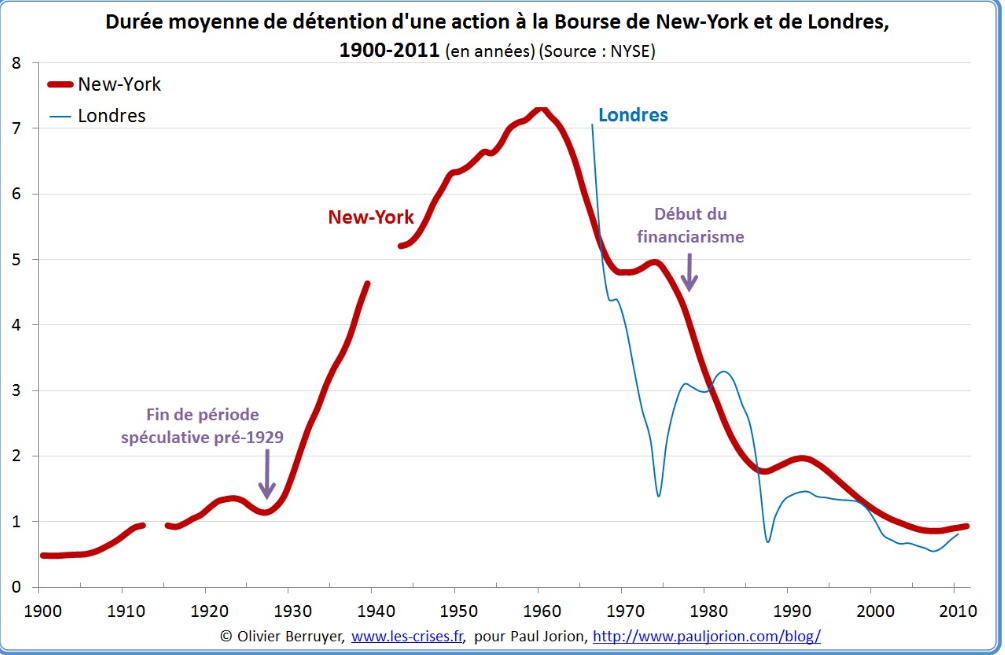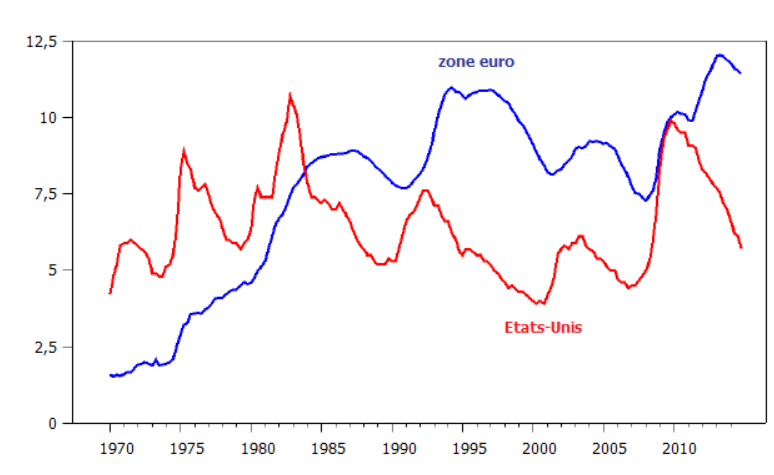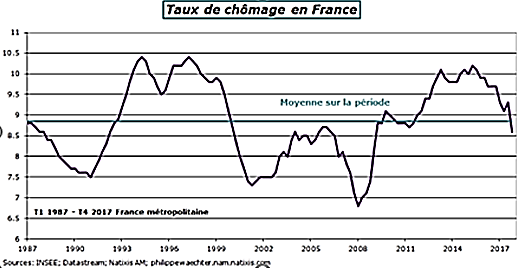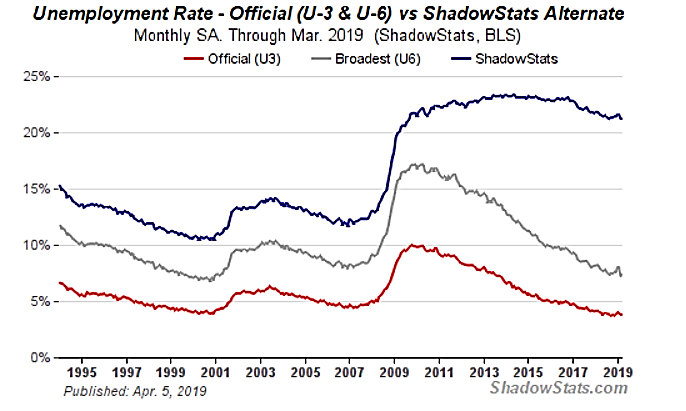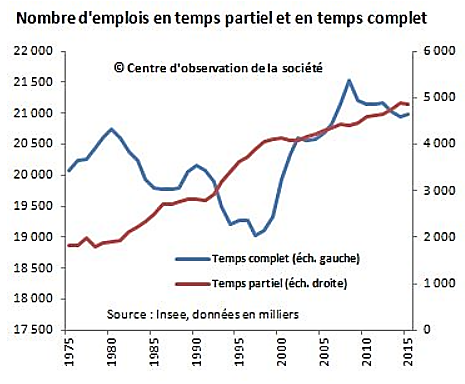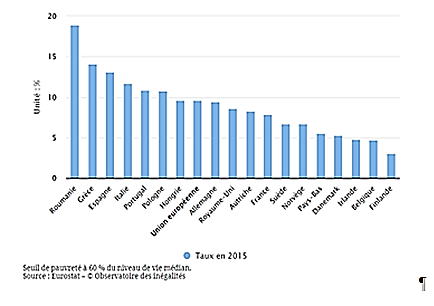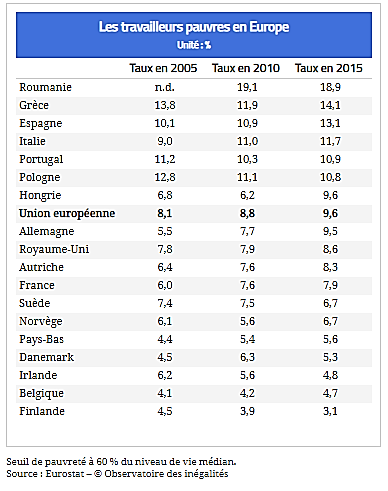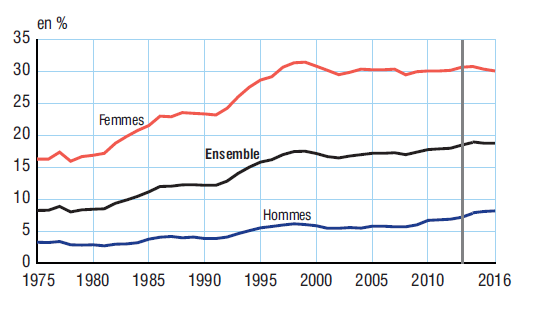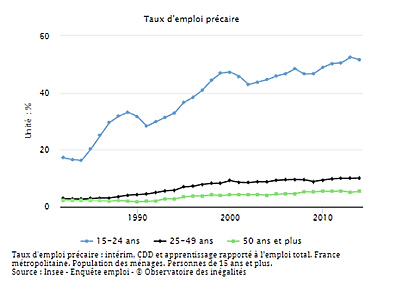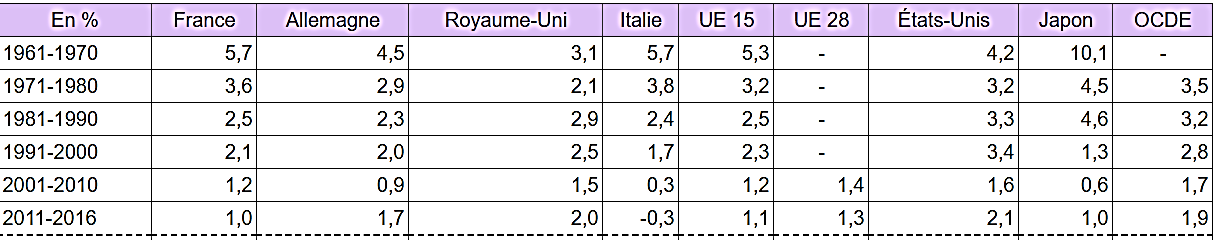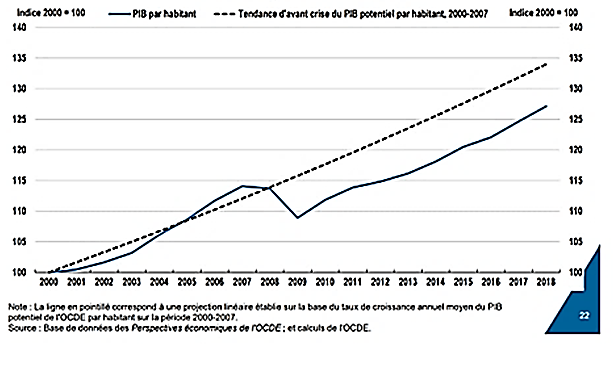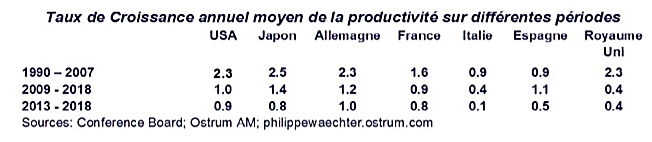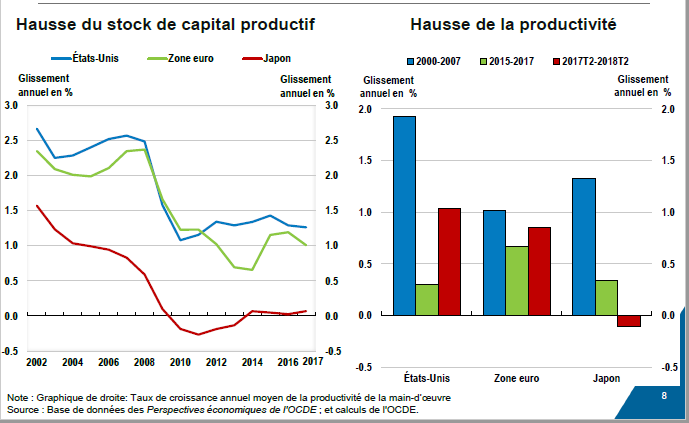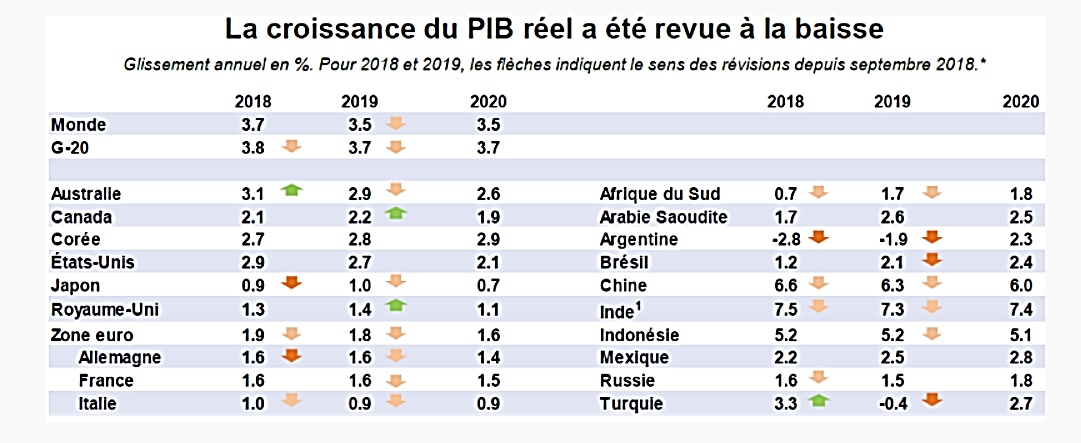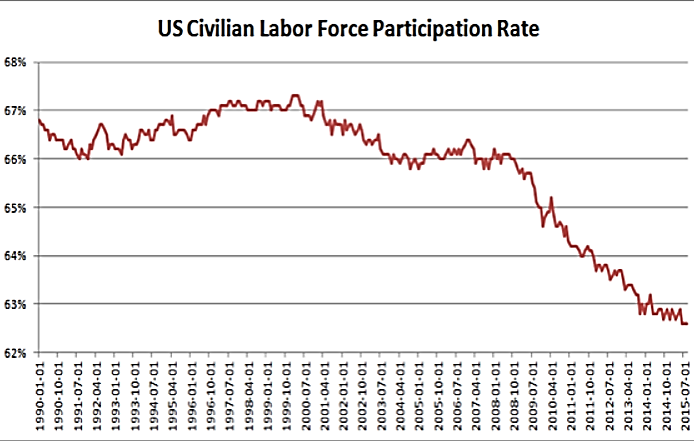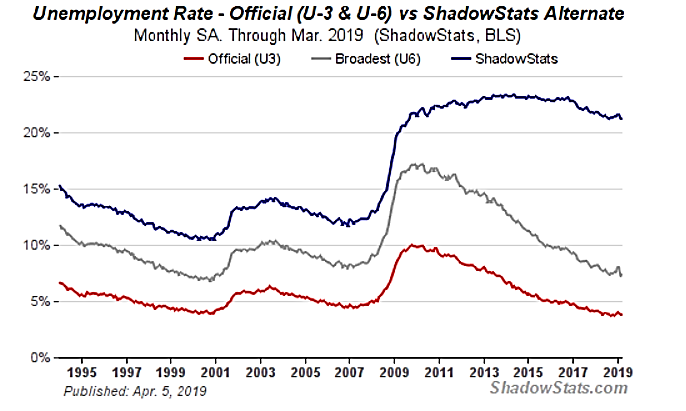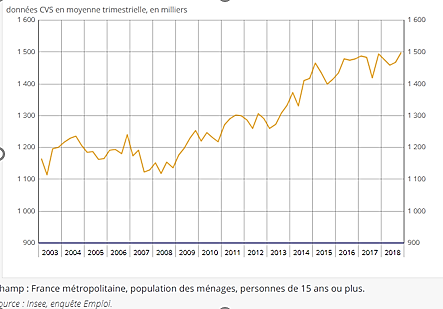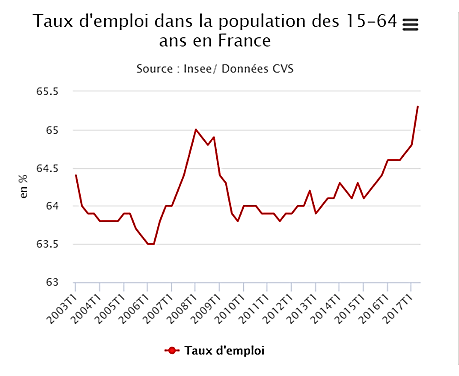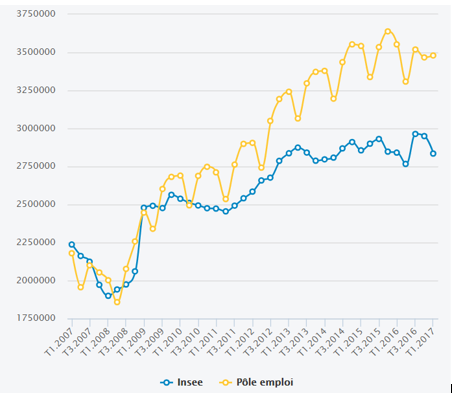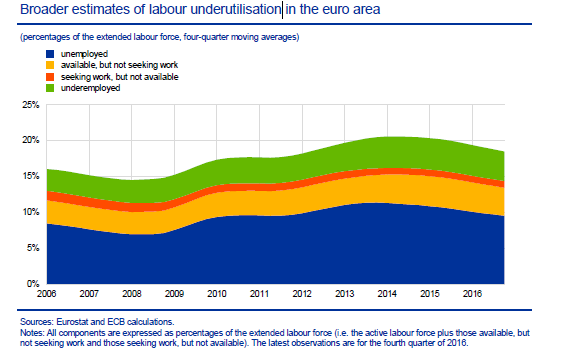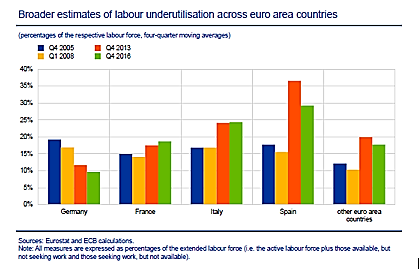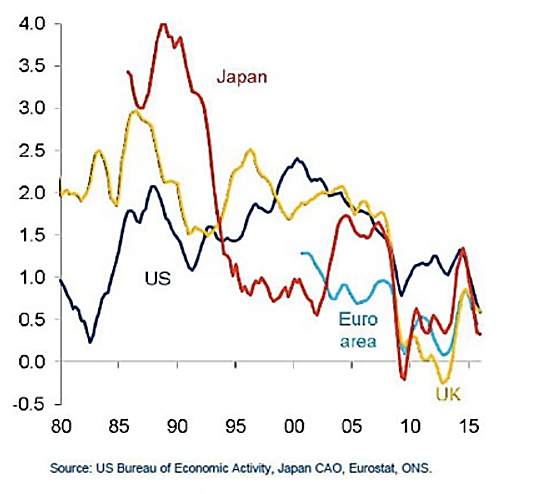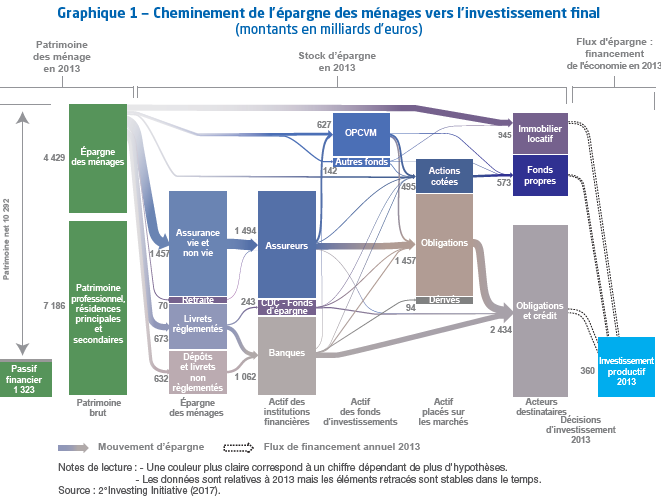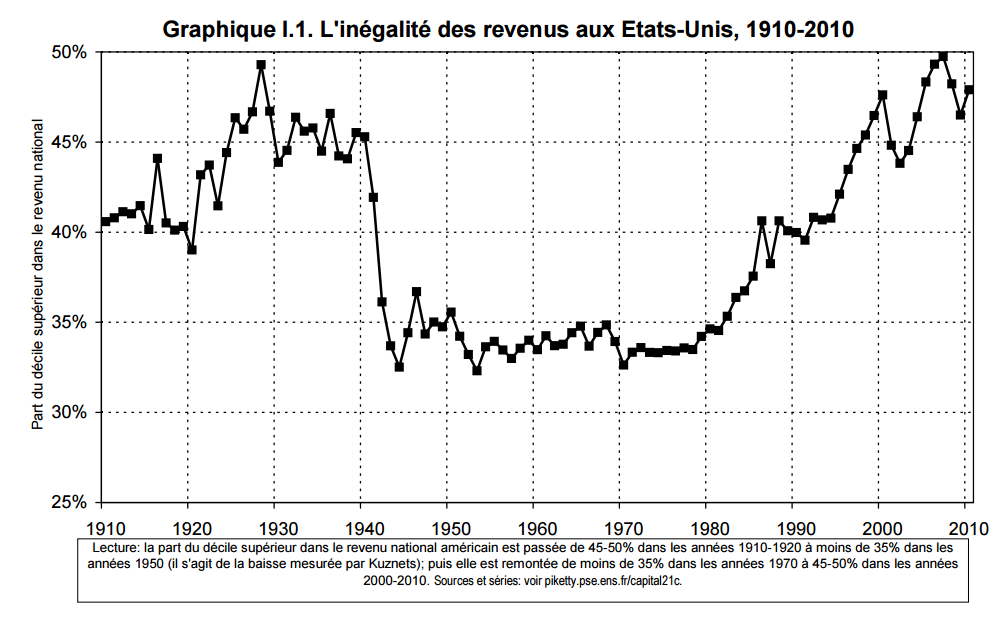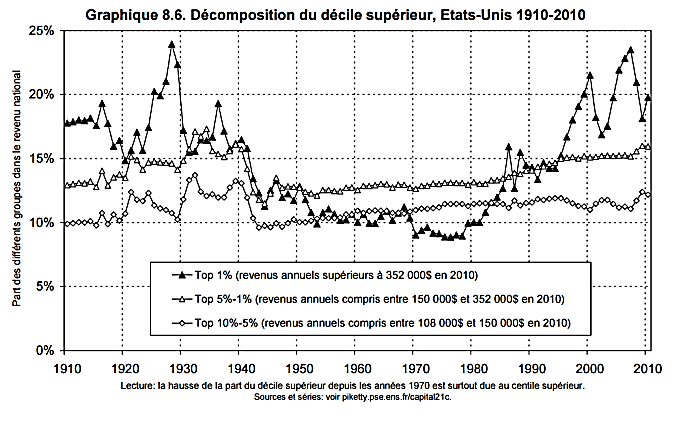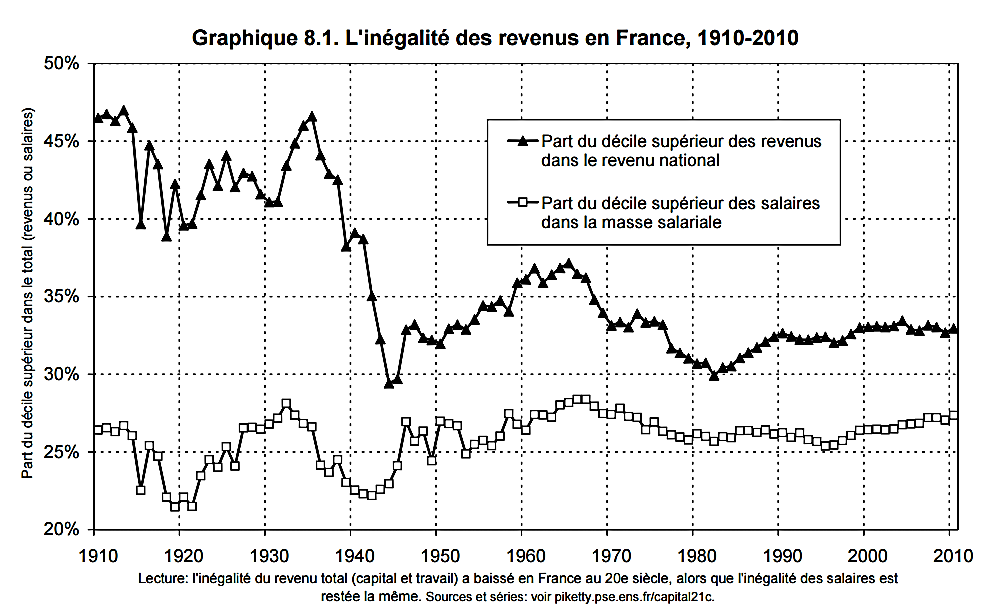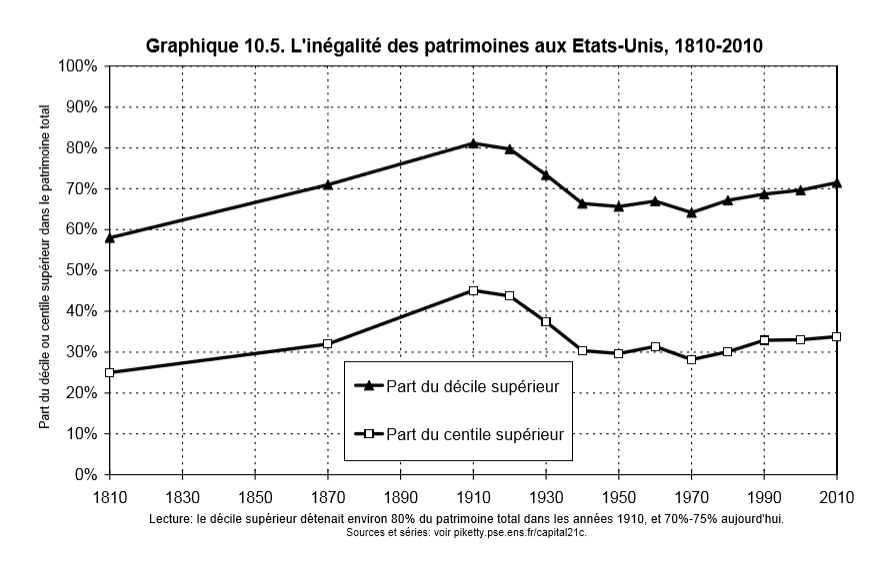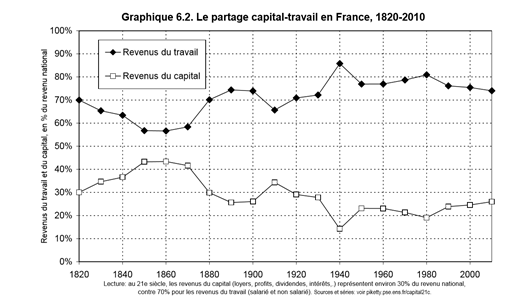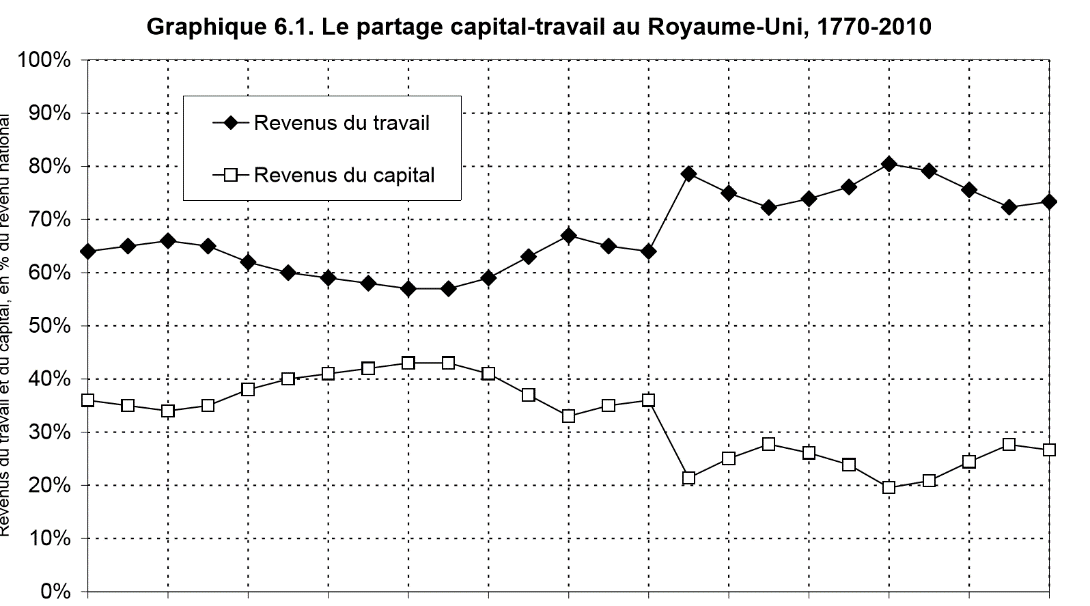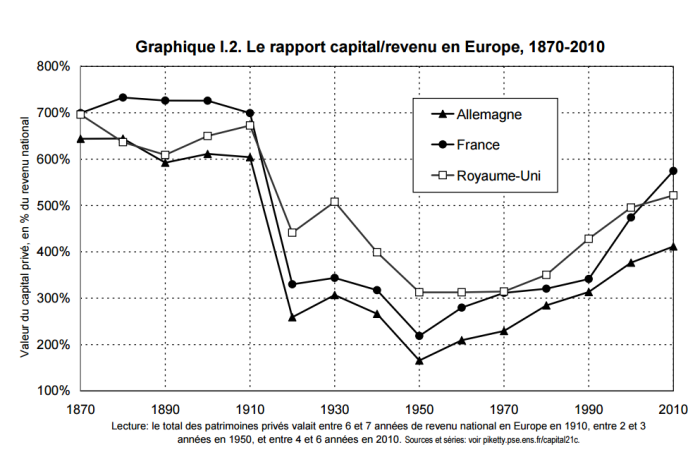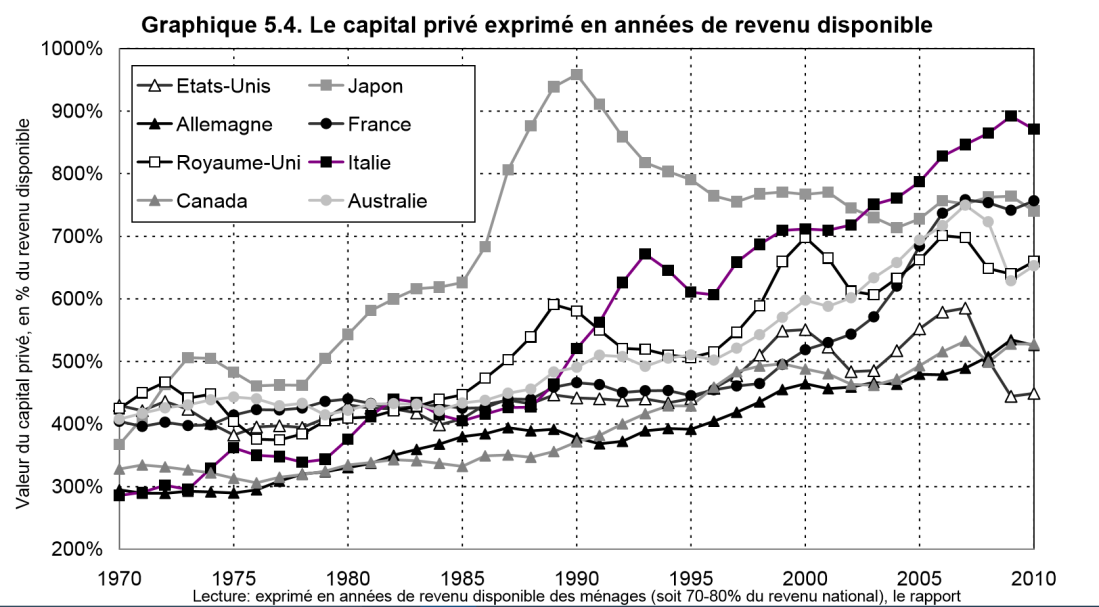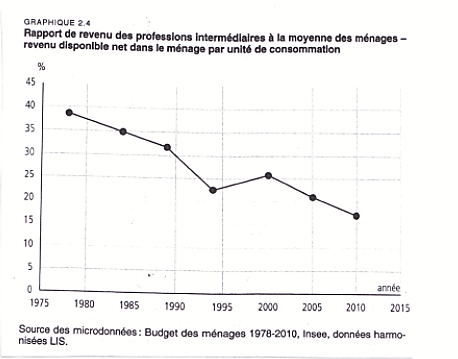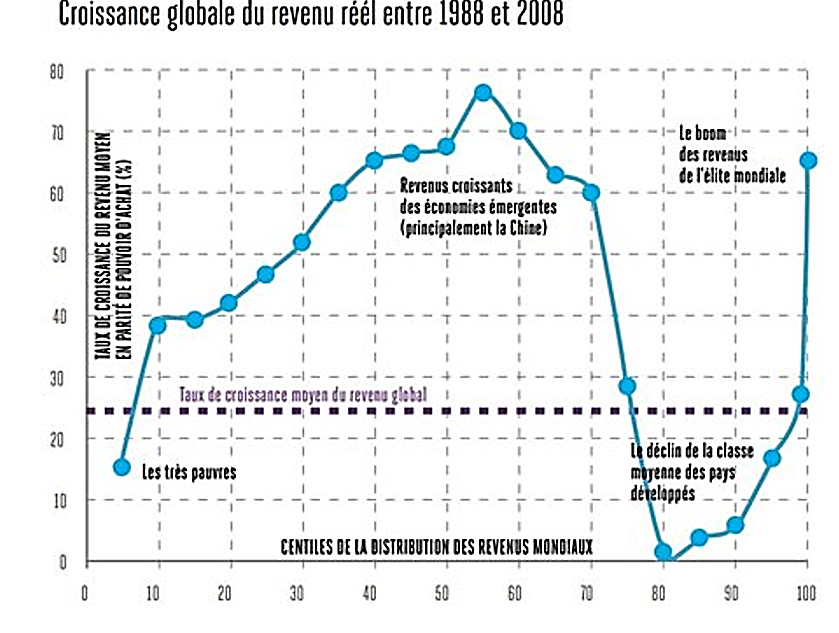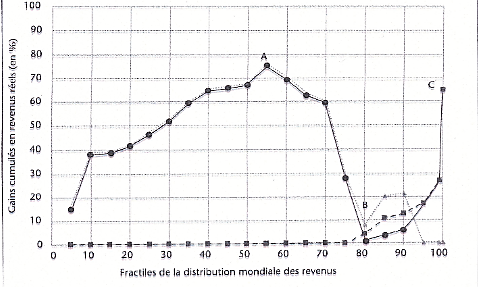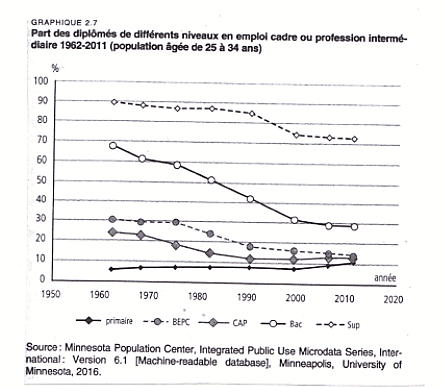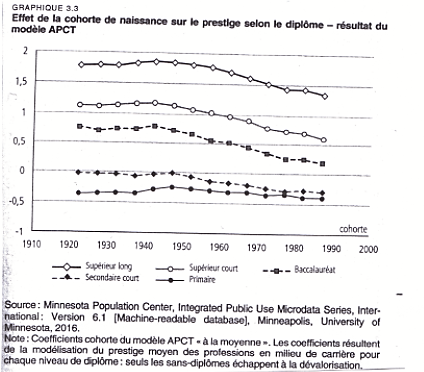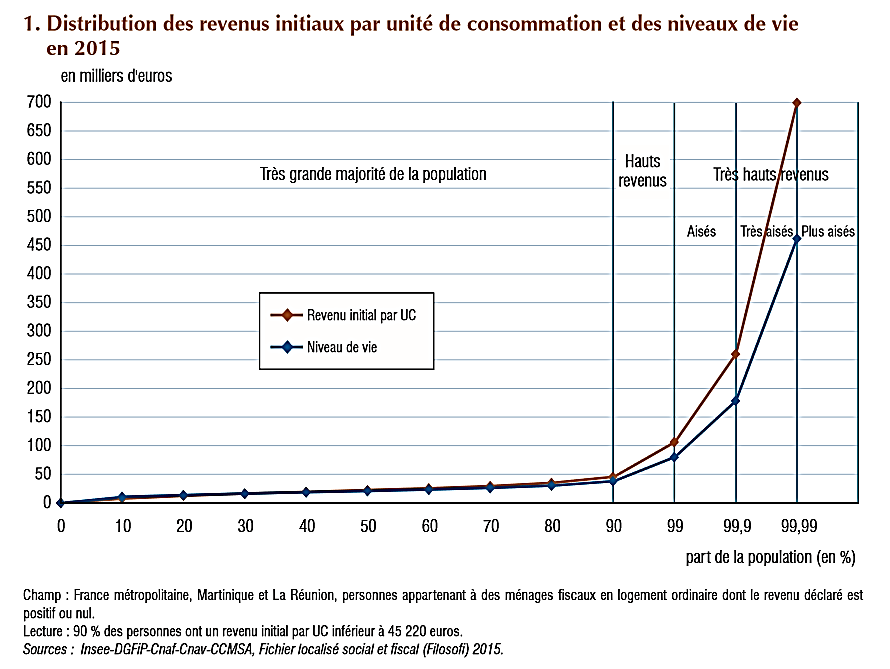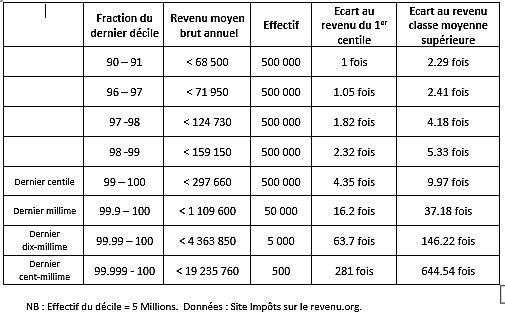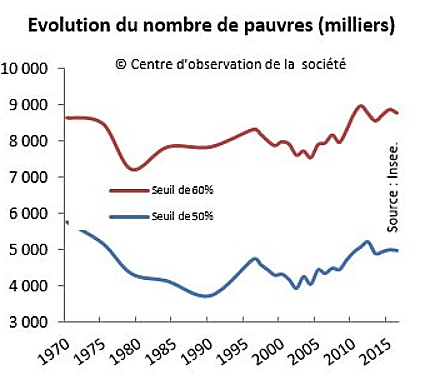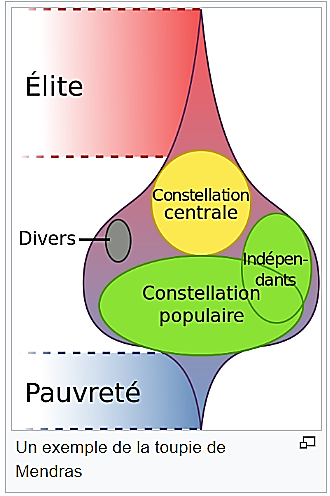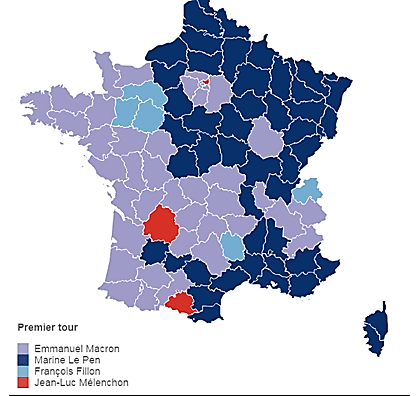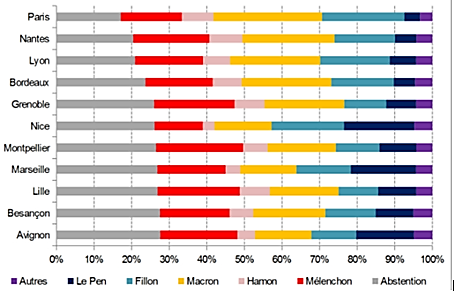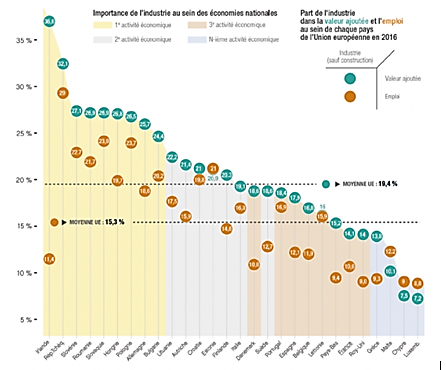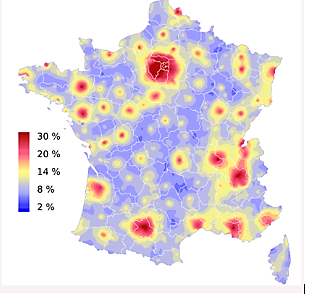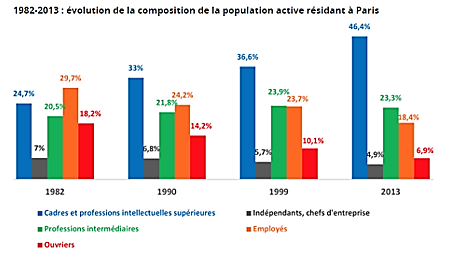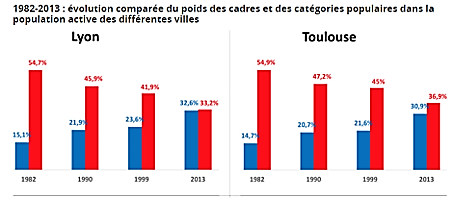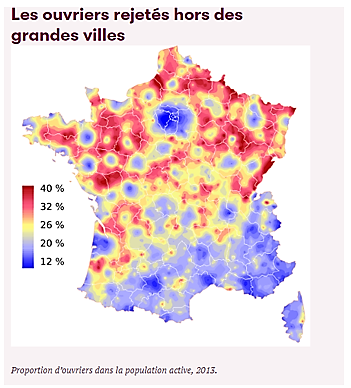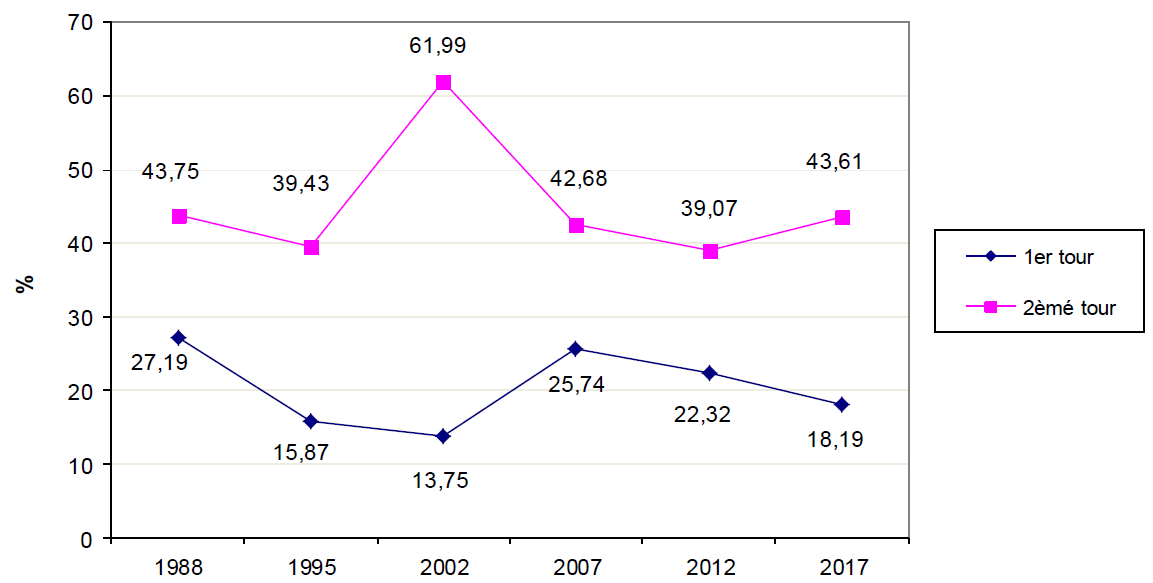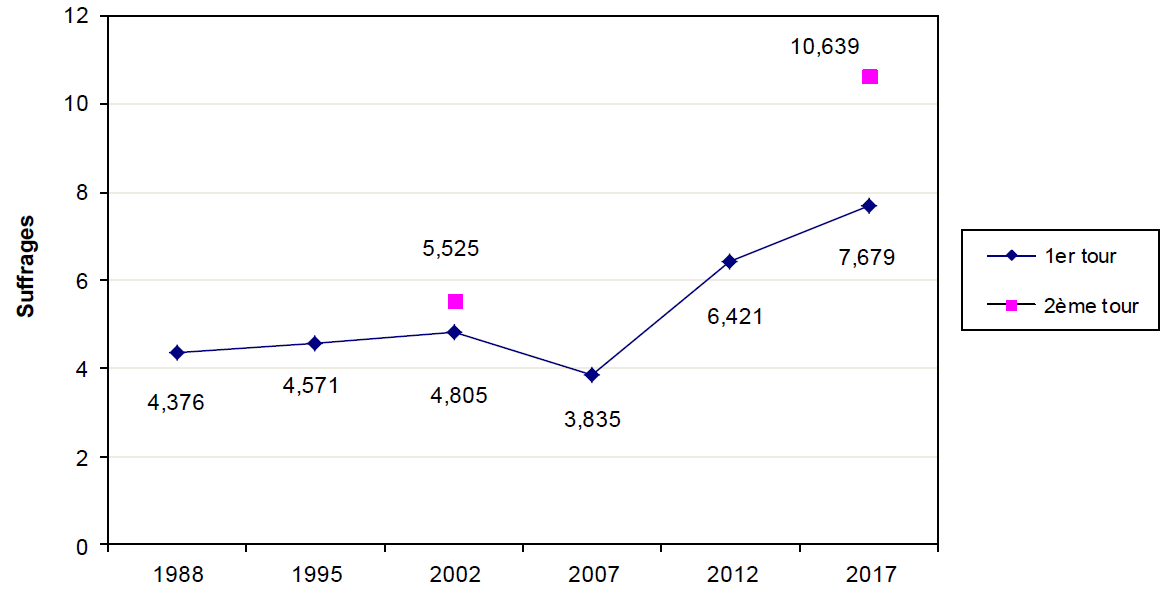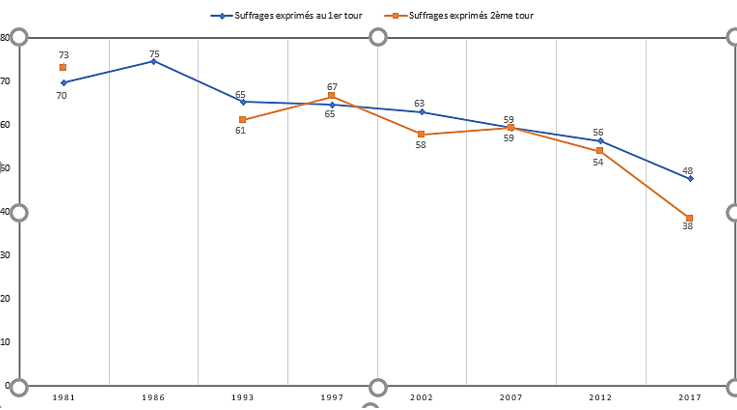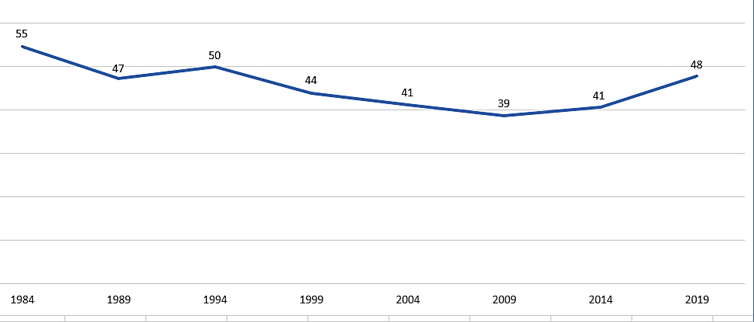Rapport d'information n° 125 (2019-2020) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT , fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 14 novembre 2019
Disponible au format PDF (7,4 Moctets)
-
AVERTISSEMENT
-
PROLÉGOMÈNES
-
I. LA GRANDE ILLUSION
-
II. LE RETOUR DE L'HISTOIRE OU LA GRANDE
DÉSILLUSION
-
A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE
À L'ABRI DES CRISES
-
B. LA FIN DE L'ESPOIR D'UN EMPLOI SÛR, POUR
SOI ET SES ENFANTS
-
C. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS LA
SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE PERMISE PAR LE PROGRÈS
TECHNIQUE
-
D. LA FIN DE L'ESPOIR DANS LA DERNIÈRE
UTOPIE RÉALISTE : L'EUROPE UNIE
-
E. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UNE
DÉMOCRATIE APAISÉE
-
A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE
À L'ABRI DES CRISES
-
I. LA GRANDE ILLUSION
-
ANNEXES DES PROLÉGOMÈNES
-
PARTIE I - LA FABRICATION D'UN NOUVEAU
KRACH FINANCIER
-
I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES
FONCTIONS
-
II. LA MÉCANIQUE DES CRISES
FINANCIÈRES
-
III. LES MASSES MONÉTAIRES EN JEU
AUJOURD'HUI ET L'ENCHAÎNEMENT CRITIQUE
-
IV. LES PARAMÈTRES CRITIQUES AU TERME DE DIX
ANS DE RÉFORMES
-
A. LE COMBUSTIBLE
-
B. LE CARBURANT
-
C. DES VECTEURS DE CRISE TOUJOURS AUSSI NOMBREUX
ET ACTIFS
-
1. Des liens interbancaires complexes et
nombreux
-
2. Un niveau de produits dérivés
toujours astronomique
-
3. Des banques systémiques, toujours aussi
nombreuses, toujours aussi « systémiques » et
toujours aussi dangereuses !
-
4. Toujours pas de réelle séparation
entre les activités de banques de dépôts et de banques
d'affaires
-
5. Une interpénétration toujours
aussi forte entre la finance officielle et une finance
« parallèle » en expansion
-
1. Des liens interbancaires complexes et
nombreux
-
D. LES DÉTONATEURS POTENTIELS
-
A. LE COMBUSTIBLE
-
V. SURVEILLANCE ET CAPACITÉS
D'INTERVENTION
-
VI. EN GUISE DE CONCLUSION
-
I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES
FONCTIONS
-
ANNEXES DE LA PARTIE I
-
PARTIE II - EN ATTENDANT LE PLEIN
EMPLOI
-
I. LES FORMES DU CHÔMAGE EN EUROPE ET AUX
USA
-
II. AUX ORIGINES DU CHÔMAGE ET DU
SOUS-EMPLOI
-
A. LA LANGUEUR ÉCONOMIQUE
-
B. UNE STAGNATION CONSENTIE
-
A. LA LANGUEUR ÉCONOMIQUE
-
I. LES FORMES DU CHÔMAGE EN EUROPE ET AUX
USA
-
ANNEXES DE LA PARTIE II
-
PARTIE III - LES DÉFORMATIONS
DE LA PYRAMIDE SOCIALE : RETOUR VERS LE PASSÉ.
-
I. RETOUR VERS UNE DISTRIBUTION DES REVENUS ET DU
PATRIMOINE TRÈS INÉGALITAIRE
-
A. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DE LA
RICHESSE
-
B. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DU
PATRIMOINE
-
C. LA MÉCANIQUE INÉGALITAIRE
-
1. Baisse des revenus du travail versus hausse des
revenus du capital
-
2. Inflation de la valeur des patrimoines
partiellement occultée : plus-values de placements financiers
immobilisés et augmentation de la valeur des biens immobiliers
particulièrement dans les centres des grandes villes
-
3. Croissance du patrimoine privé plus
rapide que celle du revenu en général
-
1. Baisse des revenus du travail versus hausse des
revenus du capital
-
A. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DE LA
RICHESSE
-
II. LES CLASSES MOYENNES AU
CRÉPUSCULE
-
III. L'OLIGARCHIE NÉOLIBÉRALE
-
I. RETOUR VERS UNE DISTRIBUTION DES REVENUS ET DU
PATRIMOINE TRÈS INÉGALITAIRE
-
ANNEXE DE LA PARTIE III
-
PARTIE IV - L'EFFACEMENT DU MONDE
COMMUN
-
ANNEXES DE LA PARTIE IV
-
PARTIE V - L'ÉTAT
NEOLIBERAL
-
I. L'ÉTAT PRÉDATEUR
ÉTASUNIEN
-
II. L'ÉTAT COLLUSIF FRANÇAIS
-
A. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE POUVOIR
POLITIQUE EN FRANCE
-
B. LA LIBÉRALISATION DE LA FRANCE
-
1. L'idéologie néolibérale
européenne : l'ordolibéralisme
-
2. La libéralisation de la France ou quand
la haute administration se met à son compte
-
3. La domination du droit européen
-
4. Le pouvoir par le droit européen
-
5. Le Conseil d'État et la privatisation de
l'intérêt général
-
6. La Cour des comptes défenseur de
l'orthodoxie libérale
-
7. Les Autorités administratives
indépendantes (AAI)
-
1. L'idéologie néolibérale
européenne : l'ordolibéralisme
-
C. UN ÉTAT MINIMUM SOUS TUTELLE
-
D. L'ÉTAT COLLUSIF OU LA GESTION
PUBLIQUE-PRIVÉE
-
A. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE POUVOIR
POLITIQUE EN FRANCE
-
I. L'ÉTAT PRÉDATEUR
ÉTASUNIEN
-
ANNEXES DE LA PARTIE V
-
PARTIE VI - LA FIN DU BAL
MASQUÉ
-
I. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE N'EXISTE
PAS
-
A. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE EST UNE
CONTRADICTION DANS LES TERMES
-
B. UNE CHIMÈRE POLITIQUE
-
C. LE GRAND BAL MASQUÉ DE LA
DÉMOCRATIE LIBÉRALE
-
A. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE EST UNE
CONTRADICTION DANS LES TERMES
-
II. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE
OCCIDENTALE FACE À SES CONTRADICTIONS
-
I. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE N'EXISTE
PAS
-
CONCLUSION
-
RÉSUMÉ DES
PRÉCONISATIONS
AVERTISSEMENT
Le but de cette analyse n'est pas d'inquiéter mais d'éclairer sur le processus de dissolution de l'État acteur et de la République sociale, reconstruits sur les ruines morales et matérielles de la Seconde Guerre mondiale. Un processus en cours depuis un demi-siècle, avec les résultats politiques calamiteux que l'on peut observer aujourd'hui, en France, en Europe et dans l'ensemble de l'Empire américain. C'est à la qualité des informations fournies et à leur convergence qu'elle demande à être jugée, libre à chacun d'en tirer des conclusions plus optimistes.
Le texte, quant à lui, peut faire l'objet d'une lecture plurielle. Le lecteur pressé ou impatient pourra se contenter de celle des prolégomènes et de la conclusion, quitte à approfondir les points qui l'intéressent grâce aux renvois aux différentes parties du rapport. Ceux qui sont moins pressés pourront choisir une lecture plus ou moins intégrale selon les goûts.
PROLÉGOMÈNES
« L'universalisation de la démocratie libérale occidentale [est la] forme finale de tout gouvernement humain ».
Francis Fukuyama (1989)
« La fin de l'Histoire et le dernier homme » 1 ( * )
I. LA GRANDE ILLUSION
Au cours de l'été 1989 paraissait aux USA un article de Francis Fukuyama - professeur de sciences politiques à Stanford (Californie) - célébrant la victoire définitive de la « Grande Transformation » néolibérale engagée dans les années 1970, sur toute autre formule d'organisation économique (le capitalisme financiarisé) et politique (la démocratie libérale parlementaire ou présidentielle sous contrôle parlementaire) : « La fin de l'Histoire et le dernier homme ».
En clair, l'organisation économique, financière et politique néolibérale de cette fin de XX e siècle marque l'aboutissement de l'évolution de l'humanité, la fin de l'Histoire.
Une eschatologie libérale qui donne une idée de la lucidité de ses propagandistes et de leur capacité à faire face aux soubresauts d'une Histoire dont la seule chose que l'on puisse assurer, c'est qu'elle ne prendra fin qu'avec l'Homme.
Il faut, cependant, reconnaître à leur décharge que les évolutions mondiales de l'entre-deux siècles - « perestroïka » et « glasnost » soviétiques, « modernisations » de Deng Xiao Ping en Chine, démocratisation de l'Europe de l'Est, fin du rideau de fer avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989, semblaient donner raison à Fukuyama et aux thuriféraires qui saluèrent cet essai confortant leurs convictions, comme l'un des plus importants du XX e siècle.
Se trouvait ainsi définitivement effacée la tache d'infamie et de sang laissée par le naufrage du premier Titanic libéral 2 ( * ) ( voir annexe 1 des prolégomènes) d'où sortirent émeutes et révolutions, les fascismes et l'hitlérisme, la Grande crise de 1929-1930 et finalement la Seconde Guerre mondiale. Se trouvait aussi définitivement refermée la courte parenthèse de l'État-providence interventionniste 3 ( * ) des « Trente glorieuses » ( voir annexe 2 des prolégomènes) .
Avec son inscription dans le marbre institutionnel se trouvait surtout réalisée l'utopie politique de réorganisation par le marché et la concurrence, de la société dans toutes ses dimensions, véhiculée par l'idéologie libérale ( voir annexe 3 des prolégomènes).
Les officiants et gérants du système libéral occidental semblaient pouvoir d'autant plus dormir sur leurs certitudes qu'il était entendu par tous les économistes et experts es finances, en tous cas par ceux qui avaient une présence médiatique, recevaient les prix de la Banque de Suède 4 ( * ) et régentaient la science officielle mitonnée sur les fourneaux des écoles de Chicago et du MIT, que l'on savait désormais éviter les crises systémiques, maîtriser par le calcul et la modélisation le risque spéculatif sans règlementer des marchés, « autorégulés » par le simple jeu de la concurrence libre et non faussée. Certes, quelques réfractaires, comme Minsky, continuaient à penser que les marchés financiers, étant par essence instables et volatiles, ne pouvaient être maîtrisés ou, comme Benoît Mandelbrot, que s'ils l'étaient, ce ne serait pas par les formules des charlatans Main Stream :
« L'économie financière, en tant que discipline, écrit Mandelbrot, en est là où était la chimie au XVI e siècle : un ramassis de savoir-faire, de sagesse populaire fumeuse et de spéculations grandioses. »
Pour lui, « c'est l'équivalent financier de l'alchimie. » 5 ( * )
La Grande Transformation libérale de l'Empire américain avait démarré dès la dénonciation par Richard Nixon - empêtré dans les déséquilibres financiers générés par la guerre du Vietnam - des accords de Bretton Woods et la mise en flottaison du dollar et des monnaies.
Pour plus de détails sur les modalités de cette reconquête libérale, nous renvoyons à la partie III de « Une crise en quête de fin. Quand l'Histoire bégaie », rapport de la Délégation à la prospective du Sénat n° 393 (2016-2017), qui analyse les facettes de cette mutation historique lourde de conséquences.
Régulé par le marché et la concurrence, le nouveau système devait faire mieux que l'État interventionniste en matière de croissance économique et d'emploi et au moins aussi bien que l'État-providence en matière sociale -quoique par d'autres moyens. Le progrès social ne passait plus par la redistribution confiscatoire mais par l'agrandissement du gâteau. La richesse produite par les entreprises performantes dirigées par des premiers de cordée entreprenants et inventifs ruissellerait sur tous ; les métropoles dynamiques serviraient de locomotive aux wagons poussifs du reste du territoire.
En plus de l'assurance qu'elle apporterait plus de bien-être que l'État interventionniste qu'elle remplaçait, la révolution libérale avait fait miroiter des horizons radieux nouveaux, « modernes » : la dépolitisation du gouvernement des nations et son remplacement par un management dont le seul guide est l'efficacité, et, en Europe, le dépassement de la démocratie conflictuelle dans une démocratie raisonnable apaisée, le dépassement de la Nation « moisie » 6 ( * ) aux horizons étriqués dans une Europe ouverte sur le monde.
La situation chaotique d'aujourd'hui n'est donc pas le produit d'un décret divin mais d'une volonté opiniâtre de déconstruire l'État-providence mis en place dans la plupart des pays occidentaux dès la fin de la guerre. Or, loin de faire mieux que l'État-providence interventionniste, comme annoncé et répété, les marchés libérés, non seulement ont fait moins bien mais, au terme d'un demi-siècle de domination, ont déçu les espoirs qu'avaient fait germer les « Trente glorieuses » sans apporter la modernisation heureuse annoncée.
Certes, quelques esprits chagrins ou plus attentifs, notamment aux USA d'où était parti le mouvement de libéralisation et où donc il avait pris le plus d'ampleur, avaient observé les failles de ce système miraculeux et averti que, contrairement au bruit ambiant, il n'était pas insubmersible.
Observé également que les performances économiques et en matière d'emploi du nouveau système étaient nettement inférieures à celles des Trente glorieuses [voir partie II pour la démonstration] et que l'explosion des inégalités de revenus et patrimoniales [voir partie III] était en train de détruire les fondements mêmes de la démocratie étasunienne.
C'est dès 1981, en effet, que Christopher Lasch commence la rédaction d'un livre passé à la postérité : La révolte des élites et la trahison de la démocratie 7 ( * ) , et dont les conclusions vaudront pour le Royaume-Uni ainsi que pour le reste de l'Europe, avec des nuances, le temps passant [voir partie IV].
Si le carburant d'un tel système, c'est le crédit, l'endettement privé et public compense la stagnation des revenus du travail au nom de la compétitivité, afin de maintenir un niveau de consommation suffisant pour les entreprises et les ménages.
Plus étonnant, l'antiétatisme idéologique dogmatique de façade du néolibéralisme masque une arrière-cour tout autre : l'arraisonnement de l'État au profit d'une oligarchie et de clientèles économiques ou électorales [voir partie V].
Plus inquiétant, quelques économistes hétérodoxes, au premier rang desquels Hyman Minsky, avaient établi que le système financier néolibéral dérégulé spéculatif, était fondamentalement instable, une véritable fabrique de bulles spéculatives promises à un éclatement qui se terminerait en crise financière et économique.
Mais bon ! Un système qui créait autant de « valeur » ne pouvait être mauvais.
Et, quand bien même le serait-il devenu par le manque de doigté de ses pilotes et par l'accumulation de ses excès, comment échapper au mouvement d'enrichissement spéculatif qui emportait la planète finance ?
Le « Titanic financier » était si rassurant pour ses officiers, si confortable pour les passagers de la classe affaires, qu'à son bord les Cassandre y étaient inaudibles. « Tant que l'orchestre joue, il faut continuer à danser » se persuadait Chuck Price, P-DG de City Group en 2007 au vu de l'accumulation des signes avant-coureurs d'une possible catastrophe.
II. LE RETOUR DE L'HISTOIRE OU LA GRANDE DÉSILLUSION
C'est dans l'insouciance des « investisseurs », des responsables financiers et politiques, sous ce ciel serein, qu'éclate en 2008 ce qui allait devenir la première Grande crise financière systémique du XXI e siècle, passée à la postérité sous le nom de « crise des subprimes » 8 ( * ) .
Une crise dont quelques observateurs attentifs du marché immobilier étasunien, spéculateurs compris 9 ( * ) avaient perçu les prodromes dès 2007. Une crise qui, de financière, se transformera rapidement en économique puis, faute de traitement, en crise sociale puis politique.
Le système financier responsable du krach, sauvé aux frais du contribuable auquel on ne cessera de prêcher la rigueur, fut l'origine de la première grande désillusion.
Comme le relève Martine Orange, le prix politique de l'opération sera fort : « Les moyens colossaux mis en oeuvre pour assurer le sauvetage du système financier eurent un prix politique. L'opinion publique fut outrée de voir les banques et, surtout, les dirigeants de ces banques sauvés avec de l'argent public, sortir de la crise indemnes, et parfois avec des bonus. Aucun responsable bancaire ne fut inquiété par la justice. Pendant ce temps, des millions de personnes perdaient leur emploi, leur maison, étaient poursuivies par les huissiers. La confiance entre les élites dirigeantes et les citoyens de base était rompue. Elle n'est toujours pas revenue. »
Faute de réponse à la crise économique et sociale qui suivit la crise financière, ce fut l'effondrement des illusions qui avaient bercé le dernier demi-siècle ; une sorte de retour du refoulé : la Grande crise de 1929-1930. En s'éternisant, contrairement à la théorie, la crise réveillait les fractures de la société libéralisée, anesthésiée par l'endettement et l'opium médiatique.
Ce sera le début d'une lente prise de conscience qui, commençant par une déception de masse - devant l'incapacité des élites néolibérales, non seulement à trouver une issue à la crise, mais à comprendre ce qui se passait 10 ( * ) -, se transformera en perte de confiance dans cette « démocratie libérale occidentale » dont Fukuyama avait annoncé l'apothéose vingt-cinq ans avant, enfin une sécession civique.
La crise politique actuelle, vécue selon des modalités variant selon les provinces et les pays de l'Empire, est d'abord celle des espoirs déçus : espoirs auxquels les Trente glorieuses avaient donné un contenu, emportés par la vague néolibérale, espoirs nés et morts avec elle.
A. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UN MONDE À L'ABRI DES CRISES
Dix ans après la tourmente financière de 2008, l'épée de Damoclès de sa réédition, est toujours suspendue sur nos têtes [voir partie I].
Les réformes attendues, même celles préconisées par les G20 de 2009- 2011 ont été très incomplètes, laissant de côté des questions aussi essentielles que la séparation entre banques d'affaires et de dépôts, entre système bancaire et finance parallèle dont le champ d'action s'est considérablement agrandi. De plus, les modalités de mise en oeuvre de ces réformes ont été laissées aux intéressés, leur ôtant ainsi l'essentiel de leur efficacité.
D'où une impression de bricolage pour temps calme arraché à un lobby financier bien décidé à tourner la règle, sans rapport avec les enjeux financiers, économiques, sociaux et politiques réels.
Les établissements systémiques, toujours aussi puissants au coeur du système financier, ont même été rejoints par les chambres de compensation, mises en place dans l'espoir de réguler le marché toujours aussi monstrueux des produits dérivés.
Plus menaçants encore et facteurs essentiels de crise financière, la dette, l'endettement public et surtout privé qui, dopés par la surabondance de liquidités et des taux d'intérêts étrangement bas, ne cesse d'augmenter. D'un côté on régule, de l'autre on alimente la machine à crise !
Le coeur du problème, c'est que le crédit est devenu, dans nos sociétés financiarisées, le palliatif d'un pouvoir d'achat qui baisse ou stagne, le principal vecteur d'enrichissement des plus riches, le carburant d'un système économique créant proportionnellement plus de valeur pour moins de richesse.
Résultat : les bulles spéculatives dans l'attente de crever se multiplient et les conduites spéculatives à risques avec elles.
S'étant laissé prendre au piège du capitalisme financier néolibéral, les responsables politiques et financiers, faute d'une volonté politique de réorienter l'épargne et le crédit vers l'économie réelle, ont fait le choix de la fuite en avant dans la production de liquidités et de crédit qui, au lieu de stimuler l'économie réelle, viennent alimenter la machine à laver spéculative qui tourne pour elle-même.
Résultat : un système financier toujours aussi instable comme le reconnaît le FMI lui-même : « Alors que les conditions financières demeurent accommodantes, les facteurs de vulnérabilité continuent à s'accumuler... si bien que les risques à moyen terme qui pèsent sur la stabilité financière dans le monde restent globalement inchangés » 11 ( * ) .
Pour couronner le tout, sous la pression du lobby bancaire puissamment relayé par des exécutifs sensibles aux sirènes de l'emploi, ces réformes, à peine acquises, sont remises en cause.
B. LA FIN DE L'ESPOIR D'UN EMPLOI SÛR, POUR SOI ET SES ENFANTS
L'un des apports les plus appréciés des Trente glorieuses, c'est certainement un quasi plein emploi qui tranchait avec les incertitudes de l'avant-guerre, conséquence immédiate de la marginalisation des crises financières et économiques de la période précédente.
Conséquence aussi, en France, de l'intense politique d'investissement de l'État, à travers le Fonds de modernisation et d'équipement, le Crédit foncier et le Crédit agricole.
La productivité de l'économie française est forte et le taux de croissance du PNB élevé : en moyenne annelle plus de 5 % entre 1950 (fin de la reconstruction) et 1974 12 ( * ) .
La traduction la plus immédiate donc de la Grande Transformation libérale c'est, le chômage de masse permanent en Europe et l'instabilité de l'emploi aux USA que les expédients réglementaires et les exploits statistiques ont du mal à masquer. Une certitude, en tous cas, le sous-emploi, le mal-emploi, le chômage massif des jeunes entraînant leur émigration dans un certain nombre de pays européens, la stagnation en valeur des revenus du travail et leur baisse relative par rapport à ceux du capital ont remplacé le plein emploi rémunérateur.
Pour l'analyse plus fouillée, plus technique et quantifiée de la question, on verra la partie II.
Ce chômage et ce sous-emploi s'enracinent, évidemment, dans la maladie de langueur qui depuis la crise de 2008 frappe l'économie européenne et, quoiqu'à un moindre degré et sous des formes différentes, les USA. La différence cependant entre les deux rives de l'Atlantique c'est qu'aux USA, parvenir au plus bas niveau de chômage possible est l'objectif prioritaire du gouvernement (que les moyens utilisés ne soient pas sans risques est une autre affaire) alors qu'en Europe c'est l'équilibre budgétaire et l'euro fort.
Pour dire les choses clairement, en faisant de tels choix, l'Europe a fait le choix du chômage, espérant de cette rigueur et des politiques de l'offre qui se résument à des cadeaux fiscaux aux plus riches, une relance économique que l'on attend toujours.
À côté de ces choix strictement idéologiques interdisant toute relance par l'investissement public, l'autre cause de la stagnation économique - alors même que les liquidités banque centrale et scripturales abondent, et que les taux d'intérêt restent très bas - c'est que l'essentiel de la masse monétaire ne vient pas irriguer l'économie réelle mais se perd dans la sphère spéculative. Là se trouve le problème essentiel.
Contrairement à ce que prétendent ses représentants, le financement des entreprises - crédits bancaires ou émissions boursières - n'est pas la principale préoccupation du système financier. Compte tenu du manque d'informations pertinentes, on en est réduit à estimer que la part des prêts bancaires destinée au financement de l'économie se situe entre 10 et 20 % au grand maximum des bilans bancaires, l'essentiel étant destiné aux grandes entreprises et de l'ordre de 5 % aux PME.
Le financement par les marchés, quant à lui, est essentiellement pratiqué par les grandes entreprises multinationales, surtout en vue du rachat d'entreprises concurrentes (fusions acquisitions) ou pour doper la valeur boursière de l'entreprise. La plupart des transactions portant sur des actions ou obligations déjà émises, on peut estimer que le financement d'investissements nouveaux ne dépasse pas 5 % du montant des échanges.
En conclusion, l'activité du système financier se résumant à des opérations au sein même du système, sans lien avec la production réelle, on peut dire qu'il joue le même rôle qu'un parasite, un parasite dangereux à en juger par les krachs ravageurs dont il porte la responsabilité.
C. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE PERMISE PAR LE PROGRÈS TECHNIQUE
Apaisées par la réduction progressive des inégalités et des conflits de classe qu'elles sécrètent, par la magie du progrès et de la communication, (voir parties III et IV), les Trente glorieuses avaient initié un processus de réduction des inégalités sociales et une dynamique de « moyennisation » par le développement des classes moyennes, par le haut et par le bas.
Au cours de ce dernier demi-siècle libéral, cette société, dont la place centrale est occupée par une classe moyenne appelée à devenir largement majoritaire par les vertus du progrès technique, du plein emploi, de l'école et de la démocratie, a été progressivement remplacée par une autre : une société où les classes populaires ont fait leur deuil de se fondre un jour dans la classe moyenne devenue majoritaire et dont la principale crainte est de sombrer dans la précarité.
Une société où moins de 10 % de la population peuvent être considérés comme disposant de hauts revenus, de plus de 50 % du patrimoine et de l'essentiel des pouvoirs d'influence.
Au sein de cette couche sociale aisée, la distribution des revenus du patrimoine et du pouvoir d'influence suit une courbe exponentielle dont la pente s'accélère avec les derniers 1 %, puis 0,1 %, et ainsi de suite, des plus hauts revenus et patrimoines.
L'essentiel des gains de la croissance allant à une minorité étroite, captant les revenus du capital, alors que ceux du travail stagnent, celle-ci se transformera en oligarchie.
Comme le dit un rapport de l'OCDE publié le 10 avril 2019 : on s'achemine vers « une polarisation des sociétés occidentales en deux groupes : une classe riche et prospère au sommet et un groupe, beaucoup plus nombreux, de personnes dont le travail consiste à servir la classe riche ».
Un signe ne trompe pas : aux USA, malgré les progrès fantastiques de la recherche médicale, l'espérance de vie diminue.
Les effets de cette déformation de la pyramide sociale issue des Trente glorieuses ne furent pas seulement matériels mais aussi culturels et comportementaux. Ainsi les « élites » développèrent-elles une culture de l'entre soi, certes objet d'imitation mais les coupant du reste de la population de leur pays, voire de leur pays lui-même : choix résidentiel privilégiant les grandes métropoles, choix de filières d'éducation socialement sélectives, émigration vers des pays fiscalement accueillants pour les plus riches.
Le corollaire de cette concentration de la richesse et du pouvoir culturel, économique et politique sera la dérive des territoires périphériques et des enclaves urbaines de pauvreté, laissés en déshérence par les insuffisances du service marchand et surtout par le retrait de l'État-providence et interventionniste, opérateur historique des services publics. Les inégalités sociales se sont donc territorialisées, grandement aidées en cela par l'État libéral minimum qui abandonne ainsi - en France en tous cas - sa fonction historique.
Loin de favoriser l'émergence d'un « monde commun », ce qui se transformera en réseaux fortement capitalisés en bourse, loin d'être sociaux, créèrent des solitudes à plusieurs et, indirectement, une sécession sociale lourde de conséquences. Censés, comme leur nom l'indique, créer du lien, ces médias protègent plutôt de la proximité des autres en les tenant à distance.
Croire que le progrès technique peut compenser le délitement d'une société de plus en plus inégalitaire est un leurre. Il l'aggrave.
Mais, en France, les espoirs que les Trente glorieuses avaient fait naître n'ont pas été les seuls à avoir été déçus par un demi-siècle de libéralisation qui devait faire mieux que les trente ans précédents. L'ont été aussi ceux que la révolution néolibérale avait imaginé pour les remplacer : la dépolitisation du gouvernement des nations remplacé par le management pour le marché et par le marché, le dépassement de la démocratie conflictuelle dans une démocratie raisonnable apaisée, le dépassement de la Nation aux horizons étriqués dans une Europe ouverte sur le monde.
D. LA FIN DE L'ESPOIR DANS LA DERNIÈRE UTOPIE RÉALISTE : L'EUROPE UNIE
L'incapacité de l'Europe - pourtant sauvée de la faillite en 2008 par les USA et la Fed qui injectèrent, via la BCE, 10 000 Md$ dans le système bancaire européen - à faire face unie au krach financier, son choix de sacrifier des pays comme la Grèce pour sauver des banques irresponsables, son choix de la stagnation économique et du chômage au nom d'une conception de la monnaie commune totalement irréaliste, a fait voler en éclat les illusions. Non seulement, comme l'avait annoncé Jean Monnet, on n'avait pas réussi à unir des hommes mais on n'avait même pas réussi à coaliser des États.
Quelle réalité politique peut bien avoir un système qui ne tient debout que par sa bureaucratie et ses tribunaux ?
« Comment expliquer, s'interroge Adam Tooze , l'étrange métamorphose d'une crise des prêteurs en 2008 en une crise des emprunteurs après 2010 ? Difficile de ne pas soupçonner un tour de passe-passe. Pendant que les contribuables européens sont soumis à rude épreuve, les banques et d'autres bailleurs de fonds sont remboursés grâce à de l'argent injecté dans les pays qui bénéficient d'un sauvetage. On en déduit facilement que la logique cachée de la crise de la zone euro, après 2010, est une redite déguisée des sauvetages bancaires de 2008. Selon un critique mordant, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. La zone euro, par ses choix politiques obstinés, a poussé des dizaines de millions d'Européens dans les abysses d'une dépression, rappelant celle des années 1930. C'est l'un des pires cas d'autodestruction économique de notre histoire. Qu'un pays minuscule comme la Grèce, dont l'économie représente 1 % à 1,5 % du PIB de l'UE, soit devenu l'élément clé de cette catastrophe, fait de l'histoire européenne une cruelle caricature.
C'est un spectacle scandaleux. Des millions de personnes ont souffert sans raison valable. Et malgré notre indignation, il faut insister lourdement sur ce point : les mots-clés sont « sans raison valable. » 13 ( * )
L'enthousiasme des débuts qui s'annonçaient prometteurs retomba donc au constat de l'enlisement des politiques communes remplacées par des conflits d'intérêts entre les membres quand ce ne sont pas entre les financiers.
Cette crise économique et institutionnelle montrera à ceux qui conservaient la foi que le « couple franco-allemand » n'existait pas plus que la « solidarité européenne », comme le confirmera une crise migratoire qui n'est pas prête de finir.
Non seulement elle confirmait que l'UE c'était le chacun pour soi - absence d'accord sur les buts, sur les politiques à mener, impossibilité de revoir les accords de Dublin qui font porter le plus gros du fardeau à la Grèce, à l'Italie, et à l'Espagne - mais aussi que se délitait, l'une des rares réussites de la construction européenne : les accords de libre circulation de Schengen.
Deux mots résument la politique migratoire européenne : grands principes et bricolage, l'un des meilleurs exemples étant les accords d'Ankara avec la Turquie 14 ( * ) .
L'Union européenne devenait un champ clos de rivalités que seul l'immobilisme empêchait de se disloquer.
La construction européenne, la constitution de l'Europe en sujet politique avait pourtant été la dernière utopie réaliste devant changer le cours du XXI e siècle, un projet d'une telle importance qu'il justifiait, comme on le vit en 2005 en France, de le poursuivre contre l'avis des Français.
À la lecture du flot d'inepties prononcées par des responsables politiques français durant la campagne pour l'adoption du traité de Maastricht (1992) permettant la création de la monnaie unique (voir annexe 4 des prolégomènes, Le bêtisier de Maastricht), on se demande comment de telles bouffonneries sont possibles.
E. LA FIN DE L'ESPOIR DE VIVRE DANS UNE DÉMOCRATIE APAISÉE
Apaisée par le dépassement du clivage droite/gauche - vestige devenu soluble désormais dans le changement permanent - la démocratie devait être remplacée par un centrisme de bon aloi rassemblant deux Français sur trois selon la formule magique de Valéry Giscard d'Estaing.
Sur les bords de cette majorité du bon sens, désignant des représentants non moins réalistes, les agités des extrêmes étaient censés pouvoir, sans conséquence, continuer à vaticiner dans le désert médiatique.
1. Une démocratie de façade
La suite se chargea de montrer que la réalité était tout autre et que la démocratie libérale occidentale, association contradictoire de démocratie et de libéralisme, était une chimère. Il est impossible, en effet, sauf sur le papier ou en parole, qu'un système politique puisse suivre à la fois la volonté de marchés fonctionnant selon leur logique propre et celle du peuple souverain.
La démocratie libérale n'existe pas : parce qu'elle ne peut pas être démocratique et même réellement libérale.
Un tel libéralisme qui ne peut fonctionner sans tuteurs bureaucratiques - le plus parfait exemple étant l'ordolibéralisme européen - est une forme de « libéralisme bureaucratique » monopolistique.
Deux exemples emblématiques : l'État prédateur américain et l'État collusif français [ voir Partie V].
Selon James K. Galbraith, les États-Unis sont devenus une sorte de « république-entreprise » que réguleraient non pas les marchés, mais des coalitions de puissants lobbies managériaux et financiers soutenus par un État « prédateur », en ce sens que sa fonction est de mettre l'économie et la finance au service d'intérêts privés. Le discours libéral officiel n'est qu'un rideau de fumée destiné à masquer cette forme perverse d'étatisme. La première place n'est plus occupée par les grandes entreprises industrielles qui ont fait la force des USA mais par la finance, les oligarques du numérique, de la communication et des services. C'est cette « élite », pour reprendre le terme de Lasch qui s'est emparée de l'État et qui le gère exclusivement en fonction de ses propres intérêts.
L'État collusif français, qui est le résultat, lui, d'un double mouvement, la concentration du pouvoir à l'Élysée, donc la neutralisation du Parlement, et la libéralisation du pays, à commencer par le démantèlement de l'État interventionniste, né avec la Libération.
Au terme de ces quarante ans de profondes transformations, le pouvoir politique devait donc faire face au défi suivant : comment gouverner avec une légitimité démocratique de plus en plus contestée, après s'être volontairement placé sous la tutelle des marchés, du carcan européen et en ayant supprimé, par souci d'économie et parce que les prestataires de services étaient censés faire mieux, une bonne partie de ses capacités d'expertise et de ses moyens d'action directs ?
La réponse sera, en s'appuyant de moins en moins sur la légitimité des urnes, qui, de scrutin en scrutin, donnent des résultats de plus en plus hasardeux, et de plus en plus sur le monde des affaires et de la finance, désormais incontournable. La haute administration devenue experte en pantouflage et rétro-pantouflage fait le lien entre les hauteurs du pouvoir politique, les intérêts économiques et la sphère, de plus en plus complexe, de la régulation indispensable au fonctionnement des marchés.
Comme le montre son discours devant l'OIT du 11 juin 2019, Emmanuel Macron est parfaitement conscient de cette mutation d'un libéralisme devenu prédateur et qui n'a plus de libéral que le nom :
« Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale de marché, mais qui a été depuis quarante ans l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation qui, en gardant les prémisses du raisonnement et de l'organisation, en a perverti l'intimité et l'organisation dans nos propres sociétés. La rente peut se justifier quand elle est d'innovation, mais peut-elle se justifier dans ces conditions lorsque la financiarisation de nos économies a conduit à ces résultats ? Et en avons-nous tiré toutes les conséquences ? Je ne crois pas. »
La conclusion politique s'impose d'elle-même, pour pouvoir fonctionner la « démocratie libérale » ne peut qu'être une démocratie « Potemkine » 15 ( * ) dont la façade démocratique (l'élection au suffrage universel des représentants du Souverain) cache une machinerie du pouvoir [ voir partie VI] dont la finalité première est d'interdire toute remise en question de la forme néolibérale du mode dominant de production et de partage de la richesse produite, de ses finalités et de ses bénéficiaires. Une démocratie dont les usagers sont privés du premier droit des citoyens - pouvoir modifier le régime sous lequel ils veulent vivre - privés de leur souveraineté donc.
Au cours de ce dernier demi-siècle, l'Empire a donc vu se succéder, démocratiquement, des majorités parlementaires et des exécutifs (Présidents de la République ou du Conseil, Premiers ministres) se combattant devant les électeurs pour mieux assurer l'essentiel : la pérennité de l'organisation néolibérale de la société. Ainsi, les « libéraux centristes », pour reprendre l'expression d'Adam Tooze (op cit), se perpétuèrent-ils au pouvoir, contre vents et marée, appliquant leurs projets, même quand les électeurs se sont clairement exprimés contre, comme on l'a vu en 2005, quand le projet de traité constitutionnel européen, rejeté par référendum, est adopté sous une forme à peine modifiée par la voie parlementaire.
2. Quand la sécession populaire répond à la révolte des « élites »
Paradoxalement on peut dire que cette démocratie en trompe-l'oeil qui a permis d'imposer les règles du jeu néolibérales à la majorité qui en voulait de moins en moins a trop bien réussi. « Bien » réussi puisque, jusqu'à ces dernières années, où des formations et des leaders « atypiques » commencèrent à accéder, en coalition puis seuls, au pouvoir, ce dernier fut exercé sans discontinuité par des néolibéraux.
« Trop » bien, puisque l'impossibilité de changements politiques significatifs a finalement donné consistance à un sentiment diffus que danser au bal institutionnel serait perdre son temps et légitimer les organisateurs et l'orchestre. Les électeurs ont donc fui les urnes, transporté le débat dans la rue sous des formes nouvelles, parfois violentes et finalement créé le terreau d'alternatives politiques inédites que les maîtres du pouvoir pensaient neutraliser en les traitant avec mépris de « populisme ».
Ils ne voulaient pas accepter que ledit peuple, las de voir le changement politique se limiter à celui du plan de table, au choix d'un cuisinier plus ou moins habile à faire prendre les vessies pour des lanternes, le menu restant le même, déserta les urnes, ou transforma les élections en émeutes électorales antisystème.
On vote de moins en moins « pour » quelqu'un, un programme, mais « contre », ce qui prit le nom de « dégagisme » et qui explique le caractère de plus en plus aléatoire des résultats électoraux.
Puis, le mécontentement s'exprimera dans la rue par des manifestations, des opérations contre des cibles symboliques pour le pouvoir, voire par des émeutes. Le point d'orgue final sera, après leur montée en puissance, l'accès au pouvoir de partis ou de leaders populistes antisystème.
Le spectre du populisme se mit à hanter, non seulement l'Europe, comme le communisme au temps de Marx, mais le monde ! Un populisme aux formes diverses : d'extrême droite ou de droite extrême (les plus fréquents) mais aussi de gauche (France insoumise en France 16 ( * ) , Podemos en Espagne) ou d'extrême gauche, voire non identifié comme le mouvement « Cinq étoiles » italien ou celui des « gilets jaunes » en France.
Le dénominateur commun c'est de contester le système tel qu'il fonctionne et ceux qui l'ont jusque-là fait fonctionner.
À considérer les résultats des dernières élections européennes en France ou dans de nombreux pays, les partis alternant depuis des dizaines d'années au pouvoir ont été pulvérisés, on peut se demander s'ils n'ont pas déjà atteint leur but.
En Europe continentale, pas de trimestres, voire de mois, sans que l'extrême droite marque des points à l'issue d'élections nationales ou locales. Des gains en termes de suffrages et de plus en plus de sièges : Rassemblement national en France (présidentielles et dernières élections européennes où il arrive en tête devant tous les autres partis, y compris celui actuellement au pouvoir), Vox en Espagne, le parti AfD en Allemagne, Vrais Finlandais en Finlande, Aube dorée en Grèce, PDS Slovène. Des gains en termes de pouvoir dans des coalitions avec la droite comme en Autriche, avec le centre (Estonie), avec des formations de gauche antilibérale ou libérale : Matteo Salvini leader de la Ligue coalisée avec Cinq étoiles, puis Cinq étoiles avec le Parti démocrate de centre gauche.
Sans compter les partis de droite extrême déjà au pouvoir en Pologne, Hongrie ou, comme en Slovaquie, y participant au sein d'une coalition hétéroclite.
Mais le plus surprenant est venu de là où on l'attendait le moins, des parrains du néolibéralisme mondialisé : le Royaume-Uni et les USA.
Le Royaume-Uni, à l'origine de la première sécession européenne avec le « Brexit », et dont le parti arrivé en tête aux européennes, l'UKYP de Nigel Farage, est d'extrême droite.
Les USA, avec l'élection de Donald Trump, qui donne des sueurs froides aux libres échangistes de stricte obédience.
Même la Suisse, avec Christoph Blocher, apporte sa contribution de droite extrême et de gauche avec une votation sur la « monnaie pleine » 17 ( * ) (2018) rassemblant 24,3 % de suffrages favorables. Ajoutons le Canada lors des élections provinciales québécoises, avec la victoire de la Coalition avenir Québec (CAQ) et l'élection d'un premier ministre, François Legault, « hors normes ». S'il refuse l'étiquette de « populiste », constatons qu'il a d'abord été élu contre les appareils en place.
Voter contre les partis et les leaders politiques qui se sont partagés, sous des formes diverses, le pouvoir depuis quarante ans est devenu une manie.
3. L'insaisissable populisme
Faute de pouvoir définir, de manière univoque, ce qu'est le populisme (voir partie VI) on est bien obligé de constater que c'est un « mot valise » susceptible de transporter les idéologies et les programmes politiques les plus contradictoires, un concept vide, ce qui explique la mise en échec de tous ceux - et ils sont nombreux - qui se sont risqués à lui donner un contenu invariant.
Ce n'est pas un concept mais une arme politique, offensive ou défensive, utilisée contre un système politique qui refuse de changer alors qu'il ne donne plus satisfaction et qui ne bénéficie pas de la confiance populaire. C'est la réaction à un système politique incapable d'évoluer substantiellement par le jeu institutionnel normal. L'analyse que fait Karl Polanyi des mouvements fascistes et socialistes de l'entre-deux-guerres, toutes choses inégales par ailleurs, est tout à fait transposable à celle des populismes d'aujourd'hui : « Le fascisme, comme le socialisme, étaient enracinés dans une société de marché qui refusait de fonctionner. »
L'appel au peuple est donc d'abord et essentiellement une arme dans le combat pour le pouvoir, nullement un programme de gouvernement ayant une chance d'être appliqué tel quel, même si les programmes sont aussi des armes politiques utiles. Désigner l'ennemi dispense les populistes d'indiquer précisément comment ils entendent répondre réellement aux attentes populaires. Ceci explique l'évolution des programmes et du discours populiste en fonction des circonstances, des affects changeants des cibles populaires visées ou, pour les partis au pouvoir, des alliances.
4. Mondialisation et populisme
L'une des explications les plus courantes de l'origine de la fièvre populiste actuelle est l'incapacité des institutions à protéger les perdants (quand ce ne sont pas les xénophobes ou les incapables) d'une mondialisation imposée par le progrès et le sens de l'Histoire. Ce serait le produit de l'impréparation à des changements inéluctables mais trop rapides.
Que la mondialisation, notamment par ses effets sur le tissu industriel, l'emploi, et dans la montée des inégalités (voir parties III et IV) ait stimulé le malaise social, aucun doute là-dessus. Mais, à ceci près, qu'elle n'est nullement le produit de la fatalité. Cette mondialisation est d'abord un système financier dominé par des oligopoles interconnectés à un tel degré que la faillite de l'un entraînerait l'effondrement des autres, mondialisé mais avec l'Amérique du Nord et l'Europe pour épicentre, la City de Londres et Wall Street comme capitales interconnectées, le dollar et l'eurodollar - dépôts en dollars déposés dans des banques hors de la juridiction étasunienne - pour monnaie et donc la Fed pour principale source de monnaie centrale.
C'est, complémentairement, un système économique monopolistique dominé par de grandes entreprises multinationales, plus destructrices que créatrices d'emplois, dépendant pour leur financement de l'oligopole financier.
Pas grand-chose à voir donc avec un « club Med » pour petits épargnants, PME et PMI, pour peu qu'ils fassent l'effort de la qualité et de l'innovation, ou avec la « mondialisation heureuse », dont Alain Minc réservait les fruits juteux aux « bons élèves de la modernité ».
Pas de fatalité donc mais le produit d'une volonté politique.
Conclusion : ce qu'une volonté politique a fait, seule une autre volonté politique peut le changer.
ANNEXES DES PROLÉGOMÈNES
Annexe 1 : Le naufrage du premier Titanic libéral
Le « côté jardin » du siècle libéral qui commence vers 1830, c'est l'instauration d'une « paix de cent ans » pour reprendre l'expression de Polanyi, période marquée par un fort développement de l'industrialisation et des échanges. Une « paix de cent ans » puisque de 1815 à 1914, les grandes puissances européennes - Angleterre, France, Prusse, Autriche, Italie, Russie - ne se seront fait la guerre que dix-huit mois au total.
Lors des deux siècles précédents, chaque pays avait été en guerre contre un autre en moyenne soixante à soixante-dix ans par siècle !
Une paix évidemment favorable à la circulation de capitaux et à la recherche des investissements les plus rentables ainsi qu'aux échanges de marchandises. Belle illustration du « doux commerce » cher à Montesquieu !
Quatre institutions 18 ( * ) assuraient l'équilibre de cette première mondialisation : l'équilibre des puissances qui, comme on l'a vu, ne se firent qu'exceptionnellement et uniquement localement, la guerre (guerre de Crimée, aventures coloniales) ; l'étalon or international qui garantissait la convertibilité des monnaies ; le marché autorégulateur ; l'État libéral qui se gardait de perturber le libre fonctionnement des marchés, sauf exception.
Quatre institutions, plus une : la haute finance, dans le rôle de facilitateur des échanges et de gardien de la paix générale favorable à l'enrichissement 19 ( * ) .
Côté « cour et arrière-cour », le nouvel ordre mondial fut nettement moins riant, très contrasté et de plus en plus contesté.
J.M. Keynes résume la situation en une formule : « Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont le premier que le plein emploi n'y est pas assuré, le second que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité » 20 ( * ) .
Le titre d'un des recueils de ses articles et interventions - La pauvreté dans l'abondance 21 ( * ) - est tout aussi parlant : le paradoxe et le scandale, c'est un système créant richesse et pauvreté en même temps.
Le siècle qui commence en 1830 sera effectivement ponctué de crises financières et économiques, de poussées inflationnistes et de stagnations avec leur cortège de chômage et de misère endémique ou paroxystique lorsque ces crises durent comme en 1919-1924 en Allemagne ou dans les années 1929-1930 et suivantes aux USA.
Après trente ans de croissance régulière, les crises se multiplient à partir de 1873, qui marque le début d'une période de stagnation jusqu'en 1896-97. Seuls y échapperont les USA qui voient leur population doubler entre 1870 et 1910, devenant alors la première puissance économique mondiale.
Durant cette période dite de « Grande dépression », la croissance annuelle du PIB/habitant se limitera à 0,1 %, ce qui, au final, et sur une longue période, relativisera fortement la croissance qu'on aurait pu attendre de la modernisation économique. Ce sont pourtant les fluctuations de court terme, entretenant un sentiment de précarité, qui caractérisent la période : deux années de croissance du PIB sont en moyenne suivies d'une année de régression, soit trente années entre 1830 et 1911. Toute ressemblance avec la situation actuelle n'est pas vraiment fortuite.
Mais, c'est à partir du début du XX e siècle que les choses se gâtent vraiment. Outre la Première Guerre mondiale et ses conséquences calamiteuses, ce début de siècle connaîtra, en effet, une forte instabilité financière : 1907, panique bancaire aux USA ; 1911, crise bancaire en Europe ; 1920-21, récession aux USA ; 1919-1924 crise financière, économique, sociale et politique en Allemagne ; 1929-1930 et suivantes, Grande crise. Face aux contradictions et à l'impuissance du libéralisme et de la social-démocratie qui pourtant se renforcent électoralement, apparaîtront des alternatives nouvelles : communisme soviétique, fascisme sous des formes diverses en Europe et paroxystique avec l'hitlérisme, interventionnisme d'État revendiqué et généralisé avec le New Deal de F. D. Roosevelt.
Le fascisme sous toutes ses formes ayant été éliminé au prix du sang 22 ( * ) , puissance étasunienne et keynésianisme aidant, c'est finalement la formule rooseveltienne du libéralisme politique interventionniste économiquement qui s'imposera dans l'Empire américain et le communisme bureaucratique, plus ou moins totalitaire selon les pays et les époques, dans l'Empire russe, dans sa galaxie et en Chine.
Annexe 2 : L'État-providence et les « Trente glorieuses »
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la puissance étasunienne et le keynésianisme aidant, c'est donc finalement la formule rooseveltienne du libéralisme politique interventionniste économiquement qui s'imposera en Occident, face à ce qui devenait le « bloc communiste » qui s'avérera finalement moins monolithique et moins solide que d'apparence.
L'installation progressive des « États-providence », associés aux accords de Bretton Woods conclus avant même la fin de la guerre (juillet 1944) firent que l'Occident capitaliste ne connut pas de crises financières jusqu'à la dénonciation unilatérale par les USA en 1971 - qui n'y trouvaient plus leur compte - des accords de régulation du système monétaire international. Qu'il s'agisse des « États-providence » redistributeurs de la richesse produite, contrôleurs des mouvements financiers ou du système de Bretton Woods, les leviers de l'action politique étaient les mêmes : la règlementation et la régulation en lieu et place de la totale liberté de circulation des capitaux.
Cette organisation nouvelle se voulait une réponse pérenne à la paupérisation de masse, à la montée des inégalités, aux problèmes sociaux, politiques puis internationaux majeurs qu'avait fait naître la première libéralisation et mondialisation financière et économique. Accessoirement c'était le moyen - qui s'avérera efficace - de miner l'attractivité du communisme, qui, avec la guerre avait étendu son influence en Europe, en Chine puis dans les anciennes colonies.
John K. Galbraith pourra écrire en 1975 : « Les historiens célèbreront sans doute la vingtaine d'années qui va de 1948 à 1967 comme l'ère la plus faste de l'histoire des économies industrielles et aussi de la science économique. Ces deux décennies ne connurent ni panique, ni crise, ni dépressions, à peine des récessions mineures...
Que la croissance fût saine, personne assurément n'en doutait. Peu de chômage durant ces années, du moins par rapport aux années trente...
Et par rapport aux années qui suivirent, l'inflation fut négligeable...
Cette description vaut tout particulièrement pour les États-Unis, mais dans les autres pays industriels les choses allaient à peine moins bien. Les destructions de la guerre furent vite effacées... » 23 ( * )
Quant à l'historien britannique, Eric Hobsbawm 24 ( * ) , en 1994 et donc plus de dix ans avant le krach, il résume ainsi cette courte période : « À une ère de catastrophes, de 1914 aux suites de la Seconde Guerre mondiale, succédèrent quelque vingt-cinq ou trente années de croissance économique et de transformation sociale extraordinaires, qui ont probablement changé la société humaine plus profondément qu'aucune autre période d'une brièveté comparable. Avec le recul, on peut y déceler une sorte d'Âge d'or, et c'est bien ainsi qu'on l'a perçu presque au moment où il touchait à sa fin, au début des années 1970. La dernière partie du siècle a été une nouvelle ère de décomposition, d'incertitude et de crise... »
Mais cette « Grande Transformation », pour reprendre, encore une fois, l'expression de Polanyi, ne se résumait pas à des dispositions relevant de la technique financière ou du pragmatisme politique. Elle résultait de la prise de conscience que l'ordre libéral du XIX e siècle n'était pas mort seulement du krach financier de 1929-1930 mais de ses conséquences politiques, que ce soit aux USA avec l'arrivée au pouvoir de F.D. Roosevelt, que ce soit en Europe sur le mode apocalyptique avec l'arrivée des fascismes au pouvoir dans de nombreux pays, les délires racistes hitlériens et finalement la guerre mondiale. Conséquences politiques d'un système non viable de régulation économique et sociale par le marché libre. C'était donc cette idéologie et son mode de régulation de l'économie et de la société même qu'il s'agissait de remplacer.
Il est significatif que la réforme du système monétaire international à Bretton Woods en juillet 1944 ait été suivie, quelques mois plus tard, de la reconnaissance unanime par la conférence de Philadelphie de la nature non marchande du travail (10 mai 1944). Significatif également qu'à la domination du marché sur l'économie et le partage de la richesse succède un pilotage financier de l'économie par un improbable mélange de monétarisme et de keynésianisme, l'interventionnisme économique de l'État (New deal aux USA, programme du Conseil national de la Résistance (CNR) et planification incitative en France, etc.) ou d'organisations internationales (Banque mondiale, CECA). Significatif aussi sur le plan social, le développement de politiques réductrices des inégalités et la mise en place « d'amortisseurs sociaux » ( Welfare state de Beveridge en Grande-Bretagne, New Deal (Roosevelt puis Johnson, sécurité sociale française, etc.)
C'était le temps de l'Empire américain triomphant, tellement assuré de sa puissance que les accords de Bretton Woods ne prévoyaient pas seulement un système de taux de changes fixes liant les monnaies à un dollar convertible en or mais aussi un mécanisme mondial de recyclage des excédents commerciaux et monétaires, au départ surtout étasuniens, réinjectés dans les économies déficitaires sous forme d'investissements directs, d'aides ou d'assistance. Le plan Marshall en fut l'une des formes.
Il ne s'agissait évidemment pas de philanthropie, même si l'idée de faire le bien caresse toujours l'âme américaine. Comme le rappelle Yanis Varoufakis dans son « Minotaure planétaire » 25 ( * ) , il s'agissait d'intérêts bien compris, le but final étant d'asseoir le camp des démocraties capitalistes, face au camp communiste, en aidant l'Europe, notamment l'Allemagne ainsi que le Japon, à se relever : « Pour maintenir la prospérité et la croissance américaine écrit Varoufakis , Washington offrit à dessein un morceau du « gâteau » global à ses protégés : tandis que les États-Unis perdirent près de 20 % de leur part du revenu mondial durant la période du Plan mondial, l'Allemagne vit la sienne augmenter de 18 % et le Japon connut une croissance phénoménale de 156,7 % » . La part de la France augmenta de 4,9 % alors que celle de la Grande-Bretagne diminua de 35,4 %.
Annexe 3 : L'utopie libérale selon Karl Polanyi26 ( * )
Selon l'analyse de Karl Polanyi, le libéralisme du XIX e et du début du XX e siècle - comme sa version néolibérale qui commencera sa reconquête dès la dénonciation des Accords de Bretton Woods et la mise en flottement du dollar - ne renvoie pas seulement à une transformation du mode de production capitaliste manufacturier ancien, puis du capitalisme managérial de l'Après-guerre, il représente une véritable mutation culturelle en ce sens qu'il institue les lois du marché devenu autonome, en régulateur de l'activité humaine dans toutes ses dimensions, en lieu et place de toutes autres règles sociales ou politiques. La concurrence « non faussée » entre des entités individuelles indépendantes, mues par leur seul intérêt, la loi de l'offre et de la demande, ne sont plus seulement le mode de régulation souhaitable pour la sphère économique mais pour la société toute entière, en lieu et place du politique, du religieux, de la tradition, etc.
« Pour la première fois, on se représentait une sorte particulière de phénomènes sociaux, les phénomènes économiques, comme séparés de la société et constituant à eux seuls un système distinct auquel tout le reste du social devait être soumis. » 27 ( * )
Peu de chose à voir donc avec le libéralisme classique pour qui le « laisser faire, laisser passer » 28 ( * ) , la loi de l'offre et de la demande, valaient seulement pour l'économie (production et commerce) , l'État conservant toujours le droit d'intervenir en cas de nécessité.
Pour Karl Polanyi, la totale nouveauté de l'utopie libérale moderne tient donc à une double innovation :
1- Des marchés économiques de plus en plus importants, interconnectés, constituant ainsi un « grand marché » autonome par rapport à la société.
2- Des règles de fonctionnement du reste de l'activité humaine alignées sur celles censées assurer l'efficacité de la sphère économique.
Le libéralisme moderne n'est donc pas qu'une manière de penser l'organisation économique. C'est d'abord et fondamentalement une utopie politique de réorganisation de la société dans tous ses secteurs et toutes ses dimensions, un projet idéologique.
Le propre des idéologies étant d'être imperméable aux faits, lesquels ne sauraient invalider le dogme, quand pour le commun des mortels la réalité dément la thèse des bienfaits de la concurrence quel que soit le secteur considéré, c'est simplement qu'elle n'y est pas encore assez parfaite, qu'elle est entravée. Quand une politique budgétaire restrictive, une politique fiscale favorable aux détenteurs de capitaux, ne donnent aucun des résultats attendus, c'est qu'elles n'ont pas encore eu le temps de produire tous leurs effets ou qu'elles ne sont pas allées assez loin 29 ( * ) .
Dans un tel système, la succession des crises financières et économiques n'est que la manifestation exacerbée de la « destruction créatrice » 30 ( * ) , principe vital du capitalisme qui ne survit qu'en se renouvelant continuellement.
Quant aux effets sociaux négatifs des crises, ce sont seulement des collatéraux temporaires, le prix à payer pour assurer le dynamisme d'une création de richesse profitant à tout le monde.
Si, comme dit Karl R. Popper « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique » 31 ( * ) , alors la théorisation libérale, à l'évidence, n'est pas une science.
C'est à l'Angleterre, nation dominante du XIX e siècle que reviendra l'initiative de commencer la construction du « grand marché » mondial interconnecté, fonctionnant de manière autonome, autrement dit le premier Titanic libéral.
C'est là qu'en sera construit le prototype par une série d'étapes décisives : création d'un « marché du travail » (Loi sur les pauvres en Angleterre 1834) 32 ( * ) , d'un marché de la monnaie ( Bank Act de 1844 fixant les règles de l'étalon or), d'un marché de la terre devenue outil de production comme les autres (Lois rendant la propriété de la terre transférable, abrogation de la loi sur le blé de 1846). Le marché des richesses naturelles et de l'environnement au sens large 33 ( * ) s'ajoutera à ces marqueurs d'une mutation de portée générale. Le processus de marchandisation généralisé avec la création de « marchandises fictives », fictives en ce sens qu'elles n'ont pas été produites pour être vendues, une fois lancé n'aura plus de limite. Son champ d'action est potentiellement infini, la prochaine marchandise attendant son marché étant le vivant 34 ( * ) .
Il faudra une Première Guerre mondiale, la Révolution d'octobre en Russie, l'émergence du fascisme un peu partout en Europe, du nazisme et surtout la Grande crise de 1929-1930, suivie d'une Seconde Guerre mondiale pour que la viabilité de l'utopie libérale soit sérieusement mise en doute au sein des sphères dirigeantes et par les esprits « éclairés », encore pas par tous, loin de là. À peine l'armistice signé, les irréductibles reprendront leur bâton de prêcheur pour la construction d'un Titanic néolibéral étasunien, encore plus puissant et insubmersible que son ancêtre.
Annexe 4 : Le bêtisier de Maastricht
En 1997, cinq ans après le référendum sur le traité de Maastricht, Jean-Pierre Chevènement publiait Le Bêtisier de Maastricht (Éditions Arléa). La campagne électorale qui mobilisa tout ce que la France comptait « d'esprits éclairés », la victoire s'annonçant incertaine, sera l'occasion d'un déferlement de déclarations péremptoires très révélatrices de la considération que nos élites portent au « commun » et accessoirement de sa lucidité.
Quelques extraits des citations mises en exergue dans ce Bêtisier :
« [Les partisans du "non"] sont des apprentis sorciers. [...] Moi je leur ferai un seul conseil : Messieurs, ou vous changez d'attitude, ou vous abandonnez la politique. Il n'y a pas de place pour un tel discours, de tels comportements, dans une vraie démocratie qui respecte l'intelligence et le bon sens des citoyens. » Jacques Delors (Quimper, 29 août 1992)
« Ce qui n'était pas prévu, c'est que les peuples puissent refuser ce que proposent les gouvernements. » Michel Rocard ( International Herald Tribune , 28 juillet 1992)
« Le traité de Maastricht fait la quasi-unanimité de l'ensemble de la classe politique. Les hommes politiques que nous avons élus sont tout de même mieux avertis que le commun des mortels. » Élisabeth Badinter ( Vu de Gauche , septembre 1992)
« Maastricht apporte aux dernières années de ce siècle une touche d'humanisme et de Lumière qui contraste singulièrement avec les épreuves cruelles du passé. » Michel Sapin, alors ministre socialiste des finances (Le Monde, 6 mai 1992)
« Interrogez les peuples de Bosnie, de l'ex-Yougoslavie, de Pologne et des autres pays. Ils nous disent : "chers amis français, entendez-nous. Apportez-nous votre soutien et votre oui. Ce sera un oui à la française, à l'amitié, à la paix, à l'union. Votre oui à l'union fera tache d'huile dans nos pays où nous souffrons tant ”. Les gens qui sont aujourd'hui sous les bombes seraient désespérés si les Français tournaient le dos à l'unité européenne. » Jack Lang (France Inter, 18 septembre 1992)
« Oui, pour aller de l'avant dans les conquêtes sociales, il n'est d'autre avenir que la Constitution de l'Europe. » Julien Dray
« Mon raisonnement est profondément socialdémocrate. À vrai dire, je n'ai pas encore compris pourquoi les libéraux veulent de cette Europe-là ». Michel Rocard (Assemblée nationale, 6 mai 1992)
« Le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie contre le retour à l'expérience socialiste pure et dure. » Alain Madelin (Libération, 3 août 1992)
« Si le “non” l'emporte, on ne reparlera plus de l'Europe mais des batailles qui se sont déroulées au cours des siècles passés. » Simone Veil (14 septembre 1992)
« Un “non” au référendum serait pour la France et l'Europe la plus grande catastrophe depuis les désastres engendrés par l'arrivée de Hitler au pouvoir. » Jacques Lesourne (Le Monde, 19 septembre 1992)
« Je suis persuadé que les jeunes nazillons qui se sont rendus odieux à Rostock votent “non” à Maastricht. » Michel Rocard (Le Figaro, 17 septembre 1992
« En votant “non”, nous donnerions un magnifique cadeau, sinon à Hitler, à Bismarck. » Alain-Gérard Slama (Le Figaro, 18 septembre 1992)
« Moi aussi, j'ai peur de l'Allemagne. [...] Il ne faut pas prendre l'Allemagne pour un gros chien dressé parce qu'elle a été irréprochablement démocratique depuis quarante-cinq ans. » Françoise Giroud (Le Nouvel Observateur, 3 septembre 1992)
« M. De Villiers, donc s'installa à l'Élysée. [...] Le “non” français à Maastricht fut interprété, de fait, comme un encouragement aux nationalismes. Il relança la guerre dans les Balkans. [...] Si bien que, sans aller, comme certains, jusqu'à imputer à ce maudit “non” le soulèvement transylvain, la nouvelle guerre de Trente ans, entre Grèce et Macédoine, les affrontements entre Ossètes du Nord et du Sud, puis entre Russes et Biélorusses, bref, sans aller jusqu'à lui attribuer toutes les guerres tribales, ou paratribales, qui enflammèrent l'Europe de l'Est, on ne peut pas ne pas songer que c'est lui, et lui seul, qui offrit à Berlin l'occasion de son nouveau “Reich”. » BHL (Le Figaro, 18 septembre 1992)
« Maastricht constitue les trois clefs de l'avenir : la monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie » Michel Rocard (Ouest-France, 27 août 1992)
« Si le Traité était en application, finalement la Communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré. » Valéry Giscard d'Estaing (RTL, 30 juillet 1992)
« Le traité d'union européenne se traduira par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. » Michel Sapin
« Si vous voulez que la Bourse se reprenne, votez “oui” à Maastricht ! » Michel Sapin, ministre socialiste des finances, (Le Figaro, 20 août 1992)
« L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. » Martine Aubry (Béthune, 12 septembre 1992)
« Avec Maastricht, on rira beaucoup plus. » Bernard Kouchner (Tours, 8 septembre 1992)
« Si vous voulez que la Bourse se reprenne, votez “oui” à Maastricht ! » Michel Sapin, ( université d'été du PS à Avignon , 31 août 1992)
« Pour pouvoir dîner à la table de l'Europe [monétaire], encore faut-il savoir se tenir à cette table et ne pas manger avec ses doigts. [...] Si la monnaie unique a un mérite, et un seul, c'est d'obliger les pays à se conduire correctement. » Jean-Marc Sylvestre (France Inter, 18 septembre 1992)
« La France est une locomotive. Elle n'a pas le droit d'être dans le wagon de queue. [...] Le train de l'espoir ne passe pas deux fois. » Jack Lang (RTL, 23 août 1992)
PARTIE I - LA FABRICATION D'UN NOUVEAU KRACH FINANCIER
« Ce régime absurde et insensé de l'économie libérée qui est la négation même de l'économie libérale »
Jacques Rueff
L'un des objets initiaux de cette étude qui fait suite à « Une crise en quête de fin. Quand l'Histoire bégaie » ( Rapport de la Délégation à la prospective n° 393, 2016-2017 ), présenté en février 2017, était d'évaluer si les réformes du système financier qui se sont succédé depuis 2008, et maintenant « presque achevées » 35 ( * ) , avaient porté leurs fruits.
Autrement dit, si la perspective d'une réédition d'un krach financier de magnitude équivalente à celui de 2007-2008 restait d'actualité au terme de dix ans de réforme.
On se doute que toute réponse catégorique, dans un sens ou un autre ne serait pas sérieuse, d'autant moins que l'actualité peut prendre son temps et que tout krach financier ne se transforme pas forcément en crise générale comme celles de 1929-1930 et 2007-2008.
De plus, tout autant que l'aspect financier de telles crises, compte leur contexte, l'ensemble du système géopolitique, économique, social, politique dont elles sont le produit et qu'en retour elles modifieront profondément
Et puis, l'air du temps compte pour beaucoup dans ce type de pronostic.
En 2007, à part quelques originaux tels Minsky et une poignée d'économistes, ou de quelques spéculateurs avisés, personne n'a vu venir la crise.
Le 26 septembre 2008, le ministre du budget français d'alors, Éric Woerth, pouvait encore dire « La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte. ».
Pour lui, comme pour tous les libéraux, une crise est seulement le prix à payer pour la régénération du capitalisme, celui d'une nouvelle jeunesse.
Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, la détection de bulles spéculatives et l'annonce d'un krach prochain sont devenus un genre journalistique.
Au point où nous en sommes, la seule démarche raisonnable c'est d'évaluer comment a évolué l'instabilité du système financier, tout en gardant à l'esprit que, pour reprendre l'expression d'Henri Sterdyniak 36 ( * ) , ce qui caractérise la situation depuis quelques années c'est d'être « une instabilité stable qui n'a aucune rationalité. Elle est insoutenable et, paradoxalement, le système tient bon. » .
En gardant aussi à l'esprit qu'en retour, les effets collatéraux - économiques, sociaux et politiques - d'un krach comme ceux de 1929 et 2008 peuvent, en cas de crise, entraîner des modifications en profondeur du système financier.
Mais, pour commencer, quelques considérations sur la monnaie, sa création et ses fonctions ne sont pas inutiles.
I. LA MONNAIE, SA CRÉATION ET SES FONCTIONS
« Dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, [...], à la création de monnaie par des faux-monnayeurs, si justement condamnée par la loi. Concrètement elle aboutit aux mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents ».
Maurice Allais 37 ( * )
A. DEUX CONCEPTIONS DE LA MONNAIE
On peut distinguer deux grandes conceptions de la monnaie.
La plus ancienne renvoie à l'époque où dominait l'économie agricole et où le rôle de la monnaie se limitait largement à celui de facilitateur des échanges entre des produits dont la valeur - hors situation de pénurie - dépendait essentiellement du temps de travail nécessaire pour les obtenir.
En ce temps-là, quand on retranche une quantité de blé à la production pour l'affecter à la récolte suivante on retranche une part non consommée (l'épargne) qui sera affectée à l'investissement.
Cette conception conforme au sens commun, toujours bien vivante, fait partie du crédo des adorateurs de la rigueur pour qui, pour pouvoir dépenser (demain) il faut se priver (aujourd'hui).
On la retrouve dans le célèbre Théorème d'Helmut Schmidt, passé en proverbe : « Les profits d'aujourd'hui (sous-entendu non consommés) sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ».
La seconde, qui renvoie à l'économie monétaire de production actuelle, voit le financement de l'investissement par le crédit comme une solution normale.
La création monétaire se justifie par l'anticipation de création de richesses et de profit.
En quelque sorte, la société crée ses propres moyens pour assurer son expansion.
Plus on crée de la monnaie par le crédit plus on dispose de moyens et plus on anticipe ainsi un avenir en expansion.
La monnaie est le moyen de l'expansion. Si les anticipations se révèlent justes, une fois la monnaie créée (les crédits accordés) et après remboursement des emprunts, qui sont autant de destruction de monnaie, il doit rester un solde positif.
Ce solde positif peut être réinvesti en tout ou partie mais pas obligatoirement, les taux d'intérêt devenant une des clefs de l'arbitrage 38 ( * ) .
On aura compris qu'un fonctionnement sans à-coup du système suppose des anticipations suffisamment réalistes des besoins en monnaie.
Ce qui pose la question du pouvoir de création monétaire, de ses motivations et de son contrôle.
B. LA PRIVATISATION DU POUVOIR DE CRÉATION DE LA MONNAIE
« Ce processus est sans doute le tour de passepasse le plus étonnant jamais inventé... »
Sir Josiah Stamp 39 ( * )
Qu'est-ce qu'un prêt bancaire, sinon le pouvoir de créer de la monnaie ex nihilo, par un simple jeu d'écriture ? L'ouverture d'une ligne de crédit de X€ sur le compte de dépôt de monsieur Y, inscrite au passif de la Banque, somme dont il pourra disposer à sa guise et en contrepartie une reconnaissance de dette de monsieur Y, avec les obligations qui s'y rattachent, inscrite à l'actif de l'établissement.
Aussi facile que cela.
Or, aussi étonnant que cela puisse être, ce pouvoir de création monétaire par un simple jeu d'écritures, devenu aujourd'hui essentiel au fonctionnement de l'économie, a été entièrement et partout privatisé lors de la Grande Transformation néolibérale du dernier demi-siècle.
Un pouvoir tout à fait extraordinaire désormais accordé au système bancaire (privé) de fabriquer de l'argent à partir de rien, sans même avoir dans ses coffres une certaine quantité d'or comme au temps de l'étalon du même nom.
Certes, ce pouvoir de production monétaire quasi illimité avant la crise a été encadré après...
Un peu.
Ainsi, pour créer 100 unités de monnaie, la banque doit avoir :
- des réserves auprès de la banque centrale (2 % des dépôts en zone euro) ;
- de quoi effectuer ses règlements en monnaie banque centrale auprès des autres banques (circuit inter bancaire) ;
- de quoi régler à la banque centrale les billets retirés par ses clients ;
- des fonds propres : 8 % des actifs pondérés par les risques, portés à 10,5% avec Bâle III ainsi que diverses réserves mobilisables en cas de crise pour les établissements systémiques.
Quel que soit l'habillage technique et les artifices utilisés pour dissimuler la modestie de la réforme (voir plus bas), celle-ci fait l'objet d'un tir de barrage et d'un lobbying intense de banquiers trouvant anormal que la puissance publique puisse limiter leur privilège inouï de battre monnaie en lieu et place du pouvoir politique légitime.
C. MONNAIE ET QUASI-MONNAIE
À côté de la monnaie fiduciaire (billets et pièces) et scripturale (simple trace sur les livres de comptes des banques de dépôts ou de la banque centrale), se sont développées des transactions de produits financiers qui, par-delà leur complexité, renvoient tous à des titres de créances donnant une espérance de revenu (créance sur un emprunteur hypothécaire, obligation du Trésor Public ou d'une entreprise...), et qui vont fonctionner comme une quasi-monnaie.
Monnaie, parce que ces titres ont une valeur (une cote), et peuvent circuler, être échangés, servir de caution, etc.
Une propriété qui suppose qu'ils ont une certaine liquidité, autrement dit la capacité de trouver preneur, ce qui suppose à son tour qu'ils aient un prix.
D'où l'obligation pour le système bancaire et boursier de maintenir un volume d'échanges suffisants pour qu'une valeur puisse être attribuée aux titres.
On aura compris que cette forme de création monétaire, qui va augmenter considérablement la masse monétaire en circulation, n'est pas sans conséquence sur la stabilité du système financier.
Car si les titres sont une quasi-monnaie, c'est que leur valeur est suspendue à la confiance qu'a le public dans la capacité du débiteur à rembourser ce qu'il s'est engagé à rembourser.
Quand cette confiance n'est plus là, tout s'arrête et les créanciers sont ruinés... Sauf ceux qui ont vendu leurs titres à temps.
C'est ce qu'on appelle une crise.
D. EN GUISE D'ÉPILOGUE
La monnaie (en l'espèce le crédit) est indispensable au fonctionnement d'une économie moderne.
Le problème, comme on le verra ( partie II ), c'est que le financement de l'économie n'est plus l'activité principale des banques, ce qui explique pour une bonne partie la stagnation économique européenne depuis 2008.
Comme on le verra aussi, la monnaie circule davantage au sein de la sphère financière que de celui de l'économie réelle.
La production, sans contrôle vraiment contraignant, de dettes et de crédits, déconnectée de l'économie réelle, ces activités spéculatives de ventes et achats de titres productrices de plus-values, d'intérêts, de revenus des conseils et autres opérations d'intermédiation, qui représentent désormais l'essentiel de l'activité bancaire, ont transformé le système financier en bombe à retardement.
Le plus extravagant dans la situation présente c'est que ce danger n'est pas la contrepartie d'un service rendu à la collectivité et que, soit une renationalisation des banques de dépôts, soit une réduction drastique de leur bilan ou un composé des deux, non seulement s'imposent pour des raisons de sécurité mais aussi à qui entend vraiment relancer la machine économique et l'emploi.
II. LA MÉCANIQUE DES CRISES FINANCIÈRES
Comme le corps humain ne peut vivre si la circulation du sang s'arrête, la nouvelle économie moderne ne peut fonctionner si le circuit financier des créances se bloque au niveau bancaire.
Autrement dit, si les banques ne peuvent plus faire face aux demandes de remboursement de leur passif (dépôts et dettes) , soit parce qu'elles manquent de fonds propres, soit parce qu'elles ne peuvent mobiliser (vendre) leurs actifs à temps ou à un prix suffisant, la défiance s'installe sur leur fiabilité et le circuit interbancaire reliant l'ensemble du système se bloque.
Pour l'éviter, il suffit de croire à l'impossibilité d'une telle situation. D'où l'importance de la transparence des opérations bancaires et des acteurs financiers avec lesquels elles sont en relations d'affaires.
Une crise 39 ( * ) commence par une crise de liquidité : l'impossibilité temporaire de transformer une partie suffisante des actifs en monnaie banque centrale pour faire face aux demandes de remboursement des engagements inscrits au passif. La fourniture de cette liquidité par la banque centrale en contrepartie de ces créances permet généralement de restaurer la confiance et de remettre en marche la « pompe à phynance » pour parler comme le père Ubu.
Quand cette impossibilité temporaire de faire face à ses engagements devient permanente, du fait de l'insuffisance de fonds propres, de la faible liquidité des actifs ou parce qu'ils sont invendables, la crise de liquidité devient crise de solvabilité .
Si la ou les banques ne sont pas recapitalisées (rachat par une autre banque ou nationalisation), elles font faillite (résolution), lésant les déposants et les autres créanciers.
C'est ce qui s'est passé en 2008, le krach débutant par une crise de liquidité pour s'achever en crise de solvabilité.
La crise de liquidité a alors été rapidement réglée par l'intervention massive des banques centrales (Fed, BCE, Banque d'Angleterre, etc.).
À noter, cependant ce point est généralement oublié, le rôle tout particulier de la Fed qui non seulement a fourni massivement du dollar aux USA mais aux autres banques centrales, pour permettre aux banques de leur ressort de faire face à leurs obligations considérables en dollar.
12 000 Md$ ont été ainsi fournis par la Fed aux autres banques centrales - dont 10 000 Md$ à la BCE - dans le cadre d'accords de lignes de crédit réciproques ( swap de devises).
Ainsi, ce qui n'est pas banal, relève Adam Tooze, « la Fed autorise un groupe de banques centrales triées sur le volet à créer des crédits en dollars à la demande... »
L'apport de liquidités de la Fed est spectaculaire, historique et d'une importance durable. Presque tous les spécialistes s'accordent à dire que les lignes de swap qui ont permis à la Fed d'injecter des dollars dans l'économie mondiale sont sans doute l'innovation décisive de la crise. Mais le grand public ignore pour ainsi dire leur existence » 40 ( * ) .
À noter qu'en 2018, les échanges (exportations plus importations) de la zone euro ont été réalisés à 45 % en dollars contre 41 % seulement en euros.
Si la lutte contre la crise de solvabilité sera rondement menée aux USA (et au Royaume-Uni) par le Gouvernement, la Fed (Banque d'Angleterre) et les autorités financières qui ont rapidement diagnostiqué le problème, elle interviendra d'abord en ordre dispersé, par chaque État, dans la zone euro, la BCE et Jean-Claude Trichet tardant à comprendre que l'on avait quitté la zone bien balisée de la crise de liquidité.
III. LES MASSES MONÉTAIRES EN JEU AUJOURD'HUI ET L'ENCHAÎNEMENT CRITIQUE
A. DE QUOI PARLE-T-ON ?
Pour bien saisir ce que signifie une crise financière systémique mondiale, comme celle de 2007-2008 et évaluer ce que signifierait sa réédition, il faut à la fois mesurer ce que représente aujourd'hui la « bulle financière » et comprendre l'enchaînement du processus critique.
Comme le résume le tableau ci-dessous, on parle de masses d'argent considérables, déconnectées dans des proportions variables du processus normal de production de la richesse réelle.
Pas besoin d'un long discours pour comprendre qu'un système où la dette (publique et privée) représente entre 2 et 3 fois la richesse produite annuellement 41 ( * ) , où les bilans des systèmes bancaires représentent entre 2 et 3,25 fois cette même richesse, est à la merci d'une vague de perte de confiance amenant les créanciers à demander le remboursement de leurs titres.
Comme c'est proprement impossible, le système financier se bloque et le système économique avec lui.
Et que dire du volume de cette invention récente - à laquelle on doit largement l'ampleur mondiale prise par la crise immobilière au départ des subprimes - que sont les produits dérivés de crédits, innovation censée sécuriser les échanges par un filet de garanties mutuelles ? Quand ces sortes de polices d'assurance garantissent entre 19 et 38 fois l'ensemble des biens assurés, qui peut croire que les assureurs pourront faire face à leurs obligations une fois le processus critique engagé ?
Ces chiffres étant les plus récents que l'on puisse obtenir - avec toute l'incertitude qui s'attache à un exercice que ne facilite pas le développement du shadow banking et surtout l'omerta du système financier et de ses gardiens - on aura compris qu'il faudra plus qu'une correction marginale à la baisse pour changer la donne.
B. L'ENCHAÎNEMENT CRITIQUE
« En fait, quand on analyse l'histoire des grandes crises financières systémiques, on constate qu'elles éclatent lorsque trois facteurs sont réunis : une création monétaire excessive, une dette élevée, une régulation insuffisante »
Jean-Michel Naulot (Blog, 18 octobre 2018).
Le processus auquel obéit une crise financière est tout à fait comparable à celui des incendies de forêts et de leur propagation jusqu'à la catastrophe.
Minuscules au départ, si rien ne les freine suffisamment, passé un seuil critique, plus rien ne peut les stopper.
Dans les deux cas, les ingrédients sont les mêmes : un carburant abondant (biomasse/ créances et dettes), un comburant abondant (vent/ facilités de création de monnaie, liquidité des créances 42 ( * ) , taux d'intérêt bas, voire négatifs), enfin un détonateur (flamme ou étincelle d'origine humaine ou naturelle/bulles spéculatives, prises de risques excessives, trading algorithmique et robots de débouclage de positions de marché, créances irrécouvrables ...).
Ce qui, dans les deux cas, permet à la crise de devenir systémique (catastrophique), ce sont les interconnexions au sein de la biomasse ou du système financier : embroussaillement, absence de coupures de combustibles, naturelles ou artificielles/interconnexions interbancaires (marché interbancaire, absence de séparation entre banques de dépôts et banques d'affaire ou entre établissements bancaires et shadow banking , établissements systémiques, dérivés de crédit...).
À l'inverse, les risques de crise sont réduits par la surveillance des départs de feux ou d'emballements financiers et, en amont, par la prévention : obligations en matière de débroussaillement ou interdictions de circulation et usage du feu/régulation (niveau de fonds propres, réserves de précaution, dispositifs de résolution, en français standard : accompagnement des faillites pour qu'elles n'aient pas de conséquences trop fâcheuses.)
Enfin, une fois l'incendie déclaré, il ne reste plus que l'intervention la plus rapide possible des pompiers ou des banques centrales et de l'État.
IV. LES PARAMÈTRES CRITIQUES AU TERME DE DIX ANS DE RÉFORMES
A. LE COMBUSTIBLE
« Il est apparu au début de l'année 1928 que la croissance du volume du crédit dépassait largement les besoins ordinaires de crédits commerciaux et industriels. De nombreuses années d'expérience ont montré que les augmentations de crédit au-delà des besoins de l'économie conduisent normalement à des résultats malheureux, à des excès spéculatifs, à des hausses de prix, à des bulles qui se terminent dans la dépression » . 43 ( * )
1. Jamais le volume de la dette n'a été aussi important
Qu'il s'agisse des entreprises ou des ménages, l'encours des crédits augmente plus vite que l'activité.
À noter que cette tendance continue à l'endettement des entreprises françaises est l'inverse de la tendance européenne, que l`endettement des grandes entreprises progresse plus vite que celui des autres et que le taux d'endettement des ménages français rejoint désormais le taux européen.
|
Zone Euro |
2008 |
2018 |
|
Dette Privée |
0.87 PIB |
39 929 Md€ soit 1.2 PIB |
|
Dette Publique |
0.66 PIB |
19 930 Md€ soit 0.86 PIB |
|
Dette Totale |
1.53 PIB |
35 638 Md€ soit 2.06 PIB |
|
USA |
Zone Euro |
2018 |
|
Dette Privée |
1.7 PIB |
30 396 Md$ soit 1.49 PIB44 ( * ) |
|
Dette Publique |
0.66 PIB |
25 058 Md$ soit 1.03 PIB |
|
Dette Totale |
2.36 PIB |
61 488 Md$ soit 2.52 PIB |
En Chine, l'endettement des entreprises non financières serait passé de 160 % du PIB en 2008 à 260 % du PIB en 2016.
« Loin d'arrêter le mouvement, la crise financière a au contraire accéléré l'endettement à tous les niveaux. Les centaines de milliards à taux zéro déversés par les banques centrales ont incité les acteurs privés à s'endetter tant et plus, y compris dans les entreprises, pour racheter leurs propres actions et verser des dividendes exceptionnels. Les États, eux, ont pris en charge l'essentiel de la note de la crise financière et ont continué à s'endetter pour maintenir leur économie, même quand ils prônaient une rigueur économique et un ajustement budgétaire. » comme le dit Martine Orange 45 ( * ) .
Le moteur économique est désormais l'endettement : selon l'économiste Daniel Lacalle Sousa, « au cours des huit dernières années, pour chaque dollar de PIB, trois dollars de dette ont été créés. » 46 ( * )
2. Des bilans bancaires toujours en croissance
Si, à partir de 2015 le bilan du système bancaire européen a baissé (34 855 Md€ en 2012/31 315 Md€ en 2015), celui de la BCE a été multiplié par 3 (1 500 Md€ en 2012/4 700 Md€ en 2018).
Ces bilans ont augmenté aux USA, celui de la Fed étant multiplié par 4 (1 000 Md$ en 2008/4 400 Md$ en 2018).
Ces politiques qui donnent une fâcheuse impression d'improvisation, sans souci des conséquences possibles, ne sont pas sans contradictions.
« L'augmentation des bilans des banques centrales est un fait entièrement nouveau. On est donc dans un univers inconnu. Pour prendre l'exemple de la plus grande banque centrale, la Fed, son bilan représentait entre 4 et 5 % du PIB américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, il représente 22 % du PIB. Les autorités monétaires américaines considèrent donc qu'il est urgent de réduire ce bilan. Il en va, estiment-elles, de la crédibilité de la Banque centrale. Warren Buffett a même dit un jour que la Fed devenait un « hedge fund ! » Jean Michel Naulot (Blog 18 octobre 2018)
Sauf que le nouveau locataire de la Maison blanche, Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille et fait ce qu'il faut pour que la Fed continue à racheter les créances pour doper la croissance économique et accessoirement faciliter la campagne du président à son renouvellement.
« En zone euro, le bilan de la BCE représente plus de 40 % du PIB, au Japon plus de 90 %, en Suisse plus de 100 %. La Banque Nationale Suisse achète toute sorte d'actifs en devises pour lutter contre la réévaluation du franc suisse, y compris des actions, alors que dans le même temps le gouvernement suisse pratique une politique d'excédents budgétaires qui a pour effet de réévaluer le franc suisse ! » ( ibidem ).
B. LE CARBURANT
1. Une masse monétaire en expansion
« Nous sortons d'une période de dix ans absolument inédite dans l'histoire économique où les banques centrales du monde entier, des États-Unis à la Chine et au Japon, en passant par la zone euro, le Royaume-Uni et la Suisse, ont créé de la monnaie comme jamais dans le passé. »
Jean-Michel Naulot - Blog 18 octobre 2018
Entre 2008 et 2016, les banques centrales des États-Unis, de la zone euro, du Japon, de la Grande-Bretagne, sans parler de la banque de Chine, auront déversé l'équivalent de plus de 10 000 Md$ dans la sphère financière.
Première origine de cette situation, la politique « accommodante » des banques centrales de quantitative easing : achat de dettes publiques et privées - y compris douteuses - et parfois d'actions dans l'espoir que la nouvelle capacité d'émission de crédit donnée aux banques les incitera à mieux financer l'économie réelle.
La suite montra que cela était vain.
Il faut y ajouter, les politiques fiscales favorables aux classes aisées sous prétexte, là aussi, de relance économique, aggravant les déficits publics.
Ainsi, aux USA où, en quelques mois, pour financer ses largesses, Trump a-t-il creusé de manière spectaculaire le déficit budgétaire, ainsi en France où ces classes aisées ont été les principales bénéficiaires des réformes fiscales (voir partie II).
Rien de nouveau en réalité, simplement l'accélération d'une pratique devenue courante.
D'où l'accumulation de liquidités dans la trésorerie des entreprises, utilisées pour augmenter les dividendes, racheter leurs propres actions pour en faire monter le cours plutôt que d'investir ou, encore moins, augmenter les salaires
Ainsi En 2016, les entreprises américaines disposaient déjà de 1 860 Md$ de trésorerie, soit 9 % du PIB, une bonne partie utilisée sous forme spéculative.
L'évolution de la masse monétaire
|
2008 |
2010 |
2016 |
2018 |
|
|
USA |
84.5% PIB |
85.2% PIB |
89.9% PIB |
89.5% PIB |
|
Zone € |
100.57% PIB |
124.3% PIB |
108.6% PIB |
104% PIB |
|
Chine |
148.7% PIB |
175.7% PIB |
202.6% PIB |
199.1% PIB |
|
Monde |
100.6% PIB |
108.6% PIB |
124.3% PIB |
123% PIB |
Avec la nouvelle politique de la Fed sous pression présidentielle, la masse monétaire étasunienne devrait de nouveau progresser.
Autre facteur influençant le niveau de la masse monétaire, des taux d'intérêt proches de zéro voire négatifs pendant toute une période, facilitant le développement des prêts bancaires.
Une politique justifiée au moment de la crise, devenue contre-productive puis un piège, toute remontée des taux risquant de provoquer un cataclysme.
2. Des taux d'intérêt très bas ou négatifs
« Lorsque l'on crée trop de monnaie, nous dit Jean-Michel Naulot, vous êtes sûr que cela se terminera très mal car toute cette monnaie part dans le système financier alors que les besoins de l'économie réelle sont limités. » (opus cit).
Ce qui explique l'effet contreproductif de l'injection globale de liquidité dans le système au lieu de la cibler sur des objectifs précis.
Ce à quoi on peut ajouter que la spéculation financière rapporte plus, en se fatiguant moins.
Et puis, note William White : « Peut-être le plus important, [c'est que] les politiques monétaires ultra-faciles ont précisément encouragé le comportement financier risqué que les réglementations étaient censées limiter. Avec une politique monétaire fermement ancrée dans l'accélérateur et une politique réglementaire fermement en frein, le résultat le plus probable est une instabilité accrue. » 47 ( * )
Et une instabilité accrue, c'est plus de risque de déstabilisation, donc de crise.
Désireuse de contenir cet emballement, à partir de la fin de 2018, la Fed a haussé son taux directeur entre 2,25 % et 2,5 avant de succomber aux pressions de de Donald Trump et de le baisser à 1,75-2 %.
3. Des titres financiers toujours artificiellement liquides
Outre les titres entrant dans la définition de la masse monétaire - pièces et billets/dépôts et prêts à courts termes/ placements monétaires à terme/ certains titres du marché monétaire (bons du Trésor par exemple) - la quasi-monnaie (actions, obligations, créances diverses) maintenue relativement liquide par le trading fonctionne comme de la monnaie.
Autre moyen d'augmenter la liquidité des titres de créances, la titrisation, comme on l'a vu avec les subprimes . Mêlés à d'autres titres plus présentables, découpés en tranches certifiées sans risque par les agences de notation, ils peuvent circuler partout dans le monde sous leur habit respectable et propager une crise systémique.
Ainsi l'essentiel des actions ne sont-elles pas des investissements de long terme dans des entreprises mais des supports spéculatifs.
Il a été estimé en 2011 qu'une action changeait de main toutes les 22 secondes à Wall-Street (en tenant compte du trading haute fréquence) et toutes les 11 minutes sans tenir compte du THF.
Si les études sur ce sujet ne sont ni nombreuses ni récentes, ce qui est certain c'est que la durée de détention des actions (hors THF) a régulièrement baissé avec le temps, passant à New York et Londres, en moyenne, de 8 ans 4 mois à 2 ans 9 mois en 1980 et 1 an 2 mois en 2000, la généralisation du THF brouillant ensuite considérablement les pistes (voir annexe 2).
Constatons cependant qu'entre « 1975 et 2015, au niveau mondial, alors que le PIB a été multiplié par 15, la capitalisation boursière a été multipliée par 50 et le montant des transactions boursières par 300.» 48 ( * )
D'où le projet européen, à la demande du Parlement, d'endiguer cette explosion, source d'opacité, sans autre bénéfice que de stimuler la spéculation bancaire de créer une Taxe sur les transactions financières (TTF), plus connue sous le nom de taxe Tobin. Non seulement elle est restée lettre morte mais la titrisation est revenue en odeur de sainteté auprès de la Commission, une titrisation « sécurisée » selon elle, évidemment !
Selon Gunther Capelle-Blancard, cité plus haut, cette taxe, facile à percevoir et d'un bon rapport, serait cependant plus intéressante fiscalement que pour freiner le trafic financier.
À ce jour, le projet européen est resté lettre morte, seuls deux pays, l'Italie et la France (2012) ayant pris l'initiative de mettre en place une telle taxe, les Britanniques conservant une taxe spécifique sur les transactions portant sur les actions.
La taxe française dont le taux devait être porté de 0,2 % à 0,3 % en 2018 et étendue aux transactions intra-journalières (sur le THF), ne sera finalement pas modifiée.
Dès lors, il est clair que la France s'opposera à la création de toute TTF européenne.
4. Ratios de fonds propres des banques : une réforme en trompe-l'oeil
Comme on l'a vu, l'un des moyens de limiter la production de crédit et donc de garantir la capacité de résistance des établissements bancaires à la défaillance d'un ou plusieurs débiteurs, c'est de leur imposer une réserve de fonds propres suffisante.
De l'ordre de 15 % à 20 % il y a un siècle, notamment aux USA, avec le temps les ratios devenus obligatoires de fonds propres (fonds propres/bilan) ont fondu.
De l'ordre de 3 % en 2000, ils n'étaient guère supérieurs à 1,5 % pour les banques systémiques en 2007.
Les accords « Bâle III » ont apparemment relevé significativement les obligations de fonds propres : un ratio pondéré des risques de 10,5 %, porté progressivement à 15,5 % pour les établissements systémiques.
Le problème, c'est que l'essentiel des progrès apparents résulte plus de la magie de la pondération, laissée à la discrétion des intéressés, que d'une augmentation réelle des fonds propres.
Ainsi, dans son rapport de 2015 49 ( * ) , la BRI montre, graphique à l'appui, que, si entre mi-2011 et mi-2014, les actifs bancaires pondérés ont baissé, faisant apparaître une amélioration de 45 % du ratio officiel de solvabilité (CET1), les actifs réels ont continué à augmenter.
Le graphique ci-dessus montre que, si les fonds propres « officiels » (CET1) ont pu augmenter de 45 % (courbe du haut), c'est que la pondération des actifs (courbe du bas) a fait baisser des actifs réels qui, en réalité, augmentaient de 10 % (courbe du milieu).
Même le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a trouvé le tour de passe-passe un peu gros : « Nous avons besoin d'un ratio de levier simple - le montant des capitaux nécessaires pour une quantité donnée du total des actifs - afin de contrôler le problème des banques ayant un capital trop faible. Les règles de Bâle ont malheureusement donné aux banques de grandes possibilités pour éviter de telles limites via la soi-disant "optimisation de la pondération", ceci ayant pour résultat le fait que les banques n'ont pas toujours les capitaux nécessaires pour faire des affaires en toute sécurité. Cela est particulièrement vrai en Europe, où 700 Md€ seraient nécessaires pour mettre les banques en conformité. »
Cet indice simple, c'est le classique ratio de levier : fonds propres/total des actifs.
Un ratio que les négociateurs de Bâle ont certes ajouté à la panoplie des obligations, fixé à 3 % mais dont la date de mise en oeuvre attend toujours.
Or, un ratio de levier de 3 %, cela signifie qu'avec 1 € la banque peut créer 32,3 € de crédit. C'est le même levier qu'avant la crise !
Ainsi en 2018, BNP-Paribas avec 98,8 millions d'euros de fonds propres et un bilan de 1 952 Md€ a-t-elle pu créer 18,7 € de crédit avec chaque euro de fonds propres.
À noter que le ratio de levier est de 4 % aux USA et de 6 % au Royaume-Uni, ce qui n'empêche pas les banques européennes de mener campagne contre les accords de Bâle III.
Aux USA, aux termes du Dodd-Franck Act , les établissements présentant un risque systémique voient leur levier limité à quinze fois les fonds propres. D'où l'acharnement de Donald Trump contre cette loi.
Selon Jean-Michel Naulot, « il s'agit d'une simple remise à niveau. Si les banques étaient à ce point sous-capitalisées en 2008, c'est parce qu'une réforme néfaste avait été adoptée le 26 juin 2004 à Bâle lors d'une réunion des banquiers centraux réunis sous la présidence de Jean-Claude Trichet... La réforme adoptée est minime et elle ne sera applicable qu'en... 2028 ! »
S'agissant de la liberté laissée aux banques de pondérer les risques, Laurent Clerc (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) fait valoir, lors de son audition, que celle-ci n'est pas totale puisque « l'écart en capital réglementaire entre une banque utilisant la méthode standard et la même banque recourant aux modèles internes est limité à 27,5 %... C'est mieux qu'avant ! Avant, il n'y avait rien. » Il est vrai que trois fois rien c'est quand même quelque chose.
Bâle III s'attèle aussi à renforcer la capacité de résistance des banques à des chocs durables de liquidité en les contraignant à conserver, au sein de leur bilan, une quantité d'actifs liquides de très grande qualité leur permettant de faire face à une période de stress de 30 jours, de façon autonome.
Elle vise également à réduire le risque de transformation en s'assurant que leurs actifs les moins liquides soient bien financés par leurs ressources les plus stables.
Comme on voit, tout cela est difficile à contrôler et ne règle pas le problème essentiel, le pouvoir des banques d'émettre de la monnaie sans rapport avec les besoins de l'économie.
Au final : « à partir du 1 er janvier 2019, les exigences seront fixées au maximum entre 16 % des actifs pondérés par les risques ( Risk weighted assets ou RWA) et 6 % des expositions de levier, puis 18 % des RWA et 6,75 % des expositions de leviers en 2022. »
Ultime justification, pour Laurent Clerc, des exigences pour le moins modérées de Bâle III : « Les forts ratios de leviers n'ont jamais empêché les faillites... Voyez les États-Unis ».
Curieuse démonstration, les ratios de leviers bancaires n'étant pas spécialement élevés aux USA en 2007 !
C. DES VECTEURS DE CRISE TOUJOURS AUSSI NOMBREUX ET ACTIFS
Comme l'incendie de forêts, une crise financière, d'abord localisée, ne devient systémique qu'en se propageant à l'ensemble du système financier puis à l'économie. Or, les relations interbancaires sont de multiples sortes : marché interbancaire, prêts de titres, produits dérivés, existence d'établissements systémiques, absence de séparation entre banques de dépôts et d'affaire, entre banques et shadow banking...
1. Des liens interbancaires complexes et nombreux
Selon une étude de la Banque de France 50 ( * ) portant sur un échantillon de grandes banques européennes, ces échanges interbancaires (refinancement par des prêts interbancaires, portefeuilles commun de titres, contrats sur produits dérivés...) se seraient réduits.
Ceci dit, si cette baisse est forte, mesurée par rapport à l'encours des dépôts, elle l'est beaucoup moins, mesurée par rapport au total des actifs et surtout, comme le souligne la conclusion de l'étude, les données dont on dispose sont loin d'être exhaustives : « il reste encore des progrès à accomplir pour parvenir à une compréhension exhaustive des interdépendances dans l'ensemble du système financier et, au-delà, des banques. La première étape serait de garantir un partage efficace des données entre les régulateurs de différents secteurs au niveau national, ainsi qu'au niveau mondial. Comme constaté en 2008, les crises financières ne se limitent pas aux crises bancaires et ne s'arrêtent pas aux frontières. »
Parmi les interactions interbancaires difficiles à évaluer et donc à contrôler : les prêts de titres entre établissements. Le volume d'échanges est très important : 17 000 Md$ (2017), en comptant les prêts banques centrales, contre 4 000 Md$ en 2008, générant 8 à 9 Md$ de bénéfice.
Selon BNP-Paribas : « Le prêt de titres et la vente à découvert sont reconnus comme des éléments clés du développement de marchés financiers solides, liquides et efficaces . » 51 ( * )
Sauf qu'en cas de crise, cette pratique augmente la confusion, un même titre pouvant être revendiqué par plusieurs acteurs. Selon Jean-Michel Naulot : « À un instant donné, le FMI considère qu'un même titre peut être revendiqué par deux acteurs et demi » 52 ( * ) .
2. Un niveau de produits dérivés toujours astronomique
« La preuve la plus évidente des bienfaits visibles apportés par les produits dérivés est la constance de leur croissance spectaculaire. »
Alan Greenspan (2005) 53 ( * )
Warrren Buffett, lui, considérait « les produits dérivés comme des armes de destruction massive, véhiculant le risque, qui, même s'il reste latent actuellement [on était en 2003], est potentiellement mortel. »
Avec la crise des subprimes , la suite lui donna raison, et tort à « Magic Greenspan ».
C'est pourquoi la question de leur volume, certes en réduction mais toujours très élevé, demeure très préoccupante, particulièrement en France et en Europe où la valeur du sous-jacent oscille entre 19 et 33 fois le PIB des zones concernées.
Valeur du sous-jacent des produits dérivés (estimations)
|
France |
75 000 Md€ (2016) |
|
Europe |
660 800 Md€ (2018) |
|
USA |
247 000 Md$ (2016) |
|
Monde |
1 500 000 Md$ (2018) |
La prise de conscience de la dangerosité de ces sortes d'assurances, utiles s'il s'agit de garantir des échanges de produits réels (de l'ordre de 7 % des transactions), est à l'origine de la décision du G20 de 2009, de faire transiter ces échanges par des « plateformes d'échanges » garantissant leur transparence et la qualité de la compensation.
À noter que l'obligation concerne seulement les contrats de gré à gré standardisés et pas l'ensemble des produits dérivés, notamment les produits complexes dont il semble fait un usage important 54 ( * ) .
Le problème, c'est qu'en matière financière, rares sont les réglementations qui n'aient pas leur revers.
En l'espèce, l'existence de ces « compensations centrales » (CCPs) - interface entre les acquéreurs et les vendeurs de produits dérivés qui garantit la bonne fin de l'opération - crée un écheveau de liens mondial entre ces plateformes et entre les établissements bancaires.
Le problème c'est surtout que ces plateformes deviennent, par leur importance, des établissements systémiques d'un nouveau genre dont on n'est pas assuré qu'ils pourront faire face à leurs obligations en cas de crise sérieuse.
Ainsi « en devenant des acteurs, concentrant sur elles les risques des opérateurs, les chambres de compensation deviennent potentiellement des acteurs systémiques et sont encore pour le moment peu capitalisées et peu surveillées. » (Jezabel Couppey-Soubeyran)
Ce que confirme Laurent Clerc : il s'agit bien d'un nouvel acteur systémique et « c'est pour cela qu'elles sont particulièrement surveillées, non seulement sur leur mode de gouvernance, mais aussi sur leur mode de résolution en cas de difficultés. »
À noter aussi, qu'internationales, en cas de problème on voit mal quel État ou quelle banque centrale pourraient venir à leur rescousse.
Les dérivés deviendraient alors une « arme de destruction massive à retardement. »
À se demander pourquoi mettre en place des usines à gaz financières dangereuses, dont l'intérêt pour l'économie réelle est d'autant plus limité que la baisse des taux a grandement limité le risque dans ce secteur où la demande de garanties était la plus importante.
3. Des banques systémiques, toujours aussi nombreuses, toujours aussi « systémiques » et toujours aussi dangereuses !
a) Le système bancaire systémique mondial
Il s'agit d'un système financier dominé par des oligopoles interconnectés à un tel degré que la faillite de l'un entraînerait l'effondrement des autres, au niveau mondial mais avec l'Amérique du Nord et l'Europe pour épicentre, avec la City de Londres et Wall Street comme capitales interconnectées, avec le dollar et l'eurodollar - dépôts en dollars déposés dans des banques hors de la juridiction étasunienne - pour monnaie, et donc la Fed pour principale source de monnaie centrale, comme on l'a bien vu lors de la crise de 2008.
Selon Jezabel Couppey-Soubeyran, le nombre de ces banques systémiques est passé de 29 à 30 entre 2011 et 2018.
Surtout, elles n'ont pas diminué d'importance, seule la répartition mondiale s'étant modifiée : baisse des bilans agrégés en Europe (baisse de 35 à 56 %) et hausse très importante en Chine (69 à 80 %).
Si dans la zone euro le nombre de banques systémiques a diminué (10 en 2011, 8 en 2016, 7 en 2017), leur part de marché a peu varié (37 % en 2016 contre 39 % en 2011) 55 ( * ) .
À noter que parmi les banques systémiques mondiales, quatre sont françaises à des niveaux par rapport au PIB français, sans commune mesure avec ceux des autres pays.
Ainsi, le bilan de BNP-Paribas représente-t-il 87 % du PIB français contre 13 % du PIB des USA pour la plus grande banque américaine, JP Morgan Chase & Co.
À noter cependant que le mode de comptabilisation des produits dérivés aux USA minore leurs bilans par rapport à ceux des banques européennes et que la hausse des bilans de la totalité du système américain ayant été plus forte que celle des banques systémiques, la place de ces dernières en pourcentage baisse (47 % en 2016 contre 54 % en 2011).
Au final, le bilan agrégé de ces banques systémiques mondiales, qui était de 46 859 Md$ en 2011, atteint 51 676 Md$ en 2017. « Le grand désendettement » 56 ( * ) attendu est ainsi loin d'avoir eu lieu !
b) Un système bancaire systémique toujours « trop gros pour faire faillite »
Malgré les réformes donc, ces établissements « trop gros pour faire faillite » ne sont toujours pas en capacité de faire face à leurs obligations en cas de problème majeur. États et banques centrales devront donc, contraints et forcés, continuer à les tirer d'affaire.
En effet, si le niveau de fonds propres obligatoires prévus par Bâle III a amélioré leur solvabilité, on est encore loin du compte.
Quant au « mécanisme de résolution unique » (MRU) et au fonds de garantie des dépôts européen, censés libérer les pouvoirs publics de leur obligation d'intervenir en cas de krach, ils ne pourront remplir leur mission que par temps calme et pour des sinistres de faible magnitude, ce qui n'est ni le problème, ni juste vis-à-vis des déposants dont les dépôts ne sont plus garantis qu'à hauteur de 100 000 €.
Une garantie en principe assurée par les banques, aux frais des déposants donc !
Le « Fonds de résolution unique » censé couvrir, à terme, 1 % des dépôts au niveau européen (55 Md€) est alimenté par une contribution des établissements bancaires 57 ( * ) .
Selon Laurent Clerc, cependant, la résilience du système bancaire européen, notamment celle des établissements systémiques, après Bâle III a considérablement augmenté : « Concrètement, depuis le début de l'année 2019, les banques ont l'obligation de détenir, en plus du capital réglementaire minimum pour éponger les pertes, des titres, à reconvertir en capital en cas de pertes. Ce sont donc des titres hybrides qui ressemblent à des obligations, mais convertissables. Ces titres sont détenus par des organismes, des investisseurs étrangers, notamment. Il s'agit donc en pratique d'un quasi doublement des exigences réglementaires pour les banques systémiques. On arrive à des niveaux de 25 % de passif, qui peuvent être convertis en capital en cas de crise. »
Sauf qu'en cas d'une crise du type de celle de 2008, il n'est pas prouvé que les garants, par ailleurs en difficulté, soient en capacité d'intervenir.
C'est d'ailleurs l'un des reproches essentiels fait aux stress tests de la BCE, évaluer la résilience comme si les établissements ne faisaient pas partie d'un système dont les unités interfèrent entre elles.
Pour plus de détails sur le système et son fonctionnement, on se reportera à l'Annexe 1 de cette première partie mais, il suffit de regarder les chiffres pour comprendre qu'il ne peut régler que de petits sinistres locaux - ce qui n'est pas le problème - non une crise systémique européenne. Donc beaucoup de complication pour bien peu.
4. Toujours pas de réelle séparation entre les activités de banques de dépôts et de banques d'affaires
La confusion entre le rôle des banques de dépôts - transformer des dépôts en prêts dont a besoin l'économie réelle - et celui des banques d'affaires, qui mêlent inextricablement investissement d'une faible partie de l'épargne existant dans l'économie réelle et une autre de plus en plus grande de celle-ci en spéculation, est certainement l'une des formes les plus dangereuses d'interpénétration entre activités financières.
Parce que c'est fournir à la spéculation des ressources potentiellement infinies en en privant d'autant l'économie réelle, favoriser la formation de bulles spéculatives et multiplier les risques d'insolvabilité pour le créancier bancaire.
Comme le dit crûment Maurice Allais : « Il faut empêcher les banques de spéculer avec l'argent qu'elles créent comme il faut empêcher les filiales des banques ou les fonds d'investissement de spéculer avec de l'argent prêté par les banques. On n'empêchera jamais la spéculation mais il faut que les spéculateurs spéculent avec leur argent, pas avec celui des autres. »
Autrement dit, il faut supprimer la garantie publique au casino bancaire, garantie qui lui permet par ailleurs de s'endetter à un coût inférieur à celui des établissements non systémiques.
Un problème d'autant plus urgent que la gestion d'actifs est devenue, si on en croît Patrick Artus, l'une des activités essentielles des banques : « Quand vous regardez l'origine du revenu des banques, en 10 ans il y a eu un changement incroyable : les activités de marché qui faisaient 50 % des revenus sont passées actuellement à 10 %. Ce qui monte énormément ce sont les activités de gestion d'actifs - assurance, etc. Dans ma banque plus de 60 % du revenu représente de la gestion d'actifs et de l'assurance »
Ce qui apparente l'activité bancaire à celle des hedges funds .
Pas vraiment rassurant.
Il est significatif que le Banking Act ou Glass-Steagall Act , du nom du sénateur Carter Glass et du représentant Henry Steagall qui défendirent la loi au Congrès, fut la toute première mesure importante de Roosevelt après son arrivée à la Maison-Blanche en mars 1933.
Signée dès le 16 juin 1933 par le Président Roosevelt, elle instituait une incompatibilité rigoureuse entre les activités de banque de dépôts ( commercial banking ) et celles de banque d'affaires ( investment banking ). Une banque de dépôts ne pouvait posséder une banque d'affaires ni, inversement, une banque d'affaires posséder une banque de dépôts.
Une banque de dépôts ne pouvait pas non plus acheter, vendre ou négocier des titres financiers, ni une banque d'affaires accepter des dépôts.
Le but était clairement de protéger les dépôts, d'empêcher la spéculation à partir de dépôts.
Une telle législation ne pouvant que susciter l'opposition farouche de ceux qui vivent de cette spéculation, dès le retour aux commandes politiques du néolibéralisme aux USA vont se multiplier les entorses aux obligations initiales, avant la suppression définitive du Glass-Steagall Act sous la présidence Clinton en 1999.
Les banquiers d'affaires pourront de nouveau utiliser les dépôts de leurs clients pour investir et spéculer sur les marchés et faire gonfler les bulles spéculatives.
Sur ce chapitre, plus moderne que les États-Unis, la France reviendra dès 1984 sur la séparation entre banques de dépôts et d'affaires via la loi bancaire.
Il lui faudra cependant une dizaine d'années pour voir le triomphe du modèle de « banque universelle » qui en sera l'aboutissement.
La crise de 2007-2008 révélant au grand jour les conséquences du privilège accordé aux banquiers de pouvoir spéculer avec l'argent des déposants, la séparation bancaire ressurgit au G20 de 2009.
Au grand dam du lobby bancaire qui multiplia les manoeuvres de retardement, espérant bien que la montagne des bons sentiments accoucherait d'une souris réglementaire.
Trois solutions étaient possibles :
- la seule vraiment efficace, la séparation totale. Personne n'en voudra ;
- la holding coiffant deux entités distinctes mais maintenant quand même un lien entre-elles, ce à quoi revient la solution britannique ;
- la solution européenne du transfert à une filiale des activités jugées spéculatives ou, selon la loi française, de séparation bancaire des activités qui « ne sont pas utiles à l'économie », autant dire quasiment aucune vu le sens pris par la notion d'« investisseur ». Dans ce cas, non seulement les liens sont maintenus mais la définition de « l'utilité pour l'économie » étant extensive, il y avait toutes les chances que la séparation se limite à pas grand-chose, ce que la suite montra.
En fait dans les deux derniers cas il ne s'agit pas d'une séparation des établissements selon leurs activités mais, à l'intérieur d'un même établissement, de la séparation des activités. Les mastodontes restaient donc debout.
À l'heure actuelle seuls les Britanniques sont allés au bout de leur propre démarche.
Quant à la solution européenne, après un départ brillant avec le rapport Liikanen et le projet de réforme de Michel Barnier, alors commissaire européen, on l'attend toujours.
Entre autres mesures, le projet Barnier interdisait aux banques de dépôts de spéculer pour leur propre compte sur les produits financiers s'échangeant sur les marchés (actions, obligations, produits financiers complexes...), ainsi que sur les matières premières.
Il donnait le pouvoir aux autorités de contrôle d'imposer le cantonnement, dans une filiale séparée, des activités de marché jugées à hauts risques pour le compte de tiers : négoce de produits dérivés complexes, l'essentiel des opérations de titrisation, « tenue de marché » (nécessaire à garantir la liquidité des produits achetés, autrement dit la garantie de pouvoir les revendre). La réforme est toujours bloquée au Parlement européen.
Défendant bec et ongles son modèle de « banque universelle », la France ne sera pas pour rien dans cet enlisement du projet européen.
Prenant les devants, elle adoptera un placebo sous le nom de loi de « séparation et de régulation des activités bancaires », un projet qui pourtant ne visait rien moins qu'à « remettre la finance au service de l'économie réelle ». Présentée à la fin de 2012 au Parlement par Pierre Moscovici, la loi sera publiée le 27 juillet 2013.
Comme prévu, au final, les activités devant être filialisées ne représentent pas grand-chose : 1 % des revenus de la Société Générale, reconnaîtra Frédéric Oudéa, son P-DG, lors de son audition par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à la surprise des députés présents et de la rapporteure du projet, Karine Berger, persuadés de son caractère avant-gardiste.
Ne sont concernés ni les prêts aux hedges funds , ni le trading haute fréquence, ni les opérations sur produits dérivés.
Selon Christophe Nijdam (Audition dans le cadre du rapport « Une crise en quête de fin ») : « Sur une banque spécifique comme la BNP, Liikanen aurait séparé 13 % des activités en termes de produit net bancaire (chiffre d'affaires d'une banque). La proposition, qui est entrée en vigueur, de M. Moscovici, prévoyait 0,5 % du chiffre d'affaires, par rapport à l'activité totale. Le projet français était beaucoup moins ambitieux que le projet européen, vingt-six fois moins ambitieux dans le cas d'espèce. »
Comme le dit Jézabel Couppey-Soubeyran : « Il ne faut pas seulement se contenter d'isoler les activités spéculatives utiles au financement de l'économie, il faut les décourager » . (Audition du 18 février 2016)
Encore une fois, rien d'étonnant à cet échec des réformateurs, puisque l'essentiel était de préserver le modèle de « banque universelle », patiemment et opiniâtrement construit depuis la loi de 1984, et qui devait assurer à la France une place de premier plan en Europe, faute d'un appareil industriel aussi puissant que celui de l'Allemagne. « Ce qui m'a encore plus marqué, nous dira Gunther Capelle-Blancard lors de son audition, c'est l'argument selon lequel le secteur financier allait devenir une spécialité de la France, non pas juste parce qu'il s'agit d'activités à forte valeur ajoutée, donc que c'est très rémunérateur, mais parce que c'est non polluant, c'est formidable, c'est "très créatif". » (Audition du 28 janvier 2016)
Dominé par les « grands corps », pratiquant intensément le « revolving doors » entre les sommets de l'État et ceux de la haute finance, un aussi bel outil de pouvoir et de carrière devait forcément être à tout prix conservé.
Ce choix politique essentiel ne pouvait être remis en cause, quels qu'en soient les risques et les interrogations - de plus en plus nombreuses - sur l'efficacité réelle de ce modèle bancaire « made in France ».
D'où l'engagement des serviteurs du système dans une lutte totale contre le projet « irresponsable », pour reprendre l'expression du gouverneur de la Banque de France d'alors, contre le projet Barnier. « Je suis absolument convaincu, certain, que la séparation est une fausse bonne idée. C'est une idée qui ne résout rien et qui crée des risques considérables pour le financement de l'économie, donc pour la croissance » dira encore Christian Noyer ( Nouvel économiste du 11 janvier 2016).
Apparemment, la doctrine de la Banque de France est toujours la même.
Ainsi, pour Laurent Clerc (Banque de France - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR), l'idée de séparer les banques procède de « l'hypothèse qu'en coupant les banques en deux, chaque partie sera plus résistante. Or, rien ne le prouve ! [...] Les banques ont été séparées aux États-Unis. Cela n'a pas empêché le krach. »
À ce jour cependant, que le Glass-Steagall act avait encore force de loi aux USA avant 2008 est une information connue seulement de quelques initiés. Comme on va voir, il est même fort probable que ce qui l'a remplacé et qui n'est pas une séparation bancaire, résiste longtemps aux coups de boutoirs de Donald Trump.
La solution étasunienne ou Dodd-Frank Act , résultat d'innombrables marchandages, de multiples réécritures du texte, de rajouts, d'amendements parlementaires de précision, ne sépare pas les types d'établissements bancaires mais interdit ou limite certaines opérations bancaires :
Interdiction pour les banques commerciales et aux établissements financiers supervisés par la Fed de spéculer pour leur propre compte... à moins d'investir aux côtés d'un client. Elles peuvent, aussi, prendre des participations dans des fonds de capital-investissement ou des « hedge funds » à hauteur de 3 % de leurs fonds propres.
Les banques doivent conserver 5 % des crédits titrisés à leur bilan (ce qui signifie que 95 % peuvent donc être revendus).
Outre la question de la séparation bancaire, la loi embrasse tout un ensemble de dispositions (supervision, produits dérivés, protection des consommateurs, etc.) sur lesquelles on ne peut revenir ici.
Une réglementation évidemment combattue par le lobby bancaire, soutenu désormais par Donald Trump qui, la tenant pour « désastreuse », en avait fait un argument de campagne.
Ainsi, dès son entrée en fonction, en février 2017, signera-t-il deux décrets qui lancent le processus de démolition, les accompagnant de ce commentaire :
« Nous projetons de supprimer une grande partie de la loi Dodd-Frank, parce que je connais beaucoup de personnes, des amis, qui ont de belles affaires mais ne peuvent pas emprunter de l'argent. Les banques ne veulent pas leur prêter à cause des règles et des régulations inscrites dans la loi ».
5. Une interpénétration toujours aussi forte entre la finance officielle et une finance « parallèle » en expansion
« Finance parallèle », « intermédiation non bancaire du crédit », telles sont les dénominations officielles du FSB (Conseil de stabilité financière) et de la Banque de France, pour l'inquiétant « shadow banking », ensemble non défini d'activités financières dont le point commun est d'échapper, en tout ou partie, à la réglementation bancaire et à l'obligation de transparence.
Le problème c'est que le FSB lui-même ne sait pas très bien ce qu'il faut entendre par « finance parallèle ».
Selon la définition la plus large, toute activité financière non soumise à la réglementation bancaire (l'assurance, les fonds de pension, les assurances vie, les OPCVM régulées, les fonds de capital-risque, les entreprises de micro-crédit...) en relève, ce qui enlève tout intérêt à la notion. Et qui explique la variation des évaluations selon les sources, qui ne prennent pas toutes en compte les mêmes opérateurs.
S'agissant même des activités financières hors normes, sources de risques pour la stabilité du système, le shadow banking au sens traditionnel, les évaluations de ce qu'elles représentent varient entre 52 000 Md$ et 160 000 Md$ !
Les activités exposées à une liquidation « en panique » pourraient correspondre à l'estimation basse et représenter entre 30 et 44 % des actifs mondiaux 58 ( * ) .
Le « narrow shadow banking » représenterait 160 000 Md$, « soit près de la moitié des actifs financiers détenus par les institutions financières à l'échelle mondiale » selon François Villeroy de Galhau 59 ( * ) .
Plus de 45 000 milliards de ces actifs, toujours selon lui, présenteraient des risques pour la stabilité financière
Une chose est certaine en tous cas : depuis 2002, le shadow banking n'a cessé d'augmenter d'année en année (+ 8,5 % en 2018), et les risques pour la stabilité du système avec. Son volume a été multiplié par 6 depuis 2002 !
Comme si le développement de la finance parallèle était la parade de la finance au progrès de la réglementation.
Mais, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, « le shadow banking n'est pas parallèle au secteur bancaire traditionnel, il lui est au contraire étroitement relié car les entités du shadow banking n'existent qu'au moyen des garanties et des liquidités bancaires comme les lignes de crédit, que les véhicules de titrisation ont auprès des banques, ou les participations, que les banques prennent dans les hedge funds... »
De l'ordre de 8 % de l'énorme bilan du shadow banking européen est détenu par des banques, via des filiales.
Si on compare ce chiffre à celui des fonds propres, on a quelques inquiétudes à se faire, même si une bonne part de ces actifs est fiable.
La spécificité du système, c'est d'associer des fonds d'épargne et des crédits dans des opérations qui permettront de rembourser le crédit. Il y a bien une symbiose entre système bancaire et shadow banking qui permet au premier de faire des affaires sans risque pense-t-il, ce qui n'est pas le cas en réalité. Le bénéfice pour le second, c'est de pouvoir exercer des fonctions de banquier sans en avoir la licence et sans devoir respecter les contraintes réglementaires.
« Le shadow banking est un espace de prise de risque, constitué d'acteurs prêts à les porter. En cela, la plupart des entités qui le composent sont utiles au fonctionnement du système financier, en complément d'acteurs tels que les banques réglementées à qui sont confiés les dépôts et la gestion des moyens de paiement qui vont avec. » Jézabel Couppey-Soubeyran 60 ( * )
Le shadow banking est dangereux parce que si les banques lui transfèrent leurs risques, en même temps, les garanties, les lignes de crédits sans contrainte, les participations qu'elles lui accordent deviennent un risque pour elles.
L'autre résultat de ces pratiques nouvelles est de renforcer l'opacité du système financier et d'ôter aux superviseurs officiels du système financier (voir plus bas) les moyens d'apprécier avec exactitude l'émergence de nouveaux problèmes et donc de les prévenir.
« Le fait que les sociétés de gestion d'actifs et les sociétés de capital-investissement aient progressivement remplacé les banques soumises à des contraintes réglementaires en tant que prêteurs a rendu de plus en plus difficile la tâche de savoir ce qui se passe réellement et d'anticiper les conséquences futures des restrictions financières, en particulier pour les pays émergents. » William White (op cit).
Conclusion de Jézabel Couppey-Soubeyran : « Ce sont les liens entre banques et shadow banques qu'il faut défaire et non la réglementation bancaire, car ces liens dénaturent à la fois les banques en les financiarisant (leur prise de risque s'oriente vers les marchés financiers plutôt que vers l'économie réelle) et les entités du shadow banking en les bancarisant (les garanties obtenues réduisent leur responsabilité en matière de risque) ».
Seuls les USA sont allés dans ce sens, pour les seuls hedge funds , disposition qui comme toutes celles du Dodd-Frank Act a du plomb dans l'aile.
Mais les hedge funds - qui peuvent être énormes comme Black Rock (plus de 6 000 Md$ d'actifs sous gestion pour un bilan de 220 Md$) - il n'est pas question de les réguler !
Les Américains s'en tiennent au Dodd-Frank Act avant de le supprimer et pour le Gouverneur de la Banque de France, il n'est pas question non plus « d'imposer la réglementation bancaire au shadow banking : puisque les risques n'y sont pas les mêmes. »
Patrick Artus est encore plus serein : « Si un hedge fund perd de l'argent, ses clients perdent de l'argent mais ce n'est pas systémique. »
Sauf que, comme on l'a vu leurs risques sont devenus, par ricochet, ceux des banques.
Un peu l'histoire de la titrisation censée empêcher les crises systémiques en divisant et dispersant les risques et responsabilités.
D. LES DÉTONATEURS POTENTIELS
Par-delà la série de mini krachs boursiers en 2018 - USA (février, octobre), Chine (mars), Argentine (août), crise monétaire en Turquie (août), Pakistan (automne) - et les fortes turbulences de certaines capitalisations boursières comme Amazon et Apple, le ciel financier où brille le soleil étasunien semble globalement serein.
Reste, cependant, en arrière-fond une inquiétude latente renvoyant à la manière dont l'incendie a été éteint - l'arrosage monétaire et le crédit - ainsi qu'à ses effets collatéraux : bulles spéculatives et prises de risques.
1. La bulle dormante de l'immobilier
Si nous évoquons en priorité l'immobilier ce n'est pas pour le risque d'explosion prochaine d'une bulle spéculative immobilière, au contraire, la crainte des acteurs financiers serait plutôt la baisse des prix et le ralentissement des transactions du secteur après une remontée, le krach des subprimes digéré.
C'est parce que les transactions et les investissements immobiliers sont au coeur même de l'industrie financière et l'une des causes essentielles de l'instabilité du système.
« À la source de l'instabilité financière des pays avancés , selon Adair Turner 61 ( * ) , on trouve l'interaction entre l'offre de crédit bancaire, potentiellement illimitée, et l'offre très inélastique d'immobilier ou de foncier situé dans des endroits prisés. Sauf s'ils sont délibérément encadrés, les banques et le système bancaire parallèle peuvent créer du crédit privé, de l'argent et du pouvoir d'achat en quantité illimitée. »
L'immobilier qui intéresse ce type d'acheteurs existe en quantité limitée et l'interaction entre un pouvoir d'achat élastique et une offre liée inélastique rend le prix du foncier urbain extrêmement fluctuant. Ainsi le prix de l'immobilier londonien a-t-il été multiplié par 3 depuis 1990.
« Les cycles du crédit et des prêts immobiliers ne sont donc pas simplement un élément de l'histoire de l'instabilité financière dans les économies avancées : ils en constituent à eux seul presque toute l'histoire. »
La hausse continue des biens immobiliers des grandes villes, comme Londres, Paris, Stockholm, explique l'engouement des banques pour ces financements sans risque. Sans risque apparent car ces cycles autoalimentés de crédit et de hausse de la valeur des actifs engendrent des bulles dont les krachs résultent inévitablement.
Au Royaume-Uni, 79 % des prêts bancaires concernent l'immobilier résidentiel ou de bureau.
Selon une étude du Crédit Foncier (24 mai 2016), 88 % de l'endettement des ménages européens (85 % des ménages français) renvoient à des prêts immobiliers.
Avec près de 1 515 Md€ d'encours, le marché immobilier du Royaume-Uni arrive devant celui de l'Allemagne (1 086 Md€) et de la France (887 Md€).
À l'origine de la hausse des prix, essentiellement celle du foncier, particulièrement dans les grandes métropoles.
Pas étonnant que l'immobilier soit devenu une « classe d'actifs dans laquelle on investit non seulement pour profiter d'un logement mais aussi en anticipant des plus-values. »
Ce qui explique que, dans les zones spéculatives, beaucoup de grands logements de luxe ne sont pas occupés. Augmentation aussi des investissements dans les logements à louer : une sorte d'investissement de précaution et de garantie. Avec le succès d'Airbnb les choses ne risquent pas de s'arranger.
Un endettement facile vient renforcer cette tendance.
C'est ce qui s'est passé aux USA après le krach des subprimes et le nettoyage des écuries du crédit hypothécaire qui réduisit massivement le nombre de propriétaires.
Mais après quelques années de flottement, le prix des logements neufs et les loyers recommencèrent à augmenter, nettement plus vite que les salaires (deux fois plus pour celui des logements).
Le marché étant, selon Véronique Riches-Florès, dominé par les investisseurs institutionnels et des particuliers ayant investi à crédit, leur crainte est donc aujourd'hui, une remontée des taux d'intérêt.
Le changement de cap de la BCE les a partiellement rassurés.
Mais pas pour longtemps car, toujours selon Véronique Riches-Florès, avec des prix et des loyers à des niveaux « exorbitants », non seulement les ménages ne peuvent plus acheter mais la capacité des investisseurs à conserver des rendements suffisants est faible, et seuls les taux bas entretiennent l'activité.
« Le marché est complètement à bout de souffle. Mais pour autant il n'est pas menacé d'un effondrement tant que les taux ne bougent pas ».
Tel est le problème central pour les acteurs des marchés immobiliers, notamment les plus spéculatifs, c'est de voir les prix baisser, autrement dit, cette bulle dormante se dégonfler.
Outre les pays précédemment évoqués, cela concerne la Chine pour qui, avec les infrastructures, le transport et l'industrie, l'immobilier fut pendant longtemps un des vecteurs essentiels de croissance et le Canada, la Suède, la Nouvelle Zélande, l'Australie... pays qui n'ayant pas eu à subir la thérapie de choc étasunienne, abritent des bulles spéculatives immobilières très importantes dont les prix commencent à baisser.
C'est le cas en Suède dont la moitié, voire les deux tiers de la croissance de ces dernières années - on l'ignore généralement - s'explique par la bulle immobilière 62 ( * ) .
Que se passera-t-il si ce vecteur de croissance vient à manquer ?
Très probablement un ralentissement significatif de la croissance, comme on commence à le voir.
USA : Taux de propriétaires et prix des
logements
(« Une crise en quête de
fin »)
Conclusion que nous donne le Rapport 2019 sur la stabilité financière dans le monde du FMI : « Les statistiques les plus récentes mettent en évidence des risques accrus de recul des prix de l'immobilier au cours des une à trois prochaines années dans certains pays. »
« De fortes baisses des prix de l'immobilier peuvent avoir un effet néfaste sur les résultats macroéconomiques et la stabilité financière, comme lors de la crise financière mondiale de 2008 et d'autres épisodes au cours de l'histoire. Ces liens macro financiers s'expliquent par les nombreuses fonctions que remplit l'immobilier pour les ménages, les petites entreprises et les intermédiaires financiers : bien de consommation, investissement à long terme, réserve de valeur, garantie de prêt, etc. Ainsi, la rapide augmentation des prix de l'immobilier dans de nombreux pays au cours de ces dernières années a suscité des préoccupations quant à un possible recul des prix et à ses éventuelles conséquences. »
2. Les bulles en formation
a) La « bulle de tout »
L'origine du phénomène, comme l'explique James K. Galbraith, « c'est qu'aux USA, l'allocation des ressources se fait par « cycles » dans l'économie : à la fin des années 1990, c'est le secteur technologique qui concentrait toutes les ressources, plus qu'il n'était soutenable. Au milieu des années 2000, l'argent est allé vers le secteur immobilier - d'où le gonflement des créances frauduleuses et des hypothèques et l'éclatement de la « bulle » immobilière. Aujourd'hui, l'argent gonfle en volume de prêts pour l'acquisition de voitures. Tout se passe comme si le crédit tirait l'économie aux États-Unis. Or ce modèle ne pourra continuer perpétuellement. »
La « bulle de tout », tel est le nom que l'économiste espagnol Daniel Lacalle Sousa attribue à celle qui, sous l'effet de l'arrosage monétaire utilisé pour stopper la crise, a succédé aux bulles des valeurs technologiques et d'internet (1999-2001) puis immobilière (2007-2008) : « C'est là que réside le problème. Après vingt mille Md$ d'expansion monétaire inconsidérée, les actifs risqués, des plus sûrs aux plus volatils, des plus liquides aux non cotés, ont explosé avec des valorisations démesurées. »
« La bulle de tout : actifs financiers par rapport au revenu personnel disponible. »
La courbe montre clairement la déconnexion entre le revenu personnel et la valeur du patrimoine financier, l'une des origines de la montée des inégalités sociales comme on le verra plus loin.
Cette politique monétaire expansive et les taux très bas incitent les « investisseurs », même les plus prudents à prendre des risques inconsidérés, tout en faisant ainsi monter le prix de ces actifs, y compris ceux qui, comme les titres souverains, ne doivent leur solidité qu'à cette politique monétaire expansive.
Autrement dit, c'est à elle que l'on doit cette déconnexion entre la valeur boursière des titres surévalués, leur rendement réel hors inflation faible et le niveau de risques qu'ils peuvent présenter.
Et que l'on doit aussi l'engouement pour des obligations souveraines exotiques et souvent à risque qui faisaient fuir il n'y a pas si longtemps.
b) La bulle des obligations
« L'encours des obligations de premier rang moins bien notées (BBB) a quadruplé, tandis que celui des obligations spéculatives a pratiquement doublé aux États-Unis et dans la zone euro depuis la crise. » (FMI, rapport 2019 sur la stabilité financière dans le monde)
De plus en plus de pays voient ainsi leurs obligations survalorisées au point que les emprunteurs, en les achetant, perdent de l'argent !
C'est le monde à l'envers.
Désormais, ce ne sont pas seulement les obligations allemandes (le Bund) ou suisses, à taux négatifs qui sont recherchées sur les marchés obligataires, mais, fait remarquer Martine Orange 63 ( * ) , quasiment tous les titres obligataires de pays jugés sûrs : France, Pays-Bas, Norvège, Suède, émis à taux négatifs.
L'Autriche, la Belgique et l'Irlande viennent d'émettre un emprunt à 100 ans à taux zéro. Les titres italiens tenus pour risqués sont désormais à moins de 1,5 % contre près de 4 %, il y a un an.
L'épidémie des taux zéro a gagné le Tchéquie, la Hongrie, la Pologne. Même les titres des pays jugés à risque comme le Kazakhstan, la Croatie, la Turquie en pleine crise économique, politique et monétaire, sont recherchés. Reste à savoir pendant combien de temps encore la planète finance pourra tourner à l'envers et ce qui se passera lorsqu'elle s'arrêtera de tourner.
Côté entreprises, les obligations particulièrement recherchées sont les « high yield », à haut rendement, donc des entreprises à risque.
En effet, « le sous-jacent de l'économie américaine n'est pas très bon. Il n'y a pas d'investissement (...), les entreprises américaines ne gagnent pas de marchés, elles ne sont pas très compétitives, elles ont une capacité productive assez limitée » 64 ( * ) , elles sont souvent très endettées.
La faillite d'un bon nombre d'entreprises est à craindre, plan Trump ou pas : « (On entre) dans une phase extrêmement dangereuse aujourd'hui où le marché est en train d'anticiper quelque chose que les prévisionnistes de l'économie ne voient pas : une récession de l'économie. » 65 ( * )
c) La bulle des actions américaines
La « bulle de tout » prend un tour particulièrement inquiétant aux USA, comme on l'a vu, surtout après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ses cadeaux fiscaux et son coup d'arrêt aux velléités de la Fed de continuer à remonter son taux directeur.
Depuis son élection, les marchés d'actions américains 66 ( * ) , déjà hauts, ont progressé de 40 % !
L'indice PER Shiller (rapport de la capitalisation boursière d'une entreprise/bénéfices), en mars 2019 était au niveau de celui du vendredi noir de 1929 67 ( * ) .
En 2017, toujours, le PER s'est maintenu au double de la moyenne de long terme.
Particulièrement concernées, les actions et obligations US, excessivement valorisées.
Selon Nouriel Roubini 68 ( * ) « Les ratios cours/bénéfice aux États-Unis sont supérieurs de 50 % à leur moyenne historique, les valorisations de capitaux privés sont devenues excessives et les obligations d'État trop coûteuses compte tenu de leur faible rendement et de leurs primes de terme négatives. Le taux d'endettement des entreprises américaines atteint des sommets historiques. »
Cet écart entre la valeur boursière des entreprises et leur chiffre d'affaires ou même leurs bénéfices devient abyssal avec les GAFAM dont la capitalisation boursière atteint des sommets - Apple (918 Md$ de capitalisation boursière 2019), Google (720 Md$), Amazon (700 Md$), Microsoft (1 050 Md$). Faibles bénéfices, forte valorisation boursière, telles sont leurs caractéristiques.
Ainsi Amazon réalise-t-il 10 Md$ de bénéfice annuel pour une capitalisation boursière de 941 Md$ (2019) qui, selon les critères ordinaires, devrait se situer autour de 100 Md$ maximum, soit de l'ordre de dix fois moins.
Le bénéfice rapporté au prix de l'action est faible (1,08 %) - deux fois moins qu'une assurance vie en fonds euro -, les capitaux propres par action 21 fois inférieurs au cours de l'action (2019), l'endettement, 54 % de ces capitaux propres.
Ce n'est certainement pas la réussite économique de l'entreprise qui explique l'engouement pour les actions Amazon.
La raison de ce phénomène, comme l'explique Thierry Philipponnat, c'est qu'en surpayant les acquisitions ou la neutralisation de leurs concurrents - parfois en les payant avec des actions d'Amazon devenant ainsi une quasi monnaie -, les propriétaires d'Amazon se constituent progressivement en monopole qui, le moment venu, leur permettra de fixer leurs prix à leur gré et de gonfler leur bénéfice.
C'est cette perspective de gains futurs qui explique l'engouement pour ses actions actuelles et la monté de sa capitalisation boursière.
La réussite de l'opération suppose cependant que les autorités de la concurrence laissent se développer ces pratiques contraires au crédo libéral.
Ce qui n'est pas certain et laisse imaginer ce qui se passerait alors, d'autant plus que les résultats de l'entreprise en tant que telle, comme on l'a vu, restent très médiocres.
Ce système est en lui-même une petite bombe à retardement dans la mesure où les actions survalorisées des GAFAM ayant servi à agrandir l'empire sont susceptibles de baisses au moindre incident boursier.
« Le problème , explique Romaric Godin, c'est que si vous commencez à avoir des corrections boursières et que vous avez une dépréciation de leur monnaie, ils vont faire comme les États lorsque leur monnaie s'effondre : trouver des liquidités ailleurs, réduire les dépenses, rassurer les investisseurs. »
Des ajustements seront nécessaires et ce retour à la réalité risque d'être dangereux, vu les pertes que subiront les acquéreurs de ces actions survalorisées et dont les effets se transmettront fatalement au reste de l'économie.
« Quand vous avez une valorisation d'entreprise à 1 000 milliards -c'est-à-dire un tout petit peu moins que le PIB espagnol - et que vous pouvez utiliser ces actions comme force de frappe pour racheter n'importe quoi », vous avez acquis le pouvoir d'États conquérants...
Au final, comme l'analyse James K. Galbraith « le talon d'Achille de l'économie américaine se trouve dans le financement des entreprises. Les entreprises sont très endettées : elles ont racheté leurs propres actions pour en soutenir le cours. À la moindre récession, elles vont s'effondrer, car elles dépendent de la croissance, même lente. »
Un phénomène comparable à celui de la crise des subprimes .
À noter que cet écart entre le haut niveau de valorisation des actions des entreprises et leur endettement croissant concerne aussi la France, particulièrement les grandes entreprises dont l'endettement est passé de 400 Md€ en 2008 à 700 Md€ en 2017 69 ( * ) .
À noter que dans le même laps de temps, celui des PME est passé de 210 Md€ à 410 Md€.
3. L'énigme chinoise
« Le problème c'est que la Chine aujourd'hui est confrontée à la bulle financière qu'elle a créée elle-même (...) dans l'intérêt du reste du monde. » Romaric Godin
Extérieurement la politique des autorités chinoises face à ce problème donne l'impression d'être incohérente : d'un côté des mesures restrictives sur les banques et le « shadow banking », de l'autre des mesures pour faciliter l'entrée des capitaux étrangers en Chine.
L'hypothèse de Romaric Godin est que la Chine « essaie de refiler sa bulle financière au reste du monde pour s'en débarrasser, ce qui est préoccupant et d'autant plus qu'on ignore ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays au niveau financier. »
Le plus probable, c'est que les investisseurs, attirés par l'odeur du profit y achètent des actifs financiers douteux.
Pour Romaric Godin, l'état économique réel (croissance, emploi) de la Chine et des USA est plus préoccupant que l'actuelle « guerre » commerciale qui ne saurait aller très loin.
« Le pouvoir chinois ne peut pas se permettre une récession, or la Chine y va tout droit » et les moyens d'en sortir se neutralisent.
Confrontée à la bulle financière et à la surcapacité de production de l'économie, elle tente d'accroître la demande intérieure en augmentant les salaires, ce qui diminue sa compétitivité extérieure. Une contradiction parmi les autres...
Elle essaie d'y répondre en dévaluant le yuan au risque d'une riposte étasunienne...
Il ne faut pas oublier non plus que ce système bancaire chinois en surchauffe est adossé à un shadow banking monstrueux (de l'ordre de 95 000 Md$), avec des engagements importants vis-à-vis des banques occidentales. Penser que les effets d'un krach chinois resteront cantonnés à l'Empire du milieu est une illusion.
4. Les conduites à risques
La contrepartie des taux bas sur les produits financiers classiques, c'est l'engouement pour des produits à risques, donc mieux rémunérés, comme nous l'avons vu, s'agissant de celui pour des obligations d'États ou d'entreprises qui, en d'autres temps, auraient été l'objet de suspicions.
Autre conduite à risque, les prêts bancaires à effet de levier (« leverage loans ») contractés par des entreprises ne pouvant obtenir de crédits classiques parce que très endettées et revendus comme des actifs par les prêteurs.
On parle de levier parce que les groupes de capital-investissement apportent les capitaux sous forme de prêts, en contrepartie d'une part de capital de la société, le plan de financement de l'opération pouvant être bouclé par un prêt bancaire.
C'est le modèle de la titrisation des « subprimes » en plus sophistiqué.
Certes, seuls les USA semblent aujourd'hui concernés et les masses en jeu (entre 1 300 Md$ et 1 600 Md$ selon les estimations) ne sont pas celles du modèle hypothécaire, mais le phénomène est suffisamment inquiétant pour avoir été dénoncé par Janet Yellen, ex-présidente de la Fed, débarquée par Donald Trump.
Ainsi dans un entretien du 26 octobre 2018 au Financial Times, dénonce-t-elle le processus de dérégulation en cours qu'elle tient comme dangereux.
Elle s'est particulièrement inquiétée de la détérioration des normes prudentielles dans le secteur des prêts à effet de levier.
Même inquiétude du côté de la Banque d'Angleterre qui pense que les emprunts à effet de levier pourraient devenir un problème plus grave que les prêts hypothécaires à risque, y compris en Grande-Bretagne.
Selon le comité de politique financière de la Bank of England (BOE), « le marché mondial des prêts à effet de levier est plus important que le marché américain des prêts hypothécaires à risque et a augmenté aussi rapidement que celui de 2006. » 70 ( * )
À noter que, non seulement ce type « d'investissement » augmente en volume mais que les ratios de leviers croissent aussi, autrement dit que la dette est importante par rapport au bénéfice à attendre de l'opération.
L'administration Trump accepte aujourd'hui des ratios supérieurs à 6, ce qui était le plafond pour l'administration Obama.
À noter enfin que ces transactions à effet de levier élevé sont aujourd'hui majoritaires.
Au final, plus les sommes à rembourser sont grandes, plus les chances de voir l'emprunteur honorer ses engagements sont minces, et moins les banques qui se sont risquées dans de telles opérations auront de chances d'en sortir avant la catastrophe.
Alléchées par les profits à en attendre, elles acceptent de plus en plus de signer des « contrats allégés » des possibilités de retraits anticipés prévues dans les contrats de leveraged buy out (LBO) classiques.
Le Haut Conseil de la stabilité financière français note de son côté dans un rapport sur l'endettement des entreprises (2018), le « fort dynamisme des émissions structurées et opérations LBO des grandes entreprises françaises, du fait des taux historiquement bas, des liquidités abondantes et d'une concurrence importante liée à la forte rentabilité de ces activités. »
Il note aussi l'allègement progressif des clauses financières contractuelles (covenants) et une augmentation de la part du financement venant d'acteurs non bancaires.
Actuellement, conclut le HCSF, « le taux de défaut de ces opérations reste particulièrement faible, mais est sensible à un retournement de conjoncture, d'autant qu'une grande partie des crédits arrive à maturité en 2018-2019. »
Autre conduite à risques, la vague « d'investissement » dans les pays « émergents » de meilleur rapport.
L'essentiel de ces prêts en dollars ayant été contracté par les nationaux, en cas de dévaluation de leur monnaie, le réveil risque d'être rude, comme ce fut le cas des pays de l'Est européen ou de l'Islande, un peu avant la crise des subprimes .
Dans le jargon financier on appelle cela une « crise d'asymétrie des monnaies ».
5. Les étincelles de risque
« Une étincelle peut embraser la plaine »
Mao Zedong
En reprenant cet ancien proverbe chinois, Mao entendait faire comprendre que lorsqu'une situation est suffisamment instable, tout incident (fortuit ou provoqué) peut déclencher la révolution.
Pareillement, la complexité, l'opacité du système financier mondial, l'enchevêtrement des interconnexions entre les engagements, les contreparties des uns et des autres, la fuite en avant des « investisseurs » dans des conduites spéculatives ou à risque rendant la planète finance instable, des pratiques apparemment sous contrôle ou jugées marginales, des problèmes jusque-là circonscrits, peuvent avoir des conséquences imprévisibles.
Cinq exemples de nature très différentes d'étincelles de risque qui peuvent être jugés mineurs mais potentiellement capables d'embraser la forêt : la persistance sectorielle de poches de créances douteuses à l'actif des banques, le trading algorithmique, les nouveaux subprimes , le retour de la titrisation, la guéguerre des monnaies.
a) Les créances européennes « non performantes »
« Non performantes » est l'euphémisme utilisé par les autorités financières pour désigner les créances non négociables, stationnant dans les bilans bancaires ou gelées dans des « structures de défaisance » construites pour permettre aux établissements, initialement propriétaires, de fonctionner avec ce qui leur reste d'actifs.
Après une forte croissance post crise, le stock s'est progressivement dégonflé partout dans le monde atteignant des taux de 1,1% des prêts aux USA, 1,2 % au Japon, moins de 2 % en Chine, selon le chiffre parfaitement invérifiable qui circule.
Avec un taux inférieur à 5 % et un encours de quelque 700 Md€ en 2019, en baisse régulière, la zone euro malgré ses efforts de normalisation resterait la plus handicapée des pays développés sur ce point.
Il faut noter de grandes différences de situation selon les pays.
Taux de créances douteuses dans les bilans des banques européennes par pays (fin 2017)
Après la Grèce, Chypre et le Portugal, le premier « grand pays » européen concerné est l'Italie, du fait de sa structure bancaire, faite de petits établissements finançant de petites entreprises locales, survivant difficilement du fait de la stagnation économique générale. Une situation qui a nécessité l'intervention de l'État italien à hauteur de 50 Md€.
Actuellement, la persistance de ce taux relativement élevé de créances « non performantes » est plus un boulet économique pour ces pays qu'une menace pour la zone euro.
b) Le « trading algorithmique »
Il se résume à confier à des robots gouvernés par des algorithmes les transactions (achat et vente de titres) sur les marchés financiers, transactions effectuées automatiquement à des vitesses de plus en plus grandes, la tenue de marchés par algorithmes se confondant alors avec le « trading haute fréquence » (THF).
Marginal en Europe il y a une dizaine d'années, il occupait une telle place aux USA qu'il fut accusé d'être à l'origine du krach du 19 octobre 1987 (chute de 22,6 % du Dow-Jones) et de la crise qui suivit.
Il représente aujourd'hui 35 % des transactions sur Euronext, le reste incombant aux opérateurs classiques contre un ratio de 50 %/50 % aux USA 71 ( * ) .
Quant à l'encours des « fonds indiciels » 72 ( * ) , qui sont des accélérateurs de tendance, il est passé de 700 Md$ en 2007 à 4 500 Md$ en 2018.
« La grande majorité des ordres sont passés par des algorithmes informatiques qui spéculent sur des laps de temps extrêmement courts, de l'ordre de la nanoseconde (soit un milliardième de seconde). Même si l'essentiel des ordres de ce trading haute fréquence sont par la suite annulés - ce qui pose d'ailleurs la question de leur bien-fondé -, les transactions boursières dans le monde se chiffrent aujourd'hui en centaines de milliers de Md$ (soit quatorze zéros...) », selon Gunther Capelle-Blancard et Thomas Renault 73 ( * ) , qui ajoutent que « La moindre rumeur peut déclencher une vague de panique se traduisant par des milliards de pertes ».
Si cette technique - significative du caractère purement spéculatif de la tenue de marché - ne peut déclencher une crise systémique en période calme, elle peut devenir une source d'incidents graves quand la volatilité du marché explose ou quand les algorithmes n'arrivent plus à digérer le flux des informations qui leur parviennent 74 ( * ) .
Le risque, c'est celui d'un emballement de la tendance, les algorithmes étant tous bâtis sur le même modèle. Ainsi ont-ils été, plus récemment, accusés d'être à l'origine du « flash crash » sur les actions américaines le 6 mai 2010, ou de la chute de 700 points du Dow Jones en dix minutes, le 6 février 2018.
On imagine ce qui pourrait se passer dans une période d'incertitude politique forte, avec les difficultés d'interprétation des informations qui afflueraient aux machines numériques.
Qu'il s'agisse du « trading algorithmique » ou du THF, les seules régulations imposées se limitent à la tenue d'un registre des ordres émis. Pas vraiment l'idéal si l'on entend prévenir les incidents !
En France, le projet de taxer le THF a été enterré par le gouvernement d'Édouard Philippe.
Quant à l'UE, elle étudie le problème...
c) Le retour des subprimes
Le principe des subprimes c'est : 1) de vendre des créances à des débiteurs dont on sait qu'ils ne pourront rembourser ; 2) de camoufler cette insolvabilité dans des « véhicules de crédit » pour les vendre, mélangés à d'autres, sous forme de titres, découpés en tranches selon le niveau de risque et certifiés par des agences de notation « respectables ».
Ainsi, sous le nom de « non primes, mon QM » les prêts hypothécaires ont-ils refait surface, pour l'heure en quantité limitée, mais en augmentation.
Grâce à la créativité de Goldman Sachs, en changeant les créances à risque concernées, sont apparues de nouvelles formules comme les « Coco Bonds » qui recyclent des prêts de banques européennes, émis au moment de la première crise de l'euro.
Dans la foulée, Goldman Sachs réinvente les CDS, permettant de garantir la valeur à terme de titres que l'on ne possède pas 75 ( * ) .
On peut aussi fabriquer ce type de produit financier avec des prêts à des entreprises en difficulté (secteur pétrolier à une époque), étudiants, automobiles, à la consommation (cartes de crédit) ... de débiteurs incertains.
d) La titrisation au secours de l'économie européenne
Faisant semblant de croire que la langueur économique européenne vient d'un manque de moyens de financement, la Commission européenne mise sur une relance de la titrisation ; mais attention : une titrisation nouvelle, obligatoirement labélisée STS pour « simple », « transparente », « standardisée ».
Comme l'origine de la stagnation économique européenne n'a rien à voir avec le manque de moyens de financement, mais tout avec le manque de volonté des financeurs faute de rendements suffisants, il y a fort à parier que si la titrisation prospère, STS ou pas, elle ne fera que rendre encore un peu plus opaque le système financier.
e) La « guéguerre » des monnaies
Toujours latente, la guerre des monnaies pourrait bien reprendre sous une forme un peu nouvelle à l'initiative de Donald Trump qui menace de taxer les exportations de la Chine et de l'Europe aux USA, la première pour avoir une nouvelle fois baissé la valeur du renminbi par rapport au dollar, la seconde parce que la BCE, en poursuivant sa politique « accommodante », bloque la hausse de l'euro qui favoriserait les exportations étasuniennes.
V. SURVEILLANCE ET CAPACITÉS D'INTERVENTION
A. DES BANQUES MIEUX SURVEILLÉES MAIS UN DOMAINE FINANCIER PARALLÈLE EN PLEINE EXPANSION
En matière de surveillance du système financier, l'Union européenne a fait un réel effort pour combler son retard sur les USA et le Royaume-Uni.
Aux dispositifs nationaux se sont ajoutés divers systèmes de supervision de niveau européen au point qu'on est pris de doute sur l'intérêt de cette accumulation de régulateurs.
Au niveau français, ils ne manquent pas : AMF au statut d'AAI, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution placée à la Banque de France, Haut conseil à la stabilité financière placé auprès du ministre de l'Économie et des Finances, tous composés en très grande majorité de hauts fonctionnaires et de financiers.
Un gage de professionnalisme dont on a pu apprécier l'efficacité lors du krach (!) mais pas forcément d'esprit critique sur le fonctionnement du système.
1. Le mécanisme de supervision unique (MSU)
La nouveauté, au niveau européen, c'est la mise en place d'un mécanisme de supervision unique (MSU).
Confié à la BCE, il a en charge la supervision de quelque deux cent soixante banques dont cent trente transnationales, soit 30 000 Md€ d'actifs.
Depuis 2014, les établissements sont soumis par vagues, à des « stress tests » ou simulation de situations critiques et de ce qu'il en résulterait pour eux, compte tenu de leur structure financière (niveau de fonds propres, capacité de mobilisation de liquidités, etc.)
Le test de 2014 a révélé que 25 des 128 établissements de crédit européens présentaient des niveaux de fonds propres inférieurs aux exigences réglementaires.
Sans surprise, les banques les plus fragiles sont les banques italiennes.
Le test de 2018, visant à mesurer la capacité de survie de 48 banques à un scénario économique catastrophe ou à un krach boursier, montre, selon l'Autorité bancaire européenne (ABE) en charge de l'administration des tests, une amélioration en matière de fonds propres : « Le résultat des tests de résistance montre que les efforts des banques pour solidifier leur base capitalistique ces dernières années ont renforcé leur capacité à résister à des chocs importants ».
S'agissant des banques de la zone euro, selon la BCE, « les 33 plus grandes banques directement supervisées ont amélioré leur capacité de résistance aux chocs financiers ces deux dernières années. En dépit d'un scénario adverse plus sévère que lors de l'exercice 2016, le ratio CET1 moyen de ces trente-trois banques, au terme d'une période de trois ans de tensions, s'élève à 9,9 %, un niveau supérieur au chiffre de 8,8 % obtenu il y a deux ans ».
Tout va donc pour le mieux... Sauf que, selon l'ABE, les banques européennes devront mobiliser 135 Md€ de capital supplémentaire pour satisfaire, dans deux ans, les nouvelles normes prudentielles.
Sauf que tout le monde ne partage pas l'optimisme officiel pour des raisons qui vont du doute sur la fiabilité des modèles mathématiques utilisés, au rejet de la conception simpliste des crises, de leurs causes et du processus critique qui sous-tend la démarche en question :
- La conformité à des ratios de fonds propres corrigés de risques calculés selon des formules contestables, ratios trop faibles pour garantir la résistance de l'établissement en cas de crise d'une certaine importance.
- Des calculs qui reposent souvent sur des hypothèses invérifiables comme, par exemple, l'effet sur le bilan d'une banque, d'une baisse de quelques pourcents du PIB.
- L'absence de garantie que les fonds propres théoriquement disponibles le seront en réalité.
- Surtout, le fait que la résistance d'une banque à un coup dur ne peut s'apprécier indépendamment de l'écheveau de ses relations avec les autres établissements - qu'évidemment les contrôleurs ne peuvent mesurer - indépendamment de son insertion dans le système financier global et des inquiétudes du moment.
« Une banque qui fait faillite, c'est une banque qui ne peut pas se refinancer, ou qui ne peut le faire à des conditions qui ne grèvent pas complètement sa rentabilité (Dexia). C'est une banque qui affronte une défiance générale des prêteurs (Lehman) ou la fuite de ses déposants (les banques islandaises en 2008, par exemple). Ceci, parce que l'incertitude est trop forte quant aux risques réels qu'elle porte (cas de plusieurs banques espagnoles après la crise) ou quant à sa capacité à générer des résultats suffisants pour combler les défaillances qu'elle enregistre sur ses crédits (Monte Paschi). Pourquoi, interroge Guillaume Alméras, les tests de résistance de l'EBA, cependant, n'en tiennent-ils pratiquement aucun compte ? 76 ( * ) »
Même la Commission européenne, elle-même, n'est pas convaincue par ces résultats rassurants.
Certes la situation retenue en 2018 est plus grave que celle de 2014 quant à la baisse du PIB mais, étrangement, son impact est moindre en termes de pertes pour les banques : « le manque de transparence et l'hétérogénéité des pratiques bancaires pour prédire les pertes induites affaiblissent considérablement la crédibilité du test et limitent son utilité pour soutenir la discipline de marché parmi les banques européennes. »
La Cour des comptes européenne estime aussi, début juillet 2019, que ces tests « présentaient des insuffisances dans l'évaluation de la résilience aux risques systémiques... Les chocs stimulés étaient en réalité moins violents que ceux subis lors de la crise financière de 2008 et le scénario défavorable ne reflétait pas de manière satisfaisante l'ensemble des risques systémiques pour le système financier de l'Union. » 77 ( * )
La Cour relève aussi que toutes les banques n'étaient pas soumises aux mêmes tests, les banques et les pays fragiles ayant un traitement de faveur. Par exemple, les tests réservés à la Suède étaient deux fois plus sévères que ceux subis par l'Italie.
Apparemment un certain nombre de banques fragiles ont été exclues de l'épreuve.
On n'est jamais trop prudent.
Disons donc que si, incontestablement, l'effort d'analyse de la solidité du système bancaire européen est réel et suivi, on est encore loin de pouvoir mesurer sa résistance réelle à une situation critique et d'autant moins que le halo d'obscurité qui entoure cette nouvelle transparence, en même temps, s'est approfondi 78 ( * ) .
2. Le système européen de supervision
Abondance de biens ne pouvant nuire, outre les supervisions nationales et le MSU, sera mis en place un système européen de supervision composé de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et un Comité européen du risque systémique (CERS).
B. UNE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE MOINS INCOMPLÈTE MAIS DONT L'EFFICACITÉ RESTE À PROUVER
Outre les réglementations déjà évoquées (exigences en matière de fonds propres et de liquidités, de résolution notamment), une refonte des réglementations prudentielles européennes applicables aux banques ainsi qu'aux marchés a été engagée.
Parmi cette vague de directives, il faut citer celles relatives aux marchés des instruments financiers (Mifid et Mifir) avec leur règlement, adoptées en avril 2014. On leur doit notamment l'obligation de faire transiter les opérations sur certains produits dérivés par des chambres de compensation (voir plus haut).
On aura remarqué des oublis et des replis pour le moins fâcheux : aucune disposition commune relative à la séparation bancaire, aucune réglementation relative au shadow banking et à ses liens avec le système bancaire (niveau de levier autorisé notamment, obligation de transparence), aucune taxation et réglementation concernant le trading haute fréquence ou le trading algorithmique...
C. LES POMPIERS PYROMANES
Comme nous l'avons vu, l'administration du remède utilisé par les pouvoirs publics contre le krach - la production massive de liquidités par tous les moyens connus - n'a pas cessé avec la fin de la crise des subprimes.
Elle a été poursuivie jusqu'à aujourd'hui, devenant une drogue, dont ni le système financier, ni l'économie pense-t-on, ni même les États ne semblent pouvoir se passer.
Nous en avons longuement développé les effets collatéraux fâcheux.
La question est donc : que se passerait-il en cas de nouveau krach, sachant qu'il serait difficile pour les États (les contribuables) de s'endetter de nouveau au point où ils l'ont fait, peu probable que les USA réinjectent de nouveau 12 000 Md$ dans le système financier mondial devenu incapable de fonctionner sans être irrigué par la devise reine de l'Empire, sachant enfin que les politiques financières « accommodantes » des banques centrales ont montré les limites de leur efficacité ?
Les pompiers centraux d'hier sont devenus, sans y prendre garde et sans le vouloir, les pyromanes de demain.
VI. EN GUISE DE CONCLUSION
« Ce n'est pas en corrigeant à la marge le système financier que nous sortirons des crises. »
Jean-Michel Naulot
A. DES RÉFORMES EN TROMPE-L'oeIL
De cette revue de détail des évolutions du système financier mondial depuis le krach de 2008, nous tirerons six conclusions essentielles :
1- Les réformes attendues ont été très incomplètes, laissant de côté des questions aussi essentielles que la séparation entre banques d'affaires et de dépôts, entre système bancaire et finance parallèle et les modalités de leur mise en oeuvre aux intéressés, ce qui leur ôte une grande partie de leur efficacité.
« Quand on fait le bilan des réformes, on peut considérer que l'on a seulement parcouru, aux États-Unis et en Europe, le tiers de la feuille de route établie par les G20 de 2008-2009. Dès le lendemain de la crise, on a nommé aux postes-clés des responsables 79 ( * ) qui ont assuré la continuité alors qu'il fallait une rupture. » (Jean-Michel Naulot Blog).
Tout cela donne l'impression d'un bricolage pour temps calme arraché à un lobby financier bien décidé à tourner la règle et sans rapport avec les enjeux financiers, économiques, sociaux et politiques réels.
2- Si le système financier qui a pignon sur rue est désormais sous surveillance, le champ de la finance parallèle s'est, lui, considérablement élargi, ses connexions avec le système bancaire et les autres acteurs du système financier approfondies. Progression de la transparence d'un côté, extension de l'opacité de l'autre, autant dire que le système financier est toujours incontrôlable.
3- Les établissements systémiques sont toujours aussi nombreux, n'ont pas vu leur part de marché réduite et leur rôle central au coeur du système financier mondial est toujours déterminant. En plus, même les chambres de compensation mises en place dans l'espoir de réguler le marché des produits dérivés sont venues s'ajouter à la liste des monstres « trop gros pour faire faillite. »
« Si la philosophie du dispositif prudentiel n'a, en dépit des réformes, pas fondamentalement changé, pense Jézabel Couppey-Soubeyran, c'est parce que le rapport au crédit, à la dette, à la taille des établissements financiers, et plus largement à la finance, n'a lui-même pas fondamentalement changé. »
4- Si le volume des dérivés, spécialité des établissements systémiques, semble avoir baissé en Europe et aux USA, son évaluation est toujours aussi problématique et son niveau astronomique. Autant dire que l'un des principaux facteurs de propagation des crises, malgré les efforts de transparence, est toujours aussi menaçant.
5- Plus menaçants encore et facteur essentiel de crise financière, la dette, l'endettement public et surtout privé qui, dopés par la surabondance de liquidités et des taux d'intérêt étrangement bas, ne cesse d'augmenter. D'un côté on régule, de l'autre on alimente la machine à crise !
C'est que le crédit est devenu dans nos sociétés financiarisées le palliatif d'un pouvoir d'achat qui baisse ou stagne, le principal vecteur d'enrichissement des plus riches, le carburant d'un système économique qui crée proportionnellement plus de valeur pour moins de richesse.
Résultat : les bulles spéculatives dans l'attente de crever se multiplient et les conduites spéculatives à risques en même temps.
6- Le reproche rédhibitoire que l'on peut faire aux responsables politiques et financiers, ce n'est pas tant une réforme du système financier très en-dessous des engagements pris aux G20 de 2009 et 2011 que d'ignorer volontairement le plus important : la fuite en avant des banques centrales dans la production directe ou indirecte de liquidités qui, au lieu de stimuler l'économie réelle, vient alimenter la machine à laver spéculative.
En fait, s'étant laissé prendre au piège du capitalisme financier néolibéral, ils ne peuvent politiquement faire autre chose. Les solutions techniques existent : un système de financement de l'économie réelle par de nouveaux circuits de recyclage de l'épargne et, parallèlement, une réduction progressive de l'endettement spéculatif.
Ce qui manque, c'est la volonté politique d'agir.
L'heure est donc toujours à la fuite en avant, au dopage répétitif du système par toujours plus de liquidité et de crédit.
Au final ces réformes, arrachées de haute lutte à des lobbys puissants sont, dirait Freud, des « actes manqués », conciliations insatisfaisantes mais qui permettent cependant de vivre, d'injonctions contraires : d'un côté, améliorer la stabilité du système, ce qui supposerait réduire sa capacité de production de crédit et d'échanges internes, de l'autre, éviter de ralentir le business et donc la production de crédit et de réduire la liberté de son affectation là où il rapportera le plus.
Résultat : un système financier toujours aussi instable.
Ce que reconnaît le FMI lui-même dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde paru en avril 2019 : « Alors que les conditions financières demeurent accommodantes, les facteurs de vulnérabilité continuent à s'accumuler.
Le resserrement des conditions financières au quatrième trimestre de 2018 a été trop bref pour ralentir sensiblement l'accumulation de facteurs de vulnérabilité, si bien que les risques à moyen terme qui pèsent sur la stabilité financière dans le monde restent globalement inchangés. Actuellement, la vulnérabilité financière est élevée dans le secteur souverain, le secteur des entreprises et le secteur financier non bancaire dans plusieurs pays d'importance systémique. (...)
La vulnérabilité du secteur des entreprises, qui semble forte dans environ 70 % des pays d'importance systémique (selon le PIB), pourrait accentuer un ralentissement de l'activité économique. »
Car, le problème de la stabilité du système financier - donc de sa dangerosité - est inextricablement lié à celui du financement de l'économie réelle dont dépendent l'emploi et la stabilité sociale et politique.
Comme le dit Adair Turner, l'objectif final d'une véritable réforme du système financier ne saurait se limiter à stabiliser le système, à régler la question des établissements systémiques, même s'il faut le faire, mais « de gérer la quantité de crédit et d'influencer son allocation dans l'économie réelle. » (opus cit)
Comme on va le voir (partie II), la tendance ne va pas dans cette direction.
B. DES RÉFORMES REMISES EN CAUSE À PEINE ACQUISES
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le temps, l'ardeur réformiste post-crise (2009-2011), sous la pression du lobby financier - tout particulièrement bancaire en Europe - s'est bien refroidie.
À l'époque les dirigeants du monde parlaient de « refonder le capitalisme ».
On en est de plus en plus loin.
En l'espèce, Emmanuel Macron a rejoint Donald Trump en proposant de réécrire des règles jugées contraignantes et de confier cette réécriture aux ministres des Finances.
« Ce que je souhaite, c'est que les grands ratios de solvabilité de liquidité et de fonds propres des banques et des assurances puissent être discutés au niveau européen à l'Ecofin chaque année et qu'on en fixe, avec des objectifs de financement économique, les grandes règles » a-t-il déclaré, devant un parterre de chefs d'entreprises petites et moyennes, dès sa campagne présidentielle (mars 2017).
« Nous nous sommes fait avoir », a-t-il assuré. Les règles adoptées « touchent beaucoup les économies comme les nôtres qui n'étaient pour rien dans l'origine de la crise » 80 ( * ) .
« Les instances prudentielles veulent de la prudence, donc elles n'ont qu'un objectif de réduction du risque et donc elles ont désincité (sic) les banques et les assurances à financer l'économie », a-t-il regretté.
Comme si le système bancaire avait jusque-là le financement de l'économie réelle pour première préoccupation !
Mais le champion de la dérégulation reste Donald Trump, qui en avait fait un thème de campagne et qui, à la Maison Blanche, n'est pratiquement entouré que de banquiers.
Dès son arrivée au pouvoir, il s'est donc attaqué à la démolition de la loi Dodd-Frank (2010), pourtant très en retrait par rapport aux ambitions initiales de séparation bancaire de Barack Obama, ainsi qu'aux dispositions de protection des consommateurs contre les pratiques abusives et les produits toxiques type subprimes, adoptées dès 2008.
« Nous projetons de supprimer une grande partie de la loi Dodd-Frank , a déclaré Donald Trump début 2017 à l'occasion de la signature de ses deux premiers décrets de dérégulation , parce que je connais beaucoup de personnes, des amis, qui ont de belles affaires mais ne peuvent pas emprunter de l'argent. Les banques ne veulent pas leur prêter à cause des règles et des régulations inscrites dans la loi » 81 ( * ) .
Bien qu'à pas comptés, la suite législative va dans le même sens avec la loi du 22 mai 2018 qui réduit considérablement le seuil d'actifs à partir duquel un établissement bancaire est soumis à des stress de résistance.
Seules 12 banques désormais y seront soumises contre 50 auparavant.
Changement de la réglementation (le diable est dans les détails) : la loi qui avait été adoptée en juin 2016 pour endiguer la corruption a été jugée trop contraignante et « anti-compétitive ».
L'allègement de toutes les règles est déjà en marche.
Ainsi celle qui imposait aux grands groupes miniers et pétroliers de déclarer chaque année tous les paiements faits auprès des gouvernements étrangers pour acquérir des permis ou des droits d'exploitation a été supprimée par la Chambre des représentants.
On voit donc clairement dans quel sens souffle le vent.
Ainsi l'ex-présidente de la Fed, débarquée par Donald Trump, dans un entretien au Financial Times du 26 octobre 2018 souligne-t-elle que « le système présente de nombreuses faiblesses et qu'au lieu de chercher à y remédier, (on se dirige) vers une vaste déréglementation ».
Je suis « vraiment préoccupée par le fait que nous sommes sur le point d'oublier la crise financière et le besoin de davantage de régulation » a-t-elle ajouté.
Aucune raison actuellement donc d'être optimiste, ce qui est aussi le sentiment de bon nombre de personnalités du monde financier (voir annexe).
ANNEXES DE LA PARTIE I
Annexe 1 : Le mécanisme de résolution unique (MRU) et le fonds de garantie des dépôts européen
« Bail-in » ou « bail-out ? », telle est la question. Autrement dit, en cas de faillite, faut-il faire payer l'État, comme ce fut largement le cas durant la crise des subprimes , ou les créanciers de la banque, y compris les déposants, devenus créanciers à titre gratuit ? Rappelons pour mémoire que le montant des aides publiques au secteur bancaire et financier a été de 1 616 Md€ (13 % du PIB de l'Union européenne) entre octobre 2008 et décembre 2011 (chiffres cités par Martine Orange et le rapport sénatorial Une crise en quête de fin - février 2017).
Voté le 15 avril 2014, le MRU est une institution relativement indépendante puisqu'il garde un lien avec la BCE et qu'il doit rendre des comptes au Parlement européen. Il est constitué d'un conseil de résolution unique et d'un fonds de résolution commun financé par le secteur bancaire.
Après le traitement massif des faillites bancaires par l'injection lourde de capitaux des États ( bail-out ) et dont on sait qu'elle aura du mal à être répétée en cas de crise majeure, la mode est désormais au bail-in , autrement dit au sauvetage par les apporteurs de crédits, les déposants et les détenteurs de titres subordonnés 82 ( * ) . En revanche, il n'est pas prévu de mettre à contribution les bonus des managers auxquels on doit une partie au moins du problème. Un oubli sans doute.
Cette technique, utilisée la première fois lors de la crise chypriote, est désormais inscrite dans la loi bancaire française, l'État ne garantissant plus les dépôts au-dessus de 100 000 euros contre 200 000 dollars aux États-Unis et ensuite une aide dégressive ; disposition dont il n'est pas sûr que les clients des banques aient saisi toute la portée.
Le choix qui a été fait semble imparable, ce qui est loin d'être le cas.
On aurait, par exemple, pu commencer par sécuriser le système en imposant aux banques des ratios de fonds propres beaucoup plus élevés et en leur interdisant de spéculer avec l'argent qu'elles créent ou celui des autres.
Ce n'est pas le choix qui a été fait. Non seulement les banques pourront continuer, sans qu'ils le sachent, à spéculer avec l'argent des déposants, mais ceux-ci devront assumer une partie du risque, à hauteur de 8 % des besoins, ce qui ne choque personne ou presque.
Après la question de la pertinence de la solution choisie, se pose celle des incertitudes quant à sa capacité réelle de stabilisation du système financier.
Par exemple, non seulement la mise à contribution des déposants et de certains des propriétaires d'obligations subordonnées, véritables placements de « père de famille » - comme on l'a vu lors de la faillite récente de quatre banques régionales italiennes - ne représente pas un modèle de justice mais d'autres banques étant souvent propriétaires de ces obligations subordonnées, le risque de propagation de la crise par ce canal s'en trouve augmenté.
Que penser aussi des dépôts des trésoreries des entreprises et de l'ensemble des opérations de placement de leurs excédents de trésorerie ponctuels ? Outre les risques de retraits préventifs, il y a ceux de mise en difficulté des entreprises elles-mêmes.
Pour faire face à la crise éventuelle, comme d'ordinaire, est prévu un mécanisme dont la complexité peine à masquer les insuffisances. Pour faire simple, outre diverses dispositions réglementaires, disons qu'il comprend deux volets :
- un dispositif destiné à renforcer les capacités de renflouement interne ou « mécanisme relatif à la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) » qui ressemble fort à un renforcement d'exigences de fonds propres (de l'ordre de 6 %) souffrant des mêmes défauts que ses semblables ;
- un fonds de résolution unique (FRU) alimenté par les banques devant atteindre 1 % des dépôts garantis de l'ensemble des banques européennes, soit 55 Md€, à l'horizon de huit ans. Cette mutualisation ne sera que progressive à partir de « compartiments » nationaux. Chiffre à comparer au 31 000 Md€ que représentait le total des bilans des banques de la zone euro !
Quoi qu'il en soit, à voir la taille des bilans des banques européennes et particulièrement ceux des grandes banques systémiques, en l'absence d'un prêteur en dernier recours qui ne peut être que la BCE ou un MES doté de moyens propres suffisants, qui peut croire à la fiabilité de cette construction ? Croire même que la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros pourra être assurée sans intervention des États ? Où l'on retrouve toujours le même problème : à ne pas séparer la protection des déposants de celle des banques à finalité spéculative, on le rend insoluble.
Avis d'experts : le verre aux trois quarts vide et au quart plein
À la différence du krach de 2008 qu'aucun « expert » n'avait prévu et dont la perspective n'avait été évoquée par aucun média, la possible sinon probable répétition d'une crise de cette ampleur est une préoccupation largement partagée.
Quelques exemples significatifs de ces avis figurent ci-dessous, classés sur l'échelle de l'optimisme :
a) Les pessimistes
Georges Soros (mai 2018) : « Ce n'est plus une figure de style de dire que l'Europe court un danger existentiel. C'est la dure réalité. Nous nous dirigeons vers une autre crise financière majeure »
Nouriel Roubini , Professeur à la Stern School of business Université de NYU, consultant : « On va vers une crise financière, suivie d'une récession mondiale. Les politiques de relance budgétaire qui poussent actuellement la croissance annuelle américaine au-dessus de son potentiel de 2 % ne sont pas tenables. D'ici à 2020, ladite relance se sera épuisée. »
William White , ancien économiste en chef de la Banque des règlements internationaux (BRI) et actuellement à l'OCDE à Paris. Déclaration au Daily telegraph (Davos 23 janvier 2018) : « Tous les indicateurs du marché ressemblent beaucoup actuellement à ce que nous avons vu avant la crise de Lehman, mais la leçon a quelque part été oubliée. »
Dominique Strauss-Kahn (cité dans l'AFP) : « Dix ans après Lehman Brothers sommes-nous mieux armés pour affronter une crise de même magnitude ? » Non, répond Dominique Strauss-Kahn . Nous avons fait quelques progrès, notamment dans les ratios de capitalisation des banques. Mais c'est très insuffisant. Imaginez que demain la Deutsche Bank ait des difficultés, ce n'est pas les 8 % de capital dont elle dispose qui vont résoudre le problème. En vérité, on est moins bien préparé. La régulation est insuffisante. »
« À partir de 2012-2013, on abandonne finalement le thème de la nécessité d'une économie régulée, par exemple sur la taille des banques ou sur les agences de notation. On est totalement revenu en arrière, d'où mon pessimisme sur notre préparation. On est dans une sorte d'impensé de la globalisation et cela ne donne pas de bons résultats. »
« La coordination a très largement disparu. Plus personne ne joue ce rôle, ni le FMI, ni l'UE, et la politique du président des États-Unis n'aide pas. Par conséquent, la mécanique qui avait été mise en place au G20, extrêmement salutaire car elle associait les pays émergents, a volé en éclats. »
« Il y a une conséquence de la crise qui, à mon avis, est complètement sous-estimée : les populismes que l'on voit apparaître partout sont le produit direct de la crise et de la façon dont elle a été traitée à partir de 2011/2012, en privilégiant des solutions qui allaient aboutir à accroître les inégalités. Le QE a été utile et bienvenu. Mais c'est une politique qui consiste fondamentalement à renflouer le système financier et donc à servir les plus riches de la planète. Quand il y a un incendie, les pompiers interviennent et il y a de l'eau partout. Après il faut éponger, ce que l'on n'a pas fait. Et comme cette eau est tombée dans les poches de certains et pas dans celles de tout le monde, il y a eu une explosion des inégalités. »
James K. Galbraith : « Est-ce qu'une crise est possible ? Oui sans le moindre doute. C'est une évidence. Je ne peux bien sûr pas dire si cela sera demain, l'année prochaine ou dans cinq ans. Des crises financières il y en a toujours eu, il n'y a pas besoin d'être un expert en économie pour dire qu'il y en aura toujours. Par contre, une crise financière n'a pas forcément les conséquences économiques, politiques et donc sociales que nous voyons aujourd'hui. C'est là la question principale. » ( Audition)
Thierry Philipponnat : « Les dirigeants politiques ont été et sont dans un déni total de la réalité en nous convertissent à l'argent facile de finance de l'ombre. Le résultat sera une fulgurante déflagration financière qui laminera des économies entières, des nations. La prochaine crise sera pire que celle de 2008 et se positionnera à 254 000 Md€. Au travers de ce qu'on appelle la crise des gilets jaunes s'exprime l'émotion, le ressenti des Français, et vise à dénoncer les effets néfastes pressentis de l'argent facile. Les plus fragiles de nos concitoyens savent déjà dans leur quotidien que l'argent vaut de moins en moins. Nous allons tous faire naufrage. Et chacun doit payer son écot à la société ».
Jean-Luc Ginder, économiste sur le Blog du Huffington Post : « La prochaine crise peut-être beaucoup plus grave que la précédente. Tenir un discours modéré face à une situation d'une gravité exceptionnelle, c'est prendre le risque d'un effondrement futur. »
Jean-Michel Naulot : Éviter l'effondrement (Seuil) dont le sous-titre est : Les politiques nous préparent une catastrophe financière pire que la précédente
« Les règles prudentielles actuelles ne permettront pas d'éviter un nouveau krach.
« Même s'il est difficile de tirer des comparaisons historiques, on peut penser que le scénario de 1929 va se reproduire, on commence par une crise financière qui débouche sur une crise économique, puis se traduit par une crise sociale, qui provoque une crise politique. Nous sommes exactement à ce moment-là...
« En sachant que les moyens qui ont été mis en oeuvre, le mix politique monétaire et mise en cause des États (alors qu'ils sont les seuls à agir) sont complétement inappropriés ! »
Martine Orange : « La crise est toujours au départ une crise de la dette privée avant d'être une crise de la dette publique. Aujourd'hui la dette privée augmente avec des points assez chauds sur la dette immobilière.... Donc si une baisse des revenus se produit, il y a un risque d'ajustement très violent. Une compression des salaires entraîne une forte pression sur les remboursements et un risque d'explosion de la dette financière. »
Romaric Godin : « L'accélération de l'endettement des pays émergents rend aujourd'hui l'ensemble du système financier mondial au moins aussi vulnérable sinon plus qu'en 2008. »
Jean-Claude Trichet, Challenges :
« Je l'ai dit avec force : je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient, sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qu'ils pensaient inéligibles, ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Europe alors même qu'ils pensaient que ça n'adviendrait jamais. C'était souvent les plus amoureux d'ailleurs de cette forme de capitalisme et de l'ouverture à tout crin. Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur et donc nous devons réussir à ce que notre modèle productif change en profondeur pour retrouver ce que fut l'économie sociale de marché, une manière de produire, de créer de la richesse indispensable, mais en même temps de porter des éléments de justice et d'inclusion et une manière d'organiser l'innovation partout dans le monde et l'ouverture, mais de faire que chacun y trouve sa part. »
b) Les prudents
Danièle Nouy , responsable de la supervision du secteur bancaire à la BCE Le Figaro (09/2018) : « À la question : selon vous, la règlementation a-t-elle atteint son but ? « Qu'est-ce qui pourrait provoquer la prochaine crise ? Je ne sais pas, mais je suspecte que ce pourrait être le marché immobilier » non sans expliquer que les banques sont mieux armées pour faire face qu'en 2008.
Henri Sterdyniak : « Finalement, le marché est devenu plus sain ; pourvu qu'il le reste ! En ce qui me concerne, je reste très méfiant sur les innovations financières. »
« Après des décennies de désillusions et d'échecs, le public finit par comprendre que les facilités financières (...) ne font que retarder les échéances et gagner du temps tout au plus. On en arrive à un point où ces pratiques déconsidèrent ceux qui y ont recours et n'osent pas parler le langage de la vérité. C'est là une des sources du populisme rampant d'aujourd'hui. »
Jacques de Larosière : Les dix préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier (Odile Jacob). Jacques de Larosière est ancien directeur général du FMI, ancien Gouverneur de la Banque de France, ancien président de la BRI... entre autres fonctions.
Joseph Stieglitz, Prix de la banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel (Le Monde 25/09/2019.) : « La probabilité que nous traversions, d'ici peu, une crise financière de la même ampleur que celle de 2008 reste faible. En revanche, il est certain que nos économies vont enregistrer un ralentissement marqué. »
c) Les optimistes
François Villeroy de Galhau , « Déclaration avant la réunion de Davos » France 2 (25 janvier 2019) : « Ralentir ce n'est pas reculer : C'est un ralentissement [de la croissance], on avance moins vite. Ce n'est pas un retournement, vers une récession où on reculerait. La grande explication de ce ralentissement partout, c'est l'incertitude »
« Mais où Jean-Luc Ginder va-t-il chercher tout cela ? Avait-on déjà vu des anticipations aussi alarmistes à la une de la presse mainstream ? Qu'en pensent ceux pour qui la crise était loin derrière nous, avec des taux ultra-bas pour les 12 à 18 prochains mois nous garantissant une prospérité sans nuage et des marchés inexorablement orientés à la hausse ?
En ce qui concerne le Huffington Post, on se demande vraiment pourquoi ils ont choisi la mi-juin pour publier un tel article. Les épargnants sont en train de préparer leurs vacances d'été et si ça se trouve, ils ne vont pas partir l'esprit tranquille alors que franchement, il n'y a aucune raison de redouter le pire !
Les taux sont en effet au plus bas, les marchés au plus haut et ces derniers ont toujours raison. Jean-Luc Ginder devrait le savoir, au lieu de mettre en doute la stabilité du système financier et l'infaillibilité des banques centrales...
Imaginez enfin que des lecteurs du « Huff » se mettent à leur tour à en douter et que la contagion gagne les salles de rédaction des médias financiers : vous nous connaissez, nous saurons y résister ! »
Réponse à Jean-Luc Ginder Agora bourse (17 juin 2019)
Patrick Artus : « Il n'y aura pas de crise financière - je parle de l'Europe, je ne suis pas en train de parler du Brésil ou de l'Argentine ou de la Chine. Ceci est dû, d'une part, au fait que le secteur privé s'est beaucoup désendetté et qu'on a beaucoup fait maigrir la finance compliquée. »
Annexe 2 : L'abondance de la liquidité et son origine : quelques relations significatives et la fragilité du système
a) Évolution de la masse monétaire, Dow Jones, bilans
Évolution de la masse monétaire zone Euro
M1 : Pièces, billets en circulation (monnaie la plus liquide)
M2 : M1 + Dépôts sur livrets + crédits court terme
M3 : M2 + titres durée = 2ans + dépôts remboursables avec préavis = ans, SICAV ...
b) Bilan des Banques centrales et taux directeurs
Évolution du taux directeur de la Fed et de la BCE
On remarque le décalage de la politique de la BCE et de la Fed face à la crise.
La baisse du taux de la Fed est plus précoce et plus forte que celle de la BCE dont le taux remonte même en 2011 pour éviter une inflation imaginaire. Une politique dont Mario Draghi prendra le contre-pied et qui subsistera vu la persistance de la stagnation économique contrairement aux USA.
Évolution du bilan aggloméré des principales banques centrales des pays développés
En ordonnée, l'évaluation est en milliers de Md$
Source Lazard frères gestion, Bloomberg
c) Évolution du Dow-Jones et durée de la détention des actions
Évolution du Dow-Jones mai 2016-juin 2019
PARTIE II - EN ATTENDANT LE PLEIN EMPLOI
« Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution ». G Pompidou, Premier ministre, 1967
« Le taux de chômage s'établit à 8,8 %. C'est la première fois depuis 10 ans qu'il passe en dessous de 9 %. C'est une bonne nouvelle. Le chômage de masse n'est pas une fatalité en France. » Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 2017
Avec la conférence d'Emmanuel Macron suite au Grand débat, le plein emploi serait devenu une urgence... pour 2025, ce qui reste bien court à en juger par la tendance lourde de ces quarante dernières années.
Rappelons en effet que le chômage de masse s'est développé dans l'Empire américain et tout particulièrement en France à mesure que s'installait l'ordre libéral.
Un fait que rappellent les deux citations en exergue.
Elles montrent aussi que le chômage de masse n'est pas une fatalité mais le produit d'un choix idéologique 83 ( * ) .
Elles témoignent aussi de la mithridatisation des esprits résultant de ce choix idéologique.
Pour le Premier ministre du Général De Gaulle, la perspective de 500 000 chômeurs était un cataclysme. Pour la ministre du travail d'Emmanuel Macron 84 ( * ) , 2 800 000 chômeurs méritent un cri de victoire !
Elles montrent enfin qu'il ne suffira pas d'afficher le cap pour arriver au port.
D'autant que ce cri de victoire mériterait d'être vérifié sur la durée et regardées de près les recettes de fabrication des chiffres officiels.
Vu les enjeux politiques, rien de plus « fabriquées » et variables selon les pays, en effet que les statistiques du chômage ( voir annexe 1 de cette partie : La statistique enchantée du chômage ).
À ce jour, le meilleur moyen de faire baisser le chômage reste encore de restreindre le nombre de ceux qui mériteront le label de « chômeur ».
Rien d'étonnant donc si, comme par hasard, les chiffres retenus par la ministre sont ceux de l'INSEE et non de la DARES, qui comptabilisent seulement les demandeurs d'emploi de catégorie A, sans tenir compte du « halo autour du chômage », le sous-emploi.
Un écart entre 500 000 et 750 000 chômeurs selon les moments entre 2013 et 2017 !
Nous procéderons d'abord à une analyse comparative des modalités de traitement du chômage et du sous-emploi, inhérent au système libéral, tant en Europe qu'aux USA, avant de nous interroger sur les origines de ce chômage de masse : la stagnation économique.
I. LES FORMES DU CHÔMAGE EN EUROPE ET AUX USA
A. CHÔMAGE PERMANENT EN EUROPE, INSTABILITÉ DE L'EMPLOI AUX USA
À s'en tenir au chômage au sens officiel, sur la longue période (1970/2019), son taux a varié très différemment aux USA et dans la zone euro.
Jusqu'en 1983, qui marque le début en Europe de la grande vague de libéralisation, le taux de chômage européen est plus faible que le taux étasunien.
Ensuite, c'est l'inverse, avec de grandes différences selon les moments.
Constatons aussi que, si les effets de la crise économique (entre 2008 et 2010) ont été plus puissants aux USA, la reprise a été plus précoce (2011) et plus vigoureuse ; il faudra en effet attendre 2014 pour voir débuter en Europe, un timide retournement de tendance.
Rappelons que sur le vieux continent la reprise de 2011 avait été tuée dans l'oeuf par l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), Monsieur Trichet craignant une bouffée inflationniste !
Renvoyant à des politiques et des sensibilités différentes 85 ( * ) , ces résultats très dissemblables n'en produisent pas moins le même effet psychologique chez ceux qui vivent de leur emploi : un sentiment d'inquiétude et d'incertitude quant à l'avenir ; dans un cas parce qu'on n'est jamais sûr de conserver son emploi, dans l'autre parce que la perte d'un emploi sûr sera difficile à réparer.
Une rupture donc avec le sentiment de sécurité et l'optimisme du temps des « Trente glorieuses », en France comme aux USA.
Les employeurs y virent un moyen de modérer les prétentions salariales de leurs employés, oubliant qu'il n'y a rien de pire pour la cohésion sociale que le ressentiment de ceux qui vivent de leur travail, comme on s'en apercevra plus tard.
1. Taux de chômage aux USA et en Europe
www.Blog-illusio.com 24/08/2015
La zone euro et la France, quant à elles - à l'exception apparente de l'Allemagne (annexe 1 de cette partie) - qui se sont installées depuis une quarantaine d'années dans le chômage de masse n'ont même pas retrouvé leur niveau de chômage de l'avant crise (voir courbe 2).
Un chômage de masse évalué selon des méthodes variables et bien plus profond que les chiffres officiels ne le laissent apparaître ( voir courbe 3).
2. Variations du taux de chômage officiel en France
S'agissant de la France, constatons que les taux de chômage les plus bas se situent avant la crise de 2000-2001 (valeurs internet) et de 2007-2008, périodes d'intense spéculation avec les conséquences que l'on sait. 86 ( * )
3.
Le chômage selon Pôle
Emploi et selon l'INSEE
en France
B. LE SOUS-EMPLOI COMME REMÈDE AU CHÔMAGE
En Europe comme aux USA, si les chiffres officiels ( voir annexe 1 de cette partie) reflètent la réalité, c'est d'une manière déformée par des artifices de construction, par une collecte biaisée des données et la transformation du chômage en sous-emploi et en emploi à bas coût, avec comme conséquence une dégradation des conditions du travail, chaque pays privilégiant telle ou telle méthode en jouant sur plusieurs leviers : minoration du nombre de demandeurs d'emploi 87 ( * ) , raccourcissement de la moyenne du temps de travail annuel 88 ( * ) , baisse des rémunérations 89 ( * ) , augmentation du nombre d'emplois à temps partiel 90 ( * ) , suppression des garanties habituellement attachées à un emploi et des rémunérations qui vont avec (voir encadré ci-dessous) 91 ( * ) ...
4. La variation des estimations du chômage,
selon les choix méthodologiques USA
5. La montée du temps partiel en France
Comme on le voit, depuis 1975, le travail à temps partiel progresse régulièrement, y compris pendant la crise.
Un cas est significatif, celui de l'Allemagne qui, en même temps qu'un taux de chômage très bas, multiplie les emplois précaires, n'offrant aucune protection sociale.
En mars 2018, on comptait 7,6 millions de « mini-jobs » - emplois à temps partiel plafonnés à 450 euros par mois et une durée de 51 heures par mois, sans cotisations sociales ni retraites. Cela concernait un salarié sur six.
Un certain nombre de ces « mini-jobers » n'ont pas d'horaires fixes mais travaillent à la demande de leur employeur.
L'autre particularité tient à ce qu'une partie de ces emplois précaires viennent en complément d'un travail principal.
Cela concernerait 2,8 millions de personnes. 92 ( * )
L'autre champion de la flexibilité de l'emploi est le Royaume-Uni, inventeur du « contrat zéro heure », qui n'engage ni l'employeur à fournir un travail, ni l'employé à effectuer les heures demandées.
En 2015 les travailleurs en contrat «?zéro heure?» gagnaient en moyenne 118 £ par semaine (239 euros), contre 479 £ (610 euros) en moyenne dans le cadre d'un contrat ordinaire.
En 2008, 19 % de ces travailleurs n'arrivaient pas à trouver un emploi en contrat plein temps. Ils sont 41 % aujourd'hui (voir Les Échos du 7 janvier 2015).
Un an plus tard (juillet 2016), les contrats « zéro heure » concernaient 2,9 % des actifs soit 900 003 personnes.
Séduits par la formule, les Pays Bas l'ont adoptée : c'est le « nul uren contract ».
Mais la méthode la plus efficace pour faire disparaître les demandeurs d'emploi des statistiques officielles - faite de détails, d'accumulation d'obstacles techniques et d'absurdité bureaucratiques, de rebuffades et d'échecs répétés - reste encore de décourager les demandeurs d'emplois.
Renvoyés au-delà du cercle extérieur, ils disparaissent alors progressivement des statistiques du chômage.
En France, leur nombre est estimé entre 600 et 700 000 personnes. Constatons déjà que la moitié des allocataires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi (de l'ordre de 1 million de personnes en 2018).
Aux USA cela représenterait autour de 25 millions de personnes.
Ces conditions de travail dégradées auront un double effet discriminant :
- multiplier les travailleurs pauvres - souvent obligés de cumuler plusieurs « mini jobs », alors qu'en moyenne les revenus du travail se maintiennent ou progressent légèrement ;
- toucher plus les femmes que les hommes et surtout les jeunes qui, partout en Europe, pâtissent de cette situation, et, dans certains pays, de manière dramatique.
C. L'ÈRE DES « TRAVAILLEURS PAUVRES »
Partout les « travailleurs pauvres » 93 ( * ) se multiplient, dans les pays particulièrement touchés par la crise (Grèce, Espagne...) mais aussi dans les pays qui, comme les USA (voir annexe 1) et tous les pratiquants de « l'optimisation du taux de chômage », lui ont préféré le sous-emploi (Allemagne, Italie...).
À noter que si le taux du Royaume-Uni a peu varié depuis 2005, c'est qu'il avait été un précurseur en la matière 94 ( * ) .
Selon l'Observatoire des inégalités (13 juin 2018), un salarié sur six en Europe serait un « travailleur pauvre ».
6. Les travailleurs pauvres en Europe
7. Les travailleurs pauvres en Europe
Selon l'Observatoire des inégalités toujours, le taux français correspond à deux millions de personnes.
Au seuil de pauvreté de 50 % du revenu médian, les travailleurs pauvres seraient un million « seulement » 95 ( * ) .
Ces chiffres n'ont pas varié depuis 2000, ce qui montre l'intérêt des « amortisseurs sociaux ».
Selon Eurostat, la part des bas salaires parmi les salariés s'élevait déjà à 17,2 % dans l'Union européenne en 2014, avec de grandes variations selon les pays comme on peut le voir.
C'est en Europe de l'Est et centrale que les proportions de salariés à bas salaires sont les plus visibles (Roumanie, Pologne, Hongrie), pays qui ont, parmi les premiers, développé un « populisme » spécifique.
D. LA DISCRIMINATION PAR LE TRAVAIL
Particulièrement touchés par le sous-emploi, les femmes et plus encore les jeunes.
Inutile de préciser, qu'indépendamment de l'injustice que cela représente, une entrée dans la vie active avec le chômage pour perspective ne peut que créer le ressentiment des intéressés et, au-delà, de leur famille envers une société qui s'accommode de cette situation.
D'autant plus que, dans les pays les plus touchés par le chômage des jeunes que la construction européenne était censée avoir éloigné à jamais, ces jeunes doivent émigrer dans l'espoir d'un avenir meilleur : cas de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie.
La première discrimination dont sont victimes les femmes, c'est le niveau de salaire, nettement plus bas que celui des hommes (voir courbe ci-dessous).
La seconde c'est de devoir accepter, plus souvent que les hommes, des emplois à temps partiel ou précaires.
8. La discrimination par le travail
France : proportion des actifs employés à temps partiel, INSEE 2017
En effet, même si nombre de femmes font le choix du temps partiel pour des raisons familiales, il est clair que l'écart entre les taux d'emploi à temps partiel masculin et féminin est trop important pour que ce soit la seule explication de la surreprésentation de celles-ci parmi les employés à temps partiel. 96 ( * )
9. La discrimination par le travail en Europe
Écart d'emplois à temps partiel entre hommes et femme en Europe, en % (Eurostat)
Pour une moyenne de 26,5 % en zone euro, la France se situe à 21,9 % et l'Allemagne à 35,5 %.
Ainsi, sur 4,8 millions d'Allemands pour lesquels les « mini-job » sont la seule source de revenus, il y a 3 millions de femmes. Beaucoup risquent de se retrouver sans retraite.
Seconde catégorie des personnes les plus touchées par le chômage et le sous-emploi, les jeunes (15-24 ans pour le BIT ou moins de 25 ans pour Eurostat).
10. Chômage des moins de 25 ans en pourcentage de la population active jeune
|
Allemagne 6,2 % |
Slovaquie 14,9 % |
Italie 32,2 % |
|
Pays-Bas 7,2 % |
Belgique 15,8 % |
Espagne 34,3 % |
|
Hongrie 10,6 % |
Suède 16,7 % |
Grèce 39,9 % |
|
Pologne 11,8 % |
France 20,8 % |
USA 8,6 % |
|
Zone euro 16,9 % |
Grande-Bretagne 11,3 % |
Eurostat (2019) Sauf USA
Particulièrement inquiétant, comme on peut le voir sur l'exemple français, ces taux de chômage élevés des jeunes, endémiques, tendent à augmenter.
11. Le chômage des jeunes en France
Première conséquence de ces taux élevés : la précarité juvénile.
Elle est particulièrement évidente dans les pays pratiquant l'optimisation du taux de chômage comme l'Italie et la Grande-Bretagne.
En Italie, selon l'OCDE, le taux des jeunes Italiens en situation professionnelle instable est passé de 43 % en 2011 à 55 % en 2015.
Dans le même temps, le taux de chômage des 15-24 ans s'est accru de dix points, dépassant la barre des 40 %.
En 2016, les 16/24 ans représentaient 40% des « contrats zéro heure » en Grande-Bretagne.
12. Chômage et précarité des jeunes
La précarité est d'autant plus probable que le niveau de formation des intéressés est faible.
13. Précarité et niveau de formation
Il en résulte que, selon une enquête d'IPSOS 97 ( * ) auprès de jeunes Européens, 4 jeunes sur 10 se sentent menacés de basculer dans la précarité ou la pauvreté à court terme. 44 % le pensent en France, 56 % en Italie contre 32 % en Grande-Bretagne et 28 % en Pologne.
Ainsi, plus de deux jeunes Européens (étudiants, demandeurs d'emploi, voire jeunes actifs à temps partiel et même à temps plein) sur trois demandent de l'aide à leurs parents pour subvenir à leurs besoins, notamment en matière d'hébergement.
Cette situation semble normale aux autorités des divers pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark ou Pays-Bas) qui, par diverses mesures encouragent les jeunes à rester chez leurs parents.
Il faut dire que le logement représente une part importante du budget de ces jeunes, obligés de restreindre leurs dépenses d'alimentation ou de santé comme en témoignent les nombreuses enquêtes sur l'état sanitaire des étudiants ou des demandeurs d'emploi.
Autre résultat de cette situation angoissante : la résignation devant les offres d'emplois même sous-payés, ne correspondant pas au niveau d'étude de l'intéressé.
II. AUX ORIGINES DU CHÔMAGE ET DU SOUS-EMPLOI
A. LA LANGUEUR ÉCONOMIQUE
« ...Le vrai problème est que le PIB des économies avancées se situe aujourd'hui 10 à 15 % en dessous de ce qu'il aurait atteint si les tendances antérieures à la crise s'étaient maintenues » Adair Turner 98 ( * )
Le chômage et le sous-emploi s'enracinent, évidemment, dans la maladie de langueur qui depuis la crise frappe l'économie européenne et, quoiqu'à un moindre degré et sous des formes différentes, les USA.
Dépression, récession, stagnation : on peine à trouver le qualificatif s'appliquant à cette situation inédite par sa longueur, même si les conventions de l'économie « main stream », jamais avare de distinguos sans portée pratique, sont précises.
Lorsque le taux de croissance de la production est durablement négatif, on parle de dépression, mais à partir de deux mois de croissance négative, de récession.
La différence entre les deux, nous assure un journaliste de L'Express, « c'est la croyance en la reprise. La tristesse disait Spinoza. » 99 ( * ) Ce qui nous avance beaucoup ! Ceci dit, quand le taux de croissance, pourtant faramineux, de la Chine est divisé par plus de deux entre 2008 et 2018, mettant en danger l'équilibre politique du pays, cela ne constitue-t-il pas une véritable récession ?
Officiellement, la stagnation désigne une situation durable où le PIB réel augmente moins vite que le PIB potentiel, celui-ci étant défini « comme le volume de production de biens et de services que peut atteindre durablement une économie en utilisant pleinement ses capacités, mais sans créer de tensions inflationnistes. » 100 ( * )
En conséquence, « la croissance potentielle est le taux de croissance du PIB potentiel ».
Le PIB étant déjà une construction théorique des plus critiquables, on mesure avec quelles précautions il faut utiliser celle de « PIB potentiel », prudence que n'ont pas les amateurs de la « stagnation séculaire » qui marquerait l'économie mondiale actuellement 101 ( * ) .
Plus prosaïquement, il nous semble que le net ralentissement de la croissance par rapport à l'avant-crise, le niveau d'investissement insuffisant pour dynamiser l'économie et l'emploi, la permanence du sous-emploi, quelle que soit la définition qu'on en donne, justifient le qualificatif de « grande stagnation » appliqué à la décennie qui suit le krach financier de 2007-2008.
Cette stagnation n'a pas grand-chose de séculaire mais renvoie aux contradictions d'un système spéculatif bourgeonnant selon sa propre logique et devenu incapable de financer suffisamment l'économie réelle pour espérer la voir repartir et créer les emplois correspondant aux attentes.
1. Une croissance au ralenti
Si, comme on l'a vu, le système financier - bancaire, boursier, officiel et parallèle - est sorti indemne, sinon ragaillardi du krach de 2007-2008, il en va très différemment de l'économie, quel que soit le pays.
Contrairement à ce qui se passait habituellement 102 ( * ) - à l'exception du Japon qui ne s'est jamais remis du krach immobilier de 1990 malgré les multiples plans de relance qui l'ont suivi -, il n'y a pas eu de reprise durable après l'éclatement de la bulle financière, mais une « reprise en tôle ondulée ».
Ceci signifie une reprise de l'activité à un niveau en moyenne inférieur à celui de l'avant crise, régulièrement ponctuée de baisses et de hausses sans grande signification, quoique puissent laisser croire les cris de victoires ou de désespoir médiatiques qui se succèdent.
Comme le montre le tableau 14, les taux de croissance du PIB (en valeur) sont régulièrement décroissants, quel que soit le pays ou l'ensemble de pays depuis 1961 jusqu'en 2016, la chute brutale de la période 2001-2010 étant due à la crise économique brutale de 2008-2010.
Comme on voit aussi, la reprise de 2010 qui se poursuivra en France en 2011, sera de courte durée 103 ( * ) .
Tableau 14 - taux de croissance du PIB entre 1961 et 2016
ENS Lyon d'après les données de l'OCDE
Enchaînant les hausses et les baisses de croissance d'un peu plus ou un peu moins de 1 %, les années 2016 à 2018 ne sont guère plus brillantes : 1,7 % en moyenne pour la France, 2 % pour l'UE (à 17) et 2,2 % pour les USA.
La croissance potentielle de la France se situant autour de 2 %, on peut considérer qu'elle ne crée plus suffisamment d'emplois pour faire baisser le sous-emploi endémique dissimulé derrière les subtilités des statistiques officielles.
En tous cas, comme le montre le graphique 15, l'économie mondiale n'a pas récupéré le terrain perdu pendant la crise et encore cette projection ne tient-elle pas compte de la chute non anticipée de la croissance chinoise, véritable locomotive de l'économie mondiale jusqu'à ces dernières années, notamment par ses importations d'automobiles, de machines-outils, de biens d'équipement en général, d'avions et de produits de luxe, de matières premières et de pétrole.
De 8,3 % en 2001, année d'entrée de la Chine à l'OMC, le taux de croissance du PIB chinois atteint son point culminant en 2007, la veille du déclenchement de la crise : 14,3 %.
Grâce à la politique de relance massive du gouvernement chinois, il se maintient au-dessus de 9 % jusqu'en 2009, avant de décroitre régulièrement, passant sous la barre des 7 % en 2017 considérée comme la limite en deçà de laquelle l'équilibre politique interne qui avait permis les « modernisations » de Deng Xiaoping pourrait être fragilisé : 6,9 % en 2017, 6,7 % en 2018 et probablement 6 % en 2020.
15. La croissance du PIB dans les pays de l'OCDE
Pour la France, la croissance par habitant entre 2010 et 2017 est encore plus faible que la croissance globale :
Tableau 16
Croissance globale Croissance par habitant
2010 2 % 1,46 %
2012 0,2 % -0,3 %
2015 1,1 % 0,6 %
2017 1,8 % 1,42 %
2. Une productivité en baisse renvoyant à un niveau d'investissement insuffisant (Annexe 2 de cette partie)
L'une des origines de l'atonie de la croissance est certainement l'insuffisance des investissements et donc de la productivité, pour sortir de l'ornière de la stagnation.
La baisse est régulière et structurelle, comme le montre le tableau ci-après.
Tableau 17 - Taux de croissance moyen de la productivité
Blog de Philippe Waechter
Selon les dernières livraisons des « perspectives économiques de l'OCDE » 104 ( * ) , la légère hausse de l'investissement productif est insuffisante pour générer des gains de productivité 105 ( * ) donc pour dynamiser l'économie et l'emploi.
18. Évolution de l'investissement et de la productivité
Comme on le voit, si les investissements productifs ont considérablement baissé durant la crise en zone euro et aux USA, ces derniers les ont relancés plus vite et plus fortement que l'Europe.
Quant au Japon, même s'il ne faut pas oublier que nombre de ses entreprises opèrent à l'étranger, ce pays illustre bien ce qu'il faut entendre par stagnation économique.
3. Au final, des perspectives peu encourageantes.
Les projections de l'OCDE relatives aux prochaines années ne sont guère plus réjouissantes, comme le montre le Tableau 19.
Tableau 19
La croissance mondiale devrait baisser dans les années à venir et l'écart de croissance entre les USA et l'Europe s'accentuer. En tous cas, les chiffres du premier trimestre laissent prévoir une croissance de 3,2 % en 2019 malgré les effets du Brexit et l'offensive de Trump pour redresser sa balance commerciale, Wall-Street retrouvant des couleurs.
Il semble aussi que l'augmentation des déficits publics ne soit pas étrangère à ce rebond : la croissance du déficit budgétaire est sur un rythme de 4,4 % de PIB annuel aux USA.
Quant à la dette publique, à 78 % du PIB en septembre 2018, elle progresse régulièrement. 106 ( * )
On aura remarqué, notamment en Europe continentale, les faibles taux de croissance des fondateurs de l'UE (Allemagne, France et Italie), pays ou l'extrême droite opère une forte poussée, parallèlement à l'apparition de mouvements de contestation non orthodoxes de l'ordre européen libéral.
« Ce qui est certain, pronostique Romaric Godin, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment sur un ralentissement économique quasi général ».
C'est le cas en Allemagne et quasiment dans toutes les économies européennes - la France avec des hauts et des bas - la Chine et les économies émergentes.
Rien n'assure que la dynamique étasunienne dopée à l'endettement et au déficit public durera. « Un vrai ralentissement, qui ne s'explique pas que par l'effet commercial ; un essoufflement (...) que l'on voit depuis 40 ans, comme si cette économie était extrêmement âgée et qu'elle ne pouvait plus courir au rythme où elle courait, elle s'essouffle tout de suite... (Face à ça) on est totalement démuni, avec des outils anciens ou mal adaptés, et on ne sait plus comment faire... C'est la politique du gouvernement actuel : on ne sait plus comment faire alors on va chercher des gens de la City pour qu'ils nous donnent un peu de croissance car finalement il n'y a que la finance qui est capable de faire ça. » (Romaric Godin)
B. UNE STAGNATION CONSENTIE
« La régulation de l'activité économique est sans aucun doute la plus inélégante et la plus ingrate des entreprises d'intérêt général »
John K. Galbraith
Pour passer de la stagnation, du chômage de masse, du sous-emploi et de la précarité au plein emploi et à une rémunération du travail décente, les États disposent de plusieurs sortes de leviers : sur le court terme, des interventions financières épaulées ou non par le système bancaire pour sauver des entreprises de la faillite ou améliorer leur compétitivité, sur le long terme, l'amélioration de la formation, de la qualité des transports, etc.
Cet ensemble de dispositions relèvent de la politique de l'offre.
À l'autre bout de la chaîne, l'objet de ces interventions peut être la stimulation de la demande : amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs, investissements publics ou conflits armés, si on est américain.
La règlementation pour mobiliser l'épargne et orienter le système bancaire prioritairement vers le financement de l'économie réelle constitue un autre levier, tout comme la baisse des taux d'intérêt pour faciliter l'emprunt et l'équipement des entreprises ou la dépréciation de la monnaie pour faciliter les exportations.
La mise en oeuvre de ces politiques et la manière dont elles seront conduites dépendent cependant d'une condition préjudicielle : la volonté d'agir.
Or, la volonté d'agir dépend à son tour, certes du nombre et de l'importance des obstacles à contourner pour avoir une chance de réussir mais d'abord de l'idéologie qui anime les décideurs, et de leur psychologie.
C'est sur cette dimension idéologique et psychologique, prudemment passée sous silence, que nous nous arrêterons d'abord, en nous interrogeant sur le caractère proprement obsessionnel qu'ont pu prendre en France et en Allemagne - donc dans la zone euro - le dogme de la dette publique minimum, de l'équilibre budgétaire à tous prix et de la monnaie forte - ce qui n'est pas le cas de pays comme les USA ou le Japon par exemple.
Nous analyserons ensuite ce qu'ont été et ce que sont les politiques de l'offre, et accessoirement de la demande, dans la zone euro, enfin la question essentielle du financement de l'économie réelle.
1. Une aboulie d'origine idéologique
a) Le frein néolibéral
Selon les canons du néolibéralisme - en pratique on verra qu'il en va très différemment - l'interventionnisme étatique, même quand il sert à corriger les ratés d'un système économique concurrentiel, n'a aucun sens.
C'est même une faute qui retardera le retour naturel à la normale.
Les marchés, en effet, sont autorégulateurs et les crises des moments de « destruction créatrice », nécessaires à la régénération de l'appareil économique.
Tout au plus, comme on l'a vu, l'ordolibéralisme européen admet-il les interventions permettant d'assurer une concurrence non faussée par les monopoles, les ententes voire « les déséquilibres de l'information » selon le jargon en vigueur.
D'où, au tout début de la crise de 2007-2008, encore circonscrite au secteur immobilier, les manifestations d'incompréhension des plus zélés croyants de l'église libérale devant les opérations de sauvetage par l'État des grands établissements bancaires spécialisés dans l'immobilier.
« Quand j'ai ouvert mon journal hier, dira le sénateur républicain du Kentucky, Jim Bunning lors d'une audition au Capitole, j'ai cru que je m'étais éveillé en France. Mais non, il se trouve que le socialisme règne en maître en Amérique » ! C'était le 13 juillet 2008.
La leçon de la faillite de Lehman Brothers, deux mois plus tard, portera, et c'est à une restructuration du système bancaire tout entier que les pouvoirs publics étasuniens (État et Fed) devront se livrer en urgence.
Dès septembre 2008, le plan Paulson ou TARP ( Troubled Asset Relief Program) engagera 600 puis 700 Md$ dans le sauvetage de l'économie américaine 107 ( * ) .
Après le rachat des créances douteuses bloquant le circuit interbancaire (la Fed rachetant pour 2 300 Md$ de dettes), la crise s'approfondissant, le plan évoluera vers des apports en capitaux aux institutions bancaires et aux entreprises, accompagnés de crédits à la consommation.
L'opération emblématique de ce plan est la nationalisation en 2009 de Général Motors 108 ( * ) .
Comme quoi, les Étasuniens, avec Tartuffe, savent « trouver avec le ciel » libéral des accommodements : un exemple d'interventionnisme décomplexé que l'église libérale européenne ne s'autorise pas, en tous cas de manière aussi voyante.
Au même moment, en effet, sur le vieux continent, alors même qu'une crise immobilière d'origine endogène (en Espagne et en Irlande), ainsi qu'une crise du crédit à la consommation en Europe de l'Est et en Islande avaient débuté fin 2007, et que s'étaient manifesté dès août 2007 les premiers signes de la crise des subprimes , la mobilisation fut plus hésitante.
Il faudra attendre le 12 octobre 2008, près d'un mois après la faillite de Lehman Brothers pour que la BCE et les États de la zone euro, jusque-là intervenus en ordre dispersé pour sauver leurs meubles nationaux, aiguillonnés par les Américains, se mettent d'accord, non sur un plan d'intervention commun, mais sur un « plan d'action concerté » de traitement à la fois de la crise de liquidité et de la crise de solvabilité 109 ( * ) !
La BCE, pour sa part, injectera d'abord 50 Md€ puis 250 Md€ dans le circuit interbancaire 110 ( * ) , sans qu'aucune intervention n'advienne - évidemment - en matière économique.
Ce scénario est le même lors de la seconde crise grecque, trois ou quatre ans plus tard, alors que la spéculation bat son plein contre les emprunts des États européens (« dettes souveraines »).
Début juillet 2011, le Président de la République française d'alors - Nicolas Sarkozy - demande au président français de la BCE, ancien inspecteur des finances, ancien banquier, en fin de mandat, l'intervention de la banque centrale pour faire cesser la spéculation qui faisait rage sur la dette grecque et menaçait tous les pays de la zone euro (Portugal, Espagne voire Italie), mettant en péril la monnaie unique.
C'est une fin de non-recevoir de Jean-Claude Trichet, les statuts de la BCE le lui interdisant. La Banque de l'Europe passe avant l'Europe !
Un an plus tard, Mario Draghi, ancien employé de Goldman Sachs 111 ( * ) , citoyen des USA, devenu entre-temps président de la BCE par l'un de ces miracles dont le monde de la finance a le secret, faisait cesser instantanément l'offensive sur les titres souverains en une phrase, en anglais évidemment : « La BCE fera tout ce qui est nécessaire pour sauver la zone euro » . Tout le monde respire et les médias européens couvrent de fleurs le sauveteur de l'euro !
Entre-temps, vu le refus de la BCE de financer directement la dette publique, ce qui aurait mis les États à l'abri de la spéculation, les responsables de la zone euro bricolent un système de financement collectif complexe qui mettra du temps à se stabiliser : le mécanisme européen de solidarité financière (MESF), le fonds européen de stabilité financière (FESF), et le mécanisme de stabilité financière (MES), validé par le « Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire (TSCG) ».
Il en résultera une augmentation de l'endettement des États de la zone et la réduction des étroites marges budgétaires consenties à Maastricht.
Puis, comme si cela ne suffisait pas, s'en suivit le contrôle des projets de budgets et de leur exécution par la bureaucratie bruxelloise, et diverses bureaucraties « indépendantes » nationales. 112 ( * )
Le piège s'est refermé sur les États de la zone euro, paralysés sans même l'espoir qu'une autorité européenne légitime puisse un jour intervenir à leur place.
b) Une austérité budgétaire et sociale mortifère
Ainsi sera installée durablement en Europe une austérité budgétaire et sociale mortifère, en Grèce évidemment mais aussi dans le reste de la zone euro. On y reviendra.
Reste que, ces interventions « illibérales » massives aux USA, hésitantes en Europe se justifiaient par le caractère catastrophique de la situation et parce qu'il s'agissait essentiellement de sortir d'affaire les banques, leurs actionnaires, leurs créanciers et, pour certaines de leurs déposants ou de leurs sociétaires.
S'agissant d'une crise économique rampante, aux conséquences essentiellement sociales, plus difficiles à apprécier et touchant une population généralement oubliée des médias, il en est évidemment allé différemment.
C'est en devenant politique que cette crise rampante est devenue visible : par l'élection de Donald Trump aux USA, puis l'élection hasardeuse d'Emmanuel Macron et la crise des « gilets jaunes » en France, la montée du « populisme » un peu partout en Europe comme on le verra plus loin.
Mais l'heure est encore à « l'endiguement » du phénomène, pas encore à son traitement de fond.
Faute d'un sentiment d'urgence, c'est l'orthodoxie et la logique des institutions en place qui s'imposeront.
Reste que si les résultats en matière de croissance et d'emploi (voir ci-dessus) sont sensiblement meilleurs aux USA qu'en Europe à partir des années 1980-1983, que si la réactivité des responsables étasuniens aux situations de crise et à la stagnation économique est nettement plus vive que celle de leurs homologues européens, tous partagent le même crédo libéral.
Face aux problèmes économiques et sociaux, ils n'hésitent pas à abandonner des théories utilisées d'abord comme instruments de pouvoir.
On peut en déduire que l'idéologie néolibérale n'explique qu'imparfaitement le peu d'entrain des responsables européens pour les interventions économiques, pour eux sources d'endettement, de déséquilibre budgétaire et indirectement de fragilisation monétaire, et que cette aversion du « couple » franco-allemand pour l'interventionnisme économique renvoie d'abord à une commune appétence pour la rigueur budgétaire et la monnaie forte plus ancienne.
2. Le « syndrome franco-allemand » de la monnaie forte : mark, franc, euro forts
a) Les racines du mark fort
Contrairement à ce qui se raconte, l'origine de l'attachement à un mark stable, donc fort, n'est pas l'hyperinflation du début des années 1920 du temps de la République de Weimar, censée expliquer, par ailleurs, l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Même si son souvenir fut vivace, l'hyperinflation fut jugulée dès la fin de 1923 par le directeur de la Reichsbank, le docteur Schacht (futur ministre d'Hitler) et le ministre indépendant des Finances, futur chancelier, Hans Luther.
Le remplacement du Reichsmark par le Rentenmark, qui ruina une foule de rentiers, marque le début d'une période florissante jusqu'à la crise de 1929 que le Chancelier Brüning eut la mauvaise idée de traiter par la déflation, le retour à l'équilibre budgétaire, la baisse des salaires, des allocations, et des augmentations d'impôts.
L'accession d'Hitler au pouvoir s'explique en partie par les effets calamiteux de cette politique de déflation et non par l'hyperinflation antérieure de dix ans comme le colporte la pensée unique.
L'attachement allemand actuel au mark fort s'explique lui d'abord par les conditions dans lesquelles l'État allemand a pu renaître après la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement moral que fut le nazisme.
Comme le montre Michel Foucault dans son cours au Collège de France 113 ( * ) , à la fin de la guerre, faute de pouvoir installer un État acceptable par les vainqueurs, c'est autour d'une économie concurrentielle régulée par le droit seul que va se reconstruire l'Allemagne et que pourra exister un État uniquement préoccupé au départ de créer les conditions d'existence d'un marché libre.
C'est le modèle « ordolibéral » qui inspirera les refondateurs de la nouvelle Allemagne, tout particulièrement Ludwig Erhard.
Selon Michel Foucault, pour l'ordolibéralisme allemand, « entre une économie de concurrence et un État [...], le rapport ne peut [...] être de délimitation réciproque de domaines différents. Il ne va pas y avoir le jeu du marché qu'il faut laisser libre, et puis le domaine où l'État commencera à intervenir, puisque précisément le marché, ou plutôt la concurrence pure, qui est l'essence même du marché, ne peut apparaître que si elle est produite, [...] par une gouvernementalité active [...] Le gouvernement doit accompagner de bout en bout une économie de marché [...] Il faut gouverner pour le marché plutôt que gouverner à cause du marché ».
Le bon fonctionnement d'une économie suppose donc, en priorité, une monnaie suffisamment forte pour rester stable.
Au final, ce ne fut pas un nouvel État allemand démocratique et dénazifié qui reconstruira l'économie allemande, mais la réussite 114 ( * ) économique allemande qui permit la renaissance de l'État allemand. Créateur du Deutsche Mark en juin 1948 115 ( * ) et réduisant ainsi la masse monétaire en circulation, il stoppe l'inflation en rétablissant la liberté des prix (contre l'avis des Américains), une opération qui supposait pour réussir une monnaie stable.
Reconnu comme « le père de la réussite économique allemande », Ludwig Erhard, d'abord vice-chancelier, deviendra chancelier de la République fédérale.
C'est ce modèle qui inspirera la construction de l'UE. La « concurrence libre et non faussée » étant produite et garantie par le droit, des organismes indépendants et des cours de justice, l'État devient inutile au fonctionnement social tout entier.
Tel est le principe fondamental de la construction européenne. Rien à vois avec la volonté de réunir les peuples !
On aura compris qu'un tel système, privé d'instances décisionnelles étatiques ne peut fonctionner que par le strict respect des règles budgétaires et grâce à une monnaie stable et donc suffisamment forte pour résister à la spéculation.
L'existence d'instances décisionnelles dotées d'une légitimité démocratique faible - Conseil européen, Parlement -, aux pouvoirs bridés par le nombre et des règles strictes - par exemple, le Parlement n'a pas de pouvoir d'initiative -, ne sont que des concessions passagères, témoignant du caractère encore imparfait d'une construction, censée se maintenir par ses seules règles.
Une fois cette construction achevée, l'observation des règles, une monnaie reconnue suffiront à faire fonctionner l'Union, sans que rien ne puisse venir perturber le cours des choses.
Mais, comme on sait, les contradictions d'intérêts des pays étant trop fortes, le projet s'enlisera, personne ne voulant prendre l'initiative, soit de le faire évoluer vers une Fédération dotée d'une légitimité politique, soit de le faire échouer. En attendant, la seule solution est de faire « comme si », en se crispant sur le respect des règles, art dans lequel excellent les allemands.
On en est là.
b) L'obsession du franc fort
« Le franc fort est intéressant pour ceux qui ont des francs »
John Kenneth Galbraith
Cette obsession est repérable dès la fin de la Première Guerre mondiale comme l'atteste cette conclusion de Keynes, analysant en 1926 la politique monétaire française : « La première vérité, c'est que le franc ne retrouvera jamais son ancienne parité et qu'il doit être dévalué ». (Réflexions sur le franc et sur quelques autres sujets)
Pour les auteurs de « La guerre de sept ans » 116 ( * ) dont on ne saurait trop recommander la lecture, les racines idéologiques de cette quête impossible du franc fort, ne sont pas rationnelles mais religieuses.
En témoigne l'abondance des métaphores religieuses dans les discours de ses défenseurs, bon nombre se revendiquant d'ailleurs chrétiens : « Le dogme du franc fort a poussé sur un terreau fortement chrétien.
A la direction du Trésor [comme dans divers organismes liés à la Banque de France] de nombreux responsables sont des catholiques pratiquants . »
Il y un côté sacrificiel dans cette quête d'une monnaie forte.
« Ce qui est immoral c'est de se satisfaire tout de suite. Ce qui marche bien à long terme est toujours plus moral que le court terme. L'idée qu'un pays comme l'Allemagne puisse se faire du mal, en réévaluant pour le bien du plus grand nombre à long terme, a été une révélation pour moi » pourra écrire Michel Albert, économiste, auteur de bestsellers économiques, inspecteur des finances, membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France et chrétien convaincu (Le Nouvel économiste, 29 juillet 1994).
Sauf que, comme aimait à dire Keynes, « à long terme nous serons tous morts » ... Et lyophilisés, ce qui semble être le destin que se prépare l'Europe.
Mais le christianisme n'est certainement pas le seul terreau sur lequel a germé l'idéologie du franc fort. Elle plonge évidemment aussi ses racines au coeur même de la chose financière.
Qu'est-ce qu'une monnaie « forte » sinon une monnaie qui ne se dévalue pas, dont la valeur défie le temps. Et donc la garantie que les sacrifices de l'épargnant, fondement moral mythique du capitalisme, ne seront pas vains.
Le système capitaliste remarque Keynes « reposait pour se développer sur une double supercherie. [...] Le devoir d' « épargner » représenta bientôt les neuf-dixièmes de la vertu, et l'agrandissement du gâteau l'objet de la vraie religion. Autour de la non-consommation du gâteau s'épanouirent tous les instincts d'un puritanisme qui, en d'autres temps, s'était retiré du monde... » (cité par Gilles Dostaler dans Keynes et ses combats , chez Albin Michel).
On retrouve, sous une forme laïcisée, cette croyance dans les vertus rédemptrices du combat pour une monnaie forte chez celui qui a donné le plus de lui-même dans cette entreprise dont dépendait la monnaie unique - Pierre Bérégovoy- peut-être jusqu'à y perdre l'espoir.
Ce qui sous-tend ce combat touche à l'irrationalité de toute croyance, en l'espèce la foi dans un « bon capitalisme », dans un capitalisme pas seulement destructeur et créateur d'inégalités mais vecteur de stabilité et d'égalité.
Pierre Bérégovoy, fier de son origine populaire, de son passé d'autodidacte et de militant, aimait à dire qu'une monnaie que ne rongeait pas l'inflation, qu'une monnaie forte, protégeait d'abord les plus vulnérables, les moins riches.
L'argument a beaucoup servi et continue à servir mais si, comme le remarque J. K. Galbraith, le franc fort est intéressant pour ceux qui ont des francs, plus ils en ont, plus il est intéressant pour eux.
Il faut cependant reconnaître à Pierre Bérégovoy une lucidité que le partisan de l'Europe unie à tous prix, que le « visionnaire » comme ses amis aiment à présenter François Mitterrand, n'a pas eue.
Conscient des faiblesses de l'économie française par rapport à l'économie allemande, que l'une et l'autre évoluaient dans des contextes très différents, conscient que la seule monnaie capable de rivaliser avec le dollar était le mark, il était partisan de renforcer le système monétaire européen (SME), d'unifier les fiscalités européennes avant de passer à la zone euro, en un mot de créer une monnaie commune avant de passer à la monnaie unique.
Il apparaît que l'avenir a plutôt donné raison à Pierre Bérégovoy et qu'aujourd'hui, s'il reste une voie pour sauver la monnaie unique, elle passe par le retour à une monnaie commune avec des possibilités de réajustements périodiques des parités entre ses composantes.
À l'autre bout du spectre des croyances, il n'est pas non plus douteux que l'idolâtrie de la monnaie forte est avant tout une idéologie de rentiers à usage des rentiers, c'est-à-dire de ceux dont les revenus, assurés par leurs débiteurs, dépendent de la valeur du capital dont ils sont propriétaires.
Tout ce qui en fait baisser la valeur (inflation, dévaluation, doutes quant à la solvabilité du débiteur, susceptibles de réduire la valeur d'échange des titres de créances) ou les revenus qu'il procure (hausse de la part du travail par rapport à celle du capital dans la répartition de la valeur ajoutée, impôts, cessation des paiements du débiteur) doit donc être proscrit.
Les intérêts de ceux qui vivent de leur travail sont donc clairement antagonistes de ceux des rentiers.
Rien d'étonnant qu'aujourd'hui, alors que triomphent les fonds de placements et l'enrichissement spéculatif, comme sous la Monarchie de Juillet, la garantie d'une monnaie forte, qui ne se dévalue pas, est nécessaire à la tranquillité de la grande majorité des rentiers.
C'est aussi l'idéologie des tenants de l'étalon or - élément essentiel à la stabilité du premier libéralisme - des dévots de l'or, car l'or, qui peut être stocké, protège ceux qui en possèdent des aléas de la vie, et garantit la pérennité des fortunes et celle des rapports sociaux.
Mais la suite austéritaire de l'étalon-or, en cas de crise, comme on l'a vu en 1929, c'est aussi la catastrophe assurée.
Paul Reynaud pourra écrire en 1936 : « La bourgeoisie meurt sans le savoir, du franc à 65 mg d'or, comme le nègre de l'Afrique meurt de la tuberculose sans savoir que c'est le bacille de Koch qui le ronge. Mais du moins, le nègre ne crie pas : « Vive le bacille de Koch ! » (In Jeunesse, quelle France veux-tu ? Gallimard 1936).
À quelques corrections mineures près, le propos demeure d'une étrange actualité.
c) Du franc fort à l'euro
C'est le projet européen qui permettra de donner forme au rêve du franc fort et à la réforme morale qu'il véhicule, un rêve partagé par une partie de la classe politique et nombre de hauts fonctionnaires en charge des finances publiques.
La stabilisation de la parité franc-mark, voire un franc dont la valeur serait supérieure à celle du mark fut l'une des obsessions permanentes de la classe politique française, jusqu'à la création de l'euro, qui réglait la question en pérennisant les contraintes qui vont avec : l'équilibre, idéalement l'excédent budgétaire, l'absence d'endettement et le sous-emploi.
Dans cette logique, en effet, la dynamique économique et l'emploi ne sont pas des objectifs en soit, mais les sous-produits espérés d'une bonne politique monétaire.
Faute de pouvoir parvenir au but directement par le développement d'une économie capable de rivaliser avec celle d'outre Rhin, il s'agissait au fond, pour Valéry Giscard d'Estaing puis pour François Mitterrand, de « ligoter » l'Allemagne en fondant son Deutsche Mark dans une monnaie européenne, ce dont elle se serait bien passé n'était, pour elle, l'absolue nécessité d'obtenir l'accord de la France à sa réunification 117 ( * ) .
L'affaire se conclura en plusieurs étapes :
- création du serpent monétaire européen par les accords de Bâle en 1972 dans le but de limiter les variations de parité entre les monnaies européennes consentantes ;
- entrée en vigueur du système monétaire européen (SME) en 1979, réduisant les marges de variation et créant une monnaie de compte commune l'Ecu ;
- création de la zone euro et de l'euro par le traité de Maastricht (1992) pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 1999.
Le moindre des paradoxes n'est pas que cette tentative, pour empêcher le flottement des monnaies européennes, coïncide avec le triomphe du néolibéralisme sur le vieux continent, néolibéralisme qui s'accommode mal d'une telle contrainte.
Comme le remarque Jacques Sapir, en effet : « Il ne peut y avoir une finance, des marchés de biens libéralisés et un système de change fixe, ce qui est le cas avec l'euro. L'euro n'est pas une monnaie, c'est un système de changes fixes, facteur de rigidités insupportables. Cela bloque la parité des changes entre les pays à un niveau donné. » 118 ( * )
Bien sûr, les déséquilibres ressortiront ailleurs. Faute de transferts entre les pays excédentaires et déficitaires, faute de pouvoir faire varier administrativement les taux d'intérêt entre pays, les membres de la zone ne peuvent plus que constater les variations du spread de la dette de chacun au gré des manoeuvres spéculatives des « investisseurs » et du jugement qu'ils portent sur son niveau d'endettement ou son déficit budgétaire. Des taux d'intérêt trop élevés dans les pays qui, comme la France, avaient dû défendre la parité de leur monnaie jusqu'à la création de la zone euro, puis leur équilibre budgétaire et leur niveau d'endettement au prix de la croissance et de l'emploi !
La morale enfin sauve, les moralistes avaient de beaux jours devant eux 119 ( * ) !
3. Les faux-semblants de la politique de l'offre
a) La théorie de l'offre
« Il est très difficile d'amener quelqu'un à comprendre une chose quand son salaire dépend précisément du fait qu'il ne la comprend pas »?!
Upton Sinclair
Dans la vulgate libérale, les seules interventions extérieures au marché, théoriquement et moralement acceptables, sont celles qui augmentent ou améliorent l'offre.
Selon la vieille « loi des débouchés » formulée par Jean Baptiste Say en 1803, mais partagée par beaucoup d'autres (Jos Mill, Ricardo...), à l'échelle de l'économie, l'offre crée sa demande, « c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits ».
Dans les échanges mercantiles en effet, la monnaie ne joue qu'un rôle facilitateur, de véhicule de la valeur des marchandises déjà produites. La production constitue une demande pour d'autres produits.
Dans ce schéma, une augmentation de la production crée un surplus de revenu (salaires, dividendes, intérêts) donc de monnaie appelant une production nouvelle et donc plus de travail.
À ceci près que, pour Keynes, la théorie n'est valable qu'autant que le supplément de revenu créé est dépensé ou investi au lieu d'être épargné ou de finir dans une « trappe à liquidité » pour reprendre son expression. Trappe d'autant plus profonde que les revenus de la production sont inégalement répartis.
Pour lui, c'est une part de l'explication du chômage, dans la mesure où, selon la conjoncture, les « investisseurs », par prudence, préfèrent garder leur capital sous forme liquide plutôt que de l'investir sous formes d'équipements ou d'usines. Attitude d'autant plus tentante que les occasions de spéculation à court terme sont nombreuses comme aujourd'hui.
Bien que la réalité se soit chargée de montrer qu'il ne suffisait pas de produire pour trouver des débouchés à la production et que la production pouvait ralentir du seul fait du manque de volonté d'investir, la « loi de Say » n'a rien perdu de son prestige et continue à s'imposer.
« La loi de Say, dira John K. Galbraith, demeure le cas le plus célèbre de stabilité des idées économiques même fausses » 120 ( * ) .
À moins que sous couvert de relance économique, le patronage de Say ne serve à dissimuler des transferts financiers publics vers des « investisseurs » devenus rentiers (voir partie V).
b) La théorie de l'offre appliquée
« Les allègements fiscaux sont la manière la moins efficace de stimuler l'économie. »
J. Stiglitz
Les interventions des pouvoirs publics en faveur de la production et de l'emploi sont financières et/ou réglementaires (c'est essentiellement la flexibilisation du « marché du travail »), plus rarement orientées vers la formation.
Que ce soit aux USA, au Royaume-Uni ou dans la zone euro, tout gouvernement qui se respecte entend régler la question du chômage par une réforme du marché du travail, réforme se réduisant largement à un habillage du chômage en sous-emploi.
Quant à la formation, si elle figure rituellement en fin des plans anti-chômage, les réformes qui ont dépassé le stade de l'intention se résument à un bricolage bureaucratique sans portée réelle.
Ces interventions directes ou induites sont essentiellement financières :
- apports en capital à l'entreprise sans spécification ;
- aides financières à la modernisation de l'équipement ou au développement de produits d'avenir ;
- subventions à la production de matériels stratégiques ;
- aides directes ou indirectes à la formation ;
- baisse des cotisations sociales et/ou des impôts ;
- interventions sur la production : baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, suppression de la taxe professionnelle ;
- interventions sur les revenus de la production : taux des impôts sur les dividendes, sur les cessions d'action etc. ; interventions sur le patrimoine financier susceptible de s'investir même s'il s'agit essentiellement de placements boursiers sans portée économique réelle ;
- transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière par exemple ;
- interventions sur le niveau d'imposition des hauts revenus pour attirer les « investisseurs ».
Cette politique de l'offre, en faveur de l'emploi, masque de moins en moins un transfert financier de l'État, donc de la collectivité, aux plus riches.
Pratiquée par Ronald Reagan (parmi les mesures emblématiques, entre 1982 et 1986, le taux marginal d'imposition passe de 75 % à 28 %) et par Margaret Thatcher (baisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu de 98 % à 40 % par exemple), cette politique sera un produit d'exportation vers tous les pays néolibéralisés, notamment la France.
Comme on le verra dans la partie V, de libéral, l'État néolibéral s'est ainsi transformé en garant d'un système de rentes de positions, acquises largement à crédit et de la maîtrise du pouvoir financier.
Ainsi, entre 1983 et 2018, le taux marginal de l'impôt sur le revenu baisse-t-il en France de 65 % à 45 % en même temps que baissait l'impôt sur les sociétés (permettant de distribuer plus de dividendes), et sur les dividendes et que l'ISF se transformait en impôt sur la fortune immobilière.
Moins voyantes, les aides à l'investissement sans contreparties et...sans grands résultats, comme le CICE, se développaient aussi.
Créé par amendement à la loi de finances pour 2013, en l'absence de toute étude d'impact, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), fut présenté comme une aide aux entreprises employant des salariés - avant de devenir en 2019, un classique allégement de charges sociales - afin d'élargir leurs marges et ainsi stimuler leurs investissements et leur capacité d'embauche.
Dès juillet 2016 un rapport de la commission des finances du Sénat, présenté par la sénatrice (PC) Marie-France Beaufils montrait que, si les marges des entreprises ont été améliorées 121 ( * ) , ce ne fut pas le cas de l'emploi, en tout cas pas de manière significative.
L'échec du CICE que confirmera l'évaluation tardive de France Stratégie (octobre 2018) retenant « un effet net qui serait proche de 100 000 emplois créés et sauvegardés qui se serait matérialisé sur 2014 et 2015 dans les entreprises les plus exposées au CICE » .
Et d'ajouter que le rapport « n'exclut pas que cet effet puisse être plus important en se référant aux résultats obtenus par une équipe qui concerneraient les entreprises moyennement exposées au CICE » .
Par l'usage du conditionnel : des résultats qui « seraient proches », et par l'amalgame entre emplois créés et emplois « sauvegardés » dont le nombre est parfaitement invérifiable, ce rapport montre qu'en fait on ne peut attester un quelconque effet sur l'emploi de ce cadeau fiscal de 36 Md€ aux entreprises.
Et quand bien même, 36 Md€ pour 100 000 emplois au démarrage et au final 110 Md€ (2013 et 2018), soit 1 % du PIB par an pour des résultats improbables, on devrait pouvoir trouver un meilleur usage des deniers publics pour développer l'emploi ! 122 ( * )
Le rapport sénatorial montrait en outre que les principales entreprises bénéficiaires étaient commerciales, notamment la grande distribution aux côté de l'industrie, les deux secteurs y entrant pour 19%, ce qui est peu, vu l'importance stratégique de l'industrie. Le CICE devait aussi être un outil de soutien aux petites entreprises.
Au final, l'aide sera « majoritairement captée par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, alors même que celles-ci représentent moins de 1 % des dossiers » .
Ainsi, en 2014, les grandes entreprises ont bénéficié de 30,2 % des crédits d'impôt, les PME de 32,7 %.
L'effet fut réduit aussi sur l'exportation, près de 80 % des aides étant allées aux entreprises réalisant moins de 10 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation.
Rappelons que le CICE avait été plébiscité par le MEDEF alors présidé par M. Pierre Gattaz, qui prévoyait la création d'un million d'emplois comme le montre un célèbre Pins édité à cette occasion par l'organisation patronale !
Devant le tollé suscité par ces révélations, le CICE sera remplacé, à partir de janvier 2019, par un classique « allégement des charges sociales », autre mesure dont l'efficacité n'a pas non plus été clairement prouvée, sauf pour les bas salaires et dont l'effet sur l'investissement et la compétitivité internationale est nul. 123 ( * )
Ainsi, l'apport de l'investissement à la faible croissance est toujours aussi bas. Paradoxalement, selon Romaric Godin 124 ( * ) plus bas même après la suppression de l'ISF et l'instauration de la « flat tax » sur les revenus du capital (PFU) qu'avant.
L'une des explications pourrait être que le redressement des marges des entreprises est venu renforcer les capitaux propres des entreprises sous forme de liquidités utilisables pour des opérations d'acquisitions.
Au final, contrairement au théorème de Schmidt (voir partie I A1), les avantages fiscaux ne se transforment pas en investissements et encore moins en emplois, mais en endettement pour acquérir des entreprises généralement étrangères.
Le choix est celui d'un développement externe et non celui de l'investissement susceptible d'améliorer la productivité de l'entreprise.
4. Les plans de relance par l'investissement
Les marchés dont dépend l'activité économique étant censés autorégulateurs, les seules interventions des pouvoirs publics licites pour la doxa néolibérale sont celles visant l'amélioration ou la stimulation des marchés :
- rétablissement et optimisation du fonctionnement des marchés financiers dont dépendent tous les autres échanges ;
- interventions sur l'offre visant à améliorer la concurrence en levant les obstacles au libre jeu des marchés ;
- baisses de la fiscalité et des cotisations sociales obligatoires ;
- amélioration de la « flexibilité » du marché de l'emploi ;
- suppression des contraintes réglementaires favorables aux employés, etc.
Si des interventions sur la demande (consommation et investissement) sont envisagées, c'est en cas d'extrême urgence et, sauf exception, elles doivent rester modestes, ponctuelles.
En réalité, avant d'être économiques, il s'agit d'opérations politiques de secours immédiat surtout destinées à montrer que les responsables publics ne restent pas inertes devant la crise.
C'est ce qu'on appelle vulgairement de la gesticulation politique 125 ( * ) .
Telle est la situation en zone euro et en France.
Aux USA - pourtant champions du libéralisme - les choses sont plus compliquées et surtout plus ambigües, dans la mesure où la pensée économique y est beaucoup moins monolithique qu'en Europe, où un pragmatisme politique traditionnel tempère sensiblement les lubies idéologiques et où le souvenir du New Deal et de Roosevelt n'a pas totalement disparu.
Si, politiquement, les républicains sont de farouches libéraux quand ils s'opposent à un Président démocrate, ils peuvent être hétérodoxes dans d'autres situations. Ainsi l'ARRA ( American Recovery & Reinvestment Act ) d'Obama, le plan de relance occidental le plus ambitieux de l'après-crise (839 Md$ au final seront dépensés) prend-il la suite du plan Paulson (TARP) sous mandat de George W. Bush, qui, de facture libérale, évoluera vers un interventionnisme économique plus net.
Quant à l'ARRA, c'est plus un plan de relance composite - baisses d'impôts, protection sociale, aides aux collectivités - qu'un plan massif d'investissement public.
Un plan qui sera partiellement saboté par les gouverneurs républicains largement majoritaires dans les états. Les quelque 158 Md€ sur trois ans d'aides fédérales y seront utilisés pour se désendetter plutôt que pour sauver les emplois publics ou investir.
Même ambigüité du plan de relance de Donald Trump qui correspond à un besoin criant, vu le délabrement des infrastructures publiques étasuniennes : 2 000 Md$ consacrés aux routes, à la réfection des ponts, aux écoles et au développement du réseau numérique haut débit... Mais il s'agit de 2 000 Md$ en 25 ans, soit 80 Md$ par an et 0,4 % du PIB étasunien. Pas vraiment de quoi changer la face du pays. D'autant moins que les Républicains, dont l'électorat est essentiellement non urbain, se moquent de ces investissements destinés d'abord à relier les grandes cités.
Le moteur de la croissance actuelle des USA reste bien le classique moteur libéral : l'abondance de liquidité et l'endettement.
Seule petite nouveauté dans ce paysage familier, une sorte de frémissement des oracles de la pensée unique qui, constatant les insuffisances de la politique de l'offre, en viennent à murmurer que l'heure pourrait être venue de stimuler la demande par une relance de l'investissement public.
Ainsi voit-on régulièrement des organismes officiels de stricte obédience néolibérale - FMI, OCDE et même BCE et Commission européenne - revenir sur le sujet dans des déclarations certes alambiquées, mais révolutionnaires dans leurs bouches.
Celle de Mario Draghi lors d'un discours à la BCE, gardien sourcilleux de la doctrine, le 18 juin 2019 en est un bon exemple : « La politique monétaire peut toujours atteindre son objectif seule, mais surtout en Europe, où les secteurs publics sont importants, elle peut le faire plus rapidement et avec moins d'effets secondaires si les politiques budgétaires sont alignées sur celle-ci. » On n'imagine pas son prédécesseur, Jean-Claude Trichet, dire de telles horreurs même en langage codé.
On peut cependant douter que ces hirondelles suffisent à faire le printemps de la relance.
Mais qu'est-ce qu'une relance par l'investissement « keynésienne », et pourquoi constitue-t-elle un outil de relance économique, à quelles conditions l'est-elle et pourquoi les plans de relance des trois Présidents de la République française qui se sont succédé depuis le krach de 2008 n'entrent-ils pas dans cette catégorie ?
a) La relance keynésienne par l'investissement
Il s'agit, en période de sous-emploi, de financer des travaux et des investissements publics de toute nature en vertu du principe qu'une dépense nouvelle de l'État de ce type, engendre une hausse de la production supérieure à la dépense initiale, ce qu'on appelle l'effet du « multiplicateur keynésien ».
Cette relance par l'investissement gagne, par ailleurs, à s'accompagner d'une redistribution des produits de l'activité économique vers les ménages les plus pauvres, dont la propension à consommer est la plus forte.
Selon Keynes, ce n'est pas l'épargne des riches qui permettra de relancer l'économie mais la consommation des pauvres et l'augmentation de la richesse collective par l'investissement.
Cela signifie donc que la solution à la stagnation économique ne passe pas par un enrichissement des plus riches (baisse de leurs impôts ou augmentation des revenus financiers susceptibles de leur revenir) mais par une augmentation des capacités de consommation, donc des revenus des moins aisés.
Côté investissement, la réussite de l'opération suppose que l'injection de liquidités par l'État n'engendre pas l'effet multiplicateur hors du pays (ou de la zone euro si c'est le niveau d'intervention choisi), en clair n'appelle pas une forte hausse des importations.
Ce qui suppose un bon ciblage des investissements engagés.
Ainsi, annoncer un plan de « relance vert » n'a aucun sens en termes économiques si on ne dit pas quelles seront les filières directement concernées et leurs effets en termes d'importations.
Comme le disait le FMI dès 2014, l'investissement public est absolument indispensable si l'on veut sortit l'économie mondiale de la stagnation, mais sa réussite est soumise à des conditions précises :
« L'augmentation de l'investissement public a un effet particulièrement fort sur la production si : 1. Cet investissement intervient en période de ralentissement économique et de politique monétaire accommodante, cette dernière limitant la hausse des taux d'intérêt face à l'accroissement de l'investissement. 2. L'efficience de l'investissement public est élevée, en ce sens que le surcroît de dépenses d'investissement n'est pas gaspillé, mais alloué à des projets ayant un rendement élevé . 3. L'investissement public est financé par l'emprunt, et non par une augmentation d'impôts ou la réduction d'autres dépenses, les deux options entraînant des baisses similaires du ratio dette publique/PIB. » 126 ( * )
Il faut aussi évidemment que le réamorçage de la machine économique ne soit pas immédiatement bloqué par une hausse des taux d'intérêt et une raréfaction monétaire, pour conjurer tout effet inflationniste, comme ce fut le cas pour la reprise de 2011, tuée dans l'oeuf par la BCE alors présidée par Jean-Claude Trichet.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une « relance keynésienne par l'investissement public » n'a rien à voir avec un arrosage général et non ciblé de liquidité type « quantitative easing » ou « hélicoptère monétaire » façon Milton Friedman, un « quantitative easing pour le peuple » a-t-on dit à l'époque !
Elle n'a rien à voir non plus avec un saupoudrage de mesures destinées au sauvetage d'entreprises en difficultés, du fait de la crise, opération certes louable, voire nécessaire, mais d'une autre nature.
Rien à voir enfin avec la politique néolibérale de développement par l'endettement sans contrôle, de krach financier en krach financier pratiquée aujourd'hui par les USA.
Pour Keynes, la relance doit intervenir à certains moments -ralentissement économique - et cesser, lorsqu'un niveau d'emploi suffisant est reconquis. C'est alors la limitation de l'endettement et la réduction de la masse monétaire qui s'imposent.
L'efficacité de la relance dépend enfin de la rapidité de sa mise en oeuvre. S'il faut attendre plusieurs années avant que les crédits prévus ne soient engagés, il y a fort à parier qu'elle se réduise à un effet d'annonce.
Dans un article intitulé Comment éviter la récession 127 ( * ) , Keynes expose ce que pourrait-être une politique permanente du plein emploi :
« Pour maintenir la prospérité, il faut qu'une juste proportion des ressources nationales, ni trop, ni trop peu, soit consacrée à l'investissement productif (...)
Il n'y a aucune raison de supposer qu'il existe quelque « main invisible », un mécanisme d'autocontrôle du système économique qui assure que le montant de l'investissement productif soit constamment au bon niveau. Il est même extrêmement difficile d'y parvenir délibérément, au moyen de ce qu'on appelle aujourd'hui la « planification ». Le mieux que nous puissions espérer est d'utiliser certains investissements, qu'il est relativement facile de planifier, comme compléments pour assurer dans la mesure du possible, la stabilité de l'investissement global au niveau approprié. Il y a trois ans, il importait d'utiliser la politique publique pour soutenir l'investissement. Il sera peut-être bientôt tout aussi important de retarder certains types d'investissement, afin de disposer des munitions nécessaires quand nous en aurons le plus besoin. »
« De même qu'il a été judicieux que le Gouvernement s'endette en période de crise, la politique inverse serait, pour les mêmes raisons, judicieuse aujourd'hui...C'est au moment d'un boom et non d'une crise, qu'il est opportun, pour le Trésor, de mener une politique d'austérité » .
Pour Keynes, le déficit budgétaire est un instrument de politique économique contra-cyclique et de plein emploi.
L'équilibre budgétaire n'est pas un objectif en soi, comme dans la théorie néolibérale où c'est d'abord un moyen de neutraliser le pouvoir économique de l'État et de peser sur les salaires.
Son objectif c'est le plein emploi.
« De même qu'il était judicieux de la part des autorités locales d'activer les dépenses de capital durant la crise, il le serait aujourd'hui qu'elles différent tous les nouveaux investissements qui peuvent raisonnablement l'être. »
« Une politique avisée de l'encouragement à investir exige (....) une longue préparation. Il est temps d'instituer un conseil de l'investissement public pour préparer des projets sérieux qui seront disponibles au moment où on en aura besoin. Si nous attendons que la crise soit là, il sera trop tard. Il faut mettre immédiatement en place une autorité dont la tâche ne sera pas d'entreprendre quoi que ce soit pour l'instant, mais de s'assure que des plans détaillés seront prêts. Aux compagnies de chemins de fer, aux autorités portuaires et fluviales, aux compagnies de gaz, d'eau et d'électricité, aux promoteurs immobiliers, aux autorités locales et, peut-être par-dessus tout, au London County Council et aux autres grandes municipalités réunissant de grandes concentrations de population, on devrait demander d'examiner quels projets pourraient utilement être mis en oeuvre si le capital était disponible à certains taux d'intérêt : 3,5%, 3%, 2,5%, 2%. La question de l'opportunité des projets et leur ordre de priorité devraient être examinés plus tard. »
La clef de la régulation du système, selon Keynes, c'est l'investissement.
L'un de ses déterminants est le taux d'intérêt qui en période normale parvient relativement à s'autoréguler. Mais la régulation par le taux d'intérêt ne suffit pas.
Si à la fin de la théorie générale, Keynes écrit qu' « aussitôt que les contrôles centraux auront réussi à établir un volume global de production correspondant aussi près que possible au plein-emploi, la théorie classique reprendra tous ses droits ». Il ajoute : « Au surplus, il est improbable que l'influence de la politique bancaire sur le taux de l'intérêt suffise à amener le flux d'investissement à sa valeur optimum. Aussi pensons-nous qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avèrera le seul moyen d'assurer approximativement le plein-emploi (...) ».
Depuis le début de la Grande crise, trois Présidents de la République se sont succédé en France, donc trois plans de relance par l'investissement public. On en attend toujours les effets.
b) Les faux plans de relance français
(1) Le plan de relance Sarkozy
C'est évidemment chronologiquement le premier puisque engagé en décembre 2008. Disons à la décharge de l'intéressé que c'était la première fois qu'un chef d'État français se trouvait confronté à un pareil problème et qu'il était entouré de banquiers qui, comprenant encore moins que lui ce qui se passait, - comme Jean-Claude Trichet, président de la BCE - ne voulaient rien faire, pensant que la situation se normaliserait d'elle-même.
« Face à une crise mondiale qui va tout changer, expose Nicolas Sarkozy , c'est la seule manière de préparer les emplois de demain », avant d'ajouter « nous avons des retards d'investissements considérables depuis des décennies, car la France sacrifie depuis trop longtemps l'investissement au fonctionnement. »
En fait de plan « audacieux et ambitieux », il s'agit d'un plan trop modeste pour être autre chose qu'un calmant passager des douleurs les plus vives : montant 26 Md€ sur 2 ans (soit 13 Md€ annuels en moyenne et 0,6 % du PIB).
Globalement les investissements de l'État (logements sociaux, rénovation urbaine, réseaux de transport et investissement des collectivités territoriales, ne dépasseront pas 7,5 Md€ soit moins de 30% des engagements financiers.
Le reste des dispositions est un bric-à-brac d'assouplissements réglementaires (en matière d'urbanisme et du code des marchés, notamment), de mesures de soutien aux constructeurs et sous-traitants de l'automobile (mesure phare : une « prime à la casse » des vieux véhicules), d'exonération de charges patronales, et surtout d'accélération du paiement de dettes de l'État envers les entreprises, 11,5 Md€, soit beaucoup plus que les aides à l'investissement !
Compter le paiement de ce qu'on doit pour une aide, il fallait oser !
Selon le bilan du Plan de relance fait par la Cour des comptes en septembre 2011, son impact sur la croissance aurait été d'environ 0,5 point de PIB sur 2009 et 2010, pour une dépense de 1,4% du PIB. C'est que ce plan étant essentiellement centré sur le soutien à la trésorerie des agents économiques, ses effets ont été « diffus », dixit Didier Migaud - tout récemment nommé président de la Cour par Nicolas Sarkozy - pour qui le plan « a sans conteste permis d'atténuer les effets de la crise ». Voilà qui est beaucoup s'avancer !
Sur quoi reposent ces évaluations dont la précision dépasse celle de l'outil ayant servi à les établir et comment des dépenses annoncées de 0,4% du PIB par an se sont-elles transformées en dépenses de 0,7% ? Mystère...
D'autant plus grand que beaucoup de bons esprits pensent qu'en réalité c'est la Chine qui a permis à l'époque le sursaut de l'économie mondiale par un plan de relance massif de l'ordre de 1 000 Md$ et, par ricochet, de celle des autres pays en leur ouvrant des débouchés.
(2) Les plans de relance Hollande
Les plans de relance européens de François Hollande seront nettement plus ambitieux mais encore plus évanescents que le précédent.
Dès juin 2012 François Hollande milite pour un plan européen de 120 Md€ (moins de 1 % du PIB de l'UE) :
- 55 Md€ de fonds structurels en direction des régions pauvres non utilisés ;
- recapitalisation de la BEI de 10 Md€ (dont 1,6 Md€ pour la France et l'Allemagne) ce qui doit lui permettre d'emprunter 60 Md€ pour financer des projets d'infrastructures ;
- création de 4,5 Md€ de « project bonds » 128 ( * ) , d'emprunts contractés en commun par les pays européens pour garantir des chantiers de grandes entreprises.
En réalité, seuls 10 Md€ seront réellement mobilisés par les États européens, le reste du plan se limitant à réorienter des fonds existants et à des dispositions censées attirer l'investissement privé.
Même fiasco s'agissant de la proposition de financement des « projets d'avenir » par le budget européen qui d'ailleurs baissera durant le quinquennat de François Hollande.
Fin juin 2014, le Président français voit encore plus grand. Après concertation avec les chefs d'État socio-démocrates européens, il dévoile son "agenda pour la croissance et le changement en Europe".
C'est un programme d'investissements de cinq ans, financé par l'Europe, les nations, l'épargne privée et les grands « investisseurs ». Un plan à hauteur de 2 % du produit intérieur brut, soit environ 240 Md€ par an 1 200 Md€ en cinq ans.
Les secteurs concernés sont les infrastructures, la recherche, l'énergie, la formation des jeunes et la santé.
Le projet se perdra dans les sables européens.
En fait, si, selon le lieu commun, en Europe, il n'y a pas de solution à la crise sans l'Europe, constatons qu'il n'y en a pas non plus avec l'Europe et que poser ainsi le problème c'est se condamner, en l'état, à la gesticulation et à l'impuissance.
Le néolibéral François Hollande le sait très bien, lui qui n'hésitait pas à déclarer que « c'est l'offre qui crée la demande » 129 ( * ) et dont l'action économique s'est résumée à alléger les charges des entreprises (voir plus haut l'exemple du CICE), soit un coût d'environ 10 Md€ par an pour les finances publiques durant le quinquennat et la principale dépense fiscale de l'État. Avec pour résultat une augmentation de 560 000 chômeurs entre mai 2012 et juin 2017.
(3) Le plan de relance d'Emmanuel Macron
Figure imposée de tout début de présidence, dès août 2017, le Premier ministre d'Emmanuel Macron annonce un « grand plan d'investissement » (GPI) de 50 ou 57 Md€ selon les annonces, sur cinq ans, promptement présenté par les commentateurs médiatiques comme un New Deal à la française.
La comparaison est étrange puisque, conformément au principe de « l'en même temps », cher à la pensée complexe du président Macron, ces dépenses s'accompagneront, selon le Premier ministre, d'une politique de baisse des dépenses publiques.
D'autant plus étrange, qu'à en croire les experts du FMI (voir ci-dessus l'extrait de leur rapport de 2014), l'une des conditions de la réussite d'un plan de relance est justement que « l'investissement public est financé par l'emprunt, et non par une augmentation d'impôts ou la réduction d'autres dépenses, les deux options entraînant des baisses similaires du ratio dette publique/PIB. »
Plutôt habituelle cette fois, la modestie de l'engagement financier théorique de 11,4 Md€ par an dans le meilleur des cas, soit moins de 0,4% du PIB, à comparer avec les sommes engagées par l'ARRA d'Obama - 839 Md$ sur trois ans - soit près de 2% du PIB par an (5 fois plus) chaque année.
Habituel aussi le recyclage des fonds de tiroirs budgétaires et des moyens existants comme le soutien à la rénovation des bâtiments ou le « geste en direction des collectivités » pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe.
Si l'on tient compte en outre du fait que 6 Md€ viendront du recyclage des fonds du « Programme d'investissement d'avenir » de François Hollande, l'effort financier supplémentaire réel se monte à 24 Md€. Tout simplement risible. 130 ( * )
Quand on examine le détail des domaines concernés on se perd encore plus en conjecture.
Il s'agit, précise Édouard Philippe, de financer des actions « à caractère non pérenne, en vue d'effets durables, mesurables à horizon de la fin de la mandature ».
Exemple : développer les compétences facilitant l'accès à l'emploi des chômeurs de longue durée et des jeunes sans qualification, d'accélérer la transition écologique, de redéfinir la politique de transports, de stimuler la montée en gamme des filières agricoles, de transformer l'action publique et de moderniser le système de santé, de valoriser l'enseignement supérieur et la recherche, de stimuler l'innovation et la modernisation des entreprises.
On a un peu de mal dans ce catalogue à repérer ce qui relève des dépenses de fonctionnement et ce qui relève de l'investissement. Il faut avouer que comprendre ce que pourraient être des investissements non pérennes n'est pas à la portée de n'importe qui.
Il est donc clair que le plan de relance d'Emmanuel Macron n'en est pas un, ce que confirme le rapport de Jean Pisani-Ferry 131 ( * ) qui l'accompagne. Dès l'avant-propos, il vend la mèche : ce n'est pas un plan de relance, tout simplement parce que « la nécessité d'un programme de relance ne s'impose pas aujourd'hui ».
Inutile donc de s'arrêter aux chiffres ! Il faut quand même oser !
5. Un système financier parasite (voir annexe 4 de cette partie)
« La création de crédits est une chose trop importante pour être laissée aux banques »
Adair Turner
Une autre cause de la stagnation économique, alors même que liquidités banque centrale et scripturales abondent, que les taux d'intérêt restent très bas, c'est que précisément l'essentiel de la masse monétaire se perd dans la sphère spéculative sans venir irriguer l'économie réelle.
Ainsi, par exemple, nombre de grandes entreprises préfèrent, plutôt qu'investir, utiliser leurs excédents dans le rachat de leurs propres actions pour en faire monter le cours et leur fortune avec, ou pour racheter leurs concurrents.
Quant aux « fonds d'investissement », la plupart n'ont d'autre objectif que la plus-value spéculative, souvent à crédit.
a) Les sources de financement de l'économie « réelle »
Il existe deux sources de financement extérieures d'inégale importance : les prêts bancaires (un peu plus de 1 000 Md€) et le marché selon deux modalités, les émissions d'actions (de l'ordre de 30 Md€ en 2017, année exceptionnelle !) et d'obligations (de l'ordre de 600 Md€ en 2017) 132 ( * ) .
Des chiffres généralement réservés aux initiés et très volatiles car dépendant surtout des opérations des grandes entreprises. Les autres devront se débrouiller autrement.
Ainsi, en 2015, les entreprises high tech dans lesquelles le Gouvernement voit le salut de la France n'ont-elles pu lever que quelque 330 M€ auprès des investisseurs boursiers.
Le financement par les marchés (en hausse depuis quelques temps) est essentiellement pratiqué par les grandes entreprises multinationales, surtout en vue du rachat d'entreprises concurrentes (fusions acquisitions) ou pour doper la valeur boursière de l'entreprise, comme on l'a dit.
Ainsi la valeur boursière de LVMH était-elle fin 2018 de 186 Md€ avec un endettement de 5,48 Md€, un chiffre d'affaires de 46,8 Md€ et un bénéfice de 6,4 Md€
S'y ajoute l'autofinancement : 197 Md€ dont 41,8 Md€ pour les activités immobilières 133 ( * ) .
Si maintenant on compare le volume des échanges boursiers et ce qui concerne spécifiquement les investissements relatifs aux entreprises, on a quelques surprises.
Ainsi, sur les quelques 2 223 Md€ de transactions sur Euronext en 2017, 630 Md€ seulement (actions + obligations), soit 28,3 % des transactions, concernent le financement de l'économie au sens large.
Si on tient compte du fait qu'au moins 60 % des transactions s'effectuent sur le marché secondaire 134 ( * ) , le ratio est très probablement inférieur à 20 %.
Moins encore si on tient compte du fait que le rachat de ses propres actions par une entreprise est devenu courant.
Compte tenu de l'opacité du système, il est difficile d'être plus précis ou a contrario de dire si les études concluant que pas plus de 5% de l'activité boursière a pour objet le financement de l'économie a quelque fondement.
En tout cas, « ces montants donnent la mesure de ce que sont devenus les marchés boursiers, la place de Paris s'inscrivant dans un mouvement mondial.
Ce ne sont plus des places - des marchés primaires - dont la fonction est de permettre à des sociétés d'accéder à des capitaux disponibles mais des marchés secondaires, d'occasion, où se négocient des titres sans relation directe avec les sociétés. Le lien avec les entreprises n'est désormais que subalterne. » 135 ( * )
Autrement dit, ce sont des instruments de spéculation.
Ce qui vaut pour les marchés financiers vaut aussi pour l'activité bancaire dont les prêts aux entreprises passent pour être la principale préoccupation de l'institution.
Sauf que les quelques chiffres dont on dispose disent le contraire.
Ainsi selon Stat Info (juillet 2019), publication officielle de la Banque de France : « À la fin mai 2019, les crédits [bancaires] mobilisés par les entreprises atteignent 1 023,1 Md€, en hausse de 6,2 % sur un an... »
Premier constat : les crédits d'équipement représentent seulement 448 Md€ d'euros, les crédits immobiliers, de trésorerie (court terme) et autres, le reste.
Deuxième constat : l'ensemble des crédits aux 1 119 630 PME représente 433 Md€.
Troisième constat : le rapport montant des crédits aux entreprises en général/bilan 2016 du système bancaire français est de 13,75%, celui des crédits d'équipement aux entreprises en général / bilan 2016 du système bancaire français est de 6,02 % et celui des crédits d'équipement aux petites et moyennes entreprises (PME) / bilan 2016 du système bancaire français est de 2,52 %. 136 ( * )
Tout en gardant présent à l'esprit l'impossibilité de savoir ce que recouvrent exactement les chiffres publiés par les banques - un prêt à une entreprise non financière peut, par exemple, financer ses investissement mais aussi une opération immobilière ou le rachat de ses propres actions - ces évaluations sont cohérentes avec la majorité de celles dont on dispose.
En tout cas, la conclusion est toujours la même, le financement de l'économie réelle n'est pas davantage la première préoccupation du système bancaire qu'elle n'est celle des systèmes boursiers.
Lors de son audition au Sénat en février 2016, Jézabel Couppey-Soubeyran a donné les ordres de grandeur suivants : « La part du crédit aux entreprises au bilan agrégé du secteur bancaire français s'élève à 10 %. La part du crédit aux PME à 5 %, alors que les banques sont censées financer les entreprises qui ont le moins de possibilités alternatives de financement. On se demande ce qu'il en est des 95 % restants... L'activité des grandes banques européennes n'est plus tournée vers l'activité de crédit aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire » 137 ( * ) .
Selon France Stratégie, l'investissement productif en France se monte à 360 Md€, tandis que l'ensemble actifs placés sur les marchés (actions cotées + obligations) + crédits bancaires aux entreprises (hors immobilier) + fonds propres représente 3 007 Md€, soit pour l'investissement 11,9 %. (voir annexe 2 de cette partie)
On retrouve le même ordre de grandeur.
Un ordre de grandeur que l'on retrouve ailleurs qu'en France, au Royaume-Uni et ailleurs où, selon Alan Turner « la part du crédit qui finance l'investissement dans des actifs autres qu'immobiliers n'est que de 14 % ; dans les grandes lignes on observe le même phénomène dans toutes les économies avancées et, de plus en plus, dans les économies émergentes. »
Il s'agit donc d'un phénomène général inhérent au système néolibéral et non spécifique de tel pays.
Ce dont, évidemment, se défendent vigoureusement les premiers intéressés.
Ainsi la Fédération bancaire française et la Banque de France, évitant de donner des chiffres qui pourraient remettre en cause la privatisation du pouvoir et des moyens de financement de l'économie, préfèrent regarder ailleurs et braquer le projecteur sur la hausse en pourcentage (relativement récente) des crédits bancaires aux entreprises.
La dernière plaquette publicitaire de la Fédération bancaire française (janvier 2019), par exemple, s'intitule avec le plus grand sérieux : « Entreprises et PME : première priorité des banques françaises ». 138 ( * )
À l'intérieur de la plaquette, outre les variations classiques sur l'augmentation des pourcentages de crédits aux entreprises (sur un an, par jour, par heure), un savant brouillage des chiffres mêlant prêts aux ménages (sans spécification de quels types de ménages il s'agit) et crédits aux entreprises (sans précision non plus), transformés ainsi en crédits à l'économie, et surtout des affirmations dont on ignore le fondement :
- que moins de 2 % des PME et TPE ne demandent pas de crédits bancaires par peur d'un éventuel refus ;
- qu'avec 20 % du total des actifs des banques 139 ( * ) , les crédits aux entreprises représentent l'une des premières [ce qui signifie que ce n'est pas la première !] expositions des établissements de crédit français.
Par conséquent, on ne peut que prévenir les PME et les entreprises et défendre les banques françaises contre les méfaits de Bâle III !
Outre les chantres officiels du système bancaire français, Patrick Artus est, à notre connaissance, l'un des rares économistes à contester que le système bancaire français contribue peu au financement de l'économie du pays :
« Si on regarde les chiffres de la Banque de France, la masse des crédits bancaires aux entreprises représente 60 % du PIB et ça augmente de 6 % par an. Tous les ans on met 3,6 points de PIB en crédit supplémentaire dans l'économie. C'est beaucoup. Les investissements des entreprises c'est à peu près un tiers des investissements. Un tiers des investissements se fait par le crédit bancaire ... »
Outre que 1 043 Md€ de crédit bancaire aux entreprises en 2019 représente seulement 45,7 % du PIB 2018, les crédits d'équipement (hors immobilier et crédits de trésorerie à court terme) représentent 19,7 % du PIB et les crédits aux PME 1,9 % de ce même PIB.
Ce que Patrick Artus reconnaît d'ailleurs : « le vrai sujet est le financement des petites entreprises, les TPE et les start-up. »
Plus surprenante, l'affirmation selon laquelle « dans le bilan de l'ensemble des banques françaises, le crédit représente à peu près 80 % du bilan de la banque. Le crédit aux ménages et aux entreprises, c'est à peu près moitié-moitié. Ça fait 80 % du bilan des banques. Que font-elles d'autre les banques ? »
Sauf qu'en admettant que le crédit aux entreprises représente 40% du bilan de l'ensemble des banques françaises, on prétend que l'encours bancaire du crédit aux entreprises est de 2 920 Md€, ce qui n'est évidemment pas le cas.
L'argument en défense le plus courant, cependant, c'est que la modestie de la contribution du système bancaire au financement de l'économie renvoie à l'absence de la demande des entreprises elles-mêmes, réticence dont l'origine - comme entend le prouver le sondage rappelé plus haut - n'est pas la crainte d'un refus.
Une explication qui est loin de faire l'unanimité. « Si l'on se fie à ce que disent les statistiques, nous dit Pierre-Charles Pradier 140 ( * ) , évidemment, tout va bien : le volume de prêts aux entreprises augmente plus vite que l'inflation et les taux des prêts aux entreprises sont les plus bas de l'Union européenne. Les statistiques disent qu'il n'y a pas de contrainte.
Mais, on n'arrive pas à rapprocher ces chiffres de la demande potentielle.
Et en effet, il y a des centaines de milliards de volume de prêts, mais ce que l'on ne peut mesurer, ce sont les demandes insatisfaites : il y a des entreprises qui ne vont même plus voir les banques, tellement elles savent qu'elles n'obtiendront pas ce qu'elles demandent. Beaucoup d'entrepreneurs français pensent à des stratégies non-bancaires pour monter ou augmenter leurs boites. »
Et quand bien même la faiblesse de la demande expliquerait la modestie de l'engagement du système bancaire dans le financement de l'économie, resterait à expliquer ce manque de confiance des chefs d'entreprises dans l'avenir et surtout pourquoi continuer à entretenir un système bancaire aussi énorme et dangereux que peu utile à la collectivité ?
Pourquoi accepter cette bombe à retardement sans utilité sociale évidente ? Et pour reprendre l'interrogation de Patrick Artus, si elles ne financent pas l'activité productive « que font-elles d'autre les banques » ?
Si on entend par spéculation tout placement d'argent visant l'acquisition de tout ou partie d'un bien, d'une action, d'un titre de créance, d'une entreprise existante, dans l'espoir de voir monter son prix, la réponse est : elles spéculent. Et ce sont ces activités spéculatives multiformes, plus ou moins directes et officielles, qui expliquent l'importance des bilans bancaires qui, en France, représentent 3,25 fois le PIB national et, en Europe, 2 fois le PIB européen !
À part ça, la première préoccupation du système bancaire, comme du système financier en général d'ailleurs, c'est le financement de l'économie !
b) Un système financier qui fonctionne sur lui-même et pour lui-même
Le signe le plus évident de la déconnexion entre les sphères financière et économique, c'est :
1- l'écart entre le volume de la richesse économique mesurée par le PIB et celui des bilans bancaires, de la dette ou des produits financiers (voir tableau partie I).
Pour prendre le seul exemple de la France : la dette totale représente 2,75 fois le PIB ; le bilan consolidé du système bancaire 3,25 fois le PIB et la valeur des sous-jacents des produits dérivés, 33 fois le PIB français.
En fait, 7 % seulement des produits dérivés couvrent des risques économiques, ce qui signifie « que 93 % de ces produits servent à spéculer ou faire des jeux qui ne servent à rien pour l'économie réelle. » 141 ( * )
2- l'écart considérable entre les taux de croissance de la richesse réelle et de la valeur des produits financiers.
Selon Jean Michel Naulot, la déconnexion entre bourse et économie réelle date des années 1980. Avant ce tournant, la progression du PIB et de l'indice Dow Jones allaient de pair.
Les délocalisations et les paradis fiscaux ne suffisent pas à tout expliquer. En tous cas, entre les années 1990 et 2017, le Dow Jones a été multiplié par 30, le PIB des USA se contentant lui de doubler !
En France, si le phénomène est moins spectaculaire, il n'en existe pas moins. Sur une longue période, entre 1988 142 ( * ) et 2018, le Cac 40 a été multiplié par 5,52 et le PIB par 2,45. Sur une courte période, entre le point bas de l'indice après la crise en 2009 et juillet 2019, l'indice a été multiplié par 205 %, pendant que le PIB progressait de l'ordre de 19,5 %.
Comme on le voit, la stagnation économique n'empêche pas les actions de monter.
La crise n'a rien changé puisque depuis, en neuf ans, les indices boursiers à Wall Street ont augmenté de 300 %, alors que l'économie réelle peinait à enregistrer une croissance moyenne de 2 % par an. 143 ( * )
Depuis l'élection de Donald Trump, les marchés d'actions ont progressé de 30 %, l'argent de sa réforme fiscale en faveur des entreprises ayant servi essentiellement au rachat de leurs actions : doublement des mouvements (1 000 Md$) en 2017 et +20 % sur les dividendes.
Le principal gouffre qui aspire la production monétaire, qu'elle provienne des banques commerciales ou des banques centrales, c'est l'immobilier 144 ( * ) .
« Dans la plupart des systèmes bancaires modernes, l'essentiel du crédit ne sert pas à financer de nouveaux investissements , soutient Adair Turner . Il finance l'achat d'actifs déjà existants, au premier rang desquels des biens immobiliers anciens. » 145 ( * ) Immobilier pour le logement, immobilier d'entreprise et de bureaux.
C'est inévitable dans la mesure où l'immobilier constitue la majorité de toute la richesse dans toutes les économies développées.
Le prêt immobilier individuel est utile socialement et le prêt hypothécaire ou la garantie de l'existence d'un patrimoine sont une garantie incomparable pour le banquier.
Toujours selon Adair Turner, la proportion des crédits immobiliers spéculatifs, c'est-à-dire utilisés à l'acquisition d'actifs déjà existants, a considérablement augmenté depuis 45 ans.
Elle passe de quelque 32 % en 1950 à près de 60 % en 2008, une part importante des 40 % restant étant allouée à l'immobilier commercial.
« En 2007, les banques de la plupart des pays étaient devenues des prêteurs immobiliers. L'intermédiation de l'épargne des ménages vers l'investissement productif dans les entreprises - le rôle normal du secteur financier, à en croire les manuels - ne constitue qu'une part mineure de l'activité foncière aujourd'hui. » 146 ( * )
Apparemment le krach de 2007-2008, d'origine immobilière, n'a rien changé.
« En France, la dette immobilière a atteint 1 000 Md€ : soit un doublement depuis 2008, un quadruplement depuis 2000 ! Quand on sait que ces crédits sont accordés au taux de 1,5 % avec une durée moyenne de 20 ans, cela laisse rêveur... Et au Canada, c'est le double ! » (Jean-Michel Naulot)
On pourrait peut-être se satisfaire de cette situation si elle avait apporté un début de solution à la crise endémique du logement en France, si elle ne reflétait pas la croissance de la valeur du foncier plutôt que celle du bâti.
Tel est le cas, particulièrement, dans les grandes métropoles où 80 % de l'augmentation de la hausse du prix de l'immobilier entre 1950 et 2012 renvoie à celle du prix du m², les 20 % restant à l'augmentation des surfaces construites.
Avec des effets proprement surréalistes 147 ( * ) et un démenti au lieu commun, selon lequel notre économie serait de plus en plus immatérielle !
Comme au Moyen-Âge, la richesse et la puissance, c'est la possession du sol au bon endroit.
Le nouveau mode d'urbanisation (partie IV) ne signifie pas autre chose.
L'immobilier est devenu une « classe d'actifs » dans laquelle on investit non seulement pour améliorer le logement sous toutes ses formes mais aussi pour les plus-values qu'on en espère. Pour les banques, c'est le type même de l'investissement sûr, bien plus en tous cas que les prêts aux entreprises.
Pas étonnant donc si, comme le note encore Turner, « dans l'histoire économique moderne, crédit et prix immobilier évoluent en parallèle. De 2000 à 2007, avant la dernière crise, le crédit hypothécaire aux États-Unis a augmenté de 134 % et le prix de l'immobilier de 90 % ; en Espagne, les hausses ont été de 254 % et 120 % ; en Irlande de 336 % et de 109 %. »
L'autre grand gouffre spéculatif dans lequel disparaît l'essentiel de la création monétaire, ce sont les marchés financiers.
Une solution de facilité pour les banquiers, comme le fait remarquer Thierry Philipponnat, parce que c'est plus lucratif et moins fatigant que le financement de l'économie.
Les agences fournissent des évaluations toutes prêtes des risques d'investissement financier, ce qui n'est pas le cas du risque entrepreneurial. Des robots, comme on l'a vu, peuvent même se charger de la gestion de votre portefeuille.
La Bourse elle-même n'est qu'un rouage de la machine spéculative.
« Les entreprises lèvent leurs capitaux auprès des investisseurs privés, et lorsqu'elles vont en Bourse, c'est pour permettre aux actionnaires de vendre. La Bourse n'est pas le lieu où l'on finance, mais où l'on encaisse, par le biais des cessions, des dividendes et surtout des rachats d'actions (qui n'entraînent pas de frottement fiscal, à la différence des dividendes), qui ont dépassé les 800 Md$ en 2018. » 148 ( * )
Il en résulte le détournement du flux monétaire du financement de la production de richesses nouvelles. « C'est un système qui non seulement crée de l'instabilité financière - parce que c'est évidemment fragile - mais surtout détourne, stérilise, des masses de capitaux de l'économie réelle vers un jeu - je concède ne pas l'appeler spéculation... Ça stérilise tout, je suis totalement d'accord. » ( Thierry Philipponnat)
Dans la langue diplomatique de Mario Draghi, s'interrogeant sur les effets économiques de la première émission de 1 000 Md€ de crédits à bas coûts, cela donne : « nous avons peu de preuves que cela ait atteint l'économie réelle ».
Constatons, en tous cas, que les instances européennes ont préféré ignorer ce problème et que ce n'est pas le projet européen d'union bancaire et des marchés de capitaux européens qui, bien que l'une des « grandes priorités de l'UE », en l'absence de volonté des principaux acteurs, y changera quelque chose
Cette déconnexion des sphères n'est pas nouvelle, mais, comme le fait remarquer Romaric Godin, aujourd'hui, si « la sphère financière se porte bien, si les marchés sont à des niveaux historiquement élevés (...) tout cela s'est fait avec un sous-jacent économique très faible. »
Ce qui était moins le cas avant la crise des valeurs internet, dans les années 1999-2000.
« Vous aviez certes une déconnection entre les marchés financiers et la réalité économique mais on avait quand même une croissance qui s'était très fortement accélérée à la fin des années 90 ».
La nouveauté donc, c'est qu'on ne peut même plus prétendre que la spéculation est le prix à payer du développement, quels qu'en puissent être les risques.
C'est toujours un prix à payer mais exclusivement pour l'enrichissement d'une minorité.
Une mécanique d'autant plus difficile à démonter qu'apparemment -en tous cas selon la « science » économique - la débauche de création monétaire ne semble créer aucune inflation sérieuse.
Constatons cependant que les actifs étant convertibles par le canal boursier, voire de gré à gré, en monnaie banque centrale, ils fonctionnent comme une quasi-monnaie, laquelle permet la captation de biens rares au détriment de ceux qui ne disposent pas de la même faculté.
Cet effet d'éviction est particulièrement évident en matière immobilière.
Il s'agit en fait d'un transfert de richesse des actifs vers les rentiers de la spéculation, sans effet apparent d'inflation, vu le mode de calcul de celle-ci, ce qui l'aurait rendu plus visible.
Le jeu spéculatif est peut-être à somme nulle, les pertes des uns équilibrant les gains des autres, mais à « somme sociale non nulle », dans la mesure où ceux qui gagnent n'appartiennent pas aux mêmes catégories économiques (actifs/non actifs) ou sociales que ceux qui perdent.
Il ne s'agit plus de simples jeux de casino marginaux, comme les décrivait Keynes, mais d'une mécanique de captation des biens rares par le biais d'enrichissements réalisés largement à crédit, autrement dit par la grâce de ceux qui ont le pouvoir de le distribuer.
Cela donne l'impression que la sphère financière, fonctionnant selon ses propres règles, dominant les pouvoirs politiques, ne pèse pas seulement sur la société par son incapacité à jouer son rôle économique naturel mais plutôt comme le parasite qui perturbe et dévitalise son hôte.
Ce qui rejoint la réflexion de Gunther Capelle-Blancard : « Même s'il est difficile de les quantifier, on a légitimement l'idée qu'on a affaire à des activités presque parasitaires, qui se développent, au sens biologique du terme. Il n'y a pas de déconnexion [entre finance et économie réelle] : le parasite se nourrit de la bête, le développement du parasitaire n'a pas d'utilité, il n'y a pas de déconnexion, il y a même une symbiose entre eux. Si on coupe ce lien, le parasite meurt. » 149 ( * )
Le constat d'Adair Turner est édifiant : en Grande-Bretagne, en 1960, le bilan bancaire typique était constitué à 90 % par des prêts à l'économie réelle (entreprises et ménages), des obligations d'État, et les réserves à la banque d'Angleterre.
« En 2008, l'interbancaire représentait bien plus de la moitié des bilans de la plupart des grandes banques du monde (...) : liens contractuels, sous la forme de prêts/dépôts ou de produits financiers dérivés, entre ces banques et leurs homologues, ou entre elles et d'autres établissements financiers, comme les fonds du marché monétaire, les investisseurs institutionnels ou les fonds spéculatifs. » 150 ( * )
ANNEXES DE LA PARTIE II
Annexe 1 : La statistique enchantée du chômage
Alfred Binet répondait à ceux qui lui demandaient de définir l'intelligence : « L'intelligence, c'est ce que mesure mon test » .
Il en va de même du chômage : c'est ce que mesurent les statistiques officielles, variables selon les pays et les choix méthodologiques.
Il en résulte une grande liberté d'interprétation de la situation selon le commentateur et les circonstances.
Ainsi, Donald Trump à peine élu, peut-il dresser devant le Congrès le 28 février 2017, un tableau dramatique de la situation de l'emploi laissée par son prédécesseur 151 ( * ) et quatorze mois plus tard, en mai 2018, annoncer dans un tweet jubilatoire que le taux de chômage étasunien vient de percer le plancher des 4 % (3,9 %), signe évident de la réussite de sa politique.
Pour saisir l'ampleur du miracle et ce que signifient réellement les chiffres du chômage étasunien, il faut descendre dans les arcanes de leur production, assez différente de la nôtre.
Selon la nomenclature du Bureau de la statistique du travail (BLS), entre janvier 2017 et janvier 2018, corrigées des variations saisonnières, les données sont les suivantes (en millions) :
|
Janvier 2017 |
Janvier 2018 |
Mars 2019 |
|
|
Population civile non institutionnelle 152 ( * ) |
254,082 |
256,780 |
258,537 |
|
Population active |
159,718 |
161,115 |
162,960 |
|
Taux de participation |
62,9% |
62,7% |
63% |
|
Population en emploi |
152,076 |
154,430 |
156,748 |
|
Taux d'emploi |
59,9% |
60,1% |
60,6% |
|
Chômeurs |
7,642 |
6,684 |
6,211 |
|
Taux de chômage |
4,8% |
4,1% |
3,9% |
|
Population hors marché du travail |
94,364 |
95,665 |
95,577 |
|
Actuellement à la recherche d'emploi |
5,719 |
5,171 |
|
|
Marginaux hors de la population active |
1,769 |
||
|
Personnes à temps partiel (raisons économiques ou non) |
30,034 |
Ce qui signifie qu'en mars 2019, il y avait 95,577 millions de personnes, plus 1,769 million d'Américains sans emploi aux USA, soit 37,7 % de la population de plus de 16 ans susceptible de demander un emploi, et 30 millions d'employés à temps partiel. Même si taux de participation et taux de chômage ne sont pas directement comparables, il y a de quoi relativiser le taux de chômage de 4,1 % en janvier 2018 et de 3,9 % en avril 2019.
L'influence du taux de participation sur celui du chômage est, en effet, considérable. Ainsi, à structure de population équivalente et avec un taux de participation de 66,3 % (taux moyen pour la période 1990-2008), le taux officiel du chômage serait de 9,1 % et non de 3,9 %.
Parmi les facteurs invoqués pour expliquer la baisse régulière du taux de participation, il en est de naturels comme le vieillissement de la population ou l'augmentation du nombre d'étudiants 153 ( * ) , et d'autres, comme la dépendance croissante aux opiacés et aux tranquillisants, plus inquiétants quant à l'évolution de la société étasunienne 154 ( * ) .
Taux 2019
62,7
Économie Matin 10/09/2015 d'après les données du BLS
On peut aussi penser que le retrait de la population active peut être dû au découragement des intéressés, las de chercher en vain un emploi ou découragés par la médiocrité de ceux qu'ils trouvent 155 ( * ) . C'est d'autant plus probable qu'aux USA beaucoup d'emplois manufacturiers ayant disparu, l'essentiel de ceux qui les remplacent sont à temps partiel, précaires et mal rémunérés. Il est d'ailleurs révélateur que la baisse significative du chômage ces dernières années n'ait pas entrainé une augmentation notable des salaires, contrairement aux enseignements de la théorie.
La contraction de la population active peut aussi résulter de l'élimination administrative de demandeurs d'emplois potentiels : prisonniers, malades de longue durée, handicapés...
Ainsi les USA sont-ils les champions mondiaux pour leur taux d'incarcération et la sélectivité de celui-ci : 2,213 millions de prisonniers en 2012 (0,9 % de la population adulte) sur un total de 6,937 millions sous contrôle judiciaire. Quant à la sélectivité, elle est d'abord raciale 156 ( * ) .
Au point que l'on a pu se demander si cette politique pénale hyper répressive n'était pas un moyen de régler des problèmes sociaux et économiques : montée de la pauvreté et des inégalités, emploi 157 ( * ) .
Un autre moyen, moins expéditif et au final moins coûteux, consiste à remplacer des chômeurs par des malades de longue durée ou des handicapés. C'est la méthode largement utilisée par les gouvernements de Tony Blair 158 ( * ) .
Constatons aussi que, très généralement aux USA, la population susceptible de demander un emploi hors marché du travail augmente (95,577 millions en 2019) en même temps que le taux de chômage officiel baisse. Ce qui tendrait à prouver que s'il y a moins de chômeurs, c'est qu'il y a moins de personnes sur le marché de l'emploi. La ventilation entre ceux qui sont déclarés être sur le marché de l'emploi et ceux qui ne le sont pas est l'une des causes essentielles des interrogations que l'on peut avoir sur la signification des chiffres officiels de l'emploi quelles que soient les méthodes de comptabilisation et les pays, à ceci près que le camouflage n'est pas utilisé avec la même intensité par tous.
Population hors du marché du travail
Business Bourse d'après les données du BLS
Par ailleurs, tout un faisceau d'indices - pour certains relevés par Donald Trump lui-même - incitent à penser que malgré des taux de chômage à faire pâlir les Européens, on est encore loin du plein emploi aux USA : nombre de pauvres et d'assistés des organisations humanitaires, nombre de sans abri 159 ( * ) et de villages de tentes, vagues de faillite de grandes et moyennes enseignes de distribution, ce qui laisse à penser que le pouvoir d'achat de beaucoup d'étasuniens n'est pas à la hausse 160 ( * ) .
En ce qui concerne la sélectivité, il est significatif qu'autour de 2014, la probabilité d'être incarcéré pour un noir né en 2001 ait été de 1/3, contre 1/6 pour un hispanique et 1/17 pour un blanc.
Pour finir cet inventaire des moyens de tordre la statistique, à l'inverse de tous ceux qui visent à minorer la population active (le dénominateur dans le calcul du taux de chômage), on peut aussi majorer le nombre d'emplois en comptabilisant de la même manière les emplois à temps partiel et les emplois à plein temps. Ainsi un emploi manufacturier à plein temps disparu pourra être remplacé par deux ou trois emplois à temps partiel et donc par autant de travailleurs !
Au final, quel était le taux de chômage aux USA en mars 2019 ?
Comme le montrent les courbes ci-dessous, cela dépend de quoi on parle.
Selon le BLS, le taux de chômage au sens strict (indice U3) était de 3,8 % en avril 2019.
Selon le BLS toujours, le taux de chômage au sens large (U6) se situe autour de 7,3 % 161 ( * ) .
Selon le site critique « Shadowstat » qui passe régulièrement au crible les statistiques officielles des USA, le taux de chômage au sens de sous-emploi serait de 21,2 % 162 ( * ) .
La complexité favorable aux discours officiels n'est pas une spécialité étasunienne, les statistiques françaises et européennes suscitent les mêmes interrogations.
En France, il y a même deux indices officiels du chômage, censés mesurer la même réalité :
Le taux de chômage de l'INSEE et celui de la DARES. Cela permet de présenter les résultats sous le meilleur angle possible et de faire oublier ce qui gêne le plus (courbe 5) 163 ( * ) .
Pour l'INSEE, comme pour le BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) vérifiant simultanément trois critères :
- être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de référence, ce qui est une conception très extensive de la notion d'activité ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois, ce qui laisse une large marge d'interprétation.
L'INSEE évalue aussi un « halo autour du chômage » (courbe 4).
La collecte des données est faite par sondages et non par recensement, ce qui, là aussi, veut dire qu'il y a une marge d'erreur non négligeable.
Le chômage officiel est entouré d'un « halo du chômage ». Fin 2018, il s'établissait à 1,5 million de personnes pour 2,7 millions de chômeurs officiels ; soit 4,2 millions de chômeurs au sens large fin 2008.
Le « halo de chômage » et son évolution selon l'INSEE
Autres indices publiés par l'INSEE : Le taux d'activité et le taux d'emploi 164 ( * )
La DARES, elle, procède, de manière très différente, à partir des inscriptions à Pôle Emploi, en distinguant plusieurs catégories de demandeurs d'emploi, certaines tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C), d'autres non (catégorie D) :
Catégorie A : Personne sans emploi devant accepter toute espèce d'emploi (à temps plein, temps partiel, saisonnier, en CDI ou CDD...) Ce sont les « chômeurs » de l'indice officiel.
Catégorie B : Personne ayant travaillé au maximum 78 h par mois.
Catégorie C : Personne ayant une activité réduite de plus de 78 h par mois.
Catégorie D : Personne sans emploi mais non disponible et non tenue de rechercher un emploi, comme les demandeurs en formation.
Selon ces définitions et par construction donc, ceux qui, lassés de ne pas trouver d'emploi ont renoncé à s'inscrire ou se réinscrire régulièrement à Pôle emploi, ne figurent pas parmi les sans emploi. C'est notamment le cas des allocataires du RSA non-inscrits à Pôle Emploi ou de la fraction des bénéficiaires de la prime d'activité dans la même situation tout en souhaitant trouver un emploi répondant mieux à leur attente 165 ( * ) .
S'agissant des inscrits à Pôle Emploi, les moyens de toiletter les chiffres ne manquent pas.
Ainsi pour réduire le nombre de « chômeurs officiels » (catégorie A), on peut : augmenter temporairement les effectifs de la catégorie D par des formations sans débouchés, radier ceux qui ne remplissent pas leurs obligations, notamment en matière de recherche d'emploi.
Il est, en effet troublant qu'au quatrième trimestre 2018, sur les quelques 530 000 personnes des catégories A, B et C radiées, un peu plus de 20 % seulement l'aient été pour avoir trouvé un emploi ! Gageons que le récent décret supprimant la prise en considération du salaire antérieur pour juger du caractère « raisonnable » ou pas d'une offre d'emploi creusera encore l'écart entre nombre de radiations et retour à l'emploi.
Selon les chiffres de la DARES (février 2019), les demandeurs d'emploi se répartissent ainsi :
Catégorie A : 3,366 millions
Catégorie B : 0,759 million
Catégorie C : 1,465 million
Catégorie D : 0,271 million
Soit, en ajoutant les 1,2 million (estimé) des allocataires du RSA et de la prime d'activité non-inscrits à Pôle Emploi, de l'ordre de 7 millions de « chômeurs au sens large » et un taux de chômage « au sens large » de l'ordre de 22 à 23 % 166 ( * ) .
2,8 millions de chômeurs officiels selon l'INSEE, 3,4 millions selon la DARES, l'écart n'est pas mince et rend dérisoire tous les commentaires sur des variations de moins d'un pourcent du taux de chômage.
Variations de la mesure du chômage
selon
l'INSEE et Pôle emploi
De 2007 à 2009-2010, les courbes évoluent dans le même sens (baisse du chômage jusqu'à la crise financière, puis accélération de celui-ci dès que les effets du krach sur l'économie se font sentir) pour diverger de plus en plus à partir de la « reprise » avortée de 2011. D'où l'impression - renforcée par l'importance des variations de court terme des résultats fournis par la DARES, que l'INSEE a tendance à aplatir les variations à la hausse du chômage, à court, comme à moyen terme.
Les distorsions dans les indices du chômage au sens strict et au sens large, relevées pour les USA et la France, existent aussi pour la zone euro (courbe 6) et entre les pays de celle-ci (courbe 7).
Le sous-emploi au sens large en Europe, en pourcentage de la population active
Chômeur (trait bleu)/disponible mais ne cherchant pas de travail (trait jaune)/à la recherche d'un emploi mais non disponible (trait orange)/sous employé (trait vert).
BCE Bulletin économique mars 2017
Comme on le voit, si en 2017 le taux de chômage au sens strict était de 8,5 %, celui au sens de l'indice U6 étasunien se situait autour de 13 %, pour un taux au sens large autour de 18,5 %, soit près du double du taux officiel.
L'examen de la situation par pays montre une évolution différente selon les pays et un usage différent du sous-emploi pour embellir les taux de chômage.
Le chômage au sens large en zone euro avant et après la crise financière
On constate que le taux de chômage allemand est le plus bas de la zone euro, baissant même par rapport à l'avant crise, à la différence de tous les autres pays de la zone.
Visiblement, face au chômage, il est difficile de parler de solidarité européenne.
Plus intéressant est l'importance du sous-emploi par rapport à l'emploi, selon les pays de la zone, autrement dit des expédients permettant de faire baisser le taux de chômage officiel
|
Allemagne |
France |
Italie |
Espagne |
|
|
0-Taux officiel Q1 2019 |
3,2% |
8,8% |
10,(% |
14,1% |
|
1-Taux officiel Q4 2016 |
4,1% |
10,1% |
11,7% |
19,6% |
|
2-Taux large |
10% |
18,5% |
25% |
37% |
|
3- ½ |
2,44 |
1,83 |
2,13 |
1,88 |
Ligne 0 : rappel du taux de chômage officiel au début de l'année 2019 dans les quatre pays.
Ligne 1 : Taux officiel du chômage au quatrième trimestre 2016 dans les quatre pays.
Ligne 2 : Taux large du chômage au quatrième trimestre 2016 dans les mêmes pays
Ligne 3 : Rapport entre le taux de chômage au sens large et au sens strict dans chaque pays.
On constate que deux pays - l'Allemagne et l'Italie - font un plus large appel au sous-emploi que les deux autres - France et Espagne - pour améliorer leur taux de chômage officiel.
Annexe 2 : Une chute tendancielle de la productivité
On constate une chute tendancielle du taux annuel de croissance de la productivité depuis les années quatre-vingt-dix.
Annexe 3 : Allégements fiscaux et croissance
Annexe 4 : Circuit du financement de l'économie
France Stratégie : Note d'analyse n°54 Mai 2017
PARTIE III - LES DÉFORMATIONS DE LA PYRAMIDE SOCIALE : RETOUR VERS LE PASSÉ.
« L'oligarchie dominante (en France) est formée par un millième de la population- pourcentage qui ferait pâlir de jalousie l'oligarchie romaine. »
Cornélius Castoriadis, La montée de l'insignifiance (Seuil)
Au cours de ce dernier demi-siècle libéral, la pyramide sociale issue des Trente glorieuses a connu une double déformation : montée des inégalités et rétractation de la classe moyenne.
Une société dont la place centrale était occupée par une classe moyenne appelée à devenir largement majoritaire par les vertus du progrès technique, du plein emploi, de l'école et de la démocratie a été progressivement remplacée par une autre : une société où les classes populaires ont fait leur deuil de se fondre un jour dans la classe moyenne devenue majoritaire et dont la principale crainte est de sombrer dans la précarité.
Une société où moins de 10% de la population peut être considérée comme disposant de hauts revenus, de plus de 50% du patrimoine et de l'essentiel des pouvoirs d'influence.
Au sein de cette couche sociale aisée, la distribution des revenus du patrimoine et du pouvoir d'influence suit une courbe exponentielle dont la pente s'accélère avec les derniers 1 %, puis 0,1 %, et ainsi de suite, des plus hauts revenus et patrimoines.
Au final et pour simplifier, disons que nous sommes passés d'une société animée par une dynamique de « moyennisation » à une société de plus en plus inégalitaire et oligarchique.
L'essentiel des gains de la croissance va à une minorité très étroite, la transformant en oligarchie.
Comme le dit un rapport de l'OCDE publié le 10 avril 2019 : on s'achemine vers « une polarisation des sociétés occidentales en deux groupes : une classe riche et prospère au sommet et un groupe, beaucoup plus nombreux, de personnes dont le travail consiste à servir la classe riche ».
La distribution des revenus et des patrimoines donne une photographie ressemblante des résultats de ces transformations imposées, au nom du bien commun, par une minorité pour capter l'essentiel de la richesse produite depuis les années 1970.
On l'observe dans tous les pays avec des variantes significatives selon la résistance à la « modernisation » des systèmes de redistribution existants.
Ce sont évidemment les USA et le Royaume-Uni qui montreront le chemin, l'Europe et tout particulièrement la France de l'égalité dans la liberté et la fraternité, et dont le système de redistribution sociale était ancien, résistant assez bien jusqu'à ces dernières années.
I. RETOUR VERS UNE DISTRIBUTION DES REVENUS ET DU PATRIMOINE TRÈS INÉGALITAIRE
Deux méthodes d'évaluation dominent la recherche dans ce domaine : soit on observe l'évolution de la part du revenu national revenant à la fraction sociale supérieure préalablement définie (méthode utilisée par Thomas Piketty par exemple) 167 ( * ) ; soit on regarde le taux de croissance des revenus en fonction de leur niveau (méthode utilisée par Branko Milanovic) 168 ( * ) .
A. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DE LA RICHESSE
Les graphiques 1.1, 8.6, 8.1, 9.6, 10.5 et 10.1 sont extraits du livre de Piketty cité.
Comme on l'a dit, c'est aux USA, initiateurs et propagandistes de la « révolution libérale », que le phénomène est le plus visible.
Il commence par un processus brutal d'égalisation des revenus à partir de 1930 où les 10% des étasuniens se partageaient 50% du revenu national, s'accélérant brutalement avec la guerre. (graphique 1.1)
Durant toute la période de l'après-guerre et jusqu'en 1980, la part des hauts revenus oscille entre 33 et 35 % du revenu national.
La tendance s'inverse à partir de là. En 2008 on est revenu au niveau d'inégalité d'avant-guerre.
Au terme du processus, les effets du New Deal sont complètement gommés.
Autre constat : plus les revenus sont élevés, plus ils bénéficient du processus de libéralisation.
On notera l'accélération régulière de la croissance des revenus des 1 % les plus riches dès 1980.
Pour la France, l'Allemagne et le Japon, s'agissant du décile supérieur, l'évolution est très sensiblement différente puisque la part du revenu national allant au décile supérieur baisse jusqu'en 1982 pour atteindre 30 % (valeur proche des 33 % étasuniens de 1970), pour remonter ensuite, mais seulement de 3 %, ce qui n'a rien à voir avec les 50 % étasuniens.
On constate la même évolution modérée, en France, en Europe continentale et au Japon pour le millième supérieur comme le montre le graphique ci-dessous.
Ceci dit, pendant ce temps-là, les revenus du reste de la population (déduction faite de l'inflation) ont stagné et 1 % des revenus les plus hauts représentent nettement plus que 1 % de revenus les plus bas.
B. LE PARTAGE INÉGALITAIRE DU PATRIMOINE
Le mouvement de concentration patrimoniale est, lui aussi, mondial.
Il concerne d'abord les USA mais aussi la France (elle compte 2 milliardaires parmi les 15 premières fortunes mondiales en 2017), l'Espagne, la Chine, etc.
Ce mouvement ne ralentit pas.
Entre 1987 et 2013, le taux de croissance des fortunes des plus riches a été le double de celui du PIB mondial.
On notera qu'à la différence des revenus, les patrimoines ont bien résisté à la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas en France où la concentration patrimoniale diminue avec la Première Guerre mondiale et continue avec la Seconde. La remontée ne commence qu'à partir de 1990.
C. LA MÉCANIQUE INÉGALITAIRE
1. Baisse des revenus du travail versus hausse des revenus du capital
À l'origine de cette distorsion de la répartition des revenus et du patrimoine, existe une mécanique complexe aux rouages pour partie obscurs.
Entre en jeu l'évolution du partage de la valeur ajoutée entre revenus du travail et revenus du capital, défavorable aux premiers.
Au nom de la compétitivité et du fait de la chute massive du taux de syndicalisation entre 1960 et 1990, résultante de l'individualisme triomphant et pour partie de la répression syndicale au Royaume-Uni de Margaret Thatcher et aux USA de Ronald Reagan, on assiste à la montée du chômage et du sous-emploi.
Résultat : l'augmentation des revenus supérieurs du travail est plus rapide que celle du salaire moyen. On observe aussi le fait que ce sont de plus en plus les mêmes qui cumulent hauts salaires et hauts revenus du capital.
Si la France reste plus réservée sur ces pratiques, elle n'en supprime pas moins dès 2002-2003 l'indexation des salaires sur l'inflation, inaugurant par ailleurs, au nom de la lutte contre l'inflation puis pour le « franc fort » dont dépend l'avènement de la zone euro, la « désinflation compétitive » que l'Allemagne avec les lois Hartz 169 ( * ) portera à sa perfection en 2004.
Pour Branko Milanovic , c'est la marque de naissance d'un nouveau capitalisme « très différent de celui, classique, fondé sur la division entre un capital et un travail incarnés par des personnes différentes » (op cit), avec pour résultat d'aggraver encore les facteurs d'inégalité et le laminage des classes moyennes, comme on le verra.
« Dans le nouveau capitalisme, les riches capitalistes et les riches travailleurs sont les mêmes personnes. L'acceptation de la structure sociale est renforcée par le fait que les personnes riches travaillent. De plus, pour une personne extérieure, il est d'autant plus difficile, voire impossible, de dire quelle part de leurs revenus provient de la propriété, et quelle part provient du travail. Alors qu'auparavant les rentiers étaient fréquemment ridiculisés et mal-aimés car leur unique travail consistait à détacher des coupons, la critique des 1 %, dans le nouveau capitalisme, se trouve affaiblie par le fait que beaucoup d'entre eux sont très qualifiés, travaillent dur et ont des carrières couronnées de succès. Les inégalités apparaissent alors sous un jour méritocratique. Les inégalités générées par le nouveau capitalisme sont plus difficiles à remettre en cause, idéologiquement et probablement aussi politiquement, parce qu'il n'existe pas de soutien populaire fort en faveur de leur limitation. Elles semblent plus justifiables - et, dans une certaine mesure, elles le sont - et sont, par conséquent plus difficiles à déraciner. » (op cit)
Comme le montre le graphique 8.6 non seulement la part du 1 % d'Américains disposant des plus hauts revenus fait un bond à partir des années 1980 mais cette augmentation renvoie largement aux plus-values boursières, revenus volatiles comme le montre (courbe du haut) la baisse brutale des revenus les plus hauts lors des crises des « valeurs technologiques et internet » (2001-2002) et des subprimes (2008-2009).
2. Inflation de la valeur des patrimoines partiellement occultée : plus-values de placements financiers immobilisés170 ( * ) et augmentation de la valeur des biens immobiliers particulièrement dans les centres des grandes villes
Pour Adair Turner 171 ( * ) , les conséquences majeures de la spéculation immobilière alimentée par le système financier, particulièrement bancaire qui y trouve une source de profit à peu de risque, ce sont les hausses des prix des bien concernés avec les effets d'éviction pour la plus grande partie de la population qui vont avec, un endettement privé massif producteur de « bulles » et de krachs 172 ( * ) .
Pour lui, au coeur du problème spéculatif, il faut donc placer la métropolisation urbaine galopante, particulièrement des très grandes villes, comme Londres ou Paris.
Assurées d'une croissance régulière des prix, les banques prêtent toujours plus d'argent pour le financement d'un même bien, soit autant d'argent qui ne va pas à l'économie réelle.
Là est l'origine de l'augmentation des inégalités patrimoniales massivement observée et de la baisse du revenu disponible des locataires ou des nouveaux accédants à la propriété.
La baisse des taux d'intérêt nominaux (les taux d'intérêt réels c'est tout autre chose) se trouve ainsi largement compensée par la charge de remboursement du capital sur des périodes de plus en plus longues, véritable rente sur laquelle sont assises les banques.
Sur le papier, le nombre de propriétaires augmente (marque d'accès à la classe moyenne pour certaines études), en réalité ce sont de quasi locataires des banques, auxquelles ils verseront plusieurs fois la valeur initiale de leur bien.
En ne créant pas de biens nouveaux, mais en se limitant à augmenter la « valeur » (en réalité le prix) des biens rares, la spéculation, privilège des privilégiés de la fortune, est un puissant levier d'appropriation patrimonial.
En résumé, avec la pression sur les revenus du travail, les inégalités grandissantes des revenus de celui-ci, l'augmentation des patrimoines privés et des revenus qui vont avec, rien d'étonnant à ce que la distribution des revenus soit de plus en plus inégalitaire.
Plus la minorité concernée est étroite - le décile, le centile et le millième supérieurs -, plus l'écart se creuse dans les pays anglo-saxons. Si l'on observe aussi cette évolution sur le vieux continent, elle est nettement plus modérée.
Les exemples de la France et de la Grande-Bretagne sont représentatifs de l'évolution générale tant par leurs ressemblances que leurs différences d'intensité.
Des évolutions sont plus ou moins spectaculaires selon les pays mais partout et particulièrement dans les pays anglo-saxons, la tendance est la même : dès 1970 en Grande-Bretagne et 1980 en France, les revenus du capital augmentent et ceux du travail baissent.
La crise des subprimes ne fera pas cesser le mouvement, au contraire.
Ainsi, selon une étude d'Oxfam publiée en mai 2018, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont augmenté de 60 % entre 2009 et 2016, atteignant 96 milliards en 2017.
Sur les quelque 600 Md€ de profits réalisés entre 2009 et 2017, 67,4 % (407 Md€) ont été versés sous forme de dividendes aux actionnaires, 27,3 % ont été réinvestis dans les entreprises et 5,3 % versés sous une forme ou une autre aux employés.
À part ça, selon le théorème d'Helmut Schmidt, « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain . » Constatons qu'ils sont surtout les revenus des actionnaires d'aujourd'hui et de demain.
Cette déflation des revenus du travail, socialement et politiquement dangereuse, pénalisante pour la consommation et donc pour l'économie, comme on l'a vu, sera compensée par une explosion de l'endettement privé (entreprises, ménages) et public, en contradiction d'ailleurs avec le crédo libéral.
On connait le résultat final : après diverses répétitions de moindre ampleur, le krach de 2007-2008 et la crise interminable qui suivit.
3. Croissance du patrimoine privé plus rapide que celle du revenu en général
Selon une ampleur variable en fonction des pays, mais partout à partir de 1970, le patrimoine privé croît plus vite que le revenu général.
On remarquera :
- la chute du rapport capital/revenu partout en Europe à compter de 1910 ;
- l'inversion de la tendance dès 1950 en Allemagne et en France et vingt ans plus tard au Royaume-Uni ;
- l'accélération de celle-ci à partir de 1980 au Royaume-Uni (début du thatchérisme) et en France à partir des années 1990, que les vagues successives de privatisation placent à l'avant-garde de la libéralisation.
La courbe japonaise atypique s'explique par le krach immobilier de 1990 dont le Pays du soleil levant ne s'est pas encore remis à ce jour.
On remarquera que c'est en Italie que la valeur du capital par rapport au revenu disponible est la plus élevée et que c'est en Allemagne et en Amérique du nord qu'il est le plus bas. Un élément qui n'est pas sans effet sur la compétitivité de ces pays, le coût du logement étant une dépense contrainte majeure.
Les effets de cette « repatrimonialisation » de la richesse du fait de la croissance plus rapide des revenus du patrimoine, et plus encore de sa valeur (du fait de la spéculation) sur les revenus du travail, comme le souligne Louis Chauvel 173 ( * ) , expliquent largement les transformations sociales de ce dernier demi-siècle.
Après les Trente glorieuses durant lesquelles les revenus du travail évoluaient plus vite ou de manière comparable à ceux du patrimoine (mobilier et immobilier), commence un processus de re-accumulation de la richesse, favorisant les rentiers ainsi que les héritiers de la fortune et ralentissant considérablement la mobilité sociale.
Louis Chauvel donne cet exemple : en 1950 et au rythme de la croissance d'alors, il aurait fallu 30 ans à un ouvrier pour atteindre le niveau de vie d'un cadre, en 2013 il lui faudrait un siècle.
II. LES CLASSES MOYENNES AU CRÉPUSCULE
A. QUI SONT LES CLASSES MOYENNES ? (voir annexe de cette partie)
La notion de « classe moyenne » ou de « classes moyennes » probablement plus appropriée particulièrement caractéristique en Europe 174 ( * ) , apparaît avec les Trente glorieuses, ce qui n'est pas un hasard, puisque c'est un moment faste d'égalisation des revenus et où ceux du travail progressent plus que ceux du patrimoine.
Cette période est aussi, voire dès l'avant-guerre avec le début de l'exode rural, du développement de la fonction publique et des « cols blancs », puis la guerre qui favorisera la disparition des rentiers, une période de rapprochement des modes de vie de catégories sociales dont les écarts de revenus restent limités, en tous cas sans rapport avec celui qui sépare ces catégories « moyennes » des sommets de la pyramide sociale.
Ce qui caractérise ces strates imbriquées les unes dans les autres, si l'on suit le modèle de Mendras (voir annexe), tout autant qu'une relative proximité de revenu, en effet, c'est le mode de vie, l'aspiration à la promotion sociale pour soi et pour ses enfants, par le travail et l'éducation.
Or, ce sont ces deux leviers de promotion qui vont être remis en cause et la cohésion sociale avec eux.
Au final, la définition la plus parlante de cette nébuleuse rassemblée sous le nom de « classes moyennes », notion autant politique que sociologique, est celle que donne Louis Chauvel :
« La langue française, plus riche et précise, aime parler "des classes moyennes" au pluriel. La partie supérieure - les professions libérales ou les enseignants agrégés, par exemple - côtoie les élites, et la partie basse est faite notamment d'ouvriers très qualifiés, stables et reconnus. Mais cette pluralité a été unie par un ciment : le rêve collectif des "civilisations de classes moyennes" (Alexandre Koyré, 1954) qui ont émergé des décombres de 1945. Elles reposent sur sept piliers : le salariat stable, la société d'abondance, l'expansion des protections de l'État-providence où le patrimoine n'est plus la condition sine qua non de la sécurité, une croissance scolaire permettant la mobilité sociale ascendante, la croyance au progrès, la centralité politique des catégories moyennes et finalement la démocratie représentative, stable et rationnelle. Celle-ci contraste avec la vieille démocratie bourgeoise et les régimes autoritaires d'avant 1945. Aujourd'hui, le ciment qui tenait ces sept piliers se délite. » 175 ( * )
B. LE DÉLITEMENT DU NIVEAU DE VIE
Ce délitement est sensible au regard des revenus qui stagnent, ou comparativement baissent, par rapport à ceux du bas et plus encore du haut de la pyramide sociale.
L'évolution des revenus catégoriels - par exemple des professions intermédiaires 176 ( * ) - le montre.
Avec le livre de Branko Milanovic « Inégalités mondiales » on élargit la perspective au niveau mondial.
Comparant les taux de croissance des revenus en fonction de leur place dans la grille des revenus, durant les vingt années qui ont précédé la crise de 2008, son étude donne des informations parlantes sur l'évolution de la situation des classes moyennes.
La fameuse courbe de « l'éléphant » permet de visualiser ces évolutions.
La courbe montre que les revenus moyens des pays non occidentaux, principalement la Chine et l'Inde, sont à l'origine, en particulier la Chine, de la baisse de pauvreté dans le monde. Ils sont ceux qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, de conserve avec les 1 % les plus riches des pays occidentaux.
Par contre, ceux qui ont le moins bénéficié de la croissance sont les plus pauvres des pays pauvres et les classes moyennes des pays occidentaux.
Résultat : ces classes moyennes se trouvent amputées de leur partie la plus populaire, menacée de paupérisation, et placées à des années-lumière des quelques pourcents, voire fractions de pourcents, des « élites » que la mondialisation a le plus enrichies.
NB : En abscisse sont classés par ordre croissant les revenus moyens par centiles (exprimés en parité de pouvoir d'achat) et en ordonnée l'augmentation de revenu au cours de la période considérée. La classe moyenne est ici définie comme celle dont le revenu disponible par tête est compris entre +/- 25 % de la médiane.
Du fait de la croissance accélérée des très hauts revenus et parce qu'en valeur absolue 1 % d'augmentation d'un milliardaire occidental n'a rien à voir avec le même 1 % de revenu moyen supérieur, la distance entre le haut de la classe moyenne et « l'élite de la fortune et du pouvoir d'influence » s'est creusée.
À l'opposé, c'est vers le bas qu'est aspirée la classe moyenne populaire.
Pour Milanovic, statistiquement définie comme on l'a dit ci-dessus, la classe moyenne existe toujours mais régresse : « Dans les démocraties occidentales, la classe moyenne est aujourd'hui à la fois moins nombreuse et plus faible économiquement qu'il y a 30 ans, comparativement aux riches. »
C'est aux USA que le phénomène a été le plus net puisque la classe moyenne qui représentait un tiers de la population en 1979 n'en représentait plus que 27 % en 2010, soit une perte de un cinquième, la plupart des individus ayant été relégués vers le bas puisque la part située au-dessous de 25 % de la médiane a augmenté de 3 % et celle au-dessus de 25 % de la médiane de 2 % seulement.
Dans le même temps, le revenu moyen de la classe moyenne, qui se situait à 80 % du revenu moyen de la population américaine en 1979, n'en représentait plus que 77 % en 2010.
La captation des revenus s'est donc effectuée au profit des plus riches et d'autant plus qu'ils l'étaient.
Si c'est aux USA que cette rétractation de la classe moyenne est la plus visible, on peut l'observer dans toutes les démocraties occidentales.
Il est regrettable de manquer de chiffres pour la France, les études dont on dispose - parfois remarquables comme celle de Thomas Piketty - étant surtout centrées sur la place des hauts et très hauts revenus et non sur les revenus moyens.
Peut-être faut-il y voir aussi un effet de la mode sociologique de la « déconstruction », plus portée à démystifier qu'à faire comprendre, même de manière approximative, faute de mieux.
Le rapport 2019 de l'OCDE fait le même constat : entre le milieu des années 80 et le milieu des années 2010, le nombre de foyers qui appartiennent aux classes moyennes s'est réduit, passant de 64 % à 61 % du total.
Le nombre de foyers aisés et pauvres a en revanche augmenté, reflétant une montée des inégalités.
La France, de ce point de vue, reste bien placée. Les classes moyennes y représentent un groupe social plus large que dans la moyenne de l'OCDE, « signe que le système les protège sans doute un peu mieux » ajoute le rapport.
Si, sur trente ans, le revenu médian dans les pays de l'OCDE a progressé trois fois moins vite (0,3 %) que celui des 10 % les plus riches depuis dix ans, leurs revenus n'ont quasiment pas progressé.
Résultat, dans l'ensemble de l'OCDE, le revenu global des classes moyennes s'est dégradé par rapport à celui des 10 % les plus riches au fil du temps : il était quatre fois plus important que celui des 10 % les plus riches il y a 30 ans, aujourd'hui il l'est moins de trois fois...
Parallèlement, les dépenses contraintes caractéristiques du mode de vie 177 ( * ) des classes moyennes ont progressé largement plus vite que l'inflation : santé, logement et éducation des enfants.
Le fait qu'en France les dépenses de santé soient largement socialisées et que l'éducation - sauf pour certaines formations professionnelles ou supérieures spécifiques - soient pour une bonne part gratuite, explique la meilleure résistance des classes moyennes françaises.
Reste la progression du coût du logement et des transports, en général inversement proportionnels : un coût du logement modéré va souvent avec des frais de transport qui ne le sont pas.
Toujours selon l'OCDE, un ménage sur cinq de classe moyenne, actuellement obligé de dépenser plus qu'il ne gagne, s'endetterait de plus en plus. « Le mode de vie typique des classes moyennes est de plus en plus coûteux », observent les auteurs de l'étude.
Un ménage de classe moyenne sur deux des 24 pays étudiés déclare avoir des difficultés à boucler ses fins de mois.
40 % d'entre eux se disent vulnérables face à un imprévu ou un accident de la vie.
D'où un pessimisme généralisé quant à leur avenir et plus encore à celui de leurs enfants et le sentiment que « c'était mieux avant ».
En France 70 % seulement des personnes interrogées pensent que leurs enfants auront l'opportunité de mieux réussir qu'eux.
Un chiffre paradoxalement supérieur à celui de la moyenne de l'OCDE qui se situe à 60 %.
Cette inquiétude se nourrit aussi du fait que les compétences nécessaires pour appartenir aux classes moyennes n'ont cessé de grimper.
Il faut de plus en plus de compétences pour faire partie des classes moyennes et pouvoir résister à l'automatisation des emplois.
D'où la peur du chômage et du déclassement qui l'accompagne fatalement 178 ( * ) .
De plus en plus fréquemment deux salaires sont nécessaires pour que le foyer appartienne à la classe moyenne, dont l'un fortement qualifié, ce qui était plus rare auparavant.
S'agissant des effets de la mondialisation sur la structure sociale des pays concernés, ces résultats signifient-ils que l'enrichissement des classes moyennes non occidentales (essentiellement chinoise et indienne) se soit fait au détriment des classes moyennes occidentales ?
C'est à cette question que les auteurs de la postface à la traduction française d 'Inégalités mondiales , Pascal Combemale et Maxime Gueuder, ont tenté de répondre en revisitant l'éléphant de Milanovic.
La technique consiste à affecter les gains de revenus totaux aux classes moyennes occidentales dont les revenus ont le moins augmenté durant la période (80 e , 85 e et 90 e percentile) ce qui apparaît sur la courbe rectifiée en carrés du graphique ci-après, ou seulement les gains des 5 % les plus riches à ces classes moyennes, ce qui apparaît sur la courbe rectifiée en triangles.
La conclusion est claire : le gain maximum pour les classes moyennes correspondrait à la situation où les gains de revenus - colossaux - des 5 % les plus riches durant la période leur seraient revenus.
Solution qui n'aurait pas l'inconvénient de ponctionner les gains (importants en proportion de leurs revenus initiaux mais modestes quoique significatifs en valeur absolue) des classes moyennes des pays non occidentaux.
Pour les auteurs, ce sont les politiques de redistribution propres à chaque pays occidental qui sont responsables de la plus ou moins grande équité de la redistribution des augmentations de revenus durant ces trente années : « Le contraste entre les deux alternatives conforte une idée ancienne, puis oubliée, selon laquelle l'ouverture internationale doit avoir, pour contrepartie, des politiques nationales de redistribution. »
C. LA MENACE DU DÉCLASSEMENT
Mais, comme on le sait, le niveau de revenu en soi ne suffit pas à caractériser ce que recouvre la notion de « classes moyennes », encore plus aujourd'hui que dans la période où la notion est apparue.
Interviennent aussi le mode de vie et plus encore le « statut social », la position sociale relative, les efforts faits pour la conserver ou l'améliorer.
Au final, ce qui caractérise le plus la classe moyenne c'est l'aspiration à la promotion sociale, pour soi et pour ses enfants, grâce au progrès, par le travail et l'éducation.
Or le progrès bat de l'aile, les deux leviers de promotion que sont le travail et l'éducation étant remis en cause.
Si, entre 1962 et 2011, les taux de chômage des catégories socio-professionnelles généralement classées parmi les classes moyennes - à l'exception notable des employés - ont progressé moins vite que celui des ouvriers, ils n'en ont pas moins augmenté de manière significative, suffisamment en tous cas pour installer une crainte du déclassement, d'autant plus importante que leur endettement à des fins immobilières est grand.
« La dérive des classes moyennes intermédiaires est bien plus qu'un sentiment : en 2006, à l'étiage d'avant la nouvelle récession, un taux de chômage déclaré (supérieur au taux du BIT) de l'ordre de 7 % les frappait et justifiait dans les faits une peur du déclassement plus rationnelle que subjective. Même parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures (CPIS), le chômage (un taux de près de 4 %, soit deux fois le taux des ouvriers de 1970) s'est installé à des niveaux tels que le risque est signifiant. » (Louis Chauvel op cit )
Avec le travail qualifié, le second levier de promotion pour cette classe méritocratique, à la différence des rentiers du patrimoine de la classe supérieure, c'est l'éducation.
Or, force est de constater que la multiplication des diplômés, faute d'une croissance comparable des emplois auxquels leurs diplômes étaient censés ouvrir la porte, a surtout débouché sur une dévalorisation de ces diplômes et le sentiment de frustration qui va avec.
Selon Louis Chauvel : « l'intensité de cette dynamique de dévalorisation sociale d'un diplôme n'a pas d'équivalent dans les pays voisins, exception faite des pays méditerranéens. Que l'on distingue ou non les baccalauréats généraux, techniques et professionnels, le résultat est le même. »
Ce que l'on constate au fil du temps, c'est la baisse de la part des diplômés en emplois cadres ou professions intermédiaires (phénomène de substitution dû à l'évolution d'une partie de ces professions).
Et la baisse de prestige des diplômes
Ce déclassement des classes moyennes n'est pas qu'un constat sociologique, c'est aussi un évènement politique dans la mesure où il signifie le délitement de la couche intermédiaire qui - en Europe en tous cas, en France particulièrement - jouait le rôle de ciment social et permettait le fonctionnement régulier de la démocratie parlementaire 179 ( * ) .
On commence à se douter que ce retour à l'avant-guerre ne peut être sans conséquences.
Si, depuis Aristote 180 ( * ) , la supériorité des régimes assis sur une classe moyenne forte était devenue un lieu commun, il était fortement soupçonné de servir à masquer les affrontements de classes, l'exploitation exercée par une minorité de possédants sur ceux qui disposent seulement de leur force de travail, et à rassembler les majorités politiques nécessaires à la conservation du système.
Ainsi pour Christian Guilluy 181 ( * ) dans La France périphérique 182 ( * ) , la « classe moyenne » n'existe pas, elle est un abus de langage qui permet au pouvoir de prendre des décisions au nom d'une majorité qui n'existe pas.
Qu'elle existe ou non, la classe moyenne n'en avait pas moins permis à la France de résister aux diverses crises sociales de l'après-guerre, au traumatisme de la guerre d'Algérie et d'absorber sans problème la révolte de mai 1968.
Elle avait aussi applaudi la néolibéralisation du pays, le projet européen et permis par ses votes - au centre droit ou gauche - la poursuite de la même politique en ces domaines.
Encore aux dernières élections présidentielles, elle a très majoritairement voté pour le candidat de l'Europe libérale.
Une attitude paradoxale dans la mesure où, comme on l'a vu, une bonne partie des classes moyennes a pâti de cette Grande Transformation néolibérale. Apparemment paradoxale faudrait-il dire, l'appartenance aux classes moyennes étant autant un projet de mode de vie qu'une réalité.
Sauf qu'on approche du moment où l'espoir de voir les choses s'arranger d'elles-mêmes ne suffisant plus à contenir les désillusions, s'ouvre un champ d'incertitudes inédit.
III. L'OLIGARCHIE NÉOLIBÉRALE
Au cours du dernier demi-siècle, comme nous venons de le voir, la structure sociale de toutes les provinces nationales de l'Empire américain s'est déformée, au détriment des classes moyennes dont l'importance s'est trouvée réduite, les inégalités de revenus et de patrimoine ayant augmenté au point d'annuler les effets du rabot de la Seconde Guerre mondiale et des Trente glorieuses.
Ces phénomènes, déjà lisibles si on compare l'évolution des revenus des 10 % ou des 20 % les plus riches aux 90 % ou 80 % restants, pour significatifs qu'ils soient, masquent cependant une mutation aux conséquences politiques peut-être plus importantes : la transformation d'une partie de la classe aisée en oligarchie, autant dire d'une petite minorité non seulement riche - ce qui n'est pas une nouveauté - mais tellement riche que ses revenus et son patrimoine lui confèrent un pouvoir d'action économique et d'influence politique qui avaient disparu.
Au final une situation plus proche de l'avant-guerre que de celle des débuts de la V e République où le général de Gaulle pouvait dire sans pouvoir être démenti que « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Constatons qu'aujourd'hui, elle est le produit des tractations entre le pouvoir politique et les « investisseurs », mot valise destiné à transporter d'authentiques investisseurs et de non moins authentiques spéculateurs.
Comme nous l'avons vu, la Grande Transformation néolibérale s'est accompagnée aux USA, dès la fin des années soixante-dix, d'une forte poussée inégalitaire, d'autant plus forte que les revenus et les patrimoines étaient élevés.
Par comparaison, l'évolution en France paraissait nettement plus modérée.
C'est exact mais à un correctif près : si l'oligarchie française a mis du temps à se reconstituer, la libéralisation devant dissoudre un État-providence fort et structuré, elle n'en a pas moins fini par exister, prospérer, transformant une infime minorité en oligarchie politiquement puissante.
Dans une récente étude 183 ( * ) , l'INSEE classe les revenus entre :
Les « revenus plancher » inférieurs à 45 220 € annuels par unité de consommation, ceux de 90 % de la population ; les « hauts revenus » situés entre 45 220 € et 106 210€, ceux des 9% suivants de la population du haut de la pyramide ; puis le dernier centile.
Les « très hauts revenus », ceux des 1 % les plus aisés (plus de 106 210 euros de revenu initial par unité de consommation - mensuellement 8 850 euros pour une personne seule et 18 590 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans) gagnent en moyenne près de sept fois plus que l'ensemble de la population, percevant 6,8 % de la masse des revenus.
Ces « très hauts revenus » sont eux-mêmes très hétérogènes.
L'étude de l'INSEE les subdivise en catégories : « aisée » (revenus compris entre 106 210 € et 259 920€ soit 0,9 % de la population supérieure) ; « très aisée » (revenus entre 259 920 € et 699 230 € soit 0,09 % de la population) ; « plus aisée » avec des revenus supérieurs à 699 230 €, perçus par le dernier 0,01 % supérieur.
L'étude constate que plus les revenus sont élevés et plus leur origine est diversifiée : les « très hauts revenus » déclarent en particulier des revenus non commerciaux et d'actifs financiers. En 2015, 1 % de la population déclare ainsi 30 % des revenus du patrimoine. Au sein des ménages à très haut revenu, les salariés sont cadres dans près de 60 % des cas et chefs d'entreprise dans près de 10 % des cas.
Toutes les études de l'INSEE convergent, les revenus des 0,1 % les plus aisés sont proprement pharaoniques puisqu'ils représentent 15,5 fois ceux de 90 % de la population, 34 fois le revenu médian et 38 fois le SMIC.
Le tableau de la répartition des revenus (déclarés au fisc), par strates, du Top 10 est encore plus édifiant.
Ce tableau est réalisé à partir des données publiées sur le site « Impôt sur le revenu.org »
Quelques constats :
1- La distance est impressionnante entre le revenu moyen des 500 membres du Top 10 000 et celui de la classe moyenne supérieure : 644 fois.
2- On retrouve la situation d'avant-guerre. En effet, comme le note Louis Chauvel, reprenant Thomas Piketty, les successions de « 200 familles » représentaient alors, en moyenne, 700 fois celles de la classe moyenne. Après un demi-siècle de néolibéralisme, les revenus du Top 10 000 représentent 645 fois ceux du haut de la classe moyenne (29 844€ par an selon l'INSEE).
3- Le salaire moyen des patrons du CAC 40 s'élève à 4,2 M€ bruts par an ;
4- S'agissant des revenus déclarés, il n'est pas tenu compte de l'évasion fiscale, sport plus facilement pratiqué sur les sommets, et d'autant plus que la part des revenus du patrimoine et des placements est importante.
5- Après les USA, c'est la France qui est le pays le mieux représenté au classement mondial Forbes (2019) des milliardaires. Au palmarès des vingt plus grandes fortunes, on retrouve certes 14 Étasuniens mais aussi 2 Français (Bernard Arnault - 4 ème place en début d'année 2019 avec 76 Md $, puis 3 ème avec plus de 100 Md$ en juin accompagné de Françoise Bettencourt et sa famille, 15 ème place 49,3 Md$), 1 Mexicain, 1 Espagnol, 1 Indienne et 1 Chinoise qui ferme la marche.
On s'étonne de ne pas trouver de Russes, les seuls pourtant à être qualifiés « d'oligarques » dans les médias français !
Rapportant l'exploit inouï pour un Français de figurer parmi les 300 milliardaires mondiaux, ils se limiteront à expliquer que la fortune de Bernard Arnault a progressé de 32 Md$ depuis le début de 2019, du simple fait de la valorisation boursière des actions LVMH, donc sans création de richesse réelle en contrepartie.
Cette croissance accélérée du patrimoine des plus riches n'est pas spéciale à Bernard Arnault, elle concerne l'ensemble des grandes fortunes, ce qui tendrait à prouver que les qualités de gestionnaire des uns ou des autres n'y entrent pas pour grand-chose.
Ainsi, selon le Bloomberg Billionaires Index qui classe les 500 plus grosses fortunes mondiales, le patrimoine des 14 milliardaires français a augmenté de 78 Md$ (69 Md€) au cours du premier semestre 2019, soit de 35 %, deux fois plus vite que pour leurs homologues chinois et étasuniens (Forbes 2019).
A. L'ASCENSEUR SOCIAL EN PANNE
Au final, en termes d'amélioration, la mobilité sociale n'a guère évolué, ce dernier demi-siècle, la France figurant parmi les plus rigides de l'OCDE.
Selon une étude internationale 184 ( * ) , la France figure parmi les pays européens où la mobilité sociale est la plus réduite.
Il faut, en effet, en moyenne six générations aux enfants des 10 % des Français les plus pauvres pour atteindre le revenu moyen du pays.
En Europe, seules l'Allemagne (à égalité) et la Hongrie demandent plus : sept générations. Alors que c'est seulement deux générations au Danemark, trois en Espagne, et quatre en Belgique.
Si, comme on l'a vu, la mobilité s'est réduite au niveau des classes moyennes, elle est restée stable aux deux extrémités de la pyramide sociale : « Ceux qui viennent de familles au bas de l'échelle n'ont que peu de chances de monter, le "plancher collant" les empêchant d'évoluer d'une génération à l'autre... Dans le même temps, ceux qui sont nés dans des familles riches ont beaucoup moins de chances de descendre dans la hiérarchie sociale, bénéficiant d'un "plafond collant". »
Ainsi, en France, 50 % des enfants de cadres supérieurs et seulement 11 % de travailleurs manuels deviendront cadres supérieurs.
Sous cet angle, la mobilité sociale apparaît nettement plus grande en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.
On retrouve aussi dans cette étude l'un de nos constats précédents, la frange inférieure des classes moyennes s'est paupérisée. Ainsi un quart des pauvres les plus riches est passé en quatre ans dans la catégorie des pauvres les plus pauvres. En l'espèce, la France fait moins bien que la République Tchèque, la Pologne, l'Estonie ou le Portugal.
La dernière étude de l'INSEE sur le sujet, quoiqu'un peu plus nuancée (à moins que ce ne soit plus sophistiqué !), montre aussi la faible plasticité sociale française.
Les principales conclusions de l'étude sont :
- En quarante ans, la mobilité des hommes est restée quasi stable : en 2015, la proportion d'hommes ayant un meilleur statut que leur père est seulement de 4 % supérieure à celle de 1977 (contre 7 % en 2003, ce qui confirme l'évolution négative des quinze dernières années et que la mobilité a diminué avec le temps). À l'origine de ces modestes évolutions positives figurent essentiellement le déclin de l'emploi agricole, la baisse de l'emploi industriel et le développement du secteur tertiaire
À noter aussi que les promotions ou les déclassements restent modérés. Les fils d'employés ou d'ouvriers non qualifiés deviennent principalement des employés ou ouvriers qualifiés, seuls 19 % exerçant une profession intermédiaire et 8 % de cadre. Pour leur part, 27 % des fils d'employés ou d'ouvriers qualifiés exercent une profession intermédiaire, mais seulement 13 % sont cadre.
Les évolutions sont plus importantes pour les femmes : la proportion de celles dont, entre 1977 et 2015, le statut n'a pas évolué passe de 40 % à 30 % ; la proportion de celles dont il a évolué positivement passe de 17 % à 39 %.
L'origine de ces évolutions renvoie essentiellement au fait que la structure des emplois féminins s'est davantage modifiée ces quarante dernières années que celle des emplois masculins.
À noter cependant une augmentation de 6 % des taux de déclassement, essentiellement celui des filles de cadres.
D'une manière générale, si la progression statutaire des femmes est positive par rapport à leur mère, elle est globalement négative par rapport à leur père : 61 % des filles de cadres occupent un échelon inférieur à celui de leur père.
Les positions des mères sont, en effet, souvent inférieures à celle de leur mari.
B. L'AUGMENTATION DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE
Comme le montre la courbe ci-dessous, après avoir fluctué à la hausse puis à la baisse par rapport à son point bas de 1990, le taux de pauvreté est reparti à la hausse ces dix dernières années.
Encore faut-il, comme pour ceux du chômage, prendre ces chiffres avec précaution.
En effet, le taux de pauvreté étant calculé par rapport au revenu médian, celui-ci ayant baissé du fait de la paupérisation d'une partie de la classe moyenne, le nombre de pauvres a baissé sans que leurs revenus aient changé !
Centre d'observation de la société (septembre 2018)
Comme on l'a vu (voir partie II), la stagnation économique et le sous-emploi qui en est résulté sont largement responsables de cette évolution, la manière de traiter le problème consistant pour partie à transformer les chômeurs en travailleurs pauvres.
Autre biais des chiffres de la pauvreté : ils ne rendent qu'imparfaitement compte de la situation réellement vécue.
Ce qui compte pour les intéressés, c'est moins le revenu dont ils disposent que celui disponible après paiement des dépenses contraintes dites « pré-engagées », celles auxquelles on ne peut échapper.
Selon une étude de la DREES 185 ( * ) , les dépenses pré-engagées représentent 30 % du revenu, proportion qui augmente au fur et à mesure que le niveau de vie baisse.
Au final, les inégalités dans le niveau de vie arbitrable des personnes pauvres (340 € par mois) sont plus fortes que pour celles du niveau de vie général, la différence étant particulièrement importante pour les familles monoparentales.
ANNEXE DE LA PARTIE III
Qui sont les classes moyennes ?
« Ceux qui, trop riches pour être pauvres, sont trop pauvres pour être riches ».
Nicolas Sarkozy 186 ( * )
Les définitions « scientifiques » de la notion de « classe moyenne » ou de « classes moyennes », plus appropriée, reposent sur deux méthodes : le regroupement de catégories socioprofessionnelles dont les places dans les hiérarchies professionnelles sont proches, ou qui ont un niveau de revenu comparable selon des regroupements très variables : la population dont le revenu est situé entre 70 % et 150 % du revenu médian, ou 75 % et 200 % du revenu médian ; les 20 % ou 25 % de la population de part et d'autre du revenu médian ou les 30 % au-dessous et 20 % au-dessus du revenu médian.
Dans sa contribution à l'ouvrage collectif Le fond de l'air est jaune (Seuil, 2019), Louis Chauvel définit les classes moyennes comme un « ensemble social dont le revenu net avoisine les 30 000 à 40 000 euros pour une famille complète ».
On aura compris que selon le choix méthodologique, indépendamment des aléas liés à la détermination des revenus de certaines catégories professionnelles, les effectifs des classes moyennes varieront, ainsi que les résultats de l'étude.
D'une manière générale, du fait du nombre de personnes concernées, de l'inertie des conditions de rétribution, sauf en période faste en matière d'emploi ou de politique de redistribution active, les variations de revenus sur une période pour une classe moyenne ainsi définie sont forcément atténuées, ce qui peut donner une impression de relative stabilité alors que l'essentiel est ailleurs : la patrimonialisation des fortunes par la captation de l'essentiel de la richesse nouvellement créée et de celle représentée par les biens anciens de plus en plus rares, par une petite minorité dans les grandes agglomérations.
C'est l'étude de Branko Milanovic ( Inégalités mondiales ) qui, analysant l'évolution des revenus des classes moyennes des pays occidentaux et non occidentaux au cours des vingt années précédant 2008 est, sur ce point, la plus parlante.
Ceci dit, taux de croissance significatif ne signifie pas forcément gain important en valeur absolue. Ainsi, que les revenus des classes populaires occidentales progressent plus vite que ceux des classes moyennes occidentales n'empêche pas ces classes populaires de régresser sur l'échelle des fortunes au niveau mondial. Les 25 % du bas de l'échelle occidentale détenaient 15 % de la fortune mondiale en 2000.
Depuis ils ont perdu 5 points 187 ( * ) .
Mais la limite de ces méthodes, lorsqu'elles sont utilisées seules, c'est de tenir insuffisamment compte de l'évolution du statut social des classes moyennes, de leurs espérances de promotion au cours du dernier demi-siècle.
Le statut social des catégories socioprofessionnelles change et ne préjuge pas des revenus, notamment du fait des évolutions technologiques et du chômage de masse.
La place dans la hiérarchie des revenus dépend du niveau du revenu médian qui varie avec celui du revenu des plus pauvres (baisse ou hausse du niveau du chômage, de l'aide sociale, paupérisation) ou des plus riches. Or le sentiment de déclassement ou de promotion pour les membres des classes moyennes dépend largement de la position de chacun par rapport à ces frontières, de l'impression de progresser avec le temps, par rapport au passé ou d'autres catégories.
Surtout, le niveau de revenu ne suffit pas à caractériser ce que recouvre la notion de « classes moyennes », encore plus aujourd'hui que dans la période où la notion est apparue.
Tout aussi importants sont les modes de vie et les rapports nés de la proximité comme l'observait Georges Orwell, déjà en 1941, donc avant les Trente glorieuses. Celui-ci relevait que dans certaines parties des grandes banlieues, par-delà leur niveau de vie, les habitants avaient « le même genre de vie dans les appartements en accession à la propriété, que dans les lotissements municipaux, le long des routes cimentées, dans la démocratie dénudée des piscines. Un mode de vie sans repos, sans culture, centré sur la nourriture en boite, les magazines, la radio et le moteur à explosion... ». Ces gens constituent, écrit-il « la strate indéterminée pour laquelle les anciennes descriptions de classes commencent à se briser ». Une assez bonne description des évolutions qui explique pourquoi s'est imposée la notion de la classe moyenne, même si elle ne correspond pas à l'ensemble des classes moyennes.
Cinquante ans plus tard, au terme de ce grand moment de « moyennisation » des conditions, Henri Mendras 188 ( * ) représentera cette « strate indéterminée » remettant en cause la notion classique de « classe » dont Orwell avait pressenti l'avènement, sous la forme d'une toupie appelée à devenir célèbre.
Selon Mendras, « l'élite » se limiterait à 3 % et les « pauvres » à 7 % de la population, 90 % se regroupant au sein d'une vaste constellation centrale.
Il propose un schéma en forme de toupie (ci-dessus) dans lequel, hormis une petite élite (3 % de la population) et une frange d'« exclus » (7 %), la société française se regrouperait au sein d'un vaste centre, non plus stratifié mais composé de « constellations » pas totalement disjointes : « constellation populaire » (50 % de la population), « constellation centrale » composée essentiellement de cadres (25 %) jouant le rôle de moteur de l'innovation et de modèle de vie auquel aspirer pour les autres. Même s'il n'est pas certain qu'un tel modèle ait existé aussi clairement que le dit Mendras, il n'en demeure pas moins que c'est ce type de distribution des statuts sociaux que la Grande Transformation néolibérale va mettre à mal.
Et l'on aura compris que tout autant que le revenu en soi et le mode de vie, c'est le « statut social », la position sociale relative, les efforts faits pour la conserver ou l'améliorer qui caractérisent les classes moyennes.
PARTIE IV - L'EFFACEMENT DU MONDE COMMUN
« Vivre une vie entièrement privée, c'est avant tout être privé de choses essentielles à une vie véritablement humaine : être privé de la réalité qui provient de ce que l'on est vu et entendu par autrui, être privé d'une relation “objective” avec les autres, qui provient de ce que l'on est relié aux objets communs, être privé de la possibilité d'accomplir quelque chose de plus permanent que la vie. La privation tient à l'absence des autres ; en ce qui les concerne, l'homme privé n'apparaît point, c'est donc comme s'il n'existait pas. »
Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne
Plus difficile à appréhender que la stagnation économique et son cortège de sous-emploi, que la montée des inégalités, mais tout aussi importante politiquement, la dissolution du lien social, notamment des communautés nationales, creuset de la démocratie réelle, dans lesquelles chacun, même conflictuellement, se reconnaissait, est incontestablement l'un des effets majeurs de la Grande Transformation néolibérale du dernier demi-siècle.
Croire que les réseaux numériques ou autres en plein développement pourraient être une réponse - voire représenter un dépassement libérateur de ces liens jugés étroits et aliénants - est une illusion dont on a commencé à voir les effets délétères sans comprendre ce qui se passait.
I. LE MIRAGE DU VILLAGE MONDIAL
Si l'on suit Hannah Arendt, une société uniquement gouvernée par la recherche de l'intérêt privé, qui se résume à la vie privée - sans monde commun où la rencontre, le débat et la vie politique sont possibles - fait obstacle à toute vie « véritablement humaine ».
Ce constat pourrait bien être à l'origine des jugements contradictoires portés sur des réseaux, qui, loin d'être sociaux, créent des solitudes à plusieurs et au final laissent insatisfaits, voire favorisent indirectement la sécession sociale.
Autre exemple de technologie et de réseau qui sépare en même temps qu'il relie, la dématérialisation - ou numérisation - des informations et des procédures, tenue aujourd'hui pour l'alpha et l'oméga de la modernisation de l'administration et des services, le levier de l'égalité des territoires.
Sauf que les incontestables avantages (accessibilité, coût, rapidité d'exécution...), apportés par ces technologies, non seulement ne profitent pas équitablement et encore moins également à tous, mais, pour ceux qui n'ont pas d'accès aux réseaux 189 ( * ) ou à des réseaux aléatoires (habitants des zones blanches ou plus ou moins grises) 190 ( * ) , pour ceux à qui l'usage du numérique 191 ( * ) ou de procédures administratives conçues selon des logiques peu intuitives 192 ( * ) , posent problème 193 ( * ) , cette modernisation, faute d'accompagnement humain suffisant, est une régression ressentie comme une injustice, sinon une relégation.
Le rapport 2019 du Défenseur des droits - « Dématérialisation et inégalités d'accès au service public » - rendu après l'avalanche de protestations qui a suivi le remplacement de la délivrance préfectorale directe des permis de conduire et cartes grises par une procédure dématérialisée mise en oeuvre de manière précipitée, donne de nombreux exemples de cette « relégation par la technologie » dont sont victimes les zones rurales les moins peuplées 194 ( * ) et, en zone urbaine, les populations déjà en difficulté.
Comme illustration de l'humiliation, du sentiment d'impuissance ressenti par ceux qui, ne maîtrisant pas l'outil informatique, doivent effectuer des démarches administratives sans possibilités alternatives, le film de Ken Loach : Moi, Daniel Blake mérite d'être vu.
Certes, avec le temps et une éducation adaptée, la situation devrait s'améliorer.
Certes on ne peut et on ne doit pas arrêter un progrès technologique riche d'autant de potentialités positives.
Sauf que la technologie n'est pas séparable de l'objectif à l'origine de sa mise en oeuvre et de cette mise en oeuvre elle-même.
En l'espèce, l'objectif premier n'était pas d'améliorer l'accessibilité du service public et sa qualité mais de réduire le nombre des agents de préfecture, d'où bon nombre des ratés évoqués.
Plus fondamentalement, le développement du numérique étant entièrement subordonné à des critères de rentabilité mercantile, il faut craindre que la prolifération des innovations sans intérêt pour l'usager continue, laissant chaque fois une partie de la population sur la touche .
Le « village mondial » composé d'atomes interconnectés n'existe pas, c'est un mirage.
Un mirage qui, protégeant de la réalité, rend acceptables les transformations imposées aux sociétés industrielles libéralisées : transformation de la pyramide sociale, des relations qui en découlent et des modèles d'occupation de l'espace.
On peut aussi craindre qu'une « démocratie directe interconnectée »» capable de décision ne puisse être autre chose qu'une tyrannie, au sens grec du terme, plus ou moins démagogique 195 ( * ) .
Une telle organisation politique, là encore, est incapable de favoriser l'émergence d'un monde commun sensible et pas seulement virtuel, sans lequel il ne peut y avoir d'intérêt général et donc de vie politique.
C'est ce que signifie « fraternité », le dernier mot de la devise de la République française, sentiment différent de la compassion même si l'une et l'autre peuvent assez souvent aboutir aux mêmes résultats, comme le montre le succès que rencontrent souvent les appels à l'aide financière diffusés par internet.
Comme disait déjà Leszek Kolakowski, « rien n'est moins vrai que l'opinion selon laquelle nous nous retrouvons maintenant, grâce à l'expansion incroyable des moyens d'information, dans un village gigantesque s'étendant sur toute la surface de la terre et qu'après avoir détruit le village traditionnel, nous l'avons reproduit, dans une spirale ascendante "dialectique", à l'échelle globale.
Le contraire paraît évident : il n'y a aucune spirale, il n'y a que le mouvement irrésistible unidirectionnel qui efface sans merci, d'une année à l'autre, les vestiges de la communauté rustique dont le résultat est bien visible dans les cultures urbaines et industrielles les plus avancés.
C'est un village imaginaire et artificiel, un substitut cérébral dont l'irréalité est difficile à cacher, qui semble provoquer de plus en plus la nostalgie, dissimulé sous des formes idéologiques différentes, d'un village "vrai".
Puisque le village réel, c'est surtout le monde des contacts personnels, des connaissances sans intermédiaire qui comptent, il va de soi que le village planétaire n'existe pas et n'existera jamais. » 196 ( * )
On se demande même si ce qu'il reste du village ancien, ce n'est pas son côté le plus détestable : les ragots.
II. LA CULTURE DE « L'ENTRE-SOI »
La montée des inégalités, le malaise de la classe moyenne et l'éclosion d'une oligarchie néolibérale des très riches n'a pas eu seulement des effets sur la vie matérielle des gens mais aussi des effets comportementaux et culturels que nous allons tenter d'analyser à partir des exemples étasuniens, là où le phénomène est apparu d'abord, puis en France.
A. USA : « LA RÉVOLTE DES ÉLITES »
Le premier à réaliser les conséquences sociales et politique de ce qui était en train de se passer - le rétrécissement de la classe moyenne et le repli sur soi d'une petite minorité se transformant en caste - c'est Christopher Lasch dans un essai appelé à la célébrité, La révolte des élites et la trahison de la démocratie 197 ( * ) .
Pour l'heure, nous nous limiterons à analyser ce qu'il entend par « révolte des élites » avant de revenir, plus loin (partie VI), sur la seconde partie du titre, un peu gênante il est vrai et pour cela généralement passée sous silence.
« C'est sur la crise des classes moyennes, et non pas simplement l'abîme croissant entre richesse et pauvreté, qu'il nous faut mettre l'accent si nous voulons analyser avec sang-froid ce qui nous attend. »
Et encore Lasch raisonne-t-il à partir des 20 % les plus fortunés qui captaient alors (milieu des années 1990), 50 % des revenus du pays.
A la veille de la crise, c'est au top 10 % qu'ira la moitié des revenus.
Pour lui, une telle captation de richesse est à la fois une menace pour la société et pour le projet de civilisation porté par la culture occidentale 198 ( * ) .
« Naguère, c'était la "révolte des masses" qui était considérée comme la menace contre l'ordre social et la tradition civilisatrice de la culture occidentale. De nos jours, cependant, la menace principale semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale et non pas des masses.
L'évolution générale de l'histoire récente ne va plus dans le sens d'un nivellement des distinctions sociales, mais de plus en plus vers une société en deux classes où un petit nombre de privilégiés monopolisent les avantages de l'argent, de l'éducation et du pouvoir... De nos jours, la démocratisation de l'abondance -l'attente de chaque génération de se voir bénéficier d'un niveau de vie qui était hors de portée de ses prédécesseurs - a cédé la place à un retournement où des inégalités séculaires commencent à se réinstaurer, quelques fois à une vitesse terrifiante, et parfois si progressivement que nous ne nous en rendons pas compte. »
Et Lasch de préciser que : « le problème de notre société n'est pas seulement que les riches ont trop d'argent mais que leur argent les isole, beaucoup plus que par le passé, de la vie commune. »
Ils « se sont effectivement sortis de la vie commune » en quittant les grandes villes industrielles en pleine déconfiture, en s'affranchissant de tout ce qui pourrait ressembler aux services publics 199 ( * ) , en scolarisant leurs enfants dans des établissements privés et par leur mode de vie hygiéniste et sans aspérité.
« Ils ont entrepris une croisade pour aseptiser la société américaine : il s'agit de de créer un "environnement sans fumeur", de tout censurer, depuis la pornographie jusqu'aux "discours de haine", et en même temps de manière incongrue, d'élargir le champ du choix personnel dans des questions où la plupart des gens éprouvent le besoin de disposer de solides orientations morales ; lorsqu'ils se trouvent confrontés à de la résistance devant ces initiatives, ils révèlent la haine venimeuse qui se cache pas loin sous le masque souriant de la bienveillance bourgeoise... Dans le feu de la controverse politique ils jugent impossible de dissimuler leur mépris pour ceux qui refusent avec obstination de voir la lumière- ceux qui "ne sont pas dans le coup", dans le langage auto-satisfait du prêt-à-penser politique. »
À la lecture de ces lignes, on entend comme en écho la sortie d'Hillary Clinton, sous les rires des participants au gala LGBT pour la candidate, à New York, le 16 septembre 2016 : « Pour généraliser, en gros, vous pouvez placer la moitié des partisans de Trump dans ce que j'appelle le panier des pitoyables : les racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Vous n'avez qu'à choisir » .
La réponse des partisans de Trump a été de transformer « les pitoyables » en badge ostensiblement porté et de donner la victoire à leur champion.
De la même veine, l'entretien de Bernard-Henri Levy à la Stampa après l'élection de Donald Trump, dont il avait annoncé l'inévitable défaite !
Pour lui, il ne s'agit nullement d'un quelconque échec des néolibéraux, d'une revanche contre les « élites » de la mondialisation. Non, c'est l'expression du « mépris de la démocratie », « les lois de la téléréalité étendue à la politique (...) C'est un vote contre l'égalité et le respect des minorités. »
Autrement dit, c'est une faute morale, nullement un choix politique, fut-il erroné.
Tout à sa fureur sacrée, BHL craint d'assister à « une auto-liquidation, par les moyens de la démocratie, de la démocratie elle-même. Vous aviez la servitude volontaire façon La Boétie. Eh bien nous avons aujourd'hui la volonté de démocratie qui accouche de ce maître ultime, de ce despote sans réplique, qu'est le Peuple trumpisé. »
Un peuple capable de voter contre ses propres intérêts est-il digne de la démocratie ? Telle est la question qui affleure derrière la multiplication des dénonciations de l'inconséquence populaire venant de moralisateurs libéraux dignes des apparatchiks auxquels Brecht donnait ce conseil lors de l'invasion de la RDA par les chars soviétiques : « Le peuple ayant perdu la confiance du Gouvernement, il serait plus simple pour lui de dissoudre le peuple et d'en élire un autre » 200 ( * ) .
La tendance est aussi, note Lasch, à l'endogamie : « Autrefois, les médecins épousaient des infirmières, les avocats et les cadres supérieurs leur secrétaire. Aujourd'hui, les hommes appartenant à la bourgeoisie aisée tendent à épouser des femmes de leur classe, partenaires d'entreprise ou de cabinet, poursuivant de leur côté une carrière lucrative. »
Plus significatif encore pour lui, le fait que l'horizon de ces « nouvelles élites » n'est plus national, encore moins local, mais le marché international : « Leur sort est lié à des entreprises dont les activités franchissent les frontières nationales. »
C'est davantage le fonctionnement harmonieux de l'ensemble du système qui les préoccupe que celui d'une de ses parties.
Leurs allégeances - si le terme n'est pas lui-même anachronique dans un tel contexte - sont internationales plutôt que nationales, régionales ou locales.
Ils ont plus de choses en commun avec leurs homologues de Bruxelles ou de Hong Kong qu'avec les masses d'Américains qui ne sont pas encore branchés sur le réseau de communication mondiale.
« Une grande partie de ces privilégiés ont cessé de se penser américains dans tous les sens importants du terme, ou impliqués dans le destin de l'Amérique pour le meilleur et pour le pire.
Leur lien avec une culture internationale de travail et de loisirs - d'affaires, de distractions, d'informations et de « récupération de l'information » - rendent beaucoup d'entre eux profondément indifférents à la perspective du déclin national de l'Amérique. »
B. EN FRANCE : LA « SÉCESSION DES RICHES » ET L'ÉMIGRATION DES PLUS RICHES
Une grande partie des observations de Lasch touchant au mode de vie, aux moeurs et à la culture des classes étasuniennes les plus aisées, creusant le fossé les séparant des classes populaires, sont transposables à la France, qu'il s'agisse des préférences résidentielles, de la scolarisation des enfants, des choix esthétiques ou des goûts de minorité qui donnent le ton à la prédication médiatique devenue éducatrice des masses, à moins que ce ne soit l'inverse.
Ainsi en va-t-il de son penchant pour l'endogamie de caste, de la primauté accordée à l'international - à l'Europe tout particulièrement - sur le national auquel ne peuvent être attachés que les has been atteints de xénophobie, sinon racistes, de ses embrasements hygiénistes, moralisateurs ou contre toute forme de discrimination à l'exception de la plus répandue, celle par l'argent.
L'élite aime être choquée, le hic étant que plus rien ni plus personne ne la choque sinon quand son pouvoir est remis en cause par les antieuropéens et des populistes irresponsables.
Comme le confirme Jérôme Fourquet 201 ( * ) , sur les deux rives de l'Atlantique, outre les pratiques résidentielles communes des classes aisées, la tendance est à la scolarisation des enfants dans des établissements privés pour leur éviter les effets de l'obsolescence de l'école publique ou de côtoyer de trop près d'autres enfants que ceux des milieux dont dépendra leur avenir.
Si, quantitativement, remarque Jérôme Fourquet, la « part de marché » de l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public n'a pas évolué depuis trente ans, les établissements privés sont, socialement, de plus en plus sélectifs.
« Du fait du déclin de la pratique religieuse, y compris dans les régions autrefois les plus catholiques, l'enseignement privé (très majoritairement catholique) recrute de moins en moins sur une base confessionnelle. Alors que la compétition scolaire s'amplifie et que la baisse du niveau dans le public est régulièrement dénoncée, un nombre croissant de familles se tournent vers le privé, davantage capable à leurs yeux d'offrir un cadre d'apprentissage exigeant et performant. Dans les grandes villes, choisir le privé pour ses enfants peut également s'inscrire dans une stratégie de contournement de la carte scolaire pour éviter de les envoyer dans un établissement qu'ils considèrent comme ghetto.
Dans ce contexte concurrentiel accru, les catégories favorisées bénéficient de ressources financières plus importantes, disposent d'un meilleur niveau d'information et accordent souvent une importance primordiale à l'acquisition d'un bon capital scolaire. Elles sont donc potentiellement plus enclines à frapper à la porte de l'enseignement privé. De ce fait, si, entre 1984 et 2012, la proportion des enfants de familles favorisées est demeurée stable dans le public, elle a augmenté très significativement dans l'enseignement privé, passant de 26 % en 1984 à 30 % en 2002 pour atteindre ensuite 36 % en 2012. »
À Paris, dès 2012, les enfants des classes favorisées sont deux fois plus nombreux dans les collèges privés que dans les collèges publics.
« Les collèges scolarisant les plus faibles proportions d'enfants issus de milieux défavorisés appartiennent dans leur écrasante majorité à l'enseignement privé. À l'inverse, les collèges accueillant le public le plus défavorisé sont tous sans exception publics ».
Cet effet de ségrégation est le produit d'un double mouvement : la concentration des catégories sociaux-professionnelles supérieures (CSP+) au coeur des métropoles et le choix de plus en plus fréquent de celles-ci pour l'enseignement privé.
On constate le même caractère sélectif dans les grands lycées publics parisiens ou des capitales provinciales, passage quasiment obligé pour l'accès aux grandes écoles (École Polytechnique, ENS, HEC, ENA).
Rien d'étonnant donc si, désormais, les enfants d'origine modeste y sont rares.
Ainsi, leur représentation dans les quatre établissements cités est-elle passée de 29 % en 1950 à 9 % au milieu des années 1990, quand les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures représentaient 85 % de leurs effectifs.
Une évolution qui ne semble perturber ni les responsables administratifs absorbés par des réformes de carte scolaire, de programmes, de calendrier, de pédagogies « nouvelles » inadaptées aux conditions de leur exercice, ni les responsables politiques, préoccupés surtout de réformer les modes de sélection et les modalités de l'orientation, en ignorant superbement les débouchés réels.
Quant aux parents d'élèves, aux enseignants et à leurs représentations professionnelles, leurs urgences semblent aussi ailleurs.
« Le public de ces établissements, où se forme l'élite de la nation, est donc devenu sociologiquement complètement homogène , note Jérôme Fourquet, ce qui n'était pas le cas dans les années 1960 et 1970 » 202 ( * ) .
Le parcours scolaire royal des enfants de l'élite en route pour le pouvoir et/ou la banque passe toujours par l'École alsacienne, le lycée Stanislas, Sciences Po Paris et l'ENA, via éventuellement l'École Polytechnique ou l'ENS.
À noter enfin que ce qui vaut pour les études vaut aussi pour les loisirs, les traditionnelles colonies de vacances de l'après-guerre où se côtoyaient des enfants de milieux différents, en perte de moyens et de vitesse, ont laissé la place à des séjours à thèmes (voile, théâtre, etc.), beaucoup plus onéreux et socialement plus sélectifs.
À cela s'ajoute la disparition du service militaire obligatoire, qui a supprimé l'une des plus importantes institutions favorisant le brassage social.
Le stade ultime de la sécession des classes aisées, c'est l'émigration des plus riches vers des paradis fiscaux à proximité de Paris - Suisse, Royaume-Uni (avant le Brexit), Luxembourg, Belgique - beaucoup moins « spoliateurs » que la France à l'origine de leur fortune et de leur prospérité.
Parmi les exemples les plus emblématiques, celui de Patrick Drahi, 9 ème fortune personnelle de France (7,7 Md$ selon le classement Forbes 2019).
Ancien polytechnicien, c'est donc un authentique bénéficiaire de l'école publique et un non moins authentique « pantouflard ».
À la tête de la holding « Altice group » immatriculée au Luxembourg, il est fiscalement domicilié à Zermatt dans le canton suisse du Valais, particulièrement accueillant pour les émigrés fiscaux.
Le contribuable, en effet, n'est imposé que sur la moyenne des dépenses effectuées dans la commune, les revenus de l'étranger n'étant pas pris en compte !
La valeur des actifs de la holding varie entre 50 Md€ et 30 Md€ selon les fluctuations boursières pour un endettement quasi équivalent.
L'empire Drahi repose sur deux piliers : les télécoms (réseaux numériques avec Numéricable et téléphonie mobile avec SFR) et un panier de médias papier (l'Express, Libération., l'Expansion, l'Étudiant, Lire, etc.) ou télévision (Next radioTV, BFMTV, RMC).
Son champ d'action est essentiellement français avec des satellites étrangers (Portugal, Israël, Belgique et un moment USA).
Un empire que sa fragilité financière, dissimulée derrière des montages juridiques compliqués, vu son niveau d'endettement, condamne à la fuite en avant et au mouvement perpétuel : « tout l'empire fonctionne sur un système de vases communicants, où les actifs doivent être en mouvement perpétuel pour maintenir intacte l'illusion de santé financière. C'est ce que l'on appelle une structure de "leverage buy out", soit un dispositif de rachat et de transfert de la dette entre les différentes entités de l'empire. » (France culture 10 décembre 2018).
Ce qui a valu à Patrick Drahi le surnom « d'Houdini des télécoms ».
La clef de voûte du dispositif étant SFR qui réalise la moitié du chiffre d'affaires et qui porte l'essentiel de la dette du groupe Drahi, on comprend la valeur que pouvait avoir pour lui SFR, détenteur de l'autorisation d'exploitation du domaine public hertzien dont dépend son activité.
Or en 2014, SFR étant rachetable, plusieurs candidats sont en ligne, les deux plus importants étant Bouygues et P. Drahi. En début d'année, le ministre de l'économie, Arnault Montebourg, après enquête des services fiscaux se déclare très défavorable à P. Drahi pour cause de risque d'évasion fiscale : « Numericable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey dans un paradis fiscal de Sa Majesté la reine d'Angleterre, et lui-même est résident suisse !
Il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens, à Paris, en France. Nous avons des questions fiscales à lui poser ! »
Le 28 octobre de la même année, surprise, le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron autorise le rachat de SFR par Patrick Drahi. Côté banques, l'opération est conduite par la banque Lazard, dirigée en France par Matthieu Pigasse, propriétaire du journal Le Monde, qui prendra fait et cause pour Emmanuel Macron lorsqu'il sera candidat à la présidence de la République.
Au moment de la décision, l'action SFR valait 15,7 euros. Elle atteindra 60 euros en mars 2015 pour retomber à 34,5 euros en octobre de cette même année.
C'est Bernard Mourad, lequel connaît Emmanuel Macron depuis 2008, rencontré, selon Vanity Fair (octobre 2018), chez Morgan Stanley avant de rejoindre Patrick Drahi, qui est alors chargé des intérêts de ce dernier dans l'opération.
Toujours selon Vanity Fair, Bernard Mourad appelle Emmanuel Macron « mon lapin » , le bombarde de « forza » par SMS quand il ne l'exhorte pas à changer de politique.
Bernard Mourad, le nouveau patron de Bank of America en France, est « l'un des derniers qui osent parler "cash" au chef de l'État »
C'est donc par pure amitié et conviction qu'en octobre 2016, Bernard Mourad, alors à la tête d'Altice medias (pôle media d'Altice) rejoint Emmanuel Macron comme conseiller spécial en charge de la collecte des fonds, pour sa campagne. Il rejoindra ensuite Bank of America Paris
À part ça, l'oligarchie ne règne pas en France.
On comprend leur attachement à l'Europe en principe unie.
Cette évolution significative depuis 2000 se lit dans la hausse des inscriptions dans les consulats de ces pays et dans le nombre d'assujettis à l'ISF (avant qu'il ne soit supprimé), quittant chaque année la France (384 en 2001 et 784 en 2014, soit un quasi doublement).
Selon une récente étude du Cercle des fiscalistes 203 ( * ) , « sur quinze ans, presque 20 % des millionnaires français ont fui l'Hexagone. Un phénomène inédit, que l'on ne rencontre dans aucun autre pays de l'OCDE (...) faisant de la France le premier pays exportateur de millionnaires. »
Si ces considérations fiscales jouent un rôle essentiel dans cette émigration de l'oligarchie fortunée vers des pays plus compatissants, elle traduit aussi la disparition chez ces citoyens du monde, du sentiment d'appartenance à une communauté nationale et de de la notion même de responsabilité sociale.
Ne sont-ils pas déjà quittes en réalisant les profits dont est censé dépendre l'emploi des autres ?
Au final, l'idéal serait de pouvoir se débarrasser de ces encombrantes classes populaires devenues des boulets inutiles et de se tourner vers le grand large.
On retrouve l'analyse que Christopher Lasch consacre aux riches américains, évoquée plus haut et celle de Viviane Forrester dans L'horreur économique 204 ( * ) .
La grande nouveauté pour elle, c'est qu'il apparaissait « qu'au-delà de l'exploitation des hommes, il y avait pire : l'absence de toute exploitation », l'inutilité, l'homme devenu inexploitable, inutile à l'exploitation elle-même.
Difficile de ne pas penser à cette réflexion du tout nouveau président de la République française inaugurant « Station F », le 29 juin 2017, l'incubateur de start-up de son ami Xavier Niel : « une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, parce que c'est un lieu où l'on passe, un lieu que l'on partage (...) ».
Sauf que, précisément, une gare est un « non-lieu » au sens donné par Marc Augé 205 ( * ) à ce terme, un lieu où l'on se croise mais qu'on ne partage pas, le contraire du « monde commun » d'Hannah Arendt .
Quand le but de l'activité économique ou financière est le profit maximum et non un bénéfice « raisonnable », encore moins la production de richesse, vient un moment où c'est le producteur lui-même qui devient inutile.
D'où les entreprises bénéficiaires « dégraissées » pour faire monter leur valeur boursière, fermées définitivement ou délocalisées parce que les capitaux qui y ont été investis rapporteraient encore plus ailleurs.
D'où les territoires abandonnés parce qu'ils participent moins que d'autres à la production de la richesse nationale ou qu'y entretenir un niveau de service public minimum est jugé dispendieux 206 ( * ) .
L'économie n'est plus « localisée », ses dirigeants repérables, et encore moins identifiables les intérêts pour lesquels elle fonctionne.
D'où, à l'autre bout de l'échelle, le sentiment de toute-puissance et la morgue d'oligarques tenant la dragée haute aux chefs d'État, dont Carlos Ghosn, chef d'entreprise libano-brésilo-français, a représenté jusqu'à récemment le prototype.
Jusqu'au moment où la tempête se levant ils se redécouvrent un pays d'origine à appeler à l'aide, ce que fit Carlos Ghosn avant sa quatrième incarcération par la justice japonaise 207 ( * ) ou lors d'un retour au port en catastrophe, comme on l'a vu à l'occasion de la grande crise de 2008, pour les banques qui « croissent à l'international , comme disait l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre Mervyn King, mais (...) reviennent toujours chez elles pour mourir »...
Et y faire payer les obsèques par les contribuables.
III. LA DÉRIVE DES TERRITOIRES
Il n'y a pas que les continents qui dérivent, les territoires d'une « République indivisible » le peuvent aussi lorsque l'État abandonne aux marchés le soin d'assurer leur cohésion et de garantir l'unité nationale, notion devenue ringarde aux yeux des nouveaux riches, à l'heure de l'Europe et de la globalisation des échanges, enfin de ce qui passe pour tel.
Une situation inédite, l'État français étant par tradition nationalement interventionniste et, par force puis volonté, localement soucieux des intérêts locaux.
On le dit « jacobin » mais il s'agit d'un « jacobinisme bien tempéré », alliage d'un jacobinisme théorique, centralisateur, et d'un « girondinisme » de fait. Sur le terrain c'était un État acteur et pas seulement censeur, un État financier, ingénieur et expert, et pas seulement légiste, un État coopératif. Pierre Grémion 208 ( * ) désignera sous le nom de « pouvoir périphérique » cet attelage improbable d'élus locaux et de fonctionnaires d'État au service des collectivités locales.
Il s'agit donc pour nous d'analyser comment ont évolué des territoires ne disposant ni des mêmes atouts ni des mêmes ressources lorsqu'ils sont abandonnés à la logique des marchés ; autrement dit, la traduction territoriale de la montée des inégalités et des déformations de la pyramide sociale évoquées précédemment ainsi que les effets de la « modernisation » forcée de l'organisation territoriale ces dix dernières années.
Il s'agit enfin d'évaluer l'état de l'opinion face à ces évolutions, le meilleur baromètre restant encore les urnes, même s'il serait hasardeux de chercher une corrélation systématique entre vote et situation sociale ou territoriale.
À en juger par les résultats des présidentielles de 2017, ces opinions sont à la fois incertaines et tranchées.
Si les sentiments positifs sont encore majoritaires dans les urnes comme le montrent les résultats finaux, c'est de justesse et surtout sur fond d'absentéisme et de votes blanc ou nuls massifs.
Les résultats du premier tour, eux sont plus tranchés (carte ci-dessous).
Aux particularismes locaux - l'implantation historique de la gauche en Dordogne, Ariège, Seine-St Denis plaçant Jean-Luc Mélenchon en tête, et la forte implantation du FN dans le sud de la France liée à celle des rapatriés d'Algérie et, comme dans le Var, à une non moins forte présence militaire - la carte montre que c'est essentiellement dans les départements dotés d'une métropole que le vote « Macron » s'est manifesté dès le premier tour.
Candidats arrivés en tête du 1 er tour des élections présidentielles.
Vote des agglomérations
Ce que confirment les votes des grandes villes, encore une fois avec l'exception du sud : Marseille et Avignon particulièrement.
Elle montre aussi la corrélation entre le vote FN et les zones antérieurement industrialisées, celles qui ont le plus pâti du libre-échange version mondialisée.
Ses habitants sont les premiers à avoir le sentiment de l'effondrement de leur monde et à se sentir abandonnés de l'État.
Les autres à se sentir orphelins, sans que cela se traduise forcément dans les votes, sont les territoires victimes de la libéralisation du service public, du désengagement de l'État et de la remise en cause du modèle territorial français.
A. LES LAISSÉS-POUR-COMPTE DE LA MONDIALISATION
Cette réflexion de Lionel Jospin à l'annonce de 7500 licenciements par Michelin (septembre 1999) est passée à la postérité : « Il ne faut pas tout attendre de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse administrer désormais l'économie. Ce n'est pas par la loi, les textes, qu'on régule l'économie...Tout le monde admet le marché. »
Ce n'était pas le premier plan social - depuis 1990, ils s'étaient multipliés - mais, sur le moment, la déclaration du Premier ministre socialiste choqua au moins une partie de ses amis politiques puis, construction européenne et libre échange aidant, tous les gouvernements s'habituèrent à la multiplication des Plans sociaux rebaptisés Plans de sécurisation de l'emploi , ce qui, évidemment, changeait tout.
Les emplois étant localisés, les vagues de fermetures d'entreprises finirent par avoir des effets dévastateurs dans les régions françaises les plus industrialisées où étaient traditionnellement implantées les grandes entreprises industrielles : sidérurgie, textile et confection, chantiers navals, chimie, automobiles, etc.
La carte ci-dessous rappelle les implantations des emplois industriels lors des Trente glorieuses (Jacques Sapir Blog 25/04/2017).
Et, si on recoupe cette carte avec celle des votes au premier tour des élections présidentielles de 2017, on constate à quelques exceptions - qu'explique l'histoire locale ou l'implantation plus récente d'industries employant beaucoup de cadres, comme l'aéronautique à Toulouse - une forte coïncidence avec le vote pour Marine Le Pen.
« Ce sont, conclut Jacques Sapir, les zones d'ancienne industrialisation, les zones qui ont été le plus touchées par l'impact de la mondialisation puis par l'impact de l'euro, qui ont fourni à Marine le Pen ses meilleurs résultats. »
Un vote qui ressemble fort à du ressentiment devant l'abandon de ces territoires au nom de Ricardo, alors même que nombre de ces industries (la sidérurgie par exemple) avaient été modernisées.
Tous les pays européens n'ont pas fait le choix de laisser leur industrie se réduire comme peau de chagrin, l'Allemagne certes mais aussi d'autres, bien moins puissants économiquement : Hongrie, Pologne, Autriche, Finlande, Danemark, Suède ... (voir ci-après).
Même si, avec l'Italie et le Royaume-Uni, en termes de valeur ajoutée, la France figure parmi les premières nations industrielles européennes, l'industrie y occupe nettement moins de place que dans beaucoup d'autres pays européens.
« L'Industrie dans les territoires français : après l'érosion, quel rebond ? » (Observatoire des territoires - 14 novembre 2018)
Mais le plus difficile à accepter par les intéressés, c'est, comme l'a montré, une fois encore les palinodies qui ont précédé la fermeture des hauts fourneaux d'Arcelor Mittal de Florange (Moselle) en avril 2013, l'impression que les pouvoirs publics trouvent naturels ces abandons 209 ( * ) .
En 2014, la mairie d'Hayange passe au Front National. « En politique, la lâcheté a un prix », estimera plus tard, Arnaud Montebourg qui, « ministre du Redressement productif », avait alors milité pour une nationalisation temporaire de l'entreprise 210 ( * ) .
B. VERS UNE TERRITORIALISATION DES INÉGALITÉS ?
La montée des inégalités sociales, la formation d'une oligarchie de la fortune et du patrimoine ont-elles trouvé une traduction territoriale, ce qui marquerait la fin de la mixité sociale et, dans les faits sinon en droit, celle de la « République indivisible » ? Telle est la question qui divise les experts es territoires, leurs conclusions dépendant largement de leur méthodologie.
Quelle que soit la réponse, il est clair que c'est le phénomène de métropolisation qui sert désormais de pôle d'attraction de la recomposition sociale et territoriale avec, d'un côté ceux qui en bénéficient, de l'autre ceux qui en pâtissent, la « France périphérique ».
1. La « construction sociale des territoires »
Dans un article publié par Slate (03 avril 2017) Henri Mendras fait apparaître par une série de cartes, la « construction sociale » des territoires qui, selon lui est en cours, autrement dit la traduction territoriale des distinctions de classes et de revenus.
a) Les classes supérieures et moyennes supérieures
Les classes supérieures et moyennes supérieures, les cadres, ont investi ce qu'on appelait dans les années 1960 les « villes de commandement » : métropoles et grandes villes, villes universitaires et administratives importantes.
Sont concernées toutes les capitales des 21 anciennes régions auxquelles s'ajoutent Grenoble, Nice, Angers, Tours et des villes de l'Est.
Alors que la proportion de cadres y dépasse souvent 20 % 211 ( * ) , elle chute à moins de 2 % dans de nombreuses zones rurales.
Paris et sa première couronne sont évidemment particulièrement attractifs pour la classe dirigeante
Loin de ralentir, le processus s'accélère comme on le voit sur l'exemple de Paris et de deux des métropoles de province, Lyon et Toulouse :
Rejetant à l'extérieur les catégories populaires par un prix des loyers et du foncier hors de leur portée, la métropole ne conserve que celles dont elle a besoin : des immigrés non formés qui exercent des métiers sans qualification au sein d'un parc HLM en périphérie ; et les « key workers » (ceux qui assurent le service public mais dont les salaires ne leur permettent pas de se loger dans le privé), dans le parc HLM des centres villes en général.
Résultat : en France, deux tiers des ménages vivant sous le seuil de pauvreté habitent dans les zones les plus denses des grandes villes.
Étrange situation qui rappelle celle des grandes cités des pays autrefois appelés « sous- développés » où l'extrême richesse côtoie une pauvreté abyssale.
Selon une récente étude de l'Institut-Elabe, c'est dans ces métropoles que se concentrent 60 % de Français « affranchis », dont le revenu est de 20 % supérieur à la moyenne et qui bouclent facilement leurs fins de mois (75 %), à l'aise avec le numérique (95 %), attachés à l'UE (75 %) et optimistes quant à leur avenir et celui de la société.
Au premier tour des présidentielles 42 % ont voté Emmanuel Macron.
Ces « affranchis » représentent 21 % de la population selon l'étude.
b) Les classes moyennes (professions intermédiaires)
Si les classes moyennes - « professions intermédiaires » - sont, elles aussi, urbaines et résident en banlieue, elles sont moins sélectives dans leurs choix, résidant en première couronne des métropoles et dans les quartiers centraux des villes moyennes.
À noter cependant que la concentration urbaine de ces classes moyennes est moindre que celle des catégories supérieures puisque la proportion des professions intermédiaires dans la population active varie seulement du simple au triple entre le rural profond et les grandes villes.
Le problème c'est qu'on ignore comment se répartit cette classe moyenne entre le rural profond et les grandes villes. La formulation elle-même laisse penser qu'une partie d'entre elle (il suffit de regarder la carte) est dispersée sur l'ensemble du territoire. Les classes moyennes et supérieures ayant investi les villes, les classes populaires vivent essentiellement à la campagne, et tout particulièrement les ouvriers. Leur proportion augmente avec la distance à la grande agglomération la plus proche.
Ils se concentrent ainsi aux limites des départements voisins de métropoles où ils forment parfois plus de 40 % des actifs.
Grande différence avec le XIX e siècle où les ouvriers habitaient essentiellement dans les villes.
Le XX e siècle a progressivement repoussé ces « classes dangereuses » vers les faubourgs, puis les cités.
Aujourd'hui elles sont rejetées aux marges du territoire avec cette nuance qu'au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, les ouvriers ont été largement remplacés par des techniciens ayant une formation et un salaire supérieurs, ce qui les range dans la classe moyenne.
Le premier problème posé par cette répartition territoriale, c'est que les ouvriers sont censés représenter la totalité des classes populaires, notamment les employés.
Le second problème c'est que les professions agricoles ont disparu.
Les classes populaires constituent le gros des effectifs des 25 % de Français « assignés » (sous- entendu, à résidence) dans l'enquête de l'Institut Montaigne.
Leur revenu qui se dégrade est inférieur de 15 % à la moyenne, ils ont des fins de mois difficiles (72 %) et se disent très majoritairement pessimistes sur leur avenir comme sur celui de la société.
Aux dernières élections présidentielles 37 % ont voté Marine Le Pen et 29 % se sont abstenus, 34 %, contre 22 % en moyenne, se sont dit « Gilet jaune ».
2. France périphérique versus France des métropoles
a) La France des aménageurs
Du constat du poids économique, démographique et donc politique des grandes unités urbaines bénéficiaires de la libéralisation économique et financière, au fil de ce demi-siècle, les « experts » chargés de dire l'avenir du territoire, puis le pouvoir politique, en sont venus à l'idée que c'était à partir de ce qui allait devenir par la grâce de Nicolas Sarkozy (Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dite RCT) puis de François Hollande (Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM »), les métropoles, qu'il fallait penser le pays et repenser son organisation territoriale.
Au final, le statut de chaque collectivité serait définissable en fonction de son degré d'urbanité et de sa distance à un pôle métropolitain ou, faute de mieux, la France n'étant pas encore parfaitement moderne, ce qui en tient lieu.
Comme on le verra les lois RCT, MAPTAM et NOTRe, qui parachève l'édifice, auront pour fonction l'accélération du mouvement.
« Puisque la concentration est inévitable, alors multiplions les lieux de concentration » écrit dès 2001, l'inventeur du « polycentrisme maillé », Jean Louis Guigou (époux d'Élisabeth Guigou, ancienne Garde des Sceaux), alors délégué de la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (DATAR), avant de devenir Inspecteur général de l'Éducation nationale pour cause d'alternance (Rapport au Conseil d'analyse économique La documentation française). L'opération prendra le nom d' « approfondissement » de la décentralisation, ce qui est un abus de langage.
Morceaux choisis :
« La question du territoire local de l'action publique est désormais posée. Elle peut être envisagée sous la forme d'ajustements à la marge, s'inscrivant ainsi dans une certaine tradition politique ou administrative française. Ou bien prendre la forme d'un véritable approfondissement de la décentralisation. Dans ce cadre, il s'agirait alors d'une réforme territoriale permettant l'émergence d'un nombre réduit de collectivités de base, issu du processus intercommunal en cours... La voie suggérée conduirait à réintégrer sur un territoire pertinent et doté de l'homogénéité institutionnelle, la compétence comme habilitation à administrer, l'autorité élue au suffrage universel direct pour la mettre en oeuvre et le pouvoir fiscal propre pour lui en donner les moyens autonomes. »
« Accompagnant la recomposition du territoire de l'action publique, la région apparaît comme le niveau d'articulation le plus à même de valoriser les réseaux de croissance et de solidarité, rendant possible une adaptation des politiques publiques permettant de prendre en compte la variété des territoires...La question de la pérennité du département et de son articulation avec les autres niveaux est, dans ce contexte posée... » 212 ( * )
L'avenir du pays dépendant des locomotives métropolitaines, le temps des restrictions budgétaires étant venu avec la crise, il apparut aux stratèges officiels qu'il n'était plus possible à l'État de soutenir et les métropoles et le reste du territoire: « La nécessité de soutenir la croissance des territoires à forts avantages comparatifs [ la recherche de compétitivité dans les zones déjà les plus riches], d'une part, écrit Laurent Davezis, et l'obligation de solidarité en faveur des grands perdants de cette mutation [imposée par la crise], d'autre part, risquent fort d'épuiser les marges, déjà réduites de l'action gouvernementale. Dans ce contexte très tendu, il n'est pas douteux que ce dilemme va remettre en question la notion même d'égalité territoriale qui a été unanimement plébiscitée dans les années passées. » 213 ( * )
Du constat d'un divorce géographique entre les forces de production et les dynamiques de développement, entre les lieux de croissance (au sens classique) et ceux du bien-être, on passe donc à l'idée que les seconds, effets des mystérieux « amortisseurs sociaux », vivent en parasites des premiers. ( voir annexe 1 de cette partie)
Et quand l'argent se fait rare, plus moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre, le développement, la compétitivité et le bien-être au pays. Comme disait Nicolas Sarkozy aux maires du Cher réunis à Saint-Amand Montrond, le 1 er février 2011 : « Si vous voulez qu'on fasse plus de TGV, on ne peut pas garder le bureau de poste pour tout le monde ouvert avec, vous savez (le préposé) à la casquette au liseré jaune qui dit « mon métier c'est la poste et pas le service public ».
b) Y a-t-il une « France périphérique » ?
D'évidence, le biais le plus important introduit par cette première forme de représentation des territoires, centrée sur les métropoles, c'est de faire disparaître l'essentiel : les habitants et les collectivités rurbaines du continuum périurbain, des villes moyennes ou petites et des zones rurales qui, par-delà leurs différences, ont plus de problèmes communs qu'ils n'en ont avec les métropoles, notamment en termes d'accès aux services public.
Christophe Guilluy appellera cet ensemble : la « France périphérique » : « La distance à une ville mondialisée, dit Christophe Guilluy, donne la mesure de cette géographie sociale. Face aux métropoles mondialisées émerge une " France périphérique" majoritaire, constituée de territoires périurbains, ruraux, industriels mais aussi de petites et moyennes villes. Le séparatisme est une des dimensions de cette nouvelle géographie sociale. »
Ces territoires, nous dit Guilluy, cumulent les fragilités :
- Service public en retrait (et donc diminution de l'apport des salaires des fonctionnaires dans le tissu économique local) ;
- Distance des pôles universitaires ayant des impacts sur le devenir des enfants ;
- Nécessité de la voiture personnelle pour se déplacer ;
- Zone de faible création d'emplois et de très faible création d'emplois qualifiés ;
- Ascension sociale quasi nulle alors que les habitants des quartiers HLM des métropoles voient certains d'entre-eux s'élever à la classe moyenne 214 ( * ) .
Il faut cependant se méfier d'une vision par trop globale de ces territoires. Ainsi la carte ci-joint en visualisant ces fragilités sur l'ensemble de l'hexagone, donne une représentation unifiée de territoires par ailleurs très divers.
L'usage de critères agrégés expose aussi à ce biais.
Ainsi, l'Île-de-France qui figure parmi les zones les moins fragiles connaît-elle un taux de pauvreté (15,6 %) supérieur d'un point au taux moyen français ; en Seine-Saint-Denis il est double de ce taux moyen. Seuls les Hauts-de-Seine présentent un taux inférieur à la moyenne.
À noter enfin que le taux de pauvreté augmente dans la plupart des départements d'Île-de-France, alors qu'il baisse dans nombre de départements ruraux (Creuse, Haute Corse, Corrèze, Cantal, Lot, etc.).
D'où la question : l'existence de métropoles privilégiées et de problèmes communs ailleurs justifient-ils pour autant, comme le fait Guilluy, de regrouper cet ensemble, soit 80 % de la population sous la commune étiquette de « France périphérique » ?
Le rabot de la mondialisation et des bureaucraties bruxelloise et nationale aurait-il fait que la France ne se nomme plus diversité, pour reprendre l'expression de Braudel ? 215 ( * )
Certainement pas, et pour calmer les ardeurs captatrices des métropoles qui ont l'oreille des responsables politiques et des bureaucrates d'État, ce serait commettre une erreur symétrique à celle qui vient d'être dénoncée que de passer par pertes et profits la diversité territoriale dont le génie français, à travers les collectivités locales, a su tirer parti.
Ainsi, l'enquête de l'Institut Montaigne retient-elle la catégorie des Français « enracinés » (22 % de la population), dont la moitié vit dans une commune rurale ou dans une petite agglomération et qui, « heureux au pays » ou dans leur quartier, n'entendent pas changer de résidence.
Comprenant beaucoup de retraités, très souvent propriétaires de leur logement (75 %) disposant de revenus moyens, n'ayant pas de problèmes de fin de mois et ayant voté prioritairement Fillon ou Macron aux dernières présidentielles, ils se disent optimistes.
L'importance des fragilités est rendue selon la profondeur du bleu. Les parties violet clair renvoyant à un niveau faible sont les plus nombreuses aux alentours des villes et d'autant plus étendues que les agglomérations sont importantes.
Quant à la quatrième catégorie, retenue par l'Institut Montaigne, les Français « sur le fil » - ceux dont les revenus sont un peu inférieurs à la moyenne et qui ont des problèmes majeurs de fin de mois - qui rassemble un tiers de la population (32 %), ils sont dispersés sur l'ensemble de l'hexagone, avec une surreprésentation dans les Hauts-de-France et le Centre-Val de Loire.
La structure sociale de cette catégorie est proche de celle de la France. Ses membres sans préférence partisane spécifique sont à 32 % des adeptes de l'absentéisme électoral ou du vote blanc.
Au final, si on note bien une territorialisation des inégalités sociales, elle s'observe essentiellement au niveau des métropoles, de leur première couronne et de certains quartiers (principalement centraux) des villes moyennes où se concentrent les classes supérieures et moyennes supérieures.
Pour le reste du territoire, avec des spécificités liées à l'Histoire (naufrage de l'industrie dans la France du Nord et de l'Est ; effet de l'hélio-thalasso tropisme sur la côte atlantique ou méditerranéenne ; attachement régionaliste, notamment en Bretagne...), il serait hasardeux de lier trop strictement situation sociale et lieu de résidence.
C'est d'ailleurs l'une des interprétations que l'on peut donner d'une des conclusions de l'étude de l'Institut Montaigne :
« Le Baromètre des Territoires révèle que les fractures sociales sont plus déterminantes que les fractures territoriales pour comprendre les parcours de vie des Français. Ces fractures sociales divisent la société française qui se retrouve éclatée en quatre grandes familles qui se côtoient, voire se croisent assez largement au sein des mêmes territoires. Apparaît ainsi l'image d'une France en morceaux, qui expriment pourtant un commun attachement à la France et, à travers cet attachement, l'envie ou l'espoir d'un destin commun. »
Sauf qu'une construction intellectuelle à partir de réponses à des questions, forcément disparates, ne peut guère produire autre chose qu'un modèle juxtaposant des morceaux 216 ( * ) . Cette approche est tout aussi biaisée que celle qui classe les territoires en fonction de leur distance à une métropole.
La société française n'est pas « fracturée » mais plus inégalitaire et oligarchique que jamais depuis la Libération. En tous cas, si elle l'est c'est d'abord sur le plan social.
Pour conclure ce chapitre, disons que ce qui est incontestable, c'est l'éviction des classes populaires et moyennes inférieures des grandes villes et la « gentrification » de celles-ci, sous l'effet de la spéculation foncière, comme on l'a vu, et le développement autour d'elle d'un halo urbain par une sorte de tamisage social de plus en plus fin, à mesure qu'on s'éloigne du centre.
La constitution de véritables bastions des « élites » de la fortune et du pouvoir réel accentue évidemment le caractère oligarchique de l'évolution sociale, donnant un fondement à la théorie populiste d'une coupure entre les dominants, « eux », et le peuple, « nous ».
Si la principale explication est évidemment le prix du foncier et des loyers, passé le premier cercle du halo banlieusard, entre aussi en ligne de compte le rêve pavillonnaire qui travaille depuis longtemps la classe moyenne et la classe ouvrière supérieure, comme on l'a vu pour l'Angleterre en guerre de George Orwell.
Outre la coupure de classe, dont les effets politiques sont, à terme, ravageurs, un autre effet pervers de cette évolution - comme on commence à le voir à Paris - c'est la transformation, Airbnb aidant, de certaines capitales, grandes villes ou villes moyennes au passé prestigieux, en musées.
Par contre, l'effet positif du phénomène, c'est la revitalisation démographique de nombreuses communes, notamment rurales qui y ont puisé un nouvel élan. La rurbanisation d'espaces autrefois strictement ruraux en perte de vitesse explique pour beaucoup la vitalité des communes moyennes et rurales de ces dernières années.
Le problème, c'est qu'au lieu d'accompagner cet élan porteur, en même temps qu'il se défaussait en faveur des marchés de l'équipement des territoires et de la responsabilité des services indispensables à leur vie, l'État a paralysé les acteurs publics locaux par ses réformes de l'organisation territoriale et par ses ponctions sur les ressources - notamment fiscales - des collectivités.
Au lieu de s'appuyer sur la vitalité communale et départementale, il les a paralysées, en superposant à une organisation territoriale française imposée par deux siècles d'Histoire, un modèle d'organisation d'origine et à finalité strictement idéologique, comme on le verra un peu plus loin.
Au final donc, ce qui rend quasi impossible une représentation simple du territoire, c'est que le phénomène métropolitain associé au désengagement de l'État et à la marchandisation du service public, est venu perturber l'organisation territoriale française classique, faite d'un réseau enchevêtré de collectivités de toutes tailles.
Une situation complexe, produit de la géographie et de l'Histoire que les réformes de ces dix dernières années, bousculant le modèle classique sans le remplacer par une organisation nouvelle efficiente, n'ont fait que compliquer encore.
Le meilleur exemple c'est évidemment la réorganisation ni faite ni à faire de la région qui en aurait le plus besoin, l'Île-de-France.
Voyons donc, plus en détail, ces deux questions fondamentales que sont le service public et la « modernisation libérale » de l'organisation territoriale, de ces dix dernières années.
C. LA QUESTION DU SERVICE PUBLIC
Les métropoles et les grandes villes mises à part, la question du service public est celle qui aujourd'hui préoccupe toutes les collectivités.
À des degrés divers et pour des services différents - les villes moyennes étant surtout préoccupées par leur liaisons ferroviaires, aériennes, l'accès au haut débit numérique, et les communes rurales par l'urgence que représentent les services de proximité (écoles et établissements secondaires, poste, présence médicale, hôpitaux, etc.). (voir annexe 2 de cette partie)
Le grand déménagement des services publics a coïncidé avec la fin des années 1990 et la mise en fonctionnement de la zone euro. Entorse au règne de la concurrence libre et non faussée, d'abord tolérés durant une période de transition comme une concession à des idiosyncrasies locales, ils connaîtront un lent déclin, en phase avec celui du budget de l'État.
Le problème c'est que si dans les zones denses, des services marchands lucratifs ont pu remplacer le service public, ce n'est pas le cas dans les zones rurales, voire dans les petites villes.
L'un des meilleurs exemples est probablement celui de la téléphonie mobile où les opérateurs titulaires d'un droit d'utilisation du domaine public hertzien trainent les pieds pour équiper les territoires.
Si on ajoute l'idée saugrenue d'organiser la concurrence entre des entreprises devant utiliser un réseau commun (ferroviaire, électrique, téléphonique, hertzien dans les zones peu denses) on aura une idée assez bonne de la situation !
C'est dans ce contexte qu'on entend régler la question de l'accès au service public en zone rurale par des « maisons du service public » largement financées par les collectivités et par la dématérialisation.
L'accueil de la dématérialisation n'est déjà pas garanti lorsqu'on dispose d'un réseau de qualité, lorsqu'il fonctionne de manière aléatoire, il l'est encore moins.
Le déploiement du réseau de télévision en mode analogique puis le passage à la TNT, suivi de celui à la haute définition demandèrent d'ailleurs la contribution des collectivités pour supprimer les zones d'ombre.
On n'en finirait pas de décliner la liste des services publics en voie de dégradation.
S'agissant des services de proximité, les communes rurales sont évidemment les premières concernées.
Source : « 36 000 communes », mars 2019, d'après « Services publics et territoires » PUF 2017
Ce tableau montre l'évolution entre 1980 et 2013 de la présence réelle des principaux services publics dans les communes rurales.
À noter que depuis 2013, le mouvement, en particulier la fermeture des perceptions et des maternités, s'est accéléré.
Non seulement la présence de ces services s'est raréfiée mais leur qualité s'est dégradée.
La grande spécialité de La Poste, notamment, c'est de diminuer régulièrement les jours et les heures d'ouverture des bureaux, ou s'agissant des guichets automatiques de banque, quand ils existent, de les réparer avec retard pour mieux constater que leur fréquentation ne justifie plus leur présence.
Autre technique de La Poste et d'autres opérateurs : sous-traiter les services aux collectivités (agences postales) ou à des commerçants (points Poste). Ainsi, La Poste peut afficher n'avoir pas réduit le nombre de ses « points de contact ». C'est seulement le service qui est réduit ou assuré par d'autres en mode allégé.
Comme le montre la carte ci-dessous, toute la France rurale subit cette inégalité d'accès aux services publics qui, à mesure que l'État se désengage, va grandissant, les services marchands étant peu enclins à les remplacer.
Pire, la concentration de la distribution commerciale et la réorganisation des circuits, conjuguée au changement des habitudes alimentaires, font que même les petits commerces de détail (épiceries, boucheries) disparaissent.
À noter que les conditions de vie dégradées dans certaines zones de banlieue ont entraîné un retrait comparable des services publics et marchands.
À un autre niveau, le même problème est rencontré par les communes moyennes en matière de transports ferroviaires ou aériens.
Quand une gare existe, les trains, et plus encore les TGV, s'y arrêtent de plus en plus rarement ou sont simplement supprimés, comme beaucoup de trains express et de trains de nuit autrefois utilisés pour désenclaver les villes petites ou moyennes. Quand ils subsistent - cas du Briançon, Gap, Paris - c'est sous une forme dégradée.
Les cas d'Aurillac (voir annexe) ou de Montluçon, parmi tant d'autres, sont emblématiques.
Ainsi, la principale commune de l'Allier est située à 183 kilomètres à vol d'oiseau de Lyon, sa nouvelle capitale régionale mais à trois heures et demie par le train, avec un changement impératif.
Dans les années 1980, il y avait de six à huit liaisons quotidiennes directes entre Montluçon et Paris. Il n'y en a plus que deux 217 ( * ) .
Cette situation est d'autant plus regrettable que le maillage de la desserte aérienne des villes moyennes enclavées est très lâche (voir carte).
De plus, si les lignes aériennes doivent être financées par les collectivités, quand elles existent sur le papier, on n'est jamais sûr, notamment en hiver, que les avions partiront.
INSEE Première, janvier 2016
Manque à ce tableau édifiant l'évolution tout à fait paradoxale du système de santé en France.
Constatons d'abord qu'en la matière l'État, au nom de la sécurité, « donne le la » : entre 1996 et 2016, une maternité sur trois a été fermée. Entre 2013 et 2017, 95 hôpitaux publics de proximité l'ont été, soit une baisse du nombre de ces sites de 7 % en 4 ans. Les grèves récurrentes des hospitaliers sont le signe lancinant du malaise qui en résulte.
S'agissant des cliniques privées, la baisse se limite à 2 %.
Côté médecine libérale, malgré ce qu'on a pu dire des méfaits du numerus clausus , il n'y a jamais eu autant de médecins en France 218 ( * ) , jamais la consommation de soins et de bien médicaux n'a été aussi importante, ces dépenses font l'objet à 85 % d'une prise en charge collective et, les revenus des praticiens suivent le mouvement.
Parallèlement les files d'attentes pour accéder à certaines spécialités s'allongent, partout les urgences sont au bord de l'implosion et la démographie médicale de certains départements, des zones rurales et de certains secteurs urbains atteint la cote d'alerte.
La permanence des soins en zone rurale, y compris pour les EHPAD, n'y est plus assurée, même dans des départements - comme le Var - où la démographie médicale globalement se porte bien.
Et la dérive s'accélère. En 2017, 148 cantons, soit l'équivalent d'une région moyenne, ne disposaient pas d'un médecin généraliste contre 91 en 2010, 511 n'avaient pas de dentiste.
Au total, 3,9 millions de Français vivent dans des territoires dont la situation est alarmante (Le Monde, 31 mars 2017).
Sur la période 2007-2016, 86 départements ont vu leur densité médicale (spécialistes et généralistes confondus) baisser (-20,2 % pour le Gers).
Toutes les mesures incitatives (notamment financières) censées faciliter le remplacement des médecins partant à la retraite, la création de « maisons de santé » sont très loin d'avoir réglé le problème, lequel ne peut l'être qu'à deux conditions :
- que l'État cesse de fermer les hôpitaux et les maternités dits « de proximité », de réduire leurs moyens et leurs effectifs ;
- que la prise en charge par la collectivité de l'essentiel de la formation des praticiens - qui ailleurs, comme aux USA, est payante -, des médicaments et des soins s'accompagne d'une contrepartie de service public (gardes, possibilité d'installation) pour les praticiens qui en bénéficient.
Autant dire que ce n'est pas pour demain qu'un gouvernement libéral prendra ce risque politique.
Constatons enfin que la même disparité d'installation s'observe pour les pharmacies, ce qu'un récent conseil des ministres reconnaît en termes choisis :
« Malgré une bonne accessibilité, il existe actuellement des disparités sur le territoire, notamment entre les zones fortement urbanisées, où l'on observe une surdensité officinale, et les zones rurales ou isolées, où l'accès aux officines est moins aisé pour la population » (compte-rendu du conseil des ministres du 3 janvier 2018).
Mais là aussi, la solution n'est pas pour demain.
Comment s'étonner que « le bon peuple », se soit mis à douter de ses dirigeants et du système en place !
D. DES RÉFORMES NI FAITES NI À FAIRE
Comme nous l'avons dit plus haut, au lieu d'accompagner la redistribution démographique commencée avec les Trente glorieuses pour en tirer le meilleur parti, l'État, en même temps qu'il se défaussait sur les marchés de l'équipement des territoires déjà urbanisés ou en voie d'urbanisation, qu'il abandonnait les services publics à des marchés bien incapables de le remplacer là où les investissements ne seraient pas rentables, a paralysé les acteurs publics locaux par ses réformes et par ses ponctions sur les ressources - notamment fiscales - des collectivités.
Au lieu de s'appuyer sur la vitalité communale et départementale, il a paralysé ces collectivités pour des motifs strictement idéologiques, en superposant à l'organisation territoriale française imposée par deux siècles d'Histoire, un modèle d'organisation d'inspiration totalement différente.
Au final, une réforme ni faite ni à faire, paralysante, que l'on continue à complexifier sous prétexte de la rendre supportable au lieu de la revoir de fond en comble.
1. Le modèle républicain français d'organisation territoriale
L'organisation territoriale française, depuis la Grande Révolution repose sur deux piliers : la commune et le département.
Il faudra deux siècles pour que s'y ajoute un troisième, en août 1981, avec les lois de décentralisation Deferre-Mitterrand, collectivité territoriale d'inspiration différente qui d'ailleurs n'a pas encore vraiment trouvé sa place, faute de moyens et d'une légitimité démocratique suffisante : la région.
En ces époques où triomphe le management, on préfère oublier, qu'avant d'être une décision du « législateur », la commune française est d'origine insurrectionnelle, que la révolution paysanne contre la féodalité pour récupérer les droits du sol et d'usage des « communs » a précédé la révolution populaire et bourgeoise citadine, qu'en juillet 1789 le choix de donner le pouvoir de régler ses propres affaires à toutes les communautés et pas seulement aux villes et aux bourgs a été fait par les insurgés, ce que la loi municipale de décembre ne pourra qu'entériner.
Et cela malgré l'opposition de bon nombre de ses membres éminents comme Sieyès et Condorcet qui préféraient de grandes communes ou communes de niveau central et cantonales ou agrégatives par opposition aux communes de base. Comme dira alors Sieyès : « la France ne doit être ni une démocratie, ni un état fédératif » 219 ( * ) .
Le premier terme de l'injonction valait pour la commune et le second pour le département, qui n'avait pas vocation à remplacer les anciennes provinces.
Ils auront un temps gain de cause avec la loi du 22 août 1795 qui se soldera par un échec complet, les électeurs boudant un exercice qui avait pourtant suscité leur enthousiasme en mars 1790.
On préfère oublier aussi ce qu'avait déjà d'inouï et pour beaucoup d'esprits « éclairés » d'irresponsable, le fait de confier la gestion des affaires communes à des paysans incultes alors que la paysannerie anglaise était chassée de son terroir et que le servage régnait en Allemagne, pour ne rien dire des pays plus à l'Est.
La particularité des municipalités révolutionnaires, écrit excellemment Maurice Bourjol était de réaliser « l'adéquation de la « communauté » sociologique avec la « commune » politique, de (créer) une classe de citoyens petits propriétaires nouveaux, dont 110 000 issus du partage des communaux. » 220 ( * )
La contrepartie, c'est le grand nombre de communes de tailles et de ressources très différentes, argument critique favori des réformateurs qui se succéderont au pouvoir au fil des siècles, sans succès jusqu'à tout récemment, le réflexe démocratique ayant jusque-là prévalu.
L'autre caractéristique de la commune, en effet, est d'être la cellule de base de la démocratie républicaine.
En effet, depuis la Révolution, la citoyenneté à la française a un « double visage » : celui du droit de participer à la gestion locale dans le cadre de la loi et celui de participer à la responsabilité politique nationale par l'élection de ceux qui feront cette Loi.
Une souveraineté double donc.
La République est au village en même temps qu'à Paris, la « petite Patrie » incluse dans la Grande, la démocratie locale - apport décisif de la Révolution- au fondement de la démocratie tout court.
Au final, la République est une et indivisible, la souveraineté toute entière dans la Nation et pourtant la France est le pays où toutes les communes et pas seulement les grandes villes , ont le plus de liberté par rapport au pouvoir central ou par rapport aux collectivités de rang supérieur, ce qui est rarement le cas dans les pays fédéraux pourtant réputés plus décentralisés donc plus libéraux au sens où l'entendait Tocqueville.
Pour être d'inspiration politique, le modèle républicain français d'organisation territoriale, contrairement à ce qu'essaient de faire croire les « réformateurs », n'en est pas moins efficace.
Le développement par la démocratie locale, tel sera notamment l'ambition de la dernière grande vague de décentralisation :
« Les collectivités territoriales et leurs élus sont traités comme des mineurs, placés sous tutelle pour gérer les affaires locales...
Le projet de loi (...) a pour objet de transférer le pouvoir aux élus, aux représentants des collectivités territoriales librement désignés par leurs concitoyens. Il modifie fondamentalement la répartition du pouvoir. Il fait des communes, des départements et des régions des institutions majeures, c'est-à-dire libres et responsables. 221 ( * ) »
À aucun moment d'ailleurs les critiques de ce modèle n'apportent la preuve que gérer autrement serait plus efficace, ferait faire des économies de gestion, encore moins apporterait plus de satisfaction aux citoyens et aux usagers du service public.
Avec le développement de l'intercommunalité volontaire de projet qui se développera à partir de 1992, la démocratie locale aura su se réformer pour répondre aux difficultés posées par le grand nombre de petites, voire très petites, communes.
Au terme de deux cents ans d'histoire, vingt ans de décentralisation accélérée, après dix ans de développement spectaculaire de l'intercommunalité volontaire, au terme d'années de saines finances, d'investissements et d'équipements, le pays dans le plus petit de ses villages s'est profondément transformé.
Preuve, s'il en était besoin que le vieux modèle républicain articulant commune, département et État a parfaitement joué son rôle. Aux experts près, qui confondent la carte avec le territoire et se doivent de justifier leur existence, personne ne se posait plus vraiment la question de savoir s'il y avait trop de communes en France.
Le développement de l'intercommunalité volontaire, permettant de faire à plusieurs ce qu'aucune commune ne pouvait faire seule, le renforcement des synergies avec le département, une fiscalité dynamique et des aides non négligeables de l'État avaient réglé le problème.
Signe de cette révolution de velours : au 1 er janvier 2007, quatre ans donc avant la loi RCT (16 décembre 2010) qui marque la fin de l'intercommunalité volontaire de projet, la France compte 2 588 groupements intercommunaux à fiscalité propre, rassemblant plus de 33 400 communes et 54,5 millions d'habitants dont plus de 40 millions sous le régime de la taxe professionnelle unique (TPU).
L'Histoire a ainsi montré que libérer la démocratie locale c'était aussi dynamiser l'économie, les collectivités assurant encore, en 2011, 70 % de l'investissement public (hors armement), soit 3,1 % du PIB (2011) contre 1,6 % en Allemagne d'où est censée nous venir la lumière, avec un endettement stable demeuré inférieur à 10 % du PIB, encore aujourd'hui.
Mais voilà, vice rédhibitoire, ce modèle n'était pas d'inspiration libérale. Conformément au traité de Maastricht et pour réduire son déficit budgétaire, l'État devait donc se retirer au profit des marchés censés le remplacer avantageusement.
2. La liquidation du modèle français d'organisation territoriale
La décision de liquider communes et départements est donc strictement politique sans lien avec des problèmes réels, avec quelque dysfonctionnement interne de l'organisation territoriale séculaire.
L'objectif est de détruire le vieux modèle républicain d'organisation territoriale pour le remplacer par un modèle plus conforme aux exigences d'un libéralisme financiarisé qui, « boosté » par la construction européenne est passé au rang de priorité nationale.
Même le Conseil d'État jusque-là gardien historique de la légalité républicaine a apporté sa contribution à cette « modernisation » salutaire : « la promotion du service public commence dans une pleine reconnaissance du cadre d'ensemble de libre concurrence dans lequel il est appelé à intervenir » (Rapport « collectivités publiques et concurrence »).
C'est dire, en termes polis, que l'intérêt général est celui des marchés et que l'extension du règne de la concurrence est d'intérêt général.
C'est dire aussi que les opérateurs de service public, collectivités locales ou État doivent se plier aux exigences de la concurrence et donc que ceux de l'État (poste, télécommunications, SNCF, voire hôpitaux) ne pourront faire autrement que de se désengager des territoires où ils ne sont pas « rentables ».
C'est dire encore que la présence physique de l'État lui-même, à travers ses fonctionnaires préfectoraux ou autres, doit se raréfier, en commençant par ceux - ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs du génie rural - qui apportaient directement un concours à la gestion et au développement local. (voir annexe 3 - Un jacobinisme bien tempéré)
C'est dire enfin, selon la vision libérale, que les collectivités sont elles-mêmes des entreprises en lutte sur un champ concurrentiel, des entreprises dont il faut stimuler la compétitivité par la concentration, la spécialisation, en débarrassant les plus « performantes » (les métropoles) de la charge des territoires moins productifs.
D'où la recherche sans fin de la bonne distribution des compétences selon les échelons territoriaux, la volonté d'éradiquer toutes les structures (syndicats, pays, etc.) dont les frontières débordent la carte simplifiée dont rêvent les modernisateurs.
D'où, également, la recherche sans fin d'une spécialisation de l'impôt local par catégorie de collectivité.
Il s'agit donc de réorganiser la division du travail au sein de l'usine administrative pour la rendre plus performante et ainsi augmenter la « compétitivité » du pays - peu importe si on ne sait pas ce que peut signifier la compétitivité d'une région, d'un département, d'une commune - pour permettre le « retour de la croissance », « développer les solidarités » et permettre « la transition écologique », ce que développe longuement l'exposé des motifs de la loi NOTRE et les exégèses qui l'ont accompagnée.
Concrètement, outre la spécialisation des tâches, cela veut dire que les mailles de l'organisation territoriale doivent être beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont, d'où les grandes régions, la multiplication des métropoles et des intercommunalités XXL, les incitations à la création de « communes nouvelles », le projet de suppression d'un niveau de collectivité.
Comme le précisait François Hollande, le 2 juin 2014 dans la Tribune, accompagnant la carte des nouvelles régions qu'il entend créer, les deux pôles de la nouvelle organisation territoriale seront les régions qui « se sont imposées comme des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire » et les intercommunalités, « structures de proximité et d'efficacité de l'action locale » lesquelles hériteraient d'une partie des compétences des départements appelés à disparaître.
Faute de repreneur pour les compétences sociales, cette dernière partie du programme, déjà sous-jacente au projet de création sarkozyste d'un conseiller territorial à la fois élu régional et départemental, fera long feu.
Le terrain étant préparé ne reste plus qu'à trouver les « investisseurs » susceptibles de remplacer l'État dans son rôle de développeur et d'opérateur de services publics.
Ainsi voit-on Manuel Valls lors de son voyage promotionnel à la City le 6 mars 2014, pour démontrer que son gouvernement « is pro business » , donner en exemple sa réforme territoriale dont on voit difficilement en quoi elle pourrait faire saliver les banquiers d'un des principaux temples mondial de la finance :
« À la fin de cette année, le nombre de régions françaises sera passé de 22 à 13 ! Il y a bien sûr des blocages, des oppositions, beaucoup pensaient que cela ne se ferait pas mais nous sommes en train de réussir à dépasser les conservatismes. Cela veut bien dire que l'on peut réformer en France et qu'on peut le faire rapidement. Cette réforme des régions va nous permettre de réorganiser la carte territoriale, mais aussi la carte de l'organisation de l'État, pour gagner en efficacité et pour faire des économies. » « Gagner en efficacité », « faire des économies » , le but des réformes est là.
Qu'on n'ait pas vu le début du commencement d'un résultat après dix ans de « réforme » n'a aucune importance, le tout est de le répéter suffisamment pour que les incroyants voient la lumière .
La stagnation puis la diminution des dotations d'État et, depuis Emmanuel Macron, l'encadrement des dépenses de fonctionnement transformeront intercommunalités et fusions de communes (communes nouvelles), en bouées de sauvetage en attendant des jours meilleurs.
Quant aux contraintes institutionnelles, elles seront multiples et de plus en plus fortes au fil des réformes.
De volontaire, l'intercommunalité devient obligatoire et normée (taille minimum 5 000 puis 15 000 habitants). De plus en plus de compétences, certaines essentielles (urbanisme, eau et assainissement au sens large notamment) devront être transférées et le champ de « l'intérêt communautaire » réduit.
Les statuts des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) cessent d'être des contrats entre partenaires d'égale dignité : strictement encadrés par la loi (nombre de représentants communaux par strates démographiques, nombre de vice-présidents...), ils favorisent les grandes communes et leurs élus devenus maîtres du jeu.
Au passage, l'intercommunalité, d'outil au service des communes pour faire à plusieurs ce qu'elles ne peuvent faire seule, s'est transformée en reposoir des communes
La pression gouvernementale, aidée du Conseil constitutionnel qui invente le principe de la « représentation essentiellement démographique » des communes, transforme les intercommunalités censées représenter des communes, comme leur nom l'indique, en collectivités territoriales, de fait expression des populations, autant dire des intérêts des plus grosses communes.
Il ne restera plus qu'à faire élire les conseils de communautés, voire leurs présidents, directement par les habitants et la transformation des intercommunalités en collectivités territoriales sera achevée, sans révision de l'article 72 de la Constitution. Mise en stand-by pour cause de turbulences politiques, la marche vers le progrès devrait reprendre.
3. Le nouvel ordre territorial !
Si le principe d'organisation du territoire qui depuis la Grande révolution était de coller aux besoins de la population et de lui donner le pouvoir de gérer la proximité, comme on l'a vu, l'objectif est désormais de fournir aux « investisseurs » l'organisation territoriale que l'on pense correspondre à leurs attentes, développement, emploi et services sont censés être à ce prix.
Les efforts, budgétaires et autres, de l'État doivent donc aller là où il pense, en adepte de la théorie du « ruissellement », que se crée la richesse. Les territoires sans avenir doivent être abandonnés à leur destin, aux soins palliatifs de plus en plus maigres, tant qu'ils ne seront pas politiquement négligeables.
Que la « théorie du ruissellement » soit sans fondement, qu'on attende toujours les milliards d'euros d'économie censés résulter des réformes, n'a aucune importance.
L'essentiel est que l'on fasse ce qu'attendent Bruxelles et les « investisseurs » rêvés de la France.
Contrairement à ce que disent les propagandistes de cette politique, il ne s'agit en rien d'une nouvelle étape de la décentralisation dont l'objectif était politique et non économique comme on l'a vu. L'objectif ici est inverse : remplacer la souveraineté populaire par celle des « experts », de ceux qui savent, pour être plus efficaces.
Encore une fois, on attend toujours les résultats.
Contrairement aussi à ce qu'on entend souvent, il ne s'agit pas plus d'une recentralisation au sens traditionnel du terme mais d'un abandon des territoires devenus une charge pour l'État.
Finis non seulement la présence sur le terrain d'un État acteur, financeur, ingénieur et expert, mais aussi de l'État régalien tout court.
De révision générale des politiques publiques (RGPP) en modernisation de l'action publique (MAP), de réforme de l'administration territoriale (RéATE), de réforme de la carte des sous-préfectures, de « Plan préfecture nouvelle génération » et maintenant en « programme Action publique 2022 », en 10 ans, la fonction publique territoriale de l'État aura perdu 4 000 postes et nombre de sous-préfectures auront été vidées de leur substance.
L'ingénierie publique sera remplacée, sur le modèle anglo-saxon, par des agences comme la toute dernière « Agence pour la cohésion des territoires » en cours de création.
Associant partenaires privés et publics, elle soulagera d'autant le budget d'un État déchargé de ses obligations ancestrales puisqu'elles remontent à la Monarchie en matière d'équipement du pays.
Ainsi sont en voie de réduction, sinon d'extinction, non seulement les aides au fonctionnement des collectivités, mais les programmes d'action de long terme de l'État, remplacés avec l'avènement de « l'ère Macron » par des « expérimentations » qui ont le mérite de coûter considérablement moins cher, de donner l'impression aux acteurs locaux d'être libres, tout en conservant par des coups de pouce discrétionnaires, assortis de prescriptions, le contrôle des opérations : politique des banlieues, de revitalisation des bourgs-centres, etc.
Après l'espoir, comme on l'a vu, d'en faire des terrains d'atterrissage pour investisseurs, le but de la politique de métropolisation et de grandes, voire très grandes intercommunalités, c'est d'amortir cette désertion de l'État.
Ces collectivités d'avenir auront en charge, en effet, d'apporter, à leurs frais, les services qu'il n'assure plus, en faisant appel, si besoin, aux cabinets d'expertise privés et au marché.
En un mot, la politique du « big is beautiful », vise à permettre cette substitution des responsabilités.
Ainsi, sauf dans les zones très urbanisées où la création de métropoles peut se justifier, ces très grandes intercommunalités, notamment dans des territoires très ruraux, deviennent-elles de simples circonscriptions d'administration territoriale, en charge désormais du service public et de l'assistance aux populations.
L'État renonce-t-il pour autant à sa tutelle sur les collectivités territoriales ?
Absolument pas.
Il s'agit simplement d'une autre manière pour lui d'exercer le pouvoir, ce qu'on a pu appeler gouverner à distance.
Loin de renoncer, à la contrainte par la loi et la norme qui deviennent, au contraire et malgré les discours sur l'inflation législative, règlementaire ou des normes, de plus en plus nombreuses et détaillées, l'État utilise des leviers de pouvoir plus libéraux, apparemment non contraignants : appels à projets dont le pouvoir central sélectionnera les bénéficiaires mis en concurrence, agences, expérimentations, fonds plus ou moins exceptionnels de ceci ou de cela aussi alléchants et encadrés que les promotions publicitaires, bonifications , contractualisation, conventionnement, affichage des bonnes pratiques, benchmarking, etc.
4. Une régression démocratique
Les conditions d'exercice de la démocratie locale vont évidemment pâtir de la transformation des intercommunalités « coopératives de communes» en substituts des communes dont elles absorbent les compétences et les ressources.
Pâtir aussi de la rigidité de structures dans lesquelles les petites communes ne pèsent plus et d'autant moins que la taille des EPCI est grande.
En effet, comment assurer une gouvernance autre que bureaucratique des EPCI XL et plus encore XXL quand on voit déjà les problèmes de gestion des communautés dès lors qu'elles dépassent une certaine taille ?
Dans celles-ci le conseil n'est plus qu'une chambre d'enregistrement tempérée par de faibles oppositions vouées à demeurer stériles. Le pouvoir, du moins son apparence, est passé au Bureau où d'ailleurs toutes les communes ne sont pas toujours représentées, voire à un conseil des maires ou - dans les très grandes structures - à une émanation de celui-ci au statut juridique douteux.
Toutes les chartes, conseils ou conférences des maires n'y feront rien. Il faut n'avoir jamais vu fonctionner ce genre d'institution pour croire que ce sont les commissions et ces organismes moitié consultatifs, moitié décisionnels qui font la politique de l'intercommunalité.
La politique de l'intercommunalité c'est le président - généralement élu de la principale commune -, son administration ou les deux à la fois qui la définissent. Au mieux les autres élus en discutent-ils quelques modalités d'application.
Plus l'EPCI est gros, plus cette captation de pouvoir est inévitable. On comprend que ses principaux bénéficiaires ne voient pas où pourrait bien être le problème.
Mais, au-delà de la question de la gouvernance des grandes intercommunalités, c'est celle de la survivance du terreau républicain qui est posée.
Ce que dit excellemment Tocqueville, grand admirateur de ce que sont alors les communes autogestionnaires d'Amérique : « Parmi toutes les libertés, celle des communes, qui s'établit si difficilement, est aussi la plus exposée aux invasions du pouvoir. Livrées à elles-mêmes, les institutions communales ne sauraient guère lutter contre un gouvernement entreprenant et fort. »
Au passage, c'est le ressort démocratique qui se trouve affaibli comme le montre clairement le lien entre la taille des communes et le taux d'inscription sur les listes électorales et le taux de participation aux élections. Encore une fois Tocqueville avait, le premier, saisi les enjeux politiques cachés derrière les considérations de gestion administrative et économique :
« C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans l'institution communale une nation peut se donner un gouvernement libre, elle n'a pas l'esprit de la liberté ».
En une époque d'incivisme généralisé, d'absentéisme, voire d'émeutes électorales, de désillusion quant à la capacité de ce qu'on nomme, par habitude, les « élites », à tracer une autre voie d'avenir que l'enrichissement d'une minorité et la consommation soldée aux plus nombreux, dans le dernier des pays où on aurait pu imaginer que des jeunes gens puissent trouver un idéal dans le meurtre et la destruction de soi, on ferait bien de méditer aussi bien Tocqueville cité plus haut que ces lignes d'Henri Mendras, rédigées en 2002 (donc avant que le cumul des mandats ne soit interdit), donc avant la crise et le lancement de la campagne sournoise de sabotage de la commune :
En France, « la distance entre « nous » et « il » est réduite au minimum au sein de la commune.
Preuve en est que le maire est le personnage public le mieux aimé des citoyens, tous les sondages le montrent.
La démocratie directe du village demeure, pour les Français, la seule démocratie véritable, à la différence de la démocratie représentative qui fait passer l'élu du côté du pouvoir et le menace de corruption.
Même dans les grandes métropoles millionnaires, le maire demeure proche des habitants.
Cette singularité française explique l'attachement des parlementaires à leur mandat de maire, même lorsqu'ils accèdent à des fonctions ministérielles.
Dans aucun autre pays, ce cumul d'un mandat municipal et d'un mandat national n'existe. » 222 ( * )
Difficile de ne pas penser que nos réformateurs omniscients, s'ils ont vu le problème, ne soient pas satisfaits d'avoir neutralisé les effets délétères de la démocratie sur la marche du progrès. Une question que l'on va retrouver ci-après.
En effet « chassez le peuple, il revient au galop », comme s'en aperçoivent aujourd'hui les « élites » métropolitaines effrayées par des révoltes sporadiques qui ne demandent qu'à devenir révolution.
ANNEXES DE LA PARTIE IV
Annexe 1 : Les métropoles financent-elles le reste des territoires ?
Que le dynamisme économique des métropoles finance le bien-être des autres territoires est passé au rang des évidences. Mais, en fait, personne n'en sait rien et apparemment cherche à le savoir. Nous ne disposons, en tous cas, d'aucune étude sérieuse française retraçant les flux financiers et humains complexes entre ces deux catégories de territoires.
Les études menées par la GERI (Groupe d'étude et de réflexion interrégional), sous l'impulsion de Jacques Voisard, dans les années 1990 et non poursuivies depuis sa cessation d'activité, ont même montré, non seulement que la concentration urbaine avait un coût mais que c'était là, tout particulièrement en Île-de-France qui concentrait 40 % des cadres supérieurs français, que les financements de l'État allaient prioritairement, ce qui d'ailleurs avait permis aux collectivités locales, à l'époque, d'investir proportionnellement moins que dans le reste de l'hexagone, laissant ainsi la situation se dégrader :
« L'Île-de-France, coeur du centralisme français (...) vit de plus en plus, sur le compte de la collectivité nationale et, de moins en moins, de ses propres ressources. Ceci pose évidemment le problème de la prise en charge des coûts collectifs croissants, liés à un modèle de développement qui profite de moins en moins à ceux qui en sont les instruments. » (Jacques Voisard et Franck de Bondt : Territoire et démocratie, notes de la fondation Saint-Simon, mai 1998). Il y a fort à parier que les choses n'ont fait qu'empirer depuis 1998, mais, très opportunément, aucune étude approfondie ne permet de trancher dans un sens ou un autre.
En tous cas, constatons, s'agissant des finances des collectivités territoriales que les dernières réformes n'ont pas été une mauvaise affaire pour l'Île-de-France. Ainsi, note Charles Guené dans son Rapport sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale (Sénat, juin 2012) :
« Il apparaît par exemple que la CVAE est concentrée, à hauteur de 32,8 %, au sein de la région Île-de-France, alors que cette région représentait « seulement » 13,3 % de l'ancienne taxe professionnelle. Certes, la région Île-de-France est la seule qui contribuera au FNGIR des régions. Elle reversera donc (...) l'équivalent d'environ 55 % de son produit de CVAE, soit 669 millions d'euros, aux autres régions, et ne conservera que l'équivalent de 45 % de ce produit. Toutefois, à compter de l'année 2011, la région Île-de-France bénéficiera pleinement de la croissance de 100 % du produit de CVAE présent sur son territoire puisque le montant reversé aux autres régions demeurera figé. »
Et voici comment on peut tirer profit d'une réforme visant à réduire la fiscalité économique et censée améliorer la compétitivité des entreprises françaises, en en faisant porter le coût sur les autres et en donnant l'impression de faire acte de solidarité !
L'étude des effets de la création de l'APA, du RSA et des transferts de compétences dans le cadre de l'acte II de la décentralisation, selon les départements reste, elle aussi, à faire.
Annexe 2 : Quand on n'entend plus siffler le train (Intervention de Jacques Mézard au Sénat le 4 janvier 2013)
« Dans nos territoires ruraux, notre rêve est d'entendre à nouveau siffler le train, ce train qui, ces dernières années, s'est retiré peu à peu de tant de nos communes, ce train qui ne roule plus au rythme de l'égalité des territoires...
Aurillac est la préfecture la plus enclavée de France, c'est connu ! En 2003, pourtant, avec un Premier ministre de grande qualité nous avons subi la suppression du train de nuit vers Paris. En 2004, ce fut la suppression du dernier train direct. Depuis, nous avons connu un programme de réfection des voies ferrées grâce au plan rail État-région-RFF. Pour autant, le trajet Aurillac-Paris dure, selon les jours, entre six heures deux minutes et dix heures trente ! Parfois, une partie du trajet s'effectue en bus : c'est le progrès ! C'est en tout état de cause une demi-heure de plus, dans le meilleur des cas, que voilà vingt-cinq ans !
Ce n'est pas simplement par humour, monsieur le ministre, que j'ai déjà, dans cette enceinte, remis à deux de vos prédécesseurs les horaires de train Aurillac-Paris de 1905, que j'avais consultés et que je vais tout à l'heure vous remettre en main propre. En 1905, sous le gouvernement de Maurice Rouvier (...), le train de nuit partait à 20 heures 47 de Paris pour arriver à 8 heures 05 à Aurillac. En 2012 et en 2013, il faut aller chercher un train de nuit en autocar pour, ensuite, à partir de Figeac, rejoindre Paris. La durée du trajet de nuit est de neuf heures quarante minutes ! C'est en effet un magnifique progrès en deux Républiques et 105 ans (...) La dissociation SNCF-RFF n'a pas arrangé la situation - je crois que nous en sommes tous convenus - et, pour nous, la réunification s'impose.
Quant à l'ouverture à la concurrence, nous ne la voyons pas d'un bon oeil, car elle présente un risque certain d'élargissement de la fracture territoriale. Il est particulièrement justifié que la France, dans le débat européen, s'oppose au quatrième paquet ferroviaire ».
Annexe 3 : Un jacobinisme bien tempéré
Même avant les lois Defferre de 1982-1985, le rôle des représentants de l'État sur le terrain ne se limitait pas à celui de simples courroies de transmission.
Pierre Grémion l'a bien montré, il n'y avait pas, d'un côté, l'administration de l'État et, de l'autre, les représentants de la population mais une « consonance entre l'administration et son environnement (qui) dépasse de beaucoup un simple accord de climat. De manière plus ou moins consciente l'administration intériorise progressivement les aspirations et les valeurs de la société qu'il est chargé d'administrer. » L'administration préfectorale est autant porte-parole de l'État auprès du terrain que l'inverse, du terrain auprès du pouvoir central. De plus et surtout, sur la plus grande partie du territoire, il est d'abord présent par ses ingénieurs des ponts et chaussées ou des eaux et forêts. Une présence bénéfique très appréciée qui fait oublier ce que peuvent avoir d'urticantes les tracasseries de la bureaucratie régalienne . À travers ses ingénieurs, l'État devient partenaire et parfois acteur, du développement local. Son désengagement progressif pour laisser la place au marché sera donc ressenti comme un abandon.
Pour Pierre Grémion cette relation antagonistique, faite d'oppositions et de connivences entre fonctionnaires d'État et élus locaux constitue un véritable « pouvoir périphérique ». Les tutelles de l'État les plus insupportables aux élus sont celles qui ne s'accompagnent pas d'un retour en forme de service dans le cadre d'une relation coopérative. Ainsi, la plus détestée est-elle celle du ministère des finances alors que « les services préfectoraux ou les services techniques qui exercent à la fois une tutelle juridique et une tutelle organique organisationnelle [comme les fonctionnaires de l'Equipement ou de l'Agriculture], donc un contrôle pesant sur les communes, ne suscite pas de récriminations chez les maires... C'est que les relations de tutelle sont plus complexes que les relations de contrôle unilatéral auxquelles les réduit le droit administratif français. Elles sont caractérisées par une interaction constante du segment bureaucratique contrôleur et du segment social contrôlé. Le produit de cette interaction s'exprime dans une institutionnalisation des relations entre l'organisation administrative et son environnement à travers laquelle l'organisation intériorise en partie les valeurs du groupe placé sous son contrôle. La tutelle, à l'origine fonction de contraintes, s'enrichit d'une fonction latente de défense : fonction qui se développe à partir de la première car elle représente un moyen d'adaptation destiné à supprimer les frictions sociales que suscite la contrainte. »
PARTIE V - L'ÉTAT NEOLIBERAL
« C'est la lutte des classes. Ma classe est en train de la gagner. Elle ne devrait pas. »
Warren Buffett 223 ( * )
« Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. »
Denis Kessler 224 ( * )
Ces deux citations de deux éminents représentants de l'oligarchie libérale éclairent parfaitement les enjeux sociaux et politiques des mutations du dernier demi-siècle, le plus lucide étant le milliardaire étasunien, conscient que pareille subversion de l'État-providence ne pourrait se faire sans casse. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé « l'oracle d'Obama » qui d'ailleurs ne l'entendit guère !
Révélatrice aussi, la morgue cynique de l'impétrant oligarque français.
On est loin du « ni droite, ni gauche » servant de camouflage « bon chic, bon genre » à cette vulgaire empoignade de classe !
Comme on va le voir, on est même loin du libéralisme old fashioned, du « laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même » de Gournay, ou de la formule magique de Ronald Reagan : « l'État n'est pas la solution des problèmes, c'est le problème ».
Il s'agit, en fait, d'un système d'exploitation et de distribution de rentes de position dont l'État garantit la stabilité.
Dans son discours devant l'OIT, le 11 juin 2019, Emmanuel Macron, d'une lucidité et d'une franchise qu'on aimerait voir partagée par ses soutiens et surtout être suivie d'effet, ne dit pas autre chose :
« Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale de marché, mais qui a été depuis quarante ans l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation qui, en gardant les prémisses du raisonnement et de l'organisation, en a perverti l'intimité et l'organisation dans nos propres sociétés. La rente peut se justifier quand elle est d'innovation, mais peut-elle se justifier dans ces conditions lorsque la financiarisation de nos économies a conduit à ces résultats ? Et en avons-nous tiré toutes les conséquences ? Je ne crois pas. »
Le néolibéralisme post-Bretton Woods, réussit, en effet, le tour de force de mettre l'État au service des intérêts privés au nom de l'intérêt public en vertu du sophisme : la libre concurrence des intérêts particuliers étant le meilleur moyen de réguler les échanges économiques et sociaux, le respect de ses règles est d'intérêt général.
Ce qu'en France le Conseil d'État, désireux de « rajeunir » la conception française du service public a traduit par : « Plutôt que d'opposer intérêt général et marché, libéralisation et service public, il s'agit de rechercher, dans un contexte de libre concurrence, la prise en compte d'objectifs d'intérêt général... » 225 ( * )
Sauf que la concurrence se transforme rapidement en guerre des lobbys puis en domination plus ou moins oligopolistique. La concurrence est en quelque sorte une maladie infantile du monopole.
L'intervention de l'État devenant incontournable, il conviendra donc de le contrôler ou au minimum d'influencer ses décisions.
Les exemples étasunien et français, selon des modalités renvoyant à l'histoire et aux traditions politiques de ces deux pays, illustrent cette mutation de l'État néolibéral et de son rôle.
Contrairement à la légende colportée par les manuels de « sciences politiques », d'interventionniste il ne s'est pas transformé en « régulateur », autrement dit en arbitre neutre chargé de faire respecter les règles de la concurrence, il est tout simplement passé au service des intérêts particuliers censés tenir dans leur main la satisfaction de l'intérêt général. Le contrôle du contrôleur devenant la clef du succès des affaires, l'État se retrouve partie prenante dans les querelles d'intérêts particuliers dont dépend la satisfaction de ce qu'on continue à tenir pour l'intérêt général.
I. L'ÉTAT PRÉDATEUR ÉTASUNIEN
« L'état prédateur » tel est devenu selon James K. Galbraith 226 ( * ) le système politique installé par Ronald Reagan, arrivé au pouvoir en 1981, pour remplacer le règne de l'hydre étatique par celui du marché et en finir avec les déficits publics et l'inflation.
« La politique de Trump est fondamentalement keynésienne et réactionnaire. Il cherche le soutien du monde économique, mais par la réduction des impôts des plus fortunés. C'est la même politique que celle qu'a mise en oeuvre Reagan (...). Bref, ce n'est pas nouveau. »
Le mandat de Ronald Reagan commença donc par une période de libéralisme flamboyant - politique antisyndicale, réduction des impôts sur les entreprises et les hauts revenus, recherche de l'équilibre budgétaire fédéral, hausse des taux directeurs et déréglementation censées faire baisser l'inflation - avec la récession comme résultat.
Ce que voyant, Ronald Reagan, tournant le dos aux principes d'équilibre budgétaire et de contrôle de la masse monétaire chers aux néolibéraux, adopte une forme de keynésianisme monétaire dégradé, ce qu'autorisait le statut privilégié du dollar.
Les réductions de l'imposition des plus riches assorties d'une augmentation des dépenses publiques, notamment militaires, financées par le déficit budgétaire alimentent alors la forte reprise, de 1983 à la fin de la décennie 227 ( * ) .
Selon James K. Galbraith : « Cette forme conservatrice de politique keynésienne effaçait l'obstacle historique au keynésianisme : l'opposition féroce des très riches [...] Dans le keynésianisme version Reagan, le prix à payer pour la prospérité n'était plus le renversement des rapports sociaux établis mais leur perpétuation. »
Le remède miracle contre la récession et ses séquelles politiques était trouvé. Même après le krach de 2008 et la courte prise de conscience des effets potentiellement mortels du traitement, les USA ne surent plus s'en passer.
Comme le montre clairement la courbe des évolutions comparées du chômage aux USA et en Europe (partie II A-1), à partir de l'ère Reagan, les taux de chômage étasuniens demeureront constamment inférieurs à ceux de l'Europe libérale, adepte de l'équilibre des budgets publics et de la monnaie forte. Si, entre 2008 et 2010, au paroxysme de la crise, les courbes se rejoignent, elles divergent ensuite de nouveau. Pareillement, si aujourd'hui les USA font figure de locomotive économique mondiale, la politique ultra accommodante de Donald Trump - digne continuateur de Ronald Reagan - n'y est pas pour rien. Jusqu'à quand, c'est une autre histoire mais « tant que l'orchestre joue, il faut continuer à danser » selon la formule de Chuck Prince, ancien PDG de Citigroup, quelques mois avant le krach de 2008.
D'où le dilemme permanent d'un système dont le moteur est l'endettement : le réduire c'est accentuer les risques de récession économique, le poursuivre c'est augmenter ceux d'un nouveau krach financier...
En fait, loin d'être mis hors-jeu, l'État américain est devenu essentiel au bon fonctionnement du système. Sous Georges H. W. Bush qui succédera à Ronald Reagan, les « bases du conservatisme de libre marché ont été abandonnées » , observe James K. Galbraith. « Elles ont été remplacées par les structures d'un État prédateur, la capture des administrations publiques par la clientèle privée d'une élite au pouvoir », tout particulièrement dans le secteur financier, dont la surveillance a été confiée à ceux qui étaient les moins enclins à l'exercer et qui le conduiront au naufrage.
À ne pas oublier non plus, la ressource constituée par le libre accès des firmes à la recherche publique sans contrepartie financière. Comme le dit encore James K. Galbraith : « Le fanatisme du marché est un produit américain, mais porte clairement la mention "réservé à l'exportation" » . Opération particulièrement réussie en Europe.
Les États-Unis sont devenus une sorte de « République-entreprise » 228 ( * ) que réguleraient non pas les marchés, mais des coalitions de puissants lobbies industriels et financiers soutenues par un État, « prédateur » en ce sens que sa fonction est de mettre l'économie et la finance au service d'intérêts privés. Le discours libéral officiel n'est qu'un rideau de fumée destiné à masquer cette forme perverse d'étatisme. La première place n'est plus occupée par les grandes entreprises décrites par John K. Galbraith dans « Le nouvel État industriel » (1967).
Affaiblies par la mondialisation, elles ont été remplacées à la place dominante, par la finance et les oligarques du numérique, de la communication et des services. C'est cette « élite », pour reprendre le terme de Lasch qui s'est emparée de l'État et qui le gère exclusivement en fonction de ses propres intérêts.
Et il entre dans son intérêt de remplacer les services publics issus du New Deal par des services marchands, comme on le voit en matière de santé, le secteur avec celui des technologies de l'information, où le retour sur investissement atteint jusqu'à 45 % ! Plus exactement, il s'agit de séparer les activités rentables du service public qui seront privatisées, des activités non rentables, prix de la paix publique, qui, réduites au minimum, continueront à relever de la puissance publique, puissance publique assurant par ailleurs des débouchés aux services et entreprises privées. Il s'agit donc d'un accaparement, d'une « prédation » des biens, matériels et immatériels publics.
Ainsi « Medicare » garantit-il les prix de monopole des entreprises pharmaceutiques par ses remboursements publics, et la réforme « Obama care » (2015) oblige-t-elle les entreprises de plus de 50 salariés à souscrire une assurance privée contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. À l'opposé, Bernie Sanders a mis à son programme un système de protection de la santé publique pour tous, « Medicare for all », sur le modèle français.
On trouverait d'autres exemples dans les domaines éducatifs, des retraites ou du logement comme l'ont parfaitement illustré le sabotage par les pouvoirs publics du système populaire des caisses d'épargne et l'explosion des prêts hypothécaires qui, avec les « subprimes » toucheront les personnes manifestement insolvables.
Ce « capitalisme prédateur » n'a plus grand-chose à voir avec le libéralisme classique, et son objectif, c'est de créer des monopoles (cf les Gafam), car là est la véritable source d'enrichissement.
Comme le rappelle Adam Tooze 229 ( * ) , pour le patron d'Apple, Tim Cook, les lois antitrust, la protection des données et les enquêtes fiscales approfondies ne sont que « des conneries politiques » aussi absurdes que de placer des ralentisseurs sur une autoroute. Pour l'oligarque du secteur technologique, Peter Thiel, « créer de la valeur ne suffit pas - il faut aussi capter une partie de la valeur pour que vous créiez », ce qu'interdit la concurrence. Contrairement à ce que pensent généralement les Américains « le capitalisme et la concurrence sont à l'opposé l'un de l'autre. Le capitalisme se fonde sur l'accumulation du capital, mais en situation de concurrence parfaite, cette concurrence, annihile tous les profits. Pour les créateurs d'entreprise, la leçon est claire : la concurrence c'est pour les perdants. »
Comme on le verra, l'élection de Donald Trump, rendue possible par la mobilisation des oubliés de l'État prédateur est le premier échec politique des classes qui l'ont mis en place. D'où leur fureur... au nom de la bienséance et de la morale, bien sûr !
II. L'ÉTAT COLLUSIF FRANÇAIS
La forme actuelle du système de pouvoirs en France résulte, elle, d'un double mouvement de fond : la concentration du pouvoir politique à l'Élysée et la transformation du système politique, économique et administratif français sous l'effet de la conversion des responsables politiques, administratifs, des relais médiatiques ainsi que d'une partie de plus en plus grande des juristes, à la version allemande, financiarisée, du néolibéralisme, un néolibéralisme qui trouvera dans la construction européenne sa légitimité et son bras armé.
Au premier on doit l'importance, tout à fait atypique, du rôle de l'oligarchie administrative dans l'exercice du pouvoir politique et économique en France, au second la composante libérale affichée du système. Un système tout à fait particulier donc, une chimère au sens propre alliant la carpe étatique au lapin libéral, pour un résultat incertain. C'est l'oligarchie administrative qui fait tenir ensemble les deux parties de la chimère, d'où l'importance qu'elle a pu prendre.
A. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE POUVOIR POLITIQUE EN FRANCE
1. Du « Parlementarisme rationalisé » au Consulat électif
La Constitution de la V e République est d'abord une réaction au « régime d'assemblée » jugé responsable de la fin piteuse de la III e République et de l'instabilité paralysante de la IV e 230 ( * ) . Elle entend instituer une forme particulière de parlementarisme, un « parlementarisme rationalisé » organisant, selon Michel Debré en août 1958, une « collaboration des pouvoirs : un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable devant le second ; entre eux, un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. » En fait, enserrée dans un carcan règlementaire minutieux, la « collaboration » se limitera à l'acceptation par le Parlement des projets du Gouvernement sous menace de dissolution.
Rapidement, ce « parlementarisme sous contrainte » va évoluer vers une forme de monarchie républicaine plébiscitaire puis, faute de monarques républicains disponibles, à une forme originale de Consulat électif.
Dès 1962 et l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, il est clair que son rôle n'est plus, comme le dit l'article 5 de la Constitution, d'assurer « par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » , comme dans tout régime parlementaire, mais d'exercer le pouvoir. Ce qu'affirma de Gaulle, sans détour, lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964 :
« Le pouvoir procède directement du peuple, ce qui implique que le chef d'État élu par la Nation en soit la source et le détenteur. Il doit être évidemment entendu que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au Président par le peuple et qu'il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui. Il lui appartient d'ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ceux dont il attribue la gestion à d'autres. »
Seul correctif démocratique à cette République plébiscitaire : en cas de doute sur sa légitimité, le Chef de l'État renvoie la décision au peuple consulté par référendum ou par des élections législatives anticipées comme en 1968. De Gaulle ne s'en privera pas, ce qui lui fut, finalement, fatal.
« Cette Constitution a été faite pour gouverner sans majorité. » dira plus tard Alain Peyrefitte 231 ( * ) .
Le problème c'est que, conçue pour porter remède à un système parlementaire assis sur des majorités faibles et changeantes, type IV e République, la Constitution de la V e République a fonctionné avec des majorités solides, sinon en béton, en oubliant progressivement l'usage du référendum - ou en en contournant les résultats comme en 2005 -, et celui de la dissolution anticipée de la chambre des députés après le fiasco de Jacques Chirac en 1997 !
La dernière étape de cette lente mutation consentie par le Parlement sera de faire du Président de la République le chef direct de la majorité parlementaire. On la doit à la réforme constitutionnelle Chirac-Jospin (24 septembre 2000) qui, créant le quinquennat, et inversant le calendrier électoral, évacue en pratique tout risque de cohabitation et fait des élections législatives le complément obligé de l'élection présidentielle. Réforme complétée par celle de Nicolas Sarkozy (2008), qui, en contradiction, une fois de plus, avec le principe de séparation des pouvoirs, lui donne celui de s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Une pratique d'abord exceptionnelle qui deviendra familière avec Emmanuel Macron, destinée à confirmer annuellement au peuple, le rôle de chef de la majorité parlementaire du Président de la République.
Un Président et une majorité que, jusqu'à présent, le mode de scrutin majoritaire à deux tours a mis à l'abri de la désaffection des électeurs.
Ainsi en 2017, Emmanuel Macron rassemble au second tour seulement 43,6 % des électeurs inscrits, les abstentions, votes blancs et nuls atteignant 34 % ( voir Partie VI).
Les résultats des législatives sont encore plus significatifs puisqu'au second tour, l'abstention, les votes blancs et nuls, atteindront 62,3 %, ce qui signifie que 32,8 % seulement des électeurs inscrits ont choisi leur candidat, soit un score moyen de l'ordre de 20 % par député élu !
Merveilleux système qui transforme une poignée d'électeurs en majorité parlementaire écrasante !
Au final, le « parlementarisme rationalisé » désormais ni parlementaire, ni présidentiel, ni même « hyper présidentiel » - le présidentialisme supposant une séparation des pouvoirs - est devenu une forme de consulat où, comme disait Sieyès de la Constitution de l'An VIII concoctée spécialement pour Bonaparte, « le pouvoir vient d'en haut. » (voir annexe 1 : la V e République et le Consulat)
Il est « jupitérien » !
Il ne vient plus des grenadiers du Premier Consul mais d'élections désormais par défaut, comme on vient de le voir.
Au final donc, le Président de la République cumule les pouvoirs du Premier ministre qui, de chef d'un Gouvernement « déterminant et conduisant la politique de la Nation » (article 20 de la Constitution), est devenu « premier collaborateur » d'un Président selon l'expression de Nicolas Sarkozy, chef de la majorité parlementaire, et évidement de l'administration sans aucun contrôle comme l'a bien montré l'affaire Benalla.
Le Parlement se trouvera ainsi cantonné dans un rôle au mieux tribunicien et le plus souvent de chambre d'enregistrement dont aucune initiative ne peut aboutir sans le consentement du Gouvernement, autant dire du Président. Tout le pouvoir réel est à l'Elysée : il n'y a plus de séparation des pouvoirs.
La monarchie plébiscitaire gaulliste qui permettait à un président de gouverner sans le Parlement en s'appuyant sur le peuple s'est ainsi transformée en un système où, disposant d'une majorité parlementaire automatique, le Président peut gouverner, pendant cinq ans, sans le peuple.
Pour couronner le tout, non seulement, conformément à la tradition républicaine, la personne publique du chef de l'État est à l'abri des actions judiciaires mais, avec la révision de 2007, sa personne privée est à l'abri de toute poursuite judiciaire, administrative, civile ou pénale :
Article 67-2 : « Il ne peut durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. »
Les seuls cas où le Président peut aujourd'hui être mis en cause c'est devant le Tribunal pénal international ou « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat », formulation suffisamment vague pour lui ôter toute portée effective.
La destitution est alors prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour, au terme d'une procédure complexe fixée par l'article 68 de la Constitution 232 ( * ) .
Comme le dira Robert Badinter, lors de la discussion de la révision de 2008 au Sénat : « l e Président de la République française est le seul Français sous cloche immunisante, qui ne répond de rien pendant la durée de son mandat, ni de ses actions pénales, ni de ses actions civiles, ni même de la haute trahison ! Personne ne bénéficie d'une immunité comparable ! » C'est seulement au terme de son mandat qu'il peut être mis en cause.
2. La bureaucratisation des sommets de l'État
Cette concentration du pouvoir politique à l'Élysée s'accompagnera fatalement d'une politisation des sommets de la haute fonction publique par le biais des nominations au tour extérieur dans les grands corps et la sélection des membres des cabinets, cabinets devenus progressivement des passages obligés pour les hautes responsabilités. Mais si la très haute fonction publique se politise, inversement les sommets politiques de l'État se bureaucratisent.
À en croire une tribune du Monde, publiée quelques mois après la formation du nouveau Gouvernement (21 février 2018), une étape nouvelle aurait été franchie avec l'élection d'Emmanuel Macron. Du pouvoir d'influence de l'oligarchie administrative exercé à travers l'appartenance aux cabinets élyséen ou ministériels, on serait passé à une oligarchie administrative s'assumant comme politique par l'exercice direct du pouvoir. À une pratique marginale, aurait succédé une vague de fond significative de ministres choisis par le Président de la République et son Premier ministre parmi les directeurs et directrices de l'administration .
Les chiffres laissent, en effet, rêveur : « Parmi les quatorze ministres ou secrétaires d'État qui pourraient être considérés comme venant de la « société civile », la plupart d'entre eux avaient auparavant exercé de très hautes responsabilités administratives, le plus souvent de direction d'administration centrale. » Ce n'est plus le ministre qui choisit les directeurs d'administration mais les directeurs d'administration qui deviennent ministres. La réversibilité entre les fonctions politique et administrative est devenue ainsi totale.
Logique, puisqu'ils partagent la même croyance en l'excellence du système et ont activement travaillé à l'élection du Consul dont ils ont rédigé le programme et souvent animé la campagne. Une nouvelle manière de neutraliser parlementaires et partis politiques en les transformant en couverture démocratique minimale d'un pouvoir politico-administratif qui les a pratiquement tous.
B. LA LIBÉRALISATION DE LA FRANCE
Faisant suite à la dénonciation unilatérale par les USA des Accords de Bretton Woods le 15 août 1971, la Grande Transformation néolibérale, initiée par la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher et les États-Unis d'Amérique de Ronald Reagan, gagnera l'Europe et la France post-gaulliste devenue « socialiste ». C'est probablement dans ce pays où l'État était un acteur économique planificateur et social central que le bouleversement sera le plus grand. Le processus prendra donc du temps avant de s'imposer significativement à une nation qui s'était patiemment constituée autour d'un État acteur et garant de l'intérêt général, appuyé sur une haute administration partageant la même vision. D'où des réticences que les nouvelles élites dirigeantes contourneront en liant habilement libéralisation et projet de construction européenne.
Selon la doctrine officielle, libéraliser le système financier, l'économie et les rapports sociaux, était la condition nécessaire, non seulement de la modernisation qu'appelle le siècle mais de la construction européenne. D'où le caractère très particulier de ce libéralisme et les contraintes engendrées par le mode de construction de l'Europe qui expliquent assez largement sa paralysie actuelle face aux crises externes et même internes comme on le voit avec la question migratoire.
1. L'idéologie néolibérale européenne : l'ordolibéralisme
D'accord sur les principes, les néolibéralismes étasunien et européen, autrement dit, l'ordolibéralisme allemand 233 ( * ) , diffèrent sur un point essentiel : les Américains, comme on l'a vu, font ouvertement - tout en disant le contraire - de leur État un levier économique, alors que les Européens entendent le limiter au rôle de régulateur des marchés. Que la réalité, comme on l'a vu, soit un peu plus complexe, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont ni la franchise, ni les moyens de la franchise de ceux-ci.
L'État doit occuper la plus petite place possible et en tout état de cause ne peut être un acteur direct de la production (propriétaire et gestionnaire d'entreprises publiques, planificateur ou contrôleur des mouvements financiers, etc.), ni même indirect par des actions de stimulation de la demande, ce que préconisent les keynésiens et que pratiquent les Américains en cas de ralentissement de l'économie.
S'il intervient, en tous cas ce ne saurait être, sauf urgence et temporairement, pour des motifs d'intérêt général. Sa fonction est seulement de permettre l'avènement en ce monde d'une « concurrence libre et non faussée » qui n'est pas une donnée naturelle contrairement à la doctrine libérale classique, mais une construction.
Son rôle sera donc essentiellement celui de régulateur à travers des « autorités » non étatiques qu'animent les représentants des intérêts économiques concernés, des personnalités qualifiées dites « indépendantes » (de qui on ne sait trop), des hauts fonctionnaires détachés. De qui ces « autorités administratives indépendantes » (AAI), plus ou moins hautes, tiennent-elles leur légitimité et leur pouvoir ? Mystère.
S'y ajoutera en 2013, suite au traité sur la « stabilité, la coordination et la gouvernance », le Haut conseil des finances publiques censé endiguer les dérives budgétaires de l'État. Une « autorité administrative indépendante » créée pour régenter l'État, voilà qui ne manque pas de sel !
Étrange oxymore aussi que ces AAI, une administration par définition, tirant sa légitimité de son lien avec l'État et non de son indépendance par rapport à lui.
D'où la contradiction que représente l'institution d'une sorte de « libéralisme bureaucratique », d'un ordre « libéral » qui ne peut exister sans l'État. Les productions réglementaires foisonnantes de la Commission européenne directement applicables ou après transposition, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des autorités administratives de régulation, etc. montreront progressivement ce que signifie « libéralisme bureaucratique » !
Dans son domaine, le mode de construction de la zone euro sera la parfaite illustration de cette illusion de pouvoir construire une zone monétaire autorégulée, sans pouvoir souverain pour la légitimer, l'administrer et la gouverner en cas de crise, sans transfert financier des membres excédentaires aux membres déficitaires, et uniquement soumise au respect de quelques règles budgétaires simples : un déficit budgétaire annuel et une dette publique ne dépassant pas respectivement 3 % et 60 % du PIB (les « critères de Maastricht »), sous la surveillance du « haut clergé » financier central et de la Commission, de la Cour de justice, sous peine de sanctions.
La réalité, cependant - après une série de crises spéculatives sectorielles de portée limitée - se chargea de montrer que les « marchés autorégulateurs », contrairement à la théorie, pouvaient engendrer des krachs financiers de grande magnitude appelant l'intervention massive de l'État.
Le grand moment de frayeur 2008-2011 passé, la montagne des réformes ayant accouché de quelques souriceaux (voir partie I), les bonnes vieilles habitudes et les affaires reprirent comme si (presque) rien ne s`était passé.
2. La libéralisation de la France ou quand la haute administration se met à son compte
Par un de ces retournements dont l'Histoire est coutumière, la libéralisation de l'économie et du système financier français a commencé par la vague de nationalisations inscrite au « programme commun de la gauche » devenu programme de gouvernement avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 1981. Qui dit nationalisations dit aussi occasions exceptionnelles de promotion pour les hauts fonctionnaires nommés à la tête des banques et des grandes entreprises concernées. Le moment des privatisations venu, une bonne partie d'entre eux, devenus libéraux souvent militants, resteront en place.
La vague de privatisation (totale ou partielle) des grandes entreprises industrielles, des services (information et audiovisuel à capitaux publics), des grands équipements (autoroutes, aéroports...) propriété de l'État ainsi que le démembrement du système financier public (privatisation des banques et dérégulation) débutera en 1986 avec le gouvernement de Jacques Chirac et se poursuivra sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Elle ne s'éteindra, progressivement, que par manque de combustible... À noter que le record des privatisations appartient au gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002) qui cèdera, selon les estimations, de l'ordre de 210 MdF d'actifs (contre 80 à 100 MdF pour les gouvernements Chirac et Balladur).
Progressivement, pour réduire le déficit budgétaire, ce qui restera des « bijoux de famille » - aéroports ou participations minoritaires par exemple - fera office de recettes d'appoint.
Source : Thomas Piketty. On observe qu'à partir de 1980 l'augmentation du capital national de la France est uniquement due à celle du capital privé.
Le plus extraordinaire - c'est probablement pour ça qu'on n'en parle pas - fut la privatisation totale de système bancaire et de la Banque de France à laquelle on doit une spécialité française, les « banquiers-fonctionnaires ».
En 1993, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, la Banque de France est dotée d'un statut d'indépendance conformément aux dispositions du traité de Maastricht.
Comme le dira Lionel Jospin, lors du colloque organisé par la Banque de France à l'occasion de la célébration de son bicentenaire, le 30 mai 2000 : « L'indépendance des banques centrales s'est imposée comme une nécessité pragmatique », afin d'assurer la nécessaire stabilité des prix, ce qui, par ailleurs, sera aussi l'objectif unique assigné au Système européen de banques centrales, puis à la BCE.
Les privatisations des banques commerciales et des compagnies d'assurance auront débuté, elles, dès 1986-1987 avec Paribas, Société Générale, le CCF, la mutuelle générale française, etc. Le reste suivra sous des gouvernements de gauche comme de droite.
Suivra le démantèlement de ce qui faisait la spécificité du système de financement français, le réseau constitué autour de la Caisse des dépôts et consignations, et de l'ensemble du réseau mutualiste ou coopératif : Crédit agricole, Caisses d'épargne, Banques populaires.
Comme Laurent Mauduit l'a rappelé à la « commission d'enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique » 234 ( * ) : « Ce mouvement de privatisation va fournir de formidables opportunités de promotion pour la haute administration aux commandes de ces entreprises, établissements bancaires et financiers de tous ordres lorsqu'ils étaient publics, qui pour la plupart resteront en place.
Dans les années 80 et 90, c'est la vague des pantouflages, mais pas seulement. Je vous fais observer qu'une partie des hauts fonctionnaires, à la faveur des privatisations, se sont formidablement enrichis. Rappelons-nous les mots de Benjamin Constant : « Servons la cause et servons-nous ! »
Prenez le secteur bancaire actuel résultant des privatisations des années 80-90 : il est dirigé uniquement par des inspecteurs des finances, qui se cooptent depuis 30 ans. On a connu une sorte de hold-up de l'oligarchie de Bercy sur le coeur du CAC 40. Il y a en France, à côté du capitalisme familial, un capitalisme oligarchique qui vient de Bercy, et qui révèle cette porosité entre le public et le privé. »
Cette émigration définitive vers la banque et la grande entreprise, comme on le verra, sera progressivement remplacée, par des migrations plus ou moins alternantes vers des destinations plus diversifiées. Le « pantouflage » n'est plus le moyen de terminer brillamment une carrière de la haute fonction publique mais le mode de gestion des carrières de l'oligarchie administrative. On comprend l'attachement de ses bénéficiaires et ceux qui aspirent à l'être, à un tel système.
Le choix politique, tout à la fois tactique et structurel, d'une construction européenne sans souveraineté transnationale et dont le seul ciment serait le droit issu d'accords et de traités entre nations sera aussi l'occasion d'un transfert de pouvoirs du Parlement à des instances non élues mais nommées et, parce qu'irresponsables, dites « indépendantes » : conseil constitutionnel, juridictions administratives (Conseil d'État, Cour des comptes), AAI plus ou moins hautes qui se mettront à proliférer.
Une domination par le droit (européen) qui est aussi celle d'une haute bureaucratie sans légitimité démocratique.
3. La domination du droit européen
La création d'un marché commun étant le premier objectif de la construction européenne, le droit de la concurrence puis de la « concurrence libre et non faussée », occuperont naturellement la toute première place dans le droit européen. Priorité des priorités cette législation débuta avant même la signature du traité de Rome (1957), dès la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951).
Les principes de la concurrence libre et non faussée s'appliqueront ainsi entre les pays européens, ce qui était prévu, mais aussi dans les échanges avec le reste du monde, ce qui ne l'était pas vraiment. Sans le dire, sous la pression des USA et de l'Allemagne, l'Europe se fit libre échangiste. Exit le principe de la « préférence européenne » dont rêva la France gaulliste et qu'elle échoua à faire prévaloir.
Le but premier de cette règlementation fut donc d'éviter que la concurrence entre pays membres ne fut faussée. On contrôla et sanctionna donc les ententes, les abus de position dominante, les aides publiques (États, collectivités territoriales et organismes divers), les concentrations et regroupements d'entreprises, sous la responsabilité de la Commission européenne. Ces contrôles furent progressivement délégués aux États membres, d'où la création d'AAI, la Commission se préoccupant seulement des infractions les plus graves.
Des contrôles étendus à toutes les entreprises publiques ou privées européennes, aux entreprises industrielles ou de services, un traitement particulier étant progressivement réservé aux services considérés d'intérêt économique général (voir annexe 2) .
Si, comme on l'aura compris, une telle législation rend impossible toute politique industrielle nationale, même si ce rêve n'a pas disparu du discours politique, plus fâcheusement elle remet aussi en cause la conception française du service public, une conception très particulière il est vrai.
La conciliation des visions européenne libérale et nationale interventionniste demanda donc quelques « aménagements », ce dont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État vont s'acquitter brillamment, loin des regards du peuple souverain, mais dans son intérêt bien compris.
4. Le pouvoir par le droit européen
Des organismes nommés vont ainsi se trouver investis, sous couverture du droit européen, d'un pouvoir authentiquement politique, ce dont ils se défendent d'ailleurs mordicus.
Pour ce qui le concerne, le président actuel de la Cour des comptes excelle, évidemment, dans le rôle de gardien des engagements financiers français issus de la crise grecque et dans celui d'aiguillon moral du Gouvernement vers toujours moins de dépenses publiques. Rien de politique pourtant, jure-t-il dans ses désormais rituelles apparitions en majesté, sous les feux et les louanges médiatiques pour dénoncer les manquements du Gouvernement à la rigueur budgétaire. Comme si les modalités d'application des engagements internationaux ne relevaient pas du pouvoir politique et si la réduction des dépenses publiques était la seule politique convenable quelle que soit la conjoncture !
C'est cependant au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État et à la Cour de cassation qu'échoira la tâche essentielle : neutraliser la constitution de la V e République dont l'article 3 a malencontreusement prévu que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Une vieillerie souverainiste qu'il conviendra de contourner, faute de pouvoir la supprimer. Pour des Européens libéraux conséquents, en effet, la souveraineté appartient aux traités. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en pleine crise grecque après la victoire électorale d'Alexis Tsipras à Athènes, sera clair : « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » 235 ( * ) Un crédo repris depuis au gré de l'actualité.
Juridiquement donc, le problème à régler prioritairement et dont la solution des autres dépendait, était celui de la hiérarchie des normes.
Traditionnellement le Conseil constitutionnel considérait que le droit européen ne se distinguant pas du reste du droit international, se situait donc au-dessous de la Constitution mais au-dessus des lois, dès lors que les traités européens avaient été régulièrement ratifiés et sous condition de réciprocité.
Validant en fait des décisions antérieures 236 ( * ) du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'est l'inscription dans la Constitution en 2005 d'un Titre XV (modifié en 2008) prévoyant la participation de la France à l'Union européenne qui les gravera dans le marbre.
Si la Constitution restait au sommet de l'ordre juridique interne, non seulement les directives mais le droit dérivé, dans les domaines de compétence ayant fait l'objet d'un transfert, étaient placés au-dessus des lois.
« La transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne » (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004).
Désormais donc, c'est à la Cour de justice de l'Union européenne de vérifier si une directive ou un règlement est conforme aux traités européens dont ils découlent. Dès lors qu'ils y sont conformes ils s'imposent à la loi, leur fût-elle contraire, le Conseil constitutionnel ne pouvant vérifier que leur conformité à la Constitution et à ses principes fondamentaux.
Ainsi, dans une décision du 30 novembre 2006 le Conseil constitutionnel censurera-t-il les dispositions de transposition de la loi relative aux tarifs réglementés jugés incompatibles avec l'objectif d'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.
Concrètement, cela signifie que la loi ne peut s'opposer à un règlement ou une directive européenne.
Et voilà pourquoi votre Parlement doit rester muet !
Allons plus loin si, à la rigueur, les modifications constitutionnelles de 2005 et 2008 peuvent justifier la supériorité des dispositions européennes directement issues des traités, c'est beaucoup moins évident pour le droit qui en a été dérivé par la bureaucratie bruxelloise : règlements et directives issus de la Commission et moins encore pour les décisions des institutions européennes en général et la jurisprudence du juge européen.
Cette interprétation extensive, plus que contestable, du titre XV de la Constitution que l'on peut suivre dans la jurisprudence du Conseil d'État montre bien où sont les pouvoirs qui comptent en démocratie moderne.
L'opération de neutralisation du Parlement ne s'arrêtera pas aux principes. Puissamment secondé par le Conseil d'État dont la jurisprudence, comme on va le voir ci-après, coïncide avec la sienne, à moins que ce ne soit l'inverse 237 ( * ) , le Conseil constitutionnel imposera jusqu'au détail des lois non seulement les principes du droit européen de la concurrence mais la suprématie des intérêts économiques et des affaires sur toute autre préoccupation fût-elle d'intérêt général, ce que Jacques Caillosse appelle la « surdétermination économique du droit » 238 ( * ) : « le droit (qui) s'est placé lui-même sous dépendance économique, en faisant de cette dépendance une règle juridique. » C'est le principe même de l'ordolibéralisme : réaliser la concurrence parfaite par le droit.
Les réponses aux QPC issues de la révision constitutionnelle de 2008 qui vont proliférer en fourniront l'occasion.
Ainsi, en novembre 2013, le Conseil constitutionnel censure une disposition parlementaire prévoyant que les schémas d'optimisation fiscale, spécialité de certains cabinets d'avocats d'affaires, soient soumis à Bercy avant d'être mis à la disposition de leurs clients. Le non-respect de cette règle aurait entraîné une amende pouvant aller jusqu'à 5 % des commissions perçues par le cabinet de conseil.
Le 21 novembre 2016, c'est au tour du décret pris par Michel Sapin en mai, suite au scandale des Panama papers , instituant un registre public des trusts puis le 8 décembre de la même année de l'article 137 de la loi Sapin II faisant obligation à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux correspondant à leur activité pays par pays, afin d'éviter que leurs concurrents « identifient des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale », portant ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre. Une disposition visant à réduire les avantages fiscaux tirés de l'installation de sièges sociaux fantômes dans les paradis fiscaux.
La taxe dite « Google » votée avec la loi de finances 2017, le 29 décembre 2017 subit le même sort. Son but était d'obliger toute entreprise qui réalise des activités et des profits en France d'y payer des impôts. Une sanction de 5 points de plus par rapport au taux - théorique - de 33 % de l'impôt sur les sociétés (8 % en réalité pour les grands groupes) était prévue pour toutes les sociétés adoptant des montages d'évasion, et confondues par le fisc.
Motif de la censure : non-respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt !
Dans la foulée, le Conseil constitutionnel retoque l'article de cette loi qui prévoyait une amende proportionnelle au montant de l'opération, non plafonnée, en cas d'absence de signalement des opérations, soumises à la TVA, supérieures à 863 000 euros.
Motif : « une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer ». Rappelons que la fraude à la TVA coûte entre 20 et 30 Md€ par an à l'État et que l'équilibre budgétaire est devenu en France une ardente obligation.
Pas étonnant donc que la QPC soit devenue, selon l'expression de Xavier Dupré de Boulois, un « supermarché des droits fondamentaux » (RDLF 2014 n°2) . Ainsi, explique-t-il « la configuration actuelle de la QPC a permis le développement d'une pratique des sociétés commerciales consistant à soulever des moyens tirés de la violation de droits et libertés constitutionnels dont elles ne sont pas titulaires pour obtenir du juge qu'il abroge une disposition législative qui nuit à leurs intérêts économiques. La catégorie des droits constitutionnels devient alors un vaste supermarché où les opérateurs économiques puisent des ressources argumentatives au gré de leurs besoins. Quitte pour cela à détourner ces droits de leurs finalités initiales. »
5. Le Conseil d'État et la privatisation de l'intérêt général
Un des exemples les plus significatifs des accommodements du droit administratif national aux contraintes européennes est certainement l'« aménagement » de la notion d'intérêt général, une opération délicate visant à concilier la vision libérale d'une société, dont l'ensemble des échanges de biens et de services sont régulés par la concurrence avec celle d'un pays où existent des « services publics » fonctionnant selon la logique de l'intérêt général.
Si « la responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître ses profits » comme le dit Milton Friedman 239 ( * ) , si, comme écrit Hayek, le terme « justice sociale » n'a aucun sens dans une société libre, n'est qu'une survivance du tribalisme, « un mirage » qui ne saurait recevoir un contenu que dans une société totalitaire, pour les libéraux la notion même de « service public » n'a aucun droit de cité.
Si, comme le dit encore Hayek, l'intérêt général ce n'est pas satisfaire les intérêts particuliers de quelque groupe quel qu'il soit, fut-il jugé défavorisé, mais réaliser les conditions favorables qui permettront aux individus et petits groupes de se fournir mutuellement ce dont ils ont besoin, autrement dit de réaliser les conditions de la concurrence libre et non faussée, alors l'article 1 er de la Constitution - « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » - est nul et non avenu. À moins évidemment de poser comme axiome qu'une « République sociale » peut tout à fait être régulée par la concurrence.
C'est à cette difficile opération de transmutation des valeurs que le Conseil d'État va brillamment s'atteler. Faute de nouvelle définition abstraite de ce qu'est cet intérêt général, l'évolution de la doctrine du Conseil d'État doit être déduite de ses arbitrages entre intérêt public et intérêts privés dans des situations particulières en éclairant cette jurisprudence par les rapports publics disponibles - « Réflexions sur l'intérêt général » (1999), « Collectivités publiques et concurrence » (2002) -, par les articles et déclarations de son avant-dernier vice-président, Jean-Marc Sauvé.
La nouvelle doctrine, telle qu'on peut la déduire d'arrêts comme Société Million et Marais (1997), EDA et Aéroports de Paris (1999), Somatour (2002), réussit le tour de force d'être en continuité avec l'arrêt « Automobiles Peugeot » conforme à la jurisprudence classique 240 ( * ) tout en validant la soumission de l'administration au droit de la concurrence qui devient de fait une composante de l'intérêt général. Le message ainsi délivré est que l'État doit se comporter comme un acteur privé pour permettre à la concurrence de produire ses pleins effets et ainsi satisfaire les besoins collectifs, donc l'intérêt général. Un tour de prestidigitation juridique proprement éblouissant !
Les rapports publics sont de la même veine.
Celui de 1999 commence par rappeler que « L'intérêt général [est la] finalité ultime de l'action publique », qu'il est « l'expression de la volonté générale, ce qui confère à l'État la mission de poursuivre des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus, par-delà leurs intérêts particuliers » , qu'il est la « clef de voute du droit public français », qu'il conserve toute sa pertinence. Puis, chemin faisant, des accommodements avec le ciel sont trouvés, au nom du pragmatisme, de la recherche d'un nécessaire équilibre entre « les impératifs d'intérêt général » et l'« efficacité du marché » , et des règles de la concurrence imposées par les traités européens, « y compris aux services d'intérêt général ».
« Plutôt que d'opposer intérêt général et marché, libéralisation et service public, il s'agit de rechercher, dans un contexte de libre concurrence, la prise en compte d'objectifs d'intérêt général, expression des valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d'équilibre régional ou de protection de l'environnement. On retrouverait ainsi, dans un contexte renouvelé, l'objectif d'interdépendance sociale dans lequel Duguit 241 ( * ) voyait la raison d'être du service public. »
Puis le rapport constate qu'il existe une convergence entre les approches nationale et communautaire qui permet « une meilleure conciliation » entre principe du marché et objectifs d'intérêt général. On aura compris que ce nouvel arbitrage est meilleur en ce qu'il inverse les prérogatives : ce n'est plus l'intérêt général qui, tout en admettant qu'il convient de sauvegarder autant que c'est possible les intérêts privés, prime, mais l'inverse.
Conclusion : La notion d'intérêt général doit faire l'objet d'une « reformulation », « voire d'un rajeunissement ».
« C'est à cette condition qu'elle pourra à la fois mieux s'adapter aux enjeux économiques et sociaux contemporains, mieux s'harmoniser avec les valeurs de la modernité et mieux répondre aux besoins nouveaux qui s'expriment ».
Certes « l'équilibre entre marché et cohésion sociale ne sera pas toujours aisé à assurer , mais l'orientation dans son principe paraît désormais assez largement acceptée. »
De la notion d'intérêt général à celle de service public il n'y a qu'un pas, la finalité du service public étant la satisfaction de l'intérêt général, le concept de service public sera lui aussi revisité.
Le rapport de 2002 « Collectivités publiques et concurrence » est parfaitement clair : « La promotion du service public commence par la reconnaissance du cadre d'ensemble de libre concurrence dans lequel il est appelé à intervenir ». D'ailleurs reconnait le rapport : « Les collectivités publiques dans leur grande majorité, ont pris en compte leur ancrage dans un système d'économie de marché. »
La reconnaissance tardive par l'Europe de la spécificité de certains services essentiels, nécessaires à tous et garants de la cohésion sociale, sous les noms de « services économiques d'intérêt général » et de « services universels » permet-elle de les libérer du carcan concurrentiel ?
En partie, mais en partie seulement. En tous cas, « services économiques d'intérêt général » et « services universels » renvoient à une autre logique que celle du service public à la française. La notion de service public est politique, celles de « service universel » et plus encore de « service d'intérêt général » relèvent du mercantilisme charitable. (voir annexe 2)
De plus, le « service d'intérêt économique général » existe seulement comme exception, comme dérogation au droit de la concurrence. D'où la définition progressive de règles permettant de le concilier avec les règles du marché intérieur qui reste l'objectif essentiel. D'où aussi une approche purement économique, volontairement sectorielle et le refus d'un cadre global légitimant l'existence d'activités hors du champ de la concurrence « libre et non faussée ».
6. La Cour des comptes défenseur de l'orthodoxie libérale
Michel Crinetz 242 ( * ) résume ainsi la transformation de la Cour en acteur politique :
- En charge de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, la Cour des comptes ne se contente pas de relever les gaspillages et les fautes de gestion - ce qui lui incombe - mais de juger la stratégie de l'entreprise contrôlée, donc de remettre en cause la politique industrielle ou financière publique.
- Elle est devenue juge de l'équilibre général des finances publiques son premier président étant désormais président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), du Conseil des prélèvements obligatoires, président du « Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics », comme si c'était en termes de « coût et de rendement » qu'il fallait juger l'enseignement public, les hôpitaux ou le système de protection sociale ! Résultat, selon ces critères, toute dépense publique devient, sinon mauvaise par essence, suspecte.
On aura compris que la Cour des comptes française est devenue le bras armé de la Commission européenne pour l'application des traités visant à la suppression des déficits publics, autrement dit que, conformément au crédo libéral, il appartient aux marchés d'assurer la régulation sociale.
Une administration tançant un État pour sa gestion et lui signifiant ce qu'il doit faire, inadmissible dans toute démocratie digne de ce nom, est désormais une situation si banale que le Premier président de la Cour des comptes peut devenir une vedette médiatique sans surprendre personne.
- Devenue gardienne du non-interventionnisme de l'État, elle va jusqu'à critiquer 243 ( * ) la concurrence qu'un acteur financier public pourrait faire aux acteurs privés. Ainsi voit-elle d'un mauvais oeil celle faite par Bpifrance 244 ( * ) aux banques privées. Ainsi, victime de sa réussite, la banque publique créée pour remédier aux difficultés d'accès au crédit des PME-PMI, notamment en phase de démarrage, Bpifrance se voit reprocher par la Cour son « action coûteuse pour l'État et source de perturbation pour le marché du crédit où elle menace d'éviction des acteurs privés dans le capital-innovation. » Il faut dire que les parts de Bpifrance sur les levées de fonds en capital-innovation sont passées de 19 % au départ à près de 60 % en 2014. Le tout, noyé dans d'autres critiques, en toute objectivité bureaucratique, la Cour ne faisant pas de politique comme on sait.
7. Les Autorités administratives indépendantes (AAI)
La prolifération des AAI, comme on l'a dit, est pour partie la conséquence directe de la conception ordolibérale du « marché libre et non faussé » qui ne saurait exister sans intervention extérieure 245 ( * ) . C'est aussi celle de la défiance proclamée envers l'État soupçonné de favoritisme, de clientélisme congénital et de dissimulation systématique de ses intentions et de ses actes. Créer des Autorités proclamées indépendantes est censé être le moyen d'instaurer le règne de l'équité par la transparence sans engager la responsabilité du pouvoir politique.
Concrètement créer une AAI c'est aussi souvent le moyen pour le gouvernement d'allumer un contre-feu devant un scandale qui se développe ou simplement de se décharger d'arbitrages à ennuis, sans pour autant perdre totalement la main. Le problème c'est qu'à force de se retirer, l'État devient de moins en moins visible et que les contre-feux devenus permanents et autonomes finissent par compliquer la vie de plus en plus de gens. Ainsi, une erreur de casting élyséen dans la composition du Gouvernement est-elle à l'origine de la création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Résultat : des milliers d'élus et de responsables administratifs sont tenus, au nom de la nouvelle religion de la transparence, de multiplier les déclarations d'intérêts et de patrimoines ! Un mouvement qui n'est pas près de s'arrêter.
Mais l'essentiel est ailleurs, dans la nature juridiquement indéterminée et dans l'impact institutionnel de cette innovation.
On baigne, en effet, en pleine contradiction : les AAI relèvent de l'État en tant « qu'administration », leur budget vient pour beaucoup essentiellement de l'État 246 ( * ) , une bonne partie de leurs membres sont désignés par l'exécutif (quelques autres par le Parlement), sans être contrôlés par les Pouvoirs publics, indépendance oblige, sans être pour autant des juridictions, même si un certain nombre (comme la HATVP) y ressemblent. Selon la formule de Patrice Gélard, AAI est un « oxymore juridique », un « objet juridique non identifié » 247 ( * ) .
C'est clairement un « État dans l'État » titre le rapport de Jacques Mézard précité. La doctrine répétée avec application par la haute administration voudrait qu'il s'agisse simplement d'une autre manière d'administrer, plus moderne, « l'État régulateur » ayant remplacé « l'État prescripteur ». Mais cette régulation pourrait être faite par le biais de contrôleurs, de défenseurs ou d'agences d'État, certes dotées d'une indépendance statutaire réelle mais relevant toujours et très clairement de la puissance publique.
Le plus étonnant de ce tour de passe-passe, c'est que ces autorités sont massivement composées des mêmes hauts fonctionnaires jugés incapables de faire fonctionner une régulation administrative quand ils agissent au nom de l'intérêt général. À croire que sortir de leurs ministères les rend plus intelligents, plus intègres et plus compétents.
La présence dans certains de ces cénacles de représentants des intérêts privés qui n'a rien non plus d'original, vu leur nombre et les responsabilités exercées, ne change rien à l'affaire. Les AAI ne sont pas une nouvelle technique d'administration mais l'abandon volontaire de ses prérogatives par l'État.
En tous cas, ces AAI offrent de véritables opportunités de carrière pour les membres des grands corps : « de l'observation de la composition des collèges et des commissions de sanctions des autorités administratives indépendantes se dégage l'impression de « carrière » construite dans ces autorités de manière horizontale ou dans le temps... au point que certains membres deviennent de véritables professionnels des autorités administratives indépendantes. » (Rapport J. Mézard)
La composition de ces autorités indépendantes montre à la fois que les membres des grands corps y sont nombreux et qu'à leur tête se trouvent prioritairement des membres du Conseil d'État, et de la Cour des Comptes.
Comme l'indique le rapport, parmi les 544 sièges occupés au sein des autorités administratives indépendantes, 167 sièges sont occupés, dans l'ordre décroissant, par des membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Ensemble, les membres de ces trois corps occupent 30 % des sièges des AAI, 37 % si on retire du périmètre des AAI retenues, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Comité consultatif national d'éthique à la composition originale.
Par ailleurs, sur les 40 personnes assurant, au 1 er septembre 2015, la présidence d'une autorité ou les fonctions d'une autorité (Médiateur ou Contrôleur général des lieux de privation de liberté), 21 sont issues de deux ou trois institutions : 14 du Conseil d'État, 7 de la Cour des Comptes auxquels vient s'ajouter un inspecteur général des finances... « Or, ajoute Jacques Mézard, une fois qu'un membre de ces institutions siège, souvent comme président, au sein de cette autorité, l'habitude est généralement prise de recourir à des membres de ces institutions comme collaborateurs de cette autorité. »
L'examen de la sociologie des AAI montre, enfin, que c'est la proximité de leurs membres au pouvoir présent et passé, leur appartenance à des cercles restreints censée leur conférer un pouvoir d'expertise (milieux de l'audiovisuel, milieux financiers, etc.) ou plus généralement leur appartenance à des grands corps de l'État censée leur conférer de ce seul fait, l'indépendance en principe recherchée qui légitime leur pouvoir. Il faut avouer que le « peuple » dans sa diversité est un peu loin de ces cercles. Avouer que cette gouvernance des « meilleurs » chère à Platon, des mandarins « lettrés » post-modernes, dont la pertinence et l'efficacité restent à prouver, n'a pas grand-chose à voir avec la démocratie.
C. UN ÉTAT MINIMUM SOUS TUTELLE
1. Un État minimum
Les réductions significatives du champ d'intervention de l'État résultant de la privatisation de l'appareil de production et du système financier public sont clairement la conséquence directe du choix libéral. Celles qui suivront, sans le contredire, procèdent en même temps du choix européen.
En privatisant le système bancaire et en s'interdisant de le réglementer, la France se privait déjà de la maîtrise de sa monnaie scripturale et de la possibilité de financer son économie par ce moyen.
L'interdiction européenne des aides sectorielles aux entreprises, au nom de l'équité concurrentielle, la prive aussi de toute possibilité de politique industrielle.
En intégrant la zone euro, la France perd, en outre, tout pouvoir en matière monétaire : elle ne peut plus « battre monnaie », donc financer ses déficits et sa dette par ce moyen, comme tous les pays souverains. Ce pouvoir appartient désormais aux marchés, autant dire aux spéculateurs sous le joug desquels elle s'est placée volontairement. Avant le passage à l'euro, les autorités monétaires françaises passaient leur temps à surveiller le taux de change franc/mark (voir partie II) ; après, leur souci sera le « spread » 248 ( * ) , autre forme sous laquelle se manifeste la suprématie allemande !
S'agissant de la monnaie banque centrale, le pouvoir d'émission appartient évidemment à la BCE qui ne l'utilisera pas pour financer l'économie. Conformément à ses statuts, son rôle se limitera à la lutte contre une inflation qui d'ailleurs n'existera rapidement plus, puis cantonné à ses statuts de pompe à finance de la spéculation !
Il faudra attendre en effet le rusé Mario Draghi, faute de pouvoir financer directement une quelconque reprise économique, pour voir la BCE sous les protestations allemandes pratiquer des politiques monétaires « non conventionnelles » (« quantitative easing »), en espérant que les banques joueront le jeu du financement de l'économie, ce qui ne fut pas vraiment le cas.
La France perd aussi toute possibilité de jouer sur le taux de change de sa monnaie pour faciliter ses exportations. Condamnée à subir un euro trop fort pour la gamme de produits qu'elle exporte mais trop faible pour limiter les excédents allemands qui se trouvent ainsi favorisés, elle doit se contenter d'un déficit quasi permanent de sa balance extérieure.
Après la crise de 2008 qui fera exploser la dette publique et la crise grecque, la France, membre de la zone euro, condamnée avec la plupart des pays de la zone à une diète perpétuelle, sera de plus interdite de politique budgétaire (voir partie II).
L'État se rétractera donc un peu plus, réduisant, budgets après budgets, les effectifs de la fonction publique non oligarchique, multipliant les AAI ou facilitant les départs des fonctionnaires qui le souhaitent vers le privé ; laissant fondre sa capacité d'expertise ; transférant aux collectivités locales la charge des services publics de proximité les plus dispendieux et une partie de l'aide sociale ; nouant des Partenariats publics privés (PPP), chargeant des opérateurs privés d'équiper le pays aux frais des consommateurs (opérateurs du numérique ou de téléphonie mobile, gestionnaires d'autoroutes, etc.) ou simplement en réduisant les moyens ou les aides nécessaires au bon fonctionnement des services publics « non rentables » : hôpitaux, transports...
En attendant de pouvoir être complètement privatisés, les entreprises et les services publics marchands, qui ne le sont pas encore, sont soumis aux règles de la concurrence et les services publics non-marchands de plus en plus réorganisés selon les principes managériaux à l'honneur dans le privé.
Particulièrement significatif, l'abandon par l'État de sa présence et celle de ses services dans les territoires. (voir partie IV)
Du caractère « jacobin » de l'organisation territoriale française autour de la commune et du département, on ne retient généralement que la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales, tutelle via les préfets ; tutelle substantiellement réduite d'ailleurs par les lois de décentralisation de 1982-1983 et par les restrictions budgétaires qui ont rendu de plus en plus aléatoire l'exercice de cette tutelle.
C'est oublier qu'organisation jacobine signifie aussi présence de l'État sur l'ensemble du territoire à travers ses ingénieurs des Ponts et chaussées, des Eaux et forêts, à travers une ingénierie susceptible d'apporter un soutien aux collectivités, particulièrement aux plus petites, à travers son parc d'entretien des routes.
Or, de révision générale des politiques publiques (RGPP) en modernisation de l'action publique (MAP), en réforme de l'administration territoriale (RéATE) en Préfecture nouvelle génération et récemment Fonction publique du XXI e siècle, depuis quinze ans, pas de nouveau Président de la République sans réforme de la fonction publique territoriale, sans réduction de ses effectifs, ingénierie publique en tête.
Pour s'en tenir aux dernières années, depuis 2013, 2 000 postes de la fonction publique territoriale ont été supprimés auxquels s'ajouteront les 500 ETP prévus en 2019 et l'annonce par le Premier ministre de la suppression de 50 000 postes, globalement, dans la fonction publique d'État.
Quant à l'ingénierie publique, depuis vingt ans elle a été mise en pièce, pour cause d'entrave à la concurrence, une ingénierie dont il est à peine exagéré de dire qu'elle avait fait la France rurale. La loi MURCEF (décembre 2001) 249 ( * ) , la création puis la suppression de l'ATESAT (loi de finances pour 2014), les réformes successives décimant les services préfectoraux 250 ( * ) , en auront été les étapes les plus significatives.
Quant à « l'agence nationale de la cohésion des territoires », sorte d'Auberge espagnole », nouvellement créée, on a toujours un peu de mal à savoir ce que seront ses moyens et son rôle réel. La seule chose qui soit sûre, c'est que cette agence, comme les autres, est l'un des emballages du désengagement de l'État.
2. Un État sous tutelle
Au final donc l'État nouveau, ayant perdu en droit et en fait l'essentiel de ses moyens d'intervention directs se trouve placé sous la tutelle des « investisseurs » privés (créanciers de sa dette et acteurs économiques rendus seuls susceptibles de créer des emplois), sous surveillance européenne et dépendant des services marchands qu'il pourra payer, conception et ingénierie comprises.
Dans le novlangue tel qu'il est pratiqué, « investisseur » signifie à la fois, celui qui prend le risque de financer une entreprise ou une activité productrice de richesse réelle et le spéculateur dont l'enrichissement ne correspond à aucune richesse nouvelle (valeur d'une action, plus-value immobilière résultant seulement de la hausse des prix du marché ...). D'ailleurs souvent, ces opérations sont réalisées à crédit, crédits remboursés par les entreprises qui ont été rachetées (fusions-acquisitions) ou les usagers de services financés eux aussi à crédit comme on l'a vu pour la téléphonie mobile. (voir partie II - le financement de l'économie réelle)
Cette confusion volontaire entre investisseur au sens classique et spéculateur, évidemment pas fortuite, donne un vernis d'honorabilité à des pratiques intermédiaires entre les jeux de casino et la pure et simple rapine.
Quand règne la finance, le seul moyen de créer des emplois, que cela plaise ou non, ne cesse de répéter Emmanuel Macron, c'est d'attirer les « investisseurs » en leur donnant ce qu'ils attendent en matière fiscale, d'aides financières, de droit du travail, etc.
Ce n'est pas pour rien qu'en Une, le magazine Forbes, lors de son voyage en Australie (31 mai 2018), lui accorde le titre de « leader of the free markets » (« leader des marchés libres »). Dans l'entretien qu'il accorde alors à la revue, il rappelle l'importance pour lui de comprendre ce que sont les intérêts des « entrepreneurs et (des) preneurs de risques » : « a voir des contacts directs avec le secteur privé, avoir cette expérience de ce secteur et être capable de comprendre les déterminants clés du choix d'un investissement sont les meilleures façons de comprendre et de prendre la bonne décision » . Après Manuel Valls qui se flattait lors de son déplacement à la City de diriger un gouvernement « pro business », Emmanuel Macron vantant son « approche favorable aux affaires » (« business friendly approach » ) revendique le titre de « président des investisseurs » .
« Si vous créez les meilleures conditions possibles [pour investir de l'argent], vous pouvez mener une révolution et créer des emplois » . La mener simplement, en donnant satisfaction aux intérêts de ceux qui ont le pouvoir réel de créer des emplois : « Il n'y a pas d'autre choix ».
Au terme de ces quarante ans de profondes transformations, le pouvoir politique doit donc faire face au défi suivant : comment gouverner avec une légitimité démocratique de plus en plus contestée, après s'être volontairement placé sous la tutelle des marchés, du carcan européen et en ayant supprimé, par souci d'économie et parce que les prestataires de services étaient censés faire mieux, une bonne partie de ses capacités d'expertise et de ses moyens d'action directs ?
La réponse sera, en s'appuyant de moins en moins sur la légitimité des urnes qui, de scrutin en scrutin, donnent des résultats de plus en plus hasardeux, et de plus en plus sur le monde des affaires et de la finance désormais incontournable. Autrement dit, en allant jusqu'au bout de la logique du nouvel ordre, et donc fatalement, en accentuant ses effets économiques et politiques pervers.
Concrètement, cela se traduira par l'accentuation de la politique de dévitalisation d'un système parlementaire, source de perte de temps et surtout par le transfert au privé des missions que l'État s'est rendu incapable de remplir lui-même. Ainsi verra le jour un système de répartition et d'exercice des pouvoirs tout à fait original, que sa complexité met à l'abri de tout contrôle du souverain populaire, en principe détenteur de la légitimité.
Selon les catégories classiques à peine revisitées, on pourrait dire que ce système est de type féodal, avec un suzerain politique coiffant des barons économiques, financiers, fabricants d'idéologie, d'opinions et de normes, parfois plus puissants que lui. Ce n'est pas faux mais masque ce qui fait la nouveauté du système : son caractère « collusif » pour reprendre l'expression de Pierre France et Antoine Vauchez 251 ( * ) , et son fonctionnement à l'influence plus qu'à l'injonction.
D. L'ÉTAT COLLUSIF OU LA GESTION PUBLIQUE-PRIVÉE
Privé d'une part essentielle de ses leviers d'action, l'État libéralisé devra privatiser toujours un peu plus l'action publique et s'étant dessaisi lui-même de ses moyens de conception, d'action et de contrôle, faire appel aux compétences, à l'ingénierie technique, scientifique et financière privée.
Il se sera condamné à un usage extensif de la délégation totale ou partielle de la maîtrise d'ouvrage et de la gestion de services publics : sous- traitance, délégations de service public, concessions, partenariats public privé (PPP), autorisations d'exploitation du domaine public comme le domaine public hertzien accordées à des opérateurs privés, à charge pour eux d'équiper le pays dans le cadre d'un cahier des charges, etc.
Un usage extensif 252 ( * ) qui changera la nature de ces outils classiques, et le partenaire privé d'exécutant devient concepteur et contrôleur :
« Désormais (l'État) n'achète plus seulement des équipements ou des services à des acteurs privés, il peut en déléguer ou en coproduire la conception. Et avec eux se diffuse la maîtrise des informations qui se trouvent au fondement de toute action. Cette intrication nouvelle des missions remet en cause un partage clair entre un principal (qui commande) et un agent (qui réalise) comme la théorie économique la formalisait depuis moins de 30 ans. » (Antoine Vauchez)
S'impose alors à lui la nécessité de faciliter cette collaboration, les échanges qu'elle suppose et l'attrait qu'elle peut avoir pour ses partenaires. Au final, la nouveauté de ce système collusif, c'est le déploiement tous azimuts d'une politique d'administration « publique-privée », affranchie du principe multiséculaire de séparation de l'administration publique, visant la satisfaction de l'intérêt général, du management privé, dont la finalité se limite aux intérêts de l'entreprise. Plus globalement, ce sont les limites entre sphère privée et sphère publique qui disparaissent, remplacées par le « grand brouillage » décrit par Pierre France et Antoine Vauchez, un véritable « remodelage néolibéral de l'État » , une sorte d' « hybridation entre public et privé » pour reprendre cette fois l'expression de Pierre Lascoumes et Dominique Lorrain (voir plus loin).
1. L'extension du domaine de l'influence et de la séduction
On assiste donc au développement d'une zone intermédiaire incertaine entre public et privé où se négocient les décisions publiques plus qu'elles ne s'imposent, où se mêlent haute administration publique et représentants des intérêts publics et où prime, des deux côtés, sans que cela ne soit jamais dit, une véritable mutation de l'art de gouverner.
À la différence de l'État classique, l'État collusif, en effet, même s'il conserve théoriquement ses anciens pouvoirs régaliens, devant composer avec les intérêts privés, devra troquer son pouvoir d'injonction contre celui d'influence, pour ne pas dire de séduction.
« Situé aux confins de l'économie, de la politique et de l'administration et à la rencontre des niveaux français et européen, le champ de l'intermédiation et de l'influence a gagné en ampleur et en autonomie au cours des deux dernières décennies, dessinant en contrepoint les institutions de la démocratie représentative une nouvelle cartographie des pouvoirs. » (Pierre France, Antoine Vauchez)
C'est très exactement ainsi qu'Emmanuel Macron conçoit son rôle. Comme il l'expose dans un entretien au magazine américain Forbes (2 mai 2018) :
« Comment pouvons-nous attirer un maximum d'investissements, créer un maximum d'emplois et devenir l'un des chefs de file de ce nouveau monde ?... [En ayant] une approche favorable aux entreprises.
« L'économie repose sur la confiance et l'assurance [....] Et une fois que vous avez créé cette relation de confiance avec les entreprises, elles investissent, elles recrutent et elles envoient un message clair aux classes moyennes.
Je pense que mon expérience dans le secteur privé m'a amené deux choses. La première, c'est que je comprends assez bien les entrepreneurs et les preneurs de risques. Et c'est important selon moi. Je comprends parfaitement quels sont leurs intérêts, ce qui veut dire que je ne les vois pas seulement à travers le prisme de leurs représentants. L'une des difficultés de notre système politique, c'est que parfois, les représentants des entrepreneurs n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que les entrepreneurs eux-mêmes [...]. Avoir des contacts directs dans le secteur privé, de l'expérience dans ce secteur et être capable de comprendre les principaux moteurs d'investissement, c'est le meilleur moyen de comprendre et de prendre la bonne décision. »
Aussi, dans ce même entretien Emmanuel Macron déroule-t-il la liste des réformes - fiscales, administratives, relatives au marché du travail - favorables aux « investisseurs », menées depuis le début de son mandat.
Si donc l'État ne peut se passer de l'appui des intérêts privés pour administrer le pays, inversement ces derniers, soumis à la pression concurrentielle, vont chercher à s'assurer les bonnes grâces de l'État, qu'elles prennent la forme d'aides financières, d'avantages fiscaux ou réglementaires, ou plus subtilement d'un partenariat aux retombées plus pérennes.
D'où la multiplication des acteurs de ce ballet des pouvoirs sur la scène du théâtre de l'intermédiation : lobbys et porteurs d'intérêts privés en tous genres, groupes de pression financiers, entreprises du CAC 40 adossées à de multiples groupes d'études et think tanks, cabinets d'avocats d'affaires... D'où l'impression de dilution d'un pouvoir politique devenu évanescent aux yeux des citoyens qui ne se reconnaissent plus en lui.
De l'autre côté, outre le bénéfice financier que l'ensemble des acteurs privés du système tirent de leur activité (marchés, bénéfices de PPP, honoraires, etc.) ils acquièrent aussi à cette occasion des compétences et des connaissances nouvelles qui leur donneront un pouvoir de monopole ainsi qu'une nouvelle capacité d'orientation de l'action de l'État en matière de sécurité, de protection de l'environnement, etc., autant dire de nouvelles capacités d'influence, l'État ayant abandonné progressivement toutes capacités et tous moyens d'expertise dans ces secteurs.
Comme les « trous noirs » attirent les corps et le rayonnement sans qu'on s'en aperçoive, ces puissants centres de pouvoir infléchissent par leur capacité d'influence, sans en avoir l'air, les choix publics. Ils travaillent autant pour leur compte que pour celui de leur mandataire, dégagés des contraintes de la gestion publique, de la transparence, du contrôle parlementaire et de l'obligation de rendre périodiquement compte aux électeurs. Et pendant ce temps-là des ingénieurs de l'État de très haut niveau iront pantoufler faute de trouver dans la fonction publique un poste correspondant à leur niveau de formation et donc à leur attente !
2. Les acteurs privés du grand théâtre de l'influence et de la séduction
a) Les « trous noirs du pouvoir »
Pierre Lascoumes et Dominique Lorrain désignent sous le nom de « trous noirs du pouvoir » 253 ( * ) , ces acteurs de la « société civile », parties prenantes à part entière des décisions politiques, même s'ils s'en défendent : « Des acteurs qui a défaut d'être en première ligne participent souvent de façon décisive à l'exercice du pouvoir, soit qu'ils le détiennent en propre, soit qu'ils l'exercent par délégation des fonctions régaliennes : des banques d'affaires, des fonds d'investissement, des sociétés militaires, des sociétés d'ingénierie et de conseil, des think tanks... Ils pèsent par leurs budgets, par les effectifs employés et l'impact de leurs choix. Mais ils interviennent aussi par leur pouvoir normatif, leur capacité à produire des règles de comportement et à en surveiller l'exécution. »
Ce ne sont pas des pouvoirs de l'ombre, encore moins conjurés, mais les pièces d'une nouvelle configuration du pouvoir politique dont le centre étatique s'est dessaisi.
Certains de ces centres de pouvoirs qui voudraient rester discrets, vu leur importance, ne peuvent disparaître complètement aux yeux du public. Ainsi en va-t-il du puissant système bancaire privé français.
Il tient son pouvoir de son rôle clef dans la circulation des flux monétaires et l'émission des crédits nécessaires au financement de l'économie, autant de fonctions qu'avec la privatisation des banques, l'État a abandonnées.
Il le tient aussi de son monopole intellectuel sur l'enseignement et la recherche en matière financière, les médias et la haute fonction publique. Un pouvoir intellectuel qu'entretient, comme on le verra, un pantouflage massif propre à fortifier l'espoir dans un avenir radieux !
« Quelle voix est portée par ces hauts fonctionnaires ? », s'interroge Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au micro de France-Inter : « C'est nécessairement une voix influencée par la culture acquise dans le secteur bancaire et financier. » (Émission « Secrets d'info » consacrée au pantouflage 16 février 2017).
Il est prouvé par ailleurs que les banquiers centraux recrutés parmi les banquiers ont tendance à endosser leurs intérêts : « Des études ont été publiées montrant l'impact du passage dans le privé des banquiers centraux sur la politique de ces banques : le conflit introduit bien évidemment un biais. Le risque n'était bien évidemment pas que le candidat favorise délibérément son ancien employeur mais que la politique de la Banque de France ne favorise, elle, le secteur bancaire ». 254 ( * )
Au final un pouvoir tel, qu'il a réussi (voir partie I) à faire capoter la réforme européenne de séparation des banques de dépôts et des banques d'affaires conduite par Michel Barnier, alors commissaire européen, la seule pouvant réellement réduire significativement la dangerosité du système auquel on doit la crise de 2008 et la stagnation économique qui a suivi ; qu'il a réussi à désamorcer le projet de taxation des transactions financières spéculatives (TTP) et à vider de leur substance toutes les réformes (à commencer par celle du niveau de fonds propres obligatoires) qui suivirent.
Comme dira le Gouverneur de la Banque de France d'alors, Christian Noyer : « Les idées qui ont été mises sur la table par Michel Barnier sont des idées, je pèse mes mots, qui sont irresponsables et contraires aux intérêts de l'Union Européenne. » Elles sont surtout contraires aux intérêts d'un système bancaire qui tire des bénéfices considérables de la spéculation, activité devenue plus importante pour lui que le financement de l'économie réelle qui d'ailleurs ne pèse pas lourd dans son bilan !
C'est aussi que la séparation des activités de banque commerciale et de banque d'affaires, aurait signé l'arrêt de mort du modèle de « banque universelle, à la française », dont le pouvoir bancaire était si fier et qui n'a que des avantages pour lui et tous les inconvénients pour le pays.
L'absence de séparation entre banque de dépôts et banque d'investissement garantit d'abord aux banquiers l'intervention des pouvoirs publics en cas de crise, donc des taux d'emprunt bas, donc un avantage de compétitivité, les poussant ainsi à financer l'investissement par un endettement excessif. C'est précisément ce qui est arrivé en 2008 lorsque l'État français a dû se porter garant de la dette bancaire à hauteur de 340 Md€. En 2011, lors de la crise de liquidités en dollars qui a particulièrement touché les banques française, c'est la BCE, en liaison avec la Fed qui est intervenue en leur fournissant de la liquidité à profusion. Comme le montre l'exemple de la BPCE évoqué ci-dessus, celui de Dexia et de bien d'autres, le modèle bancaire « libéral » ne peut se passer du pompier État.
Autre trou absorbant l'énergie politique, « noir » parce que trop brillant : les médias.
La question méritant à elle seule de longs développements qui n'auraient pas leur place ici, nous nous limiterons à deux constats éclairant notre analyse du fonctionnement réel de la démocratie néolibérale.
Premier constat : actuellement, dix milliardaires français dont la fortune est issue de l'industrie de l'armement, du commerce de luxe, du BTP, de la téléphonie et de la banque, détiennent la presse écrite qui diffuse 90 % des journaux, contrôlent plus de 50 % de l'audience télévisuelle et 40 % de l'audience radiophonique. Cinq font partie des dix premières fortunes de France : Bernard Arnault, P-DG du groupe de luxe LVMH (patron des Échos, du Parisien), la famille Dassault (Le Figaro), François Pinault (Le Point), Patrick Drahi, principal actionnaire de SFR (Libération, L'Express, BFM-TV, RMC), Vincent Bolloré (Canal+, plusieurs titres de presse gratuite). Il faut y ajouter Xavier Niel, patron de l'opérateur de téléphonie Free et 11 ème fortune de France, associé à Matthieu Pigasse (Banque) dans le groupe Le Monde (L'Obs, Télérama, La Vie...). Matthieu Pigasse possède également Radio Nova et l'hebdomadaire Les Inrocks.
Second constat : les médias n'ont rien du quatrième pouvoir indépendant consubstantiel à toute démocratie véritable, c'est le type même de ce pouvoir d'influence.
Pour reprendre l'analyse de Blaise Magnin et Henri Maler 255 ( * ) , leur pouvoir se résume à sélectionner les problèmes qui méritent d'être débattus par l'opinion publique, à fixer les termes et les problématiques de ces débats, à valider les opinions acceptables en passant les autres sous silence, les caricaturant ou les déformant au besoin.
« Les médias ne fabriquent pas, à proprement parler, le consentement des peuples, mais ils sont parvenus, en quelques décennies, à réduire considérablement le périmètre du politiquement pensable, à reléguer en les disqualifiant les voix contestant l'ordre social et à imposer la centralité et la crédibilité des thèses et des solutions néolibérales. Ce faisant, ils ont construit jour après jour, par un unanimisme savamment organisé, un consensus qui tient pour évidentes et naturelles une doctrine sociale, une organisation économique et des options politiques qui protègent et favorisent les intérêts des dominants. »
Pour reprendre l'expression de Chomsky, c'est « une fabrique du consentement ».
La surprise des médias, dont beaucoup s'étaient montrés plutôt compréhensifs au début du mouvement des Gilets jaunes qui leur fournissait à profusion et gratuitement images et occasions de commentaires faciles, en découvrant l'agressivité des intéressés envers eux, témoigne de leur candeur, mais certainement pas de leur lucidité sur la nature de leur fonction. Les manifestations durant et devenant plus violentes à Paris, très logiquement l'artillerie anti-désordre entra en action. Le monde pouvait continuer de tourner dans le bon sens
À côté de ces centres d'influence bien visibles, d'autres, plus discrets mais plus nombreux, prospèrent. Faute de pouvoir les évoquer tous, on se limitera à deux catégories devenues particulièrement importantes, et pourtant dont le poids reste méconnu : les lobbys et les cabinets d'avocats d'affaires.
b) Les lobbys
Le lobbyisme, avant d'être le progrès démocratique qu'y voient ses défenseurs, est d'abord une forme d'exercice de ce pouvoir d'influence. C'est en tous cas ce qui ressort des études des chercheurs qui se sont intéressés à la question.
Selon l'étude de Sylvain Laurens sur le lobbying bruxellois, son objectif, contrairement à ce qu'on pense généralement, n'est pas d'obtenir des réponses favorisant directement un produit, il n'est pas non plus de nouer des relations de confiance avec des décideurs qui d'ailleurs changent souvent, il est de modifier les règles qui indirectement vont favoriser leur entreprise ou leur produit. D'où l'intérêt pour l'entreprise de recruter un ancien fonctionnaire connaisseur des arcanes des circuits de prise de décision. La personne la plus intéressante pour le lobbyiste n'est pas forcément celle qui in fine prendra la décision mais celle qui pourra influer sur les conditions dans lesquelles elle sera prise :
« Ce qui est important pour les entreprises, ce n'est pas tant la connaissance des responsables administratifs qui changent que la compréhension du fonctionnement des institutions. » C'est cette connaissance « qui est stratégique pour les grandes firmes ». 256 ( * )
« Recruter quelqu'un qui vient du public c'est internaliser dans son entreprise quelqu'un qui peut aider à transformer les règles juridiques qui régissent le marché sur lequel vous jouez. Vous ne cherchez plus seulement alors à battre vos concurrents sur le marché à travers vos produits mais vous cherchez à transformer les règles du jeu du marché pour qu'elles tournent à votre avantage. » (Ibidem)
« Le bon lobbyiste, c'est celui qui va faire produire par l'administration bruxelloise la norme de demain » et qui comme par hasard favorisera la firme qui vous emploie !
Par exemple, instituer au nom de la lutte contre la contrefaçon une obligation d'utiliser l'étiquetage des médicaments par hologramme, sera une mesure facile pour un groupe patronal important mais pas pour d'autres.
L'essentiel, « c'est la compréhension des attentes d'un régulateur, auxquelles le lobbyiste va faire correspondre des dispositifs techniques qui vont protéger des modèles commerciaux. »
Et, comme par hasard, ce sont les quelques grands groupes omniprésents à Bruxelles qui excellent à ce sport. Au final ce sont 4-5 grands groupes qui domineront le marché.
On voit là aussi le rôle et la place de la norme et du règlement dans ces systèmes de pouvoir particuliers.
En même temps que des avantages de compétitivité, le but est de capter des aides financières publiques, souvent par le biais de l'aide à la recherche dans des domaines d'utilité publique comme l'environnement ou pour améliorer la compétitivité des entreprises d'un secteur. Telle est la seconde raison de recruter des connaisseurs directs des institutions :
« L'administration c'est aussi un lieu qui délivre d'importantes ressources sous la forme de subventions directes, de marchés publics, d'appels d'offres, etc. Si on regarde comment les choses fonctionnent à Bruxelles, c'est assez frappant : les grands groupes sont des deux côtés du guichet administratif. D'un côté, un groupe comme Accenture a dépensé 1 million d'euros en lobbying en 2013 mais de l'autre, il a touché plus de 68 millions d'euros de marchés publics en termes de conseil (accompagnement des politiques publiques etc.). Si on prend la liste des 25 firmes qui ont touché le plus d'argent public européen en 2013 et qu'on la compare à la liste des groupes qui ont dépensé le plus d'argent en lobbying, c'est presque exactement la même. Le lobbying est un investissement très rentable sur le plan économique si on prend en compte l'intégralité de la chaîne de relations entre une firme et l'administration. On dépense de l'argent pour obtenir une représentation politique au plus près de l'administration mais celle-ci se voit rapidement concrétisée sous la forme de prestations que l'on obtient de cette bureaucratie. »
Une autre technique permettant d'obtenir le même résultat : conclure des partenariats public privé qui permettront de faire financer une partie du tournant écologique ou des normes sanitaires par de l'argent public. Et, « plus on multiplie les partenariats public privé ou l'ouverture d'anciens marchés publics ou privés et plus on augmente le besoin d'un recrutement par les firmes d'anciens hauts fonctionnaires. »
c) Les avocats d'affaires
Les avocats d'affaires sont une forme particulière de lobbyistes en ce qu'ils ne sont pas attachés à la défense d'intérêts spécifiques (telle entreprise ou branche d'entreprises, les chasseurs, les défenseurs de la nature, etc.) et que leurs formes d'interventions sont multiformes quoique principalement de nature juridique. Déjà omniprésents aux USA, les cabinets d'avocats d'affaires vont se mettre à proliférer en France (essentiellement à Paris) à partir des années 1990.
Le chiffre d'affaires des 100 premiers cabinets d'affaires parisiens de 3,47 Md€ en 2013 connaîtra une forte croissance.
Leurs interventions sont multiformes en ce qu'elles peuvent s'exercer pour le compte de l'État et d'autres personnes publiques qui les sollicitent dans le cadre d'opérations de privatisations, de financement d'opérations, de partenariats public privé, de cessions de participations, de subvention européenne, etc. À l'inverse, ce peuvent être aussi des interventions auprès de l'administration publique pour compte d'intérêts privés (optimisation fiscale, autorisation de mise sur le marché, autorisations d'exploitation du domaine public, marchés publics, PPP, fusions-acquisitions, etc.). À noter que c'est plus l'État régulateur qui est concerné (DG concurrence, Autorité de la concurrence, etc.) que l'État régalien (fiscalité par exemple).
Dans un monde où règne la « théorie de l'apparence » et où codes et chartes déontologiques vont se multiplier, il était inévitable que se développe aussi une branche très particulière de l'activité des cabinets d'affaire, le conseil aux entreprises en matière de règlementation interne des institutions (nationales ou européennes) et de déontologie ( compliance ). Le but est de protéger les réputations, véritables avantages concurrentiels, et accessoirement une bonne connaissance des rouages de la prise de décision publique.
L'invention de la QPC, censée améliorer la protection des libertés, détournée de son objet initial, va aussi devenir une spécialité de certains cabinets d'affaire. Raison supplémentaire de recruter des membres du Conseil d'État ou d'anciens membres du Conseil constitutionnel.
Grâce à la largesse d'esprit du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel qui détient la décision finale, au nom des droits et libertés constitutionnels, s'ouvrira, comme on l'a vu, un marché et un champ juridique nouveau, fort lucratif.
Bien qu'ils portent le même titre et la même robe, donc bénéficient des mêmes prérogatives en matière de secret que le reste de la profession, l'activité des avocats d'affaire n'a plus grand-chose à voir avec l'administration de la justice. Ils jouent le rôle de courtier entre les différents intérêts et les régulateurs nationaux ou européens, tout en bénéficiant de la couverture du secret professionnel attaché à leur fonction judiciaire.
Avec tous les risques de collusion, de trafic d'influences et de conflits d'intérêts que cela entraîne, la multiplication de ces cabinets d'affaires offrira des terrains d'atterrissage rêvés pour les politiques en mal de recasement et pour l'oligarchie administrative attirée par des pantoufles confortables, dont la bonne connaissance des rouages de l'État et des administrations, le carnet d'adresses et le pedigree brillant intéressent particulièrement les recruteurs, plus même que les experts d'une discipline ou d'un secteur administratif. Ainsi sur la période 2006-2014, 34 % des recrutements extérieurs des cabinets concerne ce type de collaborateurs contre 52 % pour le recrutement en provenance des entreprises et de leurs services juridiques.
Ainsi, le cabinet August Debouzy peut-il se flatter en ces termes du recrutement d'un nouvel associé - Emmanuelle Mignon - major de promotion de l'ENA, ancien rapporteur et assesseur du Conseil d'État, collaboratrice durant huit ans de Nicolas Sarkozy dans ses différentes fonctions, puis en tant que directeur de cabinet à l'Elysée - enseignante à L'IEP Paris : « Son niveau de technicité en droit public allié à sa connaissance de l'appareil de l'État sont des atouts considérables tant en matière de conseil que de contentieux pour les clients du cabinet. »
Tout récemment c'est au tour du cabinet anglosaxon Orrick de se réjouir du recrutement du mari de Fleur Pellerin, Laurent Olléon - HEC, ENA, ancien rapporteur de la section du contentieux au Conseil d'État, ancien directeur adjoint du cabinet de Marylise Lebranchu, et surtout ancien président de la Commission des infractions fiscales. Dans un communiqué, la responsable de la « branche taxe » du cabinet Orrick, Anne-Sophie Kerfant, précise que : « Laurent apportera une compréhension approfondie de la façon dont les autorités de régulation françaises abordent à la fois les transactions et les conflits, grâce à ses deux décennies de travail au sein de l'administration. Cette connaissance de l'intérieur sera d'une valeur inestimable pour nos clients français et internationaux. » Inestimable, qui pourrait en douter ?
Interrogé par l'Obs (13 septembre 2018), Laurent Olléon assure que « L'avocat fiscaliste n'est pas là pour permettre à son client d'échapper frauduleusement à l'impôt, en se soustrayant illégalement à sa contribution au financement des services publics. Il est là pour veiller à ce que le contribuable supporte seulement l'impôt qu'il doit : pas plus, mais aussi pas moins. C'est ainsi que je compte exercer mes nouvelles fonctions ». Donc, où pourrait bien être le problème ?
d) La circulation des élites dirigeantes : pantouflage et rétro-pantouflage
Les allers-retours entre public et privé sont un autre moyen d'assurer le bon fonctionnement du système collusif, en permettant à l'État d'entretenir, voire étendre, son influence, et aux entreprises et intermédiaires divers d'acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de l'État et de son administration.
L'exemple des conditions de nomination de François Pérol alors Secrétaire général adjoint de l'Élysée à la tête de la banque privée BPCE est significatif de ce « capitalisme de connivence » que le néolibéralisme a fait prospérer en France.
Peuvent également être cités la désignation de François Villeroy de Galhau (ancien polytechnicien, énarque, inspecteur des finances, directeur général de BNP-Paribas, comme Gouverneur de la Banque de France et de Éric Lombard venant de Generali et de BNP-Paribas, ayant participé à divers cabinets ministériels (dont ceux de Michel Sapin) à la tête de la Caisse des dépôts. Ce sont de bons exemples de ces chassés-croisés nécessaires au fonctionnement du système collusif en place.
Si l'État facilite autant le pantouflage et le rétro-pantouflage des hauts fonctionnaires, s'il traîne les pieds pour mettre en place un dispositif réellement dissuasif en matière de conflits d'intérêts pour ne pas dire de trafic d'influence, ce n'est pas un hasard, ni même une erreur coupable, mais une nécessité.
L'État a trop besoin de l'oligarchie administrative pour la priver de perspectives aussi lucratives et valorisantes. Placée désormais au coeur d'un système de pouvoirs complexe, comme on l'a vu, elle ne lui est plus nécessaire seulement, comme traditionnellement, pour ses compétences administratives, son expertise, ses capacités à le représenter dans les territoires ou à l'étranger, mais pour son rôle directement politique dans un régime de concentration extrême du pouvoir politique à l'Élysée. Elle lui est nécessaire en outre, comme on vient de le dire, pour son rôle de « passeur » et d'intermédiaire entre sphère publique et intérêts privés. On aura compris que le « pantouflage », le rétro-pantouflage et les conflits d'intérêts qui les nimbent ne sont en rien des exceptions mineures, tolérables au prix du respect de quelques règles déontologiques, ils sont nécessaires au fonctionnement du système collusif public-privé résultant de l'abandon volontaire des pouvoirs et moyens d'action de l'État au fil du processus de libéralisation du pays.
Le pantouflage est le nom symbolique du système de pouvoirs et de production de la richesse qui a poussé sur les cendres de l'État tel qu'on l'entendait jusqu'ici.
ANNEXES DE LA PARTIE V
Annexe 1 : La Ve République et le Consulat
Les ressemblances entre la constitution consulaire du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) et la Constitution de la V e République telle que révisée et telle qu'elle fonctionne réellement depuis que le calendrier électoral a transformé le Président de la République en chef de la majorité sont frappantes.
Seules demeurent quelques exceptions marginales comme le fait que si les chambres discutent, à la différence du Tribunat, c'est uniquement sur les détails, le Président de la République via le Gouvernement gardant toujours la possibilité d'imposer son point de vue, comme les faits l'ont amplement montré depuis les années 2000.
Quant aux questions dont on peut légitimement discuter, c'est le gouvernement et les médias qui en décident au gré de ce qu'ils jugent devoir faire de l'actualité.
|
Fonctions |
Consulat |
V e République modernisée |
|
Élaboration des lois |
Conseil d'État |
Cabinets, bureaucratie, lobbys |
|
Discussion |
Tribunat |
Média |
|
Décision sans discussion |
Corps législatif |
Parlement |
|
Surveillance de la règle du jeu |
Sénat |
Conseil constitutionnel et Conseil d'État |
Annexe 2 : Service économique d'intérêt général et service public
La validation juridique des services d'intérêt général date de l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du protocole n° 26 du Traité de Lisbonne, une innovation visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne.
Ces services d'intérêt général se verront reconnaître un champ d'application de plus en plus large puisque, outre les services économiques, ils concerneront les services sociaux (santé, sécurité sociale ou encore services à la personne), puis les services de réseaux avec la notion de service universel, permettant de garantir ces services essentiels selon une qualité définie et un prix abordable (eau, énergie, téléphonie, courrier).
Ces services d'intérêt économique général peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet de compensations financières qui, dans ce cas, ne sont pas considérées comme des aides d'État.
Ces conditions ont été définies par l'arrêt Altmark de la Cour de justice des Communautés européennes (24 juillet 2003) : une définition claire des obligations de service public ; des critères de compensation établis de manière objective et transparente ; une compensation limitée à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par les obligations de service public ; un calcul de la compensation sur la base des coûts qu'auraient assumés une entreprise bien gérée pour l'exécution de ces obligations.
Le rapprochement avec la notion de service public « à la française » est donc évident, comme les opportunités ainsi offertes aux États ayant réellement envie de répondre au défi du développement territorial inégalitaire.
Ceci dit, le « service universel » (cf le service universel postal ou téléphonique) reste un service public du pauvre, ignorant la notion d'égalité de traitement et de continuité comme l'ont appris à leurs dépens les territoires insuffisamment solvables. Résultat, le creusement d'inégalités territoriales vient se surajouter aux inégalités sociales, avec les conséquences politiques que l'on peut lire dans les scrutins électoraux successifs de ces dernières années.
Ceci dit, constatons aussi, qu'en matière de services publics, la France n'a pas vraiment cherché à utiliser les marges de manoeuvre laissées par le droit européen en la matière, au nom de la préservation de la diversité de conception des missions d'intérêt général dans une Union de 28 États membres, ceci sans toucher au sacrosaint droit de la concurrence qui entrave le démembrement des grandes entreprises publiques assurant jusque-là l'essentiel du service public (Gaz de France, Électricité de France, France Télécom, etc.) ou purement et simplement en le privatisant et en le soumettant au droit de la concurrence, pour le plus grand bonheur des Hauts fonctionnaires qui pourront continuer à les administrer avec plus de liberté.
PARTIE VI - LA FIN DU BAL MASQUÉ
« L'obstruction faite par les libéraux à toute idée de réforme comportant planification, réglementation et dirigisme a rendu pratiquement inévitable la victoire du fascisme »
Karl Polanyi
Les systèmes politiques dont accoucha, après l'effondrement des valeurs morales occidentales, la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, par-delà les variantes et les nuances tenant à l'histoire et au génie propre des pays, procèdent d'une matrice commune.
Ce sont tous des régimes démocratiques, sociaux et soucieux d'égalités, économiquement libéraux mais d'un libéralisme tempéré par un interventionnisme d'État plus ou moins marqué selon les cas.
Sans révolution institutionnelle ni changement apparent des objectifs ou du lexique politique, par une suite d'inflexions difficilement discernables, la conquête néolibérale des élites et des décideurs politiques allait transformer, de l'intérieur, ce modèle politique qui avait présidé aux Trente glorieuses.
Ainsi naquit, selon Fukuyama, la « démocratie libérale occidentale », ultime progrès de l'Humanité et fin de l'Histoire.
Mais l'Histoire se chargea de montrer qu'elle n'était pas terminée et que la « démocratie libérale occidentale » est aujourd'hui en échec, un échec inévitable qui tient d'abord à ses contradictions internes.
I. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE N'EXISTE PAS
A. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE EST UNE CONTRADICTION DANS LES TERMES
1. Elle n'existe pas parce qu'elle ne peut pas être démocratique
Pour la bonne raison que l'objectif du libéralisme moderne étant d'instituer le marché et la concurrence libre en unique régulateur de la société - à l'exclusion de tout autre, particulièrement politique - sauf à croire à la dissolution des intérêts privés, des catégories sociales et des classes dans le ruissellement naturel de la richesse des possédants vers les pauvres, du capital vers le travail, en un mot à croire à l'harmonie préétablie, l'expression démocratique ne peut avoir de place.
Conséquence : si le marché a toujours raison, à quoi bon voter ?
La notion même de « démocratie libérale » dont Fukuyama annonçait, il y a trente ans, la parousie (voir Prolégomènes), est un oxymore, une contradiction dans les termes ou, si l'on préfère, une chimère, un assemblage de parties contre nature.
Fort improbable, en effet, que Bernard Arnault - première fortune française et troisième mondiale - qui attend la prochaine crise « avec sérénité » parce qu'on « fait souvent de bonnes affaires pendant les crises » 257 ( * ) ait les mêmes préoccupations et la même conception de l'intérêt général que ceux qui craignent de perdre leur emploi avec la prochaine crise.
Peu probable qu'ils aient figuré dans le même comité de soutien à la présidence de la République en 2017.
Plus que probable, par-contre, que le système libéral, aggravant chômage, sous-emploi et inégalités au point de laminer les classes moyennes, enrichissant toujours plus l'oligarchie de la fortune, rende la paix sociale de plus en plus fragile.
La démonstration n'est plus à faire qu'il y a des gagnants et des perdants de la Grande Transformation libérale et que les systèmes démocratiques imparfaits en place après la Seconde Guerre mondiale se sont progressivement transformés, sous des formes variant selon les pays, en oligarchies de plus en plus étroites, plus exactement, en oligarchie libérale tempérée par la démagogie et la lapidation médiatique (Pour la France, voir parties III et IV).
En France, l'effectif de l'oligarchie qui a droit au chapitre représente plutôt un dix millième de la population que le millième évoqué par Castoriadis (partie III), soit au grand maximum 5 000 personnes : oligarchie politique, de l'argent, de l'économie et des groupes de pression, oligarchie du savoir-faire techno-bureaucratique et du faire-savoir médiatique, pensante et bien-pensante.
Les mêmes hommes et femmes circulent de la tête des partis de gouvernement aux sommets de la bureaucratie nationale ou européenne avec pour préoccupation première de s'y maintenir.
Participant du jeu de chaises musicales du pouvoir auquel se réduit la démocratie libérale, ils passent, en un mouvement perpétuel, des cabinets ministériels aux organismes de régulation - prétendument indépendants parce que non élus - aux sommets des entreprises privées ou publiques, des institutions financières ou des médias.
Ils se marient entre eux, habitent les mêmes quartiers sans problèmes, pratiquent les mêmes moyens de transport, lisent les mêmes journaux de référence et les mêmes livres, voient les mêmes spectacles et plébiscitent le nouvel art pompier coté en bourse, fréquentent les mêmes lieux de vacances aux mêmes époques.
L'anglais est devenu leur langue naturelle.
Leurs enfants suivent les mêmes filières d'élite au sein des mêmes écoles publiques ou privées, même si le collège unique - surtout pour ceux qui font carrière à « gauche » - figure toujours à leur crédo.
Vivant de la même façon, visant les mêmes buts par des moyens comparables, ils se posent les mêmes problèmes, dans les mêmes termes.
Seule la concurrence, le temps d'accéder à la place convoitée, leur impose de se trouver des raisons non triviales de s'opposer.
Ainsi colonisées par le haut, les structures partisanes, déjà structurellement peu démocratiques, ne peuvent plus jouer leur rôle de médiateur, de traducteur en actions des volontés populaires.
2. Elle n'existe pas non plus parce qu'elle n'est qu'accessoirement libérale
Un tel libéralisme, en effet ne peut fonctionner sans ses tuteurs bureaucratiques - le plus parfait exemple étant l'ordolibéralisme européen - en quelque sorte un « libéralisme bureaucratique » et monopolistique. Ainsi, comme on l'a vu, l'économie et le système de pouvoir néolibéral de l'État prédateur étasunien et de l'État collusif français, ne sauraient fonctionner sans soutien et sans régulation étatique. Comme le montre son discours devant l'OIT du 11 juin 2019, Emmanuel Macron est parfaitement conscient de cette mutation d'un libéralisme devenu prédateur et qui n'a plus de libéral que le nom :
« Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale de marché, mais qui a été depuis quarante ans l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation qui, en gardant les prémisses du raisonnement et de l'organisation, en a perverti l'intimité et l'organisation dans nos propres sociétés. La rente peut se justifier quand elle est d'innovation, mais peut-elle se justifier dans ces conditions lorsque la financiarisation de nos économies a conduit à ces résultats ? Et en avons-nous tiré toutes les conséquences ? Je ne crois pas. »
Quant aux autres libertés, au sens où les entendaient les libéraux qui traditionnellement luttaient contre l'arbitraire, pour les libertés publiques et privées, elles sont de plus en plus bridées au nom de la sécurité et du moralisme ambiant qui tient lieu de morale.
Les motifs d'incrimination ne cessent d'augmenter, le code pénal d'enfler et les peines de s'alourdir dans un mouvement qui n'est pas prêt de s'arréter.
En France, au nom de la lutte contre le terrorisme, les moyens policiers d'intrusion dans la vie privée rejoignent progressivement ceux des services spéciaux.
Les caméras de surveillance et les effectifs de sécurité privés ne cessent eux-aussi d'augmenter, sous les applaudissements, ce qui est probablement le plus inquiétant.
Quant aux intrusions permanentes dans la vie privée désormais permises par les techniques et les réseaux numériques - là aussi avec le consentement enthousiaste des intéressés le plus souvent - il est tellement massif et évident qu'il n'y a pas lieu d'insister.
On attend l'Étienne de La Boétie qui écrira le « Discours de la servitude volontaire » du XXI e siècle.
La conclusion politique s'impose d'elle-même, la « démocratie libérale » est une démocratie « Potemkine » 258 ( * ) faussement protectrice des libertés dont la façade démocratique (l'élection au suffrage universel des représentants du Souverain) cache une machinerie du pouvoir dont la finalité première est d'interdire toute remise en question de la forme néolibérale du mode dominant de production et de partage de la richesse produite, de ses finalités et de ses bénéficiaires.
Une démocratie dont les usagers sont privés du premier droit des citoyens - pouvoir modifier le régime sous lequel ils veulent vivre -, privés de leur souveraineté donc.
Au cours de ce dernier demi-siècle, l'Empire a donc vu se succéder démocratiquement des majorités parlementaires et des exécutifs (Présidents de la République ou du Conseil, Premiers ministres) se combattant devant les électeurs pour mieux assurer l'essentiel : la pérennité de l'organisation néolibérale de la société.
Ainsi, les « libéraux centristes », pour reprendre l'expression d'Adam Tooze 259 ( * ) , se perpétuèrent-ils au pouvoir, contre vents et marées, appliquant leurs projets, même quand les électeurs se sont clairement exprimés contre, comme ce fut le cas en 2005 en France. Le projet de traité constitutionnel européen rejeté par référendum sera adopté sous une forme à peine modifiée par la voie parlementaire.
B. UNE CHIMÈRE POLITIQUE
L'origine de la neutralisation du politique devenue aujourd'hui évidente, se trouve donc dans la conversion à la foi néolibérale de l'essentiel des partis de gouvernement des provinces de l'Empire, par intérêt, par conviction, libéralisme rimant avec modernité et progrès, par fatalisme et parce qu'il n'y a pas d'autre alternative ou faute d'alternative crédible.
Quelle qu'en soit la raison, le fait est là : la situation actuelle ne résulte pas d'un coup d'État mais d'un choix politique volontaire de majorités élues par le peuple souverain durant des décennies.
Elles étaient loin de penser qu'il débouchait sur une impasse et probablement le chaos.
Ce qui, en effet, caractérise aujourd'hui les partis politiques de gouvernement ce sont des programmes interchangeables quant à l'essentiel (notamment leurs omissions), l'absence de militants, voire d'adhérents véritables de plus en plus, ce qui les rend dépendant de financements extérieurs et donc vulnérables, sans autre objectif que leur survie et celle du système néolibéral. Que des partis traditionnels de droite se convertissent aussi facilement au néolibéralisme - à l'exception notable de ceux, comme les Gaullistes en France, qui défendaient la place et le rayonnement de leur pays - n'est pas vraiment surprenant.
Ce l'est plus s'agissant de la Gauche social-démocrate, soutien traditionnel de l'interventionnisme d'État et de la démocratie « sociale » comme l'indique son nom.
Plus surprenant encore, que la vague de conversion n'ait épargné personne.
Pour citer les partis les plus importants : SPD allemand, le plus ancien et le plus important parti social-démocrate européen, PS français héritier de Jaurès, de Blum et du Front populaire, Labour Britannique à l'origine de l'État-providence anglais, Démocrate américain héritier de Roosevelt et du New Deal et même le Parti Communiste italien, résistant de toujours au stalinisme, qui porta pendant des décennies les espoirs de la gauche transalpine, voire au- delà, etc.
Comme l'explique James K. Galbraith, aux USA, le parti qui a le plus contribué à la destruction du New Deal, au remplacement de l'État dans la régulation économique par la puissance bancaire, c'est paradoxalement le parti démocrate « c'est-à-dire celui qui est censé représenter les valeurs de démocratie sociale. C'est peut-être le parti démocrate qui est devenu le plus dépendant des grands patrons de la finance : une vraie dictature idéologique pour Clinton et Obama, notamment. » 260 ( * ) Mais ces socio-démocrates ne se doutaient pas que cette conversion au libéralisme - souvent avec le zèle des néophytes - sous couvert de modernité, et sur le vieux continent de construction européenne, serait un suicide.
Un suicide pour les partis socio-démocrates eux-mêmes, un suicide pour la démocratie, ce qui était beaucoup plus grave.
« L'effacement des frontières entre la gauche et la droite dont nous avons été témoins (et que beaucoup ont considéré comme un progrès) constitue à mon sens, écrit Chantal Mouffe, la principale raison du déclin de la sphère politique. Les conséquences de ce déclin pour la démocratie ont été négatives. » 261 ( * )
Cette mutation de la social-démocratie aura aussi pour première conséquence la désertion des masses populaires de la scène politique, comme le remarque Guido Ligori pour l'Italie avec une compréhensible nostalgie : « La fin du PCI aura été également la fin de la participation politique de masse, non pas épisodique ou "mouvementiste", dans la société italienne, et il ne reste rien de semblable chez les héritiers du PCI. Un immense patrimoine politique, historique, humain s'est ainsi perdu ». 262 ( * )
Il est certain que, sans cette « libéralisation » de la social- démocratie, le jeu politique n'aurait pas été bloqué comme il l'est aujourd'hui et le système néolibéral aurait plus de chance de pouvoir être réformé de l'intérieur par le simple jeu des institutions comme dans toute démocratie qui se respecte.
Pour les libéraux français, ces convergences, ce dépassement du clivage traditionnel Droite/Gauche étaient censés marquer l'avènement d'une « démocratie apaisée » rassemblant deux Français sur trois selon la formule magique de Valéry Giscard d'Estaing, d'un centrisme de bon sens renvoyant aux limites les agités des extrêmes.
Le problème c'est que les agités des extrêmes ne furent pas les seuls à disparaître du paysage politique, plus fâcheusement il y eu aussi... les électeurs, à commencer par ceux des formations social-démocrates qui n'arrivaient plus à trouver ce qu'elles pouvaient bien avoir de « social ».
Apparu alors, autre oxymore, un autre objet politique non identifié, la « troisième voie », non pas entre la Gauche et la Droite mais « au-delà » de l'une et de l'autre, un véritable exploit donc.
Comme dit Elias Canetti : « Le papier supporte tout ».
Que ne dirait-il des écrans !
Théorisée par le Britannique Anthony Giddens, elle fut popularisée par Tony Blair, métamorphosant le vieux Labour en New labour rejoint par Gerhard Schröder et Bill Clinton, les leaders français continuant généralement à affirmer qu'on pouvait être néolibéral et totalement de gauche. La suite montra que leurs électeurs en doutaient et plus encore que l'intérêt des plus riches, toujours plus riches, coïncidait avec les siens. Il devint alors indispensable de l'aider à faire « le bon choix, édicté par le bon sens » 263 ( * ) .
Plusieurs techniques furent ainsi mobilisées avec des dominantes selon les pays et les époques : transformation du débat politique en spectacle (pratique généralisée), concentration des pouvoirs par les exécutifs et les chefs de partis moins difficiles à convaincre sur le bon choix que les assemblées, transformation des parlements en chambres d'enregistrement (cas particulièrement évident en France), sélection des candidats par les appareils des partis et les cercles d'influence, mise sous tutelle des élus, remplacement du débat politique par la prédication morale, fabrication d'épouvantails... qui finirent par prendre leur liberté.
C. LE GRAND BAL MASQUÉ DE LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE
1. La politique comme spectacle
Comme dans les numéros d'illusionnistes, l'essentiel pour la réussite du tour, c'est que le spectateur-électeur, avant, pendant et après les élections, regarde ailleurs que là où il risquerait de trouver les questions qui pourraient fâcher.
Telle est la fonction des médias, pour les uns dirigés par des amis du pouvoir exécutif et, pour les autres, propriété d'une poignée d'oligarques.
L'âge du (de la) futur(e) capitaine, son « look », ses moeurs conjugales dans certains pays, etc., sont évidemment des sujets d'intérêt de premier ordre, bien plus en tous cas que la réforme du système financier ou comment il (elle) entend faire pour éviter un nouveau krach.
Il est significatif que pratiquement jamais, même depuis 2008, ces questions n'aient été abordées durant une quelconque campagne électorale sauf par quelques voix minoritaires, étouffées sous le flux médiatique.
Le quotidien de l'information, distillée par les exécutifs est de s'occuper de l'accessoire pour mieux éviter l'essentiel.
Comme disait déjà, irrévérencieusement, Fontenelle au Roi-Soleil : « Vous vous flattez des succès journaliers, qui ne décident rien, et vous n'envisagez point d'une vue générale le gros des affaires. » C'est que le gros des affaires ne saurait intéresser le peuple ignorant même de ses propres intérêts supérieurs. L'élection n'étant plus le lieu des débats politiques essentiels, elle se transforma alors - c'est particulièrement le cas en régime présidentiel - en cérémonie magique de conjuration et de résurrection :
« Réduction de la fracture sociale », « Travailler plus pour gagner plus », « Le changement, c'est maintenant » , « La France doit être une chance pour tous »...
Même si elles jouent leur rôle dans la présidentielle, l'élection se fait non pas sur des promesses précises significatives, mais sur l'espoir que l'on a réussi à faire naître.
« Le changement, c'est maintenant », c'est pour l'électeur « le changement pour moi », non pas la énième réforme structurelle de ceci ou de cela, non pas la réforme pour rassurer Bruxelles, Berlin, le CAC 40 ou les marchés, que sais-je.
La désillusion naîtra largement de ce décalage de plus en plus grand entre la politique et la communication qui en tient lieu.
2. Sélectionner les candidats qui compteront
« La sélection des plus aptes est la sélection des plus aptes à se faire sélectionner. »
Cornélius Castoriadis
La première condition pour éviter les dérapages, c'est de bien choisir les candidats que l'on entend faire élire, tout particulièrement ceux qui exerceront les responsabilités les plus importantes.
On doit s'assurer qu'ils ne changeront rien d'important au système en place.
Dans ce jeu d'influences, les sondages, chargés d'animer le spectacle, occupent désormais un rôle central.
Ce n'est pas un hasard si lors des dernières présidentielles aux USA, les Démocrates, ont préféré comme candidate l'épouse de Bill Clinton qui supprima ce qui restait du Dodd-Steagall Act et soutenue par Wall Street, à Bernie Sanders, militant du retour au New-Deal. Pas un hasard non plus si les Républicains ont choisi pour porter leurs couleurs, sans contestation possible, un milliardaire affairiste bien vu de Wall Street qui d'ailleurs ne manqua pas de soutenir ses intérêts une fois élu. Lorsque le système partisan est en pleine déliquescence, comme en France, le problème est plus délicat.
Les candidats des partis de gouvernement, brevetés libéraux (Républicains et Socialistes) ayant peu de chance de voir leur candidat élu aux dernières élections présidentielles, la seule solution était d'assurer par des dons substantiels, un appui médiatique sans faille à un jeune et brillant énarque, ancien banquier et déjà vieux routier de la politique, tout en assurant la promotion d'une adversaire n'ayant aucune chance d'être élue au tour décisif, le second.
Une opération à risque qui fut brillamment menée.
3. Placer les représentants sous tutelle
Une fois élus, les candidats, bien conseillés, doivent oublier les engagements mettant en cause le système libéral tel qu'il est, s'ils ont eu la légèreté d'en prendre durant la campagne, comme François Hollande et son : « mon adversaire c'est la finance ».
Ils se focaliseront donc sur les engagements répondant aux attentes du système. Dans le cas de la France : réformes institutionnelles réduisant les maigres pouvoirs du Parlement, modification du code du travail réduisant la capacité de négociation des syndicats de travailleurs, réformes fiscales, pour l'essentiel favorables aux plus riches, réforme des retraites au nom de l'égalité etc.
L'élection acquise, l'important devient d'assurer le cap en limitant les marges de manoeuvre des responsables politiques au cas où, n'ayant pas totalement oublié qu'ils ont été élus, ils risqueraient d`être un peu trop sensibles aux problèmes, aux revendications, aux souhaits, et aux intérêts de leurs mandants.
Au niveau des exécutifs, freiner les ardeurs des enthousiastes, faire échouer sans bruit leurs initiatives intempestives, tel est le rôle de la haute bureaucratie.
Une haute bureaucratie qui, désormais en France, va et vient entre son lieu naturel, l'administration et les cabinets ministériels ou présidentiel quand elle n'assure pas elle-même, les rôles de ministre ou de président de la République.
C'est de moins en moins l'élection qui fait le responsable politique et de plus en plus le choix d'appareils pour qui la fiabilité, pour ne pas dire la fidélité, est plus importante que la créativité et le courage politique de s'attaquer à ce qui mine la démocratie de l'intérieur.
S'agissant du législateur, une organisation hiérarchisée des responsabilités et des moyens d'expression en fonction des effectifs partisans, permet - au nom de l'équité - d'éviter tout risque de contagion des idées hétérodoxes.
La Constitution peut bien prévoir que « tout mandat impératif est nul » (Article 27 alinéa 1) signifiant par là qu'un parlementaire ne peut s'exprimer et n'agir qu'en son nom, la réalité - à laquelle le Conseil constitutionnel n'a jamais rien trouvé à redire - c'est que dans la discussion générale qui ouvre l'examen de tout texte parlementaire, les temps de parole étant attribués aux groupes, il s'exprime essentiellement au nom de ceux-ci ou avec leur accord.
Accessoirement, les temps de parole étant répartis en fonction des effectifs des groupes, cela signifie que les débats n'ont pas lieu à armes égales et surtout qu'ils sont remplacés par des discours parallèles forcément répétitifs.
Ainsi se trouvent justifiées les restrictions récurrentes - au nom de la modernisation des institutions parlementaires - des temps de parole consentis aux représentants du souverain, transformant le Parlement en chambre de muets ou de bavards.
Un règlement pointilleux, démocratiquement voté, sous surveillance du Conseil constitutionnel donne un semblant de légitimité à cette neutralisation du Parlement, l'administration omniprésente des chambres et plus encore la routine sécurisante faisant le reste.
Si on continue à parler de « débats parlementaires », c'est par habitude ; il n'y a plus de débat, seulement des discours parallèles sans intention même de convaincre.
Le véritable interlocuteur, comme au théâtre n'est pas sur la scène mais à l'extérieur de l'hémicycle.
On ne débat plus, on communique.
Autant dire que pour les metteurs en scène qui savent les jeux faits d'avance, on perd son temps.
Le buste de Clemenceau qui trône toujours au Sénat, doit se demander ce qu'on appelle aujourd'hui en France, République :
« Ces discussions qui vous étonnent, c'est notre honneur à tous. Elles prouvent seulement notre ardeur à défendre les idées que nous croyons justes et fécondes. Ces discussions ont leurs inconvénients, le silence en a davantage. Oui ! Gloire au pays où l'on parle, Honte au pays où l'on se tait. Si c'est le régime de discussions que vous croyez flétrir sous le nom de parlementarisme, sachez-le, c'est le régime représentatif lui-même, c'est la République sur qui vous osez porter la main » 264 ( * ) .
L'une des tutelles les plus difficiles à combattre, parce qu'apparemment incontestable, est celle du droit, des juges et cours administratives, de la Commission, des traités et du « droit » européens ( voir partie V).
En France, en sont chargés le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel interprétant la loi et la Constitution à leur convenance et assurant progressivement la domination du « droit » européen - essentiellement d'origine bureaucratique - sur le fonctionnement des institutions nationales 265 ( * ) .
On en est venu au point où cette tutelle européenne fait douter du caractère démocratique des institutions politiques nationales.
Quel crédit, en effet, accorder à une démocratie qui, comme la France, contourne une décision référendaire aussi claire et aussi importante que la création de la monnaie unique ?
Quelle conception de la démocratie peut bien avoir une UE dont le président de l'exécutif, Jean-Claude Juncker déclare à propos de la Grèce, qu'il ne peut « y avoir aucun choix contre les traités européens », dont ce même exécutif rejette le budget 2019 de l'Italie après avoir débarqué en novembre 2011 un président du Conseil italien, fut-il Silvio Berlusconi ? 266 ( * )
Faut-il après, s'étonner que l'Europe, cheval de Troie du néolibéralisme sur le vieux continent, que le fonctionnement de ses institutions, que les décisions de sa bureaucratie soient au coeur de la vague de contestation politique qui ne cesse de grossir.
4. Disposer et au besoin créer des ennemis utiles
Disposer de repoussoirs les plus horribles possible, réels ou illusoires est, comme on le sait, l'une des conditions de la réussite politique. Inutile d'y insister.
En l'espèce, c'est le rôle joué par l'extrême droite puis, plus généralement, par le populisme quel qu'il soit, pour assurer en France, dans un premier temps la suprématie du centrisme libéral de gauche sur le centrisme libéral de droite et les choses se gâtant, dans un second temps, la survie de la démocratie centriste libérale, soumise à une contestation de plus en plus difficile à contrôler.
Comme pour la plupart des mutations politiques de ces quarante dernières années, une part essentielle de l'initiative en revient à François Mitterrand.
a) La stratégie électorale de François Mitterrand
La stratégie de conquête du pouvoir de François Mitterrand reposait sur une double conviction :
- Premièrement qu'il existait un « peuple de Gauche », sociologiquement majoritaire mais politiquement impuissant ;
- Deuxièmement que cette impuissance venait, non de sa division mais de l'hégémonie de sa composante communiste. Comme il l'exprime à Vienne en juin 1972 devant l'Internationale Socialiste, un peu inquiète de l'alliance autour d'un « programme commun de gouvernement » du PS d'Epinay avec le PCF : « Notre objectif fondamental est de refaire un grand Parti Socialiste sur le terrain occupé par le Parti Communiste lui-même, afin de faire la démonstration que sur les 5 millions d'électeurs communistes, 3 millions peuvent voter socialiste ! C'est la raison de cet accord. »
Ce sera la constante essentielle de sa stratégie, amener le PC à renoncer à sa stratégie « à l'italienne » 267 ( * ) d'un regroupement de la Gauche autour de lui et à accepter que le pôle dominant soit le PS : « Pour que la Gauche pût l'emporter en France il fallait que le Parti Socialiste devint d'abord majoritaire à gauche. » (« Ici et maintenant » 1980).
Le pouvoir conquis et l'élan de 1981 remplacé par les délices de son exercice, la morosité pour le peuple de Gauche, plus l'abandon de la politique sur laquelle François Mitterrand avait été élu, il devint nécessaire de compléter le dispositif. Il le fit sur le modèle de la Droite qui, en frappant le Parti communiste d'indignité, a privé la Gauche de majorité jusque là.
L'apparition dans le champ politique d'un parti d'extrême droite électoralement significatif lui permettait à la fois de couper le bout de l'omelette de Droite et de rassembler l'extrême gauche contre lui sur le thème de l'antifascisme et de l'antiracisme, sous le contrôle du parti socialiste.
Quelques coups de pouces pour faciliter l'accès du Front national aux médias télévisuels, des gestes symboliques comme le rituel dépôt annuel d'une gerbe sur la tombe de Philippe Pétain, l'amnistie des généraux putschistes aideront celui-ci à sortir du placard électoral où l'a confiné l'histoire. L'opération « SOS racisme » sera le volet militant, « jeuniste » et intégrateur de l'électorat des oubliés de la République, du dispositif.
La tentation d'instrumentaliser le FN (et inversement) n'est pas une spécialité de François Mitterrand. Lors de la campagne présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen a révélé avoir rencontré deux fois Jacques Chirac à la recherche de voix pour assurer le deuxième tour lors des élections de 1995.
Il semble aussi qu'après avoir voulu empêcher Jean Marie Le Pen de recueillir les cinq cents parrainages sans lesquels il ne pouvait se présenter à la Présidence de la République, au dernier moment l'Élysée ait donné le coup de pouce nécessaire au leader du FN.
Le risque c'était que la division extrême de la Gauche et une trop forte poussée du Front rendent possible la non-qualification de Lionel Jospin pour le deuxième tour. Par contre un duel Chirac-Le Pen c'était la victoire assurée pour le premier alors qu'affronter Jospin au second tour était beaucoup plus risqué.
Selon l'interprétation de Jean-Marie Le Pen, l'absence de la candidature de Charles Pasqua aux présidentielles, sous la pression chiraquienne, procéderait de la volonté du Président sortant à la fois de capter directement une partie de ses voix et de faire progresser le score du FN.
Et l'incroyable s'est produit : un second tour Chirac-Le Pen.
Ce qu'aucun « expert », sondeur, communicant, politologue, aucun « journal de référence » n'avait pu imaginer, à la différence de ceux qui depuis des lustres tiraient la sonnette d'alarme devant la montée apparemment irrésistible du désintérêt des électeurs pour la chose publique et devant la crise civique et morale sous-jacente, qui ont été un peu moins étonnés.
Contrairement à ses promesses 268 ( * ) , Jacques Chirac ne fera rien de son triomphe à la tête du « front républicain » qui s'était regroupé derrière lui.
À l'exception du refus courageux de participer à l'aventure irakienne, la politique libérale européiste plan-plan continua, comme si rien ne s'était passé.
On en vient à se demander si, en fait de machiavélisme et de production de ruines politiques, Jacques Chirac n'a pas dépassé son impressionnant prédécesseur.
b) Une stratégie qui a trop bien réussi
Cette stratégie, jusqu'aux élections présidentielles de 2002, s'est révélée d'une grande efficacité. Non seulement François Mitterrand a accompli son dessein personnel mais il a atteint son objectif politique, sortir la Gauche du purgatoire électoral où le gaullisme l'avait confinée, créer les conditions durables de l'alternance gouvernementale et en rendre le PS premier bénéficiaire.
Elle a même tellement bien réussi qu'elle a créé les conditions qui l'on rendue intenable comme l'ont montré les élections présidentielles de 2017 qui rééditent en pire celles de 2002 : la présence du candidat FN au second tour et l'élimination de la Gauche social-démocrate.
En pire puisque la progression régulière du score du FN au premier tour depuis les élections de 2007 se confirme et que Marine Le Pen avec 10,639 millions de voix, en 2017, double le score déjà considérable de son père en 2002.
Elle aura rassemblé, au second tour 22,36 % des inscrits soit plus de la moitié des suffrages d'Emmanuel Macron (43,61 %).
Car, le second grand enseignement de ces élections, comme on l'a vu, c'est l'importance de l'abstention et des votes blancs ou nuls, représentant respectivement 25 % et 9 % des inscrits (11,5 % des votants).
C'est le plus fort taux d'abstention depuis l'élection de 1969, qui avait opposé Georges Pompidou à Alain Poher, la Gauche, dominée par le PC, ne voyant guère d'intérêt à départager les candidats « blanc bonnet et bonnet blanc », comme le dira Jacques Duclos, candidat de gauche arrivé troisième au premier tour et rassemblant 4,8 millions de voix, soit 21,5 % des suffrages exprimés.
Rappelons qu'Emmanuel Macron, au final, aura été élu par seulement 43,6 % des électeurs inscrits, le total de l'abstention et des votes blancs et nuls atteignant 34 % et que le vote pour Marine Le Pen aura progressé de près de 3 millions de voix par rapport au premier tour.
Preuve s'il en était besoin que la méthode de l'épouvantail a beaucoup perdu de son efficacité.
c) Démagogie, populisme chic et surenchère démocratique
Une autre façon de cacher cette incapacité à faire fonctionner la seule forme de démocratie qui ait jusque-là existé dans les grands pays modernes - la démocratie représentative - reste encore de faire la morale, de désigner les coupables de ces dysfonctionnements et de faire de la surenchère démocratique au nom d'une super démocratie consultative et participative. Exemple de cette démagogie, la cascade de lois de moralisation et de transparence de la vie publique de ces dernières années dont l'avantage est de faire oublier que si des comportements individuels scandaleux renforcent le malaise démocratique actuel, leur origine se trouve dans le caractère structurellement collusif du système (voir partie V).
Autre manière de faire oublier l'origine du malaise, jouer à la démocratie directe.
Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le moins - faire fonctionner correctement la démocratie représentative - qu'on ne peut pas rêver une « démocratie plus ».
Ainsi lors des élections législatives de 2017, le tout nouveau Président de la République se mit-il en quête de candidats représentatifs du peuple, plus « authentiques » que ceux des autres partis politiques, puisqu'issus d'une mystérieuse « société civile », autrement plus légitime qu'un corps électoral travaillé par des politiciens sans moralité.
Ces « vrais représentants du peuple », sont censés « régénérer » l'Assemblée nationale et le Gouvernement, apporter une vision nouvelle aux organismes d'État où ils seront chargés de mission diverses.
Comme dit Michel Crinetz : « La société civile a l'avantage qu'on peut la représenter non plus par des élus plus ou moins incompétents, mais par divers experts se cooptant les uns les autres et qui combinent à leur manière les divers intérêts particuliers pour en déduire une représentation de l'intérêt général. » 269 ( * )
La démocratie participative, les consultations plus ou moins grandes, citoyennes, territoriales, de ceci ou de cela, sont un autre moyen d'apaiser le citoyen sans rien lui céder et même de faire valider directement par le peuple des choix antérieurs.
Dernier exemple en date, le « Grand débat » destiné à occuper les Français inquiets de la tournure prise par la révolte des « Gilets jaunes ». « Surprise : le Grand débat valide les choix de Macron » titre ironiquement Médiapart rapportant l'analyse de la synthèse des propositions faites par le Premier Ministre 270 ( * ) .
Celui-ci retient de cette consultation de grande ampleur que les Français souhaitent payer moins d'impôts et que très raisonnablement ils espèrent en contrepartie une baisse des dépenses publiques. Proposition un peu étrange si elle vient de « Gilets jaunes » dont l'une des revendications principale est le renforcement des services publics.
Parmi les autres propositions : bâtir une démocratie participative au niveau national, sur le modèle local.
Quand on sait que la démocratie participative c'est parler plus pour décider moins, on n'est pas surpris que cette proposition ait séduit le Premier ministre qui n'a cependant rien dit de la suite qu'il comptait lui donner.
Le fin du fin cependant, c'est de jouer au populiste, un populisme chic évidemment.
Dans la chronique qu'il a tenu un moment dans Libération au début de la campagne des présidentielles, Édouard Philippe, futur Premier ministre d'Emmanuel Macron, ce qu'il ignorait alors, décrit celui-ci comme un « tribun adepte d'un populisme désinvolte », « qui n'assume rien mais promet tout, avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier ». « Il marche sur l'eau en ce moment » (15 février), « il guérit les aveugles, il multiplie les pains, il répand la bonne parole. À la France paralysée, il ordonne “Lève-toi et en marche !” (...) Et tout ça tout seul, sans réel programme ni réelle équipe. Il suffit de croire en lui. D'avoir la foi. » Saint-Matthieu - par ailleurs saint patron des banquiers, ça ne s'invente pas - est aussi cité rapportant les paroles de Jésus : « Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront : “C'est moi le Christ”, et ils abuseront bien des gens ».
Édouard Philippe constate, par ailleurs que, comme Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'est « affranchi d'une règle simple consistant à dire à quel camp on appartient ».
Il n'est, en effet, ni de droite ni de gauche, capable de dénoncer les faux semblants du néolibéralisme, le danger mortel qu'il fait courir au monde devant l'OIT et « en même temps » - expression clef de voute de sa « pensée complexe » selon ses admirateurs - de prétendre révolutionner la France en se montrant réceptif aux demandes des « investisseurs » dans ses entretiens avec la presse anglo-saxonne.
Représentant s'il en fut de la haute bureaucratie qui lui sert de réservoir ministériel, Emmanuel Macron n'en dénonce pas moins cette caste dans « Révolution » (tout un programme !), son manifeste électoral présidentiel.
Pur produit du système il ne se revendique pas moins antisystème, ce qu'il est lorsqu'on le compare à son entourage. Mais seulement dans ce cas.
Rapporteur général adjoint de la commission Attali « pour la libération de la croissance française » réunie par Nicolas Sarkozy, membre trois ans du Parti Socialiste, soutien de François Hollande aux élections présidentielles, secrétaire général adjoint de son cabinet à l'Élysée, puis ministre, c'est un pur produit de la mécanique politicienne. Ce qui ne l'empêche pas de proclamer à Sud-Ouest.fr « Je ne fais pas partie de cette caste politique et je m'en félicite. Nos concitoyens sont las de cette caste ». (9 mai 2016)
Et puis, comme dans toute opération de communication, il y a les mots pour le dire.
Les mots qui font peuple, comme en Corrèze où il fustige « ceux qui foutent le bordel » ou comme dans l'incubateur de Neill « ceux qui ne foutent rien » et quelques heures avant son discours devant la Mutualité française « le pognon de dingue » consacré à l'aide sociale...
Les mots qui signalent le lettré et le poète comme cet « héautontimorouménos » qui a donné un supplément de densité au discours présidentiel de la « Conférence nationale des territoires ».
Un vrai populisme chic.
d) Leçons de morale et disqualification
Faute de pouvoir poser les problèmes en termes de choix politiques, sous peine de pulvériser la fiction selon laquelle il n'y a pas d'alternative au système en place, on le fera en termes moraux comme les démagogues qui se passent d'explications un peu compliquées.
Dénoncer le racisme, le machisme, la xénophobie, l'homophobie, l'europhobie, l'islamophobie, entre-autres phobies, dispense d'expliquer pourquoi ces comportements prospèrent quand triomphe le mode d'organisation sociale et politique le plus achevé, la démocratie libérale occidentale, et surtout dispense d'en faire cesser les causes.
« À la place de l'ancienne dichotomie gauche-droite, nous sommes désormais tenus de penser en termes de Bien et de Mal. » 271 ( * )
La première réponse aux questions que pose la montée des populismes faute de mieux, sera la condamnation morale assortie d'injures : ils ont tort parce qu'ils sont horribles.
On a rapporté un peu plus haut celle d'Hillary Clinton aux « pitoyables, racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes » partisans de Trump ainsi que celle de BHL au « peuple trumpisé » (partie IV).
Il en est, de la même veine, plus sophistiquées. Ainsi, les Décodeurs du Monde, repèrent derrière le mouvement des Gilets jaunes des réseaux de manipulateurs (« groupes colère » et « patriosphère » d'extrême droite). Conclusion : derrière la percée des Gilets jaunes il y a des réseaux pas si « spontanés » et « apolitiques ».
Ainsi pour l'historien et sociologue Marc Lazar, avec les mouvements populistes - considérés comme une entité homogène (on verra que ce n'est pas le cas) - la démocratie se transforme en « peuplecratie ».
Faut-il que la « démocratie » telle qu'elle se pratique aujourd'hui ait été dévitalisée pour que l'on puisse l'opposer à la « peuplecratie », autrement dit, le gouvernement du peuple !
Comme dit Jacques Rancière : sous ce terme de populisme, on veut « ranger toutes les formes de sécession par rapport au consensus dominant, qu'elles relèvent de l'affirmation démocratique ou des fanatismes raciaux ou religieux ». (La haine de la démocratie)
II. LA DÉMOCRATIE LIBÉRALE OCCIDENTALE FACE À SES CONTRADICTIONS
Quel que soit le talent de l'illusionniste, vient un moment où le rideau tombe et où la réalité s'impose.
En Europe, en France notamment, deux évènements intimement liés ont dessillé les yeux : la grande crise qui démarre en 2008 et l'échec de la construction européenne avec l'enlisement des politiques communes remplacées par des conflits d'intérêts entre membres.
Les crises mondiale et européenne sont très liées parce que le système financier européen n'est qu'une des pièces du système financier irriguant l'Empire américain et parce que l'endettement public massif nécessaire au sauvetage des banques venait justifier la rigueur budgétaire imposée aux membres de l'UE, neutralisant toute tentative de relance économique avec les conséquences économiques et sociales que l'on sait.
Une erreur aux conséquences catastrophiques selon Adam Tooze : « Le contraste est douloureux, entre l'endiguement plutôt efficace de la débâcle planétaire de 2008 [conduite par les USA et la Fed injectant, via la BCE, 10 000 Md$ dans le système bancaire européen] et la catastrophe incontrôlable que connaît la zone euro à partir de 2010 (...) Comment expliquer l'étrange métamorphose d'une crise des prêteurs en 2008 en une crise des emprunteurs après 2010 ? Difficile de ne pas soupçonner un tour de passe-passe. Pendant que les contribuables européens sont soumis à rude épreuve, les banques et d'autres bailleurs de fonds sont remboursés grâce à de l'argent injecté dans les pays qui bénéficient d'un sauvetage. On en déduit facilement que la logique cachée de la crise de la zone euro, après 2010, est une redite déguisée des sauvetages bancaires de 2008. Selon un critique mordant, c'est la plus grande arnaque de l'histoire (...) La zone euro, par ses choix politiques obstinés, a poussé des dizaines de millions d'Européens dans les abysses d'une dépression rappelant celle des années 1930. C'est l'un des pires cas d'autodestruction économique de notre histoire. Qu'un pays minuscule comme la Grèce, dont l'économie représente 1 à 1,5 % du PIB de l'UE, soit devenu l'élément clé de cette catastrophe fait de l'histoire européenne une cruelle caricature.
C'est un spectacle scandaleux. Des millions de personnes ont souffert sans raison valable. Et malgré notre indignation, il faut insister lourdement sur ce point : les mots-clés sont « sans raison valable. » (opus cit)
Cette crise économique et institutionnelle montrera à ceux qui conservaient encore la foi que le « couple franco-allemand » n'existait pas, pas plus que la « solidarité européenne », ce que confirmera la crise migratoire.
Non seulement elle confirmait que l'UE c'était le chacun pour soi -absence d'accord sur les buts, sur les politiques à mener, impossibilité de revoir les accords de Dublin qui font porter le plus gros du fardeau à la Grèce, à l'Italie et à l'Espagne - mais que se délitait, l'une des rares réussites de la construction européenne : les accords de libre circulation de Schengen.
Deux mots résument la politique migratoire européenne : grands principes et bricolage, l'un des meilleurs exemples étant les accords d'Ankara avec la Turquie 272 ( * ) .
L'UE devenait un champ clos de rivalités dont seul l'immobilisme empêchait la dislocation.
La construction européenne, la constitution de l'Europe en sujet politique avait pourtant été la dernière utopie réaliste devant changer le cours du XXI e. , un projet d'une telle importance qu'il justifiait, comme on le vit en 2005 en France, de le poursuivre contre l'avis des Français.
À la lecture du flot d'inepties prononcées par des responsables politiques français durant la campagne pour l'adoption du Traité de Maastricht (1992) préalable à la création de la monnaie unique ( voir annexe : Le bêtisier de Maastricht ), on se demande comment de telles bouffonneries sont possibles.
Mais, par contrecoup, cette accumulation de promesses illusoires et de désinvolture envers les volontés des électeurs ne pouvait pas ne pas renforcer le sentiment diffus que le pouvoir n'était plus dans les urnes mais entre les mains d'une nébuleuse, aux contours flous, de politiciens (élus) et de hauts bureaucrates (cooptés), occupant les sommets de l'État en liaison permanente avec les représentants des intérêts économiques et financiers et avec la bureaucratie européenne.
Dans les mains d'un « pouvoir collusif » dont la partie V a tenté d'identifier les rouages principaux.
A. FIN DE PARTIE
Paradoxalement, on peut dire que cette démocratie en trompe-l'oeil qui a permis d'imposer les règles du jeu néolibérales à la majorité qui en voulaient de moins en moins a trop bien réussi.
« Bien » réussi puisque, jusqu'à ces dernières années où des formations et des leaders « atypiques » commencèrent à accéder, en coalition puis seuls, au pouvoir, ce dernier fut exercé sans discontinuité par des néolibéraux.
« Trop » bien puisque l'impossibilité de changements politiques significatifs a finalement donné consistance au sentiment diffus que danser au bal institutionnel serait perdre son temps, légitimer les organisateurs et l'orchestre. Les électeurs ont donc fui les urnes, transporté le débat dans la rue sous des formes nouvelles, parfois violentes et finalement créé le terreau d'alternatives politiques inédites que les maîtres du pouvoir pensaient neutraliser en les traitant avec mépris de « populisme ».
Comme si se réclamer du peuple (à tort ou à raison c'est une autre affaire) était infamant.
Ils ne voulaient pas voir que le dit peuple, las de voir le changement politique se limiter à celui du plan de table, au choix d'un cuisinier plus ou moins habile à faire prendre les vessies pour des lanternes, le menu restant le même, déserta les urnes, transforma les élections en émeutes électorales anti- système, en opérations de « dégagisme ».
On vote de moins en moins pour quelqu'un, ou un programme, mais contre, d'où le caractère de plus en plus aléatoire des résultats électoraux.
Puis le mécontentement s'exprimera dans la rue par des manifestations, des opérations contre des cibles symboliques pour le pouvoir, voire par des émeutes.
Le point d'orgue final sera, après leur monté en puissance, l'accès au pouvoir de partis ou de leaders antisystème.
« Il n'est aucun problème , aurait dit l'inusable Henri Queuille, assez urgent en politique qu'une absence de décision ne puisse résoudre ». Peut-être parce que c'est ailleurs et autrement que par le jeu normal des institutions politiques que la solution peut être trouvée ? C'est en tous cas l'impression que donne la situation actuelle.
Aucune des promesses néolibérales n'a été tenue, à commencer par celles qui conditionnent toutes les autres : la croissance économique et l'emploi.
À la place, comme on l'a vu, au fil de cette analyse, on eut une stagnation économique semblant ne pas devoir finir en Europe, une croissance anémique sous perfusion monétaire augmentant l'instabilité du système financier, un sous-emploi mal rétribué aussi incompressible que la pauvreté, malgré les prouesses des statisticiens et des gestionnaires du chômage de masse.
L'importance du chômage des jeunes, leur déqualification pour nombre de ceux qui trouvent un emploi, voire leur émigration dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne ou la Hongrie, alimentent aussi largement l'inquiétude quant à l'avenir.
La certitude générale que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, propre aux « Trente glorieuses », a été remplacée, au mieux par un sentiment d'incertitude, au pire par un pessimisme contagieux.
Une appréhension de l'avenir qui s'est progressivement installée et à laquelle la Grande crise de 2008, qui n'en finit pas de finir et l'enlisement de la construction européenne, apporteront une confirmation sans appel.
Là est l'origine de l'actuelle perte de confiance, particulièrement en Europe, dans des institutions et des élus jugés incapables, malgré de multiples tentatives contradictoires, d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux.
Perte de confiance renforcée par l'impression - malheureusement fondée - que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, qu'au jeu de la mondialisation néolibérale, il y a des perdants - les classes populaires et moyennes pour une large part, les territoires ruraux, beaucoup de villes moyennes et de quartiers défavorisés des grandes unités urbaines - et des gagnants, la pointe de la pyramide sociale et une bonne partie des agglomérations. Renforcée aussi par l'impression que le changement ne peut passer par le jeu normal des institutions.
L'élection devenant une formalité sans prise aucune sur la réalité, il n'est pas étonnant que les électeurs désertent les urnes.
B. LA SÉCESSION DU PEUPLE
1. Abstention et émeutes électorales
« Il était minuit passé lorsque le dépouillement du scrutin s'acheva. Le pourcentage des bulletins valides n'atteignait pas vingt-cinq pour cent, distribués entre le parti de droite avec treize pour cent, le parti du centre avec neuf pour cent, et le parti de gauche avec deux et demi pour cent. Très peu de bulletins nuls, très peu d'abstention. Tout le reste, plus de soixante-dix pour cent au total était constitué de bulletins blancs. »
José Saramago, « La lucidité » (Seuil)
Ainsi commence le roman où José Saramago imagine ce qui pourrait se passer dans un pays imaginaire, si seulement 15 % des électeurs se reconnaissaient dans les candidats soumis à leur choix.
Cela se passerait mal.
On n'en n'est pas encore là en France mais on s'en rapproche comme le montrent les courbes ci-dessous.
En tous cas, cette désaffection des urnes est l'un des signes principaux de la désillusion populaire. L'exemple français est, en effet, significatif.
À s'en tenir aux deux élections majeures en France, les législatives et plus encore les présidentielles qui, depuis 2002, pèsent largement sur les résultats des premières, les votes exprimés par rapport aux inscrits ne cessent de baisser, et cela depuis 1981 qui suscita une mobilisation forte de la Droite et plus encore de la Gauche.
Ainsi au second tour des présidentielles de 2017, le tour essentiel où seuls deux candidats peuvent se maintenir, un tiers des électeurs inscrits ne s'est pas exprimé, le double de 1981 et le plus haut niveau depuis cette date comme de la V e République 273 ( * ) .
Courbe 1
Si on s'intéresse maintenant aux scores des candidats, on s'aperçoit que depuis 1995, l'assiette électorale personnelle des candidats élus est basse : moins de 14 % des inscrits pour Jacques Chirac en 1995 et 2002, 18,2 % pour Emmanuel Macron en 2017 au premier tour des élections présidentielles.
Au second tour, Emmanuel Macron a certes réalisé un score plutôt meilleur que ses prédécesseurs (43,6 % des inscrits) mais bien inférieur à celui de Jacques Chirac, dans la même situation de confrontation avec le FN.
La nouveauté est double : un score inégalé du Parti d'extrême droite (près de 11 millions de voix, soit un quasi triplement par rapport à 2007, dix ans avant), et la quasi-disparition de l'effet diabolisation de celui-ci, très fort en 2002.
À cette date, le score de Jacques Chirac était passé de 13,75 % des inscrits au premier tour, un chiffre particulièrement bas, à 62 % au second, soit une multiplication par 4,5. En passant de 18,19 % à 43,61 %, Emmanuel Macron devra se contenter d'un multiplicateur de 2,4.
Entre le premier et le second tour de 2002, Jean-Marie Le Pen a gagné seulement 720 000 voix ; Marine Le Pen, près de 3 millions (2,960 millions) en 2017.
Si l'effet repoussoir du FN est évident en 2002, en 2017 il l'est nettement moins. À l'avenir, il est fort probable qu'il ne suffira pas pour lui interdire l'accès au pouvoir.
Il est clair que le régime « d'alternance unique (...) entre deux partis qui, à quelques nuances près, mènent les mêmes politiques favorables à la perte de souveraineté, à l'open society et aux flux mondiaux » 274 ( * ) ne sera pas éternel. Clair que l'alternative à laquelle se limite de fait aujourd'hui, l'enjeu de la « mère des batailles électorales » en France, l'élection présidentielle - continuer la même politique rassurante comme toutes les habitudes qui ne fera qu'aggraver la situation ou faire le saut dans l'inconnu - est une politique de Gribouille qui prendra fin un jour, la seule inconnue c'est quand et comment.
Courbe 2 : Score aux premier et second tours aux élections présidentielles en pourcentage des inscrits.
Courbe 3 : Évolution du nombre de suffrages obtenus par le FN aux élections présidentielles
Que les électeurs français ne soient pas dupes du chantage au chaos dont ils sont l'objet transparaît dans les résultats des élections législatives qui suivront le scrutin présidentiel de 2017.
Au second tour, l'abstention, plus les votes blancs et nuls, atteignait 62,3 %, du jamais vu pour une consultation de cette importance.
Ce qui signifie que 32,8 % seulement des électeurs inscrits ont choisi leur candidat, soit un score moyen de l'ordre de 20 % pour les heureux élus.
Merveilleux système qui transforme une poignée d'électeurs en majorité écrasante !
En tous cas, il n'y a pas de risque que le Parlement quitte son rôle de chambre d'enregistrement.
Courbe 4 : suffrages exprimés au premier et second tour des élections législatives
Courbe 5 : résultats des élections européennes en pourcentage des inscrits depuis l'origine
L'élection européenne est une élection qui, sauf la première fois, ne mobilise durablement que la moitié des électeurs.
En 2019, confirmant son bon score des présidentielles, c'est le FN qui arrive en tête avec 23 % des suffrages exprimés, devant le parti gouvernemental LREM avec 22 %, la droite classique (LR) étant atomisée avec 8 % et la Gauche pulvérisée, les écologistes de gauche (EELV) et de droite (GE) selon la nomenclature officielle (16 % au total).
Au final, le paysage politique donne l'impression d'un champ de ruines.
1. La voix de la rue : les gilets jaunes et les autres
Bien que pressentis par les préfets qui en avaient averti le gouvernement, lequel n'en tiendra aucun compte, comme le reconnaîtra le ministre de l'Intérieur fin août 2019 (Le Figaro, 28 août 2019), la « crise », le « mouvement » des « gilets jaunes » surprit aussi bien les responsables politiques que les observateurs médiatiques. C'est généralement le cas dans les périodes incertaines où le feu couve sous la cendre ne laissant paraître que quelques fumeroles à l'extérieur.
Ce n'était pourtant pas le premier mouvement de révolte surprenante des cinq années précédentes.
C'est ainsi qu'à l'automne 2013, la question bretonne a brusquement ressurgi à travers les manifestations des « bonnets rouges ». Personne, à Paris, n'avait vu venir une mobilisation aussi soudaine que puissante, et totalement imprévue pour la classe politique et les média
Le déclencheur : l'institution, déjà, d'une « écotaxe » sur fond de multiplication des plans sociaux, de fermeture d'usines, de montée du chômage en Bretagne, après trois décennies d'innovations et d'expansion. Plus profondément, à cette occasion, ressurgissait le vieux mouvement régionaliste contre le centralisme et le sentiment d'appartenance à une même communauté humaine que résumait le mot d'ordre « vivre, décider, travailler en Bretagne ».
Le gouvernement, devant l'ampleur du mouvement fera machine arrière, suspendant provisoirement puis sine die la taxe avant que l'Assemblée nationale ne la supprime en novembre 2016.
La Cour des comptes évaluera à 1,3 Md€ la perte annuelle de recette qui en résultera, à laquelle il fallut ajouter le dédommagement de la société chargée de mettre en place les installations nécessaires à la perception de « l'écotaxe ».
Trois ans plus tard, d'une toute autre origine et d'une toute autre forme, c'est au tour de « Nuit debout » de faire l'actualité.
Un mouvement clairement politique dont le déclencheur sera, cette fois, le projet de loi travail porté par la ministre El Khomri ; sur fond, là encore de chômage, de crise et de défiance envers une « classe politique » gestionnaire d'un système de plus en plus contesté.
Cet ensemble de manifestations contre l'austérité et le néolibéralisme, parisiennes mais pas seulement, prolonge le Mouvement Los indignados de mai 2011 puis Podemos en Espagne opposés à la politique d'austérité de l'UE, ainsi que des mouvements similaires à Londres, Athènes, Lisbonne et Paris.
Il s'inscrit aussi dans la même veine qu'« Occupy Wall Street », (septembre 2011) qui proteste à New York, puis dans d'autres grandes villes des USA, contre les abus du capitalisme financier.
L'initiative de ce qui deviendra Nuit Debout revient au journal Fakir animé par François Ruffin à l'origine de la réunion à la Bourse du travail (23 février 2016) d'intellectuels et de militants surdiplômés, sous-employés, à la fois en phase avec la globalisation mais victimes de ses effets dissolvant sur le tissu social, victime aussi de la gentrification des centres-villes.
Il en sortira une série de manifestations : contre le traitement musclé de Notre-Dame des Landes, contre l'état d'urgence, contre la condamnation des « Goodyear », la réforme des collèges, l'oligarchie qui a pris le contrôle de l'économie, les médias, la justice, le gouvernement d'alors, fut-il socialiste etc. Et les « nuits » de veille place de la République à Paris qui donnèrent leur nom à ce mouvement informel d'extrême gauche. Son objectif : faire peur à la galaxie des pouvoirs néolibéraux.
À partir de juin 2016 cependant, la participation s'étiole, seuls perdurant des rassemblements occasionnels place de la République jusqu'en 2017-2018.
Tout en étant lui aussi une manifestation de protestation contre les effets sociaux de la domination financière et de la crise économique dont elle est responsable, contre l'impuissance jugée complice d'une classe politique aux contours flous, le mouvement des « gilets jaunes » diffère très profondément de ceux qui l'on précédés : par sa forme, par l'écho rencontré dans l'ensemble de la population, par ses acteurs et par sa longévité. La France entière était concernée et pas seulement une région aux particularismes affirmés depuis longtemps de catégories sociales et de classes populaires majoritaires, et plus d'une « avant-garde » d'intellectuels ultra minoritaires.
On comprend qu'après avoir tergiversé, faute de compréhension de ce qui se passait, le gouvernement finisse par le prendre au sérieux.
C'est que le mouvement bénéficiait de la compréhension voire de la solidarité d'une majorité de Français comme le montre l'enquête de l'Observatoire Société et consommation 275 ( * ) .
Selon celle-ci, 49 % de Français se qualifient de « gilets jaunes » ou ont pris part au mouvement dont 22 % activement. Si on considère que 11 % de la population qui, sans s'auto-qualifier de « gilets jaunes », déclarent les soutenir cela représente quelque 60 % de la population. « Le mouvement des « gilets jaunes » n'est pas seulement remarquable par la profondeur de son ancrage dans la société ; chacun sait qu'il l'est aussi par sa durée, ses modalités d'expression, son absence de coordination centralisée... Bref, il s'agit d'un mouvement inédit. » (Philippe Moati)
On constate cependant que si une acception large du qualificatif de « gilets jaunes » en donne une image qui s'écarte peu de celle de la population française - à l'exception des extrêmes - des écarts plus substantiels apparaissent si on considère les plus impliqués, voire les plus politisés et les plus actifs.
Cet échantillon « d'activistes » est plus dense en retraités (particulièrement au niveau de vie faible), en ouvriers, en locataires du secteur privé à très bas revenus et ayant des revenus situés autour de la médiane (classes moyennes).
Globalement il rassemble beaucoup de personnes disant avoir du mal à joindre les deux bouts et de plus en plus de difficultés depuis cinq ans.
Il est aussi plus dense en habitants de petites et moyennes villes où le niveau de vie moyen est faible et où le taux de chômage est élevé, obligés d'utiliser quotidiennement leur voiture.
Pas étonnant si là encore c'est l'augmentation d'une taxe sur les carburants qui a été la cause du démarrage, en novembre 2018, du mouvement.
Philippe Moati remarque cependant qu'on ne peut pas parler d'échantillon homogène quel que soit le critère retenu.
Il s'agit seulement de nuances, d'autant plus fortes que l'on se rapproche du noyau dur. « Plus on s'écarte des " gilets jaunes" les plus impliqués, plus le profil se banalise. Celui des sympathisants des "gilets jaunes", comme celui des personnes ambivalentes par rapport au mouvement, est très proche de celui de l'ensemble de la population. »
« L'hypothèse que tout cela suggère est que le mouvement agrège des mécontentements et des revendications hétérogènes émanant de personnes aux profils diversifiés que l'on peut difficilement réunir dans une supposée "classe moyenne" dont l'hétérogénéité du contenu ferait perdre l'essentiel de la portée analytique. »
Cela semble cependant confirmer qu'il s'agit d'un mouvement collectif puissant de protestation globale contre une organisation sociale et politique qui ne répond plus aux attentes de la majorité d'une population diverse.
Et c'est cette diversité qui explique la difficulté du mouvement à formuler des objectifs et des revendications politiques précises autres que celles véhiculées par les médias et la communication gouvernementale.
Ce n'est pas un hasard si le Grand débat initié pour désamorcer la bombe politique - opération parfaitement réussie d'ailleurs - a montré une parfaite convergence entre les attentes de la population consultée et ce que le gouvernement était prêt à céder ! (voir plus haut I)
À quelques soubresauts près, progressivement, le mouvement perdra de sa vigueur mais, rien n'étant réglé, couvant sous la cendre, il n'attend que l'occasion pour reprendre sous une forme ou une autre, comme le montre, comme le montre la récente célébration de l'anniversaire du mouvement fin novembre 2019.
C. LE SPECTRE DU POPULISME
« Un spectre hante l'Europe. Le spectre du communisme », ainsi commence le « Manifeste du Parti Communiste » de Marx et Engels.
C'était en 1848.
Un siècle et demi plus tard, le spectre qui hante l'Europe, certainement et probablement tout l'Empire américain, c'est le populisme.
Un populisme aux formes très diverses : d'extrême droite ou de droite extrême (cas les plus fréquents) mais aussi parfois de gauche (France insoumise par certains côtés et Mouvement des Gilets jaunes en France, Podemos en Espagne) ou d'extrême gauche ou difficile à qualifier comme le mouvement « Cinq étoiles » italien.
Le dénominateur commun est la contestation du système tel qu'il fonctionne et de ceux qui l'ont jusque-là fait fonctionner.
À considérer les résultats des dernières élections européennes où dans de nombreux pays les partis alternant parfois depuis la Libération au pouvoir ont été pulvérisés, on peut se demander s'ils n'ont pas atteint déjà leur but.
En Europe continentale, pas de trimestres, et parfois de mois, sans que l'extrême droite marque des points à l'occasion d'élections nationales ou locales.
Leurs gains apparaissent en termes de suffrages et de plus en plus de sièges : Rassemblement National en France (présidentielles et dernières élections européennes où il arrive en tête devant tous les autres partis, y compris celui actuellement au pouvoir), Vox en Espagne, AfD en Allemagne qui marque des points début septembre puis en octobre 2019 aux élections régionales dans quatre Länder de l'ex RDA, Vrais Finlandais en Finlande, Aube dorée en Grèce, PDS Slovène, etc.
Des gains en termes de pouvoir dans des coalitions avec la droite comme en Autriche, avec le centre (Estonie), avec des formations de gauche antilibérales (Matteo Salvini, leader de la Ligue coalisée avec Cinq étoiles). Cette coalition ayant éclaté, elle sera remplacée par une autre : Cinq étoiles - Parti démocrate.
Sans compter les partis de droite extrême déjà au pouvoir en Pologne, Hongrie ou, comme en Slovaquie, y participant au sein d'une coalition hétéroclite.
Mais le plus surprenant est venu de là où on l'attendait le moins, des parrains du néolibéralisme mondialisé : le Royaume-Uni et les USA.
Le Royaume-Uni avec le « Brexit » - et dont le parti arrivé en tête aux européennes est d'extrême droite (l'UKYP de Nigel Farage).
Depuis le référendum d'avril 2016, une confusion jamais connue règne au Gouvernement britannique et aux Communes. Les deux partis de gouvernement Conservateurs et Labour sont chacun clivés entre pro et anti Brexit. Theresa May n'ayant réussi à trouver un accord ni avec l'UE, ni avec les Communes a dû démissionner de ses fonctions de Premier ministre. Son successeur Boris Johnson n'a réussi à faire adopter ni sa proposition de Brexit dur avec sortie de l'UE au 31 octobre 2019, ni celle d'un Brexit négocié !
En même temps, les Communes refusent la tenue d'élections anticipées, auxquelles il sera difficile d'échapper.
Les USA avec l'élection de Donald Trump qui donne des sueurs froides aux libres échangistes de stricte observance. Passées les turbulences post-électorales il semble avoir la situation en main malgré l'opposition des Démocrates, d'une partie des Républicains et les réticences de la Fed à abandonner sa politique d'assainissement par l'augmentation des taux directeurs.
Il est significatif, comme le dit James K. Galbraith, que Donald Trump ait « gagné son pari dans les États "oubliés" des États-Unis. (...) Les États qui ont voté pour Trump ont été ignorés par les démocrates depuis des années. D'autres, enfin, ont toujours été conservateurs 276 ( * ) . »
Même le Canada lors des élections provinciales québécoises a apporté sa contribution au mouvement avec la victoire de la Coalition avenir Québec (CAQ) et l'élection d'un Premier ministre - François Legault - « hors normes ».
S'il refuse l'étiquette de « populiste », constatons qu'il a d'abord été élu contre les appareils en place et que son programme vise à renforcer les spécificités québecoises.
Conclusion : le « populisme » semble partout installé et pour longtemps.
Mais, qu'est-ce que le « populisme » ? Que peuvent avoir de commun des formations et des formes d'expression aussi disparates ?
1. Qu'est-ce que le « populisme » ?
a) Une essence insaisissable
La réponse la plus courante c'est que serait populiste tout régime fondant sous une forme ou sous une autre, la légitimité de son action sur le peuple, toute formation critiquant le néolibéralisme au nom du peuple.
Ainsi, pour Konrad Adam, cofondateur du parti AfD (Alternative pour l'Allemagne), populisme et démocratie se confondent.
Pour lui « la démocratie est en son essence un phénomène populiste, car elle donne le dernier mot au peuple : au peuple, comme je l'ai dit et non à ses représentants. » 277 ( * )
Certes, mais que dit le peuple, sinon ce que d'une manière ou d'une autre, ses représentants élus ou autoproclamés lui font dire ?
Quel que soit le mode d'organisation politique, il faut un intermédiaire qui recueille, voire interprète la volonté du peuple dès lors qu'à la différence de la démocratie antique, il ne peut être en totalité rassemblé en un lieu.
Même là d'ailleurs, les démagogues venaient brouiller et influencer son expression.
Quant aux foules, elles sont rarement représentatives d'un peuple dans sa totalité (voir l'usage qu'en a fait le fascisme).
Et puis, comment savoir ce que veut une foule ?
Que voulait la foule des Parisiens rassemblés devant l'Hôtel de Ville pour acclamer le maréchal Pétain, chef de l'État français le 28 avril 1944 ? Que voulait celle des Parisiens rassemblés en ce même lieu pour acclamer le Général de Gaulle, chef de la « France libre » quatre mois plus tard ? Pour partie des choses différentes mais probablement pour une autre la même : la fin de la guerre et des privations.
Difficile donc de transformer en volonté et en action politique de telles manifestations d'adhésion, fussent-t-elles sincèrement enthousiastes.
Dans le même ordre d'idée, quelle représentativité peuvent bien avoir les échantillons de sondés, de ceux qui s'expriment lors de « grands débats » ? Que disent leurs réponses et leurs avis synthétisés, sinon ce que l'organisateur croit bon de leur faire dire, comme on l'a vu plus haut ?
Les deux autres caractéristiques du populisme, selon Jan-Werner Müller, seraient l'anti-élitisme et l'anti-pluralisme.
Curieux anti-élitisme que celui du fascisme et de tous « les populismes autoritaires » qui de tous temps ont fourni des occasions de carrières sociales fulgurantes. Le culte du chef, du leader, du guide est-il un antiélitisme ? Renouveler les élites n'est pas supprimer l'élitisme.
À contrario, à en juger sur le cas français, le libéralisme centriste a été lors de son installation et reste encore aujourd'hui un terrain fertile pour les carrières et les enrichissements fulgurants. Curieux anti-pluralisme pour le « populisme de gauche » qui, au contraire, se donne pour objectif le respect des opinions politiques individuelles.
Ainsi, pour Chantal Mouffe, soutien et théoricienne du « populisme de gauche », l'une de ses tâches essentielle est de fournir un cadre institutionnel réglé aux conflits qui sont l'essence même du politique. La caractéristique de ces conflits étant d'opposer non pas des ennemis mais « des adversaires entre lesquels existe un consensus conflictuel » 278 ( * ) .
Ce sont des conflits de forme « agonistique », entre adversaires qui reconnaissent la légitimité de la revendication de l'autre et non de forme « antagonistique » entre des ennemis dont l'un doit être éliminé.
Pour Chantal Mouffe, « le conflit agonistique est ce qui caractérise la démocratie pluraliste ».
À contrario, quelle est la caractéristique de la « démocratie libérale occidentale » sinon, comme on l'a vu, le refus du pluralisme réel et le rejet dans l'insignifiance des opinions et des mouvements qui contestent le consensus néolibéral ?
C'est même là son point faible car en réussissant trop bien la « démocratie Potemkine » a rendu impossibles les changements substantiels que nécessiteraient la stagnation économique, le risque de répétition d'un Krach financier dévastateur et la désespérance actuels.
Pour Jean-Yves Camus, si le populisme, est « avant tout un style politique, plus qu'une idéologie », une manière de faire campagne, « c'est aussi un mode de gouvernement » selon deux principes : « Le peuple, conçu comme une entité organique, a toujours raison, parce qu'il a la préscience de l'intérêt général » et « le peuple, ce n'est pas tout le monde mais Nous opposé à Eux. »
D'où, par exemple dans le discours du FN, la distinction entre les Français de souche et les immigrés.
Le problème, encore une fois, c'est que ces constats souvent exacts s'agissant d'une formation particulière ne sont pas généralisables.
Et puis tous les populismes de gauche, comme on l'a vu, ne conçoivent pas le peuple comme une entité organique.
Une « hégémonie » telle que la conçoit Chantal Mouffe se construit, et s'agissant des populismes de droite, la place et le culte du chef montrent assez que c'est plutôt lui qui a toujours raison.
Quant à la distinction entre « Eux » et « Nous », c'est une thématique de tous les conquérants politiques populistes ou non.
Le « peuple de gauche » de François Mitterrand, « ceux qui se lèvent tôt » de Nicolas Sarkozy, « les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » d'Emmanuel Macron ne sont-ils pas une manière de trier ceux au nom desquels on agit et les autres ?
Il est d'autant plus difficile de définir de manière convaincante et univoque ce qu'est le « populisme », ce qui le différencierait substantiellement des autres formes d'organisations politiques modernes que très probablement n'importe quelle structure institutionnelle, n'importe quel régime, à un moment ou à un autre voire plusieurs fois au cours de son histoire sera amené à invoquer le peuple et à faire appel à lui pour contourner ceux qu'il juge usurper la volonté populaire, amené, en un mot, à fonctionner sur le mode populiste.
Ainsi, paradoxalement, la V e République gaulliste, plébiscitaire, autrement dit « populiste » des premières années - ce qui lui fut vivement reproché par les Républicains historiques d'alors - malgré les apparences était alors nettement plus démocratique que la V e République crépusculaire actuelle qui n'hésite pas à passer par pertes et profits un référendum dont les résultats lui déplaisent.
La première se préoccupait de problèmes essentiels (décolonisation de l'Algérie, mode d'élection du président de la République, caractère bicaméral ou non du régime...), traités par referendums engageant la responsabilité du chef de l'État.
La seconde oublie soigneusement les questions essentielles, le chef de l'État devenant un as de l'esquive et n'ayant même pas à prendre le risque de dissoudre l'Assemblée nationale comme le fit Charles de Gaulle puisqu'il est devenu le chef de sa majorité.
Une sorte de « populisme chic », comme on l'a vu, est même aujourd'hui de rigueur dans la « communication » des responsables politiques néolibéraux, comme celle de Silvio Berlusconi ou dans un genre très différent Emmanuel Macron.
Et puis, il est difficile de mettre dans le même panier des formations antilibérales-antiracistes partisanes d'une régulation ouverte des flux migratoires, et des formations libérales ouvertement racistes et xénophobes à moins que le but soit de déconsidérer l'une par l'autre.
La conclusion c'est donc que « populisme » est un « mot valise » susceptible de transporter n'importe quelle idéologie, un concept vide ce qui explique la mise en échec de tous ceux - ils sont nombreux - qui se sont risqués à lui donner un contenu invariant.
Ce n'est pas un concept mais une arme politique, offensive ou défensive.
b) Une arme politique
Traiter une organisation ou un leader politique de « populiste » ou inversement se flatter de l'être est une arme tactique, ce n'est ni un programme ni une forme d'organisation politique suffisamment bien définie, ni même un « idéal type » au sens de Max Weber comme l'aurait voulu Jan-Werner Müller permettant de comprendre, malgré sa plasticité ou grâce à elle, un ensemble de phénomènes très divers.
L'appel au peuple des organisations dites populistes est d'abord et essentiellement une arme dans le combat pour le pouvoir, nullement un programme de gouvernement ayant une chance d'être appliqué tel quel, même si les programmes sont aussi des armes politiques utiles.
Désigner l'ennemi, les dispense d'indiquer précisément comment elles entendent répondre réellement aux attentes populaires.
Pas étonnant donc que les programmes et le discours populiste évoluent en fonction des circonstances, des affects changeants des cibles populaires visées ou, pour les partis au pouvoir, des alliances.
Ainsi, Victor Orbán, le champion hongrois de la démocratie « illibérale » peut-il, pour cultiver ses bonnes relations avec la Turquie, assurer lors de la visite du président Erdogan à Budapest pour la rénovation du mausolée de Gül Baba - poète ottoman et derviche qui a accompagné le sultan Soliman le Magnifique dans sa campagne de conquête de l'Europe -, que « l'image de ce saint derviche vit encore dans la mémoire du peuple hongrois » , caresser le projet, abandonné dès que révélé par la presse, de construire, dans la capitale hongroise, la plus grande mosquée d'Europe et prendre la tête de la croisade anti immigration des musulmans en Europe de l'Est 279 ( * ) .
Tout aussi étonnante la capacité de Jean-Marie Le Pen à soutenir des positions contraires selon les besoins du moment, même sur des sujets qu'on pouvait croire absolument fondamentaux pour lui, comme l'immigration, son increvable cheval de bataille.
En réalité, selon les moments et les buts poursuivis, accueillir quelques centaines de milliers d'Algériens musulmans en France est une calamité alors qu'en intégrer cinq ou six millions est une chance pour la France, comme le défendit le député Le Pen, à l'Assemblée nationale le 28 janvier 1958 : « Ce qu'il faut dire aux Algériens, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau ou que, s'ils le sont pour l'instant, ils seront au contraire la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme que dans la religion musulmane rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet... je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française [...].
Je conclus : offrons aux musulmans d'Algérie l'entrée et l'intégration dans une France dynamique. Au lieu de leur dire comme nous le faisons maintenant : « Vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau », disons-leur : « Nous avons besoin de vous. Vous êtes la jeunesse de la Nation [...] Comment un pays qui a déploré longtemps de n'avoir pas assez de jeunes pourrait-il dévaluer le fait d'en avoir cinq ou six millions ? »
Historiquement, comme l'a observé Polanyi, dans la phase de conquête les positions des organisations fascistes ont été largement opportunistes : bellicisme/ pacifisme ; anti ou pro capitaliste ; nationalistes isolationniste/internationalistes ; question sociale au premier plan/oubli de la question sociale ...
« Dans sa lutte pour le pouvoir politique, le fascisme est complètement libre de négliger ou d'utiliser les questions locales, à son gré. Son objectif transcende le cadre politique et économique : Il est social. Il met une religion politique au service d'un processus de dégénérescence. Dans sa période de montée, il n'exclut dans le char de la victoire qu'un très petit groupe de motivations, des motivations fort caractéristiques ». (La Grande Ttransformation)
Si on définit le « populisme » comme l'appel au peuple (imaginaire) selon des modalités diverses pour forcer des systèmes politiques bloqués à régler les problèmes qu'il ne veut pas ou ne peut pas régler, il ne peut qu'être un moment d'un processus que l'on n'a jamais vu durer sans changements profond, sans s'institutionnaliser.
Tel est aussi le point de vue de Bertrand Badie pour qui il n'y a pas de « populisme substantiel », seulement « des situations populistes » reconnaissables à leurs techniques de mobilisation spécifiques.
« Le populisme n'est ni une idéologie politique, ni une doctrine, ni un programme, ni une politique publique. Il ne désigne pas, contrairement à ce qu'on lit fréquemment dans la presse, un régime politique, non plus qu'un système politique.
C'est une "pathologie" politique au sens de dysfonction profonde de la société ou du système politique, le signe d'une profonde "crise de confiance" à l'égard des institutions. Une pathologie politique grave, ce moment où s'opère une coupure profonde entre les gouvernés et les gouvernants, ce dernier terme désignant aussi bien les personnes que les institutions. »
c) Populisme et mondialisation
Selon Bertrand Badie, les caractéristiques de la dernière « vague populiste » seraient d'être universelle et « d'inverser l'hégémon pour contester l'ordre du monde et la mondialisation ».
« C'est ce bouleversement du monde que nous ne savons pas regarder en face : depuis un an et demi, les États-Unis sont devenus la première puissance contestataire mondiale, et c'est une révolution absolument considérable, et le sera davantage encore si M. Trump est réélu en 2020 ! Outre les États-Unis, signalons le cas de la Russie, de la Turquie, ou encore des Philippines, dont le président Duterte a traité le Saint-Père de « fils de pute » - je me permets de le citer pour illustrer l'incroyable exceptionnalisme populiste, qui se permet tout : jamais Staline ni Hugo Chavez n'auraient parlé ainsi ! »
Or nos institutions ne nous ont pas protégés du cortège de maux économiques et sociaux que la mondialisation a amené avec elle.
« Nos institutions ne nous défendent pas contre la mondialisation, en laquelle nous ne voyons donc que délocalisations, commerce international et vulnérabilité de notre appareil industriel. »
D'où le repli sur la Nation, sur l'Europe chrétienne, l'identité, les racines instrumentalisées pour les besoins de la cause.
Si, historiquement, toutes les vagues de populisme ont eu une cause internationale (première mondialisation et Première Guerre mondiale, décolonisation, mondialisation actuelle), en l'espèce les institutions n'ont pas conduit le changement qu'appelait l'adaptation à la seconde mondialisation.
Celle-ci a donc été prise comme épouvantail alors qu'elle représente aussi un facteur de progrès pour peu qu'on la maîtrise. « La mondialisation est un processus qui échappe à tout le monde, et qui est d'ailleurs plus technologique qu'économique. Il faut savoir non seulement s'y adapter, mais la façonner, car elle est façonnable. »
Le diagnostic est bon à ceci près que la « fièvre » populiste n'a pas pour origine une impréparation à une évolution fatale et trop rapide. Ni la première ni la seconde mondialisation n'ont été le produit d'une quelconque fatalité.
Elles sont le résultat, à la fois d'un équilibre géopolitique et de politiques de libéralisation conformes aux intérêts, pour la première des nations industrielles commerçantes - Grande-Bretagne en tête - et des multinationales, toutes américaines au début, au bénéfice dans les deux cas d'une petite minorité et avec des dégâts collatéraux passés pour profits et pertes. En un mot, le produit d'une volonté politique.
La mondialisation actuelle, en effet, n'est ni le « club Med » du petit épargnant, des PME et des PMI pour peu qu'elles fassent l'effort de la qualité et de l'innovation, ni la « mondialisation heureuse » 280 ( * ) dont Alain Minc réservait les fruits juteux aux « bons élèves de la modernité ». C'est tout autre chose : 20 à 30 banques mondiales systémiques dont le bilan agrégé est passé entre 2011 et 2017, de 46 859 Md$ à 51 676 Md$ 281 ( * ) . En ajoutant les banques influentes à l'échelle d'un pays c'est de l'ordre de 140 grandes institutions financières au total.
Il est significatif que la première comme la seconde mondialisation aient commencé par celle des banques.
Significatif qu'une grosse poignée de multinationales et leurs filiales réalisent l'essentiel du trafic international.
Selon Martine Orange (Médiapart) et la Cnuced « 1 % des grands groupes faisaient 57 % du total des échanges en 2014. La part des 5 % des premières entreprises exportatrices s'élève à plus de 80 % des échanges. Et le groupe des 25 % des premiers groupes exportateurs réalise 100 % du commerce mondial. »
« De véritables rentes et monopoles mondiaux se sont constitués », insiste la Cnucted.
Ces situations « sont le résultat de barrières nouvelles et plus intangibles, reflétant les protections renforcées dont disposent les grands groupes et leur capacité à exploiter les lois et les règles nationales pour augmenter leurs profits et éviter l'impôt » , analyse-t-elle.
Ces mastodontes ont donc un poids politique énorme dans un grand nombre de pays.
Ainsi, sur les 193 pays reconnus par le FMI, moins de 25 ont un PIB supérieur au chiffre d'affaires de la société Walmart (quelque 500 Md$ en 2017).
Il ne faut pas cependant se laisser prendre par cet effet de grossissement.
Après avoir atteint 30 % en 2007, le taux d'ouverture commerciale mondiale en comptant la Chine est redescendu à 27 % en 2015, 25 % sans la Chine, ce qui montre que pour être important le commerce international ne représente qu'un quart de l'activité économique mondiale ; moins encore si on considère que le commerce entre maison mère et filiales ou entre filiales - souvent pour des motifs « d'optimisation fiscale », représente entre 30 % et 40 % de leur trafic selon les estimations disponibles.
De fait, l'activité économique est essentiellement réalisée localement par des PME-PMI.
L'autre caractéristique de la mondialisation, pourtant, c'est de n'avoir profité qu'à certaines couches sociales minoritaires, voire très minoritaires en occident, et dégradé les conditions d'existence de la majorité. Comme le montre Branko Milanovic (voir partie III), les gagnants de la seconde mondialisation sont les classes moyennes de quelques pays en développement (Chine et Inde) et de l'ordre de 5 % au grand maximum des catégories aisées des pays développés. Les grands gagnants une infime minorité (entre 1 % et 0,1 %) des pays développés.
Les grands perdants sont les classes moyennes en général et l'essentiel des territoires ne bénéficiant pas des retombées de l'enrichissement des zones très urbanisées (voir partie III).
Ce n'est pas un hasard si en Grande-Bretagne les partisans du Brexit, aux USA, les traditionnels électeurs démocrates qui ont voté pour Trump, le gros des troupes de l'AfD en Allemagne, les électeurs les plus denses du FN en France, etc., vivent dans les zones perdantes de la mondialisation néolibérale.
Il est très facile de voir que c'est là que la contestation du nouvel ordre a été la plus forte.
Il n'y a pas, d'un côté, un phénomène quasi naturel, commandé par le progrès scientifique et technologique et de l'autre ceux qui en profiteraient plus ou moins selon leurs situations ou leurs vertus.
La mondialisation est le résultat des politiques néolibérales décidées et conduites par ses bénéficiaires.
La logique de cette politique est de produire de l'inégalité et de dissoudre tout ce qui peut ressembler à des solidarités, surtout celles qui appellent une redistribution de la richesse produite, par l'État.
Elle est aussi de générer des krachs financiers dont le dernier s'est transformé en une crise générale qui s'éternise depuis plus de dix ans sans recevoir de réponse.
Si toute mondialisation n'est pas mauvaise par essence, une mondialisation dans l'unique but d'améliorer les retours sur investissement d'une oligarchie ne peut pas donner d'autres résultats que ceux qu'on observe.
Des institutions comme la FAO, l'OMS, le PNUD créés respectivement en 1945, 1948 et 1965, en réaction au fiasco de la première mondialisation libérale, marquent un progrès considérable, pas l'OMC créée, en pleine conquête néolibérale (1995), en tous cas pas telle qu'elle fonctionne.
Comme dit Adam Tooze, ce système mondialisé est fondamentalement en déséquilibre de manière permanente :
« L'interdépendance de l'ère mondialisée est omniprésente, mais elle est très loin d'être symétrique. Certains accusent les coups et d'autres les distribuent. » 282 ( * )
En prenant pour hypothèse que l'aventure fasciste catastrophique de l'entre-deux-guerres présente sous un verre grossissant une situation sur des points significatifs comparable à celle d'aujourd'hui, tout particulièrement le blocage politique et la perte de confiance, au risque de paraître anachronique, la grille utilisée par Polanyi pour l'analyser, reste encore la plus stimulante pour celle de la crise de la démocratie néolibérale finissante : comme au moment de l'entre-deux-guerres, la situation critique actuelle est le résultat de la contradiction entre la globalisation du marché, l'application de la concurrence à toutes les dimensions de l'existence humaine, assorties du refus de toute régulation d'origine politique, le système étant réputé autorégulateur.
Dans l'entre-deux-guerres, les conséquences politiques des dysfonctionnements explosifs résultant de cette contradiction furent le socialisme puis le communisme, les fascismes en général avec l'hitlérisme en particulier puis in fine, la démocratie politiquement libérale mais économiquement et socialement interventionniste.
Le New Deal et ses variantes social-démocrates furent alors la seule solution ayant réussi à concilier économie et institutions démocratiques alors que le fascisme, après avoir sauvé l'économie de marché dans sa phase d'installation, la transformait en économie de guerre dirigée, et surtout extirpait dans le sang et les larmes toutes les institutions démocratiques.
« Le fascisme, comme le socialisme, dit Polanyi, étaient enracinés dans une société de marché qui refusait de fonctionner . » 283 ( * )
Pour la faire fonctionner il aurait fallu des interventions de la puissance publique contraires au crédo libéral.
D'où la conclusion de Polanyi : « L'obstruction faite par les libéraux à toute réforme comportant planification, réglementation et dirigisme a rendu pratiquement inévitable la victoire du fascisme. » 284 ( * )
Jusque-là, les néolibéraux au pouvoir refusent toutes les réformes qui permettraient de mobiliser les ressources financières nécessaires à la relance économique dont dépend le niveau de chômage plutôt que de continuer à les engloutir dans une machine à laver spéculative transformée en bombe financière à retardement.
Ils refusent les réformes de la répartition de la richesse dont dépend la relance économique par la consommation et toute réduction des inégalités, comme ils refusent les réformes sociales qui redonneraient à la majorité des populations confiance en l'avenir.
Surtout, ils ne veulent pas entendre parler de la réforme qui conditionne toutes les autres : la réforme politique qui remplacerait la démocratie Potemkine par une authentique démocratie représentative.
2. La tentation populiste
Le régime démocratique libéral centriste que Fukuyama pronostiquait éternel, le sera-t-il ?
Rien n'est moins sûr à voir la fragilité de plus en plus grande des systèmes gouvernementaux les plus importants de l'Empire américain, à commencer par le principal, celui des USA.
Beaucoup ont du mal à constituer des majorités de gouvernement durables non conflictuelles, partout les mouvements populistes se renforcent, parvenant même au pouvoir, en coalition voire seuls comme en Europe de l'Est.
L'alternative est donc claire : ou l'abandon du néolibéralisme et un New Deal sous une forme renouvelée, ou sa survie sous la forme d'un mercantilisme plus ou moins agressif à l'extérieur porté par un régime autoritaire à l'intérieur soutenu par une coalition libéraux-populistes de droite.
Bien que la plus souhaitable parce que la seule à pouvoir restaurer la démocratie, apporter une réponse durable au blocage économique, à la dérive financière explosive actuelle et à susciter un nouvel espoir en l'avenir, la solution New Deal a peu de chance, à moyen terme en tous cas, d'aboutir. Parce que les forces politiques susceptibles de conduire une telle réforme sont encore absentes.
La social-démocratie, selon les pays, est soit divisée, soit totalement déconsidérée et ce qui reste de la gauche non social-démocrate, encore à l'état pulvérulent.
Quant à l'électorat de « gauche », découragé, une bonne partie s'est réfugiée sur l'Aventin de l'abstention.
La sortie de crise, temporaire en l'espèce parce qu'aux questions de fond non résolues s'ajouteront de nouveaux problèmes, la plus probable c'est, comme on l'a dit, un mercantilisme plus ou moins agressif à l'extérieur, porté par un régime autoritaire à l'intérieur, résultant d'une coalition des libéraux avec des populistes de droite.
Tout simplement parce qu'en dépit des conflits actuels pour le leadership des forces néolibérales, une partie des libéraux et la plupart des populistes de droite sont d'accord sur l'essentiel : pas question de réintroduire l'État et encore moins la démocratie dans le jeu économique.
Les partisans du Brexit sont loin d'être tous des anti-libéraux. De même que Donald Trump, l'ultra droite du parti Républicain et bon nombre de formations qui entendent mettre un frein au libre-échange, à l'immigration et restaurer l'intérêt national n'en sont pas non plus.
Ils ne remettent pas en question le système, seulement ce qu'ils tiennent pour des excès, des déviances, ou la manière dont est traité leur pays, ou la moralité des dirigeants au pouvoir.
Les anciens présidents péruvien (Alberto Fujimori) ou argentin (Carlos Menem) étaient d'authentiques néolibéraux, comme l'actuel président du Brésil (Jair Bolsonaro). Sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, le FN était libéral et aucunement anti européen comme la Ligue du Nord qui gouverna d'abord avec Silvio Berlusconi, néolibéral populiste s'il en fut.
Matteo Salvini, le nouveau leader de la Ligue, malgré ses démêlés avec Bruxelles et son recentrage national n'est pas non plus un antilibéral. Néolibéral aussi est le FPÖ autrichien et son leader.
Donald Trump qui refuse de freiner l'endettement, moteur de la croissance américaine, fait la politique souhaitée par Wall Street etc. etc.
C'est au nom du système lui-même que sont condamnées ses déviances.
Sarah Palin et les néoconservateurs du Tea Party américain, restent des libéraux convaincus condamnant ce qu'ils tiennent pour des déviances du néolibéralisme - capitalisme de connivence, sauvetage des banques avec l'argent public, puissance de l'oligarchie financière - tout en prêchant le retour aux valeurs morales et religieuses, le refus de l'impôt comme les Pères fondateurs rêvés des USA, ce que montre la référence à la « Boston Tea Party ».
Ils participent, par ailleurs, de la nébuleuse libertarienne professant, elle aussi, un individualisme radical, anti-état et antifiscal. Que l'institut qui a présidé à la naissance du Tea Party ait été financé par deux milliardaires - les frères Charles et David Koch - n'est pas un hasard.
Leur proximité avec les églises évangélistes non plus.
L'hitlérisme, aujourd'hui modèle d'épouvantail anti-populisme, n'était pas non plus anticapitaliste même si la logique de « l'État total » dont il rêvait l'y a conduit.
« Jamais ni nulle part , rappelle Polanyi, Hitler a promis à ses partisans d'abolir le système capitaliste. Le trait fondamental à son programme est bien plus sa croyance en un fonctionnement sain du système capitaliste dans l'État nationaliste. » (La Grande Transformation) D'où la facilité avec laquelle les intérêts industriels se sont ralliés à lui, les secteurs les plus retardataires (industries extractives et sidérurgie) et ceux qui profitaient de la politique de réarmement (chimie), les premiers.
Ensuite, progressivement, les autres pourtant défavorables à l'interventionnisme économique de l'État, l'ont fait, pour des raisons politiques : faire barrage au communisme et au syndicalisme qui nuit aux affaires.
Dans ses attaques contre le capitalisme, de rigueur dans la phase de conquête pour se rallier les masses, Hitler n'en distingue pas moins soigneusement le « capitalisme prédateur juif » du « capitalisme créateur de richesse non juif ».
Le pouvoir conquis, ces critiques disparaîtront même si, pour lui, fondamentalement, « i l n'y a pas d'économie libre dans l'État total » 285 ( * ) .
Elles eussent d'ailleurs été inutiles, tous les capitaines d'industrie appréciant l'éradication brutale des partis de gauche et des syndicats.
Quant à l'économie dirigée, nécessaire à la guerre, elle était finalement un moindre mal - le mal étant la suppression de la propriété des moyens de production promise par le communisme - avec pour bon côté de fournir des débouchés aux entreprises et rapidement de la main d'oeuvre servile quasiment gratuite.
Que tous les populismes ne soient pas anti libéraux, tant s'en faut, signifie qu'une alternative libérale de droite et plus probablement de droite extrême, au libéralisme centriste est tout à fait possible, sinon probable vu ce qui reste de la gauche non libérale sur le continent européen et aux USA.
« Pour moi, l'accession au pouvoir des populistes dans tous les pays d'Europe traduit la défiance des masses et l'épuisement d'un système aveugle à ces grandes remises en cause. En Europe, nous voyons donc l'arrivée concomitante au pouvoir des libéraux autoritaires.
« C'est la nouvelle expression du néolibéralisme 286 ( * ) . »
Si une telle réorganisation des forces politiques ne réglera rien - les raisons structurelles de l'échec du système étant toujours là - reculer pour mieux sauter n'en est pas moins gagner du temps et au moins provisoirement protéger à moindre frais les intérêts d'une oligarchie prête à accueillir ses sauveurs, comme elle le fit il y a moins d'un siècle.
Comme nous l'avons dit, on ne peut pas ne pas trouver - avec les précautions qu'impose le siècle des extrêmes qui les séparent - quelques ressemblances entre la situation actuelle et celle de l'entre-deux-guerres telle qu'elle ressort de l'analyse de la réforme fasciste de l'économie de marché par Polanyi.
« On peut, dit Polanyi, décrire la solution fasciste à l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral comme une réforme de l'économie de marché au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques. » 287 ( * )
Le fascisme est pour lui « la solution catastrophe » à l'incapacité de la démocratie libérale de surmonter la contradiction entre liberté totale du marché et démocratie.
Il n'est en rien une réponse à des problèmes locaux mais une réponse à celui qui tourmente l'ensemble des sociétés libéralisées :
« Si jamais mouvement politique répondit aux besoins d'une situation objective, au lieu d'être la conséquence de causes fortuites, c'est bien le fascisme. En même temps, le caractère destructeur de la solution fasciste était évident. Elle proposait une manière d'échapper à une situation institutionnelle sans issue qui était pour l'essentiel, la même dans un grand nombre de pays, et pourtant, essayer ce remède, c'était répandre partout une maladie mortelle. Ainsi périssent les civilisations. » 288 ( * )
Comme l'écrit Mussolini « seul un État autoritaire peut affronter les contradictions inhérentes au capitalisme. » ( La doctrine du fascisme, 1933)
Pour Hitler aussi, la cause principale de la crise, c'est l'incompatibilité entre l'égalité démocratique et le principe de propriété privée des moyens de production (Discours de Düsseldorf).
Une thèse que l'on retrouve chez le très libéral Von Mises 289 ( * ) , pour qui l'interférence de la démocratie représentative avec le système des prix fait baisser la production, tout en maintenant le principe que seul le libéralisme total est compatible avec la liberté tout court. Reste à savoir de quelle liberté et de qui on parle.
Au final, nombre de pays préfèreront le fascisme au nom de la sauvegarde de l'économie libérale, confondue avec la propriété privée des moyens de production.
La solution socialiste à la crise, c'est l'extension de la démocratie à la sphère économique, celle du fascisme, l'abolition de la sphère politique démocratique pour sauver l'économie libéralisée, explique Polanyi.
Dans la théorie fasciste, le capitalisme organisé en branches de l'industrie devient la seule réalité sociale qui se réduira dans les faits à une économie de guerre administrée. Les êtres humains n'y sont considérés que comme des producteurs.
« Dans cet ordre structurel [fasciste], les êtres humains sont considérés comme des producteurs et seulement des producteurs. Les différentes branches de l'industrie sont reconnues légalement en tant que corporation et on leur accorde le privilège de prendre en charge les problèmes économiques, financiers, industriels et sociaux qui surviennent dans leur sphère. Elles se transforment en dépositaire de presque tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires qui relevaient auparavant de l'État politique. L'organisation effective de la vie sociale repose sur le fondement professionnel. La représentation est accordée à la fonction économique : elle devient alors technique et impersonnelle. Ni les idées ni les valeurs ni le nombre des êtres humains concernés ne trouve d'expression dans ce cadre . » (La Grande Transformation).
Décidément les vieilles recettes sont immortelles. Constatons donc que la tentation « corporatiste » existe encore aujourd'hui en France, comme le montrent les tentatives récurrentes de transformer la Chambre Haute, le Sénat, en CESE et les appels à l'expression et à la représentation de la « société civile », au nom du renouveau démocratique.
Avant de renoncer à la conception révolutionnaire de la représentation du citoyen en tant que citoyen, par celle des différences, avant de remplacer la démocratie représentative - la seule qui ait réussi tant bien que mal à fonctionner - par une démocratie plus consultative et participative ou une démocratie directe dont on ignore qui en serait le maître réel, encore faudrait-il leur permettre de fonctionner correctement, ce qui, on l'a vu, n'est plus le cas aujourd'hui.
Il faut se rappeler ce que dit Sieyès : « Le droit de se faire représenter n'appartient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont communes, et non par celles qui les différencient. Les avantages par lesquels les citoyens diffèrent entre eux sont au-delà du caractère civil de citoyen » 290 ( * ) , ce qui signifie que le rôle du représentant est d'exprimer son intime conviction éclairée par le débat au risque d'être désavoué par ceux qui l'ont élu au moment de lui renouveler leur confiance.
Ce qui signifie qu'un système où de fait et généralement les parlementaires s'expriment et votent au nom d'un groupe, d'un parti, ne correspond ni au principe révolutionnaire de la représentation ni à l'article 27 de la Constitution de la V e République, ce dont le Conseil constitutionnel, toujours prompt à censurer les élus du peuple, se moque éperdument.
Au fil de cette longue analyse, on a vu ce qu'il faudrait faire pour éviter la reproduction d'un krach financier dévastateur, sortir de la stagnation économique, réduire les inégalités sociales et territoriales, enrayer la dérive oligarchique de systèmes politiques désormais sous tutelle des marchés et des intérêts privés, ce qu'il faudrait faire pour débloquer un système incapable de prendre les décisions permettant d'éviter la catastrophe générale qui se profile.
L'électeur conscient qui n'en continue pas moins à maintenir sous perfusion une démocratie Potemkine qui fabrique des électeurs populistes sous prétexte d'empêcher l'accession au pouvoir du populisme porte sa part de responsabilité.
La politique de Gribouille reste encore le meilleur moyen de se noyer.
Mais, que faire d'autre face à un système politique qui a neutralisé toute possibilité de modification substantielle de ses objectifs, de ses bénéficiaires et de ses modalités d'exercice du pouvoir, en un mot qui a rendu la démocratie aboulique, sinon le récuser en bloc et soutenir toutes les initiatives visant à débloquer ce système politique donc à le rendre démocratique parce que le succès passe par là ?
À l'époque de Tocqueville pour qui le modèle de la démocratie était américain, la supériorité de la démocratie sur l'aristocratie était de permettre la correction des erreurs. « Le grand privilège des Américains, écrit-il, est de pouvoir faire des fautes réparables. » 291 ( * )
Impossible de dire mieux : si l'on entend mettre fin au blocage actuel, la priorité c'est de rendre les institutions politiques européennes et de celles de l'Empire, démocratiques.
CONCLUSION
« Il s'agit de faire comme si on avait affaire à une fatalité, afin de mieux en détourner le cour »
Jean Pierre Dupuy
Pour un catastrophisme éclairé (Seuil)
« Une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur », voilà à quoi font irrésistiblement penser les deux premières décennies de ce XXI e siècle.
Sa seule différence avec l'histoire de Macbeth est qu'elle signifie quelque chose : la faillite de la restauration néolibérale commencée il y a une cinquantaine d'années.
Tout laisse à penser, en effet, qu'à l'image de son illustre prédécesseur, le Titanic II néolibéral, laissé à lui-même, court droit au naufrage.
Quand et après quelles péripéties ? Nul ne le sait, mais sûrement.
Prisonnier de ses contradictions et des intérêts qui le dominent, de l'insuffisance des réformes qui ont suivi le krach de 2008, conjuguée à l'aveuglement idéologique et à l'inconséquence de ses responsables politiques et techniques, on ne voit pas comment le système financier pourrait ne pas imploser.
On ne voit pas non plus comment la crise politique, résultant de la stagnation économique, de la désintégration progressive de l'État-Providence ni comment la crise morale née du constat de l'incapacité des gouvernements occidentaux à répondre aux attentes légitimes des électeurs et de la perte de confiance dans les institutions, pourraient laisser intacte « la démocratie en trompe-l'oeil » à quoi se résume la « démocratie libérale » réelle.
On voit encore moins où peuvent conduire la remise en cause par Donald Trump au nom de « l' America first » de l'ordre international ou l'éventuelle réorganisation de celui-ci avec l'apparition d'un pôle concurrent de l'Empire américain autour de la Chine, de la Russie et du Brésil.
I. DIX ANS D'ÉCHECS
A. ÉCHEC DE LA RÉGULATION DU SYSTÈME BANCAIRE
Dix ans après la crise des « subprimes », force est de constater que non seulement le système bancaire, unique préoccupation des réformateurs mobilisés pour éviter la réédition d'un nouveau krach, n'est ni moins vulnérable à une crise de l'ampleur de celle 2008, ni plus résilient.
Les demi-réformes dont il a été l'objet, très en-dessous des engagements pris aux G20 de 2009 et 2011, au terme d'interminables manoeuvres de retardement menées par le lobby bancaire, ont été contournées puis effacées, les unes après les autres.
Pour s'en tenir au plus essentiel, ainsi en fut-il :
- de la séparation des banques de dépôts des banques d'affaires, nécessaire au financement à crédit de la spéculation sous protection des contribuables 292 ( * ) ;
- du ratio obligatoire de fonds propres (Accords de Bâle III) notoirement insuffisant pour faire face à une crise systémique 293 ( * ) et calculé par les banques elles-mêmes 294 ( * ) .
La tentative de régulation des produits dérivés 295 ( * ) par des « plateformes de compensations centrales » ne concerne que les transactions de gré à gré et surtout pourrait, à son corps défendant et par ricochet, créer un nouveau risque systémique.
D'où le dilemme : rendre obligatoire pour tous les types de transactions la médiation, augmentant ainsi le risque systémique, ce qui, vu l'augmentation du coût, réduirait l'activité sur les dérivés, ou taxer purement et simplement ceux-ci.
Quand on sait qu'il n'y a pas plus de 7 % des dérivés qui garantissent des transactions sur des produits réels, il ne devrait pas être impossible de neutraliser ces « armes de destruction massive » selon l'expression de Warren Buffett.
À condition de le vouloir, ce qui est loin d'être certain.
En fait, les régulateurs, du moins leurs mandants, sont restés prisonniers d'objectifs contraires : améliorer la stabilité du système bancaire, ce qui supposerait réduire la capacité de production de crédit et les échanges internes au système, et éviter de ralentir le business, donc la production de crédit et limiter la liberté de son affectation !
Cette contradiction explique aussi le caractère jugé trop accommodant, même par des observateurs officiels des « stress tests » de la Banque centrale européenne.
Il ne faut désespérer ni l'épargnant ni « l'investisseur ».
B. ÉCHEC DE LA RÉGULATION DU SYSTÈME FINANCIER
L'échec est encore plus patent dès lors qu'on ne considère pas seulement le système bancaire mais ses relations avec ses partenaires au sein du système financier, à commencer par la « finance parallèle » qui loin d'être « fantôme » vit en symbiose avec lui 296 ( * ) .
Force est alors de constater que le durcissement du contrôle des banques a été suivi comme son ombre de l'augmentation de l'activité de la finance parallèle.
Selon François Villeroy de Galhau, le « narrow shadow banking » représenterait 160 000 Md$ aujourd'hui, soit près de la moitié des actifs financiers détenus par les institutions financières à l'échelle mondiale.
Plus de 45 000 Md$ de ces actifs, toujours selon le Gouverneur de la Banque de France, présenteraient des risques pour la stabilité financière.
On aura compris que les velléités de durcissement du contrôle bancaire, de limitation des marges de manoeuvre des banques, ont été amplement compensées par le développement d'une finance parallèle à l'abri des regards et de tout contrôle, sans même une réglementation de ses relations avec la finance officielle. Autant dire que le résultat est pitoyable.
Rien d'étonnant donc si le carburant des bulles et des crises, le crédit et son corollaire, l'endettement, n'ont pas cessé d'augmenter.
La première erreur des responsables politiques et des régulateurs est d'avoir voulu croire que la crise résultait seulement de l'exubérance naturelle d'un système bancaire libéré de ses contraintes et qu'il suffirait, après quelques fusions et recapitalisations bancaires, d'un minimum de réglementation pour le stabiliser et ainsi restreindre ses capacités de création monétaire.
Or c'est l'ensemble d'un système financier complexe, avec des secteurs opaques, qui était concerné.
L'erreur fatale, cependant, c'est d'avoir privatisé un privilège d'État essentiel : le monnayage ; qui plus est, avec le droit d'en abuser à sa guise !
C. ÉCHEC DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Un système bancaire qui a oublié les raisons de son privilège de créer de la monnaie
En se focalisant presque uniquement sur le système bancaire, sur son sauvetage et sur les moyens d'assurer sa survie, au prix d'un minimum de contraintes, les responsables politiques et des banques centrales ont oublié l'essentiel, que la stabilité de celui-ci était inextricablement liée au mode de financement de l'économie réelle dont, par ailleurs, dépend l'emploi et donc la stabilité sociale et politique.
Or, l'essentiel de l'activité bancaire n'est plus le financement de l'économie réelle mais la spéculation.
La fuite en avant des banques centrales dans la production directe ou indirecte de liquidités qui, au lieu de stimuler l'économie réelle, sont venues alimenter la machine à laver spéculative est non seulement inefficace mais dangereuse, puisqu'elle augmente encore le risque d'un nouveau krach.
Comme le dit Adair Turner, l'objectif final d'une véritable réforme de système financier ne saurait se limiter à stabiliser le système, à régler la question des établissements systémiques, même s'il faut le faire, mais « de gérer la quantité de crédit et d'influencer son allocation dans l'économie réelle. » Ce qui signifie, a contrario , limiter l'activité spéculative des banques.
Autrement dit, il s'agit de faire en sorte que le système financier crée de la valeur dans l'économie réelle, ce qui n'est pas le cas (voir partie II).
La stagnation économique, largement à l'origine du malaise social puis de la perte de confiance dans les institutions et le personnel politique vient de l'incapacité du système financier, contrairement à ce qu'assure la théorie, à réaliser une bonne allocation des fonds à sa disposition.
Cette incapacité est renforcée par le dogme néolibéral de l'interdiction de toute intervention économique de l'État - sauf évidemment pour sauver les banques et en Europe pour veiller sur son équilibre budgétaire garant de la qualité de ses dettes et donc les créances des établissements financiers.
D. ÉCHEC DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE RELANCE ÉCONOMIQUE
Faute de moyens de relance économique par voie d'intervention directe de l'État, on se replia sur le levier des politiques monétaires « accommodantes » dont on avait sous-estimé les effets pervers systémiques. L'injection massive de liquidités, accompagnée d'une baisse des taux directeurs à un niveau inimaginable jusque-là, changeant la donne - comme l'analyse Adam Tooze 297 ( * ) - va s'avérer un piège mortel.
Comment, en effet, faire fonctionner un système financier au robinet du crédit grand ouvert, où l'épargnant doit payer pour pouvoir prêter, où les banques et les fonds patrimoniaux, de pensions, etc., ne vivent plus de l'intermédiation 298 ( * ) , mais de placements spéculatifs ?
Comment faire fonctionner une économie quand il devient plus intéressant pour une grande entreprise de racheter ses concurrents que d'investir pour augmenter sa productivité et diminuer ses coûts, pratique poussée à l'extrême par les GAFAM ? (voir partie I)
Les banques centrales se sont prises à leur propre piège : continuer à produire de la monnaie, favoriser l'endettement, pour maintenir à flot l'économie et accessoirement éviter leur propre faillite, sans alimenter la machine à bulle et précipiter la chute finale ? (voir partie I)
C'est évidemment impossible.
Doper la production bancaire de crédit grâce au « quantitative easing » et aux taux très bas, sinon négatifs, c'est, en effet, augmenter la masse de dette privée, le risque de krach et enfermer le financement de l'économie dans le dilemme mortifère des drogués : soit continuer éternellement la production de crédit dont dépendent les cours de la bourse et l'activité économique et risquer un krach majeur à terme, soit ralentir, voire cesser cette production et prendre le risque d'un effondrement boursier et d'une crise économique, lourde de conséquences politiques.
On comprend qu'entre le risque d'un krach à moyen ou long terme et celui d'une crise politique majeure quasi immédiate, l'establishment étasunien ait fait le premier choix.
Après tout, pour un Président, quatre ans de mandat passent vite. En Europe, on a choisi les deux : la stagnation économique et la fatalité du krach !
Ceci dit, il faut constater que la politique des USA, à la différence de celle de l'Europe, a au moins le mérite de la cohérence.
À la différence des responsables étasuniens qui intervinrent immédiatement après le krach de 2008, il fallut, en Europe, beaucoup de temps avant qu'un plan de relance coordonné de la BCE et des États soit opérationnel.
La doctrine de Jean-Claude Trichet et des Allemands se résumait à un non-interventionnisme dogmatique doublé de rigorisme budgétaire, officiellement au motif qu'il en allait de la stabilité de la zone euro.
Le motif véritable était le choix du sauvetage des banques allemandes et françaises qui s'en étaient allées spéculer dans les eldorados qu'étaient devenus les derniers ralliés à l'UE et à la zone euro.
La spéculation sur la dette souveraine menaçant la survie de la monnaie unique, la stagnation économique s'installant et la vague « populiste » enflant, Jean-Claude Trichet laissant la place à un homme de Goldman Sachs - Mario Draghi - la BCE se mit au QE et aux taux très faibles..., tout en maintenant les politiques de rigueur budgétaire et leurs effets calamiteux pour les populations, ce qui était contradictoire.
D'où la construction de l'usine à gaz du MES (voir partie II) accompagnée de la perte de liberté budgétaire des États 299 ( * ) .
Au final, non seulement le bilan de la BCE, gorgé de titres de marché, n'est pas dans un meilleur état que celui de la Fed, mais la stagnation économique s'éternise, voire s'approfondit, en Europe 300 ( * ) .
Pas étonnant donc que l'économie européenne - y compris celle de l'Allemagne - stagne et que les nuages noirs de la contestation politique de cette politique attentiste soient beaucoup plus nombreux et denses sur le vieux continent que dans le Nouveau Monde.
Comment ne pas douter de la compétence de dirigeants et de bureaucrates qui depuis dix ans obtiennent de tels résultats ?
II. URGENCES VITALES
Au terme de dix ans de traitements bricolés d'une crise multiforme qui s'aggrave, les systèmes financier et politique ont ceci de commun d'être bloqués et au bord de l'implosion. Au bord de l'implosion parce que bloqués.
A. UN SYSTÈME FINANCIER AU BORD DE L'IMPLOSION
Rien ni personne ne semble en position d'arrêter la course folle à l'endettement et l'émission de crédit.
Surtout pas les banques centrales qui, prises au piège des contradictions dans lesquelles elles se sont enfermées, au contraire, poussent au crime par leurs émissions monétaires débridées et des taux dignes d'Alice au pays des merveilles, sauf que cette merveille est explosive, sans action perceptible sur le chômage en Europe, et avec des effets sujets à caution aux USA.
Pas non plus les gouvernements, qui n'ont jamais financé leurs dettes à des taux aussi bas !
Mais ce qui rend fondamentalement le système financier incontrôlable et dangereux, c'est son caractère systémique et mondialisé.
Il est, en effet, dominé par des oligopoles, interconnectés à un tel degré que la faillite de l'un entraînerait l'effondrement des autres. Ce sont au total 20 à 30 banques systémiques et, en ajoutant les banques influentes à l'échelle d'un pays, peut-être 140 institutions financières dans le monde.
Le seul bilan agrégé de ces banques systémiques mondiales, qui était de 46 859 Md$ en 2011, a atteint 51 676 Md$ en 2017 soit les deux tiers du PIB mondial.
S'il est mondialisé, c'est avec l'Amérique du Nord et l'Europe pour épicentre, la City de Londres - pour l'instant encore - et Wall Street comme capitales interconnectées, le dollar et l'eurodollar 301 ( * ) pour monnaie et donc la Fed pour principale source de monnaie centrale.
Ce rôle déterminant du dollar - outil financier de la puissance américaine aussi essentiel que son outil militaire - est étrangement minimisé, en positif comme en négatif.
Peu évoqué, en effet, le rôle déterminant des interventions de la Fed, la BCE restant quasi inerte, dans le sauvetage du système financier européen après le krach de 2008 : injection de quelque 10 000 Md$ par le biais de contrats de swap avec la BCE, autorisée à émettre des prêts en dollars, sauvetage de grandes banques européennes rendu possible par l'injection par l'état étasunien de 170 Md$ dans les caisses de l'assureur américain AIG.
Ainsi, en 2009 la Société générale a reçu 11,9 Md$, BNP Paribas 4,9 Md$, Calyon (Groupe Crédit agricole) 2,3 Md$, Deutsche Bank 11,8 Md$, etc.
Cette omniprésence du dollar dans les échanges financiers et économiques n'a pas été seulement conjoncturelle ; indispensable aux échanges extérieurs de l'UE, elle est structurelle : 45 % de ses échanges commerciaux (importations et exportations) s'effectuent en effet en dollar pour 41 % en euro.
Autant dire que l'UE est sous dépendance étasunienne comme vient de le montrer le repli piteux des industriels européens menacés de représailles s'ils ne respectaient pas l'embargo contre l'Iran après dénonciation par les USA d'un traité que l'Europe avait voulu et soutenu à bout de bras.
Ce système financier international vit, de plus, en symbiose avec la part monopolistique du système économique, dominé par les firmes multinationales, dont il assure, si nécessaire, la trésorerie, le financement des acquisitions, les couvertures et les garanties dont elles ont besoin, sous forme de produits dérivés notamment.
Les 100 plus grosses de ces entreprises représentaient une capitalisation boursière de 20 000 Md$ en 2018 soit 15 % de plus qu'en 2017, soit l'équivalent du PIB des USA !
Dans ce classement les Américains surpassent évidemment largement les Européens (en perte de vitesse) et les Chinois en train de les rattraper.
Enfin les deux tiers du commerce international sont réalisés par des firmes multinationales dont la moitié par 1 % d'entre-elles.
1 % des grands groupes font 57 % du total des échanges en 2014, selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
La part des 5 % des premières entreprises exportatrices s'élève, elle, à plus de 80 % des échanges. Et le groupe des 25 % des premiers groupes exportateurs réalise 100 % du commerce mondial. « De véritables rentes et monopoles mondiaux se sont constitués », insiste la Cnuced.
Ces situations « sont le résultat de barrières nouvelles et plus intangibles, reflétant les protections renforcées dont disposent les grands groupes et leur capacité à exploiter les lois et les règles nationales pour augmenter leurs profits et éviter l'impôt », analyse Martine Orange.
Aujourd'hui, contrairement à ce qui se colporte, ce ne sont pas les économies nationales, leurs relations et les échanges entre-elles, équilibrés ou non, qui importent mais les multinationales qui coordonnent des chaînes de valeur d'un bout à l'autre de la planète ainsi que les flux d'argent, en dollars, à l'échelle mondiale.
Comme dit Adam Tooze, « nous devons analyser l'économie mondiale non pas en termes de "modèle insulaire" reposant sur des relations économiques bilatérales - entre deux économies nationales -, mais au moyen de la matrice imbriquée des bilans d'entreprise - de banque à banque-. Ce qui compte donc, dans la prédiction des crises, ce ne sont pas vraiment les déficits publics ou les déséquilibres des comptes courants (des échanges) mais « les ajustements impressionnants (et qui peuvent être fulgurants) susceptibles d'avoir lieu dans cette matrice imbriquée des comptes » entre multinationales et banques systémiques.
Ce qui conditionne vraiment le destin du système financier, ce ne sont donc pas les agrégats économiques nationaux, mais les bilans d'entreprise où se joue véritablement le destin du système financier.
Le Léviathan mondialisé n'a donc que peu à voir avec le « club Med » mondial pronostiqué, au seuil du XXI e siècle et de l'avènement de la zone euro par Alain Minc 302 ( * ) .
Moins de deux décennies plus tard, rares sont ceux qui se risqueraient à de telles vaticinations.
À part quelques optimistes par fonctions, les plus prudents, après avoir rappelé les progrès notables de la régulation bancaire et de la supervision, reconnaissent que tous les clignotants sont au rouge, paramètres économiques compris.
Chacun sait que même la croissance étasunienne, perfusée à l'endettement, est artificielle. En Europe où la stagnation s'est installée, même l'exemplaire Allemagne s'essouffle. Ses prévisions de croissance pour 2019 sont de 0,7 %, soit moins que celle du reste de la zone euro 1,3 %.
Le plus inquiétant c'est que ce décrochage n'est pas conjoncturel, mais plutôt le signe précurseur de la fin du modèle allemand, entièrement guidé par une volonté d'insertion dans les grandes chaînes de production industrielles mondialisées, favorisant le « tout-export » au détriment de la consommation intérieure et de la division du travail productif avec ses partenaires - vidés en partie, eux, de leur substrat industriel - ce qui était la raison d'être du « projet » européen.
Au final, comme le reconnaît le FMI dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde (avril 2019) : « les facteurs de vulnérabilité continuent à s'accumuler ... si bien que les risques à moyen terme qui pèsent sur la stabilité financière dans le monde restent globalement inchangés. »
Trois différences notables cependant avec la crise de 2008, l'une qui pourrait être positive mais qui ne le sera probablement pas, les deux autres clairement négatives.
Le côté positif de la situation, c'est qu'à la différence de la crise précédente que personne, à quelques exceptions, n'avait vu venir, celle qui s'annonce est attendue.
De plus en plus attendue... Le problème c'est que les responsables politiques et financiers, telle la proie que le serpent fascine, ne bougent pas pour autant.
Différence cependant avec 2008, comme on vient de le voir et comme le rappelle Dominique Strauss Kahn ci-dessous, il y avait alors des pilotes dans l'avion, disposant de capacités financières d'intervention, gaspillées depuis.
Pour illustration, on trouvera dans l'encadré ci-après un échantillon représentatif des opinions d'économistes, de responsables politiques ou financiers sur la situation :
|
James Galbraith : « Est-ce qu'une crise est possible ? Oui, sans le moindre doute. C'est une évidence. Je ne peux bien sûr pas dire si cela sera demain, l'année prochaine ou dans cinq ans. Des crises financières il y en a toujours eu, il n'y a pas besoin d'être un expert en économie pour dire qu'il y en aura toujours. Par contre, une crise financière n'a pas forcément les conséquences économiques, politiques et donc sociales que nous voyons aujourd'hui. C'est là la question principale. » (audition) Jean-Claude Trichet : « L'accélération de l'endettement des pays émergents « rend aujourd'hui l'ensemble du système financier mondial au moins aussi vulnérable sinon plus qu'en 2008 » Challenges (4 septembre 2018) Dominique Strauss-Kahn : Réponse à la question, dix ans après le krach de 2008, sommes-nous mieux armés pour faire face à une crise d'une même magnitude ? « Non. Nous avons fait quelques progrès, notamment dans les ratios de capitalisation des banques. Mais c'est très insuffisant. Imaginez que demain la Deutsche Bank ait des difficultés, ce n'est pas les 8 % de capital dont elle dispose qui vont résoudre le problème. En vérité, on est moins bien préparé. La régulation est insuffisante... La coordination a très largement disparu. Plus personne ne joue ce rôle, ni le FMI, ni l'UE et la politique du président des États-Unis n'aide pas. Par conséquent, la mécanique qui avait été mise en place au G20, extrêmement salutaire car elle associait les pays émergents, a volé en éclats. » AFP (9 septembre 2018) Emmanuel Macron : « Je l'ai dit avec force : je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient, sagement assis, confortablement repus, que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qu'ils pensaient inéligibles, ce sont les mêmes qui sont sortis de l'Europe alors même qu'ils pensaient que ça n'adviendrait jamais. C'était souvent les plus amoureux d'ailleurs de cette forme de capitalisme et de l'ouverture à tout crin. Moi, je ne veux pas commettre avec vous la même erreur et donc nous devons réussir à ce que notre modèle productif change en profondeur pour retrouver ce que fut l'économie sociale de marché, une manière de produire, de créer de la richesse indispensable, mais en même temps de porter des éléments de justice et d'inclusion et une manière d'organiser l'innovation partout dans le monde et l'ouverture à même de faire que chacun y trouve sa part. » Discours à l'OIT (11 juin 2019). |
Emmanuel Macron est lucide, le risque d'implosion du système financier n'est pas le seul danger majeur qui menace l'Empire américain et ses provinces, il y a aussi celui de l'implosion politique dont les conséquences sont tout aussi difficiles à prévoir et à maitriser.
B. LA FAILLITE DE LA DÉMOCRATIE NÉOLIBÉRALE
La démocratie libérale occidentale au sens de Fukuyama est, comme on l'a vu, un alliage contradictoire de démocratie et de néolibéralisme (voir partie VI A) , une chimère qui n'a pu survivre qu'en neutralisant son héritage démocratique par une série d'artifices.
En réalité c'est une « démocratie Potemkine » dont la façade démocratique cache les rouages d'un pouvoir dont l'objectif premier est d'assurer la survie du système.
Il y parvient grâce à des institutions et des pratiques permettant de perpétuer au pouvoir une majorité du centre, tout à la fois néolibérale et libérale (au sens politique classique), d'accord sur l'essentiel par-delà les alternances des équipes au pouvoir.
À l'origine du phénomène, la déliquescence de systèmes partisans passés maîtres dans l'art de décevoir leurs électeurs, fortement bureaucratisés, sans assise populaire significative et donc totalement décrédibilisés.
Une telle majorité pour un gouvernement éternel a été rendue possible, d'abord par l'autodissolution de la social-démocratie dans le néolibéralisme et ensuite par l'abandon à droite de la défense de spécificités nationales sentant par trop le moisi, comme le dit Philippe Sollers, les yeux tournés vers l'infini.
Paradoxalement, c'est sa trop grande réussite, sa capacité à imposer des règles du jeu néolibérales à une majorité qui en voulaient de moins en moins, qui a été fatale à cette démocratie en trompe-l'oeil. Vint progressivement, puis sous forme éruptive quand il apparut que ces « élites » étaient incapables de juguler la crise, le moment où il fut évident que tout changement significatif de la ligne néolibérale, inlassablement suivie par les gouvernements successifs, était impossible par le jeu normal des institutions, évident que la « démocratie libérale occidentale » était bloquée.
Les électeurs ont donc fui les urnes, transporté le débat dans la rue sous des formes nouvelles, parfois violentes, et finalement créé le terreau d'alternatives politiques oubliées auxquelles les maîtres du pouvoir n'ont su jusque-là répondre que par le mépris et l'injure : les « populismes ». Se réclamer du peuple (à tort ou à raison c'est une autre histoire) était devenu infamant.
Quoi qu'il en soit, le spectre qui hante aujourd'hui l'Europe et l'Empire, c'est le populisme et ce n'est certainement pas par des injures, des incantations et des formules magiques que l'on répondra aux attentes du peuple, de la majorité des citoyens, comme on voudra, que l'on y parviendra.
C. QUE FAIRE ?
Vu de Sirius, la réponse est simple : le contraire de ce qui a été fait ces cinquante dernières années, autrement dit reconstruire ce que la Grande Transformation néolibérale a détruit, qu'il s'agisse du système financier et de ses finalités, de l'équilibre social, de l'État interventionniste providence.
Sauf qu'un tel programme, même par étapes graduées, n'a aucune chance d'être appliqué.
À ce jour en effet, et pas plus dans un avenir proche pensable, aucune majorité politique, aucun gouvernement n'aura même l'idée de le faire.
Quand bien même l'aurait-il dans un pays - à l'exception peut-être, des USA - les économies, intérêts et forces politiques sont trop imbriqués pour qu'il puisse prospérer.
Le piège s'est refermé.
L'oligopole financier mondial aux commandes contrôle par ses obligés nationaux des pans suffisamment importants de l'économie pour neutraliser toute tentative un peu sérieuse de réforme comme il en fut de celles soutenues pourtant par le G20.
Il faut se rappeler aussi la manière dont Bruxelles et Francfort ont réduit la Grèce, berceau de la civilisation européenne, dont le vieux continent porte le nom d'une de ses princesses mythologiques, à la misère, pour l'exemple et le salut des banques.
Une honte !
Le filet des engagements réciproques consignés dans des traités trompeurs, les intérêts croisés sont tels que la réussite de la plus petite réforme est devenue impossible. Alors les réformes substantielles !
Adam Tooze, au terme d'une analyse fouillée de la dernière décennie va plus loin. Pour lui, les crises multiformes qui se succèdent depuis 2008 sont les multiples épisodes et facettes d'une seule et même crise : celle de l'Empire américain.
Pour être le plus voyant, le krach financier et ses suites ne sont que des pièces de ce vaste ensemble politique, économique et géostratégique.
Il n'y a pas, d'un côté le système financier dont on peut décortiquer la mécanique, les ratés responsables de la crise puis les réparations, les modifications de conduite permettant d'en éviter la répétition et, de l'autre, la sphère économique, sociale et politique subissant un processus qui la domine.
Il n'y a pas le krach financier, ses conséquences et comment faire pour qu'il ne se reproduise pas, mais des mécaniques financières, économiques, géopolitiques, sociales et politiques qui, ensemble, font système. C'est à ce niveau qu'il faut envisager l'évolution de la situation car, encore une fois, le système financier néolibéral et ses excès, la stagnation économique, le chômage de masse, l'explosion des inégalités sociales, la dérive oligarchique des systèmes sociaux et politique, en un mot la sécession des citoyens, qu'elle qu'en soit la forme - absentéisme électoral ou « populisme » - ne sont pas séparables.
On ne peut avoir l'un sans tous les autres.
On aimerait donner raison à Jean-Michel Naulot quand il dit que « La seule question valable ne consiste pas à se demander : que ferait-on en cas de nouvelle crise ? Mais bien comment l'anticiper pour la prévenir ? » , sauf que les forces politiques susceptibles de soutenir un tel programme restent introuvables à ce jour.
Tant que la crise ne sera qu'une probabilité même très forte, qu'existera un espoir de sauver le nouveau Titanic néolibéral, ses armateurs, ses assureurs, ses officiers et les passagers de première classe, l'attentisme primera.
Le problème n'est pas de rédiger une illusoire ordonnance de prescriptions pour sortir du piège mais de rassembler les forces susceptibles de soutenir un tel programme. Le problème n'est ni théorique i technique,, il est politique.
« Les fondements du système monétaire moderne sont politiques, on ne peut y échapper, rappelle Adam Tooze (...) L'argent et le crédit, tout comme la structure du secteur financier qui les chapeaute, sont créés par le pouvoir politique, des conventions sociales et les règles juridiques, contrairement aux chaussures de sport, au Smartphone et au baril de pétrole. La monnaie fiduciaire est au sommet de la pyramide monétaire moderne. Créée et sanctionnée par les États, elle ne repose sur rien si ce n'est son cours légal. »
Le système bloqué, actuellement en place, n'est pas le produit du destin mais d'une politique. Les transformations permettant de le débloquer seront celles d'autres politiques. Ceci dit, qu'aucune politique significative de changement ne peut aujourd'hui aboutir ne saurait être une invitation à attendre passivement mais à se préparer au naufrage inéluctable.
S'y préparer pour limiter les dégâts et préparer l'avenir.
Le mode de traitement calamiteux du krach de 2008 est une invitation à ne pas répéter l'erreur de croire que quelques bricolages du système financier dispenseraient d'une réforme de fond en comble du système néolibéral global.
Pour un pays comme la France, s'y préparer appelle :
- d'une part la révision des modalités de fonctionnement du système financier, du financement de l'économie réelle, et une politique de relance économique ;
- d'autre part, le déblocage des institutions politiques qui les conditionnent ainsi que de faire face démocratiquement aux conséquences de la crise et de conduire les révisions institutionnelles appelées par la situation.
1. Se préparer à l'effondrement du système financier et à ses conséquences économiques
Dans un premier temps, il s'agit d'augmenter autant que les forces contraires le permettent la résilience du système bancaire en réduisant ses liens avec les acteurs de la finance parallèle plus spéculatifs et les moins contrôlables et en recentrant le système bancaire sur sa mission sociale historique : financer l'économie.
Comme le montre excellemment Adair Turner, le mal n'est pas l'endettement mais l'endettement qui n'a pas pour contrepartie une création de richesse nouvelle, l'endettement spéculatif qui se traduit seulement par la hausse du prix des titres de propriété de valeurs déjà existantes.
Il n'est pas de moyen plus efficace de préparer le système bancaire à affronter la tempête et de le préserver de l'effondrement. Le traitement de la spéculation immobilière, vu son importance fera l'objet d'une attention particulière.
Les 10 premières propositions vont dans ce sens :
1. Réduire la dépendance du système financier à la finance parallèle 303 ( * ) ;
2. Limiter strictement le financement bancaire aux opérations de fusions acquisitions des grandes entreprises ;
3. Limiter strictement le financement des hedge funds en limitant l'effet de levier à 5 ou 6 304 ( * ) ;
4. Publier dans une annexe un bilan des interdépendances avec la finance parallèle, ainsi que la liste et les caractéristiques des « véhicules d'investissements spécialisés » 305 ( * ) ;
5. Interdire l'usage de véhicules de titrisation immobilière par les banques ;
6. Adopter la solution britannique pour la séparation bancaire ;
7. Réviser la liste officielle des paradis fiscaux et obliger la publicité des moyens en personnel et financier, de l'activité qui y sont déployés ;
8. Rendre obligatoire un ratio de levier de 10 % 306 ( * ) et moduler le montant autorisé des prêts en fonction de leur affectation ou non à la création de richesses nouvelles 307 ( * ) ;
9. Généraliser l'obligation de passage par une plateforme de compensation pour l'ensemble des produits dérivés 308 ( * ) ;
10. Interdire les prêts immobiliers spéculatifs, dans les zones tendues, à partir d'un montant à définir par la loi.
Il s'agit ensuite de se préparer au moment où, le système financier global se bloquant et le système bancaire s'affaiblissant, quelles que soient les précautions prises, les besoins de l'économie appelleront le concours d'un dispositif de financement de secours.
Construire un tel dispositif par le recyclage de l'épargne des Français - très importante - sur le modèle existant avant la loi bancaire de 1984 et les vagues de privatisations qui suivirent, est donc indispensable si on entend éviter l'approfondissement de la stagnation économique et l'envolée du chômage qui ne manquerait pas de suivre un nouveau krach.
Cette restructuration du système financier serait accompagnée d'une politique interventionniste de relance par l'investissement à laquelle seront associées les collectivités territoriales, acteurs économiques malmenés sous les trois derniers quinquennats et pourtant majeurs.
Ainsi, avec des dépenses d'investissement de 45,5 Md€ en 2018, les collectivités territoriales sont-elles, et de très loin, le premier investisseur public français.
Quant à leurs dépenses de fonctionnement - 169 Md€ en 2018 - elles sont les stimulants permanents de l'économie locale.
Leur rôle économique est non seulement ignoré mais très difficilement repérable dans la comptabilité publique. Outre les dépenses et les investissements classiquement recensés dans les budgets, existe en effet tout un ensemble de partenaires économiques qui ne le sont pas comme agissant pour le compte des collectivités territoriales : concessionnaires, entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte, offices divers 309 ( * ) .
Cette politique d'investissement serait accompagnée d'un soutien indirect à la consommation à travers le développement du service public, des aides aux dépenses contraintes qui pèsent le plus sur les classes populaires et une bonne partie des classes moyennes.
S'y ajouteraient des dispositions visant à combattre l'évasion fiscale, à inciter les multinationales à investir et créer des emplois en France plus qu'elles ne le font aujourd'hui, à la différence des multinationales américaines, italiennes ou allemandes.
Les 12 propositions suivantes vont dans ce sens :
11. Réorienter l'activité bancaire vers le financement de l'économie :
- Par la réduction des activités à caractère spéculatif : augmentation de la taxe existante sur les transactions financières, taxation du trading haute fréquence ;
- Par la fixation d'un pourcentage de 50 % de prêts aux entreprises (avec un minimum pour les PME, très petites entreprises et start up) dans le bilan des groupes bancaires ;
- Par la taxation des financements immobiliers à but spéculatif ;
- Par la limitation stricte des activités exercées dans les paradis fiscaux ;
12. Renforcer la lutte contre l'évasion fiscale en supprimant totalement le « verrou de Bercy » et en autorisant la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) à prendre des initiatives sans autorisation préalable de la DGFIP ;
13. Recréer un puissant circuit de collecte de l'épargne destinée au financement de l'économie et de l'immobilier nouveau non spéculatif autour de la CDC, la BPI, la Banque Postale et éventuellement des banques partiellement ou totalement renationalisées ;
14. Dynamiser le rôle économique des collectivités locales : suppression des restrictions de dépenses, augmentation significative de la DGE, remplacement du formalisme comptable de la Cour des comptes et des chambres régionales par une expertise en matière d'investissements et de développement ;
15. Réduire progressivement puis supprimer les aides ou exonérations fiscales à la « politique de l'offre » qui a montré son inefficience et contrôle de l'utilisation de celles-ci ;
16. Réaliser un grand emprunt national destiné au financement d'un programme de grands travaux, réseaux et moyens destinés aux transports en commun (ferroviaire particulièrement) et aux économies d'énergie ;
17. Aider au pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes par l'amélioration de services publics de la vie courante ;
18. Moduler la fiscalité applicable aux firmes transnationales (FMN) en fonction des investissements et emplois créés ou maintenus en France 310 ( * ) ;
19. Lutter contre la fraude fiscale ;
20. Lancer des plans publics de logements ;
21. Renforcer la politique d'aide personnalisée au logement;
22. Interdire la titrisation immobilière.
Il s'agit enfin de redéployer la politique européenne dans un sens plus favorable aux intérêts de la France qu'actuellement.
Outre le traitement des questions relatives à la politique de relance qui viennent d'être évoquées, il importe de revoir le partenariat français « privilégié » avec l'Allemagne et de réviser les mécanismes plus ou moins conformes aux Traités qui, à l'usage, sont apparus très pénalisants pour la France.
Celle-ci étant le second contributeur au budget européen, derrière l'Allemagne - de loin principal bénéficiaire de la mécanique qui s'est progressivement mise en place - il serait logique de moduler sa contribution en fonction des progrès de la révision de cette situation inacceptable.
C'est le sens des trois propositions suivantes :
23. Renoncer au mirage du « couple franco-allemand » et rechercher les convergences d'intérêts communs avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ;
24. Moduler le versement de la contribution financière de la France aux avancées en matière de :
- dumping fiscal entre partenaires européens. Une conférence des Chefs d'État annuelle, sur ce sujet sera tenue ;
- réduction des déficits et excédents en matière d'échanges de marchandises et de services intra européens 311 ( * ) ;
- réduction de l'excédent budgétaire allemand 312 ( * ) ;
- révision de la parité de l'euro, notamment par rapport aux autres monnaies 313 ( * ) ;
- création d'euro-bonds et mise en oeuvre du plan européen d'investissement ;
- contrôle de la circulation des capitaux spéculatifs en Europe 314 ( * ) ;
- lutte contre les paradis fiscaux ;
25. Remplacer le Système européen de stabilité financière par un financement de ces créances par la BCE.
2. Débloquer les institutions politiques
De son séjour aux USA, l'aristocrate Tocqueville avait tiré la conclusion que la supériorité de la démocratie américaine sur le système aristocratique était de permettre la correction des erreurs : « Le grand privilège des Américains, écrit-il , est de pouvoir faire des fautes réparables. » 315 ( * )
La caractéristique de l'oligarchie technico-financière qui a conquis l'Empire américain c'est précisément, au nom de sa supériorité intellectuelle, de son incroyable réussite financière et politique, d'avoir construit un système de domination non réparable dans le cadre institutionnel ce qui lui assurait une protection totale contre tout assaut démocratique.
Et c'est l'efficacité même de cette démocratie Potemkine, tel l'hubris de la tragédie antique, qui l'a perdue.
N'étant pas réparable, la « démocratie libérale occidentale » doit donc être remplacée.
Mais par quoi ? Toute la question est là.
Au vu de l'histoire de l'entre-deux-guerres, des expériences du socialisme non démocratique stalinien, et plus encore du fascisme, on se met à douter que ce sera inévitablement par la démocratie, même si ce fut le cas du New Deal, démocratique, libéral et interventionniste !
Rappelons une fois encore Polanyi : « On peut décrire la solution fasciste à l'impasse où s'était mis le capitalisme libéral comme une réforme de l'économie de marché au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques. » (La Grande Transformation)
Aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, les mouvements populistes les plus nombreux et qui dans de nombreux pays sont au pouvoir n'ont rien d'anti-libéraux, ils le sont même souvent plus que ceux qu'ils critiquent pour d'autres raisons et dont ils espèrent prendre la place. Beaucoup par contre se passent de la façade démocratique affichée par les néolibéraux ayant pignon sur rue.
Ce sont, avec des nuances qui tiennent aux situations et plus encore à leurs adversaires, des mercantilistes, plus ou moins agressifs à l'extérieur et autoritaires à l'intérieur.
Vu les problèmes que posent dans beaucoup de pays européens la constitution de majorités de gouvernement stables, à moyen terme vu le malaise et les bouillonnements sociaux entretenus par une crise qui n'en finit pas de finir, on se dirige vers la multiplication de coalitions de libéraux de droite et de populistes opportunistes.
Et la France qui se croit protégée de l'extrême droite par sa constitution consulaire n'est pas à l'abri d'une telle issue. Au contraire, ce pourrait être son tendon d'Achille.
En effet, si l'élection d'une représentante du Mouvement National aux présidentielles est peu probable, à l'heure actuelle, celui d'un ou d'une représentant(e) d'une coalition à laquelle participerait l'extrême droite ne l'est pas. On prendra alors conscience de l'effet amplificateur du mode de scrutin majoritaire.
La démocratie néolibérale étant la tentative de concilier légitimité démocratique et une légitimité mercantile qui s'imposerait à la démocratie, sauf à croire à l'harmonie préétablie ou à constater dans les faits qu'elle apporterait l'abondance - ce qui ne fut pas le cas - elle ne pouvait qu'échouer, ce qu'elle fit magistralement par deux fois en deux cents ans.
Ce qui confirme que démocratie et néolibéralisme sont incompatibles.
On en est revenu là où on en était dans l'entre-deux-guerres.
Or un replâtrage populiste autoritaire du néolibéralisme en état de faillite serait reculer pour mieux sauter.
Il ne permettrait ni le déblocage économique, ni de stopper la dérive financière explosive actuelle et encore moins de restaurer la confiance dans les institutions républicaines et la foi en l'avenir.
Ce que seul un nouveau New Deal permettrait.
D'où la nécessité de redonner vie à la démocratie représentative et aux institutions parlementaires qui restent - malgré l'étendue de leurs démissions - le lieu le plus légitime où la souveraineté populaire peut s'exprimer.
Les préconisations de réforme qui suivent sont faites dans cet esprit :
- des préconisations a minima dans la mesure où un règlement du problème au fond supposerait la révision constitutionnelle qu'appelle la situation et que les forces politiques au pouvoir ne sont pas prêtes d'accepter ;
- des préconisations d'avant naufrage qui ne l'éviteront pas mais qui devraient faciliter une reconstruction démocratique de la société et de l'économie qui subsisteront.
Comme l'aurait avoué de Gaulle à Alain Peyrefitte, la Constitution de la V e République a été conçue pour gouverner sans majorité, situation que le Général avait trouvée à son retour au pouvoir et dont il avait pu mesurer les inconvénients avant- guerre.
L'origine du problème actuel c'est que, conçue pour porter remède à un système parlementaire assis sur des majorités faibles et changeantes, type III e et IV e République, la Constitution de la V e République a fonctionné avec des majorités solides puis en béton, progressivement en oubliant l'usage du référendum - ou en en contournant les résultats comme en 2005 -, ni dissolution anticipée de la chambre des députés même après le fiasco de Jacques Chirac en 1997 !
D'un « parlementarisme rationalisé », progressivement et de réforme constitutionnelle en réforme constitutionnelle, on est passé à un « parlementarisme lyophilisé », puis à un régime de type consulaire où l'hôte de l'Élysée devenu chef de la majorité parlementaire en même temps que chef de tout le pouvoir exécutif, concentre tous les pouvoirs.
Un régime qui ignore la séparation des pouvoirs et où le Parlement a été réduit, avec sa complicité active, au rôle de chambre d'enregistrement.
Paradoxe des paradoxes, après le passage de la vague néolibérale, ce chef suprême se retrouvant à la tête d'une administration très affaiblie, d'où la nécessité pour lui de s'appuyer sur les moyens et les intérêts privés, et sur une oligarchie triée sur le volet faisant le lien avec eux.
Ainsi était née une organisation politique, un système « collusif » certes original mais revenant à l'antique confusion entre intérêt public et intérêts privés (voir partie V).
Telle est donc la forme prise en France par la démocratie Potemkine libérale (voir partie VI).
Restaurer la démocratie délibérative suppose donc de redonner du pouvoir au Parlement, par la réforme de son mode d'élection et la restauration du débat parlementaire ;
26. Faire précéder l'élection présidentielle par les élections législatives ;
27. Remplacer, pour les élections législatives, le scrutin majoritaire par une élection à la proportionnelle dans des circonscriptions infra départementales ;
28. Revenir à l'égalité des temps de parole médiatiques (y compris privés) pour les candidats aux élections présidentielles ;
29. Redonner du temps de parole aux parlementaires et mieux répartir ce temps 316 ( * ) ;
30. Renforcer les moyens d'expression des minorités ;
31. Subordonner l'exercice du droit du Gouvernement à limiter l'examen de ses projets de loi à la démonstration de l'urgence ;
32. Réformer la LOLF dont l'organisation nuit à la compréhension des choix budgétaires du Gouvernement sans aucun des avantages qui étaient annoncés ;
33. Réformer le mode de mise en oeuvre de l'article 40 de la Constitution qui progressivement installe une tutelle du Conseil constitutionnel sur le Parlement et le prive de son droit d'initiative et d'amendement en :
- limitant la possibilité d'invoquer préalablement l'article 40 au Gouvernement et aux présidents des assemblées. La décision doit faire l'objet préalablement au débat d'une notification écrite suffisamment motivée ;
- limitant l'extension de la notion de « charges publiques » à celles de l'État au sens de la Constitution et non de la jurisprudence européenne.
34. Supprimer la « règle de l'entonnoir » 317 ( * ) et l'usage extensif et arbitraire de l'article 45 qui, pour gagner du temps, obsession des modernisateurs, à commencer par les responsables des assemblées, revient à tourner la règle de la double lecture 318 ( * ) ;
Il s'agit, enfin, de dissoudre l'État collusif, et pour cela :
35. Limiter les possibilités de pantouflage et les allers retours entre haute fonction publique et emplois dans le privé ;
36. Revoir le mode de nomination dans les grands corps en séparant la formation de ses membres en deux temps - ENA, puis après un temps d'expérience sur le terrain, Institut spécialisé - et en réduisant les nominations au tour extérieur ;
37. Modifier le mode de nomination du Gouverneur de la Banque de France de manière à assurer son indépendance par rapport au lobby bancaire ;
38. Renforcer l'ingénierie publique de manière à réduire la dépendance de l'État à l'expertise privée.
Le dilemme est donc clair : ou attendre le naufrage en espérant qu'il ne viendra pas, ou s'y préparer, car il aura lieu, vu l'incapacité des responsables politiques et financiers d'y remédier.
Quand aura-t-il lieu ? Sans préavis ou après avoir expérimenté une forme de néolibéralisme autoritaire de droite extrême ? Nul ne le sait.
Ce qui importe cependant c'est de préparer le retour des « Trente glorieuses », ce qui suppose la renaissance d'une social-démocratie méritant son nom et d'une droite sociale soucieuse de l'intérêt national. Comme aurait dit le Général de Gaulle : « vaste programme ! »
RÉSUMÉ DES PRÉCONISATIONS
1. Se préparer à l'effondrement du système financier et à ses conséquences économiques
1. Réduire la dépendance du système financier à la finance parallèle ;
2. Limiter strictement le financement bancaire aux opérations de fusions acquisitions des grandes entreprises ;
3. Limiter strictement le financement des hedge funds en limitant l'effet de levier à 5 ou 6 ;
4. Publier dans une annexe un bilan des interdépendances avec la finance parallèle, ainsi que la liste et les caractéristiques des « véhicules d'investissements spécialisés » ;
5. Interdire l'usage de véhicules de titrisation immobilière par les banques ;
6. Adopter la solution britannique pour la séparation bancaire ;
7. Réviser la liste officielle des paradis fiscaux et obliger la publicité des moyens en personnel et financier, de l'activité qui y sont déployés ;
8. Rendre obligatoire un ratio de levier de 10 % et moduler le montant autorisé des prêts en fonction de leur affectation à la création de richesses nouvelles ou non ;
9. Généraliser l'obligation de passage par une plateforme de compensation pour l'ensemble des produits dérivés ;
10. Interdire les prêts immobiliers spéculatifs, dans les zones tendues, à partir d'un montant à définir par la loi.
11. Réorienter l'activité bancaire vers le financement de l'économie.
12. Renforcer la lutte contre l'évasion fiscale en supprimant totalement le « verrou de Bercy » et en autorisant la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) à prendre des initiatives sans autorisation préalable de la DGFIP ;
13. Recréer un puissant circuit de collecte de l'épargne destinée au financement de l'économie et de l'immobilier nouveau non spéculatif autour de la CDC, la BPI, la Banque Postale et éventuellement des banques partiellement ou totalement renationalisées ;
14. Dynamiser le rôle économique des collectivités locales : suppression des restrictions de dépenses, augmentation significative de la DGE, remplacement du formalisme comptable de la Cour des comptes et des chambres régionales par une expertise en matière d'investissements et de développement ;
15. Réduire progressivement puis supprimer les aides ou exonérations fiscales à la « politique de l'offre » qui a montré son inefficience et contrôle de l'utilisation de celles-ci ;
16. Réaliser un grand emprunt national destiné au financement d'un programme de grands travaux, réseaux et moyens destinés aux transports en commun (ferroviaire particulièrement) et aux économies d'énergie ;
17. Aider au pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes par l'amélioration de services publics à la vie courante ;
18. Moduler la fiscalité applicable aux firmes transnationales (FMN) en fonction des investissements et emplois créés ou maintenus en France ;
19. Lutter contre la fraude fiscale et donc supprimer totalement et immédiatement le verrou de Bercy ;
20. Lancer des plans publics de logements ;
21. Renforcer la politique d'aide personnalisée au logement;
22. Interdire la titrisation immobilière.
23. Renoncer au mirage du « couple franco-allemand » et rechercher les convergences d'intérêts communs avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ;
24. Moduler le versement de la contribution financière de la France aux avancées en matière de :
- dumping fiscal entre partenaires européens. Une conférence des Chefs d'État annuelle, sur ce sujet sera tenue ;
- réduction des déficits et excédents en matière d'échanges de marchandises et de services intra européens ;
- réduction de l'excédent budgétaire allemand ;
- révision de la parité de l'euro, notamment par rapport aux autres monnaies ;
- création d'euro-bonds et mise en oeuvre du plan européen d'investissement ;
- contrôle de la circulation des capitaux spéculatifs en Europe ;
- lutte contre les paradis fiscaux ;
25. Remplacer le Système européen de stabilité financière par un financement de ces créances par la BCE.
2. Débloquer les institutions politiques
26. Faire précéder l'élection présidentielle par les élections législatives ;
27. Remplacer, pour les élections législatives, le scrutin majoritaire par une élection à la proportionnelle dans des circonscriptions infra départementales ;
28. Revenir à l'égalité des temps de parole médiatiques (y compris privés) pour les candidats aux élections présidentielles ;
29. Redonner du temps de parole aux parlementaires et mieux répartir ce temps ;
30. Renforcer les moyens d'expression des minorités ;
31. Subordonner l'exercice du droit du Gouvernement à limiter l'examen de ses projets de loi à la démonstration de l'urgence ;
32. Réformer la LOLF dont l'organisation nuit à la compréhension des choix budgétaires du Gouvernement sans aucun des avantages qui étaient annoncés ;
33. Réformer le mode de mise en oeuvre de l'article 40 de la Constitution qui progressivement installe une tutelle du Conseil constitutionnel sur le Parlement et le prive de son droit d'initiative et d'amendement en :
- limitant la possibilité d'invoquer préalablement l'article 40 au Gouvernement et aux présidents des assemblées. La décision doit faire l'objet préalablement au débat d'une notification écrite suffisamment motivée ;
- limitant l'extension de la notion de « charges publiques » à celles de l'État au sens de la Constitution et non de la jurisprudence européenne.
34. Supprimer la « règle de l'entonnoir » et l'usage extensif et arbitraire de l'article 45 qui, pour gagner du temps, obsession des modernisateurs, à commencer par les responsables des assemblées, revient à tourner la règle de la double lecture ;
35. Limiter les possibilités de pantouflage et les allers retours entre haute fonction publique et emplois dans le privé ;
36. Revoir le mode de nomination dans les grands corps en séparant la formation de ses membres en deux temps - ENA, puis après un temps d'expérience sur le terrain, Institut spécialisé - et en réduisant les nominations au tour extérieur ;
37. Modifier le mode de nomination du Gouverneur de la Banque de France de manière à assurer son indépendance par rapport au lobby bancaire ;
38. Renforcer l'ingénierie publique de manière à réduire la dépendance de l'État à l'expertise privée.
* 1 La fin de l'Histoire et le dernier homme, Flammarion - Champs essais.
* 2 L'expression est de Joseph Stiglitz (Prix de la Banque de Suède en sciences économiques) fin 2009 : « Personne ne veut regarder les choses en face. Nous sommes en train de préparer le terrain pour d'autres crises, aussi violentes que celle que nous traversons. Elles détruiront des millions d'emplois à travers le monde. Depuis le début de la crise, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. »
* 3 Le grand ennemi des libéraux, sauf quand c'est pour venir au secours du système financier.
* 4 Communément appelé Prix Nobel d'économie, son intitulé exact est : « Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel », ce qui laisse entendre que l'économie main stream est une science dure.
* 5 Une approche fractale des marchés, dont la première édition est publiée en 2004 aux USA. La seconde édition et sa publication chez Odile Jacob datent de 2009.
* 6 La France moisie est le titre publié par le post-moderne Philippe Sollers dans Le Monde du 28 janvier 1999. Parmi ses nombreuses perles de culture, cet hommage à Édouard Balladur quelques mois avant l'élection présidentielle de 1995 qui l'opposera à Jacques Chirac : « Balladur, quel nom ! C'est quand même mieux que Pompidou, de même que l'Orient de Smyrne fait plus rêver que l'Auvergne de Montboudif. »
* 7 Christopher Lasch : La révolte des élites et la trahison de la démocratie . Commencé dès 1981, l'essai restera inachevé jusqu'en 1995. Édité à titre posthume, il sera publié en 1996 en France aux éditions Climats.
* 8 Comme on sait, les subprimes sont des créances hypothécaires adossées sur des biens dont on savait les propriétaires insolvables. Transformées en titres mêlant des créances douteuses à des créances de qualité moyenne voire bonne, la qualité de ces titres authentifiée par des Agences « indépendantes » de notation ayant pignon sur rue, ils seront vendus un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Ces titres se sont vendus comme des petits pains, car d'un bon rapport et objets d'une spéculation à la hausse qui en augmentait régulièrement la valeur, jusqu'au moment où le doute sur leur fiabilité s'installa.
* 9 Voir le film The big short : le casse du siècle d'Adam McKey qui montre comment les observateurs lucides, anticipant la chute de la valeur des titres assis sur des créances hypothécaires pourries et spéculant à la baisse avec l'aide de banques bien informées -celles-là mêmes qui avaient fabriqué et vendu les titres de subprimes , comme Goldman Sachs qui afficha un profit record de 11,6 Md$ sur l'exercice 2007- amassèrent une fortune.
* 10 Parmi les perles les plus fines, celle d'Alain Minc, l'un des idéologues libéraux français, les plus en vue, dans sa tribune du Figaro (Vox) du 23 août 2019. « Nous avons cru en des lois économiques qui se trouvent aujourd'hui invalidées par les faits. Aussi avons-nous besoin de grands penseurs à la hauteur de ces bouleversements », alerte l'essayiste.
« Nous avons depuis cinquante ans été formés à respecter des tables de la loi économique peu nombreuses mais très strictes : le plein-emploi crée l'inflation et celle-ci pousse les taux d'intérêt à la hausse. Le financement de l'État par une banque centrale est un anathème car facteur d'inflation. La création monétaire doit demeurer dans des limites raisonnables sous peine, là aussi, de nourrir l'inflation. Et enfin, plus globalement, une révolution technologique engendre des progrès de productivité qui constituent le meilleur adjuvant de la croissance. Les dix dernières années viennent de nous démontrer que ces principes fondateurs n'ont plus lieu d'être et nous sommes, dès lors, désemparés car privés de boussole macroéconomique. »
Le même qui pouvait écrire en 1996, « Je ne sais pas si les marchés pensent juste, mais je sais qu'on ne peut penser contre les marchés. » ( La mondialisation heureuse ). Certes, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais c'est probablement parce qu'ils manquent d'estomac.
* 11 Rapport sur la stabilité financière dans le monde (Fonds monétaire international, avril 2019).
* 12 À comparer aux 2 % de croissance entre 1974 et 2007, aux 1,3 % de croissance du PIB annoncé pour 2019 et à l'effondrement général de la productivité.
* 13 Adam Tooze, Crashed (Les belles lettres).
* 14 Conclu en mars 2016 cet accord entre l'UE, sous l'impulsion de l'Allemagne, et la Turquie permettait, pour l'essentiel, le retour en Turquie des migrants partant de ce pays vers la Grèce qui ne satisfaisaient pas les critères leur permettant d'obtenir le statut de réfugié en Europe. Pour parler crument, à la Turquie d'en faire son affaire plutôt que l'Europe.
En contre-partie la Turquie recevait 3 Md€ d'aide supplémentaire et bénéficiait, sur fond de réouverture des négociations sur son adhésion à l'UE, de facilités d'accès de ses citoyens en Europe.
Exécuté de manière chaotique depuis le départ, l'accord sera récemment dénoncé.
* 15 Le prince Grigori Potemkine nommé gouverneur du Sud de la Russie après la victoire de celle-ci sur les Turcs en 1783, devenu le favori de l'Impératrice Catherine II est, selon le témoignage de diplomates qui ne lui voulaient pas forcément du bien, l'auteur d'une supercherie devenue célèbre : cacher la misère des villages de Crimée que l'impératrice devait visiter lors d'un voyage en les dotant de façades de carton-pâte bien plus riantes que la réalité.
* 16 France insoumise sur une de ses faces, l'autre se rattachant à la social-démocratie interventionniste classique.
* 17 Elle vise à ôter le droit aux banques de créer de la monnaie, réservant ce privilège à l'État. On mesure l'audace d'une telle proposition.
* 18 « La civilisation du XIX e siècle reposait sur quatre institutions. La première était le système de l'équilibre des puissances ; la deuxième, l'étalon-or international, symbole d'une organisation unique de l'économie mondiale ; la troisième, le marché autorégulateur, qui produisit un bien-être matériel jusque-là insoupçonné ; la quatrième, l'État libéral... Parmi ces institutions, l'étalon or est celle dont l'importance a été reconnue décisive ; sa chute fut la cause immédiate de la catastrophe. Quand il s'effondra, la plupart des autres institutions avaient été sacrifiées dans un vain d'effort pour le sauver ». (Karl Polanyi - La Grande Transformation )
* 19 « La haute finance, institution sui generis propre au dernier tiers du XIX e siècle et au premier tiers du XX e , fonctionna, au cours de cette période, comme le lien principal entre l'organisation politique et l'organisation économique mondiale. Elle fournit les instruments d'un système de paix internationale, qui fut élaboré avec l'aide des puissances, mais que les puissances elles-mêmes n'auraient pu ni créer ni maintenir... »
« En réalité, le commerce et la finance furent responsables de nombreuses guerres coloniales, mais on leur doit aussi d'avoir évité un conflit général. Chaque guerre, ou presque, était organisée par les financiers ; mais ils organisaient aussi la paix. » (Karl Polanyi - La Grande Transformation )
* 20 Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936, Traduction 1969, Payot
* 21 La pauvreté dans l'abondance, Gallimard, Tel 2002.
* 22 À l'exception notable de l'Espagne et du Portugal, dont les régimes avaient su mener double jeu durant la guerre, et devenus bien utiles quand la Guerre Froide aura remplacé la Guerre Chaude.
* 23 L'argent - (Gallimard).
* 24 L'Âge des extrêmes : le court XX e ?siècle , Le Monde diplomatique - André Versaille éditeur.
* 25 Le Minotaure planétaire - Éditions Enquêtes et Perspectives.
* 26 Karl Polanyi, né en 1886 sous François-Joseph I er d'Autriche, est un intellectuel hongrois inclassable, tout à la fois anthropologue, sociologue, historien et économiste, journaliste, écrivain et militant politique. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il émigre à Londres, puis aux USA où il enseignera, notamment à l'université de Columbia.
Paru en 1944 aux USA, La Grande Transformation est l'ouvrage qui le rendra célèbre. À noter qu'il faudra attendre 1983 pour qu'une traduction en soit donnée aux éditions Gallimard, disponible actuellement dans la collection Tel. Disponibles aussi en français : Essais de Karl Polanyi (Seuil 2008) qui traite, notamment de la crise économique mondiale, des rapports entre économie et démocratie, du fascisme etc. ; La subsistance de l'Homme (Flammarion 2011) qui traite de la place de l'économie dans l'histoire de la société.
* 27 Louis Dumont, préface à l'édition française de La Grande Transformation de Karl Polanyi
* 28 Maxime attribuée à Vincent de Gournay (1712-1759)
* 29 Un exemple récent très significatif est l'étude que le Centre de Politique Européenne, un think tank libéral allemand, vient de consacrer aux effets de l'euro sur les croissances respectives des pays de la zone. Elle montre que seuls l'Allemagne et les Pays-Bas massivement, sont gagnants, tous les autres perdants, particulièrement la France et l'Italie. Le CPE conclut-il pour autant que la France et l'Italie auraient intérêt à quitter la zone euro ? Que nenni !
« Au lieu de conseiller à la France de reprendre le contrôle de sa monnaie, et donc de précipiter la fin de la monnaie unique, commente le Figaro, le think tank souligne plutôt l'importance d'engager des améliorations structurelles sur l'économie et l'État : « des réformes structurelles sont nécessaires maintenant ». Jusqu'à donner un avis très personnel sur la politique économique française : « pour profiter de l'euro, la France doit suivre avec rigueur la voie de la réforme du président Macron », conclut l'étude. (Le Figaro 27/02/2019)
* 30 « L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle - tous éléments créés par l'initiative capitaliste. [Ce mouvement perpétuel de mutations industrielles] révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. » (Joseph Schumpeter : Capitalisme, socialisme et démocratie , éditions Payot)
* 31 Karl R. Popper : Conjectures et réfutations, Éditions Payot
* 32 Les propos de la Commission d'enquête préparatoire à la loi sur les pauvres entendent montrer que, contrairement aux apparences, cette modernisation est un progrès pour tous, y compris pour ceux qui en souffriront le plus, refrain appelé à un grand avenir : « Personne en Europe, si ce n'est en Angleterre, n'a eu l'idée que l'assistance, obligatoire ou volontaire, doive servir à autre chose qu'à secourir l'indigence, c'est-à-dire l'état d'une personne incapable de travailler ou d'obtenir, en échange de son travail, le moyen de subsister. On n'a jamais considéré comme normal d'étendre l'assistance jusqu'à secourir la pauvreté, c'est-à-dire l'état d'une personne qui est obligée d'avoir recours au travail pour obtenir uniquement de quoi subsister.
Les témoignages recueillis par la Commission permettent de penser qu'un système obligatoire d'assistance aux indigents peut fonctionner valablement pour tous selon des principes clairement définis ; une fois admis ces principes, on pourrait offrir une protection meilleure qu'aujourd'hui contre le danger de mourir dans le dénuement, tandis que seraient réprimés la mendicité et le vagabondage, puisque tous deux seraient privés de leur meilleur argument, la crainte de mourir de faim. »
L'une des dispositions les plus emblématiques de la loi, est la fin de l'assistance aux indigents en tant que tels et leur enfermement en workhouses ou « maisons de travail » dans des conditions particulièrement sévères. Pas d'assistance sans travail en contrepartie.
* 33 La création d'un marché du carbone, plus clairement parlant des droits à polluer, en est la forme la plus aboutie à ce jour mais il ne faut pas désespérer.
* 34 Ce marché existe déjà dans certains pays - marché d'organes, location d'utérus pour couples en mal d'enfants - et il n'y a aucune raison qu'il ne se généralise pas. Le dernier avis du comité consultatif national d'éthique sur la gestation pour autrui est un bon indice de cette évolution.
* 35 L'expression est celle de la BCE, elle-même, dans son rapport 2018, qui conclut évidemment positivement : « Dix ans après le début de la crise financière mondiale, les principales réformes réglementaires qui ont contribué à rendre le secteur financier plus résilient sont presque achevées ».
* 36 Henri Sterdyniak est conseiller scientifique à l'OFCE, Audition du 4 février 2016 dans le cadre du rapport Une crise en quête de fin .
* 37 Maurice Allais (1911-2010) a été le premier et pendant longtemps le seul lauréat français du « prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel », connu sous le nom de « prix Nobel d'économie »
* 38 Jean Gabriel Bliek, économiste, entretien avec l'auteur
* 2 Directeur de la Banque d'Angleterre de 1928 à 1941
* 39 En fait, les choses peuvent, comme ce fut le cas en 2008, aller très vite et rapidement la crise de solvabilité se superposer à la crise de liquidité, laissant croire qu'il suffit d'injecter de la monnaie banque centrale pour régler le problème, alors qu'il faut aussi recapitaliser les banques concernées ou les vendre à une plus grosse, susceptible de faire face à son passif.
* 40 Adam Tooze, Crashed, Les belles lettres.
* 41 Ainsi, l'évaluation de la dette mondiale totale oscille entre 2 et 2,6 fois le PIB et en valeur absolue entre 184 000 Md$ et 240 000 Md$ (chiffres fin 2017)
* 42 En période d'incertitude, les créances les plus liquides (les plus facilement négociables comme les dépôts bancaires) sont celles qui peuvent demander le plus vite leur remboursement.
* 43 Extrait du Conseil de la Banque centrale américaine - Février 1929, quelques mois avant le krach, rapporté par Jean-Michel Naulot (Blog 18 octobre 2018)
* 44 Cette baisse est essentiellement due à l'apurement des dettes hypothécaires massives à l'origine du krach
* 45 Martine Orange Les banquiers centraux face à la plus grande expérimentation monétaire , Médiapart - 25 août 2016.
* 46 Global economy - 13 octobre 2018.
* 47 William White est un économiste canadien, ancien gouverneur adjoint de la Banque du Canada, ancien chef du Département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux et ancien président du Comité d'examen des questions économiques et du développement à l'OCDE. Les citations sont extraites de son article La mauvaise lune financière se lève du 3 octobre 2018 publié dans Project Syndicate, organisation non gouvernementale regroupant 67 journaux du monde et basée à Prague.
* 48 Gunther Capelle-Blancard : La taxation des transactions financières : une vraie bonne idée. Communication au Conseil scientifique de l'AMF
* 49 85 e rapport annuel - 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 - 28 juin 2015
* 50 Bulletin de la Banque de France n° 2018 - juillet 2018.
* 51 BNP-Paribas Securities services - 22 décembre 2017
* 52 Blog - 18 octobre 2018
* 53 Cité par Adair Turner op cit.
* 54 Selon Jean-Michel Naulot, seuls seront concernés 40 % des produits dérivés : toutes les opérations de change vont rester en dehors de ce système, tout comme les dérivés de matières premières, les produits « non liquides ». Au lieu de généraliser cette obligation, on a choisi une solution entre deux alors que 92 % des produits dérivés aujourd'hui sont traités entre acteurs financiers, ce qui permet de relativiser leur intérêt pour l'économie ! C'est-à-dire entre des « asset managers », des banques et des hedge funds .
* 55 La tentation de création de nouveaux mastodontes bancaires est cependant toujours là, comme la tentative de fusion, soutenue par le ministre des Finances allemand Olaf Scholz, de Deutsche Bank avec Commerzbank, au début de l'année 2019. Finalement, devant le tollé soulevé par le projet, l'affaire échouera.
* 56 Le grand « Develeraging » qui fut un moment l'objectif prioritaire de la Fed.
* 57 Déjà les recours des banques contestant le calcul de leurs contributions, devant la cour de Luxembourg, se multiplient.
* 58 Même des activités de fonds d'investissements parfaitement transparentes, mais non réglementées ou trop peu, fragilisent le système par la grande liberté de retrait des fonds investis. En cas de panique les effets en chaîne pourraient être catastrophiques. La grande majorité des placements européens sont, en effet, de ces « fonds ouverts », c'est-à-dire sans limitation temporelle des retraits.
* 59 Conférence sur les finances parallèles (La Tribune du 26 avril 2018)
* 60 L'économie mondiale 2017 : Les réformes bancaires ont-elles été poussées trop loin ?
* 61 Adair Turner, Reprendre le contrôle de la dette , Éditions de l'Atelier.
* 62 « Ce système en Suède est complétement fou car en fait les gens ne remboursent pas le capital - maintenant il y a eu des changements - ils ne remboursent que les intérêts et transmettent les intérêts. Vous avez une sorte d'endettement indéfini par génération. » (Romaric Godin)
* 63 Martine Orange : Le testament de Mario Draghi , Médiapart du 25 juillet 2019.
* 64 Romaric Godin, audition.
* 65 Romaric Godin, audition.
* 66 Sont particulièrement concernées les entreprises de haute technologie, ce qui rappelle furieusement la bulle de 1999-2001.
* 67 Fin 2017, le créateur de l'indice PER, prix de la banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, Robert Shiller alertait sur les similitudes entre Wall Street aujourd'hui et Wall Street à la veille du krach de 1929 : « Le marché est aussi cher qu'en 1929 » avait-il déclaré à CNBC.
* 68 Nouriel Roubini est Professeur à la Stern School of business, Université de NY, et consultant
* 69 Vidéo Xerfi Canal : GAFAM et autres géants du net - Un capitalisme financier monopoliste.
* 70 Banque de France : Rapport sur l'évaluation des risques du système financier (2018)
* 71 Site TB Economie https://business.freefrencharticles.com/index.php/author/wp_admin
* 72 Les fonds indiciels sont des portefeuilles gérés par des algorithmes de manière à ce que leur valeur soit celle d'un indice de référence, le CAC 40 par exemple.
* 73 Tribune Le Monde du 13 septembre 2018.
* 74 Ce fut le cas à certains moments d'incertitude suscitée par les conséquences du Brexit sur le marché des changes londonien et la cotation de la livre sterling.
* 75 À l'époque, les petits malins qui avaient misé sur la chute des subprimes (voir le film : The big short ) ainsi que Goldman Sachs qui vendait des subprimes à ses clients, tout en se protégeant par des CDS d'une baisse des cours de ces créances douteuses, baisse qu'il entretenait par ailleurs, firent-ils une fortune avec ce qui allait devenir le krach du siècle.
* 76 Guillaume Alméras BFM Business 28/11/2018.
* 77 Le Figaro du 11 avril 2019.
* 78 Blog Michel Crinetz - 18 juillet 2018 - reference au rapport de la Commission : In-Depth Analysis - How demanding and consistent is the 2018 stress test design in comparison to previous exercises ? - PE 614.512 - Committee on Economic and Monetary Affairs
* 79 Deux anciens de Goldman Sachs, Mario Draghi puis Mark Carney ont été nommés à la présidence du Conseil de stabilité financière, bras armé du G20 ; Mario Draghi deviendra président de la BCE ; Obama s'est entouré de tous ceux qui avaient lutté contre l'encadrement de la finance du temps de Clinton. Quant à la France, « on a tenu un double discours sur la réforme de la finance ». (Jean-Michel Naulot)
* 80 La France n'était tellement pour rien dans la crise que le premier établissement bancaire à cesser sa cotation de titres assis sur des subprimes en Europe dès août 2007, fut BNP-Paribas, qui reçut 4,9 Md$ du réassureur étasunien AIG, le groupe Crédit agricole recevant 2,3 Md$, opportunément renfloué par l'État américain. Dur-dur la mondialisation, on n'est jamais pour rien dans ce qui arrive. Sauf que les banques européennes, notamment françaises, ont activement participé au système financier, pas simplement étasunien, qui s'est progressivement mis en place de part et d'autre de l'Atlantique.
Dans un récent ouvrage l'historien et économiste Adam Tooze ( Crashed, Comment dix ans de crise financière ont changé le monde , éditions Les Belles-Lettres, novembre 2018) rappelle qu'en 2008, 1 000 Md$ étaient investis par les banques européennes dans la dette et les billets de trésorerie des USA. Pour lui, les banques agissaient alors comme un « fonds spéculatif mondial ».
* 81 Martine Orange Médiapart du 4 février 2017.
* 82 Obligations de longue durée mieux rémunérées que les obligations ordinaires mais dont le remboursement en cas de problème n'est pas prioritaire et considérées comme de quasi-fonds propres.
* 83 Selon la doctrine, le chômage n'est qu'un sous-produit d'un marché du travail non concurrentiel du fait de l'existence de lois, de règlements, et de syndicats qui empêchent les salaires de baisser autant qu'ils le devraient pour permettre le plein développement des forces productives.
C'est à Denis Olivennes (haut fonctionnaire et « pantoufleur » d'élite), que revient la paternité, dans une note de la Fondation Saint Simon (février 1994) - en pleine guerre du franc fort - de l'expression « préférence pour le chômage ». Pour les libéraux, l'origine du chômage c'est l'égoïsme de ceux qui ont un emploi - trop payés- et qui refusent de partager. Comme on le verra, le remède au chômage de masse sera le développement de la précarité. Le chômage de masse écrit Olivennes « est le produit d'un choix collectif inavoué : [la France préfère] une logique du revenu, notamment à travers les transferts sociaux, à une logique de l'emploi. » Par emploi, il faut entendre évidemment, un emploi payé et exercé dans les conditions que voudra bien fixer l'employeur.
* 84 Formellement d'Édouard Philippe, Premier ministre. Mais il y a bien longtemps que sous la V e République, le véritable chef du gouvernement qui définit et conduit la politique de la France c'est le Président de la République.
* 85 Paradoxalement, en matière d'emploi, les champions incontestés du libéralisme, les USA, sont beaucoup plus interventionnistes que les pays européens après 1983. En témoignent le double mandat de la Fed (assurer le plein emploi et la stabilité des prix) plus un troisième, assurer des taux d'intérêt à long terme modéré. À comparer avec la BCE, monomaniaque dans sa lutte contre l'inflation même inexistante.
* 86 La poussée de chômage des années 1992 à 1999 renvoie aux effets de la politique de « désinflation compétitive » et du « franc fort » préparatoire à la création de l'euro.
* 87 Minoration du nombre de demandeurs d'emploi : augmenter la population carcérale (USA), transformer des chômeurs en handicapés ou malades permanents (Grande-Bretagne), durcir les conditions d'inscription sur le registre des demandeurs d'emplois ou assouplir les règles de radiation (France)...
* 88 En Allemagne
* 89 Allemagne, Grande-Bretagne
* 90 USA, Allemagne, Italie, France...
* 91 « Mini job », « emplois zéro heure » (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie)
* 92 Libération du 18 décembre 2018.
* 93 Selon La Tribune du 9 mars 2018, la part des travailleurs pauvres en zone euro est passée de 7,3 % en 2006 à 9,5 % en 2016.
* 94 Pour connaître ce qu'est la vie d'un travailleur pauvre au Royaume-Uni, on verra avec profit le film de Ken Loach : Sorry we missed you.
* 95 Seuil de pauvreté fixé à la moitié du revenu médian (855 euros par mois pour une personne seule en 2016). Si on fixe le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian (1 026 euros), on en compte deux millions.
* 96 Officiellement 70 % du temps partiel féminin serait volontaire. Difficile d'en juger mais 60 % paraît plus près de la réalité.
* 97 Enquête auprès des Jeunes européens, préparée par le Secours populaire français (Octobre 2018).
* 98 Adair Turner Reprendre le contrôle de la dette, Éditions de l'Atelier.
* 99 L'Express - 3 mars 2009.
* 100 Trésor éco n° 206, septembre 2017. Le Trésor confirme que, selon les critères admis, la France est bien en situation de stagnation puisqu'avant la crise de 2008, la croissance potentielle de l'économie française était de l'ordre de 2 %, alors qu'elle tourne autour de 1,25 % entre 2017 et 2020. Au-dessous de 2 % on peut d'ailleurs se demander de quelle « croissance » on parle, en tous cas, pas d'une croissance créatrice d'emplois.
* 101 La théorie de la « stagnation séculaire » d'Alvin Hansen a été formulée, la première fois, dans un article de 1939. La cause en serait la fin de la croissance démographique et du progrès technique entraînant une sorte d'anémie de l'économie. Une telle théorie a l'avantage de dédouaner le système capitaliste libéral d'avant-guerre de toute responsabilité dans la crise et ses séquelles économiques. D'où son caractère inusable.
* 102 Comme le déclarait Éric Woerth, alors ministre du Budget, le 26 septembre 2008 :
« La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte. ». Elle aurait pu, en effet !
* 103 Toujours perspicace, la BCE, alors présidée par Jean Claude Trichet - ancien directeur du Trésor, ancien gouverneur de la Banque de France, champion de la « désinflation compétitive » à laquelle se convertira Pierre Bérégovoy, mis en examen pour avoir cautionné la minoration du « trou » du Crédit Lyonnais, alors banque publique, puis relaxé par le Tribunal de Paris- prenant cette reprise ponctuelle pour argent comptant et craignant une inflation imaginaire, augmente en juillet 2011 son taux directeur de 0,25%. Mario Draghi nommé en novembre mettra bon ordre à ces inconséquences.
* 104 « Perspectives économiques intermédiaires » OCDE (septembre 2018 et mars 2019)
* 105 Les gains de productivité mesurent à moyens égaux l'accroissement de la production. Le produit de cette richesse supplémentaire est réparti entre salaires, profits et éventuellement hausse des prix. Plus de salaire, c'est plus de consommation et donc un effet de relance sur l'activité économique et l'emploi ; plus de dividendes c'est en principe plus d'investissement donc de dépenses en biens d'équipement et une amélioration de la compétitivité.
* 106 Le Monde, 28-29 avril 2019.
* 107 Il s'agit en fait d'une enveloppe d'autorisation de crédits utilisés finalement au coup par coup sous forme d'apports en capital. Une partie de ces crédits sera utilisée pour le plan de relance -ARRA- engagé par Barack Obama dès sa prise de fonction à la présidence. Ainsi, des entreprises, comme General Motors et Chrysler, seront-elles-renflouées.
Au final seulement 421 Md$ seront déboursés et intégralement remboursés selon les autorités étasuniennes, banques et entreprises étant « revenues à bonne fortune. » (Challenge du 11 septembre 2013)
* 108 GM rachètera son capital quatre ans plus tard. En difficulté de nouveau, l'entreprise recevra une aide de l'État sous forme de subventions pour sa voiture électrique. À l'annonce de la suppression de 8 000 emplois, Donald Trump menacera de les supprimer.
* 109 Essentiellement des garanties payantes interbancaires, l'enveloppe destinée aux recapitalisations se limitant à une centaine de Md€ pour les trois plans principaux : France, Allemagne, Espagne.
* 110 Suspension temporaire des transactions pour trois des fonds de BNP Paribas adossés à des titres immobiliers étasuniens.
* 111 Le même qui en 1999, alors employé de Goldman Sachs, avait orchestré le maquillage des comptes de la Grèce pour lui permettre de réduire artificiellement sa dette et ainsi de remplir les conditions d'adhésion à la zone euro. Les responsables européens regardant ailleurs, la manoeuvre a consisté à faire passer en hors bilan une partie de cette dette.
Comme répondit Roosevelt à ceux qui lui reprochaient d'avoir nommé un escroc à la tête de la SEC, l'organe de contrôle de la bourse nouvellement créé - en l'occurrence Joseph Kennedy, le père du futur président - : « il en faut un, pour en attraper un » (« Takes one to catch one »).
* 112 En France, le « Haut conseil des finances publiques », présidé non par un élu, mais par le président de la Cour des comptes, un irréprochable libéral.
* 113 Naissance de la biopolitique - 1979.
* 114 Avec l'aide active des USA pour lesquels la reconstruction et la résurrection de l'Allemagne, poste avancé de leur conflit avec l'URSS, est indispensable.
* 115 Le Deutsche Mark (DM) remplacera le Reichsmark (RM).
* 116 « La guerre de sept ans - Histoire secrète du franc fort 1989-1996 » d'Eric Aeschimann et Pascal Riché (Calmann Lévy 1996).
* 117 « Avec la construction de la monnaie unique, la doctrine du franc fort a trouvé son plus bel écrin, sa plus belle justification. L'une et l'autre ont vite été présentées comme l'avers et le revers de la même médaille. Toutes les tautologies rhétoriques sont devenues possibles. Le franc fort était la seule clé pour ouvrir la voie à la monnaie unique ; la monnaie unique, à l'inverse était le seul moyen de « sortir par le haut » des contraintes du franc fort » (« La guerre de sept ans » p. 86).
* 118 « Une crise en quête de fin », rapport d'information Sénat n° 393 (2016-2017), audition de Jacques Sapir (p. 195)
* 119 Ainsi, lors de la conférence nationale des territoires du 4 juillet 2017, au Sénat, transparaissait à travers les interventions de François Baroin, ancien ministre du Budget de Jacques Chirac venu, en principe, plaider la cause des communes, et du ministre du Budget d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, une commune fierté d'avoir assumé pour l'un ou d'assumer pour l'autre, le rôle impopulaire de gardien de la rigueur, la fierté du sacrifice assumé pour une noble cause !
* 120 L'Argent - Gallimard Idées
* 121 Ainsi dès le premier trimestre 2016, le taux de marge des entreprises était-il de 32,1 %, son plus haut niveau depuis le début de la crise financière de 2008 (Insee), sans que l'on sache combien a été consacré à l'investissement.
* 122 Constatons que cette gabegie d'argent public a moins scandalisé les « grands médias » que les agapes entre amis du Ministre d'État en charge de l'écologie, plus pittoresques certes, mais incontestablement moins coûteuses.
* 123 « CICE : Pour 110 milliards, t'as (presque) rien » Justin Delépine ( Alternatives économiques du 19 octobre 2018).
* 124 Romaric Godin, Médiapart du 30 janvier 2019
* 125 Voir notamment la réforme Pénicaud de 2018 en France dont nous ne recommandons la lecture qu'aux connaisseurs.
* 126 « Le moment est-il propice à une relance des investissements dans les infrastructures ? Les effets macroéconomiques de l'investissement public - Perspectives de l'économie mondiale - Octobre 2014. »
* 127 Article publié dans La pauvreté dans l'abondance (Gallimard)
* 128 Ces « project bonds » - emprunts contractés en commun - succèdent aux « euro-obligations », dont la création avait été proposée par François Hollande à Angela Merkel et refusée sèchement par la chancelière : « des euro-obligations ? Pas de mon vivant ».
* 129 Conférence de presse organisée en janvier 2014, lors de la présentation du Pacte de responsabilité.
* 130 Romaric Godin, Médiapart du 25 septembre 2017.
* 131 Économiste europhile, ancien membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron.
* 132 La Tribune du 26 juin 2018
* 133 À comparer avec Renault : pour une capitalisation boursière 2018 de 33,9 Md€, un chiffre d'affaires de 40,9 Md€ et un bénéfice de 0,58 Md€. Le ratio bénéfice/ valeur boursière pour LVMH est de 3 % et pour Renault de 0,4 %. Ce qui montre bien que la valeur boursière reflète autre chose que les performances des entreprises.
* 134 Marché des titres déjà existants.
* 135 Martine Orange
* 136 Mode de calcul : la dernière évaluation du bilan total du système bancaire français, un chiffre qui ne court pas les rues, remonte à 2016 (voir Finances et Stratégie le 7 mars 2018). Elle est cohérente avec les évaluations des bilans des 6 plus grandes banques françaises dont on dispose par ailleurs : 7 300 Md€ en 2017.
Pour calculer le dernier ratio, nous avons considéré que l'encours des crédits bancaires aux PME représentant 42 % du total des crédits aux entreprises, il en allait de même des seuls crédits d'équipement.
* 137 Rapport d'information n° 393 (2016-2017) « Une crise en quête de fin » (p.106)
* 138 La plaquette ne dit pas que le taux moyen des prêts aux grandes entreprises est de 1,25 % et celui accordé aux petites de 2 % (HCSF rapport 2018)
Le rapport cité note que : « Une large part de l'endettement des grands groupes finance des acquisitions, en particulier vers l'international... De plus, certaines de ces acquisitions se font au moyen de financements à effet de levier (ou LBO), avec un endettement très conséquent. »
* 139 Faute d'explications, on se demande d'où sort ce chiffre. Une hypothèse : il s'agit non pas des actifs tels qu'ils ressortent des bilans mais des actifs affectés d'un coefficient de risque évalué par les banques. Les investissements dans les entreprises étant tenus par les agences de notation pour plus risqués que les autres, il ne serait pas étonnant que l'exposition ainsi recalculée soit supérieure au montant des actifs eux-mêmes !
* 140 Pierre-Charles Pradier : professeur d'économie Paris 1 Panthéon Sorbonne, co-directeur du Labex ReFi.
* 141 Thierry Philipponnat
* 142 L'indice Cac 40 a été créé en 1987
* 143 Martine Orange
* 144 Selon la Banque de France (publication mai 2019), l'encours des crédits aux particuliers dévolus aux logements se monte à 1 032 Md€, soit en ajoutant les 290 Md€ consacrés à l'immobilier d'entreprise 1 322 Md€ affectés au financement de l'immobilier, à comparer aux 448 Md€ consacrés à l'investissement des entreprises : 3 fois moins.
* 145 Alan Turner op cit
* 146 Selon une étude de Jordà et divers auteurs, citée par Turner
* 147 Ainsi, en 1990 - en pleine bulle immobilière dont l'Empire du soleil levant ne s'est jamais remis - le foncier japonais valait 5,2 fois le PIB du pays. La valeur des jardins du palais impérial de Tokyo, s'ils avaient été constructibles, équivalait à celle du foncier de toute la Californie, celle du quartier de Chiyoda dans le centre de Tokyo, la valeur du foncier de tout le Canada. Après le Krach tout s'est effondré, de 80 % dans certains cas. Ce fut la catastrophe pour les entreprises japonaises qui avaient misé sur une hausse infinie des prix de l'immobilier. Pour se désendetter, elles se mirent à thésauriser, réduisant d'autant leurs investissements, d'où la récession dont le Japon n'est pas encore sorti. On ne tira, évidemment, aucune leçon de l'expérience, renvoyant ces péripéties aux spécificités japonaises.
* 148 Le Monde du 13 mai 2019.
* 149 Audition au Sénat le 28 janvier 2016 - Gunther Capelle-Blancard est professeur des universités en sciences économiques
* 150 Adair Turner : Reprendre le contrôle de la dette.
* 151 Situation de l'emploi aux USA selon Donald Trump fin février 2017 : 94 millions d'Américains sont en dehors du marché du travail ; plus de 43 millions d'Américains vivent aujourd'hui dans la pauvreté ; plus de 43 millions d'Américains bénéficient de coupons alimentaires ; plus de 20 % des Américains sont sans emploi durant les meilleures années de leur vie active.
* 152 Population de plus de 16 ans hors institutions : armée, administrations publiques, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraites.
* 153 Mais, à l'inverse on constate aussi, signe de la dégradation de la situation matérielle des plus de 65 ans, une augmentation de leur taux d'activité. Selon le BLS, celui-ci est passé de 15,4 % en 2006 à 19,3 % en 2016, et pourrait atteindre 23 % en 2026. C'est la seule classe d'âge dans ce cas.
* 154 Selon certaines recherches de l'OCDE, il y aurait une corrélation nette entre la consommation d'opioïdes et les taux de participation ce qui laisse entier le problème de savoir si la prise de tranquillisants est une cause de l'allergie au travail ou une conséquence du sous-emploi.
* 155 « L'incarcération de masse masque un fort volant de chômage en soustrayant des statistiques du chômage une masse importante d'adultes en âge de travailler. Ainsi, le faible taux de chômage américain des années 1990 est en partie un résultat et un artefact du taux élevé d'incarcération. Loin de constituer comme on voudrait nous le faire croire, l'exemple même de la dérégulation, le marché américain est en fait modelé par une intervention étatique à la fois forte et coercitive, via le système pénal. Tandis que les forts taux d'incarcération contribuent à cacher l'ampleur véritable du chômage, l'allongement des peines de prison contribue, lui, à augmenter le risque pour les anciens détenus de se retrouver durablement sans emploi une fois sortis de prison. » Bruce Western, Katherine Beckett, David Harding : « Système pénal et marché du travail aux États-Unis » (Actes de la recherche en sciences sociales, Septembre 1998)
* 156 En 2016, le BLS a comptabilisé 7,6 millions de « travailleurs pauvres », soit 4,9 % de la population active. Les Noirs et les Hispaniques sont deux fois plus représentés que les Blancs au sein de cette catégorie et la pauvreté touche une part beaucoup plus élevée de travailleurs à temps partiel (12,2 %) qu'à temps plein (3,1 %).7,5 millions d'Étasuniens occupent plusieurs emplois, y compris de plus en plus d'enseignants (Libération du 30 septembre 2018).
* 157 Après avoir été multiplié par 4,8 entre 1990 et 2010 la population carcérale a progressivement baissé, particulièrement sous Obama. Au vu de l'inefficacité de cette politique répressive et de son coût (près de 1 % du PIB), un consensus semble se dessiner entre Démocrates et Républicains pour une révision du code pénal (suppression des peines plancher, promotion des politiques de réinsertion, etc.).
* 158 « Au 1 er janvier 2006, on dénombrait 1,530 million de sans-emploi au Royaume-Uni. Pour 2,7 millions de malades (...) qui ne pouvaient être pris en compte dans les statistiques du chômage par la grâce d'un certificat médical.... Le nombre de ces malades incapables de travailler n'atteignait pas 600 000 en 1981. 25 ans plus tard, ils avaient donc été multipliés par près de quatre ! (...) en proportion, deux fois et demie plus qu'en Allemagne ; quatre fois plus qu'en Italie ! Le système de santé britannique a beau avoir périclité, cela n'a pas été à ce point. » Philippe Auclair ( Le royaume enchanté de Tony Blair, Fayard).
* 159 20 000 à Los Angeles par exemple.
* 160 Depuis 2008, chaque année amène la fermeture entre d'50 000 et 75 000 pieds carrés de magasins de distribution, avec un pic à 100 000 pieds carrés en 2017.
* 161 Le taux de chômage du BSL (U6) au sens large inclut ceux qui, sans emploi depuis moins de 3 ans, s'abstiennent de chercher un travail, les marginaux, les personnes à temps partiel contraint.
* 162 Il est obtenu en ajoutant aux sous employés recensés pour l'indice U6, les travailleurs déplacés et les chômeurs de très longue durée (6 ans), découragés, non pris en compte par l'indice du BSL.
* 163 « Ces demandeurs d'emploi oubliés de la reprise », titre le Monde du 24 mai 2018 montrant ainsi que tout ne va pas pour le mieux mais que la « reprise » est là. Quelle « reprise », c'est une autre affaire.
* 164 Le taux d'activité est le nombre d'actifs rapporté à la population concernée (population de 15 à 64 ans, jeunes de 15-24 ans par exemple).
* 165 Le taux d'activité est le nombre d'actifs rapporté à la population concernée (population de 15 à 64 ans, jeunes de 15-24 ans, par exemple).
* 166 Avec une population active de 30,4 millions, estimation 2018 de la Banque mondiale et de l'OIT.
* 167 Thomas Piketty : Le capital au XXI e siècle (Seuil 2013)
Pour une analyse plus détaillée des résultats des travaux, mondialement reconnus de Thomas Piketty, voir Une crise en quête de fin (IIIème partie Chapitre III)
* 168 Branko Milanovic est un économiste yougoslave devenu un économiste « serbo-américain ». Il a travaillé plus de vingt ans au département de la recherche de la Banque mondiale avant de rejoindre la City University of New York (CUNY), l'une des plus prestigieuses universités publiques de New York. Ses travaux ont d'abord été connus en France par des articles et, tardivement, par un ouvrage publié en 2016 aux USA et préfacé par Thomas Piketty : Inégalités mondiales aux éditions La découverte (2019). C'est sa fameuse « courbe de l'éléphant » qui, visualisant les effets de la mondialisation sur les inégalités sociales au niveau mondial, comme on le verra, le rendra célèbre.
* 169 Les réformes Hartz sont les réformes du marché du travail en Allemagne entre 2003 et 2005, sous le mandat du chancelier Gerhard Schröder.
* 170 Le montant des revenus de ces placements est évidemment inconnu, tout particulièrement ceux de la spéculation à travers des hedges funds et du shadow banking . (voir partie I)
* 171 Reprendre le contrôle de la dette (Les éditions de l'atelier 2017)
Lord Adair Turner, président de l'Autorité de régulation financière britannique de 2008 à 2013 (Financial Service Authority) en pleine crise financière, ancien banquier et ancien directeur général de la confédération de l'industrie britannique, est donc un témoin et observateur de choix. Lire son livre - exemple rare de lucidité et de liberté de penser - est une urgence.
* 172 La proportion des crédits immobiliers (spéculatifs, c'est-à-dire servant à l'acquisition d'actifs déjà existants) a considérablement augmenté depuis 45 ans. Cette part est passée de quelque 32 % en 1950 à près de 60 % en 2008, une part importante des 40 % restants étant allouée à l'immobilier commercial (voir partie II)
* 173 Louis Chauvel : La spirale du déclassement - Seuil (2016)
* 174 « La comparaison internationale montre comment l'Europe a été depuis soixante ans le continent des classes moyennes : les groupes proches du centre de la pyramide des revenus sont plus denses qu'ailleurs. La mobilité sociale européenne va avec une forte égalité des revenus, en particulier dans les pays scandinaves. Comme il est au centre des trajectoires ascendantes et descendantes, ce groupe social n'est pas homogène. » Louis Chauvel Entretien Le Figaro.fr du 15 février 2019.
* 175 Entretien Le Figaro.fr du 15 février 2019.
* 176 À noter, entre 1960 et 2010, on observe une dégradation des salaires nets des revenus des professions intermédiaires par rapport à ceux des ouvriers ; entre 1980 et 2010, c'est une dégradation du rapport entre le revenu disponible net des professions intermédiaires et le revenu moyen des ménages (Louis Chauvel op cit).
* 177 À noter que l'estimation du coût du logement par l'Insee est loin de faire l'unanimité. Disons même que l'Institut national se moque du monde.
Selon l'économiste Philippe Herlin, « le logement est sous-estimé de façon criante : il représenterait aujourd'hui 6 % du budget des ménages ! Ce qui ne correspond à aucune réalité pour les Français. L'Insee exclut notamment du budget des particuliers tous les logements achetés, car cela est vu comme un investissement ! De cette façon, la hausse de l'immobilier, surtout depuis 2000, est passée à l'as. » (Entretien - Le Figaro du 11 octobre 2018)
Quoi qu'il en soit, vu l'extrême disparité sur le territoire du coût du logement, l'usage d'un indice général de ce coût pour déterminer le pouvoir d'achat des ménages peut-il avoir un sens ?
* 178 Selon l'OCDE, un emploi sur six serait menacé d'automatisation en France.
* 179 INSEE : Les très hauts revenus en 2015 (édition 2018) - Marie-Cécile Cazenave-Lacrouts.
* 180 « La communauté politique la meilleure est celle où le pouvoir est aux mains de la classe moyenne, (et) la possibilité d'être bien gouverné appartient à ces sortes d'États dans lesquels la classe moyenne est nombreuse, et plus forte, de préférence que les deux autres réunies ou tout au moins que l'une d'entre-elles car, par l'addition de son propre poids, elle fait pencher la balance et empêcher les extrêmes opposés d'arriver au pouvoir. » Politique (IV 11 1296a).
* 181 Christophe Gilluy est l'auteur de nombreux ouvrages pour la plupart édités chez Flammarion : Fractures françaises (2013), La France périphérique (2014), Le crépuscule de la France d'en Haut (2016), No society : la fin de la classe moyenne (2018).
* 182 Il évoluera avec son ouvrage No society : la fin de la classe moyenne (2018), qui présupposait au moins qu'elle avait existé !
* 183 INSEE première : « En quarante ans la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi stable » (27 février 2019).
* 184 OCDE : L'ascenseur social est-il en panne ? Publié le 18 juin 2018 - Compte rendu dans Marianne (1 er mars 2019)
* 185 Les Dossiers de la DREES : Dépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ? (mars 2018)
* 186 Cité par Louis Chauvel (Figaro.fr - 15 février 2019)
* 187 Louis Chauvel : La spirale du déclassement, Seuil (2016)
* 188 Henri Mendras : La Seconde Révolution française , Gallimard (1988)
* 189 « Près de 500 000 personnes (sont) en incapacité d'accéder à un réseau internet depuis leur domicile. Pour elles et eux, l'entrave à l'accès aux services publics est d'autant plus importante que les territoires où ils ou elles résident sont par ailleurs enclavés, l'éloignement des zones urbaines rendant plus difficiles les démarches administratives "physiques". » Rapport « Dématérialisation et inégalités d'accès au service public » Défenseur des droits (2019).
* 190 541 communes françaises sont classées en « zones blanches » et sont donc dépourvues à ce jour de toute connexion internet et mobile.
* 191 Pour réaliser une démarche administrative en ligne, le débit nécessaire est estimé entre 3 et 8 mégabits/s ce qui signifie qu'on peut disposer d'un accès ADSL et ne pas être en mesure d'avoir une connexion internet suffisante pour réaliser une démarche en ligne.
* 192 Selon Pôle emploi, l'inscription sur leur site, c'est-à-dire la demande d'allocation et la prise de rendez-vous pour le 1 er entretien de diagnostic, prend entre 20 et 45 minutes avec téléchargement des pièces jointes. En cas de faible débit, la démarche devient particulièrement difficile à réaliser. Rapport du Défenseur des Droits
* 193 13 millions de Français en 2018 se déclaraient en difficulté pour l'accès et/ou l'usage du numérique ; 40 % étaient inquiets à l'idée de réaliser leurs démarches administratives en ligne. « Rapport et recommandations sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif, piloté par la mission Société numérique » (mai 2018)
* 194 « Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d'un tiers des habitants n'ont pas accès à un internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. » - Rapport du Défenseur des Droits.
* 195 La plupart des auteurs grecs - à commencer par Platon et Xénophon - étant favorables à un gouvernement par les « meilleurs » - donc plus ou moins oligarchique - il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils aient transmis à la postérité une vision très négative de la tyrannie, voire de la démocratie, règne de la multitude conduite par des passions changeantes. Seul Aristote fait exception.
* 196 Le village introuvable - Éditions complexes 1986
* 197 Christopher Lasch La révolte des élites . Commencé dès 1981, l'essai restera inachevé jusqu'en 1995. Édité à titre posthume, il sera publié en 1996 en France aux éditions Climats.
* 198 Là encore, il s'agit d'un phénomène essentiel généralement passé sous silence, mis en évidence par Karl Polanyi et Norbert Elias dans leurs analyses de la situation de l'Allemagne pré-nazie de l'entre-deux-guerres. (voir partie V).
* 199 Le titre de la récente « loi d'orientation des mobilités » est sur ce point significatif. Ce texte déclamatoire et réglementaire, sans portée pratique réelle a essentiellement pour objet de remplacer la notion de transport dans le code du même nom - qui rappelle trop celles d'infrastructure, d'investissement et de service publics - par celle de « mobilités » renvoyant aux initiatives et choix individuels ou des collectivités, éventuellement soutenus par l'État. Il n'y est notamment pas question d'un plan public pour régler les trois problèmes les plus urgents : le désenclavement des zones rurales, le financement d'un réseau de transport en région Île de France digne de ce nom et celui des liaisons entre les villes moyennes et la capitale. Par contre, on se préoccupe de faciliter le « covoiturage » et les « mobilités solidaires », de l'optimisation du système d'information numérique, des « cycles à pédalage assisté », d'améliorer le « contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non-routiers à moteur », préoccupations certes légitimes mais moins prioritaires que celles évoquées plus haut. Significatif aussi que les prévisions budgétaires précises des investissements publics - d'ailleurs jamais réalisées selon le calendrier prévu - soient renvoyées à un rapport annexe.
* 200 Il s'agit d'un projet de tract qui finalement ne sera pas distribué. Un acte manqué en quelque sorte.
* 201 1985-2017 : Quand les classes favorisées ont fait sécession - Fondation Jean Jaurès (21 février 2018).
* 202 Opinion sensiblement différente - s'agissant de l'ENA - du président de l'association des anciens élèves, Daniel Keller, lors de son audition par la commission d'enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique (2018). Selon lui, 30 % des élèves de l'ENA ont été, à un moment ou un autre de leur scolarité, boursier. Notons que pour l'année scolaire 2019-2020, le plafond de revenu ouvrant droit à une bourse échelon 1 pour une famille de deux enfants est 19 497 € annuels, ce qui inclut non seulement les classes « modestes » mais aussi une partie des « classes moyennes ».
L'ancienneté des chiffres dont on dispose mesure le peu d'empressement des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à « communiquer » sur ce sujet.
* 203 « L'Opinion » (31 mai 2019).
* 204 Viviane Forrester : L'horreur économique - Éditions Fayard.
* 205 Marc Augé : Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité - Le Seuil, 1992
* 206 D'où les rapports indignés répétitifs - notamment de la Cour des comptes - sur le coût prohibitif d'entretien de lignes ferroviaires de désenclavement qui ne transportent habituellement qu'une poignée de voyageurs.
* 207 Carlos Ghosn avant sa quatrième arrestation par la justice japonaise : « Je suis combatif, je suis innocent, c'est dur, il faut le savoir et je fais appel au gouvernement français pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable » (Entrevue à TF1 4 avril 2019)
* 208 Pierre Grémion « Le pouvoir périphérique » (Seuil).
* 209 Un an avant, lors de sa campagne, en 2012, le futur président de la République, François Hollande, sur les traces de Nicolas Sarkozy quelques années plus tôt, était venu « prendre des engagements » à Florange (Moselle). La fermeture des hauts fourneaux en avril 2013 aura été précédée d'un imbroglio dont le gouvernement et le président de la République ne sortent pas à leur avantage. Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, pensant avoir l'appui du Président et de son conseiller spécial Emmanuel Macron milite pour la nationalisation temporaire de l'entreprise... avant d'être désavoué par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui compte sur la volonté d'Arcelor Mittal d'investir sur le site. Selon Les Echos, le gouvernement craignait que cette nationalisation ne soit « un mauvais signal envoyé aux investisseurs internationaux » et une porte ouverte aux demandes des salariés d'autres entreprises menacées.
Seul résultat, un peu mince, l'adoption de la loi dite « Florange » en février 2014 qui oblige les dirigeants d'entreprises à informer les salariés et le comité d'entreprise de leur volonté de fermer un site avant de chercher un repreneur pendant trois mois. À noter que le Conseil constitutionnel s'est opposé à toute pénalité financière en cas de non-respect de cette obligation de chercher un repreneur.
* 210 Documentaire Danse avec le FN (Canal +)
* 211 Toutes les données sont en % de la population active (25 à 55 ans), en 2013, date du dernier recensement publié.
* 212 On aura compris que la « décentralisation » façon Guigou et autres, est le contraire de la décentralisation façon Deferre et Mitterrand de 1982-1983 : donner le pouvoir aux élus locaux pour stimuler le développement local sous toutes ses formes. Une notion politique et non administrative.
* 213 Contribution au rapport Vers l'égalité des territoires publié à la Documentation française (2013). Laurent Davezis, précédemment connu pour ses travaux sur « l'économie présentielle » était alors professeur au CNAM.
* 214 En novembre 2015, une note gouvernementale confirmait que « les chances d'ascension sociale des individus d'origine populaire (soit les enfants d'ouvriers et d'employés) variaient du simple au double selon leur département de naissance ». En effet, l'ascenseur social fonctionne mieux en Île-de-France qu'en Picardie ou dans le Nord-Pas-de Calais et la part des enfants d'ouvriers et d'employés devenus cadres ou ayant une profession intermédiaire varie presque du simple au double selon le département de naissance : 24,7 % dans l'Indre et la Creuse, contre 47 % à Paris, par exemple.
* 215 In « Identité de la France »
* 216 C'est ce à quoi parvient aussi Jérôme Fourquet dans son livre « L'archipel français », 2019
* 217 Le Monde diplomatique, mai 2018.
* 218 En 1979, la France comptait 112 066 médecins, 216 145 en 2011 et 285 840 en 2017 soit une multiplication par 2,6. Dans le même temps la population augmentait de 21,7 % seulement.
* 219 Comme il s'en explique dans son discours du 7 septembre 1789, que les citoyens décident directement est contraire à l'esprit de la démocratie représentative : « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie (et la France ne saurait l'être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
* 220 Maurice Bourjol : Intercommunalité et Union européenne. Réflexions sur le fédéralisme, LGDJ (Paris)
* 221 Exposé des motifs de la loi de 1982.
* 222 Henri Mendras - La France que je vois (Éditions de l'Aube).
* 223 Déclaration à CNN- 19 juin 2005. Warren Buffett est un milliardaire Étasunien - 3 ème fortune du monde estimée à 83,9 Md$ en 2019- bien connu pour ses capacités de prédiction de l'évolution des marchés. Il est à la tête de la holding Berkshire Hathaway.
* 224 Challenges - 4 octobre 2007. Denis Kessler, ancien assistant de Dominique Strauss-Kahn, est docteur d'État de l'université de Paris, ancien président de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, ancien Vice-président exécutif du MEDEF, PDG du groupe de réassurance SCOR.
* 225 Rapport public 1999
* 226 « L'État prédateur. Comment la droite a renoncé au marché libre et pourquoi la gauche devrait en faire autant. » Éditions Le Seuil (2009)
* 227 Ce qui reste le titre de gloire de Reagan et qui explique la faveur dont il jouit encore aujourd'hui aux USA.
* 228 Comme la Chine est devenue un « État-entreprise », la seule différence étant les modes d'équilibre entre les oligarchies concurrentes.
* 229 Adam Tooze : Crashed : Comment une décennie de crise financière a changé le monde (Les belles lettres) dont sont extraites les citations.
* 230 Un diagnostic bien exagéré, s'agissant de la IV e République à laquelle on doit la reconstruction, la création d'institutions de recherche et le lancement de programmes industriels que la V ème République fera prospérer. Quant à la décolonisation et à l'indépendance algérienne on se contentera de rappeler que les positions gaullistes furent pour le moins changeantes.
* 231 Alain Peyrefitte : C'était De Gaulle (Gallimard 1994)
* 232 Selon les premières versions qui ont « fuité » du projet de réforme constitutionnelle envisagé par Emmanuel Macron, cette Haute cour devait être supprimée. Pour l'heure, la réforme est au point mort.
* 233 Version allemande du néolibéralisme apparu dans les années 1930, l'Ordolibéralisme tire son nom de la revue ORDO. Ses chefs de file étaient Walter Eucken et Alfred Müller-Armack. Il servira de modèle pour la reconstruction de l'État allemand.
* 234 Commission d'enquête sénatoriale sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République » Rapport n°16 (2018-2019).
* 235 Entretien au Figaro du 28 janvier 2015
* 236 Arrêts du Conseil d'État précisant que les lois et règlements nationaux doivent respecter les dispositions des traités européens (CE 1975 Cafés Jacques Vabre et CE 1989 Nicolo) ; les règlements communautaires (CE 1990 Boisdet) ; les objectifs des directives communautaires (CE 1992 Rothmans et Philip Morris) ; les principes généraux du droit communautaire (CE 2001 Syndicat national de l'industrie pharmaceutique).
* 237 Comme par hasard, le Secrétaire général du Conseil constitutionnel, patron de son service juridique donc, est généralement un conseiller d'État.
* 238 « Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public », Politiques et management public Vol 29/3-2012
* 239 New York Times Magazine (13 septembre 1970)
* 240 Ayant à se prononcer sur un projet de déviation d'une route traversant les usines Peugeot, dans son arrêt de 1971 Ville de Sochaux, le Conseil d'État a jugé que « si la déviation de la route en question procure à la société « Automobiles Peugeot » un avantage direct et certain, il est conforme à l'intérêt général de satisfaire à la fois les besoins de la circulation publique, et les exigences d'un ensemble industriel qui joue un rôle important dans l'économie nationale. » Arrêt conforme à la jurisprudence classique du CE qui donne priorité à l'intérêt général quitte à prévoir des aménagements ou un dédommagement pour ne pas léser l'intérêt particulier.
* 241 Léon Duguit (1859-1928), juriste français spécialiste d'un droit public conforme à l'esprit républicain, autant dire aux antipodes de celui dont le Conseil d'État assure la promotion.
* 242 Michel Crinetz Blog 22/11/2016
* 243 Rapport novembre 2016
* 244 Bpifrance est une banque publique d'investissement (Capital : CDC, OSEO, le Fonds Stratégique d'Investissement...) créée en 2012 pour pallier les difficultés d'accès au crédit des PME-PMI (voir partie II), notamment dans leur première phase de développement. Dotée d'un capital initial de 2,8 Md€ dont 1,8 Md€ de fonds propres (à comparer au ratio des grands groupes bancaires français partie I), son objet est de favoriser « l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ».
* 245 Exemples d'AAI de ce type : « l'Autorité de la concurrence », le Médiateur national de l'énergie, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission de régulation de l'énergie, le CSA tel qu'il fonctionne, l'Autorité de régulation des jeux en ligne...
* 246 En 2014, le coût budgétaire des 42 AAI recensées par la commission d'enquête sénatoriale (Rapport de Jacques Mézard, « Un État dans l'État ») était d'environ 600 millions d'euros.
* 247 Audition Rapport J. Mézard Un État dans l'État
* 248 Spread : différence entre le taux consenti aux emprunts du débiteur réputé le plus sûr, l'Allemagne en l'espèce, et celui demandé aux autres débiteurs.
* 249 La loi MURCEF prévoit que les travaux d'ingénierie des services de l'État pour les collectivités territoriales ne sont plus effectués dans le cadre de conventions mais « dans les conditions prévues par le code des marchés publics », donc dans le cadre de marchés publics. Le champ des collectivités pouvant bénéficier des services de l'État sera réduit (création de l'ATESAT) avant de disparaître sous l'oeil soupçonneux de la Cour des comptes devenue gardien vigilant du respect de la concurrence.
* 250 Déjà entre 2008 et 2012, les effectifs des DDT et des DDTM en charge de l'ATESAT ont diminué de 30 %, passant de 1 766 à 1 266 ETP. Le mouvement ne cessera plus.
* 251 Pierre France et Antoine Vauchez : « Sphères publiques, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage », Les Presses de Sciences Po, Paris 2018
* 252 Même des pouvoirs régaliens peuvent être délégués à des entités privées comme la désormais classique gestion des prisons ou la lutte contre la grande délinquance financière confiée au système financier (surtout les banques) en échange d'une large liberté d'interprétation des normes qui leur seront appliquées et accessoirement un pouvoir discrétionnaire sur ceux qu'il est censé contrôler.
* 253 Les trous noirs du pouvoir - Les intermédiaires du pouvoir, Sociologie du travail, volume 49, n°1 (janvier 2007) de Pierre Lascoumes et Dominique Lorrain CEVIPOF-CNRS
* 254 Thomas Perroud, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) : L'encadrement des conflits d'intérêts dans l'administration (29 novembre 2017)
* 255 ACRIMED 19 mars 2018
* 256 Sylvain Laurens : Audition de la commission d'enquête sénatoriale relative aux mutations de la Haute fonction publique. (Rapport n°16, 2018-2019)
* 257 La phrase exacte de Bernard Arnault prononcée lors de l'annonce à l'Obs (25 avril 2017) de son soutien à la candidature à la présidence de la République d'Emmanuel Macron est celle-ci : « On subit une crise tous les dix ans, et j'attends la suivante avec sérénité. On fait souvent de bonnes affaires pendant les crises... ».
* 258 Démocratie Potemkine (voir Prolégomènes)
* 259 Adam Tooze : Crashed, Éditions Les belles lettres.
* 260 Voir l'audition de James K. Galbraith annexée.
* 261 Le politique et la dynamique des passions, Rue Descartes 2004/3, n°43-46
* 262 Qui a tué le parti communiste italien ? (Guido Ligori, Editions Delga)
* 263 Expression de Valéry Giscard d'Estaing
* 264 Clemenceau : discours à la Chambre - 4 juin 1888.
* 265 Ainsi, pour l'application de l'article 40 de la Constitution, la notion de « dépense publique » ne s'applique plus seulement à celles de l'État mais aux dépenses au sens de Maastricht - les traités prennent valeur constitutionnelle.
* 266 L'ancien secrétaire américain au Trésor Timothy Geithner écrit dans un livre publié en 2014 (« Stress Test: Reflections on Financial Crises »), qu'au cours de l'automne 2011 des responsables européens l'ont approché avec un projet conçu pour tenter de contraindre le président du Conseil italien Silvio Berlusconi à quitter le pouvoir : « ils nous demandaient de refuser de soutenir des prêts du FMI (Fonds monétaire international) à l'Italie jusqu'à ce qu'il soit parti », ajoutant : « Nous avons informé le président de cette surprenante sollicitation mais aussi utile que cela aurait pu être d'avoir de meilleurs dirigeants en Europe, nous ne pouvions pas participer à un tel projet. Nous ne pouvons pas avoir de son sang sur les mains » (Cité par l'Obs avec l'AFP le 14 mai 2014)
* 267 Stratégie qui, services secrets et brigades rouges, aidant échouera.
* 268 Discours de Jacques Chirac au soir du 2 e tour des élections de 2002 : « Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, nous venons de vivre un temps de grande inquiétude pour la Nation, mais ce soir dans un grand élan, la France a réaffirmé son attachement aux valeurs de la République.
Ce soir, je veux dire aussi mon émotion, et le sentiment que j'ai de la responsabilité qui m'incombe. Votre choix aujourd'hui est un choix fondateur, un choix qui renouvelle notre pacte républicain. Ce choix m'oblige, comme il oblige chaque responsable de notre pays.
La confiance que vous venez de me témoigner, je veux y répondre en m'engageant dans l'action avec détermination. Président de tous les Français, je veux y répondre dans un esprit de rassemblement. Je veux mettre la République au service de tous, je veux que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, reprennent toute leur place dans la vie de chacune et de chacun d'entre vous. (...) Dans les prochains jours, je mettrai en place un gouvernement de mission, un gouvernement qui aura pour seule tâche de répondre à vos préoccupations et d'apporter des solutions à des problèmes qui ont été trop longtemps négligés (...) Mes chers compatriotes, le mandat que vous m'avez confié, je l'exercerai dans un esprit d'ouverture et de concorde, avec pour exigence l'unité de la République, la cohésion de la Nation et le respect de l'autorité de l'État (...) »
* 269 Blog 15 janvier 2017.
* 270 Article de Romaric Godin et Ellen Salvi, Médiapart - 8 avril 2019.
* 271 Article de Romaric Godin et Ellen Salvi Médiapart - 8 avril 2019.
* 272 Accord, négocié par Mme Merkel et finalement avalisé par ses partenaires malgré leurs réticences, certains d'entre eux bien décidés à n'accueillir aucun réfugié, même pas à contribuer au financement de l'accord.
Le principe de l'accord d'Ankara c'est l'arrêt de l'immigration à partir de la Turquie à compter du 20 mars 2016. Tout migrant ne pouvant bénéficier du droit d'asile (migrant économique) ou qui, conformément à l'accord de Dublin, refuse de faire une demande d'asile là où il arrive, en l'occurrence la Grèce en provenance de Turquie, doit y être reconduit. Chaque migrant « illégal » sera remplacé par un migrant « légal » présent dans les camps de réfugiés Turcs (règle du « un pour un »), mais à hauteur de 72 000 seulement.
En contrepartie, la Turquie recevra une aide de 3 Md€ comme aide à la gestion des réfugiés, ses ressortissants étant dispensés de visa pour des séjours en Europe de moins de 90 jours, la procédure d'adhésion de la Turquie à l'Europe sera relancée. Depuis, les relations entre la Turquie et l'UE se dégraderont jusqu'à la dénonciation récente de l'accord.
* 273 À l'exception cependant de 1969 opposant Georges Pompidou à Alain Poher, comme on l'a vu plus haut. Le candidat de la Gauche au second tour, Jacques Duclos, ayant invité à ne pas choisir entre « Bonnet blanc et Blanc bonnet ».
* 274 Olivier Rey, Le vide de a campagne nourrit le désarroi des Français, Figarovox 15-16 avril 2017.
* 275 OBSOCO Rapport d'analyse : Qui sont les gilets jaunes ? Leurs soutiens, leurs opposants (février 2019). Réalisé à partir d'un questionnaire adressé en ligne à un échantillon de 4 000 personnes censé représentatif de la population française (18-70 ans). Analyse de Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris Diderot, co-fondateur de l'Obsoco
* 276 Voir son audition.
* 277 Cité par Jan-Werner Müller dans Qu'est-ce que le populisme ? (Gallimard).
* 278 Chantal Mouffe - Agonistique - Beaux-Arts Paris Edition.
* 279 Viktor Orbán ou le pragmatisme autoritaire , Médiapart (20 mars 2019).
* 280 Edition Pocket.
* 281 Ce qui prouve que la tentative (éphémère) de Ben Bernanke de faire maigrir cet oligopole financier dominant en limitant ses capacités d'endettement a échoué.
* 282 Adam Tooze : Crashed, Éditions Les belles lettres, 2 août 2018.
* 283 La Grande Transformation
* 284 Idem
* 285 La Grande Transformation, 1944.
* 286 Martine Orange (Audition)
* 287 La Grande Transformation, 1944.
* 288 La Grande Transformation (page 322)
* 289 Selon Von Mises (1861-1973) économiste américain d'origine autrichienne « L'insoluble contradiction de la politique des partis de gauche en Angleterre, en France et aux États-Unis est qu'ils s'adonnent à l'économie dirigée, sans se rendre compte que, par-là, ils préparent les voies à la dictature et à la suppression des droits civiques. La confusion de toutes les notions est arrivée à ce point qu'ils se proposent de sauver la démocratie avec l'aide des soviets... Il faut s'en rendre compte : le monde a le choix entre la démocratie politique et le système économique basé sur la propriété privée, d'une part, et de l'autre, l'économie dirigée et la dictature. La démocratie et l'économie dirigée sont inconciliables. » (Économie dirigée et démocratie)
Se trouve ainsi balayé, commente Michel Foucault, « dans une même critique, aussi bien ce qui se passe en Union soviétique que ce qui se passe aux USA, les camps de concentration nazis et les fiches de la sécurité sociale. » (Biopolitique)
Il s'agit là d'un couplet pris parmi les nombreux qui se retrouveront sous la plume des ultras et néo libéraux qui monopoliseront progressivement la scène académique et médiatique.
Ce que ne dit pas Von Mises c'est que la dictature et un système économique basé sur la propriété privée sont parfaitement compatibles. L'Histoire a montré qu'en cas de difficulté c'était généralement le choix des propriétaires du système.
* 290 Sieyès, Qu'est-ce que le tiers état, PUF.
* 291 De la démocratie en Amérique (Tocqueville, 1935).
* 292 Constatons qu'en même temps les États européens ont limité la garantie des dépôts en cas de faillite bancaire à 100 000 € par déposant.
* 293 On peut faire le même reproche au système de résolution européen censé mettre à la charge des banquiers et des déposants le coût de la faillite de leur établissement. Sauf que les fonds qui y sont consacrés (y compris les fonds propres obligatoires) sont notoirement insuffisants pour faire face à une crise de magnitude significative. Rien ne garantit qu'en ce cas les garants, par ailleurs en difficulté, soient en capacité d'intervenir. C'est d'ailleurs l'un des reproches essentiels faits aux stress tests de la BCE, d'évaluer la résilience comme si les établissements ne faisaient pas partie d'un système dont les unités interfèrent entre elles.
* 294 Un ratio de levier de 10 aurait au moins l'avantage de la clarté et d'une meilleure efficacité.
* 295 Valeur consolidée des sous-jacents au niveau mondial en 2018, 1 500 000 Md$.
* 296 De l'ordre de 8 % de l'énorme bilan du shadow banking européen est détenu par des banques, via des filiales.
* 297 Adam Tooze, Crashed , aux éditions Les Belles Lettres.
* 298 De la différence entre taux à court et long termes.
* 299 Si dès le traité de Maastricht cette liberté était bridée, les obligations, faute de sanctions, restaient plus théoriques que réelles. On peut constater que cette rigueur n'existe pas, vis-à-vis de l'Allemagne, s'agissant des excédents.
* 300 Les prévisions de croissance pour 2019 sont de +1,2 % en moyenne et de +0,5 % en Allemagne contre 2,6 % aux USA en production industrielle.
* 301 Dépôts en dollars dans des banques hors de la juridiction étasunienne.
* 302 Alain Minc, La mondialisation heureuse , 1999 (Pocket)
* 303 « Peu de progrès ont en effet été accomplis en ce qui concerne les autres entités de ce que l'on désigne à présent sous l'expression "d'intermédiation de crédit non bancaire", en particulier sur la question de la dimension systémique de certains gestionnaires d'actifs. » Laurent Clerc
* 304 « Prenons les hedge funds : ils sont tous, sans exception, domiciliés dans les paradis fiscaux et on a renoncé depuis 2008 à plafonner leurs effets de leviers. Voici deux mesures efficaces : limiter l'effet de levier à 5 ou 6, et domicilier le hedge fund là où le gérant exerce son activité, c'est-à-dire à Londres et à New York. » Jean-Michel Naulot
* 305 « Le bilan social de l'accroissement de l'activité intra financière est négatif. Un système plus complexe d'intermédiation de crédit a rendu le système financier plus instable et la crise plus probable, et, en facilitant la création de crédit, il a aggravé le poids du surendettement après la crise. » Adair Turner.
* 306 C'est le rapport entre le montant des fonds propres et des actifs.
* 307 L'objectif ne peut être seulement de stabiliser le système, de régler la question des établissements systémiques mais « de gérer la quantité de crédit et d'influencer son allocation dans l'économie réelle. » Adair Turner
* 308 « 7 % des produits dérivés servent l'économie, donc 93 % de ces produits servent à spéculer ou faire des jeux qui ne servent à rien pour l'économie réelle. Taxer la production spéculative de dérivés ou forcer tous les produits dérivés à passer par des chambres de compensation : vous réduisez aussitôt tous les produits non liquides ». « Si vous vous mettez à facturer les ordres annulés, vous en ferez drastiquement chuter le volume, car c'est devenu une méthode. » Jean-Michel Naulot
* 309 À noter, vu l'importance, dans les dépenses des collectivités, des travaux publics et des services exécutés par des acteurs locaux que celles-ci figurent parmi les moins génératrices d'importations.
* 310 La particularité des FMN françaises par rapport aux autres (notamment américaines) est d'investir et de créer des emplois à l'étranger en rapatriant les bénéfices. Selon le CPII, en effet, l'économie française se distingue par l'importance de l'implantation à l'international de ses entreprises. Elles employaient en 2014, 6 millions de personnes à l'étranger contre par exemple 5 millions pour les entreprises allemandes dont le PIB est supérieur de 50 % à celui de la France, 1,8 million de personnes pour l'Italie. Une tendance qui s'est accentuée puisque de 2007 à 2014, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés des multinationales françaises ont crû deux fois plus vite que dans les multinationales allemandes et italiennes.
* 311 Il est significatif que le principal partenaire commercial pour les exportations de biens des pays de l'UE (2016) soit un autre membre de l'Union européenne, à l'exception de l'Allemagne, de l'Irlande, du Royaume-Uni et de quelques très petits états, les États-Unis étant surtout la destination de leurs exportations.
* 312 L'excédent allemand représente 9 % de son PIB. S'il n'était que de 6 %, cela permettrait d'injecter 90 Md€ en plus dans la zone euro, par le biais d'une hausse des salaires ou en augmentant les dépenses publiques allemandes. (Romaric Godin)
* 313 Le fait que l'euro soit légèrement sous-évalué, compte-tenu de la structure de l'économie allemande, lui a permis de booster ses exportations dans un contexte où les partenaires commerciaux allemands en Europe ne pouvaient pas dévaluer leur monnaie. En outre, la monnaie unique permet à l'Allemagne de dégager des excédents beaucoup plus forts que ses voisins européens et d'investir ensuite son épargne sans crainte dans le reste de l'Europe.
Ainsi, dans son étude « External Sector Report » de 2017, le Fonds monétaire international calcule que l'euro était sous-évalué d'environ 18 % pour l'Allemagne et qu'il était surévalué de 6,8 % pour la France ( Res Publica , Note du 20 août 2018).
* 314 « Actuellement, le principe de libre circulation des capitaux coûte fiscalement à la France entre 60 et 80 Md€. On peut retrouver une base fiscale contrôlable, en disant aux gens : « si vous voulez acheter une entreprise, vous pouvez faire circuler vos capitaux, mais si c'est pour spéculer, non ». Jacques Sapir.
Significatif aussi que les échanges de la France avec l'Allemagne soient structurellement déficitaires, que les balances commerciales avec les autres pays européens de l'Allemagne et les Pays Bas soient excédentaires quand les autres sont déficitaires, les écarts se creusant pour l'Allemagne dont l'excédent commercial avec l'ensemble de ses partenaires européens était de 160,3 Md€ en 2017.
* 315 De la démocratie en Amérique.
* 316 Cela peut passer par une augmentation des temps de débat consacrés à l'examen d'un texte, des temps de parole des groupes ou des parlementaires, actuellement réduits à la limite du ridicule.
On peut envisager aussi l'attribution d'un temps de parole global par groupes à répartir à la convenance des groupes entre discussion générale, présentation d'amendements, explications de vote...
* 317 La « règle de l'entonnoir » telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui interdit d'amender en seconde lecture les dispositions adoptées par les deux chambres en première lecture.
* 318 La dynamisation du débat public passe par la suppression de la règle actuelle consistant à distribuer le temps de parole entre les groupes à proportion de leurs effectifs comme si, plus on est nombreux, plus on a de choses intéressantes à dire, ce qui est loin d'être prouvé.
Quand le Gouvernement dispose du soutien de la majorité dans une assemblée, les projets de loi et les propositions qu'il soutient sont défendus par le ministre en séance, le rapporteur et le groupe majoritaire, ce qui a un effet plus soporifique que stimulant.
Quand ce n'est pas le cas, le Gouvernement qui dispose d'un temps de parole aussi important qu'il le souhaite pour présenter ses projets et répondre aux critiques, dispose du soutien des groupes de la majorité présidentielle. Autant dire que dans ce cas non plus l'expression de points de vue hétérodoxes n'est pas facilitée.
Il est donc souhaitable d'accorder forfaitairement un minimum décent de temps d'expression aux minorités ou par une répartition du temps entre groupes pour partie à égalité, pour partie proportionnellement à leurs effectifs.