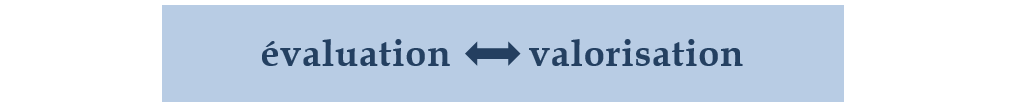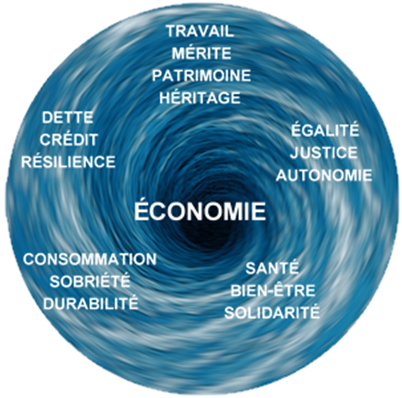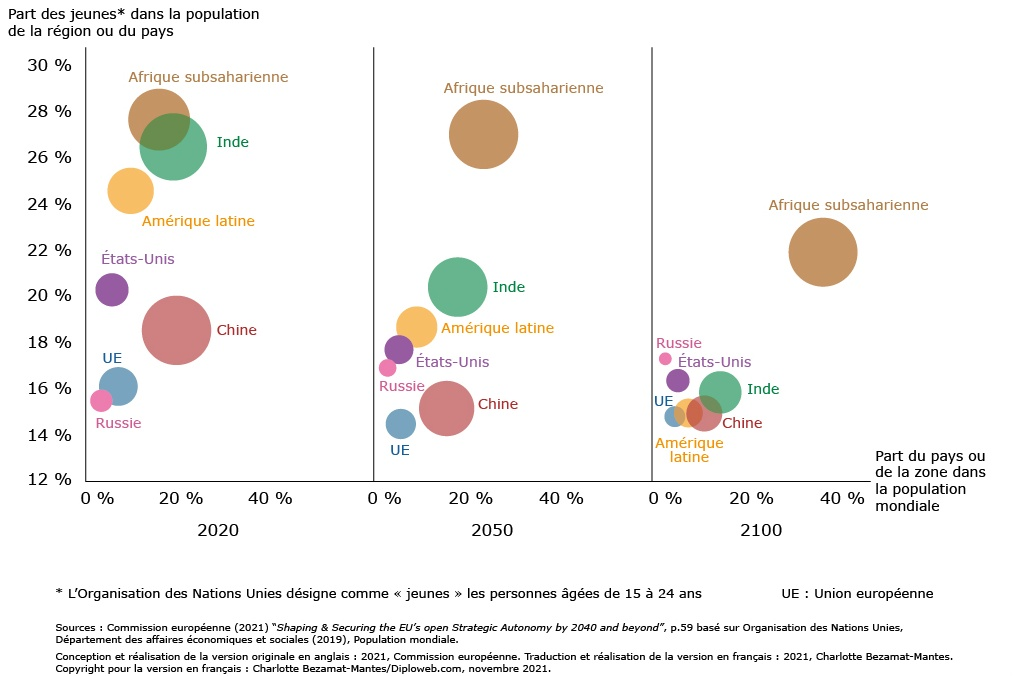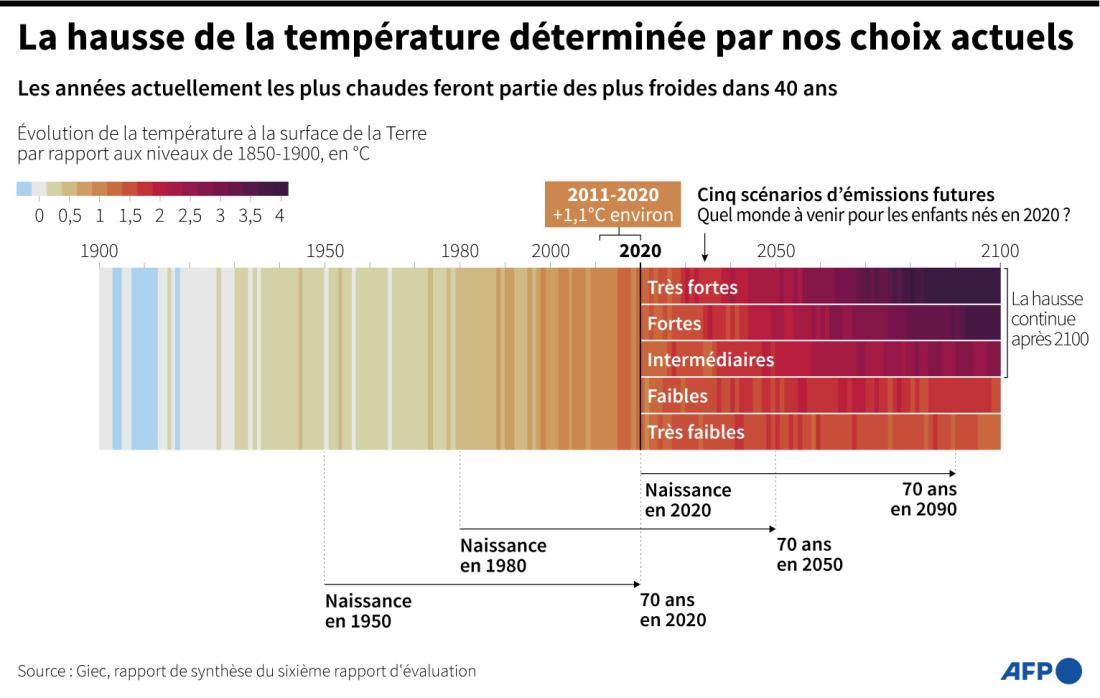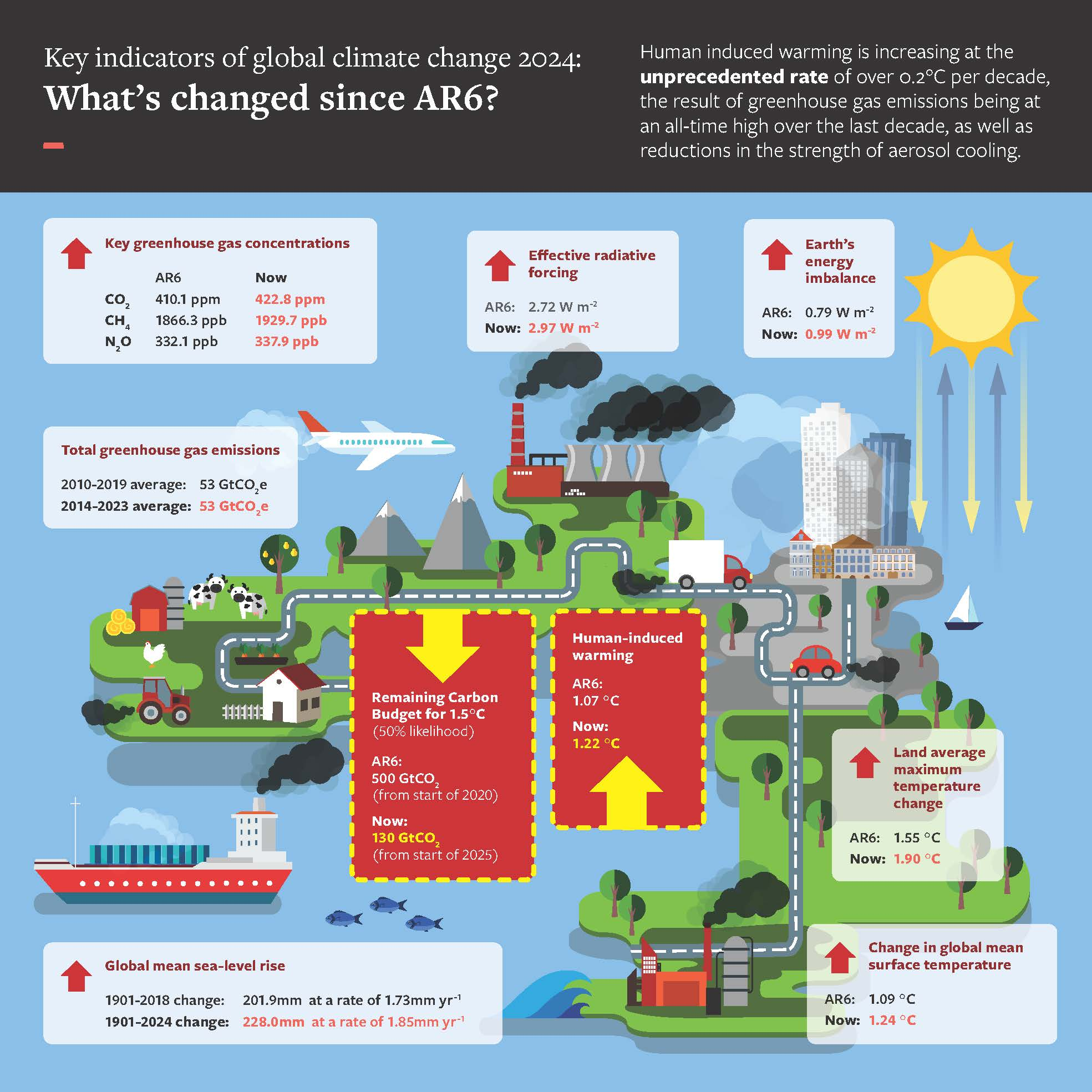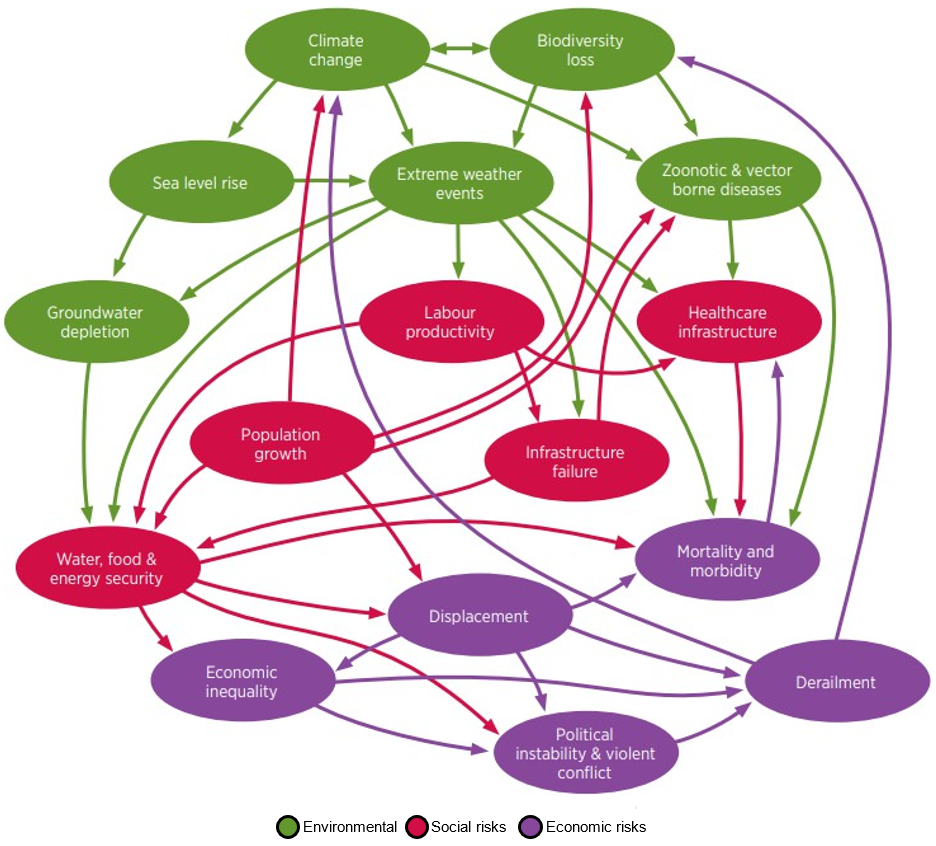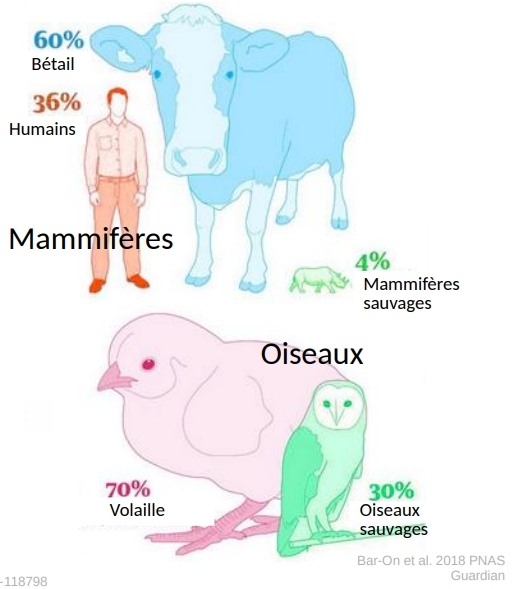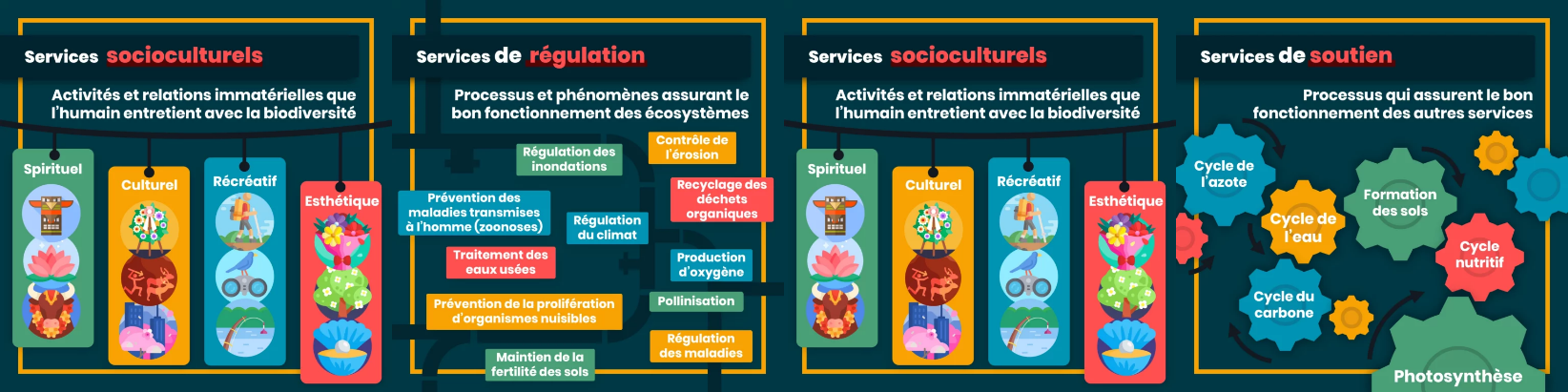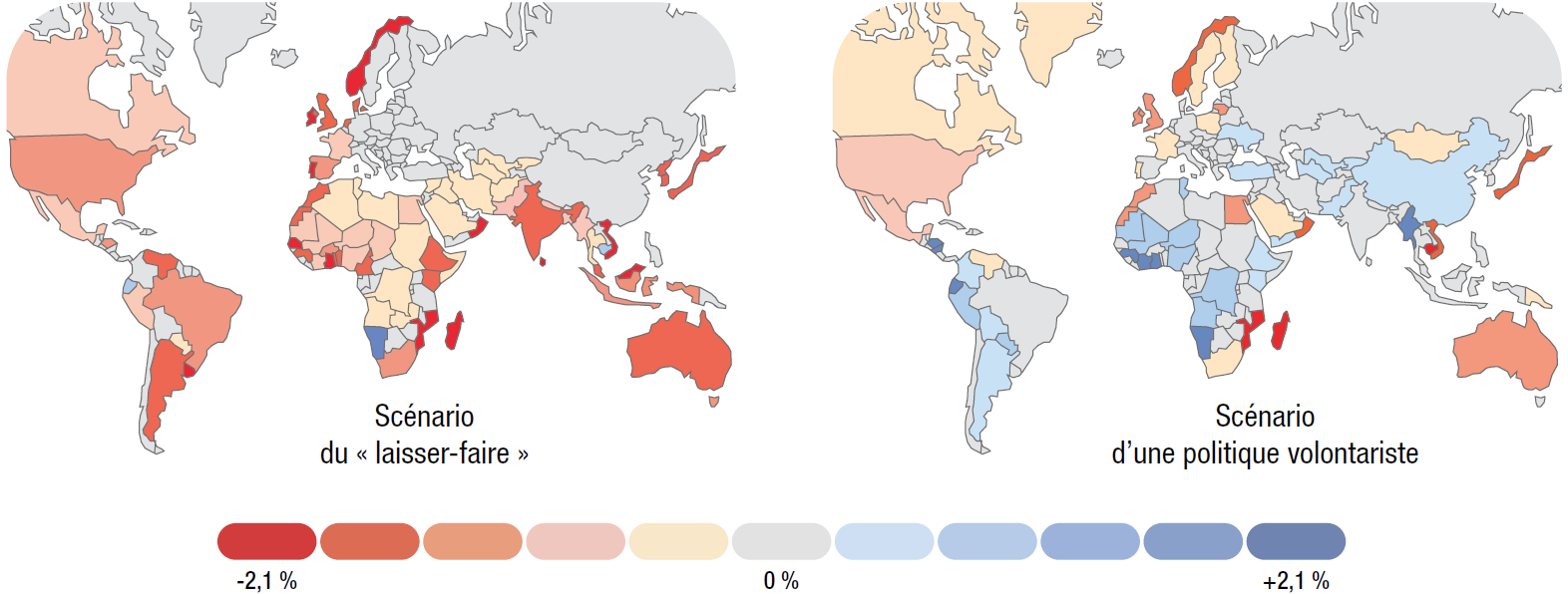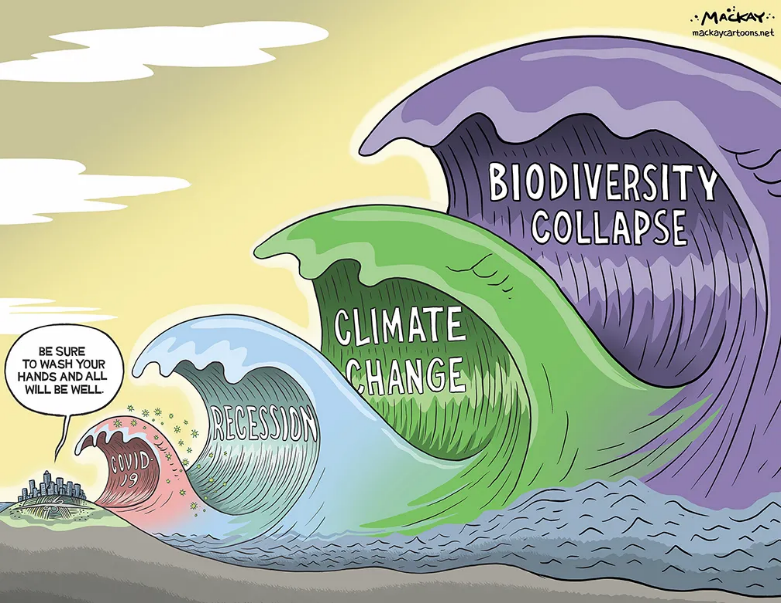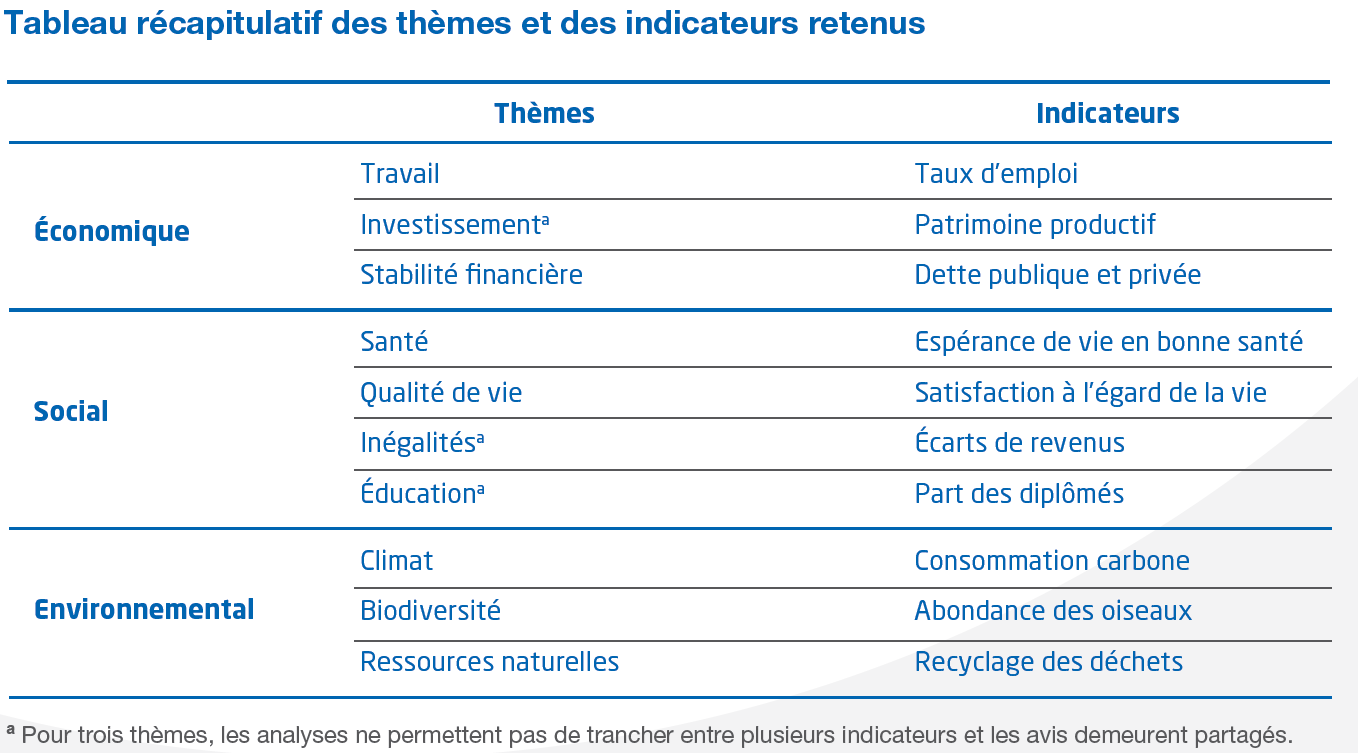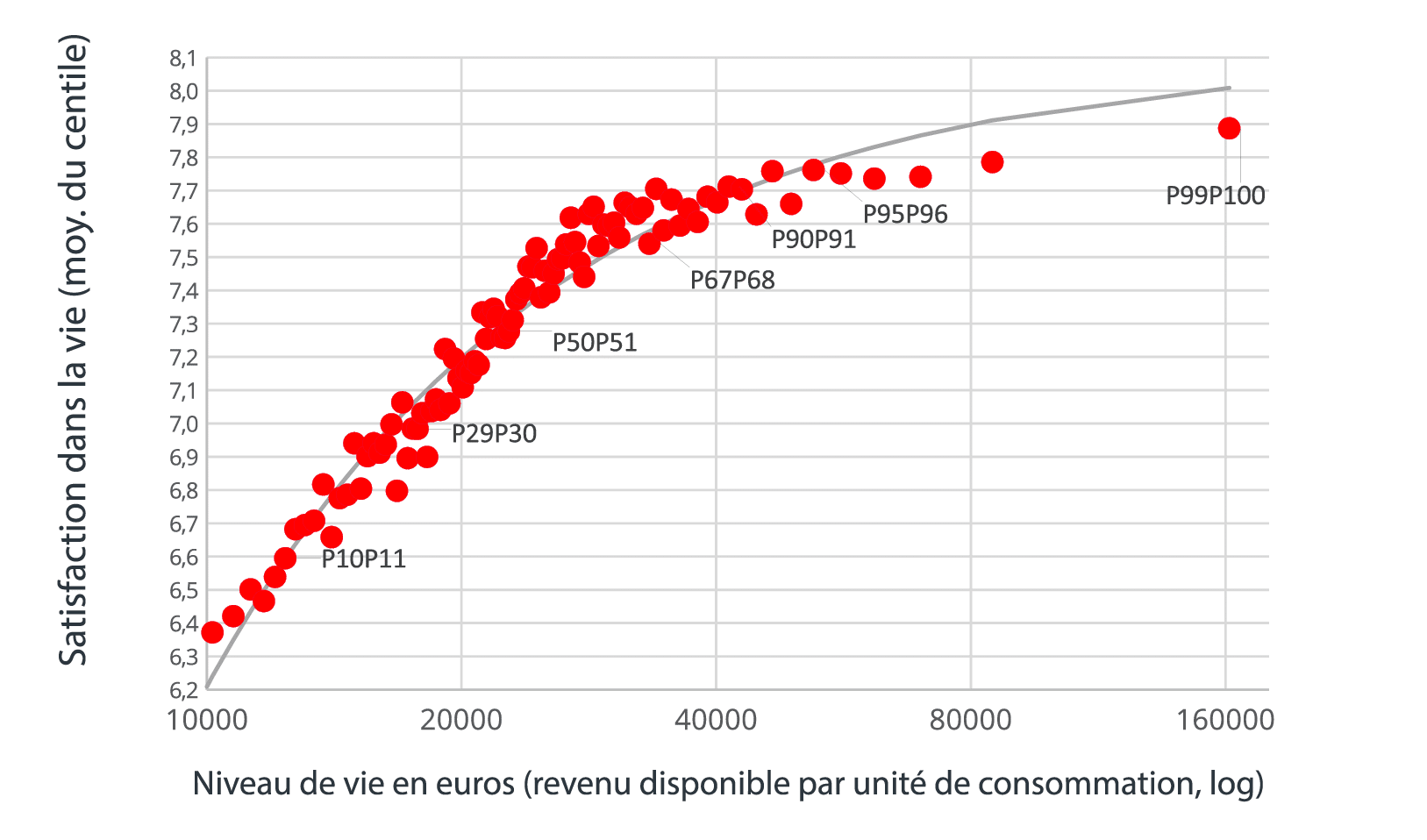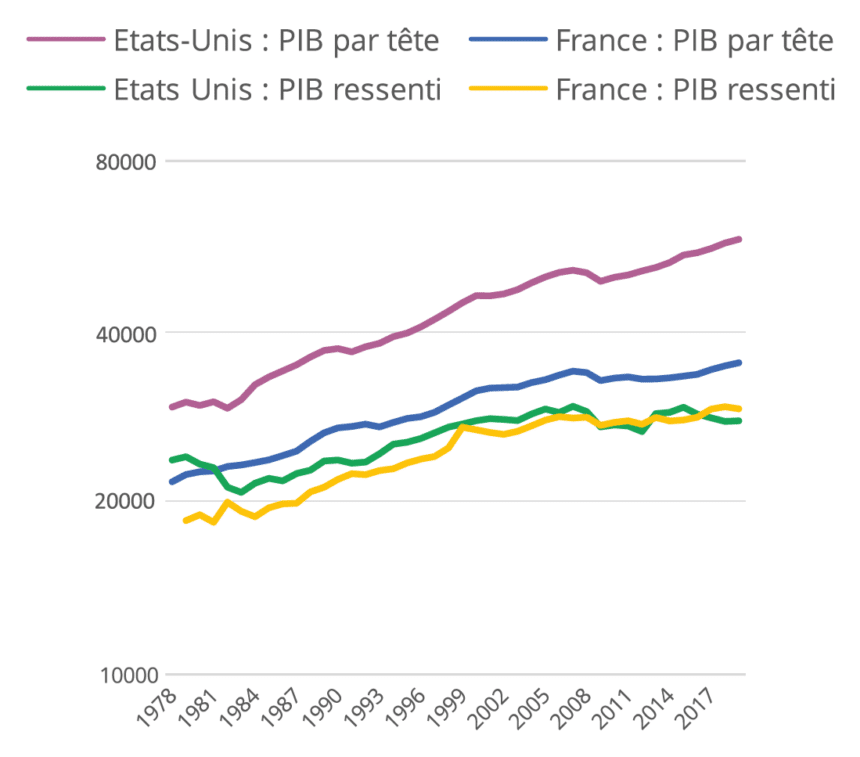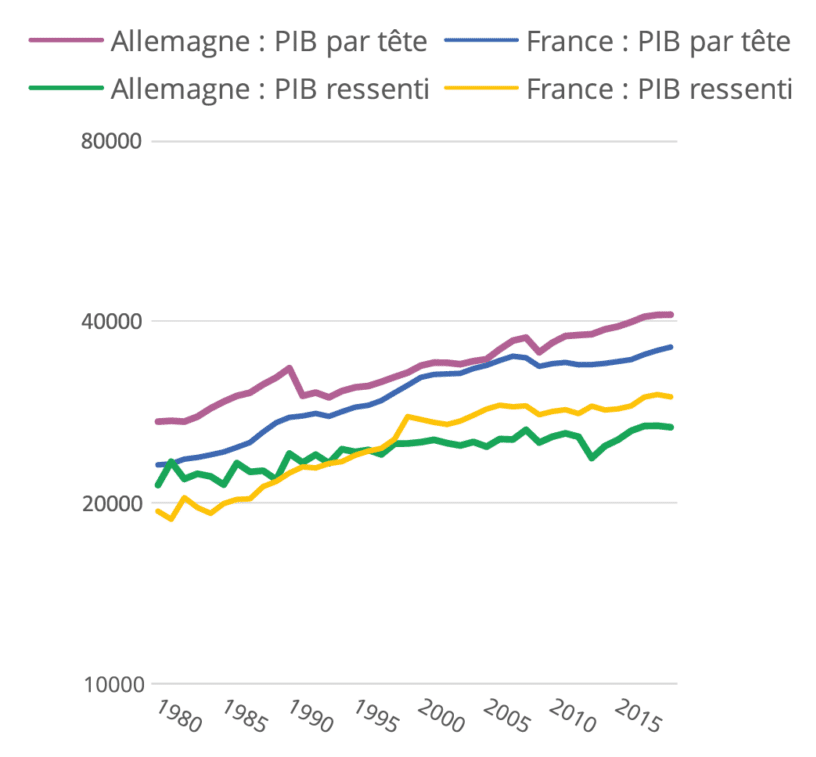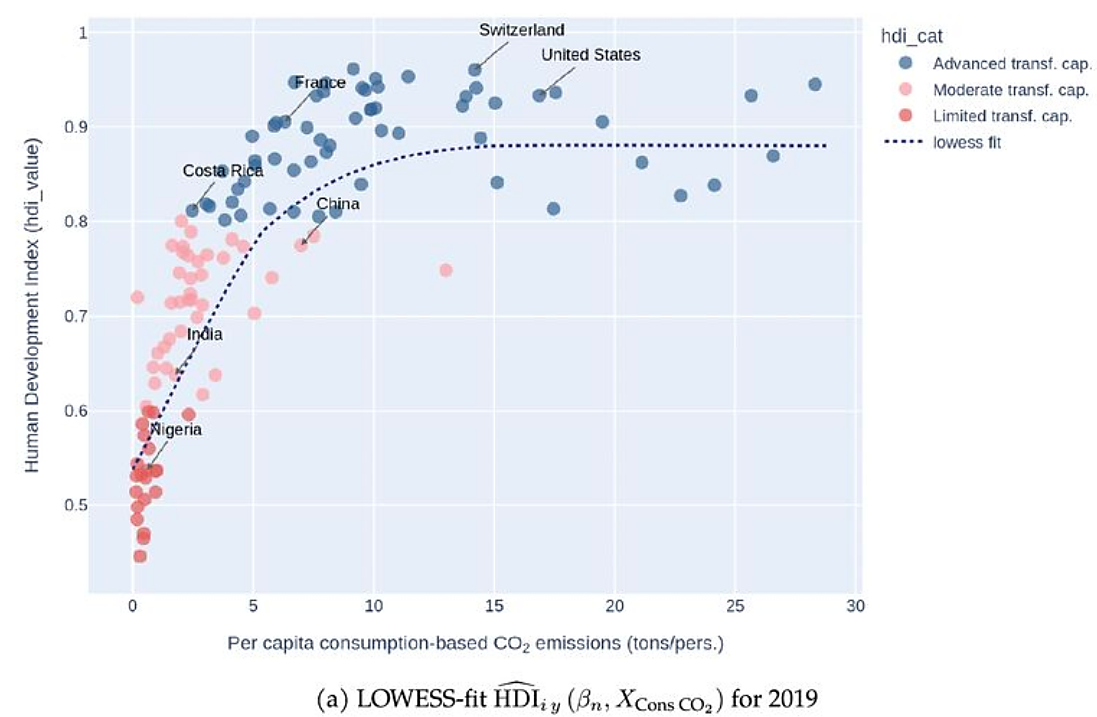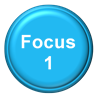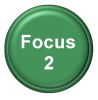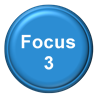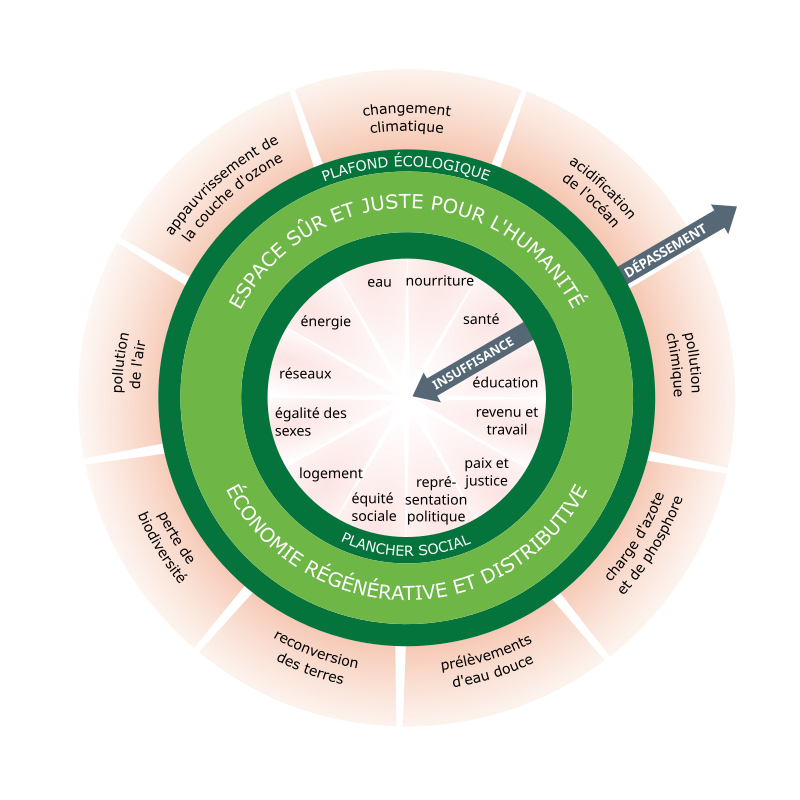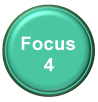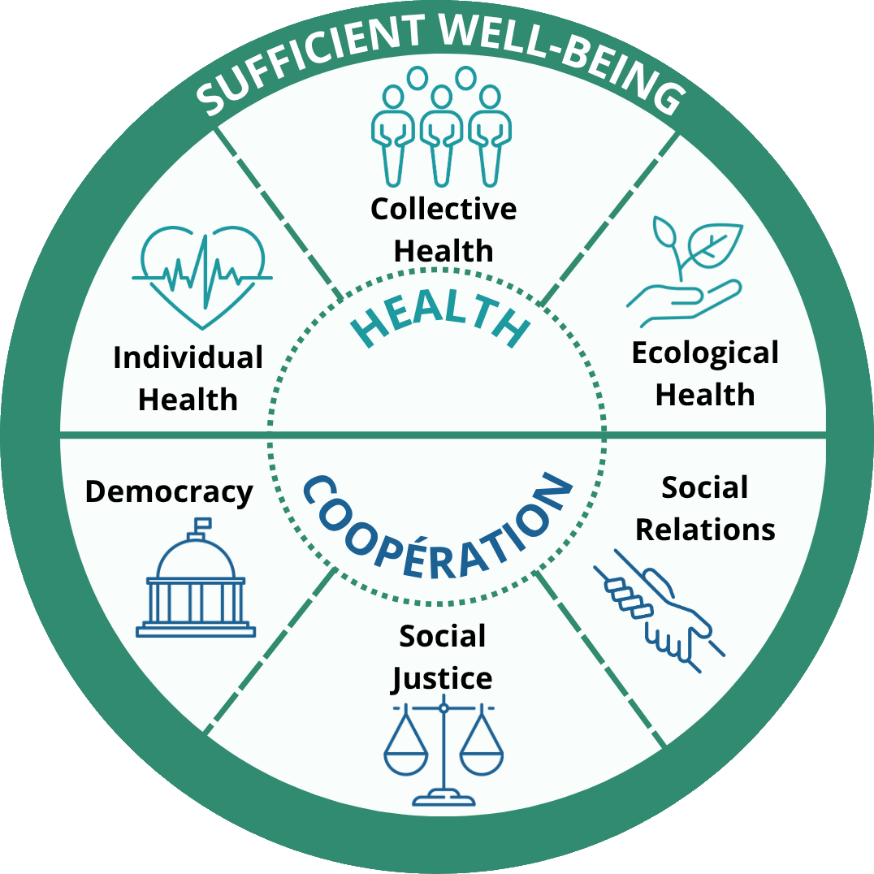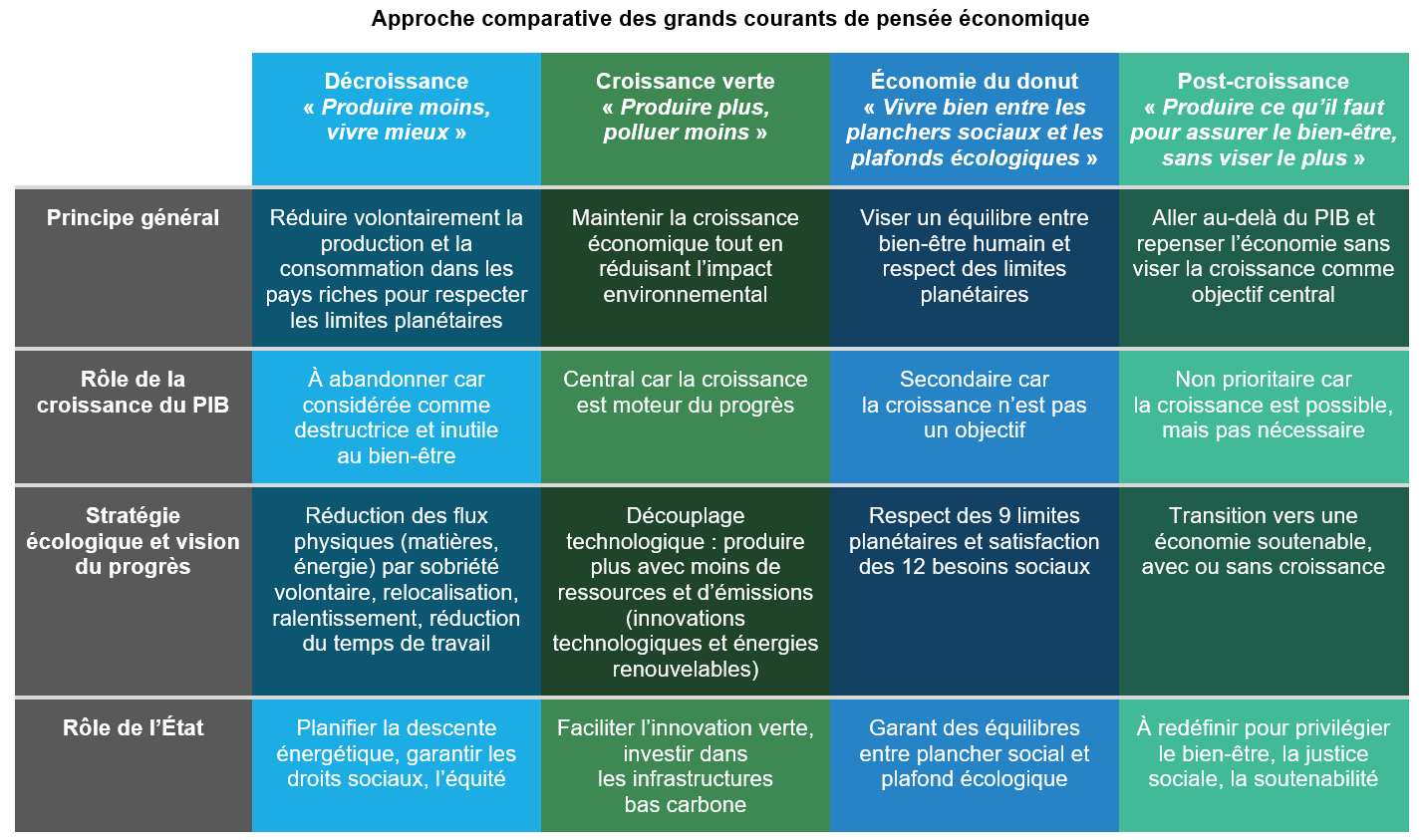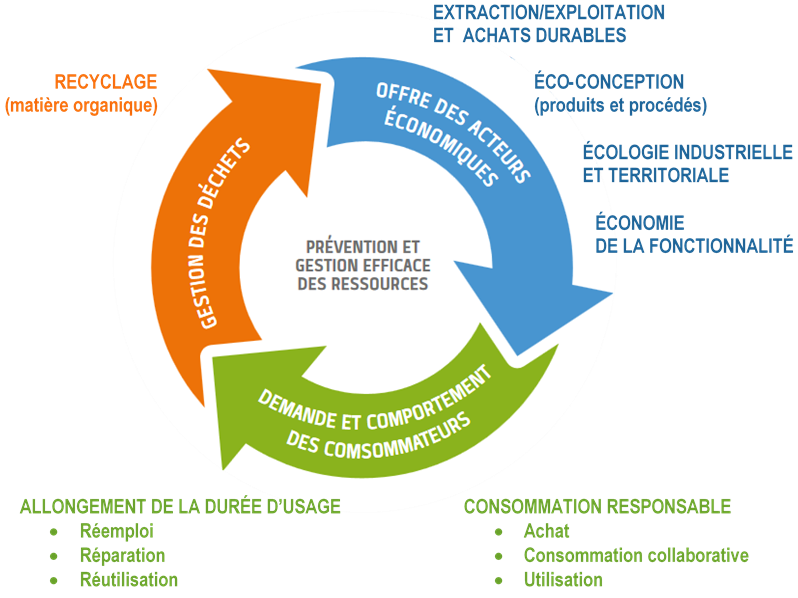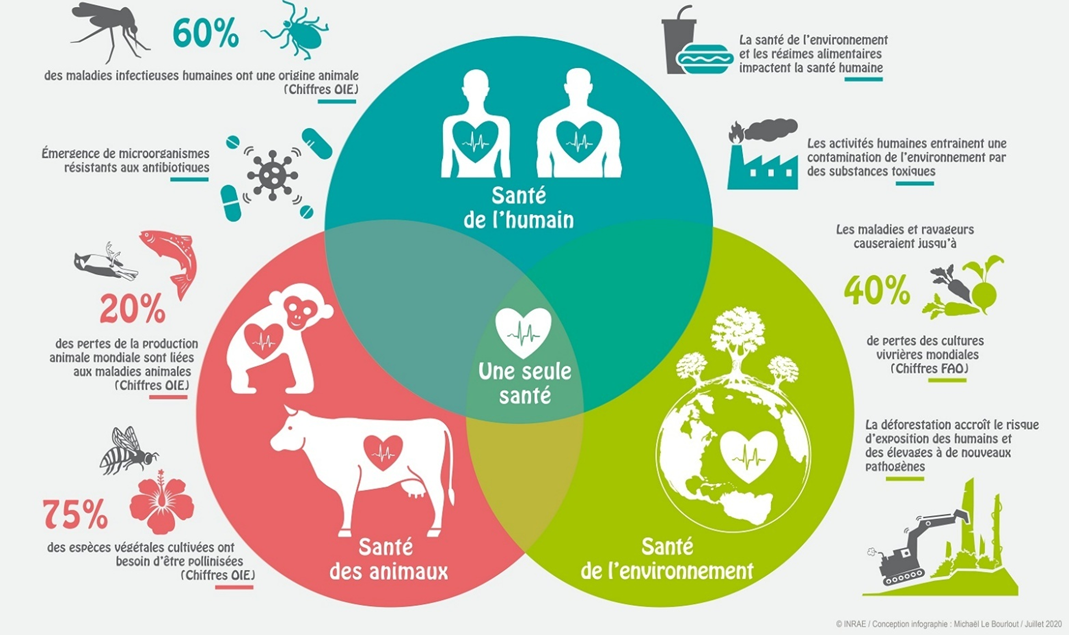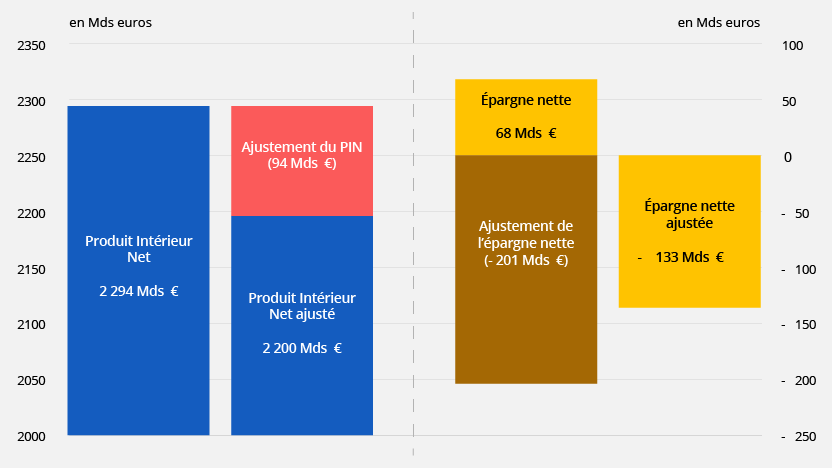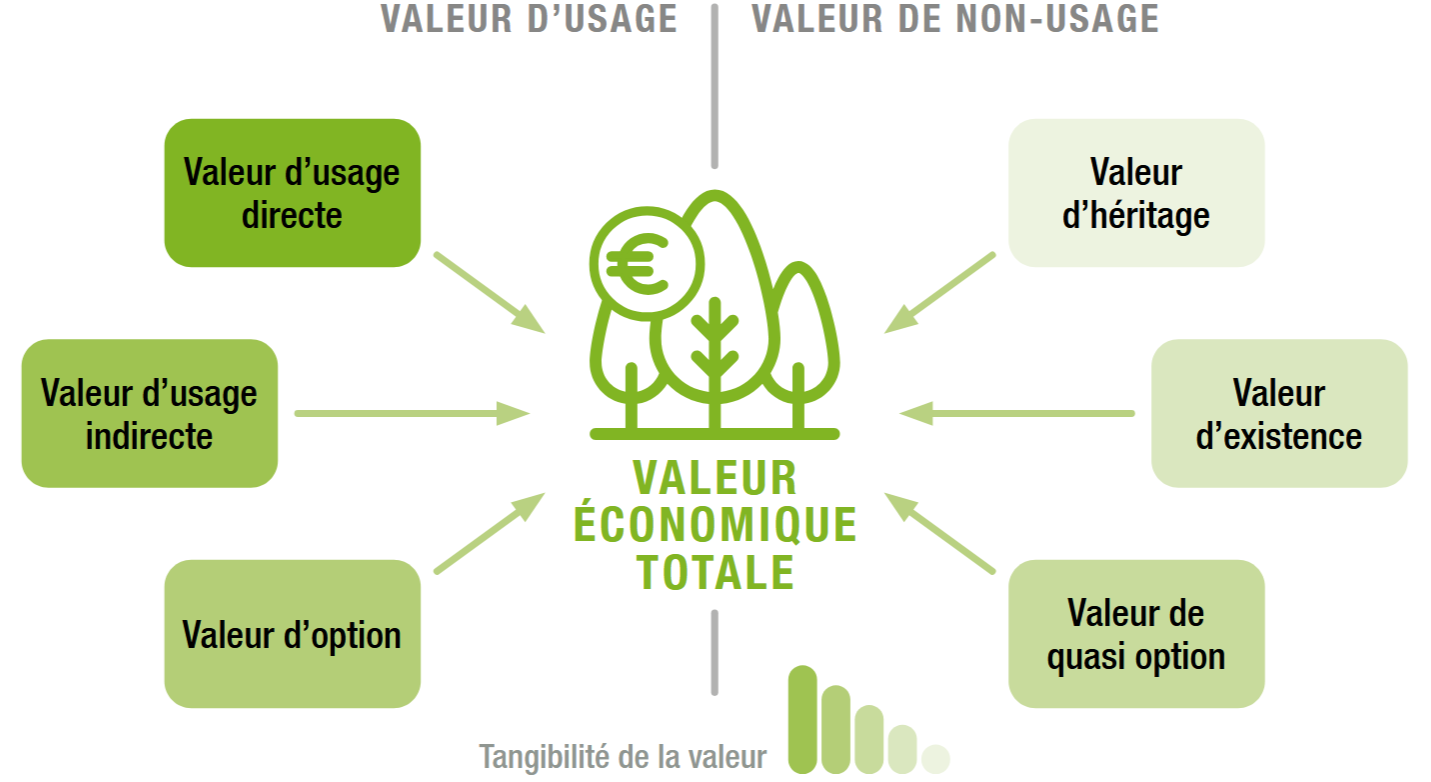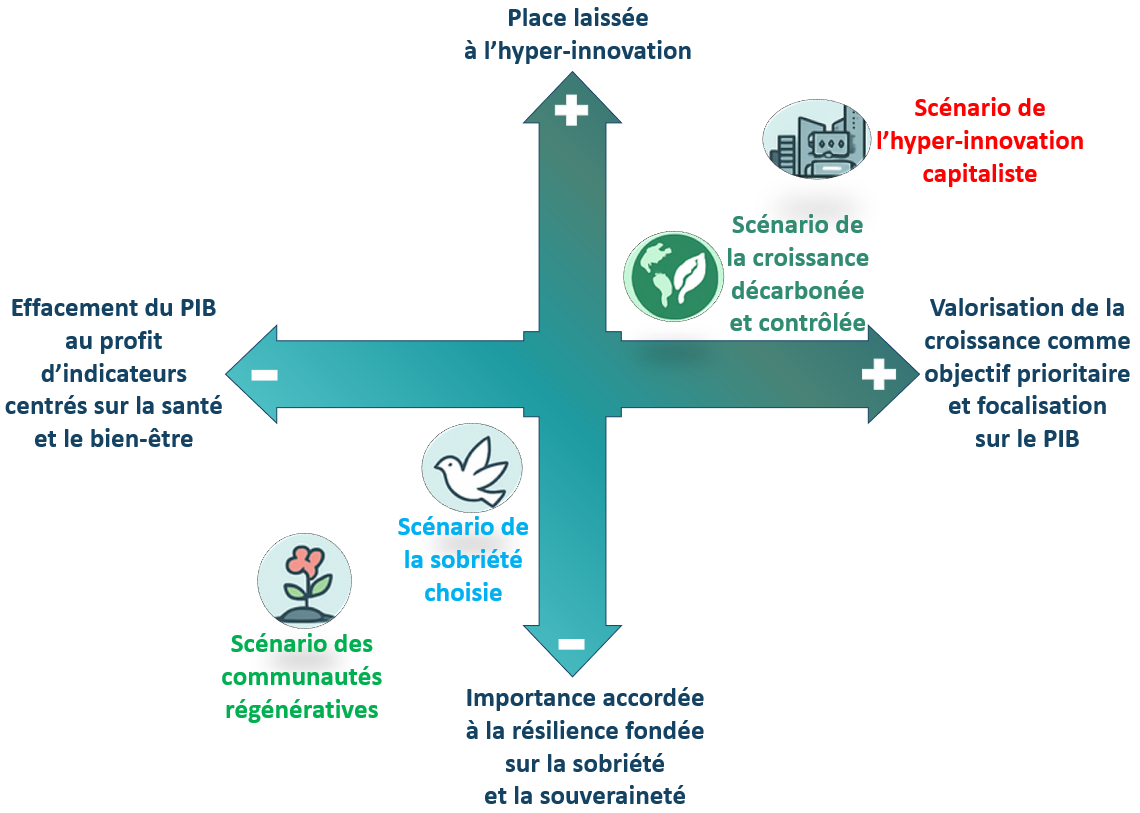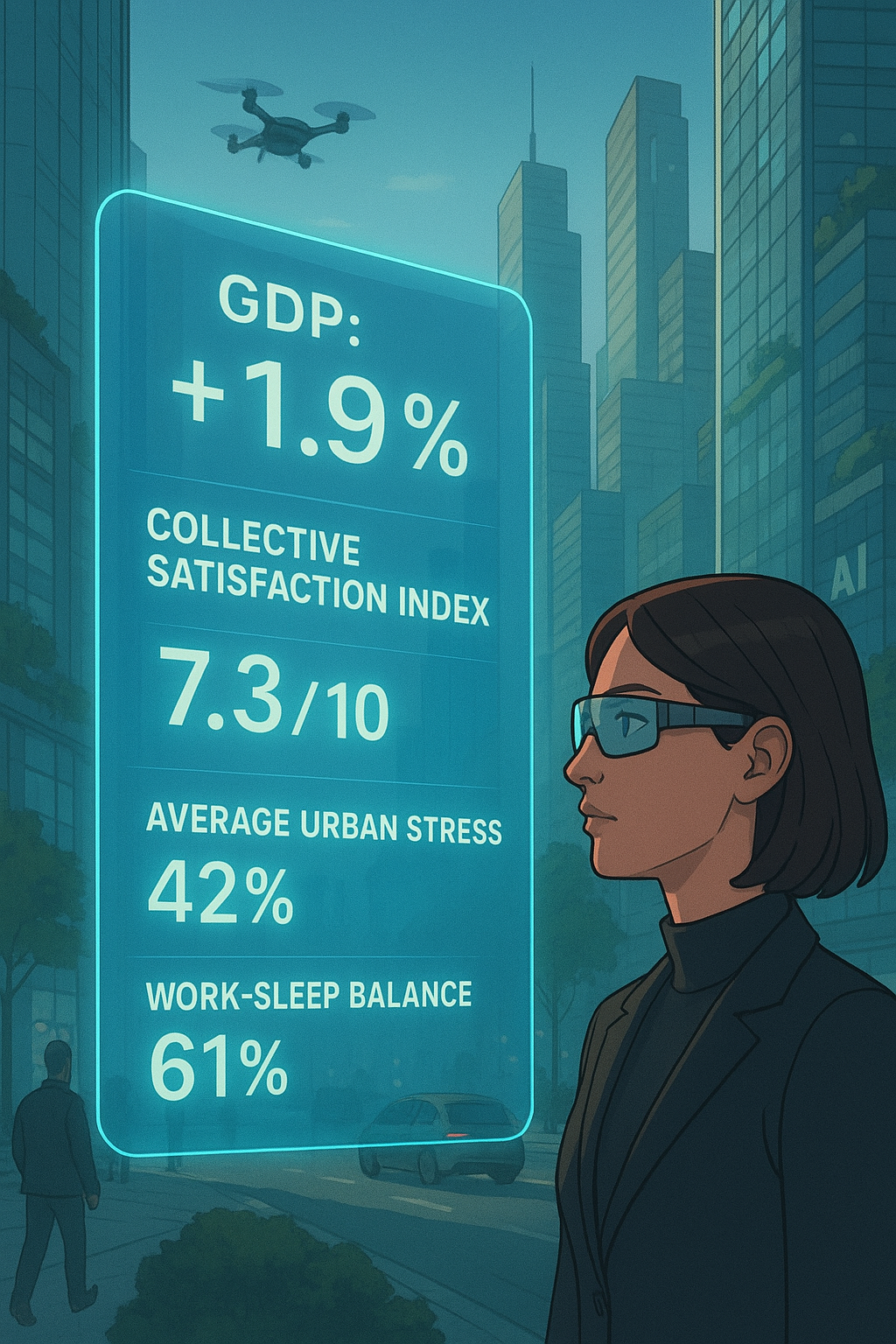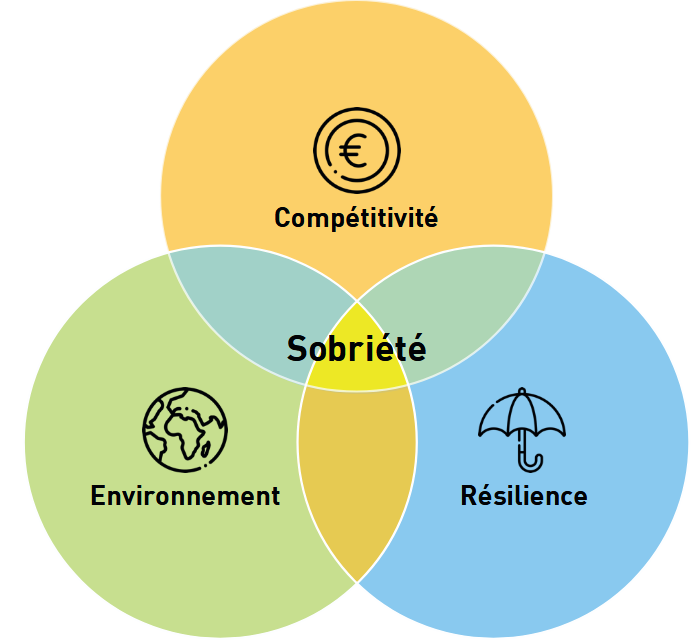- AVANT-PROPOS
- PREMIÈRE PARTIE
INSTALLÉ AU « POSTE DE PILOTAGE » DE NOS SOCIÉTÉS, L'OBJECTIF DE CROISSANCE EST DEVENU LA VALEUR ÉCONOMIQUE DOMINANTE
- I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ,
LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ
HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT
- II. LA CROISSANCE, QUI A PERMIS UNE
AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE, A
JOUÉ UN RÔLE DE CIMENT SOCIAL PENDANT PLUSIEURS
DÉCENNIES
- III. MAIS LE PRIMAT ACCORDÉ À
L'OBJECTIF DE CROISSANCE A QUELQUE PEU ESCAMOTÉ LE DÉBAT
POLITIQUE ET MORAL SUR LES VALEURS ET SUR NOTRE RAPPORT À LA FINITUDE DU
MONDE
- I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ,
LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ
HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT
- DEUXIÈME PARTIE
LA FORTE ÉROSION DU LIEN ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROGRÈS HUMAIN INTERROGE SUR CE QUE NOUS SOUHAITONS RÉELLEMENT VALORISER DANS NOTRE ÉCONOMIE
- I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT
PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »
- A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE
ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA
TRÈS CONVOITÉE
- B. UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE MONDIAL
QUI BOULEVERSE LA NOTION DE VALEUR ÉCONOMIQUE ET MET EN TENSION LES
MODÈLES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
- C. DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET
HABITABILITÉ DU MONDE : LA PERSPECTIVE D'UNE
INSOLVABILITÉ PLANÉTAIRE ?
- D. EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ :
UNE REMISE EN CAUSE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DONT ON NE MESURE
PAS TOUS LES EFFETS
- A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE
ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA
TRÈS CONVOITÉE
- II. LA QUADRATURE DU CERCLE : UNE CROISSANCE
DURABLEMENT FAIBLE, DES DETTES INSOUTENABLES ET DES BESOINS DE FINANCEMENT
MASSIFS
- I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT
PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »
- TROISIÈME PARTIE
DE NOUVEAUX OUTILS ET DE MULTIPLES INSPIRATIONS POUR REVISITER NOS SCHÉMAS DE PENSÉE ET NOS FAÇONS D'AGIR
- I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE
IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ
- II. D'AUTRES VOIES EXPLORATOIRES PLAÇANT
LA RÉSILIENCE ET LA SANTÉ DU VIVANT AU CENTRE
DE LA VALEUR « ÉCONOMIE »
- III. DE NOUVEAUX OUTILS COMPTABLES POUR
PROTÉGER LA SANTÉ DU VIVANT ET L'INTÉRÊT DES
GÉNÉRATIONS FUTURES
- I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE
IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ
- QUATRIÈME PARTIE
QUATRE SCÉNARII PROSPECTIFS SUR LA VALEUR « ÉCONOMIE » EN 2050
- CINQUIÈME PARTIE
TROIS GRANDES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR PLACER LA SANTÉ DU VIVANT AU CoeUR DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE
- I. UN NOUVEAU NARRATIF POUR FAIRE ÉVOLUER
NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR
- II. UNE RÉVISION DES OUTILS
ÉCONOMIQUES ET MÉTHODOLOGIES COMPTABLES POUR DÉCIDER
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
- III. UNE ADAPTATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE
POUR MIEUX INTÉGRER LE TEMPS LONG ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
- A. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES DE
GOUVERNANCE INTERNATIONALE POUR LEUR CONFIER LA MISE EN oeUVRE
D'ÉVALUATIONS ANNUELLES DE LA SOLVABILITÉ
PLANÉTAIRE
- B. RÉFORMER L'ENVIRONNEMENT
EUROPÉEN
- C. RENFORCER LES EFFORTS TOUS AZIMUTS EN FAVEUR DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES TERRITOIRES
- D. RÉFLÉCHIR AUX ADAPTATIONS DE LA
GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
- A. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES DE
GOUVERNANCE INTERNATIONALE POUR LEUR CONFIER LA MISE EN oeUVRE
D'ÉVALUATIONS ANNUELLES DE LA SOLVABILITÉ
PLANÉTAIRE
- I. UN NOUVEAU NARRATIF POUR FAIRE ÉVOLUER
NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR
- TROIS GRANDES ORIENTATIONS POUR L'AVENIR
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
N° 10
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation
sénatoriale à la prospective
(1)
sur l'évolution des
valeurs dans le champ
économique à
l'horizon 2050,
Par M. Éric DUMOULIN, Mme Vanina PAOLI-GAGIN et M. Stéphane SAUTAREL,
Sénateurs
(1) Cette délégation est composée de : Mme Christine Lavarde, président ; MM. Christian Bruyen, Guislain Cambier, Mme Cécile Cukierman, M. Bernard Fialaire, Mme Nadège Havet, M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Annick Jacquemet, MM. Yannick Jadot, Jean-Jacques Michau, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Anne Ventalon, vice-présidents ; MM. Bruno Belin, Vincent Delahaye, Stéphane Sautarel, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Jean-Baptiste Blanc, François Bonneau, Rémi Cardon, Christophe Chaillou, Raphaël Daubet, Mme Patricia Demas, M. Éric Dumoulin, Mme Amel Gacquerre, MM. Roger Karoutchi, Khalifé Khalifé, Vincent Louault, Louis-Jean de Nicolaÿ, Alexandre Ouizille, Didier Rambaud, Mme Marie-Pierre Richer, MM. Pierre-Alain Roiron, Jean Sol, Mmes Sylvie Vermeillet, Mélanie Vogel.
AVANT-PROPOS
Les valeurs qui sous-tendent les choix économiques sont plus que jamais au coeur des enjeux, à l'aube des grandes mutations qui se dessinent pour les décennies à venir.
Dans des sociétés en quête de sens, que restera-t-il à l'horizon 2050 des logiques actuelles de croissance, de profit, de compétition ? Comment se mesureront la prospérité et la solidarité intergénérationnelle ? Assistera-t-on à une recomposition des valeurs et à l'émergence de nouvelles priorités fondées par exemple sur la sobriété, la résilience, la santé et le bien-être ?
Car avec l'amplification de la mondialisation - mondialisation qui pourrait désormais connaître un début d'inflexion -, les références et cadres de réflexion employés ont contribué à invisibiliser les coûts réels de l'activité humaine et ses effets destructeurs sur l'environnement.
Nos paradigmes se révèlent ainsi inadaptés à la prise en compte des problématiques de long terme. De nombreuses composantes de la nature ne sont pas intégrées dans les outils et les analyses stratégiques, tandis que la prise en compte du bien-être social reste pour le moins secondaire.
Ce rapport de prospective propose d'explorer les voies possibles, en interrogeant les valeurs qui guideront les acteurs économiques dans un monde appelé à évoluer autrement pour protéger le vivant, ne pouvant plus se contenter de croître.
PREMIÈRE PARTIE
INSTALLÉ
AU « POSTE DE PILOTAGE » DE
NOS SOCIÉTÉS, L'OBJECTIF DE CROISSANCE EST DEVENU LA VALEUR
ÉCONOMIQUE DOMINANTE
I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ, LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT
A. UN DÉSIR DE CROISSANCE EN RUPTURE AVEC LA STABILITÉ DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE PENDANT DES MILLÉNAIRES
Du point de vue des valeurs économiques et du niveau de richesse, les premières sociétés humaines ont connu pendant des millénaires une extraordinaire stabilité.
Les études anthropologiques montrent que leur désir portait non sur la croissance économique mais sur la perpétuation de leur état initial à travers le temps1(*). Ces sociétés se structurent autour de la reproduction des valeurs qui leur ont été léguées par leurs ancêtres. Pour Marcel Gauchet, ce respect d'un ordre préétabli correspond à une reconnaissance de dette de sens envers les fondateurs.
De fait, alors même qu'elles auraient la capacité de produire davantage, ces sociétés premières assurent d'abord leur subsistance, ce qui occupe relativement peu de leur temps2(*); la notion de stock est absente.
Les premières manifestations de la croissance apparaissent en Angleterre et aux Pays-Bas pendant la révolution agricole des XVIe et XVIIe siècles. Ces pays voient le volume global de leur production croître structurellement plus vite que la croissance de leur population. Mais c'est la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle qui marque une accélération de la croissance et le début d'une élévation du niveau de vie dont les premiers effets apparaissent en Grande-Bretagne.
Daniel Cohen rappelle ainsi que jusqu'au XVIIIe siècle, le revenu moyen des habitants de la planète est resté stagnant : « Le niveau de vie d'un esclave romain n'est pas significativement différent de celui d'un paysan du Languedoc au XVIIe siècle ou d'un ouvrier de la grande industrie du début du XIXe. Il est proche de celui des pauvres du monde moderne : autour de un dollar par jour. »3(*)
B. LE PIB : UN OUTIL DE MESURE DE LA « SANTÉ » ÉCONOMIQUE QUI A MOINS DE 100 ANS
Aucun indicateur synthétique de suivi de l'activité économique n'existait avant la crise des années 1930. Pour mesurer la production industrielle, les décideurs s'appuyaient sur des indices statistiques éparses et incomplets, comme le chargement des wagons de marchandises ou les cours boursiers.
L'invention du produit intérieur brut (PIB) par la Commission « Kuznets » en 1934, à la demande du Congrès américain, permet pour la première fois de disposer d'un agrégat économique d'ensemble et d'évaluer les effets négatifs de la Grande Dépression à la suite de la crise de 19294(*).
En quelques années, le PIB devient la métrique de référence de la performance économique : les accords de Bretton Woods de 1944 conduisent à son adoption par le monde entier ; la France systématise son utilisation à partir de 1949. Le PIB devient une norme universelle et le PIB par habitant l'indicateur majeur permettant de comparer les pays. À la même époque se mettent en place les premiers systèmes de comptabilité nationale avant une standardisation dans les années 19605(*).
La volonté d'accumulation et d'abondance économiques, que l'on peut donc dater historiquement, est une constante des sociétés modernes, de la Révolution industrielle à la Seconde Guerre mondiale. L'après-guerre marque l'entrée dans une période de valorisation de la croissance économique comme horizon durable pour l'humanité, au terme de ce que Jérôme Batout qualifie de « révolution silencieuse des mentalités »6(*).
II. LA CROISSANCE, QUI A PERMIS UNE AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE, A JOUÉ UN RÔLE DE CIMENT SOCIAL PENDANT PLUSIEURS DÉCENNIES
A. LA VALORISATION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE : GAGE DE L'AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE
Dès les années 1930, la valorisation de la croissance comme moteur de progrès généralisé conduisait John Maynard Keynes à imaginer un décuplement du niveau de vie dans les pays développés dans le siècle à venir et à envisager que l'humanité puisse à ce terme être libérée de toute nécessité économique après avoir atteint un « point terminal d'abondance »7(*).
« Pour la première fois depuis son apparition, l'homme sera confronté à son problème véritable et éternel : comment utiliser sa liberté, une fois résolus les soucis économiques pressants ? »
John Maynard Keynes, Possibilités économiques pour nos petits enfants, 19308(*)
La prospérité, fondée sur un renouvellement technologique continuel et une croissance économique plus rapide que la croissance démographique, a permis l'élévation du niveau de vie, la réduction de la pauvreté, l'allongement de l'espérance de vie et, plus globalement, une amélioration concrète des conditions de vie pour une large partie de la population dans les pays industrialisés. La croissance du revenu par tête s'est imposée comme un indicateur central de la prospérité.
Un siècle après Keynes, la croissance économique continue d'être valorisée non dans l'objectif ultime d'atteindre un état stationnaire d'abondance mais comme un outil indispensable pour garantir le bien-être collectif et une condition dont découlent toutes les autres : pour le ministère de l'économie et des finances français, « la croissance est la quête perpétuelle des politiques économiques »9(*).
B. LA VALEUR ÉCONOMIQUE : AGENT PACIFICATEUR DANS UNE SOCIÉTÉ DEVENUE PLUS HÉTÉRONOME
En tournant les sociétés vers la recherche de croissance, de productivité, de consommation et un objectif commun de prospérité matérielle, la valeur économique a joué après-guerre un rôle unificateur et stabilisateur dans les démocraties : elle est apparue comme un terrain d'entente possible avec pour horizon commun la reconstruction.
« Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, nous avions des niveaux d'augmentation de notre PIB par la productivité dix fois plus élevés, avec des augmentations de 5 à 6 % par an. Cela a permis de réaliser de nombreux changements structurels qui sont passés inaperçus, notamment la réduction du temps de travail et l'investissement. »
Antonin Bergeaud, audition par la délégation à la prospective, 27 mai 2025
Parallèlement, comme le soulignent Emmanuel Constantin et Jérôme Batout10(*), la place prise par la valeur économique a fait glisser la société vers un fonctionnement plus hétéronome, où les finalités collectives tendent à résulter de logiques de gestion et d'optimisation davantage que de délibérations morales et collectives et où la politique économique a progressivement supplanté l'économie politique par une dévitalisation du débat politique.
III. MAIS LE PRIMAT ACCORDÉ À L'OBJECTIF DE CROISSANCE A QUELQUE PEU ESCAMOTÉ LE DÉBAT POLITIQUE ET MORAL SUR LES VALEURS ET SUR NOTRE RAPPORT À LA FINITUDE DU MONDE
A. UNE VALEUR ÉCONOMIQUE FONGIBLE DANS TOUTES LES AUTRES
D'aucuns soulignent que parce qu'elle semble offrir un langage commun, neutre, quantifiable, stable et qu'elle valorise le présent et encore davantage l'avenir, la valeur économique a pris une place première, au détriment d'un questionnement sur la finalité des actions humaines, le sens du progrès, le bien commun.
Dans cette perspective, l'économie qui mobilise ce qui est évaluable, chiffrable, comparable, et nous conduit à cesser de valoriser ou à relativiser ce qui échappe à la mesure - les valeurs éthiques -, est en quelque sorte devenue l'« accord sur lequel pouvaient se fonder tous nos désaccords ».
|
« La valeur économique est fongible dans toutes les autres zones de valeurs, et l'existence d'un prix permet de tout comparer. [...] La valeur économique a résolu le problème de la multiplicité des valeurs en leur aménageant une place qui permet à toutes les activités humaines de coexister. C'est dans cette dynamique que nous sommes entrés après la Seconde Guerre mondiale, où le PIB et la croissance se sont installés au poste de pilotage de nos sociétés. » Jérôme Batout, audition par la délégation à la prospective, 8 avril 2025 |
B. LA FIN DU MYTHE DE LA MONDIALISATION HEUREUSE ET LA CRISE DE LA VALORISATION
L'idée que la croissance économique et l'essor du commerce international seraient de puissants leviers pour faire converger les sociétés vers un modèle de développement prospère et moins inégalitaire a pu s'imposer dans les années 1990 et avec la fin de la Guerre froide.
Les vulnérabilités de ce modèle, reposant sur la mondialisation des chaînes de valeur et la place prise par l'économie immatérielle, sont aujourd'hui bien identifiées. Dans un monde confronté à de nombreux bouleversements - crises écologiques, inégalités, insécurité alimentaire, pandémies, vieillissement démographique -, le mythe de la mondialisation heureuse semble ainsi s'achever dans une crise de la valorisation : la prééminence donnée à la valeur « économie » a appauvri le rapport au monde et réduit la complexité humaine.
Les trois âges du développement humain selon Éloi Laurent11(*)
Pour Éloi Laurent, pendant « la première moitié du XXe siècle, la population augmente et le développement humain s'accroît encore plus vite. C'est le temps du progrès [...] : un plus grand nombre d'humains connaissent en moyenne un surcroît de bien-être. » Cette nouvelle prospérité se reflète dans le PIB, qui reste compatible avec la préservation de l'habitat.
Entre 1950 et 1980, « la grande désynchronisation commence ». Rattrapée par la hausse démographique, la croissance du développement humain ralentit et les émissions de CO2 et le PIB « s'emballent ».
« Le troisième âge du développement humain est le temps de l'illusion : alors que population et développement humain se stabilisent au même rythme de progression, les émissions de CO2 continuent de croître bien plus vite qu'eux tandis qu'un PIB hyperbolique, complètement déconnecté de la réalité sociale, masque la gravité de la crise écologique et fait diversion. »
Éloi Laurent conclut que « nous sommes passés en un peu plus d'un siècle du progrès à la croissance, qui n'est que l'illusion du progrès ».
La difficulté à inscrire l'action collective dans le temps long et à prendre en compte les enjeux intergénérationnels est pointée dès la fin des années 1990 dans plusieurs travaux qui réinterrogent la notion de croissance12(*).
Mais les alertes sur l'inadaptation du modèle de croissance au regard de ces enjeux ne semblent être devenues audibles qu'à mesure que les risques écologiques évoqués par la communauté scientifique sont devenus perceptibles.
Des critiques anciennes du modèle de croissance longtemps restées inaudibles
1970 : les premières critiques de la croissance connaissent une audience internationale...
Georges Pompidou : pour une morale de l'environnement
« L'emprise de l'Homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'Homme du début du siècle s'acharnait à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'Homme. »
Discours prononcé à Chicago le 28 février 1970
Sicco Mansholt : le nécessaire renversement des politiques publiques
« Il est évident que la société de demain ne pourra être axée sur la croissance, du moins pas dans le domaine matériel. [...] [N]otre objectif primordial sera de sauvegarder l'équilibre écologique et de réserver aux générations futures des sources d'énergie suffisantes. »
Lettre au Président de la Commission européenne du 9 février 1972
Denis Meadows : l'illusion d'une croissance sans limites
« Au cours des 50 dernières années, les êtres humains ont multiplié par 2, 4, 10, voire plus, leurs effectifs, leurs possessions physiques, et les flux de matières et d'énergie qu'ils utilisent, et ils espèrent que cette croissance va se poursuivre [...]. La croissance peut certes résoudre certains problèmes, mais elle peut en créer d'autres. À cause des limites [...]. Et la Terre a des limites finies. »
Les Limites à la croissance (dans un monde fini), 1972
...mais se heurtent à la crise économique et à l'inertie des sociétés.
Le regard rétrospectif de Dennis Meadows : « Il fut un temps où les limites à la croissance appartenaient à un futur éloigné. Elles sont bien là, aujourd'hui. Il fut un temps où le concept d'effondrement était inconcevable. Il fait aujourd'hui son apparition dans les discours publics, même s'il renvoie encore à une réalité lointaine, hypothétique et abstraite. Nous estimons qu'il faudra encore 10 ans pour pouvoir observer clairement les conséquences du dépassement et 20 ans pour que le dépassement soit accepté comme un état de fait. »
Dennis Meadows, Jørgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), Le Rapport Meadows 30 ans après, 2004
DEUXIÈME PARTIE
LA
FORTE ÉROSION DU LIEN ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
PROGRÈS HUMAIN INTERROGE SUR CE QUE NOUS SOUHAITONS
RÉELLEMENT VALORISER DANS NOTRE ÉCONOMIE
I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »
A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA TRÈS CONVOITÉE
En l'espace de trente ans, la Chine s'est imposée comme la deuxième économie mondiale en termes de PIB. Sous réserve des nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques et de certaines vulnérabilités (dette, crise immobilière, démographie), les projections économiques tendent à indiquer qu'elle pourrait dépasser largement les États-Unis en 2050, avec, selon le CEPII13(*), un PIB économique 44 % plus élevé.
Cette trajectoire reposerait sur une croissance ralentie mais constante, la conservation d'une forte base industrielle et une domination en parité de pouvoir d'achat. La politique d'accompagnement des entreprises technologiques chinoises (plan Made In China 2025) fait de la Chine le principal concurrent de la puissance américaine dans le domaine des hautes technologies, de l'intelligence artificielle et pour l'accès à l'énergie et aux matières premières, avec une attention particulière portée à l'environnement et la décarbonation dans le cadre de ce que certains qualifient de « projet civilisationnel ».
À l'horizon 2050, l'accentuation de la rivalité sino-américaine aurait redessiné la géographie économique, marquée par un recul de la place de l'Europe dans le monde. L'Inde pourrait avoir pris la troisième place mondiale (quatrième si l'on prend l'UE dans son ensemble), avec un PIB trois fois supérieur à celui du Royaume-Uni. L'accès aux ressources rares et la performance environnementale procureraient un avantage compétitif dans une économie où la valeur environnementale des actifs deviendra une valeur très convoitée.
« Nous entrons, en cette ère d'hyperinnovation, dans une logique où la valeur économique réside de plus en plus dans la valeur des actifs, valeur qui se comprend “en négatif” pour une entreprise qui, par exemple, fonctionnerait de façon non conforme à nos critères moraux. [...]
Lorsque nous changeons de modèle, nous avons besoin de créer des actifs, comme ceux qui permettent d'améliorer la gestion de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, qui sont des éléments non monnayables, mais ont pourtant une réelle valeur économique. [...] La notion de valeur au sens strict est probablement dépassée. Nous sommes obligés d'intégrer d'autres valeurs que celle des flux, qui reste trop souvent en économie la valeur de référence.
Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025
Dans une économie toujours financiarisée, ultra-numérisée et immatérielle, fortement interdépendante, certaines régions du monde pourraient continuer de raisonner selon des logiques de valeurs très différentes des valeurs européennes, lesquelles pourraient être de plus en plus difficiles à défendre, tandis que le besoin de protection des populations serait croissant.
B. UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE MONDIAL QUI BOULEVERSE LA NOTION DE VALEUR ÉCONOMIQUE ET MET EN TENSION LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
Les dernières projections démographiques de l'ONU14(*) indiquent que la population mondiale va poursuivre sa croissance pendant 50 à 60 ans, pour passer de 8,2 à 10,3 milliards d'habitants en 2080, avant d'entamer une baisse progressive au tournant du siècle. La population de l'Afrique subsaharienne devrait doubler d'ici 2050. L'Inde, qui compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, restera le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine.
Dans une centaine de pays, la population en âge de travailler (20-64 ans) va croître jusqu'en 2054, laissant entrevoir pour ceux-ci un « dividende démographique » sous réserve d'un investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures.
La part de quelques régions et pays dans la population mondiale et le poids des jeunes dans leur population en 2020, 2050 et 2100
Globalement cependant, en raison de l'espérance de vie croissante15(*) et de la baisse des niveaux de fécondité, la population mondiale vieillit. D'ores et déjà, un habitant sur quatre dans le monde réside dans un pays dont la démographie décline.
En 2018, pour la première fois dans l'histoire du monde, les personnes âgées de 65 ans ou plus étaient plus nombreuses que les enfants de moins de 5 ans. Dès les années 2030, les personnes âgées de plus de 80 ans seront plus nombreuses que les enfants de moins d'un an. En 2080, elles seront plus nombreuses que les moins de 18 ans.
Comme l'affirme Philippe Dessertine, « une population humaine de plus en plus âgée entraînera une évolution forte de la manière de penser le système économique et la valeur des différents actifs économiques ; cela a déjà commencé »16(*).
La proportion décroissante de la population en âge de travailler exercera une pression grandissante sur les systèmes de protection sociale (santé, retraite, dépendance) : le ratio de soutien potentiel, qui compare le nombre de personnes en âge de travailler à celui des plus de 65 ans, diminue dans le monde entier.
C. DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET HABITABILITÉ DU MONDE : LA PERSPECTIVE D'UNE INSOLVABILITÉ PLANÉTAIRE ?
· L'exceptionnel d'aujourd'hui sera la norme de demain
Au cours de leur vie, les générations nées dans les années 2020 connaîtront sept fois plus d'épisodes de chaleur extrême, deux fois plus de sécheresses et d'incendies de forêt et trois fois plus d'inondations et d'années de mauvaises récoltes que les personnes nées en 1960.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) souligne ainsi que « les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici une génération »17(*).
Aucune partie du monde n'est épargnée par le dérèglement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes, en particulier le continent européen qui se réchauffe le plus rapidement, deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
En France métropolitaine, pour un scénario d'émissions intermédiaire correspondant globalement à la réalisation des engagements de réduction des émissions de GES des États, le réchauffement atteindrait + 3,8 °C en 2100 par rapport à la période 1900-1930, contre + 2,7 °C sur l'ensemble de la planète18(*).
· L'objectif de limiter la hausse à + 1,5 °C d'ici 2030 déjà hors d'atteinte
Dans une récente étude qui actualise les principaux indicateurs de suivi du climat à l'échelle mondiale, une équipe internationale de scientifiques souligne que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à + 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle, tel que fixé par l'accord de Paris de 2015, est d'ores et déjà hors de portée, les perspectives tracées par le GIEC se réalisant plus rapidement que prévu19(*) : ce dernier estimait en 2023 que la hausse de la température moyenne mondiale aurait chaque année entre 30 % et 60 % de chance de dépasser 1,5 °C au début des années 2030.
En 2024, la hausse de la température moyenne mondiale a atteint + 1,52 °C par rapport à l'ère préindustrielle, dont 1,36 degrés attribuable aux activités humaines et le reste à la variabilité naturelle du climat. La décennie 2015-2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne de + 1,24 °C de réchauffement, dont 1,22 °C d'origine anthropique.
En raison de l'inertie de nos sociétés, les scientifiques concluent que la neutralité carbone ne pourra être atteinte d'ici la fin de la décennie.
Sans infléchissement du rythme d'émission, le budget carbone résiduel, entendu comme le total des émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour préserver les chances de maintenir le réchauffement sous les + 1,5 °C - soit 130 milliards de tonnes de CO2 - ne correspond qu'à trois années d'émissions à compter de 2025, voire moins en tenant compte des émissions de méthane qui continuent d'augmenter20(*).
Or dès 2023, les émissions de GES ont atteint le niveau record de 55 milliards de tonnes équivalent CO2, essentiellement du fait de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation. La concentration de CO2 dans l'atmosphère était 50 % plus importante qu'à l'époque préindustrielle.
Cette évolution entraîne des phénomènes irréversibles, parmi lesquels la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ainsi que la hausse du niveau marin (+ 3,91 mm par an entre 2006 et 2024, soit deux fois plus que le rythme observé depuis 1901), que seule une réduction la plus rapide possible des émissions de GES pourrait limiter car « chaque dixième de degré compte ».
· Des chocs économiquement sous-valorisés
Dans ce contexte, le coût des sinistres climatiques est appelé à s'accroître, France Assureurs estimant qu'il est déjà quatre fois plus important qu'il y a trente ans.
Dans un rapport publié par l'École britannique d'actuariat21(*) en collaboration avec l'Université d'Exeter sur les risques financiers liés au réchauffement climatique pour les entreprises et les organisations publiques, un risque ultime d'« insolvabilité planétaire » est identifié en l'absence d'intervention politique immédiate pour changer de cap.
Les auteurs de l'étude soulignent que les techniques habituelles de gestion des risques se concentrent en général sur des risques isolés, sous-estimant les risques en cascade. Or la dégradation des ressources naturelles telles que les forêts et les sols ou l'acidification et la pollution des océans ont un effet multiplicateur sur les conséquences du changement climatique.
« Si plusieurs points de bascule sont déclenchés, il pourrait exister un point de non-retour, après lequel il deviendrait impossible de stabiliser le climat. [...] Si rien n'est fait pour y remédier, les situations de mortalité de masse, les déplacements massifs de population, une forte contraction économique et les conflits deviendront plus probables. »
Rapport de l'École britannique d'actuariat en collaboration avec l'Université d'Exeter, janvier 2025
Au total, ils estiment que le PIB mondial pourrait perdre 50 % de sa valeur entre 2070 et 2090 en raison des divers chocs climatiques (sécheresses, inondations, incendies, effondrement des écosystèmes).
Cette perspective, liée à la profonde déstabilisation des fondements physiques et biologiques de nos économies, doit alerter sur le risque majeur de décroissance structurelle que nous courons désormais.
Sont ainsi pointées l'urgence de choisir un autre modèle de croissance, plus respectueux du monde vivant et de nos ressources, et la nécessité de faire évoluer nos indicateurs de référence, afin de privilégier des mesures allant dans le sens de la soutenabilité écologique, du bien-être humain et de la résilience des sociétés.
Une interdépendance des risques économiques, sociaux et environnementaux22(*)
D. EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ : UNE REMISE EN CAUSE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DONT ON NE MESURE PAS TOUS LES EFFETS
La surexploitation des ressources, la destruction des habitats, le changement climatique, la pollution de l'air, de l'eau et des sols et, dans une moindre mesure, l'introduction d'espèces envahissantes, sont des causes majeures d'érosion de la biodiversité23(*).
|
Au cours du temps, la masse des humains a été dépassée par celle du bétail utilisé pour l'alimentation humaine, laquelle a également dépassé la masse des mammifères sauvages, réduite à peau de chagrin en étant divisée par 6 en 100 000 ans. L'agriculture et l'élevage ont appauvri la diversité des plantes et des animaux : 9 plantes parmi les 6000 espèces cultivées représentent aujourd'hui deux tiers de la production végétale ; 14 espèces d'oiseaux et de mammifères fournissent plus de 90 % de l'alimentation carnée. La biomasse des insectes a quant à elle diminué de 75 % en 27 ans tandis que 30 % des arbres sont menacés d'extinction. L'indice planète vivante (IPV) montre une baisse moyenne de la taille des populations de vertébrés (en nombre d'espèces et d'individus), les plus touchées étant les espèces « spécialistes », qui ne peuvent survivre que dans des conditions environnementales et d'alimentation très précises. |
Or la variété des formes de vie sur la Terre est pour l'humanité une condition existentielle. Et nous ne mesurons pas toute la valeur des services écosystémiques apportés par la biodiversité aux êtres-humains et à la planète, indépendamment des qualités intrinsèques de la nature et du devoir moral qui nous conduit à ne pas vouloir la détruire.
Si l'on s'en tient à la valeur instrumentale des écosystèmes, ceux-ci sont une condition essentielle du bon fonctionnement de l'économie24(*).
L'impact du recul de la biodiversité sur
l'économie
en % du PIB, à l'horizon de
2050
Source : Adapté de Roxburgh et al. (2020)
Selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), plus de 40 % des titres détenus par les institutions financières françaises sont émis par des entreprises qui seraient fortement ou très fortement dépendantes d'au moins un service écosystémique25(*). Or la comptabilité traditionnelle ne considère pas les pressions exercées sur l'environnement et les risques qui en découlent pour les sociétés.
Plus globalement, de fortes incertitudes rendent difficiles les tentatives de valorisation des écosystèmes :
- l'ensemble des bienfaits que peut apporter la nature ne sont pas encore connus ; les recherches sur le vivant conduisent régulièrement à envisager de nouvelles applications potentielles dans un contexte où il reste encore de très nombreuses espèces à découvrir ;
- on ne connaît pas encore toutes les conséquences d'une diversité amoindrie. Des interdépendances complexes et des interactions constantes existent entre les humains et les autres êtres-vivants, comme l'a révélé avec force la crise généralisée du covid-19 et le laisse entrevoir la progression des zoonoses. Les scientifiques ignorent s'il existe un seuil de perte de biodiversité à ne pas dépasser.
Les dynamiques écosystémiques entraînent « des non-linéarités, des phénomènes complexes, des propriétés émergentes, des phénomènes d'emballement qu'on peut avoir du mal à prédire, en particulier parce que les évolutions actuelles des écosystèmes sortent du périmètre d'échantillonnage, de ce que nous connaissons et avec lequel nous calibrons nos modèles. [...] On doit gérer un processus très peu connu, très complexe avec de nombreuses propriétés émergentes peu anticipables, et qui met en jeu deux types de valeur, instrumentale et non instrumentale ».
Lauriane Mouysset, audition par la délégation à la prospective, 27 mai 2025
Les chercheurs insistent néanmoins sur les effets boule de neige qui peuvent entraîner une cascade de disparitions d'espèces. À titre d'exemple, selon le Réseau Action Climat et l'Ademe, avec un réchauffement de + 2 °C en 2050, 99 % des coraux auront disparu dans les Antilles françaises. Cet effondrement des écosystèmes qui concentrent 25 % de la faune marine rompra la chaîne alimentaire26(*).
En tout état de cause, comme l'indique la chercheuse Virginie Courtier-Orgogozo, cette situation « nous entraîne dans une trajectoire qui altèrera profondément et durablement les conditions de vie des générations futures ».
II. LA QUADRATURE DU CERCLE : UNE CROISSANCE DURABLEMENT FAIBLE, DES DETTES INSOUTENABLES ET DES BESOINS DE FINANCEMENT MASSIFS
Transition écologique, investissements massifs dans les infrastructures essentielles, adaptation des dispositifs de protection sociale et de sécurité : au moment même où les exigences de financement s'accroissent partout dans le monde et singulièrement en Europe, apparaissent, avec le XXIe siècle, un ralentissement structurel de la croissance et un niveau d'endettement sans précédent.
Selon les études disponibles, la transition énergétique nécessitera chaque année 3 voire 4 points de PIB d'investissements supplémentaires, soit 4 000 à 5 000 milliards de dollars par an pendant 25 ans au niveau mondial, sans tenir compte des éventuelles dépenses publiques pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages afin d'amortir notamment la hausse des prix de l'énergie27(*).
Or comment financer collectivement des transformations systémiques de long terme avec les instruments d'une économie conçue pour une croissance rapide, d'une époque désormais révolue ?
Au cours du temps, le décalage entre besoins croissants et marges de manoeuvre plus réduites a conféré à la dette un rôle central.
Pour Emmanuel Constantin, celle-ci est devenue « le carburant de la gigantesque machinerie financière et assurantielle qui permet de pousser plus loin les optimisations, de compenser les déséquilibres des uns avec ceux des autres », entre générations, entre actifs et retraités, entre territoires excédentaires et déficitaires, entre ménages vivant à crédit et ménages détenteurs de capitaux en quête de rendement.
Elle est ainsi devenue extraordinairement ambivalente au regard de la valeur que nous accordons à la résilience car tout à la fois nécessaire et source de profonde vulnérabilité.
« La dette est devenue une valeur économique centrale, addictive, en ascension constante et acceptée à des niveaux inouïs. Mais elle insère les acteurs dans un jeu d'interdépendances et de fragilités réciproques qui peut les priver des moyens de leurs ambitions. Quelle sera la valeur de la dette d'ici 2050, alors que le besoin de résilience pourrait la rendre moins attractive, mais le coût de la résilience la rendre bien plus nécessaire ? »
Emmanuel Constantin, audition par la délégation à la prospective, 8 avril 2025
La dette est ainsi devenue tout à la fois le symptôme de nos contradictions et un levier pour y répondre : symptôme, car elle traduit l'incapacité à arbitrer entre, d'une part, l'urgence et la soutenabilité du court terme, d'autre part, les investissements structurels nécessaires à la préservation du long terme, mais aussi levier, car elle semble permettre de différer l'effort financier nécessaire au changement systémique.
La dette cristallise ainsi la tension fondamentale entre le présent et l'avenir, entre ce que nous voulons préserver - nos modes de vie, nos infrastructures, nos protections sociales, les conditions de vie des générations futures - et ce que nous acceptons de sacrifier pour garantir la pérennité du monde dans lequel évoluent nos sociétés.
TROISIÈME
PARTIE
DE NOUVEAUX OUTILS ET DE MULTIPLES INSPIRATIONS POUR REVISITER NOS
SCHÉMAS DE PENSÉE ET NOS FAÇONS D'AGIR
I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ
« Il y a des choses qui peuvent être mesurées. Il y a des choses qui valent d'être mesurées. Mais ce que nous pouvons mesurer n'est pas toujours ce qui vaut d'être mesuré [...]. Les choses que nous mesurons peuvent nous éloigner des choses dont nous voulons vraiment prendre soin. Et la mesure nous apporte souvent une connaissance altérée, une connaissance qui semble solide, mais demeure plutôt décevante28(*). »
Jerry Z. Muller, La tyrannie des métriques, 2018
· Des indicateurs macroéconomiques qui ne reflètent pas l'état de santé du monde
Dès l'origine, Simon Kuznets avait indiqué que le PIB était une simple convention et qu'il ne devait en aucun cas être considéré comme un indicateur du bien-être.
Avec le temps, l'absence de lien mécanique entre bien-être et croissance économique n'a pourtant pas évité l'utilisation du PIB comme indicateur principal de la prospérité.
Construit pour mesurer la croissance de la production de richesses marchandes, le PIB est censé, lorsqu'il augmente, entraîner une hausse du taux d'emploi et des revenus, et par conséquent une amélioration des conditions de vie et de la santé. Si une corrélation existe entre ces grandeurs, le PIB ne donne qu'une image très restrictive de la richesse :
- centré sur les flux, il ne tient pas compte du capital, des inégalités de revenus, de la répartition des richesses produites et du bien-être, qui influent sur la bonne santé d'une nation ;
- il compte pour nulles de nombreuses activités au coeur de la vie sociale comme le travail bénévole ou domestique ;
- il considère à l'inverse comme utiles toutes les productions, y compris celles qui n'apportent pas de bénéfices à la société, qui lui sont nuisibles, ou qui empêcheront de générer de la valeur à long terme pour les générations futures.
En particulier, le PIB « invisibilise » les coûts du développement économique liés aux dommages écologiques et ne donne pas d'indications sur l'évolution des patrimoines critiques tels que la nature ou la santé.
Il ignore le coût implicite du préjudice climatique, lequel se traduit non seulement dans la productivité, l'emploi, la valeur d'actifs tels que les rendements agricoles, mais aussi dans les efforts de décarbonation et les politiques de restriction des émissions.
« On considère toute activité rémunérée comme une valeur ajoutée, génératrice de bien-être, alors que l'investissement dans l'industrie antipollution n'augmente en rien le bien-être, au mieux il permet de le conserver. Sans doute arrive-t-il parfois que l'accroissement de valeur à déduire soit supérieur à l'accroissement de valeur ajoutée. »
Jacques Ellul, Le Bluff technologique, 1998
Malgré ces limites, cet outil de mesure a acquis une place si centrale qu'il détermine toute une série d'indicateurs dérivés fondant l'action publique, y compris au sein de l'Union européenne avec les critères budgétaires de convergence, définis en pourcentage du PIB.
Dès 2009, la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social soulignait qu'en raison d'un emploi excessif ou inadapté du PIB, « ceux qui s'efforcent de guider nos économies et nos sociétés sont dans la même situation que celle de pilotes qui chercheraient à maintenir un cap sans avoir de boussole fiable »29(*). Dans ces conditions, la question n'est plus de savoir si le PIB doit rester la métrique de référence mais davantage de comprendre pourquoi il l'est toujours.
Pourquoi le PIB est-il toujours la métrique de référence pour évaluer le progrès ?
Le constat de France Stratégie en 2015, selon lequel « malgré les nombreuses initiatives tant locales qu'internationales, une approche différente de la mesure du progrès de notre société ne s'est pas encore imposée ni en France ni dans d'autres pays »30(*), est toujours valable.
· La recherche d'indicateurs alternatifs au PIB ou complémentaires de celui-ci dès les années 1970
Diverses démarches ont été entreprises dès les années 1970 pour tirer les conséquences des limites du PIB en tant qu'indicateur de progrès31(*). Deux principales approches ont été explorées : la définition d'un indicateur synthétique ou l'utilisation d'un éventail d'indicateurs.
L'indicateur synthétique entend résumer en un chiffre la qualité de la croissance d'un pays en l'enrichissant des dimensions sociales et environnementales, à l'instar de l'indicateur du bonheur national brut développé par le Bhoutan en 1972.
Dans le même esprit, le rapport Bruntland de 198732(*), en popularisant le concept de développement durable, a lui aussi mis en lumière la nécessité d'une vision plus holistique du progrès humain, qui inclut des critères environnementaux, sociaux et de durabilité.
Cet appel à des indicateurs alternatifs a notamment conduit au développement en 1990 de l'Indice de Développement Humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), indice aujourd'hui couramment utilisé pour mesurer le bien-être au-delà du seul PIB. Il agrège des données liées au revenu par habitant, à l'espérance de vie à la naissance et au niveau d'éducation.
Bien qu'ayant évolué avec le temps, l'IDH est toutefois critiqué pour ne pas prendre en compte certains aspects cruciaux du développement, notamment son impact environnemental, ou encore le bien-être subjectif et les inégalités au sein des pays.
La faiblesse de l'approche par un indicateur synthétique unique tient en effet à la difficulté de pondérer les différents objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans un seul chiffre : comment par exemple tenir compte simultanément d'une hausse des revenus de la population et d'une dégradation des conditions environnementales ?
· Une réflexion foisonnante au début des années 2000
L'intérêt pour les indicateurs complémentaires au PIB s'est renforcé au début des années 2000, avec en particulier le Forum mondial organisé par l'OCDE à Istanbul en 2007 (« Comment mesurer et favoriser le progrès des sociétés ? »), la conférence de la Commission européenne « Beyond GPD » la même année ou encore les travaux précités de la commission « Stiglitz-Sen-Fitoussi » en 2009. La démarche alors privilégiée est celle de l'élargissement des critères à prendre en compte pour mesurer le progrès et de la promotion de tableaux d'indicateurs.
Dans le prolongement de ces réflexions, plusieurs instances ont adopté des indicateurs alternatifs au PIB et de nombreux pays ou régions publient aujourd'hui des indicateurs pluriels, en particulier l'OCDE depuis 2011 avec le « better life index » - indice personnalisable à travers une pondération des dimensions du bien-être jugées les plus importantes - et l'Union européenne depuis 2013 avec le « tableau de bord du bien-être de l'UE »33(*).
En France, le rapport de la commission « Attali » de 2013, Pour une économie positive, plaidait quant à lui pour le remplacement du PIB par deux nouveaux indicateurs : d'une part, un indicateur de bien-être global, qui intégrerait non seulement la performance économique, mais aussi la santé, l'éducation, les inégalités, l'environnement et le bien-être subjectif pour refléter plus fidèlement la qualité de vie réelle des citoyens, d'autre part, un indicateur de dette intergénérationnelle, qui mesurerait ce que la société lègue aux générations futures, en combinant dette publique, dette écologique (pollution, climat) et dette sociale (manque d'investissement dans la santé ou l'éducation).
Bien qu'intéressante, cette proposition n'a pas trouvé d'application concrète.
La mise en place d'un tableau de bord fondé sur une série d'indicateurs thématiques, tel qu'appelé de leurs voeux par France Stratégie et le CESE en 2015, a davantage retenu l'attention. France Stratégie identifiait en particulier la nécessité de « faire progresser la conscience collective de l'impératif environnemental ». Cette proposition donnait la priorité aux aspects économiques, pondérés par une approche sociale et environnementale.
La proposition de France Stratégie en
2015
Tableau récapitulatif des thèmes et des
indicateurs retenus
Source : France Stratégie
· Une réflexion qui n'a toujours pas abouti
Inspirée des recommandations de France Stratégie, la loi dite « Eva Sas » de 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport comportant des données susceptibles de l'éclairer sur l'état de la société française à partir d'indicateurs de richesse pluridimensionnels34(*).
En dépit de ces évolutions, ces indicateurs n'ont pas pris la place escomptée pour enrichir l'information des parlementaires et plus largement des citoyens, ni a fortiori comme outils de pilotage des politiques publiques.
Malgré une réflexion foisonnante et les nombreuses initiatives pour proposer des approches alternatives, le PIB reste ainsi l'indicateur central des politiques économiques en France et dans le monde, même s'il est de plus en plus complété par d'autres données.
Les économistes eux-mêmes restent divisés sur le futur du PIB. Certains saluent son intérêt et le fait qu'il permet de bénéficier d'une profondeur historique, tout en soulignant qu'il faut le compléter pour avoir une approche « multicritères » en intégrant la valeur environnementale. D'autres considèrent que la solution ne réside pas dans une modification du PIB, mais dans la mise au point d'un indicateur synthétique de notre empreinte environnementale que l'on pourrait commenter tous les trimestres comme le PIB35(*).
« C'est peut-être ce paradoxe entre le trop-plein d'indicateurs et la dilution des valeurs qui explique que la réflexion sur les nouveaux indicateurs, foisonnante au milieu des années 2000, n'a pas vraiment abouti dans les années 2010. »
Emmanuel Constantin, audition par la délégation à la prospective, 2025
La réflexion sur les limites du PIB se poursuit, en particulier sous l'égide de l'ONU avec le lancement en mai 2025 des travaux du groupe d'experts de haut niveau de l'initiative « Beyond GPD » : dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et le Pacte pour l'Avenir, il s'agit toujours de concevoir un cadre conceptuel et un tableau de bord d'indicateurs qui reflètent mieux le bien-être humain, la durabilité environnementale et la cohésion sociale, en complément du PIB.
· PIB usuel versus PIB ressenti, reflet du divorce entre croissance et bien-être
Rejoignant les analyses déjà anciennes de l'économiste Richard Easterlin36(*), l'enquête « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages » (SRCV) de l'Insee confirme pourtant la théorie de l'« utilité marginale du revenu décroissante » : la hausse de la satisfaction apportée par une élévation du niveau de revenu s'atténue à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des revenus.
Pour tenir compte de cette décorrélation entre le PIB par habitant et le « ressenti » des ménages, un indicateur de bien-être monétaire appelé « PIB ressenti » a été exploré par l'Insee37(*).
Il mesure, en équivalent monétaire, la moyenne nationale de la contribution des revenus à la satisfaction dans la vie.
Cet indicateur montre qu'une croissance du PIB ne reflète pas nécessairement une amélioration des conditions de vie ressenties par les citoyens, la répartition des fruits de la croissance pouvant être inégale ou les modifications apportées à la vie de chacun très variables en fonction des situations de départ.
Les résultats obtenus non seulement redistribuent les hiérarchies économiques internationales, traditionnellement fondées sur une comparaison des PIB, mais aussi plaident pour des approches « multidimensionnelles » des mesures des niveaux de vie.
Satisfaction dans la vie par centile de niveau de
vie
(France, moyenne 2010-2019)
Lecture : La satisfaction dans la vie progresse de 1.0 lorsque le revenu double de 10 000 à 20 000 € par unité de consommation ; l'augmentation n'est plus que de + 0,5 lorsque le revenu double à nouveau de 20 000 à 40 000 € ; et de + 0,1 lorsque le revenu est porté de 40 000 € à 80 000 €.
Source : Germain, 2023
|
PIB par tête et PIB ressenti depuis les
années 1980 |
|
|
Jean-Marc Germain (Insee) montre qu'entre 1978 et 2020, le PIB ressenti a stagné aux États-Unis pendant que le PIB triplait. Mesuré en PIB par habitant, l'écart s'est creusé entre les États-Unis et l'Europe mais il s'est resserré en termes de PIB ressenti, certains pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande ou la France passant même devant les États-Unis. L'enquête montre en outre qu'en termes de bien-être monétaire, les ralentissements économiques ont duré beaucoup plus longtemps que ce que pourraient laisser croire les évolutions mesurées par le PIB. |
|
L'indicateur du PIB ressenti se concentre sur les aspects monétaires du bien-être. L'Insee indique qu'à l'avenir, ce cadre conceptuel pourrait être élargi aux dimensions non monétaires de la qualité de vie, incluant l'âge ou la santé. Cela pose néanmoins « la question de la disponibilité des données sur une profondeur historique et un éventail de pays suffisamment large ».
En 2013, l'ONU a ainsi souligné l'intérêt de « l'adoption d'un cadre de normes internationales pour l'établissement des comptes nationaux beaucoup plus large que l'actuel, intégrant des informations plus détaillées en matière de santé, d'éducation, de loisirs et de distribution des revenus »38(*).
· Émissions de CO2, indice de développement humain et bien-être à l'échelle internationale
Selon une logique proche appliquée à l'échelle internationale, une récente étude analyse la corrélation entre les émissions de CO2 par habitant et l'indice de développement humain (IDH)39(*).
La modélisation se traduit par une courbe dite « de Champagne » montrant que, passé un certain seuil de développement économique, la croissance des émissions de gaz à effet de serre n'est plus corrélée à une amélioration du bien-être de la population.
Sur cette base, les auteurs proposent une nouvelle classification des pays en fonction de leur capacité de transition (faible, modérée ou élevée).
Les pays ayant un IDH faible (inférieur à 0,6) affichent des émissions de CO2 par habitant relativement uniformes, tandis que ceux ayant un IDH plus élevé (supérieur à 0,8) présentent des variations beaucoup plus importantes.
Des mesures d'économie et d'efficacité énergétiques pouvant être mises en oeuvre sans réduire le bien-être individuel dans les pays figurant parmi le groupe à IDH plus élevé, l'étude plaide pour une approche différenciée de la politique climatique au niveau international.
Cette approche pourrait contribuer à atténuer l'opposition entre développement et baisse des émissions et celle entre pays dits « du Sud » et ceux dits « du Nord ».
II. D'AUTRES VOIES EXPLORATOIRES PLAÇANT LA RÉSILIENCE ET LA SANTÉ DU VIVANT AU CENTRE DE LA VALEUR « ÉCONOMIE »
« Nous devons donc changer de modèle économique, [c'est-à-dire] entrer dans un modèle universel et local. Ce modèle doit être universel en ce qu'il doit pouvoir être proposé à l'ensemble des pays, en particulier les plus pauvres, tout en s'appliquant, bien sûr, à nos pays riches. [...] Nous devons trouver des moteurs de croissance nouvelle. [...] L'indicateur, simple mais incontournable, doit être l'augmentation de l'espérance de vie pour toute la population mondiale, en particulier dans les pays pauvres. C'est un critère précis. »
Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025
· Des modèles économiques alternatifs valorisant autre chose que le PIB
Ces dernières décennies ont vu l'essor d'une pluralité de courants de pensée économique et de visions alternatifs, portés parfois par des économistes plus hétérodoxes ou s'inscrivant dans le cadre du mouvement « Rethinking Economics »40(*).
Ils invitent à repenser la notion même de croissance pour privilégier la qualité de vie plutôt que l'expansion matérielle, sans nier les changements institutionnels, culturels et démocratiques nécessaires pour accompagner cette transformation.
Dans sa série de rapports intitulés « Narratives for Change », l'Agence européenne pour l'environnement propose une classification de ces alternatives pour accompagner la transition vers des modes de vie plus durables.
Grands courants de pensée alternatifs
à la croissance
(classification d'après l'Agence
européenne pour l'environnement)41(*)
i Serge Latouche, La décroissance, Que Sais-je ? 2024 ; ii OCDE, « Fostering Innovation for Green Growth », 2011 ; iii Kate Raworth, « Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-century economist », Chelsea, Green Publishing, 2017 ; iv Op. cit.
|
L'ÉCONOMIE DE LA DÉCROISSANCE Pour les théoriciens de la décroissance, parmi lesquels Timothée Parrique, la croissance économique est loin d'être une condition nécessaire pour répondre aux crises du monde moderne (crises écologiques, inégalités, difficultés à maintenir les services publics, mal-être). Bien au contraire, elle en constitue la cause sous-jacente et, pire encore, les aggrave. Les indicateurs macroéconomiques sont obsolètes. Le PIB ne permet pas de mesurer le niveau du bien-être, l'équité de la répartition des richesses au sein de la société ou encore la valeur des liens sociaux, ni de se confronter aux limites écologiques. Le découplage entre la croissance économique, d'une part, et la consommation de ressources et les émissions polluantes, d'autre part, ne peut être absolu : on ne peut continuer à croître tout en cessant de nuire à l'environnement, ni laisser au marché les décisions sur ce qu'on produit ou consomme. Le « tout technologique » ne sera pas une réponse suffisante ; le besoin de planification est majeur. Il faut une transformation radicale visant la soutenabilité et la justice sociale. Pour Timothée Parrique42(*), il s'agit de repenser les priorités pour décroître dans le cadre d'une transition juste, ce qui passe par : - la réduction, voire l'interdiction progressive, de la production et de la consommation ce certains biens matériels et services lorsqu'ils ne sont pas essentiels et ne créent pas de valeur sociale ou de bien-être : la publicité, le transport aérien de loisir, les voitures surdimensionnées ou encore l'alimentation industrielle ultra-transformée par exemple ; |
|
« La baisse de certaines productions sera donc en partie compensée par la hausse d'autres activités. Par exemple, moins de voitures thermiques et de construction de parkings, mais davantage de rénovation de bâtiments et de réparation de vélos ; moins d'agents immobiliers et de courtiers mais plus d'aides-soignants et de paysans. » Timothée Parrique, Ralentir ou périr. L'économie de la décroissance, 2022 |
|
- un changement radical dans les modalités de travail afin de redistribuer le temps de vie au bénéfice des loisirs, des activités non marchandes, du « care », des liens sociaux, avec notamment la semaine de « 4 jours » ; - la valorisation des métiers non marchands, dans les secteurs du soin, de l'éducation, de la culture et des associations ; - l'allègement de l'empreinte écologique à l'échelle individuelle et collective, selon des modalités planifiées démocratiquement et en répartissant les efforts selon les ressources et les responsabilités de chacun ; - l'implication des citoyens dans les décisions économiques sur ce qui doit être produit, les normes de consommation, les limites acceptables, mais aussi dans l'évaluation de l'impact des politiques publiques ; - la relocalisation de l'économie pour gagner en résilience ; - plus largement, le recours à des outils contribuant au « déconditionnement » du consumérisme et de l'individualisme tout en assurant une justice sociale : fiscalité écologique, régulation, normes pour orienter la production, mesures de redistribution pour limiter les écarts de revenus. |
|
« Le pêcheur somalien qui voit son poisson se raréfier et le niveau de la mer monter n'a probablement jamais pris l'avion ; il n'a participé ni au réchauffement dont il hérite, ni à la surpêche. Pourtant, il en paiera pleinement le prix, et parmi les premiers. » |
|
Les partisans de la décroissance estiment que les fondements culturels de l'économie doivent être reconstruits, en valorisant la « sobriété heureuse » et non la richesse matérielle, en remplaçant le PIB par des indicateurs de bien-être, de santé, d'équité et d'impact écologique, et en « rééduquant » au « suffisant », au « commun » et à la lenteur. |
|
« Croissance verte, croissance circulaire, croissance inclusive, croissance bleue ; cinquante nuances de croissance mais croissance toujours. L'emprise de cette matrice sur notre imaginaire collectif est telle qu'au lieu de considérer les conséquences de notre modèle économique sur la planète, nous nous inquiétons des impacts du réchauffement climatique sur le PIB. C'est le monde à l'envers. » |
*
|
LA CROISSANCE VERTE La « croissance verte » entend concilier développement économique et durabilité environnementale. Elle s'inscrit dans le cadre plus large du « développement durable » défini par le rapport « Brundtland » de 1987 comme « répondant aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ». Elle répond au constat posé par le rapport « Stern » de 2006* selon lequel le coût du changement climatique serait significativement plus élevé que celui des investissements dans des stratégies « bas carbone ». Cette approche est soutenue au plan international (OCDE, Nations Unies, Banque mondiale) et se traduit par la recherche d'innovations dans les domaines de l'énergie, de la mobilité ou de l'agriculture ainsi que par la promotion des modèles d'économie circulaire. L'idée est par exemple de favoriser le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité) pour réduire les émissions tout en stimulant l'innovation et l'emploi, de promouvoir les véhicules moins polluants, les transports publics et les infrastructures cyclables tout en favorisant le dynamisme économique urbain, ou encore de concilier la préservation des écosystèmes et le développement économique à travers le tourisme écologique. Certains économistes soulignent cependant les limites de ce modèle, avec en particulier le risque d'effet rebond observé lorsque l'amélioration de l'efficacité énergétique vient paradoxalement accroître la consommation totale d'énergie. D'autres estiment que les politiques dites « vertes » peuvent accentuer les inégalités si les coûts de la transition sont transférés aux populations les plus vulnérables ou si les technologies vertes restent concentrées dans les pays riches. Enfin, certains chercheurs dénoncent une approche trop « techno-optimiste », qui mise sur l'innovation pour résoudre les crises environnementales sans remettre en cause le modèle économique global centré sur la croissance infinie. * Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 |
*
|
L'ÉCONOMIE DU DONUT Conceptualisée par Kate Raworth, l'économie du donut propose un cadre pour concilier les besoins sociaux fondamentaux avec les limites planétaires. Le « donut » représente un espace sûr et juste pour l'humanité : l'anneau intérieur symbolise le plancher social (nourriture, logement, santé, etc.), tandis que l'anneau extérieur marque les frontières écologiques à ne pas dépasser. Toute économie durable doit s'inscrire à l'intérieur de cet espace. Cette approche critique les fondements de l'économie néoclassique (rationalité, marché autorégulateur, croissance illimitée) et appelle à repenser les objectifs économiques au prisme de la justice sociale et de la soutenabilité environnementale. Ce modèle se veut à la fois systémique et transdisciplinaire. Rejetant l'économie linéaire fondée sur le triptyque extraire-produire-jeter, il promeut notamment les modèles d'économie circulaire. |
*
|
LA POST-CROISSANCE : L'EXEMPLE DE L'ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE Qu'est-ce qu'une économie du bien-être ? Une économie qui génère un bien-être humain suffisant, c'est-à-dire une économie centrée sur des besoins raisonnés (dans le sens d'une discussion collective sur des principes de justice) satisfaits par des ressources limitées dans les frontières planétaires (et non sur une croissance infinie qui ruissellerait ou sur des préférences d'utilité à satisfaire). Présentation d'Éloi Laurent, auteur de l'Économie pour le XXIe siècle : Manuel des transitions justes, 2023 |
|
Parmi les courants de la post-croissance, l'économie du bien-être, telle que développée par les économistes Aurore Fransolet et Éloi Laurent, propose de substituer à la logique de croissance économique une approche centrée sur l'amélioration concrète des conditions de vie humaines. Elle repose sur deux piliers fondamentaux - la santé au sens large et la coopération (liens sociaux, justice sociale, démocratie) - considérés comme les véritables finalités de l'activité économique. Rejetant le PIB comme indicateur pertinent de prospérité - l'économie peut croître ou décroître, ce n'est pas l'essentiel -, elle promeut des indicateurs alternatifs (bien-être subjectif, inégalités, empreinte écologique) pour guider l'action publique. Inscrite dans une perspective de post-croissance, cette approche défend une réorientation des politiques économiques vers la soutenabilité sociale et environnementale dans un cadre démocratique et institutionnel renouvelé. Dans ce modèle, l'économie sociale et solidaire (ESS) constitue un levier pour promouvoir le bien-être, la cohésion sociale et la résilience. La santé ne doit pas être traitée comme une dépense mais comme une boussole politique, intégrée dans toutes les sphères de l'action publique. Une boîte à outils est en cours de développement afin d'inventorier les dispositifs de politique publique existants ou émergents en Europe répondant à cet objectif (« wellbeing economy toolbox »*). Cette boîte à outils identifie dix-huit domaines d'action mobilisables et vise à fournir aux décideurs publics des exemples concrets, décrits à travers des fiches synthétiques, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de transition sociale et écologique. * Ce dispositif s'inscrit dans une initiative européenne (JA PreventNCD) lancée en 2023 et financée par la Commission européenne dans le cadre du programme « EU4Health ». |
VESTO : la concrétisation d'un projet d'économie circulaire
Une visite de l'entreprise VESTO à Compans (Seine-et-Marne) dans le cadre des travaux des rapporteurs.
Co-fondée en 2020 par trois jeunes start-uppeurs - Anne-Laurène Harmel, Bastien Rambaud et Wilfrid Dumas -, l'entreprise VESTO a ouvert trois ans plus tard la première usine de reconditionnement de matériel professionnel de restauration en France.
À l'origine, le projet prévoyait la création d'une « marketplace » pour mettre en relation spécialistes du reconditionnement et acheteurs selon un dispositif permettant de garantir la fiabilité du matériel reconditionné. L'absence de reconditionneurs professionnels de grands volumes dans le domaine de la restauration en a décidé autrement, faisant évoluer le projet d'une boîte de la tech à une entreprise de type industriel.
Implantée à Compans en Seine-et-Marne, l'entreprise emploie aujourd'hui 45 salariés dans une usine de 7 000 m² et collabore avec environ 300 restaurateurs parmi lesquels des chaînes, des groupes et des collectivités publiques.
L'économie circulaire
3 domaines, 7
piliers
Source : Ademe
L'activité se réalise dans le cadre d'une boucle fermée allant de la collecte des équipements usagés à leur redistribution et au service après-vente en passant par leur remise en état. Ce modèle répond à la nécessité pour les clients professionnels d'adopter des pratiques plus durables tout en disposant d'équipements de qualité, à moindre coût.
Les matériels à reconditionner proviennent notamment de filiales de démolition de grands groupes du secteur du bâtiment (Bouygues, Vinci), qui doivent se conformer aux nouvelles réglementations énergétiques et environnementales (diagnostic PEMD ; RE 2020), de certaines caisses des écoles et d'acheteurs publics auxquels la loi dite « AGEC » impose de consacrer entre 20 % et 40 % de leurs achats à des produits reconditionnés ou issus du réemploi.
1 410 tonnes de CO2 évitées au 31 décembre 2024, soit environ l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 140 Français
Source : VESTO
Selon les indications fournies par l'entreprise, une tonne de machine reconditionnée permet d'éviter 10 tonnes de CO2. Fin 2023, l'entreprise avait déjà reconditionné plus de 100 tonnes de matériel, soit l'équivalent de 859 tonnes d'émissions de CO2 évitées.
L'activité de l'entreprise s'ouvre à de nouveaux marchés porteurs comme le reconditionnement d'échographes utilisés dans le domaine médical.
Complémentaire de la filière du recyclage, l'entreprise incarne une dynamique tournée vers l'avenir et porteuse d'espoir, où économie, écologie et réemploi se conjuguent pour bâtir un modèle plus durable, et respectueux des ressources et des générations futures. Acteur de la transition écologique, VESTO soutient également l'emploi local, étant un débouché pour des jeunes en sortie de parcours d'insertion, et collabore avec des lycées professionnels en contribuant à la formation des jeunes.
Parmi les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée, le principal reste celui de l'accès à la commande publique et du respect de la loi « AGEC ». Son développement dépendra de sa capacité à déployer de nouvelles industries et donc l'accès à la ressource foncière ainsi que la formation de ses employés, ce qui renvoie à la nécessaire structuration de la filière industrielle.
Économie de la fonctionnalité et de
la coopération
Une journée dans la vie de Noa
en 2050
L'économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) qui a émergé au début des années 2000 privilégie l'usage d'un bien plutôt que sa possession. Elle repose sur une logique servicielle : les entreprises ne vendent plus des produits mais proposent des solutions qui intègrent les services rendus par les produits. L'entreprise Michelin propose par exemple pour les poids lourds un service de location de kilomètres parcourus en lieu et place de la vente de pneus43(*).
Ce modèle, dont les valeurs sont la durabilité, la coopération et la responsabilité partagée, incite les entreprises à fabriquer des produits plus durables, qui ne font pas l'objet d'une obsolescence programmée, et à en optimiser l'usage.
Il valorise le développement local, les dynamiques territoriales, l'ancrage dans l'économie sociale et la qualité des relations humaines.
Nous sommes le 3 mai 2050. Noa, 19 ans, se réveille dans son appartement situé à la périphérie d'une ville moyenne. Ce matin, il doit se rendre à un entretien d'embauche dans une entreprise du bâtiment à vingt kilomètres de chez lui.
Pour se déplacer, il peut compter sur une mobylette mise à disposition par un service de location proposé par la municipalité. Après son petit-déjeuner, Noa se rend au point de retrait local, un atelier de réparation solidaire. Le responsable, David, lui fait comme d'habitude un petit signe de la main et lui rappelle qu'il est important de rouler prudemment. Tout est compris dans son abonnement annuel : l'assurance, l'entretien régulier, les réparations si nécessaire, le remplacement en cas de panne, des formations de rappel à la conduite apaisée et à la sécurité routière, ainsi qu'un forfait kilométrique qui s'adapte à ses trajets.
Après son entretien auquel il s'est rendu sans difficulté, Noa dépose sa mobylette et rentre chez lui pour préparer son déjeuner. Il ne possède pas son réfrigérateur car celui-ci fait partie d'un système de location et de maintenance proposé par une entreprise locale. Ce service inclut également une optimisation énergétique à travers une surveillance de la consommation de l'appareil à distance et des conseils prodigués à Noa pour améliorer l'efficacité de son usage.
Dans l'après-midi, Noa se rend dans un atelier de bricolage collaboratif car il doit faire des travaux dans son salon : au lieu d'acheter une perceuse, une visseuse et d'autres outils coûteux qu'il n'utiliserait que quelques minutes par an, il a pu emprunter tout le matériel nécessaire. Il a également participé à un bref atelier animé par Christophe, un professionnel qui lui a appris à utiliser les outils en toute sécurité. Il a pu échanger des idées sur ses projets et recevoir des conseils avisés.
Avant de rentrer chez lui, Noa fait un tour dans une bibliothèque de meubles installée dans le même quartier. L'entreprise propose une sélection de meubles durables et modulables que chacun peut choisir et changer selon ses besoins. Si un meuble se détériore, il est remplacé ou réparé dans un délai rapide. Noa cherche une table de salle à manger plus grande pour pouvoir inviter ses amis.
En fin de journée, il reçoit un message d'Émilie sur son téléphone : il a été sélectionné pour participer à un service de transport collectif coopératif : une plateforme gérée par la responsable d'une association locale permet à des jeunes sans voiture de se regrouper pour aller faire leurs courses en co-voiturage, avec une répartition équitable des frais. Ce système lui permet de réduire ses dépenses de transport et de rencontrer de nouveaux voisins.
De retour chez lui, Noa est content de la confiance et de la solidarité dont David, Christophe et Émilie lui ont témoigné. En utilisant des services fondés sur des valeurs d'usage et de durabilité, de partage et de coopération, il a le sentiment d'avoir contribué à l'affermissement du tissu social et local.
· La santé du vivant : nouvelle boussole dans la post-croissance ?
Sans choisir entre ces différentes approches, l'Agence européenne pour l'environnement plaide globalement pour l'adoption d'une vision plus large que le PIB, valorisant le bien-être, la justice sociale et la résilience écologique. Elle appelle à se servir de l'ensemble de ces alternatives comme autant d'inspirations complémentaires pour orienter la société vers une transition juste et durable.
Bien que distinctes dans leurs méthodes et leurs focales, ces différentes approches peuvent néanmoins converger autour d'une valeur commune, celle de la santé du vivant au sens large.
Le concept de One Health, adopté au niveau international, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou encore l'Organisation mondiale de l'environnement (OIE), repose sur l'idée que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont interdépendantes. Cette vision holistique, initialement mobilisée dans le champ de la santé publique pour prévenir les zoonoses, s'est progressivement élargie pour devenir une grille de lecture transversale des enjeux socio-écologiques et économiques.
Dans ce contexte, et plus encore après la crise du covid-19, d'aucuns plaident pour mobiliser « One Health » comme la nouvelle valeur de référence dans les modèles économiques post-croissance.
III. DE NOUVEAUX OUTILS COMPTABLES POUR PROTÉGER LA SANTÉ DU VIVANT ET L'INTÉRÊT DES GÉNÉRATIONS FUTURES
« Redonner sa place au vivant dans l'économie, c'est reconnaître l'existence et définir des “communs”, des biens publics. Et à partir de là, comprendre qu'il n'y aura pas de compétitivité sans efficience (performance et efficacité) dans la gestion, la préservation, et la régénération de ces communs.
Nous sommes au pied de la montagne. Nous avons dix ans pour ouvrir une nouvelle voie et nous y engager tous ensemble. »
Emmanuel Faber, Ouvrir une voie, 2022
A. AU-DELÀ DU PIB : LES COMPTES NATIONAUX « AUGMENTÉS »
Dans la comptabilité nationale, une partie des coûts résultant des dommages climatiques est déjà prise en compte de façon directe (par exemple à travers la moindre production consécutive à un sinistre climatique) ou indirecte (par exemple à travers la perte de valeur d'une entreprise fortement émettrice de gaz à effet de serre en raison d'une politique restreignant les émissions dans un secteur donné).
Cependant, il s'agit de coûts cachés : ni directement visibles, ni isolables.
De plus, les indicateurs ne tiennent pas compte de la réduction du patrimoine légué aux générations futures en raison des émissions polluantes. Par conséquent, la comptabilité nationale usuelle tend à surestimer le produit net, le revenu net et l'épargne nette.
L'enjeu est de rendre visibles ces coûts implicites tout en intégrant les coûts liés aux dommages affectant la santé et la mortalité des ménages, actuellement ignorés.
La mise en place d'un PIB plus en phase avec l'activité humaine et l'environnement est cependant rendue difficile par l'absence de mesure synthétique des dommages environnementaux au sens large. En effet, dans la comptabilité nationale traditionnelle, les actifs sont valorisés aux prix de marché. Or il n'existe pas de marché du « capital climatique » ou de marché global des émissions de carbone.
Des travaux pionniers de l'Insee tentent de dépasser cette difficulté en explorant la voie d'un PIB ajusté des impacts environnementaux.
· Comment valoriser les dommages climatiques dans la comptabilité nationale ?
Deux méthodes sont employées pour monétiser les dommages climatiques à travers une estimation du coût de la tonne de carbone émis :
- l'approche par le coût social du carbone fournit la valeur actualisée des dommages causés par les émissions dans le futur. L'étude américaine de référence estime ainsi le coût mondial d'une tonne équivalente de CO2 émise en 2020 à environ 172 euros en 202344(*).
Certaines conséquences dommageables des émissions de GES ne sont pas mesurées dans le calcul du PIB et ne sont pas considérées comme économiques, en particulier les effets du réchauffement climatique sur la santé et la mortalité. L'approche par le coût social du carbone décompose les dommages selon leurs effets anticipés, en distinguant ceux qui affectent l'économie (se situant dans la frontière de production du PIB) et ceux sur la santé et la mortalité (hors frontière de production du PIB). Cette dernière composante est évaluée à 82 euros par tonne de CO2 en 202345(*) ;
- la « valeur de l'action pour le climat » (VAC), calculée par la commission Quinet (2019)46(*) à partir des objectifs de réduction des émissions, définit quant à elle le niveau auquel il faudrait fixer le prix du carbone pour atteindre une cible (154 euros par tonne de CO2 en 2019). Il s'agit de « la valeur pour la collectivité des actions permettant d'atteindre l'objectif de neutralité carbone ».
Elle est calculée par référence à des cibles d'émissions (SNBC 2) et prend en compte le coût croissant à décarboner dans le temps. Elle permet de conférer une valeur aux émissions évitées et de se référer à un « budget carbone » correspondant aux émissions à ne pas dépasser.
· Le calcul d'indicateurs nets ajustés de la consommation du « capital climatique » et étendus à la santé et la mortalité
Les travaux de Sylvain Larrieux et Sébastien Roux de l'Insee47(*) ouvrent une voie prometteuse pour intégrer ces deux classes d'actifs - le capital climatique et le budget carbone - dans la comptabilité nationale.
Il s'agit, à travers le calcul d'un produit intérieur net ajusté (PINA), de corriger le produit intérieur net (indicateur qui prend en compte la dégradation des équipements et des bâtiments) des dommages engendrés par les dérèglements climatiques. Cette démarche ne modifie pas le PIB mais permet de le compléter pour mieux tenir compte des valeurs environnementale et sociale.
Dans ces comptes « augmentés », les effets des émissions de gaz à effet de serre sont assimilés à des consommations de capital climatique et à la réduction du « budget carbone ». Un pays qui réduit ses émissions voit ainsi la progression annuelle de son PINA supérieure à celle de son PIN usuel.
|
Ajustements du produit intérieur net (PIN) et de l'épargne nette (EN) en 2023 Lecture : en 2023, le
PIN se monte à 2 294 Mds €. Ajusté de la
dégradation du capital climatique induite par les émissions
françaises et de l'épuisement du budget carbone, il baisse
à 2 200 Mds €, soit une baisse de
94 Mds €. L'épargne nette de 2023 est positive à
68 Mds €. Ajustée de la dégradation en France du
capital climatique induite par les émissions mondiales et de
l'épuisement du budget carbone, elle baisse de 201 Mds euros
et devient négative, établie à
- 133 Mds €. Dans le détail, les dommages liés aux émissions de gaz à effet de serre engendrés par l'activité économique française sont valorisés à près de 70 milliards d'euros en 2023, dont 36 milliards pour la composante située dans la frontière du PIB et 33 milliards pour la composante liée aux effets sur la santé et la mortalité. Les dommages des émissions mondiales pour la France sont quant à eux estimés à 144 milliards d'euros en 2023, la France important deux fois plus de dommages climatiques qu'elle n'en exporte. Parallèlement, en 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont conduit à consommer 57 milliards d'euros du budget carbone sur la base de la valeur d'action pour le climat48(*). Au total, le coût cumulé de la dégradation climatique et de l'épuisement du budget carbone s'élèverait à 94 milliards d'euros en 2023. |
Compte tenu de ces éléments, l'étude de l'Insee conclut à un écart significatif entre le PIN usuel et les indicateurs augmentés de la France : le produit intérieur net ajusté des émissions de gaz à effet de serre françaises (2 200 milliards d'euros) était inférieur de 4,1 % au PIN usuel (2 294 milliards d'euros) et même de 5,5 % si l'on prend en compte les effets sur la santé et la mortalité (PINA « étendu » estimé à 2 167 milliards d'euros).
· Une alerte sur l'insoutenabilité de l'activité économique au regard de l'intérêt des générations futures
Une logique identique est appliquée au calcul de l'épargne nette de la France, qui mesure la valeur du produit courant légué aux générations futures.
La prise en compte de la consommation de capital climatique et du budget carbone conduit à minorer l'épargne nette de 201 milliards d'euros49(*) pour mettre en évidence une épargne nette ajustée fortement négative : - 133 milliards d'euros en 2023.
En tenant compte de la perte de valeur résultant des effets futurs des émissions sur la santé et la mortalité, l'épargne nette ajustée s'élève même à - 264 milliards d'euros.
« La situation de désépargne au cours de ces années indique une dégradation des conditions de vie futures non compensée par l'augmentation de la richesse purement économique du pays et donc que l'activité économique, dans son fonctionnement actuel, n'est pas soutenable. »
Sylvain Larrieux et Sébastien Roux, Insee, 2024
Au total, les travaux de l'Insee évaluent le coût actualisé total restant pour décarboner l'économie à 929 milliards d'euros pour une cible de neutralité carbone en 2050, sur la base de la valeur de l'action pour le climat. La valorisation du cumul des empreintes carbone de la France depuis 1850 est estimé à près de 7 000 milliards d'euros, ce qui « peut s'interpréter comme une responsabilité climatique vis-à-vis de l'ensemble du monde ».
· Une démarche qui est appelée à s'étendre
Bien qu'encore exploratoire et reposant sur de fortes incertitudes50(*), cette nouvelle approche permet de prendre en compte des dimensions qui vont au-delà du PIB : le PIB net ajusté « valorise bien l'activité du pays en tenant compte de l'épuisement de ressources qui n'était pas mis en évidence jusqu'alors ».
Elle s'inscrit dans une démarche plus globale visant à compléter le PIB par des indicateurs synthétiques rendant compte des atteintes à l'environnement mais également de l'évolution des inégalités et de la redistribution des revenus en lien avec l'activité économique. Les comptes nationaux augmentés 2024 intègrent ainsi des comptes par catégorie de ménages, permettant de mesurer les effets redistributifs liés aux politiques publiques51(*).
Des travaux en cours ambitionnent par ailleurs de proposer un nouvel indicateur de « croissance équilibrée », c'est-à-dire une mesure expérimentale plus proche du ressenti des ménages. Contrairement aux modalités de calcul du PIB, où le poids de chaque foyer est fonction de son revenu, ce nouvel indicateur donnerait à chaque ménage le même poids quelles que soient ses ressources. Il contribuerait ainsi à mieux cerner la dimension du bien-être dans les indicateurs monétaires.
· Des avancées prometteuses pour aboutir à une révision du système des comptes nationaux
L'ensemble de ces réflexions ouvrent une voie prometteuse dans la perspective de la révision du système des comptes nationaux.
À terme, comme le confirment les récents travaux du Conseil d'analyse économique (CAE) sur la valorisation du patrimoine forestier, ce système pourrait intégrer d'autres dimensions de l'environnement au-delà de la seule question des GES, comme la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité, voire les activités domestiques ou de loisir. Il mettrait ainsi davantage l'accent sur le bien-être et la soutenabilité.
La valorisation dans les comptes nationaux des services rendus par la forêt : l'apport du Conseil d'analyse économique
Dans sa note intitulée « Compléter les comptes nationaux pour que l'arbre ne cache plus la forêt »52(*), le Conseil d'analyse économique (CAE) tente, à partir du cas de la forêt, de montrer l'intérêt d'une métrique commune pour valoriser les différents services rendus par cet actif naturel.
L'objectif est de rendre visibles les coûts et les bénéfices aujourd'hui implicites d'une action en faveur des forêts.
Se fondant sur une méthode originale de valorisation du service de séquestration du carbone, les auteurs évaluent la valeur ajoutée « augmentée » du secteur forêt-bois à 11,2 milliards d'euros en 2018, soit 3,5 fois sa valeur marchande.
Un tiers de cette valeur ajoutée totale résulte de la production marchande de la sylviculture (service d'approvisionnement). Quant aux services de régulation et de soutien, ils comptent pour 40 %.
« Il faut donc considérer les forêts non seulement comme un actif marchand, mais comme un patrimoine naturel stratégique dont la valeur sociale dépasse largement ce que reflètent les seuls prix de marché. »
Insistant sur le ralentissement du puits de carbone des forêts françaises en raison du changement climatique, ces travaux apportent un éclairage nouveau sur le bilan-carbone des politiques favorisant l'usage du bois-énergie.
Ils invitent à renforcer les évaluations monétaires des services écosystémiques lorsque cela est possible, afin d'établir des bilans globaux qui puissent constituer une aide à la décision. Pour les auteurs, d'autres écosystèmes pourraient en effet être concernés : les terres cultivées, les zones humides ou encore les ressources en eau.
B. DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DE PLUS EN PLUS EXIGEANTES POUR RESPONSABILISER ENTREPRISES ET INVESTISSEURS
Malgré des normes plus nombreuses et exigeantes en matière de reporting extra-financier, qui rendent obligatoire la publication par les entreprises d'informations sur leur performance environnementale sociale et sociétale53(*), il demeure souvent difficile d'évaluer avec précision leur niveau d'engagement.
Les enjeux environnementaux ne font pas encore l'objet d'une approche suffisamment systémique, aucune transformation en profondeur et à grande échelle des manières de produire et de consommer n'ayant vu le jour.
Pour renforcer la prise en compte des enjeux de durabilité par les entreprises, l'International Sustainability Standard Board (ISSB) a publié en mars 2023 deux normes comptables (IFRS S1 et S2) entrées en vigueur l'année suivante, avec l'espoir d'une adoption par un nombre croissant de pays.
De la RSE aux normes IFRS : des exigences croissantes concernant les informations destinées aux investisseurs sur la durabilité des entreprises
La « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) fait référence à l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs pratiques économiques. Évoquée dès les années 195054(*), elle a progressivement acquis une importance stratégique avec le développement de la mondialisation et la survenue de catastrophes industrielles et environnementales de grande envergure. Bien que non contraignante, la norme ISO 26000 développée en 2010 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en définit les principes directeurs.
Il s'agit de satisfaire les intérêts non des seuls actionnaires mais de l'ensemble des acteurs concernés, y compris les consommateurs et les régulateurs.
Le sigle ESG, pour « Environmental, Social and Governance », désigne quant à lui un ensemble d'indicateurs de mesure de l'impact environnemental et social d'une organisation dont l'objectif est d'orienter la prise de décision en matière d'investissement.
Depuis sa formalisation en 2005 dans le rapport « Who Cares Wins » publié sous l'égide de l'ONU, une pluralité d'initiatives et de principes structurants ont vu le jour pour définir les modalités de prise en compte des facteurs ESG dans les pratiques et la communication des entreprises et favoriser l'essor de l'investissement dit socialement responsable (ISR).
De manière plus ambitieuse, les normes IFRS55(*) développées par l'« International Accounting Standards Board » (IASB), organe international de droit privé créé en 2001, tendent à harmoniser les pratiques comptables à l'échelle mondiale pour garantir la transparence et la comparabilité des états financiers des grandes entreprises. À ce jour, plus de 140 parties ont adopté ce cadre de référence, parmi lesquels l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Japon, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud ou encore l'Indonésie.
Initialement centré sur la finance, ce référentiel a été enrichi pour intégrer les enjeux d'ESG. Avec la création en 2021 de l'« International Sustainability Standards Board » (ISSB), le développement de normes internationales de « reporting » de durabilité (IFRS Sustainability Standards) a franchi un pas supplémentaire. La norme IFRS S2 entrée en vigueur en 2024 invite par exemple les entreprises à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre selon les trois « scopes »56(*) définis par le « Greenhouse Gas Protocol » et à en informer les investisseurs. Cette exigence vise à fournir une image complète de l'empreinte carbone de l'entreprise, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie des produits, et à favoriser les modèles économiques résilients.
Cette approche reproche sur le principe d'une matérialité financière élargie : les états financiers doivent prendre en compte la façon dont les facteurs influençant la durabilité (climat, réglementation sur le carbone, attentes sociales, etc.) affectent la valeur de l'entreprise. Les externalités, positives et négatives, sont directement intégrées dans la valeur économique plutôt que d'être traitées dans de simples annexes des rapports de RSE.
Une quarantaine de pays ont adopté ce référentiel, dont la Chine, le Brésil et l'Indonésie.
Pour le Président de l'ISSB, Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone, ces normes « doivent permettre de rendre les externalités tangibles » et contribuer à un « changement systémique ». Il s'agit de sortir d'une « vision ridiculement étroite de l'économie », trop simplement « mécaniciste », et de changer d'échelle car « nous sommes totalement aveugles à l'égard des services que les écosystèmes nous rendent ».
Dans le même temps, le référentiel proposé par l'ISSB se fonde sur une approche très réaliste : pour Emmanuel Faber, « le langage comptable va être de plus en plus prégnant dans les éléments de compétitivité ».
Les pays sont engagés dans une course à la compétitivité écologique et environnementale, non sur le fondement des valeurs morales, mais parce qu'il y va de la valeur économique.
« Nous devons, nous allons passer d'une économie extractive et prédatrice du vivant dont on voit les limites et les fragilités, à une économie régénératrice du vivant, et donc forcément plus résiliente, j'irais même jusqu'à dire plus vivante. Et ceci, non pas par vertu, mais par réalisme et par opportunité, parce que c'est nécessaire pour continuer à progresser, en tant qu'humanité, en tant que civilisation, pays, communautés, personnes. »
Emmanuel Faber, Ouvrir une voie, 2022
C. LA COMPTABILITÉ SOCIO-ENVIRONNEMENTALE : DES AVANCÉES POUR REPENSER LES LIMITES DE LA CROISSANCE AU NIVEAU MICROÉCONOMIQUE
D'autres méthodes comptables innovantes sont également expérimentées à une échelle plus microéconomique pour renouveler la façon de valoriser la nature et les choix organisationnels.
C'est le cas des modèles de comptabilité environnementale dont l'objectif est d'enrichir la vision de la performance d'une entité en évaluant à la fois son impact environnemental et les effets sur celle-ci du changement climatique, de la raréfaction des ressources et de l'érosion des écosystèmes.
Différentes méthodes existent, avec un niveau d'engagement qui diffère en fonction des postulats théoriques (vision de l'entreprise, place accordée au capital naturel, caractère prioritaire ou non de sa conservation)57(*).
Le modèle dit « CARE »58(*), pour « comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement » apparaît comme le plus abouti. Il mobilise depuis une dizaine d'années une communauté d'acteurs composée d'universitaires, de professionnels (entreprises, experts comptables, etc.) et d'associations, fédéré par la Chaire publique « Comptabilité Écologique » pour la partie recherche59(*) et par l'association CERCES (Cercle des Comptables Environnementaux et Sociaux) au niveau opérationnel.
1. La comptabilité CARE : territorialiser la prise en compte des limites planétaires et valoriser l'impact local des entreprises
Dans ce modèle, expérimenté par des cabinets comptables, des associations et des entreprises, la valorisation des capitaux naturel et humain dépend des coûts de leur préservation.
La comptabilité CARE : une prise en compte conjointe des enjeux financiers, sociaux et environnementaux
CARE propose une évolution de la comptabilité des organisations pour intégrer dans les documents comptables (plans de comptes, tableaux de bord, bilans et comptes de résultats, comptabilité analytique, etc.) et les pratiques associées (performances, pilotage, modèle d'affaires, contrôle de gestion, etc.) l'impératif de préservation du capital non seulement financier mais aussi naturel et humain.
Dans ce modèle, capital naturel et capital humain sont considérés non comme un ensemble de richesses servant de moyens de production au sens économique traditionnel mais comme des « entités capitales » à préserver : ils sont enregistrés au passif en tant que dettes à rembourser.
À l'actif est comptabilisé un droit d'usage de ces entités capitales. Elles constituent des avances sur lesquelles l'organisation fonde sa fonction d'exploitation ; le remboursement de la dette correspond à la restauration de leur intégrité.
En conséquence, avec l'approche CARE, une entreprise ne peut calculer son profit qu'une fois le « remboursement » de sa « dette écologique » envers ses capitaux naturels et humains garanti, de manière analogue à l'obligation de protection du capital financier.
La valorisation du capital naturel (par exemple une forêt) ne repose pas sur les profits susceptibles d'être tirés des services rendus par la nature (valeur marchande ou économique des écosystèmes) mais sur les moyens mis en place pour la préserver (le montant des dépenses nécessaires à sa restauration ou son maintien dans son état d'origine).
Deux principes phares fondent cette approche intégrée :
- la double matérialité, qui se traduit par la prise en compte simultanée des impacts positifs ou négatifs de l'environnement sur l'organisation (matérialité financière) et des effets de cette dernière sur celui-ci (matérialité socio-environnementale) ;
- la soutenabilité forte, chaque capital étant une entité indépendante de l'entreprise que celle-ci emploie, non substituable en raison du caractère irréversible de sa destruction. Le profit financier ne peut compenser la pollution de l'environnement ou la dégradation de l'état de santé des salariés selon une logique d'internalisation des externalités.
L'objectif d'une soutenabilité forte conduit à adopter une approche de la valeur du capital naturel la plus large possible60(*).
Les composantes de la valeur du capital naturel
La mise en oeuvre de la comptabilité CARE passe tout d'abord par l'identification des « entités capitales » de l'entreprise et la définition, pour chaque entité et selon une approche scientifique, d'indicateurs permettant de les apprécier par rapport au respect des « bons états écologiques » des écosystèmes et des notions de décence au travail ainsi que d'intégrité physique et psychique des êtres humains. Chaque dépassement d'un seuil de préservation constitue une dette envers l'entité concernée.
Le profit étant le surplus après mise en oeuvre d'actions de préservation, l'entreprise a un intérêt à agir pour préserver ses entités capitales et donc à réfléchir à son modèle d'affaires pour limiter son impact sur son environnement naturel et social.
2. Une approche intégrée qui va plus loin que le reporting extra-financier et l'internalisation des externalités négatives
La comptabilité socio-environnementale permet de pousser encore plus loin les ambitions du reporting extra-financier en objectivant les données dans le cadre d'une démarche intégrée :
- d'une part, elle permet de matérialiser la responsabilité juridique de l'organisation sur les entités capitales mobilisées dans l'activité de production. Elle rend compte de l'ensemble des composantes matérielles et immatérielles qui font la valeur des entités naturelles dont nous dépendons. Elle contribue ainsi au dépassement de l'analyse fondée sur des prix de marchés pour prendre également en compte les valorisations fondées sur la valeur de non-usage ;
- d'autre part, elle intègre l'ensemble des parties prenantes dans le travail de collecte et de traitement des données, sans se limiter à quelques composantes de l'entreprise en charge de la RSE. Dans le modèle CARE, l'information comptable doit en effet servir à toutes les parties prenantes, parmi lesquelles les gestionnaires, et non pas aux seuls investisseurs qui en seraient des destinataires privilégiés.
« La comptabilité est ainsi appelée à rendre des comptes à la société, à l'environnement, aux territoires, aux travailleurs et non plus à valoriser seulement l'activité marchande des entreprises. Elle serait un important levier pour des changements transformateurs en exigeant de définir avant toutes choses les capitaux naturels et humains importants pour la société, ce que Bruno Latour nomme les attachements. Les chiffres aideraient alors l'économie à se mettre au service de la biodiversité et du social. »
Catherine Aubertin, 202261(*)
De ce point de vue, selon ses défenseurs, la comptabilité CARE s'articule favorablement avec la directive « CSRD », fondée elle aussi sur le principe de la double matérialité, et dont elle peut servir à préciser les modalités d'application.
Enfin, la comptabilité CARE permet de dépasser le modèle néoclassique et l'approche par l'internalisation des externalités, privilégiés depuis les années 1970 pour répondre à la dégradation des biens communs concomitante de la croissance industrielle.
Selon le principe des externalités, les dommages portés à l'environnement sont des défaillances du marché qui peuvent être compensées financièrement.
Différentes méthodes donnent ainsi directement ou indirectement un prix à la nature, mais sans pouvoir embrasser toutes les dimensions de sa valeur : les éléments naturels sont limités à certaines fonctions - par exemple la valeur d'une forêt exprimée en stockage de carbone -, pris en compte dans une logique de substitution - par exemple le service de pollinisation des abeilles estimé en coûts de pollinisation par des drones -, ou valorisés en fonction du consentement marginal à payer par les utilisateurs - par exemple pour bénéficier d'une promenade dans un cadre respectueux de la biodiversité.
Or un système de prix peut difficilement rendre compte de l'état des ressources naturelles. Le principe de la double matérialité, qui conduit à tenir une comptabilité de ce qu'on extrait de la nature et de ce qu'on lui restitue, est une première étape pour rendre compte des liens entre activités économiques et impacts sur l'environnement.
Au total, pour reprendre une classification des courants de l'économie en fonction de la valorisation du capital naturel62(*), l'enjeu est d'aller au-delà de l'« économie de l'environnement » afin de privilégier l'« économie écologique » : la première internalise le coût des atteintes à l'environnement dans les fonctions de production ; la seconde fait de l'environnement une priorité qui détermine les activités économiques.
QUATRIÈME
PARTIE
QUATRE SCÉNARII PROSPECTIFS SUR LA VALEUR
« ÉCONOMIE » EN 2050
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, plusieurs scénarios d'évolution des valeurs économiques et de politiques publiques peuvent être envisagés à l'horizon 2050.
Deux principales variables peuvent être retenues :
- l'importance donnée à la valorisation de la croissance et au PIB par rapport à une approche privilégiant des indicateurs reflétant la priorité donnée au bien-être et à la santé ;
- la place relative laissée à l'innovation, avec un spectre allant de l'« hyper-innovation » à la résilience fondée sur la sobriété des pratiques et la souveraineté.
I. LE SCÉNARIO DE LA CROISSANCE À MARCHE FORCÉE PAR L'HYPER-INNOVATION ET LA DOMINATION ALGORITHMIQUE
Dans ce scénario, croissance et compétitivité restent prioritaires dans l'organisation économique et sociale. La prospérité continue d'être mesurée par le PIB. Ses modalités de calcul sont restées stables dans le temps. La mesure du bien-être est déléguée à des algorithmes, aucun indicateur alternatif au PIB ne s'étant imposé dans le champ politique.
La recherche de croissance repose sur l'hyper-innovation, en particulier dans le domaine de l'environnement, et le développement toujours plus rapide de la fusion « bio-numérique » et des interfaces cerveau-machines. Le travail humain est profondément transformé, souvent remplacé par des solutions hybrides.
En raison de leurs moyens colossaux, les grandes firmes technologiques ont acquis une puissance telle que les institutions étatiques et politiques, accablées par les difficultés financières et en perte de légitimité, leur ont progressivement laissé une place qui va parfois jusqu'à empiéter sur des missions autrefois qualifiées de régaliennes.
La valeur économique s'est déplacée vers les données personnelles et les actifs environnementaux : par l'intermédiaire de solutions technologiques déployées à grande échelle telles que la géo-ingénierie, l'IA climatique ou la mise en place d'infrastructures planétaires de régulation, les grandes entreprises technologiques et numériques s'affichent en garantes de l'environnement.
La biodiversité est pilotée dans des réserves automatisées, surveillées par des systèmes robotisés. De nombreuses start-up voient le jour pour proposer des solutions de gestion plus écologique mais elles peinent à s'imposer face aux géants du numérique.
En l'absence de préconisation publique faite aux entreprises, aucun modèle de comptabilité environnementale ne s'impose ou ne se démarque. Les informations produites par les entreprises sur leur impact environnemental sont peu fiables ou illisibles. Les incitations au changement sont faibles.
Des métadonnées sur le bien-être sont utilisées par les plateformes pour évaluer en continu l'état de la population : analyse des réseaux sociaux, des messageries ou des plateformes collaboratives pour mesurer l'humeur collective, la cohésion ou la solitude ; appréciation de l'état émotionnel collectif calculé à partir de l'analyse du langage naturel (messages, posts, voix), voire de la reconnaissance faciale ou vocale ; suivi de la charge mentale, de la concentration ou de la productivité via des logiciels et des lunettes connectées ; suivi des données physiologiques et comportementales issues de capteurs, objets connectés ou encore des applications de santé.
Ces données sont parfois diffusées en temps réel sur des interfaces holographiques.
Chaque citoyen dispose d'un score personnel de bien-être algorithmique, consultable sur ses lunettes connectées, son smartphone ou via une IA-assistante. Des secteurs tels que la santé, l'éducation ou encore la sécurité sont gérés de plus en plus par des algorithmes et de manière personnalisée.
Les grandes plateformes analysent ces métadonnées pour cibler leur publicité, ajuster leurs services de santé prédictive, voire proposer un espace public qui s'adapte en fonction de l'état de satisfaction calculé : modification de l'intensité lumineuse, régulation de la température, envoi de messages « apaisants » sur des écrans.
Par la force des choses, les pouvoirs publics leur ont en quelque sorte délégué l'évaluation du bien-être collectif. Par conséquent, ces données acquièrent à côté du PIB une valeur proche de celle des indicateurs officiels.
L'activité se concentre dans des mégapoles, les campagnes s'étant vidées de leur population. Les inégalités d'accès aux technologies diminuent globalement, mais une fracture numérique demeure, en particulier entre les grandes agglomérations urbaines et les espaces ruraux moins pourvus en infrastructures numériques.
Du fait de leur opacité, la fiabilité des données diffusées sur l'environnement et le bien-être est faible. L'évaluation de la contribution réelle des grandes entreprises technologiques à la préservation de l'environnement reste difficile.
La techno-dépendance fragilise l'autonomie des choix politiques et sociétaux et met à mal la souveraineté des États, suscitant des tensions géopolitiques. La place prise par les modèles prédictifs n'est pas sans conséquences sur la santé mentale, le vivre-ensemble et la démocratie.
II. LE SCÉNARIO DE LA CROISSANCE DÉCARBONÉE ET CONTRÔLÉE
La croissance économique reste l'objectif central mais elle s'inscrit dans une trajectoire de prospérité bas carbone fondée sur des technologies dites propres. Le PIB demeure l'indicateur phare mais il est ajusté pour prendre en compte le budget carbone des entités publiques, leur empreinte sur la biodiversité et la dette écologique laissée aux générations futures.
La concurrence et l'innovation technologique, visant à concilier croissance et protection des écosystèmes, sont le moteur du changement : des efforts de recherche et développement massifs sont mis en oeuvre par le secteur privé pour développer des systèmes d'intelligence artificielle mis au service de l'environnement, des techniques de stockage du CO2 à grande échelle, l'hydrogène propre ou encore les biotechnologies.
Les écosystèmes sont protégés via leur intégration dans des marchés régulés : fiscalité verte appliquée à l'échelle mondiale, quotas carbone généralisés, mise en place de crédits biodiversité.
Dans l'espace public, la qualité de l'environnement est surveillée par des drones tandis que des informations sont affichées en temps réel sur les émissions de CO2 ou la biodiversité. Les citoyens sont connectés pour suivre leurs consommations personnelles et reçoivent des conseils personnalisés en vue d'une consommation plus durable et responsable.
L'intelligence artificielle est massivement utilisée dans la conception des politiques publiques : en matière de fiscalité, elle contribue à une redistribution ciblée, visant à réduire les inégalités sans ralentir la dynamique économique ; dans le champ social, elle permet de proposer une couverture sociale automatisée et adaptative selon les chiffres de la croissance. L'analyse de données permet d'anticiper les besoins, s'agissant en particulier des aides sociales et des pensions, et permet de prendre en compte le futur pour viser la soutenabilité intergénérationnelle.
Adoptée sur une base volontaire, la comptabilité environnementale constitue un élément de différenciation. Moyennant une révision en profondeur de leur modèle d'affaires et des investissements importants, une partie des entreprises vont au-delà des obligations qui leur sont imposées en matière de responsable sociale et environnementale (RSE) en adoptant une comptabilité socio-environnementale. Elles bénéficient de mesures d'accompagnement (subventions, prêts) de la part des pouvoirs publics et se voient plus facilement accorder des fonds « verts » par les banques.
À l'inverse, les entreprises les moins volontaires se limitent à produire les informations extra-financières. Certains consommateurs se détournent de celles qui sont dénoncées pour leurs atteintes à l'environnement. Les entreprises qui souhaitent mener des actions de RSE favorables à l'environnement et qui mobilisent des fonds en ce sens peuvent toutefois être considérées comme n'optimisant pas les bénéfices des actionnaires à court terme. C'est pourquoi leurs efforts restent contraints.
Si des indicateurs de bien-être sont utilisés, en particulier en matière de santé, d'éducation ou encore de logement, ils demeurent périphériques et ne supplantent pas la logique de croissance.
Des améliorations environnementales ont été enregistrées, en particulier dans les villes, où l'air est moins pollué et les effets du changement climatique atténués par le verdissement des infrastructures urbaines.
Cependant, les écosystèmes sont devenus des actifs financiers et la marchandisation de la nature suscite des critiques.
D'aucuns considèrent que l'ambition d'une « croissance verte » n'a pas permis une transformation en profondeur du système économique pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux sur l'ensemble du territoire. Ils estiment que la société est restée « au milieu du gué ».
III. LE SCÉNARIO DE LA SOBRIÉTÉ CHOISIE
Dans ce scénario, les sociétés, sévèrement touchées par les crises climatiques, économiques et sociales, ont décidé de rompre avec l'obsession de la croissance infinie. Sans rejeter a priori la croissance économique, elles ont fait le choix de valoriser le bien-être et la résilience à l'échelle collective, plutôt que la compétition entre individus et la recherche de la performance.
Face aux velléités des grandes firmes technologiques, certains États ont inscrit dans leur Constitution l'obligation d'assurer le respect des « neuro-droits », en particulier ceux des jeunes, et la protection de l'intégrité cérébrale.
Le PIB, longtemps utilisé comme l'indicateur de référence pour évaluer la prospérité d'une nation, a progressivement perdu de son importance.
De nouveaux instruments ont été adoptés à l'échelle internationale et sont mis en oeuvre par la majorité des États. Il s'agit d'indicateurs composites permettant de mesurer le bien-être et la qualité de vie à travers la mesure de la santé humaine et de celle des écosystèmes, de l'accès au temps libre, de la vitalité des relations sociales, ainsi que de l'empreinte écologique. Il s'agit de s'assurer que les modes de vie restent dans les limites planétaires et compatibles avec une vie saine pour les générations à venir.
La transition économique vers la sobriété a été organisée. Certains secteurs ou activités jugés destructeurs ou superflus (aviation de masse, publicité agressive, extraction intensive) ont été volontairement réduits, tandis que d'autres (agriculture durable, artisanat, énergies renouvelables) ont reçu un soutien renforcé. La consommation de biens matériels a été réduite drastiquement.
À l'échelle individuelle, des quotas ont été mis en place pour les déplacements liés au tourisme et pour un usage plus raisonné des technologies numériques.
Des standards comptables, universellement applicables, ont été adoptés par les autorités internationales et nationales. En raison d'une faible crédibilité des rapports de RSE et de la complexité des informations y figurant, la comptabilité socio-environnementale a été généralisée, d'abord sur une base expérimentale, puis avec le soutien des pouvoirs publics. Elle est désormais obligatoire.
Parallèlement, les pouvoirs publics utilisent les résultats comptables des entreprises pour mieux orienter leurs politiques, en particulier l'octroi d'aides publiques qui se fait désormais en fonction de critères relatifs à la préservation de l'environnement et la santé des salariés.
L'économie s'oriente vers des modèles circulaires et coopératifs, où la réparation, le réemploi et le partage répondent à des valeurs de sobriété et de résilience. Les coopératives locales et les structures d'économie sociale et solidaire deviennent la norme plutôt que l'exception. Les systèmes d'obsolescence programmée sont durement réprimés. Lorsque la balance coûts-bénéfices est favorable, l'intelligence artificielle est utilisée pour renforcer l'efficacité des modèles d'économie circulaire et la logistique des chaînes de valeur locales. La mutualisation des ressources a permis de réduire les inégalités.
Le temps de travail est réduit afin de mieux répartir l'activité et libérer du temps pour la vie personnelle, le bénévolat, la culture et la participation citoyenne. Les métiers du soin au sens large (éducation, santé, accompagnement social, entretien des milieux naturels) sont revalorisés au double plan économique et symbolique.
Mais cette sobriété, même choisie, ne va pas sans obstacles. La sortie du paradigme de la croissance a fragilisé les sociétés en les soumettant à des chocs économiques et sociaux, notamment dans les secteurs qui résistent à leur contraction.
L'acceptabilité sociale reste fragile : certains perçoivent la modération volontaire comme une perte de confort et souhaitent revenir en arrière. Les élites économiques et financières, attachées à l'ancien modèle, freinent les réformes ou cherchent à les contourner.
Ces tensions obligent à inventer de nouvelles formes de gouvernance démocratique, capables de maintenir le cap malgré les résistances, et d'envisager une profonde réforme des systèmes sociaux pour assurer à chacun un socle universel (revenu de base, sécurité alimentaire, santé).
IV. LE SCÉNARIO DES COMMUNAUTÉS LOCALES RÉSILIENTES
Les sociétés ont traversé une série de crises successives - dérèglements climatiques, pandémies, pénuries de ressources - qui ont mis en évidence la fragilité des chaînes de valeur dans une économie mondialisée.
Ces bouleversements ont provoqué un recentrage local. Les zones côtières ont été délaissées et l'intérieur des terres réinvesti. Les sociétés valorisent la résilience à l'échelle de la communauté locale et la solidarité intergénérationnelle sans afficher d'objectif particulier en matière de croissance.
Le PIB a été définitivement abandonné en raison de son incapacité à mesurer le bien-être. L'économie a été reconstruite sur des bases biocentrées, c'est-à-dire intégrant les écosystèmes comme piliers fondamentaux du développement humain.
De nouvelles formes d'organisation émergent. L'économie dite régénérative devient la norme : agroécologie pour nourrir les communautés sans dégrader les sols, « low-tech » et artisanat pour répondre aux besoins essentiels avec des technologies accessibles et réparables, gestion collective des communs (eau, forêts, savoirs). Le travail et la consommation se sont réorientés vers ce qui est durable.
La biodiversité est inscrite dans la Constitution, garantissant sa préservation et sa valorisation dans toutes les politiques. De nouveaux indices de résilience écosystémique guident l'action publique : santé des sols, biodiversité, disponibilité en eau, capacité de régénération des ressources, intérêt des générations futures.
Les territoires s'organisent autour de valeurs de durabilité et de solidarité et les collectivités favorisent les modèles d'économie locale dans lesquels la valeur d'usage prime sur la valeur de possession.
Les décisions politiques s'appuient sur modes de démocratie délibérative, intégrant même des « parlements du vivant », où la voix des écosystèmes et des espèces est représentée symboliquement ou par des porte-parole. Chaque décision inclut désormais une réflexion sur son impact à long terme. Les générations futures disposent de représentants officiels dans les instances décisionnelles.
Si les espoirs sont immenses, les défis le sont tout autant. Les communautés locales se sont repliées sur elles-mêmes. En fonction des capacités d'adaptation locale, de fortes inégalités perdurent entre territoires et pour l'accès aux ressources, ce qui engendre ponctuellement des conflits parfois violents.
Malgré l'importance donnée à l'égalité, au bien-être, à la résilience et à la souveraineté, l'État peine à assurer une forme de péréquation entre communautés et à garantir un socle commun universel. Il connaît des difficultés pour organiser l'arrivée des réfugiés climatiques. Son rôle et sa légitimité sont de plus en plus remis en question.
CINQUIÈME
PARTIE
TROIS GRANDES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR PLACER LA
SANTÉ DU VIVANT AU CoeUR DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE
Afin d'accompagner la transition vers la post-croissance, trois grandes orientations se dessinent, qui placent la santé du vivant, entendue dans une acception holistique selon le paradigme « One Health », au coeur des logiques de création de valeur.
I. UN NOUVEAU NARRATIF POUR FAIRE ÉVOLUER NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR
L'ampleur des bouleversements des prochaines décennies impose une rupture dans nos manières de considérer les notions de création de valeur, de richesse, de performance et de croissance. Il s'agit de revenir au sens premier de l'économie et de proposer un récit nouveau, qui puisse mobiliser à partir d'une autre échelle de valeurs.
A. REVENIR AU SENS PREMIER DE L'ÉCONOMIE
Dépasser le prisme actuel implique de refaire de l'économie au sens étymologique de la discipline : du grec ancien « oikonomia », le mot économie signifie littéralement l'art de bien gérer la maison commune63(*), c'est-à-dire l'unité de base de la vie collective (le foyer, ses ressources, ses relations humaines).
Revenir à l'étymologie, c'est ainsi se souvenir que l'économie ne devrait pas être une science abstraite des marchés ou de la croissance, mais une pratique éthique et politique : comment bien gérer les ressources ? comment garantir la subsistance de tous ? comment vivre ensemble dans un espace commun ?
L'enjeu est de revenir à une économie politique qui met en débat les valeurs et les choix politiques en posant la question des finalités, de repolitiser les décisions économiques pour une gestion éthique des biens communs. Pour reprendre les termes du philosophe Jérôme Batout, il s'agit de « cesser de déléguer à l'économie ce rôle de pivot de l'organisation des valeurs dans une société » pour privilégier une « vision enracinée de l'économie dans la politique ».
B. RÉINVENTER UN HORIZON COMMUN AVEC UN RÉCIT FÉDÉRATEUR ET UNE OUVERTURE DE L'ÉVENTAIL DES VALEURS POUR UNE APPROCHE HOLISTIQUE
La vitesse de la transition exigée pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et répondre aux crises écologiques est sans précédent.
Comment favoriser l'acceptabilité sociale des changements dans un contexte où, malgré les efforts consentis et bien que ceux-ci soient nécessaires, ils pourront sembler vains dès lors que les effets du changement climatique seront toujours ressentis en 2050 et au-delà ?
Ces efforts doivent être appréciés au regard d'autres considérations que celles des seules priorités écologiques.
Mobiliser autour de la santé du vivant - celle des êtres humains actuels et futurs, celle des écosystèmes - et de la solidarité envers les générations à venir pourrait amorcer le changement de perspective et donner envie d'évoluer dans les manières de produire, de consommer et d'agir.
« Ultimement, la transition ne sera pas seulement un effort d'adaptation à une contrainte, mais un processus générateur d'externalités positives, en termes de compétitivité et de création d'emplois dans des secteurs d'avenir, mais aussi en termes de santé publique et de qualité de vie. »
Impact France, réponse au questionnaire des rapporteurs, juin 2025
Il s'agit de fédérer autour d'un nouveau récit, ancré dans le long terme et fondé sur un rapport plus étroit au vivant et une conscience accrue des valeurs de la transmission.
Cette réappropriation des valeurs implique d'abandonner la vision de croissance extravertie pour se tourner vers un objectif de gestion équilibrée des ressources naturelles, de ne plus forcer l'environnement à entrer dans le marché mais de replacer l'économie au sein de la biosphère.
Il s'agit d'une réorientation qui renvoie à bien plus qu'à une simple réforme technique : elle suppose une transformation culturelle, éthique et politique. Redéfinir les finalités économiques, c'est aussi redéfinir ce que nous entendons par progrès, une notion à la croisée de considérations portant sur notre civilisation, notre santé ou l'espérance de vie.
L'économie, ainsi resituée dans le cadre plus large de la nature et du vivant, doit alors retrouver sa fonction première : organiser les conditions d'une existence collective soutenable, où la valeur ne se réduit pas au prix, mais s'enracine dans la volonté d'une continuité du vivant.
« Passer de la transformation de la nature à la transformation des relations de l'humanité à la nature. »
Catherine Aubertin, IPBES, 202264(*)
Ce nouvel horizon implique pour les pouvoirs publics la fixation d'objectifs collectifs clairs, stables et partagés, une relation de confiance avec les acteurs économiques, au premier rang desquels les entreprises, et surtout une vision claire de la répartition de l'effort à consentir. Il impose une réflexion sur le caractère stratégique de certaines productions (alimentation, énergie, mobilités, santé, industries clés).
À l'échelle des entreprises, dans un pays comme la France qui importe l'intégralité de ses énergies primaires non renouvelables, la sobriété peut être rendue désirable par la mise en avant des gains sanitaires mais aussi économiques ou budgétaires.
La sobriété, un triple bénéfice pour les entreprises
Source : Entreprises pour l'environnement (EpE), « La sobriété, nouveau moteur de transformation des entreprises », 5 juin 2025
II. UNE RÉVISION DES OUTILS ÉCONOMIQUES ET MÉTHODOLOGIES COMPTABLES POUR DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
Pour enrichir le débat public et retrouver le sens des limites, adapter les outils économiques et comptables en y intégrant les coûts environnementaux apparaît indispensable.
A. ADAPTER LA COMPTABILITÉ NATIONALE ET LE PIB
La réflexion sur la valorisation du capital naturel permet des avancées conceptuelles intéressantes pour une adaptation de la comptabilité nationale.
Davantage qu'un abandon du PIB, elle laisse entrevoir la possibilité d'adapter cet indicateur pour y intégrer une mesure corrigée des effets de l'activité sur l'environnement ou la santé du vivant au sens large.
« L'abandon d'un outil qui a fait ses preuves pendant des décennies ne peut se faire du jour au lendemain. Mais son incomplétude, son caractère limité, son obsolescence par rapport aux enjeux écologiques sont reconnus par l'ensemble de la communauté des économistes. Aucun indicateur synthétique ne doit s'y substituer parce que les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui (sociaux, écologiques...) ne peuvent pas être agrégés. »
Éric Vidalenc, réponse au questionnaire des rapporteurs, 2025
La référence à un PIB ajusté permettrait une représentation des enjeux plus fidèle à la réalité et de mieux orienter l'action publique.
B. MOBILISER À CÔTÉ D'UN PIB AJUSTÉ DES INDICATEURS DE RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Pour donner une vision plus complète du progrès et aller au-delà du PIB, la réflexion doit se poursuivre sur la mise en place d'indicateurs non strictement monétaires, qui pourraient faire l'objet d'un suivi périodique.
Un nombre limité d'indicateurs de « résilience écologique et sociale » pourraient par exemple être employés de façon complémentaire au PIB, tels des indices de santé sociale, déclinés par région, ou d'empreinte écologique.
Un effort de normalisation et l'accès à des données régulièrement mises à jour seraient indispensables.
C. RÉFLÉCHIR À UNE PLUS GRANDE DIFFUSION DE LA COMPTABILITÉ SOCIO-ENVIRONNEMENTALE
À l'échelle microéconomique, une plus large diffusion de la comptabilité socio-environnementale doit être envisagée.
Complémentaire des actions de « reporting », elle permet d'objectiver les démarches entreprises en application des obligations de RSE mais aussi de susciter un changement de modèle.
La méthode CARE, dans laquelle est pris en compte le coût des actions de préservation des capitaux naturel et humain, apparaît particulièrement aboutie65(*).
Son déploiement implique cependant de lever plusieurs freins :
- il suppose de changer de manière radicale notre vision de la nature et des êtres humains dans l'économie pour ne pas se limiter à une approche instrumentale ;
- il dépend de la capacité à fournir des données scientifiques pertinentes par l'intermédiaire d'experts ou d'instances compétentes, et à mettre au point des nomenclatures pour la production des données, par exemple celles nécessaires à la définition et au suivi des « bons états écologiques des écosystèmes »66(*) ;
- il implique également de bien comprendre le sens de la comptabilité socio-environnementale, qui ne joue pas un simple rôle de reporting et de transparence des données, mais d'accompagnement et de structuration de la gestion des organisations dans un objectif de « durabilité » ;
- enfin, il doit être pleinement soutenu, financièrement et politiquement, y compris au plan international, ce qui n'est pas toujours aisé en raison de la technicité du sujet et de l'existence de différentes conceptions de ce type de comptabilité.
Il conviendra également de s'interroger sur sa place dans les écoles de formation en économie et gestion, où elle n'est pour le moment pas enseignée.
« À ce stade, il est nécessaire de rappeler que le déploiement des systèmes comptables “classiques” (quel que soit leur type) a toujours été un phénomène complexe, tant les changements comptables entraînent des modifications en profondeur du fonctionnement des organisations et de l'économie.
D'un point de vue stratégique, il semble exister un réel intérêt à pouvoir assumer à l'international un positionnement sur ces questions, centrales au développement de l'économie de demain. »
Alexandre Rambaud, réponse au questionnaire des rapporteurs, 2025
Les collectivités territoriales pourraient jouer un rôle d'exemplarité en favorisant le déploiement de ces comptabilités dans les organismes publics.
Cette évolution contribuerait à mettre en oeuvre une approche de l'adaptation aux limites planétaires par territoire mais aussi de valoriser l'ancrage des entreprises dans leur territoire.
III. UNE ADAPTATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE POUR MIEUX INTÉGRER LE TEMPS LONG ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
A. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES DE GOUVERNANCE INTERNATIONALE POUR LEUR CONFIER LA MISE EN oeUVRE D'ÉVALUATIONS ANNUELLES DE LA SOLVABILITÉ PLANÉTAIRE
L'adaptation de notre modèle économique dans le sens d'une plus grande résilience ne peut se concevoir sans le partage, à l'échelle internationale, d'une culture du risque et d'outils opérationnels plus adaptés.
C'est le sens des préconisations émises dans le rapport de l'École d'actuariat britannique. Celui-ci part du constat selon lequel la gestion des risques environnementaux impliquera la mise en oeuvre de politiques publiques plus proactives, avec des institutions dédiées, des objectifs clairs et des évaluations régulières.
Les propositions formulées par l'IFoA en faveur d'évaluations annuelles des risques de solvabilité planétaire par des instances dédiées67(*)
1. Informer chaque année le Conseil de sécurité de l'ONU du risque d'insolvabilité planétaire dans le cadre d'évaluations s'appuyant sur une définition de la résilience.
2. Créer une fonction de responsable de la mise en oeuvre des évaluations de la solvabilité planétaire au sein d'une instance comme le FMI ou l'OCDE.
3. Nommer des responsables du risque systémique aux niveaux supranational, national et infranational afin de développer les outils de de gestion du risque.
L'IFoA invite les gouvernements et les institutions financières à renoncer aux arbitrages à court terme pour privilégier la préservation de la liberté de choix et le bien-être des générations futures.
Elle préconise le recours à un tableau de bord de la solvabilité planétaire, incluant des indicateurs de solvabilité naturelle, sociale et économique, inspiré des pratiques actuarielles et des bilans financiers, mais appliqué à l'environnement.
Pour l'IFoA, ces évaluations fourniraient des informations claires pour les décideurs, afin d'orienter les politiques publiques selon les limites planétaires. Elles fourniraient une base sur laquelle fonder des trajectoires nationales déclinant les limites planétaires en objectifs sectoriels et temporels.
B. RÉFORMER L'ENVIRONNEMENT EUROPÉEN
La nécessité pour l'Europe de créer une zone plus intégrée pour sa politique industrielle est bien identifiée, en particulier par le rapport dit « Draghi » sur l'avenir de la compétitivité européenne68(*).
L'enjeu est de réussir à mobiliser des moyens financiers publics et privés plus massifs afin de stimuler l'investissement et l'innovation dans les technologies d'avenir.
« Cette démarche scientifique est exactement ce qu'il faut pousser à l'échelle européenne : d'une part, une évolution de la science en lien direct avec l'intérêt de l'économie, d'autre part, une économie qui rémunère la science pour développer des analyses de plus en plus pertinentes. L'Europe l'a pressenti avec la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Toutefois, pour rentabiliser l'effort demandé, il fallait unifier les marchés de capitaux européens.
Le CSRD est l'élément central qui permet à l'Europe d'être en avance, grâce à l'identification des actifs [...] extramonétaires. Tous les détenteurs de capitaux dans le monde cherchent des investissements hors monnaie. De fait investir dans la réduction du risque d'incendie crée de la valeur, quelle que soit l'évolution du dollar ou de l'euro. »
Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025
Outre un accompagnement par des politiques claires et stables dans le temps, de nouveaux mécanismes de financement doivent être envisagés, le préalable étant l'unification du marché des capitaux.
En attendant, le renforcement de la législation extra-financière permettra d'accompagner les efforts d'adaptation vers des pratiques plus durables et à faire émerger un modèle de compétitivité davantage fondé sur la qualité sociale et environnementale des produits et des services.
La mise en oeuvre de la directrice CSRD doit permettre de hisser la qualité de l'information extra-financière au niveau de celle de l'information financière. Investisseurs, régulateurs et pouvoirs publics devront s'appuyer sur ces données plus précises, complètes et comparables pour orienter les flux financiers et les politiques publiques. Dans une approche sectorielle, ces obligations pourraient être employées comme un instrument de modulation des aides publiques et de la fiscalité.
Pour protéger les entreprises, la réflexion relative à l'extraterritorialité de certaines normes et à l'intégration de clauses miroirs dans les accords commerciaux doit par ailleurs se poursuivre. Le travail de négociation pour harmoniser les prix du carbone à l'échelle internationale et renforcer les obligations de transparence en matière de teneur en carbone des produits importés doit se poursuivre.
Plus généralement, il est nécessaire de lutter contre l'imprévisibilité réglementaire au moment où un horizon de planification de long terme est devenu primordial.
« Les valeurs fondamentales de l'Europe sont la prospérité, l'équité, la liberté, la paix et la démocratie dans un environnement durable. L'UE existe afin de garantir que les Européens puissent toujours bénéficier de ces droits fondamentaux. Si l'Europe ne peut plus garantir ces droits à ses citoyens - ou si elle se voit contrainte de les hiérarchiser -, elle aura perdu sa raison d'être. La seule façon pour l'Europe de relever ce défi est de croître et de devenir plus productive, tout en préservant ses valeurs d'équité et d'inclusion sociale. Et pour devenir plus productive, l'Europe n'a qu'une solution : changer radicalement. »
Mario Draghi, L'avenir de la compétitivité européenne, partie A, septembre 2024
Les perspectives ouvertes par le rapport de Mario
Draghi sur l'avenir de la compétitivité
européenne
(septembre 2024)
Le rapport souligne le net décrochage économique de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à la Chine. Il déplore le faible niveau d'innovation européen, l'insuffisance des investissements dans les technologies de rupture, la fragmentation du marché unique, le coût élevé de l'énergie, le haut niveau de dépendance de l'UE pour son accès aux matières premières et aux technologies ainsi que les vulnérabilités de ses capacités industrielles de défense.
Pour remédier à ces faiblesses, Mario Draghi évalue les besoins d'investissements de l'UE à 750 à 800 milliards d'euros par an. Il formule 170 propositions, parmi lesquelles :
- une accélération de l'innovation par la mise en place d'une Union de la recherche et de l'innovation, un investissement massif dans la transition énergétique et la décarbonation, le renforcement du programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, et la création d'une agence européenne pour l'innovation de rupture ;
- un investissement significatif dans l'intelligence artificielle dans les secteurs stratégiques, dont l'automobile, l'énergie ou encore la santé ;
- la création d'un nouveau statut d'« entreprise européenne innovante » et l'unification du droit des sociétés pour favoriser la croissance des start-up ;
- la finalisation de l'Union des marchés de capitaux (Capital Markets Union) pour mobiliser davantage de capitaux privés et mieux orienter l'épargne européenne, ainsi que le lancement d'un endettement commun pour faciliter le financement de l'innovation ;
- un allègement du cadre réglementaire européen, avec la nomination d'un vice-président de la Commission chargé de la simplification administrative ;
- un renforcement de la souveraineté énergétique par une diversification des approvisionnements, un renforcement des achats conjoints ou encore une uniformisation de la taxation du secteur de l'énergie ainsi que la création d'une plateforme visant à sécuriser l'accès aux matières premières critiques en coordonnant la négociation d'achats conjoints ;
- la création d'un marché unique pour les déchets et le recyclage, avec pour objectif la capacité pour l'UE en 2050 d'assurer plus de la moitié, voire les trois quarts, de ses besoins en métaux pour les technologies propres ;
- ou encore une réforme du fonctionnement des institutions, avec la généralisation du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil afin d'éviter les blocages en cas de veto d'un seul État membre.
C. RENFORCER LES EFFORTS TOUS AZIMUTS EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES TERRITOIRES
Mus par des valeurs de durabilité et de sobriété, les modèles d'économie circulaire constituent une réponse parmi d'autres aux défis environnementaux. Les efforts en faveur de leur implantation dans les territoires, où ils favorisent également l'emploi local, doivent se renforcer.
Bien que ses répercussions sur l'économie, l'emploi et l'écologie soient positives, la part de ce secteur, évaluée à environ 800 000 emplois et de 2 à 3 % du PIB, est encore trop faible.
Il s'agit désormais de structurer cette filière d'avenir, de passer d'une logique sectorielle à une logique industrielle plus systémique et territorialisée.
Afin que les modèles circulaires deviennent compétitifs, des incitations économiques ou fiscales doivent être étudiées. L'enjeu est de rendre le réemploi ou la réparation moins chères que le remplacement. Un alignement des signaux du marché avec les objectifs climatiques s'impose, ce qui soulève la question du prix du carbone.
À travers la commande publique et le respect de la loi dite « AGEC »69(*), les collectivités publiques doivent prendre toute leur part au développement de la filière.
Poursuivre la réflexion sur les évolutions du droit des marchés publics pourra être utile pour prendre en compte les spécificités des entreprises de ce secteur.
D. RÉFLÉCHIR AUX ADAPTATIONS DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Dans le prolongement de la législation extra-financière, une réflexion doit être engagée sur les adaptations de la gouvernance d'entreprise et le partage de la valeur ajoutée.
La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la composition des parts variables des rémunérations, celles des dirigeants et des actionnaires, serait par exemple un levier puissant pour accélérer la transition écologique.
Cela suppose de repenser les incitations financières, de modérer la pression sur les rendements à court terme et de renforcer les signaux économiques en faveur des investissements verts. Si les prix du carbone restent trop faibles pour rendre les investissements verts plus attractifs, la mise en oeuvre de la transition énergétique et la maximisation du rendement pour l'actionnaire demeureront difficilement conciliables.
« Le manque d'incitation au changement et de sécurisation des trajectoires collectives expose les dirigeants aux acteurs les plus courts-termistes de leur gouvernance. »
Impact France, réponse au questionnaire des rapporteurs, juin 2025
L'enjeu de la redistribution de la valeur entre le capital et le travail reste donc central, et pas moins important que la nécessité d'intégrer davantage la dimension humaine dans la gouvernance et la gestion des entités économiques.
* *
*
Les questions de gouvernance, qui interrogent nos références institutionnelles et culturelles, constituent un enjeu majeur dans la transition attendue.
Nous ne pourrons faire l'économie d'une réflexion approfondie sur nos principes démocratiques, notre rapport à la vérité, en particulier scientifique, et à l'autorité, ainsi qu'à la place essentielle que doit occuper l'éducation dans la construction d'une société capable de répondre aux défis systémiques du XXIe siècle.
Cela implique aussi d'explorer de nouveaux imaginaires, fût-ce en mobilisant la puissance évocatrice de la fiction et des arts, afin de favoriser un ancrage des valeurs de résilience et de santé du vivant au sein de notre économie.
TROIS GRANDES ORIENTATIONS POUR L'AVENIR
1. PARTAGER UN NOUVEAU RÉCIT POUR FAIRE ÉVOLUER NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR
· Revenir au sens premier de l'économie
· Réinventer un horizon commun avec un récit fédérateur et une ouverture de l'éventail des valeurs
2. RÉVISER LES OUTILS ÉCONOMIQUES ET LES MÉTHODOLOGIES COMPTABLES POUR DÉCIDER EN CONNAISSANCE DE CAUSE
· Adapter la comptabilité nationale et le PIB
· Mobiliser à côté d'un PIB ajusté des indicateurs de résilience écologique et sociale
· Réfléchir à une plus grande diffusion de la comptabilité socio-environnementale
3. ADAPTER LES INSTANCES DE GOUVERNANCE POUR MIEUX PRENDRE EN COMPTE LE TEMPS LONG ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
· Faire évoluer les instances de gouvernance internationale pour leur confier la mise en oeuvre d'évaluations annuelles de la solvabilité planétaire
· Réformer l'environnement européen
· Renforcer les efforts pour faire essaimer l'économie circulaire dans les territoires
· Réfléchir aux adaptations de la gouvernance d'entreprise et du partage de la valeur ajoutée
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Réunie le mardi 7 octobre 2025, la délégation à la prospective a examiné le rapport de M. Éric Dumoulin, Mme Vanina Paoli-Gagin et M. Stéphane Sautarel sur «L'évolution des valeurs dans le champ économique à l'horizon 2050 ».
Mme Christine Lavarde, présidente. - Nous examinons aujourd'hui le premier des quatre rapports prévus dans le cadre des travaux de notre délégation sur le thème des valeurs. Intitulé L'évolution des valeurs dans le champ économique à l'horizon 2050, il nous est présenté par nos collègues Vanina Paoli-Gagin, Stéphane Sautarel et Éric Dumoulin. Nous avons fait en sorte que ce dernier puisse co-présenter ce travail collectif alors que son départ du Sénat pourrait être imminent.
M. Éric Dumoulin, rapporteur. - Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir accepté d'avancer la date de présentation de notre rapport. En effet, Sophie Primas redevenant sénatrice vendredi prochain à zéro heure, mon mandat prendra fin après-demain. Cela me permet ainsi de conclure en beauté cette année passée au Sénat.
Vanina Paoli-Gagin, Stéphane Sautarel et moi-même avons essayé d'aborder de manière relativement exhaustive le sujet particulièrement complexe des valeurs économiques à l'horizon 2050.
« La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début du siècle s'acharnait à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme. » Cet appel à une morale de l'environnement, prononcé par Georges Pompidou il y a plus d'un demi-siècle, n'a rien perdu de sa force : à l'aube des profondes mutations qui s'annoncent, les valeurs qui sous-tendent nos choix économiques sont plus que jamais au coeur de nos interrogations.
Pendant plusieurs décennies, la croissance a été un formidable vecteur de progrès : elle a permis, dans de nombreuses régions du monde, une amélioration significative des conditions de vie.
Dans l'après-guerre, elle a été un socle de stabilité pour nos démocraties. Mesurée en termes de production, de consommation, de richesse, la valeur de la croissance économique a offert un horizon commun, une cause mobilisatrice autour de laquelle s'est cristallisé un assez large consensus social et politique.
Pourtant, d'un point de vue historique et anthropologique, l'idée d'une prospérité fondée sur l'accumulation ne s'est imposée que très récemment, avec l'entrée dans la modernité et la révolution industrielle. À l'échelle de l'humanité, le désir de croissance est en profonde rupture avec la stabilité - stabilité des besoins, de la production et de la consommation -, qui fut la valeur économique pendant des millénaires.
Aujourd'hui, un siècle après Keynes, la croissance économique continue d'être valorisée, non comme un chemin vers un état stationnaire d'abondance - ce que Keynes anticipait pour ses petits-enfants -, mais comme une condition sine qua non du bien-être collectif.
Dans la hiérarchie des priorités politiques, elle est devenue la clef de voûte dont de nombreuses autres dimensions - sociales, sanitaires, éducatives - dépendent.
Parallèlement, la place prise par la valeur économique a fait glisser la société vers un fonctionnement plus hétéronome, où les finalités collectives tendent à résulter de logiques de gestion et d'optimisation davantage que de délibérations morales et collectives.
Aux termes de ce que le philosophe Jérôme Batout qualifie de « révolution silencieuse des mentalités », l'obsession de la croissance a en quelque sorte escamoté le débat politique et moral sur les valeurs et notre rapport à la finitude du monde.
Dans un monde désormais confronté à des défis d'une ampleur inédite - crises écologiques, montée des inégalités, insécurité alimentaire, vieillissement démographique, crises géopolitiques -, le récit de la « mondialisation heureuse » s'essouffle ; il semble se conclure par une crise de la valorisation.
Cette crise n'est pas seulement économique ; elle est politique, morale, voire civilisationnelle. C'est une remise en question profonde de ce que nous jugeons souhaitable, désirable, acceptable.
Dans quel monde vivront les générations nées dans les années 2020, une fois trentenaires ?
Nous avons identifié quatre évolutions principales.
D'abord, à l'horizon 2050, ces nouvelles générations évolueront probablement dans une géographie économique remaniée, marquée par un recul de la place de l'Europe dans le monde et une accentuation de la rivalité, déjà bien réelle, entre la Chine et les États-Unis.
Les rapports de force géopolitiques se noueront autour de l'accès à l'énergie et aux matières premières, de la décarbonation, de l'innovation, du développement des hautes technologies et de la maîtrise de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, la valeur environnementale des actifs sera très convoitée, comme l'a souligné l'économiste Philippe Dessertine devant notre délégation.
Dans cette économie ultranumérisée et immatérielle, certaines régions du monde pourraient continuer de raisonner selon des logiques de valeurs très différentes des valeurs européennes. Le besoin de protection des populations serait croissant.
Deuxièmement, les bases sociales sur lesquelles repose notre conception de la prospérité seront fragilisées : je veux ici parler du vieillissement démographique mondial.
Selon les projections disponibles, dès les années 2030, les personnes âgées de plus de 80 ans seront plus nombreuses que les enfants de moins de 1 an. En 2080, elles seront plus nombreuses que les moins de 18 ans. Cette inversion historique du rapport entre générations transformera la valeur des actifs économiques et de la solidarité intergénérationnelle.
Troisième certitude, et non des moindres : le dérèglement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes. Aucune partie du monde n'est et ne sera épargnée. Le continent européen est celui qui se réchauffe le plus rapidement, deux fois plus vite que la moyenne mondiale.
Ainsi, au cours de leur vie, les générations nées dans les années 2020 connaîtront sept fois plus d'épisodes de chaleur extrême, deux fois plus de sécheresses et d'incendies de forêt et trois fois plus d'inondations et d'années de mauvaises récoltes que les personnes nées en 1960.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) prévient que « les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici une génération ». Autrement dit, ce qui relève aujourd'hui de l'exception sera la norme pour nos enfants et petits-enfants.
Dernier bouleversement majeur - constat partagé par l'ensemble des économistes et des sociologues que nous avons rencontrés : l'effondrement de la biodiversité. Or on ne mesure pas encore tous les effets de la remise en cause des services écosystémiques. De fortes incertitudes demeurent.
D'une part, l'ensemble des bienfaits que peut apporter la nature n'est pas encore connu. Les recherches sur le vivant conduisent régulièrement à envisager la possibilité de nouvelles applications dans un contexte où il reste encore de très nombreuses espèces à découvrir.
D'autre part, on ne connaît pas encore toutes les conséquences d'une diversité amoindrie. Des interdépendances complexes et des interactions constantes existent entre les humains et les autres êtres vivants. Les scientifiques ignorent s'il existe un seuil de perte de biodiversité à ne pas dépasser.
En tout état de cause, cependant, pour reprendre les termes de la chercheuse Virginie Courtier-Orgogozo devant le Collège de France, cette situation « nous entraîne dans une trajectoire qui altérera profondément et durablement les conditions de vie des générations futures ».
Dans un récent rapport sur les risques liés au réchauffement climatique, l'École britannique d'actuariat, en partenariat avec l'université d'Exeter, alerte sur un risque ultime d'« insolvabilité planétaire ».
Les auteurs de cette étude soulignent que les techniques habituelles de gestion des risques se concentrent sur des risques isolés, sous-estimant les risques en cascade. Or la dégradation des ressources naturelles telles que les forêts et les sols ou l'acidification et la pollution des océans ont un effet multiplicateur sur les conséquences du changement climatique.
Au total, ils estiment que le PIB mondial pourrait perdre 50 % de sa valeur entre 2070 et 2090 en raison des divers chocs exogènes que sont les sécheresses, les inondations, les incendies, l'érosion des ressources, etc.
Cette réalité apparaît au moment où les besoins de financement pour réussir la transition écologique explosent, où la croissance est durablement ralentie et le niveau d'endettement sans précédent.
Selon plusieurs estimations, la transition énergétique pourrait en effet nécessiter chaque année entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars d'investissements supplémentaires pendant vingt-cinq ans à l'échelle mondiale. Or comment financer collectivement des transformations systémiques de long terme avec les instruments d'une économie conçue pour une croissance rapide, qui relève d'une époque désormais révolue ?
Au regard de la valeur que nous accordons à la résilience, la dette, qui occupe une place centrale, est devenue terriblement ambivalente : tout à la fois nécessaire et source de profondes vulnérabilités. Elle cristallise les tensions entre le présent et l'avenir, entre le court terme et le long terme, entre ce que nous voulons préserver et ce que nous sommes prêts à sacrifier.
La gravité des constats ne doit pas occulter la richesse des réflexions en cours pour revisiter nos schémas de pensée, nos indicateurs et notre façon d'appréhender ces défis.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Le lien de plus en plus distendu entre développement économique et progrès humain doit en effet nous interroger sur ce que nous souhaitons réellement valoriser dans notre économie. Qu'entendons-nous préserver, transmettre, encourager à travers nos choix économiques collectifs ?
Cette interrogation a été le fil conducteur de nos travaux, ponctués de seize auditions et d'un déplacement sur le thème de l'économie circulaire.
Je commencerai avec un constat qui sonne aujourd'hui comme une évidence : nos indicateurs macroéconomiques ne reflètent pas l'état de santé du monde.
Notre compréhension de la richesse doit être élargie. Il s'agit de rendre visibles et mesurables d'autres dimensions de la valeur, qui dépassent la seule sphère économique.
Dès la création du PIB par l'économiste et prix Nobel d'origine russe Simon Kuznets en 1934, celui-ci avait indiqué qu'il était une simple convention. Il ne devait en aucun cas être considéré comme un indicateur du bien-être.
Au fil du temps, cet avertissement a souvent été ignoré : le PIB est resté la référence principale pour juger de la prospérité. Or il ne donne qu'une image très restrictive de la richesse d'un pays : il se concentre sur les flux économiques sans prendre en compte la répartition des richesses ou les inégalités, éléments pourtant essentiels à la cohésion sociale et à la qualité de vie ; il compte pour nulles de nombreuses activités au coeur de la vie sociale comme le travail bénévole ou domestique ; enfin, il considère comme utiles toutes les productions, y compris celles qui n'apportent pas de bénéfices à la société, qui lui sont nuisibles ou qui compromettent la capacité des générations futures à prospérer.
En particulier, le PIB ne renseigne pas sur l'état des patrimoines critiques que sont la nature ou la santé.
Dans ces conditions, la question est de savoir non plus tellement si le PIB doit rester la métrique de référence, mais plutôt pourquoi il l'est toujours.
La réflexion sur les alternatives au PIB a été foisonnante dès les années 1970, puis au début des années 2000. Deux principales approches ont été explorées : la définition d'un indicateur synthétique et l'utilisation d'un éventail d'indicateurs.
Malgré cela, aucun indicateur n'a supplanté le PIB comme outil d'information et de pilotage des politiques publiques, bien qu'il soit aujourd'hui de plus en plus complété par des données d'ordre qualitatif.
Pour tenir compte de la décorrélation entre le PIB par habitant et le « bien-être ressenti » des ménages, un indicateur de bien-être monétaire appelé « PIB ressenti » a récemment été proposé par l'Insee.
Il confirme qu'une croissance du PIB ne reflète pas nécessairement une amélioration des conditions de vie ressenties par nos concitoyens, la répartition des fruits de la croissance pouvant être inégale.
Les résultats obtenus plaident pour des approches « multidimensionnelles » des mesures des niveaux de vie. Ils redistribuent par ailleurs les hiérarchies internationales, traditionnellement fondées sur une comparaison des PIB.
Sur le plan théorique, plusieurs grands courants de pensée alternatifs ont pris leur essor ces dernières décennies, de la décroissance à la croissance verte en passant par la post-croissance dans toutes ses déclinaisons.
Ils invitent à repenser la notion même de croissance pour privilégier la qualité de vie plutôt que l'expansion matérielle, sans nier les changements institutionnels, culturels et démocratiques nécessaires pour accompagner cette transformation.
L'économie du bien-être, développée par Éloi Laurent, propose de substituer à la logique de croissance une approche centrée sur l'amélioration concrète des conditions de vie humaine. Elle repose sur deux piliers fondamentaux : la santé au sens large et la coopération - liens sociaux, justice sociale, démocratie -, considérées comme les véritables finalités de l'activité économique.
Selon cette approche, la santé doit être traitée non pas comme une dépense, mais comme une boussole politique, intégrée dans toutes les sphères de l'action publique.
Une boîte à outils est en cours de développement afin d'inventorier les dispositifs de politique publique existants ou émergents en Europe.
Des modèles comme l'économie circulaire ou l'« économie de la fonctionnalité et de la coopération » s'inscrivent dans cette vision, en privilégiant l'ancrage local et les dynamiques territoriales, la qualité des relations humaines et la valeur d'usage plutôt que la possession.
Malgré leurs différences, ces visions alternatives nous paraissent pouvoir converger autour d'une valeur commune, celle de la santé du vivant au sens large.
Le concept de One Health repose sur l'idée que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont interdépendantes, et même forment un tout.
Cette vision holistique, initialement mobilisée dans le champ de la santé publique pour prévenir les zoonoses, s'est progressivement élargie pour devenir une grille de lecture transversale des enjeux sociaux, écologiques et économiques. Elle se présente comme une nouvelle boussole dans le monde de la post-croissance, en particulier après la crise de la covid.
Pour s'inscrire dans une démarche de préservation du vivant et des générations futures, une évolution de nos référentiels comptables commence à se dessiner.
Au niveau macroéconomique, l'Insee travaille sur une approche novatrice consistant à calculer un « produit intérieur net ajusté » des coûts liés aux dommages environnementaux : le Pina.
Dans ces comptes « augmentés », les conséquences des émissions polluantes sont assimilées à des consommations de capital climatique et à la réduction du « budget carbone ». Un pays qui réduit ses émissions voit ainsi la progression annuelle de son Pina supérieure à celle de son produit intérieur net (PIN) usuel.
L'Insee souligne ainsi qu'en 2023, le Pina de la France était inférieur d'environ 4 % au PIN usuel, et même de 5,5 % si l'on prend en compte les effets du climat sur la santé et la mortalité. Ce nouvel indicateur permet de tenir compte de l'épuisement des ressources dans l'activité du pays, réalité qui n'était pas mise en évidence jusqu'alors.
Une logique identique est appliquée au calcul de l'épargne nette de la France, qui mesure la valeur du produit courant légué aux générations futures.
La prise en compte de la consommation de capital climatique et du budget carbone conduit à minorer cet agrégat de 201 milliards d'euros pour mettre en évidence une épargne nette ajustée fortement négative.
Pour l'Insee, cette situation de désépargne reflète une dégradation des conditions de vie futures qui n'est pas compensée par l'augmentation de la richesse purement économique.
Dans une autre étude récente, le Conseil d'analyse économique (CAE) s'est quant à lui penché sur la valorisation des services écosystémiques, en prenant pour objet d'étude la forêt française.
Les auteurs se fondent sur une méthode originale de valorisation du service de séquestration du carbone. La valeur ajoutée « augmentée » du secteur forêt-bois est ainsi évaluée à 11,2 milliards d'euros en 2018, soit 3,5 fois sa valeur marchande.
Les auteurs insistent sur l'importance de développer des évaluations monétaires robustes des services écosystémiques en soutien à la décision publique. Ils appellent de leurs voeux une extension de ces nouvelles approches à d'autres écosystèmes comme les terres cultivées, les zones humides ou encore les ressources en eau.
Bien qu'exploratoires, ces réflexions ouvrent une voie prometteuse dans la perspective d'une révision du système des comptes nationaux. À terme, ce système pourrait intégrer d'autres dimensions de l'environnement, au-delà de la seule question des émissions, comme la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité, mais aussi les activités domestiques et de loisir. Il mettrait ainsi davantage l'accent sur la soutenabilité et le bien-être.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - Au niveau microéconomique, il reste difficile d'évaluer précisément l'engagement des entreprises en matière de durabilité, en dépit des obligations croissantes de reporting extrafinancier.
Pour y remédier, deux nouvelles normes comptables sont entrées en vigueur en 2024 sous l'égide de l'International Sustainability Standards Board (ISSB), ou Conseil international des normes de durabilité. Elles reposent sur une matérialité financière élargie, ce qui signifie que les facteurs influençant la durabilité doivent être intégrés à la valorisation de l'entreprise. Ce référentiel est déjà adopté par une quarantaine de pays, dont la Chine et le Brésil.
Le président de l'ISSB, Emmanuel Faber, y voit un moyen de dépasser une vision « mécaniciste » de l'économie et de rendre les externalités tangibles. Celles-ci ne sont plus reléguées aux annexes des rapports de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
D'autres méthodes comptables innovantes cherchent à renouveler la manière de valoriser la nature et les choix organisationnels. C'est le cas des modèles de comptabilité socio-environnementale. Parmi ceux-ci, la méthode dite Care - pour comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement - est la plus aboutie. Elle repose sur une approche inédite : les capitaux naturel et humain sont considérés comme des « entités capitales » à préserver, non comme de simples ressources. Elles sont enregistrées au passif en tant que dettes à rembourser. Leur droit d'usage est comptabilisé à l'actif.
Le profit correspond au surplus dégagé une fois les coûts de préservation de ces capitaux pris en compte. L'entreprise est ainsi appelée à repenser son modèle d'affaires pour réduire son impact environnemental et social.
Ce modèle permet de matérialiser la responsabilité juridique de l'organisation envers ces capitaux. Il dépasse la seule logique de marché pour aller jusqu'à intégrer des valeurs de non-usage. De plus, il implique l'ensemble des parties prenantes dans la collecte et le traitement des données, au-delà des seules équipes chargées de la RSE.
Au final, Care est une manière exigeante de territorialiser les limites planétaires tout en valorisant l'impact local des entreprises.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, nous proposons dans notre rapport quatre scénarios d'évolution des valeurs économiques.
Le premier scénario est celui de la croissance à marche forcée par l'hyperinnovation et la domination algorithmique.
Dans ce scénario, la croissance et la compétitivité restent prioritaires dans l'organisation économique et sociale. La prospérité continue d'être mesurée par le PIB.
La valeur économique s'est déplacée sur les données personnelles et les actifs environnementaux. En raison de leurs moyens colossaux, les grandes firmes technologiques ont acquis une puissance qui défie les institutions étatiques et politiques.
Les métadonnées sont analysées en continu pour mesurer l'état émotionnel et physique des populations. La mesure du bien-être est ainsi déléguée à des algorithmes, aucun indicateur alternatif au PIB ne s'étant imposé dans le champ politique.
Du fait de leur opacité, la fiabilité des données diffusées sur l'environnement et le bien-être est faible. La techno-dépendance fragilise grandement l'autonomie des choix politiques et sociétaux.
Le deuxième scénario est celui de la croissance décarbonée et contrôlée.
La croissance économique reste l'objectif central, mais elle s'inscrit dans une trajectoire de prospérité bas-carbone fondée sur des technologies dites propres. La concurrence et l'innovation technologique visant à concilier croissance et protection des écosystèmes sont le moteur du changement.
Des indicateurs de bien-être sont utilisés, en particulier en matière de santé, mais ils ne supplantent pas la logique de croissance. Des améliorations sont enregistrées en matière environnementale.
Cependant, les écosystèmes sont devenus des actifs financiers et la marchandisation de la nature suscite des critiques. L'ambition d'une croissance durable n'a pas permis une transformation en profondeur du système économique ; la société est restée « au milieu du gué ».
Troisième scénario, celui de la sobriété choisie.
Dans ce scénario, les sociétés ont décidé de rompre avec l'obsession de la croissance infinie. Sans rejeter a priori la croissance économique, elles ont fait le choix de valoriser le bien-être et la résilience à l'échelle collective, plutôt que la compétition entre individus et la recherche de la performance.
La transition vers la sobriété a été organisée : certains secteurs ou activités jugés destructeurs ou superflus ont été volontairement réduits ; la consommation de biens matériels a été réduite drastiquement.
Cependant, la sortie du paradigme de la croissance a fragilisé les sociétés en les soumettant à des chocs économiques et sociaux. L'acceptabilité sociale des changements reste fragile.
Le dernier scénario est celui des communautés locales résilientes.
En réaction aux crises engendrées par la fragilité des chaînes de valeur mondialisées, les sociétés ont opéré un recentrage local.
Le PIB a été définitivement abandonné en raison de son incapacité à mesurer le bien-être. L'économie régénérative, fondée sur l'agroécologie, la low-tech, l'artisanat, est devenue la norme. La nature et les générations futures sont représentées dans des assemblées délibératives.
Mais, malgré l'importance donnée à l'égalité, au bien-être, à la résilience et à la souveraineté, ce modèle ne va pas sans heurts. Les inégalités territoriales sont grandes et l'État peine à désamorcer les conflits.
Ces scénarios nous donnent à voir différents futurs possibles et nous invitent à anticiper les choix collectifs à venir.
Notre rapport propose trois grandes orientations pour placer la santé du vivant, entendue dans une acception holistique, au coeur de la valeur économique.
Premièrement, imaginer un nouveau récit pour faire évoluer nos manières de penser et d'agir.
Dépasser le prisme actuel implique tout d'abord de refaire de l'économie au sens étymologique de la discipline : oikonomia, du grec ancien, c'est l'art de bien gérer la maison commune.
Revenir à l'étymologie, c'est ainsi se souvenir que l'économie devrait être non pas une science abstraite des marchés ou de la croissance, mais une pratique éthique et politique.
Il faut ensuite réinventer un horizon commun avec un récit fédérateur et une ouverture de l'éventail des valeurs. L'enjeu est celui de l'acceptabilité sociale des changements à accomplir.
Mobiliser autour de la santé du vivant - celle des êtres humains actuels et futurs, celle des écosystèmes - et de la solidarité envers les générations à venir pourrait amorcer le changement de perspective.
Deuxième orientation : réviser les outils économiques et les méthodologies comptables pour décider en connaissance de cause.
Les avancées permises par l'élaboration de comptes nationaux « augmentés » et la valorisation du capital naturel nous paraissent particulièrement prometteuses.
À côté de ce PIB ajusté, l'emploi d'un nombre limité d'indicateurs de résilience écologique et sociale nous paraîtrait bienvenu.
Au niveau microéconomique, la diffusion de la comptabilité socio-environnementale fait partie des évolutions intéressantes. Le déploiement de la méthode Care impliquera toutefois de surmonter plusieurs difficultés que nous avons détaillées dans le rapport.
Troisième orientation : adapter les instances de gouvernance pour mieux prendre en compte le temps long et les enjeux environnementaux.
L'adaptation de notre modèle économique vers plus de résilience nécessite le partage d'une culture du risque et d'outils adaptés au niveau international.
L'École d'actuariat britannique recommande en particulier de faire évoluer les institutions internationales pour qu'elles réalisent des évaluations annuelles de la solvabilité planétaire. Il s'agit de partager des données fiables sur nos « biens communs » pour orienter les choix publics aux échelles de décision.
L'adaptation de la gouvernance s'applique aussi au niveau européen, suivant les recommandations du rapport de Mario Draghi.
Enfin, elle doit se concrétiser sur nos territoires, avec le développement de l'économie circulaire, et dans les entreprises, en abordant sérieusement la question du partage de la valeur ajoutée entre capital et travail.
Je termine en insistant sur la question de la gouvernance qui nous paraît absolument centrale pour réussir la transition vers les valeurs de la post-croissance.
Au-delà de l'économie, ce sont aussi nos références institutionnelles et culturelles, nos valeurs démocratiques, qui devront être interrogées. Les prochains rapports de notre délégation devraient nous aider à approfondir ces sujets.
Mme Christine Lavarde, présidente. - Vous annoncez ainsi la suite de nos travaux.
Vous êtes tous trois du même bord politique et j'ai le sentiment que les sujets que vous avez abordés dans votre rapport et les éléments de réflexion que vous versez au débat sont peu présents dans la réflexion menée par nos partis respectifs, tandis qu'ils le sont bien davantage dans celle des partis situés de l'autre côté du spectre politique. Cela montre bien que ces sujets, qui questionnent notre futur, ne sont ni de droite ni de gauche.
Demain se tient au Sénat la journée de la sécurité au travail. J'ai été étonnée de constater que le premier point qui est mis en avant est celui de la sécurité informatique, le dernier étant la prévention des incendies. Dans mon esprit, la sécurité au travail, cela concerne avant tout les règles à respecter pour garantir sa sécurité physique - prévention des incendies, port d'un casque sur un chantier, règles d'hygiène en milieu médicalisé, etc. Cela montre bien que la manière dont on envisage le cadre de travail évolue.
Madame Paoli-Gagin, vous avez rappelé très justement que le PIB est un indicateur qui a été créé dans les années 1930. En France, la députée Eva Sas est à l'origine d'une loi, promulguée en 2015, visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. À l'occasion de son examen, il avait été rappelé que la France ne pouvait pas décider seule de changer les règles, au risque de se retrouver isolée au sein de la communauté internationale. Savez-vous si des instances internationales telles que l'ONU envisagent, à l'instar de l'Insee, de prendre en compte de nouveaux critères dans la définition du PIB ? Si oui, quelles sont les perspectives ?
M. Vincent Delahaye. - En effet, Madame la Présidente, le sujet que vous abordez nécessite d'être approfondi, et je suppose que la France n'est pas le seul pays à réfléchir à une telle évolution.
Je n'ai pas bien compris, d'ailleurs, ce qui différencie la méthode de calcul qu'utilise l'Insee pour définir le produit intérieur net de celle que retient le modèle Care. Est-il prévu de poursuivre le travail sur la prise en compte des éléments non financiers pour le calcul du PIB ? Je n'ai plus en tête le texte de loi dont Eva Sas est à l'origine, mais sans doute conviendrait-il de définir un indice qui prendrait en compte d'autres éléments que ceux qui sont retenus pour calculer le PIB.
Éric Dumoulin a indiqué que l'Europe se réchauffait deux fois plus vite que le reste du monde : sait-on pourquoi ?
M. François Bonneau. - Sans faire l'éloge des dictatures, qu'en est-il du temps politique ? Dans nos démocraties où se tient une élection tous les deux, trois ou quatre ans - voire tous les mois -, le temps politique est-il adapté pour négocier tous ces bouleversements majeurs ?
La vie urbaine est-elle remise en cause par ces constats ?
Mme Amel Gacquerre. - Qui dit valeur économique dit également valeur du travail. Avez-vous abordé les notions d'utilité sociale et de revenu universel ? Avez-vous par ailleurs sondé les jeunes générations sur la façon dont elles appréhendent les valeurs économiques à l'horizon 2050 ?
Mme Christine Lavarde, présidente. - Nous envisageons justement d'organiser des rencontres avec des élèves de terminale pour discuter de ces sujets, car c'est finalement pour eux que nous travaillons.
M. Éric Dumoulin, rapporteur. - Deux phénomènes principaux expliquent que l'Europe se réchauffe plus vite : la proximité avec l'Arctique, dont la fonte limite l'effet dit d'albédo, d'une part, et les remontées du Sud, qui sont bien plus fortes qu'auparavant, d'autre part.
Les économistes que nous avons rencontrés, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont tous très fortement insisté sur le réchauffement climatique et plus encore sur l'effondrement de la biodiversité. Ils s'inquiètent également de l'assurabilité de l'activité économique, non pas à l'horizon 2050, mais dans les prochaines années.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Nous ne nous sommes pas saisis des sujets relatifs au travail et aux aspects sociaux, car ils feront l'objet de réflexions menées par d'autres équipes de rapporteurs dans la suite des travaux de notre délégation.
En ce qui concerne l'établissement d'un référentiel international, les 17 objectifs de développement durable (ODD) établis par de l'ONU constituent un premier pas. En mai dernier, un groupe de travail international nommé Beyond GDP s'est donné l'objectif de travailler à l'élaboration d'indicateurs permettant d'aller au-delà du PIB.
Pour ce qui est enfin de la distinction entre le Pina et le modèle Care, le premier est du ressort de l'Insee et relève de la comptabilité nationale, tandis que le second est une méthode de comptabilité qui s'applique à des entités productrices, au premier rang desquelles les entreprises.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - Une étude britannique estime que le PIB mondial pourrait perdre 50 % de sa valeur entre 2070 et 2090. Il me paraît essentiel de l'avoir en tête lorsqu'on aborde les questions de décroissance ou de post-croissance, car quoi qu'il en soit de cette étude, il est clair que si nous nous en tenons au système que nous connaissons aujourd'hui, nous risquons de dégrader encore davantage notre croissance, notre richesse et nos ressources.
Les orientations que nous vous avons présentées ne constituent qu'une maigre contribution - je partage à ce titre la frustration de Vincent Delahaye. Le travail doit bien évidemment se poursuivre.
Ce qui ressort de cette analyse, c'est que le temps politique n'est en effet plus adapté, et que le politique est en train de perdre la main sur ce sujet. Il nous paraît à ce titre essentiel - nous y avons insisté - d'adapter nos instances de gouvernance.
J'estime enfin tout à fait opportun d'interroger les jeunes générations. En 2008, dans le rapport de la commission pour la libération de la croissance française, Jacques Attali proposait de transformer le Conseil économique, social et environnemental (Cese) en une instance délibérant en fonction du seul intérêt des générations futures. Je trouve cette idée intéressante.
M. Bernard Fialaire. - Il est rassurant de redonner au politique le primat détenu par l'économie. Il faut reconnaître que pour intéressante qu'elle soit, cette science se trompe souvent dès lors qu'elle s'efforce non pas d'analyser ce qu'il s'est passé, mais de prédire l'avenir ! Je me félicite donc que ce rapport porte sur les valeurs que nous devons défendre collectivement dans le champ économique.
M. Pierre Barros. - Il est en effet intéressant d'examiner nos instruments de mesure sous un prisme différent, même si je ne sais pas si cela peut nous conduire à prendre des décisions différentes.
En tout état de cause, ce pas de côté nous amène à relativiser, pour ne pas dire à transcender les oppositions politiques habituelles, qui, à cette aune, paraissent un peu convenues - du moins, je l'espère !
J'apprécie le concept de One Health. J'ai pour ma part travaillé avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury sur la question des espaces et de l'architecture et de leur incidence sur la santé.
En cette période difficile, une telle réflexion constitue une bouffée d'air dont je remercie nos rapporteurs.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Ce travail trouve son origine dans un étonnement : comment peut-on continuer à réfléchir avec un référentiel qui date des lendemains de la Seconde Guerre mondiale ? La valeur ajoutée, c'est ce qui apporte de la valeur. Or aujourd'hui, des éléments que l'on considère à haute valeur ajoutée sont en réalité à haute destruction ajoutée.
Nous nous sommes efforcés de bousculer cette évidence et de remettre le politique au centre, ce qu'à titre personnel, j'estime être un impératif existentiel.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - Remettre le politique au centre est en effet un objectif ambitieux et un enjeu majeur. La question de la gouvernance est à ce titre essentielle.
Alors qu'il n'était au départ qu'un indicateur, le PIB est devenu un objectif. Or nous avons besoin de boussoles qui ne soient pas des objectifs, et nous avons besoin de nous fixer de nouveaux objectifs. Tel est, selon nous, le principal enjeu.
M. Éric Dumoulin, rapporteur. - J'ajouterai qu'en termes de biodiversité, d'environnement naturel, de vivant, mais également en termes économiques, les économistes de tous bords s'accordent à dire que le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé que le coût de l'action.
Il nous faut donc rapidement engager une réflexion sur ce que doit être la croissance, sur les nouveaux relais de croissance et sur le changement de modèle.
M. Jean-Raymond Hugonet. - Je fais partie de cette délégation depuis 2017, et avec tout le respect que je porte à nos travaux passés, il me paraît que nous touchons là au coeur de ce qu'est la prospective. C'est du reste pourquoi nous parvenons à raisonner par-delà nos sensibilités politiques respectives. Mais ceux qui dirigent le monde n'ont-ils pas intérêt à préserver la logique de croissance actuelle et le sacro-saint PIB ? En dépit de la justesse des idées qui nous sont soumises, je crains que l'on oppose de fortes résistances à un tel changement de paradigme.
Mme Christine Lavarde, présidente. - Ce travail en appelle d'autres : sur les questions sociales que nous évoquions, mais aussi sur le futur modèle démocratique à l'aune de l'intelligence artificielle - Amel Gacquerre et Rémi Cardon se pencheront prochainement sur ce sujet.
Si nous changeons d'étalon de mesure, les riches s'en trouveront sans doute moins riches. Les échelles de grandeur en seront à tout le moins modifiées.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Un tel changement de référentiel devrait sans doute faire l'objet d'un retour au peuple. On pourrait même imaginer de lui demander de trancher dans le cadre d'un référendum pour savoir si, oui ou non, il considère qu'un tel changement relève de l'intérêt supérieur de la Nation.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur. - D'autres pays, en particulier la Chine, ont déjà engagé cette mutation et intègrent les normes comptables de l'ISSB. J'estime que nous ne pouvons pas être absents des rares instances de gouvernance internationale qui peuvent prendre en charge cette question.
La délégation adopte, à l'unanimité, le rapport et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
AUDITIONS PUBLIQUES DE LA DÉLÉGATION À LA PROSPECTIVE
· Jérôme Batout, philosophe et économiste (8 avril 2025)
· Emmanuel Constantin, essayiste (8 avril 2025)
· Antonin Bergeaud, économiste, lauréat du Prix du meilleur jeune économiste 2025 (27 mai 2025)
· Lauriane Mouysset, chercheuse en économie écologique (27 mai 2025)
· Philippe Dessertine, économiste, auteur du livre L'Horizon des possibles : construire le siècle qui vient (24 juin 2025)
AUDITIONS DES RAPPORTEURS
· Antoine Bouët, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII)
· Éloi Laurent, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et professeur à Sciences Po, auteur de Notre bonne fortune. Repenser la prospérité
· Vincent Aussilloux, ancien directeur du département économie de France Stratégie (2014 à 2023), économiste à la Commission européenne
· Éric Vidalenc, directeur régional adjoint de l'Ademe Hauts-de-France et président du conseil scientifique de REV3 (« Transformons les Hauts-de-France »), spécialiste des questions énergétiques
· Nadine Richez-Battesti, économiste et maîtresse de conférences à l'université Aix-Marseille, animatrice du comité de pilotage « Changer le modèle économique » du Labo de l'ESS
· Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne
· Emmanuel Faber, président du Conseil international des normes de durabilité (International Sustainability Standards Board) et ancien président-directeur général de Danone
· Alexandre Rambaud, codirecteur de la chaire « Comptabilité écologique » (AgroParisTech, Université Paris-Dauphine, Université de Reims, Institut Louis Bachelier) et du département « Économie & Société » du Collège des Bernardins
· Pascal Demurger, co-président du mouvement Impact France, directeur général du groupe MAIF
· Caroline Neyron, directrice générale d'Impact France
· Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, vice-président de la Société d'économie politique
· Jean-Michel Thouvignon, président de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération (IEEFC)
· Christian du Tertre, fondateur de l'IEEFC, président du conseil d'évaluation et d'orientation de la recherche opérationnelle
· Fanny Henriet, directrice de recherche au CNRS et enseignante à l'École polytechnique, auteur de L'économie peut-elle sauver le climat ?
· France Assureurs
Paul Esmein, directeur général
Aurélien Fortin, directeur des études économiques et statistiques
Émilie Netter, directrice Communication et affaires publiques
DÉPLACEMENT À COMPANS (SEINE-ET-MARNE) LE 12 JUIN 2025
· Visite de l'entreprise Vesto et échanges avec :
Bastien Rambaud, co-fondateur
Clémence Le Jeune, directeur général adjoint
* 1 Jérôme Batout, La Généalogie de la valeur, Les Belles lettres/essais, 2021.
* 2 Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d'abondance, Gallimard, 1976.
* 3 Daniel Cohen, La Prospérité du vice. Une introduction (inquiète) à l'économie, 2009.
* 4 La commission présidée par le futur détenteur du Prix Nobel d'économie Simon Kuznets (1901-1985) évaluait ainsi la chute de la croissance de la production de valeur ajoutée aux États-Unis à 40 % entre 1929 et 1932.
* 5 André Vanoli, Histoire de la comptabilité nationale, La Découverte, 2002.
* 6 Op. cit.
* 7 Op. cit.
* 8 John Maynard Keynes, La Vertu et le Bonheur, suivi de Possibilités économiques pour nos petits-enfants, Les Belles Lettres, 2021. Cité par Jérôme Batout (op. cit.).
* 9 https://www.economie.gouv.fr/facileco/culture-economique/les-grands-principes-economiques/la-croissance.
* 10 Audition par la délégation à la prospective le 8 avril 2025. Voir aussi leur article « Croissance, crise et dépérissement de la politique », Le Débat, n° 182, 2014.
* 11 Éloi Laurent, Notre bonne fortune : Repenser la prospérité, PUF, 2017.
* 12 En 1998 en particulier, le Rapport mondial sur le développement humain des Nations Unies distingue développement et croissance, en rappelant que cette dernière n'est pas une fin en soi. Dans son rapport de 2001 intitulé Du bien-être des nations : Le rôle du capital humain et social, l'OCDE adopte la même approche et relativise la notion de croissance qu'elle met en regard d'autres préoccupations comme la qualité de vie et l'insertion sociale.
* 13 La lettre du CEPII, « Horizon 2050 : où la dynamique actuelle mène-t-elle l'économie mondiale ? », n° 421, octobre-novembre 2021.
* 14 ONU, Perspectives de la population dans le monde, 2024.
* 15 L'ONU indique que l'espérance de vie à la naissance passerait de 64,2 ans en 1990 à 77,4 ans en 2054. Mais les habitants des pays les plus pauvres vivent encore 7 ans de moins que la moyenne mondiale actuelle (73,3 ans en 2024).
* 16 Audition par la délégation à la prospective le 24 juin 2025.
* 17 Friederike Otto, co-auteure du sixième rapport d'évaluation AR 6 du GIEC, 2023.
* 18 Scénario SSP2-4.5.
* 19 Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence, Earth Syst. Sci. Data, 17, 2641-2680, 2025 : https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/.
* 20 Pour un réchauffement limité à + 2 °C, le budget carbone à ne pas dépasser est estimé à 1 050 millards de tonnes de CO2, ce qui correspond à environ 25 années d'émissions à rythme d'émission inchangé.
* 21 Institute and Faculty of Actuaries, « Planetary Solvency - finding our balance with nature, Global risk management for human prosperity », janvier 2025 : https://actuaries.org.uk/media/wqeftma1/planetary-solvency-finding-our-balance-with-nature.pdf
* 22 Source : Sandy Trust et Zahrah Fauzee, « A contribution to the “Compendium of practice from a Global Community of Ministries of Finance and Leading Organizations: Economic analysis and modeling tools to assist Ministries of Finance in driving green and resilient transitions” », juin 2025.
* 23 Les données chiffrées ici présentées sont reprises de la leçon inaugurale de la chercheuse Virginie Courtier-Orgogozo, « Penser le vivant autrement », prononcée au Collège de France le jeudi 9 février 2023.
* 24 En s'appuyant sur le consentement à payer des personnes interrogées, l'économiste Robert Costanza a tenté d'évaluer en 1997 les services gratuits rendus par les écosystèmes, autrement dit leur contribution au bien-être. Ces services représenteraient près du double de la valeur du PIB mondial. Robert Costanza et al., « The value of the world's ecosystem services and natural capital », Nature 387, 1997 : https://doi.org/10.1038/387253a0.
* 25 CDC Biodiversité, « Comptabilité écologique : intégrer pour transformer », dossier de la MEB (mission économie de la biodiversité) n° 43, mars 2023.
* 26 Réseau action France en partenariat avec l'Ademe, « La France face au changement climatique : toutes les régions impactées », 2024 : https://reseauactionclimat.org/la-france-face-au-changement-climatique-toutes-les-regions-impactees/.
* 27 Patrick Artus, Marie-Paule Virard, Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde ?, Odile Jacob, 2024.
* 28 Jerry Z. Muller, La tyrannie des métriques, Markus Haller, 2018. Cité dans : CDC Biodiversité, « Comptabilité écologique : intégrer pour transformer », dossier de la mission économie de la biodiversité n° 43, mars 2023.
* 29 Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Insee, 2009.
* 30 France Stratégie, Vincent Aussilloux, Julia Charrié, Matthieu Jeanneney, David Marguerit et Adélaïde Ploux-Chillès, « Au-delà du PIB, un tableau de bord pour la France », note d'analyse n° 32, juin 2015.
* 31 Denis. H. Meadows, The Limits to Growth (1972) ; Nicholas Georgescu-Roegen, Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie (1979).
* 32 Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, « Notre futur commun », 1987.
* 33 De façon beaucoup plus ponctuelle, certaines régions françaises (Hauts-de-France, Bretagne, Normandie) ont utilisé un « indice de santé sociale » (ISS) pour réaliser des comparaisons territoriales et mieux cibler l'action publique. Il s'agit d'un indicateur composite inspiré des travaux des économistes Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice et qui reprend plusieurs grandes dimensions reflétant les enjeux sociaux contemporains et la santé sociale d'un territoire (éducation, logement, santé, revenus, travail, lien social et sécurité). L'objectif est de compléter le PIB pour prendre en compte les enjeux du développement régional.
* 34 Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 qui dispose que : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant l'évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l'horizon 2030 [...], ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. »
* 35 Voir notamment l'audition d'Antonin Bergeaud et de Lauriane Mouysset par la délégation à la prospective du Sénat le 27 mai 2025.
* 36 Richard Easterlin, « Does Economic Growth Improve the Human Lot ? », 1974.
* 37 Jean-Marc Germain, « Beyond GDP : A Welfare-Based Estimate of Growth for 14 European Countries and the USA Over Past Decades », Économie et Statistique n° 539, juillet 2023 ; « Regarder la croissance sous l'angle du PIB ressenti rebat les hiérarchies économiques internationales », Le Blog de l'Insee, 29 septembre 2023 ; « Du PIB au PIB ressenti : en retrait sur le PIB, l'Europe dépasse désormais les États-Unis en bien-être monétaire », Insee Analyses n° 57, octobre 2020.
* 38 Ibid.
* 39 Thomas Porcher et al., « The champagne curve of climate and development inequalities », Applied Economics Letters, 2025 : https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2476752.
* 40 « Rethinking Economics » est un mouvement international, fondé au début des années 2010, principalement par des étudiants en économie, qui vise à réformer l'enseignement et la pratique de l'économie. Il plaide pour une diversification des approches économiques, un décloisonnement avec les sciences sociales et une meilleure prise en compte des réalités et des débats contemporains.
* 41 Adapté du rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (EEA), « Growth without economic growth », Narratives for change, 2021.
* 42 Timothée Parrique, Ralentir ou périr : L'économie de la décroissance, Seuil, 2022.
* 43 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le développement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, avril 2022.
* 44 Kevin Rennert et al., « Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO2 », Nature n° 610, 2022. Une forte incertitude affecte toutefois cette quantification, qui peut varier de 40 € par tonne à 376 € par tonne selon les hypothèses de modélisation.
* 45 Ibid.
* 46 Alain Quinet, La valeur de l'action pour le climat, rapport de la commission présidée par Alain Quinet, France Stratégie, février 2019. L'actualisation récente du rapport Quinet conclut à une estimation à 256 euros par tonne en 2025 pour un objectif de zéro émission nette en 2050 (SNBC 3) : La nouvelle trajectoire de la valeur de l'action pour le climat, note de synthèse, France Stratégie, mars 2025.
* 47 Sylvain Larrieu, Sébastien Roux, « Peut-on prendre en compte le climat dans les comptes nationaux ? L'épargne nette ajustée des effets liés au climat est négative en France. », Insee Analyses n° 98, novembre 2024.
* 48 L'actualisation récente du rapport Quinet conclut à une estimation à 256 euros par tonne en 2025 pour un objectif de zéro émission nette en 2050 (SNBC 3). Quinet A., « La nouvelle trajectoire de la valeur de l'action pour le climat », note de synthèse, France Stratégie, mars 2025.
* 49 144 milliards d'euros de dommages en France résultant des émissions mondiales et 57 milliards d'euros de consommation du budget carbone.
* 50 Compte tenu de ces incertitudes, l'Insee précise que les évaluations doivent être utilisées comme des ordres de grandeur indicatifs.
* 51 « Transferts monétaires et services publics augmentent de 16 % le niveau de vie au milieu de l'échelle », Insee Première n° 2022, « Les ménages les plus aisés épargnent un quart de leur revenu, les plus modestes n'épargnent pas », Insee Focus n° 338, novembre 2024.
* 52 Dominique Bureau, Philippe Delacote, Fanny Henriet, Alexandra Niedzwiedz, « Compléter les comptes nationaux pour que l'arbre ne cache plus la forêt », Les notes du conseil d'analyse économique, n° 86, septembre 2025.
* 53 De la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) de 2001 et la déclaration de performance extra-financière (DPEF) entrée en vigueur en 2017 au rapport de durabilité extra-financière prévue par la directive CSRD (« Corporate Sustainability Reporting Directive ») du 14 décembre 2024.
* 54 Howard Bowen, « Social Responsibilities of the Businessman », 1953 ; George Goydern, « The Responsible Company », 1961.
* 55 International Financial Reporting Standards (IFRS).
* 56 Scope 1 : émissions directes provenant des activités de l'entreprise. Scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur achetée. Scope 3 : autres émissions indirectes, résultant des activités de l'entreprise, mais provenant de sources qui ne lui appartiennent pas ou ne sont pas contrôlées par elle.
* 57 Certaines cherchent à éviter toute atteinte à l'environnement, considéré comme une entité indépendante de l'activité économique. D'autres considèrent l'environnement comme une ressource et conservent leur objectif de rentabilité économique. Du choix entre ces approches dépend l'acceptabilité de la compensation écologique et de la substituabilité des capitaux.
* 58 Comprehensive Accounting in Respect of Ecology.
* 59 Fondation Agro ParisTech et Université Paris Dauphine. Le modèle bénéficie par ailleurs d'un soutien institutionnel.
* 60 Valeur d'usage directe (bénéfices tirés des services d'approvisionnement) et indirecte (services dérivés tels la régulation), valeur d'existence (droit d'exister de la nature), valeur d'héritage (du legs aux générations futures), valeur d'option (prix à payer en vue d'un usage futur probable), valeur de quasi-option (valeur attendue de l'information découlant du fait de retarder l'exploitation et la conversion de l'écosystème).
* 61 Catherine Aubertin, « Valorisation de la nature et outils comptables : des leviers au service de la biodiversité », Publications Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, juillet 2022 : https://hal.science/hal-04273929/document.
* 62 Éloi Laurent, Jacques Le Cacheux, Économie de l'environnement et économie écologique, Armand Colin, 2012.
* 63 « oikos » pour la maison, le foyer, et « nomos » pour la règle, l'administration, la gestion.
* 64 Catherine Aubertin, « Valorisation de la nature et outils comptables : des leviers au service de la biodiversité », Publications Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, juillet 2022 : https://hal.science/hal-04273929/document.
* 65 Rapport d'information n° 87 (2023-2024) de MM. Laurent Burgoa, Pascal Martin et Guy Benarroche, fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité, déposé le 9 novembre 2023. Dans ce rapport, CARE est identifié comme la méthode comptable socio-environnementale « la plus robuste ». En 2018, sa pertinence avait déjà été relevée par le rapport Notat-Sénard de 2018, L'entreprise, objet d'intérêt collectif.
Alexandre Rambaud souligne que CARE est mis en oeuvre dans plusieurs organisations publiques (Grand Port Maritime de La Rochelle, CNAM, Domaine de Chaalis, etc.) et fait l'objet d'une attention particulière de la part du Conseil de normalisation des comptes publics. Ce modèle voit également son intérêt reconnu par plusieurs institutions (OCDE, Ademe, AFD, CESE) et continue de faire l'objet de projets de recherche.
* 66 À titre d'exemple, la prise en compte du climat dans la méthode CARE oblige l'organisation concernée à déterminer un budget carbone. Or les méthodologies actuelles pour mettre en oeuvre un budget carbone restent peu développées. De plus, il n'existe pas de référentiels partagés sur les méthodologies disponibles et reconnues.
* 67 Institute and Faculty of Actuaries (IFoA), Planetary Solvency - finding our balance with nature, janvier 2025 : https://actuaries.org.uk/news-and-media-releases/news-articles/2025/jan/16-jan-25-planetary-solvency-finding-our-balance-with-nature/.
* 68 Mario Draghi, L'avenir de la compétitivité européenne, Une stratégie de compétitivité pour l'Europe, septembre 2024.
* 69 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.