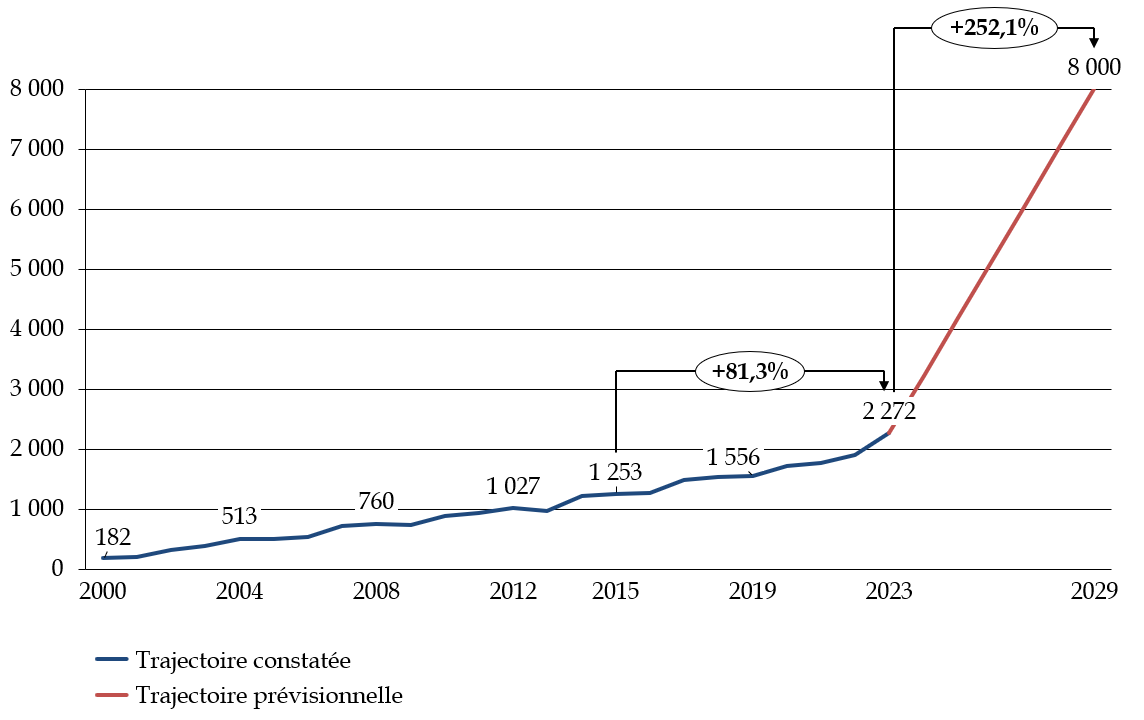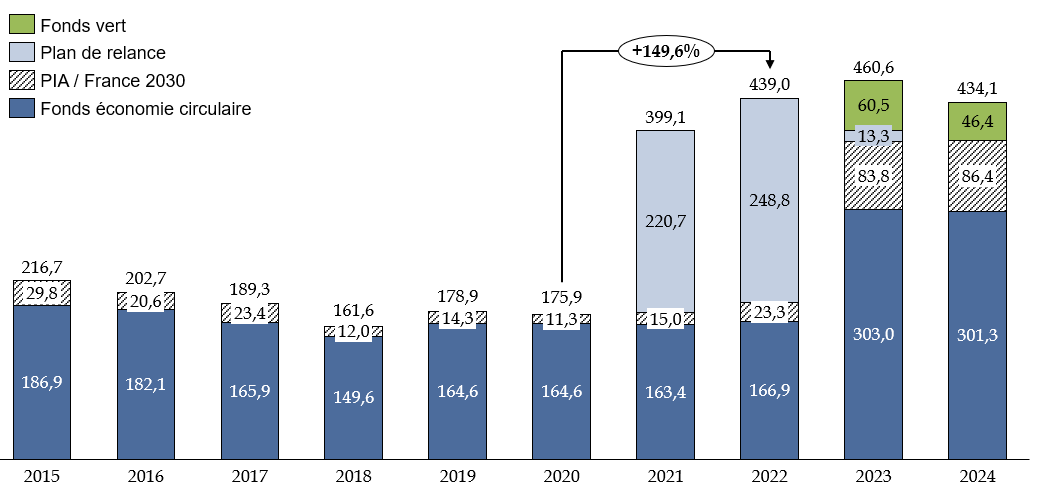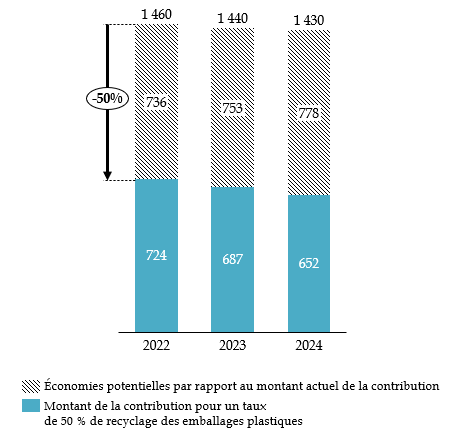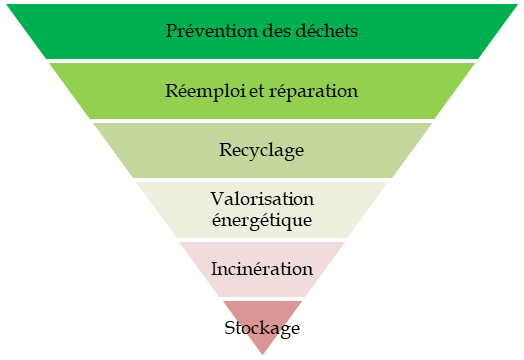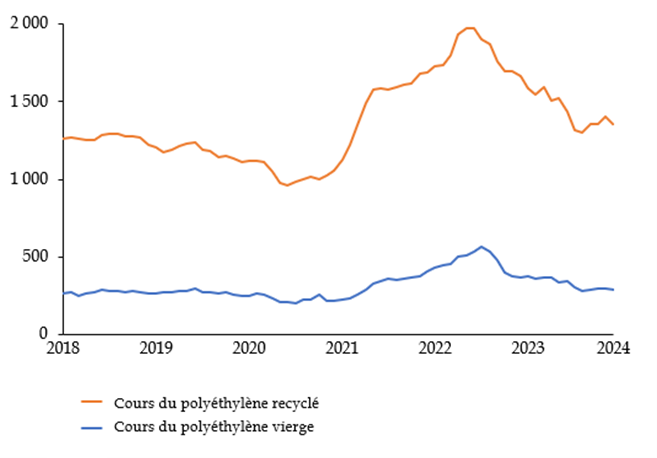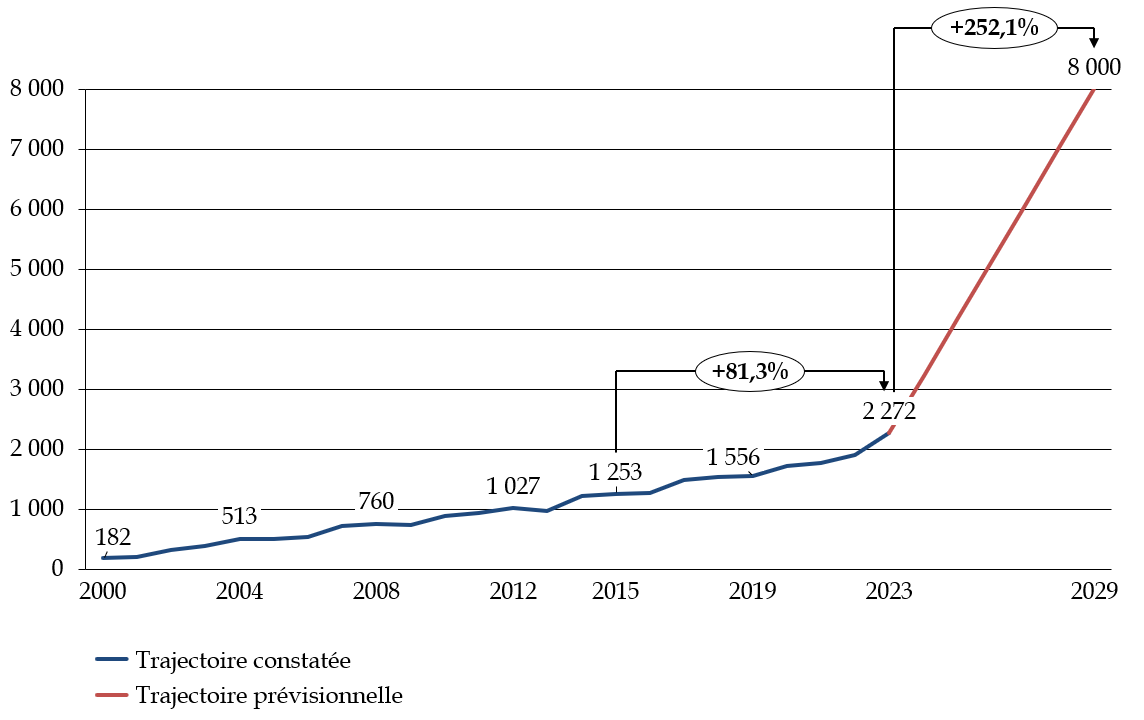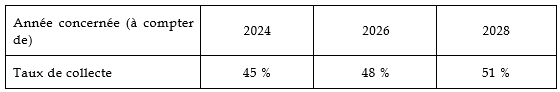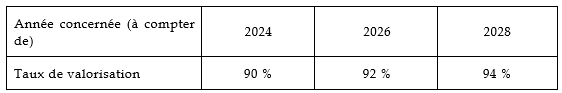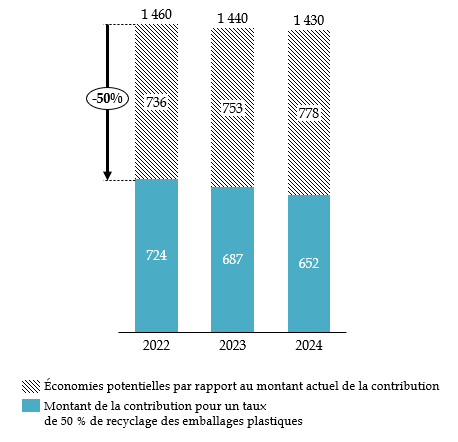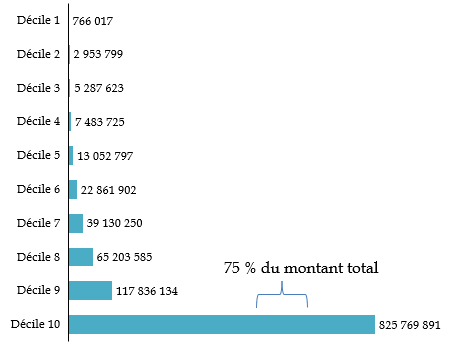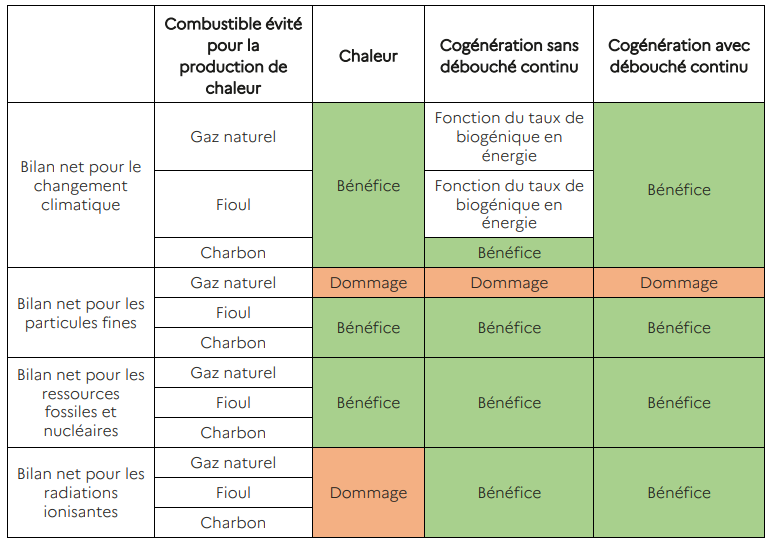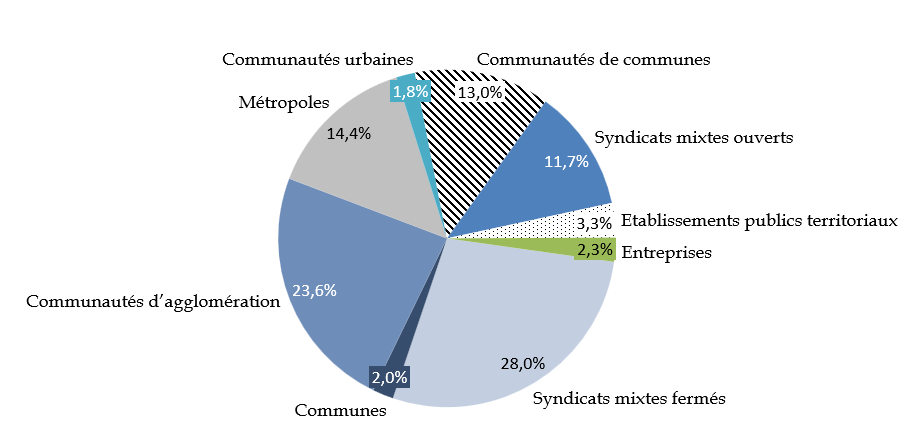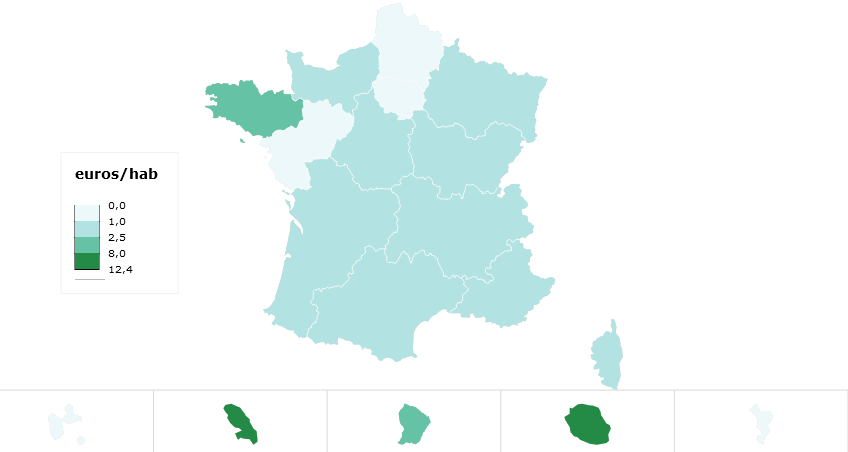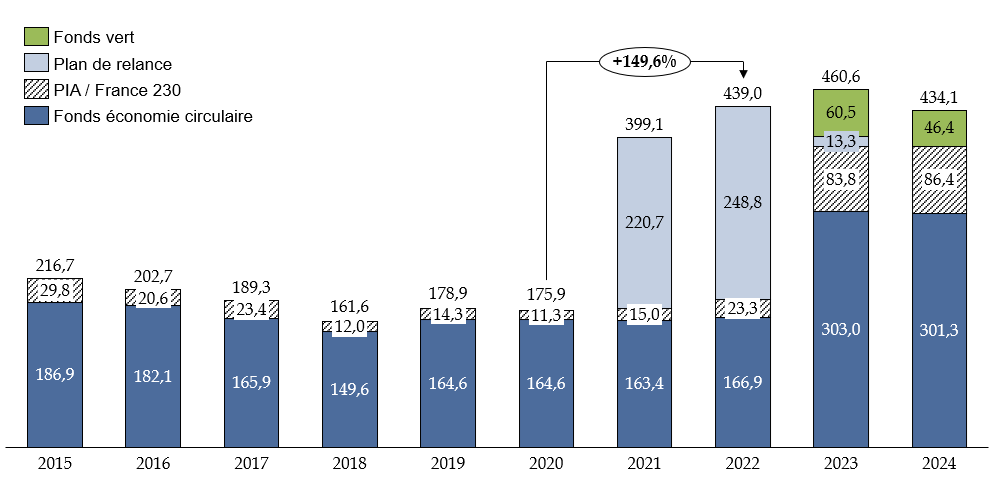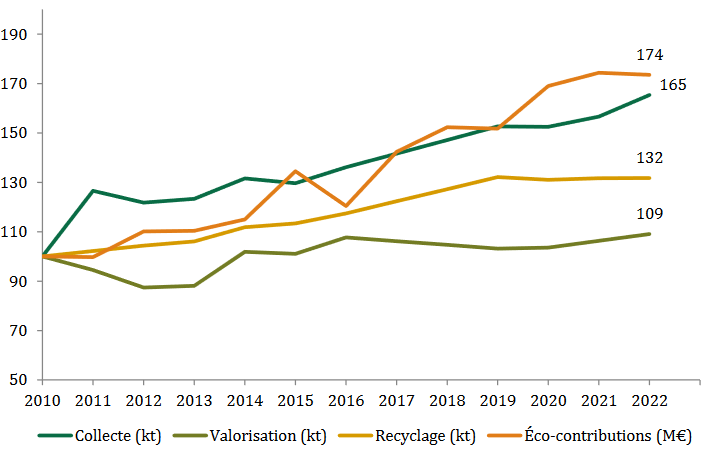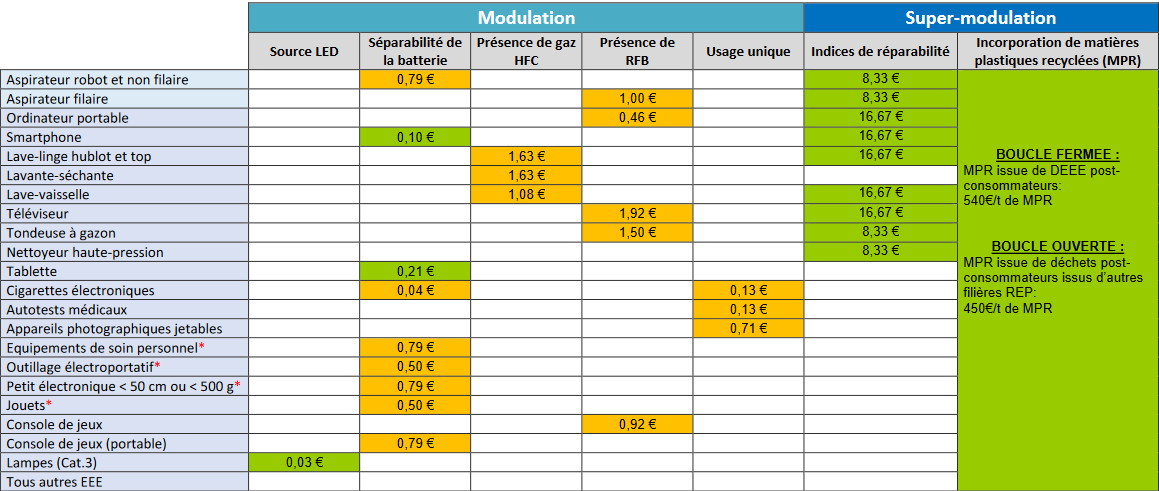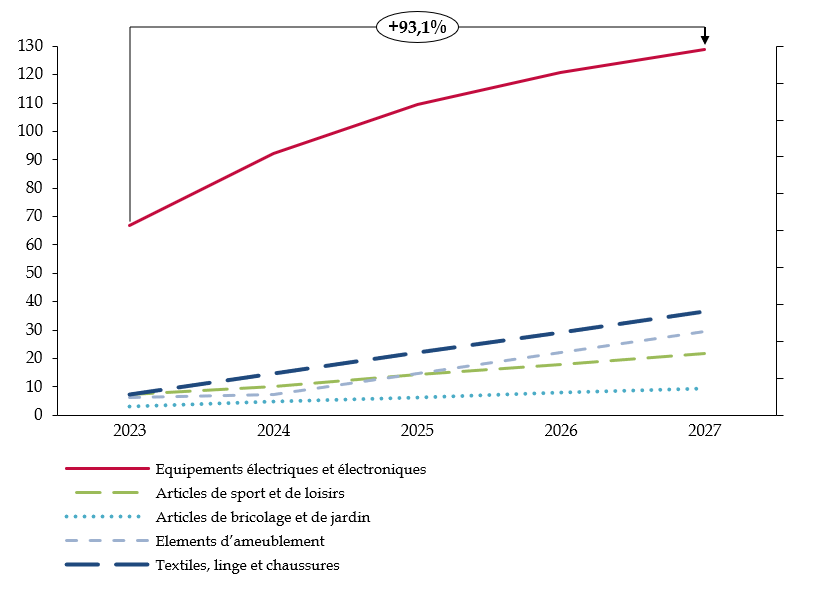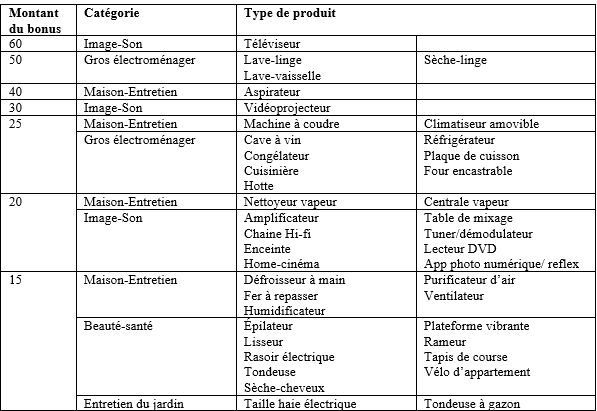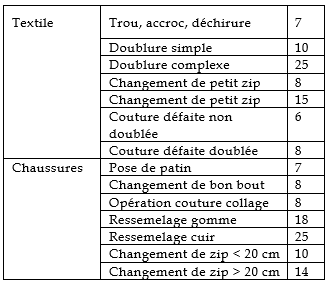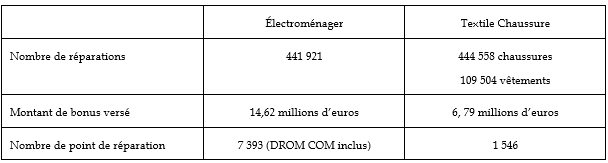- L'ESSENTIEL
- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL
- PREMIÈRE PARTIE
LA POLITIQUE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
UN SYSTÈME FRAGILE FACE À DES DÉFIS IMMENSES
- DEUXIÈME PARTIE
LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REP DOIT PERMETTRE DE RÉDUIRE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT
DANS LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
- I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS
ÉPARPILLÉS
- A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN
RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA
PANDÉMIE
- B. LE FONDS VERT : UNE POLITIQUE À
L'AVENIR INCERTAIN.
- C. LE PLAN DE RELANCE : DES DISPOSITIFS EN
PARTIE PÉRÉNISÉS
- D. FRANCE 2030 : UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS
SYMPTOMATIQUE DE L'ÉCLATEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES EN
FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
- A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN
RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA
PANDÉMIE
- II. IL EST NÉCESSAIRE QUE LA MONTÉE
EN PUISSANCE DES FILIÈRES REP S'ACCOMPAGNE D'UNE RÉDUCTION DE
L'IMPLICATION DE L'ÉTAT DANS LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
- I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS
ÉPARPILLÉS
- TROISIÈME PARTIE
PERMETTRE AUX FILIÈRES REP D'ASSUMER
LEURS RESPONSABILITÉS
- I. LES FILIÈRES REP N'ONT PAS ATTEINT LEURS
OBJECTIFS
- II. LES FILIÈRES REP ONT UN POTENTIEL DE
FINANCEMENT LARGEMENT INEXPLOITÉ
- I. LES FILIÈRES REP N'ONT PAS ATTEINT LEURS
OBJECTIFS
- QUATRIÈME PARTIE
UNE RATIONALISATION INDISPENSABLE
DU CONTRÔLE DES FILIÈRES REP
- A. LE CONTRÔLE DES FILIÈRES
REP : DES SANCTIONS RARES, INEFFICACES ET DES PROCÉDURES TROP
COMPLEXES
- B. LE SUIVI DES ÉCO-ORGANISMES : UNE
SUPERVISION ÉTENDUE, ET UNE MUTUALISATION DES MOYENS
- C. FINANCER LES BESOINS EN MATIÈRE DE
SUPERVISION DES FILIÈRES REP PAR UNE HAUSSE DE LA REDEVANCE DES
ÉCO-ORGANISMES.
- A. LE CONTRÔLE DES FILIÈRES
REP : DES SANCTIONS RARES, INEFFICACES ET DES PROCÉDURES TROP
COMPLEXES
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
(TEMIS)
- ANNEXES
N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le
soutien de l'État
à la prévention et la
valorisation des déchets
ainsi qu'à l'économie
circulaire,
Par Mme Christine LAVARDE,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
L'ESSENTIEL
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mercredi 8 octobre 2025 les conclusions de son contrôle sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire.
I. UN MODÈLE EN CRISE, CONFRONTÉ À DES DÉFIS IMMENSES
A. LE SYSTÈME DES FILIÈRES REP EST PRIS EN ÉTAU
Cinq ans après l'adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec)1(*), la politique de traitement et de prévention des déchets est à un tournant.
D'un côté, le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter dans les prochaines années : montant des éco-contributions collectées par les éco-organismes est passé de 1,9 milliard d'euros en 2022 à 2,3 milliards d'euros en 2024, et devrait atteindre 8 milliards d'euros en 2029.
Évolution constatée et
prévisionnelle du montant des éco-contributions
perçues
par les filières REP entre 2000 et 2028
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe
D'un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Les difficultés et les crises se sont en effet multipliées au cours des derniers mois :
- la fédération Envie, groupe spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, a assigné l'éco-organisme Ecosystem en justice à la suite de la perte d'un appel d'offres2(*) ;
- en raison des difficultés rencontrées par la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), le Gouvernement a décidé d'un moratoire sur la filière ;
- enfin, la filière de la collecte du textile est entrée en crise l'été dernier. L'entreprise Le Relais, qui met à disposition des bornes afin de favoriser le réemploi des vêtements, a ainsi accusé l'éco-organisme Refashion de ne pas lui reverser les éco-contributions.
Au-delà de ces exemples, la soutenabilité économique de l'ensemble des filières REP soulève des interrogations. La politique de l'économie circulaire se trouve donc prise en étau entre, d'un côté, une augmentation massive des moyens et des exigences réglementaires dans les années à venir, et de l'autre, un système qui semble déjà atteindre ses limites alors que la loi Agec est à peine mise en oeuvre.
B. UNE PROGRESSION DES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT, MALGRÉ LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES REP
Les subventions de l'État, principalement à travers le fonds économie circulaire, ne sont pas censées recouper les domaines couverts par les filières. La création de nouvelles filières, et la montée en puissance de celles déjà existantes avec la loi Agec auraient donc dû en toute logique s'accompagner d'une diminution des subventions publiques, mais c'est le contraire qui a été observé sur les dernières années : les crédits consacrés à cette politique ont plus que doublé, passant de 175,9 millions d'euros en 2020 à 434,1 millions d'euros en 2024. Cette implication de l'État doit être interrogée.
Évolution des crédits de l'État consacrés au soutien à l'économie circulaire
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction générale de la prévention des risques
En effet, la logique des filières REP repose sur une prise en charge par les producteurs eux-mêmes des externalités négatives provoquées par la production de déchets liés à la mise sur le marché de nouveaux produits. C'est l'application du principe du « pollueur-payeur » qui vise à responsabiliser les acteurs économiques.
Le rapporteur spécial propose ainsi de progressivement désengager l'État du soutien à l'économie circulaire, à l'exception des projets portés par les collectivités territoriales d'outre-mer, car les filières REP y sont peu développées. Un dispositif de prêt à taux zéro pourrait être envisagé pour faciliter le financement des projets dont la rentabilité est longue.
C. LES FAIBLES PERFORMANCES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES LA CONDUISENT À PAYER UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À L'UNION EUROPÉENNE
La « ressource propre plastique » est une taxe assise sur les déchets d'emballages plastiques qui n'ont pas été recyclés, qui a été établie pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union européenne. Cette taxe est souvent qualifiée d'« amende », dans la mesure où elle est évitable : il est possible de réduire sa contribution en améliorant le taux de recyclage du plastique. Or, la France est le premier contributeur européen de la ressource propre plastique en raison de sa faible performance dans le recyclage de ces matériaux.
Ainsi, en 2023, la France a, à elle seule, payé 20 % de l'ensemble du produit de la contribution. En comparaison, l'Allemagne a dépassé le taux de 50 % des emballages plastiques recyclés en 2022, tandis qu'en France, la même année, cette proportion n'était que de 25,2 %.
Économies potentielles dans un
scénario où la France aurait atteint une cible
de 50 %
des emballages plastiques recyclés
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
II. LES FILIÈRES REP DOIVENT ASSUMER LEURS RESPONSABILITÉS
A. DES OBJECTIFS NON ATTEINTS ALORS QUE LES ÉCO-ORGANISMES DISPOSENT D'UNE TRÉSORERIE ABONDANTE
Depuis la loi Agec, le bilan des filières REP est décevant. En 2023, 40 % du gisement de déchets soumis à une REP échappait encore à la collecte, ce qui représentait 6,6 millions de tonnes de déchets. Sur les huit filières qui disposent d'un objectif de collecte, seules trois l'ont accompli cette année, et une filière uniquement pour l'une de ses deux sous-catégories. En ce qui concerne les objectifs de recyclage, seules deux filières sur cinq les ont atteints.
Tableau des objectifs de recyclage des filières REP en 2023
|
Filières |
Objectif de recyclage |
Recyclage effectif |
Taux d'accomplissement |
|
Ameublement |
627,0 |
543,4 |
86,7 % |
|
Emballages ménagers |
4 110,0 |
4 122,0 |
100,3 % |
|
Lubrifiants |
179,3 |
181,9 |
101,5 % |
|
Papiers |
976,3 |
955,3 |
97,8 % |
|
Produits chimiques cat. 3 à 10 |
2,5 |
1,85 |
74 % |
Source : commission des finances, d'après le « Mémo REP 2023 » de l'Ademe
Dans le même temps, le montant total des provisions pour charges futures atteignait un milliard d'euros au terme de l'exercice 2022 pour les 18 éco-organismes pour lesquels la donnée était disponible, ce qui représentait en moyenne 8,2 mois de leurs charges de l'année 2021, et surtout la moitié des éco-contributions collectées. Les données analysées par le rapporteur spécial indiquent que cette trésorerie a augmenté sur les dernières années.
La moitié du montant des éco-contributions est thésaurisée.
Dans son rapport public annuel de 2016, la Cour des comptes estimaient que : « une telle situation ne peut perdurer, les éco-organismes n'ayant pas vocation à être des gestionnaires de fonds, alors que les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur. »3(*) Le rapporteur spécial souscrit entièrement à ce constat, qui reste valable neuf ans après : il n'est pas compréhensible qu'autant d'argent soit immobilisé alors que les objectifs des cahiers des charges ne sont pas atteints. Le risque est en effet que les éco-contributions progressent de plusieurs milliards d'euros, sans que les résultats des actions des éco-organismes soient clairement identifiables, ce qui conduirait inévitablement le secteur à une crise d'ampleur.
Il propose ainsi d'encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.
B. LES FILIÈRES REP DOIVENT PRENDRE LEUR PART DANS L'INVESTISSEMENT
À l'heure actuelle, les filières REP ne sont pas focalisées sur l'investissement, car leur modèle est basé sur le principe d'un soutien avant tout à la tonne de déchets collectés et valorisés. La loi Agec avait tenté d'amorcer une ouverture des filières vers l'investissement, en étendant le champ de leurs missions vers l'éco-conception notamment, mais sa mise en oeuvre s'est plutôt concentrée sur les dispositifs les plus symboliques et médiatiques, tels que le bonus réparation.
Faute de stratégie d'ensemble, aucun des nouveaux outils de la loi Agec (fonds réparation, fonds réemploi et réutilisation, éco-modulations) n'a atteint ses objectifs. Le rapporteur spécial préconise un changement de paradigme : permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, à investir directement dans des installations strictement destinées à l'atteinte des objectifs réglementaires. Une telle recommandation suppose toutefois un contrôle renforcé de la part des services de l'État, pour éviter les biais et mauvaises pratiques dans les investissements.
C. POUR UNE SUPERVISION RENFORCÉE DES FILIÈRES REP
À l'heure actuelle, cinq administrations sont en charge du suivi et de la supervision des filières. Cette organisation, particulièrement morcelée, est source d'inefficiences : par exemple, la direction générale de la prévention des risques n'a pas accès à SYDEREP, la base de données de l'Ademe, alors qu'elle détient le véritable pouvoir de sanction. Le rapporteur spécial préconise donc une mutualisation des moyens de l'ensemble de ces administrations.
Administrations en charge du suivi des filières REP
|
Administration |
Missions |
Nombre d'ETPT |
|
Direction de la supervision des filières REP de l'Ademe |
Suivi des filières, collecte et traitement des données, élaboration d'études préalables à l'agrément des éco-organismes |
35,9 |
|
Direction générale de la prévention des risques |
Suivi des filières, élaboration des textes, pouvoir de sanction |
12,2 |
|
Direction générale des entreprises |
Participe au pilotage des filières REP |
4,6 |
|
Contrôle général économique et financier |
Contrôle de la cohérence du montant des barèmes des éco-contributions |
3,4 |
|
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
Observation de l'état de la concurrence et lutte contre la fraude |
0,5 |
Source : commission des finances
La procédure de contrôle des éco-organismes et des non-contributeurs est lourde, et parfois inadaptée : par exemple, lorsqu'une filière comprend un seul éco-organisme, le retrait d'agrément n'est pas crédible car cela reviendrait à suspendre l'ensemble de la filière REP dans un secteur. Le rapporteur spécial recommande donc d'adapter et de simplifier ces procédures de contrôle, et de redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.
Les instances en charge de la supervision des REP ne réalisent pas non plus d'études économiques approfondies de la situation des filières, ce qui explique notamment que les différentes crises de cette année n'avaient pas été anticipées. Le rapporteur spécial propose donc d'étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et de rendre publique cette information.
Enfin, le rapporteur spécial appelle à ce que cette hausse des moyens de contrôle ne soit pas supportée par le budget de l'État, mais qu'elle soit prise en charge par les filières REP elles-mêmes, en augmentant la redevance payée par les éco-organismes. La redevance, qui a vocation à permettre aux producteurs d'assumer le coût de leur supervision, a été définitivement validée par le Conseil d'État par deux décisions du 6 mars 2024. Il est donc désormais possible d'étendre son champ à l'ensemble du contrôle des filières REP.
LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
Recommandation n° 1 : Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro dont la rentabilité est longue. Dans un premier temps, ce dispositif serait déployé à petite échelle pour en évaluer les coûts.
Recommandation n° 2 : Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.
Recommandation n° 3 : Permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, pour subventionner des installations permettant l'atteinte des objectifs réglementaires.
Recommandation n° 4 : Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes ; redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.
Recommandation n° 5 : Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP.
Recommandation n° 6 : Étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information.
Recommandation n° 7 : Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes.
PREMIÈRE PARTIE
LA POLITIQUE DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE :
UN SYSTÈME FRAGILE FACE À DES DÉFIS
IMMENSES
I. LE MODÈLE DES FILIÈRES REP N'A PAS ENCORE TENU SES PROMESSES
A. LA RENTABILITÉ DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST FAIBLE
L'économie circulaire consiste à produire des biens et services en limitant la consommation de matière première et la génération de déchets. L'un de ses principaux enjeux est de préserver les ressources naturelles comme l'eau, l'air, le sol et les matières premières. Elle inclut donc toutes les actions visant à renforcer la durabilité des biens, à favoriser le réemploi et à inciter l'utilisation de matériaux recyclés dans la production. Elle intègre également les initiatives ayant pour objectif de réduire la dangerosité et la pollution consécutives à la production de déchets4(*).
Toutes les alternatives au stockage et à l'enfouissement des déchets ne sont pas équivalentes. En ce sens, l'économie circulaire se fonde sur l'idée d'une hiérarchisation des modes de traitement des déchets, avec la prévention des déchets se trouvant au sommet, suivie par le réemploi, la réparation et le recyclage. Cette hiérarchisation est souvent représentée sous la forme d'une pyramide inversée, la partie la plus haute correspondant au mode de traitement le plus souhaitable.
Représentation de la hiérarchisation des modes de traitement des déchets
Source : commission des finances
Une autre grande caractéristique de l'économie circulaire est qu'elle doit être viable économiquement. L'enjeu n'est donc pas seulement de limiter les externalités négatives liées à la production de déchets, mais que les entreprises demeurent compétitives tout en produisant des biens durables qui incorporent des matériaux recyclés. Or, l'économie circulaire connaît plusieurs désavantages concurrentiels par rapport aux filières classiques.
Premièrement, l'usage de matériaux recyclés présente un surcoût par rapport à des matières premières « vierges », car plusieurs phases de production sont nécessaires pour récupérer les matières dans les déchets pouvant se substituer aux matières vierges. Par ailleurs, ses caractéristiques (pureté, résistance mécanique, contamination par d'autres matières ou polluants) peuvent être hétérogènes, ce qui complexifie d'autant plus les processus industriels. Cette difficulté est d'autant plus significative que la conception des produits intègre encore peu les enjeux liés à leur recyclage5(*).
Le problème est particulièrement significatif pour le plastique, dans la mesure où l'utilisation du pétrole est bien plus compétitive que celle de matériaux recyclés : le coût du plastique recyclé est en moyenne quatre à cinq fois plus élevé que celui du plastique vierge. L'Ademe avait ainsi indiqué dans ses réponses au rapporteur spécial que « la valorisation des déchets se heurte souvent aux réalités économiques. Un même produit ou emballage, réalisé avec de la matière recyclée, peut souvent coûter plus cher qu'avec de la matière vierge, par exemple pétrosourcée s'agissant du plastique. »6(*)
Comparaison de l'évolution du cours du
plastique (polyéthylène)
vierge et recyclé entre 2018
et 2024
(en euros par tonne)
Source : commission des finances, à partir des données de l'Agence européenne de l'environnement, « Competitiveness of secondary materials », 7 janvier 2025
Plus généralement, la difficulté à disposer de matière recyclée en quantité suffisante pour la massification des procédés nuit à la rentabilité des investissements industriels. La collecte, le tri et la transformation des déchets ne suffisent pas encore à alimenter des chaînes de production à grande échelle.
De la même façon, la valorisation énergétique des déchets se heurte à la concurrence des énergies fossiles, et en particulier du gaz. Le Conseil national de l'industrie faisait ainsi le constat que la filière des combustibles de récupération (CSR), « se heurte à un défaut de compétitivité relevant de plusieurs aspects. Premièrement, la préparation de CSR homogénéisés selon les critères de l'arrêté du 23 mai 2016, constitue un coût difficilement compensé en aval par des économies sur le tarif d'entrée dans l'installation de combustion, malgré l'exemption de TGAP déchet. Deuxièmement, une chaufferie adaptée aux CSR nécessite un certain nombre d'investissements pour le traitement des fumées, qui restent nettement plus coûteux que pour des chaufferies prévues pour des énergies fossiles ou pour la biomasse. »7(*)
Enfin, la réparation et le réemploi nécessitent de mettre en place des systèmes de collecte et de concevoir des contrôles sanitaires et de sécurité adaptés aux spécificités de ces biens. La massification de ces procédés, alors que chaque bien doit être réparé différemment, pose également un défi industriel et logistique. Ainsi, l'observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques relève « une tendance à la hausse du coût moyen de la réparation avec une augmentation allant de 10 % à 15 % pour les équipements les plus réparés »8(*) sur la période allant de décembre 2022 à décembre 2023, et que la réparation n'est pas suffisamment attractive par rapport au prix neuf pour un certain nombre de petits équipements. De même, une étude de l'Ademe indique que le prix de pièces détachées peut, dans certains cas, dépasser celui des équipements neufs9(*).
À terme, ces difficultés ne sont pas forcément irrémédiables. Le réemploi et la réparation peuvent générer des économies par rapport à la production à partir de matières premières vierges. La raréfaction des énergies fossiles, et donc l'augmentation de leurs coûts, pourra renforcer la compétitivité des matières recyclées. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) avait ainsi indiqué en audition au rapporteur spécial que l'année 2022, en pleine crise énergétique, avait été une « meilleure année » pour l'économie circulaire que celles qui ont suivi.
L'usage des déchets pour la valorisation énergétique et l'incorporation de matière recyclée dans la production de biens en tant qu'alternative à l'usage d'énergies fossiles, outre l'intérêt environnemental, permet de renforcer l'intégration des chaînes de production industrielle sur le territoire français. Il constitue en cela un enjeu de souveraineté industrielle et d'équilibre de notre balance commerciale.
En tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies, ni à court ni à moyen terme, pour que l'économie circulaire puisse être aussi compétitive que l'économie « traditionnelle ». Pour rétablir une équité concurrentielle entre les modes de production les plus vertueux et les autres, il a été mis en place des dispositifs correcteurs de marché.
L'une des façons d'atténuer les déséquilibres de concurrence est d'aider les acteurs de l'économie circulaire, que ce soit par une fiscalité plus avantageuse ou des subventions directes. Le fonds économie circulaire, géré par l'Ademe, a ainsi vocation à amorcer des projets qui, sans aide publique, ne seraient pas viables économiquement. Cependant, l'État n'a pas vocation à prendre à sa charge l'ensemble du risque inhérent à l'investissement dans l'économie circulaire.
Ensuite, la puissance publique n'a pas davantage vocation à financer les conséquences des externalités négatives provoquées par la production de déchets, mais au contraire, ces coûts doivent être supportés par les producteurs eux-mêmes.
Il s'agit d'une application du principe du « pollueur-payeur », qui est l'un des principaux fondamentaux du droit de l'environnement français et européen, et qui est défini au premier article du code de l'environnement (article L. 110-1) de la manière suivante : « le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Le principe du pollueur-payeur
Le principe du « pollueur-payeur » signifie que les personnes à l'origine d'une pollution - une entreprise générant des déchets par exemple - doivent supporter les coûts engendrés par cette pollution. En théorie économique, ces coûts sont appelés des « externalités négatives », au sens où, dans un marché sans intervention, ce ne sont pas les producteurs qui les prennent en charge, mais d'autres personnes, comme l'État, les collectivités territoriales, d'autres entreprises voire des particuliers. Le principe du pollueur-payeur vise donc précisément à réinternaliser ces externalités négatives.
Le principe du pollueur-payeur a été introduit pour la première fois par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 1972. Depuis, il est devenu l'un des principes fondamentaux du droit de l'environnement européen, le deuxième alinéa de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonçant que « la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »
En France, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « Loi Barnier », a fait du principe du pollueur-payeur l'un des quatre grands principes du droit de l'environnement. Inscrit à l'origine à l'article L. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, il a été recodifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Toutefois, dès 1975, la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoyait à son article 2 : « toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».
Les « taxes pigouviennes », du nom de l'économiste Arthur Cecil Pigou, sont l'un des moyens de corriger les externalités négatives, en envoyant un signal-prix aux agents économiques qui tienne compte des coûts engendrés par la pollution. La taxe carbone par exemple, mais également les éco-modulations prévues pour les éco-contributions des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), sont des exemples de taxes pigouviennes.
Source : commission des finances
Le principe du pollueur-payeur a bien entendu un intérêt environnemental, puisqu'il incite les producteurs à réduire la pollution à la source, mais il a également un intérêt économique, puisqu'il permet de corriger les distorsions de concurrence entre les activités les plus polluantes (qui génèrent donc un coût pour la société) et celles qui préservent les ressources naturelles. Il est donc préférable, à double titre, que ce soient les producteurs eux-mêmes qui prennent en charge le coût de la fin de vie des biens qu'ils produisent : dans un objectif de préservation des finances publiques ainsi que pour responsabiliser des acteurs économiques.
B. LE MODÈLE DES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE EST AUJOURD'HUI EN CRISE
Les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ont été mises en place pour organiser l'application du principe du pollueur-payeur à l'échelle européenne.
Les filières REP correspondent à l'obligation pour les producteurs, importateurs ou distributeurs de certaines catégories de produits d'organiser ou de financer la prévention, la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets issus de leurs activités. L'idée sous-jacente est d'obliger les producteurs à prendre en charge le coût de gestions des déchets engendrés par leurs activités - c'est-à-dire à internaliser en amont les externalités négatives produites par leurs activités.
Le principe de la REP a été introduit en droit français par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992, en application d'une loi plus ancienne, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. L'article 4 de ce décret prévoit ainsi que « tout producteur ou importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenue de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballages, dans le respect des dispositions des articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes ».
L'article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) a précisé la définition de ce qu'est un « producteur » dans le cadre des filières REP : « Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »
Depuis la première filière REP en 1992, de nouvelles filières ont été mises en place régulièrement. La loi Agec en particulier a conduit à la création de dix nouvelles filières REP entre 2021 et 2025, portant le total des filières à vingt-deux, soit le double par rapport à la situation antérieure à la loi (onze filières). La dernière filière mise en oeuvre est celle des textiles sanitaires à usage unique (lingettes), depuis le 1er juillet 2025, et une filière supplémentaire, celle des emballages industriels et commerciaux (REP DEIC) doit être mis en place en place prochainement10(*).
Historique des filières REP
La première filière REP qui a été mise en place en France est celle des emballages ménagers, par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages. Plusieurs filières importantes ont ensuite été mises en place au cours des années 2000 (pneumatique en 2002, véhicules hors d'usage en 2003, équipements électriques et électroniques en 2005, textiles d'habillement en 2008).
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II » a ensuite consolidé juridiquement le dispositif, en inscrivant explicitement les éco-organismes dans le code de l'environnement, et en prévoyant les cas où de nouvelles filières pouvaient être créées par décret.
Plus récemment, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « loi AGEC », représente la réforme la plus importante des filières REP depuis leur création. Elle a notamment élargi le champ des REP au-delà du traitement de la fin de vie des produits, et a mis l'accent sur la prévention, le réemploi et la réparation, par la création du fonds de réemploi et de réparation, géré par les éco-organismes.
Source : commission des finances
Liste des filières REP à date du 30 septembre 2025
|
Filières REP antérieures à la loi Agec |
Nouvelles filières créées par la loi Agec |
|
1. Emballages ménagers et papiers imprimés 2. Équipements électriques, électroniques et électroménagers 3. Véhicules 4. Batteries 5. Médicaments non utilisés 6. Pneus 7. Textiles, linges de maison et chaussures 8. Produits chimiques ménagers 9. Meubles 10. Bateaux de plaisance et de sport 11. Dispositifs médicaux perforants en autotraitement |
1. Bâtiments, produits et matériaux de construction 2. Emballages professionnels 3. Jouets 4. Articles de sport et de loisir 5. Articles de bricolage et de jardin 6. Huiles minérales 7. Tabac / Mégots 8. Gommes à mâcher synthétiques 9. Textiles sanitaires à usage unique 10. Engins de pêche contenant du plastique 11. Aides techniques médicales |
Note : Les filières « emballages ménagers » et « papiers imprimés » ont fusionné par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.
Source : commission des finances
Pour répondre à ces obligations, les entreprises ont la possibilité soit d'instaurer un système individuel de collecte et de traitement agréé, soit de mettre en place collectivement des éco-organismes agréés avec d'autres entreprises soumises à la même filière REP.
Les producteurs ayant choisi de mettre en place un système individuel relèvent principalement de la filière des équipements électriques et électroniques (EEE) ainsi que de la filière « véhicules » (voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles). La grande majorité des producteurs ont opté pour la solution de l'éco-organisme. L'Ademe recense ainsi 27 éco-organismes exerçant leur activité en France11(*).
Il est possible que plusieurs éco-organismes fassent partie de la même filière REP, comme c'est le cas par exemple de la filière « Emballages ménagers et papiers graphiques » qui en comprend trois (Citéo, Adelphe et Léko). Dans ce cas, les entreprises peuvent librement choisir l'éco-organisme auquel elles souhaitent adhérer. Inversement, un même éco-organisme peut être agréé sur plusieurs filières12(*). On compte actuellement 26 éco-organismes (dont trois filiales de Citéo), soit un nombre un peu supérieur à celui du nombre de filières REP. Par ailleurs, sur l'ensemble de ces éco-organismes, 24 d'entre eux13(*) se sont réunis en juin dernier sous la forme d'une association loi 1901, le « collectif des éco-organismes »14(*).
La taille et le chiffre d'affaires (qui correspond aux éco-contributions perçues) des éco-organismes varient fortement. Le plus important, Citéo, comprend 463 ETP en incluant Adelphe et Citéo Pro, tandis que le plus petit, Pyréo, n'a que 2 ETP. De même, le chiffre d'affaires de Citéo atteignait 1,3 milliard d'euros pour l'exercice 2024, alors que celui de Pyréo n'était que de 900 000 euros.
Chiffres d'affaires et ETP des
éco-organismes membres
du collectif des éco-organismes
à la date de fin 2024
|
Eco-organisme |
ETP |
Chiffres d'affaires (en millions d'euros) |
|
Alcome |
24 |
49,6 |
|
Aliapur |
25 |
84,9 |
|
Aper |
5 |
3,3 |
|
Batribox |
16,24 |
10,8 |
|
Citeo |
Citeo : 437 |
Citeo : 1 300 Adelphe : 71,4 |
|
Cyclamed |
5 |
13 |
|
Cyclevia |
13 |
44 |
|
Dastri |
8 |
13,5 |
|
Ecologic |
97 |
140 |
|
Ecomaison |
98,9 |
420,6 |
|
Ecominero |
39 |
84,2 |
|
Ecopae |
1,6 |
1,4 |
|
Ecosystem |
165 |
429 |
|
France recyclage pneumatique (FRP) |
9 |
25,6 |
|
Leko |
24 |
31,6 |
|
Pyreo |
2 |
0,9 |
|
Recycler mon véhicule |
4 |
3,2 |
|
Refashion |
68 |
120 |
|
Soren |
10 |
9,9 |
|
Tyval |
4 |
7,2 |
|
Valdelia |
62 |
41,9 |
|
Valobat |
108 |
149 |
Note : Les données d'Ecodds et de Citéo Soin & Hygiène ne sont pas présentes, puisque les deux éco-organismes ne sont pas membres du collectif des éco-organismes.
Source : données transmises par le collectif des éco-organismes
Lorsqu'une filière compte plusieurs éco-organismes, l'autorité administrative peut imposer aux producteurs de choisir un éco-organisme coordonnateur, qui doit à la fois répartir les obligations entre les éco-organismes et assurer un service de guichet unique pour les collectivités ayant la charge du service public de gestion des déchets (SPGD)15(*).
Le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter les prochaines années, ce que révèle la progression des éco-contributions collectées par les éco-organismes : leur montant est passé de 1,9 milliard d'euros en 2022 à 2,3 milliards d'euros en 2024, et il devrait atteindre 8 milliards d'euros en 202916(*). Le montant des éco-contributions est en augmentation quasi continue depuis plus de vingt ans.
Évolution constatée et
prévisionnelle du montant des éco-contributions
perçues
par les filières REP entre 2000 et 2028
(en millions d'euros)
Note : les données sont constatées jusqu'en 2023, et prévisionnelles de 2023 à 2028.
Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe
D'un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Les difficultés et les crises se sont en effet multipliées au cours des derniers mois :
- la fédération Envie, groupe spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, a assigné l'éco-organisme Ecosystem en justice à la suite de la perte d'un appel d'offres. La presse a évoqué 1 000 emplois directs et indirects au sein du réseau qui auraient été menacés17(*). La procédure contentieuse en référé initiée par la fédération Envie a été rejetée ;
- en raison des difficultés rencontrées par la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), le Gouvernement a décidé d'un moratoire pour les dispositions devant entrer en vigueur en 2025. Un projet d'arrêté a été soumis à consultation publique jusqu'au 23 septembre dernier, et celui-ci prévoit la suspension de ces mesures jusqu'au 1er janvier 2027 ;
- enfin, la filière de la collecte du textile est entrée en crise l'été dernier. L'entreprise Le Relais, une branche d'Emmaüs qui met à disposition des bornes dans toute la France afin de favoriser le réemploi des vêtements, a ainsi accusé l'éco-organisme Refashion de ne pas leur reverser les éco-contributions. En conséquence, la collecte a été arrêtée dans un certain nombre de points de vente, et le 18 juillet, le ministère de la Transition écologique a annoncé le déblocage de 49 millions d'euros en soutien aux opérateurs de tri de la filière. Ce soutien représente 15 millions d'euros de plus par rapport à la version initiale du cahier des charges18(*).
Plus généralement, la soutenabilité économique des REP soulève des interrogations. En 2021, l'institut d'études économiques Rexecode indiquait « un supplément de coût pour les entreprises des filières REP (les « metteurs sur le marché ») d'au moins 2 milliards d'euros à l'horizon 2025 »19(*) et Marta de Cidrac et Jacques Fernique soulignent dans leur rapport de juin dernier que « Les acteurs économiques entendus, dont notamment France Industrie et le Medef, ont fait part de leurs inquiétudes face au coût économique croissant des filières REP, qui apparaît insuffisamment évalué lors du vote de la loi Agec de 2020. »20(*)
La politique de l'économie circulaire se trouve donc prise en étau entre, d'un côté, une augmentation massive des moyens et des exigences réglementaires dans les années à venir, et de l'autre, un système qui semble déjà toucher à ses limites alors que la loi Agec est à peine mise en oeuvre.
Face à ce constat, plusieurs travaux ont été réalisés sur la gouvernance des filières REP pour tenter d'en dresser un premier bilan. L'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) ont ainsi remis en juin 2024 un rapport intitulé « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », qui passe en revue l'ensemble des filières, et dont la première et principale recommandation est de « créer une instance de régulation des filières REP, afin de regrouper et d'exercer de manière indépendante les fonctions de régulation des équilibres concurrentiels, de gestion des différends, de contrôle et de sanction. Conforter la direction générale de la prévention des risques, en lien avec la direction générale des entreprises, dans un rôle de définition du cadre et des objectifs de la politique publique de la REP et, plus largement, de l'économie circulaire. »21(*)
Dans leur rapport précité de juin 2025, les sénateurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique recommandent notamment d'« élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle pour chaque filière REP, en associant l'ensemble des parties prenantes » (proposition 1) et de refonder la gouvernance des filières REP par la création de « nouveaux Comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP » (proposition 3)22(*).
Le présent rapport ne reviendra donc pas sur la question de la gouvernance des filières REP, mais il se concentrera sur les enjeux budgétaires et financiers de la politique de l'économie circulaire.
En effet, même si en vertu du principe du « pollueur-payeur », les producteurs eux-mêmes ont vocation à prendre en charge la majeure partie de la politique de prévention des déchets et de soutien à l'économie circulaire, l'État continue de participer directement au financement de cette politique à travers des subventions dans le cadre du fonds vert, du fonds économie circulaire et de France 2030.
Cette implication de l'État doit d'ailleurs être interrogée. L'Ademe, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur spécial, a indiqué qu'« il est important de limiter les moyens d'action du fonds économie circulaire aux domaines non couverts par les filières REP. » La montée en puissance des filières REP avec la loi Agec aurait donc dû en toute logique s'accompagner d'une diminution des subventions publiques, mais c'est le mouvement inverse qui a été observé sur les dernières années : les crédits consacrés à cette politique ont plus que doublé, passant de 175,9 millions d'euros en 2020 à 434,1 millions d'euros en 2024.
Il est donc impératif, à cette aune, que la nécessité et les modalités des subventions en matière de soutien à l'économie circulaire soient réexaminées. Il en va non seulement de l'exigence de réduire le déficit public, mais également de rendre pleinement opérant le principe du « pollueur-payeur ».
Évidemment, si les filières REP doivent prendre en charge elles-mêmes les investissements dans l'économie circulaire, il faut que le fonctionnement et le contrôle des éco-organismes soient satisfaisants. C'est aujourd'hui loin d'être le cas, et le présent rapport formule des propositions en matière de supervision de ces filières.
Enfin, le développement de l'économie circulaire comporte des enjeux pour les finances publiques en raison également de la « ressource propre plastique », que la France paye tous les ans à l'Union européenne. La France est le premier contributeur de cette ressource, en raison de ses très faibles performances dans le recyclage des plastiques, comme cela est détaillé infra.
C. LES ÉCO-CONTRIBUTIONS DOIVENT RESPECTER LE PRINCIPE DU « POLLUEUR-PAYEUR »
Les éco-organismes ne sont pas des institutions publiques, mais relèvent du droit privé. Cependant, les éco-organismes ne sont pas autorisés à dégager des bénéfices, et par conséquent, leur équilibre économique est uniquement guidé par leurs dépenses, lesquelles doivent répondre aux obligations formulées dans le cahier des charges de la filière REP. L'enveloppe des recettes à percevoir est donc d'un montant connu à l'avance.
Ces cahiers des charges sont au coeur du fonctionnement des filières REP. L'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que chaque cahier des charges est fixé par arrêté du ministre de l'environnement, et qu'il doit préciser « les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage ». À titre d'exemple, des extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement sont présentés.
Extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement
Objectif global de collecte
L'objectif annuel de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement qui ont été collectés durant l'année considérée.
Objectif de valorisation
Le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement entrant l'année considérée dans une installation de valorisation.
Source : commission des finances, d'après l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement
Les éco-organismes sont financés par une « éco-contribution », versée par les entreprises qui leur sont adhérentes. Cette éco-contribution finance l'ensemble des obligations des fabricants et distributeurs (prévention, collecte, tri, recyclage des déchets, etc.).
L'éco-contribution est obligatoire pour les producteurs qui n'ont pas mis en place un système individuel de traitement des déchets, que cette absence soit voulue ou non, comme le rappelle d'ailleurs une décision de la cour administrative d'appel de Paris de 2014 : « si la contribution financière versée supportée par les producteurs et répercutée à l'identique jusqu'au consommateur final ne constitue pas un prélèvement fiscal, elle représente cependant une charge obligatoire, qui augmente le prix des produits »23(*).
En outre, la Cour des comptes se déclare compétente pour contrôler les éco-organismes au titre de l'article L. 111-7 du code des juridictions, au motif qu'elle considère que les éco-organismes sont des « organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. »24(*) Les magistrats financiers ont par ailleurs procédé à de nombreux contrôles des éco-organismes25(*).
Toutefois, bien qu'elle soit obligatoire, l'éco-contribution n'est pas considérée comme une imposition de toute nature, mais elle est davantage assimilée à une redevance. Le Conseil d'État a en effet estimé dans une décision de 2017 que « la contribution financière versée à l'organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci », et que pour cette raison, « elle ne saurait être regardée [...] comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique »26(*). Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un avis que le Conseil d'État a rendu le 11 juillet 2011 sur cette même question. Pour cette raison, bien qu'elles représentent des milliards d'euros, les éco-contributions ne figurent pas dans le budget de l'État.
Extrait de l'avis du Conseil d'État,
9ème et 10ème sous-sections
réunies,
11 juillet 2011, n° 346698
« 4. Il résulte des dispositions précitées que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges. Lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique. »
Source : site internet du Conseil d'État
En effet, bien qu'elle soit répercutée sur le prix des produits, l'éco-contribution ne saurait être assimilée à une taxe sur la valeur ajoutée. Elle est censée incarner le principe du « pollueur-payeur », c'est-à-dire qu'elle doit représenter le prix à payer pour les producteurs pour la gestion des externalités négatives - en l'occurrence la production de déchets - liées à leurs activités. L'éco-contribution doit donc être considérée comme une redevance sur la production, et non pas comme une taxe sur la consommation.
C'est par ailleurs la raison pour laquelle le montant de l'éco-contribution n'est en général pas indiqué sur la facture du consommateur final, sauf pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (article L. 541-10-20 du code de l'environnement), et celle des éléments d'ameublement (article L. 541-10-21 du même code).
Par ailleurs, l'indication du montant sur la facture, qui est une mesure issue de la loi Agec, est critiquable. Elle conduit en réalité à assimiler les éco-contributions à une taxe sur la valeur ajoutée, et à faire peser la responsabilité des filières sur le citoyen. Ce transfert de responsabilité va à l'encontre du principe de « pollueur-payeur », qui constitue le fondement même des filières REP.
II. LES FAIBLES PERFORMANCES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES LA CONDUIT À PAYER UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À L'UNION EUROPÉENNE
La « ressource propre plastique » est une taxe assise sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés, qui a été établie par la décision 2020/2053 du Conseil de l'Union européenne pour le budget 2021-2027 de l'UE. Cette décision fixe un taux d'appel uniforme appliqué aux déchets d'emballages en plastique non recyclés qui est aujourd'hui de 0,8 euro/kg.
La Commission européenne prévoit de passer ce taux à 1 euro/kg lors du prochain cadre budgétaire, et il faut relever que certains États membres bénéficient d'une compensation forfaitaire équivalente à 3,8 kg par habitant pour alléger leur contribution. Pour l'année 2023, cette ressource a rapporté environ 7,2 milliards d'euros, ce qui représente autour de 4 % des recettes totales du budget de l'Union européenne.
Contexte de la création de la « ressource propre plastique »
Les ressources propres sont prévues dans les traités européens (notamment l'article 311 du TFUE), qui donnent à l'UE la capacité de se doter de moyens financiers « propres » à elle.
Historiquement, trois types de ressources propres permettaient d'alimenter le budget européen :
- une ressource propre basée sur le revenu national brut (RNB) de chaque État, qui est la ressource propre la plus importante car elle permet d'abonder les deux-tiers du budget européen ;
- une ressource propre prélevée sur la base de la TVA perçue par chaque État membre, et qui représentait entre 10 et 15 % du budget européen ;
- ensemble de ressources propres dites « traditionnelles » et qui sont notamment issues des droits de douane perçus sur les importations venant de pays tiers et qui représentaient entre 15 et 20 % du budget européen.
Avec le départ du Royaume-Uni, l'Union européenne a perdu une contribution importante, estimée à environ 75 milliards d'euros sur la période 2021-2027.
Pour combler ce déficit, la Commission a proposé dès 2020 la création de plusieurs « nouvelles ressources propres », notamment basées sur les quantités d'emballages en plastique non recyclés (également appelée « ressource propre plastique », le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) ou encore les recettes excédentaires issus du système d'échange de quotas d'émission (marché carbone). L'objectif de ces « nouvelles ressources propres » est de diversifier les recettes de l'Union européenne. Elles représentent aujourd'hui environ 10 % du budget européen.
Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial
Le 30 juin 2025, Eurostat a transmis les dernières données pour 2023 du recyclage des emballages en France : 2 424 kt de déchets d'emballages plastiques ont été générés dont 628 kt ont été recyclés, ce qui aboutit à un taux de recyclage de ces déchets de 25,9 %. Sur la base de ces éléments, le montant de la ressource propre plastique s'est donc élevé à 1,44 milliards d'euros27(*).
Plus précisément, trois catégories d'emballages sont considérées dans le calcul du montant de la ressource propre : les bouteilles en plastique à usage unique pour boissons (378 kt en 2023) ; les emballages plastiques ménagers hors bouteilles à usage unique pour boissons (778 kt en 2023) ; et les emballages plastiques non-ménagers (768 kt en 2023).
Cette taxe est souvent qualifiée d'« amende »28(*), dans la mesure où elle est évitable : la France a en la possibilité de réduire sa contribution en améliorant le taux de recyclage du plastique. Or, la France est le premier contributeur européen de cette « ressource propre plastique », en raison de sa faible performance dans le recyclage de ces matériaux. En 2023, la France a à elle seule payé 20 % de l'ensemble du produit de la contribution. En comparaison, l'Allemagne a dépassé le taux de 50 % des emballages plastiques recyclés en 2022, tandis qu'en France, la même année, cette proportion n'était que de 25,2 %.
Évolution de la contribution de la France à la ressources propres « plastique » entre 2022 et 2024
|
Année |
Emballages plastiques mis en marché (en mégatonnes) |
Emballages plastiques recyclés (en mégatonnes) |
Emballages plastiques non recyclés (en mégatonnes) |
Taux recyclage |
Équivalent ressource propre (en milliards d'euros) |
|
2022 |
2,433 |
0,612 |
1,821 |
25,2 % |
1,46 |
|
2023 |
2,424 |
0,637 |
1,797 |
26,2 % |
1,44 |
|
2024 |
2,416 |
0,669 |
1,795 |
27,2 % |
1,43 |
Note : le montant indiqué pour 2024 est une estimation.
Source : réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial
En cumulé, la France a donc dépensé 4,3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 pour payer cette contribution.
Il est bien entendu irréaliste d'atteindre un taux de 100 % de déchets recyclés à court terme, mais le respect des objectifs de taux de collecte permettrait de faire des économies significatives : elles auraient atteint de l'ordre de 526 millions d'euros en 202329(*). Si la France avait un taux de recyclage des emballages plastiques similaire à celui de l'Allemagne, c'est-à-dire de 50 %, l'économie aurait été de 752,7 millions d'euros, toujours en 2023.
En cumulé, l'atteinte d'une cible de 50 % des emballages plastiques recyclés depuis 2024 aurait abouti à une économie potentielle d'environ 2,27 milliards d'euros. Ces chiffres ne sont pas négligeables : ils représentent l'équivalent du financement de plusieurs politiques publiques qui sont ainsi « gaspillées » par un taux de recyclage trop faible.
Économies potentielles dans un
scénarios où la France aurait atteint
une cible de 50 %
des emballages plastiques recyclés
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
DEUXIÈME
PARTIE
LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REP DOIT PERMETTRE DE
RÉDUIRE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT
DANS LE SOUTIEN À
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS ÉPARPILLÉS
Les aides de l'État à l'économie circulaire, ainsi qu'à la prévention et la valorisation des déchets, reposent traditionnellement sur le fonds « économie circulaire » (FEC), géré par l'Ademe. Pendant longtemps, il s'agissait pour l'essentiel du seul vecteur de financement de l'État à cette politique, la thématique étant sinon portée par les collectivités territoriales.
Ce système de subvention s'est toutefois complexifié à partir de 2021 avec le plan de relance, la mise en place du fonds vert, et la montée en puissance de France 2030, qui financent tous les trois des projets en lien avec le traitement des déchets et l'économie. Ces nouvelles enveloppes ont toutefois été confiées à l'Ademe, ce qui a permis de maintenir une certaine cohérence en évitant les doublons dans les financements. La maquette budgétaire s'en est néanmoins trouvée complexifiée, ce qui a rendu in fine le suivi de ces politiques plus difficile.
A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE
1. Le fonds économie circulaire finance un champ très large de projets
Malgré la diversification des vecteurs de financement, le principal instrument de la politique de soutien à l'économie circulaire reste le « fonds économie circulaire », géré par l'Ademe. Les principaux champs dans lesquels intervient le fonds économie circulaire sont les suivants :
- la valorisation des déchets organiques, avec des aides aux opérations de tri à la source des biodéchets (gestion de proximité et collecte séparée), de compostage, de désemballage/déconditionnement et de méthanisation par cogénération ;
- le recyclage des déchets ménagers, industriels et du bâtiment et travaux publics, notamment des opérations de valorisation matière des déchets du BTP et des déchets des entreprises ;
- la valorisation énergétique, avec le financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) ;
- le développement de l'éco-conception au sein des entreprises et des filières à travers des diagnostics, le soutien à la réparation et au réemploi, à l'allongement de la durée de vie des produits, ainsi que le développement de l'écologie industrielle et territoriale ;
- la communication, le renforcement de l'information des consommateurs, et le renforcement des dispositifs locaux et nationaux d'observation de l'économie circulaire ;
- l'accompagnement des collectivités locales et des acteurs de l'économie circulaire, notamment avec la mise en place de plans et de feuilles de route locales.
Ces domaines sont larges, et ne font pas l'objet d'une définition précise. Ainsi, dans la pratique, le fonds économie circulaire peut financer tout projet qui présente un lien avec l'économie circulaire, ce qui peut aller du financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) à la mise en place de campagnes de communication dans les écoles.
Il n'y a pas non plus de limites s'agissant de la taille des entreprises éligibles à des financements du fonds économie circulaire : plusieurs entreprises du CAC 40 ont ainsi bénéficié de subventions30(*). Des cabinets de conseil ont également perçu des financements, et ce point mériterait d'être approfondi, les montants n'étant pas négligeables31(*).
En revanche, l'Ademe souligne que le fonds économie circulaire ne finance « aucune aide aux entreprises en difficulté », dans l'idée que le fonds ne devrait financer que les projets qui puissent devenir rentables à court terme. C'est une pratique conforme à une bonne gestion des fonds publics, car les financements publics ont seulement pour fonction d'amorcer des projets, et non pas à se substituer durablement aux financements privés.
Pour éviter à l'inverse les effets d'aubaine, c'est-à-dire le subventionnement d'entreprises qui auraient pu être financées à partir de fonds privés, l'Ademe a indiqué au rapporteur spécial que l'opérateur procède à un calcul du delta du coût avec la solution de référence32(*) pour définir les coûts éligibles à un soutien du fonds économie circulaire, et que le calcul du taux de rendement interne cible, en incluant l'aide, doit être inférieur à 8 %33(*).
Toutefois, ces estimations restent prévisionnelles, et il n'est pas possible de déterminer entièrement a priori si les financements publics étaient nécessaires ou non. Il reste donc souhaitable de favoriser au maximum le recours à des fonds privés avant d'engager des subventions de l'État.
Historique du fonds Économie circulaire
En 2007, le Grenelle de l'environnement prévoit la création du fonds déchets ainsi que du fonds chaleur. Leur gestion est confiée à l'Ademe, qui récupère également en 2010 le pilotage de quatre programmes d'investissement d'avenir.
Avant le fonds déchets, l'Ademe finançait déjà des actions liées à l'économie circulaire, mais sans qu'elle fasse l'objet d'une enveloppe dédiée. Ces actions s'inscrivaient toutefois dans les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, dont le premier date de 1992, soit un an après la création de l'Ademe.
Jusqu'en 2012, les soutiens étaient principalement orientés vers les collectivités territoriales. De 2009 à 2014, la dynamique de la thématique « prévention » était tirée par deux interventions principales : les plans et programmes de prévention des déchets (environ 80 % des montants engagés en 2013 et 2014), et la tarification incitative. Ces deux dispositifs ont été remplacées en 2015 par des interventions émergentes moins coûteuses (écoconception, mise en place de relais, gaspillage alimentaire) et un volet « animation territoriale ».
En 2016, un premier appel à projets « Orplast », qui vise à soutenir les entreprises dans le recyclage des plastiques, est engagé.
À partir de 2018, le fonds déchets est renommé « fonds économie circulaire » et renforce certaines aides aux collectivités, telles que les soutiens à la modernisation des centres de tri des emballages, ou encore à la mise en oeuvre de la tarification incitative.
Le fonds économie circulaire finance des projets de valorisation énergétique depuis le milieu des années 2010, mais cette thématique a pris de l'ampleur dans les années 2020 avec le financement de plusieurs projets importants utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).
Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial
La majeure partie des financements du fonds économie circulaire est orientée vers le recyclage et la valorisation énergétique (135,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros). Ces financements dépassent ceux consacrés à la prévention, à l'éco-conception et à la valorisation organique, qui représentaient 119 millions d'euros en 2023, alors que ces mesures se situent à un niveau plus élevé de la hiérarchie de l'économie circulaire. Cependant, la fin, cette année, du financement des projets de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération devrait conduire à inverser cette proportion.
Répartition des financements du fonds
économie circulaire
selon le secteur d'activité
visé
(en millions d'euros)
|
Fonds économie circulaire |
Engagé et en validation au 31 décembre 2023 |
|
Prévention (dont tarification incitative, réemploi, réparation...) |
55,2 |
|
Production et consommation durable (dont éco conception, économie de la fonctionnalité...) |
25,8 |
|
Valorisation organique |
38 |
|
Recyclage et valorisation énergétique (dont valorisation de combustibles solides de récupération, valorisation de plastiques, métaux...) |
135,1 |
|
Outre-mer (équipements spécifiques non soutenus en métropole et rattrapage structurel) |
5,5 |
|
Autre (expertise, outils nationaux, bases de données, affichage environnemental, observation...) |
43,4 |
|
Total 2023 |
303 |
Source : réponses de l'Ademe au questionnaire budgétaire du projet de loi de finances pour 2025
Moyennes et médianes par année des
financements
du fonds économie circulaire
|
Années |
Nombre de dossiers |
Montant moyen (en euros) |
Montant médian (en euros) |
Montant total (en millions d'euros) |
|
2020 |
2 167 |
76 023 |
19 801 |
164,6 |
|
2021 |
1 972 |
83 091 |
17 500 |
163,4 |
|
2022 |
1 628 |
102 636 |
17 126 |
166,9 |
|
2023 |
2 200 |
137 848 |
13 290 |
303,0 |
|
2024 |
2 809 |
107 295 |
12 681 |
301,3 |
|
Total 2020-2024 |
10 776 |
102 111 |
15 798 |
1 099,2 |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
L'analyse des montants versés indique également un écart significatif entre la moyenne (102 111 euros entre 2020 et 2024) et la médiane (15 798 euros), ce qui est le signe d'une grande disparité dans le coût des projets financés.
Les 10 % des dossiers avec les montants les plus élevés représentent 75 % du montant total, avec un montant moyen pour ces dossiers de 766 732 euros. À l'inverse, 30 % des dossiers (ce qui correspond à 3 234 dossiers) correspondent à un montant moyen inférieur à 5 000 euros. Il est légitime pour ces derniers cas de s'interroger sur la plus-value réelle du financement par le fonds économie circulaire, au regard notamment du coût administratif d'instruction des dossiers.
Répartition des financements du fonds économie circulaire par décile
|
Décile |
Nombre de dossiers |
Montant moyen (en euros) |
Montant total (en euros) |
Part du montant total |
|
1 |
1 078 |
711 |
766 017 |
0,1 % |
|
2 |
1 078 |
2 740 |
2 953 799 |
0,3 % |
|
3 |
1 078 |
4 905 |
5 287 623 |
0,5 % |
|
4 |
1 078 |
6 942 |
7 483 725 |
0,7 % |
|
5 |
1 078 |
12 108 |
13 052 797 |
1,2 % |
|
6 |
1 078 |
21 208 |
22 861 902 |
2,1 % |
|
7 |
1 077 |
36 333 |
39 130 250 |
3,6 % |
|
8 |
1 077 |
60 542 |
65 203 585 |
5,9 % |
|
9 |
1 077 |
109 411 |
117 836 134 |
10,7 % |
|
10 |
1 077 |
766 732 |
825 769 891 |
75,0 % |
|
Total 2020-2024 |
10 776 |
102 111 |
1 100 345 723 |
100 % |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Représentation des financements du fonds économie circulaire par décile
(en euros)
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
2. L'arrêt du financement des combustibles solides de récupération par le fonds économie circulaire est justifié dans un contexte de contrainte budgétaire
Dans la loi de finances initiale pour 2025, le montant du fonds économie circulaire est passé de 300 millions d'euros à 170 millions d'euros. Cette baisse des crédits fait suite au plan d'économies décidé par le Gouvernement de Michel Barnier, et elle porte spécifiquement sur le financement des installations de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).
Les CSR ont en effet représenté une part significative des financements du fonds économie circulaire sur les dernières années. L'Ademe propose un mécanisme de soutien aux chaufferies CSR depuis 2016, et six sessions de l'appel à projets CSR ont été lancées jusqu'à aujourd'hui : en 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 (deux sessions), et enfin en 2024. Ces appels à projets ont permis d'identifier 24 projets lauréats, choisis sur la base notamment de critères environnementaux (rendement, origine et nature des déchets, substitution de combustibles fossiles) et économiques (taux de retour sur investissement minimum à atteindre).
Au-delà des subventions de l'Ademe, des certificats d'économies d'énergie (CEE) peuvent également être accordés lorsque les CSR se substituent à un combustible plus émetteur de gaz à effet de serre, et que la chaufferie CSR vient améliorer la consommation globale d'énergie. Seuls sont éligibles aux aides Ademe les projets utilisant des CSR dont la part biogénique en énergie est supérieure à 50 %34(*). Il s'agit d'une exigence découlant du régime européen d'aide aux entreprises35(*).
En 2023, le soutien aux installations utilisant des combustibles solides de récupération a ainsi constitué 23 % des financements du fonds économie circulaire, soit 71,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros. Par ailleurs, les dossiers représentant les montants les plus élevés financés par le fonds économie circulaire concernent la création de chaufferies pour des CSR.
La valorisation énergétique par combustible solide de récupération
L'article R 541-8-1 du code de l'environnement définit les combustibles solides de récupération comme des déchets solides non dangereux, composés de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, et qui sont préparés pour être utilisés comme combustibles dans une installation dédiée.
Les installations utilisant des CSR peuvent, au titre du décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, produire de l'électricité, du gaz ou de la chaleur.
La norme NF EN 15359 (2011) encadre les CSR au niveau européen : elle définit des classes de qualité en fonction du pouvoir calorifique, de la teneur en chlore et de critères environnementaux (présence de métaux lourds, teneur en mercure, taux de carbone). Les chaufferies utilisant des CSR sont une technologie récente, la première ayant été inaugurée en France à l'automne 2017.
Les CSR peuvent relever de deux types de production. La « production conjointe » signifie que les CSR sont produits au sein d'une installation de traitement de déchets qui a une autre vocation principale, tandis que la « production dissociée » signifie que les CSR sont produits dans une installation exclusivement dédiée à la transformation des déchets non dangereux en CSR normalisés.
Une nouvelle révision de ces textes est prévue d'ici la fin de l'année 2025, afin de modifier les modalités de calcul des rendements pour prendre en compte les aléas de production d'énergie, en augmentant en contrepartie le rendement minimal à atteindre pour les chaufferies CSR alimentant des industriels en chaleur uniquement.
Source : commission des finances
Le projet le plus coûteux porte sur la création en 2024 d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos, à Origny-Sainte-Benoite dans l'Aisne, pour un montant de 36,4 millions d'euros. L'Ademe finance ainsi un peu plus d'un tiers de l'investissement total (100 millions d'euros)36(*). En second rang vient la création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui a été financée par le fonds économie circulaire à hauteur de 27,6 millions d'euros sur un total de 130 millions d'euros37(*).
Le troisième projet le plus important est la création en 2023 du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia, en Haute-Corse, qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 21,2 millions d'euros de la part de l'Ademe. Plus largement, les dix projets les plus financés par le fonds économie circulaire l'ont été pour plus de dix millions d'euros, et ils concernent tous en partie ou en totalité la valorisation énergétique. L'arrêt du financement des CSR aura ainsi des conséquences importantes sur la structure des financements du fonds économie circulaire.
Les dix projets ayant obtenu les financements
les plus importants du fonds économie circulaire depuis
2020
|
Année |
Projet |
Montant (en euros) |
Entreprise ou collectivité |
Département |
|
2024 |
Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos |
36 400 000 |
Oristeam |
Aisne |
|
2023 |
Création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb |
27 594 000 |
Novasteam |
Meurthe-et-Moselle |
|
2023 |
Centre de tri et de valorisation du Grand Bastia |
21 217 164 |
Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse |
Corse |
|
2024 |
Création d'une chaufferie CSR à Auneuil |
16 000 000 |
Agri Biomasse chaudière |
Oise |
|
2023 |
Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tavaux |
14 995 000 |
E.ON Business solutions |
Jura |
|
2023 |
Création d'une chaufferie CSR à Marseille |
14 900 000 |
Mirecourt chaleur urbaine |
Bouches-du-Rhône |
|
2021 |
Création d'une chaufferie CSR sur le site de Bois-Rouge à Saint-André |
14 500 000 |
Albioma bois-rouge |
La Réunion |
|
2023 |
Création d'une chaufferie CSR sur le site de SKPRF |
13 500 000 |
Engie énergie services |
Vaucluse |
|
2020 |
Création d'une unité de valorisation énergétique fonctionnant aux CSR à Dombasle-sur-Meurthe |
13 300 000 |
Dombasle énergie (Solvay et Véolia) |
Meurthe-et-Moselle |
|
2021 |
Centre de sur-tri et de préparation CSR à partir d'encombrants et de DAE |
11 501 083 |
Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion |
La Réunion |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Il est difficile, à ce stade, de dresser un bilan du soutien aux installations utilisant des CSR. La politique est récente, et une chaufferie met plusieurs années avant de devenir opérationnelle. La capacité de consommation de CSR est seulement d'environ 500 kt/an pour une soixantaine d'installations permettant la préparation de CSR à partir de déchets non valorisables en matière, alors que la capacité de production théorique est de 2,5 Mt/an. Actuellement, les principaux consommateurs de CSR sont les cimenteries et fours à chaux : en 2022, une vingtaine d'installations consommaient environ 400 kt/an de CSR.
Néanmoins, la DPGR a indiqué au rapporteur spécial que, d'après une étude menée par l'Ademe, qui était en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport, il existe une quarantaine d'installations de production d'énergie à partir de CSR en projet, représentant une capacité de combustion d'environ 2,8 Mt/an de CSR. La valorisation énergétique des CSR devrait donc connaître une forte augmentation dans les années à venir.
La fin du financement des CSR par l'Ademe a néanmoins été déplorée par plusieurs acteurs rencontrés par le rapporteur spécial. La Federec a notamment regretté que « l'ADEME ait écarté les AAP CSR ; aussi nous estimons qu'il faut réintégrer le CSR et sanctuariser le budget de ce fonds pour qu'il continue à soutenir le développement de la filière CSR qui contribue directement à la souveraineté énergétique et industrielle de nos territoires. »38(*)
Une étude de l'Ademe, basée sur la méthode de l'analyse du cycle de vie (ACV)39(*), a toutefois conclu à un « bilan contrasté » de la filière CSR sur le plan environnemental, indiquant que « la filière CSR peut générer des bénéfices du point de vue du changement climatique et de la consommation de ressources fossiles et nucléaires, à condition que la chaufferie présente un haut rendement énergétique et que le débouché pour la chaleur soit continu. »40(*)
Selon l'étude, les CSR présentent un bilan négatif en matière de particules fines par rapport au gaz naturel, ainsi que pour l'émission de radiations ionisantes pour la production de chaleur. En revanche, les CSR connaissent un impact favorable en matière d'eutrophisation marine41(*) ainsi que d'évitement de l'usage des énergies fossiles.
Pour le critère environnemental « changement climatique », les CSR présentent un bilan positif, sauf pour la cogénération sans débouché continu auquel cas il est nécessaire que « le CSR ait un taux biogénique en énergie de 55 % ou plus » pour que le bénéfice soit supérieur à celui du gaz naturel ou du fioul.42(*) En outre, l'impact pour le changement climatique est négatif lorsque le combustible utilisé est à base de plastique43(*). Ainsi, si les CSR présentent un intérêt réel en matière environnementale, ils comportent d'importantes limites.
Bilan environnemental des CSR par rapport au combustible évité
Source : « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 134
En outre, la valorisation énergétique reste inférieure, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à la valorisation matière, au réemploi et à la prévention. Elle devrait donc être encouragée principalement dans la mesure où les autres procédés ne sont pas accessibles. Il ne s'agit pas bien entendu d'affirmer que les CSR n'ont aucune place dans la transition énergétique, et à cet égard la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un objectif de production de CSR de 10 TWh, mais, en cas d'arbitrage, de favoriser les solutions les plus vertueuses. C'est cette logique qui a été suivie lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 avec une allocation des ressources du fonds économie circulaire vers les projets qui se situent plus hauts dans les priorités de l'économie circulaire.
En outre, il est possible de soutenir la production CSR par d'autres voies, et en particulier par une simplification et une adaptation des exigences réglementaires. À ce titre, la direction générale de la prévention des risques a affirmé au rapporteur spécial qu'une nouvelle révision de ces textes est prévue d'ici la fin de l'année 2025, afin de modifier les modalités de calcul des rendements de manière à prendre en compte les aléas de production d'énergie, en augmentant en contrepartie le rendement minimal à atteindre pour les chaufferies CSR destinées exclusivement à fournir de la chaleur aux industriels44(*).
3. Quel bilan pour le fonds économie circulaire ?
Les fédérations de professionnels interrogées par le rapporteur spécial ont fait part de retours positifs sur l'action du fonds économie circulaire. La Fédération des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire (Federec) a ainsi souligné que « le fonds économie circulaire, déployé et financé par l'ADEME, est structurant pour le développement de projets locaux, territoriaux et industriels qui contribuent à la prévention des déchets, au réemploi, à la réparation, au recyclage et à l'éco-conception » et que « les montants alloués par l'Ademe sont essentiels à la viabilité de certains projets »45(*).
De la même façon, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) a souligné l'intérêt du fonds économie circulaire pour garantir la compétitivité des entreprises en relevant. Les deux fédérations plaident ainsi pour un rétablissement du fonds économie circulaire à 300 millions d'euros, comme ce fut le cas en 2023 et en 2024.
Régions de France a toutefois un avis plus nuancé sur le dispositif, indiquant que « certaines régions, c'est le cas de l'Île-de-France, font valoir que le fonds ne permet pas toujours de répondre aux spécificités régionales, les modalités de soutien et la typologie de projets / études aidés ne sont toujours pas ciblés en fonction des besoins régionaux mais en fonction des priorités nationales »46(*). L'association représentative des régions précise toutefois que « de façon générale, les régions ne disposent pas d'une évaluation nationale de l'impact de ce fonds »47(*).
La Federec a également souligné que l'affectation des fonds pourrait être améliorée : « d'un point de vue organisationnel, la Federec estime que l'affectation des fonds pourrait être réalisée avec plus de transparence et de concertation, tout comme le processus décisionnel des appels à projets. Nous pensons qu'il pourrait être utile qu'il y ait notamment davantage de concertation sur les grandes orientations nécessaires au secteur de l'économie circulaire, afin que les avis des industriels et plus largement, de l'ensemble des parties prenantes soient pris en compte et ainsi tendre vers la bonne réponse aux besoins de réindustrialisation et de circularité de nos territoires. »48(*) Dans cette optique, la fédération recommande de mettre davantage l'accent sur le développement de la demande industrielle de matière première recyclée en aval des industries de réemploi et de recyclage, afin de sécuriser les investissements réalisés dans le secteur.
B. LE FONDS VERT : UNE POLITIQUE À L'AVENIR INCERTAIN.
Annoncé en août 2022, le fonds vert, dont la dénomination exacte est le « fonds d'accélération pour la transition écologique dans les territoires » (programme 380 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ») a été mis en place dans la loi de finances initiale pour 202349(*). Il a vocation à subventionner des projets issus des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique, dans des domaines variés tels que la rénovation énergétique, l'économie circulaire, les transports, la prévention des risques, ou la renaturation des villes, entre autres.
Depuis sa première année d'existence, il finance le soutien au tri à la source des biodéchets, ainsi que des programmes de valorisation des biodéchets, notamment par le compostage ou la méthanisation.
Les dispositifs financés par le volet « biodéchets » du fonds vert sont proches de ceux pris en charge par le fonds économie circulaire, la différence se situant au niveau de la source des déchets : « Dans un objectif de complémentarité des fonds, la mesure biodéchets du fonds vert a été dédiée aux projets de collectivités traitant un flux de biodéchets issu majoritairement des ménages (par rapport au flux des producteurs assimilés, comme des traiteurs, petits restaurants...). Le fonds économie circulaire a permis de soutenir les projets d'acteurs économiques ou pour les collectivités dont le volume de biodéchets provenait en majorité des acteurs économiques et assimilés. »50(*)
Cette distinction, utile en gestion, n'était pas suffisante pour justifier l'inscription de ces financements dans deux programmes différents - le programme 181 « Prévention des risques » pour le FEC, et le programme 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires » pour la mesure « biodéchets » du fonds vert51(*). Ce chevauchement constitue un problème récurrent du fonds vert.
En effet, d'une part la majorité des mesures du fonds vert provenait du plan de relance, alors même que ces dispositifs devaient normalement être temporaires, sans que cela ait été clairement indiqué lors de la présentation du programme. D'autre part, le Gouvernement a choisi de réunir l'ensemble des financements du fonds vert au sein d'un programme unique, alors même que certaines politiques relèvent déjà d'autres versants de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », notamment la biodiversité (programme 113) et la prévention des risques (programme 181)52(*).
La procédure de traitement des dossiers du volet « biodéchets » est différente de celle des autres mesures du fonds vert. Ce ne sont en effet pas les préfets de département qui procèdent à la sélection, mais les préfets de région, et l'Ademe assure l'essentiel de la gestion et du suivi des dossiers, à l'instar du fonds économie circulaire.
Traitement des dossiers déposés pour
le fonds vert
au titre de la mesure
« biodéchets »
L'Ademe fait le suivi global de la mesure biodéchets via les outils d'instruction et de reporting internes à l'agence et propose des bilans à la DGPR et à la DGALN dans le cadre des politiques prioritaires du gouvernement. Plus précisément, l'Ademe a proposé à la DGALN la nature des dépenses éligibles à la mesure biodéchets du fonds vert, pour la création du cahier d'accompagnement.
Le processus d'instruction d'une demande de soutien est celui-ci :
- les porteurs déposent leur demande d'aide sur la plateforme Démarches Simplifiées ;
- les préfets de département peuvent être consultés sur le dossier ;
- la direction régionale de l'Ademe concernée instruit le dossier, en coordination avec la DREAL. Les préfets de département peuvent être consultés sur l'aide proposée ;
- le préfet de région procède à la sélection des projets lauréats et à la détermination du montant de la subvention attribuée ;
- la direction régionale de l'Ademe contractualise l'aide (imputation sur la ligne comptable dédiée) avec contreseing du préfet de région. Elle assure également le suivi du dossier, jusqu'à son solde.
Source : réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial
Un peu plus de 100 millions d'euros ont été versés dans le cadre du fonds vert en 2023 et en 2024, pour 389 dossiers. Le montant médian est de 99 110 euros, tandis que le montant moyen est de 274 970 euros, ce qui signifie que les montants des dossiers financés présentent des disparités significatives, quoique moindre que pour le fonds économie circulaire.
Nombre de dossiers et montants
financés
par la mesure « biodéchets » du
fonds vert
|
Année |
Nombre de dossiers |
Montant moyen (en euros) |
Montant médian (en euros) |
Montant total (en millions d'euros) |
|
2023 |
201 |
301 175 |
93 326 |
60,5 |
|
2024 |
188 |
246 952 |
122 078 |
46,4 |
|
Total 2023-2024 |
389 |
274 970 |
99 110 |
106,9 |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Le versant « biodéchets » du fonds vert a en majorité financé des projets portés par des syndicats mixtes fermés (28 % du montant total) ainsi que des communautés d'agglomération (23,6 %). Les dossiers portés par les métropoles, dont le nombre est relativement faible rapporté au total (13 sur 389), bénéficient en revanche des montants les plus importants, avec un montant médian de 1,2 million d'euros.
Sur l'ensemble du montant des financements du fonds vert (107 millions d'euros), environ 2,4 millions d'euros n'ont pas été affectés à des collectivités territoriales, mais à des entreprises.
Cependant, sur les 33 dossiers identifiés par le rapporteur spécial comme finançant des entreprises, 28 concernent l'entreprise d'intérim Adecco France, pour un montant de 1,7 millions d'euros. Interrogée sur ces dossiers en particulier, l'Ademe n'a pas apporté de réponses convaincantes au rapporteur spécial : « la mise en oeuvre du fond vert se fait pour l'essentiel par de l'intérim financé par les frais de gestion. Pour les mesures du fond vert, ces frais de gestion s'élèvent à 1,5 % du montant des mesures concernées. La Direction des ressources humaines a lancé un appel d'offres en 2024 pour la période 2025 - 2028, Adecco a remporté le marché. C'est donc avec lui que nous recourons à l'intérim. »53(*)
Le financement par les crédits du fonds vert de ces frais de gestion n'est pas une évidence. Cette pratique n'est mentionnée nulle part dans le projet annuel de performances du programme 380, et n'est pas non plus évoquée dans le dernier rapport sur l'exécution budgétaire de la mission « Écologie, développement et mobilité durable » de la Cour des comptes54(*). Il est donc indispensable de clarifier cette situation.
Les cinq autres dossiers concernent bien des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets. La possibilité de financer des établissements privés est bien prévue dans le cahier d'accompagnement de la mesure « soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets », dans la mesure où ces établissements agissent dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD). Cependant, même si ces dossiers sont peu nombreux, et représentent une part relativement faible du fonds vert (700 000 euros), il convient de veiller à l'absence d'effet d'éviction envers les collectivités territoriales, le fonds vert ayant été créé pour financer des projets issus de collectivités territoriales.
Types d'organismes financés par le fonds vert au titre de l'action « biodéchets »
|
Type de structure |
Nombre de dossiers |
Part des dossiers |
Montant total (en euros) |
Part du montant total |
Montant médian (en euros) |
|
Syndicats mixtes fermés (SMF) |
85 |
21,9 % |
29 969 383 |
28,0 % |
166 562 |
|
Communautés d'agglomération (CA) |
90 |
23,1 % |
25 190 632 |
23,6 % |
181 591 |
|
Métropoles |
13 |
3,3 % |
15 424 462 |
14,4 % |
1 233 440 |
|
Communautés de communes (CC) |
139 |
35,7 % |
13 856 156 |
13,0 % |
62 208 |
|
Syndicats mixtes ouverts (SMO) |
14 |
3,6 % |
12 473 091 |
11,7 % |
112 580 |
|
Établissements publics territoriaux (EPT) |
5 |
1,3 % |
3 542 045 |
3,3 % |
259 450 |
|
Communes |
4 |
1,0 % |
2 145 541 |
2,0 % |
29 715 |
|
Communautés urbaines (CU) |
7 |
1,8 % |
1 951 633 |
1,8 % |
183 932 |
|
Entreprises |
32 |
8,2 % |
2 410 236 |
2,3 % |
64 700 |
|
Total |
389 |
100 % |
106 963 178 |
100 % |
99 110 |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Répartition des financements du fonds vert
action « biodéchets »
selon le type de
collectivités territoriales
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Le projet qui a reçu le plus de financement du fonds vert est celui d'une unité de méthanisation de biodéchets à la Réunion, pour un montant de 8,8 millions d'euros. Cette subvention est deux fois plus élevée que celle du second projet, celui de modernisation de la plateforme de compostage de biodéchets d'Aspach-Michelbach.
En ce qui concerne la répartition territoriale des financements : la Martinique, la Guyane et La Réunion ont perçu un montant nettement plus élevé de subvention par habitant, ce qui est compréhensible au regard des besoins de ces territoires. Toutefois, dans le même temps, il apparaît que la Guadeloupe a peu mobilisé le fonds vert, et qu'aucun dossier n'a fait l'objet d'un financement à Mayotte.
En France métropolitaine, la Bretagne a particulièrement bénéficié du fonds vert, pour un montant de 3,2 euros par habitant, les autres régions se situant entre 0,7 et 1,8 euro par habitant.
Répartition territoriale des dossiers
financés par le fonds vert
action
« biodéchets »
|
Région |
Nombre de dossiers |
Part des dossiers |
Montant total (en euros) |
Montant par habitant (en euros) |
Part du montant total |
Montant médian (en euros) |
|
Bretagne |
21 |
5,9 % |
11 198 063 |
3,2 |
11,8 % |
247 284 |
|
La Réunion |
5 |
1,4 % |
10 950 879 |
12,4 |
11,6 % |
40 000 |
|
Grand Est |
25 |
7,0 % |
9 936 724 |
1,8 |
10,5 % |
125 620 |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
70 |
19,7 % |
9 480 240 |
1,2 |
10,0 % |
72 565 |
|
Île-de-France |
19 |
5,4 % |
9 274 316 |
0,7 |
9,8 % |
320 960 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
22 |
6,2 % |
7 733 462 |
1,4 |
8,2 % |
135 060 |
|
Occitanie |
42 |
11,8 % |
6 560 554 |
1,1 |
6,9 % |
70 689 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
32 |
9,0 % |
6 432 693 |
1,0 |
6,8 % |
142 547 |
|
Normandie |
20 |
5,6 % |
4 672 931 |
1,4 |
4,9 % |
183 300 |
|
Pays de la Loire |
33 |
9,3 % |
4 564 198 |
0,7 |
4,8 % |
96 784 |
|
Martinique |
5 |
1,4 % |
3 496 910 |
10,0 |
3,7 % |
804 700 |
|
Hauts-de-France |
19 |
5,4 % |
2 989 900 |
0,5 |
3,2 % |
79 159 |
|
Centre-Val de Loire |
20 |
5,6 % |
2 908 700 |
1,1 |
3,1 % |
40 140 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
16 |
4,5 % |
2 668 222 |
1,0 |
2,8 % |
78 187 |
|
Guyane |
4 |
1,1 % |
1 877 317 |
6,4 |
2,0 % |
447 400 |
|
Guadeloupe |
2 |
0,6 % |
52 268 |
0,1 |
0,1 % |
26 134 |
|
Total |
355 |
100 % |
94 797 377 |
1,4 |
100 % |
97 797 |
Note : le montant par habitant a été déterminé à partir de l'estimation de la population au 1er janvier 2024 réalisé par l'Insee, parue le 16 janvier 2024.
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
Répartition territoriale des dossiers financés par le fonds vert action « biodéchets »
(euros/habitant)
Source : commission des finances, à partir des données transmises par l'Ademe. Carte réalisée avec Khartis et openstreetmap
La mesure « biodéchets » du fonds vert est une politique très récente, et ainsi, comme l'a indiqué l'Ademe au rapporteur spécial, il est encore trop tôt pour en faire une première évaluation : « aucun dossier fonds vert biodéchets n'est arrivé au terme du projet, il n'est donc pas possible de dresser un bilan à ce jour »55(*). En effet, les collectivités mettent en moyenne 3 à 4 ans pour déployer une solution de tri. À l'issue des projets, il est demandé aux porteurs de remettre une attestation de la population desservie par les solutions installées sur le territoire et de l'évolution des tonnages « ordures ménagères résiduelles »56(*) en début et fin de projet.
L'opérateur estime cependant, selon des estimations provisoires, que les projets de solution de tri engagés ont touché 14 millions d'habitants (4,5 millions en gestion de proximité et 9,5 millions en collecte séparée) et ont permis de collecter 422 000 tonnes de biodéchets.
Régions de France a précisé au rapporteur spécial que « concernant l'efficacité de la mesure biodéchets du fonds vert, une évaluation conjointe est en cours dans certaines régions en lien avec l'ADEME dont les résultats ne sont pas encore disponibles », tout en soulignant que « plusieurs régions interviennent en cofinancement des projets financés par le fonds vert ou l'ADEME sur les biodéchets. »57(*) La région Île-de-France a relevé néanmoins que « l'absence de réflexion conjointe sur le cahier des charges des projets soutenus et des modalités d'aides n'a pas permis une efficacité complète »58(*).
L'avenir de la mesure « Soutenir le tri à la source et la valorisation des biodéchets » au sein du fonds vert est incertain. Lors d'un échange avec le cabinet de la ministre de la transition écologique, il avait été indiqué au rapporteur spécial que ce dispositif était entré en extinction en 2025. Cette information est particulièrement étonnante, dans la mesure où rien n'indiquait, ni dans le projet annuel de performance (PAP) pour 2025 ni dans les réponses au questionnaire budgétaire de la mission « Écologie, développement et mobilité durable » que cette politique serait remise en cause cette année.
En outre, une édition pour 2025 du Cahier d'accompagnement des porteurs de projet et des services instructeurs de la mesure « Soutien à la source et à la valorisation des biodéchets » a été publiée en mars de cette année59(*), et aucune personne auditionnée n'a évoqué la fin de cette mesure. L'appel à projets du dispositif précise certes que « les projets présentés en 2025 ne seront financés par le Fonds vert qu'à la condition d'être portés par des collectivités n'ayant aucun autre mode de financement possible ou au vu de leur situation particulière »60(*), mais cette restriction - qui relève surtout de la bonne gestion budgétaire - n'est pas synonyme d'une extinction de la mesure.
Dans ce contexte, il serait souhaitable de clarifier quel est le devenir de la mesure « biodéchets » au sein du fonds vert. Il ne serait pas acceptable que l'ensemble des subventions s'arrête dans la pratique dès 2025, alors que les parlementaires ont adopté le fonds vert avec ce dispositif encore présent.
C. LE PLAN DE RELANCE : DES DISPOSITIFS EN PARTIE PÉRÉNISÉS
Le plan de relance a inclus un volet consacré à la politique de prévention des déchets et de soutien à l'économie circulaire. La majorité des mesures a été engagée au cours de l'année 2021, et en particulier :
- 56 millions d'euros ont été engagés pour l'action régénération / incorporation de matière recyclée (Orplast). Plus précisément, l'incorporation de matière recyclée a représenté 32,5 millions d'euros pour 105 dossiers, tandis que pour la régénération, 39 dossiers ont bénéficié de 23,4 millions d'euros. L'Ademe précise par ailleurs que « la moitié du montant d'aide visait des PME »61(*) ;
- 40,9 millions d'euros ont été engagés pour l'action « centre de tri des emballages ménagers » ;
- 17,65 millions d'euros ont été engagés pour l'action réparation, réemploi et réutilisation ;
- 5,86 millions d'euros ont été engagés pour une action de substitution des emballages plastiques à usage unique ;
- 44,3 millions d'euros ont été consacrés au soutien aux CSR. Selon l'Ademe, quatre installations ont été soutenues par le plan de relance, pour un tonnage de 131 068 tonnes. L'enveloppe ayant été intégralement consommée en 2021, aucun appel à projets « CSR » n'a été lancé en 2022 ;
- 18,4 millions d'euros ont permis de financer l'action « déchèteries professionnelles et « centres de tri de déchets d'activité économique » (DAE). Cette enveloppe a été intégralement consommée en 2021 ;
- 30 millions d'euros ont été consacrés à l'aide aux collectivités territoriales pour la mise en oeuvre de la tarification incitative pour la prévention et la gestion des déchets ;
- 6,9 millions d'euros ont été engagés pour soutenir des démarches d'éco-conception ;
- 28,8 millions d'euros ont été engagés pour le tri à la source et la valorisation des biodéchets. L'aide est répartie thématiquement de la façon suivante : 55 % pour la collecte séparée de biodéchets, 14 % pour la gestion de proximité, 12 % pour le compostage centralisé et enfin 8 % pour le désemballage/déconditionnement de déchets organiques emballés ;
- 936 000 euros ont été engagés pour l'action « tri hors foyer ». Celle-ci vise à développer le déploiement du tri sélectif dans les espaces publics.
Bilan quantitatif du plan de relance
en
matière de soutien à l'économie circulaire
Sur la période 2021-2022, le plan de relance aura ainsi permis de :
- soutenir la modernisation de 26 centres de tri des emballages ménagers et des papiers représentant une capacité de tri d'environ 850 000 tonnes, dans le cadre de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques ;
- soutenir la modernisation d'une cinquantaine de centres de tri de déchets d'activités économiques et de déchèteries professionnelles correspondant à une capacité de 1,3 million de tonnes de déchets ;
- soutenir plus de 100 organisations (y compris les collectivités locales) pour déployer plus de 15 000 points de tri sélectif installés dans les espaces publics ;
- soutenir 130 dossiers de valorisation organique des biodéchets des activités économiques, soit 460 000 tonnes de biodéchets supplémentaires valorisés à terme, et 402 collectivités locales pour le développement du tri à la source des biodéchets, permettant à plus de 5,5 millions d'habitants supplémentaires d'être couverts par un système de tri à la source ;
- soutenir 325 structures (dont 178 entreprises d'économie sociale) dans leurs projets de développement du réemploi et de la réparation ;
- soutenir près de 500 dossiers pour la réduction, la réutilisation ou le développement de solutions alternatives au plastique, qui permettront à terme d'éviter près de 640 millions d'unités d'emballages plastiques à usage unique ;
- soutenir plus de 350 dossiers (études et investissements) de recyclage des plastiques correspondant à terme à 800 000 tonnes de capacités de traitements de déchets plastiques et/ou de réincorporation de plastiques recyclés.
Source : réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial
Dans l'ensemble, les financements du plan de relance n'étaient pas différents de ceux du fonds économie circulaire, la Cour des comptes indiquant notamment que la mesure « soutien à l'économie circulaire et aux circuits courts » a consisté « principalement à abonder les fonds préexistants de l'Ademe dans ce domaine. »62(*) À l'instar de nombreuses politiques du plan de relance, l'enjeu n'était pas tant de financer de nouvelles politiques que de mettre en avant des aides - en principe temporaires - pour faire face à la crise. Un tel procédé venait remettre en cause le principe de spécialité budgétaire, et son utilité pour la lisibilité du soutien aux politiques publiques n'était pas avérée. Il a été critiqué à plusieurs reprises sur ce fondement par la commission des finances63(*).
D. FRANCE 2030 : UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS SYMPTOMATIQUE DE L'ÉCLATEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Deux appels à projets France 2030 sont en lien avec la thématique de l'économie circulaire : le recyclage des plastiques et la mise en place de solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité et de la réincorporation des matériaux. Le premier a été lancé en 2022, et il est doté de 430 millions d'euros, tandis que le second a été engagé en 2021, et son enveloppe (120 millions d'euros) est aujourd'hui presque entièrement consommée.
L'Ademe est opérateur de France 2030 pour le soutien à l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'elle assure l'instruction, la contractualisation et le suivi des deux appels à projets précités. L'opérateur participe également aux comités de pilotage interministériels opérationnels mensuels chargés du suivi de la stratégie, sous l'égide du secrétariat général pour l'investissement (SGPI).
Les deux appels de projets de France 2030
Appel à projets « Recyclage des plastique et élastomère »
Cet appel à projets vise à sécuriser l'accès aux matières premières, en mobilisant les matières issues du recyclage. Il s'inscrit dans le cadre stratégie nationale « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux ».
L'appel à projets vise spécifiquement le recyclage des déchets plastiques, élastomères et composites, au regard des faibles performances actuelles de recyclage de ces types de déchets. L'enjeu est également de favoriser leur incorporation en veillant à ce qu'ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. En complémentarité du recyclage mécanique, qui représente actuellement 99 % du recyclage des plastiques en France, l'appel à projets vise également à développer le recyclage chimique ou enzymatique.
Appel à projets « Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux »
L'appel à projets a été lancé à la fin de l'année 2021, d'abord au fil de l'eau, puis avec une gestion sous forme de relèves (six entre juillet 2022 et janvier 2024). Il vise à sélectionner des projets de démonstrateurs développant de nouveaux produits, technologies, modèles d'affaires ou services permettant de développer le recyclage, en distinguant quatre étapes :
- conception des produits : les variables déterminantes concernent la prise en compte de la recyclabilité des matériaux et produits au moment de leur conception ;
- collecte et tri des déchets : les variables identifiées concernent la capacité à augmenter les taux de collecte, y compris au sein des filières REP. L'appel à projets vise également à l'amélioration des technologies et à renforcer l'industrialisation de celles qui sont aujourd'hui à l'état pilote comme par exemple pour les textiles ;
- préparation de la matière : il s'agit de produire des matières premières recyclées de qualité environnementale et sanitaire suffisante, maîtrisée et constante, pour approvisionner les entreprises françaises et les marchés à l'export ;
- réincorporation de la matière : développement, renforcement et adaptation de l'outil industriel pour contribuer à améliorer la substitution dans la durée aux matières premières vierges.
Source : réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial
Les programmes de France 2030, bien qu'ils relèvent d'une mission à part, financent des projets d'une nature proche du fonds économie circulaire, comme l'a indiqué l'Ademe au rapporteur spécial : « les programmes France 2030 et fonds économie circulaire visent les mêmes objectifs de valorisation matière de déchets jusqu'ici peu recyclés, en visant la complémentarité des cibles selon la maturité technologique et la taille des projets. »64(*) L'agence précise néanmoins que les projets du versant « solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux » n'ont pas d'équivalent dans le cadre du fonds économie circulaire ni du fonds vert.
Toutefois, même si certaines mesures financées n'ont pas d'équivalent, cela ne signifie pas qu'elles n'auraient pas pu l'être par le fonds économie circulaire. En outre, l'Ademe indique également que certains dispositifs issus du plan de relance, comme le dispositif Orplast, seront poursuivis via France 2030, ce qui contribue encore à brouiller la lisibilité de la maquette budgétaire.
Plus largement, le financement de cette politique au sein des plans d'investissement d'avenir est symptomatique de l'éclatement des crédits budgétaires en soutien à l'économie circulaire. Cette dispersion des financements de l'économie complique le travail de suivi du Parlement, comme c'est d'ailleurs le cas de l'ensemble des politiques financées par France 203065(*).
II. IL EST NÉCESSAIRE QUE LA MONTÉE EN PUISSANCE DES FILIÈRES REP S'ACCOMPAGNE D'UNE RÉDUCTION DE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT DANS LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
A. UNE POLITIQUE DONT LES MOYENS ONT CONNU UNE FORTE HAUSSE DEPUIS LA PANDÉMIE
La diversification des enveloppes visant à subventionner l'économie circulaire s'est accompagnée d'une augmentation des moyens de cette politique. Le plan de relance a ainsi conduit à une très forte augmentation des financements pour l'économie circulaire, passant de 175,9 à 399,1 millions d'euros (+ 126,9 %). Comme de nombreuses politiques de France Relance, une partie de ces crédits nouveaux ont été pérennisés : le montant du fonds économie circulaire a été rehaussé à environ 300 millions d'euros, et des financements pour la gestion des biodéchets ont été inscrits sur le fonds vert.
En parallèle, les subventions de France 2030 ont connu une montée en puissance au cours des dernières années, passant de 14,3 millions d'euros en 2019 à 86,4 millions d'euros en 2024.
Financements de l'État pour l'économie circulaire depuis 2015
|
Fonds économie circulaire |
Plan de relance |
Fonds Vert |
Projets d'investissements d'avenir / France 2030 |
Total |
Total hors PIA / France 2030 |
|
|
2015 |
186,9 |
0 |
0 |
29,8 |
216,7 |
186,9 |
|
2016 |
182,1 |
0 |
0 |
20,6 |
202,7 |
182,1 |
|
2017 |
165,9 |
0 |
0 |
23,4 |
189,3 |
165,9 |
|
2018 |
149,6 |
0 |
0 |
12 |
161,6 |
149,6 |
|
2019 |
164,6 |
0 |
0 |
14,3 |
178,9 |
164,6 |
|
2020 |
164,6 |
0 |
0 |
11,3 |
175,9 |
164,6 |
|
2021 |
163,4 |
220,7 |
0 |
15,0 |
399,1 |
384,1 |
|
2022 |
166,9 |
248,8 |
0 |
23,3 |
439,0 |
415,7 |
|
2023 |
303,0 |
13,3 |
60,5 |
83,8 |
460,6 |
376,8 |
|
2024 |
301,3 |
0 |
46,4 |
86,4 |
434,1 |
347,7 |
Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction générale de la prévention des risques
Évolution des crédits de l'État consacrés au soutien à l'économie circulaire
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction générale de la prévention des risques
Les données pour 2025 ne sont pas indiquées dans le graphique et le tableau précédents, faute de ventilation a priori des crédits consacrés au soutien à l'économie circulaire pour le fonds vert ainsi que pour France 2030. Le montant exact des sommes consacrées à cette politique ne pourra donc être constaté que lors de l'exécution de ces crédits. Il est cependant attendu une baisse significative des crédits en 2025. La loi de finance initiale pour 2025 a inscrit 170 millions d'euros sur le fonds économie circulaire, contre 300 millions d'euros les deux années précédentes. En tenant compte des financements du fonds vert et de France 2030, les subventions consacrées à l'économie circulaire devraient néanmoins restées supérieures à ce qu'elles étaient avant la pandémie.
B. FACE AUX CONTRAINTES BUDGÉTAIRES, TRANSFORMER LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN UN PRÊT À TAUX ZÉRO
En tout état de cause, l'augmentation des moyens jusqu'en 2022 pouvait s'entendre dans un objectif de relance de l'économie, mais sa pérennisation soulève des questions. Malgré la baisse des financements constatée entre 2022 et 2024 (de 415,7 à 347,7 millions d'euros, soit une diminution de 16,4 %), les subventions étaient demeurées encore très supérieures à ce qu'elles étaient avant la pandémie : elles sont de 347,7 millions d'euros en 2024 contre 164,6 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 111,2 %66(*).
Cette progression est d'autant plus paradoxale qu'en parallèle, la loi Agec a conduit à une forte augmentation du nombre de filières REP tout en étendant leur rôle. Il aurait été logique, dans le prolongement du principe pollueur-payeur, qu'à mesure que les producteurs eux-mêmes prennent de plus en plus en charge les coûts de gestion des déchets, les dépenses de l'État en soutien à l'économie circulaire puissent diminuer, dans la mesure où le fonds économie circulaire n'a pas vocation à intervenir dans les domaines couverts par les REP.
Interrogée sur ce paradoxe par le rapporteur spécial, l'Ademe a relevé que « les filières REP n'ont pas vocation, à date, à financer majoritairement l'investissement (au profit des soutiens au fonctionnement via la collecte et la prise en charge des couts de traitement des déchets en opérationnalité, ou en financement des collectivités). Le cas est inverse pour le fonds économie circulaire, qui soutient principalement l'investissement. » L'opérateur relève d'ailleurs que les filières REP « garantissent des flux dans les installations de recyclage. Ce n'est pas suffisant pour déclencher des investissements dans des capacités additionnelles. »67(*) Ainsi, le fait que les filières REP ne financent pas l'investissement contribuent à ce que le fonds économie circulaire comble un « vide » en intervenant, dans la pratique, dans l'ensemble des champs du traitement et de la prévention des déchets.
Les investissements dans les chaufferies à CSR par exemple, même si elles ne correspondent pas spécifiquement à certaines filières REP, offrent des débouchés pour les producteurs, et donc constituent indirectement des investissements qui bénéficient aux filières REP.
Le rapporteur spécial propose, dans la suite du rapport, de permettre aux filières d'assurer elles-mêmes les besoins en investissement pour gérer leurs déchets, avec un contrôle étroit de l'État pour s'assurer que ces investissements ne conduisent pas à des distorsions de concurrence.
En attendant que les filières REP puissent prendre en charge de tels investissements, ce qui peut potentiellement prendre plusieurs années, il est nécessaire de prévoir une phase de transition au cours de laquelle l'État continue de subventionner des projets en matière d'économie circulaire, mais à une échelle plus réduite, et avec des outils qui permettent une aide plus adaptée à la nature des projets. L'enjeu est d'identifier toutes les marges d'optimisation possibles.
À ce titre, un mécanisme intéressant est celui des prêts à taux zéro (PTZ). Si le PTZ le plus connu est celui qui est destiné à l'achat immobilier dans le neuf, il existe d'autres dispositifs, comme l'éco-PTZ pour la rénovation énergétique. Le rapporteur spécial a par ailleurs proposé l'instauration d'un prêt à taux zéro pour aider les particuliers à financer des travaux de prévention des risques, dans son rapport sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturels (« régime CatNat »)68(*). Ce dispositif a d'ailleurs été repris à l'article 7 de la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime CatNat, et celui-ci a fait l'objet d'un soutien du Gouvernement dans le cadre de l'examen en séance publique au Sénat.
L'avantage du PTZ est qu'il permet d'amorcer des projets, en leur faisant bénéficier d'un taux d'intérêt très avantageux par rapport au marché, tout en évitant un subventionnement direct de l'État, qui conduit nécessairement à transférer une partie du risque de l'entreprise à l'État. Par conséquent, il est un outil efficace pour limiter les effets d'aubaine.
Le PTZ est également une solution plus protectrice des finances publiques. Un prêt à taux zéro est déjà mis en oeuvre dans le domaine de la rénovation énergétique. Bien que l'éco-PTZ « rénovation énergétique », ait connu une progression importante sur les dernières années, passant de 35 574 éco-PTZ émis en 2019 à 82 049 en 2022, son coût est resté mesuré pour la puissance publique (42 millions d'euros en 2023, contre 39 millions d'euros en 2019), surtout en comparaison des subventions « MaPrimeRénov », qui ont représenté plus de 2 milliards d'euros en 2023.
Ce dispositif serait dans un premier temps déployé à une échelle réduite, afin d'en évaluer les coûts pour les finances publiques.
Il faut préciser en outre que cette recommandation ne concerne par les collectivités territoriales d'outre-mer. En raison du retard dans la mise en place des installations de traitement des déchets ainsi que du faible développement des filières REP, des subventions directes de l'État restent nécessaires dans ces territoires.
Recommandation : Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro pour les projets dont la rentabilité est longue. Dans un premier temps, ce dispositif serait déployé à petite échelle pour en évaluer les coûts.
TROISIÈME
PARTIE
PERMETTRE AUX FILIÈRES REP D'ASSUMER
LEURS
RESPONSABILITÉS
Malgré la loi Agec, le système des filières REP est resté à « mi-chemin ». Leurs missions ont été étendues, notamment dans les champs de l'éco-conception, du réemploi et de la réparation, et des objectifs ambitieux ont été énoncés. Toutefois, le modèle des REP n'a jamais réellement basculé du soutien au fonctionnement à la collecte à l'investissement. Les nouveaux outils de la loi Agec se sont concentrés sur des dispositifs à forte visibilité médiatique, comme les fonds réparation, sans néanmoins que les débouchés de ces politiques aient clairement été identifiés.
Par conséquent, les résultats des filières REP en la matière ont systématiquement été inférieurs aux objectifs, voire quasi inexistants dans certains cas. En parallèle, la trésorerie des filières a fortement progressé, les charges pour provisions futures ayant atteint la moitié du montant des éco-contributions en 2022, ce qui pose tout d'abord un problème en termes de gestion financière, et peut ensuite conduire à renforcer la méfiance envers l'ensemble du système des REP.
Le rapporteur spécial appelle à repenser l'investissement des REP dans un cadre général. Le risque est en effet que les éco-contributions progressent de plusieurs milliards d'euros, sans que les résultats des actions des éco-organismes ne soient clairement identifiables, ce qui conduirait inévitablement le secteur à une crise d'ampleur. Il importe donc que la trésorerie des REP soit mobilisée pour mener ces investissements.
Ce changement de paradigme devra également permettre à l'Etat de se désengager du soutien à l'économie circulaire et au traitement des déchets. En effet, le principe du « pollueur-payeur » ne s'arrête pas aux dépenses de fonctionnement, mais il doit aussi concerner l'ensemble des coûts relatifs à la gestion de la fin de vie des biens.
I. LES FILIÈRES REP N'ONT PAS ATTEINT LEURS OBJECTIFS
A. PLUS DE LA MOITIÉ DES FILIÈRES REP N'A PAS ATTEINT LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LES CAHIERS DES CHARGES
1. Un risque de décorrélation entre la progression des éco-contributions et le taux de collecte et valorisation
La question de savoir si le montant des éco-contributions a progressé plus rapidement ou non que les taux de collecte, de valorisation et de recyclage ne fait pas encore entièrement consensus.
Les inspections générales ont notamment déterminé qu'à l'échelle de l'ensemble des éco-organismes entre 2010 et 2022, les tonnages collectés ont connu une augmentation proche de celle des éco-contributions. En revanche, la croissance des tonnages recyclés et valorisés a été inférieure à la progression des éco-contributions.
Évolutions des éco-contributions, de
la collecte,
de la valorisation globale et du recyclage (base 100 à
partir de 2010).
(en millions d'euros pour les éco-contributions, et en kilotonne pour les autres données)
Source : « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », Inspection générale des finances (IGF), Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), Conseil général de l'économie (CGE), juin 2024, page 58 de l'annexe II
À titre d'exemple, pour la filière des éléments d'ameublement, le coût par tonne produit mis sur le marché a quasiment doublé entre le premier agrément (2012-2017) et le troisième (2024-2029), passant de 64 euros / tonne à 124 euros / tonne. Ainsi, sur la période 2024-2029, 770 millions d'euros d'éco-contributions supplémentaires sont demandés par rapport à l'agrément de 2018-2023 pour un tonnage pris en charge qui augmente de 1,1 mégatonne, ce qui représente un coût de la tonne marginale de 700 euros.
Comparaison entre les éco-contributions
appelées et les taux de collecte
et de valorisation de la
filière REP des éléments d'ameublement
|
Période |
Focus |
Éco-contributions appelées (en milliards d'euros) |
Tonnages mis en marché (en Mégatonnes) |
Taux de collecte |
Taux de valorisation |
Coût technique (en euros / tonne mise sur le marché multiplié par le taux de collecte) |
Coût par tonne produit mis sur le marché (euros/ tonne) |
|
2012-2017 (1er agrément) |
Collecte et valorisation |
0,74 |
11,5 |
34 |
87 |
189 |
64 |
|
2018-2023 (2e agrément) |
Matières recyclées et éco-conception |
1,62 |
18,1 |
48 |
94,5 |
186 |
90 |
|
2024-2029 (3e agrément) |
Réemploi et réparation |
2,39 |
19,2 |
54 |
97 |
230 |
124 |
Note : l'éco-organisme Ecomaison a indiqué au rapporteur spécial que le coût technique et le coût par produit mis sur le marché du 3e agrément sont respectivement de 192 euros par tonne et 102 euros par tonne en déduisant les inflations et charges liées aux obligations issues de la loi Agec et du dernier cahier des charges.
Source : commission des finances, d'après des données transmises par France industrie et Ecomaison
Les inspections générales relèvent que dans cette filière, la hausse des éco-contributions s'explique en partie par une augmentation de 28,5 % du nombre d'adhérents à l'éco-organisme Éco-mobilier en 2022 par rapport à 202169(*). L'évolution de la contribution en euro par tonne de produit neuf résulte en outre à la fois de l'effet volume (augmentation des quantités de déchets collectés) ainsi qu'à un effet prix, lié aux obligations additionnelles notamment issues de la loi Agec (fonds réemploi, fonds réparation...).
Plus généralement, une partie de la décorrélation entre l'évolution des contributions et les quantités de déchets valorisés et recyclés est attendue, et ne signifie pas nécessairement que les éco-organismes et les systèmes individuels ont perdu en efficacité. À mesure que le taux de valorisation et de recyclage progresse, les déchets qui restent à être traités sont les plus coûteux et difficiles.
Il est estimé que pour respecter les objectifs des cahiers des charges entre 2022 et 2030, il faudrait une multiplication par cinq des tonnages collectés. Le risque est donc réel que la progression des éco-contributions devienne décorrélée de la progression des taux de collecte et de valorisation dans les années à venir.
2. Les objectifs de collecte et de recyclage ne sont pas atteints pour plus de la moitié des filières REP
Lorsque l'on prend comme référence les objectifs réglementaires, le bilan des filières REP est décevant. Au niveau global, en 2023, 40 % du gisement de déchets soumis à une REP échappait encore à la collecte, ce qui représentait 6,6 millions de tonnes de déchets. En effet, sur les 8 filières qui disposent d'un objectif de collecte, seules trois l'ont accompli en 2023, et une filière ne l'a atteint que pour l'une de ses deux sous-catégories.
Tableau des objectifs de collecte des filières REP en 2023
|
Filières |
Objectif de collecte (milliers de tonnes, sauf précision contraire) |
Collecte effective (milliers de tonnes, sauf précision contraire) |
Taux d'accomplissement |
|
Éléments d'ameublement |
1260,3 |
1292,2 |
102,5 % |
|
Bateaux |
8 769 unités |
2 928 unités |
33,4 % |
|
Dispositifs médicaux perforants (standards) |
1,09 |
1,12 |
102,8 % |
|
Dispositifs médicaux électroniques |
0,09 |
0,06 |
66,7 % |
|
Équipements électriques et électroniques ménagers |
1 159,6 |
844,5 |
72,8 % |
|
Équipements électriques et électroniques professionnels |
247,5 |
165,2 |
66,7 % |
|
Lubrifiants |
182,7 |
239 |
130,8 % |
|
Piles et accumulateurs portables |
16,7 |
20,1 |
120,4 % |
|
Pneus |
556,5 |
533,1 |
95,8 % |
|
Textiles, linges, chaussures |
279,0 |
267,9 |
96,0 % |
Note 1 : les filières « dispositifs médicaux performants » et « dispositifs médicaux électroniques » sont des sous-catégories de la filière des dispositifs médicaux. De même, les filières équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels sont deux sous-catégories d'une seule filière.
Note 2 : concernant la filière « équipements électriques et électroniques professionnels », le « mémo REP 2023 » de l'Ademe présente un objectif pour cette filière, mais le cahier des charges de la filière ne mentionnait des objectifs de collecte qu'à partir de l'année 2024.
Source : commission des finances, d'après le « Mémo REP 2023 » de l'Ademe
Alors qu'un tiers des filières atteignaient leurs objectifs en 2022, le taux est de 44 % en 2023 (en comptant la filière des dispositifs médicaux comme une « demi-réussite »). La filière ameublement en particulier a atteint son objectif de collecte en 2023, alors que ce n'était pas le cas l'année précédente. Cependant, le seuil de la moitié des filières ayant atteint leurs objectifs n'est toujours pas atteint.
Tableau des objectifs de recyclage des filières REP en 2023
(milliers de tonnes)
|
Filières |
Objectif de recyclage |
Recyclage effectif |
Taux d'accomplissement |
|
Ameublement |
627,0 |
543,4 |
86,7 % |
|
Emballages ménagers |
4110,0 |
4122,0 |
100,3 % |
|
Lubrifiants |
179,3 |
181,9 |
101,5 % |
|
Papiers |
976,3 |
955,3 |
97,8 % |
|
Produits chimiques cat. 3 à 10 |
2,5 |
1,85 |
74 % |
Source : commission des finances, d'après le « Mémo REP 2023 » de l'Ademe
Ainsi, la conjonction de la non-atteinte des objectifs inscrits au niveau réglementaire, avec dans le même temps une augmentation du volume des éco-contributions sans que les débouchés ne soient clairement visibles, peut conduire à rendre l'ensemble du système des filières REP de moins en moins acceptable pour les producteurs.
Le rapport de Marta de Cidrac et Jacques Fernique rapporte ainsi que « cette hausse exponentielle engendre, comme le relèvent le Medef et France Industrie devant les rapporteurs, un manque d'acceptabilité de la part des producteurs, qui ne perçoivent pas une amélioration équivalente des performances environnementales des filières. »70(*)
La loi Agec avait tenté de remédier à cette difficulté en étendant les capacités des filières REP, avec les éco-modulations et les fonds destinés au réemploi et à la réparation. Toutefois, ces nouvelles politiques n'ont pas davantage produit les effets escomptés.
B. LE MÉCANISME DES ÉCO-MODULATIONS PRÉSENTE DES LIMITES INTRINSÈQUES
L'obligation de moduler les éco-contributions est prévue à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi Agec. Cette modulation doit s'appliquer « lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles » pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, la durabilité et la réparabilité, etc.
L'article 541-10-3 indique que cette modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance, et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en éloigne. Depuis la loi Agec, il est par ailleurs précisé que « les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. »71(*)
Les éco-organismes peuvent fixer librement le montant des primes et des pénalités, sous réserve de certaines limitations prévues par la loi Agec. Tout d'abord, les primes et pénalités doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ensuite, sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
Enfin, la modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement, et elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Toutefois, il est impossible en l'état actuel du droit d'imposer une modulation aux filières REP qui ne la pratiquent pas72(*).
La possibilité de moduler les
éco-contributions est relativement large puisque, en théorie,
elle peut aboutir à accorder une prime qui dépasse le coût
de l'éco-contribution. Ainsi, selon la direction générale
de la prévention des risques, « ce dispositif a
visé à déverrouiller l'éco-conception des produits
en déplaçant son équilibre économique :
les producteurs de produits les plus vertueux peuvent
bénéficier d'une prime d'un montant supérieur à
celui de leur
éco-contribution. »73(*)
Bien que l'éco-modulation soit en principe obligatoire, seules 15 filières REP sur 22 l'ont mise en place. En outre, les inspections générales relèvent qu'au 1er juillet 2023, seules trois filières74(*) avaient mis en place des modulations formulées en tant que primes ou pénalités en valeur absolue. Depuis le 1er janvier 2025, l'éco-modulation appliquée aux équipements électriques et électroniques est également définie indépendamment du montant de l'éco-contribution.
Tableau des éco-modulations de la
filière
des équipements électriques et
électroniques
(en euros)
Note : DEEE = déchets d'équipements électriques et électroniques. MPR = matière première recyclée.
Source : note technique « Primes et pénalités applicables aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers à compter du 1er janvier 2025 »
Dans les autres cas, la modulation est calculée en fonction d'un pourcentage de l'éco-contribution, allant de son exonération à son doublement, ce qui signifie notamment qu'elle ne peut jamais représenter un gain net pour le producteur. Or, toujours selon les inspections générales, « d'après un échantillon constitué par la mission, l'éco-contribution ne représente qu'une faible proportion du prix du produit neuf : la médiane se situe à 0,6 % du prix du neuf »75(*).
Néanmoins, même si l'effet sur le prix final du bien est limité, l'Ademe a rappelé au rapporteur spécial que pour un producteur, une différence de quelques centimes sur plusieurs millions de biens peut faire une différence réelle, et donc être un signal pour l'éco-conception. Cependant, comme cela a été vu supra, le coût d'un bien intégrant des matériaux recyclés peut aisément dépasser le double de celui qui n'utilise que de la matière vierge. L'Ademe a ainsi indiqué au rapporteur que « les premières expérimentations sur la modulation des éco-contributions ont montré qu'une variation de 20 à 50 % du montant de l'éco-contribution était insuffisante afin d'envoyer un signal fort aux metteurs en marché, et in fine incitatif à changer leurs modes de production. »76(*)
L'effet de l'éco-modulation sur le comportement des producteurs demeure donc limité, et le rapport des inspections générales en concluaient que « l'éco-modulation n'est pas un instrument efficace pour inciter les metteurs en marché à l'intégration de matériaux recyclés dans leurs produits »77(*).
Certains estiment alors que le problème est que les possibilités ouvertes par la loi Agec ne sont pas suffisamment exploitées, c'est à dire que l'on devrait généraliser le principe des primes d'un montant supérieur à celui des éco-contributions, et inversement, renforcer les pénalités pour les producteurs qui continueraient à adopter des modes de conception peu durables. L'Ademe compare un tel système au cas d'une entreprise qui percevraient des aides publiques : « ils [les producteurs] pourraient ainsi toucher une prime supérieure à ce qu'ils ont versés comme éco-contributions, ou être pénalisés dans une ampleur bien plus grande que celle-ci. De la même façon qu'une entreprise peut percevoir plus d'aides publiques qu'elle ne paie d'impôts par exemple. »78(*)
Toutefois, le collectif des éco-organismes a ainsi déclaré devant le rapporteur spécial que leurs membres s'opposaient aux primes dépassant le montant des éco-contributions, assimilables à des « éco-contributions négatives », dans la mesure où leur généralisation pourrait menacer l'équilibre économique des filières REP : « l'éco-contribution recouvre notamment des coûts incompressibles comme les coûts de collecte, de tri et de traitement, ainsi que les coûts des obligations d'agrément portés par chacune des filières concernées. L'incorporation de matière plastique recyclée, bien que vertueuse, n'efface pas ces charges fixes et ne présume pas de l'allongement de la durée de vie du produit ou de sa meilleure recyclabilité. »79(*)
Il est indéniable qu'une généralisation des primes supérieures aux éco-contributions ne serait pas soutenable pour les éco-organismes : si une majorité d'entreprises privilégiaient des modes de production plus vertueux, les éco-contributions pourraient, à terme, finir par ne plus compenser les primes. C'est pour cette raison précisément que le rapport de Marta de Cidrac et de Jacques Fernique recommande d'interdire les « éco-contributions négatives », et donc de limiter l'avantage pour les producteurs à l'exonération complète de l'éco-contribution : « encadrer les mécanismes de modulation des éco-contributions, en prévoyant explicitement que le montant des primes perçues par les producteurs ne peut excéder celui des contributions versées, afin de préserver l'équilibre financier du système et d'éviter tout effet d'aubaine. »80(*)
Une autre option serait d'augmenter en parallèle les pénalités pour les producteurs, mais des malus trop importants feraient sans doute l'objet de nombreux contentieux. En outre, comme le rappelle le rapport des inspections générales, lorsque la chaîne de valeur du produit est de dimension internationale, l'existence d'une éco-contribution, même modulée, sur le produit fini pour le seul marché français ne peut pas suffire à faire évoluer les modalités de production81(*). Le rapport précise que « cette limite concerne notamment les filières des équipements électriques et électroniques, du textile et des pneumatiques. »82(*) C'est par ailleurs l'une des raisons pour laquelle la loi limite la portée des pénalités à 20 % du prix de vente hors taxe du produit.
Les effets du système des éco-modulations resteront nécessairement limités, et il n'est donc pas réaliste de faire reposer la majorité de l'organisation des filières sur ce mécanisme. Il peut servir d'appui à une stratégie d'investissement ambitieuse, mais il ne saurait s'y substituer.
Il convient par ailleurs de s'assurer que ces éco-modulations ne soient pas supportées par les consommateurs, toujours dans le respect du principe du « pollueur-payeur » : ce sont avant tout les entreprises elles-mêmes qui doivent prendre en charge. Le rapporteur spécial réitère ainsi son opposition à leur mention explicite dans la facture des biens.
C. LES FONDS RÉPARATION ET RÉEMPLOI / RÉUTILISATION DEMEURENT À L'ÉTAT EMBRYONNAIRE
1. Les fonds réparation et réemploi / réutilisation sont très loin d'atteindre leurs objectifs
Le pilotage des fonds « réemploi » et « réutilisation » par les éco-organismes est l'un des aspects les plus controversés de la politique de l'économie circulaire. La principale critique porte sur le risque de conflit d'intérêt : la gouvernance des éco-organismes est assurée par les producteurs eux-mêmes, et les objectifs de ces fonds, en l'occurrence l'allongement de la durée de vie des produits, pourrait conduire à une perte de recettes pour les producteurs. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a confirmé qu'il s'agissait d'un risque possible : « un risque de conflits d'intérêt voire de pratiques anti-concurrentielles semble exister du fait même du rôle dévolu aux éco-organismes en matière d'économie circulaire (lutte contre le gaspillage, réemploi, réparation, économie de la fonctionnalité...) alors que ceux-ci ont par construction dans leur conseil d'administration des fabricants et vendeurs de produits neufs. Or, le gisement de produits réemployables ou de déchets réutilisables, comme les modèles alternatifs d'économie de la fonctionnalité, concurrencent directement le marché de produits neufs. La plupart des adhérents des éco-organismes n'ont donc pas intérêt à ce que les alternatives à l'achat neuf supplantent leur marché de produits neufs, ou en tout cas si cela doit se faire (puisque la loi AGEC fixe désormais des objectifs) ils peuvent souhaiter que ce soit à leur initiative (diversification des acteurs du neuf vers la seconde main, le reconditionné ou la réparation, par exemple) plutôt qu'au profit de concurrents historiques ou nouveaux entrants spécialistes de ces alternatives. »83(*)
Les fonds réparations et réemploi / réutilisation sont prévus respectivement aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 du code de l'environnement. Dans les deux cas, ces fonds peuvent ensuite faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière, et même entre filières REP différentes, sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
Les fonds réparation doivent obligatoirement être mis en place par chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel, quelle que soit la filière. En revanche, les fonds réemploi et réparation ne doivent obligatoirement être mis en place que pour six filières84(*). Les autres filières gardent néanmoins la possibilité de le faire, mais il apparaît qu'aucune ne l'a décidé à ce jour.
La loi précise que pour les filières listées, les montant du fonds réemploi / réutilisation ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions perçues.
Dans tous les cas, les fonds réparation et remploi / réutilisation doivent être dotés des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs prévus dans les cahiers des charges des filières REP. Lorsque ceux-ci ne sont pas atteints, l'éco-organisme doit augmenter la dotation des fonds « à proportion des objectifs non atteints »85(*).
Une spécificité des fonds réemploi / réutilisation est que sont éligibles aux crédits versés par ces fonds uniquement les entreprises qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire86(*), et qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation. Ces entreprises doivent également répondre à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement, et ses activités doivent « respecter un principe de proximité » (article L. 541-10-5), ce qui se traduit par la fixation d'une « distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations » (article R. 541-156 du code de l'environnement). Pour les fonds réparation, tout type d'entreprise est éligible.
Les fonds réparation et réemploi / réparation n'ont pas atteint leurs objectifs. En ce qui concerne les premiers, d'après les chiffres calculés à partir du montant des éco-contributions en 2023, seule la filière des équipements électriques et électroniques a atteint l'objectif prévu à l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, c'est-à-dire que les ressources ne peuvent être inférieures à 5 % du montant des éco-contributions perçues. Pour les filières des articles de bricolage et de jardin ainsi que des éléments d'ameublement, la mise en place des fonds réemplois / réutilisation demeurent d'ailleurs à un niveau embryonnaire, ceux-ci ne représentant respectivement que 9,2 % et 20,8 % des objectifs.
Il faut par ailleurs rappeler qu'il s'agit d'un seuil, et que le respect de l'esprit de la loi Agec conduirait plutôt à ce que ces fonds dépassent ces objectifs minimaux.
Comparaison entre les objectifs minimaux
d'abondement
des fonds réemploi / réutilisation et le montant
effectif de ces fonds en 2023
(en millions d'euros)
|
Filière |
Réalisation |
Objectif minimal |
Taux de réalisation de l'objectif minimal |
|
Équipements électriques et électroniques |
16,2 |
16,2 |
100 % |
|
Articles de sport et de loisirs |
1,3 |
1,64 |
79,3 % |
|
Articles de bricolage et de jardin |
0,1 |
1,09 |
9,2 % |
|
Jouets |
0,5 |
1,5 |
33,3 % |
|
Éléments d'ameublement |
3,2 |
15,4 |
20,8 % |
|
Textiles, linge et chaussures |
4,5 |
5,1 |
88,2 % |
Note : Refashion, pour la filière « textiles, linge et chaussures » a indiqué au rapporteur spécial qu'ils considèrent comme devant être inclus au sein de cet objectif les mesures « réemploi actions complémentaires », d'un montant supplémentaire de 3,67 millions d'euros.
Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe
Les chiffres ne sont pas meilleurs pour les fonds réparation, la principale raison étant le retard dans leur mise en place. En 2022, la seule filière pour laquelle les fonds réparations étaient opérationnels était celle des équipements électriques et électroniques.
Les fonds réparation des filières « textiles, linges et chaussures », « éléments d'ameublement » et « jouets » ne sont lancés que depuis 2023, tandis que les fonds de la filière « articles de bricolage et de jardin » et « articles de sport et de loisir » datent de 2024.
Il apparaît ainsi que les fonds réparation ont été nettement sous-exécutés : de 2022 à 2024, seuls 30 % de l'enveloppe des fonds de réparation a ainsi été dépensée, entraînant des reports significatifs. Le rapport de Marta de Cidrac et Jacques Fernique précise ainsi que « sur 2025, 140 millions d'euros sont budgétés pour l'ensemble des filières, mais, avec le report des années précédentes, le total atteint 350 millions d'euros. »87(*)
Or, comme pour le reste des politiques de soutien à l'économie circulaire, le fonds réparation est censé monter fortement en puissance au cours des années à venir, les montants totaux inscrits dans les cahiers des charges devant passer de 90,8 millions d'euros en 2023 à au moins 226,4 millions d'euros en 2027.
Montants annuels à consacrer aux fonds de
réparation
pour l'atteinte des objectifs mentionnés
dans
les cahiers des charges
(en millions d'euros)
|
Filière |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Part des éco-contributions consacrée au fonds réparation lors de l'atteinte du montant cible (2027) |
|
Équipements électriques et électroniques |
66,8 |
92,3 |
109,6 |
120,8 |
129,0 |
N.A. |
21,4 % |
|
Articles de sport et de loisirs |
7,2 |
10,0 |
14,4 |
18,0 |
21,6 |
N.A. |
29,2 % |
|
Articles de bricolage et de jardin |
3,2 |
4,8 |
6,3 |
7,9 |
9,5 |
N.A. |
17,8 % |
|
Jouets |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
N.A. |
N.A. |
0,4 % |
|
Éléments d'ameublement |
6,2 |
7,3 |
14,8 |
22,2 |
29,6 |
37,0 |
8,1 % |
|
Textiles, linge et chaussures |
7,3 |
14,7 |
22,0 |
29,3 |
36,7 |
44,0 |
12,9 % |
Source : « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 7 de l'annexe II, d'après les cahiers des charges des filières
Montants annuels à consacrer aux fonds de
réparation
et aux fonds de réemploi et réutilisation
pour l'atteinte des objectifs mentionnés
dans les cahiers des charges
pour cinq filières REP
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, d'après « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 7 de l'annexe II, d'après les cahiers des charges des filières
Les bonus réparations
Le bonus réparation est prévu par la loi AGEC et est déployé depuis décembre 2022. Son financement repose entièrement sur les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes agréés par l'État
Le bonus réparation couvre toutes les pannes sauf le remplacement d'une pièce esthétique, une pannée liée à l'environnement d'utilisation (défaut électrique, défaut d'évacuation, interopérabilité avec d'autres équipements, etc.), ou un usage non-conforme de la part du consommateur. L'appareil ne doit plus être couvert par une garantie et disposer d'un numéro d'identification (/IMEI). Le bonus réparation est appliqué directement sur la facture à condition d'avoir fait réparer l'appareil chez un réparateur labellisé QualiRépar.
71 catégories de produits sont éligibles au bonus, contre une trentaine seulement fin 2023. Ainsi, les machines à coudre peuvent bénéficier du bonus depuis le 1er janvier 2025. Le montant de ce dernier varie de 60 euros (les téléviseurs - le montant du bonus a été doublé en janvier 2024) à 15 euros. Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant du bonus est indépendant du prix initial de l'appareil ou de sa fréquence d'achat au sein des ménages. Le montant du bonus réparation est toujours au moins égal à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits.88(*)
Exemple de bonus réparation en euros au 30 septembre 2025
Source : Commission des finances à partir du site ecosystem.eco
En complément, le Gouvernement a mis en place le 7 novembre 2023 un bonus réparation sur le textile et les chaussures reposant sur le même principe que le bonus réparation sur les appareils électroniques et d'électroménagers. Le dispositif a été élargi, en février 2025, à l'ensemble des produits de la filières TLC (textile, linge de maison et chaussures).
La réparation doit coûter au minimum 10 euros TTC pour que le bonus s'applique et ne doit pas concerner des vêtements en cuir et en fourrure naturelle, ou encore des vêtements techniques de sport à usage non quotidien (chaussures de ski par exemple). Il est possible d'effectuer plusieurs réparations subventionnées sur un même vêtement ou une même paire de chaussures, à condition que le montant total de la remise ne représente pas plus de 60 % du prix de la réparation.
Montant du bonus réparation de la REP
textile, linge, chaussure en euros
selon la nature de la
réparation
Source : refashion.fr/bonus-reparation
1 546 points de réparations sont labellisés dans toute la France fin 2024 pour la filière TLC dont 569 sont identifiés comme des metteurs en marché.89(*) La relative complexité du processus de labellisation puis de remboursement freine l'accès des réparateurs indépendants au bonus.
Les critères de labellisation des réparateurs comportent l'engagement de fournir une garantie commerciale d'au moins trois mois au client bénéficiant de la réparation, l'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation et des conditions de qualification professionnelle.
Le processus de labellisation diffère selon les filières. Les éco-organismes sont chargés de prévoir, en fonction d'un cahier des charges, le processus de labellisation, y compris son éventuel coût pour le réparateur. L'accès au bonus sur l'ensemble du territoire métropolitain dépend fortement des règles de labellisation. Ainsi, le dispositif de labellisation QualiRépar a été simplifié en 2024, permettant de remplacer l'audit physique des sites de réparation par un audit documentaire pour les petites entreprises de moins de 11 personnes.
Afin d'être remboursé des bonus réparation versés à ses clients, le réparateur labellisé doit fournir une copie des factures liées aux opérations de réparation concernées. Le remboursement du réparateur doit intervenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la facture.
Bilan des bonus au 31 décembre 2024
Source : Commission des finances à partir des rapports d'activité 2024 d'ecosystem et Refashion
L'ADEME propose une carte du bonus réparation qui met à disposition la liste des magasins et réparateurs agréés partout en France (cordonniers, couturiers, magasins, ateliers, techniciens réparateurs, etc.). Si c'est outil est nécessairement un plus pour améliorer le taux de recours au dispositif en agrégeant les informations pour le consommateur, il reste perfectible comme en atteste la recherche ci-dessous.
Source : Commission des finances. Requête effectuée le 4 octobre sur les sites Le Bonus réparation - ADEME - Particulier et Trouver un réparateur labellisé près de chez moi | Refashion
2. Malgré les insuffisances, il est préférable pour des raisons juridiques que les éco-organismes conservent la gestion de ces fonds
Il est probable dans ces conditions que les objectifs ambitieux inscrits dans les cahiers des charges ne seront pas atteints.
Face à ce constat, plusieurs propositions ont été formulées pour confier la gestion de ces fonds à d'autres acteurs que les éco-organismes. Les inspections générales défendent la solution d'un transfert de ces fonds à l'Ademe, au motif notamment que l'opérateur gère déjà le fonds économie circulaire90(*), tandis que Marta de Cidrac et Jacques Fernique soutiennent que leur pilotage devrait être confié aux régions, afin « de renforcer leur efficacité, de mieux les ancrer dans les territoires, et de prévenir les blocages liés aux intérêts financiers des filières. »91(*)
Interrogé sur cette dernière proposition, Régions de France a indiqué au rapporteur spécial que cette recommandation « constitue une hypothèse de travail intéressante pour renforcer les liens entre les éco-organismes et la région au regard la compétence de planification déchets »92(*) et que « pour que les régions puissent statuer, il conviendrait d'approfondir la réflexion sur les modalités de gestion envisageables et la latitude donnée aux régions dans la gouvernance et la définition des stratégies à mettre en place en régions pour favoriser la réparation et le réemploi »93(*). Une telle proposition est cohérente avec les compétences des régions.
Toutefois, confier les fonds réparation et emploi à d'autres personnes que les éco-organismes eux-mêmes pourrait conduire à déresponsabiliser ces opérateurs. Plus fondamentalement, retirer les fonds de réemploi et de réparation des éco-organismes reviendrait à les priver d'une partie des leviers de l'allongement de la durée de vie du produit ou de l'emballage, sachant que les éco-modulations ont nécessairement une portée limitée. Un tel système ne serait donc envisageable qu'à la condition de repenser radicalement le fonctionnement des filières REP, au risque sinon que les éco-organismes deviennent des « coquilles vides ».
En outre, le transfert des fonds réparation et réemploi à des personnes publiques, comme les régions ou l'Ademe, pourrait soulever des difficultés juridiques. À l'heure actuelle, les éco-contributions ne sont pas considérées comme des taxes, dans la mesure où elles sont la « contrepartie » du service rendu par les éco-organismes. Si les éco-organismes ne devaient plus gérer ces fonds, il y aurait une véritable possibilité pour que les éco-contributions soient requalifiées en imposition de toute nature, ce qui aurait notamment pour conséquence de renforcer l'application de certains principes constitutionnels sur les éco-contributions, comme l'égalité devant les charges publiques.
À titre d'exemple, le Conseil d'État, dans sa décision du 28 décembre 2017 précitée, a estimé que « la requérante ne peut utilement soutenir qu'en n'étendant pas cette obligation [l'éco-contribution] à d'autres personnes, notamment les particuliers qui mettent sur le marché des bateaux d'occasion, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques »94(*).
La transformation des éco-contributions en imposition de toute nature signifierait également, au titre de l'article 34 de la Constitution, qu'elles ne pourraient être instaurées que par la loi, et non pas par décret, comme c'est possible à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil d'État, dans sa décision du 18 décembre 2017, a considéré que « le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire a, par le décret attaqué, incompétemment instauré une contribution, doit être écarté »95(*).
Pour l'ensemble de ces raisons, bien que les objectifs n'aient manifestement pas été atteint, le rapporteur spécial demeure favorable à un maintien des fonds réemploi et réparation dans le giron des éco-organismes, pour éviter de diluer les responsabilités. Il est préférable de continuer à inciter les éco-organismes à investir dans ces fonds par un contrôle renforcé et des sanctions plus dissuasives en cas de non-respect du cahier des charges ou de pratiques anti-concurrentielles.
Il revient en effet à l'administration de définir les lignes directrices et les modalités d'usage de ces fonds par les éco-organismes, ce qui inclut notamment le déploiement du fonds sur le territoire, le barème des soutiens, ainsi que le type de réparation ou de réemploi à soutenir. Des organes, comme le comité national de la réparation, peuvent être utilisés pour définir ces lignes directrices parmi l'ensemble des parties prenantes, dont les régions.
II. LES FILIÈRES REP ONT UN POTENTIEL DE FINANCEMENT LARGEMENT INEXPLOITÉ
A. LA TRÉSORERIE DES FILIÈRES REP N'EST PAS SUFFISAMMENT MOBILISÉE
La trésorerie des filières REP, comprise comme l'accumulation de réserves financières, se matérialise principalement par les provisions pour charges futures. Les éco-organismes ont en effet la possibilité de différer leurs dépenses, afin notamment de pallier le décalage entre l'encaissement des éco-contributions et la mise en oeuvre des mesures d'aide à la collecte et de soutien aux collectivités territoriales. L'autorité de la concurrence les définit de la manière suivante : « ces provisions pour charges futures traduisent dans les comptes de l'éco-organisme en N+1, le solde positif entre les contributions reçues des metteurs en marché et les soutiens versés aux collectivités. »96(*)
Ce mécanisme n'est pas illégitime en tant que tel, et l'autorité de la concurrence rappelle d'ailleurs que ces provisions permettent aux éco-organismes de continuer à honorer leurs obligations contractuelles en cas de difficultés, et en déduit que « cette garantie contre les aléas économiques et financiers paraît très largement justifiée par les objectifs environnementaux poursuivis par la loi. »97(*) Les éco-organismes sont par ailleurs satisfaits de ce mécanisme.
Distinction entre provision pour charges futures et trésorerie
La provision pour charges futures est un mécanisme propre aux filières REP qui permet de sécuriser le financement des engagements futurs, couvrir les aléas liés à l'évolution des volumes/coûts/réglementations et garantir la soutenabilité économique du modèle dans la durée, le tout sous contrôle du censeur d'Etat. La trésorerie, quant à elle, représente les fonds immédiatement disponibles, permettant de payer les fournisseurs/salaires/impôts, financer les investissements à court terme, répondre aux besoins de liquidité. Contrairement à la provision pour charge future, la trésorerie n'est pas affectée à des obligations spécifiques et ne reflète pas une anticipation des charges.
Source : contribution de la filière des équipements électriques et électroniques
Cependant, le montant des provisions pour charges futures a fait régulièrement l'objet de critiques de la part des organismes de contrôle. La Cour des comptes, dans son rapport public annuel de 2016, a formulé des observations particulièrement incisives sur les provisions pour charges futures des éco-organismes : « la Cour constate que certains éco-organismes ont une pratique extensive de ce mécanisme comptable qui les conduit à constituer des provisions dont le montant cumulé est trop important, voire non justifié au regard de leurs dépenses », et après ce constat, les magistrats financiers rendent une conclusion sans appel : « une telle situation ne peut perdurer, les éco-organismes n'ayant pas vocation à être des gestionnaires de fonds, alors que les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur. »98(*)
Bien qu'il en ait fait la demande auprès du collectif des éco-organismes, le rapporteur spécial n'a malheureusement pas obtenu les chiffres des provisions pour charges futures de 2024 ou 2023. Les chiffres disponibles les plus récents sont donc ceux cités pour l'année 2022 par le rapport des inspections générales.
Le montant total des provisions pour charges futures atteignait un milliard d'euros au terme de l'exercice 2022 pour les 18 éco-organismes pour lesquels la donnée était disponible, ce qui représentait en moyenne 8,2 mois de leurs charges de l'année 202199(*). La médiane est de 6,8 mois et les provisions se situent entre un minimum de 2,2 mois et un maximum de 15,9 mois de charges de l'année 2021100(*). Ce montant d'un milliard d'euros correspond également à environ la moitié du montant des éco-contributions collectées.
Au demeurant, le rapporteur spécial n'a pas eu connaissance au cours de ses travaux que le montant des provisions pour charges futures aurait drastiquement diminué en 2023 et 2024. Au contraire, le delta entre les éco-contributions perçues par les éco-organismes en 2023 et leurs dépenses (coûts opérationnels et soutiens versés aux collectivités territoriales) pourrait indiquer une progression de cette trésorerie : alors que cet écart était de 242 millions d'euros en 2022, il a progressé en 2023, pour atteindre 306,6 millions d'euros.
Différence entre dépenses et
recettes des éco-organismes
des filières REP en
2023
(en millions d'euros)
|
Type de produit |
Éco-contributions perçues par les éco-organismes |
Coûts opérationnels des éco-organismes |
Soutiens versés aux collectivités |
Différence entre les montants perçus, les coûts opérationnels et les soutiens versés |
|
Piles et accumulateurs portables |
19,8 |
16,4 |
- |
3,4 |
|
Équipements électriques et électroniques ménagers |
323,1 |
418,8 |
34,8 |
- 130,5 |
|
Équipements électriques et électroniques professionnels |
25,9 |
33,7 |
- |
- 7,8 |
|
Emballages ménagers |
983,8 |
- |
784,5 |
199,3 |
|
Médicaments |
13,1 |
9,4 |
- |
3,7 |
|
Pneumatiques |
100 |
93 |
- |
7 |
|
Imprimés papiers ménagers et assimilés |
68 |
- |
71 |
- 3 |
|
Textiles d'habillement, linge de maison, chaussures ménagères |
101,5 |
57,4 |
0,9 |
43,2 |
|
Dispositifs médicaux perforants des patients en auto-traitement (y compris les dispositifs électroniques) |
13,5 |
4,1 |
- |
9,4 |
|
Produits du tabac |
15,4 |
- |
20,8 |
- 5,4 |
|
Produits chimiques, déchets diffus spécifiques |
55 |
50,8 |
- |
4,2 |
|
Éléments d'ameublement |
308,3 |
299,4 |
44,4 |
- 35,5 |
|
Navires de plaisance ou de sport |
1,4 |
1,8 |
- |
- 0,4 |
|
Huiles lubrifiantes |
39,6 |
- |
0,2 |
39,4 |
|
Produits et matériaux de construction du bâtiment |
120,8 |
10,6 |
- |
110,2 |
|
Articles de sport et de loisirs |
32,8 |
3,6 |
0,37 |
28,83 |
|
Articles de bricolage et de jardin |
21,8 |
3,5 |
0,4 |
17,9 |
|
Jouets |
30,4 |
1 |
0,04 |
29,36 |
|
Total |
2272 |
946 |
962 |
306,6 |
Note : ce tableau ne permet pas de déterminer le niveau de la trésorerie des éco-organismes ni celui des provisions pour charges futures. En effet, les éco-organismes peuvent mobiliser leurs charges de provisions, ce qui explique que certaines dépenses soient supérieures aux recettes, comme c'est le cas de la filière des équipements électriques et électroniques ménagers. En outre, ce tableau n'inclut pas certaines dépenses des filières REP, comme les fonds réemploi et réparation, les redevances envers l'Ademe, ainsi que les actions communication et sensibilisation.
Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe
En tout état de cause, une telle situation n'est pas davantage acceptable aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016. Il n'est pas compréhensible qu'autant d'argent soit immobilisé alors que les objectifs des cahiers des charges ne sont pas atteints. La protection face aux aléas ne justifie pas la constitution de réserves aussi importantes.
En outre, la constitution d'une trésorerie importante peut conférer un avantage concurrentiel pour les éco-organismes présents depuis longtemps sur le marché, comme le relevait déjà l'avis de l'Autorité de la concurrence de 2016, qui indiquait qu'« il serait souhaitable de prévoir une traçabilité de ces provisions, une modalité de restitution simple et rapide et, à tout le moins, un mécanisme d'arbitrage pour éviter des retards ou des manoeuvres dilatoires préjudiciables à la concurrence. Il est possible qu'une disposition législative soit nécessaire pour encadrer les modalités contractuelles de restitution. »101(*)
Bien que l'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que les éco-organismes sont « tenus de transférer [aux producteurs] la part de leurs contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'organisme »102(*), seul le cahier des charges des éco-organismes de la filière des batteries mentionne le provisionnement pour charges futures dans ce contexte et l'encadre.
D'une manière générale, il n'existe aucun encadrement au niveau de l'ensemble des REP de la possibilité de provisionner pour les éco-organismes, comme le relève d'ailleurs le rapport des inspections générales : « les éco-organismes ont la possibilité, actuellement non encadrée, de différer leurs dépenses. Les sommes non dépensées sont inscrites en provisions pour charges futures. »103(*) Dans la pratique, les cahiers des charges prévoient en général des seuils et plafonds des provisions pour charges futures, mais ils ne mentionnent pas l'usage, ni la restitution de ces sommes.
Les remarques que formulaient la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2016 restent ainsi applicables aujourd'hui : « le mode de fixation de ces seuils par les ministères chargés de l'agrément est particulièrement disparate, voire arbitraire, selon les filières et même selon les éco-organismes, et leur non-respect n'a fait l'objet, à ce jour, que d'observations écrites. »104(*)
Au regard de tous ces éléments, le rapporteur spécial préconise un encadrement au niveau législatif et réglementaire de la trésorerie et des provisions pour charge futures de l'ensemble des filières REP.
Recommandation : Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.
B. LES FILIÈRES REP DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES VERS LE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
À l'heure actuelle, les filières REP ne sont pas focalisées sur l'investissement, car leur modèle est basé sur le principe d'un soutien avant tout à la tonne de déchets collectés, et ensuite à leur valorisation, recyclage et réemploi. Ce soutien est censé couvrir à la fois les frais directs des opérateurs, ainsi que les amortissements des installations, mais il n'est pas adapté à la mise en place d'une véritable stratégie d'investissement.
La loi Agec avait tenté d'amorcer une ouverture des filières vers l'investissement, en étendant le champ de leurs missions non plus seulement à l'élimination des déchets, mais également au soutien à l'éco-conception et à l'allongement de la durée de vie des produits. Toutefois, ces nouvelles dispositions législatives n'ont pas réellement conduit à la mise en place de dispositifs incitant les filières REP à l'investissement à grande échelle.
La mise en oeuvre de la loi Agec s'est plutôt concentrée sur les dispositifs les plus symboliques, et les plus susceptibles d'être connus du grand public, tels que le fonds réparation, mais dont l'extension à grande échelle s'est révélée irréaliste, comme cela a été vu supra.
S'agissant de l'éco-conception, les objectifs promus par la loi Agec sont demeurés flous. Le collectif des éco-organismes a indiqué au rapporteur spécial que « les éco-organismes financent des centres de tri et de recyclage de manière à atteindre la performance règlementaire de recyclage mais aussi améliorer en continu la valorisation des matières première en misant sur l'innovation et la prévention amont (éco-conception) »105(*). Toutefois, il n'est pas évident que l'ensemble de ces financements correspondent réellement à de l'investissement, et qu'ils soient bien distingués des autres politiques de l'économie circulaire.
Ainsi, la puissance publique a continué à prendre en charge majoritairement les investissements. La politique de soutien aux installations utilisant des CSR est emblématique de ce point de vue : elle représente un débouché significatif en aval pour les déchets générés par les metteurs en marché, et elle a fait l'objet de soutiens publics massifs sur les dernières années. Ce sont des politiques qui auraient pu s'inscrire dans une stratégie d'investissement ambitieuse organisée par les filières elles-mêmes.
Ce constat doit une nouvelle fois être mis en perspective avec la montée en puissance des filières REP dans les prochaines années. Même si les subventions par la puissance publique étaient maintenues à leur niveau actuel, celles-ci seraient très loin d'être suffisantes pour couvrir l'ensemble des investissements rendus nécessaires pour répondre aux objectifs définis par la loi Agec et au niveau européen. À ce titre, faire basculer les filières REP d'une logique de soutien au fonctionnement à celle d'une stratégie d'investissement n'est plus seulement une option, mais une obligation.
Le rapporteur spécial préconise ainsi de permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, à subventionner directement des installations strictement pour l'atteinte des objectifs réglementaires.
Il convient de rester vigilant, dans l'application de cette préconisation, à ce que les éco-organismes ne deviennent pas propriétaires des capacités industrielles de recyclage, car cela pourrait soulever des difficultés au niveau concurrentiel.
Une telle recommandation suppose également un contrôle renforcé de la part des services de l'État, pour éviter tout biais et mauvaises pratiques dans les investissements. Ce contrôle, qui n'est aujourd'hui pas satisfaisant, fait l'objet de plusieurs recommandations du rapporteur spécial (cf. infra).
Recommandation : Permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, pour subventionner des installations permettant l'atteinte des objectifs réglementaires.
QUATRIÈME
PARTIE
UNE RATIONALISATION INDISPENSABLE
DU CONTRÔLE DES
FILIÈRES REP
La non-atteinte des objectifs fixés dans la loi et dans les cahiers des charges ainsi que les crises récentes ont révélé les insuffisances du contrôle des REP. Les sanctions sont en effet rares, et peu dissuasives, en raison notamment d'une procédure qui demeure particulièrement complexe.
Cependant, au-delà de la procédure elle-même, l'organisation du contrôle est défaillante. La mission de suivi et de supervision des filières REP est en effet répartie entre plusieurs administrations, qui ne disposent pas des mêmes pouvoirs, et qui n'ont pas accès aux mêmes données. Une rationalisation de l'ensemble du système de contrôle des filières REP est donc indispensable.
A. LE CONTRÔLE DES FILIÈRES REP : DES SANCTIONS RARES, INEFFICACES ET DES PROCÉDURES TROP COMPLEXES
Il convient de distinguer deux types de contrôles : ceux relatifs aux non-contributeurs à une filière REP de ceux relatifs au respect par les éco-organismes des prescriptions et objectifs qui s'imposent à eux.
1. Une réforme du contrôle des non-contributeurs est en cours
L'identification des non-contributeurs relève en premier lieu des éco-organismes, tandis que la gestion des sanctions relève quant à elle de la direction générale de la prévention des risques (DGPR). 205 dossiers ont été transmis par les éco-organismes, et ils ont conduit à l'émission de 172 courriers de rappel réglementaire, conformément à la procédure prévue à l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement. Ces courriers de rappel réglementaire ont conduit à la mise en conformité de 55 non-contributeurs.
Concernant les non-contributeurs pour lesquels la procédure de rappel réglementaire ne s'est pas suivie d'une mise en conformité, l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement prévoit la possibilité de prononcer à leur encontre une amende ou une astreinte dont le montant est déterminé en tenant compte d'une part des quantités mises sur le marché rapportées à la durée du manquement et d'autre part de la contribution financière établie par les éco-organismes agréés de la filière et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur cette même filière.
Ainsi, la DGPR a sanctionné sept non-contributeurs pour lesquels une estimation des mises sur le marché était réalisable et dont le manquement était particulièrement significatif. En l'espèce, selon la DGPR, « il leur a été infligé une astreinte journalière redevable jusqu'à la transmission d'une attestation de régularisation (adhésion à un éco-organisme agréé ou agrément en tant que système individuel). »106(*)
Interrogée sur le délai que prenait en moyenne le contrôle des non-contributeurs, la DGPR a répondu que ce « délai est très variable selon les dossiers », car il dépend de nombreux paramètres, tels que la qualité du dossier transmis par l'éco-organisme, la complexité d'identification du producteur au sens de la REP au regard des montages juridiques mis en place par certaines sociétés, ainsi que la capacité d'estimer le montant des contributions, au regard de la complexité des barèmes définis par certains éco-organismes.
Pour remédier à cette situation, un travail est en cours entre la DGPR et l'Ademe, en lien avec les éco-organismes, pour améliorer le processus de traitement des signalements des éco-organismes et pouvoir s'appuyer sur les moyens humains dont dispose l'Ademe.
Selon la DGPR, l'objectif de ce travail est d'identifier les processus que l'agence pourrait mettre en place pour procéder à l'instruction des dossiers transmis par les éco-organismes, et ainsi en fiabiliser les éléments afin que les procédures de sanctions à l'encontre des non-contributeurs puissent ensuite être actionnées. Il s'agit ainsi, au-delà du renforcement du dispositif de sanction à l'encontre des non-contributeurs, d'améliorer la qualité des éléments sur lesquels se basent les sanctions afin que celles-ci soient robustes en cas de contentieux.107(*)
Enfin, une évolution législative est en cours d'examen afin de permettre les échanges de données entre administrations, notamment avec les Douanes, afin de fiabiliser l'évaluation des tonnages mis sur le marché par les non-contributeurs (article 1er bis A de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile).
2. Le contrôle des éco-organismes doit être simplifié et renforcé
Le contrôle des éco-organismes comprend deux procédures dédiées. La première concerne le manquement à une obligation de moyen, et elle porte sur l'absence de mise en place des prescriptions du cahier des charges de la filière, ou sur leur mauvaise application. La seconde procédure est activée lorsque l'éco-organisme n'atteint pas les objectifs assignés par la loi ou les dispositions réglementaires du cahier des charges108(*).
Dans le premier cas, le ministre chargé de l'environnement, ou le directeur général de la prévention des risques par délégation de signature, doit aviser l'éco-organisme des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Ce dernier dispose alors d'un mois pour présenter ses observations, écrites ou orales.
Une fois ces observations transmises, la direction générale de la prévention des risques procède à une instruction si les faits reprochés sont avérés. Le ministre chargé de l'environnement peut mettre en demeure l'éco-organisme de se conformer à cette prescription dans un délai compatible avec son exécution.
Une fois le délai échu, et si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, le ministre chargé de l'environnement - en pratique le DGPR, par délégation de signature - peut alors sanctionner l'éco-organisme. Les sanctions peuvent alors prendre les formes suivantes :
- le paiement d'une amende administrative, qui ne peut excéder 10 % du montant annuel des charges de gestion de déchets déduction faite des recettes tirées de cette gestion ;
- l'éco-organisme peut être obligé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites ;
- une astreinte journalière de 20 000 euros maximum ;
- la suspension ou le retrait de l'agrément à l'éco-organisme.
Lorsque l'éco-organisme n'atteint pas les objectifs fixés par le cahier des charges, l'autorité administrative doit également aviser l'éco-organisme des faits qui lui sont reprochés et lui proposer de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et ces engagements doivent être réalisés dans un délai de dix-huit mois.
En cas de non-respect de ces engagements, le ministre chargé de l'environnement ou le DGPR doit alors engager une procédure contradictoire avec l'éco-organisme afin que celui-ci soit en mesure de faire part de ses observations et c'est à l'issue de cette procédure que des sanctions peuvent être proposées, celles-ci pouvant prendre la forme d'une amende administrative, du paiement d'une astreinte journalière (dont les montants sont identiques à ceux de la procédure précédente) ou d'une suspension ou du retrait de l'agrément à l'éco-organisme (ou au système individuel).
Jusqu'à présent, deux éco-organismes ont fait l'objet d'une sanction, relevant respectivement de la première et de la seconde procédure :
- Alcome a été sanctionné à hauteur de 466 000 euros pour le non-respect du cahier des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs de tabac ;
- Dastri a été sanctionné à hauteur de 450 000 euros pour manquement aux objectifs de collecte définis dans le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement.
Le rapport des inspections générales fait ainsi le constat que « Ces pouvoirs de sanctions sont peu ou pas mis en oeuvre. »109(*) Il faut souligner qu'au moment de la rédaction de ce rapport, aucune sanction pour défaut de résultat n'avait encore été prononcée, l'amende envers Dastri ayant été confirmée en décembre 2024. Les inspecteurs précisent néanmoins que « pour de nombreuses filières, tout ou partie des objectifs ne sont pas atteints de manière récurrente depuis plusieurs années »110(*). Pour rappel, la moitié des filières REP n'atteignent pas les objectifs fixés dans leurs cahiers des charges.
En outre, certaines sanctions sont inadaptées. L'astreinte journalière de 20 000 euros notamment peut représenter une somme conséquente pour les plus petits éco-organismes, alors qu'elle serait bien moins efficace pour les plus importants, tel que Citeo, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse le milliard d'euros. Il serait plus pertinent de moduler cette astreinte selon les ressources de l'éco-organisme.
De plus, lorsqu'une filière comprend un seul éco-organisme, le retrait d'agrément n'est pas crédible car cela reviendrait à suspendre l'ensemble de la filière REP dans un secteur, ce que relevait d'ailleurs la Cour des comptes dès 2016 : « la suspension ou le retrait de l'agrément est peu crédible, notamment dans les filières où un seul éco-organisme est agréé, puisque cela désorganiserait fortement la filière, aboutissant à l'effet inverse de celui recherché. »111(*) Marta de Cidrac et Jacques Fernique recommandaient ainsi de « rendre les sanctions plus dissuasives, en systématisant la publicité des sanctions prononcées et -- comme le propose la DGPR --de relever le montant des sanctions prévues »112(*), ce que partage le rapporteur spécial. Enfin, la distinction entre ces deux procédures de contrôle pourrait gagner en clarté : il ne semble pas nécessaire d'avoir deux procédures différentes, alors que les sanctions sont de nature similaire.
Recommandation : Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes ; redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.
B. LE SUIVI DES ÉCO-ORGANISMES : UNE SUPERVISION ÉTENDUE, ET UNE MUTUALISATION DES MOYENS
1. Un chantier prioritaire : la mutualisation des moyens entre les administrations en charge du contrôle des REP
Au sein de la DGPR, huit chargés de mission sont consacrés au suivi de l'ensemble des filières REP. Au-delà de la préparation des textes réglementaires indispensables à l'encadrement des filières REP, du suivi de leur mise en oeuvre par les producteurs et les éco-organismes, de la recherche et de la sanction des non-contributeurs, de la gestion des contentieux, ils assurent également des missions dans le cadre des négociations de textes européens, des travaux législatifs au niveau national.
Au total, en incluant l'ensemble des fonctions support et la chaine hiérarchique, la DGPR estime que 12,2 ETP interviennent au sein de la DGPR sur les filières REP113(*).
Quant à l'Ademe, les effectifs de la direction de la supervision des filières REP comprennent 35,9 ETPT. Son budget s'élevait à 8,7 millions d'euros. La mission de suivi et d'observation des filières REP par l'opérateur est définie de la manière suivante par l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement, dont notamment :
- la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ;
- la collecte, le traitement et l'analyse des données et informations nécessaires au suivi et à l'observation des filières REP ;
- la mise à disposition du public d'informations sur les filières.
La DGPR et l'Ademe mobilisent ainsi 48,1 ETPT consacrés aux filières REP. À ce chiffre, il faut ajouter :
- 4,6 ETPT qui relèvent de la direction générale des entreprises (DGE), qui participent au pilotage des filières REP ;
- 3,4 ETPT du Contrôle général économique et financier (CGEFi), dont le rôle principal est le contrôle du montant des barèmes des éco-contributions ;
- et enfin 0,5 ETPT pour la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour un total de 56,6 ETPT répartis entre cinq administrations.
La séparation du contrôle des filières REP entre toutes ces administrations est source d'inefficacités. Par exemple, la DGPR n'a ainsi pas un accès direct à SYDEREP, la base de données de l'Ademe, alors qu'elle détient le véritable pouvoir de sanction.
Administrations en charge du suivi des filières REP
|
Administration |
Missions |
Nombre d'ETPT |
|
Direction de la supervision des filières REP de l'Ademe |
Suivi des filières, collecte et traitement des données, élaboration d'études préalables à l'agrément des éco-organismes. |
35,9 |
|
Direction générale de la prévention des risques |
Suivi des filières, élaboration des textes, pouvoir de sanction. |
12,2 |
|
Direction générale des entreprises |
Participe au pilotage des filières REP. |
4,6 |
|
Contrôle général économique et financier |
Contrôle de la cohérence du montant des barèmes des éco-contributions |
3,4 |
|
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
Observation de l'état de la concurrence et lutte contre la fraude. |
0,5 |
Source : commission des finances
Pour remédier à ce problème, les inspections générales recommandent ainsi la création d'une nouvelle instance de régulation des REP. Si le rapporteur spécial demeure prudent quant à la création d'une nouvelle instance ad hoc, ce qui pourrait engendrer des surcoûts, il appelle à une mutualisation des moyens entre les administrations, qui passerait a minima par la possibilité pour chaque membre du personnel d'accéder à l'ensemble des systèmes d'information.
Recommandation : Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP.
2. L'analyse économique des filières REP est l'angle mort de la supervision exercée par l'État
Les différentes crises qui sont survenues au cours de l'année 2025 montrent également que la situation financière des filières REP manque de manière inquiétante de transparence. Le mouvement de grève de l'entreprise Le Relais, contre l'éco-organisme Refashion, ainsi que la crise touchant le réseau Envie, n'avaient en effet pas été anticipés par les observateurs.
L'Ademe publie tous les ans un certain nombre de documents, dont des « mémos » qui présentent les principaux chiffres de l'ensemble des filières REP114(*). Toutefois, les publications de l'Ademe ne permettent pas d'avoir une vision suffisamment précise de la situation économique des filières. En particulier, les provisions pour charges futures ne sont pas mentionnées, et l'Ademe a par ailleurs confirmé au rapporteur spécial que cela ne faisait pas partie des données récoltées par l'opérateur115(*).
Plus généralement, il n'y a pas d'analyses économiques approfondies de la situation des filières REP réalisées par les instances en charge de leur supervision, ce que déploraient par ailleurs les inspections générales, qui parlent de données « anciennes et lacunaires (absence de la dimension économique) pour permettre un pilotage fin de la performance »116(*). De manière notable, après avoir réalisé une étude comparative du recyclage et de l'évolution du montant des éco-contributions, la mission a regretté que « ces indicateurs d'efficience économique, certainement perfectibles, aient dû être calculés par la mission et ne soient pas suivis dans le temps par les instances en charge du suivi et du pilotage des filières. »117(*)
Le rapporteur spécial peut formuler le même constat. Les publications de l'Ademe ne permettent pas de déterminer les principaux postes de coûts, de recettes et de dépenses de fonctionnement d'une filière, et de déterminer si une filière est rentable ou non. Cette mission d'analyse économique relève davantage des censeurs d'État du contrôle général économique et financier (CGEFi), mais dont les moyens sont extrêmement limités (3,4 ETPT), limitant son rôle au contrôle de la cohérence des barèmes. Par ailleurs il ne semble pas qu'il existe un canal de communication direct entre cette administration et l'Ademe.
Cette absence de communication entre administrations soulève par ailleurs des difficultés s'agissant de la fixation du montant de l'éco-contribution. En effet, l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement dispose que le montant de l'éco-contribution (qui est également appelé « barème amont ») est fixé chaque année par l'éco-organisme lui-même. Toutefois, comme il existe un risque que certains metteurs en marché utilisent le barème amont pour pénaliser des produits concurrents, plusieurs garde-fous ont été mis en place :
- les barèmes amont sont indiqués dans le dossier d'agrément déposé par l'éco-organisme, ce qui donne la possibilité à l'autorité administrative de ne pas agréer un éco-organisme dont le barème défavoriserait une catégorie de metteurs en marché ;
- les censeurs d'État, qui relèvent du service du contrôle général économique et financier (CGEFi) ont pour mission de veiller à ce que les éco-organismes établissent un barème cohérent avec les objectifs du cahier des charges de la filière ;
- le comité des parties prenantes de l'éco-organisme118(*) rend un avis public sur le barème amont (article L. 541-10 du code de l'environnement).
Dans la pratique, l'Ademe est souvent conduite à proposer des lignes directrices aux éco-organismes pour la fixation des barèmes, sans toutefois disposer de l'ensemble des moyens de contrôle, et sans mener des analyses économiques approfondies elle-même.
Au sein de la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), un éco-organisme avait ainsi publié un barème qui, a posteriori, ne permettait pas d'atteindre les objectifs du cahier des charges. Les autres éco-organismes agréés au sein de cette filière ont, par conséquent, été contraints de revoir leur barème à la baisse pour conserver leurs adhérents.119(*)
L'autre exemple régulièrement cité est celui de la filière « textiles, linges et chaussures ». En 2022, aucune éco-contribution n'avait été perçue afin, conformément au cahier des charges, d'assurer la contemporanéité des mises en marché et de la perception des éco-contributions. Cette mesure a toutefois permis à l'éco-organisme Refashion de maintenir sa position dominante, qui est d'ailleurs l'une des raisons de la crise actuelle.
Dans un document transmis au rapporteur spécial, France industrie recommande ainsi de « publier le coût de chaque REP, avant chaque examen d'un projet de loi de finances, ce depuis sa mise en place et les prévisions pour le futur avec les objectifs associés de collecte et valorisation ». Une telle proposition est pertinente, et ce bilan du coût des REP pourrait enrichir les documents budgétaires. Il serait également possible de mentionner le montant de la redevance payée par les éco-organismes, et les moyens mis à disposition dans le cadre de la supervision et du contrôle des filières REP.
Recommandation : Étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information.
C. FINANCER LES BESOINS EN MATIÈRE DE SUPERVISION DES FILIÈRES REP PAR UNE HAUSSE DE LA REDEVANCE DES ÉCO-ORGANISMES.
Dans leurs réponses au questionnaire du rapporteur spécial, l'Ademe120(*) ainsi que la DGPR121(*) considèrent comme insuffisants les moyens destinés au contrôle des filières REP, et c'est un constat largement partagé par les rapports qui ont été écrits sur la question. À ce titre, les inspections générales estiment que le nouvel organisme de régulation des filières REP qu'elles appellent de leurs voeux devrait comprendre 100 ETPT, contre 56,6 ETPT actuellement. En comparaison, en Allemagne, la coordination et le contrôle de la seule filière REP emballages sont assurés conjointement par le ministère fédéral, l'agence de coordination des éco-organismes et les Länder, et implique entre 100 et 150 ETPT.
Le rapporteur spécial appelle à ce que cette hausse des moyens ne soit pas supportée par le budget de l'État, mais qu'elle soit prise en charge par les filières REP elles-mêmes, en prolongement du dispositif qui existe actuellement.
En effet, le budget de la direction de supervision des filières REP, qui dispose d'un budget annexe indépendant du budget général de l'Ademe (article L. 131-3 du code de l'environnement), est alimenté intégralement par une redevance versée par les metteurs en marché, qui transite par les éco-organismes. L'article L. 131-3 du code de l'environnement prévoit en effet que « les coûts supportés par l'agence [l'Ademe] sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret », et il précise que « le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. » En 2024, il est estimé que cette redevance a représenté 8,7 millions d'euros.
L'article R. 131-26-2 du code de l'environnement précise toutefois que « Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement ». Si l'Ademe a ainsi la main sur la détermination du montant de cette redevance, le ministre chargé de l'environnement a néanmoins la possibilité de s'opposer aux tarifs proposés, et ces tarifs doivent être élaborés selon la méthodologie suivante (article R. 131-26-3 du code de l'environnement) :
- l'Ademe doit déterminer la répartition des coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ;
- pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant doivent ensuite être répartis entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché ;
- enfin, les tarifs annuels de redevance peuvent être augmentés de 20 % au plus afin de couvrir le coût d'investissements devant être réalisés l'année suivante et nécessaires à la réalisation des prestations assurées dans le cadre de la mission de suivi et d'observation des filières REP (article R. 131-26-1 du code de l'environnement). Ce complément de redevance doit donner lieu à régularisation au plus tard l'année suivant la réalisation des investissements, compte tenu des dépenses effectivement réalisées.
Le financement de la supervision des filières REP par une redevance payée par les éco-organismes eux-mêmes est vertueux : cette idée s'inscrit dans la continuité du principe selon lequel les producteurs doivent prendre en charge eux-mêmes les conséquences du traitement des déchets. Sa mise en oeuvre a cependant été poussive.
Les éco-organismes ont contesté cette redevance dès sa mise en place par la loi Agec, et ils ont demandé au juge administratif l'annulation des arrêtés tarifaires ainsi que les titres de perception associés à cette redevance notamment au motif que le coût de la prestation fournie en contrepartie directe de la redevance ne correspondait pas au montant appelé.
Le Conseil d'État, par deux décisions n° 456806 et n° 460437 du 6 mars 2024, a rejeté l'ensemble des moyens invoqués, en précisant notamment qu'il « il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d'allocation par filière communiqués par l'ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l'ADEME au titre de sa mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie. »122(*)
L'application de la notion juridique de « redevance pour service rendu » peut sembler paradoxale dans le cadre d'une mission de suivi et de contrôle, mais comme le souligne à juste titre l'Ademe, il faut envisager le service en question non pas seulement à l'échelle des éco-organismes stricto sensu, mais de l'ensemble de l'écosystème des REP : « il est toutefois important de rappeler que le service rendu au travers de cette redevance l'est à l'ensemble de l'écosystème REP, et va donc au-delà des éco-organismes, même si ceux-ci, par simplification, sont le canal de perception de la redevance. La supervision attendue par les pouvoirs publics porte sur l'ensemble des produits soumis au principe de la REP, et non pas simplement aux flux pris en charge par les éco-organismes. »123(*)
Les inspections générales défendent davantage une restriction de la redevance qui, au lieu de couvrir l'ensemble du budget de la DSREP, ne couvrirait que les coûts de la collecte et de la communication des données, pour se conformer « aux exigences de l'article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du parlement européen et du Conseil »124(*).
L'article 8 bis de la directive 2018/851 dispose en effet que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie couvrent : [...] les coûts de la collecte et de la communication des données », mais il n'interdit aucunement de mettre en place d'autres formes de redevance. Le Conseil d'État, dans ses décisions n° 456806 et n° 460437 précitées, a d'ailleurs validé la redevance par rapport à l'ensemble du « coût des prestations assurées par l'ADEME au titre de sa mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie », ce qui recouvre l'ensemble des missions de la DSREP telles que définies à l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement.
Il n'y a donc pas d'obstacle juridique à augmenter le montant de la redevance afin de répondre aux besoins croissants en matière de suivi et de contrôle. Pour répondre aux exigences du rapport des inspections générales, il faudrait quasiment doubler la redevance, et donc la faire passer de 8,7 millions d'euros à 16 millions d'euros.
Le rapport des inspections générales avance également que la redevance pour service rendu ne permettrait pas d'exercer la supervision des REP en toute indépendance. Le risque existe, mais il ne doit pas être exagéré, et il peut être atténué par la mutualisation des moyens des administrations en charge de la supervision des REP. Un renforcement des capacités de suivi, financé par la redevance, est au contraire un gage d'indépendance.
Recommandation : Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes.
En parallèle, il serait cohérent de comptabiliser les emplois destinés à la supervision des REP dans un budget à part, afin de distinguer les ETPT financés par la redevance des éco-organismes de ceux qui relèvent du budget général de l'État. En effet, bien que l'article L. 131-3 du code de l'environnement dispose que la DSREP dispose d'un budget annexe, ses ETPT ne sont pas distingués au sein du plafond d'emploi de l'Ademe. Le rapporteur spécial appelle ainsi à revenir à l'esprit de la loi Agec, c'est-à-dire de comptabiliser ses emplois à part.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 8 octobre 2025 sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission a entendu une communication de Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial, sur le soutien de l'État à la prévention et à la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire.
M. Claude Raynal, président. - Nous entendons ce matin le rapport de Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire.
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. - L'économie circulaire est un concept assez large. Entre le Graal vers lequel il faudrait tendre - l'absence de production de déchets -, et le stockage, qui est la pire des solutions, on passe par le réemploi et la réparation, le recyclage, la valorisation énergétique et l'incinération.
Aujourd'hui, l'usage des matériaux recyclés rencontre des difficultés économiques, notamment en raison de leur surcoût significatif par rapport aux matières vierges. Par exemple, le plastique recyclé coûte en moyenne quatre à cinq fois plus cher que le plastique vierge. Il n'y a donc pas d'intérêt économique pour un fabricant à utiliser de la matière recyclée, alors que celle produite à partir de pétrole est beaucoup moins chère.
Par ailleurs, la filière, encore naissante, rencontre des difficultés, faute de massification. Sur tout un ensemble de chaînes, les volumes de produits à traiter sont encore faibles. Par exemple, la Ville de Paris est revenue sur son système de collecte des déchets alimentaires parce que les quantités étaient trop faibles et les coûts de collecte trop élevés par rapport à la valorisation qui pouvait en être faite. En outre, l'usage des combustibles solides de récupération (CSR) se heurte à un problème de compétitivité par rapport à celui des énergies fossiles, notamment le gaz.
Quand une filière n'a pas de viabilité économique à court terme, mais que l'on est persuadé qu'elle présente un intérêt à long terme, il est possible de l'aider par des fonds publics. C'est ce qui a été fait, mais le soutien est fortement émietté.
Le traditionnel fonds économie circulaire peut en théorie soutenir tout projet présentant un lien avec l'économie circulaire, du financement de chaufferies utilisant des CSR à des campagnes de sensibilisation dans les écoles.
Jusqu'en 2025, près de la moitié des crédits du fonds était allouée au recyclage et à la valorisation énergétique, avec une grande disparité dans les projets financés. L'enveloppe du fonds a été quasiment divisée par deux dans le PLF 2025, passant de 300 à 170 millions d'euros, la baisse portant principalement sur le soutien à la filière CSR, ce qui paraît logique, car c'est celle qui présente le moins d'intérêt au regard de la pyramide de l'économie circulaire.
Le deuxième outil est le fonds vert, destiné à soutenir le tri à la source des biodéchets et leur valorisation, notamment par compostage et méthanisation. Environ 100 millions d'euros ont été versés en 2023 et 2024. Mes critiques sur ce dispositif tiennent à l'émiettement de ces crédits sur la mission « Écologie », en dépit de leur objectif commun.
Il faut citer également le volet « prévention des déchets et soutien à l'économie circulaire » du plan de relance, dont les crédits ont essentiellement été engagés au cours de l'année 2021, ainsi que France 2030, qui comporte deux thématiques liées à l'économie circulaire : le recyclage des plastiques et les solutions innovantes pour la recyclabilité. Deux appels à projets ont été lancés à ce titre, l'un en 2022 pour 430 millions d'euros, l'autre en 2021 pour 120 millions d'euros.
Si l'on additionne ces soutiens publics, en 2015, l'aide s'élevait à 217 millions d'euros. Son acmé a été atteint en 2023, avec 461 millions d'euros de crédits budgétaires, avant qu'une baisse ne s'amorce en 2024, poursuivie en 2025. Je suis toutefois incapable de vous dire quelle sera in fine l'enveloppe réelle : le fonds vert n'étant pas préaffecté, il faudra attendre la loi de règlement pour 2025 pour connaître les crédits fléchés sur ce dispositif.
À côté de ces crédits budgétaires destinés à aider les filières, un principe est mis en place dans le domaine de l'écologie, celui du pollueur-payeur, qui vise à responsabiliser les créateurs d'externalités négatives. Dans le domaine de l'économie circulaire, il s'applique depuis 1992, date de création de la première filière à responsabilité élargie du producteur (REP). Depuis cette date, les filières REP ont crû assez régulièrement, avec une très forte accélération à la suite de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec). Depuis la promulgation de cette loi, dix nouvelles filières ont été créées, ce qui porte leur nombre à vingt-deux. Une filière REP oblige les producteurs qui y sont inclus à instaurer un système individuel de collecte et de traitement agréé - ce qui a été fait par exemple pour des producteurs relevant des filières des équipements électriques et électroniques, ou de celle des véhicules -, soit à mettre en place collectivement des éco-organismes agréés avec d'autres entreprises soumises aux mêmes obligations. À ce jour, vingt-sept éco-organismes exercent en France pour vingt-deux filières REP, ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs éco-organismes pour une même filière, mais aussi un seul éco-organisme pour plusieurs filières. Leur taille est très variable : le plus important, Citeo, représente 463 équivalents temps plein pour 1,3 milliard d'euros d'écocontributions sur l'exercice 2024, tandis que le plus petit, PYRéO, compte deux ETP et a collecté 0,9 million d'euros.
Ces éco-organismes sont des organismes de droit privé. Par ailleurs, comme ils ne sont pas autorisés à dégager de bénéfices, leur équilibre économique est exclusivement guidé par leurs dépenses, qui doivent répondre aux obligations d'un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'environnement. Le budget en équilibre qu'ils présentent détermine le montant de l'écocontribution, le tout étant simplement supervisé par l'Ademe.
On constate une très forte progression des écocontributions : 1,9 milliard d'euros ont été collectés en 2022, 2,3 milliards en 2024, 8 milliards devraient l'être en 2029. Ces sommes pèsent sur l'ensemble des entreprises opérant des mises sur le marché. On peut se poser la question de la soutenabilité à long terme de ce modèle, d'autant que l'écomodulation visant à récompenser les entreprises les plus vertueuses n'est proposée que par 15 filières REP sur 22. Un rapport récent de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) concluait par ailleurs que l'écomodulation n'était pas un instrument efficace pour inciter les metteurs sur le marché à intégrer des matières recyclées dans leurs produits.
On peut aussi se poser la question de la fraude. Au regard des montants collectés, est-ce que tout le monde paie ? Le contrôle est assez faible : seules sept décisions ont été prises pour imposer des amendes à des metteurs sur le marché qui n'auraient pas réglé leur écocontribution. Un travail est en cours entre l'administration des douanes et le reste du système REP pour faire coïncider les volumes mis sur le marché et les volumes d'écocontribution.
Au final, entre les quatre dispositifs de crédits budgétaires et les filières REP, nous pouvons parler d'une véritable usine à gaz. La montée en puissance des filières REP ne s'est pas accompagnée d'une diminution des subventions publiques, pour des résultats somme toute très médiocres.
Le budget de l'Union européenne pour 2021-2027 a prévu une nouvelle ressource dépendant de la qualité du recyclage du plastique dans chaque pays. Or, la France est bonnet d'âne en la matière, puisque nous payons à nous seuls 20 % de la recette plastique du budget de l'Union. Sur la période 2022-2024, cela représente tout de même 4,3 milliards d'euros. Si la France recyclait aussi bien que l'Allemagne, nous pourrions économiser chaque année 750 millions d'euros.
Nous constatons également que les outils de la loi Agec se sont surtout concentrés sur des dispositifs à forte visibilité médiatique, dont le fameux fonds réparation, qui souffre aujourd'hui d'un problème de massification et de distribution à grande échelle. Les réparateurs indépendants - cordonniers, couturiers, distributeurs de produits électroménagers hors chaîne - en sont très peu bénéficiaires, car il est très compliqué d'obtenir l'agrément.
Si, à l'échelle de l'ensemble des éco-organismes, sur la période 2010-2022, les tonnages collectés ont connu une augmentation proche de celle des écocontributions dues, la croissance des tonnages recyclés et valorisés reste beaucoup plus faible que la progression des écocontributions. En d'autres termes, nous arrivons à collecter, mais nous n'arrivons pas à transformer et réutiliser. Au surplus, en 2023, 40 % du gisement des déchets soumis à une REP échappaient encore à la collecte, soit 6,6 millions de tonnes. Sur huit filières disposant d'un objectif de collecte, seules trois l'ont atteint en 2023.
Les REP ont par ailleurs une trésorerie dormante importante : un milliard d'euros fin 2022, soit environ la moitié de ce qu'ils ont collecté. Nous n'avons pas connaissance des données pour 2023 et 2024, ce qui pose un problème de transparence, mais nous sommes certains que cette trésorerie augmente, car nous avons pu constater un différentiel de l'ordre de 300 millions d'euros entre les dépenses effectuées par les éco-organismes et le montant de la collecte.
C'est la raison pour laquelle nous préconisons notamment d'encadrer les provisions pour charges futures, en prévoyant des seuils plus contraignants et en renforçant les sanctions en cas de non-respect.
Nous voulons aussi que cette trésorerie dormante soit utilisée pour soutenir l'investissement. Si la loi Agec a prévu une réorientation des REP vers l'investissement, nous sommes aujourd'hui très loin d'avoir atteint cet objectif. Nous proposons donc que les éco-organismes puissent initier des appels à projets capacitaires permettant d'atteindre les objectifs réglementaires de réutilisation, de réincorporation et de recyclage. L'utilisation de ces crédits disponibles dans la trésorerie des REP justifierait, dans le même temps, une diminution progressive des crédits du fonds économie circulaire, moyennant deux nuances. Premièrement, ce fonds reste indispensable dans les outre-mer, où les filières REP sont très peu développées. Deuxièmement, lorsque c'est nécessaire, des dispositifs de prêts à taux zéro restent nécessaires pour financer des projets dont la viabilité économique ne pourra exister qu'à très long terme. La Caisse des dépôts et consignations pourrait aussi jouer ce rôle de financeur.
Il faut également renforcer le contrôle des éco-organismes, qui n'est pas très efficace à en croire le rapport des inspections générales. De plus, certaines sanctions sont inadaptées. Le montant de l'astreinte journalière est ainsi indépendant des fonds collectés par les éco-organismes - PYRéO est soumis au même montant d'astreinte journalière que Citeo... La sanction qui vise à retirer la labellisation de l'éco-organisme pose également problème : lorsqu'il n'y a qu'un seul éco-organisme dans une filière REP, il ne paraît pas crédible de lui retirer sa labellisation.
Je préconise donc d'adapter et de simplifier la procédure de contrôle des éco-organismes. Le rapport propose en premier lieu de mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP. Aujourd'hui, cinq structures publiques interviennent dans ce contrôle : la direction générale de la prévention des risques (DGPR), les douanes, la direction générale des entreprises, le contrôle général économique et financier et l'Ademe. Or la majorité des effectifs sont concentrés à l'Ademe et la DGPR, pourtant administration de tutelle et disposant du pouvoir de sanction, n'a pas accès à Syderep, la base de données de l'Ademe...
Le rapport propose en second lieu de renforcer le budget de ces administrations. Actuellement, dans le projet annuel de performances de la mission « Écologie », sont seulement indiqués 4 millions d'euros de recettes sont affectés à la DGPR pour financer des campagnes de communication sur le suivi des filières REP. La redevance pour le contrôle ne figure pas dans le projet annuel de performances.
La DGPR m'a expliqué que ses moyens budgétaires étaient presque entièrement consacrés à la vérification des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui accuse un retard important. Par conséquent, le suivi des filières REP n'est pas assuré. Je suggère donc de financer les moyens supplémentaires de supervision et de contrôle par une hausse des redevances des éco-organismes.
Il serait également judicieux, au sein des informations communiquées par l'Ademe sur son plafond d'emplois, d'isoler les effectifs qui s'occupent des REP, puisqu'un budget dédié est prévu par la loi Agec.
Enfin - et c'est peut-être le plus dramatique -, la supervision des filières REP ne repose aujourd'hui sur aucune analyse économique des secteurs. Une meilleure information sur les situations financières des éco-organismes et des filières soumises à ces REP est donc nécessaire. Les contentieux sont nombreux et certains acteurs font faillite, car certains dispositifs ont été conçus en faisant totalement abstraction de l'économie de la filière. On peut entendre qu'il y ait un problème de rentabilité à court terme, mais nous ne pouvons pas avoir autant d'argent qui dort dans les filières REP et des résultats aussi mauvais.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La situation est consternante. Le rapport souligne bien les carences et les insuffisances du mécanisme des écocontributions. Les entreprises sont prélevées, puis nous assistons à une fuite en avant sans contrôle, ou avec des contrôles insuffisants, sur le niveau de dépense et d'efficacité. Nous devons réfléchir à une meilleure organisation, plus fluide, avec un nombre d'intervenants plus restreint et une nouvelle allocation des ressources.
Les dispositifs que nous avons créés à une certaine époque échappent désormais au contrôle du Parlement. Quand Christine Lavarde rappelle le montant des sommes en jeu, surtout si on le projette à l'horizon 2030 en cas de poursuite de la dérive, cela donne froid dans le dos. Nous devons faire les bons arbitrages et redresser la situation. La situation de la filière des petites réparations est assez révélatrice de la dérive actuelle : en raison de la complexité du dispositif, elle n'est pas vraiment accessible, ce qui est assez incompréhensible.
Si je souscris aux propositions de notre collègue, je souhaiterais l'interroger sur sa proposition n° 1, celle du prêt à taux zéro : quel avantage cette solution présente-t-elle ?
M. Grégory Blanc. - Je remercie notre rapporteur pour la clarté de son propos et j'approuve presque toutes ses recommandations.
Je souscris à la nécessité de bien dissocier ce qui relève du recyclage de ce qui relève de la réparation ou de la refabrication. Nous devons être extrêmement clairs, car ce sont deux façons d'envisager le développement et l'industrialisation de l'économie circulaire. Les circuits logistiques et les besoins financiers ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit de transformer la matière, d'un côté, ou de transformer ou réparer un produit, de l'autre.
Autant je soutiens les recommandations 2 à 7 de votre rapport, que je voterai sans difficulté, car nous avons besoin de plus de lisibilité, de clarté et d'efficience, autant j'ai un désaccord sur la recommandation n° 1. Nous avons besoin de plus de fonds en les orientant mieux, notamment sur la refabrication et la réparation, car il est nécessaire de développer ces filières, d'innover et d'inventer. À côté, nous devons créer des véhicules financiers qui permettent aux opérateurs de supporter le poids de produits qui pèsent dans leur stock et leur bilan. Aujourd'hui, ils ont besoin d'argent et les banques, très souvent, ne veulent pas leur prêter.
L'idée des prêts à taux zéro est bonne, mais elle ne sera sans doute pas suffisante. Il faut également travailler à la question des durées d'amortissement pour les biens dits « durables ». Je ne peux donc pas voter une recommandation qui propose de prendre de l'argent à un endroit pour le mettre à un autre, alors que les enjeux d'adaptation sont considérables et qu'ils nécessitent de repenser l'ensemble de la filière. Nous avons besoin d'investir plus d'argent et de réinventer l'ensemble de nos outils.
M. Pierre Barros. - Certains parmi nous ont été sollicités par les filières du BTP, très actives sur le sujet. Nous pouvons les comprendre, car elles paient aujourd'hui la charge des REP sans avoir en retour un niveau de services adaptés aux volumes qu'elles traitent.
Lorsqu'on connaît un peu le milieu du bâtiment, on sait ce que pèse la charge des déconstructions, des déchets et de leur traitement. Le secteur a construit depuis quelques années ses propres filières de revalorisation, mais ce changement de prestataires ou d'opérateurs crée a minima un stress pour les entreprises du BTP. Le sujet est particulièrement sensible pour les très grosses entreprises. Quant aux petites entreprises et aux PME, cette réorganisation n'a pas permis de limiter les dépôts sauvages dans nos territoires. Je trouve que ces deux échelles sont à mettre en relation.
Tant qu'il n'y aura pas une filière cohérente de revalorisation et de transformation, nous pourrons bien injecter tous les millions que nous voudrons, les objectifs ne seront pas atteints.
Mme Ghislaine Senée. - Je vous remercie de mettre en avant ce sujet, car il y a un véritable problème, notamment avec les éco-organismes. Ma rencontre avec l'entreprise Le Relais m'a permis de mieux comprendre les enjeux dans la filière textile.
Il convient de bien dissocier ce qui relève du recyclage de ce qui relève du réemploi, car ce n'est pas la même chose. Le recyclage peut être automatisé et représente un investissement que l'éco-organisme devrait pouvoir financer. En revanche, le réemploi du textile demande un tri manuel. En dépit de l'intelligence artificielle et des capteurs, une expertise humaine reste nécessaire pour apprécier la qualité du tissu.
Aujourd'hui, le coût du tri est de l'ordre de 300 euros nets, mais l'éco-organisme ne le valorise qu'à hauteur de 150 euros. Il considère que, dans le cas de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire Le Relais, les recettes d'aide à l'insertion compensent la différence. Or, l'aide à la réinsertion représente également un coût - accompagnement, formation, etc. - et cette politique publique de l'emploi n'a pas à servir les filières et les entreprises qui mettent des biens sur le marché.
Ce sujet doit être réglé une bonne fois pour toutes. L'estimation réelle du coût du traitement et du tri ne peut être effectuée par les seuls metteurs sur le marché, car cela fausse la donne. Il faut revoir la gouvernance et prévoir que les opérateurs de terrain aient au moins leur mot à dire, voire soient majoritaires.
Il faudrait aussi pouvoir régler la question des matériaux qui n'ont pas d'exutoire. Il y a par exemple aujourd'hui des montagnes de textiles qui s'entassent : les metteurs sur le marché ont la responsabilité de trouver une solution et de la financer.
Contrairement à notre collègue, je ne crois pas qu'il faille baisser les crédits du fonds économie circulaire, car nous voyons bien qu'il est, dans certains secteurs, créateur d'emplois. Les prêts à taux zéro peuvent apporter une réponse, mais elle ne sera pas totale. Je ne suis donc pas favorable à cette recommandation, non plus qu'à la recommandation n° 3, car nous savons que les appels à projets empêchent les entreprises d'avoir de la visibilité pour investir sur une base pluriannuelle. J'émets enfin une petite réserve sur la recommandation n° 4 : vous avez dit qu'il s'agissait de renforcer la procédure, mais il me semble qu'il s'agit en réalité de l'adapter et de la simplifier. Quoi qu'il en soit, si nous ne retirons pas la proposition n° 1, j'aurai du mal à voter ce rapport.
M. Laurent Somon. - Je vous remercie pour ce rapport fort intéressant et je souhaite vous poser trois questions.
La première concerne les plastiques. La contribution élevée de la France est-elle due à l'utilisation de certains plastiques difficilement recyclables ou à un véritable défaut de collecte ?
La seconde porte sur l'importante trésorerie dormante dont vous avez parlé. Existe-t-il des différences entre les filières ? Certaines sont presque autonomes, comme celle du papier-carton, d'autres non. Les filières autonomes, qui sont donc en économie circulaire, bénéficient-elles d'une valorisation ? Serait-il envisageable, comme le suggère la recommandation n° 1, de leur accorder des prêts à taux zéro plutôt que de diminuer le fonds de contribution ? La crainte de ces entreprises autonomes est de payer pour les autres, qui ont encore besoin de subsides publics.
Toujours au sujet des plastiques, les organismes publics de ramassage et de traitement craignent-ils de perdre des volumes si une consigne était mise en place ? La consigne est-elle un dispositif positif pour le recyclage du plastique ou risque-t-elle de déstabiliser les services publics de ramassage et de traitement ?
Enfin, ma troisième question porte sur le fonds réparation. Dispose-t-on d'une évaluation de son coût budgétaire ? Peut-on constater par ailleurs une diminution de la consommation, notamment dans le textile ?
Mme Florence Blatrix Contat. - Ce rapport très précis dresse un état des lieux et expose les faiblesses du financement de l'économie circulaire. Cette dernière me paraît essentielle : elle peut constituer un véritable avantage comparatif pour la France, avec des entreprises capables d'exporter leur savoir-faire.
Si la collecte s'est améliorée dans notre pays, le recyclage n'est pas au niveau. Je partage l'essentiel du rapport, mais, comme d'autres collègues, je ne souscris pas à la proposition de supprimer le fonds économie circulaire. Ce fonds est notamment utilisé pour les projets de production de CSR, qui sont essentiels pour beaucoup de nos collectivités. Sa suppression serait donc un frein au financement de ces projets.
Quelles seraient les conséquences de la suppression de ce fonds, même si j'ai bien compris que les outre-mer pourraient être épargnés ? Par ailleurs, les failles de ces dispositifs ne sont-elles pas dues à une filière de recyclage insuffisamment structurée ? Que faudrait-il faire pour avoir des filières plus efficientes ?
M. Jean-Raymond Hugonet. - C'est un sujet majeur. La semaine dernière, j'ai visité l'un des plus grands sites de recyclage de France, situé à Vert-le-Grand, dans mon département, l'Essonne ; celui-ci est adossé à la Semardel, une importante société d'économie mixte.
Je félicite Christine Lavarde pour ce rapport étayé et précis.
À l'inverse de mes collègues qui viennent de s'exprimer, la présence de la recommandation no 1 m'invite à voter le rapport : c'est la plus importante - et de loin. Prévoir de l'argent est nécessaire, certes, mais nous sommes bien placés pour savoir que celui-ci ne coule plus à flots. La diminution des crédits du fonds économie circulaire sera non pas brutale, mais progressive : voilà l'intérêt de cette proposition. Ne pas adopter cette proposition serait une erreur majeure, à l'heure où nous traversons une période difficile sur le plan financier.
M. Marc Laménie. - Merci à notre rapporteur spécial pour ce travail de qualité. Plusieurs de nos collègues ont évoqué la question du textile. Les bornes de collecte débordent dans nos départements respectifs. Quelles solutions pourraient-elles être mises en oeuvre ?
Quel est le nombre d'emplois créés par les entreprises et les associations relevant de l'économie sociale et solidaire (ESS) ?
M. Christian Bilhac. - Merci à Christine Lavarde pour son excellent travail. Nous devrions consulter les archives de l'administration : les données étaient plus faciles à trouver voilà 50 ou 100 ans qu'à l'heure actuelle, époque de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Nous avons seulement accès à des données qui datent déjà de deux ou trois ans. Ce constat vaut pour tous les rapports que nous examinons.
Quelque chose m'échappe au sujet des filières. Lorsque j'ai acheté un appareil électroménager, j'ai payé l'écocontribution. De même lorsque j'ai réalisé des travaux dans ma salle de bains : c'est moi qui ai payé la mise en décharge des gravats, et non la filière.
Toutefois, les contributions payées par les citoyens, de l'ordre de 2,3 milliards d'euros, sont insuffisantes. Résultat : des financements supplémentaires, issus du fonds vert, du fonds économie circulaire, du programme d'investissements d'avenir (PIA) sont nécessaires. Pas moins de cinq entités sont chargées des contrôles : la direction de la supervision des filières REP de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la direction générale de la prévention des risques, la direction générale des entreprises (DGE), le contrôle général économique et financier (CGefi), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Une fois encore, tout le monde fait tout : c'est le bazar !
Quelle part du montant des écocontributions est-elle réellement affectée à des actions de recyclage et à l'économie circulaire ? À combien s'élèvent les montants perdus dans les méandres de toutes ces structures ? Plus personne n'y comprend rien !
Mme Sylvie Vermeillet. - Les acteurs de la filière bois estiment que le montant de l'écocontribution qu'ils devraient verser à la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) est insoutenable, alors que le bois participe de la décarbonation du bâti. Pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet ? Je rappelle que le Sénat a adopté une proposition de loi d'Anne-Catherine Loisier à ce sujet le 15 mai dernier.
M. Claude Raynal, président. - Le graphique de la page no 1 de L'Essentiel montre l'évolution constatée et la trajectoire prévisionnelle du montant des écocontributions perçues par les filières REP entre 2000 et 2028. Je regrette que celui-ci ne comporte pas l'évolution qui était prévue en 2000 : nous aurions pu comparer les différences entre la trajectoire alors prévue et ce qui s'est effectivement passé. Le graphique traduit-il une évolution normale ou un retard par rapport aux prévisions ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. - Il reflète les nouvelles obligations introduites par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Aucune prévision n'avait été élaborée avant ce texte.
M. Claude Raynal, président. - Comment vérifier année après année que les objectifs sont atteints ? Cette courbe est-elle déclinée filière par filière pour que l'administration puisse effectuer des contrôles, et, le cas échéant, imposer des corrections ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. - Vous appelez de vos voeux un contrôle de l'efficacité de la politique publique dans son ensemble. Or celui-ci est aujourd'hui vraiment déficient, car les données ne sont pas partagées et le système est très endogame. En effet, les personnes validant les écocontributions et celles chargées des contrôles sont les mêmes : elles sont juges et parties.
Le Parlement voit son contrôle plus limité, puisqu'il s'agit d'organismes de droit privé ne bénéficiant d'aucun crédit budgétaire. C'est regrettable : nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des éléments, ce qui n'est pas le cas pour les données des différents fonds publics. Ceux-ci sont toutefois sans commune mesure avec la masse d'argent collectée auprès des entreprises et utilisée pour le fonctionnement des REP, bien plus importante.
Tel est l'objet de la deuxième série de préconisations du rapport : renforcer les contrôles. Certes, la Cour des comptes a publié plusieurs rapports sur les filières, sans oublier le travail mené par les inspections générales, mais nous déplorons tous de ne pas disposer de données en nombre suffisant. C'est seulement en consultant les rapports d'activité que nous parvenons à trouver quelques éléments. Nous faisons face à un manque de transparence évident, car le système est très fermé sur lui-même, sans que l'administration puisse jouer son rôle.
Je ne pourrai pas à votre question générale sur l'économie sociale et solidaire, Monsieur Laménie, car mon contrôle porte sur l'économie circulaire : ce sont deux champs d'activité différents, même s'il peut y avoir des recoupements.
Marta de Cidrac et Jacques Fernique, membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ont mené à bien un travail très intéressant sur la mise en oeuvre de la loi Agec. Je vous invite à lire ce rapport très complet, publié au mois de juin dernier.
Monsieur Bilhac, vous avez souligné que c'était le consommateur qui payait l'écocontribution. En théorie, ce n'est pas le cas, puisque celle-ci résulte de l'application du principe pollueur-payeur. Lors de l'examen de la loi Agec, deux filières - l'ameublement et la filière électrique et électronique - ont obtenu que cette charge figure sur la facture remise au client. La filière ameublement souhaite que cette transparence perdure, alors que celle-ci devait être temporaire : les acteurs de la filière ne souhaitent pas qu'on leur impute l'augmentation du prix de vente des meubles.
Lorsque le consommateur paie, on s'éloigne du principe pollueur-payeur, dont l'objectif était d'inciter les producteurs à être plus vertueux. Le système mis en place pèse sur les entreprises, non sur les consommateurs, même si, dans les faits, les producteurs ont répercuté sur ces derniers l'augmentation des charges qu'ils supportent.
Le bonus réparation ne représente aucun coût pour le budget de l'État, puisqu'il est entièrement financé par les filières REP. Les seuls chiffres dont nous disposons montrent qu'entre 2022 et 2024, seuls 30 % des crédits prévus ont été exécutés.
La montée en charge de ces bonus a pris du temps, car il a fallu d'abord agréer les réparateurs ; puis le nombre de produits éligibles a considérablement augmenté. On peut toutefois s'interroger sur le montant des bonus, sans lien avec le prix d'achat de l'appareil. Si vous faites réparer une machine à laver classée E, qui consomme beaucoup d'eau et d'électricité, vous bénéficiez du même montant de bonus que pour une machine A+, qui ne vous a pourtant pas coûté le même prix à l'origine. Le montant du bonus est le même pour un drone et pour une bouilloire, alors que ce ne sont pas les mêmes personnes qui les achètent. Je me pose un certain nombre de questions sur la manière dont les bonus ont été fixés et sur le choix des appareils concernés. Ces éléments n'entraient toutefois pas dans le cadre de mon contrôle budgétaire, puisque nous ne sommes pas chargés d'établir le cahier des charges : c'est le travail du ministère de l'environnement.
Les questions liées à la consigne relèvent davantage de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable que de la commission des finances. Je souhaite toutefois vous apporter quelques éléments sur les catégories de plastique nous conduisant à nous acquitter d'une amende auprès de l'Union européenne. Il s'agit des bouteilles en plastique à usage unique pour boisson, des emballages plastiques ménagers hors bouteilles, et des emballages plastiques non ménagers. En réalité, ce sont quasiment tous les emballages plastiques, mais ils sont dissociés par catégories.
Je ne suis pas en mesure d'apporter des précisions sur la situation de la filière bois. En revanche, le cas de la filière BTP, en cours de négociation, est intéressant. La durée de vie des produits utilisés est très longue. Les metteurs sur le marché sont soumis à l'application du principe pollueur-payeur. Or le moment où interviendra le recyclage des produits est lointain. Les acteurs bénéficiant du soutien logistique de la REP sont les acteurs de la démolition, et non pas nécessairement ceux qui ont payé l'écocontribution à l'origine.
Le recyclage est couvert par la REP bâtiments, mais il aura été payé par d'autres. D'où des tensions pour définir le cahier des charges de cette REP. Les enjeux sont colossaux, car les volumes le sont également et la nature des acteurs est très différente entre les géants du BTP et les petits artisans, notamment dans la filière bois. Je suis bien incapable de vous dire à quoi pourrait ressembler le futur cahier des charges.
Je m'étonne du peu d'appétit de certains pour passer d'un soutien budgétaire à un soutien par les filières REP pour financer les investissements dans le domaine du recyclage. Le financement des REP repose sur le principe pollueur-payeur : on demande à ceux qui produisent des externalités négatives de les compenser. À l'inverse, le soutien budgétaire repose sur un financement par la collectivité, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens, via l'impôt.
Par ailleurs, nous faisons face à un problème de soutenabilité des finances publiques. Or nous avons constaté à de nombreuses reprises que de l'argent dormait dans ces filières. J'ai répondu à toutes vos questions que les crédits budgétaires n'avaient pas été utilisés dans leur intégralité ; il en va de même pour les sommes collectées par les filières. Je vous invite vivement à visiter les sites internet de ces éco-organismes : il y a pléthore de personnes dont je me demande ce qu'elles font. Un même éco-organisme peut ainsi disposer de deux ou trois sites internet, selon que l'on est un professionnel, un institutionnel ou un particulier.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il y a du gaspillage !
Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial. - Oui, il y a du gaspillage. C'est d'ailleurs le titre du rapport : « Éviter le gaspillage ».
M. Claude Raynal, président. - Au regard de nos débats, je vous propose de voter d'abord la recommandation no 1, puis, en un seul bloc, les recommandations nos 2 à 7.
La recommandation n° 1 est adoptée, de même que les recommandations nos 2 à 7 du rapporteur spécial. La commission a autorisé la publication de sa communication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Direction générale des outre-mer
- Mme Delphine COLLE, cheffe de bureau ;
- Mme Mathilde OUDOM, chargée de mission eau et déchets.
Direction générale de la prévention des risques
- M. Vincent COISSARD, sous-directeur de l'économie circulaire.
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- M. Romain ROUSSEL, Sous-Directeur Industrie, santé et logement ;
- M. Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique.
Agence de la transition écologique (ADEME)
- M. Baptiste PERRISSIN-FABERT, directeur général délégué ;
- M. Roland MARION, directeur économie circulaire ;
- M. Jean-Charles CAUDRON, directeur de la supervision des filières REP.
Fédération professionnelle des entreprises du recyclage
- M. Ghislain ESCHASSERIAUX, membre du GT influence de FEDERREC, directeur affaires publiques VEOLIA ;
- M. Manuel BURNAND, directeur général ;
- Mme Adèle MOTTE, responsable affaires publiques.
Collectif des Eco-organismes
- Mme Clara SELIGMANN, directrice affaires publiques de Citeo ;
- M. Jérôme D'ASSIGNY, directeur des affaires publiques, des relations aux collectivités locales & MO Chantiers de Valobat ;
- M. Laurent WILMOUTH, directeur général de Cyclamed ;
- M. Quentin BELLET, responsable des affaires publiques chez Ecologic.
Régions de France
- M. Jean-Michel BUF, conseiller régional des Pays de la Loire.
Association Amorce
- M. Nicolas GARNIER, délégué général.
Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE)
- Mme Muriel OLIVIER, déléguée générale de la FNADE ;
- Mme Lucie MUNIESA, présidente de la commission « relations institutionnelles de la FNADE » ;
- M. Ghislain ESCHASSERIAUX, président du collège « valorisation énergétique » de la FNADE ;
-Mme Sabrine BENMOUHOUB, responsable des relations institutionnelles de la FNADE.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI (TEMIS)
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
1 |
Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro dont la rentabilité est longue. Dans un premier temps, ce dispositif serait déployé à petite échelle pour en évaluer les coûts. |
Gouvernement, Parlement |
Dès 2026 |
Loi de finances |
|
2 |
Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci. |
Direction générale de la prévention des risques |
Dès que possible |
Tous moyens |
|
3 |
Permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, pour subventionner des installations permettant l'atteinte des objectifs réglementaires. |
Parlement, direction générale de la prévention des risques, Ademe |
Dès 2026 |
Loi, tous moyens |
|
4 |
Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes ; redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles. |
Parlement, direction générale de la prévention des risques |
Dès que possible |
Loi, tous moyens |
|
5 |
Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP. |
Ademe, direction générale de la concurrence, direction générale de la prévention des risques de la consommation et de la répression des fraudes, direction générale des entreprises, contrôle général économique et financier |
Dès que possible |
Tous moyens |
|
6 |
Étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information. |
Ademe, direction générale de la concurrence, direction générale de la prévention des risques de la consommation et de la répression des fraudes, direction générale des entreprises |
Dès 2026 |
Tous moyens |
|
7 |
Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes. |
Direction générale de la prévention des risques, Ademe |
Dès 2026 |
Tous moyens |
ANNEXES
ANNEXE 1 : DÉFINITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Définitions en matière d'économie circulaire
Sont distinguées ci-dessous les définitions inscrites dans le code de l'environnement, et les définitions qui ne sont pas présentes dans la loi, mais qui peuvent aider à la compréhension du sujet.
Définitions tirées de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;
Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;
Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ;
Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits.
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie ;
Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;
Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;
Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
Autres définitions
Gisement : quantité de déchets pour une période et une catégorie de déchets données. Le gisement de déchets peut être mesuré en masse ou en unités.
Valorisation énergétique : incinération de déchets avec récupération d'énergie.
Source : commission des finances d'après l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement
ANNEXE 2 : LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les non-conformités aux dispositions encadrant ou incitant au développement de l'économie circulaire sont nombreuses, mais selon la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : « peu d'entre elles s'apparentent à de véritables fraudes (au sens d'actes déloyaux ou de non-respect intentionnel de la loi visant à procurer un avantage) ». La direction cite néanmoins le cas des pratiques de greenwashing, qui peuvent constituer des fraudes en tant qu'elles constituent une mésinformation du consommateur, en précisant toutefois que « les allégations portant sur la circularité de l'économie ne semblent pas plus affectées que d'autres types d'allégations environnementales (notamment les allégations génériques) »125(*). Ainsi :
- la première amende administrative en matière de défaut d'information sur les qualités et caractéristiques environnementales a été récemment prononcée à l'encontre de l'opérateur de mode ultra-express Shein (1,098 million d'euros), mais la plupart des contrôles se soldent par des rappels à la loi et une mise en conformité rapide ;
- quant à l'indice de réparabilité, après avoir consacré ses premières campagnes de contrôle (2021-2023) à la pédagogie et au respect des obligations d'affichage, la DGCCRF a davantage orienté depuis 2024 ses enquêtes vers la recherche de fraudes (non-respect intentionnel de la méthodologie de calcul). Il est encore prématuré de dresser un bilan, mais la DGCCRF a reçu plusieurs signalements de pratiques potentiellement frauduleuses qui font actuellement l'objet d'enquêtes126(*).
En outre, le marché des produits reconditionnés a fait l'objet d'une enquête nationale en 2022-2023 et celui des autres produits d'occasion en 2024. Pour ce qui relève de la gestion des invendus, les résultats des premiers contrôles d'ampleur, menés en 2024, seront connus au cours de l'automne 2025.
À l'heure actuelle, les contrôles vérifiant si un produit prétendant être issu de matériaux recyclés l'est effectivement sont essentiellement documentaires. Le règlement 2022/1616 de la Commission européenne du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévoit ainsi notamment une déclaration de conformité selon un modèle établi dans le règlement, ainsi qu'une fiche récapitulative de contrôle de la conformité à transmettre aux autorités compétentes.
La raison est qu'il n'existe pas de méthodologies analytiques reconnues pour évaluer le pourcentage de matériaux recyclés (par exemple un plastique, ou un textile) dans un produit fini. Toutefois, la « DGCCRF a demandé au service commun des laboratoires (commun avec les services des douanes) de mener une veille active sur ce sujet, particulièrement dans la perspective d'adoption d'exigences d'écoconception de ces produits en application du nouveau règlement européen sur l'écoconception (« ESPR »). »127(*)
Échanges entre la direction
générale de la concurrence, de la consommation
et de la
répression des fraudes, et la direction générale des
douanes
et des droits indirects
Dans le cadre de son protocole de coopération avec la direction générale des douanes et des droits indirects, dont la dernière version date de 2017, la DGCCRF échange régulièrement avec ses homologues des douanes afin de partager sa programmation annuelle d'enquête en matière de contrôle des produits non-alimentaires. La mise en commun du ciblage des catégories de produits retenues dans le cadre d'un document commun permet de renforcer la couverture du marché et d'assurer un contrôle le plus large possible, sur le marché intérieur et à ses frontières. À ce jour, les biens importés en matière d'économie circulaire ne font pas l'objet de modalités de coopération particulières. Toutefois, dans le cadre des travaux en cours de refonte du protocole, des axes de travail concernent la meilleure intégration des réglementations transversales à finalité environnementale (écoconception des produits notamment) dans le partage d'information et la coordination avec les douanes.
L'implication forte de la DGDDI sera nécessaire pour assurer la mise en oeuvre des exigences d'écoconception qui vont être définies pour davantage de familles de produits. Le fait que la DGCCRF et la DGDDI partagent les mêmes laboratoires (service commun des laboratoires) est un atout en termes d'efficience, sous réserve de disposer de moyens suffisants pour développer de nouvelles méthodes d'analyse et passer à l'échelle des volumes de produits mis sur le marché.
Source : réponses de la DGCCRF au questionnaire du rapporteur spécial
ANNEXE 3 : LES
INSTALLATIONS DE DÉCHETS
ET LE DÉVELOPPEMENT DES
FILIÈRES REP EN OUTRE-MER
A. LA SITUATION DES INSTALLATIONS DE DÉCHETS EST TRÈS CONTRASTÉE SELON LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER (DROM) AINSI QUE SELON LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
La question du traitement des déchets en outre-mer est particulièrement difficile. De multiples facteurs, comme l'insularité et le retard massif dans la mise en place des infrastructures, conduisent à un surenchérissement très important des coûts, à un taux de traitement faible et, en corolaire, à un taux d'enfouissement particulièrement élevé.
Selon le rapport de 2022 des sénatrices Gisèle Jourda et Viviane Malet, intitulé « La gestion des déchets dans les outre-mer », le taux d'enfouissement moyen des déchets ménagers est de 67 % dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) ainsi que les collectivités d'outre-mer (COM), tandis qu'il est de 15 % en moyenne au niveau national. Le coût de gestion moyen des déchets ménagers est 1,7 fois plus élevé qu'en France métropolitaine, et la quantité moyenne d'emballages ménagers collectés par habitant et par an est de 14 kg dans les 5 DROM, contre 51,5 kg en moyenne pour l'ensemble de la France128(*).
Les difficultés dans le développement des nouvelles infrastructures tiennent à la fois des tensions foncières, qui concernent la plupart des territoires ultramarins, et d'un manque de compétences comme le souligne la direction générale des outre-mer qui indique que la « majorité des acteurs locaux souffrent d'un manque de compétences en ingénierie de projets ainsi qu'en ingénierie financière et technique. »129(*)
La direction générale des outre-mer a également mentionné au rapporteur spécial que « le taux de recouvrement des impôts et des redevances significativement plus faibles que dans l'Hexagone, a un impact sur les capacités de financement des services publics de gestion des déchets : les projets d'investissement relatifs à la gestion des déchets des territoires y restent très limités. »130(*) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) couvre en moyenne seulement 80 % des dépenses du service public des déchets, avec des écarts de 15 à 100 % selon les communes131(*). En conséquence, hormis à La Réunion, le nombre de déchetteries par habitant dans les autres DROM est de 2 à 9 fois plus faible qu'en France métropolitaine132(*).
L'exportation des déchets de ces territoires vers les pays de l'OCDE, afin qu'ils puissent être traités par des installations adaptées, n'est pas une solution à grande échelle. Tout d'abord, les règles applicables, la réglementation des transferts transfrontaliers de déchets (TTD), sont particulièrement exigeantes : seuls les déchets de plastique non dangereux facilement recyclables, c'est-à-dire triés et non contaminés par d'autres déchets, peuvent désormais être exportés vers des pays tiers pour recyclage.
À cela s'ajoutent les contraintes organisationnelles pour les ports en outre-mer (quais plus longs, portiques supplémentaires, tirants d'eau, etc.), un coût élevé du transport entre l'outre-mer et l'OCDE et des difficultés assurantielles, les compagnies maritimes acceptant de moins en moins la prise en charge des déchets dangereux133(*).
La situation des installations de traitement des déchets en outre-mer
Les éléments présentés ci-après ont été collectés auprès des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), des directions générales des territoires et de la mer ainsi que des directions de l'aménagement, du logement et de la mer. Dans ce cadre, il faut noter que les chiffres concernant le nombre de déchetteries comprennent à la fois les déchetteries professionnelles et les déchetteries publiques.
Guadeloupe
La Guadeloupe compte vingt déchetteries dont deux professionnelles. En 2023, 242 687 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été produites, soit environ 633kg/habitant. Plusieurs raisons sont avancées par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) pour expliquer la faiblesse de la valorisation des déchets sur le territoire :
- collecte en porte à porte ou en bornes d'apports volontaires des emballages encore insuffisante ;
- un réseau de déchetteries encore fragile, bien qu'en cours d'expansion ;
- une qualité de tri des emballages qui demeure encore insuffisante avec un taux de refus de tri élevé (environ 40 %) ;
- l'obligation du tri 6/8 flux des déchets par les producteurs de déchets peu respectée ;
- des performances de collecte et de traitement à améliorer par les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) ou encore l'absence de certaines de ces filières sur le territoire.
Martinique
En 2023, la quantité de déchets collectée s'est élevée à 398 500 tonnes, dont 202 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA).
Le territoire compte à ce jour quatorze déchetteries dont une déchetterie professionnelle (qui est insuffisante au regard des besoins et ne comporte pas de filière de recyclage). La mise en service d'une déchetterie supplémentaire est prévue courant 2026. Par ailleurs, la Martinique est la première collectivité ultra-marine à disposer d'une installation d'incinération (110 000 T/an), permettant depuis 2002 l'élimination d'une grande partie des déchets non valorisables.
Le centre de valorisation organique (CVO), exploité en délégation de service public par IDEX comme pour l'incinérateur, permet de composter les déchets verts et organiques broyés et traités pour être transformés en compost. Il permet également le compostage des boues de station d'épuration.
L'île dispose d'une installation d'élimination de déchets non dangereux (ISDND) exploitée en régie depuis 2017 par le SMTVD. Cette ISDND est cependant exploitée dans des conditions très dégradées, accumulant les non conformités. Par ailleurs, l'absence d'exutoire pour certains types de déchets, notamment les sédiments, et l'insuffisance des déchèteries pour mailler correctement le territoire sont également à relever.
Guyane
Le territoire compte actuellement sept déchetteries, dont quatre mises en service en 2024 et une déchetterie professionnelle. Deux déchetteries professionnelles devraient ouvrir d'ici début 2026, dont une pour les déchets dangereux. En 2023, le volume total collecté de déchets ménagers et assimilés s'élève à 98 348,34 tonnes, selon les données issues du bilan du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
Plusieurs difficultés structurelles persistent sur le territoire. Au-delà des coûts élevés d'installation, notamment pour les ISDND situées en sites isolés et uniquement accessibles par pirogue, ce sont principalement les charges de fonctionnement et le déficit en ingénierie qui fragilisent les collectivités.
La Communauté de communes de l'Est guyanais (CCEG) et la communauté de communes de l'Ouest guyanais (CCOG) sont confrontées à la gestion de vastes territoires comptant peu de ménages contributeurs, dans un contexte où les filières REP peinent à se déployer, faute d'objectifs spécifiques. La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) doit identifier un nouveau site pour remplacer l'ISDND actuelle, qui atteindra sa saturation dans les deux ans. L'État souhaite que la collectivité territoriale de Guyane puisse retenir définitivement un projet de futur ISDND, potentiellement avec le projet d'UVE pour assurer la suite de l'ISDND des Maringouins.
La Réunion
La production annuelle de déchets est estimée à 546 343 tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2023 par l'Observatoire Réunionnais des Déchets (ORD), organisme en charge du suivi complet des déchets sur l'île. La Réunion compte 42 déchèteries, dont une déchetterie mobile à Salazie.
En l'absence d'installation de traitement des déchets dangereux (ISDD), ces derniers sont exportés en métropole, comme pour les autres DROM-COM. Des difficultés croissantes avec les compagnies de bateau sont signalées en raison de la complexité administrative des procédures de notification pour déchets dangereux. Ces difficultés devraient s'amplifier avec l'arrivée des batteries lithium sur le territoire. Depuis 2022, deux bateaux par an affrétés par Mer Union permettent une desserte directe de La Réunion/Mayotte vers l'hexagone (juin/décembre) et évite ainsi toute procédure TTD.
Par ailleurs, le nombre de véhicules hors d'usage VHU récupérés suite au passage du cyclone Garance est équivalent à ce que traitent habituellement les centres VHU sur une année. Ces derniers sont d'ores et déjà saturés et aucune solution d'exportation à hauteur n'a été identifiée. Pour mémoire, la Réunion compte 7 centres VHU, mal répartis sur le territoire et qui reposent sur des filières de valorisation fragiles.
Mayotte
Déjà avant le passage du cyclone Chido, Mayotte était l'un des territoires français les plus en difficulté sur la gestion des déchets tant en matière de collecte que de traitement. Malgré un soutien conséquent de l'État et notamment de l'ADEME, l'île était en effet largement sous équipée. En 2023, la quantité de déchets reçus par le SIDEVAM (Syndicat Intercommunal pour la gestion et le traitement des Déchets de Mayotte) est estimée à 73 324,3 tonnes.
Les ordures ménagères résiduelles étaient envoyées sur la seule installation de traitement de l'Île en capacité de les traiter, à savoir l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) localisée à Dzoumogne au nord de l'Île. Cette installation reçoit également une partie des déchets d'activités économiques. Un banaliseur pour les déchets d'activités de soin à risque infectieux, une déchetterie, une plateforme de compostage des déchets verts, un centre de traitement des véhicules hors d'usage et une installation de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques viennent compléter ces équipements. Un système de déchèteries mobiles a été déployé sur le territoire, et permet une meilleure adaptation aux modes de vie des populations locales. Quatre points de dépôts permettent la collecte des déchets du bâtiment. Il n'y a cependant pas de déchetterie professionnelle sur le territoire.
Le SIDEVAM avait également engagé des actions de sensibilisation ciblées à travers son Programme local de prévention des déchets ménagers (PLPDMA). Plus de 1 500 élèves ont ainsi été sensibilisés par des actions menées en écoles et en collèges. En 2024, un service de pré-collecte a été créé pour entretenir les points de collecte et sensibiliser les usagers. Des actions ponctuelles (Octobre Vert, événements locaux) complètent ce dispositif, encore insuffisant à l'échelle du territoire.
Suite au passage du cyclone Chido (puis par la tempête Dikeledi), des quantités conséquentes de déchets ont été générées, des dégâts occasionnés sur les installations de traitement de déchets et des difficultés sont survenues sur les infrastructures de circulation et de la dégradation des équipements de collecte.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Les volumes de déchets sont en pleine évolution depuis deux ans avec l'arrivée des éco-organismes qui génère une réorientation du flux. La production annuelle est actuellement estimée à 7 500 tonnes de flux entrant dans les installations municipales, dont 270 tonnes de biodéchets. À cela s'ajoutent les déchets de certaines filières gérés séparément (emballages et électroménager par exemple).
Saint-Pierre-et-Miquelon est équipé d'une déchetterie municipale à Saint Pierre. Une déchetterie est également en cours de construction sur Miquelon, ainsi qu'un centre de tri pour la filière bâtiment porté par un acteur privé. L'exigüité du territoire, qui rend difficile la construction d'une ISDND, conduit les deux communes à pratiquer le brûlage à ciel ouvert des déchets stockés dans 2 décharges brutes, une à Saint-Pierre et une à Miquelon. Si cette pratique induit des risques sanitaires, biologiques et chimiques, le territoire peine à trouver d'autres exutoires. En effet, la valorisation énergétique des déchets est également difficile à mettre en oeuvre, du fait des petits volumes de déchets.
Saint-Pierre-et-Miquelon se heurte également à un coût de gestion et de traitement des déchets très élevé en raison du contexte insulaire et de la taille du territoire. Le déchet y couterait approximativement 10 fois plus cher qu'en métropole.
Saint-Martin
La production annuelle de déchets est estimée à environ 45 500 tonnes en 2024, dont environ 16 000 tonnes de déchets ménagers.
L'île compte une seule déchetterie actuellement en fonctionnement, située à Galisbay. La quasi-totalité des déchets de Saint-Martin est actuellement traitée et /ou valorisée à l'Ecosite de Grandes Cayes, au Nord-est de l'île. Ce site constitue un pôle complet de valorisation et de traitement regroupant notamment une plate-forme de valorisation par compostage des déchets verts et des boues ainsi qu'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
Les difficultés spécifiques rencontrées par le territoire sont liées aux limitations techniques du centre de tri et de conditionnement et du site d'enfouissement : piste d'accès précaire, absence de réseau d'eau, d'électricité et de communication. L'insuffisance des infrastructures fragilisent les équipements en cas d'intempéries majeures (cyclones).
B. LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES REP EN OUTRE-MER EST LIMITÉ
Le déploiement des filières REP dans les territoires ultramarins ne suit pas les mêmes échéances qu'en métropole. Certaines filières historiques peinent encore à se mettre en place, ce qui s'explique notamment, selon la direction générale des outre-mer, en raison « d'une connaissance insuffisante des territoires et de leurs spécificités par les éco-organismes. »134(*) En outre, les retours d'expérience indiquent que les coûts de déploiement des REP sont souvent plus élevés en outre-mer.
Présence des filières REP en outre-mer
Le déploiement des filières est très hétérogène en fonction des territoires :
Guadeloupe : en 2024, 19 filières REP dont l'implantation est effective ou en cours sont recensées ;
Saint-Martin : à date, 13 filières REP sont présentes sur le territoire ;
Martinique : toutes les filières REP sont implantées, mais avec des niveaux d'opérationnalité hétérogènes selon les filières ;
Guyane : à date, 8 filières REP sont opérationnelles sur le territoire ;
La Réunion : en 2024, 19 filières REP sont actives sur le territoire ;
Saint-Pierre-et-Miquelon : à date, 10 filières REP sont opérationnelles tandis que 4 filières sont en cours de déploiement. Pour les autres filières non encore implantées, des contacts ont été engagés avec les éco-organismes ;
Mayotte : en 2024, 9 filières REP étaient opérationnelles avant le passage du cyclone Chido.
Source : direction générale des outre-mer
* 1 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
* 2 Le recours en référé du réseau Envie a été rejeté.
* 3 Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016, page 157.
* 4 Les définitions des termes relatifs à l'économie circulaire, tels que retenus dans la loi, sont présentés dans l'annexe 1 du présent rapport.
* 5 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 6 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 7 Conseil national de l'industrie : contrat de filière, transformation et valorisation des déchets 2019-2022, janvier 2018.
* 8 Bilan de l'observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques (EEE), dossier de presse, 4 janvier 2024, page 2.
* 9 Études sur les pièces détachées pour la réparation, Ademe, Avril 2024, page 27. Le rapport cite en particulier l'exemple des toiles extérieures de tente, qui coûtent entre 100 et 150 euros, ce qui ne rend pas la réparation intéressante pour les modèles de tente d'entrée de gamme.
* 10 Le cahier des charges de la REP emballages professionnels a été mis en consultation publique le 5 septembre 2025.
* 11 Nombre d'éco-organismes au 31 août 2025.
* 12 Valobat par exemple est agréé sur les filières « Articles de bricolage et de jardin », « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment » et « Éléments d'ameublement ».
* 13 22 si l'on ne compte pas de manière séparée les deux filiales de Citéo, Citéo Pro et Adelphe.
* 14 Ecodds et Citéo Soin & Hygiène ne font pas partie du collectif à ce jour.
* 15 Article R. 541-107 du code de l'environnement, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
* 16 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 9.
* 17 « Économie circulaire : 1.000 emplois menacés dans le réseau Envie suite au dernier appel d'offres d'Ecosystem », Emilie Zapalski, Localtis, 18 avril 2025.
* 18 Arrêté du 13 août 2025 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison.
* 19 Étude des conséquences pour le système productif de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec), Rexecode pour une présentation du groupe de travail « économie circulaire » du Medef, 4 février 2021.
* 20 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 28.
* 21 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 19.
* 22 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 12.
* 23 Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n°12PA02969.
* 24 Extrait de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, cité par le rapporteur de la Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016 à la page 146 pour justifier de la compétence de la Cour à contrôler les éco-organismes.
* 25 La Cour des comptes a notamment consacré un chapitre de son rapport annuel de 2020 aux éco-organismes, ainsi que celui de 2016.
* 26 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n°408425. Le cas d'espèce portait sur le recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport.
* 27 800 euros x 1796 (Tonnes de déchets d'emballages plastiques non-recyclés).
* 28 Par exemple « Traitement des déchets plastiques : la France mise à l'amende par l'Union européenne », France info, 7 août 2024.
* 29 Note de la direction de la supervision des filières REP sur la « ressource propre plastique », 18 juillet 2025.
* 30 Saint Gobain a perçu ainsi 607 144 euros du fonds économie circulaire entre 2022 et 2024. Total énergie a reçu 668 760 euros en 2024, et Véolia 668 125 euros entre 2023 et 2024. Engie a bénéficié de la subvention la plus importante, d'un montant de 13,5 millions d'euros, dans le cadre de l'installation d'une chaufferie CSR.
* 31 Entre 2022 et 2024, 349 928 euros ont été accordés à l'entreprise Capgemini, principalement pour des prestations d'accompagnement dans la mise en oeuvre de la « Fabrique de la donnée ». Ernst and Young a perçu 193 476 euros entre 2020 et 2024.
* 32 La « solution de référence » désigne une estimation du coût du projet en utilisant les technologies existantes.
* 33 Le taux de rendement interne (TRI) mesure la rentabilité d'un projet en pourcentage annuel. Viser un TRI inférieur à un certain seuil vise à éviter que le projet ne soit « sur-rentable » avec l'aide, ce qui signifierait qu'il aurait pu être financé.
* 34 La part biogénique en énergie désigne la proportion de déchets d'origine biogénique pondérée par la quantité d'énergie contenue dans ces déchets.
* 35 Communication de la Commission Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (JO C 101 du 17,03,2023). La France a ainsi notifié à la Commission européenne un régime d'aides (SA 107668) sous la forme de subventions directes ou d'avances remboursables visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d'énergie dans le contexte de REPowerEU.
* 36 « Tereos : une chaufferie en construction », La Gazette France, 6 novembre 2024.
* 37 « Novacarb continue sa décarbonation avec une chaudière à 130 millions d'euros », Le journal des entreprises, 12 avril 2024. Il faut également relever que la région Grand Est a participé au financement du projet pour un montant de 1,5 millions d'euros.
* 38 Réponses de la Federrec au questionnaire du rapporteur spécial.
* 39 La méthode de l'analyse du cycle de vie consiste à mesurer et comparer l'ensemble des impacts d'un produit, d'un service ou d'un procédé depuis l'extraction des matières premières requise pour le fabriquer jusqu'à sa fin de vie, en passant par son transport et son utilisation.
* 40 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 171.
* 41 L'eutrophisation marine désigne l'appauvrissement en oxygène des milieux marins consécutive à l'accumulation de biomasse. L'apport excessifs de certains nutriments, comme les nitrates, peut notamment provoquer la croissance excessive d'algues, tel que c'est le cas des algues vertes en Bretagne.
* 42 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 84.
* 43 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 131.
* 44 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 45 Réponses de la FEDERREC au questionnaire du rapporteur spécial.
* 46 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur.
* 47 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.
* 48 Réponses de la Federrec au questionnaire du rapporteur spécial.
* 49 Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
* 50 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 51 Ce n'est d'ailleurs pas la première politique du fonds vert qui présente ce problème : les financements de la Stratégie nationale biodiversité 2030 étaient initialement inscrits dessus, alors qu'ils relevaient du programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », tandis que les mesures relatives à l'adaptation au changement climatique auraient dû être intégrées à la politique de prévention des risques naturels.
* 52 Sur ce dernier point, la Cour des comptes a considéré que le fonds vert « porte atteinte au principe de spécialité » et que « le programme 380 est en recouvrement avec au moins deux autres programmes de la mission : le programme 113 s'agissant de l'accompagnement de la stratégie nationale de la biodiversité et le programme 181 s'agissant de la prévention des risques naturels. Le cadrage volontairement très souple de ce nouveau programme et les modalités de pilotage ne permettent pas d'apprécier pleinement la portée de ces recouvrements, ni les éventuels effets de substitution, y compris vis-à-vis des financements européens. » Cour des comptes, note d'exécution budgétaire de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » de l'exercice 2023, avril 2024, page 7.
* 53 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 54 Analyse de l'exécution budgétaire 2024, mission Écologie, développement et mobilités durables, avril 2025.
* 55 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 56 Les « ordures ménagères résiduelles » désignent la part des déchets qui restent après les collectes sélectives.
* 57 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.
* 58 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.
* 59 Le cahier d'accompagnement est disponible en ligne, sur le site « www.ecologie.gouv.fr » : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Cahier%20accompagnement_Axe1_Biod%C3%A9chets.pdf
* 60 Appel à projets « soutenir le tri à la source et à la valorisation des biodéchets » publié sur « www.aides-erritoires.beta.gouv.fr » : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/soutenir-le-tri-a-la-source-et-la-valorisation-des-biodechets-1/
* 61 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 62 Enquête de la Cour des comptes, transmise à la commission des finances en application de l'article 58-2° de la LOLF sur l'élaboration, la composition, le pilotage et la mise en oeuvre des crédits du plan de relance, 9 mars 2022, page 28.
* 63 Voir notamment l'annexe 22 du Tome III du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2022, mission « plan de relance », Rapporteur général Jean-François Husson, page 23.
* 64 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 65 Annexe n° 17 du tome III du rapport général fait au nom de la commission sur le projet de loi de finances pour 2025, Rapporteurs spéciaux Laurent Somon et Thomas Dossus, 21 novembre 2024, page 61.
* 66 Les chiffres retenus ici sont retranchés de France 2030 / des programmes d'investissement d'avenir (PIA), qui suivent une trajectoire propre.
* 67 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 68 Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur le régime d'indemnisation des catastrophes, rapporteur Christine Lavarde, 15 mai 2024, page 62.
* 69 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 63 de l'annexe II.
* 70 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 28.
* 71 Article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
* 72 Audition de l'Ademe par le rapporteur spécial.
* 73 Réponses de la direction générale de la prévention des risques au questionnaire du rapporteur spécial.
* 74 Emballages ménagers et papiers graphiques, textiles, produits chimiques.
* 75 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 32.
* 76 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 77 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 30.
* 78 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 79 Réponses du collectif des éco-organismes au questionnaire du rapporteur spécial.
* 80 Proposition n° 5 du rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 68.
* 81 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 32.
* 82 Ibid.
* 83 Réponses de la direction générale de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes au questionnaire du rapporteur spécial.
* 84 Les équipements électriques et électroniques ; les éléments d'ameublement, les produits rembourrés d'assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ; les produits textiles d'habillement, les chaussures, le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison ; les jouets ; les articles de sports et de loisir ; les articles de bricolage et de jardin.
* 85 Articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 du code de l'environnement.
* 86 Ce champ est défini par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Ces entreprises doivent notamment poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices, avoir une gouvernance démocratique, et respecter certains principes de gestion, comme le fait de consacrer la majorité des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise.
* 87 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 60.
* 88 Article R541-147 du code de l'Environnement.
* 89 refashion.fr/bonus-reparation
* 90 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 3.
* 91 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 64.
* 92 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.
* 93 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 14.
* 94 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n° 408425, considérant n° 4.
* 95 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n° 408425, considérant n° 2.
* 96 Avis n° 16-A-27 du 27 décembre 2016 concernant l'ouverture de la filière de traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes, Autorité de la concurrence, page 18.
* 97 Ibid.
* 98 Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016, page 157.
* 99 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 32.
* 100 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 37 de l'annexe IV.
* 101 Avis n° 16-A-27 du 27 décembre 2016 concernant l'ouverture de la filière de traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes, Autorité de la concurrence, page 19.
* 102 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 37 de l'annexe VI.
* 103 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 27.
* 104 Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016, page 156.
* 105 Réponses du collectif des éco-organismes au questionnaire du rapporteur spécial.
* 106 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 107 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 108 Des procédures similaires sont prévues pour les producteurs qui n'ont pas rejoint un éco-organisme mais qui ont décidé de mettre en place un système individuel.
* 109 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 17.
* 110 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 19 de l'annexe V, d'après les cahiers des charges des filières.
* 111 Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016, page 150.
* 112 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 35.
* 113 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 114 Le dernier « mémo des REP » a été publié le 22 avril 2025, et il porte sur les données de 2023. Il est disponible sur le site de l'Ademe : https://librairie.ademe.fr/economie-circulaire-et-dechets/8160-memo-des-rep-donnees-2023-9791029725296.html
* 115 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 116 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 2.
* 117 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 63 de l'annexe II.
* 118 Ce comité est composé pas uniquement de producteurs mais également d'associations de protection de l'environnement.
* 119 Exemple cité par le rapport « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 34 de l'annexe IV.
* 120 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial : « Toutefois comme relevé par la mission d'instruction commune IGF, IGEDD, CGE sur la gouvernance des filières REP, les moyens affectés côté Pouvoirs Publics sont notamment insuffisants au regard des missions confiées et de la taille des structures à contrôler. Par exemple CITEO, actuellement agréé uniquement sur la filière des emballages ménagers, compte plus de 500 salariés. »
* 121 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.
* 122 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 38 de l'annexe V.
* 123 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.
* 124 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 20.
* 125 Réponses de la DGCCRF au questionnaire du rapporteur spécial.
* 126 Réponses de la DGCCRF au questionnaire du rapporteur spécial.
* 127 Réponses de la DGCCRF au questionnaire du rapporteur spécial.
* 128 Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la gestion des déchets dans les outre-mer, Gisèle Jourda et Viviane Malet, 8 décembre 2022, page 71.
* 129 Réponses de la direction générale des Outre-mer au questionnaire du rapporteur spécial.
* 130 Réponses de la direction générale des Outre-mer au questionnaire du rapporteur spécial.
* 131 Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la gestion des déchets dans les outre-mer, rapporteures Gisèle Jourda et Viviane Malet, 8 décembre 2022, page 10.
* 132 Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la gestion des déchets dans les outre-mer, rapporteures Gisèle Jourda et Viviane Malet, 8 décembre 2022, page 8.
* 133 Réponse de la direction générale des outre-mer au questionnaire du rapporteur spécial
* 134 Réponses de la direction générale des outre-mer au questionnaire du rapporteur spécial.