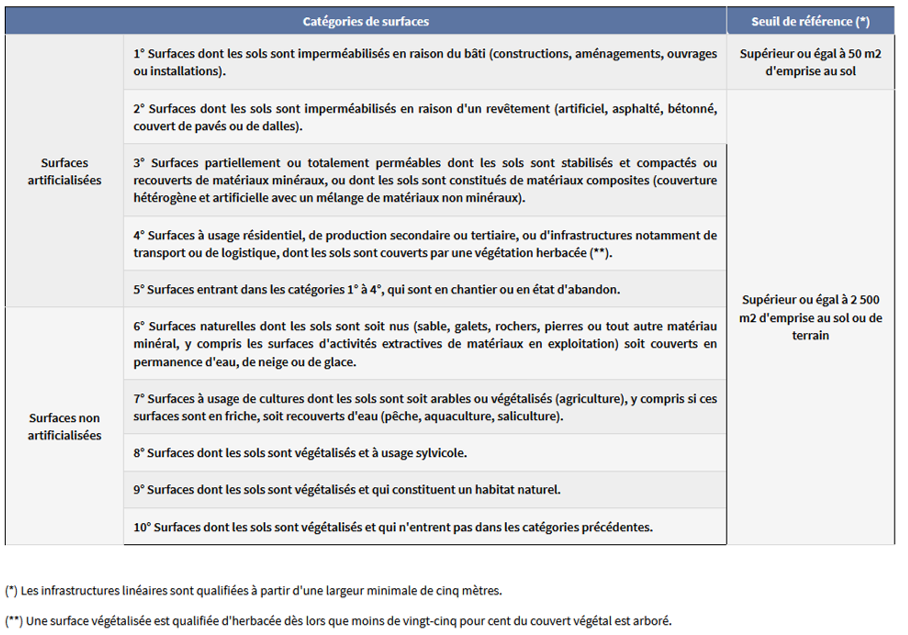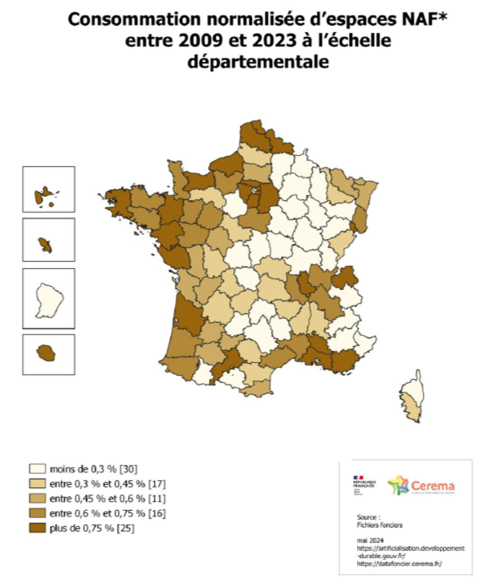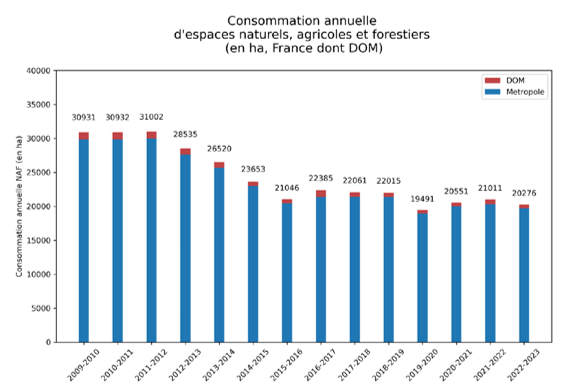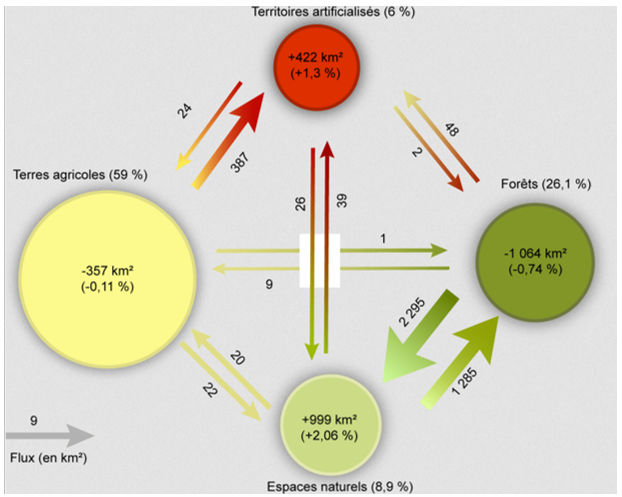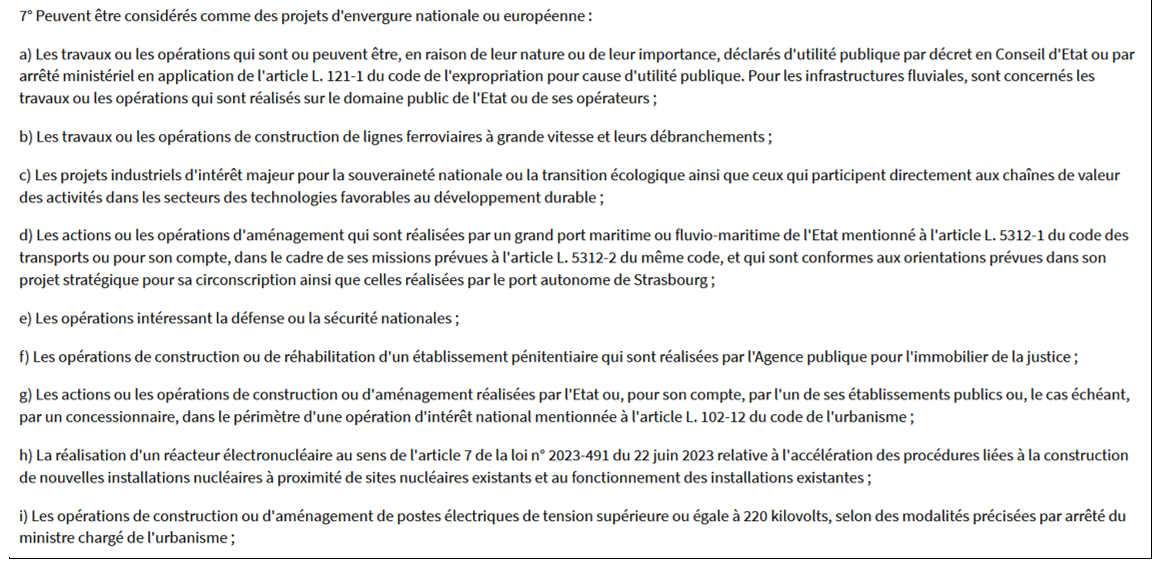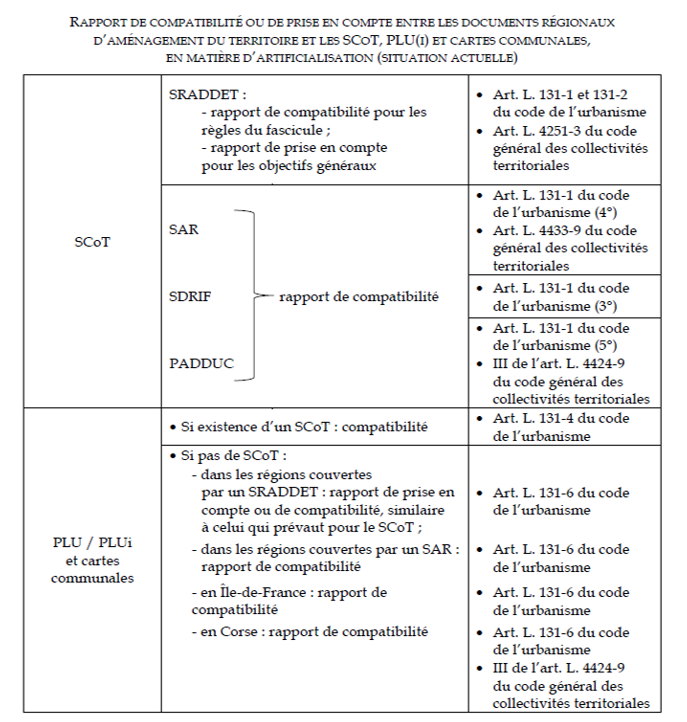- L'ESSENTIEL
- I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI
CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS
FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS
- II. LE TEXTE INITIAL : DES PROPOSITIONS
D'ÉVOLUTIONS CIBLÉES POUR TRACER AVEC LES ÉLUS UN CHEMIN
VERS UNE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE SOUTENABLE
- III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : DES
DISPOSITIFS PLUS OPÉRATIONNELS ET MIEUX ADAPTÉS AUX ENJEUX LOCAUX
ET NATIONAUX, POUR TRACER UNE TRAJECTOIRE CRÉDIBLE VERS 2050
- A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR
DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA
MATIÈRE
- B. DONNER LA MAIN AUX RÉGIONS ET AUX
COLLECTIVITÉS LOCALES, POUR ADAPTER LEURS TRAJECTOIRES AUX
RÉALITÉS DES TERRITOIRES
- 1. Permettre aux régions de fixer leur
propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires
- 2. Mieux associer les collectivités locales
à la fixation des objectifs régionaux et leur redonner de la
latitude dans leur application
- 3. Concilier les objectifs contradictoires des
politiques publiques nationales
- 1. Permettre aux régions de fixer leur
propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires
- C. AMÉNAGER LA GARANTIE DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAL AU BÉNÉFICE DES PETITES
COMMUNES
- A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR
DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA
MATIÈRE
- I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI
CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS
FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Mesure de l'artificialisation par la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers
- Article 2
Suppression de l'objectif de réduction de moitié du rythme
de l'artificialisation sur la période 2021-2031
- Article 3
Dates de modification des documents de planification et d'urbanisme
pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation
- Article 4
Exclusion des projets d'envergure nationale et européenne
du décompte de la consommation d'espace
- Article 5
Modalités de fixation et de territorialisation des objectifs régionaux
de réduction de l'artificialisation
- Article 6 (nouveau)
Garantie de développement communal
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 372
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1) sur la proposition de loi visant à instaurer une
trajectoire de
réduction de l'artificialisation
concertée
avec les
élus locaux,
Par M. Jean-Marc BOYER et Mme Amel GACQUERRE,
Sénateur et Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
124, 350 et 373 (2024-2025) |
L'ESSENTIEL
La commission des affaires économiques a adopté, le 19 février 2025, la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (« PPL Trace »).
Ce texte, élaboré dans la lignée des travaux du groupe de suivi sénatorial sur l'artificialisation des sols, vise à faciliter la mise en oeuvre de la stratégie de sobriété foncière fixée par la loi Climat-résilience1(*) de 2021, par le biais d'une meilleure différenciation territoriale. Pour ce faire, il supprime notamment l'obligation de réduire de moitié les surfaces artificialisées dans chaque région au cours de la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.
La commission a confirmé l'ensemble des dispositifs du texte initial en les précisant, pour assurer une meilleure adaptation aux contraintes et réalités locales et la prise en compte des autres priorités des politiques publiques, tout en assurant une trajectoire crédible vers l'atteinte de l'objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050. En contrepartie de l'allègement de la contrainte pour la première période décennale, les régions devront ainsi proposer une trajectoire et des jalons intermédiaires, à un rythme librement choisi, en accord avec les collectivités locales. En complément, la commission a également facilité la mutualisation de la garantie de développement communal d'un hectare, essentielle pour garantir à chaque commune le droit au projet.
|
consommation annuelle moyenne d'espaces en France |
|
|
part des élus locaux engagés en faveur de la sobriété foncière sur leur territoire2(*) |
|
|
part des communes et EPCI dont les documents d'urbanisme sont en cours de modification |
|
|
part des élus locaux qui estiment que leurs préoccupations sont insuffisamment prises en compte dans l'élaboration des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation3(*) |
I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS
Présent dans le code de l'urbanisme depuis plus de vingt ans, l'enjeu de sobriété foncière est désormais bien intégré par les élus locaux : plus des deux tiers d'entre eux déclarent souscrire à ce principe, et l'appliquer sur leur propre territoire.
Afin d'accélérer la marche vers la sobriété foncière, la loi Climat-résilience de 2021 a fixé un double objectif de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » au niveau national en 2050. Directement inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune réelle étude d'impact, et leur déclinaison territoriale n'a pas été suffisamment anticipée.
Quoique unanimement saluées par les élus, les améliorations apportées par la loi d'initiative sénatoriale « ZAN 2 » du 20 juillet 20234(*) (report des dates de modification des documents de planification et d'urbanisme, précisions des critères de territorialisation, prise en compte de la renaturation dès 2021, mutualisation au niveau national de l'artificialisation induite par les projets d'envergure nationale et européenne, garantie de développement communal, sursis à statuer et droit de préemption ad hoc...) n'ont pas permis de lever tous les blocages.
Près de quatre ans après l'adoption de la loi Climat-résilience, et l'approche de la date butoir de modification des documents d'urbanisme, l'inquiétude des collectivités locales quant à leurs capacités de développement futures ne cesse de grandir.
II. LE TEXTE INITIAL : DES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTIONS CIBLÉES POUR TRACER AVEC LES ÉLUS UN CHEMIN VERS UNE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE SOUTENABLE
Afin de répondre à ces difficultés, la proposition de loi prévoyait :
- le maintien de la mesure de l'artificialisation via la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) au-delà de 2031. Ce mode de comptabilisation, bien connu des élus locaux, permettra à ces derniers de mieux anticiper et planifier leurs consommations foncières, et également de lever durablement la contrainte foncière sur les constructions et aménagements nécessaires à l'activité agricole, qui sont assimilés à des Enaf (article 1er) ;
- la suppression de l'objectif intermédiaire national de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 et de sa déclinaison uniforme dans chaque région, au profit d'objectifs intermédiaires différenciés, fixés par les collectivités elles-mêmes (article 2) ;
- le report des dates butoirs de modification des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation, afin de leur permettre de tirer parti des souplesses permises par la future loi Trace, et de laisser davantage de temps à la concertation (article 3) ;
- l'exclusion totale du décompte de la consommation d'Enaf des projets d'envergure nationale et européenne (Pene), et non plus sa mutualisation au niveau national, injuste et pénalisante pour les régions et les collectivités, qui se sont ainsi vu imposer en cours de période un effort de réduction encore plus contraignant que celui initialement prévu (- 54,5 % au lieu de - 50 % sur la période 2021-2031), ainsi que l'obligation pour l'État de définir une trajectoire de réduction de l'artificialisation pour ses propres projets, comme la loi l'exige des collectivités (article 4) ;
- la création dans chaque région d'une instance de concertation rassemblant l'ensemble des élus locaux parties prenantes à la mise en oeuvre de la politique de réduction de l'artificialisation, dotée de pouvoirs décisionnels pour la fixation des objectifs régionaux et leur territorialisation (article 5).
III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : DES DISPOSITIFS PLUS OPÉRATIONNELS ET MIEUX ADAPTÉS AUX ENJEUX LOCAUX ET NATIONAUX, POUR TRACER UNE TRAJECTOIRE CRÉDIBLE VERS 2050
A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA MATIÈRE
Afin de donner aux élus locaux davantage de visibilité sur la manière dont seront décomptées leurs consommations futures, et ainsi sécuriser l'évolution de leurs documents d'urbanisme, la notion de « consommation d'Enaf » a été précisée, via l'inscription dans la loi de critères de définition des « secteurs urbanisés », ce qui permettra de mieux encadrer les interprétations parfois divergentes de la notion de consommation d'Enaf par les services de l'État. Les spécificités des modèles d'urbanisation et d'habitat locaux devront également être prises en compte.
La comptabilisation de la consommation d'Enaf étant réalisée par le Cerema5(*), sur la base des fichiers fonciers à l'échelle de la parcelle, ce point a également été clarifié dans la loi.
Enfin, dans le cadre du « porter à connaissance » en amont de l'élaboration ou de la modification des documents d'urbanisme, l'État fournira à chaque collectivité un bilan chiffré et détaillé de sa consommation passée, afin de servir de base fiable à la collectivité pour la planification de ses consommations futures.
B. DONNER LA MAIN AUX RÉGIONS ET AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, POUR ADAPTER LEURS TRAJECTOIRES AUX RÉALITÉS DES TERRITOIRES
1. Permettre aux régions de fixer leur propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires
La France continue de perdre, chaque année, environ 20 000 hectares de surfaces agricoles, naturelles et forestières, et la décrue de l'artificialisation observée depuis une vingtaine d'années marque le pas depuis le début des années 2020. Cette artificialisation porte atteinte à la biodiversité, à l'atteinte par la France de ses objectifs climatiques et à notre souveraineté alimentaire.
Pour toutes ces raisons, la lutte contre l'artificialisation des sols demeure une priorité. Même si la contrainte à court et moyen termes doit être assouplie, l'objectif d'absence d'artificialisation nette à horizon 2050 reste une boussole indispensable.
Pour que l'atteinte de cet objectif demeure crédible, la commission a précisé que les régions devront inscrire dans leurs documents de planification une trajectoire et des objectifs intermédiaires compatibles avec cet objectif.
Afin de permettre la mise en oeuvre effective de ces nouvelles règles, la date butoir de modification des documents régionaux a été repoussée à août 2027. Par cohérence, pour permettre la modification « en cascade » des documents d'urbanisme, les dates butoirs de modification de ces derniers ont également été repoussées, respectivement à août 2028 (pour les Scot) et 2029 (pour les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales).
2. Mieux associer les collectivités locales à la fixation des objectifs régionaux et leur redonner de la latitude dans leur application
Plutôt que de créer une nouvelle instance de concertation, la commission, sensible au besoin de stabilité exprimé par les associations d'élus, a modifié la composition des conférences régionales de gouvernance créées par la loi « ZAN 2 » - rebaptisées « conférences régionales de sobriété foncière » -, pour y assurer la prééminence des représentants des collectivités locales.
Le pouvoir de ces conférences a également été renforcé, puisqu'elles pourront désormais :
- contraindre la région à reconsidérer ses objectifs en matière de réduction de l'artificialisation et sa territorialisation, et à se saisir des assouplissements permis par la future loi Trace ;
- se prononcer par un avis conforme sur la liste des projets d'envergure régionale dont l'artificialisation fait l'objet d'une mutualisation au niveau régional, pour s'assurer que les projets retenus sont bien des projets d'intérêt commun.
Conformément à la position déjà portée par le Sénat lors de l'examen préalable à l'adoption de la loi « ZAN 2 », la commission a également levé le caractère prescriptif des documents régionaux de planification, pour le volet concernant la lutte contre l'artificialisation : les objectifs et leur déclinaison territoriale s'appliqueront donc aux documents d'urbanisme dans un rapport de simple prise en compte. Les collectivités pourront donc, au cas par cas, s'écarter des orientations fondamentales fixées par la région en la matière, dans la mesure où l'intérêt des opérations projetées le justifie. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques, le 29 janvier dernier, François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, s'est déclaré ouvert à une telle évolution, revendiquée de longue date par le Sénat.
Enfin, avec l'accord du préfet, une collectivité pourra, sur demande motivée, obtenir un délai supplémentaire de deux ans maximum pour intégrer dans son document d'urbanisme les objectifs de réduction de l'artificialisation.
3. Concilier les objectifs contradictoires des politiques publiques nationales
Les élus sont aujourd'hui soumis à des impératifs contradictoires, découlant de la déclinaison de différentes politiques publiques nationales non coordonnées.
La stratégie nationale de réduction de l'artificialisation des sols s'inscrit dans le temps long, contrairement à la lutte contre la crise du logement, au soutien à la réindustrialisation ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui imposent des mesures de court terme.
Afin de lever la contrainte foncière pour les projets qui concourent à la mise en oeuvre de ces politiques publiques prioritaires, y compris lorsqu'ils sont de faible ampleur et ne peuvent prétendre à la qualification de Pene, la commission a décidé d'exclure temporairement, jusqu'en 2036, du décompte de la consommation d'Enaf :
- les implantations industrielles ;
- les constructions de logements sociaux, dans les communes carencées au titre de la loi SRU6(*) ;
- les infrastructures de production d'énergie renouvelable.
C. AMÉNAGER LA GARANTIE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL AU BÉNÉFICE DES PETITES COMMUNES
Créée par la loi « ZAN 2 », la garantie de développement communal de 1 hectare a constitué une bouffée d'oxygène pour les communes rurales menacées de se voir privées de toute capacité d'artificialisation. Les rigidités de sa mise en oeuvre et son application homogène sur tout le territoire, pensées à l'origine pour protéger les maires des communes bénéficiaires, ont cependant abouti dans certains territoires à des situations de gel du foncier, qui grèvent les enveloppes foncières disponibles pour les autres collectivités.
Afin de remédier à cet effet de bord, la commission a ouvert la possibilité de mutualiser la garantie au niveau du Scot et de la région, a précisé que cette mutualisation pouvait être partielle, et a simplifié l'évolution des documents d'urbanisme pour permettre aux collectivités de mobiliser effectivement les surfaces ainsi mutualisées.
La commission souligne enfin qu'en complément de ce texte d'urgence, ciblé sur l'évolution des modalités de fixation et de déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, des évolutions demeurent nécessaires en matière financière et fiscale, ainsi qu'en ce qui concerne les règles d'urbanisme et de construction, afin de renforcer l'incitation à la sobriété foncière, et les outils à la main des maires pour y contribuer.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Mesure de l'artificialisation par la
consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers
Cet article vise à pérenniser la mesure de l'artificialisation par le décompte de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf), au-delà de 2031.
La commission a adopté six amendements visant à mieux définir la notion de consommation d'Enaf, en précisant que les opérations artificialisantes au sein de l'enveloppe urbaine et dans les « dents creuses » ne doivent pas être comptabilisées comme consommation d'Enaf, et prévoyant que l'État fournit à chaque collectivité en amont de la modification de son document d'urbanisme un bilan détaillé de sa consommation d'Enaf passée.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Aux termes de la loi Climat-résilience, les modalités de mesure de l'artificialisation des sols seront modifiées en 2031
A. La loi Climat-résilience de 2021 a prévu un basculement des modalités de mesure de l'artificialisation des sols en 2031
1) La loi Climat-résilience a fixé une trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols applicable dès 2021
a) Des objectifs nationaux qui doivent se décliner dans les documents d'urbanisme
L'article 191 de la loi Climat-résilience7(*) a fixé un double objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » sur l'ensemble du territoire national en 2050. Ces objectifs doivent se traduire par la définition, dans les documents régionaux de planification et, par déclinaison dans les documents d'urbanisme, d'une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.
L'article 192 de la loi Climat-résilience a introduit dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 101-2-1, qui fixe la définition de l'artificialisation des sols comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Le même article définit l'artificialisation nette des sols comme le solde de l'artificialisation et de la désartificialisation - définie comme « actions ou [...] opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé ».
b) Des modalités de reporting ascendantes
L'article 206 de la loi Climat-résilience a introduit au livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un nouveau titre III relatif à l'artificialisation des sols, dont l'unique article dispose que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de document d'urbanisme devront présenter au moins une fois tous les trois ans au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur leur territoire au cours des années précédant la présentation dudit rapport, « rend[ant] compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols [fixées dans le document d'urbanisme] sont atteints ».
Ce rapport est transmis aux représentants de l'État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l'EPCI dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l'EPCI compétent. Lorsque la commune ou l'EPCI est couvert par un schéma de cohérence territoriale (ScoT), le rapport est également adressé au président de l'établissement public en charge de celui-ci.
Ces analyses peuvent en outre être intégrées dans l'évaluation du plan local d'urbanisme (PLU(i)) et de ses résultats qui doit obligatoirement être effectuée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI concerné, au plus tard six ans après l'approbation du PLU(i)8(*).
Aux termes de l'article 207 de la loi Climat-résilience, il appartient au Gouvernement d'effectuer, tous les cinq ans, une évaluation de la politique nationale de limitation de l'artificialisation des sols, dans le cadre d'un rapport public.
Enfin, la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a prévu que la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, créée par la même loi (cf. ci-dessous, article 5), établit, au plus tard un an après sa dernière réunion préparatoire à l'intégration dans les documents régionaux de planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, un bilan de leur mise en oeuvre au niveau régional9(*).
2) La loi Climat-résilience a fixé une métrique de l'artificialisation des sols qui n'était pas applicable dès 2021
a) Le principe d'une mesure de l'artificialisation « au réel », indépendante du statut fixé par les documents d'urbanisme
Le décret d'application prévu par l'article 206 de la loi Climat-résilience précité précise que, dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, l'évaluation triennale mentionnée ci-dessus doit se faire au regard de « l'occupation effective des sols observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme ».
Autrement dit, lorsqu'un document d'urbanisme ouvre une zone à l'urbanisation, cette dernière ne sera pas intégralement considérée comme artificialisée du seul fait de ce statut (par exemple zone « AU » : « à urbaniser ») fixé dans le document d'urbanisme ; seules les surfaces effectivement urbanisées devront être considérées comme artificialisées. L'ouverture d'une zone à l'urbanisation n'implique en effet pas la réalisation de projets artificialisant sur l'ensemble de sa surface, ni immédiatement.
b) La loi Climat-résilience a défini la notion d'artificialisation, nécessitant l'invention d'une nouvelle méthode de décompte, par rapport aux outils juridiques et techniques préexistants
L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme créé par l'article 192 de la loi Climat-résilience précité, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe une nomenclature des sols devant être considérés comme artificialisés. Cette dernière a été fixée par le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, qui a ensuite été profondément remanié par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023.
Aux termes de l'article R. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du même décret, le rapport triennal mentionné ci-dessus doit notamment présenter, pour les années sur lesquelles il porte, le solde entre les surfaces artificialisées et désartificialisées telles que définies par la nomenclature fixée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les surfaces imperméabilisées au sens de la nomenclature fixée au même article R. 101-1 du code de l'urbanisme.
Nomenclature des surfaces artificialisées
et non artificialisées
prévue à
l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme
Source : Légifrance
Le même décret fixe la « maille d'observation » de l'artificialisation, l'article R. 2231-1 du CGCT précité, dans sa rédaction issue du décret de novembre 2023, à savoir 50 m² pour les surfaces bâties et 2 500 m² pour les surfaces non bâties.
En effet, aux termes de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme précité l'occupation effective des sols devra être mesurée « à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée ».
Afin de permettre le suivi des phénomènes liés à l'artificialisation des sols, l'État a construit l'outil « Occupation des sols à grande échelle » (OCS-GE), produite par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), qui permet de mesurer notamment l'artificialisation, à partir de repérages et calculs effectués par intelligence artificielle.
Au 1er janvier 2025, 60 départements métropolitains sont couverts et la photo-interprétation est en cours dans les 41 départements restants. La production devrait être terminée sur l'ensemble du territoire national à la mi-2025. L'échelle d'utilisation est le 1 :5 000. La précision de positionnement global des limites est métrique et la résolution est centimétrique. La mise à jour est envisagée sur un rythme triennal (un tiers du territoire chaque année).
Cet outil est financé par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'aménagement et de la cohésion de territoires, avec un financement initial de 25 M€ sur cinq ans (2020-2025)10(*). Le coût de la mise à jour de la base d'occupation du sol à partir de ces images est estimé à environ 2,5 M€ par an.
B. Jusqu'en 2031, la mesure de l'artificialisation se fait toutefois via la mesure de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf)
1) Des mesures dérogatoires de mesure de l'artificialisation prévues dès 2021
Compte tenu de l'entrée en vigueur, dès sa publication, des dispositions de la loi Climat-résilience relatives à la réduction de l'artificialisation des sols, cette dernière a prévu dès l'origine des modalités dérogatoires de mesure de l'artificialisation pour la première période décennale 2021-2031. Ainsi, le 2° du III de son article 194 prévoit que « [p]our la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes », le 5° du même III précisant que la notion de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers s'entend comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». La notion de « consommation d'Enaf » se distingue ainsi assez nettement de la logique dont procède l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, qui définit l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol ». Or, à horizon 2050, l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols s'apprécie au regard de cette définition et de la nomenclature qui la précise, et non pas au regard de la consommation d'Enaf.
Enfin, le bilan de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) correspond au décompte de la transformation effective d'Enaf en espaces urbanisés observée sur le terrain entre deux dates. Sa mesure est indépendante du zonage réglementaire des PLU(i) ou des cartes communales. Un Enaf est considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage des travaux d'un projet et non à compter de la délivrance d'une autorisation administrative.
2) Les Enaf, une notion familière pour les collectivités
a) La consommation d'Enaf, une notion définie de manière jurisprudentielle et qui semble plus souple que la notion d'artificialisation
La distinction entre Enaf et espaces urbanisés est jurisprudentielle. En effet, la notion d'Enaf ne recouvre pas exactement le zonage en zones agricoles, naturelles ou forestières fixé par les PLU(i)11(*). La notion d'Enaf vaut d'ailleurs aussi pour les communes qui ne sont pas dotées de PLU(i).
La détermination de la qualité d'espace urbanisé repose ainsi sur un faisceau d'indices jurisprudentiels comprenant :
- la quantité et la densité de l'urbanisation (aménagements, constructions, espaces attenants au bâti...) ;
- la continuité de cette urbanisation ;
- sa structuration par des voies de circulation, des réseaux d'accès ou de raccordement aux services publics ;
- la présence d'équipements ou de lieux collectifs, qu'ils soient publics ou privés12(*).
La notion d'« espace urbanisé » au sens ainsi défini par la jurisprudence n'est strictement équivalente ni à celle des zones urbaines (zones « U »), ni à celle de « partie urbanisée » des communes dépourvues de document d'urbanisme et soumises au règlement national d'urbanisme (RNU)13(*), ni à celle de « continuité », au sens des lois « Montagne »14(*) ou « Littoral »15(*).
Les espaces « résiduel[s], de taille limitée, entre deux bâtis existants au sein de l'enveloppe urbaine », sont qualifiés de « dents creuses »16(*). Les fichiers fonciers les classent, selon leur usage, comme urbanisés, par exemple pour les jardins pavillonnaires, ou comme « NAF », dans le cas, par exemple, de terrains à vocation agricole au sein de l'espace urbanisé. L'urbanisation des « dents creuses » classées « NAF » emporte donc une consommation d'Enaf.
Bien que sans ambiguïté au regard de la classification dans les fichiers fonciers des règles de calcul de la consommation d'Enaf, le traitement de ces espaces résiduels est difficilement compréhensible pour les élus locaux, qui assimilent souvent cette notion de « dent creuse » à l'acception qu'elle revêt, dans le langage courant, pour désigner les possibilités de construction au sein de l'enveloppe urbaine « en continuité » avec l'espace urbain existant17(*) et « dans les parties urbanisées de la commune »18(*), pour les communes soumises au RNU (cf. ci-dessus).
b) La comptabilisation en Enaf emporte la non-comptabilisation de l'artificialisation induite par les bâtiments et infrastructures agricoles
En termes de consommation d'Enaf, les surfaces agricoles et leurs dépendances bâties ne seront pas considérées comme constituant un espace urbanisé et ne seront donc pas comptabilisées dans la consommation d'espaces NAF. Cependant, si ces surfaces comprennent des bâtis agricoles en continuité d'un espace urbanisé, ou s'il s'agit d'un regroupement de plusieurs constructions agricoles, d'une certaine densité, et dont certains ont fait l'objet d'un changement de destination - par exemple en vue de la création de logements, ces surfaces seront comptabilisées comme des « espaces urbanisés »19(*) (cf. ci-dessous).
Après 2031, il est prévu que l'artificialisation des sols résultant pour les surfaces à usage agricole soit mesurée dans les conditions fixées à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme et sa nomenclature annexée. En conséquence :
- les surfaces agricoles bâties seront comptabilisées comme artificialisées20(*) ;
- les surfaces à usage de cultures, soit arables, soit végétalisées - y compris si ces surfaces sont en friche -, soit recouvertes d'eau (pêche, aquaculture, saliculture) seront comptabilisées comme non artificialisées21(*).
II. Le dispositif envisagé - Une pérennisation du décompte de l'artificialisation par la consommation d'ENAF
Cet article pérennise, au-delà donc de la date butoir de 2031 fixée par la loi Climat-résilience, la mesure de l'artificialisation par le décompte de la consommation d'Enaf, plutôt que par le décompte de l'artificialisation « au réel », telle qu'évaluée par l'outil d'intelligence artificielle OCS-GE22(*).
L'objectif de la mesure est de permettre aux collectivités de mieux piloter leur artificialisation à travers leurs documents d'urbanisme et d'assurer un suivi en temps quasi réel des consommations foncières. En outre, le choix de cette métrique exempte du décompte de l'artificialisation celle induite par les bâtiments agricoles.
III. La position de la commission - Clarifier la notion de consommation d'Enaf et ses modalités de comptabilisation, pour sécuriser les élus
A. Encadrer la notion de consommation d'Enaf
1) En définissant la notion d'« espace urbanisé »
Afin de clarifier la notion de consommation d'Enaf, la commission a, par l'adoption des amendements identiques COM-50 des rapporteurs et COM-60 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, inscrit dans la loi les critères de définition des « espaces urbanisés », dont elle est le « négatif ». Ces critères reprennent ceux définis par la jurisprudence (cf. ci-dessus) dans une rédaction proche de celle figurant dans le code de l'urbanisme concernant les « secteurs déjà urbanisés » au sens de la loi Littoral23(*) et le principe de continuité de l'urbanisation au sens de la loi Montagne24(*).
Selon les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation « [e]n ne définissant pas la notion d'"espaces naturels, agricoles et forestiers", le législateur a [...] souhaité permettre aux collectivités locales une souplesse pour appréhender de la façon la plus adaptée possible la notion aux caractéristiques et aux enjeux de leur territoire, en tenant compte du fait que la notion de consommation d'espaces existait déjà avant la loi climat et résilience et était ainsi déjà connue des collectivités »25(*). Dans les faits cependant, plus des deux tiers des répondants à la consultation en ligne des élus locaux lancée par le groupe de suivi sénatorial sur l'artificialisation des sols déclaraient avoir du mal à déterminer les opérations à considérer comme consommation d'Enaf, et le constat d'appréciations divergentes des services déconcentrés de l'État quant à la notion d' « espaces urbanisés » est récurrent.
La clarification de la notion dans un texte de niveau législatif permettra de mieux encadrer l'appréciation au cas par cas faite par les services de l'État.
2) En excluant explicitement du décompte de la consommation d'Enaf les dents creuses
Les mêmes amendements, adoptés par la commission, précisent également que les opérations de construction ou autres opérations artificialisantes effectuées au sein de l'enveloppe urbaine ne sont pas comptabilisées comme consommation d'Enaf, conformément à la doctrine de la non-comptabilisation de l'urbanisation des « dents creuses » développée par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, pour lesquels « la consommation foncière de ces dents creuses, dès lors qu'elles sont intégrées au sein de l'enveloppe urbaine, peuvent déjà, en l'état du droit et de la jurisprudence, ne pas être considérées comme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au motif que ces dents creuses peuvent être identifiées comme des espaces déjà urbanisés »26(*).
Dans les faits cependant, les modalités pratiques de comptabilisation de la consommation d'Enaf, effectuées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) sur la base des fichiers fonciers ne permettent pas systématiquement d'exclure de la consommation d'Enaf les opérations artificialisantes réalisées au sein de l'enveloppe urbaine.
En effet, selon le fascicule précité, « les fichiers fonciers » appréhenderont généralement [les dents creuses] comme urbanisé[e]s et donc consommé[e]s »27(*). Ce sera notamment le cas lorsque des constructions sont réalisées sur des parcelles déjà en majorité construites, ou sur des parcelles à usage de jardin d'agrément par exemple.
En revanche, compte tenu de l'échelle d'observation de la consommation d'Enaf effectuée par le Cerema, à savoir la parcelle, lorsque des terrains à vocation agricole, naturelle ou forestière, identifiés comme tels dans les fichiers fonciers, font l'objet de constructions ou autres opérations artificialisantes, leur catégorie au regard des fichiers change et ces opérations sont considérées comme consommation d'Enaf, même lorsque les parcelles en question sont entièrement entourées d'espaces urbanisés.
Compte tenu de la diversité des tailles et du découpage des parcelles selon les territoires, ces modalités de calcul aboutissent à considérer différemment au regard de la consommation d'Enaf des opérations très similaires dans les faits. Cela est d'autant moins compréhensible pour les collectivités que le découpage des parcelles n'est pas de leur ressort, et qu'elles se retrouvent donc comptable de paramètres sur lesquelles elles n'ont aucun moyen d'action.
L'exclusion explicite de la consommation d'Enaf de toutes les opérations effectuées au sein de l'enveloppe urbaine permet ainsi davantage de lisibilité et une plus grande équité de traitement entre les collectivités. Elle permet en outre de valoriser les opérations de densification, sur des Enaf en discontinuité, dont la qualité agronomique et écologique est en conséquence relativement limitée, par opposition à celles réalisées en extension urbaine.
B. Mettre à disposition des élus des données fiables et objectivées
La loi Climat-résilience a prévu la mise à disposition d'outils de mesure et de suivi de la consommation d'Enaf et de l'artificialisation par l'État, au profit des collectivités28(*), sans leur imposer le recours à ces outils.
Néanmoins, dans les faits, dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation et de leur déclinaison dans les documents d'urbanisme, il est nécessaire pour les collectivités de disposer de bilans partagés servant de base aux discussions avec les régions et les services de l'État. Pour cette raison, les amendements identiques COM-52 des rapporteurs et COM-61 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable disposent qu'en amont de la modification des documents d'urbanisme, le préfet transmettra aux collectivités, dans le cadre du « porter à connaissance » prévu à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, un bilan chiffré et détaillé de leur consommation sur la période de référence 2011-2021 (qui prendra en compte les évolutions des modalités de comptabilisation figurant au présent article 1er, et pourra, conformément à la pratique du Cerema, avoir fait l'objet, en amont de la transmission, de demandes de rectifications de la part de collectivité conservée, mais se trouvera ainsi cristallisé).
Cette mise à disposition ne modifiera pas la possibilité laissée aux communes d'utiliser leurs propres outils d'observation pour la réalisation de leur bilan triennal de consommation d'Enaf. En effet, le décret du 23 novembre 2023 précité précise que pour l'établissement de leur rapport triennal, les collectivités « peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation et mis en oeuvre localement », en particulier dans le cadre de l'élaboration de programmes locaux de l'habitat (PLH), et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation des Scot et des PLU(i). Cette disposition a été introduite à l'initiative du Sénat, dans le cadre des discussions connexes à l'examen de la proposition de loi ayant débouché sur la loi « ZAN 2 », et permet de mieux prendre en compte les réalités de terrain, compte tenu des rigidités des modalités de calcul des consommations par le Cerema, mentionnées ci-dessus.
La commission a également adopté deux amendements rédactionnels COM-51 des rapporteurs et COM-62 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 2
Suppression de l'objectif de réduction de
moitié du rythme
de l'artificialisation sur la période
2021-2031
Cet article vise à :
- supprimer l'objectif intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation à l'échelle nationale sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, fixé par l'article 191 de la loi Climat-résilience, pour y substituer une « trajectoire nationale de sobriété foncière » non bornée dans le temps, aboutissant à une diminution tendancielle de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) ;
- prévoir la détermination à l'échelle régionale d'objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'Enaf.
Il conserve en revanche l'objectif d'absence d'artificialisation à horizon 2050, au niveau national.
La commission a procédé à des aménagements rédactionnels pour clarifier la nécessité que les trajectoires de réduction de l'artificialisation fixent des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - La loi Climat-résilience a fixé des objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation des sols à horizon 2031 et 2050
A. L'artificialisation des sols a fortement progressé en France ces dernières décennies
1) Une artificialisation galopante depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en baisse depuis une quinzaine d'années
Actuellement, environ 9 % du territoire français hors outre-mer est artificialisé29(*). Le reste du territoire se répartit entre sols agricoles (environ 52 % de la surface totale) et sols naturels (environ 39 %)30(*).
Les chiffres de l'artificialisation diffèrent profondément selon les bases de données utilisées31(*), mais l'analyse de ces dernières aboutit dans tous les cas au constat d'une consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) supérieure à la croissance démographique et à la croissance des activités, depuis les années 195032(*). Les données « Teruti-Lucas », seules à permettre une analyse sur période longue de l'artificialisation33(*), donnent une consommation d'Enaf d'environ 60 000 ha par an en moyenne depuis 1981. Les surfaces artificialisées seraient ainsi passées, sur la même période, de 3 millions d'hectares à 5,1 millions, soit une croissance de 70 %, très supérieure à la croissance de la population française sur la période (+ 19 %)34(*), avec en particulier une forte accélération de l'artificialisation avant la crise économique de 2008, avant un reflux et une stabilisation à une valeur moyenne inférieure aux valeurs d'avant-crise35(*). L'analyse des fichiers fonciers, si elle donne des chiffres d'artificialisation beaucoup plus modestes (de l'ordre de 23 000 ha en moyenne sur la période 2006-2016), confirme cette tendance.
2) Le rythme d'artificialisation a fortement diminué depuis une quinzaine d'années
a) Une artificialisation en baisse depuis la fin des années 2000
Selon le Cerema36(*), sur la période 2009-2022, le rythme moyen d'artificialisation a atteint plus de 24 000 ha par an, « soit approximativement la surface du Val-de-Marne ou de la Seine-Saint-Denis ». Cependant, l'artificialisation des sols connaît, depuis le début des années 2010, une baisse continue au niveau national, passant de 32 000 ha en 2011 à 22 000 ha en 2015, soit une diminution de près d'un tiers des surfaces artificialisées annuellement.
La consommation d'espace pour l'habitat a représenté, ces quinze dernières années, un peu moins des deux tiers du total de la consommation d'espace, contre environ un quart pour les activités économiques, 5 % pour les infrastructures routières et environ 1 % pour les infrastructures ferroviaires (le restant étant à usage non connu ou mixte).
La consommation d'Enaf a concerné surtout le littoral
Source : Cerema, Analyse de la consommation
d'espaces :
période
du 1er janvier 2009 au
1er janvier 2023, mai 2024
La consommation d'espaces est fortement concentrée, surtout en bordure des aires urbaines et sur le littoral : les 5 % de communes qui ont le plus artificialisé ont représenté à elles seules 37 % de la consommation d'espaces. En outre, une partie de cette consommation d'espaces a concerné des zones dont la dynamique démographique ou la tension sur le logement est faible, voire négative. Ainsi, près de 8 000 communes ont consommé de l'espace alors qu'elles perdaient des habitants, et plus de 60 % de la consommation d'espaces est localisée dans des communes « détendues ».
b) Une stabilisation à un niveau élevé du rythme d'artificialisation depuis 2019
Après une période d'importante diminution sur la période 2009-2015, puis une augmentation en 2015 et 2016, la consommation d'espaces annuelle stagne entre 20 000 et 21 000 ha par an depuis 2019.
Source : Cerema, Analyse de la consommation
d'espaces : période
du 1er janvier 2009
au 1er janvier 2023,
mai 2024, p. 14
La part de l'habitat est en très légère hausse depuis 2020, tandis que la part des autres secteurs demeure stable.
3) L'artificialisation des sols présente des difficultés du point de vue environnemental, économique et social
a) L'artificialisation a des impacts environnementaux, en particulier...
(1) ... sur la biodiversité...
Selon l'Office français de la biodiversité (OFB), les sols abritent près de 60 % de la biodiversité terrestre37(*). L'artificialisation des sols entraîne une perte de la biodiversité à due proportion. Même si la loi Climat-résilience a introduit dans le code de l'urbanisme la notion de « désartificialisation »38(*), cette dernière n'équivaut pas à une restauration intégrale des qualités hydriques et environnementales du sol. En effet, selon La Fresque du Sol, 200 ans à plusieurs milliers d'années sont nécessaires, selon les cas pour former 1 cm d'épaisseur de sol39(*).
L'artificialisation affecte également la biodiversité présente dans les milieux naturels de surface préexistants. À cet égard, elle est d'autant plus préjudiciable à la biodiversité qu'elle affecte principalement, dans l'Hexagone, les prairies, qui ont représenté le milieu le plus détruit par l'artificialisation au cours des trente dernières années40(*). Or ces dernières représentent un réservoir de biodiversité particulièrement important.
Au total, selon l'étude d'impact publié par la Commission européenne à l'appui de sa proposition de directive relative à la surveillance et à la résilience des sols, la perte des services écosystémiques fournis par les sols coûterait chaque année, à l'échelle de l'Union européenne, plus de 50 Md€.
(2) ... et sur le climat
L'artificialisation des sols réduit également la capacité des sols à absorber et stocker le dioxyde de carbone (CO2). En outre, le modèle de développement urbain en étalement lié à l'artificialisation des sols est susceptible d'augmenter, à pratiques inchangées, les émissions de gaz à effets de serre, notamment occasionnées par les transports.
L'artificialisation renforce enfin le phénomène d'îlots de chaleur urbains.
b) L'artificialisation contribue à l'augmentation du risque inondation
L'artificialisation induit également une réduction de la capacité d'infiltration des sols, occasionnant une augmentation du ruissellement et donc les risques d'érosion hydrique et d'inondations. La destruction de la couverture végétale peut en outre, en fragilisant la structure des sols et en les exposant directement aux eaux de pluie et au ruissellement, augmenter le risque d'instabilité des sols, entraînant glissements de terrain et coulées de boue41(*).
c) L'artificialisation touche au premier chef les terres agricoles
Sur la période 2012-2018, les pertes de surface agricole se sont élevées en France à près de 36 000 ha42(*), tous les départements à l'exception de Mayotte ayant vu leur surface agricole reculer. Sur la même période, la plupart des changements d'utilisation des sols (71 %) ont concerné des territoires agricoles, en très grande majorité en vue d'une artificialisation, et de manière marginale en vue de la transformation en espaces naturels43(*).
Changements d'occupation des sols entre 2012 et 2018
Source : Commissariat général au
développement durable,
Les pertes de terres agricoles en
France, 21 juin 2019
Cette perte de surface agricole est une menace pour la souveraineté alimentaire française : pour les Chambres d'agriculture, l'artificialisation des sols est « une menace pour l'environnement et notre souveraineté alimentaire ».
B. La loi Climat-résilience a fixé un objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021, rigidifiant le cadre de sobriété foncière préexistant
1) Des objectifs qualitatifs de sobriété foncière ont été fixés dans la loi dès le début des années 2000
L'enjeu de la sobriété foncière a été intégré dès 2000 dans le code de l'urbanisme, via la loi « SRU »44(*), puis en 2009 via les lois Grenelle45(*) (objectif de prise en compte par le droit de l'urbanisme de la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles46(*) ; intégration de la sobriété foncière dans le développement des infrastructures de transport47(*) ; fixation d'objectifs chiffrés de consommation d'Enaf dans les Scot, sur la base d'une analyse de cette consommation les dix années précédentes, et fixation d'objectifs de « modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » dans les PLU(i)48(*)).
En 2014, la loi « Alur »49(*) a réaffirmé l'objectif de réduction de la consommation d'Enaf, et imposé une justification renforcée des projections en matière de consommation d'Enaf et des ouvertures à l'urbanisation, dans les documents d'urbanisme50(*). Enfin, en 2018, la loi « Élan » a inscrit parmi les principes généraux de l'urbanisme (listés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme), qui s'imposent aux collectivités comme aux acteurs de l'aménagement, l'objectif de « lutte contre l'étalement urbain ».
Jusqu'à la loi Climat-résilience toutefois, la notion d'« artificialisation » n'apparaissait pas en tant que telle dans le code de l'urbanisme, non plus qu'un objectif chiffré de réduction de cette dernière.
2) Un objectif de réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur dix ans fixé au niveau national
L'article 191 de la loi Climat-résilience51(*) a fixé un double objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » sur l'ensemble du territoire national en 2050. Ce double objectif est directement inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), ayant réuni entre octobre 2019 et juin 2020 un panel de 150 citoyens, et dont le rapport final proposait notamment de « définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés réduisant par 2 l'artificialisation des sols »52(*). Pour rappel, le Président de la République Emmanuel Macron s'était engagé à ce que l'ensemble des propositions de la CCC, à l'exception de trois d'entre elles maximum, soient soumises à l'examen parlementaire, ou à référendum.
3) La fixation d'objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation juridiquement contraignants : une spécificité française
À l'échelle européenne, la stratégie de l'Union européenne (UE) pour la protection des sols53(*) fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » d'ici 2050, mais s'agissant d'une communication de la Commission européenne, cet objectif n'est pas juridiquement contraignant.
La proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols, présentée en 2023 par la Commission européenne, prévoit quant à elle un système harmonisé de surveillance et d'évaluation de la santé des sols, y compris l'artificialisation, dans tous les États membres de l'UE, ainsi que la mise en place de mesures de restauration des sols. Le champ couvert par la proposition de directive est plus large que celui couvert par le cadre légal français en vigueur, puisqu'il prend également en compte la pollution des sols, qu'ils soient ou non artificialisés. La position adoptée en juin 2024 sur le texte par le Conseil européen a néanmoins ciblé plus particulièrement l'imperméabilisation et la destruction des sols. Les négociations interinstitutionnelles sur le texte ont pour l'heure échoué, en décembre 2024.
Une étude comparative effectuée, à la demande du sénateur Jean-Baptiste Blanc, par la division de la législation comparée du Sénat, en 2023, montre que la France est, en Europe, le seul pays à avoir fixé des objectifs juridiquement contraignants de réduction de l'artificialisation : l'Allemagne et l'Italie ont par exemple défini des objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation, mais ces derniers ne sont pas juridiquement contraignants, et ils ne font pas l'objet d'une déclinaison aux niveaux régional ou local54(*).
II. Le dispositif envisagé - Supprimer l'objectif de réduction de moitié du rythme d'artificialisation d'ici à 2031 tout en prévoyant de nouveaux objectifs intermédiaires régionalisés
A. Supprimer l'objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente
L'article supprime l'objectif intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation à l'échelle nationale sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, pour ne conserver que l'objectif final d'absence d'artificialisation en 2050 au niveau national. Pour ce faire, il réécrit intégralement en ce sens le premier alinéa programmatique de l'article 191 de la loi Climat-résilience, et procède à diverses coordinations au sein de l'article 194 de la loi Climat-résilience, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de l'urbanisme (CU), pour supprimer toute mention de cette première période décennale 2021-2031.
B. Élaborer de nouveaux objectifs intermédiaires de réduction de l'artificialisation au niveau régional, à échéance libre
En revanche, l'article prévoit que soient définis des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'Enaf régionalisés. En toute hypothèse, ces objectifs intermédiaires devront être au moins cohérents avec l'objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, qui est conservé au premier alinéa de l'article 191 de la loi Climat-résilience. Aucune date n'est spécifiée dans la loi pour la fixation et l'atteinte de ces objectifs.
L'article conserve également la notion d'une application de ces objectifs « de manière différenciée et territorialisée ».
III. La position de la commission - Supprimer le jalon de 2031 mais fixer des objectifs intermédiaires régionaux compatibles avec l'objectif final
A. Conserver la suppression du jalon de 2031...
La commission approuve la suppression, à l'article 191, de l'objectif national de réduction de moitié de la consommation d'Enaf pour la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, inutilement rigide, pour permettre l'atteinte de l'objectif final d'absence d'artificialisation nette au niveau national à horizon 2050. En effet, en cohérence avec les évolutions adoptées par la commission à l'article 4, cette dernière estime que la stratégie nationale de réduction de l'artificialisation des sols doit être mieux mise en cohérence avec les autres priorités de politique nationale, et doit donc pouvoir faire l'objet d'adaptations temporaires, sans que soit remis en cause l'objectif final.
Elle approuve également la suppression, à l'article 194 de la loi Climat-résilience, de l'obligation pour chacune des régions couvertes par des Sraddet, de fixer un objectif de réduction de moitié de la consommation d'Enaf pour la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021. Cette application homogène de l'objectif national ne permet en effet pas de prendre en compte l'hétérogénéité des situations régionales, notamment le plus fort dynamisme des régions littorales de l'ouest de la France. De ce fait, elle ne permet pas non plus de laisser aux régions la latitude nécessaire pour prendre en compte les besoins de foncier découlant des projets de développement tout à fait légitimes portés par des collectivités du ressort régional, ce qui contribue à une forte crispation autour de la répartition des enveloppes foncières au niveau régional. De ce point de vue, un simple report du jalon actuellement fixé à 2031 ou une réduction homogène du taux d'effort fixé au niveau national ne paraît pas de nature à permettre la prise en compte différenciée des situations régionales, et pourrait paradoxalement conduire, pour lever les contraintes, à un alignement sur les régions « moins-disantes ».
B. ...pour dessiner des trajectoires territorialisées et différenciées permettant d'atteindre l'objectif à horizon 2050
Par l'adoption des amendements identiques COM-54 des rapporteurs et COM-64 de la commission de l'aménagement du développement durable, la commission a clarifié l'obligation faite aux régions de fixer dans leurs documents de planification une trajectoire et des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050. La crédibilité de la trajectoire dessinée par ces jalons intermédiaires pour atteindre l'objectif 2050 sera déterminante pour que ces documents de planification puissent « passer » le contrôle de légalité.
La commission a également adopté deux amendements rédactionnels identiques COM-53 des rapporteurs et COM-63 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 3
Dates de modification des documents de planification et
d'urbanisme
pour y intégrer les objectifs de réduction de
l'artificialisation
Cet article vise à repousser les dates butoirs d'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience à :
- août 2026 pour les documents de planification régionale ;
- août 2031 pour les schémas de cohérence territoriale (Scot) ;
- août 2036 pour les autres documents d'urbanisme (PLU(i)) et cartes communales).
La commission a repoussé d'un an supplémentaire la date butoir de modification des documents régionaux de planification, à août 2027, et a en revanche restreint le report des dates butoirs des documents d'urbanisme, jusqu'à respectivement août 2028 et 2029 - minimum nécessaires, compte tenu du report de la modification des documents régionaux, pour permettre une modification « en cascade » conforme à la hiérarchie des normes.
La commission a également ouvert la possibilité pour le préfet d'accorder au cas par cas un délai supplémentaire pour les collectivités qui pourraient justifier de difficultés dans la modification de leur document d'urbanisme.
Enfin, par souci de simplicité, les régions qui ont déjà modifié leurs documents et souhaiteraient tirer parti des assouplissements introduits par la future loi Trace seront autorisées à modifier uniquement le volet relatif à la lutte contre l'artificialisation des sols.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - Les échéances fixées par la loi Climat-résilience pour l'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme ont déjà été repoussées plusieurs fois
A. La loi Climat-résilience a fixé des échéances pour intégrer dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme des objectifs de réduction de l'artificialisation
1) Les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience doivent être déclinés dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme
La loi Climat-résilience a fixé un double objectif national de réduction de moitié de la consommation d'espace sur la période 2021-2031, par rapport la décennie précédente, et d'atteinte du « zéro artificialisation nette » à l'horizon 205055(*).
Afin d'engager rapidement la décrue de l'artificialisation nécessaire à l'atteinte de cet objectif, l'article 194 de cette même loi a rendu obligatoire l'intégration dans les documents de planification régionaux (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), schémas d'aménagement régionaux (SAR) pour les départements et régions d'outre-mer, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc) et schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif)) d'objectifs de moyen et de long terme de lutte contre l'artificialisation des sols et d'une trajectoire « permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation »56(*).
Pour les Sraddet, la loi précise que l'objectif de réduction de l'artificialisation qui y figure ne doit pas, pour la première période décennale 2021-2031, « dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant [2011-2021] »57(*) ; l'article précise également que les Sraddet doivent procéder à une déclinaison de l'objectif fixé au niveau régional entre les différentes parties du territoire régional (territorialisation de l'objectif de réduction de la consommation d'Enaf). Pour les autres documents régionaux de planification, aucune valeur chiffrée n'est spécifiée et aucune obligation de territorialisation de l'objectif régional n'est mentionnée.
Le même article 194 prévoit également que :
- le projet d'aménagement stratégique (PAS) du Scot fixe un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranche de dix années58(*) ; le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du Scot peut décliner ces objectifs par secteur géographique59(*) ;
- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU(i), ou la carte communale, fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain « pour la réalisation des objectifs » de réduction de l'artificialisation fixés dans les Scot ou, en l'absence de Scot, dans les documents régionaux de planification. Les objectifs fixés dans ces derniers s'appliquent alors en fonction du degré de prescriptivité de ces documents par rapport aux documents d'urbanisme, à savoir : prise en compte pour les objectifs fixés dans le rapport d'objectifs des Sraddet, et compatibilité pour les objectifs fixés dans le fascicule du Sraddet ou dans les autres documents régionaux de planification60(*).
Compte tenu de la hiérarchie des normes entre les documents d'urbanisme locaux et les documents régionaux de planification, l'évolution de ces derniers est susceptible d'entraîner dans la majorité des cas une évolution « en cascade » des documents d'urbanisme. Pour rappel, dans le cadre général, l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme a fixé le délai à trois ans pour la mise en compatibilité en cascade des documents d'urbanisme entre eux.
2) La loi fixe des dates maximales pour l'intégration de ces objectifs
a) Pour les documents régionaux de planification
Afin d'engager rapidement la décrue de l'artificialisation nécessaire à l'atteinte des objectifs de réduction fixés par la loi Climat-résilience, et en particulier l'atteinte du premier objectif intermédiaire à horizon 2031, le IV de l'article 194 de la même loi prévoyait des dates limites de modification des documents de planification et d'urbanisme.
Ainsi, les différents documents régionaux de planification qui ne comportaient pas déjà des objectifs de réduction de l'artificialisation cohérents avec ceux fixés par la loi Climat-résilience devaient initialement voir leur modification pour les y inclure engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, et entrer en vigueur dans un délai de deux ans à compter de cette même promulgation, soit avant août 202361(*).
b) Pour les documents d'urbanisme
Les documents d'urbanisme devaient pour leur part intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation introduits dans les documents régionaux lors de leur première révision ou modification à compter de l'adoption desdits documents régionaux modifiés62(*).
L'entrée en vigueur de ces documents d'urbanisme ainsi modifiés devait intervenir au plus tard :
- en août 2026 pour les Scot63(*) ;
- en août 2027 pour les PLU(i) et les cartes communales64(*) (que les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés soient ou non couverts par un Scot).
Dans le cas où les modifications des documents régionaux n'auraient pas été effectuées dans les délais fixés par la loi, l'article 194 prévoit que la fixation d'objectifs de réduction de la consommation d'Enaf au sein des documents d'urbanisme se fera sur la base d'une réduction de moitié de la consommation d'espace effectivement constatée sur la décennie 2011-2021 à l'échelon, selon les cas, du Scot, de l'EPCI ou de la commune, sans tenir compte, donc, de l'éventuelle modulation résultant de la territorialisation des objectifs qui aurait pu être effectuée par le Sraddet au sein de la région65(*) ou, le cas échéant, par le Scot.
La non-modification dans les délais impartis des documents d'urbanisme entraînera quant à elle des restrictions en matière de droit à la construction :
- dans les zones couvertes par un Scot, si ce dernier n'a pas été modifié dans les délais impartis, aucune zone nouvelle ne pourra plus être ouverte à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un PLU(i)66(*) ;
- si le PLU(i) ou la carte communale n'a pas été modifié dans les délais impartis, aucune autorisation d'urbanisme ne peut plus être délivrée, y compris dans les zones ouvertes à l'urbanisation (gel des constructions)67(*).
c) Une accélération des procédures de modification des documents de planification et des documents d'urbanisme
Afin de permettre une évolution plus rapide des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y introduire les objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation, l'article 194 de la loi Climat-résilience a prévu la possibilité d'employer des procédures accélérées par rapport à la procédure de droit commun, à savoir :
- pour les Sraddet, la procédure simplifiée définie au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet la mise à disposition du public du projet de modification et des avis des personnes publiques associées (PPA) uniquement par voie électronique, pour une durée de deux mois, en lieu et place de l'enquête publique ;
- pour les documents d'urbanisme, les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à 39 et L. 153-45 à 48 du code de l'urbanisme, qui permettent d'une part de remplacer l'enquête publique par une mise à disposition du public du projet et des avis des PPA, pour une durée d'un mois (art. L.- 143-38 et L. 153-47 du code de l'urbanisme), d'autre part, que ces documents deviennent exécutoires dès publication et transmission à l'autorité administrative compétente de l'État.
B. Les dates butoirs ont déjà été repoussées à deux reprises
1) La loi « 3DS » a repoussé la date de modification des documents régionaux de planification
Compte tenu des difficultés rencontrées par les régions pour mettre à jour leurs documents de planification dans les délais impartis - notamment en raison de l'absence de visibilité sur la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées applicable à compter de 203168(*) - la loi « 3DS »69(*) a repoussé une première fois, en 2022, la date butoir d'entrée en vigueur des documents régionaux de planification modifiés, de deux ans à trente mois, ce qui la portait donc à février 2024.
La loi « 3DS » n'a en revanche pas modifié les dates de modification des documents d'urbanisme.
2) La loi « ZAN 2 » a repoussé la date de modification de l'ensemble des documents de planification et d'urbanisme
En raison de difficultés persistantes soulevées par les régions pour se conformer à ces délais, la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a à nouveau repoussé la date butoir d'entrée en vigueur des documents régionaux de planification modifiés, de trente à trente-neuf mois, c'est-à-dire à novembre 2024.
Elle a également allongé de six mois les délais pour l'entrée en vigueur des documents d'urbanisme modifiés, les portant donc :
- à février 2027 pour les Scot ;
- à février 2028 pour les PLU(i) et cartes communales.
II. Le dispositif envisagé - Repousser les dates butoirs de modification des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de l'artificialisation
L'article repousse les dates butoirs pour inclure dans les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat-résilience à :
- août 2026 pour les documents de planification régionale (report d'un an et neuf mois) ;
- août 2031 pour les Scot (report de trois ans et demi) ;
- août 2036 pour les PLU(i) et cartes régionales (report de huit ans et demi).
III. La position de la commission - Repousser les échéances a minima pour permettre aux collectivités de tirer parti des assouplissements introduits par la future loi « Trace »
A. Un report des échéances nécessaires, au vu du bilan des modifications des documents régionaux de planification
En janvier 2025, sur 11 régions couvertes par un Sraddet, cinq ont mené à terme la modification de leur Sraddet (Bourgogne, Bretagne, Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine), trois sont engagées dans le processus (Grand Est, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie) et trois ont suspendu la procédure de modification, dans l'attente de nouvelles dispositions législatives (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre, Pays de la Loire).
Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) a été approuvé par le conseil régional en septembre 2024 et entrera en vigueur dans les prochaines semaines.
En revanche, en Corse, la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc) a été lancée seulement en novembre dernier, et d'importantes difficultés demeurent pour les modifications des schémas d'aménagement régionaux (SAR) ultramarins.
L'évolution des documents régionaux de planification et, partant, l'engagement des procédures d'évolution des documents d'urbanisme, ont été retardés par la publication tardive de certains décrets et arrêtés d'application indispensables à la préparation de ces documents (décrets relatifs à la nomenclature des sols et aux modalités de territorialisation des objectifs « ZAN »70(*), avril 2022 ; décret sur les mesures de compensation écologique et de renaturation décomptables du « ZAN »71(*), décembre 2022 ; liste des projets d'envergure nationale et européenne (Pene)72(*), juin 202473(*)).
Il sera nécessaire de laisser aux régions du temps, après la promulgation de la future loi « Trace », pour s'approprier les assouplissements ainsi permis et en évaluer les effets et pour effectuer les concertations nécessaires avec les collectivités du ressort régional - d'autant que l'article 5 de la proposition de loi réforme la conférence régionale de gouvernance qui est la principale instance de dialogue régional sur le sujet74(*). Pour cette raison, par l'adoption des amendements identiques COM-55 des rapporteurs et COM-65 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la commission a repoussé d'un an supplémentaire par rapport au texte initial de la proposition de loi la date butoir de modification des documents régionaux de planification, pour la porter à août 2027.
Par coordination, par l'adoption des mêmes amendements, la commission a resserré l'extension du délai pour la modification des documents d'urbanisme, en la portant à un an et demi supplémentaire par rapport au droit existant, soit août 2028 pour les Scot et août 2029 pour les PLU(i) et cartes communales.
Ces délais supplémentaires paraissent suffisants pour permettre à ces documents d'urbanisme de tenir compte des objectifs qui seront fixés dans les documents de planification de niveau supérieur. Pour rappel, 43 % des documents d'urbanisme sont déjà à l'heure actuelle en cours d'élaboration, de révision ou de modification75(*). En outre, l'utilisation de la modification simplifiée des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs fixés par la loi Climat-résilience76(*) permet de réduire à 6 mois à un an environ la procédure (contre 3 ans en moyenne en cas de révision).
En outre, un report excessif des dates butoirs de modification des documents d'urbanisme risquerait de compromettre l'atteinte des objectifs intermédiaires inscrits dans les documents régionaux de planification, voire de l'objectif national à horizon 2050.
B. Limiter la réouverture des documents régionaux de planification au strict nécessaire
Enfin, dans un souci de simplification, de rapidité et de maîtrise des coûts, la commission, par l'adoption des mêmes amendements, va permettre aux régions qui ont déjà modifié leur Sraddet de rouvrir uniquement le volet relatif à l'artificialisation. L'objectif est de ne pas pénaliser les « bons élèves », qui pourraient être réticents à procéder à une nouvelle modification générale de leur document de planification.
Interrogée par les rapporteurs, l'association des Régions de France a en effet souligné que « les évolutions législatives récurrentes [...] génèrent des coûts pour les Régions, mais également pour les autres niveaux de collectivités qui doivent prendre en compte/mettre en compatibilité leurs SCoT/PLU avec les documents de planification régionale »77(*).
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 4
Exclusion des projets d'envergure nationale et
européenne
du décompte de la consommation d'espace
Cet article vise à exclure de manière pérenne de l'imputation aux enveloppes foncières des régions et des collectivités locales la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) induite par la réalisation de projets d'envergure nationale et européenne (Pene).
Il prévoit également la définition par l'État d'une trajectoire de baisse de la consommation d'Enaf, pour les Pene dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics.
La commission a approuvé et précisé ces dispositions, et a exempté du décompte de la consommation d'espace jusqu'en 2036 l'ensemble des implantations industrielles, d'infrastructures de production d'énergie renouvelable et de réalisation de logements sociaux dans les communes carencées.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
I. La situation actuelle - La consommation 'd'Enaf par les projets d'envergure nationale ou européenne (Pene) fait l'objet d'une mutualisation au niveau national
A. La loi « ZAN 2 » a exclu la consommation d'Enaf induite par certains grands projets des décomptes régionaux et locaux, mais a prévu sa mutualisation à l'échelon national
1) La mutualisation à l'échelon régional de l'artificialisation induite par certains projets d'intérêt national ou régional, prévue par la loi Climat-résilience, ne permettait pas de prendre en compte de manière satisfaisante certains projets très artificialisants d'envergure nationale
Afin de tenir compte du fait que certains projets artificialisants ne bénéficient pas uniquement à la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ils sont implantés, la loi Climat-résilience a prévu, dès l'origine, des modalités de comptabilisation dérogatoires de la consommation d'Enaf induite par des projets « d'intérêt national ou régional ». Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires avait précisé que les projets concernés par cette disposition étaient les projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale, et que leur liste devait être définie par la région, dans le fascicule du Sraddet.
En application de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi Climat-résilience, ces projets pouvaient ainsi voir leur consommation d'Enaf imputée non pas à l'enveloppe d'artificialisation du schéma de cohérence territoriale (Scot) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) couverts par ce dernier, mais uniquement à l'échelon régional. Ils devaient en outre être pris en compte dans la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par le Scot au sein des différentes parties de son territoire78(*). Concrètement, au sein du Sraddet, une enveloppe foncière spécifique est réservée au sein de l'enveloppe foncière régionale et affectée à la réalisation de ces projets, le reste étant réparti entre les collectivités infrarégionales.
2) La loi « ZAN 2 » a revu la liste des projets dont la consommation d'Enaf est comptabilisée de manière dérogatoire, et prévu la mutualisation de cette dernière au niveau national
Le système des projets d'intérêt régional ne permettait cependant pas de traiter le cas de projets de très grande envergure, dont l'imputation à l'enveloppe foncière de la seule région d'implantation grevait excessivement cette dernière, au détriment des collectivités locales, qui se partageaient ensuite la portion congrue. À titre d'exemple, dans les Hauts-de-France, région dont l'enveloppe d'artificialisation pour 2021-2031 s'élève à environ 8 000 ha, l'artificialisation induite par les aménagements du Canal Seine-Nord Europe et le grand port maritime de Dunkerque (respectivement 850 et 700 ha) représente près d'un cinquième de l'enveloppe régionale.
En conséquence, en 2023, l'article 3 de la loi d'initiative sénatoriale « ZAN 2 »79(*) a modifié l'article 194 de la loi Climat-résilience pour créer, pour ces grands projets, une nouvelle catégorie de « projets d'envergure nationale et européenne » (« Pene ») bénéficiant également de modalités de décompte dérogatoires. Ainsi, cet article :
- précise les types de projets pouvant être qualifiés de Pene;
- fixe les modalités de qualification de projets comme Pene (cf. ci-dessous).
- précise que pour la période 2011-2021, la consommation d'Enaf résultant des Pene est prise en compte au niveau national, et n'est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d'urbanisme80(*).
La consommation d'Enaf résultant de ces Pene est prise en compte, au niveau national, dans le cadre d'un forfait national fixe, à hauteur de 12 500 ha, dont 10 000 ha pour les régions couvertes par un Sraddet81(*).
Afin de prendre en compte ces surfaces dont la consommation est mutualisée entre régions, tout en conservant une réduction de moitié de la consommation d'Enaf sur la période 2021-2031 par rapport à 2011-2021 au niveau national, le taux d'effort de chaque région en matière de réduction de l'artificialisation, fixé initialement par la loi Climat-résilience, pour les régions couvertes par un Sraddet, à - 50 %82(*), a été relevé à - 54,5 %83(*).
L'article 194 de la loi Climat-résilience, dans sa rédaction résultant de la loi « ZAN 2 », précise que ce relèvement du taux d'effort demeurera inchangé, quand bien même la somme des surfaces consommées par les Pene dépasserait 10 000 ha ;
Catégories de projets pouvant être qualifiés de Pene84(*)
Source : Légifrance
B. Le système des Pene fait l'objet de critiques tant sur son fonctionnement que sur son principe
1) La procédure de qualification des Pene est un processus complexe dans lequel l'État a le dernier mot
L'article 194 de la loi Climat-résilience tel que modifié par la loi « ZAN 2 » dispose que la liste des Pene est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme85(*), après avis du président du conseil régional de la région d'implantation et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols86(*). Le ministre chargé de l'urbanisme doit adresser une réponse motivée sur les suites données à cet avis. Ainsi, si les Pene doivent obligatoirement appartenir à l'une des catégories de projets fixés au 7° du III de l'article 194 de la loi Climat-résilience (cf. ci-dessus), tout projet appartenant à cette catégorie n'est pas automatiquement qualifié de Pene.
En cas de désaccord sur la liste des Pene, la région peut également saisir une commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols87(*), composée de trois représentants de la région et de trois représentants de l'État - dont le préfet et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement (Dreal), ainsi que d'un magistrat administratif, qui la préside88(*). Les propositions de la commission sont rendues publiques, et lorsque le ministre chargé de l'urbanisme ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée89(*).
La liste des Pene peut être modifiée, dans les mêmes formes, sans limitation.
2) La première liste des Pene publiée en mai 2024 est caractérisée par une répartition inégale entre régions
L'arrêté listant les Pene90(*) a été publié au Journal Officiel en juin 2024. Son annexe I recense les projets fermement qualifiés de Pene, tandis que l'annexe II « mentionne à titre indicatif des projets susceptibles d'être identifiés dans l'annexe I à l'occasion d'une modification » de l'arrêté. Il s'agit le plus souvent de projets dont la réalisation demeurait hypothétique au moment de la publication de l'arrêté.
L'annexe I comprend actuellement 175 projets représentant au total 12 140 ha, dont 9 980 ha dans les régions couvertes par un Sraddet. Parmi ces projets, environ la moitié sont des projets d'infrastructures (dont 54 % d'infrastructures routières, 21 % d'infrastructures ferroviaires, 9 % d'infrastructures fluviales et 13 % d'infrastructures portuaires) et un tiers des projets industriels et nucléaires. Les projets en lien avec la défense nationale et la sécurité intérieure, ainsi que les établissements pénitentiaires, représentent environ 7 % du total.
L'annexe II comprend actuellement, à titre indicatif, 312 projets, pour une surface totale estimée de 6 050 ha91(*).
La répartition des Pene entre les régions est très inégale. À titre d'exemple, l'ensemble des projets qualifiés de Pene en Bretagne représentent un peu plus de 200 ha, contre environ 2 000 ha dans la région Hauts-de-France92(*). L'effort de réduction supplémentaire de l'artificialisation demandée à chaque région (passage de - 50 % à - 54,5 %) est ainsi plus que compensé dans certaines régions par les surfaces représentées par le Pene, tandis que dans d'autres, la perte de foncier artificialisable est « sèche ».
3) Des élargissements ciblés du système des Pene ont été introduites dans divers textes sectoriels récemment examinés au Parlement
Compte tenu du caractère limité des catégories de projets pouvant être qualifiés de Pene, et du « verrou » représenté par le contrôle in fine exercé par le ministre chargé de l'urbanisme sur la liste des projets effectivement qualifiés de Pene, plusieurs initiatives sénatoriales ont récemment tendu à prévoir des exemptions ad hoc du décompte de la consommation d'Enaf pour des catégories particulières de projets :
- dans le cadre de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique93(*), un amendement de M. Guislain Cambier, président du groupe de suivi sur l'artificialisation des sols et plusieurs de ses collègues a prévu :
o que sont éligibles à la qualification en tant que Pene l'ensemble des implantations industrielles, ainsi que certains data centers d'intérêt national majeur ;
o que la qualification en tant que Pene de ces types de projets est effectuée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, et non par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
- dans le cadre de l'examen en commission du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables94(*), la commission des affaires économiques a, par l'adoption d'un amendement du même Guislain Cambier et de plusieurs de ses collègues, prévu, sans passer par le mécanisme des Pene, une exemption sous conditions du décompte de la consommation d'Enaf pour la création de logements locatifs sociaux.
La disposition sur les projets industriels demeure en discussion, le projet de loi de simplification économique devant être prochainement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale au printemps 2025, tandis que le projet de loi sur l'accès au logement abordable a été reporté sine die.
II. Le dispositif envisagé - Exclure les Pene des décomptes locaux et régionaux de consommation d'Enaf tout en incitant l'État à davantage de sobriété foncière
A. Exclure les Pene des décomptes locaux et régionaux de consommation d'Enaf
L'article exclut la consommation d'Enaf résultant des Pene du décompte de la consommation d'Enaf au niveau régional et au niveau local et supprime la possibilité de majorer le taux d'effort régional en matière de réduction de la consommation d'Enaf, pour prendre en compte forfaitairement, au niveau national, la prise en compte forfaitaire de la consommation d'Enaf résultat des Pene.
Il ne modifie en revanche pas les modalités de qualification des projets en tant que Pene, ni la liste des catégories de projets pouvant être qualifiés de Pene.
B. Définir une trajectoire de réduction de l'artificialisation pour les Pene sous maîtrise d'ouvrage de l'État ou de ses opérateurs
L'article prévoit également la définition par l'État d'une trajectoire de baisse de la consommation d'Enaf, pour les Pene dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics, dans l'optique de soumettre l'État aux mêmes contraintes que celles imposées aux collectivités territoriales.
En effet, en l'état actuel du droit, les efforts chiffrés de réduction de consommation d'Enaf fixés en application des articles 191 et 194 de la loi Climat-résilience devront être portées uniquement par les communes ou EPCI d'implantation des projets, indépendamment de la qualité du maître d'ouvrage.
III. La position de la commission - Maintenir l'exclusion du décompte de la consommation d'Enaf les Pene et y ajouter temporairement les projets visant à la mise en oeuvre de politiques publiques prioritaires
A. Confirmer l'exclusion du décompte des Pene, sans limitation de temps
La commission a approuvé l'exclusion totale du décompte national de la consommation d'Enaf des Pene, en clarifiant la rédaction (amendements identiques COM-56 des rapporteurs et COM-67 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable). Cette exclusion permettra de ne pas pénaliser les régions non bénéficiaires de ces Pene.
B. Exclure pour dix ans du décompte de la consommation d'Enaf les projets relevant de politiques publiques prioritaires
La déclinaison dans les territoires de politiques publiques prioritaires, comme la réindustrialisation, le développement des énergies renouvelables ou l'amplification de l'offre de logement abordable, susceptibles de nécessiter la mobilisation de foncier nouveau, fait peser sur les élus des injonctions contradictoires, et aboutit pour les collectivités à des situations de blocage insolubles, que le système des Pene ne permet pas entièrement de lever, en raison :
- d'une part des catégories de projets éligibles, limitativement énumérés dans la loi ;
- d'autre part, parce que les Pene ne concernent, par définition, que des projets d'une certaine ampleur - pour la première liste des Pene publiée en juin 2024, un seuil de 1 hectare minimum avait été fixé par le ministre chargé de l'urbanisme de l'époque, Christophe Béchu.
Ainsi, en ce qui concerne l'industrie, ne peuvent être qualifiés de Pene que les « projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique », ou les projets d'industrie verte. Les infrastructures de production d'énergie renouvelable ne sont pas, à l'exception des centrales nucléaires, citées en tant que telles, non plus que les constructions liées aux logements - excepté via les aménagements réalisés dans le cadre d'opérations d'intérêt national, qui peuvent comprendre la création de logements.
Du reste, ces trois catégories de projets - industrie, logement, infrastructures de production d'énergie renouvelable - nécessitent tout autant la réalisation de grandes opérations très consommatrices d'espaces qu'une multiplicité d'opérations de faible ampleur, permettant de mailler l'ensemble du territoire. Il convient donc de lever la contrainte d'accès au foncier y compris pour ces petits projets. Toutefois, si l'industrie ne représente que 4 % des surfaces artificialisées en France, une sortie totale du décompte de l'ensemble des consommations liées au logement compromettrait immanquablement l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation, même à échéance 2050, dans la mesure où la production de logements neufs a représenté, sur la décennie 2011-2021, près des deux tiers de la consommation d'Enaf95(*), et les exemptions devraient donc être ciblées uniquement sur certaines catégories de logements.
La réalisation des objectifs de réindustrialisation, d'amplification de l'offre de logement abordable et d'augmentation de la part de la production d'énergies renouvelables, nécessite en outre que ces assouplissements soient réalisés immédiatement.
Pour cette raison, la commission a, par l'adoption des amendements identiques COM-56 des rapporteurs et COM-67 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, modifiés par les sous-amendements COM-70, COM-71 et COM-72, prévu une exclusion temporaire, jusqu'en 2036, du décompte de la consommation d'Enaf, à tous les échelons, des implantations industrielles, des infrastructures de production d'énergie renouvelable et des constructions de logement social permettant aux communes carencées d'atteindre les taux de logement social fixés par la loi, dans la lignée des amendements en ce sens adoptés par la commission lors de l'examen du projet de loi « logement abordable » (cf. ci-dessus).
Ces exemptions ciblées, limitées dans le temps, permettront de lever les injonctions contradictoires qui pèsent sur les élus, sans compromettre l'atteinte de l'objectif national d'absence d'artificialisation nette à horizon 2050.
C. Fixer une trajectoire de réduction de la consommation d'Enaf pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'État
La commission a également adopté les deux amendements identiques COM-57 des rapporteurs et COM-66 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui prévoient que l'État, à l'instar des régions, fixe une trajectoire de réduction de la consommation d'Enaf pour les Pene dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Dès lors que la consommation d'Enaf est exclue de la comptabilisation au niveau national, il n'est en effet pas cohérent, comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi, de prévoir que seuls les Pene sous maîtrise d'ouvrage de l'État suivent obligatoirement une trajectoire baissière de consommation d'Enaf.
La rédaction adoptée par la commission permettra de formaliser la réflexion de l'État sur une utilisation plus efficace de l'espace, pour les grands projets dont il a la responsabilité, afin qu'il contribue lui aussi efficacement à la réduction de la consommation d'Enaf au niveau national.
La commission a adopté l'article ainsi modifié.
Article 5
Modalités de fixation et de territorialisation des
objectifs régionaux
de réduction de l'artificialisation
Cet article modifie les modalités de détermination des enveloppes régionales de consommation d'Enaf, en prévoyant une intervention renforcée de la conférence de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, dont la composition est également modifiée afin d'assurer la représentation de l'ensemble des communes et EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme. Cette instance, rebaptisée « conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière », serait ainsi appelée à :
- répartir, à la majorité qualifiée de la moitié des communes représentant la moitié de la population de la région, l'enveloppe régionale de consommation d'Enaf déterminée par la région, lorsque cette dernière a déjà fixé cette dernière dans le Sraddet ;
- dans les régions où les nouveaux Sraddet ne sont pas encore entrés en vigueur, ou bien dans les régions qui souhaitent redéfinir leur enveloppe de consommation d'Enaf pour la période 2021-2031, participer à la fixation de cette enveloppe : cette dernière ne pourra être adoptée qu'avec avis conforme de la conférence, pouvant être selon les cas être exprimé avec une majorité renforcée.
Sur proposition des rapporteurs, la commission a re-rédigé l'article pour renforcer la place des élus du bloc communal dans les conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols - renommées conférences régionales de la sobriété foncière -, qui pourront enjoindre à la région de reconsidérer les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés dans son document de planification, ainsi que leur territorialisation, et donneront un avis conforme sur la liste des projets d'envergure nationale.
Conformément à une revendication de longue date du Sénat, elle a précisé que ces objectifs s'appliqueraient aux documents d'urbanisme dans un rapport de prise en compte, et non plus de compatibilité.
La commission a adopté l'article ainsi rédigé.
I. La situation actuelle - Les modalités de territorialisation de la réduction de l'artificialisation fixées par la loi Climat-résilience n'ont pas été mises en oeuvre de manière satisfaisante par les régions
A. Les modalités de territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation fixées par les régions en application de la loi Climat-résilience ont été modifiées à plusieurs reprises, mais leur application demeure imparfaite
L'article 194 de la loi Climat-résilience a prévu que l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation inscrit dans le Sraddet doit être « décliné entre les différentes parties du territoire régional »96(*). Les critères de territorialisation ont été précisés à l'article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'abord par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, puis par le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols. Ce dernier intègre plusieurs modifications qui figuraient initialement dans la proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, dont l'examen a abouti à la loi « ZAN 2 ».
En l'état actuel du droit, l'article R. 4251-3 du CGCT dispose ainsi que la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf fixés dans les Sraddet doivent prendre en compte :
- le nombre d'emplois et de ménages accueillis,
- les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;
- le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés (optimisation de la densité, renouvellement urbain et réhabilitation des friches) ;
- l'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales et de montagne ;
- l'adaptation des territoires exposés à des risques naturels, y compris le recul du trait de côte ;
- les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d'adaptation d'exploitations.
Les mêmes décrets ont prévu la possibilité pour les régions d'édicter, dans le fascicule du Sraddet, des règles différenciées, afin d'assurer la déclinaison des objectifs de réduction de la consommation d'espace entre les différentes parties du territoire régional, en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale (art. R. 4251-8 CGCT). La déclinaison territoriale doit ainsi tenir compte également de la « garantie de développement communale » de 1 ha créée par la loi « ZAN 2 », des enjeux liés au recul du trait de côte et des projets d'aménagement, d'infrastructures, d'équipements publics ou d'activités économiques d'ampleur régionale, dont l'artificialisation est mutualisée au niveau régional et n'est pas imputée aux collectivités locales d'implantation.
Pour rappel, l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme dispose qu'un second niveau de territorialisation peut être effectué au sein des Scot.
Malgré les modifications réglementaires ainsi introduites à l'initiative du Sénat, les représentants élus interrogés par les rapporteurs se sont fait l'écho d'un profond mécontentement des maires et présidents d'EPCI quant aux modalités de territorialisation appliquées dans les faits. Celles-ci sont globalement jugées excessivement rigides et fondées uniquement sur les dynamiques observées sur les périodes passées, sans tenir compte des projets portés par les élus locaux pour leurs territoires. La concertation avec les élus du territoire régional, pour tenir compte de ces dynamiques futures, est également jugée globalement insuffisante.
B. La conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, rénovée par la loi « ZAN 2 » n'a pas permis de procéder à une territorialisation équilibrée
1) La loi « ZAN 2 » a profondément modifié la composition et le fonctionnement de la « conférence des Scot », afin d'améliorer la territorialisation infrarégionale
a) La loi Climat-résilience a créé une « conférence des Scot » chargée de contribuer à la territorialisation infrarégionale des enveloppes foncières
Le V de l'article 194 de la loi Climat-résilience a créé une conférence des schémas de cohérence territoriale (Scot) (« conférence des Scot »), réunissant l'ensemble des Scot ainsi que des représentants des communes et EPCI non couverts par des Scot, dont le rôle était de faire à la région des propositions relatives à l'établissement des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation et à leur déclinaison territoriale, en amont de la modification des Sraddet pour y introduire les objectifs de réduction de l'artificialisation prévus à l'article 194 de la loi Climat-résilience.
Ces propositions sont cependant restées très générales, et n'ont pas permis d'élaborer des clefs de répartition directement applicables, et partagées par l'ensemble des acteurs97(*).
b) La loi « ZAN 2 » a créé des « conférences du ZAN », qui devaient être des instances de dialogue en vue d'une territorialisation régionale concertée
L'article 2 de la loi « ZAN 2 » a profondément modifié la composition et le rôle de la conférence des Scot, rebaptisée « conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols ». Ces dispositions ont été codifiées au nouvel article L. 1111-9-2 du CGCT.
La composition de la conférence, qui a fait l'objet de vifs débats au Sénat lors de l'examen du texte, est déterminée par délibération du conseil régional, prise sur avis conforme de la majorité des EPCI et communes compétents en matière de document d'urbanisme. Elle comprend au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif. À défaut de délibération en ce sens du conseil régional, la conférence est composée de :
- 15 représentants de la région ;
- 5 représentants des Scot ;
- 15 représentants des EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un Scot ;
- 7 représentants des communes compétentes en matière de documents d'urbanisme, dont un représentant au moins par département ;
- 5 représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme ;
- 1 représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;
- 5 représentants de l'État.
Dans tous les cas, la composition de la conférence doit assurer une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
La conférence est présidée par le président du conseil régional ou, selon les cas, le président de l'Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte98(*).
La conférence a notamment pour rôle de transmettre aux autorités régionales, en vue de la modification des documents régionaux de planification en vue d'y inscrire les objectifs de réduction de l'artificialisation prévus à l'article 194 de la loi Climat-résilience, des propositions relatives à l'établissement de ces objectifs et, le cas échéant, leur déclinaison en objectifs infrarégionaux. Il s'agissait, selon le rapport de la commission spéciale sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, de permettre que « le dialogue [...] engagé entre les régions et les niveaux infrarégionaux [au sein des « conférences des Scot » soit] approfondi et [puisse] se déployer sur le temps long »99(*).
2) Le bilan du fonctionnement des conférences régionales est jugé décevant par la plupart des acteurs locaux
Seize des 18 régions (toutes à l'exception d'Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Île-de-France) ont constitué leur conférence régionale. Parmi elles, sept régions ont choisi des compositions définies localement, intégrant notamment des acteurs économiques (Normandie par exemple), des chambres régionales, agences de l'eau et parcs naturels régionaux (Grand Est) ou des associations d'élus (Bretagne) ; huit autres régions ont retenu la composition par défaut fixée par la loi100(*). Des difficultés ont pu ponctuellement être relevées, lors de la mise en place des conférences, notamment lorsque la composition par défaut fixée par la loi ne permettait pas de refléter toutes les subtilités de la composition territoriale de la région.
En moyenne, les conférences se sont réunies deux à trois fois au cours de l'année 2024.
Les représentants des associations d'élus locaux interrogés par les rapporteurs ont, pour la plupart d'entre eux, exprimé un certain inconfort quant au fonctionnement des conférences régionales, telles que créées par la loi « ZAN 2 ». Ces critiques concernent tant la composition de la conférence, où les communes ne bénéficieraient pas d'une représentation suffisante, que les résultats obtenus. Si les conférences ont été consultées, ainsi que le prévoit la loi, sur la qualification des Pene, ainsi que sur les projets d'envergure nationale, lorsque les régions ont choisi d'en désigner, certaines ont en outre constitué des instances de dialogue en vue de fixer l'objectif régional de réduction de la consommation d'Enaf et sa territorialisation. C'est le cas notamment des régions Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Occitanie et Pays de la Loire). Dans plusieurs régions néanmoins, les nouvelles conférences régionales - comme avant elle les conférences des Scots - ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur une répartition de l'enveloppe foncière régionale. Mme Laurence Rouède, entendue par les rapporteurs, a notamment cité le cas de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont elle est vice-présidente.
Enfin, certaines conférences, par exemple en Bretagne, ont mis en place des groupes de travail pour poursuivre les consultations et suivre la mise en oeuvre des objectifs au niveau local.
II. Le dispositif envisagé - Renforcer la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols pour assurer la prise en compte des projets des territoires dans la fixation des enveloppes foncières régionales
L'article modifie la dénomination de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, désormais baptisée « conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière », et en réforme profondément la composition et le fonctionnement, en vue d'améliorer les modalités de territorialisation des objectifs régionaux de réduction de la consommation d'Enaf, dans une logique ascendante.
L'article ne contraint pas en revanche les régions dont les documents de planification auraient déjà été modifiés conformément à l'article 194 de la loi Climat-résilience à définir un nouvel objectif régional de réduction de l'artificialisation.
A. Modifier la composition de la conférence pour assurer la représentation de l'ensemble des communes
L'article prévoit que la nouvelle conférence est constituée de représentants de l'ensemble des communes et EPCI de la région compétents en matière de documents d'urbanisme. Ces derniers pourront, lorsqu'ils sont membres d'un Scot, être représentés par ce dernier, selon des modalités fixées par lui.
Participeront en outre, à titre consultatif, aux travaux de la conférence :
- les représentants de l'État dans la région et dans les départements du ressort régional ;
- des représentants de la région ;
- des représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme ;
- des représentants des départements du ressort régional.
Il est également prévu que la conférence puisse se réunir en formations départementales, composées :
- des représentants de l'ensemble des communes et EPCI du département compétents en matière de documents d'urbanisme, qui peuvent également être représentés au niveau du Scot dont ils sont membres ;
- des parlementaires du département ;
- de trois conseillers départementaux nommés par le président du conseil départemental, dont un conseiller départemental d'opposition ;
Participent également, à titre consultatif, aux travaux des conférences départementales, le représentant de l'État dans le département, la région et des représentants des communes non couvertes par un document d'urbanisme.
Ces conférences départementales ont pour rôle principal de préparer les travaux de la conférence régionale relatifs à la territorialisation.
B. Permettre un veto de la conférence sur la territorialisation et, dans certains cas, la fixation des enveloppes d'artificialisation régionales
1) Participer à la territorialisation infrarégionale des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf, dans les régions ayant déjà fixé leur enveloppe foncière
Dans les régions qui ont déjà fixé dans leur document de planification des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf en application de l'article 194 de la loi Climat-résilience, la conférence « détermine la répartition, entre les différentes collectivités territoriales du ressort régional représentées au sein de la conférence, de l'enveloppe foncière régionale, en tenant compte des projets et besoins à court et moyen termes signalés par ces dernières, ainsi que de leurs contraintes en matière d'exposition aux risques et de leurs spécificités », en portant une attention particulière aux communes littorales, de montagne et rurales.
Cette répartition est réputée acquise à la majorité simple des communes représentées au sein de la conférence, dès lors que ces dernières représentent plus de la moitié de la population de la région. Pour le calcul de cette majorité, lorsque les communes sont représentées au niveau d'un EPCI ou d'un schéma de cohérence territoriale, ces derniers disposent d'autant de voix qu'ils comprennent de communes membres.
La déclinaison territoriale de l'enveloppe de consommation d'Enaf ainsi déterminée est annexée au document de planification régionale et prend la même place dans la hiérarchie des normes, par rapport aux documents d'urbanisme, que le rapport du Sraddet, à savoir un rapport de prise en compte.
2) Participer, dans les régions qui n'ont pas fixé leur enveloppe de consommation d'Enaf ou souhaitent la modifier, à la détermination de cette dernière
Dans les régions qui n'ont pas encore achevé la modification de leur document de planification, ou qui souhaitent procéder à une nouvelle détermination de l'enveloppe régionale de consommation d'Enaf, la conférence se prononce en outre sur le montant de ladite enveloppe, son avis étant conforme.
La majorité requise au sein de la conférence régionale est différente selon la position exprimée, en amont de ce vote de la conférence régionale, par les conférences départementales, qui se prononcent sur le projet d'enveloppe régionale de consommation d'Enaf en prenant en compte les mêmes critères que mentionnés précédemment, et selon les mêmes modalités (les parlementaires et conseillers départementaux membres des conférences départementales disposant en outre chacun d'une voix) :
- si aucune conférence départementale du ressort régional ne s'est prononcée contre le projet, la conférence régionale se prononce à la majorité simple des communes, représentant au moins la moitié de la population régionale ;
- si au moins une conférence départementale s'est opposée au projet, la conférence régionale se prononce à une majorité renforcée des trois cinquièmes des communes, représentant au moins trois cinquièmes de la population.
III. La position de la commission - Renforcer les conférences régionales de gouvernance et lever la prescriptivité des documents régionaux de planification en matière de lutte contre l'artificialisation
A. Rénover la composition des conférences régionales de gouvernance pour renforcer la place des élus du bloc communal
La composition des « conférences régionales de gouvernance de la politique de sobriété foncière », telle que prévue dans la proposition de loi, a soulevé des réticences de l'ensemble des associations d'élus interrogées par les rapporteurs, inquiètes du manque d'opérationnalité du dispositif. Ces associations ont également unanimement souligné le fonctionnement relativement fluide des conférences régionales de gouvernance créées par la loi « ZAN 2 », les élus du bloc communal déplorant cependant leur insuffisante représentation.
Pour cette raison, et par souci de simplification et de stabilité, la commission a, par l'adoption des amendements identiques COM-58 des rapporteurs et COM-68 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, rétabli les conférences régionales existantes - rebaptisées « conférences régionales de sobriété foncière » -, tout en faisant évoluer leur composition afin d'y assurer la prééminence du bloc local, par rapport aux représentants de l'État et de la région. Ainsi, les représentants des communes, EPCI et Scot compteront désormais pour trois quarts au sein de la conférence, contre seulement 60 % aujourd'hui. En outre, la répartition des 60 représentants du bloc local se fera désormais au prorata de la répartition de ces différents types de collectivités et établissements publics dans la région, afin de tenir compte notamment des proportions variables de communes couvertes par des Scot et de communes dépourvues de document d'urbanisme, selon les régions.
Enfin, les régions conserveront la possibilité de composer différemment la conférence, dès lors que la majorité des communes et EPCI couvertes par un document d'urbanisme ne s'y oppose pas. Ainsi, dans les régions où des conférences de ce type ont été mises en place, elles pourront le plus souvent continuer à fonctionner.
B. Renforcer les pouvoirs de la conférence régionale pour mieux associer les élus locaux à la fixation des objectifs régionaux et à leur territorialisation
Par l'adoption des mêmes amendements COM-58 et COM-68, la commission a permis à la conférence régionale, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la future loi « Trace », d'exiger la réouverture par la région du volet relatif à la lutte contre l'artificialisation de son document de planification, dans les cas où les objectifs fixés et leur territorialisation ne donnent pas satisfaction à la majorité des collectivités du ressort régional.
En outre, la conférence pourra désormais donner un avis conforme - au lieu d'un avis simple - sur la liste des projets d'envergure régionale, fixée dans le document de planification régionale, et dont la consommation d'Enaf est mutualisée au niveau régional. En effet, alors que ce dispositif de mutualisation à l'échelon régional avait initialement été conçu pour des projets à la réalisation desquels l'ensemble ou la majorité des communes du ressort régional avaient intérêt - par exemple des infrastructures de transport -, plusieurs régions ont eu tendance à utiliser cette enveloppe pour soutenir leurs propres projets, notamment en matière de développement économique. L'avis conforme permettra aux collectivités de mieux faire entendre leur voix sur ce sujet.
C. Lever la prescriptivité des documents de planification pour le volet relatif à la lutte contre l'artificialisation
Conformément à la ligne qu'elle a constamment défendue depuis l'adoption de la loi Climat-résilience, la commission a précisé que les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf fixés dans les documents régionaux de planification ne s'appliqueraient aux documents d'urbanisme que dans un rapport de prise en compte, et non de compatibilité. Cette disposition figurait notamment à l'article 2 de la proposition de loi d'initiative sénatoriale visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires101(*), à l'origine de la loi « ZAN 2 » ; elle avait été supprimée en cours de navette, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Pour rappel, la hiérarchie des normes entre les documents de planification et les documents d'urbanisme est la suivante :
Source : Rapport n° 415
(2022 2023) de M. Jean Baptiste Blanc sur la
proposition de loi
visant à faciliter la
mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation
nette »
au coeur des territoires, déposé
le 8 mars 2023, commentaire de l'article 2
La notion de prise en compte, la moins contraignante en matière de hiérarchie des normes, signifie que les documents d'urbanisme ne peuvent pas remettre en cause les orientations définies par le document régional de planification. Elle impose de « ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie »102(*), tandis que la notion de compatibilité implique un respect de l'ensemble des orientations présentes dans le document de rang supérieur.
Ainsi, d'une part les collectivités pourront s'écarter des objectifs fixés au niveau régional, du moment qu'elles ne s'en écartent pas fondamentalement, d'autre part des motifs tirés de l'intérêt général pourront même, ainsi que l'a confirmé à plusieurs reprises le Conseil d'État, justifier qu'elles s'en écartent fondamentalement.
Dès lors que la contrainte que font peser les objectifs régionaux sur les documents d'urbanisme est ainsi allégée, la commission a estimé qu'il n'était plus nécessaire, comme le prévoyait le texte initial de la proposition de loi, que la conférence régionale donne un avis conforme sur ces objectifs et leur territorialisation à l'échelle infrarégionale.
La commission a adopté l'article ainsi rédigé.
Article 6
(nouveau)
Garantie de développement communal
L'article modifie les modalités de mutualisation de la garantie de développement communal de 1 hectare, afin de permettre son transfert au niveau du Scot et de la région, et non plus au seul niveau de l'EPCI.
Il procède en outre à des ajustements législatifs pour permettre la mise en oeuvre concrète de cette garantie de développement communal, y compris dans les territoires qui ont déjà modifié leurs documents d'urbanisme, et, dans les autres cas, pour permettre à la commune bénéficiaire de mutualiser cette surface après l'adoption des documents d'urbanisme modifiés.
La commission a adopté ce nouvel article.
I. La situation actuelle - La loi « ZAN 2 » a garanti à chaque commune une enveloppe foncière d'au moins 1 hectare pour la décennie 2021-2031, dont la mise en oeuvre pose des difficultés dans certaines régions
A. La loi « ZAN 2 » a créé une garantie de développement communal d'1 hectare, visant à protéger les petites communes, dans le processus de territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation
1) Les modalités de territorialisation prévues par la loi Climat-résilience devaient permettre de donner « à chacun selon ses besoins »
Aux termes de la loi Climat-résilience, les objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation, fixés dans les Sraddet, devaient ensuite être déclinés de manière territorialisée. Cette territorialisation devait s'opérer d'une part au sein de chaque région, entre chaque grand ensemble infrarégional, et au niveau de chaque Scot.
Les critères de territorialisation au sein des Scot, fixés à l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, comprennent notamment la prise en compte de « la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses » (4°), ainsi que des efforts de réduction de la consommation d'espace déjà réalisés au cours des deux décennies précédentes (5°) et des besoins en matière de logement (1°) et d'implantation d'activité économique (2°).
Les critères de territorialisation au niveau régional étaient précisés par voie réglementaire103(*) et comprenaient également « l'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de désenclavement rural » et les dynamiques démographiques et économiques prévisibles (3° et 4° de l'article R. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 précité).
2) Une territorialisation insuffisamment encadrée par la loi faisant craindre une pénalisation des communes rurales
Néanmoins, les modalités de territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation fixés au niveau régional au sein des documents de planification, très peu encadrés par la loi Climat-résilience, faisaient courir le risque qu'un certain nombre de communes se voient priver de toute capacité d'artificialiser dès la période 2021-2031.
En effet, l'analyse des données de consommation d'espace sur la décennie 2011-2021 faisait apparaître que près de 10 000 communes, principalement des communes rurales et peu denses, avaient consommé moins de 1 ha sur la période. Parmi elles, plus d'un millier n'avaient consommé aucun espace. L'application arithmétique de la réduction du rythme d'artificialisation sur la décennie 2021-2031, par rapport à la décennie passée, à l'échelon de chaque commune, faisait ainsi courir le risque que ces quelque 10 000 communes (soit près d'un tiers des communes françaises) disposent de moins d'un demi-hectare artificialisable sur toute la décennie 2021-2031104(*).
Compte tenu du profil de ces communes la plupart du temps rurales et moins souvent membres d'un EPCI, leur capacité à obtenir gain de cause lors des consultations et négociations préparatoires à la territorialisation, aux différents échelons, pouvait être questionnée, malgré les critères de territorialisation mentionnés ci-dessus, et même en justifiant de leurs besoins en foncier par l'existence de projets de territoires (implantations industrielles, actions en faveur de l'attractivité des ménages...).
3) La loi « ZAN 2 » a créé une garantie universelle de développement communal de 1 ha
Afin de garantir à l'ensemble des communes du territoire le maintien d'un « droit au projet », l'article 4 de la loi « ZAN 2 » a créé au III de l'article 194 de la loi Climat-résilience un nouveau 3° bis disposant que toute commune couverte par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou en ayant au moins prescrit l'élaboration avant le 22 août 2026, devait disposer d'une surface minimale de consommation d'Enaf de 1 hectare pour la période 2021-2031, sans que la territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf à l'échelle de la région ou du Scot puisse faire obstacle à cette disposition.
Afin de prendre en compte les cas où une commune bénéficiaire n'aurait pas souhaité utiliser cette enveloppe foncière, en raison de l'absence de projets artificialisant à court et moyen termes, ou n'aurait pas pu l'utiliser, parce que les caractéristiques de son territoire excluent toute extension des espaces urbanisés (notamment en raison de l'existence de risques naturels ou de contraintes liées au principe de constructibilité limitée dans les espaces concernés par la loi Montagne105(*) ou la loi Littoral106(*)), le même 3° bis a prévu la possibilité pour la commune bénéficiaire de transférer cet hectare artificialisable à l'échelon de l'EPCI dont elle est membre. Ce transfert ne peut se faire qu'à l'initiative de la commune bénéficiaire de la garantie, et après avis de la conférence des maires de l'EPCI concerné.
B. Les rigidités du dispositif de la garantie de développement communal aboutissent dans certains contextes à un surgel de foncier pénalisant pour les autres collectivités
Quoique plébiscitée dans son principe par les maires, notamment les maires ruraux, l'application de la garantie rurale crée un certain nombre de difficultés qui complexifient le processus de territorialisation : son application conduit en effet certains Scot, composé d'un grand nombre de communes à disposer de plus d'hectares artificialisables sur la période 2021-2031 qu'ils n'en ont effectivement artificialisés lors de la décennie précédente, à rebours de la logique de la réduction de l'artificialisation. Des difficultés ont été remontées notamment concernant les régions Normandie et Bourgogne, qui comportent un grand nombre de communes, avec une forte proportion de petites communes bénéficiaires de la garantie.
Cette situation peut en outre contribuer à grever excessivement l'enveloppe régionale d'artificialisation, et donc le reste à répartir entre les collectivités non bénéficiaires de la garantie. Cette diminution de l'enveloppe pourrait, dans certains cas, rendre plus difficile la prise en compte des autres facteurs de territorialisation fixés dans la loi et le règlement, notamment les dynamiques de développement local.
Une modélisation approximative sur la région Bourgogne-France-Comté107(*), qui compte environ 2 700 communes couvertes par un document d'urbanisme ou une carte communale, dont plus de la moitié disposent d'un droit théorique à consommation d'Enaf sur la période 2021-2031 inférieur à 1 hectare, indique que l'application de la garantie de 1 hectare aboutit ici à grever l'enveloppe foncière régionale de plus de 800 ha108(*) sur une enveloppe totale d'environ 5 700 ha, soit environ 14 % de l'enveloppe.
II. La position de la commission - Faciliter la mutualisation de la garantie de développement communal
A. La garantie de développement communal, un outil à conserver...
La mise en place en 2023 de la garantie de développement communal de 1 hectare a constitué une véritable « bouffée d'oxygène » pour les quelque 11 000 communes couvertes par un document d'urbanisme qui en sont théoriquement bénéficiaires, c'est-à-dire pour lesquelles l'application mathématique de la règle de réduction de moitié de leur consommation d'Enaf sur la période 2011-2021 (compte non tenu des effets de la territorialisation des enveloppes foncières, qui n'est pas encore achevée), donne une enveloppe foncière de moins de 1 hectare pour la période 2021-2031.
Elle permet également de garantir des possibilités de développement minimales auprès de 3 500 communes non encore couvertes par un document d'urbanisme, régies par le règlement national d'urbanisme (RNU) et où s'applique donc le principe d'urbanisation limitée109(*) : ces communes pourront bénéficier de la garantie de développement communal dès lors qu'elles auront au moins prescrit l'élaboration d'un document d'urbanisme avant le 22 août 2026110(*).
Malgré les difficultés soulevées par son application, la garantie de développement communal de 1 hectare doit donc être conservée.
B. ... en facilitant sa mutualisation
1) Mutualiser au-delà de l'échelle de l'EPCI
Afin de limiter les situations de gel de foncier, la commission a, par l'adoption des amendements identiques COM-59 des rapporteurs et COM-69 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui ouvre la possibilité de mutualiser la garantie de développement communal au niveau des Scot ou des régions, et non plus seulement au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Cette mutualisation ne pourra être effectuée qu'à l'initiative du maire de la commune bénéficiaire de la garantie, et avec l'accord du Scot ou de la région à laquelle les droits à l'artificialisation correspondant à la garantie seront transférés. L'amendement précise que ce transfert pourra faire l'objet de mesures compensatoires.
Par le même amendement, il a été précisé que la mutualisation peut concerner tout ou partie de l'hectare garanti aux communes bénéficiaires.
2) Fluidifier la mutualisation après la modification des documents d'urbanisme
Par l'adoption des mêmes amendements, la commission a clarifié le fait que la mutualisation pourrait être effectuée à tout moment, et non pas seulement en amont de la modification des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf. En effet, les communes bénéficiaires peuvent être réticentes à acter d'ores et déjà la mutualisation de la garantie, pour le cas où des projets viendraient à émerger pour leur commune dans les années à venir.
Or une fois les documents d'urbanisme modifiés, il existe un risque que la mutualisation de la garantie ne soit que virtuelle, si la commune bénéficiaire ne dispose pas de surfaces constructibles équivalentes. En effet, les coûts et délais de révision et modification des documents d'urbanisme pourraient décourager les collectivités de les faire évoluer pour pouvoir mobiliser effectivement les hectares « récupérés » grâce à la mutualisation.
Pour cette raison, la commission permet aux communes, Scot et EPCI concernés :
- d'identifier dans les documents d'urbanisme, dès leur modification pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf, des zones qui pourront être ouvertes ou fermées à l'urbanisation de manière conditionnelle, en cas de mutualisation de la garantie ;
- à défaut, lorsque les collectivités concernées n'ont pas suffisamment de visibilité pour planifier ces ouvertures conditionnelles, de recourir à la modification simplifiée des documents d'urbanisme pour assurer une plus grande flexibilité de ces derniers pour ouvrir ou fermer des zones à l'urbanisation, en cas de mutualisation de la garantie de développement communale (la modification simplifiée permet de remplacer l'enquête publique par une mise à disposition du public du projet et des avis des personnes publiques associées pour une durée d'un mois111(*) et de rendre les documents dès publication et transmission à l'autorité administrative compétente de l'État).
La commission a adopté l'article additionnel ainsi rédigé.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 19 février 2025, la commission a examiné le rapport de M. Jean-Marc Boyer et Mme Amel Gacquerre sur la proposition de loi n° 124 (2024-2025) visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport et du texte sur la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - La loi Climat et résilience adoptée en 2021 prévoyait un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en 2050 et de réduction de l'artificialisation de moitié en 2031 par rapport à la période 2011-2021. Ce n'est pas un hasard si, quatre ans plus tard, nous sommes encore en discussion à ce sujet.
De nombreux maires ont alerté les parlementaires sur la logique descendante et non concertée de cette politique de sobriété foncière, difficilement compatible avec les politiques de développement économique ou d'accueil de nouvelles populations. Pour répondre à ces difficultés, le Sénat a constitué en 2022 une mission conjointe de contrôle relative à l'application du ZAN, suivie d'une proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, adoptée en juillet 2023.
Ladite loi comprenait quelques points importants, dont la sortie des projets d'envergure nationale ou européenne (Pene) du décompte local du ZAN, la création d'un droit à l'hectare pour chaque commune, la création d'une conférence régionale d'élus pour la mise en oeuvre du ZAN, la création d'un droit de préemption spécifique et l'allongement des délais de modification des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux d'urbanisme (PLU).
Nous avions cru refermer le dossier ZAN après l'adoption de la loi de juillet 2023, mais force est de constater que, presque quatre ans après l'adoption de la loi Climat et résilience, l'inquiétude des élus locaux ne faiblit pas, bien au contraire.
Ce constat, que nous faisons tous les jours lorsque nous parlons à nos maires, a été objectivé dans le rapport d'information fait à l'automne dernier par Guislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, au nom du groupe de suivi transpartisan des politiques de réduction de l'artificialisation des sols. Oui, pour nos élus et nos collectivités, atteindre les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat et résilience, c'est bien « la quadrature du cercle » ! Je précise d'ailleurs qu'à l'initiative du groupe, près de 1 400 élus ont été consultés dans le cadre de ses travaux.
Ayant moi-même participé au groupe de suivi, je voudrais saluer le travail approfondi qui a conduit à la publication de ce rapport. Je veux aussi remercier nos deux collègues d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi, car si nous partageons tous l'objectif de sobriété foncière, les chemins pour y arriver sont nombreux. Le chemin de la loi Climat et résilience était celui du centralisme et de la contrainte, et nous avons souvent dénoncé l'application arithmétique et descendante d'objectifs nationaux fixés au doigt mouillé, sans véritable étude d'impact. Cette proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite « Trace », vise au contraire à créer les conditions d'une sobriété foncière soutenable pour nos territoires, en donnant un rôle accru aux élus.
Premièrement, l'article 1er de la proposition de loi pérennise, au-delà de 2031, la comptabilisation de l'artificialisation par le biais de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf). C'est un mode de comptabilisation que les élus connaissent bien, et qui leur permet de mieux anticiper leurs consommations futures.
Pour ma part, je ne serai pas fâché d'abandonner le mythe technocratique d'une comptabilisation au centimètre carré grâce à l'intelligence artificielle (IA), qui agrège de manière opaque des surfaces de natures différentes, sur la base d'une nomenclature incompréhensible.
Je ne parle même pas du casse-tête d'élaborer aujourd'hui des PLU qui permettraient d'atteindre en même temps des objectifs comptés en Enaf à l'horizon 2031, et d'autres objectifs ensuite avec un autre mode de comptabilisation.
Nous vous proposons de sécuriser encore un peu plus ce mode de comptabilisation plus simple et plus efficace, qui a en outre l'avantage de lever la contrainte sur les bâtiments agricoles.
Deuxièmement, la proposition de loi redonne de l'air aux collectivités en supprimant l'objectif de - 50 % d'artificialisation à l'horizon 2031, en repoussant les dates butoirs de modification des Sraddet et des documents d'urbanisme et en excluant du décompte de la consommation d'Enaf les Pene. Tel est l'objet des articles 2 à 4.
Enfin, la proposition de loi prévoit, avec son article 5, de mieux associer les collectivités locales à la détermination des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation, en remplaçant les conférences régionales de gouvernance de l'artificialisation - les « conférences du ZAN », qui ont elles-mêmes remplacé les « conférences des Scot » - par une consultation généralisée des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des Scot au sein d'une nouvelle conférence, qui aurait un pouvoir décisionnaire sur la fixation de ces objectifs.
Nous allons bien sûr vous présenter les évolutions projetées sur chaque point du texte, ainsi que sur un point complémentaire, à savoir la garantie de développement communal d'un hectare, dispositif extrêmement précieux pour les petites communes, mais qui a parfois eu des effets contre-productifs.
Je tiens à remercier Amel Gacquerre pour le bon travail que nous avons pu faire ensemble, dans un esprit de complémentarité et de respect mutuel. Je remercie également Daniel Guéret, avec qui les relations ont été très fluides, et enfin les membres du groupe de suivi qui se sont régulièrement joints à nos auditions.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Je remercie à mon tour Jean-Marc Boyer et Daniel Guéret pour les échanges fructueux que nous avons eus tout au long de nos travaux. Je m'associe également aux remerciements exprimés par Jean-Marc Boyer aux auteurs de cette proposition de loi, Guislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc.
Ces dernières semaines, nous avons entendu de très nombreuses associations d'élus, rencontré quasiment tous les ministres compétents de près ou de loin sur le sujet et reçu de très nombreuses contributions écrites. Nous savons donc à quel point, en effet, il sera difficile, pour filer le jeu de mots et la métaphore, de « tracer » un chemin qui nous permettra d'arriver collectivement jusqu'à la destination fixée par la loi Climat et résilience.
Sur le fond, comme l'a dit Jean-Marc Boyer, le diagnostic est partagé par tous : il faut assouplir le ZAN, non pas pour freiner la trajectoire de sobriété foncière, impérative et partagée par tous face à la nécessité de préserver nos terres agricoles, au réchauffement climatique et à la multiplication des catastrophes que nous sommes malheureusement nombreux à avoir connu ces dernières années, mais parce que nos maires le demandent.
L'application uniforme sur tout le territoire de la loi Climat et résilience conduit à des situations de blocage problématiques : des maires qui se démènent pour attirer de jeunes ménages et qui ne disposent plus de foncier pour construire une école ; des projets d'implantation d'usines mis en cause par manque de foncier ; des communes menacées de pénalités parce qu'elles n'atteignent pas les taux de logements sociaux fixés par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), mais qui ne peuvent pas en construire faute de place... Parallèlement à cela, il faudrait, afin de retrouver notre souveraineté, réindustrialiser, développer les énergies vertes, etc.
Nous avons donc abordé le sujet de manière pragmatique, en considérant que l'artificialisation est un réel problème, que nous avons artificialisé de manière tout à fait excessive pendant des dizaines d'années, et qu'il est temps que cela cesse ; mais en considérant aussi qu'il y a d'autres problèmes urgents à régler en France, à savoir la crise du logement, les fermetures d'usines, la transition écologique et enfin la cohésion sociale, qui passe notamment par des efforts accrus de revitalisation de la France rurale et des sous-préfectures.
C'est pourquoi nous vous proposons, à l'article 4, de confirmer la sortie des grands projets du décompte de l'artificialisation, et d'exempter jusqu'en 2036 les implantations industrielles et la création de logement social en rattrapage dans les communes carencées.
Encore une fois, nous soutenons tous ici l'objectif de sobriété foncière et nous ne voulons pas toucher à l'objectif de ZAN à l'horizon 2050. Pourtant, cet objectif est, si l'on y regarde bien, extraordinairement ambitieux ! Nous pouvons peut-être l'atteindre, car une période de vingt-cinq ans peut paraître longue, mais nous ne voulons pas du jalon à - 50 % dès 2031, cet objectif semblant inatteignable aux dires du plus grand nombre.
Cela ne veut pas dire qu'il faut lever toutes les contraintes et éteindre toutes les balises. Je le dis très clairement : je ne crois pas - nous ne croyons pas - que la somme des efforts spontanés des communes pour réduire l'artificialisation permettra d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation en 2050. Les chiffres sont clairs et le confirment : depuis 2019, il y a une stabilisation de la consommation d'Enaf à hauteur d'environ 20 000 hectares par an, et ce y compris dans des communes en déprise.
Cependant, il faut que chaque territoire, et en premier lieu chaque région, puisse se fixer sa propre trajectoire avec ses propres jalons, du moment que celle-ci reste crédible pour atteindre l'objectif 2050. C'est ce que nous vous proposons à l'article 2.
Et, pour que les collectivités locales puissent aussi adapter leur trajectoire à leurs besoins et à leurs projets, nous inscrivons dans la loi la non-prescriptivité des dispositions du Sraddet relatives à l'artificialisation : ces dispositions s'appliqueront donc aux documents d'urbanisme non plus dans un rapport de compatibilité, mais dans un rapport de prise en compte.
Il nous faut aussi renforcer le dialogue au sein de la région, car les représentants des communes et des EPCI nous ont unanimement dit qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Les modalités de concertation mises en place jusqu'à présent pour associer les élus locaux à la répartition des enveloppes foncières n'ont pas bien fonctionné - en tout cas pas partout -, et ce malgré le renforcement des critères de territorialisation apportés par la loi « ZAN 2 » de juillet 2023.
Mais nos élus ont aussi besoin de simplicité et de stabilité. Aussi, plutôt qu'un grand forum des communes tel que prévu par le texte initial, il nous a semblé préférable de conserver les outils existants, mais en les renforçant afin de donner plus de poids aux représentants du bloc communal, car il faut que toutes les communes, y compris les plus petites, puissent faire entendre leur voix.
Dans le cadre de nos travaux, un autre sujet a été fréquemment abordé, à savoir le renforcement de l'incitation à la sobriété foncière en matière fiscale et financière, via des outils qui seraient à la main des maires. Ces mesures devront nécessairement venir compléter le texte qui nous occupe aujourd'hui.
Différenciation et simplification, voilà donc l'esprit du texte qui sera, je l'espère, issu des travaux de notre commission. Nous sommes au début d'un long chemin. À tort ou à raison, le ZAN est devenu, dans nos campagnes, dans nos bourgs, dans la France périphérique, le réceptacle de nombreux maux et le symbole d'une politique déconnectée de la réalité.
Le Gouvernement s'est montré très ouvert à notre démarche. Nous aurons aussi besoin de son soutien pour obtenir l'inscription de ce texte à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire, et pour convaincre les uns et les autres que le chemin que nous proposons est à la fois soutenable et crédible.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Il me revient de vous faire part du périmètre de cette proposition de loi. En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives aux objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation des sols et aux modalités de leur déclinaison dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme, y compris en ce qui concerne leur calendrier d'application ; à la métrique utilisée pour mesurer l'artificialisation des sols et à la notion de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers ; à la gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols.
Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives aux dispositions - d'ordre général ou spécifiques - relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ; aux dispositions de la loi Climat et résilience autres que celles figurant à ses articles 191 et 194, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus.
M. Daniel Guéret, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Les rapporteurs viennent de vous présenter les enjeux d'une trajectoire de sobriété foncière favorisant un aménagement du territoire durable, plus économe en foncier. Ils ont pour ce faire « tracé » le chemin afin d'y parvenir, inversant la méthode en partant des territoires et en associant plus étroitement les élus locaux, tant à la définition des cibles intermédiaires qu'à la territorialisation des objectifs.
Je partage leurs constats et recommandations. Notre commission, saisie pour avis, a d'ailleurs adopté hier les amendements qui sont soumis à votre approbation.
J'insisterai simplement sur les raisons scientifiques qui plaident en faveur de la sobriété foncière. J'ai tenu à organiser une table ronde avec les meilleurs spécialistes des sols afin d'explorer les enjeux environnementaux de la lutte contre l'artificialisation et d'écouter ce que les experts nous disent de l'artificialisation et de l'imperméabilisation.
Le constat est clair : nous avons d'excellentes et de nombreuses raisons de lutter contre l'artificialisation des sols. L'altération des fonctionnalités et le changement d'usage des sols affectent notre capacité à maintenir une production agricole de qualité ; limitent la régulation de la qualité et de la quantité du cycle de l'eau avec des risques accrus d'inondations ; réduisent leurs capacités de stockage du carbone et, par conséquent, d'atténuation du changement climatique. La consommation des sols et l'étalement urbain conduisent également les collectivités à devoir prolonger les réseaux, à augmenter les besoins de mobilité des habitants et à réduire la surface agricole utile (SAU) en ceinture maraîchère des villes, qui sont souvent les terres au plus fort potentiel agronomique.
Je tiens, en conclusion, à saluer la qualité de la collaboration avec votre commission. Je remercie sa présidente et les rapporteurs d'avoir accepté le principe d'auditions conjointes, d'avoir réfléchi ensemble aux évolutions souhaitables en soupesant les avantages et les défauts des options qui s'offraient à nous pour finalement déposer des amendements identiques. Le travail sénatorial ne peut que sortir grandi et renforcé de cette collaboration étroite et fructueuse. Merci donc à Amel Gacquerre et à Jean-Marc Boyer de m'avoir associé à toutes les étapes de la procédure parlementaire, en dépit du fait que notre commission n'était saisie que pour avis de ce texte.
M. Guislain Cambier, auteur de la proposition de loi. - Je tiens à saluer le travail conjoint des deux commissions sur ce sujet complexe et aux nombreuses ramifications.
Face à un sujet tel que le ZAN, nous sommes parfois limités par nos propres préjugés et avons tendance à perdre l'objectif qui est le nôtre, celui de la destinée commune. À ce titre, je salue les membres du groupe de travail qui ont oeuvré sans oeillères, ce qui nous a permis de faire émerger la vision la plus pragmatique possible.
Certes, tous les sujets ne sont pas réglés dans cette proposition de loi, les questions financières et fiscales, ainsi que la santé des sols n'ayant pas pu y être abordées. Notre idée consistait à mettre de l'huile dans les rouages afin de permettre la compréhension mutuelle et de recréer du dialogue là où il n'y en avait plus, sans imposer de magistère moral et sans déni, d'un côté comme de l'autre.
Nous avons donc élaboré conjointement un texte condensé en cinq articles, l'objectif final étant bien de recoudre une sainte tunique républicaine qui est bien déchirée dans nos territoires. Je vous remercie de l'approche consensuelle et pragmatique qui a prévalu.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Un travail sérieux a en effet été accompli depuis de nombreux mois, notamment au travers du groupe de suivi.
M. Franck Montaugé. - Le ZAN illustre, selon moi, jusqu'à la caricature la dégradation de la qualité du processus de travail législatif du Parlement dans son ensemble. La loi Climat et résilience avait été en son temps critiquée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain : c'était un texte « ni fait ni à faire ». Je peine à comprendre comment l'État, fort des moyens considérables dont il dispose, n'a pas mieux cadré le sujet en amont et mieux organisé la déclinaison du ZAN sur l'ensemble des territoires.
Aujourd'hui, le principal problème réside davantage en effet dans les modalités d'application que dans l'objectif lui-même, sur lequel nous nous accordons à peu près. Faute de soutien de la part de l'État, certains territoires se sont organisés et ont avancé de leur côté sur le sujet : tel est le cas dans mon département du Gers du Scot de Gascogne - qui couvre la quasi-totalité du département -, qui s'est doté d'une méthode rationnelle permettant de décliner le ZAN dans l'ensemble des communes du département. C'est pourquoi des acteurs comme Intercommunalités de France, la Fédération nationale des Scot, ou certaines agences d'urbanisme, sont très prudents sur d'éventuelles évolutions du ZAN.
Je n'ignore pas que nos collègues Guislain Cambier et Alain Duffourg ont tenu une conférence sur le sujet, ce qui est tout à fait leur droit. Pour autant, il ne me semble pas nécessaire de venir instiller le doute dans l'esprit d'élus qui ont commencé à agir pour se conformer à des objectifs légaux et nécessaires, de la manière la plus équitable possible.
De manière générale, ce sujet est ravageur en termes d'efficacité du travail législatif : partir dans une direction puis dans une autre est catastrophique. Tâchons de cheminer collectivement pour aller jusqu'au bout de la démarche, mais évitons à l'avenir de reproduire ces erreurs sur d'autres sujets.
M. Yannick Jadot. - La remarque de M. Montaugé est importante : certaines collectivités territoriales ont travaillé et avancé, malgré les lacunes incontestables du ZAN en termes d'accompagnement de l'État et de reconnaissance des dynamiques locales.
La solution consiste-t-elle à vider ledit ZAN de son contenu ? Nous ne le pensons pas. M. Duplomb a suggéré de l'abroger purement et simplement, ce qui a le mérite de la clarté par rapport au fait de ne conserver que formellement l'objectif à l'horizon 2050, ce qui n'est pas sérieux : dès lors que vous supprimez les objectifs intermédiaires, vous savez très bien que la tâche ne sera pas accomplie, assumez-le !
À l'image de ce que nous avons pu observer avec les récents textes sur l'agriculture, vous disposez de la majorité vous permettant de vous dispenser de la recherche de compromis.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Des compromis existent encore.
M. Yannick Jadot. - Assumez jusqu'au bout votre démarche : quand vous parlez de simplification en évoquant le report des échéances pour les documents d'urbanisme ou le maintien de la garantie du développement communal d'un hectare après 2031 - qui fait complètement fi des dynamiques locales ! De la même manière, lorsqu'il s'agit d'exclure les Pene ou de subordonner les Sraddet à des conférences régionales dont on ignore largement les modalités de fonctionnement, reconnaissez qu'il est bien question de vider le ZAN de son contenu.
Vous choisissez de supprimer l'ensemble de notre cadre de protection de l'environnement et de lutte contre l'artificialisation des sols, soit, mais ne prétendez pas qu'il est question de simplifier pour gagner en efficacité : vous portez le fait de vider totalement de sa substance la loi Climat et résilience et de revenir à la situation antérieure, dans laquelle l'exigence de sobriété foncière n'était prise en compte que comme un élément parmi d'autres.
J'y vois un risque de déni des enjeux majeurs de notre époque, même si vous réaffirmez l'importance de l'environnement et la sobriété foncière. De surcroît, vous utilisez les arguments de la désindustrialisation et du manque de logements sociaux, comme si ces phénomènes vieux de quarante ans étaient liés à une loi qui n'est pas encore mise en oeuvre : ce n'est guère sérieux.
Nous porterons donc une série d'amendements de suppression, et constatons à ce stade que le dialogue n'est pas complètement franc quant à l'objectif poursuivi au travers de cette proposition de loi.
M. Philippe Grosvalet. - Je reprends à mon compte l'expression de M. Montaugé sur les défauts de la loi ayant institué le ZAN, qui n'était effectivement « ni fait ni à faire ». Cela étant, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et je pensais - naïf que je suis - que nous parviendrions à trouver un compromis, au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour faire évoluer une loi mal faite, ce qui supposait de conserver un objectif intermédiaire, quitte à le lisser dans le temps et à le quantifier différemment, mais sans pénaliser les territoires qui ont déjà avancé, parfois avec difficulté.
Le principal désavantage de la loi tenait à l'absence de prise en compte de la diversité de nos territoires, tant à l'échelle nationale - de région à région - qu'à l'échelle infrarégionale et à l'intérieur même des départements. Le mien compte ainsi une métropole, des territoires ruraux et des littoraux qui exigent évidemment un regard différencié.
Bref, je rêvais d'un compromis, mais je crois que nous en sommes loin et que les conclusions de ces discussions vont mettre en difficulté une série d'élus locaux.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le rapporteur lorsqu'il affirme que nous partageons tous l'objectif de sobriété foncière. En effet, cette notion est relative et peut varier selon l'appréciation de chacun, en l'absence de quantification précise ; de la même manière, l'assouplissement et le pragmatisme évoqués par la rapporteure ne permettent guère de définir clairement une trajectoire. C'est pourquoi M. Cabanel et moi-même avons déposé des amendements qui ont comme seule ambition de trouver une voie médiane en termes de critères quantitatifs et d'étapes.
Je suis donc à ce stade déçu, malgré des éléments positifs tels que la référence aux Enaf. En revanche, je ne partage pas l'avis de Yannick Jadot quant aux Pene, car j'estime qu'il était nécessaire, pour tenir compte de la diversité de nos territoires, de porter un regard particulier sur les problématiques du logement et de l'industrie.
Concernant la gouvernance, il faut effectivement redonner de la place aux élus locaux : si les Sraddet sont utiles, nombre de maires n'y trouvent pas leur compte, et il convient de faire évoluer les choses.
Nous sommes au début du processus législatif. Afin de ne pas créer une incompréhension chez les maires, il me paraîtrait souhaitable, une fois encore, de trouver un compromis politique, à la fois au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale : si cette proposition de loi venait à être considérée comme un passage en force, elle aura raté son objectif.
À titre personnel, je ne peux pas voter contre ou pour cette proposition de loi, ni m'abstenir. J'ai en effet été le seul président de département, en 2017, à porter le ZAN, dès avant la loi, en prévenant que le sujet serait extrêmement délicat à présenter aux maires. J'avais alors fait la démonstration - pour la Loire-Atlantique - que nous avions consommé en 150 ans autant de surfaces que dans toute l'histoire de l'humanité et qu'il était grand temps de viser le ZAN. Je m'étais cependant opposé à Ronan Dantec sur ce sujet, car il tenait absolument à fixer l'échéance à 2030 : je lui avais dit que ce n'était pas une bonne idée en l'absence d'étude d'impact.
Nous pourrions donc parvenir à un compromis, même si le chemin emprunté n'est pas le bon à ce stade de la discussion.
M. Christian Redon-Sarrazy. - Je partage une partie des constats qui viennent d'être énoncés, dont ceux qui sont relatifs à l'imperfection de la loi Climat et résilience. J'ai relu, non sans amertume, les amendements que j'avais déposés au nom de mon groupe en 2021 et qui demandaient notamment le recul de l'échéance à 2035, ce qui m'avait valu un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement. J'avais également soulevé les difficultés qui allaient émerger dans la ruralité, ainsi que les enjeux de financement du dispositif, interrogations qui avaient reçu le même accueil.
Nous ne sommes pas d'accord sur ce texte. L'absence d'objectifs intermédiaires interpelle, malgré tous les mots utilisés et scandés : pour ma part, je ne sais pas convertir du texte en chiffres. À quelle date l'échéance sera-t-elle fixée ? Lors des discussions au sein du groupe de suivi, en amont du dépôt de la proposition de loi, la définition de cette date et des objectifs chiffrés a été renvoyée à la discussion en séance, et j'espère que le travail à venir ne sera pas dans la même veine que celui qui vient d'être effectué pour le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce dernier a été en effet marqué par un passage en force, ainsi que par des salves d'applaudissements à propos de l'assouplissement du ZAN, ce qui n'augure pas a priori d'un travail très fructueux.
Nous n'avons pas déposé d'amendements à ce stade et voterons pour ou contre les amendements présentés au cas pour cas. Quelques points font consensus, dont la mutualisation de la garantie communale, mais je regrette l'insuffisance de la différenciation territoriale et de la différenciation quant à la nature des projets. Par ailleurs, je ne suis pas opposé à la comptabilisation en Enaf, mais n'oublions pas que des outils sont en train d'émerger - ceux de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), par exemple - et qu'ils pourraient permettre à l'État et aux élus d'aller plus loin qu'avec des fichiers fonciers et notamment de se pencher sur la qualité des sols.
J'espère que ce texte pourra ressortir sous la forme d'un compromis, en retrouvant un esprit qui avait prévalu jusqu'en novembre 2024 dans les réflexions que nous avons pu mener. Si nous opérons un revirement complet, tout le travail déjà engagé au niveau régional et local serait gâché - même si nous devons répondre à d'autres inquiétudes par ailleurs.
Mme Anne-Catherine Loisier. - Nous sommes tous d'accord pour constater que les points de crispation actuels ont été identifiés depuis longtemps, et que nous ne faisons que constater leur matérialisation sur le terrain.
Il relève de notre responsabilité d'élus de ne pas pratiquer la politique de l'autruche et de reconnaître que des améliorations sont nécessaires pour nous orienter vers une meilleure maîtrise de l'artificialisation des sols.
Lors de la réalisation des premières études, nous nous sommes rendu compte que la plupart des régions avaient déjà inscrit des objectifs de maîtrise de l'artificialisation des sols dans leurs Sraddet. Ces travaux mettaient également en exergue une diminution de l'artificialisation des sols ces dernières années, avec bien sûr des évolutions contrastées selon les territoires, ce qui montre bien que la réalité est complexe.
Il faut que nous nous penchions sur les points noirs du dispositif, dans un souci de meilleure application de la loi. Soyons cependant vigilants et prenons garde de ne pas rajouter encore de la complexité, tant nous excellons dans l'art de recréer des dispositifs parfois plus lourds en voulant simplifier : c'est bien là l'attente de nos collègues et élus des territoires.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Sur un sujet tel que celui-ci, nous devons sortir de l'idéologie et prendre conscience que les élus de terrain sont vent debout contre un ZAN suscitant de nombreuses incompréhensions. Pour avoir tenu récemment une réunion en présence d'une centaine de maires, je peux vous assurer que les premières questions ont porté sur l'assainissement et l'eau, et sur le ZAN.
Si certains élus et territoires ont avancé, il n'y a aucune raison de revenir sur leur travail. Cinq régions ont modifié leur Sraddet, elles semblent satisfaites. Je dis bien « semblent », car si j'en crois un récent article de La Tribune intitulé « Immobilier : en Bretagne, la loi ZAN pèse sur les transactions de terrains à bâtir », la situation de cette région, pourtant souvent citée, n'est pas si positive : « Déjà impacté par la baisse des volumes de transactions et la contraction des prix, le marché breton doit également faire face aux effets de la loi ZAN. Les professionnels redoutent une incapacité à renouveler le parc immobilier. »
Je pense donc qu'il faut écouter ce qui se passe sur le terrain, et il me semble que les auteurs de cette proposition de loi n'ont nullement l'intention de demander aux régions de faire table rase du travail qu'elles ont pu déjà accomplir.
En outre, nous voulons simplifier pour tenir compte de ces nombreuses remontées de terrain, les associations d'élus étant elles-mêmes déboussolées par la complexité du ZAN, si bien que certaines ont même pu changer de position d'une audition à l'autre.
En résumé, il faut accorder de la liberté aux élus et adopter une démarche ascendante, en partant de leur volonté en matière d'aménagement du territoire : celle-ci devrait ensuite remonter vers l'intercommunalité, puis vers la région, soit l'exact opposé du fonctionnement actuel du ZAN, puisque la volonté régionale redescend ensuite vers les collectivités, ce qui est problématique. J'espère que vous partagez au moins ce constat, sans quoi il sera difficile de poursuivre les discussions.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Je partage l'agacement de Franck Montaugé quant aux malfaçons de la loi. Je tiens à rappeler l'enjeu de cette proposition de loi, que j'évoquais hier devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : nous avons là la seule et dernière opportunité de répondre aux difficultés incontestables des élus, car une proposition de loi « ZAN 4 » n'aurait aucun sens.
Par ailleurs, je tiens à rassurer tous nos collègues qui redoutent un détricotage, car aucune disposition de ce texte n'impose aux régions de revenir en arrière. Seule une disposition leur demande d'organiser une nouvelle délibération au sujet de l'artificialisation, dans le cadre de la conférence de la sobriété foncière. Si les dispositions relatives à l'artificialisation ne posent pas problème, il n'y aura pas lieu de modifier quoi que ce soit.
Nous sommes bien conscients du fait que le travail a été lancé dans les territoires, et aucun élu n'a remis en cause l'objectif de sobriété foncière. Ne nous faites donc pas un faux procès sur ce point.
Monsieur Jadot, les mots comptent : vous disiez qu'il n'est « pas sérieux » de « vider le ZAN de son contenu », mais si nous voulons faire preuve de sérieux et de responsabilité, il faut enlever nos oeillères et apporter des solutions concrètes aux problèmes de terrain.
Enfin, je remercie M. Grosvalet pour son intervention constructive et note qu'il a exprimé, malgré ses réserves, un accord sur une série de points, tout comme M. Redon-Sarrazy, ce qui laisse espérer un texte de compromis.
EXAMEN DES ARTICLES
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-50 et COM-60 visent à simplifier et à rendre plus lisible la notion de consommation d'Enaf, avec l'objectif de permettre aux élus locaux de mieux anticiper leur consommation - et donc de mieux la planifier - lors de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme.
Les amendements prévoient donc d'inscrire dans la loi les critères permettant de déterminer ce qu'est un « espace urbanisé », ainsi que le fait que l'urbanisation sur des Enaf résiduels au sein de l'enveloppe urbaine ou dans les dents creuses ne doit pas être décomptée comme consommation d'Enaf.
Les amendements COM-50 et COM-60 sont adoptés.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - L'amendement COM-20 prévoit d'exclure du décompte de la consommation d'Enaf les bâtiments agricoles, y compris en cas de changement de destination ultérieur. Avis défavorable.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-52 et COM-61 prévoient que l'État mette à disposition des collectivités et de leurs groupements, en amont du processus d'évolution de leurs documents d'urbanisme, les données de consommation passée d'Enaf dont elles ont besoin afin de planifier ladite évolution, en fonction de la territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf.
Je précise que ces amendements ne modifient en rien la possibilité, pour les communes, d'utiliser leurs propres données de consommation pour l'élaboration du bilan triennal de réduction de l'artificialisation, auquel nous ne touchons pas.
Les amendements identiques COM-52 et COM-61 sont adoptés, de même que les amendements rédactionnels identiques COM-51 et COM-62.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après l'article 1er
L'amendement COM-44 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-40 vise à supprimer l'article, qui dessine trois voies différentes pour parvenir au résultat en 2050. L'adoption de cet amendement reviendrait à ne rien changer. Avis défavorable.
L'amendement COM-40 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-26, les amendements COM-33 rectifié et COM-34 visent à repousser à 2034 ou à 2035 la première échéance intermédiaire de réduction de l'artificialisation.
L'amendement COM-26 vise à étendre à la période 2025-2035, au lieu de 2021-2031, la période sur laquelle le rythme d'artificialisation doit être réduit de moitié.
L'amendement COM-33 rectifié tend à décaler cette première période à 2024-2034 et prévoit un deuxième jalon intermédiaire à 2044, fixant ainsi des objectifs de réduction de l'artificialisation moins ambitieux qu'une réduction de moitié. Il prévoit également que le taux de réduction de l'artificialisation soit différencié en fonction des secteurs et de leur part dans la consommation d'espace passée.
L'amendement COM-34, quant à lui, est un amendement de repli.
Monsieur Grosvalet, vous contribuez au débat en portant l'idée d'un décalage dans le temps de la première tranche décennale. C'est la position du Gouvernement, et il est possible que nous débouchions finalement sur cela, mais aujourd'hui, ce n'est pas la nôtre.
L'avis est défavorable sur ces trois amendements : nous défendons une différenciation territoire par territoire, avec l'idée que chaque région est la mieux placée pour dessiner sa propre carte, en concertation avec les collectivités infrarégionales. Ce sera l'objet de notre amendement COM-54 et de l'amendement identique COM-64.
L'amendement COM-26 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-33 rectifié et COM-34.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-24 rectifié vise à supprimer les objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification régionaux au profit des Scot et des PLU.
Cette démarche poserait un problème pratique : qui assumerait la charge de la territorialisation ? Quelle serait l'instance de concertation à une aussi petite échelle ? La région est chef de file sur la compétence d'aménagement du territoire, dont relève nécessairement la politique de réduction de l'artificialisation. Avis défavorable.
L'amendement COM-24 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements rédactionnels identiques COM-53 et COM-63 sont adoptés.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Par les amendements identiques COM-54 et COM-64, nous entendons donc redonner la main aux régions, en nous assurant toutefois que la trajectoire soit crédible - c'est inscrit dans le texte !
Les amendements identiques COM-54 et COM-64 sont adoptés.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - L'amendement COM-41 vise à supprimer l'article 3, nous y sommes défavorables.
L'amendement COM-41 n'est pas adopté.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-65 et COM-55 visent à reporter d'un an les échéances de modification des documents de planification et d'urbanisme. Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leurs documents avant l'échéance fixée en novembre 2024, environ la moitié des régions restantes ont engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir.
Le report proposé doit permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements permis par la présente proposition de loi.
Les amendements identiques COM-65 et COM-55 sont adoptés.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - L'amendement COM-1 vise à inclure les bâtiments scolaires dans les Pene. Nous en demandons le retrait : les collèges et lycées, et a fortiori les écoles, ne peuvent être qualifiés de Pene - même si pour les deux premiers, leur rayonnement dépasse souvent l'échelon local. Ils devraient, dans certains cas, être pris sur la part de l'enveloppe régionale réservée aux projets d'envergure régionale, qui sont l'équivalent des Pene au niveau national.
Il serait judicieux d'affiner la réflexion sur les projets concernant les communes, ceux qui ont une importance départementale et ne peuvent être imputés sur une enveloppe intercommunale ou communale, comme ceux qui relèvent de l'enveloppe régionale. Vous pourriez, madame Noël, déposer une proposition retravaillée en vue de la séance.
L'amendement COM-1 est retiré.
Les amendements COM-15 rectifié quater et COM-16 rectifié ter sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-42 vise à supprimer l'article 4. Nous n'y sommes pas favorables, car il faut redonner de l'air aux collectivités. C'est l'une des lignes directrices que nous avons choisies.
En raison des grands projets, l'objectif de réduction de la consommation d'Enaf des régions sur la période 2021-2031 a été augmenté de 10 %, pour certaines régions, c'est considérable.
En outre, en supprimant cet article, nous supprimerions également l'obligation pour l'État de se fixer une trajectoire propre de sobriété foncière.
L'amendement COM-42 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-35 tend à renforcer l'idée de demander à l'État de fixer sa propre trajectoire baissière pour l'artificialisation des projets, en différenciant la trajectoire selon les types de projets. Cette idée est intéressante, mais nous demandons le retrait de cet amendement, car les besoins peuvent évoluer et qu'il convient de conserver une certaine latitude : nous ne savons pas exactement de quel type d'infrastructure nous aurons besoin dans dix ou vingt ans.
Quant à nos amendements identiques COM-66 et COM-57, ils sont quasiment rédactionnels.
Les amendements identiques COM-66 et COM-57 sont adoptés.
L'amendement COM-35 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements suivants visent à exclure certains projets du décompte de la consommation d'Enaf.
L'amendement COM-25 rectifié concerne ainsi les projets industriels ; les amendements COM-28 et COM-29, les installations photovoltaïques, et les amendements COM-4 et COM-10, les logements sociaux. Les sous-amendements COM-70, COM-71 et COM-72 concernent les infrastructures de production d'énergie renouvelable.
Nous partageons la nécessité de lever temporairement la contrainte de la disponibilité du foncier au profit des deux priorités nationales que sont la réindustrialisation et la lutte contre la crise du logement. C'est pourquoi nous proposons d'adopter nos amendements identiques COM-67 et COM-56 qui tendent à exclure du décompte de la consommation d'Enaf jusqu'en 2036 les implantations industrielles et les constructions de logements sociaux permettant aux communes carencées d'atteindre leurs objectifs.
Nos amendements satisfaisant l'intention de leurs auteurs, nous demandons le retrait des amendements COM-4 et COM-10 et nous émettons un avis défavorable sur l'amendement COM-25 rectifié.
En ce qui concerne les implantations d'énergies renouvelables, nous sommes favorables à les exclure temporairement du décompte, car la transition écologique est une autre priorité nationale à laquelle la lutte contre l'artificialisation ne devrait pas faire obstacle. Nous sommes ainsi favorables aux sous-amendements identiques COM-71 rectifié, COM-70 et COM-72 à nos amendements, lesquels visent à exempter du décompte les installations de production d'énergies renouvelables jusqu'en 2036, alors que nous proposions une telle exemption pour les seules installations d'agrivoltaïsme.
L'adoption de nos amendements COM-67 et COM-56 ainsi sous-amendés priverait dès lors d'objet les amendements COM-28 et COM-29.
Les amendements COM-4 et COM-10 sont retirés.
M. Christian Redon-Sarrazy. - Nous commettons les mêmes erreurs que par le passé : notre approche est binaire, alors que la diversité des projets présentés appelle de la pondération et de la nuance, c'est-à-dire à un traitement différencié et territorialisé de certains projets, au sein d'une enveloppe, certes, fermée.
Bien sûr, il est plus compliqué de nuancer ainsi, mais nous répondrions mieux aux attentes des territoires.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - En effet, c'est beaucoup plus compliqué, et nous restons attachés à la simplification, dont la nécessité est partagée par le plus grand nombre.
L'amendement COM-25 rectifié n'est pas adopté.
Les sous-amendements COM-71 rectifié, COM-70 et COM-72 sont adoptés. Les amendements identiques COM-67 et COM-56, ainsi sous-amendés, sont adoptés. En conséquence, les amendements COM-28 et COM-29 deviennent sans objet.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-3 vise à exempter du décompte de l'artificialisation les aires d'accueil des gens du voyage. L'aménagement de ces aires fait peser sur les communes d'implantation d'importantes contraintes ; si celles-ci se traduisent en plus par une ponction sur l'enveloppe de consommation d'Enaf, c'est une double peine !
Pour autant, les secteurs d'implantation étant définis dans le cadre de schémas départementaux, de manière concertée avec les collectivités, ces aires devraient plutôt voir leur consommation d'espace mutualisée au niveau du Scot ou de la région, selon les cas.
C'est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement.
Mme Sylviane Noël. - Je le retire, mais je le déposerai en séance, car nous devons en débattre.
L'amendement COM-3 est retiré.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - Les amendements suivants portent sur l'exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les « coups partis » ; ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) ou d'une déclaration de projet pour l'amendement COM-5, les zones d'aménagement concerté (ZAC), les grandes opérations d'urbanisme (GOU) et les opérations d'intérêt national pour l'amendement COM-32, et même l'ensemble des constructions ou aménagements autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi Climat et résilience pour l'amendement COM-9.
Nous entendons permettre aux collectivités de dessiner des trajectoires crédibles vers la neutralité foncière à l'horizon 2050, ce qui nécessite une adaptabilité des enveloppes aux projets. Nous sommes donc réticents aux exemptions généralisées dont nous ne maîtrisons pas les conséquences.
Nous invitons leurs auteurs à retirer ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Mme Sylviane Noël. - Je retire l'amendement COM-9.
Concernant l'amendement COM-5, je l'avais déjà déposé sur recommandation de Jean-Baptiste Blanc lors de l'examen de la loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux : il avait alors été adopté par le Sénat, mais pas par la commission mixte paritaire.
J'accepte de le retirer à ce stade, mais je le redéposerai en vue de la séance.
Les amendements COM-9 et COM-5 sont retirés.
L'amendement COM-32 n'est pas adopté.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-49 rectifié tend à exempter du décompte de la consommation d'Enaf les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il est satisfait par l'amendement adopté à l'article 4.
M. Gilbert Favreau. - Je le retire, vous avez raison, on ne peut pas dresser une série d'exceptions.
L'amendement COM-49 rectifié est retiré.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. - L'amendement COM-2 rectifié est proche des trois amendements que nous venons d'examiner : retrait ou avis défavorable.
L'amendement COM-2 rectifié est retiré.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - L'amendement COM-43 vise à supprimer l'article ; l'avis est défavorable.
L'amendement COM-43 n'est pas adopté.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Nos amendements identiques COM-58 et COM-68 visent à rédiger l'article 5 dans le sens d'un renforcement des conférences du ZAN. Ils tendent à revoir la composition de la conférence régionale de gouvernance politique de réduction de l'artificialisation des sols, renommée conférence régionale de sobriété foncière, pour assurer une meilleure représentation des collectivités locales, dont la part passera de 60 % à 75 %, tout en maintenant la possibilité pour les régions de composer différemment la conférence avec l'accord de la majorité des communes et des EPCI compétents en matière d'urbanisme.
Ils visent également à accorder à la conférence le pouvoir de s'opposer à la liste des projets d'intérêt régional, dont l'artificialisation peut être mutualisée à l'échelon régional, au lieu d'être imputée en totalité à la commune ou à l'EPCI d'implantation.
Il nous semble nécessaire de renforcer le pouvoir de ces conférences, insuffisamment représentatives, afin qu'elles puissent agir comme une véritable corde de rappel dans le cas où la région ne consulterait pas suffisamment et ne prendrait pas assez en compte les projets et les aspirations des collectivités locales.
Les amendements identiques COM-58 et COM-68 sont adoptés. En conséquence, les amendements COM-36 rectifié et COM-48 rectifié deviennent sans objet.
L'article 5 est ainsi rédigé.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - L'amendement COM-21 rectifié vise à doubler la surface de garantie de développement communale, actuellement fixée à un hectare. À ce jour, environ 11 500 communes en bénéficient, ce qui représente un total de plus de 6 800 hectares qui sortent de l'enveloppe nationale, et même plus de 9 200 hectares si l'on compte les communes relevant du règlement national d'urbanisme (RNU) qui peuvent en devenir bénéficiaires en élaborant un document d'urbanisme d'ici à 2026.
Si la surface garantie passait à deux hectares, elle atteindrait près d'un quart de l'enveloppe foncière nationale, au détriment d'autres territoires susceptibles d'en avoir bien davantage besoin. Avis défavorable.
Notre amendement COM-69 et l'amendement identique COM-59 facilitent la mutualisation de la garantie de développement communal au-delà de l'échelle de l'EPCI, au Scot ou à la région.
Les amendements identiques COM-69 et COM-59 sont adoptés et deviennent article additionnel.
L'amendement COM-21 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements identiques COM-6 rectifié, COM-12, COM-18, COM-30, COM-38 rectifié et COM-45 rectifié bis, de même que les amendements identiques COM-7 rectifié, COM-17, COM-31, COM-37 rectifié et COM-46 rectifié bis sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. - Les amendements identiques COM-13 rectifié, COM-8 rectifié, COM-19 et COM-39 rectifié concernent le sursis à statuer. Son utilisation est déjà très encadrée. Il ne peut être mobilisé que si deux conditions sont réunies : la collectivité doit justifier que l'ampleur de la consommation d'Enaf projetée risque de compromettre le respect de ses objectifs en la matière sur la période 2021-2031 ; et le document d'urbanisme concerné doit être en cours d'élaboration, de révision ou de modification. Avis défavorable.
Les amendements identiques COM-13 rectifié, COM-8 rectifié, COM-19 et COM-39 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-23 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article additionnel après proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
L'amendement COM-11 rectifié n'est pas adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :
|
Article 1er |
|||
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
M. BOYER, rapporteur |
50 |
Définition de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
60 |
Définition de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. |
Adopté |
|
M. SAURY |
20 |
Exclusion du décompte de la consommation d'Enaf pour les bâtiments agricoles y compris en cas de changement de destination ultérieur. |
Rejeté |
|
M. BOYER, rapporteur |
52 |
Bilan de la consommation d'Enaf dans le cadre du « porter à connaissance ». |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
61 |
Bilan de la consommation d'Enaf dans le cadre du « porter à connaissance ». |
Adopté |
|
M. BOYER, rapporteur |
51 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
62 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 1er |
|||
|
M. BUIS |
44 |
Exemption du décompte de l'artificialisation des infrastructures relatives aux déchets. |
Rejeté |
|
Article 2 |
|||
|
M. DANTEC |
40 |
Suppression de l'article 2. |
Rejeté |
|
Mme HOUSSEAU |
26 |
Rythme de réduction de moitié de l'artificialisation entre 2021 et 2035. |
Rejeté |
|
M. GROSVALET |
33 rect. |
Décalage de la première période décennale à 2024-2034 et exemptions du décompte. |
Rejeté |
|
M. GROSVALET |
34 |
Décalage de la première période décennale à 2024-2034. |
Rejeté |
|
M. REICHARDT |
24 rect. |
Suppression des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification régionaux. |
Rejeté |
|
Mme GACQUERRE, rapporteure |
53 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
63 |
Amendement rédactionnel. |
Adopté |
|
Mme GACQUERRE, rapporteure |
54 |
Trajectoire et objectifs intermédiaires dans les documents régionaux. |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
64 |
Trajectoire et objectifs intermédiaires dans les documents régionaux. |
Adopté |
|
Article 3 |
|||
|
M. DANTEC |
41 |
Suppression de l'article 3. |
Rejeté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
65 |
Report des échéances de modification des documents de planification et d'urbanisme. |
Adopté |
|
Mme GACQUERRE, rapporteure |
55 |
Report des échéances de modification des documents de planification et d'urbanisme. |
Adopté |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 3 |
|||
|
Mme NOËL |
1 |
Inclusion des bâtiments scolaires dans les Pene. |
Retiré |
|
M. Vincent LOUAULT |
15 rect. quater |
Changement de destination des bâtiments agricoles. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. Vincent LOUAULT |
16 rect. ter |
Caducité automatique des Scot entièrement couverts par des PLUi. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
Article 4 |
|||
|
M. DANTEC |
42 |
Suppression de l'article 4. |
Rejeté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
66 |
Trajectoire pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'État. |
Adopté |
|
Mme GACQUERRE, rapporteure |
57 |
Trajectoire pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'État. |
Adopté |
|
M. GROSVALET |
35 |
Extension de la mutualisation des Pene au-delà jusqu'en 2044 et précisions sur la trajectoire de réduction pour les projets sous maîtrise d'ouvrage de l'État. |
Rejeté |
|
M. REICHARDT |
25 rect. |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les projets industriels. |
Rejeté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
67 |
Exclusion du décompte de la consommation d'Enaf pour l'industrie et les logements sociaux dans les communes carencées. |
Adopté |
|
Mme GACQUERRE, rapporteure |
56 |
Exclusion du décompte de la consommation d'Enaf pour l'industrie et les logements sociaux dans les communes carencées. |
Adopté |
|
M. CHASSEING |
71 rect. |
Sous-amendement à l'amendement COM-56 : Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les énergies renouvelables jusqu'en 2036. |
Adopté |
|
Mme HOUSSEAU |
70 |
Sous-amendement à l'amendement COM-56 : Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les énergies renouvelables jusqu'en 2036. |
Adopté |
|
M. BUIS |
72 |
Sous-amendement à l'amendement COM-56 : Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les énergies renouvelables jusqu'en 2036. |
Adopté |
|
Mme HOUSSEAU |
28 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour le photovoltaïque sans limitation de temps. |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme HOUSSEAU |
29 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour le photovoltaïque flottant. |
Satisfait ou sans objet |
|
Mme NOËL |
4 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour la réalisation de logements sociaux. |
Retiré |
|
Mme NOËL |
10 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour la réalisation de logements sociaux (rattrapage). |
Retiré |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 4 |
|||
|
Mme NOËL |
3 |
Exemption du décompte de l'artificialisation des aires d'accueil des gens du voyage. |
Retiré |
|
Mme NOËL |
9 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les « coups partis ». |
Retiré |
|
M. MÉDEVIELLE |
32 |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les ZAC, les GOU et les OIN créés avant 2021. |
Rejeté |
|
Mme NOËL |
5 |
Exemption du décompte de l'artificialisation pour les déclarations de projet et les DUP. |
Retiré |
|
M. FAVREAU |
49 rect. |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf pour les ICPE. |
Retiré |
|
Mme NOËL |
2 rect. |
Exemption du décompte de la consommation d'Enaf des PAE et des ZAE. |
Retiré |
|
Article 5 |
|||
|
M. DANTEC |
43 |
Suppression de l'article 5. |
Rejeté |
|
M. BOYER, rapporteur |
58 |
Renforcement des « conférences du ZAN ». |
Adopté |
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
68 |
Renforcement des « conférences du ZAN ». |
Adopté |
|
M. CABANEL |
36 rect. |
Inclusion des universités, EPF et acteurs de l'aménagement dans les conférences régionales. |
Satisfait ou sans objet |
|
M. FAVREAU |
48 rect. |
Inclusion de représentants des chambres consulaires dans les conférences régionales. |
Satisfait ou sans objet |
|
Article(s) additionnel(s) après Article 5 |
|||
|
M. GUÉRET, rapporteur pour avis |
69 |
Aménagements de la garantie de développement communal. |
Adopté |
|
M. BOYER, rapporteur |
59 |
Aménagements de la garantie de développement communal. |
Adopté |
|
M. FOLLIOT |
21 rect. |
Garantie de développement communal portée à 2 ha. |
Rejeté |
|
M. BURGOA |
6 rect. |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. BUIS |
12 |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. KERN |
18 |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
Mme HOUSSEAU |
30 |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. FAVREAU |
38 rect. |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. CHASSEING |
45 rect. bis |
Suppression de l'étude préalable d'optimisation de la densité. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. BURGOA |
7 rect. |
Suppression de l'étude préalable de potentiel de changement de destination. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. KERN |
17 |
Suppression de l'étude préalable de potentiel de changement de destination. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
Mme HOUSSEAU |
31 |
Suppression de l'étude préalable de potentiel de changement de destination. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. FAVREAU |
37 rect. |
Suppression de l'étude préalable de potentiel de changement de destination. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. CHASSEING |
46 rect. bis |
Suppression de l'étude préalable de potentiel de changement de destination. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
M. BUIS |
13 rect. |
Suppression du sursis à statuer « ZAN ». |
Rejeté |
|
M. BURGOA |
8 rect. |
Suppression du sursis à statuer « ZAN ». |
Rejeté |
|
M. KERN |
19 |
Suppression du sursis à statuer « ZAN ». |
Rejeté |
|
M. FAVREAU |
39 rect. |
Suppression du sursis à statuer « ZAN ». |
Rejeté |
|
M. FOLLIOT |
23 rect. |
Information obligatoire des communes par les Safer sur les aliénations. |
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
|
Article(s) additionnel(s) après Proposition
de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction |
|||
|
M. BURGOA |
11 rect. |
Exemption du décompte de l'artificialisation des infrastructures relatives aux déchets. |
Rejeté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 112(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie113(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte114(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial115(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des affaires économiques a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 19 février 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 124 (2024-2025) visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation des sols et aux modalités de leur déclinaison dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme, y compris en ce qui concerne leur calendrier d'application ;
- à la métrique utilisée pour mesurer l'artificialisation des sols et à la notion de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers ;
- à la gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols.
Sans que l'énumération ci-dessous soit exhaustive, ne sont pas susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé, les dispositions relatives :
- aux dispositions d'ordre général ou spécifiques relatives aux procédures d'urbanisme, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus ;
- aux dispositions de la loi Climat-résilience autres que celles figurant à ses articles 191 et 194, lorsqu'elles sont dépourvues de lien avec l'une des dispositions citées ci-dessus.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 22 janvier 2025
- Assemblée des départements de France (ADF) : MM. Pascal COSTE, président du conseil départemental de la Corrèze, Edouard GUILLOT, conseiller Environnement, transition énergétique, agriculture et réseaux, et Mme Marylène JOUVIEN, conseillère Relations avec le Parlement.
- Intercommunalités de France : M. Matthieu SCHLESINGER, vice-président d'Orléans métropole, vice-président en charge de l'urbanisme à Intercommunalités de France, Mmes Carole ROPARS, responsable du pôle Environnement et aménagement, et Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement.
Vendredi 24 janvier 2025
- Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) : M. Philippe RIBOT, président de l'AMF30, maire de Saint-Privat-des-Vieux et vice-président d'Alès Agglomération, Mmes Nathalie FOURNEAU, responsable du département Aménagement du territoire, et Charlotte de FONTAINES, chargée des relations avec le Parlement.
Mardi 28 janvier 2025
- Association des maires ruraux de France (AMRF) : MM. Sébastien GOUTTEBEL, vice-président, François DESCOEUR, membre du conseil d'administration, maire d'Anglards-de-Salers, et Maxime MACHURAT, chargé de mission.
- Régions de France : Mme Laurence ROUÈDE, vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, MM. Guillaume FOURGEAUD, directeur de cabinet adjoint du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Frédéric EON, conseiller parlementaire et juridique, et Pascal GRUSELLE, conseiller Affaires européennes, aménagement du territoire.
- Fédération nationale des SCoT (FédéSCoT) : M. Michel HEINRICH, président, et Mme Stella GASS, directrice.
- Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche : Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, accompagnée de Mmes Aurélie VIEILLEFOSSE, directrice adjointe du cabinet en charge de la biodiversité, du climat, de la forêt et de la prévention des risques, Marina MAURES, conseillère Planification, territoires et financements carbone, Lisa BROUTTÉ, conseillère parlementaire, et M. Vincent MONTRIEUX, adjoint au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN).
- Citadia (Groupe Scet) : M. Timothée HUBSCHER, directeur.
Mardi 4 février 2025
- Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) : M. Philippe MAZENC, directeur général, et Mmes Émilie VOUILLEMET, sous-directrice de l'urbanisme règlementaire et des paysages, et Céline BONHOMME, sous-directrice de l'aménagement durable à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP).
- Cabinet Létang : Mme Stéphanie ENCINAS, avocat associé et membre du conseil de l'ordre du Barreau de Paris, et Mme Gwenaël LE FOULER, avocat associé.
Mercredi 5 février 2025
- Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation : Mmes Françoise GATEL, ministre déléguée chargée de la ruralité, accompagnée de Mme Cécile DINDAR, directrice du cabinet, et M. Tristan ROCHAS, conseiller spécial, chargé des affaires parlementaires et de l'aménagement rural.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Amazon Web Services France
- Association des petites villes de France (APVF)
- Association française pour l'étude du sol (Afes)
- Conseil régional de Bretagne
- Électricité de France
- Fédération française du bâtiment
- Fédération nationale des travaux publics
- Fondation pour la nature et l'homme
- France gaz
- France urbaine
- M. Philippe Bas, sénateur de la Manche
- Mouvement des entreprises de France (Medef)
- Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti)
- Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)
- Syndicat des énergies renouvelables
- Villes de France
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-124.html
* 1 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 2 Résultats d'une enquête menée par la Fédération nationale des schémas de cohérence territoriale (Fédéscot) en avril 2024.
* 3 Résultats de la consultation en ligne des élus locaux sur la mise en oeuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, faite par le groupe de suivi sénatorial sur la stratégie de réduction de l'artificialisation des sols, juin 2024.
* 4 Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
* 5 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
* 6 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
* 7 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 8 Art. L. 153-27 du code de l'urbanisme.
* 9 V de l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales.
* 10 Réponse à un questionnaire budgétaire sur le projet de lois de finances pour 2025.
* 11 Art. L. 151-9 et L. 151-11 à L. 151-13 du code de l'urbanisme.
* 12 Ces éléments sont notamment développés dans le guide à l'usage des élus publié en décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Zéro Artificialisation Nette. Fascicule 1 : définir et observer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et l'artificialisation des sols.
* 13 Art. L. 111-3 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
* 14 Art. L. 122-5 suivants du code de l'urbanisme.
* 15 Art. L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme ; fascicule précité.
* 16 Art. R. 562-11 du code de l'environnement.
* 17 Art. L. 121-8 et L. 122-5 du code de l'urbanisme.
* 18 Art. L. 111-4 du code de l'urbanisme.
* 19 Fascicule susmentionné, p. 16.
* 20 Catégorie 1° « Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations ».
* 21 Catégorie 7°.
* 22 « Occupation du Sol à Grande Échelle ».
* 23 Art. L. 121-8 du code de l'urbanisme.
* 24 Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme.
* 25 DHUP, réponse à un questionnaire écrit.
* 26 DHUP, réponse à un questionnaire écrit.
* 27 Fascicule précité, p. 13.
* 28 Art. 206 de la loi Climat-résilience, codifié à l'art. L. 2231-1 du code de l'urbanisme, et art. R. 101-2 du code de l'urbanisme, créé par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023.
* 29 Cerema, Analyse de la consommation d'espaces : période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2023, mai 2024, p. 12.
L'inclusion de la Guyane, recouverte en grande partie de forêts, ramène cette part à 8 % (Insee, Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires, édition 2024).
* 30 Insee, document cité.
* 31 Cf. par exemple France Stratégie, Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? , p. 11 à 15.
* 32 Ibid.
* 33 L'enquête Teruti-Lucas est réalisée par les services statistiques du ministère chargé de l'agriculture depuis 1982 (la première enquête, avec une méthodologie différente, remontant même à 1946). Son objectif est de suivre les différentes catégories d'occupation et d'usage des sols, à partir d'un échantillon représentatif du territoire (méthodologie par sondage).
* 34 France Stratégie, document cité, p. 21.
* 35 Ibid.
* 36 Cerema, document cité.
* 37 https://www.ofb.gouv.fr/lartificialisation-des-sols.
* 38 Art. L. 101-2-1 du code de l'urbanisme : « La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».
* 39 Ademe, « Le ZAN en 20 questions ».
* 40 Bilan de l'Observatoire national de la biodiversité (ONB), 2021.
* 41 Inra & Ifsttar, Sols artificialisés et processus d'artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d'action. Synthèse du rapport d'expertise scientifique collective, décembre 2017, p. 30, et 49 sqq.
* 42 Données CORINE Land Cover.
* 43 Commissariat général au développement durable, Les pertes de terres agricoles en France, 21 juin 2019.
* 44 Loi n °2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
* 45 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre des 268 engagements du Grenelle de l'environnement et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 46 Art. 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre des 268 engagements du Grenelle de l'environnement.
* 47 Art. 10, 12, 15 et 16 de la loi n° 2009-967 précitée.
* 48 Art. 17 et 19 de la loi n° 2010-788.
* 49 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
* 50 Art. 129, 139, 140 et 157 de la loi n° 2014-366 précitée.
* 51 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 52 Les Propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Rapport de la Convention citoyenne pour le climat à l'issue de son adoption formelle dimanche 21 juin 2020, p. 296 et 298.
* 53 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, Stratégie de l'UE pour la protection des sols à l'horizon 2030, COM(2021) 699 final.
* 54 Les politiques de réduction de l'artificialisation des sols, Étude de législation comparée n° 325 - septembre 2023, p. 6.
* 55 Cf. ci-dessus, article 2.
* 56 I et 1° du II de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 57 3° du III de l'art. 194 de la loi Climat-résilience. Ce taux de réduction a été relevé en mai 2024 à - 54,5 %, en raison de la mutualisation entre les régions du forfait d'artificialisation prévu pour les projets d'envergure nationale et européenne (Pene), conformément à l'arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur, pris en application du deuxième alinéa du III bis de l'article 194 de la loi Climat-résilience.
* 58 2° du II de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 59 3° du II de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 60 4° et 5° du II de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 61 1° à 4° du IV de l'art. 194 de la loi Climat-résilience (version initiale).
* 62 5° du IV de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 63 6° du IV de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 64 7° et 8° du IV de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 65 5° du IV de l'art. 194.
* 66 9° du VI de l'art. 194.
* 67 Ibid.
* 68 Le décret d'application sur la nomenclature a finalement été publié en avril 2023 (décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme), et a en outre immédiatement fait l'objet de vives contestations.
* 69 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
* 70 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme.
* 71 Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement.
* 72 Cf. ci-dessous, article 4.
* 73 Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur, publié au Journal officiel le 9 juin 2024.
* 74 Cf. ci-dessous, article 5.
* 75 Chiffres fournis par la DHUP.
* 76 Cette possibilité est prévue par les 5° et 7° du IV de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 77 Réponses à un questionnaire écrit.
* 78 6° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme.
* 79 Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.
* 80 III bis de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 81 Ibid.
* 82 Cf. ci-dessus, article 2.
* 83 Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur.
* 84 7° du III de l'article 194 de la loi Climat-résilience.
* 85 8° du III de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 86 Cf. ci-dessous, article 5.
* 87 III ter de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 88 Art. 1 et 3 du décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols.
* 89 Art. 8 du décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols.
* 90 Arrêté du 31 mai 2024 relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur.
* 91 Données fournies par la DHUP, réponse à un questionnaire écrit.
* 92 L'ensemble des projets, ainsi que leur localisation et leur surface, sont accessibles en ligne.
* 93 Texte n° 550 (2023-2024) de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, déposé au Sénat le 24 avril 2024.
* 94 Texte n° 573 (2023-2024) de MM. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du logement, déposé au Sénat le 6 mai 2024.
* 95 France Stratégie, Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?, p. 24.
* 96 Art. L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi Climat-résilience (en vigueur).
* 97 Rapport n° 415 (2022-2023) de M. Jean-Baptiste Blanc sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, déposé le 8 mars 2023.
* 98 I de l'article L. 1111-9-2 du CGCT.
* 99 Rapport n° 415 (2022-2023) de M. Jean-Baptiste Blanc sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires , déposé le 8 mars 2023.
* 100 En Corse, la loi prévoit que le rôle de la conférence régionale est joué par la chambre des territoires, qui préexistait.
* 101 Proposition de loi n°° 205 (2022-2023) de M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie LÉTARD et plusieurs de leurs collègues, déposée le 14 décembre 2022.
* 102 Conseil d'État, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010.
* 103 Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, puis décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.
* 104 Cf. rapport n° 415 (2022 2023) de M. Jean Baptiste Blanc sur la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, déposé le 8 mars 2023, commentaire de l'article 7.
* 105 Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
* 106 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
* 107 À partir de données communales fournies par la DHUP en 2023.
* 108 Somme des surcroîts de consommation d'Enaf garantis aux communes bénéficiaires de la garantie, par rapport à leur enveloppe théorique.
* 109 Art. L. 111-3 du code de l'urbanisme.
* 110 3° bis du III de l'art. 194 de la loi Climat-résilience.
* 111 Art. L. 143-38 et L. 153-47 du code de l'urbanisme.
* 112 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 113 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 114 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 115 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.