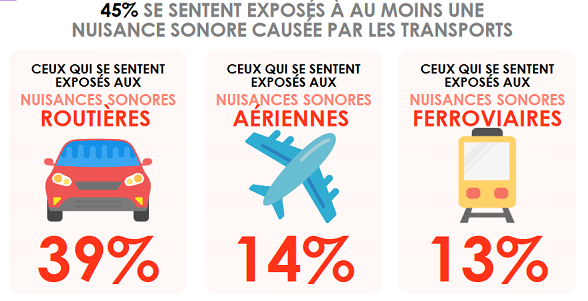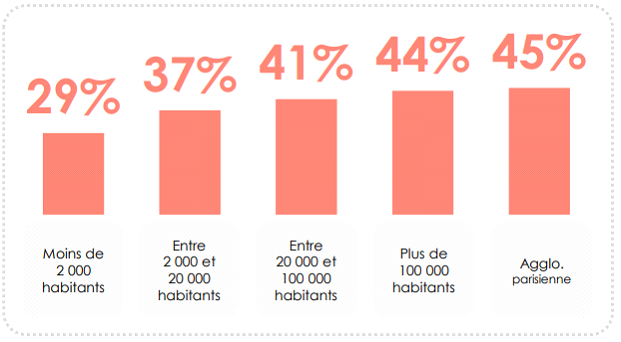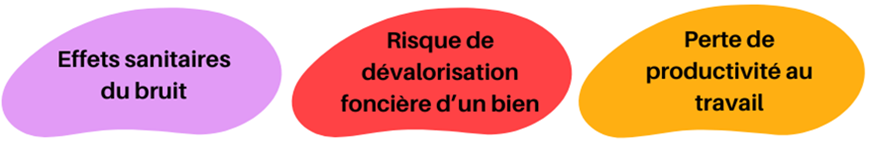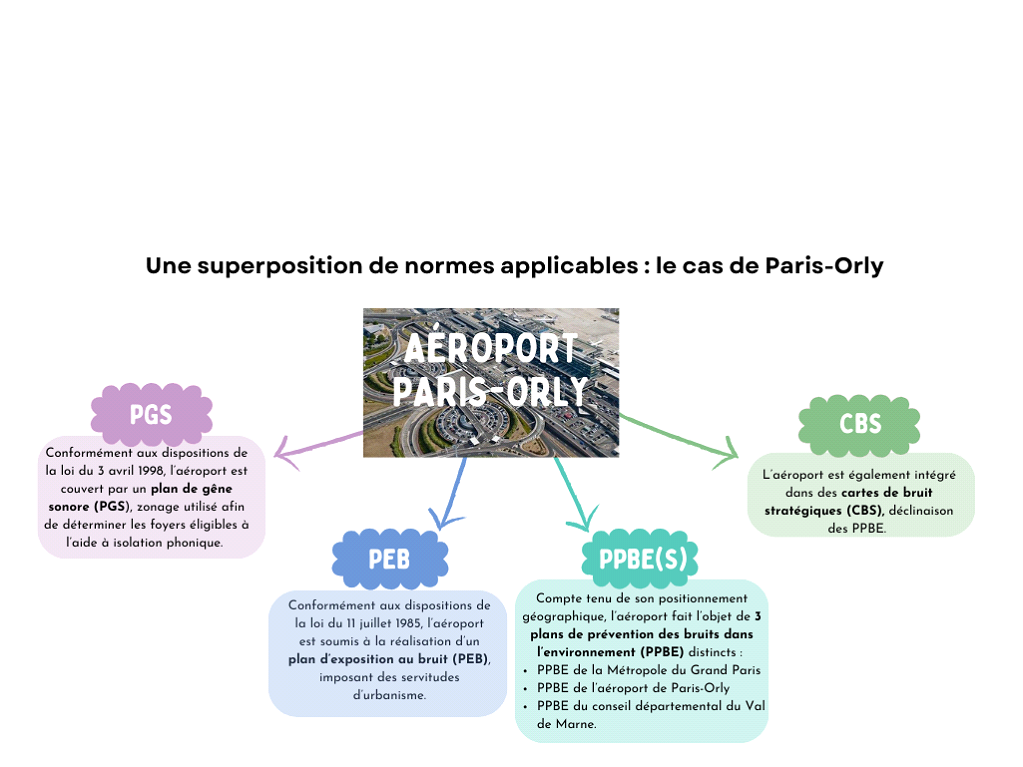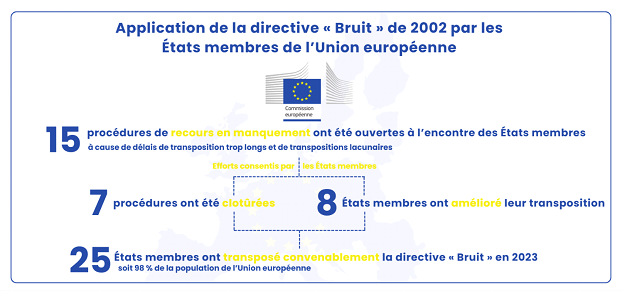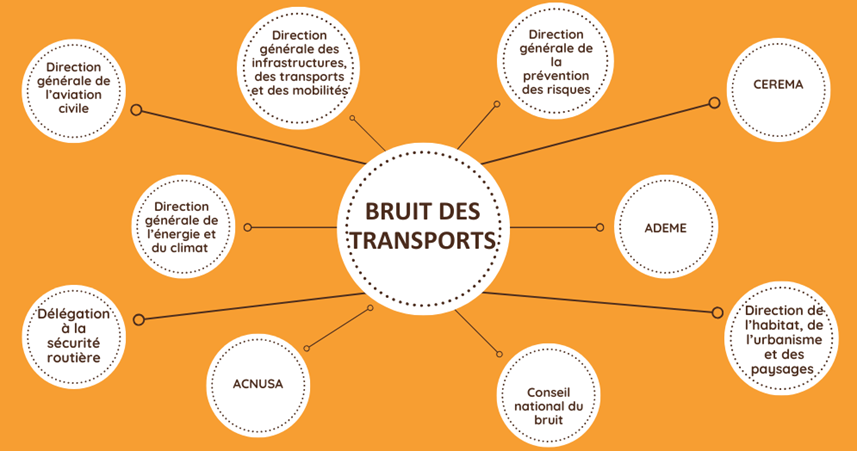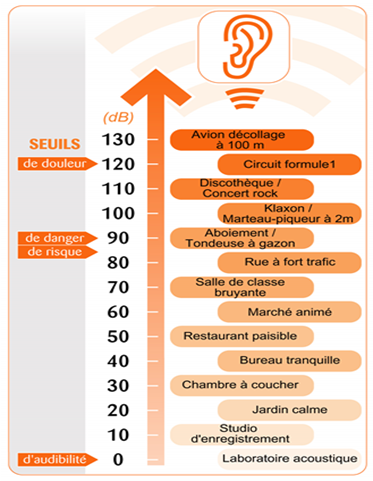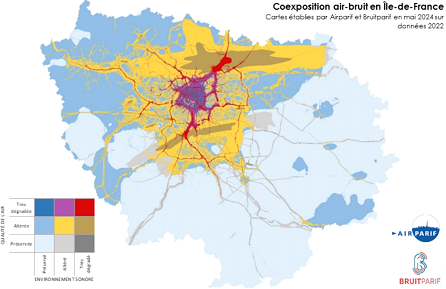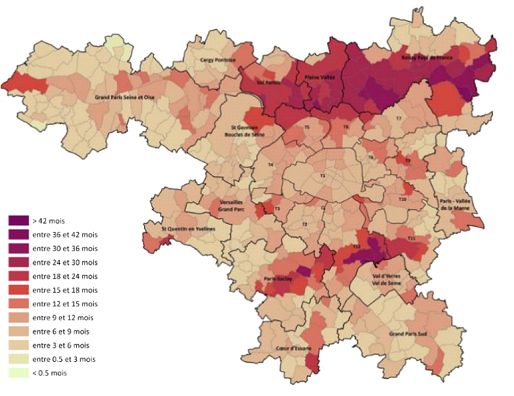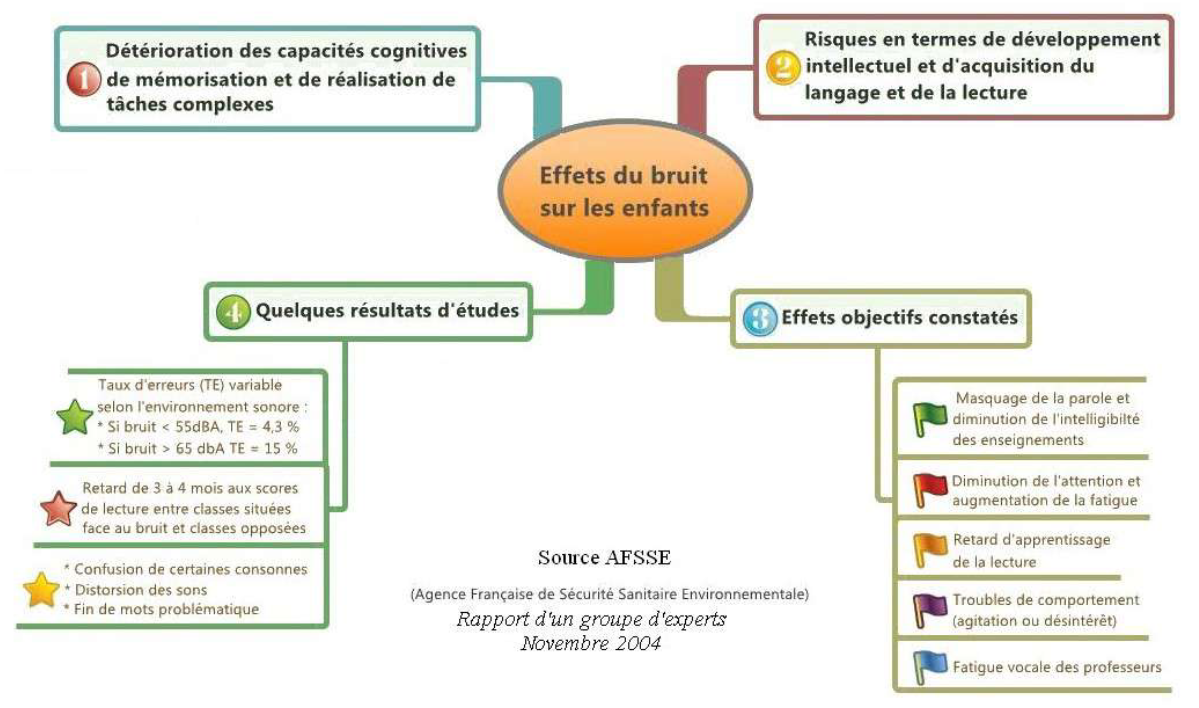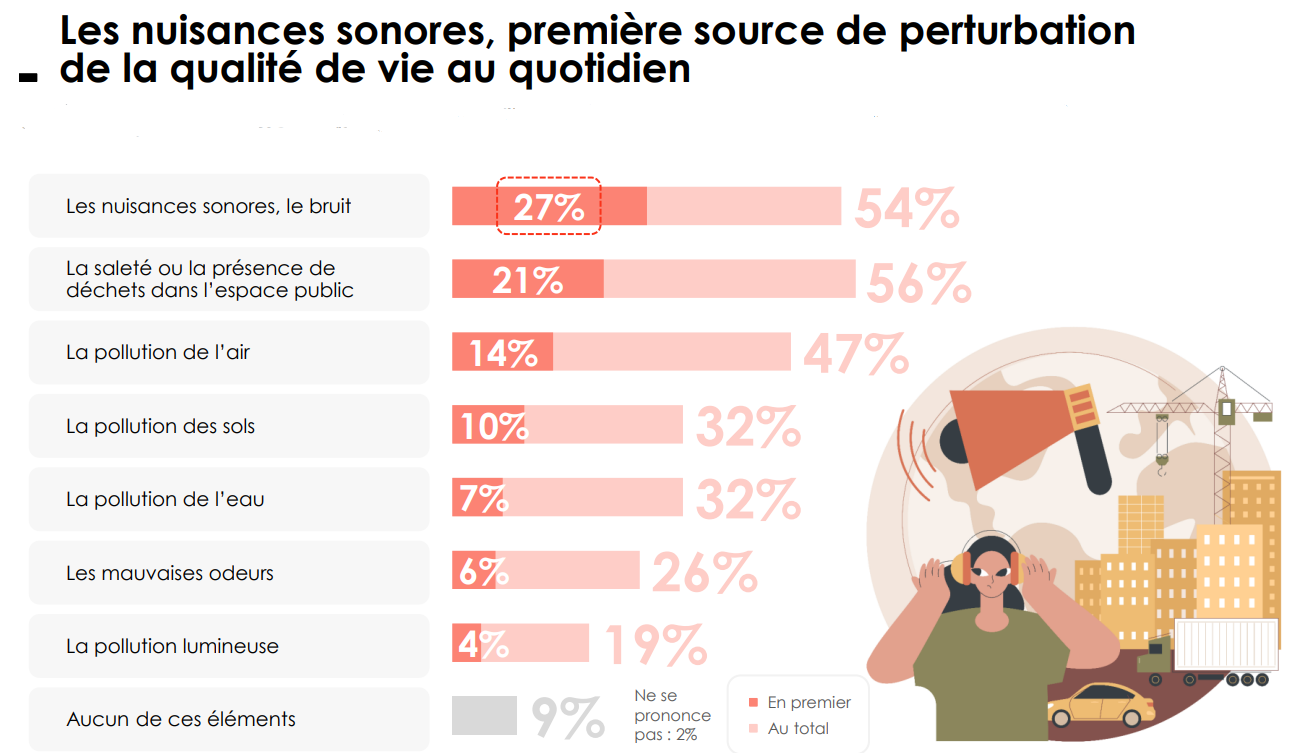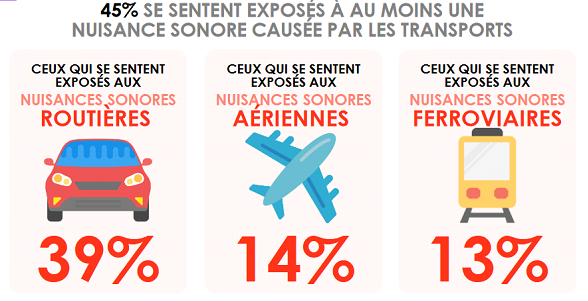L'ESSENTIEL
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité le rapport d'information de Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz sur la pollution sonore liée aux transports. Pour les rapporteurs, le constat est sans appel : la lutte contre le bruit, sujet au coeur du quotidien des Français, est loin d'être une priorité des pouvoirs publics.
Pourtant, un sondage réalisé à l'initiative de la commission1(*) révèle que le bruit est en tête des préoccupations de 27 % des Français sondés, devant d'autres perturbations quotidiennes comme les déchets dans l'espace public ou les pollutions de l'air, des sols et des eaux.
Près de la moitié de nos concitoyens se considèrent en effet exposés au bruit des transports à leur domicile ou sur leur lieu de travail, notamment en milieu urbain. Pour autant, le bilan des politiques publiques de lutte contre le bruit des transports fait apparaître que les moyens juridiques et humains déployés pour répondre à cette problématique de santé publique ne sont pas à la mesure des enjeux. Les outils réglementaires nationaux, largement perfectibles et faiblement opérationnels, s'écartent des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les référentiels utilisés sont inadaptés, et les publics les plus exposés ne bénéficient pas d'un accompagnement suffisant pour mieux s'isoler du bruit.
Face à ce constat réaliste, la commission a adopté à l'unanimité 22 recommandations, pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le bruit causé par les transports et, ainsi, mieux protéger la santé de nos concitoyens. Elle juge indispensable l'élaboration d'un plan national pour protéger les populations vivant dans les lieux les plus exposés au bruit, les « points noirs de bruit ». Elle appelle également de ses voeux :
- une adaptation de notre réglementation pour mieux protéger les riverains des infrastructures de transports routiers, ferroviaires et aériens ;
- une vigilance particulière par rapport au secteur du transport routier, principale source d'exposition au bruit causé par les transports.
I. LE BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS : UNE POLLUTION AUX EFFETS SANITAIRES MAJEURS
A. UN FRANÇAIS SUR DEUX EST EXPOSÉ AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS
Le sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que l'exposition aux bruits engendrés par les transports affecte environ 45 % des Français. La gêne ressentie liée les pollutions sonores varie d'une génération à une autre, ainsi pour la tranche d'âge des 35-49 ans, elle est particulièrement aiguë.
La perception des pollutions sonores et de la gêne en résultant dépend en effet largement de l'âge et du lieu de vie.
Part de la population se déclarant exposée aux nuisances sonores routières selon la taille de l'agglomération
Le transport routier - deux-roues, voitures, poids-lourds - est identifié par le sondage comme la principale source de pollutions sonores. Les causes sont évidentes : c'est en effet le premier mode de transport des Français, le bruit généré par ce mode de transport est donc massif : le réseau routier dessert l'ensemble du territoire, à la différence du trafic aérien et ferroviaire, concentré à proximité des aéroports et des voies de chemin de fer.
L'exposition aux pollutions sonores est particulièrement forte en milieu urbain et progresse avec la taille de l'agglomération, pour tous les modes de transport.
Source : Sondage réalisé à la demande de la mission d'information
B. LE BRUIT CAUSÉ PAR LES TRANSPORTS AFFECTE LA SANTÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES
Les effets sanitaires du bruit causé par les transports justifient de l'appréhender non comme une nuisance, mais comme une véritable « pollution ».
Ses impacts négatifs multiples sur la santé touchent toute la population ainsi que l'a mis en avant l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) : perturbations du sommeil, troubles de l'apprentissage chez l'enfant, risque accru d'infarctus du myocarde, hypertension artérielle ou encore aggravation de risques de désordres psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Les coûts induits par les pollutions sonores sont difficilement quantifiables, mais certaines conséquences sont objectivées.
II. UNE RÉGLEMENTATION COMPLEXE ET PEU LISIBLE, EN MAL D'EFFICACITÉ
A. CARTES ET PLANS DE LUTTE CONTRE LE BRUIT : UN MAQUIS PEU OPÉRATIONNEL
Éparse et complexe, la réglementation de la lutte contre les pollutions sonores s'est forgée par strates successives, sans approche globale.
Le législateur s'est dans un premier temps, en 1985, borné à encadrer les émissions acoustiques du transport aérien, en créant :
- les plans d'exposition au bruit (PEB)2(*), qui délimitent des zones à proximité des aéroports soumises à des règles d'urbanisme limitant la construction de logements ;
- les plans de gêne sonore (PGS), qui ouvrent aux riverains résidant dans les zones exposées au bruit des aéroports le bénéfice d'une aide financière à l'isolation phonique de leur logement3(*).
Puis, une étape plus ambitieuse a été franchie avec la loi « bruit » du 31 décembre 1992 afin de prendre en compte l'ensemble du spectre des nuisances sonores. Ce texte est, d'ailleurs, toujours le cadre de référence en la matière. Cette loi définit un « classement sonore des voies » de transports terrestres les plus bruyantes et des obligations de protection des riverains situés à leur proximité.
Enfin, la directive européenne « bruit » du 25 juin 20024(*) a invité les États membres à mettre en place une cartographie du bruit dans un périmètre déterminé (grandes agglomérations et à proximité des grandes infrastructures de transport) par le biais de cartes de bruit stratégiques (CBS). Des « plans de prévention des bruits dans l'environnement » (PPBE) visant la réduction du bruit ont également été définis pour mettre en oeuvre cette exigence européenne dans notre droit.
Force est de constater que ces outils se superposent sans qu'une remise à plat rationnelle et une réflexion d'ensemble aient été menées : un seul et même émetteur de bruit doit appliquer une multitude de normes.
Ainsi, les grandes infrastructures de transports terrestres sont répertoriées dans des CBS et dans le classement sonore des voies de transport terrestre. Cet enchevêtrement est source d'illisibilité et de complexité, car les indicateurs de bruit utilisés dans ces documents, applicables aux mêmes infrastructures, ne sont pas identiques.
Le cas des PPBE est révélateur de cette complexité. Les périmètres de plusieurs PPBE peuvent se chevaucher, notamment dans les grandes agglomérations. En outre, les mesures qui y figurent n'ont pas de valeur normative et leur non-respect ne fait l'objet d'aucune sanction. Il en résulte un manque d'appropriation de cet outil, perçu comme une contrainte administrative par les acteurs concernés. Un autre symptôme de ce faible intérêt pour les PPBE est que certains d'entre eux, obligatoires au regard du droit de l'Union européenne (UE), n'ont toujours pas été réalisés, si bien que la Commission européenne a ouvert une procédure de recours en manquement à l'encontre de la France.
Proposition : Rationaliser l'élaboration des PPBE sur un même territoire et en faire un outil stratégique de réduction du bruit et non un simple outil de reporting européen.
B. METTRE À JOUR NOS NORMES : UN IMPÉRATIF POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
Actuellement, les réglementations française et européenne utilisent des indicateurs énergétiques qui mesurent un niveau moyen annualisé de bruit.
Cette méthode, adaptée pour mesurer la gêne liée au bruit routier, se fonde sur une logique linéaire. Moins opérationnelle pour le transport ferroviaire et aérien, elle présente l'inconvénient de lisser les pics de forte intensité entrecoupés de silences. Pourtant, ces bruits sont gênants la nuit : ils perturbent la qualité du sommeil et méritent donc d'être pris en compte. Cette approche est en décalage manifeste avec la gêne ressentie par les riverains. À titre d'exemple, une voie ferroviaire comptant moins de 50 trains par jour n'est pas considérée comme une installation bruyante.
La loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 20195(*) a prévu, pour mesurer le bruit ferroviaire, le recours à des indicateurs dits événementiels, qui prennent en compte l'intensité et le nombre d'événements sonores : ils permettent d'éviter d'appréhender de la même façon un bruit moyen et durable et des pics de bruit répétés. Cet instrument est expérimenté depuis 2022 pour le transport ferroviaire. Le transport aérien fait l'objet d'une démarche analogue depuis 2023. Pour l'heure, ces expérimentations n'ont pas encore permis la définition d'indicateurs fiables en raison des difficultés techniques rencontrées.
Proposition : Appliquer pleinement la loi d'orientation des mobilités (LOM) avec la fixation d'un calendrier précis pour les prochaines phases d'expérimentation d'indicateurs événementiels et la réalisation d'études de santé publique.
En outre, l'OMS a défini en 2018 des seuils au-delà desquels l'exposition au bruit des transports est nocive pour la santé. Les plafonds définis dans la réglementation française sont moins disant par rapport aux indicateurs internationaux. Cet écart entre notre droit et les recommandations de l'OMS est peu satisfaisant. Cependant, l'application stricte de ces exigences aux nouveaux projets d'infrastructures de transport semble difficile à envisager dans l'immédiat, au risque d'empêcher le développement de projets indispensables au report modal et au respect de nos engagements climatiques.
Pour les rapporteurs, ce principe de réalité ne doit pas, pour autant, justifier l'inaction réglementaire. Si la définition de nouveaux seuils réglementaires à brève échéance alignés sur ceux établis par l'OMS n'est pas encore possible, des études d'impact pourraient amorcer des évolutions souhaitables de la réglementation. Dans un souci de pragmatisme, cette mise à jour pourrait s'appliquer aux nouvelles infrastructures et aux modifications significatives des infrastructures existantes.
Proposition : Mettre en cohérence les seuils réglementaires de niveaux de bruit des transports par référence aux seuils de l'OMS sur la base des résultats d'études d'impact de faisabilité.
En complément :
- introduire des zones d'ambiance sonore très modérée avec des seuils de bruit plus exigeants à respecter pour les nouvelles infrastructures de transport ;
- introduire un seuil de bruit pour la soirée, intermédiaire entre les seuils applicables le jour et la nuit pour les nouvelles infrastructures de transport.
III. UN PILOTAGE À VUE QUI NUIT À L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DE PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU BRUIT
La prévention de l'exposition des populations au bruit des transports mobilise une dizaine d'administrations et opérateurs de l'État.
La mission du bruit et agents physiques, entité de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) assure le pilotage et la coordination de tous ces acteurs. Les moyens humains qui lui sont alloués sont modestes, trois agents en équivalent temps plein. Eu égard à la diversité des actions et à la technicité des enjeux ainsi qu'au nombre d'acteurs en présence, ce service est sous-dimensionné pour s'acquitter de sa mission stratégique de pilotage dans de bonnes conditions.
Proposition : Redéployer des moyens humains au profit de la DGPR pour renforcer l'efficacité du pilotage de la politique de lutte contre le bruit.
À l'échelle des territoires, la gouvernance de la prévention du bruit est également inadaptée : elle implique de nombreux acteurs locaux dans les collectivités territoriales (conseils régionaux et départementaux, communes et EPCI) et les administrations déconcentrées (préfectures départementales et régionales, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, directions départementales des territoires). Un observatoire régional du bruit fédérant ces acteurs n'existe que dans deux régions : en Île-de-France, avec BruitParif, et en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Acoucité, l'observatoire de l'environnement sonore de la Métropole de Lyon.
Le bruit est un sujet éminemment technique, à forts enjeux scientifiques et juridiques au demeurant complexes. La dispersion des compétences engendrée par une gouvernance éclatée limite les capacités d'action des acteurs publics.
Un regroupement des moyens humains des services déconcentrés de l'État à l'échelle régionale et un renforcement de leur coordination avec les collectivités territoriales serait souhaitable. Cette mise en commun des compétences permettrait d'en éviter l'émiettement, source d'une perte d'efficience de l'action.
Proposition : Regrouper à l'échelle régionale les moyens humains et techniques de lutte contre le bruit et généraliser la mise en place d'observatoires régionaux du bruit afin de renforcer et mutualiser les compétences territoriales.
IV. UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L'EXPOSITION AU BRUIT LIÉ AUX TRANSPORTS AUX RÉSULTATS INSUFFISANTS
A. L'ÉCHEC DE LA LUTTE CONTRE LES POINTS NOIRS DE BRUIT
Source : Le Parisien
Les zones les plus exposées au bruit des transports terrestres sont appelées points noirs de bruit (PNB).
Depuis 1984, puis au début des années 2000 et en 2009, des plans visant à les résorber en isolant les logements ou en modernisant les infrastructures de transports ont été déployés. Les moyens budgétaires n'ont pas été suffisamment mobilisés, ainsi qu'en atteste la diminution progressive des crédits consacrés à la résorption des PNB, principale cause de l'échec des politiques en la matière6(*).
Ainsi, en 2017, sur 53 000 PNB ferroviaires, SNCF Réseau en a traité seulement 2 200. Quant aux axes routiers, on estimait alors à 850 000 les logements situés sur un PNB routier à protéger. Or, le plan bruit de l'Ademe mené entre 2009 et 2015 n'a permis de protéger que 3 324 logements sur le même stock. On dénombrerait donc près de 900 000 PNB liés aux transports terrestres selon le Cerema, mais le rythme atone du traitement de ce stock ne permet pas, à ce stade, d'envisager une amélioration substantielle de la situation.
De surcroît, les pouvoirs publics ne disposent malheureusement pas d'une base de données identifiant finement l'ensemble des PNB. Un recensement est donc urgent car il constitue un préalable à la définition d'un plan national de traitement en vue de financer presque intégralement les travaux pour les riverains. Un tel plan répondrait à un impératif de santé environnementale, en application du principe « pollueur-payeur ».
Proposition : Lancer un plan de résorption des PNB, à partir d'une cartographie préalable des zones concernées, par redéploiement de financements budgétaires, et d'une meilleure prise en charge des travaux d'insonorisation.
B. LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER : INTENSIFIER LA RIPOSTE
Deux modes de transports routiers sont particulièrement émetteurs de bruits : les deux-roues motorisés (2RM) et les poids lourds. Des radars sonores ont été déployés depuis la LOM de 2019 dans plusieurs territoires, notamment à Paris, dans le cadre d'une expérimentation pilotée par la DGPR. Le constat est sévère : rue d'Avron, dans le XXe arrondissement de Paris, 166 véhicules en moyenne par jour dépassent les 83 dB. Or, à partir de 80 dB, la durée d'exposition à la source de bruit devient un facteur important de risque.
« Les nuisances sont dues à des deux-roues aux pots d'échappement non conformes ainsi qu'à leur vitesse inadaptée. Et surtout à l'absence de contrôle des forces de l'ordre. »
Un répondant au sondage CSA réalisé pour le compte de la commission
Les rapporteurs ont eu l'opportunité en avril dernier d'expérimenter in situ7(*) la mise en oeuvre de ce dispositif prometteur, qui aurait un effet dissuasif sur les comportements de conduite excessivement sportive et agressive dans les agglomérations, responsables d'intenses pics de bruits.
Proposition : Déployer des radars sonores sur l'ensemble du territoire, une fois la phase d'expérimentation terminée et évaluée.
Appréhender le bruit causé par un véhicule en circulation est un impératif. Dans ces conditions, la commission estime nécessaire de remédier au décalage entre les seuils sonores réglementaires d'homologation des véhicules (obtenu à partir d'un test en mouvement) et les valeurs renseignées sur les papiers d'immatriculation des véhicules (mesurées lors d'un test à l'arrêt), utilisées pour verbaliser les véhicules trop bruyants.
Proposition : Faire converger les seuils réglementaires établis pour l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule avec les valeurs utilisées pour l'immatriculation du véhicule.
C. BRUIT AÉRIEN : AGIR POUR PROTÉGER LES RIVERAINS LA NUIT ET RÉPONDRE AUX PERTURBATIONS LOCALES
Les évolutions récentes du trafic aérien, marquées par un accroissement du trafic en soirée et tôt dans la matinée en raison de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts, méritent d'être prises en compte dans la politique de lutte contre le bruit.
Une actualisation de la réglementation applicable au trafic aérien pour appréhender la permanence de l'exposition des riverains au bruit aérien, en particulier nocturne, est souhaitable.
Certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées à l'instar de Toulouse-Blagnac, Nantes Atlantique et Paris-Orly exigent une attention particulière à l'égard de la population qui réside aux alentours. L'extension au trafic aérien de mesures de couvre-feu serait la solution la plus efficace. Il faut cependant veiller à ce que la mise en place d'un tel encadrement n'ait pas de conséquences économiques et sociales disproportionnées.
Proposition : Renforcer le couvre-feu en vigueur dans certains aéroports situés à proximité immédiate de zones densément urbanisées.
Enfin, réglementer les activités des aérodromes de loisir ou d'entraînement ne doit plus être un tabou.
Seuls quatre aérodromes sont soumis à des restrictions d'exploitation. Or, 5 % des Français sont gênés sur leur lieu de vie ou au travail par les nuisances sonores qu'ils émettent. Les communes de petite taille comptent parmi les plus pénalisées par ces nuisances.
Proposition : Mieux encadrer l'aviation de loisir et de formation en plaçant le maire au coeur de la décision : lui donner la faculté de définir des niveaux sonores maximaux pour les aéronefs utilisés et des plages horaires de restriction d'exploitation des plateformes.
I. L'EXPOSITION AU BRUIT DES TRANSPORTS : UN SUJET DE SANTÉ PUBLIQUE AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS
Le monde moderne a radicalement changé notre appréhension et notre perception du bruit. Alors que le silence était une vertu solidement ancrée dans nos sociétés comme un moment d'élévation spirituelle propice à la réflexion - ce qui poussait les moines anachorètes à se murer dans le silence ou les prêtres orthodoxes à pratiquer l'hésychasme - ce temps suspendu est devenu un produit de luxe.
Il convient toutefois de distinguer entre le bruit recherché ou voulu et le bruit subi, qui devient alors une nuisance sonore. Le tumulte des scènes de liesse et des grands rassemblements - culturels et sportifs notamment - peut être directement recherché pour la vitalité et l'effervescence qui en découlent. A contrario, le bruit, lorsqu'il est subi, revêt rapidement les caractéristiques d'une nuisance, dont l'intensité varie en fonction de nombreux facteurs.
À l'occasion de la pandémie de covid-19, en 2020, les populations confinées, l'arrêt de la circulation de masse des véhicules légers, le recul des vols commerciaux et la réduction drastique de circulation des trains ont remis au goût du jour les bienfaits du silence. Désormais, cette recherche du silence perdu se manifeste dans des objets du quotidien : écouteurs et casques à réduction de bruit active ou encore bouchons d'oreilles. Ces outils tentent alors d'atténuer les effets de nuisances sonores devenues omniprésentes et parfois insupportables aux populations.
Ces sons du quotidien, le bruit de la voiture, du passage du train sur les voies de chemin de fer qui jouxtent les habitations, des réacteurs de l'avion qui effectue sa descente dans son couloir aérien, des infrastructures de transports collectifs, ne sont pas anodins.
Les rapporteurs de la mission d'information ont souhaité s'intéresser aux désagréments liés aux transports avec trois priorités :
- ne pas s'en tenir à dresser un état des lieux du bruit causé par ces mobilités, mais aussi faire état des effets des nuisances sonores sur la santé de la population - sujet de préoccupation vive chez les Français ;
- ne pas contribuer à l'inflation normative mais plutôt proposer des pistes de simplification du droit existant et veiller à la bonne application des normes applicables ;
- enfin, ils ont voulu esquisser des pistes d'amélioration pour que ce sujet soit davantage pris en compte dans nos politiques publiques.
A. L'EXPOSITION AU BRUIT, NOTAMMENT NOCTURNE, UNE CAUSE DE BAISSE DE L'ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs de la mission d'information ont été exposés à une difficulté sémantique. Certains acteurs regardent le bruit causé par les transports comme une simple « nuisance » tandis que d'autres retenaient une approche plus maximaliste en estimant que ce bruit peut être considéré comme une véritable « pollution ».
C'est cette dernière approche que vos rapporteurs ont finalement retenue, les incidences du bruit sur la santé humaine et sur l'environnement de manière générale, ont plaidé en faveur d'une telle définition. En conséquence, il convient d'appréhender le bruit causé par les transports comme une « pollution sonore ».
1. Les pollutions sonores : un fardeau pour la santé physique, mentale et le bien-être
a) Une incidence majeure sur la santé des populations exposées
Le bruit peut représenter un double risque pour la santé humaine. D'une part, à partir d'environ 90 décibels, il peut entraîner des lésions auditives. D'autre part, il peut également entraîner des lésions dites « extra-auditives », sur la santé humaine de manière générale, qui sont plus difficiles à mesurer et évaluer. La mission d'information a principalement orienté sa réflexion sur ces lésions extra-auditives.
|
Le bruit causé par les transports se situe en effet généralement dans cette seconde catégorie de lésions. Il atteint rarement des seuils susceptibles de mettre en péril la qualité auditive d'un individu. Les effets sur la santé des bruits environnementaux - parmi lesquels figurent les bruits liés aux transports - sont aujourd'hui largement documentés. |
Source : Bruitparif
Dans un rapport de 2009 intitulé Burden of disease from environnemental noise, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) mettait en évidence plusieurs risques :
- des incidences immédiates telles que des perturbations du sommeil et des gênes quotidiennes ;
- des effets à moyen et long termes comme des troubles de l'attention et même des pathologies comme l'infarctus du myocarde, avec des effets spécifiques sur les enfants, en particulier des troubles de l'apprentissage scolaire.
Les nombreux travaux scientifiques sur ce sujet donnent une vision claire des risques associés aux nuisances sonores sur la santé humaine. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de décembre 2012 distingue les effets physiologiques extra-auditifs des effets psychosociologiques et comportementaux liés au bruit.
Les effets physiologiques sont nombreux :
- une dégradation subjective et objective de la qualité du sommeil. Un répondant au sondage réalisé à la demande de la commission a ainsi déclaré à propos du bruit lié aux transports : « Cela m'empêche de dormir correctement, même les fenêtres fermées. Lors d'une conversation, on ne s'entend plus parler. » ;
- un risque d'hypertension artérielle pouvant favoriser un accident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus du myocarde ou encore la maladie d'Alzheimer ;
- sur-sécrétion d'hormones du stress (cortisol) et un niveau élevé de glucocorticoïdes pouvant nuire au fonctionnement optimal de la mémoire ;
- aggravation de désordres mentaux tels que la dépression ou l'anxiété.
L'OMS a publié en 2018 des Lignes directrices relatives au bruit dans l'environnement dans la Région européenne, qui apportent des recommandations en vue de protéger la santé humaine de l'exposition au bruit, compte tenu des preuves scientifiques des effets du bruit sur la santé et le bien-être des individus. Les recommandations concernant le bruit des transports sont qualifiées par l'OMS de « fortes », ce qui traduit le haut degré de robustesse de la preuve scientifique des effets néfastes du bruit.
Le bruit emporte des effets sanitaires préoccupants sur la santé physique. Ils se conjuguent par ailleurs avec d'autres risques environnementaux, tels que le risque lié à la pollution de l'air, dont l'origine est étroitement liée aux transports.
|
Nuisances sonores et pollutions de l'air : les deux faces d'une même pièce ? La conjugaison des facteurs de risques liés à une coexposition air-bruit constitue un cocktail particulièrement nocif pour la santé humaine. Les victimes des nuisances sonores sont aussi généralement parmi les plus concernées par la pollution de l'air. Si toute la population est susceptible d'être concernée par cette dernière, force est de constater que les zones où le bruit causé par les transports est le plus fort sont aussi les espaces dans lesquels la pollution de l'air est la plus élevée. Ces deux pollutions constituent pour les personnes exposées une véritable double peine. En plus des risques physiologiques associés aux nuisances sonores précédemment évoqués, la pollution de l'air concourt au développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires, au cancer du poumon et à une perte globale d'espérance de vie. Elle est responsable de 7 900 décès prématurés par an en Île-de-France, et près de 40 000 décès prématurés environ sur l'ensemble du territoire hexagonal. |
Des cartes produites par Bruitparif et Airparif en mai 2024 sur la région Île-de-France font état d'une nette superposition entre ces deux risques.
Source : BruitParif
Le bruit causé par les transports sur la santé humaine a également des effets psychologiques liés à la gêne qu'il induit, susceptible d'engendrer une dégradation de la capacité d'apprentissage ou encore des comportements agressifs. Pour l'un des répondants au sondage commandé par la commission, « les nuisances sonores impactent la santé mentale et par extension, la santé au global ».
Les rapporteurs soulignent que les effets psychologiques sont variables d'un individu à un autre et qu'ils sont multifactoriels. Il est donc plus délicat d'agir sur ces paramètres de santé mentale et de les quantifier.
Les effets sur la santé des nuisances sonores peuvent mener à une diminution de l'espérance de vie en bonne santé des populations exposées. Selon une étude de Bruitparif, intitulée Impacts sanitaires du bruit des transports au sein de l'agglomération parisienne, parue en 2019 « rapportées à l'individu, les évaluations réalisées donnent une valeur statistique moyenne de 10,7 mois de vie en bonne santé perdue du fait du bruit cumulé des transports »8(*).
Les risques associés aux bruits causés par les transports sont inégalement répartis sur le territoire à toutes les échelles. Ainsi que l'illustre le graphique ci-après, les disparités intrarégionales et même locales sont fortes et dépendent de la proximité avec de grandes infrastructures de transport.
Carte représentant le cumul du bruit causé par les transports en année d'espérance de vie perdue
Source : Bruitparif
Lecture : Répartition par commune de mois de vie en bonne santé perdus par un individu sur une vie entière en raison du bruit cumulé des transports
Les associations et collectifs entendus par la mission d'information ont fait état des difficultés au quotidien, face à l'omniprésence du bruit causé par les transports. Ainsi, l'association septèmoise pour la réduction des nuisances de l'autoroute (Chutt) a décrit le calvaire quotidien vécu par les riverains de la route et le désarroi des habitants face à l'incapacité de l'État à proposer des solutions structurées, concertées et pertinentes.
Le risque lié au bruit sur le développement de l'enfant est un enjeu de santé publique à part entière, d'autant plus que le développement cognitif d'un individu a lieu essentiellement durant la période de l'enfance.
Effets du bruit causé par les transports sur les enfants
Source : Agence française de sécurité sanitaire environnementale (ex-Anses)
Au regard des effets sanitaires du bruit sur la santé, la mission d'information estime que le bruit causé par les transports doit faire l'objet d'une attention renforcée des pouvoirs publics.
Or, les impacts sanitaires de la pollution sonore sont insuffisamment suivis. L'évolution des effets auditifs et extra-auditifs du bruit à l'échelle de la population est en effet mal connue faute de marqueurs sanitaires suivis par un dispositif de surveillance des impacts sanitaires du bruit. En effet, comme l'a mis en avant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse) dès 2004, « l'évaluation des résultats d'une politique de lutte contre les nuisances sonores passe obligatoirement par la définition et le suivi d'indicateurs. Ces derniers doivent au préalable être définis comme étant représentatifs des objectifs poursuivis en matière de prévention des impacts sanitaires du bruit. Le dispositif de surveillance doit permettre le suivi de ces indicateurs ».
Saisie par la DGPR et la Direction générale de la santé (DGS), l'Anses a réalisé en février 2013 une étude visant à élaborer des indicateurs et des valeurs de référence dans le domaine des risques liés au bruit des transports.
Cependant, l'agence a conclu qu'elle n'était pas en mesure de proposer de tels indicateurs en raison des lacunes dans les connaissances et du caractère multifactoriel des impacts sanitaires du bruit, les études étant encore insuffisantes pour obtenir des courbes dose-effet robustes entre un descripteur de bruit et un impact sanitaire.
L'Agence a, en effet, mis en avant des « lacunes dans les connaissances actuelles » et « la complexité des interactions entre les divers paramètres physiques, physiologiques, humains et cognitifs impliqués dans les relations bruit-santé ».
Une décennie plus tard, les connaissances scientifiques des impacts de bruit sur la santé ont progressé.
Dans ce contexte, il pourrait donc être pertinent de confier à Santé publique France la mission de définir des indicateurs pour suivre à l'échelle de la population les impacts sanitaires du bruit. Une telle mesure permettrait d'ailleurs d'appréhender plus précisément le coût social du bruit et les effets des politiques de lutte contre le bruit.
Proposition n° 1 : Confier à Santé publique France la définition des indicateurs de mesure des impacts sanitaires du bruit et la surveillance de leur évolution.
b) Un enjeu pour les finances sociales et la productivité des individus
Les effets sur la santé des nuisances sonores liés aux transports sont nombreux et largement documentés. En plus de dégrader la santé des individus exposés, les nuisances sonores induisent également des coûts exogènes - économiques et sociaux qui pèsent sur les finances publiques et la productivité des travailleurs.
Une étude de l'Ademe de 2021, sur le « coût social du bruit en France », fait état du coût sanitaire marchand et non marchand du bruit et des coûts non sanitaires du bruit d'une ampleur loin d'être marginale.
Le bruit causé par les transports a d'abord un coût sanitaire marchand dont la charge est essentiellement endossée par la sécurité sociale. L'étude de l'Ademe propose une estimation de ces coûts - dont la certitude doit être relativisée, la relation directe de cause à effet entre le développement d'une pathologie, par exemple cardiovasculaire, ne pouvant être totalement imputée au bruit causé par les transports. Le bruit des transports peut en effet favoriser la survenue de pathologies, sans en être la cause unique.
Ainsi, environ 116 000 personnes souffrent d'une pathologie cardiovasculaire liée au bruit des transports, ce qui représente un coût d'hospitalisation annuel de près de 78 millions d'euros9(*).
Les coûts de médication sont également élevés : la prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques représenterait un coût total estimé à 3,5 millions d'euros pour environ 287 000 personnes s'administrant ces traitements en raison d'une exposition au bruit routier (en supposant un coût moyen de 12 € pour un traitement de huit semaines).
Par ailleurs, le bruit causé par les transports a également un coût sanitaire non marchand dont la quantification est néanmoins plus approximative.
En appliquant une valeur d'une année de vie en bonne santé de 132 000 €, définie pour l'année 2020 par la commission Quinet (Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013), le coût sanitaire des morbidités liées aux transports - comprenant la gêne, l'obésité, les troubles mentaux, les maladies cardiovasculaires, le diabète et le coût des difficultés d'apprentissage - est estimé à environ 82,2 milliards d'euros. S'ajoutent les coûts de la mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires liées aux bruits des transports, représentant environ 9,8 milliards d'euros.
Le Cerema a indiqué à la mission d'information que la révision par l'OMS en 2024 des coefficients d'invalidité liée aux impacts sanitaires du bruit, utilisée par l'étude de l'Ademe en 2021, conduit désormais à réduire l'estimation du coût social établie par l'étude d'environ 35 milliards d'euros par rapport à l'estimation initiale.
Enfin, le bruit causé par les transports emporte des coûts non sanitaires, qui ne sont toutefois pas à sous-estimer.
Le bruit causé par les transports est un facteur de perte de productivité au travail. Un individu qui subit des perturbations de son sommeil risque d'avoir un niveau de fatigue plus élevé et ainsi d'être moins productif dans son activité professionnelle.
Les nuisances causées par les transports peuvent enfin avoir une incidence sur la valorisation patrimoniale d'un bien immobilier.
2. Les pollutions sonores nocturnes : une gêne amplifiée
La gêne ressentie et la gêne réellement occasionnée par le bruit causé par les transports varient, d'une personne à une autre, et selon la durée de la nuisance.
Le bruit soudain, par exemple l'atterrissage d'un avion, le passage du train sur la voie de chemin de fer ou encore l'accélération du véhicule motorisé dépassant les seuils sonores réglementaires, peut ainsi favoriser une perturbation momentanée et particulièrement brève de l'attention la journée, et entraîner un réveil pendant la nuit.
Le bruit de fond, continu, provoqué notamment par le transport routier, peut perturber la qualité de vie tout au long de la journée, par exemple en empêchant l'ouverture de fenêtre, ou en nuisant à la qualité de l'attention et de la concentration.
Le bruit nocturne est davantage nocif, et ce dès des niveaux d'exposition relativement plus faibles que le bruit diurne10(*). Une étude de Santé publique France publiée en décembre 202411(*), effectuée sur la métropole de Lille estime que si les préconisations de l'OMS en matière d'exposition au bruit étaient suivies, le niveau de bruit généré conduirait à diminuer le nombre de personnes effectivement exposées aux pollutions sonores nocturnes de 7 %.
Selon cette étude, si toutes les communes de la métropole de Lille respectaient les recommandations de l'OMS sur le bruit routier la nuit (45 dB Lnight), cela permettrait à plus de 11 600 habitants d'avoir moins de fortes perturbations du sommeil. Si les niveaux de bruit routier sur 24 heures respectaient la valeur recommandée par l'OMS sur tout le territoire de la métropole de Lille (53 dB Lden), 85 nouvelles hospitalisations pour cardiopathies ischémiques seraient évitées chaque année, ce qui représente 6 % des nouvelles hospitalisations pour ce motif de la métropole de Lille. De même, près de 8 décès dus à cette pathologie seraient évités chaque année dans cette seule zone géographique.
L'OMS préconise de limiter les bruits causés par les transports sur une plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, permettant au mieux 8 heures de sommeil de qualité.
Un sondage réalisé auprès de 2 000 Français par la mission d'information montre que parmi ceux qui estiment subir des nuisances sonores liées au transport routier, 61 % estiment que la priorité des mesures visant à lutter contre le bruit devrait se concentrer sur la période nocturne.
L'ensemble des acteurs entendus par la mission d'information ont en effet insisté sur les nuisances sonores nocturnes, estimant que la réglementation et les mesures mises en oeuvre pour lutter contre le bruit causé par les transports devaient tenir compte des horaires du coucher, période durant laquelle la gêne ressentie est démultipliée.
3. Les pollutions sonores : une préoccupation majeure des Français
La mission d'information a souhaité mesurer le pouls de la population sur cette pollution générée par les nuisances sonores liées aux transports. Elle a mandaté l'institut CSA pour réaliser une enquête, conduite du 7 au 16 avril 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus. Aucun sondage en la matière de cette envergure n'avait été mené depuis plus de 10 ans12(*), si bien que le rapport des Français à cette problématique était jusqu'alors mal connu.
Les résultats de l'enquête ont été présentés à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable le 30 avril 2025. Ils révèlent que le bruit causé par les transports constitue un enjeu majeur pour les Français.
Ainsi, pour 71 % des sondés les nuisances sonores sont un sujet de préoccupation. Pour 27 % des sondés, le bruit est le premier élément qui perturbe leur quotidien, devant la saleté et les déchets dans l'espace public, mais aussi les pollutions de l'air, des sols et de l'eau. Cette approche doit toutefois être nuancée en fonction de deux facteurs : l'âge et le lieu de vie.
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
Pour les moins de 35 ans, les nuisances sonores arrivent derrière la présence de déchets et la pollution de l'air. En revanche, pour la tranche d'âge des 35 à 49 ans, les nuisances sonores sont les premières préoccupations quotidiennes des Français. La gêne ressentie par les populations dépend ainsi d'un facteur générationnel.
Le lieu de vie est également un facteur important de l'appréhension du bruit. Dans les petites communes de moins de 2 000 habitants, les habitants sondés évoquent en priorité la nuisance causée par la présence de déchets dans l'espace public. En revanche, plus les concernés vivent dans des espaces urbanisés - dans des villes de plus de 100 000 habitants - et a fortiori dans de grandes agglomérations comme Paris, plus les nuisances sonores se situent en haut du classement des nuisances.
Loin d'être anodines, les nuisances causées par les transports concernent près d'un français sur deux. Le bruit causé par le transport routier est le premier pourvoyeur de nuisances.
Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information
* 1 Sondage réalisé par l'institut de sondage CSA.
* 2 Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes
* 3 Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
* 4 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
* 5 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
* 6 Sur le réseau routier national non-concédé, l'État a apporté 6,5 M€ de financements en 2023-2024, à comparer avec une enveloppe de 78 M€ débloquée entre 2015 et 2022 dans le cadre de la part État des CPER, auxquels s'ajoutaient des financements de l'Ademe (30 M€ entre 2009 et 2021).
* 7 Au laboratoire national de métrologie et d'essais
* 8 Étude Bruitparif, février 2019, « Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Île-de-France ».
* 9 En prenant pour base le coût moyen d'une hospitalisation en de cardiologie d'environ 4 209 € en 2018
* 10 L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que des effets sanitaires extra-auditifs indésirables apparaissent dès une exposition à un bruit de 40 décibels la nuit, contre 50-55 décibels en journée.
* 11 Santé Publique France, décembre 2024, « Agir sur les espaces verts, les mobilités actives, la chaleur, la pollution de l'air et le bruit : quels bénéfices pour la santé ? ».