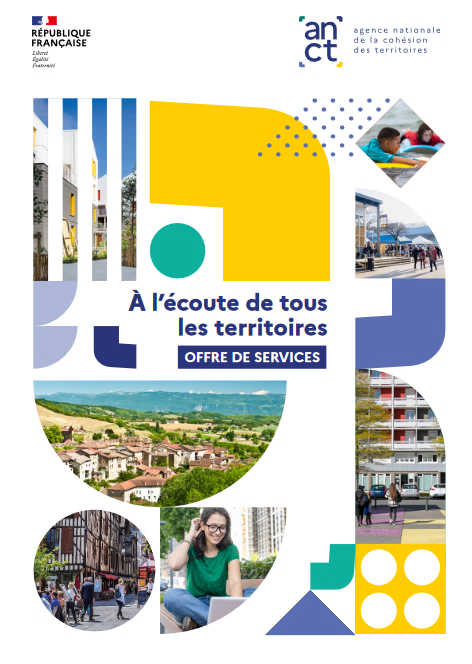AVANT-PROPOS
Le 2 février 2023, la délégation aux
collectivités territoriales a adopté
à l'unanimité le rapport « ANCT : se mettre au
diapason des élus locaux ! »7(*) de Charles
GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains) et
Céline BRULIN, Sénatrice de Seine Maritime (Communiste
Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky).
Ce rapport dressait, du point de vue des élus locaux, un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), trois ans après sa mise en place, sachant que le Sénat a joué un rôle essentiel dans cette création8(*).
Il analysait principalement la manière dont les élus percevaient l'Agence et quelle plus-value cette dernière leur apportait dans l'exercice quotidien de leur mission.
Ce rapport avançait 14 recommandations pour renforcer la proximité de l'Agence avec les élus locaux et améliorer son action.
Environ un an et demi plus tard, la délégation a souhaité faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans ce rapport.
Elle a donc confié à Sonia de LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados (Union Centriste) et Céline BRULIN (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) la mission de suivre leur mise en oeuvre.
Cette démarche s'inscrit dans le
renforcement du contrôle parlementaire et tout
particulièrement dans les mesures
« GRUNY » détaillées
dans l'encadré ci-dessous.
Le renforcement du contrôle parlementaire
À l'initiative du Président Gérard LARCHER, le Sénat a lancé, au printemps 2021, une mission de réflexion sur le contrôle sénatorial.
À l'issue d'une large consultation menée avec les présidents de groupe, de commission et de délégation, Madame Pascale GRUNY, rapporteur et vice-président du Sénat, a présenté onze propositions qui s'articulent autour de six objectifs, pour améliorer l'efficacité du contrôle de l'action du Gouvernement. Elles ont été mises en oeuvre dès le début de l'année 2022.
Les 6 objectifs pour renforcer la lisibilité des travaux du Sénat et le contrôle parlementaire sont :
- clarifier les modes de contrôle : utiliser une nomenclature homogène pour les travaux de contrôle, commune à toutes les instances du Sénat ;
- mieux cibler les priorités du contrôle sénatorial : centrer le programme de contrôle des commissions permanentes et des délégations sur 3 à 4 thèmes prioritaires par instance, de manière à se laisser une marge de manoeuvre pour déclencher des missions « flash », et veiller au pluralisme politique et à la bonne organisation de l'agenda sénatorial ;
- renforcer la coordination entre les différentes instances : organiser une concertation en amont de la Conférence des Présidents, poursuivre ces efforts de coordination tout au long de l'année, et, pour les commissions, il s'agira de davantage solliciter les délégations et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), dans une logique de complémentarité, non de concurrence ;
- densifier les travaux de contrôle en mobilisant toute la palette des outils disponibles : déclencher des missions « flash » tout au long de l'année pour être plus réactifs face à l'actualité, établir avant chaque mission de contrôle une feuille de route, mobiliser les ressources disponibles pour mener les travaux de contrôle, solliciter les prérogatives de commission d'enquête pour renforcer l'information dont dispose le Parlement et évaluer l'application des lois, sur le plan quantitatif et qualitatif ;
- assurer le suivi des propositions du Sénat pour garantir leur bonne mise en oeuvre, ce qui implique les actions suivantes :
ü harmoniser les règles d'adoption des propositions et des rapports de contrôle : pour éclairer le vote, les membres de la commission, de la délégation ou de l'instance temporaire ont accès aux propositions du rapporteur avant l'adoption du rapport ;
ü privilégier les propositions opérationnelles, quitte à en réduire le nombre, pour garantir leur efficacité et faciliter leur mise en oeuvre ;
ü assurer la mise en oeuvre du volet parlementaire des propositions en rédigeant, si nécessaire, une proposition de loi, des amendements ou une proposition de résolution ;
ü présenter les propositions de façon harmonisée dans le tableau de mise en oeuvre et de suivi (TMiS) ;
ü mettre en place un « droit de suite » du rapporteur pour qu'il puisse suivre le degré de mise en oeuvre de ses propositions ;
ü procéder, au niveau des commissions et délégations, à un bilan annuel de la mise en oeuvre de leurs propositions.
- mieux communiquer sur les travaux de contrôle du Sénat : élaborer une stratégie de communication pour faire « vivre » la mission de contrôle tout au long des travaux, en respectant le pluralisme politique, renforcer la communication en ligne, en lien avec la stratégie numérique du Sénat et la refonte du site Internet et assurer la visibilité territoriale des travaux du Sénat.
Source : Sénat9(*)
Les rapporteures ont donc adressé plusieurs questionnaires aux différents organismes concernés par les recommandations, au premier rang desquels la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et l'ANCT.
Le 23 mai 2024, les rapporteures ont également été à l'initiative de l'organisation d'une table ronde en séance plénière de la délégation sur la mise en oeuvre des recommandations qui a donné lieu à un rapport d'étape10(*).
Enfin, à l'issue de cette table ronde, d'autres échanges sont intervenus avec l'Agence sur la base de questionnaires complémentaires.
Il convient de noter que le rapport initial avait été adopté au moment où l'Agence changeait de gouvernance, avec les arrivées de :
- Christophe BOUILLON élu le 13 décembre
2022 à la présidence de l'ANCT par les membres du conseil
d'administration. Il est maire de
Barentin (76) et président de
l'Association des petites villes de France (APVF) ;
- Stanislas BOURRON nommé le 5 décembre 2022 directeur général de l'ANCT. Il était depuis 2016, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur.
Les rapporteures se sont donc attachées à évaluer la façon dont l'Agence a oeuvré pour tenter de réduire son déficit de notoriété et rendre accessibles ses dispositifs et offres de services à tous les niveaux de collectivité (partie I) et l'appui que fournit l'Agence aux collectivités en matière d'ingénierie (partie II).
I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES
Le rapport avait mis en évidence que, si l'Agence était bien identifiée et appréciée de ses bénéficiaires, elle restait inconnue pour une part importante des élus.
À titre d'exemple, lors d'une consultation des
élus locaux sur la plateforme du Sénat, à la question
« connaissez-vous l'ANCT ? » plus de la moitié des
élus (52 %) répondaient par la négative, tandis que
les trois quarts des répondants (74 %) reconnaissaient ne pas avoir
fait appel à ses
services. Ce déficit de
notoriété, confirmé par les auditions et
déplacements, ainsi que par les associations d'élus, ne
permettait pas à l'Agence d'être
identifiée par les interlocuteurs
intéressés. Son image semblait floue et générait
une impression d'éloignement du terrain. Ces éléments
contribuaient à rendre plus difficile la compréhension, par des
élus locaux, de son fonctionnement et de son offre de services.
Le rapport avait également pointé l'investissement à géométrie variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence. Certains acteurs locaux interrogés avaient regretté un réel déficit d'incarnation de l'ANCT par certains préfets et/ou certains services déconcentrés. En effet, certains représentants de l'État s'étaient contentés de présenter l'Agence au moment de sa création, comme un exercice imposé, sans plus investir le sujet.
Rappel des recommandations relatives à cette thématique
Faire connaître l'Agence et ses offres :
- échanger en direct avec les élus locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat national État/territoires (recommandation n° 1.a) ;
- élaborer une feuille de route stratégique 2023-2026 de l'ANCT (recommandation n° 1.b) ;
- privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus (recommandation n° 5) ;
- mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux par les élus locaux et mener des évaluations externes des dispositifs (recommandation n° 14).
Remobiliser les préfets et leur fournir un appui :
- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n° 2.b) ;
- doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT (recommandation n° 3).
Source : Recommandations du rapport du Sénat, « ANCT : se mettre au diapason des élus
locaux ! » rappelées en avant-propos de ce rapport.
A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX
Le rapport11(*) du Sénat publié en février 2023, comme l'enquête de la Cour des comptes12(*) de février 2024, ou encore le rapport d'information13(*) de Bernard DELCROS au nom de la commission des finances pour donner suite à l'enquête de la Cour des comptes, rappellent le défaut de visibilité de l'Agence à l'échelle locale.
Ils notent également les progrès réalisés en la matière.
Ainsi le rapport de Bernard DELCROS constate-t-il que « la démarche visant à améliorer localement l'identification de l'ANCT est aujourd'hui engagée, même si sa démarche de communication doit encore être consolidée »14(*).
« Depuis un an, nous avons multiplié les leviers pour favoriser la proximité » confirmait Stanislas BOURRON lors de son audition au Sénat15(*) le 30 avril 2024.
L'Agence a effectivement accentué son effort de proximité (1) même si ses offres bénéficient à un nombre limité de collectivités et peinent à atteindre les petites communes (2).
1. La nouvelle gouvernance de l'Agence a accentué son effort de proximité et clarifié sa feuille de route
a) Une feuille de route clarifiée et engagée
L'Agence a adopté en conseil
d'administration à l'unanimité, le
29 juin
2023, une nouvelle feuille de route (disponible en annexe 1)
structurée autour de trois grands axes :
- la mise en place d'une méthode renouvelée afin de rendre l'Agence plus proche du terrain ;
- le renforcement de l'accompagnement sur mesure, incluant une dimension forte d'accompagnement des territoires vers leur transition écologique ;
- le renforcement de l'implantation de l'ANCT, dans une démarche de consolidation de la relation de proximité avec l'État territorial et du rôle du conseil d'administration en matière d'instance de dialogue.
Ce document, qui énonce des objectifs stratégiques clairs et les décline opérationnellement est plus conforme à l'esprit d'une feuille de route que celui qui existait précédemment. Tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, cette feuille de route semble faire écho aux recommandations du Sénat.
b) Un effort de proximité multiforme
Suite aux demandes des rapporteures, l'ANCT a fait état de plusieurs de ses initiatives visant à se rapprocher des élus locaux. Comme mentionné précédemment, la feuille de route de l'Agence fait très largement écho à cette « préoccupation de proximité » exprimée par le Sénat.
Pour fêter ses trois ans d'existence, l'ANCT a organisé le 23 mai 2023, au Palais des congrès de Paris, « l'ANCTour ». Ce premier événement national avait vocation à donner aux visiteurs, en particulier aux élus locaux, une vision globale de ce que l'Agence peut leur proposer, à travers ses programmes, dispositifs et modes d'accompagnement.
L'Agence signale aux rapporteures que « l'ANCTour a été un succès : il a réuni plus de 4 000 participants dont 5 ministres parmi les acteurs du développement des territoires (élus locaux et nationaux, chefs de projets de territoire, chargés de développement économique, professionnels de l'aménagement du territoire, urbanistes, opérateurs et services de l'État, associations de proximité ou têtes de réseau, étudiants, chercheurs) engageant pleinement la volonté de l'ANCT "d'aller vers" (...). En plus de renforcer la notoriété de l'Agence, cet événement a permis des temps d'échanges, comme des temps de partage d'expérience, avec les élus sur nos accompagnements en ingénierie. Il a aussi pu répondre à un enjeu stratégique essentiel de l'organisation, qui était la fédération en interne des équipes, transcendant l'organisation par services ou programmes »16(*).
L'événement a été reconduit dans la région Occitanie, à Toulouse, le 11 juin 2024. L'espace forum était organisé en 6 villages thématiques, intégrant une nouvelle fois des espaces d'agora permettant le partage d'expériences des élus et acteurs locaux, des tables rondes en prise directe avec les actualités d'ingénierie, de la transition écologique, du numérique, de l'aménagement...
En complément, le président et le directeur général de l'ANCT ont multiplié les échanges directs avec plus de 60 déplacements réalisés dans les territoires avant l'été 2024. Certains de ces déplacements ont particulièrement visé les territoires où les marges de progression de l'Agence semblaient les plus importantes.
L'Agence signale, en réponse aux rapporteures, que « ces déplacements qui ont lieu à la demande d'élus, de préfets - à l'occasion de CLCT, d'assemblée générale des maires, d'inaugurations - ont permis de constater :
- la dynamique présente sur le terrain dans tous les programmes portés par l'Agence ("Action coeur de ville", "Petites villes de demain", "territoires d'industrie", "France service", "politique de la ville", "tiers lieux"...) avec une forte mobilisation et satisfaction des élus et acteurs locaux ;
- la connaissance croissante de l'Agence au-delà de ses programmes, renforcée par l'impact de "Villages d'avenir" et un accueil très favorable pour l'accompagnement sur mesure ;
- le rôle d'ensemblier de l'Agence, la transversalité de nos actions à travers l'ensemble de nos programmes et aussi l'amplification de l'action de l'ANCT dans les territoires visités via la mobilisation des équipes locales. Parfois aussi, ces déplacements permettent de mieux comprendre les difficultés locales pour s'emparer de certains outils d'ingénierie et les freins existants »17(*).
Par ailleurs, le Président et/ou le directeur général de l'Agence sont systématiquement présents au congrès des dix associations nationales d'élus et participent à des congrès départementaux.
Au niveau local, les CLCT, qui se réunissent au moins deux fois par an, constituent ainsi le cadre privilégié pour ces temps d'échanges déconcentrés. Les CLCT permettent, entre autres, d'orienter les travaux de l'Agence dans le département, d'identifier, de mobiliser et de coordonner les ressources en ingénierie ainsi que de communiquer sur l'action de l'ANCT.
De plus, de nombreux forums locaux d'ingénierie se sont tenus à l'initiative des délégués territoriaux de l'Agence. Lors de la table ronde organisée par la délégation le 23 mai 2024, le président de l'ANCT a déclaré avoir recensé 74 forums locaux d'ingénierie.
Enfin, la mesure de la satisfaction des élus locaux passe aussi par la qualité de l'évaluation des programmes et des dispositifs par ces derniers. Il convient de souligner qu'outre la « filature bienveillante mais exigeante » du Sénat, l'Agence fait l'objet de plusieurs travaux évaluatifs internes et externes. L'annexe 2 met en évidence que les programmes de l'ANCT sont largement évalués. En ce sens, la recommandation n° 14 du rapport du Sénat semble plutôt bien suivie.
c) Une communication en cours de refonte pour être tournée vers les besoins des demandeurs
Stanislas BOURRON déclarait lors de son audition au Sénat18(*) avoir « opéré une refonte complète de nos outils de communication, afin de rendre l'offre de l'Agence plus simple et plus synthétique ».
L'Agence a diffusé un kit de communication aux préfets, suivi d'un webinaire de présentation de l'Agence et de rappel de ses missions et dispositifs.
L'Agence diffuse, depuis janvier 2024, une « newsletter ANCTerritorial ». Il s'agit d'un courriel qui reprend les actualités de l'Agence et l'agenda du mois en cours. Cette newsletter est envoyée à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints et permet de faciliter la circulation des informations.
Depuis avril 2024, l'ANCT mobilise un outil (Canva) qui permet d'avoir accès à un kit de communication complet, comprenant les supports existants de l'ANCT : kakémono par préfecture, présentation PowerPoint de l'ANCT et de ses programmes, brochure de l'offre de services, dépliant et poster des offres d'ingénierie des six partenaires, modèles de flyers, cartes de visite personnalisables...
L'Agence fournit une licence professionnelle de cet outil et une formation à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints qui le souhaitent, afin de renforcer l'efficacité de leur communication.
Cet outil fournit également aux préfets un exemple de cartographie de l'ingénierie publique territoriale à adapter selon chaque département (voir ci-dessous).
Source : ANCT
L'Agence a également publié une nouvelle plaquette de ses offres de services.
Brochure de présentation de l'ANCT
Source : ANCT
En complément, le site « solutions d'élus » a été déployé en 2023 et valorise des projets et initiatives reproductibles.
L'ANCT s'est également engagée à faire évoluer, d'ici début 2025, son site Internet en un portail de services centré sur les besoins des utilisateurs (voir encadré ci-dessous). Ce service ambitionne de devenir le point d'entrée privilégié des collectivités vers les différents outils à leur disposition, améliorant ainsi l'accompagnement de leurs projets en cours de déploiement.
« Mon Espace
Collectivité » propose d'appliquer le principe du
« Dites-le nous une fois » où
une information saisie est automatiquement synchronisée auprès
d'autres services d'État, réduisant ainsi le temps administratif
et améliorant la lisibilité de l'offre de services.
« Mon Espace Collectivité » s'inscrira
donc au sein d'un écosystème d'outils déjà à
disposition des collectivités : Aides Territoires, Démarches
Simplifiées, Grist19(*)...
Le projet vise à améliorer l'accessibilité, la cybersécurité, à réduire les coûts et à se conformer au nouveau système de design de l'État pour harmoniser la présence numérique de l'Agence.
« Mon Espace Collectivité » : plateforme tournée vers les attentes des usagers
Conçu par l'Incubateur des territoires de l'ANCT, ce nouvel espace Internet doit faciliter la gestion et l'accompagnement des projets territoriaux par les services de l'État.
Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de l'Agence et de ses délégués territoriaux dans le cadre de la mise en place du guichet unique de l'ingénierie pour les collectivités territoriales.
Fonctionnalités attendues de « Mon Espace Collectivité » :
- agréger plusieurs services existants pour les élus, agents de collectivités et services déconcentrés ;
- faciliter le dialogue entre État et collectivités via un espace de concertation ;
- permettre de suivre l'avancée de la maturation d'un projet en fonction des recommandations ;
- faire le lien avec les aides financières et les aides en ingénierie adéquates, permettant de postuler directement ;
- permettre de visualiser des données socio-démographiques et financières concernant le territoire de l'utilisateur.
« Mon Espace Collectivité » deviendra un outil de pilotage et de suivi permettant, entre autres, le suivi, la valorisation et le développement des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Cette configuration implique une pluralité d'acteurs, faisant de « Mon Espace Collectivité » la plateforme privilégiée pour réaliser ces échanges20(*).
Source : ANCT21(*)
Dans l'attente de cette plateforme de services, les rapporteures constatent qu'une grande partie de ces éléments sont destinés aux délégués territoriaux, à leurs adjoints et aux services déconcentrés. Cette évolution était nécessaire mais elle n'est pas suffisante.
En effet, la recommandation n° 5 du rapport du Sénat relative à la communication visait essentiellement à revoir la communication de l'Agence à l'attention des élus locaux. Si la plaquette de présentation des offres a été remodelée, les rapporteures considèrent qu'il est toujours difficile, pour les élus, de s'y retrouver.
Dans les échanges de travail avec l'Agence, son directeur général a précisé que, pour tenir compte des remarques des Sénatrices, l'Agence préparait, pour la rentrée de septembre / octobre 2024, une brochure courte d'accès à l'information pour des élus qui n'auraient aucune connaissance de l'ANCT.
2. Mais l'offre de l'Agence bénéficie à un nombre réduit de collectivités et peine à atteindre les élus des communes de petite taille
Il convient de se rappeler que la faible notoriété de l'Agence n'est pas surprenante pour un organisme créé il y seulement quatre ans, qui exerce des missions très variées, le tout dans un contexte de crise sanitaire qui n'a pas permis les déplacements sur le terrain.
Malgré des progrès certains, l'Agence peut difficilement élargir son nombre de bénéficiaires et reste difficile à atteindre pour des élus de communes de petite taille.
a) Avec ses moyens actuels, l'Agence peut difficilement élargir ses offres à toutes les collectivités
Les collectivités bénéficiant des programmes de l'ANCT sont globalement satisfaites ou très satisfaites de cette opportunité. Les évaluations des programmes par leurs bénéficiaires, que nous avons précédemment évoquées, sont souvent très positives pour l'Agence.
Cependant, les dispositifs de l'Agence se concentrent sur un nombre réduit de collectivités.
À titre d'exemple, le programme
« Action coeur de ville » (ACV) concerne 244
villes moyennes, le programme « Petites villes de
demain » (PVD) concerne 1 644 territoires regroupant des
communes de moins de
20 000 habitants, et 2 458 communes sont
labélisées « Villages
d'avenir » (VA).
Ce point est souligné avec constance dans
l'ensemble des auditions de l'ANCT au Sénat. À titre
d'exemple, lors de l'audition de l'Agence en avril 202422(*) notre collègue Laurent
SOMON déclarait que « les communes qui ne font pas partie de
ces dispositifs se trouvent souvent pénalisées ».
Notre collègue
Patrice
JOLY a
également pris position en ce sens : « mon
département comporte 45 communes faisant partie de ces dispositifs et
260 communes frustrées ».
Le bilan en matière de prestation
d'ingénierie sur mesure de l'Agence est du même ordre. En
effet, Christophe BOUILLON rappelait, lors de la table ronde de la
délégation du 23 mai 2024 : « depuis 2020,
1 700 collectivités ont été accompagnées,
dont plus de 54 % sont des villes de moins de 3 500 habitants, qui
bénéficient d'une ingénierie prise en charge à
100 % par l'Agence. Nous avons donc, par ce biais, accompagné des
collectivités qui ne relèvent pas des programmes nationaux, mais
qui sont tout de même accompagnées par l'Agence
»23(*).
L'ensemble de ces chiffres, ramenés aux 34 935 communes et 1 254 EPCI recensés par la DGCL, soulignent que le nombre de collectivités soutenues reste modeste, en rapport avec le budget de l'Agence qui représente environ 200 millions d'euros.
Christophe BOUILLON reconnaissait la difficulté à atteindre toutes les collectivités : « Y a-t-il des trous dans la raquette ? J'ai parlé des grands programmes de la première vague : 250 communes "Action coeur de ville", 1 600 communes "Petites villes de demain", 2 500 communes "Villages d'avenir". La ministre a annoncé une nouvelle vague. Mais, effectivement, cela ne couvre pas absolument tout le monde. En revanche, notre capacité d'accompagnement est réelle et peut concerner la totalité des communes, notamment si le dossier est complexe. N'hésitez donc pas à nous solliciter ».24(*)
En adoptant une analyse plus fine, il convient de constater que moyennes et grandes villes sont plutôt bien couvertes par les programmes de l'Agence.
C'est surtout pour les communes rurales que
l'écart est manifeste : s'il existe plus de 30 000 communes
rurales au sens de l'Insee25(*), seulement
2 500 sont
« Villages d'avenir ». L'Agence souligne
cependant que, dans un certain nombre de départements, listés
ci-dessous, 100 % des communes candidates ont été retenues.
Elle signale également que le dispositif reste ouvert et donc que les
communes bénéficiaires ont, par rotation, vocation à se
renouveler.
Liste des départements dont les candidatures au programme « Villages d'avenir » ont toutes été retenues
|
Région |
Département |
Nombre de communes candidates |
Nombre de communes retenues en première vague |
|
PACA |
05 - Hautes-Alpes |
57 |
57 |
|
GRAND EST |
08 - Ardennes |
20 |
20 |
|
PACA |
13 - Bouches-du-Rhône |
17 |
17 |
|
CORSE |
2A - Corse-du-Sud |
25 |
25 |
|
CORSE |
2B - Haute-Corse |
36 |
36 |
|
OCCITANIE |
48 - Lozère |
30 |
30 |
|
OCCITANIE |
66 - Pyrénées-Orientales |
15 |
15 |
|
OCCITANIE |
82 - Tarn-et-Garonne |
40 |
40 |
|
PACA |
83 - Var |
15 |
15 |
|
BFC |
90 - Territoire de Belfort |
25 |
25 |
|
DOM |
971 - Guadeloupe |
4 |
4 |
|
DOM |
972 - Martinique |
5 |
5 |
|
DOM |
973 - Guyane |
6 |
6 |
Source : ANCT
Les rapporteures soulignent tout de même cette limite de l'action de l'État : la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ».
Elles appellent l'Agence à passer de réussites localisées sur quelques territoires à une politique d'aménagement du territoire plus globale.
Ce « passage à l'échelle », qui est aussi un garant d'une meilleure équité territoriale de l'action de l'État, repose probablement sur des moyens budgétaires et humains supplémentaires.
Mais il est probablement aussi possible d'explorer, à moyens constants, quelques autres pistes.
Par exemple, il serait possible que les communes qui ont réussi ces transformations puissent parrainer des collectivités moins avancées (partage des « bonnes pratiques »).
Le site Internet « Solutions d'élus » participe aussi à cette diffusion. Il valorise des projets et initiatives duplicables mais l'appropriation des projets reste probablement difficile pour certaines collectivités.
L'observatoire des territoires, qui est un des services administratifs de l'ANCT peut, sans doute, jouer un rôle, en repérant les projets qui fonctionnent et en favorisant leur capitalisation et le « passage à l'échelle ».
L'Agence a signalé faire évoluer son rôle afin de renforcer le lien entre ses études et son action opérationnelle. À titre d'exemple, l'Observatoire des territoires réalise désormais des revues régionales.
Il s'agit d'un diagnostic du territoire régional et de ses fragilités sur la base de plusieurs indicateurs composites. Ce diagnostic est destiné aux préfets des départements concernés. La superposition de ce diagnostic avec la carte des interventions de l'Agence permet de procéder à des ajustements dans les programmes et politiques publiques de l'ANCT. Cela permet de mettre en évidence des zones géographiques où des fragilités structurelles existent et doivent faire l'objet d'une attention particulière.
L'Agence dispose enfin, de plusieurs outils qui pourraient évoluer pour profiter à plus de collectivités. Par exemple, la plateforme « territoires en commun », dédiée à l'ingénierie de la coopération et de l'engagement citoyen, est ouverte à toutes les collectivités. L'objectif est de faciliter la mise en relation des acteurs, de faire circuler les bonnes pratiques, d'inspirer et d'outiller les collectivités désireuses de développer des politiques territoriales coopératives et démocratiques. À l'inverse, le « Forum des solutions » est une série de rendez-vous thématiques qui sont réservés aux villes du programme ACV. Chaque rendez-vous présente des projets innovants répondant aux problématiques rencontrées par ces villes. Il pourrait être ouvert à des villes qui ne sont pas parties prenantes du programme.
Cette problématique du « passage à l'échelle » interroge aussi la priorité à fixer à l'Agence dans les années à venir.
Certains souhaitent une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps de s'adapter, de conforter ses missions actuelles et de consolider ses réussites. D'autres souhaitent que l'Agence élargisse encore son champ d'action pour faire d'elle l'intermédiaire de référence sur l'ensemble des sujets relatifs à l'aménagement du territoire.
Dans le rapport d'information intitulé «
L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires
» déposé le 14 février 2024,
Bernard DELCROS
plaidait pour la première option.
En effet, cette phase de consolidation pourrait lui permettre de renforcer la transversalité de l'Agence et son action interministérielle afin qu'elle s'impose, bien au-delà de ses compétences et des programmes actuels, comme la structure pilote des questions d'aménagement du territoire. Elle serait la garante de la cohérence des politiques de l'État et porterait une vision et une action globales et transversales.
Il convient, en effet, de rappeler que « l'ANCT
avait dû faire face à une montée en charge très
rapide, à un empilement continu de nouvelles missions sans avoir
été toutes identifiées lors de sa création et sans
que les moyens nécessaires pour les mener à bien aient toujours
été mis à sa disposition au bon
moment ».
Bernard DELCROS insistait d'ailleurs sur la nécessité de
convenir, à l'avenir, lorsqu'une nouvelle mission est confiée
à l'Agence, « d'examiner en amont les moyens
nécessaires pour que cette mission soit menée à bien
».26(*)
Un temps de pause pourrait lui permettre de mieux assoir ses réussites et pouvoir passer à l'échelle sur certains sujets grâce à une intervention interministérielle davantage coordonnée.
Enfin, pour nuancer aussi cette critique relative au « passage à l'échelle », l'Agence soulignait que, sur plusieurs de ses programmes, tel ACV, elle n'a pas particulièrement de demandes de villes qui en seraient exclues et qui souhaiteraient le rejoindre.
Au fil du temps, l'Agence s'est plutôt efforcée d'intégrer dans les programmes les communes volontaires qui s'en donnaient les moyens.
Autre nuance, relative à PVD cette fois-ci : les chargés de projet ont souvent, par leur positionnement, un rayonnement intercommunal qui bénéficie aux autres communes du groupement y compris celles qui ne sont pas strictement PVD.
Enfin, sur l'ingénierie sur
mesure, l'Agence affirme que la
quasi-totalité des demandes
qui lui ont été adressées est traitée et a
reçu une réponse favorable.
b) L'offre de l'Agence peine à atteindre les élus des communes de petite taille
Les rapporteures se félicitent de la volonté de l'Agence d'accroître sa proximité avec les élus locaux. Cependant, comme nombre de leurs collègues, elles mesurent au quotidien que les offres de l'Agence peinent à être connues de tous.
À ce titre, le rapport recommandait l'organisation
de rencontres à l'échelle locale, mobilisant des
élus de toutes strates, sur des projets concrets ayant impliqué
l'Agence. Dans l'esprit des rapporteures, ces échanges pourraient
prendre la forme de réunions déconcentrées hors
préfecture. L'enjeu serait d'évoquer, avec les élus
locaux, le bilan et les perspectives de l'Agence. Ces réunions auraient
le mérite de projeter l'Agence sur le terrain,
de la faire
connaître, de la confronter aux perceptions locales et sans doute de
renforcer la cohésion entre niveau local et national de l'ANCT. Elles
permettraient aussi de recueillir la perception des élus locaux sur
leurs besoins et attentes, ainsi que des suggestions pertinentes pour
l'avenir.
Dans les échanges avec les rapporteures, l'Agence reconnait qu'il est difficile de toucher les 520 000 élus locaux de France. Lors de son audition du 30 avril 2024, Stanislas BOURRON déclarait en ce sens : « certaines communes ne nous connaissent pas, ce qui est normal. Nos déplacements visent à faire connaître les dispositifs que nous portons. Notre objectif n'est pas d'être connus mais de nous assurer que, si un projet mérite d'être accompagné et bute sur une difficulté, nous puissions être utiles »27(*).
À ce sujet, le rôle des associations
locales de maires est important, car il peut constituer un
relai pour mieux faire connaître les offres de l'Agence.
À titre d'exemple, lors de son audition au Sénat, le directeur
général de l'ANCT déclarait sur les financements du
« Fonds Vert » : « à
l'instant où je vous parle, je constate simplement qu'un certain
nombre de communes auraient besoin de nous solliciter, mais ne le font
pas. Nous cherchons donc à nous appuyer
sur les
associations d'élus : " Association des maires de France et
des
présidents d'intercommunalité " (AMF), "
Association des maires ruraux de
France " (AMRF). Je vous invite
également à nous signaler tous les projets
bloqués
»28(*).
L'Agence signale aussi une rencontre très fructueuse avec les directeurs des associations départementales des maires lors de leurs journées professionnelles annuelles. Ils sont un relai très pertinent pour toucher les élus locaux. Cette rencontre a vocation à se reproduire pour échanger et mieux faire connaître les programmes de l'Agence.
Le relai des parlementaires est aussi
recherché par l'Agence.
Ainsi Christophe BOUILLON signalait-il lors
de son audition du
23 mai dernier : « nous menons, en
outre, un travail permanent d'explication en direction des élus. Nous
avons fait le choix, il y a quelques mois, d'envoyer à l'ensemble des
parlementaires un document expliquant l'impact territorial de l'Agence à
travers les différents programmes qu'elle porte, ce qui constitue un bon
début d'information. Je me félicite que des parlementaires
présentent ce document aux élus de leur
territoire »29(*).
Il déclarait également « si vous identifiez, en tant que Sénateurs, des dossiers bloqués, vous pouvez proposer à l'élu concerné de s'adresser au préfet ou au sous-préfet, parce que le chemin existe »30(*).
En effet, sans doute l'élément le plus important pour assurer cet accompagnement, est-il le rôle tenu par le délégué territorial de l'Agence et ses services qui doivent faire le relai entre les besoins du terrain et les dispositifs de l'Agence.
* 7 https://www.senat.fr/rap/r22-313/r22-313.html
* 8 Le
président de la République a annoncé, à l'occasion
de la Conférence nationale des
territoires, organisée au
Sénat le 17 juillet 2017, le principe d'une nouvelle agence pour les
collectivités territoriales. Le groupe Rassemblement démocratique
et social européen (RDSE) a déposé la proposition de loi
portant création d'une Agence nationale de la cohésion des
territoires en s'inscrivant dans la continuité du travail
sénatorial relatif aux enjeux de cohésion des territoires et dans
le droit fil de l'annonce présidentielle. La loi n° 2019-753 du 22
juillet 2019 a porté la création de cette nouvelle agence,
l'ANCT.
* 9 https://www.senat.fr/fileadmin/Seance/Controle/Renforcer_le_controle_parlementaire/Controle_LIGNES-DIRECTRICES.pdf
*
10 Rapport d'information n° 702 (2023-2024) du
25 juin 2024, « 18 mois après le rapport du
Sénat : poursuite d'un dialogue exigeant avec
l'ANCT (rapport d'étape) », de Mmes
Sonia de
LA PROVÔTÉ et Céline BRULIN.
* 11 Op. cit.
* 12 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.
* 13
Rapport d'information intitulé « L'ANCT, une agence à
consolider au service des
territoires » déposé le
14 février 2024.
* 14 Ibid.
* 15 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, disponible sur ce lien : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20240429/devdur.html#toc2
* 16 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 17 Réponses de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 18 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024 à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
* 19 « Grist » est un gestionnaire de données OpenSource. Il permet la saisie et la manipulation collaborative de données et autorise une structuration avancée des données sans recourir à la programmation (NoCode).
* 20 Circulaire N° 6420/SG du 29 septembre 2023 et instruction TRED2410587C du 30 avril 2024.
* 21 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.
* 22 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 23 Table ronde de la délégation aux collectivités territoriales, 23 mai 2024.
* 24 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 25 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5039991?sommaire=5040030
*
26 Rapport d'information intitulé «
L'ANCT, une agence à consolider au service des
territoires
» déposé le 14 février 2024, Bernard DELCROS.
* 27 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.
* 28 Ibid.
* 29 Table ronde de la délégation aux collectivités territoriales, 23 mai 2024.
* 30 Ibid.