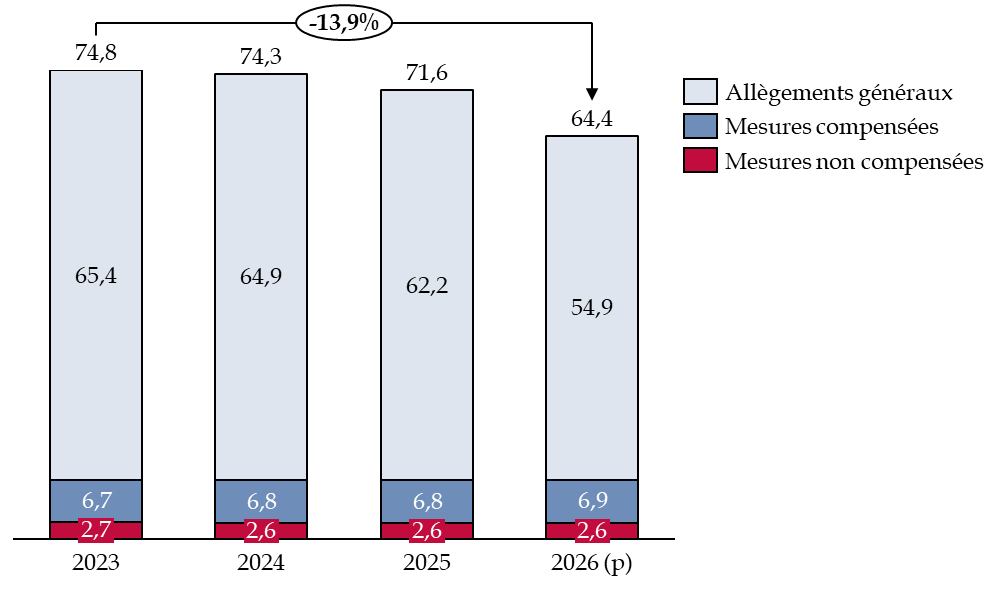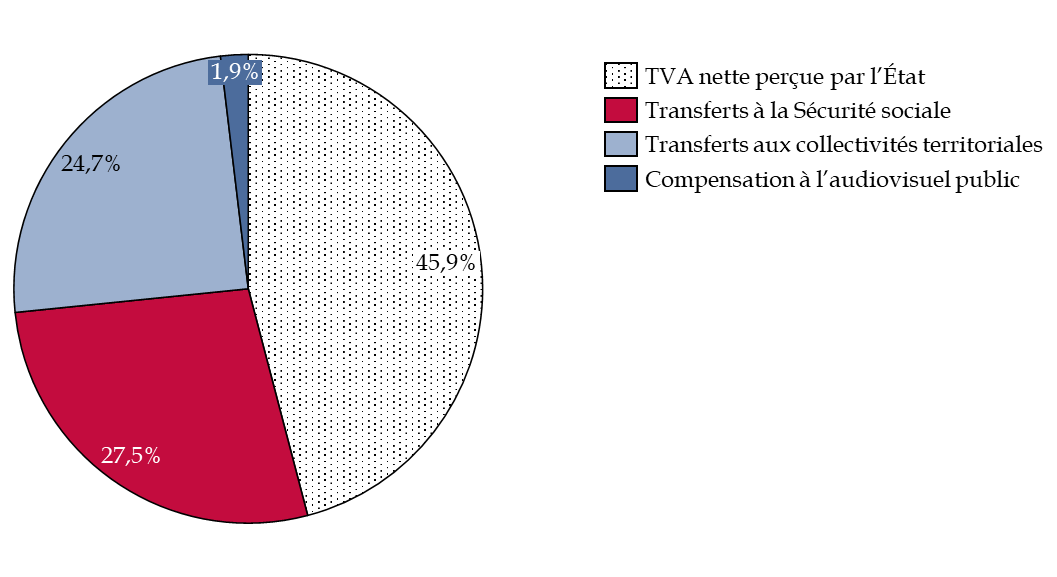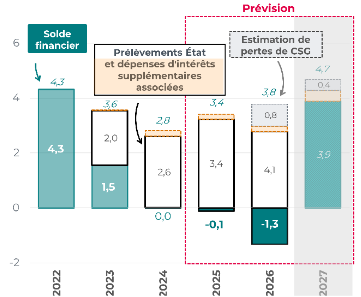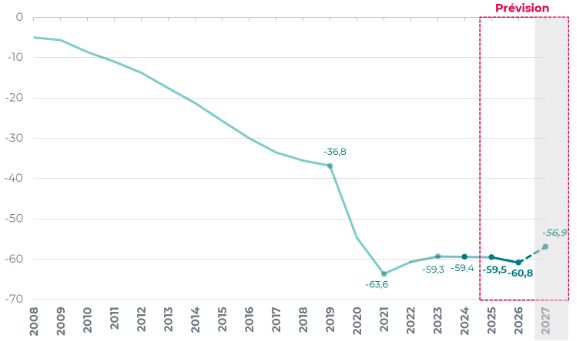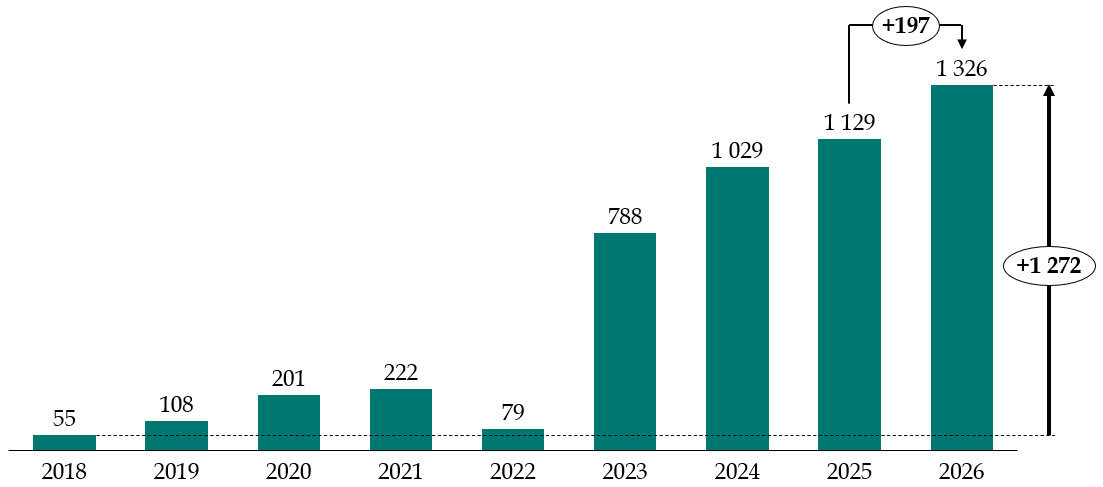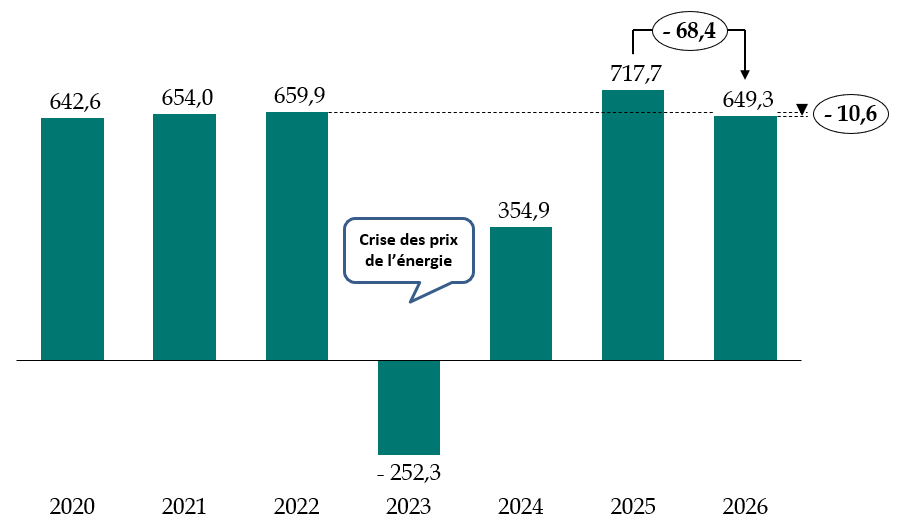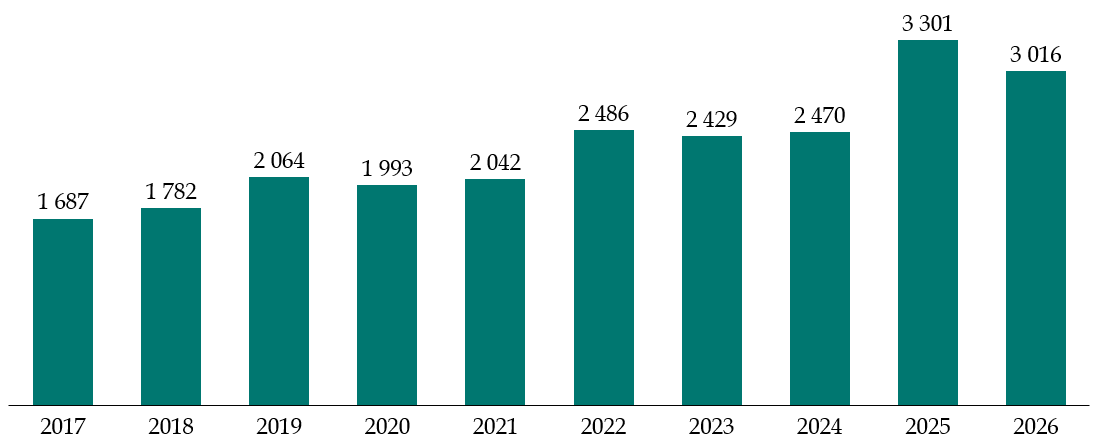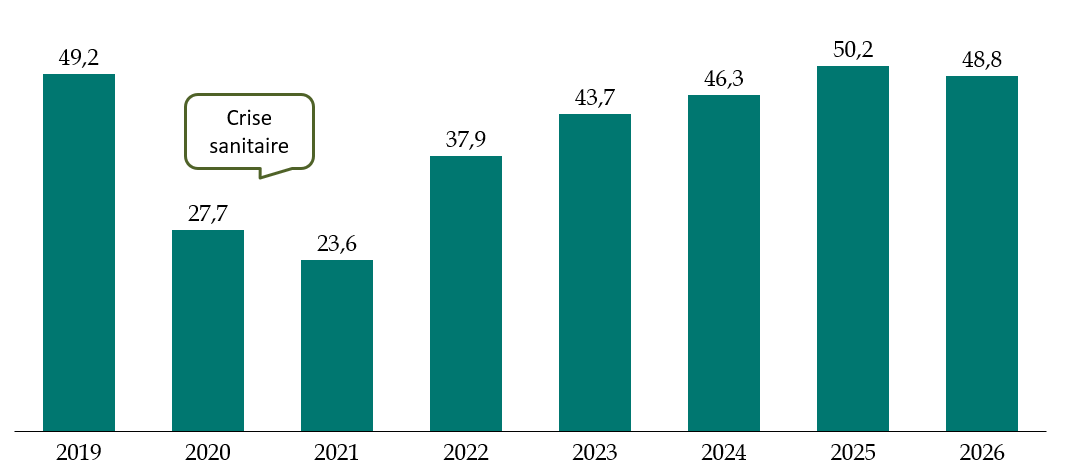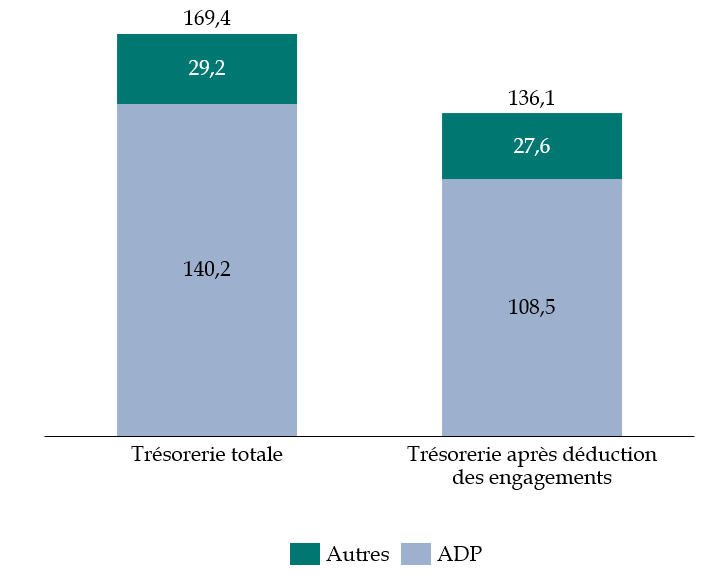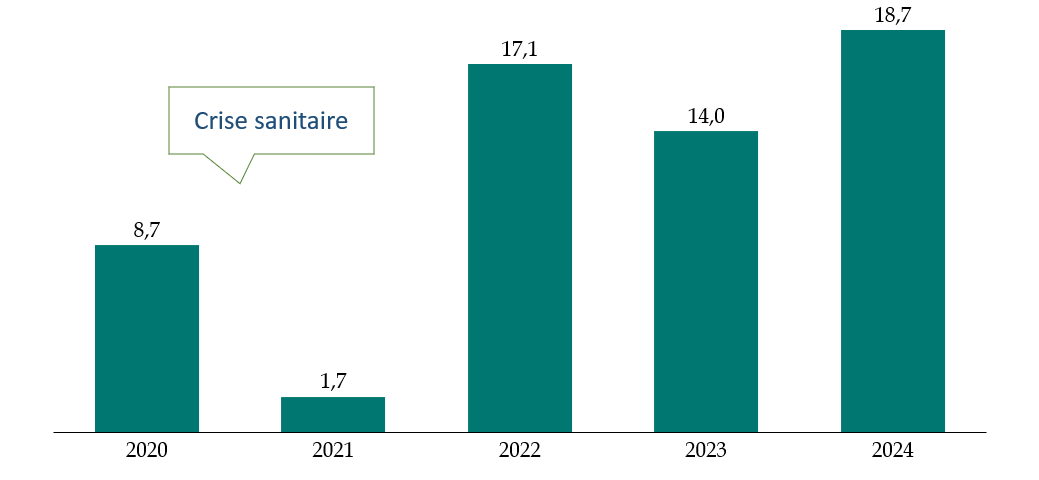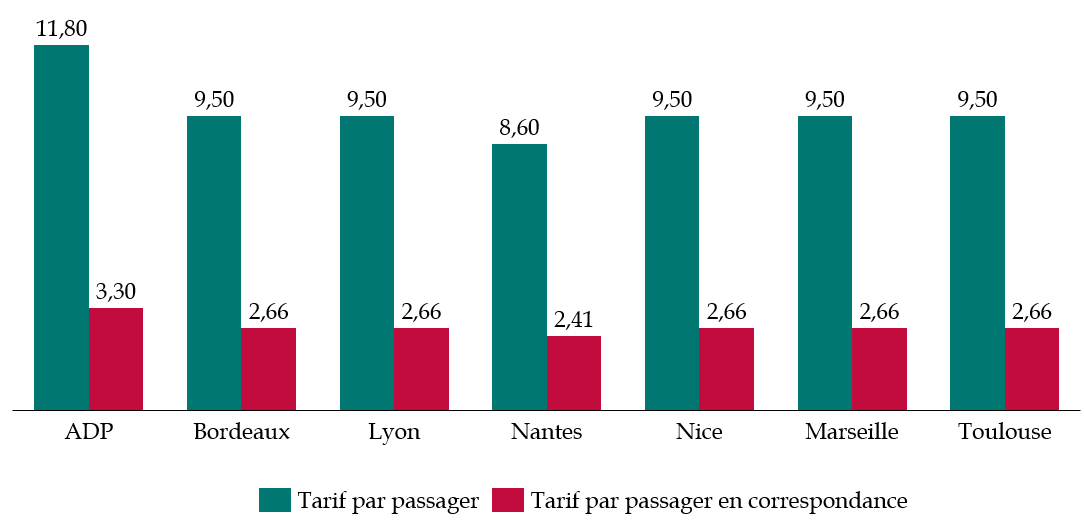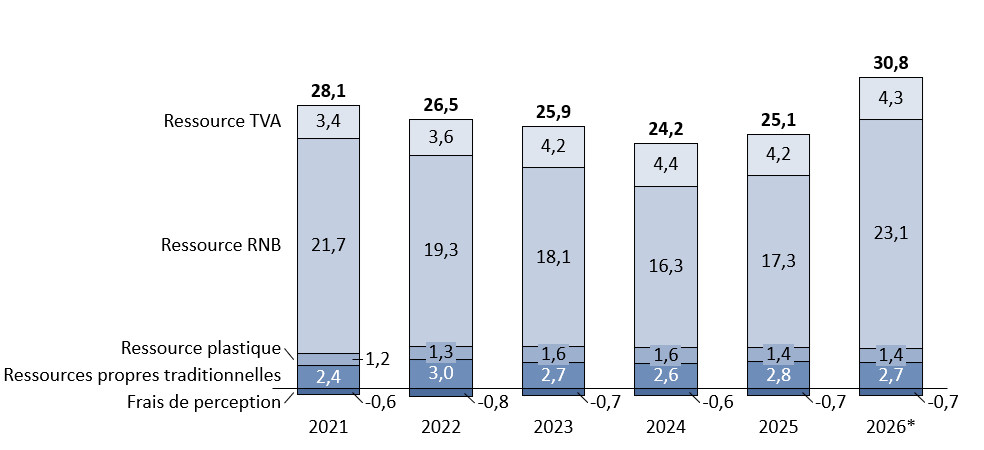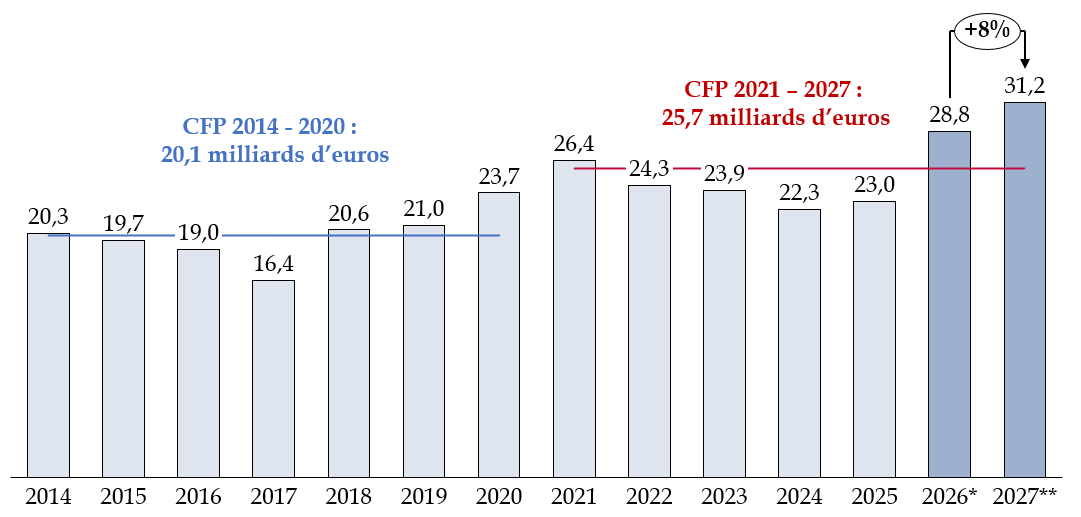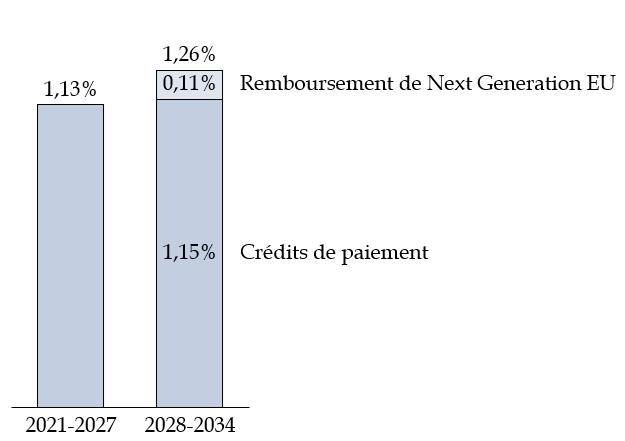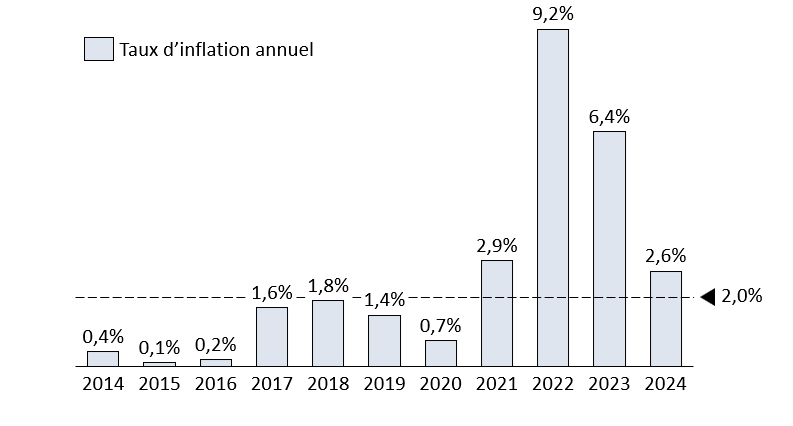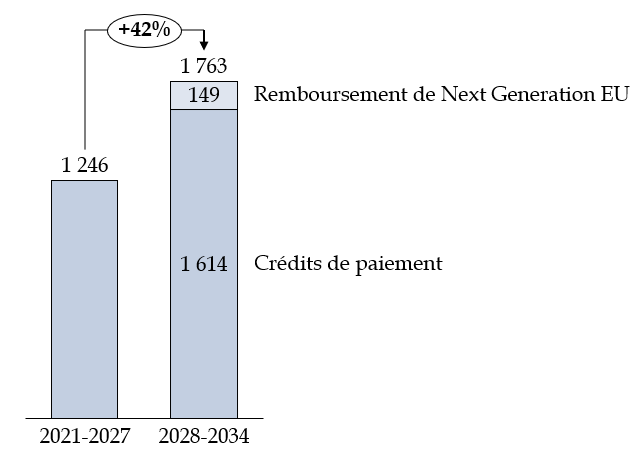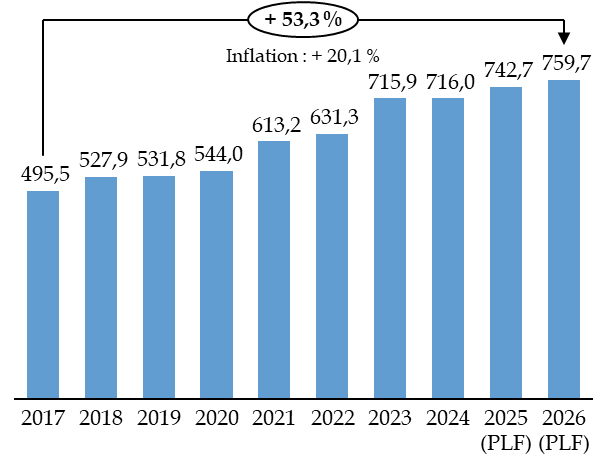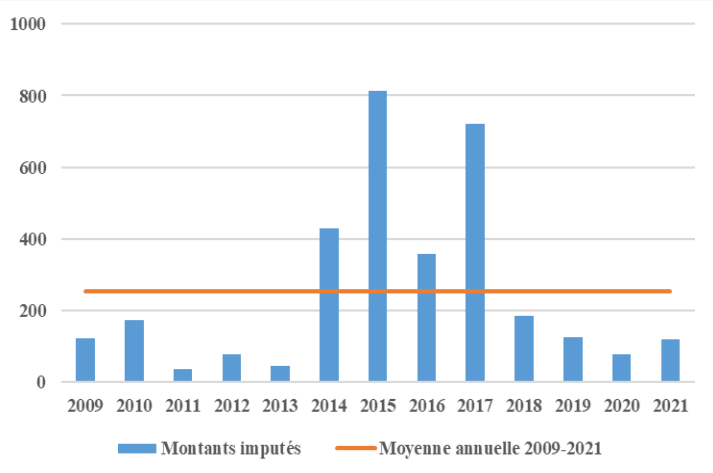D. - Autres dispositions
ARTICLE 40
Relations financières entre l'État et la
sécurité sociale
Le présent article prévoit de baisser l'affectation d'une part de TVA à la sécurité sociale de 1,06 point, soit une perte de 2,288 milliards d'euros pour la sécurité sociale, pour tenir compte de la réforme des allègements généraux des cotisations patronales portée par l'article 18 de la LFSS pour 2025.
Il prévoit également de réaliser un nouveau prélèvement sur les recettes de l'Unédic à hauteur de 4,1 milliards d'euros (+ 750 millions d'euros par rapport à 2025), améliorant d'autant le solde de l'État.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LA TVA COMPENSE AUX ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE LA MAJORITÉ DES MESURES D'ALLÈGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES ET DE TRANSFERT DE CHARGES DÉCIDÉES PAR L'ÉTAT
Comme en témoigne l'annexe au projet de loi de finances qui leur est consacrée961(*), les relations financières entre l'État et les administrations de sécurité sociale comportent de multiples aspects : l'État cotise, alloue des subventions ou affecte de la fiscalité à certains régimes de protection sociale. À l'inverse, il prend en charge des prestations sociales versées par des organismes de sécurité sociale.
L'article relatif aux relations financières entre l'État et la sécurité sociale figurant habituellement dans le projet de loi de finances porte essentiellement, depuis plusieurs années, sur certaines modalités de compensation à la sécurité sociale d'allègements de cotisations sociales ou de charges transférées par l'État.
A. UN PRINCIPE DE COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES SATISFAIT PAR L'AFFECTATION DE RECETTES FISCALES
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi dite « Veil » de 1994 puis modifié en 2004962(*), pose le principe de compensation à la sécurité sociale par l'État des mesures d'allègement de cotisations sociales et de transfert de charges décidées par lui. Ainsi, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions sociales, toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de cotisations ou contributions sociales, tout transfert de charges entre l'État et la sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application.
D'autre part, l'article LO. 111-3-16 du code de la sécurité sociale dispose que seules les lois de financement de la sécurité sociale peuvent déroger à ce principe et créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale non compensées à ces régimes.
Si l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale pose le principe d'une compensation « à l'euro près », une partie des dispositifs d'exonération ou de réduction de cotisations sociale a fait l'objet, à partir de 2006, d'une compensation « pour solde de tout compte », prenant la forme d'une affectation d'un « panier » de ressources fiscales progressivement simplifié et recentré autour d'une fraction de TVA.
Actuellement :
- les mesures générales d'allègement ou de baisse de taux, estimées à 54,9 milliards d'euros en PLFSS pour 2026, sont compensées, « pour solde de tout compte » par l'affectation de recettes fiscales, essentiellement la TVA (branche maladie) et dans une moindre mesure la taxe sur les salaires (branches famille et vieillesse) ;
- les exonérations compensées dites « ciblées », qui représentent 6,9 milliards d'euros en PLFSS 2026, qui portent sur certains publics, certains secteurs économiques ou certains secteurs géographiques, font l'objet d'une compensation budgétaire (principalement par les missions « Travail et emploi » et « Outre-mer ») ;
- certaines exonérations sont « ciblées » et non compensées, pour un montant de 2,6 milliards d'euros en PLFSS 2026, notamment la déduction sur les heures supplémentaires.
Exonérations par nature de cotisations sur
le champ des régimes obligatoires
de Sécurité
sociale
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'annexe 4 du PLFSS pour 2026
B. LA TVA, PRINCIPALE IMPOSITION AFFECTÉE À LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DES TRANSFERTS AVEC L'ÉTAT
La TVA constitue la principale recette fiscale affectée à la sécurité sociale. En 2024, dernière année pour laquelle une exécution complète est disponible, elle abondait de 57,9 milliards d'euros les comptes sociaux : 27,5 % de son produit était ainsi affecté à la sécurité sociale.
Répartition du produit de la TVA entre les différentes administrations publiques en 2024
(en milliards d'euros, en comptabilité budgétaire)
Source : commission des finances du Sénat, d'après le tome 1 des Voies et moyens du PLF pour 2026
Aux termes de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2025, une fraction correspondant à 28,42 % du produit de la TVA est affectée à la sécurité sociale :
- 23,24 points de cette fraction sont affectés à la branche maladie de la sécurité sociale (a du 9° de l'article L. 131-8 du CSS), principalement en compensation de la baisse de cotisations sociales consécutive à la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ;
- les 5,18 points restants sont affectés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), au titre des baisses de cotisations à l'Unédic et aux régimes obligatoires de retraite complémentaire (b du 9° de l'article L. 131-8 du CSS).
Une minoration de 3,35 milliards d'euros a également été appliquée au montant de TVA affecté à la sécurité sociale en loi de finances initiale pour 2025.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE BAISSE DE LA TVA AFFECTÉE EN RAISON DE LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX ET UNE AUGMENTATION DU PRÉLÈVEMENT DE L'ÉTAT SUR LES RECETTES DE L'UNÉDIC
Le présent article prévoit, à compter du 1er février 2026 (II), une diminution de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, passant de 28,42 % à 27,36 % (1° du I). La fraction affectée à la branche maladie diminuerait de 3,98 points (2° du I) et serait portée de 23,24 % à 19,26 %. D'autre part, la fraction affectée à l'Acoss passerait de 5,18 % à 8,10 %, mais se verrait retrancher de 4,1 milliards d'euros en 2026 (3° du I).
A. UNE DIMINUTION DE LA FRACTION DE TVA AFFECTÉE À LA SÉCURITÉ SOCIALE, EN RÉPERCUSSION DE LA BAISSE DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX
1. Une baisse de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale en raison de la réforme des allègements généraux portée par la LFSS pour 2025
La baisse de la part du produit de TVA affectée à la sécurité sociale liée à la réforme des allègements généraux en 2026 par rapport à 2025 correspond à une perte de 3,038 milliards d'euros pour la sécurité sociale, dont 750 millions d'euros au titre du prélèvement de l'État sur les recettes de l'Unédic (en plus des montants déjà prélevés par l'État au titre des exercices précédents).
La réforme des allègements généraux est portée par l'article 18 de la LFSS963(*) pour 2025, qui prévoit :
- une réforme paramétrique pour 2025, en diminuant le montant maximal d'exonération de la réduction générale de 2 points. En outre, les points de sortie des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales seront respectivement ramenés à 2,2 et 3,2 SMIC (contre 2,5 et 3,5 SMIC) ;
- une réforme structurelle pour 2026, dont l'objectif est de créer un dispositif unique de réduction générale dégressive des cotisations sociales, remplaçant la réduction générale dégressive et les réductions proportionnelles des taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations applicables. La réduction générale dégressive unique s'appliquera à l'ensemble des salaires de montant inférieur à 3 SMIC, avec un seuil minimal d'exonération de 2 % et un niveau moyen d'exonération réduit entre 1 et 3 SMIC.
Une économie globale de 3,1 milliards d'euros, nets de l'effet « retour » sur l'impôt sur les sociétés, est attendue pour l'année 2026 au titre de la réforme des allègements généraux. Ces gains attendus sont attribués à l'État par une diminution de la fraction de TVA attribuée à la Sécurité sociale de 1,06 point.
En raison de la suppression des deux réductions qui étaient ciblées sur les cotisations des branches maladie et famille, la réforme des allègements généraux a des effets différenciés selon la branche. Elle entraine une hausse des recettes de la branche maladie (+ 9,4 milliards d'euros) et de la branche famille (+ 3,9 milliards d'euros), tandis que la branche vieillesse subirait une perte (- 6,2 milliards d'euros). Au total, les régimes de base verraient en effet les exonérations imputées sur leurs recettes diminuer de 6,8 milliards d'euros, au détriment des autres affectataires (AGIRC-ARRCO, UNEDIC et fonds national d'action logement). En conséquence, une fraction de 2,92 points de TVA jusque-là affectée à la CNAM est attribuée à l'ACOSS pour compenser le reversement à l'AGIRC-ARRCO et l'UNEDIC des cotisations recalculées sans prendre en compte l'exonération, à hauteur de 6,7 milliards d'euros.
De plus, deux mesures de transfert sont intégrées dans le calcul de la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale :
- un abondement de 210 millions d'euros est prévu au titre des effets de la réforme des exonérations ciblées prévue à l'article 9 du PLFSS pour 2026, notamment des exonérations issues de la loi964(*) de 2009 d'orientation pour le développement économique des outre-mer (dispositif LODEOM) et de l'exonération d'aide à la création et la reprise d'entreprise, sur la réduction générale dégressive unique ;
- une reprise de 200 millions d'euros, au titre de la restitution d'impôts sur les sociétés de la mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux, prévue par l'article 8 du PLFSS pour 2026.
2. L'affectation à la Sécurité sociale des gains attendus de la suppression de l'exonération fiscale des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif d'affection longue durée
L'article 6 du PLF pour 2026 prévoit la suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu sur les indemnités journalières perçues par les bénéficiaires d'un dispositif d'affection longue durée.
Près de 739 millions d'euros sont reversés à la Sécurité sociale à ce titre.
3. La poursuite de la compensation des gains de la réforme des retraites de 2023 au titre de la fonction publique d'État
D'autres mesures ont pour effet d'augmenter de 61,5 millions d'euros la fraction de TVA affectée à la Sécurité sociale.
Un abondement de 70 millions d'euros est prévu au titre du transfert des gains liés à la réforme des retraites sur le CAS « Pensions ».
En effet, la loi965(*) de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites a porté l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans et a accéléré le relèvement de la durée de cotisation à 43 annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Ces modifications auront pour effet, en 2026, d'améliorer le solde du compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions » à hauteur de 333 millions d'euros sous l'effet d'un surcroît de cotisations et de moindres dépenses de pensions. L'article 163 de la loi966(*) de finances pour 2024 prévoyait un premier transfert de 194 millions d'euros à ce titre à la sécurité sociale. L'article 131 de la loi de finances pour 2025 prévoyait un montant supplémentaire de 70 millions d'euros transférés à ce titre la Sécurité sociale. Pour 2026, 69 millions d'euros sont transférés par le présent article, afin que l'intégralité de ces gains contribue au retour à l'équilibre de l'ensemble du système de retraites. La suspension de la réforme des retraites, envisagée à l'article 45 bis du PLFSS pour 2026, aurait toutefois des conséquences qui restent à déterminer et, le cas échéant, à prendre en compte dans le présent article, sur l'évaluation du montant transféré à la Sécurité sociale.
Par ailleurs, une reprise de 8,5 millions d'euros est effectuée au titre de la reprise des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé, qui proviennent du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux ».
B. APRÈS 2024 ET 2025, UN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'UNÉDIC PRÉVU POUR 2026
Les réformes de l'Assurance chômage entre 2019 et 2021, combinées à une orientation favorable du marché de l'emploi, avaient permis à l'Unédic de retrouver un excédent. Alors qu'elle était déficitaire en 2019 (- 1,9 milliard d'euros), son solde est redevenu excédentaire, s'établissant à + 4,3 milliards d'euros en 2022 et à + 1,5 milliard d'euros en 2023. La dette l'Unédic a ainsi diminué légèrement pour atteindre 59,4 milliards d'euros fin 2024.
Cette amélioration de la situation financière du régime d'assurance chômage a incité le Gouvernement à opérer des reprises d'excédents de l'Unédic sur la fraction de TVA affectée à l'Acoss, dont les montants se sont établis à 2,6 milliards d'euros en 2024 et 3,35 milliards d'euros en 2025967(*).
Malgré une dégradation significative de la situation financière de l'Unédic en 2025 et 2026 (cf. infra), cette tendance se poursuivrait puisque le 3° du I du présent article prévoit que 4,1 milliards d'euros seraient prélevés en 2026, soit une augmentation du prélèvement de 750 millions d'euros entre 2025 et 2026.
Ainsi, le montant total de TVA transféré s'élèvera à 54,8 milliards d'euros, en intégrant la minoration traduisant la reprise au titre des excédents de l'Unédic, contre 56,4 milliards d'euros en 2025.
C. UNE DIMINUTION DES MONTANTS DE TVA AFFECTÉS À LA SÉCURITÉ SOCIALE
En définitive, une fraction minorante de - 3,038 milliards d'euros sera affectée à la sécurité sociale au titre des transferts avec l'État. Le solde budgétaire de l'État s'en trouve donc amélioré.
À noter, toutefois, qu'au vu de la dynamique de TVA, la baisse réelle de recettes pour la Sécurité sociale ne serait que de 1,24 milliard d'euros. En effet, selon le rapport968(*) de la commission des comptes de la sécurité sociale, la TVA affectée à la sécurité sociale progresserait de 1,8 %, hors mesures nouvelles, portée par une augmentation des emplois taxables plus dynamique qu'en 2025, à hauteur de 2,5 % (contre 1,9 % en 2025).
Incidences budgétaires de l'article 40 du PLF 2026
(en millions d'euros)
|
Transferts financiers intégrés dans la fraction |
- 2288,0 |
|
Compensation des effets de la réforme des exonérations ciblées sur la réduction générale dégressive unique (RGDU) |
210 |
|
Compensation des économies résultants de la réforme des retraites pour la fonction publique d'État |
+ 70,0 |
|
Affectation des gains à la sécurité sociale de la fiscalisation des indemnités journalières versées aux bénéficiaires du dispositif d'affection longue durée |
+ 739 |
|
Reprise des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé |
- 8,5 |
|
Restitutions de la perte d'impôts sur les sociétés de la mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux |
- 200 |
|
Réforme des allègements généraux - Affectation des gains au budget général |
- 3098 |
|
Autres compensations |
- 750,0 |
|
Reprise des excédents de l'Unédic pour 2026 - en plus du montant déjà repris en 2024 et 2025 |
- 750,0 |
|
Montant supplémentaire de TVA à affecter à la Sécurité sociale en 2025 |
- 3038 |
Source : commission des finances du Sénat, d'après l'évaluation préalable de l'article 40 du PLF 2026
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE DIMINUTION DU TRANSFERT DE TVA JUSTIFIÉE PAR LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX, UNE REPRISE SUR L'UNEDIC CONFORME AUX PRÉVISIONS
A. UNE COMPENSATION AU BUDGET DE L'ÉTAT DE LA PERTE INDUITE PAR LA RÉFORME DES ALLÈGEMENTS GÉNÉRAUX DE COTISATION JUSTIFIÉE
1. Une attribution à l'État des gains de la réforme des allègements généraux
Le principe d'une moindre affectation des recettes de l'État à la sécurité sociale en raison de la diminution du montant des allègements généraux et de la perte que représente en termes d'impôt sur les sociétés la réforme des allègements généraux des cotisations patronales par l'article 18 de la LFSS pour 2025 contribue à une saine gestion des finances publiques. Une disposition visant à augmenter les recettes de la sécurité sociale, mais qui a pour effet de diminuer celles de l'État, doit en effet être compensée entre État et sécurité sociale. L'État ne devrait pas subir une hausse de son déficit en raison d'une réforme bénéficiant aux finances de la sécurité sociale, afin de ne pas tronquer les analyses globales de son niveau de déficit.
De plus, la justification même des transferts de TVA à la sécurité sociale tient à la compensation des allègements généraux, conformément à l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale. À noter, par ailleurs, que la pratique de l'affectation de points de TVA à la sécurité sociale permet de garantir une dynamique positive des transferts de l'État vers la sécurité sociale. La perte réelle de recettes pour la sécurité sociale en 2026 n'est ainsi que de 1,24 milliard d'euros.
Le rendement brut de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales devrait être de 3,9 milliards d'euros pour la sécurité sociale en 2026. Toutefois, en 2025, ce sont déjà 0,4 milliard d'euros qui avaient été repris au titre de l'effet retour sur l'impôt sur les sociétés, expliquant que pour 2026 seuls 3,1 milliards d'euros supplémentaires soient retirés de la fraction de TVA attribuée à la sécurité sociale.
2. Un transfert des gains de la réforme des retraites pour le système de pension des fonctionnaires de l'État de la branche maladie à la branche vieillesse
Le transfert de 333 millions d'euros, au titre de la réforme des retraites bénéficiera à la branche maladie (2° du I), affectataire de la fraction de TVA majorée. Il est davantage logique que ce montant bénéficie à la branche retraite, raison pour laquelle l'article 24 du la LFSS pour 2025 avait prévu une modification de la clé d'affectation de la taxe sur les salaires pour permettre un transfert de la branche maladie vers la branche retraite.
Cette affectation est toutefois précaire. En effet, la situation financière du régime de la fonction publique d'État porté par le CAS « Pensions » est en nette dégradation. Ainsi, dès le 1er janvier 2025, le taux de contribution employeur au titre des personnels civils augmente de 4 points, afin de garantir un solde cumulé positif du système. L'affectation de 333 millions d'euros n'est en réalité possible que parce que l'État augmente sa « cotisation employeur » pour maintenir le régime de pensions des fonctionnaires à l'équilibre.
B. MALGRÉ LA DÉGRADATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ASSURANCE CHÔMAGE, UN PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L'UNÉDIC CONFORME AUX PRÉVISIONS
1. Un prélèvement conforme aux prévisions établies en 2023
Le principe d'une reprise par l'État des excédents de l'Unédic a été posé dans le document de cadrage par lequel la Première ministre d'alors avait fixé les conditions de la négociation de la convention de l'assurance chômage969(*). Ainsi, entre 2023 et 2026, des prélèvements sur la fraction de TVA affectée à l'Unédic devaient lui permettre de faire contribuer le régime d'assurance chômage « au financement des politiques visant le plein emploi970(*) ».
En 2023, le montant de cette reprise a été de 2 milliards d'euros ; il a ensuite été de 2,6 milliards d'euros en 2024 et de 3,35 milliards d'euros en 2025971(*). Pour 2026, il serait de 4,1 milliards d'euros (+ 750 millions d'euros).
Reprise d'excédents de l'Unédic
prévue et en cours de réalisation entre 2023 et
2026
(en millions d'euros)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Document de cadrage |
2 000 |
2 500 |
3 000 < x < 3 200 |
3 500 < x < 4 100 |
|
Lois de finances et PLF 2025 |
2 000 |
2 600 |
3 350 |
4 100 |
Source : document de cadrage relatif à la négociation de la convention de l'assurance chômage et projet de loi de finances pour 2026
Cette trajectoire est globalement conforme à la prévision du document de cadrage. Elle lui est légèrement supérieure pour les années 2024 (+ 100 millions d'euros à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale) et 2025 (+ 150 millions d'euros). Elle est en revanche tout à fait conforme pour 2026, même si elle s'établit au montant maximal envisagé.
2. Un prélèvement qui placerait l'Unédic en déficit et aggraverait son endettement en 2026
Après une année 2025 proche de l'équilibre, l'Assurance chômage connaîtrait en 2026 un déficit de 1,3 milliard d'euros. Cette situation financière est due à une faible progression des recettes, du fait d'un recul de l'emploi salarié (- 60 000 emplois) en 2025 et d'une stagnation de cet agrégat en 2026, ainsi que d'une dégradation du marché du travail, qui aurait un effet haussier sur les effectifs de demandeurs d'emploi indemnisés.
Dans ces circonstances, les moindres compensations versées par l'État, qui s'apparentent à un prélèvement sur les recettes de l'Unédic, auraient pour effet de compromettre l'équilibre financier du régime. En effet, si le solde financier du régime s'est maintenu tout juste à l'équilibre en 2024, le prélèvement de l'État annule entièrement les excédents de l'Unédic, faisant passer son solde en territoire légèrement négatif en 2025 (- 0,1 milliard d'euros) et franchement déficitaire en 2026 (- 1,3 milliard d'euros).
Prévision d'évolution du solde
financier de l'Unédic
avec et sans prélèvement de
l'État entre 2022 et 2027
(en milliards d'euros)
Source : Unédic, prévisions financières de l'Unédic - octobre 2025
En effet, l'excédent du régime d'assurance chômage aurait pu être de 3,4 milliards d'euros en 2025 - alors qu'il est déficitaire du fait du prélèvement. En 2026, le déficit attendu est de 1,3 milliard d'euros, alors qu'un excédent de 3 milliards d'euros aurait pu être dégagé en l'absence de prélèvement de l'État à hauteur de 4,1 milliards d'euros.
Ce retour en territoire déficitaire provoque en conséquence une inversion de la courbe de désendettement de l'Unédic. Ainsi, alors que la dette de l'Assurance chômage était d'environ 59,5 milliards d'euros en 2025 sans prélèvement, elle s'établirait à 60,8 milliards d'euros à fin 2026.
Au lieu de se réduire, la dette de l'Unédic repartirait donc à la hausse en 2026, éloignant d'autant plus les perspectives d'apurement de 50 % de la dette de l'Assurance chômage à horizon 2026, objectif qui apparaît désormais hors de portée.
Prévision
d'évolution de l'endettement
du régime d'assurance
chômage entre 2022 et 2027
(en milliards d'euros)
Source : Unédic, prévisions financières de l'Unédic - octobre 2025
Enfin, le prélèvement prévu par le présent article s'inscrit dans un contexte où l'Unédic est fortement mise à contribution en faveur des politiques de d'emploi, notamment au moyen d'une subvention de l'Unédic à France Travail, fixée à hauteur de 11 % de ses recettes et versée à compter de 2024, avec une montée en charge jusqu'en 2026.
3. Une contribution qui se justifie par l'objectif d'amélioration des comptes de l'État
Jusqu'à 2024, le prélèvement sur les recettes de l'Unédic servait à abonder les crédits de la mission « Travail et emploi », qui augmentaient d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros par rapport à 2023 - un montant identique à la reprise prévue sur les excédents de l'Unédic. Le rapporteur général avait dès lors dénoncé un véritable effet d'aubaine, l'amélioration du solde de l'État n'ayant pas eu pour corollaire de quelconques efforts en dépenses972(*).
Si l'évaluation préalable du présent article indique toujours que la contribution de l'Unédic a « vocation à financer les politiques visant le plein emploi », le rapporteur général relève que, cette année comme l'année dernière, elle s'accompagne d'une diminution sensible des crédits de la mission Travail et emploi (- 15,11 % en AE et - 11,79 % en CP à périmètre courant) dans le texte proposé par le Gouvernement.
Le prélèvement sur les recettes de l'Unédic serait donc affecté à la réduction du déficit de l'État. Il convient toutefois d'apporter une attention particulière à la situation financière de l'Assurance chômage en 2026, en raison des importantes échéances de remboursement de la « dette Covid » qui s'y présentent.
À cet égard, la présence à l'article 59 du présent projet de loi d'une garantie de l'État à l'Unédic pour couvrir ses emprunts obligataires dans la limite de 10 milliards d'euros en principal - bien au-delà des 4 milliards d'euros couverts en 2025), constitue une contrepartie aux efforts consentis par l'Assurance chômage pour le rétablissement du solde de l'État.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 41
Affectation du produit de la taxe sur l'utilisation de
combustible nucléaire pour la production d'électricité au
gestionnaire du réseau public
de transport
d'électricité
Le présent article prévoit :
- d'une part, d'affecter au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité pour qu'il le redistribue aux fournisseurs d'électricité qui auront au préalable appliqué des minorations sur les factures de leurs clients conformément au dispositif de versement universel nucléaire créé par l'article 17 de la loi de finances pour 2025 ;
- d'autre part, de confier à ce même réseau la mission d'établir chaque année un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique, qui devra servir de base aux périodes au cours desquelles s'appliqueront les minorations de factures d'électricité des consommateurs prévues dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire.
La proposition visant à affecter au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et à lui confier la mission de la redistribuer est étonnante et soulève plusieurs difficultés, la première étant que le principal intéressé, à savoir RTE, y est hostile, une position partagée par la commission de régulation de l'énergie (CRE). Les différents acteurs du secteur s'accordent en effet à considérer que cette mission ne relève pas du rôle habituel d'un gestionnaire de réseau de transport d'électricité. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la Caisse des dépôts, qui assume actuellement une mission comparable dans le cadre du mécanisme de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) est volontaire pour assurer ce rôle. Compte-tenu des dispositions de l'article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement pourrait prendre l'initiative de confier à la Caisse des dépôts cette nouvelle mission de service public qui suppose des coûts de gestion prélevés sur le produit de la taxe elle-même. Aussi le rapporteur général appelle-t-il le Gouvernement à revoir sa copie dans le cadre de l'examen du texte en séance publique afin de sécuriser le dispositif proposé.
La deuxième évolution proposée par le présent article, plus technique, si elle ne pose pas de difficulté en elle-même, n'est pas non plus sans susciter des interrogations, notamment au regard du projet de décret relatif aux conditions d'application du versement nucléaire universel que le Gouvernement vient de soumettre au Conseil supérieur de l'énergie le soir du 6 novembre 2025. En effet, ce décret prévoit que la minoration des factures d'électricité dans le cadre du dispositif de versement nucléaire universel ne s'appliquerait par principe qu'entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année. Autrement dit, en cas de crise des prix de l'énergie, pendant les mois d'hiver au cours desquels les consommations d'énergie sont les plus fortes, les consommateurs seraient exposés à des prix de l'électricité potentiellement très élevés. Aussi, le rapporteur général appelle-t-il le Gouvernement à revoir d'urgence le contenu de ce projet de décret sensé entré en vigueur au 1er janvier prochain.
Malgré les problématiques que posent les dispositions du présent article, qui appellent à des modifications substantielles de la part du Gouvernement au cours de l'examen du texte en séance publique et même s'il n'y a qu'une faible chance que le versement nucléaire universel soit appliqué en 2026, la suppression pure et simple de cet article pourrait poser une difficulté dans l'hypothèse où surviendrait une crise. Aucun dispositif de protection des consommateurs ne serait alors opérationnel. Aussi, dans l'attente des évolutions nécessaires de ses dispositions au stade de l'examen du texte en séance publique, la commission propose-t-elle d'adopter cet article sans modification.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : L'ARTICLE 17 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2025 A PRÉVU LA CRÉATION, AU 1ER JANVIER 2026, D'UN MÉCANISME DE PARTAGE AVEC LES CONSOMMATEURS DES REVENUS DU NUCLÉAIRE HISTORIQUE
Alors que le mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh) expire à la fin de l'année 2025, l'article 17 de la loi de finances pour 2025973(*) a prévu la création au 1er janvier 2026 d'un dispositif ayant vocation à se substituer à cet Arenh. Ce dispositif repose sur deux piliers indissociables :
- un volet fiscal représenté par la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité qui conduira à prélever une part des revenus tirés par EDF de son parc nucléaire selon certains seuils et en fonction du prix auquel la société aura pu vendre son électricité sur les marchés de gros ;
- un volet de redistribution des sommes collectées, le « versement universel nucléaire », qui devra permettre, via des minorations appliquées par les fournisseurs d'électricité sur les factures de leurs clients, de répercuter aux consommateurs le produit de la taxe prélevée sur EDF.
A. LA TAXE SUR L'UTILISATION DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
La taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité est aujourd'hui codifiée aux articles L. 321-1 à L. 322-81 du code des impositions sur les biens et services.
La taxe prévoit qu'une fraction des ressources tirées par EDF de son parc nucléaire historique fasse l'objet d'un prélèvement progressif si ces dernières dépassent certains seuils fixés par arrêté.
La fraction de ces ressources excédant un premier seuil, correspondant aux coûts complets de production de l'électricité générée par le parc nucléaire existant majorés de 5 à 25 euros par MWh, serait taxée à un taux de 50 %. La fraction de ces ressources excédant un second seuil, dit « d'écrêtement », fixé à un niveau supérieur de 35 à 55 euros par MWh aux coûts complets, serait quant à elle taxée à un taux de 90 %.
Si, en septembre dernier, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a réévalué à 60,3 euros par MWh pour la période 2026-2028, puis 63,4 euros par MWh pour la période 2029-2031974(*), les coûts complets de production de l'électricité générée par le parc nucléaire existant, mission qui lui avait été confiée par une disposition de l'article 17 de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement n'a pas encore pris l'arrêté établissant les seuils de la taxe.
En pratique, du fait de la faiblesse des prix actuels sur les marchés de gros de l'électricité et alors qu'EDF vend une très grande part de son électricité à terme, il est extrêmement improbable que la taxe donne lieu à des prélèvements en 2026.
Le droit existant prévoit que la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité est reversée au budget général de l'État.
B. LE VERSEMENT NUCLÉAIRE UNIVERSEL DOIT PERMETTRE DE REDISTRIBUER LE PRODUIT DE LA TAXE AUX CONSOMMATEURS
Le dispositif de redistribution du produit de la taxe au bénéfice des consommateurs finals d'électricité, qualifié de « versement nucléaire universel », est quant à lui prévu par des dispositions figurant aux articles L. 337-3 à L. 337-3-6 du code de l'énergie.
Le dispositif prévoit que, lorsque les conditions du versement universel nucléaire sont réunies, c'est-à-dire lorsque la taxe donnera lieu à des prélèvements sur EDF, les fournisseurs sont tenus d'appliquer une minoration tarifaire sur les factures de leurs clients. En contrepartie, le code de l'énergie prévoit qu'ils soient compensés financièrement des charges induites par ces minorations tarifaires obligatoires.
L'article L. 337-3-2 du code de l'énergie prévoit que la minoration des factures qui pourra résulter du dispositif se traduit par l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs pendant la période annuelle concernée. L'article prévoit également que ce tarif unitaire de minoration doit être fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie sur proposition de la CRE, au moins un mois avant le début de la période annuelle d'application de la minoration.
L'article L. 337-6 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'État pris après avis de la CRE détermine les conditions d'application du versement nucléaire universel. Il précise que ce décret devra notamment définir :
- les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sera versé aux fournisseurs en compensation des pertes de recettes générées par la minoration tarifaire qu'ils auront dû appliquer à leurs clients ;
- les règles de calcul du tarif unitaire de minoration et notamment les conditions dans lesquelles il pourrait faire l'objet de modulations, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique, en fonction de plusieurs critères tels que les moments de la consommation ou son ampleur (pour encourager notamment la flexibilité de la demande d'électricité et les économies d'énergie), les prix de la fourniture d'électricité et les profils de consommation.
Un projet de ce décret a été soumis par le Gouvernement au Conseil supérieur de l'énergie le 6 novembre dernier (voir infra).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CONFIER LA REDISTRIBUTION DU VERSEMENT NUCLÉAIRE UNIVERSEL À RTE ET CIBLER LES MINORATIONS TARIFAIRES PRÉVUES PAR LE DISPOSITIF SUR LES PÉRIODES OÙ LA TENSION SUR LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EST LA MOINS FORTE, AFIN D'INCITER CERTAINS AGENTS ÉCONOMIQUES À DÉPLACER DANS LE TEMPS LEUR CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
A. LA REDISTRIBUTION DU VERSEMENT NUCLÉAIRE UNIVERSEL EST CONFIÉE À RTE
Le 2° du I du présent article propose d'insérer au sein du code des impositions sur les biens et services un nouvel article L. 322-82 disposant que l'affectation du produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité est déterminée par l'article L. 321-17-3 du code de l'énergie dont la création est elle-même prévue par le 1° du II du présent article.
En effet, ce 1° du II propose de créer au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 321-17-3 qui prévoit que le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité est affecté à Réseau de transport d'électricité (RTE) qui aura la charge de le redistribuer. Ce même article précise à cet égard que les sommes en question, qui correspondent au versement nucléaire universel devant être redistribué aux consommateurs, ont exclusivement pour objet :
- la compensation effectuée par RTE de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité en raison de l'application de la minoration de droit des factures de leurs clients prévue dans le cadre du dispositif de versement universel nucléaire tel que décrit supra ;
- la couverture des frais de gestion supportés par RTE975(*) dans le cadre de cette fonction de reversement du versement nucléaire universel.
Le a) du 2° du II procède à une coordination au premier alinéa de l'article L. 337-3-1 du code de l'énergie résultant du nouvel article L. 321-17-3 et du rôle confié à RTE de redistribution du versement nucléaire universel.
Le 6° du II opère une autre coordination ayant le même objet et portant sur l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie qui précise certains éléments du contenu du décret en Conseil d'État qui aura pour objet de déterminer certaines des conditions d'application du versement nucléaire universel.
En proposant de modifier l'article L. 322-69 du code des impositions sur les biens et services, le 1° du I prévoit quant à lui que RTE soit préalablement consulté sur le système d'acomptes dont est l'objet la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire.
B. RTE EST CHARGÉ DE CLASSER LES MOIS DE L'ANNÉE SELON UN CRITÈRE DE TENSION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE, CLASSEMENT DEVANT ÊTRE UTILISÉ DANS L'APPLICATION DU VERSEMENT UNIVERSEL NUCLÉAIRE POUR INCITER LES ACTEURS QUI LE PEUVENT À DÉPLACER DANS LE TEMPS LEURS CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES
Le 5° du II du présent article propose, au sein du code de l'énergie, la création d'un nouvel article L. 337-3-3-1 qui confie à RTE la mission d'établir chaque année « un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois ».
Ce même article précise que cet état prévisionnel, publié au plus tard au mois de septembre de l'année qui précède celle à laquelle il se réfère, devra servir de base à la détermination, fixée par décret, de la période au cours de laquelle s'appliquera, si elle a lieu d'être, la minoration des factures d'électricité prévue dans le cadre du dispositif de versement nucléaire universel. Il ajoute qu'en toute hypothèse, cette période devra à minima englober les quatre mois de l'année « pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée ».
Ce dispositif, en réduisant le prix de l'électricité au cours des mois où la tension sur le système électrique est la plus faible, a pour finalité d'inciter les agents économiques qui en ont les moyens à déplacer dans le temps leur consommation d'électricité afin d'optimiser les conditions de l'équilibre entre offre et demande d'électrons.
Les b) du 2°, 3° et 4° du II du présent article procèdent à de simples coordinations légistiques au sein du code de l'énergie destinées à rendre opérantes les dispositions de ce nouvel article L. 337-3-3-1.
Enfin, le 7° du II du présent article actualise les références des dispositions législatives relatives au versement nucléaire universel qui s'appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ARTICLE DONT L'ADOPTION EST CONDITIONNÉE AUX MODIFICATIONS QUE LE GOUVERNEMENT LUI APPORTERA AU COURS DE L'EXAMEN DU TEXTE EN SÉANCE PUBLIQUE
A. LA MISSION QUE L'ARTICLE PROPOSE DE CONFIER À RTE EST TRÈS ÉLOIGNÉE DU RÔLE HABITUEL D'UN GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
La décision d'affecter au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE) le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et de lui donner la mission de le redistribuer dans le cadre du mécanisme du versement nucléaire universel est étrange et pose plusieurs difficultés, la première étant que le principal intéressé, à savoir RTE, y est opposé. La commission de régulation de l'énergie (CRE) est également défavorable à ce que RTE se voit chargé de cette mission. Tous les acteurs du secteur s'accordent en effet à considérer que cette mission est très éloignée du rôle d'un gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
Outre le fait que la redistribution du versement nucléaire universel n'aurait rien à voir avec les missions actuelles de RTE, celui-ci souligne les risques financiers qu'elle pourrait lui occasionner du fait des mouvements de trésorerie potentiellement considérables qu'elle pourrait supposer en cas de crise des prix de l'électricité. Dans certaines hypothèses les sommes qui transiteraient ainsi par le budget de RTE dans le cadre du versement nucléaire universel pourraient ainsi représenter jusqu'à deux fois son chiffre d'affaires annuel habituel.
De plus, cette mission pourrait mettre RTE en « porte à faux » au regard du droit de l'Union européenne qui exige une indépendance stricte du gestionnaire du réseau de transport d'électricité vis-à-vis du fournisseur d'électricité historique. Le fait que RTE soit affectataire de sommes potentiellement très significative prélevées sur les revenus d'EDF et qu'il soit chargé de les redistribuer pourrait s'avérer juridiquement problématique.
Le choix du Gouvernement de désigner RTE est d'autant plus incompréhensible que la Caisse des dépôts, qui assume actuellement une mission comparable dans le cadre du mécanisme de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh), est volontaire pour assurer ce rôle, une option également recommandée par la CRE.
Compte-tenu des dispositions de l'article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement peut cependant prendre l'initiative de confier à la Caisse des dépôts cette nouvelle mission de service public qui suppose la compensation de coûts de gestion prélevés sur le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité. Aussi le rapporteur général appelle-t-il le Gouvernement à revoir sa copie dans le cadre de l'examen du texte en séance publique afin de sécuriser le dispositif proposé.
B. S'AGISSANT DE L'APPLICATION CONCRÈTE DU DISPOSITIF DE VERSEMENT NUCLÉAIRE UNIVERSEL, UN RÉCENT PROJET DE DÉCRET S'AVÈRE PARTICULIÈREMENT PRÉOCCUPANT
La deuxième évolution proposée par le présent article, plus technique, si elle ne pose pas de difficulté en elle-même, n'est pas non plus sans susciter des inquiétudes, notamment au regard du projet de décret relatif aux conditions d'application du versement nucléaire universel que le Gouvernement vient de soumettre au Conseil supérieur de l'énergie le soir du 6 novembre 2025.
En effet, ce décret prévoit que la minoration des factures d'électricité dans le cadre du dispositif de versement nucléaire universel ne s'appliquerait par principe qu'entre le 1er avril et le 31 octobre de l'année. Autrement dit en cas de crise des prix de l'énergie, pendant les mois d'hiver au cours desquels les consommations d'énergie sont les plus fortes, les consommateurs seraient exposés à des prix de l'électricité potentiellement extrêmement élevés sans qu'aucun dispositif ne permette d'en atténuer le caractère insoutenable.
Cette mesure, qui n'a en pratique vocation à ne bénéficier qu'aux seules industries et entreprises qui auront les moyens de déplacer leurs consommations des mois d'hiver vers le reste de l'année apparaît inacceptable politiquement tant elle serait susceptible d'exposer la majorité des consommateurs à des prix de l'électricité exorbitants pendant la période hivernale en cas de crise. Aussi, le rapporteur général appelle-t-il le Gouvernement à revoir d'urgence le contenu de ce projet de décret sensé entrer en vigueur au 1er janvier prochain.
Malgré les problématiques évidentes que posent les dispositions du présent article, qui appellent à des modifications substantielles de la part du Gouvernement au cours de l'examen du texte en séance publique et même si, compte-tenu des tendances de prix actuelles sur les marchés de l'électricité, il n'y a qu'une chance infime que le versement nucléaire universel soit appliqué en 2026, la suppression pure et simple de cet article pourrait poser une difficulté dans l'hypothèse où surviendrait une crise soudaine des prix de l'énergie comme l'Europe l'a connue il y a quelques années. Aucun dispositif de protection des consommateurs ne serait alors opérationnel pour répondre aux conséquences d'une telle situation. Aussi, dans l'attente des évolutions nécessaires de ses dispositions au stade de l'examen du texte en séance publique, la commission propose-t-elle d'adopter cet article sans modification.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
42
Affectation d'une fraction des recettes de l'accise sur les
carburants
au financement des charges de service public de l'énergie,
pour leur part liée à la cogénération et au
biométhane
Le présent article prévoit la réforme du financement des compensations pour charges de service public de l'énergie (CSPE) résultant des dispositifs publics de soutien destinés à encourager la cogénération d'énergie ainsi que la production de biométhane.
Aujourd'hui financées par des crédits du budget de l'État, ces dispositifs reposeraient, à compter du 1er mai 2026, sur l'affectation d'une fraction du produit issu de l'accise sur les carburants.
Cette évolution s'inscrit dans le prolongement d'une disposition similaire adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2025 concernant le financement du mécanisme de péréquation tarifaire de l'électricité au bénéfice des zones non interconnectées (ZNI).
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : SI L'ESSENTIEL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE (CSPE) RESTE FINANCÉ PAR DES CRÉDITS DU BUDGET DE L'ÉTAT, LE MÉCANISME DE PÉRÉQUATION TARIFAIRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN ZONES NON INTERCONNECTÉES (ZNI) REPOSE DÉSORMAIS SUR L'AFFECTATION D'UNE FRACTION DE L'ACCISE SUR LES ÉNERGIES
A. COMME L'ESSENTIEL DES CSPE, LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION ET AU BIOMÉTHANE SONT FINANCÉS PAR DES CRÉDITS DU PROGRAMME 345 « SERVICE PUBLIC DE L'ÉNERGIE »
Les charges de service public de l'énergie (CSPE) correspondent aux compensations financières, dues par l'État, des obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz par le code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est chargée d'en évaluer chaque année le montant.
Ces CSPE sont notamment constituées des dispositifs de soutien public à la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable, notamment d'origine photovoltaïque ou éolienne.
Ces dispositifs, en garantissant au producteur la perception d'un niveau de prix pour l'énergie qu'il produit, doivent lui assurer, sur le long terme, une rémunération supérieure à la valeur de marché de l'énergie produite. Ces dispositifs de soutien public peuvent être attribués selon deux modalités : le guichet ouvert ou la mise en concurrence via des appels d'offres. Ces dispositifs de soutien à la rémunération des producteurs d'énergie peuvent eux-mêmes prendre deux formes : l'obligation d'achat ou le complément de rémunération. Dans ce dernier cas, si les prix de marché sont inférieurs au prix garanti par les contrats de soutien, l'État finance la différence.
Depuis 2021, les CSPE sont par principe financés par des crédits du budget de l'État suivis sur le programme 345 « Service public de l'énergie » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Pour 2025, la loi de finances a ainsi prévu d'affecter 8,9 milliards d'euros au financement de ces CSPE.
Les dispositifs de soutien à l'injection de biométhane et à la cogénération sont également régis par le dispositif de CSPE et les crédits dédiés à leur financement sont suivis aux actions 10 « Soutien à l'injection de biométhane » et 12 « Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques » du programme 345.
1. Le soutien à l'injection de biométhane : des charges extrêmement dynamiques, de plus en plus coûteuses pour l'État
En matière de gaz naturel, le biométhane constitue la principale source d'énergie renouvelable, raison pour laquelle l'État soutient financièrement son injection dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Dans cette perspective, l'article L. 446-2 du code de l'énergie prévoit que les fournisseurs de gaz naturel sont tenus de conclure des contrats d'achat de biométhane produit par les installations éligibles à l'obligation d'achat. L'application de ces contrats génère un surcoût, qui correspond à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion du dispositif. Dans ce type de contrats de soutien, c'est ce surcoût que l'État compense au titre du mécanisme des CSPE.
Évolution du coût budgétaire
des soutiens à l'injection du
biométhane
(2018-2026)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les délibérations de la CRE
En 2026, d'après la délibération de la CRE publiée le 10 juillet dernier, le coût pour l'État des dispositifs de soutien à l'injection de biométhane pourrait dépasser les 1,3 milliard d'euros, soit une augmentation de presque 200 millions d'euros en un an et une multiplication par plus de 20 depuis 2018.
D'après le projet annuel de performance 2026 du programme 345, cette augmentation extrêmement significative s'explique principalement par le développement de la filière et l'augmentation des volumes de biométhane soutenus. En effet, alors qu'en 2018, 73 unités de méthanisation injectaient du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, pour une capacité raccordée de 1,5 TWh par an, au 31 mars 2025, 753 installations de production de biométhane sont raccordées aux réseaux de transport et de distribution, pour une capacité cumulée de 14,3 TWh par an.
Ce développement de la filière résulte notamment des objectifs ambitieux fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2019-2028976(*) : 6 TWh de biométhane injecté en 2023, et entre 14 et 22 TWh en 2028. Le projet annuel de performance du programme 345 précise qu'à la fin du premier trimestre 2025, 637 projets nouveaux étaient « en file d'attente » pour une capacité de 15,5 TWh par an.
Déjà, entre 2018 et 2020, les crédits consacrés au soutien public à cette filière avaient fortement augmenté, faisant craindre un emballement comparable à la situation observée à la fin de la première décennie des années 2000 concernant les contrats d'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque. Dès 2018, la CRE avait alerté l'État sur les niveaux excessifs de rentabilité de la filière mais ce n'est qu'à la fin de l'année 2020 que celui-ci est intervenu. L'arrêté du 23 novembre 2020977(*) avait ainsi révisé le dispositif de soutien au biométhane afin de tenir compte de la maturité atteinte par la filière et de l'évolution des coûts de production. Cet arrêté a réduit le tarif d'achat, prévu sa dégressivité trimestrielle et renforcé les conditions d'accès aux contrats. Ces évolutions avaient pour objectif de limiter la rémunération moyenne des capitaux investis à environ 7 %. Pour tenir compte de l'inflation des coûts de construction pour les nouvelles installations, le tarif d'achat de biométhane a ensuite été revalorisé par un nouvel arrêté tarifaire du 10 juin 2023978(*).
À l'instar des autres CSPE résultant des obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz, le principe d'un financement budgétaire par l'État du dispositif de soutien à l'injection de biométhane est prévu par l'article L. 212-35 du code de l'énergie.
2. Les charges relatives à la cogénération sont vouées à décliner en raison de l'expiration progressive des mécanismes de soutien
La cogénération correspond à la production combinée de chaleur et d'électricité par des installations fonctionnant au gaz naturel. Ce processus permet d'atteindre des rendements énergétiques globaux supérieurs à ceux obtenus via la production séparée de chaleur (chaudières) et d'électricité (centrales électriques) et de générer ainsi des économies d'énergie primaire. La chaleur produite est généralement utilisée par injection dans un réseau de chaleur ou pour un processus industriel.
Pour la soutenir, l'État obligeait EDF et les entreprises locales de distribution d'électricité (ELD) à conclure des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération avec les installations de cogénération à haute performance énergétique de moins de 12 MW. En contrepartie, il s'est engagé à compenser aux distributeurs d'électricité l'intégralité des surcoûts générés par ces mécanismes de soutien.
Conformément à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), le dispositif de soutien à la cogénération a été abrogé à compter du 23 février 2021 en application d'un décret du 21 août 2020979(*). Depuis cette date, les installations de cogénération à partir de gaz naturel ne sont plus éligibles à un soutien et aucune nouvelle demande de contrat ne peut donc être acceptée. Dans la mesure où les producteurs disposent d'un délai de deux ans pour mettre en service leur installation, depuis le début de l'année 2023, plus aucune nouvelle centrale n'est soutenue.
Les contrats en cours ne sont pas impactés par cette abrogation, aussi, la puissance et l'énergie produite soutenues doivent progressivement diminuer au fur et à mesure de l'arrivée à échéance des contrats. D'après la délibération de la CRE, la puissance soutenue devrait ainsi baisser de 0,9 gigawatt (GW) entre 2024 et 2026 pour s'établir à 1,2 GW.
Toujours d'après la délibération de la CRE, en 2026, les charges relatives au soutien à la cogénération pourraient s'élever à 649 millions d'euros, en baisse de 68 millions d'euros par rapport à l'année précédente et de 10 millions d'euros par rapport à la situation qui prévalait en 2022, avant que les effets de la crise des prix de l'énergie ne se répercutent sur les CSPE.
Évolution du coût budgétaire
des soutiens à la cogénération
(2020-2026)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les délibérations de la CRE
À l'instar des autres CSPE résultant des obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité, le principe d'un financement budgétaire par l'État du dispositif de soutien à la cogénération est prévu par l'article L. 121-6 du code de l'énergie.
B. L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2025 A MIS EN oeUVRE UNE RÉFORME DU FINANCEMENT DU MÉCANISME DE PÉRÉQUATION TARIFAIRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN ZNI
Les zones non interconnectées (ZNI) sont des territoires qui ne sont pas connectés au réseau d'électricité continental, ou de façon limitée dans le cas de la Corse. Ils voient ainsi leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint. Les caractéristiques spécifiques aux ZNI créent de fortes contraintes pour le mix énergétique, la gestion du réseau électrique et l'approvisionnement qui imposent de recourir à des solutions technologiques significativement plus coûteuses qu'en métropole.
En vertu du principe de péréquation à l'échelle nationale, les consommateurs des ZNI paient un niveau de facture d'électricité identique à celui de la France continentale. Les surcoûts générés pour les fournisseurs par cette péréquation sont compensés en vertu du mécanisme des charges de service public de l'énergie (CSPE). Comme les autres CSPE, l'ensemble de ces surcoûts supportés par les opérateurs fait l'objet d'une compensation intégrale, elle aussi évaluée chaque année par la CRE.
Jusqu'en juillet dernier, à l'instar des autres CSPE, ce soutien était financé chaque année par des crédits inscrits à l'action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » du programme 345. En 2026, le montant prévisionnel des compensations des charges liées à cette péréquation tarifaire, devrait représenter 3 milliards d'euros, contre 3,3 milliards d'euros en 2025980(*).
Évolution du coût du soutien aux ZNI (2017-2026)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat d'après les délibérations de la CRE
À compter du 1er août 2025, l'article 20 de la loi de finances pour 2025 a réformé le financement de ce soutien au profit des ZNI en substituant au dispositif budgétaire qui était alors en vigueur, un mécanisme fiscal par lequel est affecté chaque année aux opérateurs d'électricité qui interviennent en ZNI une fraction de l'accise sur les énergies appliquée aux combustibles de chauffage.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LE FINANCEMENT DES CSPE RÉSULTANT DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION ET À LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE PAR L'AFFECTATION D'UNE FRACTION DU PRODUIT DE L'ACCISE SUR LES CARBURANTS
Le présent article prévoit, à compter du 1er mai 2026981(*), de réformer le mécanisme de financement des charges de service public de l'énergie (CSPE) résultants des dispositifs publics de soutien destinés à encourager la cogénération d'énergie ainsi que la production de biométhane.
Sur le modèle de la réforme du financement des CSPE résultants du dispositif de péréquation tarifaire de l'électricité au bénéfice des zones non interconnectées (ZNI) instaurée par la loi de finances pour 2025982(*), le présent article propose ainsi de financer les CSPE résultants des mécanismes d'aide à la cogénération et à la production de biométhane par l'affectation d'une fraction du produit issu de l'accise sur les énergies perçue sur les consommations de carburants983(*).
À ce titre, le III du présent article prévoit de modifier l'article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services qui liste les références aux différentes dispositions législatives qui déterminent l'affectation du produit de l'accise sur les énergies. Ce III ajoute ainsi un alinéa pour préciser que l'affectation du produit de l'accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant serait également déterminée par les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie eux-mêmes modifiés, comme décrit infra, respectivement par les I et II du présent article.
A. LA RÉFORME DU FINANCEMENT DU DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA COGÉNÉRATION
Le I du présent article propose de compléter l'article L. 121-6 du code de l'énergie par un nouvel alinéa précisant que, par dérogation au modèle de financement de droit commun des CSPE, celles résultants des dispositifs de soutien à la cogénération à partir de gaz naturel seraient désormais financées par l'affectation d'une fraction du produit de l'accise perçue sur les carburants. Cet alinéa prévoit ainsi que les opérateurs supportant les CSPE concernées se verraient affecter cette fraction déterminée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
B. LA RÉFORME DU FINANCEMENT DU DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE
Le II du propose de compléter l'article L. 121-35 du code de l'énergie par deux nouveaux alinéas précisant que, par dérogation au modèle de financement de droit commun des CSPE, celles résultants des dispositifs de soutien à la production de biométhane seraient désormais financées par l'affectation d'une fraction du produit de l'accise perçue sur les carburants. Ces dispositions prévoient ainsi que les opérateurs supportant les CSPE concernées se verrait affecter cette fraction déterminée par la CRE.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN SIMPLE JEU DE « VASES COMMUNIQUANTS » AU SEIN DU BUDGET DE L'ÉTAT, NEUTRE POUR LES CONSOMMATEURS COMME POUR LES CONTRIBUABLES
Neutres pour le solde du budget de l'État, les dispositions du présent article ne conduiront qu'à un simple jeu de « vases communicants » entre ses dépenses et ses recettes. En effet, la baisse des dépenses qui résultera du fait que les dispositifs de soutien à la cogénération et à l'injection de biométhane ne seront plus financés par des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » sera exactement contrebalancée par une diminution des recettes de l'État du fait de l'affectation à ces mécanismes de soutien d'une fraction du produit des accises sur les produits énergétiques.
Ce jeu de « vase communicants » ne sera que partiel en 2026 en raison de l'entrée en vigueur de ces dispositifs prévue au 1er mai de l'année à venir ce qui évitera, comme cela a été le cas pour la péréquation tarifaire en ZNI dans le cadre la loi de finances pour 2025, qu'en cas d'adoption tardive de la loi de finances pour 2026, d'avoir à procéder à des mouvements budgétaires importants au sein du budget de l'État pour tenir compte de la nécessité de prévoir une entrée en vigueur différée de la mesure. Du fait de cette entrée en vigueur au 1er mai 2026, le phénomène de vases communicants entre les dépenses et les recettes de l'État ne devrait représenter que 1,1 milliard d'euros en 2026, dont 792 millions d'euros pour l'injection de biométhane et 334 millions d'euros pour la cogénération.
En année pleine, en 2027 puis en 2028, l'évaluation préalable estime ses effets à 2,2 milliards d'euros. Cependant, ce montant est à ce jour très incertain et sera dépendant des volumes soutenus, en particulier s'agissant du soutien à l'injection de biométhane qui est inscrit sur une trajectoire extrêmement dynamique (voir supra), ainsi que de l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés de gros. Il sera nécessaire d'attendre les évaluations réalisées par la CRE en juillet 2026, puis en juillet 2027 pour avoir une vision plus fine de ces incidences budgétaires.
Comme précisé supra, les dispositions du présent article suivent la même logique et s'inscrivent dans le prolongement de la réforme du financement de la péréquation tarifaire en ZNI qui a été adoptée par le Parlement dans le cadre de l'article 20 de la loi de finances pour 2025.
Neutres pour le budget de l'État, ces dispositions le seront aussi pour les consommateurs ainsi que pour les contribuables puisqu'elles ne prévoient qu'une simple affectation d'une fraction du produit de l'accise sur les produits énergétiques sans aucune majoration de celle-ci.
En disparaissant des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » où elles sont suivies aujourd'hui, ces charges perdront en visibilité dans le budget mais elles y figureront toujours en tant que recettes affectées et elles continueront de faire l'objet tous les ans d'une évaluation par la CRE publiée dans un délibération publique. Le coût pour l'État de l'ensemble des compensations de charges de service public de l'énergie, qu'elles soient financées par des crédits budgétaires ou bien par des affectations de fiscalité restera ainsi parfaitement connu et accessible pour les citoyens comme pour le législateur.
Par ailleurs, par cette réforme du financement des charges de service public de l'énergie, le Gouvernement entend rendre plus lisible les évolutions des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » aujourd'hui très fortement dépendantes des variations non pilotables et parfois erratiques de ces charges. À ce titre, l'évaluation préalable souligne qu'aujourd'hui, « cette dépense budgétaire est donc imprévisible et volatile et peut nuire à la bonne gestion de la dépense de l'État ». Elle ajoute que « l'objectif de cette réforme est de limiter l'impact des variations du programme 345 sur la gestion et la budgétisation de l'État ».
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 43
Prélèvement exceptionnel des soldes
excédentaires de la taxe
sur les nuisances sonores
aériennes
Le présent article prévoit d'opérer en 2026, au bénéfice de l'État, un prélèvement exceptionnel sur des soldes de taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) conservés au sein de certains aéroports.
Pour le seul exploitant d'aéroport concerné, à savoir le groupe Aéroports de Paris (ADP), le montant de ce prélèvement serait égal à la fraction de ce solde excédant 45 millions d'euros, soit environ 80 millions d'euros d'après l'évaluation préalable.
Les dispositions du présent article devront faire l'objet d'un examen plus approfondi d'ici à la séance publique compte-tenu des réserves qu'elles suscitent, en lien avec la disposition de l'article 36 qui prévoit d'abaisser le plafond d'affectation aux aéroports du produit de la TNSA.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : AÉROPORTS DE PARIS (ADP) DISPOSE D'UNE TRÉSORERIE DE 125 MILLIONS D'EUROS PROVENANT DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES (TNSA)
A. LA TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES (TNSA)
La taxe sur les nuisances sonores aériennes est prévue par l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services. Cette taxe est prélevée auprès des compagnies aériennes qui en sont les redevables984(*) et son fait générateur est constitué par le décollage, au départ d'aéroports appartenant aux groupes 1 à 3, d'avions d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes985(*).
Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif propre à chaque aéroport et un coefficient appliqué à chaque avion986(*). Le tarif propre à chaque aéroport est déterminé de façon à ce que le produit qui en résulte permette à l'aéroport en question de couvrir les besoins de financement de l'indemnisation des travaux d'insonorisation effectués par les riverains éligibles à ces aides. Ce tarif doit être déterminé par arrêté, en fonction des trois groupes d'aéroports, entre un niveau plancher et un niveau plafond.
Niveaux plancher et plafond des tarifs de TNSA
prévus par l'article L. 422-54
du code des impositions sur
les biens et services
|
Groupe de l'aérodrome |
Minimum (en euros) |
Maximum (en euros) |
|
Groupe 1 |
20 |
75 |
|
Groupe 2 |
10 |
20 |
|
Groupe 3 |
0 |
10 |
Source : code des impositions sur les biens et services
Le produit de cette imposition est affecté aux aéroports au prorata de leur contribution au rendement global de la taxe.
Le principe et les conditions d'application de la procédure de contribution des aéroports, au moyen des recettes de TNSA qui leurs sont affectées, aux dépenses engagées par les riverains pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores sont encadrés par les articles L. 571-14 à L. 571-17 du code des transports.
Ainsi, les riverains concernés peuvent bénéficier d'une aide à l'insonorisation de leur logement, une fois leur dossier validé par une commission consultative d'aide aux riverains (CCAR), dans la limite de plafonds fixés par un arrêté du 23 février 2011987(*). Les plafonds en question ont été revalorisés de 25 % par un arrêté du 26 décembre 2023988(*).
Après une baisse constatée durant la période de crise sanitaire du fait de la chute du trafic aérien, le rendement de la TNSA s'est progressivement redressé pour retrouver son niveau de 2019 à environ 50 millions d'euros.
Rendement annuel de la TNSA (2019-2026)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
B. EN RAISON D'UN ESSOUFFLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION POUR DES PROJETS D'INSONORISATION OBSERVÉ CES DERNIÈRES ANNÉES, LA TRÉSORERIE DE TNSA ISOLÉE DANS LES COMPTES D'ADP S'EST ACCUMULÉE
D'après les données transmises par la direction générale de l'aviation civile (DGAC), au 31 août 2025, dans les comptes d'ADP, le total de la trésorerie provenant de l'affectation du produit de la TNSA représentait 140,2 millions d'euros. En retranchant les sommes déjà engagées pour des projets d'insonorisation validés, le solde des financements TNSA isolés dans les comptes d'ADP représentait 108,5 millions d'euros à la même date, soit 80 % du total des soldes détenus à cette date pour l'ensemble des aéroports français.
Trésorerie « TNSA » des aéroports français
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la DGAC au questionnaire du rapporteur général
L'accumulation d'un tel montant de trésorerie TNSA dans les comptes d'ADP s'explique par un essoufflement des demandes d'indemnisations observées depuis la crise sanitaire et, par voie de conséquence, des aides versées chaque année. Ainsi, alors que jusqu'en 2019 le montant d'aides moyens versé par ADP par an oscillait entre 30 et 40 millions d'euros, il demeure inférieur à 20 millions d'euros depuis la sortie de crise.
Subventions aux travaux d'insonorisation versées par ADP (2020-2024)
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la DGAC au questionnaire du rapporteur général
D'après la DGAC, au 30 avril 2025 le stock de dossiers d'insonorisation relatifs aux aéroports d'ADP en Île-de-France concerne 7 170 logements pour un montant d'aides estimé à 51,7 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL AU BÉNÉFICE DE L'ÉTAT DE LA FRACTION DES SOLDES DE TNSA DES AÉROPORTS QUI EXCÈDE 45 MILLIONS D'EUROS
Le présent article prévoit d'opérer en 2026, au bénéfice du budget général de l'État, un prélèvement exceptionnel sur une part de la trésorerie résultant du dispositif de financement des mesures de lutte contre les nuisances sonores aériennes à proximité des aéroports que détient aujourd'hui certains de ces aéroports.
Pour ce faire, le I de l'article prévoit de réaliser en 2026 un prélèvement exceptionnel au profit du budget général de l'État sur le solde de TNSA figurant dans les comptes des aérodromes des groupes 1 à 3 pour lesquels le solde en question dépasse 45 millions d'euros. En pratique, seul le groupe Aéroports de Paris (ADP) serait ainsi concerné.
Le II prévoit que le montant du prélèvement correspondrait alors à la totalité de la fraction dudit solde excédant ce seuil de 45 millions d'euros.
Enfin, le III précise que le prélèvement serait « opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026 ». Il ajoute que son recouvrement serait « régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN PRÉLÈVEMENT À EXAMINER AVEC ATTENTION POUR QU'IL NE COMPROMETTE PAS LA RÉALISATION DES PROJETS D'INSONORISATION
L'étude d'impact annonce une prévision de rendement d'environ 80 millions d'euros, cependant, la DGAC, considérant que le montant de trésorerie à retenir pour l'application de la disposition correspond au solde duquel est retranché les sommes ayant déjà fait l'objet d'engagements pour des projets d'insonorisation validés, estime que la ponction représenterait plutôt 65 millions d'euros.
Comme précisé dans le commentaire de l'article 36 du présent projet de loi de finances, l'abondement du budget de l'État par des sommes issues de la TNSA suscite de vraies interrogations. En effet, ces sommes ont été initialement prélevées auprès des compagnies aériennes pour soutenir financièrement les riverains des aéroports dans leurs projets d'insonorisation. C'est pour cette raison que le prélèvement structurel sur le flux des recettes de TNSA proposé à l'article 36 du présent projet de loi de finances apparaît problématique. C'est d'autant plus vrai que, comme précisé dans le commentaire de l'article 36, les acteurs du secteur aérien ainsi que l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (Acnusa) contestent la justification invoquée par les évaluations préalables des articles 36 et 43 selon laquelle le produit de TNSA serait structurellement excessif au regard des besoins d'indemnisation.
Le prélèvement ponctuel de la trésorerie « TNSA » d'ADP prévue par le présent article doit tenir compte de l'écart constaté entre les recettes prélevées depuis la crise sanitaire et les aides effectivement versées. Il est factuel de constater que ces dernières années, les sommes consacrées par ADP aux aides à l'insonorisation ont été inférieures à celles qui étaient constatées jusqu'en 2019 et au produit annuel de la TNSA affecté au titre des aéroports franciliens. Même en cas d'accélération des demandes d'indemnisation dans les prochaines années, le niveau de trésorerie accumulé est tel qu'il ne pourrait pas être résorbé à moyen terme.
En outre, au plus fort de la crise, de peur que la baisse considérable du produit de la taxe résultant de l'effondrement du trafic aérien, ne suffise pas à financer les subventions aux projets d'insonorisation, l'État a abondé les fonds TNSA des aéroports, principalement d'ADP, à hauteur de 28 millions d'euros, une somme qui s'est finalement révélée excessive au regard du ralentissement des demandes d'indemnisations constatées ces dernières années.
Cependant, parce que les besoins d'insonorisation restent très significatifs en Île-de-France, il convient de veiller à ce que le prélèvement ponctuel qui sera effectué ne conduise pas à compromettre des projets déjà prévus ou envisagés. D'après l'Acnusa, dans le cadre des plans de gêne sonore actuels (un cadre qui est par ailleurs susceptible d'évoluer comme précisé infra), 33 000 logements resteraient encore à insonoriser en Île-de-France pour un montant d'aides prévisionnel de plus de 500 millions d'euros989(*). À proximité des aéroports d'ADP, de grands projets restent à financer tels que l'insonorisation de grands ensembles à Sarcelles, des projets avec l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou encore un « plan enseignement » destiné à insonoriser 450 établissements scolaires.
En outre, d'après la DGAC une augmentation significative des besoins de financement de projets d'insonorisation, concernant tout particulièrement les aéroports d'ADP en Île-de-France, pourrait se matérialiser dans un proche avenir, et ce, pour deux raisons :
- « Premièrement, le ministre des transports a annoncé, le 10 juillet dernier, un plan pour redynamiser l'insonorisation des logements autour des grands aéroports, ce qui pourrait se traduire par la nécessité de mobiliser des besoins supplémentaires en matière de financement de l'aide à l'insonorisation ;
- Deuxièmement, des élus et des associations de riverains demandent avec insistance, notamment en région parisienne, la révision des plans de gêne sonore, qui déterminent les bénéficiaires de l'aide financière. Ces révisions pourraient entraîner une augmentation très significative (de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers) des ayants-droits »990(*).
Comme indiqué supra, les dispositions du présent article doivent être analysées en complémentarité et en cohérence avec la baisse du plafond d'affectation de TNSA proposé à l'article 36. Ainsi, un travail de réflexion et de concertation doit se tenir d'ici à l'examen du texte en séance publique.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
44
Mesures relatives au financement des missions de
sûreté-sécurité
des aéroports
Dans un contexte d'augmentation dynamique des dépenses relatives aux missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires, le présent article prévoit deux types d'ajustements du dispositif visant à financer ces charges :
- d'une part le relèvement d'un euro du niveau plafond du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) appliqué aux aéroports de classe 2, celui-ci passant de 9,5 à 10,5 euros par passager embarqué ;
- d'autre part le relèvement de 10 centimes d'euros de la limite du tarif de péréquation aéroportuaire, qui passerait de 1,25 euro à 1,35 euro, ainsi que l'assujettissement des aéroports de classe 4, les seuls qui en étaient jusqu'à présent exonérés, à ce tarif.
L'augmentation du plafond tarif des aéroports de classe 2, qui n'a pas évolué au cours des dernières années, est nécessaire pour permettre à ces structures de financer la hausse de leurs charges de sûreté et de sécurité. En effet, le tarif de cinq des six aéroports concernés a atteint le niveau plafond actuellement prévu par la loi.
L'augmentation de 10 centimes de la limite du tarif de péréquation aéroportuaire semble également indispensable pour remédier au déficit de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports de classe 3, notamment en raison du coût résultant du remboursement des avances que l'État leur a versé pendant la crise sanitaire.
Cependant, l'assujettissement des aéroports de classe 4 au tarif de péréquation apparaît totalement inapproprié. En effet, non seulement il augmenterait les charges de ses touts petits aéroports mais son rendement prévisionnel infinitésimal d'environ 90 000 euros pourrait s'avérer inférieur à la hausse des coûts de gestion de la taxe qui résulterait de cette disposition. Aussi, par son amendement I-27 (FINC.27), la commission propose-t-elle de supprimer cette disposition.
La commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.
I. LE DROIT EXISTANT : LE DÉFICIT STRUCTUREL DU MODÈLE DE FINANCEMENT DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES
A. LE TARIF DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DE LA TAXE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS
Le tarif de sûreté et de sécurité est mentionné à l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services en tant que partie intégrante991(*) de la taxe sur le transport aérien de passagers. Le régime juridique de ce tarif, qui correspond à l'ancienne taxe d'aéroport992(*), est déterminé à l'article L. 422-23 du même code. Cet article prévoit que ce tarif s'applique à « chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports ».
Les classes d'aéroports
L'article L. 6328-2 du code des transports prévoit la répartition des aéroports en quatre classes selon leur volume de trafic calculé en unités de trafic. 1 unité de trafic ou « UDT » correspond à 1 000 passagers ou 100 tonnes de fret ou de poste.
La première classe correspond à des volumes supérieurs à 20 millions d'unités de trafic, la deuxième classe à des volumes compris entre 5 millions et 20 millions d'unités de trafic, la troisième classe à des volumes situés entre 5 000 et 5 millions d'unités de trafic et la quatrième classe, qui ne se voit pas appliquer de tarif, correspond aux plus petits aérodromes qui totalisent moins de 5 000 unités de trafic par an.
Ce même article prévoit qu'un « arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3 ».
L'arrêté du 12 mars 2025993(*) a établi cette classification pour la saison 2025-2026. Seul le groupe aéroports de Paris est catégorisé en classe 1. La classe 2 comporte quant à elle six aéroports (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse).
Source : commission des finances du Sénat
Ce tarif de sûreté et de sécurité constitue une taxe collectée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) pour le compte de tiers. À ce titre, cette dernière prélève des frais de gestion.
Conformément à l'article L. 6328-3 du code des transports, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d'aérodromes pour financer les missions d'intérêt général qui leur sont confiées en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
Article L. 6328-3 du code des transports
Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
1° À hauteur de 92 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros ;
2° À hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
Source : article L. 6328-3 du code des transports
L'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services prévoit ainsi que les tarifs sont fixés de telle manière que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, et compte tenu des besoins en financement de l'exploitation de chaque aéroport, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports.
L'article L. 422-23 précise que le tarif de sûreté et de sécurité est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures fixées par le tableau qui figure au deuxième alinéa de l'article, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes. Le dernier arrêté en date ayant fixé ces tarifs a été pris le 12 mars dernier994(*).
Tableau de l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services déterminant les niveaux plancher et plafond des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers selon les classes d'aérodromes
(en euros par passager embarqué)
|
Classe de l'aérodrome |
Tarif minimum |
Tarif maximum |
|
1 |
4,3 |
11,8 |
|
2 |
3,5 |
9,5 |
|
3 |
2,6 |
20 |
Source : article L. 422-23 du CIBS
L'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services prévoit que les passagers en correspondance font l'objet d'une minoration comprise entre 60 % et 85 %995(*) du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, ce taux de minoration étant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. L'article 1 d'un arrêté du 29 mars 2024996(*) a fixé le taux de minoration à 72 %.
Comme l'illustre le graphique ci-après, tous les aéroports de classe 2 mis à part Nantes ont vu leur tarif de sûreté et de sécurité porté à son niveau plafond de 9,5 euros pour la saison aéronautique 2025-2026.
Tarifs de sûreté et de sécurité appliqués aux aéroports de classe 1 et 2 pour la saison 2025-2026
(en euros)
ADP : Aéroports de Paris
Source : commission des finances du Sénat, d'après les articles A. 422-12 et A. 422-13 de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services
Depuis plusieurs années, la situation des aéroports de classe 3 illustrait la très forte tension qui pèse sur le système structurellement déficitaire du financement de leurs dépenses de sûreté et de sécurité, à tel point que le plafond de leur tarif a été réévalué chaque année depuis 2022 pour être finalement porté à 20 euros par l'article 134 de la loi de finances pour 2025997(*). Le tarif plafond des aéroports de classe 2 n'a quant à lui pas été réévalué dans un passé récent et reste fixé à 9,5 euros.
Évolution des niveaux plafond des tarifs de
sûreté et de sécurité de la taxe
sur le
transport aérien de passagers selon les classes d'aérodromes
(2021-2025)
(en euros par passager embarqué)
|
Classe de l'aérodrome |
Tarif maximum 2021 |
Tarif maximum 2022 |
Tarif maximum 2023 |
Tarif maximum 2024 |
Tarif maximum 2025 |
|
1 |
10,8 |
10,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
2 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
3 |
14 |
15 |
16 |
17,2 |
20 |
Source : commission des finances du Sénat
B. UN TARIF DE PÉRÉQUATION AU PROFIT DU FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DES PETITS AÉROPORTS
La taxe sur le transport aérien de passagers comporte un tarif de péréquation aéroportuaire qui est prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Ce mécanisme de péréquation a été instauré en 2008 en application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances initiale pour 2008998(*). En vertu des dispositions de l'article L. 422-24 du même code, ce tarif, identique pour l'ensemble des aéroports de classes 1 à 3, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 euro999(*). Au moment de son instauration en 2008, cette limite avait été fixée à 1 euro. Elle avait par la suite été portée à 1,25 euro par une disposition de l'article 111 de la loi de finances initiale pour 20101000(*). Les aéroports de classe 4 sont aujourd'hui exonérés de ce tarif de péréquation.
L'article 5 de l'arrêté du 12 mars 2025 précité a augmenté ce tarif à 1,25 euro, soit le niveau plafond, au titre de la saison aéronautique 2024-20251001(*). Lors de la saison aéronautique précédente (2023-2024), ce tarif s'établissait encore à 1 euro.
En vertu des dispositions de l'article L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services ainsi que celles du 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports, le produit de ce tarif est exclusivement affecté aux aérodromes de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile1002(*) afin d'assurer la couverture du coût de leurs missions de sûreté et de sécurité telles que définies par l'article L. 6328-3 du code des transports. Pour les aéroports de classe 4, l'affectation d'une fraction du tarif de péréquation constitue leur unique ressource pour couvrir leurs dépenses de sûreté et de sécurité.
De par ses règles de fonctionnement, ce système permet ainsi d'assurer un mécanisme de péréquation du financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires au bénéfice des petits aérodromes des classes 3 et 4.
C. LE FINANCEMENT DES MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES EST SOUMIS À DE FORTES TENSIONS
La crise sanitaire et l'effondrement du trafic aérien qui s'en est suivi a brisé une tendance qui s'orientait vers le retour à un quasi équilibre du financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires. En urgence, l'État avait alors alloué aux aéroports des avances remboursables pour un montant cumulé de 700 millions d'euros entre 2020 et 2022. Les échéances de remboursement de ces avances doivent s'étaler jusqu'en 2032. Ces remboursements entrent dans le périmètre des coûts de sûreté-sécurité. Par conséquent, les échéances de remboursement des avances se traduisent mécaniquement par des hausses des dépenses de sûreté et de sécurité des aéroports ayant vocation à être couvertes par le tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP.
D'après la DGAC, en 2025, comme en 2024, le produit des tarifs de sûreté et de sécurité devrait avoisiner le milliard d'euros, un montant qui ne permettra pas d'équilibrer le modèle de financement des missions de sûreté et de sécurité, qui restera déficitaire.
Au cours des années à venir, le système de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires restera soumis à de très fortes tensions, notamment en raison de nouvelles obligations réglementaires. À ce titre, le développement des équipements de détection d'explosifs pour les bagages de cabines (dits « EDS1003(*) cabine ») dans les aéroports français devrait, d'après la DGAC, occasionner un montant total d'investissements d'environ 500 millions d'euros.
Par ailleurs, la dynamique haussière de ces charges est aussi stimulée par une augmentation des coûts salariaux liée à la revalorisation des minimas conventionnels applicables au personnel du secteur de la sûreté : + 5 % à compter de 2024, + 3,2 % à compter de 2025 et + 2,8 % à compter de 2026.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : DES AJUSTEMENTS DU TARIF DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DANS UN CONTEXTE OÙ LE COÛT DE CES MISSIONS CONNAÎT UNE FORTE DYNAMIQUE
Dans un contexte où le coût des dépenses relatives aux missions de sûreté et de sécurité des aéroports connaît une forte dynamique haussière et que le modèle de financement actuel de ces charges, reposant sur le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) présente une situation de déficit chronique pour certains aéroports, le présent article propose deux ajustements de ce dispositif :
- un relèvement du niveau plafond du tarif appliqué aux aéroports de classe 2 ;
- un relèvement du tarif de péréquation aéroportuaire ainsi que l'assujettissement des aéroports de classe 4 à celui-ci.
Ces mesures ont pour principal objectif d'augmenter les ressources collectées via le tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP.
A. LE RELÈVEMENT D'UN EURO DU TARIF PLAFOND POUR LES AÉROPORTS DE CLASSE 2
En proposant de modifier le tableau figurant à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, le 1° du I prévoit d'augmenter à hauteur de 1 euro le plafond du tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP pour les aéroports de classe 2. Celui-ci passerait ainsi de 9,5 à 10,5 euros par passager embarqué.
Tableau de l'article L. 422-23 du code
des impositions sur les biens et services
qui résulterait des
dispositions du présent article
(en euros par passager embarqué)
|
Classe de l'aérodrome |
Tarif minimum |
Tarif maximum1004(*) |
|
1 |
4,3 |
11,8 |
|
2 |
3,5 |
10,5 |
|
3 |
2,6 |
20 |
Source : commission des finances du Sénat
B. LE RELÈVEMENT DE 10 CENTIMES D'EUROS DU TARIF DE PÉRÉQUATION ET L'ASSUJETISSEMENT DES AÉROPORTS DE CLASSE 4 À CELUI-CI
En modifiant l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, le 2° du I du présent article prévoit :
- d'une part, de relever de 10 centimes d'euros la limite supérieure du tarif de péréquation aéroportuaire, la faisant passer de 1,25 euro à 1,35 euro ;
- d'autre part, d'assujettir les aéroports de classe 41005(*), les seuls qui en étaient jusqu'à présent exonérés, au tarif de péréquation aéroportuaire.
Le II du présent article prévoit quant à lui que l'arrêté déterminant les modalités de répartition du tarif de péréquation au bénéfice des aérodromes des classes 3 et 4 soit pris conjointement par le ministre chargé du budget et celui en charge de l'aviation civile, alors qu'aujourd'hui ce dernier est le seul à signer ce texte.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES
FINANCES :
DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES AU FINANCEMENT DES
MISSIONS DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DES
AÉROPORTS DE CLASSES 2 ET 3 MAIS UN ASSUJETISSEMENT INAPPROPRIÉ
DES AÉROPORTS DE CLASSE 4 AU TARIF DE
PÉRÉQUATION
Depuis la crise sanitaire, chaque année, en loi de finances, des dispositions législatives sont adoptées pour tenter de résorber le déficit, devenu structurel, du mode de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires. Ces mesures font l'objet d'un paramétrage prudent dans la perspective de ne pas affecter de manière excessive la compétitivité des aéroports, en particulier des aéroports régionaux, et, plus largement l'attractivité de la desserte aérienne du territoire national dans un contexte de pénurie d'aéronefs qui incite les compagnies, en particulier à bas coûts, à s'établir sur les liaisons européennes les plus rentables. La rentabilité de certaines lignes se jouant souvent à quelques euros par passager, la moindre évolution des taxes sur le transport aérien est potentiellement susceptible d'avoir des conséquences sur la desserte aérienne des territoires et l'attractivité des aéroports de province.
Aussi, les ajustements successifs du mécanisme de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires s'apparentent-ils à un exercice d'équilibrisme entre la nécessité de combler le déficit de ce modèle et la compétitivité du transport aérien hexagonal. C'est une fois encore à cet exercice que nous nous livrons en examinant les dispositions paramétriques proposées par le présent article.
Sans éluder les conséquences potentielles qui pourraient en résulter sur la compétitivité de certains aéroports, elles apparaissent néanmoins indispensables à court terme pour participer au rééquilibrage du modèle de financement des missions de sûreté et de sécurité aéroportuaires, plus que jamais mis sous tension par le dynamisme des dépenses afférentes à ces missions.
Ainsi, l'augmentation de 10 centimes d'euros du plafond du tarif de péréquation devrait, d'après la DGAC, dégager un rendement supplémentaire d'environ 10 millions d'euros destiné à résorber le déficit de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports de classe 3. Cette mesure permettrait notamment de couvrir la moitié du coût annuel pour ces aéroports du remboursement des avances versées par l'État pendant la crise sanitaire.
Il est notable par ailleurs que le niveau plafond du tarif de péréquation fixé dans la loi, atteint pour la saison aéronautique actuel, n'ait pas été réévaluée depuis 16 ans. En outre, puisqu'elle ne porte que sur 10 centimes d'euros appliqués à l'ensemble des aéroports, l'augmentation du tarif de péréquation n'apparaît pas comme susceptible d'affecter sensiblement la compétitivité des aéroports et du transport aérien en France.
Toujours selon la DGAC, l'augmentation de 1 euro du plafond du tarif de sûreté et de sécurité pour les aéroports de classe 2 pourrait dégager un rendement supplémentaire d'environ 17 millions d'euros destiné à financer les missions de sûreté et de sécurité de cette catégorie d'aéroports. Cette évolution semble aujourd'hui incontournable puisqu'en 2025, compte-tenu de l'augmentation de leurs charges, tous les aéroports de cette catégorie, hormis Nantes, ont vu leur tarif être porté au niveau plafond actuel de 9,5 euros par passager. Il est par ailleurs notable, qu'à l'instar du tarif de péréquation et au contraire des aéroports de classe 3, le plafond du tarif des aéroports de classe 2 n'a pas été réévalué dans un passé récent.
Pour 2025, la DGAC évalue le déficit cumulé du financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports de classe 2 à 20 millions d'euros. Aussi, semble-t-il vraisemblable qu'une nouvelle hausse du tarif plafond de cette catégorie d'aéroports soit rendue nécessaire dans les années à venir. Cependant, comme le souligne l'évaluation préalable de l'article, une hausse trop significative du tarif de sûreté et de sécurité de ces aéroports pourrait affecter leur compétitivité et, in fine, aboutir à une baisse de l'assiette de la taxe, enclenchant une forme de cercle vicieux qui ne permettrait pas de résorber le déficit de financement des missions de sûreté et de sécurité : « une augmentation du tarif de sûreté et de sécurité se traduit par une hausse du coût de touchée facturé et in fine par un renchérissement du prix du billet, pouvant générer une éviction partielle du trafic. En effet, pour certains aéroports régionaux, exposés à une forte mise en concurrence exercée par les compagnies à bas coûts et permise par un maillage aéroportuaire dense, le levier tarifaire du tarif de sûreté et de sécurité est fortement contraint, et les bénéfices d'une augmentation trop importante du tarif de sûreté et de sécurité peuvent être annulés par un effet volume défavorable ».
Pour toute ces raisons, il apparaît que l'exercice d'équilibrisme entre apurement du déficit des missions de sûreté et de sécurité et enjeu d'attractivité des aéroports semble respecté par les hausses de plafonds proposées dans le présent article.
En revanche, la mesure visant à assujettir les aéroports de classe 4 semble beaucoup plus problématique et, d'une certaine façon assez incompréhensible tant elle illustre certains des pires travers du maquis fiscal français. En effet, d'après la DGAC, le rendement attendu de cette mesure atteindrait péniblement les 90 000 euros, à tel point que les coûts supplémentaires générés par la complexification qu'elle induit pourraient s'avérer supérieurs. En réponse au questionnaire du rapporteur, la DGAC en concluait que cette mesure « n'aurait pas de réel effet utile et mobiliserait des ressources administratives déjà contraintes ».
Le rapporteur général entend « tuer dans l'oeuf » cette mesure ubuesque. Aussi, l'amendement I-27 (FINC.27) de la commission propose-t-il de supprimer cette disposition de l'article.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE
45
Évaluation du prélèvement opéré
sur les recettes de l'État au titre
de la participation de la France
au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
Le présent article évalue le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 28,8 milliards d'euros pour 2026, soit une hausse substantielle de 5,7 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2025 (+ 5,8 milliards d'euros par rapport aux dernières prévisions d'exécution pour 2025).
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT ET L'EXÉCUTION DU PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES AU PROFIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN 2025
A. UN PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES PAR NATURE DIFFICILE À ÉVALUER
L'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances1006(*) définit le prélèvement sur recettes reversé au budget de l'Union européenne comme « un montant déterminé de recettes de l'État [...] rétrocédé directement au profit [...] de l'Union européenne en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ». Celui-ci doit être défini et évalué « de façon précise et distincte dans la loi de finances ».
Pour mémoire, en application de la décision relative au système des ressources propres (DRP) du 14 décembre 20201007(*), entrée en vigueur au 1er juin 2021 à l'issue du processus de ratification par l'ensemble des États membres, les ressources de l'Union européenne sont composées :
- des ressources propres traditionnelles (RPT), composées des droits de douane nets des frais de perception retenus par les États membres et évalués forfaitairement à 25 % des droits perçus ;
- de la ressource fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dû par chaque État membre et calculée par l'application d'un taux d'appel de droit commun fixé à 0,30 % à une assiette harmonisée ;
- de la ressource fondée sur le taux de recyclage des déchets plastique, obtenue par l'application d'un taux d'appel s'élevant à 0,8 euro par kilo de déchets non recyclés pour chaque État membre. Cette ressource a été introduite par la DRP 2021-2027 ;
- de la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB), obtenue par l'application d'un taux propre à chaque État membre en fonction de sa part dans l'assiette totale de l'ensemble. Cette ressource constitue la ressource d'équilibre du budget de l'Union européenne, c'est-à-dire que son montant est calculé de façon à financer la différence entre le montant des dépenses de l'année et le produit des autres ressources propres de l'Union européenne ;
- d'autres ressources marginales, telles que le report du solde de l'exercice antérieur ou le produit des amendes.
Depuis la loi de finances pour 20101008(*), le PSR-UE n'intègre plus les ressources propres traditionnelles, qui sont comptabilisées en compte de tiers. Par conséquent, le prélèvement sur recettes est composé de la ressource fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la ressource fondée sur le revenu national brut (RNB) et de la ressource fondée sur le plastique.
Le montant total de la contribution de la France au budget de l'Union européenne recouvre un périmètre plus large que le seul prélèvement sur recettes, puisqu'il intègre également les ressources propres traditionnelles (RPT) nettes des frais de perception, c'est-à-dire les droits de douane reversés à l'Union européenne.
L'évaluation du prélèvement sur recettes est fondée sur les prévisions de recettes et de dépenses de l'Union européenne, c'est-à-dire :
- d'une part, sur le besoin de financement de l'Union européenne de l'année N estimé à partir des crédits de paiement prévus dans le projet de budget européen pour l'année N, qui dépend lui-même du cadre financier pluriannuel 2021-2027, des éventuels budgets rectificatifs présentés en N-1, et du solde du budget européen N-1 qui sera reporté sur l'exercice N ;
- d'autre part, sur les données prévisionnelles relatives aux ressources propres assises sur la TVA et la RNB et des hypothèses de recouvrement des droits de douane.
Ces données sont fournies par la Commission européenne lors du comité consultatif des ressources propres (CCRP) qui se tient chaque année en mai. Les hypothèses retenues pour l'année N, fournies en N - 1, font ensuite l'objet d'une révision lors du CCRP de l'année N, ce qui peut se traduire par l'élaboration d'un budget rectificatif.
B. UNE CONTRIBUTION FRANÇAISE 2025 CONFORME AUX PRÉVISIONS
Pour 2025, la loi de finances initiale avait évalué le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 23,098 milliards d'euros. Cette prévision a été abaissée de 125 millions d'euros, pour atteindre 22,973 milliards d'euros dans les prévisions présentées dans le dernier projet de loi de finances. Les évolutions de la contribution française ont suivi celles du budget européen.
À date, trois projets de budgets rectificatifs ont été présentés par la Commission pour modifier le compromis initialement trouvé au niveau européen :
- un budget rectificatif n° 1, déposé le 9 avril 2025 et adopté le 12 septembre 2025, intègre l'excédent de 2024 qui s'élève à 1,3 milliard d'euros en CP : 1,07 milliard d'euros de surplus d'« autres recettes » (pénalités, intérêts de retard et revenus des produits financiers) et 272 millions d'euros résultant de sous-exécutions et annulation de crédits reportés ;
- un budget rectificatif n° 2, déposé le 4 juillet 2025, comporte un volet « dépenses » qui prévoit un renforcement de 3,5 milliards d'euros en CP pour le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), à la suite d'une accélération des besoins de paiement1009(*). Ce budget formalise aussi la mise à jour du volet « recettes » à la suite du comité consultatif sur les ressources propres (CCRP) pour des montants moindres ;
- un projet de budget rectificatif n° 3, déposé le 3 octobre 2025, prévoit de nouvelles hausses de dépenses à hauteur de 2,5 milliards d'euros en CP, notamment sous l'effet de l'accélération des dépenses de la politique de cohésion1010(*). Toutefois, cet effet est compensé par une hausse des recettes de 2,5 milliards d'euros : 1,2 milliard d'euros au titre des autres recettes, via les revenus d'amendes, et 1,3 milliard d'euros au titre d'une hausse de la prévision de droits de douane.
La stabilité de l'exécution en 2025 masque des évolutions divergentes en dépenses et en recettes :
- d'importantes hausses de dépenses ont été constatées au niveau de l'UE (+ 6 milliards d'euros pour l'UE, soit + 1 milliard d'euros pour la France), avec l'accélération de la consommation des fonds structurels (PAC et fonds de cohésion) ;
- compensées d'une part, par des hausses de recettes souvent exceptionnelles au niveau de l'UE (+ 3,5 milliards d'euros), issues des « autres recettes » (amendes, pénalités, intérêts de retard, produits financiers, etc.), d'autre part, pour la France, par la révision à la baisse de sa clef de contribution, reflétant sa moindre importance économique sur le continent.
Évolution du prélèvement sur
recettes au profit de l'Union européenne
par rapport à la
prévision
(en millions d'euros)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Crédits votés en PLF |
19 912 |
21 443 |
21 480 |
27 200 |
26 359 |
24 994 |
21 610 |
23 098 |
|
Crédits exécutés |
20 645 |
21 025 |
23 691 |
26 368 |
25 230 |
23 873 |
22 276 |
22 972* |
|
Écart PLF/exécution |
3,7 % |
- 1,9 % |
10,3 % |
- 3,06 % |
- 4,28 % |
- 4,49 % |
+ 3,08 % |
- 0,54 % |
* D'après la prévision actualisée figurant dans l'annexe « Voies et moyens », tome I, du projet de loi de finances pour 2026.
Source : commission des finances, à partir des documents budgétaires
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE CONTRIBUTION FRANÇAISE QUI PROGRESSE TRÈS FORTEMENT EN 2026
A. UN PSR-UE EN TRÈS FORTE HAUSSE EN 2026, PRINCIPALEMENT POUR DES RAISONS CYCLIQUES
Pour 2026, l'article 45 du présent projet de loi de finances évalue le montant du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne à 28,8 milliards d'euros, soit une hausse substantielle de 24,6 % par rapport à la prévision d'exécution à date pour 2025.
Cette hausse marquée (+ 5,7 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en LFI 2025) est essentiellement expliquée par une hausse des crédits de paiement proposés pour 2026 sous l'effet d'un phénomène de rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion (+ 26 milliards d'euros sur la rubrique 2a « Cohésion économique, sociale et territoriale » par rapport au budget initial 2025).
La hausse substantielle de la contribution française était largement attendue. En effet, la consommation des crédits s'accentue systématiquement à mesure que le cadre financier pluriannuel (CFP) progresse et les rattrapages sont fréquents en fin d'exercice. En outre, cet effet est renforcé pour le CFP 2021-2027 par l'ampleur du plan Next Generation EU, dont les crédits ne seront déboursés que jusqu'à 2026, ce qui a pu renforcer la sous consommation de fonds structurels dans certains pays.
La hausse observée est même inférieure aux attentes. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, les services du ministère de l'économie et des finances estimaient en effet qu'une très forte hausse du prélèvement sur recettes était à prévoir pour les années 2026 et 2027, avec des prélèvements sur recettes attendus respectivement à hauteur de 30,4 milliards d'euros et 32,4 milliards d'euros.
La direction du budget explique l'écart d'1,6 milliard d'euros, entre cette prévision de 30,4 milliards d'euros à et les 28,8 milliards d'euros figurant dans le PLF 2026, par « une multitude de causes dont la baisse de la prévision de dépenses, la baisse des clefs de contribution française mises à jour en mai 2025 dans le cadre du comité consultatif sur les ressources propres (CCRP) et l'intégration des corrections pour exercices antérieurs », dans des proportions comparables.
Dans son ensemble, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, qui en plus du PSR-UE inclut aussi les ressources propres traditionnelles (droits de douane) nettes des frais de perception connaît une évolution similaire à celle du PSR-UE.
La contribution de la France au budget de l'UE
(en milliards d'euros)
Note : *Contribution estimée dans le PLF pour 2026
Source : commission des finances d'après la documentation budgétaire et les projets de budgets de la Commission européenne
B. UNE HAUSSE DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE AU BUDGET EUROPÉEN QUI DEVRAIT SE POURSUIVRE POUR BOUCLER LE CFP 2021--2027
Le niveau élevé de la contribution française attendue en 2026 trouve deux explications : un cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 qui attend plus de ses États contributeurs que le CFP précédent et un cycle financier qui concentre les paiements en fin de cadre.
Ce second effet de retour à la moyenne explique la forte hausse attendue en 2026, qui devrait encore s'accentuer en 2027, la contribution française atteignant alors 31,2 milliards d'euros, soit un effort supplémentaire de 2,4 milliards d'euros pour la France.
Évolution du montant du
prélèvement sur recettes
au profit de l'Union
européenne
(en milliards d'euros, en euros courants)
Note : * PLF 2026 ; ** estimation de la direction du budget
Source : commission des finances du Sénat, d'après la documentation budgétaire
Dans l'absolu, le niveau élevé de la contribution française ne fait que refléter le niveau de financement convenu dans le CFP 2021-2027. Pour la France, ceci traduit une hausse du montant annuel moyen du PSR-UE, qui passe, en euros courants, de 20,1 milliards d'euros pour le CFP 2014-2020 à 25,7 milliards d'euros pour le CFP 2021-2027 (+ 28 %). Cette hausse reflète une progression en euros courants entre le CFP 2014-2020 (avec un budget total d'1,064 milliard d'euros) et le CFP 2021-2027 (budget total d'1,215 milliards d'euro, soit une hausse de 14 %), à laquelle il convient d'ajouter les 21,0 milliards d'euros de dépenses nouvelles issus de la révision du CFP de 2024.
En retraitant l'inflation, on observe en euros constants (prix de 2025) une hausse qui reste non-négligeable, le PSR-UE français passant de 23,9 milliards d'euros par an pour le CFP 2014-2020 à 26,5 milliards d'euros par an pour le CFP 2021-2027 (+ 11 %). Cette hausse est expliquée par les nouveaux besoins de l'Union et, surtout, est fortement accentuée pour la France par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'un des principaux contributeurs de l'Union. Le Brexit a ainsi fortement redistribué la charge du CFP 2021-2027, la contribution du Royaume-Uni représentant chaque année autour de 12 % du budget de l'Union là où la contribution française oscillait entre 15 % et 16 %.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES NÉGOCIATIONS CRUCIALES S'OUVRENT DÉSORMAIS POUR FIXER LE NIVEAU DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE POUR LES SEPT PROCHAINES ANNÉES
La Commission européenne a présenté le 16 juillet 20251011(*) sa proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2028-2034. Le paquet CFP constitué contient un ensemble de 24 propositions de textes ordonnés dans une articulation simplifiée :
- la proposition de budget est organisée en 4 rubriques contre 7 actuellement (cf. détail ci-après1012(*)) ;
- afin de gagner en flexibilité, le CFP proposé regroupe de nombreux programmes dans des enveloppes plus larges : au total, le nombre de programmes est ramené de 52 à 16.
Dans l'ensemble, la Commission propose un plafond d'engagements de 1 763 milliards d'euros (prix de 2025, soit 1 985 milliards d'euros courants) et un plafond de paiements de 1 761 milliards d'euros (prix de 2025, soit 1 980 milliards d'euros courants) pour la période 2028-2034.
À ces montants s'ajoutent différents instruments financiers visant à confier une marge de manoeuvre à l'Union européenne (en plus de la reconduction de l'instrument de flexibilité existant, la proposition prévoit un mécanisme de crise), de nouveaux engagements financiers extrabudgétaires (réserve Ukraine et prêts stratégiques), et la reconduction de la facilité européenne pour la paix1013(*).
Quel est le niveau d'ambition de cette nouvelle proposition ? La proposition de la Commission européenne se situe à 1,26 % du revenu national brut européen. Or le prochain CFP intègre le remboursement du plan de relance européen Next Generation EU, pour un montant équivalent à 0,11 % du RNB de l'UE : ne sont donc consacrées aux politiques de l'Union que 1,15 % du RNB de l'Union, soit une proportion du même ordre que celle du CFP en vigueur.
Comparaison des CFP 2021-2027 et 2028-2034
(en %du RNB de l'UE)
Source : commission des finances d'après le service de recherche du Parlement européen (EPRS)
La proposition de la Commission européenne implique néanmoins un choc budgétaire pour les États membres. En effet, la comparaison des proportions de RNB peut être trompeuse. Si en 2021, les États membres se sont engagés à hauteur de 1,13 % du PIB, les crédits du CFP étaient calibrés selon l'hypothèse standard d'un taux d'inflation à 2 % : or dans les faits, l'inflation a été bien supérieure, dépréciant la valeur réelle de ce CFP, estimée à 1,02 % du RNB.
Taux d'inflation annuel dans l'Union
européenne
(indice des prix à la consommation
harmonisé)
Source : commission des finances d'après Eurostat
La proposition de la Commission est donc d'ambition comparable à la proposition votée par les États membres en 2021, mais bien plus ambitieuse que le CFP actuellement en vigueur, représentant une hausse de plus de 40 %, comme l'indique le graphique ci-dessous.
Comparaison des CFP 2021-2027 et
2028-2034
en tenant compte de l'inflation
(en milliards d'euros, en prix de 2025)
Source : commission des finances d'après la Commission européenne et le service de recherche du Parlement européen (EPRS)
Les services du ministère de l'économie et des finances estiment que la proposition de la Commission implique que le PSR-UE annuel moyen passe de 26 milliards d'euros pour le CFP 2021-2027 à 38 milliards d'euros pour le CFP 2028-2034, soit une hausse significative de 12 milliards d'euros par an.
À ce stade, il ne s'agit que d'une proposition de la Commission européenne, qui se veut d'une ambition comparable à celle portée initialement par le CFP précédent. Elle vise principalement, d'une part, à maintenir le financement de politiques consensuelles au sein de l'union (PAC et politique de cohésion) et d'autre part à doper sa compétitivité, suivant les recommandations du rapport Draghi1014(*). Les États membres doivent maintenant étudier et se prononcer sur cette proposition.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
46
Mise à la charge de tout ou partie des frais d'enquête
pénale à la charge
de la personne condamnée
prévue à l'article 800-1 du code
de procédure
pénale
Alors que les frais de justice exposés lors d'une procédure pénale sont, par principe, mis à la charge de l'État, le présent article propose de les mettre au contraire à la charge des personnes condamnées, sauf pour des personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : LES FRAIS DE JUSTICE SONT, SAUF EXCEPTIONS, À LA CHARGE DE L'ÉTAT
A. LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT
Selon le code de procédure pénale, « constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés »1015(*).
Comme l'a indiqué le rapporteur spécial des crédits destinés à la justice, Antoine Lefèvre, dans un rapport sur les frais de justice qu'il a présenté le 1er octobre dernier devant la commission des finances1016(*), ces frais sont d'une grande diversité, puisqu'ils comprennent aussi bien les honoraires des experts et des interprètes-traducteurs que les frais de gardiennage des biens saisis, le coût des interceptions téléphoniques et les frais résultant de nombreuses autres mesures ordonnées par un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Leur coût budgétaire est estimé à 759,7 millions d'euros en 2026 selon le projet annuel de performances de la mission « Justice », ce qui représente une augmentation de plus de moitié par rapport à 2017.
Évolution du montant des frais de justice dans le budget de l'État
(en millions d'euros)
Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget
Le nombre d'affaires étant plutôt stable au cours des années récentes, l'augmentation de la dépense en frais de justice semble liée à la complexité croissante des enquêtes. À titre d'exemple, la progression du nombre d'enquêtes pour violences sexuelles et intrafamiliales accroît les besoins d'expertises médicales ou psychologiques, tandis que les enquêtes pour narcotrafic reposent sur un nombre élevé d'interceptions judiciaires.
B. LES FRAIS DE JUSTICE SONT À LA CHARGE DE L'ÉTAT, SAUF DANS UN NOMBRE LIMITÉ DE CAS
L'article 800-1 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État, sans pouvoir être récupérés auprès des personnes condamnées ou des parties civiles.
Ce principe est assorti de trois séries d'exceptions.
D'une part, si, durant la phase d'instruction1017(*), le juge ou la chambre d'instruction a prononcé une amende civile à l'égard d'une partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent être mis à la charge de celle-ci. Cette clause n'est toutefois pas applicable en matière criminelle, en matière de délits contre les personnes, ou encore lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
D'autre part, les frais de justice sont en principe mis à la charge des personnes morales condamnées ou qui ont conclu une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État.
Enfin, les frais d'interprétariat peuvent être mis à la charge d'une personne prévenue qui n'a pas comparu ou qui a informé tardivement de son absence à l'audience.
Ce principe de non récupération des frais de justice auprès des personnes condamnées n'a pas toujours été en vigueur, puisqu'il remonte à 19931018(*). Auparavant, les frais occasionnés par le procès étaient mis à la charge de la personne condamnée, en application des articles 366 et 473 anciens du code de procédure pénale.
La réforme de 1993 a mis les frais de justice à la charge de l'État pour des raisons essentiellement pratiques, constatant la complexité du calcul des dépens, les problèmes résultant de la gestion d'une masse importante de mémoires et le cas des redevables sans domicile fixe1019(*).
En revanche, le droit fixe de procédure a alors été maintenu et son montant a été revalorisé. Toute personne condamnée doit en effet payer un droit fixe de procédure d'un montant variant de 62 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle à 1 054 euros pour les décisions des cours d'assises1020(*). Si elle a été condamnée pour conduite sous l'influence de stupéfiants, le montant est rehaussé d'une somme forfaitaire correspondant aux indemnités maximales prévues pour les analyses toxicologiques.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : POSER LE PRINCIPE DU PAIEMENT DES FRAIS D'ENQUÊTE PÉNALE PAR LES PERSONNES CONDAMNÉES, TOUT EN MÉNAGEANT DES ADAPTATIONS AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES
Le présent article, dans son I, réécrit largement l'article 800-1 précité du code de procédure pénale afin de poser le principe selon lequel les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile.
Il précise également que les frais de justice sont à la charge d'une personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public, ce cas n'étant pas couvert par le principe général de mise à la charge de la personne condamnée.
Dans le cas où plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, l'article organise le partage du paiement à parts égales, sans solidarité entre les personnes condamnées.
Les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou mineures sont exemptées du paiement des frais de justice.
Enfin, une exception concerne les frais d'interprétariat, qui restent à la charge de l'État, sauf dans le cas, prévu par le droit existant et décrit supra, où le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience ou a prévenu tardivement de son absence.
La juridiction conserve une très large marge d'appréciation afin de tenir compte des capacités contributives des personnes condamnées. Elle peut modifier la répartition du paiement entre celles-ci ou décider de manière globale la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État.
Enfin, le II de l'article précise que les nouvelles règles sont applicables aux frais de justice engagés dès la publication de la présente loi de finances.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : APPROUVER UNE DISPOSITION QUI FAIT PARTICIPER LES PERSONNES CONDAMNÉES AU FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
Le présent article rejoint une proposition faite par le rapporteur spécial des crédits de la Justice pour la commission des finances, Antoine Lefèvre, dans le rapport précité sur les frais de justice qu'il a présenté le 1er octobre dernier : « Étendre le principe de recouvrement des frais de justice pénale à l'ensemble des personnes physiques, avec possibilité d'exonération par le juge ».
Il convient de ne pas exagérer les ressources qui pourraient être attendues de l'instauration de ce principe. Si l'évaluation préalable du présent article estime à un montant de 30 à 60 millions d'euros le produit résultant potentiellement de cette mesure, ces sommes seront certainement, au moins dans un premier temps, difficiles à recouvrer effectivement pour des raisons techniques. En effet, il est très difficile, en pratique, de recenser l'intégralité des mesures ordonnées par les magistrats ou les officiers de police judiciaire au cours d'une procédure, et de mesurer les coûts effectifs de toutes ces mesures. Des améliorations techniques, avec l'instauration d'un identifiant de dossier judiciaire, devraient permettre de pallier au moins partiellement cet inconvénient au cours des années à venir. L'évaluation préalable envisage d'obtenir les recettes attendues de cet article à compter de 2028. Pour ce qui concerne l'année 2026, le rendement ne peut être que négligeable, le recouvrement ne pouvant commencer qu'après la fin des procédures occasionnant des frais de justice ; l'évaluation préalable estime ce rendement à 2 millions d'euros.
En outre, la situation financière de nombreuses personnes condamnées ne leur permettra de toute manière pas de régler le montant de ces frais, surtout si elles doivent dans le même temps verser des indemnités aux victimes.
Il faut donc approuver la souplesse laissée par la rédaction de cette disposition, qui permettra au juge d'écarter la mise à la charge de la personne condamnée du paiement des frais de justice, lorsque leur recouvrement aurait peu de chances d'être suivi d'effet.
Il n'en reste pas moins qu'il parait juste et approprié de faire participer les justiciables condamnés au financement du fonctionnement de la justice. La commission a donc approuvé l'instauration de ce principe, dont la mise en oeuvre devra être surveillée périodiquement.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 47
Répartition entre les autorités de gestion
de la prise en charge du coût
des refus d'apurement de certaines
dépenses du fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) par la Commission européenne
Le présent article prévoit d'introduire une dérogation législative pour permettre à l'État et aux autorités de gestion régionales de convenir d'une répartition forfaitaire du coût des refus d'apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne pour la programmation 2014-2022.
En effet, depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les régions sont financièrement responsables de tels refus d'apurement. Toutefois, comme cela a été notamment pointé par la Cour des comptes dans un rapport remis en 2018 à la commission des finances sur la chaîne de paiement des aides agricoles (2014-2017), l'enchevêtrement des responsabilités juridiques est tel qu'aujourd'hui, la simple application de la loi emporterait un risque contentieux trop important. Aussi, dans les faits, l'État est le seul à supporter le coût de ces apurements.
La concertation avec l'association Régions de France a permis d'aboutir ces derniers mois à un accord de principe sur une répartition forfaitaire de la charge de ces corrections pour la programmation 2014-2022 uniquement : le présent article propose les modifications législatives nécessaires pour que ces corrections puissent ultérieurement être réparties par décret.
L'État supportant aujourd'hui le seul le coût des apurements, cet article, qui permet in fine une refacturation aux régions, doit générer des recettes futures, qui sont encore très incertaines : plusieurs chiffres ont été communiqués sur le montant des apurements à répartir (entre 21 millions d'euros et 134 millions d'euros) et les modalités même de répartition entre l'État et les régions n'ont pas encore été arrêtées.
Le présent article permet néanmoins à l'État et aux régions de trouver une solution pragmatique et négociée pour mettre au clair les responsabilités respectives.
La commission des finances propose donc d'adopter cet article sans modification.
I. LE DROIT EXISTANT : UNE RÉGIONALISATION INABOUTIE QUI, JUSQU'À 2022, FAIT QUE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DES RÉGIONS NE SAURAIT ÊTRE INTÉGRALE
A. LES DÉPENSES DE LA POLITIQUE AGRICOLE (PAC) SONT PRÉFINANCÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES PUIS REMBOURSÉES PAR L'UNION EUROPÉENNE SI LES CONDITIONS SONT RESPECTÉES
Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est, avec le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), l'un des deux principaux instruments de financement de la politique agricole commune (PAC). Celle-ci est organisée autour de deux piliers :
- un premier pilier rassemble les aides directes aux agriculteurs et les outils concourant à l'organisation commune des marchés ;
- un second pilier concerne les aides au développement rural (principalement orientées autour des thématiques suivantes : environnement, qualité, bien-être des animaux, installation des jeunes, régions fragiles).
Le FEAGA contribue au financement du premier pilier de la PAC et n'est constitué que de mesures surfaciques (dont le montant dépend de la surface agricole).
Le FEADER contribue quant à lui au financement du deuxième pilier de la PAC. Il est constitué de mesures surfaciques (indemnités compensatoires de handicaps naturels, les mesures agro-environnementales et climatiques, soutien à l'agriculture biologique) et non surfaciques (aides à l'investissement et à la modernisation des exploitations, aides à l'installation des jeunes agriculteurs, aides au développement rural, mesures agro-environnementales et climatiques, protection de la biodiversité et des espèces menacées).
Le règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune encadre la gestion financière de la PAC. Il prévoit tout d'abord que les aides de la PAC sont versées aux bénéficiaires par des organismes payeurs nationaux agréés, responsables de la gestion et du contrôle des dépenses, conformément aux règles établies par la Commission européenne.
En outre, des organismes de certification, publics ou privés, désignés par les pays de l'UE, émettent un avis sur :
- l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de l'organisme payeur ;
- le fonctionnement des systèmes de contrôle interne des organismes payeurs ;
- la légalité et la régularité des dépenses dont le remboursement a été demandé à la Commission.
Les dépenses sont préfinancées par l'État membre puis remboursées par la Commission européenne, tous les trimestres pour le FEADER. Afin d'assurer la défense des intérêts financiers de l'Union européenne, la Commission européenne exerce une possibilité de sanction à travers la procédure d'apurement. Les refus d'apurement constituent le refus par la Commission de prendre en charge sur le budget de l'Union européenne une partie des dépenses préfinancées au titre de la PAC par les États membres en raison d'irrégularités.
Les modalités de financement de la PAC 2014-2022 prévues dans le règlement (UE) 1306/2013 impliquent que ces corrections financières sont d'abord supportées par le budget de l'État (programme 149 « Compétitivité et à la durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ») et doivent ensuite être mises à la charge des régions.
B. LA FRANCE A SOUHAITÉ FAIRE DES RÉGIONS LES AUTORITÉS DE GESTION DES FONDS EUROPÉENS
Si les règlements européens1021(*) prévoient que chaque État membre doit désigner un organisme payeur agréé et une autorité de certification des comptes de l'organisme payeur, ils autorisent néanmoins les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, à désigner des autorités de gestion des crédits du FEADER à un niveau décentralisé.
Le transfert aux régions de l'autorité de gestion du FEADER a été essentiellement opéré par les États fédéraux, comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, qui ont une grande expérience en matière de répartition des compétences et de gouvernance partagée. La France est ainsi le seul État membre non fédéral à avoir régionalisé le FEADER.
Jusqu'à 2014, le principe retenu en France était de confier à l'État (qui la déconcentrait aux préfets de région) la fonction d'autorité de gestion des fonds, de confier aux directeurs régionaux des finances publiques la fonction d'autorité de certification des programmes régionaux des fonds structurels, et de confier à la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens la fonction d'audit.
Dans la perspective de la programmation 2014-2022, les règles de gestion du FEADER ont évolué dans le sens d'une plus grande participation des collectivités territoriales. Ainsi, la loi MAPTAM du 27 janvier 20141022(*) prévoit à son article 78 que :
« I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu'au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période :
1° L'État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. (...) ».
L'article 78 crée également un mécanisme permettant de faire supporter aux collectivités territoriales, autorités de gestion, les corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État et prononcées par les institutions européennes ayant trait aux fonds structurels, désormais codifiées à l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent (...) la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne (...) ».
Ce transfert répond à l'objection soulevée selon laquelle la désignation d'une autorité de gestion autre que l'État, sans transfert des éventuelles corrections financières associées, déresponsabiliserait celle-ci. Il est précisé que les charges qui résulteraient de ces condamnations sont des dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales concernées, ce qui a notamment pour conséquence qu'elles peuvent être inscrites d'office au budget local.
Les régions ont été désignées autorités de gestion des crédits du FEADER pour la programmation 2014-2022, dans les conditions d'abord fixées par le décret en conseil d'État du 16 avril 20151023(*). Elles assuraient ainsi, dans le cadre de vingt-sept programmes de développement rural régionaux, la définition des mesures de soutien mises en oeuvre et la programmation des crédits correspondante.
L'État est néanmoins demeuré très impliqué dans la gestion du FEADER. Par exception, il est resté l'autorité de gestion pour trois programmes de développement rural1024(*). Par ailleurs, conformément au cadre européen, l'Agence de services et de paiement (ASP), opérateur de l'État, assurait le rôle d'organisme payeur agréé pour le versement des fonds. En outre, certaines missions de gestion demeuraient assurées par les services déconcentrés de l'État : les directions départementales des territoires (DDT) assuraient l'instruction et le contrôle d'un grand nombre de mesures FEADER. Enfin, les cofinancements nécessaires à l'utilisation des crédits du FEADER restaient majoritairement apportés par l'État (à 70 %, contre 20 % pour les régions et 10 % pour les autres collectivités territoriales).
C. UN ENCHEVÊTREMENT OPÉRATIONNEL ET NORMATIF QUI COMPLEXIFIE FORTEMENT LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE L'ÉTAT ET LES RÉGIONS
La France a été confrontée autour de l'année 2014 à d'importants refus d'apurement. Dans un rapport remis en 2018 à la commission des finances du Sénat1025(*), la Cour des comptes observe, pour l'ensemble de la PAC, qu' « en cumulé sur la période 2007-2016, la France est l'État membre de l'Union européenne qui a enregistré le montant le plus élevé de corrections financières, soit 2,03 milliards d'euros. Le montant des corrections notifiées à la France, rapportées aux dépenses de la PAC, a atteint, sur cette même période, 2,3 %. Ce taux est supérieur de 0,7 point à la moyenne européenne (1,6 %). »
Dans ce rapport, a Cour constate que « les motifs de refus d'apurement apparaissant toujours principalement liés à l'inadaptation de la réglementation française et à l'insuffisance de mise en oeuvre des contrôles. (...) Ceci traduit une prise de conscience trop tardive de la part des autorités françaises du renforcement des exigences européennes. »
Or, si la responsabilité financière des régions était prévue par la loi (cf. l'article L. 1511-1-2 du CGCT), la responsabilité juridique de l'État et des régions en cas de correction financière résultant d'une décision de refus d'apurement des dépenses prise par l'une des institutions européennes n'était pas clairement établie :
- les corrections financières pouvaient résulter de décisions prises par les régions mais aussi du cadre national fixé par l'État ou de l'intervention des services déconcentrés de l'État et de l'ASP ;
- les modalités de calcul des corrections financières par la Commission européenne s'appuyaient sur un mécanisme d'extrapolation des erreurs financières détectées sur les paiements opérés, qui s'appliquait à la fois aux aides versées dans le cadre de l'ensemble des vingt-sept programmes de développement rural régionaux et des trois programmes nationaux.
Par ailleurs, dans le rapport précité, la Cour ces comptes a constaté dans le cadre de son contrôle que des conventions triparties entre l'ASP, le ministère en charge de l'agriculture et les différentes autorités de gestion régionales ont pu être signées, indiquant que la région peut demander à l'État de prendre à sa charge les corrections et sanctions financières dues. Et la Cour de conclure : « si le fait de déroger dans une convention à la règle législative selon laquelle les régions supportent la charge des corrections et sanctions financières est contestable, l'enchevêtrement des compétences est tel qu'une situation de contentieux entre l'État et les régions autorités de gestion n'est pas à exclure lorsqu'une décision de la Commission conduira à mettre une correction financière à la charge de la France ».
Il était par conséquent difficile d'affecter précisément à l'État et à chaque région les montants de corrections financières pour leur part de responsabilité respective et, en pratique, l'État a supporté l'intégralité de la charge des corrections financières pour la programmation 2014-2022. Ces dernières ont été prises en charge par le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture » de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, et la part dont les régions sont responsables n'a pas été mise à leur charge.
Refus d'apurement d'aides communautaires de 2009 à 2021
(en millions d'euros)
Source : Cour des comptes, note d'analyse de l'exécution budgétaire, Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, 2021
Compte tenu de la durée des procédures d'audit, les premières décisions d'exécution relatives à des corrections financières de la Commission européenne imputées aux régions ont été publiées en 2021. Depuis, six décisions d'exécution entraînant des corrections financières concernant les dépenses du FEADER versées dans le cadre de la programmation 2014-2022 sont intervenues, pour un total de 21 millions d'euros, repris comme estimation a minima du coût figurant dans l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2026.
Ce montant n'est en effet pas définitif dans la mesure où la Commission est encore susceptible de conduire des audits sur la période pendant plusieurs années, pouvant se traduire par de nouvelles corrections financières.
D. UNE RÉGIONALISATION PLUS EFFECTIVE POUR LA PROGRAMMATION 2023- 2027 DU FEADER
D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances, « une évolution du périmètre des responsabilités et de l'organisation entre l'État et les régions a été mise en place à partir du 1er janvier 2023 pour que la mise en oeuvre du FEADER 2023-2027 ne présente plus cette problématique d'imbrication des responsabilités. L'article L. 1511-1-2 du CGCT s'appliquera donc sans réserve pour les corrections financières portant sur la programmation 2023-2027. »
En effet, le Parlement a habilité le Gouvernement, par l'article 33 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier, en ce qui concerne le FEADER, notamment l'article 78 de la loi MAPTAM ainsi que l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, donnant lieu à une ordonnance du 26 janvier 20221026(*) qui :
- confie à l'État la qualité d'autorité de gestion du Plan stratégique national (PSN) et aux régions, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État1027(*), celle d'autorité de gestion régionale pour les aides non surfaciques du FEADER dont il fixe la liste ;
- prévoit que les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du PSN, d'un décret qui fixera certaines règles générales d'éligibilité et d'une enveloppe de crédits qui leur est attribuée ;
- prévoit que les autorités de gestion régionales assurent, par délégation de l'organisme payeur, l'instruction et le contrôle des aides dont elles auront la charge ;
- autorise les autorités de gestion régionales à confier à leurs agents des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place ;
- précise les règles d'identification des emplois transférés de l'État vers les régions pour le FEADER et fixe les conditions d'un transfert progressif des personnels de l'organisme payeur aux régions, qui interviendra au fur et à mesure de l'achèvement des contrôles sur place de la programmation actuelle.
Ainsi, la répartition des responsabilités a été clarifiée et uniformisée. Les régions, en tant qu'autorités de gestion régionales, sont responsables des interventions du FEADER non liées à la surface tandis que l'État, lui, est responsable des interventions de nature surfacique et assimilées. Par délégation de l'Agence de services et de paiement (ASP), organisme payeur, les régions réalisent sur ces interventions l'ensemble de l'instruction et du contrôle des demandes d'aide et les DDT de France métropolitaine et d'Outre-Mer ne sont plus impliquées dans ce processus.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'INTRODUCTION D'UNE DÉROGATION POUR RÉPARTIR ÉQUITABLEMENT LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE, POUR UN MONTANT TOTAL INCERTAIN
A. DES DISPOSITIONS LÉGALES ASSOUPLIES POUR PERMETTRE D'ALIGNER RESPONSABILITÉS JURIDIQUE ET FINANCIÈRE POUR LA PROGRAMMATION 2014- 2022 DU FEADER
L'article 47 du projet de loi de finances introduit de la flexibilité dans la loi pour permettre à l'État et aux régions de convenir ensemble d'une répartition des responsabilités financières qui soit plus en phase avec la répartition des responsabilités opérationnelles, normatives et financières sur la période 2014-2022.
Le premier alinéa de l'article 47 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d'exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d'apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire par l'État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds ».
Cette rédaction appelle les commentaires suivants :
- l'article L. 1511-1-2 du CGCT reste la norme ;
- l'article 47 n'introduit qu'une dérogation ponctuelle ;
- la dérogation ne couvre que la programme 2014-2022 ;
- le principe retenu est le principe du partage sous forme d'une répartition forfaitaire entre l'État et les régions, et entre les régions elles-mêmes.
Le second alinéa de l'article 47 renvoie à un décret d'application la fixation des conditions de répartition de ces charges entre l'État et les régions, conditions qui devront notamment tenir compte des deux critères suivants :
- le montant des paiements exécutés dans le cadre de chacun des programmes de développement rural placé sous leur autorité ;
- l'origine et la part de erreurs ayant entraîné les corrections financières.
B. LE MONTANT DE LA CHARGE À RÉPARTIR ENTRE ÉTAT ET RÉGIONS N'EST PAS ENCORE CONNU
En théorie, les dispositions de l'article 47 se traduiront par de moindres recettes pour l'État, les autorités de gestion régionales du FEADER ne devant rembourser à l'État qu'une partie et non plus la totalité des corrections financières opérées par la Commission européenne concernant la programmation 2014-2022.
En pratique, toutefois, compte tenu de l'insécurité juridique, la part dont les régions sont responsables n'a pas été mise à leur charge. Par conséquent, les dispositions de l'article 47 permettront au contraire à l'État de mettre à la charge des régions la part forfaitaire des corrections financières qui reste sous leur responsabilité dès 2026.
À date, six décisions d'exécution de la Commission européenne entraînant des corrections financières concernant le FEADER 2014-20221028(*) sont intervenues depuis 2021. L'évaluation préalable annexée au projet de loi de finances pour 2026 évalue, sur la base de ces décisions, un coût minimal potentiellement imputable aux autorités de gestion régionales qui s'élève à 21 millions d'euros.
Au-delà de ce coût minimal, une certaine incertitude repose sur ce le total des refus d'apurements devant être partagés. Interrogée à ce sujet, la direction du budget indique que l'ASP évalue les refus d'apurements qui concernent la programmation 2014-2022 du FEADER à 134,7 millions d'euros.
À titre de comparaison, les refus d'apurement se sont élevés à 88 millions d'euros en 2024 pour l'ensemble du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » (qui ne couvre pas que le seul FEADER), contre 187 millions d'euros en 2023.
Dans tous les cas, ce montant n'est pas définitif dans la mesure où la Commission est susceptible de conduire des audits sur la programmation 2014-2022 pendant encore plusieurs années, pouvant se traduire par des corrections financières portant sur cette programmation après la fin des paiements relevant de la programmation 2014-2022.
C. LA PART POUVANT ÊTRE MISE À LA CHARGE DES RÉGIONS N'AS PAS ENCORE ÉTÉ ARRÊTÉE
L'impact budgétaire pour l'État et les régions est doublement incertain puisqu'en plus du montant total à partager, la clef de répartition entre les acteurs n'a pas été convenue. En effet, la part de ce montant imputable aux autorités de gestion régionales, et donc le coût total pour les régions, sera déterminée en application des dispositions qui seront définies par le décret d'application du présent article.
L'article renvoie à un décret d'application la définition de la méthode de répartition. L'évaluation préalable indique que « la concertation avec les régions et l'association Régions de France a permis d'aboutir ces derniers mois à un accord de principe sur une répartition forfaitaire de la charge de ces corrections pour la programmation 2014-2022 uniquement ».
Cependant, les différentes administrations interrogées ont indiqué qu'il ne s'agissait que d'un accord de principe à ce stade et que les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières sont toujours en cours d'élaboration par le ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (MAASA). Ces conditions et modalités devront ensuite faire l'objet d'une consultation des régions puis de la direction des affaires juridiques du MAASA, avant de faire l'objet de discussions et d'arbitrages interministériels.
*
* *
L'Assemblée nationale n'ayant pas adopté la première partie du présent projet de loi de finances, celui-ci est considéré comme ayant été rejeté et le présent article n'a pas été adopté.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : MALGRÉ LES INCERTITUDES, UN DÉBUT DE SOLUTION PRAGMATIQUE
Cet article, issu d'une concertation entre l'État et Régions de France permet de sortir d'une situation d'insécurité juridique. Alors que la loi prévoit aujourd'hui une responsabilité financière entière des régions pour leur gestion du FEADER, dans les faits, la responsabilité juridique pour la programmation 2014-2022 est partagée.
Ce constat semble s'imposer aux services de l'État. D'une part, les services du ministère en charge de l'agriculture ont signé des conventions tripartites avec l'ASP et des autorités régionales1029(*) prévoyant que « (...) la Région peut demander à l'État de prendre à sa charge les corrections et sanctions financières dues à des fautes ou des erreurs de l'État ou de l'organisme payeur, dans des conditions qui seront précisées par des dispositions législatives et réglementaires complémentaires (...) », sans que soit précisée quelle instance déterminera l'éventuelle responsabilité de l'État.
D'autre part, l'État n'a pas mis à la charge des régions la part dont elles sont responsables. En, effet, comme l'indique l'évaluation préalable de l'article 47, si « l'État, en application du cadre législatif actuel, [mettait] l'ensemble des corrections financières à la charge des régions en déterminant unilatéralement la répartition entre les différentes régions conformément à l'article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales[, cela] suscitera[it] probablement l'opposition de tout ou partie des régions, aura[it] pour conséquence des recours contre les décisions correspondantes et repoussera[it] sine die toute prise en charge même partielle par les régions des corrections financières »
Si le dispositif proposé est encore très incertain, tant dans le montant réparti que dans la clef de répartition entre les différents acteurs, le présent article constitue un pas dans la bonne direction pour permettre à l'État et aux régions de convenir ensemble d'une solution qui permette d'apporter une sécurité juridique aux régions et quelques recettes à l'État.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
* 961 Bilan des relations financières entre l'État et la protection sociale.
* 962 Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (article 5) et loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (article 70).
* 963 Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
* 964 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
* 965 LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
* 966 LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
* 967 Article 163 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 - Article 131 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 968 Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2024 et prévisions 2025 et 2026, octobre 2025.
* 969 Document de cadrage relatif à la négociation de la convention de l'assurance chômage, juillet 2023.
* 970 Évaluation préalable du présent article.
* 971 Loi de finances de fin de gestion pour 2023 - article 2 ; loi de finances pour 2024 - article 163 ; loi de finances pour 2025 - article 131.
* 972 Rapport général n° 128 (2023-2024), fait par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2024, tome II. Se reporter au commentaire de l'article 32.
* 973 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 974 Évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques pour la période 2026-2028, Commission de régulation de l'énergie, septembre 2025.
* 975 Ce même article précise que « le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État ».
* 976 Prévue par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
* 977 Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
* 978 Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
* 979 Décret n° 2020-1079 du 21 août 2020 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
* 980 Évaluation réalisée par la CRE dans le cadre de sa délibération n° 2024-139 du 11 juillet 2024 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2025 et à la réévaluation des charges de service public de l'énergie pour 2024.
* 981 Et sous réserve d'une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État comme le précise le IV du présent article.
* 982 Lesquelles sont désormais financées par l'affectation d'une fraction de l'accise sur les énergies appliquée aux consommations d'énergie utilisées pour le chauffage.
* 983 C'est-à-dire de l'accise sur les énergies appliquées aux catégories des produits taxables en tant que carburant recensés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.
* 984 Article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services.
* 985 Articles L. 422-50 et L. 422-51 du code des impositions sur les biens et services.
* 986 Conformément à l'article L. 422-55 du code des impositions sur les biens et services, ce coefficient, déterminé par arrêté, est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
* 987 Arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement.
* 988 Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 23 février 2011 relatif au plafond du montant des prestations à prendre en considération en application du II de l'article R. 571-87 du code de l'environnement.
* 989 D'après des informations communiquées par la DGAC.
* 990 Réponses de la DGAC au questionnaire du rapporteur général.
* 991 Au même titre que les tarifs de l'aviation civile, de solidarité et de péréquation aéroportuaire.
* 992 Dont le régime juridique était prévu à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
* 993 Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 994 Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 995 Cette fourchette, auparavant de 40 % à 65 % a été relevée par l'article 107 de la LFI pour 2024.
* 996 Arrêté du 29 mars 2024 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux, le taux de la minoration de ce tarif, ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 997 Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 998 La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
* 999 Le même article précise que ce tarif est nul pour les aérodromes de classe 4.
* 1000 La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 1001 Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
* 1002 Pour la saison 2024-2025, il s'agit de l'arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
* 1003 Pour « Explosive Detection System ».
* 1004 Tarifs qui résulteraient des dispositions du présent article.
* 1005 En apportant une modification au premier alinéa de l'article L. 422-24 et en supprimant son second alinéa.
* 1006 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
* 1007 Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
* 1008 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
* 1009 Du fait de la mise en oeuvre par les États membres de leurs plans stratégiques nationaux de la PAC.
* 1010 Rattrapage progressif des retards de déploiement et reprogrammation au profit de la plateforme des « technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP).
* 1011 La Commission européenne a complété ce paquet le 3 septembre 2025 en publiant sept règlements sectoriels supplémentaires.
* 1012 Seules les 3 principales rubriques sont ici présentées, la dernière correspondant à l'administration européenne, soit l'équivalent de la 7e rubrique dans le CFP 2021-2027.
* 1013 Cet instrument n'est pas financé via le budget européen mais directement par des contributions des États membres. Pour la France, la contribution est ainsi versée par les ministères contributeurs, à savoir le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, et le ministère des armées.
* 1014 Une stratégie de compétitivité pour l'Europe, rapport remis à la Commission européenne, septembre 2024.
* 1015 Article R. 91 du code de procédure pénale.
* 1016 Antoine Lefèvre, Maîtriser les frais de justice pour mieux rendre la justice, rapport d'information n° 3 (2025-2026), fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 1er octobre 2025.
* 1017 Articles 177-2 (juge d'instruction) et 212-2 (chambre d'instruction) du code de procédure pénale.
* 1018 Article 120 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale.
* 1019 Voir le rapport de Jean-Marie Girault sur le projet de loi portant réforme de la procédure pénale, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat, déposé le 12 novembre 1992, p. 96.
* 1020 Article 1018 A du code général des impôts. Le montant de ce droit a encore été doublé par l' article 91 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
* 1021 Les fonds européens structurels et d'investissement, dont fait partie le FEADER, relèvent d'une gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres. Pour la période 2014-2022, cette gestion était encadrée par le règlement (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013, qui contenait des dispositions communes à l'ensemble des fonds, et, en ce qui concerne le FEADER, par les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ainsi que par des règlements d'application.
* 1022Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 1023 Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020.
* 1024 La gestion des risques et l'assistance technique, le réseau rural national ainsi que le programme de développement rural de Mayotte.
* 1025 La chaîne des paiements agricoles (2014-2017), une gestion défaillante, une réforme à mener, communication à la commission des finances du Sénat, juin 2018.
* 1026 Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
* 1027 Cf. Décret n° 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
* 1028 Hors période de transition entre les programmations 2007-2013 et 2014-2022.
* 1029 Cette clause a été retrouvée par la Cour des comptes dans les deux régions visitées (Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie) dans le cadre de son contrôle de juin 2018 sur la chaîne de paiement des aides agricoles.