III. BUDGET ET EFFICACITÉ
A. LE FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. La dépense totale en faveur de l'enseignement
En 1995, la collectivité nationale a consacré 95,7 milliards de francs à l'enseignement supérieur, soit 1,1 % du PIB. Au sein des ces 95,7 milliards de francs, il faut distinguer :
- la dépense intérieure d'éducation (DIE) en faveur de l'enseignement supérieur qui s'est élevée à 91,5 milliards de francs (sur une dépense intérieure d'éducation totale de 563 milliards de francs), en augmentation de 2,2 milliards par rapport à 1994 en francs constants,
- la formation continue et les autres formations extra-scolaires qui sont financées à hauteur de 4,2 milliards de francs.
Par grand domaine, cet effort se décompose de la façon suivante :
- 80,1 milliards de francs (soit près de 83 %) ont été consacrés aux activités de formation proprement dites ;
- les 17 % restants ont été utilisés à hauteur de 7,7 milliards de francs pour les activités annexes (administration générale, orientation, restauration et hébergement, médecine scolaire et universitaire) et de 7,8 milliards de francs pour l'achat de livres ou matériels et pour la rémunération des personnels en formation.
De 1975 à 1982, la part de la dépense du supérieur dans la dépense intérieure d'éducation avait régulièrement diminué, passant de 13,6 % à 13 %. Depuis 1982, cette tendant s'est inversé et le poids de l'enseignement supérieur dans la DIE est remonté à 16,3 % en 1995. Globalement, cette croissance a été sensiblement proportionnelle à l'augmentation des effectifs.
En 1993, selon les données établies par l'OCDE, les pays membres consacrent en moyenne 1,3 % de leur produit intérieur brut (PIB) au financement (public et privé) de l'enseignement supérieur. Les pays anglophones tels que l'Australie et le Canada y affectent des fractions sensiblement plus élevées (2 % en moyenne). Avec 1,1 %, la France se situe donc à un rang moyen.
2. La structure de financement
Dépenses de l'Enseignement supérieur (financeurs finals)
Dépenses totales pour les activités d'enseignement
(non compris enseignement à distance et formation professionnelle)

(I) Il s'agit au budget exécuté. Ne sont pas, pris en compte pour le MESR les dépenses relatives à la recherche universitaire et aux Musées de l'enseignement supérieur.
* À partir de 1993, aux bourses effectivement versées par le MESR, a été rajoutée une somme fictive de transferts versés correspondant à la part du montant de crédits d'impôt imputables aux étudiants.
Source DEP : Compte annuel de l'éducation
L'État assume plus des trois quarts de la dépense (78,3 % contre 65,4 % pour la DIE).
La prise en compte des avantages fiscaux accordés aux familles ayant des enfants étudiants (réduction forfaitaire d'impôt sur le revenu et possibilité de rattachement au foyer parental jusqu'à 25 ans) et du financement du logement locatif des étudiants par l'allocation de logement à caractère social (ALS) depuis 1993, qui ne sont pas intégrés actuellement dans le compte de l'éducation, accroîtrait encore le poids du financement public de l'enseignement supérieur : ces avantages fiscaux et sociaux consentis aux familles d'étudiants s'élèvent à près de 10,6 milliards de francs en 1995 (6,1 milliards de francs pour l'impôt sur le revenu et 4,5 milliards de francs pour l'ALS).
Les ménages viennent en deuxième position avec 9,5 %. Depuis le plan « Universités 2000 », les collectivités territoriales, notamment les régions, apparaissent comme le troisième financeur avec 5,7 % (contre 2,1 % en 1989). Viennent ensuite les entreprises avec 4,4 %. Au total, la part des financeurs privés, bien qu'en augmentation depuis une dizaine d'années, reste inférieure à 15 % de la dépense d'éducation supérieure.
Structure de financement initial de la dépense d'éducation pour le supérieur en 1995
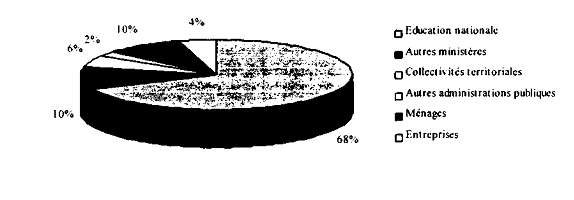
Une rapide comparaison internationale montre que le système français est loin d'être un cas isolé. L'enseignement supérieur est entièrement financé sur fonds publics en Australie, en Allemagne, au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas. À l'opposé, se situent des pays comme les États-Unis et le Japon, où le financement public du système universitaire est beaucoup plus limité, voire minoritaire (39,7 % au Japon). Les ménages contribuent substantiellement à l'effort de formation, par le biais des droits d'inscription, qui représentent une part essentielle des ressources des établissements d'enseignement supérieur (en 1985, 35,8 % au Japon, 38,7 % dans les universités privées américaines).
3. La dépense moyenne par étudiant
La dépense moyenne par étudiant est passée de 40.500 francs en 1975 à 45.200 francs en 1995, en francs constants (+ 11,5 %) alors que sur la même période, la dépense moyenne par élève, tous niveaux scolaires confondus, s'est élevée de 21.000 francs à 33.800 francs (+ 61 %). La dépense par élève varie cependant beaucoup d'une filière de formation à l'autre :
- 33.500 francs en moyenne par étudiant universitaire ;
- 52.600 francs en moyenne par étudiant des IUT ;
- 60.700 francs en moyenne par élève de sections de techniciens supérieurs ;
- 72.700 francs en moyenne par élève de classes préparatoires aux grandes écoles.
Au total, une scolarité effectuée sans redoublement sur une durée de 18 ans, menant à une licence, est estimée à 571.400 francs en 1995. En comparaison, le coût d'une scolarité en vingt ans menant à un diplôme d'ingénieur universitaire, après deux années de classes préparatoires, s'élève à 843.700 francs.
Les comparaisons internationales montrent qu'en dehors des États-Unis, les dépenses des différents pays sont comprises entre 2.500 et 8.670 équivalents-dollars par étudiant, et leur moyenne s'établit à 6.510 équivalents-dollars. Tout en ayant une dépense par étudiant (6.030 équivalents-dollars) proche de cette moyenne, la France se situe parmi les pays où cette dépense est la plus faible.
B. L'ÉQUITÉ DU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Selon une étude récente de la direction de la prévision 2 ( * ) , la faiblesse des droits d'inscription et l'importance du dispositif d'aide sociale aux étudiants ont pour conséquence un financement quasi-total de l'enseignement supérieur par le contribuable, ce qui ne va pas sans poser un problème d'équité.
En effet, le choix consistant à poursuivre des études supérieures relève avant tout d'une logique d'investissement dont l'étudiant est le premier bénéficiaire. Chaque année supplémentaire de formation se traduit pas de meilleures perspectives d'insertion professionnelle et par des gains salariaux futurs potentiellement plus élevés. Il n'est donc pas équitable que cet investissement soit intégralement financé par le contribuable moyen, qui n'en retirera aucun bénéfice direct.
En outre, la sur-représentation des enfants issus des classes aisées parmi les étudiants (un tiers d'enfants de cadres supérieurs, qui représentent seulement 20 % de chaque génération), les taux d'échec élevés constatés chez les étudiants d'origine modeste et la prédominance de l'aide sociale indirecte (sans conditions de ressources,) dans le système d'aide sociale aux étudiants (voir chapitre sur l'action sociale), viennent renforcer les effets pervers du mode de financement de l'enseignement supérieur sur la distribution des revenus.
Une récente étude de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) sur l'origine sociale des étudiants des Grandes écoles montre que ces établissements, financés sur fonds publics (à l'exception d'HEC), qui forment les cadres supérieurs publics et privés de la nation, n'ont pas vu leur recrutement s'élargir au même rythme que les universités au cours des dernières années, et restent encore quasiment fermés aux étudiants issus des classes moyennes.
L'analyse peut cependant conduire à des conclusions différentes si l'on se situe dans une perspective longitudinale. On peut en effet considérer l'État comme un organisme prêteur qui financerait dans un premier temps les études supérieures des individus, et se ferait ensuite rembourser "avec intérêts" par les diplômés pendant le reste de leur vie, sous la forme du supplément de recettes fiscales lié aux gains salariaux élevés des diplômés. Dans cette perspective, et à condition que ce schéma théorique soit vérifié empiriquement, le problème de l'équité du financement public de l'enseignement supérieur se pose en des termes différents, car le coût supporté par l'ensemble des contribuables est plus que compensé par la somme actualisée des rentrées fiscales supplémentaires versées par les diplômés.
L'importance des taux d'échec en premier cycle universitaire amène cependant à nuancer ces arguments, car le coût public de ce phénomène peut s'avérer considérable et limiter la rentabilité sociale du financement public de l'enseignement supérieur. La probabilité d'accès en second cycle universitaire pour un bachelier s'inscrivant à l'université n'était que de 55,6 % en 1993. Elle variait entre 68,2 % pour les titulaires d'un baccalauréat C et 24,4 % pour les bacheliers technologiques (F, G, H). Parmi les étudiants réussissant leur DEUG, environ 40 % l'obtiennent en deux ans et 60 % en trois ans.
Au total, le financement actuel de l'enseignement supérieur, certes globalement équitable, tend néanmoins à favoriser davantage la reproduction sociale que l'égalité des chances entre les individus, même lorsque l'on considère les trajectoires post-baccalauréat. Pour les enfants de cadres supérieurs (11 % des individus de 25 à 34 ans en 1993, mais 41 % des diplômés du supérieur long et 25 % des diplômés de niveau Bac + 2) la faiblesse des droits d'inscription et les prestations sociales sans conditions de ressources constituent un effet d'aubaine plus qu'une incitation à poursuivre leurs études.
C. L'EFF1CACITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Outre des éléments de comparaison internationale (source OCDE), quatre indicateurs sont, proposés pour apprécier l'efficacité de l'enseignement supérieur en France :
- niveau de formation et diplôme obtenu par les sortants de l'enseignement supérieur
- taux de redoublement et taux d'abandon à l'issue de la première année universitaire
- taux d'accès en second cycle universitaire
- taux de réussite dans les DEA et les doctorats
1. Niveau de formation et
diplôme obtenu par les sortants de
l'enseignement

(*) De 2000 à 4000 diplômés du secteur paramédical et social ont accompli une formation de niveau V ou IV, non de niveau III
Le solde de sortants de l'enseignement supérieur est un solde de sorties nettes une année donnée, c'est à dire le solde entre toutes les sorties recensées et les reprises d'études observées.
2. Taux d'accès en second cycle universitaire
Toutes filières générales confondues (c'est-à-dire hors médecine, odontologie et pharmacie), 59,7 % des étudiants entrés en premier cycle universitaire ont pris une inscription en second cycle universitaire à la rentrée 1994 ; ce même taux était de 51,5 % en 1988. Depuis 1992, il ne progresse plus que faiblement.
C'est en Sciences que cette proportion est la plus élevée puisqu'elle atteint 64,3 % ; à l'inverse, avec 50,4 %, c'est la filière Droit qui enregistre la moins bonne performance.
Enfin, il est important de souligner que les étudiants qui n'accèdent pas en second cycle universitaire ne peuvent pas pour autant être considérés comme ayant échoué dans le supérieur. Ceci tient notamment au fait que certaines inscriptions en DEUG ne sont que des inscriptions de précaution par rapport à une inscription principale prise dans un autre cursus (cas fréquent des étudiants en classes préparatoires), mais aussi au fait que certains étudiants ayant réussi au DEUG continuent leurs études supérieures à l'extérieur de l'université, donc ne sont pas comptabilisés comme accédants en second cycle universitaire.
Taux d'accès (2, 3, 4 et 5 ans**) en second cycle général

(*) Y compris Staps et hors médecine, odontologie, pharmacie.
(**) Sont pris en compte tous les accédants dont le premier cycle n'a pas excédé 5 ans ; dans ce dernier cas, il s'agit souvent d'étudiants qui, soit se sont réorientés au moins une fois, soit ont interrompu momentanément leurs études.

3. Taux de redoublement et taux d'abandon à l'issue de la première année dans les principales filières universitaires
Dans l'ensemble, un peu moins d'un quart des nouveaux inscrits en première année ne renouvellent pas leur inscription l'année suivante ; parmi eux, certains avaient en fait engagé un cursus parallèle (classes préparatoires par exemple) et n'avaient pris leur inscription universitaire que par précaution. Le taux d'abandon en première année reste stable au cours des dernières années.
C'est en Économie, AES que ce taux d'abandon est le plus fort où il avoisine les 30 % ; le taux de redoublement de la première année y est également particulièrement élevé, le cas de la filière Santé devant être mis à part en raison de l'existence d'un numerus clausus : faible taux d'abandon qui conduit à un taux élevé de redoublement, la règle étant de tenter deux fois sa chance pour franchir la barrière que constitue PCEM1.
Seule la filière Sciences voit son taux d'abandon diminuer régulièrement au cours des trois dernières années, pour s'établir à un niveau sensiblement inférieur à celui des autres disciplines générales.
4. Taux de réussite dans les DEA et doctorats
Après la réforme des doctorats de 1984 qui avait diminué la capacité des établissements universitaires à former des chercheurs, il fallut attendre 1989 pour que le nombre de DEA délivrés retrouve son niveau de 1985. L'augmentation régulière constatée depuis lors se ralentit depuis ces deux dernières années : après une hausse moyenne annuelle de 10 % entre 1988 et 1992 et une augmentation de seulement 4 % en 1993, l'année 1994 se solde par une progression de 3,5 %. Le nombre de DEA délivrés dépasse cette année la barre des 26.000.
À l'inverse, les doctorats retrouvent une certaine vigueur depuis 3 ans, en rupture avec la stagnation qui avait marqué la période 1983-1991. Après une hausse de 5,6 % en 1993, l'année 1994 voit une nouvelle progression du nombre de doctorats délivrés (plus de 7 %). Près de 10.000 thèses ont ainsi été soutenues avec succès, dont près de 60 % en sciences.
Plus grande vigueur des doctorats, ralentissement de la progression des DEA, ces deux phénomènes se retrouvent dans l'analyse des « taux de rendement ».
La progression des maîtrises obtenues par des étudiants français étant plus forte que celle des DEA, le rendement de celles-ci, en termes de prolongement par un DEA ; diminue à nouveau cette année ; elle s'établit à un peu plus de 39 %, soit près de 2 points de moins que l'an dernier. Cette baisse se retrouve dans toutes les disciplines, tout en étant moins marquée en droit. Les sciences, avec un rendement de 65 %, se distinguent toujours des autres disciplines générales où le ratio DEA/maîtrises est plus de deux fois moindre. Toutefois, depuis 1983, les maîtrises de sciences enregistrent un recul de près de 17 points quant à leur prolongement par un DEA.
Inversement le rendement des DEA, mesuré par le ratio doctorats/DEA, progresse nettement cette année, se rapprochant ainsi des forts taux (plus de 40 %) observés sur la période 1990-1992 ; la performance médiocre de l'année 1993 semble ainsi oubliée, au moins temporairement. Cette reprise affecte simultanément les disciplines scientifiques et littéraires. L'écart entre ces deux disciplines, quant à leur productivité en matière de DEA, se réduit toutefois cette année pour s'établir à un peu plus de 15 points, les disciplines littéraires ayant gagné plus de 4 points en un an.
Rendement 3ème cycle pour les étudiants français

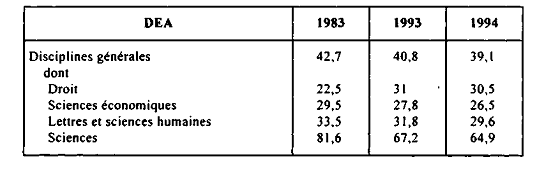
Indications méthodologiques
Taux de rendement en DEA : les DEA délivrés l'année n sont rapportés aux maîtrises (stricto sensu) délivrées l'année n-1. L'indicateur est calculé pour les principales disciplines générales. Les diplômes délivrés en MASS et AES ne sont pas pris en compte.
Cet indicateur est imparfait, puisque l'accès en DEA ne se fait pas exclusivement à partir de la maîtrise, mais aussi après un diplôme d'ingénieur. La maîtrise représente environ 65 % de l'ensemble des recrutements, mais beaucoup plus, ce qui est le cas ici, si on s'intéresse aux seuls étudiants français inscrits dans une discipline générale, soit une proportion supérieure à 80 %. Taux de rendement en doctorat : les doctorats de tous régimes (y compris diplômes d'ingénieur) délivrés l'année n sont rapportés aux DEA délivrés l'année n-3 pour les doctorats scientifiques, l'année n-4 pour les autres disciplines.

5 Répartition des bacheliers dans les principales filières du supérieur l'année suivant l'obtention de leur baccalauréat
6. Éléments de comparaisons internationales
Le tableau suivant est extrait de la publication de l'OCDE « Regards sur l'éducation - les indicateurs de l'OCDE ».
Les diplômes de « maîtrise ou équivalent » correspondent, pour la France, à la maîtrise universitaire, aux diplômes d'ingénieurs, des écoles de commerce et de gestion et plus généralement à tous les diplômes de deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
La définition de l'indicateur R12, joint en annexe, est ainsi donné par l'OCDE : « le taux d'obtention du diplôme rapproche le nombre de titulaires d'une maîtrise (ou équivalent) de l'effectif de la population ayant l'âge théorique d'obtention de ce diplôme ». Seul cet indicateur est disponible.
Les chiffres présentés doivent être utilisés avec une extrême prudence. D'une part, ils dépendent fortement de l'organisation même de chaque système éducatif. D'autre part, des choix de classement des diplômes par niveaux effectués varient d'un pays à l'autre.
En conséquence, il n'est pas possible d'en tirer un enseignement pertinent.
R12 : Niveau de formation supérieure

Taux d'obtention d'un diplôme universitaire par rapport à la population d'âge théorique par type de diplôme, établissements publics et privés, hommes et femmes (1992)
* 2 Efficacité et équité du financement de l'enseignement supérieur, J. Y. Leclercq, Direction de la prévision, 1er décembre 1995.







