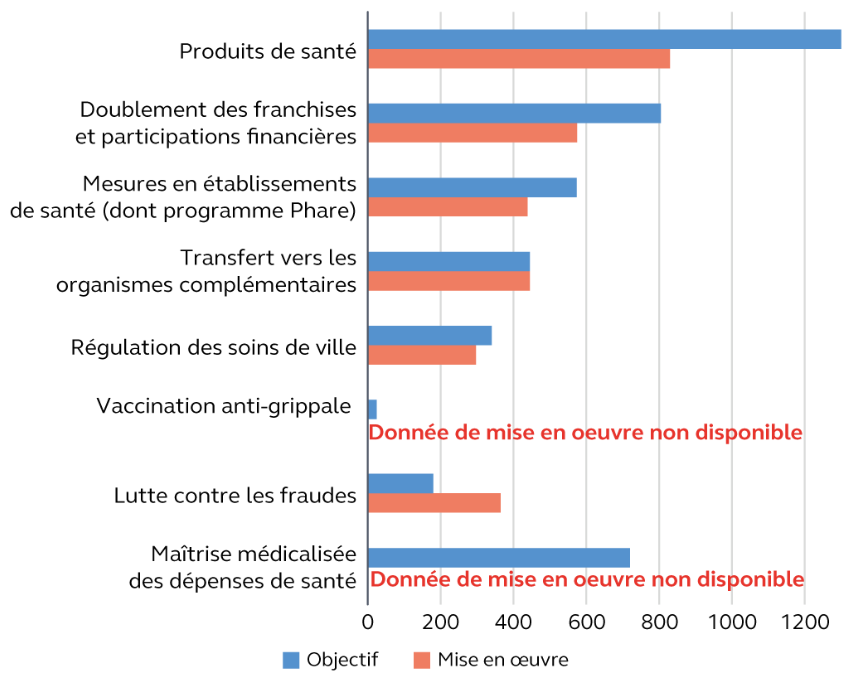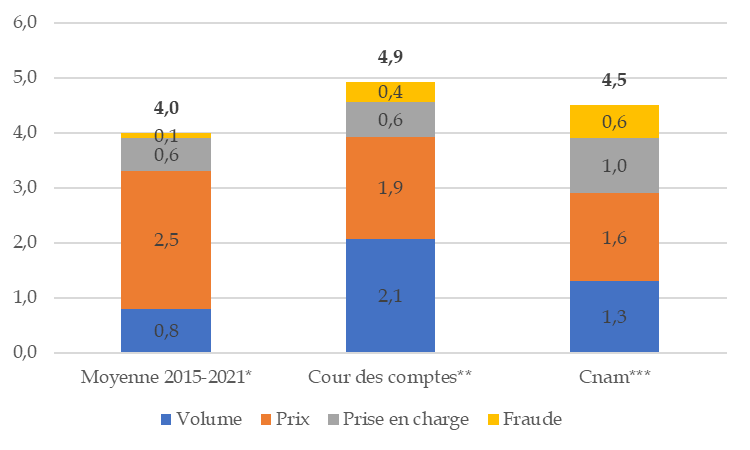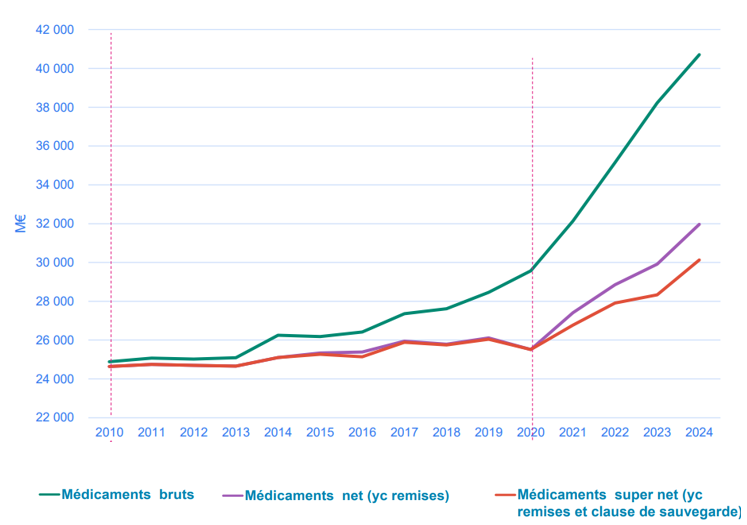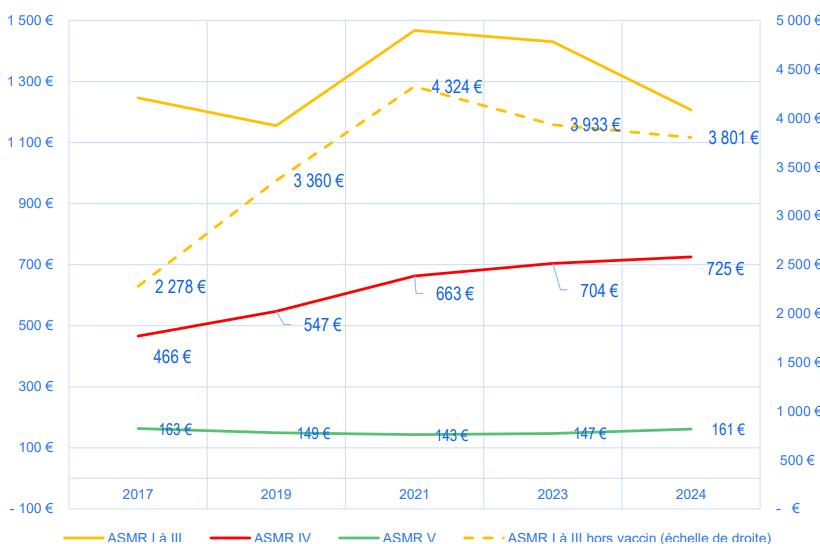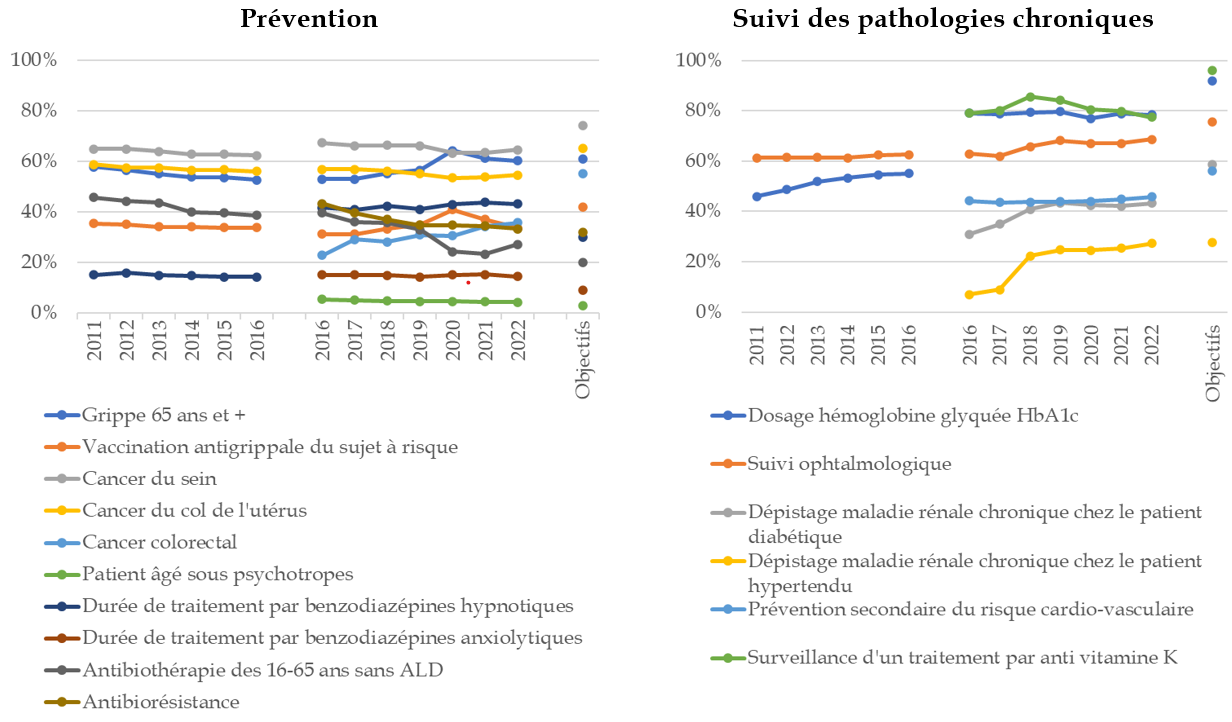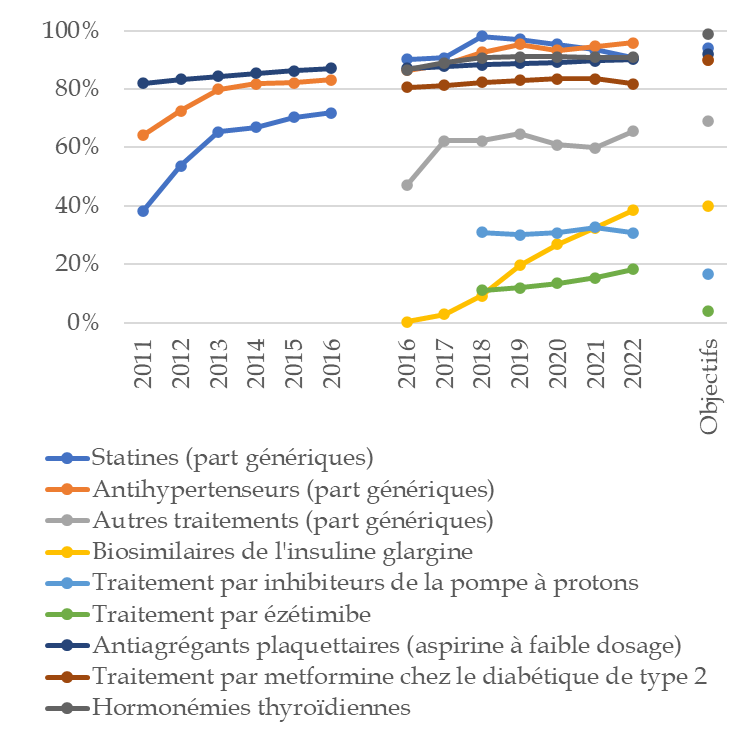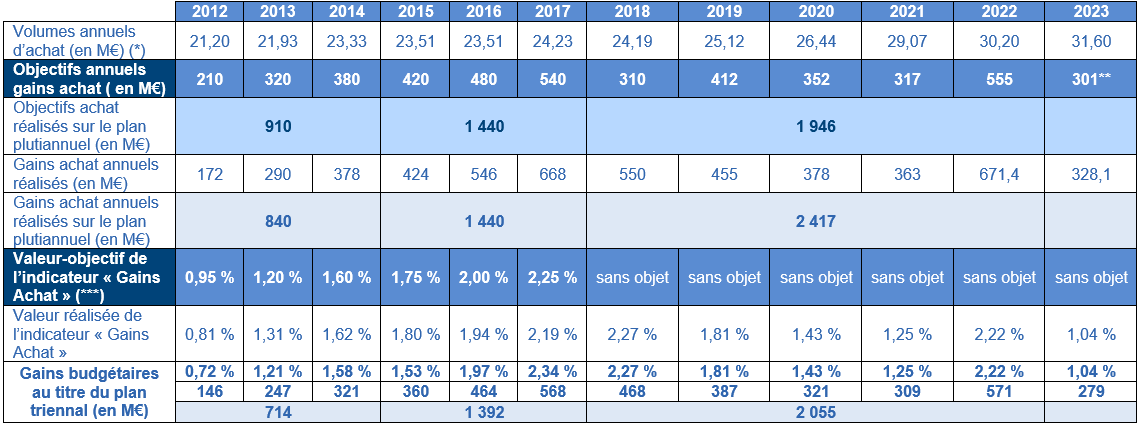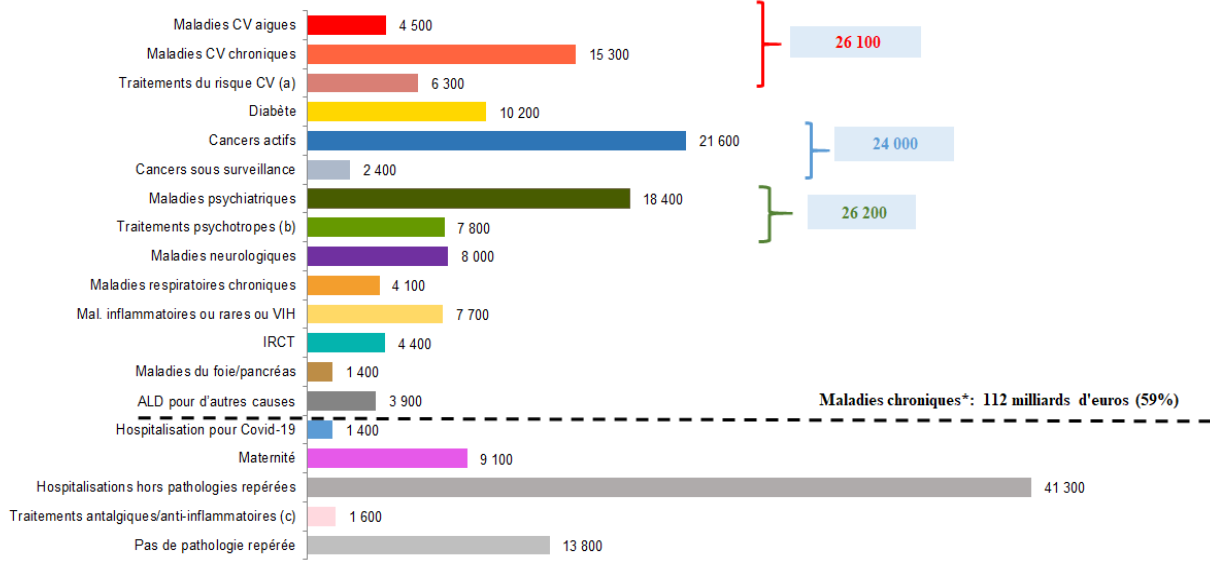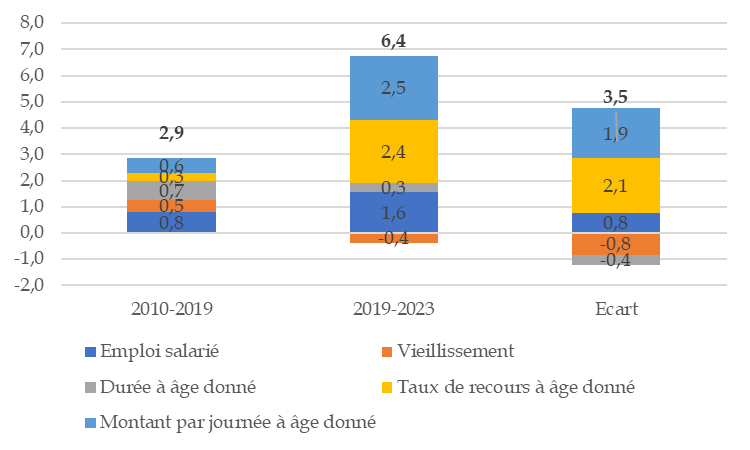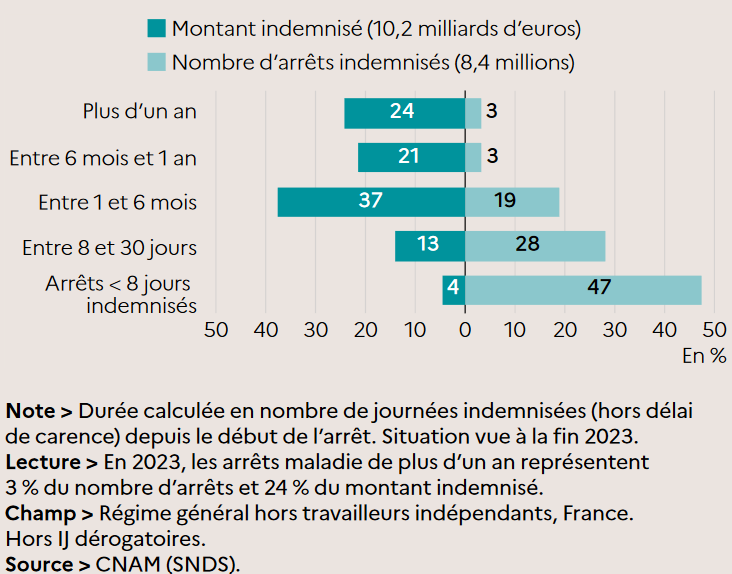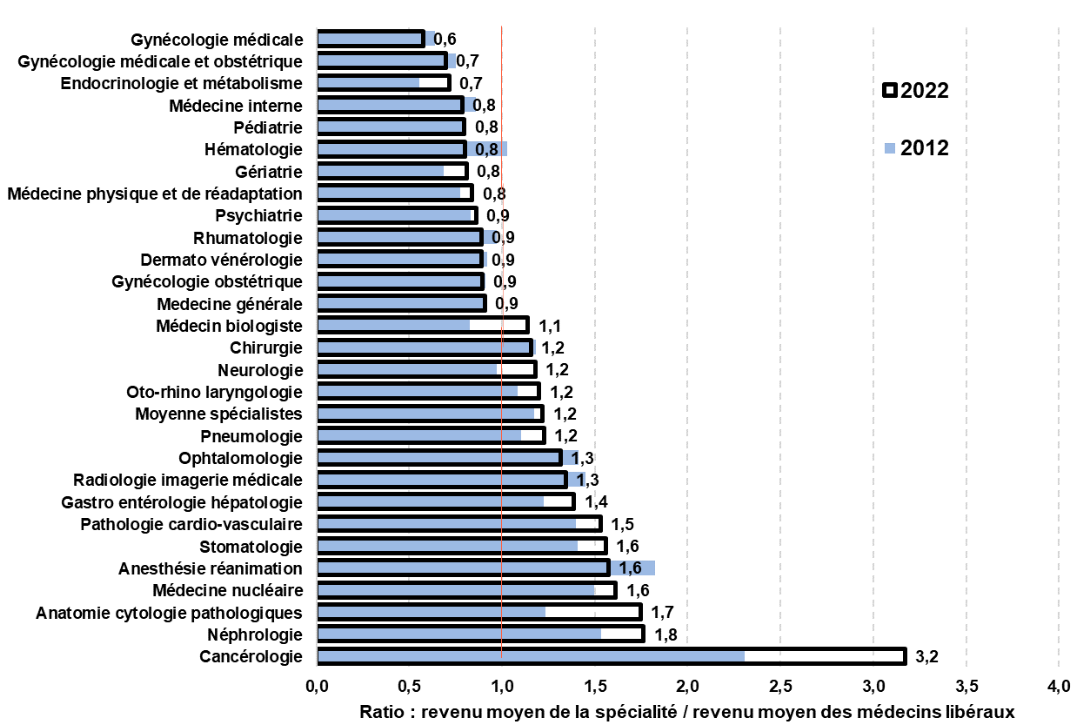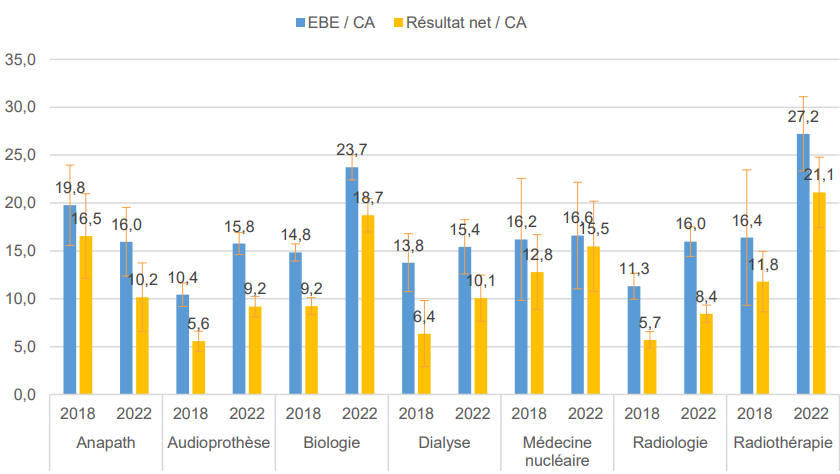II. DES OPTIONS LIMITÉES ?
Le présent rapport présente en annexe IV un chiffrage des principales mesures envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre.
Dans les développements ci-après, les rapporteures se sont efforcées de présenter les principaux enjeux, en distinguant ce qui relève du constat de ce qui relève du choix politique.
A. POUR RESPECTER LA TRAJECTOIRE D'ONDAM DE LA LFSS 2025, RÉALISER UN EFFORT NET SUR L'ONDAM D'ENVIRON 4 MILLIARDS D'EUROS PAR AN
1. La maîtrise de l'Ondam, une nécessité pour que la sécurité sociale reste finançable à long terme
Comme on l'a vu dans la première partie, laisser les dépenses de la branche maladie suivre leur tendance spontanée conduirait à les porter de 9 à 15 points de PIB d'ici 2070.
Une telle évolution ne pourrait manifestement pas être financée, que ce soit par des baisses de dépenses ou des augmentations de prélèvements obligatoires. L'absence de maîtrise des dépenses de santé conduirait donc inévitablement à la « désocialisation » d'une part importante de celles-ci, ce que, selon les rapporteures, il convient d'éviter, afin de préserver notre modèle de protection sociale.
Aussi, la prévision pluriannuelle annexée à la LFSS pour 2025 fixe un objectif de croissance de l'Ondam de 2,9 % par an en valeur, correspondant à peu près à la prévision de croissance du PIB en valeur. Si l'on considère que les dépenses de la branche maladie tendent spontanément à augmenter de 4,5 % par an en valeur, cela implique un effort annuel d'environ 4 milliards d'euros (net des mesures coûteuses).
2. Des mesures de maîtrise de l'Ondam déjà d'environ 4 milliards d'euros par an
Il n'existe quasiment pas de données d'exécution relatives aux mesures de maîtrise de la dépense. La DSS n'a pas été en mesure de transmettre aux rapporteures un chiffrage récapitulatif des mesures mises en oeuvre ces dernières années.
L'annexe des différents PLFSS relative à l'Ondam comprenait toutefois jusqu'en 2021113(*) des données prévisionnelles, synthétisées jusqu'en 2020 par un rapport de 2021 du HCAAM114(*).
Sur la période 2015-2021, celles-ci se sont élevées à 4 milliards d'euros en moyenne, comme le montre le tableau ci-après.
Synthèse des mesures prévisionnelles
de maîtrise de l'Ondam
indiquées par les documents
annexés aux PLFSS (2015-2021)
(en milliards d'euros)
|
Volume |
Prix |
Prise en charge |
Total |
|
|
Maîtrise médicalisée, tarifs et pertinences des actes et produits (conventions médicales, promotion des génériques et biosimilaires, etc.) |
0,5* |
0,5* |
1,0 |
|
|
Parcours de soins (chirurgie ambulatoire, alternatives à l'hospitalisation, réduction des hospitalisations évitables, etc.) |
0,3 |
0,3 |
||
|
Arrêts de travail, transports de patients |
0,3 |
0,3 |
||
|
Efficience administrative des hôpitaux (essentiellement optimisation des achats) |
0,7 |
0,7 |
||
|
Tarifs et remises des produits de santé |
1,3 |
1,3 |
||
|
Lutte contre la fraude |
0,1 |
0,1 |
||
|
Mise à contribution des patients et complémentaires |
0,3 |
0,3 |
||
|
Total |
1,1 |
2,5 |
0,4 |
4,0 |
Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les efforts sur la masse salariale des établissements de santé.
* Répartition conventionnelle par la Mecss.
Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021
Les rapporteures se sont efforcées, à titre indicatif, de ventiler les mesures selon qu'elles visent à agir sur les volumes, sur les prix ou sur la prise en charge. Ainsi, sur les 4 milliards d'euros d'économies annuelles, 2,5 milliards d'euros auraient porté sur les prix (prix des médicaments, prix des achats hospitaliers, dans une moindre mesure rémunération des soins de ville).
Ce tableau doit être considéré avec prudence. En particulier, il ne concerne que les prévisions associées aux PLFSS, et il est probable que les mesures n'ont pas toutes été mises en oeuvre ou eu les rendements attendus. Ainsi, selon la Cour des comptes, en 2024, les économies auraient été inférieures de 25 % aux objectifs (cf. encadré). Par ailleurs, certains chiffrages sont contestables115(*). En outre, le tableau ne prend pas en compte d'autres instruments de maîtrise des coûts, comme la maîtrise de la masse salariale.
Le non-respect des objectifs de mesures de
maîtrise de l'Ondam en 2024,
selon la Cour des
comptes
« En 2024, selon des informations disponibles partiellement, les mesures de maîtrise des dépenses n'ont été qu'en partie mises en oeuvre. Sur un objectif de 4,4 milliards d'euros, la part non réalisée peut être estimée entre 0,7 milliard d'euros et 1,1 milliard d'euros, soit jusqu'à 25 % de l'objectif. Le doublement des franchises et participations des usagers est intervenu plus tardivement que prévu et les baisses de prix de produits de santé ont été inférieures aux attentes. Les montants de maîtrise médicalisée des dépenses de santé (720 millions d'euros attendus) ne sont pas encore disponibles. Les mesures de prévention en santé en vue de réduire la dépense de santé demeurent limitées (25 millions d'euros pour la vaccination antigrippale).
« Suivi de l'exécution des mesures de maîtrise des dépenses de l'Ondam en 2024 inscrites en loi de financement de la sécurité sociale, selon la Cour des comptes
(en milliards d'euros)
« Notes : la comparaison entre économies ex ante et ex post n'est pas aisée en méthodologie. Entre ces différentes séries d'économies, il est possible d'avoir une vision ex post précise pour certaines (participations financières et franchises mesurées mensuellement par la Cnam, baisses de prix des médicaments, etc.). Pour d'autres, la mise en oeuvre n'est pas directement observable (maîtrise médicalisée des dépenses de santé, mesures en établissements de santé).
« Le résultat de la lutte contre les fraudes correspond au montant de préjudice détecté et stoppé par la Cnam.
« Sources : Cour des comptes d'après les données de la DSS, de la DGOS, du CEPS, de la Cnam, et les annexes Ondam du PLFSS et Maladie du Placss »
Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025
Ce montant de 4 milliards d'euros par an est cohérent avec les estimations disponibles par ailleurs. Ainsi, selon un rapport116(*) de l'Igas et de l'IGF, sur la période 2005-2012, la croissance de l'Ondam, de 3,2 % par an en moyenne, aurait résulté d'une croissance spontanée de 4,4 % et de mesures de régulation de 1,2 point (soit environ 3 milliards d'euros).
La maîtrise médicalisée des dépenses (environ 0,5 milliard d'euros par an)
Les seules mesures suivies en exécution dans des documents publics sont celles relatives à la maîtrise médicalisée des dépenses, d'environ 0,5 milliard d'euros par an (pour un objectif annuel d'environ 0,6 milliard d'euros). Ce suivi est assuré par la Cnam, qui renseigne l'indicateur correspondant du rapport sur l'évaluation des dépenses de sécurité sociale (Repss) relatif à la santé117(*).
En moyenne, et en chiffres arrondis, la maîtrise médicalisée se serait répartie depuis 2005 entre environ 0,3 milliard d'euros pour les prescriptions de médicaments (dont 20 % pour la réduction de la surprescription de statines118(*)), 0,1 milliard d'euros pour d'autres prestations et 0,1 milliard d'euros pour les transports médicalisés et les arrêts de travail.
3. Les propositions faites par la Cour des comptes en avril 2025 et par la Cnam en juillet 2025 ont seulement pour objet de permettre le respect de l'Ondam prévu par la LFSS pour 2025
a) Des propositions très proches par leur nature
La Cour des comptes, dans sa note sur l'Ondam d'avril 2025119(*), et la Cnam, dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025120(*), proposent des mesures devant permettre de réaliser des économies de respectivement 19,7 milliards d'euros d'ici 2029 (soit environ 5 milliards d'euros par an) et 22,5 milliards d'euros d'ici 2030 (soit environ 4,5 milliards d'euros par an).
S'y ajoutent quelques mesures relatives aux recettes, qui portent ces montants à respectivement 20,4 et 25,0 milliards d'euros. Dans le cas de la Cour, il s'agit de majorer les transferts de la branche AT-MP à la branche maladie (ce à quoi la commission s'est opposée en 2024121(*) et qui en tout état de cause n'a pas d'effet sur le solde de la sécurité sociale). Dans le cas de la Cnam, il s'agit de compenser la tendance spontanée de ses recettes à diminuer en points de PIB, du fait du faible dynamisme de certaines recettes (comme les droits tabac, en diminution structurelle)122(*).
Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, il ne s'agit pas de ramener la branche maladie à l'équilibre, mais seulement de permettre le respect de la trajectoire de l'Ondam prévue jusqu'en 2028 par la LFSS pour 2025 (qui prévoit un déficit de la branche maladie de 16,8 milliards d'euros en 2028).
Les mesures proposées sont très proches (cf. tableau).
Les propositions de mesures d'amélioration
du solde à moyen terme
de la Cour des comptes et de la
Cnam
(en milliards d'euros)
|
Amélioration du solde en 2029 (Cour des comptes) ou 2030 (Cnam) |
||
|
Cour des comptes |
Cnam |
|
|
Lutte contre la fraude |
1,5 |
3,0 |
|
« Mieux lutter contre les fraudes dans les trois branches de la sécurité sociale qui financent l'Ondam » (proposition n° 1) |
1,5 |
|
|
« Lutte contre les fraudes » |
3,0 |
|
|
Prévention /prise en charge des maladies chroniques |
1,4 |
0,5 |
|
« Améliorer la détection et la prise en charge des maladies chroniques » (proposition n° 6) |
0,4 |
|
|
« Améliorer la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et viser une réduction des chutes et des décès induits » (proposition n° 7) |
1,0 |
|
|
« Développer la prévention secondaire et tertiaire pour réduire la prévalence des maladies chroniques et leurs complications » |
0,5 |
|
|
Pertinence des soins |
4,4 |
4,0 |
|
« Amplifier la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et réduire les écarts de dépenses de santé atypiques constatés entre départements » (proposition n° 2) |
2,8 |
|
|
« Poursuivre le virage ambulatoire dans les établissements de santé » (proposition n° 8) |
0,8 |
|
|
« Viser l'amélioration de la qualité des soins pour réduire les évènements indésirables graves en établissements de santé » (proposition n° 9) |
0,8 |
|
|
« Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système » |
4,0 |
|
|
Parcours de soins/carte sanitaire |
1,0 |
2,0 |
|
« Dans la perspective d'organisation régionale des parcours de soins, restructurer les services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins » (proposition n° 10) |
1,0 |
|
|
« Organisation des parcours et du lien ville-hôpital : mieux prendre en charge les pathologies chroniques » |
2,0 |
|
|
Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |
1,7 |
3,0 |
|
« Dans une démarche partenariale et pluriannuelle avec les organismes complémentaires de santé, rééquilibrer les prises en charge des dépenses de santé » (proposition n° 11) |
1,3 |
|
|
« Mieux responsabiliser les assurés » (proposition n° 15) |
0,4 |
|
|
Stabilisation de la répartition des dépenses entre la sécurité sociale et les complémentaires santé par rapport à 2025 |
3,0 |
|
|
Produits de santé |
5,3 |
6,0 |
|
« Poursuivre la baisse des prix des produits de santé et accentuer les actions en faveur de leur bon usage » (proposition n° 5) |
5,3 |
|
|
« Produits de santé : assurer une régulation compatible avec la soutenabilité de notre système de santé » |
6,0 |
|
|
Rémunération des professionnels de santé |
0,0 |
2,0 |
|
« Régulation sectorielle : prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière » |
2,0 |
|
|
Efficience administrative |
0,6 |
0,0 |
|
« Optimiser la gestion des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics et privés à but non lucratif » (proposition n° 4) |
0,6 |
|
|
Indemnités journalières |
0,5 |
2,0 |
|
« En concertation avec les partenaires sociaux, alléger la charge pour l'assurance maladie obligatoire des indemnités journalières maladie des salariés » (proposition n° 13) |
0,5 |
|
|
« Arrêts de travail : ajuster les dispositifs de prise en charge des indemnités journalières » |
2,0 |
|
|
Transport sanitaire |
0,3 |
0,0 |
|
« Réduire la progression des dépenses de transport sanitaire » (proposition n° 3) |
0,3 |
|
|
Bonne pratique |
3,0 |
0,0 |
|
« Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS » (proposition n° 14) |
3,0 |
|
|
Total des mesures sur les dépenses |
19,7 |
22,5 |
|
Neutralisation de la tendance spontanée des recettes à diminuer en points de PIB (mesures sur les recettes) |
2,5 |
|
|
« Fixer le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie au niveau médian de l'estimation de la commission chargée de l'évaluation de la sous-déclaration des maladies professionnelles (2,8 Md€) » (proposition n° 12) |
0,8 |
|
|
Total des mesures |
20,4 |
25,0 |
Ces propositions sont présentées de manière plus détaillée dans les annexes IV et V au présent rapport.
Pour faciliter la lecture, les chiffrages indiqués sous forme de fourchette ont été remplacés par une moyenne.
Sources : D'après :
- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025
- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
b) Les propositions de la Cour des comptes
Comme le président de la sixième chambre de la Cour des comptes l'a souligné lors de son audition par la commission le 30 avril 2025, cette contribution à la revue de dépenses publiques s'appuie sur des travaux existants. Il était selon lui possible d'aller bien plus loin, en particulier dans le cas de la prévention.
La direction de la sécurité sociale estime que les mesures proposées ne sont pas toutes susceptibles de produire les montants d'économies avancés à horizon 2029. Elle souligne en outre qu'il était déjà prévu de suivre certaines pistes : transport sanitaire (protocole en cours de négociation), programme Phare, augmentation des taux d'activité ambulatoire, lutte contre la fraude.
La proposition n° 12 n'a pas d'effet sur le solde global de la sécurité sociale, et n'entre donc pas dans le champ du présent rapport.
La proposition n° 13, relative aux indemnités journalières, renvoie aux propositions plus détaillées figurant dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024.
c) Les propositions de la Cnam
Les 60 propositions de la Cnam, synthétisées dans l'annexe IV au présent rapport, sont intégralement reproduites dans son annexe V.
La Cnam propose de réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici 2030 par le levier intitulé « Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système ». La Cnam préconise notamment de mieux permettre aux professionnels de santé de comparer leurs pratiques à celles de leurs pairs, d'assurer une utilisation systématique du dossier médical partagé (DMP) en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP (biologie-radiologie en priorité), de rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec intelligence artificielle) et de sécuriser « l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».
La Cnam évalue les économies permises par la lutte contre la fraude à 3 milliards d'euros en 2030 (contre 1,5 milliard d'euros pour la Cour des comptes). Les rapporteures ne sont pas en mesure d'apprécier le réalisme de cet objectif, qui implique notamment une estimation du montant global de la fraude nettement supérieure à celle retenue jusqu'à présent par la Cnam (cf. infra).
La Cnam propose de transférer 3 milliards d'euros de charges vers les complémentaires santé, correspondant à son estimation de ce qui est nécessaire pour que les parts respectives de l'assurance maladie et des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses de santé reste constante d'ici 2030123(*).
On peut s'étonner du faible montant des économies devant résulter du développement de la prévention. Selon l'introduction au rapport « charges et produits » du directeur général de la Cnam, il faut « une mobilisation massive en faveur de la prévention, qui doit être la grande cause de la décennie ». Pourtant, les économies attendues d'ici 2030 en ce domaine sont de seulement 0,5 milliard d'euros (contre 1 milliard d'euros pour la Cour des comptes, rien que pour les personnes âgées).
d) Par rapport à la pratique 2015- 2021, les propositions de la Cour des comptes reposent nettement plus sur les volumes, celles de la Cnam nettement plus sur la lutte contre la fraude, les volumes et la prise en charge
Le tableau ci-après répartit les mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles concernent les volumes, les prix ou la prise en charge.
Répartition des mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles agissent sur les volumes, les prix ou la prise en charge
(en milliards d'euros)
|
Cour des comptes (économie en 2029) |
Cnam (économie en 2030) |
|
|
Propositions réduisant les volumes |
8,3 |
6,5 |
|
Prévention /prise en charge des maladies chroniques |
1,4 |
0,5 |
|
Pertinence des soins |
4,4 |
4,0 |
|
Parcours de soins/carte sanitaire |
1,0 |
2,0 |
|
Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les volumes* |
1,5 |
0,0 |
|
Propositions réduisant les prix |
7,4 |
8,0 |
|
Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les prix* |
1,5 |
|
|
Produits de santé |
5,3 |
6,0 |
|
Rémunération des professionnels de santé |
0,0 |
2,0 |
|
Efficience administrative |
0,6 |
0,0 |
|
Propositions réduisant la prise en charge |
2,5 |
5,0 |
|
Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |
1,7 |
3,0 |
|
Indemnités journalières |
0,5 |
2,0 |
|
Transport sanitaire |
0,3 |
0,0 |
|
Lutte contre la fraude |
1,5 |
3,0 |
|
Total des mesures sur les dépenses |
19,7 |
22,5 |
* Convention.
Sources : Mecss du Sénat, d'après :
- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025
- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, la maîtrise de la dépense cesserait de reposer majoritairement sur les prix : les mesures concernées passeraient de 60 % en 2015-2021 (en prévision) à 35 %.
Toutefois ce résultat serait atteint par des moyens différents. Dans le cas de la Cour des comptes, il s'agirait à peu près exclusivement d'agir davantage sur les volumes (les mesures concernées passant de 0,8 milliard d'euros par an à 2,1 milliards d'euros par an). Dans le cas de la Cnam, le montant des mesures relatives aux volumes augmenterait moins (passant de 0,8 milliard d'euros à 1,3 milliard d'euros), la maîtrise de la dépense reposant presque autant sur les mesures relatives à la prise en charge (passant de 0,6 à 1 milliard d'euros) ou sur la lutte contre la fraude (passant de 0,1 à 0,6 milliard d'euros).
Répartition des mesures proposées
par la Cour des comptes et la Cnam
selon qu'elles agissent sur les volumes,
les prix ou la prise en charge : comparaison avec la pratique
passée
(en milliards d'euros par an)
* Données prévisionnelles. Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021.
** Mecss du Sénat, d'après Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
*** Mecss du Sénat, d'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées
4. Limiter le coût des dépenses de médicaments ?
a) La forte augmentation des dépenses de médicaments depuis 2020
On assiste depuis 2020 à une forte croissance des dépenses de médicaments, comme le montre le graphique ci-après.
Dépenses de santé remboursées par la sécurité sociale
(en millions d'euros)
Remarque : les montants remboursés bruts sont les montants calculés sur la base des prix faciaux, les montants nets sont calculés après reversements des remises des laboratoires pharmaceutiques à l'Assurance maladie et les montants super-nets sont calculés postremboursement de la clause de sauvegarde (et correspondent donc à la dépense effective de l'Assurance maladie).
Source : D'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Alors que le nombre de boîtes vendues est plutôt orienté à la baisse, et que le prix des médicaments déjà sur le marché tend à baisser au fil du temps, cet effet provient de l'introduction sur le marché de nouveaux médicaments, ainsi que de la déformation de la consommation au profit de médicaments plus récents et plus chers (« effet structure »).
L'encadré ci-après rappelle les principaux outils de régulation du médicament.
Les principaux outils de régulation du médicament
La fixation initiale du prix
L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est attribuée par l'Agence européenne du médicament (EMA) ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
La commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) rend alors un avis évaluant le service médical rendu (SMR) et l'amélioration du service médical rendu (ASMR). Dans le cas des médicaments se revendiquant innovants (ASMR I à III) et pouvant avoir un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie, la commission économique et de santé publique (Ceesp) de la HAS évalue l'efficience sur la base des données médico-économiques.
Le SMR détermine le niveau de prise en charge par l'assurance maladie (à 65 %, 30 % ou 15 %). L'ASMR et l'efficience sont quant à elles prises en compte par le comité économique des produits de santé (CEPS) lors de sa négociation du prix avec les industriels.
Les modalités de prise en charge par l'assurance maladie et le prix sont décidés par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les autres outils de régulation
Parmi les autres outils de régulation, on peut en particulier mentionner :
- la « clause de sauvegarde », instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999124(*). Il s'agit d'une « corde de rappel budgétaire », destinée à permettre le respect de l'Ondam dans le cas où les outils de régulation infra-annuelle et microéconomique du secteur ne permettraient pas de respecter le niveau de dépenses d'assurance maladie prévu. Depuis la LFSS pour 2019125(*), la clause de sauvegarde des médicaments se déclenche lorsque l'activité du secteur dépasse le seuil déterminé, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile par l'ensemble des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est supérieur au montant M fixé annuellement en LFSS. Dans ce cas, l'ensemble de ces entreprises est assujetti à une contribution, affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)126(*). En 2025, pour la troisième année consécutive, son rendement devrait s'élever à environ 1,6 milliard d'euros ;
- les remises tarifaires négociées par le CEPS ;
- les campagnes de baisses de prix conduites par le CEPS, en application de la loi, et devant permettre une diminution progressive des prix applicables dans le cycle de vie du médicament.
b) Les principales propositions pour maîtriser les dépenses de médicaments
(1) Les propositions de la Cour des comptes dans le cas des médicaments anticancéreux (2024)
Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2024127(*), la Cour des comptes a fait diverses recommandations relatives à la régulation des médicaments anticancéreux. Il s'agissait en particulier :
- de faire en sorte que la commission d'évaluation économique et de santé publique (Ceesp) de la Haute Autorité de santé (HAS) produise elle-même des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques ;
- de définir des valeurs de référence pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé) ;
- de mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, l'exploitation de données en « vie réelle » devant permettre d'observer si les résultats étaient cohérents avec ceux des essais ;
- de renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque les études montraient des résultats inférieurs à ceux attendus.
Les recommandations de la Cour des comptes
relatives à la régulation
des médicaments
anticancéreux
« 18. renforcer la capacité de la commission d'évaluation économique et de santé publique à produire des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques, en s'appuyant notamment sur les universités (Haute Autorité de santé) ;
19. en se fondant sur les études médico-économiques et en vue de la négociation du prix des médicaments, définir des valeurs de référence pour l'indicateur exprimant le rapport entre les différentiels de coût et d'efficacité entre un nouveau médicament et un médicament comparable existant (Haute Autorité de santé, Comité économique des produits de santé) ;
20. mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, financé par une contribution des laboratoires concernés (ministère du travail, de la santé et des solidarités, Institut national du cancer) ;
21. renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque des études, non disponibles au moment de la fixation du prix initial, montrent des résultats inférieurs à ceux attendus (Comité économique des produits de santé). »
Source : Cour des comptes, « Les médicaments anti-cancéreux : mieux réguler en préservant un accès rapide aux traitements innovants », in La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024
(2) Les propositions du rapport « charges et produits »
Dans le rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam reprend, dans sa proposition n° 26, l'objectif de baisse de prix des médicaments anticancéreux (ce qu'elle appelle « le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie »).
Elle étend l'objectif de baisse des prix aux médicaments présentant l'amélioration du service médical rendu (ASMR) la plus faible, dont le coût par patient est en forte augmentation (cf. graphique ci-après), et souligne la nécessité de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques, auxquels s'ajoutent désormais les médicaments biosimilaires128(*).
Comparaison de la dépense remboursable, nette de remises, par patient, selon le niveau d'amélioration du service médical rendu (ASMR) entre 2017 et 2024
ASMR : amélioration du service médical rendu (ASMR I = la plus élevée ; ASMR V = la plus faible).
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
La Cnam envisage également, comme « option », de « reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030 ».
Les propositions du rapport « charges
et produits » de la Cnam
de juillet 2025 pour
maîtriser les dépenses de médicaments
Proposition 25 : Garantir une hiérarchie des prix cohérente avec le progrès thérapeutique des médicaments
- Réaliser des baisses de tarifs sur les ASMR IV représentant une baisse de 20 % des coûts par patient d'ici 2030 afin de compenser la forte hausse des coûts depuis 2017
- Réaliser des baisses de tarifs sur les médicaments à ASMR V afin de retrouver le niveau de dépenses observé en 2019
- Compte tenu de l'augmentation des dépenses de médicaments et du déficit de la sécurité sociale, il est nécessaire d'accroitre le niveau d'économies générées par ces produits en leur permettant de rentrer dans le panier de soins remboursable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- Les médicaments ASMR V (sous brevet) acceptent une baisse de prix de 20 % minimum par rapport au prix net du comparateur le moins cher
- Les médicaments ASMR IV acceptent une baisse de prix par rapport au prix net du comparateur le moins cher
- Dans les deux cas ci-dessus, les prix nets sont alignés aux prix faciaux.
Proposition 26 : Enrayer le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie
- Revoir la politique de tarifs excessifs sur les médicaments anti-cancéreux
- Réinterroger le remboursement de certains médicaments anticancéreux ne présentant aucun résultat probant dans le cadre de leurs essais cliniques et exiger des données probantes dans le cadre des nouvelles inscriptions
Proposition 27 : Instaurer un mécanisme permettant de faire financer par les acteurs du médicament et l'Assurance Maladie les essais thérapeutiques en lien avec la désescalade thérapeutique
Proposition 28 : Augmenter les économies en lien avec les génériques et biosimilaires
- Appliquer aux médicaments biosimilaires, l'ensemble des dispositifs ayant permis une pénétration forte des médicaments générique : tiers payant contre biosimilaires, alignement des remboursements bioréférents, biosimilaires au bout de deux ans de commercialisation du biosimilaires...
- Empêcher les stratégies de contournement des laboratoires par la constitution de groupe de médicaments interchangeables (« jumbo groups »)
- Les génériques génèrent des économies substantielles pour l'Assurance Maladie. Le délai d'entrée en vigueur de leur prise en charge sur la base du tarif de remboursement ajusté (TRA) est aujourd'hui de 2 ans. Or, compte tenu de la nécessité d'accélérer leur pénétration, ce délai doit être réduit à un an et leur base de remboursement pourrait être modifiée au profit de celle du générique le moins cher.
Proposition 29 : Accélérer les négociations pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce
- Renforcer les incitations au débouclage en limitant dans le temps la durée de la négociation pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce
Option non consensuelle* présentée au Conseil de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie sur le médicament
Reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030
* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
(3) Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils
Dans leur récent rapport129(*) au Premier ministre, les trois Hauts Conseils font pour l'essentiel des préconisations analogues à celles de la Cour des comptes et de la Cnam.
Ce rapport reprend l'essentiel des recommandations de la Cour des comptes relatives à la régulation des médicaments anticancéreux, en les étendant à l'ensemble des médicaments innovants. Il préconise, comme la Cnam, de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques et biosimilaires.
Il préconise en outre de « revenir sur l'extension de la liste en sus »130(*), qui depuis 2022 concerne notamment des médicaments dont l'amélioration du service médical rendu (ASMR) est mineure.
Les propositions du rapport des trois Hauts
Conseils
pour maîtriser les dépenses de
médicaments
• « La diffusion du générique au sein du répertoire est aujourd'hui acquise : la part du répertoire, le biosimilaire et les médicaments hybrides constituent de nouvelles marges d'efficience »
Le rapport préconise :
- d'augmenter la proportion de médicaments inscrits au répertoire. En effet, le taux de pénétration des génériques (92,7 % en 2023) est calculé sur la base des seuls médicaments dits « inscrits au répertoire », qui en 2024 ont représenté seulement 1,2 milliard de boîtes (soit 9,7 milliards d'euros), sur un total de médicaments remboursables correspondant à 2,4 milliards de boîtes (30,2 milliards d'euros)131(*). Il en résultait en 2021 un taux de pénétration sur la totalité du marché de seulement 30 % en nombre de boîtes, contre 52 % pour l'ensemble de l'OCDE132(*). Bien que, selon la Cnam, la France se situe dans la moyenne européenne après correction pour prendre en compte le Doliprane, elle n'en a pas moins un taux de pénétration plus faible que, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas133(*). Ainsi, selon le rapport « il est nécessaire que l'ANSM fasse évoluer sa politique d'inscription dans le répertoire pour la rapprocher des autres pays européens et de prendre des dispositions pour lutter contre les techniques de contournements des laboratoires (bithérapie changement de dosage...) » ;
- d'augmenter le taux de pénétration des biosimilaires, de seulement 32 %, en recourant aux « outils qui ont permis au générique d'atteindre ses niveaux actuels de substitution : alignement des marges des pharmacies d'officine pour encourager la substitution, tiers payant contre biosimilaires ».
• « Revenir sur l'extension de la liste en sus »
Un décret a ouvert, à compter du 1er janvier 2022, l'inscription sur la « liste en sus »134(*) à tous les médicaments auxquels la commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) a reconnu une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV). Cette mesure était alors présentée comme coûtant 370 millions d'euros sa première année.
• « Nécessité d'améliorer l'utilisation des données en vie réelle sur les médicaments innovants »
Un dispositif dit d'« accès précoce » permet, pour des maladies graves, rares ou invalidantes, la prise en charge par l'assurance maladie de médicaments innovants non encore titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM)135(*).
Le rapport préconise de mettre en oeuvre, pour l'ensemble des médicaments innovants, les recommandations 20 et 21 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes : « La contrepartie de l'accès précoce au marché de médicaments innovants devrait être l'exploitation de données en vie réelle permettent d'observer si les résultats sont cohérents avec ceux des essais. [...] Or, contrairement à plusieurs pays européens, la France ne dispose pas de registre national permettant de suivre en vie réelle les innovations thérapeutiques des médicaments anticancéreux et leurs résultats, hormis celui existant pour les traitements par cellules CAR-T. Cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense ».
• « Nécessité d'améliorer l'évaluation médico-économique et son utilisation »
Conformément aux recommandations 18 et 19 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes, le rapport préconise :
- que la Ceesp réalise elle-même les évaluations (au lieu de s'appuyer sur celles des industriels) ;
- que, pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé), elle publie, à titre de référence indicative, une valeur plafond que ce ratio ne devrait pas excéder136(*). Selon le rapport, « cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense, et donnera l'occasion de questionner l'acceptabilité du coût des médicaments onéreux dans leur ensemble. Le désarmement partiel de l'outil des baisses de prix a contribué à l'accélération de la dynamique des dépenses de médicaments. La situation financière de l'assurance-maladie ne permet pas aujourd'hui de faire l'économie de ce levier ».
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
5. Améliorer la pertinence des soins ?
a) Des incitations encore insuffisantes
(1) La situation actuelle pour la médecine de ville
(a) La rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp)
Dans le cas de la médecine de ville, la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), instaurée en 2012, est définie par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. La convention actuellement en vigueur, approuvée par arrêté le 20 juin 2024, supprime la Rosp à compter de 2026 (pour versement en 2027), du fait de l'instauration du forfait médecin traitant (intégrant les majorations prévention).
La Rosp correspond à environ 15 % des honoraires des médecins généralistes et 1 % de ceux des médecins spécialistes137(*). En 2022, 64 824 médecins ont été rémunérés dans le cadre de la Rosp « médecin traitant de l'adulte », pour un montant total de 264,6 millions d'euros (ce qui correspond à un montant moyen d'environ 4 000 euros).
Les indicateurs de la Rosp sont retracés chaque année dans le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).
Évolution des indicateurs de la
rémunération
sur objectifs de santé publique
(Rosp)
Optimisation des prescriptions
Remarques :
- Les graphiques concernent les conventions de 2011 et 2016, qui ne retiennent pas nécessairement les mêmes définitions.
- Pour favoriser la lisibilité des graphiques, les définitions des indicateurs ne sont pas reproduites ici.
- L'objectif peut correspondre à une hausse ou à une baisse.
Source : D'après le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023
Les résultats sont contrastés :
- dans le cas de la prévention, les seules avancées significatives sont la réduction du recours aux antibiotiques (toutefois toujours supérieur à l'objectif) et, depuis la crise sanitaire, le retour de la vaccination des personnes de 65 ans et plus, jusqu'alors en baisse, à son niveau de 2011 (sans que le lien avec l'action des médecins soit toutefois évident) ;
- dans le cas du suivi des pathologies chroniques, on peut mentionner l'augmentation du dosage de l'hémoglobine gliquée chez les patients diabétiques et du dépistage de la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques ou hypertendus (l'objectif n'étant toutefois atteint que dans ce dernier cas) ;
- dans le cas de l'optimisation des prescriptions, les principales avancées concernent le recours aux génériques (statines, antihypertenseurs, reste du répertoire) et aux biosimilaires (insuline glargine) - l'objectif n'étant toutefois pas atteint dans le cas des statines et du reste du répertoire.
Surtout, la Rosp est l'un des éléments de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui selon la Cnam ne permet globalement que des économies d'environ 500 millions d'euros par an. Si l'on veut réduire dans des proportions importantes la surconsommation de soins de ville, il faut donc aller plus loin.
(b) Les avancées récentes
L'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une utile règle procédurale.
Cet article prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé, d'un acte ou d'un transport de patient peut être subordonnée, « lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage », à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur et vérifié informatiquement, indiquant, « à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ».
La convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prévoit en outre de « renforcer les dispositifs de retour d'informations auprès des médecins ». Pour cela, l'assurance maladie doit notamment « partager avec l'ensemble des professionnels les référentiels de bonne pratique définis par la HAS et le ministère en charge de la santé et les informer des mises à jour » et « mieux outiller les médecins », ce qui implique en particulier de « mettre à disposition sur amelipro des outils de datavisualisation permettant aux médecins d'avoir un retour d'information sur leur pratique ». Les médecins doivent quant à eux « prescrire systématiquement via l'ordonnance numérique », ce qui doit notamment faciliter le suivi de leurs prescriptions.
Les médecins se sont également collectivement engagés à mettre en oeuvre des « programmes d'actions partagés » visant à améliorer la pertinence des soins.
Par ailleurs, la convention met en place des dispositifs d'intéressement, devant permettre un partage financier des économies permises par l'amélioration de la pertinence et de la sobriété des prescriptions (intéressement à la prescription de biosimilaires, intéressement à la dé-prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, etc.).
(2) La situation actuelle pour l'hôpital
Dans le cas des services hospitaliers, la Cour des comptes a souligné que les critères d'évaluation étaient insuffisamment tournés vers les résultats pour le patient.
La nécessité de davantage orienter
les critères d'évaluation des hôpitaux
vers les
résultats pour le patient, selon la Cour des comptes
Selon la Cour des comptes, « en 2016, le jeu des indicateurs de qualité utilisés par la HAS restait très centré sur les structures (76) et les processus (145), par comparaison avec les résultats pour le patient (39)114, tandis qu'en Allemagne, 308 indicateurs intéressaient les résultats des prestations de soins, contre seulement 19 pour les processus et quatre pour les structures. Tel est le cas aussi de l'Angleterre : 153 indicateurs suivis pour les résultats, 61 pour les structures et 12 pour les processus »138(*).
La Cour des comptes faisait déjà un constat analogue dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2002.
Les objectifs d'efficience fixés aux hôpitaux sont en effet de nature essentiellement administrative, comme dans le cas des gains achat (programme Phare).
Objectifs de gains achat fixés dans le cadre du programme Phare
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024
Les objectifs de régulation des dépenses et d'amélioration des pratiques au sein des établissements de santé font l'objet depuis 2018 de contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins (Caqes). En 2023, les gains correspondants ont été de seulement 45,2 millions d'euros, comme le montre le tableau ci-après.
Économies générées par indicateur régional des Caqes en 2023
|
Indicateur national |
Économies générées (en €) |
Nombre d'ES ciblés en 2023 (en €) |
Économies par ES ciblé (en €) |
|
Indicateur insuffisance cardiaque |
4 900 937 |
254 |
19 295 |
|
Indicateur examens pré-anesthésiques |
109 843 |
341 |
322 |
|
Indicateur Pansement |
3 134 852 |
113 |
27 742 |
|
Indicateurs transport |
29 663 493 |
335 |
88 548 |
|
Indicateur inhibiteurs pompes à protons |
540 182 |
186 |
2 904 |
|
Indicateur Perfadom |
6 841 199 |
343 |
19 945 |
|
TOTAL |
45 190 506 |
1 104 |
40 933 |
Caqes : contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins.
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024
La qualité des soins est prise en compte dans le cadre du financement hospitalier, au moyen de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (Ifaq). Toutefois celle-ci est d'un montant limité.
b) Trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte
Le récent rapport139(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre insiste sur la nécessité, pour améliorer la pertinence des prescriptions, de trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte.
L'incitation implique notamment un accès aisé du professionnel de santé à l'information pertinente. Tel n'est pas toujours le cas. Par exemple, la structuration du dossier médical partagé (DMP) peut amener le professionnel de santé à ouvrir de nombreux documents pour déterminer si l'examen qu'il prévoit a déjà été réalisé.
La seule mesure contraignante pour laquelle le rapport des trois Hauts Conseils prend explicitement parti140(*) est de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances numériques (en cours de déploiement141(*)). En effet, le fait qu'elle ne comporte pas actuellement de mention de l'indication thérapeutique, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays, empêche d'apprécier le mésusage. Afin de préserver le secret médical, l'accès à cette information, si elle devait figurer dans l'ordonnance numérique, devrait être strictement encadré. Si une exploitation statistique, éventuellement sur la base de données anonymisées, ne poserait probablement pas de difficulté, il conviendrait de définir strictement la liste des professionnels de santé pouvant, le cas échéant, y accéder142(*). Lors de son audition par les rapporteures, Yann-Gaël Amghar, président du HCAAM, a évoqué le cas du médecin-conseil de la Cnam, qui pourrait ainsi cibler ses contrôles a posteriori sur certains praticiens. L'adoption d'une telle mesure, qui existe déjà pour les examens de biologie143(*), impliquerait un débat approfondi.
Le rapport envisage également de rendre obligatoire l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) et la consultation du DMP, et d'étendre le champ de l'accompagnement à la prescription144(*), comme c'est le cas dans certains pays145(*).
Principaux outils visant à améliorer
la pertinence des soins
(actuels ou envisagés par le récent
rapport des trois Hauts Conseils)
|
Outils existants |
Outils envisagés par le rapport |
|
|
Outils non contraignants |
• Échanges numériques entre professionnels (exemple : DMP) • LAP |
• Amélioration de l'ergonomie du DMP (qui doit permettre au professionnel d'accéder facilement à l'information) et des LAP (qui doivent trouver le bon équilibre entre facilitation de la prescription et incitation au respect des recommandations) • Information des professionnels et des patients sur les coûts des prescriptions • Modification des modes de rémunération |
|
Outils contraignants |
• Prescription obligatoire de certains médicaments sur ordonnance sécurisée (exemple : Tramadol, un analgésique opioïde) • Limitation de la délivrance de certains produits (exemple : 7 jours pour les pansements) • Depuis le 1er janvier 2025, en application de la LFSS 2024, accompagnement à la prescription pour certains médicaments via un formulaire sur amelipro permettant de s'assurer que le contexte permet le remboursement (exemple : antidiabétiques AGLP-1) • Demandes d'accord préalable (traitement de l'apnée du sommeil par ventilation à pression positive continue (PPC) ou orthèse avancée mandibulaire (OAM), grand appareillage, chirurgie bariatrique...) • Prise en charge conditionnée à la réalisation d'un acte préalable (exemple : dans le cas du cancer de la prostate, prise en charge du PSA libre conditionnée au résultat du dosage du PSA total) • Mise du professionnel de santé sous objectifs ou sous accord préalable |
• Utilisation obligatoire d'un LAP • Consultation obligatoire du DMP • Extension du champ de l'accompagnement à la prescription, comme c'est le cas dans certains pays • « Il est indispensable de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances » |
AGLP-1 : antidiabétiques analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1). DMP : dossier médical partagé. LAP : logiciel d'aide à la prescription. PSA : Prostate Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate).
Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
c) Les propositions de la Cnam pour améliorer la pertinence des soins
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam fait 16 propositions pour renforcer la pertinence des soins.
Les propositions n° 41 et n° 42, contraignantes, consistent respectivement :
- à « rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) » et à « étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports) » ;
- à « sécuriser l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».
Les autres propositions tendent notamment à améliorer l'information des patients et des praticiens et à rendre le financement de l'hôpital plus incitatif à la qualité des soins.
Les propositions du rapport « charges
et produits » de juillet 2025
pour renforcer la pertinence
des soins
« Proposition 36 : Faire connaître l'investissement public dans la santé au global (campagnes sur le coût d'un accouchement, une nuit à l'hôpital, etc.) et restituer à chaque assuré ce que l'Assurance Maladie a réellement investi pour sa consommation de soins
Proposition 37 : Développer le « retour d'information aux PS » sur leurs pratiques afin de leur permettre d'adapter au mieux leur exercice professionnel par eux-mêmes, en se comparant à leurs pairs
Proposition 38 : À différents stades de la carrière du professionnel de santé conventionné, s'assurer de sa bonne connaissance des dispositifs de facturation et de l'état de l'art en matière de qualité et de pertinence
Proposition 39 : Assurer une utilisation systématique du DMP en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP-MES (biologie-radiologie en priorité)
Proposition 40 : Développer fortement la déprescription
Proposition 41 : Rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) et étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports)
Proposition 42 : D'ici 2030, viser la sécurisation de l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence
Proposition 43 : Mettre en place une plateforme de commandes de transports gérée par l'Assurance Maladie prioritairement à l'appui des médecins de ville
Proposition 44 : Diminuer l'impact carbone et environnemental des prescriptions et engager avec l'ANSM des travaux sur la réutilisation des produits de santé non-ouverts et non-périmés pour limiter le gaspillage
Proposition 45 : Déployer un nouveau dispositif d'intéressement des établissements, financé sur le risque, permettant de partager les gains réalisés en matière de PHEV (Prescriptions hospitalières exécutées en ville)
Proposition 46 : Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier, viser une part variable à la qualité et à la pertinence représentant un montant croissant de l'enveloppe financière des établissements de santé dispositif Ifaq rénové et simplifié (e.g. Rosp = 10 %)
Proposition 47 : Transférer aux établissements de santé le budget des transports des patients dialysés dont ils auront désormais la gestion
Proposition 48 : Revoir le financement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers durant un séjour d'hospitalisation en établissement public de santé
Proposition 49 : Dès 2026, revoir les modalités d'encadrement et la tarification de la PPC pour revenir à des standards proches de ceux observés à l'étranger
Proposition 50 : D'ici 2027, construire un dispositif de régulation sectorielle pour mieux encadrer les dépenses de dispositifs médicaux de la LPP
Proposition 51 : Renforcer la régulation à l'installation des infirmiers libéraux via l'extension des zones sur-denses et l'instauration d'une règle de « deux départs pour une installation » dans les zones très sur-dotées »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
6. Revoir l'organisation des soins ?
a) Améliorer les parcours de soins ?
La nécessité d'améliorer l'efficience des parcours de soins est reconnue depuis longtemps. Ainsi, de 2015 à 2021, les gains prévisionnels des actions en ce domaine étaient évalués par les annexes aux PLFSS à environ 0,3 milliard d'euros chaque année146(*).
L'idée qu'il faudrait aller plus loin semble faire consensus.
Il existe une inadéquation manifeste entre l'organisation des soins, centrée sur les établissements de santé et conçue pour traiter des pathologies aigues, et les pathologies actuelles, de plus en plus chroniques.
Une idée relativement consensuelle est qu'il convient de renforcer la gradation des soins, en développant l'exercice collectif en dehors des établissements de santé147(*) tout en renforçant l'articulation avec ceux-ci148(*), conformément à la politique menée depuis une dizaine d'années.
Une meilleure orientation des patients149(*) et le renforcement de la permanence des soins ambulatoires (PDSA)150(*) peuvent quant à eux réduire le nombre de passages aux urgences. Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « si l'on évitait, par une prise en charge adéquate, 20 % des passages aux urgences, on peut estimer à plus d'un milliard d'euros l'économie directe réalisée, et près de 2 milliards d'euros si l'on prend en compte les transports sanitaires associés et les hospitalisations consécutives pour les personnes âgées ». Ce rapport souligne en particulier que « parmi les établissements publics de santé, la moitié environ des séjours sont engendrés par des passages aux urgences, et les effets iatrogéniques sur des sujets vulnérables majorent ensuite le recours à des soins de réadaptation, voire à des admissions en institution pour personnes dépendantes ».
Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 préconise en particulier de créer de nouveaux métiers de « référent de parcours » et « d'infirmière de coordination ».
Le rapport précité des trois Hauts Conseils souligne que, d'un point de vue financier, le renforcement de la gradation des soins se heurte à une double difficulté. Tout d'abord, le renforcement des moyens en dehors de l'hôpital étant coûteux, le renforcement de la gradation des soins implique de réduire la capacité hospitalière. Ensuite, en supposant que ce soit effectivement le cas, une telle politique pourrait être coûteuse dans un premier temps, cette réduction ne survenant que dans un second temps.
Les principales propositions du rapport
« charges et produits »
de juillet 2025
relatives aux parcours de soins
« Proposition 11 : Organiser systématiquement la sortie d'hôpital en construisant un cadre opérationnel dans tous les territoires avec les CPTS et les établissements de santé pour assurer la gestion des sorties avec les professionnels de ville et le secteur médico-social
Proposition 12 : Créer de nouveaux métiers de « référents de parcours » et « d'infirmière de coordination », et généraliser la responsabilité populationnelle des organisations territoriales
[...] Proposition 17 : Établir le cahier des charges organisationnel et financier des structures de soins non-programmés parfois nécessaires à un territoire pour la prise en charge des urgences en ville, en coordination avec le médecin traitant et l'hôpital »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
Les principales propositions organisationnelles du
récent rapport
des trois Hauts Conseils dans le cas de la
santé
« • Définir, conformément au code de santé publique, une stratégie nationale de santé (SNS) pluriannuelle (de 5 à 10 ans) déterminant des objectifs priorisés et qui propose des transformations du fonctionnement et du financement en profondeur du système de santé (cibles en termes d'exercices coordonnés, de rémunération actes/forfaitaire/salarié), qui structure la prévention (médicalisée, éducation thérapeutique du patient, leviers en dehors des soins, etc.). Cette SNS doit s'appuyer notamment sur le levier les innovations en santé probantes de financement au parcours et répondant en particulier aux besoins des patients, pour assurer une couverture homogène dans l'accès à la santé dans les territoires.
• Prévoir une loi de programmation, de santé publique, pluriannuelle permettant de bâtir une régulation budgétaire plus juste.
• Élargir le champ des LFSS aux règles de compétences entre professionnels de santé, délégaliser les règles qui peuvent l'être, afin de rendre le droit des compétences plus évolutif.
• Accélérer le passage en droit commun et accompagner l'usage des innovations thérapeutiques et la mise en oeuvre des innovations organisationnelles en mettant en place un accompagnement au plus proche des acteurs concernés dans tous les territoires. »
Le rapport estime en outre que « le premier levier d'économies perceptible pour l'activité hospitalière, et sur lequel il est possible de fédérer les communautés soignantes, reste, à côté des prises en charge à domicile, de parvenir à organiser les soins pour éviter au maximum le recours à des nuitées hospitalières, ainsi qu'à des séjours pendant les fins de semaine, en dehors des soins critiques. Ces périodes correspondent quoiqu'il en soit à des moments où l'intensité des soins est plus modérée et où les techniques modernes permettent d'assurer une part substantielle des soins et de la surveillance à domicile. Pour rappel, la couverture de la PDSES, permanence de soins en établissements de santé (nuits et weekends) représente plus de la moitié des moyens hospitaliers et il y a donc une capacité à dégager des moyens soignants considérables au bénéfice des usagers si ce besoin de couverture est réduit ».
Le rapport envisage en outre, notamment :
- dans le cas des GHT, de leur donner la personnalité morale et d'élargir le périmètre des mutualisations obligatoires à des activités présentant un fort potentiel d'économies d'échelles, comme la biologie ;
- dans le cas des maternités, d'en réduire le nombre, tout en permettant un hébergement temporaire à proximité d'une maternité quand la situation le nécessite151(*) ;
- de requalifier certains sites en antenne.
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
b) Revoir la carte hospitalière ?
Dans son rapport précité d'avril 2025 sur la maîtrise de l'Ondam, la Cour des comptes estime que la restructuration des services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins permettrait d'économiser entre 0,8 et 1,2 milliards d'euros152(*).
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire respecter les seuils existants d'activité minimum pour réaliser certaines activités de chirurgie » (proposition n° 19). Elle juge en outre nécessaire de « réussir la 2e vague de la chirurgie ambulatoire et ouvrir le champ de la chirurgie hors bloc » (proposition n° 18), ce qui impliquerait en particulier de « définir un plan opérationnel pour atteindre l'objectif de 80 % de taux de chirurgie ambulatoire » et de « définir le périmètre potentiel de la chirurgie hors bloc (en lien avec les sociétés savantes) ».
Le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre souligne les inégalités territoriales en ce qui concerne le nombre de lits par habitant153(*).
Toute réforme de la carte hospitalière devrait être incluse dans une réflexion plus large sur l'organisation des parcours de soins.
c) Améliorer la gouvernance pour favoriser la planification ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam propose d'« instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans ».
7. Développer la prévention ?
La nécessité de développer la prévention, qu'elle soit ciblée ou universelle, fait consensus, tant au niveau politique que parmi les experts de santé publique et les professionnels de santé.
La situation est toutefois très différente selon les différents types de prévention.
Les trois types de prévention
Il est d'usage de distinguer trois types de prévention :
- la prévention primaire, visant à éviter l'apparition de pathologies ;
- la prévention secondaire, visant à les détecter ;
- la prévention tertiaire, visant à prévenir leur aggravation.
La prévention primaire comprend notamment la vaccination, l'éducation à la santé et l'évitement des comportements à risque (tabagisme, consommation nocive d'alcool, consommation d'aliments à faible qualité nutritionnelle, etc.).
La prévention secondaire correspond principalement aux actions de dépistage.
La prévention tertiaire concerne en particulier la prise en charge des malades chroniques. Les actions d'éducation thérapeutique du patient, développées notamment dans le cadre hospitalier et impliquant le patient comme acteur de sa prise en charge, relèvent de la prévention tertiaire.
a) La prévention primaire implique un fort engagement politique
(1) Les pathologies évitables coûtent plus de 10 milliards d'euros aux finances publiques (hors impact du moindre PIB sur les recettes)
Le coût net des principales pathologies évitables pour les finances publiques154(*) est estimé, dans le cas de celles découlant de la consommation nocive d'alcool et du tabagisme, à respectivement 3,3 et 1,7 milliards d'euros en 2019155(*), et, dans le cas de l'obésité, à 9,5 milliards d'euros en 2012156(*).
(2) Développer la vaccination, éventuellement en la rendant obligatoire pour certains publics ?
La vaccination est insuffisamment développée en France.
À titre d'illustration, à l'hiver 2024-2025, la grippe a causé environ 10 000 morts, 30 000 hospitalisations et 3 millions de consultations. Cela doit être mis en relation avec une couverture antigrippale chez les 65 ans et plus de seulement 54 % et inférieure à 30 % chez les soignants.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire progresser la couverture vaccinale de la population » (proposition n° 5). Elle propose pour cela de « poursuivre la simplification du calendrier vaccinal, améliorer la lisibilité de la communication en la structurant par âge et par public, et poursuivre la dynamique d'extension du nombre de professionnels et d'établissements de santé en capacité de vacciner ».
Elle envisage (parmi les « options ») l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe en Ehpad pour les résidents » et l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé ».
(3) La fréquente nécessité d'arbitrer entre santé publique et soutien de filières économiques
Loin de se limiter à des enjeux techniques, le développement effectif de la prévention primaire est souvent un sujet essentiellement politique. En effet, les pathologies évitables découlant avant tout de comportements de consommation inadaptés, il s'agit en particulier de réaliser un arbitrage entre la santé publique et le soutien de filières économiques.
(4) Le rapport de la Mecss sur la fiscalité comportementale en santé (2024)
Un rapport157(*) de la Mecss du Sénat de 2024 sur la fiscalité comportementale en santé fait 16 propositions afin de renforcer la politique de prévention du tabagisme et de mettre en place une politique de prévention dans le cas de la consommation nocive d'alcool et de la mauvaise alimentation.
Dans le cas du tabagisme, la suppression par la commission mixte paritaire (CMP) d'un amendement du Sénat au PLFSS pour 2025, qui prévoyait pourtant une augmentation très modeste de la fiscalité du tabac158(*), montre la difficulté d'avancer en ce domaine. Comme le souligne le rapport précité, même selon les données de l'industrie du tabac, il n'y a pas d'explosion du nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle159(*), la forte augmentation de la part des cigarettes vendues dans ce cadre160(*) venant très majoritairement de la baisse du nombre de cigarettes vendues par les buralistes (qui traduit elle-même l'efficacité de la politique de lutte contre le tabagisme). Le principal enjeu des prochaines décennies est de faire en sorte que le prix des cigarettes demeure suffisamment élevé pour dissuader les jeunes d'entrer dans le tabagisme161(*), permettant ainsi de réduire la prévalence du tabagisme, particulièrement élevée en France.
Aucune avancée n'a eu lieu dans le cas de la lutte contre la consommation nocive d'alcool, au sujet de laquelle la Mecss du Sénat préconisait de réfléchir à l'instauration d'un prix minimum par unité d'alcool. Les rapporteures relèvent que le récent rapport162(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre considère que l'instauration d'un prix minimal par unité d'alcool « constitue la priorité ».
Les seules avancées sont :
- la mise en oeuvre de la proposition n° 11 par l'article 31 de la LFSS pour 2025, qui a réformé le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition (pour un rendement d'environ 0,2 milliard d'euros) ;
- la mise en oeuvre partielle de la proposition n° 6 par le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, qui interdit les produits à usage oral contenant de la nicotine (comme les « billes »).
Propositions du rapport d'information de la Mecss sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé (2024)
« Proposition n° 1 : Orienter davantage les recettes de la fiscalité comportementale vers des actions de prévention et communiquer clairement à ce sujet.
Proposition n° 2 : Concevoir et structurer une politique de prévention globale impliquant les structures scolaires et les collectivités territoriales, et intensifier les efforts en faveur de l'information et de la sensibilisation des consommateurs.
Proposition n° 3 : Assurer le respect des interdictions de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, par le renforcement des contrôles et des sanctions et la mise en place d'outils conditionnant le paiement à la vérification de l'âge.
Proposition n° 4 : Augmenter le prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation jusqu'en 2040, par la fiscalité et par une augmentation du taux de rémunération des buralistes.
Proposition n° 5 : Chiffrer selon une méthodologie fiable et transparente le nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle, et réduire ce nombre, par un renforcement de la lutte contre le commerce illicite, par des actions de prévention ciblées dans le cas du commerce transfrontalier licite, et en promouvant une révision en ce sens des directives tabac (harmonisation des prix à la hausse, application obligatoire des règles sur l'approvisionnement proportionné des marchés prévues par le protocole de 2012 à la convention de l'OMS sur la lutte antitabac).
Proposition n° 6 : Mieux encadrer la vente de produits contenant de la nicotine, en la limitant aux bureaux de tabac et aux magasins spécialisés et en interdisant leur vente aux mineurs, voire en instaurant une licence pour les magasins spécialisés.
Proposition n° 7 : Mener à bien, comme prévu par la loi, l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes.
Proposition n° 8 : Poursuivre, en associant les producteurs, la réflexion sur l'instauration éventuelle d'un prix minimum par unité d'alcool, afin notamment d'éviter que les augmentations de marge soient captées par les distributeurs.
Proposition n° 9 : Mieux encadrer la publicité pour l'alcool, en inscrivant à l'article L. 3351-7 du code de la santé publique des peines plus dissuasives et adaptées et en interdisant la publicité pour l'alcool sur internet.
Proposition n° 10 : Élaborer et rendre public un programme national de réduction des consommations nocives d'alcool.
Proposition n° 11 : Réformer le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition, afin de renforcer son efficacité et d'accentuer sa visée comportementale.
Proposition n° 12 : Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée, explicitant les objectifs poursuivis en termes de santé publique et valorisant le financement d'actions de prévention.
Proposition n° 13 : Fixer des quantités maximales de sucre, de sel ou de matières grasses pour certaines catégories d'aliments.
Proposition n° 14 : Produire et transmettre au Parlement dans les meilleurs délais le rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021, puis expérimenter un dispositif de soutien à l'achat de fruits et légumes par les ménages disposant de ressources inférieures à un seuil à déterminer.
Proposition n° 15 : Interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans.
Proposition n° 16 : Plaider pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. »
Source : Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024
(5) Taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons ?
Le rapport de 2024 précité de la Mecss du Sénat ne proposait pas de taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam suggère deux mesures à cet égard (proposition n° 8), consistant à modifier certains taux de TVA ou à instaurer une taxe sur certains aliments.
(a) Imposer certains aliments à un taux de TVA réduit ou nul ?
La directive (UE) 2022/542 a modifié l'article 98 de la directive TVA de 2006 pour prévoir que les États peuvent, en plus des deux taux réduits existant jusqu'alors (pour la France, 5,5 % et 10 %), instaurer un taux réduit supplémentaire ou un taux zéro, notamment pour les « denrées alimentaires ».
Aussi, le rapport « charges et produits » de juillet 2025 envisage d'utiliser cette nouvelle possibilité163(*) pour « redéfinir les taux de TVA sur plusieurs catégories de produits pour inciter à une consommation de produits sains et durables et à la pratique d'une activité physique ».
Il propose de réorienter ainsi la consommation vers « les produits issus d'une agriculture durable et labellisée comme telle ».
Une autre possibilité (non évoquée par le rapport « charges et produits ») serait de favoriser les fruits et légumes. En première analyse, l'instauration d'un taux de TVA nul sur les fruits et légumes pourrait coûter environ 1 milliard d'euros164(*).
Selon le rapport « charges et produits », « ce dispositif de modulation devra s'effectuer à rendement constant pour préserver les finances publiques, en augmentant le taux de certaines catégories de produits pour compenser l'application de taux réduits ou super réduits sur certains taux ».
(b) Instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires ?
Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 suggère en outre d'instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires : « sucre ajouté et produits alimentaires ultra-transformés, nitrites additifs, perturbateurs endocriniens (notamment le phtalate) ». Une mesure de ce type est également suggérée par le récent rapport des trois Hauts Conseils165(*).
Ces deux rapports ne présentent pas de chiffrage à cet égard.
Pour fixer un ordre de grandeur dans le cas du sucre, en première analyse, une taxe d'un euro par gramme de sucre pur pour les produits dont la masse comprend au moins 40 % de sucre pur pourrait rapporter près d'un milliard d'euros166(*).
Sur le modèle de la taxation des boissons sucrées résultant de la LFSS pour 2025, le barème de la taxe pourrait comprendre divers seuils afin d'inciter les entreprises à adapter leurs formules.
Il est à noter toutefois que, contrairement à ce qui est le cas pour les boissons sucrées, peu de pays appliquent aux aliments à faible qualité nutritionnelle une taxation spécifique167(*). Il est donc difficile de porter une appréciation sur l'efficacité de ce type de mesure, qui devrait vraisemblablement être incluse dans une politique nutritionnelle globale pour être efficace. Par ailleurs, le sujet est politiquement très sensible. Ainsi, la taxe sur les aliments contenant plus de 2,3 % de graisses saturées instaurée par le Danemark en 2011 a dû être abrogée 13 mois plus tard.
(6) Mieux prendre en compte les enjeux environnementaux ?
La qualité de l'environnement joue un rôle important en matière de santé, et donc de prévention. Ainsi, selon l'article 1er de la Charte de l'Environnement de 2004, « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Selon le rapport168(*) de 2015 de la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, les trois types de maladies causées par la pollution de l'air les plus communes sont les maladies respiratoires, au premier rang desquelles la bronchopneumopathie obstructive (BPCO), les pathologies cardiaques, dont les infarctus, et les cancers du poumon. Le rapport mentionne une étude de 2007 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset)169(*), qui évalue le coût global des traitements de l'asthme et des cancers imputables à la pollution de l'air à un montant compris entre 0,3 et 1,3 milliard d'euros. Il mentionne également une étude de 2015 du Commissariat général au développement durable (CGDD), qui évalue le coût de la pollution atmosphérique pour le système de soins à un montant compris entre 0,9 et 1,8 milliard d'euros.
Retenant une définition « large » de la notion d'environnement, le rapport170(*) de 2022 de la mission d'information du Sénat sur la sécurité sociale écologique prend en compte non seulement la qualité de l'air et le changement climatique, mais aussi la qualité de l'alimentation, et même l'ensemble des politiques publiques. En particulier, il considère que la crise sanitaire a montré qu'il convient, dans un objectif de prévention en santé, de prendre en compte les relations avec les écosystèmes, conformément à l'approche dite « Une seule santé » (« One Health »). Cela l'amène à préconiser, notamment, de « prendre en compte l'impact environnemental dès la conception des politiques publiques afin de créer un système de protection sociale plus résilient », d'« intégrer la santé environnementale dans les études d'impact accompagnant les projets de loi » et de « diffuser le concept Une Seule Santé (One Health) dans la littératie pour prendre davantage en compte la santé environnementale ».
Les moyens à mettre en oeuvre pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux ne relèvent pas des compétences de la commission des affaires sociales.
(7) Étendre la fiscalité comportementale aux « écrans » ?
Le récent rapport171(*) des trois Hauts Conseils préconise d'instaurer ce qu'il appelle une « taxe sur les écrans ».
Sans faire de préconisation précise, il évoque deux propositions à cet égard :
- une taxe de 2 % sur les revenus des « plateformes du numérique » générés en France, dont le produit serait alloué à un fonds en faveur de la santé mentale, comme préconisé par Gabriel Attal et Marcel Ruffo172(*) ;
- une taxation de la publicité numérique, comme proposé par les prix Nobel d'économie Daron Acemoglu et Simon Johnson173(*). Ces auteurs recommandent, dans le cas des États-Unis, une taxe de 50 % pour les revenus annuels de la publicité numérique dépassant 0,5 milliard d'euros. Il s'agit explicitement d'inciter à passer d'un financement par la publicité à un financement par abonnement, dont ils considèrent qu'il susciterait moins de problèmes de santé mentale et inciterait moins à l'extrémisme et à la violence.
Pour mémoire, depuis la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, les articles 299 et suivants du code général des impôts prévoient une « taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique » (dite « taxe Gafam », ou « taxe sur les services numériques »). La taxe est de 3 % sur les « sommes encaissées par le redevable ». Son rendement prévisionnel en 2025 est de 0,8 milliard d'euros174(*).
Les rapporteures n'ont pas eu le temps d'expertiser ce sujet, qui par ailleurs dépasse les compétences de la seule commission des affaires sociales. En particulier, la « taxe Gafam » a été mentionnée par la présidence des États-Unis dans le cadre de l'actuel conflit commercial175(*).
On peut toutefois indiquer qu'en 2024, le chiffre d'affaires de la publicité digitale aurait été de 11 milliards d'euros176(*). Toutes choses égales par ailleurs, taxer cette assiette au taux de 50 % (préconisé par Acemoglu et Johnson) pourrait donc rapporter initialement plus de 5 milliards d'euros.
b) Renforcer la prévention secondaire ?
(1) Renforcer les dépistages ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire progresser les dépistages du cancer » (proposition n° 2). Il s'agirait notamment d'« interdire les dépassements d'honoraires pour les actes en lien avec les dépistages organisés (mammographie, échographie et coloscopie...) » et d'ouvrir « la possibilité de remettre le kit de dépistage du cancer colorectal aux infirmières, aux biologistes et aux sages-femmes ».
La Cnam préconise également de « faire progresser les dépistages des [maladies cardio-vasculaires] » (proposition n° 3). Elle annonce qu'une grande campagne de communication sera déployée à destination du grand public au printemps 2026. Comme pour la campagne « know your numbers »177(*) diffusée au Royaume-Uni, les assurés seront invités à « connaître leurs chiffres » (pression artérielle, glycémie, cholestérolémie, poids) et à agir sur leur santé cardiovasculaire en conséquence. Le dépistage serait en outre ouvert aux pharmaciens.
(2) Faut-il subordonner le niveau de prise en charge au respect des obligations de dépistage par le patient ?
Lors des auditions, a été envisagée la possible subordination du niveau de prise en charge de certaines pathologies par l'assurance maladie au respect par le patient de ses obligations en matière de dépistage.
Il est à noter qu'une incitation de ce type existe en Allemagne dans le cas des soins dentaires (cf. encadré).
De telles mesures, en particulier si elles devaient concerner des pathologies lourdes, poseraient des questions de principe, qui impliqueraient un débat politique approfondi.
Le rapport précité des trois Hauts Conseils considère que si elles étaient mises en oeuvre au moyen d'une prime (plutôt que par une réduction de la prise en charge par la sécurité sociale), elles constitueraient un effet d'aubaine pour une grande partie, voire la majorité, des personnes concernées. Il estime en outre qu'elles pourraient défavoriser les personnes à faibles revenus, souvent éloignées de la prévention, ou celles ayant des « difficultés d'accès aux professionnels et aux rendez-vous » (déserts médicaux, freins monétaires réels ou supposés, fracture numérique, freins à la mobilité).
Lors de son audition par les rapporteures, Yann-Gaël Amghar, président du HCAAM, a estimé que les inégalités d'accès à la prévention accentuaient les inégalités de santé.
L'incitation financière à la prévention bucco-dentaire en Allemagne
En Allemagne, pour les plafonds de prise en charge des prothèses dentaires, un système de bonus (Festzuschusssystem für Zahnersatz) vise à garantir que les assurés bénéficient de soins dentaires préventifs. L'assuré doit faire examiner ses dents au moins une fois par an et documenter ces examens dans un carnet de bonus.
Les taux de prise en charge sont en effet les suivants :
• prise en charge standard sans bonus : 60 % ;
• après 5 ans avec une documentation complète des contrôles : 70 % ;
• après 10 ans : 75 %.
c) Renforcer la prévention tertiaire, en particulier dans le cas des personnes atteintes de pathologies chroniques ?
Dans un récent article178(*) publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, préconise d'inciter les professionnels de santé à développer la prévention tertiaire. Il s'agirait en particulier d'instaurer un dispositif financier incitant à mettre en place des équipes suivant à distance, notamment par des moyens numériques179(*), les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Les propositions du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour développer la prévention tertiaire
Dans un récent article publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel considère que « c'est surtout dans le champ de la prévention tertiaire [qui s'intéresse aux personnes malades] et de la prise en charge des pathologies chroniques que se situe le coeur de la bataille et des gains d'efficience que nous pouvons espérer avec des effets potentiellement puissants et rapides ». Les parcours des patients sont en effet « heurtés, ponctués de décompensations et d'hospitalisations qui auraient pu être évitées, et par des pertes de chances parfois considérables ».
Il préconise de s'inspirer des cellules d'expertise et de coordination de l'insuffisance cardiaque sévère (Cecics) de l'AP-HP, qui font l'objet d'une expérimentation de l'article 51 de la LFSS pour 2018. Les Cecics permettent aux équipes de suivre les patients, notamment au moyen d'une télésurveillance. Il indique que « les résultats de l'expérimentation qui a permis de prendre en charge près de 2 000 patients sur trois ans ont fait apparaître une moindre mortalité précoce, une diminution des hospitalisations pour les motifs les plus graves, une diminution de la durée cumulée des hospitalisations par patient (passée de 6,4 à 1,7 jours par patient et par an) et une satisfaction des patients qui gèrent leur maladie de manière plus autonome ».
Selon lui, « sous réserve de la mise en place d'un système de financement adapté, le modèle des Cecics pourrait facilement être décliné pour d'autres maladies chroniques » : pathologies cardiovasculaires, diabète, maladies inflammatoires chroniques digestives ou rhumatologiques, bronchopneumopathie chronique obstructive, pathologies neurologiques.
Il préconise de mettre en place un financement forfaitaire prenant en charge « non seulement le suivi à distance des patients mais aussi les éventuelles consultations et hospitalisations de jour liées à ce suivi » et permettant « un « retour économique » vers les organisations de soins à hauteur d'une part des dépenses évitées ».
Source : D'après Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025
De fait, les pathologies chroniques correspondent à 60 % des dépenses d'assurance maladie remboursées, comme le montre le graphique ci-après.
Répartition des dépenses d'assurance maladie remboursées par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisodes de soins (2022)
ALD : affection de longue durée
(a) Hors pathologies cardiovasculaires (CV), diabète et insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
(b) Hors maladies psychiatriques
(c) Hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations
* Les embolies pulmonaires sont enlevées.
Note de lecture : répartition des dépenses d'assurance maladie remboursées en 2022 par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisode de soins : 190,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes.
Pour aboutir au total de 190,3 milliards d'euros, il faut rajouter aux dépenses par pathologie les 7,2 milliards d'euros de soins courants, qui ne sont pas affectées à des pathologies spécifiques.
Source : Cnam, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, Propositions de l'Assurance Maladie pour 2025, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2025 (loi du 13 août 2004), juillet 2024
La Cnam a récemment renforcé sa prévention tertiaire dans le cas des pathologies chroniques. On peut ainsi mentionner :
- « Sophia », un service d'accompagnement, reposant sur des informations spécifiques sur le site ameli, des entetiens téléphoniques réalisés par des infirmiers et un magazine. Initialement destiné aux diabétiques, il s'adresse depuis 2025 à l'ensemble des personnes souffrant de pathologies chroniques à risque cardiovasculaire (« Sophia 2.0 ») ;
- la télésurveillance (qui dans le cas de l'insuffisance cardiaque permet de détecter la prise de poids rapide, signe de rétention d'eau) ;
- la mise en place de cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère (Cecics). Il s'agit d'une expérimentation sur la base de l'article 51 de la LFSS pour 2018, permettant à des équipes de suivre les patients, notamment au moyen d'une télésurveillance.
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « sécuriser le parcours de prévention tertiaire des personnes souffrant de pathologies chroniques (éducation thérapeutique, Sophia 2.0, télésurveillance, APA180(*)) et assurer une surveillance populationnelle possiblement portée par les établissements de santé pour les patients non stabilisés, avec un financement incitatif (sur le modèle de l'expérimentation « article 51 » Cecics) » (proposition n° 20).
d) Installer une gouvernance de la prévention en santé ?
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025181(*), la Cnam préconise, dans sa proposition n° 1, d'« organiser une coalition des financeurs et des acteurs mobilisés en faveur de la prévention en santé ».
Il s'agirait en particulier d' « installer une gouvernance de la prévention en santé permettant la coordination nationale et locale des financeurs et acteurs mobilisés en faveur de la prévention sur la base des priorités de santé publique définies par l'État ».
Cette gouvernance permettrait notamment de développer la prévention dans les entreprises et à l'école.
8. Limiter le coût des indemnités journalières (IJ) relatives aux arrêts de travail ?
a) Des dépenses augmentant de plus de 6 % par an, du fait notamment d'une hausse de la sinistralité
Le montant des indemnités journalières (IJ) maladie du régime général est passé de 6,2 milliards d'euros en 2010 à 10,2 milliards d'euros en 2023.
Leur coût a augmenté en moyenne de 2,9 % par an en 2010-2019 et 6,4 % par an en 2019-2023 (soit environ 0,6 milliard d'euros par an). Cet écart de 3,5 points vient essentiellement du fait qu'en conséquence de l'inflation post-crise sanitaire, les salaires ont augmenté plus rapidement, ce qui s'est répercuté dans le coût par journée (1,9 point). Toutefois elle s'explique également (pour 1,5 point) par les changements de comportement (taux de recours et durée à âge donné, la durée ayant diminué).
Décomposition du taux de croissance annuel
moyen
du coût global des IJ maladie
(en % et en points)
IJ : indemnité journalière.
Source : D'après les données de Nadine Colinot, Gonzague Debeugny, Catherine Pollak, « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Études et résultats n° 1321, 13 décembre 2024
Les arrêts d'au moins un mois représentent seulement un quart du nombre d'arrêts, mais plus de 80 % des dépenses, comme le montre le graphique ci-après.
Répartition des dépenses et du
nombre d'arrêts maladie
par durée en 2023
(en %)
Source : Nadine Colinot, Gonzague Debeugny, Catherine Pollak, « Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019 », Études et résultats n° 1321, 13 décembre 2024
b) Prendre des mesures paramétriques ?
Diverses mesures d'économies paramétriques relatives au secteur privé ont été proposées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024, pour un montant variant selon le scénario retenu mais de l'ordre du milliard d'euros.
Dans sa note précitée d'avril 2025, la Cour des comptes fixe un objectif d'économies de 0,5 milliard d'euros, sans spécifier de scénario à privilégier.
Principales propositions paramétriques
tendant à réduire le coût
des indemnités
journalières
(en milliards d'euros)
|
Amélioration annuelle du solde en « régime de croisière » (Md€) |
Source du chiffrage |
« Qui paie » |
|
|
Limitation des surprescriptions |
0,2 |
Ralfss 2024 |
Salariés abusant du système |
|
Contrôles et lutte contre les fraudes |
0,05 |
Ralfss 2024 |
Fraudeurs |
|
Réforme jours de carence et/ou suppression d'indemnisation des arrêts courts par l'assurance maladie : |
|||
|
- Suppression de l'indemnisation de la sécurité sociale sur les arrêts maladie de moins de 8 jours, et maintien d'un délai de carence de 3 jours sur les arrêts de plus de 8 jours |
0,47 |
Ralfss 2024 |
Entreprises (330 M€) et salariés (140 M€) |
|
- Allongement du délai de carence de trois à sept jours quelle que soit la durée des arrêts de travail |
0,95 |
Ralfss 2024 |
Entreprises (660 M€) et salariés (290 M€) |
|
- Mise en place d'un jour de carence d'ordre public et diminution du niveau des indemnités journalières de 50 % à 45 % du salaire |
0,6 |
Ralfss 2024 |
Salariés |
|
- Allongement du délai de carence de 3 à 7 jours combiné à l'instauration d'un jour de carence d'ordre public |
0,55 |
Mecss du Sénat |
Salariés |
|
Diminuer les indemnités journalières de 50 % du salaire à un pourcentage plus bas |
0,2 Md€ par point de pourcentage |
Ralfss 2024 |
Entreprises et salariés |
Ralfss : rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Sources : D'après Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2004 ; calculs de la Mecss du Sénat
L'allongement du délai de carence dans le secteur privé de 3 à, par exemple, 7 jours permettrait à la sécurité sociale d'économiser près d'un milliard d'euros. Les deux tiers environ des entreprises maintenant le salaire des employés en arrêt maladie malgré le délai de carence182(*), cela conduirait à des dépenses supplémentaires de 0,6 milliard d'euros pour les entreprises (et une baisse des salaires de 0,4 milliard d'euros).
Une autre possibilité, qui ne ferait pas supporter la mesure par les entreprises (mais qui la ferait en conséquence supporter par les salariés), serait d'instaurer un jour de carence d'ordre public (c'est-à-dire ne pouvant pas être indemnisé par les entreprises). La mesure permettrait aux entreprises d'économiser 1 milliard d'euros, répartis entre 0,6 milliard d'euros de salaires et 0,4 milliard d'euros de cotisations sociales. Comme cette mesure aurait donc un coût pour la sécurité sociale, il faudrait la coupler à une autre mesure, coûteuse pour les entreprises mais source d'économies pour la sécurité sociale. La Cour des comptes propose ainsi une baisse de 5 points du taux de prise en charge par l'assurance maladie183(*), ces deux mesures cumulées suscitant pour la sécurité sociale une économie de 0,6 milliard d'euros.
Une solution (non envisagée par la Cour) pourrait consister, en plus de l'instauration d'un jour de carence d'ordre public, à porter le délai de carence de 3 à 7 jours. Les deux mesures correspondraient à une économie d'environ 0,55 milliard d'euros pour la sécurité sociale et 0,34 milliard d'euros pour les entreprises (supportée par les salariés).
Le récent rapport184(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre indique que la question des jours de carence « constitue un objet important de désaccords ». Il est plutôt réservé sur le sujet, évoquant des études selon lesquelles une réduction des arrêts courts susciterait des arrêts plus longs en moyenne. Il s'interroge en outre sur la constitutionnalité d'un jour de carence d'ordre public185(*).
Rappel des règles actuellement applicables aux indemnités journalières du secteur privé
Actuellement l'assurance maladie indemnise le salarié après trois jours de carence, à hauteur de 50 % du salaire brut. À cela s'ajoutent :
- l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, dans le cadre du maintien obligatoire du salaire (loi de 1978). Cette indemnité186(*), qui s'applique après 7 jours de carence, a pour effet de porter le maintien du salaire (après prise en compte des IJ) à 90 % du salaire brut pendant 30 jours, puis 66,66 % ensuite187(*) ;
- le cas échéant, une prise en charge supplémentaire par l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise. Celle-ci peut augmenter le taux de prise en charge ou inclure des périodes supplémentaires (comme les jours de carence). En particulier, la prise en charge des trois premiers jours d'arrêt de travail n'est pas forcément incluse dans la garantie incapacité d'un contrat de prévoyance, et peut être versée directement par les établissements aux salariés.
Il résulte de ce mécanisme qu'une diminution de la prise en charge par l'assurance maladie tend à se reporter sur l'entreprise. En particulier, sur la période couverte par l'obligation de maintien du salaire par l'employeur, toute diminution de la prise en charge par l'assurance maladie se traduit mécaniquement par une augmentation à due concurrence de la prise en charge par l'employeur.
c) Enrayer la hausse de la sinistralité ?
Sur le long terme, le principal sujet est celui de la hausse du taux de recours, c'est-à-dire de la sinistralité, particulièrement marquée pour les tranches d'âge les plus jeunes.
(1) Une hausse de la sinistralité imparfaitement expliquée
Les conditions de travail semblent moins bonnes en France que dans les autres pays européens, en particulier pour ce qui concerne les risques physiques et la qualité de l'environnement de travail188(*). Toutefois il ne s'agit pas d'un fait nouveau.
Le récent rapport189(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, tout en soulignant la difficulté à expliquer la hausse de la sinistralité, envisage qu'elle puisse provenir d'une dégradation des conditions de travail, d'une évolution de la morbidité à âge donné (notamment des épisodes dépressifs, en particulier chez les jeunes adultes), de l'augmentation du taux d'emploi (qui aurait conduit à employer des personnes plus fragiles).
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam souligne que la croissance des arrêts longs provient en quasi-totalité non des personnes relevant du régime ALD, mais des personnes relevant du régime dit « ALD non exonérante » (qui n'ouvre pas droit à la prise en charge de 100 % du ticket modérateur). Les principales pathologies couvertes par ce régime sont celles liées à la dépression légère (33 % de ces situations) et aux troubles musculo-squelettiques (32 %). Les personnes concernées semblent peu suivies médicalement : par exemple, dans le cas des troubles musculo-squelettiques, seules 41 % consomment des antalgiques et 72 % ont vu un masseur-kinésithérapeute.
(2) Lutter contre la fraude aux arrêts de travail
Bien que la fraude ne représente qu'une faible partie du coût des arrêts de travail, la lutte contre la fraude est un enjeu essentiel, par principe et pour faciliter l'acceptation des autres mesures.
En 2024, le préjudice financier détecté par la Cnam au titre des faux arrêts de travail a été de plus de 30 millions d'euros (contre 8 millions d'euros en 2023). Selon la Cnam, la vente de faux arrêts de travail sur les réseaux sociaux ou sur internet est à l'origine de cette forte hausse.
Aussi, depuis le 1er septembre 2025, le recours à un formulaire sécurisé est obligatoire pour tout envoi d'avis d'arrêt de travail papier.
(3) Les propositions de la Cnam dans le rapport « charges et produits »
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam fait diverses préconisations.
(a) Prévenir la désinsertion professionnelle ?
Sa proposition 23 consiste notamment à « renforcer [les] efforts [de la Cnam] en termes de prévention de la désinsertion professionnelle ».
(b) Veiller à la pertinence des prescriptions ?
La proposition 24 du rapport « charges et produits » consiste en particulier à « limiter la durée de l'arrêt de travail pouvant être prescrit (1 mois en primo-prescription en cas d'hospitalisation et 15 jours en ville, puis par tranche de deux mois maximum) afin de garantir un vrai suivi médical de la personne arrêtée et la pertinence de l'arrêt de travail ».
En effet, selon la Cnam, « l'analyse des quatre principaux motifs d'arrêt maladie prescrits en 2023190(*) montre que la majorité des arrêts dépassent les durées recommandées ».
En cas de recours à amelipro ou à un logiciel d'aide à la prescription, le prescripteur pourrait se voir proposer une liste déroulante de motifs, puis la liste des dates d'arrêt correspondantes (tout en gardant la possibilité de modifier les dates prescrites en fonction de la situation).
(c) Inciter les employeurs à améliorer les conditions de travail ?
Le conditions de travail semblent moins bonnes en France que dans la plupart des pays européens (cf. supra).
Des « référentiels de bonnes pratiques en matière de conditions de travail » seraient diffusés aux entreprises montrant un « absentéisme atypique ».
(4) Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils
Le rapport des trois Hauts Conseils souligne que le coût des IJ ne résulte que marginalement des arrêts de courte durée. Ainsi, les arrêts dépassant six mois représentent 7 % du nombre d'arrêts mais 45 % de la dépense.
Il considère donc que le principal enjeu est de ramener à l'emploi les salariés en arrêt de longue durée (cf. encadré).
Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils pour enrayer la sinistralité191(*)
• « Les actions doivent prioritairement porter sur le retour à l'emploi des salariés en arrêt de longue durée »192(*)
• « Améliorer l'efficacité des contrôles notamment par le partage d'informations entre acteurs »
• « Agir en direction des entreprises atypiques »
• « Agir en direction des prescripteurs »193(*)
Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025
9. Réduire la prise en charge des ALD par la branche maladie ?
a) Les ALD
En 2023, le montant remboursé total des dépenses de santé des personnes en arrêt de longue durée (ALD) a été de 135,2 milliards d'euros194(*), soit plus de la moitié des dépenses d'assurance maladie.
En 2021, les ALD concernaient 13,7 millions de personnes, soit 20 % de la population. L'ALD a pour principale conséquence la prise en charge du ticket modérateur par la branche maladie.
Le surcoût du dispositif ALD par rapport au droit commun est estimé à 12,1 milliards d'euros en 2021, dont 11,3 milliards d'euros pour l'exonération du ticket modérateur. Jusqu'à 16 millions de personnes pourraient bénéficier du dispositif en 2030, pour une hausse du surcoût net du dispositif de 2 à 3 milliards d'euros.
b) Le rapport de l'Igas et de l'IGF (2024)
Un rapport195(*) de 2024 de l'Igas et de l'IGF - dont les données des deux alinéas précédents sont issues - présente diverses mesures, dont les chiffrages sont synthétisés dans l'annexe IV au présent rapport.
Le rapport précité propose diverses mesures à court terme. Celle au rendement le plus élevé consisterait à introduire un ticket modérateur de 5 points pour les dépenses en lien avec l'ALD, plafonné à 1 000 euros par an, pour un rendement de 2,5 milliards d'euros. Il est en outre proposé de veiller à ce que seules les dépenses en lien avec l'ALD soient prises en charge à 100 %, par exemple en intégrant aux logiciels métiers une « liste positive » d'actes et prestations exonérés (pour un gain estimé à 0,3 milliard d'euros).
Il propose également deux pistes de réforme structurelle :
- l'introduction de deux niveaux de reconnaissance en ALD, selon la sévérité des pathologies et l'intensité des soins. Dans le cas du premier niveau, qui concernerait les patients sans traitement très coûteux, l'exonération du ticket modérateur serait limitée aux produits et prestations destinés à la prévention. Le gain pour les finances publiques serait à peu près nul, les économies réalisées dans le cas des assurés non reconnus en niveau 2 étant quasiment compensées par les coûts supplémentaires des assurés reconnus en niveau 1196(*) ;
- l'instauration d'un mécanisme de plafonnement des restes à charge (« bouclier sanitaire »)197(*) pour l'ensemble des assurés, accompagnée de la suppression du dispositif des ALD. Une telle réforme ferait des gagnants (les assurés hors ALD) et des perdants (les assurés en ALD). Par exemple, pour un plafond annuel de 2 000 euros, le gain net pour la sécurité sociale serait de 4 milliards d'euros (économie de 4,7 milliards d'euros sur les ALD et surcoût de 0,7 milliard d'euros pour les autres assurés)198(*).
c) Le rapport « charges et produits » de juillet 2025
Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « mettre en place une gestion plus dynamique des entrées et des sorties du dispositif des ALD » (proposition n° 21). Il s'agirait en particulier de prévoir dès l'entrée « un parcours de prévention et d'information renforcées destiné à éviter, du moins à retarder, l'aggravation de la pathologie (Sophia 2.0199(*), Mon Espace Santé, etc.) ». La Cnam préconise également d'« évaluer régulièrement la consommation de soins des personnes bénéficiant du dispositif » afin de permettre leur sortie du dispositif en cas de guérison ou de rémission.
Elle reprend également, en tant qu'« options », les propositions du rapport précité de l'Igas et de l'IGF de définir une liste de soins spécifiques et opposables à chaque ALD et de distinguer deux niveaux d'ALD, seul le second niveau disposant d'une prise en charge à 100 %200(*). Le premier niveau lui permettrait d'identifier des assurés actuellement peu coûteux et donc exclus du dispositif ALD (comme des personnes en hypertension artérielle), qui lui échappent actuellement, et d'engager des actions d'accompagnement (Sophia 2.0, campages d'aller-vers, etc.).
d) Le rapport des trois Hauts Conseils
Selon le récent rapport201(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre, l'instauration d'un ticket modérateur pour les personnes en ALD ou d'un double niveau d'ALD serait dans les faits un pur transfert de la branche maladie vers les complémentaires, le ticket modérateur entraînant en outre « des restes à charge très élevés pour certains patients » dépourvus de complémentaire santé, soit moins de 3 % des assurés.
Le rapport semble plutôt privilégier le scénario du bouclier sanitaire, qu'il ne présente pas toutefois comme une piste d'économies202(*), tout en soulignant qu'il ferait des perdants. Il s'interroge en outre sur une possible modulation du plafond en fonction du revenu (qui réduirait le reste à charge en part du revenu pour les ménages modestes mais pourrait être perçue comme une rupture avec le principe d'universalité, et donc remettre en cause « l'adhésion autour du système »).
10. Prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière ?
a) D'importantes inégalités de revenus
La direction du budget203(*) souligne que la hausse du montant global des honoraires des médecins spécialistes a été de + 3,2 % par an en moyenne sur 2016-2023, alors que la patientèle a augmenté de « seulement » 4 % au global sur la période.
En effet, les médecins effectuent de plus en plus d'actes à patientèle donnée. La direction du budget constate en outre « un phénomène de forte croissance du nombre d'actes, par ailleurs très hétérogènes entre spécialités et au sein même de spécialités, peu explicables par les seuls facteurs habituellement mis en avant que sont le vieillissement de la population et la hausse de certaines pathologies ».
Plusieurs personnes auditionnées se sont interrogées sur les écarts de revenus entre secteurs ou professionnels de santé, qui ne leur ont pas toujours semblé justifiés par des niveaux de compétence ou des conditions d'exercice spécifiques. Le risque que ces anomalies de revenu, découlant pour partie des modalités de prise en charge par l'assurance maladie, déstabilise le système de santé en suscitant un désintérêt pour les secteurs ou spécialités les moins rémunérés, a été évoqué.
De fait, les écarts de revenus entre professionnels de santé sont importants. À titre d'illustration, et sans préjuger d'éventuelles anomalies, le tableau ci-après indique les niveaux de revenu des médecins libéraux exerçant en secteur 1.
Disparités de revenus des médecins libéraux exerçant en secteur 1
Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « Santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024
Dans son rapport204(*) de 2024 sur la financiarisation de l'offre de soins, la commission s'est interrogée sur la pertinence de certaines rentes. De même, dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam s'interroge sur le niveau élevé de la rentabilité opérationnelle (ratio excédent brut d'exploitation/chiffre d'affaire) de certains secteurs, supérieure à 15 % (soit le double de la rentabilité moyenne des entreprises marchandes non agricoles et non financières françaises, de 7,8 % en 2022).
Évolution de la moyenne des ratios de rentabilité selon le secteur d'activité, 2018 - 2022
(en %)
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
b) Mettre en place un observatoire chargé d'identifier les rentabilités anormalement élevées ?
Dans son rapport « charges et produits » précité, la Cnam préconise la mise en place d'un « observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement », qui lui serait rattaché.
De même, le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre préconise l'instauration d'un « observatoire de la situation économique et de la rentabilité ».
c) Les autres propositions de la Cnam pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière
La Cnam fait d'autres propositions pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière, concernant l'amélioration de la transparence, la réduction des tarifs et l'obligation d'un plan de continuité des soins pour les principaux acteurs.
Les propositions de la Cnam pour prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière
« Proposition 30 : Clarifier les règles de gouvernance des Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) ayant ouvert leur capital à des acteurs financiers pour garantir l'indépendance des professionnels de santé (sur le modèle de la conciliation organisée par le Conseil d'État dans la santé animale)
Proposition 31 : Établir la transparence totale sur les situations de rentes économiques et sur la composition de l'offre de soins
- Rendre obligatoire à chaque offreur de soins la déclaration de son éventuelle appartenance à un groupe, groupement ou réseau et faire évoluer les SI de l'Assurance Maladie pour rattacher chaque acte à la fois à un praticien, à une structure d'exercice, et le cas échéant à un groupe / groupement / réseau
- Instituer et rattacher à l'Assurance Maladie un Observatoire des niveaux de rentabilité et d'endettement de l'ensemble des secteurs qui composent l'offre de soins
Proposition 32 : Pour répartir plus équitablement les dépenses d'Assurance Maladie, baisser les tarifs des secteurs présentant un très haut niveau de rentabilité
Proposition 33 : Prévenir la constitution de rentes en faisant évoluer de manière plus réactive la tarification des actes et forfaits versés aux professionnels de santé (maintenance de la CCAM, études régulières de coûts, etc.)
Proposition 34 : Améliorer la régulation territoriale pour s'assurer du développement ou du maintien d'une offre de soins pertinente sur l'ensemble du territoire
- Repenser le régime des autorisations des Equipements Médicaux Lourds (EML) : renforcer la transparence sur l'usage des autorisations et des équipements, geler les installations dans les zones où l'accessibilité est satisfaisante, identifier les impacts en terme de dépenses en améliorant les échanges ARS-Assurance Maladie et conditionner les nouvelles autorisations respect d'objectifs quantifiés de santé publique et à des engagements de solidarité territoriale (soutenir l'offre de zonesdoutées situées à proximité)
- Construire un cahier des charges de présence territoriale et le faire respecter par les groupes, groupements et réseaux
Proposition 35 : Pour éviter les phénomènes de « too big to fail » (prise en charge par la puissance publique des conséquences des erreurs de gestion d'un acteur privé), identifier les opérateurs de l'offre de soins dont la défaillance serait susceptible d'avoir un impact significatif sur l'offre de soins et les obliger à communiquer au régulateur un plan de continuité des soins en cas de défaut au niveau du groupe »
Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025
* 113 Dans le cas de l'hôpital, l'annexe 7 au PLFSS 2022 et l'annexe 5 au PLFSS 2023 indiquent explicitement qu'aucune mesure de régulation n'est prévue ; l'annexe 5 aux PLFSS 2024 et 2025 n'a pas retrouvé le niveau de précision antérieur à la crise sanitaire et est peu exploitable (en particulier elle ne comprend plus le tableau synthétisant le montant des différentes mesures de régulation prévues pour l'exercice à venir).
* 114 Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021.
* 115 Par exemple, comme le souligne le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, la mesure dite de « rééquilibrage » (en fait, de réduction) de la contribution de l'Ondam à l'objectif global de dépense (OGD) de la branche autonomie, chiffrée autour de 200 millions d'euros par an sur la période, revient en réalité à mobiliser une source de financement extérieure (les réserves de la CNSA), ce qui n'améliore pas la situation des finances publiques (« La mesure de « rééquilibrage » de la contribution de l'Ondam à l'OGD réduit de 247 millions d'euros les dépenses de l'Ondam et est présentée à ce titre comme une mesure d'économie alors qu'elle consiste à mobiliser une source de financement extérieure (les réserves de la CNSA) en atténuation de la dépense Ondam ») (Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, avis du Comité d'alerte n° 2019-3, 15 octobre 2019).
* 116 Vincent Lidsky, Pierre-Emmanuel Thiard, Maryvonne le Brigronen, Jérôme Thomas, Matthieu Olivier, Quentin Jeantet (IGF), Dominique Giorgi, Hubert Garrigue-Guyonnaud, Marine Jeantet, Virginie Cayre, Jeanne Davenel (Igas), Propositions pour la maîtrise de l'Ondam 2013-2017, juin 2012 (IGF N° 2012-M-007-03 /Igas n° RM2012-083P).
* 117 Annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).
* 118 Prescrites en prévention des maladies cardiovasculaires, les statines ne sont considérées comme présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant que pour la prévention primaire des patients à haut risque cardiovasculaire et pour la prévention secondaire, mais pas pour la prévention primaire des patients à faible risque cardiovasculaire (Haute Autorité de santé, Efficacité et efficience des hypolipémiants - Une analyse centrée sur les statines, juillet 2010).
* 119 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.
* 120 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 121 Rapport d'information de Mmes Richer et Le Houérou sur la branche AT-MP (2024) : « Proposition n° 2 : Prendre en compte la sur-reconnaissance des AT-MP dans la détermination du montant versé à la branche maladie au titre de la sous-déclaration ».
* 122 La Cnam considère que de 2026 à 2030, ses recettes augmenteront spontanément chaque année de 0,5 milliards d'euros de moins que ce qu'impliquerait une croissante spontanée identique à celle du PIB en valeur, et préconise donc des mesures augmentant ses ressources de 2,5 milliards d'euros d'ici 2030.
* 123 « Entre 2013 et 2023, le taux de prise en charge par l'AMO a [...] progressé de 75,5 % à 79,5 % soit une hausse de 4 points en 10 ans. Cette déformation représente environ 600 millions d'euros par an de moindre dynamisme de la dépense pour les organismes complémentaires. À l'horizon 2030, la stabilisation de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire nécessiterait donc de programmer un nouveau partage de prise en charge de certains soins avec les organismes complémentaires et les patients à hauteur de 3 milliards d'euros. »
* 124 Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
* 125 Article 21 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
* 126 Article L. 138-16 du code de la sécurité sociale.
* 127 Cour des comptes, « Les médicaments anti-cancéreux : mieux réguler en préservant un accès rapide aux traitements innovants », in La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024.
* 128 Les médicaments biosimilaires sont l'équivalent des médicaments génériques dans le cas des médicaments biologiques (comme l'insuline ou l'hormone de croissance).
* 129 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 130 Il s'agit de médicaments hospitaliers pris en charge à 100 % par l'assurance maladie. Selon le rapport de juin 2025 à la commission des comptes de la sécurité sociale, leur coût a augmenté de 7,1 % en 2024, pour atteindre 10,9 milliards d'euros.
* 131 Source : réponse de la Cnam au questionnaire des rapporteures.
* 132 Source : Repss « maladie » annexé au Placss 2024.
* 133 « La particularité de la France par rapport aux autres pays est l'absence d'existence de groupe générique doliprane. La part des médicaments génériques dans le marché global est, en intégrant le Doliprane®, dans la moyenne européenne (54 %). Elle est cependant nettement moins élevée que dans des pays voisins comme l'Allemagne ou les Pays-Bas où les génériques représentent respectivement 83 % et 79 % du marché global en 2021 » (réponse aux rapporteures).
* 134 Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l'assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d'hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
* 135 L'accès précoce vise les médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert, innovants et pour lesquels le laboratoire s'engage à déposer une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou une demande de remboursement de droit commun. Les autres procédures d'accès dérogatoire au marché sont celle dite d'« accès compassionnel » (qui vise les médicaments non nécessairement innovants, qui ne sont initialement pas destinés à obtenir une AMM mais qui répondent de façon satisfaisante à un besoin thérapeutique non couvert), ainsi que la procédure, en cours d'expérimentation, dite d'« accès direct post-HAS ».
* 136 Selon le rapport, « le Royaume-Uni, qui a été pionnier dans cette démarche, a d'abord utilisé cette notion de seuil (fixé initialement à 20 000 £ à 30 000 £ par année de vie gagnée en bonne santé) comme critère de décision pour accepter ou refuser la prise en charge d'un médicament ».
* 137 Source : Cour des comptes, Accélérer la réorganisation des soins de ville pour en garantir la qualité et maîtriser la dépense, contribution à la revue des dépenses publiques, juillet 2023.
* 138 Cour des comptes, Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité, rapport public thématique, octobre 2023.
* 139 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 140 « Il est indispensable de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances. »
* 141 Au 31 mars 2025, 38 944 médecins (38,9 % des médecins libéraux) ont créé une ordonnance numérique et 15 079 pharmacies (75 %) ont exécuté une ordonnance numérique.
* 142 Par exemple, les études internationales soulignent l'absence de consensus sur l'opportunité de permettre aux pharmaciens d'accéder à l'indication thérapeutique, certains médecins considérant qu'ils n'ont pas nécessairement la formation appropriée (Amina Hareem, Joshua Lee, Ieva Stupans, Joon Soo Park, Kate Wang, « Benefits and barriers associated with e-prescribing in community pharmacy - A systematic review », Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, volume 12, décembre 2023).
* 143 L'article L. 6211-8 du code de la santé publique prévoit qu'« un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents ». Toutefois souvent cette obligation n'est pas respectée par le prescripteur.
* 144 Il s'agirait de prévoir le renseignement en ligne d'un formulaire permettant de s'assurer que la prescription est conforme aux recommandations et peut donc être remboursée.
* 145 « Dans nombre de pays la prescription médicamenteuse fait l'objet d'un contrôle plus important par les payeurs. Les médicaments sont classés en plusieurs catégories en fonction des risques qu'ils présentent, risques financiers liés à leur coût mais aussi risques de mésusage, et pour certains la prise en charge financière peut être conditionnée au respect de conditions de prescription qui peuvent être contrôlées soit a posteriori, à charge pour le praticien de tenir ces éléments à disposition, soit a priori (accord préalable). Ces procédures ont longtemps été génératrices de surcharges administratives mal vécues par les professionnels, mais aujourd'hui l'ordonnance numérique peut permettre de les intégrer de manière beaucoup plus fluide dans le fonctionnement du système. Le dispositif d'accompagnement à la prescription issu de la LFSS pour 2024, qui repose sur un téléservice à remplir par le prescripteur, constitue un bon équilibre entre une contrainte permettant d'infléchir les pratiques et la souplesse nécessaire. »
* 146 D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021.
* 147 Comme actuellement avec par exemple les maisons de santé pluridisciplinaires et les centres de santé.
* 148 Comme actuellement avec par exemple les communautés professionnelles et territoriales de santé.
* 149 En particulier grâce au service d'accès aux soins (SAS), accessible par le 15 et qui oriente le patient vers le Samu ou les soins non programmés (SNP) de la médecine de ville.
* 150 Mission de service public assurée par les médecins généralistes libéraux et les médecins salariés des centres de santé.
* 151 « L'obstétrique soulève de manière plus impérative des enjeux de maillage territorial liés aux délais d'accès, 45 minutes au plus d'une maternité. L'expérience d'autres pays montre qu'il est possible de fonctionner autrement, mais cela implique un suivi resserré de l'ensemble de la grossesse et un hébergement temporaire à proximité d'une maternité dès que la probabilité d'accoucher le nécessite. »
* 152 Proposition n° 10.
* 153 « Le taux d'équipement en lits de médecine rapporté à la population varie du simple au triple, sans que les impacts en termes de résultats de santé soient immédiatement perceptibles. Paris figure parmi les départements les plus dotés, alors que le taux de personnes âgées est parmi les plus faibles de France aux côtés d'autres départements de petite couronne (cela s'explique toutefois par des mouvements de patients depuis les départements de petite couronne). »
* 154 Coût des soins et de la prévention moins économies de retraites venant des décès prématurés et recettes fiscales assises sur le comportement concerné.
* 155 Pierre Kopp, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019, Observatoire français des drogues et tendances addictives, juillet 2023.
* 156 Daniel Caby, « Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? », Trésor-Eco n° 179, septembre 2016.
* 157 Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.
* 158 Lors de l'examen du PLFSS 2025 l'amendement du Sénat visait seulement à augmenter légèrement le barème de l'accise sur les produits du tabac afin de s'approcher dès 2025 de l'objectif d'un paquet de cigarettes à 13 euros en 2027 figurant dans le plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027 (qui, selon les indications alors fournies par l'administration à la commission, n'aurait pas été atteint en 2027 à droit constant).
* 159 C'est à dire le commerce transfrontalier légal, la contrebande et la contrefaçon.
* 160 Passée de 20 % en 2010 à 40 % en 2022 selon l'industrie du tabac.
* 161 Alors qu'en 2011 la prévalence du tabagisme quotidien des lycéens était de 30,8 %, soit un taux analogue à celui observé en population générale, elle était en 2022 de 6,2 %.
* 162 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 163 « L'évolution récente de la législation européenne autorise le recours à un taux de TVA inférieur à 5 % ou un taux zéro pour une catégorie limitée de biens et services dont certains types de denrées alimentaires. »
* 164 La consommation de fruits et légumes frais par les ménages français est estimée à environ 20 milliards d'euros. Passer d'un taux de 5,5 % à un taux nul coûterait donc environ 1 milliard d'euros.
* 165 « La hausse rapide de l'obésité chez les jeunes suppose également de travailler à un renchérissement substantiel de l'accès aux produits transformés gras et sucrés. »
* 166 Selon le ministère de l'agriculture des États-Unis ( https://www.ers.usda.gov), les produits dont la masse est supérieure à 40 % de sucre pur sont les céréales pour petit déjeuner et barres céréalières ; les viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés ; les confiseries et chocolats. Il résulte des données de l'Anses (Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (Inca 3), avis de l'Anses - rapport d'expertise collective, juin 2017) relatifs à chacun de ces produits que ceux-ci correspondent globalement à une consommation journalière de 70 grammes par personne, dont (sur la base des données du ministère de l'agriculture des États-Unis) plus de 30 grammes de sucre pur. Appliquée à l'ensemble de la population française, une taxe assise sur ces produits d'un euro par kilogramme de sucre pur, ajouté ou non, rapporterait donc environ 68×365×0,03800 millions d'euros.
* 167 On peut toutefois mentionner, notamment, les cas de la Hongrie (aliments transformés préemballés) et du Mexique (produits dont la valeur calorique excède 275 kilocalories pour 100 grammes).
* 168 Leila Aïchi, Pollution de l'air : le coût de l'inaction, rapport n° 610 (2014-2015), commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, Sénat, 8 juillet 2015.
* 169 Remplacée le 1er juillet 2010 par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
* 170 Mélanie Vogel, Construire la sécurité sociale écologique du 21e siècle, mission d'information sur la sécurité sociale écologique, rapport d'information n° 594 (2021-2022), Sénat, 30 mars 2022.
* 171 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 172 « Le tabac et l'alcool sont surtaxés, mais on ne demande rien aux plateformes du numérique. Nous proposons donc que 2 % des revenus des plateformes générés en France soient allouées à un fonds dédié au financement de la recherche et de la prise en charge de la santé mentale » (Gabriel Attal, Marcel Rufo, « Il faut interdire l'accès des jeunes de moins de 15 ans aux réseaux sociaux », tribune publiée dans Le Figaro, 29 avril 2025).
* 173 Daron Acemoglu, Simon Johnson, « The Urgent Need to Tax Digital Advertising », Network Law Review, printemps 2024.
* 174 Source : fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2025.
* 175 « Bien que les États-Unis n'aient pas de telles taxes, et que seuls les États-Unis devraient être autorisés à taxer les entreprises américaines, leurs partenaires commerciaux facturent aux entreprises américaines quelque chose appelé une taxe sur les services numériques. Le Canada et la France utilisent ces taxes pour collecter chacun plus de 500 millions de dollars par an auprès des entreprises américaines » (« Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces “Fair and Reciprocal Plan” on Trade », présidence des États-Unis, 13 février 2025 ; traduction des rapporteures).
* 176 Source : Syndicat des régies internet (SRI), Union des entreprises de conseil et d'achat média (Udecam), 33ème Observatoire de l'e-pub, étude réalisée par le cabinet Oliver Wyman, février 2025.
* 177 « Connaissez vos chiffres ».
* 178 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.
* 179 Par exemple, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, la télésurveillance permet de détecter la prise de poids rapide (signe de rétention d'eau).
* 180 Activité physique adaptée.
* 181 Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.
* 182 En 2017, 63,5 % des salariés travaillaient dans une entreprise indemnisant les trois premiers jours d'arrêt de travail (répartis entre 38 % dans des entreprises effectuant cette indemnisation pour tous les salariés et 25,5 % dans des entreprises effectuant cette indemnisation pour seulement certains salariés) (Marc Perronnin, « L'enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise 2017 », Les rapports de L'Irdes n° 572, novembre 2019).
* 183 Le taux de prise en charge passerait donc de 50 % à 45 %, suscitant pour la sécurité sociale une économie d'1 milliard d'euros, en quasi-totalité compensée aux salariés par les entreprises, dans le cadre de leur obligation de maintien du salaire.
* 184 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 185 « La constitutionnalité d'une telle mesure devrait être évaluée. En effet, une telle mesure reviendrait à écarter toute possibilité pour les partenaires sociaux de branche ou d'entreprise de négocier et d'adopter une clause plus favorable que l'absence de jour de carence : une telle restriction constituerait plutôt une exception par rapport au droit de la négociation collective (ainsi qu'au droit de la négociation individuelle). Elle constituerait donc une atteinte forte à la liberté contractuelle, qui est un principe constitutionnel consacré dont les atteintes ne peuvent être que justifiées par un objectif d'intérêt général, et à condition d'être nécessaires et proportionnées. L'objectif d'équilibre de la sécurité sociale ne peut être mobilisé comme élément de justification dès lors que la mesure porte précisément sur des prises en charge qui ne relèvent pas de la sécurité sociale. »
* 186 Qui n'est due qu'aux salariés disposant d'une certaine ancienneté (1 an).
* 187 Pendant 30 jours supplémentaires, cette durée étant augmentée de 30 jours par tranche de 5 années d'ancienneté.
* 188 Cf. notamment Christine Erhel, Mathilde Guergoat Larivière , Malo Mofakhami, La qualité de l'emploi et du travail en comparaison européenne : une contre-performance française ?, 11 septembre 2024.
* 189 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 190 Troubles anxio-dépressifs mineurs, lombalgie commune, sciatique, tendinopathie de la coiffe des rotateurs (douleur à l'épaule).
* 191 Le rapport envisage également, comme la Cour des comptes, de confier à l'employeur la totalité de l'indemnisation des arrêts maladie de courte durée et d'augmenter le nombre de jours de carence, sans prendre parti sur ces deux points.
* 192 Le rapport renvoie au rapport de Jean Luc Bérard, Stéphane Oustric et Stéphane Seiller (Plus de prévention, d'efficacité, d'équité et de maîtrise des arrêts de travail - neuf constats, vingt propositions, rapport au Premier ministre, janvier 2019). Il insiste sur la préconisation d'assouplir l'accès des salariés en arrêt maladie à des périodes de formation permettant de faciliter leur retour à l'emploi et une diversification des outils possibles en alternative à l'arrêt maladie à temps plein, avec l'accord du salarié à temps partiel thérapeutique, prescription de travail à domicile pour raison de santé, « essai encadré » permettant de tester pendant trois jours le retour à l'emploi.
* 193 Il s'agit notamment de réserver la prescription d'arrêts maladie au médecin traitant (pour éviter le « nomadisme médical »).
* 194 Source : rapport « charges et produits » de juin 2025.
* 195 Pascale Dugos, Pierre Prady, Gabrielle Gauron, Marie Truffier-Blanc, Philippe Fontaine, Mathias Albertone, Émilie Fauchier-Magnan, Emmanuelle Michaud, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée - Pour un dispositif plus efficient et équitable, rapport de l'Igas et de l'IGF (IGF N° 2023-M-109-03/Igas N° 2023-126R), juin 2024.
* 196 Maintien pour certains actes de l'exonération de ticket modérateur et prise en charge de nouvelles prestations.
* 197 Le bouclier sanitaire ne concernerait ni les équipements (audioprothèses, dentaire, optique), ni les dépassements d'honoraire.
* 198 Pour que les assurés en ALD ne soient pas perdants il faudrait fixer le plafond à environ 500 euros, mais alors la mesure serait coûteuse pour les finances publiques (2,6 milliards d'euros pour ce niveau de plafond).
* 199 Sophia est un service d'accompagnement, reposant sur des informations spécifiques sur le site Ameli, des entetiens téléphoniques réalisés par des infirmiers et un magazine. Initialement destiné aux diabétiques, il s'adresse depuis 2025 à l'ensemble des personnes souffrant de pathologies chroniques à risque cardiovasculaire (« Sophia 2.0 »).
* 200 Et, dans le cas de la proposition de la Cnam, du statut d'ALD (le premier niveau étant dénommé « statut de risque chronique »).
* 201 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025.
* 202 Il souligne que selon le rapport Igas-IGF, « le niveau de plafond financièrement neutre pour les finances publiques se situe entre 500 et 1 000 euros par an ».
* 203 Réponse aux rapporteures.
* 204 Corinne Imbert, Bernard Jomier, Olivier Henno, Financiarisation de l'offre de soins : une OPA sur la santé ?, rapport d'information n° 776 (2023-2024), commission des affaires sociales du Sénat, 25 septembre 2024.